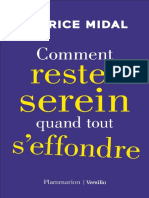Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
15.L'Empire de La Valor - Orleans
Transféré par
ChechucochaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
15.L'Empire de La Valor - Orleans
Transféré par
ChechucochaDroits d'auteur :
Formats disponibles
L'EMPIRE
DELA VALEUR
DU MME AUTEUR
La Violence de la monnaie
(en collaboration avec Michel Aglietta)
PUF, coll. conomie en libert , 1982
(2 dition avec avant-propos, 1984)
Le Pouvoir de la finance
Odile Jacob, 1999
La Monnaie entre violence et confiance
(en collaboration avec Michel Aglietta)
Odile Jacob, 2002
De l'euphorie la panique: penser la crise financire
ditions de la Rue d'Ulm, coll. Opuscule du Cepremap , 2009
Direction d'ouvrages
Analyse conomique des conventions
PUF, coll. Quadrige , 1994,2004
Advances in Self-Organization and Evolutionary Economics
(en collaboration avec Jacques Lesourne)
Economica, 1998
La Monnaie souveraine
(en collaboration avec Michel Aglietta)
Odile Jacob, 1998
Evolutionary Microeconomics
(en collaboration avec Jacques Lesourne et Bernard Walliser)
Springer, 2006
ANDR ORLAN
L'EMPIRE
DE LA VALEUR
Refonder l'conomie
DITIONS DU SEUIL
25, boulevard Romain-Rolland, Paris X/V"
CE LIVRE EST PUBLI
DANS LA COLLECTION LA COULEUR DES IDES
SOUS LA RESPONSABILIT DITORIALE DE JEAN-PIERRE DUPUY
ISBN 978-2-02-105437-8
ditions du Seuil, octobre 2011, l'exception de la langue anglaise
Le Code de la proprit intellectuelle interdit les copies ou reproductions destines une utilisation
collective. Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle faite par quelque procd que
ce soit. sans le consentement de j'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une
contrefaon sanctionne par les articles L. 3352 et sui\'ants du Code de la proprit intellectuelle.
www.seuil.com
Que Jean-Yves Grenier et Ramine Motamed-Nejad soient
vivement remercis pour leur soutien amical, leur regard cri-
tique et leur rudition.
Introduction
L'conomie en tant que discipline traverse aujourd'hui une
grave crise de lgitimit. Alors qu'elle aurait d tre un guide
pour nos socits, les conduisant vers plus de rationalit et de
clairvoyance, elle s'est rvle tre une source de confusion et
d'erreur. En son nom a t mene une politique suicidaire de
drgulation financire sans que jamais l'ampleur des dangers
encourus n'ait fait l'objet d'une mise en garde approprie. Au
lieu d'veiller les esprits, elle les a endormis; au lieu de les
clairer, elle les a obscurcis. Le discrdit qu'elle connat
aujourd'hui auprs de l'opinion publique est proportion de
cette faillite: extrme. Face cette situation sans prcdent, face
aux virulentes critiques dont ils sont l'objet, la raction des co-
nomistes tonne par sa timidit. Mme si une majorit d'entre
eux est prte reconnatre que des erreurs dommageables ont t
commises, domine l'ide qu'il ne faut pas jeter le bb avec
l'eau du bain. Certes, il faut critiquer les drives d'une mod-
lisation trop confiante dans l'efficacit de la concurrence ou sol-
licitant jusqu' l'absurde la rationalit des acteurs, mais il ne faut
pas perdre de vue que ces errements n'offrent qu'une image
dforme de la discipline. Celle-ci possderait les moyens de sa
rnovation, du ct des quilibres multiples, de l'conomie
exprimentale, voire de la neuroconomie. Tel est aujourd'hui le
point de vue qui domine. C'est dire si l'conomie n'est nulle-
ment sur la voie d'une remise en cause: l'enseignement pratiqu
dans le suprieur est rest identique ce qu'il tait avant la crise
l
1. Sur cette question, on pourra lire avec profit J'article de Patricia Cohen
9
L'EMPIRE DE LA VALEUR
et, dans le domaine de la recherche, on chercherait en vain une
inflexion quelconque des conceptions et des mthodes. Contrai-
rement ce qu'ont pu faire croire certaines couvertures de
magazine annonant le retour de Marx, de Schumpeter et
d'autres, rien ne bouge.
Cette situation ne doit d'ailleurs pas tonner. La dmarche
scientifique a sa propre temporalit. Les conomistes ne sont
pas des girouettes qui, la demande, pourraient enseigner
aujourd'hui le contraire de ce qu'ils ont profess hier. La thorie
conomique n'est pas un catalogue de recettes dans lequel on
peut puiser au gr des circonstances, mais un corps de doctrines
fortement structures autour d'hypothses, de mthodes et de
rsultats: ce qu'on nomme galement un paradigme. En son
temps, Thomas Kuhn a montr qu'il est dans la nature mme de
l'organisation paradigmatique de rsister aux crises. Pour chan-
ger de paradigme, il faut non seulement une srie persistante
d'anomalies graves remettant en cause les rsultats passs, mais
surtout il faut qu'un nouveau paradigme soit prt prendre la
relve. Or ce n'est pas parce que de nouveaux problmes ont
surgi avec la crise que de nouvelles solutions seraient disponibles,
prtes tre adoptes. Le fait que les conomistes aujourd'hui
citent plus volontiers Keynes, Minsky ou Kindleberger, ne doit
tromper personne. Ces rfrences expriment une certaine prise
de distance l'gard de l'hypothse d'efficience des marchs
financiers, mais le cadre conceptuel est conserv l'iden-
tique.
Le prsent livre propose de rompre avec cette timidit. Il part
du constat que les difficults rencontres par la thorie cono-
mique ne doivent rien aux circonstances mais sont la cons-
quence d'une conception d'ensemble dfaillante. Il milite en
consquence pour une refonda/ion de l'conomie. Ce diagnostic
ne peut manquer de susciter un certain scepticisme, voire
quelques sourires ironiques, pour qui a en tte les remarquables
Ivory Tower Unswayed by Crashing Economy , paru dans le New York
Times du 4 mars 2009 : http://www.nytimes.com/2009/03/05/books/
05deba.html?pagewanted=l.
10
INTRODUCTION
succs de la discipline conomique au cours des trente dernires
annes. Des centaines de revues scientifiques tmoignent de la
fcondit et de l'inventivit des conomistes. On ne saurait
contester cette vitalit. De mme, l'apport de la modlisation
noc1assique une meilleure comprhension des mcanismes
conomiques n'est gure douteux. En consquence, il n'est pas
question de la rejeter. Ce qui pose problme est ailleurs, dans
l'troitesse de ses hypothses institutionnelles, que ce soit en
matire de rationalit, de prfrences individuelles, de qualit
des biens ou de nature des interactions. Parce qu'elles se foca-
lisent sur certains aspects du fonctionnement des marchs, ces
hypothses laissent de ct de larges pans de la ralit cono-
mique. Le prsent livre a pour objectif de montrer qu'un cadre
d'intelligibilit gnral est possible, un cadre apte saisir l' co-
nomie marchande dans la totalit de ses dterminations, y com-
pris l'approche noc1assique qui sera prise en compte la
manire d'un cas particulier associ un rgime institutionnel
spcifique. cette occasion, l'appartenance de l'conomie aux
sciences sociales sera affirme avec force.
La premire partie de ce livre est consacre l'examen du
paradigme noc1assique, galement appele marginaliste ou
encore walrassien , aux fins d'en expliciter la cohrence et
les limites. Contre certains de nos collgues qui ne voient dans
l'conomie qu'une simple bote outils, constitue pour
l'essentiel de mthodes quantitatives, s'adaptant aux ralits
tudies sans leur imposer une interprtation plutt qu'une
autre, nous soutenons qu'il existe bel et bien un tel paradigme
dont les conceptions engagent en profondeur la comprhension
des relations marchandes, en particulier par le fait qu'elles
dfinissent ce qu'est l'conomie et ce que font les conomistes.
Ce corps de doctrine, qui nonce les dfinitions lmentaires
comme la structure de base de l'argumentation, il revient ce
qu'on nomme la thorie de la valeur d'en expliciter le
contenu. Pour cette raison, son rle est crucial, comme le sou-
ligne Joseph Schumpeter dans sa monumentale Histoire de
l'analyse conomique: Le problme de la valeur doit tou-
jours occuper la position centrale, en tant qu'instrument
11
L'EMPIRE DE LA VALEUR
d'analyse principal dans toute thorie pure qui part d'un
schma rationnel!. )) La valeur d'une marchandise, nous dit la
thorie marginaliste, a pour fondement son utilit. Telle est la
conception princeps qui est l'origine de la pense cono-
mique moderne. La valeur est considre comme une grandeur
qui trouve son intelligibilit, hors de l'change, dans une sub-
stance - l'utilit - que possdent en propre les marchandises.
Pour les conomistes noclassiques, la qute de biens utiles est
la force qui anime les conomies marchandes. La satisfaction
des consommateurs est l'origine de la production comme des
changes. Cette conception de la valeur trouve sa pleine
expression dans l'quilibre gnral walras sien qui sera, en
consquence, soigneusement tudi.
Pour le dire succinctement, nous refusons d'admettre que la
valeur marchande puisse s'identifier une substance, comme
l'utilit, qui prexiste aux changes. Il faut plutt la considrer
comme une cration sui generis des rapports marchands, par
laquelle la sphre conomique accde une existence spare,
indpendante des autres activits sociales. Les relations mar-
chandes possdent leur propre logique de valorisation dont la
finalit n'est pas la satisfaction des consommateurs mais
l'extension indfinie du rgne de la marchandise. Que, pour ce
faire, la marchandise prenne appui sur le dsir d'utilit des
individus est possible, et mme avr, mais l'utilit n'entre
dans la valorisation que comme une composante parmi
d'autres. Il n'y a pas lieu d'enfermer la valeur marchande dans
cette seule logique. La qute de prestige que manifestent les
luttes de distinction est un aiguillon galement puissant du rap-
port aux objets. Plus gnralement, dans de multiples situa-
tions, la valeur se trouve recherche pour elle-mme, en tant
que pouvoir d'achat universel. Notre projet de refondation
trouve ici sa dfinition: saisir la valeur marchande dans son
autonomie, sans chercher l'identifier une grandeur prexis-
tante, comme l'utilit, le travail ou la raret. Cette autonomie
1. Joseph Schumpeter, Histoire de l'analyse conomique, tome II: L'ge
classique, de 1790 1870, Paris, Gallimard, 1983, p. 287.
12
INTRODUCTION
qui donne voir la valeur en majest, dans la plnitude de sa
puissance, c'est grce la monnaie qu'elle s'obtient. Pour cette
raison, dans notre approche, la monnaie joue un rle essentiel.
Elle est l'institution qui fonde la valeur et les changes. La
deuxime partie lui est entirement consacre. Une telle
dmarche rompt radicalement avec la thorie de la valeur no-
classique pour laquelle la monnaie est un fait priphrique, un
ajout secondaire qui vient aprs l'utilit, dans le but troite-
ment circonscrit de rendre les transactions plus faciles, autre-
ment dit, comme un instrument au service de cette utilit. Pour
nous, au contraire, la monnaie est premire en ce qu'elle est ce
par quoi la valeur marchande accde l'existence. Le dsir de
monnaie, et non la qute de biens utiles, est la force qui donne
vie toute la mcanique ; il en constitue l'nergie
originelle. Il dcoule de cette analyse un cadre d'intelligibilit
qui pense l'activit marchande dans sa radicale autonomie,
sans l'assujettir ds l'origine l'utilit ou toute autre finalit.
L'change suit une logique sui generis. Comme l'avait not
Simmel:
[ ... ] l'change est une figure sociologique sui generis [ ... ] ne
dcoulant nullement, comme une suite logique, de cette nature
qualitative et quantitative des choses que l'on dsigne par utilit
et raret. Il faut, l'inverse, la condition pralable de l'change
pour que ces deux catgories dveloppent toute leur importance
dans la cration de valeur. Quand, pour une raison quelconque,
tout change (un sacrifice pour un gain) se trouve exclu, aucune
raret de l'objet convoit n'en fera une valeur conomique,
jusqu'au moment o la possibilit d'un tel rapport se prsente
nouveau
1
Cette analyse ne conduit pas rejeter l'approche noclassique
mais en contester la gnralit. L'utilit ne nous livre pas la
pleine intelligibilit du rapport aux objets. Elle n'en constitue
qu'une modalit particulire. Pour qu'il y ait transaction, encore
faut-il que se manifeste le dsir d'change qui n'est rien d'autre
1. Georg Simmel, Philosophie de l'argent, Paris, PUF, 1987, p. 81-82.
13
L'EMPIRE DE LA VALEUR
que le dsir d'argent. Par ailleurs, l'utilit ainsi conue ne pr-
existe nullement aux changes mais, tout au contraire, elle en
est le rsultat. Elle est une cration des relations marchandes.
En mettant l'accent sur le rle des dispositifs d'change et
des rapports de force dans la dtermination des prix, notre
dmarche rompt avec l'ide d'un primat absolu des grandeurs
sur les relations. Il est un domaine o cette conception est par-
ticulirement prgnante, c'est le domaine financier. Selon les
conomistes noc1assiques, les titres ont une valeur intrinsque,
encore appele valeur fondamentale , qui dtermine le mou-
vement des prix. L'adquation de cette hypothse la ralit n'a
rien d'vident: comment peut-on concilier, sans contorsions
excessives, les mouvements erratiques que connaissent sans
cesse les cours boursiers, la hausse comme la baisse, avec
l'hypothse d'une valeur intrinsque stable? Le plus souvent,
les conomistes sont conduits admettre que les donnes objec-
tives ne russissent pas expliquer les variations de prix. C'est
le cas, par exemple, lors du krach du 19 octobre 1987. L'indice
Dow Jones perdit 22,6 % de sa valeur, soit la baisse la plus
importante jamais observe aux tats-Unis, alors que rien de
comparable, mme de loin, ne s'observait dans l'conomie
relle. Tout l'effort thorique de la troisime partie de cet
ouvrage vise montrer que l'hypothse d'une valeur financire
objective ne tient pas. Sur ce point galement, la thorie de la
valeur doit tre abandonne. valuer un titre suppose ncessai-
rement une part irrductible d'indtermination. Le rle du mar-
ch financier n'est pas de faire connatre une valeur qui lui
prexisterait mais, sur la base des estimations subjectives des
uns et des autres, de faire advenir une estimation de rfrence
laquelle tout le monde adhre. La logique sous-jacente est de
nature essentiellement mimtique: peu importe la manire dont
chacun estime en son for intrieur le titre, ce qui compte, sur un
march, c'est de prvoir l'opinion majoritaire. C'est cette nature
mimtique qui explique la dconnexion maintes fois constate
entre conomie relle et dynamiques financires. Il s'ensuit un
modle qui pense le prix comme rsultant d'un processus
d'auto-extriorisation, le march se mettant distance de lui-
14
INTRODUCTION
mme. Ce modle d'auto-extriorisation mimtique joue un
grand rle dans notre dmarche car il dmontre que les interac-
tions marchandes peuvent produire d'elles-mmes leurs propres
mdiations, sans qu'il soit ncessaire de mobiliser un principe
qui leur soit extrieur. Ce rsultat s'impose comme essentiel
pour une approche qui fait de l'autonomie des valeurs mar-
chandes son principe central d'intelligibilit. L'analyse de la
monnaie comme celle de la finance en illustrent la pertinence.
Notre critique de la thorie existante ne porte pas tant sur la
qualit de ce qui est produit dans le cadre du paradigme no-
classique que sur le fait que d'importants pans de l'conomie
restent ignors. La crise l'a dmontr avec clat. Cependant
cette exigence de refondation vaut par-del la crise. Elle n'est
nullement lie aux circonstances. Elle est une ncessit absolue
si l'on veut que nos socits accdent une meilleure connais-
sance d'elles-mmes.
PREMIRE PARTIE
CRITIQUE DE L'CONOMIE
Chapitre 1
La valeur substance: Travail et utilit
Une conomie marchande est une conomie dans laquelle la
production des biens se trouve dans les mains d'une multitude
de producteurs-changistes indpendants qui dcident, souverai-
nement, en fonction de leurs seuls intrts personnels, de la qua-
lit et de la quantit des biens qu'ils produisent. En raison
mme de cette autonomie des dcisions prives, rien n'assure a
priori que les biens produits dans de telles conditions rpon-
dront aux besoins de la socit. Ce n'est qu'a posteriori, une
fois la production ralise, que s'opre par le biais du march
la mise en relation des producteurs. Dans une conomie mar-
chande pure, la connexion entre les hommes se fait exclusive-
ment ex post par le biais de la circulation des choses. Par
dfinition se trouve exclue de la relation marchande toute rela-
tion personnelle ou hirarchique de mme que tout engagement
collectif qui viendrait restreindre a priori l'autonomie des
volonts prives. Les producteurs-changistes ne se connaissent
jamais les uns les autres que superficiellement, au travers des
objets qu'ils apportent au march: aucun lien direct, aucune
dpendance personnelle, aucune finalit collective n'y vient
rduire la distance autrui. Tout advient par la mdiation des
marchandises. Le terme de sparation marchande semble le
plus adquat pour exprimer ce rapport social paradoxal o cha-
cun doit constamment affronter autrui pour susciter son intrt
s'il veut faire en sorte qu'il y ait transaction. Pour autant, ds
lors qu'on considre une division sociale du travail un tant soit
peu dveloppe, chaque producteur-changiste spar se trouve
dpendre matriellement d'un trs grand nombre d'autres
19
L'EMPIRE DE LA VALEUR
producteurs-changistes, d'abord du ct de la production, pour
l'obtention de tous les inputs qui lui sont ncessaires, mais ga-
lement du ct de la vente lorsqu'elle met en jeu une multitude
de consommateurs finaux. Qui plus est, l'identit de ce trs
grand nombre d'individus varie en fonction de l'volution des
techniques de production comme de celle des prfrences des
consommateurs. la limite, dans une socit marchande dve-
loppe, chacun dpend potentiellement de tous, soit comme
fournisseur, soit comme client, bien qu'tant spar de tous.
Cette dpendance universelle a pour lieu d'expression le march
sur lequel les objets produits sont changs.
Cette prsentation met bien en relief ce qui fait l'nigme sp-
cifique de l'ordre marchand: sur quelle base des individus
spars peuvent-ils se coordonner durablement? N'y a-t-il pas
une contradiction flagrante entre, du point de vue des forces
productives, une dpendance matrielle troite de chacun
l'gard de tous et, du point de vue de la relation sociale, une
extrme autonomie formelle des dcisions prives? Comment
ces deux aspects peuvent-ils tre rendus compatibles? Pourquoi
la logique de l'accaparement priv ne dbouche-t-elle pas sur
l'anarchie? Quelles forces agissent pour faire en sorte que les
individus spars puissent tenir ensemble et constituer une
socit? En un mot: pourquoi y a-t-il de l'ordre plutt que du
nant? Il s'agit de mettre au jour les mdiations sociales par le
jeu desquelles les dsirs acquisitifs individuels se voient trans-
forms et models jusqu' tre rendus compatibles.
La rponse ces questions suppose que soit introduite une
notion fondamentale: la valeur. Elle est au cur de la rgula-
tion marchande. Il n'est pas exagr de dire qu'elle en constitue
l'institution fondatrice. Pour en prendre pleinement la mesure, il
n'est que de considrer la relation marchande lmentaire,
l'change. Son principe de base est l'quivalence en valeur, par
laquelle les transactions marchandes se distinguent radicalement
de toutes les autres formes d'appropriation (don, redistribution,
vol ou capture violente). C'est en tant que valeur que les mar-
chandises entrent dans l'change. Comme valeur, la marchan-
dise a la proprit de s'changer dans des proportions
20
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
dtermines avec d'autres marchandises; c'est l que rside
l'unit des marchandises 1. Ds lors qu'elle est reconnue
comme ayant une certaine valeur, la marchandise change de
statut. Elle cesse d'tre le produit spcifique de tel centre de
production particulier, simple expression des conceptions per-
sonnelles de son propritaire quant ce qu'il faut produire et
selon quel procd, pour tre dsormais considre universel-
lement comme apte l'change, ce qui implique que son pro-
pritaire possde dsormais un droit de mme montant
l'gard des productions de toute l'conomie. Autrement dit, en
tant qu'elles valent, les marchandises accdent une forme
d'objectivit particulire, l'objectivit de la valeur, fondamen-
talement distincte de leur objectivit en tant que valeur
d'usage, mais qui s'impose aux acteurs marchands d'une
manire tout aussi imprative. Cette objectivit si nigmatique
est ce qui caractrise l'conomie marchande. Pour cette raison,
il faut dfinir le rapport marchand comme une relation autrui
mdie par l'objectivit de la valeur. Tout le mystre de l'co-
nomie est dans cette objectivit sui generis, spcifique la
marchandise, qui ne se confond en rien avec l'objectivit
matrielle des marchandises en tant que choses. Marx exprime
bien cette ide quand il remarque: Par un contraste des plus
criants avec la grossiret du corps de la marchandise, il n'est
pas un atome de matire qui pntre la valeur. On peut donc
tourner et retourner volont une marchandise prise part; en
tant qu'objet de valeur, elle reste insaisissable
2
Cette nigme
est au cur de la rflexion des conomistes: D'o vient l'objec-
tivit de la valeur?
Si l'on examine l'histoire de la pense conomique, on
observe que deux rponses se sont successivement imposes : la
valeur travail et la valeur utilit. La premire caractrise la
priode classique, celles des pres fondateurs, Smith, Ricardo et
1. Antoine Artous, Le Ftichisme chez Marx, Paris, ditions Syllepse,
2006, p. 61.
2. Karl Marx, Le Capital, Livre 1 sections T TV, Paris, Flammarion, 1985,
p.50.
21
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Marx; la seconde, la priode noclassique qui a pour origine les
travaux marginalistes de Jevons, Menger et Walras. Cette der-
nire rponse a connu une laboration extrmement sophisti-
que grce au dveloppement de l'conomie mathmatique.
Elle est aujourd'hui absolument dominante. C'est dans le cadre
de celle-ci que raisonnent tous les conomistes contemporains,
ou peu s'en faut. Aussi sera-t-elle au cur de la rflexion que
propose le prsent livre, car il s'agit bien, en priorit, ici, de dia-
loguer avec l'conomie telle qu'aujourd'hui elle se pratique. On
la dsignera du terme de thorie orthodoxe ou domi-
nante , par lequel il s'agit simplement de dcrire ce qui est,
sans jugement de valeur: l'existence d'un paradigme accept
trs largement par la communaut des conomistes.
Cependant, avant de l'analyser en dtail dans le chapitre II,
une constatation prliminaire s'impose: la thorie de la valeur
utilit partage avec la thorie de la valeur travail une manire
identique de concevoir la valeur et son objectivit, sans quiva-
lent dans les autres sciences sociales. Toutes deux y voient
l'effet d'une substance ou qualit que les biens marchands
possderaient en propre. Cette hypothse que nous nommerons
hypothse substantielle )) tend naturaliser)) les rapports
conomiques. En accordant la primaut aux objets, elle
construit une conomie des grandeurs )) au dtriment d'une
conomie des relations )). Mettre au jour cette structure
conceptuelle permet de comprendre que les impasses actuelles
de la thorie conomique ont des racines profondes. Y remdier
passe ncessairement par une refondation)) conceptuelle. Il
s'agit de promouvoir un nouveau cadre global d'intelligibilit
apprhendant la ralit conomique sous une nouvelle perspec-
tive. Par ailleurs, cette analyse, parce qu'elle permet de faire
merger, par-del la coupure entre classiques et marginalistes,
une structure conceptuelle commune, tablit l'unit profonde de
la pense conomique et en rvle l'origine : l 'hypothse sub-
stantielle. Ce rsultat ne doit pas tre nglig. La prtention
une scientificit popprienne comme la revendication d'autono-
mie l'gard des autres sciences sociales comptent parmi ses
22
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
expressions les plus notables 1. On les trouve prsentes chez des
auteurs que par ailleurs tout, ou presque, oppose. C'est cette tra-
dition qui doit aujourd'hui tre transfonne.
Le prsent chapitre vise mettre au jour cette structure
conceptuelle commune
2
Il s'agit donc d'en revenir ce que les
conomistes nomment thories de la valeur . Il est inutile
d'insister sur la place centrale qu'elles occupent dans la pense
conomique. Quatre proprits seront mises en vidence:
l'insistance sur le troc, l'exclusion de la monnaie, la sous-
estimation des relations d'change et le caractre global du
concept de valeur. Ces quatre proprits se dduisent logique-
ment de l'hypothse substantielle, comme l'atteste le fait
qu'elles sont prsentes aussi bien chez les classiques que chez
les noclassiques. Une fois cette mise en vidence effectue et
aprs un ultime dtour du ct de la pense de Marx, le chapitre
suivant se centrera sur la seule pense noclassique.
Avant de poursuivre selon ces lignes, une ultime remarque
introductive s'impose: la rflexion de ce livre porte exclusive-
ment sur l'conomie marchande et non sur le capitalisme.
S'intresser au capitalisme supposerait d'introduire, ct de la
sparation marchande, un autre rapport social, savoir le rap-
port salarial. Il n'en sera rien. L'analyse qui suit ignore le
salariat et traite la production la manire d'une bote noire,
chaque acteur tant simultanment producteur et changiste
comme le souligne le terme de producteur-changiste .
L'conomie marchande s'impose comme le cadre conceptuel
adquat pour mettre au jour le rle que joue la valeur dans la
1. Se reporter Roger Guesnerie, L'conomie, discipline autonome au sein
des sciences sociales? , Revue conomique, vol. 52, nO 5, septembre 2001.
2. l'vidence, ce projet, pour tre men bien, ncessite bien plus de
connaissances que je n'en possde, en particulier concernant les auteurs pr-
classiques et classiques. Il fait l'objet d'un travail en cours men avec Jean-
Yves Grenier, spcialiste de ces questions. De nombreuses ides qui sont
prsentes ici lui doivent beaucoup, en particulier la thse centrale selon
laquelle les thories de la valeur se caractrisent par ce qu'il appelle une
triple exclusion : exclusion des changes, du march et de la monnaie
(Jean-Yves Grenier, L'conomie d'Ancien Rgime. Un monde de l'change et
de l'incertitude, Paris, Albin Michel, 1996).
23
L'EMPIRE DE LA VALEUR
coordination des activits spares. L rside tout son intrt.
Mme si la comprhension du capitalisme demeure le but final
que poursuit l'conomie, cette comprhension passe au pra-
lable par une pleine lucidation de la valeur.
L'hypothse substantielle
La tradition conomique nomme thorie de la valeur les
approches qui cherchent dcouvrir le secret de l'changeabi-
lit marchande dans l'hypothse d'une substance ou qualit
confrant aux biens une valeur intrinsque. Le plus souvent, ce
livre se conformera l'usage et retiendra la qualification usuelle
de thorie de la valeur pour les dsigner, mais sans jamais
perdre de vue que, sous cette appellation d'apparence gnrale
et neutre, se cache en fait une conception trs particulire.
Lorsqu'il s'agira de les distinguer d'autres approches, le terme,
plus lourd mais plus prcis, de thorie substantielle de la
valeur , ou encore de thorie de la valeur substance , sera
utilis. Historiquement, deux substances ont t prises en
considration par les conomistes: le travail et l'utilit. Cepen-
dant, quelle que soit la substance considre, ces approches par-
tagent la mme conception princeps selon laquelle, pour penser
l'change, il convient d'aller par-del l'apparence des transac-
tions montaires de faon mettre en vidence la prsence
d'une grandeur cache qui prexiste logiquement aux transac-
tions et les organise. L'ide d'une valeur objective ordonnant de
l'extrieur l'anarchie apparente des changes marchands trouve
dans ce corps de doctrine son hypothse fondatrice. Elle
faonne en profondeur le regard que les conomistes portent sur
la ralit. Il s'agit de faire apparatre ce qui est dissimul: la loi
de la valeur qui, l'insu des changistes, commande aux tran-
sactions. Il y a des changes parce qu'il y a de la valeur et cette
valeur se prsente comme une qualit que possdent en propre
les biens marchands.
Ainsi, Lon Walras commence-t-il ses lments d'conomie
politique pure par une spcification de ce qu'est la richesse
24
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
sociale en partant de la notion de raret: J'appelle richesse
sociale l'ensemble des choses matrielles ou immatrielles qui
sont rares, c'est--dire qui, d'une part, nous sont utiles, et qui,
d'autre part, n'existent notre disposition qu'en quantit limi-
te 1. Comme on le note, cette dfinition de la raret renvoie
des ralits indpendantes de l'change, savoir l'utilit et une
quantit limite. Il nonce ensuite que la raret, proprit objec-
tive, est ce qui confere de la valeur aux objets et fonde, de ce
fait, l'change. La nature de la valeur est ainsi totalement sp-
cifie par des critres objectifs. L'change en dcoule logique-
ment. Comme le dit Walras lui-mme, le fait de l'change est
dduit a priori de cette substance spcifique qu'il nomme
raret . Une fois la valeur explicite dans la premire section
des lments d'conomie politique pure, Walras passe l'tude
de l'change de deux marchandises entre elles (section II), puis
celle de l'change de plusieurs marchandises entre elles (sec-
tion III). Il dmontre que, l'tat d'quilibre, le rapport des
valeurs est gal au rapport des rarets. Ce n'est qu'en tout der-
nier lieu que la monnaie se trouve introduite. Cette progres-
sion valeur, troc, monnaie est caractristique de l'hypothse
substantielle.
Pour ce qui est de la thorie de la valeur travail, elle trouve
son expression la plus aboutie chez Karl Marx
2
Dans le premier
chapitre du Capital, Marx considre deux marchandises, du fro-
ment et du fer, et il observe que, dans l'change, une quantit
donne de froment est rpute gale une quantit quelconque
de fer
3
. partir de cette observation, il s'interroge sur ce que
signifie cette galit. Il rpond: C'est que [dans ces deux
objets diffrents, le froment et le fer], il existe quelque chose de
1. Lon Walras, lments d'conomie politique pure ou thorie de la
richesse sociale, Paris, Librairie Gnrale de droit et de jurisprudence, 1952,
p.21.
2. La thorie de la valeur d'change de Marx est aussi une thorie de la
quantit de travail, et peut-tre [".] la seule vraiment complte qui ait jamais
t crite (Joseph Schumpeter, Histoire de l'analyse conomique, tome II,
op. cit., p. 296).
3. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 42.
25
L'EMPIRE DE LA VALEUR
commun. En consquence, il cherche dterminer ce
quelque chose de commun . Selon lui, ce quelque chose de
commun ne peut pas tre une proprit naturelle quel-
conque, gomtrique, physique, chimique, etc 1. . Plus large-
ment, il carte tout ce qui est de l'ordre de la valeur d'usage. Il
conclut avec assurance: La valeur d'usage des marchandises
une fois mise de ct, il ne reste plus qu'une qualit, celle d'tre
des produits du travail ! Plus loin, il prcise: Tous ces objets
ne manifestent plus qu'une chose, c'est que dans leur produc-
tion une force de travail humaine a t dpense [ ... ]. En tant
que cristaux de cette substance sociale commune, ils sont rpu-
ts valeurs
2
En l'occurrence, cette substance sociale com-
mune est mesure par le temps de travail socialement
ncessaire la production des biens
3
Il crit: Nous connais-
sons maintenant la substance de la valeur: c'est le travail. Nous
connaissons la mesure de sa quantit: c'est la dure du
travail
4
A l'vidence, chez Marx, la valeur substance a le statut d'une
hypothse a priori qui structure le regard de l'conomiste et lui
dicte ce qu'il doit voir. Elle est une construction conceptuelle et
non pas un fait d'observation. Certes Marx cherche persuader
son lecteur qu'il suffirait d'examiner attentivement les changes
pour que la valeur travail se rvlt ses yeux. Mais sa dmons-
tration n'est gure convaincante. Pourquoi rejeter la valeur
d'usage comme source potentielle de la valeur? Ou encore, une
fois celle-ci rejete, pourquoi ne resterait-il que le travail
humain pour justifier la commensurabilit ?
Ces deux auteurs illustrent parfaitement l 'hypothse substan-
tielle. Il s'est agi pour Marx comme pour Walras de mettre au
jour une grandeur, le travail socialement ncessaire, pour le pre-
mier ; la raret pour le second, qui fonde la valeur et, ce faisant,
1. Ibid.
2. Ibid., p. 43.
3. Se reporter Isaak: Roubine pour une analyse fouille de la thorie de
la valeur de Marx.
4. Ibid., p. 45.
26
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
l'change. La force de cette construction tient au fait que ces
grandeurs peuvent tre calcules sans rfrence aux changes.
Une fois l'conomie marchande spcifie par ses productions et
ses consommations, il est possible de calculer la valeur de
toutes les marchandises. Ces grandeurs peuvent tre dites objec-
tives. Ceci est clair pour Marx. C'est galement vrai de Walras
mais demandera quelques explications supplmentaires dans la
mesure o l'objectivit de l'utilit renvoie des prfrences
individuelles qui sont subjectives. Cependant, ds lors que ces
dernires sont supposes exognes, rien ne les distingue plus
des fonctions de production. Elles sont tout autant objectives du
point de vue du thoricien de la valeur. Elles sont des donnes
partir desquelles les valeurs se dduisent. Le chapitre II,
consacr la thorie noclassique, reviendra longuement sur ce
point.
La centralit du troc et l'exclusion de la monnaie
Une premire caractristique commune ces deux approches
est trouver dans le rle primordial qu'y joue l'change direct
d'une marchandise contre une autre, le troc. On le constate chez
Marx qui prend pour point de dpart de son analyse l'change
froment contre fer. Comment justifier la mise l'cart de
l'change montaire alors que, dans la ralit, les marchandises
sont universellement changes contre de la monnaie? Pour-
quoi un tel point de dpart si contraire aux faits? On a vu que
Walras faisait de mme. Une fois la valeur spcifie (section 1),
il passe l'tude de l'change de deux marchandises entre elles
(section Il). Plus gnralement, on constate que les thoriciens
de la valeur s'intressent prioritairement au troc. C'est essentiel-
lement de lui dont il est question. Ainsi, dans Thorie de la
valeur', le livre dans lequel Grard Debreu prsente l'approche
moderne sous sa forme paradigmatique, il n'est question que
1. Grard Debreu, Thorie de la valeur. Analyse axiomatique de l'qui-
libre conomique, Paris, Dunod, 2001.
27
L'EMPIRE DE LA VALEUR
d'changes directs. La monnaie en est absente. Cette omnipr-
sence du troc peut paratre bien paradoxale si l'on garde
l'esprit, d'une part, que le troc s'observe le plus souvent dans
les conomies non marchandes et, d'autre part, que son appari-
tion dans les conomies marchandes dveloppes est le signe
infaillible de leur dysfonctionnement! On admettra que ces
faits d'observation conduiraient plutt considrer l'change
direct comme tranger la logique marchande qu' le mettre au
cur de son analyse. Comment expliquer, dans ces conditions,
que Marx et Walras, comme l'immense majorit des cono-
mistes, et malgr l'vidence empirique, abordent l'tude de la
circulation des marchandises en partant du troc? La responsa-
bilit en incombe entirement l'hypothse substantielle elle-
mme et l'adhsion gnralise dont elle fait l'objet au sein
de la communaut des conomistes, y compris parmi les plus
grands. Autrement dit, si les conomistes attachent une telle
importance l'change direct, c'est parce que, depuis plus de
deux sicles, les thories de la valeur leur ont appris penser la
transaction marchande comme tant une extension du troc. Il ne .
faut pas chercher ailleurs le statut si particulier qu'occupe le
troc dans la pense conomique. Parce que les conomistes
pensent que la valeur est dans la marchandise, l'change de
marchandises contre d'autres marchandises s'impose eux
comme la forme naturelle, simple et immdiate, de l'change
et acquiert, de ce fait, une position centrale dans leur modli-
sation des rapports marchands. Paradoxalement, c'est a contra-
rio l'change montaire qui dsormais se rvle totalement
nigmatique. Carl Menger est peut-tre l'conomiste qui a le
mieux restitu ce mystre que constitue l'change montaire
pour le thoricien de la valeur utilit, compar l'vidence du
troc: Il est vident mme pour l'intelligence la plus ordi-
naire, crit-il, qu'un bien puisse tre cd par son propritaire
pour un autre qui lui soit plus utile. Mais que chaque unit co-
nomique d'une nation soit prte changer ses biens contre des
petits disques de mtal apparemment sans utilit [ ... ] est un
processus si oppos au cours ordinaire des choses [que mme
un penseur aussi pertinent que Savigny le trouverait] tout fait
28
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
"mystrieux
1
". Cette citation illustre quel point, dans l 'hypo-
thse de la valeur, substance et troc marchent de conserve. Pour
le thoricien de la valeur, le fait premier est l'attirance que les
marchandises exercent directement les unes l'gard des autres
en tant qu'elles sont toutes porteuses de valeur. Et cette atti-
rance immdiate qu'institue la logique de la valeur ne trouve
nulle part d'expression plus fidle que dans le troc, avant que
diverses institutions, dont la monnaie, en altrent la nature comme
la puissance. En conclusion, c'est bien la diffusion des thories
de la valeur qui a dform le regard des conomistes. La place
qu'occupe l'change direct au sein de la thorie conomique,
dmesure si on la compare son rle infiniment marginal dans
les conomies relles, trouve ici sa source vritable. Elle est la
consquence d'une hypothse conceptuelle qui s'est peu peu
propage l'ensemble des conomistes: la valeur substance. Il
est dans la logique de cette construction conceptuelle d'attribuer
l'change direct une place centrale dans son analyse des rap-
ports marchands en tant qu'expression la plus simple de la
valeur. Tout l'effort thorique du chapitre IV visera dmontrer
qu'il est erron de considrer le troc comme tant une forme
simple d'expression de la valeur. Il n JI a d'expression de la
valeur que montaire. Pour qui adhre cette dernire thse, le
statut du troc se rvle conforme ce que l'observation
indique: il s'agit d'une aberration. En conclusion, il faut se
mfier fortement des analyses qui utilisent le troc comme
modle de la relation marchande car le troc est, au mieux, une
forme marchande dgnre. En tant que telle, il livre une
image particulirement dforme du rapport marchand. Si les
conomistes l'oublient malgr l'observation, c'est par l'effet
d'un long apprentissage thorique qui les a conditionns pen-
ser la valeur comme une substance que possderaient en propre
les marchandises.
Ce rle primordial dvolu au troc par les penseurs de la
valeur les conduit fort logiquement dlaisser le rapport
1. Carl Menger, On the Origin of Money , Economic Journal, vol. 2,
1892, p. 239.
29
L'EMPIRE DE LA VALEUR
montaire. C'est l un des traits les plus caractristiques et les
plus nigmatiques des thories de la valeur: elles se donnent
pour objet une conomie sans monnaie. Que ce soit chez
Marx, chez Sraffa, chez Walras ou chez Arrow et Debreu, la
thorie de la valeur s'intresse uniquement aux prix relatifs,
savoir: dans quel rapport tel bien s'change contre tel autre
bien. Pour ce faire, elle introduit le plus souvent un numraire.
Autrement dit, elle pose par convention que le prix de tel bien
vaut 1, partir de quoi on dtermine la valeur de tous les
autres biens relativement celui-ci, ce qu'on nomme {( prix .
Mais c'est l une hypothse purement technique qui vise sim-
plement faciliter l'explicitation des valeurs d'change. En
aucun cas introduire un numraire n'altre la nature profonde
de l'conomie considre. Celle-ci reste une conomie de troc
puisque les biens s'y changent exclusivement contre d'autres
biens. Il n'y existe pas de monnaie relle, {( c'est--dire de
monnaie qui, non seulement procure une unit de compte,
mais encore circule effectivement et en outre fonctionne
comme "rserve de valeur
1
" . Cette absence de monnaie doit
tre souligne avec vigueur. Elle n'est en rien un accident
mais l'expression significative du fait que, aux yeux des tho-
riciens de la valeur, l'changeabilit est la consquence d'une
substance sociale. En consquence, ce qui importe est de
dterminer celle-ci. Omettre la monnaie rpond la volont
d'aller au-del des apparences immdiates dans le but de cir-
conscrire au mieux le principe de l'change. Le bon thoricien
de la valeur ne doit pas se laisser tromper par l'illusion mon-
taire qui masque l'essentiel. Il convient de s'abstraire des
apparences pour saisir l' changeabilit des biens dans son
principe propre: la valeur. Ce qu'exprime Schumpeter avec
une rare pertinence lorsqu'il crit:
Non seulement on peut rejeter ce voile [montaire] chaque fois
que nous analysons les traits fondamentaux du processus cono-
mique, mais il faut le faire, l'instar d'un voile qui doit tre t
1. Joseph Schumpeter, Histoire de l'analyse conomique, tome II, op. cit.,
p.287.
30
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
lorsqu'on veut voir le visage qu'il recouvre. C'est pourquoi les
prix en monnaie doivent cder la place aux taux d'change des
marchandises entre elles qui sont vraiment la chose importante
"derrire" les prix en monnaie 1.
On trouve une ide semblable chez Marx qui crit propos
de l'expression des marchandises en argent:
Cette forme acquise et fixe du monde des marchandises, leur
forme argent, au lieu de rvler les caractres sociaux des tra-
vaux privs et les rapports sociaux des producteurs, ne fait que
les voiler
2
Cette pense de la relation marchande a une consquence pri-
mordiale. Elle conduit ncessairement relguer la monnaie
dans une position accessoire. En effet, ds lors que la commen-
surabilit des marchandises se trouve fonde en amont de
l'change montaire dans le principe de valeur, quel rle peut-
il bien rester la monnaie? Ni l'changeabilit en elle-mme,
ni la dtermination des rapports quantitatifs travers lesquels
celle-ci se manifeste ne sont plus de son ressort. Dans un tel
cadre, il ne reste plus la monnaie qu'un rle parfaitement
secondaire: rendre plus aises des transactions dont la logique
lui chappe totalement parce qu'elle relve tout entire de la
thorie de valeur. En un mot, tre l'instrument des changes.
Schumpeter crit: La monnaie n'entre [dans cette analyse]
qu'en y jouant le modeste rle d'un expdient technique adopt
en vue de faciliter les transactions
3
Il faut bien lire facili-
ter , dans la mesure o ces approches considrent toujours le
troc comme une alternative possible. Ici, la monnaie est, au sens
fort, un moyen, un instrument, un expdient technique au
service d'un principe qui la domine entirement: la valeur. Il ne
peut en tre autrement ds lors qu'on adhre une conception
substantielle de la valeur. Celle-ci dbouche ncessairement
1. Joseph Schumpeter, Histoire de l'analyse conomique, tome 1: L'ge
des fondateurs, des origines 1790, Paris, Gallimard, 1983, p. 389.
2. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 72.
3. Joseph Schumpeter, Histoire de l'analyse conomique, tome J, op. cit.,
p.389.
31
L'EMPIRE DE LA VALEUR
sur une conception instrumentale de la monnaie. Elle sera
prsente et critique au chapitre IV pour ce qui est de la tho-
rie noc1assique.
Sous-estimation des changes
Cette mise l'cart de la monnaie par les thories de la
valeur peut galement s'interprter sous un autre angle : elle
tmoigne d'une dsinvolture certaine l'gard des transactions
relles et de la manire dont elles se droulent. Ceci ne doit pas
surprendre dans la mesure o la valeur substance construit un
point de vue qui apprhende les changes de l'extrieur, partir
de la mise au jour du contenu substantiel des objets en prsence.
L'change proprement dit n'y joue aucun rle. Pour s'en per-
suader, il suffit de considrer les deux prdicats qui sont la
base de la notion de valeur: l'unit et la transitivit. D'une part,
il est postul que la valeur d'un mme bien reste gale elle-
mme quel que soit l'exemplaire du bien considr. Autrement
dit, deux biens identiques, tirs au hasard dans des lieux dis-
tincts de l'univers marchand, ont ncessairement la mme
valeur. D'autre part, il est postul que la valeur d'un bien ne
varie pas, qu'il soit chang contre tel bien ou tel autre bien.
Marx crit ce propos: La valeur d'change reste immuable,
de quelque manire qu'on l'exprime, en x cirage, eny soie, z or,
et ainsi de suite. Elle doit donc avoir un contenu distinct de ces
expressions diverses 1. Ces deux spcifications dotent la valeur
d'une singulire puissance: quel que soit l'exemplaire du bien
considr, quel que soit l'change considr, elle demeure
inchange. Pourtant, on sait, pour ce qui est des prix, que la
question est loin d'tre aussi simple: ni la loi du prix unique, ni
la transitivit des prix relatifs ne s'imposent absolument dans le
monde rel. Il semble bien que les forces de l'change puissent
perturber durablement l'expression des valeurs intrinsques.
Pour le thoricien de la valeur, il n'en est rien; l'essentiel est
1. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 42.
32
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
dans celles-ci qui dterminent la fois ce qui sera chang et
selon quel rapport. Il s'ensuit un discours thorique o l'objec-
tivit des valeurs domine les relations d'change. Nous ne vou-
lons pas dire que les thories de la valeur ne s'intressent pas
aux changes marchands puisqu'il s'agit bien pour elles, via la
valeur, d'en produire l'intelligibilit, mais qu'elles considrent
que tout ce que ceux-ci ont dire d'intressant l'conomiste
se trouve contenu dans le concept de valeur: ce dernier en livre
l'entire comprhension. Une fois la valeur calcule, les
changes ont tout dit. L'cart qui peut apparatre entre le prix et
la valeur n'est qu'un rsidu, sans porte thorique. Il chappe
toute dtermination quantitative. Ceci est vrai de la pense clas-
sique comme de la pense noclassique. La sous-estimation des
changes leur est commune.
Cependant, sur ce point important, les conomistes classiques
et noclassiques procdent d'une manire trop diffrente pour
qu'il soit fructueux de continuer les considrer conjointement.
En effet, dans la thorie que ls premiers proposent, les
variables d'offre et de demande sont absentes alors que les
seconds les intgrent explicitement leur analyse. Prima facie
la divergence semble radicale. En consquence, pour ce qui est
des classiques, leur sous-estimation des changes relve de
l'vidence puisque la valeur travail, dans sa nature mme, a
pour fondement exclusif les conditions de production. Le mar-
ch s'y trouve vinc de jure. Il s'ensuit que l'galit entre
valeur et prix n'est en rien assure puisque chacune de ces gran-
deurs semble rpondre des dterminations indpendantes :
productivit du travail, pour la premire; rapport entre offre et
demande, pour le second. Les thoriciens de la valeur travail
(Smith, Ricardo et Marx 1) reconnaissent d'ailleurs explicitement
que d'importants carts peuvent exister entre ces deux gran-
deurs. En effet, leurs yeux, si les volutions de la valeur sont
au fondement des volutions des prix, la conformit entre valeur
1. Comme on le sait, la position de Marx est complexe puisque, pour ce
qui est des conomies capitalistes, il introduit un nouveau concept: le prix de
production. Celui-ci diffre structurellement de la valeur. Ds lors, concernant
33
L'EMPIRE DE LA VALEUR
et prix ne prvaut que tendanciellement, sur le long terme.
Lorsque Marx s'efforce de rpondre la question de savoir
comment cette conformit advient, il rpond: Parce que, dans
les rapports d'change accidentels et toujours variables [ ... ], le
temps de travail social ncessaire [la] production l'emporte de
haute lutte comme loi naturelle rgulatrice, de mme que la loi
de la pesanteur se fait sentir n'importe qui lorsque sa maison
s'croule sur sa tte 1. Cette analyse est emblmatique des
thories de la valeur: une puissance cache, invisible, meut les
objets, produisant de l'ordre l o semble rgner le jeu aveugle
des intrts privs. En consquence, l'conomiste classique
oppose ce qui est du domaine de l'intelligible, la loi de la
valeur, et ce qui est du domaine de l'accidentel et du
variable , les fluctuations des prix court terme. Celles-ci
chappent la loi de la valeur travail ; elles sont secondaires et
priphriques. Elles apparaissent lorsque la forme prix est intro-
duite, s'analysant comme des corollaires de celle-ci. On ne sera
pas surpris de retrouver chez Adam Smith une analyse iden-
tique: [La valeur
2
] est donc, pour ainsi dire, le prix central,
vers lequel les prix de toutes les denres gravitent continuelle-
ment. Diffrents accidents peuvent tantt les tenir en suspens
largement au-dessus de ce prix, et tantt les forcer tomber
quelque peu au-dessous. Mais quels que puissent tre les obs-
tacles qui les empchent de se fixer en ce centre de repos et de
les conomies capitalistes, l'approche de Marx est fort diffrente de celle de
Smith et Ricardo qui, eux, adhrent toujours la primaut de la valeur travail,
ou prix naturel . Cependant, dans le cas de ce que Marx nomme une co-
nomie marchande simple , c'est la valeur travail qui reste, pour lui comme
pour eux, le concept pertinent. Dans une telle conomie, la valeur reprsente
le niveau moyen autour duquel les prix de march fluctuent (Isaak Roubine,
Essais sur la thorie de la valeur de Marx, Paris, ditions Syllepse, 2009,
p. 104). Il est donc possible de considrer conjointement Smith, Ricardo et
Marx condition, pour ce qui est de Marx, de s'intresser ses analyses des
conomies marchandes simples. Aussi, dans cette section consacre la sous-
estimation des changes par la valeur travail, laisserons-nous de ct la ques-
tion du prix de production pour nous intresser exclusivement aux rapports
entre valeur et prix de march chez Smith, Ricardo et Marx.
1. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 71.
2. Smith utilise le terme de prix naturel pour dsigner la valeur.
34
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
continuation, ils y tendent constamment
1
De nouveau, l' co-
nomiste classique recourt la loi de la gravitation lorsqu'il
cherche expliciter comment la loi de la valeur agit. Partout,
chez les classiques, on retrouve cette mme construction
conceptuelle : il faut aller par-del l'apparence des choses, la
manire de la physique newtonienne. Ce qui est primordial est
l'action de la valeur travail; elle domine les changes. Il est
vident que ce n'est pas l'change qui rgle la quantit de
valeur d'une marchandise, mais au contraire la quantit de
valeur de la marchandise qui rgle ses rapports d'change
2
,
crit Marx. En consquence, ce qui, dans l'change marchand,
n'est pas pris en compte par le biais de la valeur a le statut d'un
bruit, sans porte conceptuelle. Le thoricien n'a pas lieu de
s'en proccuper. Pour cette raison, une analyse dtaille des
marchs en tant que dispositifs de mise en rapport des acheteurs
et des vendeurs est inutile. On la trouve peine chez Smith,
mais ni chez Ricardo, ni chez Marx. Ils ne s'intressent pas au
fonctionnement concret des marchs. Ce qui peut tre rendu
intelligible dans les variables d'offre et de demande se trouve
entirement lucid grce au concept de valeur: Par cons-
quent, si ce sont l'offre et la demande qui rglent le prix de mar-
ch ou plus exactement les carts des prix de march par rapport
la valeur de march, par contre c'est la valeur de march qui
rgle le rapport entre l'offre et la demande ou qui constitue le
centre autour duquel les fluctuations de l'offre et de la demande
font varier les prix de march
3
, explique Marx. Autrement
dit, chez les classiques, le passage de la valeur au prix se fait
sans ajout conceptuel important: le prix, c'est la valeur plus
des fluctuations court terme qui, parce qu'elles sont sans
rgle, chappent toute dtermination quantitative. Laissons
Marx conclure: Il est donc possible qu'il y ait un cart, une
1. Adam Smith, Enqute sur la nature et les causes de la richesse des
nations, Paris, PUF, 1995, Livre l, chapitre VII, p. 67.
2. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 62.
3. Le Capital, Livre III, cit par Isaak Roubine dans Essais sur la thorie
de la valeur de Marx, op. cit., p. 245.
35
L'EMPIRE DE LA VALEUR
diffrence quantitative entre le prix d'une marchandise et sa
grandeur de valeur, et cette possibilit gt dans la forme prix
elle-mme. C'est une ambigut, qui au lieu de constituer un
dfaut, est au contraire une des beauts de cette forme, parce
qu'elle l'adapte un systme de production o la rgle ne fait
loi que par le jeu aveugle des irrgularits qui, en moyenne, se
compensent, se paralysent et se dtruisent mutuellement
1
L'approche noclassique est trs diffrente puisque l'galit
de l'offre et de la demande appartient aux conditions que la
valeur doit respecter. Cette approche cherche dcrire le mca-
nisme de march pour expliciter par quel processus la valeur se
transforme en prix. Pourtant, comme le soulignera le prochain
chapitre, la sous-estimation des changes y est galement pr-
sente, mais sous une forme spcifique.
Une conception totalisante
Cette analyse de ce qu'ont en commun les diffrentes thories
de la valeur fait apparatre une troisime caractristique que les
historiens de la pense conomique ont souvent nglige :
contrairement ce que peut laisser accroire une lecture rapide,
la valeur est essentiellement un concept global. Elle a comme
finalit de rendre visibles les interdpendances caches qui
relient objectivement les activits les unes aux autres, par-del
la sparation formelle des acteurs. Parce qu'il en est ainsi, elle
est conduite saisir l'conomie comme un tout. Elle traite de la
cohsion globale de l'ordre marchand et cherche en lucider
le principe. En consquence, la valeur se donne penser comme
un fait collectif, comme une puissance qui, au-del des actions
individuelles, ordonne l'conomie en une totalit quilibre. On
reconnat ici l'ide de main invisible chre Adam Smith et aux
conomistes: la valeur va au-del des apparences pour identi-
fier ce qui, l'insu mme des agents, guide leur conduite et pro-
duit l'harmonie des intrts.
1. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 88.
36
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
Cette dimension systmique apparat sans ambigut dans les
travaux consacrs la dtermination quantitative des valeurs.
En effet, parce que l'estimation de la valeur d'un bien parti-
culier suppose une rflexion sur les relations rciproques qui
unissent ce bien aux autres biens, la valeur ne se dtermine
jamais isolment, mais toujours conjointement avec la valeur de
toutes les autres marchandises. Pour ce faire, il faut expliciter de
quelle manire ce bien rclame la prsence des autres biens et
de quelle manire il les affecte en retour. Autrement dit, la
dtermination d'une valeur lmentaire ne peut tre faite qu'au
sein d'un processus d'valuation qui apprhende l'conomie
dans sa totalit. En cela, la valeur est un concept totalisant. On
comprend, ce faisant, que cette dtermination ne sera pas aise
puisqu'il s'agit, pour y russir, de modliser l'conomie en son
entier. Or il est un outil particulirement adapt cette tche, un
outil qui prcisment a pour finalit la dtermination simultane
d'un ensemble de grandeurs. Cet outil est de nature mathma-
tique: les systmes d'quations simultanes. Il permet d'expli-
citer les multiples liens rciproques qui unissent la valeur d'un
bien aux valeurs des autres. chaque quation correspond la
valeur lmentaire d'un bien spcifique, analyse dans son rap-
port de dpendance aux autres biens. Si l'conomie a n biens, le
systme a n quations et n inconnues, savoir la valeur de cha-
cun des biens. Ces n inconnues sont dtermines simultanment
comme solutions du systme que forment les n quations. Bien
entendu, l'criture explicite du systme dpend de la nature sp-
cifique des liens de dpendance considrs par la thorie. En
consquence, le systme que propose la thorie de la valeur tra-
vail diffre de celui de la thorie de la valeur utilit. Mais tous
deux ont en commun de recourir un systme d'quations
simultanes. Sa seule prsence formelle atteste elle seule du
caractre global de la valeur. Elle dmontre que l'on ne peut
dterminer la valeur d'un bien particulier qu'en connaissant la
valeur de tous les autres biens.
Considrons d'abord l'approche classique. C'est essentielle-
ment sous l'angle de la division du travail qu'elle aborde
l'tude de la cohsion marchande. Les activits des uns et des
37
L'EMPIRE DE LA VALEUR
autres sont relies par le fait qu'elles s'insrent dans une struc-
ture collective de production. Parce que l'conomie classique
appartient une poque o les conomistes n'utilisaient pas les
mathmatiques, on ne trouve pas explicitement, sous la plume
des conomistes classiques, de tels systmes d'quations. Pour-
tant, l'ide que la valeur est un fait collectif, et non local, est
bien prsente dans leur pense. On le voit chez Marx avec son
concept de travail socialement ncessaire qui tablit que la
valeur dpend des conditions productives moyennes de l'co-
nomie. Il crit: Le temps de travail socialement ncessaire
la production des marchandises est celui qu'exige tout travail,
excut avec le degr moyen d'habilet et d'intensit et dans
des conditions qui, par rapport au milieu social donn, sont
normales 1. Pour le calculer, il importe de dterminer ce que
sont les conditions normales de production. Analyser l' vo-
lution du travail socialement ncessaire suppose en cons-
quence, pour les marxistes, un point de vue qui saisit l'entiret
des conditions productives de l'conomie de faon pouvoir
identifier celles qui peuvent tre dites normales. Ainsi, la
mme marchandise produite par un producteur donn peut voir
sa valeur se transformer sans que ce producteur ait modifi en
quoi que ce soit sa faon de produire ds lors que les condi-
tions normales de production se trouvent transformes, par
exemple du fait de l'introduction de nouvelles machines chez
ses concurrents.
Si les auteurs classiques ne recouraient pas aux mathma-
tiques, il n'en est pas de mme de leurs pigones modernes. Or
ceux-ci, lorsqu'ils ont voulu prolonger les travaux antrieurs,
ont tout naturellement eu recours des systmes d'quations
simultanes pour modliser les ides qu'ils contenaient, ce qui
atteste leur nature totalisante. Ainsi en est-il des travaux de
Piero Sraffa dans son livre Production de marchandises par des
marchandises
2
, crit dans une perspective ricardienne. L' cono-
mie qu'il modlise possde n marchandises. Dans ce cadre no-
1. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 44.
2. Paris, Dunod, 1999.
38
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
ricardien, la valeur de chaque marchandise dpend de la valeur
des marchandises ncessaires sa production, ainsi que du taux
de profit et du taux de salaire que Sraffa considre comme iden-
tiques pour toutes les branches productives. Ces hypothses le
conduisent crire un systme de n quations, une pour chaque
marchandise. Ce systme explicite, sous la forme d'quations,
le tissu des interdpendances qui assurent la cohsion mar-
chande. Dans la perspective de la valeur travail, ces interdpen-
dances sont principalement de nature productive, mais pas
uniquement. Sans concurrence largie au capital et au travail, on
ne pourrait pas supposer l'uniformit du taux de profit et l' ga-
lit des taux de salaire dans les diffrentes branches, hypothses
qui jouent un rle important. Il s'en dduit que les valeurs de
toutes les marchandises sont dtermines simultanment.
Michio Morishima adopte, pour ce qui est de Marx, une
dmarche analogue celle de Sraffa concernant Ricardo. Il
cherche modliser la thorie marxienne de la valeur travail.
Ceci le conduit un systme d'quations proche de celui pro-
pos par Sraffa, ceci prs que, s'intressant une petite co-
nomie marchande, et non pas une conomie capitaliste, la
notion de profit n'est pas introduite. Parce que chez Marx,
comme chez Ricardo, la valeur d'un bien dpend de la valeur
des biens qui entrent dans sa production, on obtient un systme
o les valeurs sont troitement interdpendantes. Morishima
note: Pour aucun secteur, la valeur du produit n'est dtermi-
ne de manire indpendante [ ... ]. En consquence, les valeurs
sont dtermines socialementl.
Parce qu'elle rejette la valeur travail pour lui prfrer la
valeur utilit, l'approche noclassique aborde la question de la
cohsion marchande d'une manire entirement renouvele.
Celle-ci n'est plus principalement technique ou productive. La
question du rapport individuel aux objets domine dsormais la
question strictement productive. En consquence, ce qui
importe, pour cette thorie, est la compatibilit entre la demande
1. Michio Morishima, Marx's Economies. A Dual Theory of Value and
Growth, Cambridge, Cambridge University Press, 1974, p. 14.
39
L'EMPIRE DE LA VALEUR
de biens et l'offre de biens, compatibilit qui, chez les clas-
siques, ne jouait qu'un rle priphrique. Il s'agit de s'assurer
que les dsirs individuels de marchandises n'entrent pas en
conflit, de telle sorte qu'un accord entre acteurs marchands
puisse merger. Pour cette raison, la valeur se dtermine lorsque
tous les marchs sont l'quilibre, ce qui signifie que
l'ensemble des dsirs de tous les acteurs se trouve simultan-
ment satisfait. l'vidence, l'ide d'une dtermination indivi-
duelle de la valeur pour une marchandise n'a ici aucun sens.
Dans un tel cadre, la valeur s'impose comme un fait collectif:
l'accord de tous les acteurs quant la rpartition de tous les
objets. En consquence, ce sont toutes les valeurs de tous les
biens qui se trouvent dtermines dans un mme mouvement.
L'quilibre gnral walrassien l, grce aux travaux de Kenneth
Arrow et Grard Debreu au dbut des annes 1950, nous en
offre l'illustration la plus aboutie sous la forme d'un systme de
n quations n inconnues dans lequel chaque quation lmen-
taire dcrit l'galit de l'offre et de la demande pour une mar-
chandise particulire. Le fait que la valeur d'un bien dpende
des valeurs des autres biens rsulte du jeu des interdpendances
que la thorie noc1assique prend en compte. Celles-ci sont bien
plus complexes
2
que celles prises en compte dans l'approche de
la valeur travail. Outre les dpendances techniques qui conti-
nuent d'tre prsentes par l'intermdiaire des fonctions de pro-
duction, l'quilibre gnral intgre les effets de substituabilit
prsents du ct de la consommation et les effets lis au revenu.
Par exemple, la valeur du bien i peut dpendre de la valeur du
bien j, soit que ces deux biens sont substituables comme dans le
cas du sucre blanc et du sucre brun, soit que certains consom-
mateurs du bien i ont un revenu qui dpend de la valeur du
bien j. Ainsi, la valeur des chaussures dpend-elle de la valeur
1. Sous la plume des conomistes franais, on trouve le plus souvent
walrasien et non walrassien . C'est l un barbarisme qui a pour origine
le terme anglais walrasian . En franais, le doublement du s s'impose,
comme dans maurassien , jurassien , circassien ou parnassien .
2. Ce qui ne veut pas dire plus pertinentes. Ni moins pertinentes.
40
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
de la viande parce que l'augmentation de la valeur de la viande
accrot le revenu des bouchers et que les bouchers achtent des
chaussures. Le chapitre II reviendra en dtail sur l'quilibre
gnral.
En conclusion de cette section, il apparat que l'hypothse
substantielle construit une conception systmique de l'conomie
marchande. Cette caractristique a certainement jou en sa
faveur. L'nigme marchande originelle qu'affronte la pense
conomique - par quel processus la sparation marchande se
trouve-t-elle surmonte? - y trouve une rponse des plus
convaincantes. Sous l'apparence du dsordre est mise au jour
une puissance ordonnatrice, i)1visible, la valeur, qui tient
ensemble les acteurs. A son origine, cette laboration thorique
a trouv dans sa proximit conceptuelle avec la pense newto-
nienne (loi de la gravitation) un lment supplmentaire de
conviction. Cependant, cette approche holiste ouvre sur une
nouvelle question: comment rendre cette approche globale
compatible avec la nature fondamentalement dcentralise des
conomies marchandes? N'y a-t-il pas l une difficult? Il
semble bien que, dans les conomies relles, les prix et les
individus ont une marge d'volution locale importante dont
cette analyse ne rend nullement compte. Cette interrogation sera
reprise au chapitre IV.
Le ftichisme de la marchandise
Lorsque, la lumire de tous nos rsultats prcdents, on
examine l'hypothse substantielle dans la globalit de ses dter-
minations, il apparat nettement qu'elle avance une conception
du monde marchand centre sur les objets. Elle ne met qu'au
second plan les rapports des acteurs entre eux dans la mesure o
l'intelligibilit des faits conomiques primordiaux, comme les
prix et les volumes changs, repose intgralement sur le calcul
des valeurs. Pour dsigner cette spcificit si forte, il sera dit
que la tradition conomique privilgie une conomie des gran-
deurs au dtriment d'une conomie des relations . Cette
41
L'EMPIRE DE LA VALEUR
manire de faire n'a rien de choquant a priori, dans la mesure
o elle rflchit un fait propre aux conomies marchandes: les
individus spars y entrent en relation non pas directement mais
par l'intermdiaire de la circulation des marchandises. C'est
par le biais de l'objectivit des valeurs que les producteurs-
changistes font l'exprience du social. Ce faisant, la primaut
des grandeurs, sous la forme du combien, s'impose la
conscience de tous les protagonistes. De ce point de vue, la
thorie de la valeur est fidle la manire dont les conomies
marchandes se prsentent aux acteurs: la valeur et ses volu-
tions s'imposent eux la manire d'une puissance naturelle
face laquelle ils sont impuissants. Ces [quantits de valeur]
changent sans cesse, indpendamment de la volont et des pr-
visions des producteurs aux yeux desquels leur propre mouve-
ment social prend ainsi la forme d'un mouvement des choses,
mouvement qui les mne, bien loin qu'ils puissent le diriger
l
.
Les thories de la valeur collent l'exprience commune d'une
valorisation objective qui chappe la volont et aux prvi-
sions . La question se pose alors de savoir quel est le statut de
cette reprsentation. Est-elle la vrit ultime des conomies
marchandes?
Cette question trouve son analyse la plus fouille chez Marx
lorsqu'il introduit ce qu'il nomme le ftichisme de la mar-
chandise dans le premier chapitre du Capital. Il s'agit prcis-
ment pour lui d'tudier la perception que les acteurs ont des
marchandises, comme des tres indpendants, dous de corps
particuliers, en communication avec les hommes et entre eux
2
.
rebours de cette manire de voir commune aux individus
marchands, Marx souligne que la valeur est un fait social, pro-
duit spcifiquement par la sparation marchande, et en rien une
grandeur naturelle . Il crit: La forme valeur et le rapport
de valeur des produits du travail n'ont absolument rien faire
avec leur nature physique. C'est seulement un rapport social
dtermin des hommes entre eux qui revt ici pour eux la forme
1. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 71.
2. Ibid., p. 69.
42
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
fantastique d'un rapport des choses entre elles 1. Pour Marx, de
la mme manire que certains peuples considrent faussement
telle ou telle proprit comme appartenant en propre aux objets
ftiches, les acteurs conomiques considrent que la valeur
appartient en propre la marchandise, comme une qualit natu-
relle. Les uns comme les autres ne peroivent pas la nature
exacte du phnomne qu'ils ont sous les yeux. Pour autant, nous
dit Marx, cette manire de voir n'est pas une illusion. Elle est
constitutive de la ralit marchande: la valeur avance masque,
sous la forme d'une grandeur objective, intrinsque aux mar-
chandises : elle ne porte pas sur le front ce qu'elle est
2
.
Autrement dit, l'abstraction de la valeur est constitutive de la
ralit marchande. C'est ce que veut dire Marx lorsqu'il crit:
Les catgories de l'conomie bourgeoise sont des formes de
l'intellect qui ont une vrit objective, en tant qu'elles refltent
des rapports sociaux rels, mais ces rapports n'appartiennent
qu' cette poque historique dtermine, o la production mar-
chande est le mode de production social
3
Ceci exprime par-
faitement la position subtile de Marx. On trouve, chez Antoine
Artous, une dfense minutieuse d'un tel point de vue :
Pour Marx, les marchandises sont des choses "sensibles, supra-
sensibles", les formes de pense ont une objectivit sociale et,
somme toute, le rapport social ne tient pas debout sans les repr-
sentations qui l'accompagnent et le structurent. Ds lors, le ph-
nomne du ftichisme ne relve pas d'une simple illusion de
conscience - individuelle ou collective -, il ne renvoie pas seu-
lement l'apparence des rapports sociaux, la surface des
choses, il traduit le mode d'existence des rapports de production
capitalistes, leur forme sociale objective
4
Autrement dit, si l'objectivit de la valeur est constitutive de
la ralit marchande, il importe, pour le thoricien, de ne jamais
perdre de vue que cette objectivit est le produit historique
1. Ibid.
2. Ibid., p. 70.
3. Ibid., p. 72.
4. Antoine Artous, Le Ftichisme chez Marx, op. cit., p. 21.
43
L'EMPIRE DE LA VALEUR
d'une certaine structure sociale. La valeur n'est pas une gran-
deur naturelle mme s'il semble qu'il existe dans [les mar-
chandises] une proprit de s'changer en proportions
dtermines comme les substances chimiques se combinent en
proportions fixes 1 . Le thoricien ne doit pas se laisser prendre
ces apparences. Il doit viter de tomber dans l'illusion fti-
chiste et, pour ce faire, ne jamais oublier que la forme mar-
chandise est le rsultat d'un rapport social particulier,
historiquement dtermin, la production marchande: les objets
ne deviennent des marchandises que parce qu'ils sont les pro-
duits de travaux privs, excuts indpendamment les uns des
autres
2
. Cette thse est galement au cur du prsent livre car
celui-ci a pour projet de construire un cadre conceptuel qui
pense la valeur pour ce qu'elle est, non pas une substance, mais
une institution sociale-historique: l'institution qui est au fonde-
ment de l'conomie marchande. Cependant, contrairement
Marx, ce livre soutient que, pour tre men bien, ce projet
ncessite absolument de rompre avec l'hypothse substantielle.
Cette rupture est cruciale nos yeux car elle nous apparat
comme la condition mme pour sortir du ftichisme de la mar-
chandise, c'est--dire pour penser la nature sociale de la valeur.
Nous aurons l'occasion de prciser dans les chapitres venir ce
que cela signifie. Mais, avant de faire ceci, il importe de
rpondre un argument de poids: Marx ne prouve-t-il pas la
fausset de ce projet en dmontrant par son uvre mme qu'il
est possible de faire tenir ensemble, et la critique du ftichisme,
et l'hypothse substantielle? Nous voudrions montrer dans la
suite de cette section qu'il n'en est rien: son adhsion la tho-
rie de la valeur travail conduit Marx, malgr lui, des positions
qui sont en contradiction flagrante avec son approche sociale-
historique des rapports marchands, en particulier sa critique du
ftichisme.
Dmontrer ceci, c'est faire comprendre que la valeur sub-
stance et la valeur institution sont deux approches irrconci-
1. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 71.
2. Ibid., p. 69.
44
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
liables. Comment une substance, par nature ternelle, comme le
travail et l'utilit, pourrait-elle donner accs une conception
sociale-historique de la valeur? Il Y a l une antinomie irrduc-
tible. Au contraire, ce qui est pleinement conforme l 'hypo-
thse substantielle est l'ide qu'il y a toujours eu de l'conomie
marchande, comme il y a toujours eu de la valeur conomique:
que ce soit par le fait du travail auquel les hommes ont toujours
t contraints pour assurer leur existence, ou que ce soit par le
fait des biens utiles dont les hommes ont toujours eu le besoin.
Dans les deux cas, c'est une mme conception naturaliste
des rapports conomiques qui s'impose au dtriment d'une
approche historique. Cette pense naturaliste peut tre
dfendue mais ce n'est pas celle de Marx. Aussi, comme Marx
retient l'hypothse substantielle, cela le conduit, dans certains
passages, s'opposer lui-mme lorsqu'il semble se faire le
dfenseur d'une interprtation transhistorique de la valeur tra-
vail. Cette drive trouve dans la dtermination quantitative de la
valeur travail un terrain particulirement propice: parce que le
temps de travail socialement ncessaire est une quantit qui
peut tre calcule pour tout produit, quels que soient les rap-
ports de production, c'est naturellement qu'on est conduit le
regarder comme tant une grandeur naturelle , savoir une
grandeur vide de rapports sociaux. En effet, rien dans son calcul
formel ne fait rfrence aux relations marchandes d'change.
D'ailleurs, de tels calculs ont t effectus pour des socits non
marchandes. Chez Marx, la critique du ftichisme n'est pas
articule de l'intrieur la dtermination quantitative de la
valeur travail. Elle apparat comme un ajout qui vient spcifier
cette dernire de l'extrieur la manire d'une mise en garde.
Personne mieux que Cornelius Castoriadis' n'a mis en vi-
dence cette contradiction du texte de Marx, oscillant entre deux
conceptions antagoniques. Conformment ce qui vient d'tre
crit, il en repre l'origine dans la notion de substance, en ce
qu'elle renvoie une qualit dote d'une signification abso-
lue , manifestant ce qui tait l toujours, depuis toujours et
1. Les Carrefours du labyrinthe, Paris, Seuil, 1978.
45
L'EMPIRE DE LA VALEUR
dans le toujours
l
. Penser ainsi, c'est introduire l'existence de
dterminations universelles, valides quels que soient les rap-
ports sociaux considrs. Castoriadis crit: L'antinomie de la
pense de Marx est que ce Travail qui modifie tout et se modifie
constamment lui-mme est en mme temps pens sous la cat-
gorie de la SubstancelEssence, de ce qui subsiste inaltrable
[ ... ], ne se modifie pas, ne s'altre pas, subsiste comme fonde-
ment immuable des attributs et des dterminations chan-
geantes
2
Pour illustrer son propos, Castoriadis rappelle que
Marx lui-mme montre Robinson, dans son le, procdant une
comptabilit de son temps de travail dans le but final d'tablir
une allocation de celui-ci entre ses diverses activits produc-
tives selon la plus ou moins grande difficult qu'il a vaincre
pour obtenir l'effet utile qu'il a en vue
3
; ce qui, en bon lan-
gage conomiste, se traduit par: maximiser son utilit .
Marx conclut propos des calculs de Robinson: Son inven-
taire contient le dtail [ ... ] du temps de travail que lui cotent
en moyenne des quantits dtermines de ces divers produits.
[ ... ] Toutes les dterminations essentielles de la valeur y sont
contenues
4
Autrement dit, dans ce passage, la valeur travail
se donne voir comme une catgorie transhistorique s'imposant
Robinson comme l'conomie marchande. C'est mme vrai,
ajoute Marx, pour la socit communiste venir pour laquelle
[tout] ce que nous avons dit du travail de Robinson se repro-
duit, mais socialement et non individuellement
5
. La dimension
historiquement dtermine que revendique Marx pour la valeur,
comme propre la production marchande, dans de nombreux
passages de son uvre, est ici absente. Castoriadis multiplie les
exemples de cette oscillation perptuelle: Marx peut penser la
Substance Travail tantt comme purement physiologique-
naturelle, et tantt comme pleinement sociale, tantt comme
1. Ibid., p. 264.
2. Ibid.
3. Le Capital, op. cit., p. 72.
4. Ibid.
5. Cit in Cornelius Castoriadis, Les Carrefours du labyrinthe, op. cit., p. 265.
46
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
transhistorique et tantt comme lie spcifiquement la phase
capitaliste, tantt comme manifestation de la rification de
l'homme sous l'exploitation capitaliste et tantt comme le fon-
dement qui permettrait un "calcul rationnel" dans la socit
venir'. Il conclut en soulignant: La vraie borne historique
aussi bien d'Aristote que de Marx est la question de l'institu-
tion. C'est l'impossibilit pour la pense hrite de prendre en
compte le social-historique comme mode d'tre non rductible
ce qui est "connu" ailleurs
2
C'est parce que l'approche
substantielle est, en sa structure mme, oubli de l'institution
qu'elle se montre inapte tayer un discours qui pense les faits
conomiques la lumire des rapports sociaux historiquement
constitus qui les ont produits. Il faut donc conclure qu'tre
fidle la conception sociale-historique de l'conomie capita-
liste impose de rompre avec l'hypothse substantielle pour pen-
ser l'institution de la valeur. Il y a une contradiction entre
1 'hypothse d'une substance, dont la validit est par nature uni-
verselle, et l'insistance considrer la valeur comme une ralit
spcifique l'ordre marchand.
Pour clore cette rflexion sur Marx, il est un auteur passion-
nant tudier, Isaak Roubine, prcisment parce qu'il cherche
dpasser cette antinomie, savoir articuler la thorie
marxienne de la valeur travail et la thorie marxienne du fti-
chisme. S'il n'y russit pas, sa rflexion n'en est pas moins
remarquable car elle voit le problme l o de trs nombreux
lecteurs n'ont rien vu. Roubine comprend que la thorie du
ftichisme est une critique de l'approche substantielle. Il s'ensuit
un livre qui constitue certainement la prsentation la plus
fouille qui ait jamais t consacre la thorie de la valeur
chez Marx. Centrons-nous sur son analyse du travail abstrait. Ce
concept constitue un enjeu crucial au regard de notre rflexion
prsente en ce que Marx avance prcisment le concept de tra-
vail abstrait pour spcifier cette forme si particulire que prend
le travail comme crateur de valeur en conomie marchande.
1. Ibid., p. 269.
2. Ibid., p. 314.
47
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Autrement dit, le travail abstrait constitue la substance mme
de la valeur. Et l'on retrouve, en consquence, notre question
prcdente: comment le travail abstrait, crateur de valeur,
concept spcifiquement marchand, peut-il trouver sa dtermina-
tion adquate dans une substance gnrique comme le travail ?
Comment articuler travail abstrait et ce que Castoriadis nomme
le Travail/Substance? En quoi le travail abstrait est-il encore du
travail, mme sous la forme de travail socialement ncessaire?
Roubine est conscient de ces difficults. Il comprend parfaite-
ment que la thorie du travail abstrait est l'un des lments
fondamentaux de la thorie marxienne de la valeur
l
. Pourtant,
bien qu'il en soit ainsi, il constate que le travail abstrait fait
l'objet d'une profonde erreur d'interprtation: le concept de tra-
vail abstrait est pens comme un concept physiologique .
Roubine lutte contre cette interprtation physiologique du
travail abstrait, qui peut encore tre dite matrielle ou
technique . Les raisons qu'il invoque sont si proches de
celles qui ont t prsentes que nous sommes tents de citer
Roubine longuement:
Marx a inlassablement rpt que la valeur est un phnomne
social, que "les valeurs des marchandises n'ont qu'une ralit
purement sociale" et ne contiennent "pas un atome de matire".
Il s'ensuit que le travail abstrait, crateur de valeur, doit tre
compris comme une catgorie sociale dans laquelle ne pntre
"pas un seul atome de matire". De deux choses l'une: ou bien
le travail abstrait est une dpense d'nergie humaine sous une
forme physiologique, et alors la valeur a aussi un caractre
matriel rifi. Ou bien la valeur est un phnomne social, et le
travail abstrait doit alors lui aussi tre compris comme un phno-
mne social, li une forme sociale de production dtermine. Il
est impossible de concilier une interprtation physiologique du
concept de travail abstrait avec le caractre historique de la
valeur que ce mme travail cre. 'La dpense physiologique
d'nergie en tant que telle se retrouve toutes les poques, et
autant dire alors que cette nergie cre de la valeur toutes les
1. Isaak Roubine, Essais sur la thorie de la valeur de Marx, op. cit.,
p.179.
48
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
poques. Nous en arrivons alors l'interprtation la plus gros-
sire de la thorie de la valeur, interprtation qui contredit nette-
ment la thorie de Marx
l
. [Je souligne.]
On ne saurait exprimer plus clairement le dilemme que pose
le concept de travail abstrait un marxiste qui se veut fidle
la conception sociale-historique des rapports conomiques. En
dfendant une telle conception, Roubine est ncessairement
conduit critiquer vivement ce qu'il nomme l'approche phy-
siologique . Or il n'est pas difficile de reconnatre, dans cette
approche physiologique, l 'hypothse substantielle, savoir une
conception qui pense le travail abstrait sous la forme d'une
substance ternelle, vide de rapports sociaux, en l'occurrence
l'nergie dpense dans l'acte productif. Elle est ternelle en ce
qu'on la retrouve toutes les poques et qu'elle cre de la
valeur toutes les poques . Or, cela ne se peut pas. Pour
Marx, le travail abstrait est propre la priode marchande.
Aussi, pour Roubine, la conception physiologique est-elle une
trahison du marxisme, l'interprtation la plus grossire de la
thorie de la valeur , crit-il. Notons qu'il reconnat cependant
que, dans de nombreux passages, Marx lui-mme n'est pas
clair. Ses noncs peuvent donner prise l'interprtation phy-
siologique
2
Il faut, sur ce point, admettre que la pense de
Marx est intrinsquement dficiente. Sinon comment expliquer
que tant d'auteurs aient suivi ce (mauvais) chemin, comme le
constate Roubine
3
? Il nous semble ici que cette dviation
1. Ibid., p. 184.
2. En fin de compte, toute activit productive, abstraction faite de son
caractre utile, est une dpense de force humaine. La confection des vtements
et le tissage, malgr leurs diffrences, sont tous deux une dpense productive
du cerveau, des muscles, des nerfs, de la main de l'homme, et en ce sens du
travail humain au mme titre (Le Capital, op. cit., p. 47). Ou encore: Tout
travail est d'un ct dpense, dans le sens physiologique, de force humaine,
et, ce titre de travail humain gal, il forme la valeur des marchandises
(ibid., p. 49).
3. Si mme des marxistes dfinissent couramment le travail abstrait
comme une dpense d'nergie physiologique, il n'est pas tonnant que cette
conception soit largement rpandue dans la littrature antimarxiste (Isaak
Roubine, Essais sur la thorie de la valeur de Marx, op. cit., p. 180).
49
L'EMPIRE DE LA VALEUR
trouve ses racines dans l'inadquation de l'hypothse substan-
tielle elle-mme qui, spontanment, tend faire prvaloir une
interprtation naturaliste du travail abstrait, savoir un travail
dpouill de tout lment social et historique [ ... ] qui existe
dans toutes les poques, indpendamment de telle ou telle forme
de production 1 . Roubine s'efforce de montrer qu'une autre
voie est possible. C'est le cur de son travai1
2
Suivons-le,
mme s'il n'y russira pas, car, ce faisant, il ouvre des pistes qui
ne demanderont qu' tre explores.
Dans le but d'chapper la drive naturaliste, Roubine se
propose d'expliciter ce qui fait la spcificit marchande du tra-
vail abstrait. Il s'ensuit une longue analyse dans laquelle de
nombreuses citations de Marx se trouvent mobilises. Cette
analyse et ces citations convergent vers un mme lment, la
mise en exergue de l'acte d'change: Marx souligne que cette
rduction des formes concrtes du travail du travail abstrait
s'accomplit dfinitivement dans le procs d'change
3
, crit-il.
Nous sommes ici en plein accord avec Roubine et Marx.
L'change doit tre mis au centre de l'analyse: Le travail abs-
trait apparat et se dveloppe dans la mesure o l'change
devient la forme sociale du procs de production, donnant ce
dernier la forme de la production marchande
4
C'est l'change
qui est central et, parce que l'approche de la valeur travail le
sous-estime grandement, elle perd la capacit saisir le travail
abstrait comme une grandeur spcifique la production mar-
chande. C'est la prise en compte de l'change et de ses dtermi-
nations spcifiques qui, seule, ouvre une perspective
entirement nouvelle. Cependant, deux manires de concevoir
1. Ibid.
2. Par ailleurs, il est frappant de constater que ce projet va de pair avec le
rtablissement de la thorie du ftichisme au centre de la rflexion et non pas
comme une entit spare et indpendante, que seul un lien tnu rattachait
la thorie conomique de Marx [ ... ], comme une intressante digression litt-
raire et culturelle qui accompagne le texte fondamental de Marx (ibid.,
p.35).
3. Ibid., p. 193.
4. Ibid., p. 194.
so
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
l'change sont possibles: comme le lieu o la valeur est cre
ou comme le lieu o la valeur est rvle. Roubine de nouveau
est conscient de la difficult :
Certains critiques pensent que notre conception peut conduire
la conclusion que le travail abstrait n'a son origine que dans
l'acte d'change, ce qui entranerait que la valeur tient elle aussi
son origine uniquement de l'change. Or, selon le point de vue
de Marx, la valeur et donc aussi le travail abstrait doivent dj
exister dans le procs de production. Nous touchons ici une
question trs srieuse et dlicate, celle des rapports entre la pro-
duction et l'change. Comment rsoudre ce problme? D'une
part, la valeur et le travail abstrait doivent dj exister dans le
procs d'change et, d'autre part, Marx dit plusieurs reprises
que le travail abstrait prsuppose le procs d'change 1.
Comment concilier deux thses contradictoires. D'une part,
l'change rvle une valeur qui est produite antrieurement
dans le procs de production et, d'autre part, la valeur est intrin-
squement lie l'change. Ces deux thses, pourtant, coexistent
chez Marx: la premire, au nom de 1 'hypothse substantielle et
la seconde, au nom de 1 'historicit de la valeur marchande. On
note, ce propos, combien le terme de travail est ici strat-
gique car si, conformment la seconde thse, le travail abstrait
se trouvait produit par l'change, au travers des actes de valori-
sation, on serait alors en droit de se demander en quoi il est du
travail plus qu'autre chose, par exemple de l'utilit. Sa fid-
lit la valeur travail conduit Roubine choisir la premire
voie: l'change rvle la valeur; par quoi il retombe, son
corps dfendant, dans 1 'hypothse substantielle. En effet,
comme il le reconnat lui-mme explicitement dans la citation
suivante, les dterminations essentielles de la valeur travail ne
peuvent tre autre chose que d'une nature matrielle-technique
et physiologique: Nous voyons que la dtermination quantita-
tive du travail abstrait est conditionne de faon causale par une
srie de proprits qui caractrisent le travail sous ses aspects
1. Ibid., p. 197.
51
L'EMPIRE DE LA VALEUR
matriel-technique et physiologique dans le procs de produc-
tion direct, antrieurement au procs d'change et indpendam-
ment de celui-ci 1. Certes, Roubine fait une place plus large
l'change mais sans que cela affecte srieusement l'analyse.
Comme Marx au fond, la thorie du ftichisme chez Roubine
gardera le statut d'une mise en garde externe, d'un ajout, faute
d'avoir pu tre articule de l'intrieur la conception du tra-
vail socialement ncessaire .
Conclusion
Le prsent chapitre a cherch dmontrer que l'hypothse
substantielle est le concept adquat permettant d'identifier ce
qui fait la singularit du discours conomique, par lequel se
constitue une tradition de pense originale en rupture avec les
autres sciences sociales. Alors que d'ordinaire les valeurs sont
affaire de jugement, la valeur marchande telle que la pense la
tradition conomique se distingue radicalement des autres
valeurs sociales, morales, esthtiques ou religieuses, par le fait
qu'elle se prsente comme une grandeur objective et calculable,
en surplomb des acteurs et de leurs relations. C'est une concep-
tion sans quivalent dans les sciences sociales: pour com-
prendre les hommes, peu importent leurs opinions ou leurs
croyances, ce qui compte, c'est l'volution quantifiable de la
valeur des biens, ce qu'il faut nommer une conomie des
grandeurs . Cette analyse nous a conduits une conclusion
quelque peu paradoxale: l'approche conomique laisse peu de
place aux changes proprement dits. Ce dsintrt l'gard des
transactions relles se retrouve dans les quatre spcifications qui
ont t mises en avant: que l'on rejette les transactions mon-
taires pour leur prfrer le troc, qu'on nglige l'influence propre
aux circonstances de l'change, ou qu'on considre l'conomie
marchande comme un systme global, c'est toujours une mise
entre parenthses du march rel qu'on assiste. En crivant cela,
1. Ibid., p. 208.
52
LA VALEUR SUBSTANCE: TRAVAIL ET UTILIT
nous sommes parfaitement conscients de la ncessit o nous
sommes, pour rendre cette conclusion crdible, de procder
une prise en compte de la thorie noclassique bien plus en pro-
fondeur que ce que nous avons fait jusqu' maintenant. En effet,
prima fade, tout dans l'approche orthodoxe semble contredire
ces conclusions: comment peut-on dire que la thorie noclas-
sique nglige les changes alors que l'analyse walras sienne fait
jouer un rle central aux marchs de concurrence parfaite?
Tout le chapitre suivant sera consacr cette question.
Cependant, nous ne pouvons clore cette rflexion consacre
l'hypothse substantielle en gnral sans souligner quel point
il s'agit d'une construction d'une grande puissance. Assur-
ment, elle saisit une part de la ralit des relations marchandes,
l'objectivit de la valorisation, et nous comprenons aisment le
puissant attrait qu'elle peut exercer sur les meilleurs esprits. Par
sa volont d'aller au-del des apparences pour saisir la com-
mensurabilit dans ce qu'elle a de plus fondamental, la valeur
substance est un concept d'une grande tmrit. Elle rorganise
la vision de l'observateur pour dgager, par-del la surface des
changes concrets, les forces objectives qui faonnent la ralit
conomique. Ce faisant, elle donne voir un processus d'abs-
traction proche de celui que pratiquent les sciences de la nature.
Tout au long de notre travail, nous nous sommes efforcs d'en
prsenter la logique de la manire la plus rigoureuse. Lorsque
nous serons amens critiquer l'hypothse substantielle, ce ne
sera pas pour des raisons logiques, mais parce que cette
approche, par ailleurs parfaitement cohrente, ne fournit pas,
selon nous, une bonne description des faits conomiques. Elle
n'est pas adquate la ralit. Ou encore, pour le dire d'une
manire plus prcise et rigoureuse, elle ne saisit pas cette ra-
lit dans sa totalit, elle laisse de ct des lments essentiels.
Selon nous, c'est la question des changes qui est centrale et,
plus prcisment, des changes montaires. Son exclusion inter-
dit une comprhension en profondeur de la sparation mar-
chande. Comme on l'a vu, Marx galement tombe dans ce
pige. Sa position est particulirement intressante car, par
ailleurs, il est le thoricien le plus attach prendre en compte
53
L'EMPIRE DE LA VALEUR
les rapports sociaux de production comme l'illustre sa critique
du ftichisme. Marx insiste juste titre sur le fait que l'objecti-
vit de la valeur n'est pas un fait naturel, ahistorique, mais bien
l'expression d'une certaine structure sociale, l'conomie mar-
chande. Cependant, parce qu'il adhre l'hypothse substan-
tielle, il se trouve plus d'une fois conduit, sur ce point, se
contredire. En consquence, l'conomie des relations que
nous cherchons fonder comme alternative l'conomie des
grandeurs de la tradition conomique, si elle trouve dans Marx
un cadre global d'intelligibilit et des concepts importants, doit
cependant rompre avec la valeur travail. Il est clair qu'une rup-
ture d'une telle ampleur ne signifie pas autre chose qu'une
refondation du marxisme. Cela sort amplement du cadre du pr-
sent travail. Il importe maintenant d'en venir au plat de rsis-
tance: la thorie noclassique de la valeur.
Chapitre II
L'objectivit marchande
La thorie noclassique de la valeur a le mme point de
dpart que celui de Marx au dbut du Capital: dcouvrir ce qui
fonde la commensurabilit des marchandises, ce qui fait que les
individus changent des biens. Pour ce faire, elle propose une
rponse formellement identique: la mise en avant d'une subs-
tance sociale. Cependant, cette substance, qui est l'origine
de l'changeabilit, ce n'est plus le travail comme chez les clas-
siques, c'est l'utilit des biens. Les biens s'changent parce
qu'ils sont utiles. La construction de cette valeur utilit passe
par l'laboration d'un cadre conceptuel qui apprhende l'indi-
vidu sous l'angle de sa relation aux biens. C'est l un point
dcisif qui, dans la pense classique, ne jouait qu'un rle secon-
daire. L'Homo conomicus de la thorie noclassique est
d'abord un individu qui recherche les objets pour leur utilit.
Cette manire si particulire de dfinir l'acteur est au fondement
de cette approche. Elle en est l 'hypothse de base : pour l'co-
nomiste noclassique, la relation aux objets prime sur la relation
aux autres individus ou la socit. L'conomie, dans son prin-
cipe, est pense comme ayant pour finalit ultime de rpondre
aux besoins des consommateurs. C'est la recherche perptuelle
de satisfaction par les biens consomms qui justifie l'existence
des conomies marchandes comme leur dynamisme. L'quilibre
gnral walrassien illustre la perfection cette manire de pen-
ser. On y voit n individus luttant pour obtenir le panier de mar-
chandises qui leur apportera la satisfaction la plus grande.
Contrairement l'approche classique qui la met au centre de
son dispositif conceptuel, la production ne joue ici qu'un rle
55
L'EMPIRE DE LA VALEUR
secondaire. Elle est envisage, comme une bote noire, sous un
angle exclusivement technique: largir la gamme des objets
disponibles conformment aux capacits productives existantes.
Elle n'implique pas, comme chez Marx, de rapports sociaux
spcifiques qui demanderaient une tude particulire. Pour le
producteur, il s'agit d'acheter les inputs ncessaires, y compris
la force de travail, pour ensuite les vendre. En consquence,
c'est le march qui s'impose comme le rapport social primordial
en tant qu'il rgle la rpartition des marchandises entre les indi-
vidus. C'est uniquement par son entremise que les individus-en-
relation-aux-objets font l'exprience des autres. Telle est la
conception noclassique de la sparation marchande: des indi-
vidus en lutte pour des objets utiles.
Pour rendre intelligible cette relation aux objets, constitutive
de l'individu marchand et de la sparation marchande, la thorie
noclassique avance le concept de prfrences indivi-
duelles : il est fait l'hypothse que tout individu est capable de
classer les divers paniers de biens qui lui sont offerts, par ordre
de prfrence croissante
l
Dire que l'individu prfre le panier
A au panier B signifie que la consommation du panier A lui pro-
cure une satisfaction suprieure celle du panier B. En cons-
quence, toutes choses gales par ailleurs, l'individu s'efforcera
d'acqurir le panier A plutt que le panier B. Soulignons que la
prfrence s'labore dans un strict face--face mettant aux
prises le consommateur et les objets. Ce qui signifie que la pr-
frence ne' dpend en rien de ce que font les autres: ni de ce
qu'ils consomment, ni de ce qu'ils dsirent. S'affirme, ce fai-
sant, la nature strictement individualiste jusqu'au solipsisme de
ce cadre conceptuel. Le rapport aux marchandises tel que
l'apprhende la pense noclassique est un rapport purement
priv o l'individu spar est confront directement aux mar-
chandises : il estime, par introspection, l'effet sur lui-mme de
leur consommation. L'valuation qui en rsulte est galement
1. Cette proprit, jointe celle de transitivit , conduit faire de la
relation de prfrence ce qu'en mathmatiques on nomme un prordre com-
plet .
56
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
exclusivement individuelle. Le plus souvent, ces prfrences
sont reprsentes l'aide d'une fonction, dite fonction d'uti-
lit , qui, chaque panier de biens, associe la satisfaction qu'il
procure, encore appele utilit . Dans un tel cadre, chaque
individu possde ses propres prfrences individuelles formali-
ses par une fonction d'utilit spcifique. En consquence, de
manire indiffrente, on dira, soit: l'individu prfre le panier
A au panier B, soit: l'utilit subjective que le panier A procure
l'individu est suprieure celle que lui procure le panier B.
Dans cette approche, la recherche par tous les individus d'un
accroissement de leur satisfaction est la force fondamentale qui
met en mouvement l'conomie marchande par le biais des
changes. Elle est au fondement de sa thorie de la valeur.
Le rapport utilitaire aux objets et l'accord walrassien
Pour avancer, centrons-nous sur l'quilibre gnral walras-
sien qui offre la formulation la plus rigoureuse de la thorie de
la valeur utilit et qui, pour cette raison, reste aujourd'hui le
modle de base autour duquel se structure la pense cono-
mique. Cette modlisation est trs intressante puisqu'elle sou-
tient non seulement que la concurrence permet l'conomie
marchande d'accder l'quilibre mais, qui plus est, que l'qui-
libre concurrentiel ainsi obtenu serait optimal au regard de
l'allocation des ressources rares'. C'est donc une dmonstration
trs puissante. Cette analyse
2
donne voir une conomie paci-
fie dans laquelle tous les agents, les consommateurs comme les
1. Sans entrer dans des dtails par trop techniques, notons cependant que
cette optimalit est une optimalit particulire, nomme optimalit par-
tienne, du nom de Vilfrid Pareto, grand conomiste. Il s'agit d'un critre
faible au regard du sens commun.
2. Elle a dj fait l'objet d'une brve prsentation au chapitre prcdent.
Cette analyse associe chaque bien son march et montre qu'il existe une
situation o tous les marchs sont simultanment l'quilibre, savoir que
l'offre s'y galise avec la demande. Se reporter au paragraphe intitul Une
conception totalisante .
57
L'EMPIRE DE LA VALEUR
producteurs, voient leurs dsirs pleinement satisfaits. En cons-
quence, ils ne souhaitent plus modifier leur situation parce
qu'elle leur procure dj le maximum de ce qu'ils peuvent
esprer, au niveau de prix propos. Comment un tel miracle est-
il possible? D'o vient que la lutte concurrentielle permet
l'autorgulation du systme de marchs? Rpondre ces ques-
tions suppose de revenir sur les hypothses mobilises par la
thorie noclassique de la valeur et, en premier lieu, sur celles
qui ont trait aux dsirs des acteurs et la manire dont ces dsirs
entrent en concurrence.
Une premire hypothse joue un rle central dans l'obtention
de l'accord walras sien : l'objectivit des prfrences
l
. En impo-
sant que jamais le dsir des acteurs ne s'carte de ce que dicte
le calcul de l'utilit, cette hypothse a pour effet d'introduire un
puissant facteur de modration dans la lutte concurrentielle : ce
faisant, la violence acquisitive se trouve de facto troitement
encadre. La monte aux extrmes, caractristique des processus
agonistiques, qui pousse certains miser plus, ou hors de pro-
pos, pour s'emparer de ce que les autres dsirent ou possdent,
y est strictement interdite. Autrement dit, la fixit des prf-
rences forme un ancrage objectif qui vient contraindre puissam-
ment les rivalits acquisitives. Celles-ci doivent, tout instant,
se conformer ce que le calcul des utilits impose. Elles ne sau-
raient sortir de ce cadre rigide. Que le dsir pour un bien puisse
s'accrotre proportion du fait que les autres le possdent - ce
qu'on nomme jalousie ou envie -, voil ce qui ne saurait
tre, ce qui est tout simplement exclu d'emble. l'vidence,
cette hypothse qui implique que les stratgies individuelles ne
sont jamais affectes par la volont de l'emporter tout prix
correspond une situation de violence totalement domine. Ou
mme, pour mieux dire, une absence de violence, puisque
jamais la rivalit envers autrui ne vient instiller dans le cur des
changistes un quelconque sentiment d'hostilit ou de revanche
qui viendrait perturber la perception utilitaire du monde. Dans
1. Techniquement, nous appelons objectivit le fait que les prfrences
sont exognes et qu'e11es ne dpendent pas de la situation des autres acteurs.
58
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
l'change walras sien, les protagonistes restent froids et imper-
turbables en toutes circonstances, dpourvus d'affects autres
que leur intrt pour les biens utiles. Cela atteste d'une concep-
tion de la sparation marchande pousse ses plus extrmes
limites. Les individus sont spars, non seulement en tant que
chacun est un centre de dcision autonome, mais galement au
sens o chaque individu se rvle parfaitement indiffrent
l'gard des autres : ce que les autres acteurs font ou possdent
ne l'affecte en rien; il reste totalement impermable leur
regard, ce qu'ils pensent de lui. Seule importe sa relation aux
biens; les autres ne comptent pas. La satisfaction que procurent
les biens consomms est sa passion exclusive, son unique int-
rt, son seul affect.
Cependant l'hypothse d'objectivit elle seule ne suffit pas
assurer l'existence de l'quilibre gnral. Il est ais de le com-
prendre: si jamais les prfrences individuelles, bien qu'objec-
tives, taient par trop antagoniques, il ne serait pas possible de
trouver un accord entre les changistes. Par exemple, imaginons
que tous les acteurs veulent uniquement d'un mme bien. S'il
en tait ainsi, aucun accord ne pourrait tre trouv. Pour qu'un
quilibre existe, il faut que les prfrences objectives des
acteurs soient suffisamment flexibles, autrement dit qu'elles
ne soient ni trop exagres, ni trop exclusives. C'est ce que
recouvre l 'hypothse technique dite de convexit des prf-
rences mise en avant par Arrow et Debreu comme une condi-
tion ncessaire pour qu'existe un quilibre. Les prfrences
exagres sont du type: plus j'en ai, plus j'en veux , et
les prfrences exclusives sont du type: un seul bien
m'intresse , les deux aspects tant troitement lis.
L'hypothse de convexit exclut d'emble les prfrences exa-
gres puisqu'elle suppose une saturation progressive de la
satisfaction la manire de ce qu'on ressent lorsqu'on consomme
un produit alimentaire. Aussi dlicieux et raffin soit-il, le dsir
d'en manger encore plus diminue au fur et mesure que la
quantit dj consomme crot. Techniquement, on dit que l'uti-
lit marginale est dcroissante: lorsque l'individu accrot sa
consommation d'un bien, son utilit augmente mais, pour
59
L'EMPIRE DE LA VALEUR
chaque unit supplmentaire du bien, la satisfaction marginale
apporte diminue, en consquence de quoi son dsir pour le
bien diminue. La convexit interdit galement l'exclusivit des
prfrences en imposant que l'individu aime les mlanges 1 .
Autrement dit, elle suppose que l'accroissement de la diversit
produit un accroissement de la satisfaction, toutes choses tant
gales par ailleurs
2
En conclusion, on peut dire que l'hypothse
de convexit, en excluant du champ de l'analyse tous les com-
portements monomaniaques, modlise un rapport de l'individu
aux objets marchands particulirement pacifi et raisonnable,
totalement non nvrotique. On comprend alors que, sous de
telles conditions, un accord puisse merger. Par construction,
les acteurs ont t dots de la flexibilit qu'il faut vis--vis des
objets poUr qu'il en soit ainsi. On serait mme tent de dire que
les acteurs walrassiens sont indiffrents aux objets en tant que
tels. Essayons de comprendre comment cela est possible.
D'abord commenons par noter que de telles prfrences
n'ont rien de naturel. Il serait erron de considrer une telle
conception comme reprsentative de la manire dont, de tous
temps et en tous lieux, les hommes se sont comports. Le
consommateur noclassique, si tant est qu'il existe, doit bien
plutt tre pens comme rsultant d'un travail prolong de la
socit sur la subjectivit humaine aux fins de la rendre parfai-
tement adquate au monde marchand. Pour s'en persuader, il
n'est que de considrer, par exemple, ce que sont les gots d'un
amateur d'art. On y observe, le plus souvent, un attachement
obsessionnel certaines uvres allant de pair avec une dvalo-
risation, non moins excessive, pour ce qui n'est pas ces uvres.
Si l'amateur d'art se comporte ainsi, c'est parce qu'il appr-
hende l'uvre dans son individualit, dans ce qui fait sa radi-
cale singularit. Il l'apprcie avec passion parce qu'elle n'est
1. Bernard Guerrien, La Thorie noclassique, tome 1 : Microconomie,
Paris, La Dcouverte, 1999, p. 16.
2. Techniquement, si deux paniers PI et P
2
procurant la mme utilit sont
combins sous la forme aPI + (l-a)P
2
, avec a compris strictement entre 0 et
1, cela entrane un accroissement de l'utilit obtenue.
60
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
semblable nulle autre. L'objet en tant que tel lui importe au
plus haut point. Par contraste, il apparat que, pour l'Homo co-
nomicus, tous les biens se ressemblent peu ou prou. Il n'prouve
aucun attachement spcifique. Tout est affaire de quantit. Il est
toujours prt troquer l'un pour l'autre. C'est d'ailleurs ce pour
quoi la thorie noclassique l'apprcie tant. Cela fait de lui un
parfait changiste. S'il en est ainsi, c'est parce que l'Homo co-
nomicus regarde par-del les biens eux-mmes, travers eux,
devrait-on dire: ce qui compte pour lui, ce n'est pas leur indi-
vidualit, mais l'utilit qu'ils sont aptes lui procurer. Telle
est la solution l'tonnant et paradoxal dtachement
qu'prouve le consommateur no classique l'gard des mar-
chandises. ses yeux, tous les biens ne sont que des dclinai-
sons d'une mme substance gnrique: l'utilit. C'est celle-ci
qu'il poursuit. L'hypothse de convexit des prfrences s'en
dduit. Elle est la traduction d'un rapport strictement utilitaire
aux objets. Les objets ne comptent pas; seule leur utilit
importe.
Cette interprtation du modle du consommateur trouve dans
la thorie des caractristiques de Kelvin Lancaster un puissant
appui. En effet, cette thorie soutient qu'il est possible d'identi-
fier les sources de l'utilit, par-del les biens, dans ce que Lan-
caster nomme proprits ou caractristiques , comme par
exemple la caractristique nutritionnelle ou calorique 1. Selon
cette approche, les consommateurs ne sont pas intresss par les
biens en eux-mmes mais par les caractristiques qui les com-
posent et qui sont l'origine de l'utilit. Ces caractristiques
sont une ralit objective, identique pour tous les individus. Il
s'ensuit que les biens disparaissent en tant qu'objets spcifiques
pour ne plus tre apprhends que comme des paniers de carac-
tristiques
2
Avec ce modle, l'utilit d'un bien se voit dfmie
1. Kelvin Lancaster, A New Approach to Consumer Theory , Journal
ofPolitical Economy, vol. 74, n 2, avril 1966, p.193.
2. On comprend alors pourquoi l'introduction de la singularit conduit
un profond ramnagement de la thorie noc\assique, comme l'a dmontr
Lucien Karpik (dans L'conomie des singularits, Paris, Gallimard, 2007).
61
L'EMPIRE DE LA VALEUR
comme une grandeur objective multidimensionnelle qui peut
tre mesure indpendanunent de la subjectivit des acteurs:
[ ... ] les caractristiques possdes par un bien sont les mmes
pour tous les consommateurs et, une fois les units de mesure
dfinies, sont en mme quantit, de telle sorte que l'lment per-
sonnel dans le choix de consommation porte seulement sur le
choix entre des ensembles de caractristiques, non dans l'alloca-
tion des caractristiques aux biens 1.
Il n'en reste pas moins que les prfrences demeurent subjec-
tives au sens o les consommateurs diffrent dans leur intrt
pour les caractristiques. En rsum, le travail de Lancaster a
consist introduire entre les prfrences individuelles et le
bien un lment objectif: le panier de caractristiques, qu'on
pourrait galement nommer l'utilit objective du bien pour
la distinguer de l'utilit subjective. En ce sens, dans le cadre de
cette rinterprtation des prfrences individuelles, les objets ne
comptent pas; seule leur utilit est pertinente aux yeux des
consommateurs.
L'ensemble de ces rflexions nous permet de mieux com-
prendre ce qu'est l'quilibre gnral et, par voie de cons-
quence, d'estimer avec justesse la porte de ses rsultats. Il est
apparu que l'quilibre gnral donne voir une conomie dans
laquelle la mdiation par les objets est pousse ses extrmes
limites. Les acteurs n'ont aucun lien direct les uns avec les
autres. Seul compte leurs yeux le rapport aux biens tel qu'il
s'exprime dans l'valuation subjective des utilits. En cons-
quence, la valeur utilit impose une parfaite indiffrence aux
autres. Seule importe la satisfaction que procurent les objets.
Comme la relation de chacun aux objets est d'une nature stric-
tement utilitaire, sans exclusive, ni exagration, un accord mer-
gera aisment. On ne voit pas ce qui pourrait y faire obstacle.
Tout ce qui aurait pu poser problme a t mis de ct: la
jalousie, l'envie ou la violence d'un dsir exclusif. Pratique-
1. Kelvin Lancaster, A New Approach to Consumer Theory , art. cit.,
p.134.
62
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
ment, l'accord walras sien est obtenu par l'intermdiaire des
prix 1. On peut donc dire que, dans ce modle, les prix et les
biens absorbent toute la substance sociale : le seul rapport aux
prix suffit dterminer compltement la position de chacun des
individus sans qu'il soit ncessaire pour eux d'entrer en relation
directe avec les autres agents, ou mme de s'y intresser.
Le ttonnement walrassien et la mdiation par les prix
ce moment de l'analyse, le lecteur sceptique sera tent de
faire valoir que, si la position des acteurs conomiques se
dfinir seulement grce aux prix, sans faire intervenir directe-
ment les autres acteurs, cette analyse trouve ses limites natu-
relles lorsqu'on prend en compte l'change lui-mme qui
introduit ncessairement des interactions entre les acheteurs et
les vendeurs. Le march n'est-il pas fondamentalement dcen-
tralis? En analyser le fonctionnement n'implique-t-il pas la
prise en compte de relations directes entre acteurs? Assur-
ment, ceci est vrai dans le monde rel, mais pas dans l'approche
walrassienne qui modlise un march dans lequel les acheteurs
et vendeurs ne se parlent ni ne se rencontrent jamais. C',est l
un point si contraire l'intuition qu'il mrite une analyse
dtaille. Dans la conception retenue par les thoriciens noc1as-
siques pour penser la concurrence, aucune place n'est aux
interactions directes entre acheteurs et vendeur car tout passe
via le secrtaire de march , encore appel commissaire-
priseur . C'est lui qui communique les prix aux agents eono-
miques; c'est lui qui les modifie en fonction des dsquilibres
constats entre offres et demandes; c'est encore lui qui orga-
nise les changes une fois l'quilibre trouv. La ncessit d'une
1. Dans la mesure o l'conomie walras sienne est une sans
monnaie, dans laquelle les marchandises s'changent contre d'autres marchan-
dises, ce sont des valeurs qui sont analyses. Pour nous conformer l'usage,
nous parlerons cependant de prix , mais le lecteur ne doit pas perdre de vue
la ralit de ce qui est analys. Walras se contente de poser l'existen d'un
numraire (se reporter au chapitre J).
63
L'EMPIRE DE LA VALEUR
telle hypothse si contraire l'intuition trouve son origine dans
la manire dont les conomistes walrassiens conoivent la
concurrence, savoir une configuration de march dans
laquelle les acteurs sont sans influence sur les prix. Dans un tel
cadre, la concurrence se donne comprendre comme un mca-
nisme purement abstrait, comme une force dsincarne, sur
laquelle personne n'a prise, un procs sans sujet )). Dans la
mesure o les prix s'imposent aux acteurs, les individus sont
dits des preneurs de priX)) (price-takers). Aucun n'est suffi-
samment important pour que son action puisse affecter le prix.
Or, si chaque agent considre les prix comme des donnes hors
de son contrle, comment se forment les prix? Qui les dter-
mine? Le secrtaire de march est la rponse apporte par la
thorie conomique noc1assique cette question essentielle.
Elle se trouve chez Lon Walras qui, en la formulant, avait en
tte l'organisation des marchs boursiers. Avec cette hypothse,
la formation des prix se donne penser comme entirement
extrieure aux individus, comme un mcanisme parfaitement
objectif.
Il s'ensuit un processus qu'on peut dcrire de la manire sui-
vante. Premire tape: les acteurs prennent connaissance des
prix cris par le secrtaire de march, savoir un prix Pi pour
chaque bien i. Deuxime tape: sur la base de cette informa-
tion, ils calculent quelles quantits de chaque bien il est optimal
pour eux de dtenir et ils communiquent le rsultat de leur
calcul au secrtaire de march. Troisime tape: partir de ces
donnes, le secrtaire de march calcule, pour chaque march,
l ~ diffrence qui existe entre l'offre et la demande. Il peut alors
constater quels marchs sont en quilibre et quels marchs sont
en dsquilibre. Lorsque offres et demandes s'galisent sur tous
les marchs, l'quilibre gnral est obtenu et le processus de
ttonnement s'arrte. Tout est alors pour le mieux. Chaque
agent est satisfait puisqu'il obtient le maximum d'utilit aux
prix considrs. En revanche, si l'offre diffre de la demande
pour certains biens, une nouvelle tape est ncessaire : le secr-
taire de march modifie les prix de ces biens en suivant ce
qu'on appelle communment la loi de l'offre et de la
64
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
demande 1 : savoir augmenter le prix sur les marchs o la
demande l'emporte sur l'offre, le diminuer dans le cas contraire.
Par exemple, lorsque la demande l'emporte sur l'offre, le secr-
taire de march accrot le prix du bien de faon en diminuer
la demande et en augmenter l'offre. Ce faisant, il peut alors
esprer se rapprocher d'une situation d'quilibre. Les nouveaux
prix ainsi forms sont alors communiqus aux agents et donnent
lieu un nouveau cycle. Ce processus d'volution des prix est
appel le ttonnement walras sien . Il se droule jusqu' ce
qu'un prix d'quilibre pour chaque marchandise soit obtenu
2
Lorsqu'il en est ainsi, on se trouve l'quilibre gnral de tous
les marchs : pour les prix indiqus, chacun est son optimum
au sens o personne ne souhaite plus modifier sa situation. Qui
plus est, les dsirs de tous les acteurs conomiques sont compa-
tibles puisqu'offres et demandes sont, pour toutes les marchan-
dises, gales. Aussi ne reste-t-il plus qu' effectuer les
changes ! Cette dernire tape passe de nouveau par la mdia-
tion du secrtaire de march qui opre la manire d'une
chambre de compensation en centralisant tous les biens offerts
et en les redistribuant aux demandeurs. Il s'ensuit que, comme
le ttonnement, les transactions ont lieu sans que les acteurs
entrent en contact.
En conclusion, dans ce formalisme, les acheteurs et vendeurs
ne se rencontrent jamais ni ne se parlent. Ce dficit de relations
sociales a t soulign avec beaucoup de force par Albert
Hirschman lorsqu'il crit: [sur de tels marchs] de nombreux
preneurs de prix anonymes, acheteurs et vendeurs disposant
d'une information parfaite, [ ... ] fonctionnent, sans qu'il y ait de
contact humain ou social, prolong, entre les individus qui ra-
lisent les changes. En concurrence parfaite, il n'existe ni mar-
chandage, ni ngociation, ni contestation ou entente, et pour
1. Se reporter Frank Hahn, Stability , in Kenneth J. Arrow et Michael
Intriligator (dir.), Handbook of Mathematical Economies, vol. II, Amsterdam,
North-Holland Publishing Company, 1982.
2. On a pu dmontrer que le ttonnement walrassien ne converge pas
ncessairement vers un quilibre gnral de l'conomie.
65
L'EMPIRE DE LA VALEUR
passer des contrats, les acteurs n'ont pas besoin d'avoir des
relations rptes ou continues entre eux, qui les amneraient,
finalement, bien se connatre 1. Cette interprtation est par-
faitement conforme au modle. Elle en souligne bien l'tran-
get : au cours du ttonnement walras sien, les acheteurs et les
vendeurs n'interagissent qu'avec le secrtaire de march. Mme
les transactions ne mettent pas en prsence les protagonistes
puisqu'ils suivent une procdure rigoureusement centralise
autour du secrtaire de march. Par ailleurs, ces transac-
tions , dj si nigmatiques, n'ont lieu qu'ex post, une fois les
prix d'quilibre dcouverts ! Elles ne font qu'entriner cette
dcouverte et n'apportent aucune information nouvelle. Elles ne
participent en rien la dtermination des prix d'quilibre. Cette
sous-estimation des changes n'est pas un accident. Elle rpond
un projet parfaitement assum. En effet, ce que recherche
Walras est la mise au jour d'un mcanisme permettant l'expres-
sion la plus fidle qui soit des prfrences des acteurs, ce qui
suppose de mettre hors jeu toutes les influences perverses qui
viendraient en perturber l'expression sincre. Pour Walras, tre
libre, c'est tre quitte de tous les autres
2
. En consquence, il
convient de neutraliser tous les canaux par lesquels transite la
dpendance l'gard d'autrui, ce qui suppose la mise l'cart
de ce que l'on peut appeler les j eux marchands. La rationa-
lit walrassienneest entirement non stratgique
3
: l'acteur
walras sien formule sa demande de marchandises, en rponse
aux prix que lui communique le secrtaire de march, sans tenir
compte des autres, comme si ces prix allaient effectivement se
raliser; autrement dit, il fait abstraction de la situation concrte
1. Cit dans Mark Granovetter, Action conomique et structure sociale:
le problme de l'encastrement , in Le March autrement. Essais de Mark
Granoveffer, Paris, Descle de Brouwer, Paris, 2000, p. 79.
2. Sur ce point, se reporter Arnaud Berthoud (<< conomie politique et
morale chez Walras , conomia, nO 9, mars 1988), et Jean-Pierre Dupuy
(<< Le signe et l'envie , in Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy (dir.),
L'Enfer des choses, Paris, Seuil, 1979).
3. Le qualificatif adquat serait paramtrique , mais il ne sera dfini que
dans la suite de ce chapitre.
66
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
du march, par exemple de l'existence de possibles ds-
quilibres. chaque fois, l'agent dlibre et se dcide comme
s'il s'agissait de la premire et dernire fois. Il n'a donc ni
mmoire, ni attente, mais seulement la conviction toujours
actuelle que chaque prix cri vaut toujours comme prix
d'change rel!.
Pour nous rsumer, il apparat que le projet walrassien ne
rpond pas uniquement une finalit descriptive, mais gale-
ment un objectif normatif en ce sens qu'il s'agit d'imaginer
une procdure respectant l'indpendance rigoureuse des acteurs
de telle sorte que le prix form offre une synthse non biaise
des choix privs. C'est au nom de la morale, crit Arnaud
Berthoud, que les changes connus dans la ralit empirique
doivent tre en quelque sorte dpouills de toute qualification
communautaire et transforms en machines s'interposant entre
les individus pour les rendre libres les uns des autres
2
Le
march s'y donne penser sous la forme d'un mcanisme
automatique, absolument neutre, qui a pour fonction d'enregis-
trer les dsirs individuels exognes, sans les transformer. En
consquence, tout effet en retour du march sur les positions
individuelles est rejet. L'ide que les interactions marchandes
puissent tre un lieu propice aux influences rciproques des uns
sur les autres, qui pseraient sur la formation des prix, est tota-
lement rejete. De tels phnomnes sont perus comme faisant
obstacle l'valuation juste, savoir une valuation qui
soit conforme la ralit des dsirs individuels. Il importe
d'carter tout effet parasite qui aurait pour origine la position
privilgie de tel ou tel acteur au moment des changes,
lorsque les prix sont ngocis. La modlisation walrassienne
pousse d'ailleurs trs loin cette exigence puisqu'elle va jusqu'
bannir toute interaction entre les participants au march ! En
consquence, toute drive que pourraient produire les
contacts entre individus au moment des changes se trouve, par
1. Arnaud Berthoud, conomie politique et morale chez Walras, art.
cit., p. 82.
2. Ibid., p. 74.
67
L'EMPIRE DE LA VALEUR
dfinition, rendue impossible, Ce faisant, le prix qui se forme
sur la base d'une telle construction institutionnelle peut pr-
tendre l'objectivit la plus totale. Il est l'expression synth-
tique du rapport entre offres et demandes, une fois qu'ont t
cartes toutes les frictions propres la vie sociale et co-
nomique. Il en rsulte que le prix walras sien est bien plus une
rgle d'valuation abstraitement construite pour respecter scru-
puleusement la libert de chacun qu'une description de ce qui
se passe rellement sur les marchs. Pour s'en persuader, il
n'est que de mesurer l'cart existant entre le prix chez Walras
et la description qu'en donne Max Weber dans conomie et
Socit: Les prix [ ... ] sont le rsultat de luttes et de compro-
mis; autrement dit, ils dcoulent de la puissance respective des
parties engages 1. Les luttes et les compromis qui forment la
substance mme des jeux marchands n'ont pas leur place dans
l'analyse mene par Walras.
Ainsi comprise, la thorie walrassienne de la valeur peut se
comparer celle des classiques. Toutes deux sous-estiment
grandement les relations d'change et leur impact sur la ralit
conomique. On se souvient que les classiques voyaient dans la
valeur, non pas le concept permettant de penser le prix imm-
diat tel que les forces du march le faonnent tout instant,
mais bien la norme sous-jacente qui en rgle l'volution long
terme. L'analyse que propose Walras est d'une mme nature:
son prix d'quilibre a galement la nature d'une norme. Le
modle walrassien ne cherche nullement dcrire la concur-
rence telle qu'elle est mais bien plutt en reconstruire le
concept adquat telle qu'elle devrait tre. Ce qui intresse
Walras dans la concurrence, c'est son aptitude fonder un ordre
juste, c'est--dire proposer un mcanisme qui laisse chacun
libre de tous les autres. A contrario, les relations stratgiques ne
l'intressent pas, ni les rapports de force, qui se trouvent exclus
de son analyse parce que Walras poursuit une finalit autre que
descriptive. Le rsultat est assurment d'une grande force.
1. Max Weber, conomie et Socit, tome 1 : Les Catgories de la socio-
logie, Paris, Plon, Pocket, 1995, p. 158.
68
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
Comme l'crit Berthoud: L'conomie Politique Pure est
l'laboration analytique d'un modle de justice. Le march
gnral est un moyen de prserver la libert individuelle 1.
Cette dimension normative ne devrait pas nous tonner. Elle est
une consquence ncessaire du projet que se donnent toutes les
thories de la valeur: non pas penser le prix mais penser ce qui
est derrire le prix, ce qui fonde le prix, savoir la valeur
substance. Le fait de considrer une conomie sans monnaie
illustre pleinement jusqu'o cette exigence est pousse: elle
vise construire un point de vue en surplomb permettant
d'apprhender les changes de l'extrieur, partir de l'explici-
tation de ce qui en constitue le principe.
Cette reprsentation walrassienne du march concurrentiel
a t critique par plusieurs conomistes
2
qui lui reprochent
son extrme centralisation alors mme que le march est pr-
sent d'ordinaire comme l'archtype d'une structure sociale
dcentralise. Il n'en reste pas moins qu'elle demeure jusqu'
aujourd'hui le modle de rfrence, celui qu'on trouve dans
tous les manuels de microconomie. Il en est ainsi essentiel-
lement parce que aucune modlisation alternative ne s'est
impose, malgr de nombreuses tentatives
3
En effet, ds lors
qu'on dfinit la concurrence comme une configuration de
march compose uniquement d'agents preneurs de prix, on
est conduit ncessairement faire reposer le mcanisme des
prix dans les mains d'un agent extrieur, ce qui dbouche sur
un systme d'changes peu ou prou centralis. Notons cepen-
dant que la centralisation n'est pas la seule faiblesse de ce
1. Arnaud Berthoud, conomie politique et morale chez Walras , art.
cit., p. 65.
2. Voir Bernard Guerrien, La Thorie noclassique, tome 1: Microcono-
mie, op. cit., Franklin M. Fisher, Disequilibrium Foundations of Equilibrium
Economies, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, et Alan Kirrnan,
General Equilibrium , in Paul Bourgine et Jean-Pierre Nadal (dir.), Cogni-
tive Economies. An Interdisciplinary Approach, Berlin-Heidelberg-New York,
Springer-Verlag, 2004.
3. Voir les processus de non-ttonnement chez Frank Hahn (<< Stability ,
art. cit.) et Franklin M. Fisher (Disequilibrium Foundations of Equilibrium
Economies, op. cit).
69
L'EMPIRE DE LA VALEUR
modle. Il en est au moins deux autres. D'une part, le tton-
nement walras sien, en la personne du secrtaire de march,
suppose la prsence d'un individu compltement bnvole
[ ... ] qui assume de lourdes tches de coordination sans exiger
la moindre rmunration. L'gosme absolu de tous ne peut
donner un bon rsultat que s'il existe au moins un altruiste
absolu 1 )). C'est l un manquement manifeste aux rgles l-
mentaires de l'individualisme mthodologique. Par ailleurs,
toutes les analyses empiriques montrent a contrario l'impor-
tance des cots associs l'organisation d'un march centra-
lis. La seconde faiblesse de ce modle porte sur une question
beaucoup plus importante, savoir l'aptitude suppose de la
flexibilit concurrentielle des prix permettre la dcouverte
de l'quilibre.
Ce qu'ont dmontr les thoriciens noclassiques des annes
1950 est qu'il existe toujours au moins un quilibre gnral,
savoir une configuration dans laquelle les n marchs de biens
sont simultanment en quilibre, ds lors que les hypothses de
convexit des choix sont satisfaites. Ce faisant, ils ont rsolu ce
qu'on nomme la question de l'existence)} de l'quilibre gn-
ral. Quand celui-ci prvaut, chaque individu peut acqurir le
panier qu'il dsire, celui qui maximise ses prfrences, aux prix
considrs. Autrement dit, l'quilibre gnral, tous les consom-
mateurs sont parfaitement satisfaits. En consquence, aucune
force ne pousse sa transformation ou son volution
2
Cet tat
conomique va perdurer, raison pour laquelle le terme d'qui-
libre est pertinent. Cependant, tre capable de dire que telle
configuration de prix est un quilibre ne nous dit absolument
1. Bernard Guerrien, La Thorie noclassique, tome 1 : Microconomie,
op. cit., p. 45-46.
2. N'oublions pas cependant qu'on se situe dans un cadre thorique qui
suppose que les prix chappent aux individus. Ceux-ci sont des preneurs de
prix. En consquence, ils se contentent de juger, compte tenu des prix tels
qu'ils sont fixs par le secrtaire de march, si le panier de biens obtenu leur
convient. Dans un tel cadre d'analyse, les agents ne peuvent juger des prix
eux-mmes puisqu'ils ne relvent pas de leur choix. Ils leur sont imposs par
la concurrence, personnifie par le secrtaire de march.
70
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
rien quant la manire de l'obtenir. Il ne faut pas confondre la
question de l'existence de l'quilibre gnral et la question
des processus qui permettent de l'obtenir, qu'on nomme tradi-
tionnellement la question de la stabilit de l'quilibre gn-
ral. Ce sont deux questions tout fait distinctes. Si on a pu
dmontrer qu'il existe un vecteur de prix rendant les dsirs de
chacun compatibles, le processus conomique permettant de le
faire connatre n'a nullement t spcifi. Le ttonnement wal-
rassien a t propos par la thorie noclassique pour rpondre
cette nouvelle question dite de la stabilit . Il s'agit d'intro-
duire des prix flexibles, ragissant aux dsquilibres existant sur
les marchs, aux fins d'examiner si cette flexibilit permet de
rduire ces dsquilibres jusqu' conduire l'conomie une
situation d'quilibre. On comprend aisment l'importance de
cette dmonstration. quoi servirait d'avoir prouv qu'existe
toujours un quilibre gnral si on ne montre pas que cet qui-
libre peut tre atteint? Qui plus est, lorsque l'opinion librale
dfend les conomies de march, elle le fait, le plus souvent, en
mettant en avant les proprits rgulatrices de la concurrence,
par exemple lorsqu'elle soutient que la flexibilit des prix per-
met de rsorber les dsquilibres . Cette efficacit suppose de
la concurrence est au fondement des politiques dites de drgu-
lation. Or les thormes d'existence, eux seuls, ne permettent
en rien d'affirmer une telle proposition. Ils disent simplement
qu'il existe des prix tels que tous les marchs sont l'quilibre.
Pour faire plus, il convient d'examiner comment l'conomie se
comporte hors de l'quilibre, de faon prouver qu'elle y revient
ncessairement sous l'action des forces concurrentielles. Telle
est la question de la stabilit. Les conomistes l'ont aborde en
supposant que le ttonnement walras sien constituait une approxi-
mation acceptable de la dynamique des prix hors quilibre. Or le
rsultat obtenu est trs perturbant. En effet, il a t dmontr que
le ttonnement walras sien ne converge pas ncessairement vers
l'quilibre gnral. Autrement dit, l'ide selon laquelle tout
dsquilibre peut tre rsorb grce un ajustement suffisam-
ment rapide des prix se rvle tre fausse. En consquence, il
faut admettre que les conomistes n'ont pas dmontr qu'en
71
L'EMPIRE DE LA VALEUR
toute gnralit 1 la concurrence pennet une coordination efficace
des acteurs conomiques. C'est l un grave manque dans l'di-
fice noclassique, pour dire le moins. La proposition la plus
troitement associe la position librale, savoir que la concur-
rence conduit l'conomie vers une situation d'quilibre, est
inexacte si l'on considre le ttonnement walras sien comme une
bonne description du comportement des prix hors quilibre. En
consquence, l'difice noclassique a, dans ses fondations, une
grave dficience.
Soulignons que cette critique porte spcifiquement sur l'apti-
tude de la concurrence ramener l'quilibre simultanment sur
tous les marchs. C'est la question de l'quilibre gnral et de son
obtention qui est alors pose. Pour autant, cette analyse ne remet
pas en cause les capacits rgulatrices de la concurrence dans le
cadre d'un march isol. En effet, on peut dmontrer que le tton-
nement walras sien appliqu un march unique fonctionne
confonnment la thse librale ds lors que les hypothses
noclassiques sont satisfaites: le prix du bien retourne ncessai-
rement son niveau d'quilibre. Lorsqu'on passe d'un march
unique l'quilibre gnral, ce rsultat se transfonne parce que
s'introduisent un trs grand nombre de nouvelles interdpen-
dances, en particulier via la fonnation des revenus, dont la
logique n'a aucune raison a priori d'aller dans le sens d'une
rduction des dsquilibres. Pour cette raison, la stabilit de
l'quilibre gnral et la stabilit de l'quilibre partiel sont deux
questions distinctes.
L'hypothse mimtique
Mme si elle a ses faiblesses et mme si elle demande tre
amliore, l'analyse que propose l'quilibre gnral n'a pas
1. Il est possible de dmontrer que le ttonnement walrassien converge
vers l'quilibre pour des conomies spcifiques, par exemple s'il y a substi-
tuabilit brute de tous les biens. Voir Bernard Guerrien; La Thorie noc/as-
sique. tome 1 : Microconomie, op. cit.
72
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
tre rejete. Sans conteste, elle dcrit un aspect important des
conomies marchandes: la mdiation par les objets dans le
cadre d'une relation au monde strictement utilitaire. Cela
exprime assurment une part de la vrit des conomies dve-
loppes. Elle nous fait comprendre ce qu'est la sparation mar-
chande : une indpendance de chacun l'gard de tous mdie
par les objets et la concurrence. Cependant, d'autres aspects ont
totalement t laisss de ct, et qui ne sont pas moins impor-
tants. Parce que cette thorie surestime l'autonomie des indivi-
dus, savoir leur capacit exister indpendamment du regard
des autres, elle manque quelque chose de l'pret des relations
conomiques. L'exemple du consommateur est emblmatique
de cette vision rductrice des choses. Il nous donne voir un
individu sachant parfaitement ce qu'il veut. Le lecteur familier
des travaux de Ren Girard ne peut manquer de reconnatre
dans cette thorie du consommateur une conception bien parti-
culire du dsir humain, savoir une configuration dans
laquelle l'individu est suppos matre absolu de ses dsirs,
capable d'lire, de par sa seule rsolution, dans la masse indif-
frencie des objets environnants ceux qu'il juge dignes d'tre
aims. C'est bien ce mme dsir vcu sur le mode de la plni-
tude et de la transparence qu'on retrouve dans la thorie du
consommateur
l
. Le consommateur noc1assique sait avec certi-
tude ce qu'il veut, et sa matrise est telle que les autres sont sans
influence sur ses ,choix. Son autonomie de dcision est perue
comme complte. Il est important de souligner que cette hypo-
thse d'un individu souverain sur sa propre personne, sur ses
actions et sur sa propre proprit
2
est un trait qui va bien au-
del du seul consommateur. Il est constitutif de l'individualisme
libral en gnral. Il ne faut donc pas tre trop tonn de retrou-
ver cette mme conception dans la pense noc1assique. L'ide
de souverainet de l'individu conduit une vision extrme de la
1. Parce qu'il a la littrature pour objet d'tude, Ren Girard nomme cette
conception, errone ses yeux, le mensonge romantique .
2. Murray Rothbard, Man, Economy, and State, Auburn, Alabama, Ludwig
von Mises Institute, 2004, hapitre X Monopoly and Competition .
73
L'EMPIRE DE LA VALEUR
sparation marchande en ce que chacun y est peru, non seule-
ment comme juridiquement autonome en tant que propritaire
de ses biens, mais galement intrieurement indiffrent aux
autres.
Ren Girard oppose cette conception une critique radicale
de la souverainet individuelle en matire de dsirl. Selon lui,
l'individu ne sait pas ce qu'il dsire. Il n'est pas matre de ses
attirances. Ses prfrences sont fluctuantes et indtermines:
l'individu souffre d'une infirmit du dsir qui le pousse
chercher en autrui les rfrences qu'il ne russit pas se don-
ner lui-mme par un acte de pure souverainet intrieure.
Pour ce faire, il recourt l'imitation d'un modle. Aussi, la
critique suivante que Ren Girard adresse la psychanalyse
freudienne s'appliquerait-elle tout aussi bien la thorie co-
nomique:
En nous montrant en l'homme un tre qui sait parfaitement ce
qu'il dsire, [ ... ] les thoriciens modernes ont peut-tre manqu
le domaine o l'incertitude humaine est la plus flagrante. Une
fois que les besoins primordiaux sont satisfaits, et parfois mme
avant, l'homme dsire intensment, mais il ne sait pas exacte-
ment quoi, car c'est l'tre qu'il dsire, un tre dont il se sent
priv et dont quelqu'un d'autre lui parat pourvu. Le sujet attend
de cet autre qu'il lui dise ce qu'il faut dsirer, pour acqurir cet
tre
2
partir de cette hypothse d'une nature mimtique du dsir,
il est possible de distinguer deux logiques d'interaction: la
mdiation externe et la mdiation interne . La variable
dcisive pour rendre compte de cette dualit des rgimes du
dsir imitatif est la distance existant entre le sujet et son modle.
Lorsque la distance entre les deux est si grande qu'elle interdit
toute interaction entre le sujet et son modle autre que l'imita-
tion unilatrale du second par le premier, on est en prsence de
ce qu'on appellera la mdiation externe . Dans cette configu-
1. Il la nomme vrit romanesque parce qu'on la trouve dans les
grands romans.
2. Ren Girard, La Violence et le Sacr, Paris, Grasset, 1972, p. 204-205.
74
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
ration, le modle esf en surplomb et son dsir est indpendant
de celui du sujet. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le modle
volue dans un monde social diffrent de celui du sujetl. Dans
le cadre d'une telle configuration, l'interaction imitative est des
plus sommaires: l'imitateur se contente de suivre le modle.
Cette situation est formellement analogue celle que dcrit la
thorie du consommateur dans la mesure o les prfrences du
sujet y apparaissent comme exognes et fixes. Il en est ainsi,
non pas parce que le sujet est souverain, mais parce que ses pr-
frences procdent d'un modle en surplomb, extrieur aux
interactions marchandes. Il s'ensuit que l'existence d'une fonc-
tion d'utilit exogne peut s'interprter selon deux perspectives
distinctes : soit comme la consquence de prfrences naturelles
stables (hypothse de souverainet du sujet) ; soit comme la
consquence d'une imitation portant sur un modle en position
de mdiateur externe (hypothse mimtique). Outre que cette
deuxime interprtation nous parat plus conforme aux faits, son
intrt vient de ce qu'elle indique clairement que l'utilit elle-
mme n'est en rien une donne naturelle, intrinsque l'objet.
La valeur d'usage comme la valeur d'change sont un produit
de la socit. Parce qu'elle met en avant l'existence d'un pro-
cessus d'apprentissage conduit sous l'autorit d'un ou plusieurs
modles, la mdiation externe offre des outils permettant d'ana-
lyser cette ralit. Elle ne se contente pas de constater les prf-
rences pour ce qu'elles sont; elle ouvre des pistes permettant de
comprendre comment elles se forment et voluent. Dans un
monde marchand o la qualit des biens est en perptuelle
mutation, cet intrt n'est pas ngligeable.
Cependant, si le profit attendre de l 'hypothse mimtique se
rsumait cette rinterprtation de l'hypothse d'exognit des
prfrences, l'intrt de son introduction resterait limit. En fait,
la mdiation externe ne constitue qu'un rgime possible du
dsir imitatif. Il s'agit mme d'un rgime plutt exceptionnel
dans la mesure o, le plus souvent, le sujet et le modle partagent
1. Ren Girard prend comme exemple don Quichotte ayant pour modle
Amadis de Gaule qui est un personnage de fiction.
75
L'EMPIRE DE LA VALEUR
un mme monde et interagissent. Ces interactions peuvent alors
devenir complexes dans la mesure o le modle imit par un
individu est lui-mme un sujet qui imite un autre modle. Cette
proximit entre sujets et modles modifie radicalement la dyna-
mique des prfrences : parce que les dsirs des individus
s'influencent les uns les autres, les prfrences cessent d'tre
exognes. Nous nommerons ce nouveau rgime mimtique: la
mdiation interne . Dans une telle configuration, les prf-
rences de i dpendent dsormais de celles de j qui sont elles-
mmes conditionnes par celles de k, selon une chane de liens plus
ou moins longue, plus ou moins stable, pouvant faire retour sur
l'individu i lui-mme. En consquence, la mdiation interne ouvre
un large champ de possibilits, en fonction de la nature des liens
mimtiques existant au sein de l'conomie, si large qu'il ne sau-
rait, dans le cadre de ce livre, faire l'objet d'une prsentation sys-
tmatique. Il est cependant possible d'en saisir la porte gnrale.
Pour ce faire, il importe d'abord de rappeler que la fixit des
prfrences n'est en rien une hypothse secondaire pour le
modle walrassien. Tout au contraire, son rle est crucial parce
que la fixit des prfrences, allie leur convexit et la sta-
bilit des relations techniques, construit une structure de liens
objectifs qui contraint le prix, en cas de chocs, retourner son
niveau d'quilibre, L'objectivit des prfrences fait obstacle
la drive des prix. C'est trs prcisment ce que la thorie de la
valeur noclassique explicite. Si, par exemple, le prix d'un bien
A augmente temporairement au-dessus de sa valeur d'quilibre,
toutes choses gales par ailleurs, les consommateurs vont alors
se reporter sur les marchandises substituables devenues moins
chres relativement au bien AI. Il s'ensuit une baisse de la
demande du bien A qui va ramener son prix sa valeur d'qui-
libre. C'est ce mcanisme qu'on appelle traditionnellement la
loi de l'offre et de la demande . Cette loi est au cur de la
conception librale. La possibilit d'une rgulation marchande
1. Techniquement, il s'agit de comparer le prix relatif de A par rapport
B au rapport des utilits marginales, encore appel taux marginal de substi-
tution entre A et B .
76
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
sans intervention extrieure, par le seul jeu des intrts privs, y
trouve son fondement. Or, une des conditions pour que cette
autorgulation concurrentielle fonctionne est que les appr-
ciations subjectives restent fixes!, conformment l'hypothse
de souverainet de l'individu libral rinterprte dans le cadre
de la mdiation externe. Cette fixit est l'origine des forces de
rappel qui ramnent le prix l'quilibre. Si a contrario l'aug-
mentation du prix du bien A affectait les prfrences des agents,
en intensifiant leur got pour A, il en irait tout fait autrement.
On se trouverait alors projet dans un univers conceptuel trs
diffrent dans lequel le rle stabilisateur de la concurrence par
les prix serait remis en cause
2
En effet, dans ces conditions, la
loi de l'offre et de la demande n'est plus valide: l'augmen-
tation du prix, loin de faire dcrotre la demande, la rend plus
forte, ce qui conduit une nouvelle augmentation du prix, l'loi-
gnant encore plus de son niveau d'quilibre. En consquence se
met en branle une dynamique perverse du prix et de la demande
qui, si elle n'est pas stoppe temps, peut mettre en danger la
totalit du systme conomique. On mesure, dans ces condi-
tions, quel point la question de la fixit des prfrences est
stratgique. Ce n'est rien de moins que l'aptitude de la concur-
rence stabiliser l'conomie qui se trouve remise en question, et
donc le rsultat qui est la base mme de l'difice noclassique.
Pour bien comprendre ce qui est en jeu ici, commenons par
nous demander quelles conditions une augmentation du prix
peut provoquer une augmentation de la demande. Comment un
tel phnomne est-il possible? Lorsque le prix d'un bien
s'accrot, l'individu rationnel n'est-il pas ncessairement
conduit l'abandonner pour des produits moins onreux? Cela
est vrai, toutes choses gales par ailleurs, si ses prfrences
sont fixes et convexes. Si on introduit des comportements
1. Sans entrer dans des dtails techniques, la fixit dont il est question ici
porte sur la/onction d'utilit. Dire que la fonction est fixe signifie qu'elle est
indpendante du comportement des autres.
2. Notons, pour mmoire, que mme dans le cas classique la stabilit n'est
pas toujours obtenue.
77
L'EMPIRE DE LA VALEUR
mimtiques, il en va tout autrement: l'augmentation du prix, dans
la mesure o elle traduit un accroissement du dsir des autres
l'gard du bien considr, peut provoquer, chez le sujet imitatif,
une intensification de son propre dsir. Une premire illustra-
tion d'un tel mcanisme nous est donne par les biens qui sont
soumis aux influences de la mode. Il apparat alors que l' attrac-
tion qu'exercent ces biens, au moins dans une premire phase
du mcanisme
l
, s'accrot avec le nombre d'acheteurs. Plus le
produit est rpandu, plus il est la mode , plus son acquisi-
tion est souhaite. Comme l'accroissement du nombre d'ache-
teurs va de pair avec une augmentation du prix, on constate un
lien positif entre demande et prix. Ce phnomne diffre fonda-
mentalement du modle noc1assique par le fait que l'objet est
convoit, non pour lui-mme, mais en tant qu'il est dsir par
les autres, pour son prestige. Ce faisant, la logique mimtique
donne voir un mode de relation l'objet radicalement dif-
frent du rapport utilitaire. Certes, il est toujours possible de
dcrire le comportement des acteurs dans une telle situation
comme tant motiv par l'utilit du bien, mais condition de
prciser que l'utilit en question n'est plus fixe mais dpend
positivement du nombre des acheteurs. Le recours au mme
terme ne doit pas masquer l'cart existant entre un bien dont
l'utilit est intrinsque, dtermine sur la base du seul rapport
de l'individu l'objet, et un bien dont l'utilit est fonction du
comportement des autres. Ce sont l deux structures aux pro-
prits divergentes qui doivent tre distingues.
titre d'illustration, considrons les biens ou les techniques
dont le rendement est d'autant plus grand que le nombre de per-
sonnes qui les ont adopts est grand. Les conomistes parlent de
rendements croissants d'adoption
2
. Cette croissance du ren-
dement a des sources multiples, par exemple : une plus large
diffusion rend la technique plus attractive parce qu'elle rend
plus aise la communication avec le reste du groupe; ou bien
encore : la gnralisation de son adoption favorise la production
1. Lorsqu'un tel bien est trop rpandu, il cesse d'tre la mode.
2. En anglais: increasing returns to adoption,
78
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
de nouveaux usages qui accroissent grandement l'intrt de la
technique 1. Brian Arthur, le spcialiste de ces questions, nous
propose pour illustrer ces points l'exemple de la technologie
VHS. Il crit: Plus le nombre d'usagers est grand, plus il est
probable que le nouvel acqureur de VHS bnficiera d'une
plus grande disponibilit et d'une plus grande varit de pro-
duits enregistrs sous VHS
2
Pour ces raisons, ces techniques
rendement croissant nous offrent une illustration exemplaire
de produits dont l'utilit est croissante avec le nombre d'acqu-
reurs. Les analyser va nous permettre d'valuer quel point
l'abandon de l'hypothse de convexit modifie l'analyse wal-
ras sienne. Pour ce faire, considrons ce qui se passe lorsque de
telles techniques sont mises en concurrence.
Les rsultats mis en avant par Brian Arthur sont impression-
nants. Ils donnent voir une dynamique en tout point oppose
celle que construit la loi de l'offre et de la demande. Pour aller
l'essentiel, dans le cas standard, lorsqu'un choc fait dvier le
march de sa position d'quilibre, mergent des forces de rappel
qui vont dans le sens contraire du choc, ce qu'on appelle des
rtroactions ngatives (negative feedbacks). Autrement dit,
comme on l'a dj soulign, la concurrence est stabilisante: elle
fait obstacle la drive des prix. Si le choc a propuls le prix
au-dessus de son niveau d'quilibre, la demande diminue et
l'offre augmente, ce qui pousse le prix la baisse. On dit que le
systme rtroagit ngativement; ce qui signifie qu'il s'oppose
au choc. Dans le cas analys par Brian Arthur, les rtroactions
sont, l'inverse, positives (positive feedbacks) : loin de faire
obstacle au choc, les forces que la concurrence libre accentuent
encore l'cart initial. Elles poussent dans le sens d'une drive
encore plus grande. Pour le voir, supposons que la situation
initiale donne un petit avantage la technique A au dtriment de
1. Pensons aux nombreuses applications qui multiplient l'intrt d'un ordi-
nateur ou d'un iPhone.
2. Arthur W. Brian, Competing Technologies: An Overview , in Gio-
vanni Dosi, Christopher Freeman, Richard Nelson, Gerarld Silverberg et Luc
Soete (dir.), Technical Change and Economic Theory, Londres, Pinter
Publishers, 1988, p. 591.
79
L'EMPIRE DE LA VALEUR
la technique B. Ce petit avantage va alors attirer de nouveaux
acheteurs qui auront pour effet d'accrotre encore le rendement
de la technique A, puisque celui-ci est une fonction croissante
du nombre des acqureurs, de telle sorte que l'avantage initial,
loin d'tre rsorb, se trouve accentu par l'effet de la concur-
rence. On est donc face une dynamique cumulative, typique du
mimtisme: plus grande est l'attirance que le produit exerce,
plus grand est le nombre d'acheteurs, plus forte est l'intensit du
dsir de l'acqurir, plus sa diffusion progresse. Une telle situa-
tion peut conduire des phnomnes d'unanimit et de blocage
(lock-in) sur une seule technique: chacun imitant le choix majo-
ritaire, les dcisions individuelles de l'ensemble des membres
du groupe finissent par converger vers un mme choix. Le sys-
tme se trouve alors bloqu mais stable. Arthur montre qu'il
peut exister plusieurs quilibres de cette sorte: la technique col-
lectivement lue peut tre n'importe laquelle des techniques en
comptition. Elle est indtermine. Pour nous faire comprendre,
prenons l'exemple hypothtique du choix d'une langue.
La langue est typiquement un produit qui prsente des
rendements croissants d'adoption: plus il y a d'individus dans
le groupe qui parlent la langue X, plus il est intressant, pour
n'importe quel membre de ce groupe, de choisir cette mme
langue puisqu'elle lui permettra plus aisment de se faire com-
prendre. Supposons que le groupe ait choisir entre la langue X
et la langue Y, que se passera-t-il? Si nous prenons la situation
o la moiti du groupe parle X et l'autre moiti Y, il est clair
que les deux langues ont la mme utilit, savoir que toutes
deux permettent de communiquer avec la moiti du groupe.
Aucune des langues ne fait mieux que l'autre. Cependant une
telle configuration ne saurait perdurer en raison des rtroactions
positives. En effet, ds lors que survient le plus lger choc en
faveur d'une des deux langues, ce choc va rendre cette langue
plus performante que l'autre par le fait qu'elle permet de com-
muniquer avec plus de la moiti du groupe 1. En consquence,
les membres du groupe qui avaient choisi l'autre langue sont
1. Mathmatiquement, on dit que l'quilibre est instable. C'est le cas d'une
80
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
dfavoriss puisque leur aptitude communiquer est moindre
que celle des autres. Ils seront alors conduits modifier leur
choix et suivre l'opinion en faveur de la langue dominante. Du
fait des rtroactions positives, ce processus imitatif continuera
jusqu' ce que tout le groupe ait converg sur une mme langue.
Notons que cette convergence mimtique peut se faire aussi
bien sur la langue X que sur la langue Y. Ces deux situations
d'unanimit sont toutes deux des quilibres. Lorsque tout le
groupe a choisi une langue, l'irruption d'un petit groupe parlant
l'autre langue ne remet pas en question l'quilibre existant
parce que la capacit communiquer de ce petit groupe est
extrmement restreinte. Si ce groupe reprsente, par exemple,
1 % de la population, ses membres ne peuvent communiquer
qu'une fois sur cent, alors que les autres locuteurs communiquent
quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent '.
Notons cette occasion un nouveau rsultat important. Sup-
posons que les deux langues en comptition n'aient pas la
mme capacit intrinsque communiquer. Supposons que la
langue X soit plus concise et plus prcise, de telle sorte que,
pour le mme temps et le mme effort, elle vhicule plus
d'informations que la langue Y. Dans ces conditions, l'quilibre
sur la langue Y ne va-t-il pas disparatre? Ne risque-t-il pas
d'tre dtruit ds lors que les membres du groupe prennent
conscience qu'une langue plus performante est disponible? Il
n'en est rien. En effet, un individu qui comprend que la
langue X est plus efficace que la langue Y n'aura nanmoins
aucune incitation en changer ds lors que la langue X n'est
pyramide pose sur son sommet. Le moindre souffle de vent suffit la faire
tomber.
l. Il en est ainsi parce qu'on suppose que les individus se rencontrent au
hasard. Comme ils sont perdus dans la masse, du fait de l'ala des rencontres,
ils ne sont mis en contact avec quelqu'un ayant choisi la mme langue que trs
rarement. Il en serait diffremment si les membres du petit groupe dcidaient de
ne parler qu'entre eux. Pour une prsentation complte, se reporter Robert
Boyer et Andr Orlan (How do Conventions Evolve ? , Journal of Evolutio-
nary Economies, vol. 2, 1992, et Persistance et changement des conven-
tions , in Andr Orlan (dir.), Analyse conomique des conventions, Paris,
PUF,1994).
81
L'EMPIRE DE LA VALEUR
parle que par un nombre trs restreint d'individus. En effet,
quoi bon choisir une langue performante si personne ne la pra-
tique? Il est rationnel pour lui de conserver le choix majoritaire
qui lui apporte une utilit bien plus grande. Il en irait diffrem-
ment si une proportion importante d'individus dcidait collecti-
vement de changer de langue. Mais une telle dcision collective
ne peut se produire si, comme c'est notre cas, les individus sont
supposs spars et prendre leur dcision de manire indpen-
dante, sans contact avec les autres, sur la base de leur seul int-
rt priv. Un changement coordonn requerrait imprativement
une organisation collective, centralise, de grande ampleur
l
. En
conclusion, lorsque l'hypothse de convexit est abandonne,
l'quilibre obtenu ne correspond plus ncessairement un usage
efficace des ressources disponibles.
Pour illustrer ce phnomne, Paul David a propos l'exemple
du clavier QWERTY qui est l'homologue de notre clavier
AZERTY pour la langue anglaise. Il observe que ce clavier ne
propose nullement une combinaison performante des lettres de
l'alphabet. Par exemple, il est largement surpass, en termes de
vitesse de frappe, par le clavier DSK (Dvorak Simplified Key-
boarcf). Pourtant, malgr cette inefficacit vidente, il demeure
la convention dominante en la matire. L'analyse prcdente
permet d'expliquer cette situation: c'est une consquence des
rtroactions positives. Il n'est dans l'intrt de personne de pro-
mouvoir un clavier plus performant tant que le groupe des adop-
teurs est trop faible. Qui achterait aujourd'hui un clavier
DSK? En consquence, la convention QWERTY perdure mal-
gr ses carences. Cet exemple est galement illustratif du rle
que jouent les petits vnements dans la dtermination du rsul-
tat final. En effet, la disposition des lettres que propose le cla-
1. Notons que, mme dans ce cas, il n'est pas facile de changer une
convention. Pensons au passage au systme mtrique pour les Anglais.
2. Ce rsultat a depuis fait l'objet de nombreux dbats. Se reporter au
numro spcial Les claviers de la revue Rseaux qui leur est consacr
(nO 87, janvier-fvrier 1998). Pour une synthse, voir Histoire conomique. La
rvolution industrielle et l'essor du capitalisme, de Jean-Yves Grenier (palai-
seau, ditions de l'cole polytechnique, 2010).
82
L'OBJECTIVITE MARCHANDE
vier QWER TY trouve son origine dans une priptie fort
ancienne, lie certaines difficults trs particulires, propres
la technologie utilise pour les premires machines crire,
aujourd'hui parfaitement obsolte et totalement oublie. Le
problme alors rencontr venait du fait que les tiges porte-
caractres se coinaient quand on les utilisait de faon rap-
proche. La solution a t de choisir un ordre des lettres sur le
clavier qui loigne celles qui sont le plus frquemment utilises.
L'objectif n'tait donc pas de maximiser la vitesse de frappe
mais au contraire de la ralentir. Son inventeur, Christopher
Sholes, ayant pris conscience que ce clavier produisait un
ralentissement de la vitesse de frappe, avait d'ailleurs voulu le
modifier. Cependant, Remington, le premier industriel com-
mercialiser la machine crire, satisfait de ses ventes, n'a rien
voulu savoir. Une fois habitu au standard, personne n'a sou-
hait en changer. Aussi a-t-il t conserv jusqu' aujourd'hui,
malgr son inefficacit. Il est possible de montrer que cette
influence des petits vnements est tout fait gnrale. Autre-
ment dit, lorsqu'on est en prsence de rtroactions positives,
l 'histoire du processus influe sur le rsultat final. Les cono-
mistes, pour qualifier ce phnomne, parlent d'une dpen-
dance par rapport au chemin (path-dependency). Quand le
systme dpend du chemin , cela signifie qu'il ne suffit pas
de connatre son point de dpart et les facteurs qui dterminent
objectivement le niveau des rendements pour tre capable d'en
infrer avec certitude le point de convergence. De petits chocs
dus au hasard, sans aucune pertinence au regard des donnes
fondamentales du problme, sont capables d'orienter la dyna-
mique long terme en favorisant la slection d'un quilibre sp-
cifique. Typiquement, l'conomie des grandeurs ne fonctionne
plus. Il ne suffit pas de connatre les rendements des options
pour savoir celle qui va l'emporter. Pour le comprendre, il faut
lui substituer une conomie base sur les relations, qui s'int-
resse aux rencontres entre acteurs et aux hasards qu'elles ont
produits.
L'ensemble de ces proprits (unanimit, multiplicit des
quilibres, indtermination, inefficacit, dpendance par rapport
83
L'EMPIRE DE LA VALEUR
au chemin, non-prdictibilit) dmontre l'vidence quel
point la concurrence mimtique est loigne de la concurrence
walrassienne. Ce rsultat n'est pas une dcouverte. Depuis
Arrow et Debreu, les conomistes savent que, en prsence de
rendements croissants, les proprits walrassiennes ne sont plus
valides. Pour que celles-ci soient pertinentes, l'utilit indivi-
duelle ne doit pas dpendre des choix des autres. Dans le jargon
des conomistes, on dit qu'il ne doit pas y avoir d'extemalits 1.
Autrement dit, la marchandise ne joue pleinement son rle wal-
rassien qu'en tant qu'elle est une mdiation parfaite entre les
acteurs, savoir un tiers qui absorbe toutes les relations directes
sans laisser de reste: lorsque l'individu estime l'objet mar-
chand, seuls comptent l'utilit subj ective prouve par l'acteur
et le prix propos par le secrtaire de march, les autres acteurs
sont sans importance
2
Toute notre analyse rejoint la pense
walrassienne pour souligner combien une telle mdiation est
cruciale. Elle est au fondement de la rgulation concurrentielle.
Elle tire sa force du fait qu'elle supprime les comparaisons
interpersonnelles directes. Ce faisant, elle permet de rompre
avec les emballements mimtiques. Elle transforme une logique
instable, feedbacks positifs, en une logique autorgulatrice,
feedbacks ngatifs
3
Cependant, notre point de vue diffre de
l'analyse noc1assique par le fait que les individus n'y sont pas
considrs comme tant souverains par nature. La souverai-
net n'est que le rsultat transitoire d'une structuration spci-
fique des interactions mimtiques lorsqu'elles se polarisent sur
un modle extrieur aux acteurs. Autrement dit, l'individu-en-
relation-aux-objets, tel que la thorie de la valeur noclassique
1. On nomme externalits les situations dans lesquelles l'utilit d'un
individu dpend directement de l'action des autres.
2. Cette forme particulire de rationalit, dite paramtrique , sera pr-
sente et tudie dans la section suivante, consacre aux asymtries d'infor-
mation.
3. Rappelons, comme nous l'avons dj indiqu, que la question de la sta-
bilit n'a pas t entirement rsolue par la pense noclassique. Autrement
dit, il n'a pas t dmontr, en toute gnralit, que la flexibilit concurren-
tielle des prix conduisait ncessairement l'quilibre, mme lorsque prdo-
mine la mdiation externe.
84
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
le donne voir avec ses prfrences exognes, ne constitue pas
la forme lmentaire, indpassable, de la rationalit conomique
individuelle. Ce modle dcrit un rgime particulier du rapport
mimtique, que nous avons nomm mdiation externe , qui
s'impose lorsque le rapport aux objets s'est structur autour de
prfrences stabilises, c'est--dire lorsque les buts sociaux
poursuivre ont t fixs sous la forme d'une liste de biens dsi-
rables. Il ne s'agit nullement d'en nier la pertinence, tout au
contraire. Il s'agit plutt de se demander quelles conditions la
mdiation externe merge comme forme possible du lien cono-
mique.
Lorsque les prfrences ne sont pas stabilises, le dsir pour
les objets devient fluctuant, en fonction de la position de chacun
l'gard des autres. L'affect individuel n'est plus capt par un
modle en surplomb. En consquence, le mimtisme cesse
d'tre routinier, rptitif, pour devenir stratgique. Chacun, la
recherche du bon modle, anxieux de dcouvrir quelles sont les
clefs de la plnitude, se tourne vers les autres et scrute leur com-
portement. Alors que le monde noclassique est un monde o la
valeur des choses est fixe, dans le monde de la mdiation
interne, la valeur devient fondamentalement incertaine, diff-
rents points de vue s'opposant quant sa dtermination exacte.
Les points de repre sont brouills, sujets caution. Le mim-
tisme stratgique est la forme que prend la rationalit dans une
telle configuration, lorsque les agents ne savent plus exactement
ce qu'il faut dsirer et se tournent vers les autres pour le dter-
miner. Imiter l'autre est une stratgie d'exploration visant
dcouvrir qui, chez les autres, possde la rponse correcte. En
consquence, comme le dsir individuel se construit partir du
dsir des autres, la demande que connat un bien s'impose
comme une mesure de sa dsirabilit intrinsque. Plus elle est
grande, plus le bien est recherch. Dans ces conditions, le libre
jeu de la concurrence conduit des mouvements cumulatifs de
prix aux effets perturbateurs.
La force de l'hypothse mimtique, comme l'ont montr ces
premires rflexions, tient sa capacit penser une grande
varit de rgimes d'interactions dans un cadre thorique unifi.
85
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Autrement dit, l'imitation est fondamentalement polymor-
phique. Elle est source de stabilit lorsque, d'une manire rp-
titive, elle se polarise sur un mme modle extrieur aux
interactions, dont la lgitimit n'est pas mise en question.
Cependant, lorsque le modle perd sa position d'extriorit, le
mimtisme cesse d'tre routinier pour devenir stratgique et
producteur de dynamiques contagieuses. Du fait de ce polymor-
phisme, 1 'hypothse mimtique permet, dans un mme cadre
conceptuel, de penser la fois la stabilit et l'instabilit, et les
transitions de l'une l'autre. C'est sa grande force.
Avant de continuer cette analyse de l'hypothse mimtique
dans les chapitres qui suivent, il nous a paru important de nous
arrter un instant pour prsenter la thorie des asymtries
d'information dans la mesure o cette approche partage avec la
ntre de nombreux points communs. D'une part, elles ont un
mme point de dpart, savoir souligner le rle central que joue
le rapport aux marchandises dans l'obtention de l'quilibre
concurrentiel. D'autre part, elles adhrent une mme thse
centrale: si jamais ce rapport se trouve perturb de telle sorte
que la mdiation externe ne fonctionne plus, le prix peut perdre
son caractre autorgulateur. Il en est ainsi lorsque les acteurs
conomiques ne savent plus exactement ce qu'ils veulent,
lorsque leurs dsirs deviennent dpendants de l'action des
autres. Dans la thorie des asymtries d'information, cette
incertitude de l'valuation subjective drive de l'incertitude sur
la dfinition des objets eux-mmes: leur qualit n'est plus
dtermine parfaitement. Ce faisant, on se trouve face une
configuration formellement identique celle considre par la
thorie mimtique: l'individu a besoin des autres pour savoir ce
qu'il recherche; mme si cet effet est obtenu indirectement, au
travers de l'incertitude sur les qualits, et non directement par
l'imitation du dsir. La thorie des asymtries d'information
dmontre que, dans une telle configuration, l'quilibre walras-
sien disparat. Le mcanisme concurrentiel ne fonctionne plus
parce que la demande devient une fonction croissante du prix.
On retrouve ainsi ce qui nous est apparu comme la proprit
fondamentale de la mdiation interne.
86
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
Asymtries d'information et conventions de qualit
Tous les manuels de microconomie commencent leur prsen-
tation des conomies marchandes en dcrivant la liste des n
biens susceptibles d'tre changs. Cette hypothse initiale
s'analyse comme la description d'une nature que les individus
trouvent prsente devant eux avec l'vidence de ce qui est. C'est
sur la base de cette nature dj l que se construit l'activit co-
nomique d'change et de production. Carlo Benetti et Jean Car-
telier ont propos le terme d' hypothse de nomenclature 1
pour la dsigner. Nous retiendrons dsormais le terme d' hypo-
thse de nomenclature des biens pour des raisons qui devien-
dront bientt videntes. Le plus souvent, cette hypothse a t
perue comme parfaitement anodine, ne faisant que prendre acte
du fait que les marchandises, parce qu'elles sont des choses ,
peuvent faire l'objet d'une description objective naturelle
avant mme que les changes aient lieu. Il revient aux thori-
ciens des asymtries d'information (George Akerlof, Michael
Spence et Joseph Stiglitz) d'avoir montr quel point cette inter-
prtation tait errone. Ils ont montr que cette hypothse est
essentielle et qu'elle doit tre interprte de manire trs restric-
tive : chaque bien soumis change doit avoir une qualit homo-
gne, parfaitement dfinie et connue de tous les agents au sens
technique du savoir commun ou common knowledge ,
encore not CK. C'est cette condition que le mcanisme des
prix peut fonctionner conformment aux analyses walras siennes.
En effet, la possibilit de pouvoir parler d'un prix not Pi suppose
une opration de catgorisation donnant sens sans ambigut ce
qu'est le march du bien i pour tous les intervenants. Lorsqu'il
1. L'hypothse de nomenclature revient supposer possible une descrip-
tion d'un ensemble de choses, qualifies de biens ou de marchandises, ant-
rieurement toute proposition relative la socit. En d'autres termes, les
formes sociales spcifiques (change, production ... ) s'difient sur un substrat
neutre: la nature ou le monde physique dont il est possible de parler en pre-
mier lieu , in Carlo Benetti et Jean Cartelier, Marchands, Salariat et
Capitalistes, Paris, Franois Maspero, 1980, p. 94.
87
L'EMPIRE DE LA VALEUR
en est ainsi, chaque agent conoit de la mme manire le bien i
et, lorsque le prix se modifie, il en comprend sans ambigut la
signification, savoir quels biens sont concerns par cette modi-
fication et comment il convient d'y ragir. Cette configuration est
trs particulire. Pour la qualifier, nous parlerons d'une mdia-
tion parfaitement objective . L'objectivit renvoie l'ide
d'une rfrence chappant aux manipulations stratgiques des
agents, extrieure tous, qui s'impose comme un fait reconnu
unanimement par le groupe. videmment, les faits naturels sont
des faits objectifs, mais certains faits sociaux. peuvent galement
tre dits objectifs au sens prcdent. C'est la notion technique de
savoir commun ou encore connaissance commune qui
spcifie de la manire la plus adquate ce qu'est cette connais-
sance collective objective des qualits. Cette notion pousse trs
loin la communaut des esprits puisqu'elle stipule non seulement
que chacun connat la qualit, mais galement que chacun sait
que les autres la connaissent, et cela jusqu' l'infini des savoirs
croiss. En consquence, le savoir commun modlise une situa-
tion de parfaite transparence. Aucune suspicion d'aucune sorte
ne demeure quant au fait qui est suppos de savoir commun :
chacun est sr de son savoir et, surtout, chacun est sr du savoir
des autres. Aussi est-ce le concept appropri pour penser l'objec-
tivation russie d'un fait social ou d'une rgle, savoir son
extriorit par rapport aux acteurs. Comme le remarque Jean-
Pierre Dupuy, il existe cependant une contradiction latente entre
le degr infini de convergence des points de vue que ce concept
subsume et le fait que, dans l'univers walrassien, les acteurs co-
nomiques sont considrs par ailleurs comme tant spars:
Le CK voudrait tre ce qui totalise et unifie un ensemble de
consciences radicalement spares 1 , crit-il. Ainsi, dans l'uni-
vers walrassien, la rfrence du bien i est-elle si prcisment
dtermine que chaque agent peut acheter ou vendre ce bien,
sans se proccuper de ce que font les autres, dans la mesure o
tous sont srs qu'ils partagent une mme dfinition du bien i. Au
1. Jean-Pierre Dupuy, Convention et Common knowledge , Revue co-
nomique, vol. 40, n 2, mars 1 989, p. 370.
88
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
moment de l'change, il n'y aura pas de mauvaises surprises. La
dfmition socialement accepte des valeurs d'usage fait mdia-
tion entre les acteurs de par son objectivation. Dupuy ajoute:
Au cur mme du modle walras sien du march, ou thorie
conomique de l'quilibre gnral, on trouve cette mdiation par
un tiers en surplomb, cette extriorit de l'objet collectif par
rapport aux acteurs individuels. Cela est crit en pensant au
commissaire-priseur walrassien, mais cette mme analyse peut
galement s'appliquer l'hypothse de nomenclature des biens.
C'est sur la base de cette extriorit sans ambigut de la qualit
des biens que peut s'difier un ensemble de prfrences indivi-
duelles parfaitement dfinies, autrement dit, c'est l un lment
essentiel de la mdiation externe .
L'expression la plus synthtique de ce rle mdiateur de la
qualit des produits est lire dans le fait que la rationalit des
acteurs walrassiens est de type paramtrique . Les cono-
mistes utilisent ce concept pour souligner que les acteurs se pr-
occupent uniquement des prix et des quantits, et non de ce que
font les autres acteurs. Ainsi, la position de chaque individu
s'apprcie-t-elle sans ambigut au travers d'une fonction d'uti-
lit individuelle ayant pour uniques arguments les quantits des
n biens que l'acteur a acquis, le comportement d'autrui n'y
apparaissant pas. Pour les consommateurs, il s'agit de dtermi-
ner en quelle quantit les divers biens seront consomms pour
que soit maximise leur utilit sous la seule contrainte que les
dpenses ne dpassent pas les recettes. Pour les producteurs, il
s'agit de dterminer les quantits des inputs et des outputs de
faon maximiser leur profit sous la seule contrainte du respect
des exigences techniques. Dans les deux cas, la logique est for-
mellement identique: les individus ne se proccupent en rien
des dcisions des autres pour ne considrer que le niveau des
prix. La rationalit paramtrique s'est substitue la rationalit
stratgique : tout ce que les agents ont savoir sur la manire
dont les autres agissent est intgralement contenu dans les prix 1
l. C'est ce qui distingue l'conomie walrassienne de la thorie des jeux,
puisque la thorie des jeux est, quant elle, centre sur la dimension stratgique
89
L'EMPIRE DE LA VALEUR
On peut donc dire que, dans le modle walrassien, les prix
constituent une mdiation parfaite au sens o ils font parfaite-
ment cran entre les hommes.
Il en est ainsi en raison du savoir commun des qualits (dans
l'hypothse de nomenclature des biens) qui impose une qualifi-
cation des marchandises parfaitement dtermine et connue de
tous. Grce cette hypothse, les acteurs peuvent ne se proc-
cuper que des prix. Le comportement des autres leur est parfai-
tement indiffrent. Cependant, ce rle mdiateur des qualits
n'est en rien une donne naturelle, une substance neutre , que
les acteurs trouveraient toute prte l'emploi. Le savoir com-
mun est une construction institutionnelle qui repose sur l'adh-
sion collective des acteurs conomiques. En consquence, s'il
peut sembler que les acteurs walras siens sont coups les uns des
autres, sans reprsentations collectives, exclusivement proccu-
ps par l'appropriation d'objets aux prix variables, c'est parce
que antrieurement ils se sont mis d'accord sur la qualit des
objets et leur dfinition. Si chacun peut agir localement de
manire parfaitement indpendante des autres, c'est parce qu'au
centre est suppose une institution, productrice de savoir com-
mun. On peut prendre ici l'exemple du feu rouge. Si chaque
automobiliste peut s'en remettre entirement la couleur du feu
pour dterminer son action, sans s'occuper du comportement des
autres (rationalit paramtrique), ce n'est nullement parce que
les choix des autres lui sont indiffrents, mais bien parce que
le feu tant unanimement respect, sa seule observation suffit
dfinir la bonne action. Elle fournit chacun toutes les
informations ncessaires concernant le comportement des autres.
On est ici dans le cas d'une mdiation institutionnelle parfaite-
ment objective la manire du march walrassien. Mais cela
est vrai de toutes les conventions qui finissent par tre consid-
res comme des secondes natures, masquant le travail social qui
leur a donn sens : dans l'esprit des acteurs, la puissance de la
socit disparat derrire les automatismes individuels.
des interactions. On comprend que la thorie des jeux soit apparue initiale-
ment comme une critique de la microconomie.
90
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
Pour le comprendre, il n'est pas de meilleur moyen que
d'analyser ce qui se passe lorsque la rfrence cesse d'tre par-
tage, lorsque le savoir commun disparat et que l'objectivation
est remise en cause. Quand la rgle du feu rouge n'est plus sui-
vie automatiquement, chaque conducteur ne peut plus s'en tenir
la seule observation de la couleur du feu. Il doit alors s'inter-
roger directement sur les intentions des conducteurs qui se
trouvent au croisement. La nature stratgique de la rationalit
rapparat en pleine lumire parce que la mdiation institution-
nelle ne joue plus son rle. C'est cette mme conclusion
qu'aboutissent les thoriciens des asymtries d'information
lorsqu'ils considrent des situations o la qualit i n'est plus
dtermine objectivement mais est soumise incertitude. Ils
montrent que, dans ces conditions, la variation du prix Pi
devient sujette interprtation. Plus spcifiquement, ils ont ana-
lys des situations o les vendeurs connaissent parfaitement la
qualit de ce qu'ils vendent mais o l'acheteur ignore partielle-
ment la qualit des marchandises qu'il trouve sur le march,
d'o le terme: asymtrie d'informations . Dans ces condi-
tions, le prix offert n'est plus pour l'acheteur une variable suf-
fisante ds lors que lui manque la connaissance de la qualit des
biens; le prix ne construit plus une mdiation parfaite. Il
s'ensuit une consquence d'une grande porte: les acheteurs
sont conduits prendre en compte le comportement des ven-
deurs car c'est de celui-ci dont dpend dsormais la qualit du
bien offert. Ce faisant, on assiste un retour de la rationalit
stratgique, signe que la mdiation externe ne fonctionne plus.
On constate alors que l'existence de l'quilibre n'est plus assu-
re, preuve a contrario du rle dcisif de l'hypothse de nomen-
clature des biens et du savoir commun des qualits dans
l'obtention de l'accord walrassien.
Cette configuration est proche de la mdiation interne prsen-
te antrieurement, mais elle en diffre par le fait que ce qui
devient incertain n'est pas tant les prfrences individuelles
elles-mmes que la qualit des objets. En effet, l'introduction des
asymtries d'information ne revient pas sur l'exognit des pr-
frences. Notons ce propos qu'il est trs rare, voire exceptionnel,
91
L'EMPIRE DE LA VALEUR
que la thorie conomique considre des prfrences variables
ou endognes. Cependant, de manire indirecte, c'est un rsultat
trs voisin qui est obtenu: l'indtermination de la qualit
conduit l'acheteur s'intresser aux dcisions du vendeur car
c'est d'elles que dpend dsormais la qualit du bien propos
sur le march. Il s'ensuit une configuration dans laquelle,
comme dans la situation mimtique, les prfrences de l'ache-
teur deviennent dpendantes des choix du vendeur. Dans ces
conditions, les proprits d'autorgulation concurrentielle, dont
on a vu qu'elles faisaient jouer un rle stratgique la fixit des
prfrences, se trouvent mises en cause. Notons que le vendeur
reste, lui, parfaitement souverain. Ses choix ne sont pas dpen-
dants des choix de l'acheteur, ni des autres vendeurs.
Pour en savoir plus, examinons le cas paradigmatique des
voitures d'occasion tudi par George Akerlofl. Il fait l'hypo-
thse que la catgorie voiture d'occasion recouvre dsor-
mais un ensemble de voitures htrognes. La qualit d'une
voiture offerte sur ce march n'est plus dfinie de manire
dterministe, sans ambigut. Elle peut varier entre des voitures
d'occasion qui sont de bonne qualit et d'autres, de mauvaise
qualit. Aussi, lorsqu'on lui propose une voiture d'occasion au
prix p, l'acheteur ne peut-il tre sr de sa qualit. Pour connatre
cette qualit, le seul label voiture d'occasion ne suffit plus.
Il lui faut dsormais s'intresser directement aux vendeurs qui
ne sont plus interchangeables. Sont-ils propritaires d'une voi-
ture de bonne ou de mauvaise qualit? C'est l le point fonda-
mental: on sort de la rationalit paramtrique parce que la
qualit n'est plus de savoir commun. Elle est variable et dpend
dsormais des stratgies suivies par les offreurs. Dans cette
configuration, ce sont eux qui dterminent la qualit des voi-
tures offertes. De quelle manire? Pour le prciser, il faut
connatre leurs motivations. Akerlof suppose qu'eux galement
cherchent maximiser leur utilit, en l'occurrence leur profit:
plus le prix offert est lev, plus seront mises sur le march des
1. The Market for "Lemons" : Quality Uncertainty and the Market
Mechanism , Quarterly Journal of Economies, vol. 84, nO 3, aot 1970.
92
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
voitures de bonne qualit. On note, en consquence, que la qua-
lit n'est plus fixe mais devient une variable qui dpend du
prix: plus le prix est lev, plus la qualit des voitures offertes
s'amliorera. Cela est naturel. Ceux qui sont en possession de
voitures de bonne qualit ne s'en spareront que pour un prix
lev. Akerlof suppose que les acheteurs ont leur disposition
toutes ces informations. Ils ont une parfaite connaissance des
motivations des vendeurs (hypothse d'anticipation rationnelle).
Dans ces conditions, une fois le prix de march annonc, ils
sont capables de dterminer quelles voitures seront mises en
vente. En consquence, le prix devient, pour les acheteurs, un
indicateur de la qualit moyenne des produits offerts. C'est l
un effet nouveau qu'ignorait totalement l'analyse walrassienne
puisque, pour celle-ci, la qualit tait fixe antrieurement aux
changes. Cet effet qualit modifie en profondeur l'analyse tra-
ditionnelle. En effet, avec lui, c'est un lien positif entre le prix
du bien et la demande pour ce mme bien qui se trouve introduit
dans les mcanismes marchands : plus le prix est lev, plus le
produit offert est de bonne qualit, et plus la demande, toutes
choses gales par ailleurs, est leve. C'est l une violation fla-
grante de la fameuse loi de l'offre et de la demande . Il
s'ensuit de graves consquences : les proprits rgulatrices tra-
ditionnellement associes aux prix flexibles se trouvent remises
en cause. Plus prcisment, dans le cas des voitures d'occasion,
Akerlof dmontre qu'aucun change ne peut avoir lieu bien que
des changes mutuellement avantageux existent: le march
n'arrive pas se constituer. Gnralisant ce rsultat, Joseph Sti-
glitz
1
a montr que, en cas d'asymtrie d'informations, des situa-
tions de rationnement pouvaient galement tre observes. Dans
tous les cas, qu'il y ait absence de transactions ou rationnement,
c'est donc une logique de march fort loigne de celle que
considre l'analyse walras sienne qui prvaut. Le thorme d'exis-
tence de l'quilibre n'est plus valide, ni l'optimalit partienne.
1. Dans The Causes and Consequences of the Dependence of Quality on
Price , Journal of Economic Literature, vol. 25, mars 1987.
93
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Dans la situation classique considre par le modle walras-
sien, conformment la loi de l'offre et de la demande ,
l'augmentation des prix a pour consquence d'accrotre l'offre
et de baisser la demande de telle sorte que, si initialement le
bien considr tait en quantit insuffisante, cette situation de
pnurie relative disparat. Comme on l'a dj not, tel est le fon-
dement du rle rgulateur des prix. La flexibilit des prix per-
met de grer efficacement la raret des biens. Dans le cas o la
qualit n'est plus dtermine ex ante, la fonction de demande
connat une transformation radicale: au lieu de dpendre exclu-
sivement du prix, la demande dpend dsormais galement de
la qualit moyenne offerte, puisque celle-ci est devenue endo-
gne et variable comme l'est le prix. Notons que la dpendance
l'gard de la qualit moyenne est positive: lorsque celle-ci
augmente, la demande augmente son tour. Or, pour dterminer
cette qualit moyenne, les acheteurs, comme on l'a vu, se
tournent vers le comportement des vendeurs. cette occasion,
les acheteurs dcouvrent que la qualit est endogne et qu'elle
est une fonction croissante du prix de march.
Il s'ensuit que la demande dpend dsormais du prix par deux
canaux: le canal habituel qui fait que la demande baisse lorsque
le prix augmente, et un canal entirement nouveau qui fait que
la demande augmente lorsque le prix augmente parce que la
qualit moyenne offerte augmente elle-mme. D'o deux effets
contradictoires : l'effet raret et l'effet qualit. Lorsque l'effet
qualit l'emporte sur l'effet raret, on perd le lien ngatif entre
prix et demande qui tait au fondement de la concur-
rentielle par les prix. En consquence, l'quilibre disparat, et
l'on observe soit du rationnement, soit une absence de transac-
tion. En rsum, dans cette configuration d'asymtrie d'infor-
mations, on exige trop des prix. On leur demande de grer la
fois la raret des biens et leur qualit. Or ces deux missions sont
incompatibles. Dans la situation walras sienne, .la qualit fait
l'objet d'une dtermination exogne aux marchs, ce qui permet
de restreindre l'usage des prix la seule gestion de la raret.
Telle est la condition pour qu'un quilibre soit obtenu, ce que
nous avons nomm la mdiation externe .
94
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
Akerlof finit'son article en notant que de nombreuses insti-
tutions mergent pour contrecarrer les effets de l'incertitude 1
et permettre le fonctionnement des marchs. Il s'agit de crer
artificiellement , c'est--dire en mobilisant des institutions
visibles, ce qui tait suppos dj l naturellement dans le
modle walrassien, savoir une qualit exogne au march fai-
sant l'objet d'un savoir commun. Cette opration nous livre
alors le secret de l'hypothse de nomenclature des biens, le dvoi-
lement de sa vraie nature : une hypothse simplificatrice qui dis-
simule un travail sophistiqu d'estampillage des qualits en le
donnant voir au moment o il est totalement achev et russi.
Au titre de ces institutions productrices de la qualit, Akerlof
cite les garanties, les marques, les chanes de restaurants et
d'htels et les licences (avocats, mdecins, barbiers). Et il en est
bien d'autres. Lorsque la mmoire des processus de qualifica-
tion s'est estompe, l'hypothse de nomenclature s'impose de
nouveau et donne voir des biens toujours dj prsents.
Rsumons les rsultats obtenus par les thoriciens des asym-
tries d'information. Ils dmontrent clairement que l'accord wal-
rassien requiert pour tre obtenu que, au pralable, les agents
s'accordent sur la qualit des biens changs, ce que nous
appellerons une convention de qualit
2
)). Celle-ci doit tre
parfaitement dfinie et de connaissance commune pour tous les
changistes, au sens technique du savoir commun. Le lien ainsi
postul est donc trs fort. Il correspond une transparence pous-
se de l'espace social : chacun connat la qualit, sait que les
autres la connaissent, sait que les autres savent que tous la
connaissent et ainsi de suite jusqu' l'infini. C'est ce que nous
1. George Akerlof, The Market for "Lemons" : Quality Uncertainty and
the Market Mechanism , art. cit., p. 21.
2. Sur cette question, il faut se reporter l'approche thorique nomme
conomie des conventions . Voir le numro spcial de la Revue cono-
mique (vol. 40, nO 2, mars 1989), qui en prsente les axes directeurs (Jean-
Pierre Dupuy, Franois Eymard-Duvemay, Olivier Favereau, Andr Orlan,
Robert Salais et Laurent Thvenot). Voir galement Andr Orlan, L'cono-
mie des conventions: dfinitions et rsultats , prface Analyse conomique
des conventions, Paris, PUF, 2004, p. 9-48.
9S
L'EMPIRE DE LA VALEUR
avons nomm mdiation externe . Ds lors qu'il en est ainsi,
l'espace des quantits s'impose comme un espace commun sur
lequel la rationalit paramtrique peut trouver s'exercer. Si
l'acteur n'a pas se soucier du comportement des autres, c'est
parce qu'il sait que la qualit est une donne qui, par hypothse,
chappe aux comportements stratgiques. Interprte de cette
manire, l'objectivit des marchandises apparat comme le
rsultat d'un puissant travail d'authentification sociale et de
contrle. En consquence, l'quilibre gnral ne peut plus tre
pens, conformment la conception traditionnelle, comme
tant le fruit spontan des changes tels qu'ils rsulteraient de
la libre rencontre d'individus parfaitement trangers les uns aux
autres. Tout au contraire, il suppose que les acteurs cono-
miques partagent un certain nombre de rfrences communes
avant de prendre part aux transactions. Cette analyse est absolu-
ment gnrale comme l'illustre le fait que tous les marchs sont
concerns: biens ordinaires, services, travail, assurances, crdit
ou actifs financiers 1. Dans tous les cas, l'objectivation des qua-
lits est absolument requise pour que fonctionne la rgulation
concurrentielle. Il est vrai cependant que chaque march a ses
caractristiques propres et diffre dans sa capacit produire,
sur des bases stables, l'objectivation marchande. Dans certains
cas, la marchandisation se fait sans difficult mais, dans
d'autres cas, le processus trouve face lui l'opposition d'impor-
tants intrts. Par exemple, au Royaume-Uni, les luttes autour
de la marchandisation de la terre, ce qu'on a appel les enclo-
sures )), ont t d'une grande violence parce que de nombreux
paysans refusaient nergiquement l'appropriation prive de la
terre, condition sine qua non de sa marchandisation. De mme,
ce qu'on nomme aujourd'hui les nouveaux marchs du
vivant)) suscitent de fortes rsistances dans la mesure o ils
heurtent nombre de conceptions thiques auxquelles sont pro-
fondment attachs de larges secteurs de la socit. La force de
travail est galement un exemple intressant. L'objectivation de
1. Se reporter Joseph Stiglitz, The Causes and Consequences of the
Dependence of Quality on Price , art. cit.
96
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
la qualit du travail sous la forme de comptences collective-
ment reconnues n'a rien d'vident. C'est un processus haute-
ment conflictuel qui oppose les employeurs aux salaris, sur
fond d'une volution constante des techniques. Il demande
constamment tre recommenc. Les pratiques de marquage
des monnaies tudies par Viviana Zelizer
l
montrent galement
que des objets parfaitement standardiss, les monnaies fidu-
ciaires, peuvent faire l'objet de stratgies individuelles de diff-
renciation qui en modifient radicalement les conditions d'usage
et les qualits. Ces quelques situations indiquent clairement que
l'objectivation marchande est un processus complexe qui
demande tre tudi au cas par cas. Il est des situations o
l'objectivation trouve face elle des rapports sociaux s'oppo-
sant radicalement la logique marchande.
Incertitude et monnaie
L'ensemble des analyses menes dans le prsent chapitre
s'est efforc de saisir ce qui fait la spcificit de l'approche
noclassique en examinant sa rponse la question conomique
. par excellence: d'o vient l'ordre marchand? Comment la
sparation marchande se trouve-t-elle surmonte? Il nous est
apparu que la rponse avance par la thorie de la valeur no-
classique consiste supposer l'existence d'un principe de coh-
sion qui, l'insu mme des acteurs conomiques, vient
structurer leurs conduites et leurs dsirs : la valeur utilit. Pour
ce faire, le modle walrassien suppose des individus ayant un
rapport exclusivement utilitaire au monde par le biais des mar-
chandises. Parce que ce rapport aux objets s'exprime dans des
prfrences parfaitement stabilises et objectives, indpen-
dantes du choix des autres (mdiation externe), tout en tant
suffisamment flexibles (hypothse de convexit), on a pu
dmontrer qu'il existait un vecteur de prix rendant compatibles
toutes les dcisions individuelles. Tel est le rsultat obtenu par
1. La Signification sociale de l'argent, Paris, Seuil, 2005.
97
L'EMPIRE DE LA VALEUR
les thoriciens de l'quilibre gnral. Dans un tel cadre, par
construction, l'infmi du dsir est rejet. L'adhsion gnralise
l'utilit comme valeur fondamentale construit un encadrement
rigoureux qui interdit tout drapage. Au fond, ce qui frappe
dans l'quilibre gnral, c'est la srnit des acteurs, leur mod-
ratim. Ils semblent assurs de leur existence comme de leur
reconnaissance par autrui. La seule relation aux objets est apte
les calmer. Cette puissance du lien objectal l'origine de la
mdiation externe est ce sur quoi nous avons insist jusqu'
maintenant comme caractrisant la manire dont la pense no-
classique modlise la sparation marchande. Pour s'en
convaincre nouveau, considrons deux phnomnes impor-
tants qui ont t, jusqu' prsent, laisss de ct, savoir
l'incertitude et la monnaie, et examinons quelles modlisations
sont proposes pour en rendre compte. Nous allons voir que,
dans les deux cas, les modles proposs par la pense noclas-
sique rejettent l'hypothse mimtique parce qu'ils font jouer un
rle central l'objectivit marchande sous la forme de la mdia-
tion externe. Commenons par la question de l'incertitude et
considrons la version intertemporelle de l'quilibre gnral,
encore nomme quilibre Arrow-Debreu.
Dans cette nouvelle version du modle d'quilibre gnral,
on introduit la dure. Dsormais, les individus vivent, pro-
duisent et consomment sur plusieurs priodes, alors que, dans le
modle prcdent, tout se droulait sur une seule priode. Dans
la ralit des conomies marchandes, la relation au futur est
source d'incertitudes et de risques pour l'individu. Pour cette
raison, sa prise en compte affecte fortement l'analyse. De quoi
demain sera-t-il fait? et Comment me protger contre des
alas trop dfavorables? sont, en effet, les nouvelles et diffi-
ciles questions que l'acteur est amen se poser. En cons-
quence, l'individu perd une partie de sa srnit car il doit
dsormais se protger contre une prise de risque excessive. La
pense noclassique aborde la question du rapport au futur en
postulant qu'il est possible d'effectuer une numration objec-
tive de tous les scnarios susceptibles de se raliser l'avenir;
ce qui permet de rduire l'incertain une liste probabilisable
98
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
d'vnements dfinissables a priori. C'est ce que nous appelle-
rons l'hypothse probabiliste
l
. L'incertitude se trouve repr-
sente sous la forme d'une liste exhaustive d'vnements
exognes ou tats du monde, cense dcrire tout ce qu'il est per-
tinent de connatre pour un agent conomique. Pour chacun de
ces tats du monde, l'individu dtermine les marchandises lui
permettant d'obtenir une satisfaction optimale, par exemple, s'il
pleut, l'acteur achtera un parapluie et, en cas de scheresse, de
l'eau. Dans ces conditions, si on suppose l'existence de marchs
terme contingents permettant l'achat aujourd'hui de ces mar-
chandises pour le moment futur o ces vnements sont suppo-
ss se produire, alors les agents peuvent aujourd'hui s'assurer
de manire absolument parfaite contre les effets de l'incertitude.
Quel que soit l'vnement futur qui se produira, l'acteur aura
accs son panier de biens optimal. Aucun risque rsiduel ne
subsistera. Le point remarquable est que ce rsultat est obtenu
sans qu'il soit besoin de faire appel des moyens d'assurance
spcifiques, par exemple, financiers ou montaires. L'hypothse
probabiliste prserve la toute-puissance de la marchandise face
au futur et ses incertitudes. Ce qui est vis par cette pense
est la conception idaltypique d'une socit qui serait de bout
en bout rgie par le seul rapport aux biens, une socit sans lien
personnel parce que entirement mdie par les objets. Cela est
vrai en synchronie comme en diachronie : dans les deux cas, le
rapport aux marchandises suffit coordonner les individus
spars. Il faut d'ailleurs souligner fortement l'troite homologie
existant entre l'hypothse probabiliste et l'hypothse de nomen-
clature des biens. L 'hypothse probabiliste exerce, pour ce qui
est du rapport l'incertain, la mme fonction que celle dont est
en charge l 'hypothse de nomenclature des biens par rapport
aux qualits, savoir produire une reprsentation collective
objective l o spontanment on s'attendrait trouver un
ensemble d'valuations subjectives. De mme que l'hypothse
de nomenclature des biens suppose que la liste exhaustive des
biens est de connaissance commune, de mme 1 'hypothse
1. Se reporter au chapitre V qui lui est consacr.
99
L'EMPIRE DE LA VALEUR
probabiliste suppose que la liste exhaustive des vnements
incertains est de connaissance commune pour tous les acteurs de
l'conomie. Pour souligner cette homologie fonctionnelle, nous
nommerons galement cette dernire hypothse de nomencla-
ture des tats du monde . Ds lors, chaque individu n'a plus
se proccuper du comportement des autres: la seule connais-
sance des alas potentiels suffit. Ce faisant, l 'hypothse proba-
biliste permet de construire une mdiation objective entr.e les
acteurs conomiques en matire de risque de la mme manire
que l'hypothse de nomenclature l'avait fait en matire d'utilit.
Dans les deux situations, la mme logique est l'uvre: spa-
rer les hommes.
Pour conclure, venons-en la question montaire. L'analyse
complte du rapport montaire faisant l'objet du chapitre IV,
limitons-nous, dans le cadre du prsent chapitre, quelques
rflexions liminaires. D'abord pour rappeler que l'quilibre
gnral walrassien traite d'une conomie d'o la monnaie est
absente. Comme on l'a soulign, c'est l une caractristique des
approches qui adhrent une conception substantielle de la
valeur : la thorie de la valeur donne les clefs de l'change sans
qu'il soit ncessaire de prendre en considration la monnaie.
Celle-ci ne s'introduit que secondairement pour faciliter les
transactions sans que cette introduction n'adultre en rien les
lois intrinsques de l'change marchand, Pour rendre intelli-
gible le passage de l'conomie de troc l'conomie montaire,
plusieurs approches sont disponibles. Celle propose par Don
Patinkin a jou un rle majeur. Elle a donn voir, dans les
annes 1950, une fois dmontre l'existence de l'quilibre
gnral, une premire intgration de la thorie montaire et de
la thorie de la valeur
l
, Ce fut l un grand pas pour la thorie
noclassique qui disposait ainsi dsormais d'un cadre adquat
pour penser les conomies marchandes dans leur totalit. L'ide
directrice qu'a suivie Patinkin pour russir ce coup de force
s'analyse aisment partir de nos hypothses. Il se propose de
traiter la monnaie la manire d'une marchandise comme les
1. Don Patinkin, La Monnaie, /'Intrt et les Prix, Paris, PUF, 1972, p. 16.
100
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
autres 1. Pour ce faire, il lui faut dmontrer que la monnaie pos-
sde une utilit sui generis, de telle sorte que l'on puisse penser
le rapport des individus celle-ci comme exclusivement motiv
par la recherche de cette utilit, la manire des marchandises
ordinaires. Si cela est vrai, il est alors possible de faire entrer la
monnaie dans la fonction d'utilit au mme titre que les mar-
chandises, ce qui rend lgitime le recours aux techniques habi-
tuelles de maximisation pour dterminer les demandes
individuelles de monnaie. Autrement dit, on reprend le modle
de la mdiation externe qu'on applique la nouvelle variable.
Mais quelle est cette utilit propre la monnaie? Il ne s'agit pas
de l'utilit indirecte qu'elle produit par le fait qu'elle permet
d'acqurir des marchandises utiles. Comme il l'crit: Nous
nous intresserons l'utilit de dtenir de la monnaie et pas
l'utilit de la dpenser
2
En effet, aux yeux de Patinkin, la
monnaie a une utilit directe, par-del sa capacit acheter des
biens utiles. Selon lui, cette utilit intrinsque dcoule de son
aptitude viter les dsagrments que cause la dsynchronisation
temporaire entre dpenses et recettes, dsynchronisation qui se
traduit par un manque provisoire de liquidit
3
Dans cette optique,
le service de la monnaie, ce serait donc la liquidit. Il s'en dduit
que l'on peut dcrire le choix individuel partir de la maximisa-
tion d'une fonction d'utilit classique du consommateur, ds lors
qu'on ne se restreint plus aux seules marchandises et qu'on tend
les variables considres aux encaisses montaires
4
Dans ce
1. On trouve dj cette ide chez Walras.
2. Don Patinkin, La Monnaie, l'Intrt et les Prix, op. cit., p. 101.
3. Pour Patinkin, l'individu qui se trouve court de liquidit a deux choix:
Il peut manquer temporairement ses engagements [ ... ] - acte qui est sup-
pos lui causer certains dsagrments; ou bien il peut reconstituer ses
encaisses en obtenant [ ... ] le remboursement des titres qu'il dtient - ce qui
est suppos exiger de sa part des dmarches ennuyeuses. La scurit que pro-
curent les encaisses montaires contre ces deux types d'inconvnients est ce
qui est suppos leur confrer de l'utilit (ibid., p. lOI).
4. Ce qui compte du point de vue des agents, c'est le pouvoir d'achat de
l'encaisse montaire. Aussi la variable considre est-elle ce qu'on appelle
l'encaisse relle, qui est gale l'encaisse nominale divise par le niveau
gnral des prix.
101
L'EMPIRE DE LA VALEUR
cadre conceptuel avanc par Patinkin, l'utilit de la monnaie est
pense comme tant totalement indpendante du comportement
des autres individus. Il s'agit d'une caractristique intrinsque,
propre la monnaie, caractristique dont l'valuation dpend
exclusivement des prfrences particulires des individus, en
l'occurrence de leur aversion plus ou moins grande l'gard
des dsagrments qu'engendre l'illiquidit. On comprend la
force de cette approche: elle fait de la monnaie un pur objet
dont chacun peut apprhender les qualits sans tenir compte du
regard d'autrui. On reconnat le modle de la mdiation externe.
En consquence, la demande de monnaie rsulte d'un calcul
purement priv o chaque individu compare l'utilit marginale
de la monnaie qu'il dtient aux utilits marginales des autres
marchandises. Il s'ensuit que le recours aux mmes outils que
ceux traditionnellement utiliss pour les marchandises permet
d'analyser la demande de monnaie. Telle est la russite ultime
du travail de Patinkin. Il propose un cadre formel unifi dans
lequel marchandises et monnaie font l'objet d'un traitement par-
faitement symtrique : Les propositions de ces deux thories
[thorie de la valeur et thorie montaire] sont dduites en
appliquant les mmes techniques analytiques aux mmes fonc-
tions de demande sur les mmes marchs 1.
Pourtant, ce rsultat n'est pas sans poser de nombreux pro-
blmes. Rduire la relation montaire la recherche indivi-
duelle d'une utilit intrinsque, c'est refuser de voir que la
monnaie est, d'abord, une relation entre acteurs conomiques
qui repose sur de la confiance, des reprsentations collectives et
des attentes stratgiques. Autrement dit, il n'est pas vrai que, en
toutes circonstances, l'utilit de la monnaie puisse tre traite
comme une donne exogne, indpendante du comportement
des autres acteurs. l'vidence, le choix de dtenir de la mon-
naie est fortement conditionn par ce que pensent les autres :
s'ils refusent d'accepter cette monnaie, alors celle-ci n'a plus
aucune utilit. Elle cesse d'tre liquide. C'est l un fait incon-
tournable. Le nier n'est gure raliste. Autrement dit, si je sais
1. Ibid., p. 16.
102
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
que telle monnaie sera refuse par tous les changistes, alors je
ne l'accepterai pas. Pour cette raison de fond, il est impossible
de rduire, en toute gnralit, le rapport la monnaie une
relation purement prive, de type objectale, indpendante du
choix des autres. Pour le dire autrement, la liquidit n'est pas
une proprit intrinsque l'objet montaire au sens o, par
exemple, le lait possde en propre ses capacits nutritives.
Pour autant, l'approche de Patinkin n'est pas totalement
fausse. Durant les priodes o la qualit de la monnaie est
accepte par tous, alors son aptitude produire un service de
liquidit s'impose chacun, et le modle de Patinkin fournit
une approximation satisfaisante de la ralit conomique. On
retrouve ici un rsultat dj mis en avant pour les marchandises
ordinaires. Le modle de prfrences exognes correspond un
rgime spcifique, local, celui observ lorsque la qualit s'est
stabilise et fait l'objet d'une connaissance commune, ce qui
suppose un certain contexte institutionnel, la convention de qua-
lit, condition pour que la mdiation externe prvale. Cela est
vrai galement pour la monnaie avec le codicille supplmentaire
important que les conditions institutionnelles conduisant une
stabilisation de la qualit montaire sont beaucoup plus restric-
tives du fait de la nature mme de la monnaie. On sait, par
exemple, que les innovations financires conduisent une ins-
tabilit chronique de la demande de monnaie. Comme on l'a
dj not la fin de la section prcdente consacre aux asym-
tries informationnelles, les conditions de l'objectivation mar-
chande dpendent troitement de la marchandise considre et
des rapports sociaux qu'elle met en jeu. Pour la monnaie, elles
sont particulirement drastiques.
Le regard que nous portons sur le modle de Patinkin nous
conduit ne pas adhrer aux critiques que lui adresse Frank
Hahn dans son fameux article de 1965
1
Dans cet article, Hahn
montre, en substance, que Patinkin ne russit pas prouver que
1. On Sorne Problerns of Proving the Existence of an Equilibrium in a
Monetary Econorny , in Frank Hahn, Equilibrium and Macroeconomies,
Oxford, Basil Blackwell, 1984.
103
L'EMPIRE DE LA VALEUR
l'conomie qu'il considre est bel et bien une conomie mon-
taire, autrement dit que la monnaie mise en avant par Patinkin
s 'y trouve effectivement accepte par tout le groupe 1. Ce point
est indniable mais notre propre interprtation nous conduit
distinguer nettement les modles qui supposent l'objectivation
acquise des qualits (mdiation externe) et ceux qui s'int-
ressent aux conditions de formation de cette objectivation
(mdiation interne). Les configurations d'interaction qu'ils tu-
dient, parce qu'elles ont des logiques distinctes, renvoient des
problmatiques spares. Le modle qui analyse la cration
d'une institution est diffrent de celui qui analyse les effets de
cette institution, une fois qu'elle a t cre. Ainsi, personne ne
reproche l'quilibre gnral de ne pas expliquer d'o viennent
les marchandises dont il analyse les prix concurrentiels. De
mme, le modle de Patinkin, parce qu'il tablit les proprits
d'une conomie dans laquelle la monnaie se trouve parfaitement
objective, ne saurait rpondre la question: comment cette
monnaie s'est-elle impose? Examiner le rapport entre ces deux
types d'intelligibilit, ce qu'on a appel la mdiation interne et
la mdiation externe, fera l'objet du prochain chapitre. Cela
demandera que soit labore une thorie de l'mergence des
institutions, question que l'quilibre gnral a pris soin de ne
pas aborder pour se concentrer sur les proprits en rgime de
l'conomie marchande. En conclusion, Hahn a raison de dire
que le modle de Patinkin n'explicite pas les raisons qui font
que la monnaie est adopte par tous les socitaires mais, pour
autant, cela n'invalide en rien l'aptitude de ce modle penser
correctement le fonctionnement d'une conomie montaire. Ce
sont l deux problmes distincts2.
1. Techniquement, il s'agit de prouver que, dans le modle que propose
Patinkin, la monnaie a bien un prix strictement positif, autrement dit qu'il
s'agit bien d'une vraie conomie montaire. Si le prix de la monnaie s'avrait
nul, l'conomie considre par Patinkin ne serait montaire qu'en apparence.
En fait, ayant un prix nul, la monnaie ne serait pas demande par les acteurs
et elle ne jouerait aucun rle.
2. Autrement dit, l'conomie que propose Patinkin peut fonctionner for-
mellement avec un prix nul de la monnaie, mais de la mme manire que le
104
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
Objectivit marchande et modlisation idaltypique
L'analyse mene tout au long du prsent chapitre nous per-
met de mieux comprendre comment la thorie de la valeur no-
classique apprhende et rsout la question de la coordination
marchande. Elle le fait en supposant un monde si fortement
objectiv que chaque agent est capable de dterminer ce qu'il
doit faire uniquement sur la base des prix. Nulle autre connais-
sance n'est exige, en particulier nulle autre connaissance quant
au comportement des autres individus. Comme dans l'exemple
du feu rouge, la dimension stratgique disparat car le rapport
aux institutions suffit entirement dterminer la position de
chacun. En consquence, chaque individu semble n'avoir plus
se proccuper que de la satisfaction personnelle que lui pro-
curent les objets marchands. Seule cette relation importe pour
lui. Il est difficile d'imaginer une expression plus radicale de la
sparation marchande. Le modle noclassique donne voir une
conomie d'individus parfaitement indiffrents les uns l'gard
des autres, qui n'entrent en relation que superficiellement, par le
biais du secrtaire de march. Personne ne s'intresse per-
sonne, et personne ne rencontre personne. Dans ce monde de
l'isolement total, la relation essentielle est celle que les indivi-
dus entretiennent avec les valeurs d'usage. Ceci doit tre nou-
veau soulign. La thorie noclassique considre des individus
qui ne recherchent qu'une seule chose, ne sont mus que par un
seul affect: consommer. In fine, tout se ramne cela. Aux
yeux des thoriciens noclassiques, la valeur ultime est trou-
ver dans la satisfaction que procurent les marchandises quand
elles sont consommes: l'utilit. Soulignons que cette satisfac-
tion elle-mme exclut la prsence de tiers puisqu'elle est pense
comme le rsultat d'un strict tte--tte de l'individu avec les
biens. Le regard d'autrui est suppos n'avoir aucune influence.
modle walrassien peut fonctionner avec un prix nul des ordinateurs. Le fait
qu'il existe une conomie marchande sans ordinateur n'invalide pas la possi-
bilit de dcrire celle-ci avec les outils de l'quilibre gnral.
105
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Ainsi, par exemple, se trouve carte l'ide d'une consomma-
tion ostentatoire qui aurait pour but une qute de prestige.
Autrement dit, le rapport aux biens se conoit sur un mode stric-
tement utilitaire, au sens d'une utilit renvoyant des finalits
exclusivement pratiques comme se nourrir, se loger ou s'ha-
biller. Le march s'impose, dans un second temps, une fois les
utilits individuelles dtermines, comme le mcanisme social
qui permet de rpartir les biens rares entre les consommateurs,
mais sans que ce mcanisme n'affecte en retour les finalits pri-
ves, ni ne les dforme.
Cette tonnante vision de la sparation marchande repose sur
quatre puissants processus institutionnels de formatage du
monde social, que nous nommerons dsormais: l'objectivit
marchande , savoir: un ensemble de biens connus de tous les
acteurs (hypothse de nomenclature des biens) ; une reprsenta-
tion commune de l'incertitude (hypothse de nomenclature des
tats du monde) ; une reconnaissance collective de ce qu'est le
mcanisme de prix (hypothse du secrtaire de march) ;
l'adoption par tous les acteurs d'une conception strictement uti-
litaire des biens marchands (hypothse de convexit des prf-
rences). Dans un tel cadre institutionnel, les individus n'ont plus
besoin de se rencontrer, ni de se parler. Leur attention porte
seulement sur les mcanismes objectifs (qualits et prix) qui
absorbent toute la substance sociale. On peut dire que, dans le
monde de l'quilibre gnral, les objets constituent une mdia-
tion parfaite entre les acteurs. Ils ne laissent plus aucune place
aux interactions stratgiques. On reconnat ici la forme spci-
fique de ce que nous avons nomm mdiation externe. Cette
interprtation tire son originalit du fait qu'elle peroit des ins-
titutions l o le plus souvent les conomistes ne voient que des
prsences naturelles propres au contexte considr. La ncessit
d'introduire du savoir commun leur sujet est la preuve
manifeste que nous sommes face, non des faits naturels, mais
des formes institutionnelles ayant pour finalit la coordination
entre individus. Il s'ensuit, dans la perspective de cette interpr-
tation, tout un ensemble de questions visant expliciter par
106
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
quels processus l'objectivit marchande se trouve produite,
questions que la pense walras sienne ignore totalement.
Assurment, l'objectivit marchande telle que nous
venons de la dfinir formalise une dimension fondamentale de
nos conomies: le rle des objets. La lutte pour leur appropria-
tion est bien au cur des rivalits concurrentielles qui dchirent
les conomies marchandes. Cependant, la modlisation qu'en
propose la thorie noclassique encadre si troitement cette
lutte, dans des institutions si puissantes, qu'elle nous en livre
une version fortement dulcore. Les hypothses d'objectivit
marchande qui ont t retenues excluent du champ des rivalits
la fois la dfinition des marchandises (hypothse de nomen-
clature des biens), l'laboration des prfrences individuelles
(hypothse de convexit des choix), la reprsentation de l'incer-
titude (hypothse de nomenclature des tats du monde) et les
changes eux-mmes (hypothse du secrtaire de march). En
consquence, c'est une conomie totalement pacifie qui est
propose l'analyse. Cette manire si particulire de concevoir
la sparation marchande est intimement lie 1 'hypothse de
souverainet individuelle: au fait que les acteurs n'ont aucun
doute quant ce qui doit tre recherch. Certes, l'action des
autres sujets peut rendre plus difficile l'obtention de ce qui est
dsir, par exemple en augmentant le prix de telle ou telle mar-
chandise, mais fondamentalement ces actions sont sans effet sur
la manire dont l'individu value ce qui mrite d'tre achet. Ce
point est fondamental: dans l'univers noclassique, les choses
ont une valeur objective, indpendante des interactions mar-
chandes. Cette valeur trouve son origine dans les prfrences
individuelles supposes exognes. Le prix d'quilibre walras-
sien en donne l'explicitation la plus complte et la plus pure.
En rsum, ce qui frappe dans cette analyse, c'est l'absence
surprenante de toute dimension mimtique. Les individus y sont
radicalement coups les uns des autres; jamais ils ne se com-
parent, ni ne se copient. Par sa systmaticit mme, cette
absence est rvlatrice de ce qui fait la puissance des institutions
walras siennes : neutraliser l'imitation et ses dynamiques dsta-
bilisantes. Il est clair que le rejet de tout lien direct (hypothse
107
L'EMPIRE DE LA VALEUR
du secrtaire de march) participe de cette entreprise antimim-
tique. Mais l'hypothse utilitaire joue, en la matire, un rle
tout aussi fondamental. En effet, rduire la marchandise sa
seule utilit vise la rendre inoffensive, inerte; elle n'est plus
objet de dsir mais rponse des besoins objectifs limits. Il
s'agit de faire en sorte qu'elle chappe l'emprise mimtique et
ses drives. L'utilit doit tre interprte comme une forme
dgrade du dsir et de l'intrt. L'observation des conomies
concrtes montre cependant combien la rduction utilitaire n'est
pas aise mener son terme. Si le rapport aux biens ne se
comprenait que sous l'angle des besoins, il est probable que le
dynamisme de la demande s'en ressentirait fortement. Comme
le prouvent les pratiques du marketing et de la publicit, la
motivation mimtique s'affirme comme une dimension essen-
tielle du rapport des individus aux marchandises. Au-del de
l'utilit, la consommation rpond aussi une qute de prestige
et de statut social. C'est l une ralit qu'en son temps Thor-
stein Veblen avait dj fortement mise en avant mais qui a dis-
paru totalement du modle walrassien.
Cette conception antimimtique de la sparation marchande
structure en profondeur toute la pense des conomistes. Elle
est le modle de base l'aune duquel toute situation, relle ou
thorique, est mesure. Elle donne voir une conomie mar-
chande sans aucune violence, ni emballements cumulatifs, ni
monte aux extrmes. Il en est ainsi du fait mme que, par
hypothse, les marchandises comblent entirement les besoins
des acteurs, sans laisser de reste. Domins par une vision stric-
tement utilitaire du monde social, les individus trouvent dans les
objets de quoi les satisfaire parfaitement. Les interactions se
font sans heurt entre des protagonistes qui partagent une mme
vision des objets et une mme absence de passion, dans le cadre
d'institutions solides considres par tous comme lgitimes. On
ne peut imaginer ordre mieux agenc: la course aux objets a
remplac la course aux honneurs. La valeur utilit s'est substi-
tue aux autres valeurs sociales. L'intrt majeur de cette ana-
lyse est de nous montrer que les rivalits interpersonnelles
peuvent tre maintenues dans de strictes limites. Mieux encore,
108
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
elle donne voir les conditions institutionnelles permettant
d'encadrer la violence marchande en faisant obstacle aux suren-
chres mimtiques, Si ce modle aide comprendre le monde
qui nous entoure, il le fait conformment la mthode idalty-
pique dcrite par Max Weber: en accentuant certains aspects au
dtriment d'autres qui sont tout simplement laisss de ct. Le
but recherch n'est pas de dcrire la ralit conomique telle
qu'elle est, mais de reconstruire le tableau idal, pur, de l'objec-
tivit marchande et de ses consquences. En cela, la construc-
tion walras sienne est trs prcieuse. Elle permet de comprendre
cette dimension importante des conomies marchandes:
l'objectivit marchande et ses capacits autorgulatrices. Mais,
pour cette mme raison, il est dans sa nature de ne proposer
qu'une analyse partielle de la ralit du fait que, par dfinition,
elle laisse de ct tout ce qui n'est pas son objet d'tude: Le
type idal est une saisie partielle d'un ensemble global
l
. Ainsi
le modle walras sien ne dit-il rien des processus qui prsident
la construction de l'objectivit marchande, en particulier celle
des conventions de qualit, parce que ceux-ci sont mis hors
champ. Par exemple, s'il permet de comprendre l'volution des
prix d'une marchandise donne, ce modle est absolument muet
quant aux innovations de produit qui ont marqu les transforma-
tions de longue priode du capitalisme, et cela bien que ces
innovations aient jou un rle majeur. Autrement dit, une partie
essentielle des conomies marchandes lui chappe. Pour cette
raison, la construction walrassienne ne saurait tre considre
comme une approximation du monde rel au sens o, par
exemple, en physique, on dira que le gaz parfait est une bonne
approximation des gaz naturels. La modlisation idaltypique
walras sienne vise la stylisation de certaines tendances particu-
lires, en l'occurrence l'impact des mdiations objectives fai-
sant obstacle au mimtisme, et non la saisie de l'conomie dans
sa globalit. Elle cherche penser, non pas les comportements
1. Raymond Aron, Les tapes de la pense sociologique, Paris, Gallimard,
2007, p. 519-520.
109
L'EMPIRE DE LA VALEUR
moyens, mais les comportements typiques, sous un certain rap-
port.
Il semble bien que Lon Walras ait t conscient, au moins
jusqu' un certain point, de la spcificit de son approche et,
tout particulirement, du fait qu'il ne convenait pas de la
confondre avec la mthode exprimentale propre aux sciences
de la nature. La citation suivante est, de ce point, sans ambi-
gut:
La mthode mathmatique n'est pas la mthode exprimentale,
c'est la mthode rationnelle. Les sciences naturelles proprement
dites se bornent-elles dcrire purement et simplement la nature
et ne sortent-elles pas de l'exprience? Je laisse aux naturalistes
le soin de rpondre cette question. Ce qui est sr, c'est que les
sciences physico-mathmatiques, comme les sciences mathma-
tiques proprement dites, sortent de l'exprience ds qu'elles lui
ont emprunt leurs types. Elles abstraient de ces types rels des
types idaux qu'elles dfinissent; et, sur la base de ces dfini-
tions, elles btissent a priori tout l'chafaudage de leurs tho-
rmes et de leurs dmonstrations. Elles rentrent, aprs cela, dans
l'exprience non pour confirmer, mais pour appliquer leurs
conclusions 1.
Walras y insiste sur le travail d'abstraction par types idaux.
Ce travail part, dans un premier temps, du rel pour lui emprun-
ter des types d'change, d'offre, de demande, de march, de
capitaux, de revenus, de services producteurs, de produits
2
.
Ensuite, dans un second temps, de ces types rels, il s'agit
d'abstraire des types idaux qui forment la base du modle.
Cette qualification d'idaltypique est importante non seulement
pour bien spcifier la nature de la conceptualisation walras-
sienne, mais galement parce qu'elle permet de comprendre un
phnomne crucial qui, sans elle, resterait nigmatique, savoir
l'utilisation des modles conomiques aux fins de rformer le
rel en le rendant conforme son concept. l'vidence, un tel
1. Lon Walras, lments d'conomie politique pure ou thorie de la
richesse sociale, op. cit., p. 29.
2. Ibid., p. 30.
110
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
projet n'aurait aucun sens si nous avions affaire une modli-
sation descriptive. On ne peut vouloir implanter ce qui est !
Mais prcisment, parce que le modle ne vise pas dcrire
l'conomie relle mais en styliser une forme exemplaire sous
un certain rapport, il offre cette possibilit nouvelle: s'appli-
quer la ralit, non pas en tant qu'il la dcrit, mais en tant
qu'il la rtablit dans la puret de son concept. Depuis les tra-
vaux de Marie-France Garcia' jusqu' ceux de Michel Callon
2
,
de nombreuses tudes ont montr combien ce rle performatif
tait stratgique et jouait un rle essentiel dans la pratique des
conomistes. On utilise les modles comme guides aussi bien
pour construire de nouvelles institutions que pour penser de
nouvelles rgulations. L'volution de la sphre financire au
cours des vingt dernires annes en fournit une illustration
exemplaire. Cet effet est spcifique aux sciences sociales. Et
c'est certainement en conomie qu'il est le plus flagrant et le
plus significatif. Pour cette raison, la thorie conomique joue
un rle immense dans nos socits dveloppes. Elle est le dis-
cours qui indique comment les affaires humaines doivent tre
menes. C'est l une consquence directe de son caractre
idaltypique. Or rappelons que, en son temps, Max Weber avait
dj mis en garde sur le fait qu'il convient de ne pas confondre
l'idaltype, construit par le savant pour rendre intelligible le
monde social, et les idaux qui, un moment historique donn,
sont poursuivis pratiquement par les individus en vue d'une
transformation de leurs conditions de vie. Cette mise en garde
s'imposait ses yeux d'autant plus que, par leur contenu subs-
tantiel, l'un et l'autre pouvaient tre trs proches:
Il arrive qu'un idaltype de certaines conditions sociales, qu'on
obtient par abstraction de certaines manifestations sociales carac-
tristiques d'une poque, ait effectivement pass aux yeux des
contemporains de celle-ci pour l'idal qu'ils s'efforaient
1. La construction sociale d'un march parfait: le march au cadran de
Fontaines-en-Sologne , Actes de la recherche en Sciences sociales, nO 65,
novembre 1986.
2. The Laws of the Market, Oxford, Blackwell, 1998.
111
L'EMPIRE DE LA VALEUR
pratiquement d'atteindre ou du moins pour la maxime destine
rgler certaines relations sociales - les exemples de ce genre sont
mme assez frquents 1
Cette mise en garde s'adresse tout particulirement aux cher-
cheurs qui peuvent tre conduits considrer l'idaltype non
plus comme un outil de connaissance objective de la ralit pr-
sente, mais comme l'expression du devoir-tre ; ce que
Weber appelle la confusion des problmes
2
. Le chercheur
utilise alors l'idaltype comme un instrument d'valuation nor-
mative pour juger de ce qui devrait tre. Il abandonne alors
l'exigence de neutralit axiologique , centrale aux yeux de
Weber, et, en consquence, sort de son rle d'observateur
objectif. Il en est ainsi des conomistes libraux lorsqu'ils attri-
buent leur modle idaltypique de l'conomie marchande la
valeur d'une norme atteindre:
Malheureusement la thorie conomique a t elle aussi vic-
time du phnomne typique de la "confusion des problmes". En
effet, la thorie purement conomique en son sens "individua-
liste", politiquement et moralement "neutre", qui a t un moyen
mthodologique indispensable et le restera sans doute toujours,
fut conue par l'cole radicale du libralisme comme [ ... ] ayant
le caractre d'un "devoir-tre" ; autrement dit on lui a attribu la
validit d'un idal dans la sphre des valeurs au lieu d'un idal-
type utiliser au cours d'une recherche empirique portant sur
l'tant3".
Cette dernire analyse illustre nouveau la richesse du
concept d'idaltype dans son application la modlisation co-
nomique. Il permet d'en saisir aussi bien la nature que les
usages et les dvoiements. Grce lui, on prend la mesure de
ce qui distingue les modles conomiques des modles utiliss
par les sciences de la nature. Clairement, ces divers discours
l. Max Weber L'objectivit de la connaissance dans les sciences et la
politique sociales , in Essais sur la thorie de la science, Paris, Plon, 1965,
p. 187-188.
2. Ibid., p. 471.
3. Ibid., p. 471.
112
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
relvent d'pistmologies distinctes. Notons qu'on trouve chez
Franois Simiand' une analyse similaire lorsqu'il souligne
l'oscillation constante de la thorie conomique entre analyse
positive et analyse normative.
Pour clore ce chapitre, insistons sur une dernire spcificit
de la thorie de la valeur noclassique, par quoi l'approche co-
nomique se distingue radicalement des autres sciences sociales :
l'absence de toute reprsentation collective. En effet, la puis-
sance particulire de cette construction institutionnelle, que
nous avons nomme objectivit marchande , se mesure au
fait que l'adaptation des conditions nouvelles (nouvelles pr-
frences ou nouvelles technologies ou nouvelles ressources) se
fait par le jeu des prix sans qu'il soit ncessaire qu'aucun acteur
ait une reprsentation globale du processus. On trouve une
illustration exemplaire de cette analyse chez Friedrich Hayek
2
lorsqu'il met l'accent sur la capacit des prix coordonner effi-
cacement les acteurs spars, sans qu'il y ait besoin de supposer
un espace commun de reprsentation autre que celui des prix.
Hayek prend comme exemple la manire dont une conomie,
confronte soudainement une raret accrue de l'tain, volue
et s'adapte. Une telle modification produit une multiplicit
d'actions locales visant conomiser cette matire premire, et
cela sans qu'il soit ncessaire que les agents connaissent les rai-
sons qui ont rendu l'tain plus rare :
Ce qu'il y a de merveilleux dans un cas comme celui de la
raret d'une matire premire, c'est que, sans qu'il y ait eu
d'ordre initial, sans que plus qu'une poigne d'acteurs ait su la
cause initiale, des dizaines de milliers de gens sont conduits
utiliser la matire premire avec davantage de mesure, et que, ce
faisant, ils agissent de faon adquate
3
1. Dans Un systme d'conomie politique pure , in Critique sociolo-
gique de l'conomie (textes prsents par Jean-Christophe Marcel et Philippe
Steiner), Paris, PUF, 2006.
2. L'utilisation de l'information dans la socit , Revuefranaise d'co-
nomie, vol. 1, nO 2, automne 1986.
3. Ibid., p. 130.
113
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Les agents n'ont pas besoin de savoir ce qui a caus la hausse
du prix de l'tain pour pouvoir prendre la mesure qui s'impose.
Le modle ainsi construit donne voir un ensemble de voisi-
nages individuels interconnects grce aux prix et conduisant
une adaptation globale de l'conomie bien qu'aucun agent ne
possde un savoir global du processus. Hayek crit:
Cet ensemble joue comme un seul march non pas parce que
chacun de ses membres scrute l'ensemble de l'conomie, mais
parce que les champs de vision individuels se recouvrent suffi-
samment, de telle sorte qu' travers de nombreux intermdiaires,
l'information en cause est communique tous!.
L'objectivit marchande permet ce rsultat en crant un
ensemble intgr de rfrences partages. Ce faisant, elle
autorise une fantastique conomie de savoir et d'intelligence.
C'est de l que les prix tirent leur qualit rgulatrice essentielle.
On peut en conclure que l'objectivit marchande joue, pour
l'conomie, le rle que jouent les reprsentations collectives
pour les sciences historiques
2
Dans les deux cas, fondamenta-
lement, ce qui est en jeu, c'est l'existence d'une croyance
commune. C'est cette croyance commune (sur les qualits et sur
les prix) qui permet la coordination. Simplement, dans le cas
walrassien, cette croyance commune est cache dans les hypo-
thses. Elle est, en quelque sorte, transfigure. Cette transfigu-
ration ne donne voir qu'une relation entre choses, l o est
prsente une relation sociale entre individus, conformment la
dfinition marxienne du ftichisme: un rapport social dter-
min des hommes entre eux [ ... ] revt ici pour eux la forme
fantastique d'un rapport des choses entre elles
3
.
Cette construction sophistique met en scne une dimension
importante de ce que sont les conomies marchandes, comme
des forces qui les animent. Pour cette raison, elle n'a pas tre
1. Ibid., p. 128-129.
2. Au sens que leur donne Jean-Claude Passeron (dans Le Raisonnement
sociologique. L'espace non-popprien du raisonnement naturel, Paris,
Nathan, 1991), savoir anthropologie, histoire et sociologie.
3. Karl Marx, Le Capital, op. cU., p. 69.
114
L'OBJECTIVIT MARCHANDE
rejete. Si nous n'en contestons pas le bien-fond, il nous est
cependant apparu qu'elle n'exprime pas la totalit du fonction-
nement de la sphre marchande. Elle donne voir une conomie
fortement pacifie, une conomie o la place de chacun est
durablement dfinie. Ce qui frappe est l'absence d'incertitudes,
au sens o chacun sait exactement ce qu'il veut. Au fond, les
changes concurrentiels par eux-mmes n'ont gure d'impor-
tance, une fois que les finalits stratgiques de chacun se
trouvent dtermines sans ambigut. Ils prennent acte d'un rap-
port utilitaire au monde. Comme l'ont dj remarqu divers
analystes, l'conomie de march walrassienne ressemble forte-
ment une conomie planifie. On a simplement remplac le
planificateur par le secrtaire de march. Mais, pour le reste, on
observe une mme transparence et, fondamentalement, une
mme absence de conflits. Il s'agit maintenant de proposer une
analyse plus gnrale de l'ordre marchand qui apprhende les
conditions mmes de sa stabilisation, qui aille au cur de son
nergie. Tel est le sens gnral de l'hypothse mimtique.
Cette hypothse affirme que les individus ne savent pas ce
qu'ils dsirent. La seule introspection ne leur en livre pas la
clef. Pour dterminer ce qui mrite d'tre acquis, ils regardent
autour d'eux, cherchant dans l'exprience des autres un modle
imiter. Cette conception s'oppose l'hypothse de souverai-
net individuelle. L'individu mimtique est un tre foncire-
ment social au sens o il est constamment plong dans les
interactions. Non seulement il n'est pas extrieur elles, mais
elles le faonnent. Ce faisant, le modle mimtique inverse
l'ordre des causalits: il recommande de partir des relations
pour penser les valuations individuelles. On ne saurait suresti-
mer l'importance de ce renversement: l'change est remis au
centre du dispositif conceptuel. Loin d'tre manipul de l'ext-
rieur par des valeurs objectives qui lui prexistent, savoir les
prfrences individuelles, l'change marchand apparat comme
le lieu vritable de constitution de la valeur, y compris de l'uti-
lit. Tel est l'enjeu fondamental de l'hypothse mimtique:
proposer une conomie des rapports et non des substances.
C'est l une mutation thorique de grande ampleur.
Chapitre III
La raret
La qute des biens pour leur seule utilit construit un monde
marchand sans conflit, parce que sans enjeu vritable. Telle est
l'conomie que nous donne penser le modle d'quilibre
gnral. Certes, la raret demeure mais, du fait de 1 'hypothse
de convexit des prfrences, elle se trouve fortement diminue
jusqu' devenir parfaitement inoffensive: l'obtention d'une
rpartition des richesses acceptable par tous est rendue possible
ds lors que chacun se montre absolument dispos l'change.
Aucune prfrence exclusive ni aucune revendication exagre
ne vient faire obstacle un tel partage. C'est ce que formalise
l'accord walras sien. Ce faisant, l'utilit noclassique s'affirme
comme un puissant baume, comme une substance capable
d'apporter la paix aux socits en les dtournant des luttes vio-
lentes que suscite l'apptit de pouvoir et de domination. Il en est
ainsi parce que l'utilit isole les hommes en les enfermant dans
leur vie pratique. Le consommateur walrassien ne s'intresse
pas aux autres, ni ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils font. Son
idal de vie est dans la sant et le confort que seules les valeurs
d'usage peuvent lui apporter. Il ne connat pas d'autres intrts.
Parce qu'elle inhibe les rflexes mimtiques et met hors jeu la
comparaison avec autrui, l'utilit noclassique est au fondement
d'un monde sans rivalit.
Dans la pense noclassique, cette hypothse d'une relation
utilitaire aux marchandises relve, pour une grande partie, du
sens commun. Elle fait partie des vidences qui sont nonces
aux premires pages des manuels de microconomie. Pourtant,
que l'utilit puisse s'imposer comme la modalit exclusive du
116
LA RARET
rapport aux objets est une hypothse qui mrite d'tre discute.
Comme le notait dj Marx, pour ce qui est du dsir d'objet, le
prestige a certainement t une motivation bien plus forte, du
moins si l'on considre les premiers stades du dveloppement
conomique :
La premire forme naturelle de la richesse est celle du superflu
ou de l'excdent; c'est la partie non immdiatement requise
comme valeur d'usage, ou encore, c'est la possession de produits
dont la valeur d'usage dpasse le cadre du simple ncessaire
[ ... ] ; ce superflu ou cet excdent des produits constitue, un
stade peu dvelopp de la production, la sphre proprement dite
de l'change des marchandises 1.
Cette mme thse se retrouve sous la plume de Thorstein
Veblen. Pour cet auteur, l'objet est d'abord un trophe qu'on
acquiert parce que sa possession confre de la puissance. Il
s'agit, grce lui, d'affirmer sa supriorite. Or, dans l'ordre
marchand noclassique, cette motivation a disparu; elle n'a
plus cours. Elle est mme rejete comme illusoire, voire irra-
tionnelle. Ce qui compte pour l'individu walrassien, c'est son
bonheur individuel qui ne peut venir que d'une consommation
adapte ses gots personnels, satisfaisant sa recherche d'uti-
lit. Pour les thoriciens noclassiques, les prfrences indivi-
duelles s'exprimentent, hors de l'influence des autres, dans le
cadre d'un strict face--face mettant en prsence l'individu
solitaire et les marchandises. En consquence, point de public
qui donner spectacle de sa qualit! La logique noclassique
parie sur l'intensit des bienfaits que procurent les valeurs
d'usage pour dtourner les individus des luttes mimtiques et,
1. Marx, Contribution la critique de l'conomie politique, Paris, ditions
Sociales, 1957, p. 92.
2. Veblen ne nie pas que, dans ces premiers stades, il y eut des traces
d'appropriation d'articles utiles. [ ... ] toutefois la personne qui s'approprie et
utilise ces objets ne se figure pas les possder. Il s'agit l de biens sans
importance, et cette habitude ne pose pas la question de la proprit (Thor-
stein Veblen, Thorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard, 1970, p. 17-18).
Autrement dit, les biens utiles sont si bas dans la hirarchie culturelle qu'on
ne voit pas le besoin de s'en rendre propritaire!
117
L'EMPIRE DE LA VALEUR
ce faisant, les transformer en acteurs walrassiens. C'est cette
source que l'objectivit marchande puise toute sa force, dans la
reconfiguration des dsirs humains dsormais focaliss sur les
seules valeurs du bien-tre individuel et de l'aisance matrielle.
C'est' l une transformation sociale de grande ampleur, pluri-
sculaire, jamais acheve, dont les manifestations concrtes
varient avec l'volution du capitalisme et des techniques. Le
modle fordien, centr sur la voiture et l'quipement mnager l,
qui a prvalu durant les Trente Glorieuses, nous en offre une
illustration exemplaire. Aujourd'hui, certains diagnostiquent
l'mergence d'un nouveau modle ayant pour cible l'tre
humain lui-mme au travers de son ducation, sa formation, sa
sant et ses loisirs, ce que Robert Boyer nomme le modle
anthropogntique
2
. L'analyse historique met ainsi en vi-
dence une srie de standards de consommation qui se sont suc-
cd depuis l'origine des socits marchandes jusqu'
aujourd'hui. Cependant, par-del cette diversit, c'est toujours
le mme principe de marchandisation utilitaire, la mme qute
de fonctionnalit, qui est l'uvre. Il s'agit toujours d'amlio-
rer les conditions matrielles de l'existence en prenant appui sur
la science et ses progrs. L'historien Philippe Perrot en dcrit
admirablement la nature lorsqu'il met en avant le souci crois-
sant du bien-tre et de la chaleur, l'obsession grandissante de
l'intrieur et du familier, le got du capiton et du rembourrage,
de la doublure et du fourr, derrire la faade austre, voire
asctique, du "comme-il-faut
3
" . Il s'agit de rompre avec la
dpense ostentatoire qui produisait la supriorit en la manifes-
tant: la charge symbolique, esthtique, sensuelle de l'objet
somptueux, se substitue la valeur d'usage du produit ordinaire
4
1. Se reporter Michel Aglietta (Rgulation et Crises du capitalisme,
Paris, Odile Jacob, 1997).
2. Se reporter Robert Boyer, La Croissance, dbut de sicle, Paris, Albin
Michel, 2002. La dfinition du modle anthropogntique occupe tout le cha-
pitre VIII, intitul L'mergence d'un modle anthropogntique (p. 163-192).
3. Philippe Perrot, Le Luxe. Une richesse entre faste et confort XVllf-
XIX sicle, Paris, Seuil, 1995, p. 10.
4. Ibid., p. 19.
118
LA RARET
L'quilibre gnral walrassien, d'une certaine manire, tire
les consquences de cette volution historique. Sur le mode de
l'idaltype, il formalise la marchandisation utilitaire par-del la
diversit de ses manifestations. Faisant l'hypothse d'une
socit entirement soumise ce principe, il dmontre que, dans
un tel cadre, les acteurs peuvent toujours trouver s'entendre
sur un mme vecteur de prix. C'est l un rsultat d'une grande
force. Il faut cependant regretter que la tradition conomique
considre que le mcanisme l'origine de cet accord est la
flexibilit concurrentielle des prix. Cette interprtation nous
semble profondment errone. La flexibilit des prix ne joue,
dans ce modle, qu'un rle parfaitement secondaire. L'essentiel
est dans la constitution d'un rapport aux objets de nature utili-
taire. Ce rapport est l'origine de l'quilibre gnral par le fait
qu'il cre les conditions structurelles de l'accord entre des indi-
vidus devenus des consommateurs raisonnables, c'est--dire
n'ayant plus que des besoins satisfaire. C'est cette conception
utilitaire du monde que l'quilibre gnral nous donne voir.
Bien qu'elle ne manque pas de pertinence, cette analyse
idaltypique n'offre cependant qu'une vision tronque de l'co-
nomie marchande. D'une part, mme s'il tait vrai que seule
l'utilit des biens intresse les acteurs conomiques, la question
des moyens permettant de les acqurir resterait pose. Elle fera
l'objet du prochain chapitre. D'autre part, il n'est pas vrai que
le rapport aux marchandises se rduise l'utilit. Celle-ci ne
donne voir qu'une forme particulire de la relation mar-
chande. Tout l'effort thorique que propose le prsent livre vise
prcisment ne plus considrer le rapport utilitaire aux biens
comme la ralit ultime des conomies marchandes. L'utilit
n'est en rien une donne exogne vidente , tout comme le
march n'est en rien la rencontre d'individus constitus prala-
blement autour de prfrences. Il faut considrer l'utilit et les
prfrences comme un rgime particulier des changes mar-
chands, et non comme sa forme naturelle. L'utilit est une
construction sociale qui vise, sans jamais y russir totalement,
stabiliser la sparation marchande en faisant obstacle aux riva-
lits mimtiques. Pour mener bien ce projet thorique, il est
119
L'EMPIRE DE LA VALEUR
impratif d'aborder la relation aux objets dans un cadre plus
large que celui imagin par la conception utilitariste. Ce n'est
qu'en sortant du modle noclassique qu'il sera possible d'en
penser les conditions de validit. Pour ce faire, nous partirons
du concept de raret, non pas la raret walras sienne prcdem-
ment dfinie, mais la raret en tant qu'elle dsigne la forme
gnrique de la dpendance aux objets telle que la sparation
marchande l'institue. La raret ainsi conue va bien au-del des
seuls besoins par le fait que, dans le cadre de la sparation mar-
chande, l'accs aux objets s'impose comme la condition mme
de l'existence sociale. Il faut des conditions trs particulires
pour que le modle utilitaire s'impose comme la forme domi-
nante du rapport aux biens.
La dpendance l'gard des objets
Il faut bien comprendre que la raret n'est aucunement une
donne naturelle qu'on pourrait mesurer l'aide d'indicateurs
objectifs comme, par exemple, le niveau de vie moyen de la
population considre. De mme, on commettrait une mprise
en disant que plus une socit est prospre et techniquement
dveloppe, moins la raret y est prsente. Il en va tout autre-
ment. La raret dsigne une forme d'organisation spcifique,
institue par le march, qui fait dpendre, dans des proportions
inconnues des autres socits, le statut de chacun de sa seule
capacit acqurir des objets sans qu'il puisse attendre un
secours d'autrui. Apparat ici le fait que la libert et l'indpen-
dance par rapport aux autres qu'institue si puissamment la spa-
ration marchande peut galement prendre la forme de la solitude
et de l'exclusion, o l'on voit l'ambivalence profonde des rap-
ports marchands. Le manque, la pnurie ou la famine pour cer-
tains alors que d'autres bnficient de bien plus qu'ils n'ont
besoin, loin d'tre considrs comme des scandales, y sont per-
us comme l'expression de rgulations sociales lgitimes. Ce
serait une ralit profondment tonnante, et mme scandaleuse,
aux yeux des peuples pr-marchands, habitus valoriser
120
LA RARET
l'identit sociale des tres en tant que telle. Mais elle est au
cur de ce qu'est la raret.
Marshall Sahlins, dans un ouvrage clbre, analyse cette ra-
lit. tudiant les peuples de chasseurs-cueilleurs, c'est--dire
une des socits les plus anciennes du globe puisqu'elle
remonte au palolithique, il montre que, paradoxalement, ils
connaissent l'abondance au sens o tous les besoins matriels
des gens y sont aisment satisfaits 1 . Il en est ainsi parce que
ces populations ont su dsirer peu
2
La cause de cet tat de fait
n'est pas chercher dans l'adhsion collective une sagesse
asctique prnant l'abstinence. C'est la consquence d'institu-
tions particulires qui font en sorte que, dans ces socits,
aucune relation entre l'accumulation de biens matriels et le
statut social n'a[it] t institue
3
Toute l'organisation com-
munautaire vise limiter la proprit des biens matriels ,
encadrer rigoureusement les objets utiles de telle manire que
les quotits normales des biens de consommation soient,
culturellement, fixes assez bas
4
. Certes, le niveau de vie y est
trs modeste mais personne n'y meurt de faimS, car la coutume
du partage et de l'entraide y domine la vie sociale. C'est dans
nos socits dveloppes, domines par la sparation mar-
chande, que la raret s'impose comme une puissance autonome,
sans appel, qui rgle la vie des individus, sans considration
pour leur dignit sociale :
C'est nous et nous seuls qui avons t condamns aux travaux
forcs perptuit. La raret est la sentence porte par notre
conomie, et c'est aussi l'axiome de notre conomie poli-
tique ... L'Homo conomicus est une invention bourgeoise; il
1. Sahlins Marshall, ge de pierre, ge d'abondance. L'conomie des
socits primitives, Paris, Gallimard, 1976, p. 38.
2. Il y a deux voies possibles qui procurent l'abondance. On peut "ais-
ment satisfaire" des besoins en produisant beaucoup, ou en dsirant peu
(ibid., p. 38).
3. Loma Marshall cite in ibid., p. 48.
4. Ibid., p. 49.
5. Sauf si tous y meurent de faim, par exemple en cas de catastrophe
naturelle.
121
L'EMPIRE DE LA VALEUR
n'est "pas derrire nous, disait Mauss, mais devant nous comme
l'homme moral". Les chasseurs-collecteurs n'ont pas brid
leurs instincts matrialistes; ils n'en ont simplement pas fait
une institution 1.
L'analyse de Sahlins pennet de nous dprendre de la concep-
tion conomiciste d'une raret dfinie arithmtiquement comme
la diffrence entre des besoins naturels et des biens produits. La
raret est tout autre chose. Elle est un rapport social s'exprimant
dans une certaine mise distance structurelle des objets aux fins
de les rendre sans cesse dsirs. Pour ce faire, les objets ne
doivent tre ni trop prs, ni trop loin ; ni trop aisment acces-
sibles, ni trop difficilement atteignables. Les relations mar-
chandes ne tolrent ni l'extrme raret, parce qu'elle engendre
la violence et dtruit le corps social, ni l'abondance, parce
qu'elle ruine le pouvoir des objets et rend le calcul conomique
caduc. Paul Samuelson crit: Si les ressources taient illimi-
tes [ ... ], il n'existerait pas de biens conomiques, c'est--dire
de biens relativement rares, et il n'y aurait plus gure lieu d'tu-
dier l'conomie [ ... ]. Tous les biens seraient des biens gra-
tuits
2
En consquence, l'conomie marchande est fonde sur
une raret relative, inlassablement recommence. Ce phno-
mne est nigmatique et paradoxal en ce sens qu'il contredit
l'intuition d'un besoin qui irait diminuant au fur et mesure
qu'il trouverait sa satisfaction. Tout au contraire, l' accroisse-
ment de la production en rponse aux besoins, loin d'lever la
satisfaction des acteurs et de rduire l'cart entre offre et
demande, provoque de nouvelles aspirations diriges vers de
nouveaux biens, ce qui reproduit la situation de raret relative,
et mme quelquefois l'largit. De cette manire, le pouvoir des
objets sur les hommes se trouve continuellement reproduit.
Nous voici perptuellement sous leur dpendance. Comment
est-ce possible? Comme le souligne Paul Dumouchel dans un
1. Ibid.. p. 52.
2. Paul Samuelson, cit in Paul Dumouchel, L'ambivalence de la
raret , in Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy (dir.), L'Enfer des choses,
op. cU., p. 146.
122
LA RARET
texte consacr l'ambivalence de la raret, l'conomie mar-
chande est confronte une causalit circulaire o les besoins
dterminent la quantit de biens ncessaires, et la quantit de
biens produits dtermine les besoins [de telle sorte] qu'il est
impossible de rduire l'cart qui spare les biens et les res-
sources accessibles des dsirs [ ... ]. La raret n'est jamais
rduite, elle est perptuellement reconduite 1. l'vidence,
l'exognit des prfrences ne permet pas de rendre intelligible
un phnomne de cette sorte. Il faut tout au contraire se deman-
der par quel processus l'conomie marchande produit, sur
longue priode, une incitation constante dsirer toujours plus
d'objets. Cette autoreproduction endogne de la propension
consommer n'est rien de moins que le moteur qui fait fonction-
ner les socits marchandes et il demande imprativement
tre compris, surtout aujourd'hui o la dgradation de notre
cadre naturel de vie appelle son urgente transformation. Si
l'approche walras sienne fait jouer un rle primordial la raret
dans sa comprhension de la valeur, elle s'en tient une vision
strictement mcaniste du rapport entre des besoins exognes et
une production visant leur satisfaction. L'ide d'une raret
perptuellement reconduite est absente. Or, parce que cette
question est primordiale, sa non-prise en compte par la thorie
noclassique est le signe patent d'un chec
2
Trs clairement,
autre chose que l'utilit au sens strict est enjeu dans la consom-
mation, et lui donne tout son dynamisme. Analyser cet aspect
1. Ibid., p. 147.
2. Autrement dit, la question pose est celle de l'endognisation des pr-
frences individuelles. Mais une endognisation qui ait pour fondement
l'change lui-mme. En effet, le cadre walrassien peut parfaitement accueillir
une transformation exogne des prfrences. Il montrerait par exemple que,
sous l'action d'une telle transformation, le prix de tel bien augmenterait ou
diminuerait. Mais ce qui chappe la pense noclassique est le fait que les
prfrences soient le produit des relations d'change elles-mmes. Ajouter ce
lien causal modifie radicalement la logique de tout l'difice thorique parce
que l'exognit des prfrences par rapport aux relations d'change est une
hypothse centrale de la thorie de la valeur utilit. Il est impratif que l'utilit
prexiste l'change pour pouvoir prtendre l'expliquer. C'est prcisment
cette hypothse qu'il s'agit de lever.
123
L'EMPIRE DE LA VALEUR
dans sa totalit dpasse le cadre du prsent livre. Indiquons sim-
plement que l'hypothse mimtique offre des pistes intressantes
la rflexion. Elle donne voir un rapport aux objets plus ra-
liste, c'est--dire bien plus pre et conflictuel que celui prsent
dans l'analyse marginaliste. Il n'y est pas simplement question
d'utilit mais bien d'une lutte pour l'existence. C'est le cadre
adquat pour rendre intelligible ce qu'est la raret.
Pour le dire simplement, la thorie mimtique prend pour
point de dpart de ses analyses la relation autrui. Elle pose
comme premire hypothse que l'action des individus est mue
par la qute de satisfactions d'une nature essentiellement rela-
tionnelle: Pour l'essentiel, il s'agit d'tre reconnu, aim par
les autres 1. En consquence, si les individus recherchent des
objets, c'est en tant que ces objets sont des moyens qui per-
mettent d'agir sur les autres: Par les objets que nous acqu-
rons [ ... ], nous disons aux autres qui nous sommes, nous leur
signifions notre statut, notre position dans la socit, notre pou-
voir, notre attention 2. En un mot, l'individu recherche le
regard approbateur des autres. L'estime d'autrui est le but pour-
suivi qui permet celui qui en jouit de s'lever au-dessus de ses
concurrents. Tel est le secret de la consommation ostentatoire
chre Thorstein Veblen : les biens consomms sont autant de
signes qui donnent voir la valeur de leur propritaire. La
possession des richesses confere l'honneur
3
, crit-il. Dans un
tel cadre, l'utilit disparat au profit de l'effet de signe
comme le nomme Jean-Pierre Dupuy. Ce qui meut les consom-
mateurs, c'est la recherche, non pas de l'utilit, mais de ce
qu'on peut appeler gnriquement le prestige . Ce faisant, la
relation aux autres acteurs retrouve la premire place dans
l'analyse. Il faut partir des interactions pour rendre intelligible
la dynamique de la consommation. C'est l une premire piste
pour endogniser les prfrences individuelles.
1. Jean-Pierre Dupuy in Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy (dir.),
L'Enfer des choses, op. cil., p. 24.
2. Ibid.
3. Thorstein Veblen, Thorie de la classe de loisir, op. cil., p. 19.
124
LA RARET
Pour tre dveloppe, cette approche doit cependant rpondre
une question pralable centrale : comment se trouvent dter-
mins les objets porteurs de prestige? Quels sont-ils? Pour y
rpondre, plusieurs stratgies sont possibles. La premire
consiste examiner ce qu'il en est rellement du prestige dans
la socit considre. Il faut alors se tourner vers l'anthropolo-
gie et la sociologie. Le concept de groupe de rfrence a
prcisment t propos par ces dernires pour rpondre notre
question. Par dfinition, le groupe de rfrence d'un individu est
l'ensemble de personnes auquel cet individu se compare pour
valuer ses propres caractristiques ou sa propre position
sociale. Autrement dit, le groupe de rfrence sert de modle
l'individu pour dcouvrir les conventions qui rglent la dfini-
tion du prestigieux. Jean-Pierre Dupuy crit: Dans quelle
direction le Sujet tourne-t-il ses regards pour apprendre les
normes du convenable et de l'excellent, les moyens et les signes
du prestige social? C'est ce qu'en jargon sociologique on
nomme la question du groupe de rfrence 1. On reconnat
dans ce type d'interaction mimtique ce que nous avons nomm
la logique de la mdiation externe, savoir une configuration
dans laquelle la dtermination du modle chappe aux interac-
tions mimtiques. L'analyse que propose Veblen nous en offre
une illustration remarquable.
Le modle de Veblen
Veblen considre une socit de rivaux dans laquelle chacun
s'efforce de monter d'un cran sur une chelle de prestige social
qu'il suppose dfinie sans ambigut et connue de tous les
socitaires. Pour Veblen, le groupe de rfrence d'un individu
est le groupe social qui lui est immdiatement suprieur, celui
qu'il souhaite intgrer parce qu'il offre un gain de prestige tout
en n'apparaissant pas comme trop inaccessible. Toute classe
1. In Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy (dir.), L'Erifer des choses, op.
cit., p. 48.
125
L'EMPIRE DE LA VALEUR
[ ... ] rivalise avec la classe qui lui est immdiatement suprieure
dans l'chelle sociale, alors qu'elle ne songe gure se comparer
ses infrieurs, ni celles qui la surpassent de trs loin. Autre-
ment dit, le critre du convenable en matire de consommation
[ ... ] nous est toujours propos par ceux qui jouissent d'un peu
plus de crdit que nous-mmes 1. Arrtons-nous un instant ce
premier modle et examinons ce qu'il nous dit de la raret. Au
fondement de cette approche, on trouve l'hypothse d'acteurs
en lutte pour la puissance. Pour Veblen, la proprit drive
directement de cette hypothse: Le motif qui se trouve la
racine de la proprit, c'est la rivalit
2
, crit-il. Tel est le puis-
sant aiguillon qui pousse l'accumulation des richesses: se dis-
tinguer, dmontrer glorieusement [sa] puissance
3
:
La proprit a pris naissance et s'est faite institution sur des
bases qui n'ont aucun rapport avec le minimum vital. Le grand
aiguillon, ds le principe, c'est l'envie; c'est elle qui s'attache
la richesse, et nul autre mobile, sauf exception momentane,
n'en a usurp la primaut dans les stades ultrieurs de l'volu-
tion [ ... ]. Les possessions tmoignent [ ... ] de la prpondrance
du propritaire sur les autres individus de sa socit [ ... ]. La pro-
prit tient toujours du trophe; mais le progrs venant, ce tro-
phe reprsente de plus en plus les points marqus dans le jeu de
la proprit
4
L'activit du consommateur est, dans son principe mme,
tourne vers autrui qu'il s'agit d'impressionner. Pour Veblen, la
consommation a la nature d'un trophe! Elle a pour enjeu le
prestige, et pas l'utilits. Telle est l'incitation qui pousse si
vigoureusement les individus marchands acqurir toujours
plus de marchandises. Plus prcisment, comme on l'a prc-
demment not, les individus convoitent les biens de la classe
1. Thorstein Veblen, Thorie de la classe de loisir, op. cit., p. 69.
2. Ibid., p. 19.
3. Ibid., p. 18.
4. Ibid., p. 20-21.
5. Une fois que les biens accumuls sont devenus le signe distinctif de la
valeur, la possession des richesses s'arroge le caractre d'un fondement ind-
pendant et dfinitif de l'estime (ibid., p. 21).
126
LA RARET
qui leur est immdiatement suprieure dans l'chelle sociale car
l'esprit de comparaison provocante nous incite laisser plus
bas que nous les gens de notre condition 1 .
Sur de telles bases, pour autant que les hirarchies sociales
conservent une certaine stabilit au cours du temps, se forment
des habitudes de got qui, force de rptition, s'objectivent
dans des conventions donnant connatre directement ce qu'il
convient d'acheter. L'usage tabli prend la forme de normes
extrieures dictant comment se conduire si on veut s'pargner
[des] remarques dsobligeantes
2
. C'est le rgne de ce qu'on a
nomm la mdiation externe. Il peut alors sembler que les indi-
vidus agissent dsormais sans rfrence aux autres, ne prenant
en considration que ce qu'ils pensent tre sages de consommer,
conformment aux codes en vigueur. L'influence exerce par
les autres semble s'tre vanouie. Les comportements d'achat se
rapprochent alors de ceux dcrits par la thorie noclassique
l'aide d'un ordre de prfrences ou d'une fonction d'utilit exo-
gne. Ceci ne doit pas nous tonner, ni nous tromper. On a dj
not que, dans le passage de la mdiation interne la mdiation
externe, l'imitation se conserve mais se transforme dans la
mesure o le modle change de nature en s'excluant des rela-
tions sociales ordinaires. Il acquiert sa stabilit en prenant
l'apparence d'une fin en soi lgitime, recherche pour elle-
mme, exogne. Plus prcisment, pour Veblen, cette norme de
consommation qui, une priode donne, vient structurer le
rapport de l'conomie aux objets, trouve son origine dans les
habitudes de comportement et de pense en honneur dans la
classe la plus haut place tant par le rang que par l'argent [ ... ].
C'est cette classe qu'il revient de dterminer quel mode de vie
la socit doit tenir pour recevable ou gnrateur de considra-
tion
3
. C'est elle, la classe dominante, qui, par une sorte de
ruissellement du haut vers le bas, diffuse, dans toutes les
couches infrieures de la socit, la dfinition des biens
1. Ibid., p. 69.
2. Ibid., p. 77.
3. Ibid., p. 69.
127
L'EMPIRE DE LA VALEUR
prestigieux, et ce d'autant plus efficacement que la hirarchie
des rangs, n'tant pas fonde dans une diffrenciation absolue
des statuts, se prte plus aisment la contagion des opinions.
Veblen parle ce propos de socits o les distinctions de
classe sont moins nettes 1 .
Il est clair qu'une telle conception du rapport aux biens mar-
chands est aux antipodes de la pense utilitariste
2
La lutte pour
le prestige, et non l'utilit, y occupe la place primordiale. Le
principe du gaspillage ostentatoire peut conduire les acteurs
rechercher des biens n'ayant qu'une faible utilit, voire pas
d'utilit du tout. Veblen prend l'exemple des modes vestimen-
taires dont il nous dit qu'elles cherchent sduire en affichant
quelque utilit prtendue
3
, mais que ce n'est qu'un simu-
lacre
4
. Cependant, il faut souligner que le prestige et l'utilit
peuvent tout fait aller de pair. Il n'y a pas lieu de les opposer
radicalement. Il faut plutt considrer les objets marchands
comme mlant ces deux logiques, mais sans jamais perdre de
vue que la dimension honorifique ou mimtique reste, en
dernire instance, celle qui l'emporte. D'ailleurs, Veblen en
convient parfaitement. Ainsi, propos de la proprit des per-
sonnes qu'on rencontre essentiellement dans les conomies
primitives, crit-il: Pour acqurir ces sortes de biens, les
hommes ont t stimuls par 1 la tendance dominer et
contraindre; 2 l'utilit [de ces biens] comme tmoignage de
la vaillance de leur possesseur; 3 l'utilit de leurs ser-
1. Ibid.
2. Le regard d'autrui est essentiel puisque le respect de soi se fonde sur
le respect tmoign par autrui (ibid., p. 22). La logique est inverse de celle
propose par la thorie noclassique.
3. Ibid., p. 116.
4. D'o une thorie tonnante des modes changeantes . Selon Veblen,
c'est le dgot pour ces simulacres qui nous conduit les rejeter, mais au pro-
fit d'autres qui obissent aux mmes lois de la futilit. Il crit: Cette valeur
pratique pour rien, cette feinte dont nul n'est dupe, cette foncire vanit
imposent si platement notre attention les dtails innovs qu'ils nous
deviennent insupportables et que nous courons nous rfugier dans un autre
style: un autre style qui obit, lui aussi, aux injonctions de la prodigalit et de
la futilit honorables (ibid., p. 116) ;
128
LA RARET
vices). L'utilit en tant que telle
2
n'est donc pas absente de
l'analyse, mme si elle n'apparat qu'en troisime position aprs
l'exercice brut de la domination et le dsir d'ostentation. Ce rle
de l'utilit est prsent pour toutes les marchandises: L'l-
ment honorifique et l'lment de pure et simple efficacit ne se
sparent pas dans l'apprciation du consommateur. Ils se com-
binent en un agrgat d'utilit qui ne s'analyse pas
3
Ce point
doit tre soulign. rebours de Veblen, il faut mme considrer
qu'existe naturellement une certaine affinit entre utilit et pres-
tige. L'aisance, le confort, la facilit d'action que procurent les
biens utiles leur propritaire sont des traits qui se proposent
assez naturellement la valorisation du prestige en ce qu'ils
donnent voir des individus actifs et efficaces, qualits qui vont
souvent de pair avec la puissance. Certes, on ne peut aller trop
loin dans cette direction, car le prestige n'a certainement pas la
nature d'une substance qui pourrait trouver tre dfinie abs-
traitement par des caractristiques dfinissables ex ante. Il
existe assurment des carts significatifs entre la logique du
prestige et celle de l'utilit pure, mais peut-tre sont-ils moins
cruciaux et systmatiques que ne le croit Veblen.
1. Ibid., p. 37.
2. L'utilit renvoie deux types de jugement diffrents: celui, objectif, de
l'analyste qui juge de l'extrieur si une marchandise est profitable la vie des
hommes et leur bien-tre; et celui, tout diffrent, subjectif, du consomma-
teur qui dsire tel objet et, en vertu de ce dsir, le juge utile pour lui. Pour le
consommateur, peu importe le type de dpense choisi, peu importe la fin qui
dicte ce choix; c'est la prfrence mme qui fait l'utilit (ibid., p. 66). S'il
prfre le gaspillage ostentatoire, on dira simplement qu'il y trouve relative-
ment plus d'utilit que dans des formes de consommation sans gaspillage .
Tel est le point de vue de Veblen. Walras ne dit pas autre chose lorsqu'il
remarque qu'un objet dsir est, par dfinition, utile, quels que soient par
ailleurs les motifs de ce dsir. Qu'une substance soit recherche par un
mdecin pour gurir un malade, ou par un assassin pour empoisonner sa
famille, c'est une question trs importante d'autres points de vue, mais tout
fait indiffrente au ntre. La substance est utile, dans les deux cas, et peut
mme l'tre plus dans le second que dans le premier (Lon Walras, l-
ments d'conomie politique pure ou thorie de la richesse sociale, op. cit.,
p. 21). Dans cet ouvrage, selon le contexte, nous employons l'une ou l'autre
de ces deux acceptions.
3. Thorstein Veblen, Thorie de la classe de loisir, op. cil., p. 103.
129
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Pour terminer, venons-en la question de la raret elle-mme.
Sur ce point, le modle de Veblen est trs sduisant. Il com-
prend parfaitement que la rivalit est le plus puissant, le plus
constamment actif, le plus infatigable des moteurs de la vie co-
nomique
l
. La tendance l'mulation exerce une forte pression
sur les individus, toujours renouvele. Il en est ainsi parce que,
quelque niveau qu'on soit, on peut toujours souhaiter en avoir
plus
2
, contrairement l'ide d;utilit marginale dcroissante.
Cela est particulirement vrai pour des socits comme les soci-
ts marchandes, marques par une forte indiffrenciation des
individus, et dans lesquelles la possession de richesses concentre
tous les dsirs de prestige. Telle est la source de l'nergie qui
irrigue l'conomie marchande. Celle-ci a focalis la lutte sociale
3
sur la production des objets. Veblen donne une forte description
de ce dsir insatiable propre aux rivalits pcuniaires:
On aurait beau distribuer avec largesse, galit, "justice",
jamais aucun accroissement de la richesse sociale n'approcherait
du point de rassasiement, tant il est vrai que le dsir de tout un
chacun est de l'emporter sur tous les autres par l'accumulation
de biens. Si, comme on l'a parfois soutenu [les conomistes],
l'aiguillon de l'accumulation tait le besoin de moyens de sub-
sistance ou de confort physique, alors on pourrait concevoir que
les progrs de l'industrie satisfassent peu ou prou les besoins
conomiques collectifs; mais, du fait que la lutte est en ralit
une course l'estime, la comparaison provocante, il n'est pas
d'aboutissement possible
4
1. Ibid., p. 74.
2. Au fur et mesure qu'une personne fait de nouvelles acquisitions et
s'habitue au niveau de richesse qui vient d'en rsulter, le dernier niveau cesse
tout coup d'offrir un surcrot de contentement. Dans tous les cas, la tendance
est constante: faire du niveau pcuniaire actuelle point de dpart d'un nouvel
accroissement de la richesse; lequel met son tour l'individu un autre
niveau de suffisance, et le place un nouveau degr de l'chelle pcuniaire
s'il se compare son prochain (ibid., p. 23).
3. Dans ce livre, nous ne tenons pas compte des rapports de production qui
opposent salaris et propritaires des moyens de production. Nous ne consid-
rons l'conomie que dans sa dimension marchande.
4. Ibid., p. 23.
130
LA RARET
En consquence, Veblen comprend que la consommation
ostentatoire, par nature, ne peut jamais tre satisfaite. La rivalit
impose le toujours plus au fondement de la logique mar-
chande. Ce qui implique en particulier que la production ne ren-
contrera aucune limite du ct des besoins individuels. La
productivit peut crotre sans qu'il s'ensuive une quelconque
saturation du dsir d'objets. Il en est ainsi parce que les objets
n'ont pas pour finalit de satisfaire des besoins mais de produire
de la diffrenciation, tche qui demande tre toujours recom-
mence, quel que soit le niveau de dveloppement. Il faut ici
citer longuement Veblen :
Le besoin d'taler des dpenses se trouvera toujours point
nomm pour rpondre aux accroissements de la production et du
rendement, et absorber le surplus des marchandises, une fois
satisfaits les besoins les plus lmentaires [ ... ]. Le rendement va
augmentant dans l'industrie, les moyens d'existence cotent
moins de travail, et pourtant les membres actifs de la socit,
loin de ralentir leur allure et de se laisser respirer, donnent plus
d'efforts que jamais afm de parvenir une plus haute dpense
visible. La tension ne se relche en rien, alors qu'un rendement
suprieur n'aurait gure eu de peine procurer le soulagement,
si c'tait l tout ce qu'on cherchait; l'accroissement de la pro-
duction et le besoin de consommer s'entre-provoquent; or ce
besoin est indfmiment extensible'.
L'esprit de cette analyse est trs proche de celui de Sahlins
cit prcdemment, qui nous mettait en garde contre les tra-
vaux forcs perptuit auxquels les acteurs des socits mar-
chandes se sont eux-mmes condamns. Constamment, nous dit
Veblen, le dsir d'tre conduit les individus marchands
rechercher de nouveaux objets, perus comme les garants d'une
capacit suprieure de vie. C'est l une course sans fin dont la
tension ne se relche jamais. Il en est ainsi parce que, dans le
monde marchand, l'accomplissement individuel repose entire-
ment sur l'aptitude contrler les objets, les accumuler, en
possder toujours plus, pour que l'acteur affirme ainsi sa
1. Ibid., p. 74.
131
L'EMPIRE DE LA VALEUR
puissance l'gard des autres. En ce sens, la raret est bien un
rapport social. Il trouve son fondement dans la nature des liens
interpersonnels que l'conomie marchande produit et exacerbe,
savoir la rivalit mimtique. On retrouve ici une ide avance
par Paul Dumouchel : Nulle quantit de biens et de ressources
disponibles, nulle parcimonie de la nature ne dfinit la raret.
La raret est construite dans le tissu des relations interperson-
nelles [ ... ]. La raret n'existe pas ailleurs que dans le rseau
d'changes intersubjectifs qui l'a fait natre. La raret est une
organisation sociale, et rien d'autre'. Il est clair que le rapport
marchand ainsi compris avait pour destin d'entrer en contradic-
tion violente avec les limites du monde physique.
Le modle de concurrence mimtique
Le modle de Veblen fournit des lments de rflexion essen-
tiels pour qui cherche prendre ses distances l'gard du
modle utilitaire. Il dmontre que le rapport aux marchandises
peut rpondre d'autres motivations que la seule qute d'uti-
lit: en tant que biens prestigieux, les marchandises sont l'objet
d'pres rivalits. Cependant, la conception de Veblen reste ina-
cheve dans la mesure o il ne dfinit le prestige que dans le
contexte d'une socit dj hirarchise, une socit dans
laquelle chacun sait reconnatre, sans ambigut, quelle classe
il appartient et quelles classes lui sont suprieures et infrieures.
Dans ce contexte qui est celui de la mdiation externe, les biens
prestigieux sont les biens consomms par les classes suprieures
selon une logique d'imitation verticale qui fait de la classe la
plus haut place le modle de rfrence. C'est elle qui dter-
mine les normes gnrales du bon got et qui fait connatre ce
que sont les biens prestigieux. Cette stratgie d'analyse permet
de nombreuses avances intressantes mais elle reste prison-
nire d'un point de vue qui rifie le prestige en l'identifiant
1. Paul Dumouchel, in Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy (dir.),
L'Enfer des choses, op. cit., p. 1'64.
132
LA RARET
une dfinition particulire, fixe une fois pour toutes par la
classe dominante. Au regard de cette perspective, il n'est de
mouvement que vertical, le long de l'chelle sociale, soit vers le
haut, soit vers le bas. L'incompltude de cette logique verticale
apparat nettement dans le fait qu'elle ne sait rien dire sur le
comportement de la classe dominante elle-mme: n'ayant pas
de modle copier, elle chappe au modle rivalitaire. Aussi,
pour caractriser les gots de la classe oisive, Veblen procde-
t-il autrement. Il recourt une explicitation socio-historique de
ses habitudes de pense qui mobilise la notion de culture prda-
trice et invoque les forces d'une tradition qui ne s'est jamais
teinte 1. L'argument de rivalit ne vaut que pour l'analyse de
la consommation des classes infrieures. Pourtant, la classe
dominante n'chappe pas la rivalit. Faut-il alors considrer
qu'elle-mme se scinde en plusieurs sous-groupes rivaux, eux-
mmes hirarchiss? Faut-il, en consquence, introduire
l'hypothse d'un sous-groupe qui dominerait les autres sous-
groupes et qui donnerait le la en matire de consommation
toute la classe dominante? Il en serait ainsi qu'on serait recon-
duit la mme question pour ce qui est des penchants de ce
sous-groupe dominant. l'vidence, cette stratgie d'analyse
mne une impasse. Une autre perspective doit tre adopte. Il
faut abandonner le modle vertical de Veblen qui atteint ici ses
limites pour se poser une question entirement nouvelle: qu'en
est-il de la rivalit pour le prestige au sein d'un groupe horizon-
tal, c'est--dire un groupe qui n'est pas dj hirarchis? Il
s'agit de comprendre comment, dans un groupe d'gaux, se
forment les rgles du prestige. La question est difficile par le
fait qu'il n'est plus possible, comme dans le modle de Veblen,
d'y fixer a priori le modle imiter et d'en dduire les rgles
du prestige partir de l'analyse socio-historique des habitudes
de celui-ci.
Pour rpondre ce nouveau dfi, notre point de dpart demeure
l 'hypothse mimtique selon laquelle est prestigieux aux yeux
du sujet ce qui est dsir par le modle. Mais, dsormais, le
1. Thorstein Veblen, Thorie de la classe de loisir, op. cit., p. 27.
133
L'EMPIRE DE LA VALEUR
modle n'est plus dtermin par le critre exogne de la sup-
riorit sociale, comme chez Veblen. Dsormais, n'importe qui,
dans le groupe, peut prtendre au rle de modle. Ce faisant, on
passe de la mdiation externe la mdiation interne, du groupe
vertical au groupe horizontal. Il s'ensuit une modification en
profondeur de la logique collective. Parce que le modle n'est
plus exogne, son dsir n'est plus dfini a priori: comme celui
du sujet, il se dduit de l'imitation d'un modle. Telle est la
complexit du modle mimtique.
Dans le cadre de cette interaction, une premire proprit
s'impose qui va jouer par la suite un rle central, savoir la
nature autorfrentielle du prestige au sens o l'objet presti-
gieux que tous recherchent peut tre absolument n'importe
lequel. Le prestige ne renvoie aucune qualit substantielle par-
ticulire, dfinissable antrieurement aux relations interperson-
nelles, mais simplement la logique mimtique des dsirs.
Autrement dit, l'objet devient la cration du dsir] . Il
merge de l'interaction qui le faonne entirement son image.
Pour le comprendre, examinons le cas des doubles mimtiques,
savoir deux individus A et B parfaitement symtriques, cha-
cun prenant l'autre comme modle. Dans une telle structure,
chacun pie le comportement de l'autre pour dcouvrir o se
cache le dsirable. Supposons, dans un premier temps, que
l'individu A, sans raison, fasse un mouvement et que ce mou-
vement sans intention soit interprt faussement par l'individu
B comme ayant pour vise de saisir l'objet X. Dans ces condi-
tions, en rponse la convoitise suppose de l'individu A,
l'individu B, par imitation, se mettra, dans un second temps,
dsirer effectivement l'objet X en question. Or un tel dsir
dsormais manifeste ne manquera pas, dans un troisime temps,
d'affecter en retour l'individu A qui voudra galement possder
l'objet X dsign par son modle comme tant dsirable. Puis,
quatrime temps, ce dsir chez l'individu A viendra confirmer
l'interprtation initiale de l'individu B : l'individu A est bien
1. Jean-Pierre Dupuy, in Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy (dir.),
L'Enfer des choses, op. cit., p. 74.
134
LA RARET
attir par l'objet X et l'objet X est bien dsirable. In fine, cin-
quime temps, merge une situation o les deux individus dsi-
rent le mme objet X, et ceci indpendamment de ce qu'est
effectivement l'objet X. La dsirabilit de X s'impose comme le
rsultat de l'interaction, parce qu'il est l'objet des dsirs
conjoints des deux protagonistes. Il faut en conclure que
l'objet X est une pure cration de l'interaction mimtique.
Chacun contemple la preuve absolue de la ralit et de la
valeur de l'objet dans le dsir de l'Autre 1. Le bien prestigieux
a une nature purement autorfrentielle conforme ce modle :
peu importe ce qu'il est rellement, ce qui compte est le fait
d'tre considr par tous comme prestigieux et dsir comme
tel. Comme l'objet X dans notre exemple, le bien prestigieux est
une invention de l'interaction mimtique. Si chacun dsire selon
le dsir de l'autre, n'importe quel objet est mme de les satis-
faire ds lors que ce dsir est partag. Le fait mme d'tre par-
tag assure la dsirabilit de l'objet considr.
Une deuxime proprit essentielle de la dynamique mim-
tique dcoule directement de nos hypothses: plus un objet est
dsir par les autres, plus la rivalit son endroit est forte, plus
il est dsirable. Aussi, dans un monde rgi par le mimtisme, la
rivalit s'impose-t-elle comme un marqueur de la valeur des
choses. On a dj rencontr cette proprit trs paradoxale au
chapitre prcdent. Nous la rencontrerons encore. Elle joue un
rle crucial par le fait qu'elle introduit une profonde instabilit
dans la logique concurrentielle. Contrairement aux dsirs struc-
turs par l'utilit, encore appels besoins, le dsir mimtique est
crateur de rtroactions positives, ce qui peut le rendre terrible-
ment dstabilisant et destructeur. Il peut conduire un emballe-
ment mimtique, ayant pour apothose l'unanimit de tous.
Autrement dit, la logique du dsir mimtique conduit une
valorisation paradoxale de l'obstacle pour lui-mme: [Le
sujet] choisira donc ses modles sur la base non de leurs quali-
ts positives, mais de leur inaccessibilit. Le dsir mimtique
commence par transformer les modles en obstacles, il finit en
1. Ibid., p. 70.
135
L'EMPIRE DE LA VALEUR
transformant les obstacles en modles 1. Quelques auteurs ont
explor cette perspective d'analyse qui tablit une dpendance
positive entre dsir et obstacle. C'est le cas en particulier de
Georg Simmel qui en fait le fondement de sa thorie du dsir:
Loin qu'il soit difficile d'obtenir les choses pour la raison
qu'elles sont prcieuses, nous appelons prcieuses celles qui
font obstacle notre dsir de les obtenir. Le dsir venant se bri-
ser ou se bloquer dessus, elles y gagnent une signification que
jamais une volont sans entrave n'aurait t incite leur recon-
natre
2
En consquence, il faut inverser la causalit des co-
nomistes qui faisaient de la raret le point d'origine de la
rivalit. S'il en tait ainsi, une production plus grande diminue-
rait la raret et attnuerait la rivalit. Comme on l'a vu, il n'en
est rien. C'est bien la rivalit qui est premire et c'est elle qui
est au fondement de la raret pense comme rapport social. La
rivalit recherche la raret pour en faire un instrument de puis-
sance. C'est un progrs dcisif par rapport toute pense co-
nomique que de faire de la raret un fruit de la rivalit, et non
de la rivalit un produit de la raret
3
Il s'agit constamment de
susciter de nouveaux dsirs sur de nouveaux objets. L'hypo-
thse mimtique nous conduit directement au cur de la raret ;
elle en explicite le principe bien mieux que la conception mar-
ginaliste.
Il dcoule de cette analyse que, dans un monde d'gaux en
lutte pour le prestige, chacun est l'afft des dsirs de l'autre
afin de dcouvrir les objets producteurs d'influence et de pres-
tige. Comme l'illustrent les phnomnes de mode, n'importe
quelle diffrence objectivement insignifiante peut se trouver
soudainement investie, par la logique du mimtisme, d'une
importance considrable. De mme, les stratgies de distinction
tudies par les analystes du snobisme ont cette particularit de
sans cesse faire merger de nouvelles diffrenciations sur les-
1. Ibid., p. 95.
2. Georg Simmel, Philosophie de ['argent, op. cit., p. 32.
3. Jean-Pierre Dupuy, in Paul Dumouchelet Jean-Pierre Dupuy (dir.),
L'Enfer des choses, op. cit., p. 42.
136
LA RARET
quelles convergent toutes les convoitises 1. Plus gnralement, le
monde de la rivalit mimtique est un monde soumis de per-
ptuelles innovations ayant pour finalit de se diffrencier des
autres en modifiant les rgles du prestige son propre profit. De
ce point de vue, le modle mimtique se distingue du modle
walras sien par le fait qu'il traite d'une valeur qui ne s'est pas
encore fixe, une valeur en gestation. Les rtroactions positives
expriment cette dynamique de la valeur en procs. Dans le
modle walrassien, au contraire, la valeur est donne ds l' ori-
gine dans les jugements personnels d'utilit; elle prexiste aux
interactions qui n'ont pour finalit que de la faire connatre. Le
modle mimtique cherche rendre intelligible la lutte conti-
nuelle dont la valeur est l'objet. Il s'agit de dcrire un monde de
valeurs d'usage en perptuel ramnagement sous l'impulsion
des rivalits mimtiques.
Notons qu'on trouve, chez certains conomistes spcialiss
dans l'tude de la concurrence, des rflexions qui dlaissent une
stricte optique walras sienne pour s'intresser aux stratgies de
diffrenciation des produits. C'est le cas d'Edward Chamberlin.
Son concept de concurrence monopolistique a pour point de
dpart une observation banale: il est dans l'intrt du vendeur
de diffrencier son produit afin d'tre le seul le proposer. De
cette manire, chaque vendeur a le monopole absolu de son
produit
2
. La cration de marques est le moyen par excel-
lence qu'utilisent les producteurs cette fin. Pour autant,
l'invention de marques ne supprime pas le jeu des forces
concurrentielles car le vendeur reste soumis la concurrence
des produits de substitution
3
:
Le propritaire d'une marque de fabrique ne possde videm-
ment pas un monopole ou un degr quelconque de monopole sur
1. La nature de l'honneur est de demander des prfrences et des distinc-
tions , Montesquieu, De l'esprit des lois, livre III, chapitre VII (Paris, Clas-
siques Garnier, 20 Il).
2. Edward Chamberlin, La Thorie de la concurrence monopolistique. Une
nouvelle orientation de la thorie de la valeur, Paris, PUF, 1953, p. 7.
3. Ibid., p. 7.
137
L'EMPIRE DE LA VALEUR
le domaine plus vaste o cette marque est en concurrence avec
d'autres. Un monopole de "Lucky Strike" ne constitue pas un
monopole des cigarettes, car il n'y a aucun degr de contrle de
l'offre des autres marques substituables 1.
Le recours une marque vise crer du prestige susceptible
d'attirer les dsirs des consommateurs. Chamberlin souligne
la valeur considrable de prestige de noms tels que: "Ivory",
"Kodak", "Uneeda", "Coca-Cola", "Old Dutch" pour n'en citer
que quelques-uns
2
. Cette citation qui date de 1933 montre que
certaines marques peuvent avoir une dure de vie extrmement
longue. Pour crer une marque, le vendeur utilise massivement
la publicit. Celle-ci est, en son essence, de nature mimtique.
Elle joue principalement sur la force irrpressible de l'envie:
L'envie pour l'autre prcde et dtermine le dsir objectal,
elle ne le suit pas
3
La prsence de ces marques nous
confronte un phnomne nouveau, savoir l'aptitude de cer-
tains capter le dsir mimtique
4
leur profit. L'offreur qui a
vu les dsirs d'une partie des consommateurs converger mim-
tiquement sur son produit cherche, au travers de la cration
d'une marque, prenniser cette situation et s'en rendre
matre. Il s'agit d'instituer la marque comme attestant ce qu'il
est convenable de consommer. Russir une telle mtamorphose
constitue pour ceux qui y parviennent un formidable atout dans
les rivalits concurrentielles. En assurant la perptuation de la
dsirabilit de leur bien, les voil qui chappent, pour un temps,
aux incertitudes des luttes mimtiques. Cependant, comme le
voit bien Chamberlin, cette situation ne saurait jamais tre
acquise pour toujours. Constamment, des concurrents offrent de
nouveaux produits susceptibles de remettre en cause le statut
acquis en produisant de nouveaux dsirs et de nouvelles
1. Ibid., p. 71.
2. Ibid., p. 67.
3. Jean-Pierre Dupuy, in Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy (dir.),
L'Enfer des choses, op. cit., p. 47.
4. Sur la notion de capture du dsir, se reporter Frdric Lordon, Capi-
talisme, Dsir et Servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique ditions,
2010.
138
LA RARET
marques. Il s'ensuit une rpartition constamment mouvante des
dsirs sans que jamais les rivalits ne s'teignent.
Retour sur la valeur
Aprs les chapitres 1 et II consacrs la critique des thories
de la valeur, le prsent chapitre s'est engag dans une voie nou-
velle, celle de la construction d'une conception conomique
alternative, libre de l'hypothse substantielle. Il s'est agi, dans
un premier temps, de mettre en doute l'vidence d'un monde
d'objets utilitaires la disposition des individus. Pour ce faire,
nous avons considr que les individus marchands ne sont plus
clos sur eux-mmes, la manire de l'Homo conomicus, mais
en rivalit avec les autres. Ils appartiennent un groupe et
cherchent, par l'achat des valeurs d'usage, accrotre leur pres-
tige, c'est--dire leur puissance. Cette hypothse transforme en
profondeur notre comprhension du rapport aux marchandises.
En plaant la lutte pour le prestige au cur des stratgies de
consommation, cette interprtation nous conduit considrer la
possibilit d'une dynamique endogne de diffrenciation des
valeurs d'usage, sans cesse renouvele au fur et mesure que
les distinctions antrieures se rvlent obsoltes. Parce que ce
processus repose sur des prfrences endognes, fonction des
interactions mimtiques, il nous a t possible d'expliquer le
phnomne d'une raret perptuelle, ncessitant de la part des
acteurs une tension constante, un effort sans relche dirig vers
l'acquisition de nouveaux signes de distinction. C'est ce prix
que les acteurs marchands se maintiennent dans l'chelle
sociale.
Nous avons construit cette analyse sur la base d'un modle
dans lequel tous les acteurs se dterminent mimtiquement dans
le cadre de relations strictement horizontales. Autrement dit, il
n'y existe aucune puissance dj constitue qui viendrait dis-
tordre l'isotropie des interactions. Seule la mdiation interne y
est prise en compte. Aucune diffrenciation sociale, qui vien-
drait fournir aux acteurs des repres exognes, n'y est prsente.
139
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Un tel modle ne saurait se comprendre comme une description
de ce qui est. En effet, par nature, la ralit sociale est faite de
puissances, d'institutions, de rfrences qui affectent fortement
les acteurs dans leurs choix, Ce modle est cependant trs utile
en tant qu'idaltype permettant de dgager les proprits gn-
rales du mcanisme imitatif. C'est ainsi qu'il faut l'utiliser,
comme une abstraction qui nous a permis de comprendre la
qute de diffrenciation des acteurs, d'autant plus forte que
l'conomie est faite d'gaux,
Pour aller plus loin dans l'analyse de la raret, il est nces-
saire d'introduire le rle des institutions, ces puissances
capables de produire des diffrenciations prennes qui struc-
turent le mimtisme, la manire des marques ou des normes
de consommation. C'est par elles qu'on peut rendre compte du
passage de la mdiation interne la mdiation externe. Tout au
long du prsent chapitre, c'est principalement la question de
l'utilit qui a retenu plus particulirement notre attention. L'uti-
lit est l'institution no classique par excellence en ce qu'elle
transforme en profondeur le rapport des individus aux marchan-
dises. Par le biais de l'utilit s'institue une relation aux biens
caractrise par des rtroactions ngatives (negative feedbacks),
autrement dit apte viter les emballements mimtiques. Cette
stabilit a pour fondement le fameux principe de l'utilit margi-
nale dcroissante qui nous dit que le dsir d'objet diminue au
fur et mesure que crot la quantit acquise, ce qui assure
terme sa saturation. Cette hypothse, dite de convexit des
choix, est trs largement retenue par la thorie noclassique.
Elle dcrit un mcanisme important de stabilisation des compor-
tements de consommation. Soulignons nouveau que l'hypo-
thse de l'utilit et l'hypothse mimtique ne sont, nos yeux,
nullement contradictoires. La recherche d'utilit ne signifie en
rien une disparition du mimtisme mais simplement le fait
qu'un certain modle de consommation a acquis la force d'une
norme. Aussi, dsormais, est-ce elle qui indique aux acteurs
quels biens il importe d'acqurir pour affirmer sa qualit sociale
au regard de tous. Autrement dit, la motivation honorifique et la
motivation utilitaire peuvent parfaitement aller de pair: le pres-
140
LA RARET
tige peut s'investir dans l'utilit. Veblen nglige ce fait parce
qu'il dfend une conception troite du prestige qu'il identifie
unilatralement ce que la culture prdatrice 1 dfinit
comme tel. Cette rification du prestige lui fait passer ct de
la nature essentiellement mimtique et changeante du prestige,
ce qui veut dire avant tout contingente aux intrts qui, un
moment donn, ont t en mesure de capter les dsirs indivi-
duels. Ce faisant, il oublie une de ses leons les plus essen-
tielles : ce sont les intrts dominants qui dterminent ce qui est
digne, honorable, noble
2
N'est-ce pas lui qui crit: Dans les
faits qui sont notre porte, les traits qui ressortent, qui
prennent de la ralit, sont ceux qu'claire 1'intrt dominant de
l'poque. N'importe quelle base de distinction peut paratre
irrelle qui envisage ordinairement les faits d'un autre point
de vue et les valorise pour d'autres fins
3
On ne saurait mieux
exprimer la contingence de l'valuation: derrire les normes du
prestige et de la reconnaissance sociale, il y a des intrts et des
puissances capables de faire entendre ces intrts en captant le
dsir d'autrui. Il importe maintenant d'aborder le cur de notre
analyse: le fait montaire.
1. Dans son introduction la Thorie de la classe de loisir, Raymond Aron
note que, chez Veblen, la rivalit jalouse exprime un penchant de l'homme
occidental tel que l'ont fait des millnaires d'histoire, tel que le refont chaque
jour les institutions charges des manifestations symboliques des instincts pr-
dateurs (Thorstein Veblen, Thorie de la classe de loisir, op. cit., p. xxxm).
2. Un acte honorifique, y bien regarder, n'est pas grand-chose, ni
mme rien d'autre qu'un acte d'agression reconnu victorieux; et quand
l'agression signifie conflit avec hommes et btes, l'activit honorifique, c'est
surtout, c'est essentiellement la manire forte (ibid, p. 14).
3. Ibid., p. 8.
DEUXIME PARTIE :
L'INSTITUTION DE LA VALEUR
Chapitre IV
La monnaie
Par quel mcanisme l'ordre marchand accde-t-il l'exis-
tence? Telle est la question centrale laquelle est confronte la
thorie conomique. On en a dj soulign toute la complexit.
Dans une conomie fonde sur la sparation marchande, c'est-
-dire sur l'autonomie des dcisions prives de production et
d'change, comment est-il possible de rendre les actions des uns
et des autres cohrentes? Quel sens faut-il mme donner la
notion de cohrence? Il nous appartient maintenant de rpondre
ces questions. La thorie conomique noclassique doit pour
une large part sa rputation la qualit des rponses qu'elle a
apportes ces mmes questions. Ces rponses ont pour point
de dpart des individus en qute d'objets utiles. Dans un tel
cadre, c'est par le biais de la notion clef d'quilibre que la tho-
rie conomique noclassique rend compte de la formation de
l'ordre marchand, savoir l'existence d'un vecteur de prix tel
que les dsirs d'objets de tous les acteurs soient rendus compa-
tibles : aux prix d'quilibre, la satisfaction de chaque agent est
son maximum 1 et l'offre est gale la demande pour chaque
bien. Rappelons que, dans la conception walrassienne de la
concurrence, les acteurs sont preneurs de prix, ce par quoi il faut
entendre qu'ils acceptent l'autorit du secrtaire de march dans
la fixation de ceux-ci sans qu'eux-mmes interviennent. Tous
souhaiteraient que les prix des biens qu'ils achtent soient plus
faibles et que ceux des biens qu'ils vendent soient plus levs.
1. S'il s'agit d'un consommateur, sa satisfaction est mesure par son uti-
lit; s'il s'agit d'un producteur, par son profit.
145
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Mais les prix chappent leur juridiction. C'est le march qui
dcide. partir de ces prsupposs, les thoriciens de l'qui-
libre gnral ont dmontr que les intrts privs pouvaient tre
rendus compatibles. La dmonstration de ces rsultats constitue
une russite remarquable: L'ide selon laquelle un systme
social m par des actions indpendantes en qute de valeurs dis-
tinctes connat un tat d'quilibre cohrent [ ... ] est assurment
la contribution intellectuelle la plus importante faite par la pen-
se conomique la comprhension gnrale des processus
sociaux 1. }}
Les chapitres prcdents se sont efforcs de rendre ce rsul-
tat moins tonnant en faisant apparatre en pleine lumire les
puissantes institutions caches}} sur lesquelles il repose, en
premier lieu l'institution d'un rapport aux marchandises
strictement utilitaire. Mais une autre institution doit maintenant
tre considre avec attention: la centralisation du lien mar-
chand autour du secrtaire de march. En effet, rappelons que
l'ordre marchand, tel que l'quilibre gnral nous le donne
comprendre, suppose l'action simultane de tous les acteurs
sous l'gide d'un mcanisme unique intgrant tous les mar-
chs de biens. Ce cadre thorique interdit les actions isoles,
circonscrites certains marchs. Dans le chapitre l, le terme de
conception totalisante }} a t propos pour qualifier cette
dmarche si particulire: le secrtaire walras sien totalise en un
lieu unique toutes les dcisions partir desquelles il produit une
cohrence globale, qui apprhende simultanment tous les
acteurs et tous les marchs. Cette manire de concevoir la rgu-
lation marchande s'oppose au sens commun qui a contrario voit
la spcificit de l'ordre marchand dans son aptitude autoriser
des actions locales, sans concertation pralable avec autrui, ce
par quoi les ides mme d'autonomie individuelle et de
sparation marchande prennent tout leur sens. C'est prcisment
sa capacit accepter des stratgies innovantes, en rupture avec
1. Kenneth J. Arrow et Frank Hahn, General Competitive Analysis, San
Francisco, Holden-Day, 1972 (cit chez Franz Hahn, Equilibrium and
Macroeconomies, op. cit., p. 64).
146
LA MONNAIE
les comportements passs, sans crise majeure, mme si ces inno-
vations provoquent temporairement des dsquilibres, qui fait
toute la puissance du rapport marchand, ce qu'on nomme gn-
ralement sa flexibilit. Certes, cette proprit est insuffisante
pour caractriser elle seule l'ordre marchand. Il faut lui ajouter
l'existence de mcanismes de rquilibrage faisant en sorte que
ces dsquilibres locaux se rsorbent et ne dgnrent pas en
une crise globale. Mais c'est bien dans l'articulation de ces deux
processus que doit tre cherche la vrit de l'ordre marchand:
libert ex ante et quilibrage ex post. Sur ce point, la thorie no-
classique a chou. Son cadre thorique ne lui a pas permis de
produire une analyse satisfaisante des situations hors quilibre,
ce qu'on appelle la question de la stabilit!. notre sens, cette
limite n'est pas due une insuffisante habilet des conomistes,
mais une faille conceptuelle fondamentale: l'exclusion de la
monnaie. Pour les acteurs noclassiques, la socit n'a qu'un
seul visage, celui des prix que le secrtaire de march crie tous
les acteurs simultanment. C'est par leur intermdiaire exclusi-
vement qu'ils font l'exprience de leur appartenance au groupe
marchand. C'est sous l'gide du secrtaire de march que se
construit l'accord universel des individus, partir de quoi
l'existence sociale de chacun se trouve reconnue. notre sens,
cette vision hypercentralise ne rend pas compte de ce qu'est
une conomie marchande. Elle a d'ailleurs fait l'objet de nom-
breuses critiques
2
Pour le dire schmatiquement, la conception
alternative que nous dfendons substitue la monnaie au secr-
taire de march : ce qui rend socialement valide une action n'est
pas sa compatibilit avec l'quilibre gnral calcul par le
secrtaire de march, mais l'utilisation de la monnaie. Il s'ensuit
la possibilit d'une vritable dcentralisation: chacun peut agir
de manire individuelle, sans l'accord pralable des autres
1. Pour le traitement complet de cette question, se reporter au chapitre II.
2. Au sein d'une littrature critique trs vaste, signalons Philippe de Vill
(<< Comportements concurrentiels et quilibre gnral: de la ncessit des ins-
titutions , conomie applique, tome XLIII, nO 3, 1990, p. 9-34) sur la com-
paraison entre le secrtaire de march et le Lviathan de Thomas Hobbes.
147
L'EMPIRE DE LA VALEUR
socitaires, pour autant qu'il possde les moyens de paiement
lui permettant de financer sa stratgie. Dans un tel cadre, l'exis-
tence d'actions localises ne soulve aucune difficult. Le rle
des marchs et de la concurrence est conserv mais comme un
mcanisme de validation ex post permettant ou non la rsorp-
tion des dsquilibres. En consquence, la concurrence y appa-
rat comme un problme distinct de celui de la valeur. Dans le
cadre de l'quilibre gnral, l'action d'un individu requiert
imprativement la validation du secrtaire de march. Dans la
ralit, la monnaie y suffit. Examinons ces points.
Monnaie versus valeur: les lments d'un dbat
Dans notre approche, le rapport aux marchandises est tou-
jours un rapport montaire, suivant la trs classique formule de
Marx : M - A, o M reprsente la marchandise et A, l'argent.
Ce qui revient dire que, dans ce cadre thorique, la monnaie
s'impose comme l'institution premire des conomies mar-
chandes. La monnaie fonde l'conomie marchande. Pour qu'un
achat ait lieu, il faut et il suffit que l'acheteur possde la quan-
tit de monnaie adquate. Si les deux protagonistes en sont
d'accord, la transaction se ralisera mme si elle se fait un
prix distinct du prix d'quilibre walrassien. En consquence,
contrairement au modle walras sien, il n'est pas ncessaire pour
agir que l'action individuelle rencontre l'accord universel des
socitaires valid par le secrtaire de march. Le sceau de la
monnaie suffit valider une action. Il s'ensuit, pour celui qui la
possde en quantit suffisante, une trs large autonomie strat-
gique. En ce sens, dans le cadre thorique qui est propos, mon-
naie et sparation marchande se trouvent indissolublement lies.
Parce que les actions montaires ne supposent pas l'quilibre,
les changes de biens raliss ne se compensent pas ncessaire-
ment, au sens o, pour chaque agent, les achats de biens ne sont
pas gaux en valeur aux ventes de biens. Ce dsquilibre se tra-
duit par le fait que certains agents vont obtenir un supplment
de monnaie alors que d'autres puiseront dans leurs avoirs mon-
148
LA MONNAIE
taires. Par exemple, lorsque l'individu 1 achte l'individu 2 un
bien a au prix Pa' il dpense Pa alors que l'individu 2 obtient Pa'
Cette situation trouve dans les comptes des agents sa pleine
expression: l'individu 1 subit un dficit de valeur Pa alors que
l'individu 2 connat un excdent de mme montant. Dans une
conomie montaire simplifie, sans financement, le dficit
quivaut une sortie de monnaie, encore appele dcaissement,
et l'excdent, une entre de monnaie, encore appele encais-
sement. Par convention, nous crirons positivement les encais-
sements et ngativement les dcaissements, savoir:
Compte de
l'individu 1 :
Compte de
l'individu 2 :
Dans une telle conomie, toute action se traduit par des mou-
vements de monnaie, encaissements et dcaissements, dont la
somme est ncessairement nulle. Pour les changes correspon-
dant l'quilibre gnral, il s'ajoute, en outre, que chaque
compte individuel est quilibr, puisque chaque agent achte
autant qu'il vend. En consquence, tous les soldes montaires
sont nuls 1.
Il semble qu'avec de telles hypothses l'conomie se trouve
remise l'endroit. L'analyse devient beaucoup plus aise et
naturelle . Qu'est-ce qu'une conomie marchande? C'est
une conomie dans laquelle les acteurs sont la recherche de
monnaie. Pourquoi? Parce que la monnaie est l'instrument par
excellence de la puissance marchande en tant qu'elle ouvre
l'accs toutes les marchandises. Autrement dit, le monde
marchand possde un dsir-matre
2
, le dsir d'argent, qui
englobe tous les autres dsirs. La fascination pour l'argent est
au fondement de toutes les conomies marchandes. Elle en est
1. Inversement, il ne suffit pas que tous les soldes individuels soient nuls
pour avoir l'quilibre gnral!
2. Frdric Lordon, Capitalisme, Dsir et Servitude, op. cil.
149
L'EMPIRE DE LA VALEUR
l'nergie primordiale, jamais puise. l'vidence, avancer une
telle proposition n'a rien de rvolutionnaire. Elle ne surprendra
personne. Aucun fait social n'est sans doute mieux tabli que
l'illimitation du dsir que la monnaie suscite. La voie qui mne
l'intelligibilit de la ralit conomique doit, selon nous,
prendre, pour point de dpart, la reconnaissance de cette ralit :
l'attrait absolu qu'exerce la monnaie. En cela, la prsente ana-
lyse se distingue radicalement des thories de la valeur. Pour les
thoriciens de la valeur, ce qui est premier est le dsir pour les
objets. La valeur, selon eux, est intrinsque aux objets rares,
savoir les objets utiles et dont la quantit est limite. C'est le
point de dpart de Walras. La monnaie n'apparat que dans un
second temps, comme un instrument facilitant l'accs aux mar-
chandises, raison pour laquelle cette conception de la monnaie
sera dite instrumentale . Dans notre cadre d'analyse, les
acteurs dsirent d'abord de la monnaie et, pour l'obtenir, se font
producteurs ou commerants. La logique est inverse : le dve-
loppement de la production marchande n'est que la cons-
quence de la qute montaire.
Cette prsentation rapide dmontre nouveau la place
qu'occupent les questions lies du dsir et de l'intrt dans ces
rflexions. Elles sont au cur du dbat qui oppose approches
par la valeur et approches par la monnaie. Du ct de la thorie
noclassique prvaut une conception troite de l'intrt indivi-
duel identifi strictement l'acquisition de choses utiles. La
richesse y est toujours relle, faite de marchandises. Sur de
telles bases, comment pourrait-on vouloir de la monnaie? Com-
ment expliquer qu'on puisse changer un bien utile contre un
disque de mtal sans utilit ? Cela dfie le bon sens utilitariste.
La rponse apporte massivement par la thorie conomique
noclassique consiste accepter la monnaie mais en la limitant
strictement son rle d'intermdiaire des changes. Telle est la
place, et la seule place, qui lui est dvolue dans l'difice no-
classique. Elle n'est admise qu'en tant qu'elle permet l'obten-
tion de biens utiles. Dans ce cadre conceptuel, le dsir que
suscite la monnaie pour elle-mme se trouve entirement banni,
car, aux yeux de la rationalit utilitariste, il s'analyse au mieux
150
LA MONNAIE
comme une anomalie, au pis comme une monstruosit. Dans
tous les cas, il doit tre combattu. Pour dcrire l'attitude des
conomistes son gard, le qualificatif le plus adquat est celui
de voltairien , que propose Franois Simiand l, au sens o il
s'agit de dnoncer une croyance idoltre, sans fondement. La
monnaie y est pense la manire d'une fausse idole dont le
rationaliste a pour mission de dvoiler toute la perversion.
Parce que contraire la nature humaine, le dsir de monnaie
pousse les hommes des comportements aberrants. Ce thme
est dj prsent chez Aristote dans sa critique de la mauvaise
chrmatistique qui corrompt l'ordre social. Cette conception a
t galement prsente avec beaucoup de brio par Keynes
dans un texte dit en 1930, intitul en franais Perspectives
conomiques pour nos petits-enfants . Anticipant sur des
temps d'abondance dont il prophtise l'arrive dans plus d'un
sicle, Keynes crit :
L'amour de l'argent comme objet de possession, qu'il faut dis-
tinguer de l'amour de l'argent pour se procurer les plaisirs et ra-
lits de la vie, sera reconnu pour ce qu'il est: un tat morbide
plutt rpugnant, l'une de ces inclinaisons demi criminelles et
demi pathologiques dont on confie le soin en frissonnant aux
spcialistes des maladies mentales
2
Dans cette analyse se trouve exprim avec force et clart le
point de vue de la morale utilitariste : la qute de monnaie pour
elle-mme relve de l'aberration mentale. Cependant, s'il par-
tage ce diagnostic fondamental, Keynes se spare de la pense
conomique dominante en ce que, pour autant, il ne cherche pas
en nier la ralit. Mme s'il juge ce penchant dgotant , il
lui faut faire avec. ses yeux, ce comportement, l'instar
1. Franois Simiand (dans La monnaie ralit sociale , Annales sociolo-
giques, srie D, fascicule l, 1934) considre trois stades de la connaissance:
le premier stade est celui de la croyance simple, le second est le stade vol-
tairien de critique de la superstition et le troisime reconnat le rle positif
des croyances (cf p. 228).
2. John Maynard Keynes, Perspectives conomiques pour nos petits-
enfants , in Essais sur la monnaie et l'conomie, Paris, Payot, 1978, p. 138.
151
L'EMPIRE DE LA VALEUR
d'autres tout aussi problmatiques comme l'avarice, l'usure et
la prudence , trouve son origine dans les dures contraintes que
la raret fait subir aux hommes. Lorsque l'humanit atteindra
l'ge d'abondance et de l'oisivet , ces comportements dis-
paratront. En ce sens, ces comportements peuvent tre dits
rationnels mais d'une rationalit contingente un certain tat
conomique dans lequel les besoins fondamentaux ne sont pas
encore satisfaits :
Nous maintenons tout prix actuellement [toutes sortes
d'usages sociaux et de pratiques conomiques touchant la
rpartition de la richesse et des rcompenses et pnalits cono-
miques], malgr leur caractre intrinsquement dgotant et
injuste parce qu'ils jouent un rle norme dans l'accumulation
du capital [.,,]. Pendant au moins un sicle de plus, il nous fau-
dra faire croire tout un chacun et nous-mmes que la loyaut
est infme et l'infamie loyale, car l'infamie est utile et la loyaut
ne l'est point. Avarice, Usure et Prudence devront rester nos
divinits pour un petit moment encore. Car elles seules sont
capables de nous faire sortir du tunnel de la ncessit cono-
mique pour nous mener la lumire dujour
l
.
Cette attitude est propre l'analyse keynsienne et en illustre
bien l'ambivalence. En tant que libral, Keynes adhre aux ana-
lyses utilitaristes qui voient dans le dsir d'argent pour l'argent
une aberration, mais ce rejet moral, voltairien, ne le conduit pas
en contester l'existence lorsqu'il s'agit pour lui de comprendre
l'conomie de son temps. Le scientifique ne doit-il pas consid-
rer les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'il voudrait
qu'elles soient? De ce point de vue, moins comprhensible est
l'attitude noclassique qui refuse d'admettre, dans ses modles,
la ralit du dsir d'argent pour lui-mme. Ce refus illustre bien
la spcificit de son pistmologie qui n'a pas pour but premier
de comprendre le monde tel qu'il est, la manire des sciences
exprimentales, mais qui, bien plus, cherche le rectifier pour
le reconstruire conforme son concept.
1. Ibid., p. 138-140.
152
LA MONNAIE
Pour notre part, confronts au choix radical d'une approche
par la valeur ou d'une approche par la monnaie l, nous suivrons
cette dernire, mais en refusant de considrer l'attraction que la
monnaie exerce sur les esprits comme relevant de l'aberration
mentale. Tout au contraire, nous nous efforcerons de dmontrer
qu'elle est pleinement rationnelle pour peu qu'on retienne un
cadre conceptuel adapt. C'est le concept d'lection mimtique
qui sera alors mobilis.
Gense conceptuelle de la monnaie
Dans le monde de la sparation marchande, une question clef
taraude les producteurs-changistes, celle de leur accs aux
marchandises. Plus celui-ci est large, plus leur contrle sur les
autres est important, et plus leur capacit d'action est grande.
En ce sens trs fondamental, la puissance marchande, en tant
qu'elle vise s'amnager le plus large accs aux objets par
l'change, se dfinit comme un pouvoir d'achat. Ceci vaut pour
tous, du plus humble qui lutte pour sa survie au plus fort qui
cherche tendre sa domination. Il s'agit toujours de faire
reconnatre ses droits sur les marchandises: le droit de les
acqurir. Or ce pouvoir d'achat est un pouvoir d'une nature trs
particulire car, pour obtenir les marchandises des autres, il faut
imprativement en contrepartie leur proposer des objets qu'ils
dsirent. Cette configuration est d'autant plus complexe que ces
ils qui dsirent, dans une conomie dveloppe, peuvent tre
absolument quiconque. En consquence, le pouvoir d'achat sup-
pose une capacit d'changer tout instant avec des producteurs-
changistes inconnus, anonymes, dont on ignore les gots
spcifiques. Tel est le problme que rencontre, ds ses premiers
pas, l'acteur marchand s'il veut simplement exister. Il revient
Adam Smith d'en avoir fait la description la plus claire:
1. Jean Cartelier analyse bien ce choix dans son article justement intitul:
Thorie de la valeur ou htrodoxie montaire: les termes d'un choix
(conomie applique, tome XXXVIII, nO l, 1985).
153
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Tout homme prudent, aprs le premier tablissement de la
division du travail, a d naturellement s'efforcer de grer ses
affaires de faon avoir par-devers lui, en plus du produit
particulier de sa propre industrie, une quantit d'une certaine
denre ou d'une autre, qu'il a imagin ne pouvoir tre refuse
que par peu de gens en change du produit de sa propre indus-
triel.
Il s'agit pour chaque homme prudent, nous dit Smith, de se
demander quels biens seront accepts par le plus grand nombre
en change de leur production, afm de les stocker en vue de pro-
chaines transactions. Cela est affaire d'anticipation et d'imagi-
nation. Chaque individu doit s'interroger sur les biens
susceptibles d'tre dsirs par les autres, pour autant qu'il
puisse le prvoir. Le terme qu'utilisent gnralement les cono-
mistes pour dsigner cette aptitude tre accepte dans
l'change est la liquidit . Pour cette raison, nous proposons
de nommer biens liquides ou liquidits , les biens en
question, savoir ceux qui confrent un certain pouvoir d'achat
parce qu'ils sont accepts par les autres dans l'change
2
Ne pas
se tromper quant la nature des biens liquides est essentiel pour
tous les acteurs marchands, car ne pas retenir la bonne dfini-
tion de la liquidit, c'est se retrouver avec une puissance d'achat
notablement amoindrie. En effet, les droits que l'individu pos-
1. Adam Smith, Enqute sur la nature et les causes de la richesse des
nations, op. cit., p. 22 (la traduction a t lgrement modifie).
2. Notons que d'autres termes auraient pu tre choisis. Dans les ouvrages
publis prcdents (Michel Aglietta et Andr Orlan, La Monnaie entre vio-
lence et confiance, Paris, Odile Jacob, 2002, Frdric Lordon et Andr Orlan,
Gense de l'tat et gense de la monnaie: le modle de la potentia multitu-
dinis, in Yves Citton et Frdric Lordon (dir.), Spinoza et les Sciences
sociales. De la puissance de la multitude l'conomie des affects, Paris, di-
tions Amsterdam, 2008, ou encore Andr Orlan, La sociologie conomique
de la monnaie , in Franois Vatin et Philippe Steiner (dir.), Trait de socio-
logie conomique, Paris, PUF, 2009), c'est celui de richesse , ou de
biens-richesse , que nous avions retenu. Mais le tenne de monnaie par-
tielle , ou de monnaie prive , aurait galement pu tre retenu. Cette ind-
tennination vient du fait que ces objets sont tout la fois des liquidits, des
richesses et des monnaies.
154
LA MONNAIE
sde sur la socit, ou qu'il croit possder, ne sont valids
socialement que s'ils prennent la forme de biens liquides. Pen-
sons un acheteur qui viendrait chez un vendeur avec, non pas
de l'or ou des billets, mais des appareils d'astronomie, des
prparations anatomiques, des crits en sanscrit , ou encore des
instruments chirurgicaux , pour reprendre les exemples pro-
poss par Carl Menger
l
Il aurait quelques difficults obtenir
ce qu'il dsire et subirait des pertes importantes. En cons-
quence, la question pose chacun est de savoir ce qu'il lui faut
retenir comme dfinition de la liquidit pour viter de telles
pertes.
La structure des interactions que suscite la liquidit est d'une
nature typiquement mimtique puisque le dsir de chacun
l'gard des biens liquides se rgle sur le dsir prouv par les
autres pour ces mmes biens. Comme pour le prestige, on peut
crire: Est liquide pour un individu ce que les autres consi-
drent comme liquide et dsirent comme tel. En consquence,
comme pour le prestige, il vient que la liquidit ne renvoie
aucune qualit substantielle particulire, dfinissable antrieure-
ment aux relations interpersonnelles (cf. supra). On retrouve
la mme logique autorfrentielle : la liquidit est une cration
du dsir de liquidit. Cependant, les intrts mis en jeu par la
liquidit sont sans commune mesure avec ceux que suscitent les
luttes pour le prestige: il ne s'agit plus simplement d'affirmer
sa supriorit dans l'ordre des valeurs d'usage mais d'assurer
son existence en tant que producteur-changiste. En cons-
quence, les dsirs et rivalits que mobilise la liquidit sont
d'une rare intensit. C'est exclusivement via l'acquisition de
biens liquides que l'individu marchand peut prtendre la
pleine reconnaissance de ses droits sur les marchandises. Dans
une conomie marchande, la puissance, c'est--dire le pouvoir
d'acheter, prend la forme d'une quantit: la quantit de biens
liquides qui sont aux mains du producteur-changiste, de telle
sorte que le bien liquide est conduit naturellement servir
d'unit de mesure du pouvoir d'achat. D'ordinaire, dans les
1. Dans Carl Menger, On the Origin of Money , art. cit., p. 244 et 251.
155
L'EMPIRE DE LA VALEUR
conomies que nous connaissons, les individus trouvent la ques-
tion de la liquidit dj rsolue. La liquidit se prsente directe-
ment leurs yeux sous la forme de la monnaie. Et comme la
monnaie condense le dsir unanime de tous les acteurs, elle
exerce sur chacun une puissance d'attraction sans gal. La ques-
tion alors pose est de savoir d'o vient une telle puissance?
Quelle en est l'origine ?
Quand nous pensons l'origine, nous ne voulons pas dire ici
l'origine historique. La question n'est pas de savoir comment
la monnaie est apparue historiquement. Cette question est
certes intressante mais ce n'est pas la ntre 1. Ce que nous
nous efforons de comprendre est comment, au sein mme des
conomies marchandes, les dsirs de liquidit voluent jusqu'
converger sur un objet unique, la monnaie. Pour ce faire, nous
nous livrerons l'exprience de pense suivante : considrer
une conomie marchande dveloppe et lui enlever sa mon-
naie. Nous chercherons alors dmontrer qu'au sein d'une
telle conomie, prive de monnaie, s'engendrent spontanment
certaines forces sociales conduisant la rsurgence de cette
dernire. Toute notre analyse vise caractriser ces forces ainsi
que les processus par lesquels elles produisent l'ordre mon-
taire. Cette dmarche peut sembler paradoxale par le fait qu'on
commence par y postuler l'existence de rapports marchands
sans monnaie, alors mme que tout notre effort thorique vise
tablir qu'une telle configuration sociale ne peut pas exister.
La contradiction n'est cependant qu'apparente ds lors qu'on
comprend que cette configuration n'est postule que pour pr-
cisment dmontrer qu'elle ne peut pas perdurer parce qu'elle
porte en elle la ncessit de la monnaie. Il est alors visible
qu'une telle tude est absolument trangre la question de
l'origine historique de la monnaie au sein de socits pr-
marchandes qui en seraient dpourvues. Le but de l'analyse est
tout autre: il s'agit d'expliquer en quoi des rapports marchands
1. Pour ce qui est de la naissance des monnaies frappes, se reporter
Georges Le Rider, La Naissance de la monnaie. Pratiques montaires de
"Orient ancien, Paris, PUF, 2001.
156
LA MONNAIE
dj constitus et pleinement matures, du fait des contradic-
tions qui leur sont propres, appellent ncessairement la mon-
naie pour accder une existence stabilise. Pour cette raison,
il faut parler d'une gense conceptuelle' de la monnaie. Celle-
ci permet de penser au plus prs la monnaie marchande en met-
tant au jour les nergies sociales qui, constamment, au sein
mme des conomies marchandes, uvrent sa prsence.
Conformment notre problmatique, nous montrerons que la
monnaie rsulte de la lutte entre les producteurs-changistes
pour la matrise de la puissance marchande, via l'acquisition
des biens les plus liquides. Cette mthode de gense concep-
tuelle
2
est connue des physiciens qui, pour prouver qu'un corps
doit avoir telle forme dtermine, imaginent une dformation
virtuelle, hypothtique, et montrent que cette dformation vir-
tuelle engendrerait ncessairement des forces qui ramneraient
le corps sa position initiale, ce qu'on nomme le thorme
des travaux virtuels .
Examinons donc une conomie marchande dveloppe qui a
t prive de sa monnaie
3
Que s'y passe-t-il? Comme on l'a
dj not, la premire revendication des acteurs marchands a
1. Dans le texte de Frdric Lordon et Andr Orlan, Gense de l'tat et
gense de la monnaie: le modle de la potentia multitudinis (in Yves Citton
et Frdric Lordon (dir.), Spinoza et les Sciences sociales. De la puissance de
la multitude l'conomie des affects, op. cit.), on trouvera de longs dvelop-
pements consacrs ce concept.
2. La dmonstration de Thomas Hobbes suit une mme logique. Son tat de
nature est une hypothse logique et non historique. De mme que notre tat de
nature se dfinit comme l'conomie actuelle moins la monnaie, l'tat de
nature chez Hobbes, c'est l'tat social actuel moins son souverain imparfait
(Crawford Macpherson, La Thorie politique de l'individualisme possessif,
Paris, Gallimard, 2004, p. 49). JI s'ensuit, chez Hobbes comme chez nous, dans
nos textes antrieurs, la possibilit d'une mauvaise interprtation conduisant
comprendre l'tat de nature comme dcrivant un tat historiquement antrieur
l'conomie montaire. L'tat de nature [ ... ] est donc bien un tat hypothtique
auquel Hobbes arrive par abstraction logique. Mais en baptisant "tat de nature"
cette condition hypothtique, il a tendance induire en erreur: il est en effet
facile d'y voir un tat historiquement antrieur la socit civile (ibid., p. 57).
3. Dans deux livres prcdents, nous avons prsent longuement notre
modle de gense mimtique de la monnaie: Michel Aglietta et Andr Orlan,
La Violence de la monnaie (Paris, PUF, 1982) et Michel Aglietta et Andr
157
L'EMPIRE DE LA VALEUR
pour objet la liquidit. Pour exister, ils n'ont d'autres choix que
d'acqurir des biens liquides, car c'est l la condition d'un accs
efficace la circulation des marchandises. En effet, la socit
marchande ne connat pas ces liens de solidarit existant entre
parents, voisins ou proches, grce auxquels, dans les socits
traditionnelles, chacun peut mobiliser directement l'assistance
des autres pour raliser ses projets. Pour obtenir quelque chose
d'autrui, dans l'ordre marchand, il n'est pas d'autres moyens
que de susciter son dsir. Telle est la nature de la sparation
marchande. La liquidit en tant que capture du dsir de certains
rpond cette ncessit. Il apparat ainsi de nouveau que la
liquidit n'est pas une substance mais un mode de relation
autrui, un lien social par lequel est reconnue entre les protago-
nistes l'existence d'une communaut d'intrts mais transfigu-
re sous la forme d'un dsir d'objet. En consquence, la
liquidit n'a pas de dfinition substantielle mais dpend de la
manire dont chaque protagoniste se reprsente le dsir des
autres. N'importe quel objet peut tre liquide. Il s'ensuit, dans
un premier temps, une grande diversit des conceptions quant
la dfinition des biens liquides. Lorsque deux individus par-
tagent la mme dfinition du bien liquide, leurs changes sont
grandement facilits. La vente et l'achat se font par simple
transfert du bien liquide en question. Lorsque ce n'est pas le
cas, les changes sont rendus plus difficiles parce qu'ils nces-
sitent des conversions et des taux de change entre les diffrents
biens liquides qu'utilisent les uns et les autres. Pour ce faire, il
faut recourir des acteurs spcialiss, les changeurs , qui pr-
lvent une commission au passage. Dans le but de minimiser ces
cots de conversion, il est dans l'intrt de chaque producteur-
changiste d'adopter l'unit de compte majoritairement utilise
dans le sous-groupe des individus avec lesquels il fait habituel-
lement des changes. Tel est le principe central qui rgle la
Orlan La Monnaie entre violence et confiance, op. cit. C'est galement
l'objet de l'article Frdric Lordon et Andr Orlan Gense de l'tat et
gense de la monnaie: le modle de la potentia multitudinis (art. cit.).
158
LA MONNAIE
concurrence entre biens liquides. Il est de nature mimtique,
mais d'un mimtisme qui touche en priorit le groupe des indi-
vidus avec lequel, habituellement, l'individu transacte 1. Ce prin-
cipe mimtique dbouche sur une circulation marchande
fractionne en sous-espaces de circulation fortement intgrs,
au sein desquels les acteurs partagent une mme conception de
la liquidit. Pour dsigner cette configuration, on parlera d'une
structure marchande fractionne. Ainsi, notre situation sans
monnaie lgitime certifie n'est-elle aucunement une situation
de troc mais une configuration o coexistent des reprsentations
concurrentes de la liquidit qui fractionnent l'espace de circula-
tion des marchandises. Dire qu'il y a fractionnement, c'est dire
qu'il existe une pluralit d'units de compte, sans lien stable
entre elles, le taux de conversion entre ces units tant absolu-
ment flexible, laiss au libre jeu des rapports de force entre
sous-groupes marchands, chaque agent pouvant tout instant
modifier sa conception de la liquidit. Comment volue ce frac-
tionnement? Est-il stable?
Avant d'aborder cette question dans toute sa gnralit, il peut
tre clairant, dans un premier temps, de s'intresser au cas par-
ticulier d'un fractionnement extrme, celui qu'on observe
lorsque les divers espaces de circulation sont parfaitement
tanches. Dans ces conditions, chaque producteur-changiste ne
connat qu'une seule unit de compte puisque toute son activit
conomique se droule au sein d'un unique espace de circula-
tion. En consquence, pour lui, la question de la liquidit se
trouve rsolue: le bien liquide qu'il utilise, tant accept par
tous les acteurs avec lesquels il est susceptible de nouer des
relations d'change, lui donne pleine satisfaction. Si on consi-
dre le groupe dans son entier en cas de fractionnement extrme,
il est constitu d'une juxtaposition d'espaces de circulation
dconnects tant du point de vue des conjonctures que des
niveaux de dveloppement. Il s'ensuit une forte htrognit
1. Cette argumentation est, par divers cts, proche de celle avance par
Carl Menger. Il est rationnel pour chacun de transacter en utilisant les biens
les plus liquides.
159
L'EMPIRE DE LA VALEUR
des situations individuelles au sein du groupe. Entre l'acteur qui
appartient l'espace X et celui qui appartient l'espace Y, rien
de commun. Du point de vue du groupe et de ses intrts spci-
fiques en tant que groupe, il est possible que cette htrognit
soit considre comme trs prjudiciable, par exemple si elle
dbouche sur des dsirs politiques de sparatisme. Cependant, du
point de vue strictement marchand qui est le ntre dans ce livre,
rien ne fait obstacle la perptuation du fractionnement extrme
tant que les espaces de circulation restent rigoureusement spa-
rs. La situation se transforme lorsque des flux d'changes entre
espaces apparaissent, ce qui ne peut manquer d'arriver au fur et
mesure que la division du travail s'approfondit. Dans ces
conditions, divers acteurs conomiques se retrouvent, du fait de
leur appartenance une pluralit d'espaces de circulation, avec
un portefeuille constitu de liquidits diffrentes. A l'exception
notable des changeurs, cette diversit n'apporte que des dsagr-
ments aux acteurs marchands du fait, d'une part, des cots de
conversion et, d'autre part, de l'incertitude existant sur le niveau
des taux de change entre les biens liquides. Parce que cette plu-
ralit de liquidits ne procure que des dsavantages, les acteurs
essaieront de la contourner et cela d'autant plus vivement que
l'interconnexion entre les espaces sera importante, qu'elle tou-
chera un plus grand nombre d'agents. Chacun recherchera la
rfrence liquide la plus utilise lorsque la totalit de l'conomie
est prise en considration et abandonnera les autres 1. Autrement
dit, il apparat, dans ces conditions, que la dynamique mimtique
se diffuse au niveau du groupe dans sa totalit. Comme nous
l'ont appris les rendements croissants d'adoption, la recherche
du bien le plus/liquide par tous les acteurs engendre un processus
rtroactions positives qui polarise cumulativement les choix
sur les liquidits les plus usites. Ce processus, s'il se poursuit
sans obstacle extrieur, conduit une situation d'unanimit dans
1. On trouve chez Kevin Dowd et David Greenaway (dans Currency
Competition, Network Externalities and Switching Costs : Towards an Alter-
native View of Optimum Currency Areas , The Economie Journal, vol. 1 03,
nO 420, septembre 1993, p. 1180-1189) un modle d'inspiration similaire.
160
LA MONNAIE
laquelle tous les membres du groupe partagent la mme concep-
tion de ce qu'est la liquidit: le fractionnement disparat. Cette
liquidit ultime laquelle tous adhrent par la grce de la polari-
sation mimtique est ce qu'on nomme une monnaie. tant accep-
te par tous, la monnaie jouit d'une liquidit absolue 1. Elle est le
condens de tous les biens comme l'crit Spinoza, parce qu'elle
permet de tout obtenir, non pas en vertu de sa qualit intrin-
sque, mais par la vertu de l'unanimit mimtique elle-mme.
Se dduit de notre modle que l'conomie marchande tend
s'unifier autour d'une dfinition unique de la liquidit qui
acquiert, ce faisant, une emprise extrme sur les acteurs. La plu-
ralit des monnaies se trouve rejete en tant qu'elle constitue un
obstacle l'expression des intrts marchands. Le fait d'obser-
ver une grande diversit de monnaies au niveau plantaire
n'infirme en rien cette thse. Car, derrire ce phnomne, ce
sont d'autres intrts que les seuls intrts marchands qui sont
l' uvre, principalement la volont de la souverainet politique
d'instrumentaliser l'mission montaire aux fins de sa propre
puissance. En effet, l'existence d'une monnaie nationale
s'affirme comme un lment essentiel dans la construction
d'une identit politique durable
2
Deux faits d'observation tmoignent de cette propension
l'unification des monnaies. D'une part, il apparat que, sur la
longue priode, le systme montaire international montre une
tendance certaine se structurer autour d'une monnaie unique,
la monnaie hgmonique
3
Autrement dit, dans le cadre des
1. Cette analyse partage de nombreux points communs avec celle que pro-
pose Carl Menger (dans On the Origin of Money , art. cit.). Sur le rapport
entre ce modle et celui de Menger, on peut se reporter Michel Aglietta et
Andr Orlan La Monnaie entre violence et confiance, op. cit., p. 91-96.
2. Un raisonnement similaire pourrait tre tenu propos des langues. Du
point de vue de la stricte communication, la pluralit des langues est une
hrsie. Ceci est d'autant plus vrai que le monde se trouve par ailleurs for-
tement intgr. Pourtant, on continue observer une grande diversit des
langues. Il en est ainsi parce que l'identit linguistique, comme l'identit
montaire, est un lment important dans la construction d'une identit poli-
tique forte.
3. De mme existe-t-il des langues hgmoniques.
161
L'EMPIRE DE LA VALEUR
relations internationales, l o les acteurs ont une certaine
libert dans leur choix montaire, leurs suffrages se portent sur
la liquidit la plus rpandue, ce qui en renforce cumulativement
l'attrait. Cette observation illustre nouveau la singularit des
forces concurrentielles en matire de liquidit: leur logique est
fort loigne de celle de la loi de l'offre et de la demande. Elle
rejette la coexistence d'options substituables pour lui prfrer
une conformit universelle, conduisant ce qui a t nomm
blocage (fock-in).
D'autre part, l'observation du march des changes donne
voir une dynamique concurrentielle instable, qui amplifie les
chocs plus qu'elle ne s'y oppose. Si on se limite la priode
d'existence de l'euro, celui-ci est pass de 1,17 dollar sa cra-
tion le 1
er
janvier 1999 0,85 dollar en 2000, puis 1,6 dollar
en juillet 2008. Comme le montrera le chapitre VII consacr aux
volutions financires, cette propension l'excs, la hausse
comme la baisse, est l'expression d'un fonctionnement mim-
tique, rtroactions positives. Soulignons que de telles dyna-
miques s'observent alors mme que les monnaies en question,
dollar et euro, se trouvent garanties par de puissants Etats qui
limitent fortement la spculation, non seulement par le biais de
leurs interventions, mais galement parce que leur seule pr-
sence signale aux investisseurs que certaines bornes ne sau-
raient tre franchies. Il n'est pas absurde de penser que, laisse
totalement elle-mme, cette mme logique concurrentielle
conduirait l'lection d'un bien liquide au dtriment des autres.
Sans la puissance des tats, une monnaie l'emporterait sur
toutes les autres conformment notre modle.
Une fois l'unanimit mimtique obtenue, il s'ensuit une trans-
formation en profondeur des interactions. L'imitation acquiert
de nouvelles proprits : au lieu de pousser les individus
explorer de nouvelles hypothses, elle n'a plus pour seul effet
que de renforcer la croyance lue. On prend ainsi la mesure des
bouleversements que connat l'environnement cognitif et social
des agents: la diversit erratique des anticipations succde
une soudaine stabilit qui se perptue. Comment interprter un
tel bouleversement, sinon par le fait qu'enfin a t dcouverte la
162
LA MONNAIE
forme adquate de la liquidit? Telle est l'analyse qui va pr-
valoir. merge, en consquence, une croyance collective ferme-
ment attache l'objet montaire lu 1. On passe de la
mdiation interne)) la mdiation externe )). Il s'agit tou-
jours d'imitation, mais d'une imitation qui a pour modle le
groupe tel qu'il se construit distance des sujets, dans l'unani-
mit sur l'objet lu. Jean-Pierre Dupuy propose de nommer
auto-extriorisation )) ou auto-transcendance )) cette extrio-
risation produite par le groupe lui-mme. Elle joue un rle fon-
damental. Par le jeu de cette transformation, l'objet lu acquiert
le statut d'institution socialement reconnue. partir de l, en
tant que moyen de paiement accept par tous, la monnaie lue
s'impose galement comme l'unit de compte de rfrence,
comme moyen de rserve et comme moyen d'change. Les
fonctions montaires se dduisent de la polarisation mimtique.
La crise de la monnaie
Si l'lection mimtique est le concept fondamental grce
auquel la nature de la monnaie et du pouvoir montaire est ren-
due pleinement intelligible, il faut cependant souligner que le
modle prcdent n'en explicite que partiellement le processus.
En effet, seuls les rendements croissants d'adoption y sont pris
en compte; ce qui signifie qu'il est fait implicitement l'hypo-
thse que les individus sont indiffrents quant aux diverses
dfinitions de la liquidit. Seul importe pour eux de dcouvrir la
liquidit la plus utilise, quelle qu'elle soit. C'est l une hypo-
thse imparfaite. En effet, en matire de liquidit, un autre l-
ment affecte fortement les intrts des uns et des autres :
l'accessibilit. Il ne suffit pas de savoir sous quel masque se
cache la liquidit, encore faut-il pouvoir l'acqurir aisment.
Un individu n'a aucun intrt choisir une liquidit qui, par
1. Dans la suite du texte, on parlera d' exclusion pour dsigner le pro-
cessus par lequel la monnaie lue se prsente aux acteurs comme possdant,
par nature, la qualit de liquidit. Se reporter au chapitre V.
163
L'EMPIRE DE LA VALEUR
ailleurs, lui est interdite! En revanche, les biens liquides qui
dpendent de son champ d'action le favorisent. En consquence,
si chaque producteur-changiste reste la recherche d'une rf-
rence partage lui permettant de stabiliser son rapport aux autres
changistes, il lui importe que cette rfrence convienne ses
intrts. Intgrer cet lment nouveau conduit largir notre
modle pour ne plus nous en tenir uniquement des agents
entirement passifs, proccups seulement de suivre l'opinion
majoritaire. Les agents sont galement actifs. Ils cherchent
peser sur le processus de choix pour l'orienter en leur faveur,
par exemple en faisant lire leur propre bien. C'est pourquoi la
recherche angoisse de tous pour identifier la liquidit a pour
autre face la qute forcene de certains pour lever cette incerti-
tude leur profit et raliser la convergence montaire sur leur
bien. La logique de l'unit montaire est donc insparablement
cognitive et agonistique. Il n'en reste pas moins que la conver-
gence mimtique finit par l'emporter. Pourquoi? Parce que,
lorsque merge une coalition trs large autour d'une certaine
liquidit, les bnfices que procure l'adhsion celle-ci sont trop
importants pour pouvoir tre rejets. Un mme objet finit donc
par recueillir l'assentiment de tous les producteurs-changistes.
Assentiment contrari pour ceux qui, dans la lutte de promo-
tion de leur bien particulier comme bien universel, ont eu le
dessous, mais assentiment tout de mme, car les rendements
croissants d'adoption sont les plus forts et dcouragent la sces-
sion montaire: les vaincus se rallieront, car leur intrt leur
commande tout de mme de rejoindre l'espace de circulation le
plus large, celui qui leur donnera accs la division du travail
la plus profonde, la gamme de biens la plus tendue. N'ayant
pas russi faire prvaloir leur propre dfinition du rapport
montaire, les groupes domins sont contraints d'accepter la
monnaie dominante, faute de quoi ils se trouveraient exclus de
la circulation marchande. Au terme de cette convergence, l'una-
nimit d'identification s'impose donc mme ceux qui ont
d'abord tent de la contester. Lorsque nous parlons d'unanimit
montaire, il ne faut pas perdre de vue ce fait: elle procde le
164
LA MONNAIE
plus souvent d'une acceptation contrainte, c'est--dire d'une
domination.
Ces dernires remarques sont importantes, car il ne faut pas
croire que, une fois produite, la polarisation mimtique perdure
l'infini sans jamais tre remise en question. Tout au contraire,
une monnaie pour exister doit constamment se montrer capable
de faire converger sur elle tous les dsirs de liquidit. C'est
cette condition qu'elle conserve son statut de monnaie. C'est
cette condition que l'institution montaire maintient son auto-
rit. Cela n'a rien d'vident, car la prsence de la monnaie ne
supprime en rien la conflictualit marchande et les luttes de
puissance. La monnaie leur apporte simplement un cadre stable.
Mais, comme elle institue de fortes contraintes en matire de
paiement l, la norme montaire nourrit un mcontentement
latent chez les acteurs qui prfreraient disposer d'un accs plus
ais au monnayage ou que soit suivie une politique montaire
plus conforme leurs intrts. Rappelons ce propos que, ds
son origine, l'unanimit montaire est une unanimit plus impo-
se que dsire. Certains auraient prfr qu'un autre bien ft
lu. En consquence, perptuellement, des insatisfactions
l'gard de l'institution montaire demeurent latentes dans le
tissu conomique. Cependant, tant que les gains qu'engendre
l'adhsion l'institution montaire par le jeu des rendements
croissants d'adoption l'emportent sur le poids des contraintes,
ces mcontentements restent limits au for intrieur de chacun
et l'ordre n'en est nullement affect. Cela est la situation gn-
rale, situation dans laquelle l'autorit montaire se maintient
bien qu'tant fort contraignante. Pour que les choses changent,
il faut que le mcontentement fasse bloc et dpasse une certaine
masse critique, qu'il devienne public. On retrouve ici les rsul-
tats obtenus au chapitre II lorsque a t prsente la concurrence
entre les langues. On a vu que la convention dominante une fois
tablie ne peut tre remise en cause par une dissidence
1. Contrainte de se procurer les quantits de monnaie ncessaires au paie-
ment des achats dsirs, et plus gnralement d'assurer des flux de recettes
montaires permettant de couvrir dans le temps tous les dbours.
165
L'EMPIRE DE LA VALEUR
individuelle, mme si celle-ci est porteuse d'une langue plus
performante. Pour que la convention soit remise en cause, il faut
que se constitue une coalition. Cette proprit assure la pola-
risation mimtique une grande stabilit. Il faut des chocs impor-
tants, affectant simultanment un grand nombre d'agents, pour
que de telles coalitions voient le jour
l
. Plus prcisment, la crise
montaire dbute lorsqu'un groupe d'individus dviants, insa-
tisfaits par la monnaie existante, se tournent simultanment vers
de nouvelles liquidits, qu'on peut encore appeler des mon-
naies prives , plus conformes leurs intrts. On est alors
face ce qu'il faut appeler une sdition montaire . Telle est
notre dfinition de la crise montaire: l'mergence d'une dissi-
dence cherchant faire prvaloir de nouvelles normes mon-
taires. Cette dissidence peut russir si elle apparat sur fond
d'une insatisfaction latente gnralise qui trouve alors un
moyen de s'exprimer.
Notons que cette sdition peut prendre des formes multiples
dont l'analyse dpasse largement le cadre du prsent livre. Nous
n'en prsenterons que quelques-unes parmi les plus typiques. La
forme la plus simple consiste recourir une monnaie trangre,
par exemple le dollar
2
, la fois comme moyen d'valuation des
marchandises et comme moyen de thsaurisation, voire comme
moyen d'change. Autrement dit, les acteurs prennent appui sur
le fait qu'existent des monnaies dj constitues dans d'autres
espaces marchands et cherchent en dvelopper l'utilisation
dans leur espace habituel d'changes. Mais il existe des formes
plus subtiles de sdition montaire, par exemple l'indexation des
prix. Avec l'indexation se trouve remise en cause la capacit de
la monnaie existante reprsenter adquatement le pouvoir
d'achat. Le recours l'indexation s'analyse, dans notre cadre
thorique, comme le rejet par certains de la monnaie nationale en
1. Si on quitte notre modle abstrait pour prendre en compte d'autres rap-
ports sociaux que le seul rapport marchand, c'est d'ordinaire par le biais de la
politique que ces coalitions mergent et se font entendre.
2. Rappelons que, du point de vue des institutions montaires nationales,
le dollar doit tre considr comme une monnaie prive .
166
LA MONNAIE
tant qu'unit de compte et l'mergence d'une nouvelle unit, par
exemple un indice de prix ou un taux de change, qui vient la
concurrencer. Dans la mesure o le support de l'indexation n'est
pas une monnaie complte puisqu'elle se limite la fonction de
compte, sans tre ncessairement un instrument des changes, on
parlera son propos de monnaie prive partielle . L'mer-
gence de cette monnaie prive partielle s'analyse comme une
remise en cause de l'unit montaire du groupe. Si la crise
dbute frquemment par des indexations qui expriment la
dfiance des producteurs-changistes dans la capacit de la mon-
naie valuer correctement les marchandises, elle se mue le plus
souvent en crise du moyen de rserve lorsque les acteurs se pr-
cipitent vers de nouvelles formes de richesse pour assurer la
conservation de leur patrimoine. Enfin, au stade final, on observe
des individus qui refusent purement et simplement d'accepter la
monnaie en change de leur production. Dsormais, la monnaie
se voit concurrencer dans toutes ses fonctions par d'autres
formes de liquidit. Cette situation peut conduire l'mergence
d'une nouvelle monnaie, au rtablissement de l'ancienne ou
l'clatement de l'espace marchand. Cela dpend. Les forces
politiques jouent, cet gard, un grand rle.
Ce qui essentiel dans l'ensemble de ces processus, par-del
leur diversit, est la remise en cause du monopole de la monnaie
centrale du fait de l'utilisation par certains groupes de nouvelles
rfrences montaires, dites prives tant qu'elles n'ont pas
reu l'onction du groupe uni. L'adhsion collective, jusqu'alors
tout entire focalise sur une mme dfinition de la liquidit,
connat une soudaine dperdition de puissance du fait de son
fractionnement en une multiplicit de dfinitions rivales. Il faut
ici parler d'une crise de la puissance souveraine
I
. C'est en cela
que le fractionnement est le concept adquat pour penser la
crise montaire dans sa forme la plus gnrale: le courant
unitaire qui donnait l'adhsion toute sa force se voit parpill
pour laisser place la concurrence des prtendants montaires.
1. Se reporter Frdric Lordon et Andr Orlan Gense de l'tat et
gense de la monnaie: le modle de la potentia multitudinis (art. cit.).
167
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Cependant, le fractionnement laiss lui-mme est instable. Les
groupes montaires dissidents uvrent aux fins de constituer
une communaut de circulation de la plus grande extension pos-
sible, autour d'une mme dfinition de la liquidit. En cela, ils
suivent une logique identique celle mise en vidence lors de
l'analyse du processus d'mergence de l'ordre montaire.
Lorsqu'on prend le point de vue de cette mergence, ce proces-
sus est saisi au moment de son triomphe: quand s'impose une
nouvelle dfinition reconnue par tous. Lorsqu'on s'intresse la
crise, ce processus est apprhend comme processus de contes-
tation de l'ordre montaire, au moment o des revendications
montaires partisanes viennent s'agrger mimtiquement pour
contredire l'ancienne norme et affirmer l'ambition d'en former
une nouvelle. Cependant, la source de tous ces phnomnes
- ordre et dsordre - se trouve le mme concept de concurrence
mimtique.
L'objectivit de la valeur
Ces analyses clairent d'une lumire entirement nouvelle la
question de la valeur conomique et de son objectivit. Elles ne
croient pas l'hypothse d'une commensurabilit naturelle,
intrinsque, des marchandises, dont il s'agirait d'identifier le
principe. Autrement dit, dans le dialogue avec Aristote que
Marx met en scne dans le premier chapitre du Capital, c'est la
position d'Aristote qui est la bonne lorsqu'il juge qu' il est
impossible en vrit que des choses si dissemblables soient
commensurables entre elles 1 a priori, de par leurs propres
qualits intrinsques. Rejetant l 'hypothse de valeur substance,
Aristote est conduit penser l'galit des biens dans l'change
comme tant l'uvre du nomos, de la loi, de l'institution
sociale-historique pour reprendre les termes utiliss par Cas-
toriadis, ou encore pour le besoin pratique , comme il l'crit
lui-mme. Telle est galement notre conception. L'galisation
1. Le Capital, op. cit., p. 59.
168
LA MONNAIE
dans l'change est le rsultat de l'institution montaire. Ce qui
rend les marchandises commensurables et permet l'change,
c'est seulement le dsir unanime des acteurs marchands pour la
monnaie. La valeur d'un bien se mesure la quantit de mon-
naie que ce bien permet d'obtenir, savoir son prix. Prix et
valeur sont une seule et mme ralit. Cette valeur est objective
par le fait que la monnaie obtenue par le vendeur est reconnue
universellement. Autrement dit, ce sont les mouvements mon-
taires qui sont objectifs. En revanche, la valeur obtenue pour un
mme bien peut varier; elle dpend des circonstances de
l'change. Ceci n'est pas un problme ds lors qu'on accepte
que l'objectivit ne porte pas sur un certain niveau des prix, le
prix juste , mais sur la forme prix elle-mme en tant qu'elle
renvoie une unit de compte reconnue par tous. La question
de l'unicit du prix pour un mme bien est une question diff-
rente de celle de l'objectivit de la valeur. Son analyse suppose
que l'on prenne en compte les dispositifs d'change. En ce sens,
notre conomie n'est plus une conomie des grandeurs .
En rsum, notre cadre thorique distingue deux questions :
(1) s'interroger sur les conditions qui font qu'un objet capte le
dsir unanime du groupe pour la liquidit ; (2) une fois la mon-
naie produite, s'interroger sur les rapports de force qui se
nouent lors de l'change entre les acheteurs et les vendeurs. Ces
deux questions sont nettement distinctes ; elles appellent des
outils conceptuels de nature diffrente. La premire, la plus fon-
damentale, porte sur la monnaie en tant qu'elle s'impose tous
les acteurs comme la liquidit absolue qui donne accs aux mar-
chandises. C'est le concept d'lection mimtique qui nous per-
met d'y rpondre. On dmontre grce lui que la valeur
marchande s'impose objectivement aux producteurs-changistes
par le biais des quantits de monnaie acquises dans l'change.
Puis, une fois la question montaire rsolue, il reste com-
prendre, pour chaque marchandise, comment se dtermine son
prix, ce qui suppose un cadre d'analyse diffrent qui examine la
position relative des acheteurs et des vendeurs ainsi que le degr
de concurrence existant entre eux. Autrement dit, la premire
question tablit l'existence de la forme prix alors que la seconde
169
L'EMPIRE DE LA VALEUR
cherche expliciter le niveau des prix. L'erreur des thoriciens
de la valeur a t de confondre ces deux questions alors qu'elles
sont indpendantes. En effet, leurs yeux, tablir l'objectivit
de la valeur, c'est tablir qu'il existe un niveau normal pour les
rapports d'change, ce qui suppose une thorie de la dtermina-
tion des prix. En consquence, dans l'approche noclassique, la
concurrence est convoque l'occasion d'une question, l'objec-
tivit de la valeur, qui ne la requiert aucunement. D'ailleurs,
selon nous, si Lon Walras propose un concept si particulier de
concurrence, cela tient au fait que son but n'est pas d'tudier
vritablement la concurrence en tant que telle, savoir com-
ment la position relative des acheteurs et vendeurs influe sur le
prix, mais de rpondre une question trs diffrente et trs sp-
cifique : montrer qu'il existe des prix justes. Dans notre cadre,
l'objectivit de la valeur ne signifie absolument pas qu'il existe
un niveau normal des rapports d'change. Nous ne pensons
mme pas qu'une mme marchandise a ncessairement un prix
unique sur tout l'espace montaire. Pour nous, l'objectivit de
la valeur signifie tout autre chose, savoir que tous les protago-
nistes reconnaissent la mme dfinition du valoir, de telle sorte
qu'il est possible de dterminer sans ambigut les comptes qui
sont en excdent et ceux qui sont en dficit. La monnaie, en tant
qu'elle est considre par tous comme l'expression lgitime de
la liquidit absolue, transforme les estimations prives en valeur
socialement reconnue. Pour ce qui est de la dtermination des
prix, la question est d'une autre nature. La thorie de la concur-
rence se donne prcisment pour but d'tudier ce problme, ce
qui impose de spcifier les dispositifs d'change.
La thorie quantitative de la monnaie
La spcificit de cette approche s'exprime dans le fait qu'elle
pose, au point de dpart de l'conomie marchande, le un de
l'unit de compte. C'est sous cette forme que la valeur se trouve
institue, partir de quoi se dveloppe la circulation des mar-
chandises. Une fois l'unit de compte dfinie, il est possible de
170
LA MONNAIE
mesurer la valeur des diffrentes marchandises, savoir leur
prix, conformment aux galits suivantes:
fi unit de bien A vaut Pa units de compte dans les circonstances (l
\ :
Si, en partant de ces galits, on veut dterminer la valeur de
l'unit de compte, on obtient une multiplicit d'valuations
concurrentes, sous la forme :
(
1 unit de monnaie vaut 11 Pa units de bien A dans les circonstances (l
.. .. .. .. ..
1 unit de monnaie vaut 11 Pz units de bien Z dans les circonstances
On se trouve confront autant d'valuations qu'il y a de
biens et de circonstances d'change sans pouvoir en dduire
quoi que ce soie. Cette proprit joue un rle important dans
la stabilit du rapport montaire. Elle nous dit que la monnaie
chappe l'valuation: face elle, ne sont prsentes que des
marchandises ordinaires, sans lgitimit spcifique pour ce qui
est d'exprimer la valeur. D'ailleurs, le plus souvent, les prix
voluent dans des directions opposes, refltant la diversit
des marchandises et des situations, sans qu'il soit possible
d'en dduire quoi que ce soit pour ce qui est de la valeur
de la monnaie. Cependant, lorsqu'on observe un paralllisme
dans les volutions de prix, que faut-il en infrer? Lorsque
l'hypothse d'une tendance gnrale affectant la formation des
prix semble pouvoir tre retenue, doit-on en conclure, confor-
mment au sens commun, une modification dans la valeur
1. [ ... ] la valeur du numraire exprime en marchandises ne change pas
seulement avec les temps et les lieux, mais elle varie encore en diverses
mesures et mme en divers sens d'aprs l'espce de marchandise qui sert
l'exprimer (Carl Menger, cit in Gilles Campagnolo, Carl Menger entre
Aristote et Hayek. Aux sources de l'conomie moderne, Paris, CNRS ditions,
2008, p. 210).
171
L'EMPIRE DE LA VALEUR
mme de la monnaie? N'est-ce pas la manire naturelle
d'interprter le facteur commun qui emporte, la hausse
comme la baisse, tous les prix? Si, par exemple, tous les
prix augmentent simultanment de 5 %, il est tentant d'inter-
prter cette situation comme ayant pour origine l'unit de
compte elle-mme dont la valeur aurait baiss de 5 %. C'est ce
que font trs communment les conomistes lorsqu'ils intro-
duisent un indice de prix pour mesurer l'volution moyenne de
tous les prix. Cet indice sert mesurer le pouvoir d'achat de
la monnaie, savoir la quantit de marchandises qu'une unit
montaire est capable d'acheter. Si l'indice de prix a doubl
pendant une certaine priode, on dira que la valeur de la mon-
naie a diminu de moiti puisque sa capacit d'achat est deux
fois moindre. En consquence, les conomistes ont coutume
de dfinir la valeur de la monnaie comme tant l'inverse du
niveau gnral des prix.
Si nous ne contestons nullement que le recours aux indices de
prix constitue une source importante d'informations pour les
conomistes et les acteurs conomiques, il convient cependant
d'utiliser avec prudence la notion de valeur de la monnaie .
Il s'agit d'une notion fondamentalement statistique dont la mise
en uvre pratique rencontre de nombreuses difficults comme
le savent bien les statisticiens. Par exemple, on ne sait pas trai-
ter en toute rigueur l'apparition de nouvelles valeurs d'usage.
Par ailleurs, mme dans le cas d'une nomenclature de biens par-
faitement dfinie, les pondrations retenir dpendent des
structures individuelles de consommation '. Ces difficults ne
sont nullement anecdotiques. Elles illustrent le caractre arbi-
traire du concept de niveau gnral des prix et, en consquence,
de celui de pouvoir d'achat de la monnaie. On trouve dj de
telles ides chez Carl Menger qui n'hsite pas conclure :
1. Don Patinkin aborde cette question aux pages 452 et 453 de La Mon-
naie, l'Intrt et les Prix (op. cit.). Pour chaque individu, il faut introduire une
fonction de dflation, subjective, propre l'individu. Dans la mesure o
Patinkin tudie essentiellement des situations de croissance homothtique des
prix, cette difficult n'affecte pas ses rsultats.
172
LA MONNAIE
C'est une erreur de croire l'existence d'une variation exacte-
ment mesurable dans le prix de la totalit des biens sur des mar-
chs diffrents ou deux poques diffrentes: en d'autres
termes, c'est une mprise de chercher le chiffre qui exprimerait
exactement les variations ou la valeur extrinsque 1 du numraire
[ ... ]. Il n'existe aucune mesure du mouvement extrinsque de
l'argent; il est impossible d'en trouver une
2
Comme notre thorie le soutient, la seule estimation objective
de la valeur de la monnaie est le un de l'unit de compte,
partir duquel se forment les prix. C'est la convergence des
doutes qui modifie cette situation en faisant merger une nou-
velle reprsentation de la valeur. En ce sens, l'indice de prix est
l'expression d'une sdition victorieuse, mimtiquement consti-
tue, et non pas la dcouverte d'une grandeur cache qui vien-
drait expliquer les prix. Montrons-le.
Commenons par considrer la situation qui prvaut lorsque
la valeur de la monnaie n'est pas questionne: l'unit de
compte tant considre comme stable, la formation des prix se
fait essentiellement partir des fondamentaux. Ce qui ne veut
pas dire que les conditions montaires n'ont pas d'impact, mais
qu'elles en ont uniquement par des effets indirects transitant
via les conditions de l'offre et de la demande. C'est ce qu'on a
appel le rgime de la confiance mthodique
3
, savoir la
confiance telle que la produit le cours routinier des transactions
russies. Lorsqu'il en est ainsi, la monnaie proprement dite
4
dispa-
rat du questionnement des acteurs conomiques. La monnaie
n'est plus qu'un instrument docile, sans paisseur. Il en est ainsi
parce que la prfrence pour la liquidit est stabilise. Il est
1. Chez Carl Menger, la valeur extrinsque correspond trs exactement
ce que nous nommons son pouvoir d'achat .
2. Carl Menger, cit in Gilles Campagnolo, Carl Menger entre Aristote et
Hayek. Aux sources de l'conomie moderne, op. cit., p. 212.
3. Michel Aglietta et Andr Orlan (dir.), La Monnaie souveraine, Odile
Jacob, Paris, 1998, par exemple p. 25.
4. Marx distinguait la monnaie idale, l'unit de compte, la monnaie
symbole, le moyen de circulation et la monnaie relle, moyen de paiement:
Jusqu'ici nous avons considr le mtal prcieux sous le double aspect
de mesure des valeurs et d'instrument de circulation. Il remplit la premire
173
L'EMPIRE DE LA VALEUR
alors concevable de traiter la monnaie, la manire de Patinkin
ou Walras, comme un bien particulier ayant pour utilit spci-
fique la liquidit. La monnaie fait l'objet d'une demande stable
qui peut tre modlise et teste. Lorsque ces conditions pr-
valent, lorsque la confiance l'gard de la monnaie est acquise,
la description du fonctionnement conomique que propose la
dmarche instrumentale s'avre satisfaisante et peut tre accep-
te. Cette manire d'intgrer notre difice conceptuel les
approches dites standard comme des configurations particu-
lires la validit limite a dj t rencontre au cours de notre
rflexion. Rappelons, en effet, que notre dmarche ne rejette
nullement a priori! les analyses conomiques dveloppes dans
le cadre de la thorie de la valeur utilit. Mais, dans la mesure
o cette thorie a pour hypothse premire l'objectivation rus-
sie des rapports marchands, ces analyses ne peuvent prtendre
tre valides que pour autant que cette hypothse tient. Le cas
montaire illustre pleinement cette position. La thorie de la
valeur noclassique est a priori lgitime pour dcrire les encha-
nements conomiques, pour autant que la qualit montaire ne
fait pas l'objet de controverses et qu'elle apparat aux yeux de
tous comme une ralit objective et durable, c'est--dire tant
que la question de la valeur de la monnaie ne se trouve pas
pose. Dans ces conditions, l'effet d'un accroissement de la
masse montaire dpend crucialement de la manire dont cet
accroissement se trouve rparti entre les acteurs ; autrement dit,
il dpend des conditions d'mission. Pour cette raison, l'analyse
que propose Patinkin est limite par le fait qu'elle traite exclu-
sivement de situations dans lesquelles les variations des
fonction comme monnaie idale, il peut tre reprsent dans la deuxime par
des symboles. Mais il y a des fonctions o il doit se prsenter dans son corps
mtallique comme quivalent rel des marchandises ou comme marchandise-
monnaie. [ ... ] nous dirons qu'il fonctionne comme monnaie ou argent propre-
ment dit (Le Capital, op. cit., p. 106).
1. Nous disons a priori en ce sens que l'hypothse d'objectivation tant
acquise, ces analyses ne sont pas rejeter. Cependant, elles ne sont pas pour
autant exactes. Il reste vrifier, au cas par cas, si elles sont conformes la
nature du capitalisme de la priode considre.
174
LA MONNAIE
encaisses montaires individuelles sont homothtiques. C'est
sous cette condition restrictive que Patinkin peut dmontrer
qu'un accroissement de x % de la masse montaire conduit un
accroissement gnralis de tous les prix de x %. Conceptuelle-
ment, une telle situation est intressante tudier mais son
application aux situations conomiques relles pose problme.
Ne faudrait-il pas plutt l'interprter comme une critique de la
thorie quantitative tant l 'hypothse d'une croissance homoth-
tique des encaisses parat peu plausible? Si la nouvelle monnaie
n'est pas rpartie homothtiquement, alors rien n'assure que
l'augmentation de tous les prix se fera au mme taux. La neu-
tralit de la monnaie doit tre abandonne.
Ce rsultat de non neutralit est obtenu sans qu'il soit nces-
saire de supposer une perte de confiance dans la monnaie. Il se
peut que tous les prix augmentent mais cette augmentation
gnralise n'est pas perue comme une remise en cause de la
valeur de la monnaie. Lorsque le doute s'installe quant cette
valeur, le rgime montaire se modifie en profondeur. La mise
en doute de l'unit de compte se manifeste par le biais d'esti-
mations subjectives, idiosyncrasiques, au plus prs des intrts
de chacun, de ce que vaut la monnaie. Pour comprendre cette
dynamique, il est intressant d'introduire les travaux du grand
conomiste franais de l' entre-deux-guerres, Albert Aftalion.
Aftalion a, sous les yeux, vingt ans de crise montaire presque
continue entre 1919 et 1939. partir d'une analyse statistique
fouille, il souligne quel point la thorie quantitative est
incapable de rendre intelligibles les dynamiques montaires de
cette crise. Alors que cette thorie soutient que les variations
du niveau gnral des prix (P) sont toujours la consquence des
variations de l'mission montaire
l
(M), Aftalion montre qu'il
n'en est rien
2
Il observe que, pour de nombreuses priodes, ce
1. Parce que la valeur de la monnaie y est dtermine causalement par la
quantit de monnaie mise, cette thorie peut tre qualifie de quantitative.
2. Quelquefois cette thorie est vrifie (1914-1919), quelquefois non
(1919-1939), ce qui pourrait conduire l'ide de rgimes diffrents selon les
circonstances, ce qu'Aftalion ne dveloppe pas.
175
L'EMPIRE DE LA VALEUR
sont les variations de P qui commandent celles de Ml . Pour-
quoi en est-il ainsi? Parce qu'il entre dans la formation des
prix, nous dit Aftalion, un lment que n'avaient pas vu les
conomistes quantitativistes, savoir l'estimation par le ven-
deur ou l'acheteur de la valeur de l'unit de compte. Il crit
ainsi:
[Dans] les courbes individuelles d'offre et de demande [ ... ],
ct de la valeur de la marchandise est prise en considration la
valur de la monnaie. Toute demande tant une demande un
certain prix implique une comparaison entre la valeur de la mar-
chandise demande et la valeur de la monnaie offerte. [ ... ] Deux
individus qui ont un dsir gal de la marchandise, pour qui les
courbes dcroissantes de l'utilit des marchandises seraient
entirement semblables, n'arriveront pas sur le march avec les
mmes courbes d'offre et de demande si leurs apprciations de
la valeur de l'unit montaire diffrent. Celui des deux qui atta-
chera plus d'importance l'unit montaire, qui sera moins dis-
pos offrir de la monnaie, sera par l mme moins demandeur
de marchandises
2
.
Le point crucial de l'analyse propose par Aftalion est dans
le fait que l'apprciation par l'individu de la valeur de l'unit
montaire est fondamentalement de nature psychologique et
subjective, comme peuvent l'tre ses prfrences, tout particu-
lirement en raison du rle prpondrant qu'y jouent les prvi-
sions et l'incertitude. En effet, pour Aftalion, la valeur de la
monnaie dpend des satisfactions que chacun attend de l'unit
montaire plutt que des satisfactions que donne cette unit
3
.
Ds lors, cette analyse met en relief le rle que joue la
croyance
4
, savoir la croyanceS que quelque chose a chang
ou changera dans les conditions du march, de manire que les
1. Albert Aftalion, Monnaie, Prix et Change. Expriences rcentes et tho-
rie, Paris, Sirey, 1940, p. 34.
2. Ibid., p. 384-385.
3. Ibid., p. 383.
4. Ibid.
5. Pour Aftalion, cet lment d'anticipation est un fait gnral qui ne se
restreint pas au seul domaine montaire. Il est propre toutes les valeurs co-
176
LA MONNAIE
prix varieront, qu'ils s'orienteront dans le sens de la baisse ou
de la hausse
l
)).
Cette analyse de la crise montaire offre des convergences
intressantes avec nos propres rflexions en raison du rle cen-
tral qu'y joue la mise en cause de l'unit de compte. A contra-
rio, la croyance en la constance de la valeur de la monnaie
apparat comme un facteur important de stabilit :
La croyance la stabilit du pouvoir d'achat de l'unit mon-
taire agit elle-mme d'ordinaire comme un facteur important de
stabilit [ ... ]. Si un changement survient, beaucoup d'esprits le
considreront comme une erreur passagre, accidentelle. L'unit
montaire retrouvera bientt sa valeur antrieure
2
Aussi, lorsqu'une pression inflationniste se fait jour, dans un
premier temps, dit Aftalion, les individus restent-ils attachs aux
anciennes valuations, ce qu'il nomme fidlit aux apprcia-
tions anciennes de l'unit montaire
3
)). Ce qui a pour cons-
quence que le rgime stationnaire continue prvaloir. Ce sont
seulement les prix de certains produits qui paraissent monter
pour des raisons sans doute accidentelles, passagres, tenant la
marchandise plutt qu' la monnaie
4
)) Les hausses de prix sont
perues comme localises, comme exprimant les fondamentaux
et non comme une question proprement montaire. Mais cela ne
peut durer si les dsordres persistent. Ds lors que les augmen-
tations de prix se font de manire plus systmatique, les
prvisions se modifient la fois quant leur nature et quant
l'tendue de leurs effets. [ ... ] Beaucoup commencent se rendre
nomiques : Ce ne sont pas exactement les jouissances que donne un objet qui
font sa valeur, mais plutt les jouissances qu'on croit qu'il donne, les jouissances
qu'on s'attend qu'il procurera. Peu importe qu'on se trompe, qu'on s'abuse sur
les jouissances escomptes. L'objet a de la valeur dans la mesure de ce qu'on en
attend (ibid.). Il insiste fortement sur ce point qu'il analyse comme un apport
majeur de la thorie montaire la thorie de la valeur: Celle-ci aussi pourra
emprunter quelque chose la thorie de la monnaie (ibid.).
1. Ibid., p. 270.
2. Ibid., p. 269.
3. Ibid., p. 268.
4. Ibid., p. 276.
177
L'EMPIRE DE LA VALEUR
de plus en plus nettement compte qu'il ne s'agit pas simplement
d'une hausse des prix de divers produits particuliers, mais d'une
maladie plus gnrale qui a gagn la valeur mme de la monnaie.
Ils comprennent que c'est la monnaie qui se dprcie sous leurs
yeux! . C'est l le signal de la crise montaire s'exprimant par
une mise en cause gnrale de l'unit montaire. Comme y
insiste Aftalion, dans cette conjoncture conomique de crise,
l'ensemble des apprciations individuelles devient la variable
active, celle qui commande la totalit du processus : La
valeur sociale, objective de la monnaie, les prix sur le march
dpendent de l'ensemble des apprciations individuelles
2
Pourtant, la thse d'une apprciation purement psychologique
ne dcrit, selon nous, qu'une partie seulement du phnomne.
On ne peut en rester l. l'vidence, comme le prouve la
dprciation continue de la monnaie, on observe une polarisa-
tion de ces apprciations dans une certaine direction. Certaines
forces poussent l 'homognisation des anticipations et cette
homognisation joue un rle crucial dans le dveloppement de
la crise. Pour le comprendre, il faut aller un pas plus loin
qu'Aftalion et considrer que les apprciations individuelles,
pour s'imposer, ne sauraient rester purement indpendantes. Il
doit s'tablir une certaine coordination au sein des stratgies de
dfiance. Ce point n'apparat pas chez Aftalion qui s'en tient
des anticipations individuelles indpendantes. Pourtant, les
acteurs ne peuvent rester indiffrents aux anticipations des
autres, dans la mesure o celles-ci faonnent les prix. Une
erreur en la matire les conduirait des prix trop levs ou des
prix trop bas, selon que leur anticipation surestime la dprcia-
tion de l'unit de compte ou la sous-estime. C'est ce que dit le
modle mimtique : les acteurs, pour tablir leurs prvisions,
tiennent compte des anticipations du groupe. Si on introduit
cette hypothse, il devient possible de comprendre par quels
processus s'opre une harmonisation des pratiques d'indexation
autour d'une mme grandeur. L'mergence de cette rfrence,
1. Ibid., p. 272-273.
2. Ibid., p. 267.
178
LA MONNAIE
parce qu'elle polarise sur elle l'ensemble des apprciations
dviantes, donne toute sa cohrence et toute sa vigueur au mou-
vement de dfiance. Dans son analyse, Aftalion constate, pour
les crises qu'il tudie, que la grandeur qui sert de rfrence au
mouvement collectif de dfiance est le taux de change l'gard
du dollar ou de la livre sterling. Dans les cas d'inflation impor-
tante, selon Aftalion, l'apprciation de la valeur de l'unit
montaire se rgle sur les variations du change :
Le change devient l'indicateur des prix, le baromtre de la
valeur intrieure de la monnaie sur lequel tout le monde a ses
yeux fixs. Ce n'est pas par l'intermdiaire de la vitesse de cir-
culation comme le voudrait la thorie quantitative, ni par l'inter-
mdiaire des revenus comme le voudrait la thorie du revenu,
que la dprciation intrieure de la monnaie a lieu. C'est direc-
tement par cette dprciation que la hausse des prix suit la
dprciation extrieure 1
Trs clairement, dans ces situations, on assiste la formation
d'une estimation collective de la dprciation de l'unit de
compte, rsultant de la focalisation mimtique des apprciations
individuelles sur le taux de change de la monnaie. Il est difficile
de trouver des situations conomiques dans lesquelles les repr-
sentations jouent un plus grand rle. Ce sont elles qui dominent
entirement le processus. Cependant, parce que Aftalion privi-
lgie l'analyse strictement psychologique, il ne livre pas d'ana-
lyse systmatique de ces croyances montaires et de leur
polarisation. Il ne nous dit pas pourquoi merge cette focalisa-
tion universelle sur le change. Pourtant, cette dernire est essen-
tielle pour comprendre l'approfondissement de la crise. Aftalion
se contente d'indiquer le fait qu'interviennent de nombreux fac-
teurs, bien au-del de l'conomie, en insistant tout particulire-
ment sur l'impact des variables politiques. Il convient ici d'aller
bien plus loin qu'Aftalion.
Pour conclure cette section, notons que Simiand comme Sim-
mel se dclarent galement critiques de la thorie quantitative.
1. Ibid., p. 247.
179
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Ils lui reprochent fortement son aspect mcanique : une crois-
sance de la quantit de monnaie provoque automatiquement une
baisse de sa valeur, c'est--dire une augmentation des prix. Pour
eux, la puissance de la monnaie est ailleurs : dans les reprsen-
tations qu'elle donne d'elle-mme, dans les croyances qui sont
au fondement de forces sans commune mesure avec les
influences mcaniques que produisent les variations de sa quan-
tit sur les prix. Simmel met en avant le retentissement [des
mouvements montaires] dans l'esprit des hommes :
On se reprsente quelquefois que la signification conomique
de l'argent est le produit de sa valeur par la frquence des tran-
sactions qu'elle ralise dans une priode donne [thorie quanti-
tative], mais c'est ignorer les puissants effets que l'argent exerce
simplement par l'espoir et la crainte, le dsir et le souci qui
s'attachent lui; ces affects qui jouent un si grand rle sur le
plan conomique. La simple ide de la prsence ou du manque
d'argent un endroit donn cre la tension ou la paralysie, et les
rserves de mtal jaune dans les caves des banques, couvrant
leurs billets, prouvent de faon tangible que l'argent, reprsent
par un symbole purement psychologique, a des effets complets 1.
Dans cette analyse, Simmel nous prsente la monnaie comme
une force de rayonnement qui touche tout le groupe social.
L'anticipation collective de sa raret ou de son abondance influe
sur le cours prsent de l'conomie beaucoup plus que les offies
et demandes effectives actuelles, pour paraphraser Simiand
2
Ce
sont l diverses situations o le pouvoir montaire apparat dans
toute son tendue et dans toute sa puret. C'est une puissance
d'influence ou encore une capacit affecter tous les individus
du groupe. La substance dont est faite la monnaie ne joue, dit-
il, une priode o les conceptions mtallistes sont majori-
taires, qu'un rle secondaire dans la production de cette
puissance d'affecter. Ce qui compte essentiellement, ce sont les
1. Georg Simmel, Philosophie de l'argent, op. cit., p. 186.
2. Les prvisions [ ... ] qui peuvent tre faites [ ... ] influent sur [le] cours
prsent autant et mme beaucoup plus que l'offre et la demande effectives
actuelles (Franois Simiand, La monnaie ralit sociale , art. cit., p. 242).
180
LA MONNAIE
croyances que la monnaie vhicule et la manire dont celles-ci
entrent en rsonance avec les intrts et les projets des indivi-
dus: [Ce qui fait fondamentalement que la monnaie est mon-
naie] n'a aucune relation intrinsque avec le fait que l'argent
soit li une substance, et [ cela] fait apparatre de la faon la
plus sensible que l'essence de l'argent consiste en reprsenta-
tions, investies en lui bien au-del de la signification propre de
son supportI. Ce rle des reprsentations est pour Simmel ce
qui dsigne la monnaie comme un phnomne intgralement
sociologique :
Ces phnomnes [ ... ] montrent de manire particulirement
transparente combien l'argent, de par son essence profonde, est
peu li la matrialit de son substrat; comme il est en effet,
intgralement, un phnomne sociologique, une forme d'interre-
lations humaines, sa nature apparat avec d'autant plus de puret
que les liens sociaux sont plus condenss, plus fiables, plus
aiss
2
La critique de Simiand est de mme nature bien qu'elle
prenne pour point de dpart l'ide chre aux quantitativistes
selon laquelle la monnaie est un bon d'emploi
3
qui vaut au
prorata de ce qu'elle permet d'acheter: cette chose qui ne sert
rien sinon que de pouvoir obtenir de quoi servir tout
4
.
Dans cette conception, la masse des marchandises susceptibles
d'tre achetes grce cette monnaie apparat comme le gage
global sur lequel cette monnaie est, en quelque sorte, assi-
gneS . Il s'agit en consquence de mettre en regard la masse
des emplois et la masse des moyens montaires, la valeur de
l'unit montaire se dterminant partir du rapport de ces deux
masses. Simiand souligne immdiatement combien cette
prsentation est faussement simple, la fois pour ce qui est du
calcul du gage comme pour ce qui est du calcul des moyens
1. Georg Simmel, Philosophie de l'argent, op. cit., p.225.
2. Ibid., p. 187.
3. Franois Simiand, La monnaie ralit sociale , art. cit., p. 240.
4. Ibid., p. 249.
5. ibid., p. 240-241.
181
L'EMPIRE DE LA VALEUR
montaires. Il Y insiste fortement et retrouve le point de vue de
Simmel:
Qu'est-ce dire sinon que cette thse quantitative se montre
radicalement errone en pensant tirer d'un rapport entre des
quantits physiques 1 une valeur conomique : si cette valeur co-
nomique varie alors, elle varie seulement par le fait du retentis-
sement de ces mouvements physiques dans l'esprit et sur les
actions et les ractions des hommes ; et disons pll.!s : dans
l'esprit et sur les actions et ractions non pas des hommes
comme individus,' mais des groupes fonctionnels, des classes,
des nations, de la socit tout entire
2
Comme pour Simmel, la pense montaire de Simiand se
veut sociologique prcisment en ce qu'elle prend les croyances
pour ce qu'elles sont, savoir des forces qui modifient effecti-
vement les comportements parce qu'elles modlent les esprits.
Pour ces deux auteurs, il faut absolument intgrer le rle que
jouent les reprsentations collectives, car elles sont au fonde-
ment du fait montaire:
[ ... ] ce n'est pas la reprsentation montaire qui est un voile
devant les phnomnes conomiques vritables; c'est l'effort
pour se dgager et se passer de la reprsentation montaire qui
lve un voile obscurcissant [ ... ] et cela parce que la reprsenta-
tion montaire est effectivement une ralit, part intgrante,
constitutive, essentielle, dans le fonctionnement d'un systme
proprement conomique
3
[les italiques sont de l'auteur]
On notera, par ailleurs, que chez Simiand le rle des
croyances est troitement li la nature incertaine de l'avenir.
L'intervention du futur introduit des effets de croyance parce
qu'il chappe au calcul rationnel. En consquence, dans la
mesure o la valeur de l'unit montaire dpend d'vnements
venir, il entre ncessairement une part d'opinion dans son
estimation. De ce point de vue, la proximit de Simiand avec la
l. En l'occurrence, le rapport entre E, les emplois de la monriaie, et M, le
mtal montaire (ibid., p. 246-247).
2. Ibid.
3. Ibid., p. 257.
182
LA MONNAIE
pense keynsienne est frappante et doit tre souligne. Parce
que Simiand rejette, comme Keynes, la possibilit de rduire le
rapport au futur un calcul probabiliste objectif
l
, indpendant
des personnes, il est ncessairement conduit donner toute sa
place la subjectivit des anticipations individuelles et, par voie
de consquence, aux logiques sociales d'opinion qui les struc-
turent. C'est ainsi que Simiand dcrit le futur comme non pas
une donne quantitative dtermine ou dterminable, mme en
coefficient mathmatique de probabilit plus ou moins grande,
mais affaire d'apprciation qui, pour une part, est de sentiment
plus ou moins indistinct plutt que de prvision raisonne et cri-
tique: en un mot, affaire de confiance (ou de dfiance
2
) .
Comme Simiand et Simmel, Keynes soulignera que le rapport
la monnaie, ce qu'il appelle la prfrence pour la liquidit, ne
saurait se construire sur une base uniquement rationnelle. Il y
entre des lments instinctifs, subjectifs et mimtiques, comme
le souligne l'article de 1937. Il crit:
[ ... ] pour des motifs en partie rationnels et en partie instinctifs,
notre dsir de dtenir de la monnaie comme rserve de richesse
est un baromtre de notre degr de dfiance quant nos propres
calculs et conventions concernant l'avenir. Mme si cette
impression au sujet de la monnaie est elle-mme conventionnelle
ou instinctive, elle agit, pour ainsi dire, un niveau plus profond
de nos motivations. La possession de monnaie relle apaise notre
inquitude ; et la prime que nous requrons pour nous faire nous
sparer de la monnaie est la mesure de notre degr d'inqui-
tude
3
Ce clbre passage illustre la puissance de la pense de
Keynes qui n 'hsite pas introduire dans ses analyses des
lments conceptuels n'appartenant en rien au rpertoire habi-
tuel de l'conomiste comme l'inquitude, les conventions, les
1. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment , Quar-
ter/y Journa/ of Economies, vol. 51, nO 2, fvrier 1937, p. 217.
2. Franois Simiand, La monnaie ralit sociale , art. cit., p. 242.
3. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment , art.
cit., p. 147.
183
L'EMPIRE DE LA VALEUR
esprits animaux (animal spirits) ou les instincts. C'est le signe
d'une analyse qui fait jouer un grand rle aux croyances. Pour
Keynes, la crise conomique est d'abord essentiellement une
crise de confiance, savoir une situation o les croyances de
l'acteur sont remises en cause. Il ne croit plus aux conventions
passes. Si la dfiance a des effets sur l'conomie, nous dit
Keynes, c'est parce qu'elle trouve, dans le choix de la liquidit,
un moyen de s'exprimer qui n'est pas une dpense. Le seul
remde radical aux crises de confiance [ ... ] serait de restreindre
le choix de l'individu la seule alternative de consommer son
revenu ou de s'en servir pour faire fabriquer l'article de capital
rel qui [ ... ] lui parat tre l'investissement le plus intressant
qui lui soit offert!. Avec la liquidit, l'individu peut se mettre
hors jeu, c'est--dire refuser de participer l'activit cono-
mique parce qu'elle lui parat trop incertaine, trop opaque, trop
confuse. Cette mise hors jeu, ds lors qu'elle se gnralise,
affaiblit la demande effective et la production. Elle produit la
crise conomique gnrale.
conomie et sciences sociales
Dans le monde de la sparation marchande, une question
taraude tous les acteurs, la liquidit, parce qu'elle est au fonde-
ment de ce qui constitue la puissance marchande, savoir le
pouvoir d'acheter. Le dsir de liquidit est l'origine d'un pro-
cessus de concurrence mimtique, rtroactions positives, au
cours duquel les biens liquides les plus en vue voient leur attrait
s'accrotre cumulativement jusqu'au point o une seule option
est retenue au dtriment de toutes les autres. Dans l'objet ainsi
lu se manifeste l'tat pur, par la grce de la polarisation
mimtique, cette qualit spcifique qu'on nomme la valeur
conomique . Il en est l'expression absolue. En consquence,
notre cadre conceptuel, loin de voir dans la monnaie une donne
1. John Maynard Keynes, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de
la monnaie, Paris, Payot, 1971, p. 173.
184
LA MONNAIE
secondaire et contingente de l'ordre marchand, la pense comme
son rapport primordial, celui grce auquel cet ordre social
accde l'existence complte. Ce rle fondateur a pour base
non pas quelque qualit intrinsque qu'il faudrait spcifier, mais
l'accord unanime des socitaires pour reconnatre en elle ce que
les autres dsirent absolument: la liquidit absolue. Dans la
monnaie, c'est l'unit objective du corps social qui se donne
voir. On ne saurait mieux exprimer la nature holiste de la mon-
naie, son statut de puissance collective. Son rle de mdiation
s'en dduit: tous partageant une mme vnration son gard,
les individus marchands cessent d'tre l'un face l'autre dans
un tat d'absolue tranget et leur lutte peut se polariser sur sa
seule possession. De cette faon, la monnaie s'impose toutes
les activits marchandes comme le tiers mdiateur qui en
authentifie la valeur conomique. Telle est la signification sp-
cifique de la monnaie: elle est l'institution qui donne ralit
la notion de valeur conomique et, par l mme, celle qui per-
met l'activit marchande dfinie comme activit tout entire
tourne vers l'appropriation de celle-ci. Le point thoriquement
dcisif est dans la rupture radicale avec les approches substan-
tielles de la valeur, pense hors de l'change comme donne
objective, dj l, intrinsque aux marchandises. Tout au
contraire, nous dfendons la thse selon laquelle c'est la mon-
naie, et elle seule, en tant qu'unit de compte, qui donne sens et
ralit l'valuation. Dans une structure fractionne coexistent
une multiplicit d'valuations prives qui varient erratiquement
avec les choix privs concernant ce que sont les biens liquides.
L'mergence de la monnaie met fin ce chaos et produit une
valeur conomique reconnue par tous. Autrement dit, la mon-
naie est ce par quoi les rapports marchands se trouvent pleine-
ment institus comme rapports nombrs. Elle est l'institution du
nombre marchand. Il est vain de chercher penser le prix
comme l'expression d'une grandeur qui lui prexisterait. Il faut
partir du dsir unanime de liquidit et des formes sociales qui
l'encadrent. En ce sens, la monnaie peut tre dite expression
de la totalit sociale condition de bien souligner que totalit
sociale (marchande) et monnaie se construisent simultanment
185
L'EMPIRE DE LA VALEUR
en prenant appui l'une sur l'autre. L'outil conceptuel pour pen-
ser cette totalisation est la polarisation mimtique. Elle produit
l'institution montaire.
Bien que minoritaire en conomie, cette conception de la
monnaie, qui sera dite institutionnaliste , n'est pas totalement
isole au sein des sciences sociales. Des penseurs comme Mar-
cel Mauss, Franois Simiand ou Georg Simmel ont dfendu des
positions assez proches. Ce qui fondamentalement rapproche
tous ces penseurs est une conception similaire de la valeur, aux
antipodes de l 'hypothse substantielle : la valeur conomique
n'est pas une substance mais une puissance de nature spcifi-
quement sociale, ne de la multitude et tendant ses effets tous
les membres de celle-ci au travers des reprsentations qu'elle
donne d'elle-mme. Une des forces de cette conception est
qu'elle n'est pas limite la seule conomie; on la retrouve
dans de nombreuses analyses sociologiques. Autrement dit, une
fois rejete l'hypothse de la valeur substance, il est possible
d'laborer un modle gnral d'intelligibilit des valeurs qui
englobe galement l'activit conomique. Cette perspective uni-
taire occupe une place stratgique dans notre projet: nos
yeux, une vritable refondation de l'conomie passe ncessaire-
ment par l'affirmation de son appartenance part entire aux
sciences sociales. Il faut dfendre l'ide que le fait conomique
est un fait social comme un autre. Il ne possde en rien une
essence particulire qui justifierait une pistmologie spcifique
ou une discipline indpendante. Ce point est essentiel: selon
nous, les sciences sociales relvent toutes d'une mme intelligi-
bilit. Nous proposons le terme d' uni disciplinaire pour qua-
lifier cette perspective qui vise surmonter les divisions
artificielles que connaissent actuellement les sciences sociales,
en affirmant leur profonde unit conceptuelle. On ne saurait
surestimer les consquences d'une telle position, non seulement
quant l'architecture globale des sciences sociales, mais gale-
ment pour ce qui est de la manire dont chacune d'elles conoit
son objet. On peut en esprer des avances considrables, et
d'abord pour l'conomie elle-mme qui, prisonnire de sa
conception de la valeur substance, est fortement limite dans
186
LA MONNAIE
son aptitude dchiffrer le capitalisme. Le chapitre V sera
entirement consacr l'explicitation de ce projet unidiscipli-
naire. Il s'agira de montrer par quoi l'analyse dveloppe
jusqu' maintenant s'intgre dans un modle plus gnral de ce
que sont les valeurs sociales. La rfrence Durkheim y jouera
un grand rle.
Chapitre V
Un cadre unidisciplinaire
pour penser la valeur
Comme toute valeur, religieuse, esthtique, morale ou
sociale, la valeur conomique a la dimension d'un jugement
portant sur la puissance des individus ou des objets. Ainsi la
valeur esthtique est-elle la reconnaissance du degr de puis-
sance de certains individus ou objets dans le champ des activits
artistiques. La question centrale que les valeurs posent aux
sciences sociales est celle, nigmatique, de leur objectivit, sans
laquelle il n'y aurait pas de valeurs au sens propre mais un
ensemble pars d'estimations subjectives. Durkheim en sou-
ligne bien la centralit lorsque, aprs avoir considr divers
jugements de valeur du type ce tableau a une grande valeur
esthtique , ce bijou vaut tant , il note: Dans tous les cas,
j'attribue aux tres et aux choses dont il s'agit un caractre
objectif, tout fait indpendant de la manire dont je le sens au
moment o je me prononce [ ... ]. Toutes ces valeurs existent
donc, en un sens, en dehors de moi
l
Or, souligne Durkheim,
la valeur renvoie une capacit produire du dsir chez les
sujets. Comment, dans ces conditions, concilier ces deux dimen-
sions: le dsir, d'un ct, et l'objectivit, de l'autre? Il crit:
Ce qui a de la valeur est bon quelque titre; ce qui est bon est
dsirable; tout dsir est un tat intrieur. Et pourtant les valeurs
dont il vient d'tre question ont la mme objectivit que des
choses. Comment ces deux caractres, qui, au premier abord,
semblent contradictoires, peuvent-ils se rconcilier? Comment
1. mile Durkheim, Jugements de valeur et jugements de ralit , in
Sociologie et Philosophie, Paris, PUF, 1967, p. 91.
188
UN CADRE UNIDISCIPLlNAIRE POUR PENSER LA VALEUR
un tat de sentiment peut-il tre indpendant du sujet qui
l'prouve 1 ?
On aura not quel point ce questionnement se retrouve
l'identique chez les conomistes. Il n 'y a rien dans la valeur co-
nomique qui, ontologiquement, la distingue de ses consurs des
sciences sociales. Durkheim en tait si convaincu qu'il n'hsite
pas crire: Certes, il y a des types diffrents de valeurs, mais
ce sont des espces d'un mme genre
2
Ce qui va produire
l'autonomisation de l'conomie que l'on connat, ce n'est donc
pas la spcificit de la question qui lui est pose - puisque cette
question est commune toutes les sciences sociales - mais la
particularit de la rponse qui lui a t apporte par les cono-
mistes. Ceux-ci ont labor un cadre thorique sans quivalent
dans les autres disciplines, savoir les thories de la valeur, qui
attribuent l' obj ectivit de la valeur conomique l'existence
d'une substance sociale, travail ou utilit, dont la grandeur peut
tre mesure. Sur un tel socle, comme on l'a soulign, s'est
constitue une tradition de pense indpendante en rupture avec
le raisonnement sociologique
3
, ce que nous avons nomm une
conomie des grandeurs . Elle a pour trait caractristique de
ne faire aucune place aux reprsentations et aux croyances col-
lectives. On ne saurait imaginer rupture plus radicale.
Tout l'effort thorique poursuivi au long du prsent livre vise
raffirmer la loi commune de la valeur pour en finir avec le
sparatisme qui caractrise l'conomie en tant que discipline.
Bien qu'elle ait l'apparence d'un nombre, la valeur conomique
est bien une puissance de nature sociale, en l'espce un pouvoir
sur autrui qui prend la forme d'un pouvoir d'achat sur les
choses, dont l'origine est dans la capture universelle des dsirs
individuels de liquidit. Ce qui demande tre compris est la
1. Ibid., p. 92.
2. Il ajoute: Le progrs qu'a fait, dans les temps rcents, la thorie de la
valeur est prcisment d'avoir bien tabli la gnralit et l'unit de la notion
(ibid., p. 10 1). Il pensait que la sociologie avait rsolu dfinitivement cette
question.
3. Au sens que lui donne Jean-Claude Passeron dans Le Raisonnement
sociologique (op. cil.).
189
L'EMPIRE DE LA VALEUR
nature de cette puissance: comment un sentiment collectif
s'extriorise durablement dans un objet? Cette question a reu
de longs dveloppements de la part des sciences sociales.
Confiance, affect commun, puissance de la multitude, croyances
collectives sont les concepts proposs pour en apprhender la
nature. Ils font l'objet du prsent chapitre. Il est esprer que
leur analyse permettra de rendre notre dmarche plus lisible en
montrant dans quelle perspective gnrale elle s'intgre. Nous
montrerons, la fin du chapitre, que cette rflexion dbouche
sur une vision de l'activit conomique notablement distincte de
celle qui prvaut chez les conomistes noclassiques. leurs
yeux, la socit marchande rsulte du libre engagement des par-
ties prenantes, conformment ce que leur dictent leurs intrts.
Autrement dit, elle est pense sur le modle de l'accord contrac-
tuel. A contrario, notre approche insiste sur la prsence de
forces collectives sui generis qui enrlent les individus en
jouant sur la puissance des affects qu'elles provoquent chez
eux. La monnaie et la fascination qu'elle exerce sur tous les
individus nous en fournissent l'illustration exemplaire. Elles
dmontrent qu'on ne saurait identifier le lien marchand un lien
d'une nature contractuelle 1. Mais avant d'examiner ces points,
commenons par l'analyse du concept de confiance tel que Sim-
mel nous le propose.
Simmel et la confiance
Alors que dans la tradition conomique la valeur est une gran-
deur substantielle, faite de travail ou d'utilit, dans l'approche
que nous proposons, la valeur est essentiellement une puissance
1. On retrouve par ce biais une thse dfendue par Durkheim dans De la
division du travail social (paris, PUF, 1978). Durkheim note que le contrat
repose sur le droit contractuel et que le droit contractuel n'est pas d'une nature
contractuelle. Cet argument lui permet de conclure qu'il n'y a pas que du
contractuel dans le contrat. Notre argument est diffrent. Nous prenons appui
sur la prsence de la monnaie dans le rapport marchand en soulignant que la
monnaie n'est pas de nature contractuelle.
190
UN CADRE UNIDISCIPLINATRE POUR PENSER LA VALEUR
d'achat qui, une fois investie dans l'objet montaire, se trouve
reconnue et dsire par tous. En tant que l'acquisition de mon-
naie signifie une capacit accrue d'achat, cette acquisition n'est
pas en contradiction avec les intrts de l'individu, pour peu
qu'on largisse la thorie de l'action rationnelle la puissance et
aux instruments de la puissance. Il est clair cependant que cette
action met en jeu une croyance: la croyance selon laquelle
l'objet acquis conservera ses qualits montaires de telle sorte
que son propritaire puisse, grce lui, effectivement acheter les
marchandises qu'il souhaite au moment o il le souhaite. C'est
cet endroit prcisment qu'intervient la confiance parce que rien,
dans la nature de la monnaie, ne garantit absolument qu'elle soit
pour toujours accepte comme moyen de paiement par les
acteurs marchands. Ce que la polarisation mimtique a fait, elle
peut galement le dfaire en s'investissant dans un nouveau bien
liquide et en dlaissant l'ancien. En d'autres termes, les mon-
naies ne sont jamais qu'une promesse de liquidit. Cette ide est
au point de dpart de la rflexion que Simmel a dveloppe
propos de l'argent. En effet, pour Simmel, le possesseur
d'argent ne peut contraindre quiconque lui livrer pour de
l'argent, rut-il incontestablement du bon argent, quoi que ce soit,
comme on l'a bien vu dans des cas de boycott
l
. Il faut l'achat
effectif d'une nouvelle marchandise pour que la validit de
l'argent se voie provisoirement confirme. Sur la base de ce
constat, Simmel se refuse opposer radicalement monnaie et
crdit : Le fait que les promesses contenues dans l'argent
puissent [ ... ] ne pas [ ... ] tre remplies confirme l'argent dans ce
caractre de simple crdit; car il est bien dans la nature du crdit
que la vraisemblance de sa ralisation ne soit jamais totale, si
grande soit-elle
2
. Ou encore: Tout argent est proprement
parler du crdit, puisque sa valeur repose sur la confiance qu'a
la partie prenante de recevoir contre cet instrument d'change
une certaine quantit de marchandises
3
Il s'ensuit que, aux
1. Georg Simmel, Philosophie de l'argent, op. cit., p. 198.
2. Ibid., p. 198.
3. Ibid., p. 196-197.
191
L'EMPIRE DE LA VALEUR
yeux de Simmel, rien ne distingue qualitativement l'argent mtal
et l'argent crdit: Il ne fait aucun doute que l'argent mtal lui
aussi est une promesse et ne se distingue du chque que par
l'tendue de la sphre o sa convertibilit est garantie 1. C'est
l une analyse d'une trs grande originalit en cette fin de
XIX
e
sicle o dominent les conceptions mtallistes qui consi-
drent que l'or est la seule monnaie vritable. Pour Simmel, mme
l'or repose sur de la confiance: non aes sedfides
2
, comme il
se plat le rpter, car les individus peuvent refuser le mtal.
Simultanment, Simmel souligne que la monnaie est un crdit
d'un type trs particulier parce que l'entit dbitrice n'est pas un
individu ou une socit juridiquement responsable, mais la com-
munaut marchande prise dans sa totalit. Celui qui a de l'argent
possde un droit sur l'ensemble des producteurs-changistes:
[Dans l'change montaire] il intervient entre les deux parties
une tierce instance, l'ensemble du corps social qui, pour cet
argent, met disposition une valeur relle correspondante [ ... ].
L-dessus se fonde le noyau de vrit contenu dans la thorie
selon laquelle tout argent n'est qu'une assignation sur la socit ;
il apparat comme une lettre de change sur laquelle le nom de
l'intress n'est pas port [ ... ]. L'acquittement de toute obliga-
tion particulire au moyen d'argent signifie prcisment que
dsormais la communaut dans son ensemble va assumer cet
engagement vis--vis de l'ayant droit. [En remettant l'argent
celui qui a fourni la prestation, l'acheteur] lui assigne un produc-
teur provisoirement anonyme qui, en raison de son appartenance
la sphre conomique en question, prend sa charge la presta-
tion exige en change de cet argene.
C'est la nature holiste de la monnaie qui se trouve ici pleine-
ment reconnue. Penser la monnaie, c'est penser un engagement
de la socit en tant que totalit. Si la socit avait une identit
reconnue, le problme montaire serait aisment rsolu. Toute
la difficult vient prcisment du fait que le corps social dans
1. Ibid., p. 196.
2. Non pas le mtal mais la foi.
3. Ibid., p. 195.
192
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
son ensemble n'est pas une entit juridique qui puisse s'enga-
ger envers autrui. Pour cette raison, la monnaie chappe la
logique contractuelle: la monnaie est un droit qui tire son effec-
tivit du dsir des autres et non pas d'un engagement formel qui
contraindrait tous les acteurs l'accepter en toutes circons-
tances. En consquence, le droit montaire n'existe que pour
autant que la polarisation mimtique des dsirs se trouve, repro-
duite. Telle est la nature de la confiance montaire.
Simmel poursuit son analyse en observant que deux sortes de
confiance doivent tre distingues. La premire, d'une trs
grande banalit, se rencontre dans la quasi-totalit des activits
conomiques: Si l'agriculteur ne croyait pas que son champ
va porter des fruits cette anne comme les annes prcdentes,
il ne smerait pas ; si le commerant ne croyait pas que le public
va dsirer ses marchandises, il ne se les procurerait pas 1. Pour
Simmel, cette forme commune de la confiance a la nature d'un
savoir inductif : Cette sorte de foi n'est rien d'autre qu'une
forme de savoir inductif attnu
2
Par l'utilisation d'un tel
qualificatif, Simmel veut souligner que les croyances en ques-
tion se conforment aux rgles gnrales de la connaissance
objective: partir de l'observation des vnements passs,
l'individu construit inductivement sa reprsentation de ce que
sera le futur. Il s'ensuit que cette confiance ne demande pas de
longues explications; elle est facile analyser. On agit confor-
mment ce que prdit l'analyse inductive de la situation, tout
en sachant que la prvision ainsi tablie n'est pas parfaite. Cette
mme rationalit statistique sera au cur des analyses finan-
cires du chapitre VI. Parce que ce savoir reste approximatif et
que l'acteur en est conscient, entre un lment de confiance
dans l'action. Mais c'est une confiance par dfaut car elle vise
essentiellement carter le doute. Aussi le terme de dm-
fiance , s'il existait, serait-il plus appropri
3
Le cas du crdit
l. Ibid., p, 197.
2. Ibid.
3. Voir galement la p. 26 de La Monnaie souveraine de Michel Aglietta
et Andr Orlan (op, cit.).
193
L'EMPIRE DE LA VALEUR
est bien plus complexe parce que s'y trouve prsent un lment
supplmentaire, d'une tout autre nature, qui chappe aux rgles
de la connaissance inductive :
Dans le cas du crdit, de la confiance en quelqu'un, vient
s'ajouter un moment autre, difficile dcrire, qui s'incarne de
faon la plus pure dans la foi religieuse. Quand on dit que l'on
croit en Dieu, il ne s'agit pas d'un degr imparfait dans le savoir
relatif Dieu, mais d'un tat d'me qui ne se situe absolu-
ment pas dans la direction du savoir; c'est, d'un ct, absolu-
ment moins, mais de l'autre, bien davantage que ce savoir. Selon
une excellente tournure, pleine de profondeur, on "croit en
quelqu'un" - sans ajouter ou mme sans penser clairement ce
que l'on croit en vrit son sujet. C'est prcisment le senti-
ment qu'entre notre ide d'un tre et cet tre lui-mme existe
d'emble une connexion, une unit, une certaine consistance de
la reprsentation qu'on a de lui: le moi s'abandonne en toute
scurit, sans rsistance, cette reprsentation se dveloppant
partir de raisons invocables, qui cependant ne la constituent
pas
l
.
Comme on le remarque dans cette citation, Simmel n'est pas
trs clair dans sa spcification de ce qu'est cette foi socio-
psychologique apparente la foi religieuse
2
, qu'il nomme
galement foi supra-thorique
3
. Elle est, dans un premier
temps, dfinie ngativement, par le fait qu'elle chappe au
domaine de la connaissance rationnelle ; elle ne se situe pas
dans la direction du savoir , dit-il. La confiance en question
n'est pas la simple consquence d'un savoir imparfait comme
prcdemment. Puis, dans un second temps, Simmel nous dcrit
positivement cette croyance. Elle porte sur l'tre mme de ce
quoi on croit, selon la formule: croire en quelqu'un ou
quelque chose . Cette croyance en peut conduire, nous dit
Simmel, un sentiment d'une grande intensit lorsque s'tablit
entre l'tre en quoi on croit et l'ide qu'on s'en fait une
1. Georg Simme1, Philosophie de l'argent, op. cit., p. 197.
2. Ibid., p. 198.
3. Ibid., p. 197.
194
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
connexion troite, allant jusqu' provoquer un abandon irrsis-
tible du moi. Mais d'o vient l'ide qu'on se fait de cet tre?
Que veut dire cette connexion? Simmel n'en dit rien. On n'en
saura pas plus. Il passe directement la confiance montaire
qui, bien qu'appartenant cette deuxime catgorie, se dis-
tingue par son extrme intensit :
Le sentiment de scurit personnelle qu'assure la possession de
l'argent est peut-tre la forme et l'expression la plus concentre
et la plus aigu de la confiance dans l'organisation et dans
l'ordre tatico-social. Ce processus subjectif reprsente pour
ainsi dire la puissance suprieure de cet ordre qui cre la valeur
du mtal!.
Ces dernires rflexions s'intgrent parfaitement notre
cadre thorique. nos yeux galement, la confiance montaire
doit tre distingue en raison du rle central qu'elle joue dans
la construction de l'organisation conomique. Elle est au fonde-
ment de l'ordre marchand; elle en est le matriau de base. On
le voit nettement au moment des crises montaires. La valeur y
devient floue, incertaine. On constate une perte gnralise des
repres d'valuation, rendant de plus en plus problmatique
l'activit conomique jusqu' y faire totalement obstacle. Pen-
sons, par exemple, au calcul des profits en priode de forte
inflation. Le chiffre nominal n'est plus pertinent. A contrario, la
croyance en la liquidit absolue de la monnaie est ce qui fait
que la production et les changes marchands peuvent se dve-
lopper. Elle est le socle sur lequel tout repose. En ce sens, on
peut dire que toutes les autres formes de confiance conomique
lui sont subordonnes; elles ne prennent sens que si la
confiance montaire existe. En consquence, on peut affirmer
que la confiance montaire est l'expression la plus concen-
tre de la confiance conomique, l'nergie mme qui donne
vie aux rapports marchands. C'est la socit qui s'exprime par
son entremise. Elle est ce par quoi l'individu marchand fait
l'exprience de son appartenance une totalit qui le dpasse et
1. Ibid., p. 198.
195
L'EMPIRE DE LA VALEUR
le protge. Une fois ce constat fait, il reste expliquer d'o
viennent cette nergie et cette puissance. Tout l'intrt de
l 'hypothse mimtique se trouve prcisment dans son aptitude
rendre compte de cette ralit si nigmatique : la confiance en
la monnaie est au fondement de la valeur conomique.
L'affect commun
L'ide directrice de la thorie mimtique consiste en ceci que
la polarisation mimtique des dsirs individuels sur un mme
objet (ou une mme reprsentation) dote celui-ci d'une puis-
sance d'attraction d'autant plus grande que sont nombreux les
dsirs individuels. Il faut alors parler d'une composition mim-
tique des dsirs transformant des affects individuels disperss
en un affect commun polaris. La monnaie tire son pouvoir
d'attraction de cet affect commun qui se trouve investi en elle.
Notons, comme on l'a soulign prcdemment, que cette attrac-
tion est conforme aux intrts des producteurs-changistes
puisque, grce la dtention de monnaie, les individus ont
accs la liquidit. C'est mme une des raisons qui rend les
individus si rceptifs son influence. Mais, tant donn qu'il
mobilise le dsir des individus, ce pouvoir d'attraction que pro-
duit l'affect commun s'exerce de manire directe, immdiate,
hic et nunc. Il a pour fondement l'unisson des dsirs du groupe
qui produit, par rsonance, un affect de grande puissance.
Conformment ce que propose Frdric Lordon partir de sa
lecture de Spinoza!, nous nommerons cette puissance spci-
fique, propre l'affect commun, puissance de la multitude ,
puisqu'elle trouve sa source dans la multitude: Par puissance
de la multitude, il faut entendre une certaine composition pola-
1. L'analyse qui est ici propose partir des concepts de puissance de la
multitude, d'affect commun et de capture n'aurait pu voir le jour sans les
importants travaux que mne Frdric Lordon dans la perspective d'une
science sociale spinoziste . On en trouvera les rfrences dans la bibliogra-
phie.
196
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENS ER LA VALEUR
rise des puissances individuelles telle que surpassant, par la
composition mme, toutes les puissances dont elle est consti-
tue, elle est un pouvoir d'affecter tous 1. Cependant, dans le
cas qui nous intresse, la puissance de la multitude, en prenant
la forme de l'objet montaire, est, en quelque sorte, mise dis-
tance d'elle-mme et transfigure. Ce phnomne de captation
de la puissance de la multitude par l'objet montaire est d'une
grande importance. Il en est ainsi ds lors que l'objet se pr-
sente la conscience de l'ensemble des acteurs comme tant
l'origine mme de l'affect commun, en raison de ses qualits
spcifiques; autrement dit, ds lors que l'objet revendique la
puissance de la multitude comme tant son uvre. Selon cette
revendication, la ncessit de son lection serait inscrite dans sa
nature, dans le fait que l'objet lu n'est pas une marchandise
comme les autres. Telle est la reprsentation que le bien liquide
veut donner de lui-mme, reprsentation qui se construit, volue
et devient connaissance commune au cours des intenses interac-
tions mimtiques que la qute de liquidit provoque, chacun
cherchant convaincre autrui de la justesse de son choix et
rglant son argumentaire sur le dsir des autres. Certes, en tant
que thoricien, nous savons la fausset de cette reprsentation :
chaque coalition forme autour d'un bien liquide dfend
d'abord ses intrts et, pour ce qui est de la liquidit, la nature
de l'objet importe peu. Cependant, dans la lutte pour la supr-
matie, chaque prtendant la liquidit est conduit faire valoir
son propre rcit pour l'emporter sur les autres. Il s'agit de mon-
trer qu'on possde un droit particulier tre choisi pour rgner
sur le monde des biens ordinaires. Au cours du processus
concurrentiel, cette reprsentation que l'objet donne de lui-
mme, en tant qu'objet promis l'lection montaire, devient
indissociable de l'objet lui-mme. Le dsir se porte sur l'objet,
mais peru au travers de la reprsentation qu'il donne de lui-
mme. La convergence mimtique, par le fait qu'elle ralise
1. Frdric Lordon, La puissance des institutions (autour de la critique
de Luc Boltanski) , Revue du MA USS permanente, 8 avril 2010 [en ligne:
http://www.joumaldumauss.netlspip.php?article678]. p. 8.
197
L'EMPIRE DE LA VALEUR
effectivement la promesse de liquidit, valide ex post les prten-
tions de l'objet montaire. Sa liquidit absolue atteste de la jus-
tesse de sa reprsentation: le voil de facto exclu de la
circulation des marchandises profanes.
Cette exclusion parachve l'lection mimtique. Par son
action, l'unanimit mimtique acquiert le statut d'une mdiation
durable; elle cesse d'tre perue comme le produit transitoire
du mimtisme ou comme la victoire d'un clan sur un autre clan.
Elle apparat comme une ralit sur laquelle chacun peut dsor-
mais compter parce qu'elle est fonde dans des qualits propres
l'objet lu. On reconnat ici le croire en de Simmel: la
connexion entre notre ide d'un tre et cet tre lui-mme . Ce
faisant, l'lection se trouve lgitime. Dans notre cadre tho-
rique, le croire en X, en tant que capture de l'affect commun
par X (un objet ou un tre), repose sur deux ralits: (1) la pro-
duction d'un affect commun, et (2) X qui se prsente comme
possdant un droit particulier exprimer cet affect commun.
Mary Douglas, dans Ainsi pensent les institutions, souligne
qu'il n'existe pas de pouvoir institutionnel sans une reprsenta-
tion lgitimante qui vienne faire obstacle la propagation des
contestations et des dissidences. Il s'agit essentiellement, pour
l'institution, de faire valoir que sa prsence est incontestable
en l'inscrivant dans la nature mme des choses:
Pour acqurir une lgitimit, toute institution a besoin d'une
dfinition qui fonde sa vrit en raison et en nature [ ... ]. Une
convention est institutionnalise quand, la question de savoir
pourquoi on agit ainsi [ ... ], l'on peut rpondre infine en se rf-
rant au mouvement des plantes dans le ciel ou au comportement
naturel des plantes, des animaux et des hommes 1.
En matire montaire, c'est ce que nous avons appel l' exclu-
sion
2
qui joue ce rle: la mise distance de l'objet. Il s'agit de
montrer que l'objet tait promis l'lection en vertu de cer-
1. Mary Douglas, Ainsi pensent les institutions, Paris, Usher, 1989, p. 41.
2. Michel Aglietta et Andr Orlan, La Violence de la monnaie, op. cit., et
La Monnaie entre violence et confiance, op. cit.
198
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
taines proprits qui le distinguent radicalement des marchan-
dises ordinaires. Par le jeu de cette reprsentation qu'il donne de
lui-mme, l'objet lu se montre apte capter le dsir commun
de liquidit. Telle est la nature de la confiance montaire mise
en lumire par Simmel. Elle porte sur la lgitimit de l'lection.
Comme l'illustrent ces premires rflexions, on trouve au
cur de cette analyse des concepts qui sont d'ordinaire absents
des livres d'conomie: la polarisation mimtique des dsirs,
l'affect commun et la puissance de la multitude. Ils sont la
base de notre conception de la valeur conomique: la valeur est
une puissance qui a pour origine le groupe social, par le biais de
la mise en commun des passions et des penses. Introduire cette
ralit collective en conomie constitue une innovation de
grande ampleur l o d'ordinaire les conomistes ne recon-
naissent que l'action des volonts prives. Cette ralit n'est pas
propre l'conomie. Elle est mme, aux yeux de Durkheim,
caractristique du fait social . Il devient alors possible d'ima-
giner un cadre thorique unidisciplinaire qui mettrait fin au
schisme qui dchire les sciences sociales entre conomie, d'un
ct, et sciences historiques de l'autre.
Durkheim: une conception unidisciplinaire de la valeur
Au cur de toute l' uvre de Durkheim, on trouve la thse
selon laquelle le groupe social est porteur d'une vie psychique
d'un genre particulier, possdant une nergie et une autorit
qu'on ne retrouve pas chez les individus isols. Durkheim n'uti-
lise pas le terme d' affect commun mais, lorsqu'il parle de
sentiment commun ou de pense collective, c'est bien cette ra-
lit qui est dcrite. Cette vie psychique particulire, sui generis,
joue, selon lui, un rle crucial dans la rflexion sociologique par
le fait qu'elle est au fondement des valeurs sociales et de leur
autorit:
Quand les consciences individuelles, au lieu de rester spa-
res les unes des autres, entrent troitement en rapport, agissent
199
L'EMPIRE DE LA VALEUR
activement les unes sur les autres, il se dgage de leur synthse
une vie psychique d'un genre nouveau. Elle se distingue d'abord
de celle que mne l'individu solitaire, par sa particulire inten-
sit. Les sentiments qui naissent et se dveloppent au sein des
groupes ont une nergie laquelle n'atteignent pas les senti-
ments purement individuels [ ... ]. C'est, dans les moments
d'effervescence [ ... ], que se sont, de tous temps, constitus les
grands idaux sur lesquels reposent les civilisations. Les
priodes cratrices ou novatrices sont prcisment celles o, sous
l'influence de circonstances diverses, les hommes sont amens
se rapprocher plus intimement, o les runions, les assembles
sont plus frquentes, les relations plus suivies, les changes
d'ides plus actifs [ ... ]. On diminue la socit quand on ne voit
en elle qu'un corps organis en vue de certaines fonctions
vitales. Dans ce corps vit une me : c'est l'ensemble des idaux
collectifs. Mais ces idaux ne sont pas des abstraits, de froides
reprsentations intellectuelles, dnues de toute efficace. Ils sont
essentiellement moteurs ; car derrire eux, il y a des forces
relles et agissantes: ce sont les forces collectives [ ... ]. L'idal
lui-mme est une force de ce genre 1.
Cette citation est remarquable. Pour Durkheim, ce qui est
pens et senti en commun acquiert une emprise extrme sur tous
les esprits individuels et les transforme en profondeur. C'est sur
ce modle qu'il rend compte de l'mergence de la vie morale et
des idaux collectifs, qui sont une cration de l'effervescence
du groupe. Il n'est pas difficile de reconnatre dans ces forces
relles et agissantes qu'engendre le groupe social en fusion ce
que nous avons nomm la puissance de la multitude. Notons
avec quelle insistance Durkheim souligne le fait que ces repr-
sentations collectives sont proprement parler des forces
2
et
non de froides reprsentations intellectuelles . Il s'agit bien
pour lui de rendre intelligible la transformation que connat
1. mile Durkheim, Jugements de valeur et jugements de ralit , art.
cit., p. 102-105.
2. Dans Les Formes lmentaires de la vie religieuse (paris, PUF, 2003),
il va mme jusqu' soutenir que le concept de force tel que l'utilisent les phy-
siciens trouve son origine dans cette exprience de la force religieuse qui agit
matriellement sur les individus.
200
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
l'individu lorsqu'il devient un tre social, c'est--dire un tre se
conformant certaines manires de faire, de penser et d'agir.
Cette transformation n'est pas le produit d'une adhsion intel-
lectuelle, rsultant d'une analyse rationnelle de la situation,
mais bien celui d'une mise en mouvement du dsir individuel
par une puissance plus grande que l'individu. L'individu calque
mimtiquement son dsir sur celui de son modle : la multitude
unie. Par ailleurs, l'analyse que propose Durkheim pour rendre
intelligible le processus par lequel merge le sentiment commun
met fortement en avant le rle que jouent les interactions entre
agents afin de crer une troite corrlation entre les affects indi-
viduels, ce qu'il nomme une situation d'unisson. On reconna-
tra, dans ce processus d'actions et de ractions conduisant
l'unisson, notre dynamique d'interactions mimtiques dans
laquelle chacun rgle son choix sur celui des autres. Autrement
dit, le sentiment collectif que suscite l'affect commun n'est pas
simplement la somme des sentiments individuels. Il rsulte plu-
tt d'une mise en cho mimtique des motions individuelles:
Un sentiment collectif, qui clate dans une assemble, n'ex-
prime pas simplement ce qu'il y avait de commun entre tous les
sentiments individuels. Il est quelque chose de tout autre, comme
nous l'avons montr. Il est une rsultante de la vie commune, un
produit des actions et des ractions qui s'engagent entre les
consciences individuelles; et s'il retentit dans chacune d'elles,
c'est en vertu de l'nergie spciale qu'il doit prcisment son
origine collective. Si tous les curs vibrent l'unisson, ce n'est
pas par suite d'une concordance spontane et prtablie; c'est
qu'une mme force les meut dans le mme sens. Chacun est
entran par tous
1
Pour Durkheim, cette autorit particulire que produit le sen-
timent commun, ce que nous avons nomm la puissance de la
multitude, joue un rle fondamental dans son cadre thorique
puisqu'il y voit l'expression par excellence de ce qui fait la sp-
cificit du fait social. C'est l une thse proprement fondatrice
1. mile Durkheim, Les Rgles de la mthode sociologique, Paris, PUF,
1993, p. II.
201
L'EMPIRE DE LA VALEUR
qui demande tre rappele. Pour se faire comprendre,
Durkheim prend l'exemple des diffrents rgnes naturels et de
leur succession hirarchique 1 : minral, animal, humain. Chaque
fois qu'on passe de l'un l'autre, note-t-il, de nouvelles pro-
prits mergent que l'ordre infrieur ne connaissait pas, alors
mme que l'ordre suprieur ne rsulte que de la simple combi-
naison d'lments appartenant l'ordre infrieur. Ainsi, la
cellule vivante ne contient rien que des particules minrales [ ... ]
et pourtant il est, de toute vidence, impossible que les phno-
mnes caractristiques de la vie rsident dans des atomes
d'hydrogne, d'oxygne, de carbone et d'azote. [La vie] est
dans le tout, non dans les parties
2
On passe ainsi de la matire
(physique) la vie (biologique) et de la vie (biologique) la
conscience (psychique). chaque fois, une qualit nouvelle se
fait jour par quoi le nouveau rgne se trouve radicalement dis-
tingu du rgne infrieur. C'est selon ce mme modle que
Durkheim pense les rapports du social l'individuel: le fait
social est au fait individuel ce que le fait psychique est au fait
biologique et le fait biologique au fait physique. L'autonomie
du rgne social, son irrductibilit aux individus, s'en dduisent
directement. Bien que compose uniquement d'tres humains,
la socit n'en possde pas moins des proprits que les indivi-
dus ne connaissent pas: Cette synthse sui generis qui consti-
tue toute socit dgage des phnomnes nouveaux, diffrents
de ceux qui se passent dans les consciences solitaires
3
Mais
quelle qualit mergente caractrise le rgne social ? Quel est
son signe distinctif? Aprs la matire, la vie et la conscience,
quelle est l'expression de cette nouvelle complexit? Il est inu-
tile d'insister sur l'importance conceptuelle de cette question
pour la sociologie naissante. Y rpondre, c'est, d'une part,
dcouvrir de quoi la sociologie est la science; autrement dit,
1. Par exemple dans Les Rgles de la mthode sociologique [1895] et dans
la prface sa seconde dition [1901] ; ou dans Reprsentations indivi-
duelles et reprsentations collectives [1898].
2. Les Rgles de la mthode sociologique, op. cit., p. XVI.
3. Ibid., p. XVI/XVII.
202
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
dfinir quel est son objet d'tude. D'autre part, en tablissant
que le fait social est irrductible au fait individuel, comme le
fait individuel au fait biologique, et comme le fait biologique au
fait physique, le chercheur justifie du mme coup qu'il doive
exister une sociologie, autonome par rapport la psychologie,
comme la psychologie s'est affirme face la biologie et la bio-
logie face la physique. Durkheim est tel point conscient des
enjeux que recouvre la question Qu'est-ce qu'un fait social?
qu'il lui consacre tout le premier chapitre de son grand livre,
Les Rgles de la mthode sociologique. Sa rponse est la sui-
vante: le fait social se reconnat au pouvoir de coercition
externe qu'il exerce ou est susceptible d'exercer sur les indi-
vidus 1 . Durkheim dsigne comme caractristique de la vie
sociale cette forme sui generis d'autorit, extrieure aux indivi-
dus, qui les transforme en tres sociaux, ce qu'il nomme ailleurs
l'autorit morale . Pour Durkheim, le rgne social n'existe
que par le jeu de cette puissance particulire qui brise l'isole-
ment des individus et produit un cadre commun d'appartenance,
la socit. L'exprience du social, c'est toujours l'exprience
d'une force qui nous dpasse et nous unit. Aussi Durkheim
n'hsite-t-il pas crire: Le problme sociologique - si l'on
peut dire qu'il y a un problme sociologique - consiste cher-
cher, travers les diffrentes formes de contraintes extrieures,
les diffrentes sortes d'autorit morale qui y correspondent, et
dcouvrir les causes qui ont dtermin ces dernires
2
L'erreur, selon lui, consiste nier cette spcificit du fait social
en voulant tout expliquer sur la base exclusive des consciences
individuelles, en quoi on reconnat une forme extrme d'indivi-
dualisme mthodologique
3
Il conteste qu'on puisse, de cette
manire, expliquer la pression que subissent les tres sociaux,
pression qui est au fondement mme de la vie collective. Parce
1. Ibid., p. 11.
2. mile Durkheim, Les Formes lmentaires de la vie religieuse, op. cit.,
p.298.
3. Voici quelques exemples de cette erreur proposs par Durkheim dans
Les Rgles de la mthode sociologique: C'est ainsi qu'on explique couram-
ment l'organisation domestique par les sentiments que les parents ont pour
203
L'EMPIRE DE LA VALEUR
qu'elle s'exerce sur les volonts individuelles, elle ne saurait en
driver.
Puisque l'autorit devant laquelle s'incline l'individu quand il
agit, sent ou pense socialement, le domine ce point, c'est
qu'elle est un produit de forces qui le dpassent et dont il ne sau-
rait, par consquent, rendre compte. Ce n'est pas de lui que peut
venir cette pousse qu'il subit. [ ... ] En vertu de ce principe, la
socit n'est pas une simple somme d'individus, mais le systme
form par leur association reprsente une ralit spcifique qui a
ses caractres propres. Sans doute, il ne peut rien se produire de
collectif si des consciences particulires ne sont pas donnes;
mais cette condition ncessaire n'est pas suffisante. Il faut encore
que ces consciences soient associes, combines, et combines
d'une certaine manire; c'est de cette combinaison que rsulte la
vie sociale et, par suite, c'est cette combinaison qui l'explique.
En s'agrgeant, en se pntrant, en se fusionnant, les mes indi-
viduelles donnent naissance un tre, psychique si l'on veut,
mais qui constitue une individualit psychique d'un genre nou-
veau [ ... ]. Le groupe pense, sent, agit tout autrement que ne
feraient ses membres, s'ils taient isols 1.
Pour rendre visible l'troite proximit d'analyse existant
entre la sociologie durkheimienne et notre approche, il n'est que
de donner son nom cette autorit morale sui generis que pro-
duit la fusion du collectif: la puissance de la multitude. Ainsi
l'affinit des deux conceptions est-elle rendue patente. Elles
partagent une mme conception princeps : l'origine de la vie
sociale se trouvent de puissantes forces affectives qui modlent
leurs enfants et les seconds pour les premiers; l'institution du mariage, par les
avantages qu'il prsente pour les poux et leur descendance; la peine, par la
colre que dtermine chez l'individu toute lsion grave de ses intrts. Toute
la vie conomique, telle que la conoivent et l'expliquent les conomistes, sur-
tout de l'cole orthodoxe, est, en dfinitive, suspendue ce facteur purement
individuel, le dsir de la richesse. S'agit-il de la morale? On fait des devoirs
de l'individu envers lui-mme la base de l'thique. De la religion? On y voit
un produit des impressions que les grandes forces de la nature ou certaines
personnalits minentes veillent chez l'homme, etc., etc. (Les Rgles de la
mthode sociologique, op. cit., p. 100).
1. Ibid., p. 101-103.
204
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
les comportements individuels. Par ailleurs, ces forces pos-
sdent une proprit trs nigmatique. Elles peuvent s'investir
dans des objets et, par ce fait, leur transmettre une partie de leur
pouvoir. C'est toute la question de ce que Marx a nomm le
ftichisme . Pour l'aborder, nous ne quitterons pas Durkheim
mais nous nous baserons sur un autre ouvrage majeur de cet
auteur: Les Formes lmentaires de la vie religieuse.
Le fait religieux
Durkheim, afin de comprendre ce qui est au fondement de
l'opposition entre sacr et profane, par quoi il dfinit le fait
religieux, se propose d'tudier les formes lmentaires de la
vie religieuse, savoir le totmisme. Dans le chapitre VI du
Livre II, il s'intresse aux origines des croyances totmiques. Sa
premire interrogation porte sur l'extrme diversit des entits
ayant un caractre religieux : sont sacrs des animaux, des
vgtaux, des hommes et des images. Comment est-ce pos-
sible ? On reconnat ici la mme interrogation que celle de Marx
au dbut du Capital propos de la valeur conomique : Com-
ment des valeurs d'usage d'une si grande diversit peuvent-elles
s'galiser dans l'change? Est-il mme possible qu'elles aient
quelque chose en commun? Oui, rpond Marx, le fait d'tre
des produits du travail' . Examinons la rponse propose par
Durkheim:
Les sentiments semblables que ces diffrentes sortes de choses
veillent dans la conscience du fidle, et qui font leur nature
sacre, ne peuvent videmment venir que d'un principe qui leur
est commun toutes indistinctement, aux emblmes totmiques
comme aux gens du clan et aux individus de l'espce qui sert de
totem. C'est ce principe commun que s'adresse, en ralit, le
culte. En d'autres termes,le totmisme est la religion, non de tels
animaux, ou de tels hommes, ou de telles images, mais d'une
sorte de force anonyme et impersonnelle, qui se retrouve dans
1. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 43.
205
L'EMPIRE DE LA VALEUR
chacun de ces tres, sans pourtant se confondre avec aucun
d'eux
l
la question: comment expliquer que des choses si dis-
semblables soient toutes galement des valeurs, quoique des
degrs divers? , Durkheim rpond en formulant l'hypothse
dj rencontre d'une mme force anonyme et imperson-
nelle qui se trouverait prsente dans chacun de ces tres.
Aussi le raisonnement que va suivre Durkheim est-il tout entier
tendu vers l'explicitation de cette force impersonnelle qui est au
fondement du sacr. tudiant plus particulirement la tribu des
Sioux, il dcouvre que, chez ces peuples, par-dessus tous les
dieux auxquels les hommes rendent un culte, il existe une puis-
sance minente dont toutes les autres sont comme des formes
drives, qu'ils appellent wakan :
Tous les tres que [ces Indiens rvrent...] sont des manifesta-
tions de. [ ... ) ce pouvoir qui circule travers toutes choses. [ ... ]
Mais il n'est pas d'numration qui puisse puiser cette notion
infiniment complexe. Ce n'est pas un pouvoir dfmi et dfmis-
sable, le pouvoir de faire ceci ou cela; c'est le pouvoir, d'une
manire absolue, sans pithte ni dtermination d'aucune sorte.
Les diverses puissances divines n'en sont que des manifestations
particulires et des personnifications; chacune d'elles est ce
pouvoir vu sous l'un de ses multiples aspects
2
On observe l'quivalent du wakan dans les autres croyances
totmiques: l' orenda chez les Iroquois ou le mana chez les
Mlansiens. Dans tous les cas, on retrouve cette mme imper-
sonnalit. Le mana n'est point fix sur un objet dtermin; il
peut tre amen sur toute espce de choses ... Toute la religion
du Mlansien consiste se procurer du mana soit pour en pro-
fiter soi-mme, soit pour en faire profiter autruP. Durkheim
conclut de son tude que cette puissance fondatrice, cette ner-
gie, est la matire premire du fait religieux :
1. Les Formes lmentaires de la vie religieuse, op. cit., p. 269.
2. Ibid., p. 275.
3. Ibid., p. 277-278.
206
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
Ce que nous trouvons l'origine et la base de la pense reli-
gieuse, ce ne sont pas des objets ou des tres dtermins et dis-
tincts qui possdent par eux-mmes un caractre sacr; mais ce
sont des pouvoirs indfinis, des forces anonymes, plus ou moins
nombreuses selon les socits, parfois mme ramenes l'unit,
et dont l'impersonnalit est strictement comparable celle des
forces physiques dont les sciences de la nature tudient les
manifestations. Quant aux choses sacres particulires, elles ne
sont que des formes individualises de ce principe essentiel
1
Dans le chapitre VII qui suit, Durkheim cherche comprendre
la nature de cette force et le rle que joue le totem dans sa
constitution. Pour ce qui est de la premire question, savoir la
nature de cette force impersonnelle, la rponse nous est dj
connue, ce que nous avons nomm la puissance de la multitude
et qu'il dcrit comme l'unisson du groupe. Durkheim en tudie
longuement la nature et les effets. Il nomme autorit morale
cette force qui s'impose, non par la coercition, mais par l' attrac-
tion qu'elle exerce sur les esprits, en raison du respect dont elle
est l'objet: Le respect est l'motion que nous prouvons
quand nous sentons cette pression intrieure et toute spirituelle
se produire en nous
2
Elle dgage une nergie psychique
d'un certain genre
3
qui fait plier notre volont. Il faudrait pou-
voir tout citer, tant ces analyses permettent de bien saisir ce que
sont l'affect commun et sa phnomnologie:
Parce que [les manires de penser en socit] sont labores en
commun, la vivacit avec laquelle elles sont penses par chaque
esprit particulier retentit dans tous les autres et rciproquement.
Les reprsentations qui les expriment en chacun de nous ont
donc une intensit laquelle des tats de conscience purement
privs ne sauraient atteindre: car elles sont fortes des innom-
brables reprsentations individuelles qui ont servi former
chacune d'elles. C'est la socit qui parle par la bouche de ceux
qui les affirment en notre prsence; c'est elle que nous enten-
dons en les entendant et la voix de tous a un accent que ne
1. Ibid., p. 285-286.
2. Ibid., p. 296.
3. Ibid.
207
L'EMPIRE DE LA VALEUR
saurait avoir celle d'un seul [ ... ]. En un mot, quand une chose
est l'objet d'un tat de l'opinion, la reprsentation qu'en a
chaque individu [ ... ] commande des actes qui la ralisent, et
cela, non par une coercition matrielle ou par la perspective
d'une coercition de ce genre, mais par le simple rayonnement de
l'nergie mentale qui est en elle 1.
Il nous reste comprendre pourquoi ces forces ont pris la
figure d'un animal ou d'une plante. l'vidence, les animaux
et les plantes concerns ne sauraient par eux-mmes produire de
puissantes motions religieuses
2
C'est en tant qu'ils servent
d'emblmes au clan qu'ils captent l'affect commun. Durkheim,
pour expliquer ce phnomne, prend comme modle le drapeau,
symbole de la patrie, pour lequel le soldat est prt mourir.
Le totem est le drapeau du clan
3
, crit-il.
Plus largement, concernant les reprsentations collectives,
Durkheim note qu'elles attribuent aux choses auxquelles elles
se rapportent des proprits qu'elles n'ont pas. En un sens, on
peut parler d'un dlire: Si l'on appelle dlire tout tat dans
lequel l'esprit ajoute aux donnes immdiates de l'intuition sen-
sible et projette ses sentiments et ses impressions dans les
choses, il n'y a peut-tre pas de reprsentation collective qui, en
un sens, ne soit dlirante; les croyances religieuses ne sont
qu'un cas particulier d'une loi trs gnrale
4
Il en est ainsi du
drapeau comme du totem qui se voient dots de qualits sans
rapport avec le morceau de drap ou avec l'animal. Cependant,
ces qualits correspondent une ralit, certes pas la ralit des
objets en tant que tels, mais la ralit de ce que la socit voit
en eux : Ce n'est donc pas un dlire proprement dit; car les
1. Ibid., p. 297.
2. Le lzard, la chenille, le rat, la fourmi, la grenouille, la dinde, la
brme, le prunier, le kakatos, etc., pour ne citer que des noms qui reviennent
frquemment sur les listes de totems australiens, ne sont pas de nature pro-
duire sur l'homme de ces grandes et fortes impressions qui peuvent, sous
quelque rapport, ressembler aux motions religieuses et imprimer aux objets
qui les suscitent un caractre sacr (ibid., p. 293).
3. Ibid., p. 315.
4. Ibid., p. 325.
208
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
ides qui s'objectivent ainsi sont fondes, non pas sans doute
dans la nature des choses matrielles sur lesquelles elles se
greffent, mais dans la nature de la socit 1. Ici, ce qui est en
jeu est ce que nous avons nomm la capture de l'affect com-
mun. Il s'investit dans une chose par le biais d'une reprsenta-
tion et, ce faisant, dote cette chose de proprits nouvelles dont
la source n'est pas l'objet en tant que tel mais l'affect commun.
Dans ce processus, n'importe quel objet peut convenir, car ce
qui compte en dernire instance, c'est l'affect commun, la pola-
risation mimtique. Cela est vrai de la liquidit comme du sen-
timent religieux. Lisons ce qu'crit Durkheim :
On peut maintenant comprendre comment le principe tot-
mique et, plus gnralement, comment toute force religieuse est
extrieure aux choses dans lesquelles elle rside. C'est que la
notion n'en est nullement construite avec les impressions que
cette chose produit directement sur nos sens et sur notre esprit.
La force religieuse n'est que le sentiment que la collectivit
inspire ses membres, mais projet hors des consciences qui
l'prouvent, et objectiv. Pour s'objectiver, il se fixe sur un objet
qui devient ainsi sacr; mais tout objet peut jouer ce rle. En
principe, il n'yen a pas qui y soient prdestins par leur nature,
l'exclusion des autres; il n'yen a pas davantage qui y soient
ncessairement rfractaires. Tout dpend des circonstances qui
font que le sentiment gnrateur des ides religieuses se pose ici
ou l, sur tel point plutt sur un tel autre. Le caractre sacr que
revt une chose n'est donc pas impliqu dans les proprits
intrinsques de celle-ci: il y est surajout. Le monde du reli-
gieux n'est pas un aspect particulier de la nature empirique; il y
est superpos
2
Cette citation donne voir trs prcisment ce que nous avons
nomm capture de l'affect commun . Elle s'applique sans dif-
ficult la monnaie (<< tout objet peut jouer ce rle), car la
liquidit y est surajoute . Encore cette analyse reste-t-elle
incomplte, car elle procde comme si le sentiment commun
1. Ibid., p. 327.
2. Ibid., p. 327-328.
209
L'EMPIRE DE LA VALEUR
pouvait exister par lui-mme. Il faut aller plus loin dans l'ana-
lyse et considrer que: L'emblme n'est pas seulement un
procd commode qui rend plus clair le sentiment que la socit
a d'elle-mme: il sert faire ce sentiment; il en est lui-mme
un lment constitutif!. Ce point essentiel complexifie
quelque peu notre modle de la capture. Pour qu'il y ait objec-
tivation du sentiment commun, sans laquelle le sentiment res-
terait vanescent et disparatrait, celui-ci a besoin d'un
intermdiaire matriel pour lui donner corps et le rvler aux
yeux des individus. En ce sens, l'objet est ncessaire. Sans lui,
les tats de conscience resteraient intrieurs. Il permet au senti-
ment commun de perdurer par-del le moment de la fusion. Ce
point dlicat est remarquablement mis en avant par Durkheim:
[ ... ] par elles-mmes, les consciences individuelles sont fer-
mes les unes aux autres; elles ne peuvent communiquer qu'au
moyen de signes o viennent se traduire leurs tats intrieurs.
Pour que le commerce qui s'tablit entre elles puisse aboutir
une communion, c'est--dire une fusion de tous les sentiments
particuliers en un sentiment commun, il faut donc que les signes
qui les manifestent viennent eux-mmes se fondre en une seule
et unique rsultante. C'est l'apparition de cette rsultante qui
avertit les individus qu'ils sont l'unisson et qui leur fait prendre
conscience de leur unit morale. [ ... ] Les reprsentations collec-
tives [ ... ] supposent que des consciences agissent et ragissent
les unes sur les autres; elles rsultent de ces actions et de ces
ractions qui, elles-mmes, ne sont possibles que grce des
intermdiaires matriels. Ceux-ci ne se bornent donc pas rv-
ler l'tat mental auquel ils sont associs; ils contribuent le
faire. Les esprits particuliers ne peuvent se rencontrer et commu-
nier qu' condition de sortir d'eux-mmes; mais ils ne peuvent
s'extrioriser que sous la forme de mouvements. C'est l'homo-
gnit de ces mouvements qui donne au groupe le sentiment de
soi et qui, par consquent, le fait tre. Une fois cette homog-
nit tablie, une fois que ces mouvements ont pris une forme
une et strotype, ils servent symboliser les reprsentations
1. Ibid., p. 329.
210
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
correspondantes. Mais ils ne les symbolisent que parce qu'ils ont
concouru les former
l
Cette longue citation se justifie par l'importance de ce que
Durkheim y dtaille avec clart. Les intermdiaires matriels
jouent un rle fondamental, la fois dans la formation mme de
l'affect commun et dans sa durabilit. Sans eux, le sentiment
commun serait phmre. Il disparatrait une fois la foule dis-
soute. Leur rle consiste garder la mmoire de ce qui s'est
pass: Ces choses les rappellent sans cesse aux esprits et les
tiennent perptuellement en veil; c'est comme si la cause ini-
tiale qui les a suscits continuait agir. Ainsi l'emblmatisme,
ncessaire pour permettre la socit de prendre conscience de
soi, n'est pas moins indispensable pour assurer la continuit de
cette conscience
2
De ce point de vue, l'objectivit des choses
qui servent de support l'affect commun n'est nullement
conventionnelle. C'est la transcendance des faits sociaux par
rapport aux consciences individuelles, leur extriorit, qui se
trouve ainsi exprime. Autrement dit, l'objectivit est une pro-
prit intrinsque l'affect commun, qu'il ralise au moyen
d'un support matriel, en prenant l'apparence d'une chose:
Quand donc nous nous reprsentons [les phnomnes sociaux]
comme manant d'un objet matriel, nous ne nous mprenons
pas compltement sur leur nature. Sans doute, ils ne viennent
pas de la chose dtermine laquelle nous les rapportons ; mais
il reste vrai qu'ils ont leur origine hors de nous. Si la force
morale qui soutient le fidle ne provient pas de l'idole qu'il
adore, de l'emblme qu'il vnre, elle ne laisse pas cependant
de lui tre extrieure et il en a le sentiment. L'objectivit du
symbole ne fait que traduire cette extriorit
3
Cette analyse,
parce qu'elle traite de la capture de l'affect commun, s'applique
-parfaitement l'objet montaire.
Il dcoule de ce passage de Durkheim la mise en vidence d'un
cadre d'intelligibilit des phnomnes de valeur suffisamment
1. Ibid, p. 329-330.
2. Ibid., p. 331.
3. Ibid.
211
L'EMPIRE DE LA VALEUR
gnral pour apprhender aussi bien le fait religieux que le fait
montaire. En son fondement, on trouve l'hypothse d'une auto-
rit spcifique au social, la puissance de la multitude, qui agit sur
les individus en leur imposant des manires collectives d'agir, de
penser et de sentir, encore appeles institutions 1 . Dans le cas
marchand, cette autorit que la socit engendre prend la forme
d'un pouvoir d'acheter. Elle s'investit dans certains objets lus,
qualifis par nous de liquides, plus couramment appels
richesses . Ces biens liquides sont le pendant des objets sacrs
en matire religieuse. Ce qu'on a observ, en analysant les co-
nomies marchandes dveloppes, c'est une tendance l'unit
montaire, la production d'une liquidit ultime admise univer-
sellement par le groupe marchand. Cette proprit spcifique
2
l'ordre marchand a des consquences considrables par le fait
qu'elle institue une dfinition univoque de la valeur, dpourvue
de toute ambigut: le bien lu. C'est lui qui rgle l'accs aux
marchandises profanes. Pour cette raison, on peut le dire souve-
rain dans l'ordre marchand. De mme que, dans l'ordre poli-
tique
3
, le souverain est celui qui capte l'affect commun son
profit, la monnaie est souveraine dans l'ordre marchand par le
fait qu'elle tient les sujets sous son empire, en tant qu'elle est
1. Selon la belle dfinition qu'en donnent Paul Fauconnet et Marcel Mauss:
Qu'est-ce en effet qu'une institution sinon un ensemble d'actes ou d'ides tout
institu que les individus trouvent devant eux et qui s'imposent plus ou moins
eux? Il n'y a aucune raison pour rserver exclusivement, comme on le fait
d'ordinaire, cette expression aux arrangements sociaux fondamentaux. Nous
entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes, les prjugs et les
superstitions, que les constitutions politiques ou les organisations juridiques essen-
tielles ; car tous ces phnomnes sont de mme nature et ne diffrent qu'en degr.
L'institution est en somme dans l'ordre social ce qu'est la fonction dans l'ordre
biologique: et de mme que la science de la vie est la science des fonctions
vitales, la science de la socit est la science des institutions ainsi dfinies (<< La
sociologie: objet et mthode , in Marcel Mauss, uvres, tome III: Cohsion
sociale et divisions de la sociologie, Paris, ditions de Minuit, 1974, p. 150).
2. Il semble que les autres sphres de valeur admettent plus volontiers un
certain flou dans l'estimation de la valeur. Nous dirions qu'elles fonctionne-
ment sur un mode fractionn, autorisant plusieurs points de vue.
3. Se reporter Frdric Lordon et Andr Orlan (<< Gense de l'tat et
gense de la monnaie: le modle de la potentia multitudinis , art. cit.).
212
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
l'autorit premire 1 par la grce de la puissance de la multitude
investie en elle. Par son biais, l'anarchie marchande est provisoi-
rement contenue. La sparation des producteurs-changistes est
certes maintenue mais dans le cadre d'une forme commune
d'valuation qui ouvre la possibilit d'une coordination efficace
entre les acteurs. En ce sens, dans notre approche, la coordina-
tion marchande est d'abord une coordination par la monnaie
avant d'tre une coordination par les prix. C'est l'mergence
d'une dfinition de la valeur, reconnue par tous, qui est l'ori-
gine de l'conomie marchande. Le fait que toutes les valeurs
conomiques soient rendues directement comparables en raison
de l'unicit de la rfrence montaire a engendr un monde
social particulirement adapt aux calculs, condition du dvelop-
pement de conduites rationnelles en finalit. Contrairement aux
autres sphres de valeur qui tolrent sans difficult une variabi-
lit importante des estimations, l'activit marchande peut se tar-
guer de spcifier avec rigueur la valeur de chaque bien
marchand. Cette singularit a pu tre interprte par les cono-
mistes comme attestant d'une diffrence en nature de la valeur
conomique. Si le fait quantitatif est certes une dimension impor-
tante du fait marchand qui demande tre pris en compte, il
serait, cependant, faux d'y voir la preuve d'une valeur substance.
La pense librale face au fait montaire
Entre le religieux et le montaire, si l'on en croit notre
modle, existe une forte homologie dans la mesure o tous deux
procdent d'une mme source : la puissance de la multitude.
Dire cela, c'est en mme temps dire quel point la monnaie
chappe la logique contractuelle. Pour s'en convaincre, il n'est
que de considrer les angoisses que suscite le fait montaire
chez les grands penseurs libraux, Ludwig von Mises, Jacques
1. Pour viter tout contresens, notons bien que cette souverainet est cir-
conscrite l'ordre marchand. Dans le monde rel, coexistent diverses valeurs et
diverses autorits qui se limitent les unes les autres.
213
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Rueff ou Friedrich Hayek, farouches partisans des relations
contractuelles. Comme le souligne Bruno Pays, ils s'accordent
tous pour penser que la monnaie est irrmdiablement pertur-
batrice) . Sous leur plume, la monnaie apparat toujours comme
le lieu d'un possible drapage, d'un trouble potentiel l'ordre
concurrentiel. A contrario, une bonne monnaie est une monnaie
qu'on ne remarque pas, une monnaie qui s'efface derrire
l'action efficace des marchs, une monnaie muette. Quand la
monnaie parle, ce n'est jamais le langage de l'conomie qu'elle
tient, mais toujours celui, tout autre, de la souverainet. Elle
donne voir la socit en tant qu'autorit, mimtiquement uni-
fie autour de croyances, ce que l'individualisme libral ne sau-
rait accepter. La monnaie est inquitante par sa puissance mme,
provoquant des conduites individuelles qui chappent la ratio-
nalit, comme par exemple les brutales courses la liquidit.
Il suffit d'ailleurs de considrer l'appareil lgislatif entourant
la monnaie pour que son caractre drogatoire l'ordre contrac-
tuel saute aux yeux. Pensons, d'une part, au monopole d'mis-
sion qui confre une institution spcialise, la Banque centrale,
le privilge d'mettre la monnaie, et, d'autre part, au cours lgal
qui contraint les socitaires accepter cette dernire dans leurs
changes. Assurment, nous voil bien loin des rgles usuelles
de la concurrence et de l'change volontaire. Mais l'action ta-
tique ne s'arrte pas l. Il faut encore prendre en considration
le rseau serr des rglementations qui viennent encadrer l'acti-
vit montaire des banques. Forts de ces observations, d'impor-
tants conomistes contemporains n'ont pas hsit avancer que
la monnaie est un pur produit de la rglementation
2
, Sans
action tatique, leurs yeux3, la monnaie n'existerait pas: Dans
une conomie de laisser-faire o le secteur financier serait com-
pltement dbarrass de toute ingrence gouvernementale, la
1. Bruno Pays, Librer la monnaie. Les contributions montaires de Mises,
Rueff et Hayek, Paris, PUF, 1991, p. 72.
2. Robert E. Hall, Monetary Trends in the United States and the United
Kingdom , Journal of Economic Literature, vol. 20, dcembre 1982, p. 1554.
3. Ce n'est pas notre position. Voir plus loin notre critique du chartalisme.
214
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
monnaie au sens usuel n'existerait pas 1. Ces fortes analyses
librales convergent pour voir dans la monnaie un obstacle au
plein panouissement de l'ordre contractuel. Aussi, en raction,
les penseurs libraux font-ils de la neutralisation )) de la mon-
naie leur objectif central en matire de politique montaire. Il
s'agit pour eux d'immuniser l'conomie relle contre les per-
turbations)) dont la monnaie est un des vecteurs privilgis.
Pour Rueff, rendre au monde le silence de la monnaie, c'est
essentiellement la dbarrasser de ses influences politiques
2
)).
Par cet acte de neutralisation montaire, il s'agit de rtablir
l'autorgulation concurrentielle dans son entire puret. Cette
neutralisation peut prendre des formes diverses. Chez Jacques
Rueff, il s'agit de revenir l'talon-or. Milton Friedman, quant
lui, propose de faire voter un ensemble de rgles rigides,
limitant par avance la marge d'initiatives dont peuvent disposer
les autorits montaires
3
)). Dans ces deux propositions, on
reconnat aisment une mme inspiration : supprimer la main
visible)) des autorits gouvernementales pour lui substituer la
main invisible )) des rgles automatiques. Autrement dit,
dpolitiser la monnaie, la rendre indpendante de l'arbitraire
tatique, et, ce faisant, la transformer en un pur instrument au
seul service de la concurrence. Aujourd'hui, c'est au travers de
l'indpendance des banques centrales que s'exprime essentielle-
ment ce mme objectif de neutralisation montaire. De nou-
veau, l'ide sous-jacente consiste encadrer le fait montaire
pour en radiquer la dimension politique. Cependant, l' observa-
tion historique la plus cursive montre clairement que ces poli-
tiques de neutralisation chouent priodiquement, par exemple en
situation de crise. On a observ un tel chec )) rcemment
lorsque la Banque centrale europenne (BCE) s'est mise ache-
ter une partie de la dette publique de certains pays de la zone
1. Tyler Cowen et Randall Kroszner, The Development of the New
Monetary Economics , Journal of Political Economy, vol. 95, nO 3, p. 569.
2. Bruno Pays, Librer la monnaie, op. cit., p. 264.
3. Milton Friedman, Inflation et Systmes montaires, Paris, Calmann-
Lvy, 1976, p. 167.
215
L'EMPIRE DE LA VALEUR
euro, en parfaite contradiction avec sa doctrine selon laquelle
l'mission montaire devait tre radicalement spare du poli-
tique.
C'est en songeant ces limites que Friedrich Hayek propose
de conduire la neutralisation montaire jusqu' son terme
logique: la suppression pure et simple de la monnaie et son
remplacement par un systme de libre concurrence entre
moyens de paiement privs 1. Il crit: Je crois que tant que les
affaires montaires restent du ressort du gouvernement, l' talon-
or est le seul systme tolrable; mais on peut certainement faire
mieux, et sans l'intervention des gouvernements2. En effet,
fait-il remarquer, tant que la monnaie existe, elle constitue une
cible de choix pour les autorits gouvernementales qui auront
toujours la tentation de passer outre aux obstacles juridiques
mis en place pour leur interdire de manipuler l'mission mon-
taire, ds lors qu'il y va de leurs intrts vitaux. Historiquement,
ni l'talon-or, ni la rgle friedmanienne, ni l'indpendance de la
Banque centrale n'ont constitu des remparts srieux la
volont politique de passer outre
3
Aussi propose-t-il une autre
voie, savoir en finir une bonne fois pour toutes avec la mon-
naie telle que nous la connaissons, en autorisant les agents pri-
vs mettre des moyens de paiement fiduciaires concurrents
dont il reviendra au march de slectionner les meilleurs. Ce
faisant, Hayek pousse sa conclusion ultime l'analyse librale.
Si l'on veut une conomie efficace, il faut tendre l'action de la
loi de l'offre et de la demande la production des moyens
d'change de telle sorte que, infine, le monde social soit rgi de
part en part par la loi concurrentielle. La monnaie est un intrus,
une monstruosit dont il faut absolument se dbarrasser. Sa pr-
sence fait obstacle au plein dveloppement des valeurs indivi-
dualistes.
1. Friedrich Hayek, Denationalization of Money, Londres, Institute of Eco-
nomie Affairs, 1976.
2. Ibid., p. 126, traduction de Bruno Pays.
3. Le souverain politique, en tant que dtenteur du monopole de la vio-
lence lgitime, peut mme aBer jusqu' interdire l'accs de la Banque centrale
un fonctionnaire rcalcitrant, comme on l'a observ en Argentine.
216
UN CADRE UNlDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
Cette dfiance gnralise que suscite la monnaie chez les
penseurs libraux est trs instructive. Elle trouve dans notre
hypothse thorique une interprtation directe : c'est l'tranget
du phnomne montaire, au regard de la logique contractuelle,
qui se trouve reconnue, le fait qu'elle participe de principes
sociaux irrconciliables avec le primat de la rationalit utilita-
riste. L'argent constitue un scandale idologique de premire
grandeur au regard des valeurs individualistes, parce qu'il
donne voir l'autorit de la socit en tant que totalit. Autre-
ment dit, dans la monnaie, c'est l'tre ensemble du groupe qui
se trouve exprim. Parce que l'individualisme est une ido-
logie qui valorise l'individu et nglige ou subordonne la tota-
lit sociale , comme l'crit Louis Dumont\ cette expression
holiste de la totalit constitue un dfi la hirarchie individua-
liste des valeurs. La voie traditionnelle pour rtablir cette hi-
rarchie consiste neutraliser la monnaie, c'est--dire en
subordonner l'expression aux contraintes conomiques. C'est la
voie propose par Rueff, Friedman, les partisans de l'indpen-
dance des banques centrales ou Hayek. Si les modalits propo-
ses varient selon les auteurs, leur but, en revanche, est
identique: refouler les croyances montaires pour faire en sorte
que soit produite une monnaie pleinement conforme son
concept conomique, savoir une monnaie qui serait un pur ins-
trument, une monnaie sans autorit. Il s'agit donc bien, par des
institutions appropries, de rformer la ralit conomique pour
la rendre fidle au modle concurrentiel que les conomistes ont
en tte. On observe de nouveau combien l'conomie diffre des
sciences de la nature par le poids qu'y pse le point de vue per-
formatif. L'accent n'est jamais mis sur l'explication des faits
conomiques mais plutt sur la construction d'une conomie
nouvelle, pleinement rationnelle et efficace, apte produire le
bien-tre collectif, c'est--dire une utopie. Dans le cas mon-
taire, cela conduit ce paradoxe d'une thorie qui, alors mme
qu'elle affirme que la monnaie est neutre, ne cesse pas pour
autant de s'en proccuper pour la rendre inactive ! Ce pouvoir
1. Louis Dumont, Essais sur l'individualisme, Paris, Seuil, 1991, p. 304.
217
L'EMPIRE DE LA VALEUR
de la monnaie, que la thorie conomique ne comprend pas et
rejette, passe essentiellement par le biais des croyances collec-
tives dont elle est le sige, sur le modle du fait religieux, celui
d'une puissance d'intgration ex ante qui lie entre eux les
agents spars selon des rgles qui lui sont propres.
Outre le rejet des libraux, on peut trouver une preuve
supplmentaire du lien existant entre le religieux et le montaire
lorsqu'on se tourne du ct de la gense historique des mon-
naies. En effet, l'hypothse s'impose d'une origine religieuse de
la liquidit. C'est ce que je propose de nommer le modle du
talisman! . Il est avanc par Marcel Mauss dans sa communi-
cation Les origines de la notion de monnaie (1914). Mauss
observe que les objets sacrs, qu'il nomme talisman, pos-
sdent, de par leur nature, un grand pouvoir d'attraction sur les
individus, ce qui conduit en faire des biens liquides. Pour qui
associe troitement l'activit marchande la rationalit utilita-
riste, ce rapprochement peut sembler incongru. A contrario,
notre hypothse thorique rend compte de cette observation:
parce que religion et monnaie sont l'expression d'une mme
ralit, l'affect commun, ils sont aptes se convertir l'un en
l'autre, dans les deux sens : Le talisman et sa possession ont
trs tt, sans doute ds les socits les plus primitives, jou ce
rle d'objets galement convoits par tous, et dont la possession
confrait leur dtenteur un pouvoir qui devint aisment un
pouvoir d'achae. Cette citation est galement intressante par
le fait qu'elle montre bien que le pouvoir d'achat est, en son
fondement, d'abord, un pouvoir sur les hommes. Les talis-
mans, en tant qu'ils sont dpositaires du mana, de la puissance
de la multitude, ont une autorit, un prestige qui les rend dsi-
rables aux yeux des individus: Le pouvoir d'achat de la mon-
naie primitive, c'est, avant tout, le prestige que le talisman
confre celui qui le possde et s'en sert pour commander aux
1. Andr Orlan, La sociologie conomique de la monnaie , art. cit.
2. Marcel Mauss, Les origines de la notion de monnaie , in uvres,
tome II : Reprsentations collectives et diversit des civilisations, Paris, di-
tions de Minuit, 1974, p. Ill.
218
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
autres 1. )) En raison de ce prestige, les talismans seront large-
ment accepts comme contreparties dans l'change. Cette proxi-
mit du religieux et du montaire qu'on observe aux origines
historiques du fait montaire trouve dans nos hypothses une
explication simple et rigoureuse: la puissance de la multitude
investie en un objet.
Cependant, on ne saurait pousser trop loin la comparaison du
religieux et du montaire. Si les richesses partagent avec les
objets sacrs le fait d'tre le rceptacle d'un affect commun, ils
s'en distinguent nettement quant la nature des intrts qui sont
mis en jeu et des activits par lesquelles ils s'expriment. Les
individus recherchent dans la monnaie l'accs aux marchandises et
non leur salut. Aussi, pour que la confiance dans la monnaie per-
dure, importe-t-il au premier chef que son pouvoir d'achat se
vrifie; autrement dit, que chacun puisse ex post acqurir les biens
qu'il dsire. C'est cette condition, sans rapport avec la question
du sacr, que la monnaie conserve son ascendant. On trouve chez
Franois Simiand cette mme mise en garde quand, aprs avoir
observ le rle qu'ont jou les valeurs religieuses dans l'mer-
gence des premires monnaies, il insiste sur le fait que l'conomie
moderne s'est totalement dgage de ces croyances, pour crer ses
propres reprsentations et croyances collectives. Il crit:
Mais tout de mme la valeur conomique, [ ... ] avec le dve-
loppement de l'conomie moderne, s'est [ ... ] lacise, c'est--
dire rendue distincte, spare des valeurs thico-religieuses. Si
grande que nous fassions la part des survivances, ne serait-il pas
assez surprenant d'aboutir trouver, comme base essentielle et
ultime de rfrences pour tout le systme des prix de l'conomie
la plus avance, un reste de superstition magico-religieuse, deve-
nue trangre, du reste, aux croyances et pratiques des religions
du type plus avanc
2
?
Il faut donc considrer une croyance montaire spcifique,
rendue indpendante du fait religieux. En consquence, le
rapport du montaire au sacr ne doit pas se comprendre sur le
1. Ibid., p. Il.
2. Franois Simiand, La monnaie ralit sociale , art. cit., p. 238.
219
L'EMPIRE DE LA VALEUR
modle d'une simple extension des valeurs religieuses aux
valeurs conomiques. Ce serait une grave erreur. S'il a pu en tre
ainsi dans une premire phase du dveloppement des socits
humaines, la croyance montaire s'est progressivement rendue
matresse d'elle-mme, trouvant les arguments de sa lgitimit
dans un registre spcifique, en rupture avec le discours du sacr.
De cette rupture est n un nouvel ordre de valeurs, radicalement
autonome par rapport la moralit religieuse. L'expression la
plus exemplaire de cette autonomisation des valeurs cono-
miques, dans nos socits, est constater dans le fait que les
pratiques montaires y font, pour une part significative, l'objet
d'une ferme rprobation morale. Valeurs conomiques et
valeurs morales sont si peu identiques qu'elles s'opposent. Ce
point doit tre soulign, car, dans les socits primitives, il en
va tout autrement. Comme l'objet montaire y renvoie l'affect
commun religieux, savoir la puissance sociale par excellence,
objet de toutes les vnrations, on le trouve par nature au som-
met de la hirarchie des valeurs. L'exemple des 'Ar'ar tudi
longuement par Daniel de Coppet et prsent dans La Monnaie
souveraine ne laisse aucun doute sur ce point:
Pour les 'Ar'ar, la monnaie est lie au degr suprieur de
civilisation [ ... ]. La monnaie prside l'instauration d'un tat
suprieur de la socit [ ... ]. Ainsi se dresse-t-elle comme auto-
rit suprieure au plus haut de l'chelle des tres, au sommet des
relations socio-cosmiques, au niveau du tout de la socit [ ... ].
Sur l'chelle des tres, le plus valoris d'entre eux est coup sr
la monnaie
1
. [les italiques sont de l'auteur.]
Il serait absolument impossible d'en dire de mme
aujourd'hui. Mettre sur le mme plan le religieux et le mon-
taire relverait du pire blasphme
2
Dans nos socits marques
1. Daniel de Coppet, Une monnaie pour une communaut mlansienne
compare la ntre pour l'individu des socits europennes , in Michel
Aglietta et Andr Orlan (dir.), La Monnaie souveraine, op. cit., p. 195.
2. Pourtant, lorsqu'un 'Ar'ar devenu prtre anglican veut faire comprendre
aux siens Jsus-Christ, il est conduit tout naturellement faire appel aux mon-
naies: Jsus-Christ = la collecte des monnaies , dclara-t-i! (ibid., p. 197).
220
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
par le polythisme des valeurs, les pratiques montaires sont
vivement contestes par d'importants groupes sociaux, certains
visant mme explicitement l'avnement d'une socit sans
monnaie, ce qui ne les empche pas, par ailleurs, d'utiliser
celle-ci dans leur vie courante 1. Pourtant, si les contenus des
croyances sont dsormais spars et distincts, il reste un point
commun entre religion et monnaie: la confiance collective elle-
mme en tant que moment de production de la valeur, ce que
nous avons nomm l'affect commun. Ce que partagent les deux
configurations, marchande et religieuse, est la prsence d'une
autorit sui generis, la puissance de la multitude, s'exprimant
par le biais de croyances fortement tablies, recueillant l'adh-
sion de tous. Le mme processus formel est la source de ces
deux ralits. Il serait cependant erron d'y voir un archasme .
Une telle conception supposerait que soient identifies stricte-
ment modernit et rationalit contractuelle !
Pour conclure cette deuxime partie, montrons quel point
les faits empiriques attestent de la puissance des croyances col-
lectives en matire montaire.
Les miracles montaires
Dans les phases normales, lorsque l'activit marchande se
droule sans heurt, les acteurs puisent dans la continuit routi-
nire des oprations d'change leur conviction que la monnaie
sera accepte demain comme elle l'a t hier. Cela suffit
assurer le bon fonctionnement conomique et montaire. On
reconnat dans cette forme affaiblie de confiance ce que Georg
Simmel appelait savoir inductif et que nous avons nomm
confiance mthodique . Les acteurs se contentent de prolon-
ger les tendances passes. Certes, ils savent que de telles prvi-
sions sont entaches d'erreurs, mais leur probabilit est trop
faible pour qu'ils y prennent garde srieusement. Si un grand
1. De mme, les Systmes d'changes locaux (SEL) inventent de nou-
velles monnaies.
221
L'EMPIRE DE LA VALEUR
nombre d'individus partagent ce point de vue, la prvision d'un
fonctionnement rgulier se trouve effectivement ralise.
Autrement dit, dans la confiance mthodique, c'est la puissance
fonctionnelle de l'institution une fois stabilise qui se donne
voir. La monnaie valeur disparat derrire la monnaie instru-
ment. Cette configuration peut donner l'impression d'une
rconciliation entre la monnaie et l'approche instrumentale.
Mais cette rconciliation ne peut tre que transitoire. Elle ne
saurait perdurer. Constamment, des questions mergent quant
la lgitimit de la monnaie, quant la justesse des conditions
d'mission, quant au bien-fond de la politique montaire,
questions qui appellent des rponses plus consistantes que la
seule perptuation de ce qui a t. Il s'agit d'tre convaincu
que l'objet lu est le bon: il faut croire en lui. C'est dans les
priodes de crise, lorsque la qualit de la monnaie est mise en
doute, que cette confiance par-del la confiance mthodique
intervient
1
Dans certaines conjectures historiques, son impact
est si saisissant et si contraire ce que prvoit la conception
instrumentaliste de la monnaie que les contemporains n'ont pas
hsit la qualifier de miracle ; ainsi en fut-il de l'introduc-
tion du rentenmark en Allemagne, le 15 novembre 1923, et de
l'effet qu'a eu sur la monnaie nationale l'arrive au pouvoir,
en France, de Poincar, le 23 juillet 1926. Pour le premier, on
parle de miracle du rentenmark et, pour le second, de
miracle Poincar . Leur prsentation mme succincte per-
mettra de mieux faire comprendre ce que sont ces croyances
montaires et comment elles agissent.
Ces deux pisodes ont lieu alors que les deux pays connaissent
de srieuses difficults conomiques, mme si, l'vidence, les
difficults allemandes sont d'une intensit bien plus grande. Il
en rsulte, en France comme en Allemagne, une forte dfiance
l'gard de la monnaie nationale. Elle a pour expression cen-
trale le recours de plus en plus large, de la part des acteurs pri-
1. Dans La Monnaie souveraine (Michel Aglietta et Andr Orlan, op.
cit.), on a distingu deux aspects de cette confiance profonde : la confiance
hirarchique et la confiance thique.
222
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
vs nationaux, aux devises trangres. C'est vrai de la fonction
d'unit de compte, que ce soit par le jeu de l'indexation ou par
le fait de proposer des prix libells directement en monnaies
trangres. C'est vrai de la fonction de rserve de valeur,
chaque acteur conomique cherchant convertir ses encaisses
liquides et nourrissant de ce fait une spculation effrne
contre la monnaie nationale sur le march des changes. C'est
mme vrai de la fonction de circulation puisque, dans certains
cas, la monnaie nationale n'est mme plus accepte dans les
transactions. On observe ce phnomne en Allemagne o,
l't 1923, il fait craindre un dramatique blocus des villes du
fait du refus des paysans d'accepter le mark en change de
leurs produits agricoles. Ce qu'il faut souligner est que cette
dfiance l'gard de la reprsentation sociale de la valeur est
un problme en soi qui produit de graves dysfonctionnements,
quelle que soit par ailleurs la situation macroconomique. Il en
est ainsi parce que les acteurs, privs et publics, ont de plus en
plus de mal savoir quelles valeurs ils reoivent et quelles
valeurs ils produisent. C'est clair pour ce qui est du budget
public dont une partie des dficits a pour origine directe l'ins-
tabilit montaire. Le cas allemand est, cet gard, emblma-
tique, en raison des extravagants niveaux d'inflation qu'on y
observe. Pensons, en premier lieu, la dfinition des diff-
rentes tranches d'imposition comme celle des divers seuils
d'exemption. En priode hyperinflationniste, il est ncessaire
de continuellement les modifier. Il s'ensuit une succession
continuelle de lois et d'amendements qui crent une grande
confusion et des difficults d'application croissantes. Mais le
point central porte sur le fait que, en raison du temps ncessaire
au calcul et la collecte de l'impt, le rendement de l'impt
connat une chute d'autant plus grande que l'inflation est leve
et que ce temps ncessaire est grand. Il s'est ensuivi de cela, dans
le cas allemand, une atrophie complte du systme fiscal' .
1. Costantino Bresciani-Turroni, The Economics of Inflation. A study of
Currency Depreciation in Post-War Germany, Londres, August M. Kelley
Publishers, 1968, p. 74.
223
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Ainsi, dans les derniers dix jours du mois d'octobre 1923, seu-
lement 0,8 % des dpenses furent couvertes par les recettes
ordinaires ! On retrouve cette mme difficult pour les tarifs
des services publics. Ce n'est seulement qu' partir du 20 aot
1923 que les chemins de fer allemands abandonnrent le
systme d'augmentation progressive du prix des billets pour
adopter le systme du multiplicateur. Mais comme un multi-
plicateur reste valable pendant quelques jours, il ne peut
qu'tre trs en retard derrire la dprciation du mark. Les
tarifs fixs en or et payables en mark papier au taux du jour
prcdent ne furent introduits que le 1 er novembre 1923
1
Mais, plus que la crise elle-mme, ce qui justifie nos yeux
le rapprochement des pisodes allemand et franais est
l'extrme soudainet avec laquelle le retour la stabilit mon-
taire s'est impos dans les deux pays. Alors que la dprciation
du mark a atteint des niveaux vertigineux dbut novembre
2
, la
monnaie allemande se stabilise brutalement le 20 novembre au
taux de 4 200 milliards de marks pour un dollar et demeure
constante partir de cette date. Pour le franc, la situation est
tout aussi tonnante. Alors que la livre sterling, depuis quatre
mois, est passe de l35 francs 243 francs et que l'inflation des
prix de gros progresse un rythme annuel de 350 %, le proces-
sus s'arrte soudainement le jeudi 22 juillet 1926 quand est
annonc que Poincar a accept de former un ministre
3
. La
livre sterling retombe le 26 juillet sous la barre des 200 francs,
196,50 francs, soit une baisse de 20 % en trois jours. Par
ailleurs, ds aot 1926, les prix de gros diminuent et se stabi-
lisent. Si, dans les deux cas, les analystes et les opinions
publiques ont retenu le terme de miracle , ce n'est pas seu-
lement en raison de sa soudainet mais galement parce que
aucune mesure n'est prise qui pourrait expliquer le nouveau cli-
1. Ibid., p. 72.
2. Rudiger Dombusch mesure l'augmentation des prix moyenne par jour
en novembre 20,9 % !
3. mile Moreau, Souvenir d'un gouverneur de la Banque de France. His-
toire de la stabilisation dufranc (1926-1928), Paris, ditions M.-Th. Gnin,
Librairie de Mdicis, 1954, p. 38.
224
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
mat. En France, le retournement des anticipations prcde
l'annonce de tout programme
1
Il se fait sur le seul nom de
Poincar. La restauration de la confiance est instantane. Le cas
allemand est peut-tre encore plus tonnant. En effet, le retour-
nement trouve sa source dans l'mission, le 15 novembre 1923,
d'une nouvelle monnaie, nomme rentenmark , qui obtint
immdiatement la faveur du public. Or, il est difficile de com-
prendre cette faveur. En tout cas, le fait de pouvoir convertir les
rentenmarks en titres de rente (Rentenbriefe) libells en marks-
or et procurant un intrt de 5 % ne fournit pas l'explication
recherche. Pour diverses raisons: d'une part, l'poque consi-
dre, le rendement des titres indexs est bien suprieur aux
5 % des Rentenbriefe, entre 15 % et 20 %. D'autre part, dans la
situation de crise budgtaire du gouvernement allemand, en cas
de conversion gnralise des rentenmarks, le paiement des
intrts serait devenu rapidement problmatique. C'est d'ailleurs
un fait que les porteurs des nouveaux billets n'ont pas us de la
facult de conversion: La dlivrance de titres de rente contre
billets n'a pas dpass 230000 marks-or pour une circulation
qui a atteint la limite d'mission fixe par les statuts de la Ren-
tenbank, soit 3 200 millions de marks-or
2
Techniquement, on
a simplement remplac une dette par une autre !
Dans les deux pisodes, le retournement ne trouve pas sa
source dans les mesures de politique conomique. Il s'agit d'un
pur mouvement d'adhsion collective, de croyance mimtique
de tout le groupe, conforme notre modle. Cela explique sa
brutalit et son caractre miraculeux . Sa russite tient pour
partie au rle que jouent certains symboles forts, aptes runir
la population autour de la nouvelle norme montaire. Dans le
1. La dclaration d'investiture du nouveau gouvernement est lue devant le
Parlement le 27 juillet 1927 et provoque une lgre baisse du franc (Bertrand
Blancheton, Le Pape et l'Empereur. La Banque de France, la Direction du
Trsor et la Politique montaire de la France (1914-1928), Paris, Albin
Michel, 2001, p. 387).
2. Andr Fourgeaud, La Dprciation et la Revalorisation du mark alle-
mand et les Enseignements de l'exprience montaire allemande, Paris. Payot,
1926, p. 202.
225
L'EMPIRE DE LA VALEUR
cas franais, c'est le nom mme de Poincar qui est central,
mais aussi sa capacit former un cabinet d'Union nationale
restreint
l
, propre frapper les esprits. Le cas allemand est plus
complexe. Il tient la nature mme de la Rentenbank qui runit
toutes les classes possdantes : agriculteurs, industriels, com-
merants et banquiers. De manire tout li fait rvlatrice, Wilfrid
Baumgartner dans son fameux livre consacr au rentenmark,
aprs avoir soulign l'insuffisance du gage obligataire, cite
Hans Luther, le ministre allemand des Finances, dclarant: La
solidarit des classes productrices, qui s'exprime dans l'acte de
fondation de la Rentenbank, est la meilleure garantie de la
confiance qu'inspirera l'instrument de paiement mis par le
nouvel institut
2
On ne peut tre plus clair. La confiance dans
cette nouvelle monnaie rsulte directement de la garantie que lui
apportent les puissances conomiques coalises, dsormais res-
ponsables de son mission.
Il est clair que les succs long terme qu'ont connus ces
deux expriences ne peuvent s'interprter uniquement comme
des faits de pure confiance. Leur russite a dpendu fortement
des choix de politique conomique qui ont t faits par la suite.
D'ailleurs, divers moments, des difficults ont surgi qui
auraient pu conduire une nouvelle crise. Cependant, il apparat
que la constitution d'une reprsentation lgitime de la valeur
marchande sous la forme d'une nouvelle norme montaire
s'imposait comme un pralable indispensable tout retour la
stabilit. La croyance collective a permis que se mette en place
un nouveau rgime montaire, condition indispensable pour
qu'une nouvelle politique conomique puisse voir le jour. Ce
faisant, ces pisodes soulignent le rle que joue ex ante la
confiance montaire. Ils montrent l'autonomie que possde le
montaire l'gard de l'conomique. Certes, c'est l une auto-
nomie rduite, car la confiance montaire ne saurait perdurer si
la monnaie ne ralise pas ce pour quoi elle est faite: acheter des
marchandises. Mais, autonomie quand mme qui peut anticiper
1. Les socialistes en sont exclus.
2. Wilfrid Baumgartner, Le Rentenmark, Paris, PUF, 1925, p. 35.
226
UN CADRE UNIDISCIPLINAIRE POUR PENSER LA VALEUR
sur des changements venir et, ce faisant, leur donner ralit,
pour le meilleur comme pour le pire.
Cette deuxime partie avait pour but de dmontrer qu'il
existe une alternative possibl aux thories de la valeur subs-
tance. Celles-ci relvent de ce que Slavoj Zizek nomme l'illu-
sion ftichiste : Nous sommes victimes de l'illusion
ftichiste quand nous percevons en tant que proprit imm-
diate, "naturelle", de l'objet ftiche ce qui est confr cet objet
par sa position au sein de la structure'. N'est-ce pas trs exac-
tement ce que nous proposent les thories de la valeur
lorsqu'elles postulent que tous les exemplaires d'une mme
valeur d'usage ont, par dfinition, la mme valeur? Ce que la
thorie marginaliste confirme explicitement en soutenant que la
valeur a pour origine l'utilit des objets. Notre approche pro-
cde diffremment. Notre point de dpart est la sparation mar-
chande, c'est--dire un monde dans lequel chaque individu est
coup de ses moyens d'existence. Seule la puissance de la
valeur, investie dans l'objet montaire, permet l'existence d'une
vie sociale sous de tels auspices. Elle runit les individus spa-
rs en leur construisant un horizon commun, le dsir de mon-
naie, et un langage commun, celui des comptes. L'obtention de
monnaie se fait, selon la formule M - A, par la vente de mar-
chandises. Plus la marchandisation s'intensifie, plus la monnaie
accrot son empire sur le monde social. Dans un tel cadre, l'ide
d'une valeur fondamentale , d'un vrai prix , ou encore
d'un juste prix , n'a plus lieu d'tre. Autrement dit, contrai-
rement ce qu'ont cru des gnrations d'conomistes, la ques-
tion de la valeur ne se confond nullement avec la question du
juste prix. Ce qui est objectif, qui s'impose aux agents, par quoi
un ordre conomique est rendu possible, ce sont les mouvements
montaires. Pour ce qui est des prix des marchandises, ils sont
variables: ils sont ce que les luttes d'intrt entre producteurs et
1. Slavoj Zizek, Ftichisme et subjectivation interpassive , Actuel Marx,
nO 34, 2003, p. 101.
227
L'EMPIRE DE LA VALEUR
consommateurs font qu'ils sone. Il n'y a pas lieu de doter le
prix de concurrence pure et parfaite d'une dignit particulire.
Si Walras le distingue, c'est en vertu de considrations thiques
a priori
2
, et non pas en vertu d'une analyse positive portant sur
les conomies marchandes telles qu'elles sont. Il n'est mme
pas ncessaire de postuler l'unicit du prix: un mme bien, en
un mme lieu, peut avoir diffrents prix sans que cela ne
remette' en cause l'objectivit de la valeur. C'est l'tude de la
concurrence et des dispositifs d'change qui permet de savoir ce
qu'il en est. Dans notre cadre conceptuel, l'intelligibilit des
configurations conomiques n'est donc pas chercher dans des
valeurs objectives calculables a priori qui dtermineraient le
destin des acteurs, mais bien dans des jeux montaires
d'change et de production continuellement transforms par les
luttes concurrentielles. En d'autres termes, notre approche subs-
titue une conomie des relations une conomie des gran-
deurs. L'tude des marchs fmanciers va nous permettre de
montrer quel point une telle perspective transforme notre com-
prhension en profondeur. Sans la bquille d'une prtendue
vraie valeur , non seulement il est possible de rendre intelli-
gible l'volution des prix, mais une plus grande conformit aux
faits est obtenue.
1. L'conomie rationnelle est une activit objective. Elle s'oriente par-
tir des prix montaires, qui se forment sur le march dans le cadre de la lutte
d'intrts que les hommes mnent les uns contre les autres. Sans valuation en
prix montaires, donc sans cette lutte, il n'y a aucun calcul possible. L'argent
est ce qu'il y a de plus abstrait et de plus "impersonnel" dans la vie des
hommes (Max Weber, Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996,
p.421).
2. Nous suivons ici de nouveau l'analyse d'Arnaud Berthoud: On doit
affirmer, d'abord, que la thorie de l'quilibre gnral n'est pas une hypothse
dont la valeur est attendue de la validation dans l'exprimentation, mais la
construction d'un concept dont la valeur vient des principes moraux poss a
priori (<< conomie politique et morale chez Walras , art. cit., p. 85).
TROISIME PARTIE
LA FINANCE DE MARCH
Chapitre VI
L'valuation financire
Aprs avoir prsent les fondements de notre approche tho-
rique dans la partie prcdente, il importe dsormais de la faire
travailler sur un objet spcifique pour en montrer toute la perti-
nence et toute la fcondit. Telle est la finalit que poursuit
cette troisime partie consacre aux marchs financiers. Pour
ce faire, nous commencerons, dans le chapitre VI, par montrer
que l'approche noclassique de l'efficience financire repose
sur une hypothse errone quant la manire dont les investis-
seurs peroivent le futur et ses incertitudes, ce que nous avons
nomm l'hypothse probabiliste . Une fois cette dernire
abandonne, il n'est plus possible de dfinir une valeur objec-
tive des titres. De mme, il faut renoncer l'ide d'efficience.
Pour comprendre dans une telle perspective comment les mar-
chs financiers fonctionnent, le chapitre VII mobilise le concept
de liquidit dj prsent au chapitre IV. Comme pour la mon-
naie, la liquidit des titres repose sur l'mergence d'une
croyance partage, ce que nous nommerons une convention
financire . Pour en expliciter la logique, le modle de concur-
rence mimtique sera nouveau utilis.
Hypothse probabiliste et valeur intrinsque des titres
Ce qui distingue la finance des autres domaines tudis par la
thorie conomique est le fait qu'elle a pour objet, non pas le
rapport des individus aux marchandises, comme le plus souvent
en conomie, mais le rapport des individus au temps. En effet,
231
L'EMPIRE DE LA VALEUR
rappelons qu'un actif financier est un droit sur des revenus
venir, de sorte que l'investisseur qui entre en sa possession
change de la monnaie aujourd'hui, d'un montant gal au prix
du titre, contre de la monnaie demain, par exemple sous fonne
de dividendes s'il s'agit d'une action. En consquence, l'inves-
tisseur doit imprativement se projeter dans le futur de faon
anticiper ce que seront ces rendements venir pour en esti-
mer la valeur aujourd'hui et la confronter au prix qui lui est
demand. Compare l'estimation des marchandises, l'estima-
tion d'une valeur financire est simplifie dans la mesure o les
grandeurs considres sont directement des grandeurs mon-
taires, par exemple des dividendes, et non des utilits. Cepen-
dant, une difficult majeure se trouve introduite du fait de la
nature intrinsquement incertaine de ces grandeurs. En effet, les
investisseurs ne connaissent pas de manire certaine ce que
seront ces revenus futurs. Ils s'efforcent de les anticiper au
mieux, compte tenu des infonnations dont ils disposent. Comme
l'crit Keynes, l'utilit sociale des marchs financiers se mesure
leur aptitude vaincre les forces obscures du temps et percer
le mystre qui entoure le futur! ; ou encore : triompher des
forces secrtes du temps et de l'ignorance de l'avenir
2
. Pour
le dire autrement, dans la perspective librale, le march bour-
sier est l'quivalent fonctionnel du planificateur socialiste. Il a
en charge de dtenniner les secteurs et les entreprises o il
convient prioritairement d'investir cette ressource rare qu'est le
capital, sans le gaspiller dans des projets la rentabilit insuffi-
sante. La thorie financire examine ces questions : les marchs
boursiers jouent-ils bien leur rle? Sont-ils efficaces? Le cours
boursier est-il un estimateur fiable de la rentabilit venir de
l'entreprise? Fournit-il aux investisseurs l'infonnation dont ils
ont besoin pour agir de manire pertinente?
Pour faire face ces questions complexes, la thorie finan-
cire noc1assique dispose d'un acquis important: les
rflexions suscites par l'tude du comportement individuel en
l. Thorie gnrale de l'emploi, op. cit., p. 167.
2. Ibid., p. 169.
232
L'VALUATION FINANCIRE
situation d'incertitude 1. Considrons l'exemple bien connu que
propose Leonard Savage. Vous souhaitez faire une omelette.
Quand vous entrez dans la cuisine
2
, vous trouvez dj 5 ufs
casss et mlangs dans un bol, ct duquel se trouve le
6" uf. Vous devez dcider quoi faire de cet uf. Parce que
votre connaissance de la situation vous conduit savoir que le
6" uf peut tre pourri, trois actions sont envisageables : casser
l'uf dans le bol o se trouvent dj les 5 premiers ufs; le
casser dans une soucoupe part de faon pouvoir au pra-
lable l'inspecter; le jeter sans l'inspecter. L'existence d'une
incertitude quant la nature du 6" uf, qui peut tre sain ou
pourri, fait que chaque action a elle-mme des consquences
incertaines. Il est alors possible de dcrire cette incertitude en
distinguant les consquences de chaque action selon les diff-
rents tats de la nature possibles. Savage obtient le tableau qui
suit:
tat de la nature
Action
Sain Pourri
Casser l' uf Une omelette Aucune omelette
dans le bol de 6 ufs et 5 ufs perdus
Casser l'uf Une omelette de 6 ufs Une omelette de 5 ufs
dans la et une soucoupe laver et une soucoupe laver
soucoupe
Jeter l'uf Une omelette de 5 ufs Une omelette de 5 ufs
et un uf comestible
perdu
1. Les travaux fondateurs datent des annes 1940 et 1950 : Oskar Mor-
genstern et John von Neumann (Theory of Games and Economic Behaviour,
Princeton, Princeton University Press, 1944) et Leonard Savage (The Founda-
tions ofStatistics, New York, Dover Publications, 1954).
2. Savage considre un mari qui souhaite aider son pouse et trouve la cui-
sine telle que celle-ci l'a laisse.
233
L'EMPIRE DE LA VALEUR
La notion d'tat de la nature est fondamentale. C'est par son
biais que l'incertitude se trouve modlise. Elle saisit les l-
ments du contexte susceptibles d'affecter le rsultat d'une
action. Lorsqu'il prend sa dcision, l'individu ne sait pas quel
tat sera choisi par la nature, mais il tudie la situation qui se
prsente lui et, sur la base de ses connaissances et de ses
informations, il dresse la liste des diverses ventualits pos-
sibles. Une fois ce travail fait, lorsque sont dfinis toutes les
actions et tous les tats de la nature, l'analyse thorique fournit
un critre pour dterminer quelle action doit tre choisie. Ce
critre! met en jeu deux types de donnes. D'une part, comme
on pouvait s 'y attendre, le choix dpend de la satisfaction que
procure chacune des situations finales. Cette donne varie avec
les individus. Par exemple, si l'individu prfre les omelettes
de 5 ufs aux omelettes de 6 ufs, il choisira de jeter le
6" uf qui ne peut lui apporter que du dsagrment. Peu lui
importe alors qu'il soit pourri ou sain. D'autre part, le choix
dpend des probabilits associes aux tats de la nature. C'est
l encore un rsultat tout fait intuitif: si la probabilit que
l' uf soit pourri est trs faible, ce sont les satisfactions obte-
nues lorsque l' uf est sain qui, en gnral, l'emporteront dans
la dcision. On distingue d'ordinaire deux cas: celui des pro-
babilits objectives, quand ces probabilits sont calculables a
priori, et celui des probabilits subjectives, lorsque les indivi-
dus sont contraints de les estimer sur la base de leurs
croyances.
Ce cadre conceptuel se transpose directement aux dcisions
d'investissement. Quand un homme achte un bien de capital, il
acquiert le flux des revenus qui seront engendrs par ce capital
toute sa vie durant. Or ces revenus attendus ne sont pas connus
avec certitude. Ils dpendent de nombreuses variables, comme
les gots des consommateurs, le cot de l'nergie, l'intensit de
la concurrence ou l'tat de la conjoncture. L'investisseur est
conduit s'intresser aux diffrentes valeurs prises par ces
variables dans la mesure o elles affectent ses revenus futurs, ce
1. Ce qu'on nomme )' esprance d'utilit .
234
L'VALUATION FINANCIRE
qu'on a nomm prcdemment les tats de la naturel. Prendre
en compte la totalit de ces incertitudes requiert que soit dresse
la liste exhaustive de tous les tats de la nature possibles pour
toutes les dates futures. C'est l une tape ncessaire. partir
de quoi, pour chaque tat du monde, l'investisseur tablit au
mieux de ses connaissances ce que sera le rendement attendu.
Une fois ces oprations termines, la dcision de l'investisseur
entre parfaitement dans le cadre conceptuel dcrit prcdem-
ment: choisir un investissement parmi plusieurs revient choi-
sir une action parmi diffrentes actions dont les rsultats
dpendent des tats de la nature.
C'est ce mme cadre conceptuel qu'a retenu la thorie no-
classique pour aborder la question financire. Son hypothse de
base est que le futur peut se reprsenter sous la forme d'une liste
exhaustive d'tats de la nature, suppose dcrire toutes les incer-
titudes qui affectent l'conomie considre. Cette hypothse a t
prsente au chapitre II sous le nom d' hypothse probabiliste ,
ou d' hypothse de nomenclature des tats du monde . Une
fois cette hypothse pose, tout actif se dcrit comme un flux de
revenus dpendant des tats du monde. Cette description extr-
mement synthtique est le point de dpart de toute la rflexion
noclassique. Elle joue un rle capital dans les rsultats qu'obtient
ce corps de doctrine. titre d'exemple, considrons une action.
chaque tat e du monde est associe une valeur donne du
dividende distribu. Aussi une action sera-t-elle dcrite par le
dividende qu'elle gnre dans chaque tat. On trouve cette hypo-
thse clairement expose chez Robert Kast et Andr Lapied :
[On peut dcrire] l'incertitude de la manire suivante: toutes
les situations conomiques pertinentes pour les agents sont
rpertories dans un ensemble E. Chaque lment e de cet
ensemble E caractrise une description complte d'un tat
1. Dans l'exemple choisi par Savage, la situation est particulirement
simple puisqu'il n'existe qu'une seule variable, savoir l'tat de l'uf, et que
cette variable ne peut prendre que deux valeurs, sain ou pourri. Dans le cas
gnral, plusieurs variables sont actives et elles peuvent prendre de trs nom-
breuses valeurs. Cela complexifie le problme mais n'en change pas la nature.
235
L'EMPIRE DE LA VALEUR
possible de l'conomie ... Pour un e quelconque, le dividende de
chaque action sera connu. L'incertitude est donc, par cette
mthode, reporte des dividendes vers les e appels tats de la
nature ou tats du monde (ou plus simplement tats). Un titre
sera finalement dcrit par les paiements qu'il gnre dans chaque
tat: d(e) pour e appartenant El.
En consquence, tout bon manuel de finance noclassique
commence par postuler une liste exhaustive d'tats de la nature,
encore nomme espace des tats , puis introduit un ensemble
d'actifs, chaque actif tant dfini par les revenus auxquels il
donne droit dans tous les tats de la nature. Il est frappant
d'observer que l'introduction de ces hypothses se fait gnra-
lement sans aucune discussion, sans qu'il soit mme besoin de
les justifier
2
Il ne faut pas s'en tonner, ces hypothses sont uti-
lises si communment par la thorie noclassique
3
qu'elles
apparaissent aux conomistes comme des vidences, la
manire de l 'hypothse de nomenclature des biens. Pourtant,
cette manire de concevoir la relation au futur est sujette de
nombreuses rserves, bien plus fortes que celles formules
l'encontre de l'hypothse de nomenclature des biens.
Une premire critique renvoie au fait que l'espace des tats
intervenant dans l'analyse propose par Savage est d'une nature
1. Robert Kast et Andr Lapied, Fondements microconomiques de la
thorie des marchs financiers, Paris, Economica, 1992, p. 23.
2. Par exemple Stephen Ross (Neoclassical Finance, Princeton-Oxford,
Princeton University Press, 2005) ou Robert Kast et Andr Lapied (Fonde-
ments microconomiques de la thorie des marchs financiers, op. cit.) ou
encore Darrell Duffie (Modles dynamiques d'valuation, Paris, PUF, 1994).
Duffie est le plus concis. Deux phrases suffisent: L'incertitude est repr-
sente par un ensemble fini d'tats, dont un seul se ralisera. Les N titres sont
reprsents par une matrice D [ ... ] o Dij reprsente le nombre d'units de
compte payes par le titre i dans l'tatj (ibid, p. 3).
3. Le point de dpart de cette tradition est trouver dans le modle Arrow-
Debreu. Voir Kenneth J. Arrow (<< The Role of Securities in the Optimal
Allocation of Risk-Bearing , The Review of Economic Studies, vol. 31, nO 2,
avril 1964), Grard Debreu (Thorie de la valeur. Analyse axiomatique de
l'quilibre conomique, op. cit.) ou Jack Hirshleifer (<< Investment Decision
under Uncertainty : Choice-Theoretic Approaches , The Quarterly Journal of
Economics, vol. LXXIX, n 4, novembre 1965).
236
L'VALUATION FINANCIRE
essentiellement subjective. Si, face l'incertitude du futur,
chaque investisseur est conduit, par ncessit, se reprsenter
de quoi le futur sera fait, cette reprsentation demeure person-
nelle : elle est l'expression des connaissances et des croyances
propres l'individu concern. Sur la base de celles-ci, l'acteur
propose la description qui lui semble, autant qu'il peut en juger,
la meilleure possible. Il peut considrer que le risque consiste en
la possibilit d'un 6" uf pourri, ou bien qu'il s'agit essentielle-
ment de cuisiner rapidement car les convives sont impatients.
En consquence, rien n'assure a priori que deux individus
aboutissent une mme analyse de la situation. Cette subjecti-
vit de la reprsentation ne constitue en rien une faiblesse du
modle de Savage. Elle est dans la nature des choses et il est
heureux que ce formalisme en tienne compte. Tout au contraire,
c'est l'hypothse d'une reprsentation collectivement admise
qui ne va pas de soi et qui demande tre justifie. Comment
est-il possible que tous les agents partagent une mme concep-
tion de l'avenir? D'o vient une telle unanimit? La manire
la plus simple et la plus directe de justifier ce consensus est de
faire valoir que le risque est d'une nature objective. Pour cette
raison, il ne peut manquer de s'imposer uniformment tous les
individus rationnels et informs, de mme que s'impose leur
perception la prsence d'un objet au milieu d'une pice. Cette
objectivit postule justifie non seulement que tous les acteurs
s'accordent sur une mme liste des tats futurs, mais galement
qu'ils s'accordent sur la valeur des rendements que procurent
les actifs dans chacun des tats. Tel est effectivement le point
de dpart oblig des manuels de finance noclassique : un
accord de tous les individus rationnels, bien informs, quant aux
rendements attendus de tous les actifs pour tous les tats de la
nature. C'est ce qu'on nomme galement l'hypothse d'antici-
pation rationnelle. L'anticipation rationnelle est celle laquelle
est ncessairement conduit un statisticien examinant la chro-
nique historique des rendements et ayant accs toute l'infor-
mation dont dispose l'conomie l'instant t.
partir de cette hypothse qui stipule que, pour chaque titre,
sont connus et les rendements attendus et les probabilits
237
L'EMPIRE DE LA VALEUR
assoclees, la question de l'valuation se trouve rsolue pour
l'essentiel. Il reste seulement dterminer ce que les cono-
mistes appellent le taux d'actualisation 1. Classiquement, on uti-
lise le taux d'intrt
2
Concluons en disant que l'hypothse
probabiliste rend possible la dtermination d'une valeur de rf-
rence, pour n'importe quel titre, ce que nous nommerons sa
valeur fondamentale , dite encore valeur intrinsque
3
.
Dans la mesure o les investisseurs rationnels partagent une
mme information, savoir l'information disponible l'instant
considr, et une mme reprsentation du futur, savoir celle
que suppose 1 'hypothse probabiliste, leur calcul, men sur la
base des mmes rendements objectifs, des mmes probabilits
et du mme taux d'actualisation, les conduira un rsultat iden-
tique. Les opinions personnelles ne jouent plus ici aucun rle.
Cela rsulte directement de l'hypothse d'objectivit du futur. A
contrario des divergences d'valuation supposent ncessaire-
ment, soit que les agents ne sont pas rationnels, soit qu'ils ne
disposent pas des mmes informations. Notons que la rationalit
mise en jeu par l'investisseur rationnel est d'une nature essen-
tiellement statisticienne. Elle analyse la variabilit objective des
1. Le principe d'valuation d'un titre est simple. Il consiste calculer la
somme des revenus que le titre engendre tout au long de sa vie. Mais deux dif-
ficults se prsentent. D'une part, le revenu n'est connu qu'en probabilit.
Aussi on utilise son esprance mathmatique. D'autre part, il faut tenir compte
du fait que 1 euro dans 10 ans ne vaut pas 1 euro aujourd'hui. Cela vaut beau-
coup moins comme en tmoigne le fait que, avec 1 euro aujourd'hui, j'obtien-
drai dans 10 ans, en le plaant au taux d'intrt en vigueur, une somme bien
plus leve, trs exactement (I+r)10 euros, si le taux d'intrt r reste constant
au cours de ces \0 annes. L'actualisation est l'opration qui consiste trans-
former 1 euro l'horizon t en euros l'instant O. Comme on le voit, l'actuali-
sation dpend du taux d'intrt mais elle dpend galement du fait que
l'individu a une prfrence marque ou non pour le prsent, ce qu'on nomme
aussi aversion au risque. In fine, la valeur du titre s'obtient en calculant ce
qu'on appelle l'esprance mathmatique du flux actualis des rendements
attendus.
2. L'utilisation du taux d'intrt correspond l'valuation que ferait un
investisseur neutre au risque . Il est galement possible d'intgrer une
prime de risque exprimant l'aversion au risque de la population concerne.
3. Les anglo-saxons utilisent frquemment le terme de present value .
238
L'VALUATION FINANCIRE
revenus dans le but d'en infrer leurs lois de probabilit et de
pouvoir calculer avec prcision les valeurs fondamentales des
titres. Elle sera qualifie de fondamentaliste' . Dans la tho-
rie noclassique, la rationalit fondamentaliste joue un rle
prpondrant, .car c'est en valuant au mieux la valeur fonda-
mentale des titres que le spculateur obtient son profit tout en
rendant les cotations plus efficaces. La stratgie fondamentaliste
consiste acheter (respectivement vendre) les titres pour les-
quels le prix observ est infrieur (respectivement suprieur)
la valeur fondamentale calcule.
La suite du livre s'attachera dmontrer que cette hypothse
d'objectivit du futur doit tre rejete parce qu'elle ne fournit
pas une description satisfaisante de l'incertitude marchande.
Mais, avant de procder cette dmonstration, il importe de
comprendre d'o vient l'attraction si puissante qu'elle exerce
sur les conomistes. Pourquoi retenir une analyse si trange et
si contraire l'intuition? La rponse est simple: l'hypothse
probabiliste conserve l'ide cruciale d'objectivit de la valeur et
permet de maintenir les croyances collectives hors du champ de
l'conomie. Ce faisant, elle s'affirme comme le prolongement
naturel, dans le domaine financier, des thories de la valeur
substance dont elle reproduit le geste fondateur: tablir l'exis-
tence de grandeurs en surplomb des changes, chappant aux
opinions et aux rapports de force. De mme que les valeurs des
marchandises sont l'expression des rarets objectives, de mme
les valeurs des actifs sont-elles l'expression des rendements
objectifs. Dans un cas comme dans l'autre, la valeur se donne
comprendre comme indpendante des opinions humaines,
comme chappant aux manipulations stratgiques, comme
l'expression de contraintes qu'il n'est pas dans le pouvoir des
hommes de nier. L 'hypothse probabiliste tire sa puissance de
cette capacit tendre la logique de la valeur la finance, sans
1. Sur ce point, se reporter Andr Orlan (<< Efficience, finance compor-
tementale et convention: une synthse thorique , in Robert Boyer, Mario
Dehove et Dominique Plihon (dir.), Les Crises financires, complments A,
rapport du Conseil d'analyse conomique, octobre 2004).
239
L'EMPIRE DE LA VALEUR
solution de continuit. L'hypothse de nomenclature des tats
du monde joue, dans le rapport au temps, le mme rle que
l'hypothse de nomenclature des biens, dans le rapport aux
valeurs d'usage. Dans les deux cas, des mdiations objectives
sont postules qui viennent faire obstacle aux interactions
directes entre individus. Du fait de la prsence de ces repres
communs (valeurs d'usage ou tats du monde), connus de tous,
les individus peuvent s'en remettre la seule rationalit para-
mtrique pour se coordonner. La rationalit fondamentaliste
est la forme que prend cette rationalit paramtrique dans le
domaine financier. Elle prend appui sur la connaissance com-
mune des tats du monde. Il s'ensuit un difice thorique no-
classique d'une grande cohrence quant sa conception de la
coordination marchande. C'est ce que le concept d'objectivit
marchande dveloppe au chapitre II s'est efforc de synthti-
ser. Cette cohrence globale est pousse son extrme lorsque
les thoriciens noclassiques transposent aux marchs finan-
ciers les mmes proprits d'efficacit que celles mises au jour
pour les marchs de biens ordinaires. Autrement dit, la concur-
rence financire serait productrice d'autorgulation comme
l'est la concurrence des marchandises. La mme loi de l'offre
et de la demande serait l'uvre pour imposer la justesse des
prix et la stabilit. Cette thse connue sous le nom d' effi-
cience financire a jou un rle primordial dans la
lgitimation du processus de drglementation financire qui,
depuis plus de trente ans, a transform en profondeur le
capitalisme.
Efficience des marchs financiers
L'efficacit des marchs constitue sans conteste la question
qui, par excellence, mobilise l'intrt des conomistes. Il s'agit
de savoir si le mcanisme concurrentiel permet une gestion des
ressources rares au mieux des besoins, sans gaspillage. Les co-
nomistes parlent alors d' efficacit allocative. C'est le critre
essentiel pour juger des performances marchandes. L'efficacit
240
L'VALUATION FINANCIRE
allocative a pour condition premire des prix justes, permettant
aux acheteurs et aux vendeurs de prendre les bonnes dcisions
en matire d'investissement et de consommation. Autrement
dit, les prix doivent exprimer toute l'information pertinente
quant la valeur des biens changs. Comme l'crit Eugene
Fama, l'idal est un march sur lequel les prix fournissent des
signaux appropris pour allouer les ressources 1 , ce qu'on
nomme galement 1' efficacit informationnelle. Il en dcoule
qu'efficacit informationnelle et efficacit allocative sont troi-
tement lies. Cette proposition se transpose sans difficult la
sphre financire : un march financier efficient est celui sur
lequel les actifs financiers sont valus correctement, compte
tenu de l'information disponible l'instant considr
2
l'vi-
dence, cette dfinition suppose que le thoricien soit capable de
dfinir ce qu'est une valuation correcte. Dans le cadre no cl as-
sique, la notion de valeur fondamentale, ou de valeur intrin-
sque, remplit ce rle. Il s'ensuit qu'un march financier est
efficient si la concurrence fait en sorte qu' tout instant le prix
form soit conforme la valeur intrinsque de l'actif considr.
C'est trs prcisment ce que dit Fama: Sur un march effi-
cient, le prix d'un titre constituera, tout moment, un bon esti-
mateur de sa valeur intrinsque
3
Ou encore: Sur un march
efficient, la concurrence fera en sorte qu'en moyenne toutes les
consquences des nouvelles informations quant la valeur
intrinsque soient instantanment refltes dans les prix
4
On
utilisera le signe [HEF] pour dsigner cette approche de l'effi-
ciences. Robert Shiller en propose une dfinition trs complte,
mme si elle a l'inconvnient de recourir la notion d'esp-
rance mathmatique conditionnelle, c'est--dire la meilleure
1. Eugene Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and
Empirical Work , Journal of Finance, vol. 25, 1970, p. 383.
2. Robert J. Shiller, Irrational Exuberance, Princeton (New Jersey), Prin-
ceton University Press, 200 1, p. 171.
3. Eugene Fama, Random Walks in Stock Market Priees , Financial
Analysts Journal, vol. 21, nO 5, septembre-octobre 1965, p. 55.
4. Ibid., p. 56.
5. Pour Hypothse d'Efficience Financire .
241
L'EMPIRE DE LA VALEUR
anticipation qui puisse tre faite compte tenu de l'hypothse
probabiliste 1 :
La thorie des marchs efficients peut se formuler comme ta-
blissant que le prix Pt d'une action est gal l'esprance math-
matique de la valeur prsente Pt* des dividendes futurs de cette
action, conditionnellement toute l'information disponible cet
instant. Pt* n'est pas connue l'instant t et doit tre anticipe.
L'hypothse des marchs efficients dit que le prix est gal
l'anticipation optimale de cette grandeur. Selon le choix du taux
d'actualisation utilis dans le calcul de la valeur fondamentale,
sont obtenues des formes diffrentes d'efficience, mais l'hypo-
thse gnrale d'efficience peut toujours s'crire sous la forme
de Pt = Elt* o Et dsigne l'esprance mathmatique condition-
nelle l'information publique disponible en t. Cette quation
implique que tous les mouvements non prvus affectant le mar-
ch boursier doivent avoir pour origine quelque information nou-
velle quant la valeur fondamentale pt*2.
l'vidence, sans l'hypothse d'une valeur fondamentale
objective, dfinie sans ambigut, cette approche n'aurait aucun
sens. Dans le cadre nocJassique, la valeur fondamentale pr-
existe objectivement aux ffi.!:U"chs financiers et ceux-ci ont pour
rle central d'en fournir l'estimation la plus fiable et la plus pr-
cise. Aussi l'hypothse d'efficience financire conoit-elle le
march financier comme tant un reflet fidle de l'conomie
relle. Dans une telle perspective, l'valuation financire ne
possde aucune autonomie, et c'est prcisment parce qu'il en
est ainsi qu'elle peut tre mise tout entire au service de l' co-
nomie productive laquelle elle livre les signaux qui feront que
1. Autrement dit, une fois connue la structure probabiliste, il est possible
de dfinir l'anticipation optimale sachant l'information 1. Cette anticipation
optimale s'exprime mathmatiquement au travers de l'oprateur d'esprance
conditionnelle, sachant 1. Cette notion mathmatique correspond trs exacte-
ment la notion conomique d'anticipation rationnelle, savoir la meilleure
estimation que les agents rationnels et anticips sont capables de faire sachant
l'information I.
2. Robert J. Shiller, From Efficient Markets Theory to Behavioral
Finance , Journal of Economie Perspectives, vol. 17, nO l, hiver 2003, p. 84
et 85.
242
L'VALUATION FINANCIRE
le capital s'investira l o il est le plus utile. Dans l'obtention
de ce rsultat, la concurrence n'est qu'un aiguillon: la force
cognitive relle l'uvre, celle qui pennet l'obtention du rsul-
tat considr, est la rationalit fondamentaliste, c'est--dire la
capacit des investisseurs percer les mystres du futur.
Tester directement l'efficience allocative est dlicat car, pour
dmontrer que la dynamique des prix suit l'volution de la
valeur fondamentale, encore faut-il pouvoir expliciter cette der-
nire. C'est seulement lorsqu'on dispose d'une telle explicita-
tion qu'il est possible d'examiner si les prix se confonnent ou
non la valeur fondamentale. Aussi l'conomiste est-il
contraint d'introduire une hypothse supplmentaire portant sur
la valeur fondamentale elle-mme. C'est ce que Fama appelle le
problme de l 'hypothse jointe. En consquence, dans le cas
d'un test ngatif, on ne sait jamais avec certitude s'il faut reje-
ter l'efficience ou bien si c'est le modle d'valuation fonda-
mentale qui n'est pas pertinent. Pour cette raison, une autre
approche de l'efficience est avance qui se prte mieux aux
tests empiriques. C'est la fameuse marche au hasard (ran-
dom walk), qui dit que les variations successives des cours sont
statistiquement indpendantes: Les rendements financiers ne
sont pas corrls et sont imprvisibles statistiquement 1.
Comme elle met l'accent sur la non-prdictibilit des rende-
ments, nous la noterons [NPR]. Les travaux statistiques ont
confinn trs largement cette conception de l'efficience. Nan-
moins, des anomalies ont t mises en vidence, ce que Malkiel
dfinit comme des volutions de rendements montrant une
prvisibilit statistiquement significative
2
. Il s'agit d'volu-
tions qui, de par leur systmaticit, violent l 'hypothse de non-
prdictibilit des rendements. Il en est ainsi, par exemple, de
l'effet janvier, savoir la tendance des titres de petite capitali-
sation plonger considrablement fin dcembre et rebondir
durant la premire semaine de janvier. La raison couramment
1. Stephen A. Ross, Neoc/assical Finance, op. cit., p. 44.
2. Burton G. Malkiel, The Efficient Market Hypothesis and its Critics ,
Journal of Economic Perspectives, vol. 17, nO 1, hiver 2003, p. 71.
243
L'EMPIRE DE LA VALEUR
invoque est de nature fiscale : le gestionnaire a intrt faire
apparatre des moins-values dductibles avant de clore les
comptes de faon payer moins d'impts. L'existence de telles
structures de corrlation prvisibles ouvre des opportunits de
profit. Ainsi peut-on exploiter l'effet janvier en achetant des
petites capitalisations fin dcembre, lorsque leur cours est bas,
pour les revendre la fin de la premire semaine de janvier,
lorsque leur cours est lev. C'est pourquoi la thorie noclas-
sique prvoit que ces anomalies, quelles qu'elles soient, doivent
ncessairement disparatre au fur et mesure qu'elles sont
dcouvertes et exploites '.
En fait, cette dfinition [NPR] de l'efficience est encore trop
forte dans la mesure o elle identifie d'une manire excessive
anomalie statistique et anomalie conomique. Elle nglige le
fait que les investisseurs financiers, lorsqu'ils tentent d'exploi-
ter ces anomalies statistiques, supportent des cots de transac-
tion qui viennent en dduction des profits raliss. Pensons, par
exemple, aux commissions qu'exigent certains intermdiaires
ou bien encore l'existence d'un cart structurel entre prix
d'achat et prix de vente
2
Aussi une anomalie statistique qui
engendrerait des profits trop faibles par rapport aux cots nces-
saires son limination pourrait-elle se maintenir sans que ce
soit la preuve d'une vritable inefficience. Tenir compte de
cette ralit conduit une troisime conception de l'efficience
qui prend pour critre les profits effectivement raliss par les
agents et non les corrlations statistiquement significatives.
Cette conception met en avant le fait que, sur march efficient,
la seule manire d'accrotre son profit est de prendre plus de
risque. Il n'existe pas de repas gratuie . Comme l'crit Mal-
kiel, les marchs financiers sont efficients parce qu'ils ne
permettent pas aux investisseurs d'obtenir des rendements sup-
rieurs la moyenne une fois le risque pris en compte (above-
1. Ibid., p. 72.
2. Ce qu'on nomme le spread bid-ask dsignant la fourchette de cotations
d'un titre entre le meilleur vendeur et le meilleur acheteur.
3. Au-del du taux d'intrt sans risque, celui que fixe la Banque centrale.
244
L'VALUATION FINANCIRE
average risk adjusted returns') . Nous la noterons [NPBM]
pour: on ne peut pas battre le march , ce qui signifie que
les investisseurs ne peuvent surperformer le march pour un
risque donn.
Ces trois approches sont troitement lies. On peut montrer,
sans trop de difficults, que la premire est la plus restrictive
2
On a:
[HEF] ~ [NPR] et [HEF] ~ [NPBM]
Mais il importe de souligner que les relations inverses ne
sont pas vrifies. Ainsi peut-on avoir [NPBM] sans avoir
[HEF], et mme sans avoir [NPR]. C'est ce qui vient d'tre
dmontr. Lorsqu'une anomalie est d'ampleur insuffisante, du
fait de ses cots de transactions, pour tre exploitable, le mar-
ch ne peut pas tre battu alors mme que la non-prvisibilit
des rendements est rejete. Autrement dit, il ne suffit pas de
reprer conomtriquement des anomalies statistiques pour
dire qu'il y a inefficience financire. Il s'ensuit une tendance
privilgier la dfinition [NPBM] comme constituant la bonne
approche de l'efficience. Par exemple, Ross crit: [Ces ano-
malies] sont gnralement petites, ce qui signifie qu'elles
n'impliquent que quelques dollars en comparaison de la taille
des marchs de capitaux
3
Ou Richard Roll galement: J'ai
personnellement essay d'investir de l'argent [ ... ] dans chaque
anomalie spcifique [ ... ]. Et jusqu ' maintenant je n'ai pas t
capable de gagner un seul centime sur ces supposes ineffi-
ciences de march [ ... ]. Une vraie inefficience devrait tre une
opportunit exploitable
4
Malkiel indique lui aussi clairement
sa prfrence pour [NPBM]. Notons cependant que tester
1. Burton G. Malkiel, The Efficient Market Hypothesis and its Critics ,
art. cit., p. 60.
2. Par exemple, se reporter au chapitre III de Stephen A. Ross, Neoc/as-
sical Finance, op. cit.
3. Ibid., p. 67.
4. Richard Roll cit in Burton G. Malkiel, The Efficient Market
Hypothesis and its Cri tics , art. cit., p. 72.
245
L'EMPIRE DE LA VALEUR
[NPBM] est plus dlicat que tester [NPR], car il s'agit de mon-
trer que le profit obtenu par les investisseurs est toujours en
proportion du risque qu'ils ont pris. En consquence, ces tests,
pour tre probants, supposent que le statisticien dispose d'un
modle robuste et convaincant du risque. On retrouve ici le
problme de l'hypothse jointe
l
En l'absence d'un tel modle,
la tentation sera forte, pour les partisans de l'efficience, face
l'observation d'une situation de rendements anormaux, d'y
voir simplement la consquence d'un risque lev. C'est ce
point que souligne Shleifer, lorsqu'il crit que [les partisans
de l'efficience] sont prompts suggrer un modle de risque
qui rduit les surprofits n'tre que la compensation quitable
de la prise de risque
2
, ce qui veut dire qu'ils ne sont prcis-
ment plus des surprofits et que l'hypothse d'efficience
[NPBM] peut tre conserve.
Notons galement que [NPR] n'entrane nullement [HEF]. En
consquence, le fait que [NPR] soit vrifie ne nous dit rien
quant l'efficacit allocative des marchs financiers. C'est l
un point beaucoup plus dlicat et rarement reconnu par la
finance noclassique avec toute la force qu'il conviendraitl. Il
est pourtant d'une importance capitale puisque c'est bien la
capacit du march boursier fournir au reste de l'conomie les
bons signaux, savoir ce que nous avons not [HEF], qui
constitue, pour tous les conomistes, la proprit significative.
Burton Malkiel reconnat ce point
4
propos de la bulle Internet,
puisqu'il crit: Les marchs peuvent tre efficients mme
s'ils commettent quelquefois des erreurs d'valuation, ce qui fut
certainement le cas durant la bulle Internet en 1999 et dbut
1. Stephen A. Ross, Neoclassical Finance, op. cit., p. 50. Mme point de
vue chez Burton G. Malkiel, The Efficient Market Hypothesis and its Cri-
tics , art. cit. .
2. Andrew Shleifer, Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral
Finance, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 50.
3. Avec une exception notable: pour la thorie des bulles rationnelles,
[NPR] est vrifie mais pas [HEF].
4. On trouve cette mme ide chez Shiller dans sa conclusion (<< From
Efficient Markets Theory to Behavioral Finance , art. cit., p. 101).
246
L'VALUATION FINANCIRE
2000'. Autrement dit, Malkiel concde que son critre d'effi-
cience, en l'espce [NPR] ou [NPBM], n'assure pas l'efficacit
allocative ; les marchs peuvent tre efficients au sens de [NPR]
et engendrer de mauvais prix ! Un tel aveu chez les partisans de
l'efficience est rarissime. Il en tire la conclusion importante que,
durant la bulle Internet, du capital s'est trouv inutilement gas-
pill : Le rsultat a t que trop de capitaux nouveaux se sont
investis dans les compagnies Internet et dans les compagnies de
tlcommunications qui leur taient lies. En consquence, le
march financier a bien pu temporairement faillir son rle
d'allocateur efficace du capital
2
Il est vrai que Malkiel pour-
suit en soulignant que de tels drapages ne sont que des
erreurs occasionnelles , qu'ils constituent l'exception plu-
tt que la rgle , car, [] la fin, la vraie valeur l'emporte
3
)).
On ne trouve pas de tels aveux sous la plume de Ross. Nan-
moins, il est un point sur lequel ce dernier confie son embarras :
le fait qu'ex post, une fois les informations connues, il n'est
qu'une si petite partie de l'volution constate des prix qui
puisse tre explique par les informations nouvelles
4
Autre-
ment dit, la plus grande partie du mouvement des prix reste
nigmatique pour qui adhre la conception de la valeur objec-
tive. Elle ne trouve pas dans l'volution des fondamentaux une
explication satisfaisante. Ce faisant, c'est directement l'hypo-
thse [HEF] qui se trouve mise en cause, bien que [NPR] soit
gnralement vrifie.
Distinguer ces trois approches et comprendre les liens qui les
unissent est important d'un point de vue conceptuel comme
d'un point de vue pratique. Or, lire les dclarations des finan-
ciers noclassiques, il pourrait sembler que la non-prvisibilit
des rendements suffit assurer l'efficience vritable. En effet,
c'est ce critre qui est systmatiquement mis en avant par les
1. Burton G. Malkiel, The Efficient Market Hypothesis and its Cri tics ,
art. cit., p. 60.
2. Ibid., p. 75-76.
3. Ibid., p. 61.
4. Stephen A. Ross, Neoclassical Finance, op. cU., p. 64.
247
L'EMPIRE DE LA VALEUR
thoriciens de la finance lorsqu'il est question d'efficience.
Pourtant, il ne devrait pas tre ainsi. Il faut toujours garder
l'esprit que la proprit stratgique reste l'efficacit allocative,
ce que nous avons nomm [HEF]. Ainsi, lorsqu'il faut statuer
sur l'opportunit de laisser une plus grande place la concur-
rence et aux marchs financiers, importe-t-il avant tout de
prendre en compte leur aptitude permettre une gestion satis-
faisante du capital, sans gaspillage, et non pas de savoir si les
rendements sont ou non prvisibles. Comme on l'a vu, la non-
prvisibilit est une proprit peu exigeante en comparaison de
[HEF]. Elle dit simplement que, s'il existe des structures de cor-
rlation, les acteurs fmiront par les dcouvrir en sorte que, si
elles sont conomiquement significatives, ils les feront dispa-
ratre en jouant contre elles. Pour dsigner cette proprit, le
terme d' efficience technique ou oprationnelle parat
appropri 1. Cette efficience technique repose sur une rationalit
bien moins labore que la rationalit fondamentaliste. Il suf-
fit d'tre capable de dcouvrir ce que nous avons nomm des
structures de corrlation , et ce que les anglo-saxons
nomment des patterns . C'est l une tche plus aise que
celle consistant calculer la valeur fondamentale des titres,
comme l'indique clairement le fait qu'elle est indpendante de
1 'hypothse probabiliste. Rappelons que le recours la concep-
tion [NPR] trouve prcisment son origine et sa justification
dans la ncessit de concevoir des tests qui vitent les difficul-
ts que pose l'hypothse jointe. Aussi ne faut-il pas tre tonn
que les tests ainsi conus soient plus faibles et ne puissent
conclure sans ambigut l'efficience. En conclusion, il importe
de ne pas confondre ces deux approches. Pourtant cette confu-
sion est couramment faite, et mme sous la plume des meilleurs
spcialistes. Ainsi, lorsqu'Eugene Fama, le pape de l'effi-
cience , est interrog par John Cassidy quant la prsence de
1. Se reporter l'introduction gnrale de David Bourghelle, Olivier Bran-
douy et Andr Orlan dans Croyances, Reprsentations collectives et Conven-
tions enfinance, (en collaboration avec Daniel Bourghelle, Olivier Brandouy
et Roland Gillet, Paris, Economica, 2005).
248
L'VALUATION FINANCIRE
bulles financires lors de l'euphorie prcdant la crise des sub-
primes, il les rejette catgoriquement, non pas en faisant valoir
que les prix auraient t au bon niveau, mais en dclarant qu'il
s'agit d'volutions non prvisibles. tes-vous en train de dire
que les bulles ne peuvent pas exister? , demande alors le jour-
naliste du New Yorker', quelque peu dstabilis par les rponses
de Fama niant toute responsabilit des marchs financiers dans
la crise des subprimes. quoi Fama rpond: Elles doivent
tre des phnomnes prvisibles. Je pense qu'aucune ne ft par-
ticulirement prdictible. On trouve une rponse similaire de
la part de Robert Lucas dans The Economist
2
Ces conomistes
ne semblent pas concevoir qu'il puisse exister des volutions de
prix sans rapport avec les fondamentaux, qui ne soient pas pr-
visibles au sens de [RPR] ! Pourtant, les prix peuvent monter
sans que cette hausse soit perue par tous les agents comme
absolument invitable. Il n'y a pas lieu d'assimiler bulle et
prvisibilit des rendements . On peut reprendre le raisonne-
ment des partisans de l'efficience et faire valoir que, chaque
jour, des informations nouvelles taient divulgues, non antici-
pes, mais majoritairement interprtes comme justifiant la
hausse des cours. Il s'ensuit un processus de drive des prix
la hausse sur une longue priode et, consquemment, un
important gchis de capital qui donne voir pleinement l'inef-
ficience des marchs financiers, bien que l'hypothse [NPR]
soit satisfaite.
Il faut conclure de ces analyses que l'approche noclassique
ne fournit pas de preuve statistique convaincante permettant
d'affirmer que les marchs sont efficients. Son recours systma-
tique aux tests de non-prvisibilit ne constitue en rien une telle
preuve car l'efficience allocative requiert bien plus que la non-
prvisibilit, savoir la prsence d'une valeur objective. Sans
un tel concept, il est impossible de dterminer sans ambigut si
1. Se reporter l'entretien d'Eugene Fama avec John Cassidy paru dans le
New Yorker du 13 janvier 2010 : http://www.newyorker.comlonline/blogs/
johncassidy/20 1 % I/interview-with-eugene-fama.html.
2. 6 aot 2009.
249
L'EMPIRE DE LA VALEUR
les prix constats sont au bon niveau ou non. Or, comme on l'a
vu, l' obj ectivit de la valeur financire repose sur 1 'hypothse
d'un futur objectivable, pouvant faire l'objet d'une description
exhaustive ex ante, ce qu'on a nomm l'hypothse de nomen-
clature des tats du monde . Examinons cette conception si
contraire au sens commun.
Incertitude knightienne et irrductible subjectivit
des estimations individuelles
Cette hypothse est assurment droutante. Elle conoit
l'incertitude selon le modle de l'ala mtorologique. Dans
une telle perspective, les probabilits mesurent la variabilit
objective
l
du monde conomique telle que l'engendre la volati-
lit naturelle, intrinsque, des facteurs exognes (ressources,
productivit, prfrences) qui conditionnent l'activit cono-
mique. L 'hypothse de nomenclature des tats du monde en ta-
blit la liste exhaustive. Autrement dit, dans une telle approche,
avant mme que s'ouvrent les marchs financiers, le futur est
dj crit et connu
2
Certes, il s'agit d'une criture probabiliste
mais cette concession est toute relative. Par rapport la logique
du certain, elle n'introduit au plus qu'une inflexion, comme
l'avait bien compris Keynes : Le calcul des probabilits [est]
suppos capable de rduire l'incertain au mme statut [ ... ] que
1. Une autre conception est possible dans laquelle la probabilit mesure
l'incertitude subjective qu'prouve l'acteur face au phnomne. Pensons un
individu qui prvoit que le prix demain vaudra 100 mais qui nanmoins intro-
duit un intervalle de variation parce qu'il n'est pas absolument sr de son
chiffre. Dans ce cas, la probabilit exprime la mconnaissance du sujet et non
pas la variabilit intrinsque du phnomne. Le mme concept mathmatique,
la probabilit, renvoie deux ralits tout fait diffrentes.
2. Rappelons que, dans le cadre du modle Arrow-Debreu d'quilibre
gnral intertemporel, les marchs n'ouvrent qu' la date initiale. cette date
sont dtermins les prix pour toutes les marchandises, pour toutes les dates
futures, pour tous les tats susceptibles de se raliser. A la date t, quand est
connu l'tat e, les transactions correspondant cette ventualit s'effectuent
conformment au prix dtermin la date initiale.
250
L'VALUATION FINANCIRE
le certain lui-mme 1. Il importe de faire beaucoup mieux:
proposer une modlisation de la temporalit conomique qui
soit fidle sa nature radicalement opaque. Pour ce faire, il suf-
fit de prendre pour point de dpart l'ide banale, majoritaire-
ment accepte par les conomistes, selon laquelle le futur ne
prexiste pas aux actions individuelles mais en est le produit.
Dans ce cadre alternatif, les valuations des investisseurs s' ana-
lysent comme des paris concernant un futur qui, non seulement
n'est pas encore crit, mais qui surtout dpend troitement des
paris qui auront t faits sur lui. Le rapport au temps ainsi conu
met en jeu deux boucles d'interaction: la premire, qui va du
futur au prsent sous la forme d'anticipations concernant ce que
sera demain, et la seconde, du prsent au futur, par le fait que
ce qui adviendra demain est le rsultat des choix effectus
aujourd'hui sur la base des anticipations faites sur le futur. Dans
une telle perspective, l'ide d'une objectivit du futur, mme de
nature probabiliste, est totalement inutile, pour ne pas dire
incongrue. Pour ce qui est des anticipations individuelles, on
peut conserver le formalisme antrieur, la Savage, mais en
soulignant bien qu'il s'agit d'estimations subjectives formes
par les diffrents investisseurs, et non pas la simple prise en
compte d'un futur objectivement donn. Cela fait une grande
diffrence. La question est alors de comprendre sur quelles
bases les acteurs forment leurs anticipations, lorsqu'on ne pos-
tule plus a priori qu'une seule reprsentation est conforme la
rationalit. Quelle part de subjectivit entre dans ces anticipa-
tions ? Est-il possible que tous les investisseurs convergent
spontanment vers la mme reprsentation du futur? On
retrouve par ce biais la thorie noclassique dont le formalisme
correspond au cas particulier o tous les acteurs partagent une
mme analyse des rendements futurs 2. quelle condition cette
unanimit est-elle plausible?
1. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment , art.
cit., p. 212-213.
2. Notons cependant que, mme lorsqu'un tel consensus prvaut, cela
n'implique en rien que les probabilits associes aux divers scnarios mesurent
251
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Pour aborder cette question des anticipations, il n'est pas inu-
tile d'en revenir aux rflexions de Frank Knight dans son grand
livre Risk, Uncertainty and Profit. Son ide est que la forme
probabiliste ne suffit pas dfinir la nature d'une estimation
parce qu'il existe plusieurs probabilits 1 associes des
formes diverses d'incertitude. Autrement dit, l'nonc tel v-
nement a une probabilit de 1/3 ne peut tre pleinement com-
pris tant que n'a pas t explicite la nature de la situation et de
la probabilit. Knight distingue trois types de probabilits. Le
premier correspond des loteries, la manire du jeu de rou-
lette, pour lesquelles, par construction, nous sommes en pr-
sence d'vnements se rptant l'identique. Dans de telles
configurations, le calcul des probabilits s'applique entire-
ment, sans restriction. Knight parle alors de probabilits a
priori . Le deuxime type correspond des configurations o
l'vnement considr est suffisamment commun pour que des
frquences empiriques puissent tre observes et calcules.
L'exemple propos par Knight est celui du risque d'incendie.
La proposition telle maison ayant la caractristique X a la pro-
babilit p de brler rsulte de l'observation empirique des
incendies concernant des maisons ayant la caractristique X, par
exemple, avoir t construites au sicle dernier. Knight insiste
sur le fait que ce type d'valuation repose sur la possibilit de
former des groupes d'occurrences homognes (les maisons
construites au sicle dernier) suffisamment nombreux pour que les
les probabilits objectives de survenance de ces scnarios. Cela supposerait
non seulement qu'il y ait un consensus mais que ce consensus porterait sur la
description relle du futur et, qui plus est, que ce futur serait d'une nature pro-
babiliste. Formellement, une telle situation n'est pas proprement parler
impossible. On sait que certaines croyances ont la proprit de s'autoraliser,
ce qu'on nomme les prophties autoralisatrices . Ce phnomne a t
observ et ne peut tre rejet. Mais, lorsqu'il s'agit de l'conomie dans son
entier, savoir tous les rendements futurs de tous les actifs, cela relve de la
science-fiction.
1. C'est le vocabulaire qu'emploie Knight, mais il serait plus judicieux
d'crire qu'il existe plusieurs usages des probabilits et non plusieurs proba-
bilits car, stricto sensu, c'est le mme concept de probabilit qui se trouve
employ.
252
L'VALUATION FINANCIRE
frquences observes puissent fournir une approximation accep-
table des probabilits. Knight propose le terme probabilit sta-
tistique 1 pour dsigner ce deuxime type de probabilit. Enfin,
un dernier type de probabilit est mis en jeu lorsque l'vne-
ment est si entirement unique
2
qu'il n'est pas possible de
calculer des frquences. L'outil statistique devient impuissant.
Knight donne l'exemple d'un entrepreneur devant estimer
l'opportunit d'accrotre ses capacits de production. Cette situa-
tion est trop particulire (mtier spcifique, conjoncture spci-
fique) pour que puisse tre compos un chantillon significatif
permettant de dterminer la probabilit de succs de cette strat-
gie. Dans ce cas, l'individu doit recourir son opinion person-
nelle. Knight parle alors de jugements ou d' estimations .
En conclusion, il propose de rserver le terme incertitude pour
cette dernire situation et nomme risques les deux autres
3
La force de cette analyse est de montrer que l'acteur cono-
mique ne peut pas toujours compter sur les outils probabilistes
et statistiques (situations un et deux) pour former ses anticipa-
tions et prendre sa dcision. Dans les situations d'incertitude,
l'acteur n'a d'autre instrument que sa facult de juger. Ce rsul-
tat est essentiel car il tablit que les estimations individuelles
face l'incertitude ont une dimension irrductiblement subjec-
tive : ce sont des opinions personnelles. Comme le comprend
bien Knight, un monde sans incertitude serait un monde du
savoir parfait dans lequel l'intelligence ne serait mme pas
ncessaire
4
Par l, il faut comprendre que la seule rationalit,
identifie la matrise des techniques logiques et mathma-
tiques, suffirait rsoudre tous les problmes : par le biais de
l'infrence statistique, l'acteur serait capable d'estimer toutes
les ventualits. Dans un tel monde hypothtique, des individus
rationnels et galement informs sont ncessairement conduits
1. Statistical probability .
2. Frank H. Knight, Risk, Uncertainty, and Profit, Boston-New York,
Houghton Mifflin Company, 1921, p. 226.
3. Ibid., p. 233.
4. Ibid., p.268.
253
L'EMPIRE DE LA VALEUR
aux mmes estimations, car des techniques statistiques iden-
tiques associes une information identique dbouchent nces-
sairement sur un diagnostic identique. Les acteurs peuvent
diverger quant leur action car leurs prfrences divergent,
mais pas quant leur constat ds lors qu'ils sont rationnels et
informs. On reconnat l le monde noclassique. La prise en
compte de l'incertitude modifie radicalement cette analyse. Elle
introduit la possibilit d'valuations diverses, selon les per-
sonnes,. indpendamment de leur rationalit. Pour Knight, ce
rsultat est d'autant plus important que, ses yeux, l'incertitude
est ce qui caractrise la vaste majorit des situations auxquelles
un homme d'affaires est confront: [Les dcisions qu'il
prend] se rapportent des situations qui sont bien trop uniques
pour que les outils statistiques aient une quelconque valeur pour
ce qui est du choix de la conduite suivre 1. Autrement dit,
l'aptitude dcider quoi faire, parce qu'elle ne se rduit pas
la seule rationalit, devient une ressource rare, ingalement par-
tage, qui distingue les bons entrepreneurs des mauvais. Pour
Knight, cette aptitude exige bien plus que de savoir calculer.
Elle demande du jugement
2
Ce concept d'incertitude knightienne a pour trait distinctif la
prise en compte de la nouveaut dans les volutions mar-
chandes. C'est parce que les acteurs se trouvent confronts des
ralits jamais observes que la rationalit statistique se rvle
impuissante leur fournir des estimations satisfaisantes. Knight
ne cesse de revenir sur cette ide : Le fait marquant et essen-
tiel est que l'vnement en question est si totalement unique
[ ... ] qu'il est impossible d'en exhiber un chantillon sur la base
duquel il serait possible d'en infrer une estimation de la proba-
bilit sous-jacente
3
Pour le dire en termes techniques, le
monde conomique n'est pas stationnaire . Sa structure vo-
1. Ibid., p. 231.
2. Cet argumentaire conduit un discours libral qui justifie l'entrepreneur
comme celui qui possde une facult de juger suprieure aux autres, le profit
tant la rmunration de cette ressource rare et utile la socit.
3. Frank H. Knight, Risk, Uncertainty, and Profit, op. cit., p. 226.
254
L'VALUATION FINANCIRE
lue et se transforme: de la nouveaut se fait connatre 1. Or
l 'hypothse de stationnarit est essentielle pour que l'infrence
statistique soit recevable. En effet, celle-ci ne fait rien d'autre
que de projeter dans le futur les relations que l'observation sta-
tistique du pass a mises en vidence. l'vidence, cette tech-
nique fournit des prvisions justes, pour autant que l'conomie
ne se modifie pas fortement (hypothse de stationnarit). Ds
lors que le monde conomique change en profondeur sous
l'action des innovations, il n'est plus lgitime de supposer que
le futur sera semblable au pass. En consquence, la rationalit
statistique n'est plus oprante. Il entre alors dans l'anticipation
un lment irrductible de jugement personnel. C'est ce que
Knight souligne. Le savoir inductif ne suffit plus.
L'incertitude knightienne est la bonne hypothse pour qui
cherche comprendre l'conomie financire. Elle rend bien
compte de la faiblesse des bases objectives dont disposent les
investisseurs pour justifier leurs estimations. On reconnat l un
thme sur lequel Keynes, fin connaisseur des marchs boursiers,
insiste avec beaucoup de force :
Le fait marquant en la matire est l'extrme prcarit des bases
sur lesquelles nous sommes obligs de former nos valuations
des rendements escompts. Notre connaissance des facteurs qui
gouverneront le rendement d'un investissement quelques annes
plus tard est en gnral trs frle et souvent ngligeable. parler
franc, on doit avouer que, pour estimer dix ans ou mme cinq
ans l'avance le rendement d'un chemin de fer, d'une mine de
cuivre, [ ... ] d'un transatlantique, les donnes dont on dispose se
rduisent bien peu de choses, parfois rien
2
C'est ce constat que la thorie conomique doit prendre au
srieux. Il est aux antipodes de la thorie noclassique dont le
point de dpart consiste supposer que tous les acteurs connaissent
tous les rendements futurs de tous les actifs. A contrario, les
analyses empiriques attestent des difficults que rencontrent les
1. Ce qui distingue radicalement le monde physique du monde social.
2. John Maynard Keynes, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de
la monnaie, op. cit., p. 162.
255
L'EMPIRE DE LA VALEUR
investisseurs pour estimer les valeurs fondamentales, surtout en
prsence d'innovations, sans mme parler des agences de nota-
tion et des analystes financiers dont c'est pourtant la mission
premire. Prenons comme illustration la bulle Internet de la
fin des annes 1990. Ce fut une poque qui connut des estima-
tions extravagantes. Comment cela fut-il possible? Les raisons
en sont multiples mais il est clair que la rvolution qu'ont
connue les techniques d'information avec Internet a constitu
elle seule un facteur puissant d'incertitude knightienne. Elle a
nourri la thse de l'mergence d'une nouvelle conomie,
conduisant un rgime indit de fonctionnement du capitalisme
contemporain. En consquence, lorsque certains conomistes se
montraient critiques et sceptiques face des cours boursiers qui
. semblaient totalement dconnects des ralits conomiques, et
faisaient valoir que jamais dans le pass une telle valorisation
n'avait t constate, il leur tait rpondu qu'ils manquaient sin-
gulirement d'imagination et que ce n'tait pas parce qu'un v-
nement n'avait jamais t observ qu'il ne pouvait pas advenir.
Et assurment, cet argument ne manque pas de poids. Cepen-
dant, ds lors qu'on s'autorise repousser les enseignements du
pass au motif, par ailleurs exact, que le monde n'est en rien
stationnaire et que du nouveau y apparat de manire rcurrente,
il est possible de neutraliser toutes les objections. Telle est pr-
cisment la difficult laquelle nous confronte l'incertitude
knightienne. Elle met l'individu face des vnements pour
lesquels la connaissance objective est si imparfaite et floue
qu'elle autorise les avis les plus opposs. Il faut alors recon-
natre notre ignorance, comme l'crit Keynes : En cette
matire, il n'existe aucune base scientifique permettant de cal-
culer une quelconque probabilit. Nous ne savons pas, tout sim-
plement
l
. Une telle situation se caractrise par le fait que deux
individus rationnels, parfaitement informs et pouvant mobiliser
les avis d'autant d'experts qu'ils le souhaitent, peuvent nan-
moins conserver des avis divergents, sans violer leur rationalit
1. Ibid., p. 144.
256
L'VALUATION FINANCIRE
ni les faits '. Ce rsultat est fondamental. Il tablit la subjectivit
irrductible des valuations financires
2
Il dcoule directement de cette analyse qu'il n'est plus pos-
sible, dans un monde knightien, de dfinir ce qu'est la vraie
valeur d'un titre. Ce qu'on observe est une grande diversit
d'estimations individuelles entre lesquelles il n'est pas possible
ex ante de trancher. Aucune ne peut se prvaloir d'une lgiti-
mit scientifique suprieure, puisqu'elles sont toutes compa-
tibles avec l'exploitation rationnelle, c'est--dire statistique, des
donnes disponibles. L'conomiste ne saurait faire mieux, tant
soumis galement l'incertitude. Ce qui est en cause est la fai-
blesse du savoir collectif l'instant t, concernant des faits co-
nomiques indits sur lesquels la socit ne dispose pas d'un
recul suffisant. En consquence, 1 'hypothse knightienne
conduit rompre radicalement avec l'ide qu'il serait possible
de calculer, l'instant t, la valeur objective des titres. C'est l
assurment une rvolution conceptuelle. De fait, l'attachement
des conomistes
3
l'objectivit de la valeur les a conduits
1. On peut rapprocher ces rflexions des intressants travaux dvelopps
par Mordecai Kurz propos de ce qu'il appelle les croyances rationnelles
(rational beliefs) (Mordecai Kurz, On the Structure and Diversity of Ratio-
nal Beliefs , Economie Theory, vol. 4, 1994, et Rational Beliefs and Endo-
genous Uncertainty: Introduction , Economie Theory, vol. 8, 1996). Cet
auteur dmontre que, dans le cadre d'une conomie non stationnaire, des
agents parfaitement rationnels, possdant la mme information, en l' occur-
rence une information exhaustive contenant l'observation de toutes les
variables conomiques depuis le dbut d'existence de l'conomie, peuvent
nanmoins former des croyances divergentes. Pour nous comme pour cet
auteur, c'est la question de la non-stationnarit qui est essentielle, de par la
multiplicit des interprtations compatibles avec les donnes observes qu'elle
autorise. Kurz note mme ce propos qu'il n'est pas ncessaire que l'cono-
mie soit vritablement stationnaire et qu'il suffit que les agents le croient,
parce qu'il n'existe aucun moyen statistique grce auquel les agents pour-
raient certifier qu'un systme stationnaire est, en fait, stationnaire (<< On the
Structure and Diversity of Rational Beliefs , art. cit., p. 877).
2. Indiquons que cette proprit est testable. On peut vrifier qu'il n'existe
pas de procdure systmatique permettant la convergence des estimations
individuelles hors march.
3. Une preuve de cet attachement est trouver dans le fait que la finance
comportementale adhre cette hypothse, malgr tout ce qui la spare par
257
L'EMPIRE DE LA VALEUR
rejeter vigoureusement la vision knightienne, pourtant si intui-
tive. Robert Lucas soutient ainsi que l'introduction de l'incerti-
tude conduit la thorie conomique dans une impasse:
John Muth a propos d'identifier les probabilits subjectives
des agents aux frquences observes des vnements qu'ils
cherchent anticiper, ou aux probabilits "vraies", nommant
"anticipation rationnelle" l'identit postule des probabilits sub-
jectives et "vraies". l'vidence, cette hypothse ne peut
s'appliquer dans les situations o on ne peut dterminer quelles
frquences observes, si mme elles existent, sont pertinentes:
situations que Knight a nommes "incertitude". Cette hypothse
aura le plus de chances d'tre utile dans des situations o les pro-
babilits considres concernent un vnement rcurrent, bien
dfini, situation nomme "risque" dans la terminologie de
Knight ... Dans les situations d'incertitude, le raisonnement co-
nomique ne sera d'aucune valeur'. [Je souligne.]
On ne saurait dire les choses plus clairement. Dans un monde
d'incertitude radicale la Knight, l'conomiste est livr
l'infinie variabilit des estimations subjectives. Il n'existe plus
de valeur objective. Dans ces conditions, le raisonnement co-
nomique n'est plus d'aucune valeur , faute de pouvoir avancer
quoi que ce soit quant aux anticipations individuelles. En cons-
quence, Lucas circonscrit l'espace de validit du raisonnement
conomique aux seules situations de risque, au sens knightien
du terme, savoir des situations pour lesquelles l'hypothse
probabiliste est pertinente. Tel est le sens de l'hypothse d'anti-
cipation rationnelle: identifier les probabilits subjectives des
individus aux probabilits objectives, ce qui suppose l'existence
de ces dernires. Cette prise de position conduit les conomistes
restreindre leur analyse un monde d'vnements rcurrents
dans lequel les frquences empiriques observes constituent de
ailleurs de la finance noclassique - et qui n'est pas rien, par exemple l'effi-
cience.
1. Robert Lucas, Understanding Business Cycles (in Studies in
Business-Cycle Theory, Cambridge (MA)-Londres, The MIT Press, 1984),
p.223-224.
258
L'VALUATION FINANCIRE
bons estimateurs des probabilits sous-jacentes. Autrement dit,
un monde o la rationalit statistique est toute-puissante, o le
savoir inductif suffit. Le prochain chapitre se propose de
dmontrer que le pessimisme de Lucas n'est pas fond. Les co-
nomistes ne sont pas contraints de limiter leur rflexion au seul
monde factice du risque stationnaire. Le vrai monde financier,
avec son incertitude radicale, peut tre rendu intelligible. Par
ailleurs, nous situant dans un cadre thorique qui rejette l'ide
d'une valeur objective, dfinissable ex ante, nous sommes
conduits nous intresser de prs aux jeux marchands en tant
qu'ils sont au cur du processus de production du prix. Autre-
ment dit, pour nous, les interactions marchandes ont de l'impor-
tance; elles faonnent les individus et leurs croyances. La
valeur ne prexiste pas au march. C'est ce processus qu'il nous
faut maintenant tudier.
Chapitre VII
Liquidit et spculation
Dans les parties prcdentes, deux modles de march aux
proprits contrastes ont t analyss. Le premier, rtroac-
tions ngatives, prvaut lorsque la relation individuelle l'objet
chang se construit indpendamment du march, pralable-
ment son ouverture. Autrement dit, le march a pour unique
fonction de rpartir la quantit limite des biens au mieux des
dsirs exognes des changistes. L'archtype d'un tel modle
est le march walrassien, qui a pour hypothse centrale l'exo-
gnit des prfrences individuelles: les changes n'affectent
en rien la manire dont les acteurs valuent les objets. Les
conditions institutionnelles pour qu'un tel modle fonctionne
sont trs contraignantes, savoir ce qu'on a nomm l'objecti-
vit marchande qui suppose : (1) une dfinition stricte des qua-
lits, (2) l' exognit des prfrences individuelles, et (3)
l'absence de tout phnomne parasite d'influences interperson-
nelles lors des transactions qui viendrait polluer l'expression
des prfrences individuelles. En rgle gnrale, lorsque ces
conditions sont vrifies, la concurrence garantit la stabilit du
march en raison de la fameuse loi de l'offre et de la demande.
En cas de perturbations, elle ptoduit des forces de rappel qui ont
pour origine l'invariance de l'utilit: lorsque le prix s'carte de
son niveau d'quilibre, par exemple la hausse, il s'ensuit un
dsquilibre provisoire entre l'utilit inchange des biens et le
nouveau prix, ce qui conduit les consommateurs se tourner
vers d'autres biens devenus moins chers relativement. Cette
forme d'arbitrage concurrentiel entre biens substituables pro-
voque mcaniquement une diminution de la demande qui
260
LIQUIDIT ET SPCULATION
psera la baisse sur les prix, et cela tant que les prix ne
reviendront pas au niveau des utilits marginales. Telle est
l'ide centrale: l'ancrage dans l'utilit intrinsque des marchan-
dises interdit toute drive des prix. Un tel fonctionnement sup-
pose imprativement que les utilits ne dpendent pas des
changes.
Les marchs rtroactions positives correspondent prcis-
ment ces situations dans lesquelles la relation de l'individu
l'objet chang n'est plus fixe hors de la sphre des changes.
Il s'ensuit un bouleversement des proprits marchandes : la
concurrence n'est plus ncessairement stabilisante, car les
conditions de validit de la loi de l'offre et de la demande ne
sont plus runies. Quatre illustrations ont t prsentes: les
asymtries d'information (chapitre II) ; les rendements crois-
sants (chapitre II) ; le prestige (chapitre III) ; la liquidit (cha-
pitre IV). Dans toutes ces situations, les jugements que les
individus portent sur les objets changs, la manire dont ils les
valuent subjectivement, sont influencs par ce qui se passe sur
le march, conduisant une demande qui n'est plus ncessaire-
ment dcroissante avec le prix. Notons nanmoins que ces illus-
trations diffrent fortement dans leur manire de concevoir les
jugements individuels. Divers registres de valeur se trouvent
mobiliss. Les deux premiers cas (asymtries d'information et
rendements croissants) conservent le cadre traditionnel d'une
relation aux marchandises strictement utilitaire : les individus
jugent de l'utilit des biens. Simplement , cette utilit n'est
plus invariable. Elle dpend soit de la qualit des produits, soit
des extemalits de rseau. Si la prise en compte de ces phno-
mnes transforme notablement la logique walrassienne en intro-
duisant de l'inefficience dans l'allocation des ressources rares,
la thorie de la valeur quant elle se trouve intgralement main-
tenue. L'hypothse de la valeur utilit n'est nullement remise en
question puisque les acteurs sont mus uniquement par la
recherche de l'utilit et que le prix reste l'expression de cette
utilit. Une telle conformit aux canons de la discipline
explique la trs large diffusion de ces analyses chez les
261
L'EMPIRE DE LA VALEUR
conomistes, allant jusqu' la remise du prix Nobel Akerlof,
Spence et Stiglitz en 2001.
Le troisime cas est d'une autre nature puisqu'une nouvelle
valeur s 'y trouve prise en considration: le prestige. Veblen
met au jour l'existence d'une consommation de pur gaspillage,
pour la montre , qui tire son origine d'une culture prdatrice,
barbare, archaque. Que l'conomie la plus dveloppe puisse
ainsi autoriser en son sein de telles irrationalits d'un autre ge
constitue un scandale thique dont la dnonciation fait toute
la force du livre Thorie de la classe de loisir, jusqu'
aujourd'hui. Les valeurs marchandes s'y trouvent ouvertement
bafoues. Soulignons que, d'un point de vue conceptuel, l'ana-
lyse de Veblen est intressante justement par le fait qu'elle donne
voir une situation dans laquelle l'espace des prix ne se trouve
plus identifi la seule utilit, ouvrant ainsi la possibilit de pen-
ser les valeurs marchandes par elles-mmes. Cependant, Veblen
n'empruntera pas cette voie. Il n'interprte pas l'cart entre prix
et utilit dans la perspective d'une autonomie des valeurs mar-
chandes. Pour Veblen, il s'agit simplement de reconnatre que
d'autres valeurs que l'utilit sont au fondement du comportement
individuel, hypothse conduisant, non pas une critique de la
valeur substance, mais une redfinition de cette dernire qui se
trouve dsormais analyse comme un mixte d'utilit et de pres-
tige. Penser l'autonomie des valeurs marchandes exige de
rompre avec cette vision, ce que propose la dernire illustration.
La dernire modlisation donne voir une configuration qui
peut tre dite autorfrentielle , au sens o le conflit entre les
acteurs ne porte plus sur l'utilit, ni sur le prestige, mais sur la
puissance marchande elle-mme. Autrement dit, les biens
liquides, ou monnaies prives , ne sont pas dsirs en tant
qu'ils seraient utiles, ni mme en raison d'un quelconque pres-
tige, mais en tant qu'ils sont les moyens de la puissance mar-
chande. La comptition porte directement sur les valeurs
marchandes elles-mmes, savoir la liquidit. Cette compti-
tion est d'une nature fondamentalement mimtique, chacun
copiant son voisin, tant que les valeurs marchandes n'ont pas
trouv, avec la monnaie lue, leur pleine reconnaissance sociale.
262
LIQUIDIT ET SPCULA TION
Lorsque l'lection montaire a eu lieu, l' autorfrentialit cesse
puisque la puissance marchande a dsormais un visage: la mon-
naie. Une rfrence a t construite qui permet l'ordre mar-
chand d'accder une existence stable. Il a pour fondement,
non pas la recherche de l'utilit, mais le dsir de monnaie. Cette
analyse ne nie pas l'importance du rapport utilitaire aux biens
mais l'apprhende, non comme une ressource dj l dans
laquelle l'conomie n'aurait qu' puiser, mais comme une cra-
tion de la logique marchande grce laquelle elle construit son
empire sur les hommes.
L'entreprise et la spculation
Analyser les marchs financiers, c'est d'abord se demander
lequel de ces modles est pertinent. Pour les conomistes no-
classiques, la rponse ne fait aucun doute : le cadre walrassien
leur semble parfaitement adapt parce que, leurs yeux, la
concurrence financire n'est pas fondamentalement diffrente
de la concurrence marchande telle qu'elle s'exerce sur les mar-
chs de biens ordinaires. Toutes deux relveraient d'une mme
conceptualisation. Cette proposition a de quoi tonner car, sur
les marchs financiers, on ne trouve point d'utilit intrinsque,
extrieure aux changes, permettant de stabiliser les prix. Mais
la finance noclassique propose une rfrence exogne d'une
autre nature. Cette rfrence exogne, qui assure l'ancrage des
prix financiers hors de la sphre des changes, c'est la valeur
fondamentale du titre. C'est partir de cette valeur estime que
l'investisseur noclassique se dtermine. Elle est son point de
rfrence, car son profit attendu dpend de l'cart existant entre
ce que le titre vaut et le prix auquel il est possible de l'acqurir:
entre la valeur estime et le prix 1. Lorsque cette valeur estime
reste fixe, une baisse du prix provoque mcaniquement une
hausse du profit attendu et, corrlativement, une hausse de la
1. Nous reviendrons plus loin sur le paradoxe de deux valeurs pour un
mme titre.
263
L'EMPIRE DE LA VALEUR
demande
l
Telle est la conception noclassique, dont on note
qu'elle transpose directement la logique concurrentielle mar-
chande aux marchs boursiers, ceci prs que l'ancrage des
prix n'a plus pour source l'utilit mais la valeur. Par le biais des
estimations dont cette valeur fait l'objet, le prix financier se
trouve enracin dans une ralit conomique extrieure au mar-
ch, enracinement qui fait obstacle toute drive des prix. A
contrario, si cette valeur estime fluctuait en mme temps que
le prix, rien n'assurerait plus qu'une baisse des prix provoque
une hausse de la demande. Pour le comprendre, imaginons que,
confronts une baisse du prix, les acteurs, par mimtisme, en
infrent qu'il leur faut revoir la baisse leur estimation de la
valeur fondamentale. Si cette baisse induite est plus importante
que celle du prix de march, il ne sera plus profitable pour les
investisseurs de se porter acqureurs de ce titre qui est devenu
plus cher que ce qu'il vaut rellement. La loi de l'offre et de la
demande n'est donc valide que lorsque l'hypothse d'exog-
nit des estimations fondamentalistes est respecte. Cela n'a
rien pour nous surprendre. Nous avons beaucoup insist prc-
demment sur le fait que les rtroactions ngatives ont pour
condition que la relation individuelle l'objet chang se
construise indpendamment du march . Soulignons que pour
obtenir ce rsultat de stabilit il n'est pas ncessaire de supposer
que tous les investisseurs partagent une mme estimation de la
valeur fondamentale. La condition pour que la logique des
rtroactions ngatives l'emporte est que l'valuation de chacun
1. Le lecteur soucieux de rigueur logique pourrait faire remarquer que seu-
lement deux situations sont prendre en compte: soit le prix est au-dessous
de la valeur et l'investisseur achte tout ce qu'i! peut acheter; soit le prix est
au-dessus de la valeur et l'investisseur vend tout ce qu'il peut vendre. En
consquence, si le prix augmente alors mme qu'i! est dj au-dessus de la
valeur estime, l'investisseur considr ne modifie pas son comportement.
Cette analyse est exacte stricto sensu pour autant que le risque soit nul. En
fait, il est possible de montrer que l'introduction du risque conduit ce que
l'investissement soit sensible au prix. Ce rsultat est d'ailleurs intuitif. Par
exemple, considrons un titre dont on pense que sa valeur est 100. On sera
prt en acheter beaucoup plus si le prix propos est lOque si le prix propos
est 99. Cette intuition trouve dans la thorie conomique sa justification.
264
LIQUIDIT ET SPCULATION
soit exogne, qu'elle ne subisse pas l'influence du prix et des
changes. Peu importe que ces estimations soient divergentes.
Le prix qui merge est gal la moyenne des estimations sub-
jectives de l'ensemble des protagonistes. Ce rsultat n'est pas
satisfaisant du point de vue de l'efficience, qui requiert impra-
tivement que le prix se fixe au bon niveau . L'hypothse pro-
babiliste est introduite en consquence pour satisfaire cette
exigence particulire qui s' aj oute l'exigence de stabilit 1
D'une part, elle assure qu'on peut donner un sens la notion de
bon niveau ; d'autre part, elle assure que ce bon niveau
s'impose tous les investisseurs rationnels et informs. Dans
ces conditions, si les investisseurs rationnels et informs sont en
grand nombre, le prix de march sera dtermin majoritairement
par eux
2
, ce qui signifie que le prix ne sera pas trs diffrent de
la valeur fondamentale objective. L'efficience prvaudra. Mais,
rptons-le, pour ce qui est de la seu1e stabilit, l'hypothse cru-
ciale est que chacun prenne pour rfrence son estimation de la
valeur fondamentale, suppose indpendante de ce qui se passe
sur le march. Par le biais de ces estimations, le march se
trouve connect l'conomie relle. Dans cette situation, la loi
de l'offre et de la demande est valide, condition pour que les
marchs financiers puissent tre laisss eux-mmes.
Cette analyse pose en son fondement que les investisseurs
agissent sur la base de la comparaison entre leur estimation de
la valeur fondamentale et le prix. Il y a l quelque chose d'nig-
matique. En quelque sorte, un titre a deux valuations et deux
prix. Comment est-ce possible? Que mesurent ces valuations?
Pour le comprendre, centrons-nous dsormais, sauf mention
1. On peut cependant noter que l 'hypothse probabiliste a pour cons-
quence l'indpendance l'gard des prix puisque la valeur y est suppose
objective.
2. Lorsque le march n'est pas constitu uniquement d'investisseurs
rationnels, l'analyse prcdente doit tre modifie pour tenir compte des com-
portements d'arbitrage des investisseurs rationnels tant qu'existe un cart
entre le prix et la valeur fondamentale. Il s'ensuit que le prix sera exactement
gal la valeur intrinsque. Se reporter Andr Orlan (<< Efficience, finance
comportementale et convention: une synthse thorique , art. cit.).
265
L'EMPIRE DE LA VALEUR
explicite, sur ces titres financiers essentiels que sont les
actions 1. Par leur intermdiaire, c'est la proprit du capital qui
se trouve soumise aux changes et cote. Par dfinition, la
valeur intrinsque d'une action s'interprte comme la mesure de
la valeur montaire qui revient au propritaire lorsque ce capital
est mis en mouvement via la production des marchandises et
leur vente. C'est ce que dit Keynes: Quand un homme achte
un bien de capital ou investissement, il achte le droit la srie
de revenus escompts qu'il espre tirer pendant la dure de ce
capital de la vente de sa production, dduction faite des
dpenses courantes ncessaires obtenir ladite production
2
En consquence, il apparat que le calcul fondamentaliste
endosse le point de vue de l'entrepreneur. Il s'agit d'valuer les
profits qui reviendront celui-ci une fois l'investissement ra-
lis et la production effectue, ce qui suppose de sa part de
prendre en compte de nombreuses variables ayant trait aussi
bien la nature de l'organisation productive et du management
qu' la structure des marchs ou l'volution prvisible de la
conjoncture conomique. Il est une circonstance spcifique o
ce calcul s'impose sans conteste: lorsque l'entrepreneur est
confront la perspective d'un nouvel investissementl. En effet,
la dcision d'investissement ne se justifie que si la valeur pro-
duite l'emporte sur le cot support. Dans cette circonstance,
l'existence de deux valuations cesse d'tre nigmatique. Il ne
s'agit pas de deux prix pour un mme bien mais de la compa-
raison entre un prix aujourd'hui, le prix d'offre des biens capi-
taux, machines et btiments, et une estimation des revenus que
la mise en uvre de ces biens capitaux produira au cours du
temps. D'ailleurs, dans cette situation, le capital, en tant que
droit de proprit, ne fait pas l'objet de transactions et n'a pas
de prix. Les changes portent sur les biens dont le capital est
1. Ce faisant, nous sortons de l'conomie marchande. Mais il s'agit ici uni-
quement d'admettre l'existence de flux rgulier de profits.
2. John Maynard Keynes, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de
la monnaie, op. cit., p. 149
3. Les conomistes distinguent le march primaire , celui du capital nou-
vellement mis, et le march secondaire , o s'change du capital ancien.
266
LIQUIDIT ET SPCULATION
constitu: les machines et les btiments, et non pas sur les
droits de proprit eux-mmes. Il est intressant d'investir si la
valeur obtenue tout au long du p r o c ~ s s u s productif est sup-
rieure au cot des machines et des btiments.
Considrons maintenant le march des actions sur lequel,
dsormais, les droits de proprit ont un prix et sont ngocis.
Le lien avec ce qui prcde semble vident. Le raisonnement est
le suivant: il n'est intressant d'acheter une action que pour
autant que son cot d'acquisition est infrieur au flux de reve-
nus qu'elle produit. En consquence il s'agit, pour l'investis-
seur, de comparer le prix offert et la valeur fondamentale telle
qu'il l'estime au mieux de ses connaissances. Cependant, l'ana-
logie avec le raisonnement prcdent est trompeuse. Dans le cas
prcdent, la comparaison entre le prix du capital et la valeur
produite se justifie par le fait que l'investisseur a effectivement
comme projet la mise en uvre du capital. En consquence, la
valeur fondamentale s'impose lui en tant qu'elle mesure les
profits qui seront effectivement obtenus grce la mise en
uvre du capital produit. Dans le cas du march boursier, la
situation est plus complexe. Plusieurs conduites sont possibles.
Pour les investisseurs qui cherchent conserver en portefeuille
sur une longue priode les actions qu'ils acquirent, l'analyse
prcdente s'applique l'identique. L'investisseur boursier agit
alors la manire d'un entrepreneur qui investit sur le long
terme. Cependant, cette stratgie d'investissement long terme
n'est nullement la seule stratgie financire possible. Par le fait
mme qu'existe dsormais un lieu d'changes organiss, il est
dsormais possible d'acheter dans la perspective d'une revente
un meilleur prix 1. C'est l une conduite entirement nouvelle,
fort diffrente de l'investissement long terme: elle n'a plus
pour cible le flux de revenus, savoir les dividendes distribus,
mais les plus-values qu'engendrent les variations de prix.
1. Michael J. Harrison et David M. Kreps, (dans Speculative Investor
Behavior in a Stock Market with Heterogeneous Expectations , Quarterly
Journal of Economics, vol. XCIII, nO 2, mai 1978) prsentent ce fait avec une
grande clart.
267
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Ce dualisme des stratgies est important parce qu'il donne
voir la nature double du titre, la fois capital immobilis et actif
liquide. En tant que capital immobilis, l'action produit de la
valeur au cours du temps, sous la forme de dividendes, au fur et
mesure que la production s'opre. Parce que le profit attendu
est directement li l'cart entre la valeur fondamentale et le
prix d'acquisition, l'investisseur est incit anticiper au mieux
la valeur fondamentale. En tant qu'actif liquide, faisant l'objet
de transactions sur le march boursier, l'action connat des
variations constantes de prix, qui sont autant d'occasions de
profits pour les changistes. Il ne s'agit plus d'un profit obtenu
grce la mise en uvre effective du capital, mais d'un profit
issu des transactions elles-mmes. Parce que ce profit est direc-
tement li l'cart entre le prix futur et le prix d'acquisition,
l'investisseur est incit anticiper au mieux le prix futur. Il
s'ensuit deux attitudes trs diffrentes : la premire est tourne
vers l'conomie; la seconde, vers le march lui-mme. Keynes
est un des rares thoriciens de la finance avoir compris
l'importance de cette dualit. Il propose de nommer la premire
stratgie, tourne vers la mise en uvre du capital, entre-
prise , et la seconde, tourne vers le march, spculation :
Par le terme spculation [je dsigne] l'activit qui consiste
prvoir la psychologie du march, et par le terme entreprise
celle qui consiste prvoir le rendement escompt des actifs
pendant leur existence entire '.
La prise en compte des stratgies spculatives modifie radi-
calement l'optimisme que nourrissent les financiers noclas-
siques quant la stabilit des marchs financiers, pour ne rien
dire de l'efficience. Il faut abandonner le modle rtroactions
ngatives pour lui substituer le modle rtroactions positives.
C'est l le point fondamental de cette section: parce que le sp-
culateur n'a plus pour rfrence la valeur fondamentale mais le
prix lui-mme, tout ce qui a t dit propos de l'ancrage des
cours boursiers et des forces de rappel est caduc. L'ancrage hors
1. John Maynard Keynes, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de
la monnaie, op. cit., p. 170.
268
LIQUIDIT ET SPCULATION
du march ne tient plus quand seul le march intresse le sp-
culateur. Dans la perspective spculative, la valeur fondamen-
tale ne joue plus, au mieux, qu'un rle indirect'. Elle perd son
rle de pivot. Pour le comprendre, il n'est que de citer de nou-
veau Keynes :
[Les investisseurs professionnels] se proccupent, non pas de
la valeur vritable d'un investissement pour un homme qui
l'acquiert afin de le mettre en portefeuille, mais de la valeur que
le march, sous l'influence de la psychologie de masse, lui attri-
buera trois mois ou un an plus tard. Et cette attitude ne rsulte
pas d'une aberration systmatique, elle est la consquence invi-
table de l'existence d'un march financier organis [ ... ]. Il ne
serait pas raisonnable en effet de payer 25 pour un investisse-
ment dont on croit que la valeur justifie par le rendement
escompt est 30, si l'on croit aussi que trois mois plus tard le
march l'valuera 20
2
Dans cet exemple, Keynes souligne que l'investisseur profes-
sionnel s'intresse l'opinion du march, non pas parce qu'il ne
sait pas calculer la valeur fondamentale, mais parce que le profit
dpend du prix ralis. Pour se faire comprendre, Keynes consi-
dre un investisseur valuant 30 la valeur fondamentale d'une
action dont le cours vaut 25. S'il suivait uniquement sa ratio-
nalit fondamentaliste, il constaterait la sous-valuation de
l'action et, en consquence, serait amen l'acheter
3
C'est ce
que lui dicterait la stratgie d'entreprise. Ce n'est pourtant pas la
stratgie optimale. En effet, anticipant que demain le prix tom-
bera 20, l'investisseur rationnel a intrt vendre aujourd'hui
pour racheter le titre lorsque son cours sera tomb 20, quitte
le revendre plus tard si jamais le cours finit par se fixer au
niveau de la valeur fondamentale, c'est--dire 30. Ce petit
exemple illustre l'ide selon laquelle la rationalit financire ne
1. Le spculateur peut penser que la valeur fondamentale donne une bonne
indication de ce que seront les prix futurs. Nous analyserons cette attitude.
2. John Maynard Keynes, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de
la monnaie, op. cit., p. 167.
3. Soit pour la garder en portefeuille toute sa vie, soit parce qu'il anticipe
que le prix retrouvera le niveau de la valeur fondamentale.
269
L'EMPIRE DE LA VALEUR
saurait se rduire la seule rationalit fondamentaliste, parce
que les volutions venir du prix offrent des occasions effec-
tives de profit qui ne peuvent tre ignores. Alors que, dans
l'exemple propos par Keynes, un investisseur de type entrepre-
neur se serait trouv dans le camp des haussiers, un investisseur
spculateur se retrouve dans le camp des baissiers, non pas
parce qu'il pense que le titre est, au regard des fondamentaux,
survalu, mais parce qu'il anticipe que l'volution du march
est la baisse. Cet exemple montre que la spculation peut
conduire l'investisseur agir dans un sens contraire de ce que
son propre calcul de la valeur fondamentale indique. Bien qu'il
sache que le titre est sous-valu, notre spculateur vend le titre,
sans que cela implique de sa part un comportement irrationnel.
Il en est ainsi parce que, ce qui importe pour le profit, ce n'est
pas la valeur fondamentale mais le niveau des prix. Conform-
ment cette analyse, on comprend que les volutions du prix,
mme court terme, exercent une vritable tyrannie sur les
comportements financiers, car elles offrent des possibilits de
profit que les investisseurs ne peuvent ngliger. Et cela est vrai
galement pour les investisseurs qui privilgient le long terme.
Il est dans leur intrt de rester attentifs aux mouvements de
court terme. C'est de cette manire que la liquidit exerce son
emprise sur le monde financier. C'est elle qui est l'origine des
bulles spculatives.
Il dcoule de cette analyse que le spculateur cherche
constamment dchiffrer l'opinion du march pour prvoir
dans quel sens elle dirigera les prix. Pour cette raison, la spcu-
lation financire peut tre dite d'une nature autorfren-
tielle . Elle ne se dfinit pas partir d'une norme extrieure au
march comme peut l'tre la valeur fondamentale ou l'utilit,
mais partir du march lui-mme. Si l'on anticipe une hausse,
on achte le titre; dans le cas contraire, on vend. Contrairement
au modle fondamentaliste, cette analyse nous dit que les anti-
cipations des agents ne sont pas tournes vers l'conomie relle,
mais vers les anticipations des autres intervenants. Ce qui importe
sur un march, ce n'est pas le contenu rel d'une information au
regard des donnes fondamentales, mais bien la manire dont
270
LIQUIDIT ET SPCULATION
l'opinion collective est suppose l'interprter. Il s'ensuit une
rationalit singulire, de nature fondamentalement mimtique
en ce qu'elle cherche mimer le march pour le prcder dans
ses volutions, aussi erratiques soient-elles. Si l'investisseur
croit que, demain, les cours de la Bourse vont augmenter, alors
son intrt lui dicte d'acheter des actions, mme s'il pense que,
au regard des fondamentaux, cette hausse est aberrante.
Pour conclure cette analyse, il apparat que deux modles aux
proprits contrastes s'opposent pour dcrire ce qu'est la
concurrence financire. Le tableau suivant en rsume les traits
les plus saillants
TABLEAU: Capital versus liquidit
CAPITAL LIQUIDIT
Immobilisation Ngociabilit
Profits Variations de prix
Entreprise Spculation
Capital productif Capital financier
Long terme March
Valeur Fondamentale Opinion du march
Rationalit fondamentaliste Rationalit autorfrentielle
Rtroactions ngatives Rtroactions positives
Stabilit Instabilit
Modle noclassique Modle autorfrentiel
L'attachement que manifeste la pense noclassique l'gard
du modle fondamentaliste a partie lie avec sa sous-estimation
chronique des effets propres la liquidit. Il faut mme aller
plus loin et dire que la liquidit est un phnomne qui, pour
271
L'EMPIRE DE LA VALEUR
l'essentiel, chappe son entendement. Certes, cette ralit
n'est pas totalement ignore ; les conomistes noclassiques
s'essaient la dfinir et la mesurer, Mais la liquidit y reste
un fait secondaire, annexe, de faible porte. Que la liquidit
puisse tre cratrice de prix est une thse que la thorie de la
valeur ne saurait admettre. Sur ce point, la position de Walras
est sans ambigut : l' changeabilit drive intgralement de la
richesse . Pour faire l'objet de transactions, il suffit que les
marchandises aient de la valeur, savoir qu'elles soient utiles et
en quantit limite. En consquence, la circulation proprement
dite ne ncessite pas une intelligibilit spcifique. La question
des changes se trouve court-circuite. Seule la contrainte de
solvabilit importe. D'ailleurs, l'quilibre gnral suppose que
tous les biens sont par hypothse absolument liquides, ce qui
n'est gure raliste
l
Comme on y a longuement insist, cette
manire de penser trouve son origine dans l 'hypothse de valeur
substance, en tant qu'elle fonde un point de vue en surplomb,
qui apprhende les transactions de l'extrieur. Le chapitre IV a
dj montr l'importance que peut jouer le concept de liquidit
dans la construction d'une rflexion alternative. L'analyse des
marchs financiers va nous permettre d'aller plus loin dans cette
voie. Nous montrerons que les proprits suivantes, dj ren-
contres lors de l'analyse du rapport montaire, y prvalent:
1. la liquidit est institue. Elle est de nature autorfrentielle, ce
par quoi il faut comprendre qu'elle construit un monde qui a pour
rfrence les prix et non une prtendue valeur extrieure aux
changes.
2.la logique autorfrentielle se rgule au travers de l'mergence
d'une rfrence qui, bien que produite par les interactions, s'impose
aux acteurs comme une puissance autonome, extrieure eux.
3. l'valuation financire ne se confond pas avec les estimations
fondamentalistes. Elle est partiellement indpendante de celles-ci.
Ces trois points seront traits successivement. On commen-
cera par l'institution de la liquidit dans la section qui suit.
1. Soulignons que Carl Menger a une position trs diffrente.
272
LIQUIDIT ET SPCULATION
Ensuite, l'aptitude de la liquidit produire des rfrences fera
l'objet de la section consacre l'tude thorique du concours
de beaut keynsien. Enfin, dans une dernire section, on
reviendra sur la spculation financire dont on montrera qu'elle
est partiellement indpendante des fondamentaux.
L'institution de la liquidit
La spculation est la consquence directe de la ngociabilit
des titres, encore appele liquidit . Cette proposition relve
de l'vidence puisque, sans liquidit, il n'y aurait pas de cota-
tion permanente des prix, les actifs seraient totalement immo-
biliss et la seule variable qui importerait aux yeux de
l'investisseur serait le flux des revenus que la dtention du titre
permet d'obtenir. L'investisseur n'aurait alors d'autre choix que
de considrer la valeur fondamentale du titre. Seule l'mergence
de la liquidit modifie cette configuration. Elle introduit de nou-
velles opportunits. Comment est-ce possible? Et d'abord, d'o
vient la liquidit?
Rpondre ces questions suppose de prendre conscience des
contraintes qu'prouvent les investisseurs qui se trouvent en
possession de droits de proprit totalement immobiliss : s'ils
ont faire face des difficults imprvues ncessitant des
apports d'argent, ils peuvent tre acculs la faillite malgr leur
richesse financire. En effet, faute de pouvoir ngocier rapide-
ment leur portefeuille, ils sont incapables de faire face leurs
engagements. Lorsque de telles conditions prvalent, l'investis-
sement n'est le fait que d'institutions ou d'individus disposant
de ressources et de liquidits suffisantes pour leur permettre
d'affronter les imprvus sans courir des risques excessifs 1 Pour
1. N'oublions pas que, historiquement, c'est sur ce mode qu'a fonctionn
essentiellement le capitalisme. Voir, par exemple, ce qu'on appelle le
modle rhnan . Pensons galement au capitalisme familial. Durant de trs
longues priodes de temps, les droits de proprit taient exclus du march.
Leur gestion relevait d'agents spcialiss. L'emprise de ,la liquidit est une
caractristique du capitalisme financier contemporain.
273
L'EMPIRE DE LA VALEUR
surmonter cette difficult et rendre plus facile l'investissement,
il convient de rendre liquides les investissements, c'est--dire
ngociables. Il s'agit de transformer ce qui n'est qu'un pari per-
sonnel sur des dividendes futurs en une richesse immdiate hic
et nunc. En rendant les titres ngociables, on attnue les risques
que fait courir l'investissement, puisqu'il devient alors possible
de se dfaire d'un titre. Pour qu'il en soit ainsi, il faut transformer
les valuations individuelles et subjectives en un prix accept par
tous. Telle est la clef du problme. Autrement dit, la liquidit
impose que soit produite une valuation de rfrence, reconnue
par tous les fmanciers, qui dise tous ce que le titre vaut. La struc-
ture institutionnelle qui permet l'obtention d'un tel rsultat est le
march : le march financier organise la confrontation entre les
opinions personnelles des investisseurs de faon produire un
jugement collectif qui ait le statut d'une valuation de rfrence.
Le cours qui merge de cette faon a la nature d'un consensus qui
cristallise l'accord de la communaut financire sur le prix auquel
le titre peut tre chang. Annonc publiquement, il a valeur de
norme: c'est le prix auquel le march accepte de vendre et
d'acheter le titre considr, au moment considr. C'est ainsi que
le titre est rendu liquide!. Le march financier, parce qu'il institue
l'opinion collective comme nonne de rfrence, produit un prix
reconnu unanimement par la communaut financire.
Cependant, le caractre artificiel de cette construction appa-
rat tout entier lorsqu'on ralise que le capital productif quant
lui demeure toujours immobilis, quelle que soit la liquidit des
titres. Ce point tait dj soulign par Keynes:
En l'absence de bourses de valeurs, il n'y a pas de motif pour
qu'on essaye de rvaluer frquemment les investissements o
l'on s'est engag. Mais le Stock Exchange rvalue tous les jours
un grand nombre d'investissements, et ses rvaluations four-
nissent aux individus (mais non la communaut dans son
ensemble) des occasions frquentes de rviser leurs engage-
1. Sur ce point, nous convergeons avec Bruce G. Carruthers et Arthur L.
Stinchcombe, The Social Structure of Liquidity : Flexibility, Markets and
States , Theory and Society, vol. 28, nO 3, juin 1999, p. 353-382.
274
LIQUIDIT ET SPCULATION
ments. C'est comme si un fermier, aprs avoir tapot son baro-
mtre au repas du matin, pouvait dcider entre dix et onze heures
de retirer son capital de l'exploitation agricole, puis envisager
plus tard dans la semaine de l 'y investir de nouveau 1.
Autrement dit, s'il est possible pour un individu de se dbar-
rasser d'un titre qu'il juge peu comptitif, une telle possibilit
n'existe pas pour le march dans son ensemble. Le march, pris
dans sa globalit, ne peut se dfaire d'un titre
2
Pour qu'un
individu vende un titre, il est ncessaire qu'un autre se propose
de l'acheter. En effet, quels que soient les mouvements d'achat
ou de vente, la quantit de titres reste constante, tout comme le
capital cot reste inchang sous forme de capital productif.
C'est ce que nous avons appel le paradoxe de la liquidit
3
.
Ce paradoxe met en vidence que la libert individuelle
l'gard du titre n'existe que sur fond d'un engagement collectif
implicite: le march, dans sa globalit, ne peut pas vendre la
totalit des titres. Or cette dpendance mutuelle ne trouve pas
d'expression adquate dans le fonctionnement concurrentiel.
C'est l une caractristique qui distingue nettement les marchs
financiers des marchs ordinaires. Sur ces derniers, sont mis en
prsence deux groupes aux intrts nettement divergents: les
producteurs et les consommateurs. Le prix qui se forme rsulte
de l'opposition entre ces deux forces contraires: l'une poussant
les prix la hausse ; l'autre, les prix la baisse. La loi de l'offre
et de la demande rsulte de cette structure particulire qui inter-
dit que l'un des deux intrts l'emporte trop sur l'autre. Sur les
marchs financiers, rien de tel. Il n'existe pas des acheteurs face
des vendeurs, mais un ensemble d'individus qui sont alterna-
tivement acheteurs et vendeurs. Structurellement, leurs intrts
sont convergents, au-del des raisons locales qui poussent tel ou
1. John Maynard Keynes, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de
la monnaie, op. cit., p. 163.
2. On distingue le march primaire, o se ngocient les missions nou-
velles de capital, du march secondaire qui est un march d'occasion o l'on
vend et achte les mmes titres. Ce qui nous intresse ici est le march secon-
daire. Sur ce march, le nombre de titres un instant considr est constant.
3. Andr Orlan, Le Pouvoir de la finance, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 45.
275
L'EMPIRE DE LA VALEUR
tel acheter ou vendre. La liquidit n'est en rien une proprit
intrinsque du bien chang, comme peut l'tre la valeur fonda-
mentale ou l'utilit qui existe mme en l'absence du march :
elle rsulte du march lui-mme. La liquidit a la dimension
d'une croyance collective. Elle repose sur la confiance que la
communaut financire lui accorde. Elle disparat quand tous la
rclament.
Cette analyse thorique a des consquences qui modifient en
profondeur notre perception de la sphre financire. Elle donne
voir un march financier qui, ds son origine, dans sa concep-
tion mme, est l'expression d'un projet collectif visant
contourner les contraintes que l'immobilisation fait peser sur la
valorisation et l'extension du capital. En consquence, il faut
interprter la liquidit financire, non pas comme tant au ser-
vice de la production, mais comme constituant, par sa nature
mme, une transgression de l'conomie productive, transgres-
sion conue dans l'intrt des dtenteurs de titres. Si l'on
adhre cette analyse, la dconnexion entre finance et pro-
duction que donne voir, par exemple, la spculation autorf-
rentielle ou les bulles spculatives, cesse d'apparatre comme
un accident irrationnel. Tout au contraire, elle rvle la nature
profonde du projet que poursuit la communaut financire
lorsqu'elle choisit de s'organiser en marchs boursiers:
construire une modalit d'organisation du capital, partiellement
libre du temps productif. Les bourses de valeurs sont des
crations institutionnelles inventes pour rpondre une exi-
gence spcifique des cranciers et des propritaires: rendre
liquides les droits de proprit 1. Ils n'ont pas pour but de
reflter la production . La liquidit construit un monde de
prix qui ont pour critre de lgitimit, non pas de fournir une
reprsentation adquate de la ralit productive pour autant
qu'il soit possible de donner uns sens cette formulation dans
1. D'ailleurs, on n'a jamais vu de financiers se plaindre du fait que les
cours seraient dconnects des fondamentaux. Par contre, un arrt de la ngo-
ciabilit n'est pas admis. Il importe que les entreprises en charge des bourses
de valeurs produisent la ngociabilit qui est leur raison d'tre.
276
LIQUIDIT ET SPCULATION
un monde d'incertitude knightienne, mais d'tre accepts par la
communaut financire.
Pour le dire simplement, du point de vue de la liquidit, ce
qui est essentiel est le fait qu'une action puisse, tout instant,
tre change contre de la monnaie. Ce faisant, c'est la toute-
puissance de l'argent qui se trouve reconnue. Il s'agit, en cons-
quence, de construire des prix auxquels les titres puissent tre
achets ou vendus. Le niveau du prix est une question secon-
daire. Bien plus stratgique est la question de l'ampleur que
connat l'acceptation du prix, car la puissance du march se
mesure l'influence que ses prix exercent sur l'activit cono-
mique, non seulement directement, via les changes, mais aussi
indirectement, via la manire dont les acteurs valuent la situa-
tion conomique et fixent leurs priorits 1. L'attitude spculative
s'impose tous par le fait que, tant en permanence l'coute
du march, elle tire parti au maximum des variations de prix qui
caractrisent la liquidit. Elle est la stratgie adapte cette der-
nire : la rationalit spculative est la rationalit qu'exige la
liquidit. Pour cette raison, la domination de la spculation sur
l'entreprise ne rsulte en rien d'un penchant de nature psycho-
logique. Ainsi, lorsque la liquidit se trouve diminue et entra-
ve, par exemple suite un alourdissement des frais de
transaction, les achats et ventes deviennent plus difficiles et plus
coteux, ce qui rend la spculation moins rentable et moins
significative, quels que soient par ailleurs les dsirs des uns et
des autres. Ce lien troit entre liquidit et spculation est trs
prsent chez Keynes qui plaide en faveur de cots de transac-
tion levs, y compris par l'imposition de taxes fiscales impor-
tantes, de faon affaiblir le rle jou par la spculation. C'est
ainsi que, lorsqu'il compare Wall Street avec la Bourse londo-
nienne, sise Throgmorton Street, il note que, dans cette der-
nire, la spculation est moins intense en raison des cots
importants qui grvent les transactions londoniennes :
1. De ce point de vue, leur utilisation en comptabilit, ce qu'on appelle la
fair value , est un lment clef du pouvoir de la finance, par lequel celle-ci
propage ses manires d'valuer, bien au-del des seuls marchs.
277
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Le fait que le march de Londres ait commis moins d'excs
que Wall Street provient peut-tre moins d'une diffrence entre
les tempraments nationaux que du caractre inaccessible et trs
dispendieux de Throgmorton Street pour un Anglais moyen
compar Wall Street pour un Amricain moyen. La marge des
jobbers l, les courtages onreux des brokers, les lourdes taxes
d'tat sur les transferts, qui sont prlevs sur les transactions au
Stock Exchange de Londres, diminuent suffisamment la liquidit
du march pour en liminer une grande partie des oprations qui
caractrisent Wall Street. La cration d'une lourde taxe d'tat
frappant toutes les transactions se rvlerait peut-tre la plus
salutaire des mesures permettant d'attnuer aux tats-Unis la
prdominance de la spculation sur l' entreprise
2
On est ici aux antipodes des volutions contemporaines qui
visent toutes rduire les cots de transaction dans le but
d'accrotre la liquidit. Si ces cots taient levs, alors les atti-
tudes visant le long terme, c'est--dire se proposant d'acheter
un titre pour le conserver dans son portefeuille pour une longue
priode, deviendraient de nouveau prdominantes. Au contraire,
les stratgies reposant sur de nombreux achats et ventes rappro-
chs, de faon tirer profit au mieux des changements court
terme de la conjoncture et des prix, subiraient des cots prohi-
bitifs. Cette ide centrale conduit Keynes crire :
Devant le spectacle des marchs financiers modernes, nous
avons parfois t tents de croire que si, l'instar du mariage, les
oprations d'investissement taient rendues dfinitives et irrvo-
cables, hors le cas de mort ou d'autres raisons graves, les maux
de notre poque pourraient en tre utilement soulags; car les
dtenteurs de fonds placer se trouveraient obligs de porter leur
attention sur les perspectives de long terme et sur celles-l
seules
3
1. Intermdiaire de march, market makers .
2. John Maynard Keynes, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de
la monnaie, op. cit., p. 171-172.
3. Ibid.
278
LIQUIDIT ET SPCULATION
Autrement dit, l'importance relative des fondamentalistes et
des spculateurs est fonction du degr de liquidit des marchs :
moins le march est liquide, plus les anticipations se portent sur
le long terme, savoir les dividendes futurs et la valeur fonda-
mentale des capitaux; plus les marchs sont liquides, plus les
mouvements rapides d'achats et de ventes deviennent rentables
et dominent le march. Cette ide a connu d'importants prolon-
gements contemporains au travers de ce qu'on a coutume
d'appeler la taxe Tobin . L'ide de cette taxe se situe dans le
droit fil de cette analyse applique au march des devises. Dans
le but de rendre ces marchs plus stables, James Tobin a pro-
pos d'en diminuer la liquidit en crant une taxe sur les trans-
actions
l
.
Une fois tablie la prdominance de la stratgie spculative
dans un contexte domin par l'institution de la liquidit, se pose
la question thorique du comportement d'un march constitu
uniquement de spculateurs. Sur quelles bases peuvent-ils se
coordonner? Comment peuvent-ils construire une estimation
commune?
Le concours de beaut keynsien:
autorfrentialit et croyances conventionnelles
Sur un march pleinement liquide, tous les participants sont
des spculateurs qui cherchent anticiper l'volution du prix.
Le prix qui se forme rsulte de ces anticipations tournes vers
le prix futur. Il s'ensuit une structure singulire, dite autorf-
rentielle , qui diffre du modle fondamentaliste en ce qu'elle
se donne comme norme, non pas une ralit objective extrieure
au march, savoir la valeur fondamentale, mais une variable
endogne, en l'occurrence l'opinion du march. Face une
information nouvelle rendue publique, il s'agit pour chacun,
non pas d'analyser les effets de cette information sur la valeur
fondamentale, mais de prvoir comment le march va ragir.
1. Cette ide ne sera pas discute plus avant.
279
L'EMPIRE DE LA VALEUR
C'est cette logique qu'il importe de comprendre. Comment
peut-elle se stabiliser alors mme que le prix peut a priori
prendre n'importe quelle valeur, faute d'un lien avec une gran-
deur exogne? Comment les participants au march peuvent-ils
se mettre d'accord sur un prix? Pour l'analyser, on peut consi-
drer le modle qu'en a propos Keynes dans sa Thorie gn-
rale, savoir le fameux concours de beaut. Certes, ce modle
ne reproduit pas le fonctionnement du march dans sa totalit,
mais il en saisit pleinement la dimension autorfrentielle. La
prsente section lui sera entirement consacre. L'analyse sera
essentiellement abstraite et thorique. Il reviendra la section
suivante d'en tirer les consquences quant au fonctionnement
des marchs boursiers. Mais commenons par rappeler ce qu'est
le concours de beaut keynsien:
La technique du placement peut tre compare ces concours
organiss par les journaux o les participants ont choisir les six
plus jolis visages parmi une centaine de photographies, le prix
tant attribu celui dont les prfrences s'approchent le plus de
la slection moyenne opre par l'ensemble des concurrents.
Chaque concurrent doit donc choisir non les visages qu'il juge
lui-mme les plus jolis, mais ceux qu'il estime les plus propres
obtenir le suffrage des autres concurrents, lesquels examinent
tous le problme sous le mme angle
1
La particularit de ce jeu tient au fait que la rfrence que
cherchent dcouvrir les agents, en l'occurrence les six plus
jolis visages, est dtermine par les choix des joueurs eux-
mmes. Une telle interaction doit tre dite autorfren-
tielle , au sens o la rfrence est le produit des interactions.
A contrario, lorsque la cible poursuivie est fixe et dfinie
indpendamment des actions individuelles, le jeu sera dit
htrorfrentiel , ou plus simplement rfrentiel . Ce
serait le cas, par exemple, si les six plus jolis visages taient
dtermins par un jury d'experts. Dans cette dernire situation,
l'action des joueurs n'affecte en rien la cible atteindre.
1. John Maynard Keynes, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de
la monnaie, op. cif., p. 168.
280
LIQUIDIT ET SPCULATION
Celle-ci est dfinie indpendamment des interactions. En
consquence il s'agit, pour les acteurs, d'essayer de dcouvrir
le plus justement possible ce que pense le jury d'experts. Les
anticipations individuelles sont tournes vers un objet ext-
rieur aux interactions. La rationalit est de type fondamenta-
liste: elle est tourne vers la nature et se donne pour but
l'lucidation de vrits objectives. Chaque joueur est indiff-
rent aux actions des autres, qui sont sans influence sur la
dtermination de la cible atteindre. Nanmoins, mme dans
le cadre du jeu rfrentiel, ce que les acteurs informs savent
quant aux prfrences du jury est important connatre, non
pas parce que l'action de ses acteurs aurait un effet sur la
cible, mais parce que l'information qu'ils possdent est une
ressource prcieuse pour ce qui est de la dcouverte du but. En
revanche, peu importe le comportement et les analyses des
acteurs ignorants. Il en va tout diffremment dans le jeu key-
nsien puisque la cible atteindre est dtermine par les choix
des participants au jeu. Les ignorants comme les informs
doivent tre pris en compte. Comment se dterminer dans un
tel cadre autorfrentiel ?
L'approche noclassique soutient que les acteurs doivent
investir conformment leur estimation de la valeur fondamen-
tale. Transpose au concours de beaut, il s'agit, pour chaque
joueur, de retenir les six visages qu'il juge lui-mme les plus
jolis, sur la base de ses propres prfrences. Pour des raisons qui
deviendront rapidement claires, on dsignera par le terme de
croyance primaire , ou croyance de degr un , ces estima-
tions personnelles. Lorsque tous les acteurs jouent sur la base de
leur croyance primaire, les gagnants sont ceux qui, par chance,
se trouvent avoir la croyance primaire la plus usite. Un cas par-
ticulirement intressant est celui o tous les joueurs partagent
la mme croyance primaire. Dans ces conditions, tous font le
mme choix et tous gagnent. S'il en est ainsi, la stratgie consis-
tant agir conformment son estimation personnelle s'avre
pertinente. Mais une telle unanimit des croyances primaires
est-elle plausible? C'est ce que dfend l'approche noclassique
avec son hypothse probabiliste selon laquelle il existerait une
281
L'EMPIRE DE LA VALEUR
valeur objective s'imposant tous J. A contrario, la rflexion
mene autour de l'incertitude knightienne conduit rejeter cette
hypothse d'unanimit des croyances primaires. Elle n'est pas
conforme aux faits. L'estimation de la valeur fondamentale est
d'une nature essentiellement subjective. Chaque participant la
calcule partir de ses propres hypothses. Si on retient cette
hypothse de diversit, l'analyse prcdente dmontre que
l'estimation fondamentaliste n'est pas une bonne stratgie. Elle
n'assure en rien l'obtention d'un bon score. L'individu ayant un
point de vue excentrique aura un profit nul. Peut-il faire mieux?
Une meilleure ide pour lui consiste jouer, non pas sur la base
de sa croyance primaire, mais en cherchant anticiper les esti-
mations des autres. Il s'agit de former une croyance qui a pour
objet les croyances des autres participants. On la nommera
croyance de degr deux , ou croyance secondaire . Le pro-
blme avec cette stratgie est que, pour tre pertinente, elle sup-
pose imprativement que tous les autres agissent conformment
leur croyance primaire. En effet, si chacun joue selon sa
croyance personnelle, alors celui qui anticipe les croyances pri-
maires des autres gagnera, pour peu que son information sur ce
que pensent les autres soit fiable. Mais, s'il en est ainsi, peu
peu, tous les joueurs prendront conscience qu'il est de leur int-
rt de jouer en fonction des croyances primaires des autres. Or,
lorsque cette prise de conscience se diffuse largement, la
croyance de degr deux elle-mme devient caduque. Il faut pas-
ser une croyance de degr trois pour anticiper les croyances de
degr deux. Plus gnralement, si tous se dterminent partir de
leur croyance de degr n, il faut passer au degr n + 1 pour faire
mieux. Cette dynamique qui exige sans cesse des croyances de
niveau suprieur peut tre dite spculaire , car, la manire
de deux miroirs mis face face, elle donne voir une dyna-
mique de reflets infinie. Chacun essaie d'anticiper toujours un
degr au-dessus des autres pour l'emporter, sans y arriver car les
1. Notons que ceci ne suffit pas. Il faut encore que ce fait lui-mme soit
connu: non seulement chacun doit avoir la mme croyance primaire mais tout
le monde doit le savoir. C'est ce qu'on appelle un savoir commun.
282
LIQUIDIT ET SPCULATION
autres en font autant. C'est trs exactement ce que nous dit
Keynes dans son analyse du concours de beaut :
Il ne s'agit pas pour chacun de choisir les visages qui, autant
qu'il en peut juger, sont rellement les plus jolis [croyance de
degr un] ni mme ceux que l'opinion moyenne considrera
comme tels [croyance de degr deux]. Au troisime degr o
nous sommes dj rendus, on emploie ses facults dcouvrir
l'ide que l'opinion moyenne se fera l'avance de son propre
jugement. Et il y a des personnes, croyons-nous, qui vont
jusqu'au quatrime ou cinquime degr ou plus loin encore!. [Je
souligne.]
Cette remarque clt l'analyse trs succincte que Keynes
consacre au concours de beaut dans la Thorie gnrale. Il
n'en dira pas plus. Trs clairement, l'tude des interactions
autorfrentielles ne peut en rester ce seul constat qui dcrit
un processus inachev de croyances imbriques sans aborder la
question centrale de savoir vers quoi il tend et comment il se
stabilise. Par ailleurs, dans ce mme chapitre XII de la Thorie
gnrale, Keynes met en avant avec force le rle que jouent les
conventions dans le fonctionnement financier, mais sans jamais
relier celles-ci la dynamique autorfrentielle. Qu'elles en
soient l'expression et la consquence, telle est la proposition
qu'il reste dmontrer, ce qui suppose d'tablir que l'autorf-
rentialit peut produire de l'extriorit sous la forme de
croyances conventionnelles. Ce rsultat thorique est capital, ce
qui explique qu'en soit dtaille la dmonstration. Il est au cur
de la transition entre mdiation interne et mdiation externe.
Pour approfondir la comprhension des processus autorf-
rentiels, il est intressant de mobiliser les rsultats obtenus par
la thorie des jeux et l'conomie exprimentale. Cela s'impose
d'autant plus que le concours de beaut keynsien possde une
structure classique pour un thoricien des jeux, savoir celle
d'un jeu de pure coordination )). Elle a dj t rencontre au
chapitre II dans le cas du choix des langues. Dans un jeu de pure
1. John Maynard Keynes, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de
la monnaie, op. cit., p. 168.
283
L'EMPIRE DE LA VALEUR
coordination, chaque joueur a le choix entre n options. Toutes
les options sont quivalentes: l'utilit obtenue ne dpend pas de
l'option. Plus spcifiquement, le gain est proportionnel au
nombre de joueurs ayant choisi la mme option. En cons-
quence, la seule chose qui importe pour le joueur est de se coor-
donner avec les autres, et l'option qui permet cette coordination
est sans pertinence ses yeux. En ce sens, ce sont des jeux de
pure coordination. Une illustration classique est le jeu du
rendez-vous : deux personnes sont perdues dans une ville et
dsirent se retrouver. Le lieu de la rencontre leur est indiffrent.
Ils souhaitent seulement se retrouver. Dans le concours de
beaut keynsien, on observe une mme logique: chacun doit
trouver quel sera le choix le plus souvent retenu, peu importe ce
choix. La thorie des jeux applique ces situations permet
d'tablir plusieurs rsultats. D'une part, l'unanimit est un qui-
libre, quel que soit le choix retenu. En effet, en situation d'una-
nimit, chaque agent obtient son gain maximal. Il s'ensuit que
personne ne souhaite modifier sa dcision, de telle sorte que la
polarisation unanime perdure. D'autre part, lorsque tous les
membres du groupe font l'hypothse qu'une certaine dcision
est la bonne, alors elle le devient ipso facto par l'effet du choix
de tous. On dira que la croyance collective s'autoralise : elle est
devenue exacte parce que tous l'ont crue exacte. Ce faisant, on
retrouve un triptyque de proprits, caractristiques de la liqui-
dit, dj rencontres dans les chapitres prcdents: indtermi-
nation des quilibres, polarisation mimtique et autoralisation
des croyances. Applique aux marchs financiers, cette analyse
indique que n'importe quel prix peut tre un prix d'quilibre ds
lors que tous les participants le considrent comme tant le juste
prix. Ces rsultats sont importants mais ils sont obtenus sans
qu'il soit fait mention des jugements spcifiques que portent les
joueurs sur les options offertes, ce qu'on a nomm leur croyance
primaire. Introduire ce nouvel lment permet-il d'tre plus pr-
cis quant au choix de l'quilibre? Les travaux mens par Tho-
mas Schelling dans The Strategy of Conflid peuvent le faire
1. Oxford, Oxford University Press, 1977.
284
LIQUIDIT ET SPCULATION
esprer. Ils montrent que certains choix sont plus particulire-
ment retenus par les acteurs, ce qu'il nomme des points
focaux . Cette perspective a connu d'importants dveloppe-
ments rcents grce aux travaux de Judith Mehta, Chris Starmer
et Robert Sugden 1.
Mehta et alii ont expriment un grand nombre de jeux de pure
coordination. Dans le cadre de la prsente rflexion, on se limi-
tera aux deux suivants: dterminer un nombre et dterminer une
anne. Pour les nombres, il est demand un ensemble de joueurs
de choisir simultanment un entier naturel positif, sachant que le
gain associ est proportionnel au nombre d'individus qui ont fait
le mme choix. Il s'agit donc pour les joueurs de trouver le
nombre qui rcoltera le plus de suffrages. Cette tche n'a rien
d'ais car a priori n'importe quel nombre peut convenir. La thorie
des jeux n'est d'aucune utilit, car, selon elle, toutes les options
sont absolument identiques : rien ne permet de les distinguer ds
lors qu'elles procurent les mmes gains. Si les joueurs russissent
se coordonner malgr tout, c'est parce qu'ils raisonnent autre-
ment que ce que prend en compte la thorie des jeux. Ils appr-
hendent les choix, non seulement partir des gains, mais aussi
partir de leur libell. Or, de ce point de vue, 1 et, par exemple,
130220 Il sont nettement distincts mme si leurs gains sont les
mmes. Comme le notait dj Schelling en 1960, en la matire,
l'imagination est bien plus utile que la logique. Pour tester cette
hypothse, Mehta et alii ont eu l'ide de slectionner un groupe
de contrle, not C, auquel il a t simplement demand de choi-
sir un entier naturel positif, en l'absence de toute contrainte de
coordination. De cette faon, les auteurs ont obtenu des informa-
tions quant la distribution des opinions personnelles au sein de
la population teste, ce que nous avons appel les croyances pri-
maires. Ensuite, dans le deuxime groupe
2
, not J, le jeu de coor-
dination est jou selon les rgles prcises prcdemment.
1. The Nature of Salience : An Experimental Investigation of Pure Coor-
dination Games , American Economic Review, vol. 84, n 2, juin 1994.
2. Les deux groupes sont distincts mais il est fait l'hypothse que les choix
du groupe C sont reprsentatifs des croyances primaires du groupe J.
285
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Groupe C (n = 88) Groupe J (n = 90)
----------------
----------------
Rponses Proportion Rponses Proportion
Question 1 (annes):
1971 8,0 1990 61,1
1990 6,8 2000 11,1
2000 6,8 1969 5,6
1968 5,7
r=43 r = 15
Question 2 (nombres) :
7 11,4 1 40,0
2 10,2 7 14,4
10 5,7 10 13,3
1 4,5 2 11,1
r=28 r = 17
Considrons les rsultats obtenus (pour la question 2). Dans
le groupe C de contrle qui mesure les croyances primaires,
viennent en tte les rponses 7 (11,4 %), puis 2 (10,2 %), puis
10 (5,7 %) et 1 (4,5 %). Dans le groupe J soumis au jeu, on
observe une forte convergence des rponses : 40 % choisissent
le nombre 1 qui est suivi par le nombre 7 dans 14,4 % des
rponses. Par ailleurs, le nombre r de rponses distinctes dimi-
nue nettement. Il passe de 28 17. Ces rsultats sont tonnants.
Ils prouvent une capacit certaine du grope J se coordonner,
mme dans une situation autorfrentielle, c'est--dire une
situation o les joueurs n'ont pas de rfrence commune! Selon
la thorie des jeux, chaque nombre tant identique aux autres,
une trs forte dispersion des rponses aurait d tre obtenue 1.
1. Comme le nombre d'options proposes est infini, la probabilit que
deux individus aient choisi le mme nombre tait nulle, ou peu s'en faut.
286
LIQUIDIT ET SPCULATION
l'vidence, il n'en a pas t ainsi. L'utilisation du libell des
choix a permis aux acteurs de mettre en place des stratgies de
coordination efficaces. Pour en dcouvrir les modalits, les
auteurs commencent par considrer, titre d'hypothses, les
stratgies les plus simples, celles que Keynes mentionne expli-
citement dans sa citation: choisir les visages qui sont rel-
lement les plus jolis (croyance de degr un) et choisir
ceux que l'opinion moyenne considrera comme tels
(croyance de degr deux). La premire suppose que les joueurs
suivent leur croyance primaire 1. C'est ce que nous avons
nomm galement la stratgie fondamentaliste. La remarquable
convergence des rsultats obtenus dans le groupe J compare
la dispersion du groupe C de contrle permet de rejeter cette
hypothse. On peut penser que les joueurs comprennent que,
pour gagner, il faut d'abord s'intresser aux choix des autres
2
En consquence, sa propre opinion est sans pertinence. L'hypo-
thse de la croyance secondaire parat bien plus prometteuse.
Elle suppose que les joueurs examinent les croyances primaires
du groupe et slectionnent celle qui est la plus usite
3
Dans
notre exemple, il s'agit du nombre 7. Si on suppose que les
joueurs ont une information fiable quant aux croyances pri-
maires du groupe, le recours une croyance de degr deux
conduirait faire merger une coordination sur le nombre 7
4
L'mergence du nombre 1 dans le groupe J alors mme que ce
nombre n'occupe que la 4
e
position dans le groupe C atteste
d'une stratgie autre que la croyance secondaire. C'est ce que
1. Les auteurs lui donnent galement le nom de saillance primaire , par
quoi il faut entendre qu'elle s'impose l'individu lorsqu'il est isol et ne se
soucie pas de se coordonner avec autrui.
2. Hormis les situations dans lesquelles les joueurs peuvent avoir des rai-
sons de penser que les croyances primaires sont identiques.
3. Ce que Judith Mehta, Chris Starmer et Robert Sugden nomment la
saillance secondaire . En conclusion, ces auteurs comparent trois strat-
gies : saillance primaire, saillance secondaire et saillance la Schelling.
4. Plus gnralement, si on suppose une information incomplte mais
conforme la ralit des croyances primaires, les auteurs notent que l'utilisa-
tion de la croyance secondaire conduirait une hirarchie de choix similaires
celle observe dans le groupe C.
287
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Mehta, Stanner et Sugden nomment une saillance la Schel-
ling .
Pour Schelling, qui tudie galement ce jeu, le chiffre 1
s'impose en raison de ses qualits intrinsques: en tant qu'il est
le premier et le plus petit entier, son unicit saute aux yeux 1
Plus gnralement, une saillance la Schelling s'analyse
comme un choix qui s'impose tous
2
Il s'agit de faire merger
une option qui puisse recueillir l'adhsion de tous les joueurs,
ce qui suppose de prendre appui sur ce qui leur est commun; ou
plutt sur ce qu'ils croient leur tre commun. Pour mener bien
une telle tche, la prise en compte des opinions personnelles, en
raison de leur diversit naturelle, ne peut constituer qu'un obs-
tacle. C'est au contraire en se plaant au niveau de l'unit du
groupe lui-mme, dans ce qui en dfinit spcifiquement l'iden-
tit, qu'il est possible de faire merger une saillance la Schel-
ling. Ainsi le chiffre 1 a-t-il t slectionn par 40 % du groupe
bien qu'il n'ait t retenu comme croyance primaire que par une
toute petite proportion des joueurs (4,5 %). Le jeu portant sur
les annes conduit aux mmes rsultats. Alors que les croyances
primaires slectionnent l'anne 1971, le groupe se coordonne de
manire massive (61,1 %) sur l'anne 1990. Pourquoi? Parce
que 1990 est l'anne du test qui a vu le groupe runi. Pour cette
raison, ce choix s'impose au collectif alors mme que les indi-
vidus prfrent leur date de naissance (1971 ou 1968) comme
croyance primaire
3
Cela illustre de nouveau le fait qu'une
1. Si on demande quel nombre, parmi tous les nombres positifs, est le
plus clairement unique, ou quel1e rgle de slection conduirait des rsultats
dpourvus d'ambigut, on est frapp par le fait que l'ensemble des nombres
positifs a un "premier" et un "'plus petit" nombre (Thomas Schel1ing, The
Strategy of Conflict, op. cit., p. 94).
2. Une rgle de slection est sail1ante [ la Schelling] dans la mesure o
el1e se suggre el1e-mme ou semble vidente ou naturel1e pour ceux qui
cherchent rsoudre des problmes de coordination (Judith Mehta, Chris
Starmer et Robert Sugden, The Nature of Salience : An Experimental Inves-
tigation of Pure Coordination Games , art. cit., p. 661).
3. On peut infrer du test qu'il a t effectu en 1990 sur une population
d'tudiants dont l'ge varie entre 19 et 22 ans. Le choix primaire a pu tre
2000 en raison de sa nature spcifique ou mme, pour certains, 1990, l'anne
288
LIQUIDIT ET SPCULATION
saillance la Schelling s'labore partir des caractristiques du
groupe en tant qu'entit particulire dote d'une histoire spci-
fique.
En conclusion, la saillance la Schelling s'analyse comme
une remarquable mise distance du groupe l'gard de lui-
mme. Par son biais, le collectif s'extriorise sous la forme
d'une rfrence que chacun reconnat comme lgitime. Pour en
mesurer pleinement la nature, il faut quitter le cadre statique
pour considrer un jeu dynamique. Dans le cas d'une rptition
l'identique du jeu, le choix slectionn l'instant t s'impose
naturellement comme saillance en t +1. Cette force des pr-
cdents! illustre l'autonomie des saillances, le fait qu'elles
acquirent une puissance propre. Le groupe conserve en
mmoire son aptitude faire prvaloir l'unisson. Il la stocke et
la ractualise lorsqu'il se trouve confront un problme de
coordination qu'il juge similaire
2
C'est ainsi qu'mergent ce
que nous appellerons des croyances conventionnelles
3
ou,
plus simplement, des conventions. Lorsqu'une telle rfrence
apparat, la coordination est rendue considrablement plus aise.
Les joueurs, pour savoir ce que les autres vont choisir, n'ont
plus qu' se tourner vers la convention. Tant que celle-ci fait
l'objet d'une adhsion majoritaire, la conformit la convention
s'impose comme une stratgie gagnante qui permet d'anticiper
le comportement des autres. Pour copier les autres, il suffit de
du test. Dans le cadre du jeu, 1990 s'impose une crasante majorit
(61,1 %), vient ensuite 2000, mais disparaissent les annes de naissance qui
perdent toute pertinence.
1. Autrement dit, si on fait jouer une seconde fois le groupe J, on verra
prvaloir une situation de quasi-unanimit sur le chiffre 1 et sur l'anne 1990.
De mme, si on indique au groupe J que, la veille, telle option X s'est trouve
choisie, cette option s'impose comme une saillance la Schelling.
2. Ainsi le bret et la baguette peuvent-ils continuer symboliser l'identit
franaise mme si personne ne porte plus de bret!
3. Dans nos travaux antrieurs, nous les avons nommes croyances
sociales (voir Andr Orlan, Le tournant cognitif en conomie , Revue
d'conomie politique, vol. 112 (5), septembre-octobre 2002). En anglais,
collective belief (Andr Orlan, What is a Collective Belief? , in Paul
Bourgine et Jean-Pierre Nadal (dir.), Cognitive Economies, Berlin-Heidelberg
et New Yok, Springer-Verlag, 2004).
289
L'EMPIRE DE LA VALEUR
copier la convention. En rsum, l'mergence d'une croyance
conventionnelle modifie la structure des interactions: la mdia-
tion interne laisse la place la mdiation externe. Par ailleurs,
la saillance des conventions, par quoi se trouve dsign le fait
qu'elles s'imposent aux esprits individuels la manire d'une
force qui les dpasse, est une manifestation de l'affect commun
dont elles sont porteuses.
Dans la section qui suit, il s'agit de mobiliser cette compr-
hension gnrale des interactions autorfrentielles pour clairer
certains aspects du fonctionnement des marchs financiers, tout
particulirement leur inefficience, savoir la dconnexion
durable entre prix et estimations fondamentalistes. Cela nous
permettra de comprendre pourquoi la concurrence financire ne
produit pas les forces de rappel que ncessiterait sa stabilit.
Inefficience des marchs financiers
Ce qui caractrise les croyances conventionnelles telles
qu'elles viennent d'tre dfinies est le fait paradoxal d'une
croyance collective qui n'est la croyance de personne! Le
chiffre 1 et l'anne 1990 illustrent ces options choisies par tous
sans tre choisies par quiconque, ou presque. Ce paradoxe est au
cur de l'inefficience des marchs financiers. Il permet de com-
prendre que des investisseurs pleinement rationnels puissent
s'carter de leur estimation fondamentaliste sans transgresser
leur rationalit. Il s'agit de situations dans lesquelles chaque
individu croit individuellement la proposition VF en mme
temps qu'il croit que le groupe se conforme la convention P,
diffrente de la proposition VF, sans qu'aucune de ces
croyances ne soit errone. Cette situation illustre ce que nous
nommons l'autonomie des croyances conventionnelles. Cette
proprit d'autonomie met au jour une logique d'un type nou-
veau, en rupture avec le modle individualiste. Selon ce dernier,
la croyance collective est la somme des opinions indivi-
duelles. En tant que telle, elle ne jouit d'aucune autonomie par
rapport celles-ci. Dans la perspective que propose la notion de
290
LIQUIDIT ET SPCULATION
saillance la Schelling, il en va tout autrement. Deux niveaux
spars aux logiques distinctes coexistent: le niveau des
croyances individuelles et le niveau de la convention. La pro-
prit d'autonomie transpose au march donne voir un prix P
dconnect des valuations individuelles, VF
j
Un tel prix P peut
tre appel, au sens fort, la production du march. Il est le pro-
duit de la liquidit et d'elle seule.
L'analyse des jeux autorfrentiels permet de comprendre
pourquoi il en est ainsi. Elle invite distinguer soigneusement
ce que l'individu pense vraiment, savoir son estimation fonda-
mentaliste, et son choix effectif. Cela tient la nature mme de
l'interaction considre qui rcompense, non pas ceux qui
auraient raison et rpondraient correctement la ques-
tion pose, mais ceux qui russissent prvoir au mieux les
mouvements de l'opinion majoritaire. Cette distinction appli-
que aux marchs financiers permet d'viter les jugements
htifs d'irrationalit qui sont frquemment profrs l'encontre
des investisseurs financiers lors des bulles spculatives, savoir
lorsqu'on constate une dconnexion durable entre le prix cot et
ce que la communaut des conomistes considre comme tant
l'valuation fondamentale. Prenons le cas d'une monnaie dj
sous-value' qui fait nanmoins l'objet d'un important mouve-
ment de ventes sur le march des changes, conduisant une
sous-valuation encore plus grande. C'est ce qu'on a connu sur
le march de l'euro en septembre 2000. Dans cette situation de
sous-valuation, on constate l'absence de forces de rappel pous-
sant l'euro la hausse et le ramenant son juste niveau. Selon
une analyse commune, cette situation serait due l'irrationalit
des cambistes, incapables d'valuer correctement ce que vaut la
devise. Cette hypothse ne tient pas. Elle n'est d'ailleurs pas
ncessaire. Les cambistes, comme tout un chacun, peuvent par-
faitement savoir que la monnaie en question est sous-value et
pourtant continuer la vendre. En effet, ce qui compte pour eux
lorsqu'ils interviennent sur le march n'est pas ce qu'ils pensent
tre la vraie valeur de la monnaie, autant qu'ils en peuvent
1. Mais le mme raisonnement vaut pour toutes les bulles spculatives.
291
L'EMPIRE DE LA VALEUR
juger, mais ce qu'ils pensent que le march. va faire. Sur un
march, on fait du profit quand on russit prvoir correcte-
ment l'volution de l'opinion du groupe. Telle est la rgle du
jeu. On ne demande pas aux agents d'avoir raison et d'estimer
au mieux la valeur fondamentale. De ce point de vue, la dcla-
ration qui suit provenant d'un cambiste interrog au moment de
la forte baisse de l'euro en septembre 2000 est rvlatrice de la
dichotomie existant entre valuation personnelle sur une base
fondamentaliste et choix d'investissement. On y voit un indi-
vidu intimement persuad du caractre sous-valu de l'euro,
mais expliquant qu'il est nanmoins tenu vendre s'il ne veut
pas perdre de l'argent :
L'oprateur que je suis a beau croire une apprciation de
l'euro, il ne fait pas le poids lorsqu'il constate qu'un peu partout
les positions des autres intervenants sur le march des changes
sont la vente de l'euro. Du mme coup, mme si j'estime que
l'euro mrite d'tre plus cher par rapport au dollar, j'hsite tou-
jours acheter la devise europenne. En effet, si je suis le seul
acheteur d'euros face cinquante intervenants vendeurs, je suis
sr d'y laisser des plumes [ ... ]. Je ne fais pas forcment ce que
je crois intimement, mais plutt ce que je crois que fera globale-
ment le march qui infine l'emportera. Le travail de l'oprateur
est de tenter d'valuer au plus juste le sentiment du march des
devises 1.
Malgr sa conviction personnelle d'une sous-valuation, ce
cambiste joue la baisse et c'est l un comportement parfaite-
ment rationnel: s'il avait achet de l'euro, il aurait fait des
pertes ! Une premire manire d'analyser cette situation
consiste suivre l'interprtation que nous en propose le cam-
biste interrog. Il oppose deux valuations, son valuation fon-
damentaliste personnelle et celle des autres cambistes. Dans un
tel cadre, l'individu interrog justifie son suivisme par le fait
qu'il existe un grand nombre d'investisseurs vendeurs qui dter-
minent l'volution du march. Selon cette analyse, ces cin-
quante intervenants vendent parce qu'ils pensent que l'euro
1. Libration, 8 septembre 2000, p. 24.
292
LIQUIDIT ET SPCULATION
est survalu. C'est donc une conception errone du point de
vue des fondamentaux qui les conduit vendre. Face ce fait
accompli, notre cambiste n'a plus aucun choix. Il ne peut que se
plier au diktat inadquat de l'opinion majoritaire. Si l'on retient
cette interprtation, nous n'observons pas ce que nous avons
appel l'autonomie des croyances conventionnelles , c'est--
dire une situation o, pour tous les acteurs, est observ un cart
entre leur opinion personnelle et leur croyance sociale. En effet,
dans le cadre de l'interprtation propose par le cambiste inter-
rog, le prix de march est le reflet direct des estimations fon-
damentalistes de la majorit des intervenants, les fameux
cinquante vendeurs . Il n'y a donc pas d'cart entre le prix et
les croyances primaires. C'est seulement pour le cambiste inter-
rog qu'on constate un cart entre son valuation fondamenta-
liste et la croyance du march. Soulignons que, dans une telle
situation, la rationalit lui dicte d'imiter l'opinion majoritaire.
Cette interprtation n'est pas ncessairement fausse. Il se
peut, dans telle ou telle conjoncture financire donne, qu'il
existe, en effet, sur le march, des investisseurs nafs, mal infor-
ms ou irrationnels. C'est l une question de fait. S'il en est
ainsi, la bulle baissire sur l'euro s'interprte aisment par le
fait qu'il existe un grand nombre d'investisseurs qui se
trompent quant ce que vaut la monnaie. Elle est un produit de
l'irrationalit collective. C'est la voie emprunte par la finance
comportementale 1. Notons, cependant, que cette interprtation
doit, au pralable, nous faire comprendre pourquoi cinquante
cambistes se trompent simultanment. Quel mcanisme permet
d'expliquer qu'une mme erreur se soit propage au sein du
march? La finance comportementale, sur ce point, invoque la
1. Pour la finance comportementale, il faut ncessairement des investis-
seurs irrationnels pour que des bulles se forment. Andrew Shleifer est trs
clair ce sujet: Sans lubie des investisseurs, il n'y a pas au dpart de per-
turbations sur les prix efficients, de telle sorte que les prix ne dvient pas de
l'efficience. Pour cette raison, la thorie comportementale requiert la fois
des perturbations irrationnelles et un arbitrage limit qui ne les annule pas
(Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral Finance, op. cit., 2000,
p.24).
293
L'EMPIRE DE LA VALEUR
psychologie cognitive pour expliquer cette corrlation des
erreurs. Sur la foi des travaux de Daniel Kahneman et Amos
Tversky, Andrew Shleifer note : Les analyses empiriques
dmontrent [ ... ] que les gens ne dvient pas de la rationalit
d'une manire alatoire, mais bien plutt que la plupart dvient
d'une faon identique!. Cette rponse n'est pas entirement
convaincante. Il reste suffisamment de biais, mme si leur
nombre est limit, pour que la conformit de tous au mme
biais continue poser problme, mme pour qui adhre aux
conceptions dveloppes par Kahneman et Tversky. Qui plus
est, cela n'explique pas du tout pourquoi certains investisseurs
chappent la fatalit des biais et se comportent de manire
parfaitement rationnelle. Pourquoi notre cambiste ne se trompe-
t-il pas? En quoi serait-il si spcial? En consquence, il est
intressant de considrer une interprtation alternative qui
abandonne la dissymtrie suspecte entre notre cambiste parfai-
tement rationnel et un march constitu d'oprateurs focaliss
sur la mme erreur. Selon cette nouvelle interprtation, tous
les intervenants possdent les mmes informations et forment
les mmes estimations fondamentalistes. En consquence, ils
agissent de manire identique notre cambiste, c'est--dire
d'une manire mimtique, en se fondant sur ce qu'ils pensent
tre la croyance conventionnelle du march, en l'occurrence la
baisse. Dans une telle perspective, chacun est identiquement
rationnel, agissant en fonction d'une mme anticipation quant
aux comportements des autres. Il n'y a pas cinquante interve-
nants farouchement vendeurs, mais cinquante cambistes qui,
rflchissant ce que vont faire les autres intervenants, parmi
lesquels se trouve le trader interrog par Libration, anticipent
qu'ils vont vendre. Si on les interrogeait, ils feraient remarquer
leur tour qu'il ne sert rien d'aller contre-courant d'un mar-
ch aussi dtermin dans son aveuglement. Autrement dit, le
cambiste interrog interprte mal leurs penses. Comme il les
voit vendre, il en dduit faussement qu'ils considrent que
l'euro est survalu. En fait, comme lui, ils savent ne pas pou-
1. Ibid., p. 13.
294
LIQUIDIT ET SPCULATION
voir rsister l'opinion baissire du march, bien qu'ils consi-
drent que cette baisse ne se justifie pas. Sur un march, on ne
fait pas ce qu'on croit mais ce que le march croit.
Si cette interprtation des faits est exacte, on reconnat alors
notre situation de dconnexion entre les croyances prives,
VF , toutes convaincues du caractre sous-apprci de l'euro,
et la croyance conventionnelle, P , selon laquelle le march
croit la baisse. Si chacun croit que le march croit la
baisse , alors chacun sera baissier et le march baissera effec-
tivement en validant ex post la croyance conventionnelle. Dans
une telle situation, une bulle merge sans qu'il ait t ncessaire
de supposer la prsence d'acteurs irrationnels. Chacun est par-
faitement rationnel, dans ses valuations prives comme dans
son valuation du march. Les deux valuations sont exactes.
Elles ne sont pas contradictoires parce qu'elles ne portent pas
sur les mmes objets: la croyance prive, haussire, porte sur la
valeur fondamentale ; la croyance conventionnelle, baissire,
porte sur l'volution future du march. Dans l'esprit des parti-
cipants, la dconnexion entre ces deux apprciations n'a rien de
choquante. Elle s'enracine dans l'autonomie des mcanismes de
march. L'exprience du march, vcu comme une force qui les
dpasse et s'impose eux, valide avec force aux yeux des
investisseurs cette hypothse d'une autonomie de l'valuation
collective. Aussi, loin de produire un ajusteinent de la croyance
conventionnelle aux estimations privs, cette situation conduit
renforcer encore la croyance conventionnelle, qui s'impose
comme seule explication plausible, expression d'une force
qu'ils ne dominent pas. En consquence, les croyances se voient
confirmes 1 tous les niveaux: l'euro est effectivement sous-
valu au regard des fondamentaux ; le prix baisse; le march
se comporte de manire autonome, c'est--dire dconnecte des
apprciations fondamentalistes.
1. Cette conception d'une bulle rationnelle contredit non seulement
l'hypothse d'efficience financire, mais galement les positions dfendues
par la finance comportementale (se reporter Andr Orlan, Efficience,
finance comportementale et convention: une synthse thorique , art. cit.).
295
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Mme si les deux valuations renvoient des expriences
distinctes, la valeur fondamentale, d'un ct, et le prix, de
l'autre, il existe nanmoins une tendance les comparer en tant
qu'elles sont toutes deux des valuations d'un mme actif. De
ce point de vue, l'observation ne laisse aucun doute: l'estima-
tion personnelle tend s'ajuster sur le prix, et non le contraire.
On constate, sans ambigut, une contagion qui va du march
vers les jugements subjectifs, ce qui a pour consquence de ren-
forcer encore la puissance des croyances conventionnelles
lorsqu'elles finissent mme par tre intriorises et adoptes
comme opinions individuelles. Ce fait est important car il
montre que le march est une entit sociale hirarchise et non
pas la juxtaposition d'esprits indpendants qui changeraient
sur la base de conceptions construites hors march. Contraire-
ment au point de vue walrassien, les changes engagent les per-
sonnalits et les valeurs. Ils les modlent. Cette influence
qu'exerce le prix de march sur les consciences est la cons-
quence de son pouvoir propre, c'est--dire de l'ensemble des
intrts qu'il suscite, selon des voies diverses. Le prix a la puis-
sance d'une norme. L'exemple des analystes financiers et des
agences de notation est tout particulirement reprsentatif de ce
pouvoir, dans la mesure o ces acteurs sont supposs produire
des estimations fondamentalistes afin d'informer le march. Or
leurs pauvres performances sont bien connues. Par de multiples
canaux, ils se trouvent lis aux intrts fmanciers et, malgr leur
dclaration d'indpendance, ils sont conduits aligner leur
jugement sur celui des marchs. Comme le montre bien
douard Ttreau dans un petit livre percutant, il vaut mieux,
pour les analystes financiers, avoir tort avec les autres que rai-
son tout seuIl . Ce que disait dj en son temps Keynes: La
sagesse universelle enseigne qu'il vaut mieux pour sa rputation
chouer avec les conventions que russir contre elles
2
Il
dcoule de cette lgitimit propre au prix de march une pro-
1. douard Ttreau, Analyste. Au cur de la folie financire, Paris, Gras-
set, 2005, p. 86.
2. Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de la monnaie, p. 170.
296
LIQUIDIT ET SPCULA TION
pension absolue des investisseurs valider les volutions
constates quelles qu'elles soient. C'est tout l'oppos de la loi
de l'offre et de la demande. Ainsi, en 2007 et 2008, quand le
prix d'un grand nombre de produits titriss s'est mis chuter,
aussi bas que le prix ait pu tomber, ceci n'a pas enclench une
forte demande, conformment l'hypothse d'efficience. C'est
l'intervention des autorits publiques qui a arrt la chute. Il a
donc fallu un acteur extrieur au systme pour stopper la
panique. Sans lui, le systme aurait explos, preuve manifeste
que le march financier ne peut se sauver seul. La concurrence
financire n'est pas autorgulatrice. En consquence, sa drgu-
lation est une faute majeure.
Sur quelques proprits des prix:
variabilit excessive, bulles spculatives
et aveuglement face au dsastre
Jusqu' maintenant, notre analyse a port sur les proprits
structurelles de la logique financire: valorisation, efficience,
stabilit, loi de l'offre et de la demande, liquidit, capacit
d'autorgulation. Le principe de saillance mis en vidence
prcdemment permet galement d'avancer dans la compr-
hension dtaille des volutions boursires. Il offre de nou-
velles pistes pour rendre intelligibles leurs proprits
statistiques. Considrons, pour commencer, la nature non
gaussienne des variations de prix. Il s'agit l d'une caractris-
tique nigmatique: si l'on prend n'importe quel indice bour-
sier, il apparat que sa performance sur une longue priode est
obtenue, non pas, comme on aurait pu s'y attendre, par une
longue succession cumulative de petites variations, conform-
ment au modle gaussien, mais par de trs fortes variations
concentres sur un tout petit nombre de jours. Ainsi sur la
priode de 15 ans qui va de 1993 2008, l'indice MSCr
l
Europe
a montr une croissance moyenne de 9,27 %. Or, si on enlve
1. Morgan Stanley International Index.
297
L'EMPIRE DE LA VALEUR
les dix jours 1 pour lesquels la variation a t la plus importante,
cette croissance tombe 5,68 %. La chute est impressionnante
alors qu'a t enlev moins d'un jour par an. Si on enlve les
30 meilleurs jours, la performance tombe 0,90 % et, pour les
40 meilleurs jours, - 1,13 %. Autrement dit, la performance
globale est obtenue sur trs peu de jours, moins de 1 % de la
priode considre. Interprt en termes probabilistes, ce rsul-
tat indique que les variations de prix connaissent des carts trs
importants par rapport leur moyenne. Les vnements excep-
tionnels, savoir de trs fortes hausses ou de trs fortes baisses,
ne sont pas rares. Ils sont bien plus frquents que ce qu'on obserVe
dans le cas d'une loi gaussienne ou courbe en cloche. En
effet, cette loi, classiquement utilise pour dcrire le hasard,
donne voir un phnomne alatoire qui reste fortement
concentr autour de sa moyenne. l'vidence, la reprsentation
gaussienne ne convient pas pour les cours boursiers. Pour
reprendre les termes de Mandelbrot
2
, le hasard boursier n'est
pas un hasard bnin. Par exemple, une variation des cours
comme celle qu'a connue la Bourse tatsunienne le 19 octobre
1987, savoir une perte de 22,6 % pour l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles, est incompatible avec une loi gaussienne.
En effet, si l'on suppose que les carts de prix sur ce march
suivent une loi normale, on peut dmontrer que le temps moyen
ncessaire l'observation d'une telle dviation est de 10
47
ans,
soit l'ge de la Terre la puissance 5. Comme l'crivent Jean-
Philippe Bouchaud et Christian Walter: Dans le cas gaussien,
les grandes dviations sont tellement rares que le krach de 1987
(et beaucoup d'autres plus petits dont la mmoire collective n'a
pas retenu l'occurrence) n'aurait pas d exister, mme si la pre-
mire place boursire avait t ouverte par Lucy3.
1. Se reporter Fidelity Fundamentals, Long- Term Investing
Through the Cycle , 2010 : http://www.capitaltower.co.uk/files/
Long'l1020Term%20Investing.pdf.
2. Benot B. Mandelbrot, Formes nouvelles du Hasard dans les
Sciences , conomie applique, vol. XXVI, 1973.
3. Jean-Philippe Bouchaud et Christian Walter, Les marches alatoires ,
Pour la science, dossier hors-srie sur Le Hasard, avril 1996, p. 94.
298
LIQUIDIT ET SPCULATION
L'analyse autorfrentielle offre une explication simple pour
comprendre cette variabilit excessive des prix. Elle donne
voir une communaut financire active et anxieuse, interrogeant
toutes les hypothses et toutes les rumeurs pour dterminer
celles susceptibles d'obtenir l'assentiment du march. Ce pro-
cessus d'exploration dgnre frquemment en polarisations
mimtiques sporadiques et violentes lorsque tel ou tel vne-
ment se trouve slectionn simultanment par un grand nombre
d'acteurs en raison de sa saillance suppose, et cela indpen-
damment de son contenu informationnel rel. Il s'ensuit de
fortes et soudaines variations de prix, sans rapport avec les fon-
damentaux 1. Autrement dit, la qute de saillances est fondamen-
talement un mcanisme d'amplification qui procde par
agrgation mimtique, en focalisant l'attention du march sur
certaines variations de court terme, au dpart insignifiantes.
Sur la longue priode, ce mme mcanisme joue diffrem-
ment. Il tend se stabiliser durablement lorsqu'une interprta-
tion finit par recueillir l'adhsion gnrale du march. Dans ces
conditions, merge un modle d'valuation reconnu par chacun
comme lgitime, ce qu'on appellera une convention d'valua-
tion . C'est de cette faon que le groupe autorfrentiel sur-
monte provisoirement son dficit de rfrence objective: tant
que la convention d'valuation est accepte, la dynamique sp-
culaire est notablement simplifie, puisque, alors, pour prvoir
ce que les autres vont faire, il suffit. de considrer ce que la
convention prvoit. Les conventions d'valuation fournissent
des schmas interprtatifs par le biais desquels les investisseurs
peroivent la ralit. Tant que les phnomnes observs sont
conformes aux prvisions, la convention perdure. Ds lors que
les faits observs entrent par trop en contradiction avec la repr-
sentation conventionnelle du monde qui prvaut et qu'en cons-
quence les anomalies s'accumulent, le march abandonne la
convention considre pour en rechercher une autre. C'est ce
1. David M. Cutler, James M. Poterba et Lawrence H. Summers, What
Moves Stock Priees? , The Journal of Portfolio Management, printemps
1989.
299
L'EMPIRE DE LA VALEUR
qu'on a observ au dbut de l'an 2000 quand les prvisions de
croissance du commerce lectronique, sur lesquelles reposait la
convention Nouvelle conomie , sont apparues comme tant
bien trop optimistes. Il s'est ensuivi une importante chute des
cours. Cette convention qui a prvalu la fin du xx sicle pro-
posait en outre d'estimer la valeur des entreprises dot.com
partir du nombre de visiteurs des sites Internet ou du nombre de
clics. Cela a permis de valoriser fortement des entreprises
connaissant un grand succs d'audience bien qu'tant par
ailleurs structurellement dficitaires. Pourtant, cette hypothse
tait des plus douteuses car il n'existe pas de lien mcanique
entre le nombre de visiteurs et le niveau des profits. Par ailleurs,
cette mme convention Nouvelle conomie attribuait un
avantage dfinitif au premier arriv sur la Toile du fait de sa
suppose capacit retenir l'attention des clients potentiels.
Qu'une entreprise classique puisse remonter ce handicap grce
ses importantes ressources n'tait pas alors considr comme
possible, tant les deux cultures taient perues comme tota-
lement antagoniques. partir de quoi, la capitalisation bour-
sire d'une jeune entreprise comme eToys a pu tre value la
fin de 1999 un tiers de plus que celle du gant du jouet Toys
R Us, alors qu'elle reprsentait, en chiffre d'affaires, trois
magasins de ce dernier qui en comptait plus d'un millier, tout
en tant dficitaire. Les annes suivantes prouvrent amplement
l'erreur de la convention. eToys se dclara en faillite en
mars 2001, la valeur de son action ne valant plus que quelques
cents, alors mme que Toys R Us s'allia avec Amazon pour
dvelopper avec succs son commerce en ligne, toutes choses
que la convention Nouvelle conomie jugeait peu probables.
Cette dynamique historique, qui pense une convention finan-
cire partiellement arbitraire, confmne provisoirement dans les
faits qu'elle aide produire, pour finir par tre rejete quand elle
a fait son temps, est similaire celle prsente par Joseph
Schumpeter propos du cycle des innovations technologiques.
Dans un cas comme dans l'autre, l'ide qu'existeraient des cri-
tres permettant ex ante de dfinir avec certitude quelle est la
bonne option doit tre rejete. Autrement dit, cette analyse nous
300
LIQUIDIT ET SPCULA TION
donne voir une temporalit pleinement historique, faite
d'essais, d'erreurs et d'apprentissages, dans laquelle il n'y a pas
d'optimalit ex ante. Le futur y est radicalement indtermin. Il
est la consquence des choix individuels, qui eux-mmes
dpendent de la manire dont le march pense l'avenir. Comme
l'avait dj vu Schumpeter propos des innovations techniques,
l'erreur centrale de la dmarche noclassique est de vouloir une
optimalit a priori des choix dans un domaine, l'volution des
socits humaines, o cela n'a pas de sens, sauf se placer dans
un temps logique et non pas dans un temps historique. Le modle
d'essais, erreurs et apprentissages est le seul qui soit adquat
une conception historique du temps 1. Dans un tel cadre, les
seules donnes conomiques fondamentales ne suffisent pas
rendre intelligible l'volution des connaissances individuelles et
collectives. Celles-ci dpendent d'autres facteurs, comme les
diverses croyances et valeurs, ou encore les esprits animaux (ani-
mal spirits), qui structurent le contexte social. Alors que dans le
modle traditionnel de l'conomie, l'volution des connaissances
est conue comme refltant la ralit objective, dans notre
modle, la connaissance collective est pense comme rsultant
des interactions financires elles-mmes. En rsum, les marchs
financiers sont des machines cognitives complexes qui, partir
de l'ensemble htrogne des conjectures personnelles, ont pour
finalit de produire une estimation collectivement admise, la
convention d'valuation. Du fait mme de l'incertitude knigh-
tienne, cette production possde une part irrductible d'arbitraire.
On ne peut tre sr a priori d'avoir fait le bon choix. En cons-
quence, le choix d'une convention plutt qu'une autre prend
ncessairement la forme d'un pari. Mais cela n'est en rien une
limitation qu'on pourrait dpasser car, en matire d'incertitude
knightienne, c'est l le mieux qui puisse tre fait.
1. Dans Andr Orlan (Le Pouvoir de la finance, op. cU.), nous avons rap-
proch la convention financire de la notion de paradigme avance par Kuhn.
Dans les deux cas, il s'agit pour une communaut (soit financire, soit scien-
tifique) de grer son rapport un futur incertain. Cette comparaison permet de
faire ressortir la nature rationnelle de l'organisation conventionnelle.
301
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Il n'entre pas dans le projet de ce livre d'analyser en dtail
les conventions financires 1. Notons simplement que le march
montre une tendance certaine slectionner des conventions
haussires, productrices de bulles spculatives. Ce point ne doit
pas nous tonner. De telles conventions sont dans l'intrt des
investisseurs car elles leur apportent des profits phnomnaux.
En une matire si fortement incertaine et indtermine, il est
dans la nature des choses sociales que l'opinion qui finisse par
l'emporter soit celle qui satisfasse les intrts des protagonistes.
Il ne s'agit nullement d'un processus conscient de slection,
mais d'une dynamique d'essais et erreurs qui, infine, conduit
ce que le march se focalise sur la croyance qui sert le mieux
sa prosprit. Une fois qu'a merg une telle croyance haus-
sire, savoir une fois que le march a pu constater son apti-
tude effective crer massivement de la richesse, il en
soutiendra la lgitimit contre les critiques, d'o qu'elles
viennent. Cette convention haussire aura ds lors la dure pour
elle et, consquemment, produira une forte hausse des cours.
Notre analyse montre que l'aveuglement face au dsastre
2
ne
manquera pas de prvaloir. Aucune force de rappel mcanique
ne viendra en limiter l'ampleur. Deux arguments vont dans ce
sens.
Le premier argument, le plus important conceptuellement, se
base sur l'incertitude propre l'valuation financire. Lorsque
des voix discordantes s'lvent et plaident pour la prudence en
mobilisant l'exprience passe, les partisans de l'euphorie sp-
culative font valoir qu'il n'y a pas lieu de s'inquiter. Ils sou-
tiennent que les enseignements du pass sont dsormais caducs
pour une large part parce que le monde est entr dans une
nouvelle re , ce qui justifie des rgles d'valuation nou-
1. Par exemple la convention Nouvelle conomie ou encore la conven-
tion miracle asiatique. Se reporter au Pouvoir de lafinance, dans la section
intitule Quelques exemples de conventions d'interprtation (op. cil.,
p. 145-166.
2. Se reporter Andr OrIan, Les croyances montaires et le pouvoir
des banques centrales , in Jean-Philippe Touffut (dir.), Les Banques centrales
sont-elles lgitimes ?, Paris, Albin Michel, 2008.
302
LIQUIDIT ET SPCULA TION
velles '. Autrement dit, ce qui a t observ avant ne vaut plus.
On retrouve ici, trs exactement, notre propre analyse tho-
rique : le monde social n'est pas stationnaire et l'infrence sta-
tistique n'offre donc pas de certitude. Chaque situation est
potentiellement nouvelle et doit tre analyse sous cet angle.
C'est un argument fort car fond sur une vrit incontestable. Il
est d'autant plus convaincant que la situation considre pr-
sente des innovations significatives justifiant la thse d'une
transformation radicale de l'ordre conomique
2
L'illustration la
plus exemplaire nous en est donne par la bulle Internet. Les
partisans de la hausse ont fait valoir que la rvolution informa-
tique avait modifi en profondeur les mcanismes conomiques,
rendant obsoltes les rgles traditionnelles de l'valuation bour-
sire. Nous tions entrs dans une nouvelle re . On retrouve
une ide similaire au moment de la spculation sur les chemins
de fer: Nous voil justifis d'attendre l'arrive d'un temps o
le monde entier sera devenu une seule famille, parlant une seule
langue, gouvern par les mmes lois et adorant un seul Dieu
3
,
pensent les gens de cette poque, ce qui justifie des prises de
risque inconsidres. Cet argument d'un capitalisme transform
est de nouveau trs rpandu durant la priode 2000-2007. C'est
ce que l'on a appel la grande modration , savoir l'ide
selon laquelle les conomies dveloppes seraient devenues
moins instables et donc plus sres. On serait entr dans une re
de risque faible et de hauts rendements, ce que venaient
d'ailleurs confirmer les records historiques observs en matire
de spread ou de volatilit. L'important mouvement d'innova-
tions financires qu'a connues cette priode venait conforter cette
vision. La titrisation aurait rendu le capitalisme structurellement
1. R. J. Shiller, Irrational Exuberance, Princeton (New Jersey), Princeton
University Press, 2001, p 96-117.
2. Charles Kindleberger reconnat l'importance des innovations au travers
de ce qu'il appelle displacements (dans Manias, Panics, and Crashes. An
History of Financial Crises, Londres-Basingstoke, The Macmillan Press Ltd,
1978, p. 41-45).
3. Edward Chancellor, Devi! Take the Hindmost. An History of Financial
Speculation, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1999, p. 126.
303
L'EMPIRE DE LA VALEUR
plus stable, d'une part en diffusant largement le risque immobi-
lier chez un grand nombre d'investisseurs au lieu de le mainte-
nir concentr chez les metteurs primaires du crdit, et d'autre
part en permettant que des investisseurs mieux mme de
l'assumer puissent le dtenir:
Ces nouveaux acteurs ayant une gestion du risque et des pers-
pectives d'investissement diffrentes aident attnuer et absor-
ber les chocs qui, dans le pass, affectaient essentiellement
quelques intermdiaires financiers importants 1.
Cet argumentaire est partout prsent avec une constance
remarquable. Il a justifi une grande confiance dans les nou-
veaux produits.
Le deuxime argument pour contrer les voix discordantes
repose sur la puissance suppose du nombre contre l'opinion
de quelques individus isols. Ce que l'on peut encore appeler
la sagesse des foules . Autrement dit: qui sont-ils pour
s'opposer au march? Comment un individu seul pourrait-il
avoir raison contre une multitude d'acteurs rationnels? Cette
ide tire une grande partie de sa lgitimit de la thorie de
l'efficience qui soutient que le march, en tant qu'il agrge de
trs nombreuses informations, est bien suprieur n'importe
quelle personne particulire, aussi informe soit-elle. Il faut
donc s'en remettre au march et se mfier des analyses mino-
ritaires.
L'ensemble de cette analyse montre quelle puissance est der-
rire la convention haussire : la puissance coalise des intrts
financiers investis dans la bulle. Elle est d'autant plus forte que
les conseils de prudence qui lui sont opposs ne peuvent se pr-
valoir d'aucune certitude. Que peut une simple prsomption
contre la vigueur et l'clat de la russite? La partie est trop
dsquilibre. Il s'ensuit que la capacit du systme financier
se corriger lui-mme est quasi nulle. Sur ce point, les faits sont
sans ambigut. Dans le cas de la crise des subprimes, il a fallu
1. Fonds montaire international, Global Financial Stability Report,
avril 2006, p. 51.
304
LIQUIDIT ET SPCULATION
attendre dbut 2007, avec le retournement effectif du prix de
l'immobilier et les niveaux inquitants de dfaut sur les crdits
subprimes, pour que les esprits voluent. Comme dans tous les
cas tudis, la capacit anticiper l'obstacle pour l'viter s'est
rvle trs faible. notre sens, cela ne tient pas des
erreurs commises par les agences de notation. En la matire,
elles n'ont fait que se conformer aux croyances de leur milieu,
relayes par les voix les plus minentes. D'autres agences
auraient fait de mme ou, si elles s'taient conduites autrement,
elles auraient perdu leurs clients. Il en est ainsi parce que cet
aveuglement n'a rien d'un fait psychologique, il rsulte des
contraintes propres au j eu financier. C'est bien ce que dmontre
toute l'histoire financire: aucune crise n'a t vite de cette
manire. Cela n'a rien voir avec une suppose irrationalit, ou
cupidit, des hommes de la finance. Entre le profit immdiat
que propose la continuation de la hausse et l'ide d'une possible
catastrophe, il y a toute la distance existant entre la puissance et
l'impuissance. La lutte est par trop ingale entre un intrt futur,
c'est--dire hypothtique et virtuel, et l'intrt prsent qui, lui,
se fait connatre sur le mode impratif]. Ds lors qu'autour de
vous, tout vous pousse agir conformment ce que votre
intrt immdiat vous dicte, les acteurs ne peuvent rsister.
Comment un grant de sicav, en pleine bulle Internet, aurait-il
pu conseiller d'viter le secteur des nouvelles technologies? Il
aurait immdiatement perdu tous ses clients. Qui plus est, celui-
l mme qui est conscient du caractre draisonnable de la
hausse n'a nul intrt la stopper. Son intrt est au contraire
d'enjouer aussi longtemps que possible. De nouveau, cette ana-
lyse dmontre qu'aucune force de rappel n'est prsente sur les
marchs financiers, qui viendrait en rguler les excs. La
concurrence financire est d'une nature spcifique, fondamenta-
lement instable.
1. Andr Orlan, L'aveuglement au dsastre , Esprit, nO 343, mars-avril
2008, p. 12.
305
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Liquidit et convention: une synthse
La troisime partie a dmontr pourquoi concurrence finan-
cire et concurrence ordinaire rpondent des logiques distinctes,
aux proprits contrastes. Sur les marchs de biens, deux
groupes aux intrts opposs se font face, les producteurs et les
consommateurs. Les premiers, qui sont offreurs de biens, sou-
haitent des prix levs, alors que les seconds, qui sont demandeurs,
luttent pour des prix bas. Cette opposition, parce qu'elle produit
des forces de sens contraire, stabilise les prix conformment la
loi de l'offre et de la demande. Sur les marchs secondaires de
titres, rien de semblable ne s'observe. Les propritaires d'actifs
partagent tous le mme dsir d'un rendement lev. Il n'existe
pas structurellement, d'un ct, des acheteurs et, de l'autre, des
vendeurs, mais des investisseurs qui sont alternativement offreurs
ou demandeurs au gr de leur besoin de liquidit. Pour sauver,
dans ces conditions, la loi de l'offre et de la demande, les cono-
mistes noc1assiques se sont prvalus d'une grandeur objective,
la valeur intrinsque des titres, suppose assurer l'ancrage des
cours boursiers dans une ralit extrieure au march et aux inte-
ractions. La prsence de cette valeur serait l'origine de forces
de rappel interdisant la drive des prix et conduisant l'effi-
cience. Ce modle rtroactions ngatives ne tient pas, ni thori-
quement parce que l'existence d'une telle grandeur objective
repose sur une hypothse errone quant la nature de l' incerti-
tude marchande, ce qu'on a nomm 1' hypothse probabiliste ;
ni empiriquement dans la mesure o les donnes fondamentales
se montrent incapables de rendre compte des volutions des
cours qu'on a pu observer. L'ide rpandue selon laquelle une
mme logique concurrentielle prsiderait l'change des biens
ordinaires comme celle des actifs doit donc tre rejete
l
. Deux
1. Cette ide a trouv sa conscration avec l'quilibre gnral, qui, grce
l'introduction des biens contingents, propose une intelligibilit de l'ordre mar-
chand intgralement construite autour du seul rapport aux objets. Se reporter
au chapitre Il.
306
LIQUIDIT ET SPCULATION
dynamiques distinctes doivent tre considres selon que
l'change porte sur l'utilit ou sur la liquidit. Il faut galement
abandonner l'hypothse d'une valeur intrinsque gouvernant la
dynamique des cours boursiers.
Un tel abandon modifie en profondeur notre comprhension
de la finance de march. Rejeter l'existence d'une valorisation
objective des titres bouleverse nos habitudes de pense les
mieux ancres et ouvre des voies d'interprtation qui n'ont
jamais t explores. Le prix n'est plus l'expression d'une gran-
deur dfinie en amont des jeux marchands mais une cration sui
generis de la communaut financire en qute de liquidit. Telle
est notre thse centrale. Elle a pour fondement la notion de
liquidit dj rencontre au chapitre IV.
Un objet est rendu liquide par le fait qu'un groupe le recon-
nat comme constituant une expression lgitime de la valeur.
Chaque membre de ce groupe l'accepte dans l'change en tant
que pouvoir d'achat , ou moyen de rglement, pour autant
qu'il anticipe qu'il sera accept par les autres sur ces mmes
bases. En ce sens, la liquidit ne renvoie pas une substance
mais une croyance conventionnelle. Un tel lien ne peut se fon-
der que sur la base d'une solide confiance collective. La pola-
risation mimtique nous en livre le concept. Cette logique a t
analyse en dtail pour ce qui est de la monnaie. Elle donne
voir la forme absolue de la liquidit: Comme reprsentant
universel de la richesse matrielle, l'argent est sans limite parce
qu'il est immdiatement transformable en toutes sortes de mar-
chandises 1. Les titres en circulation dans la sphre financire
constituent galement une forme de liquidit, mais une liquidit
subordonne qui a pour origine l'quivalence avec la monnaie,
et non l'accs direct aux marchandises. La condition pour que
l'investisseur accepte de dtenir le titre est qu'il lui soit possible
de le revendre un prix acceptable. Il s'ensuit une configuration
autorfrentielle dans laquelle les acteurs sont focaliss sur le
march lui-mme et ses volutions prvisibles. Mais comment
tre sr que le titre puisse tre revendu des conditions
1. Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 108.
307
L'EMPIRE DE LA VALEUR
acceptables? Comme dans le cas de la monnaie, il est impos-
sible d'tre absolument sr: rien ne garantit que, demain, le
titre pourra tre revendu, de mme qu'aucune certitude n'existe
quant l'acceptation future de la monnaie. Il s'agit d'une ques-
tion de confiance quant au comportement collectif, ce que nous
avons nomm le croire en . On peut cependant se montrer
plus spcifique pour ce qui est des marchs financiers: il s'agit,
pour les investisseurs, de croire en la justesse du prix. Prati-
quement, ce croire en)) a pour objet la convention d'valua-
tion qui, durant une priode donne, structure la formation des
prix financiers 1
Cette analyse conforte ce qui a t dit propos des biens
liquides dans les chapitres prcdents. merge, ce faisant, un
modle concurrentiel fort diffrent de celui traditionnellement
mis en avant par les conomistes lorsqu'ils analysent le rapport
des individus l'utilit. La mise en exergue de ce modle de la
liquidit, si particulier dans sa dynamique comme dans ses qui-
libres, est, nos yeux, l'un des apports du prsent livre. Son
point de dpart est une configuration autorfrentielle d'inter-
actions dans lesquelles chacun recherche ce que les autres
dsirent, sur le modle des jeux de pure coordination
2
)). On
reconnat ici ce que nous avons nomm au chapitre II, la suite
I. Il est possible de distinguer la convention d'valuation stricto sensu,
telle qu'elle a t dfinie prcdemment, et une mtaconvention portant sur
l'aptitude gnrale du march produire des prix justes. C'est ce que nous
avons propos dans Le Pouvoir de la finance (op. cil.) qui distingue la
convention de continuit et la convention d'valuation . Cette distinc-
tion n'est pas fondamentale. Son intrt vient principalement du fait que,
lorsque Keynes parle de convention financire au chapitre XII de la Thorie
gnrale de l'emploi, de l'intrt et de la monnaie (op. cit.), il pense ce que
nous nommons convention de continuit .
2. Dans les jeux considrs par Schelling comme dans ceux analyss par
Mehta, Starmer et Sugden, les gains sont identiques dans tous les quilibres.
Cette hypothse doit tre leve la manire de ce que nous avons considr,
au chapitre II, lorsque deux langues, dont une est plus performante que l'autre,
entrent en comptition. De mme chez Brian Arthur (<< Competing Technolo-
gies: An Overview, art. cit.), Robert Boyer et Andr Orlan (<< How do
Conventions Evolve ? , art. cit.) et Paul David (<< Clio and the Economies of
QWERTY , American Economic Review, vol. 75, n 2, mai 1985).
308
LIQUIDIT ET SPCULATION
de Ren Girard, la mdiation interne' : un processus rivali-
taire rtroactions positives entre individus mimtiques. Il a t
montr que la rationalit, dans une telle configuration, se porte
sur les objets saillants, c'est--dire ceux propres tre copis
par le plus grand nombre. Ces interactions se stabilisent via une
croyance collective qui tablit conventionnellement la valeur de
ce qui est lu, ce par quoi cette valeur est mise provisoirement
hors de porte des acteurs. Ce phnomne d'auto-extriorisation
transforme en profondeur le groupe puisque, pour se coordonner
avec autrui, il n'est plus ncessaire d'imiter tel ou tel. Il suffit
dsormais de s'en remettre au comportement conventionnel. La
mdiation externe se substitue la mdiation interne. Le mim-
tisme demeure, mais il est dsormais focalis sur un mme
modle commun de sociabilit et de valeur, institu en surplomb
des interactions. la base de la monnaie, du titre ngociable
comme du chque, se trouve cette mme structure de nature
autorfrentielle : une adhsion collective qui se construit par-
tir d'anticipations individuelles portant sur le comportement du
groupe. En ce sens, la logique de la liquidit, qu'elle soit mon-
taire, financire ou bancaire, est fort diffrente de la logique de
l'utilit. La liquidit a pour objet une croyance durable portant
sur la valeur de la monnaie, du titre ngociable ou des monnaies
bancaires, alors que, du point de vue de l'utilit, le prix n'est
que la mesure de l'obstacle qui doit tre surmont pour obtenir
la valeur d'usage. Il n'a d'importance qu'instantane, au moment
de l'achat, en tant que dpense. Le prix d'une marchandise et le
prix d'un titre ont des natures diffrentes.
La similitude existant entre ces diverses liquidits est gale-
ment apparente dans le fait qu'elles produisent une intercon-
nexion des intrts pour tous ceux qui appartiennent leur
espace de circulation. C'est l la forme spcifique que prend la
sociabilit marchande, par laquelle les individus spars font
1. Il Y a mdiation au sens o le sujet est la recherche d'un modle.
Mais ce modle peut changer n fonction des interactions. Il est fluctuant.
Dans le cas des jeux de pure coordination, c'est peine si on peut encore par-
ler de mdiation au sens propre.
309
L'EMPIRE DE LA VALEUR
socit. La liquidit lie troitement les acteurs conomiques
entre eux. Il en est ainsi, en premier lieu, parce que la valeur du
bien liquide que dtient l'individu a dpend du comportement
des autres dtenteurs. Si les autres dtenteurs, pour une raison
ou une autre, ne veulent plus du bien liquide, sa valeur tombera
zro et l'individu a considr pourrait se retrouver ruin sans
avoir rien fait. En consquence, chaque acteur n'a d'autre choix
que d'tre constamment attentif au comportement du groupe
dont il dpend pour sa richesse. S'il anticipe une inquitude
venir, il est alors conduit vendre au plus vite car les premiers
vendeurs sont toujours ceux qui perdent le moins. Cette particu-
larit qui pousse vendre en premier rend possible ce qu'on
appelle les phnomnes de prophtie autoralisatrice : ds
lors que les individus craignent une possible dfiance, ils sont
amens vendre pour se protger, ce qui a pour effet de provo-
quer cette mme panique dont ils cherchaient se protger. La
simple crainte d'une crise peut produire la crise. Ce mcanisme
s'observe classiquement pour les banques de dpt
1
comme
pour les marchs financiers. De telles dynamiques ne sauraient
nous tonner. Elles ne sont que l'illustration du fait que la liqui-
dit repose sur une croyance conventionnelle. La liquidit dis-
parat quand cette croyance est mise en doute. Certains
s'opposent cette manire de voir en faisant observer que
l'acceptation du titre, comme celle du chque, repose sur la
garantie d'une valeur objective, soit la valeur fondamentale des
titres, soit la couverture en monnaie centrale pour les dpts
vue. Il n'en est rien. On a dj vu ce qu'il fallait penser de la
valeur objective des titres. Il en va de mme pour les dpts. Ils
ne sauraient tre garantis 100 %. Seules les premires
demandes de remboursement peuvent tre intgralement satis-
faites. Si la garantie a un rle jouer, ce n'est pas en tant que
garantie objective mais en tant qu'elle favorise la perptuation
d'un climat de confiance.
1. Se reporter au fameux article de Douglas W. Diamond et Philip H. Dyb-
vig, Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, Journal of Political
Economy, vol. 91, nO 3, 1983.
310
LIQUIDIT ET SPCULATION
Si on reprend la comparaison entre liquidits et langues pro-
pose au chapitre II, on est conduit voir dans les liquidits
subordonnes ce qu'on peut nommer des patois , savoir des
langues locales, parles par des groupes spcifiques. Cette com-
paraison est intressante par le fait que la valeur d'un patois, sa
puissance de rayonnement, n'est pas chercher dans sa confor-
mit la langue nationale sur le modle de la convertibilit,
mais dans son dynamisme propre, sa capacit s'imposer large-
ment comme moyen de communication. Il en va de mme des
liquidits. Elles progressent en fonction du nombre d'acteurs
qui sont prts les accepter comme expression de la valeur. Ce
point est important. Il doit tre soulign 1. Il est ais com-
prendre pour ce qui est des monnaies bancaires. La chose est
plus subtile et moins classique pour les cours boursiers. Selon
cette analyse, la force du cours boursier dpend, non pas de sa
prtendue efficacit informationnelle, mais de son aptitude
s'imposer largement comme rfrence dans l'espace cono-
mique. Le capitalisme financiaris moderne, parce qu'il pousse
cette aptitude son maximum, nous en offre une illustration
exemplaire: tous les comportements, qu'ils soient de consom-
mation, d'investissement, de production, d'pargne ou de rpar-
tition, y mettent en jeu cette variable. Il n'est que de penser la
valeur actionnariale pour la gestion des entreprises; aux stock-
options pour le calcul des rmunrations; l'effet richesse pour
la consommation. C'est parce qu'il s'insinue dans toutes les
pratiques, dans toutes les dcisions, que le cours boursier
affirme sa puissance. Considrons titre d'exemple la norme
comptable dite de la fair value (juste valeur). Elle impose
que les actifs ne soient plus valoriss leur cot historique
d'achat, mais leur valeur de march. Par le biais de la dif-
fusion de cette norme comptable, le march financier voit son
emprise sur les comportements conomiques s'accrotre. Il
1. D'ailleurs, mcaniquement, l'ampleur des conversions exiges par le
souverain dcrot au fur et mesure que l'espace de circulation augmente. Se
reporter au Pouvoir de la finance, dans la section consacre La liquidit
(op. cit., p. 130-138).
311
L'EMPIRE DE LA VALEUR
s'affirme ce faisant comme le lieu lgitime de la valorisation.
On se souvient que, en octobre 2008, cette norme comptable a
d tre amende car son maintien intgral aurait oblig les
banques constater des dprciations qui auraient pes forte-
ment sur leurs capitaux propres et les auraient empches de
respecter les ratios prudentiels 1. Pour viter ces faillites, il a
fallu restreindre l'usage de la juste valeur. Cet exemple est
reprsentatif d'un mode d'action qui est proprement conven-
tionnel en tant qu'il a pour fondement la capacit de la liquidit
s'imposer comme une rfrence pour les comportements co-
nomiques.
Il rsulte de cette analyse que la liquidit merge comme un
concept crucial permettant de rendre intelligible une large
gamme de phnomnes, montaires, financiers
2
et bancaires. Ce
qui est en jeu dans tous ces phnomnes, c'est la reconnaissance
,sociale de la valeur au sein d'une communaut particulire. Cet
accord ne rsulte pas d'un contrat mais de la constitution sui
generis d'une puissance propre au groupe considr, selon le
modle de la confiance conventionnelle. La production de cette
rfrence commune procde selon une mme dynamique
rtroactions positives conduisant aux mmes proprits: unani-
mit, multiplicit des quilibres, indtermination, inefficacit,
dpendance par rapport au chemin, non-prdictibilit. Il faut
cependant souligner qu'on ne peut mettre sur le mme plan ces
trois liquidits prcites. La liquidit montaire, en tant qu'elle
dfinit l'espace marchand originel, possde un pouvoir d'attrac-
tion qui demeure suprieur aux deux autres.
1. Bernard Colasse, IFRS : Efficience versus instabilit, Revue fran-
aise de comptabilit, n 426, novembre 2009.
2. Financier au sens large, y compris les marchs de matires premires.
Conclusion gnrale
Dans ses travaux, Charles Malamoud, spcialiste de l'Inde
vdique, insiste sur le fait que, dans la socit qu'il tudie, les
rites servent de modles 1 )) aux relations profanes. Ainsi, la
dakshin, le paiement du prtre sacrificiel, sert-elle de modle
au salaire
2
)). L'acte rituel est l'pure et le modle de l'acte
organis, compliqu, qui connat des articulations
3
)) Il fournit
des principes, des schmas interprtatifs et une terminologie
pour analyser et organiser le monde profane
4
Les modles ))
que propose la thorie noclassique sont de cette mme nature.
Comme les rites vdiques, ils sont indissociablement des
normes, des explications et des instruments. Ce faisant, ils
1. [ ... ] l'acte rituel est le modle mme de l'acte (Charles Malamoud,
Le paiement des actes rituels dans l'Inde vdique , in Michel Aglietta et
Andr Orlan (dir.), La Monnaie souveraine, op. cit., p. 38).
2. Dans Terminer le sacrifice , cit par Mark Anspach (<< Les fonde-
ments rituels de la transaction montaire, ou comment remercier un bour-
reau , in Michel Aglietta et Andr Orlan (dir.), La Monnaie souveraine, op.
cit., p. 70).
3. Charles Malamoud, Finance et monnaie, croyance et confiance; le
paiement des actes rituels dans l'Inde ancienne , in Michel Aglietta et Andr
Orlan (dir.), Souverainet, Lgitimit de la monnaie, Paris, Cahiers Finance,
thique, Confiance , Association d'conomie financire, 1995, p. 103.
4. C'est bien la structure du rite qui fournit ses schmas et une partie de
sa terminologie l'action profane (Charles Malamoud, Le paiement des
actes rituels dans l'Inde vdique , art. cit., p.46). Ou encore: Souvent,
quand on essaie d'expliquer et d'analyser un ensemble complexe d'actions, on
s'efforce de le prsenter comme un analogue de ce prototype qu'est le sacri-
fice et d'y reconnatre les combinaisons d'actes, de personnages et de subs-
tances matrielles qui constituent le sacrifice (ibid., p. 38).
313
L'EMPIRE DE LA VALEUR
mlent trois finalits qui demandent tre distingues : dire ce
qui doit tre, dire ce qui est, et construire le monde. Toute la
difficult est dans ce mlange des genres sans quivalent du
ct des sciences de la nature. En fait, l'conomie s'intresse
moins ce qui est qu' ce qui devrait tre', comme en tmoigne
sa propension avre se focaliser sur des formalismes dcon-
nects de tout fondement empirique, ce que Edmond Malinvaud
nomme des modles abstraits pour des conomies ima-
ginaires
2
La rencontre entre Leonard Savage et Maurice
Allais, Paris, en 1952, l'occasion d'un colloque sur l'incer-
titude, illustre de manire exemplaire le rapport difficile des
conomistes aux faits. L'enjeu du dbat tait le critre de choix
propos par Savage pour slectionner plusieurs actions aux
consquences incertaines 3. Allais veut dmontrer que le critre
de Savage n'est pas conforme au comportement de l'homme
rationnel
4
Montrer cela n'a rien d'vident, car ce critre met en
jeu des estimations subjectives qui chappent en grande partie
l'observateur extrieur. En consquence, face au choix entre
une action A et une action B, il est possible que certains pr-
frent A quand d'autres prfrent B, sans que cela n'implique
nullement que l'un ou l'autre des deux groupes agisse d'une
manire errone. La diversit des dcisions rsulte simplement
1. propos de l'conomie, Durkheim crit: Ces spculations abstraites
ne constituent pas une science proprement parler puisqu'elles ont pour objet
de dterminer non ce qui est [ ... ] mais ce [qui] doit tre (Rgles de la
mthode sociologique, op. cif., p. 26).
2. Edmond Malinvaud (<< Pourquoi les conomistes ne font pas de dcou-
vertes?, Revue d'conomie politique, vol. 106, nO 6, novembre-dcembre
1996, p.939). Il ajoute: [ ... ] j'ai le sentiment [que les conomistes] sont
souvent trop lous pour un travail initial sur des modles trs spciaux d'co-
nomies imaginaires [ ... ], tandis que les explorations plus utiles et pnibles de
l'adquation au monde rel ne retiennent gure l'attention.
3. Ce critre suppose de comparer les esprances d'utilit pour choisir
la plus grande. L'esprance d'utilit se calcule comme une moyenne des uti-
lits pondre par les probabilits subjectives. Elle introduit deux estimations
subjectives: les utilits et les probabilits.
4. Voir Maurice Allais, Le comportement de l'homme rationnel devant
le risque: critique des postulats et axiomes de l'cole amricaine, Econome-
frica, vol. 21, nO 4, octobre 1953.
314
CONCLUSION GNRALE
de la diversit des points de vue quant l'utilit des cons-
quences ou la valeur des probabilits subjectives. Allais
dcouvre cependant un moyen astucieux pour contourner cette
difficult et tester la validit du critre. Il propose deux choix
simultans, d'une part, entre A et B, et, d'autre part, entre C et
D, qu'il a construits de telle sorte qu'un individu se conformant
au critre de Savage et prfrant A B prfrera ncessairement
C D, quels que soient par ailleurs ses penchants personnels 1
Lorsqu'un individu quelconque est confront ces choix, ce
lien logique sous-jacent n'est en rien apparent. Dans ces condi-
tions, que lui dicte son intuition
2
? Quel sera son choix effectif?
Pour le savoir, Allais procde empiriquement. Il runit une
population d'individus pris au hasard auxquels il pose les deux
questions: prfrez-vous A ou B ? Prfrez-vous C ou D? Le
rsultat obtenu est tonnant : Allais observe que les individus
qui prfrent A B prfrent majoritairement D C. Autrement
dit, le comportement observ est en pleine contradiction avec le
critre de Savage. C'est ce qu'on nomme le paradoxe d'Allais .
Il a t, par la suite, frquemment reproduit. Ce rsultat porte un
coup la position de Savage. Il dmontre que son critre ne
fournit pas une bonne description de la manire dont les indivi-
dus, dans la ralit, se comportent face l'incertain. Mais ce
1. Dans l'article de Maurice Allais (ibid.), on trouve la dfinition des dif-
frentes alternatives :
A : Certitude de recevoir 100 millions.
B : 10 chances sur 100 de gagner 500 millions; 89 chances sur 100 de
gagner 100 millions; 1 chance sur 100 de ne rien gagner.
C : Il chances sur 100 de gagner 100 millions; 89 chances sur 100 de ne
rien gagner.
D: 10 chances sur 100 de gagner 500 millions; 90 chances sur 100 de ne
rien gagner.
Comme on le note, les loteries proposes ne sont pas intuitives. Elles ont
t dfinies de faon ce que, pour qui se conforme au critre de Savage, pr-
frer A B entrane ncessairement de prfrer C D. La dmonstration
mathmatique de cette proprit est simple. Notons que les probabilits sont
ici des donnes. Elles sont objectives. Le critre de Savage englobe des situa-
tions pour lesquelles les probabilits sont estimes par les joueurs.
2. Ce choix n'est pas simple dans la mesure o la diffrence entre les
loteries met en jeu des vnements de faible probabilit, savoir 1 %.
315
L'EMPIRE DE LA VALEUR
n'est pas tout, car Allais n'a pas hsit soumettre Savage lui-
mme ce test. Il lui a prsent les deux choix et l'a interrog
sur ses prfrences, videmment sans rien dvoiler du lien
mathmatique sous-jacent. Allais a pris un gros risque car
Savage n'est nullement un individu quelconque. Savage a lon-
guement rflchi aux dcisions en situation d'incertitude et cette
rflexion aurait pu le conduire choisir conformment son
critre. Il n'en a rien t. Savage a rpondu comme la majorit
de la population: il a prfr A B et D C. Comble de l'iro-
nie, l'inventeur du critre se comporte d'une manire qui
contredit ses propres recommandations 1 !
Les expriences d'Allais sont sans ambigut: pour qui
cherche comprendre l'conomie telle qu'elle est, elles imposent
d'abandonner le critre de Savage pour lui substituer une
conception mieux adapte aux comportements observs
2
Or il
n'en a pas t ainsi. Contre l'vidence empirique, l'conomie a
maintenu le critre. Malgr les travaux de Allais, la maximi-
sation de l'esprance d'utilit reste le modle de base auquel
recourent massivement les conomistes pour dcrire le compor-
tement des individus rationnels face au risque. Cela est extrme-
ment rvlateur du rapport contourn que l'conomie entretient
avec les faits. Les durkheimiens, en leur temps, ont justement
insist sur ce point. Ils n'ont cess de souligner la lgret avec
laquelle les conomistes traitent des faits
3
Il faut ici citer lon-
1. Sur cet pisode, on peut se reporter Peter C. Fishburn, Reconsidera-
tions in the Foundations of Decision Under Uncertainty, The Economie
Journal, vol. 97, nO 388, dcembre 1987.
2. On notera que le critre de Savage est, en son origine, un critre norma-
tif et non descriptif. Cependant, il est bien utilis comme modle descriptif par
les conomistes, ce qui renforce encore nos propres conclusions quant au
mlange des genres pratiqu par les conomistes: ils passent, sans diffi-
cult, d'un modle qui dit ce qui doit tre un modle suppos dire ce qui est.
3. Contre ce point de vue, on peut faire valoir le dveloppement rcent de
l'conomie exprimentale. Plus largement, on peut souligner que de nombreux
conomistes contemporains laissent de ct le cadre conceptuel de la thorie
conomique pour ne retenir que ses mthodes quantitatives (conomtrie, sta-
tistiques ... ). Dans cette perspective, l'conomie ne serait plus qu'une boite
outils, sans parti pris interprtatif. Cette approche demande tre tudie
srieusement. Dans le cadre du prsent livre, j'en resterai une seule remarque:
316
CONCLUSION GNRALE
guement Franois Simiand, qui a consacr de nombreuses
rflexions aux questions de mthode en conomie 1 :
Au lieu que les abstractions de la mthode exprimentale font
un effort incessant pour se modeler ou se rgler sur la ralit
concrte, se soumettent sans cesse un contrle de correspon-
dance avec les faits et ne valent que dans la mesure o cette
correspondance se vrifie, les abstractions dont il s'agit [en
conomie] sont des ides, que l'esprit de l'auteur forme l'occa-
sion, sans doute, de certaines donnes objectives originelles,
mais qu'il forme librement, sans le souci immdiat d'une corres-
pondance avec les faits, qu'il dfinit, modifie, combine en se
gardant seulement de la contradiction formelle, mais sans proc-
cupation de la vrification exprimentale, et par sa seule facult
rationnelle de dduction, de prsomption, d'imagination
2
Simiand oppose cette dmarche qu'il qualifie de concep-
tuelle ou d' idologique
3
une approche qui se conformerait
au modle des sciences naturelles : [une approche qui aurait
pour finalit de faire] la thorie des phnomnes conomiques
pris objectjvement en eux-mmes et d'un point de vue cau-
sal
4
. Simiand s'insurge tout particulirement contre cette pra-
tique constante des conomistes consistant interprter l'cart
existant entre le modle et la ralit comme une dfaillance de
la ralit et non pas comme une erreur du modle! Peut-on
imaginer drive plus inquitante par rapport aux rgles lmen-
taires de la dmarche scientifique? Elle conduit au paradoxe
d'une science qui n'a pas produit de lois. Comme le dit Durk-
heim, celles qu'on a l'habitude d'appeler ainsi ne mritent
les faits ne se livrent jamais d'une manire brute et directe. Autrement dit,
toute mthode quantitative met en jeu des hypothses conceptuelles. Elle
impose un filtre. Aussi l'conomie exprimentale ne saurait-elle se substituer
entirement la rflexion thorique. La question centrale reste bien celle d'un
cadre alternatif d'intelligibilit.
1. On les trouve runies dans le recueil d'articles intitul Critique sociolo-
gique de ['conomie, Paris, PUF, 2006.
2. Franois Simiand, La monnaie ralit sociale , art. cit., p. 62.
3. Ibid.
4. Ibid., p. 77.
317
L'EMPIRE DE LA VALEUR
gnralement pas cette qualification, [elles] ne sont que des
maximes d'action, des prceptes pratiques dguiss
l
. Il en est
ainsi de la loi de l'offre et de la demande ou de la loi
d'Hotelling . Il ne s'agit en rien d'authentiques lois de la
nature la manire des lois de la physique. Elles ne disent nul-
lement ce qui est mais ce qui pourrait tre sous certaines condi-
tions. Au mieux, elles dcrivent des mcanismes plausibles.
Cependant, la vigueur de cette critique comme son bien-
fond ne doivent pas masquer sa totale impuissance. Malgr
leur pertinence, ces mises en garde ont t sans effet sur le des-
tin de la discipline, comme en tmoigne la diffusion exception-
nelle de la pense noc1assique. Comme l'crit le sociologue
Richard Swedberg, peu suspect de partialit en la matire :
Il est clair, aux yeux de la plupart des spcialistes, que la
science sociale la plus importante de notre temps est la science
conomique, plus prcisment le type d'conomie qui est habi-
tuellement qualifie de mainstream, dont le bastion le plus puis-
sant est aux tats-Unis
2
Comment expliquer un tel succs malgr de telles faiblesses?
Cette incapacit de la critique inflchir d'une quelconque
manire l'conomie est en soi un phnomne tonnant et para-
doxal qui demande une interprtation. nos yeux, l'erreur des
durkheimiens rside dans le fait de croire que sciences de la
nature et sciences sociales partagent une mme conception de la
scientificit, en consquence de quoi ils ont valu la russite de
l'conomie sur la base de son aptitude rendre intelligible le
rel, d'un point de vue causal . Assurment, sous cet angle,
l'conomie fait pauvre figure. Mais il est d'autres critres d'effi-
cacit que ceux mis en avant par la mthode hypothtico-
1. Rgles de la mthode sociologique, op. cil., p. 26. Il ajoute: [ces lois]
ne sont en somme que des conseils de sagesse pratique et, si l'on a pu [ ... ] les
prsenter comme l'expression mme de la ralit, c'est que, tort ou raison,
on a cru pouvoir supposer que ces conseils taient effectivement suivis par la
gnralit des hommes et dans la gnralit des cas (Ibid., p. 27).
2. Richard Swedberg, Une histoire de la sociologie conomique, Paris,
Descle de Brouwer, 1994, p. 77.
318
CONCLUSION GNRALE
dductive. L est la clef du succs de l'conomie. Pour le
comprendre, revenons la rencontre entre Allais et Savage
Paris en 1952.
Lorsque Allais montre Savage que son choix en faveur de
D invalide ses travaux les plus clbres, ce dernier ressent un
srieux choc psychologique. Il peroit immdiatement toute la
porte de son erreur. Il n'en conteste pas la ralit mais, aprs
quelque temps de rflexion, il rpond: Vous avez raison. J'ai
fait une erreur. Je suis tout fait sr de prfrer A B et je suis
tout fait sr qu'une personne qui prfre A B sera galement
plus heureuse avec C plutt que D. En consquence, je choisis
C au lieu de Dl. Cette rponse est surprenante. Savage y
dclare s'tre tromp mais n'hsite pas inverser son choix ini-
tial, affirmant dsormais prfrer C. Autrement dit, il s'en tient
fermement son critre et refuse la critique avance par Allais.
Quel mauvais joueur et quel menteur! , serions-nous tents
de nous exclamer, voil un individu qui n'accepte pas sa
dfaite et qui, par pur opportunisme, prtend maintenant prf-
rer C D. Telle n'est pas notre analyse. Pour le comprendre,
il faut commencer par noter que les choix A, B, C et D sont,
l'exception de A, des loteries complexes mettant enjeu des v-
nements de trs faible probabilit, savoir 1 %. Il n'est pas ais
a priori de dterminer celles que l'on prfre. Chacun se sentira
hsitant devant de tels choix. Or qu'est-ce que le critre de
Savage ? Le critre de Savage est une construction normative
qui a pour point de dpart un certain nombre de postulats
conformes l'intuition. Ils sont supposs tre aisment accep-
tables par tous les acteurs. Par exemple, le postulat de transiti-
vit selon lequel un individu qui prfre A B et B C doit
prfrer A C ne choquera personne. Le critre de Savage se
dduisant logiquement de ces postulats, toute personne qui y
adhre est rationnellement conduite approuver le critre. En
consquence, ayant pris conscience de la contradiction entre son
1. Cit par Steve Landsburg le 20 octobre 2010 dans Anecdotes, Econo-
mies, Puzzles and Rationality: http://www.thebigquestions.com/2010/10/20/
the-noble-savage/.
319
L'EMPIRE DE LA VALEUR
choix en faveur de D et son critre, Savage reprend son raison-
nement pas pas pour trouver la faille. Il commence, dans un
premier temps, par raffirmer sa prfrence pour A. Sur ce
point, son intuition est suffisamment solide pour qu'il ne la
remette pas en cause. Dans un deuxime temps, il note que, si
son critre est correct, alors toute personne prfrant A B doit
prfrer C D. Dans un troisime temps, il applique cette pro-
position lui-mme: puisqu'il croit effectivement en la justesse
de son ritre, il doit prfrer C D. Tel est le sens de sa nou-
velle rponse. Lorsqu'il compare la force de son intuition en
faveur du choix D la force de sa conviction en la pertinence
de son critre, c'est cette dernire qui l'emporte. Donc il choisit
C en toute bonne foi 1.
Assurment, cette manire de raisonner a sa cohrence. Il faut
cependant souligner qu'elle manifeste une transformation radi-
cale dans la nature et l'utilisation du critre de Savage. Dsor-
mais, ce critre intervient par le biais de l'adhsion dont il fait
l'objet; il influence directement les comportements individuels.
Ce faisant, on sort totalement du cadre des sciences de la nature.
C'est comme si la pierre qui tombe se rfrait directement la
loi de la gravitation pour dterminer sa trajectoire. Dans ces
conditions, ce n'est plus la gravit qui la meut mais son adh-
sion au modle newtonien. De la mme manire, le modle de
l'conomiste cesse d'tre une description objective de ce qui
est; il est devenu un guide pour l'action qui propose des
conseils aux acteurs. Son rle est d'autant plus souhait que la
situation est plus complexe. L'individu est heureux de trouver
de l'aide, surtout lorsque cette aide emporte l'adhsion parce
qu'elle prsente tous les dehors de la rationalit et de l'effica-
cit. Lorsque Savage revient sur cet vnement quelques annes
1. Leonard Savage, The Foundations of Statistics, op. cit., p. 103. Par
ailleurs, le mme type de test a t effectu sur des individus informs au pr-
alable du dbat entre AlIais et Savage. Cette information ne modifie pas les
rsultats. On observe toujours le paradoxe. Se reporter Peter C. Fishburn,
Reconsiderations in the Foundations of Decision Under Uncertainty , art.
cit., p. 838.
320
CONCLUSION GNRALE
plus tard, il justifie son geste en faisant valoir qu'il s'agissait de
corriger une erreur. Il crit:
Il me semble que, en inversant mes prfrences entre C et D,
j'ai corrig une erreur. videmment, en un sens important, mes
prfrences, parce qu'elles sont entirement subjectives, ne sau-
raient tre dans l'erreur - mais dans un sens diffrent, plus subtil,
elles peuvent l'tre. Permettez-moi de l'illustrer par un exemple
simple sans rfrence l'incertitude. Un homme achetant une
voiture pour 2 134,56 dollars est tent de la commander avec une
radio dj installe pour le prix total 2228,41 dollars, parce
qu'il ressent la diffrence comme insignifiante. Mais lorsqu'il
rflchit que, s'il avait dj la voiture, il ne dpenserait certaine-
ment pas 93,85 dollars pour une radio, il ralise qu'il a fait une
erreur).
Dans l'exemple de la voiture, l'erreur que commet l'individu
est classique. Il estime le prix de la radio comparativement au
prix de la voiture, alors que la seule chose qui importe est son
prix effectif. Peu importe que 93,85 dollars ne fassent que 4,3 %
du prix de la voiture, c'est toujours trop cher par rapport ce que
cela vaut. Ce type d'erreur est d'une nature similaire aux illu-
sions d'optique: l'acteur a l'impression que la radio ne cote pas
cher parce que, son insu, il la compare au prix de la voiture. Le
fait de dvoiler l'illusion ne modifie pas ncessairement la per-
ception de l'acteur, mais son cerveau sait que dsormais ses sens
le trompent. D'ailleurs, dans ce mme texte, Savage confesse
qu'il continue ressentir une attirance spontane pour le choix D,
dont son cerveau lui dit par ailleurs qu'il ne convient pas.
Cet pisode illustre parfaitement l'ambigut du discours co-
nomique. Dj, Franois Simiand, au dbut du xx
e
sicle, met-
tait en garde contre la prtention des conomistes dfinir le
vrai intrt des individus l o un partisan convaincu de la
dmarche scientifique s'attendrait trouver une explicitation de
ce que les individus considrent comme tant leur intre. Ces
1. Leonard Savage, The Foundations of Statistics, op. cit., p. 103.
2. [ ... ] [L'conomiste] assigne pour tche la science conomique de
dterminer ['intrt vrai des hommes [ savoir ce que l'conomiste juge tre
321
L'EMPIRE DE LA VALEUR
faits montrent quel point la thse de l'unit de la science,
chre Karl Popper, et selon laquelle sciences de la nature et
sciences sociales partageraient une mme pistmologie, est
errone. Les sciences sociales sont spcifiques par le fait
qu'elles influencent directement la ralit qu'elles tudient.
D'ailleurs, comment peut-on soutenir que l'conomie est une
science comme une autre et, en mme temps, constater qu'elle
n'a jamais exhib aucune de ces lois par lesquelles la scientifi-
cit traditionnelle se fait classiquement reconnatre? En guise
de rponse, certains invoquent la jeunesse de cette discipline.
Mais, outre que l'argument est factuellement faux, il passe
entirement ct du vrai problme qui est dans la singularit
mme de son projet scientifique. Dans l'exemple propos, le
choix en faveur du critre de Savage dmontre clairement que
les conomistes n'ont pas pour finalit prioritaire de com-
prendre les faits tels qu'ils sont. Bien plus importante leurs
yeux est la mission ducative de l'conomie. Lutter contre les
illusions d'optique des acteurs est son mot d'ordre. L'cono-
miste est essentiellement un tuteur qui fait advenir une ralit
conforme son modle. La priode actuelle offre une infinit
d'exemples de cette implication de l'conomie dans la transfor-
mation du monde. C'est particulirement vrai de la financiarisa-
tion qui a trouv dans la thorie de l'efficience son meilleur
alli et son meilleur argumentaire. Face cette situation, on
serait tent de dire, rebours de Marx, que les conomistes
jusqu' maintenant ont eu trop tendance transformer le
monde, et qu'on souhaiterait dsormais qu'ils prennent plus de
soin l'interprter. C'est l un des buts de notre projet de
tel]. Si elle tudie l'intrt putatif [c'est--dire ce que les intresss eux-
mmes jugent tre leur intrt], c'est pour en tablir l'erreur; et pas un
moment il ne semble lui tre venu l'ide que la science conomique aurait
peut-tre plutt pour objet premier et essentiel d'tudier l'intrt des hommes
tel qu'ils l'entendent en fait, et non pas tel qu'il nous parat [ ... ] qu'ils
devraient l'entendre, et qu'avant de dclarer que cet intrt tel que l'entendent
les hommes est une erreur, elle devrait commencer par le comprendre et
l'expliquer, et mme que c'est l sa tche propre (Franois Simiand, La
mthode positive en science conomique , art. cit., p. 83).
322
CONCLUSION GNRALE
refondation : proposer une approche conomique qui soit plus
attentive aux faits parce qu'elle se donne pour priorit la com-
prhension de ce qui est. Cette mutation est essentielle.
En rsum, cette analyse prend acte du fait que le rapport
la ralit des sciences sociales se dcline selon deux modalits :
en tant qu'elles s'efforcent de rendre intelligible le monde et en
tant qu'elles proposent des conseils visant le transformer. Il
s'ensuit deux critres d'valuation concurrents, selon qu'on
juge une proposition sur la base de sa capacit penser les faits
tels qu'ils sont, ou qu'on la juge sur la base de sa capacit
changer efficacement le monde. Dans la mesure o l'aptitude
d'une ide agir sur le monde suppose une certaine adqua-
tion la ralit - faute de quoi l'ide resterait virtuelle -, cer-
tains ont pu dfendre que ces deux critres sont moins
contradictoires qu'il n'y parat. Il faut pourtant repousser une
telle analyse. L'exprience est sur ce point sans ambiguYt : la
mise en uvre d'une ide est fonction des intrts qui la
dfendent et des convictions qu'elle suscite, toutes choses
n'ayant que le rapport le plus lointain sa vrit intrinsque.
La priode rcente nous en fournit une illustration exemplaire.
Il est certain que les immenses intrts qu'a engendrs la finan-
ciarisation du capitalisme ont favoris, chez les conomistes,
une vision bienveillante l'gard de la finance de march qui
n'tait pas justifie et qui a conduit une drgulation catastro-
phique. Comment pourrait-il en tre autrement? Ds lors que
les sciences sociales sont parties prenantes des affaires du
monde, elles ne peuvent manquer de susciter l'intervention
d'intrts extra-scientifiques qui chercheront en modifier les
analyses leur profit. C'est la loi commune. Il importe que les
conomistes en soient conscients 1 et qu'ils se donnent des
rgles mme de protger au mieux l'autonomie de leur
1. Les conomistes montrent une extrme rticence admettre que leurs
travaux puissent tre influencs par des pouvoirs extra-acadmiques. C'est une
rticence bien naturelle qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les communauts
scientifiques. Ce qui rend le cas des conomistes particulier est le fait que, par
ailleurs, leurs analyses sont fondes sur le primat de l'intrt. Ils ne devraient
pas penser qu'eux-mmes y chappent.
323
L'EMPIRE DE LA VALEUR
discipline 1. Si cette question dpasse le cadre de la prsente
rflexion, il en est cependant une autre, troitement lie, qui est,
quant elle, au centre des proccupations de notre livre: en
quoi l 'hypothse de la valeur utilit favorise-t-elle cette propen-
sion de l'conomie ngliger les faits pour rflchir des
mondes imaginaires? Et en quoi, l'approche montaire pro-
pose comme alternative vite cette drive?
Pour rpondre ces questions, il importe de comprendre que
ces deux approches n'ont pas la mme conception du rapport
la ralit. En disant cela, nous ne voulons pas dire qu'elles sont
en dsaccord sur les faits eux-mmes. La question n'est pas l.
Le rel que la science considre va au-del des faits constats
pour englober tout vnement qui est compatible avec les lois
rgissant le monde, mme si cet vnement ne s'est pas ralis
et demeure simplement l'tat de possible. Selon cette accep-
tion, est rel tout ce que les forces l'uvre dans le monde sont
susceptibles de produire. Le dsaccord essentiel entre les deux
approches porte prcisment sur la nature de ces forces. Pour
l'approche noclassique, il n'existe qu'une seule force agis-
sante: l'individu qui veut quelque chose parce que ce quelque
chose lui est utile. Son modle de base est celui du consomma-
teur en qute de marchandises tel qu'on l'observe l'origine de
la thorie marginaliste de la valeur. Tout au long du prsent
livre, nous nous sommes efforcs de montrer qu'on ne pouvait
pas s'en tenir aux seules volonts individuelles: l'activit co-
nomique met galement en jeu des puissances collectives qui
viennent dicter aux individus ce qu'il convient de faire. La mon-
naie nous en fournit l'illustration paradigmatique. Le dsir
qu'elle suscite ne rsulte en rien d'une utilit intrinsque qui
serait recherche pour elle-mme. Il est une construction sociale
qui trouve son origine dans la puissance de la multitude telle
qu'elle est engendre par la polarisation mimtique. Ce dsir
connat sa propre logique. Pour cette raison, les miracles
montaires tudis au chapitre V chappent au modle indivi-
1. Se repgrter Nicolas Postel, Le pluralisme est mort, vive le plura-
lisme ! , L'Economie politique, nO 50, avril 20 Il.
324
CONCLUSION GNRALE
dualiste de l'action rationnelle. Ils donnent voir la prsence de
reprsentations collectives autonomes qui modlent les anticipa-
tions des acteurs, pouvant les conduire soit rechercher plus de
monnaie, soit la refuser. Du point de vue de la macroconomie
standard, ces phnomnes se traduisent par une forte instabilit
de la demande de monnaie. L'conomie noc1assique s'est
jusqu' maintenant refuse prendre en considration de telles
forces collectives 1. Elle ne connat que des volonts indivi-
duelles mues par l'utilit. De ce point de vue, il faut dfinir les
conomistes noclassiques comme les spcialistes de cette force
particulire qu'est l'action rationnelle, dont ils inventent sans
cesse de nouvelles configurations. Est relle leurs yeux toute
dynamique mettant en scne des individus poursuivant ration-
nellement leur intrt. Il s'ensuit une conception trs large de la
ralit. En ce sens, le march walrassien de concurrence pure
et parfaite est bien rel, non pas en tant qu'il existerait factuel-
lement des marchs fonctionnant conformment son principe,
mais en tant que le mcanisme walras sien est conomiquement
viable et peut fonctionner. Il en dcoule que le critre d'adqua-
tion au rel d'un modle repose, non pas sur sa conformit ce
qui est, mais sur la possibilit de le faire fonctionner. Non pas
une confirmation par l'observation, mais par la fabrication.
1. Sur ce point, la citation de Edward Lazear est fort claire: Le point de
dpart de la thorie conomique est que l'individu ou la firme maximise
quelque chose, habituellement de l'utilit ou du profit. Les conomistes,
presque sans exception, font de la maximisation la base de toute thorie.
Nombre de nos analyses empiriques visent tester des modles qui sont fon-
ds sur un comportement maximisateur. Quand nous obtenons des rsultats
qui semblent dvier de ce qui apparatrait comme la conduite individuelle
rationnelle, nous rexaminons les preuves et rvisons la thorie. Mais ces
rvisions thoriques n'cartent presque jamais l'hypothse selon laquelle les
individus maximisent quelque chose, mme si ce quelque chose n'est pas
orthodoxe. Peu d'conomistes sont prts admettre que les individus simple-
ment ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons permettre une information
imparfaite, des cots de transactions et d'autres variables qui rendent les
choses plus floues, mais nous ne modlisons pas de comportement qui soit
dtermin par des forces au-del du contrle de l'individu (<< Economic
Imperialism , Quarterly Journal of Economies, vol. 115, nO l, fvrier 2000,
p.lOO).
325
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Dans cette analyse, l'conomie est apprhende la manire
d'un jeu de Lego, constitu de briques lmentaires qui peuvent
tre dplaces, sans tre altres, donnant naissance des confi-
gurations d'interactions plus ou moins complexes. L'cono-
miste n'intervient qu'en aval, sur le dessin des interactions, de
faon permettre une ralisation plus efficace des intrts indi-
viduels, sans modifier ceux-ci. Pour que le mcanisme fonc-
tionne, il suffit de laisser les individus agir librement. Pensons,
titre d'exemple, la construction du march walrassien
Fontaines-en-Sologne
l
ou la lgitimation des stock-options de
faon aligner les intrts de la direction d'entreprise sur ceux
des actionnaires. La gouvemementalit conomique est fonde
sur cette modalit spcifique de contrle des conduites indivi-
duelles qui consiste miser sur les intrts
2
Cependant, comme
on l'a vu, les transformations que l'conomie noclassique pro-
voque peuvent conduire des catastrophes.
Si l'conomie noclassique fait valoir sa pertinence par le
biais de son aptitude transformer la ralit, il en va tout autre-
ment avec l'approche que propose le prsent livre. Son. point de
dpart n'est pas une axiomatique de la souverainet individuelle
mais l'tude des forces sociales qui produisent les valeurs. Trois
manifestations en ont t tudies : la raret, la monnaie et les
conventions financires. Elles sont l'origine, respectivement,
des valeurs d'usage, de la valeur marchande, et de la valorisa-
tion boursire. Parce que ces forces sont au-del de la matrise
des individus, il s'ensuit que cette approche entretient un rap-
port au rel trs diffrent de celui que promeut l'conomie no-
classique. L'conomiste ne saurait fabriquer ces forces, ni
l. Marie-France Garcia (dans La construction sociale d'un march par-
fait: le march au cadran de Fontaines-en-Sologne , Actes de la recherche en
Sciences sociales, nO 65, novembre 1986) montre comment les producteurs et
les distributeurs de fraises de cette localit franaise se sont mis d'accord, en
1981, pour construire un systme centralis d'enchres de faon dterminer
les prix.
2. Michel Foucault, Scurit, Territoire, Population. Cours au Collge de
France (1977-1978), Paris, Gallimard/Seuil, 2004, et Naissance de la biopoli-
tique. Cours au Collge de France (1978-1979), Paris, Gallimard/Seuil, 2004.
326
CONCLUSION GNRALE
mme les contrler, car elles chappent radicalement l'inten-
tionnalit individuelle 1. On ne peut que tenter d'en percer les
mystres par l'observation scientifique. Pour cette raison de
fond, cette approche privilgie l'tude des faits, qui est le seul
chemin pour accder l'intelligibilit de ces phnomnes. Pour
autant, elle ne ngligera pas l'analyse des interactions telles
qu'elles se dveloppent une fois les valeurs institues. C'est
pour cette raison que l'approche orthodoxe n'est nullement
rejete. En effet, ce qui est propre l'approche noc1assique, ce
qui la caractrise, est de supposer la question de la valeur rso-
lue avant mme que ne dbutent les interactions. Pour le dire
simplement, l'Homo conomicus, quand il entre en relation
avec autrui, sait parfaitement ce qu'il veut. Sa fonction-objectif
est dj dtermine comme le sont les qualits des objets autour
de lui. La seule question que l'individu doit alors rsoudre est
de savoir comment agir pour satisfaire au mieux ses intrts. Il
en dcoule un discours thorique qui saisit l'action conomique
du point de vue de la seule rationalit instrumentale. Cette
manire particulire d'aborder les relations sociales est explici-
tement revendique par de nombreux conomistes, comme en
tmoigne le succs que connat la dfinition de Lionel Robbins :
l'conomie est la science qui tudie le comportement humain
en tant que relation entre des fins et des moyens rares qui ont
des usages alternatifs
2
. Dtache de toute rfrence un
champ spcifique de phnomnes, cette dfinition ne retient
comme seul critre que le principe de l'action rationnelle instru-
mentale. Il n'existe aucune limitation quant l'objet de la
science conomique
3
, prcise Lionel Robbins. Comme le dit
Edward Lazear, la seule condition est que l'individu maximise
1. mon sens, tous ces efforts pour rduire l'intentionnalit collective
l'intentionnalit individuelle se sont solds par un chec. L'intentionnalit col-
lective est un phnomne biologique primitif qui ne saurait tre rduit ou li-
min en faveur de quelque chose d'autre (John Searle, La Construction de
la ralit sociale, Paris, Gallimard, 1998, p. 42).
2. Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Signijicance of Economic
Science, Londres, The Macmillan Press Limited, 1932, p. 15.
3. Ibid., p. 16.
327
L'EMPIRE DE LA VALEUR
quelque chose
l
. Pour l'analyser, l'conomiste a dvelopp
toute une panoplie d'instruments mathmatiques visant dter-
miner quelle stratgie satisfait au mieux le but recherch par
l'individu, compte tenu de ses diverses contraintes 2. La dext-
rit mathmatique que peut ncessiter le calcul de la stratgie
optimale sous contraintes ne doit cependant pas faire oublier
que, du point de vue de l'intelligibilit du monde conomique,
ce qui est vraiment important est de savoir ce qui fait que
l'individu poursuit telle finalit; autrement dit, la question du
sens de son action et des valeurs qui la gouvernent.
Ainsi interprt, le travail noclassique fournit de prcieuses
connaissances quant la dynamique en rgime de l'ordre mar-
chand, lorsque les qualits et les utilits sont dfinies. En cons-
quence, pour autant que les finalits individuelles se trouvent
dcrites d'une manire satisfaisante, il s'offre de nombreuses
applications: aide aux acteurs afin de dterminer la stratgie
optimale; aide aux dcideurs afin de faire advenir la solution
conforme au bien commun. La force de l'conomie noc1as-
si que est tout entire dans cette aptitude rpondre aux intrts
des uns et des autres. C'est aussi sa fragilit, dans la mesure o
ces mmes intrts vont en retour faire pression sur les analyses
conomiques pour les enrler leur service (patronat, syndicats,
pouvoirs publics ou mdias). Cependant, ne perdons pas de vue
que cette dmarche est fragile essentiellement pour des raisons
1. Edward Lazear, Economic Imperialism , art. cit., p. 100. Voir cita-
tion prcdente.
2. C'est ainsi que Gary Becker dfinit l'approche conomique comme la
combinaison des hypothses de comportement maximisateur, d'quilibre du
march et de stabilit des prfrences employe de manire ferme et dfini-
tive . Ce qui le conduit soutenir que l'approche conomique est une
approche globale qui peut s'appliquer tous les comportements humains
(The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, University of
Chicago Press, 1976, cit in Richard Swedberg, Une histoire de la sociologie
conomique, op. cif., p. 215-216). Lazear, pour sa part, associe comportement
maximisateur, quilibre et efficacit. Chez tous ces auteurs, l'conomie se
trouve dfinie, non pas substantiellement partir de la spcification des acti-
vits qui la constituent, comme l'avait propos Max Weber, mais bien partir
d'un modle conceptuel.
328
CONCLUSION GNRALE
d'un autre ordre, savoir pour des raisons d'une nature stricte-
ment thorique: parce qu'elle ne matrise pas les conditions de
sa validit. La thorie noc1assique repose sur des hypothses
institutionnelles implicites qui chappent au modlisateur. Dans
le cadre thorique troit qui a t considr, savoir une cono-
mie marchande
l
, il s'agit essentiellement de la question de la
liquidit. Le rapport utilitaire aux marchandises que dcrit
l'quilibre gnral a pour condition l'institution de la monnaie.
Si son aptitude rpondre au dsir de liquidit des acteurs en le
stabilisant se trouvait remise en cause, il s'ensuivrait de graves
perturbations dans les changes, perturbations dont la logique
est totalement trangre la pense walrassienne. En rsum,
l'intelligibilit complte de l'ordre marchand chappe l'co-
nomiste noc1assique parce qu'elle ncessite un point de vue qui
va bien au-del de la seule rationalit instrumentale. Il importe
de saisir les valeurs communes qui sont au fondement de toute
vie sociale
2
On reconnat l le fil directeur du livre: il s'agit de
rompre avec la perspective de la valeur substance qui objective
indment les relations conomiques. La valeur n'est pas dans
les objets; elle est une production collective qui permet la vie
en commun. Elle a la nature d'une institution.
1. L'analyse du capitalisme demande d'aller au-del de la prise en compte
du seul rapport marchand. titre d'exemple, la thorie de la rgulation dis-
tingue ~ i n q formes institutionnelles : la monnaie, la concurrence, le rapport sala-
rial, l'Etat, l'insertion internationale.
2. Les rflexions que Marie-France Garcia consacre la fabrication d'un
march walrassien Fontaines-en-Sologne vont tout fait dans ce sens. Il est
montr que ce march repose sur un intense travail social sans lequel le
mcanisme d'enchres centralises ne fonctionnerait pas. Garcia note, en par-
ticulier, des manifestations hostiles des producteurs l'gard des acheteurs qui
risquent de compromettre le climat de cordialit ncessaire la ralisation
des transactions (<< La construction sociale d'un march parfait: le march
au cadran de Fontaines-en-Sologne , art. cit., p. 11). En consquence, pour
maintenir la "bonne entente" [ ... ], le prsident et le trsorier sont prsents tous
les jours, observent, conseillent, rappellent l'ordre (ibid.).
Rfrences bibliographiques
Aftalion Albert, Monnaie, Prix et Change. Expriences rcentes et tho-
rie, Paris, Sirey, 1940 [1927].
Aglietta Michel et Andr Orlan, La Violence de la monnaie, Paris, PUF,
coll. conomie en libert , 1982.
Aglietta Michel, Rgulation et Crises du capitalisme, Paris, Odile Jacob,
coll. Opus , 1997 [1976].
Aglietta Michel, Andreau Jean, Anspach Mark, Birouste Jacques, Carte-
lier Jean, de Coppet Daniel, Malamoud Charles, Orlan Andr, Servet
Jean-Michel, Thret Bruno et Jean-Marie Thiveaud, Introduction ,
in Michel Aglietta et Andr Orlan (dir.), La Monnaie souveraine,
Paris, Odile Jacob, 1998, p. 9-31.
Aglietta Michel et Andr Orlan (dir.), La Monnaie souveraine, Paris,
Odile Jacob, 1998.
Aglietta Michel et Andr Orlan, La Monnaie entre violence et confiance,
Paris, Odile Jacob, 2002.
Akerlof George, The Market for "Lemons" : Quality Uncertainty and
the Market Mechanism , Quarterly Journal of Economics, vol. 84,
n 3, aot 1970, p. 488-500 (traduit dans Maya Bacache-Beauvallet et
Marc Montouss (dir.), Textes fondateurs en sciences conomiques
depuis 1970, Rosny-sous-Bois, Editions Bral, 2003, p. 9-22).
Allais Maurice, Le comportement de l'hom!De rationnel devant le
risque: critique des postulats et axiomes de l'Ecole amricaine , Eco-
nometrica, vol. 21, n 4, octobre 1953, p. 503-546.
Anspach Mark, Les fondements rituels de la transaction montaire, ou com-
ment remercier un bourreau , ~ n Michel Aglietta et Andr Orlan (dir.),
La Monnaie souveraine, Paris, Editions Odile Jacob, 1998, p. 53-83.
Aron Raymond, Les tapes de la pense sociologique, Paris, Gallimard,
coll. Tel , 2007.
Arrow Kenneth J., The Role of Securities in the Optimal Allocation of
Risk-Bearing , The Review of Economic Studies, vol. 31, nO 2,
avril 1964, p. 91-96.
Arrow Kenneth J. et Frank Hahn, General Competitive Analysis, dim-
bourg, Oliver and Boyd, 1972.
331
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Arthur W. Brian, Competing Technologies: An Overview, in Gio-
vanni Dosi, Christopher Freeman, Richard Nelson, Gerarld Silverberg
et Luc Soete (dir.), Technical Change and Economic Theory, Londres,
Pinter Publishers, 1988, p. 590-607.
Arthur W. Brian, Les rtroactions positives en conomie , Pour la
science, nO 150, avril 1990, p. 114-119.
Artous Antoine, Le Ftichisme chez Marx, Paris, ditions Syllepse, 2006.
Baumgartner Wilfrid, Le Rentenmark, Paris, PUF, 1925.
Becker Gary S., The Economic Approach to Human Behavior, Chicago,
University of Chicago Press, 1976.
Benetti Carlo et Jean Cartelier, Marchands, Salariat et Capitalistes, Paris,
Franois coll. Intervention en conomie politique , 1980.
Berthoud Arnaud, Economie politique et morale chez Walras , cono-
mia, n 9, mars 1988, p. 65-93.
Blancheton Bertrand, Le Pape et l'Empereur. La Banque de France, la
direction du Trsor et la Politique montaire de la France (J 914-
1928), Paris, Albin Michel, coll. Histoire de la mission historique de
la Banque de France , 2001.
Boltanski Luc et Laurent Thvenot, De la justification. Les conomies de
la grandeur, Paris, Gallimard, coll. NRF essais , 1991.
Bouchaud Jean-Philippe et Christian Walter, Les marches alatoires ,
Pour la science, dossier hors-srie sur Le Hasard, avril 1996, p. 92-95.
Bourghelle David, Brandouy Olivier, Gillet Roland et Andr Orlan,
Croyances, Reprsentations collectives et Conventions en finance,
Paris, Economica, 2005.
Boyer Robert et Andr Orlan, How do Conventions Evolve ? , Jour-
nal of Evolutionary Economics, vol. 2, 1992, p. 165-177.
Boyer Robert et Andr Orlan, Persistance et changement des conven-
tions , in Andr Orlan (dir.), Analyse conomique des conventions,
Paris, PUF, 1994, p. 219-247.
Boyer Robert, La Croissance, dbut de sicle, Paris, Albin Michel, 2002.
Bresciani-Turroni Costantino, The Economics of Inflation. A study of Cur-
rency Depreciation in Post-War Germany, Londres, August M. Kelley
Publishers, 1968.
Callon Michel, The Laws of the Market, Oxford, Blackwell, 1998.
Campagnolo Gilles, Carl Menger entre. Aristote et Hayek. Aux sources de
l'conomie moderne, Paris, CNRS Editions, 2008.
Carruthers Bruce G. et Arthur L. Stinchcombe, The Social Structure of
Liquidity : Flexibility, Markets and States , Theory and Society,
vol. 28, n 3, juin 1999
Cartelier Jean, Thorie de la valeur ou htrodoxie montaire: les
termes d'un choix , conomie applique, tome XXXVIII, nO 1, 1985,
p.63-82.
Castoriadis Cornelius, Valeur, galit, justice, politique: de Marx
Aristote et d'Aristote nous , in Les Carrefours du labyrinthe, Paris,
Seuil, coll. Esprit ,1978, p. 249-316 [1975].
332
RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Chamberlin Edward Hastings, La Thorie de la concurrence monopolis-
tique. Une nouvelle orientation de la thorie de la valeur, Paris, PUF,
1953 [1933].
Chancellor Edward, Devil Take the Hindmost. An History of Financial
Speculation, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1999.
Colasse Bernard, IFRS : Efficience versus instabilit , Revue franaise
de comptabilit, n 426, novembre 2009, p. 43-46.
de Coppet Daniel, Une monnaie pour une communaut mlansienne
compare la ntre pour l'individu des socits europennes , in
Michel Aglietta et Andr Orlan (dir.), La Monnaie souveraine, Paris,
Odile Jacob, 1998, p. 159-211.
Cowen Tyler et Randall Kroszner, The Development of the New
Monetary Economics , Journal of Political Economy, vol. 95, nO 3,
p.567-590.
Cutler David M., Poterba James M. et Lawrence H. Summers, What
Moves Stock Prices ? , The Journal of Portfolio Management, prin-
temps 1989, p. 4-12.
David Paul, Clio and the Economies of QWERTY , American Econo-
mic Review, vol. 75, nO 2, mai 1985, p. 332-337.
Debreu Grard, Thorie de la valeur. Analyse axiomatique de l'quilibre
conomique, Paris, Dunod, coll. Thories conomiques , 2001
[1959].
Diamond Douglas W. et Philip H. Dybvig, Bank Runs, Deposit Insu-
rance, and Liquidity , Journal of Political Economy, vol. 91, nO 3,
1983, p. 401-419.
Dornbusch Rudiger, Stopping Hyperinflation : Lessons from the Ger-
man Inflation Experience of the 1920s , NBER Working Paper,
nO 1675, aot 1985.
Douglas Mary, Ainsi pensent les institutions, Paris, Usher, 1989.
Dowd Kevin et David Greenaway, Currency Competition, Network
Externalities and Switching Costs: Towards an Alternative View of
Optimum Currency Areas , The Economic Journal, vol. 103, nO 420,
septembre 1993, p. 1180-1189.
Duffie Darrell, Modles dynamiques d'valuation, Paris, PUF, coll.
Finance , 1994 [1992].
Dumont Louis, Essais sur l'individualisme, Paris, Seuil, coll. Points
Essais ,1991 [1983].
Dumouchel Paul, L'ambivalence de la raret , in Paul Dumouchel et
Jean-Pierre Dupuy (dir.), L'Enfer des choses, Paris, Seuil, 1979,
p. 135-254.
Dupuy Jean-Pierre, Le signe et l'envie , in Paul Dumouchel et Jean-
Pierre Dupuy (dir.), L'Enfer des choses, Paris, Seuil, 1979, p. 15-134.
Dupuy Jean-Pierre, Convention et Common knowledge , Revue cono-
mique, vpl. 40, n 2, mars 1989, p. 361-400.
Durkheim Emile, Reprsentations individuelles et reprsentations collec-
tives , in Sociologie et Philosophie, Paris, PUF, coll. Le sociologue ,
333
L'EMPIRE DE LA VALEUR
1967, chapitre I, p. 1-38 (publi dans la Revue de mtaphysique et de
morale, tome VI, mai 1898).
Durkheim mile, Jugements de valeur et jugements de ralit , in
Sociologie et Philosophie, Paris, PUF, coll. Le sociologue , 1967,
chapitre IY, p. 90-109 [1911].
Durkheim Emile, De la division du travail social, Paris, PUF, 1978
[1893].
Durkheim mile, Les Rgles de la mthode sociologique, Paris, PUF, coll.
, 1993 [1895].
Durkheim Emile, Les Formes lmentaires de la vie religieuse. Le sys-
tme totmique en Australie, Paris, PUF, coll. Quadrige , 2003
[1912].
Fama Eugene, Random Walks in Stock Market Prices , Financial Ana-
lysts Journal, vol. 21, n 5, septembre-octobre 1965, p. 55-59.
Fama Eugene, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and
Empirical Work , Journal of Finance, vol. 25, 1970, p. 383-417.
Fauconnet Paul et Marcel Mauss, La sociologie: objet et mthode , in
Marcel Mauss, uvres, tome III: Cohsion sociale et divisions de la
sociologie, Paris, ditions de Minuit, 1974, p. 139-177 [1901].
Favereau Olivier, Marchs internes, marchs externes , Revue cono-
mique, numro spcial consacr L'conomie des conventions ,
vol. 40, n 2, mars 1989, p. 274-328.
Fidelity Fundamentals, Long-Term Investing Through the Cycle ,
2010 :
http://www.capitaltower.co.uk/fiieslLong % 20Term % 20Investing.pdf.
Fishburn Peter C., Reconsiderations in the Foundations of Decision
Under Uncertainty , The Economic Journal, vol. 97, nO 388,
dcembre 1987, p. 825-841.
Fisher Franklin M., Disequilibrium Foundations of Equilibrium Econo-
mics, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
Fonds montaire international, Global Financial Stability Report,
avril 2006.
Foucault Michel, Scurit, Territoire, Population. Cours au CoJlge de
France (1977-1978), Paris, Gallimard/Seuil, coll. Hautes Etudes ,
2004.
Foucault Michel, Naissance de la biopolitique. Cours au Collge de
France (1978-1979), Paris, Gallimard/Seuil, coll. Hautes Etudes ,
2004.
Fourgeaud Andr, La Dprciation et la Revalorisation du mark allemand
et les Enseignements de l'exprience montaire allemande, Paris,
Payot, coll. Bibliothque technique , 1926.
Friedman Milton, Inflation et Systmes montaires, Paris, Calmann-Lvy,
coll. Agora , 1976.
Garcia Marie-France, La construction sociale d'un march parfait: le
march au cadran de Fontaines-en-Sologne , Actes de la recherche en
Sciences sociales, nO 65, novembre 1986, p. 2-13.
334
RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Girard Ren, Mensonge romantique et Vrit romanesque, Paris, Grasset,
1961.
Girard Ren, La Violence et le Sacr, Paris, Grasset, 1972.
Granovetter Mark, Economic Action and Social Structure: the Problem
of Embeddedness , American Journal of Sodology, vol. 91, nO 3,
novembre 1985, p. 481-510 (traduit sous le titre Action conomique
et structure sociale: le problme de l'encastrement , in Le March
autrement. Essais de Mark Granovetter, Paris, Descle de Brouwer,
coll. Sociologie conomique , Paris, 2000, chapitre II, p. 75-114).
Granovetter Mark, Les institutions conomiques comme constructions
sociales , in Andr Orlan (dir.), Analyse conomique des conven-
tions, Paris, PUF, coll. Quadrige ,2004, chapitre III, p. 119-134.
Grenier Jean-Yves, L'conomie d'Ancien Rgime. Un monde de
l'change et de l'incertitude, Paris, Albin Michel, 1996.
Grenier Jean-Yves, La monnaie des sciences sociales, Annales, His-
toire, Sciences Sociales, vol. 55, n 6, novembre-dcembre 2000,
p.1335-1342.
Grenier Jean-Yves, Histoire conomJue. La rvol!ltion industrielle et
l'essor du capitalisme, Palaiseau, Editions de l'Ecole polytechnique,
2010.
Guerrien Bernard, La Thorie noclassique, tome 1 : Microconomie,
Paris, La Dcouverte, coll. Repres , 1999.
Guesnerie Roger, L'conomie, discipline autonome au sein des sciences
sociales? , Revue conomique, vol. 52, n 5, septembre 200 l,
p. 1055-1063.
Hahn Frank, Stability, in Kenneth 1. Arrow et Michael Intriligator
(dir.), Handbook of Mathematical Economics, vol. II, Amsterdam,
North-Holland Publishing Company, 1982, p. 746-793.
Hahn Frank, Equilibrium and Macroeconomics, Oxford, Basil Blackwell,
1984.
Hahn Frank, On Sorne Problems of Proving the Existence of an Equili-
brium in a Monetary Economy, in Frank Hahn, Equilibrium and
Macroeconomics, Oxford, Basil Blackwell, 1984, p. 147-157.
Hall Robert E., Monetary Trends in the United States and the United
Kingdom , Journal of Economic Literature, vol. 20, dcembre 1982,
p. 1552-1556.
Harrison J. Michael et David M. Kreps, Speculative Investor Behavior
in a Stock Market with Heterogeneous Expectations , Quarterly Jour-
nal of Economies, vol. XCIII, nO 2, mai 1978, p. 323-36.
Hayek Friedrich A., Denationalization of Money, Londres, Institute of
Economic Affairs, 1976.
Hayek Friedrich A., L'utilisation de l'information dans la socit , Re-
vue franaise d'conomie, vol. 1, nO 2, automne 1986, p. 117-135
(traduction de The Use ofKnowledge in Society, American Econo-
mic Review, vol. 35, n 4, septembre 1945, p. 519-530).
335
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Hirshleifer Jack, Investment Decision under Uncertainty : Choice-
Theoretic Approaches , Quarterly Journal of Economics,
vol. LXXIX, nO 4, novembre 1965, p. 509-536.
Kahneman Daniel et Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of
Decision Under , Econometrica, vol. 47, mars 1979, p. 263-291.
Karpik Lucien, L'Economie des singularits, Paris, Gallimard, coll.
Bibliothque des sciences humaines , 2007.
Kast Robert et Andr Lapied, Fondements microconomiques de la tho-
rie des marchs financiers, Paris, Economica, coll. Gestion , 1992.
Keynes John Maynard, The General Theory of Employment , Quar-
terly Journal of Economics, vol. 51, nO 2, fvrier 1937, p. 209-223.
Keynes John Maynard, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de la
monnaie, Paris, Payot, coll. Petite bibliothque Payot , 1971 [1936].
Keynes John Maynard, Perspectives conomiques pour nos petits-
enfants , in Essais sur la monnaie et l'conomie, Paris, Payot, coll.
Petite bibliothque Payot , 1978, p. 127-141 [1930].
Kindleberger Charles P., Manias, Panics, and Crashes. An history of
Financial Crises, Londres, Macmillan Press Ltd, 1978.
Kirman Alan, General Equilibrium , in Paul Bourgine et Jean-Pierre
Nadal (dir.), Cognitive Economies. An Interdisciplinary Approach,
Berlin-Heidelberg et New York, Springer-Verlag, 2004, chapitre III,
p.33-53.
Knight Frank H., Risk, Uncertainty, and Profit, Boston-New York,
Houghton Miffiin Company, 1921.
Kuhn Thomas S., La Structure des rvolutions scientifzques, Paris, flam-
marion, 1983.
Kurz Mordecai, On the Structure and Diversity of Rational Beliefs ,
Economic Theory, vol. 4, 1994, p. 877-900.
Kurz Mordecai, Rational Beliefs and Endogenous Uncertainty : Intro-
duction , Economic Theory, vol. 8, 1996, p. 383-397.
Lancaster Kelvin, A New Approach to Consumer Theory , Journal of
Political Economy, vol. 74, nO 2, avril 1966, p. 132-157.
Lazear Edward, Economic Imperialism , Quarterly Journal of Econo-
mics, vol. 115, nO l, fvrier 2000, p. 99-146.
Le Rider Georges, La Naissance de la monnaie. Pratiques montaires de
l'Orient ancien, Paris, PUF, 2001.
Lordon Frdric, La lgitimit au regard du fait montaire , Annales.
Histoire, Sciences Sociales, vol. 55, n 6, novembre-dcembre 2000,
p. 1349-1359.
Lordon Frdric et Andr Orlan, Gense de l'tat et gense de la mon-
naie : le modle de la potentia multitudinis , in Yves Citton et Frd-
ric Lordon (dir.), Spinoza et les Sciences socjales. De la puissance de
la multitude l'conomie des affects, Paris, Editions Amsterdam, coll.
Caute ! , 2008, p. 127-170.
Lordon Capitalisme, Dsir et Servitude. Marx et Spinoza, Paris,
La Fabrique Editions, 2010.
336
RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Lordon Frdric, La puissance des institutions (autour de De la critique
de Luc Boltanski) , Revue du MAUSS permanente, 8 avril 2010 [en
ligne]. http://www.journaldumauss.netlspip.php?article678
Lucas Robert E., Studies in Business-Cycle Theory, Cambridge (MA)-
Londres, The MIT Press, 1984.
Macpherson Crawford B., La Thorie politique de l'individualisme pos-
sessif, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais , 2004 [1962].
Malamoud Charles, Finance et monnaie, croyance et confiance; le paie-
ment des actes rituels dans l'Inde ancienne , in Michel Aglietta et
Andr Orlan (dir.), Souverainet, Lgitimit de la monnaie, Paris,
Cahiers Finance, thique, Confiance , Association d'conomie
financire, 1995,p.99-129.
Malamoud Charles, Le paiement des actes rituels dans l'Inde vdique ,
in Michel Aglietta et Andr Orlan (dir.), La Monnaie souveraine,
Paris, Odile Jacob, 1998, p. 35-52.
Malinvaud Edmond, Pourquoi les conomistes ne font pas de dcou-
vertes? , Revue d'conomie politique, vol. 1 06, nO 6, novembre-
dcembre 1996, p. 929-942.
Malkiel Burton G., The Efficient Market Hypothesis and its Critics ,
Journal of Economic Perspectives, vol. 17, n l, hiver 2003, p. 59-82.
Mandelbrot Benot B., Formes nouvelles du Hasard dans les Sciences ,
conomie applique, vol. XXVI, 1973, p. 307-319.
Marx Karl, Contribution la critique de l'conomie politique, Paris, di-
tions Sociales, 1957. .
Marx Karl, Introduction la critique de l'conomie politique, in Karl
Marx et Friedrich Engels, T e x t e ~ sur la mthode de la science cono-
mique (dition bilingue), Paris, Editions Sociales, 1974 [1857].
Marx Karl, Le Capital, Livre 1, sections 1 IV, Paris, Flammarion, coll.
Champs , 1985 [1867].
Mauss Marcel, Les origines de la notion de monnaie , in uvres,
tome q : Reprsentations collectives et Diversit des civilisations,
Paris, Editions de Minuit, 1974 [1914], p. 106-112.
Mehta Judith, Starmer Chris et Robert Sugden, The Nature of Salience :
An Experimental Investigation of Pure Coordination Games , Ameri-
can Economic Review, vol. 84, nO 2, juin 1994, p. 658-673.
Menger Carl, On the Origin of Money , Economic Journal, vol. 2,
1892, p. 233-255.
Menger Carl, La monnaie, mesure de valeur , Revue d'conomie poli-
tique, vol. 6, 1892, p. 159-175 (repris dans Gilles Campagnolo, Carl
Menger entre Aristote et Hayek. Aux sources de l'conomie moderne,
Paris, CNRS ditions, 2008, p. 206-220).
Montesquieu, De l'esprit des lois, Paris, Classiques Garnier, 2011.
Moreau mile, Souvenir d'un gouverneur de la Banque de france. His-
toire de la stabilisation du franc (1926-1928), Paris, Editions M.-
Th. Gnin, Librairie de Mdicis, 1954.
337
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Morgenstern Oskar et von Neumann John, Theory of Games and Econo-
mic Behaviour, Princeton, Princeton University Press, 1944.
Morishima Michio, Marx 's Economics. A Dual Theory of Value and
Growth, Cambridge, Cambridge University Press, 1974 [1973].
Mour Kenneth, La Politique du franc Poincar (1926-1936), Paris, Albin
Michel, coll. Histoire de la mission historique de la Banque de
France , 1998.
Orlan Andr, Le Pouvoir de lafinance, Paris, Odile Jacob, 1999.
Orlan Andr, Le tournant cognitif en conomie , Revue d'conomie
politique, vol. 112 (5), septembre-octobre 2002, p. 717-738.
Orlan Andr, L'conomie des conventions: dfinitions et rsultats ,
prface Analyse conomique des conventions, Paris, PUF, coll.
Quadrige Manuels , 2004, p. 9-48.
Orlan Andr, Efficience, finance comportementale et convention: une
synthse thorique , in Robert Boyer, Mario Dehove et Dominique
Plihon (dir.), Les Crises financires, complments A, rapport du
Conseil d'analyse conomique, octobre 2004, p. 241-270.
Orlan Andr, What is a Collective Belief? , in Paul Bourgine et Jean-
Pierre Nadal (dir.), Cognitive Economics, Berlin-Heidelberg et New
Yok, Springer-Verlag, 2004, p. 199-212.
Orlan Andr, L'aveuglement au dsastre. Le cas des crises finan-
cires , Esprit, nO 343, mars-avril 2008, p. 9-19.
Orlan Andr, Les croyances montaires et le pouvoir des banques cen-
trales , in Jean-Philippe Touffut (dir.), Les Banques centrales sont-
elles lgitimes? Paris, Albin Michel, 2008, p. 17-35.
Orlan Andr, La sociologie conomique de la monnaie , in Franois
Vatin et Philippe Steiner (dir.), Trait de sociologie conomique, Paris,
PUF, 2009, chapitre VI, p. 209-246.
Passeron Jean-Claude, Le Raisonnement sociologique. L'espace non-
popprien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, coll. Essais &
recherches , 1991.
Patinkin Don, La Monnaie, l'Intrt et les Prix, Paris, PUF, 1972 [1955].
Pays Bruno, Librer la monnaie. Les contributions montaires de Mises,
Rueff et Hayek, Paris, PUF, 1991.
Perrot Philippe, Le Luxe. Une richesse entre faste et confort XVIII
e
-
XIX
e
sicle, Paris, Seuil, 1995.
Polanyi Karl, La Grande Transformation, Paris, Gallimard, coll. Biblio-
thque des sciences sociales , 1972 [1944].
Postel Nicolas, Le pluralisme est mort, vive le pluralisme! , L'cono-
mie politique, n 50, avril 20 Il, p. 6-31.
Rseaux, numro spcial Les claviers , n 87, janvier-fvrier 1998.
Revue conomique, L'conomie des conventions , vol. 40, nO 2,
mars 1989.
Robbins Lionel, An Essay on the Nature and Significance of Economic
Science, Londres, The Macmillan Press Limited, 1932.
338
RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ross Stephen A., Neoclassical Finance, Princeton-Oxford, Princeton Uni-
versity Press, 2005.
Rothbard Murray, Man, Economy, and State, Auburn, Alabama, Ludwig
von Mises Institute, 2004.
Roubine Isaak: I., Essais sur la thorie de la valeur de Marx, Paris, di-
tions Syllepse, ~ 0 0 9 [1928]. ,
Sahlins Marshall, Age de pierre, Age d'abondance. L'conomie des soci-
ts primitives, Paris, Gallimard, 1976 [1972].
Samuelson Paul A., Economics, New York, McGraw-Hill, 1976.
Savage Leonard J., The Foundations of Statistics, New York, Dover
Publications, 1954.
Schelling Thomas, The Strategy of Conflict, Oxford, Oxford University
Press, 1977 [1960].
Schumpeter Joseph, Histoire de l'analyse conomique, tome 1: L'ge des
fondateurs, des origines 1790, Paris, Gallimard, 1983 [1954].
Schumpeter Joseph, Histoire de l'analyse conomique, tome Il : L'ge
classique, de 1790 1870, Paris, Gallimard, 1983 [1954].
Searle John, La Construction de la ralit sociale, Paris, Gallimard, 1998
[1995].
Shiller Robert J., Irrational Exuberance, Princeton (New Jersey), Prince-
ton University Press, 2001.
Shiller, Robert J., From Efficient Markets Theory to Behavioral
Finance , Journal of Economic Perspectives, vol. 17, nO l, hiver 2003,
p.83-104.
Shleifer Andrew, Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral
Finance, Oxford, Oxford University Press, 2000.
Simiand Franois, La mthode positive en science conomique , in
Critique sociologique de l'conomie, (textes prsents par Jean-
Christophe Marcel et Philippe Steiner), Paris, PUF, coll. Le lien
social ,2006, chapitre VII, p. 129-149 [1907].
Simiand Franois, Un systme d'conomie politique pure , in Critique
sociologique de l'conomie (textes prsents par Jean-Christophe Mar-
cei et Philippe Steiner), Paris, PUF, coll. Le lien social , 2006, cha-
pitre IV, p. 75-85 [1908].
Simiand Franois, La monnaie ralit sociale , Annales sociologiques,
srie D, fascicule J, 1934, p. 1-81 (repris dans Franois Simiand, Cri-
tique sociologique de l'conomie (textes prsents par Jean-Christophe
Marcel et Philippe Steiner), Paris, PUF, coll. Le lien social , 2006,
p. 215-279).
Simmel Georg, Philosophie de l'argent, Paris, PUF, 1987 [1900].
Smith Adam, Enqute sur la nature et les causes de la richesse des
nations, Paris, PUF, coli. Pratiques thoriques , 1995 [1776].
Spence Michael, Job Market Signaling , Quarterly Journal of Econo-
mics, vol. 87, nO 3, aot 1973, p. 355-374.
Sraffa Piero, Production de marchandises par des marchandises, Paris,
Dunod, 1999 [1960].
339
L'EMPIRE DE LA VALEUR
Stiglitz Joseph, The Causes and Consequences of the Dependence of
Quality on Price , Journal of Economic Literature, vol. 25,
mars 1987, p. 1-48.
Swedberg Richard, Une histoire de la sociologie conomique, Paris, Des-
cle Brouwer, coll. Sociologie conomique , 1994.
Ttreau Edouard, Analyste. Au cur de la folie financire, Paris, Grasset,
2005.
Veblen Thorstein, Thorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard, coll.
Tel , 1970 [1899].
de Vill Philippe, Comportements cqncurrentiels et quilibre gnral:
de la ncessit des institutions , Economie applique, tome XLIII,
nO 3, 1990, p.,9-34.
Walras Lon, Elments d'conomie politique pure ou thorie de la
richesse sociale, Paris, Librairie Gnrale de droit et de jurisprudence,
1952 [1900).
Weber Max, L'objectivit de la connaissance dans les sciences et la
politique sociales , in Essais sur la thorie de la science, Paris, Plon,
coll. en sciences humaines , 1965, p. 117-213 [1904].
Weber Max, Economie et Socit, tome 1: Les Catgories de la sociolo-
gie, Paris, Plon, Pocket, coll. Agora , 1995 [1921].
Weber Max, Sociologie des religions, Paris, Gallimard, coll. Tel , 1996
[1920].
Zelizer Viviana, La Signification sociale de l'argent, Paris, Seuil, coll.
Liber , 2005.
Zizek Siavoj, Ftichisme et subjectivation interpassive , Actuel Marx,
n 34, 2003, p. 99-109.
Table
Introduction .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PREMIRE PARTIE:
CRITIQUE DE L'CONOMIE
Chapitre 1: La valeur substance: travail et utilit 19
L'hypothse substantielle ............................ 24
La centralit du troc et l'exclusion de la monnaie. . . . . . . . . 27
Sous-estimation des changes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Une conception totalisante ........................... 36
Le ftichisme de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Chapitre Il : L'objectivit marchande ............... 55
Le rapport utilitaire aux objets et l'accord walrassien . . . . . . 57
Le ttonnement walrassien et la mdiation par les prix . . . . . 63
L 'hypothse mimtique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Asymtries d'information et conventions de qualit ....... 87
Incertitude et monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Objectivit marchande et modlisation idaltypique ....... 105
Chapitre III : La raret ............................ 116
La dpendance l'gard des objets .................... 120
Le modle de Veblen ............................... 125
Le modle de concurrence mimtique .................. 132
Retour sur la valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
DEUXIME PARTIE :
L'INSTITUTION DE LA VALEUR
Chapitre IV : La monnaie ................ . . . . . . . . . . 145
Monnaie versus valeur: les lments d'un dbat. . . . . . . . . . 148
Gense conceptuelle de la monnaie .................... 153
La crise de la monnaie .............................. 163
L'objectivit de la valeur ............................ 168
La thorie quantitative de la monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
conomie et sciences sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Chapitre V: Un cadre unidisciplinaire
pour penser la valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Simmel et la confiance .............................. 190
L'affect commun. ... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 196
Durkheim: une conception unidisciplinaire de la valeur . . . . 199
Le fait religieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
La pense librale face au fait montaire. . . . . . . . . . . . . . . . 213
Les miracles montaires ............................. 221
TROISIME PARTIE :
LA FINANCE DE MARCH
Chapitre VI : L'valuation financire ... . . . . . . . . . . . . . 231
Hypothse probabiliste et valeur intrinsque des titres ..... 231
Efficience des marchs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Incertitude knightienne et irrductible subjectivit
des estimations individuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Chapitre VII : Liquidit et spculation ..... . . . . . . . . . . 260
L'entreprise et la spculation ......................... 263
L'institution de la liquidit ........................... 273
Le concours de beaut keynsien: autorfrentialit
et croyances conventionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Inefficience des marchs financiers .................... 290
Sur quelques proprits des prix: variabilit excessive,
bulles spculatives et aveuglement face au dsastre ....... 297
Liquidit et convention: une synthse .................. 306
Conclusion gnrale ............................... 313
Rfrences bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
RALISATION: NORD COMPO VILLENEUVE-D'ASCQ
CPI FIRMIN-DIDOT AU MESNIL-SUR-L'ESTRE
DPT LGAL: OCTOBRE. N 105437 (106847)
IMPRIM EN FRANCE
Vous aimerez peut-être aussi
- Comment Rester Serein Quand Tout Seffondre - Fabrice Midal-1Document112 pagesComment Rester Serein Quand Tout Seffondre - Fabrice Midal-1gard30100% (2)
- Aradia Levangile Des SorciereDocument68 pagesAradia Levangile Des Sorciereapi-27173350100% (2)
- La Loi Universelle Du SuccesDocument2 pagesLa Loi Universelle Du Succesbokajude80% (5)
- Bien-Être Subjectif La Science Du BonheurDocument12 pagesBien-Être Subjectif La Science Du Bonheur'Personal development program: Personal development books, ebooks and pdfPas encore d'évaluation
- Encyclopédie Berbère Volume 24Document172 pagesEncyclopédie Berbère Volume 24idlisen100% (5)
- Gérard Granel-Cours Sur Gramsci-1973-1974.Document241 pagesGérard Granel-Cours Sur Gramsci-1973-1974.Chechucocha100% (1)
- Sequences Textuelles JMAdamDocument4 pagesSequences Textuelles JMAdamNicoleta Cristina SuciuPas encore d'évaluation
- 7.hitler, L'irrésistible Ascension-2006.gossweilerDocument256 pages7.hitler, L'irrésistible Ascension-2006.gossweilerChechucochaPas encore d'évaluation
- Commentaire Extrait L'Étranger - A. CamusDocument4 pagesCommentaire Extrait L'Étranger - A. CamusCé CilPas encore d'évaluation
- Les Beaux-Arts Réduits À Un Même PrincipeDocument53 pagesLes Beaux-Arts Réduits À Un Même Principelepton100Pas encore d'évaluation
- Evaluer Un ÉvénementDocument2 pagesEvaluer Un ÉvénementLoic TamisierPas encore d'évaluation
- 19.de L'analyse Marxiste Des Classes Sociales Dans Le Mode de Production Capitaliste - Saint-PierreDocument53 pages19.de L'analyse Marxiste Des Classes Sociales Dans Le Mode de Production Capitaliste - Saint-PierreChechucochaPas encore d'évaluation
- 12.RETOUR AU PROBLÈME DE LA TRANSFORMATION DES VALEURS EN PRIX DE PRODUCTION 1979.lipietzDocument26 pages12.RETOUR AU PROBLÈME DE LA TRANSFORMATION DES VALEURS EN PRIX DE PRODUCTION 1979.lipietzChechucochaPas encore d'évaluation
- 8.marx Et Le Capitalisme Contemporain-Chap-15.HussonDocument10 pages8.marx Et Le Capitalisme Contemporain-Chap-15.HussonChechucochaPas encore d'évaluation
- 19.de L'analyse Marxiste Des Classes Sociales Dans Le Mode de Production Capitaliste - Saint-PierreDocument53 pages19.de L'analyse Marxiste Des Classes Sociales Dans Le Mode de Production Capitaliste - Saint-PierreChechucochaPas encore d'évaluation
- 8.marx Et Le Capitalisme Contemporain-Chap-15.HussonDocument10 pages8.marx Et Le Capitalisme Contemporain-Chap-15.HussonChechucochaPas encore d'évaluation
- Alvarado Nicolas 2008-Poesie Et Philosophie Chez Alain Badiou.Document94 pagesAlvarado Nicolas 2008-Poesie Et Philosophie Chez Alain Badiou.ChechucochaPas encore d'évaluation
- Proces de Production Et Crise Du Capitalisme - PalloixDocument240 pagesProces de Production Et Crise Du Capitalisme - PalloixChechucochaPas encore d'évaluation
- 16.economie Mondiale Capitaliste Et Les Firmes Multinationales Tome I.1975.PalloixDocument206 pages16.economie Mondiale Capitaliste Et Les Firmes Multinationales Tome I.1975.PalloixChechucochaPas encore d'évaluation
- 16.L'Internationalisation Du Capital-1975.PalloixDocument212 pages16.L'Internationalisation Du Capital-1975.PalloixChechucochaPas encore d'évaluation
- 18.les Theories Des Crises Economiques - RosierDocument5 pages18.les Theories Des Crises Economiques - RosierChechucochaPas encore d'évaluation
- 16.problemes de La Croissance en Economie Ouverte-1969.PalloixDocument288 pages16.problemes de La Croissance en Economie Ouverte-1969.PalloixChechucochaPas encore d'évaluation
- 2.la Crise Systemique Actuelle - BoccaraDocument16 pages2.la Crise Systemique Actuelle - BoccaraChechucochaPas encore d'évaluation
- 16.proces de Production Et Crise Du Capitalisme - PalloixDocument240 pages16.proces de Production Et Crise Du Capitalisme - PalloixChechucochaPas encore d'évaluation
- 2.pour Une Nouvelle Theorie - BoostelDocument11 pages2.pour Une Nouvelle Theorie - BoostelChechucochaPas encore d'évaluation
- 16.de La Socialisation-1981.PalloixDocument196 pages16.de La Socialisation-1981.PalloixChechucochaPas encore d'évaluation
- 2.de La Crise Financière À La Crise Économique Une Analyse Comparative France-EEUU - BlotDocument33 pages2.de La Crise Financière À La Crise Économique Une Analyse Comparative France-EEUU - BlotChechucochaPas encore d'évaluation
- 2.démêler Le Vrai Du Faux Dans La Flambée Des Prix Agricoles Mondiaux - BerthelotDocument57 pages2.démêler Le Vrai Du Faux Dans La Flambée Des Prix Agricoles Mondiaux - BerthelotChechucochaPas encore d'évaluation
- 6.financiarisation Et Chomage en Argentine - FirminDocument199 pages6.financiarisation Et Chomage en Argentine - FirminChechucochaPas encore d'évaluation
- 16.travail Et Production-1974.PalloixDocument140 pages16.travail Et Production-1974.PalloixChechucochaPas encore d'évaluation
- 2.la Crise Économique en Cours, La Comparaison Avec La Crise de 1929-1933.bonhommeDocument26 pages2.la Crise Économique en Cours, La Comparaison Avec La Crise de 1929-1933.bonhommeChechucocha0% (1)
- 2.l'emergente Asie Face A Un Occident Enfievré de Bulles Spéculatif - BaeckDocument25 pages2.l'emergente Asie Face A Un Occident Enfievré de Bulles Spéculatif - BaeckChechucochaPas encore d'évaluation
- 2.la Critique Et La Crise Du Capitalisme Global - BezerraDocument33 pages2.la Critique Et La Crise Du Capitalisme Global - BezerraChechucochaPas encore d'évaluation
- 4.du Feodalisme Au Capitalisme, Problèmes de La Transition, Tomo II - Dobb-SweezyDocument198 pages4.du Feodalisme Au Capitalisme, Problèmes de La Transition, Tomo II - Dobb-SweezyChechucochaPas encore d'évaluation
- 7.rembourser La Dette Publique La Pire Des Hypothèses - GillDocument123 pages7.rembourser La Dette Publique La Pire Des Hypothèses - GillChechucochaPas encore d'évaluation
- 11.les Illusions Spéculaires Du Capitalisme Balzac Et Marx Sur Les Fictions Critiques de L'économie Politique - KempleDocument22 pages11.les Illusions Spéculaires Du Capitalisme Balzac Et Marx Sur Les Fictions Critiques de L'économie Politique - KempleChechucochaPas encore d'évaluation
- 18.intellectuels, Pouvoir Et Politique Démocratique - RodriguezDocument975 pages18.intellectuels, Pouvoir Et Politique Démocratique - RodriguezChechucochaPas encore d'évaluation
- 7.la Théorie de La Transition Chez Marx - GodelierDocument30 pages7.la Théorie de La Transition Chez Marx - GodelierChechucochaPas encore d'évaluation
- 20.suspension Du Capital-Monde Par La Production de La Jouissance - TreviniDocument649 pages20.suspension Du Capital-Monde Par La Production de La Jouissance - TreviniChechucochaPas encore d'évaluation
- B04 - La Condamnation de Monseigneur WilliamsonDocument26 pagesB04 - La Condamnation de Monseigneur WilliamsondefagojiPas encore d'évaluation
- Bou 1026Document243 pagesBou 1026Mourad BenderradjiPas encore d'évaluation
- Formation Vastu TlseDocument8 pagesFormation Vastu TlseGeetha MaPas encore d'évaluation
- Determinants de La Demande Touristique (Maroc)Document13 pagesDeterminants de La Demande Touristique (Maroc)Ilassa SavadogoPas encore d'évaluation
- Grammaire Par Les Exercices 4e 2021-ExtraitDocument1 pageGrammaire Par Les Exercices 4e 2021-ExtraitMarlen LylyPas encore d'évaluation
- Bellavance, G. (2002) Démocratisation Culturelle Et Actions LocalesDocument4 pagesBellavance, G. (2002) Démocratisation Culturelle Et Actions LocalesChaire Fernand-Dumont sur la culturePas encore d'évaluation
- Histoire de Lester LevensonDocument22 pagesHistoire de Lester LevensonPatricia DieghiPas encore d'évaluation
- Exposition L'aventure de La CouleurDocument19 pagesExposition L'aventure de La Couleurfrancebleuweb100% (1)
- Chapitre 1 L'époque de L'ignoranceDocument12 pagesChapitre 1 L'époque de L'ignorancearain91Pas encore d'évaluation
- TAF: Livret Méthodologie de RechercheDocument15 pagesTAF: Livret Méthodologie de RechercheWael MtirPas encore d'évaluation
- Evolution Psychologique EnfantDocument37 pagesEvolution Psychologique EnfantMalak MeriemPas encore d'évaluation
- Faut Il Renoncer À Définir Le BeauDocument2 pagesFaut Il Renoncer À Définir Le BeauAhmed AbdiPas encore d'évaluation
- Iged 20-21 Unigba-1Document98 pagesIged 20-21 Unigba-1pascalmambengaPas encore d'évaluation
- Demorgnon (2004) - Invencion de L InterculturelleDocument28 pagesDemorgnon (2004) - Invencion de L InterculturelleojoveladorPas encore d'évaluation
- Politiques RH Et Législation Du TravailDocument6 pagesPolitiques RH Et Législation Du TravailAdil LamPas encore d'évaluation
- Français 1re Grammaire - Les CirconstanciellesDocument2 pagesFrançais 1re Grammaire - Les CirconstanciellesValérie DucretPas encore d'évaluation