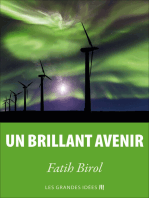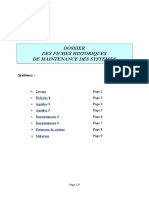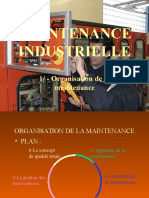Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Management Maintenance Industrielle Conseil Formation
Transféré par
khlafanesrineCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Management Maintenance Industrielle Conseil Formation
Transféré par
khlafanesrineDroits d'auteur :
Formats disponibles
Conseil, Accompagnement du Management de la
Maintenance industrielle, tertiaire, BTP, transport et biomdicale
Fiabilisation des quipements
Faire voluer votre maintenance
Ingexpert vous accompagne dans le ddale dun projet jusqu sa russite :
o le labyrinthe symbolise sa complexit
o au centre se trouve la lumire qui symbolise latteinte du rsultat
2 / 67
Faire voluer votre maintenance
Ce document est tlchargeable sur www.ingexpert.com
Contact :
INGEXPERT - Expertise conseil maintenance
SARL au capital de 7 622 euros SIREN 450502455
www.ingexpert.com - 17 F bd Jean Duplessis 13014 Marseille
Tl. 00 33 (0)4 91 63 48 67
Fax : 09 81 70 23 10
contact@ingexpert.com
Ed. : Mai 2013
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
3 / 67
Faire voluer votre maintenance
Table des matires
A VANT PROPOS ............................................................................................................................. 6
DEFINITIONS ............................................................................................................................. 7
1. Maintenance..................................................................................................................... 7
Les types de maintenance ................................................................................................... 7
2. Maintenance corrective.................................................................................................... 7
3. Maintenance prventive................................................................................................... 8
3.1 La maintenance systmatique................................................................................... 8
3.2 La maintenance programme ................................................................................... 9
3.3 Le matriel sous surveillance ................................................................................... 9
3.4 Dfinir et appliquer la maintenance prventive ..................................................... 10
4. Maintenabilit ................................................................................................................ 13
5. Fiabilit .......................................................................................................................... 13
6. Disponibilit .................................................................................................................. 13
Exemple : .............................................................................................................................. 14
7. Objectifs de maintenance............................................................................................... 15
LES INDICATEURS ................................................................................................................... 16
A - Exemple d'indicateurs techniques .................................................................................. 16
B - Les indicateurs financiers et de gestion .......................................................................... 17
Cot de la maintenance..................................................................................................... 17
Cot de la maintenance dans le cot ajout du site .......................................................... 17
Comparaison conomique et sociale ................................................................................ 17
C - Tableau de bord .............................................................................................................. 17
MANAGEMENT - LES HOMMES DE LA MAINTENANCE ...................................................... 18
A - La maintenance requiert de la polyvalence .................................................................... 18
B - Maintenance dans l'organigramme ................................................................................. 18
C - Motivation du personnel ................................................................................................. 19
Mise en place dun cahier dide latelier ...................................................................... 19
Motivation par largent ..................................................................................................... 19
D - Mauvaises habitudes ...................................................................................................... 19
E - Management du personnel .............................................................................................. 20
PROCESSUS MAINTENANCE .................................................................................................. 21
A - Prparation ..................................................................................................................... 21
B - Ordonnancement ............................................................................................................. 21
C - Mthodes ........................................................................................................................ 22
D - Les tapes de lintervention de maintenance.................................................................. 22
PROCESSUS TOURNE VERS LAMELIORATION .................................................................... 24
A - La mission de progrs de la maintenance....................................................................... 24
LES 5 NIVEAUX DE LA MAINTENANCE .................................................................................. 26
1er niveau de maintenance ................................................................................................... 26
2me niveau de maintenance ................................................................................................ 26
3me niveau de maintenance ................................................................................................ 26
4me niveau de maintenance ................................................................................................ 26
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
4 / 67
Faire voluer votre maintenance
5me niveau de maintenance ................................................................................................ 26
GMAO ....................................................................................................................................... 28
A - Des questions se poser : .......................................................................................... 28
B - Le plan de maintenance ............................................................................................. 28
C - Les dmarches pour la mise en place d'une GMAO: ................................................. 29
I - Ralisation du cahier des charges (surtout dfinir le besoin) ...................................... 29
II - Choix du logiciel ........................................................................................................ 29
III - Mise en place............................................................................................................. 29
IV - Formation du personnel ............................................................................................ 30
V - Utilisation / Exploitation de la GMAO .................................................................. 30
LES EQUIPEMENTS ................................................................................................................. 31
A - DTE : Dossier Technique Equipement ...................................................................... 31
B - Comment localiser les quipements critiques ? ......................................................... 31
ILe diagramme de Pareto ......................................................................................... 33
II - Criticit des quipements ....................................................................................... 34
C - Analyse des dfaillances ............................................................................................ 35
1 - Les causes des dfaillances : ....................................................................................... 35
2 - Les modes de dfaillance ............................................................................................ 36
D - Plan de fiabilit............................................................................................................... 37
DEMARCHES, METHODES ET OUTILS ................................................................................... 38
A Prsentation ................................................................................................................... 38
B Cas particulier de la TPM .............................................................................................. 41
1 Auto-maintenance : .......................................................................................... 41
2 - TRS : ........................................................................................................................ 41
3 - 5S : .......................................................................................................................... 42
C Cas particulier de lAMDEC ......................................................................................... 42
D Critiques des dmarches et mthodes ............................................................................ 44
D - Outils et techniques volues ......................................................................................... 45
FIABILITE - COMPORTEMENT DU MATERIEL, DEFAILLANCE, PROBABILITES .................. 46
A - MTBF......................................................................................................................... 46
B - Taux de dfaillance .................................................................................................... 47
C - Fiabilit ...................................................................................................................... 48
D - Disponibilit............................................................................................................... 49
E - La matrise de lefficience ......................................................................................... 50
F - Sret de fonctionnement................................................................................................ 50
CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, EXTERNALISATION ....................................................... 51
A - Pourquoi sous-traiter ? ............................................................................................... 51
B - Les diffrentes formes de sous-traitance et leurs rmunrations ............................... 51
ILes formes de sous-traitance .................................................................................. 51
II - Contrat de moyen ou de rsultat ? .......................................................................... 52
III - Un exemple de rmunration "mixte", le cas du "cost and fee" : .......................... 52
C - Cas particulier: le contrat de maintenance au forfait ................................................. 52
ILe contenu du contrat ............................................................................................. 53
II - Eviter certains piges lors de la rdaction .............................................................. 53
III - Les tapes de l'laboration d'un contrat .................................................................. 53
IV - Planification de la rdaction d'un contrat et dmarrage du contrat ........................ 54
V - Les lacunes d'un encadrement par une socit de conseil ...................................... 54
D - Jusqu "o" sous-traiter l'activit de maintenance ? .................................................. 54
D - Le nombre de contrats de sous-traitance la globalisation .................. 55
E - Le dmarrage d'un contrat : priode dlicate ............................................................. 55
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
5 / 67
Faire voluer votre maintenance
GESTION DE STOCK ................................................................................................................ 57
A - Choix d'une mthode d'approvisionnement : ............................................................. 57
B - Liste des quipements ................................................................................................ 57
C - Stock minimum / rapprovisionnement ..................................................................... 58
1.
Loi de poisson ........................................................................................................ 58
2.
Mthode du point de commande ............................................................................ 58
D - Choix d'un fournisseur : ............................................................................................. 58
E - Cot d'un quipement ................................................................................................ 58
FQuantit conomique de commande .......................................................................... 59
G - Magasin ...................................................................................................................... 59
H - Valorisation du stock :................................................................................................... 60
IInventaire ................................................................................................................... 60
J - Les ratios en rapport avec la gestion de stock ................................................................. 60
LES EQUILIBRES DE LA MAINTENANCE ................................................................................ 62
A - Equilibre maintenance prventive / corrective .......................................................... 62
B - Equilibre en matire de prparation des travaux ....................................................... 62
C - Niveau de stock .......................................................................................................... 63
LCC ............................................................................................................................................ 64
A - Dfinition ................................................................................................................... 64
B - Programme de maintenance base sur le LCC .......................................................... 65
C - Quelques chiffres ....................................................................................................... 65
PLAN DE MAINTENANCE ........................................................................................................ 66
A - Dfinition selon la norme NF EN 13306 ....................................................................... 66
B - Application pratique ....................................................................................................... 66
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
6 / 67
Faire voluer votre maintenance
AVANT PROPOS
Ce recueil a pour but daider les interlocuteurs de la maintenance dans la mission de maintien de leurs
quipements dans un tat souhait.
Il reprsente une premire approche de la conceptualisation de leur mtier en vue de la rationalisation
souhaite.
Des exemples simples agrmentent des prsentations succinctes.
La socit Ingexpert est votre disposition pour approfondir chacun des sujets en les appliquant au cas
particulier de chaque contexte industriel et tertiaire.
Toute reproduction, mme partielle, doit tre soumise lautorisation dINGEXPERT
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
7 / 67
Faire voluer votre maintenance
DEFINITIONS
1. Maintenance
(extraits de la norme europenne NF EN 13306 X 60-319 de 2010)
Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant
le cycle de vie d'un bien, destines le maintenir ou le rtablir dans un tat dans
lequel il peut accomplir la fonction requise
Les types de maintenance
Attention, la norme NFX 60-010 n'existe plus puisque la terminologie
est maintenant europenne. Certaines dfinitions, non reprises au
niveau europen, comme les 5 niveaux de maintenance par exemple
jusquen 2010, se retrouvent dans la norme FD X60-000 de mai 2002.
2. Maintenance corrective
(extrait norme NF EN 13306 X 60-319)
Maintenance excute aprs dtection d'une panne et destine remettre un bien dans
un tat dans lequel il peut accomplir une fonction requise
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
8 / 67
Faire voluer votre maintenance
3. Maintenance prventive
(extraits norme NF EN 13306 X 60-319)
Maintenance excute des intervalles prdtermins ou selon des critres prescrits et
destine rduire la probabilit de dfaillance ou la dgradation du fonctionnement d'un
bien
Cette dfinition est gnrale : lobjectif de la maintenance prventive est dviter les
pannes.
3.1 La maintenance systmatique
Maintenance prventive excute des intervalles de temps prtablis ou selon
un nombre dfini d'units d'usage mais sans contrle pralable de l'tat du bien
Problmatique
Tout le problme est de dterminer T. La priode T doit tre dfinie en
fonction du risque de panne MTBF = Moyenne des temps de bon
fonctionnement.
On a Intervalle de maintenance :
I(n) I(n-1) = k . MTBF (k tant < 0)
Aides la dtermination de T
Simulation conomique
Loi de Weibull et abaque doptimisation
Approche modulaire des quipements
Un quipement est modlis par des modules. Il est ainsi constitu de
plusieurs modules.
On a :
MTBF (module) = MTBF (composant le plus fragile)
Pour augmenter T, il faut que les MTBF de tous les composants soient
identiques : homognisation des dures de vie (fiabiliser les
composants les plus fragiles) et ventuellement rduire la dure de vie
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
9 / 67
Faire voluer votre maintenance
dautres composants pour faire des conomies). Tous les T on remplace
ainsi le module tout entier et non juste un composant qui possde un
T infrieur . De plus, pour changer un module complet il faut moins de
comptences que pour changer un composant du module.
3.2 La maintenance programme
Maintenance prventive excute selon un calendrier prtabli ou selon un
nombre dfini d'units d'usage
3.3 Le matriel sous surveillance
Par observation visuelle, contact mcanique (vibration, qualit de lhuile, analyse
non destructive) ou par retour dinformation lectronique (alarmes, lectronique,
retour dfauts sur rgime de neutre, etc.) vous pouvez anticiper une intervention
de maintenance. Vous intervenez afin dviter de subir une panne.
Exemples :
Analyse vibratoire - pour machines tournantes ;
Analyse thermique - pour les armoires lectriques ;
Mesure de dbit - pour remplacement de filtres ;
Rondes - contrles visuels ou techniques simples.
3.3.1 Maintenance conditionnelle
Maintenance prventive base sur une surveillance du fonctionnement du
bien et/ou des paramtres significatifs de ce fonctionnement intgrant les
actions qui en dcoulent
3.3.2 Maintenance prvisionnelle
Maintenance conditionnelle excute en suivant les prvisions extrapoles
de l'analyse et de l'valuation de paramtres significatifs de la dgradation du
bien
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
10 / 67
Faire voluer votre maintenance
3.4 Dfinir et appliquer la maintenance prventive
3.4.1 Pourquoi dvelopper un programme de maintenance prventive ?
Pour respecter des objectifs :
de fiabilit et de disponibilit ;
de scurit, dhygine ;
denvironnement ;
de contraintes rglementaires ;
de cots ;
etc.
Cas de la maintenance prventive dfinie pour matriser les cots dexploitation et
de maintenance tout en respectant la scurit :
o
o
Vulgarisation : Cot dfaillance > Cot intervention prventive
Mais attention aux pertes lies larrt du bien.
Equilibre financier maintenance prventive / maintenance corrective dun
ensemble de biens :
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
11 / 67
Faire voluer votre maintenance
Attention: trop de maintenance prventive nest souvent pas
conomiquement viable. Chaque service maintenance doit trouver le
niveau atteindre (par exemple 30%).
On tudiera en premier les biens jugs critiques pour savoir sil faut leur appliquer
de la maintenance prventive.
3.4.2 Comment dfinir la maintenance prventive ?
La maintenance prventive est dfinie partir :
Des historiques de maintenance (voir GMAO) ;
Des donnes des constructeurs ;
De la connaissance des techniciens ;
De raisonnements structurs (AMDEC, ingnierie, 5 pourquoi, ) ;
De faon empirique, par ttonnements ;
Des redondances dquipements ;
Etc..
3.4.3 Plan de maintenance prventive
La mise en place de la maintenance prventive est concrtise par le Plan de
maintenance *, saisi le plus souvent dans la GMAO*.
*Voir dfinitions la suite
3.4.4 Interventions de maintenance prventive
Elle peut se faire quipements larrt ou en marche.
Attention ce que la maintenance prventive soit bien comprise et quainsi les
quipements soient mis disposition comme programm.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
12 / 67
Faire voluer votre maintenance
Automaintenance :
quipements.
maintenance
prventive
faite
par
les
utilisateurs
La maintenance prventive sappuie idalement sur des modes opratoires.
La maintenance prventive se sous-traite trs facilement.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
des
13 / 67
Faire voluer votre maintenance
4. Maintenabilit
Dans des conditions donnes d'utilisation, aptitude d'un bien tre maintenu ou rtabli
dans un tat o il peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est
accomplie dans des conditions donnes, en utilisant des procdures et des moyens
prescrits
(extrait norme NF EN 13306 X 60-319)
Cest la probabilit que la maintenance dun systme S accomplie dans des conditions
donnes, soit effectu sur lintervalle [0,t] sachant quil est dfaillant linstant t = 0.
M(t) = P {S est rpar sur lintervalle [0,t] }
La maintenabilit est conditionne par la conception de lquipement :
Outils ncessaires au diagnostic de la panne incorpors ou non et la rparation
(dont dispositif de Maintenance conditionnelle)
Contrle du bon fonctionnement (points de mesure, afficheurs, etc.)
Documentation approprie (dont modes opratoires)
Rparation ou mesure en marche (isoler certains circuits, etc.)
Accessibilit,
dmontabilit
(dtrompeur,
reprage,
outils
communs),
interchangeabilit
Manutention simple (potence intgre, rails, etc.)
etc.
5. Fiabilit
Aptitude d'un bien accomplir une fonction requise, dans des conditions donnes,
durant un intervalle de temps donn
(extrait norme NF EN 13306 X 60-319)
R(t) = P {S non dfaillant sur lintervalle [0,t] }
6. Disponibilit
Aptitude d'un bien tre en tat d'accomplir une fonction requise dans des conditions
donnes, un instant donn ou durant un intervalle de temps donn, en supposant que
la fourniture des moyens extrieurs ncessaires est assure
(extrait norme NF EN 13306 X 60-319)
A(t) = P {S non dfaillant linstant t }
Disponibilit =
MTBF
MTBF+MTTR
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
14 / 67
Faire voluer votre maintenance
LAMDEC est surement la mthodologie la plus directe pour augmenter la disponibilit
dune ligne dquipements.
1. Disponibilit dune ligne dquipements sans stockage intermdiaire
Di tant la disponibilit de chaque quipement constituant la ligne :
Exemple :
Trois quipements en srie ont les historiques permettant de dterminer
les caractristiques de disponibilit suivantes :
MTBF
210 h
350 h
150 h
Equipement 1
Equipement 2
Equipement 3
MTTR
3h
4h
1h
Le systme compos des trois quipements a une disponibilit :
D = 0,969
Remarque :
Les disponibilits individuelles sont suprieures :
D1 = 0,986
D2 = 0,989
D3 = 0,993
2. Disponibilit dune ligne dquipements avec stockage intermdiaire
Di tant la disponibilit de chaque quipement constituant la ligne :
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
15 / 67
Faire voluer votre maintenance
7. Objectifs de maintenance
Les services de maintenance doivent dfinir leurs objectifs qui doivent correspondre
la politique de leur entreprise. Les objectifs peuvent toucher tous les aspects du
management avec les prcisions dchance :
Financier
Technique
Humain
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
16 / 67
Faire voluer votre maintenance
LES INDICATEURS
Il existe un nombre sans fin d'indicateurs. Vous trouverez ici quelques-uns d'entre
eux mais attention ils ne sont pas assurment reprsentatifs des indicateurs
primordiaux. Il n'existe pas d'indicateur tout faire ou encore d'indicateurs miracles.
Chaque service Maintenance doit trouver les indicateurs qui lui conviennent.
Pour qu'un indicateur soit significatif et exploitable, il faut que les valeurs utilises qui
le composent soient mesurables, dfinies avec prcision, et qu'elles aient des bases
homognes (ex : priodes de rfrence).
Le choix de l'indicateur dpend de l'utilisation que l'on veut faire des informations, et
appartient chaque responsable.
Il doit permettre de contrler et de vrifier :
latteinte des objectifs
le bon fonctionnement du processus
Pourquoi ne pas mettre en place ponctuellement et pour une priode limite, des
indicateurs spcifiques destins mesurer un aspect particulier du processus
Maintenance.
Bien souvent on s'aperoit qu'un seul indicateur n'est pas suffisant pour interprter
une situation : il faut qu'il soit complt d'indicateurs complmentaires.
Enfin, bien souvent, plus que la valeur nette de l'indicateur, c'est la variation de celuici au travers du temps qui est intressante.
ll existe une norme franaise traitant des indicateurs : XP X 60 020. Une norme
europenne tarde venir.
A - Exemple d'indicateurs techniques
Voici quelques indicateurs techniques de premier plan.
TRS ;
MTBF ;
MTTR ;
Taux de maintenance prventive ;
Taux de rupture de stock.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
17 / 67
Faire voluer votre maintenance
B - Les indicateurs financiers et de gestion
Les indicateurs financiers dun service Maintenance sont fonction des objectifs ou
ventuellement destins au benchmark avec dautres sites de la mme socit par
exemple.
Cot de la maintenance
Le suivi du cot de maintenance peut tre trs utile. La principale difficult tant de
dterminer les cots qui vont constituer le cot global. Aussi, une fois la rgle dfinie,
il est surtout intressant de suivre lvolution du cot de Maintenance moins quil ne
soit surtout destin comparer des maintenances de sites entre eux.
Cot de la maintenance dans le cot ajout du site
Si lon estime que lanalyse du cot de maintenance seul nest pas assez rvlatrice
de son activit, car par exemple trop variable en fonction de lactivit des
quipements quelle doit maintenir, il peut tre intressant de suivre le cot de la
maintenance dans le cot ajout du site. Cest assurment un bon outil de
benchmark, pour des maintenances comparables.
Comparaison conomique et sociale
Il peut galement tre intressant de suivre lcart entre les implications
conomiques et sociales. Mais attention bien affecter les dpenses au bon
indicateur, comme par exemple, il ne faut pas comptabiliser les heures de main
duvre traites en cot mais bien en effectif.
C - Tableau de bord
Un tableau de bord reprend les valeurs relles d'indicateurs et les compare des
rfrences. Cet outil est particulirement adapt au travail en groupe. Les carts
mesurs par le tableau de bord seront analyss et sources de la dmarche
Amlioration.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
18 / 67
Faire voluer votre maintenance
MANAGEMENT - LES HOMMES DE LA
MAINTENANCE
A - La maintenance requiert de la polyvalence
Le groupe constituant le service Maintenance a des comptences techniques diverses,
la complmentarit permet de rsoudre des problmes dorigines diverses.
Mtier ingrat : la panne vite par la maintenance ne vaudra pas de
remerciements puisquelle na pas existe, par contre la panne relle vaudra des
critiques.
B - Maintenance dans l'organigramme
Direction gnrale
Production
Serv. Techniques
Maintenance
Il n'y a pas d'organigramme type, toutefois cet organigramme est peut-tre
privilgier par rapport celui qui suit. Il est peut-tre plus adapt aux petites socits
(permet d'avoir une personne forte "gnraliste"), mais ne permet pas de suivre une
maintenance efficace. Production et maintenance ont des intrts totalement
diffrents, il faut bien souvent un arbitre pour sparer les budgets, les ressources
humaines (la production et la maintenance ont deux faons diffrentes de vivre
l'entreprise). Mais bien entendu tout dpend des hommes en place.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
19 / 67
Faire voluer votre maintenance
C - Motivation du personnel
Mise en place dun cahier dide latelier
Demander aux intervenants Maintenance de retranscrire leurs ides afin de rendre
ces derniers moteurs d'une dmarche de progrs.
Date
Nom
Matriel
Ide
Suite donne
Le responsable Maintenance veillera ce que la colonne Suite donne soit bien
remplie afin que la motivation entoure le cahier.
Motivation par largent
A viter car une prime risque de devenir normale et perd de son effet : le
pourquoi est vite oubli.
D - Mauvaises habitudes
Loprateur de maintenance qui a de lexprience mais manque de mthodologie
tendance faire correspondre un symptme une cause de panne connue. Cette
association le gnera dans lidentification de nouvelles pannes : il risque de faire de
mauvais diagnostics.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
20 / 67
Faire voluer votre maintenance
E - Management du personnel
Il faut dfinir le profil de chaque intervenant Maintenance. Pour cela, sappuyer sur
une schmatisation du type :
Niveaux
dintervention
Domaine
technique
Mcanique
Electricit
Pneumatique
Automatisme
Rgulation
Le plan de formation sera dduit des objectifs fixs la lecture de cette
schmatisation.
Rem. : cette dmarche minimale est obligatoire dans le cadre de lISO.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
21 / 67
Faire voluer votre maintenance
PROCESSUS MAINTENANCE
Le processus Maintenance est constitu de diffrentes fonctions qui peuvent tre :
Prparation
Ralisation travaux maintenance
Ordonnancement
Mthodes
Achats
Gestion de stock - Magasin
Nous abordons certaines fonctions la suite.
A - Prparation
La prparation des travaux ncessite le plus de rigueur possible dans la collecte des
informations pour dfinir le triplet symptme, cause et remde de panne . Les
informations peuvent tre collectes par plusieurs intervenants avec pour support la
GMAO mais ncessitent toujours rigueur et objectivit.
Analyse de panne : l'application d'une mthodologie d'analyse de panne est conseille
pour diminuer le temps de rparation : une procdure base ventuellement sur une
mthodologie (5 pourquoi, QQOQCCP) est prconise.
B - Ordonnancement
La fonction d'ordonnancement permet d'organiser le travail raliser :
prvoir la chronologie du droulement des diffrentes tches de maintenance,
optimiser les moyens ncessaires en fonction des dlais,
ajuster la charge,
contrler lavancement et la fin des travaux,
analyser les carts entre les prvisions et les ralisations,
avoir une vision long terme (plan de charge annuel), moyen terme et
court terme.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
22 / 67
Faire voluer votre maintenance
Maintenance prventive
- Plan de maintenance -
Maintenance corrective
Prparation
Planification / Ordonnancement
Approvisionnement
Outillage
Pices de rechange
(Sous-traitants)
Excution des travaux
Suivi - Mthodes
C - Mthodes
Le service mthodes assure la rflexion du fonctionnement du service
maintenance sur la base de ses rsultats de fonctionnement (documents, actions
de maintenance). Le but est dassurer lefficience de la maintenance, son
amlioration en prennisant les outils et les dmarches et en mettant au point des
amliorations:
les mesurer ;
les analyser ;
les critiquer ;
les amliorer.
D - Les tapes de lintervention de maintenance
Documents jalonnant le processus dintervention de maintenance :
Emis par
Fabrication
Agent de maintenance
Agent de maintenance
Mthodiste / Prparateur
Mthodiste / Prparateur
Type de document
Technique
Technique
Scurit
Magasin
Achat
Noms constats
Avis / DI
OT / DT
AT / BT
BSM
DA
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
23 / 67
Faire voluer votre maintenance
Glossaire :
DT
OT
BT
DA
BSM
BOP
Demande de Travail
Ordre de Travail
Bon de Travail
Demande dAchat
Bon de Sortie Magasin
BOrdereau Point
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
24 / 67
Faire voluer votre maintenance
PROCESSUS TOURNE VERS LAMELIORATION
Il est trs important d'orienter le processus vers le progrs. Cette terminologie de
progrs, spcifique la maintenance, revt lobligation damlioration au sens de la
norme ISO 9001.
Il existe un cheminement trs gnral pour assurer le progrs de la maintenance. La
mise jour du processus de maintenance fait d'ailleurs partie de cette mission.
Le but de ce chapitre n'est pas de fournir un processus universel de maintenance, ni
mme dtre exhaustif dans la dfinition des missions.
A - La mission de progrs de la maintenance
Vous trouverez la suite une bonne partie des missions qui doivent jalonner votre
processus de maintenance. Gnrer une dynamique de progrs, c'est aborder les
points suivants et les remettre en question en permanence.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
25 / 67
Faire voluer votre maintenance
Mthodes - Documentation de base
Documentation technique (DTE)
Equipements critiques
Performances requises
Disponibilits requises
Schmas installations
Politique
Plan de maintenance
Gammes, BOP, Prparation
Atelier
Motivation
GMAO
Valeur indicateurs
Actions scurit
Fiches de fonction
Ordonnancement / Prparation
Planning plan de charge (Prestataire)
Moyens internes, externes et matriels
Diagnostic des pannes
Prparation des travaux
Programmation des arrts
Progrs
Gestion matriel et PdR
Achat
Gestion de stock
Magasin
Outillage
Amliorations
Modifications
Travaux
Lancement travaux
Ralisation travaux correctifs
Ralisation travaux prventifs
Heures supplmentaires - Astreintes
Suivi des contrats de sous-traitance
Pointage / paiement
Comptabilit / gestion
Plan qualit
Rapports techniques
Suivi des dlais
Retour dexprience - Mthodes
Analyse
des
comptes-rendus
d'intervention
Gestion des historiques
Gestion des cots
Prventif
Indicateurs et tableaux de bord
des
bons
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
26 / 67
Faire voluer votre maintenance
LES 5 NIVEAUX DE LA MAINTENANCE
Les interventions de maintenance peuvent tre classes par ordre croissant de
complexit (selon norme X60-000 de 2002) :
1er niveau de maintenance
Actions simples ncessaires lexploitation et ralises sur des lments facilement
accessibles en toute scurit laide dquipements de soutien intgrs au bien.
Ce type dopration peut tre effectu par lutilisateur du bien avec, le cas chant,
les quipements de soutien intgrs au bien et laide des instructions dutilisation.
2me niveau de maintenance
Actions qui ncessitent des procdures simples et/ou des quipements de soutien
(intgrs au bien ou extrieurs) dutilisation ou de mise en uvre simple.
Ce type dactions de maintenance est effectu par un personnel qualifi avec les
procdures dtailles et les quipements de soutien dfinis dans les instructions de
maintenance.
Un personnel est qualifi lorsquil a reu une formation lui permettant de travailler en
scurit sur un bien prsentant certains risques potentiels, et est reconnu apte pour
lexcution des travaux qui lui sont confis, compte tenu de ses connaissances et de
ses aptitudes.
3me niveau de maintenance
Oprations qui ncessitent des procdures complexes et/ou des quipements de
soutien portatifs, dutilisation ou de mise en uvre complexes.
Ce type dopration de maintenance peut tre effectu par un technicien qualifi,
laide de procdures dtailles et des quipements de soutien prvus dans les
instructions de maintenance.
4me niveau de maintenance
Oprations dont les procdures impliquent la matrise dune technique ou technologie
particulire et/ou la mise en uvre dquipements de soutien spcialiss.
Ce type dopration de maintenance est effectu par un technicien ou une quipe
spcialise laide de toutes instructions de maintenance gnrales ou particulires.
5me niveau de maintenance
Oprations dont les procdures impliquent un savoir-faire, faisant appel des
techniques ou technologies particulires, des processus et/ou des quipements de
soutien industriels.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
27 / 67
Faire voluer votre maintenance
Par dfinition, ce type doprations de maintenance (rnovation, reconstruction, etc.)
est effectu par le constructeur ou par un service ou socit spcialise avec des
quipements de soutien dfinis par le constructeur et donc proches de la fabrication
du bien concern.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
28 / 67
Faire voluer votre maintenance
GMAO
La Gestion de la Maintenance Assiste par Ordinateur est constitue dune base de
donnes (historique) qui est alimente par le personnel de maintenance via un
formulaire. Des pannes sont mises en mmoire pour certains quipements (date,
temps pass, intervenant, matriel remplac, etc.).
La base de lhistorique est linventaire des quipements : appel dcoupage
fonctionnel.
Chaque GMAO est personnalise selon les besoins spcifiques dexploitation de
lhistorique ou le fonctionnement dun site.
A-
Des questions se poser :
Avant de faire l'acquisition d'une GMAO, il est ncessaire de se poser toutes les
questions appropries :
Dcoupage fonctionnel : jusque sur quelle plus petite partie d'quipement
faut-il travailler ?
Historiques : jusqu quel niveau de panne faut-il aller ? Par exemple, faut-il
enrichir la GMAO des micros-pannes ? Tous les quipements sont-ils
concerns ?
Etc.
Les renseignements fournis la GMAO seront fonction des informations que lon
souhaite exploiter ultrieurement. Il est donc ncessaire de connatre sa politique de
maintenance et plus particulirement le rle du service Mthode.
Des rponses toutes les questions natront la dfinition de la GMAO, qui sera
traduite en cahier des charges destin l'acquisition de l'outil appropri.
B-
Le plan de maintenance
Le plan de maintenance regroupe les intentions dintervention de maintenance
prventive (et non corrective au sens de la normalisation). Il est maintenant
couramment intgr la GMAO. Ainsi ce qui est planifi est rappel par la GMAO
(alarmes). Aux oprateurs ensuite de renseigner la GMAO de ce qui a t dcouvert
sur le terrain et de ce qui a t rellement fait.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
29 / 67
Faire voluer votre maintenance
CLes dmarches pour la mise en place d'une
GMAO:
I - Ralisation du cahier des charges (surtout dfinir le besoin)
Volume de l'inventaire Matriels maintenir et documents d'quipement
informatiser
Degr de sophistication du logiciel (plus il est performant plus il est
complexe utiliser)
o Statistiques : calculs raliser, niveau de diagnostic souhait,
exportation du fichier vers Excel par exemple, etc.
o Personnes qui sont appeles l'utiliser : situation gographique,
niveau en informatique, service de rattachement
o Dfinir les ditions que l'on souhaite raliser
o Niveau de complexit de l'environnement industriel: simple ou
multi-site, un ou plusieurs magasins, etc.
o Mise en rseau souhaite (SQL, SAP, etc.)
Dfinir le budget allouer (hard matriel- et soft logiciel-, formation,
maintenance)
Dfinir le temps allou la mise en place (installation, formation, soutien
extrieur)
Dfinir le prventif suivre (plan de maintenance)
Dfinir le suivi Magasin raliser
Dfinir les documents (et leurs contenus) utiles au droulement du
processus de maintenance (Avis, DT, AT, etc.), y compris scurit (permis
de feu, consignations CO2, etc.)
Recenser les outils en place (GMAO existante, saisie papier ou Excel des
interventions), dfinir s'il faut les exploiter
Dfinir le suivi informatique pour la bonne exploitation du logiciel (mise en
place, maintenance hard et soft)
Dfinir les moyens de sauvegarde et d'archivage
II - Choix du logiciel
Dveloppement spcifique ou achat d'un logiciel
Orientation vers un logiciel ou un ensemble de logiciels (GMAO, graissage,
gestion stock) avec les interfaces ncessaires
Choisir un prestataire de services informatiques si pas de comptences
informatiques en interne
III - Mise en place
Installation hard et soft
Essais
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
30 / 67
Faire voluer votre maintenance
IV - Formation du personnel
Les formations prendre en compte sont les suivantes :
Formation gnrale l'informatique (systme d'exploitation Windows par
exemple)
Formation spcifique au logiciel
Remise d'un cours chaque personne
o Veiller ce que les personnes exploitent leurs nouvelles
connaissances trs rapidement aprs la formation, prvoir priode
d'accompagnement
V - Utilisation / Exploitation de la GMAO
Au pralable:
Saisie de l'inventaire COMPLET du matriel
Utilisation de la GMAO:
Saisie des Demandes d'Intervention et des Ordres de Travaux
Saisie des comptes rendus d'intervention et clture
Saisie des alarmes pour les interventions prventives
Autres saisies
Ralisation / ditions des statistiques (indicateurs, Pareto, etc...)
Archivages/sauvegardes
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
31 / 67
Faire voluer votre maintenance
LES EQUIPEMENTS
A-
DTE : Dossier Technique Equipement
Dossier destin aux intervenants techniques dans le cadre de leur mtier
(maintenance, mthodes, BE, etc.)
Dossier papier qui est toutefois de plus en plus informatis (schmas type PID Autocad, dossier constructeur - pdf, plan de maintenance dans la GMAO). On y
retrouve principalement :
Dossier technique (caractristiques de lquipement)
o Dossier constructeur
documents achats dont cahier des charges,
caractristiques techniques,
factures pour la garantie,
coordonnes SAV,
catalogue des pices dtaches
liste des pices critiques avec rfrence et leur cot,
plans de toutes sortes (ensemble, dtail, montage/installation,
vues clates) et schmas (fonctionnels, techniques)
le mode demploi,
les notes dentretien,
matriel de maintenance prconis
quipements dintervention et de mesure
liste des outillages spciaux
listings des programmes
automates
informatiques
o Gammes et modes opratoires
o Check-lists
Dossier historique (carnet de sant de lquipement)
o Dossier interne tenu jour par la maintenance (historique des
modifications, OT, rapports dexpertise, etc)
o Plan de maintenance
Le dossier sera tabli et class selon les procdures en vigueur. Il est tenu jour.
Rappel : il est intressant de faire une approche modulaire des quipements pour
monter le dossier.
B-
Comment localiser les quipements critiques ?
La notion d'quipement critique est primordiale dans l'activit de maintenance. C'est
un critre trs puissant qui sera utilis trs souvent, puisqu'une attention toute
particulire sera accorde ces quipements.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
32 / 67
Faire voluer votre maintenance
Pour dterminer la criticit d'un quipement, un certain nombre doutils sont votre
disposition. Tous partent de lexploitation de lhistorique de maintenance (voir
GMAO).
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
33 / 67
Faire voluer votre maintenance
I - Le diagramme de Pareto
Le diagramme de Pareto permet de localiser rapidement les quipements qui
tombent le plus souvent en panne. L'analyse est ralise en exploitant
directement les temps de panne des quipements qui peuvent tre issus de la
GMAO.
Le diagramme de Pareto appliqu la maintenance peut par exemple
correspondre la courbe du total des temps darrts en fonction du nombre
dinterventions. Les interventions les plus longues sont reprsentes les
premires.
Cela permet de sapercevoir que 6,7% des interventions reprsentent 30% des
heures darrt.
La mthode ABC de Pareto
Exploitez votre historique de maintenance pour dgager des valeurs du type :
A : 20% des temps darrts de maintenance sont
dus des casses garnitures
B : 12% des temps darrts de maintenance sont dus
des arrts dlectrovannes
C : 7% des temps darrts de maintenance sont dus
des arrts dautomates
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
34 / 67
Faire voluer votre maintenance
Exemple dhistogramme de Pareto
II - Criticit des quipements
La criticit des quipements peut tre dfinie prcisment par notation. La
mthode est longue puisqu'il faut numrer chaque quipement. Elle peut
s'avrer ncessaire quand les historiques de panne ne sont pas disponibles.
Le groupe de travail charg de la notation doit avoir la mme composition (pour
que la notation demeure homogne) et sera idalement compos de personnes
issues de services diffrents mais concerns par les arrts (maintenance,
production, mthodes, achats, etc.)
Le groupe de travail pourra utiliser la grille de notation suivante :
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
35 / 67
Faire voluer votre maintenance
Poids
2
P Incidence
panne
Rpercussions
sur la qualit
avec
gnration de
rebuts
Retouches
possibles
Aucune
rpercussion
sur la scurit
et qualit
I Importance
Stratgie par le
dlestage sur
une autre
machine, pas de
sous-traitance
possible
Important : pas
de dlestage
sur autre
machine mais
sous-traitance
possible
Primaire :
dlestage
sur autre
machine et
soustraitance
possible
Secondaire
De secours
E Etat
Rpercussions
graves sur la
qualit et/ou
lenvironnement
A rformer
A rnover
Mauvais
tat
Bon tat
Neuf
Satur (100%)
Fort
Moyen
Fiable
Trs faible
U Taux
dutilisation
Critres
La criticit CR va se dterminer quipement par quipement en
multipliant entre elles les valeurs de critre :
CR = P x I x E x U
C-
Analyse des dfaillances
Aprs localisation des quipements critiques, il peut tre judicieux
dentreprendre une analyse des dfaillances de ses quipements. Cette
dmarche nous fait accder une maintenance proactive :
dmarche de progrs, les dfaillances deviennent source de profit si
elles sont correctement exploites. Pour cela on entreprend un
diagnostic dont on dfinit ltendue (quipement tudi). Cette tude
se fait au calme loin de la maintenance journalire. Elle va regrouper
les personnes susceptibles dapporter des informations sur la
dfaillance traite (fabricants, BE, oprateurs, experts, etc.) via une
AMDEC par exemple.
La norme X60-011 propose des familles pour regrouper les dfaillances.
1 - Les causes des dfaillances :
Les causes de dfaillance sont intrinsques (inhrentes) ou
extrinsques :
Dfaillance de conception
Dfaillance des composants
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
36 / 67
Faire voluer votre maintenance
Dfaillance de fabrication
Dfaillance de montage
Dfaillance lutilisation
2 - Les modes de dfaillance
Les modes de dfaillance sont de deux types:
Dfaillance progressive
Le TBF sarrte ds que lon passe en dessous du Seuil de la
perte de la fonction requise .
Exemple : appareil qui rouille.
Maintenance applique : maintenance conditionnelle ou
prvisionnelle (surveillance dun paramtre).
Dfaillance brusque
Exemple : soupape.
Maintenance applique :
connatre le TBF)
maintenance
systmatique
(bien
Remarque
Le mode de dfaillance est exploit dans les tudes AMDEC et
cette occasion on utilise les modes de dfaillance suivants :
perte de la fonction
fonctionnement intempestif
refus de s'arrter
refus de dmarrer
fonctionnement dgrad
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
37 / 67
Faire voluer votre maintenance
D - Plan de fiabilit
Ltude des dfaillances doit dboucher sur la mise jour (ou la
cration) dun plan de fiabilit : il se traduira dans le plan de
maintenance. Ce plan doit permettre de faire concider Fiabilit
prvisionnelle et Fiabilit oprationnelle .
On notera que ltre humain est considr comme environ deux fois
moins fiable quun quipement mcanique.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
38 / 67
Faire voluer votre maintenance
DEMARCHES, METHODES ET OUTILS
Il est parfois difficile de se mettre d'accord sur le partage des mthodes et outils.
Voici une proposition de classement des mthodes, outils et dmarches pouvant
tre utiliss en maintenance ou ayant un lien direct avec la maintenance.
Dmarche de management
Mthodes
Outils
TPM
(dont automaintenance)
PDCA (Roue de Deming)
5 M ou arbre des causes
dIshikawa ou artes de
poisson
5S
MBF
QQOQCCP
Kaizen
Kanban
Poka Yoke (dtrompeur)
Ingnierie
Pareto ou analyse ABC
Hoshin
5 pourquoi
Benchmarking
AMDEC
MERIDE
Brainstorming
Par exemple la mthode SMED n'est pas aborde ici. C'est notamment parce que son
application est quasiment rserve la gestion de la production.
A Prsentation
AMDEC : Analyse des Modes de Dfaillances, de leurs Effets et de leur Criticit
MBF : Maintenance Base sur la Fiabilit. Correspond lapplication en France
de la RCM Reliability Centered Maintenance dveloppe aux Etats-Unis.
o MBF = AMDEC + Organisation de la maintenance
Benchmarking : Moyen de comparaison quantitatif et/ou qualitatif de
performances avec un rfrentiel (les dfinitions rencontres sont trs
variables, elles se veulent trs restrictives ou trs ouvertes selon les
ouvrages). Le but est clair: le benchmarking permet de mettre en perspective
des axes d'amliorations.
PDCA (dite Roue de Deming) : Cest une dmarche danticipation et un moyen
de piloter efficacement des projets importants pour lentreprise.
o Plan/Prvoir
o Do/Faire
o Check/Vrifier
o Act/Ragir
HOSHIN : systme de management qui permet de concentrer tous ses efforts
et toutes ses ressources dans la ralisation rapide dun objectif.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
39 / 67
Faire voluer votre maintenance
Brainstorming (remue-mninges) : a pour but de produire un grand nombre
d'ides sur un thme donn. Il favorise la crativit des participants et permet
de faire surgir des ides nouvelles.
Diagramme de Pareto ou analyse ABC (exploitation des relevs de
dfaillance) : permet d'orienter la politique de maintenance mettre en
uvre. Le but est de faire apparatre les priorits, de faire le tour d'un
problme ou d'une situation (rsolution de problme en groupe de travail).
Diagramme d'Ishikawa (diagramme causes/effets) encore appel
Diagramme en artes de poisson ou Mthodes des 5 M (
o Mthodes,
o Milieu,
o Matire,
o Maintenance ou Main d'uvre,
o Moyens ou Machines)
dont le but est de formuler collectivement les causes d'un problme, de
dterminer avec prcision les situations problmes, puis de lister toutes les
causes pour ensuite les classer en famille afin de les positionner sur le
diagramme.
Fig.: 5M
Pour arriver au 6M ou 7M, on ajoute:
Management ;
Moyens financiers.
QQOQCCP : technique de recherche des informations, pour faire le tour d'un
problme ou d'une situation en se posant tour tour les 7 questions.
o Qui :
o qui a le problme ?
o qui est intress par le rsultat ?
o qui est concern par la mise en uvre ?
o Quoi :
o De quoi sagit-il ?
o Quel est ltat de la situation ?
o Quelles sont les caractristiques ?
o Quelles sont les consquences ?
o O :
o Ou le problme apparat-il ?
o Dans quel lieu ?
o Sur quelle machine ?
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
40 / 67
Faire voluer votre maintenance
Quand :
o Quand le problme a-t-il t dcouvert ?
o Quelle est sa frquence ?
o Comment :
o Comment mettre en uvre les moyens ncessaires ?
o De quelle manire ?
o Avec quelles procdures ?
o De quelle manire intervient le problme ?
o Combien :
o Combien de fois cela sest-il produit ?
o Combien a cote ?
o Combien cote la non rsolution du problme ?
o Pourquoi :
o Pourquoi raliser de telles actions ?
o Pourquoi respecter telles procdures ?
Kaizen : cette dmarche japonaise repose sur des petites amliorations faites
au quotidien, constamment.
MERIDE : valuation des risques des dfaillances des quipements en termes
de quantit, dlais et qualit des produits, ainsi que leurs consquences sur la
scurit et l'environnement.
TPM (Total Productive Maintenance) : systme de recherche du rendement
global maximum. Deux points sont inclus dans la TPM :
o
TRS
o
5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) se traduit du japonais en
franais par :
Ordonner (ou plus littralement ter l'inutile),
Ranger,
Dpoussirer, Dcouvrir des anomalies,
Rendre vident,
Etre rigoureux.
o
Auto-maintenance : maintenance lmentaire (souvent niveau 1)
ralise par les agents de production qui ont disposition les
procdures et les moyens techniques.
5 pourquoi : partir dun problme nonc, on se pose 5 fois la question
Pourquoi pour dterminer la cause premire. Exemple :
o
Le compresseur dair est larrt (le problme)
Pourquoi ? - Il sest mis en dfaut ;
Pourquoi ? - Parce quil manque dhuile ;
Pourquoi ? - Il y a une fuite dhuile ;
Pourquoi ? - Je nai pas vrifi le niveau dhuile ;
Pourquoi ? - Je n'ai pas respect le plan de graissage (la cause
premire).
Remarque : il peut y avoir plusieurs causes possibles un problme donn,
la mthode devrait tre rpte pour tre systmatique, ce qui revient
faire une AMDEC.
Poka Yoke : un dtrompeur (ou anti-erreur, poka-yoke en japonnais), est un
dispositif, gnralement mcanique, permettant dviter les erreurs
d'assemblage, de montage ou de branchement.
Kanban : Le Kanban est une tiquette qui sert matrialiser la commande
que passe un poste client un poste fournisseur dans un systme de
production ou dapprovisionnement par flux tendu.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
41 / 67
Faire voluer votre maintenance
B Cas particulier de la TPM
La TPM (Total Productive Maintenance) est un systme global de maintenance industrielle
fond sur le respect des facults humaines et la volont participative de lensemble du
personnel pour rentabiliser au maximum les installations.
1 Auto-maintenance :
Maintenance de premier niveau ralise par les oprateurs.
Avantages :
Gain en efficacit : plus rapide = systme pompier
Maintenance mieux faite car interventions avant la vraie panne
Inconvnients :
La fabrication ne voit pas les choses de la mme faon
Risque de vouloir en faire trop
REX (Retour dEXprience) difficile (de petites pannes rptitives non
remontes peuvent gnrer une grosse panne)
Mal accept par la maintenance qui voit sa profession partir
Les UAP (Units Autonomes de Production) ont ts, pour la maintenance, une
version renforce de la dilution de la maintenance, abandonne par le pass.
Aujourd'hui l'automaintenance revient au devant de la scne mais de faon plus
mesure.
L'auto-maintenance se dfinie trs bien :
sous forme de logigramme afin de dfinir les rles de chacun
L'auto-maintenance ncessite :
un investissement de la part du responsable de fabrication
2 - TRS :
Analyse de l'efficience.
Somme de 3 coefficients dont 1 concerne directement la maintenance : B / A
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
42 / 67
Faire voluer votre maintenance
Temps douverture
Arrts
programms
A = Temps de charge (temps requis)
B = Temps brut de fonctionnement
C = Temps net de fonctionnement
D = Temps utile
de
fonctionnement
Arrts
Ralentissements
Dfauts
TRS = D / A
B / A = taux de disponibilit
C / B = taux de performance
D / C = taux de qualit
3 - 5S :
Usine bien tenue (ordonne, propre). Important pour :
la qualit du travail
l'image de marque Engagement de la Direction qui commence donner
l'exemple mais trs difficile mettre en place car remise en question de
chacun.
C Cas particulier de lAMDEC
LAMDEC est une mthodologie danalyse en profondeur des pannes et des
quipements permettant de prendre des dcisions telles que la mise jour du plan
de maintenance ou la modification de la conception de lquipement.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
43 / 67
Faire voluer votre maintenance
La mthodologie suivre est la suivante :
1. Une fonction est dcompose ventuellement en systmes
2. On ralise :
Une analyse fonctionnelle pour chaque systme
Une analyse de dysfonctionnement des systmes
tout en faisant apparaitre les quipements concerns.
3. On ralise alors une AMDEC pour chaque quipement concern*
4. On en dduit les effets et leur criticit
* Exemple de support AMDEC :
Dfaillance
Mode Cause
Effets
Sur le
systme
Sur la
fonction
Dommage
induit
Nb de
pannes
Criticit FxGxE
Frquence Gravit
F
G
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
Evidence
E
Obs.
44 / 67
Faire voluer votre maintenance
D Critiques des dmarches et mthodes
1 - Remarques propos des dmarches et mthodes
La clef de vote de bon nombre de dmarches et mthodes imposes par les
managers est l'implication et la participation. Or la participation des acteurs n'est
pas vidente obtenir. Si la participation est formalise (fiches documentes, plan
de progrs), les promesses d'implication ne sont pas assurment respectes. La
participation est assurment dcrte (engagement de la direction) mais il faut
veiller ce que cela ne demeure pas formel. Le formalisme peut engendrer un
excs de contrle, freinant la valorisation -pourtant dcrt galement- des
acteurs. Une rorganisation formelle n'est pas assurment la faon la plus efficace
d'voluer. Dans le cadre de la TPM par exemple, rien n'empche un oprateur de
remonter des informations fausses pour donner l'apparence d'adhrer la
dmarche.
2 - Cas particulier de la TPM
La TPM met en avant l'oprateur qui reprend une partie du travail de la
maintenance. La maintenance se trouve ainsi partiellement dpouille au profit de
la production. Par contre dans le cadre de sa maintenance prventive, elle doit
souvent ngocier la disponibilit des installations. Sur ce point la maintenance se
retrouve en position de force : la fabrication doit rendre les installations
disponibles. La dmarche TPM n'a priori de sens que si la maintenance est
rattache la production. Dans le cadre de la mise en place de la dmarche, on
voit que le rle, la rpartition du pouvoir lintrieur de lentreprise se trouve
profondment modifi.
3 - Problme
On remarque que les diffrents mthodes et outils se superposent et/ou se
compltent. Cela complexifie la comprhension.
Sur la figure suivante on retrouve une imbrication des outils et des diffrentes
mthodes de maintenance.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
45 / 67
Faire voluer votre maintenance
4 - Conclusion
En vertu du changement, on assiste souvent au dploiement de mthodes qui ne
sont en fait que de fausses images cachant une ralit complexe. La
mconnaissance de certains managers des pratiques concrtes de fonctionnement
est souvent constate.
D - Outils et techniques volues
Les outils informatiques prennent de plus en plus de place dans la gestion de la
maintenance.
GMAO : Gestion de la Maintenance Assiste par Ordinateur
Applicatifs pour raliser de la maintenance conditionnelle
Systmes experts
Etc.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
46 / 67
Faire voluer votre maintenance
FIABILITE - COMPORTEMENT DU MATERIEL,
DEFAILLANCE, PROBABILITES
A - MTBF
MTBF : moyenne des TBF (temps de bon fonctionnement)
Attention : Mean Time Between Failure (anglais) est diffrent du
MTBF (franais)
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
47 / 67
Faire voluer votre maintenance
B - Taux de dfaillance
Taux de dfaillance (lambda) : (t)
Taux de dfaillance : (t)
Unit = pannes / heure
Le taux de dfaillance est fourni par les constructeurs mais vous pouvez le
dfinir par exploitation des historiques de pannes.
Evolution du cycle de vie des quipements :
Zone 1 : priode de rodage, les pannes nombreuses au dbut diminuent
Zone 2 : priode durant laquelle le nombre de pannes est le plus faible
Zone 3 : priode de vieillissement acclr, le nombre de pannes augmente sans
cesse
Cette courbe est appele Courbe en baignoire .
Durant la priode o est constant il est opportun de faire de la maintenance
conditionnelle. On veille ne pas en faire trop .
Diagramme de Weilbull
Permet de savoir dans quelle zone de la courbe du cycle de vie on se trouve: Zone 1, 2
ou 3.
R(t) = e ( (t ) / )
Lutilisation dabaques est ncessaire.
Exemple dapplication :
Les historiques de maintenance de vingt emboutisseuses pour 1.000 heures de
fonctionnement ont rvls 50 pannes.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
48 / 67
Faire voluer votre maintenance
Le taux de dfaillance est :
MTBF = 400 heures
C - Fiabilit
Fiabilit : R(t) = e
.t
Exemple de calcul :
Quelle est la probabilit de fonctionnement dune pompe donne durant
1 an (8760 heures) ?
Pompe, taux de dfaillance : = 2.10-5 pannes / h
R (8760) = e 2.10-5 x 8760 = 0,84
R = 84 %
Remarque :
MTBF = 1 /
MTTR = 1 /
Ainsi : R(MTBF) = e
( . MTBF)
=e
= 0,37
On a 63 % de chance de tomber en panne avant le MTBF !
Remarque : il est intressant de savoir que lhomme est souvent le maillon le moins
fiable de toutes les fonctions de maintenance.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
49 / 67
Faire voluer votre maintenance
D - Disponibilit
D = MTBF / MTBF + MTTR
Remarque : en fixant la disponibilit on fixe le MTTR et le MTBF.
Les tables de dfaillances sont trs utiles pour faire des calculs.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
50 / 67
Faire voluer votre maintenance
E - La matrise de lefficience
Est-ce que mon magasin fonctionne bien, mon quipe est oprationnelle, etc. ?
Que surveiller ?
F - Sret de fonctionnement
La sret de fonctionnement a pour finalit le maintien du bon fonctionnement d'un
systme, tout au long de son cycle de vie et ce, moindre cot.
Les paramtres surveills sont :
Fiabilit
Maintenabilit
Disponibilit
Scurit
Cot
La sret de fonctionnement concourt la matrise des risques.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
51 / 67
Faire voluer votre maintenance
CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE,
EXTERNALISATION
A - Pourquoi sous-traiter ?
Les arguments pour passer la sous-traitance peuvent tre de plusieurs ordres (en
dehors du gain financier qui reste dmontrer) :
Attention: le but est de faire un constat de la situation actuelle et
nullement de critiquer les intervenants de maintenance, c'est bien la
conjoncture qui nous amne la situation dcrite.
La sous-traitance de la maintenance est un moyen de contrler les dpenses. Plus
que le Donneur dOrdres, le sous-traitant doit veiller la rentabilit du contrat.
L'image de la maintenance n'est pas bonne. Le rejet frquent de la fonction
mthodes tend prouver que le personnel Maintenance refuse de progresser.
Quel est le service maintenance qui pratique les probabilits ?
Absence frquente de veille technologique en interne.
La technique n'est souvent pas le problme de fond.
Le service Maintenance a du mal chiffrer son budget et de fait ne sait pas
convaincre sa direction.
Les maintenanciers ne sont pas souvent trs humbles (mais il est vrai souvent
trs comptents).
Les personnels Maintenance prfrent malheureusement le rle de pompier (qu'ils
matrisent mieux que quiconque, et pour cause) aux interventions prventives
Le personnel de maintenance n'est pas renouvel l'issue des dparts (retraite,
mutation, etc.)
B - Les diffrentes formes de sous-traitance et leurs
rmunrations
I-
Les formes de sous-traitance
Les formes de sous-traitance de la maintenance sont nombreuses. Ce n'est pas la
faon d'intervenir qui change, puisque le travail du technicien reste le mme, mais
c'est le cadre juridique de l'intervention qui va dfinir la forme de sous-traitance.
Aussi, nous pouvons dissocier les interventions en les classant par modes de
rmunration :
Intervention rmunre au temps pass : mission limite dans le temps
(rgie, travail temporaire). La rmunration pourra tre de type
dpense contrle
Intervention sur devis
Forfait (peut tre partiel : limit un nombre d'heures, le restant tant de la
dpense contrle plafonne ou non)
Intervention rmunre au bordereau point
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
52 / 67
Faire voluer votre maintenance
Bien entendu la relation entre le Donneur dOrdres et le prestataire de maintenance
ne devra jamais entrer dans le cadre d'un dlit de marchandage.
Pour cela il faut que le primtre d'intervention soit dfini et qu'il n'y ait pas
subordination : les quipes intervenantes doivent donc tre totalement
indpendantes du Donneur dOrdres (donc avoir un responsable dsign) et avoir
une mission parfaitement dfinie l'avance.
II -
Contrat de moyen ou de rsultat ?
Notion de rsultat :
Contrairement la notion de moyen, la notion de rsultat comporte l'obligation
pour un prestataire de maintenance de raliser sa prestation en respectant un
objectif dfini au pralable (ratio, un nombre d'heures, rsultat technique, etc.). La
relation est plus confortable pour le Donneur dOrdres qui aura su dfinir des
objectifs avant l'intervention : en cas de litige sur l'objectif, c'est au prestataire de
dmontrer qu'il a tout mis en uvre pour atteindre l'objectif et non pas au Donneur
dOrdres de dmontrer la faute.
Nous encourageons vivement les contrats obligation de rsultats, mais il n'est pas
toujours simple de dfinir l'objectif atteindre (dlai imparti, cot, etc.).
III -
Un exemple de rmunration "mixte", le cas du "cost and fee" :
Ce type de rmunration d'une prestation trs labor est destin motiver le
prestataire de maintenance.
Rmunration = Cots fixes + Cots variables + 0,5* (Valeur Cible - Cots
variables)
Cots fixe = le prestataire est assur de voir ses frais de structure pays.
Cots variables = le prestataire se voit rmunr pour la partie variable de
son intervention (heures) en fonction du temps pass.
Intressement : 0,5* (Valeur Cible - Cots variables) = une cible d'heures a
t dfinie, en cas de dpassement le prestataire ne touchera pas
d'intressement.
* A moduler
C - Cas particulier: le contrat de maintenance au forfait
Le contrat de maintenance de type forfait suscite un engouement tout particulier en ce
dbut de 21me sicle. La mode mondiale de matrise des cots fait de ce type de
rmunration l'outil idal puisque son exploitation permet de dfinir clairement les
budgets de maintenance.
L'application du contrat de type forfait est-elle si simple ? Malheureusement il n'est pas
rare de constater que des prestataires rclament, au-del du forfait, des sommes parfois
consquentes (20% du forfait) au Donneur dOrdres. A qui incombe la faute ? La rponse
n'est pas simple, on constate qu'il arrive souvent que le Donneur dOrdres paye les
sommes rclames en plus du forfait. Le prestataire lui soumet pour cela des lments
de preuves qui justifient ces dpassements.
On comprend donc que la rdaction du contrat et le montant du forfait ne doivent pas
tre labors avec lgret. Pour arriver une valeur chiffre finale (le montant
forfaitaire annuel), un Donneur dOrdres doit traiter/recouper beaucoup de chiffres issus
des :
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
53 / 67
Faire voluer votre maintenance
Primtres gographique et technique
Historiques travaux (nature, type, urgence, dure)
I-
Le contenu du contrat
Le contenu d'un contrat n'est pas fig, il doit tre adapt la particularit de
chaque service maintenance. Il pourra par exemple tre constitu de 2 parties: une
gnrale et une spcifique dans le cas o plusieurs contrats auraient la mme
partie gnrale.
Sommaire
Gnralits
Etendue de la prestation contractuelle
Moyens
Modalits dexcution
Suivi du contrat
Conditions conomiques
Complments juridiques
Modifications
Annexes
Glossaire
Index
II -
Eviter certains piges lors de la rdaction
Se poser la question de savoir si lon est prt passer un contrat de maintenance
forfaitis :
si lon a une connaissance suffisante de sa maintenance. La meilleure faon
de le savoir est de se heurter la dtermination prcise du cot de
maintenance pour un primtre dfini.
Se poser la question de savoir si lon est prt sous-traiter :
le processus maintenance est-il adapt la forfaitisation ?
III -
Les tapes de l'laboration d'un contrat
L'laboration d'un contrat de type forfait est des plus contraignantes. Les tapes
ncessaires sa rdaction sont les suivantes :
Etat des lieux
Dfinition* de la stratgie de maintenance
Dfinition* de la politique dexternalisation (externalisation pices de
rechange par exemple, primtres)
Rdaction du plan de communication
Rdaction du cahier des charges
Rdaction*/rassemblement
des
documents
dannexes
(processus
maintenance, plan des arrts, plan prventif (dont graissage), plan des
visites rglementaires, etc.)
Dfinition* spcificits (scurit par exemple)
Rdaction* de documents spcifiques soumettre au prestataire
(fonctionnement informatique par exemple)
Prparation du pr-contrat et des documents achats
Dfinition de la stratgie de consultation
Dfinition des valeurs cibles
Grille de rponse technique
Grille de dcomposition de cots
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
54 / 67
Faire voluer votre maintenance
Dtermination short lists
Consultations
Comparaison des offres, notations
Alignement des offres
Dfinition des axes de ngociation, ngociation
Adaptation du contrat
Signature contrat
Priode de mobilisation
o Dmarrage contrat
* A partir de lexistant
IV -
Planification de la rdaction d'un contrat et dmarrage du contrat
Il faut compter environ 2 mois pour passer toutes ces tapes.
Aprs le lancement de la consultation, il faut compter galement 2 mois pour
obtenir les offres des prestataires. La phase de ngociation dure environ 1 mois.
V-
Les lacunes d'un encadrement par une socit de conseil
La rdaction d'un contrat de maintenance reprsente un travail ponctuel important
que le Donneur dOrdres, faute de moyens internes suffisants, souhaite soustraiter. Il fait pour cela appel un cabinet de conseil.
La mconnaissance de la maintenance par une socit de conseil peut,
malheureusement, tre une ralit. Dans le cadre du montage d'un contrat
forfaitaire, un mauvais choix de conseil peut avoir des consquences humaines et
financires qui se rvleront lors du fonctionnement du contrat. On ne pensera
alors pas forcment ce moment-l que le cabinet de conseil a prpar un
document qui a conditionn les problmes et souvent on recherche la faute du ct
des oprationnels de maintenance.
La mauvaise socit de conseil compte parfois sur le Donneur dOrdres (quelle juge
experte en maintenance !) pour remdier ses propres lacunes : le monde est
alors l'envers. L'un des risques consiste par exemple exploiter sans filtrage, par
dfaut de comptence, des informations brutes collectes en interne (informations
incompltes ou fausses fournies par le service maintenance par exemple) pour
dfinir la valeur cible d'un contrat forfaitaire ou consulter les entreprises.
En maintenance, la connaissance du terrain est indispensable. Le cabinet de conseil
ne doit pas tre exempt de cette qualit.
La socit de conseil devra savoir mener son projet en motivant notamment les
gens de terrain. Elle devra donc tenir compte de leur avis et se mettre leur niveau
et tirer tout le monde vers le haut. Sans la motivation du personnel de terrain, le
projet ne peut aboutir.
D - Jusqu "o" sous-traiter l'activit de maintenance ?
La question de savoir jusqu' quel point il faut sous-traiter est peu vidente. La rponse
est fonction du Donneur dOrdres : de son activit, de son histoire, de sa situation
gographique, de ses acquis, de sa situation sociale, de sa situation financire, de sa
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
55 / 67
Faire voluer votre maintenance
politique. Aujourd'hui nous constatons une disparit importante dans les politiques de
sous-traitance.
N'est-il pas surprenant de constater qu'un site prparant du combustible nuclaire
sous-traite son activit de maintenance, notamment de production, 90% ?
Nous ne saurions trop conseiller aux donneurs dordres de conserver un minimum de
matrise de leur outil de production critique, pour la scurit et pour la production
essentiellement.
Le Donneur dOrdres doit garder la matrise de la politique maintenance
Le Donneur dOrdres doit avoir une visibilit totale des pratiques de maintenance
en place
Le Donneur dOrdres doit conserver une fonction mthode au moins pour traiter
de lamlioration de la fiabilit.
o Cette fonction mthode sera un lment moteur lors de la mise en place
ventuelle de la TPM ou d'autres dmarches :
o Le Donneur dOrdres garde la matrise des amliorations rentabilit non
immdiate (retour sur investissement suprieur 1 mois par exemple)
o Le Donneur dOrdres garde la matrise de la maintenance prventive
(hormis le systmatique et conditionnel type CND, contrles
radiographique)
o Selon le niveau de la maintenance prventive (si auto-maintenance), le
Donneur dOrdres pourra garder la matrise des interventions de niveau 1
et 2
o Le Donneur dOrdres gardera lentretien de certains quipements, les plus
critiques par exemple
o Si le Donneur dOrdres possde un contrat de rsultat de type forfait, le
prestataire ralisera la prestation mthode afin de se garantir la rentabilit
du contrat sur la dure
Une sous-traitance importante doit OBLIGATOIREMENT saccompagner dune tenue jour
stricte de :
plan de maintenance
DTE (Document Technique des Equipements)
Comptes rendus d'intervention
Tous les historiques doivent tre rcuprables sur les outils appartenant au Donneur
dOrdres (GMAO essentiellement). Le Donneur dOrdres ne doit pas se trouver dmuni
dhistoriques au dpart du Prestataire.
D - Le nombre de contrats de sous-traitance la globalisation
Sans relle politique d'externalisation, il est un fait que le nombre de contrats augmente
sans cesse et que leur suivi est d'autant plus difficile mesure que l'effectif interne
dcrot.
La rduction du nombre de formes de sous-traitance peut tre source de profit pour un
service maintenance ou plus exactement pour le service achats. Ainsi on parle de
maintenance globale: un prestataire ou une poigne de prestataires de maintenance vont
se partager l'ensemble de l'activit de maintenance externalise.
E - Le dmarrage d'un contrat : priode dlicate
Les Donneurs d'Ordres qui ne matrisent pas la mise en route d'un contrat ne sont
malheureusement pas rares. Par exemple, la mise en place des contrats de maintenance
forfaitiss pose dnormes problmes aux Donneurs d'Ordres Franais.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
56 / 67
Faire voluer votre maintenance
Bien entendu ceci nest pas d au hasard. C'est laboutissement malheureux dun
enchanement de faits qui ont un point commun : le manque de matrise de l'laboration
du projet.
La mise en place d'un contrat de maintenance mrite une attention toute particulire. En
effet la russite du dmarrage conditionne l'avenir du contrat. Il faut prparer la venue
du prestataire :
Expliquer aux fabricants le projet
Remettre en question le processus gnral
Rdiger la procdure de mise en place (+ formation, plans de prvention, etc.)
Aider la prise en main (plan de maintenance)
Dsigner un interlocuteur. Dfinir la forme et le fond des rapports : l'interlocuteur
du prestataire a un rle trs important jouer.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
57 / 67
Faire voluer votre maintenance
GESTION DE STOCK
Les stocks de maintenance sont constitus de pices de rechanges (pices d'usure,
pices de fonctionnement, pices de structure) qui peuvent tre classes en :
pices d'origine
pices quivalentes (non fournie par le constructeur de l'quipement, mais cahier
des charges identique)
pices interchangeables (peu se substituer une pice d'origine)
pices adaptables (doit tre adapte pour tre monte)
Dfinitions utilises
Codification unique des pices de rechange : les articles sont composs d'une
dsignation (libell long et court) et d'un code article. Le code article est constitu
de lettre et chiffres en fonction des caractristiques de l'article (classe
d'quipement, diamtre, paisseur, etc.).
Remarque : la codification fournisseur n'est pas utilise comme codification
de magasin mais on lutilisera comme une information complmentaire.
Classes d'articles : les articles peuvent tre regroups par classes, ces classes
constitueront une partie des codes article.
Catalogue des pices de maintenance : est constitu de la liste des rfrences des
articles que lon peut retrouver dans le magasin des pices de rechange.
A - Choix d'une mthode d'approvisionnement :
Selon le type d'article consommer et son utilisation, on utilisera une mthode diffrente
d'approvisionnement.
Quantit
Intervalles
Point de commande
Variables
Variables
Plan
d'approvisionnement
Variables
Fixes
Programme
dapprovisionnement
Fixe
Fixe
B - Liste des quipements
La liste des quipements avoir en stock correspond au moins aux quipements les plus
critiques (voir tude de criticit). En effet, il ne parait pas judicieux daller beaucoup au
del.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
58 / 67
Faire voluer votre maintenance
C - Stock minimum / rapprovisionnement
1. Loi de poisson
S'applique aux phnomnes rares ou alatoires.
Exemple : probabilit que sur un quipement j'ai 10 pannes pour les 6 mois
qui viennent avec un MTBF donn.
Permet notamment de dterminer les niveaux de stock.
n : nb de pannes
t : au temps t
L'abaque de Molina permet de dterminer n quand on connat les autres
paramtres.
2. Mthode du point de commande
Valable si l'on consomme plus de 20 pices.
Seuil de dclenchement d'une commande = Quantit de commande + K
K = taux de scurit = 1 / rupture de stock
= cart type de consommation
D - Choix d'un fournisseur :
Afin de choisir un fournisseur pour la fourniture d'un quipement donn, il est utile de
hirarchiser ses fournisseurs sur la base du ratio suivant :
Cot de maintenance + Cot de non production
MTBF quipement
Le fournisseur peut tre not, cela sert notamment dans le cadre de l'ISO.
E - Cot d'un quipement
Le cot d'un quipement est constitu de :
Cot d'achat
Cot d'acquisition (cot ligne de commande, etc.)
Cot de possession (financier, magasinage, etc.)
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
59 / 67
Faire voluer votre maintenance
Cot de destruction, recyclage
F - Quantit conomique de commande
Pour dfinir notamment la priodicit de passage d'une commande de matriel, il faut
comparer les cots d'acquisition et les cots de possession.
Q = quantit optimale d'units d'articles commander
Formule de Wilson :
Q = 2 b n / a i
a : prix unitaire de l'article, rendu magasin
b : cot de passation de commande
i : taux de possession (% annuel) - Valeur comprise habituellement entre 20 et 26
%
n : nombre d'articles utiliss pendant 1 anne
T : temps entre 2 commandes
Rem. : il vaut mieux commander un peu plus qu'un peu moins (courbe plus plate vers la
droite)
G - Magasin
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
60 / 67
Faire voluer votre maintenance
Pour assurer un bon rangement, il est envisageable que les aires de circulation d'un
magasin reprsentent 60% de la surface du magasin.
Le plan de stockage doit tre tenu jour : le MTTR sera d'autant plus faible.
Le conditionnement d'origine doit tre conserv.
De faon gnrale les pices doivent tre conserves dans des endroits qui leur
conviennent.
H - Valorisation du stock :
Lutilisation du PUMP (Prix Unitaire Moyen Pondr) est la plus courante en France (par
opposition au systme anglo-saxon appel FIFO, ou dautres LIFO, Prix standards, MEFO)
Principe : chaque nouvel approvisionnement le prix de la pice est revu.
Exemple :
Entre / Sortie
Prix achat
Stock
Valeur totale
PUMP
Stock initial = 0 + 10
50
10
500
50
-3
inutile
7 x 50 = 350
50
+5
52
12
7 x 50 + 5 x 52 = 610
610 / 12 = 50,83
I - Inventaire
La ralisation dun inventaire du magasin de pices de rechange est obligatoire tous les
ans. Il rentre dans le calcul du bnfice de la socit.
Ldition doit tre faite par magasin,
puis par zone (voir plan de magasin) ;
avec les numros demplacement.
N emplacement
Dsignation
Code article
Quantit
GMAO
Quantit
pointe
Ecart
J - Les ratios en rapport avec la gestion de stock
Valeur du stock = Cot de possession + cot de gestion du stock
cot de possession = cot de stockage unitaire x quantit moyenne
stocke
cot de gestion
= cot de traitement (passation commande, transport,
traitement administratif) x nombre de livraisons d'articles
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
61 / 67
Faire voluer votre maintenance
Cot de passation dune commande : cot correspondant aux moyens dployer
pour passer une commande un fournisseur. Toutes les tches amont peuvent
tre incluses. Par exemple, on peut inclure le suivi des fournisseurs.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
62 / 67
Faire voluer votre maintenance
LES EQUILIBRES DE LA MAINTENANCE
Prfrez une maintenance qui accumule des quilibres une maintenance qui accumule
des compromis. Ces simples graphiques sont bien utiles la rflexion.
A - Equilibre maintenance prventive / corrective
Valeurs donnes titre indicatif
B - Equilibre en matire de prparation des travaux
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
63 / 67
Faire voluer votre maintenance
C - Niveau de stock
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
64 / 67
Faire voluer votre maintenance
LCC
LCC = Cot du cycle de vie
Voici le genre de question qu'il est possible de rsoudre par l'approche du cot du cycle
de vie :
"Je dois optimiser la maintenance d'un point de vue financier. Pour cela on me demande
d'utiliser la mthode LCC, qui est le calcul du cot d'un quipement tout au long de sa
vie. Je dois dterminer, en fonction de son prix, de sa date d'achat, et des actions de
maintenance associes, s'il faut continuer d'investir sur un tel matriel ou s'il est
prfrable de le changer."
A - Dfinition
Le LCC correspond au cot global de possession. Pour le dterminer, il faut tenir compte
des cots suivants:
acquisition
exploitation
maintenance (y compris cots indirects)
limination / revente du bien
LCC = V + D + C + E
V = investissement initial (frais d'tudes, cot de passation commande, frais de
logistique, cot de l'quipement)
D = dpenses d'exploitation (nergie, consommables, main d'uvre)
C = cots de maintenance y compris cots indirects
E = cot d'limination, prix de revente
Remarque 1 : il faut travailler en euros constants en additionnant les cots sur plusieurs
annes.
Remarque 2 : les cots indirect de maintenance sont constitus de :
Perte de production (
o main duvre larrt,
o non-qualit,
o arrts induits,
o micro-arrts,
o mode dgrad,
o casse induite,
o etc)
Pnalits
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
65 / 67
Faire voluer votre maintenance
B - Programme de maintenance base sur le LCC
C - Quelques chiffres
Il est reconnu couramment que le cot global de maintenance d'un quipement est dfini
60 / 70 % par les dcisions de conception.
En moyenne, le cot global de maintenance dun quipement pour sa dure de vie
reprsente 2 3 fois son cot d'investissement initial.
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
66 / 67
Faire voluer votre maintenance
PLAN DE MAINTENANCE
A - Dfinition selon la norme NF EN 13306
"Ensemble structur de tches qui comprennent les activits, les procdures, les
ressources et la dure ncessaire pour excuter la maintenance."
Cette dfinition manque de prcision et offre donc une grande libert dapplication.
B - Application pratique
Le plan de maintenance est compos minima du programme dintervention de
maintenance prventive. Il est maintenant couramment intgr la GMAO. Ainsi ce qui
est planifi est rappel par la GMAO (alarmes).
L'tendue du plan de maintenance dfini la matrise de l'activit de la maintenance. Il
dfini les conditions et les informations ncessaires la bonne ralisation des
maintenances prventive et curative.
Il existe des outils pour la constitution du plan (mthodologies, arbres de prises de
dcision, abaques) mais la base de sa ralisation est lie lexploitation des historiques
de maintenance et des statistiques.
Il doit tre mis jour ds que le contexte change (taux dengagement, produit fabriqu,
etc.).
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
67 / 67
Faire voluer votre maintenance
Socit Ingexpert consultants experts maintenance
17F Bd Jean Duplessis
13014 MARSEILLE
http://www.ingexpert.com
contact@ingexpert.com
Auteur : Guillaume Laloux
04.91.63.48.67
Ce document est conu et diffus par www.ingexpert.com
Vous aimerez peut-être aussi
- Sypemi Guide Gmao V Finale 07aout2009Document26 pagesSypemi Guide Gmao V Finale 07aout2009jeaneric82100% (2)
- Gmoa LamyaeDocument33 pagesGmoa LamyaeAmrani IlyassPas encore d'évaluation
- Pile À Combustible Domestique: Petit générateur pour l'électricité et l'eau chaufféeD'EverandPile À Combustible Domestique: Petit générateur pour l'électricité et l'eau chaufféePas encore d'évaluation
- Documentation M4TDocument5 pagesDocumentation M4TSonychrist ElliotPas encore d'évaluation
- Structure Multifonctionnelle: Les futurs systèmes de l'armée de l'air seront intégrés dans des cellules matérielles multifonctionnelles avec capteur intégré et composants de réseauD'EverandStructure Multifonctionnelle: Les futurs systèmes de l'armée de l'air seront intégrés dans des cellules matérielles multifonctionnelles avec capteur intégré et composants de réseauPas encore d'évaluation
- BTS Maintenance IndustrielleDocument139 pagesBTS Maintenance IndustriellefgfPas encore d'évaluation
- Stockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissanceD'EverandStockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissancePas encore d'évaluation
- Epreuve TC 2019 - Corrigé SPDocument11 pagesEpreuve TC 2019 - Corrigé SPSara EcheradiPas encore d'évaluation
- Analyse d’impact réglementaire (AIR): Balises méthodologiques pour mieux évaluer les réglementationsD'EverandAnalyse d’impact réglementaire (AIR): Balises méthodologiques pour mieux évaluer les réglementationsPas encore d'évaluation
- Relation Gs MNTDocument22 pagesRelation Gs MNTMohamedAmineBelkhiterPas encore d'évaluation
- Techniques de L'ingénieurDocument14 pagesTechniques de L'ingénieurMohamed EL MaaroufiPas encore d'évaluation
- Liste LogicielsDocument35 pagesListe LogicielsCROIX ROUGEPas encore d'évaluation
- Guide de Rédaction Du Rapport PFEDocument4 pagesGuide de Rédaction Du Rapport PFELamrani MohamedPas encore d'évaluation
- BPO Maintenance Batiments PDFDocument141 pagesBPO Maintenance Batiments PDFBouazza ZiouPas encore d'évaluation
- Les Normes HopitaleDocument14 pagesLes Normes HopitaleDo Ben100% (1)
- Maintenance Et Entretien Poste TransfoDocument4 pagesMaintenance Et Entretien Poste TransfoFaraba SISSOKO100% (1)
- These AmdecDocument226 pagesThese Amdecr_prePas encore d'évaluation
- Fiche Historique de MaintenanceDocument9 pagesFiche Historique de MaintenanceJamila DebayaPas encore d'évaluation
- Version FinaleDocument104 pagesVersion Finalenadine laabidiPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges TFEDocument34 pagesCahier Des Charges TFEManasse MalangoPas encore d'évaluation
- GT Securite MachineDocument20 pagesGT Securite MachineFrank LambertPas encore d'évaluation
- Resistance Des MateriauxDocument66 pagesResistance Des MateriauxdouminawalPas encore d'évaluation
- Cours Controle ProcessusDocument339 pagesCours Controle ProcessusDayan Van RillaertPas encore d'évaluation
- Groupe ElectrogeneDocument4 pagesGroupe Electrogenel'Aigle Migrateur100% (1)
- Rapport Du Mini-ProjetDocument23 pagesRapport Du Mini-ProjetMohammed Amine Smouh100% (1)
- UTC Formation 2009 La TPMDocument45 pagesUTC Formation 2009 La TPMaymenPas encore d'évaluation
- 5166 8 s9 Strategie Et Organisation Maintenance PdenisDocument18 pages5166 8 s9 Strategie Et Organisation Maintenance PdenisHichem YahiPas encore d'évaluation
- Mahmoudi AnisDocument88 pagesMahmoudi AnisSoufian TouaniPas encore d'évaluation
- 01 Organisation MaintenanceDocument45 pages01 Organisation MaintenanceAya El Koussami100% (1)
- Manuel de Gestion Et de La Maintenance Du Matériel de SangDocument114 pagesManuel de Gestion Et de La Maintenance Du Matériel de Sangsaid3232Pas encore d'évaluation
- Expose Introduction A La MaintenaceDocument40 pagesExpose Introduction A La MaintenacethekrumpPas encore d'évaluation
- OptiMaint GMAO Gestion de MaintenanceDocument16 pagesOptiMaint GMAO Gestion de MaintenanceChiheb Ba100% (1)
- LannoyDocument46 pagesLannoydjamelPas encore d'évaluation
- Diaporama Gipsi M2 FLUXDocument43 pagesDiaporama Gipsi M2 FLUXMed Aymen SalemPas encore d'évaluation
- PERT Et GANTTDocument5 pagesPERT Et GANTTandichPas encore d'évaluation
- Dossier Candidature Master Modev 2020 2021Document8 pagesDossier Candidature Master Modev 2020 2021Guy NdzanaPas encore d'évaluation
- Etude de Cas Développement DurableDocument37 pagesEtude de Cas Développement DurableMire55Pas encore d'évaluation
- Amelioration de Lma Gestion de - Maskar El Houssaine - 519Document69 pagesAmelioration de Lma Gestion de - Maskar El Houssaine - 519Med ElbataniPas encore d'évaluation
- Approche Economique de La MaintenanceDocument20 pagesApproche Economique de La Maintenancebenoit16000Pas encore d'évaluation
- Fiche Prospection Audit ElecDocument5 pagesFiche Prospection Audit ElecGaëlle No'osi TchendjePas encore d'évaluation
- Génie Civil UICDocument2 pagesGénie Civil UICMohcine RouessiPas encore d'évaluation
- Fabrication Et Pose en Coffrage Des ArmaturesDocument63 pagesFabrication Et Pose en Coffrage Des ArmaturesDu Châu100% (1)
- Ventilateurs PDFDocument90 pagesVentilateurs PDFaminePas encore d'évaluation
- GmaoDocument86 pagesGmaoAnouar Aleya50% (2)
- Condition de Fonctionnement Sans CavitationDocument22 pagesCondition de Fonctionnement Sans Cavitationbaccour bilelPas encore d'évaluation
- Etude Et Mise en Œuvre de L'automatisation ManDocument62 pagesEtude Et Mise en Œuvre de L'automatisation ManAbir Khriss100% (2)
- Etablissement d'AMDEC Machine - El Hayani Adil - 479Document42 pagesEtablissement d'AMDEC Machine - El Hayani Adil - 479aliouiPas encore d'évaluation
- Cours de Gestion de Maintenance GBM2 2022Document110 pagesCours de Gestion de Maintenance GBM2 2022Razack SawadogoPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges Specifications Techniques - Lot Electricite PDFDocument66 pagesCahier Des Charges Specifications Techniques - Lot Electricite PDFBachir FethizaPas encore d'évaluation
- Récipients Sous PressionDocument13 pagesRécipients Sous PressionRaouf BelamriPas encore d'évaluation
- CIPAC - Data CenterDocument31 pagesCIPAC - Data CenterAmine HedjemPas encore d'évaluation
- Les Essais MécaniquesDocument7 pagesLes Essais MécaniquesHadjerBenzelmatPas encore d'évaluation
- Cours Electromecanique Transmissions MecaniquesDocument6 pagesCours Electromecanique Transmissions MecaniquesMendieta RayanPas encore d'évaluation
- Projet Plan MaintenanceDocument19 pagesProjet Plan MaintenanceHaytem ChhimiPas encore d'évaluation
- Gamme de La MaintenanceDocument27 pagesGamme de La MaintenanceOliver TwistePas encore d'évaluation
- POWER POINT Final Stage À SOGARA Mlle AMBONGUILATDocument23 pagesPOWER POINT Final Stage À SOGARA Mlle AMBONGUILATFabrice Bessime-MinkoPas encore d'évaluation
- Chap1 B PDFDocument35 pagesChap1 B PDFToutFikeGuedouahPas encore d'évaluation
- 11 - Amdec Résumé Par Hadramy MécatroniqueDocument6 pages11 - Amdec Résumé Par Hadramy MécatroniqueImmamHadramyPas encore d'évaluation
- 1-TP Microprocesseur PDFDocument5 pages1-TP Microprocesseur PDFAmin DAHMANI100% (1)
- Chapter 2 DiskDocument16 pagesChapter 2 DiskYamina ZitouniPas encore d'évaluation
- 12qs23dwin FRDocument86 pages12qs23dwin FRgipson cashPas encore d'évaluation
- Linux - Corrections Des Exercices Du TP N°1Document1 pageLinux - Corrections Des Exercices Du TP N°1Bertrand Wãrí0% (1)
- SRWE Module 3Document64 pagesSRWE Module 3Ibrahima Sory BahPas encore d'évaluation
- 004-SÃrie TP N 04Document1 page004-SÃrie TP N 04donkihotinazimPas encore d'évaluation
- Commande Open - VMSDocument2 pagesCommande Open - VMS6wrgpcs6ngPas encore d'évaluation
- Cours - VirtualizationetCLOUD - Master - Chapitre1 - Zbakh (1) - ConvertiDocument44 pagesCours - VirtualizationetCLOUD - Master - Chapitre1 - Zbakh (1) - ConvertiEss100% (1)
- Contrôle de Parité Verticale (Vertical Redundancy Check VRC)Document51 pagesContrôle de Parité Verticale (Vertical Redundancy Check VRC)DO UAPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Introduction Au Langage PLSQLDocument33 pagesChapitre 1 - Introduction Au Langage PLSQLMotaz TrabelsiPas encore d'évaluation
- Alphorm Fiche Formation Word 2016 InitiationDocument6 pagesAlphorm Fiche Formation Word 2016 Initiationulrich DjokoPas encore d'évaluation
- Cour Merise 1Document35 pagesCour Merise 1Aime TiemelePas encore d'évaluation
- Embase Modicon Momentum: Guide de L'utilisateurDocument720 pagesEmbase Modicon Momentum: Guide de L'utilisateurd.simPas encore d'évaluation
- Chapitre2 Electronique Numérique Avancée FPGA Et VHDLDocument72 pagesChapitre2 Electronique Numérique Avancée FPGA Et VHDLAll AhmeDciaPas encore d'évaluation
- Procedes ExplicatifsDocument1 pageProcedes ExplicatifsIsaek IsberabahPas encore d'évaluation
- TD 1 SeDocument2 pagesTD 1 Setalamahcen wardaPas encore d'évaluation
- Test 1 2020 2021Document3 pagesTest 1 2020 2021Chaima BenabdallahPas encore d'évaluation
- La Communauté OWASPDocument5 pagesLa Communauté OWASPRania MenzerPas encore d'évaluation
- Le Port SerieDocument3 pagesLe Port SerieEmcee CissePas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Precision Performances Regime TransitoireDocument8 pagesChapitre 4 Precision Performances Regime TransitoirePierre GoitaPas encore d'évaluation
- BDD No SQL-2023Document42 pagesBDD No SQL-2023ktyetoto55Pas encore d'évaluation
- Leçon FiltrageDocument2 pagesLeçon Filtrageamira meghaPas encore d'évaluation
- 3 - Projet EcoBoxDocument60 pages3 - Projet EcoBoxAnouar AlamiPas encore d'évaluation
- Remote Method InvocationDocument22 pagesRemote Method InvocationYin YangPas encore d'évaluation
- Rapport de PFEDocument51 pagesRapport de PFEMahranBarhoumiPas encore d'évaluation
- TP 1 Techniques Et Supports TXDocument2 pagesTP 1 Techniques Et Supports TXJOEL NDJAYICKPas encore d'évaluation
- Réseau Par Classe Et Sous RéseauxDocument31 pagesRéseau Par Classe Et Sous RéseauxSarah BensPas encore d'évaluation
- Révision AuthentificationDocument3 pagesRévision AuthentificationAhmed FayçalPas encore d'évaluation
- R2.02 - Cours 2a - JavaFX - Developpement DinterfaceDocument17 pagesR2.02 - Cours 2a - JavaFX - Developpement DinterfaceTom DPas encore d'évaluation
- CloudDocument4 pagesCloudsibonox9Pas encore d'évaluation