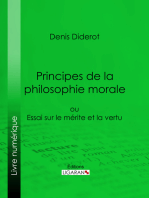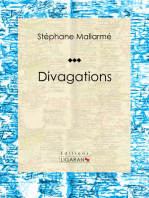Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Platon, Pythagore Et Les Pythagoriciens1
Platon, Pythagore Et Les Pythagoriciens1
Transféré par
cerberusalexCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Platon, Pythagore Et Les Pythagoriciens1
Platon, Pythagore Et Les Pythagoriciens1
Transféré par
cerberusalexDroits d'auteur :
Formats disponibles
Platon, Pythagore et les pythagoriciens1
Luc Brisson
Il est trs difficile de parler de linfluence exerce par Pythagore et les
Pythagoriciens sur Platon, et ce pour de multiples raisons, dont voici les principales:
1) Platon cite trs rarement les noms de ses prdcesseurs, mme lorsquil les
utilise.
2) Pythagore et son cole avaient pour particularit la pratique du secret; do
leur refus de recourir lcriture et leur choix dune transmission code de
linformation 2.
3) Dun point de vue historique 3, on sait trs peu de choses sur les origines, la
formation et lactivit de Pythagore. Il serait n Samos au dbut du VI e sicle et aurait
migr Crotone, o il aurait pris le pouvoir. Une rvolte aurait renvers les
Pythagoriciens la fin du sicle, un peu aprs 510, mais lclipse fut de courte dure, car
il semble quils contrlrent un solide bloc de territoire entre Mtaponte et Locres
jusquen 450. Par la suite, linfluence pythagoricienne ne rapparat quau dbut du IVe
sicle Tarente avec Archytas, condition videmment que celui-ci puisse tre dclar
pythagoricien . On peut en effet se demander si au IVe sicle lpithte
pythagoricien ntait pas revendique par de fortes personnalits regroupant autour
delles quelques disciples, au nom dun hritage relatif un certain idal de science ou
de vie.
1 . Cette article a tre publique: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens, dans Platon, source des
Prsocratiques. exploration, d. par M. Dixsaut et A. Brancacci, Histoire de la philosophie, Paris
(Vrin) 2003, p. 21-46. Et il a la permission de Monique Dixsaut et de la maison Vrin para se pubiquer
dans cette reviste.
2. L. Brisson, Usages et fonctions du secret dans le Pythagorisme ancien , Le Secret, textes runis par
Philippe Dujardin, Lyon (C.N.R.S.-Centre rgional de Publication/Presses Universitaires de Lyon)
1987, p. 87-10; repris dans Orphe et lOrphisme dans lAntiquit grco-romaine, Aldershot
(Variorum), 1995.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 39-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
4) cette raret dinformations historiques concernant Pythagore et les
Pythagoriciens, rpond, dans lhistoire de la philosophie dans lAntiquit, une tendance
faire de Pythagore le matre et linspirateur privilgi de Platon. Cette tendance prend sa
source chez Aristote 4, qui crit:
Aprs les philosophes dont nous venons de parler [Pythagoriciens et
lates], survint Platon, dont la doctrine est en accord le plus souvent avec celle
des Pythagoriciens, mais qui a aussi ses caractres propres, bien part de la
philosophie de lcole italique 5. (Mt., A 6, 987 a 29- 31)
Ce jugement sera, comme on le verra, repris et illustr par un des disciples
dAristote, Aristoxne. N entre 375 et 360 Tarente, o son pre aurait connu
Archytas6, celui-ci aurait t Athnes le disciple dun Pythagoricien avant de frquenter
le Lyce; il na pu connatre que les Pythagoriciens contemporains de Platon et
dAristote, qui vcurent deux sicles aprs le matre. Il a crit sur la musique, et il est
lauteur de biographies 7, notamment sur Pythagore et sur Archytas: ce fut un antiplatonicien farouche, refusant en particulier la mathmatisation de la musique telle que la
prconise Platon la fin du passage de la Rpublique qui va tre analys dans la suite de
cet article.
5) Le cas d'Aristoxne illustre merveille la propension des auteurs antiques
prendre partie pour ou contre l'auteur dont ils prsentent les opinions. Voil pourquoi,
dans l'Antiquit, on a prtendu, interprtant ainsi le jugement d'Aristote en un sens ngatif
ou positif, ou bien que Platon avait plagi Pythagore ou bien qu'il avait men sa pense
son terme.
3. Sur le sujet, voir Le monde grec et lOrient, t. I: Le Ve sicle (510-403), par E. Will, Paris (PUF)
1972, 19893, p. 237-241; II: Le IVe sicle et lpoque hellnistique, par E. Will, C. Moss et
P. Goukowsky, Paris, PUF, 1972, 19852, 156-170
4. Aristote aurait crit un ouvrage Contre les Pythagoriciens et un autre Sur les Pythagoriciens (D.L.,
V, 25).
5. Sur ce passage, voir le commentaire de H. Cherniss, Aristotles Criticism of Plato and the Academy
[1944], New York, Russell & Russell, 1962, p. 177-184.
6. Son pre avait connu personnellement Archytas (Jamblique, Vie de Pythagore 197; voir aussi D.L.
II 20, V 92.
7. Fragments runis par F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles: II. Aristoxenos, Ble, Schwabe & Co,
1945, 19672. Voir aussi Jamblique, La Vie de Pythagore, Paris, La Roue Livres, Introduction,
traduction et notes par L. Brisson et A.Ph. Segonds.
40-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
6) Suivant le principe qui prvaut dans le domaine de lrudition et qui veut que
la production savante croisse en proportion inverse de l'information disponible, la
littrature secondaire sur Pythagore et les Pythagoriciens est foisonnante et difficile
matriser.
Cela dit, la question est la suivante: comment faire la distinction entre la ralit
dune influence et la projection dune interprtation, sinon malveillante du moins
critique? Entre une information historique et une appropriation idologique? Aussi,
lorsquil tente dapprcier linfluence pythagoricienne sur Platon, lhistorien de la
philosophie doit-il se battre sur deux fronts. Il lui faut la fois valuer les maigres
informations historiques concernant Pythagore et les Pythagoriciens, puis sopposer la
pythagorisation systmatique de Platon, qui ne peut alors rsulter que dun cercle vicieux:
pour interprter Platon, on fait appel un Pythagorisme reconstruit de toutes pices
partir de Platon.
Afin den sortir, je voudrais tenter de dresser ici un bilan, le plus objectif
possible, de ltat de nos connaissances en la matire 8.
I. Rfrences chez Platon Pythagore et aux Pythagoriciens
Dans toute luvre de Platon, on ne trouve que deux rfrences Pythagore et aux
Pythagoriciens.
1. Pythagore
Dans la Rpublique, probablement crite aprs son voyage en Italie du Sud qui fut
suivi par un sjour en Sicile auprs de Denys lAncien 9, Platon fait une allusion
8. Je prends pour point de dpart de cette mise au point de W. Burkert, Pythagoreanism in Plato and
the origin in Platonism of the Pythagorean tradition , dans Lore and Science in Ancient
Pythagoreanism [1962], transl. by E.L. Minar Jr., Cambridge [Mass], Harvard University Press, 1972,
p. 83-96.
9. Ce voyage se situerait vers 388-387, et la Rpublique aurait t crite entre 385 et 370. Cela dit, on
ne peut savoir si Platon rencontra Archytas ds ce premier voyage, ou seulement au cours du second
(366-367) comme le laisserait entendre la Lettre VII (338 c-d), si lon admet que cette lettre est
authentique. Sur tout cela, cf. L. Brisson, Introduction aux Lettres, attribues Platon, Paris, GFFlammarion, 1987, 19992.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 41-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
Pythagore et une autre aux Pythagoriciens; ce sont l, il faut y insister, les deux seules
rfrences explicites dans le corpus platonicien.
Le premier passage se trouve dans le livre X qui se veut une attaque contre
limitation, juge dun point de vue ontologique. Dans ce livre o Homre, considr
comme le matre dcole des Grecs, est particulirement attaqu, Platon sen prend trs
ironiquement au soi-disant mode de vie homrique, en le comparant celui instaur par
Pythagore:
SOCRATE Mais sans doute, dfaut daction sur la vie publique
(demosai), Homre, dans le domaine priv (idai), a-t-il t selon la tradition par
sa propre vie le guide pour quelques-uns de leur ducation (tisn hegemn
paideas) 10, pour des gens qui avaient envers lui de la dvotion parce quils
taient ses familiers, et qui ont transmis (pardosan) la postrit un mode de vie
homrique (hodn tina bou) comme le fit Pythagore. Pythagore fait lui-mme pour
cela lobjet dune exceptionnelle dvotion, et ses successeurs (hoi hsteroi) de nos
jours encore (ti nn) suivent une rgle de vie (trpon to bou) qu'ils qualifient de
pythagoricienne et par laquelle ils pensent se diffrencier du reste des hommes.
GLAUCON Sur cet autre point non plus, on ne rapporte rien de pareil sur
Homre. Par le fait, il est bien possible, Socrate, que le compagnon dHomre,
Crophyle 11, se rvle, sous le rapport de lducation, plus risible encore que ne
lest son nom, si ce quon raconte dHomre est vrai: on dit en effet que, pendant
quil tait vivant, il fut, au-del de tout, dlaiss par le personnage en question.
(Rpublique, X, 600 a-b, trad. Robin modifie)
Limportance de ce passage vient de son contexte. Homre, considr comme
linstituteur des Grecs, nest tout compte fait quun imitateur. Il ne peut se targuer ni
davoir t un lgislateur comme Lycurgue Sparte, Charondas en Italie du Sud 12 ou
Solon Athnes, ni mme davoir donn des conseils pratiques comme Thals de
Milet 13 ou comme Anarchasis le Scythe 14. Il ne peut mme pas revendiquer lhonneur
davoir t dans le domaine un guide pour lducation (hegemn paideas), comme cest
le cas pour Pythagore.
10. Jai utilis le systme de translittration suivant: ta = e; omga = o; dzta = z; thta = th; xi = x; phi
= ph; khi = kh; psi = ps. Liota souscrit est adscrit (par exemple ei); et lorsquil sagit dun alpha, cet
alpha est long = ai). Lesprit rude est not h, et lesprit doux nest pas not. Tous les accents sont nots.
11. Jamblique voque Crophyle en deux passages de sa Vie de Pythagore ( 9 et 11) qui se
contredisent (voir les notes ad locum par L. Brisson et A.Ph. Segonds).
12. Lgislateur des colonies que Chalcis avaient tablies en Italie du sud et en Sicile.
13 Il avait, disait-on, prdit des clipses, calcul la distance des navires en mer, dtourn le cours de
fleuves et fait des pronostics sur les rcoltes.
14. Il avait, racontait-on, invent lancre et la roue de potier.
42-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
Platon en veut pour preuve le comportement de Crophyle qui, bien qutant le
compagnon dHomre 15, fit preuve dune grande ngligence (poll amleia) lgard
du pote, du vivant mme de ce dernier. Une telle attitude illustre bien que toute
revendication dHomre en matire dducation serait encore plus risible que le nom de
son propre compagnon qui aurait d tre parfaitement duqu par lui,. Platon interprte en
effet Crophyle comme form partir de kras-phul, cest--dire de la ligne de la
viande 16, alors quil faudrait plutt le rattacher kron-phul, de la ligne de
Kron , Kron venant de kreon, le plus fort , le chef . Trs curieusement,
Jamblique prend au srieux ce passage de Platon particulirement ironique. partir de
lui, Jamblique (ou sa source) tente dtablir des rapports entre Homre, Crophyle et
Pythagore au mpris de toute vraisemblance chronologique 17. Il raconte en effet que
Pythagore fut confi par son pre Crophyle pour recevoir un enseignement en matire
de religion ( 9). Un peu plus loin, il affirme que Pythagore entreprit ses premiers
voyages avec Hermodamas, appel le Crophylien, parce quon disait quil tait un
descendant de Crophyle, lhte du pote Homre... ( 11).
Quoi quil en soit, ce nest ni comme savant ni comme lgislateur ou homme
politique 18, mais comme guide dans le domaine de lducation (hegemn paideas)
ayant instaur un mode de vie propre (hods bou), que Pythagore mrite d'tre connu aux
yeux de Platon. Cette rgle de vie, qualifie de rgle de vie pythagoricienne (ho trpos
puthagreios to bou) tait encore pratique son poque par des gens pensant ainsi
se diffrencier du reste des hommes. Malheureusement, on ne trouve rien chez Platon qui
la dcrive; ce quen dit Jamblique (VP, 96-100) est peu digne de foi. Les seuls
tmoignages directs viennent de la comdie moyenne, mais le contexte de leur production
dnonce leur caractre excessif19.
15. Le terme hetaros prsente plusieurs significations: il peut vouloir dire partisan , disciple ,
ami ou mme amant . tre un hetaros, cest tre li un individu ou un groupe dont on partage la
vie ou les convictions, que ces conviction ressortissent la politique, la philosophie ou la religion.
16. Le gnitif attique de kras est kros. Le terme kras dsigne la chair manger, le morceau de
viande.
17. Sur le sujet, voir Jamblique, La Vie de Pythagore, Introduction, traduction et notes par L. Brisson et
A.Ph. Segonds, Paris, Les Belles Lettres, La Roue Livres, 1996.
18. Comme la bien vu W. Burkert, Lore and Science, p. 117 et note 51.
19. Pour une analyse de ces tmoignages qui viennent notamment d'Alexis (c. 375-c.275), voir
W. Burkert, Lore and Science, p. 198-205.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 43-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
2. Les Pythagoriciens
Il en va pour les Pythagoriciens comme pour Pythagore; un seul passage du corpus
platonicien fait expressment rfrence eux, et seulement pour dire quils appellent la
musique et lastronomie surs jumelles , et quils essaient de dcouvrir les nombres
qui reprsentent les intervalles musicaux.
SOCRATE Ce nest assurment pas une espce unique, mais plusieurs que,
si je men crois, prsente le mouvement. Sans doute quiconque est savant sera-t-il
probablement mme de les dire toutes: il y en a deux cependant qui sautent aux
yeux, mme pour nous.
GLAUCON Lesquelles?
SOCRATE En plus de la prcdente, il y en a une autre qui en est la
contrepartie.
GLAUCON Laquelle?
SOCRATE Il y a chance que tout comme les yeux sont attachs l'astronomie, de
mme les oreilles sont attaches au mouvement harmonique, et que ces
connaissances sont lies l'une l'autre comme des surs alllon adelpha tines hai
epistmai), ainsi que les Pythagoriciens l'affirment, et nous galement, Glaucon,
sommes d'accord avec eux. moins que nous ne fassions les choses autrement?
GLAUCON Convenons de faire ainsi.
SOCRATE Donc, puisque la question traiter est complexe, nous nous
informerons auprs deux sur ces matires et, en plus de celles-l, sur tout autre,
ventuellement.
Dun
autre
ct,
tout
au
long
de
ces
considrations, nous conserverons notre point de vue.
GLAUCON Quel point de vue?
SOCRATE Celui qui consiste faire que ceux dont nous ferons lducation
n'entreprennent jamais chez nous dtudier incompltement quelquune de ces
matires, et sans aboutir dans chaque cas ce terme qui doit tre laboutissement
universel, celui dont nous parlions propos de lastronomie, il ny a quun instant.
Mais peut-tre ignores-tu que, dans le cas aussi de lharmonique, on fait encore
quelque chose de pareil? En soccupant en effet mesurer les uns par les autres des
consonances (sumphonas) et des sons (pthggous), cette fois sensibles loue,
on fait, comme cest le cas des astronomes, un travail qui naboutit pas.
(Rpublique, VII, 530 c-531 a, trad. Robin)
la fin de ce passage, Platon reproche aux Pythagoriciens de perdre leur temps
lorsque, menant leurs recherches en astronomie et en musique, ils donnent trop de place
aux donnes perues par les sens de la vue et de loue. Nulle part il ne laisse supposer
qu'ils ont pratiqu le genre dastronomie thorique quil recommande dans la
Rpublique 20. De fait, Platon oppose les deux faces de lastronomie et lharmonique:
comme phnomnes sensibles, et comme rapports mathmatiques. Dans un cas, cest le
20. Voir Rpublique, VII, 530 c, et Science and the Sciences in Plato, ed. with an introduction by J. P.
Anton, New York, Eidos, 1980.
44-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
mouvement matriel des corps clestes, ou bien lobservation de lintervalle entre les
sons et de leurs hauteurs21, qui intressent les savants, tandis que dans lautre, cest leur
description mathmatique, laquelle na rien voir avec un mouvement ou un son
matriels.
Le lien entre les deux domaines, celui de l'astronomie et l'harmonique, est illustr
dans le Time (34a-40d) lorsque se trouve dcrite la structure mathmatique de l'me du
monde qui meut les corps clestes, la condition que l'on assimile la corde d'un
instrument de musique le rayon de lorbite dun corps cleste. Alors seulement, on peut
parler dharmonie des sphres 22. En se fondant sur ce tmoignage, on a aussi voulu
attribuer conjointement aux Pythagoriciens et la tradition orphique certaines doctrines
sur lme faisant intervenir l'ide d'harmonie. On les retrouverait dans le Gorgias
(493 a), le Cratyle (405 c) et surtout dans le Phdon (82 d, voir 69 c-d). Mais nulle part
ces doctrines ne sont explicitement attribues des Pythagoriciens 23, et il est mme
impossible de trouver des preuves qu lpoque de Platon les Orphiques dfendaient ce
type de doctrine 24. Je reviendrai sur ce point essentiel.
II. Rfrences des personnages considrs comme Pythagoriciens par les
interprtes de Platon
Passons maintenant aux personnages que la tradition a considr comme des
Pythagoriciens, mais qui ne sont jamais prsents comme tels chez Platon. Aucun de ces
personnages qualifis de pythagoriciens na connu Pythagore et son groupe Crotone,
puisquils taient actifs la fin du Ve ou dbut du IVe sicle.
Pour qualifier un penseur de pythagoricien , les rudits ont recours au
catalogue donn par Jamblique la fin de sa Vie de Pythagore ( 266-267). Mais, en ce
21. Je ne crois pas qu'il faille rattacher le passage qui vient d'tre cit avec les allusions Damon en
Rpublique III, 398d-400a et en IV, 424c. Ce professeur de musique ne doit pas tre identifi avec le
Damon de Syracuse dont le nom se retrouve dans le catalogue des Pythagoriciens et dont parle
Aristoxne. Sur Damon d'Athnes, voir la notice de D. Delattre, dans le Dictionnaire des philosophes
antiques, d. par R. Goulet, II, Paris, CNRS d., 1994, p. 600-607; et sur Damon de Syracuse, voir la
notice de B. Centrone, ibid., p. 607-608.
22. Selon Jamblique aux 65-67 de la Vie de Pythagore, Pythagore percevait, par son oue, lharmonie
des sphres. En Time 37b, Platon indique clairement que les mouvements de l'me du monde ne
produisent aucun son.
23. Lidentification partir de sopho des Pythagoriciens dans le Gorgias ne tient pas, voir
W. Burkert, Lore and Science, p. 78, n. 157.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 45-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
domaine, la plus grande prudence simpose. Ce catalogue que lon trouve la fin de la
Vie de Pythagore vaut assurment la peine qu'on s'y intresse 25. Sur 235 noms, 145 y
apparaissent pour la seule et unique fois. Ce nest pourtant pas une production de
Jamblique, puisque ce dernier mentionne dans sa Vie de Pythagore 18 noms qui ne se
retrouvent pas dans le catalogue. Ce dernier semble par ailleurs tre indpendant de la
littrature pseudo-pythagoricienne, car 18 noms mentionns dans le recueil de Thesleff 26
ne sy retrouvent pas. Aristoxne de Tarente pourrait bon droit tre considr comme
lauteur du catalogue, hypothse renforce par le fait que Time de Locres ny est pas
mentionn; cette omission sexpliquerait fort bien par le fait que lapocryphe mis sous
son nom a t fabriqu aprs Aristoxne. On notera par ailleurs quAristoxne est, sur
Pythagore et les Pythagoriciens, la source principale de Diogne Larce, de Porphyre et
de Jamblique.
Cela dit, avec Jamblique ( la fin du IIIe sicle de notre re), Pythagore, initi aux
Mystres dOrphe, devient le dpositaire dun message divin: la philosophie est
devenue thologie et le restera jusqu la fin de lAntiquit. Dans le premier paragraphe
de sa Vie de Pythagore qui devait en fait servir dintroduction son grand ouvrage Sur
lcole pythagoricienne en dix livres 27, Jamblique crit:
Dans toute entreprise de philosophie, cest la coutume de tout le monde, au moins
chez les sages, que dinvoquer laide de dieu; mais, dans le cas de la philosophie qui
porte le mme nom que Pythagore, lequel tait surnomm juste titre divin , il
convient encore plus de le faire: en effet, comme cette philosophie a t enseigne
lorigine par les dieux, il nest pas possible de sen saisir autrement que par lentremise
des dieux. (Jamblique, Vie de Pythagore, 1, trad. L. Brisson et A. Ph. Segonds)
Pour Jamblique, la philosophie pythagoricienne, qui consiste surtout en ltude
des quatre disciplines mathmatiques du quadrivium 28, nest quune prparation la
24. Sur le sujet, voir W. Burkert, Lore and Science, p. 248, n. 48
25. Voir W. Burkert, Lore and Science, p. 105, n. 40. W. Burkert se fonde sur H.A. Brown,
Philosophorum Pythagoreorum Collectionis Specimen, Diss. Chicago, 1941.
26. Voir H. Thesleff, The Pythagorean Texts of the Hellenistic Period, bo, Acta Academiae
Aboensis, Humaniora 24.3, 1965.
27. Sur le sujet, voir D. OMeara, Pythagoras Revived, Oxford, Clarendon Press, 1989.
28. I. Hadot, Arts libraux et philosophie dans la pense antique, Paris, tudes Augustiniennes, Srie
Antiquit 107, 1994.
46-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
vritable philosophie, celle de Platon, dont le programme est donn dans la Rpublique
et culmine dans la deuxime partie du Parmnide, considre comme un vritable trait
de thologie. Pour tablir cette ligne, Jamblique a besoin dune part de lier Pythagore
un mouvement religieux, en loccurrence lOrphisme, et dautre part dtablir un lien
objectif entre Platon et le Pythagorisme. Cela dit, force est de reconnatre que les
Noplatoniciens, et Jamblique en particulier, sont tributaires dun courant interprtatif qui
remonte la fin de la priode hellnistique.
Cest dans ce contexte quil faut sinterroger sur les Pythagoriciens dont
Platon aurait pu subir linfluence.
1. Philolaos
Philolaos 29 est cit par deux fois dans le mme passage du Phdon. La
discussion sy engage ainsi sur la question du suicide:
Tout en disant cela, Socrate posa les pieds sur le sol, sassit au bord du lit
et cest dans cette position quil continua de converser. Sur
quoi Cbs lui posa cette question.
CBS Mais quest-ce que tu veux dire, Socrate? Dun ct, il est interdit de se
tuer, mais de lautre le philosophe doit chercher suivre celui qui meurt?
SOCRATE Mais quoi, Cbs? Les familiers de Philolaos que vous tes, toi et
Simmias, avez bien entendu parler de ce genre de questions.
CBS Oui, mais rien ntait clair (oudn gesaphs) , Socrate.
SOCRATE En vrit, de ces choses-l je ne peux moi aussi parler que par oudire. Mais ce que jai pu entendre ainsi, je nprouve aucune rticence vous en
parler. Dailleurs, cest sans doute qui doit faire le voyage de l-bas quil
convient tout particulirement de soumettre ce voyage un examen approfondi et
dexprimer par une histoire ce quil simagine que cela peut bien tre. Que
pourrait-on dailleurs faire dautre dans le temps qui reste jusquau coucher du
soleil?
CBS Enfin, Socrate, sur quoi sappuie-t-on pour affirmer quil est interdit de se
donner la mort? Certes, et pour rpondre la question que tu posais linstant, jai
dj entendu Philolaos lorsquil sjournait chez nous, comme jen ai dj aussi
entendu bien dautres, dire quil ne fallait pas le faire. Mais de personne, jamais, je
nai rien entendu de vraiment clairant ce propos. (Phdon, 61 d-62 a, trad.
M. Dixsaut un peu modifie)
29. Sur Philolaos, on peut lire maintenant Philolaos of Croton. Pythagorean and Presocratic. A
commentary on the fragments and testimonia with interpretative essays, by Carl A. Huffman,
Cambridge, Univ. Press, 1993. Cet ouvrage, trs bien fait, manque desprit critique. W. Burkert, est
beaucoup plus critique dans son Lore and Science, 1972.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 47-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
Cest Thbes en Botie que Simmias et Cbs ont rencontr Philolaos. Mais de
quel Philolaos sagit-il? Il est impossible de le dire en raison de linvraisemblance
historique des diffrentes pices du dossier: on ne peut en effet faire de Philolaos la
fois un disciple de Pythagore et un condisciple dEmpdocle, et prtendre que Simmias et
Cbs, encore vivants en 399 av. J.-C., lui ont prt loreille Thbes 30.
Nulle part dans les dialogues, Philolaos nest qualifi de Pythagoricien par
Platon. On ignore sa cit dorigine. Tout ce que lon sait d'aprs le passage qui vient
d'tre cit, cest quil condamnait le suicide, et quil ntait pas le seul. Mais ni lui ni les
autres penseurs auxquels il est fait allusion de faon voile ne semblent avoir vraiment
justifi leur interdiction; Cbs va mme jusqu' se plaindre de l'obscurit des propos de
Philolaos31. La brivet et le caractre ironique de cette allusion ne permettent aucune
extrapolation associant la doctrine de lme chez les Pythagoriciens celle des
Orphiques 32.
Walter Burkert a dfendu les deux thses suivantes: 1) Philolaos est la source
principale dAristote pour la description du Pythagorisme (celle quon trouve notamment
en Mt., A 5, 985 b 23-986 b 8); 2) il a dvelopp une doctrine o lIllimit et de la
Limite trouvant leur harmonie mutuelle grce au nombre, laquelle pourrait tre l'arrireplan du Philbe. Mais force est de reconnatre que Philolaos nest cit quune seule fois
par Aristote, qui ne le qualifie dailleurs pas de pythagoricien , dans un passage
prsentant des difficults textuelles rendant sa comprhension difficile:
30. Mme Walter Burkert ne peut ne pas reconnatre lamoncellement dinvraisemblances (voir Lore
and Science, 1972, p. 228 n. 48). Il est impossible de savoir d'o Philolaos est originaire (de Crotone
ou de Tarente?), quand il a vcu (est-ce un contemporain de Pythagore et d'Empdocle ou de Socrate?),
pourquoi et comment il est venu Thbes. La scholie Phdon 61 d, qui combine des informations
venant d'poques diffrentes, fourmille de contradictions. Pour rendre compte la fois du fait que
Simmias et Cbs, qui assistent aux derniers moments de Socrate en 399, ont pu prter l'oreille
Philolaos Thbes et du fait que Philolaos aurait t un Pythagoricien chass de l'Italie du sud par une
rvolte contre les Pythagoriciens que l'on situe vers 450, on a fait l'hypothse qu'il a vcu entre 470 et
400. Est-ce acceptable, dans la mesure o on ne sait rien des aventures d'un Philolaos pythagoricien
avant son sjour Thbes.
31. la limite, mme si Platon laisse planer le doute, on pourrait penser une obscurit intentionnelle,
celle qui caractrise les maximes pythagoriciennes. Mais ce n'est l qu'une hypothse.
32. Voir L. Brisson, Nascita di un mito filosofico: Giamblico (VP. 146) su Aglaophamos , Tra Orfeo
e Pitagora. Origini e incontri di culture nell Antichit [Atti dei Seminari Napoletani 1996-1998], a
cura di Marisa Tortorelli Ghidini, Alfredina Storchi Marino, Amedeo Viscionti, Napoli, Bibliopolis,
2000, p. 237-253.
48-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
Mais nous ne disons pas non plus que ce quon fait par apptit dpend de soi; en
consquence, certaines penses et certaines passions ne dpendent pas de nous, ni les
actes conformes ces penses et ces raisonnements, mais, comme la dit Philolaos,
certaines raisons sont plus fortes que nous. (thique Eudme, II, 8, 1225 a 30-33, trad.
V. Dcarie)
Rien nassure donc quen Mt., A 5, 985 b 23-986 b 8 Aristote parlait de
Philolaos: aucun commentateur ancien, si prompt habituellement identifier les sources
dAristote, ne propose cette identification. Par ailleurs, une reconstruction de la doctrine
suppose de lIllimit et de la Limite fait intervenir six fragments: l'un qui vient de
Diogne Laerce (VIII, 84-85), l'autre de Jamblique (Commentaire sur L'introduction
arthimtique de Nicomaque (7, 24-25) et les cinq autres de Stobe (Anthologie, I, 21,
7a, 7b, 7c, 7d). Or, ces auteurs qui ont vcu pour l'un au dbut du IIIe sicle de notre re,
pour l'autre la fin de mme sicle et pour le dernier au dbut du Ve, ont pu s'inspirer
d'apocryphes qui foisonnaient ds le dbut de l'Empire. De ce fait, on trouverait dans ces
fragments non pas l'arrire-plan du Philbe, mais l'une des premires interprtations de
ce dialogue 33.
Philolaos est prsent dans le catalogue des Pythagoriciens, et il est cit pour la
premire fois comme tel par Diogne Larce (VIII, 84), qui semble lui aussi stre
inspir dAristoxne de Tarente, lequel aurait connu personnellement deux disciples de
Philolaos (D. L., VIII, 46). On notera que, dans sa trs brve notice, Diogne Larce
mentionne le nom de Philolaos en rapport avec lanecdote des livres que Platon avait fait
acheter par Dion et dont il stait servi pour crire le Time.
Tout ce qui vient dtre dit passera pour tre le rsultat dune position hypercritique. Mais aucun des fragments considrs comme authentiques par Walter Burkert et
Carl Huffman ne possde une lgitimit propre: ils ne peuvent tre interprts que par un
recours constant des tmoignages dpoque diffrente.
33. On comprend que linterprtation de W. Burkert ait rencontr lopposition de J.A. Philip,
Pythagoras and Early Pythagoreanism, Toronto, Univ. Press, et de J. Barnes, The Presocratic
Philosophers, London, Routledge, 1979, 19822.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 49-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
2. Thodore de Cyrne
Dans le Thtte, Thodore de Cyrne est dcrit comme un expert en gomtrie,
astronomie, calcul et musique. On y apprend quil sest intress au problme des
longueurs irrationnelles (Thtte, 147 d). Plus loin, on apprend quil fut le disciple
(hetaros) de Protagoras (Thtte, 161 b, 162 a, 164 e, 183 b), lequel avait pourtant
critiqu les mthodes auxquelles ont recours les mathmaticiens. On retrouve le nom de
Thodore dans le catalogue de Jamblique, mais jamais, chez Platon, il nest qualifi de
pythagoricien 34. On a limpression que, dans le cas de Thodore, le rflexe conditionn:
mathmaticien / pythagoricien a jou plein.
3. Archytas de Tarente
On sait peu de choses sur lhistoire de Tarente, dans le premier quart du Ve
sicle. Touche par linfluence du Pythagorisme, elle nentre cependant pas dans lorbite
de Crotone. partir de 470, cest une dmocratie modre (Aristote, Politique, VI 5,
1320 b 9-17) avec une Assemble, un Conseil et des magistratures annuelles, parmi
lesquelles la Stratgie tait la plus importante; lexistence dphores nest pas atteste,
mais reste probable. Cest dailleurs comme stratge 35, il faut le rappeler, quArchytas
exera pendant sept annes conscutives une autorit quasi absolue sur la cit.
Ce dut tre ce moment-l queurent lieu les interventions dArchytas, avec qui,
au cours de son premier sjour en Sicile auprs de Denys lancien, Platon avait conclu
des accords 36. On comprend ds lors que Denys le jeune ait fait intervenir Archytas et
ses amis pour demander Platon de revenir en Sicile. Archdme 37 vient Athnes, et
Archytas lui-mme envoie des lettres 38. Et, aprs que Platon a t mis en rsidence
34. Aristote ne le mentionne pas.
35. Magistrature militaire, lune des plus importantes Athnes. Pricls fut lu stratge pendant plus
de dix ans conscutifs.
36. Avant de prendre la mer pour men aller, javais en effet tabli des liens dhospitalit et damiti
entre Archytas et les gens de Tarente dun ct, et Denys le jeune de lautre. (Lettre VII, 338 c, trad.
par L. Brisson) Dans le discours Sur l'amour (Erotiks) [LXI] ( 46) attribu Dmosthne, c'est la
frquentation de Platon qui aurait fait faire Archytas d'admirables progrs comme administrateur de la
cit de Tarente!
37. Archdme, celui des Siciliens dont, pensait-il, je faisais le plus de cas, lun des disciples
dArchytas. (Lettre VII, 339 a-b, trad. L. Brisson)
38. Voir Lettre VII, 339 a.
50-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
surveille dans la citadelle, Denys le jeune commence par le mettre en rsidence
surveille chez Archdme 39, faisant pour cela directement appel Archytas:
Jimagine donc, pour assurer mon salut, de recourir au stratagme suivant.
Jenvoie Archytas et mes autres amis de Tarente une lettre dcrivant la situation dans
laquelle je me trouve. Eux, sous le couvert dune ambassade dpche par leur cit,
envoient un navire trente rames avec lun des leurs, Lamisque, lequel, une fois arriv,
va intercder auprs de Denys le jeune en ma faveur, en disant que je souhaitais partir et
le priant de ne rien faire pour sy opposer. Denys le jeune donna son accord de me
congdier aprs mavoir remis ce quil fallait pour le voyage; quand aux biens de Dion,
je nen rclamai rien et personne ne men remit rien. (Lettre VII, 350 a-b, trad.
L. Brisson)
Cest donc Archytas, que connat bien Platon, qui lui permet de repartir de Sicile.
Mais rien chez Platon ne laisse entendre quArchytas ait t un pythagoricien. Cela dit, il
semble quil y ait eu entre les deux hommes des relations sur le plan de la doctrine et de
lenseignement 40; la Lettre VII laisse aussi entendre que lenseignement dispens
Denys le jeune par Archytas ou ses associs fut catastrophique 41. Cette information a
donn lieu dans lAntiquit une sorte de petit roman, o Archytas et Platon changent
des lettres 42.
Aristote considre la thorie de la dfinition propose par Archytas comme
anticipant sa propre doctrine du compos impliquant la matire et le forme 43. Jamblique
cite Archytas dans le catalogue des Pythagoriens, probablement la suite dAristoxne. Il
39. Voir Lettre VII, 349 d.
40. On en voudra pour preuve le fait quArchdme soit prsent comme un disciple (hetaros)
dArchytas (Lettre VII, 339 a). Les lettres envoyes par Archytas et les autres amis de Platon
tmoignent des progrs faits par Denys en philosophie (Lettre VII, 339 b, d).
41. Voir 338 d et 341 b. Limage dArchytas qui ressort de cette lettre est assez ngative, comme la
bien montr G.E.R. Lloyd, Plato and Archytas in the Seventh Letter , Phronesis 35, 1990, p. 159-174
42. Sur le sujet, voir Luc Brisson, Lettres, 1987, 19992 , Lettre XII (suivie de la lettre dArchytas),
p. 267-274.
43. Mtaphysique, H 2, 1043 a 22-26. Aristote ne cite Archytas que dans deux autres passages. En
Rhtorique III 11, 1412 a 9-13, il lui reconnat un esprit sagace pour avoir su tablir une similitude
entre deux objets forts diffrents: Un arbitre et un autel sont choses identiques, car l'un et l'autre sont
le refuge de tout ce qui souffre l'injustice. Et en Politique VIII 5 1340 b 36, il semble lui attribuer
l'invention de la crcelle (platag). Par ailleurs, un Problme (section XIV, 9, 915 a 25-34) qui n'est
pas aristotlicien semble lui attribuer une explication relative aux faits que les parties externes des
plantes et des animaux sont de forme circulaire.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 51-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
est qualifi de pythagoricien pour la premire fois chez Diogne Larce (VIII, 79) qui
semble l encore sappuyer sur le tmoignage dAristoxne. Pourtant, dans sa Vie de
Pythagore, il convient dy insister, Jamblique semble tre trs gn par la figure
dArchytas. Pour lui, il y a deux Archytas: le vieil Archytas, condisciple dEmpdocle
auprs de Pythagore ( 104) et qui fut chass de Crotone par le soulvement contre le
pouvoir pythagoricien ( 157), et le jeune Archytas, celui que connut de Platon ( 127,
160, 197). Le vieil Archytas, mort la fin du VI e sicle ou au dbut du Ve sicle, ne peut
en effet avoir connu Platon, n en 428 et mort en 348 44.
4 Time de Locres
Dans le Time, le personnage ponyme est dcrit dans les termes suivants:
En effet, Time que voici, qui vient de la cit si bien police de Locres en Italie,
o, par la fortune et par la naissance, il nest infrieur personne, sest vu dans sa cit
confier les plus hautes charges et dcerner les plus grands honneurs: en outre, il sest,
mon sens, lev aux sommets de la philosophie dans son ensemble. (Time, 19 e, trad.
L. Brisson).
Considr, linstar dArchytas, comme un homme politique et un philosophe, il
nest pas qualifi de pythagoricien par Platon. De plus, comme on la vu, il nest
mme pas nomm dans le catalogue des Pythagoriciens; ce qui trs probablement
sexplique par lhypothse faite plus haut, suivant laquelle est postrieur Aristoxne
lapocryphe mis sous son nom et que que lon a considr comme la source du Time de
Platon 45. Au tout dbut de son Commentaire au Time de Platon, Proclus admet cette
44. Sur Archytas, il faudrait tre beaucoup plus prudent que ne lest Charles Kahn dans Pythagoras and
the Pythagoreans. A Brief History, qui dans un chapitre intitul: Pythagorean philosophy in the time
of Archytas and Plato sinspire dun livre de Carl Huffman paratre.
45. Pour une dition et une traduction de cet opuscule, voir Timaios Lokros, De natura mundi et
animae, berlieferung, Testimonia, Text und bersetzung, von W. Marg, editio maior, Philosophia
Antiqua 24, Leiden, Brill, 1972; pour un commentaire, Timaios Lokros, ber die Natur des Kosmos
und der Seele, komm. von Matthias Baltes, Philosophia Antiqua 21, 1972, Leiden, Brill, 1972. Pour une
traduction anglaise, Timaios of Locri, On the Nature of the World and the Soul, text, translation and
notes by Th.H. Tobin, Texts and translations 26. Graeco-Roman religion series 8, Chico [Cal], Scholar
Press, 1985. Voir aussi B. Centrone, La cosmologia delle pseudo-Timeo di Locri et il Timeo di
Platone , Elenchos 3, 1982, 293-324.
52-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
filiation, et lpoque moderne Alfred E. Taylor 46, dans son commentaire, a repris cette
hypothse.
Mais il est impossible de prouver que tel ou tel lment du Time soit
pythagoricien. On y trouve des rfrences des points de doctrines mathmatiques
attribues par Euclide, dans ses lments, aux Pythagoriciens; mais rien ne dit que Platon
les ait emprunts directement aux Pythagoriciens; il faut en effet se garder une fois de plus
dassimiler automatiquement mathmaticiens pythagoriciens. Sil est exact que
lastronomie et lharmonique sont associes dans la description de lme du monde,
Platon insiste sur le fait que dans le cas de lharmonie, ce ne sont pas les donnes des
sens qui sont importantes, mais les mathmatiques (Time, 37 b; voir aussi 47 d).
III. Platon, plagiaire de Pythagore et des pythagoriciens
Dans lAntiquit, on a accus Platon davoir plagi plusieurs philosophes 47.
Laccusation qui prsente le plus de signification philosophique est certainement celle
qui concerne la famille de pense pythagoricienne, dans la mesure o elle remonte
directement Aristote. Mais Aristote nest pas tant un historien de la philosophie, qu'un
penseur qui veut montrer la supriorit sur toutes les autres de la position quil dfend.
La question se pose alors de savoir si les rapports quil tablit entre Platon et les
Pythagoriciens ne doivent pas tre compris comme une tentative de systmatisation
critique.
1. Doctrine de lintelligible
On estimait qupicharme, qui aurait crit des comdies syracuse sous le rgne
de Glon (485-478) et sous celui de Hiron (478-467), avait t le disciple de
Pythagore: tout ce que Platon lui aurait emprunt, selon Alcimos 48, reviendrait donc en
46. A commentary on Platos Timaeus [1928], Oxford, Clarendon Press, 1962. Pour une critique
radicale, voir Gabor Betegh, The Timaeus of A.N. Whitehead and A.E. Taylor , Le Time de Platon.
Contributions lhistoire de sa rception. Platos Timaios. Beitrge zu seiner Rezeptionsgeschichte,
d. / hrsg. Ada Neschke-Hentschke, Bibliothque Philosophique de Louvain 53, Louvain-la-neuve (d.
de lInstitut Suprieur de Philosophie), LouvainParis, Peeters, 2000, 271-294.
47. Sur le sujet, voir L. Brisson, Les accusations de plagiat lances contre Platon , Contre Platon I:
Le Platonisme dvoil, textes runis par Monique Dixsaut, Paris, Vrin, Tradition de la pense classique,
1993, p. 339-356; repris dans mes Lectures de Platon, Paris, Vrin, 2000, p. 25-41.
48. Diogne Larce donne Alcimos de Sicile comme source de laccusation de plagiat dont Platon se
serait rendu coupable contre picharme et par voie de consquence contre Pythagore. Rhteur et
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 53-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
dernire instance Pythagore 49. Or, ces emprunts concernaient des lments
fondamentaux de sa doctrine de lintelligible:
a) lopposition entre le sensible et lintelligible;
b) lide suivant laquelle le sensible est peru par le corps, alors que
lintelligible est peru par lme sans laide du corps;
c) la distinction au sein des Formes entre celles qui sont indpendantes et celles
qui sont relatives
d) la participation du sensible lintelligible
e) et la rminiscence qui a pour instrument la ressemblance.
Cette accusation est tellement invraisemblable quelle mrite peine une mention.
En fait, elle se borne illustrer de faon malveillante les rapports quAristote
avait remarqus entre les doctrines platoniciennes et des pythagoriciennes. Au dbut du
chapitre 6 du livre A de la Mtaphysique, Aristote explique que Platon fit l'hypothse
des formes intelligibles pour chapper au changement perptuel qui affecte les choses
sensibles, en objectivant les dfinitions communes auxquels tentait de parvenir Socrate: il
fait donc l une distinction trs nette entre les formes intelligibles spares de Platon et
les nombres des Pythagoriciens qui se trouvent dans les choses sensibles. En revanche, il
insiste en ces termes sur le fait que Platon a annex la notion pythagoricienne de
participation en se bornant en changer le nom.
Quant cette participation, Platon ne modifiait que le nom: les Pythagoriciens en
effet disent que les tres existent par imitation des nombres; pour Platon, c'est par une
participation, le mot seul est chang. Toutefois cette participation ou imitation des formes
historien (fin IVe-dbut IIIe sicle), Alcimos de Sicile aurait t le disciple de Stilpon, le troisime chef
de lcole mgarique; disciple de Diogne le Cynique et dEuclide de Mgare, Stilpon aurait notamment
refus la distinction platonicienne entre le sensible et lintelligible. Jaurais tendance identifier cet
Alcimos avec lauteur du Contre Amyntas, dont Diogne Larce cite un large extrait en III, 917.
49. Pour une analyse en ce sens du tmoignage dAlcimos, voir larticle de K. Gaiser, Die PlatonReferate des Alkimos bei Diogenes Laertios (III 9-17) , dans Zetesis. Mlanges . de Strycker,
Antwerpen-Utrecht, De Nederlandsche Boekhandel, 1973, p. 61-79.
54-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
intelligibles, quelle peut en tre la nature? C'est l une recherche qu'ils laissent dans
l'indcision. (Mt., A 6, 987 b 10-14, trad. Tricot modifie)50
Cela dit, il est bien difficile de se reprsenter de quelle faon le type de rapport
tabli entre les nombres et les choses sensibles o ils se trouvent peut tre identique
celui des formes intelligibles avec les choses sensibles dont elles sont spares. Le
rapprochement parat bien scolaire.
2. Description du monde sensible
Lanecdote relative au plagiat dont le Time serait le rsultat comporte plusieurs
versions 51. La source la plus ancienne se trouve reprsente par trois vers satyriques de
Timon de Phlionte 52 cits par Aulu-Gelle: Platon aurait achet pour une grosse somme
dargent un petit pome qui lui aurait servi crire le Time. Timon ne prcise pas quel
tait lauteur de ce petit livre. Mais Jamblique 53, Proclus 54 et lauteur des
Prolgomnes la philosophie de Platon 55 estiment quil sagit de Time de
Locres 56; selon eux, Platon se serait inspir de la doctrine de Pythagore, sans aller
jusqu copier lcrit.
Sur la foi dHermippe de Smyrne 57, Diogne Larce (VIII, 85) considre le
pythagoricien Philolaos comme lauteur de ce livre. Or, Diogne Larce connat deux
versions de cette acquisition; soit Platon aurait achet ce livre, soit Philolaos le lui aurait
donn pour avoir obtenu de Denys le pardon dun de ses disciples.
50. Sur ce passage, voir le commentaire de H. Cherniss, Aristotles Criticism of Plato and the Academy
[1944], New York, Russell & Russell, 1962, p. 475, n. 426.
51. Pour plus de prcision, cf. Alice Swift Riginos, Platonica. The Anecdotes Concerning the Life and
Writings of Plato, Columbia Studies in the classical tradition 3, Leiden, Brill, 1976, p. 165-174.
52. Philosophe sceptique (320230 av. J.-C.) qui aurait t le sectateur de Pyrrhon et qui crivit des
Slloi (Satires) en hexamtres contre les philosophes dogmatiques, dont Platon.
53. In Nicomachi arithmeticam, p. 105.10-17 Pistelli.
54. In Tim. I, 1.8-13 Diehl.
55. Voir p. 5.35-39 Hermann.
56. Un faux du dbut du II e sicle av. J.-C. Voir n. 00.
57. Hermippe de Smyrne (III e sicle av. J.-C.) se rattache lcole pripatticienne. Il crivit, sur la vie
de philosophes et de lgislateurs notamment, une uvre immense dont sinspira beaucoup Plutarque.
Amateur de sensationnalisme, Hermippe falsifie dlibrment lhistoire.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 55-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
Enfin, sappuyant sur Satyros, un jeune contemporain dHermippe, Diogne
Larce (III, 9, cf. VIII, 15 et 84) rapporte que Platon demanda Dion dacheter
Philolaos trois livres concernant la doctrine de Pythagore; il ne parle pas ici ouvertement
de plagiat, mais laccusation semble aller de soi.
Quelle que soit la version retenue, cette anecdote tait transmise pour illustrer la
conviction largement rpandue, mme chez les Platoniciens, suivant laquelle le
platonisme drivait du pythagorisme 58. Elle constitue le socle sur lequel repose le
phnomne exgtique des doctrines non crites de Platon 59.
Mme si lon refuse dadmettre lauthenticit de cette anecdote, on ne peut
s'empcher de se demander si Platon sest inspir dune cosmologie pythagoricienne,
supposer bien sr que cette cosmologie ait vraiment exist, et si oui jusquo. Il est en
effet une chose trange, sur laquelle il convient dinsister: quand Platon veut discuter des
thses de ses prdcesseurs sur le monde sensible, il a recours aux Milsiens ou
Anaxagore, jamais Pythagore ou un Pythagoricien. Par ailleurs, le seul passage
dAristote qui donne une prsentation explicite et globale de la cosmologie
pythagoricienne est le suivant:
Quant au systme des Pythagoriciens, dun ct, il offre des difficults moindres
que les prcdents [ceux de Speusippe, Platon et Xnocrate], mais, dun autre ct, il en
prsente dautres qui lui sont particulires. Prendre le nombre non spar du sensible,
cest faire disparatre assurment une grande partie des impossibilits que nous avons
signales; par contre, admettre que les corps sont composs de nombres et que le nombre
composant est le nombre mathmatique, cest ce qui est impossible. En effet, il nest pas
vrai de dire quil existe des grandeurs inscables; et, quand bien mme on admettrait
lexistence de grandeurs de cette sorte, les units, en tout cas, nont pas de grandeur; et
comment une tendue peut-elle tre compose dindivisibles? Or, alors que le nombre
arithmtique, du moins, est une somme dunits, ces philosophes veulent que les tres
58. Sur ce prtendu rapport, cf. H. Cherniss, Aristotles Criticism of Presocratic Philosophy,
Baltimore, Johns Hopkins Press, 1935, p. 43-46, 223-226, 386-392; Aristotles Criticism of Plato and
the Academy [1945], New York, Russell & Russell, 1962, p. 181-194 et The Riddle of the Early
Academy [1945], New York, Russell & Russell, 1962, p. 48-59; ce second ouvrage a t traduit en
franais par Laurent Boulakia sous le titre : Lnigme de lancienne Acadmie, Paris, Vrin, 1993,
p. 123-134.
56-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
soient le nombre mme, et, de toute faon, appliquent aux corps les propositions des
nombres, comme sils taient composs de ces nombres. Il est donc ncessaire, sil est
vrai que le nombre est un tre rel et par soi, quil le soit de lune des manires que nous
avons distingues, et, sil ne peut ltre daucune de ces manires, il est manifeste que la
nature du nombre nest pas celle que lui construisent ces philosophes qui en font un tre
spar. (Mt., M 8, 1083 b 8-19, trad. Tricot modifie)
Ce texte, suivant Raven 60, contient huit assertions:
1) Les Pythagoriciens reconnaissent une seule espce de nombre, le nombre
mathmatique;
2) ce nombre nest pas spar des sensibles;
3) les corps en sont composs, ce sont des agrgats dunits;
4) il y aurait des grandeurs (physiques) indivisibles;
5) le nombre arithmtique est pluralit dunits indivisibles;
6) les units auraient une grandeur;
7) les choses sont nombres;
8) les Pythagoriciens appliquent aux choses physiques des thormes
arithmtiques.
1), 2), 3) sont donnes comme des thses pythagoriciennes galement en
1080 b 16-18; 5) en 1080 b 19-20, et 32-33; 7) en 987 b 28 et passim; 8) en 989 b 29-34.
Quant 4) et 6), ce sont des consquences invitables de la conjonction de 3), 7) avec 1)
et 5). Dans cette perspective, le nombre est conu comme corporel. En dautres termes, le
nombre nest pas diffrent du corps physique. Les arguments de Znon pourraient bien
sattaquer ces thses pythagoriciennes, car elles dveloppent une critique contre une
59. Sur le sujet, voir L. Brisson, Prsupposs et consquences dune interprtation sotriste de
Platon , dans Lectures de Platon, p. 43-110.
60. J.E. Raven, Pythagoreans and Eleatics. An account of the interaction between the two opposed
schools during the fifth and early fourth centuries B.C., [1948], Amsterdam, Hakkert, 1966, p. 53-54.
Sur ce texte, cf. aussi H. Cherniss, Aristotles Criticism of the Presocratics, p. 39-40.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 57-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
conception marque par un syncrtisme archaque qui ne distingue pas entre le plan des
choses physiques, celui des notions mathmatiques, et celui de ltre; Znon associe aux
multiplicits sensibles, afin den rendre compte comme de ralits, des multiplicits de
choses qui sont (t nta) , do rsultent les contradictions quil met en lumire. Il sagit
donc bien dune critique des objets visibles et de ce qui les concerne, et cest une
controverse sur lexplication du monde physique que mettent en uvre les arguments de
llate; voil dailleurs ce qui justifie leur examen par Aristote dans sa Physique. Sur
ce point aussi, Platon, dans le Parmnide, se trouve en accord avec ce que nous savons
par ailleurs 61.
Dun autre ct, lide dutiliser non le seul langage ordinaire, mais les
mathmatiques, pour dcrire le monde sensible semble venir de Pythagore ou des
Pythagoriciens. Toute la question est de savoir si cette influence fut directe ou si elle eut
comme relais des mathmaticiens comme Thtte qui, eux, auraient pu sinspirer de
dcouvertes faites par les Pythagoriciens en mathmatiques, mais en les intgrant dans un
ensemble nayant plus rien de pythagoricien. Cette seconde hypothse me parat la plus
vraisemblable.
3. Doctrine de la transmigration de lme
On estime que la transmigration de lme tait un dogme chez les Orphiques et
chez les Pythagoriens 62 et que Platon laurait repris son compte. Lenjeu est important
dans la mesure ou la transmigration de lme est, chez Platon, la base de la doctrine de
la rminiscence qui elle-mme implique la notion de forme intelligible spare qui peut
tre contemple par lme mme spare du corps.
Mais aucun des tmoignages avancs pour prouver que les Pythagoriciens
prnaient la doctrine de la transmigration nest dcisif.
Diogne Larce cite des vers de Xnophane quil rapporte Pythagore:
61. Sur le sujet voir M. Caveing, Znon dle. Prolgomnes aux doctrines du continu, tude
historique et critique des Fragments et Tmoignages, Paris, Vrin, 1982.
62. Voir Lore and Science, II, 3, et, de faon beaucoup moins rigoureuse et prudente, G. Casadio, Le
metempsicosi tra Orfeo e Pitagora dans Orphisme et Orphe, en lhonneur de Jean Rudhardt, ed.
par Ph. Borgeaud, Genve, Droz, 1991, 119-155.
58-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
Alors qu'un jour il passait prs d'un jeune chien que l'on battait, il fut, raconte-ton, pris de piti et pronona ces mots: Arrtez ces coups de bton, car c'est l'me d'un
tre qui m'est cher. Je la reconnais en l'entendant aboyer . (DL, VIII 36)
Mais aucun nom propre nest cit dans ce fragment qui pourrait faire rfrence
un autre personnage que Pythagore. De plus, il pourrait sagir l dune critique du genre
de celle que fait Aristote aux Pythagoriciens.
Au dbut du De anima, Aristote fait cette remarque polmique:
Or nos thoriciens sefforcent seulement de dterminer de quelle sorte dtre est
lme, mais pour le corps qui doit la recevoir, ils napportent plus aucune dtermination;
comme sil se pouvait, conformment aux mythes pythagoriciens, que nimporte quelle
me pntre dans nimporte quel corps ! (De anima, I, 3, 407 b 20; cf. aussi II, 2,
414 a 22)
Mais rien ne permet de dterminer si Aristote veut parler l dindividu ou
despce. Ce qu'il dnonce l, cest lerreur qui consiste ne pas distinguer l'animal de
l'homme.
Lorsquil dcrit larrive de Pythagore Crotone, Porphyre rapporte ce que dit
Dicarque, le disciple dAristote:
Quant ce quil disait aux gens de son entourage, nul ne peut le formuler avec
certitude; et en effet il rgnait parmi eux un silence exceptionnel. Toutefois les points les
plus gnralement admis sont les suivants: dabord que lme est immortelle; ensuite,
quelle passe dans dautres espces animales; en outre, qu des priodes dtermines ce
qui a t renat, que rien nest absolument nouveau, quil faut reconnatre la mme espce
tous les tres qui reoivent vie. Car ce sont l, ce qu'on rapporte (phretai), les
dogmes que Pythagore le premier introduisit en Grce. (Porphyre, Vit. Pyth., 19, trad.
. des Places modifie = Dicarque, fr. 33 Werhli)
Comme le reconnat lui-mme Walter Burkert, il ny a sur un plan philologique
aucun moyen de dterminer ce qui, dans cette citation, vient de Dicarque. De plus, il
convient de remarquer le scepticisme dont fait preuve ce tmoignage qui s'en remet ce
qu'on rapporte (phretai).
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 59-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
En outre, mme si Hrodote (IV, 95-96) affirme que les Grecs qui vivent dans la
rgion de la mer Noire rapportent Pythagore les pratiques dimmortalit en vigueur chez
les Gtes (Getai athanatizontes), la tradition postrieure tend ngliger de rapporter
galement lui la doctrine de la transmigration.
Par ailleurs, aucun tmoignage ancien nattribue explicitement la doctrine de la
transmigration lOrphisme. Seule est explicitement attribue lOrphisme la doctrine
d'une pr-existence de lme qui nest pas forcment individuelle, et celle dune
rtribution dans lautre monde.
Aristote explique ainsi comment lme entre dans un corps:
Sous ce mme grief tombe aussi la doctrine exprime dans les vers attribus
Orphe: daprs elle, lme provient de lunivers extrieur et pntre dans les tres
vivants par la respiration, les vents lui servant de vhicule chose impossible dans le
cas des plantes et de certains animaux, puisque tous ne sont pas dous de respiration !
Cest ce qui a chapp aux tenants de cette opinion. (Aristote, De anima, I, 5, 410 b 27,
trad. A. Jannone)
Comme je lai dit plus haut, il est impossible ici encore de savoir si Aristote
parle de lindividu ou de lespce.
Cette me semble (si lon se trouve toujours dans un contexte pythagoricien,
mais la chose est loin dtre certaine) subir un chtiment lorsquelle se trouve dans un
corps qui constitue pour elle une prison (Platon, Cratyle 400 b-c; Phdon 62 b). Tout le
problme est de savoir si cette punition est individuelle ou collective, et si elle dcoule
dune faute antrieure qualifie.
Et surtout, il convient de noter que les initiations sont destines laver les mes
de leurs fautes pour leur assurer une survie heureuse. Relisons ces quelques lignes de la
Rpublique (II, 364 e-365 a):
Ils produisent dautre part une foule de livres de Muse et dOrphe, fils de la
Lune et des Muses, dit-on. Ils rglent leurs sacrifices sur lautorit de ces livres et font
accroire non seulement aux particuliers, mais encore aux cits, quon peut par des
sacrifices et des jeux divertissants tre absout et purifi de son crime, soit de son vivant,
60-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
soit mme aprs sa mort. Ils appellent initiations ces crmonies qui nous dlivrent des
maux de lautre monde et quon ne peut ngliger sans sattendre de terribles supplices.
On ne peut tirer de ce passage aucune allusion prcise une thorie de la
transmigration: il ne sagit que de survie heureuse, tout comme dailleurs, semble-t-il,
dans les Lois (IX, 870 d-e), dans le papyrus de Derveni et dans les feuilles dor, o
aucune trace de transmigration ne peut tre dcele. De surcrot, Platon se montre ici trs
ironique lgard de ces individus qui promettent de laver les fautes commises par des
cits et des individus en mettant en uvre des sacrifices et jeux divertissants . On
notera que les fautes commises par les cits ne peuvent tre punies dans le contexte de la
transmigration: une cit ne peut renatre. De plus, on promet aux individus qu'ils seront
exempts de chtiments dont ils sont menacs, dans cette vie et lorsqu'ils seront morts.
La seule faon daffirmer que lOrphisme dfend une doctrine de la transmigration
des mes serait de penser que sont orphiques les prtres et les prtesses quvoque
Platon dans le Mnon (81 a-e), ou de tirer en ce sens le tmoignage dHrodote (II, 123)
qui ramne la doctrine de la transmigration aux gyptiens.
Or, voici ce quon peut lire chez Hrodote (II, 123):
Au dire des gyptiens, ce sont Dmter et Dionysos qui rgnent dans les Enfers.
Les gyptiens sont aussi les premiers avoir nonc cette doctrine, que lme de
lhomme est immortelle; que, lorsque le corps prit, elle entre dans un autre animal qui,
son tour, est naissant; quaprs avoir parcouru tous les tres de la terre, de la mer et de
lair, elle entre de nouveau dans le corps dun homme naisssant; que ce circuit
saccomplit pour elle en trois mille ans. Il est des Grecs, qui, ceux-ci plus tt, ceux-l
plus tard, ont profess cette doctrine comme si elle leur appartenait en propre; je sais
leurs noms, je ne les cris pas.
Il semble que les gyptiens naient pas cru en la transmigration de lme; et pour
ce qui est de la dernire phrase, il est prsomptueux dmettre des hypothses propos
de noms quHrodote ne veut mme pas donner, et de dire quil sagit dOrphiques.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 61-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
Par ailleurs, le passage du Mnon (81 b-c) 63 o se trouvent cits quelques
vers que lon attribue traditionnellement Pindare (frag. 133 Berk = 126 Bowra) voque
bien la doctrine de la transmigration, mais en la rapportant des prtres et des prtresses
ayant cur de pouvoir rendre raison des fonctions quils remplissent; il vise faire non
seulement de Pindare, mais galement dautres potes les porte-parole de cette doctrine.
Linterprtation de ce passage o napparat jamais le nom dOrphe ou dOrphiques
reste discute; jaurais tendance admettre la position critique de G. Zuntz contre
H.J. Rose 64.
Devant tant de confusions et tant dincertitudes, la seule hypothse valable
lheure actuelle est la suivante. Pindare, Empdocle, Hrodote et Platon connaissaient
lexistence de mouvements religieux qui soutenaient la doctrine de la transmigration. Il
semble que ces mouvements eurent une influence sur le Pythagorisme et sur lOrphisme.
Dans cette perspective, la question de savoir lequel, du Pythagorisme ou de lOrphisme,
a pu influencer lautre na pas de sens. Les deux, tout de mme que Platon, ont admis et
rejet certaines interdictions et certains points de doctrine venus de mouvements
religieux, quil est impossible didentifier.
Une telle conclusion paratra sans doute trop sceptique, mais cest la seule qui
permet dviter de tomber dans le cercle vicieux que Jamblique lve au rang de mythe et
daborder ltude de lOrphisme et du Pythagorisme pour eux-mmes, en dterminant
quels purent tre leurs traits spcifiques. Une telle position ne remet absolument pas en
cause lintrt des dcouvertes relativement rcentes: plaquettes dos dOlbia, feuilles
dor etc. Elle se borne rclamer une prudence extrme ds quil sagit de coller
ltiquette pythagoricien ou orphique sur tel ou tel document crit ou figur.
63. Sur le sujet, voir L. Brisson, La rminiscence dans le Mnon (80 e-81 e) et son arrire-plan
religieux , dans Anamnese e Saber, ed. Jos Trindade Santos, Centro de Filosofia da Universidade de
Lisboa, Lisbonne, Impresa Nacional - Casa da Moeda, 1999, p. 23-61. Discussions [48-61]
64. G. Zuntz, Persephone. Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia, Oxford, Univ.
Press, 1971; H.J. Rose, The ancient grief. A study of Pindar, Fr; 133 (Berk) 126 (Bowra) , dans Greek
Poetry and Life. Essays, presented to Gilbert Murray on his 70th birthday, January 2 1936, Oxford,
1936, p. 79-96.
62-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
4. L'invention de philsophos
Avant l'poque de Platon, l'usage des termes philosopha, philsophos et
philosophen semble avoir t trs rare65, compte tenu bien videmment du petit nombre
de textes antrieurs au IVe sicle qui nous sont parvenus. Et, semble-t-il bien, c'est Platon
qui a donn philsophos le sens qui continue d'tre le sien aujourd'hui. Mais, certains
ont cru et d'autres continuent de croire que, sur ce point galement, Platon s'est inspir de
Pythagore. Ils appuient leur conviction sur une anecdote raconte, dans son Per pnou h
per nson, par Hraclide du Pont, qui, la mort de Platon, aurait pass tout prs de
devenir scholarque de l'Acadmie.
Pythagore fut le premier s'appeller philosophe (philsophos). Non seulement
il employa un mot nouveau, mais il enseigna une doctrine originale. Il vint Phlionte, il
s'entretint longuement et doctement avec Lon, le tyran de Phlionte, Lon qui, admirant
son esprit et son loquence, lui demanda quel art lui plaisait le plus. Mais, lui, il rpondit
qu'il ne connaissait pas d'art, qu'il tait philosophe . S'tonnant de la nouveaut du mot,
Lon lui demanda quels taient donc les philosophes et ce qui les distinguait des autres
hommes.
65. En voici un inventaire qui se fonde sur le travail d'A.-M. Malingrey, Philosophia. tude d'un groupe
de mots dans la littrature grecque, des Prsocratiquee au IVe sicle apr. J.-C., Paris, Klincksieck,
1961. I) Pour philsophos, 1) Hraclite (DK 22 B 35 = Clment d'Alexandrie, Stromates V 140,6). J.
Bollack et H. Wismann (Hraclite ou la sparation, Paris, Minuit, 1972, p. 143-144) ont raison
d'insister sur le fait que, chez Hraclite, ce terme ne peut avoir le sens de "philosophe". Par ailleurs, dans
son commentaire ce fragment, T. M. Robinson (Heraclitus, Fragments, Toronto / Buffalo / London,
Univ. of Toronto Press, 1987, p. 104 rappelle que certains commentateurs ont cru que le terme tait un
ajout de Clment d'Alexandrie. 2) Selon la Souda (s.v. Znon, t. II, p. 506.26 Adler = DK 29A2), Znon
aurait crit un ouvrage intitul Prs tos philsophous. Mais Platon (Parmnide, 127b-d, 128a-d) et
Simplicius (In Arist. Phys. 139.5 Diels) semblent n'avoir connu qu'un seul ouvrage de Znon (sur le
sujet, cf. M. Caveing, Znon d'le, Paris, Vrin, 1982, p. 134-135). 3) Dans son Per homonoas (DK
87B44a = Philostrate, Vit. Soph. I 15, 4), Antiphon parle de gnomologai te lampra ka philsophoi
De toute vidence, philsophoi dsigne ici une qualit du langage quivalente lampra. De faon
similaire, dans son loge d'Hlne (DK 82B11, 13), Gorgias utilise l'expression philsophon lgon
pour indiquer la qualit d'une parole qui exprime adquatement la pense. II) Pour philosopha, 1) on ne
trouve qu'une seule occurrence (Trait de l'ancienne mdecine, 20). Cette occurrence prsenterait un
intrt considrable si, comme le pensait A.-J. Festugire, on pouvait prouver que l'ouvrage fut compos
vers 420 av. J.-C. Mais la plupart de ceux qui rcemment ont pris position sur le sujet placent la
composition de cet ouvrage aprs 380 av. J.-C. (cf. Ch. Lichtenthaeler, Chronologische und
gedankliche Bezugssysteme in und um Ueber die alte Medizin, Genve, Droz, 1980, p. 27, n. 42. III).
Pour philosophen, 1) Hrodote (I 30) fait usage de ce verbe dans un sens trs large pour dsigner
l'acquisition d'un savoir indtermin. 2) Thucydide (II 40, 1) met dans la bouche de Pricls prononant
l'loge funbre de 431/0 av. J.-C. cette phrase concernant les Athniens: Nous cultivons la beaut dans
la simplicit, et les choses de l'esprit sans manque de fermet (philosophomen neu malakas). Or
l'activit dsigne par le verbe philosophen ne peut tre autre chose que l'acquisition de la
connaissance en gnral.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 63-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
Pythagore rpondit que notre passage dans cette vie ressemble la foule qui se
rencontre aux pangyries. Les uns y viennent pour la gloire que leur vaut leur force
physique, les autres pour le gain provenant de l'change des marchandises, et il y a une
troisime sorte de gens, qui viennent pour voir des sites, des uvres d'art, des exploits et
des discours vertueux que l'on prsente d'ordinaire aux pangyries. De mme nous,
comme on vient d'une ville vers un autre march, nous sommes partis d'une autre vie et
d'une autre nature vers celle-ci; et les uns sont esclaves de la gloire, d'autres de la
richesse. Au contraire, rares sont ceux qui ont reu en partage la contemplation des plus
belles choses et c'est ceux-l qu'on appelle philosophes (philsophoi), et non pas
sages (sopho), car personne n'est sage si ce n'est Dieu... 66
Mais l'interprtation de ce texte, qui voque la tripartition fonctionell67e, a
suscit une controverse qui est loin d'tre termine, et dont les dveloppements les plus
rcents ont oppos Robert Joly, qui penche pour l'authenticit de l'anecdote, et Walter
Burkert68, qui, suivant en cela Werner Jaeger69, estime que les thmes de cette anecdote
trahissent une origine platonicienne et illustrent la conception platonisante qu'on se faisait
de Pythagore l'Acadmie peu aprs la mort de Platon.
L'argument dcisif en faveur de cette attitude de rejet s'enracine dans l'affirmation
qui clt l'anecdote: ... et c'est ceux-l qu'on appelle "philosophes", et non pas "sages",
car personne n'est sage si ce n'est Dieu... Cette dclaration fait cho ces deux
passages du corpus platonicien: Parmi les dieux, il n'y en a aucun qui s'emploie
philosopher (philosophe), aucun qui ait envie de devenir sage (sophs), car il l'est.
(Banquet, 204 a) et: L'appeler sage (sophs), Phdre, c'est, mon avis du moins,
quelque chose d'excessif et qui ne convient qu' un dieu. Mais l'appeller "philosophe"
(philsophos), [...] voil qui lui conviendrait mieux et qui serait mieux dans le ton.
(Phdre, 278 d). Le sens donn aux termes sophs et philsophos dans ces passages
66. La traduction est celle de R. Joly, dans Platon ou Pythagore? Hraclide Pontique, fr. 87-88
Wehrli. , dans Hommage Marie Delcourt, Collection Latomus 114, Bruxelles, 1970, p. 136-148.
67. Viennent aux pangyries ceux qui recherchent le gain, ceux qui recherchent la gloire que leur vaut
leur force physique, et les troisimes pour voir des sites, des uvres d'art, etc.
68. W. Burkert, Platon oder Pythagoras. Zum Ursprung des Wortes "Philosophie" , Hermes 88, 1960,
p. 159-177.
69. W. Jaeger, Ueber Ursprung und Kreislauf des philosophischen Lebensideals , Sitzungsberichte
des Preussichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch- historische Klasse 1928, p. 390-421.
64-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
dpend de l'opposition entre l'tre et le paratre, entre le modle et l'image, entre
l'intelligible et le sensible, oppositions qui recoupent celle entre dieu et homme.
Jusqu' Platon, en effet, le terme sopha peut recevoir n'importe quel contenu dans
la mesure o la sopha n'est, dans le monde sensible, lie aucun contenu particulier.
Etre sphos dans ce contexte, c'est dominer son activit, se dominer soi-mme et dominer
les autres70; voil pourquoi peuvent tre dclars sopho le charpentier, le mdecin, le
devin, le pote, le rhteur, le sophiste, etc. Par suite, sopha devient synonyme de
"civilisation". C'est d'ailleurs la position qu'adopte Aristote dans son Per
philosophas71. Peut donc tre qualifi de philsophos quiconque fait l'apprentissage
d'une sopha, quelle que soit la nature de l'activit implique; et c'est le mme individu
qui, une fois qu'il aura acquis cette sopha, pourra tre qualifi de sophs. C'est aussi
dans ce sens large qu'Isocrate utilise les termes philsophos et philosopha. Mais pour
Platon, le terme philosopha ne dsigne plus l'apprentissage d'une sopha humaine, dont
le contenu peut varier l'infini. Elle devient aspiration une sopha qui dpasse les
possibilits humaines, car son but ultime est la contemplation d'un domaine d'objets, le
monde des formes intelligibles, dont le monde des choses sensibles, o a chu l'me
humaine, pour un temps du moins, n'est qu'un reflet. Or, c'est bien l, semble-t-il, le sens
de philsophos dans les passages du Banquet et du Phdre cits.
Sur ce point encore, on a voulu retrouver chez Platon l'influence d'un Pythagore
fabriqu de toutes pices partir de Platon
On ne peut nier que se soit exerce sur Platon linfluence de Pythagore et des
Pythagoriciens. Mais ds que lon cherche prciser la nature et limportance de cette
influence, la plus grande retenue s'impose si l'on veut viter de se laisser aller des
excs dans lesquels sont tombs bon nombre dinterprtes anciens pour des raisons
polmiques (Aristote, Aristoxne, par exemple) ou idologique (Jamblique et les
Une traduction anglaise de cet article se trouve imprime en Appendice (II) de la traduction anglaise par
R. Robinson de l'Aristote de W. Jaeger.
70. M. Dixsaut, Le Naturel philosophe. Essai sur les dialogues de Platon [1985] Paris, Vrin, 19993, p.
45-51.
Eikasia. Revista de Filosofa, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 65-A
Brisson, Luc: Platon, Pythagore et les Pythagoriciens
Noplatoniciens postrieurs), et dont les modernes reprennent sans esprit critique les
affirmations. Seule lapplication dune mthode historique prudente et lucide permet
dviter cette drive. J'ai tent dans ce texte de montrer pourquoi un lecteur de Platon
peut et doit chapper un rflexe conditionn consistant rapporter une source
pythagoricienne tout ce qu'il lit sur la transmigration de l'me et sur les mathmatiques au
sens large. Un tel rflexe ne permet de mieux comprendre ni Platon ni Pythagore ni les
Pythagoriciens; il contribue recouvrir d'hypothses d'autres hypothses tout aussi
fragiles.
Si ce travail contribue mettre un terme cette profusion de suppositions qui
nourrissent une histoire de la philosophie d'autant plus sduisante qu'elle est virtuelle, il
aura t salutaire.
71. Frag. 8 Ross = Philopon, Commentaire sur l'Isagog de Nicomaque de Grase, 1.8-2.42 Hoche.
Texte traduit et comment par A.-J. Festugire, dans La Rvlation d'Herms Trismgiste, t. II: Le dieu
cosmique, Paris, Gabalda, 1949, p. 221-229, surtout p. 222-223.
66-A Eikasia. Revista de Filosofa, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org
Vous aimerez peut-être aussi
- Platon Et Les Mathématiques (Rashed)Document16 pagesPlaton Et Les Mathématiques (Rashed)xfgcb qdljrkfglePas encore d'évaluation
- La Nuit du renard de Mary Higgins Clark (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandLa Nuit du renard de Mary Higgins Clark (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- (L'Âne D'or, 12) Tiziano Dorandi - Le Stylet Et La Tablette - Dans Le Secret Des Auteurs Antiques-Les Belles Lettres (2000)Document228 pages(L'Âne D'or, 12) Tiziano Dorandi - Le Stylet Et La Tablette - Dans Le Secret Des Auteurs Antiques-Les Belles Lettres (2000)azac98Pas encore d'évaluation
- La Thēurgie Chez Les Neo Platoniciens Et Dans Les Papyrus Magiques S. EitremDocument32 pagesLa Thēurgie Chez Les Neo Platoniciens Et Dans Les Papyrus Magiques S. EitremaavahosPas encore d'évaluation
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- L'apparition Du Sphinx Dans L'art Grec Aux VIIIe Et VIIe Siècles Avant J.-C.Document38 pagesL'apparition Du Sphinx Dans L'art Grec Aux VIIIe Et VIIe Siècles Avant J.-C.LudwigRossPas encore d'évaluation
- Etude de La Substance Chez AristoteDocument18 pagesEtude de La Substance Chez AristoteLesco GriffePas encore d'évaluation
- Alexandre D'Aphrodise - Traité Du DestinDocument173 pagesAlexandre D'Aphrodise - Traité Du Destinzevencias100% (1)
- Bidez - Note Sur Le Mysteres NeoplatoniciensDocument6 pagesBidez - Note Sur Le Mysteres NeoplatonicienstheourgikonPas encore d'évaluation
- Gérard Verbeke, Comment Aristote Conçoit-Il L'immatériel ?Document33 pagesGérard Verbeke, Comment Aristote Conçoit-Il L'immatériel ?gonzorecPas encore d'évaluation
- L'Hexatonique Grec D'après Nicomaque (Article Par J.chailley) - 1956Document29 pagesL'Hexatonique Grec D'après Nicomaque (Article Par J.chailley) - 1956FaustusSapiens100% (1)
- Mithra Et L'orphismeDocument12 pagesMithra Et L'orphismeTiffany BrooksPas encore d'évaluation
- Le Du Traite Aristotelicien Du CiDocument30 pagesLe Du Traite Aristotelicien Du Cijramos_117817Pas encore d'évaluation
- Trouillard - La Moné Selon ProclosDocument12 pagesTrouillard - La Moné Selon ProclosRupertoPas encore d'évaluation
- Poesie Orphique Et Rituel Initiatique ElDocument24 pagesPoesie Orphique Et Rituel Initiatique Elmasanta11Pas encore d'évaluation
- Platon - Hippias Majeur (Grenoble)Document61 pagesPlaton - Hippias Majeur (Grenoble)5892fyf5znPas encore d'évaluation
- Le Nombre Entier Dans TheeteteDocument20 pagesLe Nombre Entier Dans TheetetelangoustmanPas encore d'évaluation
- La Philosophie de Pythagore Et L'harmonie Chiffrée de La NatureDocument1 pageLa Philosophie de Pythagore Et L'harmonie Chiffrée de La NatureAmin ChaachooPas encore d'évaluation
- Ousia Hypostase Ariens PDFDocument58 pagesOusia Hypostase Ariens PDFsimonPas encore d'évaluation
- La Fonction de Diotime Dans Le Banquet de Platon (201d1-212c3) : Le Dialogue Et Son Double PDFDocument31 pagesLa Fonction de Diotime Dans Le Banquet de Platon (201d1-212c3) : Le Dialogue Et Son Double PDFcerberusalexPas encore d'évaluation
- SIMONDON Sur Kronos & ChronosDocument11 pagesSIMONDON Sur Kronos & Chronosmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Deux Allusions Aux Doctrines Non Écrites de Platon P.AubenqueDocument15 pagesDeux Allusions Aux Doctrines Non Écrites de Platon P.AubenqueJorge CarrilloPas encore d'évaluation
- Narbonne - Henosis Et Ereignis PDFDocument18 pagesNarbonne - Henosis Et Ereignis PDFFrankPas encore d'évaluation
- Les Miracles D'empédocle - Christine MauduitDocument22 pagesLes Miracles D'empédocle - Christine Mauduitvordevan100% (1)
- BERGER Proclus Exposition de Sa DoctrineDocument131 pagesBERGER Proclus Exposition de Sa DoctrineBashy Skanker100% (1)
- BoyanceDocument40 pagesBoyanceGelu DiaconuPas encore d'évaluation
- Commentaire Du PhédonDocument32 pagesCommentaire Du PhédonRomain PtrPas encore d'évaluation
- JOURNAL Émile BrehierDocument11 pagesJOURNAL Émile BrehierMaikon ScheresPas encore d'évaluation
- VrinDocument22 pagesVrinpetarPas encore d'évaluation
- De La Nature Des Choses Poëme. Tome 1 PDFDocument404 pagesDe La Nature Des Choses Poëme. Tome 1 PDFAnonymous WE5dIf7BHPas encore d'évaluation
- Abaris HeraclideDocument33 pagesAbaris Heraclidegeorges BIZOTPas encore d'évaluation
- Plotin Et Les Gnostiques L'audace Du Demiurge PDFDocument27 pagesPlotin Et Les Gnostiques L'audace Du Demiurge PDFjusrmyr100% (2)
- Querelles Cartésiennes I (Alquié-Gueroult) : Animé Par Pierre MachereyDocument11 pagesQuerelles Cartésiennes I (Alquié-Gueroult) : Animé Par Pierre MachereyAbdelazizGammoudiPas encore d'évaluation
- Les Dialogues Platoniciens Chez PlutarqueDocument182 pagesLes Dialogues Platoniciens Chez PlutarqueMassimo Giuseppetti100% (1)
- Henri de Lubac, La Rencontre Du Bouddhisme Et de L'occident, 2000Document2 pagesHenri de Lubac, La Rencontre Du Bouddhisme Et de L'occident, 2000Joop-le-philosophePas encore d'évaluation
- PhA 050 - Hoffmann - Commentaire Sur Les Catégories - Traduction Commentée Sous La Direction de Ilsetraut Hadot. Fascicule I - Introduction, Première Partie (P. 1-9, 3 Kalbfleisch) 1989 PDFDocument249 pagesPhA 050 - Hoffmann - Commentaire Sur Les Catégories - Traduction Commentée Sous La Direction de Ilsetraut Hadot. Fascicule I - Introduction, Première Partie (P. 1-9, 3 Kalbfleisch) 1989 PDFPhilosophvs AntiqvvsPas encore d'évaluation
- Turcan Robert - L'oeuf Orphique Et Les 4 ÉlémentsDocument14 pagesTurcan Robert - L'oeuf Orphique Et Les 4 ÉlémentsAlmuric59Pas encore d'évaluation
- Simondon - Le Temps, Père de Toutes Choses . Chronos - Kronos PDFDocument11 pagesSimondon - Le Temps, Père de Toutes Choses . Chronos - Kronos PDFTiago da Costa GuterresPas encore d'évaluation
- Réflexions sur l'Ὄχημα dans Les Eléments de Théologie de ProclusDocument7 pagesRéflexions sur l'Ὄχημα dans Les Eléments de Théologie de ProclusAnonymous o3QDRuLopPas encore d'évaluation
- Biologie Végétale: 6R/H) Ohelhqyhqxwrxmrxuwpopfkdujhu Soxvgholyuhvjudwxlwhphqwvxu Zzzjudwxlw/LyuhveorjvsrwfrpDocument318 pagesBiologie Végétale: 6R/H) Ohelhqyhqxwrxmrxuwpopfkdujhu Soxvgholyuhvjudwxlwhphqwvxu Zzzjudwxlw/LyuhveorjvsrwfrpClara MarmolPas encore d'évaluation
- Histoire Du Texte de Platon (... ) Alline Henri Bpt6k331179Document340 pagesHistoire Du Texte de Platon (... ) Alline Henri Bpt6k331179Bruno Domingues Machado100% (1)
- APOLLONIUS de TYANE - DUMERIL - L'État Du Paganisme Dans Les Premiers Siècles de L'ère ChrétienneDocument23 pagesAPOLLONIUS de TYANE - DUMERIL - L'État Du Paganisme Dans Les Premiers Siècles de L'ère ChrétienneOlivier SARTOUXPas encore d'évaluation
- Les 22fragments 22 de L Ancien Stoicisme - Une IntroductionDocument18 pagesLes 22fragments 22 de L Ancien Stoicisme - Une IntroductionJérôme RobinPas encore d'évaluation
- La Théorie Des Nombres Chez PlotinDocument152 pagesLa Théorie Des Nombres Chez PlotinBAHA ZAFERPas encore d'évaluation
- Les Quatre ÉvangilesDocument24 pagesLes Quatre ÉvangilesChristian AmisiPas encore d'évaluation
- KhôraDocument5 pagesKhôrajacquesderrida100% (1)
- Boehm, Rudolf - Le Fondamental Est-Il L'essential (Aristote, Métaphysique Z 3)Document18 pagesBoehm, Rudolf - Le Fondamental Est-Il L'essential (Aristote, Métaphysique Z 3)DamaskiosPas encore d'évaluation
- Bakhouche Calcidius 01introduccion (2011)Document125 pagesBakhouche Calcidius 01introduccion (2011)Epistêmôn EmpéïrôsPas encore d'évaluation
- Ordre Et Désordre en Territoire GrecDocument12 pagesOrdre Et Désordre en Territoire GrecJamaa OuarezzamenPas encore d'évaluation
- Fragments de Numénius D'apamée Dans La Préparation Évangélique D'eusèbe de Césarée PDFDocument9 pagesFragments de Numénius D'apamée Dans La Préparation Évangélique D'eusèbe de Césarée PDFLycophronPas encore d'évaluation
- Maspero. Papyrus Grecs D'époque Byzantine (1911) .Document322 pagesMaspero. Papyrus Grecs D'époque Byzantine (1911) .Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (2)
- La Biographie D'empédocle - Bidez (1894)Document187 pagesLa Biographie D'empédocle - Bidez (1894)Babilonia Cruz100% (1)
- Platon. Lectures Platoniciennes (Laurent Cournarie)Document179 pagesPlaton. Lectures Platoniciennes (Laurent Cournarie)Boudzi_Boudzo_5264Pas encore d'évaluation
- La Theorie Du GnomonDocument56 pagesLa Theorie Du GnomonGuillaume DenomPas encore d'évaluation
- Bresson, Mythe Et Contradiction. Analyse de La VIIe Olympique de Pindare, Les Belles Lettres 1979Document189 pagesBresson, Mythe Et Contradiction. Analyse de La VIIe Olympique de Pindare, Les Belles Lettres 1979Jorge Cano100% (1)
- Hoffmann - Temps Et Éternité Dans Le Livre XI Des Confessions - Augustin Plotin Porphyre Et Saint PaulDocument50 pagesHoffmann - Temps Et Éternité Dans Le Livre XI Des Confessions - Augustin Plotin Porphyre Et Saint PaulAri CostamagnaPas encore d'évaluation
- Le Prince de la Concorde: La vie lumineuse de Jean Pic de la MirandoleD'EverandLe Prince de la Concorde: La vie lumineuse de Jean Pic de la MirandolePas encore d'évaluation
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- La place de l'homme dans l'univers: L'unité et la pluralité des mondesD'EverandLa place de l'homme dans l'univers: L'unité et la pluralité des mondesPas encore d'évaluation