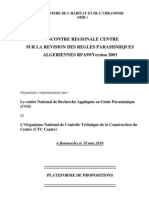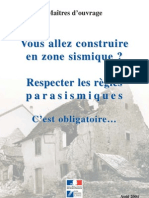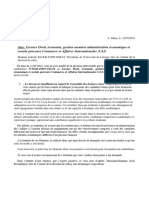Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Regles Parasismiques
Regles Parasismiques
Transféré par
Karim ArfaouiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Regles Parasismiques
Regles Parasismiques
Transféré par
Karim ArfaouiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Reef4 - CSTB
Page 1 of 184
Reef4 version 4.1.1.10 - Edition 159 - Mars 2010
Document : Rgles PS 92 (DTU NF P06-013) (dcembre 1995) : Rgles de construction parasismique - Rgles PS applicables
aux btiments + Amendement A1 (fvrier 2001) + Amendement A2 (novembre 2004)
NF P 06-013
Dcembre 1995
DTU Rgles PS 92
rgles de construction parasismique
Rgles PS applicables aux btiments, dites
Rgles PS 92
earthquake resistant construction rules - earthquake resistant
rules applicable to buildings, called PS 92
Regeln fr erdbebensicheres Bauen - Regeln zum Schutz von
Gebuden gegen Erdbeben, sogenannte PS 92-Regeln
Statut
Norme franaise homologue par dcision du Directeur Gnral de
l'AFNOR le 20 novembre 1995 pour prendre effet le 20 dcembre 1995.
Le prsent document remplace le document DTU Rgles PS 69 Rgles parasismiques 1969 et annexes , de fvrier 1972 (Rfrence
DTU P 06-003)
Il inclut l'Amendement A1 de fvrier 2001, l'Amendement A2 de
novembre 2004
Correspondance
A la date de publication du prsent document, des prnormes ENV
(Eurocodes) sont, suivant les parties concernes, soit en cours
d'laboration soit en cours de publication au sein du CEN/TC 250/SC 8
Structures en rgion sismique sur la conception et le calcul des
structures en zone sismique.
Analyse
Le prsent document constitue les rgles de conception et de calculs
des btiments soumis l'agression sismique.
Ces rgles dfinissent les dispositions qui compltent celles applicables
en situation non sismique.
Descripteurs
Thsaurus International Technique : construction, construction rsistant
au sisme, rgle de construction, conception, calcul, vrification,
scurit, risque, fondation, bton arm, construction en bois,
construction mtallique, paroi, faade, maonnerie.
Modifications
Refonte complte du document.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 2 of 184
Membres de la commission de normalisation
Prsident : M PECKER
Secrtariat technique : M DOURY - CSTB
Secrtariat administratif : M RUTMAN - BNTB
M AMIR-MAZAHERI SEEE STRUCTURES
ARIBERT INSA
ASANCHEYEV Ingnieur conseil
ASHTARI CETEN-APAVE
BALOCHE CSTB
BETBEDER-MATIBET EDF-DE
BIGER BUREAU VERITAS
BISCH SECHAUD ET METZ
BOULLARD CAPEB
BOUTIN SOCOTEC
BRIN CEP
BROZZETTI CTICM
CALLIES AIMCC
CAPRA SPIE BATIGNOLLES
CHEYREZY BOUYGUES S.A.
CLAUZON U.N.MACONNERIE
COIN SAE
COMAIR CERIB
CONSTANTINIDIS BOUYGUES S.A.
COSTES IGPC
DARDARE CERIB
DEMANGE CTBA
DAVIDOVICI SOCOTEC
MME FERNANDEZ AFNOR
M FOURE CEBTP
GUILLON EUROPE ETUDE GECTI
GROSJEAN U.N. MACONNERIE
HRABOVSKY BNTEC
JALIL SOCOTEC
LERAY CGPC
MARRAST UNSFA
MME MICHEL CTTB
M MONTRELAY CAPEB
MOULIN Expert
PECKER GEODYNAMIQUE ET STRUCTURE
RAYNAUD CEBTP
SCHMOL SNBATI
SOLLOGOUB GEODYNAMIQUE ET STRUCTURE
SOULOUMIAC BUREAU VERITAS
THONIER FNTP
WALTER GEODYNAMIQUE ET STRUCTURE
Membres rdacteurs
Prsident : M JALIL
Groupe de rdaction :
M ARIBERT CTICM
BIGER BUREAU VERITAS
BISCH SECHAUD ET METS
CAPRA SPIE BATIGNOLLES
COIN SAE
DARDARE CERIB
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 3 of 184
JALIL SOCOTEC
MOULIN Expert
SOULOUMIAC BUREAU VERITAS
Membres :
M ASANCHEYEV Ingnieur conseil
CLAUZON UN MACONNERIE
MME CLAVAUD CTICM
M COMAIR CERIB
CONSTANTINIDIS BOUYGUES S.A.
COSTES IGPC
FOURE CEBTP
SCHMOL SNBATI
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 4 of 184
Avant-propos
Le niveau de protection vis
L'objectif principal des rgles est de protger les vies humaines, avec une faible probabilit de ruine des
btiments par croulement pour un niveau d'agression nominal du sisme. Un deuxime objectif important
est la limitation des dommages matriels, mais, dans la mesure o sont admises de larges incursions des
matriaux dans leur domaine plastique, une proportion un peu plus importante de btiments peut ne pas
tre rparable aprs l'preuve d'un sisme l'acclration nominale. La probabilit de rparabilit
s'amliore rapidement si on considre des niveaux infrieurs au niveau nominal. En revanche, la
probabilit de ruine par croulement augmente rapidement quand le niveau d'agression dpasse le
nominal.
L'action sismique est considre comme accidentelle et les coefficients de scurit partiels adopts sont
ceux relatifs cette situation. Nanmoins, afin de rpondre aux objectifs fixs, on a cherch viter les
risques de rupture fragile au voisinage de l'acclration nominale en utilisant des coefficients de scurit
partiels complmentaires (par exemple pour l'effort tranchant et la contrainte de compression dans les
murs en bton arm), et on a pnalis les structures prsentant des irrgularits de nature augmenter le
risque de comportements mal matriss.
Enfin, comme dans les rgles PS 69/82, l'importance socio-conomique du btiment considr est prise
en compte par une modulation de l'acclration nominale. Cette disposition est d'ordre rglementaire, car
rendue obligatoire par l'arrt du 16 juillet 1992, paru le 6 aot 1992, pris en application du dcret du 14
mai 1991 relatif la prvention du risque sismique.
La prvention du risque sismique
Les rgles PS 92 visent amliorer de manire significative la prvention du risque sismique par rapport
aux Rgles PS 69/82 :
Elles apportent des lments trs complets et nouveaux concernant les fondations et les problmes
lis au sol : la prvention des risques de liqufaction des sols et d'instabilit des pentes, la prise en
compte des effets amplificateurs lis la topographie, des mthodes d'analyse de l'interaction
dynamique sol-structure, la dfinition de l'action des sols sur les niveaux enterrs des btiments. Les
diffrents types de fondations usuelles des btiments sont traits.
En ce qui concerne les dispositions constructives, elles concernent essentiellement les ossatures en
bton arm et les murs en maonnerie, et, par rapport aux Rgles PS 69/82, elles voluent dans le
sens d'une plus grande exigence, justifie par l'exprience acquise, et apportent des complments
indispensables pour traiter un plus grand nombre de cas.
Elles apportent une meilleure diffrenciation de la prise en compte de la ductilit en fonction des
matriaux et des types de structures : cette modulation apparat par le biais d'un coefficient de
comportement qui dpend du matriau, du type de contreventement, de la rgularit du btiment et,
dans certains cas, des dispositions constructives.
Les mthodes de calcul proposes, dont le niveau de simplification dpend de la rgularit du
btiment, imposent une modlisation plus fine dans le cas des btiments irrguliers, notamment pour
une meilleure prise en compte de la torsion.
Les diffrents types de constructions (bton, acier, etc.) sont traits de faon beaucoup plus
complte, tant du point de vue de leur conception gnrale que de leurs dispositions constructives.
Les constructions murs porteurs en bton arm, qui n'taient pas spcifiquement traites dans le
texte PS 69/82 malgr leur trs large usage en France, font l'objet de spcifications dtailles. De
mme, les constructions mtalliques et en bois font l'objet de traitements spcifiques.
Incidence sur les projets de construction
Les premires comparaisons effectues avec les Rgles PS 69/82, sur la base de niveaux sismiques
prsupposs, semblent montrer que les effets des actions de calcul diffrent peu pour les portiques en
bton arm, qu'elles augmentent sensiblement pour les murs en bton arm et en maonnerie, mais
qu'elles peuvent tre plus ou moins fortes pour les structures en charpente mtallique selon le type de
contreventement utilis.
De faon gnrale, les structures moins ductiles sont pnalises et, dans la trs grande majorit des cas,
les nouvelles valeurs de la rsistance requise sont suprieures celles obtenues par l'application des
Rgles PS 69/82.
Il apparat que les majorations d'actions les plus sensibles, auxquelles conduit l'application des nouvelles
rgles, concernent les constructions dont le contreventement est assur par des murs rigides en bton
(refends, pignons, cages...), parti constructif le plus couramment retenu pour les btiments principalement
d'habitation.
Perspectives d'volution
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 5 of 184
Nanmoins, la rdaction de ce texte et sa discussion ont bien montr qu'il subsistait des questions
techniques approfondir. Ainsi les prsentes spcifications sont susceptibles d'tre rvises ds que des
avances suffisamment significatives donneront matire les amliorer.
Dans cette perspective, le prsent texte apporte une contribution aux travaux du Comit Europen de
Normalisation (CEN) servant de base l'laboration de l'Eurocode 8.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 6 of 184
Prface
Le prsent document " PS 92 " nonce les rgles parasismiques de conception et de vrification de
projets de btiment en complment des rgles gnrales relatives aux diffrents types de construction : en
bton, en acier, en bois, en maonnerie, etc.
Ces rgles se substituent aux Rgles PS 69 compltes en 1982 par un addendum tir des leons du
sisme d'EL ASNAM de 1980. Depuis cette date, la plupart des membres de la commission de rvision
des Rgles PS 69, auxquels se sont joints d'autres experts, ont poursuivi leurs travaux pour tenir compte
des progrs du gnie parasismique et bnficier des leons des sismes rcents tels que ceux de
MEXICO (1985), SPITAK (Armnie - 1988), LOMA PRIETA (Californie - 1989).
Les progrs des connaissances en matire de construction parasismique ont fait apparatre que certains
des concepts retenus dans les Rgles PS 69, maintenant dpasss, devaient tre revus. Cela a fait
apparatre la ncessit de publier de nouvelles rgles, de manire apporter une amlioration sensible
la fiabilit des constructions.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 7 of 184
1 Objet, domaine d'application, conditions de validit
1.1 Objet
Les prsentes rgles ont pour objet, dans les rgions exposes des sismes, de proportionner la
rsistance des ouvrages aux secousses svres qu'ils sont susceptibles de subir, pour leur confrer un
comportement global satisfaisant en vue d'assurer la scurit des personnes. Elles visent aussi limiter
les dommages conomiques.
Les rgles dfinissent ainsi des prcautions qui compltent celles applicables en toutes rgions. Ces
rgles sont tablies sur la base de mouvements de sol forfaitaires, considrs comme descriptifs des
mouvements forts attendus dans les zones concernes et vis--vis desquels la rsistance doit tre
assure.
En ce qui concerne le bton arm, les btiments sont ceux relevant de la partie B des rgles BAEL . Les
constructions mtalliques concernes par les prsentes rgles sont celles relevant du DTU P 22-701 ou
de l' Eurocode 3 avec son Document d'Application National (D.A.N.).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 1.1
Ces rgles concernent les constructions neuves. Les dispositions constructives ne peuvent
s'appliquer in extenso aux btiments anciens. Elles doivent alors faire l'objet de justifications
spcifiques.
1.2 Rfrences normatives
Ce document comporte par rfrence date ou non date des dispositions d'autres publications. Ces
rfrences normatives sont cites aux endroits appropris dans le texte et les publications sont
numres ci-aprs. Pour les rfrences dates, les amendements ou rvisions ultrieurs de l'une
quelconque de ces publications ne s'appliquent ce document que s'ils y ont t incorpors par
amendement ou rvision. Pour les rfrences non dates, la dernire dition de la publication laquelle il
est fait rfrence s'applique.
NF P 06-001
Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des btiments (juin 1986).
DTU P 06-006
Rgles N 84 - Actions de la neige sur les constructions.
NF P 06-014
Rgles de construction parasismique - Construction parasismique des maisons individuelles et des
btiments assimils (Rgles PS-MI 89 rvises 92).
NF P 08-302
Murs extrieurs des btiments - Rsistance aux chocs - Mthode d'essais et critres.
DTU P 11-211
DTU 13.11 - Fondations superficielles.
NF P 10-202-1, 2 et 3
Parois et murs en maonnerie de petits lments (Rfrence DTU 20.1).
NF P 18-210
Murs en bton banch (Rfrence DTU 23.1).
NF P 22-460
Assemblages par boulons non prcontraints - Dispositions constructives et calcul des boulons (juin 1979).
DTU P 22-701
Rgles CM 66 - Rgles de calcul des constructions en acier.
NF P 28-001
Faades lgres - Dfinitions - Classifications - Terminologie (dcembre 1990).
NF P 68-202
Plafonds suspendus en lments de terre cuite (Rfrence DTU 25.231).
NF P 72-202-1, 2 et 3
Ouvrages verticaux de pltrerie ne ncessitant pas l'application d'un enduit en pltre - Excution des
cloisons en carreaux de pltre (Rfrence DTU 25.31).
1.3 Domaine d'application
Les prsentes rgles s'appliquent essentiellement aux systmes sol-structure rpondant principalement
par inertie un mouvement sismique impos leur base. Ne sont viss que les btiments pour lesquels
les consquences d'un sisme demeurent circonscrites leurs occupants et leur environnement
immdiat.
Sont exclus du domaine d'application des prsentes rgles : les ouvrages raliss l'aide de matriaux
structuraux ou de systmes non couverts par les documents normatifs en vigueur.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 1.3
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 8 of 184
Les btiments ainsi viss correspondent ceux de la catgorie dite risque normal, dfinie par le
dcret du 14 mai 1991 .
Les procds de construction non traditionnels relvent de la procdure de l'Avis Technique institu
par le ministre charg de l'Equipement et du logement et par le ministre charg du
Dveloppement Industriel et Scientifique. Les Avis Techniques dfinissent alors les conditions de
vrification et les spcifications complmentaires vises aux deuxime et troisime termes de
l'numration du paragraphe 1.4.
1.4 Contenu
Les prsentes rgles, en plus des rgles gnrales de conception et de calcul :
dfinissent, partir de choix effectus par la puissance publique, les actions sismiques de calcul
prendre en compte et les combinaisons d'actions correspondantes ;
prcisent les objectifs de comportement au regard de ces combinaisons, ainsi que les conditions
dans lesquelles doivent tre effectues les vrifications de scurit ;
dfinissent, le cas chant, les spcifications complmentaires auxquelles doivent satisfaire les
matriaux utiliss ainsi que les dispositions techniques adopter ; elles indiquent pour les diffrents
matriaux et types de structure les valeurs des divers coefficients intervenant dans les diffrentes
mthodes de calcul.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 9 of 184
2 Dtermination de la scurit
2.1 Actions et situations sismiques
Dans le prsent document, les actions sismiques sont considres comme des actions accidentelles.
En consquence, elles sont dfinies par des valeurs nominales et sont pondres dans les calculs par un
coefficient gal 1.
2.2 Objectifs de comportement
On attend des constructions difier en zone sismique qu'elles ne prsentent vis--vis des actions
sismiques de calcul qu'une probabilit raisonnablement faible d'effondrement ou de dsordres structuraux
majeurs, et que les dommages mineurs ou non structuraux y restent contenus dans des limites
acceptables.
En particulier, il est admis que les structures puissent subir, dans les limites imparties par les prsentes
rgles, des dformations se situant dans le domaine post-lastique.
L'obtention de cet objectif de comportement peut tre rendu plus probable par l'adoption d'une classe de
protection plus leve pour l'ouvrage considr (voir paragraphe 3.4 ci-aprs) qui doit alors figurer dans
les Documents Particuliers du March (D.P.M.).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 2.2
On se dfend d'agressions fortes de nature alatoire en dfinissant des cas de charge " accidentels
", ventuellement plusieurs niveaux avec des coefficients de scurit appropris, pour assurer
une progressivit de la rponse de la structure et viter ainsi des dsordres supplmentaires
importants pour un accroissement faible de l'agression. Dans le prsent texte on utilise pour
chaque construction un seul niveau typique d'agression. Bien entendu, la progressivit de la
rponse de la structure reste souhaitable, mais il n'a pas paru possible de traiter cet aspect de
manire simple par le calcul. Les dispositions constructives contenues dans les rgles vont dans le
sens de cette progressivit : certaines correspondent au respect d'tats limites de service pour des
agressions plus faibles.
Les prcautions dictes sont comparables celles d'autres rgles qui, dans le monde, ont montr
une grande efficacit lors de forts sismes, rduisant considrablement les dommages aux
personnes et aux biens. La probabilit accepte de dommage, aprs application des prsentes
rgles dans le contexte sismotectonique considr, ne peut pas tre actuellement explicite. On
doit accepter la possibilit de certaines ruines si survenaient des mouvements sismiques
extrmement forts pour un tel contexte, et trs peu probables, mais auxquels il ne parat pas
possible de poser des limites absolues. Les prcautions dictes assureraient au moins, en un tel
cas, une grande limitation des dommages. Elles sont modules (voir article 3 ) selon l'importance
socio-conomique des btiments.
Le niveau de ces prcautions, imposes par la puissance publique, correspond ainsi un arbitrage
de fait entre le risque relatif l'ouvrage, du point de vue de la scurit publique et de la
prservation du potentiel conomique, et les dpenses mises la charge de la collectivit nationale
pour la protection parasismique.
Le Matre d'Ouvrage peut imposer un niveau plus lev de prcautions par la voie des Documents
Particuliers du March (D.P.M.).
L'acceptation de dformation du domaine post-lastique rpond des considrations d'ordre
conomique, et parfois des impratifs de faisabilit.
2.3 Vrifications de scurit
2.3.1 Actions de calcul
En vue des vrifications de scurit, il est dfini :
des actions d'ensemble s'exerant sur la structure considre dans son ensemble ;
des actions locales s'exerant sur certains lments de la structure, certains lments non
structuraux ou certains quipements.
Ces actions sont considrer indpendamment les unes des autres. Elles entrent dans les vrifications
sous la forme des combinaisons de calcul.
2.3.2 Etats limites ultimes
Il doit tre vrifi que sous l'effet des combinaisons des actions de calcul aux tats limites ultimes, aucun
tat d'quilibre libre d'ensemble, de rsistance ou de stabilit de forme n'est dpass dans la structure,
ses composants ou sa fondation. L'action sismique doit tre considre comme une action accidentelle vis
--vis des tats limites ultimes.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 10 of 184
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 2.3.2
Dans une structure comportant des lments linaires, on appelle rotule plastique une zone dans
laquelle, sous l'effet des forces sismiques, apparat une concentration de courbure avec
dpassement des limites lastiques des matriaux et affaiblissement de la rigidit. La dtrioration
progressive dpend du nombre et de l'ampleur des dformations forces et peut tre limite par
des dispositions constructives comportant en particulier, pour le bton arm, le confinement du
bton comprim. Les zones o une rotule est susceptible de se produire est dnomme zone
critique.
2.3.3 Etats limites de dformation
Il doit tre vrifi que, sous l'effet des actions d'ensemble, les dformations de la structure n'excdent pas
les maximums fixs dans le prsent document.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 2.3.3
Ces limitations rpondent plusieurs fins :
maintenir la structure dans le domaine d'volution de ses proprits, domaine tel qu'il a t
pris en compte pour le calcul ;
contenir les dommages non structuraux dans les limites acceptables ;
assurer un certain contrle de la structure vis--vis des tats limites de service.
2.3.4 Scurit des lments non structuraux
Il doit tre justifi que les lments non structuraux dont le comportement peut prsenter un danger grave
pour la scurit des personnes, ainsi que leurs fixations, sont aptes supporter les actions locales
mentionnes dans le paragraphe 2.31 .
Pour les lments les plus couramment rencontrs dans la pratique, on peut se dispenser de la
vrification explicite de cette condition si les rgles techniques ou dimensionnelles dfinies leur sujet
sont respectes.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 11 of 184
3 Niveau minimal rglementaire de protection - valeurs de a N
Le niveau de l'agression prendre en compte dans l'tablissement d'un projet est conventionnellement
spcifi au moyen d'un paramtre unique a N (acclration nominale).
Le niveau minimal de protection exig pour les divers ouvrages est fix par la puissance publique.
Pour l'application des prsentes rgles la catgorie d'ouvrages dite risque normal :
le territoire national est divis en zones de sismicit ;
les ouvrages sont rpartis en classes de risque.
NOTE SUR L'ARTICLE 3
L'acclration nominale, calant un spectre dfini, reprsente mieux la svrit d'une agression
sismique que l'acclration maximale autrefois propose. Cette svrit, relie l'intensit
macrosismique, dpend de la forme du spectre (voir 5.2.3 ), c'est--dire de la nature du sol du site.
Pour un mme spectre et la mme acclration nominale, cette svrit dpendrait encore de la
dure des mouvements, que les mthodes de calcul ne prennent gnralement pas en compte. Si
la dure estime est spcialement importante, le Matre d'Ouvrage peut imposer des conditions
plus svres par la voie des Documents Particuliers du March (D.P.M.).
3.1 Zones de sismicit
Le territoire national est divis, par voie de dcret, en zones de sismicit croissante.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 3.1
A la date de publication des rgles, il existe quatre zones : zone 0, zone I, zone II et zone III.
La zone I est subdivise en zone la et zone Ib.
3.2 Classes de protection des ouvrages
Les ouvrages sont rpartis en classes de risque par voie d'arrt.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 3.2
A la date de publication des rgles, il existe quatre classes de risque, A, B, C et D. La rpartition
des ouvrages entre ces classes est rappele l'annexe B. La classe de protection est
habituellement gale la classe de risque mais tout Matre d'Ouvrage peut imposer un niveau de
protection plus lev par la voie des D.P.M.
3.3 Valeurs de a N
En fonction des zones de sismicit et des classes de risque, les valeurs de a
d'arrt.
sont fixes par voie
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 3.3
Il n'existe qu'une trs mauvaise corrlation entre l'intensit macrosismique et l'acclration
maximale d'un point du sol au cours de la secousse (ou tout autre paramtre du mme genre).
Pour une acclration nominale donne, l'agressivit, en relation avec l'intensit macrosismique,
dpend de la forme du spectre normalis associ, c'est--dire de la nature du sol du site
(paragraphe 5.2.2 ). Pour le mme spectre et les mmes niveaux d'acclration, l'agressivit d'un
sisme rel dpend encore de la dure des mouvements, ceci est pris en compte de manire
simplifie au stade du choix de a N .
Les valeurs des acclrations nominales a N sont fixes par l' Arrt du 29/05/1997 .
3.4 Surclassement des ouvrages
Pour satisfaire des situations particulires de risque, un surclassement des ouvrages peut tre envisag.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 3.4
La classe de protection qui est retenue doit alors tre stipule dans les Documents Particuliers du
March.
Le surclassement est fix par voie d'arrt de faon gnrale, pour des cas particuliers, par les
Commissions charges de l'application des rgles de scurit.
A la date de publication des prsentes rgles, un surclassement est prvu dans les cas suivants :
pour un btiment, dont diverses parties relvent de classes diffrentes, son classement doit
tre effectu pour son ensemble dans la classe la plus contraignante ;
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 12 of 184
l'ouvrage dont la dfaillance peut compromettre la scurit d'un ouvrage voisin est ranger
dans la classe de l'ouvrage voisin si elle est plus svre, sauf si les largeurs des sparations
sont suffisantes.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 13 of 184
4 Rgles gnrales de conception
4.1 Choix du site
4.1.1 Voisinage des failles
Sauf ncessit absolue, aucun ouvrage ne doit tre difi au voisinage immdiat d'une faille dont les
ruptures de surface potentielles sont reconnues dangereuses par les PPR. Il appartient ces plans de
dfinir les bandes neutraliser et, le cas chant, des bandes dans lesquelles il convient de prendre en
compte un mouvement de calcul plus svre.
NOTE :
Les DPM fixent la conception et les dispositions constructives adquates
4.1.2 Zones suspectes de liqufaction
Les couches de sol prsentant les caractristiques dcrites dans le paragraphe 9.1.2 doivent tre a priori
considres comme susceptibles de donner lieu des phnomnes de liqufaction.
L'valuation du risque de liqufaction doit tre faite suivant les dispositions des paragraphes 9.1.2 9.1.5 ;
les mesures prendre lorsque la scurit apparat insuffisante vis--vis de ce risque sont prcises au
paragraphe 9.1.6 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 4.1.2
Les plans d'exposition aux risques ou les cartes de microzonage, lorsqu'ils existent, mentionnent
les zones liqufiables de quelque tendue. Ces indications ne peuvent cependant pas tre tenues
pour exhaustives, des formations liqufiables de faible tendue pouvant avoir chapp aux
investigations grande chelle sur lesquelles sont bass ces documents. Inversement, la prsence
d'une zone liqufiable n'implique pas ncessairement l'abandon du site. La hauteur de la zone
liqufiable, sa position par rapport la surface libre du sol et par rapport la fondation, et surtout le
type de structure et le mode de fondation sont les lments les plus importants de la dcision.
La nature et les modalits des reconnaissances effectuer et des justifications produire sont
dfinies dans le paragraphe 9.1 .
4.2 Reconnaissances et tudes de sol
Les reconnaissances et tudes de sol sont en principe conduites de la mme manire que dans le cas
des situations non sismiques.
Elles doivent cependant tre suffisamment dtailles pour permettre :
le classement du site par rapport aux sites types dcrits dans le paragraphe 5.2.2 ;
la dtection des formations a priori suspectes de se liqufier sous l'action sismique de calcul ;
l'utilisation d'une mthode de calcul impliquant la prise en compte des proprits dynamiques du sol
lorsque les mthodes des paragraphes 9.4.2 et 9.7 sont envisages.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 4.2
Le tableau de la note sur le paragraphe 5.2.1 fait apparatre une liste de paramtres dont la
connaissance peut aider asseoir le classement du site sur une base rationnelle.
4.3 Fondations
4.3.1 Homognit du systme de fondations
La fondation d'un ouvrage doit constituer un systme homogne, moins que cet ouvrage ne soit
fractionn en units spares par des joints. Dans ce cas, le mode de fondation adopt peut varier d'une
unit l'autre, mais doit rester homogne dans chacune d'elles.
Lorsque le sol prsente des discontinuits telles que contacts de formations gologiques de proprits
gotechniques trs diffrentes, fractures, brusques changements de pente, l'ouvrage tout entier doit tre
implant d'un mme ct de la discontinuit, ou scind en units distinctes de manire que chaque unit
soit implante d'un mme ct de la discontinuit et fond de faon homogne.
4.3.2 Choix du systme de fondation
Le choix du systme de fondation est, en principe, effectu dans les mmes conditions qu'en situation non
sismique, compte tenu de la condition suivante :
Des diffrences de niveaux d'assise peuvent tre tolres pour autant que la pente gnrale n'excde pas
la moiti de celle normalement admissible, sauf justifications particulires.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 14 of 184
4.3.3 Solidarisation des points d'appui
a. Les points d'appui d'un mme bloc de construction doivent tre en rgle gnrale solidariss par un
rseau bidimensionnel de longrines (ou tout autre systme quivalent) tendant s'opposer leur
dplacement relatif dans le plan horizontal.
b. On peut se dispenser de raliser cette solidarisation la condition que les effets des dplacements
diffrentiels soient pris en compte dans les calculs.
c. Aucune prcaution particulire n'est exige dans le cas de semelles convenablement engraves
dans un sol rocheux ou de consistance rocheuse, non fractur et non dlit.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 4.3.3
Un dallage en bton arm et bien conu cet effet peut jouer le rle de solidarisation des points
d'appui.
4.3.4 Liaisonnement avec la structure
Dans le cas des fondations profondes (puits, pieux, barrettes), il doit tre tabli entre la structure et ses
fondations une liaison tendant s'opposer leurs dplacements relatifs, sauf justifications particulires
relatives la transmission des efforts.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 4.3.4
Cette prescription ne s'applique pas au cas des structures reposant sur des appuis spciaux
(appuis en lastomre ou autres) disposs en vue de permettre le dplacement de la structure par
rapport sa fondation.
4.4 Structures
4.4.1 Ductilit
Les divers lments structuraux doivent prsenter une ductilit suffisante pour conserver leur rsistance
de calcul sous les dformations qu'ils sont exposs subir au cours du mouvement sismique.
A dfaut d'autres justifications, cette condition est rpute satisfaite si, l'ouvrage tant calcul
conformment aux prsentes rgles, les dispositions techniques dfinies dans le prsent document pour
les diffrents matriaux sont respectes.
4.4.2 Monolithisme
Les structures doivent tre conues de manire constituer des ensembles aussi monolithiques que
possible.
En particulier, on ne doit pas diminuer sans ncessit l'hyperstaticit d'un systme. Lorsque, du fait de la
nature d'un ouvrage ou des ncessits de son exploitation, il est introduit des liaisons isostatiques, toutes
dispositions doivent tre prises pour viter la formation d'un mcanisme, avec une forte prdominance
d'articulations, qui mettrait en cause la stabilit d'ensemble de la structure.
Lorsqu'il est recouru l'utilisation d'lments prfabriqus ou prassembls, les assemblages doivent tre
raliss de faon telle que, dans son tat final, la construction prsente le mme degr de monolithisme
que la construction conventionnelle de mme forme et de mmes dimensions. A dfaut, on applique les
prescriptions de l' article 16 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 4.4.2
Il est important que les jonctions des lments prfabriqus, entre eux ou vis--vis du reste de la
structure, ne constituent pas des zones de fragilit.
4.4.3 Position des zones critiques
Les zones critiques, dans lesquelles sont susceptibles d'apparatre des rotules plastiques, doivent tre
identifies et traites conformment aux prsentes rgles, pour aboutir une possibilit de dformation
post-lastique apprciable avant perte de rsistance importante et rupture. Toutes dispositions doivent
tre prises pour que la formation de rotules les plastiques, si elle est ncessaire, se produise en dehors
des noeuds et avant la rupture de l'assemblage des lments linaires.
On doit vrifier qu'il n'apparat pas d'instabilit des lments ou de l'ensemble.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 4.4.3
Dans une structure comportant des lments linaires, on appelle rotule plastique une zone dans
laquelle, sous l'effet des forces sismiques, apparat une concentration de courbure avec
dpassement des limites lastiques des matriaux et affaiblissement de la rigidit. La dtrioration
progressive dpend du nombre et de l'ampleur des dformations forces et peut tre limite par
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 15 of 184
des dispositions constructives comportant en particulier, pour le bton arm, le confinement du
bton comprim. La zone o une rotule est susceptible de se produire est dnomme zone critique.
En particulier, on doit veiller viter la ruine des noeuds avant l'puisement de la rsistance et de
la ductilit des lments de type poutre (ventuellement de type poteau) aboutissant ces noeuds.
L'objet de la clause 4.4.3 est illustr par les figures a), b), et c) ci-aprs :
Figure 1 Emplacement des zones critiques
La configuration a) qui correspondrait des poteaux trs insuffisants est proscrire.
La configuration b), correspondant la formation de rotules plastiques dans les lments porteurs,
est viter grce des dispositions de " dimensionnement en capacit " (donner aux poteaux une
raideur telle que les rotules plastiques ne puissent se produire que dans les lments horizontaux,
poutres, linteaux ou dalles, et dans les lments inclins). On peut admettre dans des poteaux
l'apparition de rotules plastiques, moyennant une justification montrant que, malgr l'affaiblissement
des raideurs de zones critiques, une limite d'instabilit n'est pas atteinte.
En outre, et autant que possible, toutes dispositions doivent tre prises pour que la formation de
rotules plastiques dans les lments porteurs verticaux ne puisse pas prcder la formation de
rotules dans les lments horizontaux (poutres horizontales, linteaux, traverses inclines).
4.4.4 Espacement entre blocs ou ouvrages voisins
4.4.4.1 Principe
Les joints de sparation (joints de dilatation, joints de rupture) doivent assurer l'indpendance complte
des blocs qu'ils dlimitent.
En rgle gnrale, et en dehors du cas des joints de rupture imposs par les contacts de formation de
proprits gotechniques trs diffrentes ( voir 4.3.1 ), il n'est pas ncessaire de les poursuivre en
fondation.
4.4.4.2 ralisation
Les joints doivent tre soigneusement dbarrasss de tout matriau et tre protgs durablement contre
l'introduction de corps trangers susceptibles d'en altrer le fonctionnement.
Les couvre-joints, les matriaux d'obturation ou d'tanchit ne doivent pas pouvoir transmettre d'effort
notable d'un bloc l'autre.
4.4.4.3 largeur
La largeur des joints doit tre telle que les blocs qu'ils sparent ne puissent entrer en contact au cours de
leur mouvement. Elle ne peut tre infrieure 4 cm en zones la et Ib, et 6 cm en zones II et III.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 16 of 184
5 Dfinition du sisme de calcul
Il s'agit d'une dfinition conventionnelle utilise pour le calcul des ouvrages, dduite du mouvement du sol.
5.1 Modlisation du mouvement du sol
Le mouvement du sol dans l'emprise d'un ouvrage est considr dans les prsentes rgles comme
rsultant de la composition :
d'un mouvement de translation d'ensemble, dans lequel tous les points du sol sont anims tout
instant du mme mouvement ;
et de mouvements diffrentiels, fonctions de la distance sparant les points considrs.
Le mouvement de translation est dfini par trois composantes : deux composantes horizontales
orthogonales et la composante verticale.
Chaque composante du mouvement est caractrise par un spectre de rponse en termes d'acclration
et donn en annexe A et dont drivent les spectres de dimensionnement dfinis au paragraphe 5.2.3 .
On utilise le mme spectre pour les deux composantes horizontales du mouvement.
La composante verticale est, sauf spcification contraire, considre comme d'intensit gale 70 % de
celle des composantes horizontales.
Les dplacements diffrentiels doivent tre considrs dans les trois directions principales ; dans une
direction donne, ils sont valus partir du dplacement maximal du sol dans cette direction.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 5.1
Les spectres considrs ne sont pas des spectres lastiques dduits directement des mouvements
du sol, mais des spectres conventionnels de dimensionnement, directement utilisables par les
mthodes pseudo-dynamiques simplifies. Les spectres lastiques de base sont fournis en annexe
A.
5.2 Dfinition de l'action sismique
Le mouvement sismique de calcul est dfini par les paramtres suivants :
l'acclration nominale a N dj dfinie au paragraphe 3.3 ;
l'ordonne du spectre de dimensionnement normalis dpendant des formations gologiques du site
( voir figure 2 ) et de la priode T, appele R D (T) ;
un coefficient li la topographie ;
un coefficient correctif d'amortissement p.
On dsigne par la suite le produit de ces paramtres par R(T) = a N R D (T)
La dfinition des spectres de dimensionnement normaliss repose sur les classifications des paragraphes
5.2.1 et 5.2.2 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 5.2
Figure 2 Site gologique
5.2.1 Classification des sols
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 17 of 184
En vue de la dfinition des sites-types, les sols sont classs en quatre catgories, en fonction de leurs
proprits mcaniques, comme indiqu ci-aprs :
rocher sain ;
catgorie a : sols de rsistance bonne trs bonne (par exemple sables et graviers compacts,
marnes ou argiles raides fortement consolides) ;
catgorie b : sols de rsistance moyenne (par exemple roches altres, sables et graviers
moyennement compacts, marnes ou argiles de raideur moyenne) ;
catgorie c : sols de faible rsistance (par exemple sables ou graviers lches, argiles molles, craies
altres, vases).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 5.2.1
La connaissance d'un ou de plusieurs des paramtres figurant dans le tableau ci-dessous permet
d'asseoir le classement sur une base objective :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 18 of 184
Tableau 2 Paramtres d'identification des sols
5.2.2 Classification des sites
Il est considr quatre types de sites correspondant aux descriptions suivantes :
Sites S0
sites rocheux (site de rfrence)
sols du catgorie a en paisseur infrieure 15 m
Sites S1
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 19 of 184
sols du catgorie a en paisseur suprieure 15 m
sols du catgorie b en paisseur infrieure 15 m
Sites S2
sols du catgorie b en paisseur comprise entre 15 m et 50 m
sols du catgorie c en paisseur infrieure 10 m
Sites S3
sols du catgorie b en paisseur suprieure 50 m
sols du catgorie c en paisseur comprise entre 10 m et 100 m
Dans le cas de sites comportant des sols du catgorie c en paisseur suprieure 100 m, il convient de
procder une tude particulire en vue de la dtermination d'un spectre spcifique.
Ces descriptions supposent que les sols en cause sont disposs en formations peu prs rgulires.
Dans le cas de formations irrgulires ou lenticulaires, ou en cas d'ambigut, il convient de procder
l'assimilation qui, compte tenu de la forme des spectres ci-dessous et des priodes propres de la
structure, conduit au degr de conservatisme immdiatement suprieur.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 5.2.2
Les profils de sol sont reprsents schmatiquement ci-dessous :
Figure 3 Classification des sites
L'attention est attire sur le fait qu'un spectre peut tre plus dfavorable qu'un autre dans une
certaine bande de priodes et plus favorable dans une autre bande.
5.2.3 Spectres de dimensionnement normaliss
5.2.3.1 Gnralits
Les spectres de dimensionnement normaliss sont donns pour la valeur 5 % de l'amortissement relatif et
sont rapports la valeur unit de l'acclration nominale.
Leur forme est reprsente dans la figure 4 ci-contre. Elle rpond la dfinition analytique suivante :
Branche A'C : R D (T) = R M
Branche CD' : R D (T) = R M [T C / T] 2/3
Branche D'E' : R D (T) = R M [T C / T D ] 2/3 [T D / T] 5/3
Le paramtre R M et les ordonnes R D (T) sont des nombres sans dimension.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 5.2.3.1
Les spectres de dimensionnement drivent des spectres lastiques normaliss dfinis dans l'
annexe A par le remplacement de la branche ascendante AB de ces derniers par un palier
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 20 of 184
horizontal prolongeant le palier BC et par un relvement des ordonnes des branches
descendantes :
Figure 4 Spectres de dimensionnement normaliss
Pour la simplicit, on ne proportionne pas ces relvements au coefficient " q " choisi (voir
paragraphe 6.3.2 et note sur le paragraphe 6.3.2 ). Dans le cas o q = 1, on garde le spectre de
dimensionnement indiqu.
Ces modifications sont destines permettre une prise en compte approximative et globale de
comportements lastoplastiques rpartis dans la structure. Lorsque ces effets sont pris en compte
plus directement dans la modlisation, il convient de revenir aux spectres lastiques normaliss et
d'abandonner l'usage du coefficient de comportement global.
5.2.3.2 Composantes horizontales
Les valeurs T B , T C et T D exprimes en secondes, et celle de R
par le tableau ci-dessous :
sont donnes pour chaque type de site
Tableau 3 Spectres de dimensionnement - Valeurs de T B ,
T C , T D normal et R M
Les quations analytiques des branches de ces spectres sont donnes pour chaque type de site au
tableau 4.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 21 of 184
Tableau 4 Equations analytiques de spectres de
dimensionnement normalises
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 5.2.3.2
Figure 5 Composantes horizontales
5.2.3.3 Composante verticale
Le spectre de la composante verticale est considr comme identique au spectre de la composante
horizontale si l'on se trouve sur les sites S0 ou S1 ; dans les autres cas, les branches descendantes du
spectre sont remplaces par celles du spectre correspondant au site S1.
On effectue ensuite une affinit de rapport 0,7 comme prcis au paragraphe 5.1 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 5.2.3.3
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 22 of 184
Figure 6 Composante verticale
5.2.3.4 Correction d'amortissement
Les spectres de dimensionnement utiliser pour des valeurs de l'amortissement relatif diffrentes de 5 %
(voir paragraphe 6.2.3.4 ) sont obtenus en multipliant les ordonnes des spectres normaliss ci-dessus
par le facteur :
avec l'amortissement relatif diffrent de 5 %.
Hormis l'utilisation de dispositifs mcaniques, la correction est limite 2 % 30 %.
5.2.4 Coefficient d'amplification topographique
Il est tenu compte d'un coefficient multiplicateur dit d'amplification topographique, pour les ouvrages
situs en rebord de crte.
Si l'on considre une arte C ( voir figure 7 ) dlimitant un versant aval de pente I (tangente de l'angle de
pente) et un versant amont de pente i, et si :
H 10 m (H tant la hauteur de l'arte au-dessus de la base du relief)
i 1/3
Le coefficient :
prend la valeur :
= 1 pour l - i 0,40
= 1 + 0,8 (I - i - 0,4) pour 0,40 I - i 0,90
= 1,40 pour I - i > 0,90
I et i sont pris en valeur algbrique
Sur le tronon CB du versant amont dfini par la longueur b de sa projection horizontale (exprime
en mtres) :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 23 of 184
fait l'objet d'un raccordement linaire entre les valeurs 1 et le long des deux tronons AC et BD, de
longueur :
a = AC = H/3
c = BD = H/4
prend la valeur 1 l'aval du point A et l'amont du point D.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 5.2.4
La dtermination de H laisse une certaine part l'apprciation. A titre indicatif, on peut considrer
comme base du relief le point au-dessous duquel la pente gnrale du site redevient infrieure
0,4. Pour la stabilit des pentes, voir le paragraphe 9.2 .
Figure 7 Variation du coefficient multiplicateur suivant
la topographie du site
5.3 Dplacement du sol
5.3.1 Dplacement absolu
On dsigne par D M le dplacement maximum subi par un point du sol au cours du mouvement sismique
pour une acclration unit. Les valeurs de D M sont donnes dans le tableau 5 .
5.3.2 Dplacement diffrentiel
En l'absence de discontinuit mcanique ou topographique accuse, la valeur maximale du dplacement
diffrentiel dans une direction donne entre deux points distants de la longueur X horizontale est donne
par :
Dans ces expressions,
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 24 of 184
a N reprsente l'acclration nominale exprime en m/s (valeurs du tableau 1).
D M , le dplacement maximum subi par un point du sol au cours du mouvement sismique,
L M , la distance horizontale au-del de laquelle les mouvements de deux points peuvent tre considrs
comme indpendants ;
est le coefficient de topographie dfini dans le paragraphe 5.2.4 .
Les valeurs de et L M sont donnes, pour les quatre sites-types, par le tableau 5 ci-dessous.
Tableau 5 Dplacement diffrentiel
Dans le cas o les deux points sont situs de part et d'autre d'une discontinuit mcanique ou
topographique accuse, la valeur de d est majorer de 50 %.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 5.3.2
Par discontinuit mcanique, on entend le contact de deux formations gologiques de proprits
trs diffrentes (par exemple contact de formations rocheuses et sdimentaires ; de formations
stratifies horizontalement et de couches prsentant un pendage accus) ou encore les failles
reconnues inactives.
Par discontinuit topographique, on entend les dpressions naturelles (thalwegs, etc.) ou
artificielles (tranches, etc.) de profondeur suprieure 5 m.
Dans le cas de thalwegs ou de tranches, cette majoration s'entend pour des profondeurs
suprieures 10 m.
Pour des profondeurs comprises entre 5 m et 10 m, il peut tre procd une interpolation linaire.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 25 of 184
6 Actions sismiques d'ensemble
NOTE SUR L'ARTICLE 6
Cet article concerne les actions envisager pour la vrification de la structure dans son ensemble
(voir paragraphe 2.3.1 ). Les actions locales considrer pour la justification de la rsistance ou de
la stabilit de certains lments d'ouvrage ou quipements figurent dans l'article 7.
Dans ce qui suit, le terme " action sismique " s'entend comme le systme de dformations ou de
forces impos au btiment par le mouvement sismique, tel que calcul selon les prsentes rgles.
Le terme " sollicitation " dsigne les lments de rduction en un point d'une section du systme
des forces agissant sur cette section (effort normal, effort tranchant, moments de flexion et de
torsion).
L'attention est attire sur le fait que, de mme que les sollicitations, les actions sismiques sont des
systmes vectoriels dont les composantes sont susceptibles de varier indpendamment les unes
des autres et pour lesquels, par consquent, la notion de maximum est en gnral dnue de sens.
Elle est remplace parcelle d'action la plus dfavorable (sous-entendu : " pour la section tudie "),
c'est--dire celle qui dveloppe dans la section en cause la sollicitation la plus dfavorable.
La notion de maximum conserve cependant un sens, et reste en consquence utilise, lorsqu'on a
affaire des systmes de vecteurs variant de faon proportionnelle (cas des modes principaux de
vibration considrs isolment) ou lorsqu'on ne s'intresse qu' un seul vecteur de direction
dtermine (par exemple : valeur maximale du dplacement d'un point, d'une force, d'une
composante d'une sollicitation).
6.1 Modlisation du mouvement sismique et nature des actions considrer
6.1.1 Orientation du mouvement sismique
Les composantes horizontales du mouvement de calcul doivent tre orientes suivant les axes principaux
de l'ouvrage.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.1.1
Par axe principal d'un ouvrage, on entend la direction dans laquelle ce dernier prsente un
maximum ou un minimum de rigidit.
6.1.2 Nature des actions sismiques
Dans le modle de mouvement sismique dfini l' article 5 , l'action sismique s'exerant sur un ouvrage
peut tre considre comme compose :
a. des forces d'origine dynamique induites dans la structure par le mouvement de translation
d'ensemble du sol du fait de l'inertie des masses qui la composent, lui sont lies, ou s'appuient sur
elle ;
b. des dplacements directement imposs l'ouvrage ou sa fondation par les mouvements
diffrentiels, ces dplacements tant considrs comme appliqus de faon statique ;
c. des forces dveloppes par les oscillations de torsion d'axe vertical induites par les mouvements
diffrentiels horizontaux ;
d. le cas chant, des surpressions dynamiques exerces sur l'ouvrage par les terres et l'eau
ventuellement retenues par ce dernier ou par les matires solides ou liquides qu'il contient.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.1.2
Dans le modle de mouvement sismique considr dans ce paragraphe, les effets dynamiques des
mouvements diffrentiels autres que ceux dfinis en c) sont ngligs.
Il est rappel que dans le cas o il est procd un calcul linaire ou un calcul linaire quivalent
du type dfini en 6.3.2 , les effets de chaque composante peuvent tre valus sparment puis
combins suivant les rgles du paragraphe 6.4 . Les sollicitations dues aux systmes b) et c) et
ventuellement au systme d) sont combines au rsultat prcdent.
6.1.3 Coefficient sismique
Lorsque les composantes de l'action sismique sont exprimes en termes de forces, ces forces peuvent
elles-mmes tre exprimes au moyen d'un coefficient sismique dfini comme le rapport de leur
intensit celle du poids mg de la masse m laquelle elles s'appliquent.
6.2 Modlisation des structures
6.2.1 Masses prendre en compte dans les calculs
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 26 of 184
Les masses faire entrer en ligne de compte pour la dtermination des actions sismiques sont celles des
charges permanentes et d'une fraction des charges d'exploitation et de la charge de neige entrant dans
les rgles de combinaisons d'actions donnes au paragraphe 8.1 .
Cette fraction est donne par le coefficient ci-dessous dit " coefficient de masse partielle " en fonction de
la nature des charges et leur dure. En ce qui concerne les charges d'exploitation, il n'y a pas lieu d'oprer
la dgression verticale ni la dgression horizontale prvue par la norme P 06-001 .
1. Btiment d'habitation ou d'hbergement, bureaux et assimils : = 0,20
2. Halles divers, salles d'exposition, et autres locaux destins principalement au transit des personnes Salles de runions, lieux de culte, salles et tribunes de sport, salles de danse et tout autre lieu avec
places debout et utilisation priodique : = 0,25
3.
4.
5.
6.
Salles de classe, restaurants, dortoirs, salles de runions avec places assises : = 0,40
Archives, entrepts : = 0,80
Autres locaux non viss en 0) - 1) - 2) et 3) : = 0,65
Dans le cas des btiments industriels :
catgorie a 1 : = 1
catgorie a 2 : = 0
catgorie a 3 : = 0,65
7. Dans le cas de chemins de roulement :
pour la masse propre du pont roulant ...... = 1
pour la masse suspendue au pont roulant dans les directions horizontales ... = 0
pour la masse suspendue au pont roulant dans la direction verticale, et dfaut d'indication
contraire par les DPM sur les taux de chargement et d'utilisation ............................. = 0,2
En ce qui concerne la charge de neige (dont la valeur est spcifie en fonction de l'altitude, jusqu' 2 000
m, dans les Rgles N84 - paragraphe 3.2 ), la valeur de est la suivante :
pour une altitude infrieure ou gale 500 m : = 0
pour une altitude suprieure 500 m : = 0,30
La charge due la prsence de personnes sur une terrasse accessible n'est pas cumuler avec la charge
de neige.
Le coefficient applicable une certaine action doit tre pris gal 0 lorsque cette ventualit est plus
dfavorable pour la rsistance ou l'quilibre de l'lment tudi.
Les coefficients applicables aux charges d'exploitation pour le calcul des actions locales sont gaux
1,0.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.2.1
Il est rappel que les valeurs des charges d'exploitation et de la surcharge de neige, dans le cas
des situations accidentelles de type sismique, ont le sens de valeurs caractristiques ou nominales,
telles qu'elles sont dfinies dans la norme NF P 06-001 pour les charges d'exploitation des
btiments et dans le DTU P 06-006, Rgles N84 pour la neige. Par ailleurs, l'introduction du
coefficient offre l'intrt de n'avoir considrer qu'une modlisation unique des masses pour
l'analyse de la structure.
NOTE SUR 5) DU PARAGRAPHE 6.2.1
La norme P 06-001 dfinit les catgories des btiments industriels.
6.2.2 Discrtisation des masses
Les structures, les sols, ou les systmes sols-structures, et les charges supportes, peuvent tre
dcomposes en un certain nombre de solides lmentaires possdant chacun au regard du problme
tudi, le caractre de solide indformable, et soumis des liaisons appropries.
Chacun de ces solides peut lui-mme tre remplac par un lment matriel quasi ponctuel, de mme
centre de gravit que le solide, de mmes proprits d'inertie que ce dernier (masse, moments et produits
d'inertie) et dot de degrs de libert appropris (translations et rotations).
La dcomposition du systme et le choix des degrs de libert doivent permettre la mise en vidence des
dformations ventuellement prjudiciables la scurit de l'ouvrage et permettre en particulier
l'identification des zones pouvant donner lieu des concentrations de dformations ou des dformations
post-lastiques importantes.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.2.2
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 27 of 184
La discrtisation en solides d'tendue non ngligeable implique, en rgle gnrale, l'introduction de
degrs de libert de rotation et celle d'inerties de rotation. Dans la rduction en lments quasi
ponctuels, il convient de ne pas omettre les couples rsultant du transfert des forces au centre de
gravit. Les rotations peuvent tre ngliges si la discrtisation est suffisamment fine pour qu'onpuisse considrer que leurs effets sont convenablement simuls par les translations des masses
lmentaires. Elles peuvent galement tre ngliges s'il apparat que ces rotations sont a priori
ngligeables.
Le choix du modle est pour une large part affaire de jugement. Le modle doit faire apparatre les
couplages significatifs entre degrs de libert de directions diffrentes. Les meilleurs modles sont
ceux qui rendent compte de l'essentiel sans superflu ; en particulier, l'apparition au niveau des
rsultats de modes infrieurs n'apportant qu'une contribution ngligeable la rponse, est souvent
l'indice d'une modlisation inutilement sophistique.
6.2.3 Liaisons
6.2.3.1 Nature
Les liaisons entre les diffrentes masses sont ralises par des lments des structures comportement
linaire lastique.
Les liaisons non linaires peuvent toutefois tre envisages sur justifications particulires.
6.2.3.2 rigidits
1. Le modle doit prendre en compte l'ensemble des lments structuraux ou non, susceptibles
d'apporter une contribution sensible la rigidit de la structure, mme s'ils sont ngligs dans les
calculs de rsistance.
2. Les valeurs des modules d'lasticit ou autres paramtres introduire dans les modles linaires
pour les divers matriaux sont les valeurs moyennes des rgles de calcul de ces matriaux.
3. Les caractristiques mcaniques d'une section droite d'un lment en bton sont calcules partir
de son coffrage.
NOTE SUR 1) DU PARAGRAPHE 6.2.3.2
Cette rgle prend toute son importance, notamment dans le cas d'ossatures en portiques dont le
fonctionnement peut tre plus ou moins brid par la prsence de maonnerie de remplissage.
Les rigidits sont prises en compte pour la dtermination des priodes propres (voir 6.2.4) donc des
actions sismiques en fonction du spectre, et pour celle des dformes modales. L'adoption de
rigidits relativement leves, avec prise en compte de la rigidit totale des remplissages et en
section non fissure du bton, tend ainsi majorer les actions et les sollicitations par rapport la
situation relle, mais ceci est cohrent avec la dfinition des coefficients de comportement et il
importe de ne pas prendre en compte les assouplissements rels.
NOTE SUR 2) DU PARAGRAPHE 6.2.3.2
Le terme valeur moyenne s'entend ici au sens statistique (par opposition valeur caractristique
par exemple).
NOTE SUR 3) DU PARAGRAPHE 6.2.3.2
Pour les lments en bton, les caractristiques mcaniques des sections doivent donc tre
calcules partir des coffrages, sans tenir compte ni du coffrage ni de la fissuration, ni de la
section des armatures.
6.2.3.3 liaisons avec le sol et hauteur de dimensionnement
a. Modle avec ressort
Les liaisons avec le sol peuvent tre modlises sous la forme de ressorts et d'amortisseurs en
rapport avec la nature et le. nombre de degrs de libert choisis (translations et rotations) et avec la
position de la fondation par rapport la surface du sol (superficielle ou encastre). La caractrisation
de ces ressorts et amortisseurs doit correspondre au rgime dynamique. Les modules de
dformation concernant les sols s'entendent comme les modules scants correspondant aux
distorsions moyennes engendres par le passage de l'onde sismique.
b. Mthode forfaitaire
Lorsque les btiments comportent une infrastructure, il est loisible de considrer une hauteur de
dimensionnement, qui est dfinie ci-aprs en fonction des hauteurs respectives de l'infrastructure et
de la superstructure et en fonction de la nature de la couche de sol de fondation.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 28 of 184
Si H 0 dsigne la hauteur de la superstructure et si H 1 dsigne la hauteur de l'infrastructure, la hauteur
H de dimensionnement est telle que :
H = H 0 si la structure est fonde sur rocher ou sol de catgorie a,
H = H 0 + H 1 /2 1,5 H 0 si la structure est fonde sur sol de catgorie b,
H = H 0 + H 1 2H 0 si la structure est fonde sur sol de catgorie c.
Les catgories de sols mentionnes ci-dessus sont rpertories au paragraphe 5.2 ( tableau 2 ).
Selon le prsent article, il ne doit pas tre tenu compte de l'interaction sol-structure et le mouvement
du sol est suppos impos un niveau conventionnel.
Les masses situes sous le niveau d'encastrement de dimensionnement et y compris celles situes
ce niveau, sont supposes soumises l'acclration a N (dfinie au paragraphe 3.3 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.2.3.3
Le paragraphe 6.2.3.3 rend compte de manire simple mais approximative du phnomne de
l'interaction sol-structure qui se manifeste dans les sols de caractristiques mcaniques moyennes
mdiocres.
C'est la hauteur de dimensionnement H qui est prise en compte dans la dtermination du mode
fondamental et de la priode correspondante donne au paragraphe 6.6.1 .
Figure 8 Interaction sol-structure
Les limitations indiquent que si l'ouvrage est compltement enterr (H 0 = 0), la hauteur de
dimensionnement prendre en compte est nulle ; ce type d'ouvrage est analyser au titre des
ouvrages enterrs.
La rgle spcifie s'applique mme lorsque le sol est constitu d'un bicouche ; on peut rencontrer
par exemple les cas suivants :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 29 of 184
Figure 9 Hauteur de dimensionnement
Dans la dtermination de la hauteur de dimensionnement, il est raliste d'arrondir la cote au
plancher le plus proche.
Pour la vrification des lments structuraux, c'est le modle complet du btiment de hauteur H t qui
doit tre pris en compte.
6.2.3.4 Amortissement
1. Mthode de prise en compte de l'amortissement
A dfaut d'valuation plus prcise, l'amortissement structurel et les frottements internes dvelopps
dans l'ouvrage peuvent tre pris en compte par un amortissement quivalent de type visqueux, dfini
par un pourcentage d'amortissement critique constant pour chacun des modes.
2. Structures matriau unique
Lorsque les lments structuraux sont constitus d'un seul type de matriau, la valeur du
pourcentage d'amortissement critique est la mme pour tous les modes et est donne dans le
tableau 6 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 30 of 184
Tableau 6 Amortissement critique
3. Structures composites
Lorsque la structure est constitue de plusieurs matriaux, la valeur du pourcentage d'amortissement
critique est gale, pour chacun des modes considrs :
o :
dsigne le pourcentage d'amortissement critique du mode considr ;
E dsigne l'nergie lastique de la structure, associe la dforme modale considre ;
i Sommation tendue l'ensemble des matriaux constituant la structure ;
i dsigne, pour chaque matriau, le pourcentage d'amortissement critique dfini dans le
tableau 6 ;
i dsigne la part d'nergie lastique, associe la dforme modale considre,
emmagasine dans chacun des matriaux.
4. Influence des lments secondaires
Lorsque la structure comporte une densit de cloisons comparable celle des btiments d'habitation,
ou d'autres lments non structuraux, mais lis la structure, susceptibles de dissiper de l'nergie,
les valeurs du pourcentage d'amortissement critique peuvent tre augmentes de 1 % dans le cas
des murs et de 2 % dans le cas des portiques ou des structures en treillis mtallique.
5. Interaction sol-structure
En l'absence de justification prcise par une mthode scientifiquement tablie et valide par
l'exprience, l'amortissement rsultant de la prise en compte de l'interaction sol-structure doit tre
limit 50 % de sa valeur thorique, augment de 5 % pour tenir compte de l'amortissement matriel
du sol.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.2.3.4
Par amortissement quivalent, on entend un amortissement conduisant, pour un niveau de
dformation comportant de faibles incursions dans le domaine plastique, la mme dissipation
d'nergie par cycle que les amortissements et frottements rels.
Lorsque la structure subit des incursions dans le domaine plastique, les effets de l'augmentation de
l'amortissement rel sont inclus dans le coefficient de comportement q. On ne peut donc pas dans
ce cas majorer les valeurs de l'amortissement. Il est nanmoins admis que l'amortissement initial
est maintenu.
Il est rappel que l'amortissement quivalent est pris en compte par une modification du spectre de
calcul, conformment au paragraphe 5.2.3.4 .
La formule de pondration donne dans ce paragraphe considre que les matriaux et dispositifs
utiliss ont un comportement hystrtique, ce qui est le cas des matriaux courants.
Dans le cas o des dispositifs mcaniques sont introduits pour amortir la structure, la contribution
de ces dispositifs l'amortissement de chacun des modes doit faire l'objet d'une justification
spciale.
Les valeurs du tableau 6 s'entendent pour des ouvrages dans lesquels il n'existe que peu
d'lments secondaires tels que remplissages, partitions, etc., susceptibles de contribuer la
dissipation d'nergie. C'est par exemple le cas des salles de spectacles, halls de production
industrielle, halls de gare et d'aroports, bureaux partitions amovibles, etc.
Suivant les modles de calcul de l'interaction sol-structure utiliss, on peut assimiler le pseudoamortissement (dit gomtrique) d cette interaction un amortissement relatif i associ la
pulsation du mode considr.
Les limitations introduites concernant la valeur d'amortissement ont pour objet de tenir compte des
rflexions d'ondes rsultant de la stratification rencontre dans les sols. Ces limitations ne peuvent
tre leves que si la stratigraphie est suffisamment connue et prise en compte dans l'valuation du
pseudo-amortissement.
6.2.4 Evaluation des priodes propres
Dans les prsentes rgles, les priodes et les modes propres introduire dans les calculs sont
dterminer dans l'tat lastique initial du systme (domaine des petites oscillations).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 31 of 184
Les masses prendre en compte dans cette valuation sont celles dfinies dans le paragraphe 6.2.1 .
Les priodes propres peuvent tre calcules par les mthodes classiques de la dynamique des structures.
Dans le cas o elles s'appliquent, les formules empiriques peuvent tre utilises.
6.3 Prise en compte des comportements non linaires
6.3.1 Gnralits
Dans le prsent document, sont considres les structures de btiment ne prsentant que des nonlinarits de comportement des matriaux et des non-linarits gomtriques peu accuses.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.3.1
En ce qui concerne les non-linarits, on distingue :
les non-linarits de comportement des matriaux, qui correspondent aux excursions de
certaines parties du systme hors du domaine lastique conventionnel ;
les non-linarits gomtriques, qui correspondent aux modifications subies par la gomtrie
du systme du fait des dformations ou dplacements subis par ce dernier, par exemple les
effets dits " du second ordre ", en particulier ceux dus aux forces de gravit, aux soulvements
des fondations, etc. ;
les non-linarits mcaniques qui tiennent la nature ou aux caractristiques des liaisons :
dissymtries de comportement en compression et traction ; liaisons unilatrales
l'exclusion de celles apparaissant par fissuration ;
percussions ;
utilisation de dispositifs mcaniques ou de matriaux de caractristiques non linaires, en
particulier dispositifs de friction, de glissement, etc.
Dans certaines installations peuvent apparatre des non-linarits dues la variation des masses
lies la structure (fluides). Dans le prsent document, elles sont ranges dans les non-linarits
gomtriques.
6.3.2 Calcul linaire quivalent : spectre de dimensionnement - coefficient de comportement
Les structures dfinies dans le paragraphe 6.3.1 peuvent faire l'objet d'un calcul linaire dans les
conditions ci-aprs :
modle : la structure est fictivement considre comme restant indfiniment lastique, et sans
modification de ses conditions de liaisons, quelle que soit l'intensit des actions sismiques ;
mouvement sismique : on utilise les spectres de dimensionnement dfini au paragraphe 5.2.3 ;
les dplacements de la structure sont en principe considrs comme gaux ceux calculs pour le
modle lastique fictif, partir du spectre de dimensionnement, sauf dans le cas d'une dtermination
directe du coefficient de comportement ;
les forces et sollicitations de calcul sont obtenues en divisant les forces et sollicitations calcules
dans les mmes conditions que ci-dessus par un coefficient q dit " coefficient de comportement ".
Le coefficient " q " forfaitaire fix par les prsentes rgles est global pour le btiment, il est fix en fonction
de la nature des matriaux constitutifs, du type de construction, des possibilits de redistribution d'efforts
dans la structure et des capacits de dformation des lments dans le domaine post-lastique.
Cependant, dans le cas o on veut justifier le coefficient de comportement par une dtermination directe,
cela conduit une autre estimation des dplacements.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.3.2
L'attention est attire sur le caractre empirique de l'approche. Sa validit repose essentiellement
sur l'observation des comportements des btiments ayant t soumis des sismes.
L'attention est galement attire sur le fait que l'tat lastique de la structure (domaine des petites
oscillations) est pris comme un tat de rfrence auquel sont rapports le spectre de
dimensionnement et le coefficient q.
La prise en compte des caractristiques vibratoires initiales du btiment au lieu des caractristiques
susceptibles d'apparatre en comportement inlastique, pour aboutir des mouvements maximaux,
est cohrente avec une modification a priori du spectre lastique. En principe, cette modification
devrait porter non seulement sur les niveaux, mais aussi sur les frquences (priodes) de manire
proportionne aux valeurs admises pour le coefficient de comportement " q ". Dans un but de
simplicit, une telle modification a t omise.
Une autre simplification importante, dans les cas o l'on doit prendre en compte plusieurs modes
lastiques, consiste attribuer ces modes le mme coefficient de comportement, si l'on excepte
les hautes frquences (voir 6.3.3 ), alors que les parties sollicites sont diffrentes et que les
assouplissements de certaines parties peuvent en protger d'autres.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 32 of 184
Les dplacements doivent bien entendu tre estims sans application des coefficients q. Ils ne sont
pas lastiquement cohrents avec les raideurs lastiques du modle et les efforts de
dimensionnement des structures. Ceci reflte la prise en compte de dplacements de type
plastique.
6.3.3 Coefficient de comportement
A dfaut de valeurs diffrentes obtenues par toute mthode scientifiquement tablie et sanctionne par
exprimentation, l'exprience et l'observation, les valeurs des coefficients de comportement sont dfinies
en fonction de la classe de rgularit des structures ( voir 6.6.1 ) et pour chaque matriau dans l'article le
concernant.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.3.3
La formulation indique qu' priode nulle, la rponse de la structure ne saurait tre infrieure
l'acclration R A au niveau du sol ; dans ces conditions, le spectre de dimensionnement rduit pour
le calcul des forces statiques quivalentes se prsente comme suit :
Figure 10 Spectre de dimensionnement rduit
6.3.3.1 Correction du coefficient de comportement aux basses priodes
Lorsque la priode du mode de vibration fondamental est infrieure T B , et lorsque la valeur de q n'est
pas justifie par une mthode de vrification de compatibilit de dformation (voir 11.8.2.3 ), la valeur q
prendre en compte est remplacer par :
Avec q ' q
T est exprime en secondes ;
correction d'amortissement.
6.3.3.2 Coefficient de comportement pour composante verticale du sisme
Le coefficient de comportement relatif la composante verticale du sisme doit tre pris gal :
max (1 ; q /2)
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 33 of 184
6.4 Combinaison des effets des composantes du mouvement sismique
Il est loisible de substituer aux combinaisons linaires pondres un cumul quadratique des effets des
trois directions sismiques sur chacune des variables d'intrt (en fait sur toute grandeur linairement lie
chacune des excitations sismiques).
Les maxima des effets de chaque composante peuvent tre dtermins sparment puis combins
suivant les formules symboliques suivantes :
S = S x S y S z
S = S x S y S z
S = S x S y S z
expressions dans lesquelles S x , S y , S z dsignent les dformations ou sollicitations dues
chacune des composantes horizontales et verticales respectivement et S l'action
rsultante.
et sont pris gaux 0,3 dans le cas gnral. Des valeurs diffrentes sont utiliser pour certaines
vrifications prcises au paragraphe 12.2.3.4.6 .
Les effets de la composante verticale peuvent tre ngligs ( = 0 et la troisime quation ci-dessus est
nglige), exception faite des cas suivants :
a. structures dans lesquelles il existe un couplage entre un degr de libert horizontal et un degr de
libert vertical (voir figure 11 ) ;
b. structures prsentant des non-linarits gomtriques accuses (voir note sur le paragraphe 6.3.1 ).
Les composantes horizontales peuvent en outre tre considres sparment pour le dimensionnement
de la structure ( = 0, = 0, troisime quation nglige) dans le cas des constructions rgulires (au
sens de 6.6.1 ) contreventes de telle sorte qu'aucun lment vertical ne puisse tre sollicit
simultanment dans deux directions sismiques diffrentes (voir figure 12 ).
Il est loisible de substituer aux combinaisons linaires pondres un cumul quadratique des effets des
trois directions sismiques sur chacune des variables d'intrt (en fait sur toute grandeur linairement lie
chacune des excitations sismiques).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.4
En cas de cumul quadratique, les valeurs prendre en compte sont comprises entre la variable
cumule (toujours positive) et son oppos (variable cumule multiplie par - 1).
La mthode du cumul quadratique ne conduisant pas des effets concomitants, il est erron de
dduire un effet produit par une combinaison de deux variables d'intrt de la combinaison des
cumuls quadratiques de ces variables. Il faut valuer la grandeur combine sous chaque excitation
sismique et ne faire le cumul quadratique qu'aprs coup.
Comme exemples de structures pour lesquelles cette simplification ne peut pas tre opre, on
peut citer :
a. les votes ou arcs, les portiques montants inclins ou traverses brises, etc. ; les
structures comportant des poteaux ou voiles supports par une poutre ou un poitrail
horizontal, etc. ;
b. les btiments prsentant des transparences dans les niveaux infrieurs, etc.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 34 of 184
Figure 11 Exemples de structures o la simplification
n'est pas autorise
Figure 12 Exemple de structure o les composantes
horizontales sont calcules sparment
6.5 Notations
Les notations utilises sont les suivantes :
M masse totale au-dessus de l'interface sol-structure
M i masse modale du mode de rang i
m r masse de l'tage r
u r composante de dplacement de l'tage r dans la dforme modale considre
T priode du mode fondamental
q coefficient de comportement (voir 6.3.3 )
R(T) acclration spectrale telle que :
R(T) = a N R D (T)
avec :
a N acclration nominale (voir 3.3 )
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 35 of 184
coefficient topographique (voir 5.2.4 )
correction d'amortissement (voir 5.2.3.4 )
R D (T) ordonne du spectre de dimensionnement normalis (voir 5.2.3 )
H hauteur de dimensionnement (voir 6.2.3.3 )
H 0 hauteur de la superstructure
H 1 hauteur de l'infrastructure
d r dplacement de l'tage r
NOTE :
Pour la vrification au glissement d'une structure fonde sur radier, il convient d'inclure la masse du
radier la masse totale M.
6.6 Mthodes de calcul
Les structures autres que celles prsentant des irrgularits accuses sont classes, en fonction des
critres dfinis en 6.6.1.2 et 6.6.1.3 , en structures conventionnellement dsignes comme structures
rgulires et structures moyennement rgulires.
Les structures dites rgulires peuvent tre calcules partir d'une dforme forfaitaire dfinie par une
expression analytique simple.
Dans le cas des structures d'irrgularit moyenne, il doit tre procd au calcul effectif de la dforme ou
d'une dforme approche. A dfaut de dtermination plus prcise, on peut retenir la dforme obtenue
en supposant la structure indfiniment lastique et en appliquant chacune des masses qui la composent
une force de direction approprie (horizontale ou verticale) et proportionne son poids.
Les structures dfinies en 6.3.1 n'entrant dans aucune des catgories ci-dessus font obligatoirement
l'objet d'une analyse modale sur modle tridimensionnel.
Dans le cas de la prise en compte de l'interaction sol-structure, on peut utiliser des mthodes de calcul
lastique valides, avec des impdances de sol prsentant des amortissements diffrents de ceux pris en
compte pour la structure, mais les coefficients " q " doivent alors tre justifis.
De mme, la prise en compte du dcollement de fondation par un calcul lastique doit tre justifie.
Les structures dans leur ensemble peuvent tre traites par des mthodes de calcul non linaire justifies,
pour lesquelles le mouvement sismique incident correspond au spectre lastique normalis dfini en
annexe A .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6
Les dformes forfaitaires utilises sont, suivant le type de structure, des courbes d'quation :
u = z
(u longation de la dforme la cote adimensionnelle z, exposant dpendant du type de
structure).
Les dispositions relatives aux structures d'irrgularit moyenne rpondent au besoin de donner au
projeteur un moyen de traiter le cas d'ouvrages s'cartant parfois sensiblement des conditions
exiges des structures rgulires, mais sans prsenter pour autant une importance ou une difficult
justifiant le recours l'analyse modale. Il est alors ncessaire de recourir une dforme et par
suite une distribution des efforts plus raliste que celle rsultant des lois forfaitaires.
6.6.1 Mthodes simplifies
Les ouvrages des types les plus courants peuvent, sous rserve du respect des conditions spcifies
dans le prsent document, tre calculs par les mthodes simplifies explicites ci-aprs.
6.6.1.1 Conditions remplir par la structure
a. Il ne doit pas exister de couplage significatif entre les degrs de liberts horizontaux et verticaux. Il
faut en particulier pour cela que la structure de contreventement ne comporte pas d'lment porteur
vertical dont la charge ne se transmette pas en ligne directe la fondation (voir figure 13 ).
b. Dans chacun des deux plans verticaux passant par les axes principaux de l'ouvrage, la structure doit
pouvoir tre rduite, par les mthodes indiques au paragraphe 6.2 , un systme plan ne
comportant qu'une seule masse chaque niveau. Vis--vis des excitations verticales, elle doit tre
rductible un systme plan ne comportant qu'une seule masse le long d'une mme verticale (voir
figure 14 ).
c. La structure doit comporter au moins trois plans de contreventement non concourants.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 36 of 184
d. Les planchers ou diaphragmes horizontaux doivent prsenter, eu gard la disposition et la raideur
des contreventements verticaux, une rigidit suffisante pour qu'ils puissent tre considrs
indformables dans leur plan (voir figure 15 ).
e. La forme de la construction en plan, ainsi que la distribution des masses et des rigidits suivant la
hauteur, doivent satisfaire aux conditions de rgularit indiques en 6.6.1.2 et 6.6.1.3 ci-aprs.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.1
La figure note 13 ci-dessous donne des exemples de structures auxquelles les rgles simplifies ne
peuvent pas tre appliques du fait de la condition a).
Figure 13 Exemples de structures prsentant une
rupture d'alignement dans les descentes de charge
La figure 14 ci-dessous reprsente deux types de structures auxquelles les mthodes simplifies
ne sont pas applicables du fait de la condition b).
Figure 14 Exemples de structures discontinues
certains niveaux
La configuration montre la figure 15 n'est pas favorable du fait de la condition d).
Figure 15 Exemple de configuration dfavorable
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.1 (SUITE)
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 37 of 184
Figure 16 Critres a) et b) de rgularit des btiments
Figure 17 Critre b) de rgularit des btiments
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 38 of 184
Figure 18 Critres b), c) et d) de rgularit des
btiments
Dans le cas o le contreventement est assur par des voiles i d'inertie I i , situs suivant les axes
principaux des ouvrages, le rayon r est donn par :
C : centre de torsion
Figure 19 Critre d) de rgularit des btiments
La formule r x 2 est valide lorsque la dformalit l'effort tranchant reste ngligeable.
6.6.1.2 Mthode simplifie applicable aux btiments rguliers
6.6.1.2.1 Critres de rgularit respecter
Sous rserve de l'application de 6.6.1.1 a) , sont considrs comme rguliers les btiments respectant les
critres suivants :
6.6.1.2.1.1 Configuration en plan
a. Le btiment doit prsenter une configuration sensiblement symtrique vis--vis de deux directions
orthogonales, tant en ce qui concerne les raideurs de flexion que la distribution des masses (voir
figure 16 ).
b. La forme de la construction doit tre compacte et les dimensions des parties rentrantes ou saillantes
ne doivent pas excder 25 % de la dimension totale du btiment dans la direction correspondante
(voir figure 17 ).
c. L'lancement = Lx/Ly de la section en plan du btiment ne doit pas excder la valeur 4 (voir figure
18 ).
d. A chaque niveau y compris dans la hauteur des fondations et pour chaque direction de calcul,
l'excentricit structurale doit vrifier :
e o 0,2 r et r 0,2 L (voir figure 18 )
avec :
(voir figure 19 )
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 39 of 184
La raideur de translation est calcule partir du dplacement total li la flexion et l'effort
tranchant l'ensemble des points C et G de tous les tages doit se projeter l'intrieur d'un rectangle
de 0,2 r de ct (voir figure 18 ).
e. A chaque niveau, et pour chaque direction de sisme, on doit vrifier la relation :
f. La condition d'lancement limite exige l'article 6.6.1.2.1.1 c) ne s'applique pas aux btiments un
seul niveau lorsque ces btiments disposent en toiture d'un diaphragme horizontal rigide en plan ou
lorsque les rigidits latrales et les masses peuvent tre considres comme distribues
rgulirement le long de la dimension Lx.
Dans ce dernier cas, l'espacement entre systmes structuraux principaux assurant les distributions
de rigidit et de masse ne doit pas dpasser 12 m. En outre, pour deux systmes structuraux
principaux quelconques, le ratio des rapports des rigidits aux masses (K j /M j ) doit tre compris
entre les valeurs 0,8 et 1,2
6.6.1.2.1.2 Configuration verticale
a. La structure ne doit pas comporter d'lment porteur vertical dont la charge ne se transmette pas en
ligne directe la fondation. De faon plus gnrale, il ne doit pas exister de couplage significatif entre
degrs de liberts horizontaux et verticaux.
b. Dans chacun des deux plans verticaux dfinis par l'axe de torsion et les directions horizontales de
calcul, la structure doit pouvoir tre rduite par les mthodes indiques au paragraphe 6.2 un
systme plan ne comportant qu'une seule masse chaque niveau.
Vis--vis des excitations verticales, elle doit tre rductible une poutre verticale unique le long de
laquelle sont alignes les masses des diffrents niveaux.
c. Dans le cas d'un rtrcissement graduel sur la hauteur et prservant sensiblement la symtrie du
btiment, le retrait chaque tage ne doit pas dpasser 15 % de la dimension en plan du niveau
prcdent, sans que le retrait global ne dpasse 33 % de la dimension en plan de l'ouvrage au
niveau du sol (voir figure 20 a) ).
d. Dans le cas d'un largissement graduel sur la hauteur et prservant sensiblement la symtrie du
btiment, le porte--faux chaque tage ne doit pas dpasser 10 % de la dimension en plan du
niveau prcdent, sans que le porte--faux global ne dpasse 25 % de la dimension en plan de
l'ouvrage au niveau du sol (voir figure 20 b) ).
e. Dans le cas de rtrcissement apparaissant sur une seule faade, le retrait chaque tage ne doit
pas dpasser 10 % de la dimension en plan du niveau prcdent, sans que le retrait global ne
dpasse 20 % de la dimension en plan de l'ouvrage au niveau du sol (voir figure 20 c) ).
f. Par drogation la rgle c), si un seul rtrcissement au plus gal 33 % et prservant la symtrie
se trouve plac dans les 15 % infrieurs ou suprieurs de la hauteur totale du btiment au-dessus du
sol d'assise des fondations, le btiment peut encore tre class comme rgulier (voir figure 20 e) ).
g. Par drogation la rgle d), si un seul largissement au plus gal 25 % et prservant la symtrie
se trouve plac dans les 15 % infrieurs de la hauteur totale du btiment, celui-ci peut encore tre
class comme rgulier (voir figure 20 d) ).
h. La distribution des raideurs doit tre sensiblement rgulire sur la hauteur de l'ouvrage, le rapport
des raideurs tant compris entre les valeurs suivantes :
0,67 K i /K i-1 1,33
K i et K i - 1 tant les raideurs des contreventements de deux tages conscutifs dans la mme
direction de calcul.
i. La distribution des masses doit tre sensiblement rgulire sur la hauteur de l'ouvrage, le rapport des
masses tant compris entre les valeurs suivantes :
0,85 m i /m i-1 1,10 et 0,80 m i /m 1,20
sauf pour les btiments dfinis aux alinas d) et e) o la formule devient :
0,90 m i /m 1,10
m i et m i - 1 tant les masses de deux tages conscutifs, m la masse moyenne d'un tage.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.2.1.2
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 40 of 184
A chaque fois que les dformations d'effort tranchant peuvent tre ngliges devant celles de la
flexion, ce sont ces dernires seules qui sont prises en compte pour le calcul de la raideur.
Figure 20 Configurations verticales des btiments
rguliers
6.6.1.2.1.3 Cas particuliers
Sous rserve de l'application de la rgle nonce au paragraphe 6.6.1.1 a), sont considrs comme
rguliers les btiments composs de l'empilage d'une superstructure respectant les critres de rgularit
proposs en la considrant comme isole et d'une infrastructure respectant les critres de rgularit
proposs en la considrant comme isole sans que les critres de distributions de raideur et de
distribution des masses soient satisfaits l'interface et en regard de la masse moyenne globale pour
autant que :
a. la raideur en flexion des contreventements de l'infrastructure soit plus grande que celle de la
superstructure ;
b. la hauteur de l'infrastructure soit infrieure au tiers de la hauteur de la superstructure ;
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 41 of 184
c. les centres de gravit des masses de chaque niveau de la superstructure et de l'infrastructure
doivent concider avec une tolrance limite 10 % de la plus petite dimension en plan de
l'infrastructure et de la superstructure, mesure perpendiculairement la direction du sisme.
6.6.1.2.2 forme forfaitaire du mode fondamental
Il est choisi forfaitairement pour la forme du mode fondamental (voir figure 21 ), la courbe d'quation :
u = z
o z est la cote adimensionnelle du niveau du plancher et u le dplacement de ce plancher(par exemple
pour le
niveau r : Zr = hr/H, dans la direction de calcul.
L'exposant est fonction du systme de contreventement et on peut prendre :
= 1 pour les ossatures dont la stabilit latrale est assure par des portiques ;
= 1,5 pour les structures dont le contreventement est assur principalement par des voiles ou des
pales triangules.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.2.2
Figure 21 Forme forfaitaire du mode fondamental
6.6.1.2.3 priode de vibration
La priode du mode fondamental de vibration dans la direction de calcul x peut tre value par les
formules forfaitaires suivantes :
pour les ossatures non bloques par un remplissage ; ou une maonnerie
pour les contreventements par voiles de bton arm et/ou chans, ou contreventements mixtes
(voiles + portiques)
pour les ossatures avec remplissage en maonnerie, ou remplissage ou pales triangules.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 42 of 184
On peut galement valuer la priode fondamentale par l'expression :
Dans laquelle n dsigne le dplacement, en mtres, du sommet du btiment plac dans un champ
d'acclration horizontale uniforme unit (1 m/s) (voir figure 22 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.2.3
Les trois premires formules sont d'origine exprimentale, L x et H sont exprims en mtres et les
priodes, en secondes.
La quatrime formule est la formule simplifie de RAYLEIGH applicable aux structures considres
comme des consoles masse uniformment rpartie :
Figure 22 Dfinition de n
6.6.1.2.4 forces statiques quivalentes de calcul
Les forces statiques quivalentes qui s'appliquent chaque niveau dans la direction de calcul s'expriment
par la relation :
Le terme 0 est un coefficient majorateur ayant pour expression :
0 = 1 + 0,10(T/T C ) 3/2
est 1,10 pour les contreventements par voiles ;
0 = 1 + 0,05(T/T C ) 3/2
est 1,05 pour les portiques.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.2.4
Les forces statiques quivalentes sont proportionnelles aux longations du mode fondamental de
vibration.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 43 of 184
Le terme correctif 0 est cens tenir compte des modes de vibration ngligs.
T c est la priode correspondant l'extrmit du plateau du spectre de dimensionnement et est
dfinie en 5.2.3.2 ; lorsque T < T B , q est remplac par q' (voir 6.3.3 ).
6.6.1.2.5 dplacements par rapport la base
Les dplacements prendre en compte chaque niveau ont pour expression :
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.2.5
Il convient de noter que les dplacements calculs sont des dplacements lastiques, donc sans
rduction par le coefficient de comportement q.
6.6.1.3 Mthode simplifie applicable aux btiments moyennement rguliers
6.6.1.3.1 Critres de rgularit respecter
Sont considrs comme moyennement rguliers, les btiments respectant les critres dfinis en
6.6.1.2.1.1 a), b), c) et en 6.6.1.2.1.2 a) et b) .
Pour les autres rgles, les critres sont dfinis avec une tolrance largie.
6.6.1.3.1.1 Configuration en plan
A chaque niveau et y compris dans la hauteur des fondations et pour chaque direction de calcul,
l'excentricit structurale doit vrifier :
e 0 0,30 r
On doit vrifier la relation :
L'ensemble des points C et G de tous les tages doit se projeter l'intrieur d'un rectangle de 0,30 r de
ct.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.3.1.1
Le changement de type de contreventement est autoris entre la superstructure et l'infrastructure ;
ceci vise les btiments transparence dans la hauteur du rez-de-chausse, sous rserve que soit
respect le rapport des raideurs spcifi ci-aprs.
6.6.1.3.1.2 Configuration verticale
a. Dans le cas d'un rtrcissement graduel sur la hauteur et prservant sensiblement la symtrie du
btiment, le retrait chaque tage ne doit pas dpasser 25 % de la dimension en plan du niveau
prcdent, sans que le retrait global ne dpasse 50 % de la dimension en plan de l'ouvrage (voir
figure 23 a) ).
b. Dans le cas d'un largissement graduel sur la hauteur et prservant sensiblement la symtrie du
btiment, le porte--faux chaque tage ne doit pas dpasser 15 % de la dimension en plan du
niveau prcdent, sans que le porte--faux global ne dpasse 50 % de la dimension en plan de
l'ouvrage (voir figure 23 b) ).
c. Dans le cas de rtrcissement apparaissant sur une seule faade, le retrait chaque tage ne doit
pas dpasser 15 % de la dimension en plan du niveau prcdent, sans que le retrait global ne
dpasse 33 % de la dimension en plan de l'ouvrage (voir figure 23 c) ).
d. Par drogation la rgle a), si un seul rtrcissement au plus gal 50 % et prservant la symtrie
se trouve plac dans les 25 % infrieurs ou suprieurs de la hauteur totale du btiment au-dessus du
niveau d'application de l'excitation sismique, le btiment peut encore tre class comme
moyennement rgulier (voir figure 23 d) ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 44 of 184
e. Par drogation la rgle b), si un seul largissement au plus gal 50 % et prservant la symtrie
se trouve plac dans les 25 % infrieurs de la hauteur totale du btiment, celui-ci peut encore tre
class comme moyennement rgulier (voir figure 23 e) ).
f. La distribution des raideurs doit tre sensiblement rgulire sur la hauteur de l'ouvrage, le rapport
des raideurs tant compris entre les valeurs suivantes :
0,50 K i /K i-1 1,5
K i et K i-1 tant les raideurs en flexion des contreventements de deux tages conscutifs dans la
direction de calcul.
g. La distribution des masses doit tre sensiblement rgulire sur la hauteur de l'ouvrage, le rapport des
masses tant compris entre les valeurs suivantes :
0,75 m i / m i-1 1,15 et 0,67 m i / m 1,33
sauf pour les btiments dfinis aux alinas b) et c) o la formule devient :
0,80 m i / m 1,20
m i et m i-1 tant les masses de deux tages conscutifs, m la masse moyenne d'un tage.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.3.1.2 G)
Ce critre exclut les structures en pendule invers, dfinies en 6.3.3 , du champ d'application
des btiments rgularit moyenne.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.3.1.2
A chaque fois que les dformations d'effort tranchant peuvent tre ngliges devant celles de la
flexion, ce sont ces dernires seules qui sont prises en compte pour le calcul de la raideur.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 45 of 184
Figure 23 Configurations verticales des btiments
moyennement rguliers
6.6.1.3.1.3 Cas particuliers
Sous rserve de l'application de la condition indique au paragraphe 6.6.1.1 a) , sont considrs comme
moyennement rguliers, les btiments composs de l'empilage d'une superstructure respectant les
critres de rgularit proposs en la considrant comme isole et d'une infrastructure respectant les
critres de rgularit proposs en la considrant comme isole sans que les critres de distributions de
raideur et de distribution des masses soient satisfaits l'interface et en regard de la masse moyenne
globale pour autant que :
a. la raideur en flexion des contreventements de l'infrastructure soit plus grande que celle de la
superstructure ;
b. la hauteur de l'infrastructure soit infrieure au tiers de la hauteur de la superstructure ;
c. les centres de gravit des masses de chaque niveau de la superstructure et de l'infrastructure
doivent concider avec une tolrance limite 10 % de la plus petite dimension en plan de
l'infrastructure et de la superstructure, mesure perpendiculairement la direction du sisme.
6.6.1.3.2 forme du mode fondamental
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 46 of 184
On dtermine une forme approche du mode fondamental (voir figure 24 ) en plaant la structure dans un
champ d'acclration horizontale unit (1 m/s), et en calculant les longations u i (m) chaque niveau
pour chaque direction de calcul.
On dsigne par le facteur de participation du mode fondamental, tel que :
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.3.2
Figure 24 Forme approche du mode fondamental
6.6.1.3.3 priode de vibration
A dfaut de calcul plus prcis, la priode de vibration du mode fondamental est donne par la formule
approche :
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.3.3
La formule indique est la formule de RAYLEIGH, qui donne une trs bonne approximation de la
valeur de la priode du mode fondamental de vibration.
6.6.1.3.4 forces statiques quivalentes de calcul
Les forces statiques quivalentes s'appliquant chaque niveau et correspondant au mode fondamental de
vibration dans la direction de calcul s'expriment par la relation :
On considre en outre un mode de vibration complmentaire (voir figure 25 ) auquel correspondent les
forces statiques quivalentes suivantes :
f * r = m r (1-u r ) a N
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 47 of 184
A chaque niveau, les variables d'intrt tudies doivent tre combines quadratiquement sous
l'ensemble des actions des forces f r et f* r
A dfaut de considrer le mode de vibration complmentaire prcdent, les variables d'intrt tudies
peuvent tre obtenues partir de la considration du seul mode fondamental, condition de majorer les
forces statiques quivalentes f r par le terme correctif 0 dfini ci-dessous :
Le terme 0 est un coefficient majorateur ayant pour expression :
0 = 1 + 0,05(T/T c ) 4/3
pour les contreventements par voiles ;
0 = 1 + 0,03(T/T c ) 4/3
pour les portiques.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.3.4
Ce mode de vibration complmentaire n'est autre que le mode rsiduel dfini l'article 6.6.2.2 et
cens tenir compte de tous les modes ngligs ; il fournit une bien meilleure estimation des efforts
tranchants en pied de structure.
La combinaison quadratique est conforme celle dfinie dans l'article 6.6.2.3 pour la mthode
gnrale.
Il est bien entendu possible (et majorant) de remplacer la combinaison quadratique du mode
rsiduel avec le mode prpondrant par deux combinaisons linaires du mode rsiduel (et de son
oppos) avec le mode prpondrant.
Figure 25 Forme des modes considrs
6.6.1.3.5 Dplacements par rapport la base
Les dplacements prendre en compte chaque niveau ont pour expression :
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.3.5
La considration du mode rsiduel exprim en termes de dplacements conduit des
dplacements complmentaires ngligeables.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 48 of 184
6.6.1.4 Prise en compte des torsions d'axe vertical
Les forces statiques quivalentes de calcul donnes en 6.6.1.2.4 dans le cas de btiment rgulier et au
6.6.1.3.4 dans le cas de btiment moyennement rgulier sont supposes agir au centre de gravit
massique de l'tage concern.
Pour tenir compte des distributions dfavorables des masses et des effets dynamiques des mouvements
diffrentiels horizontaux, on dplace le point d'application de ces forces de e' r dans un sens (voir figure 26
b) ) et dans l'autre (voir figure 26 c) ) e' r tant dfini comme suit :
e' r = 0,10L r Z r
avec :
Z r = h r /H
Dans cette expression, L r dsigne la dimension horizontale du plancher dans la direction perpendiculaire
l'excitation, h r dsigne la hauteur du centre de gravit des masses de l'tage considr et H la hauteur
totale de dimensionnement du btiment dfinie au paragraphe 6.2.3.3 (voir figure 26 a) ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.4
Les oscillations de torsion d'axe vertical ont une triple origine. On peut distinguer :
les oscillations d'origine structurelle, dues l'excentrement du centre de gravit des masses
par rapport au centre de torsion de la structure aux niveaux considrs (cet excentrement est
important dans le cas de structures dissymtriques) ;
les oscillations d'origine accidentelle, dues la variabilit spatiale des charges permanentes
ou une distribution dfavorable des charges d'exploitation ;
et celles dues aux mouvements diffrentiels horizontaux du sol.
Pour des raisons de commodit, dans la mthode forfaitaire ci-contre, les deux derniers effets sont
confondus.
En pratique, la spcification conduit effectuer quatre calculs diffrents de contreventement.
Figure 26 Point d'application des forces statiques
quivalentes
6.6.1.5 Prise en compte des effets du second ordre
Dans le cas d'une structure calcule selon l'une des mthodes simplifies du paragraphe 6.6.1, les effets
du second ordre dus aux forces de gravit peuvent tre ngligs si chaque niveau r la condition suivante
est satisfaite :
Dans cette expression : h e = z r - z r-1 , r est le dplacement horizontal relatif d r - d r-1 de la masse m r par
rapport la masse m r-1 ; P r le poids des masses situes au niveau r et au-dessus ; F r la grandeur de la
rsultante des forces horizontales f s agissant au niveau r et au-dessus prises avec leur valeur de
dimensionnement (voir figure 27 ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 49 of 184
Lorsque le paramtre r est suprieur 0,10, il faut procder un calcul tenant compte des effets du
second ordre.
Lorsque le rapport r reste infrieur 0,25, il est admis d'utiliser une mthode avec amplification des
moments dus la dformation latrale, consistant majorer ces derniers, calculs par une analyse
lastique au premier ordre, dans le rapport 1/1 - r .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.5
Figure 27 Evaluation des effets du second ordre
Les dplacements et les forces sont calculs partir des formules de 6.6.1 . Il convient d'y ajouter
les dplacements et forces dus aux torsions d'axe vertical.
6.6.1.6 Prise en compte des effets de la composante verticale
Les effets de la composante verticale sont valus partir du spectre de dimensionnement normalis
vertical dfini en 5.2.3.3 , et du coefficient de comportement dfini en 6.3.3 pour la composante verticale.
Dans le cas o il n'existe pas de couplage significatif entre degrs de libert horizontaux et verticaux, les
effets de la composante verticale peuvent tre dtermins par les formules simplifies donnes au
paragraphe 6.6.1.3 , dans lesquelles les forces f r reprsentent les forces verticales (ascendantes ou
descendantes) engendres par l'action sismique.
Les longations u r (ascendantes ou descendantes) sont obtenues en appliquant chacune des masses
une acclration unit (ascendante ou descendante), et les forces statiques quivalentes verticales ont
pour expression :
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.6
Ce coefficient de comportement est distinct de celui dfini pour les composantes horizontales.
La disposition indique permet de se contenter d'une valuation approche des effets de la
composante verticale, mme dans le cas o les critres d'irrgularit conduisent utiliser la
mthode gnrale pour valuer les effets des composantes horizontales.
Le calcul des longations u s fournit simultanment une valeur suffisamment approche de la
priode du mode fondamental
vertical par application de la formule :
6.6.1.7 mthode forfaitaire applicable aux btiments de faible hauteur
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 50 of 184
Pour les btiments de faible hauteur, dont la hauteur H o au-dessus du sol est infrieure 10 m ou
comportant trois niveaux de superstructure au plus on peut appliquer la mthode des btiments rguliers
(voir 6.6.1.2 ), mais en prenant en compte toute la masse et en appliquant le coefficient q des btiments
rguliers :
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.1.7
Les btiments comportant de fortes discontinuits de rigidit en lvation mritent une justification
particulire.
6.6.2 Mthode gnrale - analyse modale spectrale
6.6.2.1 Domaine et modalits d'application
A dfaut d'utiliser une analyse dynamique directe ou chronologique prenant en compte les comportements
effectifs des matriaux et des structures, la mthode gnrale prsente est l'analyse modale spectrale
assortie de l'utilisation d'un coefficient de comportement.
Le systme est modlis sous la forme d'un systme lastiquetridimensionnel rpondant aux conditions
dfinies en 6.2 .
Le mouvement sismique de calcul est pris en compte sous la forme d'un spectre de dimensionnement.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.2.1
Le fait que les prsentes rgles aient choisi comme mthode gnrale l'analyse modale sur modle
lastique avec raideur initiale et spectre de dimensionnement ne fait pas obstacle ce que d'autres
mthodes puissent tre retenues au cas par cas sur justifications particulires. Dans ce cas, l'cart
entre les rsultats et l'application de la norme doit tre argument.
6.6.2.2 Slection des modes
Dans chacune des directions d'excitation tudies, le calcul des modes de vibration doit tre poursuivi
jusqu' la frquence de 33 Hz (priode de 0,03 s). La suite des modes peut tre interrompue si le cumul
des masses modales M i dans la direction de l'excitation considre atteint 90 % de la masse vibrante
totale M du systme ; dans ce cas, les effets des modes non retenus peuvent tre ngligs. En aucun cas
le nombre de modes retenus ne doit tre infrieur 3. Si la frquence de 33 Hz (priode de 0,03 s) le
cumul des masses modales dans la direction de l'excitation n'atteint pas 90 % de la masse totale vibrante,
il doit tre tenu compte des modes ngligs par toute mthode scientifiquement tablie et sanctionne par
l'exprience ; en particulier, il peut tre considr un mode rsiduel affect d'une masse gale la masse
vibrante nglige :
M-Mi
La suite des modes peut galement tre interrompue avant la frquence de 33 Hz (priode de 0,03 s)
condition que la somme des masses modales M i reprsente au moins 70 % de la masse totale vibrante
M ; dans ces conditions, le mode rsiduel doit tre calcul en appliquant au modle l'acclration
spectrale du dernier mode retenu, et en l'affectant du facteur multiplicateur dfini ci-dessus.
A dfaut de procder au calcul d'un mode rsiduel, il faut majorer toutes les variables d'intrt (forces,
dplacements, contraintes, etc.) obtenues par la combinaison des rponses modales par le facteur :
M / M i
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.2.2
Par masse totale vibrante, on entend la somme des masses situes au-dessus de l'interface solstructure susceptibles de subir des dplacements dans la direction tudie.
Dans le cas de fondations profondes (pieux, barrettes), cet interface est cens tre constitu par la
face suprieure des pieux ou barrettes.
La frquence de 33 Hz est la " frquence de coupure " du spectre.
Les considrations de masse modale ne sont ncessaires et suffisantes que pour l'tude des effets
globaux en pied de structure. Il est de la responsabilit du concepteur d'tendre ou d'accepter une
rduction de ces critres selon les variables d'intrt qui sont les siennes.
La notion de mode rsiduel vise complter la base modale par le vecteur dformation qui est
ncessaire pour reprsenter rigoureusement la rponse une acclration constante uniforme ; de
ce fait, il permet de reprsenter correctement les ractions d'appui du modle (donc les efforts en
pied si l'on n'oublie pas l'acclration absolue des masses situes au point fixe du modle).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 51 of 184
D'autres types de mode rsiduel peuvent tre utiles lorsqu'on analyse le comportement d'une partie
seulement de la structure.
6.6.2.3 combinaison des rponses modales une direction sismique
Les valeurs de calcul des dplacements, dformations, sollicitations, et plus gnralement de toute
variable d'intrt linairement lie l'amplitude de l'excitation sismique pour l'tude, sont obtenues en
combinant comme indiqu ci-aprs les valeurs maximales obtenues sparment dans chaque mode.
Deux modes i et j de priodes T j T i sont considrs comme ayant des rponses modales indpendantes
si le rapport : = T j / T i vrifie l'ingalit :
expression dans laquelle i et j sont les amortissements relatifs, exprims en pourcentage des deux
modes.
1. Lorsque les rponses modales peuvent tre considres comme indpendantes, la combinaison
peut s'effectuer suivant la formule :
o S dsigne la variable calculer, et S i sa valeur maximale dans le mode i.
2. Si pour certains couples i et j les rponses modales ne peuvent pas tre considres comme
indpendantes, la combinaison peut s'effectuer suivant la formule :
o S' i et S' j sont les valeurs extrmales des rponses modales prises avec leur signe respectif, et ij
le coefficient de corrlation :
3. Dans le cas o une sollicitation comporte plusieurs composantes dont les signes algbriques ne sont
pas indpendants, des mthodes plus favorables que celles donnes ci-dessus peuvent tre
admises sur justification.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.2.3
Lorsque l'amortissement modal est constant, l'ingalit devient :
1. La formule de combinaison dfinie dans l'alina 1) est connue sous le nom de combinaison
quadratique (ou mthode SRSS).
2. La formule de combinaison dfinie dans l'alina 2) est connue sous le nom de combinaison
quadratique complte (ou mthode CQC).
Il convient de rappeler que la rponse modale a un signe intrinsque indpendant du choix de
la constante multiplicative des modes puisque cette rponse est le produit du facteur de
participation par la composante de rponse du mode.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 52 of 184
Lorsque l'amortissement modal est constant, l'expression du coefficient de corrlation
devient :
3. Cette circonstance se produit en particulier dans les poteaux o un moment flchissant positif
est systmatiquement associ par exemple, un effort axial de compression dans un mode, et
un effort de traction dans un autre (et o, vice versa, un effort axial de compression se
trouve associ un moment positif dans un mode et ngatif dans l'autre).
La combinaison quadratique, qui opre la confusion entre les compressions et les tractions ou entre
les moments positifs et les moments ngatifs, conduit en ce cas des rsultats plus dfavorables
que ceux auxquels conduirait la superposition pure et simple des maxima des rponses modales.
6.6.2.4 Prise en compte des torsions d'axe vertical
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.2.4
En pratique, la spcification conduit effectuer quatre calculs diffrents de contreventement.
Il y a deux cas considrer suivant que l'excentricit structurale dfinie en 6.6.1.2.1.1 a une valeur
infrieure ou non la limite fixe 0,3 r au paragraphe 6.6.1.3.1.1 .
a. Cas o e 0 0,30 r.
Il est loisible, pour chaque direction de calcul, de calculer les actions sismiques horizontales l'aide
d'une analyse modale spectrale effectue sur un modle plan. Dans ce cas, on doit procder comme
indiqu en 6.6.1.4 .
b. Cas o e 0 > 0,30 r.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 6.6.2.4 B)
Les notations L rx et L ry sont celles dfinies au paragraphe 6.6.1.4
Figure 28 Positions des centres de gravit des
masses dans le cas o e 0 > 0,3 r
Lorsque e 0 0,3r, la mthode prvue en 6.6.2.4 b) peut naturellement s'appliquer.
Il est ncessaire pour chaque direction principale de calculer les actions sismiques horizontales
l'aide d'une analyse modale spectrale effectue sur un modle tridimensionnel.
Dans ce modle, les masses doivent tre discrtises de telle manire que leur centre de gravit se
dduise du centre de gravit thorique par une translation latrale e' dfinie comme suit :
e x = 0,05L rx
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 53 of 184
e y = 0,05L ry
Dans l'analyse, on doit considrer les deux modles indiqus ci-dessous :
les masses sont toutes cartes du centre de torsion de l'tage considr de la quantit (e' x ;e' y ) ;
les masses sont rapproches du centre de torsion de l'tage considr de la quantit (e' x ;e' y ).
Ces dplacements des masses sont explicits sur la figure 28 .
6.6.2.5 prise en compte des effets du second ordre
La prise en compte des effets du second ordre est effectue selon les prescriptions vises en 6.6.1.5 avec
F r la rsultante de la combinaison des sollicitations des divers modes.
6.6.2.6 Prise en compte des effets de la composante verticale
La prise en compte des effets de la composante verticale est effectue en conformit avec les
prescriptions du paragraphe 6.6.1.6 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 54 of 184
7 Actions locales
NOTE SUR L'ARTICLE 7
Indpendamment des actions d'ensemble dont l'valuation fait l'objet de l' article 6 , certaines
parties des constructions ou des installations peuvent tre soumises des actions excdant
localement celles prises en compte dans la vrification de la rsistance et de la stabilit d'ensemble
de la structure. Ces actions ne sont pas cumuler avec les autres actions sismiques mais les
vrifications doivent tre tendues tous les lments concourant la rsistance ou la stabilit
des parties concernes.
7.1 Elments passibles d'un calcul forfaitaire
Les lments figurant dans le tableau 7 ci-dessous doivent tre conus et calculs pour rsister un
systme de forces parallles dfinies par le coefficient sismique et la ou les directions spcifies dans le
tableau, tel que :
= Ka N /g
Dans cette valuation, les charges d'exploitation sont prises avec leur valeur caractristique ou nominale.
A ces forces s'ajoutent, lorsqu'il y a lieu, les pousses horizontales prescrites par les rglements de
charge en vigueur.
Les fixations de ces lments doivent tre calcules pour des valeurs des ractions gales 1,5 fois les
ractions calcules dans les hypothses ci-dessus, celles-ci tant considres comme accidentelles.
Dans les cas de dispositifs justifis par des essais, les ractions prcdentes ne doivent pas excder 90
% de la valeur de la charge de rupture garantie par le fabricant.
Tableau 7 Elments courants de btiment
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 7.1
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 55 of 184
Les pousses horizontales vises sont essentiellement celles prvues pour les parapets, gardecorps, etc.
Le coefficient sismique est dfini en 6.1.3 .
Les quipements viss ici sont les quipements courants de btiment.
Le coefficient q de comportement n'a pas tre pris en compte dans le calcul des lments
passibles de la mthode forfaitaire prsente.
7.2 Structures secondaires et sous-systmes
Les structures secondaires et autres sous-systmes supports par la structure principale peuvent tre
calculs par la mthode des spectres de plancher.
Lorsque ce calcul n'est pas exig par les prsentes rgles ou par le Cahier des Charges Particulires de
la Construction, ces structures secondaires ou autres sous-systmes peuvent tre calculs compte tenu
de l'application aux poids des masses qui les composent, et dans les directions appropries de
coefficients sismiques ' gaux :
avec :
(voir figure 29 )
Dans cette expression, T dsigne la priode du mode de vibration de la structure apportant la plus forte
contribution la rponse d'ensemble ; T' la priode du mode de vibration du sous-systme tudi,
considr comme rigidement encastr sa base, de plus forte masse modale, r = f r /m r g (dfini en
6.1.3 ) est le coefficient sismique applicable dans la direction, tudie au solide lmentaire dont le soussystme est solidaire, tel qu'il ressort du calcul des actions d'ensemble.
Lorsque ce calcul est appliqu l'un des lments numrs dans le tableau 7 , la valeur ' ne peut pas
tre infrieure celle figurant dans le tableau.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 7.2
La dfinition des situations exposes est donne dans les articles de ce document relatifs aux
diverses catgories d'ouvrages.
Figure 29 Variation du coefficient en fonction de la
priode de vibration
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 56 of 184
8 Rgles de vrification
8.1 Combinaison d'actions
Les combinaisons d'actions considrer pour la dtermination des dformations et sollicitations de calcul
sont les combinaisons accidentelles pour lesquelles le sisme est pondr par un coefficient Q = 1 :
o :
G est le poids mort et actions permanentes de longue dure le cas chant (prcontrainte, action
latrale statique des terres P1 et B1 - voir figure 29 ) ;
E est l'action du sisme, calcule avec les rgles du paragraphe 6.1 et pousse latrale dynamique
des terres : P2 et B2 (voir article 10 ) ;
Q k,i sont les actions variables (charges d'exploitation avec les dgressions correspondantes, charge
de neige, vent, temprature) ;
1 , 2 sont les facteurs d'accompagnement.
Dans les cas les plus courants o interviennent essentiellement le poids mort et les charges d'exploitation,
les combinaisons de calcul peuvent se limiter :
S 1u = G + 0,8 Q + E + 0,1 N
S' 1u = G + E + 0,3 N
S 2u = G + E + 0,2 N + 0,4 Q
o :
N est l'action de la neige.
Les cas courants ne couvrent pas les btiments industriels soumis des charges importantes et pour
lesquelles les actions d'accompagnement ne sont pas ngligeables et sont dfinies par les D.P.M.
Il n'est pas envisag de combiner l'action du vent avec celle du sisme.
Pour les btiments possdant une infrastructure enterre et pour lesquels il peut tre justifi que l'action
dynamique du terrain sur l'infrastructure puisse tre dcouple des actions dues aux forces d'inertie de la
superstructure, on utilise les deux combinaisons :
E = E 1 E 2
E = E 2 E 1
o :
E 1 est la partie dynamique de l'action des terres ;
E 2 est l'action dynamique sur la structure.
A dfaut de justification plus prcise, on peut dans ce cas comparer la priode de vibration, fondamentale
T de la structure la priode de vibration T s de la colonne de sol situe au-dessus du substratum rsistant
en limitant la profondeur de celui-ci 100 m.
En se rfrant au 9.4.2.2 relatif au calcul des fondations profondes, on peut valuer la priode de vibration
de la colonne de sol homogne par la formule :
T s = 4H s / V s
Dans ces conditions, le coefficient rducteur de la combinaison S = S i S j peut tre pris gal :
= 1 si 0,8 T/T s 1, 25
= 0,3 si T/T s 0,5 ou T/T s 2
Entre les valeurs T/T s de comprise entre 0,5 et 0,8 ou entre 1,25 et 2, on peut dterminer par
interpolation linaire comme indiqu sur la figure 31 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 8.1
Il est rappel que les valeurs des actions variables considrer dans le cas des situations
accidentelles rsultent de l'application leur valeur caractristique ou nominale d'un facteur
d'accompagnement 1 ou 2 multiplicatif infrieur ou gal 1 (on prcise que 1 correspond une
action variable de valeur frquente et 2 une action variable de valeur quasi permanente).
Il est rappel que E inclut les pousses des terres et des nappes phratiques calcules comme
indiqu dans l' article 10 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 57 of 184
Figure 30 Reprsentations des actions permanentes
de longue dure
Le coefficient 1 est dfini dans la norme NF P 06-001 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 58 of 184
Figure 31 Variation du coefficient rducteur en
fonction de la priode de vibration
8.2 Scurit vis--vis des tats ultimes
Pour chaque section critique, il convient de vrifier que l'ingalit suivante est satisfaite :
Dans cette expression, S d reprsente la sollicitation agissante de calcul rsultant de la combinaison
dfinie en 8.1 et R d la sollicitation rsistante de calcul obtenue partir des valeurs caractristiques f mk des
rsistances des matriaux constitutifs.
Les coefficients m , coefficients de scurit partiels applicables aux rsistances de ces matriaux dans le
cas des situations sismiques, sont donns dans les articles relatifs aux matriaux concerns.
Le coefficient R reprsente symboliquement le coefficient de scurit partiel qui figure ultrieurement
dans le texte. Par dfaut, sa valeur est prise gale 1.
8.3 Scurit vis--vis des dformations
8.3.1 Limites de dformation
Il doit tre vrifi que les divers lments non structuraux, ainsi que leurs attaches la structure,
conservent leur rsistance et leur fonction lorsque la structure subit ses dformations maximales.
dfaut d'une telle justification, le dplacement diffrentiel d'entre deux niveaux conscutifs de hauteur h
d'un btiment, valu en tenant compte des effets du 2 e ordre gomtrique si ceux-ci sont significatifs ( cf.
6.6.1.5 ), est limit aux valeurs suivantes :
d' = h / 100 lorsqu'il y a des lments non structuraux constitus de matriaux fragiles et participant
pleinement la dformation de la structure ;
d' = 1,5 h / 100 lorsqu'il y a des lments non structuraux constitus de matriaux fragiles mais ne
participant pas la dformation de la structure du fait de la souplesse des liaisons.
Par ailleurs, il convient de s'assurer qu'il n'y a aucun risque de chute des lments de faade, compte tenu
des dformations imposes et des efforts exercs sur ces lments, ceux-ci tant valus conformment
l' article 15.2.2 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 8.3.1
Cette justification a pour objectif de minimiser le risque d'accident, par chute d'lments
secondaires.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 59 of 184
Figure 32 Dplacements du btiment
8.3.2 Espacements entre blocs ou ouvrages voisins
Deux blocs voisins doivent tre spars par des espacements rpondant aux conditions de 4.4.4 . Les
dplacements prendre en compte sont les dplacements maximaux (voir figure 33 ) ; ils doivent inclure
les dplacements conscutifs aux oscillations de torsion (voir figure 34 ) et, si la structure a t calcule
dans l'hypothse d'une rotation de sa fondation ou de ses points d'appui autour d'axes horizontaux, ceux
conscutifs ces rotations (voir figure 35 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 8.3.2
Il est rappel (voir 4.4.4.3) que la largeur des joints ne peut pas tre infrieure 4 cm en zones I a et
I b ni 6 cm en zones II et III.
Figure 33 Dplacement maximal entre blocs ou
ouvrages
Figure 34 Dplacement conscutif aux oscillations de
torsion
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 60 of 184
Figure 35 Dplacement relatif une rotation de la
fondation d'un ouvrage
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 61 of 184
9 Fondations
9.1 Liqufaction des sols
9.1.1 Dfinition
On appelle liqufaction d'un sol un processus conduisant la perte totale de rsistance au cisaillement du
sol par augmentation de la pression interstitielle. Elle est accompagne de dformations dont l'amplitude
peut tre limite ou quasi illimite.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.1.1
L'augmentation de la pression interstitielle s'effectue en gnral selon un processus cumulatif sous
l'effet de plusieurs cycles de dformations alternes. Elle peut, plus rarement, rsulter d'un seul
chargement monotone. L'amplitude des dformations peut tre limite par la dilatance des sols.
La perte de rsistance peut persister quelque temps au-del de la dure de l'action sismique.
9.1.2 Identification des sols liqufiables
9.1.2.1
Sont considrer comme a priori suspects de liqufaction, les sols ci-aprs :
a. Sables, sables vasards et silts prsentant les caractristiques suivantes :
degr de saturation S r voisin de 100 %,
granulomtrie assez uniforme correspondant un coefficient d'uniformit C u infrieur 15 :
C u = D 60 /D 10 < 15
diamtre 50 %, D 50 compris entre 0,05 mm et 1,5 mm,
et soumis en l'tat final du projet une contrainte verticale effective ' v infrieure aux valeurs
suivantes :
1. 0,20 MP a en zones I a et I b
2. 0,25 MP a en zone II
3. 0,30 MP a en zone III
b. Sols argileux prsentant les caractristiques suivantes :
diamtre 15 %, D 15 suprieur 0,005 mm,
limite de liquidit w L infrieure 35 %,
teneur en eau w suprieure 0,9 w L ,
point reprsentatif sur le diagramme de plasticit se situant au-dessus de la droite " A " dudit
diagramme.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.1.2.1 B)
Dans le diagramme classique limite de liquidit w L indice de plasticit I p , la droite dite " A " est la
droite d'quation :
I p = 0,73 (w L - 20)
9.1.2.2
Peuvent a contrario tre considrs comme exempts de risque :
a. les sols dont la granulomtrie prsente un diamtre 10 %, D 10 suprieur 2 mm ;
b. ceux dans lesquels on a simultanment :
D 70 < 74
I p > 10 %
9.1.2.3
Lorsque les indications de 9.1.2.1 et de 9.1.2.2 ci-dessus laissent apparatre une possibilit de
liqufaction, il y a lieu de procder des investigations complmentaires suivant les mthodes dcrites en
9.1.4 ci-aprs.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.1.2.3
Ces investigations complmentaires ont pour objet l'valuation de la contrainte de cisaillement
provoquant la liqufaction. Elles peuvent consister en essais in situ ou en essais de laboratoire.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 62 of 184
9.1.3 Donnes sismiques
Les donnes sismiques utiliser dans la conduite des essais et les tudes subsquentes sont les
suivantes :
acclration maximale de surface :
a N sur site de type S 1
0,9 a N sur site de type S 2
0,8 a N sur site de type S 3
o :
a N est l'acclration nominale (voir 3.3 ) ;
nombre de cycles quivalents n :
Tableau 8 Nombre de cycles quivalents selon les
zones de sismicit
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.1.3
Les cycles quivalents sont par convention des cycles harmoniques produisant des contraintes
maximales de cisaillement gales 0,65 fois la contrainte maximale dveloppe dans le sol par le
sisme. On considre que, du point de vue de la liqufaction, l'action de n cycles quivalents
produit les mmes effets que ceux d'un sisme rel. Le nombre de cycles quivalents dpend de la
magnitude M S (qui s'entend comme la magnitude dtermine sur les ondes de surface), ou de la
dure du sisme.
A titre indicatif, cette magnitude M S peut tre prise gale :
6 en zone I
7 en zone II
8 en zone III
9.1.4 Mthodes d'essai
9.1.4.1 Essais de laboratoire
1. Les essais suivants peuvent tre utiliss :
essai cyclique l'appareil triaxial ;
essai cyclique la bote de cisaillement parois latrales mobiles ;
essai cyclique de cisaillement par torsion.
Ils doivent porter sur des chantillons non remanis.
2. Il peuvent tre conduits selon les mthodes usuellement suivies sous rserve que soient respectes
les conditions ci-aprs :
les essais doivent tre poursuivis jusqu' liqufaction des prouvettes et ceci sous diverses
valeurs de la contrainte maximale de cisaillement ;
la pression de confinement doit rester voisine de celle rgnant au niveau du prlvement l'tat
final du projet ;
le degr de saturation de l'prouvette doit tre gal celui du sol en place dans les conditions
du projet.
Les rsultats doivent en outre faire clairement apparatre :
les variations de la pression interstitielle mesure au sein de l'prouvette et des dformations de
cette dernire en fonction du nombre de cycles appliqus ;
le volume final de l'prouvette aprs dissipation de la pression interstitielle.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.1.4.1.1
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 63 of 184
La prservation de toutes les caractristiques physiques et mcaniques des sols (principalement
leur structure et leur densit en place) au cours du prlvement et des manipulations ultrieures est
essentielle pour la crdibilit des rsultats. Elle exige des prcautions trs particulires tant au
niveau du mode de prlvement (carottage en gros diamtre, choix du carottier et du fluide de
forage, etc.) qu' celui du transport, de la conservation et de la prparation des chantillons.
Les modes opratoires concernant ces essais ne sont pas encore normaliss. En attendant que
cette normalisation intervienne, on peut se baser sur une tude de la littrature spcialise.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.1.4.1.2
Pour atteindre cet tat, on prend soin reproduire en laboratoire le chemin de contrainte suivi in
situ entre l'tat initial et l'tat final du projet.
9.1.4.2 essais in situ
Les essais de pntration in situ du type dynamique , essais SPT (Standard Penetration Test) ou statique
(pntration d'un cne ou d'un pizocne) peuvent tre utiliss pour le diagnostic des sols liqufiables
lorsqu'il existe pour le type d'appareil utilis des corrlations bien tablies entre les indications de l'essai et
la liqufaction ou la non-liqufaction des sols.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.1.4.2
Ces corrlations sont tablies pour diverses valeurs de la magnitude. Il convient de veiller la
nature de la magnitude utilise (M S ou M L ) et de faire le cas chant la correction ncessaire.
Les corrlations actuellement disponibles ont t tablies l'origine avec l'essai SPT. Les critres
de liqufaction correspondants ont fait l'objet de transpositions d'autres essais en place comme
l'essai au pntromtre statique dont l'usage est plus rpandu en France.
La mesure en continu de l'volution de la pression interstitielle provoque par le dispositif d'essai
la profondeur considre peut faciliter ou valider le diagnostic. Cette mesure peut tre ralise
l'aide d'essais en place tels que le pizocne.
9.1.5 Critre de liqufaction
Doivent tre considrs comme liqufiables en champ libre sous le sisme de calcul, les sols au sein
desquels la valeur des contraintes de cisaillement engendres par le sisme dpasse 75 % de la valeur
de la contrainte de cisaillement provoquant la liqufaction, pour le nombre de cycles quivalents n dfini
en 9.1.3 .
La contrainte effective verticale ' v prendre en compte est celle rgnant dans le sol aprs ralisation du
projet.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.1.5
Outre la rduction de la rsistance au cisaillement et de la capacit portante des sols considrs, le
processus de liqufaction conduit des dformations temporaires ou permanentes des sols
pouvant entraner l'atteinte d'un tat limite dans l'ouvrage tudi.
L'attention est particulirement attire sur le dernier alina du paragraphe 9.1.5 : l'tat final
considr est celui qui peut rsulter d'un abaissement dfinitif du niveau du terrain naturel, d'une
remonte de la nappe imputable aux travaux raliss, etc.
9.1.6 Traitement des sols ou de la construction
Lorsque les essais font apparatre une scurit insuffisante vis--vis de la liqufaction au sens du
paragraphe 9.1.5 , la construction ne peut tre entreprise sauf justification technique particulire, que dans
l'une des hypothses ci-dessous :
9.1.6.1 Traitement du sol
On fait subir au sol un traitement propre liminer les risques de liqufaction ou rtablir la marge de
scurit prvue au 9.1.5 . Il y alors lieu de justifier les mesures proposes et d'en contrler l'efficacit par
des essais et mesures appropris.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.1.6.1
Pour certains sols pulvrulents denses dont le comportement doit tre justifi vis--vis de sismes
de forte intensit, il peut s'avrer difficile de rtablir la marge de scurit prvue au paragraphe
9.1.5 , alors mme que leur comportement dilatant limite leurs dformations en cas de liqufaction.
Dans ce cas, les risques attachs la liqufaction de ces terrains sont apprcis par rfrence aux
dformations cycliques que l'on peut attendre et tenant compte bien sr de la nature de l'ouvrage
projet.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 64 of 184
Les procds gnralement utiliss pour liminer ou rduire les risques de liqufaction sont,
suivant les cas :
rabattement permanent du niveau de la nappe ;
densification du milieu liqufiable (prchargement, compactage, vibroflottation, etc.) ;
modification des proprits du milieu par injection, etc. ;
constitution de colonnes drainantes limitant l'lvation des pressions interstitielles ;
substitution aux sols liqufiables de matriaux de caractristiques physiques appropries
convenablement compacts.
Le mode de fondation doit tre adapt aux nouvelles conditions ainsi cres.
9.1.6.2 Renforcement des fondations
L'ouvrage tant fond sur des fondations profondes appuyes en pointe au-dessous des couches
liqufiables, les fondations profondes sont calcules, notamment en ce qui concerne leur flambement au
sein des milieux liqufis, compte tenu des charges additionnelles apportes par les couches suprieures.
9.2 Stabilit des pentes
9.2.1 Principes gnraux
9.2.1.1 Hypothses et donnes
Il doit tre vrifi que les talus et versants, naturels ou artificiels, restent stables sous l'action du
mouvement de calcul compte tenu des charges apportes par les constructions, et dans leur configuration
dfinitive.
Le mouvement sismique considrer est celui qui correspond la plus leve des classes de risques
auxquelles appartiennent les ouvrages affects par le glissement ou menacs par lui.
La classe de risque envisager doit alors tre prcise dans les documents particuliers du march.
9.2.1.2 Justification
La justification peut tre apporte par toute mthode scientifiquement tablie et confirme par
l'exprience. A dfaut, et pour les matriaux dont la rsistance n'est pas significativement affecte par la
vibration sismique, elle peut tre conduite selon les mthodes usuelles de la mcanique des sols dans les
conditions dfinies au paragraphe 9.2.2 .
9.2.2 Coefficients sismiques
La vrification peut tre effectue partir d'un modle statique quivalent rsultant de l'application tous
les lments du sol et des charges supportes de deux coefficients sismiques H et v dfinissant
respectivement les forces horizontales contenues dans les plans verticaux de plus grande pente et
diriges vers l'aval, et les forces verticales descendantes ou ascendantes.
Ces coefficients sont donns dans le tableau 9 .
Tableau 9 Coefficients sismiques
o :
a N est l'acclration nominale (voir 3.3 ).
Les catgories de sites sont dfinies en 5.2.2 et la hauteur de la couche considre s'entend comme la
hauteur du substratum la crte du talus et les combinaisons suivantes sont tudier :
a. H , v ;
b. H , - V .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.2.2
Le coefficient sismique est dfini au paragraphe 6.1.3 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 65 of 184
Figure 36 Reprsentation des combinaisons tudier
On peut remarquer que l'application des coefficients H et v quivaut une rotation du champ de
pesanteur d'un angle :
l'intensit du champ de pesanteur g tant remplace par l'intensit fictive :
9.2.3 Caractristiques mcaniques des sols
Pour les sols non cohrents, le paramtre considrer dans les calculs d'quilibre est l'angle de
frottement interne .
Pour les sols cohrents, ces paramtres sont la cohsion C u et l'angle de frottement interne u
correspondant aux conditions non draines.
9.2.4 Vrification de stabilit
L'quilibre du massif dlimit par la surface de glissement la plus critique doit tre vrifi compte tenu de
l'application aux rsistances des sols concerns d'un coefficient de scurit partiel gal :
s= 1
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.2.4
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 66 of 184
Figure 37 Surface de glissement la plus critique
Les surfaces de glissement les plus critiques sont le plus souvent dlimites l'intrieur d'une zone
d'influence dfinie par le schma ci-dessus (ligne en tiret).
9.3 Dispositions techniques concernant les ouvrages de fondation
9.3.1 Liaisons
9.3.1.1 Solidarisation des points d'appui
1. Les longrines de solidarisation ou les lments remplissant le mme office prvus en 4.3.3 et 4.3.4 ,
ainsi que les lments d'ossature concourant l'quilibre, doivent tre calculs en supposant les
points d'appui runis par la longrine concerne soumis des forces horizontales centres opposes
dans un sens puis dans l'autre (voir figure 38 ), gales :
F = a N /g W 20 kN
o :
a N est l'acclration nominale (voir 3.3 ) ;
est le coefficient d'amplification topographique (voir 5.2.4 ) ;
W est la moyenne des valeurs des charges verticales apportes par les points d'appui relis par la
longrine considre ;
est un coefficient dpendant de la nature du sol telle que dfinie en 5.2.1 , et gal :
0,3 dans les sols de catgorie a ;
0,4 dans les sols de catgorie b ;
0,6 dans les sols de catgorie c.
Les sollicitations rsultant de la prise en compte des forces F sont ajouter celles rsultant d'autres
fonctions.
2. Les poutres du plancher infrieur d'une construction ne peuvent tre considres comme jouant le
rle de longrines que si elles sont situes une distance de la sous-face des semelles ou massifs
sur pieux infrieure 1,20 m. Le cas chant, un dallage peut remplacer les longrines lorsqu'il
respecte la rgle ci-dessus.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.3.1.1.1
Par exemple : la fonction de longrine de redressement.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 67 of 184
Figure 38 Exemple de solidarisation des points d'appui
9.3.2 Fondations profondes
9.3.2.1 Dispositions gnrales
1. Les rgles s'appliquent aux types de fondations profondes suivantes :
pieux en bton moul dans le sol ainsi qu'aux pieux excuts la tarire creuse,
barrettes en bton moul dans le sol,
pieux battus prfabriqus en bton arm,
pieux battus mtalliques tubulaires, pieux H, caissons de palplanches ou palplanches,
micropieux et pieux injects sous pression.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.3.2.1.1
Les inclusions d'amlioration des sols (par exemple clouage, pieux-aiguilles) peuvent
comporter des lments inclins.
2. L'emploi de fondations profondes inclines est interdit.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.3.2.1.2
Les groupes de pieux doivent dlimiter en plan un contour convexe aussi rgulier que possible
centr sur la verticale du point d'appui.
3. Des longrines de solidarisation formant un rseau bi-directionnel et conformes aux prescriptions du
paragraphe 9.3.1.1 doivent tre disposes dans le cas d'appui reposant sur des pieux isols, des
groupes de deux pieux, et plus gnralement dans le cas de groupes de pieux dlimitant en plan un
contour dont l'une des dimensions est faible par rapport l'autre.
De telles liaisons sont prvoir aussi dans le cas des barrettes, moins que ces dernires ne forment en
plan un rseau continu dans les deux directions.
9.3.2.2 Pieux en bton moul dans le sol et pieux excuts la tarire creuse
Ils doivent tre arms sur toute leur longueur de la manire indique ci-aprs :
a. Armatures longitudinales
nombre minimal de barres : 6
diamtre minimal : 12 mm
section totale rapporte la section nominale du pieu :
minimum :
sols de type a ou b 0,5 %
sols de type c 0,6 %
maximum : 3 %
b. Armatures transversales
Elles doivent tre composes de spires et/ou de cerces rpondant aux conditions ci-aprs :
diamtre minimal : 6 mm
pourcentage minimal en volume :
0,6 % en partie courante
0,8 % en zone critique
Dans la zone critique des pieux, les spires sont proscrites.
La mise en place d'pingles et de cadres en complment des cerces est autorise dans le
cas de pieuxde diamtre important ( > 1m).
Sauf dispositions techniques spciales, est considre comme zone critique, en raison des courbures que
les pieux sont exposs y subir, la partie suprieure des pieux sur une longueur gale 2,5 fois leur
diamtre nominal.
Dans le cas d'une couche de sol dont les caractristiques de rsistance sont fortement diminues par la
sollicitation sismique, la longueur de la zone critique doit tre prise gale la hauteur de cette couche,
augmente de 2,5 fois le diamtre nominal.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 68 of 184
Dans le cas o le bton est mis en place dans une chemise ou une gaine mtallique abandonne dans le
sol aprs coulage, la section d'acier de cette chemise ou de cette gaine peut, dfalcation faite de
l'paisseur de mtal susceptible de se corroder pendant la dure de vie de l'ouvrage, tre prise en compte
dans l'valuation de la quantit d'armatures transversales dfinies ci-dessus sans avoir cependant pour
effet de rduire ces armatures de plus de 50 %.
Les armatures transversales polygonales ne sont pas autorises pour les pieux excuts la tarire
continue.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.3.2.2
La classification des sols voque dans ce paragraphe est celle qui figure au tableau 2 figurant en
note sur le paragraphe 5.2.1 .
9.3.2.3 barrettes en bton moul dans le sol
Les prescriptions qui suivent concernent les lments faisant partie d'un ensemble comportant des
barrettes places orthogonalement (ou dans des directions convenables) et constituant un systme
complet de fondation.
Les barrettes isoles plates, dont la dformation latrale n'est pas limite par leur disposition d'ensemble,
doivent tre armes en suivant les mmes prescriptions que celles dictes en 9.3.2.2 pour les pieux de
section circulaire.
Les barrettes doivent tre armes sur chacune de leurs grandes faces d'un quadrillage d'armatures
horizontales et verticales l'espacement maximal de 35 cm.
La section totale des armatures verticales doit tre suprieure 0,5 % de la section horizontale des
barrettes lorsque celle-ci est infrieure 1 m et 0,25 % de cette section lorsque celle-ci est suprieure
2 m ; elle doit tre au moins gale 50 cm dans le cas intermdiaire. Dans tous les cas elle ne doit pas
excder 3 %.
Les armatures horizontales doivent tre dessines de faon assurer leur participation la rsistance aux
efforts tranchants agissant suivant la grande dimension horizontale de la barrette et s'opposer au
flambement des armatures verticales disposes sur les petites faces ; dfaut, elles doivent tre
compltes par une armature approprie.
Les deux nappes doivent tre relies par des armatures transversales susceptibles, en autres fonctions,
de s'opposer au flambement des armatures comprimes.
La section des armatures horizontales doit tre au moins 0,1 % de la section verticale transversale des
barrettes.
Les armatures transversales doivent reprsenter un pourcentage d'au moins 0,1 % de la section verticale
longitudinale
des barrettes.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.3.2.3
Dans ce cas, on entend par " diamtre ", l'paisseur nominale des barrettes.
9.3.2.4 Puits
a. Dfinition
On dsigne par puits une colonne en bton creuse la main et reportant les charges verticales sa
base, dont l'lancement (hauteur/diamtre) est compris entre 4 et 6 et dont le diamtre est au moins
gal 120 cm.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.3.2.4 A)
Il est gnralement excut la main avec blindage ventuel.
On appelle " fondations semi-profondes ", les fondations non superficielles et dont
l'lancement est infrieur 6.
Dans le cas de puits de forme non circulaire, on se rattache au puits de section circulaire
quivalente.
b. Dispositions constructives
armatures longitudinales :
nombre minimal de barres : 8
diamtre minimal : 12 mm
pourcentage minimal : > 0,3 %
tant la section totale rapporte la section nominale B du puits.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 69 of 184
armatures transversales :
elles sont constitues par des spires ou des cerces rpondant aux conditions ci-aprs :
diamtre minimal : Max [ 1 / 3 ; 8 mm]
pourcentage minimal en volume : 0,2 %
espacement maximal des spires ou cerces :
S' = 12 fois le diamtre des barres longitudinales en zone courante
S' = 10 cm en zone critique en considrant comme zone critique la partie suprieure
et infrieure des puits de longueur gale deux fois leur diamtre nominal.
S' est l'espacement maximal nu nu des cerces.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.3.2.4 B)
Les dispositions constructives minimales ne concernent pas les fondations semi-profondes.
Dans le cas d'une couche de sol dont les caractristiques de rsistance sont fortement diminues par la
sollicitation sismique, la longueur de la zone critique doit tre prise gale la hauteur de cette couche,
augmente de deux fois le diamtre nominal.
Dans le cas o le bton est mis en place dans une gaine mtallique abandonne dans le sol aprs
coulage, la section d'acier de cette chemise ou de cette gaine peut, dfalcation faite de l'paisseur de
mtal susceptible de se corroder pendant la dure de vie de l'ouvrage, tre prise en compte dans
l'valuation de la quantit d'armatures transversales dfinies ci-dessus sans avoir cependant pour effet de
rduire ces armatures de plus de 50 %.
9.3.2.5 Pieux de fondation prfabriqus en bton arm
La section totale des armatures longitudinales des lments de fondation prfabriqus en bton arm doit
tre au moins gale 1 % de la section droite de ces lments et infrieures 3 % de cette section.
Toutes les autres dispositions relatives au nombre minimal de barres et aux armatures transversales
spcifies en 9.3.2.2 et 9.3.2.3 restent applicables ces lments prfabriqus selon leur forme.
9.3.2.6 Pieux battus mtalliques tubulaires, pieux H, caissons de palplanches ou palplanches
Ce type de fondations doit se conformer pour les dispositions constructives, la mise en oeuvre et le calcul,
aux rglementations en vigueur.
La liaison la structure doit raliser un encastrement effectif du pieu dans cette structure. Cette dernire
doit tre conue pour rsister tout clatement dans cette zone d'encastrement (voir figure 39 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.3.2.6
Figure 39 Exemple de pieux
9.3.2.7 Micropieux et pieux injects sous pression
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 70 of 184
Les recommandations s'appliquent des micropieux de type II, III, IV de diamtre de forage infrieur
250 mm, ainsi qu'aux pieux injects sous faible ou haute pression de diamtre suprieur 250 mm, battus
ou fors.
La liaison la structure doit raliser un encastrement effectif du micropieu dans cette structure. Cette
dernire doit tre conue pour rsister tout clatement dans cette zone d'encastrement. L'encastrement
de la tte des micropieux et de pieux injects dans les longrines de couronnement doit respecter les
critres dfinis en 9.3.2.6 .
Les micropieux ou pieux injects doivent comporter, sur toute la hauteur d'une couche de sol dont les
caractristiques peuvent tre affectes par les sismes, une section largie qui doit tre justifie comme
un pieu, rsultant de la mise en place d'une chemise perdue (voir figure 40 ). Ce type de solution doit
assurer la transmission des efforts de la section largie la section courante.
L'encastrement de la partie largie dans le sol rput non liqufiable, est d'au moins 2,5 diamtres D g .
La section d'acier du chemisage dans la partie largie, dfalcation faite de la corrosion, peut tre prise en
compte dans les calculs.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.3.2.7
Figure 40 Exemple d'encastrement dans le sol
9.4 Calcul des fondations profondes
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.4
Par fondations profondes, on entend les fondations numres au 9.3.2.1.
9.4.1 Principes gnraux
9.4.1.1 Hypothses et conditions
Le calcul doit tenir compte des rductions ou pertes de rsistance que certains des sols traverss peuvent
subir pendant et aprs le mouvement sismique, pour tous les types de fondations profondes numrs au
paragraphe 9.3.2.1 .
Il doit galement prendre en compte, lorsqu'il y a lieu, les frottements ngatifs ou les pousses latrales
engendres par le tassement que certaines des formations traverses peuvent subir du fait des vibrations
sismiques.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 71 of 184
Au sein du volume de sol sollicit par le systme de fondation, les zones reconnues comme susceptibles
de se liqufier doivent tre soit traites, soit prises en considration comme spcifi en 9.1.6.2 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.4.1.1
Ces rductions concernent aussi les sols structures particulires tels que loess, sols affaissables,
coralliens, certaines argiles trs sensibles. Si c'est le cas, il faut tenir compte des caractristiques
rsiduelles.
9.4.1.2 vrifications
Il doit tre vrifi pour tous les types de fondations numres au paragraphe 9.3.2.1 qu'elles sont aptes
supporter les charges verticales, y compris celles engendres par l'action sismique, dans l'tat de
dformation rsultant de l'action combine du sol et de la structure porte.
Dans le cas d'lments en bton arm, leur section et leur ferraillage doivent tre tels que leurs tats
limites de rsistance ne correspondent pas une rupture fragile.
9.4.2 Mthodes de calcul
9.4.2.1 Mthode gnrale
Les actions apportes par la structure sur les fondations rsultent de l'application du paragraphe 8.1 .
Cependant, dans la limite des conditions de validit imparties, les structures fondes sur fondations
profondes peuvent tre calcules conformment aux dispositions du paragraphe 9.4.2.2 ci-aprs.
Il faut vrifier que tous les types de fondations satisfont aux conditions de non-rsonance dfinies en
9.4.2.2.3 .
Tous les types de fondations profondes doivent tre vrifis au flambement.
Les fondations profondes implantes en sites liqufiables et les micropieux doivent tre vrifis au
flambement.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.4.2.1
a. il faut entendre par paramtre de portance :
le facteur de pointe permettant de calculer la rsistance de pointe ;
le frottement latral unitaire limite.
b. Dans le but de justifier le dimensionnement des fondations profondes mises en oeuvre dans
des sols dont le comportement est mal connu, cas des sols coralliens par exemple ou ne
figurant pas dans la rglementation, on peut recourir aux publications ayant un lien avec le
sujet.
Si ncessaire, il faut procder des essais de chargement en vraie grandeur avec, si
possible, instrumentation des fts pour dterminer la distribution des efforts.
c. La vrification au flambement peut tre effectue en s'inspirant de la mthode propose par
MANDEL (Le flambage en milieu rsistant lastique - Mmoires et documents n 25 - T 532)
ou des travaux exprimentaux en relation avec le sujet, publis dans la littrature technique.
9.4.2.2 Mthode simplifie pour le calcul des constructions sur fondations profondes
9.4.2.2.1 Domaine de validit
Les conditions suivantes doivent tre simultanment satisfaites :
a. Les fondations profondes doivent avoir dans toutes les directions horizontales une flexibilit
suffisante pour qu'elles ne dveloppent avec le sol qu'une interaction modre et que leur dforme
puisse tre valablement assimile la dforme du sol.
En outre, la section totale des fondations profondes doit reprsenter au plus 5 % de l'emprise qu'elle
dlimite et la structure doit prsenter, proximit de la tte des fondations, un diaphragme horizontal
de rigidit suffisante pour uniformiser les dplacements de ces dernires.
b. La structure doit tre suffisamment encastre dans le sol pour qu'on puisse considrer que les
dplacements de sa base s'identifient ceux du sol situ dans son emprise.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.4.2.2.1
A dfaut d'un encastrement suffisant, il doit tre dispos la priphrie de la construction une
bche de profondeur et de rigidit suffisantes pour remplir le mme office.
A dfaut de ces dispositions, l'interaction inertielle, alors prpondrante dans le dimensionnement
des pieux, doit tre prise en compte.
9.4.2.2.2 calculs
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 72 of 184
a. La structure est soumise aux actions sismiques de calcul correspondant au site.
b. Les fondations profondes sont calcules partir du premier mode de vibration du sol en champ libre
et en tenant compte de leurs conditions de liaison avec la structure (articulation ou encastrement), ce
qui peut conduire une redistribution des sollicitations initiales.
Dans le cas d'un sol de profil homogne d'paisseur H, on peut admettre que la dforme du sol est un
quart de sinusode dfini par le dplacement maximal la surface (voir figure 41 ), soit :
d max = a N ( / G) (2H/)
avec :
= 1 en site de type S 1 ;
= 0,9 en site de type S 2 ;
= 0,8 en site de type S 3 ;
o :
p est la masse volumique du sol ;
G est le module de rsistance du sol au cisaillement.
La valeur du module de cisaillement du sol doit tre compatible avec le niveau moyen de dformation
induit par le sisme. A dfaut de justification particulire, cette valeur peut tre obtenue partir de la
valeur du module tangent G max en la multipliant par le coefficient rducteur suivant, fonction de
l'acclration nominale a N :
Tableau 10 Coefficient rducteur
Dans le cas d'un profil stratifi dans lequel les caractristiques mcaniques varient peu d'une couche
l'autre, et dfaut d'un calcul plus labor, la valeur de d max peut tre value en remplaant dans
l'expression ci-dessus, p respectivement par :
o :
H i , i , G i reprsentent les paramtres relatifs la couche i.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.4.2.2.2
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 73 of 184
Figure 41 Dforme du sol
Dans le cas d'un profil homogne, la dforme du sol et le dplacement d max sont ceux qui sont
donns par la thorie. Ils correspondent une priode fondamentale de :
o :
V S est la vitesse des ondes de cisaillement.
Dans le cas d'un profil stratifi, cette priode peut tre considre comme gale :
Dans les zones de faible moyenne sismicit, les dispositions constructives minimales spcifies
en 9.3.2.4 permettent de se dispenser de ces vrifications.
9.4.2.2.3 rsonance
Il doit en outre tre vrifi que les fondations profondes n'entrent pas en rsonance avec la colonne de
sol. Cette condition est rpute satisfaite si la quantit suivante :
(T s /T i ) est soit infrieure 0,64, soit suprieure 1,56.
o :
T s est la priode fondamentale de la couche du sol ;
T i est la priode fondamentale du mouvement de tamis de l'ensemble de la structure fondation, calcule
en supposant le sol immobile.
Si la condition prcdente n'est pas satisfaite, les fondations doivent tre calcules par toute mthode
d'interaction sol-structure scientifiquement tablie.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.4.2.2.3
La condition de non-rsonance est particulirement importante dans le cas de fondations profondes
de type rigide, telles que les barrettes (voir 9.3.2.3 ) ou les puits (voir 9.3.2.4 ), situes en zone de
forte sismicit.
Lorsque les conditions suivantes sont remplies :
la fondation est constitue de pieux encastrs en tte et articuls en pied, suffisamment
souples pour que l'on puisse ngliger la dformation d'effort tranchant,
l'effet de groupe est ngligeable,
le sol est homogne,
la structure est notablement plus rigide que la fondation, la quantit (T s /T i ) peut tre
calcule par la formule :
o :
El est la rigidit de flexion du pieu (produit du module d'Young par l'inertie de la section)
S est la section du pieu
p est la contrainte verticale statique qui s'exerce sur le pieu
g est l'acclration de la pesanteur
k est un facteur numrique qui dtermine le coefficient de ballast du sol (raideur par unit de
longueur de pieu) pris gal kG. Les valeurs de k varient gnralement entre 2 et 4
, G et H sont dfinis comme au b) de 9.4.2.2.2
Parmi les conditions de validit de cette formule, l'attention est particulirement attire sur celle
relative l'effet de groupe , qui peut tre importante pour des groupes denses de pieux.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 74 of 184
9.5 Vrification de la force portante
9.5.1 Fondations superficielles
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.5.1
Les notations symboliques G, Q, E sont prcises au paragraphe 8.1
9.5.1.1 Sollicitations
Les fondations superficielles sont dimensionnes en conformit avec le DTU 13.11 mais avec les
sollicitations complmentaires suivantes :
S u1= G + Q E
S u2= G E
compte tenu de l'application la rsistance ultime du sol q u d'un coefficient de scurit partiel de 1,5.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.5.1.1
Le coefficient de scurit partiel de 1,5 remplace le coefficient de scurit partiel de 2 retenu dans
le DTU 13.11 pour les situations non sismiques.
Dans le cas particulier de certains sols sensibles aux vibrations, l'attention est attire sur le fait que
la rsistance ultime q u peut tre diffrente de celle retenue pour les vrifications sous combinaisons
d'actions en situation non sismique.
9.5.1.2 Etat limite de glissement sous la base de la fondation
Les vrifications doivent tre effectues en tenant compte de l'application la rsistance ultime au
glissement calcule sur la partie comprime du sol d'un coefficient de scurit partiel de 1,2 au lieu de 1,5.
9.5.2 Fondations sur pieux-puits et sur barrettes
Les sollicitations rsistantes des pieux appuys en pointe des puits et des barrettes sont values compte
tenu des coefficients de scurit partiels suivants :
termes de pointe pour pieux fors : = 2
termes de pointe pour pieux battus : = 1,5
termes de frottement latral : = 1,5
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.5.2
Le coefficient de 2 au lieu de 1,5 couvre les alas lis aux difficults d'excution.
9.5.3 Fondations sur pieux flottants
Les sollicitations rsistantes sont values dans les mmes conditions que ci-dessus, sauf en ce qui
concerne les termes de frottement latral qui doivent tre valus compte tenu d'un coefficient partiel de
2,0.
9.6 Fondations sur sols substitus compacts
9.6.1 Domaine d'application
Les prescriptions qui suivent ne sont applicables qu'aux remblais artificiels difis en site terrestre,
ventuellement destins supporter des constructions. Elles peuvent tre, par drogation, tendues aux
remblais difis en site maritime tant que leur hauteur reste infrieure ou gale 10 m.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.6.1
Le cas des remblais de grande paisseur, difis en site maritime, pose le problme la fois de la
mise en oeuvre du matriau (mise en place, compactage) et du contrle aprs ralisation ; ces
oprations ncessitent des techniques spciales.
9.6.2 Dispositions gnrales
9.6.2.1 conception
Les remblais artificiels doivent tre conus de faon assurer le confinement latral des matriaux mis en
place :
1. soit par un encagement convenable dans une masse suffisante de terrain naturel ;
NOTE SUR 1) DU PARAGRAPHE 9.6.2.1
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 75 of 184
C'est gnralement le cas lors de la substitution d'une certaine paisseur de sols naturels de
qualit mdiocre par des matriaux de meilleures caractristiques.
2. soit par la mise en oeuvre d'ouvrages de soutnement reportant efficacement les contraintes de
confinement sur les sols en place ;
3. soit par la mobilisation mcanique d'une certaine surlargeur sur le contour de ces remblais
uniquement destine assurer ce confinement.
NOTE SUR 3) DU PARAGRAPHE 9.6.2.1
Cette prescription implique le maintien et l'entretien de cette surlargeur en toute circonstance.
9.6.2.2
Les matriaux mettre en oeuvre doivent tre slectionns de faon possder, dans les conditions de
service du remblai, un comportement satisfaisant sous l'action sismique envisage.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.6.2.2
Par condition de service des remblais, on entend les conditions prvalant aprs achvement des
travaux : position de la nappe par exemple.
Le comportement sismique satisfaisant est assur si les pertes de rsistance ultime sont
ngligeables, le risque de liqufaction cart, les tassements sous sollicitation sismiques limits.
Cette prescription implique un contrle en continu de la qualit des matriaux approvisionns.
9.6.2.3
Les techniques de mise en place et de compactage doivent permettre d'assurer un comportement
sismique satisfaisant et l'obtention des caractristiques mcaniques requises.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.6.2.3
L'attention est plus particulirement attire sur les risques de dformations irrversibles induites par
la sollicitation sismique : tassement, affaissement latral en l'absence de confinement structural.
Ces dformations peuvent tre limites par un compactage appropri.
Cette prescription implique un contrle de la mise en oeuvre et un contrle gotechnique " a
posteriori " du remblai dans sa globalit au moyen d'essais en place appropris.
9.6.3 Principes gnraux de justification
Il doit tre vrifi que les remblais sont aptes supporter toutes les sollicitations provenant :
a. des actions dynamiques en cours de sisme dues :
la dformation propre des sols supports ;
aux constructions portes ;
et leurs interactions.
b. des actions statiques aprs sisme.
Les vrifications de stabilit des lments de confinement doivent tre conduites selon les mthodes
figurant aux paragraphes 9.2 , 9.4 , et 9.5 .
9.7 Prise en compte de l'interaction sol-structure
Les justifications donnes dans le prsent document sont bases sur la non-prise en compte de
l'interaction sol-structure.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 9.7
La prise en compte de l'interaction sol-structure dans le cadre d'tudes particulires doit amener
reconsidrer et justifier toutes les dispositions et valeurs numriques prconises dans ces
rgles.
L'interaction sol-structure peut tre prise en compte dans le cadre de la mthode envisage au
paragraphe 6.6.2.1 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 76 of 184
10 Parois d'infrastructure et ouvrages de soutnement
10.1 Rgles gnrales
10.1.1 Mthodes de calcul
Les parois d'infrastructure des btiments formant soutnement peuvent tre justifies sous sollicitation
sismique suivant toute mthode scientifiquement fonde et valide par l'exprience.
A dfaut, les mthodes simplifies nonces au paragraphe 10.2 , bases sur la considration de
systmes statiques de forces quivalentes, peuvent tre utilises.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 10.1.1
Les parois d'infrastructure sont constitues par les murs ou voiles priphriques des sous-sols des
btiments : comme elles s'appuient contre les planchers du btiment, ces parois sont considres
comme indplaables.
10.1.2 Acclrations nominales
L'acclration nominale applicable l'ouvrage est fixe d'aprs les indications de 3.3 en fonction de
l'importance de l'ouvrage pour la scurit des personnes et de la continuit des services.
10.1.3 Coefficients sismiques
Pour l'utilisation des mthodes simplifies, il est pris en compte des coefficients sismiques horizontaux h
et verticaux v , uniformes pour toutes les parties de l'infrastructure et du massif retenu (y compris le cas
chant les charges d'exploitation prsentes sur ce dernier) et dfinissant respectivement des forces
horizontales perpendiculaires l'ouvrage diriges vers l'cran et des forces verticales descendantes ou
ascendantes (voir figure 42 ).
Ces coefficients sont, s'il y a lieu, multiplis par le coefficient topographique dfini en 5.2.4 et sont dfinis
ci-dessous :
h = K a N /g
v = 0,3 h
o :
a N est l'acclration nominale (voir la note au paragraphe 3.3 ) ;
est le coefficient topographique (voir 5.2.4 ) l'aplomb du mur avant tablissement du soutnement ;
K est un coefficient compris entre 1 et 1,2 suivant qu'il s'agit de pousse active ou de pousse de terre au
repos.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 10.1.3
Figure 42 Coefficients sismiques
Dans la figure 42 , W s reprsente le poids du sol.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 77 of 184
10.2 Mthode de calcul simplifie
10.2.1 Forces prenant naissance dans l'ouvrage
Ces forces sont dtermines par application aux diverses parties de l'ouvrage des acclrations dfinies
plus haut.
10.2.2 Pousse active due au terrain
Les diffrents paramtres gomtriques et gotechniques pris en compte dans le calcul d'un mur de
soutnement sont illustrs la figure 43 .
La pousse active dynamique globale qui s'exerce sur la paroi est prise gale :
P ad = 1/2H (1 v ) K ad
o :
K ad est le coefficient de pousse dynamique active et s'exprime par la relation :
o :
est le poids volumique du sol humide non djaug ;
est l'angle de flottement interne du terrain soutenu ;
H est la hauteur de la paroi ;
est l'angle du terre-plein avec l'horizontale ;
est l'angle de frottement terrain/paroi, pris gal zro ;
h est le coefficient sismique horizontal (pourcentage de g) ;
v est le coefficient sismique vertical (pourcentage de g) ;
= arctg( h /1 v ) est l'angle apparent avec la verticale de la rsultante des forces des masses
appliques au remblai contenu par le mur sous excitation sismique.
L'angle doit tre limit dans l'expression de K ad , la valeur de l'angle de frottement
A dfaut de justification plus prcise, il est admis que la pousse dynamique globale s'exerce mi-hauteur
de la paroi. La cote du point d'application de la pousse spcifie ci-avant indique que les pressions
correspondantes obissent une rpartition uniforme.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 10.2.2
La mthode envisage consiste considrer chaque particule de sol comme soumise aux forces
suivantes :
l'acclration de la pesanteur,
l'acclration horizontale due au sisme,
l'acclration verticale due au sisme.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 78 of 184
Figure 43 Pousse dynamique
Figure 44 Diagramme de composition des forces au
centre de gravit
Le poids apparent de la particule (diminu de la pousse d'Archimde quand il y a lieu) fait alors
avec la verticale un angle tel que :
= arctg( h / 1 v )
et son intensit a pour valeur :
(1 v /cos )
Le principe de la mthode consiste faire subir fictivement l'ensemble mur-sol une rotation telle
que le poids apparent du sol devienne vertical, et appliquer ce poids apparent vertical les
formules classiques de COULOMB ou les tables usuelles de pousses et butes (CAQUOT et
KERISEL).
La mthode simplifie indique est connue sous le nom de mthode de MONONOBE-OKABE.
10.2.3 Raction passive due au terrain
Lorsqu'il est ncessaire de prendre en compte une raction passive du terrain pour assurer l'quilibre
d'ensemble d'un ouvrage possdant une infrastructure, cette raction ne doit pas tre suprieure :
P pd = 1/2 H
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 79 of 184
L'obliquit de cette raction doit tre prise gale zro, et il est admis que la raction passive globale
s'exerce au tiers de la hauteur de la fiche de la paroi.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 10.2.3
La raction passive est souvent dsigne sous le nom de " bute hydraulique ". La cote du point
d'application de cette raction indique que les pressions correspondantes obissent une loi
triangulaire sur la hauteur de la fiche.
Sur justification du dplacement admissible du btiment il est possible de retenir une valeur
suprieure celle de Ppd sans excder la bute passive.
Figure 45 Raction dynamique
10.2.4 Pousse due une surcharge uniforme
Lorsque le terre-plein supporte une surcharge uniforme d'intensit q, la pousse dynamique active globale
est prise gale :
P ad (q) = (q H / cos) (1 v ) K ad
Il est admis que cette pousse s'exerce mi-hauteur de la paroi.
10.2.5 Cas des sols saturs
A dfaut d'valuation plus prcise concernant la permabilit du sol, celui-ci peut tre considr comme
ferm ; on admet dans ce cas que l'eau et les particules solides subissent les mmes acclrations.
Les forces sismiques par unit de volume du milieu satur sont alors prises gales h et v .
La pousse dynamique globale est alors gale la somme de la pousse dynamique P ad du terrain
djaug, s'exerant mi-hauteur de la paroi :
P ad = 1/2 (- w ) H (1+ v ) K ad
et de la pousse hydrostatique :
P hs = 1/2 w H
s'exerant au tiers de la hauteur de la paroi.
K ad est calcule par la formule donne au paragraphe 10.2.2 avec un angle ' tel que :
tg ' = ( h / 1 v ) ( / - w )
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 10.2.5
L'angle apparent ' de rotation dfini en 10.2.2 doit tre dtermin en djaugeant le poids apparent
du sol comme indiqu sur la figure ci-dessous :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 80 of 184
Figure 46 Cas des sols saturs
10.3 Vrifications de stabilit
10.3.1 Combinaisons d'actions lmentaires
Les actions lmentaires dfinies en 8.1 sont additionner algbriquement pour produire l'effet le plus
dfavorable.
10.3.2 Vrifications aux tats limites de stabilit
Les vrifications aux tats limites de stabilit d'ensemble sont effectuer conformment aux spcifications
du paragraphe 9.2 .
Les vrifications aux tats limites de glissement sous la base de la fondation sont effectuer compte tenu
d'un coefficient de scurit partiel valant 1,2.
Les vrifications aux tats limites de poinonnement sous la fondation sont effectuer compte tenu d'un
coefficient de scurit partiel valant 1,5.
10.4 Vrifications de rsistance
Les vrifications de rsistance des diverses parties de l'ouvrage sont effectues compte tenu des
coefficients de scurit partiels dfinis dans l'article 11 pour le bton arm.
Pour les btiments possdant une infrastructure mobilisant effectivement une raction passive du terrain
pour assurer la stabilit d'ensemble, la pression de calcul prendre en compte dans les vrifications de
rsistance des parois d'infrastructure est la plus grande des pressions rsultant :
soit de la dtermination de la pousse due au terrain telle que spcifie au paragraphe 10.2.2 ;
soit de la dtermination de la raction assurant l'quilibre d'ensemble, cette raction tant limite la
valeur spcifie au paragraphe 10.2.3 .
10.5 Murs de soutnement isols
Les murs de soutnement dont la hauteur est gale ou infrieure 6 m peuvent tre justifis par
application des rgles du prsent article.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 10.5
Les autres murs relvent de la norme " Ouvrages de soutnement en zone sismique " 1 .
1)
En prparation la date de parution des prsentes rgles.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 81 of 184
11 Bton arm et bton prcontraint
11.1 Gnralits
11.1.1 Elments principaux - lments secondaires
Dans ce qui suit, sont dsigns sous le nom d'lments principaux les lments qui interviennent dans la
rsistance aux actions sismiques d'ensemble ou dans la distribution de ces actions au sein de l'ouvrage.
Les lments structuraux n'apportant pas de contribution significative la rsistance aux actions
sismiques d'ensemble ou leur distribution peuvent tre considrs comme lments secondaires,
condition que leur rsistance ces actions soit effectivement nglige et qu'ils ne soient soumis du fait
des dformations imposes qu' des sollicitations ngligeables vis--vis des sollicitations d'autre origine.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.1.1
La diffrence entre lment principal et lment secondaire peut tre subtile, par exemple,
lorsqu'une dalle de plancher joue le rle de diaphragme, ses nervures peuvent cependant tre
considres comme lments secondaires.
Les dformations imposes sont celles dfinies en 6.6.1.2.5 et 6.6.1.3.5 .
La prise en compte des remplissages en maonnerie effectus a posteriori dans l'ossature est
traite en 12.2.2.4 .
11.1.2 Dfinitions et conventions - notations
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.1.2
* Les lments secondaires ne sont pas censs comporter des zones critiques.
** Les dispositions prescrites dans ce paragragphe concernent galement les lments en bton
prcontraint. Dans ce cas, l'effort normal N exclut les forces de prcontrainte.
*** Les notations utilises dans cet article sont explicites dans les textes ou portes sur les figures.
Les principales d'entre elles sont rappeles ci-aprs :
Matriaux :
f e est la limite d'lasticit caractristique (ou garantie) d'un acier (notation EC 2 : f yn ) ;
f cj est la rsistance caractristique d'un bton la compression (notation EC 2 : f ck : en gnral
f c90 ) ;
f tj est la rsistance caractristique d'un bton la traction ;
s est le coefficient de scurit partiel applicable la limite d'lasticit d'un acier ;
c est le coefficient de scurit partiel applicable la rsistance d'un bton la compression ;
cv est le coefficient de scurit partiel applicable la contribution du bton comprim la
rsistance l'effort tranchant ;
f ed = f e / s est la rsistance de calcul d'un acier ;
f cd = f cj / s est la rsistance de calcul d'un bton la compression.
Sollicitations :
S est une sollicitation en gnral ;
N, V, M sont l'effort normal, l'effort tranchant, le moment flchissant ;
N d , M d sont l'effort normal, et le moment flchissant de dimensionnement ;
N du , M du sont l'effort normal, et le moment flchissant ultime.
Indices :
S, R pour une sollicitation agissante, rsistante ;
d pour une sollicitation de calcul (S ad : agissante ; S rd : rsistante) ;
dis pour une sollicitation (agissante) de dimensionnement ;
u pour un tat ultime.
Contraintes et dformations relatives :
f cm est une contrainte moyenne de compression dans une section sous l'effort normal de
calcul, rapporte la section nette de la section de bton ;
est un effort normal rduit ( = f cm /f cj ) ;
u est une contrainte de cisaillement conventionnelle (ou de rfrence) au sens des Rgles
BAEL ;
c est le raccourcissement du bton comprim ;
cu est le raccourcissement du bton l'tat ultime.
Caractristiques gomtriques des sections et lments :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 82 of 184
B, B n sont l'aire et l'aire nette d'une section de bton ;
A est la section totale d'une armature (Al : armatures longitudinales ; At : armatures
transversales) ;
a, b sont les dimensions d'une section mesures suivant ses directions principales d'inertie,
avec, lorsqu'il y a lieu, b > a (voir figure 47 ) ;
a m , b m sont les valeurs moyennes de ces dimensions dans le cas d'lments de section
variable ;
b w , b wm sont la largeur d'une me de bton, largeur moyenne (aire divise par la hauteur
totale) dans le cas d'une largeur non uniforme ; paisseur d'un voile ;
h est la hauteur totale d'une section ;
h tot est la hauteur totale d'un voile, d'une console verticale ;
l est la longueur d'un lment linaire ;
l w est la largeur d'un mur ou voile (grande dimension horizontale) ;
x est la distance de l'axe neutre la fibre la plus comprime ;
est l'lancement d'une pice (rapport de sa longueur libre sa plus grande dimension
transversale) ;
0 , sont les pourcentages d'armatures (respectivement gomtrique et en volume).
11.1.2.1 Zones critiques
On dsigne par zone critique, toute partie d'un lment structural principal dans laquelle des
concentrations de dformations ou de sollicitations sont susceptibles de se produire (voir 4.4.3 ). Ces
zones sont celles dfinies dans le prsent article pour les diffrentes sortes d'lments et ventuellement
celles que le calcul fait apparatre comme telles.
11.1.2.2 confinement
On dsigne par bton confin, un volume de bton pourvu d'armatures transversales de type dcrit en
11.3.2 , disposes de faon s'opposer au gonflement du matriau sous l'effet des contraintes de
compression ainsi qu'au flambement des armatures.
Par convention, on considre que la partie confine d'une section est celle qui est dlimite en projection
par le contour intrieur des armatures de confinement disposes la priphrie de la section.
Il est loisible sur justification particulire de tenir compte de la modification de la courbe contrainte dformation du bton, lie son confinement par des armatures transversales.
11.1.2.3 effort normal rduit
On entend par effort normal rduit, le rapport :
= N d / B n f cj
o :
N d dsigne l'effort normal de calcul s'exerant sur une section de bton ;
B n est l'aire nette de ce dernier ;
f cj est sa rsistance caractristique.
11.1.2.4 Pices comprimes, pices flchies
On entend par pice flchie, un lment linaire ou deux dimensions, soumis la flexion simple ou
dvie, pour lequel on satisfait aux conditions suivantes :
v max 0,07
hl/4
Lorsque h > l / 4, la pice est dite " courte ".
Une pice est dite comprime lorsque v max > 0,17.
Si on dsigne par a et b respectivement la plus petite et la plus grande dimension de la pice,
si b < 4a, la pice est considre comme un poteau ;
si b 4a, la pice est considre comme un mur.
Dans le cas d'lments composs tels que poutres-chelles, pales triangules, association de voiles ou
murs, etc., le terme de pice s'entend de chacun des lments constitutifs.
Les dispositions quantitatives dfinies dans cet article pour les pices comprimes peuvent tre
considres comme concernant plus spcifiquement celles dans lesquelles v max suprieur ou gal 0,17.
Lorsque v max est compris entre 0,07 et 0,17, il est loisible de procder une interpolation linaire entre les
valeurs donnes pour les pices flchies et celle pour les pices comprimes respectivement.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 83 of 184
11.2 Spcifications concernant les matriaux
11.2.1 Bton
Pour les lments principaux, le bton doit avoir une rsistance f c28 au moins gale 22 MPa et au plus
gale 60 MPa ; pour les lments secondaires, aucune disposition particulire n'est retenue.
Les valeurs des modules d'lasticit doivent tre conformes celles fixes par le BAEL .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.2.1
Dans le cas d'utilisation de btons de rsistance suprieure 45 MPa, pour lesquels les
comportements sous grandes dformations cycliques seraient mal connues, il importe d'apporter
une justification scientifique de l'quivalence des prcautions prises, vis--vis de celles dictes par
les prsentes rgles.
11.2.2 Aciers
Pour les lments principaux, les armatures pour bton arm doivent tre haute adhrence, avec une
limite d'lasticit spcifie infrieure ou gale 500 MPa. L'allongement total relatif sous charge maximale
spcifie doit tre suprieur ou gal 5 % .
11.3 Dispositions constructives des lments principaux des ossatures
Le prsent paragraphe dfinit les rgles minimales auxquelles doivent satisfaire tous les lments
structuraux en bton arm, l'exception des lments considrs comme secondaires. Les rgles propres
aux diffrents types d'lments ou les rsultats des calculs peuvent imposer des conditions plus svres.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3
Les rgles propres aux lments secondaires sont prcises en 11.9.
11.3.1 Armatures longitudinales
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.1
Par armatures longitudinales, on entend les armatures ncessaires la rsistance aux efforts
normaux ou de flexion, et par armatures transversales celles ncessaires la rsistance aux efforts
tranchants ou au confinement du bton.
11.3.1.1 Continuit
La continuit des armatures longitudinales peut tre assure par recouvrement ou par tout autre procd
dont il est tabli qu'il n'entrane pas de fragilisation de l'armature.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.1.1
L'attention est attire sur le fait que certains types de soudure peuvent conduire des jonctions
fragiles. Il peut en tre de mme dans le cas de filetages usins dans des conditions trop
sommaires.
11.3.1.2 Ancrages d'extrmits
NOTE SUR LES PARAGRAPHES 11.3.1.2 11.3.1.3
L'exprience et l'observation montrent que l'adhrence acier-bton peut tre rapidement dtruite
par les renversements d'efforts. Le phnomne, irrversible par nature, est particulirement
sensible dans les noeuds et zones d'assemblage, o il progresse de cycle en cycle le long des
barres. Il convient en consquence d'apporter le plus grand soin l'tude des conditions d'ancrage
et de recouvrement des armatures.
L'emploi de coudes ou crochets dans les pices comprimes ou les parties comprimes des pices
flchies est interdit.
Toutefois, en cas de ncessit (liaison avec une semelle de fondation, voisinage d'une surface libre, etc.),
les ancrages d'extrmit peuvent tre assurs au moyen de coudes 90.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.1.2
Les retours rectilignes des coudes viss au paragraphe 11.3.1.2 doivent se situer dans la partie
confine de la pice ou des pices sur lesquelles l'lment est assembl, et tre disposs le long
de la face la plus loigne dudit lment, la concavit du coude tant dirige vers l'intrieur du
bton. Toutes dispositions doivent tre prises le cas chant pour viter les pousses au vide et
prvenir l'clatement du bton le long des surfaces libres.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 84 of 184
Figure 47 Exemples d'emploi de coudes
11.3.1.3 Prescription
Toutes les longueurs de recouvrement ou d'ancrage sont majorer de 30 % pour la part situe hors zone
critique et de 50 % pour la part situe dans la zone critique. Chaque fois que c'est possible, on vite de
recouvrir en zone critique.
Les longueurs de scellement des armatures de prcontrainte sont soumises la mme majoration.
Dans les zones de recouvrement, les armatures transversales doivent respecter la rgle des coutures
rsultant de la transmission des efforts entre les barres longitudinales.
11.3.2 Armatures transversales
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.2
Les armatures transversales, en prvenant le flambement des armatures longitudinales et assurant
un certain frettage du bton, ont pour objet de faire en sorte que les tats limites ultimes
surviennent par coulement plastique des barres longitudinales plutt que par crasement du
bton. Elles visent galement retarder la destruction de l'adhrence.
Des crochets d'angle au centre suprieur 135 (pa r exemple 180) peuvent tre utiliss
condition que soit conserv le retour rectiligne de 10 diamtres. Les crochets 135, qui donnent
lieu de moindres concentrations de contraintes, doivent cependant tre prfrs.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 85 of 184
Figure 48 Dispositions types
En parement, l'emploi de recouvrements rectilignes ainsi que celui de coudes ou crochets, d'angle au
centre infrieur 135 pour assurer la continuit, la fermeture ou l'ancrage des armatures transversales,
est interdit.
Dans les zones critiques, les armatures transversales doivent tre constitues soit par des spirales
continues soit par des cadres, triers et pingles dont la continuit, la fermeture et l'ancrage sont
obligatoirement assurs au moyen de crochets d'angle au centre au moins gal 135 et comportant un
retour rectiligne d'au moins 10 diamtres.
Ces armatures doivent tre disposes de faon telle que chaque barre longitudinale comprime ou
chaque groupe de barres comprimes soient individuellement maintenus par une armature s'opposant
son flambement. Ceci doit tre ralis par au moins un cadre, ou plusieurs si la forme de la section l'exige,
disposs de faon s'opposer au gonflement du bton.
Les premires armatures transversales doivent tre disposes 5 cm au plus du nu de l'appui ou de
l'encastrement.
11.3.3 Dispositions communes aux poutres et poteaux
Ces dispositions concernent les lments principaux.
11.3.3.1 Dimensions minimales des sections
Les lments linaires doivent prsenter les dimensions minimales dfinies ci-dessous et (voir notations
dans la note sur le paragraphe 11.1.2 ).
a, b > 25 cm
B > 625 cm
me des poutres : b w > 15 cm
Voir les exemples donns en figure 49 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.3.1
En raison des effets de paroi, de la prsence d'armatures et des effets d'chelle, des
comportements sous charges alternes raisonnablement fiables ne peuvent pas tre obtenus avec
des lments de trop faible section. Les minimums fixs par le texte correspondent aux dimensions
de granulats gnralement utilises, et aux densits de ferraillage rsultant des prsentes rgles.
Des dimensions diffrentes peuvent tre adoptes sur justification spciale.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 86 of 184
Figure 49 Section des lments linaires
11.3.3.2 position et dimensions relatives des lments
Dans le cas de pices faisant partie d'un systme continu (portiques ou cadres, ossatures diverses), les
dispositions suivantes doivent tre observes :
Les axes des deux pices ne doivent pas tre excentrs l'un par rapport l'autre de plus du 1/8 de la
largeur de la pice d'appui (voir figure 50 ). Les moments rsultant de cette excentricit sont en tout tat
de cause pris en compte dans les calculs.
Note sur le paragraphe 11.3.3.2
Les sections d'extrmit d'un lment flchi, dalle de compression ventuelle exclue, ne doivent
pas dborder la pice d'appui d'une longueur suprieure au quart de la dimension offerte par cette
dernire dans la direction correspondante.
Figure 50 Position des axes de pices d'un systme
continu
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 87 of 184
11.3.4 Dispositions propres aux lments flchis
Ces dispositions concernent les lments principaux.
11.3.4.1 Zones critiques
Sont considres comme zones critiques :
les parties de l'lment, s'il en est, dans lesquelles le calcul sismique conduit disposer des
armatures de compression ;
les rgions voisines des sections de moment maximal sous les actions sismiques seules. Ce sont
habituellement les rgions des extrmits des poutres autres que les extrmits libres. La longueur I
ces zones critiques est gale 1,5 fois la hauteur utile d compter du nu des appuis.
crit de
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.4.1
Par extrmit libre on entend une extrmit dont les rotations ne sont pas contraries.
Figure 51 Zones critiques des lments flchis
11.3.4.2 armatures longitudinales
a. Le pourcentage gomtrique 0 des armatures disposes sur une face tendue (hors zones de
recouvrement) doit satisfaire aux conditions suivantes dans lesquelles f e dsigne la limite d'lasticit
spcifie des aciers, exprime en MPa :
0 minimum : 1,4/f e
0 maximum : 0,025
b. Dans le cas de poutres ou de traverses solidaires d'une dalle, on peut disposer dans la dalle, de
chaque ct de l'me, jusqu' 1/8 de la section d'acier tendue.
Les armatures correspondantes doivent rester comprises dans une bande de largeur au plus gale
deux fois l'paisseur de la dalle ( voir figure 52 ).
Les conditions supplmentaires suivantes doivent tre satisfaites :
c. Si l'on considre la plus importante des armatures de flexion disposes dans les zones d'extrmit,
au moins le quart de la section de cette armature doit tre prolong sur toute la longueur de la pice.
d. Dans les zones critiques, la section des armatures comprimes doit tre au moins gale la moiti
de celle des armatures tendues.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.4.2
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 88 of 184
Figure 52 Exemple de disposition des armatures
longitudinales dans la section d'appui
11.3.4.3 armatures d'effort tranchant
Dans les zones critiques, il faut disposer une armature de confinement du type dcrit au paragraphe
11.3.2 et satisfaisant aux conditions minimales indiques ci-dessous (voir notations de la note sur le
paragraphe 11.1.2 ).
diamtre minimal : 6 mm
espacement maximal : minimum de 24 T
8 L ( L minimal)
0,25 d
Dans la zone courante, l'espacement maximal est de 0,5 d.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.4.3
Rappel de notations :
d : hauteur utile ;
L : diamtre des armatures longitudinales ;
T : diamtre des armatures transversales.
11.3.5 Dispositions propres aux lments comprims (poteaux)
Ces dispositions concernent les lments principaux.
11.3.5.1 Zones critiques
On appelle " zone critique " les rgions d'extrmits ainsi que toute zone intermdiaire dans laquelle les
conditions de coffrage, ferraillage et/ou de contacts externes risqueraient de conduire une occurrence
prmature d'un tat limite ultime au regard de celui des sections d'extrmits.
11.3.5.1.1 Elments lis leurs deux extrmits
Sont considrer comme zones critiques (voir figure 53 ) :
Les rgions d'extrmit, sur une longueur I crit au moins gale la plus grande des longueurs ciaprs :
a. la hauteur utile de la section ;
b. s'il existe un point d'inflexion, le tiers de la distance l
i sparant ce point de l'extrmit
considre ; s'il n'existe pas de point d'inflexion, la longueur nette de l'lment ;
c. 45 cm.
Et en outre, dans le cas d'un poteau bordant un mur de maonnerie ou tout autre panneau rigide de
hauteur infrieure celle du poteau, dans les rgions situes de part et d'autre de l'arase du mur ou
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 89 of 184
du panneau, la longueur critique est value comme ci-dessus, la dimension de la section
considrer en ce cas tant celle parallle au mur ( voir figure 54 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.5.1.1
L'lancement de l'lment est dfini comme le rapport de sa longueur nette la plus grande
dimension de sa section.
Figure 53 Dfinition des zones critiques dans les
lments comprims
Figure 54 Dfinition des zones critiques dans le cas
des poteaux bordant un mur de maonnerie
11.3.5.1.2 lments fonctionnant en console verticale
Sont considrer comme zones critiques ( voir figure 55 ) :
la rgion de l'encastrement, sur une longueur I crit au moins gale la plus grande des longueurs ciaprs :
a. la hauteur utile de la section ;
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 90 of 184
b. le 1/6 de la hauteur de l'lment ;
c. 45 cm ;
et le cas chant les rgions de longueur I crit comme ci-dessus de part et d'autre des sections dans
lesquelles des ruptures prmatures ou la formation prmature de rotules plastiques sont
susceptibles de se produire.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.5.1.2
Figure 55 Dfinition des zones critiques pour les
lments fonctionnant en console verticale
Les ventualits envisages dans le dernier alina du paragraphe peuvent tre la consquence
d'un changement rapide de section.
Elles peuvent aussi correspondre l'apparition d'un maximum relatif de courbure, suite
l'intervention des modes suprieurs. Ces circonstances ne sont cependant susceptibles de se
produire que dans le cas de consoles lances, de priode fondamentale relativement leve (de
l'ordre de 0,8 s ou plus).
11.3.5.2 Armatures longitudinales
Le pourcentage gomtrique des armatures longitudinales hors zones de recouvrement doit tre compris
dans les limites suivantes :
1 % 0 5 %
Les barres doivent tre rparties aussi uniformment que possible sur la face du bton concerne, leur
espacement d'axe en axe ne devant pas excder 25 cm.
11.3.5.3 Armatures transversales
Les armatures transversales doivent satisfaire aux conditions suivantes :
diamtre minimal : 8 mm
zones critiques : volume minimal d'armatures de 0,8 % et espacement maximal gal la plus petite
valeur de :
8 L
0,25 a
15 cm
parties courantes : espacement maximal gal au minimum de :
12 L
0,5 a
30 cm
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.5.3
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 91 of 184
Rappel des notations :
a : plus petite dimension de la section.
L : diamtre des armatures longitudinales.
11.3.6 Pices courtes
Ces dispositions concernent les lments principaux.
Dfinition
Sont considres comme des pices courtes celles dont la longueur nette est infrieure quatre fois
leur hauteur moyenne dans la direction tudie.
Cette dfinition inclut les consoles courtes, les poutres cloisons et les parois flchies dans leur plan.
Zones critiques
Les pices courtes sont considres comme critiques sur toute leur longueur.
Armatures
Les armatures doivent satisfaire aux conditions dfinies pour les zones critiques des lments
linaires flchis ou comprims suivant le cas.
11.3.7 Noeuds
Ces dispositions concernent les lments principaux.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.7
Pour les armatures longitudinales, voir paragraphe 11.3.1.3 et voir figure 47 .
Figure 56 Noeuds
Les lments aboutissant un noeud peuvent tre considrs comme assurant un confinement
suffisant de ce dernier si leur section reprsente environ 80 % au moins de l'aire de la face
correspondante de ce dernier.
11.3.7.1 Dfinition
On entend par noeud la partie du bton intrieur au volume dlimit par les plans ou autres surfaces
contenant les sections d'about des lments assembls et le cas chant par les surfaces libres du bton
(voir figure 56).
11.3.7.2 Armatures transversales
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 92 of 184
a. La plus importante en pourcentage volumtrique des armatures transversales disposes dans les
lments comprims aboutissant au noeud doit tre poursuivie dans tout le volume de ce dernier.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.3.7.2 A)
Dans le volume commun poutre-poteau, on prolonge de prfrence les nappes d'armatures
transversales du poteau.
b. Lorsque la disposition des lments aboutissant au noeud est telle qu'elle puisse tre considre
comme assurant un confinement suffisant de toutes les faces de ce dernier, cette armature
transversale peut tre rduite celle exige par les calculs, sans qu'elle puisse toutefois tre
infrieure la moiti de celle dfinie dans l'alina prcdent.
L'espacement des lits ne doit pas excder dix fois le diamtre des barres longitudinales ou 20 cm suivant
ce qui est le plus dfavorable.
11.4 Dispositions propres aux murs et voiles de contreventement
Ces dispositions concernent les lments principaux.
11.4.1 Dimensions minimales
Les murs en voiles doivent prsenter une paisseur minimale de 15 cm et une largeur au moins gale
quatre fois l'paisseur.
Les lments ne satisfaisant pas cette condition sont considrs comme des lments linaires.
11.4.2 Zones critiques
Sont considres comme zones critiques les rgions situes la base des voiles habituellement sur une
hauteur d'tage et dont la hauteur n'excde pas la largeur l w des trumeaux, ainsi que celles situes
chaque niveau de changement notable de la section de coffrage.
11.4.3 Dispositions constructives minimales
A chaque extrmit de mur est prvu un chanage vertical (CV) en acier Fe E 500 ainsi qu'au droit de
toute ouverture et de chaque intersection de murs. Ces chanages sont disposs de la manire suivante :
a. Tous les chanages verticaux sont continus sur toute la hauteur de l'tage, de plancher plancher et
se recouvrent d'tage tage avec acier de couture au droit des recouvrements.
b. Les chanages horizontaux (CH) des planchers sont continus, ils sont dfinis en 11.5 .
c. Les chanages des linteaux (CL) sont constitus en acier Fe E 500 et ancrs de 50 diamtres (voir
figure 57 a) ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.4.3 C)
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 93 of 184
Figure 58 Cas de changement de section
Ces dispositions sont illustres par la figure 57 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.4.3
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 94 of 184
Figure 57 Chanages des murs et voiles
11.4.3.1 Zone courante
Les chanages minimaux des zones courantes d'un mur principal sont :
CV : quatre armatures 10 haute adhrence (HA) avec des armatures transversales constitues
de cadre en 6 espacs d'au plus de 10 cm.
CL : deux armatures 10 HA.
11.4.3.2 Zone critique
Au niveau le plus bas du btiment et sur une hauteur d'tage on dispose les chanages minimums
verticaux CV suivants aux bords de chaque trumeau :
CV : quatre armatures HA 12 ligatures avec des armatures transversales en 6 espacs de 10 cm au
plus.
11.4.3.3 zone de changement de section
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 95 of 184
Pour tout niveau avec changement de section et ou de contreventement apprciable, on dispose les
chanages prvus au 11.4.3.2 ci-dessus (voir figure 58 ).
11.5 Dispositions propres aux dalles et diaphragmes
Il doit exister un chanage priphrique continu ( voir figure 59 ) d'au moins 3 cm de section et un
chanage au croisement de chaque lment de contreventement avec le plancher, de section minimale
1,5 cm et respectant la rgle de 0,28 L dans le cas de contreventement par voiles, et 0,50 L, dans le cas
de contreventement par portiques, L tant la largeur chane exprime en mtres.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.5
Figure 59 Chanages des dalles et des diaphragmes
11.6 Dispositions propres aux lments prcontraints
Ces dispositions concernent les lments principaux.
Les lments totalement ou partiellement prcontraints sont traits suivant les rgles indiques pour les
lments en bton arm compte tenu des dispositions complmentaires ci-aprs :
11.6.1 Zones d'ancrage
a. Prcontrainte par pr-tension
Les zones d'ancrages de la prcontrainte par fils adhrents doivent se situer en dehors des noeuds
et tre aussi loignes que possible des rotules plastiques ventuelles.
b. Prcontrainte par post-tension
Au voisinage des ancrages des cbles de prcontrainte par post-tension, on s'assure d'un excellent
confinement notamment l'aide de cadres ferms enveloppant toute la section.
11.6.2 Noeuds
Les armatures de prcontrainte traversant les noeuds doivent tre rparties entre les parties infrieures et
suprieures des poutres de manire assurer un confinement convenable de ces dernires, dans la
mesure ou le ferraillage passif n'y pourvoit pas.
11.6.3 Coefficient de comportement
Le coefficient de comportement d'ossature base d'lments prcontraints se dduit de celui de la mme
ossature suppose base d'lments en bton arm par des coefficients multiplicateurs d'ajustements
compris entre 1,0 et 0,3 suivant la proportion des zones de bton tendues au-del de f ti sous sollicitation
sismique. A dfaut de justifications particulires on retient le coefficient multiplicateur de 0,3.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.6.3
Pour les coefficients q se reporter au 11.7 ;
La valeur de 0,3 peut tre considre comme donne titre provisoire.
11.7 Coefficient de comportement
A dfaut de valeurs plus prcises obtenues par toute mthode scientifiquement tablie et sanctionne par
l'exprience, les valeurs des coefficients de comportement sont dfinies en fonction de la classe de
rgularit des structures.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 96 of 184
Tableau 11 Valeurs du coefficient de comportement
Pour les structures de type 2, si la formation de rotules plastiques dans les lments comprims porteurs
est admise, ou s'il existe des articulations dans ces lments, les valeurs des coefficients de
comportement sont diviser par 1,33.
Lorsque la priode du mode de vibrations considr est infrieure T B , il y a lieu de rectifier la valeur de
q conformment au 6.3.3 sauf si la vrification de compatibilit des dformations est effectue (voir
11.8.2.3 ).
Pour le coefficient de comportement relatif la composante verticale, se reporter au paragraphe 6.3.3 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.7
Les valeurs numriques des coefficients de comportement figurant dans le tableau 11 doivent tre
considres comme provisoires.
Les classes de rgularit des btiments sont dfinies en 6.6.1 .
Dans la formule d'interpolation relative aux structures de type 4, V i dsigne l'effort tranchant
quilibr par un systme de contreventement lmentaire, et q i le coefficient de comportement
associ compte tenu du critre de rgularit :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 97 of 184
Figure 60 Diagramme donnant le coefficient de
comportement en fonction du pourcentage d'effort
tranchant quilibr par les voiles
Les structures de type 5 sont les structures fonctionnant en console verticale masses rparties
prdominantes, les masses ponctuelles reprsentant moins de la moiti de la masse totale ; ce
sont par exemple les chemines, les tours, les mts, etc.
Les structures de type 6 sont des structures comportant des transparences dont le mode de
contreventement change avec le niveau.
Les structures, dans lesquelles plus de la moiti des masses est situe dans le tiers suprieur, sont
considres comme irrgulires et sont classer dans l'une des catgories du tableau 11 .
11.8 Vrification de scurit (des lments principaux)
11.8.1 Vrification des lments linaires (poutres, poteaux)
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.8.1
La rptition de quelques cycles de dformations anlastiques entrane une rduction de la rigidit
et de la rsistance des lments en bton arm, notamment du fait de la dgradation (irrversible)
de l'adhrence acier-bton. Cet affaiblissement est particulirement sensible en ce qui concerne la
rsistance aux efforts tranchants, les ruptures correspondantes prenant alors trs gnralement le
caractre de ruptures fragiles. Indpendamment de leurs consquences directes sur la stabilit
d'ensemble de la structure, ces ruptures prmatures rendent inoprantes les dispositions prises
pour assurer les dissipations d'nergie dans la structure.
Il est tenu compte dans une certaine mesure de ces effets dfavorables en conservant le coefficient
0,85 dans l'expression de f bu , au lieu d'utiliser le coefficient unit applicable en principe aux
sollicitations dynamiques.
11.8.1.1 Diagrammes dformations-contraintes
Les diagrammes dformations-contraintes considrer sont ceux des rgles BAEL .
11.8.1.2 Coefficients de scurit partiels
On vrifie que les sollicitations accidentelles agissantes sont infrieures aux sollicitations rsistances
obtenues en prenant en compte les coefficients de scurit partiels suivants :
Acier : s = 1 ;
Bton : b = 1,15.
La rsistance de calcul f bu du bton est : f bu = 0,85 f cj / b .
11.8.1.3 Dimensionnement au noeud vis--vis des moments flchissants
Il convient de vrifier pour chacune des orientations possibles de l'action sismique que la somme des
moments rsistants ultimes des extrmits des poteaux ou montants aboutissant au noeud est au moins
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 98 of 184
gale en valeur absolue la somme des valeurs absolues des moments rsistants ultimes des extrmits
des poutres ou traverses affects d'un coefficient f gal 1,25 ( voir figure 61 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.8.1.3
Cette disposition tend faire en sorte que les rotules plastiques se forment dans les poutres plutt
que dans les poteaux (voir 4.4.3 ).
Figure 61 Dimensionnement d'un noeud poutre/poteau
11.8.1.4 ferraillage minimal dans les poutres
Les sections d'armatures minimales imposes par c) de 11.3.4.2 et d) de 11.3.4.2 peuvent tre diminues
de 30 %, sous rserve d'effectuer la vrification des sections l'aide de la combinaison complmentaire
suivante :
0,5 G E
11.8.1.5 efforts tranchants
les vrifications relatives au cisaillement limite ainsi que la dtermination des armatures d'effort
tranchant sont effectues conformment au BAEL avec b = 1,15 et s = 1, en prenant en compte un
coefficient de scurit supplmentaire de 1,25 ;
en outre, dans les zones critiques, la contribution du bton est nglige.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.8.1.5
Dans les zones courantes et en l'absence de reprise de btonnage, la contrainte de cisaillement
rsistante l'tat limite ultime u doit vrifier :
u (0,8f e (A t / b 0 s t ) + 0,3f tj ) 1 / 1,25
Dans les zones critiques, la contrainte de cisaillement l'tat limite ultime u doit vrifier :
u (0,8f e (A t / b 0 s t )) 1 / 1,25
11.8.2 Vrification des murs et voiles de contreventement
11.8.2.1 Cas des trumeaux
Les prescriptions donnes ci-aprs s'inscrivent dans le respect et en complment des rgles en vigueur :
le DTU 23.1 (NF P 18-210) .
11.8.2.1.1 Vrification des contraintes normales
Les sollicitations appliques toute section droite conduisent la dtermination des ferraillages
longitudinaux et des contraintes normales associes dans le respect des lois de comportement du bton
et des aciers et de la conservation des sections planes.
La contrainte du bton ne doit pas excder la valeur suivante :
bc = 0,85f cj / 1,15 f
f est un coefficient partiel de scurit gal 1,3.
La contrainte de l'acier ne doit pas excder la valeur :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 99 of 184
F e / s avec s = 1
La section droite est ensuite dcoupe en bandes de largeur b i sur lesquelles on calcule par sommation
les contraintes normales pour en dduire une contrainte moyenne n i pour chaque bande considre
(exemple de deux bandes illustres par la figure 62 ).
La vrification de chaque bande consiste s'assurer que :
n i n ul
La valeur de n ul est donne par le DTU 23.1 (NF P 18-210) en fonction de l'lancement du trumeau. Cet
lancement doit tre calcul en supposant que l'paisseur du mur est (a - 2) cm ce qui donne la
formule :
La longueur de flambement I f est dfinie dans le DTU 23.1 (NF P 18-210) en prenant en considration le
fait que la distance entre raidisseurs latraux peut tre rduite par le coefficient (a-2 / a) 3/4 avant d'tre
prise en compte dans les formules.
Le recouvrement des aciers calculs doit respecter les rgles du paragraphe 11.3.1.3 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.8.2.1.1
Pour cela on recherche une loi de dformation plane limite par les lois de dformation limite ultime
dcoulant de la rgle des trois pivots, et dont les contraintes associes sommes sur la section
droite correspondent aux sollicitations appliques.
pivot rsultant des lois de comportement du bton : b1 3,5
b2 2
pivot rsultant de la loi de comportement de l'acier, lorsqu'ils sont ncessaires l'quilibre : a
- 10,0 .
Le cas de diffusion des charges localises est traiter spcialement.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 100 of 184
Figure 62 Dimensionnement d'un mur en bton
(contrainte/dformation)
L'paisseur du mur est rduite d'une part par le coefficient a-2 / a dans le calcul de l'lancement
comme prcis dans le texte et d'autre part dans le calcul de la section rsistante comme prcis
dans le D.T.U. 23.1 (NF P 18-210) .
11.8.2.1.2 ferraillage longitudinal et pourcentages minimaux
Les aciers verticaux situs dans les deux bandes d'extrmits du trumeau, dfinies par une largeur b f
avec :
b f = minimum (b/2 ; 100 cm)
doivent respecter les pourcentages minimaux suivants, en fonction de la valeur n i de la contrainte
moyenne de la bande considre (voir 11.8.2.1.1 ) et du coefficient de comportement q choisi a priori par
le projeteur pour le btiment :
p = 0 si 1 0,001
= 1 si 1 > 0,001 avec 1 = 0,001 q n i / bc
Le recouvrement des aciers mis pour respecter le pourcentage prcdent doit respecter les rgles
traditionnelles du bton arm.
Les aciers de flexion rellement prvus sur les plans ne doivent pas avoir localement une section
sensiblement suprieure celle rsultant de l'application de 11.8.2.1.1 , de 11.8.2.1.2 et de 11.4.3 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.8.2.1.2
Le fait de trouver p = 0 ne dispense pas de vrifier les rgles de chanage minimal prescrites au
paragraphe 11.4.3 .
Une majoration non rpartie de faon homogne peut en effet changer notablement le schma de
comportement.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 101 of 184
11.8.2.1.3 vrifications l'effort tranchant
Il y a lieu d'effectuer successivement les deux vrifications suivantes :
a. vrification de cisaillement
Etant donn une section droite (voir figure 63 ) :
paisseur a
hauteur de la section droite b
hauteur utile d
section d'armature A f de flexion ou de chanage d'un seul ct ;
Le pourcentage d'armatures associ est dfini par :
f = 100 (A f / ad)
- Etant donn les sollicitations de cette section droite :
N effort normal
M moment de flexion
V effort tranchant
on dfinit :
la contrainte normale de compression : = N/a.b
le paramtre d'excentricit : N = M/b.N
la sollicitation tranchante de calcul : V*
sauf justification particulire, on prend : V* = V(1 + q)/2
le cisaillement conventionnel de calcul associ : * = V* / a d
le paramtre d'lancement de calcul : v = M / (bV*)
on calcule :
le moment limite de fissuration systmatique en flexion compose, associ l'effort normal N,
soit M lim . On dduit le cisaillement conventionnel associ :
1 = * M lim /M
la contrainte limite de fissuration l'effort tranchant :
cette formule n'est retenir que lorsque 0,5 f cj ; dans le cas contraire, le voile ou le trumeau
doit tre considr comme un poteau et vrifi comme tel.
la contrainte limite de rsistance l'effort tranchant aprs fissuration, compte tenu des
armatures longitudinales.
3 = min ( 1 , 2 ) (1 + 3 f ) + 0,15
la valeur de f tant plafonne par 2 %
il n'est pas ncessaire de prvoir des armatures d'effort tranchant si la condition suivante est
satisfaite :
* lim avec lim = max( 3 ;0,5f tj )
Lorsque la condition prcdente n'est pas satisfaite, il y a lieu de prvoir des armatures d'effort
tranchant disposes horizontalement ou verticalement suivant les cas et calcules par la
formule :
o :
s t est l'espacement entre les lits d'armatures A t avec s t b/3
s est gal 1
f e est la limite lastique des aciers A t
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 102 of 184
Les armatures A t sont disposes :
horizontalement si v 1,5
verticalement si v 0,5
horizontalement et verticalement si 0,5 < v < 1,5
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.8.2.1.3 A)
Figure 63 Section droite d'un trumeau
Les armatures A f rsultent du calcul en flexion compose ou des diverses rgles d'armatures
et/ou de chanages minimaux.
Les sollicitations tranchantes calcules aprs application du coefficient de comportement
q, soit V, sont majores par le coefficient (1 + q)/2 pour tenir compte du fait qu'il n'est pas
tabli que la notion de coefficient de comportement permette d'apprcier fiablement la
valeur effective des efforts tranchants.
Les justifications particulires qui autoriseraient retenir des valeurs de V* plus faibles
que V* = V 1 + q/2 doivent porter sur la similitude de comportement dynamique entre le
btiment rel et le modle lastique associ, le rapport V*/ V tant d'autant plus proche
de 1 que cette similitude est plus prononce.
La condition de non-fissuration systmatique en flexion compose s'crit dans le cas
d'une section rectangulaire et d'un matriau homogne :
6(M lim / ab) - (Nab) f tj / 1,5
ce qui donne :
M lim = (ab / 6) ( + f tj /1,5)
Il est loisible d'effectuer ce calcul dans le cas d'une section homognise avec un coefficient
d'quivalence pour les aciers pris gal 15.
Il est rappel que f tj est la rsistance caractristique la traction. Les formules donnant 1 , 2
et 3 ont t tablies avec un coefficient b = 1,5 appliqu sur la rsistance caractristique f tj .
Il est loisible de rpartir les armatures A t ou de les regrouper sous forme de potelets ou de
chanages intermdiaires incorpors dans le respect de la limite maximale s t b/3.
b. Vrification du non-glissement ( voir figure 64 )
Si on dsigne par x la largeur comprime du mur, d'paisseur a , sous sollicitation de flexion
compose, on doit vrifier la condition suivante :
V* 0, 35f ti ax + (F b + A'f e ) tg
o :
tg est gal 0,7 ;
f e est la limite lastique des aciers A' ;
A' sont les armatures verticales rparties hors membrures d'extrmit existant dans la section a.b.,
laquelle est associe une quantit d'armatures horizontales respectant le mme pourcentage ;
F b est la rsultante des contraintes de compression.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.8.2.1.3 B)
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 103 of 184
Figure 64 Trumeau tendu et flchi (flexion
compose)
Dans le cas de trumeaux tendus et flchis sans zone comprime rsiduelle, il ne reste que
l'effet des aciers de glissement et d'effort tranchant (A' f e ).
11.8.2.1.4 ferraillage transversal minimal
Chaque armature longitudinale rsultant du calcul en flexion compose ou des dispositions constructives
minimales de 11.8.2.1.2 est ligature transversalement par des pingles de diamtre t et d'espacement s
t vrifiant les conditions suivantes :
S t min (10 L ; 20 cm)
t max ( L /3 ; 6 mm)
Les aciers longitudinaux mentionns ci-dessus, calculs conformment aux paragraphes 11.8.2.1.1 et
11.8.2.1.2 sont en outre regroups dans un potelet ( voir figure 65 ) de dimensions minimales a, d', avec :
Dans le cas de murs avec raidisseurs, la valeur de d' peut ne plus faire intervenir la condition lie l f et le
potelet peut tre plac dans le mur ou dans le raidisseur.
Les aciers horizontaux constituant les cadres du potelet sont de diamtre t dfini ci-dessus et sont
espacs au plus de 20 cm.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.8.2.1.4
Les armatures verticales de rpartition des aciers d'effort tranchant ne sont pas concernes.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 104 of 184
Figure 65 Dimensions minimales des potelets
11.8.2.2 linteaux
Les armatures minimales des linteaux sont celles prvues pour le cas des poutres au paragraphe 11.3.4 .
11.8.2.3 Vrification de compatibilit de dformation
La vrification de compatibilit de dformation a pour objet de contrler la cohrence entre la valeur
choisie pour le coefficient de comportement et les aptitudes dformation non linaire du voile.
Il est loisible, dans le cas des btiments dont la hauteur au-dessus du sol n'excde pas 28 m, de ne pas
effectuer cette vrification pour autant que l'on retienne des valeurs de q indiques dans le tableau 12 ,
plus faibles que celles donnes en 11.7 .
Tableau 12 Coefficients de comportement des btiments
de hauteur n'excdant pas 28 m
b t reprsente la longueur du mur de contreventement quivalent aux murs pris en compte dans le sens de
l'action sismique tudie.
Cette vrification de compatibilit, si elle est satisfaite, permet de justifier des valeurs du coefficient de
comportement plus grandes que celles donnes dans le tableau 12 prcdent, sans excder celles
donnes dans le tableau 11 figurant au paragraphe 11.7 .
On procde comme suit :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 105 of 184
On calcule les dplacements horizontaux du voile au niveau des diffrents planchers suivant les
hypothses et mthodes du bton arm ( BAEL A.4.6.1 ) en partant des coffrages et ferraillages rels
prvus sur plan, et de l'action sismique de dimensionnement.
On calcule par ailleurs les dplacements horizontaux du voile aux mmes niveaux en admettant que le
voile est constitu d'un matriau homogne lastique linaire caractris par son module de dformation
E i sous l'action sismique de dimensionnement multiplie par q.
La vrification de compatibilit exprime sous l'angle des dformations consiste s'assurer pour tous les
niveaux que le dplacement de bton arm est suprieur ou gal celui du dplacement lastique. La
vrification de compatibilit exprime sous l'angle nergtique consiste vrifier que l'nergie totale
(somme des produits force x dplacement) bton arm est suprieure ou gale l'nergie totale lastique.
A dfaut de justifications particulires, le coefficient q choisi est considr comme acceptable si la plus
dfavorable des deux conditions prcdentes est satisfaite.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 11.8.2.3
Le fait de ne pas faire cette vrification conduit des vrifications plus svres l'effort tranchant.
Sauf justification spciale les principales hypothses et la mthode sont les suivantes :
un diagramme contrainte-dformation du bton devant respecter les critres prciss sur la
figure 66 ;
Figure 66 Diagramme contrainte-dformation du
bton
le diagramme contrainte-dformation de l'acier donn par la figure 67 ;
Figure 67 Diagramme contrainte-dformation de
l'acier
une mthode d'intgration des courbures dduites du diagramme des dformations ( n , s )
associes aux contraintes sous sollicitation de dimensionnement en tenant compte de la
contribution du bton tendu (' s au lieu de s figure 68 ) ;
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 106 of 184
Figure 68 Diagramme des dformations
d'o la courbure = n - s / h t
diagramme parabole-rectangle du bton. L'utilisation de ce diagramme peut tre envisage
moyennant tout correctif visant rectifier la discordance entre sa pente au dpart sous faible
contrainte et le module d'lasticit du bton.
l'attention est attire sur la ncessit de ne pas sous-estimer les valeurs calcules de
dplacement non linaire. Pour cela, il convient notamment de ne pas ngliger la contribution
du bton tendu, d'utiliser des pas d'intgration des courbures assez petits et ventuellement
de considrer des courbures pouvant varier rapidement avec la hauteur.
Sauf justifications spciales, b t peut tre obtenu comme :
La moyenne des longueurs b ti des i murs de contreventement envisags, chaque longueur
b ti d'un mur tant pondre par la raideur de ce mur. Un mur files d'ouvertures sera
envisag comme un mur plein si les linteaux sont pris en compte ou comme une juxtaposition
des murs trumeaux indpendants si les linteaux sont ngligs.
dfaut la longueur du mur de contreventement la plus dfavorable.
11.9 Dispositions propres aux lments secondaires
Les dispositions constructives prendre en sus de celles de rgles traditionnelles sont les suivantes :
a. poutres, poutrelles et dalles
Il faut s'assurer d'une bonne liaison de l'lment port sur l'lment porteur par l'intermdiaire
d'armatures ralisant la continuit mcanique du ferraillage.
b. poteaux
NOTE SUR LE PARAGRAPHE DE 11.9 B)
Cette continuit mcanique peut tre assure soit par la continuit des aciers infrieurs, soit
par des chapeaux quilibrant au moins 0,15 M o , soit par des barres releves ancres sur
appuis.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 107 of 184
Figure 69 Zones de continuit mcanique des
armatures des poteaux
La continuit mcanique des armatures doit tre assure aux extrmits de poteaux ( voir figure 69 ).
De plus les armatures transversales aux extrmits du poteau sur la hauteur b doivent avoir un
espacement maximal savoir : le minimum de 12 L
0,5 a
30 cm
c. murs secondaires
Un mur secondaire comporte au minimum les chanages verticaux CV, les chanages CL de linteaux
et les chanages horizontaux CH suivants :
CV : 3 HA 10 ou 4 HA 8 - cadres 6 espacs de 10 cm
CL : deux armatures HA 8
Les chanages CH sont dfinis au paragraphe 11.5 .
L'emplacement des chanages CV et CL est dfini au paragraphe 11.4.3 sauf qu'il n'y a pas
obligation de prvoir des chanages CV l'intersection des murs.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 108 of 184
12 Structures en maonnerie
12.1 Gnralits
12.1.1 Domaine d'application
Cet article traite des lments structuraux et non structuraux raliss en maonnerie de petits lments.
Les dispositions constructives relatives aux maisons individuelles et btiments assimils sont indiques
dans la norme NF P 06-014 (rfrence DTU Rgles PS-MI 89 rvises 92) .
Les matriaux constitutifs concerns sont :
les moellons de pierre ;
les pierres de taille ou " prtailles " ;
les briques et blocs de terre cuite ;
les blocs en bton ;
les blocs de bton cellulaire.
Les lments de structures constitus par ces matriaux doivent tre conus, calculs et excuts suivant
les rgles propres ces matriaux, compte tenu des prescriptions complmentaires contenues dans le
prsent article.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.1.1
Le terme maonnerie de petits lments correspond au cahier des clauses techniques du DTU 20.1
(NF P 10-202) .
Les lments structuraux sont dfinis en 11.1.1 , il s'agit essentiellement de murs.
Les lments non structuraux sont dfinis en 12.3.1 , il s'agit essentiellement de cloisons de
distribution ou de doublage des murs extrieurs.
Les maonneries sans dispositions constructives particulires ont une faible rsistance l'effort
tranchant, notamment parce que les panneaux sont longs par rapport leur hauteur, ce qui est
dfavorable la formation de bielles dans les panneaux (voir 12.2.3.2 ). Pour amliorer la
rsistance aux sismes, des dispositions constructives peuvent augmenter la ductilit dans une
certaine mesure ; mais il est plus efficace d'augmenter la rsistance l'effort tranchant, en agissant
sur la qualit de la maonnerie et en lui procurant un encadrement suffisamment rparti et rsistant
l'effet des bielles.
12.1.2 Systmes constructifs
Les systmes constructifs envisags dans ce document sont :
les maonneries chanes ;
les maonneries armes ;
les ossatures en bton arm ou prcontraint avec remplissage en maonnerie.
12.2 Elments structuraux
12.2.1 Spcifications concernant les matriaux
12.2.1.1 Pierre
Le fournisseur doit tablir un document donnant les caractristiques physiques et mcaniques du
matriau, en particulier, la rsistance la rupture en compression. A dfaut de dtermination
exprimentale, la rsistance caractristique est prise gale la valeur minimale, pour le calcul sous action
sismique.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.1.1
Dans le cas des pierres calcaires il existe la norme NF B 10-001 " Pierres calcaires " qui doit tre
remplac par une nouvelle norme en projet NF B 10-601 " Pierres naturelles ". On peut s'inspirer de
ce document pour les autres natures de pierre.
Pour les pierres provenant de carrires couramment exploites, les valeurs de la rsistance
peuvent ventuellement tre prises dans la littrature technique.
12.2.1.2 briques, blocs de terre cuite et de bton
Briques et blocs de terre cuite ;
Blocs de bton ;
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 109 of 184
Blocs de bton cellulaire.
Les normes fixent des catgories de briques et de blocs et les rsistances correspondantes la
compression.
Les valeurs des rsistances caractristiques prendre en compte dans les calculs sont les valeurs
minimales de chaque que catgorie, garanties soit par une marque de conformit la norme, soit par des
essais systmatiques de rception.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.1.2
Les essais de rception sont limits la dtermination de la rsistance la compression.
12.2.1.3 aciers
Les armatures utiliser sont celles prvues pour le bton arm et dfinies par les normes, la valeur
utiliser dans les calculs tant la limite d'lasticit f e .
12.2.2 Dispositions constructives
12.2.2.1 Gnralits - mise en oeuvre
Il est rappel que les rgles ci-aprs viennent en complment des dispositions constructives prvues pour
les btiments ments en situation non sismique, ou s'y substituent. Les dispositions constructives
correspondantes sont donnes par systme constructif et non par nature de matriau ; pour chaque
systme, les matriaux les plus adapts sont indiqus cas par cas. En outre, certaines dispositions de
mise en oeuvre des matriaux sont indiques dans les paragraphes suivants.
12.2.2.1.1 joints
Les joints verticaux doivent toujours tre remplis.
12.2.2.1.2 murs double paroi
La ralisation de murs avec paroi extrieure relie par des attaches la paroi intrieure doit faire l'objet de
justifications des attaches sous action sismique.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.1.2
Les vrifications peuvent tre effectues l'aide des coefficients donns l'article 7 " Actions
locales ".
12.2.2.1.3 pierre
Les maonneries de moellons de pierre doivent tre ralises avec des assises horizontales.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.1.3
Figure 70 Exemples de blocs pouvant ou ne pouvant
pas tre pris en compte
12.2.2.1.4 blocs creux
Pour les lments structuraux principaux, les briques ou blocs creux doivent comporter au moins une
paroi intermdiaire oriente paralllement au plan de l'lment ( voir figure 70 ).
12.2.2.2 Maonneries chanes
12.2.2.2.1 principe.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 110 of 184
Dans le prsent document on appelle " Maonneries chanes " les structures porteuses ralises en
maonnerie de petits lments ( voir 12.1.1 ) et comportant des chanages en bton arm mis en oeuvre
aprs excution de la maonnerie :
chanages horizontaux :
au niveau des fondations (ventuellement) ;
au niveau de chaque plancher ;
au niveau haut ;
chanages verticaux, au moins :
tous les angles saillants ou rentrants de la construction ;
aux jonctions de murs ;
encadrant les ouvertures de hauteur suprieure ou gale 1,80 m ;
avec les dispositions complmentaires nonces ci-aprs.
Aucun lment de mur ne doit prsenter de bord libre en maonnerie.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.2.1
Le cas des maonneries de remplissage dans des ossatures est trait en 12.2.2.4 et 12.2.3.4 .
Chanages horizontaux :
Dans le cas d'un plancher sur vide sanitaire situ moins de 1,20 m au-dessus du fond de
fouille, les chanages prvus au niveau des fondations peuvent tre supprims si la stabilit
reste vrifie.
En l'absence d'un plancher haut en bton (toiture terrasse, plancher sous comble), il est
ncessaire de prvoir des chanages horizontaux en partie haute des murs.
Dans le cas de murs dans la hauteur des combles (pignons, refends), un chanage suivant le
rampant doit tre prvu.
12.2.2.2.2 lments structuraux principaux
Des lments structuraux principaux doivent tre prvus dans deux directions perpendiculaires et
dimensionns comme indiqu en 12.2.3.2 .
Ces lments doivent tre constitus de trumeaux bords de chanages verticaux et ne doivent comporter
aucune ouverture. Il est toutefois tolr dans un panneau des percements de diamtre infrieur ou gal
20 cm en dehors de l'emprise des bielles diagonales (voir 12.2.3.2 ).
Les caractristiques gomtriques de ces trumeaux doivent satisfaire aux conditions suivantes :
paisseur brute minimale :
15 cm pour les murs en lments pleins ;
20 cm pour les murs en lments creux ;
dimensions entre chanages parallles :
dimensions infrieures ou gales 5 m ;
superficie infrieure ou gale 20 m ;
longueur de la diagonale infrieure ou gale :
40 fois l'paisseur brute pour les murs en lments pleins ;
25 fois l'paisseur brute pour les murs en lments creux.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.2.2
La dfinition des lments principaux est donne en 11.1.1 .
Des maonneries de remplissage (faades ou murs intrieurs) rigides par rapport une ossature,
empchant celle-ci d'atteindre une proportion suffisante de sa dformation calcule, doivent tre
considres comme lments structuraux principaux.
Les lments pleins sont :
la pierre, les briques pleines de terre cuite, les blocs pleins de bton, les blocs en bton
cellulaire ainsi que les briques et les blocs perfors mis en oeuvre avec leurs perforations
perpendiculaires au plan de pose.
Les lments creux sont :
les briques creuses de terre cuite et les blocs creux de bton.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 111 of 184
Il est toujours possible de dcomposer un panneau trop grand en deux panneaux plus petits au
moyen d'un chanage vertical. On raccourcit ainsi les bielles actives travaillant en compression
suivant la diagonale des panneaux (voir 12.2.3.2 ).
12.2.2.2.3 lments structuraux secondaires
Les dimensions de ces parties de maonnerie, entre chanages parallles, doivent tre infrieures ou
gales 5 m et les ouvertures qu'elles peuvent comporter doivent tre encadres suivant les dispositions
de 12.2.2.2.7 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.2.3
Il est rappel que les lments structuraux secondaires ne participent pas au contreventement.
Ces parties de maonnerie ont en principe la mme paisseur que les lments structuraux
principaux.
12.2.2.2.4 Chanages horizontaux
Les chanages horizontaux ( voir figure 71 ) doivent rgner sur toute l'paisseur du mur (paisseur totale
du mur s'il s'agit d'un mur double paroi). Toutefois, pour permettre la ralisation de faades dans
lesquelles les lments de bton arm ne restent pas apparents, il est admis que la dimension minimale
des chanages soit ramene aux deux tiers de l'paisseur.
Les chanages encadrant des lments structuraux, principaux ou secondaires, doivent avoir une hauteur
minimale de 15 cm. Leur armature longitudinale doit tre compose d'au moins une barre dans chaque
angle de la section. L'ensemble de ces barres doit pouvoir quilibrer, sous contrainte gale leur limite
lastique, une traction minimale de 80 kN. L'espacement de deux barres d'une mme nappe horizontale
ne doit pas excder 20 cm ( voir figure 72 ).
Tout chanage horizontal doit comporter des armatures transversales d'espacement au plus gal la
hauteur du chanage et 25 cm. Les longueurs de recouvrement et d'ancrage sont celles qui
correspondent la contrainte d'utilisation des barres, majores de 30 %.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.2.4
Il s'agit d'paisseurs brutes et non finies.
Les sections minimales de bton et d'acier sont donnes sous rserve que l'application des rgles
du paragraphe 12.2.3.2 et des rgles DTU 20.1 (NF P 10-202) ne conduise pas des sections
suprieures.
Figure 71 Dispositions types de chanages, en plan.
Figure 72 Chanage des lments structuraux
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 112 of 184
Cette disposition peut tre l'origine de l'adjonction de barres supplmentaires.
12.2.2.2.5 chanages verticaux
Les chanages verticaux doivent rpondre aux mmes rgles que les chanages horizontaux en ce qui
concerne les sections de bton et les armatures longitudinales et transversales.
Toutefois, lorsque l'acclration nominale prise en compte pour l'tablissement du projet est infrieure ou
gale 2,5 m/s, et lorsqu'il s'agit de chanages verticaux de moins de 3 m de hauteur libre, les
dispositions ci-aprs peuvent tre tolres :
a. La section peut tre limite la section ncessaire et suffisante pour assurer un enrobage correct de
l'armature dfinie ci-aprs.
b. L'armature longitudinale minimale d'un tel chanage doit pouvoir, sous contrainte gale la limite
lastique conventionnelle, quilibrer le mme effort que l'armature du chanage horizontal
correspondant. La disposition de ces barres par rapport l'paisseur du panneau peut cependant
tre diffrente de celle des barres du chanage horizontal, condition que la transmission des efforts
reste assure de faon correcte.
Toutefois, la distance d'axe en axe de deux barres voisines ne doit pas tre infrieure 5 cm, et,
hormis le cas des retraits prvus en 12.2.2.2.4 , la distance d'une barre de rive la face du panneau
la plus rapproche ne doit pas tre suprieure 6 cm. Dans le cas de chanages en retrait, les barres
de rives doivent tre places aussi prs du parement que les dispositions du chanage horizontal le
permettent.
Aux angles des constructions, les chanages doivent tre constitus au minimum de quatre barres,
les chanages intermdiaires pouvant ne comporter que deux barres.
c. Il doit tre dispos des armatures transversales d'espacement au plus gal la hauteur de la section
de bton.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.2.5
L'attention des projeteurs est attire sur le fait que certains chanages verticaux peuvent tre
communs deux murs perpendiculaires. En ce cas, on peut retenir pour section du chanage celle
qui rsulte de la superposition des sections auxquelles conduirait l'application de la rgle chaque
mur successivement.
De tels chanages peuvent tre raliss par coulage du bton dans des lments creux de terre
cuite ou de bton de forme approprie.
Les dispositions du dernier alina du paragraphe b) visent assurer aux chanages couls dans
des lments creux un minimum de rsistance aux sollicitations agissant perpendiculairement au
plan des murs.
12.2.2.2.6 Noeuds des chanages
La continuit et le recouvrement des armatures des divers chanages concourant en un mme noeud
doivent tre assurs dans les trois directions ( voir figure 73 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.2.6
Les dispositions adoptes ne doivent pas donner lieu des pousses ou des tractions au vide.
Les noeuds doivent tre traits comme indiqu l' article 11 (frettage ventuel du volume de bton
composant le noeud).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 113 of 184
Figure 73 Exemples de dispositions constructives
12.2.2.2.7 encadrement des baies et ouvertures des lments structuraux secondaires
Les baies et ouvertures qui ne sont pas bordes par des chanages prvus aux articles prcdents
doivent en principe recevoir un encadrement en bton arm ou en mtal trait aux angles comme un
systme mcaniquement continu et reli aux chanages suivant les prescriptions qui suivent. A cette fin,
les ouvertures sont divises en trois catgories :
Catgorie G : Baies et ouvertures prsentant une dimension suprieure 2,50 m.
Catgorie M : Baies et ouvertures prsentant une dimension suprieure 1,50 m (autres que celles
de la catgorie G).
Catgorie P : Baies et ouvertures autres que celles des catgories G et M.
Les dispositions sont les suivantes :
Catgorie G : Encadrement et liaisons aux chanages obligatoires, quelle que soit a N .
Catgorie M : a N 3,5 m/s : encadrement et liaisons aux chanages obligatoires.
2,5 a N < 3,5 m/s : encadrement et liaisons aux chanages obligatoires, sauf lorsque l'ouverture est
pratique dans un panneau dont aucune dimension n'excde 3,20 m.
Catgorie P : si a N 3,5 m/s : encadrement obligatoire,
si 2,5 a N < 3,5 m/s : encadrement obligatoire, sauf lorsque la baie est pratique dans un panneau
dont aucune dimension n'excde 3,20 m.
Les linteaux doivent tre constitus par des poutres ou poutrelles en bton arm, en bton prcontraint,
en mtal ou en bois.
Les encadrements en bton arm doivent avoir une hauteur minimale de 7 cm et leur armature
longitudinale doit tre constitue d'au moins deux barres, une au voisinage de chaque face latrale.
L'ensemble de ces barres doit tre capable d'quilibrer, sous contrainte gale leur limite lastique, une
traction minimale de 40 kN en zone la, 60 kN en zone Ib, 85 kN en zone II et 120 kN en zone III, et
l'espacement de deux barres ne doit pas excder 20 cm.
Les encadrements en mtal doivent avoir une rsistance la traction au moins gale celle exige des
encadrements en bton arm.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.2.7
Cette prescription ne fait pas obstacle l'utilisation d'lments spciaux en terre cuite ou en bton
formant coffrage d'un linteau en bton arm.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 114 of 184
Figure 74 Encadrement en bton arm
12.2.2.3 maonneries armes
12.2.2.3.1 Principes
Les maonneries armes comportent d'abord les dispositions dcrites pour les maonneries chanes et
s'en distinguent par l'existence d'armatures rparties selon le prsent document :
avec armatures horizontales uniquement, disposes dans les joints horizontaux,
avec armatures horizontales et verticales.
12.2.2.3.2 dispositions constructives des maonneries armes horizontalement
Les armatures doivent tre disposes en lits horizontaux continus, allant de chanage vertical chanage
vertical. Chaque lit doit comporter au moins deux barres, une au voisinage de chaque parement.
L'ensemble de ces barres doit pouvoir quilibrer, sous contrainte gale leur limite lastique, une traction
minimale de 13 kN. L'espacement maximal des barres doit tre de 20 cm, et leur enrobage au moins gal
2 cm ct parement extrieur.
L'cartement maximal des lits doit tre de 50 cm.
Les armatures doivent tre correctement ancres dans les chanages verticaux.
Elles doivent tre rectilignes et ne prsenter en aucun point une flche suprieure 1 cm sur une
longueur de 2 m.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.3.2
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 115 of 184
Figure 75 Maonnerie arme horizontalement
12.2.2.3.3 dispositions constructives des maonneries armes horizontalement et verticalement.
Les chanages verticaux et horizontaux doivent rpondre aux mmes critres que ceux fixs au
paragraphe 12.2.3.2 pour la maonnerie chane. Les armatures horizontales et verticales doivent tre
ancres leurs extrmits dans les chanages.
La section minimale, dans chaque direction, disposer entre deux chanages parallles est de 0,5/1000
de la section correspondante des panneaux ; le diamtre minimal des armatures est 5 mm.
L'espacement maximal entre deux lits d'armatures, horizontaux et verticaux, doit tre de 60 cm.
Pour l'application du paragraphe 12.2.2.2.7 , la section des armatures disposes au voisinage des
ouvertures peut tre prise en compte dans la dtermination de la section des armatures des
encadrements.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.3.3
Ce systme constructif concerne particulirement l'emploi de briques ou de blocs de terre cuite ou
de bton, spcialement prvus pour disposer les armatures verticales et horizontales.
Les maonneries de pierre ou de blocs de bton cellulaire ne se prtent pas la ralisation de ce
systme constructif.
Le paragraphe 12.2.2.2.7 traite de l'encadrement des baies et ouvertures. Une largeur de 20 cm
peut tre considre comme constituant le voisinage des ouvertures.
12.2.2.4 maonneries de remplissage dans des ossatures en bton arm ou prcontraint
12.2.2.4.1 principe
Cet article traite des maonneries ralises dans des ossatures en bton arm ou prcontraint et qui n'ont
pas t mcaniquement lies celles-ci.
Sont considrs comme remplissages les panneaux de maonnerie sans fonction porteuse caractrise
vis--vis des charges verticales. Ces panneaux peuvent tre " complets ", c'est--dire remplir
compltement l'espace dlimit par deux poteaux et deux poutres, ou tre " partiels ".
Pour la vrification sous action sismique, les panneaux pris en compte dans la modlisation (voir
12.2.3.4.1 ) constituent des lments structuraux principaux, il s'agit en gnral de panneaux complets
sans ouverture.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.4.1
Le comportement des constructions concernes apparat comme assez alatoire. On ne dispose
pas l'heure actuelle d'lments exprimentaux suffisamment complets pour permettre l'tude
rationnelle de ces btiments.
Les rgles forfaitaires nonces plus loin doivent tre considres comme provisoires. Il est
dconseill de raliser de la sorte des btiments de plus de quelques niveaux (trois ou quatre).
Les panneaux partiels sont par exemple ceux comportant une imposte en partie haute ou une
fentre le long d'un poteau.
12.2.2.4.2 dispositions constructives
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 116 of 184
Les maonneries doivent satisfaire aux conditions gomtriques dfinies en 12.2.2.2 et les lments
d'ossature en bton arm doivent satisfaire aux rgles de l'article 11 du prsent document, relatif au bton
arm.
Les baies et ouvertures doivent recevoir au minimum un encadrement suivant les rgles du paragraphe
12.2.2.2.7 . De mme, les bords libres des panneaux partiels doivent recevoir au minimum un
encadrement suivant les dispositions du paragraphe 12.2.2.2.7 pour les ouvertures de la catgorie G.
Lorsque les panneaux complets avec ouverture et les panneaux partiels sont pris en compte dans la
modlisation (voir 12.2.3.4.1), ces encadrements doivent tre dimensionns pour les sollicitations
rsultantes.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.2.4.2
L'attention est attire sur les poteaux bordant des panneaux partiels dont la partie non bloque par
la maonnerie peut constituer une pice courte dont les dispositions constructives et le
dimensionnement sont traits dans l'article 11 (voir 11.3.6 ).
Les panneaux qui ne sont pas pris en compte dans la modlisation sont des lments non
structuraux (en gnral panneaux complets avec ouverture et panneaux partiels).
Les dispositions du paragraphe 12.2.2.2.7 pour les ouvertures de la catgorie G imposent une
liaison l'ossature, liaison indispensable pour assurer la stabilit des panneaux partiels vis--vis
des actions perpendiculaires leur plan.
12.2.3 Calculs et vrifications des lments structuraux principaux
12.2.3.1 Rgles gnrales
12.2.3.1.1 Sollicitations agissantes
Les sollicitations agissantes sont dtermines suivant l' article 8 , partir des combinaisons indiques en
8.1 , et en tenant compte des coefficients de comportement q indiqus dans l' article 11 , et en 11.7 , du
prsent document.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.1.1
Pour les ossatures en bton arm avec remplissage a posteriori en maonnerie, dfaut de
justifier que le blocage de la maonnerie contre l'ossature assure un comportement quivalent
celui de la maonnerie chane, on doit prendre, dans le tableau 11 du paragraphe 11.7, la valeur
la plus faible du coefficient q.
12.2.3.1.2 sollicitations rsistantes
12.2.3.1.2.1 Actions parallles au plan moyen des lments structuraux
Les sollicitations rsistantes sont calcules compte tenu de l'application aux rsistances caractristiques
des matriaux, ou-considres comme telles, des coefficients de scurit partiels suivants :
Bton de granulats courants : m = 1,5
Pierres
Briques et blocs de terre cuite : m = 0,5 N
Blocs de bton : m = 0,5 N
Blocs de bton cellulaire : m = 0,5 N
Acier : m = 1,0
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.1.2.1
Le coefficient N est prcis pour chaque matriau dans le DTU 20.1 (NF P 10-202) .
12.2.3.1.2.2 Actions perpendiculaires au plan moyen des lments structuraux
Une limitation des contraintes est indique dans les paragraphes qui suivent.
12.2.3.1.3 principes de calcul
12.2.3.1.3.1 Actions parallles au plan moyen
Les lments verticaux de mur (lments structuraux principaux) sont considrs comme des consoles
encastres leur base.
Le principe de fonctionnement et de calcul de ces consoles est indiqu dans les paragraphes suivants du
prsent article pour chaque systme constructif.
12.2.3.1.3.2 Actions perpendiculaires au plan moyen.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 117 of 184
On considre que les panneaux de maonnerie fonctionnent en plaques non encastres sur les appuis.
Les appuis sont constitus par les chanages horizontaux et verticaux. Les actions sont dtermines
suivant l'article 7 des prsentes rgles, concernant les actions locales. Pour les panneaux non arms,
entre chanages, la contrainte de traction doit tre infrieure ou gale 0,3 MPa.
Dans le cas de la maonnerie arme, les panneaux sont justifis par un calcul type " bton arm " ; le cas
chant, les panneaux peuvent tre considrs comme continus sur certains de leurs appuis.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.1.3.2
Ces prescriptions sont valables pour tous les types de matriau, les articles suivants ne concernant
que les actions parallles au plan moyen.
Par calcul type " bton arm " on entend :
plaques sur deux appuis pour la maonnerie arme horizontalement
plaques sur quatre appuis pour la maonnerie arme horizontalement et verticalement.
La continuit peut tre assure par des armatures filantes jusqu'aux appuis sur les deux faces.
12.2.3.2 maonneries chanes
Le principe de calcul de rsistance consiste assimiler l'ensemble form par les panneaux de maonnerie
et par les chanages en bton arm qui les encadrent un systme triangul dont les lments diagonaux
sont constitus par les bielles actives susceptibles de se former dans la maonnerie.
Si les bielles ont une pente comprise entre 1/2 et 2, il n'est pas ncessaire de justifier le non-glissement au
droit des joints.
La largeur w de ces bielles est prise, dans les calculs, gale la plus petite des deux valeurs d/6 et 4e,
soit :
w = min (d/6 ;4e)
o :
d est la longueur de la bielle (diagonale du panneau),
e est l'paisseur brute de la maonnerie.
La contrainte de compression dans la maonnerie doit tre infrieure la rsistance caractristique
divise par m ; les armatures des chanages sont calcules suivant les rgles du bton arm.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.2
Le respect des dispositions constructives du paragraphe 12.2.2.2 permet en gnral pour les
btiments courants d'avoir des bielles d'inclinaison comprise entre 1/2 et 2 ; dans le cas contraire,
deux solutions peuvent tre envisages :
recoupement des panneaux par chanages verticaux ou horizontaux (panneaux de grande
longueur).
considrer dans le calcul des panneaux concerns comme lments structuraux secondaires
pour la rsistance aux actions sismiques (panneaux de faible longueur).
Cette dernire solution concerne en particulier les panneaux de petite longueur, dans les btiments
courants, dont la pente de bielle peut tre suprieure 2 et dont la faible inertie, vis--vis des
autres panneuax, justifie de ngliger leur participation la rsistance aux actions sismiques.
Il est rappel que la dtermination des rsistances caractristiques est indique en 12.2.1 , que les
m sont indiques en 12.2.3.1 et que des rsultats d'essais peuvent tre pris en compte le cas
chant (DTU 20.1) (NF P 10-202) .
Lorsqu'il est ncessaire de connatre le module d'lasticit E de la maonnerie, et dfaut de
justification exprimentale sur les matriaux utiliss, les valeurs disponibles sont de l'ordre de 3 200
MPa, rsultant d'essais raliss en France.
12.2.3.3 maonneries armes
12.2.3.3.1 maonnerie arme horizontalement
Pour les lments structuraux principaux, le principe de calcul est celui indiqu au paragraphe 12.2.3.2
pour la maonnerie chane.
12.2.3.3.2 maonnerie arme horizontalement et verticalement
Deux possibilits sont offertes pour le calcul des lments structuraux principaux :
modlisation analogue celle des maonneries chanes, en prenant pour le calcul de la contrainte
dans la maonnerie une largeur w = min (d/5 ; 5e),
calcul en section type " bton arm ", les armatures verticales des chanages et des parties
courantes devant quilibrer les tractions des zones tendues.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 118 of 184
12.2.3.4 Maonneries de remplissage dans des ossatures en bton arm ou prcontraint
Les principes de calcul noncs ci-aprs correspondent au cas o la maonnerie est mise en oeuvre
aprs ralisation de l'ossature. Dans le cas d'excution de l'ossature aprs la maonnerie, en particulier
poutres coules sur la maonnerie, les principes noncs en 12.2.3.2 pour les maonneries chanes sont
applicables.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.4
Les dformations de l'ossature en bton arm, dtermines par le calcul sans tenir compte des
remplissages, sont en ralit limites par ces remplissages qui donc interviennent dans le
fonctionnement d'ensemble des btiments.
12.2.3.4.1 Modlisation et vrification effectuer
A dfaut de mthode plus prcise, il est admis que la distribution des efforts dans la structure est calcule
en assimilant l'ensemble form par un portique en bton arm et par les panneaux complets de
remplissage qu'il contient, un systme triangul dont les lments diagonaux sont constitus par les
bielles actives susceptibles de se former dans la maonnerie.
Si les bielles ont une pente comprise entre 1/2 et 2, il n'est pas ncessaire de justifier le non-glissement au
droit des joints.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.4.1
Le principe nonc dans ce paragraphe ne permet de prendre en compte ni les panneaux complets
avec ouverture ni les panneaux partiels ; ces panneaux constituent des lments non structuraux
qui doivent tre vrifis comme des lments structuraux secondaires, c'est--dire pour des
dformations imposes.
12.2.3.4.2 dformations horizontales
Il peut tre admis en outre que les dformations horizontales du systme, et par voie de consquence les
moments de flexion dans l'ossature, sont entirement conditionnes par le raccourcissement des bielles,
la rigidit propre de l'ossature tant nglige devant celle des panneaux.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.4.2
Cette simplification est en apparence en faveur de la scurit. Toutefois, cet avantage est plus
apparent que rel car il est compens par le fait que l'intgrit des panneaux de maonnerie,
soumis la fois une compression diagonale et aux flexions rsultant de l'action de la composante
de l'action sismique perpendiculaire son plan et trs sensibles aux imperfections d'excution,
n'est pas entirement fiable.
12.2.3.4.3 pousse des bielles
La rsistance de tous les lments actifs retenus dans le modle doit tre justifie. Il doit tre vrifi en
particulier que les poteaux sont aptes rsister au cisaillement et au moment de flexion dvelopps par
les pousses des bielles, compte tenu des dlestages oprs par la composante verticale de ces
dernires et de ceux conscutifs aux effets de la composante verticale de l'action sismique ( voir figure
76 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.4.3
Comme indiqu dans la note sur le paragraphe 12.2.2.4.1 , il faut envisager dans le fonctionnement
de ce type de structure un glissement entre l'ossature et le panneau de maonnerie, glissement
conduisant un effort tranchant dans le poteau gal l'effort sismique horizontal.
Figure 76 Schma de fonctionnement d'une ossature
avec remplissage en maonnerie
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 119 of 184
12.2.3.4.4 cas des panneaux ngligs
Cette dernire vrification doit tre effectue aussi pour les poteaux bordant les panneaux de maonnerie
ngligs dans le modle. Dans leur cas, les pousses des bielles peuvent tre values en considrant
que les dplacements relatifs horizontaux des planchers du modle constituent pour les bielles des
dformations imposes ( voir figure 77 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.4.4
Ces panneaux ngligs sont par exemple ceux qui ne remplissent pas la condition exprime au
dernier alina de 12.2.3.4.1 ci-dessus, ou certaines des conditions nonces en 12.2.2.2.2 . Il peut
aussi s'agir de ceux que le projeteur a cru bon de ngliger en raison de leurs faibles dimensions et
du peu d'importance de leur participation la rsistance d'ensemble. On doit veiller ce que les
panneaux ngligs ne soient pas susceptibles d'engendrer des efforts de torsion importante.
Les dplacements prendre en considration sont ceux qui rsultent de l'application, au modle,
du systme de forces dfini dans l' article 6 du prsent document.
Figure 77 Dplacement relatif horizontal du plancher
modle
12.2.3.4.5 cas des poteaux d'angle et de rive
Pour les poteaux d'angle et de rive, il doit tre justifi que les pousses au vide s'exerant sur les faces
libres des noeuds, du fait de l'existence d'efforts tranchants dans les poteaux sont correctement
quilibres et reportes sur les poutres ( voir figure 78 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.4.5
On convient d'appeler poteau de rive (mme s'il est en situation intrieure), un poteau qui, au
niveau considr, ne reoit que trois poutres, et poteau d'angle, un poteau qui reoit seulement
deux poutres perpendiculaires. Les poteaux recevant quatre poutres sont dits centraux.
Figure 78 Poteau de rive
12.2.3.4.6 Rsistance l'effort tranchant
Les vrifications de rsistance l'effort tranchant doivent tre en principe effectues suivant les
combinaisons indiques en 6.4 dans lesquelles et ont les valeurs suivantes :
poteaux centraux = 0,3 , = 0,8,
poteaux de rive = 0,3 , = 1,0,
poteaux d'angle = 0,3 , = 1,2.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.4.6
Il est rappel que dans le cas gnral les valeurs de et sont de 0,3 (voir 6.4 ).
12.2.3.4.7 mthodes de vrification
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 120 of 184
12.2.3.4.7.1 Cas gnral
Les vrifications peuvent tre effectues suivant toute mthode scientifiquement tablie sur la base de
rsultats exprimentaux suffisants.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.4.7.1
On ne dispose pas, en l'tat actuel, des connaissances de rsultats suffisamment gnraux et de
mthodes suffisamment simples pour la codification complte de ces vrifications.
12.2.3.4.7.2 Cas de btiments peu levs
A dfaut d'utilisation d'une telle mthode, la vrification de la rsistance des poteaux peut, dans le cas de
btiments de quatre niveaux au plus, tre effectue forfaitairement comme suit :
les moments flchissants dus la dformation de l'ossature sont ngligs ;
les efforts axiaux dans les poteaux sont supposs rduits 50 % de la charge de service pour les
poteaux centraux, et totalement annuls pour les poteaux de rive ou d'angle ;
pour l'effort tranchant, l'effet des deux composantes horizontales est considr indpendamment et
successivement dans chaque direction, les valeurs tant multiplies par :
1,10 pour les poteaux centraux,
1,30 pour les poteaux de rive,
1,50 pour les poteaux d'angle.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.2.3.4.7.2
On entend par charge de service la charge rsultant de la combinaison :
Pour les btiments concerns par ce paragraphe, la combinaison donne au paragraphe 8.1 du
prsent document devient celles du tableau 13 suivant :
Tableau 13 Combinaisons d'actions pour les btiments
de moins de cinq niveaux
12.3 Elments non structuraux
12.3.1 Dfinitions
Les lments non structuraux sont les lments en maonnerie qui n'ont de fonction ni porteuse ni de
contreventement caractrise.
Note sur le paragraphe 12.3.1
Il s'agit essentiellement de cloisons ralises en lments de terre cuite, en bton ou en pltre.
12.3.2 Exigences de comportement
Les dispositions constructives propres aux lments non structuraux sont destines limiter les risques
d'accidents corporels et les risques de dgts aux installations et quipements.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 121 of 184
On doit examiner les possibilits d'interaction avec les lments structuraux et adopter les dispositions
ncessaires pour les lments concerns.
Note sur le paragraphe 12.3.2
Certains lments non structuraux, de par leurs caractristiques (rsistance, raideur), peuvent
modifier le comportement rel des lments structuraux, en particulier gner la dformation des
ossatures souples ; il faut alors en tenir compte dans la modlisation, dans le calcul d'ensemble et
dans les dispositions constructives.
Il faut en particulier viter de modifier la raideur des lments structuraux. Dans le cas du bton
arm, il faut viter le fonctionnement en " poteau court " (voir notes sur 12.2.2.4.2 et 11.3.6 ).
12.3.3 Dispositions constructives
12.3.3.1 Cloisons de distribution intrieure d'paisseur infrieure ou gale 10 cm
Les cloisons de distribution intrieure d'au plus 10 cm d'paisseur brute doivent satisfaire aux rgles ciaprs :
a. Elles ne doivent pas prsenter de bord libre.
b. Elles doivent toujours se joindre soit avec une cloison ou un mur perpendiculaires, soit avec des
lments d'ossature, soit avec des potelets de bton arm, mtal ou bois, spcialement disposs
cet effet et fixs leurs deux extrmits.
c. Les cloisons rgnant sur toute une hauteur d'tage doivent tre rendues suffisamment solidaires de
la sous-face du plancher suprieur pour viter leur dversement.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.3.3.1 C)
Lorsqu'une semelle rsiliente est prvue en partie haute d'une cloison, la tenue au
dversement de celle-ci doit tre assure (cas de certains ouvrages raliss suivant le DTU
25.31 (NF P 72-202) par exemple).
d. Les cloisons ne rgnant pas sur toute la hauteur de l'tage doivent tre encadres par des lments
de bton arm, mtal ou bois, solidariss entre eux et lis au gros-oeuvre.
e. La jonction de deux cloisons perpendiculaires doit tre ralise par harpages alterns tous les lits,
ou par toute disposition constructive quivalente.
f. La surface des panneaux dlimits par les lments verticaux d'appui (cloisons ou murs
perpendiculaires la cloison considre, lments d'ossature, ou potelets) ne doit pas dpasser,
ouvertures comprises, 14 m, sans que la plus grande dimension puisse excder 5 m, ni la diagonale
cent fois l'paisseur brute.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.3.3.1 F)
Les panneaux prsentant initialement de trop grandes dimensions peuvent toujours tre
diviss en panneaux lmentaires rpondant aux conditions du paragraphe. Cette division
peut tre ralise par exemple au moyen de potelets lis au gros-oeuvre.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.3.3.1
L'ossature support des ouvrages en plaques de parement en pltre permet de rpondre aux
exigences nonces dans les articles suivants. Il en est de mme pour tout systme similaire
disposant d'une ossature relie aux lments structuraux.
12.3.3.2 cloisons de distribution intrieure d'paisseur suprieure 10 cm et lments de mur non
structuraux
Les cloisons de distribution intrieure de plus de 10 cm d'paisseur brute et les lments de mur non
structuraux doivent recevoir des chanages en bton arm, mtal ou bois, fixs leurs extrmits et
dlimitant des panneaux suivant les rgles ci-dessous :
dimensions infrieures ou gales 5 m,
superficie infrieure ou gale 20 m,
longueur de la diagonale infrieure 50 fois l'paisseur brute.
Les chanages en bton arm doivent tre raliss suivant les dispositions constructives donnes au
paragraphe 12.2.2.2.7 et les chanages en mtal ou bois doivent avoir une rsistance la traction et une
rigidit au moins gales celles exiges des chanages en bton arm ( voir figure 79 ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 122 of 184
On doit examiner les rpercussions que les panneaux ainsi constitus peuvent avoir sur le comportement
des structures, et prendre des dispositions en consquence.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.3.3.2
Figure 79 Rappel des dispositions constructives des
encadrements des baies et ouvertures
Les dispositions prendre peuvent tre :
vrification des panneaux et chanages pour les dformations imposes ;
vrification des poteaux d'ossature constituant des pices courtes.
12.3.3.3 Baies et ouvertures
Les baies et ouvertures pratiques dans les lments non structuraux doivent recevoir un encadrement en
bton arm, mtal ou bois, mcaniquement continu aux angles et reli l'ossature ou aux chanages,
lorsqu'elles prsentent une dimension suprieure 2,50 m.
Pour les lments viss en 12.3.3.2 ci-dessus, ces encadrements doivent tre conformes aux dispositions
de ce paragraphe.
12.4 Elments divers
12.4.1 Gnralits
Les paragraphes qui suivent ont pour objet de donner des limites d'utilisation.
Ils ne concernent ni les enduits ni les revtements, pour lesquels aucune prcaution spciale n'est exige.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.4.1
Dans les articles suivants, les renvois au paragraphe 12.2.2.2 concernent les dispositions
constructives pour les maonneries chanes.
12.4.2 Murs ou lments de mur isols
12.4.2.1 Petits lments de mur en console verticale
Les petits lments de mur libres en tte doivent, lorsqu'ils font partie d'un btiment, tre traits dans les
conditions dfinies en 12.2.2.2 .
Pour l'application de ces rgles, ils sont considrer comme des lments non structuraux, mais les
chanages horizontaux et verticaux correspondant sont calculer comme indiqu l'article 7 " Actions
locales ".
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.4.2.1
Cette disposition concerne par exemple des parapets, garde-corps, couronnement, acrotres, etc.
12.4.2.2 Murs de clture et murs d'enceinte
a. Aucune justification par le calcul et aucune disposition constructive particulire ne sont exiges pour
les murs de hauteur au plus gale 1,50 m.
b. Aucune disposition constructive particulire n'est exige lorsque l'application des rgles de calcul
dfinies l'article 7 ne fait pas apparatre de traction dans les maonneries.
c. Dans le cas contraire, ces ouvrages sont justiciables des dispositions prvues en 12.2.2.2 , mais,
pour l'application de ces rgles, ils sont considrer comme des lments non structuraux.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 123 of 184
12.4.3 Murs de soutnement
Ces ouvrages sont dispenss de prcautions spciales lorsque l'application des rgles de calcul dfinies
l'article 10 ne fait pas apparatre de traction dans les maonneries de ces ouvrages.
Dans le cas contraire, ces ouvrages sont justiciables des prescriptions gnrales prvues en 12.2.2.2 .
Pour l'application de ces rgles, ils sont considrer comme des lments structuraux principaux.
12.4.4 Plafonds suspendus - plafonds fixs
12.4.4.1 Systmes constructifs
L'utilisation de tous les systmes dfinis dans les DTU est admise avec les prcautions donnes dans les
paragraphes ci-aprs. Les autres systmes ne pourraient tre admis que sur justifications spciales.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.4.4.1
L'utilisation de plafonds en lments lourds est viter.
12.4.4.2 vrification de la rsistance
Les plafonds et leur ossature doivent pouvoir rsister aux efforts dfinis l' article 7 .
De plus, dans le cas des plafonds suspendus, la suspension doit tre contrevente dans le plan vertical et
tudie de telle sorte que, dans l'ventualit d'un effondrement local, la chute d'un ou plusieurs lments
ne puisse entraner la chute des lments voisins.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.4.4.2
Dans le cas de plafonds suspendus pour lesquels les conditions nonces ne seraient pas
ralises, un dispositif de protection devrait tre prvu pour viter la chute des lments en cas de
dsordre. L'attention est tout spcialement attire sur les plafonds suspendus dont la suspension
comporte des crochets obliques et pour lesquels l'ventualit d'un effondrement local apparat
comme plus particulirement redouter. Les dispositions correspondantes doivent faire l'objet
d'une vrification minutieuse de ce point de vue.
12.4.4.3 limitation d'emploi
Les plafonds suspendus en lments de terre cuite ( DTU 25.231 (NF P 68-202) ) doivent tre de type A.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.4.4.3
Il est prcis que le type A comporte une armature longitudinale continue, le type B sans armature
n'tant pas admis.
12.4.5 Escaliers
Les escaliers en vote sarrasine, les paliers constitus par des votes en maonnerie, les escaliers
forms de marches prises en console dans un mur d'chiffre en maonnerie, sont interdits.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 12.4.5
Cet article ne concerne pas les escaliers que l'on peut considrer comme des ouvrages annexes
(tels que les perrons, etc.) et dont l'effondrement ne parat pas susceptible d'entraner d'accident
corporel.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 124 of 184
13 Construction en acier
13.1 Symboles utiliss
majuscules latines
G action permanente
L longueur
M moment flchissant
N effort normal
Q action variable
R rsistance
S sollicitation
V effort tranchant
minuscules latines
b largeur
f rsistance (d'un matriau)
i rayon de giration
q coefficient de comportement
t paisseur
y, z axes de la section transversale
minuscules grecques
(alpha) multiplicateur de charge
(gamma) coefficient partiel de scurit
(lambda) lancement
p (rho) coefficient de corrlation
(psi) facteurs dfinissant des valeurs reprsentatives d'actions variables
indices
A structure acier
B structure bton
b flambement
d valeur de calcul
E effet des actions
el lastique
K critique
max maximum
min minimum
o point central
pl plastique
R rsistance
S sollicitation
y, z axes de la section transversale
13.2 Principes gnraux
Les structures de btiments en acier situs en zones sismiques doivent, pralablement toute vrification
parasismique, satisfaire aux rglements de construction en acier et aux normes en vigueur.
En complment de ces rgles, les structures en acier devant rsister l'action sismique doivent en outre
satisfaire aux conditions particulires de conception et de rsistance dfinies dans le prsent article.
La structure en acier peut tre conue :
soit avec un comportement non dissipatif,
soit avec un comportement dissipatif.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 125 of 184
Pour des raisons de cohrence et d'homognit de la scurit, il convient d'utiliser, pour un ouvrage, un
seul et mme rglement de conception et calcul des constructions en acier.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.2
Documents en vigueur :
DTU P22-701 : Rgles CM 66 incluant l'Additif 80
Norme NF P 22-311 (Eurocode 3 et son Document d'Application Nationale)
Autres normes NF de la srie P22-xxx.
Chacun de ces rglements doit tre utilis dans le respect de son domaine de validit, en particulier
pour ce qui concerne la limitation de l'lancement des parois de profils.
Dans le cadre de la vrification parasismique, les sollicitations sont calcules partir d'une analyse
globale lastique de la structure du premier ordre gomtrique ou, si ncessaire, du deuxime
ordre.
13.2.1 Structures en acier comportement non dissipatif
Ces structures sont dimensionnes de manire devoir rsister l'action sismique de calcul en restant
dans le domaine du comportement lastique.
Dans ce cas, la vrification parasismique ne comporte aucune exigence particulire par rapport aux rgles
en vigueur.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.2.1
Pour ces structures non dissipatives seules sont applicables les Rgles CM 66 ou la norme NF P
22-311 , avec la possibilit de considrer des sections de classe 3 et/ou 4.
Pour ces structures, l'nergie sismique ne peut tre dissipe que par amortissement interne (voir
Tableau 6 ).
13.2.2 Structures en acier comportement dissipatif
Ces structures sont dimensionnes de telle faon que, lors d'un vnement sismique, certains de ses
lments soient le sige de dformations plastiques dont la localisation et l'efficacit dissipative doivent
tre parfaitement contrles.
L'nergie sismique externe, laquelle les structures sont soumises, est dissipe essentiellement sous
forme hystrtique par le travail de dformation plastique dans les lments de structure ou dans des
zones localises de ces lments.
Pour une bonne efficacit des zones dissipatives, les dimensions nominales des sections doivent tre
respectes ainsi que des exigences particulires concernant :
le matriau acier,
la stabilit de forme des lments,
la stabilit d'ensemble de la structure,
et le principe de dimensionnement en capacit (cf. article 13.8 ).
En ce qui concerne :
le matriau acier dans les zones dissipatives : il y a lieu de s'assurer d'une ductilit, d'un
raffermissement et d'un allongement en rupture convenables (les conditions de l' article 3.2.2.2 de la
norme NF P22-311 doivent tre appliques) ainsi que d'une bonne soudabilit ;
le matriau acier dans les zones dissipatives et non dissipatives adjacentes : les variations des
limites d'lasticit relles vis--vis des limites d'lasticit de calcul ne doivent pas remettre en cause
l'emplacement des zones dissipatives. Plus prcisment, si le rapport maximal de la limite d'lasticit
relle la limite d'lasticit de calcul dans une zone dissipative, savoir (f yr /f y )max venait tre
suprieur de plus de 15 % au minimum du rapport de mme type (f yr /f y )min dans une zone non
dissipative, il y aurait lieu de reconsidrer les calculs de vrification en rsistance et stabilit des
barres de la structure. Dans cette ventualit, il est admis de procder par une simple majoration des
sollicitations de calcul dans les barres non dissipatives, en les multipliant par le facteur : (f yr /f y )max/(f
yr /f y )min ;
la stabilit d'ensemble de la structure : conformment l'application de 6.6.1.5, les effets du second
ordre peuvent tre ngligs dans certains cas, ou peuvent tre pris en considration par des
mthodes de calcul appropries, telles que celles de l' article 5.2.6.2 de la norme NF P 22-311 ou de
l'article 7 de l' Additif 80 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.2.2
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 126 of 184
Des dispositions constructives spcifiques peuvent tre envisages pour privilgier la formation de
zones dissipatives localises sous l'action sismique. L'augmentation d'hyperstaticit d'une structure
peut favoriser galement un meilleur comportement dissipatif.
L'attention doit tre attire sur l'incidence prjudiciable que peut avoir la variation de la limite
d'lasticit relle, ceci pour chaque nuance d'acier concerne (diffrentes nuances d'acier pouvant
tre utilises dans une mme structure). En particulier, on doit s'assurer que la limite d'lasticit
nominale des aciers utiliss sur le site correspond bien celle qui a t spcifie au projeteur.
En ce qui concerne la dispersion du rapport f yr /f y , il est admis de ne faire rfrence qu' la limite
d'lasticit des semelles des profils ( l'exception du cas de profils hybrides reconstitus par
soudage). Il appartient au projeteur de fixer une valeur, suffisamment reprsentative de la ralit,
du rapport (f yr /f y )max/(f yr /f y )min ; pour cela, il peut se baser sur des certificats dlivrs par les
forges et sur des contrles appropris effectus lors de la fabrication en atelier.
13.3 Types de structures en acier
Les structures sont classes en diffrents types en tenant compte la fois de leur rigidit et de leur
rsistance plastique (au sens dissipatif) vis--vis de l'action sismique. Ce classement se traduit dans les
valeurs affectes au coefficient de comportement q qui peut tre utilis dans l'analyse de la structure (voir
6.3 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3
Le coefficient de comportement q peut tre dfini comme le rapport entre l'intensit sismique
maximale que peut subir la structure et celle pour laquelle la structure atteint son tat limite
lastique.
13.3.1 Structures parasismiques comportement non dissipatif
Ces structures ne relvent d'aucune classification particulire en terme de conception parasismique.
Le coefficient de comportement q adopter dans les calculs doit tre gal 1.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3.1
Dans le cas de structures parasismiques comportement non dissipatif, les sollicitations
engendres dans les structures par l'action sismique de calcul sont dtermines par une analyse
globale lastique, mais il est admis de pouvoir effectuer les vrifications de rsistance et de stabilit
des lments dans le domaine plastique lorsque ceux-ci prsentent des sections de classe 1 ou 2.
13.3.2 Structures parasismiques comportement dissipatif
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3.2
Les schmas de structures reprsents ci-aprs sont purement conceptuels et sont donns titre
indicatif. Les articulations sont indiques par des cercles et les encastrements par des angles
renforcs. Il appartient au projeteur de modliser correctement le fonctionnement de sa structure en
fonction de la conception des assemblages qu'il entend retenir.
On distingue :
13.3.2.1 Les structures en " portiques "
Ces structures rsistent aux efforts sismiques essentiellement par la rsistance en flexion des poutres, les
assemblages de type poutre-poteau devant tre rigides et avoir une rsistance suffisante pour ne pas tre
dissipatifs.
Les poteaux doivent tre conus et calculs comme des lments non dissipatifs. Toutefois, des rotules
plastiques peuvent tre admises leur base lorsque celle-ci est encastre.
NOTE
Dans ces structures, les zones dissipatives se dveloppent essentiellement dans les poutres au
voisinage des noeuds d'assemblages poutre-poteau. La dissipation d'nergie se fait par
dformations plastiques localises sous forme de rotules plastiques (R.P.) (fonctionnant en flexion
alterne), comme indiqu en Figure 80 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 127 of 184
Figure 80 Exemples de structures en " portiques "
NOTE
Pour un portique un seul niveau et une seule trave, la situation assez frquente o les rotules
plastiques sont dans les poteaux est considre l'article 13.3.2.5 .
13.3.2.2 Les structures contreventement triangul
Vis--vis du comportement dissipatif de ces structures, le systme de contreventement peut tre conu de
deux manires diffrentes : soit de manire " centre ", soit de manire " excentre ".
13.3.2.2.1 Contreventement " centr "
Il s'agit de structures triangules classiques pour lesquelles les lignes d'pure des diagonales de
contreventement (les lignes des centres de gravit) ne prsentent aucun excentrement par rapport
l'intersection des lignes d'pure des poutres et des poteaux.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3.2.2.1
Dans ces structures, l'action sismique est reprise essentiellement au niveau des sollicitations
axiales (de traction et de compression) dans les diagonales composant le systme de
contreventement. En ralit, la majeure partie de l'nergie dissipe est due au comportement
ductile des barres en traction. Toutefois, sous rserve d'une limitation de l'effet de dgradation par
flambement et du contrle des conditions de rigidit des noeuds, les diagonales de
contreventement en compression peuvent contribuer partiellement au comportement dissipatif de la
structure.
Les systmes de contreventement centr se classent comme suit.
a. Contreventement en croix de Saint-Andr
Dans ce systme, il est admis de considrer que seules les diagonales de contreventement en
traction, pour un sens donn de l'action sismique horizontale, interviennent avec efficacit dans la
rsistance dissipative de la structure (exemples donns en Figure 81 ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 128 of 184
Figure 81 Exemples de structures " contreventement
en croix de Saint-Andr "
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3.2.2.1 A)
Les diagonales en compression constituent des lments faiblement dissipatifs en raison de
leur flambement sous sollicitations axiales rptes.
b. Contreventement en V
Dans ce systme, le point d'intersection des diagonales de contreventement se trouve sur la traverse
horizontale qui doit tre continue. La rsistance l'action sismique horizontale ne peut tre procure
qu'en considrant la participation conjointe des diagonales tendues et comprimes (exemples
donns en Figure 82 ).
Figure 82 Exemples de structures " contreventement
en V "
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3.2.2.1 B)
Dans la mesure o les diagonales de contreventement comprimes doivent intervenir dans la
stabilit de la structure, le comportement global dissipatif de ce type de structure est moins
efficace que le prcdent.
c. Contreventement en K
Dans ce systme de contreventement, le point d'intersection des lignes d'pure des diagonales de
contreventement se trouve sur l'axe des poteaux. Un tel systme ne doit pas tre considr comme
dissipatif (exemple donn en Figure 83 ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 129 of 184
Figure 83 Exemple de structure " contreventement en
K"
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3.2.2.1 C)
Un contreventement en K n'est pas considr comme dissipatif parce qu'il exigerait la
coopration du poteau au mcanisme plastique ; en effet, ce mcanisme tend former une
rotule plastique dans le poteau ds que la rsistance en compression de la diagonale du
contreventement est dpasse.
13.3.2.2.2 Contreventement " excentr "
Il s'agit d'un systme o les lignes d'pure des diagonales de contreventement ne passent pas par les
intersections des lignes d'pure des poutres et poteaux (exemples donns en Figure 84 ).
Figure 84 Exemples de structures " contreventement
excentr "
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3.2.2.2
Les excentrements introduisent dans la structure des zones plastiques o se localisent les
dissipations d'nergie par dformation plastique, la fois en flexion et en effort tranchant.
13.3.2.3 Les structures " en portiques " et contreventes par triangulation
Ce type de structure combine les comportements des deux types de structure dcrits prcdemment.
La dissipation de l'nergie apporte par l'action sismique se fait la fois par formation de rotules
plastiques dans les poutres et par dformation plastique axiale dans les diagonales de contreventement.
Ces diagonales interviennent galement pour limiter les dplacements relatifs entre planchers conscutifs
(exemples donns en Figure 85 ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 130 of 184
Figure 85 Exemples de structures " en portiques " et
contreventes par triangulation
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3.2.3
Les structures " en portiques " et contreventes par triangulation prsentent un trs bon
comportement parasismique.
13.3.2.4 Les structures avec diaphragmes
Ces structures rsistent, vis--vis de l'action sismique, par l'effet de diaphragme des parois verticales
(murs) et/ ou horizontales (planchers). Le niveau de comportement dissipatif de ces structures est fonction
de la capacit de rsistance ductile au cisaillement des parois, celles-ci pouvant tre labores partir de
techniques et matriaux trs divers (tle nervure forme froid, mur en maonnerie arme, voile en
bton arm, panneaux spciaux prfabriqus, etc.). Les parois doivent tre fixes au cadre de l'ossature
mtallique de manire pouvoir considrer la liaison comme rigide (exemple donn en Figure 86 ).
Figure 86 Exemple de structure avec diaphragmes
13.3.2.5 Les structures fonctionnant en console verticale
Ces structures particulires se traduisent par un comportement dissipatif localis uniquement aux
extrmits de poteaux (exemples donns en Figure 87 ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 131 of 184
Figure 87 Exemples de structures fonctionnant en console
verticale
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 13.3.2.5
Ce type de structure, de faible degr d'hyperstaticit, concerne aussi bien des portiques classiques
un seul niveau, avec une traverse rigide, que des structures lances de type " tube " o les
lments rsistants sont essentiellement des poteaux situs en priphrie de la structure.
13.3.2.6 Les structures couples en acier et bton arm
Ces structures comprennent la fois une (ou plusieurs) ossature(s) mtallique(s) et une (ou plusieurs)
ossature(s) en bton arm qui rsistent conjointement sur toute la hauteur aux actions sismiques
(exemple donn en Figure 88 ).
Figure 88 Exemple de structure couple en acier et bton
arm
13.4 Coefficient de comportement des structures dissipatives
Le coefficient de comportement introduit au paragraphe 13.3 traduit la proprit pour une structure d'avoir
un plus ou moins bon comportement dissipatif vis--vis des sollicitations sismiques (exemple donn en
Figure 89 ). Dans le cas de structures rgulires ( voir 6.6.1.2.1 ), le coefficient de comportement pour les
divers types de structures prsents en 13.3 est donn dans le Tableau 14 ci-aprs .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 132 of 184
Tableau 14 Coefficient de comportement (structures
rgulires)
Les valeurs du coefficient de comportement donnes dans le Tableau 14 sont multiplier par 0,85 pour
les constructions moyennement rgulires ( cf. article 6.6.1.3.1 ) et 0,70 pour les constructions
irrgulires, il n'est pas ncessaire que les valeurs finales soient infrieures 2.
u / 1 est le facteur d'adaptation plastique de la structure. Forfaitairement, on peut adopter u / 1
gal :
1,1 pour un portique simple 1 seule trave et 1 seul niveau ;
1,2 pour un portique 1 seule trave et plusieurs niveaux ;
1,3 pour un portique plusieurs traves et plusieurs niveaux ;
1,2 pour les structures triangules avec triangulation excentre ;
1,1 pour les structures avec diaphragme ou " en consoles ".
Les valeurs indiques pour q dans ce Tableau ne peuvent tre utilises que si les exigences de l'article
13.5 relatives la classe des sections sont satisfaites ; dans le cas contraire, des valeurs de q infrieures
celles indiques dans le Tableau doivent tre utilises, en conformit avec la classe de section adopte.
L'utilisation de la valeur q = 5 u / 1 8 spcifie pour les structures en portiques avec contreventement
triangul ou non et les structures triangulation excentre ncessite de garantir que la ruine de la
structure sous les actions sismiques se produit suivant un mcanisme plastique global ; on doit en
particulier viter les ruines par mcanisme local d'tage ou par mcanisme partiel impliquant un nombre
restreint d'tages. Lorsqu'une analyse globale plastiqueest utilise pourdterminer le rapport u / 1 , elle
permet de vrifier ce caractre global du mcanisme de ruine.
Pour les structures couples en acier et bton arm, on peut adopter le coefficient :
avec :
V A , V B = efforts tranchants la base repris respectivement par la structure acier et par la structure
bton, pour une distribution verticale des actions sismiques lastiques, non rduites par un facteur de
comportement et bases sur le mode fondamental de vibration dans la direction de calcul,
q A , q B = coefficients de comportement correspondant respectivement la structure en acier et la
structure en bton arm.
Dans le cas d'une structure compose d'un ou plusieurs niveaux en bton arm surmonts d'une ossature
en acier, sauf justification particulire par une approche plastique globale, il convient d'adopter pour q A,B la
plus faible des valeurs q A et q B .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 133 of 184
Dans le cas de constructions pour lesquelles a N 2,5 m/s, on peut adopter un coefficient de
comportement q = 2, sans exigence particulire autre que les suivantes :
Les lments constitutifs du systme de stabilit vis--vis des actions sismiques doivent tre au
minimum de la classe C dfinie au Tableau 13.5.1, except si une capacit de dissipation de ces
lments peut tre dmontre partir d'essais appropris.
Les triangulations en K sont exclues du systme de stabilit vis--vis des actions sismiques.
Les assemblages boulonns du systme de stabilit vis--vis des actions sismiques sont constitus
de boulons haute rsistance prcontraints, travaillant soit au frottement, soit en extension de
plaques, ou ventuellement de boulons calibrs dans des perages jeu rduit (boulons dits " plein
trou ") travaillant en pression diamtrale.
Deux coefficients de comportement q diffrents peuvent tre adopts pour les deux composantes
horizontales de l'action sismique lorsque deux systmes structuraux dissipatifs diffrents sont utiliss dans
les directions correspondantes de cette action ou lorsque diffrents matriaux structuraux en lvation
interviennent dans ces directions, sous rserve toutefois qu'il n'y ait pas un couplage des rponses
dynamiques de la structure dans les deux directions.
Figure 89 Dtermination de 1 et 4
NOTE
L'utilisation du coefficient de comportement q se place dans le cadre de la mthode dfinie en 6.3 .
Dans le Tableau 14 , le rapport u / 1 traduit la facult de redistribuer les efforts plastiquement dans
la structure : il est donc d'autant plus lev que celle-ci est plus hyperstatique. Cette redistribution
peut tre prise en compte sous rserve que les zones dissipatives de la structure ne prissent pas
prmaturment, faute d'une capacit de dformation suffisante (ductilit).
Les paramtres 1 et u sont des valeurs particulires du multiplicateur des actions sismiques
seules, celles-ci tant dtermines sur la base du mode fondamental de vibration ou d'une
approximation de ce mode dans le cas d'un btiment rgulier ( cf. 6.6.1.2.4 ). Avec l'hypothse
d'une croissance monotone de , les autres actions restant constantes, 1 et u correspondent
respectivement au stade d'apparition de la premire rotule plastique et au stade provoquant un
mcanisme de ruine de la structure (dtermin par une analyse globale plastique du premier ordre
gomtrique).
Les paragraphes 13.3 et 13.4 , ainsi que leurs commentaires distinguent diffrents types de structures
courantes dont les parties dissipatives concernent des systmes de contreventement disposs dans des
plans verticaux de la construction. Pour autant, on peut galement donner un rle dissipatif des
systmes de contreventement de mme nature disposs dans des plans horizontaux de la construction.
NOTE
On peut notamment citer l'exemple d'une poutre au vent de toiture de grande porte, conue
comme dissipative, reportant les actions sismiques sur des stabilits verticales d'un seul niveau
(croix de Saint Andr ou voiles en bton arm).
13.5 Exigences relatives la classe des sections
Pour les structures calcules avec un coefficient de comportement q > 1, les parois des sections flchies
et/ou comprimes des lments ayant un rle dissipatif dans ces structures (poutres, barres de
contreventement) doivent satisfaire les critres de classe de section indiqus dans le Tableau 16 . Les
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 134 of 184
classes de section sont indiques dans le Tableau 15 en fonction directement du coefficient de
comportement q.
Tableau 15 Critres de classe de section en relation avec
le coefficient de comportement
Dans le cas o des lments dissipatifs sont soumis des efforts normaux de compression, l'utilisation
d'un coefficient de comportement suprieur 6 est subordonne au respect des conditions suivantes sur
l'lancement rduit dans le plan de flambement le plus dfavorable pour chacun de ces lments :
barre flchie avec inversion de courbure : N Sd /N pl ,R d 0,15 et [lambar] 1,1
barre flchie en simple courbure : N Sd /N pl ,R d 0,15 et [lambar] 0,65
o :
N pl,Rd est la rsistance plastique de calcul de la barre l'effort normal.
NOTE
Les classes de section considres au Tableau 15 sont celles de la norme NF P 22-311
l'exception de la classe C se situant entre les classes 2 et 3 de cette norme dans la mesure o elle
intgre un aspect dissipatif en plus de l'exigence de ductilit. La classe 4 de la norme NF P 22-311
oblige adopter q = 1, except si une certaine capacit dissipative peut tre dmontre partir
d'essais appropris.
On notera, par rfrence au Tableau 14 , que le coefficient de comportement q de structures en
portiques, ou structures triangulation excentre, ou encore structures en portiques et triangules,
doit tre abaiss la valeur :
q = 4 si les sections sont de classe B
q = 2 si les sections sont de classe C
Pour rappel,
est l'lancement rduit o est l'lancement rel et o
dsigne l'lancement qui correspond l'atteinte de la limite d'lasticit f y .
On pose
avec f y en N/mm.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 135 of 184
Tableau 16 Valeurs maximales du rapport b/t
13.6 Calcul des dplacements lasto-plastiques
Pour les structures en portiques et les structures triangulation excentre dans lesquelles la dissipation
rsulte essentiellement de rotules plastiques formes dans les poutres, permettant ces structures de
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 136 of 184
bnficier d'un facteur de comportement q 5, les dplacements lasto-plastiques maxima par rapport
la base des structures dfinies ci-aprs peuvent tre rduits lorsque ces structures sont surdimensionnes
par rapport aux actions sismiques. Les dplacements concerns par cette rduction correspondent aux
expressions d r donnes aux clauses 6.6.1.2.5 et 6.6.1.3.5 pour les btiments respectivement rguliers et
moyennement rguliers, et plus gnralement aux dplacements lastiques engendrs par les forces
statiques quivalentes de calcul non rduites par le facteur de comportement q lorsqu'une analyse modale
spectrale est utilise ( cf. 6.6.2 ). Le facteur multiplicatif de rduction 1/ appliquer ne doit pas tre
infrieur 0,6 ; il convient de s'assurer galement que les structures sont capables d'tre pleinement
dissipatives avec formation d'un mcanisme global (cf. 5 e alina de 13.4 ) sous des actions sismiques
d'intensit croissante.
est la valeur minimale des rapports i = R di /S di dans toutes les zones dissipatives censes se former ;
R di est la rsistance de calcul de la zone i, et S di la valeur de calcul de la sollicitation (essentiellement ici le
moment flchissant, combin ventuellement avec l'effort normal et/ou l'effort tranchant) exerce sur la
zone i dans la situation sismique de calcul ( cf. 13.8 ).
13.7 Assemblages situs au voisinage des zones dissipatives
A dfaut d'une justification scientifiquement tablie et valide par l'exprience, l'emploi d'assemblages
semi-rigides et/ou partiellement rsistants n'est pas autoris au voisinage des zones dissipatives.
Les cordons de soudure en bout ou en T, raliss pleine pntration, avec ou sans prparation en
chanfrein, ne ncessitent aucune vrification de calcul.
Les cordons d'angle ou les cordons pntration partielle, ainsi que les assemblages boulonns, doivent
vrifier la condition gnrale suivante :
R as,d E R p,d
avec :
R as,d rsistance de calcul du cordon de soudure ou de l'assemblage boulonn (tant des lments de
fixation que des pices constitutives de l'assemblage) ;
E coefficient de scurit pris gal 1,2 ;
R p,d rsistance de calcul de la tle ou de la poutre assemble.
Dans les assemblages en T, les cordons d'angle et les cordons pntration partielle ne sont pas admis
pour les paisseurs de tle suprieures 16 mm.
Pour les assemblages de type poutre-poutre ou poutre-poteau d'lments sollicits essentiellement en
flexion, R as,d et R p,d correspondent des moments rsistants, ventuellement rduits par la prsence de
l'effort normal et de l'effort tranchant.
Les assemblages boulonns doivent tre constitus de boulons haute rsistance prcontraints
travaillant soit au frottement soit en extension de plaques, ou ventuellement de boulons calibrs dans
des perages jeu rduit (boulons dits " plein trou ") travaillant en pression diamtrale. La rsistance des
assemblages travaillant en extension doit tre tablie par application de la norme NF P 22-460 ou par
application de l'annexe J (avec l'amendement A2) de la norme NF P 22-311 . Dans ce second cas, la ruine
de l'assemblage doit intervenir suivant le mode 1 dfini par la clause J.3.2.1.
La condition gnrale de sur-rsistance nonce ci-avant doit tre applique aux dispositions d'ancrage
prvues en pied de poteaux.
NOTE
En fonction de leur rigidit, on peut classer les assemblages en assemblages de type articul,
assemblages rigides et assemblages semi-rigides (voir article 6.4.2 de la norme NF P 22-311 ).
L'utilisation d'assemblages semi-rigides et/ou partiellement rsistants ncessiterait le contrle
rigoureux de la capacit de rotation de ces assemblages (avec le risque de fatigue oligocyclique) et
l'valuation approprie du coefficient de comportement q qui en rsulterait.
Les assemblages calculs sur la base de la norme NF P 22-460 sont rputs galement tre de
type rsistant au glissement l'tat limite ultime.
Des lments d'attache prsentant un mode de fonctionnement quivalent aux boulons
prcontraints haute rsistance peuvent galement tre utiliss.
13.8 Vrification de la rsistance et de la stabilit des barres
En rgle gnrale, il y a lieu de s'assurer que :
les lments considrs comme dissipatifs pour le type de structure mtallique concern ( cf. 13.3 )
ont une rsistance et une stabilit suffisantes, soit :
R di S di pour l'lment dissipatif i,
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 137 of 184
tout en prsentant une capacit de dformation, compatible avec la valeur prvue pour le coefficient
de comportement q ;
les lments considrs comme non dissipatifs le restent effectivement lorsque la structure atteint
l'tat limite ultime, en vrifiant la condition de sur-rsistance suivante pour l'lment non dissipatif j :
R dj E (S d,Gj + S d,Ej )
o :
S d,Gj est l'effet d aux actions non sismiques incluses dans la combinaison d'actions pour la
situation sismique de calcul ;
S d,Ej est l'effet d l'action sismique de calcul ;
est dfini en 13.6 ;
E est un coefficient de scurit pris gal 1,2.
NOTE
Lorsque la vrification en rsistance ou stabilit d'un lment dissipatif i fait appel une
combinaison (cherche la plus dfavorable) de plusieurs sollicitations, le rapport i dfini en 13.6
peut tre gnralis. Par exemple, avec une combinaison faisant intervenir l'effort normal N Sdi ,
l'effort tranchant V Sdi et le moment flchissant M Sdi , et avec la vrification effectuer crite sous la
forme :
f(N Sdi /N Rdi , V Sdi /V Rdi , M Sdi /M Rdi ) 1
o N Rdi , V Rdi et M Rdi sont les rsistances associes aux sollicitations prcites et supposes agir
seules, le rapport i sera pris gal 1/f.
13.8.1 Poteaux
En dehors des poteaux situs la base de structures en portiques ( voir Figure 80 ) ou la base de
structures contreventement excentr ( voir Figure 84 ) ou encore des poteaux de structures en consoles
( voir Figure 87 ), les poteaux doivent tre considrs comme des lments non dissipatifs.
Toutefois, tous les poteaux doivent respecter les exigences relatives la classe des sections nonces
l'article 13.5 , l'exception des poteaux des structures en consoles qui doivent tre de classe A.
D'une manire gnrale, les poteaux doivent tre vrifis comme des lments comprims et flchis. De
plus, l'effort tranchant dans ces lments doit tre born afin de ne pas diminuer la capacit de rsistance
des rotules plastiques susceptibles de se former leurs extrmits.
NOTE
Il est raliste de concevoir en gnral les poteaux comme des lments non dissipatifs, leur
capacit de dformation en rotation aux extrmits tant faible de par la prsence de l'effort normal
de compression. Toutefois, les vrifications de rsistance et de stabilit effectues sur les poteaux
considrs individuellement ne permettent pas totalement de se prmunir contre la formation
ventuelle de rotules plastiques aux extrmits de certains poteaux, au stade limite ultime de la
structure et notamment lorsque le facteur de comportement q a une valeur leve. En revanche, il
convient de s'assurer qu'aucune rotule plastique ne puisse se former en partie courante des
poteaux.
13.8.1.1 Vrification des poteaux en compression et flexion
N Sd dsignant l'effort normal le plus dfavorable pour le poteau, on doit satisfaire, pralablement toute
vrification de l'lment, aux conditions suivantes :
pour un poteau flchi avec inversion de courbure :
(N Sd /N pl.Rd ) + 0,8 [lambar] 1 si (N Sd /N pl.Rd ) 0,15
[lambar] 1,6 si (N Sd /N pl.Rd ) < 0,15
pour un poteau flchi en simple courbure :
(N Sd /N pl.Rd ) + 1,35 [lambar] 1 si (N Sd /N pl.Rd ) 0,15
[lambar] 1,1 si (N Sd /N pl.Rd ) < 0,15
La vrification des poteaux doit tre effectue en considrant la combinaison la plus dfavorable de l'effort
normal N Sd et du moment flchissant M Sd devant satisfaire aux critres de rsistance et de stabilit au
flambement prvus par le rglement de calcul et conception retenu par le projet.
En particulier, les critres de rsistance plastique en section sont donns au paragraphe 4.5 de l'Additif 80
et au paragraphe 5.4.8 de la norme NF P 22-311 .
Les critres de stabilit lasto-plastique au flambement sont donns au paragraphe 5.3.2 de l'Additif 80 et
au paragraphe 5.5.4 de la norme NF P 22-311 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 138 of 184
Dans le cas d'un poteau soumis de la flexion biaxiale (M y,Sd , M z,Sd ), la vrification de stabilit peut tre
effectue suivant ces mmes critres, en considrant successivement et de manire indpendante
chacun des deux moments de flexion M y,Sd et M z,Sd majors par un coefficient multiplicateur gal 1,2.
NOTE
Les conditions sur l'lancement rduit [lambar] d'un poteau (dfini dans la note sur 13.5 ) limitent le
risque d'amplification de sa flche et garantissent en consquence une ductilit convenable du
poteau en termes de variables " moment-rotation " considres ses extrmits.
A noter que ces conditions ne sont valables que si l'on a un coefficient de comportement de la
structure q 6 ; les conditions sur l'lancement sont plus svres si q > 6 (voir paragraphe 13.5 ).
Le moment flchissant M Sd signifie ici M y,Sd ou M z,Sd selon le plan d'action considr pour
l'excitation sismique.
Dans le cas o est utilise une analyse modale de la structure ( voir 6.6.2 ), le couple (N Sd , M Sd )
devrait tre, en toute rigueur, envisag comme tout point possible d'une ellipse d'incertitude qui doit
rester en de du domaine de rsistance, ou de stabilit, dfini par la relation d'interaction
approprie. Cette ellipse est centre au point :
N 0 = N Sd (G, , , Q), M 0 = M Sd (G, , , Q)
c'est--dire pour l'action sismique E = 0 dans la combinaison E, G, Q, et elle est inscrite dans
un rectangle dont les demi-cts sont gaux aux moyennes quadratiques de chacun des efforts
induits par les diffrents modes de vibration retenus :
Ces moyennes sont corriger, comme indiqu en 6.6.2.3 , si certains de ces modes ne peuvent
pas tre considrs comme indpendants. Pour prcision, l'quation de l'ellipse d'incertitude est la
suivante :
o est un coefficient de corrlation :
13.8.1.2 Vrification des poteaux vis--vis de l'effort tranchant
L'effort tranchant de calcul V Sd doit satisfaire au critre de rsistance l'effort tranchant prvu par le
rglement de calcul et de conception retenu pour le projet.
En particulier, la rsistance plastique de calcul l'effort tranchant V pl,Rd est donne au paragraphe 4.4 de
l'Additif 80 ou au paragraphe 5.4.6 de la norme NF P22-311 .
Pour les poteaux flchis admis comme dissipatifs ou susceptibles de l'tre partiellement au stade limite
ultime de la structure, il convient de limiter l'effort tranchant de calcul la moiti de la rsistance plastique,
soit :
V Sd 0,5V pl,Rd
NOTE
La limitation 0,5V pl,Rd vise l'me du poteau seul et non la vrification du panneau d'me dfini par
la jonction poutre-poteau.
13.8.2 Poutres dissipatives
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 139 of 184
Le moment rsistant de calcul des poutres qui comprennent des zones dissipatives est gal au :
moment rsistant plastique de calcul M pl,Rd pour les sections de classes A et B (si la norme NF P 22311 est utilise, voir le paragraphe 5.4.5.1 alina (1) a ; si l' Additif 80 est utilis, voir le paragraphe
4.3 ) ;
moment rsistant lastique de calcul M el,Rd pour les sections de classe C (si la norme NF P 22-311
est utilise, voir le paragraphe 5.4.5.1 alina (2) ; si les rgles CM 66 sont utilises, voir le
paragraphe 3.2.1 ).
Les poutres de sections de classes A et B dont le comportement dissipatif se fait par flexion doivent, au
droit de zones de formation de rotules plastiques, satisfaire la condition suivante :
(M Sd /M pl,Rd ) 1 avec (N Sd /N pl,Rd ) 0,15 et (V Sd /V pl,Rd ) 0,5
Les tronons de poutre dont le comportement dissipatif se fait par dformation de cisaillement (structures
contreventement excentr) doivent, dans les zones de dformation, satisfaire la condition suivante :
(V Sd /V pl,Rd ) 1 avec (M Sd /M pl,Rd ) 0,7 et (N Sd /N pl,Rd ) 0,15
Si N Sd /N pl,Rd > 0,15, la poutre doit tre considre comme un lment comprim et flchi.
Les poutres doivent tre maintenues vis--vis du dversement : les sections susceptibles de se plastifier
doivent tre obligatoirement entretoises. Pour les conditions d'espacement entre points de maintien
latral, il convient d'appliquer 5.5.2 pour la norme NF P 22-311 , les sections de classe C tant assimiles
la classe 3, et d'appliquer 5.2.2 pour l' Additif 80 (sections de classes A et B uniquement).
NOTE
Voir note sur 13.8.1.1 lorsque N Sd /N pl,Rd > 0,15.
Voir note sur 13.8.1.2 la limitation 0,5V pl,Rd relative l'me de la poutre.
Pour dissiper de l'nergie par rotules plastiques dans les tronons de poutre, conus dans ce but,
dans les structures triangules contreventement excentr, il convient d'utiliser un tronon
suffisamment long. Par exemple, pour un profil en l, la longueur du tronon ne devrait pas tre
infrieure 4M pl,Rd /V pl,Rd .
En revanche, pour dissiper l'nergie par cisaillement plastique, il convient d'utiliser un tronon
suffisamment court. Par exemple, pour un profil en l, la longueur du tronon devrait tre infrieure
1,4M pi,Rd /V pi,Rd .
Dans le cas o une analyse modale de la structure est utilise ( cf. article 6.6.2 ), il est admis
d'effectuer la vrification au dversement en s'assurant que la combinaison quadratique des
rapports M Sdi /M b,Rdi des divers modes de vibration reste infrieure ou au plus gale 1.
M Sdi et M b,Rdi sont respectivement le moment de flexion et le moment de rsistance au dversement
relatifs au mode i dans la section de rfrence approprie ( associer la distribution du moment
flchissant engendre par ce mode). En pratique, seuls les premiers modes contribuant 70 % de
la masse totale vibrante sont considrer.
13.8.3 Diagonales de contreventement
13.8.3.1 Diagonales de contreventement des croix de Saint Andr
L'effort axial des diagonales de contreventement doit tre limit leur rsistance plastique de calcul en
traction :
N Sd N pl,Rd
et l'lancement de ces diagonales doit satisfaire aux conditions suivantes :
1,0 [lambar] 2,0
NOTE
Les sollicitations sismiques dans les diagonales en traction doivent tre calcules en ngligeant,
dans la modlisation de la structure, la rigidit des diagonales en compression.
La condition sur la valeur infrieure de [lambar] permet de rpondre l'exigence de rigidit indique
prcdemment.
La condition sur la valeur suprieure de [lambar] permet d'viter une dgradation trop importante
des diagonales lors de l'inversion des efforts.
13.8.3.2 Diagonales de contreventement des systmes en V
L'effort axial des diagonales de contreventement doit tre limit leur rsistance de calcul au
flambement :
N Sd N b,Rd
et leur lancement doit satisfaire la condition : [lambar] 2,0.
NOTE
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 140 of 184
La sollicitation de flexion dans une poutre ne peut tre calcule avec prcision que par une analyse
de structure prenant en compte l'hyperstaticit provenant conjointement des dformations axiales
des diagonales de contreventement tendues et comprimes et des dformations en flexion des
poutres.
La rsistance de calcul au flambement N b,Rd , fonction de [lambar], est spcifie en 5.5.1 de la
norme NF P 22-311 et en 5.3.1 de l' Additif 80 .
13.A Constructions mixtes
13.A.1 Symboles utiliss
Voir 13-1 complt par les symboles suivants :
majuscules latines
A s,eff aire de section d'armature longitudinale sur la largeur participante de dalle
A T aire de section d'armature transversale de dalle au voisinage d'un poteau
E a module d'lasticit de l'acier de construction
E cm module d'lasticit scant moyen du bton
F Rd rsistance axiale de calcul de la dalle au contact d'un poteau
F Sd dsquilibre d'effort axial de calcul dans la dalle de part et d'autre d'un poteau
l a , l c , l s moments d'inertie de flexion respectivement de la section en acier, de l'armature
longitudinale et de la section en bton d'un poteau mixte
l eq moment d'inertie de flexion homognise (poutre ou poteau mixte)
l 1 , l 2 moments d'inertie d'une section de poutre mixte sous flexions respectivement positive et
ngative
P Rd rsistance de calcul au cisaillement d'un connecteur
minuscules latines
b + e , b - e parties de dalle participante, de chaque ct de l'me, sous flexions respectivement positive
et ngative
b + eff , b - eff largeurs participantes totales de dalle sous flexions respectivement positive et ngative
d hauteur totale de section de poutre mixte
d c paisseur de dalle
h hauteur totale de section de poteau
n coefficient d'quivalence acier-bton
x distance de l'axe neutre plastique la face suprieure de dalle
13.A.2 Principes gnraux
Les structures de btiments mixtes acier-bton doivent, pralablement toute vrification parasismique,
satisfaire la norme en vigueur, savoir le Document d'Application Nationale (DAN) de l' Eurocode 4 Partie 1.1 correspondant la norme NF P 22-391, parue en 1994.
En complment de cette norme, les structures de btiments mixtes acier-bton devant rsister l'action
sismique doivent satisfaire aux conditions particulires de conception et de rsistance dfinies dans la
prsente partie 13-A.
Trois concepts de comportement peuvent tre utiliss pour ces structures :
un comportement non dissipatif (q = 1),
un comportement dissipatif (q > 1) de la structure en acier seule (sans chercher tirer avantage du
comportement mixte dans les zones dissipatives),
un comportement dissipatif (q > 1) de la structure mixte acier-bton (o l'on tire avantage du
comportement mixte dans les zones dissipatives).
13.A.2.1 Structures mixtes comportement non dissipatif
Ces structures sont dimensionnes de manire devoir rsister l'action sismique de calcul en restant
dans le domaine du comportement lastique.
Dans ce cas, les structures ne doivent satisfaire que les rgles en vigueur pour la vrification des
constructions mixtes acier-bton dans le domaine lastique relevant de la norme NF P 22-391 .
13.A.2.2 Structures mixtes comportement dissipatif de l'acier seul
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 141 of 184
Dans ce concept, il convient d'adopter des dispositions constructives appropries permettant d'viter une
contribution du bton dans la rsistance des zones dissipatives. En particulier, les conditions spcifies en
13.A.10 doivent tre satisfaites.
Les structures mixtes doivent tre dimensionnes selon la norme NF P 22-391 pour rsister aux actions
de type non sismique et selon la partie 13 des prsentes rgles pour rsister l'action de type sismique.
13.A.2.3 Structures mixtes comportement dissipatif acier-bton
Ces structures mixtes doivent tre dimensionnes de telle faon que, lors d'un vnement sismique,
certains de ses lments mixtes soient le sige de dformations plastiques dont la localisation et
l'efficacit dissipative doivent tre parfaitement contrles. En particulier, les conditions spcifies en
13.A.7 et 13.A.8 doivent tre satisfaites.
Pour ce qui concerne le matriau acier de construction, les spcifications donnes en 13.2.2 s'appliquent.
Pour le matriau bton, l'article 11.2.1 s'applique.
Pour les aciers d'armatures, l'article 11.2.2 s'applique.
13.A.3 Types de structures mixtes
13.A.3.1 Structures parasismiques comportement non dissipatif
L'article 13.3.1 s'applique.
13.A.3.2 Structures parasismiques comportement dissipatif
On distingue :
13.A.3.2.1 Les structures " en portiques "
L'article 13.3.2.1 s'applique en prcisant que, sur toute la hauteur du btiment, les poutres et poteaux
peuvent tre tous deux mixtes (concept de comportement 13.A.2.3 ), ou que les poteaux seuls peuvent
tre mixtes (concept de comportement 13.A.2.2 ) ou encore que les poutres seules peuvent tre mixtes
(concept de comportement 13.A.2.3 ).
13.A.3.2.2 Les structures contreventement triangul
13.A.3.2.2.1 Contreventement " centr "
L'article 13.3.2.2.2.1 s'applique, en prcisant que les barres de contreventement doivent tre en acier de
construction (concept de comportement 13.A.2.2 ).
13.A.3.2.2.2 Contreventement " excentr "
L'article 13.3.2.2.2 s'applique, en prcisant que les tronons d'excentrement (lments dissipatifs) doivent
tre en acier de construction, les parties restantes des poutres, les poteaux et les barres de
contreventement pouvant tre mixtes ou en acier de construction (concept de comportement 13.A.2.2 ).
13.A.3.2.3 Les structures " en portiques " et contreventes par triangulation
L'article 13.3.2.3 s'applique, avec la dfinition donne en 13.A.3.2.1 pour les structures " en portiques " et
la condition impose aux barres de contreventement en 13.A.3.2.2.1 .
13.A.3.2.4 Les structures fonctionnant en console verticale
Ces structures relvent de la mme dfinition qu'en 13.3.2.5 , les poteaux tant toutefois des lments
mixtes.
13.A.3.2.5 Les structures mixtes constitues principalement de murs en bton arm
Dans ces structures, les murs en bton arm collaborent avec l'ossature en portique ralise en acier de
construction ou en mixte (type 1). Les murs peuvent galement tre renforcs sur leurs bords verticaux
par des poteaux en acier partiellement ou totalement enrobs de bton (type 2) (exemples donns en
Figure 13A.1 ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 142 of 184
Figure 13A.1 Structures mixtes comportant des murs en
bton arm
13.A.3.2.6 Les structures en mur de cisaillement de type mixte
Ces structures consistent en des plaques verticales en acier de construction enrobes par une couche en
bton arm sur une face ou sur les deux faces, et bordes d'lments structuraux en acier de construction
ou mixtes.
13.A.4 Coefficient de comportement des structures dissipatives
Les articles de 13.4 et le tableau 14 s'appliquent, l'exception de ce qui concerne les structures avec
diaphragme ( 13.3.2.4 ) et les structures couples en acier et bton arm ( 13.3.2.6 ).
Le tableau 14 est complt par le tableau 14.A ci-aprs, dans l'hypothse de murs en bton arm
dimensionns selon l' article 11.8.2 .
Tableau 14.A Coefficient de comportement
NOTE
Pour mmoire, les facteurs de rduction de 0,85 pour les constructions moyennement rgulires et
de 0,70 pour les constructions irrgulires s'appliquent l'ensemble des valeurs de q de l'article
13.A.4 , les valeurs obtenues n'tant pas prises infrieures 2.
13.A.5 Exigences relatives la classe des sections
Les articles de 13.5 et les tableaux 15 et 16 s'appliquent, en prcisant que N pl,Rd est maintenant la
rsistance plastique de calcul l'effort normal de la section mixte des barres (cf. section 4.8 de la norme
NF P 22-391 ) et que l'axe neutre plastique de flexion dans le tableau 16 doit tre dtermin en tenant
compte de la prsence de la dalle (en concept de comportement 13.A.2.3 ).
Sous flexion positive (face suprieure de la dalle comprime, en concept de comportement 13.A.2.3 ), le
rapport x/d ne doit pas dpasser les valeurs indiques au tableau 15.A en fonction du facteur de
comportement q adopt, o x est la distance entre l'axe neutre plastique et la face suprieure de la dalle
et o d est la hauteur totale de la section mixte (exemple donn en Figure 13A.2 ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 143 of 184
Tableau 15.A Valeurs maximales de x/d des poutres
mixtes (en flexion positive)
Figure 13A.2 Distribution plastique des contraintes en
section (flexion positive)
13.A.6 Analyse de la structure et tats limites de dformation
13.A.6.1
L'article 13.6 s'applique aux structures mixtes acier-bton.
13.A.6.2
Pour la dtermination des effets S d,E dus l'action sismique de calcul dans les lments structuraux, il
convient de tenir compte de la rduction de rigidit rsultant de la prsence de zones fissures
d'extension majore en raison du caractre cyclique altern de l'action sismique.
Il convient galement de dterminer la rigidit des lments structuraux en ngligeant la contribution du
bton en traction et en considrant celle du bton en compression au moyen du coefficient d'quivalence :
n = E a /E cm
o :
E a est le module d'lasticit de l'acier de construction, et
E cm est le module d'lasticit scant moyen du bton, pour un chargement court terme, fonction de sa
rsistance caractristique en compression f ck , conformment la clause 3.1.4.1 de la norme NF P 22391 .
NOTE
Il convient de noter qu'un coefficient d'quivalence de valeur double peut tre utilis pour le calcul
des effets de type S d,G dus aux actions non sismiques incluses dans la combinaison d'actions pour
la situation sismique de calcul, conformment la clause 3.1.4.2.4 de la norme NF P 22-391 .
13.A.6.3
Avec les lments de type poutre mixte, il convient d'utiliser une largeur participante de dalle approprie
dsigne par :
b + eff pour le calcul du moment d'inertie l 1 sous flexion positive,
b - eff pour le calcul du moment d'inertie l 2 sous flexion ngative.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 144 of 184
Ces largeurs participantes, considres comme des fonctions des longueurs de poutre sous flexion
positive et flexion ngative, doivent tre dfinies sur les mmes bases que celles de la clause 4.2.2 de la
norme NF P 22-391 .
Pour une traverse courante de portique, de porte L, o des rotules plastiques (de signes opposs) sont
supposes se former aux extrmits, on peut adopter les valeurs suivantes simplifies pour chaque partie
participante de dalle situe de chaque ct du plan moyen de l'me mtallique, aussi bien sous flexion
positive que ngative :
b + e = b - e = 0,08 L b
o 2b est l'espacement entre poutres du plancher mixte.
( Voir figures 13A.3 et 13A.4 )
Figure 13A.3 Section transversale de plancher mixte
Figure 13A.4 Allure des distributions limites de moment
flchissant le long des traverses
13.A.6.4
Avec les structures mixtes en portiques, il est admis de ne pas localiser les zones fissures des lments
et d'effectuer l'analyse globale lastique avec des valeurs homognises de rigidit en flexion sur la
longueur des lments, savoir :
pour les poutres mixtes :
(El) eq = E a (0,6 l 1 + 0,4 l 2 )
pour les poteaux mixtes :
(El) eq = 0,9 (E a l a + E s l s + 0,4 E cm l c )
o E a l a , E s l s et E cm l c sont respectivement les rigidits en flexion de la section en acier,
des armatures longitudinales et de la section en bton du poteau mixte (comme dfinis
dans la clause 4.8.3.5. de la norme NF P 22-391 .
En principe, l'analyse lastique globale pour le calcul des effets S
gomtrique.
d,E
doit tre effectue au 2
ordre
NOTE
Pour mmoire, le coefficient de sensibilit r peut constituer un critre utile pour dcider de la
ncessit d'une analyse au 2 e ordre gomtrique ( cf. article 6.6.1.5 ).
13.A.7 Assemblages mixtes situs au voisinage des zones dissipatives
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 145 of 184
13.A.7.1
A dfaut d'une justification scientifiquement tablie et valide par l'exprience, l'emploi d'assemblages
mixtes semi-rigides et/ou partiellement rsistants n'est pas autoris au voisinage des zones dissipatives.
NOTE
L'utilisation d'assemblages mixtes semi-rigides et/ou partiellement rsistants ncessiterait le
contrle rigoureux de la capacit de rotation de ces assemblages (avec le risque de fatigue
oligocyclique) et l'valuation approprie du coefficient de comportement q qui en rsulterait.
13.A.7.2
Pour les assemblages mixtes de type poutre-poutre ou de type poutre-poteau d'lments sollicits
essentiellement en flexion, il convient de satisfaire la condition gnrale suivante (pour les deux sens de
rotation de l'assemblage) :
R as,d E R p,d
avec :
E = 1,2 sous rserve de respecter la clause donne en 13.2.2 concernant la variation de la limite
d'lasticit relle de l'acier dans les zones dissipatives et non dissipatives adjacentes ;
R as,d moment rsistant de calcul de l'assemblage mixte, incluant les contributions de l'assemblage en
acier, de la dalle connecte agissant en continuit au passage de l'assemblage, et ventuellement de
l'enrobage de bton partiel de la poutre et partiel ou total du poteau ;
R p,d moment rsistant de calcul de la poutre mixte assemble.
En outre, il convient de tenir compte de l'influence ventuelle de l'effort normal et/ou de l'effort tranchant
dans la dtermination des moments rsistants R as,d et R p,d .
NOTE
Le dimensionnement en capacit des assemblages mixtes de type poutre-poteau implique
l'utilisation de dispositions constructives appropries telles que raidisseurs transversaux souds
dans l'me du poteau lorsque celui-ci est en acier, platine d'extrmit de poutre boulonne et
renforce l'aide d'un jarret, enrobage partiel de bton arm entre les semelles ou enrobage total
d'un poteau de section en acier l ou H, ceintures annulaires soudes pour un poteau mixte avec
profil creux en acier (renforces ventuellement par des diaphragmes internes large ouverture),
etc.
13.A.7.3
Pour le calcul et la conception des systmes d'attache en acier (soudures, boulons), l'article 13.7
s'applique.
13.A.7.4
La dtermination du moment rsistant de calcul R as,d d'un assemblage mixte peut tre base sur la
mthode des composants utilise dans l'Annexe J de la norme NF P 22-311 (DAN de l'Eurocode 3-1-1),
sous rserve d'y inclure les composants propres aux parties en bton de l'assemblage (armatures
longitudinales de la dalle, connecteurs acier-bton d'une zone de poutre adjacente l'assemblage,
contribution aux rsistances en compression locale et en cisaillement du panneau d'me apporte par du
bton d'enrobage entre ailes de poteau, etc.).
NOTE
On peut trouver dans les normes europennes des informations dtailles sur les divers
composants considrer pour un assemblage mixte de type poutre-poutre ou poutre-poteau, ainsi
que sur la mthode d'assemblage de ces composants (par exemple, Section 8 de l' EN 1994-1-1 et
EN 1993-1-8).
13.A.8 Vrification de la rsistance et de la stabilit des barres
La rgle gnrale de vrification des lments dissipatifs d'une part, et des lments non dissipatifs
d'autre part, telle qu'nonce en 13.8 , s'applique.
13.A.8.1 Poteaux mixtes
Le principe gnral de vrification des poteaux, nonc en 13.8.1 s'applique, que ces poteaux soient en
acier ou mixtes.
13.A.8.1.1 Vrification des poteaux en compression et flexion
L'article 13.8.1.1 s'applique aux poteaux mixtes, sous rserve d'utiliser la Section 4.8 de la norme NF P 22
-391 de manire approprie. En particulier, il convient de :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 146 of 184
considrer N pl,Rd comme la rsistance plastique de calcul l'effort normal de la section mixte des
poteaux,
et d'effectuer la vrification en rsistance et stabilit des poteaux en s'assurant que le moment
flchissant maximal M Sd , amplifi par les effets du 2 e ordre gomtrique, satisfait la condition :
M Sd 0,9 M Rd (N Sd )
o le moment rsistant M Rd est dduit de la courbe d'interaction plastique " effort normal - moment
flchissant " prcise la clause 4.8.3.13 de la norme NF P 22-391 .
13.A.8.1.2 Vrification l'effort tranchant des poteaux flchis
L'article 13.8.12 s'applique aux poteaux mixtes en prcisant que pour les poteaux de section en acier l ou
H et partiellement ou totalement enrobs de bton, la rsistance l'effort tranchant V pl,Rd doit tre
dtermine sur la base de la section en acier seule. Dans le cas de poteaux mixtes avec profil creux en
acier, V pl,Rd peut tre dtermine sur la base de la section en bton arme seule, le profil tant considr
comme une armature de confinement rsistant l'effort tranchant ( cf. 11.3.4.3 ).
13.A.8.1.3 Autres spcifications propres aux poteaux mixtes
13.A.8.1.3.1 Voilement local
Pour les poteaux de section en acier l ou H partiellement enrobe de bton et pour les poteaux mixtes
avec profils creux, des valeurs souvent plus favorables des limites d'lancement des parois peuvent tre
utilises comme spcifies au tableau 16.A (par comparaison au tableau 16 du chapitre 13 ).
Tableau 16.A Valeurs maximales du rapport b/t (poteaux
mixtes)
13.A.8.1.3.2 Zones critiques
Pour les poteaux mixtes comprims et flchis (dans les structures en portique), l'ventualit de formation
de rotules plastiques aux extrmits exige une disposition approprie des armatures transversales ( cf.
11.3.5.3 ) sur les longueurs dites " critiques ", dfinies en 11.3.5.1 .
13.A.8.1.3.3 Adhrence mcanique acier-bton et transfert d'effort de cisaillement entre parties en acier et
en bton arm
En dimensionnement sismique, il convient de rduire par le facteur multiplicatif 0,5 les valeurs de
rsistance au cisaillement donnes dans la clause 4.8.2.7.2 de la norme NF P 22-391 pour l'adhrence
mcanique par frottement entre l'acier et le bton.
Lorsque le transfert d'effort de cisaillement entre parties en acier et en bton arm ne peut tre assur par
la seule adhrence mcanique, en particulier aux extrmits des poteaux en raison des efforts tranchants
provenant des poutres, des connecteurs acier-bton doivent tre placs sur la partie en acier pour assurer
un bon fonctionnement mixte des sections des poteaux.
13.A.8.2 Poutres mixtes
L'article 13.8.2 s'applique aux poutres mixtes en T avec dalle en bton connecte sous rserve de :
considrer les rsistances de calcul la flexion M pl,Rd ou M el,Rd (sous flexions positive et ngative),
l'effort normal N pl,Rd et l'effort tranchant V pl,Rd en conformit avec la Section 4-4 de la norme NF P
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 147 of 184
22-391 et en conformit avec l'article 13.A.6.3 pour la dfinition des largeurs de dalle participante b +
eff et b eff ;
et vrifier la stabilit au dversement des poutres mixtes en conformit avec la clause 4.6.2 de la
norme NF P 22-391 .
L'article 13.8.2 s'applique sans modification aux tronons de poutre dissipatifs, obligatoirement en acier
(cf. 13.A.3.2.2.2 ) des structures mixtes avec contreventement " excentr ".
13.A.8.3 Barres de contreventement
Les articles 13.8.3.1 et 13.8.3.2 s'appliquent aux barres de contreventement obligatoirement en acier ( cf.
13.A.3.2.2.1 ) des croix de Saint-Andr et des systmes en V.
13.A.9 Connexion acier-bton
13.A.9.1
Il convient d'utiliser des connecteurs ductiles dans les lments structuraux dissipatifs et d'adopter une
rsistance de calcul au cisaillement de 0,8 P Rd par connecteur, o P Rd est la rsistance de calcul statique
spcifie dans la clause 6.3 de la norme NF P 22-391 .
NOTE
Cette rduction de la rsistance des connecteurs est justifie exprimentalement pour se prmunir
d'une rupture par fatigue oligocyclique.
13.A.9.2
Dans le cas d'une poutre mixte dissipative, avec formation de rotules plastiques de signes opposs aux
extrmits, il convient de concevoir et de calculer la connexion acier-bton comme complte.
13.A.9.3
Dans les lments structuraux non dissipatifs, l'utilisation de connecteurs non ductiles ou d'une connexion
partielle avec connecteurs ductiles est autorise.
13.A.10 Condition de non fonctionnement en mixte d'une poutre
13.A.10.1
Les moments de rsistance en flexion M pl,Rd et M el,Rd d'une section de poutre mixte ne peuvent tre
calculs partir de la poutre en acier seule que si la dalle est suffisamment dconnecte de la poutre en
acier, en particulier totalement dconnecte chaque extrmit dans une zone circulaire centre sur l'axe
du poteau et de rayon b eff , o b eff est la plus grande des largeurs participantes b + eff et b - eff dfinies en
13.A.6.3 .
13.A.10.2
Une dconnexion totale de la poutre implique de ne pas utiliser de connecteurs ou d'autres systmes de
fixation de la dalle, de ne pas clouer une tle mince profile (servant ultrieurement de coffrage une
dalle mixte), de respecter un jeu suffisant entre dalle et ailes d'un poteau mtallique, etc.
13.A.10.3
L'utilisation de poutres en acier partiellement enrobes de bton entre les semelles et sans dalle ou avec
une dalle totalement dconnecte peut tre envisage dans la conception de la clause 4.3.1.6 de la
norme NF P 22-391 en vue de s'opposer au voilement de l'me et partiellement celui de la semelle
comprime. La solidarisation de l'enrobage avec l'me doit satisfaire alors les dispositions constructives
donnes aux clauses 4.3.1.(7 9) de la norme NF P 22-391 .
13.A.11 Transfert d'effort entre poteau et dalle
13.A.11.1
Dans le cas des ossatures " en portiques " avec poutres mixtes aux extrmits desquelles se forment les
zones dissipatives, une armature transversale suffisante doit tre place dans ces zones dissipatives pour
assurer une rsistance suffisante de la dalle au contact du poteau. La prsence, au niveau du poteau,
d'une poutre transversale celle considre et solidarise la dalle galement par des connecteurs, peut
contribuer augmenter la rsistance de la dalle au contact du poteau.
13.A.11.2
Dans le cas d'un poteau intrieur flchi dans le plan dfini par ce poteau avec les poutres attaches de
part et d'autre ( cf. figure 13A.5 ), le dsquilibre d'effort axial dans la dalle peut tre valu par la relation
suivante :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 148 of 184
F Sd = A - s,eff f sk / s + b + eff d c (0,85f ck / c )
o :
A - s,eff est l'aire de la section d'armature longitudinale sur la largeur participante b - eff ,
et d c est l'paisseur de la dalle (dans le cas d'une dalle pleine, ou l'paisseur utile dans le cas d'une
dalle mixte).
Figure 13A.5 Sollicitation en flexion d'un poteau
intrieur par les poutres mixtes adjacentes
13.A.11.3
Il convient de s'assurer, pour la situation prcdente, que :
F Sd F Rd
avec : F Rd = F Rd1 + F Rd2 + F Rd3
o : F Rd1 est la rsistance de contact avec la semelle du poteau :
F Rd1 = bd c (0,85f ck /y c )
et o F Rd2 est la rsistance apporte par les bielles comprimes de bton :
F Rd2 = 0,7h d c (0,85f ck / c )
(cf. la figure 13A.6 pour le modle de rsistance en treillis et les notations).
Figure 13A.6 Bielles de bton comprimes et armatures
transversales tendues
En prsence d'une poutre transversale comportant N connecteurs distribus sur les longueurs b eff /2 de
part et d'autre du poteau, on peut adopter :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 149 of 184
F Rd3 = N(0,8 P Rd )
En l'absence d'une telle poutre, F Rd3 = 0 .
L'aire A T de section d'armature transversale permettant d'assurer la rsistance de type F
donne par :
A T 0,5 F Rd2 s /f sk
Rd2
doit tre
13.A.11.4
Dans le cas d'un poteau extrieur, l'armature longitudinale de la dalle doit prsenter un ancrage suffisant
sur l'extrmit de dalle en console (ou sur une poutre de rive transversale au poteau) de manire
pouvoir atteindre sa rsistance plastique en traction.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 150 of 184
14 Constructions en bois
14.1 Principes gnraux
Les constructions en bois situes en zone sismique doivent rpondre aux exigences normatives et
rglementaires en vigueur ; elles doivent en outre se conformer aux exigences supplmentaires de
conception et de rsistance dfinies dans le prsent document.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.1
Les matriaux, les assemblages, la conception, le dimensionnement, la mise en oeuvre des
constructions en bois doivent tre dfinis selon les critres de rfrence spcifis par les normes et
les rgles en vigueur, compltes s'il y a lieu par les recommandations professionnelles.
14.1.1 Domaine d'application
Les constructions en bois vises dans cet article correspondent aux types de structures suivants :
les charpentes traditionnelles en bois massif,
les charpentes industrielles (fermettes, poutrelles),
les charpentes en bois lamell coll,
les murs en ossature bois.
Plusieurs de ces types de structures peuvent tre combins dans une structure en bois.
Des lments de construction en bois peuvent tre combins des lments de construction en
maonnerie, bton, ou acier.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.1.1
Cette typologie se rfre aux domaines d'applications respectifs des textes normatifs et
rglementaires spcifiques, et des recommandations professionnelles.
14.1.2 Dformabilit des assemblages
Selon leur composition, les assemblages des structures en bois peuvent tre rigides ou semi-rigides.
Les assemblages colls, bois sur bois, ou bois sur mtal, sont considrs comme des assemblages
rigides.
Les assemblages mcaniques raliss par des lments de liaison mtalliques non colls sont considrs
comme des assemblages semi-rigides. La dformation de ces assemblages sous charge monotone
croissante peut comporter :
une dformation initiale de mise en place,
une dformation lastique,
une dformation post-lastique (voir les courbes de la figure 90 ).
Selon leur capacit de dformation post-lastique, les assemblages sont classs comme :
non ductiles ou fragiles,
semi-ductiles,
ductiles.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.1.2
On s'carte ici du principe de rigidit des assemblages retenu en gnie parasismique pour les
constructions en bton et en acier.
Les diffrents comportements d'assemblages lmentaires de petites dimensions sont illustrs par
les courbes charge-dplacement de la figure 90 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 151 of 184
Figure 90 Essais comparatifs sous chargement
croissant jusqu' la ruine des principaux assemblages
actuels par juxtaposition
14.1.3 Rigidit des structures
Pour le calcul des priodes de vibrations des structures dans le domaine lastique, on tient compte de la
dformabilit lastique des assemblages, mais on ne tient pas compte de leur dformabilit initiale
ventuelle.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.1.3
Le terme de glissement d'assemblage est utilis dans les rgles CB 71 et dans l' Eurocode 5 pour
dfinir la dformation des assemblages sous charges de service. Il recouvre la phase de mise en
place lorsqu'elle existe et la phase lastique.
Il est habituel de calculer les dplacements des charpentes triangules en multipliant les
dplacements du modle noeuds rigides par un coefficient de glissement d'assemblages.
Les panneaux de murs en ossature bois comportant un voile clou sur le cadre constituent un cas
particulier, pour lequel le dplacement rsultant du glissement des coutures est prpondrant.
14.1.4 Amortissement
Dans la suite du texte, et en particulier pour le dimensionnement des structures en bois, il est fait
rfrence aux spectres de dimensionnement spcifis en 5.2.3 , tablis conventionnellement pour un
amortissement relatif de 5 %.
Les valeurs des coefficients de comportement, spcifis en 14.4 , et associs aux spectres de
dimensionnement, tiennent compte de l'influence des taux d'amortissement que l'on peut raisonnablement
estimer pour chaque type de structure.
Par voie de consquence, la correction pour amortissement diffrent de 5 % de 5.2.3.4 n'est pas
applicable.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.1.4
La concordance des essais en grandeur relle n'est pas suffisante pour que l'on puisse s'y rfrer
de faon prcise. Cette spcification doit tre considre comme provisoire.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 152 of 184
14.1.5 Dissipation de l'nergie
Les lments de structures, les assemblages, les structures capables de dissiper de l'nergie sismique
dans le domaine post-lastique sont dissipatifs.
14.1.5.1 Elments en bois
Les lments de structure en bois, ou en matriaux drivs du bois, ne sont pas dissipatifs, sauf en
compression transversale (les diagrammes contrainte/dformation et charge/flche sont donns en figures
91 et 92 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.1.5.1
En dimensions d'emploi, le bois se comporte de manire :
fragile, en traction transversale, en cisaillement, en traction axiale, en flexion,
semi-ductile, en compression axiale,
ductile, en compression transversale.
Figure 91 Relation contrainte-dformation du bois
Figure 92 Comportement en fonction de la taille de
l'prouvette
En flexion le comportement de bois en dimensions d'emploi est fragile alors que le comportement
de petites prouvettes est semi-ductile.
Des essais d'assemblages boulonns ductiles, effectus sous charges alternes croissantes,
montrent que :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 153 of 184
la surface des boucles d'hystrsis successives qui reprsentent l'absorption d'nergie
chaque cycle est croissante,
la courbe charge-dplacement statique enveloppe les boucles d'hystrsis de l'essai sous
charges alternes croissantes.
14.1.5.2 assemblages
Les assemblages rigides et les assemblages semi-rigides non ductiles ne sont pas dissipatifs.
Les assemblages semi-rigides (semi-ductiles et ductiles) sont dissipatifs (voir exemple de diagramme en
figure 93 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.1.5.2
Figure 93 Rsultat d'essais d'assemblages boulonns
ductiles sous charges alternes croissantes
14.1.5.3 structures
Les structures comportant des assemblages dissipatifs sont considres comme dissipatives, en
proportion de la ductilit et du nombre de leurs assemblages.
14.2 Assemblages
Les assemblages mcaniques utilisables dans les constructions parasismiques sont ncessairement des
assemblages dfinis par les rgles en vigueur.
14.2.1 Typologie des assemblages
Sont concerns, conformment aux Rgles CB.71 , les assemblages comportant :
des pointes,
des connecteurs dents,
des boulons,
des broches,
des crampons associs des boulons,
des anneaux associs des boulons.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 154 of 184
Des exemples sont donns en figure 94 .
Les assemblages ainsi raliss transmettent les efforts directement d'un bois l'autre, ou indirectement au
moyen d'clisses, de plaques ou de goussets dfinis par les rgles en vigueur.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.2.1
Figure 94 Exemples d'assemblages mcaniques
14.2.2 Limite d'lasticit
La limite lastique des assemblages est dfinie conformment aux Rgles en vigueur.
A dfaut de dfinition rglementaire explicite, on dfinit la limite d'lasticit d'un assemblage comme 1,75
fois sa charge admissible.
14.2.3 Effets d'chelle
Le comportement des assemblages en dimensions d'emploi ne doit pas tre extrapol partir d'essais
portant sur des assemblages de dimensions infrieures.
14.2.4 Ductilit statique
A dfaut de dfinition rglementaire, la ductilit statique des assemblages est dfinie conventionnellement
comme le rapport entre le dplacement correspondant la force maximale atteinte au cours de l'essai
sous charge monotone croissante, et le dplacement correspondant la limite lastique (voir figure 95 ).
s = u / y
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.2.4
Cette dfinition doit tre considre comme provisoire.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 155 of 184
Figure 95 Proposition de dfinition de la ductilit
statique
14.2.5 Classes de ductilit statique
On dfinit trois classes de ductilit statique (voir tableau 18 ) :
Tableau 18 Classes de ductilit statique
La classe de ductilit d'un assemblage est dtermine par voie d'essais.
14.2.6 Caractrisation des assemblages
Les assemblages cits au paragraphe 14.2.1 sont caractriss par leur dfinition rglementaire, seule ou
complte par l'indication de leur classe de ductilit.
Le coefficient de comportement des structures dont les assemblages sont caractriss uniquement par
leur dfinition rglementaire figure dans le tableau 19 .
Le coefficient de comportement des structures dont les assemblages sont caractriss la fois par leur
dfinition rglementaire et par leur classe de ductilit figure dans le tableau 20 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.2.6
Le comportement post-lastique des assemblages et leur capacit dissiper l'nergie sismique ne
peuvent pas tre pleinement apprcis partir des rgles CB 71 ou de l'Eurocode Eurocode 5 .
14.3 Rgles particulires aux structures en bois
14.3.1 Dispositions constructives
a. Appuis
Tous les appuis doivent comporter une liaison mcanique. Les fixations et les supports doivent tre
conus de manire viter que les lments supports chappent leur support.
b. Systmes constructifs
Les systmes constructifs doivent tre conus de telle sorte que la rupture de l'un de leurs lments
secondaires ne puisse pas entraner d'effondrement en chane (voir exemple donn en figure 96 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.3.1 B)
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 156 of 184
Figure 96 Exemple de systme constructif
rpondant au b) de 14.3.1
Dans la figure ci-dessus, la rupture de l'lment central n'entrane pas l'effondrement.
c. Stabilit
Le nombre des dispositifs de stabilit doit tre suprieur ou gal deux dans la direction de calcul.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.3.1 C)
Cette disposition est destine viter que la rupture d'un dispositif unique n'entrane un
effondrement d'ensemble.
14.3.2 Rgularit
Lorsque les critres de rgularit dfinis aux paragraphes 6.6.1.2 et 6.6.1.3 sont respects, les structures
peuvent tre considres comme rgulires moyennement rgulires ; on peut dans ce cas appliquer la
mthode simplifie dfinie en 6.6.1.3 , avec les coefficients de comportement appropris dfinis en 14.4
pour les btiments rguliers ou moyennement rguliers.
Lorsque l'un ou plusieurs des critres prcdents ne sont pas respects, les btiments doivent tre
considrs comme irrguliers. Dans ce cas, on doit appliquer la mthode gnrale donne au paragraphe
6.6.2 avec les coefficients de comportement appropris dfinis en 14.4 pour les btiments irrguliers.
14.3.3 Priodes de vibration
Lorsque les critres de rgularit des structures rappels en 14.3.2 sont satisfaits, les priodes
fondamentales de vibration doivent tre dtermines par la formule spcifie en 6.6.1.3.3 (exemple sur un
modle donn en figure 97 ).
Les dplacements lastiques d'une structure comportant des assemblages semi-rigides peuvent tre
obtenus directement par le calcul d'un modle noeuds semi-rigides, ou de manire indirecte comme
indiqu ci-dessous.
Pour les charpentes triangules, on peut appliquer aux dformations du modle noeuds rigides, le
coefficient de glissement suivant :
fermettes, poutres assembles par connecteurs 1,5
charpente triangule assemble par boulons ou crampons 1,5
charpente triangule assemble par pointes 1,5
charpente assemble par anneaux 1,1
Pour les portiques et les arcs, on ajoute les dplacements dus aux glissements d'assemblages ceux du
modle noeuds rigides.
Pour les panneaux d'ossature clous, on calcule uniquement les dplacements dus aux glissements
d'assemblage.
Pour les panneaux d'ossature colls, on admet un glissement lastique de 1 mm sur les ancrages tendus.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.3.3
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 157 of 184
Figure 97 Forme approche du mode fondamental
Dans l'exemple ci-dessus, la priode fondamentale a pour valeur (formule de RAYLEIGH)
14.4 Coefficients de comportement
Les valeurs des coefficients de comportement q indiques ci-aprs tiennent compte de la nature des
informations relatives aux assemblages, de la ductilit de ces assemblages, et de leur nombre.
14.4.1 Structures dont les assemblages sont caractriss par rfrence aux Rgles CB.71
Tableau 19 Valeur du coefficient de comportement
Ces valeurs concernent les structures satisfaisant aux critres de rgularit spcifis en 6.6.1.2 .
Pour les structures rgularit moyenne (critres dfinis en 6.6.1.3 ), il faut prendre 85 % des valeurs du
tableau.
Pour les structures irrgulires, il faut prendre 70 % des valeurs du tableau. Dans tous les cas, la valeur
du coefficient de comportement ne peut pas tre infrieur 1.
NOTE SUR LES PARAGRAPHES 14.4.1 ET 14.4.2
La caractrisation des assemblages peut aussi faire rfrence aux critres de l' Eurocode 5 .
Les valeurs des coefficients q indiques au tableau 19 doivent tre considres comme provisoires,
compte tenu du caractre incomplet des informations et dfinitions actuellement disponibles au
sujet des assemblages.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 158 of 184
Des complments d'information issus d'essais d'assemblages statiques et notamment cycliques,
d'essais de structures en vraie grandeur, de simulations numriques, d'analyses post-sismiques
sont indispensables pour procder une rvision.
Des valeurs de q diffrentes de celles du tableau 19 peuvent tre dduites de rsultats
exprimentaux portant sur des assemblages ou des structures en vraie grandeur, soumises des
sries de chargements cycliques alterns, ou encore des chargements dfinis partir
d'acclrogrammes.
14.4.2 Structures dont les assemblages sont caractriss par rfrence aux Rgles CB. 71 et par
leur classe de ductilit
Tableau 20 Coefficient de comportement (prise en compte
de la classe de ductilit)
Les abattements appliquer aux valeurs des coefficients de comportement relatifs aux structures
irrgulires sont les mmes que ceux indiqus au paragraphe 14.4.1 .
L'utilisation de ce tableau implique que l'on considre la distribution des efforts internes correspondant la
semi-rigidit des assemblages lors de la vrification du dimensionnement.
14.4.3 Structures hybrides
On appelle hybride une structure dont les systmes de contreventement sont constitus de matriaux
diffrents (exemple prsent en figure 98 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.4.3
Figure 98 Exemple de structure hybride
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 159 of 184
14.4.3.1 Contreventements en parallle
Lorsque les systmes de contreventement sont en parallle (dplacements lis), c'est--dire lorsqu'un
plan de contreventement est constitu de plusieurs systmes composs de matriaux diffrents, ou
lorsque plusieurs plans de contreventement, chacun constitu d'un matriau unique, sont relis par des
diaphragmes horizontaux considrs comme indformables dans leur plan (voir exemple de la figure 99 )
le coefficient de comportement moyen prendre en compte peut tre dtermin par la formule indique
au paragraphe 11.7.4 :
o : T i dsigne l'effort tranchant quilibr par un systme de contreventement lmentaire, et q
coefficient de comportement associ.
le
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.4.3.1
Figure 99 Structure " systme de contreventement en
parallle (dplacements lis) "
14.4.3.2 contreventements en srie
Lorsque les systmes de contreventement sont en srie (dplacements indpendants), c'est--dire
lorsqu'ils sont constitus d'un matriau unique dans une ou plusieurs hauteurs d'tage, mais que la nature
du matriau peut varier entre deux niveaux conscutifs, il faut prendre en compte comme coefficient de
comportement unique pour l'ensemble de la structure, le plus petit des coefficients de comportement
(exemple donn en figure 100 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.4.3.2
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 160 of 184
Figure 100 Structure " systme de contreventement
en srie (dplacements indpendants) "
14.5 Vrifications
14.5.1 Combinaisons d'actions
Les combinaisons d'actions sont dfinies l' article 8 .
14.5.2 Contraintes
Les valeurs maximales des contraintes sont celles des limites lastiques dfinies par les rgles en
vigueur.
A dfaut de dfinition rglementaire des limites lastiques des assemblages, on applique la dfinition
donne au paragraphe 14.2.2 .
14.5.3 Dformations maximales
Dans le cas o existent des lments non structuraux dont l'intgrit et la capacit de rsistance doivent
tre conserves, il doit tre justifi que les dformations maximales subies par la structure permettent
d'atteindre cet objectif.
A dfaut d'une telle justification, les dplacements diffrentiels entre deux niveaux conscutifs doivent tre
limits 1/125 de la hauteur de l'tage considr, sans excder 25 mm.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 14.5.3
On rappelle que les calculs de dformation sont mens dans le domaine lastique.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 161 of 184
15 Faades lgres
15.1 Gnralits
15.1.1 Objet
Le prsent article concerne les menuiseries, faades lgres et verrires.
Il dfinit les prescriptions complmentaires auxquelles les ouvrages doivent satisfaire, en sus des rgles
normales, pour que leurs performances sismiques puissent tre atteintes avec une fiabilit juge
satisfaisante. En particulier, il donne le moyen de proportionner la rsistance des ouvrages l'intensit
des secousses sismiques dont on entend les protger.
15.1.2 Domaine d'application
Le domaine d'application de cet article est celui des menuiseries, faades lgres (au sens de la norme
NF P 28-001 ), et verrires des btiments.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.1.2
Dans la suite du texte, le terme " faades lgres " recouvre l'ensemble de ce domaine, sauf
prcisions particulires.
15.1.3 Niveau de protection
Le niveau de protection de la faade lgre, et en particulier sa classe de risque, est identique celui du
btiment concern.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.1.3
Les niveaux de protection des ouvrages rappels en note sur le paragraphe 3.3 , et les classes de
risque des ouvrages, rappels en note sur le paragraphe 3.2 , sont dfinis par Arrt ministriel.
15.1.4 Comportement assurer
Il est assign pour les faades lgres l'un des objectifs suivants :
E0 : sont ranges dans cette classe, les faades lgres pour lesquelles aucune vrification n'est
demande au titre des prsentes rgles. Entrent dans cette catgorie, les aires d'activit intrieures ou
extrieures, dfinies par la norme NF P 08-302, dans lesquelles est exclue toute activit humaine
ncessitant un sjour de longue dure.
E1 Objectif Scurit : faades lgres pour lesquelles il suffit de prvenir les risques d'effondrement et
de chutes d'lments dangereux pour les vies humaines.
E2 Objectif intgrit : faades lgres qui doivent de plus maintenir l'essentiel de leurs fonctions :
permabilit l'air et tanchit l'eau, et protection des occupants vis--vis des chutes.
A dfaut de spcifications particulires dans le Document Particulier du March, seuls les objectifs E0
et/ou E1 sont retenir.
Les objectifs noncs ci-dessus sont considrs comme satisfaits si les faades lgres sont conues et
calcules conformment au prsent article.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.1.4
Les dformations permanentes de l'ossature de la faade lgre sont admises.
L'effondrement partiel ou gnralis d'lments d'ossature de faades lgre et d'lments de
remplissage peut tre admis dans le cas des objectifs E0 et E1. Dans le cas de l'objectif E2,
certaines dgradations mineures sont admises condition qu'elles soient facilement rparables
(par exemple : rglage de composant, remise en place de certains joints, etc.) et qu'elles ne
compromettent pas cet objectif.
15.1.5 Terminologie
En vue de l'application des mthodes de calcul spcifies en 15.4 du prsent article, il est procd ciaprs une classification des faades lgres en se basant sur les dfinitions donnes par la norme NF P
28-001 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.1.5
L' article 15 se limite aux parois dont l'inclinaison sur la verticale est infrieure ou gale 15.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 162 of 184
Figure 101 Faade panneau
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 163 of 184
Figure 102 Faade rideau
15.1.5.0 Faade panneau
Entrent dans ce type les faades lgres mono- ou multiparois insres entirement entre planchers.
15.1.5.1 Faade rideau
Entrent dans ce type les faades constitues d'une ou de plusieurs parois situes entirement en avant
des nez de plancher ( voir figure 101 ).
15.1.5.2 faade semi-rideau
Entrent dans ce type les faades dont la paroi extrieure est situe en avant d'un nez de plancher, et dont
la paroi intrieure est insre entre deux planchers conscutifs ( voir figure 102 ).
15.1.5.3 verrire
Entrent dans ce type les parois extrieures vitres, inclines de plus de 15 sur la verticale, avec o u sans
structure porteuse propre, et pouvant se prolonger en faade.
15.2 Actions
15.2.1 Gnralits
Les actions considres sont les actions locales s'exerant sur des lments isols, ou faisant partie d'un
ensemble. On distingue trois types d'lments ( voir figure 103 ) :
a. L'lment de faade support par la structure principale du btiment.
b. L'lment de faade support par une structure dpendant elle-mme de la structure principale.
c. L'lment tant la fois lment de faade et structure autoportante.
Pour les deux premiers types, les actions appliquer sont calcules conformment l' article 6 et au
paragraphe 8.3.1 ou le cas chant prcises dans les Documents Particuliers du March.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 164 of 184
Dans tous les cas, ces actions se traduisent par :
des efforts appliqus l'lment, en fonction de la masse de l'lment et des coefficients sismiques ;
des dformations diffrentielles imposes entre deux niveaux conscutifs par les dplacements du
gros oeuvre.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.2.1
Figure 103 Elments de faade
Les actions appliquer sont calcules suivant les mthodes donnes au paragraphe 6.6 .
15.2.2 Dfinitions des efforts
15.2.2.1 Elments de faade non structurels
Pour les types d'lments viss aux alinas a) et b) prcdents, les coefficients sismiques prendre en
compte sont ceux dfinis pour la structure porteuse considre dans son ensemble et aux diffrents
niveaux de l'ouvrage (voir exemple de modlisation donn en figure 104 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.2.2.1
Les coefficients sismiques, dfinis au paragraphe 6.1.3 , rsultent de l'analyse de la structure
porteuse au titre des actions d'ensemble.
Figure 104 Coefficients sismiques
15.2.2.1.1 efforts
Les effets de l'acclration impose sur cet lment entrane des efforts horizontaux et verticaux tels que :
F x = x . Mg
F y = y . Mg
F z = z . Mg
o : M dsigne la masse de l'lment considr, et g l'acclration de la pesanteur.
Si un lment est rigide et se trouve rigidement fix la structure, le coefficient inclut le coefficient q du
btiment, sinon une tude particulire est ncessaire, en liaison avec le 15.4.1.2
15.2.2.1.2 sollicitations
Les efforts appliqus l'lment de faade engendrent des sollicitations dans les composants de l'lment
et sur les supports qui le liaisonnent au gros oeuvre.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 165 of 184
Comme pour le calcul des sollicitations dues aux charges permanentes ou aux effets du vent, il faut tenir
compte de la nature et du nombre de degrs de libert aux noeuds des lments (liaison entre lments,
clisse, continuit, etc.) et aux appuis de fixation (exemples donns en figure 105 ).
Pour les efforts sur les supports, il faut combiner leurs diffrentes composantes conformment aux
indications du paragraphe 6.4 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.2.2.1.2
La combinaison des composantes des efforts dpend de la fonction de l'attache. Une ou deux
composantes peuvent tre ngliges.
Quelques exemples :
Attache porteuse fixe en X, Y, Z : zro degr de libert ;
Attache porteuse libre en Y pour permettre la dilatation : un degr de libert ;
Attache vent fixe en X et Y, libre en Z : un degr de libert ;
etc.
Figure 105 Diffrents types d'attaches des faades
15.2.2.2 lments de faades structurels
Les types d'lments viss l'alina c) de 15.2.1 doivent tre traits conformment aux rgles de calcul
de l' article 6 .
15.2.3 Dformations imposes
Les dispositions constructives de la faade doivent permettre d'absorber les dformations dfinies au
paragraphe 8.3.1 selon l'exigence de comportement dfinie en 15.1.4 (voir figures 106 et 107 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.2.3
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 166 of 184
Figure 106 Dformations imposes
Figure 107 Exemple d'un dispositif de fixation (attache
fixe avec clisse)
Les valeurs de calcul des dformations diffrentielles entre deux niveaux conscutifs sont calcules
conformment l' article 6 et au paragraphe 8.3.1 , et peuvent ventuellement tre prcises dans
les Documents Particuliers du March.
15.2.4 Combinaisons d'actions
La combinaison d'actions, dfinie en 8.1 , applique aux lments de faade, devient :
E+G
o :
E est l'action sismique calcule comme indiqu au paragraphe 15.2.2 ;
G sont les charges permanentes (valeur moyenne, ou s'il y a lieu, valeurs nominales).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 167 of 184
15.3 Rgles de vrifications
Les contraintes maximales calcules sous les efforts dfinis au paragraphe 15.2.4 doivent tre infrieures
ou gales aux valeurs des limites lastiques des diffrents constituants de la faade. La rupture de
certains lments fragiles peut tre admise dans les conditions prcises en 15.5 . On doit donc vrifier :
S d R d (f e )
o :
S d est la Sollicitation agissante de calcul rsultant de la combinaison dfinie en 15.2.4 ;
R d est la Sollicitation rsistante de calcul, fonction de la limite lastique f e .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.3
Dans l'ingalit dfinie en 8.2 .
les coefficients de scurit R et m sont pris gaux 1, et la valeur f mk caractristique de la limite
lastique est prise gale la valeur de f e 0,2 % d'allongement.
15.4 Mthodes de calcul
15.4.1 Mthodes simplifies
Pour les ouvrages des types a) et b) viss en 15.2.1 , on peut utiliser des mthodes simplifies
correspondant deux stades de complexit successifs et dfinis en 15.4.1.1 et 15.4.1.2 ci-aprs.
15.4.1.1 Calcul forfaitaire
L'analyse est effectue en prenant en compte un coefficient sismique uniforme dans la direction
approprie gal :
= i+ j
o : i et j sont les coefficients sismiques des planchers encadrant l'ouvrage considr et rsultant de
l'analyse de la structure porteuse au titre des actions d'ensemble.
15.4.1.2 Calcul unimodal
On effectue une analyse dynamique de l'ouvrage en limitant celle-ci la considration du seul mode
fondamental dans la direction de calcul entre les points de fixation.
Si T dsigne la priode du mode de vibration de la structure apportant la plus forte contribution la
rponse d'ensemble, et T' la priode de vibration du panneau considr, l'ouvrage peut tre calcul en
appliquant au poids des masses qui le compose et dans la direction de calcul approprie, un coefficient
sismique gal :
= 1/2( i + j )
Dans cette expression :
o : i et j sont les coefficients sismiques, tels que dfinis en 7.2, au niveau des points de fixations
rsultant de l'analyse de la structure porteuse au titre des actions d'ensemble (voir figure 108 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.4.1.2
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 168 of 184
Figure 108 Calcul unimodal
15.4.2 Mthode gnrale
Lorsque les ouvrages considrs n'entrent pas dans le champ d'application des mthodes prcdentes,
on doit appliquer une mthode rendant compte de manire raliste de leur comportement dynamique.
A dfaut, on peut utiliser la mthode des spectres de plancher, dfinie dans la norme relative aux
quipements.
15.5 Dispositions constructives
15.5.1 Gnralits
Les dispositions constructives adopter pour les faades lgres doivent permettre d'atteindre les
objectifs dfinis au paragraphe 15.1.4 du prsent article.
15.5.2 Critres de performance
Dans les objectifs viss ci-dessous, les critres de performance sont :
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.5.2
Pour l'objectif EO, les aires d'activit A.E.A. et A.I.A. sont dfinies dans la norme NF P 08-302 .
Pour l'objectif E1, les projections d'clats de verre tremp dans les aires A.E.A. et A.I.A. sont
autorises, sauf dans les zones d'accs pompiers et dans les zones d'vacuation.
Pour l'objectif E2 - Clos et couvert : permabilit l'air et tanchit l'eau.
15.5.2.1 Objectif (E0)
Les chutes de dbris sont acceptes dans les aires d'activits et hors de celles-ci.
15.5.2.2 Objectif scurit (E1)
la stabilit de l'ossature secondaire doit tre assure ;
le maintien en place des lments de remplissage en tolrant des chutes de dbris non dangereux
doit tre assur.
15.5.2.3 objectif intgrit (E2)
Les critres sont les mmes que pour l'objectif (E1), avec en outre la conservation de l'aptitude la
fonction caractrise par le maintien du clos et du couvert dans tous les cas et, s'il y a lieu, celui des
fonctions particulires suivant la destination du btiment et les prescriptions du matre de l'ouvrage.
15.5.3 Dispositions particulires aux vitrages
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.5.3
Dans le cas de vitrage isolant, tous les composants verriers sont concerns.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 169 of 184
Figure 109 Balcons
Figure 110 Auvents
15.5.3.1 Ouvrages formant rceptacles
Sont considrs comme ouvrages formant rceptacles pour les chutes de dbris, les balcons, loggias,
auvents et ouvrages similaires dont les dimensions respectent les critres suivants :
a. balcon : h dsignant la hauteur d'tage, le dbord du balcon doit tre suprieur h/3 si le nez de
balcon possde un relev suprieur 0,10 m, et h/2,5 dans le cas contraire ( voir figure 109 ) ;
b. auvent : H dsignant la hauteur totale du btiment, le dborde de l'auvent doit tre suprieur :
H/10 pour les btiments de hauteur infrieure 28 m, sans tre infrieur 1,50 m ;
H/20 + 1,40 m pour les btiments de hauteur suprieure 28 m ( voir figure 110 ).
15.5.3.2 Emploi des vitrages
En fonction des trois objectifs prcdemment dfinis, de la hauteur du btiment, de la prsence de
dispositions architecturales susceptibles de retenir les dbris (par exemple prsence d'un balcon ou loggia
formant rceptacle), l'utilisation de matriaux fragiles tels que les glaces ncessite gnralement des
justifications par voie d'essais, ou par toute autre mthode scientifiquement tablie et/ou sanctionne par
l'exprience.
En l'absence de ces justifications, les dispositions suivantes doivent tre adoptes :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 170 of 184
Tableau 21 Emploi de vitrage
Dans le tableau prcdent, E2.1 dsigne l'objectif E2 lorsque les vitrages ne participent pas la fonction
clos et couvert, et E.2.2 dsigne l'objectif E2 lorsque les vitrages participent la fonction clos et couvert.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.5.3.2
Les prsentes Rgles ne visent que la fonction scurit dans le cas de vitrages organiques : la
durabilit du matriau et sa mise en oeuvre doivent faire l'objet d'une justification complmentaire.
15.5.3.3 maintien des remplissages
Dans ce cas, la conception des btis, (cadres, feuillures, etc.) recevant les remplissages (vitrages, EDR,
fentres, etc.) doit tenir compte des dformations induites par le sisme.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 15.5.3.3
Dans ce cas, le calage du remplissage dans sa feuillure doit permettre d'absorber les dformations,
et lorsqu'ils assurent le maintien des lments de remplissage, les profils " clipss " comme les
parecloses doivent faire l'objet d'une justification de leur tenue sur le profil rcepteur.
15.5.3.4 joint de dilatation
Dans le cas des objectifs E1 et E2, les largeurs de joint prvues pour la structure doivent tre
rigoureusement respectes pour la faade.
15.5.4 Verrires
Le respect des objectifs E1 et E2 impose l'utilisation de verre feuillet.
Dans le cas de vitrages isolants, il est admis d'utiliser du verre recuit en face suprieure dans le cas de
l'objectif E1 ; dans le cas de l'objectif E2, cette disposition ncessite des justifications particulires.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 171 of 184
16 Complments relatifs aux composants prfabriqus en bton et aux
structures utilisants ces composants
16.1 Domaine d'application
Ces complments l' article 11 sont relatifs aux principales dispositions parasismiques prvoir pour les
composants prfabriqus en bton arm et en bton prcontraint par pr-tension ainsi qu'aux
constructions dans lesquelles ils sont utiliss.
Suivant leur participation dans la stabilit d'ensemble de la construction vis--vis des actions sismiques,
ces composants peuvent tre considrs soit en tant qu'lments principaux, soit en tant qu'lments
secondaires au sens du paragraphe 11.1.1 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.1
Il est rappel que certains composants relvent d'Avis Techniques.
16.2 Terminologie
16.2.1 Composants
Les composants viss sont :
des composants linaires (poutres, poteaux, etc.),
des composants plans (lments de planchers, lments de murs, etc.),
des composants de fondations (plots encuvement, etc.)
16.2.2 Structures
Elles sont le rsultat de l'association de ces composants, entre eux ou avec des parties coules en place
ou maonnes, au moyen d'assemblages leur confrant un comportement quivalent celui d'une
structure monolithique en situation sismique.
Parmi ces structures, on distingue :
les structures portiques obtenues par l'assemblage de poteaux prfabriqus ou non et de poutres
prfabriques, associes ou non des planchers,
les structures parois de contreventement. Les parois de contreventement rsultent de l'assemblage
de composants plans verticaux fonctionnant suivant la nature de leurs liaisons soit en consoles
indpendantes, soit en consoles associes.
16.2.3 Chanages
Le comportement monolithique des structures ralises partir de composants prfabriqus est obtenu
notamment par la mise en place de chanages et ventuellement de systmes de triangulation.
Les chanages peuvent tre raliss soit entirement sur site, soit tre incorpors dans les composants.
On distingue :
Les chanages priphriques :
A chaque niveau de plancher et au niveau de la toiture, il doit tre prvu un chanage priphrique
mcaniquement continu et dimensionn de manire reprendre les efforts de traction et de tractionflexion dvelopps dans leur fonctionnement en diaphragme.
Les chanages transversaux :
Ces chanages transversaux qui doivent tre ancrs dans le chanage priphrique jouent le rle de
tirants. Ils peuvent tre constitus par :
les armatures sortant en attente des composants et conues pour ce rle,
des armatures longitudinales disposes dans les joints entre les composants plans constitutifs
du plancher,
des poutres coules en place ou prfabriques dont les armatures sortant en attente sont
ancres dans le chanage priphrique.
Les chanages verticaux :
Ils jouent le rle d'armatures tendues dans le fonctionnement en console du contreventement
vertical. Ils sont rendus continus sur toute la hauteur du btiment ou de l'lment (voir figure 57 ). Ils
peuvent tre incorpors dans les composants prfabriqus, auquel cas ils doivent tre relis entre
eux d'une manire non fragile.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.2.3
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 172 of 184
Figure 111 Coupe sur chanage priphrique
On considre comme non fragile une liaison qui ne rduit pas la capacit du chanage en zone
courante.
16.2.4 Systmes de triangulation
Lorsque le contreventement vis--vis du sisme n'est pas assur par des moyens conventionnels, il est
possible d'utiliser des systmes de triangulation.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.2.4
Dans les constructions ralises partir de composants prfabriqus, il est gnralement fait
usage d'entretoisements mtalliques en croix de Saint-Andr.
Pour la dfinition des types de structures, se rfrer au paragraphe 11.7 .
16.3 Coefficient de comportement
A dfaut de valeurs plus prcises obtenues partir d'essais ou sanctionnes par l'exprience, les valeurs
de base des coefficients de comportement " q " donnes en 11.7 et 11.8.2.3 sont multiplier par des
coefficients d'ajustement dont les valeurs sont donnes par le tableau suivant :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 173 of 184
Tableau 22 Coefficients d'ajustement des coefficients q
Pour les lments de mur, les joints simple clavage, lisses, ne peuvent pas tre pris en compte dans un
fonctionnement en consoles associes.
La figure 112 illustre les principaux types de liaisons mises en place
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.3
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 174 of 184
Figure 112 Types de liaisons mises en place
Dans les assemblages brochs, les composants peuvent tre ventuellement brls entre eux.
16.4 Dispositions relatives aux composants linaires principaux
16.4.1 Dimensions minimales
Tableau 23 Dimensions minimales des composants
prfabriqus
Pour les dfinitions de a, b, B, b w , se reporter au paragraphe 11.1.2 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.4.1
Dans les montages composites, la hauteur considrer est la hauteur de la poutre, augmente de
celle du bton de clavetage.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 175 of 184
Pour les poutres de section trapzodale, la largeur b w considrer est celle de la petite base du
trapze.
16.4.2 Matriaux
Elments en bton arm : voir les paragraphes 11.2.1 et 11.2.2 .
Elments en bton prcontraint par pr-tension :
Bton : pour les lments prcontraints par pr-tension, la rsistance du bton doit tre au moins gale f
c28 = 30 MPa.
16.4.3 Dispositions propres aux lments flchis principaux (poutres)
Le dimensionnement de ces lments est ralis conformment aux Rgles en vigueur, moyennant les
dispositions complmentaires donnes ci-aprs.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.4.3
Les rgles en vigueur sont le BAEL et le BPEL .
16.4.3.1 Elments flchis en bton arm
Zones critiques-voir 11.3.4.1
Armatures longitudinales - voir 11.3.4.2
Armatures transversales - voir 11.3.4.3
16.4.3.2 lments flchis en bton prcontraints par pr-tension
a. Dfinition des zones critiques
Sont considres comme " zones critiques ", celles dfinies en 11.3.4.1 , auxquelles il faut adjoindre
pour les lments prcontraints par pr-tension, la condition supplmentaire :
I cr 1,80 I sn
o : I sn est la longueur nominale de scellement des armatures actives (voir 2.2.3.1 du BPEL ).
b. Ancrage des armatures de prcontrainte
Dans le cas o les armatures actives sortent en attente des poutres, l'ancrage est assur suivant un
fonctionnement de type bton arm, comme indiqu en 11.3.1.3 par les armatures sortant en attente
de la poutre.
Dans le cas o les armatures actives ne sortent pas en attente des poutres, il convient de dmontrer
que l'enveloppe de la force de traction dveloppe sous l'action sismique n'excde pas la force de
traction rsistante des armatures actives, donne par la note sur le paragraphe 16.4.3.2 (voir figure
113 ).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.4.3.2 B)
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 176 of 184
Figure 113 Enveloppe de la force de traction
rsistante des armatures actives
I sn longueur de scellement des armatures actives ;
F pm force probable de prcontrainte ;
I ba longueur de scellement ncessaire pour ancrer la surtension suivant un fonctionnement en
BA (voir BAEL Art. A6.1,21) ;
p coefficient partiel de scurit considrer en situation sismique, p = 1.
c. Armatures longitudinales
Zones critiques :
La section des armatures longitudinales passives disposer dans les zones critiques est celle
donne au paragraphe 11.3.4.2 .
Leur ancrage dans les zones critiques est ralis conformment au paragraphe 11.3.1.3 .
Rgions non critiques :
Cas des lments prcontraints :
Les pourcentages d'armatures actives disposer sur une face tendue doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
Pmax = 2,5 %
Po min = 0,80(f tj /f peg )100 ( %)
o :
f tj est la rsistance caractristique la traction du bton de l'lment (en MPa) ;
f peg est la limite d'lasticit garantie de l'acier de prcontrainte (en MPa).
Cas des lments en bton arm :
Le pourcentage d'armatures disposer sur une face tendue (hors zone de recouvrement) doit
satisfaire aux conditions du paragraphe 11.3.4.2 .
d. Armatures transversales
Des armatures transversales constitues par des cadres, comme indiqu en 11.3.4.3 , doivent tre
disposes dans les zones critiques et espaces de d/2 dans les rgions non critiques.
La section d'armature transversale disposer vis--vis de la sollicitation sismique est dtermine
comme indiqu en 11.3.4.3 .
16.4.4 Dispositions propres aux lments comprims (poteaux, etc.)
a. Dfinition des zones critiques
Sont considres comme " zones critiques ", celles dfinies en 11.3.5.1 , auxquelles il faut adjoindre
dans le cas de poteaux prcontraints par pr-tension, la condition :
I cr 1,80 I sn
Les poteaux constitutifs des btiments industriels sont, dans le cas gnral, considrs comme tant
encastrs en pied et assujettis en tte (voir figure 114 ). Dans ce cas, la tte du poteau est organise
comme indiqu en 11.3.5.1 et 11.3.5.3 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.4.4 A)
Figure 114 Poteaux encastrs en pied et assujettis
en tte
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 177 of 184
b. Armatures longitudinales
Voir le paragraphe 11.3.5.2 .
c. Armatures transversales
Voir le paragraphe 11.3.5.3 .
16.4.5 Assemblages entre lments linaires
16.4.5.1 Principes gnraux
Le volume de l'assemblage est celui qui est dlimit par les extrmits de la partie bton des lments
assembls, augment le cas chant pour les poutres, par l'paisseur de la dalle de compression.
Les matriaux et les dispositions constructives retenues pour la ralisation de l'assemblage et le transfert
des charges sismiques d'un composant l'autre tels que les inserts, les pices soudes, les manchons ne
doivent pas prsenter un comportement fragile.
On doit s'assurer par ailleurs que les dispositions constructives retenues ne conduisent pas un
affaiblissement des barres qu'elles assemblent (ralisation des filets et des soudures, etc.).
L'ancrage des dispositifs mis en place pour assurer l'assemblage des composants entre eux (inserts,
armatures en attente, manchons, etc.) doit tre ralis dans un volume conu de manire viter
l'clatement de l'assemblage et des composants y aboutissant conformment aux paragraphes 11.3.1.3 et
11.3.4.1 .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.4.5.1
On considre comme non fragile, une liaison dont la capacit n'est pas infrieure la capacit de la
zone courante.
16.4.5.2 Principaux types d'assemblage
a. Assemblage poutre-poteau par armatures en attente
En l'absence de dispositions particulires (voir note ci-contre), le confinement de l'assemblage sur
poteau est assur par la mise en place de cadres horizontaux d'au moins 6 mm de diamtre,
espacs au plus du quart de la hauteur h' de l'assemblage, sans excder 150 mm. L'espacement de
ces armatures peut tre augment la moiti de cette hauteur, sans dpasser 200 mm lorsque les
poutres sont prsentes sur les quatre faces.
Le bton de clavage doit prsenter une rsistance f c28 d'au moins 30 Mpa.
La transmission des efforts tranchants de la poutre prfabrique au bton de clavage doit tre
assure par l'une ou l'autre des deux dispositions suivantes, ces deux dispositions ne devant pas
tre combines :
par embiellement au niveau de l'interface verticale, ncessitant que le plan de reprise prsente
des indentations horizontales de 10 mm de profondeur minimale, espaces au plus de 50 mm ;
par appui sur le poteau, ce dernier devant tre dimensionn en consquence et l'about de la
poutre devant tre rugueux.
Dans les deux cas, les ttes de poteau doivent tre armes pour prvenir les risques d'clatement.
Les abouts des poutres doivent prsenter des indentations de largeur et de profondeur minimales de
10 mm et espaces de 50 mm au plus.
b. Assemblage poutre-poteau sans armature en attente pour liaison de tte (assemblage par broche
d'lments en bton arm)
La reprise des efforts de traction s'effectue dans la poutre au moyen de boucles entourant le
dispositif de liaison et ancres au-del de la longueur nominale de scellement des armatures actives
I sn , en majorant de 50 % la longueur de scellement ncessaire en situation non sismique. Ces
boucles, dont le diamtre est d'au moins 8 mm, sont espaces au plus du quart de la hauteur de la
poutre sans excder 150 mm.
Les broches et le volume d'assemblage intress sont dimensionns pour reprendre l'ensemble de la
sollicitation sismique en considrant pour les efforts horizontaux du sisme les efforts de cisaillement,
l'effet goujon et les effets d'encastrement locaux. Les broches sont ancres en tte de poteau et dans
la poutre, comme indiqu en 11.3.1.3 , l'ancrage dans la poutre tant ventuellement complt par
un assemblage de type boulonn ou soud (voir le paragraphe 16.4.5.1 ).
A dfaut, conventionnellement, les broches sont dimensionnes pour quilibrer en traction, leur
limite lastique, au moins :
3H + V
o :
H est la force globale horizontale rsultant de la combinaison des actions,
V est l'effort de traction (sisme, flexion ).
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 178 of 184
c. Autres types d'assemblages
Ils sont raliss conformment aux principes noncs dans ce texte.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.4.5.2
Figure 115 Assemblage poutre-poteau avec armatures
en attente
Des dispositions particulires d'assemblage peuvent tre dcrites dans les Avis Techniques.
16.5 Dispositions relatives aux planchers
16.5.1 Gnralits
Les planchers, raliss partir de composants et assimils au traditionnel, sont dimensionns vis--vis
des sollicitations sismiques verticales et relvent des prescriptions gnrales du prsent texte.
Ils doivent par ailleurs tre organiss de manire :
a. assurer le rle de diaphragme en transmettant aux lments de contreventement verticaux les efforts
sismiques horizontaux provenant des masses agissantes chaque niveau.
Toutefois, dans une structure particulire, les planchers peuvent ne pas avoir jouer le rle de
diaphragme si les efforts sismiques horizontaux sont transmis aux lments de contreventement par
un autre moyen pour autant que les effets mcaniques lis cette adaptation ne soient pas
prjudiciables tout ou partie de la structure.
L'analyse structurelle du diaphragme peut tre ralise :
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 179 of 184
soit par assimilation une poutre plate de grande hauteur,
soit par assimilation un arc ou une poutre treillis.
b. assurer la liaison entre les diffrents lments de la structure
Cela implique que les lments de planchers soient correctement ancrs sur leurs appuis
conformment aux prescriptions de ce texte. Un ancrage efficace des armatures principales est un
facteur primordial de la scurit des lments contre leur chute en cas de sisme.
16.5.2 Cas des planchers raliss partir de dalles alvoles
Ces planchers avec ou sans dalle rapporte peuvent tre admis en zone sismique dans le cadre de
procdures particulires.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.5.2
Les conditions d'utilisation sont prcises dans les Avis Techniques.
16.5.3 Cas des planchers poutrelles et entrevous et bton coul en oeuvre
Le dimensionnement des lments constitutifs de ces planchers est ralis conformment aux rgles en
vigueur moyennant les dispositions complmentaires donnes ci-dessous.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.5.3
Les rgles en vigueur sont le BAEL et le BPEL .
16.5.3.1 Planchers comportant une dalle de compression coule en oeuvre
La fonction diaphragme est assure par la dalle de compression en bton arm coule en oeuvre dont
l'paisseur h 0 est calcule en fonction des efforts transmettre, avec un minimum de 4 cm s'il s'agit
d'entrevous de coffrage rsistant (bton, terre cuite) et de 5 cm s'il s'agit d'entrevous de coffrage non
rsistant (par exemple polystyrne expans).
La section des aciers porteurs du treillis soud plac perpendiculairement la porte des poutrelles est au
moins gale 1 cm/ml, la section des aciers de rpartition parallles la porte des poutrelles est au
moins gale la moiti de celle des aciers porteurs.
L'ancrage du treillis soud de la dalle dans les chanages ainsi que celui des poutrelles est ralis comme
indiqu en 11.3.1.3 , en majorant de 30 % la longueur d'ancrage dtermine en situation non sismique.
Le monolithisme des montages doit tre assur par des armatures transversales dimensionnes
conformment aux prescriptions du BAEL ou du BPEL .
16.5.3.2 Planchers poutrelles et entrevous ne comportant pas de dalle de compression coule en
oeuvre
Ces planchers peuvent tre admis en zone sismique dans le cadre de procdures particulires.
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.5.3.2
Les conditions d'utilisation sont prcises dans les Avis Techniques.
16.5.4 Cas des planchers prdalles et bton coul en oeuvre
Le dimensionnement des prdalles est ralis conformment aux rgles en vigueur, moyennant les
dispositions complmentaires donnes ci-dessous. Les planchers raliss partir de prdalles
prsentent, compte tenu des dispositions donnes ci-dessous, le mme comportement en situation
sismique que les planchers dalles pleines.
La section des armatures principales des prdalles doit tre suffisante pour assurer la transmission de
l'effort sismique. Ces armatures sont ancres dans les chanages conformment au paragraphe 11.3.1.3
en majorant de 30 % leur longueur d'ancrage dtermine en situation non sismique.
Des armatures transversales de rpartition sont mises en oeuvre dans la prdalle perpendiculairement
aux armatures principales. Ces armatures sont mises en continuit par recouvrement au moyen
d'armatures droites disposes dans le bton de second oeuvre lorsque l'paisseur de la prdalle n'excde
pas le tiers de l'paisseur totale du plancher. De mme, des armatures droites sont places au droit des
chanages. Ces diffrentes armatures sont ancres comme indiqu en 11.3.1.3 , en majorant de 30 % les
longueurs d'ancrage dtermines en situation non sismique.
Le monolithisme des montages doit tre assur par des armatures transversales dimensionnes
conformment aux prescriptions du BAEL .
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.5.4
Les rgles en vigueur sont le BAEL et le BPEL .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 180 of 184
16.6 Dispositions relatives aux toitures des btiments industriels
Dispositions gnrales
En l'absence de rigidit ou en cas d'insuffisance de rigidit de la couverture vis--vis des efforts dirigs
paralllement son feuillet moyen, la fonction diaphragme des toitures des btiments industriels est
obtenue en organisant le plan de la toiture de telle sorte que celle-ci puisse tre considre comme
indformable sous sollicitation sismique par un contreventement de versant.
Mme lorsqu'elles sont considres comme lments secondaires au sens du paragraphe 11.1.1 , les
pannes doivent satisfaire aux conditions suivantes :
elles comportent des triers en armatures HA d'au moins 6 mm de diamtre et espaces de d/2 sur
une distance gale 1,5l sn compte partir des deux extrmits de l'lment,
elles sont rendues solidaires des poutres de rive soit au moyen d'armatures en attente, soit par des
assemblages brochs (voir 16.4.5.2 ).
Dans le cas o la liaison est ralise par des armatures actives ou passives en attente, leur ancrage
est assur en majorant de 30 % la longueur d'ancrage dtermine en situation non sismique.
Dans le cas o la liaison est assure par des broches, on se reporte au 16.4.5.2 , en considrant
comme espacement maximal des boucles la plus petite valeur de d/2 et de 150 mm.
L'ancrage des boucles est ralis conformment au paragraphe 11.3.1.3 , en considrant pour cette
vrification les distances 1,2 I sn en tant que zones critiques.
La largeur minimale b w dfinie en 16.4.1 peut tre porte 80 mm pour les poutres, et 60 mm pour
les pannes, pour autant que ces dernires comportent des blochets d'extrmit en l'absence de
dispositions constructives particulires.
Les pannes doivent tre vrifies en flexion dvie sur toute leur longueur sous les actions sismiques
horizontales et verticales (voir paragraphe 6.4 : Vrification de leur non-dversement).
NOTE SUR LE PARAGRAPHE 16.6
Il s'agit gnralement de toitures constitues par un rseau de pannes recevant des couvertures
lgres de type " bac acier " ou semi-lgres constitues par des composants en bton cellulaire
arm. Dans le cas o ces couvertures ne prsentent pas une rigidit suffisante pour dvelopper un
rseau de bielles, un systme de triangulation doit tre prvu de manire confrer la toiture un
comportement en cadre rigide.
Le fait de considrer les pannes en tant qu'lments secondaires justifie le fait de pouvoir ancrer
les broches dans les rgions dlimites par la longueur I sn et admettre ainsi des recouvrements
d'armatures dans ces rgions.
16.7 Dispositions relatives aux lments de fondations
16.7.1 Cas des longrines
Les dispositions retenir pour les longrines sont identiques celles relatives aux composants linaires
principaux (voir 16.4).
16.7.2 Cas des plots encuvement
Les plots encuvement sont considrs comme zones critiques sur toute leur hauteur comme indiqu en
11.3.5.1 .
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 181 of 184
Annexe A (normative) Dfinition des spectres lastiques normaliss
Les spectres lastiques normaliss sont donns pour la valeur de l'amortissement relatif. Ils sont
rapports la valeur unit de l'acclration nominale.
Leur forme gnrale est reprsente dans la figure A.1 . Elle rpond la dfinition analytique suivante
dans laquelle les ordonnes R D (T) sont des nombres sans dimension :
Branche AB : R E (T) = R A + (R M - R A ) [T/T B ]
Branche BC : R E (T) = R M
Branche CD : R E (T) = R M [T C /T]
Branche DE : R E (T) = R M [T C /T] [T D /T]
Le spectre normalis associ au site S est dsign par (S i ).
Composantes horizontales
Les valeurs T B , T C et T D , exprimes en secondes, et celle de R M , sont donnes pour chaque type de site
par le tableau ci-dessous :
Tableau A.1 Coordonnes des points remarquables des
spectres des composantes horizontales
Tableau A.2 Expression analytique des spectres des
composantes horizontales
La figure A.2 donne une reprsentation des spectres des composantes horizontales.
NOTE SUR L'ANNEXE A
L'attention est attire sur le fait que les spectres R E (T) ne peuvent tre utiliss pour le calcul des
structures par une mthode spectrale que dans le cas assez particulier ou la structure conserve un
comportement lastique pendant toute la dure du mou vement, et ou sa rponse est value par
une analyse modale complte. Dans le cas o le comportement post-lastique est pris en compte
au moyen d'un coefficient " de comportement " q (voir. 6.3.3 ) suprieur 1, ou s'il est fait usage
d'une mthode simplifie, il y a lieu de substituer au spectre lastique normalis R E le spectre de
dimensionnement R D dfini au paragraphe 5.2.3 .
En dehors du cas purement lastique voqu ci-dessus, les spectres normaliss ont pour objet la
spcification du contenu frquentiel prendre en compte dans la dtermination ou la slection des
acclrogrammes utiliss dans les calculs dynamiques.
La branche CD, qui correspond la pseudovitesse maximale pour l'amortissement 5 %, permet
d'valuer directement l'nergie cintique maximale prise par un mode.
Il convient d'insister sur le fait que les contenus frquentiels dfinis par les spectres normaliss sont
des contenus frquentiels de calcul, qui ne prtendent pas reprsenter le contenu frquentiel d'une
secousse relle, passe ou future, considre isolment. Les spectres de calcul constituent
seulement un moyen de couvrir de faon rationnelle l'ensemble des ventualits dfavorables dans
lesquelles peut se trouver place une structure.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 182 of 184
Lorsqu'on n'est pas certain du spectre choisir entre S 0 et S 3 , on peut soit effectuer deux calculs
et prendre le plus dfavorable, soit considrer uniquement l'enveloppe des deux spectres.
Figure A.1 Forme gnrale du spectre lastique
normalis
Figure A.2 Spectres des composantes horizontales
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 183 of 184
Annexe B (informative) Classes de risques des ouvrages
Il est rappel que sont classs en :
Classe A : Les ouvrages dont la dfaillance ne reprsente qu'un risque minime pour les personnes
ou l'activit conomique ;
Classe B : Les ouvrages et installations offrant un risque dit " courant " pour les personnes ;
Classe C : Les ouvrages reprsentant un risque lev pour les personnes en raison de leur
frquentation ou de leur importance socio-conomique ;
Classe D : Les ouvrages et installations dont la scurit est primordiale pour les besoins de la
Scurit Civile, de l'ordre public, de la Dfense et de la survie de la rgion.
NOTE SUR L'ANNEXE B
D'une faon gnrale, le classement des catgories d'ouvrages est opr par rfrence aux
exemples suivants :
Classe A : Perrons et escaliers poss mme le sol, murs de clture de moins de 1,80 m de
hauteur ; constructions agricoles usage principal de logement de cheptel vif, de remisage du
matriel et des rcoltes dans les exploitations individuelles ; constructions en simple rez-dechausse usage de garage ou d'atelier priv, etc.
Classe B : Habitations, bureaux, locaux usage commercial, ateliers, usines, garages usage
collectif, etc.
Classe C : Etablissements d'enseignement, stades, salles de spectacles, halls de voyageurs, et
d'une faon gnrale, Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1 re , 2 e et 3 e catgories ;
muses ; centres de production ou de distribution d'nergie, etc.
Classe D : Hpitaux, casernes, garages d'ambulances, dpts de matriel de lutte contre l'incendie,
etc., muses, bibliothques, abritant des oeuvres majeures ou des collections irremplaables, etc.
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Reef4 - CSTB
Page 184 of 184
Annexe C (informative) Bibliographie
Textes rglementaires
Dcret n 91-461 du 14 mai 1991
relatif la prvention du risque sismique (J.O. du 17/05/91).
Arrt du 16 juillet 1992,
relatif la classification et aux rgles de construction parasismiques applicables aux btiments de la
catgorie dite " risque normal " telle que dfinie par le Dcret n 91-461 du 14 mai 1991, relatif la
prvention du risque sismique (J.O. du 06/08/92).
Textes normatifs
NF B 10-001
Pierres calcaires (avril 1978 et modif. juil. 78).
P 21-701
(Rfrence DTU Rgles CB 71) - Rgles de calcul et de conception des charpentes en bois.
AFNOR 1995 - Imprim par BET SECBA le 14/06/2010
http://localhost:8080/reef4/actions/documents/print.jsp?code4x=MJH
14/06/2010
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Essentiels: Niveau 1Document44 pagesLes Essentiels: Niveau 1Clément Minougou100% (2)
- SismiqueDocument47 pagesSismiqueMariam MoumniPas encore d'évaluation
- 243-1 S-Transmission Niveleuse SérieHDocument35 pages243-1 S-Transmission Niveleuse SérieHمحمد يونس100% (3)
- Note de Calcul USINE CM KEB HangarDocument91 pagesNote de Calcul USINE CM KEB Hangaretanok22Pas encore d'évaluation
- ps92 Calcul Para-SismiqueDocument3 pagesps92 Calcul Para-SismiqueMars76100% (6)
- Predimensionnement Des Elements Structuraux Formation RobotDocument31 pagesPredimensionnement Des Elements Structuraux Formation RobotDarylPas encore d'évaluation
- Cahier CSTB 3633 - Étanchéité Des Toitures MétalliquesDocument38 pagesCahier CSTB 3633 - Étanchéité Des Toitures MétalliquesAntoine Carimalo100% (1)
- 4 Regles de Calcul de La Force SismiqueDocument46 pages4 Regles de Calcul de La Force SismiqueAbdi Lhsan100% (1)
- Tuto PHP-Mysql PDFDocument86 pagesTuto PHP-Mysql PDFReda Moatassim100% (1)
- Cours BA 1-Partie 1Document55 pagesCours BA 1-Partie 1Ismael ABDOULYE OUSSEINI100% (1)
- RefroidissementDocument17 pagesRefroidissementBa Hamzik HPPas encore d'évaluation
- PS 92Document192 pagesPS 92aborazanePas encore d'évaluation
- Etude SismiqueDocument40 pagesEtude SismiqueAskriEinmPas encore d'évaluation
- Principe Constructif Enduit ExterieurDocument4 pagesPrincipe Constructif Enduit ExterieurMorched TounsiPas encore d'évaluation
- Capacité PortanteDocument5 pagesCapacité PortanteSel BenPas encore d'évaluation
- Cheville - Général Note de CalculDocument10 pagesCheville - Général Note de CalculDBE MJSPas encore d'évaluation
- NF P 92-701Document71 pagesNF P 92-701rcosentino_publicPas encore d'évaluation
- Coll1 2013 Bielles TirantsDocument42 pagesColl1 2013 Bielles TirantsMouhameth SOWPas encore d'évaluation
- Webinar N°7 FR - FinalDocument44 pagesWebinar N°7 FR - FinalAhmed Ben HmidaPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 Fondations Superficielles PDFDocument58 pagesChapitre 6 Fondations Superficielles PDFTorpirPas encore d'évaluation
- CH III - Calcul Des Structures Selon EC0 Et EC1Document53 pagesCH III - Calcul Des Structures Selon EC0 Et EC1Hamza MokhtariPas encore d'évaluation
- OnduleurDocument23 pagesOnduleurSalahBenMohammedHaddadji100% (1)
- TC GE M106 - Manuel de Cours - FusionnéDocument85 pagesTC GE M106 - Manuel de Cours - Fusionnéfarrouj abdelhamid100% (1)
- Eurocode 0 Et Eurocode 1 Actions Et Combinaisons Niveau 1 BAS01 PDFDocument2 pagesEurocode 0 Et Eurocode 1 Actions Et Combinaisons Niveau 1 BAS01 PDFOUEDRAOGO IdrissaPas encore d'évaluation
- C Gilbert - EC7 Pieux-3Document31 pagesC Gilbert - EC7 Pieux-3lguisset100% (1)
- TP ArduinoDocument22 pagesTP ArduinokamalPas encore d'évaluation
- Memoire GC 2019 Chapitre VDocument23 pagesMemoire GC 2019 Chapitre VFara SofPas encore d'évaluation
- Eurocode 4: Calculs Des Structures Mixtes Acier-Béton: Connaissance Des Techniques de BaseDocument1 pageEurocode 4: Calculs Des Structures Mixtes Acier-Béton: Connaissance Des Techniques de BaseaminePas encore d'évaluation
- Combinaisons Actions BaelDocument62 pagesCombinaisons Actions BaelAnas CheraiPas encore d'évaluation
- AFPS - Guide - Technique - 2002 - Protection Parasismique Des Ponts de TuyauteriesDocument64 pagesAFPS - Guide - Technique - 2002 - Protection Parasismique Des Ponts de TuyauteriesYaya MamadouPas encore d'évaluation
- Dtu EtancheiteDocument146 pagesDtu EtancheiteAEMPas encore d'évaluation
- CH 6-2 Etude SismiqueDocument9 pagesCH 6-2 Etude SismiqueBeny Abdou100% (10)
- 8 Genie ParasismiqueDocument22 pages8 Genie Parasismiqueprincedj33Pas encore d'évaluation
- Construction en Zone Sismique - SocotecDocument166 pagesConstruction en Zone Sismique - SocotecHamza MamiPas encore d'évaluation
- Dyn Genie Parasismique KotronisDocument188 pagesDyn Genie Parasismique KotronisAssata TourePas encore d'évaluation
- SoutènementDocument33 pagesSoutènementzikas-linkinPas encore d'évaluation
- Cimfeu Calcul Feu Structure BetonDocument82 pagesCimfeu Calcul Feu Structure BetonLionel TebonPas encore d'évaluation
- Modele de Swot PowerpointDocument1 pageModele de Swot PowerpointFranck SoglohounPas encore d'évaluation
- Construction ParasismiqueDocument7 pagesConstruction ParasismiqueENAENA187Pas encore d'évaluation
- Fondations Superficiellesv3Document13 pagesFondations Superficiellesv3viva34100% (3)
- M2 Part5 Ec8Document138 pagesM2 Part5 Ec8Saad BenchekrounPas encore d'évaluation
- Règlement PS-MI 92Document42 pagesRèglement PS-MI 92Ferdinand HOUNYEMEPas encore d'évaluation
- T4-A Conception Parasismique Des BatimentsDocument12 pagesT4-A Conception Parasismique Des BatimentsFabien Rivron100% (1)
- Les EurocodesDocument39 pagesLes EurocodesfahimPas encore d'évaluation
- Dtu 13.12Document23 pagesDtu 13.12asdasPas encore d'évaluation
- Complements Rpa Final1Document17 pagesComplements Rpa Final1AliSlimaniPas encore d'évaluation
- Construction Zones SismiquesDocument16 pagesConstruction Zones SismiquessahjPas encore d'évaluation
- Chapitre 02Document48 pagesChapitre 02Sergio RodríguezPas encore d'évaluation
- Comparaison Des Normes Euro Code 8Document23 pagesComparaison Des Normes Euro Code 8شمس اللهPas encore d'évaluation
- Robot Sismique Mode RésiduelDocument8 pagesRobot Sismique Mode Résidueldaongocha108Pas encore d'évaluation
- Reprise en Sous Sol Dcn5Document7 pagesReprise en Sous Sol Dcn5Far FarhaanPas encore d'évaluation
- ContreventementDocument4 pagesContreventementYassine ElmPas encore d'évaluation
- Charpente Mettalique Mini ProjetDocument2 pagesCharpente Mettalique Mini ProjetZineb JelbaouiPas encore d'évaluation
- 4 CHAPITRE 4 CorrigéDocument16 pages4 CHAPITRE 4 Corrigékikp100% (1)
- TALEB R CGS JPOGC 08 Calcul Des Structures Selon Le RPA 2003 PDFDocument31 pagesTALEB R CGS JPOGC 08 Calcul Des Structures Selon Le RPA 2003 PDFMohamed Seghir Benzemrane100% (1)
- Chap 4Document8 pagesChap 4Rabah HaPas encore d'évaluation
- 1 Eurocode 8: Résistance Des Structures Aux Séismes: 2 Outils de Calcul DisponiblesDocument2 pages1 Eurocode 8: Résistance Des Structures Aux Séismes: 2 Outils de Calcul DisponiblesHKDOCUMENTPas encore d'évaluation
- Chebap 201 7 / 2018: TD Mécanique Des Sols / ConsolidationDocument11 pagesChebap 201 7 / 2018: TD Mécanique Des Sols / ConsolidationLemallemPas encore d'évaluation
- Evaluation de Coefficient de Comportement Des Structures en AcierDocument73 pagesEvaluation de Coefficient de Comportement Des Structures en AcierGhadir BeyroutiPas encore d'évaluation
- Manuel Pushover PDFDocument16 pagesManuel Pushover PDFAnonymous ww55t9C100% (2)
- Sismique EC8Document14 pagesSismique EC8Екатерина ВеликаяPas encore d'évaluation
- 6.escaliers Droits en Béton Armé PDFDocument3 pages6.escaliers Droits en Béton Armé PDFYassin FrikhaPas encore d'évaluation
- Pieu Sous SeismeDocument148 pagesPieu Sous Seismeqwerty2500Pas encore d'évaluation
- Arche 16.1 - Guide de Validation PDFDocument135 pagesArche 16.1 - Guide de Validation PDFarbiPas encore d'évaluation
- Sécurité Des Constructions - Règles de Calcul IIDocument40 pagesSécurité Des Constructions - Règles de Calcul IIstereonePas encore d'évaluation
- Reglementation Eurocode2 (Beton Armé)Document24 pagesReglementation Eurocode2 (Beton Armé)mriliPas encore d'évaluation
- SelDocument42 pagesSelNdéné NDIAYEPas encore d'évaluation
- Cahier CSTB - 3194 - Ossat MétalDocument76 pagesCahier CSTB - 3194 - Ossat MétalbefacadePas encore d'évaluation
- Efficience Des Marchés (10) OkDocument31 pagesEfficience Des Marchés (10) OkBadal SamuelPas encore d'évaluation
- Correction LAgrivoltaïsme Enseignement Scientifique TerminaleDocument2 pagesCorrection LAgrivoltaïsme Enseignement Scientifique Terminalejosiastite22Pas encore d'évaluation
- 0604 Confort Thermique Faure V1 PDFDocument2 pages0604 Confort Thermique Faure V1 PDFAkshay GopeePas encore d'évaluation
- TalendOpenStudio DI GettingStarted FR 7.1.1Document39 pagesTalendOpenStudio DI GettingStarted FR 7.1.1Yacine MaastrichtPas encore d'évaluation
- TP de Data Mining 00-Utilisation de Clementine-EPFDocument7 pagesTP de Data Mining 00-Utilisation de Clementine-EPFBacary SènePas encore d'évaluation
- Plan - Système Pour La Recommandation Du Menu Selon Les Vitamines Et Minéraux Supplémentaires Nécessaires Pour Une PersonneDocument5 pagesPlan - Système Pour La Recommandation Du Menu Selon Les Vitamines Et Minéraux Supplémentaires Nécessaires Pour Une Personneiulya13Pas encore d'évaluation
- Cours 1 IntroductionDocument22 pagesCours 1 IntroductionAhmed BetaimiPas encore d'évaluation
- 128 - Endomorphimes Trigonalisables. Endomorphismes NilpotentsDocument4 pages128 - Endomorphimes Trigonalisables. Endomorphismes Nilpotentsayoub ayoubbPas encore d'évaluation
- LVM30 Lovato PDFDocument4 pagesLVM30 Lovato PDFJosé PalomaresPas encore d'évaluation
- Sage 100cloud Gestion Commerciale Version 3.0Document10 pagesSage 100cloud Gestion Commerciale Version 3.0haythem.bchir.10Pas encore d'évaluation
- Détermination Du PCNDocument7 pagesDétermination Du PCNRAHMA ABDELLIPas encore d'évaluation
- Phi1501 Raisonnement Et Pensée CritiqueDocument3 pagesPhi1501 Raisonnement Et Pensée Critiquelove wambisPas encore d'évaluation
- Fiche Technique - Actionneur Encastrable v35 16FDocument4 pagesFiche Technique - Actionneur Encastrable v35 16FGERARD ArnaudPas encore d'évaluation
- Emploi Du Temps - S2 - L1 - G1+G2 - GT - 21-22Document2 pagesEmploi Du Temps - S2 - L1 - G1+G2 - GT - 21-22edzeghe victorPas encore d'évaluation
- Evaluation Isostatisme PDFDocument4 pagesEvaluation Isostatisme PDFGenie Meca100% (1)
- Rapport PFF ICF.021Document68 pagesRapport PFF ICF.021Oussama KosbiPas encore d'évaluation
- Procédure Dessai de Contrôle Sur ClouDocument4 pagesProcédure Dessai de Contrôle Sur ClouVirane DantonPas encore d'évaluation
- Atome3d Phrozen TransformDocument2 pagesAtome3d Phrozen TransformSalamin FlorianPas encore d'évaluation
- FDS DetergentsDocument14 pagesFDS DetergentslionelPas encore d'évaluation
- Recours GracieuxDocument2 pagesRecours Gracieuxmbaye seyePas encore d'évaluation