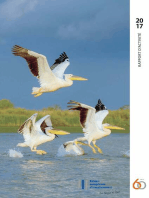Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
2 - Support Du Module Creation Dentreprises 1.2 PDF
2 - Support Du Module Creation Dentreprises 1.2 PDF
Transféré par
Yassine ChamsiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
2 - Support Du Module Creation Dentreprises 1.2 PDF
2 - Support Du Module Creation Dentreprises 1.2 PDF
Transféré par
Yassine ChamsiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Centre Universitaire
Universit de Sfax dInsertion et dEssaimage de Sfax
Projet Culture Entrepreneuriale et Cration dEntreprise lUniversit de Sfax
CE & CE
Support pdagogique du module
Cration dEntreprises
Version 1.2 Septembre 2008
A lusage des formateurs et des tudiants de lEnseignement Suprieur
(Toutes disciplines confondues)
Support conu, dvelopp et dit par :
Lassad Mezghani
Mohamed Belhaj
Habib Affes
Wassim Aloulou
Faouzi Ayadi
Bilel Bellaj
Jamel Choukir
Slim Mseddi
Avec la participation de toute lquipe du projet CE&CE
Et lappui de lAssociation Universit Environnement
Anne universitaire : 2008-2009
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Table des matires
TABLE DES MATIERES .................................................................................................. 2
INTRODUCTION A LA CREATION DENTREPRISES ............................................. 5
1 LES ETAPES DE LA CREATION DENTREPRISES ............................................................... 5
2 INITIATEUR DU PROJET OPPORTUNITE COMMERCIALE PLAN DAFFAIRES ................ 6
2.1 Initiateur du projet ou promoteur .......................................................................... 6
2.2 Lide ou opportunit commerciale ...................................................................... 7
2.3 Plan dAffaires ...................................................................................................... 7
2.4 Grandes questions et grands pas franchir........................................................... 8
CHAPITRE 1. INITIATEUR DU PROJET - IDEE/OPPORTUNITE -
ADEQUATION ..................................................................................... 10
1 LE CREATEUR OU LEQUIPE ENTREPRENEURIALE......................................................... 10
1.1 Les motivations ................................................................................................... 10
1.2 Les alternatives de carrire ................................................................................. 11
1.3 Les ambitions et les objectifs .............................................................................. 11
1.4 Auto-diagnostic et profil entrepreneurial : Qui bien se connat mieux russit ... 11
2 LIDEE/OPPORTUNITE : LA RACINE DU PROJET ............................................................. 12
2.1 Lide ou lopportunit (occasion daffaires) : recherche, gnration............ 12
2.2 Les sources dides ............................................................................................. 13
2.3 La validation de lide de cration dentreprise.................................................. 13
2.3.1 Dterminez les composantes de votre ide (votre offre : produit/service) ........ 14
2.3.2 Dlimitez le march vis a priori ...................................................................... 16
2.3.3 Dcrivez votre activit de faon trs prcise..................................................... 17
2.3.4 Collectez les informations essentielles .............................................................. 17
2.3.5 Sollicitez avis et conseils ................................................................................... 17
2.3.6 Analysez les contraintes de votre projet............................................................ 18
2.3.6.1 Les contraintes propres la nature du produit ou du service........................... 18
2.3.6.2 Les contraintes lies au march ....................................................................... 21
2.3.6.3 Les contraintes de moyens............................................................................... 22
2.3.6.4 Les contraintes de rglementations.................................................................. 24
2.3.7 Dfinissez votre projet personnel de crateur................................................... 24
2.3.8 Vrifiez enfin le ralisme de votre ide ............................................................. 26
2.4 Votre ide est-elle raliste ? ................................................................................ 29
3 LADEQUATION DU COUPLE CREATEUR/PROJET ........................................................... 29
3.1 Affinit entre le crateur et son ide dentreprise ............................................... 29
3.2 Contraintes du projet de cration et du projet personnel du crateur.................. 29
3.3 Adquation du couple Homme(s)/Projet............................................................. 29
CHAPITRE 2. ETUDE DE FAISABILITE DE LA CREATION DENTREPRISES
................................................................................................................. 31
1 VOLET COMMERCIAL .................................................................................................. 31
1.1 Aspects stratgiques............................................................................................ 31
1.1.1 Identifier et tudier le comportement des clients cible...................................... 32
1.1.1.1 Analyse qualitative du march cible................................................................ 32
CUIES Universit de Sfax 2/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
1.1.1.2 Analyse quantitative du march cible.............................................................. 33
1.1.1.3 Analyse dynamique du march cible ............................................................... 33
1.1.2 Etude du comportement de la concurrence ....................................................... 34
1.1.3 Dfinition dune stratgie de dveloppement .................................................... 35
1.2 Aspects oprationnels ......................................................................................... 36
1.2.1 Dcisions produit/service .................................................................................. 36
1.2.2 Dcisions relatives la communication............................................................ 37
1.2.3 Dcisions relatives la force de vente .............................................................. 37
1.2.4 Dcisions relatives la distribution : Choix des circuits et canaux et de la
stratgie de distribution..................................................................................... 38
1.2.5 Dcisions relatives au prix ................................................................................ 39
1.3 Autres aspects : Etude et Recherche Marketing.................................................. 40
1.3.1 Ltude de march : objectifs et tapes ............................................................. 40
1.3.2 Les sources dinformations : primaires et secondaires..................................... 41
2 VOLET TECHNIQUE ...................................................................................................... 42
2.1 Dfinition des produits ou services..................................................................... 43
2.2 Le choix du processus de production.................................................................. 44
2.2.1 Description du processus de production ........................................................... 44
2.2.2 La capacit et le niveau de production.............................................................. 45
2.2.3 Les besoins en moyens de production ............................................................... 45
2.3 Implantation et besoins en btiments .................................................................. 46
2.4 Investissements : Besoins en moyens de production investir .......................... 47
2.4.1 Classification des Investissements..................................................................... 47
2.4.2 Choix dinvestissements, Rentabilit et critres dacceptation ......................... 47
3 VOLET RESSOURCES HUMAINES .................................................................................. 49
3.1 Rle et importance des RH dans lentreprise...................................................... 49
3.1.1 La direction de lentreprise ............................................................................... 49
3.1.2 Les besoins en personnel de production............................................................ 50
3.1.2.1 Les besoins en formation et assistance ............................................................ 50
3.1.2.2 Cot de formation............................................................................................ 51
3.2 La gestion prvisionnelle du personnel (Rappel de cours GRH)........................ 51
3.2.1 Dfinition de lanalyse des fonctions ................................................................ 51
3.2.2 Les principales tapes de lanalyse des fonctions............................................. 51
3.2.3 Questions essentielles poser pour lanalyse des fonctions............................. 51
3.2.4 Lexploitation de lanalyse des fonctions .......................................................... 52
3.2.4.1 Lanalyse des fonctions et la planification des RH.......................................... 52
3.2.4.2 Lanalyse des fonctions et la formation........................................................... 52
3.2.4.3 Lanalyse des fonctions et le recrutement........................................................ 52
3.2.4.4 Lanalyse des fonctions et la rmunration ..................................................... 53
3.2.4.5 Lanalyse des emplois et lvaluation du rendement ....................................... 53
3.3 Rmunration et avantages sociaux .................................................................... 53
3.3.1 Dtermination du niveau de salaire .................................................................. 53
3.3.2 Dtermination des avantages sociaux ............................................................... 53
4 VOLET ECONOMIQUE ET FINANCIER ............................................................................ 54
4.1 Rentabilit conomique du projet ....................................................................... 54
4.1.1 Etude de la rentabilit du projet........................................................................ 54
4.1.1.1 Prvision des ventes : Chiffre daffaires prvisionnel ..................................... 55
4.1.1.2 Prvision des charges....................................................................................... 55
4.1.2 Calcul du point mort (seuil de rentabilit) : Analyse Cot - Volume Profit... 56
4.1.2.1 Evolution des cots selon le niveau dactivit................................................. 57
4.1.2.2 Analyse C-V-P................................................................................................. 57
4.2 Faisabilit financire ........................................................................................... 58
4.2.1 Construction du plan de financement initial ..................................................... 59
CUIES Universit de Sfax 3/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
4.2.1.1 Besoins durables .............................................................................................. 59
4.2.1.2 Le recensement des ressources durables.......................................................... 60
4.2.2 Compte de rsultat prvisionnel........................................................................ 60
4.2.3 Plan de trsorerie.............................................................................................. 61
4.2.4 Le bilan prvisionnel ......................................................................................... 62
4.2.5 Plan de financement sur 3 ans .......................................................................... 63
4.2.6 Les rgles de financement ................................................................................. 64
4.2.6.1 Les fonds propres............................................................................................. 64
4.2.6.2 Le financement par lendettement ................................................................... 64
4.2.6.3 Le financement en Tunisie............................................................................... 64
4.2.6.4 Lquilibre financier ........................................................................................ 64
5 VOLET JURIDIQUE, FISCAL ET SOCIAL .......................................................................... 65
5.1 Dossier juridique et ses aspects........................................................................... 65
5.1.1 Choix de la structure ......................................................................................... 65
5.1.2 Les principaux critres de choix........................................................................ 66
5.1.3 Etapes juridiques de la cration et formalits de constitution (EI, SURL, SARL,
SA) ..................................................................................................................... 66
5.1.3.1 Etapes juridiques ............................................................................................. 66
5.1.3.2 Formalits juridiques de constitution............................................................... 67
5.2 Dossier social et ses aspects................................................................................ 70
5.2.1 Scurit sociale.................................................................................................. 70
5.2.2 Rgime social (40 ou 48 heures) et salaire minimum ....................................... 71
5.2.3 Charges sociales................................................................................................ 71
5.3 Dossier fiscal et ses aspects ................................................................................ 71
5.3.1 Rgime rel ou forfaitaire ................................................................................. 71
5.3.2 Obligations fiscales de lentreprise................................................................... 71
CHAPITRE 3. LA CREATION DENTREPRISES ET LES PRINCIPAUX
INTERVENANTS ................................................................................. 73
1 LENVIRONNEMENT DE CREATION DENTREPRISES EN TUNISIE................................... 73
1.1 Les mutations et les dfis .................................................................................... 73
1.2 Un cadre institutionnel et juridique particulirement favorable ......................... 73
1.3 La simplification des rgles administratives....................................................... 74
1.4 Le soutien et la formation aux entreprises .......................................................... 74
2 LINCITATION AUX INVESTISSEMENTS : AVANTAGES FINANCIERS ET FISCAUX
ACCORDES ................................................................................................................... 77
2.1 Le Code dincitations aux investissements et nouveau promoteur ..................... 77
2.2 Les fonds spciaux dincitation........................................................................... 77
2.2.1 Les activits artisanales et petits mtiers : FONAPRAM.................................. 77
2.2.2 Les activits industrielles et de services : FOPRODI et le dveloppement
rgional ............................................................................................................. 78
2.2.3 Le Rgime dIncitation lInnovation dans les Technologies de lInformation
(RITI)................................................................................................................. 82
2.2.4 Les Socits dInvestissement Capital Risque (SICAR) ................................. 82
2.2.5 Les socits octroyant des crdits dinvestissement .......................................... 82
2.2.5.1 Banque Tunisienne de Solidarit (BTS) .......................................................... 82
2.2.5.2 La Banque de Financement des PME (BFPME) ............................................. 83
2.2.5.3 Autres Etablissements financiers ..................................................................... 83
2.2.6 Les socits de Garanties .................................................................................. 83
2.2.6.1 La Socit Tunisienne de Garantie (SOTUGAR)............................................ 83
2.2.6.2 Le Fonds National de Garantie (FNG) ............................................................ 84
CUIES Universit de Sfax 4/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Introduction la cration dentreprises
Ce support de cours est une introduction la cration dentreprises. Elle se propose den
prsenter les tapes et de vous donner des repres pour aider rduire les risques inhrents
toute cration dentreprises. Mme si la dmarche cratrice prsente des caractristiques
universelles, les risques dpendent en grande partie du type dentreprise envisag et de
votre propre profil entrepreneurial, et cest la raison pour laquelle vous devez analyser
srieusement votre profil, pour rduire les risques qui pourraient surgir en raison de vos
points faibles et utiliser au mieux vos atouts en fonction de votre opportunit.
La cration dentreprises prsente, comme toute uvre humaine, des risques, des
sacrifices, mais aussi des satisfactions. La russite, elle, prsente une dmarche volontaire
et consciente, qui privilgie lessentiel et se base sur les fondements solides des entreprises
performantes : la qualit des hommes et des relations humaines dans lentreprise afin
doffrir au client du produit/service de qualit. Toute dmarche de la cration russie, doit
converger vers ce mme but.
1 LES ETAPES DE LA CREATION DENTREPRISES
La russite de la cration dune entreprise exige une dmarch rigoureuse et consciente,
elle suppose de la part du futur entrepreneur des qualits et des capacits entrepreneuriales
pour conduire de manire progressive et efficiente les diffrentes tapes du processus de
cration : Chercher une bonne ide de cration dentreprise, vrifier si cette ide constitue
rellement une opportunit exploitable, transformer cette opportunit en une entreprise
viable qui, ds son dmarrage maximise son potentiel de rentabilit et de croissance, tel est
le but de tout crateur dentreprise. Le parcours du crateur dentreprise suit une
progression en tapes prsentes dans la figure n1.
CUIES Universit de Sfax 5/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Figure 1 : Etapes de la cration dentreprises
Le crateur Ide-opportunit
Motivation Besoin, ide, concept.
Profil entrepreneurial Etude de lopportunit
Forces et faiblesses Prix, produit, march, clients.
Forces - Faiblesses
Adquation
Entrepreneur -Opportunit
Stratgie personnelle
Stratgie dentreprise
du promoteur
Elaboration du
plan daffaires
Ralisation du Formalits, autorisations,
Banques, partenaires,
financement
Ngociations,
Mise disposition des
Ralisation moyens.
Btiments
Matriels,
Dmarrage Moyens humains
Mobilisation des moyens
Monte en capacit de lentreprise.
Mise en place dun
systme de gestion.
Croissance et Organisation
dveloppement
Ce parcours consiste :
identifier une ide potentielle, opportunit exploitable (ventuelle entreprise viable et
saine),
rechercher une cohrence du projet travers une tude dtaille de faisabilit,
lancer ensuite les diffrentes oprations du projet, et enfin
dmarrer dune manire effective lactivit et essayer datteindre la vitesse de
croisire.
2 INITIATEUR DU PROJET OPPORTUNITE COMMERCIALE
PLAN DAFFAIRES
2.1 INITIATEUR DU PROJET OU PROMOTEUR
Le succs dans la cration dentreprise, repose sur la motivation et les qualits du
promoteur, mais aussi sur lintrt de lide ou opportunit quil compte exploiter.
Cependant, mme si lide est gniale et le march porteur, rien ne dit que le promoteur
possde les atouts et les comptences pour capter une partie de ce march et pour russir.
Tout promoteur doit sassurer quil veut rellement crer une entreprise et commencer par
rflchir sur lui-mme ; connatre et expliciter ses motivations, identifier ses atouts,
dtecter ses points faibles et dfaillances pour la cration dentreprise.
CUIES Universit de Sfax 6/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Il faut surtout viter de se dire : je nai rien perdre, alors je fonce . Les grandes
facilits offertes la cration dentreprise, lassistance et le maintien artificiel en activits
dentreprises inefficientes, appartiennent une poque rvolue dans notre pays. Les
conditions conomiques changent avec une grande rapidit et les entreprises inefficaces
nchapperont plus dsormais aux lois de la concurrence et la sanction du march.
Il sagit, pour le porteur de projet dentreprise :
dexpliciter ses motivations, ses objectifs,
didentifier ses atouts, forces,
de dtecter ses points faibles, faiblesses,
de chercher valuer son profil entrepreneurial (innovateur, preneur de risque et
proactif).
2.2 LIDEE OU OPPORTUNITE COMMERCIALE
En ralit, aucun promoteur aussi dou soit-il, ne peut esprer russir sil ne propose pas
un produit ou un service capable de rpondre un besoin insatisfait ou mal satisfait et, sil
ne peut vendre ce produit ou ce service un prix acceptable pour ses clients, et rentable
pour sa future entreprise. Ainsi, il ne suffit pas de trouver une ide, il est ncessaire de
vrifier si cest une opportunit en soi ensuite, sassurer que cest une opportunit pour
vous.
Une bonne ide ne reprsente pas toujours une opportunit pour la cration dentreprise,
car une ide sans march ou ne rpondant pas un besoin, na aucun intrt. Une ide se
prsente comme une opportunit si elle rpond un besoin insatisfait ou mal satisfait.
Une ide susceptible de trouver un march nest probablement pas une bonne ide, si le
promoteur na pas pris la peine danalyser les facteurs-cls de russite de son futur
domaine dactivit.
Pour minimiser les risques, le futur crateur doit analyser soigneusement le secteur
dactivit dans lequel il veut sengager et valuer srieusement lopportunit, en se posant
les questions suivantes : lide est-elle une opportunit ? Existe-t-il un march solvable
pour cette ide ? Quels sont les facteurs cls de russite sur ce march ? Quels sont vos
atouts et vos faiblesses sur ces facteurs ? Pouvez-vous rduire les faiblesses et profiter au
maximum de ces atouts ? Comment ? Si la rponse ces questions est positive, alors le
futur crateur doit avancer dans ltude des diffrentes composantes du projet et laborer
un plan daffaires.
2.3 PLAN DAFFAIRES
Lexprience montre, quun projet mal ou insuffisamment tudi, est une raison frquente
de difficult de dmarrage de la future entreprise et souvent, dchec. Il faut prendre son
temps, pour rflchir et bien tudier les questions suivantes notamment :
Comment tudier un projet dune manire dtaille ? Comment dterminer les moyens
ncessaires son lancement ? Quelles sommes faut-il apporter soi-mme, si lon veut
prsenter au banquier un dossier de financement acceptable ou un investisseur potentiel
de type SICAR ou autres ? Que peut-on demander au banquier et comment laborder pour
maximiser les chances dobtenir les crdits ncessaires la ralisation de laffaire ? Que
faut-il connatre en gestion avant de crer une affaire ? Quelle structure juridique choisir ?
Quelles formalits administratives accomplir avant de se lancer ?
CUIES Universit de Sfax 7/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Autant de questions qui se posent en mme temps, et auxquelles le promoteur doit donner
des rponses prcises et cohrentes. Pour cela, il doit btir un plan daffaires montrant
lobjectif atteindre et la manire de le faire.
Un plan daffaires doit couvrir les aspects les plus importants de ltude du projet ainsi que
les diffrentes phases de la ralisation de laffaire. Il doit montrer que lopportunit
envisage est ralisable, rentable et quil est en mesure de la saisir. Ce plan doit sexprimer
par des plans, programmes et des budgets. Lobjectif tant donc la rduction des dlais de
ralisation et loptimisation de lutilisation des ressources, et la prvision. Cest un moyen
de pilotage, de suivi et de contrle de la ralisation du projet.
Ltape dlaboration du plan daffaires vient aprs avoir tudi la faisabilit du projet tel
que prsent dans la figure n2.
Figure 2 : Le Plan dAffaires
Ide du projet
Analyse de lopportunit et tude de pr-faisabilit
Etude de faisabilit
Etude de March Etude Technique Etude des Ressources Etude Economique Etude Juridique,
Humaines et Financire Fiscale et Sociale
Plan dAffaires
Ensuite, le promoteur devra boucler le schma de financement, runir et prparer la
mobilisation des ressources financires et accomplir les diffrentes formalits
administratives, les autorisations, constituer des garanties Cest alors quil peut
commencer la ralisation effective du projet : acqurir et mettre la disposition de
lentreprise les moyens matriels et les ressources humaines pour le dmarrage des
activits.
Ce dmarrage ncessite une prparation minutieuse et une coordination rigoureuse des
tches pour viter les retards de ralisation et les gaspillages.
Le promoteur devra au cours de cette phase excuter trois tches importantes : assurer un
bon dmarrage pour garantir la survie de lentreprise, mettre en place le systme de
direction et de gestion et prparer la croissance de lentreprise.
2.4 GRANDES QUESTIONS ET GRANDS PAS A FRANCHIR
Une cration dentreprise doit se raliser sur des bases saines, il faut insister sur le point
primordial de la cration : celui des interrogations avant le dmarrage. Il sagit de poser les
"grandes questions" et rflchir sur les "grands pas franchir". Le test de russite ou
dchec dun projet se ralise plus souvent au moment de llaboration du dossier
stratgique. Le rle de ce dossier doit, dune part, forcer le crateur formaliser des
notions sur ses propres motivations, sur la concurrence ou sur le secteur choisi. Il doit
CUIES Universit de Sfax 8/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
servir, dautre part, de pralable llaboration du dossier financier prsenter devant les
banquiers.
Le projet de cration est fond sur deux aspects (ples insparables du moins durant le
processus de cration) :
la comptence de lindividu : crateur (personnalit, motivations, profil
entrepreneurial),
la validit du projet : analyse de facteurs cls de succs matriser
CUIES Universit de Sfax 9/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Chapitre 1. Initiateur du projet - Ide/Opportunit -
Adquation
1 LE CREATEUR OU LEQUIPE ENTREPRENEURIALE
Chaque individu initiateur et porteur de projet doit rflchir sur lui-mme, connatre et
expliciter ses motivations, identifier ses atouts, dtecter ses points faibles, Des questions
tournant autour de ces thmes doivent se poser avec un maximum dobjectivit et de recul.
1.1 LES MOTIVATIONS
Le dsir dentreprendre nmane pas dune formation. Il dpend de la personnalit de
chacun, quelle que soit son origine sociale ou le niveau de ses tudes : la volont
dentreprendre est un point qui domine une cration. (Cest une qualit, vocation,) La
cration intgre en plus de ce point, la notion de rentabilit.
La volont dentreprendre reprsente des besoins que ressentent certains individus : le dsir
dindpendance (dtre libre), le got du pouvoir (dtre son propre patron), la volont de
"se raliser", lattrait de largent, le got de comptition,
La motivation premire des entrepreneurs dans la cration dune entreprise, cest la volont
daller toujours plus loin (satisfaction du besoin de ralisation de soi), de se dpasser et
surmonter les obstacles, et de persvrer (patient, tenace,...).
Des questionnaires pour dtecter vos motivations sont disponibles et permettent par
exemple dapprcier votre dsir de dpassement ; votre got du pouvoir ; et de mieux
connatre vos qualits (et ses dfauts) en tant que crateur potentiel (tnacit ; esprit
dinitiative ; sens des responsabilits ; rsistance aux chocs et aptitude se contrler ;
capacit de travail ; sant ; enthousiasme ; aptitude communiquer cet enthousiasme aux
autres ; aptitude dcider ; art de se vendre ; bon sens ; jugement ; capacit dadaptation ;
curiosit pour tout ce qui vous entoure ; dsir de comprendre les autres ; flair).
Deux autres motivations, assez peu cites, et pourtant primordiales, sont : le temps et les
circonstances inattendues,
Pour ce qui est du temps, le crateur dit "cest le moment o jamais, et je dois foncer".
"Crer quand on est jeune" voque un problme dexprience pour le jeune crateur.
Il est primordial de ne jamais sengager sur un plan technique ou sur un plan
financier avant davoir longuement "mri" son projet.
"Crer avant dtre vieux" est une motivation pour certains individus atteignant la
quarantaine, priode dinterrogation sur leur vie. Cest aussi cet ge que lon a
amass une somme dexprience et de connaissance permettant de bien choisir son
produit et affiner son projet.
Pour ce qui est des circonstances inattendues, elles sont quelques fois fcheuses : le dcs
dun proche (une reprise dune activit aprs dcs), le chmage,
Dans le cas dune cration plusieurs, en quipe, il est important quil stablisse un
dialogue frquent entre chaque partenaire. Chacun doit avoir conscience de ses motivations
et doit les avoir exprim.
CUIES Universit de Sfax 10/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Le crateur dentreprise devra sattacher des collaborateurs plus qualifis que la moyenne.
Ils devront tre dautant plus motivs que le crateur.
Pour les mobiliser fond, le crateur devra possder au plus haut degr lesprit dquipe et
avoir le profil dun leader. Le crateur doit distinguer deux types de partenaires :
ceux qui lui apportent des fonds et qui ne travaillent pas avec lui,
ceux qui travaillent avec lui (associs ou non).
Donc, il est ncessaire de les bien choisir, car une entreprise est toujours laffaire dune
quipe et devra tre mene par un leader dynamique.
1.2 LES ALTERNATIVES DE CARRIERE
Crer une entreprise est un acte surexcitant et enthousiasmant, mais il faut savoir peser les
termes de son choix et se demander avec lucidit si le projet est viable et si les motivations
et aspirations sont assez profondes.
Pour cela, il faut aussi faire la balance entre le rapport futur de lentreprise et les offres de
travail que lon peut avoir par ailleurs et qui peuvent tre plus intressants terme.
Ce petit calcul na pas pour but de dcourager, simplement, il met en vidence que la
cration dentreprise a un cot. Cela peut tre la perte dune situation intressante dans une
entreprise o un individu dynamique peut trs bien entreprendre, crer et mme innover.
Il faut bannir du langage lexpression suivante : je nai rien perdre, donc jy vais . Le
prix payer pour crer une entreprise est lev en efforts, en temps, en argent, quen
confiance en soi et en prestige. Les alternatives signifient aussi autre chose quun arbitrage
financier entre une cration et le calcul dun plan de carrire trac. Le cot dune cration
nest pas seulement financier, il est aussi social, familial, humain, (un sacrifice pour le
bien de la famille).
1.3 LES AMBITIONS ET LES OBJECTIFS
Les ambitions dcoulent des motivations : Que cherche le crateur ? Quelles sont ces
ambitions personnelles et quels sont ses objectifs pour son entreprise ?
Lentreprise est-elle cre pour se dvelopper, tre vendue, permettre au fondateur den
vivre, sassocier avec dautres entreprises ?
Ltude des ambitions et des objectifs permet de se reconnatre, dharmoniser la
personnalit du crateur avec son projet et son quipe, et de prendre conscience du but
dentreprendre.
Mais si lon persvre, alors il est ncessaire de mettre sur pied le projet.
1.4 AUTO-DIAGNOSTIC ET PROFIL ENTREPRENEURIAL : QUI BIEN SE
CONNAIT MIEUX REUSSIT
Il existe plusieurs tests dauto-diagnostic permettant au crateur dorienter et de renforcer
ses potentialits entrepreneuriales.
Pour mieux se connatre et faciliter lauto-valuation, le crateur a besoin de plusieurs
tests :
Test n1 : Test du profil entrepreneurial
test de personnalit : temprament, sens de responsabilit, crativit
test de prise de risque : rapport du crateur (attitude) avec la notion de risque,
CUIES Universit de Sfax 11/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
test dvaluation de son rapport au travail,
test dvaluation du rapport largent.
Test n2 : Test dvaluation du leadership
test de la sociabilit et communication,
test du leadership
test de limage, du pouvoir et leadership.
Test n3 : Test dvaluation de potentialit en planification et en organisation
test de fixation des objectifs,
test de planification et programmation,
test dorganisation du travail personnel.
Test n 4 : Test dvaluation des comptences en gestion
test en marketing : produit, qualit, prix, vente et promotion,
test en comptabilit, administration, finance
test en organisation et gestion des Ressources Humaines
test de contrle de gestion,
test de la Gestion de production.
Dtermination du score total du profil entrepreneurial partir des scores obtenus par les
diffrents tests.
Lanalyse sans complaisance et minutieuse du profil entrepreneurial labor par tout
crateur pourra lorienter vers une minimisation de ses points faibles et vers une manire
de profiter au maximum de ses points forts. Elle permettra de samliorer et de travailler
son profil avant de se lancer.
Voici quelques exemples de sites Internet pratiques permettant de diagnostiquer le profil
entrepreneur de ltudiant :
http://www.wd.gc.ca/apps/amianent-fr.nsf/ : Suis-je entrepreneur ? ;
http://www.entrepreneurship.qc.ca/fr/entrepreneur_etudiant/Intro_Passez_Test.asp/
ISCE : Instrument de Sensibilisation sur vos Caractristiques Entrepreneuriales
de la Fondation de lEntrepreneurship du Qubec.
2 LIDEE/OPPORTUNITE : LA RACINE DU PROJET
Lobjectif de ce guide est de permettre aux diplms et jeunes tudiant(e)s tunisien(ne)s de
connatre les diffrentes dmarches ncessaires la cration dentreprise.
Il permettra galement, une prise de conscience, chez ceux et celles qui dsirent crer leurs
propres affaires et les incitations quoffre lenvironnement tunisien pour les jeunes
promoteurs.
2.1 LIDEE OU LOPPORTUNITE (OCCASION DAFFAIRES) : RECHERCHE,
GENERATION
Lidentification dune bonne opportunit, lexploiter et en tirer profit, reprsentent tout
lart dentreprendre. Certaines activits professionnelles sont propices la cration de
nouvelles entreprises : la recherche et dveloppement (en ce qui concerne les ides
innovantes) et le marketing (pour ce qui est des projets qui cherchent combler des
besoins insatisfaits ou mal satisfaits sur le march).
Quelle soit Innovante ou classique, il faut que lide ait un march pour quon puisse la
qualifier de vraie opportunit. Elle doit rpondre donc un besoin du march : elle a pour
fondement la cration de valeur pour le consommateur, cest dire un vrai "plus" pour ce
CUIES Universit de Sfax 12/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
dernier au niveau de lun ou plusieurs des aspects suivants : produit/service, qualit, dlais,
prix
Les techniques de crativit individuelles et collectives : analyse combinatoire,
consultation de catalogues et de fournisseurs ; Brainstorming,
2.2 LES SOURCES DIDEES
Les sources dides sont multiples :
Les raisons dinsatisfaction des consommateurs,
Les produits et les services offerts par les socits existantes,
Les intervenants dans les diffrents rseaux de distribution (grossistes, dtaillants,
agents indpendants et reprsentants) etc.
Lvolution de la technologie constitue galement une source dides pour les
projets innovateurs dominante technologique.
La consultation dorganismes publics dincitation aux investissements tels que :
lAgence de Promotion de lIndustrie (API),
lAgence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA),
le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX),
lInstitut National de Normalisation et de la Proprit Industrielle (INNORPI),
les Centres dAffaires
La consultation du code dincitation aux investissements vous permettra davoir
une ide sur les avantages accords par lEtat dans le cadre de divers types
dinvestissement.
2.3 LA VALIDATION DE LIDEE DE CREATION DENTREPRISE
Il sagit de sinterroger sur le degr de ralisme de(s) ide(s) gnres. Une faon de le
faire consiste, tout dabord, prciser lide. Il sagit de rpondre aux questions suivantes :
Quels services ou produits produire et commercialiser ?
Pour quels profils de clients ?
Pour desservir quels besoins ?
Quels plus vous apporterez par rapport vos clients ?
Nous proposons un guide excellent de lAgence franaise Pour la Cration dEntreprise
(APCE) : Valider son ide de cration dentreprises , qui est disponible en ligne
ladresse suivante : http://www.apce.com/upload/fichiers/etapes/Valider_son_idee2.rtf.
Ce guide permet de donner une dmarche permettant de mobiliser quelques investigations
concernant le degr de validit et de ralisme de lide de cration dentreprise.
Voir aussi le site de lAPCE : Rubrique : Toutes les tapes de cration, thmatique de
lide http://www.apce.com.
Ci-dessous le guide ainsi que ses 8 tapes :
Vous avez une ide de cration dentreprise ?
Avant dengager du temps et de largent dans le montage de votre projet, vous devez
commencer par vrifier la pertinence de votre ide. Cela suppose de prendre le temps de
mener quelques investigations. En vous appuyant sur les lments tangibles recueillis et
sur de fortes probabilits, vous serez ainsi en mesure :
de dterminer les risques et les conditions de russite de votre projet,
le cas chant, de corriger votre ide de dpart,
CUIES Universit de Sfax 13/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
de conclure ou non que votre ide est raliste et que vous tes bien lhomme de la
situation .
Ne ngligez pas cette rflexion. En effet, lenjeu personnel que reprsente une cration
dentreprise, mrite dy consacrer de nombreuses heures. Pour vous aider dans cette
dmarche, lAPCE vous propose une mthode par tapes. Nhsitez surtout pas revenir
sur chacune dentre elles afin denrichir progressivement votre rflexion.
Dterminez les composantes de votre ide
Dlimitez le march vis a priori
Dcrivez votre activit de faon trs prcise
Collectez les informations essentielles
Sollicitez avis et conseils
Analysez les contraintes de votre projet
Dfinissez votre projet personnel de crateur
Vrifiez enfin le ralisme de votre ide
2.3.1 Dterminez les composantes de votre ide (votre offre : produit/service)
Cette tape, qui peut vous paratre vidente, est en fait capitale. Toute la prparation de
votre projet en dcoule. Par exemple dire je voudrais ouvrir une boutique de vtements
nest pas suffisant. Cette ide peut en effet senvisager sous diffrentes formes et pour
diffrents types de publics, engendrant des contraintes spcifiques chaque cas et
ncessitant des moyens en partie diffrents.
Ds lors que le projet consiste raliser des prestations de services ou prsente une
certaine originalit (par exemple : offre nouvelle, transposition dun produit ou dun
service sur un autre march ou un autre canal de distribution, etc.) cet exercice peut
devenir dlicat. Vous aurez, trs certainement, revenir plusieurs fois sur cette dfinition.
Les diffrents aspects de lide indiqus ci-dessous doivent vous aider dtecter les
facteurs cls de votre projet.
Posez-vous les questions suivantes :
Quels services ou biens, trs prcisment, souhaiteriez-vous produire ou fabriquer ?
(sil y a lieu)
Par exemple, concevoir des modles de vtements, ou bien crer des collections et vendre
des vtements dont vous ferez totalement sous-traiter la fabrication
Limportance des moyens mettre en uvre et les risques encourus sont trs diffrents
entre le premier cas activit de styliste et le second, qui implique une logistique, la
mise en place dune force de vente et peut-tre la cration dune griffe.
CUIES Universit de Sfax 14/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Quel produit ou quel service serait rellement vendu ?
Par exemple, ce ne sera peut-tre pas le bien que vous fabriquerez, mais simplement son
droit dusage, ou encore son droit de reproduction
A quel besoin rpond prcisment le bien ou la prestation ? Quelle est son utilit ?
Cest un point capital : il peut y avoir un cart important entre ce que lon croit que les
autres ont besoin et ce quils ressentent ou attendent vraiment. Est-ce un besoin dj
largement exprim ou constat ou seulement latent ?
Dans un projet proposant un ensemble de prestations, il y a souvent un problme de
lisibilit pour les acheteurs potentiels.
Quel serait le mode dutilisation du bien ou du service ?
Pour prciser ce point, essayez de vous mettre mentalement la place de lacheteur
potentiel. (Rien ninterdit de demander cet exercice galement des parents ou des amis).
Comment serait-il vendu ?
En boutique : llment majeur sera lemplacement.
Grce une force de ventes : il faut avoir lesprit que recruter un ou des
commerciaux prsente des risques importants, en termes de temps et dargent sils
ne font pas laffaire. Par ailleurs, il nest pas facile danimer une force de ventes.
Grce des prescripteurs : un savoir-faire particulier est souvent ncessaire pour
cultiver des relations avec les prescripteurs. Un commissionnement doit peut-tre
tre envisag.
Par correspondance : cela induit le cot de ralisation dun catalogue et une
logistique de marketing direct
Sil y a lieu, quel est le caractre novateur de votre produit/service ?
En gnral, une amlioration est plus facilement adopte par le march quune innovation
radicale, susceptible de changer les habitudes.
Une innovation de rupture devant sintgrer dans dautres quipements, dans une chane de
production, rend son adoption encore plus difficile.
Quels sont les points forts de votre produit/service :
Performances attendues, avantage concurrentiel
Par exemple : la dmonstration probante dun prototype ; la dtention dun droit
dexploitation exclusif ou dune technologie protge ; une rputation acquise par ailleurs
et favorable lactivit envisage ; une notorit dans le milieu vis ; etc.
Quels sont ses points faibles :
Elments de vulnrabilit actuels ou prvisibles.
Par exemple : un vide juridique qui pourrait prochainement tre combl dfavorablement ;
un procd nouveau susceptible dtre copi trs facilement sans pouvoir prtendre une
protection juridique ; ne pas tre du "srail " alors que votre futur march est une chasse
garde ou un milieu trs ferm ; un concept est souvent imitable ; etc.
Composantes de votre ide
..
..
CUIES Universit de Sfax 15/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
..
..
..
2.3.2 Dlimitez le march vis a priori
A ce stade, il ne sagit pas davoir des certitudes - ltude de march, que vous effectuerez
plus tard, confirmera ou infirmera vos intuitions - mais de prciser, en fonction dlments
plus ou moins tangibles, quelles cibles de clientles vous viseriez de prime abord.
Quelle est la nature du march vis ? Un march peut tre :
Local : ce sera le cas si vous ouvrez un point de vente de proximit.
Rgional : ce sera le cas, par exemple, si vous faites de la vente par prospection
aux entreprises.
National, voire international, (un march trs vaste ncessite des moyens souvent
difficiles runir).
Diffus : ce sera le cas si votre clientle vient de partout (ex. : spectacles, tourisme,
thermalisme).
Permanent ou saisonnier (un march saisonnier prsente souvent des risques de
vulnrabilit, ou pose des problmes spcifiques de Besoin en Fonds de
Roulement,).
Lactivit peut tre sdentaire ou ambulante (vendre sur des marchs forains
ncessitera de sinquiter de la qualit de chaque emplacement).
etc.
Quelle clientle pensez-vous pouvoir toucher ?
Par exemple : Les particuliers en activit ? Les retraits ? Les entreprises artisanales ? Les
petites ou moyennes entreprises ? Les grands groupes ? Les cabinets libraux ? Les
administrateurs de biens, les organismes divers, etc.
Sagit-il, au sens marketing du terme, dune "clientle identifiable" (par fichiers, par
annuaires, par base de donnes), dune "clientle diffuse" (venant de toutes parts), dune
"clientle de proximit" (trs localises), de la grande distribution (march grand public) ?
Quelle cible pressentez-vous ?
A ce stade, en fonction de quelques lments objectifs et intuitifs, donnez une premire
description sommaire de ce que pourrait tre votre clientle principale.
Par exemple : Les couples salaris, de la classe moyenne, possdant leur rsidence
principale, avec enfants en ge scolaire . Noubliez pas que votre future clientle doit
tre :
Accessible : selon la cible que vous visez, vous devrez parfois tre dj introduit
dans le milieu ou "avoir la tte de lemploi" ou avoir des rfrences
Solvable : des prospects* sans le pouvoir dachat ncessaire pour votre offre ne sont
pas de futurs clients et un gros impay est souvent fatal une jeune entreprise !
(*sans compter quil faudra vrifier ultrieurement quils sont disposs "y mettre le
prix" que vous souhaitez).
Votre march priori
..
..
CUIES Universit de Sfax 16/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
..
..
..
2.3.3 Dcrivez votre activit de faon trs prcise
Au vu de tous les lments dtermins, grce aux questions poses ci-dessus, vous devez
pouvoir, prsent, crire de faon rigoureuse, prcise et complte, en peu de phrases, ce
que pourrait tre lactivit de votre future entreprise en tenant compte de toutes les
dimensions qui touchent aux principes de production et de vente.
Cet exercice vous fera gagner du temps pour rdiger, plus tard, le rsum de votre plan
daffaires (business plan) si vous dcidez de lancer votre projet.
Votre activit
..
..
..
..
..
2.3.4 Collectez les informations essentielles
Vous avez prcdemment mis en vidence quelques points cls qui demandent tre
approfondis. Vous allez devoir dsormais rechercher des informations essentielles sur ces
points. Il ne sagit naturellement pas, ce stade, de raliser une vritable tude de march,
mais dexploiter quelques renseignements qui vous permettront de vrifier rapidement la
pertinence de vos premires rflexions.
Recherchez, en fonction de lactivit projete :
Les spcifications techniques ou juridiques,
Les donnes sur vos clients potentiels, disponibles la chambre de commerce et
dindustrie ou la chambre de mtiers,
Les statistiques sur un volume de consommation spcifique, sur un taux
dquipementou autres informations pertinentes disponibles auprs dun syndicat
professionnel, de lINS, dune mairie, dun ministre, etc.
Les informations essentielles
..
..
..
..
..
2.3.5 Sollicitez avis et conseils
En complment de la collecte dinformations vise ci-dessus, il est important que, ds
maintenant, vous parliez de votre projet des professionnels de la cration dentreprise.
CUIES Universit de Sfax 17/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Ceux-ci sont tenus au secret professionnel, ils vous apporteront un regard extrieur, avis
et neutre, indispensable pour avancer dans vos recherches et viter des erreurs
monumentales.
Qui sont ces professionnels ?
Ce sont les conseillers que lon trouve dans les centres daffaires, les universits, les autres
rseaux daccompagnement
De plus, il ne faut pas hsiter approcher, avec prudence, certaines personnes qui, de par
leur comptence professionnelle et leur exprience, sont en mesure de vous fournir des
informations pertinentes par rapport au projet : responsable dun syndicat professionnel ;
fournisseurs ou sous-traitants, revendeurs ou concurrents potentiels, etc.
Par exemple, si vous voulez devenir commerant ambulant, il pourra sagir du placier
dune mairie.
Prparez les questions avant de les rencontrer. Cest galement le moment, si votre ide est
innovante, dans son produit, service, de prendre des prcautions dusage, qui vous
permettront, le cas chant, de prouver que vous tiez bien lorigine de cette ide.
Les experts rencontrer
..
..
..
..
..
2.3.6 Analysez les contraintes de votre projet
Vous avez dcrit de manire prcise votre activit ? Vous savez quelle clientle vous
rechercheriez en priorit ? Vous avez collect un certain nombre dinformations ? Vous
tes dsormais en mesure de recenser lensemble des exigences du projet et de vrifier
quelles pourront bien tre satisfaites.
Cette analyse est essentielle car les caractristiques contraignantes repres auront une
incidence sur :
Lestimation des moyens runir (comptences, quipements, partenariats,
financements).
Les risques pouvant peser sur le projet.
La faisabilit de celui-ci et sa probabilit dtre rentable.
Ce travail vous permettra de refaonner votre ide de dpart, pour vacuer ces contraintes
ou trouver une parade.
Ce qui est voqu ci-dessous nest naturellement pas exhaustif : ce ne sont que quelques
exemples destins vous inciter creuser votre propre rflexion. Chaque projet est
toujours un cas unique.
2.3.6.1 Les contraintes propres la nature du produit ou du service
De par sa nature mme, le produit ou le service que vous voulez vendre peut induire des
contraintes spcifiques. Il convient donc de les reprer, afin de les rduire ou de les
liminer.
CUIES Universit de Sfax 18/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Un produit peut tre difficile raliser, avec beaucoup dalas technologiques.
Cest le cas des innovations, pour lesquelles on constate frquemment des retards par
rapport la planification initiale, retards pouvant engendrer des difficults financires
Dans un tel cas, il faut rflchir la faon de trouver les partenaires fiables, de raliser tous
les tests et pr-sries ncessaires, dobtenir les moyens financiers indispensables pour
lancer lentreprise au bon moment, etc.
Un produit ou service peut tre difficile distribuer, car ncessitant, par exemple, la
contribution de diffrents prescripteurs et/ou intermdiaires.
Il convient alors de vrifier que leur collaboration sera vraiment possible, en obtenant leur
accord de principe.
Un produit ou service peut tre difficile comprendre spontanment par lacheteur
potentiel.
Ce serait le cas, par exemple, dun nouveau produit dassurance-maintenance-intervention
domicile pour les particuliers, avec diffrents types de franchises, de garanties et de
prestataires. Pour un tel produit, il faut prendre en compte limportance et la multiplicit
des besoins en marketing, en prospection et en communication.
Exemples de contraintes lies aux caractristiques du produit ou service
Caractristiques du produit ou
Exemples de contraintes particulires
service
Complexe - temps de mise au point de lindustrialisation
- normes respecter
- niveau de fiabilit atteindre
- dpendance de partenariats technologiques externes, besoin
ultrieur de R et D, etc.
- lisibilit difficile par le march, par les prescripteurs, par les
relais dopinion
Innovant - produit dpendant dautres quipements ou dautres
oprateurs
- ncessit de modifier le processus de fabrication ou les
quipements ou les habitudes chez lutilisateur
- communication adapter en consquence
Fragile - surcot de processus de fabrication
- cration spcifique dun emballage adapt
- stockage particulier
Prissable - infrastructure lourde en consquence
- pertes rgulires possibles sur stock
Dangereux - normes de fabrication
- assurances
- autorisations
Polluant - autorisations
- raction possible des riverains
Copiable -risque darrive rapide de "gros concurrents" sur le march
- ncessit doccuper le march trs vite
A faible valeur ajoute - ncessit de forts volumes
- cohrence entre charges fixes probables et marge
commerciale
CUIES Universit de Sfax 19/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Caractristiques du produit ou
Exemples de contraintes particulires
service
Trs coteux - cycle de production trs long
- niveau lev de Besoin en Fonds de Roulement
- hsitation longue chez lacheteur potentiel
A usage unique - emballage spcifique
- normes de scurit respecter (souvent le cas)
A renouvellement dachat lent - ncessit de reconstituer chaque anne sa clientle
Saisonnier - locaux de stockage
- besoin de crdit de campagne
Garantie accorder - cot dun service aprs-vente
- assurances
Sujet aux alas climatiques - rserve financire de scurit
- assurances
Susceptible dtre rapidement - disponibilit de gamme suivante
obsolte - cadence dans la recherche-dveloppement
Ncessitant un emplacement - dans un quartier spcialis
particulier - prs des donneurs dordres
- dans une rue trs commerante
Non rentable par lui-mme - alas des recettes provenant des tierces-parties
(ex : journal gratuit)
Dpendant - de partenaires incontournables : pour son installation, pour
son exploitation
- ou denveloppes budgtaires (priode plus ou moins
favorable dans lanne)
Exemples de contraintes lies la production
Un des facteurs de succs dun projet est, bien sr, davoir un bon produit, mais encore
faut-il quil soit mis sur le march au bon moment et au bon prix.
La fabrication du produit est sujette des risques quil convient de prendre en compte ds
maintenant : rats , retard, surcots, etc.
Par exemple, lexistence de variations trs brutales du prix de certains approvisionnements,
doit conduire prvoir au dmarrage la constitution dun stock de prcaution. De mme, la
qualit dun produit ou dun service peut dpendre des salaris qui seront affects la
production et dont le recrutement peut savrer difficile. Il peut donc tre utile, ce stade,
de rencontrer un responsable du bureau de lemploi pour valuer le cot et laccs une
main duvre approprie.
Caractristiques lies
Exemples de contraintes particulires
la production
Approvisionnements - cours trs fluctuant des matires premires
- risques politiques ou climatiques sur les approvisionnements
- rapport de force avec des fournisseurs en situation
doligopole
Processus de fabrication - qualification du personnel
- existence sur le march de la sous-traitance ncessaire
- dpendance vis--vis de sous-traitants
Conditionnement - emballage spcial
- emballage recycler obligatoirement
Exemples de contraintes lies limage du produit ou du service
CUIES Universit de Sfax 20/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Limage, ou la perception spontane dun produit ou dun service, chez les
consommateurs, peut induire des contraintes spcifiques.
Il est donc conseill, avant mme de raliser une tude de march, de se rapprocher de
professionnels qui peuvent apporter un regard neutre et extrieur sur le produit ou le
service.
Caractristiques lies limage
Exemple de contraintes particulires
du produit ou du service
Effet de mode - quel produit prendra la suite ?
Image ngative (mauvaise - communication longue et lourde prvoir
rputation du mtier, dficit de - "positionnement rendant crdible" trouver
confiance)
Image de luxe - politique de communication et de distribution adapte,
- dpt dune marque,
- emballage coteux,
- ncessit dun emplacement dans un beau quartier,
Impact sur lEnvironnement - hostilit de futurs voisins, dassociations de dfense de
lenvironnement ou de groupes de pression,
Lisibilit faible - ncessit dune forte communication,
Exemples de contraintes lies la distribution du produit :
L encore, sans prsumer du choix final, il convient de prendre en compte les spcificits
lies lcoulement du produit sur le march, ou les barrires quil pourrait tre ncessaire
de franchir pour cela. Exemples :
Sera-t-il ncessaire de crer une marque ?
Faudra-t-il utiliser un rseau slectif ?
Faudra-t-il mettre en place un service aprs-vente ?
Avez-vous valu le temps et les moyens ncessaires pour approcher la grande
distribution, sil y a lieu ?
Votre produit ou prestation ncessitera-t-il de mettre en place des moyens de
publicit particuliers ?
Les contraintes propres votre produit ou votre prestation
..
..
..
..
..
2.3.6.2 Les contraintes lies au march
Le march que vous visez a priori peut prsenter des particularits, quil convient de
discerner ds maintenant de manire prvoir les moyens appropris. Exemples :
Etat du march :
le march est-il : crer ?
en dmarrage ?
en fort dveloppement ?
mature ?
en dclin ? etc.
CUIES Universit de Sfax 21/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Supposons quil soit crer : vous devrez prendre en compte les problmes de lenteur de
raction du march et dinvestissements en termes de communication ou de prospection.
De mme il faut savoir que vous essuierez peut-tre les pltres pour dautres, qui
attendront que vous ayez prouv lexistence du filon pour arriver avec des capitaux
importants ; vous devrez alors avoir prvu les moyens mettre en uvre pour devenir la
rfrence .
Barrires lentre : Selon les cas, lentre sur le march ncessitera :
une capacit de production importante (ex : pour traiter avec les grandes surfaces),
des autorisations, diplmes, agrments (ex : pour les activits trs rglementes),
des introductions (ex : pour atteindre les bons interlocuteurs dans les grandes
entreprises),
du temps et de largent (ex. pour se faire rfrencer dans certains circuits de
distribution),
la rduction de la marge commerciale (ex : en cas de march trs concurrentiel),
une tude approfondie de rentabilit (ex : en cas de march troit), etc.
Autres caractristiques :
Votre march est-il :
Atomis ? (Problme de cots pour atteindre ces clients : risque de charges fixes
trop leves par commandes unitaires trop faibles ?)
trop large ? (Ncessit dune stratgie pour limiter ses cibles)
peu solvable ou trs risqu ? (Ncessit dune assurance-crdit, risque dimpay
fatal ?)
versatile ? (Besoin dune prsence commerciale forte ? dapprovisionnements
limits mais trs rapides ?)
peu ractif (dlai de dcision lent : lutilisateur nest pas lacheteur qui nest pas le
dcideur grands comptes, collectivits territoriales) ?
dlais de paiement longs (grande distribution, collectivits)
Les habitudes des consommateurs gnrent-elles des afflux ? ("heures de pointe" ; les
installations et la gestion de leffectif devront en tenir compte)
Y a-t-il un risque de raction de concurrents disposant de gros moyens ?
Risquez-vous de vous trouver en prsence dune concurrence dloyale ou occulte
(contrebande, contrefaon, travail au noir) ?
Les contraintes lies votre march
..
..
..
..
..
2.3.6.3 Les contraintes de moyens
La rflexion que vous avez mene jusqu prsent vous a sans doute conduit reconsidrer
certains points de votre projet. Vous allez devoir prsent identifier les moyens
ncessaires pour le faire aboutir.
Lanalyse des contraintes de moyens dcoule donc logiquement de lanalyse des
contraintes du produit (ou service) et de lanalyse des contraintes du march vis a priori.
CUIES Universit de Sfax 22/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Moyens humains :
Vous devrez peut-tre constituer une quipe dirigeante. Assurez-vous que chaque
associ fondateur a la mme vision du projet que vous-mme. Ny-a-t-il pas de
risques de doublons ? Serez-vous vraiment complmentaires dans les fonctions et les
responsabilits ?
Vous devrez peut-tre galement faire appel des comptences particulires. Seront-
elles faciles trouver ? Nombre dentreprises se plaignent des difficults quelles
rencontrent pour trouver des collaborateurs dans certaines spcialits. Il peut donc
tre utile de faire le point sur le march local de lemploi avec les bureaux demploi.
Devrez-vous recruter une force de vente ? Quel peut en tre le dlai et le cot ?
etc.
Moyens techniques :
Devrez-vous recourir des investissements lourds engendrant obligatoirement des
pertes de dmarrage pendant plusieurs exercices ? (les ressources financires seront
trouver en consquence).
Les quipements ncessaires votre activit sont-ils actuellement disponibles et
fiables ?
En cas de besoin de machines spciales, pourrez-vous trouver le constructeur sr ?
Serez-vous contraint dengager des partenariats technologiques ou commerciaux ou
de faire appel la sous-traitance ? Cela risque-t-il dinduire un rapport de force avec
ces partenaires ou sous-traitants ?
Quelle logistique spcifique devrez-vous mettre en place ?
Devez-vous anticiper sur des normes venir ?
etc.
Moyens financiers :
Evaluez, de manire approximative :
le cot de vos investissements de dpart (sans oublier le cot des "dpts et
cautionnements" fournir)
votre Besoin en Fonds de Roulement : en utilisant, ce stade, le BFR moyen de la
profession fourni par des organismes professionnels, les Centres de Gestion Agrs,
les documentations dites sur le secteur concern, ou par un calcul raliste mais
sommaire,
les pertes certaines pour les premiers exercices, si cela devrait tre le cas.
Votre capacit financire sera-t-elle suffisante ? Devrez-vous recourir des
emprunts ? Votre capacit demprunt est-elle en rapport avec les besoins de votre
projet ? Le potentiel de votre projet peut-il intresser des apporteurs de capitaux ?
Etes-vous conscient quil vous faudra peut-tre accepter larrive de tiers dans le
capital de votre entreprise ?
Les contraintes de moyens
..
..
..
..
..
CUIES Universit de Sfax 23/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
2.3.6.4 Les contraintes de rglementations
De leur existence peuvent dpendre la faisabilit et la viabilit de votre projet.
Disposez-vous de lexprience professionnelle ou du diplme requis pour lexercice de
votre activit ?
Pourrez-vous obtenir les autorisations exiges (licence, certification, agrment,) ?
Avez-vous vrifi que votre activit nest pas en cours de rglementation. Une nouvelle
rglementation peut sensiblement lever le cot initial dun projet et de facto son point
mort.
Si vous tes salari (ou si vous ltiez il y a peu), votre contrat de travail contient-il une
clause restrictive pour exercer lactivit projete ?
Votre projet est-il soumis une contrainte de garantie induisant un besoin financier ?
(obligation de fournir une caution financire professionnelle).
Les contraintes de rglementation
..
..
..
..
..
2.3.7 Dfinissez votre projet personnel de crateur
Pour mettre toutes les chances de votre ct, il est important de vrifier la cohrence entre
les contraintes propres au projet, que vous venez didentifier et qui doivent savrer
matrisables, et :
votre personnalit,
votre potentiel,
vos motivations,
vos objectifs,
vos comptences et savoir-faire,
et vos contraintes personnelles.
Votre personnalit :
Listez les qualits qui vous paraissent essentielles la ralisation de votre projet. Quelques
traits dominants de votre personnalit auront une grande importance pour le succs du
projet.
Exemples : Pour conduire des chantiers avec des marges faibles et des plannings trs
serrs, lautorit naturelle et le sens de lorganisation sont plus que ncessaires ; pour un
projet ncessitant beaucoup de relations publiques, laisance, lentregent savrent
indispensables ; pour motiver une quipe de haut niveau, outre la comptence, le charisme
est essentiel.
Votre potentiel :
Une bonne condition physique et psychique, une capacit absorber le stress, savoir
ngocier, tre dbrouillard, cratif et ractif, cultiver des rseaux relationnels sont
autant de facteurs dterminants pour la russite dun projet.
CUIES Universit de Sfax 24/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Exemple : Le punch commercial ncessaire nest pas le mme pour vendre des
photocopieurs ou pour ouvrir une boutique de modlisme !
Vos motivations :
On ne cre pas une entreprise sans raison forte. Les motivations ne sont pas toujours toutes
clairement exprimes et certaines peuvent entraner des dconvenues.
Vous souhaitez crer :
par dsir dindpendance ? Assurez-vous que cette motivation ne vous conduira pas
certaines erreurs, comme, par exemple, vous isoler, refuser laide et le conseil de
professionnels.
par got des responsabilits ? Mais serez-vous capable de prendre seul des dcisions
stratgiques ?
pour concrtiser un rve, une passion ?
pour vous raliser, changer de vie ? Etes-vous prt accepter un changement brutal :
changement denvironnement, changement de rythme
pour exploiter une opportunit ? Si celle-ci vous tombe dessus, tes- vous rellement
fait pour la cration dentreprise si vous naviez jamais voqu cette perspective
auparavant ?
pour accder un meilleur statut social ? Avez-vous cependant conscience des
nouvelles obligations que vous devrez assumer en contrepartie ?
pour disposer dun revenu immdiat ? Attention aux dcalages pouvant exister entre
le dmarrage de lactivit et les premires rentres dargent.
pour gagner beaucoup dargent ?
pour revenir ou rester au pays ? Vrifiez que votre march, sil est localis, est
suffisant.
pour travailler avec votre conjoint ? Rflchissez bien outre les problmes
relationnels susceptibles de se poser, une seule source de revenu peut tre dangereuse
pour le couple).
etc.
Vos objectifs :
Il est important que vous ayez une vision claire de lentreprise que vous souhaitez avoir
moyen terme. Cela, afin de vrifier que les moyens dont vous disposez aujourdhui sont
compatibles avec les exigences de dveloppement de lentreprise, mais aussi pour vous
assurer que le potentiel de votre projet puisse rellement rpondre vos attentes afin
dviter une frustration ultrieure, la longue insupportable.
Si vous tes plusieurs porteurs de projet, il est galement primordial que vous partagiez la
mme vision terme de lentreprise et de votre place dans cette entreprise. Serez-vous
prts aux mmes sacrifices pour y arriver ? (exemples : absence temporaire de salaires ou
de congs, semaines de travail trs charges, ).
Par exemple, vos objectifs peuvent tre de :
travailler en solo pour ne pas avoir de problmes de personnel,
tre la tte dune entreprise de plusieurs dizaines de salaris au bout de quelques
annes,
vous constituer un revenu dappoint,
revendre rapidement votre entreprise en ralisant une forte plus-value,
etc.
Vos comptences et votre savoir-faire :
CUIES Universit de Sfax 25/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Faites le point en toute objectivit sur ladquation de vos comptences et expriences
professionnelles ou extra-professionnelles avec les besoins du projet.
Avez-vous le savoir-faire requis, et/ou les diplmes ncessaires ?
Avez-vous besoin dune formation complmentaire en gestion, en marketing, ou
mieux encore en cration dentreprise ?
Vos contraintes personnelles :
Cette analyse consiste prendre un temps de rflexion sur soi , en tant que porteur de
projet, dans le but de prendre conscience des facteurs dchec que lon pourrait porter.
Aurez-vous la disponibilit et le temps ncessaires pour prparer correctement votre
projet ?
Une bonne prparation prend, le plus frquemment, entre six mois et deux ans et il
est prfrable de vous y consacrer pleinement.
Quelles sont vos contraintes financires actuelles : charges de famille, pension
alimentaire verser, prts personnels en cours, etc. ?
Avez-vous par ailleurs des revenus rguliers vous permettant de vivre avant
lencaissement des premires ventes ? (Salaire du conjoint, perception de loyers,
etc.). Si ce nest pas le cas, votre projet permet-il des rentres de fonds rapides ou
avez-vous pris la prcaution de vous constituer une pargne ?
Votre capacit demprunt est-elle suffisante au regard de la taille de votre projet ?
Votre famille adhre-t-elle rellement votre projet ?
La cration de votre entreprise va vous mobiliser de manire importante et risque, dans un
premier temps de faire baisser votre niveau de vie. Cela peut crer des tensions trs vives,
si le projet nest pas partag par votre entourage.
Votre projet personnel
..
..
..
..
..
2.3.8 Vrifiez enfin le ralisme de votre ide
Reprenez, dans le tableau ci-dessous, les caractristiques majeures de votre ide de
cration. Ce travail de synthse vous permettra de vrifier si votre projet est raliste.
Exemples :
- Au vu de ce que vous avez constat sur le terrain, votre produit / prestation
semble rpondre un vrai besoin.
- Votre clientle devrait tre suffisante, accessible, solvable.
- Vous possdez un avantage significatif, que vous pourrez mettre en avant face
Atouts aux concurrents potentiels.
- Vous matrisez votre mtier et vous avez les connaissances minimales
essentielles qui vous permettront de diriger une entreprise (techniques,
informatiques, commerciales, de gestion).
- Ou encore, vous avez runi une quipe soude et exprimente, aux comptences
complmentaires
Exemples :
Points faibles - Vous aurez probablement des difficults runir certains moyens, sauf
recalibrer votre projet en consquence.
CUIES Universit de Sfax 26/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
- Vous naurez, au dmarrage, quun seul donneur dordres et disposerez de peu
de temps pour prospecter dautres clients.
- Vous tes dpendant dun sous-traitant ou pis dun seul donneur dordres
- Vous ne matrisez pas techniquement le mtier ou ne disposez pas des diplmes
et expriences ncessaires et serez donc dpendant dun salari.
-
Exemple :
Menaces Votre activit risque dtre prochainement rglemente.
(Avez-vous trouv une parade, un produit de substitution ?)
Exemple :
Une fois install, vous aurez lopportunit de complter votre offre avec la
reprsentation exclusive pour la France des matriels dun fabricant anglais N3
Opportunits mondial.
Cela ne devrait pas entraner dinvestissements ni de frais supplmentaires.
Lopportunit ne doit pas ajouter immdiatement un risque supplmentaire au
projet, mais au contraire tre un atout porte de main pour rentabiliser mieux et
plus rapidement son entreprise.
Conclusion sur le La synthse des rponses doit permettre de conclure que le projet parat raliste.
ralisme du projet Sinon il faudra le remodeler, si cest possible, ou labandonner.
Attention : un projet peut tre raliste dans labsolu et mal adapt celui qui le porte.
Cest pourquoi, en final, vous devez confronter en toute objectivit les exigences de votre
projet avec vos propres caractristiques.
Exemples :
Exigences du projet Rponse
Votre activit suppose une gestion trs Vous tes conscient de cette difficult mais vous
serre disposez dun atout : vous savez acheter ; vous
La marge bnficiaire est faible et tout se joue avez pratiqu cela pendant longtemps en tant
sur les achats. que salari ; vous tes dj introduit dans le
milieu professionnel
Votre activit est trs prenante. Vous tes conscient de cette difficult, mais vous
Elle impose, tous les jours, une large amplitude avez une sant de fer, une volont du
dheures de prsence, ou une trs grande tonnerre . Ces dernires annes, vous
disponibilit. travailliez 60 heures par semaine pour votre
Ou bien, elle ncessite une forte ractivit pour patron
conserver des clients prestigieux. Vous navez pas dattache familiale
Cette activit, cest votre passion
Vous entreprenez dans un secteur rput Vous tes bien conscient que vous ny connaissez
difficile. rien en recouvrement de crances et que, de
Votre clientle a la rputation de payer mal. Or toute faon, vous naurez pas le temps de vous
un impay pourrait tre fatal. en occuper.
Mais votre pouse, qui a travaill pendant 12
ans dans une banque, dont 7 ans au service du
contentieux, va vous seconder plein temps
pour la gestion.
Votre clientle sera compose, en grande partie, Votre rseau relationnel vous ouvre de
de collectivits et organismes publics et nombreuses portes chez les dcideurs
parapublics. conomico-politiques.
Leur dcision dachat et les dlais de paiement Vous avez calcul de faon approximative, mais
seront longs. pessimiste votre BFR et vous tes en mesure de
lautofinancer aux deux tiers.
CUIES Universit de Sfax 27/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Les exigences majeures de votre projet Vos rponses personnelles
........................................................................ .........................................................................
........................................................................ .........................................................................
........................................................................ .........................................................................
Schma gnral de la dmarche permettant de valider une ide de cration
dentreprise
Projet personnel du crateur Projet conomique
Personnalit - Potentiel Activit envisage
Motivations - Objectifs March vis
Comptences Contraintes Risques - Menaces
Contraintes personnelles Atouts
Cohrence Homme / Projet Ralisme du projet
Conclusion finale sur
la validation de lide
CUIES Universit de Sfax 28/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
2.4 VOTRE IDEE EST-ELLE REALISTE ?
Vous pouvez tablir une liste :
De vos motivations pour crer une entreprise,
Des objectifs viss au travers de ce projet,
De vos comptences professionnelles ou extra-professionnelles. Avez-vous le savoir-
faire requis pour le projet ? Faut-il que vous suiviez une formation au pralable ?
De vos contraintes personnelles :
Pouvez-vous dgager suffisamment de temps pour ltude et la prparation du
projet, compte tenu de votre situation (salari, en cours de licenciement...) ?
Votre apport financier personnel (hors emprunt) est-il suffisant pour chercher des
financements complmentaires et convaincre vos partenaires ?
Votre entourage familial adhre-t-il au projet ?
Votre projet peut-il gnrer, en temps voulu, le revenu minimal vital qui vous est
ncessaire ?
Votre sant est-elle compatible avec les exigences de votre projet ? Pourrez-vous
faire face des priodes dintense charge de travail ?
3 LADEQUATION DU COUPLE CREATEUR/PROJET
3.1 AFFINITE ENTRE LE CREATEUR ET SON IDEE DENTREPRISE
Lide nest que lun des facteurs qui vous mneront la russite. Il doit y avoir affinit
entre ce que vous tes et votre ide pour que vous obteniez de bons rsultats. Vous devrez
aller chercher dautres ressources pour vous prparer le mieux possible - vous et votre
entreprise - russir.
Vous pouvez entamer le processus dautovaluation. Une autovaluation vous aidera
dterminer si votre ide dentreprise vous convient et tient compte de vos gots et
aversions, de vos aptitudes et comptences, de vos forces et faiblesses.
On ninsistera jamais assez sur limportance des comptences de lentrepreneur dans la
russite dune entreprise.
De nombreuses ides resteront sans suite et mourront chez lun, tandis que chez lautre
elles spanouiront et deviendront fertiles. Parmi les comptences ncessaires, citons la
comptence en gestion financire, la connaissance et la comprhension du march, la
capacit de se procurer des ressources suffisantes, et laptitude planifier et agir. Il vous
faut tre trs motiv et persvrant pour russir.
3.2 CONTRAINTES DU PROJET DE CREATION ET DU PROJET PERSONNEL DU
CREATEUR
Voir aussi le Guide de lAPCE : Valider son ide de cration dentreprise (polycopi),
disponible en ligne ladresse :
http://www.apce.com/upload/fichiers/etapes/Valider_son_idee2.rtf
3.3 ADEQUATION DU COUPLE HOMME(S)/PROJET
Avant de sintresser en dtail votre projet, vos partenaires futurs (financiers, organismes
dappui...) vont valuer le couple homme(s)-projet. Il sagit tout simplement pour eux de
trouver une rponse aux questions suivantes : Qui sont-ils ? Que recherchent-ils ? Do
CUIES Universit de Sfax 29/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
vient leur dcision dentreprendre ? Lquipe est-elle fiable et viable durablement ? O se
situe le facteur dterminant pour le succs du projet (en terme de viabilit et de prennit) ?
Le "mariage" de ces hommes avec leur projet est-il crdible ?
Vous serez jug loccasion des contacts que vous aurez avec vos interlocuteurs
partenaires (existants ou potentiels). On cherchera :
A apprcier les diffrents aspects de votre personnalit,
A vrifier la cohrence entre les enjeux du projet prsent et vos propres ambitions,
motivations, traits de personnalit et aptitudes,
A cerner le bon quilibre entre les associs : comptences et aptitudes
complmentaires, objectifs, degr commun dimplication et de motivation, cohsion
des comportements...
De mme quil ny a pas dentrepreneur ce point performant quil peut russir nimporte
quel lancement daffaire, il ny a pas de projet ce point prometteur quil puisse tre
ralis avec succs par le premier venu. Le critre suprme de succs est incontestablement
ladquation mutuelle au sein du couple entrepreneur-projet. De manire gnrale et
sommaire, cette adquation se vrifie lorsque le projet exploite bien les points forts de son
promoteur et dpend le moins possible de facteurs considrs comme ses points faibles.
CUIES Universit de Sfax 30/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Chapitre 2. Etude de faisabilit de la cration
dentreprises
La premire phase vous a permis dexplorer les diffrents paramtres rattachs la
ralisation de votre projet, cest--dire passer dune ide un projet raliste.
Cette seconde tape doit servir vrifier sa faisabilit et sa rentabilit. En effet, ltude de
faisabilit doit porter sur un certain nombre daspects permettant de passer laction, cest
dire le dmarrage de votre projet dinvestissement. Ces aspects sont rattachs
lexistence du march et de la meilleure manire de laborder (faisabilit commerciale),
la disponibilit des moyes techniques tels que le processus de production, les matires
premires, les sites de production et le personnel qualifi (faisabilit technique), la forme
juridique de la socit et aux avantages accords (faisabilit juridico-fiscale), et aux
moyens financiers, leurs sources et la rentabilit future du projet dinvestissement
(faisabilit financire).
Lexprience montre que les entrepreneurs ont tendance privilgier certains aspects (le
produit, les prvisions financires etc.) selon leur formation ou expriences initiales
(ingnieur, gestionnaire). Cela constitue un mauvais rflexe viter car le plan daffaires
doit couvrir tous les aspects techniques, commerciaux et conomiques.
Il est recommand aux futurs entrepreneurs dcrire eux-mmes leurs plans daffaires avec
la possibilit dtre assists par des spcialistes (consultants, experts comptables) et les
faire lire par des gens dexprience (organismes de soutien, banquiers, hommes
daffaires).
Un plan daffaires doit plaire sur le fond et sur la forme car cest la premire vitrine du
projet.
1 VOLET COMMERCIAL
Ltude commerciale occupe une place cl dans llaboration de votre projet. Toute la
construction de votre future entreprise va sappuyer sur les conclusions de cette tape, qui
doit vous permettre :
La connaissance et la comprhension de votre march,
La formulation de votre stratgie de lancement
La dfinition de vos actions commerciales.
1.1 ASPECTS STRATEGIQUES
Il sagit dune tape importante permettant de dcider les choix stratgiques pour la
conqute des marchs cibles. Pour cette fin, nous proposons une dmarche trois tapes.
CUIES Universit de Sfax 31/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
1.1.1 Identifier et tudier le comportement des clients cible
1.1.1.1 Analyse qualitative du march cible
Il sagit de rpondre aux questions suivantes :
Qui est le client ? Le profil du client : Dfinissez plus prcisment votre clientle :
Sa rpartition : entreprises, associations, institutions, collectivits, individus, couples,
familles...
Sagit-il dune clientle homogne ou htrogne ? Quelles sont ses
caractristiques (taille, activit, chiffre daffaires pour les entreprises ; ge,
catgorie socioprofessionnelle pour les particuliers, etc.)
Quel est son niveau de consommation ou taux dquipement ?,
Est-elle concentre, disperse, de passage, de proximit... ?
Quoi ? Le produit quil achte : Affinez les caractristiques de vos produits ou
services :
Spcialisation, niveau de qualit, avantages, gamme, prsentation, finition, conditions
demploi, prestations complmentaires, et Prcisez les avantages que vous allez leur
apporter : garantie de qualit, de technicit, de ponctualit, de souplesse, de dlais
dexcution, horaires, tendue du choix, etc.
Pourquoi il achte ? Motivations dachat : Analysez les attentes de vos clients :
gain de temps, de place, dargent, besoin de scurit, de confort, de nouveaut, etc. ?
Comment ? Processus dachat du client : Il sagit de dcrire et danalyser les
diffrentes tapes du processus dachat chez le consommateur ou chez le client
organisationnel. Ce travail vous permettra de dgager les actions marketing pour
amener le client acheter votre produit.
Quand ? Priode dachat : Il sagit didentifier les priodes ainsi que les moments
dachat du produit ou du service
O ? Lieux dachat : Il sagit des canaux de distribution et de points de vente que le
consommateur sollicite pour lachat
A combien ? Prix et budget dachat pour la catgorie du produit : Il sagit
didentifier les niveaux de prix que le client ou le consommateur est prt payer pour
lachat dune catgorie de produit ou de service. Important galement de connatre
les budgets consacrs par cet acheteur.
CUIES Universit de Sfax 32/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Etude de la clientle
Qui consomme
Combien ? Pourquoi ? O ?
quoi ?
Diffrentes Rpartition des Motivation Lieu dachat
catgories de clients (ABC dachat Moments dachat
consommateurs clients) Ordre des et de
(sexe, ge, CSP, Parts de march prfrences consommation
etc.) Produits Attributs et Circonstances
Diffrentes Conditionnement critres de choix dachat
catgories de Marques des marques
produits
consomms
Caractristiques
techniques
Conditionnement
Marques
Remarque importante : ce travail doit se faire pour lensemble des segments de marchs
(catgories de clients actuels et potentiels).
1.1.1.2 Analyse quantitative du march cible
A combien pouvez-vous estimer votre chiffre daffaires prvisionnel ?
En recoupant les diffrents lments dinformations recueillis, vous devez pouvoir
maintenant valuer le nombre de clients potentiels sur votre zone dintervention et mesurer
leur volume de consommation possible afin de btir, en le justifiant, votre chiffre daffaires
prvisionnel
Dterminer le nombre de client par segment
Dterminer la quantit dachat de la catgorie de produit par type de client
Dterminer des hypothses de prix par produit et client
Afin de prvoir le chiffre daffaires, il convient dlaborer trois scnarios. Un premier
scnario optimiste, un deuxime moyen et un troisime pessimiste
1.1.1.3 Analyse dynamique du march cible
Il sagit de savoir dans quelle phase le secteur vis se trouve (mergence, croissance,
maturit ou dclin) et quels sont les facteurs qui agissent sur son avenir. Lavenir dun
secteur est important pour le nouveau promoteur.
CUIES Universit de Sfax 33/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
1.1.2 Etude du comportement de la concurrence
Ltude de la concurrence vous permettra positionner vos produits et services par rapport
ce qui est offert sur le march. Ltude de la concurrence doit porter sur les stratgies et
actions marketing de la concurrence dans une situation concurrentielle donne.
Lanalyse directe de la concurrence revient :
Analyser la situation concurrentielle (duopole, oligopole, concurrence )
Analyser le comportement actuel des concurrents ainsi que leurs forces et faiblesses
au niveau des produits et services offerts, de la communication et vente, de la
distribution et des prix.
Tableau : Profil et politique commerciale de la concurrence
CUIES Universit de Sfax 34/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
tude de la concurrence
Situation de la Facteurs sur lesquels Avantages comptitifs
concurrence sur le sopre la concurrence
march
Prix, la qualit ; Avantages comptitifs des
Marque, image de marque, concurrents entre eux
Nombre de concurrents sur communication ; Faiblesses de lentreprise
le march ; Distribution, service par rapport aux
Existe-t-il des concurrents Alliances, jeux dinfluences, concurrents ;
dominants, monopoles, ou pouvoir Atouts de lentreprise par
quasi ?
Existe-t-il des produits Protection juridique, rapport aux concurrents ;
dominants ? brevets ; Avantages comptitifs :
Concurrence dans la zone Barrires institutionnelles, prix, qualit,
dinfluence ; clients dominants, barrires diffrenciation ;
Rythme dapparition et de diverses distribution, services, et
disparition des concurrents prestations.
sur le march Protections (innovation,
Le march est-il protg ? brevets), innovation de
Parts de march marketing
1.1.3 Dfinition dune stratgie de dveloppement
Il sagit de dmontrer les facteurs cls de succs du projet (technologie, capacits
commerciales, matrise des cots etc.) et de prsenter les sources de diffrenciation par
rapport aux concurrents. Gnralement, deux sources sont la base de lavantage
concurrentiel dun produit : les cots et la diffrenciation.
Pour un nouveau promoteur dpourvu de moyens, il est recommand dopter pour une
stratgie de diffrenciation au niveau du produit, de la qualit du service aprs vente etc.
et ce afin dviter la concurrence frontale avec des entreprises disposant de plus de moyens
et capables de rsister aux nouveaux venus en rduisant les prix.
La stratgie va permettre lentreprise naissante de choisir un positionnement sur le
march et de sen tenir. Les principales stratgies de dveloppement sont :
Stratgie de domination par les cots : appliqu lorsque les produits sont
homognes et la diffrenciation ne peut se faire que sur la base du prix propos.
Lapplication de cette stratgie passe par une matrise des cots (le prix de revient
des produits et services) pour pouvoir fixer un prix plus intressant que celui offert
par les concurrents.
Stratgie de diffrenciation : appliqu lorsquil est possible de diffrencier ses
produits ou ses services par rapport la concurrence. Elle se traduit par lapplication
dun prix suprieur celui propos par la concurrence et accept par les clients.
Stratgie de concentration : appliqu lorsquon propose un produit novateur et on
sadresse une cible particulire de clients.
CUIES Universit de Sfax 35/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Schma 3 : Stratgies gnriques de Michael Porter
1.2 ASPECTS OPERATIONNELS
Il sagit de prendre des dcisions oprationnelles portant sur :
Les produits et les services vendre
Les actions de communication et de vente
Les rseaux de distribution et points de vente
Les prix appliquer
REMARQUE : Les dcisions doivent tre prises par produit/March et doivent tre
cohrentes avec les choix stratgiques.
1.2.1 Dcisions produit/service
Caractristiques des produits et services (voir Etude de faisabilit technique)
Caractristiques intrinsques lies la composition (matires )
Caractristiques extrinsques (forme, couleur )
Gamme des produits et services
Il sagit de dcider le nombre de lignes par produit/service (largeur) et du nombre de
modles par ligne (profondeur). Une ligne de tlviseurs peut comporter une multitude de
modles (ligne profonde). La diversification des produits et modles limite le risque
commercial.
Schma 4 : Famille de produits et niveau de gamme
CUIES Universit de Sfax 36/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Schma 5 : Cycle de vie du produit
Chiffre
daffaires Chiffre daffaires
Profit
0 Temps
Lancement Croissanc Maturit Dclin
Etude du produit
Test de Test Test des Test de Test du
conception dacceptabilit prix lemballage nom
- Mise au point - Acceptabilit - Prix minimum - Aspect - Image et ide
Technique aprs - Prix fonctionnel voque
- Type de utilisation maximum - Aspect - Mmorisation
clientle - Aspect esthtique
favorable fonctionnel
Fourchette de
- Avantages et du produit
prix
inconvnients
- Intention
dachat
1.2.2 Dcisions relatives la communication
Il sagit de prendre un certain nombre de dcisions portant notamment sur le :
Choix des types dactions : Actions de publicit, Actions de relations publiques,
Actions de promotion, Actions de Marketing direct
Choix des mdias et supports : Tv, Radio, Presse crite, Affichage, dpliants, Internet
Fixation du budget de communication
Les actions relatives la communication (par les mdias ou autres) se concrtisent par le
biais de 6 lments principaux :
La publicit
La promotion
Les relations publiques (confrences de presse, parrainage, dons, concours)
Les commandites (sponsoring), parrainage
Le marketing direct sous toutes ses formes (tlmarketing, mailing, mailing fax)
La vente (forme de communication directe)
1.2.3 Dcisions relatives la force de vente
Celles-ci sont relatives :
CUIES Universit de Sfax 37/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Organisation de la force de vente (le personnel, leurs responsabilits, tches)
Fixation des territoires de vente (exp. Nord, centre, sud)
Fixation du nombre de vendeurs par territoire de vente
Fixation des quotas (objectifs de vente en DT et en volume par produit et par
territoire)
Fixation des moyens de vente (budget de vente, moyens matriels)
Dans lhypothse o le nouvel entrepreneur doit recruter des vendeurs, il devra rechercher
certaines caractristiques auprs deux traduisant un tat desprit ncessaire lacte de
vente.
Motivation : le vendeur veut russir et que son entreprise russisse.
Empathie : il sintresse autrui, essaie de le comprendre, de percevoir ses attentes,
ses proccupations, ses dsirs. Il est centr sur le client.
Communication : un plaisir ne lui est plaisir que partag.
Adaptabilit : il est apprci dans tous les milieux parce quil apprcie tous les
milieux.
Mthode et lorganisation : il passera moins de temps en voiture et plus de temps
chez le client.
Energie et la persvrance : il devra tirer les leons de ses checs pour les
transformer en facteurs de russite.
1.2.4 Dcisions relatives la distribution : Choix des circuits et canaux et de la
stratgie de distribution
Il sagit de choisir entre un circuit long, moyen ou court ? La longueur du circuit est
dtermine par le nombre de niveaux dintermdiaires qui sinterposent entre le producteur
et le client final. Ceci dpend de la nature du produit de la clientle vise et de la stratgie
de distribution adopter. Il faut galement dcider le niveau de coopration avec les
intermdiaires (Modalits de distribution physique, Modalits et Mode de paiement,
Quantits dachat, Service, Promotions, rabais, )
Schma 6 : Types de canaux de distribution
Canal de distribution direct Canal de distribution indirect
Producteur Producteur
Grossiste
Dtaillant
Consommateur Consommateur
CUIES Universit de Sfax 38/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
tude de la distribution
Qui vendre quoi ? A qui ? Combien ? Pourquoi ?
- Catgorie de - Description des - Rotation du stock - Motivations de
commerce profils des clients du - Parts des diffrentes revendeur ;
- Zone de chalandise point de vente marques - Taux de marque
- Assortiment - Chiffre daffaires par - Ristournes, Remises
- Importance du point produit (ABC - Conditions de vente
de vente produits) - Assistance technique
- Degr de standing - Aide la vente
- SAV - Aide publicitaire
- Mode - Rgularit et
dapprovisionnement disponibilit
- Diversit des
produits
1.2.5 Dcisions relatives au prix
Il sagit de fixer les prix par produit /service, par type de client et par type de distributeur.
On distingue diffrents types de prix, savoir :
Le prix de pntration : prix bas (gagner plus de clients) ;
Le prix dcrmage : prix lev qui justifie la qualit suprieure ;
Le prix dalignement sur la concurrence : prix du march.
Schma 7 : Niveaux de fixation de prix (fourchette : prix min et max)
La fixation des prix est fonde sur la pratique :
du cot : Prix = somme du cot et de la marge bnficiaire Prix plancher long
terme / court terme
du profit : Analyse du seuil de rentabilit (aspect financier) ou analyse du point mort
(aspect de la production)
de la demande (principe de lutilit) :
Opinion du consommateur propos du produit ?
Rputation de loffreur, du producteur ou du vendeur ?
Prix que lacheteur est prt payer ?
Marges bnficiaires quexige le commerce de gros et de dtail ?
Marge de manuvre en matire de politique de prix ?
Prix rond (2D.000) ou non (1D.950) ?
CUIES Universit de Sfax 39/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Nouveau prix suprieur, infrieur ou dans la fourchette des anciens ?
de la concurrence (branche) : leadership des prix entente sur les prix
1.3 AUTRES ASPECTS : ETUDE ET RECHERCHE MARKETING
1.3.1 Ltude de march : objectifs et tapes
Ltude du march doit vous permettre de vous assurer vous-mme et de montrer aux
partenaires lexistence de dbouchs pour votre produit/service.
Pour russir une cration dentreprise, il faut adopter une attitude de marketing moderne
tourne vers le client et le march. Les objectifs des tudes de marchs pour la cration
dentreprise sont multiples et permettent dapporter des rponses aux questions poses
(qui ? quoi ? comment ? o ? combien ? pourquoi ? ) ; de fixer des objectifs
commerciaux et dimpliquer des orientations pour la prise de dcision, politiques et actions
(march, produit, prix, distribution et communication).
Schma 8 : Etapes de ralisation dune tude de march
Identification du problme ou de lopportunit
Dtermination des objectifs
Plan de la recherche :
Recherche documentaire
Hypothse de travail
Inventaire des moyens
Budget de recherche
Ralisation de la recherche :
Choix de la mthode denqute
Prparation de lenqute
Ralisation matrielle
Traitement des donnes
Analyse des rsultats
Prparation et prsentation des rsultats
Synthse et recommandations
CUIES Universit de Sfax 40/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
1.3.2 Les sources dinformations : primaires et secondaires
Schma 9 : Mthodes dtude de march
Les sources dinformations secondaires sont relatives aux :
Statistiques officielles et tudes sectorielles
Publications et renseignements fournis par : des organismes publics ou
dconomie ; des associations professionnelles, de consommateurs et des
syndicats ; des instituts dtudes de march ; des banques ; des organismes
dappui (API, APIA, CEPEX, CCI, Centres daffaires)
Presse spcialise et Presse quotidienne,
Rapports de travaux scientifiques, thses,
Tarifs et matriel publicitaire de la concurrence,Foires et expositions, catalogues
dexpositions, renseignements fournis par les organisateurs, documentation
fournie par les exposants, etc.
Les mthodes ou techniques de collectes de donnes sont diverses : observation ;
exprimentation ; entretiens individuels ; runions de groupe (focus group) ; analyse
des traces comportementales (ticket de caisse, cartes de fidlit, de crdit,
Internet...) ; enqutes.
Les mthodes dadministration sont : le face--face (Dans les lieux publics : rue,
sortie de magasin, etc. ; au domicile de la personne interroge) ; tlphone ; voie
postale ; Tlmatique
Comment construire un questionnaire ?
Questions : Questions fermes ; Question ouverte ; Question caftaria (semi-
fermes)
Diffrents buts
Recueillir des faits (la marque de votre voiture, O habitez-vous)
Recueillir une intention
Recueillir des opinions : Intensit de la rponse (ordre de prfrence) ;
Comparaison par paire ; Graduation ; chelle smantique.
Rponses : uniques ; multiples ; nominales (texte, par ex. oui/non) ; numriques ;
ordinales (classement dordre)
Quelques lignes directrices pour construire un bon questionnaire :
Que des questions utiles !
Pas de biais et dambigut (par ex. double ngation)
Pas de termes techniques / jargon
CUIES Universit de Sfax 41/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Une seule ide par question
Questions filtres
Questions de contrle/recoupement
Logique de lentonnoir : Commencer par le facile ; Du gnral au spcifique
Limiter le nombre de questions (2 3 pages max)
Ne pas oublier de tester au pralable le questionnaire avant son exploitation pour
sassurer de la bonne formulation des questions.
Le dpouillement et lanalyse de donnes de lenqute (questionnaire) peut
concerner :
Tri plat et analyse univarie : Permet de mettre en vidence des diffrences entre
segments
Analyse de corrlation : Permet destimer dans quelle mesure deux variables
voluent conjointement
Tri crois et Analyses multivaries
Mthodes explicatives : Rgression (par ex. linaire) ; Segmentation ; Analyse
discriminante ;
Mthodes descriptives : Analyse factorielle ou typologique.
2 VOLET TECHNIQUE
Les diffrents choix portant sur la nature du produit ou du service, le type de clientle et la
stratgie marketing et commerciale requirent des moyens techniques et humains pour les
mettre en oeuvre. Cela vous amne clarifier un ensemble dinterrogations dordre
technique telles que : En quoi consiste votre produit ? Comment produire ? Quels sont les
moyens ncessaires pour raliser un produit comptitif (qualit, prix de revient) ? (Avec
quoi produire ? Avec qui produire ? A quel prix produire (cot) ?)
Ces questions doivent tre poses pour les diffrentes fonctions (achat, stockage,
production et distribution physique des produits).
Le but de ltude technique du projet est de fournir des rponses prcises et pratiques ces
questions. Mais, quatre remarques simposent ce niveau aux crateurs lorsquils
commencent laborer leur tude technique :
Pensez en terme de procds et non de machines : Savoir comment faire est plus
important que de savoir avec quoi faire SAVOIR-FAIRE.
Les aspects conomiques sont plus importants que les aspects techniques : il faut
garder prsent lesprit que les dcisions ne doivent tre prises que sur des bases et
selon des critres conomiques (meilleure qualit du produit/service, productivit,
rduction de cots et des dlais,, critres qui influent de manire directe sur
lefficacit et la rentabilit conomique de lentreprise.
Face un objet (produit, processus, entreprise) dont la composition, lorganisation et
le fonctionnement sont complexes, et dont ltude consiste un problme compliqu,
la mthode la plus courante consiste dcomposer lobjet analyser en parties
(ensemble, sous-ensemble) et identifier les relations entre elles.
CUIES Universit de Sfax 42/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Beaucoup de crateurs rencontrent des difficults lors de la ralisation de leur projet, dues
essentiellement une conception sommaire du produit et du projet qui se traduit par des
oublis de certaines composantes importantes qui auront des incidences sur le cot de
linvestissement et provoquent des difficults de financement et de dmarrage et des sous-
estimations des calculs de rentabilit.
Schma 10 : Structure dun systme complexe
au niveau de la collecte de linformation technique, on pourra sadresser aux centres
techniques institutionnels (INNORPI, CETIME, CNCC,), avoir recours aux conseils des
bureaux dtude et aux consultations des fournisseurs (de matriel, matires
premires,) pour connatre la dfinition industrielle de son produit, les normes,
caractristiques techniques, spcifications exacte des contraintes de
commercialisation et des procds.
2.1 DEFINITION DES PRODUITS OU SERVICES
Il sagit de dresser une liste des produits et services produire et commercialiser.
Caractristiques intrinsques (lies la composition du produit)
La dfinition des produits et services signifie llaboration de fiches de produits contenant
les caractristiques lies la composition du produit. Le promoteur doit inclure les
caractristiques les plus importantes qui illustrent les avantages recherchs par le
client.
Caractristiques extrinsques (non lies la composition du produit)
Cette fiche doit galement inclure les caractristiques intrinsques telles que la forme, le
design, la couleur qui constituent des indices informationnels importants sur la qualit
de vos produits.
La connaissance du produit est une condition pralable pour tudier la faisabilit du projet.
Il importe dtablir la liste des caractristiques du produit (physio-chimiques : poids,
composition, rsistance aux chocs, temprature ; fonctionnelles : utilisation, limite,
installation, entretien, ; spcifications par procd de fabrication, par usage de standards
ou normes, et par niveau de performance).
La structuration du produit permet dacqurir une connaissance du produit sous ses
diffrents aspects. Elle se droule en 3 tapes : identifier la nature des pices, quantits
utilises et tapes de groupages possibles entre composantes.
Exemple : Un briquet
CUIES Universit de Sfax 43/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Palier 0 : Briquet complet, Palier 1 (groupes) : Rservoir complet + Botier complet +
Couvercle avec mcanisme dallumage, Palier 2 (groupes) : Couvercle de rservoir +
Mcanisme dallumage ; Palier 3 (groupes) : soupape de flamme + allumeur ; Palier 4
(groupes) : Roulette tincelles compltes ; Palier 5 (pices) : rservoir, plaque, botier de
soupape, cne de soupape, ressort, joint, botier, ressort de rservoir, support, sabot, report,
support, roulette tincelles, goujon rivet, pierre briquer, rgulateur de flamme, sniper,
rivet ; Palier 6 (matires premires).
2.2 LE CHOIX DU PROCESSUS DE PRODUCTION
Il sagit dexpliquer le processus de production du bien ou de service propos, de justifier
les choix de production et de prsenter les partenariats techniques (marques trangres,
fournisseurs).
2.2.1 Description du processus de production
Le processus de production doit tre prsent dune manire simple et dtaille au moyen
de schma qui distingue les diffrentes phases de production. Un processus de production
est une combinaison ordonne des actions ncessaires la mise en uvre dun processus
pour la fabrication dun produit. Il est dcompos en processus partiels. Chaque processus
est constitu de gammes opratoires qui supposent que des oprations sont effectues avec
des machines et sur des postes de travail dtermins. Donc, pour chaque processus, on peut
tablir la liste des oprations ordonnes et identifier les paramtres importants des
oprations.
Schma 11 : La structuration du processus de production
Pour le produit et le processus de fabrication, un diagramme de circulation permet de
reprsenter le cheminement des matires premires, produits semi-finis, encours, pices,
parmi les postes de travail, les personnes et les machines. Ceci est important et utile pour la
dtermination des besoins rels en espace, pour la conception des btiments et pour ne pas
avoir des goulots dtranglement et des dsquilibrages dans les circuits de production.
Trois principales activits peuvent tre distingues. En amont, les activits
dapprovisionnement (fournisseurs, quipements, matires premires, composantes,
stockage) doivent tre dcrites. Ensuite, les activits de production peuvent faire lobjet
dune description (phases, activits, tches). En aval, on dcrira les activits rattaches
la distribution physique (emballage, conditionnement, manutention, entreposage, transport,
stockage et distribution des produits finis).
CUIES Universit de Sfax 44/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
2.2.2 La capacit et le niveau de production
En fonction des prvisions des ventes, on tablira les capacits et les niveaux de production
et ce, pour les diffrentes catgories de produits.
Une attention doit tre accorde lvolution de la production pour les 1ers mois dactivit
en tenant compte des possibilits de ventes et des dlais ncessaires pour la formation du
personnel et autres contraintes dues au dmarrage.
2.2.3 Les besoins en moyens de production
La capacit de production qui rsulte de ltude de march et du programme des ventes, va
dterminer les besoins en moyens de production :
Besoins en matires premires : nature des matires premires consommer, norme
de consommation de matires premires par unit de production.
CUIES Universit de Sfax 45/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Besoins en quipements et matriels de production : pour chaque processus et chaque
procd pour les diffrentes oprations ou phases.
Autres besoins en quipements et installations : besoins en utilits, matriel de
scurit, quipement de maintien des conditions dambiance, agencement et matriel
auxiliaire, matriel de manutention, matriel de stockage,
Matriel de transport,
Une liste des matires premires, de composants, dquipements ainsi que leurs
fournisseurs doit tre tablie et les cots qui sy rattachent doivent tre estims. De mme,
une liste du matriel de transport servant pour la manutention et la distribution physique
des produits finis doit tre dresse.
La liste des investissements sera dtaille dans la section 4 (tude de faisabilit
conomique et financire). Elle concernera les investissements productifs, frais
dtablissement, frais dapproches et divers et le fonds de roulement.
2.3 IMPLANTATION ET BESOINS EN BATIMENTS
Il sagit deffectuer le choix demplacement du projet sur la base de critres rattachs aux
conomies de cots, linfrastructure environnante (routes, ports), la proximit des
sources dapprovisionnement et de distribution, disponibilit de la main duvre, des
moyens de production et des services de maintenance.
Une gestion de lespace industriel permet dadopter une attitude rationnelle pour la gestion
de lespace, loptimisation de limplantation des machines et des besoins en btiments.
Rechercher le meilleur emplacement des diffrents postes de travail. Aussi, ltude du
problme dimplantation permet danalyser les transports et les dplacements internes de
lentreprise afin de trouver une disposition des postes de travail qui rduise au maximum
les manutentions. Enfin, ltude technique ncessite de rassembler les donnes sur les
machines, circuits de fabrication, sur les flux, et identifier les servitudes techniques et les
contraintes respecter ()
CUIES Universit de Sfax 46/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
2.4 INVESTISSEMENTS : BESOINS EN MOYENS DE PRODUCTION A INVESTIR
Investir est un acte risqu au moment o lentreprise est dans lincertitude du dmarrage.
Cest une dpense immdiate pour raliser des gains importants dans le futur.
Est-ce que lentrepreneur, dans ltat actuel de sa cration, est en mesure daffirmer
que cet investissement correspond lactivit quelle aura dans un ou deux ans ?
Est-ce que linvestissement na pas pour but de concurrencer une entreprise
importante ?
Est-ce quil ne satisfait pas plutt les objectifs du crateur au dtriment de ceux de
lentreprise ?
Est-il en cohrence avec les objectifs poursuivis ?
Lors dune cration, il est important de classer les investissements en plusieurs catgories
afin dapprcier que lopportunit dinvestir soit bien en rapport avec les objectifs de
lentreprise : investissements stratgiques, productifs, et de financement de lactivit.
2.4.1 Classification des Investissements
Il est quelques fois, mais trop risqu, de vouloir se dvelopper partir dune seule
opportunit, mme "juteuse" si elle ne correspond pas exactement aux objectifs de
lentreprise.
De mme linvestissement, son opportunit, son importance, sa destination, doit tre aussi
en cohrence avec le stade de vie du produit.
Les investissements stratgiques : Correspondants aux moyens que se donne lentreprise pour
atteindre ses objectifs en terme de produits ou dimage de marque ou financement dune
recherche ou mme obtention dun know-how
Les investissements productifs :
Pour vendre : dpenses engager pour mettre en place la force commerciale,
Pour grer : dpenses engager pour financer les cots de la gestion et
dadministration,
Pour produire : dpenses engager pour financer son processus de production.
Les investissements de financement de lactivit : Besoins de liquidit pour financer son
fonds de roulement. Besoins provenant de la diffrence des dlais de rglement entre les
encaissements et les dcaissements que lentreprise effectue.
2.4.2 Choix dinvestissements, Rentabilit et critres dacceptation
0 CF1 CF2 CF3 CFi CFn
::
I0
I0 : investissement initial, n = dure de vie de linvestissement (projet), CFi : cash flow de
lanne i.
CF = (Produits encaisss -charges dcaissables - amortissements) * (1 - t I/S) +
amortissements.
t(I/S) : Taux dimpt sur les socits (ou bnfice).
CUIES Universit de Sfax 47/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Avant de se lancer dans un projet dinvestissement, il est primordial de savoir si ce projet
est rentable et si sa rentabilit est suffisante. Son valuation intresse tout crateur, car il
pourra avoir faire un choix entre des projets dinvestissement prcis.
Plusieurs critres de choix sont cits :
Valeur Nette de linvestissement (VN)
n
VN = -I0 + CFi
i =1
, VN > 0
La VN est un critre qui permet de comparer les bnfices (revenus, CF) obtenir au
montant de linvestissement.
Dure ou dlai de rcupration, Payback (DR) : Elle calcule le temps ncessaire
lentreprise pour rcuprer le montant de linvestissement initialement dpens.
La mthode de la DR ne prend pas en considration le cash-flow dgag postrieurement
au dlai de recouvrement. Elle ne tient pas compte de la distribution dans le temps des CF
tout au long de priode de recouvrement. Une entreprise pauvre en liquidit peut juger
cette mthode trs utile pour apprcier la rapidit du recouvrement des fonds investis. Cette
mthode donne aux dirigeants une vision limite du risque et de la liquidit du projet.
Valeur Actuelle Nette (VAN)
Les insuffisances prsentes par la mthode de la DR incitant se pencher sur des
mthodes utilisant des CF actualiss qui donnent une base dvaluation et de slection des
projets dinvestissements plus objective. Cest le cas de la VAN.
Le crateur doit recevoir plus tard un certain montant dargent dont il cherche tablir la
n
valeur aujourdhui. VAN = -I0 + CFi
i =1
(1 + ta)
i
, ta : taux dactualisation.
Critre dacceptation : si le bnfice total actualis VAN 0, le projet est adopt, sinon
rejet.
Taux de Rendement Interne TRI
n
TRI tel que VAN = 0, cest--dire, I0 = CFi
i =1
(1 + TR II )
i
Comparaison du TRI avec le taux dactualisation ou le cot global du financement du
projet (ta).
Le cot global du financement tant un cot moyen pondr tel que :
Ta = Ka * (% des fonds propres par rapport I0) + Kd * (% des dettes par rapport I0)
Critre dacceptation : Le projet est entrepris si TRI > ta
Valeur actuelle des encaissements
Indice de Rentabilit (IR) : = Valeur actuelle des dcaissements
Critre dacceptation : IR > 1
Indice de Profitabilit (IP) : = VAN
I0
CUIES Universit de Sfax 48/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
3 VOLET RESSOURCES HUMAINES
Pourquoi aborder la question des RH en matire de cration dentreprise ? La rponse
cette question constitue la trame des lignes qui vont suivre. Nous examinerons le rle et
limportance de la notion des RH dans lentreprise, et nous essayerons de prciser partir
de limportance de la fonction RH comment lentrepreneur ou lentreprise en tant que
structure, procde au choix de son personnel et enfin, quelles sont les contraintes quil
rencontre et les techniques quil utilise.
3.1 ROLE ET IMPORTANCE DES RH DANS LENTREPRISE
La comptence humaine occupe une place prpondrante acquise au fil des dcennies
depuis la premire guerre mondiale en fonction de la perception de la place de lindividu
dans lentreprise et de lvolution sur le fond et la forme de son rle. Cette volution a
conduit considrer lhomme dans lentreprise sous un double angle :
le personnel peut tre un cot quil sagira de minimiser ;
le personnel peut tre une ressource quil faudra optimiser, mobiliser, dvelopper
et dans laquelle il faudra investir.
La seconde conception fait des RH une ressource stratgique pour lentreprise .
Historiquement, elles faisaient simplement appel des notions de main duvre .
Aujourdhui, le niveau de formation du facteur travail est dsormais considr comme un
avoir fixe , tout comme le matriel immobilis.
Il sen suit que le succs dune entreprise moderne dpend surtout de sa capacit acqurir
et utiliser effectivement les ressources dont elle a besoin pour couler ses produits et ses
services. Si les entreprises reconnaissent dsormais que les ressources qui conditionnent le
plus leur chec ou leur russite sont les ressources humaines, cest peut-tre parce que les
hommes sont enfin considrs comme les seuls capables de mettre en uvre les
stratgies qui vont faire fonctionner lorganisation.
Les hommes constituent la ressource la plus prcieuse dune entreprise et son succs ou
chec dpend en grande partie du dirigeant et de ses collaborateurs.
Vous devez montrer comment vous allez procder pour disposer des ressources humaines
pour russir la cration de votre entreprise :
Constituer une quipe de direction et de gestion.
Recruter du personnel technique et de production.La direction de lentreprise
Concernant les principales fonctions de direction, vous devez commencer par donner des
rponses aux questions suivantes :
Qui va diriger lentreprise ? Vous-mme
tes-vous prpar et avez-vous les comptences ncessaires pour diriger votre
entreprise
Qui seront les titulaires des postes cls de direction : salaris,
associs/collaborateurs ?
CUIES Universit de Sfax 49/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Comment toutes ces personnes se compltent-elles pour former une quipe efficace ?
Vous pouvez, tout de mme, faire lorganigramme de votre entreprise et essayez dy placer
les personnes que vous allez recruter ou vos associs.
Vous devez pensez comment ces diffrentes fonctions doivent tre et vont tre remplies et
comment constituer une quipe de gestion capable dassurer un dmarrage efficace et de
maximiser le potentiel de dveloppement de votre entreprise. Vous utilisez par exemple le
tableau suivant pour dcrire votre quipe de direction
3.1.2 Les besoins en personnel de production
Vous devez tablir les besoins de votre entreprise en personnel de production et en
personnel technique par catgorie. (Catgories du personnel : Personnel de gestion ; Cadres
techniques ; Cadres de matrise ; Ouvriers qualifis ; Techniciens ; Ouvriers ; Personnel de
soutien). Cette valuation quantitative et qualitative des besoins doit driver de ltude
des diffrents postes de travail et des qualifications requises pour chaque type de poste.
Formations techniques ou administratives requises soit de lquipe de direction ou des
employs.
Prendre connaissance de la lgislation et des cots relis lembauche.Les besoins en
formation et assistance
Spcifier pour chaque catgorie de personnel la disponibilit sur le march de travail et les
besoins en formation. Si les qualifications requises ne sont pas facilement disponibles sur
le march, indiquer comment allez-vous procder pour les acqurir Essayez dvaluer les
besoins de formation de votre quipe de direction et de gestion en particulier pour le
personnel technique : cadres et matrise.
CUIES Universit de Sfax 50/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
3.1.2.2 Cot de formation
Essayer de donner une valuation des dpenses de formation. Ces dpenses sont
importantes, elles doivent tre inclues dans les dpenses dinvestissement (frais
dapproche)
3.2 LA GESTION PREVISIONNELLE DU PERSONNEL (RAPPEL DE COURS
GRH)
La gestion prvisionnelle du personnel consiste essentiellement grer les emplois et les
carrires : estimer les besoins en personnel et en qualifications, concevoir les instruments
pour grer les recrutements, les salaires, lapprciation du travail, la formation et les
carrires.
La point de dpart dune gestion prvisionnelle est la connaissance des emplois sur la base
dune analyse approfondie et systmatique.
3.2.1 Dfinition de lanalyse des fonctions
Lanalyse des fonctions consiste examiner dans le dtail une fonction en vue didentifier
ces composantes et les circonstances dans lesquelles elle est ralise. Lanalyse des
fonctions aboutit la production dun dossier danalyse riche dinformation et pouvant
servir aux diffrentes fins de la gestion.
3.2.2 Les principales tapes de lanalyse des fonctions
1- Etablir la liste de tous les emplois pourvoir dans lentreprise
2- Choisir les emplois-types, reprsentatifs de lactivit et bien rpartis dans
lentreprise
3- Mettre au point limprim de recueil de donnes
4- Dterminer qui mnera les tudes de fonctions
5- Choisir la mthode (observation, questionnaire, entretien)
6- Collecter les donnes et ;
7- Analyser et exploiter les donnes.
3.2.3 Questions essentielles poser pour lanalyse des fonctions
Que fait le salari ? Quelles sont les activits physiques et mentales effectuer par le
titulaire du poste ?
Comment le fait-il ? Quels sont les moyens, les procdures et les normes suivre
dans le travail ?
Quels les objectifs, les relations et les liens avec les autres activits et les autres
postes ?
CUIES Universit de Sfax 51/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Quimplique le travail ? Quelles sont les connaissances, les aptitudes, les
qualifications et les capacits et quel est le degr de difficult des tches ?
3.2.4 Lexploitation de lanalyse des fonctions
3.2.4.1 Lanalyse des fonctions et la planification des RH
Dfinition : la planification des RH est une activit qui permet de prvoir les besoins en
main duvre de lentreprise et dexaminer loffre interne de manire disposer des RH
ncessaires la ralisation des objectifs de lentreprise.
Lien entre lanalyse des emplois et la planification des RH : Trois types dinformations
pralables sont ncessaires pour mener une dmarche de planification savoir :
la connaissance de la mission et des objectifs de lentreprise
la connaissance des caractristiques des RH existantes
la connaissance des profils des postes actuels.
Utilit de lanalyse des emplois pour la planification des RH : Lanalyse des postes est
essentielle en ce sens quelle permet de :
raliser linventaire des postes actuellement occups ;
prciser le contenu de chaque poste (description des tches)
tudier lutilit des postes et des tches en fonction des nouvelles orientations de
lentreprise (objectifs et stratgies) ;
introduire les modifications ncessaires au niveau du nombre et de la nature des
tches inhrentes chaque poste de travail.
3.2.4.2 Lanalyse des fonctions et la formation
Dfinition : La formation est un ensemble de programmes visant lacquisition des
connaissances, des habilets et des comportements qui permettront aux employs de
sadapter leur environnement.
Lien entre lanalyse des fonctions et la formation des RH : La formation doit permettre
lemploy de rpondre efficacement aux exigences de son emploi. A cet effet, lanalyse
des emplois, complte par les rencontres et discussions avec les employs, constitue une
source de renseignement concernant les besoins en formation.
Utilit de lanalyse des fonctions pour la formation des RH : lanalyse des emplois facilite :
ltablissement du contenu de la formation cest--dire les connaissances et les
comportements qui amneront lemploy accomplir adquatement les tches relies
son emploi ;
la collecte des renseignements concernant la manire dexcuter les tches relies
un emploi. ;
lexamen minutieux des tches qui devront tre accomplies une fois la formation
acheve.
3.2.4.3 Lanalyse des fonctions et le recrutement
Dfinition : le recrutement est lensemble des activits de recherche de la main duvre
capable doffrir les services (comptences, connaissances, expriences) dont lorganisation
a besoin.
Lien entre lanalyse des fonctions et le recrutement : Lanalyse des emplois est essentielle
pour entreprendre la premire tape du processus de recrutement des RH savoir la
CUIES Universit de Sfax 52/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
dtermination des besoins. Elle constitue ce niveau une source de renseignements qui
permet de maximiser ladquation entre les exigences du poste pourvoir et les
caractristiques de son dtenteur.
Utilit de lanalyse des fonctions pour le recrutement des RH : Lanalyse des emplois
permet de :
dfinir lemploi pourvoir et dcrire ses caractristiques ;
prciser le profil du titulaire (savoir, savoir-faire, savoir-tre)
arrter les critres de slection des diffrents candidats.
3.2.4.4 Lanalyse des fonctions et la rmunration
Dfinition : La rmunration renvoie lensemble des avantages conomiques, sociaux et
autres dont bnficie un travailleur en contrepartie dun travail fourni.
Lien entre lanalyse des emplois et la rmunration des RH : La structure de la
rmunration doit tre tablie sur la base des contenus de travail. Pour ce faire, il faut
procder la dfinition et lvaluation des emplois. Lanalyse des emplois constitue une
premire source de renseignement qui permet de procder lvaluation des emplois.
Utilit de lanalyse des emplois pour la rmunration des RH : lanalyse des emplois
facilite la mise en place des oprations suivantes :
prciser les principales caractristiques des emplois ;
dfinir les critres qui seront utiliss pour lvaluation des emplois ;
rpartir les postes selon un systme prtabli ;
assigner chaque poste une classe de rmunration spcifique.
3.2.4.5 Lanalyse des emplois et lvaluation du rendement
Lanalyse des postes permet aussi dtablir les normes de rendement, cest--dire la
quantit et la qualit du travail que le titulaire de lemploi doit atteindre. Ces normes
permettront dvaluer le rendement de lemploy. La description de lemploi incluant la
fixation dobjectifs et des normes ou standards conditionne donc la russite dun systme
dapprciation du personnel.
3.3 REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX
3.3.1 Dtermination du niveau de salaire
Niveaux SMIC, SMAG
Conventions collectives
3.3.2 Dtermination des avantages sociaux
Accessoires aux salaires
Avantages en nature
CUIES Universit de Sfax 53/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
4 VOLET ECONOMIQUE ET FINANCIER
Cette tude consiste traduire, en termes financiers tous les lments que vous venez de
runir et vrifier la viabilit de votre projet.
Ltude financire, comme les autres tapes de la cration dentreprise, est un processus
itratif qui permet progressivement de faire apparatre tous les besoins financiers de
lentreprise en activit et les possibilits de ressources qui y correspondent.
4.1 RENTABILITE ECONOMIQUE DU PROJET
4.1.1 Etude de la rentabilit du projet
Il stablit en comparant toutes les charges de lactivit avec tous les produits quelle va
engendrer. Avant de se lancer dans la cration de lentreprise, il est primordial de savoir si
lentreprise est rentable et si cette rentabilit est suffisante pour vous et vos associs et
partenaires. La rponse cette question est donne par le tableau dexploitation
prvisionnel.
Chiffre daffaires hors taxe CA HTVA
- Consommations Intermdiaires -CI
= Rsultat de production (ou valeur ajoute) = RP (VA)
- Frais de production (y compris les charges de personnel) -FP
= Rsultat brut dexploitation = RBE
- Frais financiers -FF
- Amortissements -AMT
= Rsultat Net dExploitation = RNE
- Impts sur les socits -I/S
= Rsultat net dimpt ou rentabilit Nette = RN
+ Amortissements +AMT
= Cash flow = CF
Le cash-flow a une importance considrable dans lvaluation de la rentabilit de
lentreprise dans la mesure o il permet de prvoir effectivement sa capacit de financer
CUIES Universit de Sfax 54/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
son activit future et sa croissance par des fonds propres, sa solvabilit financire pour ses
extensions futures.
Il sagit denvisager les diffrentes variantes de construction du projet (capacit de
production, choix des procds et quipements, volume des ventes,) et leur incidence sur
la rentabilit prvisionnelle pour plusieurs annes dactivit.
Ainsi, lestimation des produits et des charges constitue la 1re tape de lvaluation de la
rentabilit du projet et ceci devant tre effectu pour diffrentes hypothses sur les niveaux
de ventes et de production au dmarrage et lors des annes venir.
Ces prvisions constituent le point de dpart pour se fixer les objectifs atteindre, prparer
des normes ou standards et laborer ses budgets.
4.1.1.1 Prvision des ventes : Chiffre daffaires prvisionnel
Trois hypothses dvaluation des ventes sont possibles (bas niveau : pessimiste, moyen :
normal, haut : optimiste), chacune de ces hypothses doit comprendre la fois le niveau
dactivit de lanne et la progression de ce niveau dactivit sur les 12 premiers mois.
Hypothse sur le prix de vente : fourchette de prix en tenant compte de la clientle,
de la concurrence, du statut du produit, de la distribution et de la politique de
pntration au march (tude de march),
Capacit thorique prvue par le fournisseur ou value partir des quipements et
capacit pratique relle de la production (entre 70 et 90% de la capacit thorique).
Nombre de journes effectives de travail : dpasse difficilement les 250 j/an. La
capacit annuelle sera gale au produit de ce nombre par la capacit journalire.
Niveau dactivit au dmarrage et sa progression varient selon lactivit, lexprience
du promoteur, les possibilits de recrutement, les niveaux de qualification exigs et
la rapidit de la formation de la main-duvre.
4.1.1.2 Prvision des charges
Les matires premires et consommables, emballages,
Le prix prendre pour lvaluation de ces charges est le prix rendu usine qui inclut
lensemble des frais sur achat et de transport (dpenses dassurance, demballage, droit de
douane et au port, frais sur transport jusqu lusine). Les prvisions de consommation
doivent tre effectues avec prcision en tenant compte de lvolution du niveau de
production au cours des premiers mois dactivit, qui sera infrieur au niveau normal.
Les charges de personnel
Les niveaux de salaire tablis pour chaque catgorie de personnel selon les secteurs
dactivit et fixs par des conventions collectives.
Les charges sociales (CNSS) et supplments de salaire.
Frais divers de production
frais de maintenance, pices de rechange pour les rparations et les entretiens
(indexs au cot des quipements pour les 1res annes dactivit et augmentent avec
le vieillissement du matriel).
dpenses en nergie et en fourniture
Services Extrieurs (SE) effectus par des tiers pour le compte de lentreprise : loyers et
charges locatives de terrains, de btiments, de fonds de commerce, location de matriel de
transport, travaux dentretien et les rparations faites par des tiers, redevances pour brevets
CUIES Universit de Sfax 55/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
et licences, rmunration dhonoraires, primes dassurance de matriel, de personnes
contre vol, incendie, transport,
Les SE sont valus poste par poste et leur importance varie selon le montage du projet.
Transport et dplacement : dirigeants et personnel, frais de transport de
lapprovisionnement, distribution et ventes de produits indexs aux frais de personnel ou
bien au chiffre daffaires selon que lentreprise dispose des moyens propres de distribution.
Frais de promotion et de publicit : publicit, propagande, prospection, voyages
commerciaux, prospectus et dpliants). Pour un projet nouveau, il faut prvoir de 2 5%
du chiffre daffaire annuel.
Frais divers de gestion : fournitures de bureau, frais de communication, PTT, timbres (de
0.5 1% selon lactivit)
Impts et taxes : Taxe de Formation Professionnelle TFP (1% ou de 2% de la masse
salariale brute mensuelle msbm), Foprolos (1% de msbm), autres droits (douane, taxes sur
les vhicules,), La TVA nentre pas dans le calcul du rsultat, car elle nest pas
dductible.
Frais financiers : de fonctionnement (intrts pays sur les crdits court terme pour
financer lexploitation) et de financement lis au cot des emprunts et des dcouverts,
dettes bancaires, intrts pays sur le montant des crdits MLT obtenus pour financer les
valeurs immobilises.
Amortissements : on retient pour lvaluation de la rentabilit du projet la mthode de
lamortissement linaire qui est lgalement accepte par les diffrents partenaires du projet
(banques, administration,).
Les rgles damortissement linaire selon le type dimmobilisation sont les suivantes :
Dure : anne Taux
Nature
damortissement damortissement
Frais dtablissement 3-5 20-33%
Btiments 20 5%
Matriels et quipements 10 10%
Matriel de transport 5 20%
Meubles et Mobiliers de 4 25%
bureau
Frais dapproche et divers 3 33%
Impts sur les bnfices : de 35% du rsultat avant impt ou bnfice brut pour le secteur
industriel et commercial et de services et de 10% du RAI pour le secteur agricole.
4.1.2 Calcul du point mort (seuil de rentabilit) : Analyse Cot - Volume Profit
Le point mort reprsente le niveau dactivit qui permet, grce la marge ralise
(diffrence entre le niveau des ventes et les charges variables dcoulant implicitement du
chiffre daffaires) de couvrir les charges fixes.
CUIES Universit de Sfax 56/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Comment lentrepreneur peut-il rapidement et sans calcul excessif, se rendre compte que
son produit est rentable ou partir de quelles quantits vendues il le sera ? Cest le seuil de
rentabilit qui nous intresse dans ce cas. Le problme est de dterminer la fois le volume
minimum de lactivit partir duquel lexploitation devient rentable et la possibilit de
latteindre dans un dlai raisonnable. Ce niveau minimum est appel point mort ou seuil de
rentabilit.
4.1.2.1 Evolution des cots selon le niveau dactivit
Cot fixe : il ne dpend pas du volume dactivit et demeure donc au mme niveau quel
que soit le volume dactivit ralis (taxes foncires ou locatives, frais dassurance, loyers,
frais de personnel fixe, quelques frais divers de gestion, quelques taxes, amortissements,
frais financiers de financements). Les fais fixes unitaires diminuent avec laugmentation du
nombre dunits produites Economie dchelle.
Cot variable : il fluctue en fonction du volume dactivit jusquau point dtre
directement proportionnels au volume, (matires premires, matires consommables,
personnel de production, frais divers de production, consommation dnergie, taxes
indirectes, une partie des frais de transport, une partie des frais divers de gestion, frais de
vente, frais financiers de fonctionnement.
Cot semi-variable : reprsente une volution qui cumule les caractristiques des cots fixe
et variable. Il se comporte pour un certain niveau de production comme un cot fixe et
pour un autre comme un cot variable (cot dentretien des machines, fournitures dusine,
cot de la force motrice, salaires des contrematres, cot de la main-duvre indirecte,
salaire des cadres, cot de service contrle de qualit,).
Cot total de production : Cf + CV + CSV = C V + CF
4.1.2.2 Analyse C-V-P
Cette analyse reprsente ltude de la relation qui existe entre les cots, les volumes
dactivit et le profit (ou perte) que dgage chaque niveau dactivit.
SR est dfini tel que Ventes = Cot total.
Pour le calcul du SR, il faut faire une analyse de sgrgation des cots en sparant les cots
variables des cots fixes, puis faire une rpartition des cots semi-variables. Le calcul sera
tel que :
CUIES Universit de Sfax 57/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Chiffre daffaires : CA
Cots variables : - CV
= Marge sur cots variables = M/CV
- Cots fixes dpenss quelle que soit lactivit - Cf
= Rsultat (bnfice ou perte) =R
SR est tel que : M/CV = Cf
Les ventes et les cots sont lis par la relation CA = CV + Cf + Bce
Or au seuil de rentabilit, le bnfice dexploitation est nul, donc lquation devient B = 0
et Cf
Marge unitaire sur CV
M/CV = (P-CUV)Q* = Cf, do SR (Quantit) est tel que Q* =
SR (Argent) est tel que CA0 = P.Q*
Le graphique ci-aprs indique limportance relative des cots fixes, lvolution des ventes
et des cots variables, il fait ressortir les zones de profit (>0) et de perte (<0) et il permet
dindiquer comparativement lvolution des positions de lentreprise.
Cette mthode de seuil de rentabilit devrait suffire pour le crateur, le rsultat du calcul du
point mort doit constituer pour lui un repre atteindre : un objectif de vente et de
rentabilit commerciale. Graphiquement :
CA
Point mort
Point mort M/C
>0 CT
>0
CV Ou Cf
Cf <0
<0
QSR
QSR
, tant le profit ou rsultat de lentreprise.
4.2 FAISABILITE FINANCIERE
Un crateur est un fonceur, cest exact. Mais, il doit aussi tre un bon gestionnaire cest--
dire avoir une bonne perception des chiffres et des quilibres de sa socit.
Avant de demander des prts ou des prises de participations, il doit sinterroger sur la
structure de son exploitation. Elle est traduite par le schma dinvestissement et de
financement, le plan de financement, le compte de rsultat et le bilan.
Il est recommand de suivre les tapes suivantes :
Llaboration du plan de financement initial qui permettra de dterminer les
capitaux ncessaires pour lancer le projet. Il permet, en outre, dvaluer les
besoins durables de financement ainsi que les ressources financires durables ;
Ltablissement du compte de rsultat prvisionnel permettant de juger si lactivit
prvisionnelle de lentreprise sera en mesure de dgager des recettes suffisantes pour
couvrir la totalit des charges (moyens humains, matriels et financiers) ;
CUIES Universit de Sfax 58/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Ltablissement du plan de trsorerie sur 12 18 mois susceptible de mettre en
vidence, mois par mois, lquilibre ou le dsquilibre entre encaissements et
dcaissements ;
Llaboration du plan de financement sur 3 ans capable dapprcier la solidit
financire prvue de lentreprise sur les premires annes dexercice.
Cette dmarche doit conduire la construction dun projet cohrent et viable puisque
chacune des options prises trouve sa traduction financire et sa rpercussion sur les
quilibres financiers.
Si le dsquilibre est trop important, le projet doit tre remani et sa structure financire
adapte en consquence.
4.2.1 Construction du plan de financement initial
Le plan de financement initial se prsente sous la forme dun tableau comprenant deux
parties :
Dans la partie gauche, les besoins de financement durables quengendre le projet :
Les investissements effectuer sont les frais dtablissement (frais de constitution,
frais dtude et de recherche et frais de licence, brevets et marques) ; terrains et
amnagement ; btiments ; quipements et matriels de production ; matriels de
manutention et de stockage ; quipements de mesure et dentretien ; matriel de
transport ; frais dapproche ; frais dessai et de dmarrage ; fonds de roulement ;
Dans la partie droite, le montant des ressources financires durables quil faut
apporter lentreprise pour financer tous ses besoins de mme nature : Les
financements apporter sont les capitaux propres (apports nets des associs ou
partenaires) ; les subventions les crdits moyen et long terme ; les crdits court
terme.
-les valeurs immobilises doivent tre finances par des capitaux permanents,
-les besoins en fonds de roulement doivent tre financs par les capitaux permanents,
-seules les variations du besoin en fonds de roulement seraient finances par les crdits
court terme.
4.2.1.1 Besoins durables
Les frais dtablissement
Les frais de constitution de lentreprise (honoraires de conseil, frais dimmatriculation,
frais de premire publicit) font partie des dpenses engages au bnfice de lentreprise
pour une longue priode.
Les investissements
La cration dentreprise ncessite des investissements en :
Immobilisations incorporelles telles que les acquisitions de brevet et licence, le
droit au bail, le droit dentre dans une franchise, le fonds de commerce,
CUIES Universit de Sfax 59/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Immobilisations corporelles telles que les acquisitions de terrains, matriels,
machines, mobilier, vhicules, ordinateurs, construction, agencements, installations
etc.
Le besoin en fonds de roulement (BFR)
Il sagit dune somme dargent devant tre disponible de manire permanente pour faire
face la constitution dun stock minimum avant le dmarrage de la commercialisation et
daccorder des dlais de rglement vos clients (crances clients).
Cet investissement dans le cycle dexploitation est appel besoin en fonds de roulement
(BFR). Pour le calculer, il convient de chiffrer si possible leur niveau maximum (fin
danne parce que le chiffre daffaires est cens crotre avec le temps ou la pointe
dactivit saisonnire).
La formule gnrale du calcul du besoin en fonds de roulement est la suivante :
4.2.1.2 Le recensement des ressources durables
Une fois les besoins durables sont valus, il est ncessaire de chiffrer les ressources
financires qui vous permettront de couvrir ces investissements.
Elles se regroupent en deux catgories :
Celles que vous apporterez (vos apports personnels ).
Les ressources que vous devrez trouver en complment (prime, subvention, emprunt
moyen ou long terme).
Ce financement, en principe de nature bancaire, devra tre en cohrence avec la pratique
des banques qui appliquent certains principes pour la distribution des crdits
dinvestissements (crdit moyen ou long terme).
Le crateur aura aussi recours au schma dinvestissement et de financement qui fera
apparatre aussi les postes dinvestissement : frais dapproche et divers ; et fonds de
roulement comme lments dinvestissement.
4.2.2 Compte de rsultat prvisionnel
Lorsquon tablit un compte de rsultat prvisionnel, on commence par calculer le chiffre
daffaires mensuel (dtermin par le plan commercial). Ensuite, on tablit des projections
de toutes les charges dexploitation pour chaque mois de la premire anne.
CUIES Universit de Sfax 60/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Il sagit dun tableau retraant lactivit et permettant, pour chacun des trois premiers
exercices, de recenser :
Dans la partie gauche, lensemble des dpenses (charges) de lexercice ;
Dans la partie droite, les recettes (produits) de lexercice et, par diffrence entre les
deux colonnes du tableau, de sassurer que lactivit dgage un bnfice suffisant
(reliquat des produits par rapport aux charges).
Tous les montants sont en hors taxes.
NB : A ce stade, le compte de rsultat ne peut pas tre dfinitivement arrt, car il est
possible que la situation de trsorerie au cours des premiers mois ncessite le recours
des crdits bancaires court terme. Si tel est le cas, il faudrait bien sr incorporer aux
charges financires dj inscrites les agios y affrents. Ce calcul ncessite dtablir le plan
de trsorerie (voir plus loin).
4.2.3 Plan de trsorerie
Cest un tableau qui prsente tous les dcaissements et tous les encaissements prvus au
cours de la premire anne (voir mme sur 18 mois), en les ventilant mois par mois. Si ce
document prvisionnel devait faire ressortir une impasse de trsorerie un certain moment,
il faudrait alors trouver une solution avant le dmarrage de lentreprise.
On ne doit pas commencer lactivit en sachant lavance que dans les tous prochains
mois il risque dy avoir une grave crise de trsorerie et que lon naura pas les moyens dy
remdier.
CUIES Universit de Sfax 61/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
La plupart des disparitions dentreprises nouvelles intervenant la premire anne sont le
fait de problmes de trsorerie.
4.2.4 Le bilan prvisionnel
Lentrepreneur doit aussi prparer un bilan prvisionnel relatif la premire anne
dexercice.
Actif : il inclut toutes les valeurs possdes par lentreprise. On distingue lactif circulant
de lactif immobilis. Lactif circulant comprend le patrimoine disponible et tout ce qui
peut tre ralis ou consomm par le fonctionnement de lentreprise sur une priode gale
ou infrieure un an. Lactif immobilis est constitu de biens matriels utilisables sur une
longue priode de temps.
Passif : il reprsente tout ce que lon doit aux cranciers. Certains de ces montants peuvent
tre payables moins dun an (passif court terme) alors que dautres sont des dettes
long terme.
Fonds propres : Ce montant est gal lexcdent du total de lactif par rapport au total du
passif.
BILAN PREVISIONNEL
ACTIF
Actif circulant
Disponibilits
Clients et effets recevoir
Stocks de produits finis
Stocks de matires premires
Total de lactif circulant
Actif immobilis
Immobilisations +
Moins amortissements
Total de lactif immobilis
= TOTAL DE LACTIF
CUIES Universit de Sfax 62/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
PASSIF ET FONDS PROPRES
Passif court terme
Fournisseurs et effets payer
Dettes financires
Autres
Total du passif court terme
Passif long terme
Emprunts long terme
Dettes commerciales
Autres dettes
Total du passif long terme
Total du passif
Fonds propres
Apport en capital +
Bnfices reports
Total des fonds propres
= TOTAL DU PASSIF ET DES FONDS PROPRES
4.2.5 Plan de financement sur 3 ans
Une bonne structure financire est un gage de prennit pour une nouvelle entreprise. Elle
sera en mesure de faire face des alas (retard dans la monte en puissance du chiffre
daffaires, impays, etc.) dautant mieux quelle aura des ressources financires stables en
rserve pour cela.
NB : Pour les annes 2 et 3, il ne faudrait porter que les lments nouveaux affrents ces
exercices.
CUIES Universit de Sfax 63/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
4.2.6 Les rgles de financement
4.2.6.1 Les fonds propres
Bien que la lgislation tunisienne (voir code des investissements) impose un taux
minimum, en gnral, de 30% pour les projets industriels et touristiques et de 40% pour les
projets de service, il est recommand dopter ds le dpart si possible pour un schma de
financement quilibr (par exemple, 50% fonds propres, 50% sous forme demprunts).
On entend par fonds propres (FP) tous les fonds faisant partie du patrimoine de
lentreprise, cest dire :
Les ressources personnelles du promoteur (en espces ou en nature) ;
Les emprunts titre personnel (parent, amis) ;
Les subventions (pour les nouveaux promoteurs, les primes dtudes) ;
Les fonds apports par les associs (y compris les socits de capital-risque) ;
Les quasi-fonds propres (comptes courants des associs, prts participatifs).
4.2.6.2 Le financement par lendettement
Il sagit des crdits moyen terme (2 7 ans) et long terme (plus de 7 ans), du leasing et
des lignes de crdit bancaire sont libres et sont exprims en fonction du Taux du March
Montaire (TMM).
Les marges bancaires varient gnralement de 2 5 points selon la nature du projet, la
dure du crdit et la crdibilit du promoteur.
4.2.6.3 Le financement en Tunisie
Une multitude dinstruments de financement des projets est aujourdhui, la disposition
des promoteurs tunisiens et trangers :
FONAPRAM
Nouveaux promoteurs (FOPRODI, FITI)
Prise de participation (SICAF et SICAR)
Crdits bancaires (BTS, BFPME,)
Lignes de partenariat
Leasing.
4.2.6.4 Lquilibre financier
Une attention particulire est accorde au fond de roulement, les erreurs de financement les
plus fatales pour les entreprises en cration sont dues une mconnaissance de
limportance du Fonds de Roulement FR aussi bien pour lvaluation des besoins en fonds
que pour les choix des modes de financement.
Lanalyse financire du projet revient galement aux prteurs potentiels (banques,
investisseurs privs, socits de capital risque,).
Le cycle dexploitation de lentreprise engendre trs souvent un besoin de financement, ce
besoin est le Besoin en Fonds de roulement BFR. Cest un besoin moyen, fonction du dlai
moyen dcoulement des stocks, du dlai moyen de paiement par les clients et du dlai
moyen de rglement des fournisseurs. Il sappelle aussi le fonds de roulement normatif et il
est permanent car cest la somme qui permettrait lentreprise de continuer lexploitation
dans les conditions normales. En contrepartie de ce besoin, lentreprise dispose du FRN
pour financer son exploitation.
CUIES Universit de Sfax 64/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
2.000 DT viennent
1er mois 2me mois 3me mois consolider le FRN, mais
Dpenses dexploitation 5.000 5.000 5.000 ne diminuent en rien le
Recettes de ventes - - 7.000 BFR ou FR normatif
(BFR = 10.000)
Une somme infrieure 10.000 DR ne permet pas de continuer lexploitation dans les
conditions normales.
Trois cas possibles :
FRN < BFR ou FR normatif, la situation de lentreprise est dsquilibre,
FRN > BRF, on dit que lentreprise est financirement sur-quilibre.
FRN = BFR, la situation est quilibre.
Valeurs Capitaux
Immobilises Propres
Capitaux Rgle dor :
BFR Permanents
FRN Dettes FRN FR normatif ou BFR moyen
MLT
Excdent de financement
Le BFR reprsente le besoin de financement dclench par le cycle dexploitation. Le FRN
reprsente laptitude de lentreprise financer son cycle dexploitation par des capitaux
permanents ou stables.
5 VOLET JURIDIQUE, FISCAL ET SOCIAL
Les dossiers juridique, fiscal et social sont traits dans ce chapitre successivement.
5.1 DOSSIER JURIDIQUE ET SES ASPECTS
La structure juridique correspond au cadre lgal dans lequel vous allez exercer vos
activits et qui aura un impact sur votre statut patrimonial, social et fiscal.
Ce choix doit donc tre tudi minutieusement avec, si possible, laide dun conseil
spcialis.
5.1.1 Choix de la structure
Quelle que soit lactivit que vous allez exercer (Artisanat, Agriculture, Profession librale,
Industrie, Commerce), il faut choisir entre :
CUIES Universit de Sfax 65/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Demander votre immatriculation en tant quentrepreneur individuel (personne
physique) ;
Ou crer une socit et attribuer une forme socit pour son entreprise.
Les formes dentreprises les plus courantes sont :
LEntrepreneur Individuel ;
La Socit Unipersonnelle Responsabilit Limite (SURL) ;
La Socit Responsabilit Limite (SARL) ;
La Socit Anonyme (SA).
5.1.2 Les principaux critres de choix
Le choix de la forme juridique de lentreprise dpend de :
La nature de lactivit ;
La volont de sassocier ;
Lorganisation patrimoniale ;
Lengagement financier ;
La crdibilit vis--vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs...).
Le tableau suivant reproduit les principales caractristiques des diffrentes structures
juridiques.
5.1.3 Etapes juridiques de la cration et formalits de constitution (EI, SURL,
SARL, SA)
5.1.3.1 Etapes juridiques
La constitution de socits ncessite laccomplissement des formalits suivantes :
CUIES Universit de Sfax 66/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Dclaration auprs des organismes concerns ;
Enregistrement des statuts la recette des finances ;
Dclaration douverture dune patente au bureau des impts ;
Dpt des statuts et dimmatriculation au registre du commerce auprs du bureau du
greffe du tribunal de 1re instance ;
Publication au JORT qui seffectue au bureau de lIORT ;
Obtention du numro de code de douane
5.1.3.2 Formalits juridiques de constitution
Dune Entreprise Individuelle
CUIES Universit de Sfax 67/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Dune SURL ou dune SARL
CUIES Universit de Sfax 68/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Dune socit anonyme
CUIES Universit de Sfax 69/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
5.2 DOSSIER SOCIAL ET SES ASPECTS
5.2.1 Scurit sociale
Le rgime de la scurit sociale qui rgit le secteur priv est prvu par la loi n60-30 du 14
dcembre 1960. Il est administr par la Caisse Nationale de Scurit Sociale (CNSS). Il est
obligatoire. Sont assujettis ce rgime, les personnes suivantes :
les salaris et les personnes qui leur sont assimiles par le code du travail. Est salari
tout individu li un employeur physique ou moral par un contrat de travail crit ou
verbal.
les employeurs : il est noter que les prsidents directeurs gnraux des socits
anonymes et les grants des SARL qui ont la signature sociale ne sont pas des
salaris, mais des mandataires. Ces personnes physiques dirigeant des personnes
morales sont tenues responsables par la loi de laccomplissement des obligations vis-
-vis de la CNSS.
les travailleurs indpendants.
CUIES Universit de Sfax 70/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
5.2.2 Rgime social (40 ou 48 heures) et salaire minimum
SMIG : Salaire Minium Interprofessionnel Garanti :
Rgime de 48 heures : 180,752 D (SB) + 30,368D (ICP)
Rgime de 40 heures : 159,800 D (SB) + 30 D (ICP) (Dcret n2004-1803 du 02
aot 2004).
SMAG : Salaire Minium Agricole Garanti : fix 6,709 dinars par journe de travail
effectif pour les travailleurs des deux sexes gs de 18 ans au moins. (Dcret n2004-1804
du 2 aot 2004).
5.2.3 Charges sociales
Parmi les obligations des personnes assujetties au rgime de la scurit sociale, il y a :
laffiliation des employeurs ds le moment du commencement de lactivit,
limmatriculation des salaris : o la responsabilit incombe leur employeur. Elle
permet louverture des droits aux prestations de scurit sociale au profit des
travailleurs.
les dclarations de salaires : priodiques et trimestrielles (1re quinzaine de chaque
trimestre civil). Elles comprennent toutes les sommes verses titre de rmunration
et les avantages en nature accords.
5.3 DOSSIER FISCAL ET SES ASPECTS
5.3.1 Rgime rel ou forfaitaire
Voir itinraire fiscal de lindustriel
5.3.2 Obligations fiscales de lentreprise
La TVA : Taxe sur la Valeur Ajoute : Sont soumises la TVA toutes les affaires faites en
Tunisie revtant le caractre : industriel, artisanal, de profession librale, et les oprations
commerciales. Sont assujetties la TVA toutes les personnes qui ralisent les oprations
cites ci-dessus et toutes celles qui optent pour le rgime de la TVA.
Les taux de TVA sont au nombre de trois : 10%, 18%, 29% (voir code de TVA pour les
listes de produits concerns).
Les personnes assujetties la TVA doivent tablir une facture pour chacune des oprations
quelles effectuent comportant la date de lopration, client, le n de la carte
didentification fiscale dassiette la TVA, bien ou service, prix H.T., le taux de TVA et
CUIES Universit de Sfax 71/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
prix T.T.C. Elles doivent dposer une dclaration du chiffre daffaire ralis chaque mois
auprs de la Recette des Finances dans les quinze premiers jours du mois suivant pour les
personnes physiques et avant la fin du mois qui suit pour les personnes morales. Le dfaut
de dclaration, la dclaration errone ou en retard constituent des infractions graves et sont
pnalisables.
La Taxe de Formation Professionnelle : La TFP est due par tout employeur. Elle est assise
sur les lments de salaires servis au taux de 2%, lexception des entreprises exerant
dans le secteur des industries manufacturires qui sont soumises un taux de TFP de 1%.
La dclaration et lacquittement se font dans les mmes formes et dlais pour la TVA.
Le Fonds de Promotion des Logements Sociaux : (FOPROLOS) Les employeurs publics et
privs acquittent au profit du FOPROLOS un prlvement de 1% des traitements et
salaires servis leurs employeurs.
LImpt sur les revenus : Impt sur les socits (IS) (ou sur les bnfices raliss : taux
35% ou 10%) et Impt sur le revenu des personnes physiques (IRPP : voir barme de
calcul).
Les droits de douane : Ce sont des impts qui frappent les marchandises importes (droits
dentre) ou exportes (droit de sortie). Tous les biens soumis aux droits de douane
figurent dans la "Nomenclature Douanire", liste exhaustive de lensemble des biens. Le
promoteur doit prendre en considration lors du montage de son affaire, le rgime douanier
qui sera le sien pour tre en conformit avec la rglementation en vigueur.
Les droits de timbres et denregistrement : Ceux sont des impts qui sont perus
loccasion de lenregistrement dun acte ou dune mutation entre vifs ou cause de mort.
La taxe sur les vhicules : On distingue deux taxes : la taxe unique de compensation due au
titre des vhicules de transport de marchandises ou des personnes, et la taxe de circulation
automobile ou vignette due au titre des vhicules de tourisme. La vignette est due en dbut
danne et reste valable pour toute lanne en cours. La taxe de compensation peut tre
acquitte par mois, trimestre, semestre ou anne.
CUIES Universit de Sfax 72/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Chapitre 3. La cration dentreprises et les principaux
intervenants
Ce chapitre se veut plutt informative, en premier lieu, sur lenvironnement tunisien de la
cration dentreprises (contexte, dfis, cadre institutionnel et juridique, incitations aux
investissements et avantages fiscaux et financiers) et en deuxime lieu, sur les principaux
organismes dappui de la nouvelle entreprise (acteurs de soutien, daide et
daccompagnement la cration ; acteurs de financement, acteurs de sensibilisation et
dinformation...).
1 LENVIRONNEMENT DE CREATION DENTREPRISES EN
TUNISIE
1.1 LES MUTATIONS ET LES DEFIS
Lacte dentreprendre en Tunisie devrait prendre en considration les trois dimensions
suivantes :
- Adhsion de la Tunisie lOrganisation Mondiale du Commerce (OMC) (ex-
GATT) et son association des zones de libre change (change sans barrires
douanires) avec lUnion Europenne, avec les pays arabes et (en perspective) avec
les Pays de lUnion du Maghreb Arabe (UMA).
- Cadre mondial la fois de concurrence et dalliance exacerbe pour la domination
des marchs.
- Rgles de jeu de lconomie mondiale mouvantes et dpendantes de la capacit
produire de la valeur ajoute dans des conditions plus comptitives.
Les pays en dveloppement ou mergent sont appels suivre ces mutations pour ne pas
rester en retrait ou tout simplement tre carts de ce processus.
1.2 UN CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE PARTICULIEREMENT
FAVORABLE
Pour promouvoir la PME tunisienne, les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures
varies et complmentaires dordre fiscal et financier.
La naissance du Fonds de Promotion et de Dveloppement Industriel FOPRODI a
permis dapporter une rponse une demande locale soutenue et non satisfaite pour
des produits traditionnels qui rpondent des besoins de base du consommateur
tunisien.
La gnralisation des ppinires dentreprises3 et les centres daffaires qui favorisent
lmergence dune nouvelle gnration de promoteurs.
Lincitation des Socits dInvestissement Capital Risque (SICAR) la
participation aux oprations de privatisation.
La cration du Fonds de Promotion de la Dcentralisation Industrielle (FOPRODI)
pour le dveloppement de la PMI.
La cration du Fonds National de lArtisanat et des Petits Mtiers (FONAPRA).
La cration du Fonds National de Garantie (FNG) en tant que levier de financement
bancaire de lactivit des PME et du Nouveau Systme de Garantie : la SOTUGAR
CUIES Universit de Sfax 73/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
(La Socit Tunisienne de Garantie) qui a pour objectif dencourager les
tablissements de crdit, Banques et SICARs, continuer financer les projets
initis par les moyennes entreprises dans les secteurs des industries manufacturires
et des services connexes.
Enfin on peut mentionner les institutions de couverture de certains risques et
daccompagnement des entreprises : la COTUNACE, et la toute rcente compagnie
dassurance du commerce intrieur, ASSURCREDIT, les fonds publics ou
financement multilatral comme le FOPRODI, le FOPRODEX, le FAMEX, le RITI.
Lexistence de toutes ces sources de financement et daccompagnement constitue
une avance relle, qui doit donc tre apprcie sa juste valeur.
1.3 LA SIMPLIFICATION DES REGLES ADMINISTRATIVES
Le Guichet Unique de lAPI : est un centre de formalits administratives et lgales
runissant, en un mme espace, les diffrentes administrations intervenant dans
laccomplissement des formalits de cration dentreprises : Dclarations de projets
dinvestissement et constitution de socits.
1.4 LE SOUTIEN ET LA FORMATION AUX ENTREPRISES
Plusieurs institutions et intervenants apportent leur soutien, diffrents degrs et diffrents
niveaux, aux promoteurs de PME.
LAgence de Promotion de lIndustrie API
Cest un tablissement public qui a pour mission de mettre en oeuvre la politique du
gouvernement relative la promotion du secteur industriel en tant que structure dappui
aux entreprises et aux promoteurs.
Dans le cadre des appuis dvelopps au profit des entrepreneurs lAPI dispose des
structures suivantes :
* Le Centre de Facilitations et de Gestion des Avantages CFGA
Ce centre informe, conseille et assiste le promoteur dans la prparation de son projet en se
rfrant au code dinvestissement et aux diffrents textes dencouragement de
linvestissement. Lassistance porte principalement sur dclaration dintention
dinvestissement. Ce centre est dot dune unit de gestion des avantages qui concerne les
nouveaux promoteurs, les petites et moyennes entreprises, les projets implants dans les
zones de dveloppement, les projets de premire transformation de produits agricoles, et
loctroi davantages financiers accords dans le cadre du FOPRODI.
* Le Centre dEtudes et de Prospective Industrielles CEPI
Ce centre peut aider dans lorientation des entrepreneurs potentiels car il assure une veille
stratgique permanente par llaboration dtudes de positionnement par branche, des
facteurs de comptitivit
* Le Centre de Soutien la Cration dEntreprises CSC
Cest une structure ddie entirement la formation et lappui aux nouveaux
entrepreneurs.
* Le Centre dAppui la PMI CAPMI
Il met la disposition des promoteurs dune Task Force PMI constitue de cadres de lAPI
et des Centres Techniques pour mener des actions de mise niveau, de modernisation et
CUIES Universit de Sfax 74/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
dextension au profit des petites et moyennes entreprises en vue damliorer leur
comptitivit.
* Le Centre de Documentation et dInformation Industrielle CDII
Il fournit une information en temps rel tels que Le Salon Virtuel de lindustrie tunisienne,
des annuaires, des CD sur lindustrie tunisienne, des informations, des brochures et des
dpliants dits par lAPI.
LAgence Foncire Industrielle AFI
Elle soccupe essentiellement de lamnagement des zones et terrains industriels et la
construction des btiments industriels en vue de les mettre la disposition des promoteurs
en location.
LAgence Nationale de lEmploi et du Travail Indpendant ANETI
LANETI soriente vers lassistance (lidentification et ltude des projets), le conseil
(recrutement, slection et proposition de candidature pour la satisfaction des besoins des
entreprises en ressources humaines) et la formation des promoteurs de petites entreprises
dans le secteur de la petite industrie, les mtiers et les services.
Agence Tunisienne de Formation Professionnelle ATFP
Cest lorganisme spcialis dans la formation professionnelle. Lagence dispose de 130
centres sectoriels, polyvalents, dartisanat, de jeunes filles rurales et de travail indpendant.
Les Offices de dveloppement
Ces offices fournissent linformation et lassistance aux promoteurs depuis lidentification
du projet jusqu la ralisation du projet. Ces offices sont au nombre de trois :
LOffice de dveloppement du centre Ouest ODCO
LOffice de dveloppement du Sud ODS
LOffice de dveloppement du Nord Ouest ODNO
Les socits rgionales dinvestissement et de dveloppement
Lobjectif des socits est doffrir des moyens financiers additionnels aux promoteurs de la
rgion, de les encourager sinstaller et dynamiser ainsi linvestissement et la cration
demplois. Ces socits participent par des apports sous forme de capital-risque dans les
projets promouvoir.
Les Centres Techniques Sectoriels
Les huit Centres Techniques sectoriels, assurent un rle dassistance technique aux
entreprises des secteurs industriels concerns et fournissent linformation notamment
technique.
LINNORPI
LInstitut national de normalisation et de la proprit industrielle offre aux nouveaux
promoteurs aux inventeurs comme aux investisseurs trangers la garantie dune production
scurise.
LAgence Nationale de Protection de lEnvironnement ANPE
LANPE aide les promoteurs raliser des investissements supplmentaires pour la
protection de lenvironnement en leur fournissant une prime financire et lassistance
technique ncessaire. Elle joue un rle important pour la prservation de lenvironnement.
Le Centre de Promotion des Exportations CEPEX
CUIES Universit de Sfax 75/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Le rle du CEPEX dans la cration dentreprises se limite fournir des informations
touchant aux commerce international, aux changes et aux accords entre la Tunisie et les
autres pays pour ceux qui le sollicitent.
LAgence de Promotion de lInvestissement Extrieur FIPA
Cette agence est charge dapporter le soutien ncessaire aux entrepreneurs trangers et de
promouvoir linvestissement extrieur en Tunisie. FIPA et ses bureaux ltranger forment
un rseau dinformations, de contacts, de conseils, dassistance, daccompagnement et de
soutien au service des investisseurs et
LUnion Tunisienne pour lIndustrie le Commerce et lArtisanat UTICA
Cette organisation patronale nationale regroupe des structures professionnelles des
diffrents secteurs conomiques (industrie, commerce, service artisanat, petits mtiers).
Elle a pour mission la promotion des diffrents secteurs conomiques dans tous les
domaines.
LUniversit et le dveloppement de lentrepreneuriat
Depuis les annes 90 et suite aux rformes des programmes denseignement suprieur,
plusieurs changements ont t introduits. Une nouvelle dmarche a t alors adopte pour
rapprocher lUniversit de la ralit conomique et lui permettre dtre ouverte sur son
environnement.
Les Centres dAffaires
* Cadre juridique
a- Loi n 2005-57 du 18 juillet 2005 :
Les centres daffaires dintrt public conomique sont des personnes morales dotes de la
personnalit juridique et de lautonomie financire qui offrent aux promoteurs et
investisseurs des services visant impulser linitiative prive dans les rgions concernes
par leurs activits.
Les centres daffaires exercent les activits ayant pour but de faciliter la ralisation des
projets et doffrir les services ncessaires aux promoteurs et investisseurs pour le
lancement ou le dveloppement de leurs projets et notamment :
renseigner les porteurs dides de projets, les promoteurs et les investisseurs sur les
procdures de cration dentreprises, les avantages et incitations qui leur sont
destins, les sites dinstallation possibles et les opportunits prometteuses
dinvestissement et de partenariat,
accompagner les promoteurs dans les diffrentes phases de dmarrage et de suivi de
la ralisation de leurs projets et notamment dans la phase dlaboration des tudes de
faisabilit et de la finalisation du schma de financement,
mettre, les cas chant et titre onreux, la disposition des promoteurs et
investisseurs des bureaux quips de moyens de communication et leur assurer les
services de base,
organiser au profit des promoteurs et investisseurs des sminaires en vue de les
informer sur les avantages comparatifs de la rgion.
b- Dcret n 2005-2611 du 24 septembre 2005 relatif lapprobation du statut-type
des centres daffaires dintrt public conomique.
CUIES Universit de Sfax 76/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
c- Les actes constitutifs de cration des centres daffaires dintrt public
conomique (approuvs par arrts du Ministre de lIndustrie, de lEnergie, et des Petites
et Moyennes Entreprises).
* Champ dintervention des centres daffaires :
Les interventions des centres daffaires concernent les diffrents secteurs conomiques :
lindustrie, les services, lagriculture, le commerce, lartisanat, les petits mtiers et le
tourisme.
Pour plus dinformation voir site : http://www.investir-en-
tunisie.net/news/article.php?id=1483
2 LINCITATION AUX INVESTISSEMENTS : AVANTAGES
FINANCIERS ET FISCAUX ACCORDES
2.1 LE CODE DINCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ET NOUVEAU
PROMOTEUR
Tel que dfinis dans le code dincitations linvestissement (loi 93-120 du 27 dcembre
1993, entre en vigueur le 01/01/1994 et modifie par la loi 96-113 du 30 dcembre 1997
et le dcret n94-492 du 28 fvrier 1994) sont considrs nouveaux promoteurs les
personnes physiques de nationalit tunisienne regroupes ou non en socit, qui :
ont lexprience et les qualifications requises,
assument personnellement et plein temps la responsabilit de la gestion du projet,
ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers et immobiliers,
ralisent leur premier projet dinvestissement.
2.2 LES FONDS SPECIAUX DINCITATION1
Sont imputes :
sur le FONAPRAM les primes et participation de ltat accords aux projets
artisanaux,
sur le FOPRODI, les primes et participation de ltat accords aux projets industriels
et de services,
sur le RITI les primes issues des projets technologie de linformation,
sur le FOSDA celles accordes aux projets agricoles,
sur le FODEC les primes accordes dans le Programme de Mise Niveau .
Dans ce qui suit, seuls les trois premiers fonds seront dtaills.
2.2.1 Les activits artisanales et petits mtiers : FONAPRAM
Objet du Fonds : Lobjectif du fonds est de favoriser la promotion des projets caractre
artisanal et encourager les petits mtiers.
Conditions de bnfice des avantages du Fonds : Le projet doit comporter un schma de
financement comme suit : 40 % Fonds propres ; 60% Crdits bancaires. Linvestissement
maximum est de 50 mD. Ce montant est port 80 mD pour les projets promus par les
diplms de lenseignement suprieur.
1
Synthse du code dincitation aux investissement : visitez le site web de lAPI.
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
CUIES Universit de Sfax 77/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Formes dinterventions du Fonds :
1- Dotation remboursable sur 11 ans dont un dlai de grce ne dpassant pas la dure de
remboursement du crdit bancaire avec un taux dintrt de retard de 4%. La dotation
remboursable se calcule comme suit :
90% des fonds propres pour la part de 1investissement qui ne dpasse pas 10 000 dinars
condition de justifier dun apport personnel en numraire ne devant pas tre infrieur
10% des fonds propres.
80% des fonds propres additionnels affrents la part de linvestissement suprieur 10
000 dinars condition de justifier dun apport personnel en numraire ne devant pas tre
infrieur 20% des fonds propres additionnels.
2- Une prime dinvestissement gale 6 % du cot du projet.
Bnficiaires : Les projets de cration ou dextension nayant pas obtenu laide du Fonds et
promus par des personnes de nationalit tunisienne dans le cadre dentreprises
individuelles, de socits de personnes ou de coopratives ;
Banques gestionnaires : Pour une mise en uvre adquate des interventions du
FONAPRAM, le Ministre des Finances a confi la gestion dudit Fonds aux 12 banques
commerciales suivantes :
N Banques Date de signature de la convention Adresse du sige
1 STB 12 Juillet1994 Rue Hdi Nouira - Tunis
2 BNA 12 Juillet1994 Rue Hdi Nouira - Tunis
3 BIAT 12 Juillet1994 70-72 Av Bourguiba - Tunis
4 AB 12 Juillet1994 Av Med V - Tunis
5 BS 12 Juillet1994 95 Av de la Libert - Tunis
6 BH 12 Juillet1994 Av Khereddine Pacha - Tunis
7 UBCI 12 Juillet1994 139 Av de la Libert - Tunis
8 BT 12 Juillet1994 Rue de Turqui Tunis
9 ATB 12 Juillet1994 9 Rue Hdi Nouira - Tunis
10 BFT 12 Juillet1994 24- 26 Place 7 Novembre - Tunis
11 UIB 12 Juillet1994 Av Bourguiba - Tunis
12 BTS 4 Juin 1998 Av Med V - Tunis
2.2.2 Les activits industrielles et de services : FOPRODI et le dveloppement
rgional
Objet du FOPRODI : Les objectifs du FOPRODI se rsument comme suit : Favoriser la
promotion des entrepreneurs ; Encourager la cration et le dveloppement des petites et
moyennes entreprises ; Mise en uvre des mesures dincitation la dcentralisation des
investissements dans le domaine industriel.
Formes dinterventions du FOPRODI :
1- Pour les nouveaux promoteurs :
Participation au capital conformment au schma suivant :
CUIES Universit de Sfax 78/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Pour la premire tranche de linvestissement jusqu un Million de Dinars, le montant de la
participation au capital ne doit pas dpasser 45% du capital minimum, le promoteur devant
justifier dun apport personnel au moins gal 10% du capital et dune participation dune
SICAR ;
Pour le reliquat de linvestissement et jusqu 5 millions de dinars, le montant de la
participation au capital est limit 20% du capital minimum additionnel, le promoteur
devant justifier dun apport personnel au moins gal 20% du capital additionnel et dune
participation dune SICAR ;
La participation impute sur les ressources du FOPRODI ne peut tre octroye que dans le
cas ou le projet comporte une participation dune SICAR et est aligne sur celle ci. Cette
participation est rtrocde en faveur des bnficiaires au nominal major de 3% lan, et
ce, dans un dlai maximum de 12 ans.
Une prime dinvestissement fixe 10% du cot des quipements avec un plafond de
100000 dinars ;
Une prime dtude et dassistance technique fixe 70% du cot des tudes et de
lassistance technique avec un plafond de 20 000 dinars ;
Une prise en charge par lEtat de 1/3 du prix des terrains ou des locaux ncessaires aux
projets, acquis auprs de damnageurs dment agres, avec un plafonds de 30 000 dinars.
2- Pour la petite et moyenne entreprise :
Participation au capital conformment aux schmas suivant :
Pour la premire tranche de linvestissement et jusqu 1 million de dinars, la participation
impute sur les ressources du FOPRODI ne doit pas dpasser 30% du capital minimum ;
pour le reliquat de linvestissement et jusqu 3 millions de dinars, la participation du
FOPRODI ne doit pas dpasser 10% du capital additionnel minimum.
Une prime dtude et dassistance technique reprsentant 70% du cot global de ltude et
de lassistance technique plafonne 20 000 dinars.
Bnficiaires :
1- Pour les nouveaux promoteurs : Les personnes physiques de nationalit tunisienne,
regroupes ou non en socit, et qui ne disposent pas suffisamment de bien propres
mobiliers ou immobiliers et qui ralisent leur premier projet dinvestissement.
2- Pour la petite et moyenne entreprise :
Les investissements de cration raliss par les PME industrielles et de services dont le
total ne dpasse pas trois millions de dinars et les investissements dextension, condition
que linvestissement global de lentreprise, y compris les immobilisations nettes, ne
dpasse pas trois millions de dinars ;
Les entreprises initialement finances dans le cadre de lencouragement des nouveaux
promoteurs ou du Fond National de Promotion de lArtisanat et des Petits Mtiers
demeurant ligibles au concours du FOPRODI au titre de leurs investissements
dextensions.
Conditions de bnfice des avantages du fonds : concernent aussi bien les nouveaux
promoteurs que les petites et moyennes entreprises.
Le montant de linvestissement ne doit pas dpasser 5 MD ;
CUIES Universit de Sfax 79/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
Le projet doit comporter un schma de financement comme suit : 30% fonds propres ; 70%
crdits bancaires.
Organisme gestionnaire :
Pour une mise en uvre adquate des interventions du FOPRODI, le Ministre des Finances
a confi la gestion dudit Fonds aux banques et SICAR suivantes :
LISTE DES BANQUES CONVENTIONNEES
N BANQUES DATE DE SIGNATURE ADRESSE / SIEGE
1 STB 15 Aot 1994 Rue Hdi NOUIRA Tunis
2 BNA 15 Aot 1994 Rue Hdi NOUIRA Tunis
3 BIAT 15 Aot 1994 70-72 Av. BOURGUIBA Tunis
4 AB 6 Septembre 1994 Av. Mohamed V Tunis
5 BS 23 Aot 1994 95, Avenu de la libert Tunis
6 BDET 15 Aot 1994 Rue Hdi karay - Ariana Tunis
7 BH 15 Aot 1994 Av. Kheireddine BACHA - Tunis
8 BT 15 Aot 1994 Rue de Turqui Tunis
9 UBCI 13 Juillet 1994 139, Avenu de la libert Tunis
10 UIB 15 Aot 1994 Av. BOURGUIBA - Tunis
CUIES Universit de Sfax 80/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
LISTES DES SICAR CONVENTIONNEES
DATE DE
N SICAR ADRESSE DU SIEGE
SIGNATURE
Socit dInvestissement Capital
1 8 Juillet 1999 Rue Hdi Nouira Tunis
Risque du groupe STB ( STB SICAR)
Socit dInvestissement et de
2 Dveloppement du Centre-Ouest 8 Juillet 1999 70, Av. de la Libert Tunis
(SIDCO)
Socit dInvestissement et de
3 8 Juillet 1999 70, Av. de la Libert Tunis
Dveloppement du Sud (SODIS)
4 Maghrbia Financire SICAR 8 Juillet 1999 9, Rue de lArtisanat Tunis
Compagnie Tunisienne
5 dInvestissement et de Financement 8 Juillet 1999 12, Av. Habib THAMEUR Tunis
(COTIF-SICAR)
6 SICAR INVEST 8 Juillet 1999 Rue Hdi Nouira Tunis
Socit de Participation et de
7 8 Juillet 1999 139, Av. de la Libert Tunis
Promotion des Investissements (SPPI)
Socit de Dveloppement
Av. Sufetula - Cit Ezzouhour
8 Economique au Kasserine (SODEK - 8 Juillet 1999
Kasserine
SICAR)
Socit dInvestissement Moderne
9 8 Juillet 1999 24, Av. Kheireddine PACHA Tunis
(SIM SICAR)
Fonds de reconversion et de
10 27 Juillet 1994 8, Rue du Nil 2100 Gafsa
dveloppement des centres Miniers
11 SUD - SICAR 8 Juillet 1999 116, Av. de la libert Tunis
Socit de dveloppement et
12 dinvestissement du NORD-OUEST 8 Juillet 1999 70, Av. de la libert Tunis
(SODINO)
13 SICAR AMEN 1 Novembre 1999 Av. Mohamed V Tunis
14 TUNIVEST - SICAR 8 Juillet 1999 147, Av. de la libert Tunis
Union mditerranenne
15 27 Dcembre 1999 139, Av. de la libert Tunis
dinvestissement
Socit de dveloppement et
16 dinvestissement du CAP-BON 19 Juin 2000 Imm. La Jarre 8000 Nabeul
(SODICAB)
17 International SICAR 19 Juin 2000 65, Av. Habib BOURGUIBA Tunis
CUIES Universit de Sfax 81/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
2.2.3 Le Rgime dIncitation lInnovation dans les Technologies de lInformation
(RITI)
Lentreprise bnficie de lintervention du RITI sur la base dune participation aux fonds
propres. Cette intervention est conditionne par limplication dune socit
dinvestissement capital risque (SICAR).
Lintervention du RITI peut tre pour un projet de cration ou dextension dont
linvestissement ne dpasse pas 500.000 dinars.
Compte tenu du caractre des projets concerns par le RITI, le financement doit tre au
moins 50% en fonds propres. Lintervention du RITI ne peut excder 120.000 dinars. Le
promoteur doit justifier dun apport personnel au moins gal 2%.
La participation de socits ou personnes physiques (tunisiennes ou trangres) au projet
est possible, mais la cession de la participation du RITI ne peut se faire titre prfrentiel
quau profit du promoteur du projet.
2.2.4 Les Socits dInvestissement Capital Risque (SICAR)
Les SICAR interviennent au moyen de la souscription ou de lacquisition dactions ou des
parts sociales, et dune faon gnrale de toutes les autres catgories assimiles des fonds
propres.
Les participations des SICAR doivent faire lobjet de conventions avec les promoteurs
fixant les dlais et modalits de ralisation des rtrocessions.
Les participations ne doivent pas constituer la majorit du capital.
Participation aux fonds propres pour leur compte ou le compte des autres dans le but de
financement de linvestissement pour lencouragement de nouveaux promoteurs ou les
entreprises dans les ZDRP.
Les SICAR participent galement laugmentation des fonds propres des entreprises en
difficults conomiques et bnficiant des mesures de redressement, ainsi que les
entreprises innovatrices.
22 SICARs sont conventionnes pour la gestion du FOPRODI.
2.2.5 Les socits octroyant des crdits dinvestissement
2.2.5.1 Banque Tunisienne de Solidarit (BTS)
Bnficiaires : les personnes physiques diplmes de lenseignement suprieur, ou de
formation professionnelle, la recherche dune rinsertion dans le cadre de la
restructuration de lconomie nationale.
Crdit maximum : 15mD et peuvent atteindre 80mD pour les diplms de lenseignement
suprieur.
Modalits dintervention : la BTS accorde des crdits court et moyen terme en
pratiquant un taux dintrt prfrentiel de 5% maximum lan.
Dlais de remboursement : de 6 mois 7 ans.
Dlais de grce : de 3 mois 1 an.
CUIES Universit de Sfax 82/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
2.2.5.2 La Banque de Financement des PME (BFPME)
Bnficiaires :
Les entreprises projetant une extension
Les PME adjudicataires dun march public
Investissement maximum de 80 mD 5 MD
A lexception des projets dans le secteur touristique, la promotion immobilire et la
spculation foncire.
Modalits dintervention
Lintervention de la banque est plafonne 1MD
Octroi des crdits moyen et long terme en cofinancement avec dautres institutions
financires :
Moyen terme : De 5 7 ans TMM + 2.75% allant 3.25%
Long terme : De 7 10 ans TMM + 3.5% allant 4%
Participation, limite, au capital des entreprises cres, ou dj existantes, en partenariat
avec les SICAR.
Avances accordes aux PME adjudicataires dun march public.
Systme bancaire : il couvre les autres banques et qui est dispos daccorder toutes formes
de crdits et de prendre des participations.
2.2.5.3 Autres Etablissements financiers
* Socits de factoring :
Grer au moyen de techniques de gestion financire appropries les comptes clients
en acqurant leurs crances.
Assurer le recouvrement de ces crances pour son propre compte.
* Leasing
Le leasing est un moyen de financement autre que les crdits bancaires, il seffectue par un
contrat crit, pour une dure dtermine en change dun loyer et permet au preneur :
La location des quipements, de matriel ou de biens immobiliers achets ou raliss
en vue de la location par le bailleur qui en demeure propritaire.
La possibilit dacquisition par le preneur, lexpiration de la dure de la location,
de tout ou partie des quipements, du matriel ou de biens immobiliers moyennant
un prix convenu.
2.2.6 Les socits de Garanties
2.2.6.1 La Socit Tunisienne de Garantie (SOTUGAR)
Bnficiaires : Les industries manufacturires, les services informatiques, les projets
bnficiant des concours du RITI dont le cot dinvestissement est situ entre 50mD et
5MD, ainsi que les Fonds Communs de Placement capital risque et les Fonds
damorage.
Modalits dintervention
Partage des risques :
75% Zones de Dveloppement Rgional
CUIES Universit de Sfax 83/84
Support pdagogique du module : Cration dEntreprises Version 1.2 Septembre 2008
60% Les autres zones.
Prise en charge :
75% Zones de Dveloppement Rgional
50% Les autres zones.
2.2.6.2 Le Fonds National de Garantie (FNG)
Objet du FNG : cest de garantir le dnouement de certaines catgories de prts consentis
par les banques sur leurs ressources ordinaires, ou demprunts en faveur des petites et
moyennes units conomiques ainsi que certaines catgories de participations ralises par
les SICAR dans les PME, et aussi les micro-crdits accords par les associations.
Crdits et Participations ligibles :
Crdits court, moyen et long terme accords en faveur des petits et moyens
agriculteurs et pcheurs
Crdits accords dans le cadre du FONAPRAM, du FOPRODI et du RITI
Les participations accordes dans le cadre du FOPRODI et du RITI
Autres types de crdits (Prfinancement export, culture saisonnire)
Modalits dintervention
La prise en charge des intrts dcoulant des montants impays en principal des crdits
dclars au Fonds et dune proportion allant de 50% 90% des crdits et des participations
irrcouvrables.
La prise en charge des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crdits et
dune proportion de rendement sur les participations ainsi que de la totalit des intrts
dcoulant du rchelonnement des crdits.
Ressources du FNG :
Une commission de garantie de 5/16 de point prleve par les banques sur les
dcouverts bancaires ;
La contribution des bnficiaires des crdits, dtermine comme suit :
3% flat du montant du crdit accord aux petites et moyennes entreprises
travaillant dans le secteur des industries manufacturires et dans les services
ligibles aux concours du FOPRODI ;
1.5% flat du montant du crdit qui a reu laval de la Socit de Caution Mutuelle
Agricole laquelle adhre le bnficiaire du crdit ;
2% flat du montant du crdit pour les autres crdits ligibles la garantie du FNG.
La SICAR doit payer au titre de la participation quelle dclare la garantie du FNG, un
montant gal 3% flat de ladite participation.
CUIES Universit de Sfax 84/84
Vous aimerez peut-être aussi
- 3AP - Contrôle N°2 - Exercices ÉcritsDocument1 page3AP - Contrôle N°2 - Exercices ÉcritsAdilKnightPas encore d'évaluation
- Rapport SoutenanceDocument41 pagesRapport SoutenanceJustin BOBOPas encore d'évaluation
- FormationSW2007 09-10Document53 pagesFormationSW2007 09-10فدوى غانيPas encore d'évaluation
- Résumé Des AOPDocument2 pagesRésumé Des AOPفدوى غاني100% (3)
- La Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerD'EverandLa Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Module 2-Faisabilit Du ProjetDocument58 pagesModule 2-Faisabilit Du ProjetItto MohaPas encore d'évaluation
- Cours de CréationDocument10 pagesCours de Créationcoordinateurlpa coordinateurlpaPas encore d'évaluation
- Rapport Finale PDFDocument49 pagesRapport Finale PDFAhlem ChebelPas encore d'évaluation
- andrianariberaHarimbolaS GES M1 07Document102 pagesandrianariberaHarimbolaS GES M1 07Allouane MohamedPas encore d'évaluation
- Dossier Projet Personnel PDFDocument12 pagesDossier Projet Personnel PDFHhhPas encore d'évaluation
- Conception Et Réalisation D'une Plateforme Web Et Mobile de Gestion Des AbsencesDocument65 pagesConception Et Réalisation D'une Plateforme Web Et Mobile de Gestion Des AbsencesBachar Ben SlemaPas encore d'évaluation
- Cours 2 Conception D'usineDocument29 pagesCours 2 Conception D'usinemarzoukPas encore d'évaluation
- Entr Pre Unari atDocument3 pagesEntr Pre Unari atRokaya JawadPas encore d'évaluation
- Chap 11 Exercices Corriges 5emeDocument11 pagesChap 11 Exercices Corriges 5emeChaoubi YoussefPas encore d'évaluation
- Td14 Estimation CorrigeDocument8 pagesTd14 Estimation CorrigeMonumento ChePas encore d'évaluation
- Rapport de Stage OuvrierDocument29 pagesRapport de Stage OuvrierabdelmoughitPas encore d'évaluation
- Document STDocument80 pagesDocument STMehdi HammaniPas encore d'évaluation
- Le Tourisme en Tunisie (Cours Et Annexes, 01072015VD) 2Document129 pagesLe Tourisme en Tunisie (Cours Et Annexes, 01072015VD) 2Aymen Kamergi100% (1)
- Guide Du Candidat CN2023Document63 pagesGuide Du Candidat CN2023Wissem LatrachPas encore d'évaluation
- FICHE D'EVALUATION Du RAPPORT TECHNIQUEFiche Appreciationv2Document5 pagesFICHE D'EVALUATION Du RAPPORT TECHNIQUEFiche Appreciationv2Anass Ait BenhaPas encore d'évaluation
- Ec - GMP341 - Creation Entreprise - MangaDocument55 pagesEc - GMP341 - Creation Entreprise - MangaYannick AtsinaPas encore d'évaluation
- Ms ELN Zergot+Douibi+Charik PDFDocument62 pagesMs ELN Zergot+Douibi+Charik PDFEL Mansour BrahimPas encore d'évaluation
- Guide-Mémoire ISG 20211Document4 pagesGuide-Mémoire ISG 20211Faycel SekrafiPas encore d'évaluation
- Etude de Cas Cellule de Veille 170323145711Document30 pagesEtude de Cas Cellule de Veille 170323145711Kholoud LachhabPas encore d'évaluation
- Création Dun ProjetDocument15 pagesCréation Dun ProjetOMG oUSsaMa 111Pas encore d'évaluation
- Cahier de Chages Guide Touristique GLODocument23 pagesCahier de Chages Guide Touristique GLOsurfer mbockPas encore d'évaluation
- Rapport PFE DesignThinkingDocument66 pagesRapport PFE DesignThinkingRanya SoudanaPas encore d'évaluation
- EchantillonageDocument2 pagesEchantillonageOthmane Bén100% (2)
- Genie Informatique Pfe FinalDocument21 pagesGenie Informatique Pfe FinalKhadija IdbabaPas encore d'évaluation
- Sahli Souha F5 1657103614Document38 pagesSahli Souha F5 16571036143aslemaa2Pas encore d'évaluation
- PfaDocument5 pagesPfamouhamed hmidetPas encore d'évaluation
- Fiche Affectation Stage D'été 2021Document1 pageFiche Affectation Stage D'été 2021D IMPas encore d'évaluation
- m11 Topographie 2-Approfondissement BTP-TSGT PDFDocument221 pagesm11 Topographie 2-Approfondissement BTP-TSGT PDFFayçal El100% (1)
- PfepfeDocument129 pagesPfepfe3aslemaa2Pas encore d'évaluation
- Demande de CotationDocument14 pagesDemande de CotationAbdoul Fatao DabrePas encore d'évaluation
- Rapport de Projet FinalDocument44 pagesRapport de Projet FinalSLIMANE ARBAOUIPas encore d'évaluation
- Rapport 2Document16 pagesRapport 2Ayoub TarhouchiPas encore d'évaluation
- Etude de Cas HopitalDocument24 pagesEtude de Cas HopitalTúlio MraPas encore d'évaluation
- FinaleDocument109 pagesFinaleMed Aminn H'mPas encore d'évaluation
- PFE Rapport de Projet de Fin D'étude 105Document81 pagesPFE Rapport de Projet de Fin D'étude 105phone shopPas encore d'évaluation
- KadhemfinalpfeDocument101 pagesKadhemfinalpfemeriam issamiPas encore d'évaluation
- Fiche de PosteDocument2 pagesFiche de PosteMOUMOUNI AZIA NafissatouPas encore d'évaluation
- Procuration Pour Retrait DiplômeDocument1 pageProcuration Pour Retrait DiplômeAnass TchenchanaPas encore d'évaluation
- Fiches de Projets Des Communes TunisiennesDocument14 pagesFiches de Projets Des Communes Tunisiennesnessrine charfiPas encore d'évaluation
- Pfe PDFDocument72 pagesPfe PDFJalal RamiPas encore d'évaluation
- Sig IDocument8 pagesSig Iسعيد سعيدPas encore d'évaluation
- AutocadDocument8 pagesAutocadabou_rim0% (1)
- Exam RegiioDocument40 pagesExam RegiioKhalil ThePianistPas encore d'évaluation
- Gestion Industrielle Techniques de Planification Des Besoins OUTIL MRP PDFDocument39 pagesGestion Industrielle Techniques de Planification Des Besoins OUTIL MRP PDFnarimenePas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges (Exemple de Proposition Commerciale Pour Un Site Internet Vitrine)Document11 pagesCahier Des Charges (Exemple de Proposition Commerciale Pour Un Site Internet Vitrine)BenjiPas encore d'évaluation
- Cours Systèmes Informatiques de Géolocalisation 2021 - CopieDocument36 pagesCours Systèmes Informatiques de Géolocalisation 2021 - CopieHANS AKAPas encore d'évaluation
- Journal de StageDocument17 pagesJournal de StageGhaya Ben HamadouPas encore d'évaluation
- Conception Et Réalisation D'un Mini DroneDocument71 pagesConception Et Réalisation D'un Mini DroneSamar ghPas encore d'évaluation
- Amghar, Abdenour Elhaddad, Adel PDFDocument74 pagesAmghar, Abdenour Elhaddad, Adel PDFyeoi ganamPas encore d'évaluation
- Amari Hakim ADocument117 pagesAmari Hakim ANada YnsPas encore d'évaluation
- WEB-C3-Un Sou Au Souk - Le Materiel Du CouturierDocument2 pagesWEB-C3-Un Sou Au Souk - Le Materiel Du CouturieradnenePas encore d'évaluation
- MemoireDocument12 pagesMemoirevariety jonesPas encore d'évaluation
- Analyse de La Contribution Du PCDC Dans La Commune GasorweDocument54 pagesAnalyse de La Contribution Du PCDC Dans La Commune GasorweNTAKIRUTIMANA Jean BoscoPas encore d'évaluation
- Rapport d'activité 2017 de la Banque européenne d'investissement: Un impact qui façonne l'avenirD'EverandRapport d'activité 2017 de la Banque européenne d'investissement: Un impact qui façonne l'avenirPas encore d'évaluation
- 2 - Support Du Module Creation DEntreprises 1.2Document84 pages2 - Support Du Module Creation DEntreprises 1.2ontt2010Pas encore d'évaluation
- 2 - Support Du Module Creation DEntreprises 1.2Document84 pages2 - Support Du Module Creation DEntreprises 1.2imane gadanPas encore d'évaluation
- Projet EntrepreneurialDocument33 pagesProjet Entrepreneurialmohamed.hachimi2904Pas encore d'évaluation
- Asservissement PDFDocument69 pagesAsservissement PDFفدوى غانيPas encore d'évaluation
- 02 AeroglisseurDocument2 pages02 Aeroglisseurفدوى غانيPas encore d'évaluation
- Chap 1 Liaisons ProfDocument4 pagesChap 1 Liaisons Profفدوى غانيPas encore d'évaluation
- GRAFCET Cours PDFDocument8 pagesGRAFCET Cours PDFفدوى غانيPas encore d'évaluation
- Initiation Simulation AnalogiqueDocument6 pagesInitiation Simulation Analogiqueفدوى غانيPas encore d'évaluation
- Etude Du Microcontrleur Pic16f84 160919133655Document72 pagesEtude Du Microcontrleur Pic16f84 160919133655فدوى غانيPas encore d'évaluation
- 6 TP BARIERRE PARKING PDFDocument37 pages6 TP BARIERRE PARKING PDFفدوى غاني100% (2)
- Outilsdanalysefonctionnellesadt 160919140831Document31 pagesOutilsdanalysefonctionnellesadt 160919140831فدوى غانيPas encore d'évaluation
- Raps at Genya GerardDocument10 pagesRaps at Genya Gerardفدوى غانيPas encore d'évaluation
- Analyse Fonct Elev2014Document32 pagesAnalyse Fonct Elev2014فدوى غاني0% (1)
- Maintenance 8 ReglesDocument12 pagesMaintenance 8 Reglesفدوى غاني100% (1)
- Correction A PCH 11 ErDocument10 pagesCorrection A PCH 11 Erفدوى غانيPas encore d'évaluation
- Correction A PCH 41 ErDocument16 pagesCorrection A PCH 41 Erفدوى غانيPas encore d'évaluation
- Microcontrôleurs PIC: (Cas Du 16f628)Document18 pagesMicrocontrôleurs PIC: (Cas Du 16f628)فدوى غانيPas encore d'évaluation
- CO GrafcetDocument7 pagesCO Grafcetفدوى غانيPas encore d'évaluation
- Microcontrôleurs PIC: (Cas Du 16f628)Document18 pagesMicrocontrôleurs PIC: (Cas Du 16f628)فدوى غانيPas encore d'évaluation