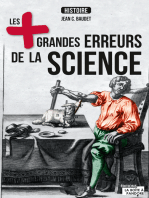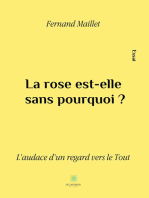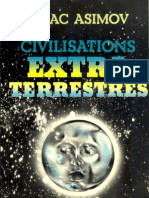Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
L'Origine de La Croyance - Albert Piette - Dissonances, 2013 - Berg International - 9782917191859 - Anna's Archive
Transféré par
Faiz AbdelhamidTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
L'Origine de La Croyance - Albert Piette - Dissonances, 2013 - Berg International - 9782917191859 - Anna's Archive
Transféré par
Faiz AbdelhamidDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
CROIRE.indd 1 22/02/13 11:29:59
albert piette - l'origine de la croyance
CROIRE.indd 2 22/02/13 11:30:01
L'ORIGINE DE LA CROYANCE
CROIRE.indd 3 22/02/13 11:30:01
albert piette - l'origine de la croyance
ouvrages du même auteur
Les Jeux de la fête, Paris, Publications de la Sorbonne, 1988.
Le Mode mineur de la réalité. Paradoxes et photographies en anthropologie,
Louvain, Peeters, 1992.
Les Religiosités séculières, Paris, Presses Universitaires de France, 1993.
Ethnographie de l’action. L’observation des détails, Paris, Métailié, 1996.
La Religion de près. L’activité religieuse en train de se faire, Paris, Métailié, 1999.
Le Fait religieux. Une théorie de la religion ordinaire, Paris, Économica, 2003.
Le Temps du deuil. Essai d’anthropologie existentielle, Paris, L’Atelier, 2005.
L’Acte d’exister. Une phénoménographie de la présence, Charleroi, Socrate Éditions,
2009.
Anthropologie existentiale, Paris, Pétra, 2009.
Propositions anthropologiques, Paris, Pétra, 2010.
Fondements à une anthropologie des hommes, Paris, Hermann, 2011.
De l'ontologie en anthropologie, Paris, Berg International, 2012.
© 2013, Berg International éditeurs
129 bd Saint-Michel, 75005 Paris
ISBN : 978-2-917191-85-9
www.berg-international.fr
CROIRE.indd 4 22/02/13 11:30:01
Albert Piette
L’origine
de la croyance
« Dissonances »
Collection dirigée par Sébastien Schehr
BERG INTERNATIONAL
5
CROIRE.indd 5 22/02/13 11:30:01
albert piette - l'origine de la croyance
CROIRE.indd 6 22/02/13 11:30:02
INTRODUCTION
« Morte pour la Beauté – je venais à peine
D’être ajustée dans la Tombe
Qu’on a couché Quelqu’un mort pour la Vérité
Dans une Chambre voisine –
[…]
Ainsi, comme des Parents, un Soir réunis –
Nous avons papoté d’une Chambre à l’autre –
Jusqu’à ce que la Mousse ait atteint nos lèvres –
Et recouvert – nos noms » (Emily Dickinson)
« L’ontoanthropologie s’interroge sur les deux à la fois : sur
l’extase humaine, qui porte le nom d’être dans le monde, et
sur l’ancien animal qui a connu ce devenir-extatique »1
« Avoir une conscience toujours en éveil, redéfinir sans cesse son rapport
au monde, vivre dans la perpétuelle tension de la connaissance, cela revient à
être perdu pour la vie. Le savoir est un fléau, et la conscience une plaie ouverte
au cœur de la vie »2 . Des pensées m’interpellent régulièrement à ce sujet. Mais
rarement vives. Parfois. Les hommes le savent et ne le savent pas vraiment : qu’ils
courent, qu’ils marchent, qu’ils parlent, qu’ils discutent, qu’ils se disputent, qu’ils
continuent sans s’arrêter, qu’ils ne s’arrêtent pas. Et pourtant ils le savent, ils en
possèdent le potentiel réflexif, même les moins instruits et les moins intelligents.
Même les très surdoués n’arrivent pas à arrêter de continuer, à penser vraiment
qu’ils vont mourir. C’est là que réside l’exception humaine : le savoir et le garder
en toile, plus ou moins lointaine, de fond. Et Pascal le dit : « Qu’une chose aussi
visible qu’est la vanité du monde soit si peu connue, que ce soit une chose étrange
et surprenante de dire que c’est une sottise de chercher les grandeurs, cela est
admirable »3 !
1
P. Sloterdijk, La Domestication de l’ être, Paris, Mille et une nuits, 2000, pp. 27-28.
2
E. Cioran, Sur les cimes du désespoir, Paris, Le Livre de poche, (1934), 2007, p. 50.
3
B. Pascal, Pensées, Paris, Garnier-Flammarion, (1670), 1976, p. 95.
CROIRE.indd 7 22/02/13 11:30:02
albert piette - l'origine de la croyance
Mais pourquoi ? Je risque une hypothèse : l’Homme moderne, disons
Homo sapiens, est le seul à savoir et à le supporter. Les autres espèces animales
ne le savent pas. Sauf – c’est l’hypothèse – l’Homme de Neandertal qui savait,
enterrait ses morts, mais ne croyait pas en l’existence de choses incroyables. Ce
n’est pas que celles-ci consolent et aident à continuer. Mais que l’acte de croire
aux incroyables a appris à l’homme, Homo sapiens, à inventer, à gérer et à garder
ce « flou cognitif » : ne pas penser que c’est incroyable, ne pas y penser, le
laisser là, en toile de fond. Une nouvelle aptitude cognitive, surgie à partir de la
« croyance » aux idées religieuses et étendue progressivement à l’ensemble des
choses de la vie pour devenir une spécificité anthropologique. C’est l’aptitude
majeure des Homo sapiens : être minimal, ou plutôt : ne pas être maximal. Et si
donc le Néandertalien avait su trop, n’avait pas eu le déclic cognitif de croire, de
ne pas aller jusqu’au bout, d’amortir, de voiler, de ne pas « voir ». L’« extase » par
excellence ! L’hypothèse présente-t-elle quelque plausibilité, elle invite alors à une
interrogation : comment apprendre à l’homme à mieux savoir, à mieux penser, à
ne pas trop oublier, mais sans trop penser, sans trop savoir, être confronté. Entre
l’Homme de Neandertal et Homo sapiens, ce serait donc l’histoire, cognitive et
existentiale, d’un « voilement », l’histoire qui va du premier penseur au premier
croyant. Une évolution qu’il est possible de retracer à partir des documents laissés
par l’archéologie et les interprétations des préhistoriens.
Il serait absurde de chercher dans les lignes de l’évolution des espèces un
moment précis au cours duquel des êtres qualifiés rétrospectivement d’humains
ont commencé dans un espace spécifique à avoir une vie sociale. Les chimpanzés,
observés aujourd’hui par les primatologues, reconnaissent leurs parents, leurs
alliés, leurs ennemis, pratiquent des échanges sociaux et il n’est pas risqué de
penser que les « ancêtres », communs aux hommes et aux chimpanzés, le
faisaient déjà il y a sept ou huit millions d’années, avant qu’en Afrique certains
d’entre eux commencent à s’isoler et à se reproduire, étant ainsi à la base de ce qui
sera plus tard considéré comme de nouvelles lignées. Alliance, échange, empathie,
réconciliation, technique, ce seraient donc des capacités et des comportements
qu’ont emportés avec eux ces êtres qui, sans le savoir, allaient faire diverger les
lignes de l’évolution de la vie. Contrairement à de nombreux scénarios sur les
origines, il n’y a donc pas un moment fondateur par lequel des êtres sont devenus
des hommes en pratiquant une vie sociale. Il n’y a pas eu une première fois, la
société !
Faisons le pari qu’il y a eu une première fois un homme en train de croire,
en train de se dire : « Et si c’était vrai ? ». Cette capacité, aujourd’hui partagée
par tous les humains, peut difficilement être attribuée aux chimpanzés ou aux
gorilles… Il y a bien eu une première fois un être qui a cru, qui a perçu qu’il croyait
à quelque chose d’incroyable. L’a-t-il raconté à d’autres ? L’a-t-il partagé avec
d’autres lorsqu’il a renouvelé, quatre, cinq ou six fois ce type d’expériences ?
Et très probablement, une expérience analogue, dans le fond toute simple,
a pu avoir lieu mille ans plus tôt, à deux cents kilomètres plus au sud… Ceux à
CROIRE.indd 8 22/02/13 11:30:02
introduction
qui ces êtres ont réussi à transmettre leurs expériences de croire vont peut-être
se rencontrer au cours d’un déplacement saisonnier. Ils échangent alors sur un
contenu de croyance, ils confirment, ils nuancent. Ils continuent à transmettre
plus ou moins. Et ainsi de suite, ils font d’autres échanges, d’autres expériences
de croire, essaient de transmettre, de stabiliser, peut-être aussi. Retournons aux
premières traces archéologiques de ces moments de croire pour tenter d’imaginer
ces premières fois, en les mettant en parallèle avec les opérations cognitives qu’elles
supposent. Nous sommes il y a 100 000 ans, dans les ossements et les squelettes
du Paléolithique moyen, dans les sépultures, peut-être même avec des offrandes.
Il y a Homo sapiens, l’Homme moderne en Afrique et au Proche-Orient. Il y a
en Europe et aussi au Proche-Orient, l’Homme de Neandertal. Les deux types
existent, déjà depuis longtemps, plus encore pour les Néandertaliens. La mort,
le corps mort, le cadavre constituent les indices les moins impalpables à partir
desquels nous pouvons imaginer la naissance de la croyance.
Des préhistoriens, des paléontologues, des anthropologues partagent un
intérêt pour cette longue période de la préhistoire, les uns à partir d’indices de
sépultures, les autres à partir des opérations cognitives supposées par l’acte de
croire et de ses avantages évolutionnaires. Peu de chercheurs associent d’ailleurs
les deux démarches, en faisant correspondre les traces archéologiques sur la longue
durée et les opérations cognitives1. Et se glissant dans les études spécialisées, des
travaux de synthèse reprennent, transforment, décontextualisent les données
originelles, les alimentant avec des comparaisons ethnographiques et associant,
ainsi sur le mode de la surinterprétation, le moindre os de bovidé à une croyance
à l’au-delà. Souvent conseillée, la prudence analytique face à la maigreur des
faits vraiment indiscutables s’impose, avant de justifier la nature religieuse de
l’homme et sa disposition aux interrogations métaphysiques2 . C’est le contraire
qui s’impose : la croyance est récente.
Tentons de trouver quelque cohérence dans les restes des restes, les sépultures
du Paléolithique moyen, avec leurs squelettes souvent incomplets et les objets
qui les accompagnent. Suivons la naissance de l’acte de croire tel qu’il peut se
laisser appréhender à partir des différentes formes de présence du mort. Peut-
être y trouverons-nous la clé, une des clés de l’acte humain d’exister, dans lequel
l’homme n’arrive pas à être vraiment lucide, à voir « si » clair, celle aussi par
laquelle il voile tellement qu’il en oublie de prendre distance.
Pourquoi donc je suis comme je suis, et ainsi les autres humains ? Ce livre
n’est qu’une hypothèse : si c’était vrai !
1
Cf. S. Mithen, The Prehistory of the Mind, London, Thames and Huston, 1996.
2
A. Leroi-Gourhan, Les Religions de la préhistoire, Paris, puf, 1964.
CROIRE.indd 9 22/02/13 11:30:03
albert piette - l'origine de la croyance
10
CROIRE.indd 10 22/02/13 11:30:03
LE PREMIER CROYANT
« Que mes Lecteurs ne s’imaginent donc pas que j’ose
me flatter d’avoir vû ce qui me paroit si difficile à voir. J’ai
commencé quelques raisonnements ; j’ai hasardé quelques
conjectures, moins dans l’espoir de résoudre la question
que dans l’intention de l’éclaircir et de la réduire à son véri-
table état. D’autres pourront aisément aller plus loin dans
la même route, sans qu’il soit facile à personne d’arriver au
terme » 1
Qu’apprend l’observation d’un singe ou d’un grand singe face au cadavre d’un
de ses partenaires de vie ? Que retenir par exemple du gorille qui hurle, frappe
sa poitrine devant le corps immobilisé de sa compagne et place dans sa main
un morceau de sa nourriture préférée ? Une forte émotion sans doute devant
la longue immobilité et l’absence de réaction mais aussi la non-perception de
l’état de mort qu’il ne distinguerait pas d’un état non réactif de vie. C’est ainsi
que le geste alimentaire du gorille peut être interprété. Après une longue attente
à côté du corps inanimé, il arrive que le babouin, par exemple, se rapproche de
ses compagnons comme si, note Bekoff 2 , l’intensité des contacts sociaux avec
ceux-ci, en particulier de l’épouillage, diminuait la pression émotionnelle. Après
des tentatives de faire vivre le corps, l’animal reste près de celui-ci. Il le regarde,
non comme s’il vivait sur le mode du comme si, mais pensant qu’il vit. Il peut
aussi s’isoler du groupe, avant de mourir, sans s’être nourri. Le chagrin comme
émotion partagée par de nombreuses espèces vivantes fait place à l’échec de vivre
et d’interagir avec le cadavre.
Sans capacité de différenciation d’un corps mort et d’un corps vivant, il n’est
pas étonnant alors que l’animal tente de relever ou même d’animer le corps.
Cette absence de différenciation entre mort et repos ou entre mort ou simple
absence, nous la retrouvons aussi chez les chimpanzés décrits par Jane Goodall :
« Nous ne permîmes à aucun chimpanzé de voir son cadavre et il nous sembla
1
J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’ inégalité parmi les hommes, Paris,
Gallimard, (1750-1755), 1965, p. 33.
2
M. Bekoff, The Emotional Lives of Animals, Novato, New World Library, 2007, pp. 62-67.
11
CROIRE.indd 11 22/02/13 11:30:03
albert piette - l'origine de la croyance
que, longtemps, Humphrey ne se rendit pas compte qu’il ne reverrait plus son
vieil ami. Pendant près de six mois, il revint régulièrement sur le site où Mc
Gregor avait passé les derniers jours de sa vie ; il s’asseyait en haut d’un arbre, il
regardait dans toutes les directions, il attendait, il écoutait. Il se joignait rarement
aux autres chimpanzés quand ils partaient ensemble pour une vallée éloignée ;
quelquefois il faisait un bout de chemin avec tel ou tel groupe mais, un peu plus
tard, nous le voyions revenir, et il s’asseyait ; il scrutait la vallée de tous ses yeux
dans l’espoir d’apercevoir de nouveau le vieux Mc Gregor et d’entendre encore la
voix grave, stridente, si semblable à la sienne, qui s’était tue pour toujours »1.
Mais la célèbre primatologue fait aussi une autre observation : « Le changement
subit et complet qui s’opéra dans les manières de Olly vis-à-vis de son bébé me
stupéfia. J’avais déjà vu une jeune mère inexpérimentée porter le cadavre de son
bébé et, au lendemain de sa mort, le tenir comme s’il vivait encore, niché contre
sa poitrine. Mais Olly quitta l’arbre avec son dernier-né dans une main, et quand
elle se retrouva à terre, jeta négligemment le petit corps flasque sur son épaule.
C’était à croire qu’elle le savait mort. Peut-être était-ce parce qu’il ne bougeait et
ne criait plus que ses instincts maternels s’étaient assoupis ». Ce qui n’empêche
pas Gilka, une jeune chimpanzé, d’associer le cadavre à « l’occasion de jouer avec
son demi-frère »2 . Ainsi, dans l’attitude d’Olly, s’impose la constatation de sa
capacité de reconnaître la différence entre le corps malade à protéger et le cadavre
négligé comme une simple chose.
Mais alors ne faut-il pas penser que le gorille évoqué tout à l’heure avait
aussi perçu quelque chose de l’irréversibilité du corps mort ? Comment alors
interpréter son geste de nourrir le cadavre ? Il semble difficile de penser que le
gorille fait consciemment semblant de nourrir un mort, lui offre de la nourriture
en faisant comme s’il vivait encore, tout en sachant qu’il est mort. L’observation
des comportements ludiques de la plupart des animaux met en doute leur
capacité, non pas à jouer (comme on l’entendrait), mais à métacommuniquer à
propos d’un engagement sur le mode du comme si ou du faire semblant. Les
chimpanzés et les gorilles feraient-ils exception ?3 Lorsqu’ils jouent à se battre,
ils montrent effectivement les signaux métacommunicatifs qu’ils s’engagent bien
dans une autre activité que le vrai combat. Mais les observateurs précisent aussi
qu’ils effectuent cette activité dans laquelle ils sont bien absorbés, semble-t-il,
sans restriction. Ils seraient ainsi engagés dans une activité, jouer à se battre,
dont ils ne percevraient pas la dimension de jeu par rapport au vrai combat.
Sans doute y a-t-il là une capacité comportementale à dissocier une activité de
son contexte habituel, mais sans qu’il y ait une distinction cognitive entre ledit
comportement et sa reprise ludique. Les singes accompliraient celle-ci comme
une activité « normale », par exemple pour réguler une situation tendue de
1
J. Van Lawick-Goodall, Les Chimpanzés et moi, Paris, Stock, (1970), 1971, pp. 304-305.
2
Ibidem, pp. 292-294.
3
Cf. R.W. Mitchell (ed.), Pretending and Imagination in Animals and Children, Cambridge,
Cambridge University Press, 2002: en particulier les articles de J.C. Gomez, de B. Martin-
Andrade et de P. Reynolds.
12
CROIRE.indd 12 22/02/13 11:30:03
le premier croyant
conflits. Dans ce cas, le singe n’engage pas un combat « comme si » mais un
autre type de combat « au lieu de » celui qui se déploie dans l’agressivité et
la violence. Peut-être sommes-nous près du comportement d’imitation, un des
premiers stades du comportement ludique observable chez les tout jeunes enfants
qui, avant la capacité de différencier une activité et sa réappropriation sur le mode
du jeu, passe par l’imitation sensori-motrice d’un geste de lui-même ou perçu
chez un autre. Dans l’état de tension, la « modalité simulative » constituerait
ainsi chez le singe une activité « normale » parmi d’autres comportements.
Par le geste de nourriture envers le mort, le gorille engagerait cette « modalité
simulative » presque instinctive ou mécanique (comme il est facile de le dire) en
particulier pour diminuer une tension émotionnelle (n’oublions pas qu’il crie
et frappe sa poitrine). Il y aurait là l’ébauche ou l’esquisse d’un comportement
faisant la distinction entre le vivant et le mort et se traduisant dans ce cas par une
animation imitative vis-à-vis du corps mort, en l’occurrence toujours réellement
présent (la compagne du gorille vient juste de mourir) sans nécessairement passer
par l’opération mentale de représentation de la différence.
Allons de là retrouver les hommes. Ce qui supposerait d’attendre de
nombreuses centaines de milliers d’années avant de découvrir un ensemble de
données significatives sur le rapport des humains à la mort. « L’esprit, écrit
Pinker, est un système d’organes de computation élaboré par la sélection naturelle
pour résoudre les différents types de problèmes que nos ancêtres ont rencontrés
dans leur mode de vie de chasse et de cueillette, en particulier pour comprendre
et maîtriser les objets, les animaux, les plantes et les autres individus. Cette
formule peut se décomposer en plusieurs affirmations. La pensée, c’est ce que
fait le cerveau, en particulier il traite l’information, et la réflexion est un type de
computation. L’esprit est organisé en modules, ou organes mentaux, dont chacun
a une structure spécialisée qui en fait un expert dans un domaine particulier
d’interaction avec le monde. Les spécifications de la logique de base des modules
sont données par notre programme génétique. Le fonctionnement des modules
a été modelé par la sélection naturelle pour résoudre les problèmes de la vie de
chasse et de cueillette qu’ont menée nos ancêtres dans la plus grande partie de
notre passé dans l’évolution. Les différents problèmes de nos ancêtres consistaient
en des tâches à effectuer qui dérivaient toutes d’un seul grand problème pour
leurs gènes : produire un maximum de copies capables d’accéder à la génération
suivante »1. C’est dans cette évolution cognitive que surgit l’énoncé religieux et
surtout l’assentiment que lui donne l’être humain. Il est bien sûr à distinguer des
effets à moyen et long terme engendrés par leur gestion sociologique au profit du
maintien de l’autorité, de la légitimité des pouvoirs. Trois sites archéologiques2
du Paléolithique moyen, Kebara, La Ferrassie et Qafzeh3 m’interpellent.
1
S. Pinker, Comment fonctionne l’esprit, Paris, Odile Jacob, (1997), 2000, pp. 28-29.
2
Je n’intègre pas dans mon dossier le site de Sima de los Huesos (en Espagne) où furent
découverts des restes osseux d’une trentaine d’individus rassemblés (datant de 400 000 ans
environ) et pour lequel les spécialistes ne s’accordent pas pour conclure qu’il s’agit d’une
sépulture collective.
3
Parmi les travaux comparatifs et critiques, citons P. Binant, Les Sépultures du Paléolithique,
13
CROIRE.indd 13 22/02/13 11:30:03
albert piette - l'origine de la croyance
La présence des morts, des anciens vivants
En Israël, à Kebara, une des grottes du Mont Carmel, plusieurs campagnes
de fouilles ont été entreprises. En 1983, un squelette qui allait devenir célèbre
est découvert : « Il reposait dans une fosse, sur le dos, la main droite ramenée
vers le haut du thorax au niveau de l’omoplate, la main gauche en bas du
thorax, au-dessus de la colonne vertébrale. La mandibule reposait sur sa base,
légèrement déportée du côté droit du rachis qui est dans un état de conservation
remarquable. L’atlas se trouvait entre les branches de la mandibule. Le crâne a
disparu ».1 Cette description de squelette, qui est pour la plupart des spécialistes
l’indice d’une sépulture nous suffit… pour nous déplacer jusqu’en Dordogne, au
site de La Ferrassie lui aussi riche en découvertes successives, comme les dates
de ce texte l’indiquent :« Les découvertes réalisées dans ce gisement ont été
nombreuses et assez bien étudiées pour que l’existence de sépultures primaires
néandertaliennes soit définitivement acceptée. La Ferrassie 1 (1909) représente
un adulte en décubitus ; des objets en os étaient peut-être associés à cet individu,
dont un fragment de diaphyse portant des stries régulièrement espacées. La
Ferrassie 2 (1910) est un sujet plus gracile. Il est en décubitus latéral droit, en
position hyper contractée. Les deux individus sont tête-bêche et à 50 cm l’un
de l’autre. La Ferrassie 3 (1912) est un enfant de 10 ans, la Ferrassie 4 (1912) un
nouveau-né et la Ferrassie 5 (1920) un fœtus (le seul de tout le Paléolithique
moyen). Tous ont été inhumés. Il s’agit de sépultures primaires individuelles en
pleine terre. Au sommet de la fosse de LF 3, trois silex auraient été posés dans
une disposition particulière. La Ferrassie 6 (1921) est un enfant de 3 ans. Une
grosse pierre portant des cupules, peut-être creusées par l’Homme, aurait été
posée en surface de la fosse funéraire de forme triangulaire (la seule de ce type
comme pour tout le Paléolithique »2 .
Que retenir de toutes ces informations ? Sachons d’abord que la bonne
connexion du squelette et l’état des ossements sont moins imputables à une
conservation naturelle qu’au fait de la sépulture témoignant que le corps mort
fut un objet d’attention. Mais d’aucuns pourraient objecter que la mise en
terre est due à une volonté de se débarrasser d’un corps mort pour des raisons
simplement sanitaires. Ce sont d’ailleurs près des sites d’habitation que la
plupart des sépultures ont été découvertes. Ou encore pour éviter d’attirer les
carnivores, ou même par peur du mort et dégoût des corps vite décomposés, qui
Paris, Errance, 1991 ; A. Defleur, Les Sépultures moustériennes, Éds du CNRS, 1993 ; B.
Maureille, Les Premières sépultures ; B. Maureille et B. Vandermeersch, Les Sépultures
néandertaliennes, in Bernard Vandermeersch et Bruno Maureille (dir.), Les Néandertaliens.
Biologie et culture, Paris, Éds du cths, 2007, pp.311-322. Cf. aussi A. Leroi-Gourhan, op. cit.
Et plus récemment, la synthèse d’Anne-Marie Tillier, L’Homme et la mort. L’ émergence du geste
funéraire durant la préhistoire, Paris, CNRS Éditions, 2009. Beaucoup moins critique est par
exemple E. Anati, La Religion des origines, Paris, Hachette, (1995), 2004. Pour une position
très critique : R.H. Gargett, “Middle Palaeolithic Burial is not a Dead Issue”, Journal of Human
Evolution, 37, 1999, pp. 27-90.
1
A. Defleur, op. cit., p.175.
2
B. Maureille et B. Vandermeersch, op. cit., pp. 315-316.
14
CROIRE.indd 14 22/02/13 11:30:04
le premier croyant
semblent des réactions largement partagées par les hommes au moins face aux
cadavres inconnus. Autant de bonnes raisons rationnelles et émotionnelles de
s’occuper d’un corps mort. Mais, répondront d’autres, elles n’excluraient pas de
s’en débarrasser par d’autres moyens que la mise en terre.
L’argument de l’attention portée au mort par la sépulture se renforce avec
la position des squelettes tels qu’ils ont été découverts, sur le dos, sur le côté,
fléchis ou contractés, et qui n’a pu être obtenue que par la flexibilité du cadavre
seulement possible un court temps après la mort. D’autres éléments confirment
encore cette attention par la sépulture. Ainsi, la tête est parfois bien calée dans
la fosse, posée contre des pierres. Le squelette, quand il est découvert intact, fait
d’ailleurs supposer qu’il a bien été recouvert par exemple d’une dalle de calcaire
et de blocs de pierre (comme à La Ferrassie et aussi dans d’autres sépultures), ce
qui permettrait, dans la fosse elle-même, d’être moins exposé aux petits animaux
nécrophages. Ce sont souvent des analyses et des interprétations précises des
ossements qui confirment ce point de vue. Ainsi, par exemple selon Defleur, « la
position de l’humérus droit qui apparaissait sur sa face latérale et de l’os coxal droit
qui ne s’était pas ouvert comme cela se passe généralement après décomposition
des chairs, indique que le côté droit du corps devait être calé contre la paroi de
la fosse et donne les limites de celle-ci dans cette zone »1. Comme si l’homme
voulait assurer une protection encore meilleure, par exemple, selon la description
citée plus haut, avec cette pierre à La Ferrassie 6, une sorte de dalle recouvrant
la sépulture. La découverte de squelettes et même d’un fœtus comme dans cette
sépulture ne serait certainement pas contradictoire à l’idée d’un attachement
familial et surtout de la reconnaissance du mort, ici du mort-né à qui un espace
de protection a été réservé.
Gardons donc l’idée d’une attention au corps mort, celui d’une personne
en particulier, attention qui pourrait s’apparenter au respect revendiqué par
Antigone pour le cadavre de son frère que le roi veut priver de sépulture. Il y a
donc des animaux qui attendent l’animation du corps, qui s’émeuvent de son
absence, qui continuent dans l’immédiat après-mort à se comporter envers lui
comme s’il était vivant. Il y en a aussi qui semblent percevoir la différence entre la
vie et la mort et qui ébauchent un « comme si » instinctif de continuité de la vie
juste après la mort. L’homme de Kebara ou de La Ferrassie, lui, a une perception
nette de la mort non seulement comme processus irréversible (le corps est enterré)
mais aussi comme non incompatible avec le maintien d’une attention accordée à
la personne vivante : « oui, c’est un cadavre, mais c’était lui ». C’est ce qu’atteste
le geste de la sépulture et de la protection de l’espace funéraire. Le processus de
décomposition des cadavres que notre homme n’a pas pu ne pas percevoir, la vue
insoutenable du corps d’un parent exposé aux animaux carnivores, deviennent
des raisons pour expliquer la protection intentionnelle du mort. La connaissance
de la destinée biologique d’un cadavre a pu inciter au choix de sa protection et,
peut-être de manière plus passive, au confort par l’enterrement de ne pas voir ce
qu’il lui arrive.
1
A. Defleur, op. cit., p. 250.
15
CROIRE.indd 15 22/02/13 11:30:04
albert piette - l'origine de la croyance
Contrairement au corps mort de l’animal, traité par ses congénères comme
toujours en vie ou en attente de réanimation, ou comme un objet inerte, le corps
du mort est associé, au moins au moment de l’acte d’enterrer, à celui d’un vivant
bien connu, avec qui diverses activités ont été partagées. Le corps protégé dans
une sépulture n’est pas l’indice de l’attitude d’un vivant pensant que son mort
continue à vivre. Il s’agit d’un geste certes qui n’exclut pas la peur ou le dégoût
mais qui en l’occurrence ne pousse pas à se débarrasser du corps mais au contraire
à le protéger comme l’indiquent l’état et la position des squelettes. Dans de telles
sépultures, il n’y a pas trace d’une compétence cognitive faisant du mort un vivant,
mais il y a au moins l’attestation d’une continuité de l’attention du vivant envers
le mort, analogue en tout cas à celle qui était portée lorsque celui-ci vivait. Le
vivant imiterait-il ainsi son attention interactionnelle d’avant, en sachant bien que
le corps mort ne le perçoit pas ? Il s’agirait alors moins d’une réaction instinctive
et mécanique comme celle du gorille décrit plus haut que de la manifestation
d’un premier acte de « comme si » : bien traiter le mort, comme si c’était encore
« lui ». Ce serait, face au mort, un début de « comme si » dans la mesure
où ce comportement est ponctualisé, réduit au temps et à l’acte d’enterrement.
Mais nous serions ainsi toujours plus près d’un réflexe attentionnel vis-à-vis du
récent « ex-vivant », à partir d’une assimilation ponctuelle du cadavre à son état
précédent de vivant, que d’un travail de représentation du mort comme vivant1.
Cet homme est aussi capable d’une telle représentation. J’ai mentionné que le
squelette de Kebara était célèbre. Que le lecteur se rappelle la description : il n’a
pas de crâne et le prélèvement de celui-ci aurait été intentionnel et minutieux,
accompli là où le corps reposait sur le dos après une première sépulture. « On
peut penser, écrit Alban Defleur, que quelques mois ou années ont été nécessaires
pour détruire les principaux tendons qui maintiennent la mandibule au crâne et
celui-ci aux premières vertèbres, pour que les premières dents se déchaussent, et
que l’enlèvement du crâne a dû avoir lieu après ce délai. Du fait de la position de
la première vertèbre cervicale, qui apparaît à plat entre les deux branches de la
mandibule, elle-même déposée à plat, il est probable que le crâne devait reposer
sur sa base, l’occipital butant contre la paroi d’une fosse »2 .
Que pouvait faire un homme avec un crâne ou avec tout autre os – dans ce
squelette de Kebara, la jambe droite est aussi manquante – ? Ce crâne (qui n’a
pas été retrouvé), en tant que partie d’un corps mort, est, selon la terminologie
de Peirce, un indice, l’indice d’un corps qui a été vivant, l’indice d’un ex-vivant,
susceptible d’être traité comme tel au moins pendant un certain temps. Il ne
faut pas oublier que ce crâne a été enlevé délicatement par un homme. S’il était
posé quelque part dans le site d’habitation, le crâne ne permettait-il pas de
garder « quelque chose » de celui qui a été vivant ? Ainsi, il n’est pas exclu de
1
À ce propos, la lecture piagétienne du développement de l’enfant peut être utile : cf. J. Piaget,
La Formation du symbole chez l’enfant, Neuchatel, Delachaux et Niestlé, 1972. Sur le dialogue
anthropologie-psychologie, cf. l’article très heuristique de F. Clément, « Des jeux symboliques
aux rituels collectifs », in J.-Y. Béziau (dir.), Le Langage symbolique, Paris, Pétra, 2012.
2
A. Defleur, op. cit.,pp. 175-176.
16
CROIRE.indd 16 22/02/13 11:30:04
le premier croyant
penser que le crâne puisse générer un sentiment troublant de « présence », ce
qui supposerait son assimilation à la personne qui a été vivante. La distinction,
désormais nette entre l’état de mort et l’état de vie, entre le mort et le vivant,
permet ici une nouvelle opération mentale consistant à prendre l’un pour l’autre.
Le crâne de Kebara pourrait être la marque d’une capacité cognitive à faire
comme si l’autre, le vivant, était encore là. Et sans doute à le percevoir ainsi, à le
sentir. C’est l’utilisation d’un élément à la place d’un autre, c’est la représentation
d’un absent par un substitut de celui-ci, dont l’homme de Kebara aurait été
ainsi capable. Il ne s’agit pas d’associer cet homme à la capacité de croire que le
mort vit dans un autre monde mais à celle de le représenter dans son habitation
avec un élément direct de son corps (et non par un objet qui en est éloigné). Ce
« comme si » pourrait même être lui-même activé dans des moments spécifiques,
qui ressembleraient à ce que nous appelons cérémonie, célébration ou rituel, avec
aussi des comportements d’interaction entre le(s) vivant(s) et l’ex-vivant. Ils
consisteraient en paroles et en gestes imitant les anciennes relations, « comme
avant ». Dans ce cas, l’imitation de celles-ci n’est pas vraiment détachée de
la présence du modèle, le crâne constituant une médiation nécessaire pour le
déroulement de la représentation-imitation. Et celle-ci a pu produire l’émotion
facilitant le sentiment de présence de l’absent, de re-présentation.
Il s’agit là d’une capacité d’associer le cadavre à quelque chose d’autre, en
plus, à l’état de vivant qu’il a été. Le crâne de x, squelette et bien mort, est traité
comme quand l’homme était vivant. Le crâne comme re-présentation et les
gestes ou paroles comme imitation consistent à faire comme si la personne était
encore en vie, comme elle l’a été il y a quelques temps, tout en sachant qu’elle est
morte. L’os est utilisé comme si c’était la personne. Une telle opération mentale,
d’autant plus plausible qu’il s’agit de la tête, est largement distribuée depuis
longtemps chez les hommes, habitués d’être à l’affût d’indices divers, de traces
de pas, à l’écoute de bruits, qu’ils associent à une présence possible de prédateurs
et qui incitent à la réaction salutaire de défense ou de fuite1. À ce moment-là, la
possibilité de faire jouer des actions au crâne et de lui prêter des intentions n’est
pas à exclure. Mais dans ce cas, avec le crâne, cette capacité serait réalisée sur
le mode du « comme si ». Ainsi, la représentation de la personne par le crâne
suppose un premier détachement par rapport au référent de base, le vivant tel
qu’il était. Mais en même temps, ce détachement n’est pas totalement réalisé car
il a besoin d’une partie réelle de l’ex-vivant, d’un indice de celui-ci.
Dans la situation du crâne de Kebara, la représentation ne s’est pas totalement
affranchie de la perception de la réalité première. C’est une sorte de copie,
d’imitation du vivant qui le remplace. L’ensemble de notre interprétation
indiquerait que l’homme de Kebara ne sépare pas le mort enterré de son état
de mort, dont la sépulture et surtout le crâne sont un indice. La présence
possible de celui-ci dans le campement ne permet pas d’associer le mort à un
autre état que celui de mort. C’est en tant que tel qu’il peut être présent. Des
1
Cf. pour un développement théorique de ce point de vue, S. Guthrie, Face in the Clouds. A
New Theory of Religion, New York, Oxford University Press, 1993.
17
CROIRE.indd 17 22/02/13 11:30:05
albert piette - l'origine de la croyance
gestes ou des paroles d’imitations des relations passées peuvent être accomplis ou
énoncés, rituellement ou non, avec le crâne mais alors associés à une opération
de simulation. Dans ce cas, la représentation permet de faire comme si c’était lui,
encore lui, comme quand il était vivant.
La sépulture de La Ferrassie donne encore d’autres informations. Non
seulement l’endroit de la sépulture est près de l’habitation à laquelle le groupe
était susceptible de revenir régulièrement selon les saisons, et où plusieurs morts
étaient parfois rapprochés. Et n’était-il pas lui recouvert par une dalle et des blocs
de pierre ? Ce lieu serait alors lui aussi l’indice du mort, un rappel possible de
celui-ci, en particulier quand le groupe revenait à « son » camp. Dans ce cas,
la relation indiciaire, toujours opérante, serait plus détendue puisqu’elle se fait
entre le mort et le lieu d’enterrement, et non plus directement, par le crâne, entre
le vivant et le mort. Après la mort, la durée d’existence de l’espace funéraire pour
représenter l’ex-vivant était sans doute bien plus longue que celle d’un os prélevé
et vite fragilisé.
Mais il y a un autre enjeu. La sépulture de La Ferrassie est en effet représentative
du débat et des controverses entre préhistoriens et paléontologues, à partir des
objets découverts à côté du squelette comme dans ce cas, des cupules, des silex et
des stries. Au Paléolithique moyen, le squelette découvert dans une fosse est en
effet rarement dissocié, comme des descriptions présentées ci-dessus l’attestent,
d’un ensemble d’objets qui l’entourent : des os d’animaux, dont certains seraient
incisés, des traces de combustion ou des colorants, des éclats de silex, des blocs de
pierre et même du pollen. Toutes les interprétations sont possibles pour faire d’un
os d’animal une offrande au mort, malgré les appels récurrents de chercheurs à
la prudence. Des études récentes, très techniques, de ces éléments constituent
d’ailleurs une remise en cause de la plupart de ces interprétations et réduisent
à presque rien le nombre de « faits positifs » ou indiscutables1. Les ossements
gravés ou percés qui ont été découverts dans plusieurs sépultures néandertaliennes
l’auraient été à la suite de processus naturels, des incisions régulières qui ont été
repérées sur des pierres ne seraient pas dues au travail des hommes, les pollens
(sur le site de Shanidar) que d’aucuns associaient à une litière de fleurs auraient
été transportés par des animaux.
Croyance aux morts qui vivent, de nouveaux vivants
Retournons en Israël, à Qafzeh, à la sépulture de Qafzeh 11, où ont été
découvertes les cornes d’un cervidé sur les mains du corps mort. Voici la
description de Bernard Vandermeersch qui a découvert la sépulture : « Le
corps reposait sur le dos, le crâne était appuyé contre le bord nord de la fosse et
légèrement incliné sur le côté droit. La mandibule avait glissé vers l’avant et ne
se trouvait plus en connexion anatomique. Les côtes étaient écrasées contre le
rocher. Les bras étaient serrés contre le thorax, les avant-bras fortement repliés, si
1
Cf. M. Soressi et F. D’Errico, « Pigments, gravures, parures : Les comportements
symboliques controversés des Néandertaliens », in B. Vandermeersch et B.Maureille (dir.), Les
Néandertaliens. Biologie et culture, op. cit., pp. 297-309.
18
CROIRE.indd 18 22/02/13 11:30:05
le premier croyant
bien que les trois os, l’humérus, radius et cubitus étaient côte à côte et parallèles
entre eux ; les mains se trouvaient donc ramenées de chaque côté de la tête. La
partie inférieure du corps, très abîmée, était à peine identifiable. Le bassin était
complètement écrasé et il en était de même des jambes, en position semi-fléchie
et rejetées sur le côté droit »1.
Et sur le corps, ce morceau de bois d’un cerf dont, selon B. Vandermeersch,
l’association étroite avec le corps et son absence dans le reste du niveau
archéologique constituent un bon argument pour l’interpréter comme une
offrande funéraire. Il y a aussi un gros bloc de calcaire et des fragments d’ocre
rouge, eux en grande quantité, ainsi que, sur la poitrine de l’enfant, des morceaux
de coquille d’œufs d’autruche et des traces de feu dont la présence serait fortuite.
Et Alban Defleur de commenter : « Cette sépulture est, peut-être, la plus riche de
tout le Paléolithique moyen. La situation du bois de massacre de cerf posé sur les
mains montre qu’il y a eu offrande faite au mort. Le fait que les Moustériens aient
renforcé les bords particulièrement friables de la fosse avec des blocs de calcaire
non altérés pour qu’ils ne s’affaissent pas, comme le pense B. Vandermeersch,
apparaît curieux, puisque la fosse funéraire n’a qu’une mission très brève et n’est
destinée, après avoir reçu le corps, qu’à être rapidement comblée. Remarquons,
là encore, que du fait de la position ramassée du squelette, la fosse semble trop
longue. Peut-être existait-il d’autres offrandes qui ne sont pas conservées ? Il est
certain que, comme dans le cas de Qafzeh 8, le bloc de calcaire posé sur le cadavre
au niveau du bassin devait avoir un but rituel précis »2 .
Bien sûr l’offrande en question pourrait seulement consister en un simple
geste sentimental d’un proche envers le mort. Mais la présence indiscutable d’une
offrande – pas nécessairement la « première » offrande peut-être accomplie
précisément sur ce mode sentimental – permet aussi de poser la possibilité
d’une nouvelle opération cognitive progressivement réalisée et transmise. L’objet
offert au mort ne supposerait-t-il pas en effet, non pas de faire comme si le mort
était encore le vivant connu et activant quelques instants une sorte de respect,
non pas de rendre présent le mort dans l’espace des vivants par un indice de
son corps, mais bien de représenter le mort comme destinataire toujours vivant
d’un cadeau. Dans ce cas, le mort n’est plus présent comme mort sur le mode
du comme si en tant qu’ancien vivant mais comme toujours vivant. Vivant où ?
Il est bien sûr prématuré de penser qu’il y a là une représentation d’un autre
monde vers lequel la mort serait un passage. Disons que cette nouvelle forme de
vie du mort reste indéterminée. Ce lieu pourrait d’ailleurs être considéré comme
proche, mais invisible. Il est peut-être d’ailleurs aussi indéterminé pour ceux
qui ont placé le bois de cervidé sur le cadavre. Les offrandes d’objets spécifiques
laissent penser qu’il ne s’agit pas de faire pendant quelques instants comme si le
mort était encore vivant mais plutôt qu’elles sont destinées à un mort comme
revivant. Faire donc comme s’il était à nouveau vivant. C’est alors que la capacité
1
B. Vandermeersch, « Une sépulture moustérienne avec offrandes découverte dans la grotte de
Qafzeh », Compte rendu de l’Académie des sciences, T. 270, série D, 1970, pp. 298-301.
2
A. Defleur, op. cit., p.148.
19
CROIRE.indd 19 22/02/13 11:30:05
albert piette - l'origine de la croyance
symbolique du langage fait de signes arbitraires et combinables est capitale,
permettant de construire, à partir de la dissociation du signe et de ce qui est
perçu ici et maintenant, un monde précisément détaché des situations concrètes.
Telle est la portée d’un langage constitué de signes arbitraires : non seulement
discuter et argumenter mais aussi évoquer des événements passés ou à venir,
se projeter hors du moment présent, et raconter des choses qui n’existent pas
nécessairement, bizarres, invraisemblables, incroyables. Par exemple sur ce mort
qui aurait besoin d’un bois de cervidé !
L’acte de croire a pu être progressif. Ainsi, l’homme a pu élaborer autour de
ce geste d’offrande des scénarios représentant le mort revivant. Et comme au
crâne de Kebara, le vivant de Qafzeh prête au mort vivant des capacités nouvelles
d’intention et d’action dans « son » monde et sans doute aussi dans celui des
vivants. Une mise en scène rituelle n’est pas à exclure, faisant exercer le « comme
si » non seulement au mort revivant et désormais capable d’agir comme tel
(revivant) avec les vivants actuels mais aussi à ceux-ci en train de jouer, raconter
ou écouter les scénarios imaginés. N’oublions pas la présence à Qafzeh 11 des
blocs de calcaire et des fragments d’ocre. Le contenu du récit ou du rituel ne
porterait plus, selon le mode de l’imitation, sur des paroles ou des gestes du mort
quand il était vivant mais sur le mort en tant que revivant, c’est-à-dire vivant
une nouvelle vie. Comment est le vivant quand il représente ou met en scène ce
scénario du mort revivant ? Fait-il comme si, à la manière de l’enfant construisant
un monde imaginé avec ses poupées ou ses voitures ? Et donc est-il capable au
terme du jeu, de se détacher de la représentation ? Sans doute d’abord a-t-il pu
le vivre ainsi, comme un simple « faire », un jeu rituel. Mais aussi – et là surgit
la « différence » capitale – à partir du scénario imaginé ou avant même celui-ci
et sa mise en scène rituelle, avant de poser l’offrande sur le cadavre, l’homme
a pu faire émerger circonstanciellement une autre capacité cognitive : « Et si
c’était vrai ? ». Point d’interrogation ou point d’exclamation. Se le dire : si c’était
vrai que le mort vit toujours sous une autre forme. Peut-être d’ailleurs le geste
sentimental a-t-il incité cette transformation cognitive. Et cet homme, n’a-t-il pas
pu raconter, d’abord à quelques-uns, sa « croyance » ? Ceux-ci ont-ils imaginé
alors un récit détaché de la réalité de l’ex-vivant mais au contraire centré sur le
mort comme re-vivant « ailleurs » ? Des hommes croiraient désormais que des
morts vivent, re-vivent.
Il faut penser, me semble-t-il, cette « scène primitive » comme celle
d’un homme, d’un individu en particulier dans un espace-temps précis,
énonçant une équivalence entre le mort et le vivant, et se laissant aller à une
sorte d’approbation de cette idée. Un homme en particulier, par hasard, sans
avoir – évidemment – le projet de mieux s’adapter, de mieux survivre. Ensuite,
il l’a répété à d’autres… L’introduction de cette différence individuelle, une
petite variation circonstancielle, a sans doute modifié progressivement le cours
de la vie des humains. « Et si c’était vrai » : voilà bien un homme en train de
croire à l’existence d’un autre monde, un monde incroyable. Cet acte de croire
a pu advenir à tel endroit lorsqu’il a posé une offrande sur le corps – et pas
20
CROIRE.indd 20 22/02/13 11:30:05
le premier croyant
nécessairement la première fois –, à un autre endroit lorsqu’il s’est rappelé un
peu plus tard son geste, ou encore ailleurs lorsqu’il a accompli un jeu, un rite
faisant interagir les vivants et le mort. Croire, c’est aussi continuer à le croire et
parfois à le dire, après cette mise en scène rituelle. N’excluons pas, pour activer
cet acte de croire, la préparation possible de visions ou d’hallucinations vécues
personnellement ou racontées comme témoignages par d’autres. Et aussi les rêves
de morts potentiellement fréquents dans les premiers temps de l’absence1. Cet
homme qui n’est pas dupe sait que ce n’est qu’un rêve, en tout cas que ce n’est pas
la réalité. Mais cela n’exclut pas que les rêves aient pu contribuer à favoriser le
brouillage ponctuel entre réalité et invention, et de là, l’acte de croire. Posant ce
« et si c’était vrai », notre homme n’a-t-il pas pu percevoir un certain bien-être,
un réconfort, un soulagement face à l’absence réelle de son compagnon ? Ceci
est capital. Il n’est pas difficile dès lors de penser les effets positifs, voire sélectifs
d’un tel acte de croire dans le processus évolutionnaire. Se représenter seul cet
autre monde ou le jouer dans une mise en scène rituelle, le « vivre » ou ne pas le
vivre, se le représenter à nouveau et régulièrement, c’est l’opération cognitive de
croire. Elle consiste à donner un assentiment à un énoncé incroyable : « le mort
vit ». C’est croire à l’existence d’un autre monde imaginé et raconté et ce, selon
des assentiments variables : croire un peu, croire quand même, vouloir croire que
le mort soit encore là et savoir qu’il n’y est plus, etc.
Dans mon exemple, croire consiste donc à porter des assentiments plus ou
moins fugaces à la représentation du mort comme vivant. Il est une nouvelle
capacité cognitive consistant à mettre ponctuellement entre parenthèses
l’évidence empirique, à surpasser les contraintes logiques, à ne pas accepter
momentanément de comprendre. Ne surgit-il pas là un nouvel état d’esprit : celui
de ne pas pousser à fond la certitude, d’accepter l’incertitude, de goûter ainsi à
une nouvelle forme de distance ? Nous y reviendrons.
Deux présences au monde
Kebara-La Ferrassie-Qafzeh : trois sites archéologiques associés à des
sépultures et témoignant d’un développement de capacités cognitives des
hommes. Nous pourrions nous attendre à une chronologie linéaire entre ces
trois sites. Mais non ! La sépulture de Kebara remonte à 60 000 ans, celle de La
Ferrassie à 35 000 ans et celle de Qafzeh, qui attesterait une capacité cognitive
supérieure, en tout cas supplémentaire, est plus ancienne, elle date de 100 000
ans. Il y a un code de lecture de cette hétérogénéité : les sépultures de Kebara et
de La Ferrassie appartiennent à l’Homme de Neandertal et celle de Qafzeh à
l’Homme moderne, Homo sapiens2 !
Qui est cet Homme de Neandertal ? Il vécut surtout en Europe, au moins
aussi au Proche-Orient, avant de ne plus laisser aucune trace à partir de 30 000.
1
Cf. S. Atran, Au Nom du Seigneur. La religion au crible de l’ évolution, Paris, Odile Jacob,
(2002), 2009, ch. 2.
2
J’attends beaucoup des compléments d’informations qui ne manqueront pas de surgir suite
aux nouvelles découvertes paléontologiques, comme récemment sur l’existence d’autres Homo
(de Florès et de Denisova) pour préciser les enjeux des hypothèses proposées ici.
21
CROIRE.indd 21 22/02/13 11:30:06
albert piette - l'origine de la croyance
Il a d’ailleurs côtoyé au Proche-Orient, puis en Europe, l’Homme moderne venu
d’Afrique1. Dans l’arbre touffu de l’évolution, les deux hommes partagent un
ancêtre commun duquel ils se sont séparés il y a environ 500 000 ans, en formant
progressivement deux espèces différentes. Il y a donc des ressemblances mais
aussi des différences entre les deux hommes. D’abord l’apparence. Le squelette
de Neandertal est plus petit et plus massif que celui de l’Homme moderne. Son
tronc est long par rapport aux jambes. Il possède des grosses articulations et une
forte musculature. Ces caractéristiques font penser à une locomotion moins
prompte que celle de l’Homme moderne, s’exerçant dans un espace relativement
circonscrit à des distances de vingt kilomètres maximum. Quant à son cerveau,
il est au moins aussi gros que celui des Hommes modernes mais le cortex frontal
serait moins développé, avec un front bas et plutôt étroit.
Dans les livres ou les articles sur les comparaisons morphologiques et
cérébrales des deux Hommes, se découvre une alternance entre celles qui insistent
sur la ressemblance et, malgré les différences, posent deux univers semblables, et
celles qui marquent, malgré les points communs, les différences en indiquant
deux modes de vie différents. Selon ce point de vue, des études sur les restes de
Néandertaliens mentionnent un bilan de santé plutôt défavorable : nombreux
traumatismes, arthroses, carences alimentaires, stress, surmortalité infantile, pas
d’espérance de vie au-delà de 40 ans. Cela confirmerait-il le « cliché » (selon
certains) de la vie difficile de l’Homme de Neandertal équipé d’un outillage
relativement uniforme (sur une très longue durée) et peu performant, notamment
avec peu de lances-projectiles – ce qui oblige le chasseur à se rapprocher, non sans
risques, de la proie ? Quel type de langage avait l’Homme de Neandertal ? Il
chassait, il utilisait des outils. Il devait donc communiquer et même transmettre.
Le débat sur la hauteur de son larynx et les capacités de mouvement de sa langue
semble porter à hésiter sur son aptitude au langage articulé. Peut-être pouvait-il
émettre certains sons pour désigner des choses proches de son environnement,
perçues ou entendues, mais pas toutes les voyelles. Et surtout, il n’aurait pas
combiné ceux-ci selon la forme syntaxique. Cette différence est-elle due moins
à un déficit des centres cérébraux à la base de l’opération cognitive du langage
qu’au contexte de vie de l’enfant néandertalien peu exposé aux interactions avec
les adultes mais aussi avec d’autres enfants ? L’Homme moderne serait-il le seul
à atteindre ce développement cognitif, parce que contrairement à l’Homme
de Neandertal l’enfant y serait mieux protégé par la mère et même les grands-
parents ? Ainsi la croissance de l’enfant néandertalien aurait pu être plus rapide
que celle de l’Homme moderne, donc avec un temps d’apprentissage moins long
et peut-être un développement moins complet. Durant plus longtemps, l’enfance
permettrait ainsi de nouveaux apprentissages et l’actualisation d’un potentiel
cérébral qui faisait ou ne faisait peut-être d’ailleurs pas défaut à d’autres êtres.
1
Cf. les informations synthétiques et critiques dans B. Vandermeersch et B. Maureille (dir.), Les
Néandertaliens, op. cit. . Voir aussi M. Patou-Mathis, Néandertal. Une autre humanité, Paris,
Perrin, 2006. Sur les 150 ans de découvertes sur l’Homme de Néandertal et les controverses
toujours actuelles sur sa parenté avec l’Homme moderne, cf. C. Cohen, Un Néandertalien dans
le métro, Paris, Seuil, 2007.
22
CROIRE.indd 22 22/02/13 11:30:06
le premier croyant
Notons aussi que des recherches récentes attestent que la croissance du cerveau
néandertalien, en particulier de sa forme, ne ressemblerait pas à celle des sapiens,
laissant supposer une organisation neuronale différente de ceux-ci1.
À ce propos, il faut ajouter que la lignée des Homo sapiens, différente de celle
de l’Homme de Neandertal, permet de repérer des manifestations symboliques
très tôt. Ainsi, avant même de faire connaître leurs représentations du mort, la
lignée des Homo sapiens offrait un témoignage d’activité symbolique, à Herto,
aujourd’hui un petit village dans l’Est de l’Éthiopie, où deux crânes d’adulte
et un crâne d’enfant ont été découverts en 1997. Ils datent de 160 000 ans et
sont actuellement parmi les représentants les plus anciens d’Homo sapiens. Avec
des caractéristiques morphologiques proches de l’Homme moderne, ces crânes
montrent surtout des traces d’entailles et une forme de polissage. Traces d’un
geste mortuaire, lignes arbitraires ? On ne sait pas. En Afrique du Sud, près du
Cap des Aiguilles, dans les grottes de Blombos, trente-neuf coquillages marins
datant de 75 000 ans ont été découverts, avec des perforations reconnues comme
intentionnelles, ainsi que deux blocs d’ocre gravés de signes abstraits2 . Ajoutons
que, dans le site de Qafzeh, mais en dehors des sépultures, des restes d’ocre et des
objets recouverts d’ocre pour lesquels la recherche et le travail des colorants ont
été reconnus et ont permis l’interprétation en termes de marques symboliques.3
Faut-il en conclure que la capacité symbolique est exclusivement associée à la
lignée des Homo sapiens ? Ce serait trop radical. Il y a bien des chimpanzés et
des gorilles, devenus célèbres, qui ont réussi à apprendre avec des professeurs un
langage de signes abstraits et quelques possibilités de les combiner. Et surtout
des indices de manifestations symboliques ont été découverts dans des sites
néandertaliens sans doute plus récents : des coquillages percés, des incisions
sporadiques ou des objets ocrés4. Ceci indique bien toute la différence entre
l’objet symbolique utilisé pour jouer ou décorer, peut-être marquer, capable sans
doute de générer des émotions, qu’aurait pratiqué l’Homme de Neandertal, et
l’acte de croire qui suppose de poser l’existence de choses incroyables.
À propos des Néandertaliens et des Hommes modernes, Homo sapiens, la
conclusion de Liliane Meignen5 me semble significative : « Peu de différences
existent entre les pratiques de ces deux populations, mais à part les cas d’offrandes
qui ne semblent attestées que chez les premiers Hommes modernes (mais elles
sont effectivement peu nombreuses) ». Peu de différences, dit-elle, mais ce ne
sont pas n’importe lesquelles : avec ou sans offrandes ? J’en fais donc l’enjeu d’une
autre compétence cognitive : l’acte de croire dont la certitude de sa manifestation
1
Ph. Guntz et al., Brain Development After Birth Differs Between Neanderthals and Modern
Humans, Current Biology, Vol. 20, 21, 2010.
2
Cf. C.S. Henshilwood et al., « Emergence of Modern Human Behavior : Middle Stone Age
Engravings from South Africa », Sciences, 15 February 2002, pp. 1278-1280.
3
E. Hovers et al., « An Early Case of Color Symbolism », Current Anthropology, Vol. 44, 4,
August-October 2003, pp. 491-522.
4
M. Soressi et F. D’Errico, op. cit.
5
L. Meignen, « Néandertaliens et Hommes modernes au Proche-Orient », in B. Vandermeersch
et B. Maureille (dir.), Les Néandertaliens, op. cit., p. 249.
23
CROIRE.indd 23 22/02/13 11:30:06
albert piette - l'origine de la croyance
et de son développement serait seulement possible pour l’Homme moderne. C’est
en tout cas un diagnostic plausible, mais pas nécessaire et certain, après le tri des
« bons » ou des « mauvais » dépôts dans les sépultures néandertaliennes1. Ce
n’est donc qu’une hypothèse.
Ce qui m’importe en effet à travers cette lecture comparée des sépultures,
c’est la compréhension de la genèse de l’acte de croire. Les critères archéologiques,
certes incertains, et leur association avec des processus cognitifs font penser que
l’Homme de Neandertal, contemporain de l’Homme moderne mais appartenant
à une autre espèce, non seulement n’aurait pas privilégié le marquage territorial
avec des signes divers, mais surtout n’aurait pas expérimenté l’acte de croire. En
effet, avant de donner son assentiment à une représentation mentale de ce type
(« le mort vit »), l’homme a dû développer un type d’énoncé associant dans une
même représentation deux catégories différentes (comme la mort et la vie). Et
ceci constituerait une opération spécifique qui selon le travail de Steven Mithen
serait seulement attestée chez les Hommes modernes. Cette capacité de réaliser
des interférences cognitives constitue un argument « contre », si l’on veut,
l’Homme de Neandertal.
De l’analyse de sa « personnalité », il ressort une psychologie gérant mal les
contradictions, une attention en difficulté face à de nouvelles informations ou
à des interférences diverses, une résistance à des changements qui solliciteraient
des tâches autres que celles qu’il maîtrise, une difficulté à bien évaluer les
coûts, et en même temps une endurance à l’épreuve, et peu de violences entre
les hommes2 . Les Néandertaliens, qui auraient été peu enclins, selon Mithen, à
l’humour, vivaient dans de très petites communautés avec peu d’« étrangers »3.
Ils ont certes manifesté une intelligence sociale, des capacités techniques, une
compréhension de leur environnement et des adaptations dans des espaces ou des
climats différents. Mais ce qui leur ferait défaut, c’est ce que justement l’Homme
moderne a réussi : mélanger les informations et les actions correspondant à
chacun de ces trois domaines. À propos des Hommes de Neandertal, les données
archéologiques sont diverses. Elles n’excluent pas une organisation de son habitat
fait d’un foyer central (dans des abris sous roches ou des huttes posées avec des
piquets) et d’aires spécialisées, en particulier dans des sites de longue durée. Mais
ce serait rare et ce qui semble le plus fréquent est la répartition de sites différents
pour chaque activité : halte de chasse, site de boucherie, endroit de débitage.
Les traces de feu attesteraient des foyers diffus et éphémères plutôt qu’un foyer
1
« Nous ne connaissons pas, écrivent Bruno Maureille et Bernard Vandermeersch, de tombe
néandertalienne qui, en fonction de la rigueur de nos méthodes actuelles, nous assurerait de
l’existence de dépôt d’un ou plusieurs objets funéraires » : B. Maureille et B. Vandermeersch,
« Les sépultures néandertaliennes », in B. Vandermeersch et B. Maureille (dir.), op. cit., pp. 318-
319. Indiquons que dans son livre déjà cité, L’Homme et la mort (pp. 113-127), A.-M. Tillier
semble présenter des interprétations plus généreuses.
2
T. Wynn et F.L. Coolidge, « The Expert Neandertal Mind », Journal of Human Evolution,
46, 2004, pp. 467-487. Cf. aussi F.L. Coolidge et T. Wynn, The Rise of Homo Sapiens : the
Evolution of Modern Thinking, Oxford, Wiley-Blackwell, 2009, pp. 180-206.
3
S. Mithen, The Singing Neanderthals. The Origins of Music, Language, Mind, and Body,
Cambridge, Harvard University Press, 2007, p. 225.
24
CROIRE.indd 24 22/02/13 11:30:07
le premier croyant
central avec une vie sociale continue1. Mais soyons prudent. Il y aurait différents
cas de figures : travail à proximité du lieu de chasse puis transport, ou transport
direct au lieu d’habitation avec transformation de l’animal sur place. Et dans ce
cas, les découvertes archéologiques des outils semblent confirmer une séparation
des activités dans des petits espaces différents2 . Un débat intense existe entre
préhistoriens et paléontologues sur les modalités d’habitation, de transport et
de travail. La question n’est d’ailleurs pas absente des travaux des primatologues,
desquels il apparaît que le chimpanzé par exemple est bien plus prêt à abandonner
qu’à transporter3. Tout au plus, laisse-t-il des « outils » à l’endroit où il peut
s’en servir, par exemple près d’un arbre pour y casser des noix. L’enjeu du
débat est la capacité de fluidité cognitive des hommes, se manifestant dans les
interférences entre activités en particulier sociales, techniques et écologiques.
Tattersall et Mithen tendent à opposer, selon cet axe, l’Homme de Neandertal
et l’Homme moderne. Le premier serait sans fluidité cognitive : pas d’outil en
os ou en ivoire car il réserve ces matières au domaine de la nature, peu de lances-
projectiles pour la chasse, ce qui supposerait d’associer technique et nature, peu
de contacts sociaux qui permettraient d’observer et de transmettre pendant
l’exercice d’activités techniques, séparation, comme nous l’avons vu, des activités
(boucherie, débitage, consommation) parfois d’ailleurs réalisées simultanément
au hasard des lieux et des opportunités.
Tandis que l’Homme moderne, Homo sapiens, multiplie les interférences
entre les domaines : os ou pierres incisés pour marquer avec un élément naturel
ou technique une appartenance sociale, outils en ivoire ou en os, statuettes
mêlant des parties corporelles d’hommes et d’animaux, organisation de l’habitat
sur un site central permettant le déroulement de différentes activités techniques
et l’échange social, ou au moins mise en place d’aires spécialisées pour les
travaux après lesquels il y a retour au campement afin de privilégier les contacts
sociaux. Le langage syntaxique qui serait spécifique aux sapiens a sans aucun
doute joué un rôle capital dans la création de combinaisons et d’interférences
entre des registres sémantiques différents4. « Le mort est vivant », cet énoncé
auquel l’Homme moderne accorde son assentiment, relève précisément du
même principe d’interférence des catégories. Mais cela aurait entraîné une autre
capacité cognitive, plus exactement deux autres capacités cognitives : d’une part
celle d’y croire, de penser que c’est vrai, et d’autre part, le relâchement mental que
cette acceptation implique, l’oubli que c’est « bizarre ». Telle serait une leçon
de ce long détour dans les modes préhistoriques de vie et de mort. Bref, avant de
1
F.L. Coolidge et T. Wynn, op. cit., pp. 201-202.
2
Cf. les analyses de F. Delpech et D.K. Grayson, de L. Meignen, de J. Jaubert et A. Delagnes, in
B. Vandermeersch et B. Maureille (éds), op. cit. Cf. aussi I. Tattersall, L’Émergence de l’ homme,
Paris, Gallimard, (1998), 1999, pp. 253-278, et S. Mithen, op. cit., pp. 166 et sq.
3
A. Piette, Anthropologie existentiale, Paris, Pétra, 2009. Le lecteur peut trouver des indications
empiriques précises dans W.C. McGrew, Chimpanzee Material Culture, Cambridge, Cambridge
University Press, 1992.
4
S. Mithen, The Singing Neanderthals, op. cit., pp. 263-265. Cf. aussi M. Patou-Mathis, op. cit.,
ch. 11.
25
CROIRE.indd 25 22/02/13 11:30:07
albert piette - l'origine de la croyance
passer inaperçu dans le métro, il faudrait que l’Homme de Neandertal puisse y
rester : ce qui paraît difficile sans cette capacité de fluidité et de relâchement !
Ainsi se font des vies individuelles qui, au fil de détails accumulés, aboutissent,
lorsque l’on se retourne, à des différences. L’évolution des espèces se fait par
la reproduction, la vie et la succession d’individus, et j’insiste sur ce terme.
« Selon moi, écrit Darwin lui-même, on a, dans un but de commodité, appliqué
arbitrairement le terme espèce à certains individus qui se ressemblent de très
près, et que ce terme ne diffère pas essentiellement du terme variété, donné à des
formes moins distinctes et plus variables.»1
Aujourd’hui, l’anthropologie s’intéresse rarement à la question des origines.
C’était une de ses forces captivantes il y a cent cinquante ans, lorsqu’elle posait
des interrogations sur l’origine ou l’évolution de la vie sociale et des religions et
tentait d’y répondre. Elle le faisait d’ailleurs à partir de documents ethnologiques
sur des populations d’Amérique, d’Afrique ou d’Océanie, des sociétés dites
primitives, pour comprendre la nature humaine. Mais pouvons-nous penser
que celles-ci, observées au moment où leurs croyances et leurs rituels sont bien
établis, ressemblent à cet homme qui, il y a peut-être 100 000 ans, a commencé
à croire ? Le moment originel de la croyance n’a rien à voir avec la somme
des rituels, des tabous, des prohibitions dont l’ethnologie se fait l’interprète.
Désormais, c’est d’une part vers l’archéologie préhistorique, surtout celle de la
fin du Paléolithique, et les sciences de la cognition, en particulier la psychologie
évolutionnaire, que doit se tourner l’anthropologue pour tenter de se rapprocher
des premiers moments, des premières apparitions de l’acte de croire, et d’autre
part vers la primatologie afin de comprendre les événements et les étapes
chronologiques ayant précédé, préparé et permis la nouvelle aptitude à croire.
Il réside une force saisissante à associer les informations de l’archéologie et de
la psychologie évolutionnaire, comme en témoigne l’ouvrage de Steven Mithen,
The Prehistory of the Mind2 .
Penser le moment du commencement des croyances implique donc de poser
un temps, une longue période pendant lesquels des êtres proches des hommes
actuels n’ont pas eu de croyances. « La croyance en une puissance invisible et
intelligente, écrit Hume, s’est très généralement répandue dans l’humanité, en
tout lieu et en tout âge ; mais elle n’a peut-être pas été si universelle qu’elle n’ait
souffert aucune exception ; et elle n’a produit aucune uniformité dans les idées
qu’elle a fait naître ». Il ne faut dès lors pas chercher l’explication dans un besoin
ou un manque, dans on ne sait quel instinct proprement humain, mais plutôt
dans l’actualisation à un moment donné de certaines compétences cognitives
peut-être déjà anciennes et non encore actualisées. Les interrogations de Hume
sont précises : « Qu’est-ce qui donne naissance à la croyance primitive ? Quels
sont ces accidents et ces causes qui dirigent son opération ? C’est le sujet de notre
enquête. »3. Cette perspective est opposée au principe durkheimien selon lequel
1
C. Darwin, L’Origine des espèces, Paris, Flammarion, (1859), 1992, p. 100.
2
S. Mithen, The Prehistory of the Mind, op. cit.
3
D. Hume, L’Histoire naturelle de la religion et autres essais sur la religion, Paris, Vrin, (1757),
26
CROIRE.indd 26 22/02/13 11:30:07
le premier croyant
« il n’y a pas un instant radical où la religion ait commencé à exister et il ne s’agit
pas de trouver un biais qui nous permette de nous y transporter par la pensée.
Comme toute institution humaine, la religion ne commence nulle part »1. Ce
dernier principe est acceptable, je l’ai dit, pour la vie sociale en général qui est
presque aussi ancienne que l’histoire de la vie, en tout cas des espèces animales.
Mais à l’évidence la croyance est une aptitude au moins cognitive, spécifique aux
hommes, et plus précisément à l’espèce Homo sapiens du genre Homo.
L’homme n’a donc pas commencé par croire à des choses bizarres avant
de penser rationnellement. Ce qui serait contraire à l’évidence même des
compétences des singes et des premiers hominidés, capables de planifier une
activité, de chercher des indices et des traces, de déduire la présence d’autres
êtres, de faire des prévisions météorologiques. Une telle pensée logique est
d’ailleurs nécessaire à la vie sociale des singes et des hominidés, à la constitution
d’alliances, la reconnaissance d’alliés, la chasse et l’activité coopérative. Les
évolutionnistes de la fin du xixe siècle ne nient d’ailleurs pas la capacité des
« hommes primitifs » à raisonner et à réfléchir mais elle se faisait, selon Spencer
ou Tylor, sur base de connaissances limitées. En outre, la réflexion des premiers
anthropologues, Müller, Spencer, Tylor, Smith, Frazer et bientôt Durkheim et
Mauss, concerne particulièrement le contenu des premières idées religieuses et
leur ordre chronologique d’apparition dans l’histoire de l’humanité, plutôt que
l’acte de croire lui-même, parfois assimilé à une réflexion embryonnaire ou à
un raisonnement qui a échoué. Ces croyances concernent-elles un phénomène
naturel, un objet, un mort, un ancêtre ? Les formes originaires de la religion,
quelles seraient-elles ? Il s’agirait, selon ces auteurs, de vénérer un objet, de
personnifier le soleil ou la lune, de croire à la survie du mort, d’adresser un
culte au totem du groupe. Sans doute, aucune de ces possibilités n’est exclusive
spatialement et chronologiquement à partir des données archéologiques de la
Préhistoire. Ces éléments sont capables de dire la réalité de ce qui s’est passé pour
un homme ici, pour un autre là-bas. Mais ce qui me semble plus important est
bien la compréhension de l’apparition de l’acte de croire, de l’aptitude cognitive
qui est sous-jacente à ces contenus de croyance, et de son impact sur le mode
d’exister en général.
Lorsque j’évoque les premières apparitions de l’acte de croire, j’indique donc
un acte mental, intime et privé, dont l’objet même n’est pas nécessairement
dépendant d’une causalité sociale et dont le surgissement précède l’explicitation
verbale, la transmission d’abord informelle puis sa fixation dans un système
d’idées et de rituels. Mais c’est aussi un acte tardif, dont Homo sapiens aurait
l’exclusivité. C’est la « croyance » qui le caractérise, ou plus précisément ce
qu’elle a impliqué chez les humains dans leur manière d’être présent.
En vue de préciser comment l’acte de croire a pu surgir dans un lieu et à un
moment spécifiques, il est possible de penser que cet homme, le premier qui a
cru, puisse nous ressembler cognitivement…
1989, pp. 39-40.
1
É. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, puf, (1912), 1985, pp. 10-11.
27
CROIRE.indd 27 22/02/13 11:30:07
albert piette - l'origine de la croyance
Il y aurait bien dans nos modalités de croire des éléments capables de nous
aider à comprendre l’expérience cognitive et émotionnelle de ces premiers
hommes croyants. Ainsi l’observation rapprochée de formes contemporaines et
géographiquement proches, même très ordinaires, de la vie religieuse et surtout
l’auto-observation de moi-même en train de croire semblent des éléments
importants non pour donner une description vraie (évidemment !) du moment
initial de la croyance, mais pour aider à le penser, en accord avec les données
archéologiques et cognitives. C’est bien le travail d’introspection que je valorise,
qu’Evans-Pritchard1 a sévèrement reproché aux premiers anthropologues mais
qu’au contraire Bergson revendiquait : « Il faut aller à la recherche, écrit-il,
de ces impressions fuyantes, tout de suite effacées par la réflexion, si l’on veut
retrouver quelque chose de ce qu’ont pu trouver nos plus lointains ancêtres »2 .
Ou encore :« N’oublions pas que nous cherchons au fond de l’âme, par voie
d’introspection, les éléments constitutifs d’une religion primitive »3.
Dans cette perspective, l’anthropologie des origines consiste, à partir de
dossiers empiriques, à imaginer des « scènes primitives » et à penser des scénarios
évolutionnaires capables de donner une intelligibilité nouvelle à l’être humain,
tout au moins de l’interroger sur telle ou telle spécificité de son mode spécifique
d’exister.
Ces dossiers peuvent être constitués de documents de l’archéologie
préhistorique et de psychologie évolutionnaire qu’il s’agit de confronter à des
observations rapprochées et en direct des hommes. C’est le défi de réaliser un
« grand écart » et en même temps de créer des liens entre quelques instants de
vie d’êtres et les milliers d’années d’évolution.
La plongée dans le paléolithique de l’histoire des hommes sera donc suivie
d’une autre plongée, dans le « paléolithique intérieur », le mien, mais entre les
deux, le lien est fort, comme le présente Edgar Morin : « Argument quelque
peu solipsiste que celui qui justifie les vérités de ma personne par les vérités
générales de l’anthropos, et les vérités générales de l’anthropos par les vérités
miennes. Mais qu’est-ce que la connaissance sinon un échange où nous restituons
par le langage ce que le monde nous a donné ? Reste à vérifier désormais cette
connaissance intrinsèquement, à en discuter, critiquer la théorie, pour voir si j’ai
effectivement reçu le baiser anthropologique ou si j’ai émis un malencontreux
borborygme »4.
1
E.E. Evans-Pritchard, La Religion des primitifs à travers les théories des anthropologues, Paris,
Payot, (1965), 1971.
2
H. Bergson, Les Deux sources de la morale et de la religion, Paris, Puf, (1932), 2008, p. 167.
3
Ibidem, pp. 137-138.
4
E. Morin, Le Vif du sujet, Paris, Seuil, 1969, p. 372.
28
CROIRE.indd 28 22/02/13 11:30:08
ÊTRE EN TRAIN DE CROIRE
« Tout ce qui est sur la terre a une existence singulière. […].
Rien n’est identique à rien. Tout s’offre au regard dans sa
différence »1
Chaque existence qui se pense et se vit si singulière n’est au fond qu’un détail,
rien même pour presque toutes les autres existences passées, présentes et futures.
L’anthropologue doit rester interpellé par cet extraordinaire contraste en chaque
humain entre l’extrême singularité et la vanité vide, par cet effet de l’être, celui de
l’acte d’être, disons de l’acte d’exister uni à chaque étant concret et créant ainsi
une richesse inépuisable. Je suis ainsi convaincu que l’objet de l’anthropologie ne
peut être celui de la sociologie ou de l’ethnologie, sous peine de galvauder une
discipline, d’en faire un fourre-tout défini par défaut. Mon hypothèse serait de
laisser à la sociologie et à l’ethnologie l’étude des phénomènes sociaux et culturels,
et de permettre à l’anthropologie d’être la science empirique des hommes, des
individus, de leurs singularités vivantes, existantes et présentes.
Le philosophe Bernard Grœthuysen évoque Platon et Socrate. Dans l’œuvre
de Platon, écrit-il, l’homme qui fait de la philosophie est toujours présent. Il vit, il
pense, il parle. Ce n’est pas « de l’homme en général » dont il est question, « mais
de cet homme-ci : Socrate ». Cet homme n’est pas l’Homme mais précisément
cet homme-ci, tel qu’il ne peut se laisser résumer en un système de philosophie.
C’est un homme concret. Inépuisable, il résiste. Pas question pour Platon de
présenter une philosophie sans son philosophe confronté aux problèmes de la
vie. C’est « la philosophie de l’homme philosophique […]. Il pense sa vie, tout lui
devient objet de méditation. »2 Une réflexion aussi sur le chemin parcouru et à
reparcourir dans un retour permanent sur soi, sans chercher un résultat définitif,
1
E. de Dampierre, Penser au singulier, Paris, Société d’ethnographie, 1984, p. 11.
2
B. Grœthuysen, Anthropologie philosophique, Paris, Gallimard, (1928), 1980, p. 13.
29
CROIRE.indd 29 22/02/13 11:30:08
albert piette - l'origine de la croyance
« une philosophie du philosophe où la philosophie se prend elle-même comme
objet »1. Sans doute une philosophie de la vie qui n’exclut pas de se regarder, de
solliciter son expérience de la vie. Non pas une sociologie, non pas une ethnologie,
mais une anthropologie, une anthropologie de la vie, même et surtout, à la
différence de celle de Platon et de Socrate, très ordinaire. En général, la vie du
chercheur en dehors de son terrain professionnel ne semble pas bonne à raconter
ni pertinente pour produire de la connaissance. L’exercice d’observation de soi-
même en actes, en pensées et en émotions serait-il donc illégitime ? Pourtant
l’auto-observation de son expérience personnelle est parfois le seul moyen
pour capter non seulement des vécus intimes et émotionnels comme l’amour,
la souffrance, le deuil, la croyance, les secrets ou les mensonges, mais aussi les
différentes couches de la conscience. Bref, la fluidité et le mouvement de la vie.
Le récit auto-ethnographique qui cherche ainsi à saisir des séquences précises
d’une expérience n’a rien à voir avec les récits de vie racontés à l’ethnologue y
cherchant un accès privilégié à une culture. Je préfère parler d’« autographie »
visant à comprendre ce qu’il y a d’humain et non nécessairement de socioculturel
dans l’action. Bien sûr, les objections épistémologiques sont nombreuses à cette
méthode de travail. Son seul pari est de faire progresser le savoir, à partir d’une
information intime, dont le « pacte autographique » doit garantir la fidélité et
la précision.
Il me semble en effet important de renouveler le matériau ethnographique
sous la forme d’observations d’individus et en particulier de soi-même.
L’exercice autographique présente un ensemble d’atouts qui ne le délégitiment
pas nécessairement par rapport aux observations participantes dans les groupes
humains plus ou moins étrangers. Que suppose une démarche autographique ?
Une bonne connaissance de soi-même, une proximité avec ses actions et ses
pensées, une capacité de se réfléchir, donc de créer et de recréer une distance
interrogative, de pratiquer celle-ci avec des concepts et dans un dialogue partagé
avec des collègues, de maintenir la focalisation sur un individu en particulier,
cet homme-ci, dans ses détails singuliers avec – j’y tiens – la saisie d’éléments
généraux sur la différence anthropologique. À partir de cette rencontre intuitive
et réflexive avec soi-même, il s’agit moins d’établir une collection de données
que d’interroger la présence humaine, de la décrire, de la penser. Disons, de faire
de l’anthropologie. Décrire, interroger, comprendre sa propre présence dans
diverses situations permet aussi et sans aucun doute de dire quelque chose sur
l’existence humaine, qui puisse interpeller l’épistémologie et les théories des
sciences sociales. Ainsi, le lecteur va le découvrir, l’exercice autographique me
permet d’expliciter l’acte de croire, d’atteindre de petites couches de la conscience
et de la non-conscience, de réfléchir sur la notion de présence, de critiquer celle
d’action et aussi d’enrichir une théorie de la présence à partir de l’idée de reposité.
Il s’y déploie progressivement un lexique pour une anthropologie des existences.
En sciences sociales, un grand reste, n’est-ce pas l’existence et le plus grand reste
l’existence de soi-même ?
1
Ibidem, p. 19
30
CROIRE.indd 30 22/02/13 11:30:08
être en train de croire
Les vertus de l’exercice autographique ne consistent certainement pas dans
le déploiement narcissique. J’y vois quatre atouts, qu’il faut sans cesse garder à
l’esprit : une information détaillée sur ce que des gens, en particulier un individu
est capable de faire, dans mon cas sur ses modalités d’être présent, de croire, de
continuer ; une forme d’ambition-limite des descriptions et d’étalon par rapport
auquel situer les descriptions typiquement synthétiques des sciences sociales ; un
moyen de dialogue avec des observés, d’échange à égalité sur des choses intimes
comme les croyances, l’amour, les états d’esprit ; un exemple d’écriture accessible
aux observés pour qu’ils s’en inspirent afin d’écrire à leur tour des sentiments ou
des humeurs.
Anthropologie singulière ? Dans son très beau livre sur Kierkegaard,
Vincent Delecroix indique l’œuvre du philosophe : « penser l’existence (sur le
mode singulier) » et « faire exister le sujet qui la pense »1. Il faut trouver les
« moyens » : les mots, les méthodes. La mise en perspective aussi. Je me présente
donc en échantillon d’humanité, celle de sapiens bien sûr : dans chaque attitude
singulière, n’y aurait-t-il pas le tout de la singularité humaine ? Dans les détails de
ma singularité, je tenterai de (re-)trouver la différence anthropologique en général.
Les humains, qui sont-ils ? L’homme en général et des individus singuliers, réels,
particuliers. Qui existent, chacun rivé inexorablement à sa singularité, à son
existence. À l’anthropologue de déchiffrer le mélange et l’interférence du sens et
du non-sens, de l’engagement et du dégagement, du drame et de la légèreté. Tout
cela régulé par une autre polarité : la conscience, la possibilité de la conscience de
soi, de la durée, de la mort et la non-conscience, l’oubli, la mise entre parenthèses.
L’énigme anthropologique, par excellence.
Dans cette perspective, il n’y a aucune raison de penser qu’une expérience
religieuse chrétienne ne dise rien sur l’être humain, sur ce dont il est capable.
Il me semble au contraire qu’elle attire particulièrement l’attention sur une
spécificité cognitive des hommes, dont l’acte de croire constitue une expression
privilégiée. C’est cela que je veux montrer.
La mort constitue une rupture dans le cours ordinaire du temps aussi pour
ceux et celles qui partageaient la présence quotidienne du mort. L’absence de
celui qui vient de mourir engendre souvent une vraie résistance au cours de la
vie. Ces moments de confrontation à l’absence du mort et au risque de son oubli,
je les décris comme une expérience existentielle, émotionnelle et intellectuelle.
Avant que l’être humain retrouve le cours ordinaire de la vie, le deuil fait croire,
il fait se souvenir. Il fait oublier aussi. Contrairement à d’autres sentiments ou à
d’autres émotions, l’expérience de la mort d’un proche, de son absence irréversible
et du travail de deuil qui la suit ne peut être ressentie par le chercheur au terme
d’un travail de terrain par lequel il aurait partagé la vie d’une famille ou d’un
groupe pendant un an. Comment, dans ce cas, se mettre à la place des autres ? Il
ne peut en résulter que le récit tronqué d’une expérience réduite à l’inventaire,
certes compréhensif, des ressources socioculturelles pour gérer la mort. C’est le
1
V. Delecroix, Singulière philosophie. Essai sur Kierkegaard, Paris, Félin, 2006, p. 128.
31
CROIRE.indd 31 22/02/13 11:30:08
albert piette - l'origine de la croyance
décès brutal de mon père à l’âge de 64 ans qui me confronte pour la première fois
avec la mort. J’ai 29 ans. La disparition brutale de celui dont la vie a été partagée
pendant près de trente ans ne peut que constituer une rupture avec le temps
ordinaire en train de s’écouler. Au lendemain de la mort, la réalité de l’absence
s’impose comme une nouvelle donnée qui n’échappe ni à la perception, ni à la
conscience1.
Des actes de croire
Quelques heures après la mort de mon père, je ressens profondément le besoin
de ne pas laisser le néant le recouvrir. Je perçois et je comprends la nécessité
de trouver une solution à son absence. Il y a comme une évidente obligation
de transporter mon père mort mais toujours vivant dans un lieu duquel nous
pourrions continuer à communiquer. À plusieurs reprises, je sens une sorte
d’instinct évident de survie et la nécessité de faire confiance aux représentations
religieuses gardées en pointillé depuis mon enfance. C’est comme si mon propre
élan vital me poussait à croire que mon père n’est pas ce mort comme les autres.
À cet effet, j’interpelle le curé du village qui est venu prier auprès de mon père. Il
doit bien savoir lui où son esprit, son âme se trouve désormais… À ce moment-là
précis, au moment de cette interrogation, je crois que mon père a la possibilité
d’être dans un autre monde. Et mes idées religieuses enfouies à l’arrière-plan
sont ainsi projetées à l’avant de la scène, à la surface de ma conscience. Elles
commencent à résonner.
Mon attitude croyante n’est pas vraiment étonnante. Elle renvoie directement
à ma trajectoire biographique. Je ne sais trop s’il faut établir un lien, une
causalité entre mes croyances et mon enfance : ce que j’ai appris dans un petit
village de Belgique francophone des années soixante, dans une famille, comme
on dit, croyante et pratiquante, ce que j’ai souvent entendu de mes parents, de
mes grands-parents, ma fréquentation même irrégulière des messes du village,
ma participation au catéchisme, etc. À l’évidence, je n’aurais pas été le même
croyant si cette enfance s’était déroulée trente ans plus tard, dans une famille
moins ritualiste, dans une paroisse sans prêtres… Sans doute aussi, l’intensité
de mon réflexe croyant à la mort de mon père n’est pas dissociable de mon goût
pour les rituels sécurisants, la pensée, peut-être superstitieuse, voire les gestes ou
les idées compulsives, comme le diagnostiqueraient les psychologues. De mon
histoire personnelle, très banale et même si elle n’illustre pas une socialisation
très intégrée dans le monde des chrétiens, il résulte incontestablement une
disposition à croire.
Je pourrais alors répondre à n’importe quel enquêteur : « je crois que … », « je
crois que Dieu existe, que Jésus est mort et ressuscité, qu’il y a une autre vie après
la mort ». Je possède un réservoir culturel constitué de quelques propositions,
extraites du catéchisme de l’Église catholique, qui entretiennent l’espoir d’une vie
après la mort. Dans mon esprit, comme chez beaucoup d’autres, ces propositions
ne sont pas organisées en un système cohérent. L’expression de leur contenu peut
1
Cf. A. Piette, Le Temps du deuil, Paris, Éds de l’Atelier, 2005.
32
CROIRE.indd 32 22/02/13 11:30:09
être en train de croire
difficilement être précise. En latence depuis longtemps, elles résultent d’une
habitude passive et ne correspondent en rien à une décision volontaire ou à des
raisons d’y croire. « C’est comme ça » : une affaire de biographie et de contexte.
Ces croyances, qui atteignent rarement la conscience, restent là, avec une certaine
ténacité. Elles sont comme protégées par la profondeur de leur enfouissement et
par la perception de la force de l’autorité qui les a installées il y a vingt ou trente
ans : mes parents, les prêtres, … C’est l’intensité de ma douleur et de mon refus
d’accepter l’absence de mon père qui crée une telle émotion qu’il me semble aller
de soi de réactiver ces représentations enfouies pour trouver une solution. Il y a,
sans aucun doute, une confiance implicite en l’autorité de l’Église, en tout cas
en sa compétence sur les choses de l’au-delà. Je ne pourrais pas prendre pour
acquis ce que je découvrirais, par exemple, dans la religion juive ou dans la
religion musulmane. Cette forme de confiance, d’autant plus évidente qu’autour
de moi, elle est partagée, constitue sans doute une expérience de croire, même
si l’accomplissement de tel geste ou la lecture de telle prière ne supposent pas
toujours un état mental spécifique et qu’ils peuvent être effectués et récités dans
une certaine automaticité.
Si la rationalité consiste dans l’intention délibérée de recourir à tels moyens
et à telles idées pour atteindre telles fins, mes croyances ne sont pas rationnelles.
Je ne décide pas de croire pour résoudre une situation difficile. Je dispose de
croyances. Les circonstances, ma tristesse, ma peur permettent leur expression.
Mais si la rationalité est une évaluation a posteriori constatant l’utilité subjective
d’une attitude, les croyances ont de bonnes raisons de surgir. Je le perçois et je le
comprends : les propositions auxquelles je m’accroche, les prières que je lis, que je
répète m’assurent une certaine paix, une sérénité dans le cours de mes journées.
Ce qui, sans doute, me permet de vivre selon une apparence habituelle avec les
autres. Mes croyances ont d’autant plus de raisons de se manifester que les mêmes
attitudes croyantes d’amis, de parents, de vagues connaissances constituent,
peut-être à mon insu, une forme d’encouragement, voire de validation. Je fais
partie des êtres qui préfèrent garder des habitudes acquises au fil du temps, et
maintenir la confiance le plus souvent accordée. Je ne suis d’ailleurs pas dupe de
l’effet positif immédiat de mon attitude.
Par le hasard de mes lectures, je découvre des prières. Chaque soir, je lis le
même texte, extrait d’un journal paroissial. J’égrène ainsi des énoncés qui me
parlent, qui génèrent en moi l’écho attendu. Ce genre de prières me rapproche
mentalement de mon père et, de plus, elles supposent implicitement qu’il a sa
place, un lieu dans un autre monde. Cela me fait du bien ! Chaque jour, souvent
l’après-midi, parfois avec ma mère, parfois seul, je me rends au cimetière, pas
très loin de chez nous. Debout, devant la tombe de mon père, je m’adresse à lui,
je le remercie, je lui demande des choses. J’en espère d’autres pour lui. C’est la
proximité de son corps qui permet ces paroles murmurées. Le plus souvent, je
répète les mêmes phrases. Je me tiens le plus près possible de la place de mon père
sous la pierre. Jamais, ailleurs qu’au cimetière, je ne lui parle aussi directement. À
33
CROIRE.indd 33 22/02/13 11:30:09
albert piette - l'origine de la croyance
ce moment-là, je dépasse nécessairement ce que je vois. De mon comportement,
on ne peut que déduire que je vois quelque chose d’autre que la tombe. L’image
de mon père. Est-il allongé comme je l’ai vu, mort ? Oui, non. C’est un peu cela.
C’est flou.
Je n’entends pas mon père. Je sais que son corps sans vie près de moi est un
cadavre dont l’odeur, surtout lorsqu’il fait chaud, ne trompe pas. Je sais et je sens.
Et je continue à m’adresser à mon père dont je ne me représente pas clairement
l’état actuel, mais que je ne me représente pas non plus vivant. La re-présentation
de l’absent peut sembler culturellement évidente puisque, dans la tradition
chrétienne, l’être divin est souvent sollicité comme une personne avec laquelle
une communication est possible. Autant que le dialogue intérieur, la prière
constitue pour moi une modalité analogue de rester en présence de mon père.
L’amour, qui est nécessaire pour réaliser cette communication, a lui-même des
médiations : les paroles de la prière eucharistique, les prières du soir et même
dans ce cas, le support papier sur lequel je les lis et qui m’accompagne partout.
Outre les messes dominicales, je participe sans aucune exception aux liturgies
spécifiques : à la Toussaint, à Noël, à Pâques, à l’Ascension. En accord avec ma
mère, et comme je l’ai demandé au curé de notre paroisse, ces messes sont toujours
célébrées à l’intention de mon père nommément cité. L’occasion de sentir, de
tenter de sentir une nouvelle proximité et d’écouter l’espoir de la résurrection.
Par exemple, à la célébration de la Toussaint et surtout à celle du Jour des morts,
le lendemain, le prêtre prie pour « ceux qui nous ont quittés » en évoquant
l’espérance qu’ils ne sont pas seulement partis de ce monde mais qu’ils sont
arrivés auprès du Christ. Je suis présent, j’écoute. Puisque le prêtre le dit et que
tant de personnes sont là…, je ne suis pas arrêté dans ma croyance à la possibilité
d’un autre monde où serait mon père. À Pâques, l’expérience de quelques dames
découvrant un tombeau vide devient un signe pour moi qui suis en train de
chercher. « Et si c’était vrai ! », me dis-je sans amener cette proposition trop
près de ma conscience comme si, à d’autres moments, la perception de cette
possibilité d’un autre monde était moins garantie. À cette occasion, il ne s’agit
pas de croire de manière tacite que…, ni de sentir une connexion approbatrice
avec l’idée de la résurrection, mais de croire à cette possibilité d’une vie éternelle.
Le contenu presque réaliste de ma croyance devient tel que je me surprends moi-
même à demander naturellement à mon amie si mon père pourra savoir quand
je serai muté dans une autre université. Cela s’appelle « croire ». Un moment.
Il semble bien impossible d’approfondir la question et la réponse ! Mais pas
de tiraillement ni de litige intérieur. Je sais de manière diffuse que je ne puis
attendre une réponse nettement affirmative ou négative. Quand j’ai tendance à
pencher du côté approbateur, je sens, plus ou moins mollement, en toile de fond,
en arrière-plan, une incertitude. Mais pas grande. Il y a comme « un cran d’arrêt
dans la course à la vérité », selon la belle expression de Pierre Reverdy1, un cran
d’arrêt pour la pensée, de toute pensée, y compris celle qui concerne l’énoncé
religieux lui-même.
1
P. Reverdy, Le Livre de mon bord, Paris, Mercure de France, 1989, p. 13.
34
CROIRE.indd 34 22/02/13 11:30:09
être en train de croire
Comment je suis quand je crois ?
Parmi les milliers de représentations qui traversent l’esprit des hommes,
il y a donc des idées religieuses associées à une attitude mentale spécifique
d’assentiment. Comment les gens croient-ils ? Que se passe-t-il dans l’esprit des
hommes qui croient ? À quoi cela revient-il de penser que le mort est ressuscité ?
C’est à ces questions, dont les ethnologues ne sont pas très friands, que mon
expérience singulière tente d’apporter une réponse. Ce que les ethnologues
essaient d’identifier et de comprendre, correspond le plus souvent à une unité
culturelle caractérisée par un ensemble cohérent de pratiques et de représentations.
Ce sont les croyances telles qu’elles sont professées et communiquées dans des
célébrations religieuses, ou transmises publiquement dans des versions écrites.
Dans ce cas, les variations individuelles qui animent la vie mentale de chacun ne
sont pas pertinentes pour l’analyse ethnologique. Comme si lesdites croyances
étaient représentées mentalement de façon uniforme, l’ethnologue construit une
synthèse culturelle, poussant son interprétation jusqu’à attribuer à cette unité
des intentions, des désirs, des idées. S’il n’a pas l’inconvénient d’être vraiment
faux, ce type de compréhension ne détient pas non plus le mérite de saisir les
attitudes et les représentations mentales des gens, dont la part commune au sein
d’un même groupe, d’une même société, est plus que réduite. Il en ressort une
description au grand pouvoir d’intelligibilité mais très éloignée de ce qui fait
l’expérience des humains.
Bref, l’affirmation d’une croyance, l’inventaire d’énoncés religieux, sans
compter la possibilité du mensonge, ne disent rien sur l’attitude mentale et les
modalités d’adhésion du croyant. Il est sans doute possible d’attribuer un contenu
de croyance d’après ce que quelqu’un peut dire dans une prière. Mais cette
attribution de croyance ne renseigne ni sur la dimension floue de son contenu,
ni sur les modalités de l’assentiment, tout aussi indéterminé, qui lui est donné.
Le risque est de toujours analyser des représentations publiques bien stabilisées,
d’en faire une marque culturelle et de sacrifier ainsi toute connaissance sur l’acte
de croire. Le récit de mon expérience constitue une manière d’éviter une sorte de
perte de contact entre l’anthropologie et l’expérience du croire, plus simplement
ou plus radicalement, entre l’anthropologue et la vie. En deçà des validations
sociales, des logiques de transmission, des témoignages des uns et des autres, le
croire est une expérience mentale, intime, privée. Elle est un reste de la logique
sociale. Il y a bien le risque qu’il soit contourné en sciences sociales.
Que se passe-t-il donc quand je crois ? Comment suis-je ? Il m’a fallu un certain
temps pour expliciter mon expérience de la croyance. À cet effet, l’interprétation
cognitive de Dan Sperber sur l’acte même de croire pointe précisément ce qui
dans mon état d’esprit me semblait sourd, latéral et difficilement dicible1. Plus
tard, l’analyse détaillée de Pascal Engel2 , qui explicite les processus mentaux de
1
D. Sperber, Le Savoir des anthropologues, Paris, Hermann, 1982, chapitre 2.
2
P. Engel, « Les croyances », in Denis Kambouchner (dir.), Notions de philosophie II,
Paris, Gallimard, 1995, pp. 10-111 et aussi « La grammaire de l’assentiment revisitée », in
35
CROIRE.indd 35 22/02/13 11:30:10
albert piette - l'origine de la croyance
l’acte de croire comme moment spécifique d’assentiment à une proposition, et
aussi le travail de Fabrice Clément1 sur les mécanismes cognitifs et émotionnels
sous-tendant l’acte d’adhésion à des idées « bizarres » m’ont donné les outils
intellectuels et les mots, pour décrire des moments de croyance et faire ainsi
une sorte d’autographie cognitive. C’est créer une dynamique féconde entre la
philosophie comme réservoir conceptuel et l’autographie comme capacité d’auto-
observation rétrospective de mes actes de croire. C’est aussi une réponse – peut-
être la seule possible – à la demande déjà ancienne de Dan Sperber d’analyser les
formes d’adhésion2 .
Répondre à un enquêteur qu’il croit consiste à énoncer une opinion qui ne
supposerait pas une attitude mentale spécifique. Mais je reconnais, dans mes
actes de croire, une attitude mentale spécifique. À ce moment du deuil, les idées
religieuses qui me font signe, je tente intérieurement de les approuver. Ce sont
des états de croyance. Ils correspondent à l’action proprement dite de croire, qui
surgit sous forme d’une attitude mentale caractéristique, peut-être pas exclusive,
mais sans doute différente d’autres attitudes mentales. Tel un événement, croire
constitue, dans un contexte, un lieu et un temps spécifique, un acte capable de
se manifester sous différentes occurrences : une pensée, une émotion, un geste.
L’acte de croire est une sorte d’approbation, plus ou moins réfléchie aux contenus
propositionnels des croyances dont je dispose. Une manière de les confirmer.
Lorsqu’il se manifeste sous la forme de pensée, l’acte de croire consiste en une
représentation approbatrice d’une image ou d’une proposition. L’assentiment
surgit ponctuellement, disant « oui » à la représentation de la vie du mort dans
un autre monde. De manière insaisissable, elle repart en laissant l’impression,
la sensation que cet autre monde n’est pas impossible. Surtout il apparaît que
la pensée de telles représentations religieuses au cours des célébrations n’est pas
nécessairement accompagnée d’un mouvement net d’acceptation. Il m’arrive
souvent de pousser mon accord, comme si je voulais croire, adhérer, alors que je
m’en sens peut-être incapable. Je suis comme forçant mon croire contre l’évidence.
Cet acte de volonté qui me pousse à croire ce que je désire se laisse alors pénétrer
d’une sorte de réserve, d’un doute qui accompagne le mouvement d’assentiment.
C’est dans ce rapport plus ou moins approbateur à la représentation que l’acte
de croire crée une marge possible et, en même temps, des degrés d’approbation.
Je ne suis jamais, même un instant, dans l’acquiescement radical. Il s’infiltre
toujours un manque rappelant qu’il n’y a pas une garantie objective à l’existence
de cet au-delà, mais toujours dépassé par l’espoir d’en savoir plus un jour, plus
tard. De savoir que c’est possible. Sans doute, la force même de cet assentiment
est-elle dépendante de la stabilité du contenu des propositions dont le croyant
dispose et de la confiance qu’il éprouve vis-à-vis de l’autorité émettrice. Pour ce
qui me concerne, même s’il y a confiance et croyances à disposition, la force de
S. Bourgeois-Gironde, B. Gnassounou et R. Pouivet (dir.), Analyse et théologie. Croyances
religieuses et rationalité, Paris, Vrin, pp. 143-161.
1
F. Clément, Les Mécanismes de la crédulité, Genève, Droz, 2006.
2
D. Sperber, op. cit.
36
CROIRE.indd 36 22/02/13 11:30:10
être en train de croire
l’une et des autres est comme émoussée, érodée par un doute. Comme si mon
désir de croire se heurtait à une imprécision de ce à quoi je voudrais croire et
surtout à l’évidence d’une probabilité difficile de la résurrection. Je me perçois
dans un effort qui ne peut aller au bout. Sans simuler pour autant. Est-ce que je
me crois incapable de croire ? Mais même interrogateur, l’assentiment consiste
en un état de croyance. Comme lorsque je me demande si mon père mort aura
connaissance de ma mutation professionnelle. Terrible ! C’est toujours croire à
un autre monde possible que de ne pas répondre « non » et de continuer le
mouvement dans l’espoir d’informations nouvelles. Je suis comme celui qui n’est
pas certain que ses idées religieuses sont fausses.
De ces moments ponctuels que constituent les états de croyance, le désir et
la peur sont souvent des moteurs. Juste après la mort de mon père, mon désir et
ma peur atteignent une forte intensité : désir d’éternité, peur de perdre, peur de
plus rien, désir de retrouver. Alors, l’émotion qui peut constituer la dynamique
principale du mouvement de croire en est aussi son attestation la plus radicale.
De ses prières, de ses communications avec mon père, de ses moments d’attention
dans les célébrations, j’acquiers, même légère, une certaine tranquillité. Suffisante
pour poursuivre le cours de la vie. Cette sérénité est la marque que je crois, comme
la peur du fantôme peut être l’indice d’une autre croyance.
À l’opposé de l’état émotionnel, le simple geste peut traduire une croyance,
sans mobiliser une approbation consciente et volontaire. Sans état mental
spécifique, la prière peut parfois devenir automatique, une sorte de récitation en
pilotage non contrôlé. L’acte de présence à une célébration religieuse ne répond
pas nécessairement à une décision bien délibérée, à une émotion mystique.
Inscrites désormais dans le rythme des activités, de telles participations, même
dissociées d’un mouvement volontaire, ne trouvent leur cohérence qu’à partir
de ses croyances. Celles dont je dispose depuis longtemps. Mais surtout que je
mobilise depuis la mort de mon père et qui me procurent une certaine sérénité.
Le fait qu’il n’y ait pas d’états actifs des croyances dans de tels comportements
ou de telles attitudes ne suppose pas l’absence du croire. L’acte de croire, c’est
aussi une manière de se comporter, de lier les événements, sans nécessairement
déclencher une approbation consciente à quelque contenu propositionnel. L’acte
de croire consiste alors à « sentir » un signe supplémentaire, au-delà de ce qui
est directement visible ou lisible, ou, plus simplement encore, à refuser de ne pas
percevoir un enjeu, « quelque chose » dans la messe, l’hostie, la prière, devant la
tombe. Refuser de n’y voir que de la fiction. Il est un autre effet de réverbération
des états de croyance : je fais, à la sortie de la messe, l’aumône au clochard. Ce que
je ne faisais pas avant.
Cette description de ma croyance à la réalité de l’au-delà est sans doute encore
loin de dire tout ce qui se passe dans ma tête. Les idées religieuses me semblent
tellement fuyantes, leur réception passive et mes connexions éphémères. Le
contenu de la croyance est trop flou et son assentiment trop furtif pour qu’il
y ait une phrase correspondant à ma propre expérience. Il ne faut surtout pas
37
CROIRE.indd 37 22/02/13 11:30:10
albert piette - l'origine de la croyance
associer cette indétermination à une dimension mystérieuse. C’est la spécificité
même du contenu et du mode d’approbation des croyances qui est en jeu.
On sait qu’elles contredisent les attentes ordinaires des individus, qu’elles ne
correspondent pas à leurs anticipations habituelles, qu’elles sont le plus souvent
associées à des notions et à des expressions complexes, non compréhensibles
pour le croyant lui-même et qu’il ne cherche d’ailleurs pas à comprendre, à
mettre en cohérence avec d’autres croyances et avec ses propres comportements
quotidiens. Par rapport au contenu, par définition, non établi d’une croyance, je
me replie dans une sorte de relâchement mental dont la fluidité est la dimension
caractéristique. Le contenu de la croyance ne correspond pas vraiment à une
proposition qu’on isolerait d’un catéchisme. Les croyances constituent un tissu
confus et enchevêtré. La traduction verbale des croyances, même des siennes,
est nécessairement au-delà du contenu imprécis de la représentation religieuse.
Des phrases simples ne peuvent pas exprimer le contenu flou et indéterminé de
ce qui est cru. Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, le contenu est rarement l’objet
d’une expérience nettement approbatrice. Il est plus souvent suspendu par une
impression d’incertitude comme si le moment même de l’état de croyance mettait
en coprésence, parfois contradictoire, différentes parties de la personnalité. À
l’instant de cette croyance, elle ne paraît pas vraiment coordonnée ou hiérarchisée
dans une direction précise. Ma raison, sous la pression de la peur et du désir,
semble céder face au contenu indéterminé de la croyance, à la faiblesse de ma
volonté. D’où le flou de l’attitude mentale. Cet instant de confrontation furtive
fait parfois place à une sorte de compartimentage plus pacifique. À la messe,
je dois me sentir plus protégé de l’interférence possible du monde des hommes
que lorsque j’interroge mon amie sur ce que continue à savoir mon père mort.
La sortie d’une célébration a d’autant plus de chances d’être suivie d’un effet de
tranquillité que d’une suspension critique de la croyance.
Je ne sais pas vraiment ce qui est stocké dans ma tête, non pas des phrases ou
des propositions bien déterminées mais plutôt des idées diffuses qui résonnent
et me suggèrent qu’elles sont une solution. Ce que j’entends à l’Église sur la
résurrection et les retrouvailles après la mort est ce dont j’ai besoin. À aucun
moment, je ne me dis : « Mon père est ressuscité, oui, oui, il a réussi son passage
avec Dieu ». C’est beaucoup plus diffus, comme si ces énoncés entendus
remontaient ponctuellement à la surface de mon esprit, sans que je les rejette
comme je pourrais le faire avec une négation radicale à propos de pensées
erronées. Je ressens bien que c’est « cela » que je dois garder en suspension. C’est
le moment de faire confiance, même si c’est un grand mot.
Il faut croire, je désire croire. Il faut que je donne mon assentiment à ces idées,
je dois les répéter, les lire et les relire dans des prières. Mais, en même temps, je
ne prends pas la décision de croire. Il y a comme une sorte de rencontre – mais
là aussi le mot est trop fort – entre un réservoir de propositions de l’Église
catholique, une habitude très passive de les garder en moi, et des moments très
brefs où leur résonance fait sens et suscite un assentiment. Lui non plus n’est pas
38
CROIRE.indd 38 22/02/13 11:30:10
être en train de croire
complet. Il est flou et solitaire même si bien sûr il y a validation, légitimation,
diraient les sociologues, dans les nombreuses célébrations où je participe et
où sont annoncées des retrouvailles possibles. Ces moments particuliers me
rapprochent mentalement de mon père comme si ce que j’y entends concentrait
ponctuellement mon attention et suscitait une telle proximité. Et en même
temps tout cela est furtif. La peur de l’absence, l’émotion de la perte qui, sans
que je puisse à ce moment-là l’expliciter, dirige mon attention vers l’idée d’une
présence autre de mon père et exclut le gouffre, le vide. C’est celui-ci que je ne
peux pas, que je ne veux pas ressentir. Mon être perçoit un possible de réponse
dans les propositions de l’Église. Mon être ? Mais est-ce moi ? C’est la vie tout
simplement. Le bien-être, que je ressens à partir de ces actes de croire et qui est
plutôt l’absence d’un gouffre, confirme la pertinence de ces rencontres même
furtives avec l’idée que mon père n’est pas vraiment mort. Même furtives, même
minimales, même un peu, ça marche. Ce qui apparaît souvent, ce sont des flashes
mentaux, des moments ponctuels de représentations mentales imprécises d’un
être ressuscité. Cette présence mentale répétée sous une forme émiettée suffit.
Mais je crois. Ce désir ou ce réconfort constitue des moments particuliers de
croyance. L’attention, la concentration, l’effet de paix qui en émane sont comme
des traces de l’expérience du croire.
Ces représentations me font signe, je tente intérieurement de les approuver,
elles génèrent des moments de concentration comme si je voulais, par ces
représentations, me rapprocher de mon père. De manière insaisissable, l’idée de
l’au-delà repart en laissant l’impression, la sensation que cet autre monde n’est pas
impossible. Mais il m’apparaît également que la pensée de telles représentations
religieuses au cours des célébrations n’est pas nécessairement accompagnée
d’une approbation claire. Je suis comme celui qui n’est pas certain que ses idées
religieuses sont fausses. Je sais aussi que ce n’est pas le moment de réfléchir, de
mettre en doute, de me confronter à des éléments qui pourraient contredire. Je
sens furtivement la nécessité de cet évitement.
Je ne ressens donc pas un aveuglement dans ces moments de croyance. C’est
une sorte de capacité de simuler sans mauvaise foi, de faire comme si c’était vrai,
de se connecter mentalement à un être, de mobiliser son attention vers celui-ci
par des lectures et des prières. Mais ce n’est pas de la simulation. Ces moments
sont « réels ». Mais quelle consistance ont-ils ? Peu dans le fond. Ponctuellement,
je m’imagine que c’est vrai, que c’est possible. J’évite ainsi le mal-être plus que je
ne crée le bien-être. Je fais comme si ce n’était pas impossible. Mon désir de la
présence de mon père, la peur du néant sont tellement forts qu’ils permettent ces
connections à des idées religieuses dont je sais la fragilité, dont je sens la faiblesse
référentielle que pourtant je ne veux pas expliciter.
Quand croire, c’est faire et un peu plus
Du quotidien du croyant, le lecteur l’a compris, je porte un intérêt particulier
aux moments spécifiques où le croyant porte plus ou moins activement son
39
CROIRE.indd 39 22/02/13 11:30:11
albert piette - l'origine de la croyance
assentiment, par une parole, une émotion, un sentiment. Cela va de la peur
ponctuelle du fantôme à mon interrogation sur le savoir de mon père défunt
sur ma vie professionnelle. Ce sont là des actes « actifs » de croire qui existent
dans tous les univers religieux sous des formes diverses. Alors, quand « faire,
c’est croire »1 et que l’activité religieuse est surtout présentée comme un
accomplissement respectueux de règles et d’obligations rituelles en lien avec des
« immortels », je me demande ce qu’ont dans la tête ces Romains effectuant,
peu attentifs aux énoncés, leurs rituels. Pensent-ils que ces dieux existent ?
Comment y croient-ils, aussi en dehors des rites ? À propos des Grecs, Paul
Veyne écrit d’ailleurs : « L’existence même de ces dieux n’était pas le moins du
monde mise en doute »2 . Cela consiste à croire, et aussi mentalement et pas
seulement gestuellement. Valorisé ou non valorisé dans un univers religieux,
l’acte de croire, d’accepter, de lancer une approbation avec le doute en toile de
fond est universel. S’il semble difficile aujourd’hui d’observer des Romains de
l’Antiquité, ne laissons pas passer notre possibilité d’observer les croyants des
différents univers religieux existants. Je ne dirais donc pas « quand faire, c’est
croire » mais plutôt « quand croire, c’est faire, et un peu plus » : cet état d’esprit
d’assentiment.
De la rencontre entre une représentation religieuse et celui-ci, il résulte quelques
états de croyance qui rejoignent, sous des formes diverses, mon expérience :
– L’adresse à l’être surnaturel : un homme, devant une chapelle fermée dans
laquelle se trouve une Vierge, ôte son chapeau. Il marmonne quelques prières
pendant deux à trois minutes avant de repartir. Plutôt que d’émettre une opinion
d’existence, il est en état de croyance. À la limite, un « état de corps » faisant
intervenir, de manière ponctualisée et allant de soi, des habitudes corporelles et
linguistiques. Il est en train de croire.
– La présence intime : seul à côté d’autres fidèles pendant une cérémonie,
le croyant entre en larmes en écoutant le récit du dernier repas de Jésus et la
transformation du pain et du vin qui deviennent son corps et son sang. Le contenu
de l’énoncé du prêtre invite cette personne, selon sa propre interprétation et son
évocation personnelle, à vivre effectivement la « consécration ». Il est en train
de croire vraiment que le Christ est présent.
– La vision directe : dans un « état de grâce » particulier, le croyant voit l’être
surnaturel, Jésus ou la Vierge, qu’il peut décrire selon des traits particuliers. Il croit
que cette entité divine existe vraiment. Déclenchée par un processus émotionnel
particulier, cette « vision » n’est pas indépendante des représentations dont
dispose dans un contexte précis l’individu en question.
– Le lien à une émotion : seul dans une maison où repose un mort, le croyant
associe le premier bruit nocturne à la manifestation sous une forme particulière
du défunt. Tout aussi persuadé de l’inexistence des fantômes, il fait dériver une
même réaction émotionnelle à partir d’un contenu latent (les fantômes existent)
1
J. Scheid, Quand faire, c’est croire. Les rites sacrificiels des Romains ?, Paris, Aubier, 2005.
2
P. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Paris, Seuil, 1983, p. 52.
40
CROIRE.indd 40 22/02/13 11:30:11
être en train de croire
dans un état de croyance, même si ce dernier peut être très éphémère. Dans ces
cas, il croit quand même que …
– Le geste inévitable : glisser, avant la fermeture du cercueil pour accompagner
le défunt, des souvenirs personnels, par exemple des photographies. Le besoin
inébranlable de ne pas perdre un contact avec le disparu par la médiation de
tels objets est en tension avec la conscience, que l’on ne veut pas trop vive, de
l’inutilité pratique de ce geste. La personne ne croit pas vraiment que...
– La connexion mentale positive : elle peut avoir lieu en dehors d’un rituel
religieux proprement dit. Elle permet de construire mentalement, à partir de
représentations latentes dans une culture, l’image d’une situation que l’homme
se met à espérer (les retrouvailles au-delà de la mort avec ses parents) ou craindre
(la brûlure en enfer de son corps...).
La vie quotidienne du « croyant » est ainsi relayée par la dynamique de
l’ensemble de ces mises en phase entre lui-même et l’être surnaturel. Celui qui
croit vraiment aura sans doute régulièrement des connexions mentales positives.
Mais ne lui arrivera-t-il pas aussi de croire quand même ou également de ne pas
croire vraiment ? L’expérience du croire se traduit donc par la rencontre entre
un état d’esprit dans une situation spécifique, une manière d’être résultant
d’une trajectoire personnelle, et des propositions culturellement présentes, qui
traduisent la possibilité d’événements contraires aux attentes et aux anticipations
ordinaires des individus. D’une part, ces propositions peuvent se présenter au
croyant, sous la forme d’énoncés dogmatiques, d’une vérité globale épurée de
ses détails ou d’idées flottantes. D’autre part, l’acte proprement dit de croire
s’exprime par des gestes, des adresses à l’être surnaturel, des états mentaux
cognitifs et émotionnels. Et cette rencontre entre une peur, un désir, une volonté
et un contenu de croyance engendre des effets de résonance ou d’assentiment
variable et implique dans le cours de la vie des effets tout aussi variables de
réverbération.
Ces états éphémères de croyance sont enchaînés aussi dans divers basculements.
En plus de cette réverbération dans des attitudes spécifiques ou dans une manière
globale d’être serein, le plus courant est sans doute l’indifférence même entre
l’état de croyance ou l’acte de croire et les autres situations dans lesquelles le
croyant peut basculer – ce que l’on pourrait appeler le principe même de coupure.
À l’Église, je peux avoir un flash, une connexion mentale positive à l’idée que
mon père est ressuscité et mettre ce contenu entre parenthèses quelques minutes
plus tard. Je sais que le cadavre ne pourra pas utiliser les objets qui lui seront
destinés mais je les lui donne quand même... Il est impossible au moment du
geste de pousser mentalement à fond cet acte de croire sans en même temps faire
surgir un savoir critique. L’individu qui accomplit ce geste reste en léthargie,
préférant garder de telles représentations en-dessous du niveau de conscience :
c’est l’intériorisation minimale qui permet la gestion de telles incompatibilités.
Ceci est capital.
41
CROIRE.indd 41 22/02/13 11:30:11
albert piette - l'origine de la croyance
Quand je multiplie des lectures sur les expériences aux frontières de la mort,
mon désir de connaître constitue un acte d’adhésion éphémère à un contenu. Mais
d’emblée surgit un scepticisme, voire un clin d’œil ironique, et ce très rapidement
après la lecture des énoncés en question. L’hésitation est une autre modalité
de pratiquer en même temps une forme d’adhésion et la distance critique. Par
exemple, à l’Église, en train de regarder les autres debout et s’inclinant, j’hésite,
je théâtralise un geste rituel, je tente d’entrer en « phase », pensant que je dois
y entrer... Peut-être est-ce la situation dans laquelle se trouve tout participant de
quelque cérémonie. Chacun, à partir de son attitude, de son acte de croire non
pleinement satisfaisant, se réserve de communiquer son insatisfaction spirituelle,
jouant le jeu d’une parfaite expérience selon un mode caractéristique auquel il
peut d’ailleurs se laisser prendre, en pensant que les autres la réalisent. Ceux-ci,
se croyant les seuls à manquer un tel contact avec le divin, peuvent produire,
selon la même phase, les mêmes témoignages, se laisser peut-être prendre en
pensant qu’ils étaient les seuls à simuler... La recherche de preuves est encore
une autre modalité d’assurer le basculement de l’état de croyance. Elle consiste
par exemple à lire des théories de physique quantique pour y découvrir la réalité
de ce qui peut être dit dans des récits sur les expériences aux frontières de la
mort. Chercher de telles preuves, c’est d’une certaine façon croire à la possibilité
d’existence d’un autre monde.
Les états de croyances constituent, dans l’expérience du deuil, des moments
particuliers, dont l’intensité a rejailli, à mon insu, dans le cours de ma vie
quotidienne, dans une manière d’être serein et aussi joyeux avec les autres. Je ne
me souviens pas aujourd’hui explicitement de moments radicalement critiques
générant une mise en doute des propositions religieuses qui, placées à l’avant-plan
de mes pensées, structurent mon temps de deuil. Si critique il y a, elle n’est que
diffuse. Il en ressort un contraste saisissant entre les temps de douleur marqués
par l’absence de mon père, les temps de croyance qui reconstruisent une nouvelle
forme de sa présence et les autres temps, amoureux ou professionnels, de ma vie.
Face à la diversité des théories philosophiques mais aussi sociologiques,
je suis toujours frappé par leur incompatibilité qui engendre des débats non
clôturables. Ce propos qui peut sembler trivial signifie la nécessité des données
continues de la « vie », par le suivi d’hommes dans des situations et des instants
successifs. La croyance est-elle un acte mental ou une disposition sans état mental
correspondant ? De telles observations rapprochées de « croyants » ferait
voir un enchaînement de situations dans lesquelles l’individu sent ou ressent
mentalement l’acceptation d’un énoncé religieux, une sorte d’assentiment à des
idées, à des images, puis s’affaire et pense à d’autres choses. Un peu plus tard, il
accomplit des gestes qui, sans générer un état mental de « croyance », supposent
une sorte de disposition, d’habitude ancrée en lui, commencée un jour peut-être
suite à l’advenue spécifique d’un état de croyance, se déployant par résonance ou
réverbération, ou plus simplement par effet d’éducation, disposition d’ailleurs
possiblement réactivée mais pas nécessairement par ces moments de croyance.
42
CROIRE.indd 42 22/02/13 11:30:11
être en train de croire
L’observation rapprochée suppose aussi de dépasser le strict point de vue
cognitiviste de Sperber et Boyer ainsi que l’analyse des raisons de croire, qui posent
un acte cognitif sans décrire l’expérience même du porteur, de l’accomplisseur.
L’essentiel est justement la dynamique entre les bonnes raisons, plus ou virtuelles
à l’état présent, qui un jour ont pu être actives dans une décision mais qui le plus
souvent ne répondent pas à un acte ponctuel de décision, entre la socialisation
des allants de soi et aussi des états d’esprit particuliers. La phénoménographie
d’un catholique, d’un protestant, d’un juif, d’un musulman, c’est observer
et décrire cette dynamique entre les idées sociologiques. Cela suppose bien
de considérer le croyant comme un « oignon » à éplucher à l’instant t, t+1,
t+2, …, avec la certitude qu’il n’y a pas de noyau dans l’oignon, mais différentes
pelures, différentes strates : une sorte de rationalité virtuelle, des apprentissages
familiaux et des états d’esprits plus ou moins vifs, plus ou moins évanescents,
avec intensification et désintensification variables et quasi simultanées.
Une autre précision. Personne ne dirait que Tintin et le Roi Lion « existent ».
Le croyant, lui, dit que son Dieu existe ou que le mort est ressuscité, et ne dit
rien de semblable pour Tintin ou le Roi Lion, dont il apprécie par ailleurs les
histoires. Certes, ceux-ci ont une forme d’existence dans des films ou dans des
livres, ils peuvent même le faire pleurer ou devenir un modèle de vie, eux-mêmes
agir et avoir des émotions, mais sans être interrogés sur leur « existence ». Ce
propos est presque banal mais par contraste indique toute la spécificité d’un être
divin ou d’un mort vivant et de la croyance. D’une certaine façon, il n’y aurait
que des cultes avec des adresses, des gestes divers envers Dieu, je serais presque
tenté de le ranger parmi les personnages fictionnels. Mais, contrairement à ces
derniers, Dieu continue à exister, à être présent de diverses manières après le
rituel, après la lecture d’un récit qui le met en scène. Dans certains lieux, il est
même présent avant que les gens n’y soient, re-présenté par tels et tels objets. C’est
d’ailleurs seulement la présence en situation de la divinité qui est dépendante de
médiations variées (paroles, personnes, objets). Son existence, elle, est présentée
comme autonome.
La divinité n’est pas, à partir de ces caractéristiques, une fiction dont son
créateur serait connu, elle n’est non plus un abstrait puisqu’elle a des modes de
présence spatiotemporels. Elle est bien sûr dépendante de certains médiateurs
mais elle est aussi autonome pour beaucoup d’humains qui la reconnaissent, la
perçoivent, lui parlent. C’est bien la croyance. La peur réelle au cinéma, la pitié
réelle au théâtre sont des émotions fortes, et pas si courantes dans une cérémonie
religieuse, qui peuvent se continuer avec quelques traces après la fiction. Alors
que dans un culte, l’homme est souvent sans émotion, avec beaucoup de distance,
plus qu’au théâtre et au cinéma, et alors qu’il ne garde peut-être aucune trace de
ce qu’il a fait, le dieu continue à sa manière à « exister » après le rituel. L’homme
est ainsi capable de dire « de sang-froid » que des dieux existent. C’est un autre
« un peu plus ». La croyance, ce n’est pas avoir peur au cinéma, ce n’est pas
seulement jouer le jeu et « faire » pendant une cérémonie, c’est surtout associer,
en dehors de celle-ci, la divinité à un statut non fictionnel. Ce qui caractérise
43
CROIRE.indd 43 22/02/13 11:30:12
albert piette - l'origine de la croyance
l’univers religieux (contrairement au théâtre et au cinéma) est ce maintien
au-delà du faire rituel de l’idée que le dieu ou le mort ressuscité existe dans un
autre monde.
La participation à un rituel est certes un indice d’une présence croyante, mais
pas nécessairement activée mentalement. Cette activation y est possible mais aussi
dans d’autres moments et situations d’hommes, nous l’avons vu. Mais le croyant
est aussi celui qui accepte, hors l’acte de croire proprement dit, cet assentiment
à la réalité non mondaine d’existences non vraisemblables, non confirmables et
non confirmées et de leurs possibles actions mondaines. Plusieurs expériences
font ainsi l’individu croyant : des moments de coprésence avec ces entités,
coprésence ressentie mais pas nécessairement, alors simplement automatisée, des
moments ponctuels d’assentiments sentis et vécus à l’idée de ces existences, des
acceptations proclamées de ces assentiments, et aussi la dynamique quotidienne
et le suivi situationnel de ces assentiments et coprésences.
Ces énoncés religieux décrivant cet autre monde, c’est bien sûr une erreur
de considérer qu’ils sont pris par les gens eux-mêmes comme des métaphores de
quelque chose. Mais ce n’est pas juste de penser que ces derniers les prennent
littéralement. « La plupart des phrases métaphoriques sont littéralement
fausses, écrit Donald Davidson. Le caractère absurde ou contradictoire d’une
phrase métaphorique garantit que nous ne la croirons pas et nous invite, dans les
circonstances appropriées, à prendre la phrase métaphoriquement »1.
À l’évidence, croire ne peut ainsi consister à se rapprocher d’un énoncé
religieux perçu comme une métaphore, c’est-à-dire comme littéralement faux.
Le croyant perçoit l’énoncé en question certes non pas comme tout à fait vrai
littéralement, mais pas non plus comme littéralement faux. C’est cela son
extraordinaire spécificité. C’est cet état d’esprit que je ressens comme tel. L’acte
de croire s’inscrit précisément dans cette oscillation incertaine : « Ce n’est pas
littéral, est-ce alors une métaphore ? Non. Mais, ce n’est pas non plus vraiment
littéral… sans être pour autant une métaphore ». Le croyant ne perçoit l’énoncé
religieux ni comme réaliste, c’est-à-dire associé à une référence et à une réalité
précise, ni comme non réaliste, c’est-à-dire sans aucune contrepartie référentielle.
Ce n’est ni l’un, ni l’autre, ou l’un et l’autre, mais rien exclusivement. C’est ainsi
que je le vis. Croire consiste à se rapporter à des énoncés religieux, en pensant
ou en ressentant qu’ils ne sont pas des expressions métaphoriques, sans accepter
vraiment la littéralité de leurs contenus. Cette oscillation, cette hésitation, cet
entre-deux mental sont fascinants. Ils font l’acte de croire. Ce qui ne signifie pas
qu’il y ait des moments d’arrêts ponctuels plus prononcés sur le doute ou sur la
certitude, au cours desquels le croyant garde en arrière-pensée son assentiment
ou sa modulation. Croire, c’est entrer dans cette oscillation.
Question d’intensité, le croire est plastique et malléable. C’est ainsi qu’il est
exposé aux effets collectifs, de pouvoir, d’autorité, d’influence au point qu’il
1
D. Davidson, Enquêtes sur la vérité et l’ interprétation, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon,
(1984), 1993. p. 367.
44
CROIRE.indd 44 22/02/13 11:30:12
être en train de croire
peut se transformer en son contraire : la certitude. De même que l’émission d’un
doute sur le temps qu’il fera n’a rien à voir avec le croire religieux, la pensée de la
certitude religieuse constitue une erreur sociale et s’éloigne du croire religieux.
Devant un croire par définition malléable, ce n’est donc pas illogique que la
sociologie des religions s’intéresse aux rapports sociaux qui s’y engouffrent. Mais
c’est regrettable que les « rapports » se soient imposés dans l’objet sociologique
au point d’oublier le croyant et la divinité. Le social n’est qu’une pelure parmi les
autres pelures de l’oignon. Pelure interne du croyant ou entité externe repérable
en situation, sous des formes diverses.
Aux idées religieuses, les gens y croient précisément parce que c’est incroyable.
Croire, ce n’est pas savoir. On calcule quelque chose parce que c’est calculable,
on le pense parce que c’est pensable et on le croit parce que c’est incroyable. On le
croit, on ne fait que le croire. Il y a donc une restriction inhérente à l’acte de croire.
Sinon nous dirions que nous le savons. Ainsi par principe de fonctionnement,
l’acte de croire génère une amplitude variable d’assentiment, à partir de cette
marge de la restriction. Le croyant n’est jamais loin de se rappeler et de savoir que
c’est incroyable. Mais justement puisqu’il y croit, ce n’est plus si incroyable que
cela ! L’acte de croire est intrinsèquement une question d’intensité. De ce qu’on
sait être incroyable et de notre poussée à le tenir pour vrai. L’acte de croire est
indissociable de la mesure variable de pousser à fond un moment d’émotion et
de redescendre dans la critique ou l’indifférence, de mitiger un assentiment par
le doute, par la toile de fond du doute (comme lors de cette question sur le savoir
posthume du père), de nuancer un doute par une volonté d’assentiment (l’effort
de la concentration). Au point que l’intensité nulle ou quasi nulle n’élimine pas
la position de la croyance en toile de fond du quotidien. En particulier dans
mon quotidien d’aujourd’hui, la croyance reste en toile de fond alors même que
j’affirme dans le chapitre précédent que l’homme a dans le hasard de ses exploits
cognitifs inventé l’acte de croire et ainsi l’existence des entités surnaturelles. « La
religion répond d’autant moins à des angoisses qu’il lui est essentiel de “rester
obscurité” »1, note Paul Veyne. Et les croyants le savent, que c’est obscur, qui
n’osent pas vraiment le dire, qui n’osent pas dire que c’est réel, que ce n’est pas
réel : un fil conducteur pour une anthropologie comparée des croyants. En tout
cas, les états d’esprit existent, le flou, le vague, le mitigé, le modalisé aussi. Ce que
j’ai appelé le mode mineur.
Et la présence humaine dans d’autres accomplissements, comment se déploie-
t-elle ? Car c’est bien là l’enjeu de mon hypothèse : Homo credens et fluens.
1
P. Veyne, René Char en ses poèmes, Paris, Gallimard, 1990, p. 525.
45
CROIRE.indd 45 22/02/13 11:30:12
albert piette - l'origine de la croyance
46
CROIRE.indd 46 22/02/13 11:30:12
PRÉSENCES RÉELLES
« La grande idée des modernes est d’ordre révolutionnaire :
les terrains extrêmes sont les plus vrais ; la surenchère qu’a
été la Révolution française de 1789 à 1794 a peut-être servi
de schème à ce radicalisme »1.
Anthropologie
Comment cet homme-ci est réellement, à quoi pense-t-il réellement, que
ressent-il réellement, que perçoit-il réellement, comment interagit-il réellement ?
Maintenant et quelques instants plus tard ? Disons qu’un homme est un « flux
somato-psychique », une « danse d’électrons et de représentations », pris dans
« une indéfinité d’autres flux ». C’est une définition, certes parmi d’autres,
que nous devons à Castoriadis2 . Que deviendraient les sciences sociales si elles
possédaient un film complet de la vie de tous ces « flux » pendant une semaine ?
Que deviendraient les choix paradigmatiques des théories de l’action ? C’est le
pari phénoménographique de dire le cours de l’existence, ordinaire ou moins
ordinaire, non focalisé sur un lieu, sur une épreuve, sur une activité, de suivre
les actes, les gestes, les pensées (qui ne sont pas le plus souvent les causes de
l’action et dont les contenus sont alors dissociés de celle-ci), de comprendre les
instants et les présences qui sont, se font, continuent. Les différentes théories
philosophiques ou sociologiques contiennent chacune une part de vérité mais
elles ne sont pas vraies pour tous les hommes et même qu’elles sont toutes vraies
pour le même individu mais à des moments différents. Comment un homme
est réellement : il y a sans doute plusieurs manières de le dire mais il n’y a qu’une
1
P. Veyne, L’Élégie érotique romaine, Paris, Seuil, 1983, p. 302. Sur ce point, j’indique aussi la
critique de Peter Sloterdijk dans un livre au titre suggestif : La Mobilisation infinie, Paris, Seuil,
(1989), 2003.
2
C. Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975, p. 470.
47
CROIRE.indd 47 22/02/13 11:30:12
albert piette - l'origine de la croyance
manière d’être, de sentir, de ressentir à l’instant t, certes complexe ambigüe,
ambivalente. C’est celle qu’il faut décrire et comparer. L’anthropologie consiste
ainsi à se rapprocher au plus près des présences réelles, concrètes, des instants
de présence et des successions d’instants. Et dans toutes les manières humaines
d’exister, n’y a-t-il pas quelque une part de voile ?
Lamarck insistait sur les « circonstances » pour montrer que selon celles-ci,
c’est telle loi et non telle autre qui pertinente pour rendre compte de ce qui se
passe1. Cette posture n’est pas sans lien avec mon insatisfaction des théories
sociologiques elles aussi pertinentes à tel moment, tel lieu, pour tel individu et
non en général. Les circonstances de la vie d’un homme donnent raison à toutes
les théories, mais jamais en même temps. Ceci signifiait pour Lamarck la prise
en compte du temps. Pour moi, c’est prendre en compte l’existence de l’individu
devenant ainsi objet d’observation, plutôt que telle activité, tel état, à tel endroit,
à tel moment. C’est ainsi que Lamarck a inventé le terme « biologie » comme
science des êtres vivants (et non inanimés) dans des situations diverses. Des êtres
vivants en tant qu’ils sont vivants. Et je continue la transposition en vue d’une
spécificité cette fois de l’anthropologie : une science des êtres, des individualités
en tant qu’ils existent en situation, en tant qu’ils y sont présents. Elle se veut une
résistance à la dissolution plus ou moins précoce ou tardive de l’individualité
corporelle et mentale des hommes dans le processus de recherche (sociologique
ou ethnologique), du choix du sujet et de l’observation à l’écriture finale.
« La réalité est infiniment diverse ; elle échappe, écrit Dostoïevski, aux
ingénieuses déductions de la pensée abstraite ; elle ne souffre pas de classification
étroite et précise. La réalité tend au morcellement perpétuel, à la variété infinie.
Même chez nous [en prison], chacun gardait sa vie distincte, sa vie privée à côté
de la vie officielle, réglementaire »2 . Pour que l’anthropologie existe comme
discipline distincte de l’ethnologie et de la sociologie sans être un mode fourre-
tout, il importe qu’elle trouve son objet. Il y en a un possible, ni pris par les
sciences sociales, ni par la psychologie : l’individu en train de vivre, d’exister,
d’être en situation, l’individu comme unité phénoménale avec ses gestes et
ses états d’esprit, un individu qui continue, toujours en train de passer au
moment suivent, à la situation suivante. Marcel Mauss indique que la couche
de la conscience individuelle est « mince » mais reste présente « même lorsque
l’esprit de l’individu est entièrement envahi par une représentation ou une
émotion collective, même lorsque son activité est entièrement vouée à une œuvre
collective », associée, dit-il, à « action et impression particulières »3. « La
collectivité laisse toujours à l’individu, écrit Mauss, un sanctuaire, sa conscience,
qui est à vous ». Pour Mauss, l’esprit de groupe est une abstraction abusive. Il
n’absorbe pas la réalité des phénomènes sociaux4. Mauss fait appel à la psychologie
1
A. Pichot, Histoire de la notion de vie, Paris, Gallimard, 1993, pp. 582 et sq.
2
F. Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts, Paris, Gallimard, (1860-1862), 1977, p. 408.
3
M. Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, (1964), 1985, p. 290.
4
B. Karsenti, L’Homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss, Paris,
PUF, 1997, p. 107.
48
CROIRE.indd 48 22/02/13 11:30:13
présences réelles
pour ne pas que la sociologie croie à « l’uniformité d’une mentalité »1. Il laisse
ainsi à la psychologie l’étude de « la personnalité consciente », du sens de
« son individualité spirituelle et corporelle »2 . Mais elle ne le fait pas, selon moi.
Elle ne décrit pas les manières avec lesquelles l’individu est présent, vit sa présence
en continu. Elle ne répond pas à cette interrogation à partir d’observations de la
vie en temps réel et ne décrit pas les modalités vécues d’être présent en continu.
La « psychologie collective » aurait à travailler, selon Mauss, sur des subjectivités
particulières, en considérant différentiellement les individus et leurs degrés de
socialisation3. Mais ce travail existe-t-il ? C’est bien ce travail que je réserverais
à l’anthropologie: « comprendre « comment il [l’homme] parle, il s’entend et
croit, il s’exhale par toutes les fibres de son être »4. Je préciserais : l’homme en
particulier, l’individu singulier.
« Est-il imaginable, se demande Gérard Lenclud, que des communautés
puissent s’abstenir de transformer l’être humain en personne, dans un sens
proche de celui que les philosophes contemporains attribuent à ce terme ?
Des anthropologues ont-ils vraiment pu tomber sur ce cas de figure ? J’incline
à penser que non »5. L’unité numérique reste l’unité numérique, avec ses
propres sentiments, repérable, avec laquelle d’ailleurs l’ethnologue a échangé.
Avec des accents critiques vis-à-vis de recherches ethnologiques, qui sont trop
sensibles à montrer qu’ailleurs qu’en Occident, l’idée d’individu est absente ou
peu importante, et qui insistent trop sur une représentation collectiviste de la
personne, Maurice Bloch note ceci : « Selon ces anthropologues et d’autres
encore, au sein de ces communautés éloignées de l’Occident, la conscience
d’être celui qu’on est seul à être est entièrement recouverte par la conscience
d’occuper une place déterminée et prescrite dans un réseau de relations sociales.
Il n’est d’identité individuelle que socialement constituée. Le statut et le rôle
conférés à l’être humain y tiennent lieu de sphère individuelle. En réalité, il
est légitime de se demander si cette tendance à opposer en bloc notre forme de
société et son idéologie à toutes les autres n’est pas précisément ce qui pousse
tant d’anthropologues à exagérer le contraste entre eux et nous, en nous les
présentant, eux, comme bien plus ‘‘exotiques’’ qu’ils ne le sont. »6 Il importe,
continue Maurice Bloch, de bien distinguer et de ne pas confondre d’une part les
conceptions sur la personne ou l’individu que l’ethnologue réussit à comprendre
par ses observations et ses entretiens sommaires avec les gens, et d’autre part le
Soi éprouvé, vécu de l’intérieur. « On en vient à laisser supposer, sans l’écrire
expressément, qu’il existe à la surface du globe des façons humaines différentes
d’être, chacun pour soi, celui qu’on est. Autres hommes, autres Soi(s) ! Il est pour le
1
M. Mauss, op. cit., p. 306.
2
Ibidem, p. 335.
3
Cf. B. Karsenti, op. cit., pp. 112-113. Mauss parle aussi de « sociologie psychologique »
(p. 289).
4
M. Mauss, op. cit., p. 305.
5
G. Lenclud, « Être une personne », Terrain, 52, mars 2009, p. 16.
6
M. Bloch, « La mémoire autobiographique et le Soi. Pour une alliance entre sciences sociales
et sciences cognitives », Terrain, n° 52, mars 2009, p. 60.
49
CROIRE.indd 49 22/02/13 11:30:13
albert piette - l'origine de la croyance
moins surprenant que des gens de science en arrivent à se fourvoyer à ce point. »1
Et il prolonge sa critique, en ciblant une recherche de Marylin Strathern sur des
rituels en Nouvelle-Guinée et en indiquant des interrogations qu’elle aurait dû
poser mais que l’ethnographie classique peut difficilement intégrer : « Quelle
sorte de traces mémorielles la pratique de rituels laisse-t-elle dans l’autobiographie
des hommes qui y participent ? Comment en parlent-ils ? Comment en parlent-
ils entre eux ? Comment y pensent-ils à travers la réactivation de leurs souvenirs ?
Que peuvent révéler les récits que les participants font après coup de ces rituels ?
En d’autres termes, peut-on établir l’existence d’une relation significative entre
leurs agissements publics dans les cérémonies, dont Strathern estime qu’ils
traduisent une conception intimement vécue d’un Soi non individuel, et ce qui
pourrait se passer à l’intérieur de chaque être à propos de lui-même ? »2
Il ne s’agit pas, dans le travail phénoménographique, de penser la « structure »
comme la seule chose à connaître, ni la structure comme seule chose existante, ni la
structure comme projection de la faculté humaine de connaître (qui sélectionne,
filtre, relie). Ces trois sens du mot « structure », il semble bien que Lévi-Strauss
les cumule, en produisant un système de pensée du coup inéluctablement fermé.
C’est toujours le principe de base de l’anthropologie sociale. Lévi-Strauss l’a-t-il
fait pour sortir l’anthropologie de la sociologie et des sciences sociales ? Mais
c’était un risque, celui d’ancrer l’anthropologie dans une perspective structuraliste
et relationniste, et de revenir à une anthropologie sociale, à une sociologie. Ce
que ne voulait sans doute pas Lévi-Strauss. Mon propos est de prendre le contre-
pied de ces trois structures, en pensant que seuls les détails hors structure sont à
connaître, que la singularité de chaque particularité est la seule chose existante et
qu’il faut adapter l’opération scientifique à une sélection plus que maîtrisée pour
que les restes ne soient pas exclus mais réinclus progressivement dans les données.
L’observation est d’autant plus détaillée qu’elle se focalise sur un individu qu’elle
suit dans son flux, ses passages et son mouvement.
Ce que j’appelle individualisme méthodologique radicalisé ou ontisme
méthodologique3 décrit moins la relation que les modalités avec lesquelles
l’homme est ou n’est pas relationnel, moins le « en tant que » que le comment
il est « en tant que », la particularité singulière irréductible, cachée certes
derrière les systèmes et les cultures mais aussi derrières les relations et les réseaux.
Dans cette perspective, l’anthropologie ne rejoint-elle pas ce qui est désigné par
philosophie empirique. Cela suppose une tâche difficile, faite d’essais et d’erreurs,
de méthodes et de concepts à inventer. Husserl avait le projet de la philosophie
comme science rigoureuse. Ce n’est pas ce qu’il est advenu à la philosophie qui,
tout en étant rigoureuse, n’est pas du tout empirique, comme on le sait.
Carlo Ginzburg commente les sciences de la nature à une époque différente
pour lesquelles Galilée imprimait « une direction fondamentalement anti-
anthropocentrique et anti-anthropomorphique qu’elles ne devaient jamais
1
Ibidem, p. 61.
2
Ibidem, p. 62.
3
Cf. A. Piette, Fondements à une anthropologie des hommes, Paris, Hermann, 2011.
50
CROIRE.indd 50 22/02/13 11:30:13
présences réelles
abandonner »1 contre des médecins qui diagnostiquaient « en sentant des fèces
et en goûtant des urines ». D’où l’alternative jalonnant l’histoire des sciences :
« soit sacrifier la connaissance de l’élément individuel à la généralisation […],
soit chercher à élaborer, quand bien même en tâtonnant, un paradigme différent,
s’appuyant sur la connaissance scientifique (mais d’une scientificité restant à
définir) de l’individuel »2 . C’est bien le travail que je confierais à l’anthropologie
contre les sociologies existantes, toutes confondues, qui constituent des
contournements méthodologiques et théoriques de l’individu. C’est même leur
spécificité disciplinaire. L’anthropologie aurait à travailler sur des observations
phénoménographiques caractérisées par un détaillisme méthodologique
radicalisé et centré sur l’individu, dont la mise en perspective théorique viserait
l’homme comme espèce. « Explorer l’univers invisible » : c’est le thème d’une
exposition très sérieuse au Palais de l’Unesco à Paris en juin et juillet 2009. Les
astrophysiciens y rappellent que beaucoup des théories cosmologiques existantes
sont sans doute justes mais que 95 % de la nature de l’univers est inconnu. À ce
propos, constatons l’importance permanente de la notion de « vide » dans les
théories de la physique. Selon celles-ci, le vide ne désigne pas toujours la même
chose mais il est admis en astrophysique et en cosmologie que « le vide est un
objet physique nécessaire »3. Mais surtout il apparaît comme un élément capital
dans le développement et la fructuosité des théories : « les difficultés suscitées
par les réflexions autour du vide constituent l’un des générateurs du progrès
physique, en faisant naître une conception inédite »4. Il me semble que ce qui
reste quand beaucoup de choses socialement pertinentes de la vie sont enlevées
devient un objet anthropologique nécessaire.
Je ne dis pas que les éléments individuels, vous en particulier, moi, pourraient
exister sans relations avec d’autres, sans perceptions et cognitions diverses.
Évidemment ! Mais, pour améliorer l’impact descriptif, je mets la focale sur
l’individualité qui est en relations différentes, successives, explicites et implicites,
actuelles et potentielles. Observer, décrire et comparer des singularités
individuelles suppose quelques principes, ainsi que des repères conceptuels.
Ainsi, le « quotidien » n’est pas ce qui resterait quand nous avons enlevé les
autres activités de la vie, comme le travail, la politique, la religion, l’école. Il n’est
pas non plus l’addition ou la juxtaposition de ces activités. Il est le mode d’être des
hommes dans le cours de ses actions, c’est-à-dire en permanence. Aucun moment,
aucune situation n’échappe au quotidien, ni l’accident, ni la catastrophe, ni même
la mort5. Si le quotidien constitue un défi pour le philosophe, il l’est plus encore
pour l’anthropologue. Et pourtant, c’est là son vrai objet d’analyse, l’homme,
l’individu réel et en continu, avec des méthodes précises et des possibilités de
comparaison.
1
C. Ginzburg, « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », Le Débat, n° 6,
novembre 1980, p. 14.
2
Ibidem, p. 20.
3
M. Lachièze-Rey, Les Avatars du vide, Paris, Le Pommier, 2005, p. 10.
4
Ibidem, pp. 113-114.
5
Cf. B. Bégout, La Découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005.
51
CROIRE.indd 51 22/02/13 11:30:14
albert piette - l'origine de la croyance
Comprendre l’existence d’un individu, c’est toujours se rapprocher de comment
il est, il fait, il ressent. C’est refaire et intégrer de nouvelles observations et de
nouvelles descriptions à partir des restes des précédentes. La phénoménographie
décrit et explicite l’évidence de la présence. Dans cet esprit d’attachement à ce
que fait ici-maintenant un individu et comment il le fait, les résidus des logiques,
des régimes ou des grammaires d’action ont beaucoup plus d’importance que
leur statut de résidu ne le laisse supposer, et en tant que résidus. L’idée, la réalité
et le problème méthodologique de l’inépuisabilité des êtres sont au centre de
l’anthropologie. Il y a d’une part l’extrême singularité de chaque être avec ses
pensées, ses gestes, ses mimiques, ses actes, ses objets, dont beaucoup n’ont pas
d’effet, de pertinence au-delà de quelques moments et même à l’instant t de leur
déploiement, et d’autre part la capacité à oublier, à ne pas voir les détails de la
singularité, les siens et ceux des autres, dans une situation commune. Mais ils
sont là, constitutifs du volume d’être de chacun. Si la sociologie est la science
sociale de la déperdition de la densité de ces singularités, l’anthropologie pourrait
être ainsi la science du volume des êtres. Il ne faut pas faire comme si l’écart
entre les paradigmes sociologiques (ou les logiques d’action) et les volumes d’être
n’était pas important ou qu’une simple nécessité épistémologique. La notion de
présence s’inscrit précisément dans cette perspective d’atteindre des restes laissés
par les logiques d’action. L’anthropologie devient même une non-sociologie. Une
citation de Deleuze et Guattari sur la non-science et la non-philosophie n’est pas
sans analogie avec cette proposition de non-sociologie ou non-ethnologie : « C’est
que chaque discipline distincte est à sa manière en rapport avec un négatif : même
la science est en rapport avec une non-science qui en renvoie les effets. Il ne s’agit
pas de dire seulement que l’art doit nous former, nous éveiller, nous apprendre
à sentir, nous qui ne sommes pas artistes – et la philosophie nous apprendre à
concevoir, et la science à connaître. De telles pédagogies ne sont possibles que
si chacune des disciplines pour son compte est dans un rapport essentiel avec
le Non qui la concerne. Le plan de la philosophie est pré-philosophique tant
qu’on le considère en lui-même indépendamment des concepts qui viennent
l’occuper, mais la non-philosophie se trouve là où le plan affronte le chaos. La
philosophie a besoin d’une non-philosophie qui la comprend, elle a besoin d’une
compréhension non philosophique, comme l’art a besoin de non-art, et la science
de non-science »1. Il s’agit ainsi d’emmener l’anthropologie « au-delà de son
propre sol », comme Castoriadis l’indiquait à propos de la philosophie.
Les propos qui suivent constituent une refondation de l’anthropologie
comme discipline. Elle suppose une autre anthropologie comme représentation
de l’homme et se pose comme dépassement des paradigmes sociologiques ou
ethnologiques. Ainsi, pour exister, l’anthropologie doit accepter de décrire le
mode d’être humain, fût-il « médiocre », puisqu’il est la spécificité (à durée
indéterminée) des Homo sapiens. C’est en ce sens que je considère l’anthropologie
comme une ontologie existentiale2 .
1
G. Deleuze et F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991, pp. 205-206.
2
Cf. A. Piette, op. cit.
52
CROIRE.indd 52 22/02/13 11:30:14
présences réelles
Modes humains de présence
« Nous ne savons encore presque rien, écrit Edgar Morin, de notre présence
à nous-mêmes, qui est en même temps notre absence à nous-mêmes »1. Le
défi phénoménographique de l’anthropologie est capital : observer, décrire et
comparer des singularités, celles de X, ou de Y, ou de Z, en train de continuer
à vivre, étudier des existences, des individus singuliers qui vivent, c’est-à-dire :
qui continuent d’instant en instant, de situation en situation. Telle serait
l’œuvre de l’anthropologie :être individuelle, différente ainsi de la sociologie
et de l’ethnologie, comparative et aussi évolutionnaire, privilégiant des mises
en perspective d’observations sur des hommes et sur des (grands) singes par
exemple, avec des dossiers d’archéologie préhistorique, en vue de construire
des hypothèses et des clés d’explicitation évolutionnaire. Une de ces clés, parmi
d’autres possibles, viendrait de la comparaison des modalités de combinaison du
repos et du travail, du voisinage de la conscience et de la non-conscience dans
les modes différents d’exister. La minimalité ou le mode mineur sont la base,
moins d’une théorie explicative, que de clés d’explicitation des modes humains
(ceux d’Homo sapiens) d’existence et des modes de coprésence des hommes
entre eux et avec leurs compagnons, les para-humains. À l’instar de théories
anthropologiques, comme celle de Lévi-Strauss en référence à la capacité humaine
de classer en oppositions binaires, ces clés sollicitent des traits universels (pour
moi, le mode mineur) qui sont spécifiques aux hommes par rapport à d’autres
êtres vivants. Il apparaît ainsi que l’anthropologie se décale par rapport aux
présupposés fondateurs des sciences sociales sur l’unicité et l’invariabilité de
l’espèce humaine, en faisant sortir sociologie et ethnologie d’elles-mêmes par
l’analyse comparée avec d’autres espèces, bien sûr les grands singes mais aussi
avec d’autres Homo, dont les lignées sont aujourd’hui disparues mais qui ont été
contemporaines il y a à peine 30 000 ans.
Selon le Petit Robert, le mot « ordinaire » veut dire, comme adjectif,
conforme à l’ordre normal, habituel des choses, sans conditions particulières,
dont la qualité ne dépasse pas le niveau moyen. Comme substantif, il signifie
le degré habituel, moyen d’une chose, ce qui ne se distingue par rien de
particulier. Une anthropologie de l’ordinaire est d’abord un point de vue par
lequel l’anthropologue se rapproche de l’action et de la présence des hommes,
des détails de leur visibilité concrète et de leur intériorité subjective. Comme le
spécialiste en art se rapproche d’une peinture et y perçoit les détails des coups de
pinceau. Ainsi observées de près, l’action et la présence ne se distinguent « par
rien de particulier ». Tout est alors ordinaire ou rien ne l’est. Une anthropologie
de l’ordinaire consiste en une observation-compréhension du mode d’être de
l’homme, qui apparaît dans sa continuité, presque par définition, « normal
et habituel », plus précisément, ordinarisé, normalisé, habitualisé par l’être
humain, quels que soient l’événement, la situation, l’action, joyeux ou tragique.
Rien n’échappe au cours ordinaire, au mode d’être de l’homme.
1
E. Morin, Le Vif du sujet, op. cit., p. 157.
53
CROIRE.indd 53 22/02/13 11:30:14
albert piette - l'origine de la croyance
Faisons ainsi l’hypothèse que, dans une situation, l’action humaine se réalise,
posée sur différents appuis, permettant aux hommes diverses formes de repos,
disons de reposité, comme je l’ai suggéré dans d’autres ouvrages. Et cela vaut
pour toute situation, selon des proportions bien sûr variables. Il me paraît non
seulement impossible de comprendre l’acte d’exister en dehors d’un ensemble
d’appuis sous les formes diverses de personnes, d’objets et de règles, non que
l’être humain aurait à re(créer) mais en tant qu’ils sont toujours déjà là et sur
lesquels il peut se poser, mais tout aussi important de décrire ces modes de repos.
Une situation d’hommes présenterait quatre types d’appui. D’abord, les règles,
normes, valeurs ou lois composant le cadre à partir duquel une situation est
organisée. Extérieurs à la situation, ils se manifestent sous forme d’indices et
permettent de ne pas inventer à chaque fois les règles de la partie. Sans ces appuis,
la situation est désordre. Il y a aussi des repères immanents à la situation. Ils
constituent des ressources directes pour l’accomplissement de l’action, servant
à organiser l’espace, à informer sur l’action immédiate à accomplir, à susciter
les gestes précis. Ils facilitent ainsi l’automaticité des actions. Sans repères ni
indices, c’est l’étrangeté de la situation qui s’impose. Il y a encore l’enchaînement
des situations dans le temps quotidien, jalonné par des conventions et des
repères horaires facilitant le déroulement des actions sans besoin de décisions sur
l’action suivante. Sans eux, l’ennui ou l’angoisse s’installe. Enfin, il y a le maillage
des situations, insérant chacune de celles-ci dans un réseau et l’associant ainsi à
d’autres situations selon des liens divers qui laissent dans chacune des traces ou
des indices de cette configuration. En dehors de son maillage, la situation crée
une épreuve de rupture.
C’est sur base de ces appuis et de la possibilité de s’y poser que l’être humain
développe une capacité à se reposer sous la forme de la confiance, du relâchement
ou de la passivité. Quatre formes de repos sont possibles. L’économie (au sens de
parcimonie) cognitive permet à l’homme, sur base d’habitudes, d’expériences
antérieures et de scénarios mentaux, de ne pas vérifier toutes les informations
ou compétences nécessaires pour accomplir une action. Non seulement,
l’économie cognitive correspond au déploiement routinisé, sans référence à une
instruction, des séquences d’actions mais aussi, elle permet d’alléger le travail
d’interaction sociale, grâce aux appuis matériels et aux identités stabilisées de
chacun des partenaires. Le contraire de l’économie cognitive est l’évaluation, la
stratégie, la justification, l’intrigue mobilisant l’attention, voire l’obsession sur
des fragments spécifiques de la réalité. La docilité correspond à la possibilité de
conserver les appuis, les indices et les repères existants, plutôt qu’à l’intention et
au désir de les modifier, et à l’évitement de la tension cognitive, émotionnelle ou
morale, résultant d’une épreuve de changement. La fluidité correspond, elle, à la
possibilité d’associer des informations ou des modes de raisonnement contraires
ou contradictoires dans une même situation ou dans des situations successivement
proches. Elle illustre la capacité immédiate au relâchement, à l’acceptation de
l’incohérence et au basculement des êtres humains de situation en situation. Le
contraire en est la raideur. Il y a enfin la distraction qui correspond à la capacité
54
CROIRE.indd 54 22/02/13 11:30:14
présences réelles
cognitive d’associer un être, un objet ou un événement à l’état de détail (sans
importance), à n’en faire qu’un élément de distraction, sans compromettre
l’attention minimale requise dans la situation. C’est l’état de concentration ou
d’intolérance qui est le contraire de la distraction.
Je dispose donc tant pour les appuis que pour les formes de repos de
quatre éléments et de leur contraire respectif. Pour les appuis : normes (règles,
conventions…) versus violence (conflits), repères (indices) versus perte de repères
(d’indices), maillage des situations versus rupture des liens, rythme temporel
versus angoisse (ennui…). Pour les formes de repos, nous avons : économie
cognitive versus décryptage (évaluation, jugement), docilité versus désir de
changement, fluidité versus raideur, distraction versus concentration. Il se
dégagerait quatre modalités, en réalité imbriquées et se succédant parfois vite, de
présence-coprésence. La tranquillité se déploie à partir d’un mode perceptif et
même infraperceptif de repères et d’indices spatio-temporels, sur fond d’une toile
bien stabilisée, parfois ressentie comme telle, avec l’émergence possible de détails
sans importance. Dans la familiarité, des repères et des indices sont nouveaux, en
tout cas différents, d’autres font défaut par rapport à des situations précédentes
mais la différence est quand même absorbée sur le mode économique, sur fond
d’une toile restant bien ancrée. C’est quand l’effritement au moins partiel de
celle-ci, avec une absence imposée ou créée de certains appuis, est ressenti que
la fatigue surgit, réduit la possibilité de distractions. Il s’en suit une tension
attentive et concentrée de (re)construction, de jugement et d’évaluation. Alors,
la toile de fond s’est comme retirée et a fait place à la saillance quasi exclusive de
tel ou tel fragment d’attention. Il est ainsi essentiel de percevoir le jeu constant et
enchevêtré de ces différents modes de présence selon la mobilité des appuis qui
restent, qui s’en vont ou qui se recréent. Souvent, la manière d’être avec évidence
et immédiateté dans une situation, pendant une action, ne se ressent pas. Elle
n’est pas un sentiment mais le degré zéro avec lequel l’action est accomplie de
manière régulière et selon un ensemble spécifique d’appuis.
Dans De l’existence à l’existant, Emmanuel Lévinas situe explicitement sa
réflexion philosophique sur le thème du « voisinage » de la conscience et de
la non-conscience. « La conscience, dans son opposition à l’inconscient n’est
pas faite de cette opposition, mais de ce voisinage, de cette communication avec
son contraire : dans son élan même, la conscience se lasse et s’interrompt, a un
recours contre elle-même »1. Mon objectif anthropologique est de décrire ce
« voisinage », de moment en moment et de réfléchir à sa genèse phylogénétique.
Il me semble toutefois que l’oscillation que je valorise n’est pas exactement
superposable à celle de Lévinas. Il associe la fatigue certes au travail et à
l’effort mais elle désigne aussi la part du recroquevillement et du lâcher-prise
(p. 42). Alors que, selon mon point de vue, la fatigue correspond au moment
fort du travail, de la tension, de la concentration et de la raideur dans un acte
spécifique ou dans l’acte d’exister en général. Et c’est avec la notion de repos que
1
E. Lévinas, De l’existence à l’existant, Paris, Vrin, (1963), 2004, p. 116.
55
CROIRE.indd 55 22/02/13 11:30:15
albert piette - l'origine de la croyance
je comprends la strate de distance et de détente inhérente à tout acte, sous des
formes variables. Ainsi Lévinas évoque l’« activité de l’inactivité » (p. 51), pour
indiquer qu’au cœur même de l’inactivité ou du repos, il y a un acte : « c’est l’acte
même de se poser sur le sol, c’est le repos, dans la mesure où le repos n’est pas une
pure négation, mais la tension même du maintien, l’accomplissement de l’ici. »
(pp. 51-52). Je préférerais « inactivité de l’activité » avec l’idée de désigner le
repos comme cette couche présente dans toute action. D’ailleurs, chez Lévinas,
la tranquillité est source d’insécurité : « ce silence, cette tranquillité, ce néant de
sensations constituent une sourde menace indéterminée, absolument. » (p. 96),
alors que j’associe tranquillité au repos et au bien-être.
Pourquoi la phénoménographie privilégie-t-elle un portrait de l’homme en
mode mineur ? Car c’est la manière humaine d’être, d’être en mouvement, encore
avant, déjà après, de ne pas être absolument, totalement, à ce moment-ci, puis à ce
moment-là, comme toujours en décalage par rapport à un idéal, un absolu, une
idée, alors que cet homme-ci, cet homme-là ne sont qu’« un peu ». À l’écriture
phénoménographique de rendre alors le dégradé des modes d’être, en évitant de
rassembler, d’ensembler, en choisissant de pluraliser les êtres présents ensemble.
C’est en effet sur des strates de passivité, de basse intensité, d’hypolucidité
et aussi de reposité sur des appuis ou des restes d’appuis toujours là, qu’une
dimension « travaillante » de l’action vient se glisser et prendre des proportions
variables. La présence devient alors un mélange de travail, de repos, de tension et
de familiarités simultanés. Ce mode d’être présent, Merleau-Ponty l’écrit en ces
termes : « Donc il faut passivité et qui ne rende pas impossible activité – mais
« faiblesse dans la pâte » de la conscience, passivité constitutionnelle, germe de
sommeil, maladie, mort présente jusque dans ses actes, donc passivité latérale. »1
Le mode mineur de la présence serait ainsi comme l’envers, donc inséparable,
du mode majeur auquel presque exclusivement s’intéressent les sciences sociales.
Mais un envers déformé ou déformant par rapport à l’endroit, l’un et l’autre
ayant, selon le moment et la situation, des visibilités, des formes, des proportions
et des effets différents. « La philosophie, continuait d’ailleurs Merleau-Ponty, n’a
jamais parlé – je ne dis pas de la passivité : nous ne sommes pas des effets – mais
je dirais de la passivité de notre activité ».2
Dans une situation, il y a toujours des restes. Ils sont parfois routinisés,
absorbés, comme divers objets que je ne vois pas sur l’étagère de ma bibliothèque,
pendant que je travaille. Mais certains de ceux-ci peuvent se laisser percevoir un
bref instant comme un détail. Parfois aussi, des choses du passé s’imposent comme
pertinentes, comme le débat tendu qui vient d’avoir lieu ou comme l’émotion de
la pensée du mort. Certaines images surgissent ponctuellement mais avec force,
comme le visage d’un collègue qui pose des questions délicates… Les restes sont
sans doute importants dans les modalités de présence dans une situation et de
basculement dans une autre. Qu’est-ce qui est dominant dans une présence,
laissant les autres couches secondaires. Ce « dominant » est-il facilement
1
M. Merleau-Ponty, L’Institution, la passivité, Paris, Belin, 2003, p. 182.
2
M. Merleau-Ponty, Le Visible et l’ invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 270.
56
CROIRE.indd 56 22/02/13 11:30:15
présences réelles
réversible ou solidement installé ? L’acte de corriger des copies d’examen selon
un rythme chargé n’a par exemple de conséquences (en tout cas pour moi…) que
quelques minutes, peut-être une heure, en train de s’émietter après l’arrêt du
travail. L’inertie du moment terminé maintient une présence en pointillé par
un état de fatigue et de lourdeur dans les instants suivants. Je peux y repenser
en mangeant, en regardant la télévision, en me concentrant difficilement dans
une lecture. La mort d’un proche constitue un événement générant un nouvel
état qui modifie les appuis. Au-delà du réajustement des activités qui suivent
directement l’information de la mort, le nouvel état entraîne, pendant un temps
plus ou moins long, le temps du deuil, un être triste accomplissant beaucoup
d’activités dans la fatigue et la tension malgré la présence de repères et de règles
habituels. Nous l’avons vu, l’événement qui constitue ce nouvel état imprègne
de nombreuses situations longtemps après son surgissement. Mais l’homme est
entouré d’appuis différents selon les situations. La perte ou l’absence des uns
n’empêche pas la naissance ou le maintien d’autres.
Le travail phénoménographique consiste ainsi à observer et comparer les
différentes combinaisons de « travail-repos » et d’« activité-passivité ». Dans
un moment de présence, qu’est-ce qui est ressenti : le travail ou le repos ? Et quelles
dimensions du travail et du repos, et dans quelles proportions ? Familiarité,
tranquillité, tension, fatigue : qu’est-ce qui est ressenti et visible ? Par exemple,
sur fond de tension ou de fatigue, des strates de minimalité, pourtant visibles,
réalisées et concrétisées, ne sont pas nécessairement ressenties. Il apparaît tout
autant la capacité humaine d’absorber, de recouvrir, de laisser ponctuelles
ou diffuses (mais présentes) une ou plusieurs expressions de la fatigue et de la
tension, par la docilité, l’économie cognitive, la fluidité ou le détachement, que la
capacité d’absorber, de recouvrir, de laisser ponctuelles ou diffuses (mais toujours
présentes) une ou plusieurs expressions de la tranquillité ou de la familiarité, par
l’intrigue, le désir de changer, la raideur ou la focalisation obsédante. Et ainsi de
suite dans la continuité des instants mêlant passivité et activité, combinant le
travail et le repos.
Une erreur fondamentale
« Accéder aux Lumières consiste pour l’homme à sortir de la minorité où
il se trouve par sa propre faute. Être mineur, écrit Kant, c’est être incapable de
se servir de son propre entendement sans la direction d’un autre.[…] La paresse
et la lâcheté sont les causes qui font qu’un aussi grand nombre d’hommes
préfèrent rester mineurs leur vie durant. »1 Et Peter Sloterdijk de continuer :
« Pour beaucoup d’intelligences, la pensée des intimités familières est liée à un
sentiment spontané de suave écœurement – raison pour laquelle il n’existe pas
plus de philosophie de la suavité qu’une ontologie élaborée de l’intime. Il faut
avoir conscience de la nature de cette résistance pour surmonter les aversions
typiques des premiers temps. Vu de loin, le sujet paraît si peu séduisant et
tellement insignifiant que pour le moment, seuls les niais férus d’harmonie ou
1
E. Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, Hatier, (1784), 2007, p. 5.
57
CROIRE.indd 57 22/02/13 11:30:15
albert piette - l'origine de la croyance
les castrats théophiles peuvent y rester suspendus. L’intellect qui concentre sa
force sur les objets dignes aime en général que les choses soit hot, pas suaves. On
n’offre pas de bonbons aux héros »1.
Dans cet esprit, les philosophies de l’existence et les sociologies de l’action
valorisent selon des tonalités diverses des sujets forts, libres, responsables
et créateurs, porteurs d’une conscience intentionnelle, et/ou des hommes
inquiets, fragiles, vulnérables, tendus dans différents rapports de forces2 . Dans
l’explication de ses terrains, la sociologie s’est largement imprégnée d’une
anthropologie intensifiée, celle de l’acteur, du sujet, du travailleur et de l’inquiet.
Mais de ce « travail » et de cette « inquiétude », tels qu’ils sont sous-entendus
par les idées d’interaction, de rationalité, d’autonomie ou d’épreuve, l’homme
en est-il capable ? Non. Disons qu’il est moins fort et moins faible. De fait, dans
l’action ou la résistance, il ne tient pas jusqu’au bout le face-à-face ni avec l’objet,
ni avec l’événement, ni avec les autres humains et encore moins avec les entités
surnaturelles… L’autre être n’est pas en face, il est là plus ou moins à côté, plus ou
moins près ou loin.
Quand je regarde les hommes dans leurs instants successifs et quasiment
partout, il m’apparaît des présences anodines qui, parfois sans qu’ils le sachent,
deviendront créatrices de décisions, génératrices de conséquences diverses,
parfois aussi resteront sans suites, mais qui souvent se laissent infiltrées par des
moments vides, des gestes secondaires ou des pensées vagabondes. Je suis frappé
par l’aisance avec laquelle l’homme se déplace de situation en situation, une
sorte d’évidence existentiale, celle qui consiste à continuer dans les instants et les
actions, dans les moments et les situations.
Chaque moment de présence humaine est effectivement constitué d’une
grande quantité de détails, c’est-à-dire de choses sans importance. La réalité
phénoménale de l’action, c’est d’abord un corps en train de bouger avec des
regards latéraux et des gestes périphériques. Le volume d’être est aussi constitué
d’un état d’esprit, d’états mentaux qui n’ont souvent rien à voir avec l’action
en cours. Le mode mineur, tel que nous avons nommé cet ensemble de détails,
n’est ni une action générale, ni un type particulier d’activités. Il constitue une
modalité spécifique par laquelle un individu est nécessairement présent dans
l’espace-temps où deux ou plusieurs personnes se trouvent en coprésence. Que
celles-ci le veuillent ou non, le mode mineur en tant que modalité de présence
et de déroulement de l’action, atténue, ou, plus précisément amortit selon
des degrés variables l’enjeu de sens associé à la situation en question, sans le
transgresser et sans en générer un autre. L’effet de mode mineur et sa nécessité
apparaissent d’emblée comme évidents lorsque l’on imagine son absence dans
une situation. Je fais l’hypothèse selon laquelle toute situation, qu’elle mobilise
1
P. Sloterdijk, Bulles, Paris, Fayard, (1998), 2002, pp. 101-103.
2
Cf. D. Martuccelli, « Philososphie de l’existence et sociologie de l’individu : notes pour une
orientation critique », SociologieS. Théories et recherches, juin 2010 (en ligne) et J.-L. Genard, et
F. Cantelli, « Êtres capables et compétents : lecture anthropologique et pistes pragmatiques »,
SociologieS. Théories et recherches, avril 2008 (en ligne).
58
CROIRE.indd 58 22/02/13 11:30:16
présences réelles
des compétences incorporées ou des stratégies de gain, qu’elle privilégie un enjeu
de communication et de contrôle des expressions verbales et non verbales, qu’elle
concerne directement et explicitement l’exécution d’une règle, ou encore qu’elle
soit activement et volontairement en recherche d’une définition, est toujours
déjà imprégnée par le mode mineur. « Ainsi le on décharge à chaque coup le
Dasein dans sa quotidienneté, écrivait Heidegger. Il y a plus ; avec cette dispense
d’être le on se porte au-devant de la tendance au moindre effort que le Dasein
a foncièrement en lui. Et comme le on se porte constamment au-devant de
chaque Dasein en le dispensant d’être, il maintient et accentue son opiniâtre
domination »1. Je ne veux pas considérer ce mode d’être comme une dégradation
à résorber mais comme anthropologiquement central. Ce volume constitutif
de l’évidence existentiale, je le considère capital, surtout pas scientifiquement
accessoire ou secondaire. Il est un motif phénoménographique, une nécessité
sociologique et aussi une spécificité évolutionnaire.
Ce portrait de l’être humain permet de mettre l’accent sur le déroulement
quasi constant de l’existence dans la distraction, légère bien sûr, mais aussi sur le
mode de la non-pensée, de la non-conscience, de la non-focalisation sur l’enjeu
situationnel en cours, autant de points permettant précisément l’infiltration
des gestes périphériques et des pensées vagabondes. Comme l’indique Searle
citant James à ce sujet, l’attention quitte toute situation, tout moment, dès
qu’elle n’est plus nécessaire, remplacée alors par d’autres pensées au point que
celles-ci peuvent s’installer dans la présence mentale de l’homme dont l’activité
première le permettrait, comme la conduite d’une voiture. La présence attentive
de l’homme n’exclut pas un débordement, certes minimal, par d’autres choses,
tout en gardant une perception subsidiaire de cet « autour » comme sans
importance. Il faut ainsi bien distinguer la non-pensée qui est une condition
de la bonne exécution de l’action en cours, des pensées « autres » pendant cet
accomplissement. La première qui permettra les deuxièmes vient le plus souvent
des routines et de l’habitude d’expériences antérieures. Mais surtout la non-
pensée de l’action ne doit pas justifier l’absence d’intérêt anthropologique à la
présence, ni faire oublier ce qu’un homme a dans la tête quand il agit. Ainsi,
le mode mineur visuel, gestuel et postural comprend aussi une densité mentale
de réserve négative et de présence-absence. La minimalité constitue ce mode
d’être humain par excellence consistant à ne pas pousser à fond la conscience,
la raison d’être, à ne pas voir une conséquence possible : c’est la manière d’être
quotidien, toujours pénétré par d’autres choses que ce qui fait l’enjeu précisément
de la situation, de ne pas être face-à-face, d’agir sans besoin de la maîtrise, du
calcul, sans effort et sans fatigue. Bref, voir et percevoir sans regarder ni même
apercevoir. Avec le terme « minimalité », je ne veux pas désigner la légèreté de
la présence du flâneur mais bien la capacité d’introduire un mode mineur, une
couche de reposité, c’est-à-dire une capacité de ne pas être maximal.
« Cela commence par l’impression que les choses se passent comme dans un
théâtre ou un cirque. Je suis pris dedans.
1
M. Heidegger, Être et temps, Paris, Gallimard, (1927), 1986, p. 171.
59
CROIRE.indd 59 22/02/13 11:30:16
albert piette - l'origine de la croyance
Quand je sors dans la rue, tout s’agite comme automatiquement, je sens les
gens bizarres. Ils accomplissent leurs rôles comme s’ils les avaient répétés. Ils vont
et viennent, apparaissent et disparaissent comme dans des numéros répétés.
Tout devient comme irréel, avec une sorte de flou qui m’obnubile.
C’est une atmosphère de cirque. Les gens sont comme des personnages de
cirque qui entrent en scène, font leur numéro et ressortent sans qu’on n’ait rien
compris. Ils connaissent parfaitement leurs rôles et l’exécutent.
Chacun est dans son rôle et moi, je ne sais quel est mon rôle à moi. C’est
presque comme si les gens étaient des automates qui font leurs manèges.
C’est comme dans un rêve mais c’est plus réel. »1
D’où vient cette description ? Elle ressemble très fortement à la proposition
goffmanienne de faire en sociologie théoriquement comme si la vie sociale était
un jeu théâtral. Il s’agit pourtant dans ce cas de la description d’une présence
pathologique d’une jeune dame de vingt-quatre ans. Qu’est-ce qu’un vécu de
cirque ? C’est le nom de sa pathologie mentale, rencontrée dans des cas de psychose,
qui consiste en « vécu de déréalisation a minima ». Dans le cas présent, il faudrait
dire que la théorique interactionniste de Goffman fait comme si l’homme était
victime d’un certain type de psychose. Georges Charbonneau, psychiatre,
dresse l’interprétation de la pathologie du vécu de cirque dans les termes de la
Daseinanalyse : « Elle se manifeste dans le fait que chaque scène ‘‘accroche’’, est
en quelque sorte surdéterminée, sur impressionnante pour celui qui la vit car
aucune continuité préparatoire n’a pu lui donner de lien intra-expérientiel. Le
sujet est face à une configuration surgie comme révélée, recommencée à zéro.
Les gestes des gens du cirque n’ont pas de sens appréhendables. On peut dire
que la présence est ‘‘scénisée’’, coupée scènes par scènes, sans unité de continuité.
Plus encore, la rupture regardant/regardé est nettement prononcée. Le patient
ne voit pas ; il regarde immobile des scènes, sans pouvoir leur donner sens. Cette
scénaristique constitue une rupture d’accès libre et fluide de la réalité, comme
si un pas phénoménologique était instauré. Ce pas phénoménologique est
celui qui est instauré dans la relation à la fiction ou au souvenir. »2 . La notion
d’« épreuve »,importante dans le paysage sociologique, est particulièrement
révélatrice du « faire théoriquement comme si l’homme était un psychotique ».
À propos de la présence de l’homme au monde, je lis dans le même ouvrage :
« Le trouble est l’épreuve (le pathos) de cette incertitude [de l’existence] et des
impasses, donc de ses questions : épreuve affective, immédiate, de l’existence
en question dans son histoire » (p. 92).Tel est l’acteur goffmanien, toujours
prêt à percevoir un « sabotage social » dans les bruits du monde qui l’entoure.
Faire volontairement semblant, manipuler l’attention des autres, contrôler la
sienne : c’est l’acteur sous schème interactionniste. Il est ainsi frappant de voir les
similitudes avec l’analyse des primatologues sur les capacités attentionnelles des
1
G. Charbonneau, « Le vécu de cirque. Wahnstimmung et déréalisation », in Formes de la
présence dans les expériences pathologiques, Paris, Le Cercle Herméneutique Éditeur, 2008.
2
Ibidem, pp. 102 et 105.
60
CROIRE.indd 60 22/02/13 11:30:16
présences réelles
singes. En primatologie, les travaux de Whiten et Byrne sont célèbres. Bernard
Conein les résume pour nous : dissimuler, cacher, éviter de regarder un objet pour
qu’un autre ne le remarque pas, distraire l’attention de l’autre pour qu’il ne voit
pas ce qui est important, par exemple de la nourriture, simuler une expression
pour tromper l’autre, etc.1 C’est toujours dans la vigilance, en quête significative,
que l’animal distrait ou se distrait. Dans la théorie interactionniste, comme dans
la vie des singes, la distraction est considérée comme une action ou une relation
et non un mode d’être dans l’action. Il y a comme une erreur d’espèces dans les
choix paradigmatiques de la sociologie.
À la lettre A de son abécédaire, Gilles Deleuze parle de l’animal comme
« fondamentalement aux aguets ». Il le mime même. Aux aguets, dit-il, comme
l’écrivain et le philosophe, qui eux aussi ne sont jamais tranquilles. « Quand
vous vous promenez à la campagne, raconte-t-il dans un cours2 , il faut faire le
jeu suivant, mais aussi bien à la ville, imaginez que vous soyez une bête. Ça veut
dire quoi, être une bête ? Ça veut dire que, quoi que vous fassiez, être aux aguets
de ce qui peut survenir. Je dirais : c’est ce que Leibniz dans les “Nouveaux essais
sur l’entendement humain” appelle l’inquiétude, la perpétuelle inquiétude :
quel animal a mangé en paix ? Il peut avoir une paix, mais la paix de l’animal
est intégration d’une inquiétude perpétuelle : qui va me voler mon morceau de
je ne sais pas quoi ? Voyez l’inquiétude de la hyène, l’inquiétude du vautour ».
Même si je sais, tout en restant sceptique sur le devenir animal des hommes pour
résister aux appareils institutionnels, qu’il est absurde de tracer une frontière et
une distinction entre les animaux si pluriels et les humains à partir de la capacité
à la tranquillité, je reste persuadé de la pertinence d’une mesure expérimentale
des indicateurs de la tranquillité et de l’inquiétude dans diverses situations en
vue d’une comparaison entre différents êtres humains et diverses espèces de sin-
ges et de grands singes.« Voyons, écrit à ce propos Dennett, à quoi pouvait bien
ressembler à ce moment le comportement de notre ancien primate hypothétique
[…] : un animal capable d’apprendre de nouveaux trucs, presque sans cesse vigi-
lant et sensible aux nouveautés, et doté d’un ‘‘espace d’attention à court terme’’
et d’une tendance à voir son attention ‘‘retenue’’ par des traits de l’environne-
ment susceptibles de le distraire »3. Le travail sur les différences et les similitu-
des entre les espèces au moins proches et les êtres des temps éloignés constitue un
impératif pour l’anthropologue.
Dans un horizon de comparaison entre êtres, la phénoménographie des
individus psychotiques est un exercice nécessaire : « Toute présence affecte les
patients et personne ne les laisse plus en repos ; ils sont incapables de s’abandon-
ner, comme ils l’ont fait jusqu’alors dans l’insouciance, aux contacts courants. »4
La comparaison est particulièrement heuristique sur la question de l’intention :
1
B. Conein, Les Sens sociaux, Paris, Économica, 2006, p. 195.
2
Le 12 mai 1987 : cf. http://www.webdeleuze.com.
3
D.C. Dennett, La Conscience expliquée, Paris, Odile Jacob, (1991), 1993, p. 238.
4
H. Grivois, « Coordination et subjectivité dans la psychose naissante », in H. Grivois et J.
Proust, (éds), Subjectivité et conscience d’agir, Paris, Puf, 1998, p. 56.
61
CROIRE.indd 61 22/02/13 11:30:16
albert piette - l'origine de la croyance
« L’intensité, la préparation et même l’exécution d’une action, lorsqu’elles se
déroulent sans obstacle, sont en fait rarement l’origine de sensations ou d’im-
pressions conscientes. Une des raisons possibles de cette ‘‘hypoesthésie’’ cogni-
tive est que les signaux correspondants à ces divers états seraient de faible inten-
sité. […] Le mécanisme de gestion des intentions peut en somme fonctionner
entièrement sur le mode ‘‘automatique’’ et implicite. C’est ce processus-là qui
se trouve déficitaire chez le schizophrène, et qui constitue la clé du trouble de
l’agentivité. Une explication possible de ce trouble pourrait être que, chez ces
malades, le seuil de détection des signaux endogènes par le système de gestion des
intentions serait plus élevé que chez les sujets normaux : une différence minime
pourrait alors entraîner la faillite d’un mécanisme fonctionnant avec une faible
marge de sécurité. »1
Erreur anthropologique que de penser la vie sociale des hommes par
exemple comme un jeu théâtral d’expressions et d’impressions ! C’est dans
une anthropologie analogue que les travaux de la sociologie pragmatique
se développent depuis deux décennies en France, à partir de la notion d’«
épreuve » en tant que « passage obligé pour que les personnes s’accordent sur
leurs grandeurs et sur celle des objets qui les entourent ». Comme « exigence
de première importance pour arrêter un différend, trancher un litige ou clôturer
une discorde »2 , l’épreuve y devient l’analyseur prioritaire de la vie commune et
les situations privilégiées pour l’observation sont particulièrement marquées par
l’incertitude et l’indétermination. Il en ressort toujours cet homme compétent
dans l’examen des contraintes de la situation, de qualification des individus
et des objets, capable de justifications en vue de créer un accord ou de faire
monter une controverse. « Le cours ordinaire de la vie, écrivent Luc Boltanski
et Laurent Thévenot3, réclame un travail presque incessant pour se tenir ou
rattraper des situations qui échappent, en les mettant en ordre. Les gens, dans la
vie quotidienne, ne font jamais complètement taire leurs inquiétudes et, comme
des savants, ne cessent de suspecter, de s’interroger, de soumettre le monde à
des épreuves »4. Et si une différence avec les singes était aussi dans le « jamais
complètement ». Ainsi, quand l’anthropologue se laisse étonner par l’être
humain, je veux dire sapiens, il est interpellé par quelques éléments décisifs :
une présence toujours nuancée et modalisée, la capacité de mitiger et d’absorber
dans la fluidité la nouveauté ou la perte d’une règle ou d’un repère, mais aussi
une tolérance diffuse consistant à oublier, à ne pas y penser, à accepter sans y
penser, à manquer de volonté pour contrecarrer, à reporter ou différer, à ne pas
savoir (et l’accepter) ce que pensent les autres, à accepter les contradictions, les
1
M. Jeannerod, M., et P. Fourneret, P., « Être agent ou être agi. De l’intention à
l’intersubjectivité », in H. Grivois et J. Proust (éds), op. cit., pp. 86-87 et p. 94.
2
M. Nachi, Introduction à la sociologie pragmatique, Paris, Armand Colin, 2006, p. 61.
3
L. Boltanski et L. Thévenot, De la justification, Paris, Gallimard, 1991, p. 54.
4
Il est intéressant de noter que des ouvertures à cette orientation sont proposées dans De la
justification (pp. 425 et sq.) et plus particulièrement dans L. Boltanski, L’Amour et la justice
comme compétences, Paris, Métailié, 1990 sur les situations de « paix » et de « justesse » mais
trop peu réinvesties empiriquement et théoriquement par les sociologues en général.
62
CROIRE.indd 62 22/02/13 11:30:17
présences réelles
dissonances, les petits écarts. Les situations que je viens de décrire l’illustrent
bien, me semble-t-il. Les hommes sont des machines à amortir, à désamorcer, à
voiler. De quoi ont-ils l’air ? De présents absents, de monstres lourds légers, de
concentrés fluides, d’affairés hypolucides, d’inquiets relâchés.
Les notions de reposité et de minimalité permettent ainsi de dégager et de
confirmer des éléments critiques, à mon sens décisifs, par rapport aux diagnostics
sociologiques. La focalisation thématique et analytique des différentes sociologies
de l’action (interactionnisme, ethnométhodologie, sociologie pragmatique)
privilégie, nous le savons, les interprétations en termes de travail et de tension
dans un monde circonscrit. Or, dans une situation, comme l’atteste l’évidence
des observations rapprochées, l’individu est beaucoup moins producteur de sens,
de conscience, de rationalité, de stratégie, de justification que ne veulent bien le
dire les sociologies, toutes confondues, du sujet et de l’action, qui font l’erreur de
déduire des compétences à partir d’effets divers dans les situations postérieures.
Bruno Latour a lui-même été radical en indiquant l’erreur des sociologies de
l’action s’appliquant avec plus de pertinence à la vie des singes que celle des
hommes1. Et si la sociologie s’était trompée d’espèces !
Le mode d’être exclusivement actif (qui suppose un travail d’affairement,
d’attention, de concentration, de volonté, d’intention, de signification…) est
effectivement extrême, tout autant que le mode d’être exclusivement passif. En
effet, les sociologies des déterminations mésinterprètent les présences en situa-
tion. D’une part, en pointant surtout la docilité et l’économie cognitive, elles
oublient la part de fluidité et de distraction dans la présence humaine. D’autre
part, elles rabattent les actions et leurs modes sur les appuis, présentés comme
intériorisés et analysés comme déjà inscrits dans (et non à côté de) l’action et
la présence s’accomplissant. Ce qui est loin d’être toujours le cas. Les appuis en
question perdent ainsi leur dimension située. Une autre asymétrie consiste à pré-
senter les appuis comme seuls travaillant et à attribuer par exemple aux objets
et à l’environnement des opérations cognitives de stockage et de traitement des
informations, avec le risque de ne pas considérer alors les modes humains de pré-
sence2 . De telles lectures manquent, me semble-t-il, une bonne part du rapport
situationnel entre appuis et modes, c’est-à-dire la coprésence même de l’indi-
vidu, des autres humains, des objets, des repères et des règles.
En situation, le mode de présence humaine est donc moins riche en
« action » et en « détermination » que ne le pense l’ensemble des théories
sociologiques. Mais, en même temps, ladite situation où se déploient ces modes
de présence est plus ou moins, parfois très, décisive, entre d’autres situations en
train de se succéder, de se relayer, de se rappeler, de s’impliquer. En eux-mêmes,
les « maintenant », c’est-à-dire les moments d’être faisant les modes de présence
des individus en situation sont chaque fois marqués par des absences (de raison,
de conscience, d’intention…) alors que les situations qui les précèdent et qui les
1
B. Latour, Changer la société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2006 p. 101.
2
Cf. pour des informations critiques à ce sujet : M. de Fornel et L. Quéré (éds), La Logique des
situations, Paris, Éds de l’ehess, 1999.
63
CROIRE.indd 63 22/02/13 11:30:17
albert piette - l'origine de la croyance
suivent attestent des effets, des valorisations, des réflexions, des utilisations de
ce qui y a été ou de ce qui sera. Mais sans que les « maintenant » de chacun des
hommes n’échappent à la forme d’inconsistance que je viens d’évoquer. Il est
donc juste de valoriser l’importance de la couche de familiarité et d’immédiateté
dans la présence humaine. De fait, celle-ci se déplace au milieu d’êtres et d’objets
toujours déjà là, mais aussi toujours changeant, disparaissant, revenant dans
un temps souvent rapide : ce qui exige de l’observer et de la décrire dans ses
détails et ses diverses strates mélangeant micro-repos et micro-travail. L’attitude
naturelle consiste ainsi dans l’imbrication et le déplacement de ces quatre
modes, tranquillité, familiarité, fatigue et tension. Elle est alors décapée d’une
généalogie socioculturelle et d’une traduction intellectualiste ou moraliste
surinterprétante.
Que et comment faire pour devenir « singe » ou, selon l’interrogation de
Deleuze, « chien » ? Sa réponse : « Il faut que j’arrive à donner aux parties
de mon corps des rapports de vitesse et de lenteur qui le font devenir chien »1.
Et il continue : « Si la Tique, le Loup, le Cheval, etc., sont de véritables noms
propres, ce n’est pas en raison des dénominateurs génériques et spécifiques
qui les caractérisent, mais des vitesses qui les composent et des affects qui les
remplissent »2 . Mais avec des observations rigoureuses sur les mouvements et les
repos, les vitesses et les lenteurs, ne découvririons-nous pas certaines similitudes
entre les tiques, d’autres entre les chiens, d’autres encore entre les singes ?
Quant à la spécificité de la vie des humains, elle serait d’avoir créé et introduit
un ensemble d’appuis extérieurs et surtout d’avoir généré un mode de présence
caractéristique. Il consiste dans la possibilité de se (re)poser pendant l’action, et
donc de nuancer le mode majeur-actif par des formes diverses de passif-mineur.
L’hominisation consiste ainsi dans une modalisation en mineur des actions, c’est-
à-dire dans l’injection d’une strate amortissante simultanée à l’action travaillante,
alors qu’elle était déployée en une séquence d’actions successive à celle de la
tension chez les singes. Le travail et la tension de l’interaction se modalisent,
en proportions variables, dans l’économie de la perception, la distraction, la
docilité et la fluidité. Telle est la spécificité humaine résidant dans les nuances
modalisatrices et dans l’extension du mode mineur de l’action tandis que les
singes amortissent par des actions spécifiques et non pas par une modalisation
de l’action en cours. À travers la présence-absence et le mélange permanent
du repos et de l’action, celui-ci est devenu un mode simultané à celle-là et non
plus seulement une action suivant d’autres actions. L’homme, Homo sapiens, a
ajouté la non-pertinence de l’indifférence, de l’oubli, de la distraction. Il n’est pas
difficile de penser que cette détente de la présence dans l’action a généré un effet
libérateur sur la performance intellectuelle3.
Ce qui serait donc arrivé à l’espèce Homo sapiens est comme une sortie, au
moins un dégagement de la présence par rapport à l’action telle que celle-ci
1
G. Deleuze et F. Guattari F., Mille plateaux, Minuit, 1980, p. 316.
2
Ibidem, p. 323.
3
Cf. A. Piette, Anthropologie existentiale, op. cit.
64
CROIRE.indd 64 22/02/13 11:30:17
présences réelles
est entendue par la sociologie à partir de ses raisons, de ses effets collectifs, de
sa production de sens et d’ordre. Il nous paraît dès lors important, pour une
compréhension sociologique de l’action humaine, de prendre en compte le plus
rigoureusement possible, sur base d’observations précises, les modes d’être et
de présence spécifiques à l’homme. Ces restes constitutifs de la minimalité, il
convient ainsi de ne pas d’emblée les éliminer de la recherche, dès ses premières
étapes, mais de les intégrer à l’analyse du sens et de la tension, de mesurer les
formes différenciées du mode mineur dans la vie commune des gens, dans diverses
situations : selon la force implicatrice de l’action en cours, selon l’activation
plus ou moins forte des raisons d’être là et d’agir, selon aussi le surgissement
d’éléments divers de situations antérieures et plus généralement extérieures
à la situation immédiate. Telle est la force et l’originalité de l’être humain :
une présence amortie dans une situation par la présence d’appuis matériels et
d’éléments distrayants, et en même temps la possibilité de « décaler » l’épreuve
qui surgirait à partir d’une perte d’appuis dans l’action en cours. Le mode de
présence des singes nous oblige donc à regarder la dimension essentielle du mode
mineur de l’homme et à nuancer la part de « travail » en situation, qu’il soit
d’ajustement, de qualification ou d’identification à partir d’appuis existants ou
nouveaux. Cette lecture anthropologique permet aussi de réfléchir à nouveaux
frais sur la place (située) de l’« épreuve » dans une situation. Bien sûr, l’épreuve
peut être « là », plus ou moins présente, parfois obsédante, écrasante, parfois
aussi en toile de fond. Donc une présence en situation avec des caractéristiques
propres. Et une spécificité du cours de la vie des hommes est précisément que
l’épreuve y est reportée, déplacée, ainsi désamorcée, tenue à l’horizon, nous
dirons virtualisée ? Ceci invite précisément à penser le surgissement de l’épreuve,
son mode d’installation et la confrontation ponctualisée des hommes avec elle
selon les appuis dont ils disposent, mais aussi avec les « restes » non touchés, si
caractéristiques de l’espèce humaine. La minimalité est plus qu’un thème, elle est
un paradigme à soumettre à l’observation et à la théorie des sciences sociales.
« Que se passe-t-il donc dans cette conscience non-réflexive que l’on prend
seulement pour pré-réflexive et qui, implicite, accompagne la conscience inten-
tionnelle. »1En posant cette question, Lévinas critique aussi des positions phé-
noménologiques qu’il a rencontrées, dit-il, chez Brentano ou Husserl :« Dans sa
non-intentionnalité, en deçà de tout vouloir, avant toute faute, dans son identi-
fication non-intentionnelle, l’identité recule devant son affirmation, devant ce
que le retour à soi de l’identification peut comporter d’insistance »2 . À regar-
der l’homme au plus près, nous le savons, la conscience apparaît plus qu’éco-
nome, suspendue. Et donc il faut rester critique vis-à-vis de certains principes
et lexiques de la phénoménologie : « Plus propre encore à la Phénoménologie
fut l’erreur de faire de la conscience le principe fondateur de ce dont elle est seu-
lement l’opérateur. Le couple phénoménologique part de la conscience et y fait
retour jusqu’en son effort pour lui substituer l’existence ; davantage : c’est pour
1
E. Lévinas, Entre nous, Paris, Grasset, 1991, p. 146.
2
Ibidem, p.147.
65
CROIRE.indd 65 22/02/13 11:30:18
albert piette - l'origine de la croyance
avoir assigné la constitution à la conscience que la Phénoménologie a dû traver-
ser le labyrinthe de la transcendance et fonder toute connaissance sur une odys-
sée – selon les cas – transcendantale, perceptive ou existentielle, de l’Ego. »1. Et
Lévinas d’ajouter : « Cette passivité est, certes, une exposition du sujet à autrui ;
mais la passivité du sujet est plus passive que celle que subit l’opprimé déterminé
à la lutte »2 . Ainsi la compréhension anthropologique du mode humain de pré-
sence doit retenir, me semble-t-il, la nécessité d’infléchir la part intentionnelle,
interactionnelle et communicationnelle et de considérer dans l’acte de présence
une strate qui, tout en s’ajoutant aux premières, les nuance. L’humain de l’exis-
tence, c’est celui qui est là et qui par le fait même amortit les dimensions recon-
nues à l’homme social, interactif et communicatif mais aussi usager, moralisateur
et rationnel. Décrire ce fait d’être est central comme débordant l’acteur social
tel qu’il n’est pas en face-à-face mais tel qu’il est coprésent. Cette coprésence,
faite de présence et d’absence, en tant qu’elle suppose une part de flou, de mini-
mal et de relâchement, est constitutive de l’attitude naturelle des êtres humains.
« Cette faculté de résistance à l’information a quelque chose de fascinant, et de
magique, écrit Clément Rosset, aux limites de l’incroyable et du surnaturel : il
est impossible de concevoir comment s’y prend l’appareil perceptif pour ne pas
percevoir, l’œil pour ne pas voir, l’oreille pour ne pas entendre. Pourtant, cette
faculté, ou plutôt cette anti-faculté, existe ; elle est même des plus banales et
il est loisible à tout un chacun d’en faire l’observation quotidienne. »3 Penser
qu’Homo sapiens est la seule espèce à réaliser cette performance, et sans doute pas
avec ses premiers représentants, est encore plus fascinant. C’est ce moment de ne
pas voir, d’oublier, si particulier aux humains, commenté par Rosset, que Proust
décrit chez Swann se détourant de l’idée qu’il aime une « femme entretenue » :
« Il ne put approfondir cette idée, car un accès d’une paresse d’esprit qui était
chez lui congénitale, intermittente et providentielle, vint à ce moment éteindre
toute lumière dans son intelligence, aussi brusquement que, plus tard, quand on
eut installé partout l’éclairage électrique, on put couper l’électricité dans une
maison. Sa pensée tâtonna un instant dans l’obscurité, il retira ses lunettes, en
essuya les verres, se passa la main sur les yeux, et ne revit la lumière que quand il
se retrouva en présence d’une idée toute différente. »4
L’observation rapprochée d’un homme dans la succession des instants ne
manque presque jamais de repérer dans un moment de présence l’acceptation
de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, le repos sur des appuis, la distraction, la
fluidité dans la continuité, la parcimonie cognitive et perceptive, la tolérance de
l’incertitude à peine perçue, l’infraconscience et le report de lucidité, les face-à-
face amortis, les malheurs comme les bonheurs jamais totaux, les interférences
diverses laissées sans importance. Et c’est capital. Mais cela demande quelque
ténacité pour maintenir la pertinence de telles observations. C’est bien cela
1
F. Wahl, Le Perçu, Paris, Fayard, 2007, p. 24.
2
E. Lévinas, Autrement qu’ être ou au-delà de l’essence, Paris, Librairie générale française, (1974),
2008, pp. 90-92.
3
C. Rosset, L’École du réel, Paris, Minuit, 2008, pp. 234-235.
4
M. Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Booking international, (1913), 1993, p. 281.
66
CROIRE.indd 66 22/02/13 11:30:18
présences réelles
Homo sapiens, dont de telles modalités d’exister et d’être présent ressemblent à
ce que l’acte de croire suppose : accepter la non-vérification, accepter de ne pas
savoir jusqu’au bout. Il y a beaucoup d’analogies entre l’acte de croire et l’acte
d’être présent dans une situation. Il est ainsi tentant de penser que l’acte de
croire a progressivement transformé, depuis seulement 100 000 ans, notre Homo
sapiens.
L’acte de croire n’est en effet pas si loin ! Non par le contenu des croyances,
mais par cette analogie entre l’aptitude cognitive qu’il suppose et qu’il permet,
et les caractéristiques des modes de présence décrites. Que savons-nous de l’acte
de croire ? Qu’il consiste à croire à moitié, croire à des choses contradictoires,
croire et, en même temps, être sceptique, flotter entre l’émerveillement et la cré-
dulité, être capable de changer de « programmes de vérité », hésiter ou rester
indifférent face à l’alternative de la vérité et de la fiction. L’acte de croire fait
surgir une sorte d’entre-deux mental où vont flotter des croyances non vraiment
assumées. Dans cette perspective, je l’ai souvent indiqué, l’œuvre de Paul Veyne
est décisive. « Une même conduite (placer dans le tombeau un peu de nourri-
ture ou encore des objets domestiques à la disposition du défunt ) sera, écrit-il,
selon la société ou le groupe social considéré, tantôt une cérémonie d’hommage
dépourvu de toute croyance ; tantôt un geste de consolation auquel les acteurs,
sans y croire vraiment, se livrent à la façon d’acteurs qui jouent sur un théâtre ;
tantôt enfin une véritable croyance, mais qui n’abolit pas pour autant d’autres
croyances qui la contredisent en apparence »1. Ou encore : « La réalité d’une
croyance ne se mesure, ni à sa non-contradiction, ni aux applications pratiques
qu’on en fait : la foi qui n’agit pas est souvent une foi sincère. On peut croire à une
survie des défunts dans le tombeau, tout en constatant de ses yeux qu’ils ne sont
que poussière ; on peut croire qu’ils continuent à se nourrir, sans tirer les consé-
quences matérielles de cette croyance (on ne renouvelle pas la nourriture sur la
tombe, mais on la dépose une seule fois, le jour des funérailles) » (p. 18). Celui
qui vient présenter à sa famille défunte, devant la tombe, son nouveau-né, croit-il
vraiment que ce dernier pourra être regardé ? « Non », dirait-il dans un discours
rétrospectif, à celui qui l’interroge. « Mais quand même un peu », au moment
de l’acte qui est bref et qui ne peut pas être pensé jusqu’au bout. L’homme sait-il
s’il croit ou non ?2 « Indifférence léthargique », répond encore Paul Veyne qui
rappelle que l’homme sait bien de quoi il ne faut pas qu’il devienne conscient.
Ce sont les « inconséquences eschatologiques ». Elles disent beaucoup sur le
rapport d’une part, entre les énoncés de croyance (en particulier, à propos de
l’au-delà) et les conséquences logiques et/ou pratiques non poussées jusqu’au
bout à partir de l’acte même de croire et d’autre part, entre les comportements
spécifiques et l’attitude mentale correspondante. Et rien de cela ne participe de
quelque mauvaise foi.
1
P. Veyne, « Conduites sans croyances et œuvres d’art sans spectateurs », Diogène, n°143,
1988, p. 17.
2
La référence au célèbre texte de Mannoni, « je sais bien… mais quand même », s’impose bien
sûr : cf. O. Mannoni, Clefs pour l’ imaginaire ou l’autre scène, Paris, Seuil, 1985.
67
CROIRE.indd 67 22/02/13 11:30:18
albert piette - l'origine de la croyance
Les croyances participent ainsi d’une zone de limbes en marge des exigen-
ces de la réalité empirique, de telle manière qu’elles permettent une coexistence
pacifique de deux vérités incompatibles sans confrontation et perversion de l’une
vis-à-vis de l’autre. De même qu’un homme peut voir des âmes partout dans
la forêt et aussi tailler un arbre pour obtenir du combustible, un enfant sait à
la fois que ses jouets sont apportés par le Père Noël et donnés par les parents1.
Selon une telle lecture de l’acte de croire, la contradiction des croyances avec la
réalité, sa non-implication dans des actes et des conséquences concrètes, voire
son démenti par cette même réalité n’excluent pas le maintien des croyances en
question : « c’est notre façon d’être la plus habituelle », s’exclame Paul Veyne2
devant cette capacité humaine de changer et même d’enchevêtrer des program-
mes différents de vérité. Ce qui donne, selon son expression, « l’impression de
médiocrité humaine », constitue le mode mineur de la réalité, la manière d’être
de l’homme minimal. D’où bien sûr « des demi-croyances, des hésitations, des
contradictions, d’une part, et, de l’autre, la possibilité de jouer sur plusieurs
tableaux »3. De la même façon, mon autographie du croire a fait apparaître que
ces états éphémères de croyance basculent très rapidement dans des moments de
résonance et de réverbération de celle-ci mais aussi de suspension, d’indifférence
et même d’oubli, parfois aussi de critique.
Mais c’est aussi cela que la présence dans la suite de diverses situations d’une
journée fait voir : un homme minimal avec des ressources cognitives ne pou-
vant répondre aux normes de non-contradiction4, incapable de déduire toutes
les conséquences de ses actions, déployant sans cesse des inconsistances et des
contradictions dans ses propres pensées et actions, n’ayant pas toujours une pré-
férence explicite entre deux actions, ne réfléchissant pas avant d’accomplir l’une
ou l’autre, ou encore ne se tenant pas à une décision qui a pu être prise. Et tout
cela avec une fascinante fluidité que je juge caractéristique d’Homo sapiens. Cette
analogie entre la spécificité du croire et les modes humains de présence ne par-
ticipe pas du hasard. Car précisément, dans l’histoire de la cognition, l’acte de
croire a fait apprendre, aussi dans l’accomplissement des autres activités, l’accep-
tation des limites, des échecs, l’oubli des contradictions et des imperfections des
pensées ou des actions.
Croire, c’est en effet accepter le flou, c’est aussi ne pas « y » penser, être
« hypolucide » par rapport au potentiel d’invraisemblance des énoncés auxquels
il se rapporte. Croire, c’est ne pas penser jusqu’au bout, ne pas vouloir savoir.
C’est cela, l’être humain en train d’exister dans toutes les situations, à tous les
instants ! Ce qui me paraît très important dans mes présences successives au
cours de ces situations est bien cet en deçà de la conscience, de l’intention et
peut-être même de la perception, celle qui permet l’évidence de la coprésence
avec l’enjeu attendu et manifesté. Certes avec des degrés divers, les choses
1
P. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes, op. cit., pp. 144-145.
2
Ibidem, p. 93.
3
Ibidem, p. 53.
4
C. Cherniak, Minimal Rationality, Cambridge, The Mit Press, 1986 et aussi J. Elster, Le
Laboureur et ses enfants, Paris, Minuit, (1983), 1986.
68
CROIRE.indd 68 22/02/13 11:30:18
présences réelles
apparaissent ou redeviennent vite, malgré des interférences, des obstacles, des
tensions, comme allant de soi, en deçà de quelque face-à-face lourd. Plus que
détermination, rationalité ou interaction, le « moins-être » explicite quelque
chose de la présence des hommes entre eux et avec les objets. La présence
humaine apparaît ainsi en un déplacement permanent sous une double forme :
la modulation (comme mouvement séquentiel de gestes, de postures et d’états
d’esprit) et la modalisation (comme présence simultanée de différentes strates
dans une même présence). Modaliser la modulation assure le déplacement de
l’individu, entraînant de nouvelles modulations toujours modalisées. Ainsi
dans une situation, outre les écarts incessants par rapport à une norme ou un
rôle, l’anthropologue note la compatibilité non dérangeante entre des êtres et
des objets différents, parfois contraires et contradictoires à l’enjeu de la situation
(la modalisation externe) et les différentes strates internes des comportements
toujours nuancés des individus (la modalisation interne). La présence subsiste
comme humaine dans ce déplacement qui modalise et module, par la familiarité
et la tranquillité selon des intensités diverses, la fatigue et la tension.
Il n’est pas facile de penser les présences, les coprésences des hommes, des
hommes et des objets, des divinités ou des collectifs, autrement qu’en termes de lien
et de rapport, si ancrés dans la tradition des sciences sociales et de la philosophie.
De manière heuristique me semble-t-il, dans l’œuvre phénoménologique de Jean-
Luc Marion1, la présence de l’« Autre » est typiquement pensée, théorisée comme
allant de soi, toujours déjà là, déjà donnée, sans devoir solliciter l’intention et la
pensée des « autres »,sans gérer un face-à-face, l’attention ou encore l’obsession
pressante. La théologie qui décrit parfois la coprésence des hommes et de Dieu
en termes de non-effort et de non-jugement peut ainsi aider l’anthropologue à
penser la forme élémentaire de socialité des hommes, en deçà de la maîtrise, de
l’action, de la fixation, dans le repos, la passivité, et la suspension d’une recherche
des causes et des origines. C’est dans cette perspective également que le non-voir
ou l’en deçà de la présence humaine rend possible la présence d’un surplus, d’un
au-delà faisant apparaître l’objet clignotant en feu rouge devant lequel on s’arrête.
Ce qui lui apparaît donc, l’homme le voit, le perçoit à peine, sans contrainte, sans
qu’il le fixe, dans le flux des instants. La part de latéralité qui se déploie dans la
coprésence de l’homme et du feu rouge, non regardé, à peine perçu, n’est-elle pas,
de façon variée et proportionnée, dans tout acte de présence et de coprésence ?
La coprésence ne suppose pas d’abord un face-à-face expressif, un échange, une
réciprocité. Surtout pas la conscience et la crispation, surtout pas l’effort de
faire attention. C’est justement ne pas faire explicitement et intentionnellement
attention, comme le dit avec force Simone Weil dont toute l’œuvre constitue
une véritable anthropologie de l’attention. Dans l’attention comme manière de
ne pas faire attention, nous reconnaissons bien l’importance de la négation et
de la minimalité. Dans cette perspective, la notion de « donné » ou de don
est sans doute pertinente, avec l’objectif de décrire et comprendre les modalités
de donation (le feu toujours là et bien accroché par des maillages serrés) et de
1
J.-L. Marion, Étant donné, Paris, PUF, 2005.
69
CROIRE.indd 69 22/02/13 11:30:19
albert piette - l'origine de la croyance
réception (l’homme qui passe sans vraiment le voir). Ce sont des « donnés », sans
échange, sans dette et sans réciprocité ou en tout cas très différés. La coprésence
faite d’implicite, de non-pensée est un élément clé de la vie sociale de laquelle on
a enlevé intérêt, motivation, échange, calcul. Ici, le don n’est pas une séquence
dans un cycle relationnel mais bien une strate nécessairement et spécifiquement
humaine dans toute forme de présence. Ce reste de la pensée des sciences sociales
devient ici capital, s’exprimant dans l’acte d’être présent caractérisé par la
présence-absence à partir de pensées et gestes périphériques, à partir de l’entour
des choses, des objets et des autres. Cette présence-absence permet d’insister sur
le toujours déjà et en même temps sur le constant déplacement des êtres.
70
CROIRE.indd 70 22/02/13 11:30:19
LE MODE MINEUR :
IMPACT ET DESTINÉE
« Le savant n’est pas l’homme qui fournit les vraies répon-
ses ; c’est celui qui pose les vraies questions »1
Que diraient de très lointains descendants sur cette espèce de vivants (qu’est
Homo sapiens) qui a animé la terre pendant quelques milliers d’années ? Ce
livre veut exprimer une réponse plausible, qui soit englobante de beaucoup
de caractéristiques et respectueuse des détails de l’existence des hommes. La
spécificité, ce serait non seulement la croyance, l’acte de croire à des choses
incroyables, mais surtout la possibilité d’exister autrement qu’a déclenchée et
progressivement développée l’acceptation du flou. Ou que dirait un lointain
ancêtre qui aurait manqué de quelques années la naissance de la « croyance » ?
« Moi, Homo sapiens, né il y a 175 000 ans, je viens vous revoir et je m’étonne
de tout ce que vous avez fait. Mais ce qui m’interpelle le plus est ce que vous
avez appelé ‘‘religion’’. Si je comprends bien, de mon point de vue évolutionnaire,
vous avez, dirais-je, inventé des êtres que vous dites invisibles, vos divinités. Vous
les faites vivre dans un autre monde justement invisible, duquel elles viennent,
duquel elles agissent, entre elles, avec vous, où parfois elles sont rejointes par les
hommes quand ils sont morts et où ils continuent à vivre. N’est-ce pas cela en
gros ? Nous, nous n’avons jamais été capables de créer des êtres que nous n’avions
jamais vus. Nous pouvions entre nous, dans notre abri, parler de ce que nous
avions fait ailleurs, à la chasse, à l’atelier de taille. Nous nous accrochions aux
traces, aux indices pour déduire la présence d’un prédateur ou la pluie. Mais cela
est tout à fait étonnant : une fois que vous les avez inventés, ces esprits ou ces
dieux, vous dites qu’ils existent. Vous faites comme si ces divinités étaient là,
1
Cl. Lévi-Strauss, Mythologiques. Le cru et le cuit, Paris, Plon, 1964, p. 15.
71
CROIRE.indd 71 22/02/13 11:30:19
albert piette - l'origine de la croyance
quelque part. Vous dites que vous y croyez. Nous, nous n’avons jamais fait cela.
C’est fascinant : inventer un être invisible, s’adresser à lui, en parler beaucoup
et croire qu’il existe. Nous, nous étions rationnels, dans la mesure du possible.
C’était difficile, très tendu, nous essayions de résoudre tout, de toujours décider,
d’agir à partir de toutes les informations dont nous disposions. D’aller jusqu’ au
bout de l’accomplissement. Vous avez l’air de pratiquer beaucoup d’activités et
de passer des unes aux autres avec une grande facilité. Mais le plus extraordinaire
est qu’il vous arrive de vous tuer entre vous au nom de ces divinités, que vous
avez inventées et dont vous croyez qu’elles existent. Et vous tuez même sans
hésiter. »
L’homme fait la religion selon le discours critique de Feuerbach et de Marx,
mais la religion ferait aussi l’homme, non pas par son contenu potentiellement
confortable, mais par la caractéristique de l’acte de croire de suspendre la
contradiction. Le risque de l’intelligence est résolu par elle-même d’une certaine
façon. L’énoncé religieux ne naît pas d’un besoin ou d’un manque mais d’une
aptitude ponctuelle qui entraîne non seulement les effets psychologiques et
sociologiques bien connus mais surtout un mode d’être. Celui-ci ne constitue
pas en lui-même la dimension totale et exclusive de l’être humain mais au
moins une strate s’infiltrant selon des degrés différents dans ses pensées et ses
activités. Si aujourd’hui homo religiosus existe, il n’a pas toujours existé et il ne
se caractérise pas principalement par des actes de communion, d’engagement,
d’effervescence mais justement par une modalité d’injecter flou et relâchement
cognitif dans les autres activités. La croyance est le résultat accidentel de la
capacité cognitive de produire des interférences entre les domaines d’activité de
la vie et en particulier de créer des énoncés contradictoires, et en même temps de
leur accorder un assentiment. Celui-ci suppose de mettre entre parenthèses les
principes de logique et de non-contradiction. Elle constituerait le point de départ
de la manière d’être un humain, induite moins par le contenu de la croyance que
par le mode de pensée impliqué par l’acte de croire. Sans transgresser le principe
de non-contradiction dans un même énoncé, le relâchement ou même la paresse,
comme dit Bergson, de l’homme préférant se « laisser aller à ne pas penser »1
entraîne la fluidité des hommes capables de basculer de situation en situation, à
travers des règles contraires et contradictoires, des « programmes » différents
de vérité.
Certaines réflexions de Lévy-Bruhl sont tout à la fois proches et éloignées de
mon propos. Certes − et c’est bien connu −, elles présentent des excès lorsque Lévy-
Bruhl semble approuver le diagnostic de « lourdeur d’esprit » des Hottentots
ou qu’il constate la naïveté des Iroquois, des Zambésiens ou des Maoris. Bien
sûr, Lévy-Bruhl exagère l’association d’un objet, d’un événement à des esprits
invisibles, telle qu’elle serait faite en permanence par ces « Primitifs ». Selon sa
lecture disons durkheimienne, il explique ces modes de pensée et de raisonnement
par une dominante de représentations collectives injectant dans tout acte et
objet une force occulte. Lévy-Bruhl sait aussi qu’il ne s’agit pas d’« incapacité »
1
H. Bergson, op. cit., p. 159.
72
CROIRE.indd 72 22/02/13 11:30:19
le mode mineur : impact et destinée
ou d’« impuissance », de « faiblesse d’esprit » ou de « raison déficiente ». Car
le diagnostic sur les « Primitifs » mentionne une excellente mémoire, un sens
pratique subtil et ingénieux lorsqu’il s’agit par exemple de fabriquer un ustensile
ou de lancer un projectile. Ils ne sont d’ailleurs pas si illogiques puisqu’ils
acceptent de croire au « Dieu des Blancs » seulement lorsqu’ils le verront au
ciel… En rapport avec mon propos, d’autres points mentionnés par Lévy-Bruhl
interpellent : l’aversion des « Primitifs » pour le raisonnement abstrait et la pensée
discursive, l’appréciation de la réduction de l’effort intellectuel au minimum, et
aussi la tolérance à la contradiction1. « N’avons-nous pas dit nous-mêmes qu’ils
se dispensent de penser toutes les fois qu’ils le peuvent, et la réflexion la plus
simple n’est-elle pas pour eux une fatigue insupportable ? »2 . Une explication
sociologique associerait ces attitudes à des représentations collectives et à des
« habitudes » qui « régissaient la forme et l’objet de leur activité d’esprit »3. Ne
sont-ce pas là plutôt des éléments que nous pouvons remarquer dans toutes les
attitudes humaines, aussi en dehors des activités religieuses : la lucidité rarement
vive, la pensée qui ne va pas jusqu’au bout de ses implications dans le raisonnement
lui-même et aussi dans les pratiques, les contradictions tolérées non pas au sein
d’un énoncé mais entre les attitudes et les principes d’une situation à une autre…
Cette modalité d’être serait proprement humaine et ne peut être expliquée
seulement par un contexte social et des représentations collectives spécifiques.
Une telle habitude mentale et une telle disposition d’esprit sont ancrées dans
les modes humains de cognition, qui s’expriment dans l’économie cognitive et
la fluidité, dont le point de départ aurait été, c’est une hypothèse, la pratique des
énoncés religieux et l’assentiment incertain qui leur est donné, engendrant ainsi
cette acceptation à suspendre, à lâcher prise, à mettre entre parenthèses. C’est
cela le mode mineur qui n’est qu’une modalité cognitive ne remplaçant pas le
raisonnement pratique ou la réflexion abstraite, mais justement les modalisant,
les atténuant, les dérigidifiant en quelque sorte. C’est une strate à côté de celle de
la rationalité et du sens.
Pour croire, il a donc fallu d’une part que les hommes arrivent à construire
des énoncés susceptibles de ne pas correspondre à une référence certaine
mais aussi ni infirmable, ni confirmable et d’autre part qu’ils y jettent un
assentiment aux degrés variables. À l’évidence, personne ne penserait à dire
d’un chimpanzé ou d’un chien qu’il est rationnel ou irrationnel. Sous l’effet de
perceptions immédiates, peut-être parfois d’inférences mentales (mais dans une
moindre mesure), le chimpanzé « détecte »4 des repères ou des indices et agit
en conséquence. Ceci ne signifie pas que son acte est le meilleur dans le but de
se nourrir ou d’échapper à un prédateur. Disons que ce type de perceptions et
d’actions vaut aussi pour la vie des différents hominidés qui ont vécu après le
1
Cf. les réflexions de F. Keck, Lucien Lévy-Bruhl, entre philosophie et anthropologie, Paris,
CNRS Éditions, 2008.
2
L. Lévy-Bruhl, « La mentalité primitive », in Primitifs, Paris, Éditions Anabet, (1922), 2007,
p. 49.
3
Ibidem, p. 14.
4
R. de Sousa, Évolution et rationalité, Paris, Puf, 2004, p. 10.
73
CROIRE.indd 73 22/02/13 11:30:20
albert piette - l'origine de la croyance
débranchement de la lignée des primates, avec des capacités cognitives de plus
en plus complexes. Ne peut-on pas penser qu’avant l’Homme moderne (Homo
sapiens) et la production d’énoncés contradictoires caractéristiques de l’univers
religieux, il y eut une vie plus « logique », plus rigide aussi, faite d’idées et de
comportements en fonction d’informations directement perceptibles, infirmables
ou confirmables. Dans cette perspective, la pensée logique capable de chercher
des indices et des traces, de déduire la présence d’animaux ou d’hommes, de
faire des prévisions météorologiques précède la capacité à produire des énoncés
religieux. Une telle pensée logique est d’ailleurs nécessaire dans la vie sociale des
singes. Mais comment faisait Homo erectus ou l’Homme de Neandertal face à
un indice plutôt incertain ? Quand il ne résolvait pas une difficulté technique ?
Quand il était confronté à la contradiction ? Ces deux hominidés s’occupent
de ce qui est perceptible, de ce qui peut l’être, infirmable ou confirmable. Se
pose alors l’interrogation sur l’état d’esprit, d’émotion et de tension des espèces
appartenant au genre Homo (aussi Homo sapiens avant qu’il ne se mette à croire)
lorsque ses membres s’étaient trompés, lorsqu’ils ne savaient pas, dès lors qu’ils
ont pu se rendre compte d’une erreur ou d’une ignorance en cas d’hésitation à
propos de telle ou telle action. Et quand ils ne trouvaient pas dans leur stock
de connaissances une explication à un événement, à un échec, à un malheur, et
bien sûr à partir du moment où la conscience réflexive a permis de ressentir, de
percevoir et de réfléchir sur de telles situations. Et encore lorsque, à partir de
divers indices ou traces d’un animal par exemple, la non-découverte de celui qui
était attendu ou d’autres attributions d’« agency » non satisfaisante entraînaient
ces « hommes » dans une vigilance ou une intranquillité accrue1.
Ce serait justement la production d’énoncés hybrides, ensuite la croyance par
exemple en la vie du mort ou en l’intention agissante du nuage, et surtout la mise
entre parenthèses des contradictions de ces propositions que leur acceptation
suppose, qui a permis d’apprendre le relâchement aussi face aux choses
incertaines ou aux erreurs, ainsi que la faiblesse de la volonté et l’acceptation
non problématique de choses non certaines mais possibles. Tentons d’imaginer
le mode de langage d’êtres plus intelligents que les singes mais qui n’ont pas
développé la capacité de fluidité cognitive. Rigide, cherchant à aller jusqu’à
bout de l’information, sensible à la contradiction qui surgissait ? Sans le mode
mineur ! Ce serait la situation de beaucoup d’Homo, des Néandertaliens et aussi
des premiers Homo sapiens avec langage articulé, conscience réflexive et sans
l’hypolucidité apprise par l’acte de croire. Après, Homo sapiens a appris à accepter,
dans le relâchement et la fluidité, les inférences non valides, les choses douteuses,
les choix incohérents, les successions de principes contradictoires, ainsi que
les raisonnements très minimaux. L’effet de relâchement appris dans l’acte de
croire à des propositions contradictoires aurait façonné une hypolucidité propice
à « oublier ». Dans cette perspective, le registre des émotions, piété, crainte,
1
À ce propos, les réflexions de Justin Barrett sur l’opération cognitive de détection d’« agents »
et d’« agency » sont intéressantes : cf. J. L. Barrett, Why Would Anyone Believe in God ?,
Lanham, Altamira Press, 2004, pp. 40-41.
74
CROIRE.indd 74 22/02/13 11:30:20
le mode mineur : impact et destinée
communion, parfois sollicité pour expliquer l’émergence de l’idée religieuse me
semble chronologiquement secondaire par rapport à la production de l’énoncé
religieux et à l’assentiment qu’il a généré. Et si l’hypothèse était un jour avérée :
l’acte de croire décisif dans la survie et le mode d’être d’Homo sapiens. Par ce que
cet acte a permis d’apprendre et de générer, plus que par le contenu « religieux »
proprement dit. L’utilisation de la possibilité de ne pas (trop) penser, bien ancrée
dans le monde du vivant, vient nuancer ou freiner le potentiel de lucidité d’Homo
sapiens dont le voisinage de la conscience et de la non-conscience est ainsi très
caractéristique.
L’hypolucidité « pour anesthésier l’effroi de notre mortalité »1 et aussi pour
mettre entre parenthèses la durée, le contraste entre les moments, heureux et
malheureux, les catastrophes qu’indique sans réaction le chiffre annuel des acci-
dents de la route ou le nombre d’enfants mourant chaque jour de faim dans le
monde, même si certains d’entre-nous focalisent leur pensée et action sur l’une
et pas les autres, parmi les atrocités du monde. Même Œdipe, qui sait ses cri-
mes, qui vient de se crever les yeux, se cherche à Colone un endroit, comme il le
dit lui-même dans la première tirade de la tragédie de Sophocle, résigné, presque
mort mais docile, pour s’arrêter, s’installer, s’asseoir, prêt pour se reposer. « La
malhonnêteté, en l’occurrence, ne consiste nullement, écrit J. Bouveresse, dans
le fait de croire en dépit de l’absence ou de la faiblesse des raisons, mais dans la
façon dont la croyance dissimule sous une apparence noble et respectable sa véri-
table nature, qui est celle d’un relâchement et d’une abdication de la volonté. »2 .
Le principe de relâchement se déploie désormais dans l’acceptation des énoncés
contradictoires, religieux ou ludiques, mais aussi dans la fluidité avec laquelle
l’homme passe de séquences d’action et de situations articulées sur des données
et principes très différents, parfois même contradictoires.
L’être humain serait comme arrêté dans ses éclats de lucidité et d’acuité, c’est
par cette affirmation que ce livre a commencé, avec Cioran et Pascal. « Le Léthé
où je buvais l’oubli de l’existence », écrivait magnifiquement Hölderlin3. C’est
cela aussi la minimalité. Non par défaut d’intelligence mais par l’habitude d’une
manière d’être humain, de ne pas y penser vraiment, de ne pas aller au bout, de ne
pas aller à fond. L’histoire de l’hominisation et de la possibilité de la conscience
réflexive qui l’accompagne ne peut être dissociée de la pratique privilégiée et
acceptée du flou et du relâchement cognitif. C’est mon hypothèse : que cette
compétence s’est développée, une fois que l’homme a appris à croire à des
choses bizarres, d’emblée incroyables, disons surnaturelles, et à penser ainsi leur
existence sans trop savoir. Le propos de Lévi-Strauss en exergue de ce chapitre
n’autorise-t-il pas quelque spéculation ?
Repensons à ces hommes qui, les premiers, ont associé la mort à la vie ou le
soleil à un esprit. Repensons à cet homme, le premier. Nous serions donc il y a
environ 100 000 ans et ils commenceraient à produire des énoncés décalés par
1
F. Dastur, La Mort. Essai sur la finitude, Paris, PUF, 2007, p. 11.
2
J. Bouveresse, Peut-on ne pas croire ?, Marseille, Agone, 2007, pp. 87-88.
3
F. Hölderlin, Hypérion, Paris, Gallimard, (1797-1799), 1973, p. 118.
75
CROIRE.indd 75 22/02/13 11:30:20
albert piette - l'origine de la croyance
rapport aux attentes et aux intuitions ordinaires, puisqu’ils mêlent explicitement
des êtres et des qualités contradictoires et incompatibles : la vie et la mort, le
visible et l’invisible, la matière et la conscience. Pascal Boyer fait d’ailleurs de
cette transgression des intuitions ordinaires le trait essentiel de la proposition
religieuse et même de leur propre succès, car ce décalage créerait la visibilité et
l’expressivité du message1. D’une certaine façon, de tels énoncés utilisent des
sentiments, des qualités (des désirs, des promesses, des intentions), des êtres (les
êtres vivants et les êtres non vivants…) extraits d’activités ou de situations séparées
dans la vie quotidienne, en les connectant les uns avec les autres (la pierre à qui
on fait des promesses…).
Dans le rapport de crédulité que suscite l’énoncé religieux, sans préoccupations
de la contradiction dont celui-ci fait preuve2 , trois dimensions sont repérables 3 :
– une capacité de simuler mentalement une autre réalité déconnectée des
situations ordinaires de la vie, un autre monde possible tel qu’il serait si cette
proposition du mort vivant était vraie.
– une possibilité de penser même ponctuellement que c’est vraiment ainsi,
que « cela » existe, de jeter un assentiment à tel ou tel élément de ce nouveau
monde simulé mentalement et évocateur de diverses représentations personnelles
répondant à un désir.
– une acceptation de ne pas bien comprendre ce qui est sous-entendu, évoqué
par le contenu de cette proposition et de l’ensemble du monde auquel elle renvoie,
de ne pas trop y réfléchir, de suspendre son sens critique et donc de rester dans
une sorte de flou cognitif.
Dans son débat avec Dan Sperber et Pascal Boyer, Maurice Bloch insiste, lui,
sur la familiarité des énoncés religieux, comparables ainsi à d’autres énoncés,
car ils sont maintes fois entendus dans diverses situations et deviennent habi-
tuels pour les gens : « Thus a representation, which a particular person might
understand as counter-intuitive when they first come across it, out of the blue,
so to speak, clearly does not have the same cognitive significance as it does when
it has become totally familiar »4. Bien sûr, la confrontation à la contre-intuiti-
1
P. Boyer, Et l’ homme créa les dieux, Paris, Laffont, 2001. Cf. aussi sur ce point, D.C. Dennett,
Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon, New York, Penguin Books, 2006,
pp. 200-246.
2
Cf. aussi S. Atran, op. cit., ch. 3 et 4, dont l’ensemble de l’analyse privilégie cependant les
dimensions d’engagement et de conviction.
3
D. Sperber, Le Savoir des anthropologues, op. cit. et La Contagion des idées, Paris, Odile Jacob,
1996. Je précise que l’intérêt des travaux de psychologie évolutionnaire me semble encore plus
fort et pertinent lorsqu’ils sont insérés dans un cadre chronologique appuyé par des indices
préhistoriques et archéologiques.
4
M. Bloch, “Are Religious Beliefs Counter-intuitive ?”, in N.K. Frankeberry (ed), Radical
Interpretation in Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 2002., p. 140.Dans
cette perspective, Maurice Bloch n’associe d’ailleurs pas la “religion” à une aptitude cognitive
propre. Elle participerait, selon lui, du processus imaginatif (the capacity for imagination), celui
aussi par lequel les hommes, contrairement aux chimpanzés rivés aux strictes interactions,
“transcendentalisent” la société en la faisant exister à part des individus, ou “essentialisent” des
rôles, en faisant apparaîre le porteur avec “quelque chose en plus” indépendamment de la seule
76
CROIRE.indd 76 22/02/13 11:30:21
le mode mineur : impact et destinée
vité et la suspension de cette confrontation ne se refont pas à chaque fois, mais
le « croyant » sait que son assentiment religieux et surtout ses moments spécifi-
ques de croyance, ses actes de croire, que j’ai tenté de décrire, ne ressemblent pas
à la façon naturelle de se rapporter aux autres choses du monde. Il sait son assen-
timent restreint avec des degrés différents. Il sent poindre la contre-intuitivité et
il ne veut pas. Il se ressent comme lâchant, ne pouvant se confronter à la contre-
intuitivité de ce à quoi il donne son assentiment, de ce qu’il est prêt à accepter,
qu’il ne veut pas pousser plus loin, qu’il suspend. C’est bien la suspension du
« bizarre » et surtout l’acceptation de cette suspension, du flou qui furent struc-
turantes pour l’attitude naturelle des hommes et le mode mineur de vivre.
Je prends acte d’autres recherches de psychologie cognitive, par exemple
celles de Justin Barrett, indiquant que les hommes disposent d’un équipement
mental conférant une capacité naturelle et intuitive à associer des objets ou des
événements divers à des agencies1. C’est dans un même ordre d’idées que Jesse
Bering insiste sur une impossibilité naturelle des hommes à imaginer au moins
implicitement le mort sans quelque forme de conscience2 .Mais cette tendance
cognitive n’implique pas nécessairement de poser explicitement l’ « existence »
du référent résultant de cette « association ». De telles analyses ne me semblent
pas incompatibles avec mon propos, elles me semblent au contraire renforcer
l’hypothèse du besoin, de la tentation « favorable », et donc de la pertinence
d’une nouvelle capacité, celle d’atténuer la représentation de la dimension contre-
intuitive des énoncés qui, posant explicitement l’existence des entités contre-
intuitives, auraient suscité la croyance à l’existence de celles-ci.
Ce n’est pas la même chose 1) de faire pragmatiquement et implicitement,
dans le cours d’une situation, comme si le mort avait une intention, 2) de lui
attribuer explicitement une action, un esprit, mais sur le mode du comme si, 3)
de croire selon des degrés différents qu’il a vraiment des possibilités d’action et
d’intention et 4) de penser qu’il existe dans un autre monde. Il apparaît bien
que les anthropologues doivent mieux apprendre à connaître – et Maurice
Bloch est, me semble-t-il, d’accord sur ce point – les attitudes mentales, en
l’occurrence les modalités d’adhésion, pour mieux les comparer. En particulier
pour ce qui concerne le croire, nous l’avons vu, le relâchement, la réserve, le
flou et l’acceptation du flous ont importants. Ils s’apprennent à travers la façon
dont les parents répondent aux questions de leurs enfants, sur Dieu, la mort,
etc. Et avec des variations, des degrés dans le flou, des métasignaux de gravité
apparence et du seul contact avec les autres. Cf. M. Bloch, “Why Religion is Nothing Special
but is Central”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363, 2008, pp. 2055-2061.
Dans Anthropologie existentiale (pp. 41-79, chapitre « Généalogie de la minimalité »), j’ai tenté
de distinguer en différentes aptitudes cognitives et étapes préhistoriques le faire semblant, le
symbole, la création du collectif, l’énoncé hybride et l’acte de croire en l’existence de choses
incroyables.
1
Cf. J.L. Barrett, op. cit.
2
J. M. Bering, « Intuitive Conceptions of the Dead Agents’ Minds : the Natural Foundations
of Afterlife Beliefs as Phenomenological Boundary », Journal of Cognition and Culture, 2(4),
2002, pp. 263-308.
77
CROIRE.indd 77 22/02/13 11:30:21
albert piette - l'origine de la croyance
différents si l’interrogation porte sur le Père Noël ou la résurrection des morts1.
Le relâchement comme nouvelle aptitude cognitive est, en dehors des actes de
croire, une pratique évidente et allant de soi. Dans l’acte de croire, elle reste
étonnement observable, auto-observable, comme constituant un laboratoire
spécifique des instantanés de croyance-décroyance.
L’être humain a donc créé la tolérance au flou cognitif généré par des
représentations qui ne correspondent pas à une réalité factuelle mais
qui proposent un autre monde possible. Cette association de qualités et
d’inférences contradictoires ne constitue évidemment pas le symptôme d’un
dysfonctionnement du raisonnement ou d’une déficience cérébrale, mais
l’indice de cette nouvelle aptitude cognitive de tolérance au flou, surgie donc
après que le mode de connaissance sensible ou logique ait fait ses preuves
dans la recherche d’informations vraies. Le moment de croyance suppose non
seulement un monde à part sous-entendu par les énoncés auxquels il renvoie et
qui sont l’objet de l’assentiment humain mais surtout une aptitude spécifique
de s’y rapporter et de le solliciter mentalement selon des degrés d’assentiment
très variables, d’y croire sans véritablement y croire, d’y croire et de ne plus y
croire, sans conséquences, après fermeture de la parenthèse mentale autour de la
proposition en question.
Cette tolérance au flou cognitif que suppose le croire se serait alors étendue
dans d’autres activités de la vie quotidienne où diverses formes de prises de
distance existent, telles que nous les rencontrons à presque tous les instants
de la vie. L’injection d’un mode mineur devient en même temps d’autant plus
possible et nécessaire il y dix ou quinze millénaires. Possible car la structuration
de la vie sociale est de plus en plus organisée par le marquage matériel des rôles
sociaux impliquant leur meilleure stabilité et aussi par la vie sédentaire entourée
de champs et de troupeaux. Et d’autant plus nécessaire que cette nouvelle
sédentarisation, entraînant une vie sociale plus intense, donc potentiellement
plus conflictuelle, a besoin de s’équilibrer sur fond de normes et de règles stables,
de plus en plus sollicitées et rendues de plus en plus visibles par leur inscription
sur des supports divers. Ce sont les appuis solidifiés du monde quotidien, sur
lesquels se pose désormais le mode d’être des hommes sachant le coût des efforts
à accomplir s’ils veulent modifier le cours des choses.
Tel est le développement progressif du mode mineur par lequel l’être humain
accepte la présence d’êtres et d’informations extérieures et contradictoires, mais
non perturbatrices à l’activité en cours, le déplacement constant d’enjeux de
sens, sans requérir une solution, un accord, une clôture, ainsi que l’établissement
de parenthèses, parfois très serrées, autour d’une situation ou d’un événement
au-delà desquels les comportements et les pensées semblent sans conséquences,
comme oubliés. Aussi chez Homo sapiens, avant la naissance de l’acte de croire
et de sa rencontre sereine avec le flou et le relâchement, il y eut un temps où
ces situations d’interférences et de confrontations à la contradiction, surtout
1
P.L. Harris, « Les dieux, les ancêtres et les enfants », Terrain, n° 40, mars 2003.
78
CROIRE.indd 78 22/02/13 11:30:21
le mode mineur : impact et destinée
quand elles ont commencé à se multiplier au quotidien, n’étaient pas si faciles
à vivre. Sans aucun doute, l’acceptation relâchée du flou ne peut pas être sans
effets positifs et bénéfiques, à court et à long terme. N’aide-t-il pas par exemple
à accepter l’échec d’une simple opération technique, un mauvais coup de pierre
sur un autre1, échec que la conscience réflexive, celle de soi et du temps, rendait
sans doute plus difficile à supporter ? Le mode de conscience qui voile, qui ne fait
pas voir en face, qui atténue l’acuité de la présence et de la situation me semble
moins spécifique par l’accomplissement automatique d’actions habituelles
sans y penser, que par la sous-utilisation de la capacité d’ordre supérieur de la
pensée associée à la conscience de soi et du monde. C’est une sorte de mise en
régime potentielle, disons de potentialisation de cette lucidité, dont les instants
d’actualisation sont souvent douloureux, que les caractéristiques cognitives de
l’acte de croire aurait permis aux hommes de développer. C’est ce relâchement
cognitif que les Néandertaliens n’auraient pas pratiqué.
Même si une lecture trop dichotomisante est toujours quelque peu risquée,
disons qu’il y aurait eu un avant et un après l’acte de croire, posé comme élément
décisif dans l’évolution, la spécificité et la créativité d’Homo sapiens. « En un
sens, selon David et Ann Premack, les humains acceptent les informations
invérifiables à leurs risques et périls, car une fois qu’un individu a accepté une telle
information, il ne sera vraisemblablement plus jamais le même. Non seulement
il s’entêtera à soutenir sa conviction, rejetant toute tentative de la changer,
mais il tentera certainement de persuader les autres d’y adhérer, substituant le
consensus social à la vérification perceptive »2 . Oui, l’homme n’a plus été le
même et cela est arrivé. Quand David et Ann Premack lisent ce changement
en termes de tension et de rapports sociaux, j’y vois surtout un apprentissage à
la non-vérification, à la suspension, au report, à une forme de relâchement qui
facilitera aussi l’acceptation de ce qui lui est imposé. Ainsi l’humain ne sera
plus le même. Nous sommes dans l’ère ‒ à peine commencée ‒ de cet Homo-là.
C’est une erreur des considérations sociopolitiques et morales de négliger cette
nouvelle caractéristique d’il y a quelques dix milliers d’années.
Les théories du vivant ont souvent été pensées entermes d’adaptabilité et
de malléabilité. Analysant la vie à différents niveaux de sa constitution et de
son évolution, Dominique Lambert et René Rezsöhazy proposent une théorie
convaincante centrée sur le concept de « plasticité » qu’ils confrontent aussi
bien à la dynamique du gène, de la cellule que celle des neurones. Ils définissent
la plasticité « comme cette propriété des systèmes susceptibles de se déformer
de manière cohérente et autonome pour répondre à des sollicitations internes
ou externes. La plasticité caractérise une tension dynamique entre robustesse et
vulnérabilité, entre rigidité et malléabilité. […]. »3 Flexible et malléable, le vivant
répond à des sollicitations internes et externes, ajoute, remplace, se déforme, en
1
Dont parle Peter Sloterdijk, La Domestication de l’ être, op. cit., pp. 50-53.
2
D. et A. Premack, Le Bébé, le singe et l’ homme, Paris, Odile Jacob, 2003, p.159.
3
D. Lambert et R. Rezsöhazy, Comment les pattes viennent au serpent. Essai sur l’ étonnante
plasticité du vivant, Paris, Flammarion, 2004, p. 319.
79
CROIRE.indd 79 22/02/13 11:30:21
albert piette - l'origine de la croyance
gardant la cohérence et l’unité du système. Trop chaotique, il ne conserverait pas
celles-ci. Trop robuste, il ne pourrait s’adapter.
Aux diverses échelles de la vie, le système utilise le « bruit » ou l’aléatoire
« comme moteur de variabilité qui confère des capacités adaptatives »1. Cette
dynamique oscillatoire entre cohérence et déformabilité ne génère pas toujours
le meilleur optimum possible dans les diverses formes de vie. « Cela n’est pas
gênant, nous disent Lambert et Rezsöhazy, puisque la vie se contente souvent d’un
minimum »2 . Et ceci n’est pas sans renvoyer à des considérations éthiques, plus
particulièrement selon les deux auteurs, à un éloge de la nécessaire vulnérabilité
dans la logique du vivant et donc de la fragilité, sans trop de maîtrise. Ce
qui peut aussi se traduire par le bon dosage de mineur et de majeur : trop de
mineur et c’est la passivité, trop de majeur, c’est l’affairement qui fait oublier
l’arbitrarité des choses politiques et la relativité de la vie humaine. C’est alors
manquer de lucidité mais l’excès de lucidité génère au moins la passivité, au plus
la mort. Comme la déformabilité avec la robustesse, il n’y a pas de mineur sans
majeur. Selon Lambert et Rezsöhazy, la plasticité constitue une double liberté,
non seulement vis-à-vis de la matière mais aussi par rapport à la forme elle-
même, capable de préserver sa cohérence mais aussi de « briser le cercle étroit de
l’identité à soi »3. Il est fait explicitement mention d’une « puissance de la forme
à prendre distance de la forme par rapport à soi ». Et si précisément ce mode
mineur proprement humain dans l’histoire du vivant constituait une troisième
liberté comme distance non seulement par rapport à toute détermination mais
aussi par rapport à la distance elle-même et à la liberté elle-même ? En injectant
des modalités mineures d’être en situation, la forme humaine exhibe donc sa
propre dynamique, celle qui lui serait spécifique, entre robustesse et flexibilité.
La présence de l’homme en situation en serait l’expression, à l’échelle de la vie
psychosociologique, à travers la fluctuation oscillatoire entre majeur et mineur,
travail et repos, activité et passivité.
Il est ainsi possible de penser aux conséquences progressives que ces nouveaux
traits auraient générées sur le fonctionnement neuronal ainsi que sur les modes
d’attention et de perception. Par exemple en augmentant la labilité et la fluidité
de ceux-ci, mais surtout simplement en n’étant pas en porte-à-faux avec eux.
L’injection du mineur n’est-il pas en adéquation avec les limites de tout potentiel
attentionnel ? Si c’est le cas, seraient d’autant plus probables les fatigues cognitives
des autres Homo, en particulier ceux caractérisés par un certain développement
cérébral, comme les Néandertaliens sans ou avec peu de mode mineur.
L’assentiment accepté à des choses contradictoires a comme libéré ce mode mineur
et permis des avantages adaptatifs forts pour les humains, dans leur dépense
d’énergie et leur potentialité créatrice. Le mode mineur, comme déformation qui
n’altère pas la cohérence humaine et qui n’injecte pas de l’incohérence, constitue
une adaptation évolutionnaire qui fait développer, face au risque de la conscience,
1
Ibidem, p. 107.
2
Ibidem, p. 312.
3
Ibidem, p. 324.
80
CROIRE.indd 80 22/02/13 11:30:22
le mode mineur : impact et destinée
l’hypolucidité surgie du confort de l’assentiment relâché à des énoncés religieux
intrinsèquement contradictoires. Les Néandertaliens étaient dans un état certes
non maximal d’adaptabilité, mais sans doute vivable (et ce depuis un long temps).
Les choses ont-elles lentement changé lorsque les Homo sapiens ont commencé
à pratiquer un langage de plus en plus articulé et syntaxique, duquel ont surgi
un jour des énoncés contradictoires et puis leur acceptation ? Le relâchement
qui en a suivi était sans doute utile face au risque (et à la tension corollaire) des
performances du langage comme représentation de la réalité avec des unités
désormais arbitraires, et des erreurs ou des incompréhensions potentiellement
de plus en plus nombreuses qu’il suscite. La nouvelle présence de ces Homo
sapiens aurait-elle alors rendu difficile, encore plus difficile, la vie « tendue » de
Néandertaliens proches géographiquement ? Ceux-ci ont-ils été incapables de
faire émerger une adaptation efficace (par exemple face à un imprévu écologique
ou météorologique) par manque de ce relâchement sous forme de mode mineur,
désormais pratiqué par les sapiens1 ? Depuis 10 ou 20 000 ans, le nouveau rythme
d’innovations culturelles et politiques des Homo sapiens est d’ailleurs bien
postérieur à la présence de l’indice d’une spécificité sapiens, remontant à150 000
ou 200 000 ans. Et si ce relâchement avait joué un rôle dans ce qui est advenu à
l’espèce humaine depuis seulement quelques millénaires.
Un à quatre % de notre génome proviendrait des Néandertaliens,
apprend-on de l’analyse comparée d’une équipe de chercheurs de l’Institut Max-
Planck de Leipzig dirigée par Svante Pääbo2: c’est une découverte forte. Entre
espèces distinctes, l’hybridité est certes parfois féconde. Mais surtout comme
des taux de croisement faibles suffisent à laisser des traces dans un ADN, une
proximité, forte ou longue, de vie de l’Homme de Neandertal et d’Homo sapiens
est loin d’être attestée par cette information. Le mode mineur est constitué d’un
ensemble de traits comportementaux, dont certains sont sans doute imitables par
d’autres espèces, comme le montre Marion Vicart à propos du chien domestique
capable, en contact proche avec les hommes, d’une expression de tranquillité
caractéristique3. C’est sans doute différent pour certains traits cognitifs du mode
mineur. Les interactions entre les Néandertaliens et les sapiens n’étaient-elles
effectivement qu’éphémères et pas si nombreuses, comme c’est probable compte
tenu de la démographie faible des deux populations4 ? Les effets existentiaux des
actes de croire chez Homo sapiens (ou les actes de croire eux-mêmes) ne sont-ils
vraiment développés et multipliés qu’après ces rencontres qui auraient eu lieu
au Proche-Orient il y a 80 000 ans au moins ? Mais surtout, indépendamment
même de l’usage d’énoncés religieux, la tolérance détendue à la contradiction
1
Le lecteur peut trouver une revue critique des diverses hypothèses sur la disparition des
Néandertaliens dans le livre de B. Maureille, Qu’est-il arrivé à l’ homme de Neandertal ?, Paris,
Le Pommier, 2008.
2
R. E. Green et al., « A Draft Sequence of the Neandertal Genome », Science, Vol. 328, 2010,
pp. 710-722.
3
M. Vicart, Des Chiens auprès des hommes, Paris, Pétra, 2012. Cf. aussi A. Piette, Propositions
anthropologiques, op. cit., pp. 78-95.
4
Cf. par exemple, M. Patou-Mathis, op. cit, p. 230 et l’ensemble du chapitre 15 « La
rencontre ! ».
81
CROIRE.indd 81 22/02/13 11:30:22
albert piette - l'origine de la croyance
et la fluidité cognitive auraient-elles pu être imitées par les Néandertaliens dans
certaines de leurs activités ? Une technique d’outillage est sans doute plus facile à
imiter que les interférences sémantiques ou cognitives et aussi que l’hypolucidité.
Ceci s’inscrit bien sur fond des différences de modes de cognition, existant déjà,
entre les deux Homo, comme nous l’avons vu. Entre l’ADN de Neandertal et celui
de sapiens, des variations concerneraient en effet des gènes du développement
mental. Quoi qu’il en soit, le mode mineur constitue, après la conscience réflexive
et le langage, un grain de sable supplémentaire qui permet une manière d’être au
monde, une manière inédite d’exister, qui aura toutes les conséquences créatrices
que l’on sait.
L’hypothèse si courante de l’être dérégulé par défaut des mécanismes
instinctifs et du développement suffisant des capacités cérébrales dans l’histoire
de la vie reste tentante. Mais pour quel être cela vaut-il ? Le déséquilibre n’est
sans doute qu’embryonnaire chez les chimpanzés et autres grands singes, étant
donné leur relative stabilité évolutionnaire. Les moments de violence, face à
l’agression ou à la mort, semblent régulés par des gestes simulateurs instinctifs
plutôt que par des idées, des représentations ou des métareprésentations activant
des processus cérébraux complexes. L’état « dérégulé » vaudrait sans doute
plus pour les êtres du genre Homo qui se sont développés et qui ont disparu.
D’ailleurs, parmi ceux-ci, seul Homo sapiens reste présent sur la terre, mais dans
le fond depuis peu. Et parmi les hommes disparus, les Néandertaliens offrent les
données les moins incomplètes pour situer cet état de déséquilibre. Nous savons
au moins ses faiblesses physiologiques, en particulier pour l’activité de chasse,
et ses traumatismes corporels mais aussi le développement de ses capacités de
symboliser semble limité (mais existant). L’Homme de Neandertal aurait peut-
être été le seul être à avoir su qu’il allait mourir et qui n’ait pas trouvé quelque
réponse à cette prise de conscience, quelque relâchement à la conscience réflexive.
Et si effectivement il avait été le seul être à savoir sa mort imminente, non
seulement sans contenu de croyance et, plus difficile encore, sans pratique de la
fluidité cognitive et du relâchement mental ! Puisque celui-ci serait, comme je l’ai
indiqué, une capacité cognitive récente apprise et sélectionnée à partir de l’acte
de croire à des idées incroyables. Le Néandertalien : le seul donc à avoir vécu, en
sachant sa mort inéluctable, dans un monde a-thée, je veux dire sans présence
d’êtres surnaturels. À l’équilibre simien maintenu par défaut de développement
du potentiel intellectuel et en particulier des formes de conscience réflexive,
ou en tout cas à l’embryon de déséquilibre par l’affaiblissement des régulations
instinctives et les nouvelles possibilités cérébrales, contrasterait le déséquilibre
accentué de l’Homme de Neandertal avec des capacités cognitives trop ou
pas assez développées. Trop : par l’affaiblissement prolongé de ces régulations
instinctives et surtout le développement de la conscience réflexive ; pas assez : car
elles ne parviennent pas à la création d’énoncés incroyables et à l’acte de croire,
d’y croire. Neandertal : le premier penseur ; sapiens : le premier croyant !
C’est dans cette perspective évolutionnaire que l’Homme moderne manifeste
82
CROIRE.indd 82 22/02/13 11:30:22
le mode mineur : impact et destinée
donc la double capacité à la fixation et à la fluidité, le symbole et la croyance.
Homo sapiens a-t-il créé un nouvel équilibre compensant un déficit instinctif
par ses performances cérébrales ? N’est-il qu’une étape dans l’histoire de la vie ?
Observé de près, l’Homme moderne semble avoir la capacité de mélanger travail
et repos, engagement et relâchement, savoir et oubli avec une certaine efficacité
lui permettant de pondérer, de nuancer, d’adoucir l’un par l’autre. Telle est la
possibilité de la compétence spécifiquement humaine au mode mineur, toujours
adossé au majeur. Faut-il alors conclure à l’équilibre réussi d’Homo sapiens ?
Certainement pas, comme l’atteste la multitude de carnages interhumains depuis
au moins 20 000 ans et dont la chronologie semble parallèle à l’émergence du
symbole et de la croyance1. Le Néandertalien était-il ainsi en difficulté devant
le surgissement de contradictions diverses dans une situation ? Mais avait-il sa
lucidité et sa peur de la mort, et aussi sa raideur pour ne pas être efficace à la
préparation organisée de la guerre ? C’est possible. Peut-être n’allaient-ils pas plus
loin que dans les attaques et les violences ponctualisées, liées à des circonstances
situationnelles ?
La minimalité des sapiens, qui amortit et désamorce, est parfois proche de
la surdocilité, et autant de l’oubli qui fait se déployer l’affairement maximal ou
presque. Car l’énoncé religieux, en même temps qu’il génère un nouveau mode
mineur de vie humaine, suscite en lui-même une forme de réconfort qui l’incite
et le confronte sans doute assez vite au besoin de sa stabilité, de sa fixation et de sa
transmission. Survient en effet le risque de fixer, donc d’absolutiser, de sursignifier,
d’oublier que ce n’était qu’une croyance à un énoncé invraisemblable… puisque
l’homme vient d’apprendre à suspendre, à reporter, donc à oublier. La porte est
ainsi ouverte aux agirs (trop) passionnés. Le relâchement cognitif qu’a généré
l’acte de croire se retourne contre lui, puisqu’il peut contribuer à sursignifier
et aussi à accepter dans l’hypolucidité. Et ainsi la croyance comme acte de
simplement croire permet le glissement de la croyance en certitude, donc l’oubli
de son origine. La présentation d’un énoncé à d’autres comme une certitude,
son absolutisation et son acceptation comme tel supposent bien d’oublier et de
ne pas penser qu’il s’agit là d’un énoncé arbitraire parmi d’autres. La croyance
comme aptitude cognitive d’introduire une réserve permet la construction et la
réception de propositions sur fond d’oubli que ce ne sont que des croyances. Et
le risque de la transformation du relâchement en affairement ou en surdocilité,
dans le fond deux formes d’oubli, vaut également pour les autres activités de
l’existence !
Le mode mineur, absent ou seulement à très petites doses chez les autres êtres
vivants2 , est au centre de cet avènement de l’être humain, non seulement parce
qu’il est fluidité, distraction et relâchement mais aussi parce que cette capacité de
minoration permet à l’homme de continuer à vivre dans la souffrance endurée
ou dans la violence exercée, à accepter et à faire accepter. L’échec de toutes les
1
Cf. J. Guilaine et J. Zammit, Le Sentier de la guerre, Paris, Seuil, 2000.
2
Cf. à ce sujet Anthropologie existentiale et mes Propositions anthropologiques qui esquissent
diverses comparaisons de cette minimalité.
83
CROIRE.indd 83 22/02/13 11:30:23
albert piette - l'origine de la croyance
combinaisons politiques et morales, ainsi que de leurs tentatives d’applications
concrètes, trouve peut-être une explication dans la mécompréhension théorique
et pratique de ce mode mineur comme spécificité humaine. Comment
l’homme pourrait-il, devrait-il faire mieux dans l’exercice de la minimalité ?
Que manquerait-t-il à l’Homme moderne, celui qui est représentant non de la
modernité sociologique mais de la modernité anthropologique qui dure seulement
depuis quelques dizaines de millénaires ? Un grain d’intelligence supplémentaire
dont il a le potentiel mais qui ne serait pas encore suffisamment performé, pour
toujours pallier à cet affaiblissement déjà ancien de la régulation instinctive ? Et
pour mieux cultiver ce mode mineur ? Pourquoi pas ? La transmission peut-elle
passer autrement que par l’absolutisation et la conviction ? Comment fixer sans
fixer ? Ces questions sont sans doute à poser pour toute situation de la vie, et
d’abord pour les journées des hommes. Mais ce n’est pas simple !
Je regrette l’insensibilisation des hommes à la question anthropologique,
celle des origines et de la spécificité humaine, qui contraste avec le goût des
débats sociologiques sur les rapports sociaux ou ethnologiques sur la diversité des
cultures. Il convient ainsi de se rappeler que le moment originel de la croyance
est un moment de doute. Le doute puis l’acceptation de l’incertitude. Et aussi le
risque de ne pas trop y penser, de trop accepter. « Notre capacité à nous aveugler
nous-mêmes face à l’évidence de la souffrance et de l’atroce est, selon Jean-Pierre
Dupuy, l’obstacle principal que le prophète de malheur doit sinon franchir du
moins contourner. […]. Il serait bon que l’humanité, avant d’entreprendre quoi
que ce soit lorsque, dans la panique, elle découvrira l’étendue du désastre, se donne
les moyens de marquer une pause et de contempler le prodige qu’elle est en train
de vivre : elle accède à la conscience de soi au moment même où sa survie est en
question. Ce qui est déjà presque une tâche impossible pour un sujet individuel
a-t-il la moindre chance de réussir dans le cas d’une collectivité de plusieurs
milliards d’individus ? Seul un miracle pourrait le permettre, à condition surtout
que nous ne l’espérions pas. »1 Mais alors que faire ? Situationnellement donc.
Que serait la perspective, je dirais, « hoministe » ? Par exemple : mêler, pour les
uns et les autres, la « douceur » de la croyance, sa réserve négative, sa part de
retrait et de restriction, à l’exigence de ne pas oublier l’arbitrarité du symbole à ne
pas « vraiment » considérer comme absolu. Apprendre à ne pas faire dériver la
croyance et son relâchement intrinsèque en une attitude de mise en suspension
trop passive et d’acceptation trop facile de ce qui arrive. Ne pas oublier que nous
sommes des descendants pas si éloignés des premiers êtres qui ont symbolisé et
qui ont cru, en goûtant des avantages de la fixation et de la fluidité. Se rappeler
la spécificité de l’espèce humaine. Penser une pédagogie du mode mineur, de la
bonne dose de retrait dans ses diverses expressions situées : elle est nécessaire
puisque c’est lui aussi qui permet à l’homme de continuer à vivre en souffrant ou
après avoir fait souffrir. Ne pas être un trop actif, affairé et engagé non lucide,
mais ne pas être un lucide trop passif : le bon mineur, le bon flou passe donc
1
J.-P. Dupuy, Petite métaphysique des tsunamis, Paris, Seuil, 2005, p. 12 et p. 107.
84
CROIRE.indd 84 22/02/13 11:30:23
le mode mineur : impact et destinée
presque paradoxalement par une bonne lucidité, une meilleure lucidité, celle de
l’arbitraire et aussi de la mort. Un risque ? Sans doute, mais de toutes les façons
il y a risque ! Les bonnes doses pour la meilleure proportion de majeur-mineur
selon les situations, pour soi et pour les autres. Penser et travailler donc pour
que la capacité de minoration, si spécifiquement avantageuse à Homo sapiens, ne
devienne pas un obstacle, une compétence défavorable à la survie des humains,
mais soit comprise comme une (nouvelle) chance !
L’anthropologue ne peut se détourner de la passionnante interrogation : cet
Homme moderne qui n’existe que depuis 150 000 ans ou 200 000 ans, comment
va-t-il doucement évoluer ? À propos de René Char, Paul Veyne écrivait : « René,
qui s’était vivement intéressé à la préhistoire, était conscient de la plasticité de
l’être humain à l’échelle des millénaires ; il voyait plus large que les pauvres
quarante siècles d’histoire dont le détail est venu jusqu’à nous »1. L’être humain
est profondément « quotidien », trop, selon René Char pour qui il fait fausse
route à rester en deça… : « la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil »2 ,
selon son expression célèbre devenue une citation presque courante. L’injection
pédagogique de cette dose de savoir et de lucidité dans la présence est sans doute
essentielle pour éviter le déséquilibre de la passivité ou de l’activité3. La bonne
dose à proportionner pour éviter aussi l’hypersensibilité. L’avenir millénaire de
l’homme est peut-être l’enjeu de cette question.
La nouvelle reposité des hommes a permis de multiplier les enjeux des sens
et de pertinence. On peut penser que l’invention de l’écriture fut une étape clé
d’une part dans le processus de stockage des informations, de stabilisation des
règles, avec multiplication de facilités perceptives et cognitives, mais aussi d’autre
part dans l’intensification des enjeux de sens et de critique sans fin. Dans cette
perspective, la réflexion de Merlin Donald est intéressante : « L’innovation
critique est l’habitude très simple d’enregistrer les idées spéculatives, c’est-à-
dire d’extérioriser le processus de commentaires oraux sur les événements.
Sans aucun doute, les Grecs avaient de brillants ancêtres en Mésopotamie, en
Chine et en Égypte, mais aucune de ces civilisations n’a développé l’habitude
d’enregistrer les verbalisations et les spéculations, les discours oraux révélant le
processus lui-même en action. La grande découverte est que des idées, même
incomplètes, enregistrées dans les documents publics, peuvent plus tard être
améliorées et raffinées. Pour la première fois, la littérature écrite contenait de
longs traités de spéculation, souvent très approximative, sur un grand nombre de
questions fondamentales. L’existence seule de ces ouvrages signifie que les idées
étaient stockées et transmises sous une forme plus sûre et plus permanente que
dans la tradition orale. Des idées sur tous les sujets, de la justice et la morale à la
structure de l’univers, étaient écrites, consultées par des générations d’étudiants,
1
P. Veyne, René Char en ses poèmes, p. 477.
2
R. Char, Feuillets d’Hypnos, Paris, Gallimard, (1943-1944), 2007, p. 52.
3
Sur l’importance de la lucidité et de la réflexion sur la vie humaine, cf. M. Canto-Sperber, Essai
sur la vie humaine, Paris, PUF, 2008.
85
CROIRE.indd 85 22/02/13 11:30:23
albert piette - l'origine de la croyance
débattues, raffinées et modifiées »1. Et tel sera le rôle pédagogique de la
rhétorique écrite ou orale et des techniques d’argumentation : « La logique de
l’argumentation a aussi commencé à émerger en tant qu’habileté qui s’apprend.
En effet, les premiers développements de la rhétorique reflètent le raffinement
et la formalisation des stratégies de pensée et des critères d’évaluation et de
réalisation d’une argumentation efficace »2 .
Le mode d’être humain est-il suffisamment façonné, depuis un certain
nombre de millénaires, dans le relâchement et l’hypolucidité pour maintenir,
malgré la capacité de reposité, l’équilibre face au sursens et à la tension du débat
critique permanent, amplifié ? L’homme est-il prêt à créer un nouvel équilibre à
partir de la tension des textes, des informations, des pensées disponibles, toujours
discutables et discutées indéfiniment. Cette situation est dans le fond récente3.
Qui est Oblomov, personnage central d’un roman de Gontcharov4 ? Il est un
propriétaire terrien de la Russie du xixe siècle, qui n’aime pas « travailler ». Il
préfère rester étendu, en robe de chambre. Il est du genre timide, sans curiosité,
centré sur lui-même, sans rien voir autour de lui, caressant ses mains… À peine
commence-t-il une activité qu’il l’arrête. A-t-il l’intention de se lever, il reporte
aussitôt son mouvement, il se soulève légèrement vers ses pantoufles puis s’étend.
Oblomov sait aussi qu’il doit prendre des décisions, en particulier pour son
domaine qu’il est censé gérer. Il est ainsi tourmenté par la nécessité et le devoir
d’agir. Il ne supporte pas les soucis, se sent envahi par la sonnette, ne supporte
pas de bouger, d’« aller ailleurs ». Quand surgit un problème, il est perdu, il
demande conseil mais il refuse de changer son mode d’être. « Tu es une botte
de paille », lui dit son ami. Ou encore : « Tu es un homme perdu ». Oblomov
dit et redit qu’il ne supporte pas le changement et les imprévus. Il reproche à son
domestique que la maison n’est pas propre mais il n’accepte pas qu’il touche quoi
que ce soit. « Car Oblomov aurait bien voulu que tout devînt propre dans sa
maison, mais il aurait aussi souhaité que la chose se fît insensiblement, et comme
allant de soi » (p. 43). L’idée de déménager qui lui est proposée est bien sûr
insupportable. Il ne tolère pas l’agitation, il se réjouit de n’avoir pas envie, de ne
pas désirer rencontrer, de ne pas avoir à faire.
Oblomov n’est pas un paresseux. Il est d’abord un agité, un inquiet, un
nerveux, parfois un obsédé. Une sorte de Néandertalien gérant difficilement
les perturbations du quotidien ! Ainsi quand il veut un mouchoir, il le cherche,
mais surtout s’énerve de ne pas le trouver et réprimande son domestique (p. 39).
Il est tendu, excité par des pensées vives qui semblent parfois bouillonner dans
son esprit. Il s’énerve alors sans se calmer rapidement. Oblomov est aussi lucide
sur son mode de vie. Il est effrayé par une « minute claire » de lucidité. Plus
jeune, Oblomov avait d’ailleurs des projets, de l’ambition, des désirs. Un jour,
1
M. Donald, Les Origines de l’esprit moderne, Bruxelles, De Bœck Université, (1991), 1999,
p. 355.
2
Ibidem, p. 361.
3
Le lecteur peut trouver à ce sujet des notes complémentaires dans mes Propositions
anthropologiques.
4
I. Gontcharov, Oblomov, Paris, Gallimard, (1859), 2007.
86
CROIRE.indd 86 22/02/13 11:30:23
le mode mineur : impact et destinée
Oblomov rencontre Olga, une jeune dame ambitieuse. Il trouve désormais un
but, il chantonne, il s’illumine, il attend. Pour mieux converser avec Olga, il
passe des nuits blanches à lire et à fouiller. Mais aussi il s’inquiète, se demande
s’il la verra le jour même. Et très vite, il désillusionne, s’obsède du regard brûlant
d’Olga, préférerait la paix avec une femme tranquille à la passion épuisante.
Olga qui comprend l’être d’Oblomov l’assure de son amour et lui demande de
changer :« Tu dois te dominer. J’attends de toi que tu te domines. J’ai vu des
hommes heureux, j’ai vu la manière dont ils aiment ;tout bouillonne en eux,
et même leur repos ne ressemble pas au tien. Ils ne baissent jamais la tête, et
leurs yeux sont ouverts. Ils dorment peu, ils agissent beaucoup. » (p. 423). Alors
qu’Oblomov préférera finalement une sorte d’apaisement avec Agafia, une veuve,
bonne ménagère, Olga épouse Stolz, l’ami d’Oblomov, décrit comme expressif,
maître de lui, dont la posture n’est accompagnée d’aucun geste supplémentaire.
Olga et Stolz connaissent ainsi un bonheur sans somnolence : « Ils passaient
leurs jours sans que l’apathie ne s’emparât d’eux. Ils n’avaient ni regards flous,
ni paroles molles, leurs conversations étaient même souvent fort animées. Et
Oblomov s’enlise avec Agafia dans le repli et l’immobilité, fuyant les exigences
et les orages de l’amour, préférant être spectateur que gladiateur. « Il parvenait à
en être quitte à bon compte avec l’existence, à lui extorquer le repos dont il avait
tant besoin » (p. 525).
Oblomov serait donc allé trop loin dans la tranquillité et le repos, en
choisissant l’immobilité et en préférant déléguer la gestion de son domaine à
des individus qui vont le tromper :« Il s’allongeait, tranquille, dans le cercueil
spacieux du reste de ses jours, cercueil fabriqué de ses propres mains. Ainsi
faisaient les ermites des thébaïdes qui, se détournant de la vie, creusaient eux-
mêmes leur tombeaux » (p. 526). Oblomov, qui comprend son enlisement,
implore alors de l’aide, demande à ses amis de le sortir de « là », tant qu’il n’est
pas trop tard. Sentant qu’il n’a plus la volonté et la force, il se dit « une vieille
défroque flasque » (p. 248). Mais justement il est trop tard, Oblomov manque
de courage :« elle [la vie] me secoue, elle ne me laisse pas tranquille. Si seulement
je pouvais me coucher et m’endormir pour toujours » et son ami Stolz de lui
répondre :« Je vois. Tu voudrais éteindre les lumières et rester dans l’obscurité !
Beau programme ! Enfin, il fallait s’y attendre !Quand on commence par ne pas
savoir enfiler ses bas, on finit par ne plus savoir vivre » (pp. 460-461). Oblomov
se résume:« Dès les premiers instants où j’ai pris conscience de moi-même, j’ai
senti déjà que je m’éteignais. Je m’éteignais quand je rédigeais mes rapports
au bureau, je m’éteignais quand je trouvais dans les livres des vérités dont je
ne savais que faire. Je m’éteignais parmi mes camarades quand j’écoutais leurs
ragots, leurs bavardages méchants et plats… » (pp. 247). Gontcharov, l’auteur
d’Oblomov, qui a mis dix ans pour écrire son roman, est décrit à la fin du livre,
comme « gras, apathique, endormi » (p. 543), portant en lui son personnage.
Oblomov est le type même de l’homme qui sent, face à la dureté du
mouvement de la vie, le besoin de se replier dans un monde fermé, et de rejeter tout
87
CROIRE.indd 87 22/02/13 11:30:24
albert piette - l'origine de la croyance
changement. Ce qui le met dans la difficulté de lutter et de s’adapter. Vite tracassé
et agité, il cherche l’apaisement après l’excitation, sans être capable de mêler dans
la simultanéité activité et passivité. Et si la vie de certains Néandertaliens avait
ressemblé de quelque façon à celle d’Oblomov ? Car l’espèce néandertalienne a
quand même vécu quelques centaines de millénaires. Ils savaient la mort et peut-
être supportaient-ils difficilement l’échec de l’inquiétude et le tourment. Leur
immobilité traduirait leur refus du changement et du temps. Aussi un mode
de vie et de survie. Mais d’où leur incapacité de créer, alors que leur nouveau
contemporain, Homo sapiens, vient d’apprendre à croire, à se relâcher, à mêler le
repos à l’action, donc à créer.
Oblomov est fatigué d’être inquiet, d’être en alerte, d’avoir peur des angoisses,
de l’amour, des conflits. L’hypersensibilité fatigante d’Oblomov se résout dans
l’évitement. Sa vie est l’expression concrétisée et radicalement poussée de
ce que certains écrivains ou philosophes stigmatise chez tous les hommes : la
lâcheté, la somnolence, l’endormissement, ce qui inclut aussi l’action, l’agitation,
l’affairement, et même la révolution qui ne sont que des échappatoires pour des
êtres incapables de sentir, de ressentir, de pensées, de conscience, d’intelligence
vive, et préférant le cours de la vie à la torture de la lucidité.
De Pessoa, je retiens quelques vers :
« Je suis aujourd’hui vaincu, comme si je connaissais la
vérité ;
Lucide aujourd’hui, comme si j’étais sur le point de
mourir,
[…]
Toi qui consoles, qui n’existes pas et par là même
Consoles,
[…]
Je viens à la fenêtre et vois la rue avec une absolue
netteté.
Je vois les magasins et les trottoirs, et les voitures qui passent
Je vois les êtres vivants et vêtus qui se croisent,
Je vois les chiens qui existent eux aussi,
Et tout cela me pèse comme une sentence de
déportation,
Et tout cela est étranger, comme toute chose »1
Comme Cioran avec lequel j’ai commencé ce livre ou René Char cité il y a un
instant, Fernando Pessoa est un génie littéraire de l’intranquillité, de la lucidité
et de la sensibilité, de la conscience claire de la brutalité de l’existence2 . Oblomov
préfère lui l’immobilité du repli dans la non-action. Et si nous étions là en
présence de deux profils bien néandertaliens ? Ceux qui sont restés intranquilles,
ceux qui sont devenus immobiles.
1
F. Pessoa, Bureau de tabac et autres poèmes, Paris, Caractères, (1928), 2000, pp. 35-40.
2
J’ai fait du Livre de l’ intranquillité de Pessoa le fil conducteur de mon ouvrage L’Acte
d’exister.
88
CROIRE.indd 88 22/02/13 11:30:24
le mode mineur : impact et destinée
Les deux sont malheureux, dans l’incertitude face au mouvement et dans le
repli, l’excès du repli. Les deux ne veulent pas de ces affairés, qui rient, qui aiment,
qui rencontrent, qui s’animent, qui blessent, qui tuent, qui font, un peu comme
Homo sapiens. L’intranquille parce que leur agitation les empêche de sentir, de
penser, de savoir, les fait somnoler, oublier ; le passif comme Oblomov parce que
leur affairement et le mouvement qu’il entraîne constituent un trop lourd fardeau,
insupportable. Ainsi les Néandertaliens, eux qui savaient et qui ne pouvaient
passer outre, avaient le choix entre la vie tourmentée et la vie immobilisée.
Celle plutôt courageuse mais focalisée, tendue et raide et celle qui, plutôt que
de passer, s’arrête, inerte, incapable de changer, de supporter le changement et
de travailler, mais tout aussi raide. Ces deux hominidés pouvaient-ils survivre
face à d’autres humains moins lucides et plus actifs, tels les nouveaux Homo
sapiens ? Oblomov s’enlise dans son repos duquel il ne parvient plus à sortir et est
écrasé par ceux qui l’entourent, ses amis comme ses ennemis. Et l’intranquille,
lui, est écrasé par sa sensibilité, la lucidité, la conscience, la pensée. Et les autres,
eux, continuent toujours. L’action est une condition de survie, Oblomov nous
l’apprend à contrario. Et deux cent mille ans d’Homo sapiens le confirment. Mais
le repos est aussi une condition de survie. De fait les hommes vivent aussi dans
une certaine somnolence, une activité et même une hyperactivité somnolentes
car ils ne savent pas, ne veulent pas savoir, oublient, n’y pensent pas ou pensent
à d’autres choses. Et cela c’est la lucidité de l’écrivain qui nous le rappelle.
De la vie d’Oblomov, Homo sapiens retient le repos qu’il mêle à l’action. Des
instants de lucidité et des vies intranquilles, il retient, par envie de bien-être, qu’il
vaut mieux suspendre le savoir, l’acuité, la lucidité, la conscience claire. Il ajoute
une couche du non-savoir à d’autres formes de repos. Ainsi se fait un Homo
agissant avec des doses variables de repos et de relâchement. Mais il ne vit pas
pour autant, nous l’avons vu, dans l’équilibre de l’action et du repos, dans le bon
dosage de chacun. Faut-il qu’il oublie le « mauvais » côté d’Oblomov (ne rien
faire du tout) et le « mauvais » côté des « hypersensibles » (être trop lucide).
Certes. Mais cet équilibre à dosages variables est toujours fragile et confronté
au double risque principal de « ne pas savoir » : écraser et être écrasé. Car de
fait ces gens, sapiens, passent du temps à écraser et à s’écraser mutuellement
dans une surenchère d’agitation appelée violence. Une dose de lucidité
supplémentaire risquerait-elle de faire pencher la balance de l’autre côté ? Elle
serait incontestablement bienvenue… pour empêcher d’une part l’engagé actif
d’écraser au nom de ses propres croyances qu’il a oublié qu’il les a inventées et
d’autre part le dormeur soldat de le suivre par oubli que l’autre les a inventées.
À propos de la manière inconditionnelle et « fanatique » de se rapporter
à des idées, Gérald Bronner indique qu’il n’est pas impossible que des sociétés
humaines l’aient pratiquée, leurs individus toujours prêts à se battre pour quelque
différend. Pourrait-ce être le cas de certains Néandertaliens qui n’auraient pas
choisi le repli quasi total à la manière d’Oblomov ? À propos de possibles sociétés
fanatiques, G. Bronner précise qu’elles n’ont pas survécu « assez longtemps,
89
CROIRE.indd 89 22/02/13 11:30:24
albert piette - l'origine de la croyance
cependant pour que l’histoire ait retenu leur destin »1, tant la plasticité et la
flexibilité des hommes est nécessaire à la vie sociale. Mais en même temps, la
radicalité, ajoute-t-il, n’est pas une disposition sans avantage, en particulier dans
des phases guerrières, lorsque des individus se sacrifient pour des idées utiles à la
survie de leur groupe : « sinon, ils seraient toujours défaillants face au danger »2 .
Et justement ces Néandertaliens, pratiquaient-ils des violences ? Ponctuelles
certes mais sans doute pas le carnage organisé, la guerre organisée pour répondre
à un danger organisé, comme je l’ai indiqué.
L’évolution de la structure cognitive du cerveau n’est évidemment pas
terminée ! Il y a un double risque des supports extérieurs qui entourent la présence
humaine : de reposer trop la pensée et l’activité ou d’exciter trop la critique et
l’engagement. Le risque de l’humain surdétecteur, sursignifiant, vigilant et
attentif, qui ne voit plus le fond, qui ne sait pas qu’il impose une arbitrarité
contre une autre. Et le risque de celui qui, d’abord un peu distant, détaché,
dégagé, devient désengagé et défait. D’où le terrible enjeu de l’explicitation de la
bonne lucidité dans la transmission pédagogique, familiale et scolaire.
Ainsi le repos des appuis extérieurs (divinité, valeur, loi, norme, etc.)
génèrerait soit trop d’activisme, de critiques, de débats sur eux-mêmes, sans que
les hommes se rappellent leur arbitraire, soit trop de passivité par laquelle ils
se reposeraient. Le premier cas est celui des affairés, travailleurs et négociateurs
infatigables du social. Dans le second, style Oblomov, c’est l’acceptation de
tout et, sans doute très vite, l’inadaptation. Et les actifs d’écraser dans cette
configuration les passifs… et après de s’entretuer. À l’homme actif, des rappels
de lucidité seraient nécessaires pour modérer, minorer son action et apprendre
à se reposer aussi sur des appuis déjà là. À l’homme passif qui a renoncé par
excès de lucidité, apprendre ou réapprendre à se dégager avec la bonne mesure
de lucidité et donc à bien se réengager serait opportun. C’est bien de situation
en situation que cet apprentissage doit s’exercer, en vue de faire coexister dans
la présence et l’action de l’homme le travail, le repos et surtout la lucidité. Mais
jusqu’où aller dans celle-ci ? À propos de René Char, Veyne écrit : « c’était déjà
une chance d’avoir entrevu un grand homme une fois en sa vie »3. Un « grand
homme » qui pense que l’humain fait fausse route dans ses automatismes, ses
routines et sa manière de se reposer et aussi qu’il n’est pas assez fort pour être
bon. Et il ajoute : « L’homme, est généralement inférieur à lui-même, à l’énergie
potentielle de son cœur, de son énergie toute solaire et méconnaît sa capacité de
tout outrepasser »4.
L’anthropologie est déterminante en vue d’une pédagogie de et sur
l’humanité, disons l’hominité encore balbutiante. C’est la faiblesse des morales
de ne pas reposer sur le savoir et la connaissance de l’hominité. Les réflexions de
l’anthropologie n’éludent donc pas les questions politiques, elles les déplacent de
1
G. Bronner, La Pensée extrême, Paris, Denoël, 2009, p. 303.
2
Ibidem, p. 305.
3
P. Veyne, René Char en ses poèmes, op. cit., p. 505.
4
Ibidem, p. 225.
90
CROIRE.indd 90 22/02/13 11:30:24
le mode mineur : impact et destinée
la perspective de la stricte actualité sociale et les recadrent dans une réflexion sur
la spécificité anthropologique et une éthique hoministe. Celle-ci prend acte des
échecs des raisons classiquement politiques incapables de résoudre l’infinité des
atrocités meurtrières et estime urgent de refonder radicalement la pédagogie et
le mode de penser. Litanie ? Peut-être ? Qui pourra être répétée certes deux ou
trois cents ans, ou vingt millénaires. Même plus. Un jour, il sera donc trop tard
pour l’espèce humaine dont nous faisons partie, mais au fond, elle n’est qu’un…
détail.
91
CROIRE.indd 91 22/02/13 11:30:25
albert piette - l'origine de la croyance
92
CROIRE.indd 92 22/02/13 11:30:25
Bibliographie
Anati, Emmanuel, La Religion des origines, Paris, Hachette, (1995), 2004.
Atran, Scott, Au nom du Seigneur. La religion au crible de l’évolution, Paris,
Odile Jacob, (2002), 2009.
Barrett, Justin L., Why Would Anyone Believe in God ?, Lanham, Altamira
Press, 2004.
Bégout, Bruce, La Découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005.
Bekoff, Marc, The Emotional Lives of Animals, Novato, New World Library,
2007.
Bergson, Henri, Les Deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF,
(1932), 2008.
Bering, Jesse M., « Intuitive Conceptions of the Dead Agents’ Minds: the
Natural Foundations of Afterlife Beliefs as Phenomenological Boundary”,
Journal of Cognition and Culture, 2(4), 2002, pp. 263-308.
Binant, Pascale, Les Sépultures du Paléolithique, Paris, Errance, 1991.
Bloch, Maurice, “Are Religious Beliefs Counter-intuitive ?”, in Nancy K.
Frankeberry (ed), Radical Interpretation in Religion, Cambridge, Cambridge
University Press, 2002, pp. 129-146.
Bloch, Maurice, “Why Religion is Nothing Special but is Central”, Philo-
sophical Transactions of The Royal Society B, 363, 2008, pp. 2055-2061.
Bloch, Maurice, « La mémoire autobiographique et le Soi. Pour une alliance
entre sciences sociales et sciences cognitives », Terrain, n° 52, mars 2009, pp.
50-63.
Boltanski, Luc, L’Amour et la justice comme compétences, Paris, Métailié,
1990;
Boltanski, Luc et Thévenot, Laurent, De la Justification, Paris, Gallimard,
1990.
93
CROIRE.indd 93 22/02/13 11:30:25
albert piette - l'origine de la croyance
Bouveresse, Jacques, Peut-on ne pas croire ? Marseille, Agone, 2007.
Boyer, Pascal, Et l’homme créa les dieux, Paris, Laffont, 2003.
Bronner, Gérald, La Pensée extrême. Comment des hommes ordinaires devien-
nent des fanatiques, Paris, Denoël, 2009.
Canto-Sperber, Monique, Essai sur la vie humaine, Paris, PUF, 2008.
Castoriadis Cornelius, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil,
1975
Char, René, Feuillets d’Hypnos, Paris, Gallimard, (1943-1944), 2007.
Charbonneau, Georges, « Le vécu de cirque. Wahnstimmung et déréalisa-
tion », in Formes de la présence dans les expériences pathologiques, Paris, Le Cer-
cle Herméneutique Éditeur, 2008.
Cherniak, Christopher, Minimal Rationality, Cambridge, The Mit Press,
1986.
Cioran, Emil, Sur les cimes du désespoir, Paris, Le Livre de poche, (1934),
2007.
Clément, Fabrice, Les Mécanismes de la crédulité, Genève, Droz, 2006.
Clément, Fabrice,« Des jeux symboliques aux rituels collectifs. Quelques
apports de la psychologie du développement à l’étude du symbolisme », in Jean-
Yves Béziau (dir.), Le Langage symbolique, Paris, Pétra, 2012.
Cohen, Claudine, Un Néandertalien dans le métro, Paris, Seuil, 2007.
Conein, Bernard, Les Sens sociaux, Paris, Économica, 2006.
Coolidge, Fred L. et Tom Wynn, The Rise of Homo Sapiens: the Evolution of
Modern Thinking, Oxford, Wiley-Blackwell, 2009.
Dampierre, Éric de, Penser au singulier, Paris, Société d’ethnographie, 1984
Darwin, Charles, L’Origine des espèces, Paris, Flammarion, (1859), 1992.
Dastur, Françoise, La Mort. Essai sur la finitude, Paris, PUF, 2007.
Davidson, Donald, Enquêtes sur la vérité et l’interprétation, Nîmes, Éditions
Jacqueline Chambon, (1984), 1993.
Defleur, Alban, Les Sépultures moustériennes, Paris, Éds du CNRS, 1993.
Delecroix, Vincent, Singulière philosophie. Essai sur Kierkegaard, Paris, Félin,
2006.
Deleuze, Gilles et Guattari, Félix., Mille plateaux, Minuit, 1980 ; , Qu’est-ce
que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991.
Dennett, Daniel C., La Conscience expliquée, Paris, Odile Jacob, (1991),
1993 ; Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon, New York, Pen-
guin Books, 2006.
Donald, Merlin, Les Origines de l’esprit moderne, Bruxelles, De Bœck Uni-
versité, (1991), 1999.
94
CROIRE.indd 94 22/02/13 11:30:25
bibliographie
Dostoïevski Fedor, Souvenirs de la maison des morts, Paris, Gallimard, (1860-
1862), 1977
Dupuy, Jean-Pierre, Petite métaphysique de tsunamis, Paris, Seuil, 2005.
Durkheim, Émile, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, puf,
(1912),1985.
Elster, Jon, Le Laboureur et ses enfants, Paris, Minuit, (1983), 1986.
Engel, Pascal, « Les croyances », in Denis Kambouchner (dir.), Notions de
philosophie II, Paris, Gallimard, 1995, pp.10-111 ; « La grammaire de l’assen-
timent revisitée », in Sacha Bourgeois-Gironde, Bruno Gnassounou et Roger
Pouivet (dir.), Analyse et théologie. Croyances religieuses et rationalité, Paris, Vrin,
pp. 143-161.
Evans-Pritchard, Edward E., La Religion des primitifs à travers les théories des
anthropologues, Paris, Payot, (1965), 1971.
Fornel, Michel de et Louis Quéré (dir.), La Logique des situations. Nouveaux
regards sur l’écologie des activités sociales, Paris, Éds de l’ehess, 1999.
Gargett, Robert H., “Middle Palaeolithic Burial is not a Dead Issue”, Journal
of Human Evolution, 37, 1999, pp. 27-90.
Genard, Jean-Louis et Cantelli, Fabrizio, « Êtres capables et compétents :
lecture anthropologique et pistes pragmatiques », SociologieS. Théories et recher-
ches, avril 2008 (en ligne).
Ginzburg, Carlo, « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’in-
dice », Le Débat, n° 6, novembre 1980, pp. 6-44.
Gontcharov, Ivan, Oblomov, Paris, Gallimard, (1859), 2007.
Green, Richard E. et al., « A Draft Sequence of the Neandertal Genome »,
Science, Vol. 328, 2010, pp. 710-722.
Grivois, Henri « Coordination et subjectivité dans la psychose naissante »,
in Henri Grivois et Joëlle Proust (éds), Subjectivité et conscience d’agir, Paris, puf,
1998.
Grœthuysen, Bernard, Anthropologie philosophique, Paris, Gallimard, (1928),
1980.
Guilaine, Jean et Jean Zammit, Le Sentier de la guerre. Visages de la violence
préhistorique, Paris, Seuil, 2000.
Guntz, Philipp et al., Brain Development After Birth Differs Between Nean-
derthals and Modern Humans, Current Biology, Vol. 20, 21, 2010.
Guthrie, Stewart, Face in the Clouds. A New Theory of Religion, New York,
Oxford University Press, 1993.
Harris, Paul L., « Les dieux, les ancêtres et les enfants », Terrain, n° 40, mars
2003.
Heidegger, Martin, Être et temps, Paris, Gallimard, (1927), 1986.
95
CROIRE.indd 95 22/02/13 11:30:25
albert piette - l'origine de la croyance
Henshilwood, ChristopherS.et al., « Emergence of Modern Human Behav-
ior : Middle Stone Age Engravings from South Africa », Sciences, 15 February
2002, pp.1278-1280.
Hölderlin, Friedrich, Hypérion, Paris, Gallimard, (1797-1799), 1973.
Hovers, Erella et al., « An Early Case of Color Symbolism »,Current Anthro-
pology, Vol.44, 4, August-October 2003, pp.491-522.
Hume, David, L’Histoire naturelle de la religion et autres essais sur la religion,
Paris, Vrin, (1757), 1989.
Jeannerod, Marc et Pierre, Fourneret, « Être agent ou être agi. De l’inten-
tion à l’intersubjectivité », in Henri Grivois et Joëlle Proust (éds), Subjectivité et
conscience d’agir, Paris, puf, 1998.
Kant, Emmanuel, Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, Hatier, (1784), 2007.
Karsenti, Bruno., L’Homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez
Marcel Mauss, Paris, PUF, 1997.
Keck, Frédéric, Lucien Lévy-Bruhl, entre philosophie et anthropologie, Paris,
CNRS Éditions, 2008.
Lachièze-Rey, Marc, Les Avatars du vide, Paris, Le Pommier, 2005.
Lambert, Dominique et René Rezsöhazy, Comment les pattes viennent au ser-
pent. Essai sur l’étonnante plasticité du vivant, Paris, Flammarion, 2004
Latour, Bruno, Changer la société. Refaire de la sociologie, Paris, La Décou-
verte, 2006.
Lenclud, Gérard, « Être une personne », Terrain, 52, mars 2009, pp. 4-17.
Leroi-Gourhan, André, Les Religions de la préhistoire, Paris, puf, 1964.
Lévi-Strauss, Claude, Mythologiques. Le cru et le cuit, Paris, Plon, 1964.
Lévinas, Emmanuel, De l’existence à l’existant, Paris, Vrin, (1963), 2004.
Lévinas, Emmanuel, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Librai-
rie générale française, (1974), 2008.
Lévinas, Emmanuel, Entre nous, Paris, Grasset, 1991.
Lévy-Bruhl, Lucien, « La mentalité primitive », in Primitifs, Paris, Éditions
Anabet, (1922), 2007.
McGrew, William C., Chimpanzee Material Culture, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1992.
Mannoni, Octave, Clefs pour l’ imaginaire ou l’autre scène, Paris, Seuil, 1985.
Marion, Jean-Luc, Étant donné, Paris, PUF, 1997.
Martuccelli, Danilo, « Philososphie de l’existence et sociologie de l’indi-
vidu : notes pour une orientation critique », SociologieS. Théories et recherches,
juin 2010 (en ligne).
Maureille, Bruno, Les premières sépultures, Paris, Le Pommier,2004.
96
CROIRE.indd 96 22/02/13 11:30:26
bibliographie
Maureille, Bruno, Qu’est-il arrivé à l’homme de Neandertal, Paris, Le Pom-
mier, 2008.
Maureille, Bruno et Bernard Vandermeersch, « Les sépultures néanderta-
liennes », in Bernard Vandermeersch et Bruno Maureille (dir.), Les Néanderta-
liens. Biologie et culture, Paris, Éds du cths, 2007. pp.311-322.
Mauss, Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, (1964), 1985
Merleau-Ponty, Maurice, Le Visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964 ;
L’institution, la passivité. Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Paris,
Belin, 2003.
Mitchell, Robert W. (dir.), Pretending and Imagination in Animals and Chil-
dren, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
Mithen, Steven, The Prehistory of the Mind, London, Thames and Huston,
1996 ;The Singing Neanderthals. The Origins of Music, Language, Mind, and
Body, Cambridge, Harvard University Press, 2007.
Morin, Edgar, Le Vif du sujet, Paris, Seuil, 1969 ; Introduction à la pensée
complexe, Paris, Seuil, 2005.
Nachi, Mohamed, Introduction à la sociologie pragmatique, Paris, Armand
Colin, 2006,
Pascal, Blaise, Pensées, Paris, Garnier-Flammarion, (1670), 1976.
Patou-Mathis, Marylène, Néandertal. Une autre humanité, Paris, Perrin,
2006.
Pessoa, Fernando, Le Livre de l’ intranquillité, Paris, Christian Bourgois,
(1913-1935), 1999 ; Bureau de tabac et autres poèmes, Paris, Caractères, (1928),
2000.
Piaget, Jean, La Formation du symbole chez l’enfant, Neuchatel, Delachaux
et Niestlé, 1972.
Pichot, André, Histoire de la notion de vie, Paris, Gallimard, 1993.
Piette, Albert, Le Temps du deuil, Paris, L’Atelier, 2005 ; Anthropologie
existentiale, Paris, Pétra, 2009 ; Propositions anthropologiques pour refonder la
discipline, Paris, Pétra, 2010 ; Fondements à une anthropologie des hommes, Paris,
Hermann, 2011.
Pinker, Steven, Comment fonctionne l’esprit, Paris, Odile Jacob, (1997),
2000.
Premack, David et Ann, Le Bébé, le singe et l’ homme, Paris, Odile Jacob,
2003.
Proust, Marcel, Du côté de chez Swann, Paris, Booking international, (1913),
1993.
Reverdy, Pierre, Le Livre de mon bord, Paris, Mercure de France, 1989.
Rosset, Clément, L’École du réel, Paris, Minuit, 2008.
97
CROIRE.indd 97 22/02/13 11:30:26
albert piette - l'origine de la croyance
Rousseau, Jean-Jacques, Discours sur l’origine et les fondements de l’ inégalité
parmi les hommes, Paris, Gallimard, (1750-1755), 1965.
Scheid, John, Quand faire, c’est croire. Les rites sacrificiels des Romains, Paris,
Aubier, 2005.
Sloterdijk, Peter, La Domestication de l’ être, Paris, Mille et une nuits, 2000 ;
Bulles, Paris, Fayard, (1998), 2002 ; La Mobilisation infinie, Paris, Seuil, (1989),
2003.
Sousa, Ronald de, Évolution et rationalité, Paris, Puf, 2004.
Sperber, Dan, Le Savoir des anthropologues, Paris, Hermann, 1982.
Sperber, Dan, La Contagion des idées, Paris, Odile Jacob, 1996.
Tattersall, Ian, L’Émergence de l’ homme, Paris, Gallimard, (1998), 1999.
Tillier, Anne-Marie, L’Homme et la mort. L’ émergence du geste funéraire
durant la préhistoire, Paris, CNRS Éditions, 2009.
Vandermeersch, Bernard, « Une sépulture moustérienne avec offrandes
découverte dans la grotte de Qafzeh », Compte rendu de l’Académie des sciences,
t. 270, série D, 1970, pp. 298-301.
Van Lawick-Goodall, Jane, Les Chimpanzés et moi, Paris, Stock, (1970),
1971.
Varela, Francisco, Quel savoir pour l’ éthique ? Action, sagesse et cognition,
Paris, La Découverte, 1996.
Veyne, Paul, « Conduites sans croyances et œuvres d’art sans spectateurs »,
Diogène, n° 143, 1988 ; Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Paris, Seuil, 1983 ;
L’Élégie érotique romaine, Paris, Seuil, 1983; René Char en ses poèmes, Paris, Gal-
limard, 1990.
Vicart, Marion, Des Chiens auprès des hommes, Paris, Pétra, 2012.
Wahl, François, Le Perçu, Paris, Fayard, 2007.
Wynn, Tom et Fred L. Coolidge, « The Expert Neandertal Mind », Journal
of Human Evolution, 46, 2004, pp. 467-487.
98
CROIRE.indd 98 22/02/13 11:30:26
Table des matières
INTRODUCTION 7
LE PREMIER CROYANT 11
La présence des morts, des anciens vivants 14
Croyance aux morts qui vivent, de nouveaux vivants 18
Deux présences au monde 21
ÊTRE EN TRAIN DE CROIRE 29
Des actes de croire 32
Comment je suis quand je crois ? 35
Quand croire, c’est faire et un peu plus 39
PRÉSENCES RÉELLES 47
Anthropologie 47
Modes humains de présence 53
Une erreur fondamentale 57
LE MODE MINEUR : 71
IMPACT ET DESTINÉE 71
Bibliographie 93
99
CROIRE.indd 99 22/02/13 11:30:26
albert piette - l'origine de la croyance
100
CROIRE.indd 100 22/02/13 11:30:26
Ouvrages publiés dans la collection « Dissonances »
dirigée par Sébastien Schehr :
Frédéric Monneyron - Gérard Siary, L’Idée de race.
Isabelle Rieusset-Lemarié, Déesses du parfum et de la métamorpho-
se.
Myriam Klinger, L’Inquiétude et le désarroi social.
G. Delannoi - P. Hintermeyer - P. Raynaud - P.-A. Taguieff (dir.), Ju-
lien Freund. La dynamique des conflits.
Claude Javeau - Sébastien Schehr (dir.), La Trahison. De l’adultère
au crime politique.
Georges Zimra, Résister à la servitude.
Albert Piette, De l’ontologie en anthropologie.
101
CROIRE.indd 101 22/02/13 11:30:27
albert piette - l'origine de la croyance
102
CROIRE.indd 102 22/02/13 11:30:27
103
CROIRE.indd 103 22/02/13 11:30:27
albert piette - l'origine de la croyance
104
CROIRE.indd 104 22/02/13 11:30:27
Vous aimerez peut-être aussi
- Auburn Marc - 0,001% PDFDocument400 pagesAuburn Marc - 0,001% PDFChri Cha100% (5)
- Lespece Fabulatrice - Nancy HustonDocument23 pagesLespece Fabulatrice - Nancy Hustonkacenb005Pas encore d'évaluation
- BorisCyrulnik-Les Vilains Petits Canards-2001Document290 pagesBorisCyrulnik-Les Vilains Petits Canards-2001Jean Goyette100% (3)
- Satprem - Le Mental Des CellulesDocument42 pagesSatprem - Le Mental Des CellulesCaroline Carlin100% (2)
- Zoos HumainsDocument7 pagesZoos HumainsBelzebuthPas encore d'évaluation
- Destins Du CannibalismeDocument22 pagesDestins Du Cannibalismeguailon100% (2)
- Chamanisme CeltiqueDocument96 pagesChamanisme CeltiqueBenjamin Tristan Antinoüs Llinares100% (1)
- Pauwels Louis - Bergier Jacques - L'Homme Éternel 1Document383 pagesPauwels Louis - Bergier Jacques - L'Homme Éternel 1Materiel2100% (5)
- Les Grands Mythes: Origine, Hist Oire, Interprét AtionDocument22 pagesLes Grands Mythes: Origine, Hist Oire, Interprét AtionZezoPas encore d'évaluation
- Planète N° 14Document164 pagesPlanète N° 14humbertorafaelg100% (1)
- 9782908068160Document24 pages9782908068160Scot Exoce Müller Ndinga100% (2)
- Approche Spirituelle de La Peur Peur de Quoi Peur de Qui Qui A PeurDocument161 pagesApproche Spirituelle de La Peur Peur de Quoi Peur de Qui Qui A PeurJade IlboudoPas encore d'évaluation
- Andre KARQUEL SORCIER, HOMME ET DIEUDocument11 pagesAndre KARQUEL SORCIER, HOMME ET DIEURichard ANDRE67% (3)
- Animal, Animalité, Devenir Animal PDFDocument12 pagesAnimal, Animalité, Devenir Animal PDFSarah CarmoPas encore d'évaluation
- En plongeant dans l'univers de ma mémoire - Tome II: Histoires et pensées d'un homme - NouvellesD'EverandEn plongeant dans l'univers de ma mémoire - Tome II: Histoires et pensées d'un homme - NouvellesPas encore d'évaluation
- Intuition Et 6e Sens by Jocelin Morisson - Morisson - Jocelin - Z Lib - OrgDocument115 pagesIntuition Et 6e Sens by Jocelin Morisson - Morisson - Jocelin - Z Lib - OrgIcare Dedale100% (1)
- Jeanpierre Vernant Uvres Vol 1Document1 296 pagesJeanpierre Vernant Uvres Vol 1quatenus2Pas encore d'évaluation
- Anne Givaudan - Rencontre Avec Les Êtres de La NatureDocument245 pagesAnne Givaudan - Rencontre Avec Les Êtres de La NatureNicolas Ford100% (9)
- Histoire Naturelle de L'ame - Laura BossiDocument502 pagesHistoire Naturelle de L'ame - Laura Bossialbino aubino100% (1)
- 1972 en Regardant Le MystereDocument148 pages1972 en Regardant Le MystereKouassijoselionel YankounPas encore d'évaluation
- (Science-Conscience) Seval, Christel - Ummo, Un Dieu Venu D'ailleurs - JMG Éd (2004)Document470 pages(Science-Conscience) Seval, Christel - Ummo, Un Dieu Venu D'ailleurs - JMG Éd (2004)Javier MazzonePas encore d'évaluation
- 5° Ev T 1 CH 9 L'Organisation de Notre Monde IntérieurDocument10 pages5° Ev T 1 CH 9 L'Organisation de Notre Monde IntérieurElvis SocratePas encore d'évaluation
- Claude-Claire Kappler - MONSTRES, DEMONS ET MERVEILLLES A LA FIN DU MOYEN AGE. Edition 1999-Payot (1988) PDFDocument152 pagesClaude-Claire Kappler - MONSTRES, DEMONS ET MERVEILLLES A LA FIN DU MOYEN AGE. Edition 1999-Payot (1988) PDFEmilia AvisPas encore d'évaluation
- Nancy Claude - Les Races Humaines Tome 1Document503 pagesNancy Claude - Les Races Humaines Tome 1Izo JEANNE-DIT-FOUQUEPas encore d'évaluation
- Hypothese Extra TerrestreDocument313 pagesHypothese Extra TerrestreGeoffroy Coutellier - ChanvrierPas encore d'évaluation
- Du Sentiment Tragique de La VieDocument427 pagesDu Sentiment Tragique de La ViekarlarthurPas encore d'évaluation
- La Mort Aux TroussesDocument15 pagesLa Mort Aux TroussesEwerton M. LunaPas encore d'évaluation
- Mentalite Primitive 1Document193 pagesMentalite Primitive 1Nicoleta AldeaPas encore d'évaluation
- Boris CyDocument5 pagesBoris CyAnnaPas encore d'évaluation
- Michel FOUCAULT, Les Hétérotopies, France-Culture, 7 Décembre 1966.Document7 pagesMichel FOUCAULT, Les Hétérotopies, France-Culture, 7 Décembre 1966.thersitesPas encore d'évaluation
- Morin, Edgar. L'Homme UniversDocument4 pagesMorin, Edgar. L'Homme Universapi-37194010% (1)
- Ebook Boris Cyrulnik - Les Nourritures AffectivesDocument295 pagesEbook Boris Cyrulnik - Les Nourritures Affectivesfabien.raymond71Pas encore d'évaluation
- Delanne Exteriorisation PenseeDocument36 pagesDelanne Exteriorisation Penseehendrix2112100% (1)
- Monstres Demons KAPPLERDocument152 pagesMonstres Demons KAPPLERrayleverkunstPas encore d'évaluation
- Petit guide scientifique du voyageur au pays du paranormal: À la découverte des phénomènes occultesD'EverandPetit guide scientifique du voyageur au pays du paranormal: À la découverte des phénomènes occultesPas encore d'évaluation
- Planète N° 06Document164 pagesPlanète N° 06humbertorafaelg100% (1)
- l'héritage de pierre: qu'elle sorte d'humains sommes-nous ?D'Everandl'héritage de pierre: qu'elle sorte d'humains sommes-nous ?Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Roussel Reynald Ce Que Les Morts Nous DisentDocument66 pagesRoussel Reynald Ce Que Les Morts Nous DisentnanterrePas encore d'évaluation
- Les plus grandes erreurs de la science: A l'origine des plus importantes découvertes scientifiquesD'EverandLes plus grandes erreurs de la science: A l'origine des plus importantes découvertes scientifiquesPas encore d'évaluation
- La rose est-elle sans pourquoi ?: L'audace d'un regard vers le ToutD'EverandLa rose est-elle sans pourquoi ?: L'audace d'un regard vers le ToutPas encore d'évaluation
- Silence, Terre Et RienDocument201 pagesSilence, Terre Et RienP. RamezPas encore d'évaluation
- Sages SeDocument24 pagesSages SeBourhane Ali SoilihiPas encore d'évaluation
- Planète N° 09Document166 pagesPlanète N° 09humbertorafaelg100% (1)
- La Mentalite Primitive - Cap 1 A 7Document194 pagesLa Mentalite Primitive - Cap 1 A 7Luiz Alexandre Mees100% (1)
- Jacques Bouveresse, Sur Wittgenstein-Parle-de-Frazer PDFDocument210 pagesJacques Bouveresse, Sur Wittgenstein-Parle-de-Frazer PDFDummyPas encore d'évaluation
- Le Spiritisme IncomprisDocument80 pagesLe Spiritisme Incomprisnicole_plante100% (2)
- Atlantea - Du Sphinx à l’Atlantide: L'aventure spirituelleD'EverandAtlantea - Du Sphinx à l’Atlantide: L'aventure spirituellePas encore d'évaluation
- Le Chemin Qui Conduit À La: ConnaissanceDocument58 pagesLe Chemin Qui Conduit À La: ConnaissancePaulin KeleckPas encore d'évaluation
- Le Chemin Qui Conduit À La: ConnaissanceDocument58 pagesLe Chemin Qui Conduit À La: ConnaissanceSalehPas encore d'évaluation
- La - Naissance - de - Lintelligence - DR - BohnDocument365 pagesLa - Naissance - de - Lintelligence - DR - Bohnmika.rarison.mgPas encore d'évaluation
- MD CDocument148 pagesMD CAlqanounPas encore d'évaluation
- 1 5057939326709531169Document35 pages1 5057939326709531169Aboby emmanuel0% (1)
- Asimov Isaac - Civilisation ExtraterrestreDocument396 pagesAsimov Isaac - Civilisation Extraterrestreanaximandre06100% (3)
- Évolution Des Hiérarchies Statutaires Dans La Société Maure Contemporaine PDFDocument13 pagesÉvolution Des Hiérarchies Statutaires Dans La Société Maure Contemporaine PDFFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Anthropologie Du Nomadisme PDFDocument13 pagesAnthropologie Du Nomadisme PDFFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Vols Et Sanctions. en Mediterranee PDFDocument35 pagesVols Et Sanctions. en Mediterranee PDFFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Vols Et Sanctions. en Mediterranee PDFDocument35 pagesVols Et Sanctions. en Mediterranee PDFFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- La Tribu Mode Demploi PDFDocument21 pagesLa Tribu Mode Demploi PDFFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Du Puigaudeau, Odette (1894-1991)Document392 pagesDu Puigaudeau, Odette (1894-1991)Faiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Article - Violence Et Médiation. Théorie de La Segmentarité Ou Pratiques Juridiques en KabylieDocument17 pagesArticle - Violence Et Médiation. Théorie de La Segmentarité Ou Pratiques Juridiques en KabylieFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Le Sacrifice AnimalDocument12 pagesLe Sacrifice AnimalFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Le Sacrifice Animal Au Regard Des Textes Islamiques CanoniquesDocument22 pagesLe Sacrifice Animal Au Regard Des Textes Islamiques CanoniquesFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Nomade Et NomadismeDocument192 pagesNomade Et NomadismeFaiz Abdelhamid100% (1)
- Le NomadismeDocument16 pagesLe NomadismeFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Res Militaris Violence Guerre Et Politique-Jean-Vincent Holeindre 2 PDFDocument13 pagesRes Militaris Violence Guerre Et Politique-Jean-Vincent Holeindre 2 PDFdonguiePas encore d'évaluation
- Le Don MaussDocument18 pagesLe Don MaussFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Espaces Territoires FrontieresDocument14 pagesEspaces Territoires FrontieresFaiz AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Natalie Zemon Davis Les Conteurs de Montaillou, 1979, Annales ESCDocument14 pagesNatalie Zemon Davis Les Conteurs de Montaillou, 1979, Annales ESCCarolina Silva OrtizPas encore d'évaluation
- L'âme Et La PersonnalitéDocument378 pagesL'âme Et La PersonnalitéNora Khemissa100% (1)
- Messagescelestes - Ca-Lona Le Jeã Ne Et La Mã©moire de Qui Vous à TesDocument5 pagesMessagescelestes - Ca-Lona Le Jeã Ne Et La Mã©moire de Qui Vous à TesOumar DialloPas encore d'évaluation
- Témoignage de Sénéca Sodi PDFDocument303 pagesTémoignage de Sénéca Sodi PDFiwamaka242Pas encore d'évaluation
- Genese 1 - Corrado Malanga FrançaisDocument27 pagesGenese 1 - Corrado Malanga FrançaisC.O.M.A research -stopalienabduction-Pas encore d'évaluation
- DPF - DC (Droit Des Personnes Et de La Famille - Droit Civ22il)Document103 pagesDPF - DC (Droit Des Personnes Et de La Famille - Droit Civ22il)Priscille Amany100% (1)
- Livre (33) Fuyez L'enferDocument18 pagesLivre (33) Fuyez L'enferPapy Kakesa100% (1)
- Karma ReincarnationDocument18 pagesKarma ReincarnationLayla IshaitPas encore d'évaluation
- Guide D'un Gagneur D'âmes Pour L'évangélisation-Ash - KotechaDocument39 pagesGuide D'un Gagneur D'âmes Pour L'évangélisation-Ash - Kotechajedossous100% (1)
- Serie3no7 PDFDocument23 pagesSerie3no7 PDFBoris Foli FoliganPas encore d'évaluation