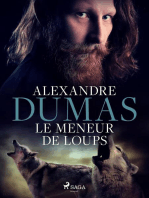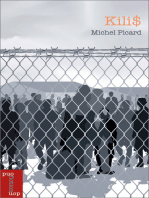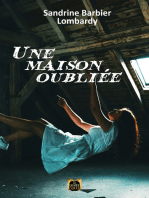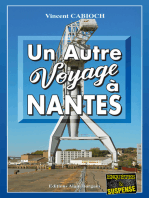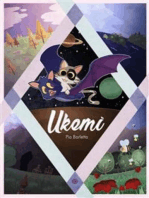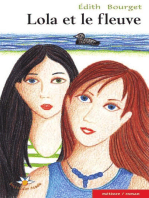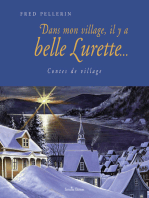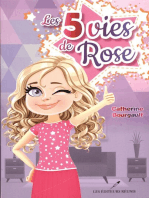Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Reves Du Ookpik
Transféré par
fred.girard26Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Reves Du Ookpik
Transféré par
fred.girard26Droits d'auteur :
Formats disponibles
Étienne Beaulieu
LES RÊVES DU OOKPIK
proses de combat
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 172 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Reves2.indd 1 2023-06-22 13:34
DU MÊME AUTEUR
La pomme et l’étoile, Montréal, Varia, 2019.
Sang et lumière. Le temps et la mort dans le cinéma québécois, Montréal, Alias,
2019.
Splendeur au bois Beckett, Montréal, Alias, 2018.
L’âme littéraire, Montréal, Nota bene, 2014.
Trop de lumière pour Samuel Gaska, Montréal, Gaëtan Lévesque, 2014.
La fatigue romanesque de Joseph Joubert (1754-1824), Québec, Presses de l’Uni-
versité Laval, 2008.
Reves2.indd 2 2023-06-22 13:34
ÉTIENNE BEAULIEU
Les rêves du ookpik
Reves2.indd 3 2023-06-22 13:34
Révision linguistique : Isabelle Bouchard
Composition et infographie : Isabelle Tousignant
Correction d'épreuves : Karianne Trudeau Beaunoyer
Infographie de la couverture : KX3 Communication
En couverture : illustration de Cécile A. Holdban
Groupe Nota bene
2200, rue Marie-Anne Est
Montréal (Québec) H2H 1N1
info@groupenotabene.com
groupenotabene.com
© Varia, 2022
ISBN : 978-2-89606-176-1
Varia est une division du Groupe Nota bene.
Diffusion pour le Canada :
Gallimard ltée
3700A, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2X 2V4
Téléphone : 514 499-0072 Télécopieur : 514 499-0851
Distribution : Socadis
Diffusion pour la France et la Belgique :
DNM (Distribution du Nouveau-Monde)
30, rue Gay-Lussac, 75005 Paris
France
http://www.librairieduquebec.fr
Téléphone : (33 1) 43 54 49 02 Télécopieur : (33 1) 43 54 39 15
Nous remercions le Conseil des arts du Canada et la Société de développement des
entreprises culturelles du Québec (SODEC) pour leur soutien financier.
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du
Fonds du livre du Canada pour nos activités d’édition. Le Groupe Nota bene (Varia)
est inscrit au Programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition et bénéficie
du Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC
Reves2.indd 4 2023-06-22 13:34
Ce livre a été soutenu par le Conseil de la culture de l’Estrie
(CALQ) et par la Bourse Charles-Gagnon (UNEQ) octroyée
par la Fondation Lire pour réussir.
Je déclare n’appartenir d’aucune façon, proche ou lointaine, aux
onze cultures autochtones du Québec. Tous les passages concer-
nant les Premières Nations et les Inuit ont été approuvés par
les personnes et par les autorités concernées, soit Yves Sioui-
Durand, Maïté Labrecque-Saganash, le conseil Mativik, la
Maison et atelier Rodolphe-Duguay, Pierre Sioui. Je leur dédie
ce livre dans l’espoir d’une authentique marche commune des
peuples.
Je remercie Georges Sioui et Dalie Giroux pour leur lecture
rigoureuse et enrichissante.
Tous les profits de ce livre seront versés à la Fondation Joséphine
Bacon afin de permettre à un jeune innu de séjourner dans l’an-
cestral nutshimit.
Reves2.indd 5 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 6 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Ce livre a été arraché au silence de mon père. Je l’ai écrit pour
mettre des mots sur ce qu’il voulait dire quand il ne parlait pas.
Quand il imitait à sa manière les taiseux de nos ascendances
venues du noir analphabète dont parlait Gaston Miron. Mon
père partait souvent pendant des semaines, on ne savait trop où.
On apprenait soudain qu’il était revenu du Grand Nord, sans
avertissement. Il déposait sans rien dire sur la table des queues
de castor séchées, du pemmican, des ouananiches congelées ou
des sculptures étranges, toutes douces, faites de pierre à savon. Je
retrouvais le matin sur la table de la cuisine toutes sortes d’ob-
jets étranges, dont ce couteau métallique en demi-lune qui m’a
tellement fait rêver. J’ai su plus tard que c’était un ulu dont les
femmes inuites se servaient pour travailler les os, la chair et la
peau des caribous. Et surtout, il avait ramené cette merveille
d’entre les merveilles : un toutou en forme de hibou, un ookpik,
dont les plumes étaient faites d’une peau de phoque, rugueuse
à rebrousse-poil, mais d’une douceur infinie dans le sens de sa
lisseur. Pour mon âme d’enfant, mon père, que ma grand-mère
maternelle appelait « le sauvage », était tout entier dans ce toutou.
Reves2.indd 7 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
J’ai dormi pendant des années avec le ookpik tout près de
moi, présence rassurante et inquiétante en même temps, sans
savoir tout le territoire qu’il avait franchi pour aboutir sur mon lit,
dans ma vieille chambre d’enfant, parmi des jouets aux couleurs
trop criardes pour la sobriété de son gris-brun. Mes filles jouent
encore avec ce toutou qui m’a regardé grandir avec sévérité, du
haut de sa tablette, ses yeux jaunes grands ouverts du fond de sa
zone d’ombre éternelle, tout près de ma lampe ancienne. À quoi
peut bien rêver le ookpik, le regard fixe, sans âge, tourné vers
un intérieur insaisissable ? De leur lointaine noirceur, du puits
sans fond de mon enfance et de toute l’enfance du monde, ces
yeux jaunes me fixent encore, immobiles à travers les temps. Ce
regard de toutou me cloue sur place, comme on clouait jadis les
effraies aux portes des granges afin de conjurer le mauvais sort.
Maintenant, c’est l’inverse : c’est le ookpik qui me transperce,
petit Blanc étrange vivant et s’agitant à la surface des choses.
Moi qui sur les photos anciennes suis vêtu à deux ou trois ans
d’une veste d’Inuk et qui lis comme premier livre ce Poutoulik
chez les Inuits venu de je ne sais où et qui m’a donné une durable
passion pour l’archéologie. Moi qui dans mes jeux d’enfants me
raconte la vie d’un petit Inuk de mon âge auquel je m’identifie,
avec qui je chasse le phoque dans mes interminables histoires
d’enfants, toujours traversées de grandes avironnées en kayak
dans une mer de glace où rôdent les ours polaires. Je ne connaî-
trai jamais autrement qu’en imagination ce double fantôme, à
l’image de tout le Québec ou presque, qui ignore quasiment tout
des onze nations autochtones qui occupent le territoire depuis
des temps immémoriaux, moi qui vis avec un ookpik dans ma
chambre sans savoir ce qu’il est, d’où il vient, ce qu’il signifie,
pourquoi il a les yeux jaunes et n’a pas de plume.
Pour comprendre aujourd’hui à quoi rêve ce ookpik venu du
fond des âges, j’essaie dans ce livre de faire à l’envers la grande
Reves2.indd 8 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
migration d’il y a plus de quarante ans, du Grand Nord jusqu’à
moi, quand il est venu dans les valises silencieuses de mon père
se déposer au creux des bras d’un enfant du Sud, comme le font
les harfangs des neiges réels qui viennent hiverner dans le sud
du Québec, peupler les plaines désertées et songer sans fin sur
les vieux piquets de clôture éparpillés ici et là autour des granges
abandonnées. J’aimerais maintenant voir ce toutou retourner au
Nunavik et se métamorphoser instantanément en un harfang
majestueux, l’emblème du Québec dont on semble avoir oublié
qu’il passe la moitié de l’année dans le Nord, chez les Eeyou,
les Atikamekw, les Innus et les Inuit. Ce toutou fabriqué à la
main dans une coopérative inuite de la ville qu’on appelait alors
Fort Chimo (Kuujjuaq) a servi d’image à l’Expo 67, symbole
de la Révolution tranquille. Il est maintenant temps, grâce au
pouvoir imaginaire des phrases, de ramener le ookpik sur ses
terres, sur un territoire qui n’a rien d’une feuille de papier, mais
qui est sacré par son silence, sa lumière crue, son lichen sans fin.
Le ookpik prendrait son envol de feutre, de silence et de plumes
froissées, pour disparaître dans la toundra et rejoindre les pré-
sences ancestrales du territoire. Voilà le nom de cette puissance
qui veut prendre forme ici, dans ces pages, pour libérer le ookpik
et le rendre aux rêves qui lui ont donné naissance dans ce Grand
Nord à moitié irréel. Pour laisser mon enfance disparaître avec
lui dans la mémoire du territoire et communier avec tous les
morts qui reposent au creux de bras plus vastes encore que les
miens, et qui m’accueilleront bientôt.
Reves2.indd 9 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 10 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
Dans mon quartier, ils ont construit un Costco. Ils ont dû raser
une forêt entière pour faire apparaître cette succursale du nulle
part. C’était un terrain sauvage qui était encore intouché il y a
quelques mois. C’est une catastrophe pour tout ce qui vit autour,
pour les humains, pour les bêtes et les plantes. Pour les épinettes
blanches, pour les sapins baumiers qui poussaient là, tranquilles,
et qui pendant l’hiver nourrissaient les animaux d’alentour de
leur gomme blanche hyper-nutritive. Pour tout l’écosystème,
c’est une perte de diversité qui ne pourra jamais être rétablie.
Pas avant des centaines d’années au moins. Il ne faut pas sous-
estimer la nature, c’est vrai, elle est plus forte qu’on ne le croit sur
la très longue durée. Mais pour le présent et les années à venir,
le résultat est atroce. Il y a maintenant des files d’automobiles à
tous les coins de rue du quartier, une pollution visuelle, sonore,
olfactive. En prévision, ils ont ajouté des feux de circulation où
il n’y avait rien d’autre qu’un petit chemin menant à l’autoroute.
C’est un drame pour mon coin de terre, mais je sais bien qu’à
cette petite échelle se joue en réalité une tragédie mondiale,
celle de l’étalement urbain, celle d’un mode de vie destructeur
11
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 11 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
qui risque de nous mener à la fin prévisible que l’on sait. C’est
une tragédie, oui, parce que, comme dans les pièces de théâtre
antiques, la fin est déjà connue depuis le début : à la fin de tout,
quand sonneront les trompettes du jugement des hommes,
quand les murs du temps s’effondreront, quand tout sera détruit
et rasé, il ne restera plus aucune forêt et le monde sera devenu un
gigantesque stationnement.
J’habite au nord de Sherbrooke, tout près du bois Beckett, un
espace miraculeusement préservé de la folie urbanistique des
humains. Mais pour combien de temps encore ? Je suis profon-
dément amoureux de cette forêt publique, j’y ai consacré un livre,
Splendeur au bois Beckett, comme une déclaration d’amour aux
forces végétales, aux fugitives puissances animales, à la force du
vent dans les branches, aux feulements des sapins en hiver. Cette
forêt ancienne laisse vivre des arbres plusieurs fois centenaires,
des pruches et des pins, et une biodiversité qui déborde de par-
tout aux alentours. Il y a des chevreuils dans ma rue, chaque soir,
c’est une sorte de rendez-vous entre nous. Ils arrivent sept ou huit
en file, tout élégants, les oreilles à l’affût, une à gauche, l’autre en
pointe au sommet de son long crane. On entend claquer leurs
petits sabots sur l’asphalte, musique étrange et délicate. Je les
aperçois souvent au début de la nuit, quand tombent cette heure
bleu sombre et l’envie de disparaître. Ils se glissent le long des
haies pour brouter avec avidité tout ce qui leur est comestible :
les hostas, bien sûr, dont ils ne laissent pratiquement rien, mais
aussi les pommettes tombées au sol, les branches basses du vinai-
grier et les gros bourgeons appétissants du marronnier que j’ai
planté il y a quelques années.
12
Reves2.indd 12 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
J’ai souvent aperçu de ma fenêtre des coyotes qui les chas-
saient, ces agents indifférents de l’équilibre éternel entre préda-
teurs et proies. Je vois aussi des porcs-épics de temps en temps,
ils avancent, bedonnants et affairés à la fois, marcheurs lents et
patients, ils rongent les branches des arbrisseaux dans la compa-
gnie nocturne des moufettes qui creusent des trous un peu par-
tout pour en tirer quelques larves de scarabées. Je sais aussi qu’il
y a des ratons laveurs évidemment, mais invisibles en personne,
masqués par la nuit noire et révélés seulement par leurs dégâts
matinaux. Des lièvres parfois déboulent sur mon terrain, surtout
en hiver, ils laissent des traces symétriques sur la neige, 1-1-2,
comme un sigle cabalistique. Quelques marmottes ont fait leurs
terriers sur le terrain vague d’à côté, ce sont des voisines plutôt
drôles, une tête sortie du sol qui s’enfuit silencieusement dans les
profondeurs. Les renards ne sont jamais loin, avides, ils guettent
tout ce remugle, mais aussitôt qu’ils me voient, ils tournent le
dos prestement en s’enfonçant dans le boisé.
Il y a aussi des oiseaux en quantité impressionnante, pas seu-
lement aux mangeoires, mais partout à la ronde dans les arbres.
Certains jours de lumière, on entend des chants d’oiseaux dans les
hauteurs, j’ai souvent le sentiment d’un autre âge de la création.
Des jaseurs, qui passent l’automne dans le pommetier avec leur
masque aristocratique et qui reviennent au printemps comme
la réponse à une question oubliée. Des quiscales qui arrivent en
bandes tôt dans la saison et qui font la loi tout autour avec leurs
cris rauques, leurs voix biphones et fêlées, leurs cous bleus et
leurs corps noirs, leurs regards torves, sortes de chevaliers ailés
d’une seigneurie aussi terrible qu’inconnue. Des mésanges qui se
glissent discrètement à travers la pagaille en hochant de la tête
aux millisecondes avec leur tiiii tiuuuu caractéristique qui nous
tient le cœur éveillé même en hiver. Des cardinaux qui écla-
boussent le décor avec leur livrée écarlate, surtout la femelle qui
13
Reves2.indd 13 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
a des airs de carnaval des animaux avec sa crête étrange et son
corps rose saumon, toute sautillante sur mon balcon, dans une
danse incompréhensible et loufoque. Je vois souvent, perchés sur
les basses branches du bouleau blanc, des merles qui se donnent
des airs importants, gonflent la poitrine, comme un maire de
village avant un discours, puis éructent des ordres improbables
pour une assemblée absente. Dans ce paradis aviaire miracu-
leusement préservé, la mort guette toujours : Et in Arcadia ego,
je suis aussi dans le paradis, dit la faucheuse. Pour les oiseaux,
la mort a le visage des chats du voisinage ou des éperviers qui
sortent soudain de nulle part et attaquent sans avertir, repartant
avec le butin atroce d’un petit ou deux dans le bec ou dans les
serres. Mais pour mon humble cas à moi, pour ma petite per-
sonne humaine, ce sont les corneilles qui attendent patiemment,
par dizaines dans les hauteurs des grands frênes, qui guettent le
moment de ma mort pour fondre sur moi à toute volée. Elles
picoreront mon corps, ma chair sera déchirée, engloutie dans des
becs noirs et mes os se mêleront à la terre, deviendront mémoire
du sol.
Ces animaux semblent anachroniques sur nos terrains bien
aménagés. Pour les chevreuils, ce sont leurs anciens ravages
hivernaux, ils mangent les cèdres, les plantes arbustives, les
genévriers mêmes, malgré leur feuillage épineux. Je ne leur en
veux évidemment pas, c’était leur territoire bien avant d’être
le mien et c’était aussi celui des Abénakis pendant des siècles,
le vaste Waban-aki du peuple du soleil levant. Même avant la
grande migration d’Asie, avant la traversée de l’immensité de
la mer atlantique, ces animaux étaient là des milliers d’années
avant nous et ils reviendront brouter tranquillement nos ter-
14
Reves2.indd 14 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
rains quand tout sera fini, quand le Costco tout neuf sera en
ruine, dans cent ans, dans deux mille ans, quand nous laisse-
rons enfin tranquille cette Terre après l’avoir violée sans relâche
depuis que nous avons compris comment nous tenir debout sur
les branches des arbres, il y a treize millions d’années, quand
nous étions des homo Pierola et que nous avions les yeux jaunes.
C’est à ce moment-là que nous avons libéré notre cerveau, cette
bombe à retardement qui va tout faire exploser d’un moment à
l’autre – je me ravise : qui en vérité fait déjà tout exploser depuis
longtemps, avec une apparente lenteur à notre échelle, mais en
réalité avec une rapidité fulgurante qui ne laissera rien d’intact
avant que nous ayons le temps de réagir. Ce sera soudain, brutal,
implacable.
J’ai toujours eu le sentiment que ma maison avait été téléportée
sur son terrain et qu’elle n’a aucun rapport avec le paysage qui
l’entoure. Pas seulement la maison que j’habite maintenant, mais
celle de mon enfance aussi, et même celles de mes amis, de mes
grands-parents. Je ne peux me défaire de ce sentiment, il me suit
depuis ma naissance. Quand je lève le regard sur les alentours,
sur toutes nos rues, nos villes, ce sentiment m’envahit jusqu’à me
terrasser : qu’est-ce qui ne va pas dans nos têtes pour avoir besoin
de raser tout ce qui était là et de le remplacer par nos architec-
tures aux angles droits, rectangulaires, aux couleurs criardes qui
détonnent entre elles et qui créent des taches de laideur dans le
paysage ? Je comprends tout à coup le fantasme de l’architecte
américain Frank Lloyd Wright de maisons enracinées dans le
sol, en harmonie avec le lieu où elles sont érigées, ses fameuses
prairie houses. Nos maisons sont des espaces confinés et séparés
du sol sur lequel elles s’appuient pourtant. Elles n’ont plus de
15
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 15 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
lien depuis longtemps avec le territoire : les pierres et le bois qui
provenaient du lieu même où les maisons se tenaient debout
ont été remplacés depuis le haut Moyen Âge par des matériaux
de synthèse (le verre, le fer et bientôt le plastique) plus facile-
ment manufacturés et bientôt usinés, maintenant transportables
à grande échelle. Mon sentiment s’apparente à une trace mémo-
rielle, une sorte de souvenir d’avant ma naissance qui me rap-
pelle mon appartenance à une civilisation qui a été implantée sur
ce vaste territoire depuis seulement quelques siècles.
Le diagnostic me semble clair : nous souffrons d’une carence
mémorielle collective, nous avons perdu le sens historique et
biologique du territoire. Car, contrairement aux idées reçues, la
biologie ne s’oppose pas à l’histoire : ce sont simplement deux
vitesses différentes de la durée, l’une assez rapide, qui se compte
en siècles, l’autre beaucoup plus vaste et lente, qui se compte
en millions d’années. Ces deux vitesses se pensent ensemble,
dans une mémoire englobante du territoire qui touche autant les
plantes, les animaux, que les traces archéologiques de tous ceux
qui y sont passés.
C’est surtout la manière dont nous habitons le territoire qui
me stupéfie. À un laisser-aller écologique ravageur s’ajoute un
manque flagrant de culture historique qui laisse démolir tout un
patrimoine architectural dont il ne reste déjà presque plus rien.
La capacité de destruction du territoire que nous avons importée
en Amérique se retourne maintenant contre nous-mêmes : ce ne
sont pas seulement les maisons de la Nouvelle-France qui dispa-
raissent l’une après l’autre, ce sont aussi les églises, les demeures
anglaises du régime britannique, les granges rondes, les lieux
sacrés autochtones, les fermes de la Survivance. Il n’y en n’a plus
maintenant que pour le clinquant de la nouveauté coupée de
toute profondeur de champ historique et biologique. Je pense
soudain à l’essayiste Fernand Dumont, à son idée voulant que
16
Reves2.indd 16 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
seule la mémoire puisse donner un sens à la vie dans la matière et
dans le temps1. En formulant les choses de cette façon plus large,
Dumont n’était pas tellement éloigné des sagesses autochtones
qui ne posent de gestes qu’en pensant à sept générations plus
tard, sagesses vers lesquelles il nous faut à présent nous tour-
ner de toute urgence. C’est notre décalage inconscient qui me
semble maintenant une aberration, qui me l’a toujours semblé,
sans que j’ose me le formuler clairement.
Parvenu à ce degré de conscience de notre mémoire défail-
lante, je sens une profonde libération à l’affirmer : le Québec
n’est pas le seul en cause, c’est toute la planète qui souffre de
ce manque de savoir-vivre sur Terre. Le constat est sans appel :
nous ne savons pas habiter la Terre.
Cette évidence me semble tout dire de notre séparation
ontologique : nous sommes des créatures cartésiennes de la
scission entre sujet et objet, nous sommes les produits de la
rupture avec le milieu que nous exploitons sans relâche et qui
s’éloigne à proportion inverse du développement de nos villes et
de nos routes. Le pays n’est souvent plus regardé que comme un
paysage de carte postale, or, on ne regarde le territoire comme
un paysage, un pays sage, assagi, qu’au moment où l’on n’en fait
plus partie, qu’à cet instant précis où il est dorénavant conquis,
dompté, perdu, objet de contemplation pour un sujet désormais
désorienté et sans monde réel qui l’environne. On sait que la
peinture de paysage n’apparaît en Europe qu’à la fin du Moyen
Âge, précisément quand cette séparation ontologique s’accom-
plit et surtout quand on découvre le supposément nouveau
monde, alors qu’il était habité depuis des millénaires, et que les
Européens vont transporter ici leur impérieuse ignorance du
territoire. Nous habitons depuis ce moment dans cette brèche
étrange, dans cette absence de monde, dans une stupeur qui n’a
toujours pas trouvé son apaisement.
17
Reves2.indd 17 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Je suis de passage sur mon petit terrain, je le sais bien. Je ne plante
donc que des vivaces, pour qu’elles durent après moi. Beaucoup
de fleurs, idéalement des espèces indigènes. Des rhododendrons,
des iris que je trouve parfois dans le creux des fossés au chalet,
des roses trémières, comme celles que nos grand-mères plan-
taient le long des maisons, des liserons que l’on voyait encore
quand j’étais enfant sur les clôtures de perche, en bordure des
chemins dans Portneuf. Je plante surtout ce qui attire les polli-
nisateurs. Des ronces, des potentilles, des gadelliers, des sureaux,
d’immenses grappes de petits fruits que les oiseaux picorent à la
tombée de l’été.
Je me vois comme un jardinier du temps qui n’a qu’un seul
but : rendre au futur une parcelle de terre plus vivante qu’au
moment où je m’y suis installé, même si je sais très bien que
toute cette vie se fout éperdument de mes plans et des cadastres
archivés dans les mairies. Elle attend seulement que nous ne
soyons plus là pour croître à nouveau, sous des formes impro-
bables et imprévisibles. Ce bout de terre n’est pas à moi, même si
je possède un bout de papier sur lequel sont dessinées schémati-
quement les limites de mon espace. La Terre n’est pas à nous, elle
nous parle une langue que nous ne comprenons plus et qui pour-
suivra son discours de rêve et de mémoire longtemps après nous.
Et j’aime cette indifférence qui m’annule en me laissant m’agiter
à la surface des choses, tout en sueur, les mains terreuses, à tenter
de rétablir un équilibre qui se passerait facilement de moi. Cette
indifférence de la terre est une forme de pardon. C’est sa façon
silencieuse de me pardonner de la détruire, même en voulant
travailler à son bien. Je l’entends me dire : « Fais tout ce que tu
peux, ça ne sert à strictement rien, tout s’égalisera quand tu ne
seras plus là, quand ton espèce envahissante disparaîtra, d’ici
18
Reves2.indd 18 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
très peu de temps. Ça ne prendra qu’un instant, et zap ! vous ne
serez plus là et tout respirera. » J’ai regardé hier une vidéo d’un
paléobiologiste, il expliquait en toute tranquillité qu’au bout de
250 000 ans après notre disparition, il ne restera plus rien de
notre civilisation, même les déchets nucléaires seront redonnés à
l’équilibre éternel. Grande respiration, profond soupir.
Je communique avec la terre en y plantant mes mains. Je couvre
ma peau de tout ce temps accumulé dans la matière décomposée.
Toutes ces bactéries et ces virus invisibles, bien plus nombreux
que nous et qui se rendront à peine compte de notre disparition.
Ils forment la base de la vie, nous n’en sommes qu’une lointaine
descendance évolutive ayant jadis eu plusieurs branches, toutes
éteintes maintenant, sauf une, sapiens sapiens, la dernière, ne
menant nulle part ailleurs qu’à la destruction générale du pré-
sent âge de la vie sur Terre qu’on appelle maintenant l’anthro-
pocène. Je révère tous ces micro-organismes qui grouillent dans
le sol, qui viennent d’un passé immémorial. Ces animalcules
résisteront même à l’hiver nucléaire qui s’en vient. En jardinant,
je jase avec le passé de la Terre, avec son futur, avec les âges des
mondes révolus et à venir. Je prends conscience que je suis tra-
versé par les temps, transparent, invisible, je me fonds dans ces
mottes de terre, je suis moi-même ce tout petit territoire dont je
prends soin. Je suis une motte de terre qui parle. Et qui se taira
bientôt.
Le sol est une métaphore, bien sûr. Mais en même temps, il n’en
est pas une. Nous vivons dans une gigantesque image. Nous
19
Reves2.indd 19 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
aménageons nos terrains, nos villes, nos territoires en fonction
de cet imaginaire qui nous traverse sans se formuler et qui passe
pour aller de soi. Mais c’est en réalité une affaire qui dépasse
largement les individus, tout simplement parce que ce sont les
sociétés et les civilisations qui rêvent tout haut à des manières
d’habiter la Terre. Certaines sont destructrices, d’autres moins,
certaines à peine. Le célèbre autochtone Standing Bear parlait
des Anciens Sioux comme étant « épris du sol. La terre était
douce sous la peau et ils aimaient à enlever leurs mocassins et à
marcher pieds nus sur la terre sacrée2 ». Que la terre soit sacrée,
encore une fois, c’est une métaphore et ce n’en est pas une. C’est
une façon de considérer l’immense importance du sol, c’est vivre
en regard d’un terreau sous ses pieds qui provient d’un imagi-
naire millénaire qui a permis de conserver en Amérique du Nord
un patrimoine écologique presque intouché des milliers d’années
durant. Le « sol sacré » est donc bien réel, c’est une relation de
mémoire avec la Terre faite de respect et d’attention, de calme,
de lenteur, de passages des saisons dans l’attente de la suivante.
C’est dire que toute la suite écologique du monde dépend de cet
imaginaire du territoire, de ce respect attentif, de cette capacité
à s’asseoir et à ne rien faire pour observer le temps changer tout
ce qu’il touche.
Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d’eux
(René Char). Les poètes s’expriment souvent sous forme d’oracle,
ils lancent des énigmes qu’il faut déchiffrer peu à peu et qui, sou-
dainement, au détour d’une expérience de vie, de l’amour, d’un
deuil ou d’une naissance, deviennent tout à coup parfaitement
claires. Ce n’est pas pour être obscur par plaisir, c’est tout simple-
ment que la langue que je parle en sait plus sur moi que je n’en
20
Reves2.indd 20 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
sais sur elle. C’est le sens même de la littérature de faire surgir
ce savoir que je ne connais pas, de laisser la parole à des forces
enfouies, inconnues et de les approcher doucement. La littéra-
ture est une manière d’apprivoiser la stupeur d’être au monde.
Si je laisse enfin parler ces puissances obscures qui m’habitent
et que je cherche à distinguer leurs contours, à dessiner leurs
silhouettes, ces forces m’apparaîtront comme ce qu’elles sont si
je les habille de mes mots, et elles me diront qui je suis, elles me
redonneront une sagesse que seuls les animaux et les végétaux
connaissent. Le territoire parlera à travers ma bouche, il dira
avec mes mots et sans mon consentement des choses qui me
sembleront incompréhensibles d’abord, mais que je comprendrai
avec le temps et en suivant les événements de ma vie un à un.
Je ferai ici une sorte d’ethnologie de moi-même, une enquête sur
ma tribu si infatuée d’elle-même qu’elle oublie d’où lui viennent
ses prétentions. Notre rapport au territoire se révèle de la même
façon : nous habitons sur une parcelle de terre qui en sait plus
long sur nous que nous-mêmes. Bedagi ou Big Thunder, un
Abénaki qui vivait au tournant du xxe siècle, essayait d’expliquer
à des Blancs interloqués, au soir de sa vie, que les arbres parlent,
que la terre est une mère qui guérit par son chant3. Le discours
scientifique nous a appris à nous méfier de ce genre de prétention
guérisseuse et de ce que l’on qualifiait jusqu’à tout récemment
d’animisme, en désignant avec dédain ces croyances supposé-
ment infondées. C’est maintenant la science qui nous apprend
exactement le contraire et c’est Bedagi qui avait raison et tous les
Autochtones avec lui : oui, les arbres parlent, ils c ommuniquent
par un réseau fongique souterrain, ils partagent des ressources
par leurs racines, se préviennent du danger, élèvent les plus petits,
21
Reves2.indd 21 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
ont des relations, oui, la terre guérit, elle a le secret de tous les
maux du corps et de l’âme. Difficile aussi pour des Occidentaux
rompus à la critique scientifique de comprendre que le sol n’est
pas seulement plein d’organismes microscopiques et d’animal-
cules imperceptibles. Il est surtout plein de paroles et d’histoires
millénaires qui dorment là sous terre en attendant qu’on les
raconte, qu’on les chante, que le rêve leur donne vie et puissance.
Je ne connais ce pouvoir onirique du territoire que par bribes,
mais je sais parfaitement qu’il existe. Il y a quelques années, je
me suis réveillé en pleine nuit dans la réserve de Matane. Au
cœur du silence de cette forêt somptueuse, j’ai fait le rêve d’un
gigantesque orignal, ou plutôt : un original est entré dans mon
rêve. J’entends encore distinctement ses pas lourds en moi, leur
résonnance profonde dans le sol, comme un gigantesque tam-
bour battant. Je perçois toujours en moi sa respiration lente, je
vois son regard pesant se poser sur moi comme une question
lourde de sens. Il me regardait droit dans les yeux, prêt à char-
ger, comme pour me surveiller, pour s’assurer que je ne détrui-
rais rien. Je suis resté pensif et attentif à toute la forêt pendant
des jours après ce rêve, j’ai été saisi d’une crainte profonde qui a
quelque chose d’un silence sacré.
Toutes les nations autochtones connaissent ces gardiens
ancestraux du territoire qu’elles craignent et respectent. Je crois
que l’esprit des animaux parle encore à qui sait les écouter, à
qui prend le temps de poser sa tête sur le sol, de s’y reposer,
d’y dormir, d’y rêver, de sentir la légèreté des étoiles éclairer
son chemin. Nous sommes encore chrétiens, malgré toutes nos
prétentions athées, par la répression des rêves qui nous obs-
true encore l’imagination. Le grand historien Jacques Le Goff
a montré comment la civilisation chrétienne s’est édifiée sur
la confiscation du pouvoir onirique et sur le « refoulement des
rêves par le rêveur4 », pendant que les mondes autochtones ont
22
Reves2.indd 22 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
au contraire rêvé le territoire, ou, mieux encore, ont laissé le ter-
ritoire rêver en eux, comme Joséphine Bacon, qui, dans Un thé
dans la toundra, a fait ce « rêve de couleurs / [qui] me conduit au
chant / de mes ancêtres5 ». Apprenons à rêver le territoire, c’est
ainsi que nous lui redonnerons sa force.
Jardinier des paroles inouïes, archéologue de l’invisible, rap-
porteur de rêves immémoriaux, il me faut maintenant prêter
l’oreille à ces voix anciennes, murmures d’un monde qui refuse
obstinément de disparaître. Approchons notre tempe du sol,
écoutons les vibrations, ce sont les paroles de mondes anciens
qui nous survivront.
Le territoire n’existe pas tel qu’en lui-même, détaché de nous,
comme une chose sans vie que l’on contemple à distance, bien
en sécurité en se berçant sur la galerie. Le territoire n’est pas un
paysage conquis, ordœonné, dompté, mis en image et sérialisé,
prêt à être vendu en lots par des agences immobilières. Ça, ce
sont des terrains. Des morceaux morts de territoire qu’on débite
au plus offrant. Il faut oublier cette vision cadastrale des choses
pour comprendre le territoire vivant, pour entendre sa parole,
son chant et ses silences. Le territoire n’est même pas un espace
biologique, un « biotope » comme disent aujourd’hui les scienti-
fiques. Le territoire fait bien sûr vivre des animaux et des plantes,
qui retournent au sol à leur mort, l’enrichissent de leurs nutri-
ments par leurs fientes et leurs déjections, mais il ne se réduit pas
à la faune et à la flore, comme dans les capsules du patrimoine
de mon enfance.
Mais qu’est-ce alors que le territoire ? On dirait qu’on
manque de mots dans nos langues européennes pour dire cette
chose essentielle qui nous fait vivre et que nous sommes et que
23
Reves2.indd 23 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
pourtant nous méconnaissons profondément. Nutshimit, le ter-
ritoire nourricier, comme nous l’a appris Joséphine Bacon, et
tous les anciens Innus à travers elle. Comment dire cette chose
essentielle en français ? Je vais essayer ici de le formuler clai-
rement une première fois, quitte à corriger au fur et à mesure :
le territoire, c’est une relation, c’est le lien entre le sol et moi,
entre la terre et notre mémoire. La philosophe Hannah Arendt
disait qu’« un territoire n’est pas tant une étendue de terrain que
l’espace entre les individus d’un groupe dont les membres sont
liés entre eux, à la fois séparés et protégés les uns des autres,
par toutes sortes de rapports, fondés sur une langue commune,
une religion, une histoire commune, des coutumes et des lois6 ».
Le territoire, c’est la manière dont nous vivons, dont nous habi-
tons la Terre, la façon dont nous la nommons. C’est la manière
dont nous la rêvons, tous ensemble pris dans le même grand rêve
qu’on appelle « une société ».
Le territoire ne devient rien en lui-même de manière défini-
tive, il se plie aux changements que les humains, les civilisations
et les bouleversements climatiques lui font subir dans la très
longue durée. Mais il dure plus longtemps que tous ceux-là. Et
il accumule toute cette puissance imaginaire comme de l’humus
décomposé dans son grand corps, terre et mémoire emmêlées,
humus des âges et des temps, restes de rêves et de vies oubliées
dans le torrent éternel. Beaucoup plus qu’un simple terrain ou
qu’un beau paysage, au-delà de la scission entre la biologie et la
culture, le territoire est une terre de mémoire, une sorte de gar-
dien des temps, une mémoire-monde, un réservoir imaginaire
disponible et toujours actualisable. En un mot : nous donnons
forme au territoire en apparence, mais en réalité, comme pour
les mots selon René Char, c’est bien plus lui qui, de manière
silencieuse et inaperçue, fait de nous ses habitants, le temps d’un
clignement d’œil qui dure quelques siècles.
24
Reves2.indd 24 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
Le rêve qui fait vivre ce livre touche donc la mémoire du ter-
ritoire : de la même façon que la terre se compose de tout ce
qui s’y est décomposé au long de millions d’années, le territoire
est fait des images dont on l’a affublé et qui s’y sont évanouies
et enfouies les unes après les autres pour venir engraisser l’hu-
mus imaginaire de nos existences. Je suis persuadé que mon rêve
d’orignal géant a déjà été rêvé par d’autres marcheurs avant moi,
et avant eux par des chasseurs immémoriaux. Le territoire n’est
pas une donnée d’arpenteur ou de géomètre. Il n’existe pas en
soi, mais surtout en moi, en nous, dans cette relation essentielle
entre la terre et nous. Le territoire, ce n’est pas un terrain ni une
image de carte postale. C’est une force, une puissance qui vit
dans l’interstice entre le monde et moi, dans la relation entre les
réalités du terrain et notre imagination. Basculant de l’archéo-
logie à l’histoire des imaginaires, c’est le lieu à la fois matériel
et immatériel où les images et les matières se rencontrent. C’est
pourquoi le territoire garde en son ventre temporel les diffé-
rents imaginaires qui l’ont peuplé et habité, qui s’y sont enfouis
et désintégrés, en attendant d’être remis au monde, transformés,
renouvelés. Aller voir le territoire, l’arpenter de ses jambes, c’est
une expérience très personnelle, intime même, qui ne demande
pas forcément de l’analyse, mais qui se raconte ou se médite par
l’essai littéraire. Je ferai donc une sorte de marche en forêt avec
vous, en passant par les lieux historiques de l’imaginaire national,
qui commence avec le monde des Premières Nations et des Inuit,
auquel succède l’épopée de la Nouvelle-France, qui se poursuit
avec le roman du terroir, se déclame dans la poésie du pays, et
aboutit enfin au temps présent, celui de l’essai sur le territoire,
qui ouvre une nouvelle ère des liens entre la terre et la mémoire.
Cette catégorisation aux connotations hégéliennes demeure
25
Reves2.indd 25 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
grossière énoncée ainsi d’entrée de jeu, je vais l’affiner en avan-
çant avec vous plus au cœur de la forêt. Je m’en sers comme d’une
carte qui indique le sentier à suivre, c’est ma façon d’expliquer
que le territoire se transforme profondément avec nos manières
de l’imaginer. Quand on l’envisage comme une terre nourricière,
il prend la forme d’un cercle où tout est à sa juste place, puis,
quand on le regarde comme une terre à conquérir, il prend les
formes de l’épopée, où tout est blanc ou noir, le bien contre le
mal, la civilisation européenne contre la « barbarie » autochtone,
l’ordre des champs de blé contre le chaos de la forêt. Quand on
tente de raconter le territoire en empruntant le regard du roman
du terroir, celui-ci montre les valeurs opposées simultanément,
le mal et le bien, la civilisation et la « barbarie » ensemble, de
manière à neutraliser toute tension et à permettre l’installation
imaginaire dans un territoire désormais conquis, tandis que la
poésie, autant autochtone qu’euro-américaine, permet de faire
naître un sentiment nouveau de la présence ici, sentiment que
l’essai littéraire, dont le temps est venu, permet de renouveler en
décloisonnant ces oppositions héritées de la mémoire historique
québécoise.
Le territoire n’a rien de neutre, on ne peut même pas lui
donner une définition claire et nette tant il change dans le temps
et dans l’imaginaire des peuples. Parler du territoire, c’est donc
aller à la rencontre de tous ceux qui y vivent et s’en soucient,
mais aussi des peuples qui l’ont habité et aimé, qui en ont pris
soin ou l’ont exploité. Les Premières Nations et les Inuit bien sûr,
mais aussi les Vikings, les Basques, les Bretons, les E uropéens,
les colons, tous ces peuples venus de partout, les Irlandais, les
Écossais, les Scandinaves, les Vietnamiens, les Sénégalais, les
Congolais, et enfin ces cravatés de nulle part venus saccager et
piller le territoire jusqu’à le vider de toute substance, de toute
âme, de toute vie et que, rendu exsangue à l’âge de l’anthropocène,
26
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 26 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
saturé de matières pétrolifères, plastiques et carburants déversés
sur le sol et dans l’atmosphère, sur les terrains de leurs temples
érigés à la vacuité, à la surface de gigantesques coupes à blanc, il ne
reste plus aucun vers de terre, aucun scarabée, plus rien de vivant.
Le territoire sera alors devenu ce que nous aurons fait de lui :
un champ de ruines, une apocalypse modelée par l’appel inces-
sant du désastre qui nous taraude depuis notre venue au monde.
Peut-être est-ce là notre mission inavouable et terrible, le
pourquoi de notre raison d’être que nous cherchons tant, qui
nous projette dans l’angoisse quand nous nous y arrêtons un
instant et pour laquelle l’évolution aurait eu besoin de nous :
détruire cet âge de la vie sur Terre. Un peu comme ce météore
de 81 km de diamètre tombé sans avertissement dans le Yucatan
à la vitesse folle de 21 km/s. Cet astéroïde a sans doute mis fin
à l’ère secondaire de la vie sur Terre, il y a 66 millions d’années,
avec l’extinction des dinosaures et le début du règne des mam-
mifères. Notre rôle bien précis dans l’ensemble de la vie serait de
remplacer le météore et d’effectuer sa tâche colossale en quelques
milliers d’années seulement. C’est-à-dire, à l’échelle géologique,
presque instantanément. Nous sommes nous-mêmes les exécu-
tants de l’apocalypse que nous redoutons tant. Nous sommes des
météores qui explosent lentement et avec fulgurance. C’est ce
que les astrophysiciens appellent le plus sérieusement du monde
The Great Filter. Le filtre qui empêche les civilisations de se
développer au-delà d’un certain degré de technologie et qui les
fait s’effondrer sur elles-mêmes. Comme des météores parcel-
laires venus par milliards incendier les territoires de vie, nous
allons par notre puissance de destruction donner naissance à un
univers qui se passera très bientôt de nous.
27
Reves2.indd 27 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Comment en est-on arrivé à ce territoire vidé de présence
ancienne ? C’est un peu l’archéologie de ces bouleversements
imaginaires que je veux faire ici, ce long processus de destruc-
tion de la relation de plénitude que les Premières Nations et les
Inuit entretenaient avec le territoire, qui passe par l’imposition
de la mystique chrétienne du défrichement, ensuite par la neu-
tralisation des forces du territoire changé en paysage, enfin par
la poésie du pays qui accapare les ressources imaginaires du ter-
ritoire pour se déplacer sur le territoire urbain et ainsi, à terme,
vider l’arrière-pays de toute présence ancestrale.
On ne peut vider le territoire ainsi sans créer un puissant contre-
coup imaginaire que l’on voit aujourd’hui dans l’ouverture de
mémoire des écrivains, des peintres, des cinéastes où ces diffé-
rentes strates d’habitations passées du territoire ressurgissent.
De la même façon qu’en jardinant j’engage une conversation avec
les âges de la terre, je vais tenter dans ce livre, depuis le silence
de ma bibliothèque et depuis ma mémoire du territoire, depuis
l’écoute des voix chères qui se sont tues, de celles qui parlent
toujours, de celles qui ne parlent pas encore, d’entendre les mur-
mures sans origines qui nous ont précédés et qui parlent toujours
à qui sait écouter et même à toutes ces consciences qui ne sont
pas encore nées. Je vais aussi mobiliser mon expérience subjec-
tive du Québec, mon humble connaissance faite en marchant en
silence dans de longues randonnées, dans des parcs nationaux,
dans des chemins perdus autour des chalets dans Portneuf, en
Estrie ou dans mes lointains souvenirs des Laurentides, dans
des excursions souvent improvisées en Minganie, à Radisson,
en Mauricie, dans le Saguenay, dans l’Outaouais, dans le sentier
international des Appalaches au cœur de ma chère et précieuse
28
Reves2.indd 28 2023-06-22 13:34
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
réserve de Matane. Je confesse ma presque ignorance du Grand
Nord, je n’y suis allé que tout petit quand je devais suivre malgré
moi les grandes équipées de mon père. J’avais quelques mois,
mon corps s’en souvient peut-être, mais je n’en ai plus d’images
que par des photographies toutes jaunies par le temps. J’ai deux
mois, je suis minuscule à côté de ces bêtes immenses et obstinées
que sont les bœufs musqués. La Koksoak puissante et magni-
fique coule éternellement juste à l’arrière-plan de cette vieille
photo. Je ne m’en souviens absolument pas, mais pourtant tout ça
reste flottant en moi, aucun souvenir précis, mais une force qui
parle encore et qui me fait écrire.
Le territoire, c’est une relation avec la Terre, j’irai donc à la
rencontre improvisée de gens qui me seraient demeurés incon-
nus sans ce souci commun de rêver la mémoire et l’avenir de la
Terre. Ce seront des cinéastes, des autochtones, des artistes, des
voix d’écrivaines qui m’y amèneront, des écologistes, de simples
citoyens, ceux qui gardent le territoire contre la destruction qui
avance jusqu’à sa fin dernière. Je vais mobiliser des expériences et
des connaissances qui me serviront dans cette volonté d’écouter
et d’interpréter à mon tour ce retour du refoulé dans l’imaginaire
du territoire en me mettant à l’école de tous ceux qui entendent
ce requiem éternel des voix enfouies dans le sol depuis des siècles.
Reves2.indd 29 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 30 2023-06-22 13:34
UN TROU DANS LE PRÉSENT
Les historiens et les sociologues parlent de notre monde
contemporain comme d’une période obsédée par le présent, ils
ont appelé ce phénomène « le présentisme1 ». La perte d’illu-
sions sur les lendemains qui chantent depuis la chute du mur de
Berlin en 1989 et le sentiment que le passé s’éloigne inexorable-
ment dans un univers dorénavant mondialisé ont isolé le présent
sur lui-même. Le Québec n’échappe pas à cet enfermement d’un
présent vécu séparément du passé et coupé en apparence de tout
avenir. Mais il faut être prudent, car rien n’est simple. Si l’on
porte attention à certaines œuvres d’imagination, on peut voir
que le présent n’est pas aussi lisse et uni qu’il semble à première
vue. Certains films, certains romans, peuvent même laisser com-
prendre que, dans l’imaginaire du territoire, un trou s’est creusé.
Je dirais même que le sol du présent, apparemment si stable et si
ferme, s’est affaissé ces dernières années d’une manière étrange et
soudaine. C’est ce qui se produit dans le film Hochelaga, terre des
âmes de François Girard (2017) et dans le roman Le nid de pierres
de Tristan Malavoy (2015). Dans Hochelaga, un sinkhole, c’est-
à‑dire un trou parfaitement rond causé par l’effondrement d’un
31
Reves2.indd 31 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
terrain souterrain, s’ouvre en plein match de football au stade
Percival-Molson et dans Le nid de pierres, un ventre-de-bœuf
d’un terrain vague de Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie, pro-
voque un affaissement du sol au creux d’un cercle de pierres.
Dans les deux cas, la porosité du sol ouvre un cercle magique
qui découvre un passé autochtone. Dans Hochelaga, les fouilles
archéologiques débouchent sur la redécouverte fictive du vil-
lage iroquoien d’Hochelaga au xvie siècle, en 1535, à l’époque
de Jacques Cartier et des Iroquoiens du Saint-Laurent. Dans le
cas du Nid de pierres, un trou de boue encerclé de pierres permet
de découvrir le passé immémorial de la nation abénakise sur le
territoire de laquelle se trouvent aujourd’hui l’Estrie, le Centre-
du-Québec et quelques États américains, dont le Maine et le
Vermont. Le trou creusé dans le présent par les forces telluriques
permet de plonger dans le passé du territoire, jusqu’au xiiie siècle
dans Hochelaga et avant la présence des Blancs dans Le nid de
pierres. De toute évidence, ces deux œuvres témoignent d’une
résurgence d’un imaginaire autochtone au cœur même du récit
national québécois. Beaucoup plus qu’un simple effet de mode,
elles montrent que la toute-puissance du présent ne repose que
sur une fine particule de mémoire qui peut s’effondrer à tout
moment et nous faire redécouvrir le vaste terreau d’expérience et
de mémoire au-dessus duquel nos vies s’agitent. Ces deux récits
signalent que le temps est venu de rêver différemment le terri-
toire et d’écouter les voix du sol ancestral.
Hochelaga et Le nid de pierres répondent à un vaste appel de
mémoire en montrant que la mémoire et le sol se répondent,
c’est-à-dire que la terre est une mémoire archéologique du
vivant, mais aussi, inversement, que la mémoire parle grâce au
sol parce qu’il forme une sorte de caisse de résonance des voix
qui y sont restées à travers le temps. Le territoire est un vaste
tambour. Dans Le nid de pierres, le trou dans le présent effectué
32
Reves2.indd 32 2023-06-22 13:34
UN TROU DANS LE PRÉSENT
par le cercle de pierres laisse s’échapper des histoires d’un autre
temps, celui où les Abénakis, le peuple du soleil levant, vivaient
selon leurs coutumes ancestrales au cœur du Wabanaki, le terri-
toire ancestral des cinq nations de la confédération abénakise. La
situation initiale de Thomas et Laure, les protagonistes du Nid de
pierres, représente parfaitement le roman québécois récent, centré
sur le présent de l’urbanité montréalaise, avant que l’espace rural
ne reprenne ses droits. Mais dès le départ, ce roman tourne en
quelque sorte le dos au présent urbain en racontant l’installation
à Saint-Denis-de-Brompton d’un jeune couple branché désirant
rompre avec cette vie stérile et fonder une famille en campagne :
le futur d’un enfant réapparaît soudain en même temps que le
territoire du passé, celui de leur enfance, dans un geste qui tente
de mettre le présent à distance, comme pour conjurer l’oubli des
dernières années. Et c’est alors que la mémoire revient, en même
temps que le territoire.
La mémoire. On a l’impression que le passé se recouvre peu
à peu d’une poussière qui en efface les contours, on est conti-
nuellement déçu d’elle, la mémoire, parce qu’elle ne redit que
par bribes les événements d’il y a quelques années, comme
un corps de métal immergé, rongé par la rouille et qui, une
fois sorti des eaux, raconte à grand-peine une histoire trouée.
Mais voilà que frottée à des circonstances particulières, la
peur, l’absence, ou par ce dispositif secret qui a pour déclen-
cheur un grain de voix, de peau, une odeur dans le vent, la
même mémoire nous redit des pans intacts d’hier2.
Et c’est toute une civilisation qui ressurgit par la mémoire
archéologique du cercle de pierres duquel émane le passé d’un
enfant abénaki ayant vécu des siècles plus tôt sur le territoire
en suivant les coutumes ancestrales. Cette enfance relaie toutes
les enfances : celle du narrateur qui retrouve la sienne à Saint-
Denis-de-Brompton, celle de l’enfant abénaki qui grandit des
33
Reves2.indd 33 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
siècles plus tôt sur le wabanaki ancestral et celle de l’enfant qui
naît à la toute fin du roman, comme une société nouvelle qui sera
à la fois celle des Abénakis et des Blancs, dans un grand cercle
de pierres qui parlent. Ces trois enfances se répondent à travers
le sas temporel du nid de pierres et dans l’espace de mémoire
retrouvé du sol où la mémoire est restée intacte.
Dans Hochelaga, les objets découverts par le narrateur, d’ori-
gine mohawk, dans la fouille archéologique au stade Percival-
Molson permettent de raconter des moments chargés de l’histoire
du Québec. Une plaque de fonte raconte la Nouvelle-France,
les coureurs des bois et les Autochtones. Des fusils rouillés
remettent en mémoire la lutte des Patriotes de 1837-1838, et
une croix fait revivre Jacques Cartier à Hochelaga en 1535. Ces
objets enfouis dans le sol portent avec eux une mémoire narra-
tive qui fait parler le temps et les époques entremêlées. Ce ne
sont pas des artefacts réels, bien sûr, mais ce sont par contre de
véritables matières d’une mémoire vivante et qui ne demande
qu’à être racontée.
C’est l’imaginaire du territoire qui permet à ces récits de
remonter à la surface par le trou magique creusé à même le pré-
sent. Et c’est par cette bouche d’ombre que le territoire s’exprime.
Lorsque l’on remue le terreau de notre mémoire tellurique, com-
ment serait-il possible que ces milliers d’années de présences
autochtones ne ressurgissent pas ? Mieux encore, ce sont les
Premières Nations et les Inuit qui vont nous apprendre comment
parler aux morts enfouis dans le sol des mémoires et surtout
comment les écouter. La tradition chrétienne, issue du monde
gréco-romain, pose un bloc de pierre sur le tombeau des morts
afin que les cadavres ne se réveillent pas et que les puissances du
34
Reves2.indd 34 2023-06-22 13:34
UN TROU DANS LE PRÉSENT
territoire restent bien enfouies dans le sol. Le scénario de base
d’un film d’horreur d’aujourd’hui joue sur cette frayeur de voir
les morts revenir parmi nous et se mélanger aux vivants, comme
si nous avions une peur sans nom de ce qui dort sous nos pas.
Beaucoup de cinéastes contemporains, comme Robin Aubert
dans Les affamés, jouent avec ce sentiment de panique qui nous
saisit au moment où l’on sent les forces du territoire reprendre
vie. Tout est organisé dans nos sociétés postchrétiennes pour que
le monde des morts et celui des vivants ne communiquent pas,
pour que le territoire demeure exploité, foulé aux pieds, comme
le très-chrétien saint Georges écrasant le dragon sous sa botte.
Nombre de rituels autochtones, comme la Fête des âmes des
Wendat, visent au contraire à faire s’interpénétrer les esprits des
morts et ceux des vivants, et pas seulement à l’Halloween, mais
de manière prolongée sur de longs cycles de vie. Cette média-
tion s’accomplit précisément par l’imaginaire du territoire : en
ouvrant le sol à fréquence plus ou moins régulière, aux dix ou
quinze ans, en déterrant les cadavres des Anciens, en astiquant
leurs os, en nettoyant leurs chairs souvent à peine décomposées
pour ceux parmi les plus récemment décédés, les Wendat scel-
laient une alliance renouvelée entre les clans, mais aussi avec les
morts, avec le réservoir de passé enfoui dans le sol et mobilisable
à l’infini, au gré des déplacements de la nation. Longtemps nous
avons tout fait pour écraser les voix du sol, en les enfouissant
sous des murmures en latin, comme pour envelopper les corps
dans une langue elle-même morte, puis en enfermant les cendres
des morts dans des urnes bien scellées et surtout détachées de
toute puissance tellurique. De cette façon, la force magique du
territoire demeure enclose, neutralisée. Nous sommes tout juste
en train de réapprendre à communiquer avec ce qui se cache
dans le sol et qui continue d’exister même si nous n’y portons
aucune attention. C’est à ces imaginaires archéologiques que je
35
Reves2.indd 35 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
veux donner voix à mon tour. Bouche d’ombre, parle-moi lente-
ment avec ta grosse voix grave de ces anciens mondes qui ont fait
de moi ce que je suis.
Cet imaginaire archéologique contemporain est le symptôme
d’un affaissement de terrain qui n’a rien de banal. La lisseur
du présent qui recouvrait la mémoire s’est fissurée pour laisser
ouvert et disponible tout un terreau de sens qu’il nous faut
désormais apprendre à cultiver, à développer et à réinterpréter.
Le sol imaginaire du Québec est assez riche et nous en sommes
maintenant suffisamment détachés pour générer une attraction
assez puissante pour que des écrivains, des cinéastes ressentent
cet appel de voix enfouies et qui parlent à qui sait les entendre
et surtout pour que le plus grand nombre de gens les entendent.
Dans toutes ces œuvres que je vais évoquer ici et là dans ce livre,
un imaginaire du territoire exprime une trouée du présent, une
brèche dans la lisseur des vies contemporaines qui laisse revenir
à la vie des présences en les racontant, en faisant de leur dispa-
rition un événement de mémoire où les temps et les époques se
mélangent dans ce grand chambardement.
Reves2.indd 36 2023-06-22 13:34
Cornelius Krieghoff, Camp de chasse, en hiver, 1858.
Huile sur toile, 48,5 × 65,5 cm. Collection Pierre Lassonde.
Au Québec, tout commence avec l’hiver. L’inscription européenne dans le ter-
ritoire a d’abord été le fait de ceux qui passent le test de l’hiver, en suivant
évidemment les manières de faire des Premières Nations : Jacques Cartier en
1535 sauvé par le miracle iroquoien de l’annedda, Champlain au tout début
du xviie siècle et l’Ordre du Bon Temps, puis les coureurs des bois et les mis-
sionnaires qui, comme Paul Lejeune en 1635, survivent à l’hiver grâce aux
Innus, ou Jean de Brébeuf grâce aux Wendat. Avec l’installation des Français,
ce sera bientôt le temps des « hivernants », de ceux qui restent dans les Pays-
d’en-Haut par-delà l’hiver, à la différence des simples engagés qui repartent en
Europe une fois leur contrat échu. Mais les hivernants ne sont pas non plus
« les mangeurs de lard », c’est-à-dire ceux qui font la navette commerciale entre
les postes de traite et les villes de la colonie et qui se disperseront dans le vaste
territoire de l’Amérique du Nord, sur le dos de la Grande Tortue. La partie de
chasse sportive que Krieghoff peint en pleine période de la Survivance porte la
mémoire de cette adaptation séculaire à l’hiver, sur les traces et au détriment des
Premières Nations, qu’on voit ici servir de guides aux Blancs dans leurs propres
forêts ancestrales. On retrouve ce schéma du territoire médiatisé par les Pre-
mières Nations et les Inuit partout dans la culture québécoise, depuis Krieghoff
jusqu’au film célèbre de Pierre P errault, La bête lumineuse (1983), qui met en
scène des Blancs qui refont à leur façon carnavalesque le rituel de la chasse sur
les terres autochtones guidés cette fois par un Algonquin, Barney, qu’on laisse
assister silencieusement à toutes ces scènes où les Blancs « se passent le panache ».
Reves2.indd 37 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 38 2023-06-22 13:34
ENFANCE DU TERRITOIRE
Si je remonte le chemin sans fin de ma mémoire du territoire,
j’ai des sensations en pagaille avant d’avoir des images claires
d’où je suis, de qui je suis. Je ferme les yeux et je sens distincte-
ment en moi la brise sur ma peau d’enfant, la lumière qui pleut
sur mon corps déjà habitué aux coups de soleil, l’odeur terreuse
de l’eau du lac où je passe mes étés. Je touche presque du doigt
les poissons innombrables, je me baigne parmi eux, je les pêche
dans l’eau claire, comme les grenouilles que j’attrape à mains
nues ou les écrevisses dont je trouve chaque fois les cachettes
sous les roches, tout près de l’immense plage de sable où je passe
mes journées de cette enfance faite des courses fin seul dans la
montagne, à suivre les rigoles qui remontaient les vieux chemins
de bûcherons, des feux de bois dans ce grand dehors quand mon
père faisait le ménage de la petite forêt, des orages puissants qui
faisaient trembler le roc sur lequel le chalet s’appuyait, un peu
chambranlant, de la pluie qui giclait sur les fenêtres pendant des
heures, des mulots qui couraient dans les couloirs menant à nos
chambres, de l’odeur du gaz propane dans ce chalet du Lac-aux-
Sables, dans Portneuf, quand j’étais encore enfant, il y a mille
39
Reves2.indd 39 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
ans et que j’avais l’impression de naître dans un monde où rien
n’aurait dû être enlevé ou ajouté. Tout était parfait, c’était la vie
comme elle devait être et rester. C’était l’enfance du monde qui
laisse à tout ce qui suit une touche artificielle, l’impression d’une
déviation accidentelle qu’on aurait pu éviter, comme dans un
mauvais rêve où l’on se retrouve pris dans une situation impro-
bable, on voudrait secouer la tête vivement sur l’oreiller pour
réussir enfin à tout faire disparaître et à revenir au cœur vivant
du monde.
Après ces détours de la vie d’après l’enfance, je sais mainte-
nant que ce paradis n’était pas seulement le mien, mais qu’il rece-
lait la force de vie millénaire des Wendat : c’était la puissance de
vie du Nionwentsïo, « notre magnifique territoire », dont Portneuf
fait partie. Cette force ancienne est aujourd’hui striée de routes
asphaltées, d’autoroutes, rasée par des coupes à blanc, ses lacs
sont pollués, ses poissons contaminés par les égouts municipaux
et par les produits agricoles, ses rivières asséchées par l’étalement
urbain. Le cauchemar de la vie d’après l’enfance du territoire n’a
toujours pas pris fin pour le Nionwentsïo. Comment se réveiller
d’un tel mauvais rêve ?
Reves2.indd 40 2023-06-22 13:34
Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Dégel d’avril à Arthabaska, 1919.
Huile sur toile, 73,3 × 93,2 cm.
Collection du Musée national des beaux-arts du Québec.
Dès les premières expériences européennes en terre d’Amérique, l’émerveil-
lement du printemps prend place parmi les plus grandes joies qui soient.
Champlain ne tarit pas d’éloges sur la santé recouvrée soudainement après
des mois d’hivernement maladif, les jésuites sont stupéfaits devant la fonte de
toute cette neige en quelques jours. Le printemps québécois s’expérimente à la
façon d’une convalescence renouvelée chaque année qui fait trouver extraor-
dinaire le recouvrement de ce qui était déjà là avant l’hiver, d’où peut-être
la secrète résilience des peuples du Nord. Ce changement de décor annuel
donne à Suzor-Coté l’un de ses plus beaux sujets et lui permet de laisser la
pâte de la matière jouer de son irisation dans la lumière impressionniste.
J’aime croiser dans le regard de mes étudiants du Cégep de Drummondville
la stupeur de découvrir un coin de leur pays qu’ils connaissent sou-
vent intimement et pourtant là devant eux sur les toiles de Suzor-Coté (la
rivière Nicolet, les Bois-Francs). L’art alors ouvre leurs yeux sur l’ici même,
sur la beauté d’être vivant dans un corps de matière traversé de lumière.
Reves2.indd 41 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 42 2023-06-22 13:34
UN CORBEAU DE PIERRE
Monts Valin, été 2020, avec mes filles Romane et Laure, 11 et
9 ans, ascension du Pic-du-Grand-Corbeau. Au beau milieu de
la randonnée, Laure s’exclame : « Papa, papa, regarde le corbeau !
Il est gigantesque, on dirait qu’il va s’envoler ! » Je n’ai d’abord
pas compris de quoi elle parlait. Nous étions dans un col étroit,
longeant le sentier entre deux hautes crêtes au cœur d’une végé-
tation luxuriante, on traversait sans cesse de petites rigoles qui
délitaient les balises du chemin en nous laissant nous enfoncer
dans le sol, parfois jusqu’au genou. J’avais du mal à garder mon
équilibre, j’avançais en souhaitant seulement que personne ne
se foule une cheville. Puis, en levant la tête, ça m’est apparu :
les immenses pierres du Pic-du-Grand-Corbeau étaient devant
nous et leur alignement hasardeux à travers les siècles ressem-
blait à s’y méprendre à un crâne de corvidé. On voyait même son
œil dans l’effondrement des pierres. Un trou caverneux où avait
dû se loger jadis une chouette ou un rapace. Mes filles se sont
mises à improviser sur-le-champ l’histoire d’un petit garçon qui
voulait apprendre à voler et qui avait demandé ce don au grand
43
Reves2.indd 43 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
esprit en échange de son âme pour l’éternité, d’où sa fixation en
forme de pierres géantes au bord d’une falaise.
Mes filles avaient saisi d’un seul coup le regard d’images du
territoire. Cet œil creux d’un gigantesque corbeau de pierre que
mon attention parentale, obsédée par la sécurité, par le chemin à
suivre, avait manqué. Elles avaient vu la capacité mythologique
du territoire, sa métamorphose incessante, sa puissance de trans-
formation, sa parole de vibrations invisibles rendue apparente
soudain sous la forme d’une image de corbeau sur les hauteurs
désertées. Elles avaient vu non pas des pierres, un col de mon-
tagne, de la matière entassée d’une certaine manière, mais la
montagne comme une image vivante prête à s’envoler. Grâce
à ce regard fabulateur, qui laisse le territoire se raconter à tra-
vers notre propre imagination, on arrive à comprendre l’incom-
préhensible : qu’une présence est logée au cœur de la pierre et
qu’elle ne demande qu’à être racontée, divinité improvisée aux
visages innombrables. C’est ce regard qui a guidé les premiers
habitants de ce territoire pendant des milliers d’années et c’est
cette attitude d’écoute humble et imaginative, enfance et sagesse
millénaire entremêlée, qu’il nous faut retrouver pour vraiment
l’habiter, pour qu’il parle en nous, qu’il nous raconte son his-
toire à travers notre propre bouche, dans nos propres mots, qu’il
connaît beaucoup mieux que nous, puisque nous sommes faits
de sa matière même.
Reves2.indd 44 2023-06-22 13:34
LA CIRCULATION DES RÊVES
Tu parles d’étoiles
Je te parle de rivières
Tu parles d’astres
Je te parle de lacs
Tu parles de l’infini
Je te parle de la toundra
Tu parles d’anges
Je te parle d’aurores boréales
Tu parles des cieux
Je te parle de la terre
Joséphine Bacon, Uiesh – Quelque part
« Nutshimiu tshuauitamatin », je te parle de la terre et non des
cieux. Toute la différence du monde se trouve dans ces quelques
mots qui expliquent mieux que tout commentaire le pro-
fond malentendu entre les cultures autochtones et l’Europe
dès l’époque des premiers contacts. Et cette incompréhension
mutuelle porte précisément sur ce qu’est le territoire. D’un côté,
une relation de subsistance spirituelle profonde d’une patience
d’au moins 18 000, sinon 30 000 ans et peut-être plus encore, des
45
Reves2.indd 45 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
fouilles archéologiques récentes parlent même de 130 000 ans.
De l’autre, une construction symbolique passée d’un empire à
l’autre (Mésopotamie, Égypte, Grèce, Rome, Europe) et exportée
brutalement sur le territoire américain. La tradition chrétienne
s’instaure par une séparation territoriale fondamentale entre ce
monde-ci et l’autre, d’où les humains proviennent mais d’où ils
ont chuté. Cette séparation constitue le fondement du sacré occi-
dental, le kadosh de la religion juive, la sainteté du monde chré-
tien. D’un côté ce qui tient du divin, de l’intérieur immatériel et
sacré des choses, maison de dieu, temple de la pensée, de l’autre
ce qui déchoit dans le profane, dans la matière, à la sortie du
temple (pro-fanum), hors du cercle magique du sacré. Il y a bien
sûr beaucoup de nuances à faire entre les différentes traditions
occidentales, mais il demeure une idée commune de séparation
originelle entre la puissante transcendante et le monde d’ici-bas.
La vie humaine se passe dans cette tradition occidentale à tenter
de retrouver la voie juste pour accéder à une survie spirituelle
bienheureuse. Nul doute que cette tradition judéo-chrétienne
forme un ensemble assez cohérent avec des traditions venues du
monde égyptien et suméro-akkadien qui font du territoire d’ici-
bas un succédané inférieur à un territoire spirituel perçu comme
meilleur et souhaitable. Le plus ancien récit occidental que nous
connaissions, L’épopée de Gilgamesh, présente la vie des humains
comme une quête vaine de l’immortalité où même le plus puis-
sant des hommes doit apprendre à vivre avec l’imperfection,
le deuil et la mort. Pour les Égyptiens du Nouvel Empire, ce
monde-ci est aussi séparé radicalement du champ des roseaux
auquel accèdent les justes en suivant les indications du Livre
des morts après la pesée de leurs âmes à la fin de leur vie. C’est à
partir de cette tradition que s’instaure un accès au transcendantal
par le moyen de l’abstraction écrite. On reconnaît dans toutes ces
traditions la séparation entre deux territoires où règnent d’un
46
Reves2.indd 46 2023-06-22 13:34
LA CIRCULATION DES RÊVES
côté le bien, l’immortalité et l’écriture, tandis que de l’autre se
trouvent le mal, la mort et la parole évanescente de l’oralité. En
un mot, l’imaginaire occidental a fait du territoire réel où nous
vivons un monde indésirable, sans âme, que l’on doit s’efforcer de
supporter toute une vie durant pour accéder après la vie au véri-
table territoire de l’immortalité, formule écrite et magique qui
change les signes fluctuants de la parole en territoire permanent
du bien. On n’a pas à chercher très longtemps d’où nous vient
notre mépris du territoire : il est inscrit dans notre culture depuis
des milliers d’années.
En poussant plus avant cette quête du territoire réel et ma fas-
cination pour les cultures autochtones, je découvre que j’avais
déjà commencé à penser confusément tout ceci dès mon premier
texte publié au début des années 2000. Il s’intitulait « Croire à
ce monde-ci », et c’était un texte posé en liminaire du premier
numéro de la revue Contre-jour. En méditant le livre de Pierre
Vadeboncoeur, Essais sur la croyance et l’incroyance, j’y développais
l’idée que la question de la croyance était très mal posée dans
nos sociétés contemporaines, que le choix de croire ou de ne
pas croire n’épuisait pas toutes les options possibles, car on peut
très bien croire à un monde que l’on a devant soi, c’est même
le plus difficile, ne pas fuir dans les arrières-mondes, essayer de
rester présent avec le plus d’intensité possible, au plus rapproché
de la source de vie qu’est le territoire. C’est maintenant que je
découvre en lisant, en écoutant les voix qui portent les sagesses
autochtones, que je marchais dans un chemin millénaire mais
caché, dont les bifurcations échappent au plus grand nombre.
Enfonçons-nous-y plus avant.
47
Reves2.indd 47 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Au moment du contact entre l’Europe et les Premiers Peuples,
c’est cet univers mental qui se heurte à une compréhension
totalement étrangère à ce que signifie notre présence ici-bas.
Le jésuite Paul Lejeune s’étonnait en 1636 que pour les Innus
l’autre monde soit parfaitement contigu à celui-ci et qu’après la
mort les âmes aillent « en un grand village situé où le soleil se
couche » et mangent pendant le trajet des âmes d’écorces et des
âmes d’animaux en marchant sur l’âme de la neige. L’objection
rationaliste du chrétien surgit tout de suite : quand ces âmes
meurent, « ont-elles une autre âme qui s’en va en un autre vil-
lage ?1 » La vision « immanente » d’un Innu du xviie siècle pro-
voque un dédoublement du monde dans l’esprit d’un Européen
puisque cette séparation entre sacré et profane n’existe pour ainsi
dire pas dans les cultures autochtones. Pour les Premiers Peuples
des Amériques, ce monde-ci n’est pas fondamentalement séparé
de l’autre, on y accède justement par le territoire, qui n’est pas
un espace de malédiction mais au contraire : le territoire est
lui-même le paradis et l’après-vie n’en est que le prolongement
bienheureux. L’Innu interrogé par Paul Lejeune ne saurait ima-
giner un plus merveilleux monde que celui qui lui est donné,
qui le nourrit et qui assure la survie de sa descendance. Pour les
Hurons-Wendat, ce monde-ci est en lui-même suffisant parce
qu’il est peuplé spirituellement, comme nous l’apprend Georges
Sioui : « Les Hurons vivaient dans un monde où tout ce qui exis-
tait, même les objets fabriqués de main d’homme, avait une âme
et jouissait de l’immortalité2. » « L’animisme » est ainsi répandu
dans l’ensemble des nations autochtones, au point où les Inuit
avaient quantité de rituels pour atténuer la culpabilité de se
nourrir d’âmes pour survivre. Ce monde-ci n’est en un mot pas
un lieu de damnation où l’humanité aurait chuté et devrait se
48
Reves2.indd 48 2023-06-22 13:34
LA CIRCULATION DES RÊVES
débrouiller pour trouver une voie de sortie vers la lumière divine,
mais au contraire c’est un monde plein, entier, suffisant en lui-
même. Ce n’est pas pour rien qu’en arrivant en Amérique les
Européens recyclent le mythe du paradis terrestre : c’est que le
territoire a été rêvé comme paradis par les Autochtones depuis
des millénaires, quand bien même la vie qu’ils y menaient était
d’une dureté qu’on imagine à peine. Les Européens se sont
insérés malencontreusement dans cette relation féconde entre
l’homme et les forces naturelles qui avaient fait du territoire
autochtone une terre nourricière de rêve et de puissance imma-
nente. Les Européens ont transporté par-delà l’Atlantique leur
vision de la forêt, qui est depuis l’Antiquité une terra nullius,
terre de personne, lieu de perdition où règnent le profane, le
sombre et le mal et qui pour cela doit être éradiquée avec le plus
grand acharnement, comme l’ont été les Celtes, les Vikings, et
toutes les cultures « barbares » de l’arbre sacré.
Les Européens ont amené dans leurs cales et dans leurs
rêves un imaginaire de la forêt profondément paradoxal, dont
j’ai exploré les fondements dans Splendeur au bois Beckett. Terra
nullius, territoire du rien, terre du vide, la forêt devient le lieu
de l’épreuve (qui hérite de l’imaginaire européen du désert3) : les
missionnaires y affrontent le diable comme dans une compéti-
tion chevaleresque médiévale. À la fin du Moyen Âge et jusqu’à
l’époque classique, la forêt est un lieu de perdition et de gloire, on
s’y perd d’autant plus qu’on s’y retrouve mieux en Dieu, comme le
bien demeure caché au cœur du mal, locus amoenus et locus terri-
bilis à la fois, paradis et enfer réunis en un seul lieu. Les coureurs
des bois vont même érotiser la forêt en remontant les rivières
pour y trouver des femmes (autochtones) qui manquent dans la
colonie. À l’époque romantique, la forêt se chargera d’une valeur
nouvelle, elle se fera le lieu où s’est réfugiée toute la puissance du
sublime et du pittoresque, au point où des peintres tels qu’Ozias
49
Reves2.indd 49 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Leduc ou Rodolphe Duguay la choisissent comme symbole d’un
mysticisme sauvage où Dieu parle au cœur humain mieux qu’en
aucun autre lieu de la Terre.
Le territoire américain était immense, sa vastitude débordait
toute imagination, il noyait d’espace toute forme de vie, il était
la transcendance elle-même par son infinité. Mais ce territoire
était en même temps régi par des zones d’échange et de respect
mutuel entre nations, il avait des formes fluctuantes, extensibles
ou rétractables. Il était d’une fluidité surprenante pour nos men-
talités euro-américaines bien balisées. Le nitassinan des Innus
pouvait changer au gré des alliances matrimoniales, qui allaient
de l’ouest à l’est du territoire, des rives du Saint-Laurent à celles
de l’Atlantique Nord4, croisant le Nitaskinan des Atikamekw
et le Eeyou Istchee des Cris, le Mi’gma’gi des Mi’kmaqs sur l’île
d’Anticosti et jusque de l’autre côté du golfe du Saint-Laurent.
Le Wendaké des Wendat est probablement passé du centre amé-
ricain au sud canadien, puis, après 1649 au moment de la des-
truction de la Huronie, il s’est réduit à l’île d’Orléans et à Lorette
près de Québec en quelques siècles pour redevenir le Nionwentsïo,
dont les frontières vont du lac Saint-Jean au Saint-Maurice et
jusqu’en Estrie. C’est tout le paradoxe des revendications terri-
toriales autochtones de formuler une demande d’assignation à
ce qui reste aujourd’hui d’un territoire sans limites et dont les
frontières n’existent souvent que dans la mentalité européenne.
« C’est qu’autrefois, dit An Antane Kapesh (ou plutôt son père,
qu’elle cite), l’Indien n’avait pas de territoire de chasse propre-
ment dit, chaque individu allait partout à la grandeur du terri-
toire indien pour chercher de quoi vivre5. » Le territoire n’est en
un mot pas géolocalisable selon la cartographie euro-américaine,
50
Reves2.indd 50 2023-06-22 13:34
LA CIRCULATION DES RÊVES
il est aussi vivant, nourricier et invisible qu’une relation amou-
reuse ou spirituelle.
Il est frappant de constater l’omniprésence des animaux dans les
récits autochtones de création du monde. On sait que pour les
nations iroquoiennes ou nadouek, la terre était formée sur le dos
d’une immense tortue. Pour les Wendat, c’est à la demande des
animaux que descend du ciel Aataentsic, soutenue par un voilier
d’oies sauvages, la femme primordiale qui a enfanté leur nation6.
Chez les peuples algonquiens ou algiques comme les Innus, c’est
un vison, ou chez les Cris-Eeyouch, c’est un rat musqué qui, à la
demande d’un homme appelé Messou, parvient à ramener de la
terre du fond des eaux pour que s’y installent les humains7. La
mythologie innue témoigne d’un profond respect pour le règne
animal, à travers les figures du maître des animaux terrestres et
en particulier du caribou, Papakassiku ou encore Missinaku, le
maître des animaux aquatiques, ou encore le carcajou, grand frère
des Innus8, un peu à l’image des maîtres des animaux des Inuit
comme la célèbre Sedna, qui règne sur les animaux aquatiques
ou Tekkeitsertok sur les caribous. Ces récits autochtones sacrés
montrent une interdépendance fondamentale entre les espèces,
y compris l’espèce humaine, au point où certaines histoires
racontent des métamorphoses animales, comme dans les récits
innus du cycle de Tshakapesh (que connaissent sous différentes
formes les nations algiques) où le vison, sous forme humaine
et malfaisante, est poussé dans une chute où il se liquéfie et se
transforme pour enfin devenir pleinement animal et ainsi mieux
servir les autres espèces, dont l’humanité9. T
shakapesh lui-même
est rescapé de l’attaque d’un ours, qui dévore son père, et de
celle d’un lièvre géant qui mange sa mère, et que Tshakapesh
51
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 51 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
venge ensuite en tuant ces deux animaux pour éventuellement
s’en sustenter. Le chassé devient chasseur et, comme le dit Rémi
Savard, on assiste alors « à une seconde naissance10 » lorsque
Tshakapesh, disparu, surgit du ventre d’un poisson pêché par
sa sœur. C’est aussi à l’intérieur du ventre d’une baleine que le
héros mi’gmaq Glooskap traverse l’Atlantique aller et retour,
comme s’il ne faisait qu’un avec l’animal11. Pour les Atikamekw,
les animaux sont des humains métamorphosés peu après le
début des temps12, tout comme les anciens Naskapis racontaient
que l’origine des « races » provient de l’accouplement ancestral
d’un carcajou et d’un rat musqué femelle13. On ne saurait mieux
exprimer l’étroite interdépendance des animaux et des hommes.
Les humains et les animaux sont constitués et maintenus en vie
par le pouvoir de la même terre nourricière, par les puissantes
métamorphoses de la matière vivante.
Les animaux mythologiques et réels ont façonné le terri-
toire, l’ont préparé en quelque sorte pour le règne des humains.
Pour les Wendat, le paysage s’inscrit dans l’origine légendaire
de leur nation, le Wendaké, qui forme une île à la fois mytholo-
gique, la grande tortue, et réelle, puisque leur territoire se situait
entre trois des Grands Lacs, Huron, Érié et Ontario, formant
une sorte d’île de terre entourée de vastes plans d’eau douce.
C’est sur ce territoire que la lutte entre Tsitstsah et Tawiskaron,
les petits-enfants d’Aataentsic, crée des serpents géants dont
les déplacements entre les Grands Lacs ont creusé les rivières
le long desquelles se déplacent ce grand peuple voyageur, diplo-
mate et commerçant qu’étaient les Wendat. Pour les Anishnabe,
l’archipel des Mille-Îles a été formé par la traque d’un person-
nage mythologique, Wiskedjak, qui, en chassant un castor géant
sous la surface à l’aide de son ciseau à glace, aurait ainsi troué le
paysage14. Dans les univers autochtones, ce sont les animaux qui
dirigent les destinées humaines, c’est grâce à eux que peuvent
52
Reves2.indd 52 2023-06-22 13:34
LA CIRCULATION DES RÊVES
subsister et prospérer les nations de la Terre. Pour eux, le ter-
ritoire a d’abord un visage animal, il est animé, plein d’âmes
vivantes.
En 1636, en un temps incroyablement court après l’installation
des Français à Québec, Paul Lejeune constate déjà la quasi-
disparition de toute cette faune grouillante aux abords de la ville
naissante15. Suivant les grands mythes du monde biblique, notre
civilisation a fait en sorte que les animaux soient soumis à la pré-
sence humaine dès la création du monde, ils sont des auxiliaires
dépendants du mal ou du bien, à l’image du serpent ou des trou-
peaux d’Abel. Si l’on cherche une origine à la catastrophe éco-
logique présente, il faut se tourner assurément vers les mythes
chrétiens de la création du monde qui ont programmé pour ainsi
dire tout le désastre actuel, en marche dès les premières années
de la Nouvelle-France pendant que les récits originels autoch-
tones tissaient patiemment des liens imaginaires et réels avec la
terre.
Ils ont rêvé le nitassinan, leur territoire, comme une terre d’abon-
dance, le nutshimit des Innus que l’on trouve dans les récits des
Anciens et dans les poèmes de Joséphine Bacon et de Natasha
Kanapé Fontaine : le « gardien / de nos vestiges, nutshimit 16 »,
où l’on entend la parole du territoire, des arbres et des animaux,
mais aussi des pierres et du vent17. « Nutshimit est un espace
vital, une source de survie, une manière de vivre et une croyance
absolue », dit Raphaël Picard18. Grâce à la tente tremblante,
kushapeshekan, les forces vives de la terre, ce « tremblement
53
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 53 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
t erritoire / Grondement d’ancêtres19 », parlent au pouvoir inter-
médiaire du chaman qui traduit la puissance du territoire pour
la communauté. La tête collée au sol au long des nuits millé-
naires, les rêves signalent l’abondance ou la famine, le territoire
lui-même avertit et dirige les nations sur le bon chemin. La
fameuse « croyance aux songes » qui a tant fait rager les pères
récollets et jésuites constitue précisément ce qui relie de manière
fondamentale les Autochtones au territoire. Les Autochtones
ont rêvé le territoire autant qu’ils ont été rêvés par les terres
qu’ils ont peuplées en tant que sédentaires ou semi-nomades et
nomades, comme les Innus qui ont marché ce territoire à pas
d’humain, de long en large, et dont on peut lire l’héritage de la
longue patience dans les poèmes de Natasha Kanapé Fontaine,
qui se dit « la fille de ceux qui marchent dans les rêves20 ». « Nous
avons marché pendant des millénaires », au point d’être, pour
Joséphine Bacon, « de celles qui accouchent / En marchant21 ».
La relation autochtone au territoire était étroite, contiguë ou
pour ainsi dire consubstantielle de l’humain à la terre, à la mesure
du corps humain, sans intermédiaire machinique. Connaître le
territoire, c’était, comme le dit An Antane Kapesh, « l’arpenter
avec ses jambes22 », s’en nourrir, le préserver pour la descendance,
en connaître tous les signaux invisibles, les présences secrètes qui
se déploient la nuit tombée dans la parole et dans les ombres de
la forêt ou de la toundra. La civilisation du cercle des autoch-
tones a rêvé un monde sans hiérarchie entre les espèces et dont
l’interdépendance entre les êtres a permis une circulation glo-
bale de l’âme à travers toutes les forces territoriales existantes.
Et c’est la transmission de ce savoir au moyen de la parole vive,
des Anciens jusqu’au présent, que l’on entend dans les poèmes
de Joséphine Bacon ou dans les récits de Raphaël Picard et dans
les essais de Georges Sioui, dans les chansons d’Ellisapie Isaac,
54
Reves2.indd 54 2023-06-22 13:34
LA CIRCULATION DES RÊVES
qui permet au territoire de poursuivre son existence de rêve, de
terre et de mémoire.
C’est ce territoire à moitié imaginaire, à moitié fait de terre
réelle qui s’est profondément métamorphosé à l’arrivée des
Européens, quand le détroit de Gespeg, qui faisait partie du grand
G’mtgiminu (« notre terre ») des Mi’kmaqs est devenu le nom
francisé de la province de « Québec » – à moins que ce ne soit
le kepek (« là où c’est bouché ») des Innus, comme ils nommaient
à l’origine la seule pointe de Québec où le fleuve se change en
un détroit23 ? Ou peut-être est-ce encore plus prosaïquement
kepak !, c’est-à-dire « débarque ! », que les Européens ont inter-
prété comme le nom du territoire alors qu’on leur demandait
simplement en innu de débarquer de leurs grands navires pour
commercer.
Je propose de faire de cette méprise le symbole de notre
mépris envers le territoire québécois, notre manière d’avoir
été aveugles et sourds à sa puissance. Débarquons donc de nos
grands concepts, descendons de nos grandes idées et foulons de
nos pieds nus la terre sacrée d’ici.
Reves2.indd 55 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 56 2023-06-22 13:34
AU CENTRE DU CERCLE
J’avais 20 ans, premier voyage, ébloui, sur la Côte-Nord, en sui-
vant des heures durant la mythique 138 et ses paysages englo-
bants. Premiers contacts avec les Innus de Uashat : ils chassaient
le canard le long de l’estuaire, visaient les volatiles au loin, les lais-
saient retomber dans l’eau et attendaient pendant des heures que
le courant pousse leurs prises sur le bord et que leurs chiens, tout
fiers, obéissants, joueurs et affamés, rapportent les prises dans
leurs gueules. J’étais déconcerté face à cette technique si efficace,
tellement sage et économe. J’étais émerveillé de leur patience, de
leur accueil simple. Nous avions fraternisé sans autre forme de
procès, je n’ai jamais su leurs noms, je ne leur ai même pas dit le
mien. Pourquoi ne pas avoir poursuivi cette relation naissante ?
J’étais trop jeune et trop peu éveillé pour comprendre la valeur de
cet accueil, toute sa dimension naïve et spontanée, mais en même
temps immémoriale. J’étais probablement le 100 000e Blanc qui
arrivait sur leurs terres sans rien comprendre à quoi que ce soit.
Nous faisions des feux sur la grève, le soir, à écouter l’infini
du fond sonore de ce territoire immense. Il ne me reste plus
qu’une seule photo de ce voyage, j’y suis rougi par le soleil, affalé
57
Reves2.indd 57 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
à côté du feu, les yeux plissés de fatigue, mais un sourire aux
lèvres. Toute la journée, nous avions fait du kayak entre les sculp-
tures étranges que le vent façonne sur les îles fantomatiques de
la Minganie. Il est facile de laisser son imagination s’emparer de
ces formes : un visage de sorcière, une main déchirée, un bâton
crochi par les marées, une bête agressive et gigantesque. Ces
pierres rouges sont aussi suggestives que des nuages figés.
Passé midi, sieste sur les battures, au soleil froid, au vent
glacial. Nous avions fait l’amour sur cette plage infinie, déserte.
Le dos enfoncé dans le sable et les cailloux, parmi les odeurs
d’algues séchées, elle était sur moi, le soleil en angle au-dessus de
sa tête. Un aigle faisait sa ronde très haut dans le ciel. Des forces
puissantes se sont emparées de moi, mon cœur battait comme
un immense tambour.
J’étais au centre du monde.
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 58 2023-06-22 13:34
Marc-Aurèle Fortin, L’orme à Pont-Viau, vers 1928.
Huile sur toile, 137 × 168,4 cm. Musée national des beaux-arts de Québec.
© Fondation Marc-Aurèle Fortin / SOCAN (2021).
Un état d’équilibre est atteint dans les aquarelles de Marc-Aurèle Fortin,
une sorte de zénith estival de l’imaginaire du paysage : splendeur des arbres,
hauteur, lumière, puissance du végétal encore en sursis dans les villages de
Sainte-Rose, à Laval, à l’île Sainte-Hélène ou à Cartierville, tout semble en
suspens entre les forces naturelles et l’avancée de l’urbanité, menaçante comme
un orage à l’arrière-plan, avant que l’étalement urbain ne vienne aplanir ces
lieux encore pleins d’âme au moment où Fortin les fait glisser dans ses mer-
veilleuses toiles ou aquarelles. Mais on sait aujourd’hui que les grands ormes
de Fortin sont presque tous disparus, décimés par la maladie hollandaise de
l’orme, comme c’est le cas maintenant des frênes, touchés par l’agrile du frêne,
de l’épinette mangée par la tordeuse, et même du bouleau blanc ravagé par
l’agrile du bouleau. Ces maladies des arbres qui envahissent le territoire sont
directement liées à ce qu’on voit à l’arrière-plan de plusieurs toiles de Fortin :
le surdéveloppement des villes et de la civilisation qui permet une plus grande
circulation des insectes parasites, et donc une éradication des forêts d’une
manière nouvelle. Après avoir détruit les populations autochtones par la pro-
pagation de virus et de bactéries d’Europe, la colonisation poursuit de nos jours
son travail d’effondrement des forêts en faisant circuler en toute inconscience
des parasites qui transforment déjà profondément le territoire.
Reves2.indd 59 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 60 2023-06-22 13:34
LE VINLAND DES VIKINGS
Ils n’étaient pas, comme le veut la légende, des guerriers sangui-
naires qui buvaient le sang de leurs ennemis dans le crâne des
vaincus, ni des mercenaires, d’ailleurs. Cette vision apocalyptique
des Vikings provient de la littérature chrétienne du Moyen Âge,
qui pousse du côté du mal les païens qu’étaient les S candinaves
avant leur conversion au christianisme . Les Vikings étaient en
1
réalité plutôt des éleveurs, un peu cultivateurs, des marchands
surtout, d’esclaves en particulier, partout à travers l’Europe, et des
marins extraordinaires qui pendant trois siècles, du viiie au xie,
ont sillonné l’Ancien Monde dans toutes les directions, et sont
aussi venus en Amérique vers l’an mille en passant par l’Islande
et le Groenland pour arriver à leur énigmatique V inland, dont
on n’a à ce jour aucune certitude de l’emplacement exact. Ils ne
naviguaient même pas dans leurs trop fameux « drakkars », dont
le nom a été inventé au xixe siècle par l’imaginaire romantique
et qui désigne plutôt le dragon (draki) que les Vikings mettaient
à la proue de leurs navires appelés en réalité des knörr, langskip
ou skeid, qui pouvaient embarquer environ 70 personnes, des
chevaux, des moutons et beaucoup de marchandises venues de
61
Reves2.indd 61 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
partout. Ces merveilles d’ingénierie étaient des bateaux à voile et
à rame, à fond plat, mais avec une dérive intégrée à la charpente,
ce qui, cumulé aux effets du gouvernail, permettait aussi bien
faire du cabotage le long des rivages en suivant les baies (d’où
viendrait leur nom : vik, baie, et le fait qu’ils ne se sont toujours
installés que sur les côtes et jamais en profondeur des terres), que
de traverser les mers et de remonter les rivières peu profondes
et d’ainsi surprendre les habitants des zones rurales et des villes
dans leurs célèbres raids, l’un des nombreux mots qu’ils ont légués
à la langue française, comme presque tout ce qui touche le voca-
bulaire nautique tel que huna (hune), skip (bateau), höfuđbenda
(hauban) ou encore le lexique de la mer : humarr (homard),
krabbi (crabe), strönd (estran), vágr (les vagues) ou vágrek (le
varech). Leurs mots se retrouvent même dans nos patronymes,
venus des paysages du Nord européen : les forêts clairsemées s’y
nomment les londes, les étangs les mares, les creux de rochers
des houles (Lalonde, Lamarre, Houle)2. Ces mots ont été trans-
mis à la langue française par les Vikings venus du Danemark
et installés à demeure en Normandie en 911, en échange de la
paix, puis sont passés dans l’anglais en 1066 avec la traversée
glorieuse de la Manche par Guillaume le C onquérant, descen-
dant de Rollon, que raconte la célèbre tapisserie de Bayeux. Ces
mots parviendront en Nouvelle-France par les filles du Roy aussi
bien que par les colons de toute provenance du Royaume-Uni,
anglaise, écossaise, irlandaise, puisque ce sont les lieux européens
d’implantation des Vikings de l’Ouest, qui ont amené avec eux
en Amérique leur vision du territoire comme land, c’est-à-dire
un ensemble de terres administrées par un Þing (assemblée pro-
tégée par Torr et orchestrée par un gođi, sorte de pasteur et chef
« religieux », god), terres exploitées localement par un bondi (éle-
veur). Les Vikings amèneront aussi leur travail de la matière, en
particulier du métal, comme celui d’un smiđ, un forgeron.
62
Reves2.indd 62 2023-06-22 13:34
LE VINLAND DES VIKINGS
Ce sont des Norvégiens anciens qui sont venus en Amérique
autour de l’an mille, comme le racontent les Sagas et le confirme
l’archéologie depuis la découverte d’un emplacement viking à
L’Anse aux Meadows au nord de Terre-Neuve, aujourd’hui devenu
lieu historique national, et maintenant par la découverte d’autres
emplacements, comme celui de Pointe Rosée, au sud de Terre-
Neuve, qui laisse croire que cette présence viking en Amérique
aurait duré en réalité plusieurs centaines d’années. Ces Vikings
sont en vérité des Islandais, donc des Norvégiens mélangés à
des populations celtes autochtones, qui finissent avec le temps
par avoir en commun un culte de l’arbre (Yggdrasil, qui traverse
les neufs mondes), avant d’être complètement christianisés dès
le xie siècle. Lorsque la route commerciale du Sud méditerra-
néen est bloquée par l’émergence du monde arabo-musulman
et qu’une embellie climatique réchauffe l’Arctique pendant
quelques décennies, ils prennent la mer et suivent le vestrvegr,
la route commerciale de l’Ouest, pour arriver au hasard des tem-
pêtes jusqu’au Groenland, la « terre verte », dont l’étymologie est
contestée. Menés par Eirίkr le Rouge (le roux), banni d’Islande,
ils fondent des colonies à l’est, eystribygđ, et à l’ouest, vestribygđ,
qui dureront respectivement jusqu’aux xvie et xive siècles. C’est
de là qu’ils partent, toujours plus à l’ouest, explorer ce qu’ils
appellent l’όbygđir, le « territoire inhabité », où ils rencontrent en
réalité des Inuit avec qui ils commercent de manière pacifique
pendant des siècles, échangeant de l’ivoire de défense de morse
contre des objets de métal, du bois contre de l’huile de baleine
ou des peaux contre des couteaux, anticipant le grand commerce
transatlantique du xviie siècle.
Selon les Sagas, ce sont les fils d’Eirίkr le Rouge qui s’im-
plantent momentanément en Amérique, mais aussi sa fille. Le
premier, Leifr Eirίksonn, « le fils d’Eirίkr », surnommé « hinn
heppni », « le chanceux », découvre en l’an mille le Halluland, le
63
Reves2.indd 63 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
pays des pierres plates, probablement le Labrador, que Cartier,
cinq cents ans plus tard, compare à des bœufs endormis sur les
côtes. Plus au sud, Leifr découvre des côtes de sable blanc où
se trouvent à l’arrière-plan des forêts immenses. Il appelle ce
territoire le Markland, le pays des forêts, où les Vikings viennent
chercher du bois pendant on ne sait combien de temps, proba-
blement pendant tout le temps que durent les colonies de l’ouest
du Groenland, où ces ressources ligneuses manquent et restent
essentielles pourtant au mode de vie des Vikings. Et c’est à un
cap précédé d’une île qu’il découvre le fameux V inland, « pays
de la vigne », si le i est long ou « pays des prairies », si le i est
bref, impossible de trancher cette question non plus. Seule cer-
titude, la Saga mentionne qu’« il y avait là des champs de fro-
ment qui s’étaient ensemencés d’eux-mêmes et des plants de
vigne. Il y avait là des arbres qui s’appelaient mösurr3 ». Ces
arbres sont sans doute des érables, dont on a retrouvé des traces
jusqu’au Groenland et en Islande des siècles plus tard. Leifr
fonde dans ce fameux Vinland la première colonie, Leifsbúđir,
qui consisterait en des baraquements de bois, peut-être situés
en N ouvelle-Écosse, peut-être dans le Maine, peut-être aussi
sur un rivage du Saint-Laurent, où Cartier trouvera, comme
on sait, de la vigne sauvage, notamment sur l’île d’Orléans, qu’il
nomme d’abord « île de Bacchus », tant il y pousse de raisins
sauvages. Le frère de Leifr, Thorvaldr Eirίksonn, revient l’an-
née suivante et meurt dans une escarmouche avec les mysté-
rieux Skraelingar, des « mauvais esprits » dans le lexique viking
et qu’on a trop rapidement identifiés aux Inuit, alors que les
Vikings connaissaient ceux du Groenland depuis des décennies.
Peut-être s’agit-il des Naskapis, qui habiteraient le très énigma-
tique Hvitramannaland, « pays des hommes blancs », puisque
ces Innus du Nord se vêtaient de peaux blanches de caribous
ou d’ours polaires, rien n’est clair. Peut-être était-ce aussi parmi
64
Reves2.indd 64 2023-06-22 13:34
LE VINLAND DES VIKINGS
les derniers descendants du peuple de Dorset, présent pendant
des millénaires dans l’Arctique ? Il plane d’ailleurs toujours un
doute sur une confusion possible entre les habitations suppo-
sées vikings retrouvées récemment, notamment à la Terre de
Baffin ou dans l’Isle d’Ellesemere, et les habitations dorse-
tiennes : est-il possible que ceux qui ont précédé les Inuit dans
les terres du Grand Nord aient été en mesure de construire des
habitations semblables à celles des Vikings ? Un autre objet de
doute est qu’en remontant vers le Nord, les Vikings rencontrent
cinq skraelingar, dont un barbu4, alors qu’on sait ces populations
glabres. De toute manière, le merveilleux se mêle à la légende
dans ces récits vikings d’origine orale retranscrits par des clercs
médiévaux où intervient le peuple des unipèdes et où les marins
restent prisonniers d’une mer de vers visqueux, où les skraelingar
disparaissent soudain, soit parce qu’ils se révèlent être une illu-
sion des sens, selon la magie scandinave, soit parce qu’ils s’en-
foncent dans le sol, comme des esprits malicieux faisant partie
du monde invisible que peuvent seules connaître, au moyen de la
cérémonie magique du sejdr, les prophétesses comme la célèbre
Thorbjörg de la Saga d’Eirik le Rouge.
Le territoire viking, en définitive, n’en est pas un seule-
ment de mer et de glace, mais aussi de mémoire et de magie.
Et c’est justement dans le sol de cette mémoire incertaine que
demeurent les traces de ces peuplades nordiques étranges,
premiers Européens venus en terre d’Amérique.
Reves2.indd 65 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 66 2023-06-22 13:34
ABEL ET CAÏN
Dès les premiers arrivages européens sur le territoire, on voit se
développer un regard que j’appellerais « agronomique ». L’ima-
ginaire venu d’Europe transforme un territoire en apparence
inexploité en de vastes terres cultivées à la façon productive
européenne qui a déjà fait à cette époque d’immenses ravages
dans les anciennes forêts du Vieux Continent. Et c’est en fonc-
tion de cette productivité future que sont jugées les découvertes
des nouveaux territoires. Pour Cartier, la Côte-Nord (qui cor-
respond au Halluland et au Markland des Vikings) ne présente
aucun intérêt, il n’y a que « pierres et rochiers effarables et mal
rabottez car en ladite coste du nort je n’y vy une charetée de terre
et si descendy en plusseurs lieux. Fors à Blanc Sablons il n’y a
que de la mousse et de petiz bouays avortez. Fin j’estime mieulx
que aultrement que c’est la terre que Dieu donna à Cayn1 ». Trop
raboteux, trop pierreux, pas assez terreux et plane, le Nord ne
cadre donc pas avec le regard de Cartier qui cherche plutôt, à
défaut d’un passage vers l’Asie ou d’un sol riche en minerais à
exploiter, de vastes terres aplanies où développer la culture du
blé comme en France. Ce faisant Cartier charrie sans trop s’en
67
Reves2.indd 67 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
aviser les préjugés occidentaux favorables à la planéité du ter-
ritoire qui vise à transformer ce que les Romains appelaient la
cultura agris (l’agriculture) en cultura animi (la culture de l’âme).
Pour élever son esprit, il faut dégager la forêt, faire place nette,
ouvrir le territoire à l’œil de Dieu. Ce que Cartier contemple
dans les basses-terres du Saint-Laurent, du haut du promontoire
du mont Royal, qu’il nomme ainsi sur-le-champ en 1535, ce sont
des terres défrichables et exploitables sans trop d’effort d’apla-
nissement et qui pourraient accueillir la vie paysanne millénaire
créée au néolithique européen dans ces autres basses-terres du
Proche-Orient suméro-akkadien d’où vient la civilisation méso-
potamienne du blé. Cet imaginaire territorial s’est fixé avec Les
travaux et les jours d’Hésiode et surtout avec Les Géorgiques de
Virgile qui célèbrent la vie paysanne et l’ordre quasi militaire
des champs de blé, et enfin avec le christianisme qui fera de la
germination du blé la métaphore des âmes s’éveillant à la vie
spirituelle en cherchant à s’élever vers le ciel dégagé. Cartier a
pour rôle dans l’histoire d’importer cet imaginaire du territoire
en Amérique – où il laisse en terre, d’ailleurs, dans son dernier
voyage en 1541, des grains germés de blé comme signe clair
d’un passage d’une civilisation de la forêt à celle de l’agricul-
ture intensive. L’agriculture écoresponsable des Autochtones, en
particulier des nations iroquoiennes, laissera bientôt la place aux
ravages du monothéisme du blé, à la valeur du travail quotidien
de la terre qui lui est associée par le mérite des récoltes comme
compensation au labeur sans fin s’élargissant depuis des siècles,
maintenant à une proportion effarante de l’écoumène terrestre.
Même chose du côté algonquien : plusieurs récits innus racontent
de quelle façon les Français ont réussi « par leur agriculture » à
« repousser les Innus de leurs terres2 » (Jean-Baptiste Bellefleur,
Unaman-Shipit). Il n’y a rien de neutre ou d’innocent dans le
fait de planter du blé en Amérique, car c’est par l’accaparement
68
Reves2.indd 68 2023-06-22 13:34
ABEL ET CAÏN
agressif des terres cultivables dans le but d’y semer du blé que les
envahisseurs parviennent à s’implanter ici et surtout à détruire
l’imaginaire du territoire autochtone.
Au moment où Cartier débarque en 1534, ces terres sont déjà culti-
vées en partie par les Iroquoiens du Saint-Laurent, descendants
des premiers agriculteurs sédentaires de la période du Sylvicole
moyen ou supérieur. Mais ce sont des plantes d’Amérique qu’ils
cultivent, c’est-à-dire les fameuses trois sœurs : le maïs, venu du
Sud vraisemblablement lors de la période archaïque, les courges
et les haricots, sans doute intégrés plus tardivement à leur diète.
En braquant son regard sur les terres arables, comme pour s’em-
parer de la productivité horticole autochtone des basses-terres,
Cartier manque évidemment la richesse insoupçonnée du Nord.
Comment aurait-il pu la voir d’ailleurs, le Nord ne faisant pas
partie de l’imaginaire territorial français du xvie siècle, ni de
celle de nos contemporains d’ailleurs, ou à peine. Cartier projette
donc tous ces schémas de manière parfaitement inconsciente et
refoule dans le mythe biblique de Caïn un territoire voué à la
malédiction divine, à la souffrance et à la stérilité, comme le sont
d’ailleurs en Europe ceux que l’on appelle à l’époque « les fils
de Caïn », c’est-à-dire les pauvres, les vagabonds, les errants3.
Très bientôt, deux siècles après Cartier, les coureurs des bois
seront à leur tour victimes du même préjugé ambigu à l’égard du
nomadisme4.
Mieux encore : ce texte fondateur de Cartier enterre dans
le sol le premier cadavre imaginaire de la littérature d’ici en
sous-entendant le meurtre d’Abel, le frère biblique de Caïn.
Caïn assassinant Abel, c’est la ville et la sédentarité prenant le
dessus sur le nomadisme et la culture des chasseurs-cueilleurs
69
Reves2.indd 69 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
de la fin du néolithique. Abel est dans la Bible une sorte de
berger nomade évidemment associé de manière implicite par
Cartier aux Premières Nations semi-nomades (Innus) ou semi-
sédentaires (Iroquoiens du Saint-Laurent et Mi’kmaqs) qu’il
rencontre dès 1534 à Gaspé et dans la baie des Chaleurs ou
encore aux semi-sédentaires d’Hochelaga rencontrés à l’au-
tomne 1535. Les mots qu’emploie Cartier rejouent sur la terre
américaine le conflit néolithique entre agriculteurs sédentaires
(Caïn) et bergers nomades (Abel) en programmant dès le départ
la supplantation de l’un par l’autre. Il est stupéfiant de lire que,
dès le premier texte transatlantique français, le sort imaginaire
des Autochtones est déjà mis en balance : dans le regard français,
ces nations inconnues sont assimilées immédiatement, comme
le veut le conflit biblique entre Abel et Caïn, aux tribus nomades
descendantes d’Abel destinées à périr sous l’avancée inexorable
du défrichement du territoire, de l’implantation d’une agricul-
ture massive et permanente formant la base de la construction
de futures villes et d’une civilisation nouvelle. C’est ce qui s’est
produit entre le Tigre et l’Euphrate dès le ve millénaire avant
notre ère et qui a donné naissance au mythe biblique d’Abel et
Caïn. Si dans l’imaginaire de Cartier le Nord a été donné à Caïn,
celui-ci se vengera en assassinant son frère nomade du Sud (les
Premières Nations) et en transformant ses vastes territoires sau-
vages en immenses terres productives. Tel est le mythe biblique
qui malheureusement s’est avéré d’une puissance redoutable
dans l’histoire et dans l’imaginaire du territoire, menant à toutes
les exactions ultérieures que l’on sait.
Cette vision du territoire qu’exprime Cartier nous hante
toujours. Elle constitue sans aucun doute le motif secret et ina-
vouable de la rage, je dirais presque de la rancœur avec laquelle
nous détruisons systématiquement et froidement le lieu d’abon-
dance que furent les basses-terres du Saint-Laurent. L’imagi-
70
Reves2.indd 70 2023-06-22 13:34
ABEL ET CAÏN
naire biblique du territoire parle encore en nous, qui pourtant
avons cessé depuis longtemps d’aller communier dans les églises
le dimanche. C’est que, beaucoup plus qu’une religion, le chris-
tianisme est une civilisation : une civilisation du blé, du défri-
chage intensif, de l’ensemencement des esprits et de leur levée
après la vie. Malgré toutes nos récriminations et dénégations,
beaucoup trop acharnées pour être neutres, nous n’en sommes
bien sûr pas encore sortis.
Mais il y a plus encore : l’imaginaire de Cartier sépare aussi,
comme si cela allait de soi, le territoire en fonction de la bonne
vieille théorie des signatures venant de l’Antiquité gréco-
égyptienne et du Moyen Âge. Selon cette théorie millénaire qui
aura cours jusqu’au xviiie siècle, la morphologie des plantes pré-
sente un signe manifeste de l’ordre divin, les bonnes et les mau-
vaises espèces étant rendues visibles aux yeux des hommes par
leur apparence immédiate. La végétation rend donc évident pour
Cartier ce contraste entre la stérilité des « petiz bouays avortez »
au nord et la fécondité des terres qu’il verra plus au sud, les îles
de la Madeleine d’abord, malgré leur sol sablonneux, de même
que la baie des Chaleurs en 1534 et surtout les basses-terres du
Saint-Laurent en 1535-1536 et en 1541. Jacques C artier ne tarit
pas d’éloges sur ce territoire qu’il appelle « Canada », situé, selon
sa compréhension parcellaire de la géopolitique des P remières
Nations, entre Stadaconé et Hochelaga. Accueilli à l’au-
tomne 1535 par les Iroquoiens du Saint-Laurent d ’Hochelaga
(ou Tutonaguy, probablement une déformation de l’iroquoien
Tiotake), Cartier gravit la montagne qu’il nomme « mont Royal »
et contemple les immenses surfaces planes qui s’offrent au
regard entre les Laurentides et les Appalaches : « Entre lesquelles
71
Reves2.indd 71 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
montaignes est la terre la plus belle qu’il soit possible de veoyr
labourable unye et plaine5. » On trouve par dizaines des passages
comme celui-ci dans les Relations de Cartier, mais aussi dans les
textes de Champlain, des Récollets, des Jésuites, et de la période
jadis dite « héroïque » (des découvertes du xvie siècle jusqu’aux
filles du Roy, 1663). Le jésuite Paul L ejeune trouve une formule
qui dit tout, un siècle plus tard, en 1636 quand il met ensemble
« le plaisir d’apprivoiser des ames Sauvages, & les cultiver pour
recevoir la semence du christianisme6 ». Récolter ce que Brébeuf
appellera après bien d’autres « la moisson des âmes7 » n’est pas
seulement une métaphore : labourer la terre et les âmes, c’est
tout un, selon la bonne vieille parabole du semeur hérité des
Évangiles. Le monothéisme du blé fait simultanément lever
les têtes et les épis vers le ciel. Si les Hurons-Wendat ont été
choisis par les Français comme alliés commerciaux et militaires,
c’est bien sûr en raison de la puissance de leur confédération
et pour des considérations de géopolitiques autochtones, mais
c’est surtout parce qu’ils étaient sédentaires et agriculteurs, et
donc jugés plus proches du christianisme. À l’inverse, les nations
nomades ou semi-nomades comme les Innus ont été vues avec
méfiance durant la période des premiers contacts et même lar-
gement au-delà. On a fait maintes fois le projet de les assigner
à résidence, non pas seulement à partir des odieux pensionnats,
mais au début, au moment où les Jésuites fondent l’idée de ce
qu’ils appellent des « séminaires », qui visent à les déraciner de
leurs territoires, et des « réductions », qui ne sont autre chose que
des réserves avant la lettre. Tout est en branle en fait dès que
Lejeune les côtoie à l’hiver 1636 ou quand Champlain tente en
vain de les sédentariser et de les mettre au travail de la terre à la
façon européenne, comme on pense d’ailleurs à domestiquer les
orignaux et les chevreuils pour le travail de la terre8 : dépeupler,
défricher, labourer, semer et récolter en maximisant la produc-
72
Reves2.indd 72 2023-06-22 13:34
ABEL ET CAÏN
tion, tel est le projet chrétien en Amérique qui a d’ailleurs survécu
au christianisme et que l’on peut lire dès que Cartier pose son
regard sur le territoire et même au moment de le quitter, quand il
sème du blé avant son départ, comme pour laisser s’implanter en
terres d’ici le végétal par excellence de la symbolique chrétienne
et occidentale. Ce n’est pas seulement du blé que sème Cartier,
c’est un symbole, c’est un imaginaire, c’est un projet de civilisa-
tion qui envahira le territoire quelques siècles plus tard. C’est sur
ce territoire plat, labourable, cultivable et ouvert au ciel chrétien,
que s’accompliront la destruction du cercle de vie autochtone
et le meurtre biblique des nations nomades et semi-nomades,
descendantes imaginaires d’Abel.
Reves2.indd 73 2023-06-22 13:34
Rodolphe Duguay, Le semeur, 1938.
Huile sur carton, 39 × 60 cm. Collection Monique Duguay, Nicolet.
Crédit photo : P. Bernard.
Il pleut de la lumière sur ce pays neuf et fraîchement défriché, dans la plus pure
tradition picturale de la représentation évangélique de l’ensemencement des
paysages, qui traverse toute l’histoire de l’art moderne, de Millet, en passant par
Van Gogh, par la puissance évocatrice d’Horatio Walker, jusqu’à la mystique
du paysage de Rodolphe Duguay. Semer du blé en terre d’Amérique, c’est faire
table rase des forêts anciennes et ouvrir la verticalité du territoire à l’œil divin.
La pluie de lumière fait germer une nouvelle symbolique du territoire, qui
demeure inséparable de la mythologie biblique. Le paysage est bien sûr une
page (pagus, page, pays, païen) sur laquelle est écrite la légende d’un meurtre,
celui d’Abel, qui fonde notre civilisation. À l’époque où sont peintes ces toiles
bibliques, Albert Tessier filme le territoire québécois en adressant dans Can-
tique à la création (1942) une sorte de poème ou de prière cinématographique à
Dieu, dans une sorte d’ode à la civilisation agraire qu’est le christianisme. Nérée
Beauchemin, le poète de Yamachiche, chante dans ces mêmes années, selon les
thèmes de la poésie du terroir, « le prodige des blés nouveaux » mis en terre et
cultivés grâce à la bénédiction d’un immense « signe de croix » et qui demeure
« le plus beau jardin du Seigneur » (« Le laboureur », Patrie intime, 1928). Com-
ment douter, à partir de cet accomplissement du projet de civilisation que por-
taient Cartier et C hamplain, que le territoire québécois soit désormais sous
l’emprise de l’imaginaire chrétien du blé ?
Reves2.indd 74 2023-06-22 13:34
AU PAYS DE SEDNA
J’ai d’abord été ébloui par la beauté des images et du texte du
documentaire Cornouailles (ONF, 1994), de Pierre Perrault,
consacré au bœuf musqué, un ovidé (et non un bovidé, comme
on le lit souvent, ou alors c’est un ovibos, espèce liminaire).
Est-ce parce que j’ai passé les premiers mois de ma vie sur les
rives de la Koksoak, alors que mon père, biologiste à Kuujjuaq,
travaillait en 1973 à la réintroduction de cette espèce dans le
Nunavik ? Pourquoi ce film me projette-t-il dans un tel malaise,
venu de très loin, du fond de mon amnésie, de notre diffi-
culté collective à nous souvenir clairement ? Toutes ces images
viennent peut-être réveiller une mémoire profonde, d’enfance
et d’archéologie imaginaire qui pour moi nimbe ce film d’une
aura poétique puissante. La voix enveloppante et généreuse de
Michel Garneau y est envoûtante. Poésie froide du Nord et de la
survie dans l’Arctique (sur l’île d’Ellesmere, au Nunavut, lieu du
tournage), attention patiente à la beauté fragile des saxifrages, à
la délicatesse des boules neigeuses d’eriophoron, à la puissance
des bœufs musqués, aux lièvres arctiques, aux sternes, à la vie
sauvage de ce territoire difficile d’accès et encore méconnu. Puis,
75
Reves2.indd 75 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
quand j’ai revu le film, l’évidence a éclaté en moi : où sont les
Inuit ? Je repasse le film et je confirme : non, non, je n’ai pas rêvé.
Pas. Un. Seul.
Pas un seul Inuk dans ce film sur le Nord, il fallait quand
même le faire ! Il faut bien sûr préciser que ce lieu extrême qu’est
l’île d’Ellesmere a une population de quelques centaines d’âmes
tout au plus. Mais Perrault, ce cinéaste de la parole et de la pré-
sence humaine qui a si bien filmé la parlure des habitants de
l’Isle-aux-Coudres, la chouenne de Charlevoix ou la rocaille
de l’Abitibi, a dans Cornouailles fait disparaître les habitants du
Nord et enseveli leurs cadavres sous des phrases somptueuses.
Des phrases tueuses. Des phrases et des images qui ont fait le
choix de cadrer la flore et la faune et de laisser dans le hors-
champ le peuple du Nord. On ne saurait mieux exprimer le
meurtre symbolique d’Abel dans l’imaginaire du territoire qué-
bécois, trace archéologique laissée en nous depuis Cartier et dont
on sait toute l’emprise sur le cinéaste de Pour la suite du monde,
où les habitants de l’Isle-aux-Coudres discutent abondamment
des Relations de Cartier et même des mythologies chrétiennes
du purgatoire et de l’encan des âmes. Aucune mention n’est
faite, d’aucune façon dans ce film, de la légende la plus connue
du Grand Nord, celle de Sedna, dont est issue, par ses doigts
coupés, la faune marine du Nord. Comment comprendre ce ter-
ritoire extrême de l’Arctique sans le raconter par les légendes de
ceux qui lui donnent vie depuis des millénaires ? Voilà exacte-
ment de quelle façon on ne filme que de la matière inerte quand
on oublie la parole de ceux qui habitent le territoire. Perrault
le savait pourtant mieux que quiconque et il nous l’a lui-même
appris : le territoire et la parole sont indissociables, c’est à tout
prendre deux faces d’une même puissance de vie.
Les autres films de Perrault portant sur le Nord et ses
peuples, comme les Innus, se révèlent tout aussi malencontreux
76
Reves2.indd 76 2023-06-22 13:34
AU PAYS DE SEDNA
et je ne pense pas seulement à ceux de la série « Au pays de
Neufve-France », qu’il réalise avec René Bonnière, dont Ka Ke
Ki Ko Ku et Attiuk. Ces deux films s’inscrivent dans la lignée
de ceux de l’abbé Proulx, qui commentait sans vergogne « la
nonchalance reconnue des sauvages » dans En pays neuf (1937)
et étalait ses préjugés colonialistes sans même se douter qu’il
tenait des propos liés à ce que plusieurs historiens considèrent
comme la base idéologique de l’exclusion des Autochtones de
leur propre territoire. Perrault pousse plus loin encore l’igno-
minie inconsciente en filmant d’une façon parfaitement neutre
le départ des tout jeunes Innus d’Unamen Shipu (La Romaine)
vers les pensionnats et s’attarde avec complaisance à leur endoc-
trinement par le père Alexis Joveneau, aujourd’hui surnommé
« le démon de la Basse-Côte-Nord » en raison de l’enfer qu’il a
fait subir aux Innus pendant quarante ans : exactions, agressions
sexuelles, détournements de mineurs, extorsions, etc. Ce même
père Joveneau revient dans Le goût de la farine (ONF, 1977)
comme interprète et intermédiaire entre les Blancs et les Innus,
alors qu’il fait mine de défendre les droits autochtones devant
la caméra pendant qu’il organise en réalité des regroupements
de communautés innues afin de mieux les déraciner, les contrô-
ler, les exploiter et les agresser. Le symbole de la farine revient
tout au long du film, non pas la farine de maïs autochtone, mais
celle des Blancs, la farine de blé à laquelle les Premières Nations
auraient pris goût en se sédentarisant et en quittant leur mode
de vie traditionnel. On mesure mieux maintenant l’horreur de ce
symbole puissant : le goût de la farine de blé nous revient comme
un arrière-goût de territoire brûlé et mutilé, exploité et agressé
jusqu’à dévorer son âme comme on ingère l’hostie à la messe,
ce pain produit à la sueur du front et par l’arraisonnement des
ressources territoriales. Voilà ce que goûte maintenant la farine
chrétienne, et pas seulement à cause du père Joveneau. Bien sûr,
77
Reves2.indd 77 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Perrault ne pouvait pas savoir à l’époque, mais c’est une consé-
quence indirecte et malheureuse d’avoir donné autant la parole
à des Blancs qui parlent à la place des Innus et qui interprètent
le territoire pour eux.
Suis-je à mon tour en train de chiper la parole autochtone pour
me l’accaparer ? Je dois confesser que, parvenu à ce point dans
ma méditation sur le territoire, je voudrais n’avoir pas écrit ce
livre et me contenter de faire connaître la pensée autochtone
sans aucun autre intermédiaire qu’elle-même. Mais nous partons
de tellement loin dans notre amnésie collective que si rien n’est
fait tout demeurera informulé ou à peine dans le noir de nos
mémoires, comme c’est le cas depuis des siècles maintenant. Je
crois, peut-être à tort, qu’il faut bien aider un peu notre mémoire
à se souvenir enfin de cette agitation dont les traces sont inscrites
dans le territoire et qui nous hantent comme de mauvais fan-
tômes pour enfin faire face à nos destins communs.
Il y a d’autres interprètes blancs dans ce documentaire de
Perrault, comme l’archéologue Serge-André Crète et surtout
la linguiste José Mailhot, « la fille de l’intérieur des terres »
comme l’appellent les Innus, parce qu’elle s’exprime parfai-
tement en innu-aimun, tant le territoire et la langue sont liés.
L’archéologue et la linguiste prennent activement parti pour
la communauté innue en cherchant à apprendre ses coutumes,
ses langues et en écoutant ses récits du territoire à la façon de
Rémi Savard, qui apparaît dans le second film de Perrault sur
les Innus, Le pays de la terre sans arbre ou le Mouchouânipi (ONF,
78
Reves2.indd 78 2023-06-22 13:34
AU PAYS DE SEDNA
1980). On entend beaucoup moins les Blancs dans ce film et l’on
voit beaucoup plus le territoire mythique du Mouchouânipi, où
l’on suit une famille innue à la chasse au caribou dans ses terres
ancestrales. Les protagonistes mangent de la moelle de caribou,
font cuire un porc-épic et plument les oiseaux qu’ils ont pris le
jour même. Ils chassent les outardes sur la magnifique rivière
Georges, dont le nom colonial masque son appellation en inuk-
titut, Kangirsualujjuap Kuunga (« rivière de la très grande baie »),
en naskapi, Mushuau Shipu (« rivière sans arbre ») et en innu-
aimun Metsheshu Shipu (« rivière à l’aigle »). Ils vivent au rythme
ancien des mangeurs de bannique et des tanneurs de peaux de
caribou. Ils suivent en un mot la grande voix du tambour qui fait
battre le cœur du territoire innu au moment où il est en train de
se vider de toute présence ancestrale au profit des compagnies
touristiques du Nord, menacé de devenir une terre sans âme,
jusqu’à ce qu’enfin, en 2020, il soit reconnu comme sacré et pro-
tégé de toute forme d’exploitation.
La vision du Nord a beaucoup évolué depuis qu’Yves Thériault
l’a fait découvrir aux Blancs du Sud en publiant Agaguk en 1958,
puis par le biais du film éponyme de Jacques Dorfmann (1992)
qui a été expurgé par l’anthropologue Bernard Saladin d’Anglure
de tous les fantasmes que Thériault, à la manière de la culture
blanche, projette sur les Inuit : scènes de cannibalisme, de sexe
collectif, etc. Si dans ce film les personnages principaux sont
joués par des non-Autochtones hollywoodiens, au moins il
y a deux familles inuites qui jouent les rôles de leurs ancêtres
et qui ont redécouvert des coutumes oubliées pour arriver à
comprendre leurs rôles précis. Mais, même en tenant compte
de toutes les transformations culturelles en cours, quelque chose
79
Reves2.indd 79 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
me frappe : la reconstitution du conflit entre les valeurs euro-
péennes et autochtones sur le territoire aujourd’hui appelé le
Nunavik s’est pourtant jouée et se joue encore aujourd’hui de
la même façon que partout ailleurs au Québec dans l’imagi-
naire du territoire, c’est-à-dire par l’inscription de la présence
de la communauté au moyen d’un meurtre symbolique. Agaguk
assassine effectivement le négociant Brown, qui refuse de mar-
chander équitablement avec lui, inaugurant ainsi la dépossession
et l’acculturation autochtones, qui ne peuvent être empêchées,
de façon imaginaire, que par le meurtre collectif d’Handerson,
le policier venu enquêter dans le village sur la mort de Brown.
Nous voici encore une fois en présence de cet imaginaire sacri-
ficiel que j’avais suivi à la trace dans Sang et lumière et qui se
retrouve jusque dans les romans « esquimaux », comme on les
appelait en 1958. Dans les romans d’aujourd’hui, le Nord est
encore compris comme territoire de la disparition et de la mort
violente cachée sous terre, que ce soit dans Niirlit de Julianna
Léveillé-Trudel, où la recherche d’Éva, disparue, s’avère vaine
parmi toutes les misères de la communauté de Salluit, ou dans
Nord Alice de Marc Séguin, où la beauté du Nunavik ne peut
être contemplée qu’à travers un imaginaire meurtrier. Comment
regarder maintenant le territoire du Nord avec un regard neuf,
délesté de cet imaginaire européen du sacrifice ?
Reves2.indd 80 2023-06-22 13:34
PARMI LES ÉPINETTES NOIRES
Automne 1995. Nous sommes cinq entassés dans une vieille
Renault 5 dont la tôle rouillée touche presque le sol, écrasée
sous notre poids. Je me souviens parfaitement de ce moment :
une vague angoisse bouge au fond de moi mêlée d’une joie folle
de sentir les vapeurs sucrées de l’automne dans une vastitude
qui ne veut jamais prendre fin. Les chansons d’Harmonium
jouent en boucle durant ce périple interminable, les joints cir-
culent abondamment, et dehors des épinettes longent à n’en plus
finir des milliers de kilomètres. Depuis Charlevoix, nous filons
vers l’Abitibi en suivant le Saguenay. Nous sommes éblouis par
le fjord, par sa puissance, sa beauté, son aridité. Face à cette
splendeur, on se prend à comprendre les Européens d’avoir été
fascinés par les histoires racontées à Cartier et aux Français par
Donnacona au sujet du royaume de Sagana. Puis s’ouvrent les
rives du lac Saint-Jean, plus peuplées, exposées à l’ordinaire de
nos rues et maisons nord-américaines, aux berges plus ou moins
aménagées de cette merveille naturelle qu’est un lac d’eau douce
aussi vaste. Et tout au bout de ce lac sans fin, à Saint-Félicien,
le chemin bifurque soudain vers le nord-ouest, piquant dans la
81
Reves2.indd 81 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
forêt profonde et nous entraînant à nouveau dans la lignée d’épi-
nettes infinies. Nous prenons une pause après quelques heures,
nous rangeons sur le côté de la route la carcasse qui nous sert
de voiture et c’est là qu’en ouvrant les portes, nous entendons sa
grande voix mugissante, que nous sentons une humidité partout
à la ronde tant la bruine de ses rapides projette aux alentours
un filet d’eau qui laisse perler quelques gouttes sur nos visages,
sur nos vêtements. La fureur de cette rivière est stupéfiante, elle
semble charrier un monde dans ses eaux lourdes et profondes.
La fougue de ses déviations provoque des cascades et des remous
dans toute sa largeur et au plus loin que l’œil peut observer. C’est
la magnifique Ashuapmushuan, la dernière grande rivière du
Sud non encore harnachée par Hydro-Québec, qui n’a toujours
pas compensé les Innus, les Naskapis, les Inuit, les Anishnabés
d’avoir saccagé leurs territoires pour donner de la lumière et
de la chaleur aux Blancs du Sud. Notre lumière électrique pro-
vient d’un trou d’oubli sans fond. L’Ashuapmushuan fournit une
image claire de ce qu’était le pouvoir rugissant du territoire avant
l’arrivée des Blancs. Elle mène au lac éponyme et une réserve
porte aujourd’hui ce nom innu qui signifie « là où l’on guette
l’orignal ». Ce territoire immense était celui que recherchait
Champlain quand il voulait trouver la mer nordique dont lui
parlaient les Innus ou les Anichinabés pour lui faire miroiter les
richesses du Nord sans pour autant lui en révéler les chemins
secrets. C’est par là que Radisson a trouvé la voie d’accès à la
Jamésie et établi les comptoirs de traite dont le dernier a fermé
en 1935 pour devenir une sorte de lieu de mémoire de l’époque
du commerce de la fourrure en Nouvelle-France. Ce territoire
parle une langue ancienne de géant que nous avons oubliée.
La 167 se poursuit sans fin, monte jusqu’à Chibougamau
et au gigantesque lac Mistassini, pays mythique de François
Paradis dans Maria Chapdelaine, mais surtout, en réalité, celui
82
Reves2.indd 82 2023-06-22 13:34
PARMI LES ÉPINETTES NOIRES
des Eeyouch depuis des millénaires, le Eeyou Istchee, « terre du
peuple », où sont situées les terres cries réservées. Ce territoire
a fait l’objet d’une entente avec le gouvernement du Québec, la
fameuse Paix des Braves de 2002, qui devrait servir de modèle à
toute entente future. À la station-service, une famille crie nous
observe patiemment, se questionnant visiblement sur ce que nous
faisons ici. Mon anglais encore balbutiant à l’époque ne suffit pas
à percer la muraille des langues et des cultures et mon ignorance
complète de leur univers force le silence, à l’image de celui de
tout un peuple. J’ai envie de pleurer devant ma propre bêtise.
Comment se fait-il que l’école québécoise ne nous apprenne pas
au moins une langue autochtone ?
C’est ce silence entre les peuples qui a donné son élan au
Peuple invisible de Richard Desjardins, quand il a constaté
qu’il était né sur un territoire dont il ne connaissait absolu-
ment pas les premiers habitants, les Algonquins, comme les
appellent les Q uébécois, après que les Français les ont appelés
« Algoumequins ». Leur nom est plutôt les Anichinabés, « le
peuple de l’origine », dont le territoire, sur la partie québécoise,
correspond à l’Abitibi, c’est-à-dire « le milieu des eaux », puisque
ce territoire est situé à mi-chemin des bassins hydrographiques
de l’Outaouais et de la Jamésie. On y accède en bifurquant à
l’ouest par la 113, en traversant la partie sud du Eeyou Istchee,
ce territoire d’épinettes, de lacs sans nombre et de lumière crue
se reflétant sur l’eau (ce que signifie « Waswanipi », comme me
l’a appris Maïtée Labrecque-Saganash dans un court échange
à propos d’une image de son pays). Il y a tellement d’eau tout
autour de la route que la petite Renault 5 semble plus flotter que
rouler, jusqu’à ce que nous arrivions, passés Lebel-sur-Q uévillon,
en Abitibi.
Je ne connaissais ce territoire que par la chanson de Raôul
Duguay, « La bittt à Tibi », et par certains films de l’abbé Proulx,
83
Reves2.indd 83 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
notamment En pays neuf (1937), qui faisait la promotion de la
colonisation de l’Abitibi par l’agriculture. Le cycle abitibien de
Pierre Perrault répond à cette propagande, notamment dans Un
royaume vous attend, dont le titre ironise sur l’optimisme de l’abbé
Proulx, en montrant la réalité des mauvaises terres de l’Abitibi
et la misère des colons venus du sud de la province pour fuir
la crise économique et en trouver une plus grande encore. Le
contraste est frappant entre les films de l’abbé Proulx, où l’on ne
voit des Anichinabés que pour en fustiger « la paresse reconnue »,
tandis que Perrault centre toute son attention sur l’échec de la
colonisation canadienne-française, pendant que Desjardins,
lui, montre ce qui reste du territoire de ce Peuple de l’origine,
aujourd’hui étouffé dans des réserves dignes du tiers-monde,
notamment les communautés de Kitcisakik et de Winneway, où
l’eau courante ne se rend toujours pas en 2021. Les pensionnats
implantés en 1955 achèvent le sort des Anichinabés de l’Abitibi
en les privant de leurs coutumes et traditions, en les déracinant,
en leur enlevant, parcelle par parcelle, tout ce qui leur restait de ce
territoire ancestral qui allait, avant la Nouvelle-France, du Saint-
Maurice à Ottawa, qui faisait la prospérité d’une nation algon
quine puissante et respectée. Ce territoire n’est plus aujourd’hui
qu’un amas de fragments de réserves dispersées où les taux de
suicide sont invraisemblables, où les mines pullulent comme
des cratères pustuleux, où les coupes à blanc ont défiguré une
forêt qui ne demandait qu’à pousser en paix. Richard Desjardins
termine son film Le peuple invisible par le mot « ethnocide » en
ajoutant sa définition. Il faudrait aussi qu’y apparaisse le mot
« écocide », qui va presque toujours de pair avec la destruction
des territoires autochtones.
Reves2.indd 84 2023-06-22 13:34
LA CROIX ET L’ANNEDDA
Tout au long de l’époque de la Nouvelle-France se joue un
conflit entre les magies autochtones et européennes. Les mis-
sionnaires récollets et jésuites font face à la rude concurrence
de ceux qu’ils assimilent évidemment à des « sorciers », comme
une image indésirable d’eux-mêmes. Les fameux « Soldats du
Christ » se mesurent à une mythologie qu’ils méprisent et incor-
porent à l’image traditionnelle de Satan dans le but de l’anéantir.
Les métaphores militaires, partout présentes dans les textes des
Récollets et dans les Relations des Jésuites1, ne mentent pas : il
s’agit bien d’un acte de destruction symbolique qui vise à l’évic-
tion de la présence « diabolique » en terre d’Amérique, comme
l’exprime en toute naïveté le récollet Sagard en 1623 quand il
raconte avoir gravé « avec la pointe d’un couteau dans l’écorce
des plus grands arbres, des croix et des noms de Jésus, pour signi-
fier à Satan et à ses suppôts que nous prenions possession de
cette terre pour le royaume de Jésus-Christ et que dorénavant il
n’y aurait plus de pouvoir et que le seul vrai Dieu y serait reconnu
et adoré2 ». On ne peut être plus clair que dans cette déclaration
de guerre à cet univers imaginaire autochtone : ce ne sont pas
85
Reves2.indd 85 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
seulement vos âmes que nous venons prendre, ce sont aussi vos
arbres et vos terres, c’est à votre relation au territoire que l’on s’en
prend dès maintenant, c’est votre univers de rêve et de mémoire
que nous venons détruire. Sagard marque un arbre d’une croix
comme les bûcherons le feront bientôt pour signaler les arbres à
abattre en poursuivant le projet chrétien d’éradication des forêts
et de désenchantement du monde autochtone. On le comprend
maintenant : c’est une seule et même chose que d’abattre ces
forêts et d’évangéliser ces âmes, puisqu’elles tiennent leur vie de
la forêt elle-même.
La lutte religieuse entre missionnaires et chamans a une
incidence directe sur le sort du territoire québécois. Dès 1534, les
imaginaires du territoire entrent en confrontation dans l’épisode
célèbre de la plantation de la croix aux environs de Gaspé (qui
se répétera à Sainte-Croix, en face de Québec, et dans les îles de
Sorel), à laquelle assistent Donnacona, ses fils et plusieurs autres
anonymes.
Le xxiiiie jour dudict moys nous fismes faire une croix de
trente piedz de hault qui fut faicte devant plusieurs d’eulx
sur la poincte de l’entree dudit hable soubz le croysillon de
laquelle misme ung escusson en bosse à troys fleurs de lys et
dessus un escripteau en boys engravé en grosse lettre de forme
où il y avoit Vive le Roy de France. Et icelle croix plantasme
sur ladite poincte devant eulx lesquelz la regardoyent faire et
planter. Et après qu’elle fut eslevée en l’air nous misme tous
à genoulx les mains joinctes en adorant icelle devant eulx.
Et leur fismes signe regardant et leur monstrant le ciel que
par icelle estoit nostre redemption dequoy ilz firent plusieurs
admyradtions en tournant et regardant icelle croix3.
Ce que Cartier fait mine de prendre pour de l’admiration chez
Donnacona et les siens ressemble plutôt, vu d’aujourd’hui, à de
la stupéfaction de comprendre soudain la menace immédiate
86
Reves2.indd 86 2023-06-22 13:34
LA CROIX ET L’ANNEDDA
d’un tout autre imaginaire du territoire. Ce qui frappe dans ce
passage n’est pas seulement l’apparition d’une fleur inconnue
en Amérique, le lys, pourtant si importante symboliquement
en Europe, surtout pour la monarchie franque depuis Clovis
jusqu’à Charles X, et imprimée sur notre drapeau national
depuis 1948, hérité de celui de Carillon, comme un déni du
territoire d’ici. L’important se trouve surtout dans la dimension
verticale de l’érection de la croix « eslevée en l’air » et « mons-
trant le ciel » qui ouvre une colonne imaginaire reliant ciel et
terre, comme s’il s’agissait de faire descendre la lumière divine
sur les ténèbres de ce territoire satanique. Ce couloir magique
forme dans l’imaginaire occidental un occulus qui permet à Dieu
et à ses créatures de communiquer « visuellement », pour ainsi
dire, pourvu que le territoire soit déblayé de tout ce qui entrave
l’ouverture divine ainsi aménagée4. La coupe à blanc permet une
meilleure communication avec Dieu. Un siècle plus tard, le père
Brébeuf ouvrira plus encore le passage de cet œil divin sur la
Terre en incitant les Wendat à déblayer la vue de Dieu sur leur
territoire, à « ôter les pierres, les arbres et les halliers qui y sont
et qui pourraient les arrêter5». D’où la valorisation des territoires
plats et des forêts défrichées qui nous pousse encore aujourd’hui
à toujours raser d’autres hectares de forêt chaque année. Cette
propension à l’aplanissement des terres et à l’exploitation maxi-
male des ressources s’inscrit dans la tendance occidentale de
domination et d’arraisonnement des territoires dont le christia-
nisme fait partie, raison pour laquelle cette manière de faire peut
aisément survivre à la fin apparente de la religion chrétienne.
Raser des terres, étendre la banlieue, favoriser l’étalement urbain
est sans doute aucun une manière insoupçonnée de poursuivre
la civilisation chrétienne bien après son apparente disparition.
87
Reves2.indd 87 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Mais revenons à 1 534 et au drame rapide qui s’y joue.
Donnacona réagit immédiatement et avec intelligence à cette
attaque imaginaire sans précédent de la plantation de la croix.
Il entame selon Cartier « une grande harangue nous monstrant
ladite croix et faisant le signe de la croix avec deux doydz et
puis nous monstroit la terre tout alentour de nous comme s’il
eust voullu dire que toute la terre estoit à luy et que nous ne
devyons pas planter ladite croix sans son congé6 ». Beaucoup plus
qu’un discours de possession territoriale comme le croit Cartier,
qu’il ne peut interpréter qu’en fonction de sa propre idée de prise
de possession du territoire au nom de François Ier, la harangue
de Donnacona se veut un rétablissement des axes imaginaires
ancestraux de son peuple en rabattant le regard sur « la terre tout
alentour », c’est-à-dire sur un axe horizontal, celui de la terre
nourricière ancestrale où les morts et les vivants communiquent
dans le grand cercle de vie. La croix est une blessure imaginaire
de leur territoire pour Donnacona et les Iroquoiens du Saint-
Laurent. La croix n’est évidemment pas seulement une balise
marine, comme Cartier tente de le faire croire à Donnacona,
mais bien un signe de prise de possession imaginaire qui inflige
une marque profonde dans la chair spirituelle des Premières
Nations aussi bien qu’à l’écorce des arbres que déchire Sagard en
y gravant des croix.
Ce conflit des magies se rejoue à nouveau à l’hiver 1536, dans
le fameux épisode du scorbut. Désespéré devant l’avancée
inexorable de la maladie, Cartier « fist mectre le monde en
prières et oraisons et fict porter ung ymage et remembrance de la
Vierge Marie contre un arbre7 ». Quelle ironie ce serait si l’arbre
en question avait été un représentant de ce mystérieux annedda,
88
Reves2.indd 88 2023-06-22 13:34
LA CROIX ET L’ANNEDDA
l’arbre de vie, qui guérit Cartier et ses compagnons. Mais on
identifie depuis trop longtemps l’annedda au cèdre blanc, alors
que Cartier nomme lui-même le cèdre lorsqu’il le rencontre et
qu’il ne se sert du terme iroquoien que pour parler de cet arbre
de vie miraculeux. Et surtout ni le Thuya occidentalis ni l’épi-
nette blanche, promue par Marie-Victorin au rang de ce remède
miracle, ne correspondent aux dimensions et aux descriptions
de Cartier. Peut-être cet arbre contre lequel Cartier fait appuyer
la statue de la Vierge était-il un énorme sapin baumier, que
l’historien Jacques Mathieu8 démontre être fort probablement
l’annedda dont les Iroquoiens font une décoction après avoir
pillé l’écorce et les bourgeons ? Peut-être ajoutaient-ils de l’eau
d’érable, comme le faisaient les Iroquois selon des témoignages
du xviie siècle, notamment celui de Lafitau ? Peut-être aussi ce
« breuvaige qui se trouva estre un vray et evydent miracle », et qui
guérit tout l’équipage aux dires de Cartier, et même des mala-
dies antérieures comme la syphilis, peut-être contenait-il des
fruits d’Aronie (Aronia melanocarpa), ultra-riches en vitamines
C et que les Iroquoiens faisaient sécher en prévision de l’hiver
tout comme les bleuets et les mûres ? Peut-être l’annedda n’est-il
autre chose que la base aujourd’hui mieux connue de la méde-
cine autochtone depuis des millénaires et qui s’est transmise
aux colons de la Nouvelle-France ? Le sapin baumier contient
de fait une dose impressionnante de vitamine C, sa gomme a
des propriétés antiseptiques et antibactériennes reconnues par
la science.
Dernière hypothèse en date : l’annedda serait le pin blanc, si
l’on en croit Berthier Plante9, pour qui l’évidence de la gomme
blanche décrite par le botaniste Pierre Belon au xviie siècle et la
mesure de trois à cinq brasses de circonférence du tronc donnée
par Cartier ne laissent aucun doute sur l’identité de l’arbre de vie,
qui serait Pinus strobus, le pin blanc si dominant dans nos forêts
89
Reves2.indd 89 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
anciennes, symbole de paix de la confédération iroquoise et de
la paix de 1701, l’arbre le plus haut et le plus puissant des forêts
boréales avant que la Royal Navy ne les coupe en presque tota-
lité au sud du Saint-Laurent pour en faire des mats de navire.
Quoi qu’il en soit, au siècle suivant Champlain n’a pas retrouvé
cet arbre miraculeux, ni personne d’autre d’ailleurs et le secret
de l’annedda s’est évanoui avec les Iroquoiens du Saint-Laurent
pour s’estomper dans les voiles de nos imaginaires.
On ne saura sans doute jamais avec une certitude pleine et
entière ce qu’était l’annedda. Les hypothèses se suivent, la nou-
velle éclipsant l’ancienne, dans une valse qui fait tourner devant
nous la totalité des conifères de nos forêts : cèdre blanc, genévrier,
if, épinette blanche, sapin baumier, pin blanc. Je propose à mon
tour une hypothèse : l’annedda serait la forêt elle-même. Le souci
que nous avons d’elle, sa puissance de guérison. L’annedda serait
le mot d’ordre de la conspiration de toutes les âmes, anciennes
ou présentes, qui ont à cœur de préserver la forêt, d’en faire une
source de vie, une forme d’avenir, une possibilité de durer malgré
toute la destruction que nous faisons subir à la Terre. L’annedda
serait la formule magique, ancienne et perdue, à retrouver, de
notre relation aux forêts, à leur survie, à la nôtre.
Rencontre avec Berthier Plante, un avant-midi du mois d’août
sur sa belle réserve de l’annedda. Berthier a acheté ce terrain
magnifique, situé en bordure de la rivière Saint-François et en a
fait une réserve naturelle protégée à perpétuité et reconnue par le
ministère. Le corridor appalachien l’a reconnu et y passe main-
tenant. Il lui a donné le beau nom iroquoien d’annedda parce
qu’il y pousse de gigantesques pins blancs qui ont été préservés
de l’exploitation en raison de la pente accentuée de la vallée de la
90
Reves2.indd 90 2023-06-22 13:34
LA CROIX ET L’ANNEDDA
Saint-François. Berthier me montre soigneusement, en prenant
bien son temps malgré mon empressement, toutes les espèces
qui croissent sur cette terre laissée à elle-même pour son plus
grand bonheur : noyer cendré, if, érable de Pennsylvanie, bouleau
jaune. Berthier me fait même déguster des brindilles de ce faux
merisier, le goût est surprenant : mentholé, frais, presque alcoo-
lisé, je soupçonne vite des propriétés antiseptiques, qui me sont
confirmées immédiatement. Voici quelqu’un qui a compris ce
qu’est l’annedda : c’est un souci du territoire, une attention à ses
ressources, un engagement corps et âme dans la préservation de
la Terre.
Revenons juste un moment à ce conflit des magies en
Nouvelle-France, à cet affrontement entre l’efficacité de la
Vierge et celle de l’annedda, qui touche surtout l’imaginaire du
territoire, car l’arbre de vie, en définitive, c’est peut-être le végé-
tal lui-même, qui forme la base de la vie. Pour les Français, la
solution se trouve dans l’appel aux puissances célestes qui font
intervenir, dans leur vision miséricordieuse des cieux entrouverts,
Domagaya, le fils de Donnacona qui leur transmet le secret de
l’annedda, afin de sauver les compagnons de Cartier. Le savoir
autochtone se limite à n’être, pour Cartier, que l’intermédiaire
de Dieu, sans égard aux Iroquoiens eux-mêmes et à leur savoir
millénaire, à leur connaissance de la forêt, de ses vertus et de ses
pièges. Alors que pour les Iroquoiens, c’est la terre elle-même
qui fournit la solution et qui pourvoit à tout, dans une phar-
macopée qui n’était pas inconnue en Europe, notamment par
la connaissance monacale de ce que l’on appelait les simples,
c’est-à-dire des herbes médicinales que l’on croyait non com-
posées. Dans certains monastères on trouvait un herbularius ou
91
Reves2.indd 91 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
jardin des simples, où l’on cultivait les plantes préconisées par
Hildegarde de Bingen dans son Liber Simplis Medicinae. C’est
dans ces monastères que se transmettait un savoir apothicaire
qui traversera aussi l’Atlantique, grâce aux botanistes qui font
partie des expéditions de Cartier et surtout à Louis Hébert, pre-
mier colon et apothicaire installé à demeure en Nouvelle-France,
non loin de l’actuelle place Royale dans le Vieux-Québec. Mais
pour l’essentiel ce savoir « magique » des plantes était réservé en
Europe à une caste ou à certains individus précis, tandis qu’il fai-
sait partie des connaissances communes autochtones. Le témoi-
gnage de Cartier est sans ambiguïté : autant Domagaya que les
femmes de Stadaconé, ou n’importe quel Stadaconien, peuvent
faire bouillir de l’annedda. « Ces remèdes naturels, confirme
Georges Sioui, étaient connus de tous et pouvaient être utilisés
par à peu près tout le monde10. » C’est un savoir qui vient avec
la naissance autochtone, qui provient du territoire lui-même.
Pour les Iroquoiens, il fait partie de la vie d’ici depuis toujours.
Même les autres nations autochtones ne pouvaient pénétrer le
secret de l’annedda tant il était lié à une connaissance singu-
lière du territoire et à une adaptation locale chaque fois unique
aux conditions de vie d’ici. Là où croît le péril croît aussi ce qui
sauve (Hölderlin) : à toute maladie, la terre ancestrale a prévu un
remède pour le peuple qui connaît les plantes et leurs propriétés.
Suffit de savoir décrocher ses yeux du ciel et de se pencher sur la
terre où poussent les plantes de vie.
Reves2.indd 92 2023-06-22 13:34
Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Jacques Cartier rencontre les Indiens
à Stadaconé, 1535, 1907. Huile sur toile, 264,5 × 401 cm.
Collection du Musée national des beaux-arts du Québec.
Tout porte au malaise dans ce célèbre échec de Suzor-Coté, dont le projet
était d’orner le parlement d’Ottawa avec cette scène pittoresque où l’ensemble
a l’air faux, comme le dénonce Natasha Kanapé Fontaine : l’idéalisation de
Cartier déguisé en conquistador, les Stadaconiens rampant comme des sous-
hommes et assimilés au décor de verdure semblent n’être qu’une émanation de
la nature à dompter et à conquérir. J’ajouterais : la lumière venant des Euro-
péens et aveuglant les Iroquoiens, la position centrale occupée par la figure
monumentale du découvreur (il faudrait maintenant dire « du conquérant »),
le contraste des couleurs entre les groupes, vives d’un côté ternes de l’autre,
et surtout la colonne armée de l’équipage suivant Cartier, anonyme, mena-
çante, comme tout ce qui vient avec ce mélange bactériologique qui a sans
doute causé le massacre des Iroquoiens du Saint-Laurent dès 1534 selon l’hy-
pothèse formulée par Georges Sioui (Pour une auto-histoire amérindienne).
On ne saurait mieux exprimer que par cette toile le catapultage des civilisa-
tions qui montre l’arrivée des Européens comme une tache trop colorée et des
formes inappropriées aux lignes fuyantes et aux tons ancestraux du territoire.
Reves2.indd 93 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 94 2023-06-22 13:34
MAISON FERMÉE
Je songe à la désolation de l’hiver
Aux longues journées de solitude
Dans la maison morte –
Car la maison meurt où rien n’est ouvert –
Dans la maison close, cernée de forêts
Hector de Saint-Denys Garneau,
« Maison fermée », Regards et jeux
dans l’espace.
Le paradoxe d’une conscience d’autant plus repliée sur elle-
même que l’espace alentour est vaste et puissant fait partie de
la manière d’être ici depuis les premiers moments de la présence
française en Amérique. Ce sentiment de fermeture de l’habita-
tion cernée de forêts, cette tentation d’un enracinement restreint
à l’espace immédiat des nécessités s’est élargi avec les siècles au
pays en entier avec la domination progressive du territoire de
la Nouvelle-France et les avancées de la civilisation techno-
scientifique. Mais la maison ne s’est pas ouverte pour autant :
c’est plutôt le territoire qui a été englobé dans la maison. Le
philosophe Peter Sloterdijk parle de « bulle » ou de « palais de
95
Reves2.indd 95 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
cristal1 » pour désigner cette domestication occidentale du terri-
toire par laquelle se forme une sorte de protection invisible grâce
à laquelle sont pratiquement éliminés tous les dangers poten-
tiels. C’est du même coup une manière sécuritaire d’exploiter le
maximum de ressources naturelles. Autrement dit, la fermeture
du territoire est un préalable à l’arraisonnement capitaliste des
ressources et tient son origine dans la mentalité de la maison
fermée que l’on voit s’implanter ici dès les premiers moments de
la colonisation.
Cette fermeture paradoxale qui intègre le dehors au dedans
contraste fortement avec la manière autochtone d’habiter le
territoire, pas seulement au regard du nomadisme algonquien
ou inuit ou même du semi-nomadisme iroquoien, mais qui
concerne même les nations sédentaires et horticoles depuis le
Sylvicole supérieur, où la maison longue reste ouverte sur le
dehors par ses ouvertures aux deux bouts et au plafond (pour
laisser passer la fumée des feux), par sa fragilité, sa simplicité et
la facilité de la reconstruire ailleurs. Malgré sa capacité à s’al-
longer indéfiniment par l’ajout de sections modulaires, l’habita-
tion iroquoienne ne peut toutefois pas s’élargir aux dimensions
entières du territoire, puisqu’elle s’y intègre plutôt en fonction
des ressources disponibles, comme le montrent de nombreux
sites archéologiques iroquoiens, dont celui, exemplaire et célèbre,
de Droulers-Tsiionhiakwatha, tout près de Saint-Anicet, délaissé
au bout de quelque temps, probablement vers 1500, après épui-
sement des stocks forestiers et halieutiques environnants. Cette
forme d’habitation reste semi-permanente et doit être laissée à
l’abandon suivant le cycle naturel d’épuisement des ressources du
site, c’est-à-dire tous les dix ou vingt ans, ce qui a pour consé-
quence que même les clairières les plus ouvertes dans la forêt
par l’agriculture iroquoienne ne créent pas de dommages perma-
nents et permettent aux arbres de se régénérer assez rapidement.
96
Reves2.indd 96 2023-06-22 13:34
MAISON FERMÉE
Dans le Haut-Saint-Laurent, la séquence probable d’habitation
des sites révèle ainsi qu’une population d’Iroquoiens s’est vrai-
semblablement installée au site McDonald, puis a migré vers
le site plus imposant de Droulers, pour ensuite se transporter
vers le site Mailhot-Curran2. Situés non loin les uns des autres,
ces sites occupés successivement donnent à penser que l’habita-
tion du territoire était conçue d’une manière qu’on appellerait
aujourd’hui « écoresponsable », mais qui était tout simplement
en adéquation avec les ressources disponibles. La composition
même de la maison longue se fond dans les couleurs et les maté-
riaux d’alentour : arches de cèdres, écorces de bouleau, branches
de chênes, tapis de conifères, isolation grâce aux peaux animales.
C’est un abri fabriqué avec les ressources du lieu. La maison
longue est une protection émanant du territoire lui-même, une
sorte de pli matériel qui continue à faire partie du lieu, rabattant
nature et culture l’une sur l’autre. Elle est un abri collectif tra-
versé par les forces naturelles, même lorsque palissadé comme
c’était le cas à Hochelaga selon le témoignage de Cartier et aussi
selon les fouilles archéologiques de plusieurs sites vraisembla-
blement entourés de palissades, comme celui de Dawson. La
maison longue est pénétrée par les forces cosmologiques des
points cardinaux qui symbolisent le parcours de la vie humaine,
de la naissance à l’est à la mort à l’ouest3. C’est cette ouverture
au dehors ou, pour mieux dire, cette habitation du dehors, cette
maison ouverte, qui a permis aux Premières Nations de laisser
malgré elles aux Européens un capital écologique extraordinaire,
qui a d’ailleurs été dilapidé à une vitesse ahurissante quand on
observe l’installation européenne en Amérique sur la longue
durée.
La tradition occidentale de la bulle territoriale qui fait du
dehors un potentiel dedans à exploiter s’inscrit dans une archéo-
logie qui remonte aussi loin que la civilisation suméro-akkadienne
97
Reves2.indd 97 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
dont Cartier se fait le porteur inconscient, comme on le dirait
d’un virus qu’il aurait transporté outre-Atlantique. S’il évite l’hi-
ver en 1534, il y fait face en 1535-1536 et en 1541-1542 en
construisant de petits forts dont on a pu retrouver quelques
traces archéologiques, dès 1608 d’ailleurs, quand Champlain
pense avoir repéré « le lieu où Jacques Cartier hiverna4 ». À Cap-
Rouge, il existe le site archéologique du Fort d’en haut, dit de
Charlesbourg-Royal, érigé par Cartier en 1541 puis réaménagé
l’année suivante par Roberval sous le nom de France-Roy. Ce
site témoigne d’une tentative d’implantation sur le territoire
en suivant les valeurs les plus fondamentales de l’urbanisme
occidental. Le site se divise en deux plateaux, l’un en contre-
haut du promontoire de Cap-Rouge, l’autre quelques dizaines
de mètres en contrebas. Les traces archéologiques, notamment
les débris d’objets trouvés sur place, suggèrent une différence
sociale entre les habitants du haut et ceux du bas, suivant leurs
positions respectives dans l’échelle de la société, des nobles
entourant le sieur La Rocque de Roberval jusqu’aux prisonniers
embauchés dans l’expédition en promesse d’une rémission de
peine5. On voit s’inscrire dans le territoire la manière de penser
européenne qui hiérarchise les sites géographiques en fonction
des positions sociales. Ces idées qui structurent inconsciemment
le site de France-Roy sont plus ou moins diffuses et sont héritées
de l’Antiquité grecque. On peut lire par exemple dans les Poli-
tiques d’Aristote : « Ainsi une acropole convient à une oligarchie
et à une monarchie, un plat pays à une démocratie, mais aucun
des deux ne convient à une aristocratie, mais plutôt plusieurs
places fortes6. » Les Politiques décrivent le système d’aplanisse-
ment et de balises en quadrillé du territoire nommé le démos,
qui a produit notre démocratie où les habitants des surfaces
planes forment la base sociale des sociétés démocratiques et où
ceux des terrains dénivelés, en hauteur, participent d’une mise
98
Reves2.indd 98 2023-06-22 13:34
MAISON FERMÉE
en valeur de l’aristocratie, perçue alors comme la classe sociale
des meilleurs7. Depuis le Fort Saint-Louis érigé par Champlain
en 1620 à l’emplacement actuel de la terrasse Dufferin, c’est-
à-dire sur le plus haut promontoire des environs, on aperçoit
encore aujourd’hui dans la ville de Québec actuelle des traces
non équivoques de cette séparation entre haute et basse-ville.
On voit d’ailleurs cette même coupure s’implanter durablement
dès les premiers plans de Ville-Marie en 16728, tout comme
dans l’organisation sociale que présuppose l’habitation du mont
Royal, qui octroie la royauté à la seule hauteur environnante. De
nos jours, le flanc de Westmount est occupé par les dirigeants
économiques des grands empires financiers du pays. Du côté
anglais, on retrouve aussi cette façon de penser le territoire. La
ville de Sherbrooke est structurée selon cette hiérarchisation par
la séparation du plateau Marquette, où se trouvent bien sûr la
cathédrale et l’hôtel de ville, de la basse-ville ouvrière sur le site
originel du Hyatt’Mill, où se sont établis les premiers fermiers,
puis les premières industries dans les bouches de la Magog, à la
croisée exacte de l’emplacement que les Abénakis nommaient
Ktinéketolekwak, les Grandes Fourches, c’est-à-dire l’endroit où
la rivière Magog se jette dans la rivière Saint-François9.
Si l’on revient un instant au site de France-Roy, on peut aussi
voir qu’il s’inscrit dans la mentalité héritée du Moyen Âge qui a
vu le processus d’incastellamento en Italie ou d’enchâtellement en
France méridionale10, c’est-à-dire d’une construction progres-
sive de l’urbanisme européen autour d’une place fortifiée. Cette
naissance des villes au Moyen Âge s’enracine sur la petite hau-
teur, souvent naturelle mais quelquefois artificielle, de la motte
castrale, sorte de butte fortifiée et le plus souvent entourée d’un
fossé. C’est autour de cette motte castrale que se structurent les
villages et bientôt les villes selon le processus d’encellulement
des territoires, qu’on retrouve dans la France du Nord11 et où le
99
Reves2.indd 99 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
haut et le bas se départissent en fonction d’une échelle sociale
appelée à se complexifier. Aux dirigeants les hauteurs, au peuple
les plaines, c’est le cœur de l’urbanisme à l’européenne. Dès les
premiers pieux plantés en terre d’Amérique par les Français,
l’aménagement de l’espace et du territoire est une conséquence
des schémas que les Européens ont en tête.
Bien sûr, les nations autochtones ont elles aussi opéré une
certaine coalescence des populations en regroupant différents
villages sous de plus grosses défenses collectives, comme c’est
d’ailleurs le cas du site Droulers-Tsiionhiakwatha, que l’archéo-
logue Claude Chapdelaine appelle pour cela un « chef-lieu12 ».
Ces villages, souvent palissadés, comme à Hochelaga selon
Cartier, quoique peut-être pas à Droulers, comprenaient entre
quelques centaines et quelques milliers d’individus pour les
plus imposants et ils étaient construits souvent sur des hauteurs
naturelles que l’on appelle des drumlins, c’est-à-dire des collines
aplaties formées de restes morainiques. La plupart des villages
iroquoiens exhumés par des fouilles archéologiques se trouvent
sur des drumlins d’une altitude approximative de 70 mètres, ce
qui permettait une certaine défense naturelle. Mais il y a d’autres
raisons, plus pratiques, qui expliquent le choix des Iroquoiens de
s’établir sur des drumlins et c’est la géographie et la géologie qui
les dévoilent. Ce sont d’abord les cours d’eau situés à proximité
qui longent les moraines et surtout la qualité des sols bien drai-
nés, non argileux ou limoneux13. En un mot, c’est le partage des
eaux qui dicte ce choix des drumlins : l’eau est disponible tout
en bas pour cultiver et absente sur les hauteurs pour y loger.
C’est donc surtout un choix de connaissance des sols et du ter-
ritoire qui explique l’emplacement des villages iroquoiens sur
les hauteurs. Nous sommes très loin de la mentalité européenne
d’échelonnage des positions sociales sur les hauteurs physiques
du territoire. J’ajoute qu’à l’intérieur même des villages, rien
100
Reves2.indd 100 2023-06-22 13:34
MAISON FERMÉE
n’indique une quelconque différence entre les dirigeants et diri-
gés. Pourquoi ? Rien ne nous permet de le savoir précisément.
Peut-être ces populations n’ont-elles pas eu le temps de se
constituer en chefferies avant l’arrivée des Blancs14 ? Mais penser
ainsi, ce serait ressusciter la vieille vision linéaire occidentale
des choses qui situe les sociétés sur une ligne évolutive, alors
que ces manières de penser étaient profondément étrangères
aux Premières Nations qui vivent, comme le dit Georges Sioui,
« la réalité du Cercle sacré de la Vie, dans lequel tous les êtres,
matériels et immatériels, sont égaux et interdépendants15 ». Les
cercles des wigwams, des iglous et des villages semi-nomades ne
connaissent pas la hiérarchisation européenne du haut et du bas,
de l’escarpé et du plat qui place le sublime dans les hauteurs et
l’humilité tout en bas. Tous font plutôt partie d’un cercle hori-
zontal où chacun est invité à trouver sa place.
La manière même de s’implanter dans le territoire montre
les valeurs fondamentales des civilisations en présence : d’un
côté, la hiérarchie et une structure de pouvoir linéaire, de l’autre
côté, la circularité et l’interdépendance. Les civilisations s’im-
plantent dans le territoire en suivant la grammaire profonde de
leurs mentalités : les cercles concentriques élevés par degrés
autour de l’autorité seigneuriale médiévale étaient en passe à
l’époque de Cartier de céder le terrain aux carrelages rationnels
de la civilisation agraire descendante de Sumer et d’Akkad qui
s’est implantée avec vigueur sur le territoire européen au point
de détruire presque toutes les forêts du continent européen. Au
moment du premier contact avec les Autochtones, alors que la
rationalité européenne triomphe de son propre paganisme fores-
tier, elle rencontre en Amérique une manière inédite d’écrire
sa présence sur le territoire, par une pensée qui tient plus du
pictogramme et du symbole tissé dans le wampum. On connaît
la fonction m némotechnique des ceintures de wampum, faites de
101
Reves2.indd 101 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
coquillages polis et percés, le noir (pourpre) indiquant le deuil, le
rouge, la guerre et le blanc, la paix. Les paroles échangées en vue
d’un traité sont ainsi matérialisées par le wampum. Ou encore
par les symboles pictogrammatiques qui représentent les nations
signataires pour les quarante nations présentes à Montréal lors
du traité de paix en 1701, par exemple la tortue, le renard ou
l’ours16. Il existe donc une forme d’inscription de la parole dans
la matière pour les Premières Nations, et elle témoigne de toute
une pensée du territoire : c’est la grammaire agglutinante des
nations algonquiennes ou la logique modulaire des maisons
longues iroquoiennes qui se regroupent en villages formant une
sorte d’écriture agglutinée sur la page irrégulière d’un territoire
qui semble les effacer en peu de temps pour les redessiner plus
loin et les effacer de nouveau dans une apparente éternité. Le
pointillé des wigwams et des shaputuans algonquiens, celui des
iglous des Inuit, l’habitation la plus évanescente et écologique
qui soit, dessine aussi à sa façon d’improbables constellations
appelées sans cesse à se reconfigurer au gré des circonstances et
des saisons du nomadisme. Ces dessins de la pensée échappent
aux civilisations dites de l’écriture qui fixent leurs paroles dans
la matière et créent ainsi une mémoire figée et linéaire qu’on
appelle ordinairement « l’histoire » et dont il faudra bien un
jour consentir à changer la définition pour y faire entrer aussi
les grandes civilisations du cercle et de l’oralité. Ces civilisations
vivent dans une apparente instantanéité, elles font et défont les
coordonnées de leur inscription dans le territoire en suivant les
ressources et ses renouvellements, alors qu’en réalité, dans la très
longue durée, ce sont elles qui vivent dans la plus grande perma-
nence. L’ouverture de la maison longue, l’évanescence de l’iglou
et la simplicité du wigwam débouchent en définitive sur une
forme d’éternité.
102
Reves2.indd 102 2023-06-22 13:34
MAISON FERMÉE
Permettez-moi d’insister un petit moment sur cette question de
l’écriture en passant par un livre bouleversant, le premier écrit en
innu par une femme, celui d’An Antane Kapesh, Je suis une mau-
dite sauvagesse. « Le Blanc dit vrai quand il dit : “L’Indien n’a pas
de livres. ” C’est vrai, l’Indien n’a pas de livres, mais voici ce que je
pense : chaque Indien possède des histoires dans sa tête, chaque
Indien pourrait raconter la vie que nous vivions dans le passé
et la vie des Blancs que nous vivons à présent, il pourrait dire à
quel point le Blanc nous a trompés depuis que c’est lui qui nous
administre17. » L’analogie avec le rapport Durham, qui faisait des
Canadiens français un peuple « sans histoire et sans littérature »
est frappante : les Innus se sont fait accuser un siècle après le
fameux rapport (1839) du même analphabétisme et de la même
absence de littérature. Savoir lire et écrire, c’est faire partie de
la civilisation du nivellement de la page (pagus : païen, paysan
et paysage). Autrement dit, c’est notre pensée de l’écriture qui
burine la page du territoire, perçue comme « blanche », comme
pour mieux nous y ancrer et repousser loin la hantise de l’ora-
lité et du nomadisme évoquée par le spectre de lord Durham.
Les Innus ne s’y étaient pas trompés à l’époque de Paul Lejeune,
quand ils attribuaient leurs problèmes à un ensorcellement par
l’écriture des Blancs : « [D]epuis que vous avez décrit notre pays,
nos fleuves, nos terres et nos bois, nous mourrons tous, ce qui
n’arrivait pas avant que vous vinssiez ici18. » L’écriture a quelque
chose d’une magie noire pour les Innus, comme la photogra-
phie plus tard pour quantité d’Autochtones qui y voient une
façon de voler leur âme. Et il faut bien comprendre qu’ils ont
vu très clair : l’écriture blanche a effectivement détruit leur pays,
comme le dit An Antane Kapesh. Nous aurions pu choisir au
contraire d’assumer, comme elle, d’être « des maudits sauvages »
103
Reves2.indd 103 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
et d’entonner avec Octave Crémazie la ballade des ensauvagés.
Mais c’est le choix collectif inverse qui a été fait, avec pour consé-
quence de détruire le pays en l’aplanissant au bulldozer comme
une immense page à remplir de nos caractères venus d’ailleurs,
par l’écriture asphaltée de nos rues rectilignes et par les formes
anguleuses de nos maisons fermées.
Il ne s’agit aucunement de reprocher à Cartier, à Roberval, ou
même à Champlain de s’être fortifiés à Sainte-Croix, à France-
Roy ou même à « l’abitation de Quebecq » en 1608. On sait
l’énergie que Champlain a déployée en vain pour convaincre les
autorités royales de bâtir un fort digne de ce nom aux environs
de Québec pour se protéger des envahisseurs potentiels en blo-
quant l’entrée de la vallée du Saint-Laurent19. On voit bien la
nécessité de cette protection à une époque où pratiquement rien
n’existe encore de la civilisation occidentale en terre d ’Amérique.
Il s’agit plutôt de remarquer la façon dont les Européens ont
pensé naturellement leur implantation sur le territoire en ame-
nant avec eux, malgré leur bonne volonté, leurs mentalités, leurs
schémas les plus fondamentaux. Comment aurait-il pu en être
autrement ? Champlain, on le sait, cartographie d’une manière
presque maniaque le territoire, en notant chaque fois ce qu’il
serait possible de faire en tel ou tel lieu : des labours ici, faire
paître le bétail là, engranger sur cette île, construire un port dans
cette baie, une ville sur ce promontoire. Il se réjouit de voir le
premier potager de Louis Hébert être aussi fertile, il voudrait
étendre ces cultures européennes sur le territoire entier des
basses-terres. Son regard projette sur le territoire une future civi-
lisation, qui est la nôtre. Nous vivons actuellement dans le futur
de cette transformation du territoire que Champlain superposait
104
Reves2.indd 104 2023-06-22 13:34
MAISON FERMÉE
aux paysages qu’il contemplait. Je ne veux pas seulement dire par
là que Champlain regarde le territoire qu’il découvre avec l’œil
d’un Européen du xviie siècle. On vient tout juste alors d’inven-
ter en Europe la notion de paysage et Champlain décrit souvent
les forêts en suivant cette idée nouvelle que les arbres semblent
avoir été plantés par plaisir, presque par caprice aristocratique,
comme si Dieu avait joué au jardinier céleste en disposant les
arbres de la Nouvelle-France selon son goût artistique, comme
dans les toiles classiques de son contemporain Nicolas Poussin
où la nature devient une force picturale majeure, et bientôt dans
celles de Jean-Baptiste Corot qui traduisent l’harmonie secrète
des masses et des couleurs végétales du paysage ou plus tard dans
les ciels exubérants d’Eugène Boudin. Nous habitons bien sûr ce
regard paysagiste qui prend forme avec Champlain dès la pre-
mière moitié du xviie siècle.
Mais je voudrais insister davantage sur son acharnement à
projeter une civilisation de l’agriculture occidentale qui détruira
à terme ces forêts somptueuses. Il débarque par exemple à
l’actuel lieu de Pointe-à-Callières en 1611 (lieu que choisiront
Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance pour
l’emplacement du Fort Ville-Marie), où il croit que les habi-
tants d’Hochelaga cultivaient les terres du temps de Cartier, et
fait « aussitôt couper et défricher le bois de ladite Place Royale
pour la rendre unie et prête à bâtir20 ». Il y fait semer toutes les
plantes européennes importées dans ses cales. Raser les forêts,
dessoucher, aplanir, labourer, semer, bâtir, fortifier, tel est le plan
de domestication du territoire qui se répétera partout sous les
régimes français, anglais et jusqu’à nous qui le poursuivons de
manière bien inconsciente, dans tous les sens du terme.
Reves2.indd 105 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 106 2023-06-22 13:34
LA FÊTE DES ÂMES
Jean de Brébeuf raconte souvent dans ses écrits spirituels les
visions qui lui viennent et qui le propulsent, « ravi en Dieu par
des mouvements d’amour1 ». D’autres fois, c’est « un squelette
qui s’enfuyait de moi2 » ou encore « avant le repas, il me sembla
voir des taches de sang ou des traces violettes sur les vêtements
de tous les nôtres, et les miens aussi, nul n’en était exempt3 ». Ces
visions cinématographiques avant l’heure sont spectaculaires par
leur capacité à attirer l’œil hors du réel et donc à manquer la
présence sur le territoire d’ici. Être visionnaire, c’est souvent ne
pas être observateur. On peut aussi y lire facilement la culpabilité
profonde que ressent le jésuite face au génocide indirect d’une
nation, les Hurons-Wendat, en train de se commettre sous ses
yeux et par son intermédiaire même. Ses visions agissent comme
un retour quasi en direct du refoulé chrétien dans l’opération de
prise de possession du territoire et de destruction symbolique et
physique de la Huronie. Et avec tout ce que l’on sait aujourd’hui
des agissements des hommes d’Église, il y a lieu de croire que
Brébeuf savait mieux que quiconque en quoi consistaient les
innombrables péchés dont il s’accusait sans cesse.
107
Reves2.indd 107 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Il est dommage que le film de Fernand Dansereau, Astataïon ou
Le festin des morts (ONF, 1965), n’ait pas insisté davantage sur la
dimension visionnaire des missionnaires jésuites dont la projec-
tion fantasmatique sur le territoire est déjà cinématographique
trois siècles avant la lettre. Mais on ne peut trop demander à
l’un des premiers longs métrages d’ici, tourné par la toute jeune
équipe française qui aura bien d’autres occasions de se faire
valoir. Bien sûr, ce n’est plus possible de regarder ce film sans un
grand éclat de rire : le ridicule des black face, les rôles autochtones
joués par des comédiens québécois ( Jacques Godin, Monique
Mercure, Jean-Louis Millette, Hubert Loiselle, etc.), le décor
de pacotille qui ressemble à s’y méprendre à un plateau de tour-
nage, le point de vue exclusivement français qui fait des Wendat
des sauvages sanguinaires, barbares et cannibales, les dialogues
dans lesquels les Wendat conjuguent leurs verbes à l’imparfait
du subjonctif avec une diction parfaite calquée sur la Comédie
française, la trame sonore digne d’un opéra amateur, l’éclairage
vaguement expressionniste allemand qui souligne la noirceur
dans laquelle les missionnaires sont plongés et qui révèle ainsi
le point de vue exclusivement européen de la caméra qui ne
voit de lumière vive que dans la mort, à l’orée des bois, hors de
l’enfer des forêts et du Wendaké. Toutes les raisons sont bonnes
pour aiguiser son sens critique sur cette malheureuse produc-
tion pourtant profondément révélatrice d’un entêtement collec-
tif à manquer le cœur spirituel de la nation wendate : la terre,
sa générosité, sa puissance. Face à toutes ces critiques, Fernand
Dansereau a répondu que ce film portait non pas sur la réalité
historique, mais sur la culture qui lui avait été inculquée en tant
que Québécois, et c’est ici que ce film devient intéressant parce
qu’il montre de façon exemplaire comment s’est instaurée une
108
Reves2.indd 108 2023-06-22 13:34
LA FÊTE DES ÂMES
barrière d’incompréhension séculaire de la manière autochtone
d’habiter le territoire. Le prétexte historique qui donne son titre
au film de Dansereau provient des descriptions de ce que les
Jésuites appellent la fête des morts chez les Wendat, mais que
ceux-ci nomment en fait Fête des âmes ou même Yandatsa4, qui
voudrait dire « le chaudron », puisque cette cérémonie consiste à
offrir un festin, une chaudronnée, c’est-à-dire un repas commun
aux vivants et aux âmes des personnes défuntes. C’est déjà un
premier immense malentendu. En réalité, vu d’aujourd’hui, ce
film porte surtout sur l’incompréhension mutuelle des nations
wendate et française débouchant sur les rituels clichés de la tor-
ture iroquoienne et sur certaines formes de cannibalisme, pour-
tant historiquement réelles mais n’ayant pas grand-chose à voir
avec l’institution de la grande Fête des âmes chez les Wendat.
Nous connaissons cette fête wendate principalement grâce à
la tradition orale et aux textes de Champlain, de Sagard, et de
Brébeuf. C’est l’un des rituels mentionnés avec le plus de préci-
sion par les explorateurs et les missionnaires de la période des
premiers contacts. Georges Sioui qualifie cette cérémonie de
« l’un des traits les plus remarquables et les plus significatifs5 » de
la civilisation wendate qui survient tous les dix ou douze ans envi-
ron et dont la dernière occurrence remonte vraisemblablement
à 1636, à la veille de la destruction symbolique de la Huronie
(elle ne sera célébrée à nouveau qu’en 1999 à Ossossané pour
réenterrer les morts mis au jour par les archéologues sans la per-
mission des Wendat). Il s’agit d’une sorte d’enterrement collectif
des membres des différents clans wendat, souvent accompagnés
de corps provenant d’autres nations, notamment algonquiennes.
Ce rituel vise surtout d’après Bruce Trigger à resserrer les liens
109
Reves2.indd 109 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
sociaux et à tisser ou à renouveler des alliances, et bien sûr à établir
une communication spirituelle avec les morts. Champlain décrit
ainsi dès 1619 la cérémonie de déterrement des os des défunts :
Ils prennent tous les ossements des défunts, qu’ils nettoient
et rendent fort nets, les gardent soigneusement, encore qu’ils
sentent comme des corps fraîchement enterrés. Ce fait, tous
les parents et amis des défunts prennent lesdits os avec leurs
colliers, fourrures, haches, chaudières et autres choses qu’ils
estiment de valeur, avec quantité de vivres qu’ils portent au
lieu destiné. Étant tous assemblés, ils mettent les vivres en
un lieu où ceux de ce village en ordonnent, faisant des fes-
tins et danses continuels en l’espace de dix jours que dure la
fête. Et pendant icelle, les autres nations de toutes parts y
abordent pour voir cette fête et les cérémonies qui s’y font
sont de grands frais entre eux. Or par le moyen de ces céré-
monies, comme danses, destins et assemblées ainsi faits, ils
contractent une nouvelle amitié entre eux, disant que les os de
leurs parents et amis sont pour être mis tous ensemble posant
une figure, que tout ainsi que leurs os sont assemblés et unis
en un même lieu, ainsi aussi que durant la vie ils doivent être
unis en une amitié et concorde comme parents et amis sans
s’en pouvoir séparer. Ces os des uns et des autres parents ainsi
mêlés ensemble, ils font plusieurs discours sur ce sujet. Puis
après quelques mines ou façons de faire, ils font une grande
fosse de dix toises en carré, dans laquelle ils mettent ces dits
os avec les colliers, chaînes de porcelaines, haches, chaudières,
lames d’épées, couteaux et autres bagatelles, lesquels néan-
moins ne sont pas de petites valeurs parmi eux, et couvrent le
tout de terre, y mettant plusieurs grosses pièces de bois avec
quantité de piliers qu’ils mettent alentour, faisant une couver-
ture sur iceux6.
Sagard reprend ces lignes de Champlain dans son Grand voyage
au pays des Hurons et y ajoute ses propres considérations spiri-
110
Reves2.indd 110 2023-06-22 13:34
LA FÊTE DES ÂMES
tuelles : « Chrétiens, rentrons un peu en nous-mêmes et voyons
si nos ferveurs sont aussi grandes, envers les âmes de nos parents
détenues dans les prisons de Dieu que celles des pauvres sau-
vages envers les âmes de leurs semblables défunts […] auxquels
ils donnent le plus beau et le meilleur qu’ils ont7. » Et Brébeuf
ajoute quelques années plus tard, dans une longue description
des cérémonies de la « fête des morts », que les Wendat appellent
les os de leurs morts, atisken, « les âmes », au sens où chaque âme
est constituée de deux parts : « L’une de ces âmes se sépare du
corps à la mort et demeure néanmoins dans le cimetière jusqu’à
la fête des morts, après laquelle elle se change en tourterelle ou,
selon la plus commune opinion, s’en va droit au village des âmes.
L’autre est comme attachée au corps et informe pour ainsi dire
le cadavre ; elle demeure en la fosse des morts après la fête et
n’en sort jamais, si ce n’est que quelqu’un l’enfante derechef 8. »
Cette grande cérémonie qui dure environ une dizaine de jours
a donc plusieurs fonctions, dont celle de séparer les deux âmes
d’une personne défunte. L’une, plus spirituelle, nommée oki
andaerandi, va au village des âmes, situé à l’autre bout de notre
monde, le plus souvent représenté comme tout à l’ouest. L’autre
âme, nommée khiondhekwi, reste attachée au corps, plus préci-
sément aux os, qui contiennent l’âme ou, pour mieux dire, sont
l’âme même9. Cette âme-os, atisken, reste dans la fosse et peut se
réincarner éventuellement en une autre personne, qui incorpore
alors l’identité défunte et l’incarne dorénavant en cherchant à
lui faire honneur. Tandis que l’autre âme entame son voyage au
pays des morts.
La médecine wendate distingue plusieurs sortes de maladies :
celles, physiologiques, qui sont guérissables par les plantes et les
111
Reves2.indd 111 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
festins, et celles qui touchent l’âme et les désirs non comblés.
Le mot wendat pour guérir ce mal est ondinnok, qui a été choisi
par Yves Sioui-Durand et Catherine Joncas pour nommer leur
maison de production de théâtre autochtone qui existe depuis
plusieurs décennies. Cette troupe à nulle autre pareille, première
institution de théâtre autochtone francophone, emploie le plus
souvent possible des personnes issues des communautés autoch-
tones, pour permettre la réappropriation de leur mythologie,
de leur mémoire et de leur histoire par les Autochtones eux-
mêmes. À la fin des années 1980 et au début des années 1990,
le premier cycle de production touchait aux grands mythes
autochtones de l’Amérique. C’est en 1988 qu’a été montée par
Ondinnok l’œuvre majeure Atiskenandahate – Le Voyage au pays
des morts10. Cette fois, plus de vingt ans après le film de Fernand
Dansereau, ce sont des dramaturges, metteurs en scènes, acteurs
et actrices autochtones qui jouent les rôles de leurs ancêtres et
qui les incarnent avec toute leur mémoire et leurs corps porteurs
de traumatismes et de souvenirs remontant à plusieurs généra-
tions avant eux : l’invasion du territoire par les Blancs, la perte
des terres, la destruction des villages, les pensionnats, l’oubli de
l’identité profonde, l’alcoolisme, la violence conjugale, le viol,
l’inceste et les meurtres. En apparence, il s’agit du même sujet,
la Fête des âmes de la tradition wendate, mais en réalité, quelle
différence ! Les morts sont non seulement les ancêtres, mais
aussi les descendants eux-mêmes, menacés de zombification, et
le théâtre d’Ondinnok a précisément pour but de redonner un
sens au destin des communautés autochtones d’aujourd’hui en
refaisant les rituels ancestraux afin que les âmes qui sont dans la
fosse trouvent de nouvelles personnes porteuses d’avenir.
Le voyage aux pays des morts que montre le spectacle
Atiskenandahate ne concerne pas seulement les deux âmes de la
112
Reves2.indd 112 2023-06-22 13:34
LA FÊTE DES ÂMES
tradition wendate, mais aussi celle des vivants. Et c’est là toute la
puissance de ce théâtre.
Le voyage au pays des morts ne traverse donc pas seulement
les grands mythes wendat (la mort et la résurrection du Soleil et
de la Lune, la naissance d’Aataentsic, sa chute du ciel sur le dos
d’un vol d’outarde, la défiance de la grand-mère, gardienne des
enfers, et la victoire de l’âme qui parvient à se réincarner). Il tra-
verse aussi les vies actuelles des descendants qui doivent retrou-
ver le sens de leurs vies en se tournant vers leurs origines. Et
c’est le territoire qui leur donne cette mémoire profonde, puisque
c’est dans cette relation essentielle avec la terre d’ici que se sont
préservés les récits et leur puissance de réincarnation. On ne sau-
rait mieux démontrer que la puissance du territoire ne réside pas
seulement dans sa dimension physique et biologique, mais qu’il
s’agit aussi et surtout du territoire de l’âme. Étrangement, c’est
avec Ondinnok que les mythes anciens deviennent parfaitement
compréhensibles au commun des mortels : la Fête des âmes n’est
pas une institution sociale qui vise seulement à solidifier les liens
entre les vivants et les clans, mais surtout, en tant qu’art de la
parole et du geste, elle propose de créer un pont entre le passé et
l’avenir grâce à la mémoire du territoire.
« Nous sommes nos ancêtres », m’écrit Yves Sioui-Durand.
Nous le sommes par la génétique, mais aussi par la mémoire des
traumatismes générationnels, qui prennent paraît-il sept géné-
rations avant d’être surmontés – d’où les malédictions bibliques
menaçant les sept générations de descendants d’un malfaiteur.
D’où aussi le temps long nécessaire aux Premières Nations et aux
Inuit pour passer à une nouvelle étape d’un compagnonnage des
peuples, puisque toutes les nations du monde ont leurs trauma-
tismes et ont besoin d’alliés pour vivre et habiter leur territoire
dans la pleine mesure de leur moyen. Rien d’ésotérique donc
à penser que nous sommes nos ancêtres, car nous le sommes
113
Reves2.indd 113 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
d’une manière très concrète, nous le sommes territorialement.
Pour les Inuit aussi, nous sommes nos ancêtres, au sens litté-
ral, puisqu’il existe toute une tradition de récits intra-utérins où
le conteur met en scène sa naissance et le choix de son sexe :
homme, femme ou ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire chaman11. C’est
le passage de l’âme à travers un corps qui l’ancre dans le ter-
ritoire et en fait un membre de la nation, un habitant de l’ici
et maintenant. Nous sommes donc incarnés grâce au territoire,
actualisés dans le temps et dans l’espace par son filtre et son assi-
gnation à exister d’une certaine manière, au sein d’une certaine
tradition. C’est lui qui nous donne corps et matière, os et âme.
L’artiste Wendat Pierre Sioui a donné un corps à cette âme
double dans son œuvre Inhumation foetale (1986, MBAC). Le
procédé de la sérigraphie, grâce au jeu entre le noir et le blanc,
permet de donner forme à la croyance wendate des deux âmes
et de montrer surtout l’importance des os-âmes dans cette tra-
dition12. Les tourterelles ou les corvidés présents dans le haut
de l’image font référence à la deuxième âme appelée à séjourner
au village des morts. Le territoire est ainsi pour les Wendat un
passage entre la vie et la mort. Et il ressemble dans cette image à
un espace utérin où le corps défunt renaît au parfum du pays des
morts. Le territoire fait de nous des enfants appelés à une autre
vie, spirituelle ou corporelle.
Peut-être nos manières contemporaines d’inhumer les morts
pourraient-elles s’inspirer des traditions autochtones, comme on
le voit de plus en plus dans l’imaginaire québécois, par exemple
dans Maelström (2000) de Denis Villeneuve, où les cendres du
père sont lancées dans la mer, comme un signe d’une tout autre
relation au territoire, pour que cesse sa répression sous le poids de
la pierre tombale, pour que circulent les âmes entre les mondes
et que le territoire reprenne enfin sa grande respiration de tam-
bour : à chaque battement, l’esprit passe d’un monde à l’autre.
Reves2.indd 114 2023-06-22 13:34
UNE GREFFE DE MÉMOIRE
« Nous sommes nos ancêtres », me dit Yves Sioui-Durand. Je
médite longtemps cette phrase qu’il m’écrit. Puis soudain, je me
souviens d’une vieille histoire qui court dans les brumes ances-
trales de ma famille : celle d’un lointain ancêtre du côté mater-
nel, Louis Durand, fils d’un coureur des bois, Jean Durand dit
Lafortune, originaire de la Sainte-Onge en France, marié à une
Wendate, Anenontha. Il n’y a rien d’exceptionnel à ce genre de
récit, qui se propage plus ou moins ouvertement dans le circuit
familial québécois des bouches à oreilles, longtemps honteuses
et maintenant fières de cette ascendance autrefois inavouée et
revendiquée aujourd’hui avec un empressement souvent louche
à l’heure de la résurgence autochtone. Avouons que la légende
est magnifique et tragique à la fois : Anenontha est née en 1648
dans la baie Georgienne, sur l’ancien Wendaké, en pleine destruc-
tion de la Huronie, au cœur des guerres iroquoises et des épidé-
mies qui n’en finissaient plus. Venue à l’île d’Orléans avec les
quelques centaines de Wendat convertis qui ne sont pas disper-
sés parmi les Iroquois ou devenus les Wyandot aux États-Unis,
elle est orpheline dès 1655 et reçoit à Québec une é ducation
115
Reves2.indd 115 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
religieuse des Ursulines, qui la rebaptisent du nom très fran-
çais de « Catherine ». Elle aura de nombreux enfants de ses trois
maris, dont le fameux Louis Durand, d’où viendrait une partie
de mon ascendance maternelle.
Cette histoire est-elle véritable ou inventée de toutes pièces ?
Je ne saurais dire avec précision, tellement tout ceci se perd dans
des arbres généalogiques parcellaires et déviés considérablement
de leur tronc principal. Et de toute manière, si l’on doit reculer à
ce point dans l’histoire, cette ancestralité ne veut pratiquement
plus rien dire. Ma mère est néanmoins passionnée de généalogie,
comme beaucoup de Québécois, et m’assure de la validité de cette
ascendance. Je vois pour ma part dans ce récit étrange et familier
une sorte de rituel, apparemment improvisé, qu’on ne rapporte
que dans des occasions très réduites et choisies, comme un secret
qu’on raconte tout bas, par temps difficile, pour communier
avec la misère ancestrale, ou par temps heureux pour ne jamais
l’oublier, comme une mémoire très ancienne du territoire qu’on
ne voudrait pas voir s’éteindre, des braises qu’on garde chaudes.
C’est en tout cas un trait typique de la culture québécoise tenant
à la fois d’une fascination pour des origines souvent invérifiables
ou carrément douteuses et d’une nécessité de passer par ces
récits pour donner un sens à notre présence sur le territoire d’ici.
Je fais l’hypothèse qu’il s’agit d’une sorte de greffe de mémoire,
c’est-à-dire une façon de se lier à une ancienneté plus profonde
et plus puissante que celle des quelques siècles historiques
d’après le contact. C’est un geste mémoriel, un acte de métis-
sage culturel beaucoup plus que réellement génétique, puisque
nous savons aujourd’hui que le métissage génétique des Blancs
et des Autochtones est un mythe. C’est néanmoins à partir de
cette greffe de mémoire que le territoire d’ici peut commencer
à signifier quelque chose pour toutes les âmes qui l’habitent et
116
Reves2.indd 116 2023-06-22 13:34
UNE GREFFE DE MÉMOIRE
qu’un avenir peut enfin être envisagé au Québec, mais seulement
à partir d’une mémoire partagée avec les Autochtones.
Le poète Alfred DesRochers, le père de Clémence DesRochers,
a mis en vers ce grand mythe québécois qui court dans nos
arrière-consciences comme les premiers Blancs au fond des bois,
entremêlés à des Autochtones plus imaginaires que réels :
Mon trisaïeul, coureur des bois,
Vit une sauvagesse, un soir.
Tous deux étaient d’un sang qui n’aime qu’une fois ;
Et ceux qui sont nés d’elle ont jusqu’au désespoir
L’horreur de la consigne et le mépris des lois.
Ils ont aussi les muscles plats.
L’insouciance du danger,
Le goût du ton criard et de fougueux ébats.
Leur fils, parmi les Blancs velus et graves, j’ai
Le teint huileux, la barbe rare et le front bas.
Et par les soirs silencieux,
Quand je parais aller, rêvant
De chimères, d’aventures sous d’autres cieux,
J’écoute en moi rugir la voix d’un continent
Que dans la nuit des temps habitaient mes aïeux.
« Ma patrie », À l’ombre de l’Orford
Nous savons que cette prétendue ascendance autochtone de
DesRochers n’a rien d’authentique au sens strictement généalo-
gique, mais combien elle est parlante ! Un ancêtre coureur des bois
amoureux d’une « sauvagesse », une ascendance autochtone floue
et légendaire : l’historiette généalogique d ’Alfred D
esRochers
ressemble étrangement à celle qui court dans ma famille, et ce
117
Reves2.indd 117 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
n’est pas un hasard. Nous sommes en présence d’un mythe collec-
tif dont la puissance traverse les générations et révèle une iden-
tité profonde, non pas généalogique mais bien culturelle. C’est
une histoire que la psychanalyste Marthe Robert qualifierait cer-
tainement de récit « d’enfant trouvé », c’est-à-dire un récit qui vise
à se réinventer des origines imaginaires pour mieux dénier la réa-
lité ou au contraire pour y faire face de façon détournée, puisque
s’inventer une ascendance autochtone revient souvent à ne pas
affronter la responsabilité historique euro-américaine. Dans ce
même poème, DesRochers traite tous les Euro-Américains de
« tas d’immigrés » et réduit leur présence en Amérique à « trois
cents ans de brimades » en se plaçant résolument du côté de
ceux qu’il appelle « les miens », les Autochtones. Être coureur
des bois devient pour DesRochers une forme de noblesse inver-
sée, un signe d’élection artistique ou poétique qui le distingue
des « immigrés », de ceux qui travaillent la terre comme des for-
çats chrétiens pendant que les coureurs des bois s’ensauvagent
et réinventent l’otium de l’aristocratie, le grand loisir, en décou-
vrant la liberté des forêts d’Amérique. On sait aujourd’hui que
DesRochers fait circuler un mythe qui est très vivace dans les
années 1930, celui d’une nation égalitariste née des coureurs des
bois, teintée de valeurs autochtones1. Ce mythe vient de loin,
c’est peut-être même lui qui est la cause profonde de l’abandon
par la France de sa colonie, vue comme un territoire peuplé de
vagabonds dégénérés, coureurs des bois, de drouines et de jupons.
Ce que DesRochers appelle « ma patrie » tient moins d’une
généalogie appuyée sur des archives fiables que de cette voix qu’il
entend en lui : « J’entends rugir en moi la voix d’un continent. »
C’est le vertige de l’espace ouvert qui s’exprime dans ce mythe de
la voix américaine, un peu à la Walt Whitman, mais c’est aussi
l’ouverture sans fond du temps qui saisit les Blancs au contact
des Premières Nations, des Inuit et du territoire américain. On
118
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 118 2023-06-22 13:34
UNE GREFFE DE MÉMOIRE
a souvent dit que les coureurs des bois sont venus chercher en
Amérique une ivresse de liberté et d’espace. C’est peut-être vrai
en partie, mais si l’on en reste là on passe à côté d’une attirance
irrésistible pour un temps abyssal, pour cette mémoire ouverte à
l’immémorial qui les a frappés à un moment quelconque de leur
parcours en compagnie des Premières Nations et des Inuit et qui
les a laissés pantois, saisis par une force sans nom, pris d’un ver-
tige devant ce puits temporel s’ouvrant sous leurs pas. Quelque
chose d’ancestral et d’impossible à situer sur une ligne chro-
nologique, une « nuit des temps qu’habitaient mes aïeux », dit
Alfred DesRochers. Non pas ces aïeux autochtones imaginaires
des fausses généalogies, mais l’arrière-pays temporel sans fin de
ceux qui ont créé cette mémoire-monde du territoire à laquelle
DesRochers se greffe pour habiter à son tour le continent entier.
Nous touchons ici je pense au cœur de l’identité d’une nation,
plurielle, métissée, entremêlée de mythes provenant de multiples
sources. Tout ceci est non seulement parfaitement légendaire,
mais aussi puissant sinon plus encore que n’importe quelle réa-
lité historique.
J’ai longtemps cherché dans l’histoire de l’Europe un refuge face
à l’insignifiance américaine, je me suis tourné sans mesure vers
sa mémoire des grands événements, j’ai été ébloui pendant des
décennies par les vieilles pierres de la Sorbonne sur lesquelles j’ai
joui d’entendre ma voix résonner des siècles après celle d’Abélard.
Je sais maintenant que tout ceci n’était presque rien, des reliques
d’un passé et d’une mémoire de surface, des signes finalement
assez insignifiants, puisque le véritable puits de mémoire se trou-
vait depuis toujours sous mes pas, ici même, dans la profondeur,
dans l’absence et dans la durée sans fin des forêts immenses qui
119
Reves2.indd 119 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
laissent basculer, sans avertissement, le randonneur qui marche
attentif et silencieux ou le canoteur qui glisse gracieusement sur
un lac, du présent vers une éternité autrement plus puissante. À
l’échelle géologique, les continents s’égalisent et les traces histo-
riques pâlissent devant le puits sans fond des millions d’années
qui s’y accumulent en silence. Je dirais même que les pierres de la
Sorbonne sont des petites jeunettes en comparaison de celles de
l’Amérique du Nord où l’on a trouvé récemment les toutes pre-
mières formes microbactériologiques de vie datant de 3,7 mil-
liards d’années, soit pratiquement l’âge du système solaire.
Je prends cette idée d’une greffe de mémoire au film fabuleux
de Francis Leclerc, Mémoires affectives (Palomar Films, 2004)2,
dont j’avais déjà souligné la dimension tragique dans Sang et
lumière 3. Plongé dans le coma à la suite d’un accident, Alexandre
Tourneur récupère peu à peu sa mémoire personnelle pour se
rappeler que c’est bel et bien lui qui a assassiné son père lors
d’une chasse, tout enfant. Je voyais dans ce film un exemple
parfait du tragique œdipien québécois qui remplace l’Église
par la projection cinématographique de son drame national,
classique des petites nations qui, depuis la Grèce antique, font
appel au sacrifice pour implorer les puissances supérieures de
leur épargner la disparition. Mieux vaut qu’un seul périsse pour
que la collectivité survive, telle était la logique repérée dans ce
schéma étrangement répétitif du cinéma québécois.
Je vois bien maintenant que j’ai négligé tout un aspect de ce
film, pourtant évident : Alexandre Tourneur prend conscience,
revenu de son coma, que ses souvenirs ne sont pas les siens et
qu’il a maintenant d’autres souvenirs en lui que les siens : il a
échangé sa mémoire personnelle avec celles d’autres mysté-
120
Reves2.indd 120 2023-06-22 13:34
UNE GREFFE DE MÉMOIRE
rieuses présences qu’il découvre pêle-mêle. L’histoire est d’une
grande limpidité en ce qui concerne la question du territoire. Le
personnage de Tourneur se trouve à un tournant de l’histoire du
Québec, qui incorpore maintenant plusieurs mémoires en une
seule : celle des Blancs bien sûr, y compris celle de son frère vivant
maintenant en anglais à Toronto, mais aussi celle d’un chasseur
innu qui dormait dans le territoire et qui s’est réveillée en lui à
cause ou grâce à son accident et même celle d’un chevreuil qui
arpente les forêts depuis des millénaires. Tourneur parle sou-
dain innu, chevreuil, anglais et français en même temps ! On
ne saurait mieux exprimer toute la puissance du territoire : c’est
au cœur de cette force sans origine que dorment, comme les
os-âmes-atisken des ancêtres des Wendat, et reviennent à la vie
toutes les identités, disponibles, pour créer une nation nouvelle
et ancienne à la fois, métissée, écologique, pleine d’avenir parce
que possédant des souvenirs sans âge.
On ne se rappelle souvent qu’après-coup d’où vient l’inspiration
d’un passage pourtant très marquant d’un livre écrit des décen-
nies plus tôt. En écrivant ce dernier paragraphe, je viens de me
souvenir que j’ai tiré sans m’en rendre compte toute une histoire
d’une scène de Mémoires affectives. Dans Trop de lumière pour
Samuel Gaska, j’ai raconté un rêve que je présentais comme « une
histoire de père et de territoire » :
Mon regard glisse au ras du sol, longuement, coulant en rase-
mottes juste au-dessus des cailloux et des herbes. Je suis léger,
planeur invisible, paire d’yeux sans corps. Mon regard s’arrête
soudain : à quelques centimètres de mon visage, un pied inséré
dans un mocassin. Une jambe est plantée devant moi, et tout
autour poussent d’immenses fougères. Mon regard lentement longe
121
Reves2.indd 121 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
la cuisse, jusqu’au tronc couvert de cuir tanné, puis traverse un
torse très large. Immobile, cet homme tient une carabine et regarde
fixement en direction des nuages. Très haut dans le ciel, des nuées
d’oiseaux se croisent comme les lames de ciseaux géants. Je recon-
nais cet homme : c’est mon père, mais ce n’est pas mon père, c’est un
amérindien et ma peau est blanche, c’est un homme qui regarde
vers le ciel, alors que moi j’en viens tout droit, catapulté sur cette
terre dont j’emprunte les figures à une mémoire étrange et qui n’est
manifestement pas la mienne.
Cette scène ressemble à s’y méprendre à la finale de Mémoires
affectives, où l’on voit effectivement un Autochtone en
contre-plongée dans une posture qui mime celle de mon récit de
rêve en pointant aussi vers des oies sauvages au loin. Cet emprunt
involontaire n’est pas banal, il me révèle une question complexe
et profonde qui hante la psyché québécoise. Je comprends main-
tenant pourquoi j’ai eu une difficulté sans nom à écrire ce récit,
Trop de lumière pour Samuel Gaska, pourquoi j’ai tenté pendant
onze ans d’en venir à bout sans succès, pourquoi je n’arrivais à
rien après douze versions. Quelque chose résistait que je ne par-
venais pas à contourner ni à éluder. Je voulais voir en couverture
des images issues de la culture de Dorset, mais je ne m’en suis
pas senti la légitimité à la toute dernière minute. Pourquoi tous
ces tâtonnements ? C’est qu’une mémoire du territoire cherchait
ainsi à se dire et je fais le pari que je ne suis absolument pas ori-
ginal, que dans mon petit drame d’écriture toute une nation fait
ce rêve d’un père qui n’est pas son ascendant réel, mais dont le
fantôme hante pourtant sa mémoire qui a été greffée à des sou-
venirs millénaires du territoire. Nous ne dormirons en paix que
quand nous ferons face, éveillés, à cette ascendance autochtone
et réelle du territoire.
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 122 2023-06-22 13:34
LES COUREURS DES BOIS
Il faut dire que ce mythe des coureurs des bois comme ancêtres
de la nation québécoise a malgré tout quelque fondement his-
torique et que la fameuse image du Canadien errant d’où vient
la mobilité québécoise sur le territoire n’est pas seulement un
mythe. On sait que pendant longtemps le personnage que l’on
appelait « l’habitant » et le coureur des bois « ne formaient qu’un
seul et même personnage1 », tant il était facile au paysan de
s’enfoncer dans l’intérieur des terres pour se changer en un pisteur
de traces animales le long des grandes rivières. Mais il fallait
pour cela être accepté par les Premières Nations. On sait depuis
longtemps que la Nouvelle-France n’a été possible que grâce aux
Premières Nations et aux Inuit, à leurs dépens, et que le mythe
du coureur des bois est d’autant plus présent dans les mémoires
qu’il contribue à rendre invisibles les Autochtones d’aujourd’hui.
Sans eux, ce territoire gigantesque n’aurait pu se constituer en un
semblant de cohésion quelconque à l’européenne. En fait, il était
déjà très bien constitué ce territoire, comme le répète à chaque
ligne An Antane Kapesh. C’est plutôt en s’y implantant que les
Français l’ont profondément déstructuré. C’est tout le paradoxe
123
Reves2.indd 123 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
de la présence française en Amérique que de s’être érigée sur ce
qui s’est effondré pour l’accueillir. Nous sommes en réalité loin
d’une hostilité permanente, comme les guerres iroquoises en ont
durablement implanté le mythe, alors qu’on oublie par exemple
la Grande Paix de Montréal en 1701 et toute la prospérité qui
s’ensuit. L’attitude conciliante des Premières Nations et des
Inuit a ainsi souvent été passée sous silence ou volontairement
ignorée, comme l’atteste l’expérience extraordinaire d’accueil
qu’ont vécue les coureurs des bois. On les a d’abord appelés
dans la première moitié du xviie siècle « les truchements »,
c’est-à-dire les traducteurs, comme l’étaient Étienne Brûlé et
son comparse Marsolet. Puis, à l’époque de Frontenac, dans
la seconde moitié du xviie siècle, quand on cherche à encadrer
leurs manières de faire la traite de façon plus ou moins légale, on
leur a progressivement donné le nom péjoratif de « coureurs des
bois », en les assimilant à tous ceux qui « courent » à la façon des
errants et vagabonds d’Europe, ou encore à ceux qui « courent la
drouine », c’est-à-dire qui « couraillent », qui passent leurs hivers
avec « les sauvagesses » pour compenser le manque de femmes
dans la colonie et qui, ce faisant, érotisent le territoire au-delà de
toutes les frontières moralement acceptables pour la mentalité
européenne. Dans la dernière partie de l’histoire de la Nouvelle-
France, on leur a enfin octroyé un certain statut en les affublant
du nom ambivalent de « voyageurs2 », mais le coureur des bois
demeure un être de toutes les frontières : linguistiques, territo-
riales, tribales, sexuelles, à la limite des empires et des lois, chan-
geant souvent d’allégeance, comme Radisson et Brûlé, passant
du côté anglais sans avertissement, revenant quelquefois avec les
Français comme des spectres d’un autre monde. Mais il faut bien
comprendre ce mythe, car le coureur des bois ne se distingue
pas fondamentalement de l’habitant, c’est plutôt le territoire qui
divise cette identité en deux pôles : les basses-terres du Saint-
124
Reves2.indd 124 2023-06-22 13:34
LES COUREURS DES BOIS
Laurent, centre de la colonie, et les Pays-d’en-Haut, par-delà
la porte de sortie de Montréal, où s’ouvre un vaste réservoir de
temps et d’espace, lisière forestière au-delà de laquelle pullulent
les mythes. Tout est alors déjà en place pour comprendre la ten-
sion identitaire québécoise : entre coureur des bois et habitant,
mobilité et implantation, transgression et rigorisme, Radisson et
Marie de l’Incarnation.
Voilà le fondement à la fois historique et mythique que je cher-
chais à tâtons dans La pomme et l’étoile, en comparant les desti-
nées contraires et pourtant liées de deux peintres, Ozias Leduc
et Paul-Émile Borduas, tournés vers l’ici et l’ailleurs chacun à sa
façon, spirituelle et géographique, artistique et sexuelle. Les deux
pôles identitaires québécois se sont constitués par cet imaginaire
du territoire échafaudé grâce aux souvenirs immémoriaux des
sociétés autochtones et des débuts historiques de la colonie fran-
çaise en Amérique. Voilà de quelle manière le territoire parle
encore clairement en nous dans tous nos débats contemporains
entre l’ici et l’ailleurs, entre la diversité et l’identité.
Ce sont les coureurs des bois qui sont les premiers passeurs cultu-
rels. Ils ont permis l’implantation française en Amérique, non
sans s’appuyer sur l’accord des sociétés autochtones. C’est par
exemple grâce à la culture autochtone de l’adoption que les cou-
reurs des bois ont pu explorer et comprendre le territoire, mettre
des mots autochtones sur ses réalités, lui donner un sens, l’inscrire
dans une histoire. Étienne Brûlé chez les Wendat, Pierre-Esprit
Radisson chez les Iroquois, Guillaume Couture chez les Innus,
125
Reves2.indd 125 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
et tant d’autres remarquables oubliés3 qui forment une longue
tradition de Blancs adoptés par les Premières Nations et les
Inuit, jusqu’à Serge Bouchard lui-même, accueilli chez les Innus
dans les années 1970 et les suivantes4. Les anthropologues, eth-
nologues, linguistes et géographes, Sylvie Vincent, Rémi Savard,
Louis-Edmond Hamelin, José Mailhot, j’ajouterais l’écrivaine
Laure Morali5 et l’enseignant Jean-François Létourneau6, et tant
d’autres, ont ainsi pris le relais des coureurs des bois comme tru-
chements modernes dans la grande lignée des Blancs accueillis
à bras ouverts parmi les cultures autochtones. À l’heure de la
réconciliation, il est temps de se souvenir de cet accueil et de
faire en sorte que cette ouverture ait maintenant lieu des deux
côtés.
Il faut bien voir qu’il s’agit d’une tradition double, autant
d’accueillir du côté des Autochtones que de prendre le bois du
côté français. D’aujourd’hui à hier, dès les premiers moments
de la présence française en Amérique en réalité, quelques-uns
vont choisir de s’ensauvager, comme ce compagnon de Cartier
inconnu, probablement le premier coureur des bois, qui prend
la fuite lors du deuxième voyage de Cartier en 1535. On ne le
reverra plus, il est passé de l’autre côté de la grande rivière, il a
rejoint les peuples de l’adoption, il s’est ensauvagé. Il inaugure
ainsi la longue tradition de ceux qui choisissent de prendre le
large et d’être adoptés par les sociétés autochtones, claniques
certes, mais ouvertes et résolument plurielles bien avant l’arri-
vée des Blancs, et de permettre la compréhension mutuelle des
peuples. Encore ici, c’est le territoire qui guide les manières de
vivre ensemble : le partage des ressources et des tâches laisse une
place à tous dans le grand cercle des vivants, pour peu que l’on
consente à la circulation du sens, des objets, des positions et des
symboles.
126
Reves2.indd 126 2023-06-22 13:34
LES COUREURS DES BOIS
Il faut le dire sans détour : les Euros-Américains sont ici
parce que ces sociétés autochtones ont bien voulu les inclure dans
leur géopolitique et sur leurs territoires. La question ethnique
n’existait pas dans ces sociétés, du moins pas tout à fait comme
on la pense de nos jours. On adoptait souvent un membre exté-
rieur au clan ou à la nation, un prisonnier de guerre, un égaré,
pour compenser la perte d’un des siens. Ce nouvel arrivant pou-
vait même prendre le nom du disparu qu’il remplaçait et se com-
porter de façon à se montrer digne de celui dont il prenait non
seulement le nom, mais aussi souvent la femme et la position
sociale. Pierre-Esprit Radisson raconte qu’il appelait « père »,
« mère », « sœurs » et « frère », les membres de la famille iroquoise
qui l’a adopté lorsqu’il a été capturé près de Trois-Rivières en
1652. Au contraire de ses deux compagnons d’infortune, qui ont
été décapités, Radisson, lui, a été épargné, pour une raison dif-
ficile à cerner. Il raconte qu’au sein de cette famille d’adoption,
il était appelé du nom du fils qu’il remplaçait, « Orinha », « ce
qui signifie pierre ou plomb »7, rappelant étrangement son nom
français, Pierre. Peut-être est-ce là une raison suffisante pour
avoir épargné ce Français un peu trop entreprenant ? Pour les
Iroquois de 1652, Radisson « relevait » de cette façon le défunt,
comme pouvaient le faire des guerriers d’une autre nation consti-
tués captifs. Mieux encore : cette culture de l’adoption pouvait
s’élever à l’échelle des nations elles-mêmes. Georges Sioui fait
ainsi l’hypothèse que les Iroquoiens du Saint-Laurent disparus
mystérieusement entre Cartier et Champlain ont été adoptés
par les Wendat dans la deuxième moitié du xvie siècle et que
les Wendat eux-mêmes, ceux qui ne se sont pas convertis et ne
se sont pas rendus à Québec avec les Jésuites ou qui ne sont
pas devenus les Wyandot américains, ces Wendat de la dernière
époque du Wendaké ancestral, donc, se seraient en quelque sorte
fondus dans la confédération iroquoise. Exactement à cette
127
Reves2.indd 127 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
époque post-destruction de la Huronie, Radisson est très clair
là-dessus : quand il est fait prisonnier, celle qu’il appelle « mère »
est d’origine wendate, à l’image de milliers des siens venus s’assi-
miler aux Iroquois après l’effondrement de 1649. Ce qui signifie
que ceux qu’on appelle globalement « les Iroquois » sont métissés
de multiples façons. C’est ce qui permet à Georges Sioui d’af-
firmer que la politique américaine du melting pot, la démocratie
à l’américaine qui tire parti des origines diverses de la nation
pour lui permettre de fonder une confédération, vient en fait
des cultures autochtones du cercle. La politique des confédéra-
tions euro-américaines, y compris la canadienne, est une imi-
tation lointaine des grandes confédérations wendate, iroquoise,
abénakise… Voilà comment, encore une fois, le territoire parle
toujours à qui sait l’écouter.
Reves2.indd 128 2023-06-22 13:34
LE BOUT DU MONDE
Réserve de Matane, été 2019, les fougères géantes des som-
mets passent au-dessus de nos têtes, parmi la pluie et le vent. Je
marche avec mes sœurs, nous cheminons lentement, d’éblouisse-
ment en éblouissement, sur le mythique sentier international des
Appalaches, comme chaque été, au beau milieu de cette splen-
deur naturelle. Puissance des hauteurs, partout à la ronde on ne
voit que des sommets, d’une verdeur infinie. Au loin, des nuages
se déchirent en rideaux de pluie. Sentiment de début des temps.
Sous la pluie, qui semble ne jamais vouloir cesser dans cette cuve
écologique où les arbres retiennent l’eau et l’appellent dans un
cycle infini, nous déboulons dans les crevasses boueuses jusqu’au
bas des pentes pour trouver à la nuit tombée le calme absolu du
lac Tombereau, qui porte son nom comme un sanctuaire. Un ori-
gnal boit à quelques mètres de nous, sans bruit, dans l’épaisseur
du calme environnant. Le lendemain, la lumière révèle la pureté
des rivières qui descendent des sommets vers les vallées dans une
beauté qu’on croirait impossible. Le ruisseau D esjarlais tombe
en cascade pendant des heures dans une résonnance qui revient
des falaises environnantes, comme un gigantesque tambour
129
Reves2.indd 129 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
naturel, une voix du territoire qui scande le rythme de nos pas.
Nous suivons les crêtes escarpées des montagnes légendaires et
ancestrales, perdues au milieu d’une puissante forêt : le mont
Craggy, en équilibre depuis des millénaires, menace de s’écrouler
à chaque instant, le pic insulaire du mont des Disparus, épeurant
de solitude, de vent, de froidure, masse élancée de cailloux géants
entassés, le fameux mont Blanc, au sommet duquel on trouve
une étonnante source d'eau claire et froide en toute saison, règne
avec majesté sur le silence des Chic-Chocs et surtout le mont
Nicol-Albert, avec sa silhouette d’un autre âge, inquiétante et
magnifique, volcanique, éruptive, contorsionnée, menaçante, on
ne le gravit qu’en s’accrochant à des cordes disséminées ici et là
le long du parcours, on n’arrive à son sommet qu’au bout d’un
effort effroyable, les muscles perclus. Au bas de ces montagnes,
le ruisseau Bascon, jadis emprunté par les pêcheurs basques en
quête de truites et de saumons, se déroule en un parcours où
les saumons viennent frayer au printemps et qui semble creusé
à même le lit rocheux depuis la nuit des temps. À la jonction
du ruisseau Beaulieu, l’eau est si claire, si pure, qu’elle impose
le silence, comme en un lieu sacré. Nous voici aux sources du
temps, au cœur du monde vivant.
Cette fosse à saumon naturelle se dit en mi’kmaq : bogan1. J’au-
rais aimé trouver à cet endroit vibrant, ne serait-ce que quelques
mots en mi’kmaq, pour redonner au territoire ses mots anciens,
qui peuvent aussi parler encore à nos oreilles endurcies. Je suis
frappé en lisant tous ces noms de montagnes par l’absence de
sonorités autochtones. Il ne reste dans toute la réserve que les
monts Matawees et le mont Ala’sui’nui comme trace des pre-
miers habitants, parmi des hordes de Fafard, Nicol, Beaulieu,
130
Reves2.indd 130 2023-06-22 13:34
LE BOUT DU MONDE
Bérubé, Bayfield, Coleman, Fortin. Ce sont les seules traces
encore perceptibles du grand territoire des Mi’gmaqs. Ala’sui’nui
signifie en micmac « le mont des voyageurs », comme une trace
mémorielle d’un chemin ancien emprunté par les coureurs des
bois qui avaient suivi les Mi’gmaqs dans les sentiers de leur ter-
ritoire ancestral. En réalité, la magnifique et sauvage réserve de
Matane se trouve sur le Mi’gma’gi, « le territoire des Mi’gmaqs »,
plus précisément sur le septième district de ce territoire gigan-
tesque, le Gespe’gewa’gi, c’est-à-dire « le dernier territoire » ou
« le bout de la terre », d’où le nom même de la Gaspésie pro-
vient et peut-être même le nom de la ville et de la province de
Québec, « Gespe’g », « la fin du territoire, le bout des terres » ou
même « le bout du monde ». Rien de plus parlant à cet égard
que de jeter un œil sur la carte de la réserve de Matane, où fleu-
rissent des noms qui ont remplacé au début du xxe siècle toute
une toponymie millénaire. Il ne reste de cet ensemble de noms
anciens que leurs déformations francisées ou leurs traductions
littérales : Mtn (Matane) : océan ; Ipsigiag (Paspébiac) : lagon ;
Maqtawapkskek (caps Noirs) : falaises noires ; Maskwe’sa’qamik
(Pointe-à-Bouleau) : bouleau blanc. Tout à coup, tous les noms
de villages et de villes, tous les saints du répertoire catholique,
m’apparaissent comme une gigantesque entreprise de destruc-
tion symbolique du territoire. Le géographe Henri Dorion allait
jusqu’à dire qu’il s’agit là d’un « génocide culturel2 ». Faire parler
le territoire, c’est surtout lui donner les noms qui lui confèrent
une profondeur de mémoire la plus vaste possible. Combien le
territoire québécois serait plus dense symboliquement si l’on
consentait à un affichage bilingue, en français et en langues
autochtones, comme c’est déjà le cas dans certains territoires,
eeyou et abénaki par exemple. Ce serait une manière de lui redon-
ner une vie nouvelle, de le sortir de sa torpeur chrétienne, puis
industrielle et banlieusarde, de créer un attachement nouveau
131
Reves2.indd 131 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
pour la terre d’ici et surtout de lui donner un pouvoir rassem-
bleur inédit, un engouement écologique plus vibrant et une poli-
tique de conciliation réparatrice dont les âmes sont aujourd’hui
assoiffées.
Reves2.indd 132 2023-06-22 13:34
UN CADAVRE DANS LE PAYSAGE
La prise de possession du territoire et l’occupation progressive
des basses-terres du Saint-Laurent et de tout le sud du Québec
ont eu des répercussions immenses sur l’imaginaire territorial
québécois. Après l’épopée de la Nouvelle-France, où le bien
s’oppose formellement au mal (la civilisation chrétienne du blé
contre la barbarie autochtone de la forêt) et avant la flambée de
la poésie du pays qui survient avec la Révolution tranquille où
l’on donne un nouveau corps au territoire, le moment fonda-
mental du roman du terroir a cristallisé cette image d’Épinal
du colon s’implantant coûte que coûte sur des terres arides,
contre les forces de l’hiver, s’acharnant avec désespoir à créer ex
nihilo une nouvelle civilisation. Stendhal a inventé l’expression
de « cristallisation » pour désigner le moment où l’amour prend
forme et se fige dans la mémoire pour donner une image sym-
bolique de la relation amoureuse. On pourrait s’inspirer de la
fécondité de l’image stendhalienne pour avancer que le roman
de la terre constitue le moment de cristallisation de la société
québécoise dans sa relation avec le territoire. À plusieurs égards,
l’imaginaire du territoire québécois est resté figé dans cette bulle
133
Reves2.indd 133 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
pittoresque de Noël au village, du Village québécois d’antan, des
reprises sans fin des séries télévisées des Pays d’en haut, des Filles
de Caleb, du Temps d’une paix, des remakes de tous les Maria
Chapdelaine, d’un passé qui, en un mot, ne passe pas, mais reste
latent, partout présent dans la mémoire nationale, montrant un
imaginaire qui tient à cette version de soi comme une névrose
nationale s’acharne à garder d’elle-même une image de l’hiver
de la Survivance, pour reprendre la belle formule de Fernand
Dumont.
Je découvre en écrivant ce passage la provenance existentielle de
ma difficulté à lire certains romans sans exaspération. J’ai eu beau
écrire tout un livre, L’âme littéraire, pour tenter de m’expliquer ces
sautes d’humeur qui me venaient en lisant des romans de toutes
sortes, c’est maintenant, avec cette question décidément infinie
du territoire, que j’en comprends la racine profonde. La société
québécoise qui m’a mis au monde s’imagine de façon névrotique
comme un roman du terroir où l’on met en scène l’ordinaire du
colon, sa médiocrité, au sens d’« homme moyen » (mediocrites),
comme nous l’a appris Alain Deneault. Le roman et l’ordinaire
vont ensemble, ce sont deux faces de la même effigie, ce sont
deux mots qui culminent dans le roman national qui met à dis-
tance l’épique ou le poétique pour mieux montrer l’installation
dans la dimension moyenne de l’existence, l’humanité sécurisée
contre les forces naturelles, la bulle protectrice de la civilisation
posée comme une chape de plomb chrétienne sur la puissance
indomptée du territoire. C’est, pour le dire clairement, le genre
littéraire même de l’humanisme, qui place l’homme au centre du
monde et fait converger tout le vivant vers ses besoins, vers sa
manière de comprendre les choses et met le reste de la création à
134
Reves2.indd 134 2023-06-22 13:34
UN CADAVRE DANS LE PAYSAGE
portée de main. Le roman n’a pas été promu par hasard au rang
de genre littéraire dominant en même temps que la révolution
industrielle se mettait en marche. Il s’agit toujours et encore de
faire du monde un réservoir de ressources à exploiter pour l’hu-
manité, que l’on place au centre du monde, origine et fin de toute
signification.
Or, le roman a pris son essor au Québec en même temps que
la domestication des terres du Sud dans la seconde moitié du
xixe siècle et jusqu’au mitan du xxe siècle. Il n’y a là, encore
une fois, aucun hasard. C’est en repoussant l’inquiétante « lisière
sombre de la forêt » qui se présente dès la première page de
Maria Chapdelaine, toujours déplacée plus avant sur un territoire
qui paraît sans limites, que les Canadiens français ont « fait de la
terre », selon l’expression consacrée, c’est-à-dire qu’ils ont installé
leur système culturel sur le territoire d’ici et l’ont exploité en sui-
vant la politique occidentale de l’arraisonnement des ressources
naturelles, pour reprendre les mots de Heidegger. À la culture
autochtone des trois sœurs a succédé de manière brutale celle du
blé sous la Nouvelle-France et, avec la Survivance, c’est l’élevage
de plus en plus intensif et l’agriculture qui se font bientôt indus-
triels. C’est à ce moment, en un mot, que le territoire passe peu
à peu au mode de production capitaliste. La destruction symbo-
lique de l’économie circulaire autochtone opérée par le monde
chrétien a permis à terme, en quelques décennies, l’exploitation
capitaliste des ressources naturelles. L’économie de subsistance
de la fin de la Nouvelle-France et des premiers temps de l’hiver
de la Survivance, cette économie presque exclusivement issue du
premier secteur, passe en un clin d’œil à une économie de trans-
formation des matières premières et aujourd’hui à une économie
135
Reves2.indd 135 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
de services largement dominante partout sur le territoire. C’est
de ce drame du passage en quelques années à peine d’une éco-
nomie primaire à une économie tertiaire qu’il est question dans
Trente arpents de Ringuet où un cultivateur est exilé de sa propre
terre par l’arrivée des machineries agricoles introduites par son
propre fils. La terre n’est dès lors plus cette grande déesse un peu
païenne à laquelle sacrifier son sang, sa sueur et sa vie, mais une
matière inerte à exploiter, désymbolisée, réduite à des mesures
quantitatives. La terre ne rêve plus, nous non plus. Tous les
centres commerciaux et les stationnements peuvent s’installer
dès lors un peu partout sur le territoire et prendre l’allure de
terrains débités comme des troncs d’arbres morts vendus au plus
offrant.
J’espère toutefois être assez clair dans mes propos pour ne
pas avoir à souligner encore que si, à plusieurs d’égards, le monde
chrétien s’oppose bien sûr au monde économique moderne, c’est
pourtant la destruction symbolique du territoire qui l’a rendu
lui-même possible. Et ce n’est pas le cas seulement en A mérique :
c’est aussi ce qui s’est produit en Europe où la civilisation chré-
tienne a provoqué l’effondrement des cultures celte et viking,
centrées sur le lien au végétal. La presque disparition des grandes
forêts européennes coïncide étrangement avec l’avènement
du monde chrétien, qui ne fait que poursuivre et développer,
encore une fois, le complexe civilisationnel gréco-romain issu du
Proche-Orient. C’est ce drame qui s’est joué sur les terres nor-
diques d’ici et qui n’est pas encore terminé d’ailleurs.
De l’autre côté de la fameuse lisière sombre de la forêt qui
enserre le petit lopin de terre de la famille Chapdelaine, il y a
une menace qui plane dès le départ. « Ite Missa Est », dit l’inci-
136
Reves2.indd 136 2023-06-22 13:34
UN CADAVRE DANS LE PAYSAGE
pit du roman : « la messe est dite », selon les mots que l’officiant
prononce pour mettre fin à la cérémonie. Pas seulement la messe
littérale qui prend fin au moment où le roman commence par ce
beau cas de performatif typique d’une culture de taiseux où les
mots doivent être des actes sous peine d’être louches ou inutiles,
voire dangereux. Il ne s’agit pas seulement de la messe que le
narrateur décrit de l’extérieur dans une perspective quasi anthro-
pologique, et presque amusée. « La messe est dite », cela veut
aussi dire que, dès le départ, tout est joué d’avance, que la menace
provenant d’au-delà de la lisière sombre de la forêt sera bien
entendu exécutée, que François Paradis sera bien sûr avalé par la
forêt. Car, oui, Maria C hapdelaine est une forme de tragédie, de
chant du bouc (tragos odê) qui laisse vivre un instant la proie des
dieux pour mieux l’exécuter ensuite et ainsi permettre à la colère
divine de s’abattre sur un seul pour détourner le malheur et que
la collectivité survive. Maria C hapdelaine n’est pas le roman le
plus représentatif du terroir canadien-f rançais pour rien : il est
une messe répétée sous une autre forme mais dont les forces
demeurent identiques : elles visent à rassembler la communauté
autour de la mise à mort de l’un de ses membres comme dans
toute bonne tragédie. C’est la fonction même de la tragédie :
opérer un sacrifice pour durer, pour survivre collectivement.
Maria Chapdelaine exprime à merveille le schéma sacrificiel
que j’avais vu à l’œuvre dans le cinéma québécois observé sous cet
angle dans Sang et lumière. J’ai pensé dans ma méditation sur le
cinéma québécois que c’était le meurtre symbolique qui permet-
tait l’implantation dans le territoire et la conservation de la com-
munauté, en suivant la pensée de l’anthropologue René Girard.
Je n’avais pas porté suffisamment mon attention cependant sur
le fait que ce cadavre qui gît dans le paysage, c’est celui du ter-
ritoire lui-même, celui d’une manière ancienne de comprendre
la terre, enfouie sous la chape de plomb du c hristianisme qui
137
Reves2.indd 137 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
débouche sur l’époque industrielle. François Paradis représente
la voie ancienne de la Nouvelle-France, celle des coureurs des
bois affiliés aux Autochtones et c’est précisément cette manière
de comprendre le territoire dont Maria Chapdelaine constitue en
quelque sorte un deuil, un recueillement collectif. La mémoire
québécoise vit désormais cette relation au passé, comme un
souvenir d’un autre temps, sur le mode de la nostalgie, c’est-
à-dire du languissement sentimental face au retour impossible
(nostos algos). À partir de ce moment dans notre histoire, c’est la
mémoire d’Eutrope Gagnon qui prend le relais, son ordinaire de
colon, de défricheur, d’homme du bien (Eu tropos : tourné vers le
bien). Eutrope Gagnon est le nom de celui qui enfouit le cadavre
de François Paradis dans les mémoires, qui enterre le territoire
ancien sous les champs cultivés bien au-delà de la frontière, tou-
jours repoussée plus avant au cœur de la forêt.
Voilà pourquoi l’imaginaire du territoire se développe
aussi souvent dans la fiction québécoise autour de la présence
d’un cadavre enfoui dans le paysage. Je ne pense pas seulement
au puissant paysage de Griffin Creek dans Les fous de Bassan
d’Anne Hébert où les falaises géantes dévorent comme une
immense mâchoire le corps d’une jeune fille assassinée par une
nuit de tempête perpétuelle dans laquelle le vent charrie les
âmes des disparus autour de Griffin Creek. C’est aussi le cas de
Kamouraska, où le paysage du bas du fleuve forme le tombeau
d’Antoine de Tassy, seigneur de Kamouraska, assassiné par le
docteur Nelson. Le paysage imaginaire de la Gaspésie constitue
aussi le décor de Malabourg de Perrine Leblanc, où l’on découvre
sous un étang gelé transformé pour l’hiver en une patinoire
« une crinière de Gorgone », c’est-à-dire la chevelure et le corps
d’une jeune fille assassinée, elle aussi. Il y a donc un cadavre dans
le paysage québécois, en particulier dans cet imaginaire de la
Gaspésie, mais il y en a un presque partout (en Abitibi dans Il
138
Reves2.indd 138 2023-06-22 13:34
UN CADAVRE DANS LE PAYSAGE
pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier, en Estrie dans Et sou-
dain Maureen de Marianne L’Espérance, au Centre-du-Québec
dans Discours sur la tombe de l’idiot de Julie Mazzieri, etc.) Cette
persistance illustre mieux que toute théorie la stratification de
l’imaginaire du territoire, sous lequel gît une tout autre relation
à la terre, ancestrale, archaïque, puissante hantise qui attend son
heure pour revenir, mais transformée cette fois par des siècles de
fermentation dans le terreau de la mémoire.
Reves2.indd 139 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 140 2023-06-22 13:34
LE SERMENT SUR LA MONTAGNE
Été 2012. Je viens de prendre la décision de quitter l’université,
de démissionner de mon poste au Manitoba, où je travaille
depuis huit ans. J’ai obtenu un contrat d’enseignement au Cégep
de Drummondville, je laisse tout ça en plan d’un seul coup, ma
vie vient de basculer avec la crise étudiante qui m’a secoué, je
me lance dans le vide, je n’ai aucune idée de la suite des choses.
La canicule s’étend sur les longs mois d’été, je n’ai qu’une envie :
le silence des montagnes, la fraîcheur des hauteurs, la paix des
marcheurs. Dans les Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie,
je gravis une à une les immenses marches du sentier mythique
qui s’étire sur des kilomètres vers les hauteurs de l’Acropole des
Draveurs, célébrées jadis par Félix-Antoine Savard, chantre du
terroir, des abattis, de la résistance paysanne et des montagnes
supposément vierges. Justement, ces gigantesques rochers qui
forment un sentier qu’on dirait taillé à la mesure d’un ours énorme
ont été alignés là par des chômeurs de la crise économique qui a
frappé le Québec il y a presque un siècle. Je fraternise en pensée
avec ces chômeurs fantômes, je suis avec eux, je suis moi aussi
dans un entre-deux qui s’apparente au chômage, c’est-à-dire la
141
Reves2.indd 141 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
longue patience de la précarité à n’en plus finir pour toute ma
génération, les X, dont Nicolas Lévesque a parfaitement compris
la pensée dans Le Québec vers l’âge adulte. Au moment d’écrire ces
lignes, je cumule vingt-trois ans d’enseignement et je n’ai jamais
vu encore la lueur d’une quelconque permanence. Je ne la verrai
probablement jamais, mais tant pis, j’en suis maintenant arrivé à
ne plus y penser et à continuer à gravir une à une les marches de
mon sentier sans me poser de questions, comme j’ai appris à le
faire pendant cet été 2012 sur l’Acropole des Draveurs.
Le paysage grandiose des montagnes enserrant la rivière,
tout au creux de la vallée, me donne des idées vastes et puissantes,
l’air raréfié des hauteurs conjugué à l’effort physique monumen-
tal qu’exige cette montée abrupte et interminable, toute cette
équipée me fait tourner la tête. Un aigle exécute au loin la danse
parfaite de son cercle, un lièvre court avec moi pendant quelques
mètres dans le sentier, l’odeur des fientes d’ours parsemées un
peu partout me remplit les narines. Un adagio de basse entame
sa ronde dans ma conscience prise tout à coup d’un irrésistible
tournis. Et soudain, je le jure, les montagnes se mettent à bouger
tout autour de moi, lentement, paisiblement, à travers les lam-
beaux de brume que le vent puissant charrie continuellement sur
ces hauteurs arides. Tout en haut de l’Acropole des Draveurs,
au moment de toucher les immenses roches dénudées qui sur-
plombent la vallée, des coups de cymbale retentissent, l’ivresse
des hauteurs m’atteint, je suis pris de la folie des grandeurs qui
s’empare de moi et qui me donne l’ordre informulé de dire les
rochers gigantesques, la voilure des conifères sur les falaises et
l’écho fêlé que lance à la ronde le cri d’un balbuzard invisible.
Cette voix a des accents profonds et lourds, elle puise sa force de
la vigueur et de la rugosité des montagnes, elle traduit la puis-
sance du lieu parlant à travers ma voix, qui a pris possession de
ma conscience et m’a donné un nouveau cœur de racines et de
142
Reves2.indd 142 2023-06-22 13:34
LE SERMENT SUR LA MONTAGNE
roches. Je communie avec les fantômes de cette cité des hauteurs
(acropolis) qui me prêtent un instant leurs voix de pierre. Il me
faut jeter dans l’air les épluchures de ma vie parmi les déchirures
de nuages qui frôlent les sommets et emportent au loin ce qui
restait de moi. Je suis dorénavant vêtu d’une nouvelle peau, lissée
par les vents des sommets, tannée comme un tambour par la
lumière crue des silencieuses hauteurs. J’appartiens désormais à
la puissance desséchée des krummholz.
C’est grâce à ce serment sur la montagne, à ce pacte avec les
hauteurs, à cette foi reconquise sur le vide que me sont donnés
les mots que j’écris ici et tous ceux qui sont venus depuis les
grandes envolées de l’Acropole des Draveurs, durant cet été de
canicule et de révolte.
Reves2.indd 143 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 144 2023-06-22 13:34
LE PAYS CHAUVE D’ANCÊTRES
Si l’on s’en tient aux symboles, on peut dire qu’avec la Révolution
tranquille, la chape de plomb du christianisme posée sur le ter-
ritoire a été abandonnée, ou plutôt laissée à l’abandon, comme
une gigantesque carcasse symbolique échouée sur les battures
de la Modernité. L’exode rural qui a transformé les Canadiens
français en Québécois est venu avec un oubli du territoire et
de la culture millénaire qui lui était associée, étrange mélange
hétérogène de pensée paysanne médiévale et de connaissance
ancestrale du savoir autochtone. Il ne reste de cet effort monu-
mental de symbolisation du territoire que la propension à défri-
cher encore et toujours plus avant dans la fuite incontrôlée de
l’étalement urbain. Même les terres agricoles sont aujourd’hui à
préserver de cette folie urbanistique et routière qui dévore le ter-
ritoire inlassablement, comme une mâchoire d’acier intraitable
en coupant tous les corridors fauniques dont les animaux et les
plantes ont un besoin essentiel pour simplement survivre. C’est
donc dire que le territoire est aujourd’hui laissé à lui-même du
point de vue du sens et qu’il faut lui inventer une symbolique
nouvelle sous peine de le donner en pâture aux industriels de
145
Reves2.indd 145 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
tous ordres qui profitent de sa réduction à de la pure matière
pour le détruire.
La symbolique chrétienne du semeur est responsable du défri-
chement intensif des terres autochtones ancestrales, mais cette
sacralisation de la déforestation a elle-même été neutralisée
dans la première moitié du xxe siècle par la poétique du paysage.
Contrairement à la vision bucolique du paysage comme espace
neutre et apaisant dans lequel il ferait bon vivre, l’expérience
de Saint-Denys Garneau montre une impossibilité d’habiter
le paysage, puisque, sous couvert de s’approcher de la source
vive du territoire, il s’agit plutôt, en réalité, d’en faire le paysage
comme on fait le deuil d’une manière ancestrale de vivre.
Comment ne pas ressentir toute la nostalgie, vécue presque au
présent, dans les illustrations des peintres (Suzor-Coté, Clarence
Gagnon, Rodolphe Duguay) qui tour à tour créent des images
pittoresques de la fable de la Survivance de Maria Chapdelaine ?
Les sculptures de métiers du terroir que réalise Suzor-Coté
dans la dernière partie de son parcours (le draveur, le bûcheron,
le cultivateur, etc) sont déjà une sorte de musée du terroir au
moment même où il en fixe les traits, comme s’ils étaient sou-
dain saisis dans la mémoire et en quelque sorte nimbés d’un vide
insaisissable. À la même époque, Saint-Denys Garneau donne
sans doute la version la plus aboutie de ce processus par lequel
le paysage s’empare des forces ancestrales pour les vider et les
rendre au « trou d’oubli » qui forme le noyau d’ombre caché au
creux du paysage.
146
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 146 2023-06-22 13:34
LE PAYS CHAUVE D’ANCÊTRES
Dans la vallée le ciel de l’eau
Au ciel de l’eau les nénuphars
Les longues tiges vont au profond
Et le soleil les suit du doigt
(Les suit du doigt et ne sent rien)
« Paysage en deux couleurs sur fond de ciel », Regards et jeux
dans l’espace
Le jeu de reflet du ciel et de l’eau forme une colonne verticale
typique de la symbolique chrétienne que l’on a vue s’implanter
dans le territoire dès Jacques Cartier, mais Saint-Denys Garneau
découvre à la racine de cette verticalité une zone obscure, ombra-
gée, un trou d’oubli et de vide par où s’échappe l’âme du paysage.
Le regard « paysageant » de Saint-Denys Garneau n’est pas une
maladie personnelle du poète, une sorte de mélancolie vague-
ment mythique. C’est un regard qui voit sous yeux le territoire se
vider de toute âme en devenant paysage mis à distance, regardé
comme une image séparée du lieu qui l’a vue naître, de l’esprit qui
lui confère la vie et qui se révèle donc inhabitable. L’angoisse de
Saint-Denys Garneau a beaucoup à voir avec la perte d’âme du
territoire qui s’effectue au moment même où il tente de donner
au monde une forme et qu’il s’y refuse, laissant dans sa voix les
fragments cassés de tous les chants.
C’est dans ce vide symbolique que s’est énoncée avec la Révolu-
tion tranquille la poésie du pays, en déplaçant la mystique chré-
tienne du semeur-moissonneur des âmes sur le corps individuel
et national, dans un classique rabattement de l’axe vertical de
l’oculus divin sur l’aplatissement des horizons contemporains. Ce
ne sont plus des germes de blé que le poète sème, comme dans
la mystique chrétienne du défrichement, c’est plutôt le corps
147
Reves2.indd 147 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
poétique lui-même qui devient l’enveloppe d’une germination
nouvelle. Dans cette poésie du pays, qui emprunte les puissances
de la symbolique chrétienne pour les détourner, le corps naissant
à même le territoire d’Amérique devient la métaphore du pays
lui-même et de son lien consubstantiel au territoire.
Ma langue est d’Amérique
Je suis né dans ce paysage
J’ai pris souffle dans le limon du fleuve
Je suis la terre et je suis la parole
Le soleil se lève à la plante de mes pieds
Le soleil s’endort sous ma tête
Mes bras sont deux océans le long de mon corps
Le monde entier vient frapper à mes flancs
Gatien Lapointe, Ode au Saint-Laurent (1961)
La poésie du pays des années 1960 opère une substitution d’au-
tochtonie (autos – chtonê : né du sol) assez caractéristique d’une
prise de parole au « je » qui peut aussi bien référer au fleuve, au
territoire d’Amérique, qu’à celui qui poétise une naissance dans
un paysage qui lui est intrinsèque au point de s’y confondre. Être
d’ici, c’est être ce paysage, ce territoire, ce fleuve qui l’irrigue
profondément. Les couleurs et les formes du paysage, « le gris,
l’agacé, le brun, le farouche », deviennent celles du corps de la
nation même, celles du territoire qui « craque dans la beauté fan-
tôme du froid » (Gaston Miron, « Les siècles de l’hiver »). Cette
poésie du pays se veut cependant « chauve d’ancêtres », (notons
précisément les mots de Miron, ils disent toute la méprise de
la mémoire québécoise), à la différence de la nouvelle poésie
autochtone du pays, qui fait revivre au xxie siècle la naissance
du corps-territoire, mais en l’inscrivant dans la longue lignée
des ancêtres et dans la mémoire du territoire de cette « Terre
148
Reves2.indd 148 2023-06-22 13:34
LE PAYS CHAUVE D’ANCÊTRES
Québec » qui a aussi pour nom « Nitassinan / Nin / innu terre /
terre assise / innu assi » (Natasha Kanapé Fontaine, Manifeste
Assi).
J’ai mémoire de la mort
embrasse le savoir sur le front
le retour des miens guidés par les ombres
Je suis femme la terre
d’où l’on a tiré mon nom
mon pubis attend l’avènement
les missionnaires me disaient Montagnaise
moi je dis femme-territoire
mes montagnes t’enseigneront l’avenir
Natasha Kanapé Fontaine, Bleuets et abricots
Dans ce réveil des morts et du savoir ancien de la terre, la
femme-pays innue prend le relais du corps mâle et blanc de
la poésie du pays de la Révolution tranquille pour opérer une
double révolution, à la fois ethnologique et sexuelle, en renver-
sant l’imaginaire sexuel associé à la supposée liberté de mœurs
des Premières Nations et des Inuit (Gilles Havard, Éros et tabou.
Sexualité et genre chez les Amérindiens et les Inuit), qui devient
la sagesse même des formes du territoire. Les montagnes de la
terre et les formes de la femme innue s’offrent en se reprenant,
en se donnant elles-mêmes leur propre destin.
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 149 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 150 2023-06-22 13:34
LA POINTE DU TRIANGLE
Les coordonnées de ma vie s’inscrivent dans le grand corps de
l’Estrie, dans les veines de ses rivières et en suivant les sentiers
de ses montagnes. Pour savoir qui je suis, je n’ai qu’à suivre la
Saint-François, depuis le grand lac Saint-François de mon ado-
lescence et du chalet familial, jusqu’à Drummondville où j’en-
seigne au cégep, en passant par Sherbrooke où je vis avec mes
filles, où j’écris mes livres, où j’ai établi mon centre du monde et
d’où je recompose mon imago mundi ancestrale, mon image du
monde devenue ma maison sous les étoiles vues d’ici, tout près de
l’observatoire du mont Mégantic, que je gravis souvent avec mes
filles. Passé, présent et futur se conjuguent pour moi dans cette
géographie intime et pourtant écrite dans le territoire lui-même.
À la croisée des Grandes Fourches, à l’exact Ktinéketolekwak
des Abénakis, ma vie se répartit les temps comme les eaux s’y
partagent et se confondent dans le grand courant qui mène au
fleuve et à la mer, à la fin de toute chose.
Les strates de mon appartenance sont distribuées selon
les habitations successives du territoire, à l’image du Québec
lui-même. Je vis à la pointe du triangle de la Saint-François,
151
Reves2.indd 151 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Alsig8tegw en langue abénakise, chemin d’eau qui découpe le
territoire du nord au sud, partage des terres iroquoiennes et
algonquiennes, juste à côté de la splendeur du bois Beckett, qui
rappelle la colonisation anglaise, non loin des quartiers ouvriers
des francophones venus vendre leurs bras aux usines il y a plus
d’un siècle. Mais je sais aussi toute la vulnérabilité de ce terri-
toire qui dépend maintenant de nous.
Je marche dans les fabuleuses montagnes Vertes, cette chaîne
appalachienne sillonnée par un sentier qui longe les crêtes de ces
sommets affaissées par les siècles. La sauvagerie de ces hauts lieux
est ahurissante, on n’y croit pas tant qu’on n’a pas subi la tem-
pête de pluie dans cet océan de brume où je me suis enfoncé un
matin de juillet, émerveillé par la puissance des éléments. Mais
il faut savoir que toutes sauvages qu’elles soient, ces montagnes
ne sont préservées que grâce à la bonne volonté de citoyens qui
ont donné le droit de passage sur leurs terrains privés. Tout près
de la frontière états-unienne, le mont H ereford s’offre à qui veut
bien le gravir silencieusement et longer l’impossible ruisseau
qui cascade à nos côtés tout au long du parcours. Encore ici, ce
sont des citoyens qui permettent à ce parc nature d’exister. Cette
montagne a été laissée en partage aux citoyens par le créateur des
gants de caoutchouc médicaux, qui voulait que les générations
futures puissent admirer pour des siècles la beauté toundrique
de ce sommet où j’ai vu souvent des lièvres parmi les lichens.
Tout ce qu’il reste de nature estrienne est aujourd’hui à notre
merci, dépend de notre volonté de la conserver, à l’image du bois
Beckett, dont je suis membre du regroupement citoyen, qu’il
faut protéger sans relâche de la destruction. Le grand lac Saint-
François est contrôlé par des barrages humains, le barrage Allard
par exemple, c’est un lac somptueux mais dont l’équilibre peut
s’écrouler chaque été, suivant la quantité de précipitations. Il faut
veiller sans cesse à le préserver de la pollution et des contami-
152
Reves2.indd 152 2023-06-22 13:34
LA POINTE DU TRIANGLE
nations de toutes sortes, agricoles et industrielles, tout comme
le grand fleuve où ses eaux se jettent sera toujours en équilibre
incertain, à la merci de notre vigilance, à l’image de tout le conti-
nent et de la Terre elle-même.
Voici venu le temps de la fragilité du territoire.
Reves2.indd 153 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 154 2023-06-22 13:34
MONTRÉAL ET LE TERRITOIRE DU VIDE
Quand je suis arrivé à Montréal au milieu des années 1990, j’ai
eu le même réflexe que pendant toutes ces années passées à Paris
quelques années plus tard : je me suis réfugié dans les parcs publics.
Je cherchais les arbres, leur ombrage, leur bercement dans le vent.
C’était souvent les mêmes arbres anciens que ceux des chroniques
de Bronwyn Chester, qui ont été recueillies dans un livre que m’a
donné un jour le chroniqueur et écrivain D ominic Tardif : Une
île d’arbres. Cinquante arbres, cinquante façons de raconter Mon-
tréal 1. Je passais le plus clair de mon temps à cette époque dans
les sentiers achalandés du mont Royal, dans les vastes ouvertures
du parc Maisonneuve, à contempler les reflets des branches dans
l’eau calme du bassin au parc Lafontaine, exactement comme
à Paris un peu plus tard j’allais passer beaucoup plus de temps
qu’ailleurs au jardin du L uxembourg à scruter les hauteurs des
magnifiques arbres centenaires. À Lyon, où j’ai fait mes études
de maîtrise, je suivais chaque jour en marchant les berges du
Rhône et de la Saône jusqu’au moment d’atteindre l’île Sainte-
Barbe, toute couverte d’arbres anciens, dans une sorte de passé
de conte médiéval. À Metz, en Lorraine, où j’ai vécu quelques
155
Reves2.indd 155 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
années, je cherchais les allées ombragées menant au bassin des
cygnes et surtout les immenses champs tout autour de la petite
ville où gisent pêle-mêle des cadavres de soldats inconnus de
la Guerre de 1914-1918 et des reliques mérovingiennes. Aussi-
tôt que j’en avais l’occasion, j’étais dans les Alpes, en hiver, dans
l’Ardèche en été, dans le Vercors tout au long de l’automne, à
suivre les anciennes rivières et les vieux chemins des moniales et
les routes menant aux abbayes. Je trouvais dans ces derniers ter-
ritoires forestiers non seulement des traces de la Résistance de la
Seconde Guerre mondiale, mais une résistance plus contempo-
raine : celle des arbres. Durant toute cette période urbaine, mon
regard se tenait haut, tourné vers les cimes, peut-être pour ne pas
voir ce qui se passait à hauteur humaine : la foule, l’asphalte, les
routes et le béton partout, la planète étouffée, envahie par une
espèce de parasite trop puissant pour elle.
Très tôt, Montréal a été un espace différent du reste du territoire
québécois. Dès l’époque préhistorique en fait, Montréal est à
part. C’est d’abord le sommet du mont Royal qui apparaît, petite
terre émergée de la mer de Champlain il y a douze mille ans,
puis une île plus vaste déjà au cœur du lac à Lampsilis, qui donne
à la Montréal actuelle ses dénivelés, celui de la rue Sherbrooke
notamment. C’est au cœur de cet archipel, dont il ne reste
que quelques traces autour de Montréal, que les A lgonquins
et les Iroquoiens se livrent déjà à un commerce intense, des
milliers d’années avant notre ère. Située à la confluence des
cultures algiques et iroquoiennes, de l’Outaouais et du Saint-
Laurent, Montréal fait l’objet de toutes les convoitises par-delà
les époques française et anglaise et jusqu’à nous. Nous savons
par les textes de Cartier et par l’archéologie que les Iroquoiens
156
Reves2.indd 156 2023-06-22 13:34
MONTRÉAL ET LE TERRITOIRE DU VIDE
du Saint-Laurent l’ont habitée de manière sporadique, à leur
manière intermittente, comme le montrent tous les sites archéo-
logiques pré-contact environnants (Droulers-Tsiionhiakwatha,
Mailhot-Curran, etc.), jusqu’à ce que les Français s’y implantent
au xviie siècle, vraisemblablement pendant un moment où l’île
est apparemment inoccupée, peut-être pour permettre au lieu
de se régénérer, ce qui laisse croire aux Européens qu’ils ont
devant eux une terra nullius, alors qu’il ne s’agit que d’une façon
complètement différente d’occuper le territoire, le laissant vivre
de sa grande respiration sans l’étouffer par la présence humaine
continuelle.
Déjà Montréal est un endroit de convergences multiples
dont le meilleur témoignage est la maison Nivard-De Saint-
Dizier, située à Verdun juste à côté des rapides de Lachine, lieu
géostratégique par excellence de la région. Des artefacts vieux
de 5 000 ans ont été retrouvés dans le sol de cette maison du
xviie siècle, ce qui montre une occupation du territoire sans
discontinuité pendant des milliers d’année. Toutes les strates de
l’occupation du territoire québécois sont présentes sur ce lieu, il
les résume comme Montréal elle-même offre un lieu hautement
symbolique du territoire québécois, mais toujours dans la conti-
nuité, souvent totalement inconsciente, de l’occupation autoch-
tone (par exemple, les cimetières actuels, disséminés autour du
mont Royal, sont situés sur l’emplacement de sépultures autoch-
tones ; le pont Champlain, la route la plus utilisée de nos jours
au Canada suit le tracé commercial autochtone d’avant la colo-
nisation). Ce n’est pas un hasard si c’est à Montréal que sera scel-
lée la Grande Paix de 1701, sur la place Royale, juste à côté du
premier emplacement du Fort Ville-Marie, autour de ce qu’on
nomme aujourd’hui la Pointe-à-Callière : c’est tout simplement
parce qu’il s’agit d’un lieu où convergent toutes les lignes du
territoire (hydrographiques, forestières, culturelles). Quelques
157
Reves2.indd 157 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
années après sa fondation par des mystiques (dont Denys
Arcand a tiré le film Les Montréalistes), Montréal s’est changée
en une sorte de carrefour de commerce à la croisée des routes
autochtones, qui sont aujourd’hui les nôtres. C’est aussi un lieu
où s’implante rapidement la culture des coureurs des bois et des
voyageurs, comme en témoigne la maison Le Ber-Le Moyne, le
plus ancien bâtiment de l’île de Montréal, qui servait de poste
de ravitaillement et d’entreposage, véritable porte s’ouvrant sur
les vastes Pays-d’en-Haut, c’est-à-dire, au xviie siècle, l’équi-
valent de l’immense Amérique du Nord, territoire sans fin qui
s’est amenuisé avec le temps pour se limiter maintenant à ce qui
reste des Pays-d’en-Haut, les Laurentides, ouvertes à la coloni-
sation par le curé Labelle pour colmater la fuite des Canadiens
français vers la Nouvelle-Angleterre au tournant du xxe siècle.
Les Laurentides, cette nature aujourd’hui surpeuplée, cette carte
postale où pénètre brutalement l’autoroute pour former une
annexe de la banlieue montréalaise, garde malgré tout son aura
de pays ancien, de récits d’enfance que se remémore la parenté
qui se souvient encore des vieux chemins tortueux contournant
en lacets les petites montagnes affaissées, mémoire d’une époque
géologique révolue où ces sommets dominaient le continent.
Lanaudière, la Montérégie, le Centre-du-Québec et l’Estrie
sont en passe de subir le même sort d’annexion au complexe
industriel et à l’étalement urbain des grandes villes québé-
coises, au point où l’on peut dire qu’aujourd’hui le territoire
rural d’antan ressemble à un fantôme d’une autre époque.
Le poète Alphonse Beauregard mettait déjà des mots sur cet
abandon à l’époque des tout débuts de l’exode rural : « Aban-
donnée, avec ces champs verts alentour ! / Vide, quand on peut
158
Reves2.indd 158 2023-06-22 13:34
MONTRÉAL ET LE TERRITOIRE DU VIDE
voir de toutes ses fenêtres / Des coteaux, des vallons et des
coteaux toujours ! / Déserte, quand un lac au gracieux contour
Se montre là-bas dans les hêtres ! » (« Maison abandonnée », Les
alternances, 1921). Aujourd’hui, l’imaginaire cinématographique
québécois ne s’y trompe pas, qui fait souvent des régions un lieu
où se déroule un mauvais film d’horreur post-ironique, comme
dans l’œuvre de Robin Aubert (Saints-Martyrs-des-Damnés, Les
affamés) ou dans Répertoire des villes disparues de Denis Côté, qui
met en images le récit éponyme de Laurence Olivier en mon-
trant tout le vide des maisons rurales laissées à l’abandon un
peu partout sur le territoire, jusqu’à mettre en scène les fantômes
mêmes de ceux qui y habitaient il n’y a pas si longtemps. Cette
ruralité est aujourd’hui en voie de disparition, elle donne ses
derniers témoignages d’une façon d’habiter le territoire qui ne
survivra pas au xxie siècle. Deux territoires à l’intérieur d’un seul
forment l’imaginaire des basses-terres de nos jours : d’un côté,
Montréal et son étalement urbain, de l’autre la ruralité aban-
donnée vivant dans une image fantomatique d’elle-même. Com-
ment ne pas voir dans ce partage du territoire, qui oublie le plus
souvent les premiers habitants, toutes les impasses politiques et
sociales du Québec d’aujourd’hui ?
Reves2.indd 159 2023-06-22 13:34
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 160 2023-06-22 13:34
NOTES
TERRE ET MÉMOIRE EMMÊLÉES
1. Fernand Dumont, L’avenir de la mémoire, Montréal, Nota bene, 1995.
2. Teri C. McLuhan, Pieds nus sur la terre sacrée, Paris, Gallimard, 2014, p. 14.
3. Ibid., p. 31.
4. Jacques Le Goff, « Les rêves », L’imaginaire médiéval, dans : Un autre Moyen
Âge, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1999, p. 730-731.
5. Joséphine Bacon, Un thé dans la toundra. Nipishapui nete mushuat, Montréal,
Mémoire d’encrier, 2013, p. 50.
6. Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, coll. « Folio
histoire », 1966.
UN TROU DANS LE PRÉSENT
1. François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps,
Paris, Éditions du Seuil, 2003.
2. Tristan Malavoy-Racine, Le nid de pierres, Montréal, Boréal, 2015, p. 57.
LA CIRCULATION DES RÊVES
1. Paul Lejeune, Un François au « Royaume des bestes sauvages », Montréal, Lux
éditeur, 2009, p. 51.
2. Bruce Trigger, Les enfants d’Aataentsic. L’histoire du peuple huron, traduit de
l’anglais par Jean-Paul Sainte-Marie et Brigitte Chabert Hacikyan, Montréal,
Libre Expression, [1976] 2016, p. 58.
3. J. Le Goff, « Le désert-forêt dans l’Occident médiéval », dans L’imaginaire
médiéval, op. cit., p. 495-510.
161
Reves2.indd 161 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
4. Rémi Savard, La forêt vive. Récits fondateurs du peuple innu, Montréal,
Boréal, 2004, p. 14-15.
5. An Antane Kapesh, Eukuan nin Matshi-manitu innushkeu. Je suis une
maudite sauvagesse, traduit de l’Innu par José Mailhot, Montréal, Mémoire
d’encrier, [1976] 2019, p. 53.
6. Georges E. Sioui, Les Hurons-Wendat. L’héritage du cercle, Québec, Presses
de l’Université Laval, 2019, p. 30.
7. Daniel Clément, Les récits de notre terre. Les Innus, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2018, p. 10.
8. R. Savard, Carcajou à l’aurore du monde. Fragments d’une encyclopédie orale
innue, Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 2016.
9. Ibid., p. 36.
10. Ibid., p. 47.
11. Richard Erdoes et Alfonso Curtiz, Et Coyote créa le monde. Mythes et
légendes des Indiens d’Amérique du Nord, t. 2, Paris, Albin Michel, coll. « Terres
indiennes », 2000, p. 285.
12. D. Clément, Les récits de notre terre. Les Atikamekw, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2018, p. 13.
13. Id., Les récits de notre terre. Les Naskapis, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2019, p. 11.
14. Id., Les récits de notre terre. Les Algonquins, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2019, p. 16.
15. Relations des Jésuites, 1636, vol. 1, Montréal, Éditions du Jour, 1972, p. 47.
16. Natasha Kanapé Fontaine, N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures,
Montréal, Mémoire d’encrier, 2012, p. 46.
17. J. Bacon, Bâtons à message, Montréal, Mémoire d’encrier, 2009.
18. Raphaël Picard, Nutshimit. Vers l’intérieur des terres et des esprits, Pessamit,
Atikupit, 2019, p. 13.
19. N. Kanapé Fontaine, Manifeste Assi, Montréal, Mémoire d’encrier, 2014.
20. Ibid.
21. J. Bacon, Iuesh. Quelque part, Montréal, Mémoire d’encrier, 2018, p. 6.
22. A. Antane Kapesh, op. cit., p. 53.
23. Denys Delâge, « L’histoire des origines de Québec d’après les sources
écrites », dans Yves Chrétien, Denys Delâge et Sylvie Vincent (dir.),
Au croisement de nos destins. Quand Uepishtikueiau devint Québec, Montréal,
Recherches amérindiennes au Québec, 2009, p. 27.
LE VINLAND DES VIKINGS
1. Régis Boyer, Les Vikings. Histoire et civilisation, Paris, Perrin, 2015.
2. Jean Renaud, Les Vikings en Normandie, Rennes, Ouest-France, 1990.
162
Reves2.indd 162 2023-06-22 13:34
NOTES
3. Anonyme, Saga d’Eirik le Rouge, Sagas islandaises, Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, p. 340.
4. Ibid., p. 353.
ABEL ET CAÏN
1. Jacques Cartier, Première relation, chapitre VIII, 1534.
2. Sylvie Vincent, « Les sources orales innues. La fondation de Québec et ses
conséquences », dans Au croisement de nos destins, op. cit., p. 64.
3. Boris Geremek, Les fils de Caïn. Pauvres et vagabonds dans la littérature euro-
péenne (vxe-xviie siècle), Paris, Flammarion, [1980] 1991.
4. Gilles Havard, Les coureurs de bois, Paris, Les Indes savantes, 2016, p. 73.
5. J. Cartier, Deuxième relation, VIII, 1535-1536.
6. P. Lejeune, op. cit., p. 35.
7. Jean de Brébeuf, Écrits en Huronie, Montréal, BQ, 2000, p. 21.
8. P. Lejeune, op. cit., p. 122.
LA CROIX ET L’ANNEDDA
1. Alain Beaulieu, Convertir les fils de Caïn. Jésuites et Amérindiens nomades en
Nouvelle-France, 1632-1642, Québec, Nuit blanche, 1994, p. 38.
2. Gabriel Sagard, Le grand voyage au pays des Hurons, Montréal, BQ, 2007,
p. 109.
3. J. Cartier, Première relation, XX, 1534.
4. Robert Harrison, Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental, Paris, Flammarion,
1974.
5. J. de Brébeuf, op. cit., p. 43.
6. J. Cartier, Première relation, XX, 1534.
7. J. Cartier, Deuxième relation, XV, 1535-1536.
8. Jacques Mathieu, Annedda, Québec, Septentrion, 2009.
9. Berthier Plante, « L’Annedda, l’arbre de paix », Histoires forestières du
Québec, vol. 4 (2012), p. 24-51.
10. G. E. Sioui, op. cit., p. 270.
MAISON FERMÉE
1. Peter Sloterdijk, Le palais de cristal, Paris, Fayard, 2006.
2. Claude Chapdelaine (dir.), Droulers-Tsiionhiakwatha : chef-lieu iroquoien
de Saint-Anicet à la fin du xve siècle, Montréal, Recherches amérindiennes au
Québec, 2019, p. 24.
3. René Sioui-Labelle, Kanata. L’héritage des enfants d’Aataentsic, Office
national du film, 1998.
4. Samuel de Champlain, Récits de voyages en Nouvelle-France 1603-1632,
Québec, Presses de l’Université Laval, 2018, p. 185.
163
Reves2.indd 163 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
5. Yves Chrétien, « Quelques traces archéologiques des premières rencontres
entre Amérindiens et Européens dans la région de Québec », dans Au croisement
de nos destins, op. cit., p. 19.
6. Aristote, Les Politiques, VII, 11, 1330-b, traduction de Pierre Pellegrin,
Paris, GF Flammarion, 1993, p. 484.
7. Jean-Christophe Bailly, Le champ mimétique, Paris, Éditions du Seuil, 2005.
8. Louise Pothier, « La place royale : le cœur battant de Montréal », dans
Anne-Marie Balac et François C. Bélanger (dir.), Lumières sous la ville.
Quand l’archéologie raconte Montréal, Montréal, Recherches amérindiennes au
Québec, 2016, p. 93.
9. Jean-Pierre Kesteman, Histoire de Sherbrooke, t. 1, Sherbrooke, Éditions
GGC, 2000.
10. Pierre Toubert, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional
et la Sabine du ixe siècle à la fin du xiie siècle, 2 vol., Rome, École française de
Rome, 1973.
11. Robert Fossier, Villages et villageois au Moyen Âge, Paris, Éditions Chris-
tian, coll. « Vivre l’histoire », 1995.
12. C. Chapdelaine, op. cit., p. 16.
13. Ibid., p. 31.
14. Ibid., p. 43.
15. G. E. Sioui, Pour une histoire amérindienne de l’Amérique, Québec, Presses
de l’Université Laval, 1999, p. 14.
16. G. Havard, Montréal, 1701 : planter l’arbre de paix, Montréal, Recherches
amérindiennes au Québec, 2001, p. 50-53.
17. A. Antane Kapesh, op. cit., p. 35.
18. Relations des Jésuites, 9 : 206, cité dans A. Beaulieu, op. cit., p. 92.
19. S. de Champlain, op. cit., p. 417.
20. Ibid., p. 249.
LA FÊTE DES ÂMES
1. J. de Brébeuf, op. cit., p. 257.
2. Ibid., p. 260.
3. Ibid., p. 261.
4. G. E. Sioui, Les Hurons-Wendat. L’héritage du cercle, op. cit., p. 250.
5. Ibid.
6. S. de Champlain, op. cit., p. 367-369.
7. G. Sagard, op. cit., p. 305.
8. J. de Brébeuf, op. cit., p. 180-181.
9. G. E. Sioui, op. cit., p. 244.
10. Yves Sioui Durand et Catherine Joncas, Atiskenandahate – Voyage au
pays des morts, Ondinnok, 1988. J’ai pu visionner cette production grâce aux
164
Reves2.indd 164 2023-06-22 13:34
NOTES
archives d’Ondinnok et avec la permission des auteurs, que je tiens à remercier
chaleureusement.
11. Bernard Saladin d’Anglure, Être et renaître inuit, homme, femme ou
chamane, Paris, Gallimard, coll. « Le langage des contes », 2006.
12. Pricile De Lacroix, « Rituels, mort et renaissance. Une redécouverte de
l’artiste huron-wendat Pierre Sioui », Frontières, vol. 29, no 2 (2018), [En
ligne], [https://doi.org/10.7202/1044164ar].
UNE GREFFE DE MÉMOIRE
1. G. Havard, Histoire des coureurs de bois, op. cit., p. 328.
2. Francis Leclerc, Mémoires affectives, Palomar, 2004.
3. Étienne Beaulieu, Sang et lumière. Le temps et la mort dans le cinéma québé-
cois, Montréal, Alias, 2019.
LES COUREURS DES BOIS
1. G. Havard, Histoire des coureurs de bois, op. cit., p. 96.
2. Ibid.
3. Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Ils ont couru l’Amérique. De
remarquables oubliés, t. 2 Montréal, Lux éditeur, 2014.
4. S. Bouchard et M.-C. Lévesque, Le peuple rieur. Hommage à mes amis
innus, Montréal, Lux éditeur, 2017.
5. Laure Morali (dir.), Amitiau ! Parlons-nous !, Montréal, Mémoire d’encrier,
2008.
6. Jean-François Létourneau, Le territoire dans les veines, Montréal, Mémoire
d’encrier, 2017.
7. Pierre-Esprit Radisson, Les aventures extraordinaires d’un coureur des bois,
Montréal, Alias, 2017, p. 35.
LE BOUT DU MONDE
1. Nta’tugwaqanminen. Notre histoire. L’évolution des Mi’gmaqs de Gespe’gewagi,
Le Mawiomi Mi’gmawei de Gespe’gewagi, Ottawa, Presses de l’Université
d’Ottawa, 2018, p. 40.
2. Ibid., p. 55.
MONTRÉAL ET LE TERRITOIRE DU VIDE
1. Bronwyn Chester, Une île d’arbres. Cinquante arbres, cinquante façons
de raconter Montréal, traduit de l’anglais par Annie Pronovost, Montréal,
Marchand de feuilles, 2017.
Reves2.indd 165 2023-06-22 13:34
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 166 2023-06-22 13:34
LISTE DES ILLUSTRATIONS
En couverture : illustration de Cécile A. Holdban
p. 37 Cornelius Krieghoff, Camp de chasse, en hiver, 1858. Huile
sur toile, 48,5 × 65,5 cm. Collection Pierre Lassonde.
p. 41 Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Dégel d’avril à Arthabaska,
1919. Huile sur toile, 73,3 × 93,2 cm. Collection du Musée
national des beaux-arts du Québec.
p. 59 Marc-Aurèle Fortin, L’orme à Pont-Viau, vers 1928. Huile
sur toile, 137 × 168,4 cm. Musée national des beaux-arts de
Québec.© Fondation Marc-Aurèle Fortin / SOCAN (2021).
p. 74 Rodolphe Duguay, Le semeur, 1938. Huile sur carton,
39 × 60 cm. Collection Monique Duguay, Nicolet. Crédit
photo : P. Bernard.
p. 93 Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Jacques Cartier rencontre
les Indiens à Stadaconé, 1535, 1907. Huile sur toile,
264,5 × 401 cm. Collection du Musée national des beaux-
arts du Québec.
Reves2.indd 167 2023-06-22 14:33
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 168 2023-06-22 13:34
TABLE
Les rêves du ookpik 7
Terre et mémoire emmêlées 11
Un trou dans le présent 31
Enfance du territoire 39
Un corbeau de pierre 43
La circulation des rêves 45
Au centre du cercle 57
Le Vinland des Vikings 61
Abel et Caïn 67
Au pays de Sedna 75
Parmi les épinettes noires 81
La croix et l’annedda 85
Maison fermée 95
La fête des âmes 107
Une greffe de mémoire 115
Les coureurs des bois 123
169
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Reves2.indd 169 2023-06-22 13:34
LES RÊVES DU OOKPIK
Le bout du monde 129
Un cadavre dans le paysage 133
Le serment sur la montagne 141
Le pays chauve d’ancêtres 145
La pointe du triangle 151
Montréal et le territoire du vide 155
Notes 161
Liste des illustrations 167
Reves2.indd 170 2023-06-22 13:34
COLLECTION PROSES DE COMBAT
David Auclair, La bio-logique du nouveau management à l’école, 2016.
Maxime Blanchard, Le Québec n’existe pas, 2017.
Simon Harel, Foutue charte. Journal de mauvaise humeur, 2016.
Nicolas Lévesque, Je sais trop bien ne pas exister, 2016.
Nicolas Lévesque, Phora. Sur ma pratique de psy, 2019.
Nicolas Lévesque, Ptoma. Un psy en chute libre, 2021.
Guylaine Massoutre, Nous sommes le soleil. Femmes sous la dictature
(Argentine 1976-1983), 2019.
Leanne Betasamosake Simpson, Danser sur le dos de notre tortue. Niimtoowaad
mikinaag gijiying bakonaan. Nouvelle émergence des Nishnaabeg, 2018.
Sébastien Ste-Croix Dubé, La culture du divertissement. Art populaire ou
vortex cérébral ?, 2018.
Lucie Taïeb, Freshkills. Recycler la terre, 2019.
Chelsea Vowel, Écrits autochtones. Comprendre les enjeux des Premières Nations,
des Métis et des Inuit au Canada (traduction de Mishka Lavigne), 2021.
Reves2.indd 171 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 172 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 173 2023-06-22 13:34
ACHEVÉ D’IMPRIMER
CHEZ MARQUIS IMPRIMEUR INC.
À MONTMAGNY (QUÉBEC)
EN JANVIER 2022
POUR LE COMPTE DU GROUPE NOTA BENE
Ce livre a été imprimé sur du papier Enviro 100 % recyclé.
Dépôt légal, 1er trimestre 2022
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
Reves2.indd 174 2023-06-22 13:34
Reves2.indd 172 2023-06-22 13:34
Au petit matin, enfant, je découvre un toutou sur la table de la
cuisine. C’est un ookpik, une sorte de hibou fabriqué à la main
avec une peau de phoque. Mon père l’avait déposé là, au beau
milieu de la nuit, sans rien dire, au retour d’un de ses voyages
dans le Nord. À quoi rêve ce ookpik avec son intense regard
jaune ? Comment savoir tout le chemin qu’il a parcouru pour
se retrouver dans les bras d’un petit Blanc du Sud qui ne sait
presque rien des Premières Nations, des Inuit, des Métis et de
leurs territoires ? J’ai grandi en serrant le ookpik contre moi sans
chercher à savoir d’où il venait, à l’image de la nation québécoise
qui n’avait pas mesuré jusqu’ici l’ampleur du refoulement des
peuples et des cultures autochtones, pourtant si près, vivant juste
à côté, mais condamnés au lointain, au silence, au déni. J’ai écrit
cette méditation écologique en pleine remise en question de ma
mémoire personnelle et collective, de notre relation toxique au
territoire. Je marche en écrivant sur la forêt, sur l’art, sur l’autre,
sur l’amour. J’ouvre grand les bras à la manière du ookpik qui
déplie soudain ses ailes afin de retrouver le Nord qui l’attend
depuis toujours.
Étienne Beaulieu est né à Québec et vit actuellement à Sherbrooke.
Il s’est affirmé comme une voix incontournable de l’essai littéraire au
Québec, tant comme auteur de plusieurs livres – dont La pomme et
l’étoile (Varia, 2019), Splendeur au bois Beckett (Alias, 2018) et L’âme
littéraire (Nota bene, 2014) – que comme éditeur aux cahiers littéraires
Contre-jour, aux éditions Nota bene et comme directeur artistique des
Correspondances d’Eastman.
En couverture :
© Cécile A. Holdban
ISBN 978-2-89606-176-1
groupenotabene.com
Licence enqc-45-47797-CZ47797 accordée le 13 septembre 2023 à
karine-samson
Vous aimerez peut-être aussi
- La Coupe à Québec: Les Bulldogs et la naissance du hockey à QuébecD'EverandLa Coupe à Québec: Les Bulldogs et la naissance du hockey à QuébecPas encore d'évaluation
- 5 Choses Savoir MicrobioteDocument10 pages5 Choses Savoir MicrobioteSteve100% (1)
- Contes Et Lavanes Bigaro DiopDocument182 pagesContes Et Lavanes Bigaro Dioplatco91Pas encore d'évaluation
- La Description D'un Lieu Anime en 5eme-1Document10 pagesLa Description D'un Lieu Anime en 5eme-1akadji00Pas encore d'évaluation
- Birago Diop Contes Et Lavanes PDFDocument107 pagesBirago Diop Contes Et Lavanes PDFGile8867% (3)
- CM 189 Septembre 2018Document27 pagesCM 189 Septembre 2018tabetfredericPas encore d'évaluation
- Comme Une Seule Voix (Monique Brillon, Francine Chicoine, Marie Clark Etc.)Document130 pagesComme Une Seule Voix (Monique Brillon, Francine Chicoine, Marie Clark Etc.)JamalPas encore d'évaluation
- Novlettre SLE n56 Tournée du Lot et autres joyeusetésDocument9 pagesNovlettre SLE n56 Tournée du Lot et autres joyeusetésellyPas encore d'évaluation
- Recueil de poèmes 2012: Poètes du Gers et d'ailleursD'EverandRecueil de poèmes 2012: Poètes du Gers et d'ailleursPas encore d'évaluation
- Penriuk et sa douleur: Ossements aïnous retenus prisonniersD'EverandPenriuk et sa douleur: Ossements aïnous retenus prisonniersPas encore d'évaluation
- Petites Boîtes de Yôko OgawaDocument1 pagePetites Boîtes de Yôko OgawaDounia AbdelliPas encore d'évaluation
- Ivoric Rencontre BernhardtDocument3 pagesIvoric Rencontre BernhardtLion de JérusalemPas encore d'évaluation
- Un siècle de vénerie dans le nord de la FranceD'EverandUn siècle de vénerie dans le nord de la FrancePas encore d'évaluation
- LES ANNÉES DU SILENCE, TOME 1 : LA TOURMENTE: La tourmenteD'EverandLES ANNÉES DU SILENCE, TOME 1 : LA TOURMENTE: La tourmentePas encore d'évaluation
- Langue Française Lecture Conte de Mes Bêtes À L'aventureDocument59 pagesLangue Française Lecture Conte de Mes Bêtes À L'aventurejeromesbazoges100% (1)
- Textes 1 À 9Document9 pagesTextes 1 À 9OnsPas encore d'évaluation
- Nauetakuan Un Silence Pour Un BruitDocument258 pagesNauetakuan Un Silence Pour Un BruitHélène DestrempesPas encore d'évaluation
- Un autre voyage à Nantes: Neïrem de Kerbidoc’h - Tome 2D'EverandUn autre voyage à Nantes: Neïrem de Kerbidoc’h - Tome 2Pas encore d'évaluation
- Québec Insolite - Croque-Morts Et ThanatologuesDocument177 pagesQuébec Insolite - Croque-Morts Et ThanatologuesYvon DemersPas encore d'évaluation
- Quand la fontaine coule dans la vallée: Fables d'ici pour maintenantD'EverandQuand la fontaine coule dans la vallée: Fables d'ici pour maintenantPas encore d'évaluation
- Orphan and Polar Bear FrenchDocument21 pagesOrphan and Polar Bear FrenchPLAINEPas encore d'évaluation
- Congo - Peuples Et ForêtsDocument4 pagesCongo - Peuples Et ForêtstooncappuynsPas encore d'évaluation
- 9782897910730Document24 pages9782897910730a mPas encore d'évaluation
- Morfondre - Recherche GoogleDocument19 pagesMorfondre - Recherche GoogleSara Avril Caicedo RiveraPas encore d'évaluation
- Le trésor de l’abbé Monfand: D’après les contes et légendes du mont VentouxD'EverandLe trésor de l’abbé Monfand: D’après les contes et légendes du mont VentouxPas encore d'évaluation
- Je Reviens Avec La Nuit Nouvelles (Pellerin, Gilles, 1954-)Document174 pagesJe Reviens Avec La Nuit Nouvelles (Pellerin, Gilles, 1954-)Paraaa metreeessPas encore d'évaluation
- ContesDocument189 pagesContesmameyirimPas encore d'évaluation
- Les Patakinès de RafaëlDocument41 pagesLes Patakinès de Rafaëlgog111Pas encore d'évaluation
- Expose Francais FredericDocument3 pagesExpose Francais FredericTEAM2 DJEBPas encore d'évaluation
- Evaluation Os MusclesDocument2 pagesEvaluation Os MusclesNiangPas encore d'évaluation
- Cours de Zoologie - Gildas DJIDOHOKPINDocument55 pagesCours de Zoologie - Gildas DJIDOHOKPINRichie DharmiePas encore d'évaluation
- Activité N°1 Le Rapprochement Des GamètesDocument3 pagesActivité N°1 Le Rapprochement Des Gamètesisaacsouless0Pas encore d'évaluation
- Synthèse Myologie Q1Document28 pagesSynthèse Myologie Q1Annabel WeverberghPas encore d'évaluation
- GENVDBwedouDocument6 pagesGENVDBwedoumosafadiengPas encore d'évaluation
- Balic Chap5-1Document7 pagesBalic Chap5-1El ShalomPas encore d'évaluation
- 1cours 1ere Bac SC Ex Communicatioin NerveuseDocument23 pages1cours 1ere Bac SC Ex Communicatioin NerveuseBASSEPas encore d'évaluation
- Evaluation Certificative - CE1D 2020 - Sciences - Questionnaires (Ressource 16367)Document36 pagesEvaluation Certificative - CE1D 2020 - Sciences - Questionnaires (Ressource 16367)Laurent HaquennePas encore d'évaluation
- Colon Anatomie ColonDocument14 pagesColon Anatomie ColonZeyneb BoutouchentPas encore d'évaluation
- Interaction Biologique - Wikipedia-FrDocument4 pagesInteraction Biologique - Wikipedia-Frhaouaia fatima zohraPas encore d'évaluation
- 6-Les Luxations de L'articulation Temporo-Mandibulaire A.T.M. Et Équilibre Des Fonctions Oro-Faciales (Première Partie)Document19 pages6-Les Luxations de L'articulation Temporo-Mandibulaire A.T.M. Et Équilibre Des Fonctions Oro-Faciales (Première Partie)MKPas encore d'évaluation
- Programme de Biologie - S4-S5: Ref.: 2019-05-D-27-fr-2 Orig.: ENDocument30 pagesProgramme de Biologie - S4-S5: Ref.: 2019-05-D-27-fr-2 Orig.: ENSouhaib AbadanePas encore d'évaluation
- Emploi Du Temps SVI 2022 2023 V2Document3 pagesEmploi Du Temps SVI 2022 2023 V2ASTA SAMAPas encore d'évaluation
- AT MicrobiologieDocument4 pagesAT MicrobiologieBoukermaPas encore d'évaluation
- Th1 Ch2 Act3 Microscopie + Membrane PlasmiqueDocument5 pagesTh1 Ch2 Act3 Microscopie + Membrane PlasmiqueMusab BilginPas encore d'évaluation
- Bio PhysiqueDocument29 pagesBio Physiquemustapha BOUMEDIANEPas encore d'évaluation
- Vos 3 Types D'hypersensibilitesDocument32 pagesVos 3 Types D'hypersensibilitesalaouikadiri8279Pas encore d'évaluation
- Laboratoire Biolab Bamako - Recherche GoogleDocument1 pageLaboratoire Biolab Bamako - Recherche GoogleAlou CoulibalyPas encore d'évaluation
- 14 La PrécipitaionDocument8 pages14 La PrécipitaionDr BENOUADFEL100% (1)
- Projet de Fin D Etude l3 Houssam LekbirDocument5 pagesProjet de Fin D Etude l3 Houssam LekbirFouad AmrouchePas encore d'évaluation
- 43023914Document3 pages43023914joseethermidorPas encore d'évaluation
- Épigénétique Et Memoire CellulaireDocument10 pagesÉpigénétique Et Memoire CellulaireAndreea SchiauPas encore d'évaluation
- La Neige de CultureDocument104 pagesLa Neige de Culturescribd30360Pas encore d'évaluation
- Chapitre 5 - Tissu OsseuxDocument12 pagesChapitre 5 - Tissu OsseuxFernando KollaPas encore d'évaluation
- DevoirDocument1 pageDevoirKeitaPas encore d'évaluation
- Effets Des Actions de L'homme Sur La NatureDocument3 pagesEffets Des Actions de L'homme Sur La Natureninonlebreton2010Pas encore d'évaluation
- Membrane Plasmique - WikipédiaDocument30 pagesMembrane Plasmique - Wikipédiagagnon.jonathan2007Pas encore d'évaluation
- PDF Complet Edition Du Soir Saone Et Loire 20220819Document42 pagesPDF Complet Edition Du Soir Saone Et Loire 20220819mamarquillyPas encore d'évaluation
- Norm RéponsesDocument2 pagesNorm RéponsesCHAIMAE AFIFPas encore d'évaluation