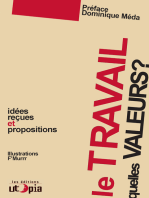Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Un Désir de Communisme (Bernard Friot Judith Bernard)
Transféré par
Slim Bencheikh0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues106 pagesTitre original
Un désir de communisme (Bernard Friot Judith Bernard)
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues106 pagesUn Désir de Communisme (Bernard Friot Judith Bernard)
Transféré par
Slim BencheikhDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 106
Un désir de communisme
Conversation entre
Bernard Friot
& Judith Bernard
Collection : Conversations pour demain
Graphisme : Agnès Dahan
© Les éditions Textuel, 2020
4, impasse de Conti
75006 Paris
www.editionstextuel.com
Dépôt légal : avril 2020
EPUB : 9782845978171
Sommaire
Avant-propos
Vers le salaire à vie pour tous
Construire des luttes offensives
Batailles sur la retraite : un enjeu anthropologique
Remerciement
Livres de Bernard Friot discutés dans cet ouvrage
Du même auteur
Dans la même collection
Notes
Avant-propos
Nous cultivons, à Hors-Série1, l’art de la conversation, auquel nous
prêtons d’immenses vertus. Si l’on en croit l’étymologie, converser, c’est
vivre avec : c’est dire combien cet art exige d’engagement de part et
d’autre. Cela commence par la fréquentation assidue du texte dont on reçoit
l’auteur : plus qu’une lecture, évidemment exhaustive, il s’agit d’une
incorporation. Les pages sont soulignées, copieusement annotées, puis
« fichées » : les citations sont recopiées – l’incorporation passe aussi, c’est
vieux comme l’histoire de l’art, par la main qui copie. Elles sont
commentées, problématisées, dialectisées : la subjectivité du lecteur et son
propre appareil critique reprennent leurs droits, détectent d’éventuels angles
morts, opposent des contradictions, suggèrent des prolongements et des
lignes de fuite…
La rencontre a déjà commencé, avant même le début du tournage de
l’entretien, où l’on arrive tout plein de l’œuvre et de questions. Lesquelles
n’ont pas vocation à faire redire à l’auteur ce qu’il a déjà écrit – cela
n’aurait guère d’intérêt (même si c’est ainsi que se réalise, dans l’immense
majorité des cas, « l’entretien », dans sa conception médiatique
traditionnelle). La conversation n’est pas la doublure orale du livre ; elle est
sa mise en mouvement, par deux subjectivités intensément engagées, saisies
par l’événement d’une rencontre et l’impromptu d’une pensée qui s’élabore,
pour une part, au moment-même où elle est captée par la caméra et le
micro. Il arrive que des invités demandent à connaître mes questions avant
le tournage ; je m’y refuse systématiquement. Ce serait vider la
conversation de sa part de vie authentique, et de ce qu’elle a de plus
précieux à mes yeux : sa part d’imprévisibilité, délivrant le trésor d’une
pensée en mouvement dans l’instant où elle se formule. C’est cette vie-là
qui est offerte à ceux qui nous suivent, qui peuvent ainsi à leur tour
s’emparer de cette pensée, portés par l’élan qui anime la conversation.
S’agissant de la production théorique de Bernard Friot, cet art de la
conversation me semble particulièrement bienvenu : c’est une pensée dont
l’abord peut sembler escarpé, tant il renverse d’évidences et retourne
comme un gant nos manières de voir et de juger. Alors que nous sommes
écrasés par le rouleau compresseur du capitalisme néolibéral, il entend faire
apparaître le « déjà là » des institutions communistes à notre disposition ;
plutôt que de se faire le défenseur des victimes qui peuplent les classes
laborieuses, il se met à l’école des vainqueurs qu’elles constituèrent ; au
lieu de se lamenter devant la supposée toute puissance de la doxa
capitaliste, il pointe les fautes stratégiques commises par la « gauche », qui
n’a perdu que dans l’exacte mesure où elle a adopté le discours et la vision
du capital. Ce faisant il nous arme, nous rendant à notre autonomie et à nos
responsabilités, et nous émancipe, en nous rappelant à notre désir de
communisme – lequel n’est pas un horizon à poursuivre comme une
chimère, mais le mouvement réel, ici et aujourd’hui, par lequel nous sortons
de l’ordre capitaliste. Cette émancipation m’a si profondément ébranlée que
j’ai éprouvé le besoin de la mettre en œuvre au-delà de cet art de la
conversation qui est le métier de Hors-Série. C’est dans ma vie artistique,
en tant qu’auteure et metteure en scène de théâtre, que j’ai traduit dans un
spectacle intitulé Amargi les propositions de Bernard Friot autour du salaire
à vie. Je me permets de l’évoquer dans cet avant-propos parce que Bernard
y fait référence dans notre deuxième conversation, à propos de la dette et de
l’illégitimité du crédit par les banques privées : c’est un spectacle qu’il a vu
maintes fois, qu’il a accompagné et soutenu, évidemment heureux de voir
sa pensée « offerte sur un plateau », c’est-à-dire, là encore, mise en
mouvement dans une proposition vivante et incarnée – comme le sont nos
conversations.
Ces conversations sont au nombre de trois dans le livre ici présent : les
deux premières sont issues de mes émissions Dans le texte sur Hors-Série et
portent successivement sur Émanciper le travail et sur Vaincre Macron,
parus respectivement aux éditions La Dispute en 2014 et en 2017. La
troisième conversation est inédite : elle répond à notre souci d’épouser le
cheminement intellectuel de Bernard Friot, dont les recherches se
poursuivent, et de mettre à jour ses analyses face à l’accélération de la
contre-révolution néolibérale à l’heure de la « réforme » des retraites ; elle
s’appuie sur la réédition augmentée de son livre Le Travail, enjeu des
retraites (La Dispute, 2019). Elle a été enregistrée dans un cadre privé, dans
la perspective de la publication de ce livre : ainsi les lecteurs disposent-ils
d’un matériau inédit, le plus actuel possible, toujours aussi roboratif, et
puissamment éclairant. Puissent-ils en être à leur tour émancipés, comme je
le fus moi-même en découvrant le travail de Bernard Friot.
Judith Bernard.
Vers le salaire à vie pour tous
Judith Bernard Vous militez pour une reprise du projet révolutionnaire qui
permette enfin de sortir du capitalisme ; il faut pour cela, selon vous,
constituer le salariat en classe révolutionnaire – la chose ne va pas de soi –
et il faut aussi non pas « s’émanciper du travail » (en revendiquant, par
exemple, une réduction du temps de travail) mais émanciper le travail,
c’est-à-dire l’arracher à l’emploi, aux employeurs, au marché du travail,
grâce à l’institution du salaire à vie. C’est une manière de dire et de penser
qui prend à contre-pied la plupart des discours militants de gauche, ce qui
constitue une difficulté d’appropriation de votre pensée. Difficulté qui vous
fait privilégier, sans doute, la forme de l’entretien pour certaines de vos
publications, forme que nous poursuivons ici : je jouerai à mon tour le rôle
du sparing partner, qui vous renvoie la balle pour nous permettre de mieux
cerner ce projet, très complet, que vous élaborez, et pour vous opposer les
contradictions apparentes que votre proposition ne manque pas de
susciter… « Sparing Partner », la métaphore est sportive, et, il faut le dire,
l’entrée dans votre pensée l’est aussi : il y a un effort à produire pour entrer
dans votre manière de concevoir les choses, parce qu’il faut se défaire des
plis intellectuels dans lesquels nous sommes habitués à penser (sans doute
sous l’empire de l’hégémonie culturelle capitaliste), il faut se défaire les
plis du cerveau pour entrer dans une manière de penser non pas contre le
capitalisme, mais sans le capitalisme – et c’est une sacrée expérience de
pensée ! Vous mesurez cet effort qu’il faut produire, pour accéder à
l’expérience de pensée que vous proposez ?
Bernard Friot Oui, je rencontre de nombreux publics, essentiellement
militants, et je mesure la difficulté. Non pas que mon propos, dans son
énoncé, est difficile. Ça n’est pas plus difficile de dire « les retraités sont
des travailleurs » que de dire « les retraités sont d’anciens travailleurs » ;
sauf que dire « les retraités sont des travailleurs » va contre l’idée reçue qui
veut que les retraités sont « utiles » mais « non productifs ». Si, dans une
activité militante, on a progressivement construit toute sa pratique autour
d’une représentation du travailleur comme celui qui va sur un marché (du
travail ou des biens et services) pour produire de la valeur pour le capital,
évidemment mon propos va paraître difficile… Alors qu’il est très simple !
Mais c’est une simplicité qui, parce qu’elle va à l’encontre des idées
majoritaires, surprend. J’ajoute quand même que c’est une surprise
heureuse : les yeux de ceux qui sont dans les salles où j’interviens sont
plutôt des yeux heureux et rieurs, même s’ils sont perplexes
éventuellement, que des yeux inquiets ou accablés…
J B Oui, parce qu’il peut y avoir bien sûr un aspect inquiétant à saisir que
beaucoup de luttes de gauche aujourd’hui font fausse route, ce qui peut
avoir un effet un peu désespérant, mais en même temps il y a un côté très
« espérant », parce que vous nous montrez qu’en réalité la révolution à
laquelle vous nous invitez à nouveau, il ne s’agit que de la poursuivre. Elle
est déjà commencée : elle commence dans ce que vous appelez « 1945 »,
dans les institutions dont la classe ouvrière s’est dotée, et dont elle a doté la
société, à travers la Sécurité sociale, le statut de la fonction publique…
Alors commençons par ça : par le « déjà là », dont vous dites qu’il est
institué en 1945, mais vous précisez en note de bas de page : « 1945 est une
date emblématique qui désigne dans cet ouvrage une offensive ouvrière de
plusieurs décennies ». Ça ne s’est pas fait en quelques semaines sous
l’impulsion du Conseil national de la résistance, il a fallu tout un travail de
plusieurs décennies pour se doter de ces institutions. On peut partir de
quelques dates-clef par lesquelles on se dote, peu à peu, d’institutions
anticapitalistes ?
BF Merci d’abord de signaler cet aspect de mon travail, car souvent 1945
est présenté comme une espèce de produit des circonstances : « le capital
était aux abois parce qu’il avait collaboré, la Russie faisait une pression
internationale suffisante pour que la classe dirigeante d’Europe de l’Ouest
fasse le gros dos, les résistants étaient armés », etc.
J B Ce sont quand même des faits, c’est vrai aussi. Il n’y a pas que ça,
mais ce sont des faits indiscutables.
B F C’est simplement ce qui a permis – et dans des difficultés
considérables qui n’ont pu être surmontées que parce qu’il y avait une
organisation et une autonomie ouvrière construites depuis belle lurette (il
suffit de lire cinq page d’Annie Lacroix-Riz pour en être tout à fait
convaincu)… Même avec toutes ces circonstances favorables, rien n’aurait
été possible sans ce préalable qu’a été la constitution de la CGT comme
syndicat de masse, comme syndicat de classe, ayant déjà plus de cinquante
ans d’expérience.
J B Parce que donc, la constitution de la CGT, ça se passe quand ?
BF La constitution de la CGT c’est 1895 ; avec une charte qui intervient
quelques années plus tard et qui pose, sur une base qu’on appelle
classiquement « anarcho-syndicaliste », la double dimension de défense
d’intérêts d’un syndicat de masse mais aussi d’organisation autonome d’une
classe qui entend bien prendre le pouvoir et organiser l’activité
économique. C’est une tradition extrêmement forte qui va être amplifiée
avec, en 1920, la transformation de la SFIO en Parti communiste, qui va
soutenir, dans la CGT, la CGT-U de 1922 (lorsque la minorité communiste
est chassée de la CGT et constitue la CGT « Unitaire »). Donc le Parti
communiste va armer idéologiquement les militants que l’on va retrouver
en 1945 : Ambroise Croizat, Marcel Paul, voilà des gens qui ont été formés,
ce sont des dirigeants syndicaux qui viennent de la CGT-U, et qui vont
avoir l’autonomie intellectuelle et organisationnelle nécessaire : c’est
décisif.
JB Oui, parce que ce qu’il faut souligner, c’est que la CGT puis le PC ne
se contentent pas de revendiquer d’aménager le capitalisme dans ses
marges, en faisant en sorte que ça fasse moins mal, en gros, mais proposent
vraiment un monde alternatif, et une autre manière de définir la valeur.
C’est ça que vous faites apparaître : l’invention et l’extension de la
cotisation, ce n’est pas juste une manière de réparer les dégâts du
capitalisme, et de faire en sorte d’aider les démunis, ceux à qui le
capitalisme ne profite pas… C’est une manière de reconnaître qu’IL Y A
une autre valeur, il y a une autre production de la valeur que dans les
entreprises capitalistes, et la cotisation reconnaît et rémunère cette valeur-
là. Dès la CGT née en 1895 puis le PC, il y a cette manière de penser une
valeur non capitaliste ?
B F Quand on invente du neuf, on le pense toujours dans les catégories
anciennes. Il ne faut pas non plus faire dire à ces militants ce qu’ils ne
disent pas. Vous pouvez très bien avoir chez des militants de la CGT-U
l’idée qu’on se bat pour augmenter le pouvoir d’achat des démunis, aussi.
Mais le cœur de l’action, c’est le pouvoir, et le pouvoir pas simplement dans
son expression politique, c’est le pouvoir sur le travail. Nous devons être
souverains sur notre travail. Je suis en train, pour des questions de
recherche, de reprendre des textes de la CGT de 1944, 1945, 1946, et c’est
évident : tous ces textes-là sont baignés de cette conviction et de ce projet
que la classe ouvrière doit gérer. Par subversion de la Sécurité sociale
existante, le régime général a été créé, par la classe ouvrière exclusivement,
au premier semestre de 1946. La CGT a eu en la matière cette capacité
d’autonomie qui repose sur l’affirmation : « nous sommes candidats au
pouvoir économique ».
JB « Candidats au pouvoir économique », ça veut dire être la classe qui
décide de ce qu’est la valeur et comment on la produit. Vous écrivez :
« c’est la production de valeur et non pas sa répartition qui est le lieu de la
lutte des classes ; c’est par sa capacité à décider de la valeur économique,
à maîtriser son mode de production, que se définit une classe dirigeante ».
On peut reprendre l’exemple du retraité dont vous parliez tout à l’heure :
considérer que le retraité travaille, c’est décréter qu’il produit une valeur
économique (plutôt que de dire : « il est utile, mais ce n’est pas pour ça
qu’on le rémunère, on le rémunère parce qu’il a des besoins »). Décréter
qu’il produit une valeur économique, c’est sortir d’une logique où les
individus sont sujets de besoins et entrer dans une logique où les individus
sont TOUS producteurs de valeur, de valeur économique. Ce n’est pas
forcément facile à comprendre. Dans votre proposition du salaire à vie, il y
a rémunération pour tous, de 18 ans jusqu’à la fin de vie, en tant que
« nous sommes tous des producteurs de valeur » ; mais comment on peut
arriver à prouver ça : que quiconque, quoi qu’il fasse, indépendamment
d’un éventuel poste de travail, de sa santé, de son éventuel handicap, est, en
toute circonstance, producteur de valeur ?
BF Ça ne se décrète pas. Ça se construit. Attention, dire que se construit
un statut du producteur qui le pose, en tant que personne, comme
producteur, ne veut pas dire que toutes ses activités sont productives ! Ça
veut dire qu’on sort d’une condition capitaliste du travailleur qui doit
quémander en permanence sa reconnaissance comme tel. Et c’est une
construction séculaire. Vous avez, à très juste titre, proposé le mot de
« révolution » à propos de ce que je dis, mais mettons-nous bien d’accord,
parce que nous avons en France un fantasme de révolution, selon lequel il
suffit de faire le 14 juillet 1789 et la révolution est faite. Évidemment, ce
n’est jamais ça. Si révolution il y a, c’est au sens où un mode de production
succède à un autre ; où un mode de production aristocratique, fondé sur la
propriété féodale de la terre, est remplacé par un mode de production
bourgeois dans lequel la propriété lucrative de l’outil de travail, la création
d’un marché du travail, permettent de générer du profit. Cette
transformation-là, qui suppose une transformation des institutions, mais
aussi des représentations, dans les têtes, ne se fait pas par du « Grand
Soir ». Je crois qu’il faut qu’on se débarrasse de l’idéologie du Grand Soir,
mais qu’en s’en débarrassant, on ne se débarrasse pas de l’ambition
révolutionnaire ! Que l’on pose bien la révolution comme une succession de
moments où l’histoire s’accélère, et où des institutions subversives de
l’ordre actuel se mettent en place, et puis il peut y avoir ensuite des
décennies d’atonie, voire de recul, et puis ça reprend… La bourgeoisie a
mis plusieurs siècles pour en finir avec l’aristocratie ! N’espérons pas
mettre beaucoup moins… Il y a des formes de pessimisme collectif
actuelles qui viennent d’une insuffisante vision du long cours de l’histoire.
Il faut être dans cette perception du long cours de l’histoire pour raison
garder : ce n’est pas parce que Thatcher arrive que le monde, brusquement,
s’effondre. Pour en revenir à votre question, poser que quelqu’un est
potentiellement producteur de valeur économique, et à ce titre, a droit à une
reconnaissance politique de cette potentialité, par un salaire à vie, ça n’est
pas décréter qu’il produit ; c’est commencer à sortir d’une préhistoire de
travailleurs soumis à l’aléa de la valorisation du capital, ce qui est une
affaire de très longue haleine. Ce qui est intéressant, c’est de repérer
comment cette construction a déjà commencé, et comment elle peut se
poursuivre.
JB Elle a déjà commencé par la cotisation, qui permet de rémunérer les
retraités, mais aussi de financer les allocations familiales, qui
reconnaissent la valeur économique produite par un parent qui s’occupe
d’élever ses enfants. Pour vous, le principe de la cotisation a déjà
commencé à reconnaître notre qualité de producteur de valeur économique,
y compris quand nous ne sommes pas dans l’emploi. Et ça vaut aussi pour
la fonction publique…
B F Ça peut être une affaire de cotisation comme une affaire d’impôt,
parce que la fonction publique, elle est à la fois hospitalière, et là c’est la
cotisation qui la paie, mais elle est aussi d’État ou territoriale, et là c’est
l’impôt qui la paie. Donc la cotisation n’est pas le seul vecteur de cette
affirmation du salaire à vie, ce peut aussi être l’impôt, et la cotisation peut
ne pas être ce vecteur. Si je cotise dans une logique de compte individuel de
type Agirc-Arrco pour les caisses de retraite, je ne suis pas du tout dans une
logique de reconnaissance de ce que le retraité travaille, puisqu’il est
supposé recevoir la contrepartie de ses cotisations passées…
J B Qui ne sont donc que de l’épargne individuelle, en fait…
B F Il n’y a pas d’épargne, mais on reste dans la prévoyance. Nous ne
sortons pas de la logique du capital, qui nous dit que vous produisez de la
valeur quand vous êtes dans l’emploi, et puis quand vous n’êtes plus dans
l’emploi, vous récupérez la partie de la valeur produite quand vous étiez
dans l’emploi que vous avez, non pas épargnée sur un marché des capitaux
(puisque nous sommes en répartition), mais que vous avez à l’époque
affectée aux retraités et qu’aujourd’hui, les actifs vous « rendent ». C’est
cette foutue « solidarité intergénérationnelle », qui est le cœur de la lecture
capitaliste de la Sécurité sociale.
J B Mais c’est terrible, parce que vous dites « foutue solidarité », alors
que la solidarité fait partie des valeurs de gauche qu’on pense porteuses
d’avenir et d’espoir, il faut de la solidarité, il faut de la redistribution, il
faut du partage, et vous, vous dites : « Attention ! Attention à ces mots-là
! » Vous dites, en gros : certes, la solidarité est une belle chose, mais
concevoir la cotisation comme un principe de solidarité, en vertu duquel
ceux qui ont la chance d’être dans l’emploi font un geste pour ceux qui
n’ont pas la chance d’être dans l’emploi, cette manière-là de concevoir le
modèle économique est une manière de continuer à se greffer sur la logique
capitaliste qui considère qu’il n’y a de valeur produite que là où il y a de
l’emploi.
B F Absolument.
JB C’est très compliqué, parce qu’il faut arriver à se débarrasser même
de nos beaux mots – « solidarité », « redistribution » – ce sont des principes
dans lesquels on croit, et vous montrez que ce sont des pièges…
BF Quand je dénonce comme capitaliste la solidarité de « ceux qui ont »
avec « ceux qui n’ont pas », c’est pour affirmer la solidarité ouvrière telle
que je l’observe dans l’institution d’un « déjà-là » alternatif. Elle ne pose
pas l’autre en état de manque que ma solidarité va combler. Il s’agit
d’égaux qui se serrent les coudes face à la bourgeoisie capitaliste pour
attaquer son monopole sur le travail. Cela dit, j’admire beaucoup la qualité
de votre lecture, depuis le début de l’entretien, ce qui montre quand même
que des idées reçues peuvent être mises en cause à travers la lecture de mon
ouvrage…
J B Ah ça, vous m’avez convaincue, oui, j’avoue. C’est très difficile
d’entrer dedans, les dix premières pages, c’est difficile, mais une fois qu’on
a compris, c’est extraordinaire ! D’ailleurs, en relisant votre livre, je ne
comprenais plus pourquoi je n’avais pas compris la première fois. J’avais
écrit dans la marge : « je ne comprends rien !!! », page 50, très énervée, et
après quand j’ai repris ma lecture, je disais : « mais pourquoi je ne
comprenais pas ça, si, c’est très clair, en fait ! » Une fois qu’on a fait sa
conversion, c’est limpide. Mais revenons à l’idée que la solidarité est un
mot piège.
B F Insistons bien sur le fait que la solidarité, c’est le patrimoine du
mouvement ouvrier, donc en aucun cas je ne mets en cause la solidarité.
C’est sa lecture capitaliste que je mets en cause. Être « solidaire » de celui
qui n’a pas, ce n’est pas du tout un supplément d’âme, c’est au cœur même
du libéralisme, dès le xixe siècle. Des gens comme Thiers nous disent : « On
ne peut pas laisser ça à la charité privée, c’est l’État qui doit organiser la
chose. » Ça ne peut pas être une obligation juridique, qui supposerait des
relations contractuelles entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, mais c’est
une obligation morale : toute l’éducation bourgeoise du xixe siècle est une
éducation à la solidarité, entendue comme sollicitude instituée envers des
démunis…
J B Donc, le libéralisme se donne une obligation morale ?
B F De solidarité, bien sûr ! Pour une raison politique très claire : ces gens-
là sont complètement conscients de ce que c’est que la lutte de classe…
J B Ça va péter s’ils ne font pas ça…
B F C’est une nécessité politique qui est convertie en obligation morale. La
solidarité ouvrière, c’est tout à fait autre chose : elle se construit dans la
CGT, au début du xxe siècle, autour de cette prétention affirmée à prendre le
pouvoir économique. C’est la même prétention que celle des bourgeois du
xiv siècle : lorsqu’ils construisent leur beffroi en face des tours de la
e
cathédrale ou des tours du château, ils se posent bien comme les
successeurs…
JB Oui, ils mettent des horloges en face des églises parce que le temps,
pour eux…
B F C’est pour imposer progressivement une autre mesure de la valeur que
celle qui est opérée par l’aristocratie ; ça va se jouer progressivement aux
xiv , xv , xvi siècles, et ça s’exprime toujours dans les cadres dominants de
e e e
l’époque. Ceux qui me disent : « Mais la Sécurité sociale, c’est dans le
capitalisme, donc ça ne peut pas être anticapitaliste », ce sont des gens qui
ne comprennent pas ce que c’est qu’une mutation historique. À Lyon, c’est
dans une église, l’église Saint-Nizier entre Saône et Rhône, que la
bourgeoisie va élire le conseil municipal contre l’évêque, qui lui est à la
cathédrale entre Fourvière et Saône…
J B Elle est dedans, mais elle subvertit le cadre…
B F Voilà.
J B Et c’est ça que le régime général de Sécurité sociale fait dans le
capitalisme : il est dedans, et il le subvertit.
B F Absolument. J’en reviens toujours à cette question : comment
revalider le vocabulaire de la révolution ? Il faut se débarrasser de toute
idée de grand soir, mais il faut aussi se débarrasser de toute idée de réforme
progressive. Il n’y a pas de réforme progressive ! Il y a des affirmations
majeures dans des moments de conflit décisifs, comme 1945-1946,
affirmations d’une altérité qui va être là comme un clou dans le soulier du
capital – et un clou durable, parce que depuis trente ans que la bourgeoisie
« réforme », elle n’a pas réussi à en venir à bout : ni de la fonction publique,
ni de la cotisation sociale. Pour en revenir, d’ailleurs, à la cotisation, il peut
y avoir une cotisation de type capitaliste qui joue sur la solidarité de type
capitaliste : lorsque Rocard crée la CSG (Contribution sociale généralisée),
on est dans la solidarité capitaliste. C’est un impôt qui nous dit : « il faut
bien qu’il y ait une solidarité nationale avec les familles, appauvries par le
coût de l’enfant, qui doit être collectivement assumé par la CSG » : c’est
parfaitement cohérent avec la logique de la solidarité capitaliste. Alors que
l’impôt qui paie les fonctionnaires relève d’une solidarité anticapitaliste. Je
prends l’exemple de l’université – en tant qu’universitaire, j’ai été pendant
quarante ans autogestionnaire : j’ai décidé des programmes, j’ai décidé de
l’utilisation des locaux, dans une enveloppe budgétaire, bien sûr…
J B Mais est-ce que ce n’est pas parce que vous y exerciez dans une
période antérieure aux réformes de type LRU, où l’esprit d’un management
libéral est venu contaminer jusqu’aux cadres de la fonction publique…
B F Vous avez raison.
JB Aujourd’hui, même la fonction publique est envahie par des manières
de penser et d’agir qui sont issues de la logique du marché capitaliste.
BF Bien sûr, mais il ne tient qu’aux fonctionnaires d’État d’honorer leur
statut. Un fonctionnaire d’État peut parfaitement s’opposer à l’invasion de
la logique managériale dans les services publics, à condition qu’il le fasse
collectivement. C’est une mutation nécessaire du rôle des syndicats : il faut
sortir de la pleurnicherie. Prenez un tract syndical aujourd’hui : sur deux
pages, vous avez déjà une page et demie de « ça va de plus en plus mal,
c’est tous des salauds, on a bien du mal », etc. Et puis ensuite, après avoir
pleurniché et dénoncé, vous avez un dernier quart « on pourra vous dire ce
qu’il faudrait faire » (on ne le dit jamais vraiment correctement). Ça, ça ne
peut pas durer. Il y a un moment où il faut que les fonctionnaires d’État
honorent leur statut, qui fait qu’ils peuvent refuser des directives contraires
à leur déontologie – à condition que ce soit collectif, qu’ils entrent dans une
démarche d’auto-organisation : c’est ça, honorer le statut mis en place en
1946 par un communiste qui s’appelait Thorez et que la classe dirigeante
appelle « l’homme de Moscou ».
JB Et en même temps, cette fonction publique que vous présentez comme
une possible avant-garde, au fond, révolutionnaire, puisque son statut
assure un salaire à vie qui reconnaît un producteur de valeur en fonction de
sa qualification (donc dans la fonction publique on est pratiquement à
l’intérieur du modèle que vous entendez généraliser), on ne peut pas nier
qu’elle souffre d’une mauvaise réputation. Il y a une image de la fonction
publique qui contamine jusqu’à nos propres esprits de fonctionnaires : cette
idée que précisément, des gens qui sont salariés à vie, quoi qu’ils fassent,
ça va générer beaucoup de paresse, une bureaucratie très lourde, avec des
postes qui sont occupés par des gens qui s’en foutent de faire du bon boulot
parce que de toute façon, ils sont payés en toute circonstance… Il y a toute
une image autour de la fonction publique, d’ailleurs « fonctionnaire » est
une insulte dans certains mondes, et on voit très bien ce que ça veut dire :
ça veut dire paresseux, indifférent aux difficultés de ceux qui sont dans
l’économie privée si violente… Alors comment on fait pour débarrasser la
fonction publique, et donc le salaire à vie qui lui est lié, de cette image un
peu dégradée ? De cette idée que si on perçoit notre salaire quoi qu’on
fasse, du coup, on ne va rien faire pour le mériter ?
B F En tout cas, dans les aspirations des jeunes, l’aspiration à avoir un
salaire à vie est très importante. Il n’y a pas que des « gagneurs » qui
veulent aller sur la place financière de Londres, dans la jeunesse. Il y a tous
ceux qui trouvent que finalement, le modèle du salaire attaché à la
personne, comme un droit politique, et non pas au poste de travail, est un
modèle beaucoup plus porteur d’avenir que le modèle de l’emploi. Il y a
aussi le fait que, quand même, malgré cette propagande permanente,
beaucoup de salarié·e·s du privé sont marié·e·s à des fonctionnaires et
voient très bien ce qu’ils font : au quotidien, ils voient très bien que les
fonctionnaires travaillent, et ils sont souvent contents, d’ailleurs, d’avoir en
leur conjoint quelqu’un qui a un salaire à vie. Et puis, à supposer même
qu’un fonctionnaire ne fasse pas grand-chose, il y a l’évidence : ce qu’il fait
est utile, pour l’essentiel.
JB Vous n’êtes pas sensible au discours sur le « manque d’efficience » du
service public ? Parce qu’on entend ça aussi, beaucoup…
B F Les services publics fonctionnent beaucoup moins bien depuis qu’on a
mis en place le new public management ; tout le monde voit bien que La
Poste fonctionne beaucoup plus mal aujourd’hui qu’il y a dix ans. On avait
la lettre le lendemain, c’est impossible aujourd’hui… Les hôpitaux
fonctionnent beaucoup plus mal aujourd’hui qu’il y a dix ans, l’école aussi.
L’introduction du new public management a entraîné une dégradation du
fonctionnement du service public qui montre très bien que le
fonctionnement du service public est supérieur au fonctionnement du privé.
Et quant à ce que l’on produit… Dans le privé, le nombre d’ingénieurs qui
ont joué le jeu, et qui se rendent compte à 35 ans que ce qu’ils ont fait c’est
de la merde, que ça ne servait à rien, qu’ils ont fait un boulot inutile ! Moi
comme fonctionnaire je n’ai jamais eu cette impression-là. J’ai enseigné,
j’ai toujours fait quelque chose d’utile, je n’ai jamais eu l’impression que je
bossais pour enrichir un capitaliste qui se foutait éperdument de ce que je
produisais. J’ai toujours eu conscience de l’utilité sociale de mon activité.
Bien sûr qu’il y a une campagne permanente pour dire que la fonction
publique ne fait rien. C’est moins important à mon avis que celle qui dit que
la fonction publique ne produit rien. Ça, c’est beaucoup plus grave. Et c’est
là qu’on en arrive à la distinction entre travail concret et travail abstrait…
JB Le bouquin commence sur cette question, et moi c’est une nuance que
j’ai du mal à comprendre.
B F Le fonctionnaire qui enseigne, ça c’est le travail concret. Le
fonctionnaire qui est à l’urbanisme municipal, c’est le travail concret, celui
qui répare les routes dans la direction départementale de la voirie, c’est du
travail concret. Le travail abstrait, c’est le fait qu’il le fait en tant que
fonctionnaire, un fonctionnaire qui est à l’indice 450 : c’est le niveau de
valeur économique qu’il est censé produire…
J B … tel que reconnu par son indice, son grade, dans l’échelle de
qualification de la fonction publique ?
B F Voilà. Et s’agissant du privé, c’est pareil. Vous pouvez être
chaudronnier, ou n’importe quel type de métier, ça c’est le travail concret,
mais vous allez être « OP2 » (Ouvrier professionnel 2e échelon), vous allez
être « Etam » (Employés, techniciens et agents de maîtrise), vous allez être
dans tel ou tel niveau de la convention collective qui définit la valeur
économique attribuée à votre poste de travail. Ça c’est le travail abstrait.
J B D’accord, d’accord !
B F C’est une convention sociale ; le fait de dire que le chirurgien est à
l’indice 750 ou qu’il est cadre supérieur, et puis que le ripeur, ou l’éboueur
est à l’indice 125, ou qu’il est ouvrier spécialisé, nous sommes là dans la
convention sociale…
JB … qui a du sens pour nous, par exemple par rapport à leur niveau de
certification. On considère que ce qui fait que le chirurgien est à cette
hauteur-là par rapport au ripeur qui est à un niveau inférieur, c’est la
différence de formation ? Ça a coûté beaucoup de produire ce niveau-là de
certification pour le chirurgien, et donc sa rémunération vient en quelque
sorte reconnaître cette valeur ?
B F Parce qu’il a beaucoup coûté, il doit beaucoup gagner ? (Rire)
J B Je ne sais pas, j’essaie de comprendre comment fonctionne
l’imaginaire précédent, mais maintenant je suis dans le vôtre alors…
B F Lier le niveau de salaire aux coûts de formation, c’est rester dans la
logique de la rémunération capitaliste, ce « prix de la force de travail » qui
reconnaît les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Or le salaire
à la qualification (pas à la certification, justement !) reconnaît non pas mes
besoins mais ma contribution à la production de valeur. Mais la mesure de
cette contribution relève d’une convention, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de
fondement naturel, qu’elle renvoie aux rapports sociaux et donc à la
violence sociale dont ils sont porteurs.
J B Oui !
BF Parce que l’utilité sociale du ripeur, elle est peut-être plus grande que
celle du chirurgien. Enfin pas quand je suis proche, moi, de me faire opérer
du genou…
J B Eh oui, c’est ça…
B F Évidemment, un chirurgien a une très grande utilité sociale, mais peut-
être que globalement notre espérance de vie diminuerait plus vite si on
supprimait le ramassage des ordures que si on supprimait les hôpitaux.
Donc, en termes de travail concret, en termes d’utilité sociale, nous avons
des valeurs, ce qu’on appelle des valeurs d’usage, qui ne correspondent pas
à la valeur économique attribuée à ce que nous faisons. Le travail abstrait
c’est la valeur économique attribuée à ce que nous faisons, en tant que
porteurs de la qualification, à tel ou tel indice, c’est abstrait – on peut être
chirurgien et chaudronnier et être au même indice, si l’on est jeune
chirurgien et vieux chaudronnier. Le travail abstrait n’est pas du tout la
mesure de l’utilité sociale, n’est pas la mesure de la valeur d’usage. Ce
travail abstrait c’est ce que mesure la qualification du poste dans l’emploi,
ou la qualification du grade dans le salaire à vie…
JB… Dans la fonction publique.
BF Et ce qui est important c’est que la contradiction sociale ne porte pas
d’abord sur l’utilité sociale de ce que nous faisons. Le conflit social majeur,
la lutte de classe, chez les économistes classiques anglais, pas seulement
donc chez Marx et les marxistes, c’est précisément un conflit sur la pratique
de la valeur économique. Qu’est-ce qui vaut ? Comment est-ce qu’on
évalue l’activité de chacun ? Et c’est ça qui, dans le capitalisme, se fait à
travers l’emploi : c’est la qualification du poste, c’est l’emploi, c’est le fait
d’aller sur le marché du travail, se soumettre à un employeur, qui va dire
que ce que je fais vaut – quoi que je fasse, d’ailleurs : dès que j’ai un
emploi, je peux conditionner du Mediator, je peux faire la pub la plus insane
qui soit, la plus mensongère qui soit, je « travaille », je « produis de la
valeur », à la hauteur de la qualification de mon poste et du profit que le
propriétaire en retire. Et la lutte de classe, c’est entre cette pratique-là de la
valeur économique, et une pratique alternative qui, non pas par décret, mais
par institution progressive (et c’est là que les choses demandent des
décennies) délégitime l’emploi comme matrice du travail et légitime une
autre matrice du travail : le salaire à vie ; délégitime la propriété lucrative
comme matrice du travail, et légitime une autre matrice du travail : la
copropriété d’usage de l’outil de travail par les salariés eux-mêmes. C’est
un mouvement de construction.
J B Ce sont des conquêtes progressives… Alors, on a parlé de la
qualification, on pourrait commencer à décrire la proposition que vous
faites sur le salaire à vie : donc, tout le monde bénéficierait d’un salaire à
vie, à partir de dix-huit ans, au même titre qu’on devient citoyen électeur à
18 ans, on est reconnu producteur de valeur, et donc on bénéficie du
premier niveau de salaire…
B F Qui correspond au premier niveau de qualification.
J B Vous proposez quatre niveaux de qualification, par exemple, qui
iraient de 1 700 à 5 000 euros mensuels ; ces salaires sont versés par la
Caisse des Salaires, financée par de la cotisation, et ce qui fait qu’on va
changer de qualification, et donc de salaire, c’est qu’on passe devant un
jury de qualification devant lequel on expose son parcours, les compétences
qu’on entend valoriser devant lui, et puis ce jury de qualification nous
attribue, ou pas, l’échelon supérieur de qualification. Ce qu’on voit dans
votre modèle, c’est que là où toute la violence sociale s’organisait autour
de l’accès à l’emploi dans le modèle capitaliste, puisque l’accès à la
monnaie passait par l’emploi, là, tout à coup, l’accès à la monnaie est
entièrement concentré dans l’accès à la qualification : ce qui fait qu’on
passe d’un niveau de rémunération au niveau supérieur, c’est le jury de
qualification. C’est un endroit de concentration de la violence sociale
majeur. Ce qu’on voit dans votre modèle, c’est qu’on ne se débarrasse pas
de la violence sociale, ni non plus du système de classes, puisqu’au fond il
reste ne seraient-ce que les classes… de salaire. On ne peut donc pas se
débarrasser de la violence, même dans le modèle du salaire à vie ? On ne
peut pas se débarrasser, ni de la lutte des classes, ni de la violence sociale ?
BF C’est exact, et ça va aussi à l’encontre d’une forme d’idéalisme de la
société future, qui serait une société sans classe. Je pense qu’il n’y a,
effectivement, aucune possibilité de faire une société sans une violence
concernant ce qui vaut. La valeur économique, c’est l’expression d’un
rapport de pouvoir décisif, inhérent à la définition et à la production de ce
qui vaut dans toutes nos activités, et c’est ce rapport de pouvoir décisif qui
est au fondement de la lutte de classes. Le travail concret implique
évidemment des rapports de pouvoir assez classiques : on aime ou on
n’aime pas son chef, on n’est pas d’accord sur la manière de faire ceci, mais
globalement, si on veut que les gens s’entendent, il suffit de leur donner du
boulot à faire ensemble, et au bout du compte, le boulot est fait. Le travail
concret n’est pas le lieu d’une violence sociale décisive ; il y a des conflits
de personnes, il y a tout ce qu’on peut imaginer, mais ce n’est pas ça, la
lutte de classe. La lutte de classe porte sur la définition et la production de
ce qui vaut, et ce qui vaut n’est pas la traduction de ce qui est utile. Il y a du
tragique dans la production : il n’y a pas de transparence des valeurs
d’usage. Je m’inscris en faux contre les rêves d’une société sans valeur
économique, sans monnaie, dans laquelle il y aurait une transparence des
valeurs d’usage. Qu’on puisse tenter de faire communauté hors de l’emprise
de la valeur, ça existe : tout l’idéal monastique dans l’Europe chrétienne,
c’est bien ça. Chacun travaille de ses mains, il n’y a pas de hiérarchie, il n’y
a pas de monnaie, on tente d’échapper à la valeur… Et ces communautés
peuvent dépasser les limites de l’autarcie. Si vous songez à l’immense
réussite cistercienne aux xiie et xiiie siècles, vous avez 300 monastères qui
mettent en commun leur production, une grande circulation, une grande
socialisation de la production qui est faite de façon tout à fait remarquable :
c’est une façon très performante de faire communauté ! Mais elle ne met
pas en cause, finalement, la société féodale. Au xiiie siècle, ces cisterciens
qui ont fait vœu de pauvreté sont les plus gros propriétaires terriens
d’Europe : on n’échappe pas à la valeur !
J B Ça fait communauté, mais ça ne ferait pas société.
B F Non, parce que faire société ce n’est pas tenter de nier la violence de la
production, c’est l’affronter. Le xiie siècle est par ailleurs passionnant
puisque c’est un siècle sans grand progrès technologique et dans lequel il y
a pourtant un réel progrès économique, parce que le statut des agriculteurs
s’améliore… Ce qui montre très bien que ce que l’on décide être le statut
des producteurs (et là on est dans le champ de la valeur économique) est
décisif dans le devenir de la production (de valeurs d’usage). Ça se fait,
évidemment, dans une société féodale, donc on crée un ordre, un tiers ordre,
à côté du clergé et de la noblesse, mais qui va donner dignité politique et
économique aux paysans. C’est un magnifique exemple du fait que quand
on émancipe le travail, même dans une logique qui reste une logique de
domination de classe par l’aristocratie, quand on émancipe le travail des
paysans en les constituant en ordre ayant une forme d’autonomie et de
spécificité, on s’aperçoit que la production de valeurs d’usage s’améliore
nettement : le travail abstrait détermine le travail concret. Si on renonce à
l’illusion magique selon laquelle on pourrait faire une société sans classe,
alors on affronte l’enjeu réel qu’il y a à faire société : euphémiser et
humaniser les rapports de violence qui naissent autour de la détermination
de ce qui vaut dans ce que nous faisons.
JB Alors donc, on peut euphémiser, humaniser, juguler la violence, mais
reste qu’elle sera, de toute façon, toujours organisée en un endroit ; il me
semble que dans le modèle que vous proposez, c’est dans les jurys de
qualification que toute la violence sociale est cristallisée, puisque l’accès à
la monnaie passe par le jury de qualification – si on veut gagner plus (et on
sait notre appétit de monnaie) c’est devant ce jury-là qu’il faut montrer
qu’on mérite de monter en grade. Alors, comment sont composés ces jurys
de qualification ? Quels sont leurs critères ? Leurs « valeurs », si je puis
dire, puisque c’est eux qui sont dépositaires de l’organisation de la violence
sociale ? C’est hyper important de savoir comment on les compose, ces
jurys, et sur quels critères ils travaillent pour décider que untel reste à 1
700 euros tandis que tel autre monte à l’échelon supérieur ?
BF D’abord, je conteste que ce soit le concentré du conflit de classes : je
pense qu’il y a d’autres lieux de conflits, dans une société qui serait
débarrassée du capital…
J B Ah bon ? Pour moi c’est parce que c’est le lieu de l’accès à la
monnaie…
BF Mais l’accès à la monnaie suppose qu’il y ait production. La monnaie
ne fait qu’exprimer une production de valeur. Il y a forcément des conflits
aussi entre l’entreprise et les caisses d’investissement, entre l’entreprise et
les caisses de salaire, il y aura tout une série d’autres conflits…
J B Précisons qu’à côté des caisses de salaire, qui rassemblent les
cotisations qui permettent de financer le salaire à vie pour tous, il y a les
caisses d’investissement, qui sont aussi financées par de la cotisation, qui
sont des instances où de la monnaie est disponible pour financer les
investissements dans les entreprises…
B F En les subventionnant, sans crédit.
JB Oui, il n’est plus question de faire du crédit à intérêt ; le seul crédit
qui reste c’est le crédit à la consommation, à destination des ménages, pour
les acquisitions de biens particulièrement coûteux, mais sinon
l’investissement est financé par la caisse des investissements. Donc, vous
parlez d’un conflit entre l’entreprise et la caisse d’investissement quand par
exemple l’entreprise sollicite une subvention qu’elle n’obtient pas ?
B F Bien sûr !
J B Parce qu’elle n’a pas réussi à prouver la valeur de son projet.
BF Oui. Donc, la question que vous posez sur la composition des jurys se
pose aussi pour les caisses de salaire, pour les caisses d’investissement, et
d’abord pour le fonctionnement de l’entreprise. C’est pour ça qu’il faut
aussi aborder la question de la copropriété d’usage. Mais revenons à ce
point effectivement nodal sur lequel vous avez insisté, celui du conflit dans
la hiérarchie des salaires, et donc l’importance des jurys de qualification : il
faut évidemment que ces jurys ne soient pas du tout composés de personnes
auxquelles la personne a eu ou va avoir affaire – on reviendrait au
clientélisme, etc. Il faut qu’ils aient une forme d’extériorité totale par
rapport aux partenaires habituels de l’intéressé. Ces jurys doivent aussi ne
pas être exclusivement des jurys de la profession de l’intéressé : il faut
qu’ils puissent avoir un point de vue un peu plus général, donc ils doivent
être interprofessionnels. Ils doivent représenter aussi des intérêts divergents.
Quelqu’un qui veut monter en grade en faisant valoir ce qu’il a fait en
matière de transport ferroviaire, il est bon qu’il soit confronté à un jury dans
lequel soient représentés le transport routier ou le transport fluvial, afin que
soit apprécié l’intérêt relatif de faire monter en qualification quelqu’un qui
fait du ferroviaire alors qu’il y a peut-être besoin de beaucoup plus de gens
dans le transport fluvial, imaginons…
J B Donc ce ne sont pas des jurys si spécialisés que ça…
B F Non. En même temps il faut évidemment que ce soient des gens
compétents : quelqu’un qui veut monter en qualification à partir de son
activité artistique, il faut quand même bien qu’il y ait des artistes dans le
jury. On a déjà des formes d’anticipation de cela. Il y a les négociateurs des
conventions collectives : ce sont des représentants syndicaux qui vont
définir le niveau de qualification d’un poste. Ils utilisent des critères :
d’ancienneté souhaitée, de diplôme souhaité, de responsabilité,
d’importance du poste dans le procès de travail, de sécurité, de pénibilité…
Il y a tout un tas de critères, qui vont intervenir aussi, en les transposant aux
personnes et non plus aux postes. Et puis il y a l’exemple de la validation
des acquis de l’expérience, même si elle porte sur les diplômes, pas sur la
qualification…
J B C’est un dispositif universitaire, c’est ça ?
B F Justement pas. Ce sont des diplômes que l’on obtient dans une logique
totalement extra-scolaire. Prenons un coiffeur qui veut obtenir son brevet
professionnel par VAE : on va lui demander de faire une coupe, de
connaître la composition des produits chimiques qu’il utilise, de savoir
gérer une petite entreprise, en termes comptables, puisque son brevet lui
permettrait ensuite d’ouvrir un salon : ça, ce sont des gens de la Chambre
des Métiers qui font ça. Et dans la fonction publique…
JB… On a les concours, qui sont anonymes.
B F Justement, anonymes pour préserver la carrière des personnes du
clientélisme, des petits chefs…
J B Justement, je me demandais s’il ne fallait pas aussi de l’anonymat
pour les jurys de qualification, qui seraient calqués sur le modèle des
concours de la fonction publique.
BF Je précise que mon propos n’est pas « tous fonctionnaires ». En aucun
cas ! Ne serait-ce que parce que je suis pour le dépérissement de l’État.
Mais il y a effectivement dans la fonction publique des anticipations
intéressantes de ce que peuvent être un salaire à vie et une montée en
qualification par des épreuves.
JB Alors, je vais vous soumettre les petites questions rituelles qu’on vous
pose toujours à propos du salaire à vie : qui va faire le sale boulot ? Si tout
le monde est payé de toute façon, en toute circonstance, si donc, la
contrainte monétaire pour faire faire le sale boulot (gardes de nuit, métiers
à forte pénibilité physique) disparaît, qui fait ces travaux-là ? Comment on
fait pour avoir une société qui fonctionne, où les tâches pénibles sont quand
même réalisées ?
B F On a déjà plein d’exemples. Prenez les paysans – je ne parle pas de
l’agro-business, ça c’est autre chose – le travail paysan, c’est un travail
physiquement difficile. Les artisans-maçons, ils font un travail
physiquement difficile, ils sont indépendants ; pourquoi le font-ils ? Parce
qu’ils maîtrisent leur outil de travail ; parce qu’ils sont copropriétaires ou
propriétaires de leur outil de travail ; parce qu’ils décident au travail…
J B Il n’y a plus de pénibilité si on est souverain sur le travail ?
BF Nous avons tous une sorte de course à l’échalote pour gagner plus…
Mais je témoigne de quarante ans d’existence dans lesquelles le salaire
maximum c’est 5 000 euros, pour les plus qualifiés (alors que je connais des
tas d’industries où des ingénieurs démarrent à 5 000 euros). Un prof de fac,
en gros, il termine à 5 000 euros. Et ce sont des gens parfaitement mobilisés
; l’amour du salaire et de la consommation sont souvent en compensation
de la non-maîtrise de l’activité ; on connaît tellement de gens qui disent « si
je n’étais pas bien payé je ne ferais pas ce boulot ». Moi, je n’ai pas eu
besoin d’être bien payé pour le faire. Parce que mon boulot me passionne,
en permanence. Et j’en ai la maîtrise. Donc, on ne peut pas dissocier le
salaire à vie de la propriété, c’est-à-dire de la maîtrise de l’outil. Dès lors
qu’il y a décision sur l’outil, alors il y a la capacité à faire y compris des
travaux pénibles. Ceci dit, l’objection est réelle : indépendamment même du
fouet du marché du travail, il y a des métiers qui ont peu de candidats à
cause de leur pénibilité, y compris aujourd’hui. Pour cela, il y a deux
situations assez différentes : soit ce sont des tâches relativement peu
qualifiées sur lesquelles il y a une interchangeabilité possible ; dans ce cas-
là on peut imaginer un service civique…
J B C’est-à-dire, c’est quoi : c’est pour les jeunes ?
B F Non, non. De même que les Suisses ont des obligations militaires toute
leur vie, on peut très bien concevoir que des tâches répétitives, pas très
complexes, fassent l’objet d’un service civique avec l’obligation d’y
contribuer périodiquement. Et ce sera possible : parce que l’économie ce ne
sera plus « eux », les autres contre lesquels on lance un poing vengeur qui
n’est jamais que la revanche des vaincus…
J B Ce sera « nous ».
B F Là, ce sera nous. À partir du moment où c’est nous, il y a un
consentement. Mais un tel service civique ne résout pas tout ; si j’ai un
accident, je suis content qu’il y ait des soignants très qualifiés la nuit, et ça
n’est pas une affaire de service civique ! Pour le travail de nuit, pour les
métiers de haute technicité particulièrement pénibles mais absolument
indispensables, c’est là que la hiérarchisation des qualifications prend son
sens : on pourra monter beaucoup plus vite en qualification si on consacre
une partie de son temps ou de sa vie (qu’il faudra limiter par la loi à
quelques années) à ce genre de métier.
J B Là, vous avez évoqué plusieurs fois l’autre pilier du projet, c’est
l’abolition de la propriété lucrative. Il n’y a plus que de la propriété
d’usage : on est légitimement propriétaire du bien dont on a l’usage, ou de
l’outil de travail dont on a l’usage, mais il n’y a pas de propriété lucrative :
il n’y a plus de possibilité de tirer un revenu du seul fait d’être propriétaire.
Donc, plus de patron propriétaire de l’outil de travail, qui tire profit du fait
qu’on travaille dans l’outil qu’il possède… Mais s’il n’y a plus de propriété
lucrative du tout, je me demandais, pardon, c’est trivial, mais comment on
fait pour louer des maisons de vacances ? S’il n’y a pas de propriété
lucrative, il n’y a pas de propriétaire immobilier qui loue une maison qu’il
n’habite pas…
B F Les logements à louer peuvent être la propriété d’une caisse du
logement sans but lucratif… Venons sur cette question de la propriété
immobilière, elle est décisive : nous crevons aujourd’hui du marché de
l’immobilier !
J B Absolument !
BF Moi-même, en étant élu professeur à Nanterre, j’ai acheté en 2001 un
petit appartement dans le XXe arrondissement : il valait 70 000 euros pour
29 m2 ; le même dans l’immeuble a été vendu récemment à 210 000 euros :
en 14 ans, on a un triplement de la valeur. C’est un scandale absolu.
J B (rire) Vous vous retrouvez dans la position d’un propriétaire
capitaliste ! Je découvre que vous êtes propriétaire d’un appartement qui
représente une fortune aujourd’hui, tout en dénonçant le scandale de la
propriété lucrative ! C’est drôle…
B F Certes, mais j’en suis propriétaire d’usage.
J B Oui, vous l’occupez.
B F Et je n’ai nulle intention de le vendre ou de le louer ! La propriété
d’usage, comment la généraliser si on en finit avec la propriété lucrative en
matière d’immobilier ? Ça suppose effectivement qu’il y ait une Sécurité
sociale du logement, qui ne signifie pas que l’accès au logement est gratuit,
parce qu’il faut bien le produire, le logement, et cette production a un
coût… Ça ne veut donc pas dire que la location de vacances sera gratuite,
mais ça ne veut pas dire non plus qu’elle sera impossible. Vous pouvez
avoir une caisse du logement qui à la fois assure les achats et les ventes de
maisons ou d’appartements, et puis qui gère des logements qui sont faits
pour du passage : il n’y a pas que pour les vacances, d’ailleurs, il peut y
avoir un besoin parce qu’on travaille temporairement ailleurs, tout ça peut
être assuré autrement que par la propriété lucrative.
JB Il y a aussi une autre question que je me pose, autour du mécanisme
de la formation des prix. Il n’y a plus d’employeur, dans votre modèle, on se
débarrasse de cette clef de voûte du capitalisme qu’est l’employeur. Ce
n’est donc pas l’employeur qui me paie, mais la caisse des salaires, qui
paie tous les travailleurs, mais alors qui calcule le prix, comment se calcule
le prix de ce qu’on vend ? Je pense à Hors-série : c’est un site qui est
financé par ses abonnés. L’argent des abonnements sert à rémunérer les
protagonistes – moi qui vous interroge, le réalisateur de l’entretien, etc.
Dans le modèle que vous proposez, l’argent des abonnements, il part
essentiellement à la caisse des salaires, un peu aussi à la caisse des
investissements, on en garde un peu pour financer nos dépenses courantes,
d’énergie etc. ; mais comment on décide le prix de l’abonnement ? Parce
que nous, on l’a fixé en fonction…
B F De vos coûts salariaux…
JB Exactement. Il y a une coïncidence parfaite. Mais comment on fixe le
prix si on n’a plus cette composante-là, le coût du travail dans le service
qu’on vend ?
BF Vous soulevez-là un problème que j’examine sur deux ou trois pages
dans Émanciper le travail. Les entreprises ne paient plus leurs salariés, mais
elles cotisent – si on veut qu’il y ait un salaire à vie de 18 ans jusqu’à la
mort, comme droit du sol, donc pour les 50 millions de plus de 18 ans qui
résident en France, que ce salaire à vie s’élève à 25 000 euros par an en
moyenne, dans une fourchette de 1 700 euros à 5 000 euros mensuels, c’est
tout à fait jouable dès maintenant. Il faut donc 25 000 fois 50 millions,
soient 1 250 milliards, ce qui correspond à la somme des valeurs ajoutées
des entreprises marchandes actuelles. Au lieu d’utiliser sa valeur ajoutée à
payer les salaires et à rembourser les emprunts pour l’achat du matériel,
votre site versera sa valeur ajoutée à des caisses qui paieront ses salariés et
qui subventionneront ses investissements.
J B Et, en gros, est-ce que ça se passe à coût constant ? Est-ce que les prix
restent à peu près les mêmes qu’en économie capitaliste ?
BF Les prix vont rester les mêmes, globalement, parce qu’il faudra bien
assurer cette valeur ajoutée. On peut penser que la suppression de ce qu’on
appelle aujourd’hui le coût du capital sera compensé par une augmentation
des salaires.
J B Donc, en ce qui concerne les prix, on est à modèle constant.
B F Je ne pense pas que les prix vont spectaculairement bouger. Mais la
formation des prix va complètement changer. Parce que, comme vous le
dites très justement, aujourd’hui, lorsque je calcule mon prix, je prends tous
mes coûts : il y a les coûts salariaux, et puis il y a les coûts de
remboursement des crédits…
J B Nous, non ! Nous on a été financés par nos abonnés. Mais
effectivement, pour la plupart des entreprises, c’est ça.
B F Vous anticipez, en quelque sorte, à travers vos abonnés, la
socialisation de la valeur, qui permet de subventionner l’investissement.
J B C’est ça, oui.
BF En quelque sorte, les caisses d’investissement, elles vont fonctionner
comme vos abonnés. Elles vont subventionner votre investissement. Mais
pour ce faire, encore faut-il que ces caisses aient de l’argent. Et cet argent,
ça va être la part de la valeur ajoutée qui ne va pas à la production de biens
de consommation. Supposons que sur les 100 % de la valeur ajoutée, 80 %
va aller à la production de biens et services de consommation, marchands et
non marchands, et 20 % à la production de biens et services de production.
Comment former les prix de sorte que les caisses de salaire collectent
suffisamment de valeur pour qu’il y ait bien salaire…
J B Oui : il faut que ça coïncide, ce qui rentre et ce qui sort.
B F Absolument. La proposition que je fais, mais qui est tout à fait
discutable (je ne suis pas spécialiste de toutes choses, donc il ne faut pas
attendre de mon travail une espèce de projet universel… Je ne suis pas un
réformateur social : j’essaie, comme historien de la sécu, de voir ce dont
elle est porteuse et de pousser plus loin), que je soumets à la critique de mes
lecteurs est la suivante : si la valeur ajoutée nécessaire pour que l’on ait un
investissement et des salaires aux niveaux où je viens de le dire s’élève à 2
000 milliards, ce qui est le cas aujourd’hui et que le chiffre d’affaires de
toutes les entreprises est de 10 000 milliards (c’est une hypothèse, je n’ai
pas fait le calcul), ça veut dire que le taux de valeur ajoutée moyen est de
20 % ; on va décider que tout prix doit être calculé à partir des
consommations intermédiaires, qui font donc 80 % du chiffre d’affaires
actuellement ; ces 20 % de valeur ajoutée, c’est 25 % des consommations
intermédiaires. Donc : tout prix sera calculé à partir des consommations
intermédiaires (ça, on les connaît : le prix de l’électricité, la location du
local, etc.) multipliées par 1,25. [Formation du prix = consommations
intermédiaires X 1,25]. Tout l’enjeu de l’affaire, c’est de sortir d’une
allocation micro-économique de la valeur : ce n’est pas chaque employeur
qui paie ses salariés…
J B Mais alors, attendez. Chaque entreprise est responsable du prix
qu’elle décide de fixer au produit qu’elle propose ; on n’a pas un système
contraignant de fixation des prix par une autorité qui dirait « vous devez
fixer vos prix à 1,25 fois vos consommations intermédiaires », ou bien si ?
C’est un système contraignant ?
B F Le taux est contraignant, mais ensuite c’est à l’entreprise de réduire
ses consommations intermédiaires si elle veut baisser ses prix vis-à-vis de la
concurrence. La concurrence marchande demeure. Elle n’est plus
capitaliste, parce que l’objectif n’est plus le profit, donc ça change
beaucoup, mais elle demeure.
J B Oui, donc on veut quand même baisser nos prix pour conquérir des
parts de marché.
BF Par exemple. Ce n’est pas non plus absolument nécessaire. Mais s’il y
a besoin de faire baisser les prix, ce n’est pas sur le multiplicateur qu’on
joue, mais en baissant les consommations intermédiaires. C’est aussi une
forme de gain de productivité, mais qui n’affecte en aucun cas les salaires
des personnes, puisque ces salaires…
JB… dépendent de la caisse des salaires…
BF… et de la qualification de la personne. Donc nous n’abandonnons pas
du tout la recherche de la productivité. Mais elle change complètement de
sens, parce que ce n’est plus la productivité pour le profit, et elle change
d’effet, puisqu’elle n’a pas d’effet négatif sur la qualification et le salaire
des personnes.
J B Autre petit point que, j’imagine, on vous oppose : n’y a-t-il pas un
risque d’inflation ? Tout à coup, tout le monde va recevoir un salaire, tous
les jeunes de 18 ans et plus reçoivent leur salaire de 1 700 euros, premier
échelon de leur salaire à vie, le fait qu’il y ait tout à coup tout cet argent
disponible, chez un public qui d’habitude en était plutôt privé, ça ne crée
pas de l’inflation, ça ? Quand tout à coup il y a un afflux monétaire de
grande échelle ?
B F Tout dépend de la capacité de l’appareil productif à répondre à la
demande que génère cet afflux. Si l’appareil productif y répond, il n’y a pas
de raison qu’il y ait inflation. Si en revanche l’appareil productif ne peut
pas y répondre, qu’il doit importer, alors il va y avoir inflation, par
insuffisance de l’offre. Les choses ne vont évidemment pas se faire en cinq
minutes : de même que la sécu, ce sont des décennies de hausse de la
cotisation – aujourd’hui, la cotisation c’est 66 % du brut, plus du double
qu’en 1945, et en 1900 ça n’était presque rien. Le taux de 66 % stagne
depuis 1980, c’est évidemment une entreprise délibérée de la classe
dirigeante qui cherche à mettre en cause cette conquête considérable. Mais
vous voyez bien qu’on est passé de zéro à 66 % du brut sur sept ou huit
décennies…
J B Oui mais ça correspond aux « Trente Glorieuses », aussi, à un moment
où l’économie est extrêmement prospère, avec une croissance très
spectaculaire ! Dans les années 1980, il y a certes le virage néolibéral et
une idéologie qui nous fait régresser complètement, mais il y a aussi une
économie qui s’essouffle, moins de croissance. Est-ce qu’on n’a pas besoin
d’une forte croissance pour soutenir une augmentation de la cotisation ?
BF Mais sûrement pas ! C’est la cotisation qui contribue à la croissance !
La cotisation ce n’est pas une ponction. Prenons la cotisation qui paie les
salaires des soignants, l’Assurance maladie : ce n’est pas une ponction sur
la valeur produite par d’autres qui irait à des espèces de bonnes sœurs très
sympathiques mais non-productives qui seraient les infirmières ! Ce que ça
a été, d’ailleurs – le rôle d’un chercheur c’est d’observer la vie qui bouge :
dans les années 1950, quelqu’un qui soigne, il ne produit pas. C’est une
bonne sœur, qui n’est pas payée, il y a une fondation qui assume ses
dépenses, elle est dans une communauté, etc. Dans les années 1960, cette
activité non-productive devient productive. Elle fait partie du PIB.
Comment est-ce qu’on finance cette croissance du PIB, liée au fait qu’on
comptabilise la production de santé là où on ne la comptabilisait pas jusque-
là ? Eh bien par une cotisation sociale ! Ç’aurait pu être par le marché. Dans
les années 1960, c’est ce qui s’est passé aux USA, on y a construit un
marché des soins, avec les résultats qu’on sait aujourd’hui…
J B Oui : ça coûte plus cher et ce n’est pas meilleur comme qualité des
soins.
BF Tout à fait. Grâce au régime général d’assurance-maladie, nous avons
inventé une autre façon qui est infiniment plus intéressante et plus
émancipatrice parce que ça a créé soit des hospitaliers fonctionnaires, soit
des libéraux conventionnés – et il n’y a pas photo entre un architecte libéral,
dont les débuts de carrière vont être très difficiles, et un médecin libéral qui
bénéficie dès son installation d’un marché solvabilisé, et par là d’une
espèce de revenu garanti par la Sécurité sociale. On pourrait très bien, sur le
modèle des soignants libéraux, instituer une Sécurité sociale du logement et
de la justice qui va solvabiliser la clientèle, rendre obligatoire le passage par
l’avocat ou par l’architecte et permettre aux avocats et aux architectes
d’avoir des revenus sur l’ensemble de la vie infiniment plus sûrs, et en
général supérieurs, à ceux qu’ils ont aujourd’hui, en les libérant de la
logique du marché et de la ponction du capital. C’est une invention inouïe !
Et tout ça a été financé par une cotisation qui n’était pas une ponction : qui
était la reconnaissance de la valeur supplémentaire. Aujourd’hui, la santé,
c’est 10 % du PIB ! Les soignants produisent 10 % du PIB.
J B « Produisent ». C’est ça qui est compliqué à comprendre. Comme
lorsque vous dites que le retraité « produit » la valeur économique qu’il
perçoit dans sa pension de retraite… Quand ce qu’on fait ne fait pas l’objet
d’une transaction avec de la monnaie en face, on a du mal à comprendre
que ça « produit » une valeur économique. Le retraité ne vend rien à
personne, ni l’enseignant, ni le soignant, et comme il n’y pas de transaction
monétaire on a du mal à comprendre que ce soit une production de valeur
économique.
BF C’est vrai. C’est d’ailleurs pour ça que je milite pour que les retraités
comme moi, par exemple, nous nous engagions dans les entreprises
marchandes. Entreprises non-capitalistes, bien sûr, on ne va pas aller fournir
gratuitement notre main-d’œuvre à des gens qui vont piller notre travail.
Mais que des retraités participent à des entreprises marchandes – on est
souvent dans le non-marchand : on est conseillers municipaux, on s’investit
dans des milieux associatifs, on garde nos petits-enfants… – mais je pense
que des retraités qui ont un salaire à vie doivent justement s’impliquer dans
le marchand. Moi, par exemple, je vais me faire violence, et je vais rendre
marchandes une partie de mes prestations.
J B Et pourquoi vous vous infligez ça ?
BF Je m’inflige ça parce que la formation continue, ou une prestation de
type « conférence gesticulée » qui relève un peu plus du spectacle, peuvent
parfaitement être marchandes. Ça dépend bien sûr, si l’usager est en
capacité de la payer. Des syndicats peuvent payer des prestations de
formation.
J B C’est pour faire apparaître le fait que vous produisez une valeur
économique.
B F C’est pour sortir notre activité d’un non-marchand qui est toujours
réputé non-productif.
J B C’est ça. Donc là, vous « prouvez », vous dites, « vous voyez bien,
c’est productif, puisque je peux le vendre ».
B F Alors c’est une preuve qui n’en est pas une, puisque c’est donner de la
vertu au vice…
J B Eh oui !
B F C’est supposer qu’il faut qu’une chose soit marchande pour être
réputée productrice de valeur.
J B C’est pour ça que ça m’étonne de votre part.
B F D’accord. Mais c’était en écho à ce que vous disiez. Nous n’allons pas
supprimer le marché, je pense que le marché est un bon allocateur de
l’activité économique. Pas partout, pas pour tout, il faut le supprimer pour
le logement, il faut le supprimer pour les premières consommations d’eau,
d’énergie, pour les transports de proximité, il faut maintenir sa suppression
pour la santé et pour l’éducation, bien sûr. Mais pour des tas de choses c’est
un bon allocateur, donc on ne va pas le supprimer. Ce qu’il faut prouver,
c’est que nous pouvons produire des biens marchands sans employeur, sans
capital, et sans prêteur. C’est pour cela que les retraités ont une
responsabilité : comme le retraité a son salaire qui est payé par la caisse, sa
contribution au chiffre d’affaire de la coopérative dans laquelle il va, par
exemple, s’engager, va permettre à cette coopérative de verser tout ou partie
du salaire qu’elle lui aurait versé à une caisse commune, qui va permettre
aux coopératives de verser des salaires à ceux qui ne sont pas retraités. Les
coopératives aujourd’hui sont en grande souffrance, globalement, parce
qu’elles ne mutualisent pas assez leur valeur ajoutée. Il faut s’inspirer de
l’exemple de la Sécurité sociale, et convaincre de l’importance de
mutualiser les valeurs ajoutées, pour tous ces sites ou ces coopératives dans
lesquelles les travailleurs sont très contents de ce qu’ils ont fait, mais d’un
point de vue économique, le modèle n’a pas été formidable. Toutes ces
formes nouvelles d’activité économique sont décisives comme
démonstration que nous pouvons produire dans une autre logique que celle
du capital. Mais ça n’est viable que si ces initiatives s’inscrivent dans une
socialisation macro-économique interprofessionnelle de la valeur ajoutée.
J B Alors donc, les retraités vont bosser dans des coopératives pour
générer une ressource qui permettra de financer les salaires des
coopérateurs.
BF Ce qui à la fois répond à un réel besoin des retraités – moi je ne veux
pas être « homme au foyer », militant le dimanche, ça ne m’intéresse pas
comme projet de vie. J’entends bien rester dans l’espace public, contribuer
au bien commun, y compris dans l’espace marchand. Me dire que jusqu’à
ma mort, je suis là, « retraité », non, non, et non ! Vous avez des gens qui
sont broyés par la vie, bon, d’accord, on ne va pas leur demander de faire ce
qu’ils ne peuvent pas faire, mais il y a des quantités de retraités qui sont
disponibles ! Il s’agit donc qu’ils contribuent à des activités marchandes, et
vous voyez bien qu’ils ne piquent l’emploi de personne, puisqu’au contraire
ils contribuent au salaire de tous, c’est ça le point.
JB Vous venez de dire « je ne veux pas être homme au foyer ». Justement
je me posais la question en vous lisant : si on instaure un salaire à vie, est-
ce qu’il n’y aura pas un risque de régression sur la conquête des droits des
femmes, qui ont réussi à s’arracher à la condition domestique où on avait
tendance à les enfermer… Avec un salaire à vie, les femmes ne sont plus
propulsées sur le marché du travail par le besoin monétaire ; est-ce qu’on
ne risque pas de revenir un peu en arrière sur le plan de l’émancipation des
femmes ?
BF La domination masculine n’est pas résolue par des mutations dans la
pratique de la valeur, et donc pas par le salaire à vie. Notons qu’elle ne l’est
pas non plus par le marché du travail : les femmes sont plus certifiées que
les hommes, mais sont beaucoup moins qualifiées, la pension moyenne
d’une femme, c’est 40 % de moins qu’un homme, etc. Pourtant, malgré
cette discrimination sur le marché du travail, les femmes y vont, donc il y a
une aspiration à sortir de la sphère domestique qui est incontestable… À
partir du moment où, le marché du travail étant supprimé, les femmes vont
pouvoir faire valoir leur qualification comme attribut personnel, leur
capacité d’émancipation sera plus grande qu’aujourd’hui. Certes, j’entends
tout à fait ce que vous dites, il va y avoir des pressions du type :
« maintenant que tu as ton salaire à vie, ne va pas t’emmerder, occupe-toi
de tes gamins », mais ça, après tout, c’est aux femmes de dire non ! C’est la
même chose pour les retraités : nous avons un salaire à vie, on nous confine
dans l’espace domestique.
J B Qui « on » ?
B F Mais l’affectueuse sollicitation de notre entourage !
J B Oui, pour garder le petit, c’est ça ?
B F Ça, pourquoi pas, après tout, c’est normal. Mais l’idée de « écoute,
ménage-toi, t’en as assez fait, pense à ta santé, il y a un moment où il faut
un petit peu… »
JB… « lever le pied »…
BF C’est insupportable. C’est pour ça que je parlais de mon refus d’être
un « homme au foyer » : les retraités sont dans la même situation que les
femmes de refuser cette assignation à domicile, et de dire : jusqu’à ma mort
j’entends bien être dans l’espace public. Jusqu’à ma mort j’entends bien
contribuer au bien commun. Et sous des formes qui peuvent être
marchandes. Jusqu’à ma mort !
JB Oui. Contribuer au bien commun c’est peut-être ce que ne reconnaît
pas le revenu de base, et je voudrais qu’on termine là-dessus : sur les
réseaux sociaux, les gens qui croient militer pour un monde alternatif
peuvent confondre salaire à vie et revenu de base. Vous insistez beaucoup
pour dire que ce n’est pas du tout pareil : le salaire à vie est vraiment
révolutionnaire tandis que le revenu de base n’est que la roue de secours du
capitalisme. Alors pour finir, comme ça concentre absolument tous les
éléments de votre réflexion, pouvons-nous redire ici en quoi le revenu de
base est le contraire d’une bonne idée selon vous ?
B F Il y a une guerre des mots, et il faut la mener. Le salaire ce n’est pas un
revenu. Et c’est pour ça que l’offensive de nos adversaires sur les retraites
porte sur le fait de savoir si les retraites c’est du salaire ou pas. Si, comme
le veut le patronat, il s’agit que ma retraite soit la contrepartie de mes
cotisations passées, ce n’est donc plus un droit au salaire, c’est un droit à la
prévoyance, garanti par un dispositif étatique, qui combat l’institution
progressive de la reconnaissance que les retraités sont des travailleurs.
Attribuer un salaire à quelqu’un, c’est dire qu’il contribue à la production
de valeur économique ; lui reconnaître du revenu, c’est dire que c’est un
être de besoin (comme vous le disiez au départ dans votre présentation
extrêmement juste de mon propos). Le combat n’est pas seulement entre
revenu de base et salaire à vie – je crois que beaucoup de gens viennent au
salaire à vie à partir du revenu de base, donc je ne vais pas commencer par
faire fuir ma clientèle !
J B Ah pardon, d’accord (rires).
B F Parce que, spontanément, quand on réfléchit à la possibilité de
ressources liées à la personne, on pense revenu de base, et puis quand on
fait la comparaison on s’aperçoit qu’il n’y a pas photo, donc les gens
viennent au salaire à vie…
JB Mais vous savez pourquoi, spontanément, on pense revenu de base ?
Je crois que, intuitivement, on se sent sujet de besoin. Quand on rentre dans
la vie, qu’on est démuni, désargenté, ce qu’on sent d’abord c’est qu’on a
des besoins : de se nourrir, de se loger, on ressent d’abord ces besoins. Et
donc le revenu de base parle à cette expérience qu’on a de soi-même, dans
la vie. Alors que ce que vous défendez comme projet, cette affirmation :
« vous n’êtes pas sujet de besoin, vous êtes producteur de valeur », cette
conscience-là elle est très seconde, elle vient beaucoup plus tard. Se
concevoir soi-même comme producteur de valeur, d’abord on n’y arrive pas
tant qu’on n’a pas trouvé sa place sur le marché du travail…
B F Oui, mais là vous faites allusion à la socialisation primaire, à la
famille, à l’école, quand l’école joue sur la compétition, quand elle ne vient
pas conforter les personnes pour dire « vous êtes créatives ». Moi j’ai connu
une (par ailleurs excellente) prof de maternelle que mes enfants ont tous
eue, elle a été pratiquement toute sa vie prof de première année de
maternelle, qui me disait : « vous savez, au bout de trois semaines, je sais
où seront les enfants quand ils auront quatorze ans »…
J B Aïe aïe aïe.
B F Comme aveu de l’inutilité du système éducatif, c’est quand même
incroyable ! Tant que nous avons un système éducatif qui ne conforte pas
les personnes dans leur capacité à, tant que nous avons un système éducatif
qui juge, qui discrimine, etc., évidemment que les gens sont réduits à être
des êtres de besoin !
J B Bien sûr.
B F On sait que de toute façon on ne sera pas propriétaire de l’outil de
travail, qu’on ne décidera pas au travail. Évidemment qu’on va se définir, je
dirais à défaut, comme des êtres de besoin – « qu’au moins ils me payent
correctement si je ne peux pas décider ».
JB Oui, il faut une révolution dans la manière-même d’enseigner, en fait.
Même la formation doit être transformée du fait qu’il y a ce projet de
société qui nous pose tous en producteurs de valeur… Et du coup,
puisqu’on est sur ça, sur les effets de cette révolution, il y a des bénéfices
secondaires que j’apprécie particulièrement dans le modèle de l’abolition
de la propriété lucrative et du salaire à vie, c’est notamment qu’il fait de
nous des citoyens enfin libérés du joug de l’employeur : on peut consacrer
du temps à la vie politique ce qui permet, hop, de satelliser, de marginaliser
la classe politique professionnelle…
BF De la supprimer ! C’est une de nos calamités essentielles, qu’il y ait
des professionnels de la politique. À partir du moment où il y a salaire à vie
et où il y a copropriété d’usage, nos choix de trajectoire, l’allocation de
notre temps, vont complètement changer. Moi je pense qu’il y a une
insuffisante présence des parents auprès des enfants très jeunes et auprès
des adolescents. À 2-3 ans et à 13-14 ans, il y a des moments un peu
compliqués : en dénouant les droits salariaux de l’emploi, il va être
possible, sans y confiner les femmes (et donc en combattant spécifiquement
la domination masculine), d’allouer le temps des parents autrement à ces
âges critiques.
J B Ça veut dire qu’on pourrait, pendant un ou deux ans, se retirer des
collectifs de travail…
BF Sans perdre en qualification, sans perdre en salaire. Bien sûr il ne faut
pas le faire trop longtemps, et puis il faut aussi se partager le temps entre les
deux conjoints, tout est possible… De même pour la politique : sur un,
deux, trois ans, un mandat. Le problème n’est pas tant le cumul des mandats
que le fait de pouvoir les prolonger. Il faut en finir avec le mandat
renouvelable, pour qu’il n’y ait pas de professionnel de la politique, pour
que nous y passions tous. J’ai connu l’autogestion de l’université : on était,
pendant trois ans, six ans, élu à une direction, et puis on s’en allait parce
que c’était un peu chiant, mais enfin on assumait tous à tour de rôle. C’est
ça la condition de la démocratie. Il n’y pas que ça ; il y a aussi le conflit
entre institutions aux intérêts divergents.
J B Le conflit est constitutif de la démocratie, c’est ça que vous dites.
BF Oui, sinon c’est le Gosplan ou je ne sais quoi. Si on veut qu’il y ait
une coordination de l’activité économique alors qu’il y a copropriété
d’usage et qu’il n’y a plus de marché du travail pour faire cette allocation,
qu’il n’y a plus la centralisation du capital qui opère cette coordination, il
faut des institutions de poids égal mais aux intérêts divergents. Il y aura la
coordination marchande qui va rester, pour une part, mais également le
conflit entre les entreprises et les caisses d’investissement, entre les jurys de
qualification et les entreprises, entre la création monétaire (qui relèvera
d’initiatives des caisses d’investissement sous régulation de la banque
centrale) et les entreprises, etc.
J B On revient sur ce qu’on évoquait tout à l’heure, c’est-à-dire la
persistance de formes de violence ou en tout cas de conflictualité dans la
société : on n’est pas dans l’utopie d’une société sans violence ou sans lutte
des classes, simplement la persistance de la conflictualité, telle que vous la
décrivez…
B F Elle est horizontale, elle a des garde-fous démocratiques parce que
toutes ces instances-là sont copropriété d’usage, avec des directions élues
ou désignées par tirage au sort, ça je n’en sais rien, je ne me prononce pas
sur ces questions-là. Mais le conflit et la lutte de classe demeurent, ça bien
sûr.
JB Oui. C’est quand même vachement plus désirable comme univers que
celui dans lequel on est en ce moment.
Cet échange est issu de l’émission Le Salaire à vie, diffusée sur Hors-
Série en septembre 2015.
Construire des luttes offensives
J B Vaincre Macron, c’est un texte de combat. Il s’agit d’intervenir dans la
lutte politique actuelle face aux réformes que la présidence Macron
entreprend d’infliger au pays, réformes que vous identifiez à une « contre-
révolution » dont il est urgent de prendre la mesure. « Contre-révolution »,
ça veut donc dire que nous sommes dans un épisode révolutionnaire, et
c’est ce que votre ouvrage s’emploie à démontrer : oui, même si nous
sommes en ce moment dans une séquence critique, nous sommes dans une
révolution de longue période – une révolution communiste, qui commence
au xixe siècle et qui trouve son apogée en France en 1946. Les lendemains
de la Seconde Guerre mondiale, ce n’est pas, contrairement à ce qu’on a
voulu nous faire croire, un moment de compromis social obtenu à la faveur
de l’affaiblissement du patronat. 1946, c’est un moment révolutionnaire qui
permet d’obtenir, de haute lutte, des institutions puissamment subversives
du capitalisme ; 1946, c’est la mise en place d’une institution communiste
du travail. Bien sûr, ensuite il y a eu les années 1980 et la contre-révolution
dont Macron, aujourd’hui, est l’incarnation la plus emblématique : avec
Macron, il ne s’agit pas d’affaiblir à la marge le droit des travailleurs ; on
a affaire, véritablement, à une contre-révolution par laquelle le capital
essaie de reprendre la main, totalement, sur la production, contre la
souveraineté populaire qu’avaient permise les institutions communistes du
travail, ces institutions que sont le régime général de la Sécurité sociale, le
salaire attaché à la qualification, le statut de la fonction publique. Ces
institutions, vous les appelez « communistes » : il faut commencer par dire
ce que vous entendez par « communiste », sachant que c’est un mot qui peut
faire peur, et qu’il convient donc de définir. Quand vous dites que ces
institutions sont communistes, qu’est-ce que ça veut dire, « communistes » ?
B F Merci de souligner d’emblée le mot « communiste », parce que je tiens
à réhabiliter ce terme qui aujourd’hui fait l’objet, y compris chez ceux qui
ont un projet communiste, d’une véritable autocensure : on va parler des
« communs », par exemple. Cette autocensure, je l’ai pratiquée aussi,
pendant des années ; surtout depuis que François Furet, Pierre Rosanvallon,
la Fondation Saint-Simon, ont déplacé à droite le débat public, et que la
seconde gauche, avec Rocard, la CFDT, etc., a identifié « communisme » et
« totalitarisme ». Du côté de ceux qui sont partie prenante de la révolution
du travail, qui s’opère essentiellement à l’initiative de la CGT, du
syndicalisme de transformation sociale depuis la fin du xixe siècle, nous
nous sommes alors largement autocensurés. Je crois qu’il faut revenir à ce
beau mot de « communisme »…
J B …En disant ce que ça veut dire, « communiste ». Une institution
comme, par exemple, le régime général de la Sécurité sociale, en quoi est-
elle communiste ?
BF Elle est communiste d’abord parce que le communisme, comme le dit
Marx, c’est le mouvement réel par lequel nous passons du capitalisme à
quelque chose qui représente une souveraineté populaire sur l’économie –
étant entendu que le capitalisme c’est le monopole de la bourgeoisie sur la
production, sur la valeur, sur l’économie. Et donc le régime général, le
statut de la fonction publique, le statut des électriciens-gaziers à la
nationalisation d’EDF-GDF, c’est le chemin concret par lequel nous sortons
du capitalisme. Appelons « communisme » le chemin de sortie du
capitalisme, et définissons-le concrètement Ce n’est pas un idéal, ce n’est
pas un but qu’on cherche à atteindre…
J B Un horizon lointain…
BF Ce n’est pas un horizon lointain, c’est un présent, qui s’exprime dans
une classe révolutionnaire qui institue autrement le travail. On va discuter
de tout cela, mais je voudrais insister sur la nécessaire définition empirique
du communisme.
J B D’accord. Donc le régime général de la Sécurité sociale, c’est une
institution communiste, notamment en cela qu’elle produit un salariat unifié
du fait de reposer sur une caisse unique et un taux unique… Ça peut
sembler un détail, et on dit que le diable est dans les détails, mais en fait
c’est surtout la révolution qui est dans les détails, me semble-t-il : c’est
dans le détail de ce régime avec un taux unique et une caisse unique que se
joue la dimension révolutionnaire et la dimension communiste de
l’institution. Il faudrait expliquer ça : pourquoi c’est décisif, par exemple,
la caisse unique ?
BF C’est décisif parce que, contrairement à la « belle lisse poire » qu’on
nous raconte, 1945 ce n’est pas la naissance de la sécu. Il y a une pléthore
d’institutions en 1945, et d’abord des institutions patronales en matière
d’allocations familiales, qui forment le cœur du dispositif : à l’époque, les
allocations familiales, c’est la moitié des prestations sociales, et ce sont des
caisses patronales gérées par les employeurs, avec des taux de cotisation
très disparates qui vont de 4 % à 17 % du salaire brut. Ces taux sont
différents d’une entreprise à l’autre parce qu’en général, les allocations
familiales ont été un outil patronal d’évitement de la hausse générale des
salaires. Par exemple elles ont servi à trouver un accord de fin de grève :
c’est très net pour les fins d’occupations d’usine de 1936. Les salariés
revendiquent 20 % de hausse des salaires, le patron refuse, on transige sur
10 % d’augmentation des salaires directs et 10 % de cotisations familiales
patronales. Et donc, en fonction de la conflictualité dans la boîte, on aura
des taux qui vont être plus ou moins importants sur la base du taux
minimum légal de 4 %.
J B Oui, d’accord.
BF En matière de santé il y a des caisses : on n’est pas dans une logique
d’absence de couverture santé. Ce sont des caisses dites d’assurance
sociale, qui ont été créées en 1930 et qui pour l’essentiel sont des caisses
départementales à gestion paritaire – nous sommes dans le paritarisme.
JB« Paritarisme », c’est-à-dire patronat face à salariés…
BF Paritarisme, ça veut dire patrons ! Parce qu’il y a toujours un syndicat
de salariés qui vote avec les patrons, donc un dispositif paritaire, c’est
toujours un dispositif dont l’initiative et le fonctionnement sont
fondamentalement patronaux.
J B D’accord.
BF C’est pour cela qu’il y a eu une telle insistance de De Gaulle en 1967
pour rendre « paritaire » un régime général qui justement ne l’était pas !
Parce que vous avez signalé, sur le régime général, deux choses : l’unité du
taux et l’unité de la caisse, mais la troisième dimension c’est la gestion
ouvrière : il n’y a pas de paritarisme !
J B Donc, il faudrait déjà lutter contre le paritarisme qui a permis au
patronat de revenir insidieusement mettre la main sur la gestion des
caisses…
B F Certes le paritarisme des assurances sociales, éliminé du régime
général, y est revenu en 1967 contre la gestion à majorité ouvrière –
c’étaient trois quarts de salariés dans les conseils issus de 1946 – mais il ne
signifie plus grand-chose aujourd’hui : la gestion des caisses est tombée
sous le coup d’une bureaucratie étatique, surtout en matière de santé, où ce
sont les agences régionales de santé qui se sont substituées à la gestion
ouvrière. Les conseils existent, mais sans pouvoir. Donc, pour revenir à
1946, on ne saura jamais trop insister sur ce point : la sécu, ce n’est pas un
bloc, c’est un lieu contradictoire, de lutte de classe. Il y a une Sécurité
sociale capitaliste, qui est pléthorique en 1945, et une Sécurité sociale
communiste qui se met en place en 1946, contre la première, ou à côté du
dispositif capitaliste. Le dispositif capitaliste, c’est un dispositif de
branches, d’entreprises, ce que Macron veut faire à nouveau – et lorsqu’à
FO on dit aujourd’hui, à propos des lois sur le travail : « on a tout sauvé
puisqu’il y a de la branche », on s’égare. Dès lors que c’est branches et
entreprises, c’est foutu…
J B Oui parce qu’il y a une dispersion des travailleurs, avec une
possibilité de concurrence entre les différentes branches…
B F Bien sûr ! D’où vient cette impossibilité de constituer des collectifs de
travail à cause de la sous-traitance ? Ça vient du fait qu’il y a des
dispositions différentes d’une branche à l’autre, et que le donneur d’ordre
essaie de jouer sur ces différences pour diviser le collectif et payer le moins
possible des salariés qui relèvent d’une convention collective moins
protectrice des salariés. Donc, le fait que la caisse et le taux de cotisation
soient uniques à l’échelle interprofessionnelle est décisif pour constituer un
salariat unifié, une classe homogène. Et puis la gestion, donc, était en 1945
soit patronale, soit paritaire, soit prise en charge par les assurances (par
exemple le risque accident du travail/maladie professionnelles était couvert
par les assurances depuis 1898). Ce qui naît en 1946 c’est un dispositif qui
s’oppose à cette Sécurité sociale de la première moitié du xxe siècle (qui
était largement à l’initiative patronale), et qui, cette fois à l’initiative de la
CGT et du Parti communiste, constitue un régime général géré par les
travailleurs eux-mêmes. De Gaulle a une haine de classe contre le régime
général : dès que Croizat, qui met en place le régime général, arrive au
gouvernement (en novembre 1945), De Gaulle, alors chef du
gouvernement, démissionne – en janvier 1946 ! Il ne supporte pas la
présence de ministres communistes comme Croizat dans son gouvernement.
Il va organiser toute l’opposition de droite à cette subversion communiste
de la sécu patronale, et son retour au pouvoir en 1958 signera l’arrêt de
mort d’un régime unifié à gestion ouvrière.
J B Dans votre livre, vous qualifiez le salariat de « classe
révolutionnaire », vous montrez que les luttes du salariat au xxe siècle
permettent d’obtenir des institutions subversives du capitalisme ; il faudrait
montrer comment ces institutions qui sont mises en place par les luttes de la
CGT et des communistes permettent en effet une subversion du capitalisme,
notamment dans la manière de penser et de définir un certain nombre de
droits qui sont ouverts. Je pense par exemple aux allocations familiales qui
sont calculées comme du salaire : c’est 225 h payées au salaire horaire
d’un ouvrier spécialisé de la métallurgie – c’est pensé et calculé comme du
travail ! C’est hyper important cette manière de reconnaître que
l’allocation qu’on donne aux parents, ce n’est pas en fonction des besoins
supposés des enfants, c’est qu’on reconnaît que les parents produisent de la
valeur, que c’est du travail, donc on calcule ça à partir du taux horaire
d’un ouvrier. C’est en cela que le salariat, prenant ces mesures, devient une
classe révolutionnaire : c’est parce qu’il étend la définition du travail au-
delà de l’emploi. Ça résume votre analyse, à peu près ?
BF C’est parfait. Et ça nous aide aussi à définir le communisme dans son
caractère concret : le concret du communisme, c’est effectivement de
changer ce que l’on appelle « travail ». C’est même l’essentiel du
communisme. Quand il y a une intervention populaire sur l’économie, elle
porte sur le changement de ce qu’on appelle « travail ». Si on appelle
« travail » ce que la classe dirigeante appelle « travail », ne « travaillent »
que ceux qui mettent en valeur du capital. Donc, les fonctionnaires ne
« travaillent » pas, les parents ne « travaillent » pas, les retraités ne
« travaillent » pas, les chômeurs ne « travaillent » pas. Et les indépendants
ne « travaillent » que pour autant qu’ils mettent en valeur du capital – sinon
ils sont éliminés : regardez comme le capitalisme de l’agro-business combat
l’indépendance paysanne, avec une férocité totale. Il y a des suicides, il y a
des normes qui sont imposées pour que les paysans disparaissent et soient
remplacés par des agriculteurs soumis à l’agro-business. La définition
capitaliste du travail, comme toute définition du travail, c’est une définition
de classe : elle réduit le travail à ce qui met en valeur du capital. Ce qui veut
dire aussi, d’ailleurs, que des activités sans aucune valeur sociale –
conditionner du Mediator2, rendre les gens malades – sont considérées
comme « productives » parce qu’elles mettent en valeur le capital de
Servier. Il y a une indifférence totale de la bourgeoisie à l’utilité sociale de
ce qui est produit : son critère de calcul de la valeur, c’est la valorisation du
capital. Soit le capital du prêteur, soit le capital de l’actionnaire, soit le
capital du propriétaire indirect. Et cela donne au champ du travail une
acception à la fois indifférente à la valeur d’usage – on va appeler
« travail » des activités extrêmement nocives et n’accorder aucune valeur à
des activités très utiles – et une acception réduite, puisque toute activité qui
ne met pas en valeur du capital est réputée ne pas être du travail. On va dire
qu’elle est « utile » : on va chanter l’utilité sociale d’un fonctionnaire, ou
d’un retraité, ou d’une femme pour la seconde journée…
J B On va dire que c’est « utile » mais pas « productif ».
B F Alors, ce que fait la classe révolutionnaire, quand elle se constitue,
c’est changer la définition, et donc la pratique, du travail. De même que la
bourgeoisie s’est battue contre la définition aristocratique du travail, qu’elle
a fini par remplacer, ce qui est à l’ordre du jour aujourd’hui, c’est de
remplacer la définition bourgeoise du travail (« travaillent ceux qui mettent
en valeur du capital ») par une définition communiste du travail. C’est ce
que fait Croizat avec sa loi d’août 1946 : il redéfinit les allocations
familiales, qui étaient le cœur de la Sécurité sociale capitaliste. Si son
action gouvernementale fait l’objet d’une telle haine de classe, au point
qu’il a été gommé de l’histoire officielle, c’est parce qu’elle fait la
démonstration de la capacité de la classe révolutionnaire à se saisir des
institutions capitalistes pour les retourner, pour les changer en leur
contraire. Donc il y a une haine de classe, vis-à-vis de ce que fait Croizat, et
au-delà de lui de ce que font des dizaines de milliers de militants de la CGT
et du Parti communiste qui sont mobilisés en 1946 autour de la création du
régime général de la Sécurité sociale, comme l’a bien montré le film de
Gilles Perret, La Sociale. Que fait alors Croizat en attribuant 225 h par mois
de salaire d’OS de la métallurgie aux parents de deux enfants ? Il en finit
avec les allocations familiales comme reconnaissance du coût de l’enfant
pour les définir comme un salaire qui est dû aux parents en tant que
parents, et qui représente une production de valeur supérieure à celle d’un
ouvrier spécialisé de la métallurgie – car, à l’époque, même s’ils
travaillaient plus qu’aujourd’hui puisque nous assistons heureusement à une
réduction du temps de travail, les OS de la métallurgie ne faisaient pas
225 h par mois.
J B Les parents produisent plus de valeur…
BF Les parents sont plus productifs que les ouvriers de la métallurgie, ce
qui est quand même une institution extrêmement forte du changement du
sens du travail !
J B Vous disiez tout à l’heure : en modèle capitaliste, ne sont reconnus
comme « travaillant » ou « produisant de la valeur » que ceux qui
valorisent du capital, alors allons au bout de l’idée. En modèle
communiste, est reconnu comme travailleur et producteur de valeur pas
seulement le parent, puisqu’on a pris l’exemple des allocations familiales,
mais finalement quiconque peut faire valoir sa qualification, dès 18 ans,
jusqu’à la fin de ses jours. Il faudrait donner du contenu, puisqu’on a
donné du contenu à la définition capitaliste du travail : quel contenu
reconnaît-on au travail dans la conception communiste du travail ?
BF Le communisme c’est un chemin empirique, donc je me garderai bien
de définir ce que sera demain la pratique communiste du travail : je n’en
sais rien. Comme historien des institutions anticapitalistes, que je ne définis
pas seulement comme anticapitalistes mais comme communistes, j’essaie
de tirer les fils de ce qui est possible aujourd’hui. Ce qui a été affirmé
jusqu’ici comme travail, là où le capital nie qu’il y ait travail, c’est le travail
des parents, c’est le travail des retraités lorsque le régime général définit la
retraite comme un pourcentage d’un salaire de référence, et donc que c’est
la personne du retraité et non plus son poste qui est le porteur de ce salaire.
Dans la dynamique concrète du communisme, il y a le fait de poser que la
matrice du travail, ce n’est pas le poste de travail (détenu par un propriétaire
lucratif de l’outil de travail), c’est la qualification de la personne ; de fait,
toute personne est reconnue comme en capacité de produire. Le droit
politique, aussi bien à la propriété de l’outil qu’au salaire, devient un droit
de la personne, dans la dynamique communiste que je peux identifier.
J B Ce qui est intéressant, c’est que cette dynamique communiste, cette
définition élargie du travail qui l’attache à la personne (et non pas au poste
de travail), cette définition permet de lutter contre les pentes xénophobes et
racistes qui sont en train d’envahir le discours public… En fait, le
capitalisme, avec sa conception très restrictive du travail qui consiste à le
cantonner dans l’emploi (et spécifiquement l’emploi valorisant du capital)
contribue à l’imaginaire du travail comme « gâteau à se partager », et un
petit gâteau, qu’on est nombreux à vouloir partager… Alors, évidemment, il
ne faut pas trop de mangeurs de gâteau, et donc les immigrés, les
« mangeurs de gâteau » qui arrivent de l’extérieur deviennent des
indésirables. Alors que si on sort de cette conception restrictive du travail,
confondu avec l’emploi valorisant du capital, si on élargit, alors tout à
coup on ne voit plus son prochain « lointain », si je puis dire, le « venant
vers nous », le migrant, l’étranger, on ne le voit plus comme un concurrent
qui va dévorer des parts du gâteau, mais comme un travailleur à égalité de
qualification, capable de produire de la valeur, comme moi. Votre manière
d’entrer dans la question du travail permet de sortir de l’ornière xénophobe
dans laquelle le débat public autour de l’emploi est tombé.
B F Merci beaucoup de souligner ce point de mon travail auquel je suis
très attaché. Je pense que la bataille contre le Front National est
extrêmement mal menée, à la gauche de gauche, et qu’il faut la mener tout à
fait autrement. Comment le faisons-nous ? Par de la morale et par de la
solidarité envers les victimes : les migrants sont des « victimes », ils
meurent en Méditerranée, il s’agit d’être solidaires avec eux, et ceux qui ne
sont pas solidaires sont des salauds. Alors, « ceux qui ne sont pas solidaires
sont des salauds », je suis d’accord, mais ce n’est pas suffisant. Parce qu’en
disant cela, on ne s’attaque pas au cœur de la xénophobie : le cœur de la
xénophobie, comme vous l’avez signalé très justement, c’est le fait de
considérer le travail comme un quantum limité. Alors, vous avez dit
« limité à l’emploi », il faudra revenir sur ce point, parce que l’emploi, c’est
aussi une conquête syndicale, et à une époque où le patronat est en capacité
de ne plus être employeur – ce qu’il n’a jamais voulu – et où il s’exonère de
tout avec les ordonnances Macron, il faut être très précis dans le rapport que
nous avons à l’emploi d’un point de vue théorique.
J B Oui, d’accord, c’est plus compliqué que je ne l’ai laissé entendre…
BF On y reviendra donc, mais reprenons cette question de la xénophobie.
La bourgeoisie fait de la globalisation financière l’occasion de mettre en
concurrence les peuples et d’accélérer sa tendance à éliminer le travail
vivant, dans nos pays anciennement industrialisés où elle avait initialement
construit sa puissance. On trouve des prévisions de suppression de 47 % des
emplois – admirez la précision ! – et il y a des gens assez désemparés dans
leur rapport au travail, ou assez aliénés à la forme capitaliste de
productivité, pour croire ce genre de choses et être tentés de rester entre soi
pour « se partager le travail » qui reste. Nous ne pourrons pas sortir de cette
folle dérive xénophobe par des propos du type : « On va accueillir
correctement les demandeurs d’asile, on va supprimer les centres de
rétention, et on va tarir les flux en encourageant le développement et la paix
dans les pays d’émigration… » Tant que la gauche de gauche ne se bat pas
sur le champ du travail, tant qu’elle ne fait pas valoir que les
révolutionnaires de 1946 ont posé comme travailleurs les parents, les
retraités, les soignants, les fonctionnaires, puis par la suite les chômeurs ;
tant qu’elle ne fait pas valoir la capacité qu’a une classe révolutionnaire à
sortir le travail du carcan dans lequel le met la bourgeoisie, en affirmant le
travail vivant sur les lieux de travail, par une autre pratique collective du
travail concret contre son tarissement par le management capitaliste ; tant
qu’elle ne fait pas valoir que, pour produire moins de marchandises
capitalistes si mortifères pour les territoires, pour notre place dans la nature
et pour notre humanité, il faut infiniment plus de travail vivant, bref tant
qu’elle continue à démissionner sur la question du travail…
JB… Elle est battue.
B F Elle est battue, et elle est irresponsable car elle n’offre aucune
alternative au refus du droit de circulation des personnes et à l’Europe
forteresse. Nous avons la responsabilité de réduire à la marginalité
l’argumentaire xénophobe et de montrer qu’il est possible de supprimer les
visas en multipliant les démonstrations concrètes d’une autre organisation
du travail.
J B Tout à l’heure, vous m’avez corrigée en disant : « Attention, la
restriction capitaliste du travail, elle n’est pas dans l’emploi ». Moi j’avais
tendance à dire : « Le capitalisme réduit le travail à l’emploi », vous dites,
vous, qu’il ne faut pas jeter l’emploi avec l’eau du bain capitaliste… Moi
j’avais tendance à vous résumer en disant : « On ne veut pas des emplois,
on veut du salaire », vous, vous dites : « Ne jetons pas la notion d’emploi »,
et vous vouliez y revenir. Alors revenons-y : en quoi l’emploi, en ce moment,
alors que c’est par là qu’on fabrique nos chaînes, doit-il être défendu ?
Pourquoi faut-il garder la lutte pour l’emploi ?
B F Eh bien, raisonnons par l’absurde : les ordonnances Macron sont
clairement dirigées contre l’emploi. Elles sont un hymne au travail
indépendant, à la Uber. Quand on nous dit : « Ce sont les insiders de
l’emploi qui empêchent les jeunes de banlieue, les outsiders, de venir dans
l’emploi, où ils sont mal accueillis, et donc nous allons sortir de cela en
permettant à ces jeunes de se lancer dans du travail indépendant qui sera
couvert en matière de chômage, avec un régime d’Assurance maladie
connecté au régime général », que fait-on sinon détruire l’emploi dans la
continuité des précédentes « lois Travail » ?
J B Oui, ça prouve bien que toute la lutte se joue là… C’est la question du
travail qui est au cœur de la lutte des classes.
B F Bien sûr qu’elle se joue là ! Il y a évidemment une petite chansonnette
patronale sur la « défense de l’emploi », mais dans le fond, les patrons ne
supportent pas l’emploi.
J B Parce que ça leur donne des devoirs ?
BF Bien sûr ! Et ça les expose comme exploiteurs. Vous avez évoqué tout
à l’heure le fait que la révolution communiste démarre à la fin du
xixe siècle, lorsque la CGT se constitue, en 1895, lorsque la section
française de l’Internationale ouvrière (la SFIO) se constitue en 1905. Nous
avons là des organisations ouvrières qui vont imposer, dans la première
décennie du xxe siècle, le code du travail, conquête syndicale et politique
considérable. Il faut ici rendre hommage à Claude Didry, qui dans son livre
L’Institution du travail (La Dispute, 2015) nous ouvre les yeux sur ce qui se
passe lorsque le contrat de louage d’ouvrage, qui était la forme capitaliste
de mise au travail au xixe siècle, est remplacé par le contrat de travail. Dans
le contrat de louage d’ouvrage, le capitaliste est un donneur d’ordre ; il se
garde bien d’être employeur, il achète de l’ouvrage fait, il ne s’embête pas
avec la production, car cela englue sur un territoire donné, dans une branche
d’activité donnée, avec un collectif donné de travailleurs, les possibilités de
mise en valeur de son capital alors qu’il veut pouvoir changer en
permanence les lieux et les formes de la ponction qu’il exerce sur la valeur
produite par les travailleurs… Dans le louage d’ouvrage, le capitaliste
donneur d’ordre passe donc contrat avec un sous-traitant, qu’on appelle un
marchandeur : le conflit des Canuts, à Lyon, dans les années 1830, se joue
entre les « soyeux » qui incarnent le capitalisme qui ne se salit pas les mains
dans la production et les canuts à qui ils commandent de l’ouvrage.
Comment est fait l’ouvrage ? Ça, on ne veut pas le savoir : le canut, il
embauche qui il veut, comme il veut. Le conflit des canuts, ce sont les
canuts qui, comme sous-traitants, se battent sur un meilleur tarif de
l’ouvrage ; mais les ouvriers qui font le boulot, eux, ils sont dans
l’invisibilité totale. Que va faire le contrat de travail ? Il va supprimer la
sous-traitance, et imposer aux capitalistes d’être employeurs, c’est-à-dire
bien sûr de respecter un certain nombre d’obligations vis-à-vis de
l’employé, mais aussi, et surtout, de se confronter directement aux
travailleurs dans un rapport d’exploitation sans fard que ceux-ci sauront
affronter collectivement pour conquérir de la puissance.
JB D’accord. Mais moi, ce qui me faisait avoir ce rapport un peu hostile
à l’emploi, c’est le fait que je me suis déjà, depuis longtemps, projetée dans
le monde du salaire à vie pour tous, dans une société en salaire
intégralement socialisé : dans une telle société, il n’y a plus d’employeur.
B F Évidemment !
J B Donc, il n’y a plus d’emploi, au sens que nous lui donnons
actuellement, c’est-à-dire au sens où, pour accéder au salaire, il faut
nécessairement passer par un contrat avec un employeur. C’est ça que
j’appelle « l’emploi », qui me fait considérer que ça ne peut pas être l’objet
de nos revendications et de nos luttes, puisque la société que nous visons est
une société dans laquelle il n’y aura plus d’employeur…
BF Encore une fois, je n’ai aucune visée de société, cette démarche m’est
étrangère. J’essaie d’être dans une dynamique révolutionnaire dont je ne
peux pas décrire ce que seront ses lendemains. Ce que je constate, c’est que
depuis l’existence du code du travail, il y a un acharnement patronal contre
lui. Un acharnement total : il y a une haine de classe contre le code du
travail ! Parce qu’il impose au capitaliste d’être employeur – ce qu’il ne
veut pas être. Il veut bien être « patron » (le CNPF représente le
« Patronat » français), il veut bien être « entrepreneur » (le Medef
représente les « Entreprises » de France), mais « employeur », jamais. Ce
que conquièrent la CGT et le Parti communiste, dans la première moitié du
xxe siècle, c’est un certain nombre de règles pour l’embauche et pour le
licenciement, règles qui seront nettement amplifiées dans les années 1970,
quand on invente le CDI, c’est-à-dire quand on oblige l’employeur à
invoquer par écrit une cause réelle et sérieuse de licenciement (ce que
précisément la loi El Khomri et le projet de loi Pénicaud détricotent). Mais
la plus grande conquête est l’imposition d’une rémunération tout autre que
la rémunération capitaliste, ce prix de la force de travail qui reconnaît des
besoins pour faire une tâche : contre le prix de la force de travail, les
travailleurs enfin directement confrontés à la bourgeoisie vont inventer le
salaire, c’est-à-dire imposer, dans une première étape, le respect de la
qualification du poste. La grande invention des syndicats dans la première
moitié du xxe siècle, c’est la qualification : c’est là un mot qui écorche la
bouche d’un patron. Il veut bien entendre « compétence », mais
« qualification », jamais. Parce que la qualification, c’est ce qui reconnaît
qu’on produit de la valeur ; c’est ce qui reconnaît qu’on est des producteurs,
et non pas des êtres de besoins qui ont droit à du pouvoir d’achat. La
bourgeoisie est toujours prête à nous filer du pouvoir d’achat. Y compris
sous forme de revenu de base : elle nous méprise suffisamment pour cela.
Mais elle refuse totalement, parce que là c’est son pouvoir qui est en jeu,
que nous soyons des producteurs, reconnus comme tels. Parce que si nous
sommes reconnus comme producteurs, alors nous sommes légitimes pour
revendiquer la souveraineté sur la production. L’obsession d’une classe
dirigeante, ça n’est pas l’argent, c’est la souveraineté sur la production. Tant
que c’est elle qui décide de qui travaille, sur quoi, où, pour quoi faire, elle a
le pouvoir (et toutes les rodomontades pour lui « prendre l’argent »
échouent, car la source du pouvoir sur l’argent, c’est le pouvoir sur le
travail). C’est pourquoi la CGT a dépassé l’étape de l’emploi, c’est-à-dire
de la qualification attachée au poste de travail, propriété de la bourgeoisie,
pour conquérir le salaire à la qualification personnelle dans la fonction
publique, les statuts des entreprises publiques, le régime général de Sécurité
sociale. À partir du moment où, par un salaire à la qualification personnelle,
on reconnaît que nous sommes porteurs, en tant que personnes, de
qualification, alors là, nous entrons dans l’institution d’un statut
communiste du producteur, et c’est insupportable au capital. C’est pour ça
que, j’en suis bien d’accord avec vous, poursuivre la révolution
communiste, ce n’est pas revenir au « plein emploi » contre les ordonnances
Macron. Ça, ce serait une faute stratégique. C’est bien aller vers le salaire à
vie pour tous, la propriété d’usage de l’outil de travail pour tous. Tout
Vaincre Macron porte là-dessus : comment conquérir des droits
économiques nouveaux attachés à la personne. Mais attention, il ne faut pas
que ça soit dans d’irresponsables « à bas l’emploi, vive le travail » qui
manifestent une absolue méconnaissance de l’histoire de la conquête du
salaire à la qualification personnelle, dont la conquête de l’emploi est une
étape. J’ajoute aussitôt, d’ailleurs, que le salaire à la qualification liée à la
personne, qui est vraiment la conquête communiste essentielle, nécessaire
pour la démocratie économique, n’est pas suffisante, comme on le voit dans
les luttes des fonctionnaires – vous êtes embarqués, en ce moment, au lycée
Suger, dans une lutte extrêmement difficile où des fonctionnaires se
heurtent au diktat d’un rectorat, et où on voit bien que le salaire à vie n’est
pas suffisant pour garantir la souveraineté dans le travail.
JB Vous avez raison, le lycée Suger, où j’enseigne, connaît en ce moment
une lutte qui oppose l’équipe enseignante au rectorat, suite à la mutation
infligée au responsable du BTS audiovisuel, mutation que nous dénonçons
comme une sanction sans motif valable, et nous nous mobilisons pour sa
réintégration3.
B F On voit donc aussi combien, si nous voulons continuer cette révolution
communiste, il s’agit que les syndicats de fonctionnaires soient des
syndicats de l’auto-organisation des travailleurs dans leur lieu de travail.
Qu’on en finisse avec la plainte, le « service public en danger », et qu’on
soit vraiment sur cette affirmation : nous sommes les copropriétaires
d’usage de nos outils, nous considérons comme illégitime le rectorat pour
décider de notre travail. Quand on parle de poursuivre la révolution
communiste, c’est sur cette modalité-là que ça se fait. Encore une fois, je
n’ai pas un « rêve de futur » communiste, le communisme se joue
exclusivement et en permanence au présent, dans la conquête de la
souveraineté sur le travail.
J B Oui, on est sur la stratégie du présent.
B F Voilà !
J B Et mettre l’accent sur la notion d’auto-organisation, c’est décisif,
parce que je pense que ça permet aussi d’aller interpeller une autre partie
de la gauche de gauche qui pour l’instant reste assez peu réactive, me
semble-t-il, aux propositions élaborées dans Réseau Salariat (l’association
d’éducation populaire avec laquelle vous travaillez). Cette question de
l’auto-organisation permet de comprendre que le modèle communiste sur
lequel vous réfléchissez et que vous essayez de développer, ce n’est pas un
modèle qui consiste à donner le pouvoir à l’État. Je me souviens d’avoir
peut-être mal défendu le principe du salaire à vie, en laissant entendre que
c’était l’affaire de l’État de mettre en œuvre des mesures favorables au
salariat… Mais en fait, ce n’est pas l’État ! La sécu, ce n’est pas l’État : je
n’avais pas compris cela au départ, mais la CGT voulait absolument que
les caisses soient privées et qu’elles soient gérées par les travailleurs – il ne
fallait surtout pas que l’État mette son nez dedans ! Et l’État, bien sûr, dès
le début, a essayé de détricoter ce que la CGT mettait en place, qui était
une gestion ouvrière privée : les travailleurs, entre eux, décident de la
valeur, qu’est-ce que la valeur, comment on la produit. Je l’ai mieux
compris dans Vaincre Macron que je ne l’avais compris dans Émanciper le
travail : le modèle qu’on promeut ici, ce n’est pas un modèle étatique ; ce
n’est pas l’État qui décide. Ce sont les travailleurs ; ce sont des
collectivités publiques et non pas des pouvoirs publics. Je pense qu’il faut
insister sur ce point, notamment pour convaincre tous les gens de gauche
de gauche qui sont de culture libertaire et qui ont l’État en horreur : il faut
leur faire comprendre qu’on ne veut pas plus d’État ! On voudrait plus
d’autogestion.
BF Il faut convaincre deux types de gauche de gauche. Les libertaires et
puis les keynésiens. Parce que du côté des Économistes atterrés, Attac, etc.,
vous avez quand même essentiellement des keynésiens qui, certes,
invoquent plus de pouvoir pour les travailleurs, mais au service d’une
« bonne politique de l’État ». Le cœur de la réflexion de cette partie-là de la
gauche de gauche, qui infuse largement dans les syndicats et dans les partis,
c’est quand même l’État et la politique publique. Il s’agit de les convaincre,
eux, qu’il faut renouer avec ce qu’a su faire la bourgeoisie quand elle a pris
le pouvoir politique : proclamer que « Les humains naissent et demeurent
libres et égaux en droit ». Elle a donné une personnalité civile aux
personnes, et cette proclamation d’un droit a été décisive. Mais elle s’est
bien gardée de définir l’égalité et la liberté en droit dans l’ordre
économique : c’est là que nous sommes.
J B C’est ce qu’il reste à faire.
B F C’est ce que la classe révolutionnaire, maintenant, a à faire :
maintenant que la bourgeoisie n’est plus une classe révolutionnaire, puisque
c’est devenu une classe complètement réactionnaire, qui piétine la planète,
qui piétine nos droits, il s’agit de reprendre le flambeau de ces mains
défaillantes, pour poser l’égalité et la liberté en droit économique de la
personne. À 18 ans, chacun doit être titulaire d’un droit au salaire à vie,
d’un droit à la propriété d’usage de l’outil de travail qu’il utilisera, et d’un
droit de délibération dans toutes les institutions de circulation et de
production de la valeur économique – les caisses d’investissement, les
caisses de salaire, la création monétaire. Tout cela doit devenir l’objet d’un
droit des personnes, dont nous sommes complètement amputés dans le
capitalisme. Or cette nécessité est ignorée à la gauche de gauche. Aussi bien
par ceux qui sont sur une logique keynesienne – « vous allez voir, on va
faire une bonne politique, avec un bon crédit, une bonne banque centrale,
un bon État » – que par ceux qui, défiants vis-à-vis des institutions de la
valeur économique, promeuvent une politique de l’alternative ici et
maintenant. Qu’il faille des alternatives ici et maintenant est évident, mais
en les inscrivant dans un cadre macro-économique – ce qu’ont su faire les
révolutionnaires de 1946 : trouver le cadre macro-économique dans lequel
les intéressés eux-mêmes décident. La CGT s’est battue, en effet, pour
l’autogestion de la sécu, et elle a été mise en minorité dans le débat
préparatoire aux ordonnances de 1945, qui font de l’organisation nouvelle
un organisme public, contre sa gestion par les seuls intéressés revendiquée
par la CGT. Reprendre ce flambeau, c’est construire des collectivités qui
décident, sauf sur certaines fonctions qui relèvent de la puissance publique
– et d’ailleurs comme personnes nous sommes toujours pris entre des
collectivités qui nous posent comme travailleurs et la puissance publique
qui nous pose comme citoyens : comme salarié d’une boîte qui fait du
nucléaire, je suis plutôt partisan du nucléaire, mais comme citoyen, je suis
plutôt partisan de la sortie du nucléaire… Nous sommes tous pris dans cette
difficulté-là. C’est pour ça qu’il faut qu’à côté des collectivités dans
lesquelles les travailleurs s’expriment (les institutions de la valeur que sont
les caisses d’investissement, les caisses de salaire, les entreprises, les jurys
de qualification), il faut qu’il y ait de la puissance publique qui soit
l’expression de notre « autre part de nous-mêmes ». Dans les deux cas, c’est
nous, bien sûr ; mais là, c’est cette autre part de nous-mêmes qui dit « Eh
bien non, il y a des choses qu’on ne fait pas ». Il faut qu’une puissance
publique impose qu’on ne fasse pas telle ou telle chose, ou au contraire
promeuve telle ou telle chose. Mais en aucun cas le chemin concret du
communisme, dans notre société, c’est l’État. Le chemin concret du
communisme, c’est ce que nous avons commencé dans la Sécurité sociale
avec le régime général, c’est-à-dire des institutions qui sont publiques mais
qui ne relèvent pas de la puissance publique. C’est aussi la question de la
propriété, et là je renvoie au livre : il faut faire la distinction entre propriété
d’usage, propriété patrimoniale, lucrative ou non lucrative : ce sont des
points importants que le lecteur pourra retrouver dans Vaincre Macron.
J B Je voulais revenir sur un levier absolument décisif de cette lutte des
travailleurs pour imposer des institutions subversives du capitalisme : le
levier majeur, c’est quand même le taux de cotisation. Tant qu’on est face
au gel du taux de cotisation, de toute façon, on s’interdit de progresser dans
la conquête de la souveraineté sur le travail et dans une pratique
communiste de la valeur. Ce taux de cotisation, il est donc en situation de
gel : la bourgeoisie ne veut pas qu’on y touche, notamment parce que c’est
très pratique, du point de vue de la bourgeoisie, pour organiser un déficit
chronique des caisses. Ce déficit, en fait, est tout à fait recherché par le
capitalisme : c’est extrêmement lucratif ! Il faudrait peut-être expliquer ça,
que le déficit des caisses de la Sécurité sociale, c’est une très belle affaire,
à tous points de vue, pour la bourgeoisie.
B F Bien sûr : la bourgeoisie est demandeuse de déficit, puisqu’elle est
prêteuse. Comme ceux qui prêtaient au roi : ils étaient demandeurs de
déficit public…
JB… pour faire du profit sur les crédits !
B F Oui : les grands promoteurs du déficit, c’est évidemment la
bourgeoisie. On en a un exemple qui est un cas d’école, c’est quand Juppé
crée en 1996-1997 la Cades (Caisse d’amortissement de la dette sociale)
J B Il faut expliquer d’abord comment ça marche.
BF Vous vous rendez compte ! ? On naît d’abord avec une dette sociale !
Tous les mots sont pesés dans cette histoire, et Juppé sait y faire : c’est le
plus malin de la droite, relayé aujourd’hui par Macron. La Cades qu’il crée
prend acte qu’il n’y aura plus de hausse du taux de cotisation ; elle prend
acte du fait que la vocation de la sécu est d’être déficitaire, et elle est là
pour assumer le déficit de l’institution. Depuis 20 ans, elle a amorti
80 milliards de déficit en versant aux prêteurs 41 milliards d’intérêts.
J B Le principe, c’est qu’elle revend la dette de la sécu sur les marchés
privés, et elle reverse des intérêts, donc c’est une opération très
intéressante pour les investisseurs privés, pour les propriétaires de
capitaux.
B F Eh oui ! On amortit 80 milliards de dettes en payant 41 milliards
d’intérêts qui sont payés par nos cotisations. Une performance !
J B Donc, en gros, les investisseurs privés font du profit sur le déficit de la
Sécurité sociale.
B F Un énorme profit. C’est pour ça que, tant que nous ne sortirons pas du
capitalisme, nous ne sortirons pas du déficit. Le régime général de la
Sécurité sociale a été une institution légèrement excédentaire pendant une
quarantaine d’années : tant que le taux de cotisation a progressé. Mais
depuis la fin des années 1970, le taux, globalement, est gelé, voire a reculé.
Et Macron va continuer ; il n’est pas l’initiateur de la chose. Macron, c’est
l’homme du capital, c’est l’homme du Medef tout le monde s’en rend
compte, c’est vraiment la voix de son maître – c’est la première fois que le
Medef est directement au pouvoir, sous la couverture de la « société civile »
dont on sait ce qui se cache derrière : les députés de la République en
marche, ce sont des DRH, les ministres c’est Muriel Pénicaud qui se fait
plus d’un million avec ses stock options sur un plan de licenciement
boursier qu’elle a organisé chez Danone…
J B Mais revenons au gel du taux de cotisation.
B F Le gel est poursuivi par Macron, qui va supprimer des cotisations pour
les remplacer par de la CSG. Mais qu’est-ce qu’a fait Jospin ? Il a supprimé
la cotisation assurance santé des salariés pour la remplacer par quatre points
de CSG !
JB Alors, pardonnez-moi, mais je pense qu’il faut expliquer, parce que la
CSG ça apparaît comme une cotisation (c’est un pourcentage sur notre
feuille de salaire, au même titre que les autres cotisations). En quoi est-ce
que la CSG est à ce point un outil contre-révolutionnaire ? Expliquez-nous
pourquoi la CSG, c’est « mal » !
B F Ce n’est pas parce que c’est un impôt. Un impôt n’est pas « mal », une
cotisation n’est pas « bien » : la cotisation à l’Agirc-Arrco, c’est mal. La
cotisation au régime général, c’est bien. L’impôt pour payer les professeurs
de Suger, c’est bien. L’impôt pour faire un marché public avec Bouygues,
c’est mal. Premièrement donc, il n’y a pas la bonne cotisation contre le
mauvais impôt. Deuxièmement, en quoi la CSG est-elle un mauvais impôt ?
C’est que c’est un impôt de solidarité capitaliste. Ce n’est pas un impôt qui
vise à payer des salaires ; c’est un impôt qui vise à soutenir des prétendus
« non-contributifs ». Il faut préciser l’enjeu de cette distinction
particulièrement violente entre non-contributivité et contributivité qui s’est
imposée à la fin des années 1980. L’obsession de la classe dirigeante, je le
rappelle, c’est d’en finir avec le salaire à la qualification personnelle. Elle
ne nous veut pas en producteurs, candidats à la souveraineté sur la
production ; elle nous veut en mineurs économiques ayant droit à du
pouvoir d’achat. Ce droit au pouvoir d’achat se compose de deux piliers :
un premier pilier qui est dit « non-contributif », parce qu’on n’a pas
toujours de boulot, parce qu’on n’est pas toujours performant, parce qu’on
est vieux, parce qu’on est malade…
J B Donc c’est « non-contributif » parce qu’on ne « contribue » pas, sur le
marché du travail, à obtenir droit à ces ressources. Ce n’est pas en fonction
de nos performances dans l’emploi qu’on a ces droits-là. C’est en cela
qu’ils ne sont pas « contributifs » ?
BF C’est ça. Le second pilier c’est la performance : le « contributif » est
fonction de la performance sur le marché du travail ou sur le marché des
biens et services, ça concerne aussi bien sûr les travailleurs indépendants.
Le pilier contributif est en cohérence avec le pilier non-contributif. Il y
aurait des populations ou des besoins qui relèvent de l’universel, du non-
contributif, et puis il y aurait des populations ou des besoins qui relèvent du
contributif. Il y a donc cette division entre les performants, ceux qui
réussissent, et puis ceux « qui ne sont rien », les « fainéants », les
« illettrés »… On a un président de la République qui est extrêmement
fécond…
J B Oui, il est prolixe en insultes aux travailleurs…
B F Oui ! Alors pour ceux-là, il y a du revenu non-contributif – pour lequel
ils seront d’ailleurs toujours stigmatisés, parce que c’est quand même un
signe de fainéantise. Pour éviter la stigmatisation, Hamon propose qu’il soit
universel, et je montre dans le livre que c’est la même chose. Hamon c’est
le promoteur du premier pilier, Macron c’est le promoteur du second pilier,
le promoteur des start-up, de ceux qui veulent devenir millionnaires…
J B Je récapitule, Hamon c’est le promoteur du premier pilier, non-
contributif…
B F Revenu de base, Économie sociale et solidaire…
J B Tout le monde a droit à un petit revenu pour ses besoins…
B F Ça c’est la soupape de sûreté… C’est la marge que le capitalisme
s’octroie, qu’il pille d’ailleurs, parce que le cœur de la valeur produite dans
l’économie sociale et solidaire est largement pillé par le capitalisme.
J B Attendez, mais comment le capitalisme fait-il pour piller l’économie
sociale et solidaire ? Par le remboursement des crédits et les intérêts qu’il
en retire ?
B F Eh bien dans une entreprise de l’économie sociale et solidaire, vous
avez forcément des marchés, des fournisseurs, des clients, des prêteurs, et
derrière un fournisseur, un client ou un prêteur on trouve presque toujours
un groupe capitaliste…
J B D’accord.
B F Donc, les travailleurs indépendants, l’économie sociale et solidaire,
tout cela est pillé par le capital, bien sûr. Et c’est aussi pour le capital un
moyen de ne pas assumer les premiers moments, difficiles, de mise en place
de nouveaux produits ; une bonne part de la recherche-développement va
être assumée, avec un financement public, par ce premier pilier de
ressources dont se contentent des jeunes passionnés attirés par le côté
horizontal des plateformes collaboratives. Car ce premier pilier de
ressources s’est construit à partir des jeunes, pour l’essentiel. La contre-
révolution est aussi empirique que la révolution : les choses démarrent avec
Barre et le « Plan Jeunes », en 1977. C’est toujours la même séquence : il
s’agit de dire qu’une population est en difficulté…
J B C’est la victimisation, en fait…
B F Voilà ! Merci de retrouver le mot que j’utilise dans mon livre.
JB Ah oui, le coup du taux de chômage des jeunes, l’arnaque sur le taux
de chômage des jeunes, c’est très éloquent pour montrer comment on
construit une catégorie sociale en victime pour pouvoir ensuite lui octroyer
des sortes de « sous-droits » : on va lui créer des contrats aménagés sur
mesure pour des « victimes ». Je me permets d’expliquer, donc : le taux de
chômage des jeunes, dont on nous rebat les oreilles, en nous disant « un
jeune sur quatre est au chômage » – ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas un
jeune sur quatre qui est chômeur, puisqu’il y a 70 % des 18-25 ans qui sont
étudiants, et eux ne relèvent pas de la catégorie des actifs ; c’est donc sur
les 30 % restants, sur ceux qui ne sont pas étudiants et qui sont donc censés
être actifs, qu’on peut observer ce taux de chômage de 1 sur 4 – c’est sur
30 % des jeunes. Et ça, ça ne fait pas du tout « un jeune sur quatre » qui est
au chômage ! Mais la raison pour laquelle la bourgeoisie, le capital, ont
intérêt à faire circuler ce taux absolument exorbitant de « 25 % de
chômeurs chez les jeunes », c’est que du coup, on va leur faire sur mesure
des petits contrats bien humiliants, qui dégradent bien leurs droits : ils vont
entrer dans les entreprises avec un sous-salaire, des sous-droits, « mais ils
en ont tellement besoin parce que ce sont des victimes ». Pardon, c’est un
peu caricatural…
BF C’est tout à fait ça. Quand on victimise une population, on la nie en
tant que porteuse d’une qualification : « Il y a un drame massif dans la
jeunesse, c’est le chômage. Mieux vaut un petit boulot que rien du tout. » Et
on va inventer les TUC, les SIVP (ça c’est les années 1980), le Contrat
emploi solidarité (toujours la « solidarité »), ça c’est Rocard, et puis le
Contrat emploi jeune, c’est Jospin, aujourd’hui le Service civique, le
volontariat, les stages… On a complètement disqualifié l’embauche : le
salaire d’embauche, en progression depuis la Libération, stagne voire recule
à partir des « mesures jeunes ». Le mot « qualification » a même disparu du
vocabulaire des jeunes en même temps que s’instituait une longue période
de la vie adulte sans les droits salariaux, l’insertion. Cette construction a été
accompagnée d’une fiscalisation du Smic.
J B Qu’est-ce que ça veut dire, « fiscalisation » ?
B F Ça veut dire qu’il est largement payé par l’impôt ; ce sont les
contribuables qui paient le Smic, ce ne sont pas les employeurs. Avec les
exonérations Aubry/Fillon vous avez 26 points de salaire qui sont
supprimés, l’essentiel des cotisations patronales au régime général : ce sont
les contribuables qui paient à la place des employeurs puisque les
exonérations de cotisations patronales sont compensées par une dotation
budgétaire d’un même montant au régime général. Et puis vous avez depuis
Hollande un dispositif qui rembourse partiellement, par un crédit d’impôt,
les cotisations patronales jusqu’à 3,5 fois le Smic. Donc, non seulement
vous avez un gel du taux de cotisation depuis la fin des années 1970, soit
depuis 40 ans, mais vous avez un remplacement de la cotisation par un
impôt de solidarité, donc une baisse de salaire ! Ce qui du point de vue
anthropologique est décisif : on remplace un travailleur candidat à la
direction de l’économie par un pauvre…
J B Un assisté…
B F Qui a besoin de la solidarité. Ou plus exactement qui « a droit ».
« Comme personnes, nous avons droit à des ressources ». « À notre
naissance, la société a une dette envers nous ». « Il y a un patrimoine
collectif sur lequel nous avons un droit de tirage ». C’est ça, l’astuce
verbale de la seconde gauche, pour légitimer un revenu universel, c’est-à-
dire une ressource qui nous est attribuée en tant que personnes, mais qui
n’est pas un droit économique de la personne. Qui est un droit attaché à la
personne, mais qui nie sa contribution économique, et qui a vocation à se
substituer aux 700 ou 800 premiers euros du salaire direct et des prestations
sociales.
J B Avec Hamon et Macron, on est toujours à l’intérieur de la
préservation du logiciel capitaliste.
BF On est à l’intérieur du remplacement du salaire à la qualification pour
tous, à partir de 18 ans, comme droit politique tel qu’il se construit
empiriquement depuis 1946, par un premier pilier de ressources qui se
construit autour du Smic. Et le Smic, ce n’est précisément pas du salaire.
J’ai évoqué tout à l’heure avec vous l’institution du salaire au xxe siècle
comme institution révolutionnaire du fait de son fondement sur la
qualification. Or le Smic apparaît, comme Smig, en 1950, en tant que
rémunération-plancher étrangère à la qualification et construite, comme
toute rémunération capitaliste, à partir d’un panier de ressources, à partir
des besoins…
J B Et non pas de la production de valeur…
BF Et voilà ! Donc, depuis Rocard, progressivement, les gouvernements
ont promu le Smic comme forme normale de salaire alors que c’est un anti-
salaire. La qualification disparaît de l’horizon des travailleurs et des
obligations patronales. Ceux qui pensent que ce premier pilier, les 700 ou
800 euros en question, viendrait s’ajouter au Smic, aux prestations sociales,
etc., se laissent berner à peu de frais. À côté de ce premier pilier pour tous,
vous avez un deuxième pilier qui lui est contributif. Là encore, Macron
annonce clairement la couleur : si vous refusez une offre d’embauche, vous
serez radié du chômage. Et on va rendre contributive la retraite : un euro
cotisé donnera le même droit pour tous. La retraite, ça ne va plus être le
remplacement du salaire, mais « j’ai cotisé tant, j’ai droit à tant »…
J B Donc on retrouve le modèle où il n’y a que dans l’emploi qu’on est
reconnu comme travailleur productif, puisque c’est exclusivement au titre
des années qu’on a passées dans l’emploi qu’on a droit à récupérer une
sorte de droit à loisir rémunéré en fin de course…
B F Effectivement. Et comme il y a de l’aléa dans la performance aussi
bien sur le marché du travail, dans l’emploi, que sur le marché des biens et
services, chez les travailleurs indépendants – et n’oublions jamais que le
projet patronal, c’est de faire basculer dans l’indépendance un maximum de
travailleurs, qui avaient conquis l’emploi – comme il y a un aléa, cet aléa
est assumé d’une part par le revenu de base « non contributif », d’autre part
par la « sécurisation des parcours professionnels ». La sécurisation des
parcours professionnels c’est la marque de fabrique du second pilier,
construit autour de comptes personnels. Compte jours, compte formation,
compte pénibilité (encore que celui-là est très contesté par le patronat),
compte points de retraite. C’est autour de cela que les gouvernements ont
accompagné les accords nationaux interprofessionnels passés entre la
CFDT et le Medef depuis 1991-1992. Depuis que la CFDT a succédé à
Force Ouvrière comme partenaire privilégié du patronat, elle passe, avec le
patronat, des accords nationaux interprofessionnels qui sont une caricature
absolue de la démocratie : le « dialogue social » ne se passe qu’au siège du
Medef, sur un texte patronal, avec des négociations en coulisse ouvertes et
conclues par une séance plénière bidon. Ces accords nationaux
interprofessionnels concoctent des comptes qui vont mesurer notre
performance : plus je serai performant, plus j’aurai de points dans mon
compte. Donc, premier pilier, négation de la qualification, en commençant
par celle des jeunes ; second pilier, négation de la qualification : « Je suis
performant ; j’ai un service public de l’emploi qui m’aide à être performant
; j’ai des comptes personnels qui comptabilisent ma performance et qui sont
en train d’être réunis dans un « compte personnel d’activité ». La
rémunération comme mesure de l’activité : nous sommes revenus à la case
départ du prix de la force de travail.
J B Quand on vous écoute, on perçoit bien que tous ces enjeux
révolutionnaires ou contre-révolutionnaires sont nichés dans des
problématiques qui peuvent sembler extrêmement techniques, dans des
données que tous ne maîtrisent pas, des taux de cotisation, des accords de
branche, des choses comme ça, et je me posais la question – parce que
Vaincre Macron est quand même un texte de combat, qui affirme sa volonté
de prendre place sur la scène de la lutte politique – je me demandais :
comment ça se transforme en slogan ? On sent bien que ce sont des enjeux
puissamment révolutionnaires qui sont nichés dans un taux de cotisation,
une appellation remplacée par une autre, ça se joue dans des micro-détails
– c’est hyper dur : on ne met pas ça sur une banderole ! Quels pourraient
être les slogans de la lutte aujourd’hui ? Vous vous sentez capable, vous, de
produire du slogan et de la banderole, ou bien ce n’est pas votre domaine
de spécialité ?
BF À Réseau Salariat, l’association d’éducation populaire à laquelle vous
avez fait allusion, nous avons eu des « Estivales » cet été, dont l’un des
ateliers travaillait sur cette recherche des slogans qu’on pourrait proposer
dans les manifs qui s’annoncent. Ce n’est pas évident.
J B Non, je suis d’accord…
B F Moi je n’ai pas d’intelligence particulière de la chose, c’est vrai. En
tout cas il s’agit de sortir de la plainte et de la dénonciation.
J B Oui : on n’est pas des victimes. On ne se plaint pas.
B F Ça c’est vraiment très important. Il s’agit évidemment d’éviter des
mots d’ordre contre-productifs, comme « hausse du pouvoir d’achat »,
parce que là nous nous posons pour ce que nous ne sommes pas, justement.
Nous avons conquis le fait que le salaire ce ne soit pas du pouvoir d’achat,
mais que ce soit la reconnaissance du fait que nous sommes producteurs, et
les seuls producteurs. Donc, éviter ce genre de slogan contre-productif.
Mais des mots d’ordre qui insistent sur le fait qu’on est tous producteurs de
valeur : ça c’est important. Des mots d’ordre qui insistent surtout sur la
maîtrise de la production : que nous n’avons pas besoin d’actionnaires. Que
nous n’avons pas besoin de prêteurs. Que le crédit doit être supprimé, et
remplacé par de la subvention de l’investissement, comme nous l’avons
déjà fait pour la santé. On a créé des hôpitaux dans les années 1960 avec de
la subvention de l’investissement par l’Assurance maladie, qui engrangeait
une hausse du taux de cotisation. Donc, des mots d’ordre positifs, des mots
d’ordre de présentation d’un possible, d’un déjà là, autour de : « salaire à
vie pour tous », « droit au salaire à 18 ans », « droit à la propriété d’usage ».
Insister sur le caractère tout à fait normal du fait d’être propriétaire d’usage
de son outil ; qu’il est normal d’être titulaire de son salaire. Alors que les
capitalistes nous culpabilisent, en nous disant « un salaire il faut le
mériter », « pour un investissement, il faut prendre un crédit », « c’est
normal de s’endetter pour travailler »… Qui dit que c’est normal de
s’endetter ? Disent que c’est normal de s’endetter ceux qui piquent une
partie de la valeur que nous produisons, la centralisent dans des marchés
financiers, et qui ensuite nous prêtent ce qu’ils nous ont piqué. Alors
évidemment ils ont tout intérêt à ce que, y compris à l’université, on
enseigne comme une espèce d’évidence que pour investir il faut
s’endetter… Abolissons la dette, comme le montre magnifiquement Amargi
! Je vous rends hommage pour Amargi – pour ceux qui ne connaissent pas
Amargi, allez-y, demandez qu’il soit programmé…
JB On ne le joue pas en ce moment… Donc, Amargi4, c’est le spectacle
que j’ai écrit et mis en scène, à propos de la dette et de la monnaie, qui est
copieusement nourri de la pensée de Bernard Friot, et qui s’efforce de
mettre en scène des choses autour du salaire à vie.
B F Et qui est aussi nourri de Graeber, de travaux extrêmement
importants…
J B Tout à fait ; David Graeber, Frédéric Lordon, André Orléan…
BF Tous ces travaux autour de la dette comme un construit social. Nous
travaillons pour rembourser une dette alors que c’est nous qui produisons la
valeur ! Je refuse complètement ! Et donc mon outil de travail doit être ma
propriété, sans que j’aie à rembourser quoi que ce soit.
J B Et donc il faut discréditer le crédit.
B F Discréditer le crédit, absolument.
J B Et, par exemple, le programme de la France insoumise, avec son
projet proposant un « bon service de crédit », une « bonne banque » c’est
encore une fausse piste ? Ça ne peut pas être la bonne direction tant qu’on
continue de légitimer le principe du crédit avec versement d’intérêt, c’est-à-
dire le principe de la propriété lucrative… À travers ça, ce que vous visez,
c’est la contestation radicale de la propriété lucrative ?
B F Oui, bien sûr. Mais je ne voudrais pas tirer contre mon camp. Il se
trouve que la France insoumise aujourd’hui, c’est l’expression de
l’opposition à Macron, donc je ne vais pas commencer par la critiquer… De
même que je ne critique pas mon parti, le Parti communiste, ou la CGT, ni
toutes celles et ceux qui se battent. Mais en même temps, j’ai effectivement
une forme de tristesse devant le fait que les organisations de la classe
révolutionnaire sont beaucoup trop dans une logique d’une « bonne
politique » de gauche, avec un « bon crédit », en méconnaissant les
puissances du salariat comme classe révolutionnaire déjà-là, avec des
réalisations communistes. Ce qu’ont fait nos anciens, c’est d’abord
conquérir des droits économiques de la personne : c’est cela qui est décisif.
Encore une fois, le capital est prêt à céder des droits au pouvoir d’achat de
la personne, avec un impôt de solidarité : si ça lui permet d’avoir la paix,
tout en mettant au travail pour pas cher, il est prêt. En revanche, il refuse
absolument des droits économiques de la personne, qui disent : « La
personne n’a pas à s’endetter pour travailler (comme travailleur
indépendant) » ; « Elle n’a pas à travailler pour rembourser la dette que
l’entreprise dans laquelle elle travaille a contractée pour financer son
investissement ». Oui, le crédit à l’investissement doit disparaître. Et il a
commencé à disparaître, déjà !
J B Dans certains champs économiques…
B F Quand on construisait un lycée ou un collège par jour entre 1965
et 1975, quand on créait les CHU, on ne s’endettait pas sur les marchés des
capitaux. On subventionnait par une hausse de l’impôt, qui était, là, un bon
impôt, ou de la cotisation, qui était une bonne cotisation. Ce que nous avons
fait, nous pouvons le refaire : le troisième chapitre de mon livre insiste sur
ce que nous pouvons faire. Ce qu’il faut redire, c’est que l’idée selon
laquelle il s’agirait d’abord de s’attaquer à l’argent, en faisant un « bon
crédit » contre le « mauvais crédit » des banques, c’est une idée discutable.
Il faut d’abord s’attaquer à la pratique capitaliste du travail, et en
s’attaquant à elle on s’aperçoit que l’on peut travailler sans crédit ; que l’on
peut socialiser une partie de la valeur dans une cotisation économique, qui
va à de l’investissement subventionné, ou que l’on peut créer de la
monnaie, par subvention, et non pas par crédit. Tout cela est possible…
J B On l’a déjà fait. J’imagine – quand vous dites : « Subvention pour
financer les investissements, et hausse du taux de cotisation, pour que les
travailleurs aient de plus en plus la main sur la production » – qu’on vous
répond : « Oui, bien sûr, c’est ça, et demain on rase gratis ! ». Ça peut
sembler, toujours, une proposition un peu utopique. J’imagine très bien le
patronat vous répondre : « Mais c’est impossible d’élever le taux de
cotisation : soit je fais baisser mes salaires nets, soit j’ai besoin de plus
d’argent, et je le trouve où, cet argent ? ». Que répondez-vous à ceux qui
vous disent : « Ça ne tient pas, économiquement, votre truc : où trouvez-
vous l’argent ? » Alors, où est-ce que vous le trouvez, Bernard, cet argent ?
B F Dans le non-remboursement des dettes. Les entreprises sont criblées
de dettes. On insiste beaucoup sur la dette publique, qui s’élève à
2000 milliards, mais les dettes des entreprises pour financer les
investissements sont très supérieures. C’est quoi, la dette pour
l’investissement ? C’est, premièrement, une bourgeoisie capitaliste qui a
ponctionné une partie de la valeur créée par les travailleurs, qui l’a
centralisée et qui va décider de l’investissement – en prêtant, et il faudra la
rembourser ! On forge nos chaînes à chaque fois que l’on rembourse un
crédit. Il y a une illégitimité totale de cette ponction qui ensuite génère un
prêt qu’il faut rembourser. Ou bien c’est, deuxièmement, une banque qui va
créer de la monnaie, mais là encore il faudra rembourser. Il faut poser tout
cela comme totalement illégitime. Insister sur le fait que les entreprises
n’ont pas à s’endetter pour se procurer leur matériel, leurs outils. Cela peut
être parfaitement compris par un petit patron. Par des actionnaires de
grosses boîtes, non, mais on ne va pas chercher à les convaincre. En
revanche, il faut pouvoir s’adresser à tous les patrons de PME, qui sont
certes idéologiquement du côté du capital… Mais cette solidarité
idéologique se fracasse, quand même, sur leur expérience concrète. Bien
souvent, il faut qu’ils se maltraitent eux-mêmes, eux et leurs salariés, ou des
sous-traitants (et souvent, eux-mêmes sont des sous-traitants de grosses
boîtes qui les maltraitent), pour rembourser un outil de travail, ou pour
payer un loyer pour tous ceux qui ne sont pas propriétaires de leurs murs.
Ils voient bien qu’ils triment eux-mêmes, non pas d’abord pour ce qui les
passionne, c’est-à-dire inventer un nouveau produit, dynamiser une
économie locale, animer une équipe, tout ce qui fait que des gens
entreprennent, parce que c’est grevé par l’obligation de rembourser un
endettement qui a été naturalisé comme légitime. J’ai enseigné trente ans
l’économie, je connais les programmes, c’est une catastrophe ! On enseigne
qu’il faut évidemment s’endetter pour investir, que les crédits font les
dépôts, tout un tas de sornettes. Rendre illégitime la dette des entreprises,
c’est une des grosses batailles syndicales à mener, une des grosses batailles
politiques. Il faut dire : « Nous allons doubler les cotisations ; actuellement
il y a à peu près 500 milliards de cotisations, nous allons passer à 1
000 milliards ». Les boîtes ne peuvent pas payer 500 milliards de
cotisations de plus, c’est évident, oui ! Mais elles ne rembourseront pas
500 milliards de dettes.
J B Et là, ça marche.
B F Le doublement des cotisations serait ainsi une opération blanche.
L’objection est que les prêteurs vont fuir. Mais qu’ils fuient ! Encore une
fois, c’est nous qui produisons la valeur. Tant que nous sommes dans cette
espèce de croyance selon laquelle le salut vient d’un prêteur, évidemment
nous sommes foutus. C’est de la tristesse que j’exprime, vis-à-vis de la
gauche de gauche…
J B Et je la partage, cette tristesse. Je lisais justement dans Le Monde
Diplomatique (de juillet 2017) un article de Danièle Linhart, qui est une
chercheuse formidable, au CNRS, sur le travail, qui réfléchit sur les
rapports de subordination au travail : elle rêve d’un « salariat sans
subordination ». On la rejoint tout à fait, on pense même que dans le
salariat, dans son principe, il n’y a pas de subordination… Mais Danièle
Linhart clôt son article en écrivant : « Disons-le d’emblée, il n’existe pas à
l’heure actuelle de modèle sur lequel se fonder pour avancer ». Même dans
ce qu’on peut penser être l’endroit le plus réceptif aux analyses que vous
portez ! De même qu’à France insoumise vous avez été auditionné, sans
effet, dans le cadre des auditions programmatiques… Je n’en finis pas
d’être perplexe devant cette sorte de cécité ou de surdité de vos partenaires
naturels dans la gauche de gauche vis-à-vis de l’analyse que vous portez,
qui me paraît pourtant assez limpide, une fois qu’on fait l’effort de rentrer
dans votre pensée… Comment expliquez-vous cette étanchéité de la gauche
de gauche ? Ce n’est peut-être pas un refus, peut-être… une forme
d’incompréhension ? Que pensez-vous de cette relative surdité de vos
interlocuteurs naturels ?
BF Je crois qu’il y a une bonne part d’anticommunisme dans la tradition
académique, de gauche, critique. Un anticommunisme qui gobe, voire qui
construit le discours sur les staliniens qui auraient empêché la révolution
possible en 1945 en France, partage de l’Europe par les accords de Yalta
oblige, et donc qui auraient conclu le compromis institutionnalisé fondateur
du fordisme. Avec de tels postulats, on ne peut évidemment qu’être aveugle
sur ce qui s’est créé de révolutionnaire à l’époque. Il y a aussi, évidemment,
l’échec des pays qui se posaient comme communistes, ça n’aide pas non
plus.
J B Bien sûr, c’est clair…
B F Moi-même, je sors de l’autocensure pour désigner comme communiste
l’institution du salaire à la qualification personnelle. Il y a certainement
aussi le poids de tout le virage à droite du débat à gauche dans les années
1980, autour de la thématique du totalitarisme. Et puis il y a aussi ce dont je
m’explique dans la conférence gesticulée que je fais à l’instigation de
Franck Lepage à partir de mon expérience de chercheur : moi-même j’ai dû
me défaire d’une position de classe assez spontanée dans la science sociale
critique, qui consiste à se mettre au service de vaincus. Au service de
« victimes », dans une forme de surplomb vis-à-vis de ces victimes dont on
va se faire la voix – et vous avez des travaux absolument magnifiques, je
rends hommage à mes collègues, bien sûr, mais toujours avec une
connotation victimaire…
J B Donc c’est émouvant, mais c’est contre-productif.
BF Parce que dans ce discours, il n’y a pas de classe révolutionnaire ; il y
a une espèce de postulat, dans la science sociale critique, d’absence de
classe révolutionnaire. Il y a des révoltes, il y a des rapports de force
favorables de temps en temps, mais il n’y a pas une classe qui est en train
d’élaborer une nouvelle pratique du travail. Or, cette classe qui élabore une
nouvelle pratique du travail, je la définis comme « salariat », à la fois parce
qu’elle se construit autour des institutions du salaire (la qualification, le fait
de sortir le salaire de l’emploi dans le régime général) et puis parce que la
classe ouvrière a été le moteur de ces conquêtes. Il me semble aujourd’hui
que ceux qui sont les porteurs possibles de ces conquêtes dépassent très
largement la classe ouvrière ; que nous avons aujourd’hui non seulement les
militants syndicalistes et politiques de la gauche de gauche, qui poursuivent
le combat dans les pas de la classe ouvrière, mais qu’on a aussi deux autres
terrains militants. Un que je connais un peu, parce que mon travail me l’a
fait rencontrer : c’est le terrain de tous ceux qui sont pour l’alternative ici et
maintenant, tous ces trentenaires éduqués qui ne veulent pas jouer le jeu du
capital, qui sont pour un changement de la production – or, être
révolutionnaire, c’est changer le travail, le travail concret bien sûr, mais
aussi le travail abstrait. C’est-à-dire changer la valeur, décider qu’est-ce
qu’on investit, pour quoi faire, comment on le fait, avec quel collectif de
travail, quels droits pour ceux qui sont au travail. Évidemment, ces
trentenaires-là sont aux avant-postes eux aussi de la lutte de classe, mais ils
ne vont pas se reconnaître dans la classe ouvrière. Alors est-ce qu’ils vont
se reconnaître dans le salariat ? Pas tellement plus, parce qu’ils sont très
tentés par le travail indépendant, mais il faut montrer, comme je le fais
longuement dans Vaincre Macron, que le travail indépendant peut être
assumé par du salaire à vie. Et puis il y a l’autre terrain militant, que nous
ignorons – peut-être pas vous, parce que vous êtes à Suger5 – mais que nous
ignorons assez massivement, aussi bien à la gauche de gauche que chez les
alternatifs, c’est le terrain de tous ceux qui se posent comme les « Indigènes
de la République » ; qui sont d’ailleurs souvent vilipendés par les deux
autres types de militance, sous couvert de laïcité – il y a des tas de façons
aujourd’hui de les vilipender. Moi ce que j’attends c’est la capacité à
articuler ces trois militances-là, pour constituer une classe révolutionnaire :
le salariat.
Cet échange est issu de l’émission Vaincre Macron, diffusée sur Hors-
Série en septembre 2017
Batailles sur la retraite : un enjeu
anthropologique
J B Notre dernière conversation remonte à l’automne 2017. Nous voici
maintenant à l’automne 2019 : on est en plein dans la réforme des retraites
voulue par Macron, on est dans la phase dite de « concertation » avec les
« partenaires sociaux », dont la CGT. La CGT, on l’a vu, a joué un rôle
historique dans la conquête d’institutions communistes du travail. Qu’est-
ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment en termes de
« concertation » dans la réforme des retraites, et que pensez-vous du rôle
que la CGT joue ? Est-elle à la hauteur des enjeux, et à la hauteur de son
propre héritage communiste ?
B F D’une part, la concertation c’est une antiphrase : il n’y a pas de
concertation. On est dans la même situation qu’à propos de la loi Pénicaud,
où il s’agit de faire semblant de négocier. Pour négocier il faut un texte, or il
n’y a pas de texte.
J B Il y a quand même le rapport Delevoye : c’est un texte de travail…
B F Le rapport Delevoye qui est né lui-même, paraît-il, de « concertation »
– où il n’y avait pas de texte – n’est pas présenté non plus comme le texte
de la réforme. Donc on est en train d’amuser le terrain en faisant croire qu’il
y a une concertation, mais il n’y a pas de concertation, ce n’est qu’un
habillage. Et je ne vois pas l’intérêt pour une organisation syndicale de
participer à cette affaire. Je parlais dans l’entretien précédent de tristesse
vis-à-vis de ces organisations : je suis toujours dans le même sentiment.
Comment se fait-il qu’une organisation comme la CGT, qui a pu être à
l’initiative d’institutions aussi révolutionnaires que le régime général, se
révèle, depuis quarante ans, incapable de les promouvoir ? Il ne s’agit pas
seulement de les défendre, car les défendre c’est un début de défaite, bien
sûr, mais de les promouvoir. Un signe de cette défaite, c’est l’incapacité où
elle a été de saisir le projet d’unicité du régime pour dire : « Oui, bien sûr,
unicité du régime ! Puisque c’est le projet de Croizat, puisque c’est le projet
dont nous avons été porteurs, qui a été entravé par le patronat mais qui a
montré sa fécondité ! » Eh bien non : la CGT parle de « la maison
commune » abritant des régimes qui resteraient distincts, ce qui permet la
propagande gouvernementale, évidente – « Est-ce que vous trouvez
légitime que les chauffeurs de bus aient un régime spécial ? »
JB Alors qu’il fallait jouer sur le terrain d’un régime unique, mais en le
ramenant sur un projet de conquête… Parce que là, le régime « universel »
préconisé par Macron, c’est un régime de nivellement par le bas, c’est
« l’universel » au ras du plancher, et non pas le régime unique que
pourraient vouloir la CGT et tous les travailleurs avec elle…
B F Évidemment, quand on parle d’unification, on dit toujours « par le
haut », et non pas par le bas. Mais de quel « bas » s’agit-il avec Delevoye ?
L’argumentaire des syndicats, des Économistes atterrés, des partis
d’opposition, etc., consiste à dénoncer le fait qu’on va baisser les pensions.
Que le projet soit de baisser les pensions, bien sûr…
J B C’est indiscutable.
BF Mais ça, c’est le projet depuis quarante ans ! Dans le régime dit « par
annuités » que nous connaissons aujourd’hui, qui calcule la pension en
fonction d’un salaire de référence et des annuités de travail validées, il y a
déjà eu une baisse des pensions tout à fait considérable.
J B Par rapport à quand ?
B F Par rapport à l’avant réforme, c’est-à-dire par rapport à avant 1987,
lorsque Séguin indexe sur les prix, et non plus sur les salaires, non
seulement les pensions du régime général, mais également les salaires
« portés au compte », comme on dit, c’est-à-dire les salaires qui vont servir
à calculer la pension. Les « meilleures années » du salaire peuvent remonter
à vingt ans avant le départ en retraite : si on indexe le salaire qu’on a touché
il y a vingt ans sur les prix, et non plus sur les salaires, le salaire qui sert de
référence au calcul de la pension est plus faible que si on l’avait indexé sur
les salaires, parce que les salaires progressent plus vite que les prix, sauf
exception. Le fait, ensuite, d’être passé des dix au vingt-cinq meilleures
années, ça a baissé évidemment le niveau moyen du salaire de référence. À
cela s’ajoute le fait d’avoir augmenté les annuités à valider pour une retraite
complète, en passant de 37,5 ans à 42 ans, ça a évidemment également
réduit les pensions. Donc dire que la caractéristique de ce projet, c’est de
réduire les pensions, non ! Ce projet, certes, continue à réduire les pensions,
mais le projet Delevoye reprend à son compte les projections faites par le
Conseil d’orientation des retraites, qui s’inscrit, lui, dans le maintien du
régime actuel. Le COR a fait ses calculs à régime actuel maintenu, avec une
part des pensions dans le PIB de 14 %, une part des cotisations à 28 % du
salaire brut, un taux de remplacement de la pension à 50 % du brut en 2050,
c’est tout ça qui est repris par le projet Delevoye.
J B On est dans une logique de continuité, pas de rupture…
B F C’est de la continuité totale en termes de baisse des pensions.
JB Mais pas sur la question annuités versus points, c’est là qu’il y a une
rupture ?
B F Là, il y a effectivement un alignement par le bas, qu’il faut
comprendre en mettant le « haut » du côté de la pension comme poursuite
du salaire, et le « bas » du côté de la pension comme revenu différé des
cotisations. Et si nous nous battons sur la généralisation du droit au salaire
des retraités, nous allons placer l’affrontement sur un terrain qui va nous
permettre de nous opposer enfin efficacement à la baisse du niveau des
pensions.
J B Oui, ça compte quand même !
BF Ce n’est pas que ça compte « quand même »… Si nous voulons enfin
stopper la baisse des pensions organisée depuis quarante ans, il faut
absolument que nous posions comme cœur de la retraite le maintien du
salaire, contre le différé des cotisations. Ce n’est que si on avance cette
proposition très simple : « Chacun doit avoir à vie le salaire net de ses six
meilleurs mois » que l’on assure le niveau des pensions : toute autre
situation va continuer à accompagner son recul. Or, dans l’argumentaire
syndical – et la CGT n’est pas seule en cause : je pense à mon syndicat, la
FSU, je pense à Solidaires – cet argument-là est absent ! L’idée que les
retraités ont droit au salaire, et que la pension doit être la poursuite du
meilleur salaire est un argument absent de la critique du rapport Delevoye,
et absent de la proposition syndicale.
J B C’est une telle absence que je me demandais s’il n’y aurait pas
meilleur compte à créer un nouveau syndicat… L’analyse que vous portez,
Bernard, et avec vous le Réseau Salariat, on la retrouve si peu dans les
combats les plus décisifs, qu’on se dit que les syndicats, dans leur forme
actuelle, ne sont plus capables de porter ce niveau d’analyse. Ne faudrait-il
pas envisager la création d’un nouveau syndicat qui serait dédié à porter
ces analyses, qui sont d’une vigueur très supérieure à celle qu’on entend
dans les syndicats actuels ? Enfin, il y a deux stratégies : soit infiltrer les
syndicats actuels, en étant très nombreux, soit créer un nouveau syndicat
capable de faire entendre ce projet de poursuite de la révolution
communiste dans les institutions.
B F Personnellement, ma culture syndicale ou politique me porte à faire
bouger l’existant plutôt qu’à créer une nouvelle organisation : l’émiettement
à la gauche de gauche est invraisemblable, je n’ai jamais trouvé utile la
création d’un nouveau Parti communiste ou d’un autre syndicat… Mais je
ne peux pas trop m’aventurer sur ce terrain parce que je ne suis pas très
doué sur les questions de stratégie et de tactique. Ce qu’on observe, et on
l’a vu avec le mouvement des Gilets Jaunes, c’est que la conflictualité se
construit beaucoup en dehors des syndicats aujourd’hui. Mais aussi dans les
syndicats, si on prend l’exemple des luttes des travailleurs migrants dans
l’hôtellerie ou la restauration : ce sont les syndicats, la CGT ou Solidaires,
qui mènent la lutte. Je ne désespère pas de la possibilité de faire bouger le
syndicalisme, et d’autant moins que toutes les sollicitations que j’ai de la
part d’unions locales, de fédérations, d’unions départementales me
montrent qu’il y a, minoritaire, certes, mais présente, une demande de
proposition d’autres revendications et d’autres analyses.
JB Donc cette demande existe à la base des syndicats, mais elle peine à
remonter dans les structures hiérarchiques : on n’arrive pas à faire
remonter cette analyse du côté des directions.
BF C’est assez classique. Et d’autre part les syndicats sont aussi boostés
par les mouvements sociaux, même s’ils ont peine à s’y articuler, on l’a vu
s’agissant de l’incapacité de la CGT à se lier aux Gilets Jaunes. Ces
mouvements alternatifs sont moteurs dans l’activité syndicale. Donc non,
mon projet n’est pas de créer un nouveau syndicat !
J B Je ne parlais pas simplement de vous, mais de Réseau Salariat…
B F La question s’est posée : est-ce qu’on se transforme en parti
politique… On a considéré qu’il fallait rester une association d’éducation
populaire.
J B Alors, dans l’éducation populaire que vous proposez, j’imagine que
vous allez militer pour la proposition que vous formulez dans la préface et
la conclusion de l’ouvrage Le Travail, enjeu des retraites : s’agissant du
combat sur les retraites, vous proposez de revendiquer la retraite à 50
ans… L’entrée en salaire à vie, attaché à la personne, à partir de 50 ans, et
non pas 60 ans qui est un âge dont on a longtemps fait un pivot. Vous, vous
passez carrément à la revendication de la retraite à 50 ans, comme salaire
attaché à la personne : vous pouvez développer cette proposition qui serait
vraiment une manière offensive d’entrer dans le combat pour les retraites ?
B F Effectivement, La Dispute vient de republier L’Enjeu des retraites,
sous un titre nouveau – Le Travail, enjeu des retraites – avec une
introduction d’une cinquantaine de pages totalement nouvelle, et une
conclusion elle aussi nouvelle. J’y fais une proposition de retraite à 50 ans.
La retraite s’est construite comme droit au salaire, et non pas comme droit
au repos avec jouissance du différé de ses cotisations. Quand je dis « et non
pas comme droit au repos », c’est parce que dans « droit au salaire » (même
si dans les représentations les choses bougent très lentement), le statut de
travailleur est posé, et ça concerne les trois-quarts des pensions : sur
320 milliards de montant des pensions, 240 concernent des pensions
calculées comme poursuite du salaire, sans tenir aucun compte des
cotisations. Mais ce que quarante ans de réformes, et d’échec du
mouvement pour les contrer, ont produit, hélas, c’est que, y compris chez
les militants, il y a la conviction que les retraites sont la contrepartie des
cotisations – ça, c’est une énorme défaite idéologique ! Tout le combat de
Croizat, ça a été justement que les retraites ne soient pas la contrepartie des
cotisations. Lorsqu’il crée le régime général en 1946, il s’inspire du régime
des fonctionnaires, et dans la fonction publique d’État il n’y a pas de
cotisation puisque la retenue pour pension civile qui figure sur les feuilles
de paie est un pur jeu d’écriture, il n’y a pas de caisse des retraites, pas de
flux de monnaie qui irait vers une caisse qui ensuite verserait des pensions.
Et si la pension est la poursuite du salaire, c’est parce que, comme nous en
avons débattu précédemment, le fonctionnaire est titulaire d’un grade, que
ce grade définit sa qualification et donc son niveau de salaire, qu’il ne perd
pas ce grade à la fin de son service, et donc il continue à être payé. C’est sur
ce modèle de la poursuite du salaire, compte non tenu des cotisations, que
Croizat crée la retraite dans le régime général, en opposition à la retraite
telle que la pratiquaient les assurances sociales de 1930. Dans ces
assurances sociales, c’étaient les cotisations, placées (jusqu’en 1941, on
était en capitalisation), puis en répartition (à partir de 1941, Vichy adopte la
répartition), qui décidaient du niveau des pensions. Avec Croizat ce n’est
plus du tout ça : dans le régime général, ce qui décide du niveau des
pensions, c’est le salaire de référence, et le taux de remplacement de ce
salaire en fonction d’un nombre de trimestres validés ; et on ne valide pas
un trimestre en faisant valoir des cotisations, on valide son trimestre en
faisant valoir un niveau de salaire, déclaré ou non. Prenez le film Mammuth,
où on voit le personnage joué par Depardieu, avec sa femme jouée par
Yolande Moreau, enfourcher sa moto à la veille de prendre sa retraite pour
reconstituer sa carrière (parce qu’il a eu une carrière assez merdique), et où
il va d’employeur en employeur pour obtenir des preuves de ses périodes de
travail, soit auprès d’eux, soit auprès d’autres salariés qui ont travaillé avec
lui : ce film montre bien que ce ne sont pas les cotisations qui servent de
base au calcul des prestations de retraite. La pension a été pensée comme un
droit au salaire libéré de l’obligation de passer par le marché du travail pour
l’obtenir, c’est ça le point central : la retraite telle qu’elle est construite en
1946 ne nous libère pas du travail, mais du marché du travail ! Je n’ai pas
envie d’être libéré de ce qui m’empêche de vieillir socialement, la
responsabilité de produire. Mais, en revanche, être libéré du chantage à
l’emploi, être libéré de l’obligation de passer par le marché du travail pour
être reconnu comme producteur et être titulaire de mon salaire, ça c’est une
sacrée libération. Et l’enjeu de classe est tel que, dès 1947, le patronat saisit
l’existence d’un plafond de cotisation au régime général pour créer pour les
cadres un régime complémentaire, l’Agirc, sur la base capitaliste du « j’ai
cotisé, j’ai droit », j’ai accumulé un avoir pendant ma vie active et j’en jouis
maintenant que je suis vieux. Vieux puisque non productif. Hélas, en effet,
la CGT, qui militait pour un régime unique, assurant donc 100 % des
prestations, est battue : le plafond d’affiliation aux assurances sociales est
supprimé, certes (donc les cadres entrent dans le régime général), mais il est
transposé comme plafond de cotisation. Et si on ne cotise pas au-delà du
plafond, on n’a pas de prestation non plus. Le régime général n’assurant pas
le remplacement du salaire dans sa totalité, alors s’ouvre un espace contre la
CGT, qui se battra encore pour le déplafonnement dans les années 1950
lorsque FO négociera avec le patronat l’Arrco, qui étend le régime
complémentaire à tous les salariés du privé. Pour l’Arrco, un retraité n’est
pas un travailleur, c’est un ancien travailleur qui a le droit de récupérer, à
travers les cotisations des actifs actuels, les cotisations qu’il a mises au pot
commun quand il était « actif »…
J B Et donc ce n’est pas du salaire, c’est un revenu différé.
BF Un revenu différé qui relève de la « solidarité intergénérationnelle ».
Nous sommes là dans le discours capitaliste qui est hélas celui des
opposants à la réforme !
JB Contre cette conception de la retraite, vous proposez donc une entrée
dans la retraite, entendue comme salaire à vie indépendant du marché de
l’emploi, à partir de 50 ans. Vous associez à cette revendication un certain
nombre de préconisations : vous imaginez que les travailleurs ainsi libérés
du marché de l’emploi dès 50 ans (cet âge pivot où à la fois on peut s’être
lassé de son poste d’emploi, et où on est au maximum de sa maturité
professionnelle et de son savoir-faire), pourraient mettre à profit cette
émancipation de deux manières, selon qu’ils restent dans leur entreprise ou
qu’ils la quittent. On peut caractériser plus précisément les effets de cette
émancipation ?
B F Merci encore une fois de cette lecture extrêmement aiguë et pertinente
de l’ouvrage. De mon côté, à force de réfléchir sur le travail, je me suis
rendu compte que je mettais l’emphase sur le travail abstrait, ce qui est
fondamental, bien sûr, parce que c’est le travail abstrait qui détermine le
travail concret : si est déclarée porteuse de valeur une activité qui transporte
sur la route, les activités qui transportent sur le rail, ou sur l’eau, ne seront,
de fait, pas développées. Toujours, ce qui est posé comme producteur de
valeur va être encouragé par rapport à ce qui n’est pas posé comme
producteur de valeur. Donc, c’est à juste titre que j’ai centré ma réflexion
sur la lutte de classes sur le conflit sur la valeur, donc sur le travail abstrait.
Mais ça m’a conduit à sous-estimer l’enjeu du travail concret, ce dont j’ai
mis du temps à me rendre compte. Ce qui m’a fait bouger, c’est le refus de
toute une jeunesse, souvent diplômée, d’adhérer à nos organisations
syndicales ou politiques parce qu’elles ne suscitent pas l’auto-organisation
des travailleurs en matière de travail concret : ces organisations acceptent le
travail concret tel qu’il est organisé par les directions d’entreprise. Tout à
fait significatif de cela est l’emphase mise dans l’activité syndicale depuis
vingt ans sur la souffrance au travail, et la lutte contre la souffrance au
travail. De fait, et ça a été évidemment accentué par le côté extrêmement
agressif et subtil du management capitaliste, la maîtrise du travail concret
par les travailleurs est devenue à peu près nulle. Danièle Linhart a bien
montré, par exemple, que, en particulier chez les travailleurs dont le travail
abstrait est le mieux reconnu – ceux qui ont un emploi durable, un salaire à
la qualification respecté, et qui sont dans une forme de sécurité de ce point
de vue-là – il y a toute une insécurité du quotidien qui est produite par un
changement permanent des logiciels, des procédures, des places (par
exemple on ne mettra que sept places dans un bureau où il y a huit
personnes), etc. Il y a toute une technologie d’insécurisation qui fait que les
travailleurs sont de perpétuels débutants, voire (car j’ai rencontré des
responsables syndicaux dans des grosses boîtes comme France Télécom et
autres qui m’en ont parlé) sont privés de travail concret : ils ne gèrent que
des sous-traitants, ils passent leur temps dans de la parlotte et de la gestion,
et ils souffrent qu’eux-mêmes et leur organisation perdent toute compétence
en matière de travail concret. Donc il y a un enjeu de travail concret qu’on
ne résoudra pas en menant le combat sur la « souffrance au travail ». Il n’y
a aucune raison pour qu’on souffre au travail : le travail est une source de
contrainte, certes, mais la contrainte ça fait partie de l’humanisation, et c’est
d’abord une source de bonheur ; et la souffrance au travail ne doit pas être
combattue par toutes les procédures qui se mettent en place, elle doit être
supprimée par le fait que les travailleurs deviennent maîtres de leur travail
concret, et soient fiers de ce qu’ils font… Qu’ils ne soient pas là à répondre
« je fais mon travail » quand on leur demande de justifier la merde qu’ils
sont en train de faire.
JB Et c’est ce qui se produirait pour ce travailleur émancipé, celui qui,
dans votre proposition, dispose de sa retraite comme salaire à vie rattaché
à sa personne : il serait, lui, souverain sur le travail concret ? Dans
l’hypothèse où, passé 50 ans, il reste dans l’entreprise où il a fait l’essentiel
de sa carrière, le fait de n’être plus dépendant de son employeur pour sa
rémunération lui permet d’exercer cette souveraineté sur le travail concret
? Vous postulez qu’il serait, éventuellement, instigateur d’une
transformation des pratiques de travail dans l’entreprise…
B F Oui. Mais le fait d’être titulaire de son salaire n’est pas suffisant. On le
voit bien dans la fonction publique…
J B Tout à fait !
B F Nous le savons bien : il peut y avoir, bien qu’il y ait propriété du
salaire, une obéissance aux injonctions, une acceptation d’un travail concret
avec lequel on est en désaccord. On ne peut pas laisser le refus du travail
avec lequel on est en désaccord aux initiatives individuelles. Il faut qu’il y
ait un déplacement de l’action syndicale vers l’auto-organisation des
travailleurs, et qu’ils envoient collectivement aux pelotes les directions en
s’appuyant sur ces quinquagénaires devenus titulaires de leur salaire, mais
aussi protégés contre le licenciement, comme les délégués syndicaux. Parce
qu’être titulaire de son salaire ne veut pas dire qu’on ne va pas être licencié
: on sera licencié, mais avec son salaire.
J B Ça change quand même beaucoup !
BF Ça change beaucoup, mais ça fait que la personne sera quand même
éliminée d’un lieu où elle aurait entrepris de s’opposer aux directions.
Aujourd’hui, les syndicats consacrent trop d’énergie militante à des
« concertations » avec la direction qui n’aboutissent à rien, à l’organisation
de la lutte contre la souffrance au travail qui s’en trouve naturalisée comme
un phénomène inévitable, à la protestation. Il faut qu’ils deviennent
l’instance d’organisation du travail concret par les travailleurs eux-mêmes
contre les directions : seule une activité collective, faite avec des
institutions qui sont protégées par la loi permettra cette mutation
indispensable. C’est pourquoi il faudra que ces plus-de-cinquante-ans
libérés du marché du travail, titulaires de leur salaire, deviennent des
salariés protégés : in-licenciables comme le sont les délégués syndicaux
aujourd’hui, de manière à ce que, bien qu’en conflit avec leur direction, ils
ne soient pas vulnérables de ce point de vue-là. À ces conditions-là,
effectivement, nous avons des travailleurs qui ont l’expérience, qui sont en
pleine maturité professionnelle, et qui vont avoir un mandat, concrètement.
On peut proposer des exemples pour ces nouveaux retraités : ils seraient
chargés, dans une grosse boîte, à l’échelle nationale, et venant de diverses
entreprises du groupe, d’élaborer des logiciels, non pour ficeler les
initiatives, mais au contraire pour accompagner l’initiative des personnes.
Ou bien ils seraient chargés, dans une Chambre d’agriculture, de faire le
tour des agriculteurs, non pour être les porte-paroles de Bayer et les inciter
au phytosanitaire, mais au contraire pour organiser la résistance des
personnels de la Chambre et des agriculteurs aux injonctions de
l’agrobusiness. Une prof nouvellement en retraite pourrait entrer dans un
collectif chargé d’élaborer, à l’initiative des enseignants eux-mêmes, les
programmes dans sa discipline.
J B Ça, ce sont les hypothèses où le travailleur émancipé reste dans
l’entreprise où il a fait l’essentiel de sa carrière ; mais vous suggérez aussi
une autre piste, qui serait que ces cinquantenaires, ces travailleurs
émancipés, aillent grossir les rangs des travailleurs dans ce que vous
appelez les entreprises alternatives, tous les collectifs de travail où on
s’efforce de produire sans le capital, sans le productivisme et
l’extractivisme qu’il implique…
BF Bien sûr. À 50 ans, on est dans deux situations différentes : soit on est
dans une entreprise où, malgré les blocages que l’on y subit, on est content
de son travail, ou en tout cas de ce qu’on espère pouvoir en faire, soit on est
dans la situation où on a envie de partir… mais on est resté jusqu’ici parce
que le salaire était lié à l’emploi. On s’est heurté en permanence à des
obstacles, on est en grande souffrance parce qu’on ne peut pas faire ce
qu’on voudrait faire, ou bien on est obligé de faire des trucs avec lesquels
on est en total désaccord… Là, il va être possible de quitter l’entreprise
puisqu’on part avec son salaire. Et bien sûr, dans ce cas aussi il faut un
accompagnement, une activité collective – il ne faut pas laisser tout ça à la
morale individuelle. Il faut aussi que la morale individuelle soit engagée,
mais on ne fait pas société en faisant de la morale. Là, ça suppose un
service public de la qualification, et non plus de l’emploi – on voit bien ce
que ça change pour le travail de tous les personnels du service public de
l’emploi, qui savent qu’ils font aujourd’hui un boulot impossible : améliorer
l’employabilité de quelqu’un, c’est accompagner Sisyphe poussant son
rocher ! Ça ne sert à rien, et c’est terrible de faire un boulot dont on sait
qu’il ne sert à rien ! Il s’agira là, au contraire, d’être au service non plus de
l’emploi, mais de la qualification des personnes, parce qu’il faut
accompagner les personnes dans leur qualification, les soutenir dans leur
ambition à améliorer leur qualification. Un service public de la qualification
va orienter ces personnes vers toutes ces entreprises alternatives dont les
rangs certes grossissent aujourd’hui, par rapport à il y a trente ans, mais qui
restent encore très marginales. Ce sont tous ces jeunes diplômés auxquels je
faisais allusion tout à l’heure, qu’on ne trouve pas dans nos organisations
parce que, précisément, ils n’y trouvent pas ce qu’ils attendent, c’est-à-dire
les conditions rendant possible de ne pas produire de merde pour le capital.
Les retraités, que ces entreprises alternatives n’auront pas à payer,
puisqu’ils seront payés par la caisse des retraites, vont pouvoir apporter
toutes leurs capacités, augmenter la valeur ajoutée de ces entreprises, et les
sortir de la marginalité. Tel publicitaire qui n’en pouvait plus d’organiser la
tromperie ou l’addiction du consommateur ira faire la com d’une
coopérative de producteurs de lait décidés à se soustraire de Lactalys. Ces
entreprises, du coup, vont cotiser, bien sûr, puisqu’il y aura une valeur
ajoutée supplémentaire, et que je préconise que la cotisation soit assise sur
la valeur ajoutée et non pas sur la masse salariale. Cet apport de valeur
ajoutée par les retraités, c’est quand même autre chose que cette espèce
d’objectif qu’on donne aux retraités aujourd’hui de faire du bénévolat, du
soutien scolaire, et d’être marginalisés dans ce bénévolat. C’est
enthousiasmant, comme responsabilité !
JB Et ça contraste avec les affects dominants qui structurent de plus en
plus notre imaginaire, l’idée qu’on est en France, et plus généralement en
Europe, une population qui vieillit, et la manière dont le gouvernement
présente la situation sur le mode de l’alarme : « on ne va pas pouvoir
financer les retraites ». Non seulement il y a de plus en plus de vieux, mais
le discours qu’on tient sur les vieux c’est un discours qui en fait, non pas
des parasites sociaux, mais des braves gens inutiles, ou bien utiles mais
évidemment improductifs, et surtout pressés de se reposer. Connaissant bien
votre travail, je me doute que cette représentation-là…
B F Elle m’excède ! J’ai dix ans de retraite à mon actif, et je suis vent
debout contre cette représentation de la retraite comme un temps de
libération du travail où enfin on fait ce qu’on veut, et où on est loué pour
son utilité sociale tout en étant nié comme productif. Les femmes
connaissent bien cela, et de même qu’on fait une chanson pour la fête des
mères, on va, pour les retraités aussi, organiser des petites gâteries. Ce qui
m’insupporte, c’est l’injonction à l’activité : pour conserver leur capital
cognitif, pour rester en bonne santé, il faut que les retraités multiplient les
activités bénévoles, les activités qui assurent le lien social, etc. Cette
injonction à l’activité, pour moi, est obscène : il y a toute une industrie de
l’activation des retraités qui s’est construite autour de la multiplication
d’erzats à la place de l’essentiel refusé : le travail dans sa dimension
productive. Les chômeurs font eux aussi l’expérience amère de cette
activation : il faut beaucoup de cynisme, et d’ingénuité, pour inviter
quelqu’un à qui on refuse le statut de producteur à multiplier les activités
prouvant qu’il peut le devenir. L’irresponsabilité économique des retraités
entraîne nécessairement leur vieillissement social, et il faut être con, ou
salaud, pour les inciter à lutter contre ce vieillissement à coups de bénévolat
et de randonnées à vélo. Qu’est-ce que ça veut dire de faire du soutien
scolaire quand on n’a plus aucune responsabilité sur ce que devient l’école
? Qu’est-ce que ça veut dire de faire un jardin de simples lorsqu’on a perdu
toute capacité de modifier l’agrobusiness ? Il y en a vraiment marre !
L’enjeu anthropologique du travail, ce n’est pas simplement que je suis utile
par mon travail concret, c’est aussi le fait que je suis contributeur dans la
production de valeur. C’est les deux ! Le féminisme s’est construit autour
de : « Nous en avons assez d’être utiles sans être reconnues comme
productrices ». Être reconnu comme producteur, je le redis sans être sûr
d’être entendu par les collègues et camarades sourds et aveugles qui
polémiquent avec moi sur ma prétendue confusion entre travail concret et
travail abstrait, ou qui insinuent que je prône l’injonction au travail, c’est
avoir un statut qui fait que, parce que je suis reconnu comme producteur en
tant que personne, je peux tenir à l’écart de la valeur des tas d’activités. Si
je peux les mener dans la gratuité absolue, c’est parce que j’ai la
confirmation que, en tant que personne, je suis en capacité de produire, avec
un droit lié à cela – le droit au salaire, le droit à la propriété de l’outil – et
un devoir de contribuer à la production. C’est quand je suis dans
l’incertitude sur ce que je suis du point de vue de la valeur que je multiplie
la marchandisation de mon activité et de mes biens : je loue mon
appartement quelques semaines par an sur Airbnb, je loue l’usage de ma
bagnole sur Blablacar, je loue dans l’économie dite « circulaire » l’usage de
mes objets quotidiens au lieu de les prêter – bref la monnaie envahit tout
mon quotidien. J’insiste aussi sur le fait que notre reconnaissance comme
producteur ne veut dire ni que toutes nos activités deviennent productives,
ni que nous sommes enjoints à l’activité, et que ceux qui le prétendent sont
à la fois dévots du fétichisme de la rémunération capitaliste, photographie
prétendue de la valeur d’usage, et aveugles sur cette conquête fondamentale
qu’est l’abstraction du salaire à la qualification relativement aux tâches
menées ! Je voudrais aussi souligner, car je le fais longuement dans Le
Travail, enjeu des retraites, que l’épreuve d’activités-erzats du travail qui
est infligée aux retraités, dont je viens de montrer la proximité mortifère
avec l’activation des chômeurs, est tout à fait symétrique de ce que
subissent les jeunes, « en insertion » comme on dit.
J B Tout à fait : c’est ce que vous appelez l’âgisme, cette logique de
discrimination par l’âge des vieux ou des jeunes qu’on présente comme non
encore producteurs ou plus producteurs.
BF Dans les années 1970, on a eu un double phénomène : premièrement
s’invente la catégorie des « jeunes » sur le marché du travail (auparavant,
cette caractéristique biographique n’avait pas d’effet sur le marché du
travail) ; c’est l’invention d’une période d’insertion qui aujourd’hui, dans
les faits, va de 18 à souvent 35 ans voire davantage, période pendant
laquelle on est nié comme producteur ayant droit au salaire, où on multiplie
les stages, on est invité à multiplier les activités… Au début des années
1970, quand j’ai commencé ma carrière, les Curriculum Vitae des étudiants
faisaient deux lignes ; aujourd’hui c’est six pages ! Il faut qu’ils montrent
combien ils s’activent pour améliorer leur employabilité, pour permettre
leur « insertion ». Tout cela est obscène. Et symétriquement, on a la même
chose avec les vieux, et ça arrive à une époque, le début des années 1970,
où les féministes ont – définitivement, je l’espère – rendu impossible
d’invoquer légitimement le genre comme source de discrimination face au
travail. Que le genre soit source de discrimination au travail, c’est évident,
mais son invocation légitime n’est plus possible…
J B Et du coup, c’est remplacé par la discrimination par l’âge… On
évince les vieux et les jeunes.
BF C’est pour cela qu’il faut se battre comme des chiens sur le caractère
anthropologique du travail dans sa double dimension concrète et abstraite.
Pour moi c’est aussi dégueulasse d’invoquer l’âge que d’invoquer le genre
pour discriminer le rapport au travail. J’ajoute que l’âgisme élimine du
travail d’abord les femmes, sauf qu’elles le sont désormais comme
« jeunes » ou comme « seniors », ce qui invisibilise la discrimination de
genre, laquelle doit évidemment continuer à être combattue comme telle.
JB Je reviens à votre proposition de retraite à 50 ans. Il faut préciser un
point s’agissant de l’augmentation de la cotisation… Les entreprises
alternatives qui accueilleraient ces nouveaux retraités auraient à cotiser
davantage pour que le salaire de ces travailleurs émancipés puisse être
versé par la caisse de retraite ; or, le modèle pour que ce soit une opération
« blanche » pour les entreprises, c’est de compenser l’augmentation de la
cotisation par l’annulation d’une partie de leur dette, ou d’annuler le
versement d’une partie des dividendes… Mais précisément, dans les
entreprises alternatives, il n’y a pas de dividende à verser (il n’y a pas
d’actionnaires), et s’agissant d’une entreprise comme Hors-Série, qui nous
servait d’exemple dans le premier entretien, il n’y a même pas de dette. Du
coup, je me demandais comment on ferait s’il fallait augmenter la
cotisation… On part du principe que la valeur ajoutée apportée par ces
travailleurs en plus suffit à couvrir l’effort économique nécessaire pour ce
surcroît de cotisation ?
B F Il s’agit d’une cotisation interprofessionnelle, bien sûr. Ce que
m’apprend le régime général, c’est qu’on ne crée pas de richesse en
socialisant des entreprises pauvres. Ce n’est pas en mutualisant la valeur
ajoutée des entreprises d’un secteur difficile, ou assises sur un faible
marché, que l’on peut générer les recettes suffisantes. C’est parce que le
régime général nous a sortis de logiques de branche ou d’entreprise, pour
instituer un régime délibérément interprofessionnel, qu’il a été performant.
Et donc bien sûr, ce ne sont pas seulement les entreprises du type de Hors-
Série qui vont socialiser une partie de leur valeur ajoutée : sa valeur ajoutée
socialisée va aller à une caisse qui recueillera aussi la valeur ajoutée de
branches en expansion…
JB Oui, mais quand bien même. Pour ces petites entreprises, ce serait un
surcroît de dépense : si la cotisation est plus élevée, cela grève nos
ressources.
B F Mais il s’agit d’affecter une partie de la valeur ajoutée supplémentaire.
Donc le surcroît de dépense est à la mesure d’un surcroît de recettes.
JB Oui, bien sûr, c’est ça. Je voudrais continuer sur l’attention que vous
portez, tout particulièrement aujourd’hui, sur le travail concret et sa
maîtrise. Il y a une polémique qui vous oppose à ceux qui devraient
pourtant être des camarades, qui écrivent dans Contretemps (qui se
présente comme une revue de « critique communiste ») : Contretemps a
publié une série d’articles, que vous qualifiez de « dossier à charge » contre
vos analyses relatives au salaire à vie. Jean-Marie Harribey, par exemple, y
a écrit un texte extrêmement sévère avec votre travail, et il vous interpelle
en vous posant cette question : « Mais qu’est-ce qu’ils font, ces retraités,
dont tu nous dis qu’ils travaillent ? ». Et vous répondez, dans l’introduction
du livre que nous discutons aujourd’hui, vous répondez en substance :
« Mais on s’en fout ! Ce n’est pas la question ». Vous montrez que cette
question est une question aliénée ; on n’a pas à se poser la question de
« qu’est-ce qu’ils font ». Mais quand vous faites ce type de réponse, on a
l’impression que vous réclamez une sorte d’indifférence au travail concret,
comme si vous disiez « Peu importe ce qu’on fabrique, ce qui compte c’est
d’être reconnu comme producteur de valeur ». Or nous avons vu au cours
de nos différentes discussions que ça ne correspond pas du tout à votre
manière de penser ; vous affirmez qu’au contraire, c’est très important, ce
qu’on fabrique, et que l’un des enjeux de la maîtrise du travail, c’est
justement d’arrêter de fabriquer n’importe quoi. Alors comment articuler
cette sorte de paradoxe qui postule à la fois qu’il faut une relative
indifférence à la question du travail concret pour assumer que nous sommes
tous producteurs de valeur, et qui alerte sur le fait que cette indifférence à
l’égard du travail concret peut être extrêmement toxique, quand elle revient
à ne plus du tout faire attention à ce qu’on fabrique, comme quand on
conditionne du Médiator, qu’on fait de la merde, et que c’est inacceptable.
BF De mon côté, j’ai bougé sur cette question de l’indifférence au travail
concret. Je me suis avisé récemment, et je n’y avais pas du tout été sensible
dans mes précédentes lectures, que Marx et Engels signalent dans
L’Idéologie allemande que la bourgeoisie capitaliste, on le sait, est
indifférente à l’utilité sociale de ce qui est produit, puisque le but de la
production c’est d’amasser du capital et non pas l’utilité sociale, mais que
par ricochet, les travailleurs organisés aussi sont indifférents…
JBÀ ce qui est produit ?
BF Oui. Parce que les syndicats ont l’œil rivé sur le travail abstrait, c’est-
à-dire sur la conquête de droits en matière de salaire à la qualification
personnelle, de reconnaissance de la production de valeur. Maintenant j’y
suis très sensible, au point de sursauter quand je constate cette indifférence :
dans un colloque à Toulon, en mai dernier, un vieux militant de l’arsenal, un
ouvrier éminemment respectable, militant CGT, a dit : « Moi qui ai travaillé
à l’arsenal toute ma vie, j’ai distribué des tracts disant que la Défense
nationale doit se cantonner à la production d’armes pour la défense
nationale, point. Évidemment, je produisais des Exocet, etc. ». C’est cet
« évidemment »-là, qui est dramatique : on se bat pour conquérir des droits
en matière de travail abstrait, on dénonce le travail concret que l’on fait,
mais « évidemment » on le fait quand même.
JB« Évidemment ».
BF C’est justement ce que tous ces jeunes qui promeuvent des entreprises
alternatives ne supportent plus. Attribuer un salaire comme droit de la
personne, c’est inséparable d’un autre droit, qui est celui de la propriété
d’usage de l’outil de travail, et ces deux droits supportent évidemment une
responsabilité. La responsabilité, c’est de faire du travail concret qui ait
sens. Sinon, je ne vois pas l’intérêt de conquérir ces droits, si c’est pour
continuer à nous enfoncer dans le mur écologique, anthropologique,
territorial dans lequel est en train de nous enfoncer le capitalisme.
Évidemment ! Le salaire à la qualification personnelle, le droit de propriété
d’usage de l’entreprise, sont au service d’une production qui ait sens. Et
c’est très contradictoire, pour une organisation syndicale, de conquérir des
droits en matière de travail abstrait dans l’indifférence au travail concret.
Non pas l’indifférence individuelle : il n’y aurait pas souffrance au travail
s’il y avait indifférence individuelle. Les individus ne sont pas indifférents à
l’utilité sociale de ce qu’ils font. Mais l’organisation syndicale en tant que
telle est relativement indifférente, puisqu’elle n’organise pas les travailleurs
pour qu’ils ne produisent que ce qui correspond à leur déontologie, et
qu’elle négocie la lutte contre la souffrance au travail avec les directions
patronales. Il est indispensable de sortir de cette contradiction. Lorsque je
réponds à Harribey que ce que font les retraités n’est pas fondateur de leur
statut de producteur, je n’exprime pas du tout une indifférence au travail
concret : j’affirme que le statut de producteur n’a pas été construit (en tant
que statut communiste du producteur), comme photographie du travail
concret que fait la personne. C’est dans le capitalisme que la rémunération
correspond à la rémunération des besoins dont on est porteur pour faire telle
tâche : le fait que les travailleurs soient payés pour la tâche qu’ils font, c’est
au cœur de la rémunération capitaliste. Contre cela, justement, contre ce
salaire « prix de la force de travail », la CGT a construit le salaire à la
qualification par abstraction à l’endroit de la tâche : « Indice 575 », ça ne
dit pas du tout ce que je fais. L’abstraction de la qualification vis-à-vis du
travail concret, ça fait partie de la conquête d’un statut du travailleur
débarrassé de la subordination à un employeur. En ce sens, poser la
question de ce que fait quelqu’un pour savoir si c’est un travailleur ou non,
c’est poser une question capitaliste. Faut-il que je répète que conquérir un
statut communiste du producteur dans lequel la personne est titulaire d’une
qualification quel que soit son rapport au travail concret, ça ne transforme
pas tout son travail concret en production de valeur ? Que le fait que je sois,
en tant que personne, reconnu comme producteur, et titulaire d’un salaire,
ça ne veut pas dire que tous mes actes sont producteurs ? Harribey croit
pouvoir disqualifier le salaire à vie en disant que c’est comme le revenu de
base, ça veut dire que quand on joue aux cartes on travaille, ça veut dire
qu’on confond travail abstrait et travail concret, valeur d’usage et valeur
économique, etc. À vrai dire j’en ai assez qu’il répète ça en permanence,
dans une sorte d’autisme – j’ai beau répondre à ses arguments, il continue !
Et l’article dans Contretemps, c’est peanuts à côté de ce qu’il vient de sortir
dans Les Possibles, la revue d’Attac : là il m’éreinte sur 17 pages, qui
montrent combien la problématique du droit politique au salaire lui est
totalement étrangère !
J B Mais c’est très mystérieux, ça, parce que son article critique sort dans
la revue Contretemps qui se présente comme la revue de critique
« communiste », il y a un papier très sévère d’Économistes atterrés (dont
Harribey, Khalfa, Husson) qui sort dans L’Humanité, le journal du Parti
communiste… Ce sont des supports communistes qui publient les critiques
les plus hostiles vis-à-vis de votre travail ! Donc, l’hypothèse que vous
formuliez au cours d’une discussion précédente pour expliquer la surdité et
la cécité de ces territoires de la gauche de gauche où votre analyse devrait
porter, l’hypothèse de l’anticommunisme ne tient pas. Là, on est dans des
espaces de formulation de l’analyse communiste : il y a un problème, chez
Harribey, chez Khalfa, qui les rend si profondément réfractaires, et ce n’est
pas de l’anticommunisme.
B F Vous avez raison : il est clair que l’hypothèse de l’anticommunisme
n’est pas suffisante. J’y ai fait allusion dans un entretien précédent, il faut y
voir d’abord une position de classe, chez les chercheurs en sciences sociales
critiques. Je m’en explique longuement dans la première conférence
gesticulée que j’ai faite6 sur mon expérience de chercheur. J’ai longtemps
été moi-même un chercheur critique du capitalisme, comme le sont tous ces
collègues – c’est de la science sociale critique qu’ils font, ce sont des
hétérodoxes, ce ne sont pas des laudateurs du capitalisme, loin de là, ils sont
anticapitalistes… Mais critiques d’un capitalisme analysé comme une sorte
de système dans lequel il n’y a qu’une seule classe pour soi…
J B La bourgeoisie…
B F La bourgeoisie. En face il peut y avoir des rapports de force
provisoirement favorables aux travailleurs, mais c’est provisoire, et les
droits sont grignotés assez vite ; il peut y avoir de la dissidence, il peut y
avoir de la révolte, mais il n’y a pas de classe révolutionnaire pour soi. En
face, il y a des « victimes ». L’idée même que des travailleurs aient pu créer
des institutions alternatives à celles du capital leur est complètement
étrangère ! Quand on est solidaires de victimes, on lit les documents – qui,
et c’est tout le problème, ne répondent qu’aux questions qu’on leur pose –
comme racontant cette histoire. Moi, je suis passé de la position « solidaire
de victimes » à la position de quelqu’un qui est à l’école de vainqueurs.
JB Et c’est la classe ouvrière que vous postulez en « vainqueurs » dans
votre postulat, et non plus en « victimes ».
B F En vainqueurs avec des moments de défaite, et les organisations qui
ont porté les victoires sont sur la défensive depuis quarante ans… Mais
aujourd’hui, à côté des organisations en grande difficulté, alors qu’elles ont
construit 1946, il y a des tas d’initiatives alternatives qui sont très positives
d’un point de vue de classe. Un jeune qui dit : « Je ne produirai pas de
merde pour le capital et j’entends être maître de mon travail », pour moi, il
est communiste.
J B Il est dans ce que vous appelez l’ethos communiste.
B F Exactement. Et des ethos communistes, il y en a à la pelle
aujourd’hui…
J B Mais qui ne se déclarent pas tels… Là on retrouve le problème du
blocage, ou du tabou sur le mot « communisme »…
B F Absolument.
J B Mot « communiste » que même le parlement européen a l’air de
vouloir nous interdire – on va vraiment être privé de tous nos outils !
S’agissant de cette difficulté chez ces économistes ou ces sociologues
hétérodoxes à reconnaître la classe ouvrière comme une classe
révolutionnaire, ou comme une classe pour soi, je vous avouerais que moi-
même, sans avoir leur niveau de qualification et de recherche, j’ai eu aussi
du mal à me représenter ça. Je me souviens de vous avoir posé cette
question dans notre premier entretien : est-ce qu’ils avaient conscience de
ce qu’ils faisaient, les militants CGT, quand ils faisaient ça ? Quand on
vous oppose que Ambroise Croizat lui-même n’a pas dit son geste comme
un geste révolutionnaire, et que donc ce n’est pas un geste révolutionnaire,
vous répondez : ce n’est pas important, ce qu’on dit ; ce qui compte c’est ce
qu’on fait. Mais la question de l’intention consciente de subvertir le
capitalisme, elle se pose tout de même, et elle est embarrassante. Est-ce
qu’on peut appeler « communistes » des institutions qui ne se proposaient
pas intentionnellement, consciemment, délibérément de produire ce
« mouvement réel qui abolit l’état actuel »7 ? Le problème, ici, c’est celui
de l’impensé ! L’impensé est au cœur de tout ce que vous travaillez : les
acteurs eux-mêmes, parfois, étaient dans une forme d’impensé de la portée
subversive de leur geste, et vous considérez que ce n’est pas grave, que ce
qui compte, c’est qu’ils l’aient fait. Sauf que vous savez bien que l’impensé
est extrêmement problématique, puisque si on ne le pense pas, on ne le
poursuit pas : ce qui se passe aujourd’hui, c’est qu’on perd, parce qu’on est
dans l’impensé. Donc, l’impensé, ce n’est pas grave au début, mais ça
devient grave sur la durée, parce qu’on ne peut pas persister ? Vous voyez
ce que je veux dire ?
B F Ce n’est pas quelqu’un qui vit depuis quarante-cinq ans avec une
psychanalyste qui vous contredira ! (Rires). Nos actes nous précèdent, nous
posons des actes qui sont totalement novateurs avec des pensées anciennes.
Là où c’est problématique, en effet, c’est lorsque cet impensé dure. Et c’est
là qu’il y a une double responsabilité : celle des organisations qui ont été les
porteuses de cette innovation (même si « impensée »), et celle des
intellectuels qui sont censés analyser ces innovations. Leur responsabilité
est de travailler à une modification des représentations, qui soient en
cohérence avec le neuf. Or cette responsabilité n’est pas assumée : les
intellectuels hétérodoxes, du fait d’une position de classe en surplomb de la
classe ouvrière, et les organisations comme la CGT ou le PCF, du fait d’un
abandon de l’ambition de conquérir la maîtrise de la valeur et d’un repli sur
son partage. C’est pourquoi elles sont effectivement dans la défaite, et
qu’elles ne sont plus, du coup, en situation de responsabilité économique
(ce qui était le cas des fondateurs du régime général : ils géraient le tiers de
la masse salariale !). Ces organisations elles-mêmes sont devenues des
défenseuses de victimes : finalement, elles jouent un rôle tribunicien. Or, et
c’est ici que les choses se nouent, cette fonction tribunicienne est tout à fait
cohérente avec le récit que font mes collègues, récit d’un réel qui serait une
domination capitaliste génératrice de victimes… Il y a là une sorte
d’alliance de la corde et du pendu, entre les Économistes atterrés, le Conseil
scientifique d’Attac et les responsables de la CGT, de Solidaires, du Parti
communiste, de la France insoumise, du NPA, etc. Et c’est pour ça que c’est
tellement difficile de rompre la cécité qui vous trouble comme elle me
trouble.
JB Et c’est pour ça aussi que vous trouvez des appuis plus sûrement du
côté de ceux qui posent des actes, qui développent l’ethos communiste, qui
inventent des entreprises alternatives – c’est là que vous voyez à l’œuvre la
poursuite de la subversion communiste. Vos appuis, à la fois empiriques et
intellectuels, ils sont dans les univers de ceux qui affirment leur possibilité
de travailler autrement, et qui travaillent en effet autrement, en étant
souverains sur la valeur qu’ils produisent : c’est là que sont les
vérifications de ce que vous décrivez, plutôt que dans l’univers de la
science hétérodoxe qui a complètement validé le récit capitaliste…
BF Pas seulement validé, mais construit : qu’on pense à la théorie de la
régulation et à son « compromis institutionnalisé » de 1945. Cela dit, il faut
rester conscient de la fragilité des alternatives que vous évoquez. Toutes ces
initiatives alternatives qui prolifèrent, et qui effectivement se reconnaissent
beaucoup plus spontanément que les directions syndicales dans mon travail,
elles sont très vulnérables : du fait même de leur méfiance vis-à-vis de la
tradition cegéto-communiste, elles risquent de se couper de ce trésor
alternatif macrosocial qui a été construit par elle. Ce que j’essaie de porter,
comme témoin admiratif de ce que la CGT et le Parti communiste ont été
capables de faire en termes d’institutions macro-économiques sans
lesquelles il n’y a pas de changement – statut de la fonction publique,
nationalisation d’EDF-GDF, régime général, construction du salaire à la
qualification, ce n’est pas rien ! – ce que j’essaie, c’est de faire le pont entre
ces deux pratiques militantes. Pour que la gauche de gauche décide d’ouvrir
le nouveau front de la maîtrise du travail concret contre les directions et les
actionnaires. Et pour qu’on invente les institutions macro-économiques qui
rendent pérennes toutes les initiatives alternatives qui sont menacées de
marginalité ou de récupération par la bourgeoisie capitaliste.
JB Oui, il faut du « macro » : il faut des institutions macro-économiques
pour parvenir à subvertir en profondeur et durablement le modèle
capitaliste, et s’il y a quelqu’un qui en est tout à fait conscient, qui vous
écoute et vous rejoint de plus en plus explicitement, c’est Frédéric Lordon.
Dans son dernier livre qui vient de paraître, Vivre sans8, il examine
différentes « méthodologies » pour en finir avec le capitalisme, et il fait
vraiment la part belle à vos analyses, auxquelles il souscrit entièrement : il
considère que votre proposition représente la « seule proposition
consistante sur la table pour sortir des rapports de production
capitalistes ». « Consistante », dit-il, « parce qu’elle vérifie la double
contrainte de la portée macroscopique et de la compatibilité avec le niveau
présent de la division du travail [et qu’elle] montre que vivre sans travail,
au sens capitaliste du mot travail, vivre sans employeur, vivre sans
actionnaires est à notre portée »9. Il a tout compris. Sauf que lui, il fait
l’hypothèse que pour parvenir à la mise en œuvre de ce que vous préconisez
comme poursuite de la révolution communiste, il faut du « Grand Soir ».
Voici ce qu’il dit : « Qu’il doive y avoir événement, et d’une taille qui
concerne le pays entier, événement macroscopique, donc, moment décisif où
l’ordre établi dans son ensemble se trouve mis en jeu, je ne vois pas
comment on pourrait en faire l’économie, comment on pourrait ne pas en
passer par un point critique de cette nature, et c’est bien cela qu’on peut
appeler « Grand Soir »10. Or, le Grand Soir, on en a parlé pendant notre
première discussion, ce n’est pas du tout le scénario révolutionnaire dans
lequel vous vous inscrivez.
B F Effectivement, je me suis déclaré hostile à cette problématique dans
notre premier entretien. Il faut préciser dans quelles circonstances j’ai été
conduit à me démarquer du « Grand Soir ». D’une part, j’ai toujours
considéré que la victoire à l’élection présidentielle, qui est en général une
des voies de ce « Grand Soir » préconisée dans la Cinquième République,
n’est pas du tout le lieu adéquat d’une telle mutation, pour deux raisons. La
première est que cette élection est totalement ficelée pour qu’au second tour
ne figurent que deux sosies, et on l’a encore vu dernièrement…
J B En 2017…
B F On a bien vu que la République en marche et le Rassemblement
national sont les deux faces, les deux enfants jumeaux, de la crise du
capitalisme : même culte du chef, même soutien déterminé au capital
(même s’il ne s’agit pas de la même fraction, en tout cas dans le discours
public), même détermination à en finir avec les conquêtes des travailleurs, y
compris avec les moyens du fascisme. La seconde raison de mon
scepticisme absolu vis-à-vis de la présidentielle (une parodie démocratique
que la gauche de gauche devrait boycotter), c’est qu’une victoire politique
qui ne s’appuie pas sur la maîtrise populaire préalable d’une part suffisante
de la production condamne le nouveau pouvoir à se trouver à la merci des
capitalistes restés en capacité de tenir en otage la société. Cette illusoire
victoire politique d’un pouvoir vite réduit à l’impuissance économique
plombera pour très longtemps un espoir de gauche, puisqu’on aura
« conquis la présidentielle »… en vain. La seconde circonstance qui m’a
conduit à me démarquer du Grand Soir entendu comme mythologie de la
révolution par la prise du pouvoir d’État comme préalable à la prise du
pouvoir économique a été le constat de l’échec de la prétendue séquence
capitalisme/socialisme/communisme : il y aurait le capitalisme, et puis il y
aurait une prise du pouvoir d’État qui permettrait d’instaurer le socialisme,
et puis ensuite on passerait au communisme – le communisme comme une
espèce d’horizon jamais atteint, quand il n’est pas totalement décrédibilisé
par la tournure que prend l’étape socialiste… Au contraire, il faut parler de
communisme dans les réalisations actuelles, et il n’y a pas de préalable par
la prise du pouvoir d’État.
J B On peut d’ailleurs reproduire ici la citation de Marx et Engels que
vous produisez vous-même dans votre introduction : « Le communisme n’est
pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité
devrait se régler ; nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit
l’état actuel »11. On est donc tout à fait au cœur de la définition matricielle
du communisme. Mais en même temps, même si les travailleurs dans toutes
les entreprises, parviennent à grignoter de plus en plus de souveraineté sur
le travail concret, il reste toujours le fait qu’il faut que ce soit validé en
mode « macro » : un taux de cotisation, ça se décide en mode « macro », il
y faut du pouvoir central ; l’abolition d’une partie des dettes privées, ça se
décide dans le pouvoir central… Les conquêtes des travailleurs sur le
pouvoir économique, elles sont limitées par ces leviers-là.
B F Je suis d’accord. J’ai toujours dit qu’il faut participer au pouvoir ; mais
ce n’est pas la peine de conquérir le pouvoir d’État pour implanter de fortes
institutions communistes de la valeur.
J B D’accord.
B F L’exemple de 1946 montre que cinq ministres communistes sur des
strapontins pendant un an, ça peut créer des institutions extrêmement fortes
et durables. Mais une fois que j’ai dit ça, je pense que mon propos est
vulnérable, et je suis très souvent interrogé là-dessus alors que ce sont des
points sur lesquels je réfléchis peu… Je suis prêt à admettre une faiblesse de
ce côté-là. Frédéric Lordon insiste sur la nécessaire mutation macro-
économique des institutions essentielles – je suis entièrement d’accord sur
le fait que ce sont des institutions macro-économiques qu’il faut construire.
Il estime que ça ne peut pas se faire sans prise du pouvoir d’État ; j’ai
discuté avec Pierre Rimbert, qui est sur des positions identiques… Ce sont
des gens pour qui j’ai le plus grand respect, je veux bien admettre qu’ils ont
raison et moi tort. Mais je crains qu’à prendre l’État on ne le quitte pas,
alors que le communisme suppose la souveraineté populaire sur la
puissance publique.
J B En tout cas, vous, vous mettez plutôt en avant les modèles de la
subversion par degrés. À Nuit Debout, vous étiez venu parler d’une
proposition d’entrée dans le salaire à vie par cohorte d’âge (la génération
des 18-24 ans) ; en conclusion de la réédition de L’Enjeu des retraites, vous
proposez l’entrée en salaire à vie de la cohorte des plus de 50 ans ; dans les
deux cas c’est une subversion progressive, par entrée d’une ou plusieurs
générations dans le salaire à vie. Et puis il y a aussi la proposition de la
socialisation de la valeur par secteur, avec la proposition d’une Sécurité
sociale alimentaire… Finalement, ce que je vous vois faire, plutôt que de
poursuivre les rêves du « Grand Soir », consiste à proposer à chaque fois
une subversion partielle : le modèle pragmatique qui correspond à votre
manière de penser la transformation radicale consiste à grignoter du
terrain, pour une génération ou pour un secteur économique. On peut
développer l’exemple de la Sécurité sociale alimentaire, dérivé du modèle
de la santé…
B F Effectivement, c’est sur le modèle de la production de soins. Ce qui
m’a frappé en regardant les années 1950-1960, c’est la mutation frappante
qui s’y produit en matière de production de soins – aussi bien les soins
hospitaliers que les soins de ville. Les soins hospitaliers, auparavant, se
réduisaient à pratiquement rien : un équipement hospitalier vétuste, très peu
de qualification professionnelle ; les soins de ville, non remboursés, étaient
peu pratiqués (les catégories populaires se contentaient des offices
municipaux publics, d’un certain nombre de dispositifs gratuits, l’hygiène
publique, la PMI, la médecine du travail, et d’ailleurs la cotisation maladie
générait un excédent qui abondait le déficit des allocations familiales). Tout
change à la fin des années 1950 : le taux de cotisation, après avoir stagné
parce que le patronat, excédé de voir le régime général lui échapper, avait
obtenu des gouvernements (qui avaient gardé la main sur le taux de
cotisation) que ce taux ne bouge pas, s’élève à compter du début des années
1960, tandis le déplafonnement de l’Assurance maladie fait aussi que
l’assiette augmente. Du coup l’Assurance maladie se trouve en capacité
d’une part de subventionner l’investissement hospitalier, d’inclure dans son
sein les hôpitaux psychiatriques, de transformer les hospices en hôpitaux
locaux, et d’autre part de conventionner les soins de ville. Et ça se fait sur
un mode que je qualifie de communiste : salaire à la qualification
personnelle, subvention de l’investissement.
Pour la Sécurité sociale alimentaire, la SSA, notre obsession au sein de
Réseau Salariat, c’est comment rendre populaires les cotisations au régime
général. Elles sont devenues impopulaires, et c’est l’une des défaites
idéologiques du mouvement communiste. Comment les rendre populaires,
sinon en montrant concrètement comment elles pourraient rendre possible
une mutation et de la production, et de la consommation, dans des domaines
absolument sensibles, aussi bien pour le quotidien que d’un point de vue de
notre avenir commun, d’un point de vue écologique ? L’alimentation, les
transports de proximité, l’énergie, le logement, voilà des lieux décisifs dans
ces deux dimensions du quotidien et de l’écologie. Il s’agit de rendre
attractive la cotisation en la mettant au service d’une mutation de la
consommation et de la production dans ces quatre domaines, pour
poursuivre le « mouvement réel » du communisme.
J B Lequel mouvement est déjà commencé. Pour le coup, vous vous
appuyez sur un domaine où il n’y a pas trop d’impensé : le rapport qu’on a
à l’alimentation est un rapport dans lequel est déjà très conscientisée la
problématique du capital qui nous fait manger de la merde… Vous vous
appuyez sur un secteur dans lequel il y a eu, très spontanément, un
mouvement d’appropriation et de conscientisation des enjeux, donc
j’imagine que c’est un terrain très propice.
BF Absolument : c’est un terrain d’autant plus propice qu’il y a à la fois
cette conscience populaire, et puis qu’il y a des alternatifs à tous les niveaux
: de la production des biens bruts comme le lait ou le blé, à la production
des biens élaborés, la distribution, la restauration, la production d’outils
agricoles : tout cela aujourd’hui est investi par des alternatifs qui ne sont
plus quantité négligeable, même s’ils restent marginalisables ou
récupérables… Il suffit de voir comment la grande distribution essaie de
conquérir un monopole dans la distribution du bio !
JB Il faut peut-être expliquer le mécanisme par lequel la cotisation pour
une Sécurité sociale alimentaire financerait un secteur de l’alimentation
émancipé du capital…
B F Cette réflexion n’est pas propre à Réseau Salariat : nous la menons
avec des organisations liées à la Confédération paysanne comme le Sivam
ou avec des agronomes d’Ingénieurs sans frontières réunis dans Agrista, on
n’est d’ailleurs pas forcément d’accord sur la totalité du projet. Ce que nous
préconisons, à Réseau Salariat, c’est une cotisation qui pourrait être de 8 %
de la valeur ajoutée marchande, soit 120 milliards, ce qui correspond en
gros à la moitié des dépenses de consommation alimentaire aujourd’hui – ce
qui n’est pas rien. De toute façon, il faut des dispositifs macro-
économiques, significatifs, pour sortir de la marginalité alternative. On
n’affecterait pas la totalité de ces 120 milliards à solvabiliser la population,
parce que les alternatifs ne sont pas en mesure aujourd’hui de fournir la
moitié de la consommation alimentaire.
J B Ils n’ont pas l’outil de production nécessaire pour ça.
B F Voilà. Le principe c’est donc celui d’une cotisation, qui est une
opération blanche à l’échelle macro pour les entreprises, puisqu’à ces
120 milliards de cotisation correspondront 120 milliards de non
remboursement de dettes, ou de non-versement de dividendes. Ça suppose
toute une bataille politique sur l’illégitimité du crédit…
J B Une énorme bataille politique…
B F On l’a évoqué dans notre précédent entretien, je ne reviens pas là-
dessus, mais c’est évidemment un combat politique considérable, qui, lui
non plus n’est pas mené ! Pour la Sécurité sociale alimentaire comme pour
le reste de nos propositions, nous n’élaborons pas un modèle clé en main, ce
qui serait contraire à notre raison d’être, la promotion de la souveraineté
populaire sur le travail. Il faut donc que ce soit le fruit d’une élaboration
démocratique, que tout le monde s’en soit emparé, que ce soit devenu
populaire – et donc ça va bouger, forcément, dans le débat. Mais disons que
pour lancer le débat, on peut proposer d’affecter les 2/3 des 120 milliards
aux consommateurs/usagers, soit 100 euros par personne, sur la carte vitale.
Je le rappelle, nous partons du déjà-là de l’Assurance maladie pour le
pousser plus loin. Les enfants deviennent titulaires eux aussi d’une carte
vitale.
JB Ah oui, c’est 100 euros par personne, bien sûr, ce n’est pas 100 euros
par foyer.
B F Leur carte est abondée de 100 euros par mois et par personne. Un
foyer de 3 personnes perçoit dont 300 euros par mois, ça ne couvre pas la
totalité de la dépense en alimentation, mais c’est quand même très
significatif. Et cette carte vitale, elle ne pourra être présentée que chez des
professionnels conventionnés qui auront l’outil pour l’utiliser – exactement
comme pour les hôpitaux et les médecins libéraux.
J B Et ne seront conventionnés que les professionnels « alternatifs »…
B F On ne va évidemment pas conventionner la grande distribution,
l’agrobusiness etc. Et il faudra aller loin dans le refus du conventionnement,
c’est pour ça qu’il ne faut pas, à mon avis, affecter la totalité de la cotisation
à la solvabilisation de la demande, parce qu’il n’y a pas assez de
producteurs répondant aux critères du conventionnement – sinon on va être
obligés de réduire les critères de conventionnement (c’est un enjeu de débat
avec nos partenaires)…
J B Et les critères pour être conventionnés, vous dites qu’il faut allez assez
loin…
BF Il faut aller loin dans la filière : un des enseignements qu’on peut tirer
de l’Assurance maladie, c’est qu’on a conventionné les producteurs de soins
en conservant un mode capitaliste de production du médicament,
moyennant quoi on a fourni un marché public incroyable aux groupes
capitalistes comme Sanofi qui ont investi, et en partie pourri, la pratique du
soin… Il ne s’agit pas qu’on fasse la même chose dans l’alimentation en
fournissant un marché public à Massey Ferguson12 ou à Bayer13 ! Il faut que
ne soient conventionnés que les producteurs qui ne font pas appel à Bayer,
qui ne font pas appel à Massey Ferguson, qui achètent leurs outils,
réparables, auprès d’entreprises qui existent déjà mais qui sont encore très
petites…
J B Elles
non plus ne seraient pas en capacité de répondre à une demande
rendue massive par la solvabilisation…
BF Voilà. Donc les critères c’est de ne pas faire appel à des fournisseurs
capitalistes, c’est de produire en respectant le droit du travail (ce qui est loin
d’être le cas aujourd’hui), produire bio…
J B Avec exclusivement des entreprises dont les travailleurs sont les
propriétaires d’usage de leur outil de travail…
B F Bien sûr. Si on veut fermement tenir ces critères, et c’est pour nous
décisif, sinon on va alimenter la logique capitaliste avec un marché public,
il faut sans doute affecter une partie, nous on propose le tiers des
120 milliards, au soutien des producteurs alternatifs. Il faut acheter des
terres, notamment : il faut arracher la terre à la logique marchande et en
faire un bien commun, et ça aussi c’est un travail considérable. Il faut payer
les travailleurs conventionnés à la qualification personnelle. Il faut
subventionner l’investissement de producteurs agricoles alternatifs, il faut
aider les agriculteurs qui voudraient passer au bio à le faire – mais il y en a
pour quatre ou cinq ans, avant que ce soit rentable, et pendant ces quatre ou
cinq ans il faut qu’ils soient soutenus ; il faut soutenir la production de
machines nouvelles, etc. C’est tout cela qu’il faut faire avec cette cotisation.
Et je voudrais insister sur le fait que nous créons là une institution
macroéconomique articulée avec cette autre institution macro qu’est la
retraite à 50 ans : les quinquagénaires retraités, dotés de leur salaire et d’une
responsabilité d’auto-organisation des travailleurs, pourront évidemment
investir massivement ces entreprises alternatives dont l’activité va être
considérablement augmentée. La proposition sur la retraite est articulée à
celles portant sur les sécurités sociales sectorielles : j’en parle au pluriel car
ce qu’on vient de dire sur l’alimentation, on pourrait le transposer sur la
production de logement, sur le transport de proximité…
JB En intégrant à chaque fois le paramètre écologique, bien sûr. S’il y a
bien un affect commun en train de monter en ce moment c’est l’affect
climatique, il y a une sensibilité beaucoup plus grande des populations à la
catastrophe qui s’annonce, et que le capitalisme a évidemment organisée, et
je pense que c’est intéressant de souligner à quel point toutes les
propositions méthodologiques que vous développez s’articulent toujours à
la question de la durabilité, de la soutenabilité, du respect de
l’environnement.
B F Les quatre secteurs que j’ai évoqués sont les secteurs les plus polluants
aujourd’hui ; ce sont ceux qui nous mènent le plus droit à la catastrophe
écologique, ce sont ceux qui sont porteurs de produits dont le sens est à
interroger en priorité, bien sûr ! L’enjeu écologique de la production est au
cœur du projet, mais sans passer par la culpabilisation des consommateurs,
en leur disant « vous êtes obèse, on va vous apprendre à manger », ou par
celles des producteurs « quand est-ce que vous arrêtez de nous
empoisonner, de faire du mal aux animaux, etc.. ». La question est : quelles
institutions nous promouvons qui font que de fait, les comportements
alimentaires vont changer – en production et en consommation. Dans le cas
de la SSA, c’est par une institution qui, de fait, dirige la moitié de la
dépense de consommation alimentaire chez des professionnels qui
proposent une alternative à l’agrobusiness et à sa distribution.
JB Puisqu’on s’achemine vers la fin de cette conversation, on peut peut-
être revenir sur la lutte contre la réforme des retraites, qui s’annonce
comme une mobilisation majeure des temps qui viennent… Comment
décririez-vous l’enjeu politique de cette réforme ?
B F L’enjeu du choix entre droit au salaire ou droit au différé des
cotisations est un enjeu anthropologique ! Est-ce qu’il est légitime qu’il y
ait, dans ma vie d’adulte, un moment où je suis exclu du travail ? Nous
avons accepté, intériorisé ce dogme capitaliste : le travail est étranger à nos
vies. C’est quelque chose dans lequel on « entre », et s’y insérer est un sacré
boulot, et puis dont on peut être sorti par le chômage – et pire, c’est ça qui
est très pervers, on est invité à se réjouir d’en être sorti par la retraite. On
voit la cohérence de cela avec le fait de ne plus se battre pour que le travail
change. Si on ne se bat pas pour que le travail change, on va se battre pour
en sortir, et on va se réjouir d’en sortir : on va se battre pour la réduction du
temps de travail, on va se battre sur l’âge de la retraite… Ces batailles sont
très ambiguës : ce sont des batailles de vaincus sur l’essentiel, vaincus sur
la maîtrise du travail…
J B Maîtrise qu’on abandonne au capital. Ce que vous appelez l’enjeu
anthropologique consiste à affirmer que le travail est intrinsèque à la
personne : l’être humain se caractérise par une consubstantialité de la
personne et du travail. Il n’y a pas d’extériorité du travail. C’est le
capitalisme qui a arraché le travail, qui l’a séparé de nous. Et la lutte
communiste consiste notamment à faire reconnaître le caractère intrinsèque
du travail. C’est ça ?
BF Absolument. Il est fondamental d’insister sur le caractère intrinsèque
du travail au cœur du mouvement réel du communisme. Le fait que le
travail soit étranger à nos personnes dans le capitalisme, que nous soyons
séparés des fins et des moyens du travail, implique qu’on se retrouve « à
poil » sur le marché du travail : on est irresponsable pour l’essentiel,
puisqu’on ne décide pas de l’investissement, on ne décide pas de ce qui est
produit, on ne décide pas de qui travaille et qui ne travaille pas, ni de ce qui
est travail et de ce qui n’est pas travail – on ne décide de rien de ce qui est
essentiel. Mais l’on est consolé par des droits qu’on accumule dans un
compte personnel d’activité, éventuellement par un droit à un revenu
minimum garanti, pour ceux qui ne pourraient pas accumuler dans leur
compte personnel d’activité suffisamment de droits… On est bien dans une
logique capitaliste : on est à poil, mais on peut accumuler. Notre personne
n’est pas enrichie, elle est au contraire amputée, et c’est toujours du côté de
l’avoir que nous sommes invités à nous affubler de prothèses censées nous
« augmenter » alors que l’essentiel nous est ravi par une bourgeoisie qui a le
monopole sur le travail.
J B Alors qu’il s’agit de grandir dans l’être.
B F Oui, et, comme toujours dans le mouvement réel du communisme,
cette grandeur est très concrète. J’ai insisté tout au long de nos entretiens
sur la confirmation permanente de nos personnes dans leur capacité à
décider du travail (et au travail), par l’exercice d’un droit politique à la
qualification et à la décision sur la valeur. Je voudrais souligner pour finir
comment la question de la citoyenneté se pose dans cette perspective. Dans
le capitalisme, la citoyenneté consiste à reverser une partie de mon avoir
dans le pot commun : je suis solidaire, avec ce que j’ai, vis-à-vis de ceux
qui n’ont pas. Je ne dis pas que l’impôt n’a pas été un élément décisif dans
la construction de nos démocraties, mais je pense qu’il faut dépasser cette
perspective – je suis contre le fait qu’on continue à payer des impôts et à
payer des cotisations sur nos revenus à la fois parce que ça nous fait croire
que c’est nous qui produisons la valeur que produisent les fonctionnaires,
les soignants, qui feraient des travaux utiles mais non productifs, et surtout
parce que c’est asseoir sur notre avoir notre contribution au bien commun.
J B Mais alors du coup il faudrait être imposé sur quoi ?
BF Je suis pour la suppression totale de l’impôt et de la cotisation sur les
revenus personnels ; toute la socialisation de la valeur doit passer par un
prélèvement direct sur la valeur ajoutée dans les entreprises. En revanche, et
c’est là qu’intervient la citoyenneté communiste, chaque personne est
responsable de la production de cette si décisive valeur ajoutée.
J B Et donc, c’est en tant que producteur que j’exerce ma citoyenneté.
B F J’exerce ma citoyenneté par ma responsabilité sur la production de
valeur. Et là c’est une tout autre citoyenneté, qui fait que je n’attends pas
des autres que le travail soit fait, que la définition de ce qu’il faut faire soit
décidée ; c’est un tout autre lieu d’exercice de la citoyenneté.
JB C’est la réalisation économique de la devise révolutionnaire « Liberté
– Égalité – Fraternité » ?
B F Quelle belle idée de conclure sur cette magnifique devise ! Je parlerais
plutôt de sa réalisation communiste. Il s’agit en effet de déplacer la
dimension économique de la citoyenneté. Ce qu’il s’agit de donner au
commun dans le communisme, ce n’est pas une partie de ce que nous
avons, c’est notre capacité à produire de la valeur dans des travaux concrets
qui aient du sens, en assumant la responsabilité de le faire.
Entretien sur la réédition de L’Enjeu des retraites
sous le titre : Le Travail, enjeu des retraites (La Dispute, 2019)
Remerciement
Quel bonheur que de converser avec Judith Bernard ! D’abord, c’est
l’assurance d’avoir été lu avec pertinence et empathie, ce qui est rare. Et
puis c’est se trouver face à une interlocutrice qui, en sortant des échanges
convenus, vous pousse au-delà de ce que vous avez écrit. Enfin, c’est avoir
le privilège de mettre son travail entre les mains d’une passeuse qui va le
rendre audible à toutes et tous, y compris dans ses développements les plus
complexes. Merci !
Bernard Friot
Livres de Bernard Friot discutés dans cet
ouvrage
• Émanciper le travail. Entretiens avec Patrick Zech, La Dispute, « Travail
et salariat », 2014.
• Vaincre Macron, La Dispute, « Travail et salariat », 2017.
• Le Travail, enjeu des retraites, La Dispute, « Travail et salariat », 2019.
Du même auteur
• La Construction sociale de l’emploi en France, des années 1960 à
aujourd’hui, avec José Rose, L’Harmattan, 1996.
• Et la cotisation sociale créera l’emploi, La Dispute, 1999 (épuisé).
• Wage and Welfare: New perspectives on Employment and Social Rights in
Europe, Avec Bernardette Clasquin, Nahalie Moncel et Mark Harvey, PIE-
Peter Lang, Bruxelles, 2004.
• « Salariat. Pour une approche en termes de régimes de ressources », in
François Vatin (sous la direction de), avec la collaboration de Sophie
Bernard, Le Salariat, Théorie, histoire et formes, La Dispute, 2007.
• L’Enjeu des retraites, La Dispute, 2010 (épuisé).
• L’Enjeu du salaire, La Dispute, 2012.
• Puissances du salariat, nouvelle édition augmentée, La Dispute, « Travail
et salariat », 2012 (première édition 1998).
• The Wage under Attack: Employment Policies in Europe, avec Bernadette
Clasquin, PIE-Peter Lang, Bruxelles, 2013.
• Après l’économie de marché ? Une controverse, avec Anselm Jappe,
commentaires de Denis Bayon, Atelier de création libertaire, Lyon, 2014.
• Abolir la dette, travailler sans crédit, avec Denis Baba, Atelier de création
libertaire, Lyon, 2020
Dans la même collection
• La Tyrannie des algorithmes Miguel Benasayag (2019)
• Régression de la démocratie et déchaînement de la violence Monique
Chemillier-Gendreau(2019)
• L’Exil de la beauté Rudy Ricciotti (2019)
• Le Vertige des faits alternatifs Arnaud Esquerre (2018)
• Face au mal. Le conflit sans la violence Michel Wieviorka (2018)
• Guerres humanitaires ? mensonges et intox Rony Brauman (2017)
• Les nouveaux visages du fascisme Enzo Traverso (2017)
• La Droitisation du monde François Cusset (2016)
• Marre de cette Europe-là ? moi aussi… Guillaume Duval (2015)
• L’Histoire, un combat au présent Nicolas Offenstadt (2014)
• Sexe, race & culture Patrick Tort (2014)
• Ce populisme qui vient Raphaël Liogier (2013)
• L’Architecture est un sport de combat Rudy Ricciotti (2013)
• Où sont passés les intellectuels ? Enzo Traverso (2013)
• L’Argent sans foi ni loi Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (2012)
• La Guerre civile numérique Paul Jorion (2011)
• L’Administration de la peur Paul Virilio (2010)
• Après Lévi-Strauss Alban Bensa (2010)
• Face à la crise : l’urgence écologiste Alain Lipietz (2009)
• Que peut l’éthique ? Faire face à l’homme qui vient Monique Canto-
Sperber (2008)
• Racisme : la responsabilité des élites Gérard Noiriel (2007)
• Face aux migrants : état de droit ou état de siège ? Danièle Lochak
(2007)
• Extrêmes gauches : la tentation de la réforme Christophe Bourseiller
(2006)
• La Société de déception Gilles Lipovetsky (2006)
• À quoi sert l’histoire de l’art ? Roland Recht (2006)
• Modèle social : la chimère française Alain Renaut (2006)
• Le Grand Méchant Loup pharmaceutique Philippe Urfalino (2005)
• Profession artiste : extension du domaine de la création Pierre-Michel
Menger (2005)
• L’Artiste et le Politique Olivier Mongin (2004)
• Face à l’islam Abdelwahab Meddeb (2004)
• L’Ultime Honneur des intellectuels François Laruelle (2003)
• Réponses juives aux défis d’aujourd’hui Gilles Bernheim (2003)
• Quel renouveau socialiste ? Jacques Généreux (2003)
• Nos amours de la France : République, identités, régions Danièle
Sallenave, Périco Légasse (2002)
• Sauver les lettres Collectif, postface de Danièle Sallenave (2001)
• Le Consentement fatal : l’Europe face aux États-Unis Pierre-Marie
Gallois (2001)
• La Misère hors la loi Paul Bouchet (2000)
• La Fabrique du sexe Pierre Babin (1999)
• Éloge de la résistance à l’air du temps Daniel Bensaïd (1999)
• Pourquoi changer l’école ? François Dubet (1999, rééd. 2001)
• Que vive l’école républicaine ! Charles Coutel (1999)
• Planète sous contrôle Dominique Bourg (1998)
• Économie : le grand satan ? Pierre-Noël Giraud (1998)
• Contre la dépression nationale Julia Kristeva (1998)
• La Hantise du passé Henry Rousso (1998)
• À quoi sert la littérature ? Danièle Sallenave (1997)
• Malaise dans la mondialisation Zaki Laïdi (1997, rééd. 2001)
• L’Avenir du progrès Dominique Lecourt (1997)
• Contre la fin du travail Dominique Schnapper (1997)
• Vers un droit commun de l’humanité Mireille Delmas-Marty (1996)
• La République menacée Pierre-André Taguieff (1996, rééd. 2001)
• Cybermonde, la politique du pire Paul Virilio (1996, rééd. 2001)
• Pour une philosophie de la maladie François Dagognet (1996)
• Humanitaire : le dilemme Rony Brauman (1996, rééd. 2001)
Notes
1 https://www.hors-serie.net. Depuis 2014, ce site internet produit et diffuse des entretiens filmés
avec des intellectuels critiques.
2 Le Mediator est un médicament commercialisé par les laboratoires Servier, et suspecté de toxicité ;
plusieurs plaintes ont été déposées à leur encontre pour « tromperie aggravée sur la nature, la
qualité substantielle et la composition du produit », « mise en danger de la vie d’autrui »,
« administration de substance nuisible » et « homicide involontaire ».
3 En dépit de la décision du tribunal administratif, qui a reconnu en décembre 2017 que cette
mutation constituait une « sanction déguisée », ce collègue n’a pas pu, à l’heure où nous
transcrivons cet entretien, réintégrer ses fonctions au sein du lycée Suger, le rectorat persistant à s'y
opposer..
4 Amargi, texte à paraître dans Théâtre politique, de Judith Bernard, en triptyque avec Bienvenue
dans l’angle Alpha et Saccage, Éditions Libertalia, avril 2020.
5 Le Lycée Suger est situé à Saint-Denis dans le 93, dans un quartier très populaire.
6 https://www.youtube.com/watch?v=ZuZz9NSOh10
7 Définition du communisme selon Marx et Engels.
8 Frédéric Lordon, Vivre sans, La Fabrique, 2019.
9 Op. cit., p. 245
10 Idem, p. 248.
11 Marx et Engels, L’Idéologie allemande.
12 Entreprise spécialisée dans les engins et machines agricoles.
13 Société pharmaceutique et agrochimique.
Vous aimerez peut-être aussi
- Le travail, quelles valeurs ?: Idées reçues et propositionsD'EverandLe travail, quelles valeurs ?: Idées reçues et propositionsPas encore d'évaluation
- Sartre, Gavi, Victor: On A Raison de Se RévolterDocument376 pagesSartre, Gavi, Victor: On A Raison de Se RévolterbricePas encore d'évaluation
- Vivre Sans Autorité, Institution, Économie... (Frédéric Lordon)Document222 pagesVivre Sans Autorité, Institution, Économie... (Frédéric Lordon)Slim BencheikhPas encore d'évaluation
- Enjeu SalaireDocument7 pagesEnjeu SalaireDavid AuthelainPas encore d'évaluation
- Au-delà du bruit: Dix solutions pour notre avenirD'EverandAu-delà du bruit: Dix solutions pour notre avenirPas encore d'évaluation
- On A Raison de Se RevolterDocument376 pagesOn A Raison de Se RevolterIMMPas encore d'évaluation
- Ukiyo, le monde flottant: essai d'anthropologie économique et socialeD'EverandUkiyo, le monde flottant: essai d'anthropologie économique et socialePas encore d'évaluation
- Expressions Et CitationsDocument11 pagesExpressions Et Citationshiba.djimarkanPas encore d'évaluation
- L'art de se (la) raconter: Du storytelling au personal brandingD'EverandL'art de se (la) raconter: Du storytelling au personal brandingPas encore d'évaluation
- Badiou Quel CommunismeDocument132 pagesBadiou Quel CommunismeHugo VezzettiPas encore d'évaluation
- 48 Méprises Et Impostures Du PossibleDocument4 pages48 Méprises Et Impostures Du PossibleChristian MahieuPas encore d'évaluation
- Quelle est la différence entre une action et une obligationD'EverandQuelle est la différence entre une action et une obligationÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Jeff Wall - Le Presque DocumentaireDocument19 pagesJeff Wall - Le Presque DocumentaireBob BobbyPas encore d'évaluation
- Vaincre Macron Tout Seul Lire B FriotDocument9 pagesVaincre Macron Tout Seul Lire B FriotandrePas encore d'évaluation
- Frederic Lordon - Crise: Protectionnisme?...Document4 pagesFrederic Lordon - Crise: Protectionnisme?...nopePas encore d'évaluation
- LISSER Article 26-10Document5 pagesLISSER Article 26-10programmeur.abdallahlisserPas encore d'évaluation
- Mark Fisher - Inprecor 651-652Document9 pagesMark Fisher - Inprecor 651-652seibpPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Antonio Negri Sur Le PostcolonialDocument9 pagesEntretien Avec Antonio Negri Sur Le PostcolonialHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Deleuze - Cinema Pensée 71-73Document102 pagesDeleuze - Cinema Pensée 71-73Giacomo MichelaucigPas encore d'évaluation
- Mode D'emploi Du Détournement - Guy DebordDocument6 pagesMode D'emploi Du Détournement - Guy DebordRubén Romero100% (1)
- MAO Catherine 2014 TheseDocument436 pagesMAO Catherine 2014 TheseM CPas encore d'évaluation
- Entretien Avec BoltanskiDocument31 pagesEntretien Avec BoltanskiAyari PM100% (1)
- TFETFETFEDocument50 pagesTFETFETFEFrançois HeusePas encore d'évaluation
- Pierre Bourdieu - La Sociologie DérangeDocument45 pagesPierre Bourdieu - La Sociologie Dérangeloran34100% (4)
- Les Revues Et Leurs Temps. Entretiens Avec Sylvain Bourmeau, André Chabin, Vincent Citot Et Olivier MonginDocument22 pagesLes Revues Et Leurs Temps. Entretiens Avec Sylvain Bourmeau, André Chabin, Vincent Citot Et Olivier MonginVincent CitotPas encore d'évaluation
- Le Sociogramme de La Guerre (Claude Duchet) PDFDocument24 pagesLe Sociogramme de La Guerre (Claude Duchet) PDFSanou Jean carmelPas encore d'évaluation
- Patrick Charaudeau, L'humour de DieudonneDocument50 pagesPatrick Charaudeau, L'humour de DieudonnePana FabaudPas encore d'évaluation
- 3 Entretiens Pierre Bourdieu Avec Roger ChartierDocument7 pages3 Entretiens Pierre Bourdieu Avec Roger ChartierYosistaPas encore d'évaluation
- Merleau-Ponty - La Philosophie Et Son Enseignement (Parcours 2, Verdier, 2000)Document4 pagesMerleau-Ponty - La Philosophie Et Son Enseignement (Parcours 2, Verdier, 2000)kairoticPas encore d'évaluation
- Quinzaine Litteraire 86Document32 pagesQuinzaine Litteraire 86egonschiele9Pas encore d'évaluation
- Encyclopédie Des Nuisances - Fascicule 12 - Février 1988 PDFDocument40 pagesEncyclopédie Des Nuisances - Fascicule 12 - Février 1988 PDFcroquignolPas encore d'évaluation
- Franck Fischbach - La Production Des Hommes Marx Avec Spinoza (2014, Vrin) PDFDocument174 pagesFranck Fischbach - La Production Des Hommes Marx Avec Spinoza (2014, Vrin) PDFEser KömürcüPas encore d'évaluation
- L'Image Confisquée PagesDocument130 pagesL'Image Confisquée PagesHassouna MansouriPas encore d'évaluation
- 2 Sartre Lexistentialisme Est Un Humanisme PDFDocument14 pages2 Sartre Lexistentialisme Est Un Humanisme PDFdarlinebalePas encore d'évaluation
- Réflexions Sur Les Dispositifs Au Lycée Autogéré de ParisDocument3 pagesRéflexions Sur Les Dispositifs Au Lycée Autogéré de ParisBernard ElmanPas encore d'évaluation
- VIRNO Grammaire de La MultitudeDocument60 pagesVIRNO Grammaire de La MultitudeHoneybunny31Pas encore d'évaluation
- Courrier Des Lecteurs - Methodolgoie - Exemple de Prodution - Sujets D'entrainementDocument6 pagesCourrier Des Lecteurs - Methodolgoie - Exemple de Prodution - Sujets D'entrainementhuunguyennguyen485Pas encore d'évaluation
- Du Cap Aux Greves ExtraitDocument8 pagesDu Cap Aux Greves Extraitlouise antheaumePas encore d'évaluation
- Sur La Passe LacanDocument6 pagesSur La Passe LacanDenise GuedesPas encore d'évaluation
- "Qu'est-Ce Que La Critique?" Michel FoucaultDocument30 pages"Qu'est-Ce Que La Critique?" Michel FoucaultTolle_Lege100% (4)
- Communication Non-Verbale AppliquéeDocument318 pagesCommunication Non-Verbale AppliquéeMytcoavanzaPas encore d'évaluation
- Antiéconomie - André Gorz Et La Critique de La ValeurDocument5 pagesAntiéconomie - André Gorz Et La Critique de La Valeurnope100% (1)
- Vicor VeryDocument39 pagesVicor VeryazouayPas encore d'évaluation
- Dissidences - Entretien Avec Quelques Anciens Membres de Socialisme Ou BarbarieDocument35 pagesDissidences - Entretien Avec Quelques Anciens Membres de Socialisme Ou BarbarieEmiliano AquinoPas encore d'évaluation
- Non Fides N°IIIDocument72 pagesNon Fides N°IIIMarcialmpo100% (1)
- J'aime PenserDocument500 pagesJ'aime PenserfabioraharisonavPas encore d'évaluation
- LA PAROLE PLURIELLE DE MAURICE BLANCHOT Idoia Quintana DomínguezDocument10 pagesLA PAROLE PLURIELLE DE MAURICE BLANCHOT Idoia Quintana DomínguezDimitris CosmidisPas encore d'évaluation
- Multitudes SimondonDocument99 pagesMultitudes Simondonmbasques100% (1)
- La Société de Consommation - Fiche de LectureDocument15 pagesLa Société de Consommation - Fiche de LectureJames100% (2)
- 079Document58 pages079Ptrc Lbr LpPas encore d'évaluation
- Elysee Module 21108 FRDocument6 pagesElysee Module 21108 FRAâñaä ŠsPas encore d'évaluation
- حمومةcours textes argumentatifsDocument22 pagesحمومةcours textes argumentatifsKheribeche Nasser EddinePas encore d'évaluation
- Grande Mue 20151Document356 pagesGrande Mue 20151legallpascal37Pas encore d'évaluation
- Fiche Platon SophisteDocument5 pagesFiche Platon SophistebhardhamuPas encore d'évaluation
- LACAN 1975-1976 - FRDocument358 pagesLACAN 1975-1976 - FRcristianPas encore d'évaluation
- Cours Jacques-Alain Miller 1-06Document13 pagesCours Jacques-Alain Miller 1-06teofarg100% (1)
- Leur Morale Et La Nôtre - (Trotsky)Document27 pagesLeur Morale Et La Nôtre - (Trotsky)Sylvain Delhon100% (1)
- Ecrits - Militaires Violence Et Constitution Des États Européens ModernesDocument618 pagesEcrits - Militaires Violence Et Constitution Des États Européens ModernesSlim BencheikhPas encore d'évaluation
- Lenine Oeuvres Choisies 1948 Tome 1Document414 pagesLenine Oeuvres Choisies 1948 Tome 1Boubacar IbrahimPas encore d'évaluation
- Oeuvres Choisies - Tome IIDocument500 pagesOeuvres Choisies - Tome IIlepton100100% (1)
- Les Luttes - de Classes - en France 1848 1850Document96 pagesLes Luttes - de Classes - en France 1848 1850Slim Bencheikh100% (1)
- Guerre de Mouvement Et Guerre de Position Antonio GramsciDocument172 pagesGuerre de Mouvement Et Guerre de Position Antonio GramsciAmwin minm100% (1)
- Lénine - La Maladie Infantile Du GauchismeDocument32 pagesLénine - La Maladie Infantile Du GauchismefuckingfuckerPas encore d'évaluation
- The Phoenicians-Compressed PDFDocument70 pagesThe Phoenicians-Compressed PDFAlia BeydounPas encore d'évaluation
- Ibn Khaldun Histoire - Des - Berbères - Et - Des - Dynasties 3Document541 pagesIbn Khaldun Histoire - Des - Berbères - Et - Des - Dynasties 3Slim BencheikhPas encore d'évaluation
- Rome, Du Libéralisme Au Socialisme - Leçon Antique Pour Notre Temps - Godefroy EditionsDocument122 pagesRome, Du Libéralisme Au Socialisme - Leçon Antique Pour Notre Temps - Godefroy EditionszinelhPas encore d'évaluation
- Chapoutot Johann-Le Grand RécitDocument318 pagesChapoutot Johann-Le Grand RécitSlim BencheikhPas encore d'évaluation
- Jacques Sapir - La Demondialisation (Economie - Politique) PDFDocument139 pagesJacques Sapir - La Demondialisation (Economie - Politique) PDFsouizo100% (1)
- Mogens-Herman Hansen, Serge Bardet - La Démocratie Athénienne À L'époque de Démosthène: Structure, Principes Et IdéologieDocument477 pagesMogens-Herman Hansen, Serge Bardet - La Démocratie Athénienne À L'époque de Démosthène: Structure, Principes Et Idéologiethy42Pas encore d'évaluation
- Les Musulmans Dans Lhistoire de Leurope - T1 - Une Intégration Invisible (Jocelyne Dakhlia Bernard Vincent)Document675 pagesLes Musulmans Dans Lhistoire de Leurope - T1 - Une Intégration Invisible (Jocelyne Dakhlia Bernard Vincent)Slim BencheikhPas encore d'évaluation
- Mythe Et Pensée Chez Les Grecs (1965)Document241 pagesMythe Et Pensée Chez Les Grecs (1965)Slim Bencheikh100% (2)
- Les Origines de La Pensée Greque (1962)Document102 pagesLes Origines de La Pensée Greque (1962)Slim Bencheikh100% (1)
- L'univers, Les Dieux, Les Hommes. Récits Grecs Des OriginesDocument162 pagesL'univers, Les Dieux, Les Hommes. Récits Grecs Des OriginesSlim Bencheikh100% (1)