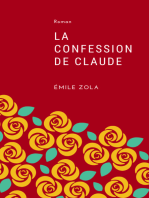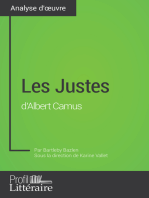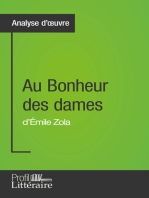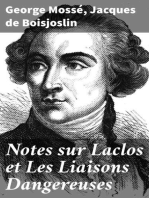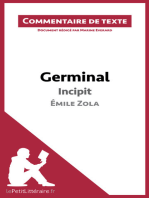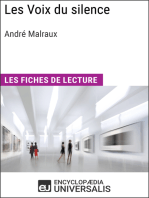Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Greve Dans Le Roman Francais
Transféré par
Esther Bautista Naranjo0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues6 pagesTitre original
LA GREVE DANS LE ROMAN FRANCAIS
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues6 pagesLa Greve Dans Le Roman Francais
Transféré par
Esther Bautista NaranjoDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 6
> Octobre 1973, page 38
Politique et littérature
La grève dans le roman français
par Roger-Henri Guerrand
LE MONDE DIPLOMATIQUE
Jusqu’au dix-neuvième siècle, notre littérature a prétendu évoquer un homme éternel,
indifférent aux régimes et aux classes. Tel est en effet l’idéal classique, encore vivant au
moins dans certains cantons de l’Université : il rejoint les préoccupations individualistes
des écrivains français, avant tout soucieux de l’analyse de leur moi. Je-romancier
domine dans nos lettres et ce n’est jamais, comme le faisait justement remarquer André
Wurmser, Je-ouvrier zingueur-romancier. Quels sont, parmi nos écrivains d’avant la
Révolution, ceux qui connurent autre chose que la « bonne société » ? Il faut attendre
Balzac, Zola et leurs épigones, c’est-à-dire l’époque où les masses commencent
vraiment d’entrer dans l’histoire, pour que ouvriers et paysans deviennent des
personnages dotés d’épaisseur romanesque et non plus de vagues silhouettes
caricaturales ou enrubannées.
Les conséquences de cette nouvelle attitude furent d’importance : Eugène Sue a été le
vulgarisateur des idées de Fourier auprès des masses imperméables au langage
ésotérique du maître, tandis que Balzac réussissait à tromper un esprit aussi averti que
Marx. Il l’a incité à croire que le paysan haineux qu’il décrivait comme rongé par les
hypothèques prises sur sa terre serait facilement enrégimenté dans l’armée de la
Révolution. On sait maintenant que Balzac voyait les campagnes par les yeux de
Fenimore Cooper regardant les Peaux-Rouges (de très loin) et de madame Hanska
quand on lui présentait ses moujiks. Mais Balzac n’a jamais accordé ia moindre
attention à la vie ouvrière, alors que les manufactures se montaient de tous côtés,
soumettant leur personnel à un régime que les esclaves de l’Antiquité n’avaient pas
connu.
Ces aliénés, Zola va enfin les intégrer dans la république des
Lettres. L’Assommoir (1877), tableau de la déchéance d’une famille ouvrière par
l’alcoolisme, marque une date ; Germinal (1884) lève un tabou, celui de l’évocation des
conflits du travail. Ces œuvres paraissent à une époque où les mythes de l’ouvrier et du
paysan commencent à se formuler et à se durcir : ils se révèlent des instruments
essentiels manipulés par les membres de l’appareil des partis politiques. Arthur Ranc,
communard et l’un des plus célèbres polémistes de gauche de la deuxième moitié du
dix-neuvième siècle, interdit aux écrivains de parler de l’ouvrier, modèle intangible. En
face, l’homme de la terre appartient aux partis de droite qui veillent sur sa légende.
Aussi bien, dès la parution de la Terre (1887), Zola fut-il accusé d’avoir calomnié le
paysan français. En octobre 1885, le gouvernement interdira la pièce tirée de Germinal
car « ce spectacle offrirait les plus grands dangers au point de vue de l’ordre social ».
Lorsque Zola avait dressé le plan des Rougon-Macquart, il n’avait prévu qu’un seul
roman ouvrier, ce sera l’Assommoir. On hésite aujourd’hui à affirmer que ce sont les
événements sociaux qui incitèrent Zola à donner une suite plus engagée à cet ouvrage. Il
est en tout cas certain que les mineurs occupaient alors le premier rang dans l’actualité :
grèves d’Anzin en 72, 78, 80, 84 surtout, qui dura cinquante-six jours marqués par des
incidents tumultueux et des interventions sanglantes des forces de l’ordre, gendarmerie
et cavalerie.
"La société qui craque en un instant"
La mine et les mineurs avaient déjà fait l’objet de plusieurs romans sociaux que Zola
connaissait bien. Le plus célèbre, encore lu aujourd’hui, est Sans famille, d’Hector
Malot (1878), dont la scène capitale, l’inondation de la mine et les péripéties du
sauvetage, se retrouvera dans Germinal. Comme à son habitude, Zola s’est documenté
sérieusement sur le sujet (700 à 800 pages de notes), il se rendit même sur le terrain
grâce a la complicité de son ami Alfred Giard, professeur à la faculté des sciences de
Lille et député radical de Valenciennes. Celui-ci le fit passer pour son secrétaire, ce qui
permit à l’écrivain de descendre dans les puits, où il rencontra plusieurs de ses futurs
modèles.
Germinal, roman-témoignage, a été clairement défini par son auteur : « Ce roman est le
soulèvement des salariés, le coup d’épaule donné à la société qui craque un instant, en
un mot la lutte du capital et du travail. C’est là qu’est l’importance du livre. Je le veux
prédisant l’avenir, posant la question qui sera la plus importante du siècle. » Mais les
exégètes contemporains de Zola, tel Claude Abastado, ont souligné « le faux jour
chronologique » du roman. Germinal est en effet invraisemblable à la date où les
événements que Zola décrit sont censés se passer. Dans les dernières années du Second
Empire, le mouvement ouvrier n’est pas constitué et, en 1865, ni l’anarchisme ni,
encore moins, le nihilisme n’avaient pénétré en France. Bakounine venait de s’évader de
Sibérie et s’installait en Suisse. Zola déclare que Souvarine s’est enfui de Russie, après
un attentat manqué contre le tsar : or la première tentative d’assassinat visant Alexandre
II aura lieu en 1866. De plus, Souvarine est embauché sans livret – comme Lantier, – ce
qui semble difficilement imaginable avant 1871, à Anzin surtout.
Ceci étant dit, reste que Zola, dans son opération de transposition, a parfaitement décrit
et compris le comportement des ouvriers grévistes de sa génération, comme une thèse
récente vient – indirectement – de le prouver. Il faudra certainement s’interroger un jour
sur le fait insolite du désintérêt des historiens français concernant le phénomène des
grèves. Mais nous allons très prochainement disposer d’une première approche,
l’excellent travail de Mme Michelle Perrot, les Ouvriers en grève (France (1871-1890),
thèse soutenue en 1971 et qui doit paraître ce mois-ci aux éditions Mouton.
La faim et l’irrationnel
La grève de Germinal se présente comme une grève causée par la faim : dans les débuts
de la IIIe République, la consommation ouvrière est encore alimentaire dans près de
70 % des budgets. Essentiellement salariale, elle ne porte pas sur la réduction de la
durée du travail qui sera encore longtemps, dans la pratique, au second plan, malgré le
fameux slogan des 3 x 8. Quand une grève éclate, au temps où les représentants du
libéralisme n’acceptent jamais la discussion, c’est une explosion qui les surprend
toujours. Rien n’a transpiré, et soudain personne ne répond à l’appel des sirènes. Une
organisation a-t-elle préparé soigneusement ce coup de force ? Non, dans la plupart des
cas. La morphologie de la grève de Germinal illustre à merveille l’ère des meneurs, qui’
ont effectivement dominé cette époque avant d’accéder au rang de mythe. Ce sont leurs
initiatives qui lancent les mouvements ; ils sont jeunes (Mme Perrot a établi un
pourcentage de 42 % entre vingt et vingt-neuf ans), célibataires et surtout hommes de
parole. Mais tout n’est pas rationnel dans les deux mille neuf cent vingt-trois grèves
recensées par Mme Perrot entre 1871 et 1890, et le jugement de l’historien-sdciologue
rejoint ici les intuitions du romancier : « Le ressentiment, la haine refoulée, l’espoir
d’un monde meilleur jettent les ouvriers hors de l’usine comme poussés par une force
irrésistible. La grève dépasse alors le jeu économique. Cri, fête, projet ou rêve, elle
cesse d’être démarche raisonnée de producteurs pour se muer en geste populaire, en
révolte globale aux significations multiples. »
Germinal est l’un des rares romans qui n’aient jamais subi d’éclipse, l’un des titres les
plus vendus dans la collection du « Livre de poche ». Par lui, Zola a ouvert au roman de
nouveaux domaines : l’étude d’un milieu professionnel devient un sujet romanesque ;
les luttes sociales, une forme d’intérêt dramatique. Pourtant, la haine que Zola inspirait
aux représentants de certains milieux mit longtemps à désarmer. Il est significatif de lire
sous la plume de René Johannet, auteur d’un essai intitulé l’Evolution du roman social
au dix-neuvième siècle et qui parut à Reims en 1910 sous le label de l’Action populaire,
les lignes suivantes : « Le roman social ne s’est pas encore débarrassé de la détestable
influence de Zola dont la lèpre a terni, pendant deux générations, toute jeunesse et
toute fleur. Faut-il, une fois de plus, noter les conséquences de son œuvre exactement
comparables à celles d’une épidémie tenace, alcoolisme intellectuel ou tuberculose
sociale ? » Suivent plusieurs pages de la même encre : Zola n’était justiciable que de
l’anathème, discuter son propos représentait déjà une compromission dégradante.
"Quand les sirènes se taisent"
Les voies de l’influence d’un écrivain sont heureusement encore impénétrables.
Qualifier un romancier de « Zola chrétien » aurait paru, avant 1914, une plaisanterie
quasi blasphématoire tant l’antinomie des deux termes paraissait monstrueuse. Or c’est
bien ainsi que la critique désigne souvent l’un des épigones du maître de Médan,
Maxence Van der Meersch. Fils d’un entrepreneur de Roubaix qui s’affichait comme
athée et anticlérical, le jeune Van der Meersch avait trouvé les œuvres de Zola dans la
bibliothèque de son père et il les lut avec passion. Il tient de lui sa méthode
documentaire et son sens de la fresque sociale dramatisée ; les deux hommes se
rencontrent aussi dans le combat qu’ils ont mené toute leur vie contre les diverses
formes de l’injustice sociale. Dès ses premières œuvres, Van der Meersch – qui fut
quelque temps avocat – n’a plaidé qu’un seul procès, le procès de ceux, de celles qui
souffrent des dures conditions de la vie sociale.
(Dans cette perspective, le J’accuse de Van der Meersch a été son roman Corps et
Ames, la plus formidable attaque jamais lancée contre les médecins français.) Comme
Zola et malgré son style heurté, parfois à la limite de l’incorrection, Van der Meersch
s’est imposé par la puissance de ses convictions. Il a cherché à communiquer à ceux qui
l’ignoraient sa hantise de la détresse ouvrière, il a voulu être un semeur d’inquiétude.
Quand les sirènes se taisent (1933) tient la troisième place dans la chronologie des
romans de Van der Meersch. Le titre reflète exactement le contenu du livre : toute
l’action se passe pendant une grève des ouvriers tisseurs de Roubaix. La référence et
l’hommage à Germinal figurent dès le début du roman : au cours de la réunion qui doit
décider de la grève, un jeune homme demande à prendre la parole. Aussitôt la foule crie
« Vive Germinal ! » Mais la comparaison pourrait presque s’arrêter là. Van der Meersch
n’est pas encore, il s’en faut, en possession de sa technique romanesque. A côté de
l’œuvre achevée de Zola, Quand les sirènes se taisent mérite d’être classé parmi les plus
effrayants mélodrames sociaux dont la fin du dix-neuvième siècle a été spécialement
prodigue. L’intrigue est simple, sans recherche de technique littéraire : les ouvriers du
textile roubaisien ne veulent pas payer la nouvelle cotisation exigée par la loi sur les
assurances sociales sans une augmentation de salaire. La « Fédération générale du
textile », qui groupe les industriels du Nord, refuse de céder. La grève est votée, elle se
déroule dans un terrible climat de violence, avec la mort d’un enfant de quatre ans tué
dans une charge de gardes mobiles et le meurtre d’un industriel – qui a pourtant proposé
la reprise du travail aux conditions imposées par les grévistes – brûlé vif dans sa voiture.
Finalement, le conflit se termine sans qu’on sache exactement pourquoi. Un seul
vainqueur dans cette affaire, le cabaretier : thème pour ainsi dire classique des
considérations patronales sur les grèves. En contrepoint du drame social, mais très mal
relié à lui. Van der Meersch s’est attaché aux amours tragiques d’un couple de
travailleurs, Laure et Jacques, qui se retrouveront in extremis alors que l’on a cru le
jeune homme tué dans une bagarre avec les gardes.
Certes, les notations ne manquent pas, dans ce roman, qui prouvent déjà, chez Van der
Meersch, des dons remarquables d’observation sociale. Il décrit exactement les courées
de Roubaix, aborde le problème des immigrés flamands, les « Flahutes », utilisés par les
industriels comme briseurs de grèves, et ne tombe à aucun moment dans l’ouvriérisme,
cette tentation majeure des écrivains « sociaux ». Sa peinture du milieu ouvrier de la
France du Nord atteste une connaissance précise du milieu géographique et humain qui
s’affirmera dans ses œuvres ultérieures. Toutefois, en tant que grévistes, les
protagonistes de Quand les sirènes se taisent n’ont pour ainsi dire aucune consistance
quand ils ne sont pas franchement caricaturaux. On sent, chez Van der Meersch, un
manque d’information sur la vie syndicale et ses militants. Du meneur de la grève,
Jacques, un ancien marin qui a bourlingué un peu partout, on sait seulement qu’il est
« socialiste » et il sera très vite dépassé par les événements, préférant se perdre dans
l’action, la quête pour les grévistes ou la bagarre. Regrettons également que la
C.G.T.U., la centrale « unitaire » où dominaient les communistes avant la réunification,
soit représentée ici par un personnage des plus louches qui sent la fabrication à l’aide
d’éléments fournis par la presse patronale. Honoré Demasure, époux d’une ancienne
prostituée, de l’argent plein les poches depuis le début de la grève (Van der Meersch ose
même employer l’expression de « fonds secrets »), lance ses camarades dans des actions
stupides auxquelles il se garde bien de participer. Il finira par se rallier au parti au
pouvoir (?) et deviendra employé, dans une mairie où il y a plus à gagner qu’avec les
communistes.
La physionomie la plus intéressante créée par Van der Meersch dans cet ouvrage
manqué – il n’a d’ailleurs pas été réédité depuis vingt ans, -est celle d’un ancien
instituteur, Pierre Jésarrez, révoqué pour avoir refusé d’accomplir une période de
réserve. C’est à notre connaissance le premier objecteur de conscience de notre
littérature. Profondément idéaliste, il se tient aux côtés des grévistes et, dans une
manifestation, il crèvera l’œil d’un garde mobile. Or celui-ci l’avait secouru et nourri. A
la fin du roman, on apprend qu’il fera tenir à Pierre, par l’un de ses amis, une somme
d’argent pour l’aider à se marier. Trop c’est trop, et il y a malheureusement beaucoup
d’épisodes de ce grain au cours du récit de Van ter Meersch.
L’observation scientifique de Roger Vailland
Zola et Van der Meersch ayant décrit des grèves ratées – il en est qui réussissent, près
de la moitié dans la période étudiée par Mme Perrot, – on pouvait se demander si un
romancier ne se déciderait pas, conformément à la « réalité des choses à à faire l’histoire
d’un conflit tournant à l’avantage des ouvriers. Peut-être fallait-il pour cette tâche
positive un militant averti : il est apparu un jour en la personne de Roger Vailland, qui a
donné en 1954, avec Beau Masque, une manière de chef-d’œuvre du roman
« syndical ».
En 1952, Roger Vailland, compagnon de route des communistes depuis la Résistance, a
pris sa carte du parti. Il habite dans l’Ain et fréquente des militants qui le renseignent
sur les luttes ouvrières, en particulier un ami cheminot, Henri Bourbon, ancien député
communiste de l’Ain. (En 1931-1932. Nizan, professeur au lycée de Bourg-en-Bresse,
participa lui aussi à la vie politique de cette région. Candidat communiste aux élections
législatives d’avril 1932, il obtint 80 voix.)
Pour la première fois dans l’œuvre de Vailland, des ouvriers seront ses personnages
principaux. Pour la première fois aussi, l’écrivain a étoffé l’intrigue romanesque qui,
dans ses livres précédents, était rigoureusement linéaire. Les travaux de Jean Recanati
(Esquisse pour la psychanalyse d’un libertin, Buchet-Chastel, 1971) ont bien mis en
lumière tout ce qu’une lecture psychanalytique de cette œuvre complexe apporte à la
connaissance de la personnalité de son auteur. Pierrette Amable, le personnage central
du roman, militante communiste et responsable du syndicat de la filature où elle
travaille, représente le double de Roger Vailland. Virilisée, taillée dans une matière
dure, plus faite pour pénétrer que pour être pénétrée, c’est une héroïne phallique qui ne
cédera pas longtemps à l’amour : il commençait à entamer sa vertu militante.
Avec Roger Vailland, nous sommes loin du lyrisme épique de Zola et de Van der
Meersch. Beau Masque est un roman « sec », où les aspects économiques et politiques
de la vie d’une région sont traités en priorité avec le détachement de l’observation
scientifique. La peinture de la grève n’occupe que la cinquième et dernière partie de
l’ouvrage, sa conclusion optimiste. Nous étions depuis longtemps préparés au succès de
l’action ouvrière : pouvait-il en être autrement avec des militants si bien formés à
exploiter toutes les contradictions de la bourgeoisie ? Ici, pas d’improvisations, pas de
harangues enflammées, pas de mouvements de foule désordonnés. La rationalité
militante triomphe.
Cependant l’auteur s’est facilité la tâche en choisissant des adversaires qui n’ont plus
l’étoffe des bourgeois conquérants du dix-neuvième siècle. Son Philippe Letourneau,
héritier décadent d’une dynastie de filateurs, ne semble pas entièrement crédible. Qu’il
soit le héros « négatif » conforme aux schémas déjà répandus par Guesde et Lafargue à
l’aube du vingtième siècle est une chose, mais son rapport à la réalité « objective » » en
est une autre. Il existe une certaine marge entre la lecture sporadique de Marx et la
remise à un membre du parti de documents condamnant sa propre famille. Sa passion,
peut-être, explique cette attitude puisque Philippe aime Pierrette, l’ennemie de classe.
Son suicide est présenté comme la cause de l’annulation des mesures de licenciement
qui frappaient les travailleurs de l’usine du Clusot. N’y a-t-il pas là une ambiguïté
curieuse ? Elle ne saurait surprendre de la part de Vailland, incapable de se plier
totalement aux impératifs du réalisme socialiste.
Trois grèves en soixante-dix ans dans le roman français, maigre recensement qui ne
prétend bien entendu nullement à l’exhaustivité. L’inventaire complet reste à
entreprendre, nous ne croyons pas qu’il serait très riche, pas plus que celui des
publications scientifiques analysant le même sujet. Peu d’ouvrages d’histoire sociale
traitant des conflits du travail existent à ce jour en France et encore moins d’études
sociologiques. Zola a devancé les spécialistes, personne n’a encore égalé Germinal.
Dans un pays où le mépris du travail manuel est toujours à l’honneur, pourquoi
s’étonner que la vie ouvrière ne soit pas un sujet d’inspiration pour les écrivains ?
Vous aimerez peut-être aussi
- Germinal de Zola - Partie V, chapitre 5: Commentaire de texteD'EverandGerminal de Zola - Partie V, chapitre 5: Commentaire de textePas encore d'évaluation
- L'Étranger d'Albert Camus (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandL'Étranger d'Albert Camus (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Gustave Flaubert, l'« homme-plume »: Entre romantisme et réalisme, un écrivain atypiqueD'EverandGustave Flaubert, l'« homme-plume »: Entre romantisme et réalisme, un écrivain atypiquePas encore d'évaluation
- Les Justes d'Albert Camus (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandLes Justes d'Albert Camus (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation
- Au Bonheur des dames d'Émile Zola (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frD'EverandAu Bonheur des dames d'Émile Zola (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frPas encore d'évaluation
- Les Misérables de Victor Hugo (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frD'EverandLes Misérables de Victor Hugo (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frPas encore d'évaluation
- La Condition humaine d'André Malraux: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Condition humaine d'André Malraux: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Peste d'Albert Camus (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frD'EverandLa Peste d'Albert Camus (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Samuel Beckett, l'écrivain du néant: Comment faire de l'antilittérature ?D'EverandSamuel Beckett, l'écrivain du néant: Comment faire de l'antilittérature ?Pas encore d'évaluation
- Edgar Allan Poe, un corbeau multicolore: L'histoire (extra)ordinaire d'un artiste mauditD'EverandEdgar Allan Poe, un corbeau multicolore: L'histoire (extra)ordinaire d'un artiste mauditPas encore d'évaluation
- Émile ZolaDocument10 pagesÉmile ZolaFilip NataliaPas encore d'évaluation
- RealislmeDocument5 pagesRealislmepapa yoroPas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire 958Document32 pagesQuinzaine Littéraire 958thanatonautePas encore d'évaluation
- Le Naturelisme Recent 7-03-12Document7 pagesLe Naturelisme Recent 7-03-12Poorna MahalingamPas encore d'évaluation
- Fiche de lecture illustrée - "L'Étranger", d'Albert CamusD'EverandFiche de lecture illustrée - "L'Étranger", d'Albert CamusPas encore d'évaluation
- Imaginaire et social et folie littéraire. Le Second Empire de Paulin GagneD'EverandImaginaire et social et folie littéraire. Le Second Empire de Paulin GagnePas encore d'évaluation
- Le tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"D'EverandLe tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"Pas encore d'évaluation
- Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandVoyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline: Les Fiches de Lecture d'UniversalisÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Le RéalismeDocument7 pagesLe Réalismepapa yoroPas encore d'évaluation
- La Fortune des Rougon d'Émile Zola (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frD'EverandLa Fortune des Rougon d'Émile Zola (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frPas encore d'évaluation
- Émile ZolaDocument3 pagesÉmile ZolaVudupecurkaPas encore d'évaluation
- Les Misérables de Victor Hugo: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Misérables de Victor Hugo: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le RomantismeDocument3 pagesLe RomantismeLidia QuesadaPas encore d'évaluation
- La Nausée de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Nausée de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Germinal La GreveDocument8 pagesGerminal La GreveEsther Bautista NaranjoPas encore d'évaluation
- Émile ZolaDocument3 pagesÉmile ZolaSandraPas encore d'évaluation
- Revue Du CrieurDocument17 pagesRevue Du Crieuretienneboisson7Pas encore d'évaluation
- Synthese de Cours D'isabelle TournierDocument14 pagesSynthese de Cours D'isabelle TournierLaurent AlibertPas encore d'évaluation
- Cours N° 3 L'après NaturalismeDocument4 pagesCours N° 3 L'après Naturalismemercibeaucoup7044Pas encore d'évaluation
- RéalismeDocument3 pagesRéalismeralantutsoaPas encore d'évaluation
- Le NaturalismeDocument21 pagesLe NaturalismeMakachPas encore d'évaluation
- Bibliographie HLP Terminale VERSION DEFINITIVEDocument3 pagesBibliographie HLP Terminale VERSION DEFINITIVEElodie DarréPas encore d'évaluation
- Victor Hugo: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandVictor Hugo: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Zola Biographie Naturalisme Contexte HistoriqueDocument8 pagesZola Biographie Naturalisme Contexte HistoriqueAymar BFDPas encore d'évaluation
- Les Rougon-Macquart: Tome 1 La Fortune des Rougon, La CuréeD'EverandLes Rougon-Macquart: Tome 1 La Fortune des Rougon, La CuréePas encore d'évaluation
- Huis Clos de Jean-Paul Sartre (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandHuis Clos de Jean-Paul Sartre (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Litterature Francaise Du XIXeme Siecle-Fiche Du ProfesseurDocument3 pagesLitterature Francaise Du XIXeme Siecle-Fiche Du ProfesseurAliceHopePas encore d'évaluation
- Le carnet d'or de Doris Lessing: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"D'EverandLe carnet d'or de Doris Lessing: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"Pas encore d'évaluation
- La Peau de chagrin d'Honoré de Balzac (Les Fiches de Lecture d'Universalis): Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLa Peau de chagrin d'Honoré de Balzac (Les Fiches de Lecture d'Universalis): Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Ulysse de James Joyce: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandUlysse de James Joyce: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Après Les Rougon-MacquartDocument4 pagesAprès Les Rougon-MacquartsaidPas encore d'évaluation
- Zola Et Les Conflits SociauxDocument10 pagesZola Et Les Conflits Sociauxviviana omedesPas encore d'évaluation
- Huis clos de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandHuis clos de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les Voix du silence d'André Malraux: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Voix du silence d'André Malraux: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- L' Amérique selon Sartre: Littérature, philosophie, politiqueD'EverandL' Amérique selon Sartre: Littérature, philosophie, politiquePas encore d'évaluation
- Biographie de Victor HugoDocument3 pagesBiographie de Victor Hugotaha AtikPas encore d'évaluation
- Germinal La GreveDocument8 pagesGerminal La GreveEsther Bautista NaranjoPas encore d'évaluation
- Les Liaisons Dangereuses GuideDocument4 pagesLes Liaisons Dangereuses GuidezouzouPas encore d'évaluation
- La Femme Dans Les Fleurs Du MalDocument5 pagesLa Femme Dans Les Fleurs Du MalEsther Bautista NaranjoPas encore d'évaluation
- Introduction Semiotique PDFDocument20 pagesIntroduction Semiotique PDFSerge KouakouPas encore d'évaluation
- Dinf Origine 8mars FRDocument2 pagesDinf Origine 8mars FRNassima ZiriatPas encore d'évaluation
- Nouvelle Et FDDocument11 pagesNouvelle Et FDEsther Bautista NaranjoPas encore d'évaluation
- Comparaison de Deux PoèmesDocument7 pagesComparaison de Deux PoèmesEsther Bautista Naranjo100% (1)
- Les SymbolesDocument4 pagesLes SymbolesEsther Bautista NaranjoPas encore d'évaluation
- Les SymbolesDocument4 pagesLes SymbolesEsther Bautista NaranjoPas encore d'évaluation
- Mythe Orphée XX SiècleDocument15 pagesMythe Orphée XX SiècleEsther Bautista NaranjoPas encore d'évaluation
- 2003 - Le Personnage de Roman, Du XVIIe A Nos Jours PDFDocument15 pages2003 - Le Personnage de Roman, Du XVIIe A Nos Jours PDFAnonymous IC3j0ZSPas encore d'évaluation
- Anatole France BalthazarDocument10 pagesAnatole France BalthazarEsther Bautista NaranjoPas encore d'évaluation
- Quest Ce Quun Mythe Litt SellierDocument16 pagesQuest Ce Quun Mythe Litt SellierOussama OuamariPas encore d'évaluation
- Délais Et FormalitésDocument1 pageDélais Et Formalitészzouitine7220Pas encore d'évaluation
- Invitation Biomr SimemDocument4 pagesInvitation Biomr SimemKhadidja BensmainePas encore d'évaluation
- M13-Technique de Vente OFPPT Par WWW - Ofppt1.blogspot - Com - 2Document43 pagesM13-Technique de Vente OFPPT Par WWW - Ofppt1.blogspot - Com - 2YoussefKemlanePas encore d'évaluation
- Dictionnaire de DonnéeDocument1 pageDictionnaire de Donnéejean5no5l5kangaPas encore d'évaluation
- Etapes de Deroulement Dun Programme de Sondage PDFDocument48 pagesEtapes de Deroulement Dun Programme de Sondage PDFOutman BenaouissPas encore d'évaluation
- Catálogo de Motores STMDocument238 pagesCatálogo de Motores STMSergio Nogales ZambranaPas encore d'évaluation
- HassanBENALLAL EpurationdeseauxuseesaumarocDocument43 pagesHassanBENALLAL Epurationdeseauxuseesaumarocnaima amzilPas encore d'évaluation
- Pompe A ChaleurDocument8 pagesPompe A Chaleurfarroukh med waelPas encore d'évaluation
- Polycopié Exes Audit VFDocument19 pagesPolycopié Exes Audit VFSoufianeBoumahdiPas encore d'évaluation
- Ed 7200Document2 pagesEd 7200MahjoubPas encore d'évaluation
- Tavaux Dirigés SoutienDocument9 pagesTavaux Dirigés SoutienOumarou Hamissou50% (2)
- Dictionnaireduweb Edition2015Document866 pagesDictionnaireduweb Edition2015Loic BastaraudPas encore d'évaluation
- Exposé de RouteDocument40 pagesExposé de RouteNaomie NdongPas encore d'évaluation
- PlaquetteSMDC PLVDocument16 pagesPlaquetteSMDC PLVAMALLLLLLLPas encore d'évaluation
- TPno1 InitiationauxAutomatesProgrammablesIndustriels APISiemensS7 300Document6 pagesTPno1 InitiationauxAutomatesProgrammablesIndustriels APISiemensS7 300halim otmanePas encore d'évaluation
- Erreurs Fréquentes SQLDocument3 pagesErreurs Fréquentes SQLAlioune Badara Thiakame100% (1)
- Exercice SDocument18 pagesExercice SMohamed ElhajamPas encore d'évaluation
- ISO 9202 2014-Character PDF DocumentDocument10 pagesISO 9202 2014-Character PDF DocumentHocine Chelghoum0% (1)
- VOIR Marche Du Bois 2020Document204 pagesVOIR Marche Du Bois 2020Bcd CdePas encore d'évaluation
- Programme CNFCCP - Talent ManagementDocument1 pageProgramme CNFCCP - Talent ManagementMoufid KarrayPas encore d'évaluation
- Examen Marketing de BaseDocument3 pagesExamen Marketing de BaseHilmi Mouna100% (2)
- Exposes Ligne ElectriqueDocument23 pagesExposes Ligne ElectriqueHabibe DJOMAKONPas encore d'évaluation
- TD HacheurDocument3 pagesTD HacheurNarutoPas encore d'évaluation
- Management Bancaire Les Moyens de Collecte Des Ressources de La BanqueDocument2 pagesManagement Bancaire Les Moyens de Collecte Des Ressources de La BanqueMéli SsaPas encore d'évaluation
- Ee Industrie Amee Module 3 PDFDocument26 pagesEe Industrie Amee Module 3 PDFDjebbar AliPas encore d'évaluation
- Examinateur: NGUEMETIA. FEUPI CYRILLE (PLEG Physique)Document2 pagesExaminateur: NGUEMETIA. FEUPI CYRILLE (PLEG Physique)Ibrahim OuarePas encore d'évaluation
- Aviation Pilote 587Document84 pagesAviation Pilote 587laurent jubeau0% (1)
- BC401 - ABAP Objects N3XT FR V5Document178 pagesBC401 - ABAP Objects N3XT FR V5Rokhaya SowPas encore d'évaluation
- Contribution VFO MEPDocument18 pagesContribution VFO MEPvendezioPas encore d'évaluation
- Exigences Norme ISO 45001.Document1 pageExigences Norme ISO 45001.Boubacar MbowPas encore d'évaluation