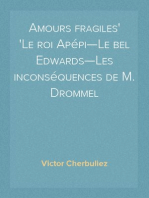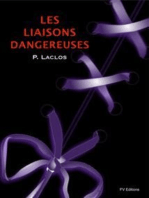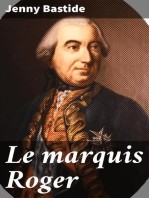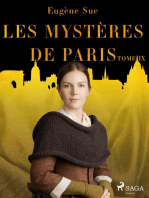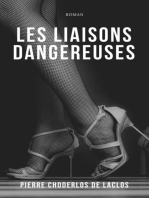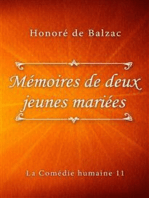Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Roman
Transféré par
cyber saadaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Roman
Transféré par
cyber saadaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Texte 1 : Le portrait élogieux de la Princesse de Clèves
Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde, et l’on
doit croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle donna de l’admiration
dans un lieu où l’on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de
la même maison que le Vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières
de France. Son père était mort jeune et l’avait laissée sous la conduite de Mme
de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient
extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années
sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à
l’éducation de sa fille ; mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit
et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre
aimable. La plupart des mères s’imaginent qu’il suffit de ne parler jamais de
galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Mme de Chartres
avait une opinion opposée : elle faisait souvent à sa fille des peintures de
l’amour ; elle lui montrait ce qu’il a d’agréable pour la persuader plus aisément
sur ce qu’elle lui en apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité
des hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les malheurs domestiques où
plongent les engagements ; et elle lui faisait voir, d’un autre côté, quelle
tranquillité suivait la vie d’une honnête femme, et combien la vertu donnait
d’éclat et d’élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance ;
mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu
que par une extrême défiance de soi-même et par un grand soin de s’attacher
à ce qui seul peut faire le bonheur d’une femme, qui est d’aimer son mari et
d’en être aimée.
Cette héritière était alors un des grands partis qu’il y eût en France, et,
quoiqu’elle fût dans une extrême jeunesse, l’on avait déjà proposé plusieurs
mariages. Mme de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait
presque rien digne de sa fille : la voyant dans la seizième année, elle voulut la
mener à la cour.
Lorsqu’elle arriva, le Vidame alla au-devant d’elle : il fut surpris de la grande
beauté de Mlle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son
teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l’on n’a jamais vu qu’à
elle ; tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins
de grâces et de charmes.
La Princesse de Clèves, Madame de La Fayette, 1678.
Texte 2 : L’aveu
-Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que
l'on n'a jamais fait à son mari ; mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en
donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je veux éviter les
périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle
marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté
de me retirer de la cour ou si j'avais encore Mme de Chartres pour aider à me conduire.
Quelque dangereux que soit le parti que je prends, je le prends avec joie pour me conserver
digne d'être à vous. Je vous demande mille pardons, si j'ai des sentiments qui vous
déplaisent, du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce
que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu ;
conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore, si vous pouvez.
M. de Clèves était demeuré, pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de
lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme.
Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux le visage
couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur, et l'embrassant
en la relevant :
-Ayez pitié de moi, vous-même, madame, lui dit-il, j'en suis digne; et pardonnez si, dans les
premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas, comme
je dois, à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration
que tout ce qu'il y a jamais eu de femmes au monde; mais aussi je me trouve le plus
malheureux homme qui ait jamais été. Vous m'avez donné de la passion dès le premier
moment que je vous ai vue ; vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre : elle dure
encore ; je n'ai jamais pu vous donner de l'amour, et je vois que vous craignez d'en avoir
pour un 20 autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte ?
Depuis quand vous plaît-il ?
Qu'a-t-il fait pour vous plaire ? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Je m'étais
consolé en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être.
Cependant un autre fait ce que je n'ai pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle
d'un amant; mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. Il
est trop noble pour ne me pas donner une sûreté entière;
il me console même comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi
sont d'un prix infini : vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu.
Vous avez raison, madame, je n'en abuserai pas et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me
rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à
son mari.
Mme de Lafayette :La Princesse de Clèves 1678 : scène de l’aveu.
Texte 3 : L’incipit de L’Étranger.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un
télégramme de l'asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments
distingués.» Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier.
L'asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres d'Alger. Je
prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je
pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à
mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il
n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit:« Ce n'est pas de ma faute.»
Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En
somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses
condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en
deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après
l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une
allure plus officielle.
J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant,
chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi
et Céleste m'a dit: « On n'a qu'une mère. » Quand je suis parti, ils m'ont
accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi, parce qu'il a fallu que je monte
chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu
son oncle, il y a quelques mois.
J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à
cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots, à l'odeur d'essence, à la
réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant
presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un
militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit «oui »
pour n'avoir plus à parler.
L’Étranger, Albert Camus, 1942.
Texte 4 : Stendhal, La Chartreuse de Parme, partie II, chapitre
XVIII, 1839.
La Chartreuse de Parme raconte l’itinéraire d’un jeune aristocrate italien, Fabrice
Del Dongo. Victime d’une vengeance, le personnage est emprisonné dans la
citadelle de Parme. Le gouverneur de cette forteresse est le général Fabio Conti,
que Fabrice avait croisé avec sa fille Clélia sept années plus tôt. Fabrice vient de
revoir la jeune fille.
Il courut aux fenêtres ; la vue qu’on avait de ces fenêtres grillées était
sublime : un seul petit coin de l’horizon était caché, vers le nord-ouest, par
le toit en galerie du joli palais du gouverneur, qui n’avait que deux étages ;
le rez-de-chaussée était occupé par les bureaux de l’état-major ; et d’abord
les yeux de Fabrice furent attirés vers une des fenêtres du second étage, où
se trouvaient, dans de jolies cages, une grande quantité d’oiseaux de toute
sorte. Fabrice s’amusait à les entendre chanter, et à les voir saluer les
derniers rayons du crépuscule du soir, tandis que les geôliers 1 s’agitaient
autour de lui. Cette fenêtre de la volière n’était pas à plus de vingt-cinq
pieds de l’une des siennes, et se trouvait à cinq ou six pieds en contrebas,
de façon qu’il plongeait sur les oiseaux.
Il y avait lune ce jour-là, et au moment où Fabrice entrait dans sa prison, elle
se levait majestueusement à l’horizon à droite, au-dessus de la chaîne des
Alpes, vers Trévise. Il n’était que huit heures et demie du soir, et à l’autre
extrémité de l’horizon, au couchant, un brillant crépuscule rouge orangé
dessinait parfaitement les contours du mont Viso et des autres pics des
Alpes qui remontent de Nice vers le Mont-Cenis et Turin ; sans songer
autrement à son malheur, Fabrice fut ému et ravi par ce spectacle sublime.
« C’est donc dans ce monde ravissant que vit Clélia Conti ! avec son âme
pensive et sérieuse, elle doit jouir de cette vue plus qu’un autre ; on est ici
comme dans des montagnes solitaires à cent lieues de Parme. » Ce ne fut
qu’après avoir passé plus de deux heures à la fenêtre, admirant cet horizon
qui parlait à son âme, et souvent aussi arrêtant sa vue sur le joli palais du
gouverneur que Fabrice s’écria tout à coup : « Mais ceci est-il une prison ?
est-ce là ce que j’ai tant redouté ? » Au lieu d’apercevoir à chaque pas des
désagréments et des motifs d’aigreur, notre héros se laissait charmer par les
douceurs de la prison.
La Chartreuse de Parme, Stendhal, 1839.
Vous aimerez peut-être aussi
- La Princesse de Clèves - Séquence - 2020-21 (Textes)Document5 pagesLa Princesse de Clèves - Séquence - 2020-21 (Textes)lyblancPas encore d'évaluation
- Utilisateur - Pour Les Premières 3pdfDocument5 pagesUtilisateur - Pour Les Premières 3pdffan ClubPas encore d'évaluation
- Etudes Linéaires P de C Et Textes Du Parcours AssociéDocument5 pagesEtudes Linéaires P de C Et Textes Du Parcours Associébabadu34Pas encore d'évaluation
- Amours fragiles Le roi Apépi—Le bel Edwards—Les inconséquences de M. DrommelD'EverandAmours fragiles Le roi Apépi—Le bel Edwards—Les inconséquences de M. DrommelPas encore d'évaluation
- La Comédie humaine. Volume II: Scènes de la vie privée. Tome IID'EverandLa Comédie humaine. Volume II: Scènes de la vie privée. Tome IIPas encore d'évaluation
- Les liaisons dangereuses (Illustré)D'EverandLes liaisons dangereuses (Illustré)Évaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- La Comédie Humaine - Etudes de Moeurs: Livre Premier - Tome IID'EverandLa Comédie Humaine - Etudes de Moeurs: Livre Premier - Tome IIPas encore d'évaluation
- La femme auteur, tome 2/2 ou les inconvéniens de la célébritéD'EverandLa femme auteur, tome 2/2 ou les inconvéniens de la célébritéPas encore d'évaluation
- Le Misanthrope de Molière - Acte V, scène 4: Commentaire de texteD'EverandLe Misanthrope de Molière - Acte V, scène 4: Commentaire de textePas encore d'évaluation
- Aurélie, ou le Monde et la piétéD'EverandAurélie, ou le Monde et la piétéPas encore d'évaluation
- Mémoires du cardinal de Retz écrits par lui-même à Madame de ***D'EverandMémoires du cardinal de Retz écrits par lui-même à Madame de ***Pas encore d'évaluation
- Le Canapé couleur de feu, par M. de ***D'EverandLe Canapé couleur de feu, par M. de ***Pas encore d'évaluation
- L'Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut: Un roman-mémoires de l'abbé PrévostD'EverandL'Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut: Un roman-mémoires de l'abbé PrévostPas encore d'évaluation
- Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome troisième - première partieD'EverandMémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome troisième - première partiePas encore d'évaluation
- Une Amazone sous le Premier Empire: Vie d'Ida Saint-ElmeD'EverandUne Amazone sous le Premier Empire: Vie d'Ida Saint-ElmePas encore d'évaluation
- Corpus - Les Liaisons Dangereuses - Extraits Des Lettres-1Document10 pagesCorpus - Les Liaisons Dangereuses - Extraits Des Lettres-1anasghedira02062007Pas encore d'évaluation
- Georges Sand - La MarquiseDocument270 pagesGeorges Sand - La Marquiseanneless14Pas encore d'évaluation
- Extraits de Manon LescautDocument13 pagesExtraits de Manon Lescautlillyta2007Pas encore d'évaluation
- Descriptif 2023Document18 pagesDescriptif 2023NCECPas encore d'évaluation
- Princesse de Clèves Arrivée À La CourDocument1 pagePrincesse de Clèves Arrivée À La CourA.- A.YPas encore d'évaluation
- FrançaisDocument3 pagesFrançaisBenardPas encore d'évaluation
- PDC Texte 3 CopieDocument1 pagePDC Texte 3 CopieA.- A.YPas encore d'évaluation
- Supports LL N°1 À 13 Bac BlancDocument17 pagesSupports LL N°1 À 13 Bac BlancZur LilonPas encore d'évaluation
- Saggio Breve N°3Document3 pagesSaggio Breve N°3giacomina urbanoPas encore d'évaluation
- Ecrit D Appropriation Sur Madame de La FayetteDocument17 pagesEcrit D Appropriation Sur Madame de La FayettePaul RicordelPas encore d'évaluation
- P. Corneille - Le MenteurDocument82 pagesP. Corneille - Le MenteurSabine BinousePas encore d'évaluation
- Liste Bac 2019 - Lectures AnalytiquesDocument14 pagesListe Bac 2019 - Lectures AnalytiquesAlionPas encore d'évaluation
- Balzac 15 Le MessageDocument34 pagesBalzac 15 Le MessagealdenaldensonnPas encore d'évaluation
- Maupassant L'Inutile Beauté - Maupassant - Linutile - BeauteDocument256 pagesMaupassant L'Inutile Beauté - Maupassant - Linutile - Beauterebu100% (1)
- BG Epreuve Anticipee Francais L 2018Document9 pagesBG Epreuve Anticipee Francais L 2018LETUDIANT100% (1)
- G° 50 EURL SOCOINOX SERVICE (2023.11) Novembre 2023Document3 pagesG° 50 EURL SOCOINOX SERVICE (2023.11) Novembre 2023cyber saadaPas encore d'évaluation
- Attestation de Travail ZitouniDocument1 pageAttestation de Travail Zitounicyber saadaPas encore d'évaluation
- Memoire OmarDocument36 pagesMemoire Omarcyber saadaPas encore d'évaluation
- Auto Ecole TimgadDocument1 pageAuto Ecole Timgadcyber saadaPas encore d'évaluation
- Autorisation Parental YOUNSIDocument1 pageAutorisation Parental YOUNSIcyber saadaPas encore d'évaluation
- Auto École ZiboucheDocument1 pageAuto École Zibouchecyber saadaPas encore d'évaluation
- Attestation Sur L'honneur de Prise en ChargeDocument1 pageAttestation Sur L'honneur de Prise en Chargecyber saadaPas encore d'évaluation
- SupplémentDocument2 pagesSupplémentcyber saadaPas encore d'évaluation
- Aliénation en PsychanalyseDocument26 pagesAliénation en Psychanalyseaysegul222Pas encore d'évaluation
- Historique Loto Excel Depuis 1976 Tirages ResultatsDocument601 pagesHistorique Loto Excel Depuis 1976 Tirages ResultatsChristian Nelson Eyoum0% (1)
- Proces Verbal de Deliberations SemestrielDocument2 pagesProces Verbal de Deliberations Semestrielzeby nemiPas encore d'évaluation
- EPP Utilisation IGEQSIDocument1 pageEPP Utilisation IGEQSIreamédicalePas encore d'évaluation
- Examen Fertilisation 2021Document2 pagesExamen Fertilisation 2021daniel.nove1Pas encore d'évaluation
- GuideDocument2 pagesGuideNaniBenPas encore d'évaluation
- La ModalisationDocument2 pagesLa ModalisationFouzia Badi100% (3)
- La Puissance de Votre Parole DON GOSSETT & E. W. KENYONDocument247 pagesLa Puissance de Votre Parole DON GOSSETT & E. W. KENYONGilles ADAMAPas encore d'évaluation
- 04 - CR1 200202CCN2 - GB 014 Enclume - Etude de Formulation - 220921Document48 pages04 - CR1 200202CCN2 - GB 014 Enclume - Etude de Formulation - 220921marius fangangPas encore d'évaluation
- Ceci Est Notre Dogme - (Par Le Sheikh Abou Mohamed Al Maqdissi)Document65 pagesCeci Est Notre Dogme - (Par Le Sheikh Abou Mohamed Al Maqdissi)AhadouneAahadePas encore d'évaluation
- 2ème Dimanche de CarêmeDocument1 page2ème Dimanche de CarêmeJoel KisoniPas encore d'évaluation
- Résumé Droit Commercial s4Document5 pagesRésumé Droit Commercial s4Asmaa Lahouaoui100% (5)
- Cameroun - Projet de Construction D'infrastructures de Réparation de Plates-Formes Pétrolières A Limbé - Rapport D'évaluation PDFDocument83 pagesCameroun - Projet de Construction D'infrastructures de Réparation de Plates-Formes Pétrolières A Limbé - Rapport D'évaluation PDFMoonRiMouPas encore d'évaluation
- Cours Législation de Travail-Séance Introductive PDFDocument28 pagesCours Législation de Travail-Séance Introductive PDFM'ąrouä AssedmerPas encore d'évaluation
- Nothing Else MattersDocument2 pagesNothing Else MattersDelta StatePas encore d'évaluation
- Correction Chap It Re 8Document6 pagesCorrection Chap It Re 8safa berkani100% (1)
- Missions MarketingDocument6 pagesMissions MarketingBEGBIN100% (1)
- LST Version FinaleDocument2 pagesLST Version Finaledey.ferrier.ramPas encore d'évaluation
- ElectroDocument14 pagesElectroceline naPas encore d'évaluation
- Rapport Du StageDocument2 pagesRapport Du StageSOFYANE BOUJAMAOUIPas encore d'évaluation
- Ministere de La Voix de Minuit MATHIEU 25: 1 - 6: Chretien Obtenir Notre DieuDocument2 pagesMinistere de La Voix de Minuit MATHIEU 25: 1 - 6: Chretien Obtenir Notre DieuCLARA AKLEPas encore d'évaluation
- ConsentementDocument1 pageConsentementWillyPas encore d'évaluation
- Convention Irsa Maj Dec 2019Document165 pagesConvention Irsa Maj Dec 2019Cédric BatistaPas encore d'évaluation
- Le Monde 27 Octobre 2022Document32 pagesLe Monde 27 Octobre 2022mikeybhabaPas encore d'évaluation
- Les Petites Entreprises Méfient La BRVMDocument8 pagesLes Petites Entreprises Méfient La BRVMEdi SambuPas encore d'évaluation
- Management Des Compétences Et Organisation Par Projets, Une Mise en Évidence Des Leviers de GestionDocument12 pagesManagement Des Compétences Et Organisation Par Projets, Une Mise en Évidence Des Leviers de Gestionnappil100% (1)
- Ms Arc SaidiDocument111 pagesMs Arc SaidiBrahim MouhcinePas encore d'évaluation
- Correction Test Eco 3A Session Printemps 2021 Version ExerciceDocument14 pagesCorrection Test Eco 3A Session Printemps 2021 Version ExercicemahdiPas encore d'évaluation
- Chapitre III Les Polluants Org Et InorgDocument11 pagesChapitre III Les Polluants Org Et InorgmortadaPas encore d'évaluation
- Les 70 Semaines Du Prophète DanielDocument362 pagesLes 70 Semaines Du Prophète Danielkouadio yao Armand0% (1)