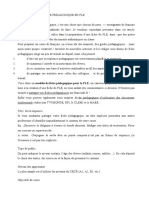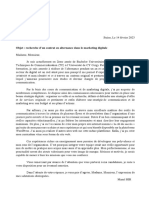Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
3 6 Regroupement Activites Regulieres
3 6 Regroupement Activites Regulieres
Transféré par
blsdonna2Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
3 6 Regroupement Activites Regulieres
3 6 Regroupement Activites Regulieres
Transféré par
blsdonna2Droits d'auteur :
Formats disponibles
2. Les activités régulières.
Les
échanges langagiers liés directement aux
apprentissages en cours : lancement et retour
d’activités, bilan de journée ou demi-journée
L’enseignant jalonne la journée avec ces différents moments. Ils ne sont cependant pas à vivre comme
de simples transitions entre deux activités, mais bien comme des situations hautement pédagogiques
où le langage va jouer un rôle déterminant pour orienter et donner sens aux activités proposées aux
enfants. C’est de cette manière que s’élabore collectivement et progressivement le contrat didactique lié
aux activités proposées.
L’activité de l’élève est indispensable pour apprendre à la maternelle. Elle n’est cependant pas suffisante
pour garantir son engagement et sa compréhension dans un apprentissage ciblé. Il ne suffit pas de
mettre les enfants en activité en classe pour qu’ils s’approprient les savoirs, savoir-faire sur lesquels est
construite la séance qui leur est proposée.
Le lancement, le retour et le bilan d’activités sont, grâce à la mise en mots, des moments de mise de
distance des gestes et des actions des enfants. Ainsi tous les actes collectifs de langage pendant, après
et avant l’action sont à orienter pour créer une dynamique d’apprentissage. Il s’agit de faire évoluer
les actions de enfants, leur activité pour la transformer en expérience partagée donnant accès à la
construction de nouvelles compétences.
L’objet de l’échange qui a lieu entre les enfants et entre les enfants et l’enseignant “avant, pendant et
après” l’activité ne varie pas : du lancement de l’activité jusqu’au bilan on parle et on revient sur
les actions et leurs résultats. Le but de ces différents moments est ainsi de construire une culture
commune de la classe à deux niveaux :
• la tâche donnée, ses contraintes et ses enjeux ;
• des éléments de langage pour parler de l’action propre à chacun en lien avec cette tâche.
L’enseignant observe les modifications progressives de points de vue de ses élèves entre le lancement,
le retour et le bilan d’activités. Ces modifications se manifestent sous différentes formes et évoluent dans
le temps de l’apprentissage : dans la réussite de la tâche de l’enfant, dans sa volonté de refaire et de
modifier pour réussir, dans son engagement, dans son attention, dans son appropriation de conduites
langagières pour décrire, justifier, expliquer, contredire, compléter les propos d’un autre enfant dans le
groupe.
2.1. L’organisation
Il est essentiel que dans tous ces moments autour de l’activité des enfants, l’échange soit conduit en
présence des objets, du matériel utilisé, mais aussi de toutes les traces de l’activité (photos, dessins,
représentations…), et des productions/réalisations des élèves. Un espace de la classe est aménagé
pour ces moments récurrents de langage sur les activités menées. Le plus souvent c’est au coin
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 7
Partie I.2 - L’oral - L’oral travaillé dans les situations pédagogiques régulières
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle
regroupement que l’on aménage un espace d’affichage (photos, photocopies, affiches…) ainsi qu’un
espace de présentation de matériaux, d’objets…
Dans tous ces moments d’échanges, pour faciliter l’interaction entre les enfants et entre les enfants et
l’enseignant, il est indispensable d’aménager l’espace pour que chaque enfant ait une place assise. Les
places assises au sol ne sont pas adaptées à l’enjeu de ces moments, elles n’aident pas les enfants à
prendre et garder une posture favorable à une attention, une écoute active. Quand le nombre d’enfants
est très important par rapport à la taille de la classe, il est possible de prévoir d’ajouter temporairement
pour ce moment un banc ou des chaises qui retrouveront ensuite leur place au sein de la classe.
Quand l’activité a lieu hors de la classe, il est indispensable d’aménager un espace à l’écart de l’activité
pour asseoir ponctuellement les enfants dans une position qui leur permettra d’être disponibles pour se
remémorer, observer un camarade en action, décrire des gestes, des procédures adoptées… (Consulter
dans les ressources pour la classe : Propositions d’aménagements « Aménager le coin rassemblement
pour favoriser les interactions langagières »)
2.2. Les gestes professionnels à adopter
2.2.1. Dès le moment de la préparation
Anticiper les mots utilisés tout au long du projet d’apprentissage. Ils sont donnés pendant l’activité
et repris après chaque séance pour parler de l’activité. Employés surtout par l’enseignant dans un premier
temps, qui les utilisent pour reformuler les actions et les intentions des enfants, ils seront progressivement
utilisés par eux pour échanger sur leurs productions. L’enseignant reste attentif à l’utilisation de ce
vocabulaire de spécialité par les enfants tout au long des séances.
Exemple dans une classe de moyenne section.
Projet de réalisation de la pâte à papier
Ce travail de formulation a priori dans un lexique de spécialité de l’activité et des notions cibles de
l’apprentissage aide à déterminer le vocabulaire qui sera travaillé avec les enfants. Exemples de
formulations prévues par l’enseignant pour accompagner, réparties tout au long des séances, l’activité
des enfants :
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
8 Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Partie I.2 - L’oral - L’oral travaillé dans les situations pédagogiques régulières
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle
• En premier (d’abord), vous déchirez de petits morceaux de papier journal que vous mettez dans
une bassine.
• Après, vous versez de l’eau sur les petits morceaux de papier et vous malaxez avec les mains.
• Ensuite, vous ajoutez 3 gouttes d’encre avec une pipette.
• Puis vous mixez la pâte avec un mixer.
• Après, vous étalez avec les mains une fine couche de pâte à papier sur le tamis.
• Ensuite, vous recouvrez le tamis d’une lingette, vous le retournez avec la maîtresse, vous posez
une autre lingette par-dessus et vous aplatissez avec le rouleau à pâtisserie.
• Enfin, vous retirez la lingette et vous laissez sécher.
2.2.2. Concernant le lancement de l’activité
Formuler la tâche prescrite dans la consigne en utilisant un vocabulaire choisi avec attention (noms,
verbes, prépositions, adjectifs, etc.) : ce vocabulaire, souvent de spécialité, fait partie de l’explication et
de la négociation de l’activité avec les enfants, avant d’être l’outil privilégié du groupe classe pour parler
de leur activité dans le cadre déterminé par l’enseignant. Il est donc adapté et choisi avec pertinence car
il sera utilisé également pendant et après l’activité.
Exemples en graphisme
Petite section
• Laisser des traces et des empreintes avec ses mains et avec de petits objets de la classe.
• Tracer des chemins avec des petites voitures qui ont roulé dans la peinture.
• Tracer, avec le fusain, des lignes qui contournent les obstacles.
Moyenne section
• Reproduire un motif choisi.
• Remplir la feuille de papier de soie en variant la taille de la forme choisie.
Grande section
• A l’aide du papier calque, repasser sur les lignes du plan du jardin.
• Reproduire à l’identique (exactement comme ils sont) les lignes et les motifs qui composent les
grilles photographiées.
Formuler la consigne pour rendre la tâche d’apprentissage compréhensible et lisible dans l’activité
proposée : il faut veiller à ce que les indications portant sur le matériel et les aspects organisationnels
ne détournent pas l’attention des enfants de la tâche qui leur est proposée. C’est souvent l’origine de
malentendus dans le contrat didactique : l’enfant interprète la consigne donnée pour la réduire à une
activité plus simple. Par exemple, dans un travail de phonologie de scansion des syllabes, certains
enfants pensent que ce que l’enseignant attend d’eux, c’est qu’ils frappent dans leurs mains en répétant
les mots donnés.
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 9
Partie I.2 - L’oral - L’oral travaillé dans les situations pédagogiques régulières
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle
Exemple en danse (petite/moyenne section)
« Je vous distribue la plume légère, elle vole, elle chute lentement. Je vous regarde faire danser la plume
en la faisant voler puis en chutant lentement comme elle. »
Exemple en littérature (moyenne et grande section)
« Je vous donne des images qui racontent l’histoire de la petite poule rousse. C’est à vous de les ranger
pour raconter ce qui arrive à la petite poule rousse au fur et à mesure de cette histoire. Pour cela je vous
donne une bande avec un point pour coller l’image qui commence l’histoire. »
Donner la consigne aux élèves en présence du support de l’activité et des outils disponibles. Autant que
possible, il conviendrait de commencer par donner à voir un ou plusieurs résultats réussis de la tâche
donnée, ce qui est possible en cas de rotation des ateliers. Un groupe peut avoir déjà effectué le travail.
La consigne contient plusieurs informations qui n’ont pas le même enjeu :
• niveau 1 : l’organisation même de l’activité : le lieu/ les participants/ le matériel utilisé/ les règles
d’organisation ;
• niveau 2 : la contextualisation : le lien avec ce qui a précédé ou l’avancée du projet ;
• niveau 3 : la tâche, ses critères de réalisations, ses contraintes, son enjeu d’apprentissage ainsi
que les opérations mentales sollicitées.
Il convient de bien marquer cette différence dans la formulation même de la consigne en insistant sur les
informations de niveau 2 qui sont les plus difficiles à comprendre. La reformulation par les enfants de “ce
qu’il y a à faire” porte sur ce niveau de la consigne et non sur le déroulement de l’activité.
Exemple en littérature - grande section
“Nous avons commencé à faire le portrait du loup à partir de l’histoire du petit chaperon rouge et des trois
petits cochons. Aujourd’hui, je vous ai apporté des illustrations de loup : il y en a dix, vous allez discuter
ensemble pour ne garder que cinq photos : celles qui, à votre avis, représentent le mieux le loup. Quand
vous avez fini, vous les collez sur cette affiche. Attention, il s’agit de dire les raisons pour lesquelles vous
gardez cette illustration plutôt qu’une autre. Vous pouvez entourer des éléments de l’image pour vous
souvenir de vos raisons. Nous vous écouterons quand tous les enfants auront fait ce travail. Enzo, tu
nous redis ce qu’il y a à faire dans cet atelier ? Qu’est-ce qui est important ? ”.
2.2.3. Retour ou bilan d’activités
L’enseignant s’appuie sur des substituts des situations. Lors du bilan des activités faites, pour revenir
sur les événements, actions vécues ou notions comprises, il est efficace d’utiliser des supports divers :
support d’images, de dessins, de photographies, de représentations ou de témoignages visuels des
événements vécus. Les images facilitent la restructuration collective des représentations mémorisées.
L’enseignant incite les élèves à parler sur ces images et à propos de ce qu’elles représentent ou évoquent
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
10 Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Partie I.2 - L’oral - L’oral travaillé dans les situations pédagogiques régulières
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle
Un exemple en petite section
Des enfants de PS ont exploré en salle de jeu les actions de grimper, s’équilibrer et redescendre.
L’enseignante, à l’aide des photos, revient sur ces actions, pour les nommer et les décrire. Cette phase
de langage peut faire l’objet d’une activité longue et pas seulement d’un retour.
Les enfants peuvent aussi disposer d’un matériel
miniature pour faire revivre les activités qu’ils
ont eues au petit personnage tout en relatant ce
qu’ils font.
Le retour d’activité peut également être l’occasion
de construire des affiches récapitulatives de ce
qui a été fait en atelier.
Un exemple en moyenne section : utiliser, manipuler des objets
En moyenne et grande section, on peut aussi faire dessiner ce qui a été vécu, mettre en ordre les
différents dessins produits, combler les lacunes, puis, à ce moment seulement, amener les enfants à
relater cet évènement.
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 11
Partie I.2 - L’oral - L’oral travaillé dans les situations pédagogiques régulières
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle
Un exemple en grande section
Les enfants ont dessiné des représentations de la position du « cochon pendu » expérimentée par l’une
d’entre eux. Ils comparent les dessins qu’ils ont faits puis les confrontent à une photographie prise par
l’enseignante.
Consulter dans les ressources pour la classe :
• Le tableau d’indicateurs n° 4 « Éléments de programmation des échanges pédagogiques de la
petite à la grande section : lancement, retour et bilan d’activités »
• Vidéo Le parcours EPS, DVD Apprendre à parler 2010 séance 9
• Vidéo Le cochon pendu, DVD paroles et langage 1999 séquence 6
• Vidéo Comprendre et reformuler, DVD paroles et langage 1999 séquence 4
• Vidéos « Lancement et retour d’activités dans une classe de petite section, et moyenne section »,
et « retour et bilan d’activités dans une classe de moyenne et grande section » 2 vidéos en cours de
réalisation.)
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
12 Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Partie I.2 - L’oral - L’oral travaillé dans les situations pédagogiques régulières
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle
Vous aimerez peut-être aussi
- Retz - Jeux Graphiques Autour Des LettresDocument67 pagesRetz - Jeux Graphiques Autour Des LettresBeatriz CaamañoPas encore d'évaluation
- English B Paper 2 Reading Comprehension HL MarkschemeDocument6 pagesEnglish B Paper 2 Reading Comprehension HL MarkschemeSol Carvajal0% (1)
- Coquelicot. Français. Collection CM2. Guide PédagogiqueDocument11 pagesCoquelicot. Français. Collection CM2. Guide Pédagogiqueelqars75% (12)
- Comment Rédiger Un Plan D'affaires Pour Une École Privée (Exemple de Modèle)Document11 pagesComment Rédiger Un Plan D'affaires Pour Une École Privée (Exemple de Modèle)AndrePas encore d'évaluation
- Concevoir Une Fiche PédagogiqueDocument6 pagesConcevoir Une Fiche PédagogiqueAdama Dacko0% (1)
- Concevoir Une Fiche Pedagogique en FleDocument5 pagesConcevoir Une Fiche Pedagogique en FleMarin Gheorghe-Marin100% (2)
- CE1 Introduction Guide CoquelicotDocument8 pagesCE1 Introduction Guide CoquelicotAmor MansouriPas encore d'évaluation
- Guide Pedagogique Rond Point 2Document103 pagesGuide Pedagogique Rond Point 2dahkeya67% (3)
- L'approche CommunicativeDocument19 pagesL'approche CommunicativeAngel LagualPas encore d'évaluation
- Atelier LexiqueDocument23 pagesAtelier LexiqueSamaPas encore d'évaluation
- Fiches - Oasis Des Mots - 2aep-1Document100 pagesFiches - Oasis Des Mots - 2aep-1Said RochdiPas encore d'évaluation
- Visit PDFcours - Com Powerpoint Comprendre Et Apprendre en Maternelle - PDF 505Document32 pagesVisit PDFcours - Com Powerpoint Comprendre Et Apprendre en Maternelle - PDF 505Anjara VestalysPas encore d'évaluation
- Fiches Unité 2 L'oasis Des Mots 3AEP OMAR ESSERHANIDocument29 pagesFiches Unité 2 L'oasis Des Mots 3AEP OMAR ESSERHANIMohammed TAMRARADPas encore d'évaluation
- Diaporama 2Document21 pagesDiaporama 2Elena Nicoleta IftodePas encore d'évaluation
- Zoom3 - GuideDocument71 pagesZoom3 - GuideNguyễn HoanPas encore d'évaluation
- Gere Ret PreparerDocument8 pagesGere Ret PreparerHassan AcharkiPas encore d'évaluation
- Ress c1 Langage Oral Coin 457870Document11 pagesRess c1 Langage Oral Coin 457870demareeyPas encore d'évaluation
- Langage Ecole Maternelle BouysseDocument11 pagesLangage Ecole Maternelle BouysseTheLookinesisPas encore d'évaluation
- Diaporama-De-Lanimation LE LANGAGE A L'ECOLE MATERNELLE CPC MAURIACDocument54 pagesDiaporama-De-Lanimation LE LANGAGE A L'ECOLE MATERNELLE CPC MAURIACblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Fiches UD2 L'oasis Des Mots 3AEPDocument28 pagesFiches UD2 L'oasis Des Mots 3AEPKARZAZIPas encore d'évaluation
- 12 Aide Personnalisee Et Familles de Goigoux 862090 1021933Document10 pages12 Aide Personnalisee Et Familles de Goigoux 862090 1021933blsdonna2Pas encore d'évaluation
- Concevoir Une Fiche Pedagogique en FleDocument5 pagesConcevoir Une Fiche Pedagogique en Flefaki50% (2)
- Oral Ecrit Phonologie 2 Principes PedaDocument3 pagesOral Ecrit Phonologie 2 Principes PedaSalif SawadogoPas encore d'évaluation
- Le-Lexique-En-Maternelle-2 TOULOUSEDocument3 pagesLe-Lexique-En-Maternelle-2 TOULOUSEblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Concevoir Une Fiche Pédagogique de LangueDocument4 pagesConcevoir Une Fiche Pédagogique de LangueDANIELA FRANCO TRUJILLOPas encore d'évaluation
- Menu Hiver NutritionDocument12 pagesMenu Hiver NutritionRomain TRUONGPas encore d'évaluation
- Supuesto 2Document6 pagesSupuesto 2Lourds Mesa RodriguezPas encore d'évaluation
- 10 Boite Palabres CopieDocument13 pages10 Boite Palabres CopiegassamaPas encore d'évaluation
- جذاذات Dire Faire Et Agir للمستوى الأول ابتدائي PDF نموذج 1Document61 pagesجذاذات Dire Faire Et Agir للمستوى الأول ابتدائي PDF نموذج 1Charaf EddinePas encore d'évaluation
- Devoir 1d - 2Document4 pagesDevoir 1d - 2pngpnrwdm9Pas encore d'évaluation
- Reguler La Seance - Premiers Gestes ProfessionnelsDocument3 pagesReguler La Seance - Premiers Gestes ProfessionnelsLotfi Elabed0% (1)
- NullDocument21 pagesNullChaimae BouzaganePas encore d'évaluation
- Pédagogie - Plan de TravailDocument13 pagesPédagogie - Plan de TravailNoraPas encore d'évaluation
- Le Premier Jour de L'ecole - French G1 Big Book 1Document23 pagesLe Premier Jour de L'ecole - French G1 Big Book 1Maisa KhamisPas encore d'évaluation
- Minibus GS Guide FrancaisDocument128 pagesMinibus GS Guide FrancaisMOHAMED AIT BENJEDDIPas encore d'évaluation
- Guide Apprentissage de La Lecture AutismeDocument4 pagesGuide Apprentissage de La Lecture Autismeandrada_miruna100% (1)
- Aide A La Prise de Fonction en Maternelle Sept 2011 862081Document10 pagesAide A La Prise de Fonction en Maternelle Sept 2011 862081Yves DoumingouPas encore d'évaluation
- Cours 3 - La Classe Et Ses Acteurs Version Finalisée Janv2015Document9 pagesCours 3 - La Classe Et Ses Acteurs Version Finalisée Janv2015dj-kizarPas encore d'évaluation
- Oasis Des Mots - 2aep - Unité 2)Document16 pagesOasis Des Mots - 2aep - Unité 2)عالم المعرفةPas encore d'évaluation
- 2022 Débuter en Mater FSDocument108 pages2022 Débuter en Mater FSgibert100% (1)
- Formation Des Professeurs Contractuels Du Primaire - CopieDocument31 pagesFormation Des Professeurs Contractuels Du Primaire - CopieHouda WahbiPas encore d'évaluation
- Comprehension Et Expression OraleDocument30 pagesComprehension Et Expression Oraleيوسف عسلي67% (3)
- Comprehension Et Expression OraleDocument30 pagesComprehension Et Expression Oraleيوسف عسليPas encore d'évaluation
- Adomina Livre PédagogiqueDocument43 pagesAdomina Livre PédagogiqueNajat chifaPas encore d'évaluation
- CM1 Introduction Guide CoquelicotDocument11 pagesCM1 Introduction Guide CoquelicotRim Taga SayadiPas encore d'évaluation
- CSA FormationDocument13 pagesCSA FormationjdjdjPas encore d'évaluation
- Préparer Une Fiche PédagogiqueDocument5 pagesPréparer Une Fiche Pédagogiqueemasin33333333Pas encore d'évaluation
- Fiches UD4 1AEPDocument17 pagesFiches UD4 1AEPfadel rifiPas encore d'évaluation
- Liaison GS-CPDocument16 pagesLiaison GS-CPfabien lafronPas encore d'évaluation
- Subjonctif ExcerciceDocument271 pagesSubjonctif Excerciceantoine15127Pas encore d'évaluation
- Comprehension Et Expression OraleDocument31 pagesComprehension Et Expression OraleExplore New Way اكتشف طريقة جديدة0% (1)
- Ress c1 Graphisme Reperes 456429Document16 pagesRess c1 Graphisme Reperes 456429Jennifer CABARRUSPas encore d'évaluation
- Madagascar Livret - 3 Travailler Les Outils de La Langue PDFDocument64 pagesMadagascar Livret - 3 Travailler Les Outils de La Langue PDFJose Adriano Valentin Paez100% (1)
- Enseigner Explicitement - SavaryDocument20 pagesEnseigner Explicitement - Savaryfabien lafronPas encore d'évaluation
- Construction D'une SéquenceDocument7 pagesConstruction D'une SéquenceAndréa SrnPas encore d'évaluation
- Orthographe La - Phrase Du JourDocument7 pagesOrthographe La - Phrase Du Jouroctarine75Pas encore d'évaluation
- Ife Enseigner Plus Explicitement Essentiel en 4 PagesDocument5 pagesIfe Enseigner Plus Explicitement Essentiel en 4 PagesocoraillerPas encore d'évaluation
- جذاذات في Le Nouvel Espace de Francais للمستوى الثاني ابتدائي PDF نموذج 1Document178 pagesجذاذات في Le Nouvel Espace de Francais للمستوى الثاني ابتدائي PDF نموذج 1Jose Manuel GarciaPas encore d'évaluation
- Ress c1 Langage Oral1.4 456421Document16 pagesRess c1 Langage Oral1.4 456421demareeyPas encore d'évaluation
- InterventionsDocument15 pagesInterventionsMaissa Jribi100% (1)
- Vers Les Mathématiques en MaternelleDocument13 pagesVers Les Mathématiques en MaternelleJean-Philippe Solanet-Moulin100% (1)
- Accompagner les enseignants du maternel dans leurs missions: Guide pédagogiqueD'EverandAccompagner les enseignants du maternel dans leurs missions: Guide pédagogiquePas encore d'évaluation
- Fpairtouraigues14 - 2020-03-23 - 11-40-21 - 577 Sequences MS GS Sur L'airDocument10 pagesFpairtouraigues14 - 2020-03-23 - 11-40-21 - 577 Sequences MS GS Sur L'airblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Montgiscard - Sequence Ms Gs - Le Vent - de L'air en MouvementDocument37 pagesMontgiscard - Sequence Ms Gs - Le Vent - de L'air en Mouvementblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Seance - de - Langage SEQUENCE LANGAGE COINS JEUX GSDocument2 pagesSeance - de - Langage SEQUENCE LANGAGE COINS JEUX GSblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Seq Expression Corporelle Cycle 1Document8 pagesSeq Expression Corporelle Cycle 1blsdonna2Pas encore d'évaluation
- Ecole Ressources VocabEcoleMaternelle SequenceGrandeSection 153038Document10 pagesEcole Ressources VocabEcoleMaternelle SequenceGrandeSection 153038blsdonna2Pas encore d'évaluation
- Séquence-Codage-Robotique-Cycle-1 BORDEAUXDocument64 pagesSéquence-Codage-Robotique-Cycle-1 BORDEAUXblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Ombres - Lumieres Sequences MS GSDocument51 pagesOmbres - Lumieres Sequences MS GSblsdonna2Pas encore d'évaluation
- PerraudinChabridonStéphanie StryjakJulien C1 Se Repérer Dans Un Espace À Deux Dimensions La PageDocument9 pagesPerraudinChabridonStéphanie StryjakJulien C1 Se Repérer Dans Un Espace À Deux Dimensions La Pageblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Diaporama-De-Lanimation LE LANGAGE A L'ECOLE MATERNELLE CPC MAURIACDocument54 pagesDiaporama-De-Lanimation LE LANGAGE A L'ECOLE MATERNELLE CPC MAURIACblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Langage Et Eps Maternelle FDG Janv 15Document18 pagesLangage Et Eps Maternelle FDG Janv 15blsdonna2Pas encore d'évaluation
- Trame-Séquence-4-pages TRAVAILLER LE LANGAGE A PARTIR D'ALBUM - CANOPEDocument4 pagesTrame-Séquence-4-pages TRAVAILLER LE LANGAGE A PARTIR D'ALBUM - CANOPEblsdonna2Pas encore d'évaluation
- C1-Histoire-frisejournée-PREVALET DANTEC Et BARRAULTDocument6 pagesC1-Histoire-frisejournée-PREVALET DANTEC Et BARRAULTblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Le Langage Au Coin Cuisine CreatorDocument22 pagesLe Langage Au Coin Cuisine Creatorblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Ressouces - Institutionnelles - c1-2 GUYANEDocument21 pagesRessouces - Institutionnelles - c1-2 GUYANEblsdonna2Pas encore d'évaluation
- 06 - SequenceMoyenneSection IEN SAVERNEDocument6 pages06 - SequenceMoyenneSection IEN SAVERNEblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Progression - Vent - Air MATERNELLEDocument13 pagesProgression - Vent - Air MATERNELLEblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Séquence Le Champ Lexical de La Maison MaternelleDocument3 pagesSéquence Le Champ Lexical de La Maison Maternelleblsdonna2Pas encore d'évaluation
- 4-Programmer Les Activites Physiques Mission MaternelleDocument4 pages4-Programmer Les Activites Physiques Mission Maternelleblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Guide Sequences Langage-2Document53 pagesGuide Sequences Langage-2blsdonna2Pas encore d'évaluation
- Je Prepare Ma Classe TPS PS VuibertDocument30 pagesJe Prepare Ma Classe TPS PS Vuibertblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Je Prepare Ma Classe Grande Section VuibertDocument28 pagesJe Prepare Ma Classe Grande Section Vuibertblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Atole Ref Ens SpeDocument5 pagesAtole Ref Ens Speblsdonna2Pas encore d'évaluation
- 01decouverte AttentionDocument21 pages01decouverte Attentionblsdonna2Pas encore d'évaluation
- ATOLE Cycle 1Document21 pagesATOLE Cycle 1blsdonna2Pas encore d'évaluation
- Canope - Bien Debuter en MaternelleDocument39 pagesCanope - Bien Debuter en Maternelleblsdonna2Pas encore d'évaluation
- b070 - T01def Ateliers Individuels Maternelle - Montessori - CanopeDocument7 pagesb070 - T01def Ateliers Individuels Maternelle - Montessori - Canopeblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Methodes - Actives - Lieu Commun MeyrieuDocument14 pagesMethodes - Actives - Lieu Commun Meyrieublsdonna2Pas encore d'évaluation
- Ateliers Autonomes MS Periode 5Document4 pagesAteliers Autonomes MS Periode 5blsdonna2Pas encore d'évaluation
- Explicitation - Maternelle - MW - Mars2019 - Sans - Ressources - Pédagogie de La RéussiteDocument24 pagesExplicitation - Maternelle - MW - Mars2019 - Sans - Ressources - Pédagogie de La Réussiteblsdonna2Pas encore d'évaluation
- Ta Deuxième Vie Commence...Document3 pagesTa Deuxième Vie Commence...Seyf Dz TvPas encore d'évaluation
- Decrire Une Personne-Projet DidactiqueDocument5 pagesDecrire Une Personne-Projet Didactiquecamelianeagu100% (1)
- Igesr Rapport 2020 133 Usages Pedagogiques Numerique Reussite Eleves PDF 73925Document77 pagesIgesr Rapport 2020 133 Usages Pedagogiques Numerique Reussite Eleves PDF 73925dep infoPas encore d'évaluation
- 721-Article Text-2604-4-10-20210827Document24 pages721-Article Text-2604-4-10-20210827Najat HadPas encore d'évaluation
- InternationalTranscriptRequestFr PDFDocument2 pagesInternationalTranscriptRequestFr PDFAndy Neymar KenPas encore d'évaluation
- Éloge de La LumièreDocument2 pagesÉloge de La LumièreBabacar GarnierPas encore d'évaluation
- Loi de Student AlphaDocument1 pageLoi de Student Alphaتيك الخبراءPas encore d'évaluation
- Conditions D'accès A L'ofppt 1Document2 pagesConditions D'accès A L'ofppt 1pmloPas encore d'évaluation
- Les Résolutions de La Transformation Digitale... : ... Que Tout Dirigeant Devrait Prendre en 2016 (Management Digital) Télécharger, Lire PDFDocument8 pagesLes Résolutions de La Transformation Digitale... : ... Que Tout Dirigeant Devrait Prendre en 2016 (Management Digital) Télécharger, Lire PDFABDESALAM KRITELPas encore d'évaluation
- DaefleDocument5 pagesDaefleGamze YapıcıPas encore d'évaluation
- Plaquette NovasunDocument2 pagesPlaquette NovasunNoureddine BouyahyaouiPas encore d'évaluation
- Guide D'inscription en Ligne Au DSCGDocument23 pagesGuide D'inscription en Ligne Au DSCGAndry TojoPas encore d'évaluation
- Lettre de Motivation Alternance HIR ManelDocument2 pagesLettre de Motivation Alternance HIR ManelhirPas encore d'évaluation
- Activités OralesDocument2 pagesActivités OralesRed RedouanePas encore d'évaluation
- 2015limo0013 Euloge IbingaDocument171 pages2015limo0013 Euloge IbingafredopolabessPas encore d'évaluation
- CHAIMAA MLIH RapportDocument80 pagesCHAIMAA MLIH RapportMarwane MlihPas encore d'évaluation
- LB Biakoa 3eme Seq2 20222023Document2 pagesLB Biakoa 3eme Seq2 20222023Keuamene Djogue MarozzottiPas encore d'évaluation
- QFD-Déploiement StratégiqueDocument6 pagesQFD-Déploiement StratégiqueIBMPas encore d'évaluation
- Pomme Juin04Document95 pagesPomme Juin04nuitPas encore d'évaluation
- Livret Colloque UCAD-version 11févrierDocument123 pagesLivret Colloque UCAD-version 11févrierMarie DiopPas encore d'évaluation
- Journal Officiel (Contenant Le Décret Présidentiel N° 02-323)Document24 pagesJournal Officiel (Contenant Le Décret Présidentiel N° 02-323)gtarek80Pas encore d'évaluation
- Recap Etoiles ComportementDocument2 pagesRecap Etoiles ComportementzioumPas encore d'évaluation
- Impact de La Motivation Et Des Caractéristiques Individuelles Sur La Performance - Application Dans Le Monde AcadémiqueDocument326 pagesImpact de La Motivation Et Des Caractéristiques Individuelles Sur La Performance - Application Dans Le Monde AcadémiquePix8Pas encore d'évaluation
- Python Pour Les SHS - Emimien SchultzDocument41 pagesPython Pour Les SHS - Emimien SchultznikaiamariposaPas encore d'évaluation
- Inscriptions Cumulatives 2022-2023Document1 pageInscriptions Cumulatives 2022-2023Remi LiuPas encore d'évaluation
- RH 444 2023 - Formateur en AgrobusinessDocument1 pageRH 444 2023 - Formateur en AgrobusinesssaidnsanPas encore d'évaluation
- CDR Octobre 2023 - DigitalDocument12 pagesCDR Octobre 2023 - DigitalSidneyPas encore d'évaluation