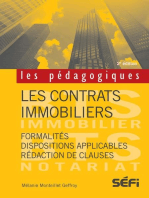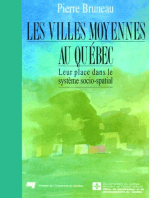Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Sommaire
Transféré par
Noureddine OmariTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Sommaire
Transféré par
Noureddine OmariDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie
Sommaire
Liste des tableaux.................................................................................................7 Liste des figures ...................................................................................................8 Ddicaces ..............................................................................................................9 Remerciements ...................................................................................................10 Introduction gnrale. .......................................................................................11
Chapitre prliminaire : Prsentation de lInternet et du commerce lectronique ........................................................................................ 15
Section 1 : Le concept du rseau Internet ........................................................15 I. Brve histoire du rseau ..........................................................................16
I-1 La naissance dARPANET .............................................................................................. 16 I-2 Internet et les annes 70 ................................................................................................... 16 I-3 La naissance de la NFSNET ............................................................................................. 16
II. III.
Internet et la croissance phnomnale ......................................................17
II-1 Comparaison entre les utilisateurs du Net et ceux des autres mdias ............................. 17 II-2 La distribution gographique des utilisateurs dInternet ................................................. 17
Internet en Tunisie ...............................................................................18
III-1 Historique de lInternet en Tunisie ................................................................................ 18 III-2 Infrastructure et communaut dInternet ....................................................................... 18 III-3 Fournisseurs de Services Internet (FSI) ......................................................................... 19 a) FSI pour le secteur public ............................................................................................. 19 b) FSI pour le secteur priv .............................................................................................. 19
Section 2 : La notion du commerce lectronique et de sa ralit en Tunisie ..20 I. Le commerce lectronique : mode comme un autre du commerce international et doffre commerciale ................................................................20
I-1 Opportunits du commerce lectronique et dfis du commerce actuel ............................. 20 I-2 Une originalit de forme indniable ................................................................................. 21 I-3 Le commerce lectronique et le droit traditionnel ............................................................ 22
II. Lincidence du commerce lectronique sur les plans conomiques, juridiques et fiscaux ........................................................................................23
II-1 La concurrence dans le march mondial ......................................................................... 23 a) La nouvelle concurrence sur Internet ........................................................................... 23 b) Lavenir de la distribution sur Internet ........................................................................ 24 II-2 La fiscalit pour le commerce lectronique .................................................................... 24 a) La TVA comme impt indirect ...................................................................................... 25 b) Limpt direct ............................................................................................................... 26 c) Les droits de douane ..................................................................................................... 26
III.
La ralit du commerce lectronique en Tunisie ..................................27
III-1 La Commission Nationale sur le Commerce Electronique (CNCE) .............................. 27 III-2 La stratgie tunisienne en matire de commerce lectronique ...................................... 28 III-3 Les projets pilotes .......................................................................................................... 29 a) Des sites virtuels touristiques ....................................................................................... 29
a.1 Le site commercial virtuel du groupe les orangers ............................................................... 29
I. Talbi et M. Helaoui
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie
a.2 Le site commercial virtuel pour le secteur de lartisanat ...................................................... 30 a.3 Le site commercial virtuel pour le tourisme saharien ........................................................... 30
b) Des projets pilotes lexportation ................................................................................ 30
b.1 La galerie marchande du CEPEX ......................................................................................... 30 b.2 Le guichet unique virtuel ....................................................................................................... 31
c) Le march virtuel pour le service postal et la consommation courante ........................ 31
c.1 Le site virtuel de la poste ....................................................................................................... 31 c.2 Le site BtoB et BtoC du magasin gnral ............................................................................. 31
Partie I - Les outils du commerce lectronique ................. 33
Chapitre I : Les outils dchanges et de communication sur le Web .............................................................................................................. 33
Section 1 : Les outils dchanges et de discussion sur le Web .........................33 I. les lieux de discussion .............................................................................33
I-1 Les listes de diffusion ....................................................................................................... 33
II. Les forums de discussion .........................................................................34 III. le protocole FTP ...................................................................................34 IV. Lchange des Produits ........................................................................35
IV-1 Les outils dachat .......................................................................................................... 35 a) Les boutiques en ligne .................................................................................................. 35 b) Les outils de recherche ................................................................................................. 35 c) Les outils pour commander ........................................................................................... 35 d) Les listes de diffusion .................................................................................................... 35 e) Les outils de paiement tels que la carte bancaire ( voir chapitre II) ............................. 36 f) Les comptes et les Caddies ............................................................................................ 36
f.1 Les comptes ............................................................................................................................ 36 f.2 Le Caddie ............................................................................................................................... 36
IV-2 Les outils de vente et de commercialisation .................................................................. 36 a) La boutique virtuelle ..................................................................................................... 36 b) La programmation ........................................................................................................ 36 c) Les outils de scurit ..................................................................................................... 37 d) Un service clientle spcialis ...................................................................................... 37 e) Une conception professionnelle .................................................................................... 37
V.
la documentation sur le web ....................................................................37
V-1 La recherche dun renseignement sur un serveur dont on connat ladresse URL .......... 38 V-2 Recherche dun document sur un guide de recherche .............................................. 38 V-3 Recherche dun document sur un moteur de recherche ............................................ 40 V-4 Recherche de documents par oprateur logique ....................................................... 41 V-5 Les nouvelles mthodes de recherche sur le Web .......................................................... 42 a) Les Mtas moteurs de recherche ............................................................................ 42 b) Les Agents Intelligents .................................................................................................. 42
Section 2 : Les outils de communication et de publication ..............................43 I. la poste lectronique ................................................................................43 II. Le Chat et le chat vocal ............................................................................44
II-1 Le Chat ........................................................................................................................... 44 II-2 Le Chat vocal et visuel .................................................................................................... 44
III.
la publicit sur le Web : exemple de cration de site Web ....................45
III-1 La phase de conception : les principes de cration de pages Web ................................. 46 III-2 Les outils utiliss pour crer une page Web .................................................................. 47
I. Talbi et M. Helaoui
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie
III-3 Lhbergement de site Web ........................................................................................... 47 a) Lhbergement mutualis .............................................................................................. 47
a.1 La premire formule d hbergement mutualis est Pack Pro ............................................... 47 a.2 La deuxime formule dhbergement mutualis est Pack Pro + ........................................... 48
b) Lhbergement ddi .................................................................................................... 48
Chapitre II : Les diffrents modes de paiement et les solutions proposes ............................................................................................ 49
Section 1 : Les diffrents modes de paiement ...................................................49 I. Le paiement lectronique ........................................................................49
I-1 Le paiement direct ............................................................................................................ 49 I-2 Le paiement par intermdiation financire ....................................................................... 50
II.
La monnaie virtuelle ...............................................................................50
II-1 Le porte-monnaie lectronique ....................................................................................... 50 a) La solution cybercash ................................................................................................... 51 b) La technique de G.Ctech ............................................................................................... 51 II-2 Le e-cash ......................................................................................................................... 51
Section 2 : Les solutions techniques et juridiques relatives aux problmes de paiement .............................................................................................................51 I. La cryptographie .....................................................................................52
I-1 Le cryptage symtrique .................................................................................................... 52 I-2 Le cryptage asymtrique .................................................................................................. 52
II. La signature lectronique ........................................................................53 III. La certification lectronique ................................................................55
Partie II - Le rgime juridique du contrat de commerce lectronique et l'incidence de son caractre mondial ............. 58
Chapitre I : Le rgime juridique du contrat de commerce lectronique ......................................................................................... 58
Section 1 : La notion du contrat en ligne .........................................................58 I. Une typologie du commerce lectronique .................................................59
I-1 Les contrats du commerce lectronique : des contrats distance .................................... 59 I-2 Les contrats du commerce lectronique : des contrats commerciaux classiques .............. 60
II.
La formation des contrats .........................................................................60
II-1 Les conditions prliminaires de formation du contrat en ligne ....................................... 61 a) Lidentification des parties ......................................................................................... 61 b) La capacit ................................................................................................................... 61 c) Lacceptation et loffre ................................................................................................. 62
c.1 Lacceptation ......................................................................................................................... 62 c.2 Loffre lectronique ............................................................................................................... 63
II-2 La validit du contrat en ligne ........................................................................................ 64 a) Le consentement ne doit pas tre vici ......................................................................... 64
a.1 Lerreur ................................................................................................................................. 65 a.2 Le dol ..................................................................................................................................... 65 a.3 La violence ............................................................................................................................ 66
I. Talbi et M. Helaoui
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie
b) Le contrat doit tre conforme lordre public conomique et social .......................... 66
Section 2 : Le rgime de preuve dans le contrat lectronique ..........................67 I. le rgime lgal de la preuve .....................................................................68
I-1 La prminence de lcrit ................................................................................................. 68 I-2 Le commerce lectronique : une exception supplmentaire lexigence de lcrit .......... 69 a) Les exceptions lgales au principe de la preuve par crit ............................................ 69 b) Lincidence du caractre mondial du commerce lectronique en matire de preuve ... 70
II.
La recevabilit de la preuve informatique : Les obligations techniques ....71
II-1 Linformatique et les avantages de lcrit ....................................................................... 72 II-2 La valeur probante des documents informatiques ........................................................... 73 II-3 La valeur probante du courrier lectronique ................................................................... 74
Chapitre II : Les incidences juridiques du caractre mondial du commerce lectronique ...................................................................... 75
Section 1 : Le problme du conflit de lois ........................................................76 I. Les solutions apportes au conflit de lois par le droit international priv ..76
I-1 Les solutions apportes au conflit de lois en matire de proprit intellectuelle dans le droit international priv tunisien ............................................................................................ 77 I-2 Les solutions apportes au conflit de lois en matire de contrat ...................................... 77 I-3 Les solutions apportes au conflit de loi en matire dlictuelle ....................................... 78
II. Les solutions apportes au conflit de lois par les conventions internationales en vigueur ...............................................................................78
II-1 La convention de Rome en matire dobligation et de protection des consommateurs : (adopte le 19 juin 1980 par la Communaut Europenne.) ................................................... 79 II-2 La convention de Vienne en matire de vente internationale de marchandises .............. 81
Section 2 : Le problme des conflits de juridictions ........................................81 I. les chefs de comptence des tribunaux tunisiens ......................................82
I-1 Les chefs de comptence ordinaire .................................................................................. 82 a) La comptence fonde sur la rsidence du dfendeur .................................................. 82 b) La comptence fonde sur la nationalit du dfendeur ................................................ 83 I-2 Les chefs de comptence extraordinaire ou exorbitante ................................................... 83 a) Lattitude du dfendeur ou la comptence subjective ................................................... 84
a.1 La comptence fonde sur lacceptation volontaire du dfendeur ........................................ 84 a.2 La comptence fonde sur llection de domicile en Tunisie ou la dsignation dun reprsentant ................................................................................................................................ 84
b) La comptence objective ............................................................................................... 85 c) La comptence au titre de la rciprocit ...................................................................... 86
II.
Les effets internationaux des jugements ..................................................86
II-1 Les solutions apportes au conflit de juridictions travers le droit commun ................. 87 a) Les dcisions judiciaires ............................................................................................... 87 b) Les sentences arbitrales ................................................................................................ 88 II-2 Les solutions apportes au conflit de juridictions travers le droit conventionnel ......... 89 a) Les conventions bilatrales ........................................................................................... 89 b) Les conventions multilatrales ...................................................................................... 89
LES HYPOTHESES .........................................................................................91
I. Talbi et M. Helaoui
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie
Partie III - L'tude pratique des entreprises en ligne : leurs suggestions et celles du consommateur ........................... 93
Chapitre 1 : Lexprience des entreprises en ligne et leurs suggestions .......................................................................................... 93
Section 1 : Cas de la Socit Magasin Gnral ................................................93 I. Prsentation de la socit .........................................................................94 II. Les tapes suivre pour passer une commande sur Internet auprs de la S.M.G .............................................................................................................95
II-1 Trouver un article ............................................................................................................ 95 a) Naviguer librement travers les rayons ....................................................................... 95 b) Se servir du moteur de recherche ................................................................................. 95 c) Enfin, lutilisation de la commande type du consommateur ......................................... 96 II-2 Prparer et conclure une commande ................................................................................ 96 a) Prparer une offre de prix pour les produits slectionns ............................................ 96 b) Finaliser une commande sur le site .............................................................................. 96 II-3 S'identifier ....................................................................................................................... 96 II-4 Confirmer une commande .............................................................................................. 97 II-5 Payer ............................................................................................................................... 97
III.
Cadre juridique et conditions gnrales de vente...................................98
III-1 Prambule ...................................................................................................................... 98 III-2 Prix ................................................................................................................................ 99 III-3 Paiement ........................................................................................................................ 99 III-4 Dlai de livraison ........................................................................................................... 99 III-5 Garantie ......................................................................................................................... 99 III-6 Risques .......................................................................................................................... 99 III-7 Rglement des litiges ..................................................................................................... 99
IV. Entretien avec le responsable du site Web de la SMG ........................ 100 V. Conclusion ............................................................................................ 104 Section 2 : Etude sur lexprience de 13 entreprises tunisiennes .................. 105 I. Au niveau de laugmentation du CA ...................................................... 106 II. Au Niveau Des Moyens Utiliss ............................................................ 107 III. Au niveau de la rduction des cots ................................................... 108 IV. Au Niveau Des Applications Sur Le Net ........................................... 108 V. Au Niveau De Limportance Des Elments Intervenant Lors Dune Opration De Commerce Electronique .......................................................... 109
Chapitre 2 : Les Internautes ou les consommateurs potentiels en ligne ................................................................................................... 110
Section 1 : Mthodologie de recherche ........................................................... 110 I. Dfinition de la population mre ........................................................... 110
I-1 Dfinition thorique ....................................................................................................... 110 I-2 Dtermination de la population mre dans notre tude .................................................. 111
II.
Les mthodes d'chantillonnage et le choix de l'chantillon ................... 111
II-1 Dfinition thorique de la mthode probabiliste choisie ............................................... 111 II-2 Dtermination de l'chantillon ...................................................................................... 112
I. Talbi et M. Helaoui
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie
Etudiants Littraires Masculins.............................................................................. 112 Etudiants Littraires Fminins. .............................................................................. 112 Etudiants Scientifiques Masculins. ......................................................................... 112 Etudiants Scientifiques Fminins............................................................................ 112
III.
Prsentation de l'laboration du questionnaire .................................... 112
a.1 Les questions fermes .......................................................................................................... 112 a.2 Les questions ouvertes ......................................................................................................... 113
III-1 Choix et test du questionnaire ..................................................................................... 112 a) Choix des questions .................................................................................................... 112 b) Test du questionnaire .................................................................................................. 113 III-2 Prsentation et laboration du questionnaire ............................................................... 114 a) Prsentation du questionnaire .................................................................................... 114 b) laboration du questionnaire ..................................................................................... 117
Section 2 : Rsultats statistiques et interprtations ....................................... 119 I. LETUDE DES VARIABLES .............................................................. 119
I-1 Etude de liens entre deux variables qualitatives nominales ........................................... 120 I-2 - Etude de liens entre deux variables qualitatives ordinales ........................................... 120 I-3 - Etude de liens entre deux variables quantitatives ........................................................ 121
II. Ltude de lien entre lintention dachat du consommateur tunisien et lintervention directe du vendeur ................................................................... 121 III. Le lien entre intervention directe du vendeur et lintention dachat du consommateur selon le sexe .......................................................................... 125 IV. Le lien entre intervention directe du vendeur et lintention dachat du consommateur selon la formation .................................................................. 129 V. Le lien entre le classement des applications sur Internet selon la formartion ...132 VI. Le lien entre le classement des applications sur Internet selon le sexe ...133 VII. Le lien entre le classement des modes de paiement selon la formation ...134 VIII. Le commerce lectronique et la ralisation des profits plus importants ...135
Conclusion ....................................................................................................... 137
Bibliographie.................................................................................................... 140 I. Ouvrages gnraux ................................................................................ 140 II. Ouvrages spcialiss ............................................................................. 140 III. Thses, mmoires et sminaires ......................................................... 142 IV. Articles, guides et groupes danalyse ................................................. 143 V. Lois et conventions ............................................................................... 144 VI. Les sites Web .................................................................................... 145
I. Talbi et M. Helaoui
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie
Liste des tableaux
Tableau 1. les principaux guides de recherches. ---------------------------------------------- 40 Tableau 2. les principaux moteurs de recherche. --------------------------------------------- 41 Tableau 3. Les principaux Mtas moteurs. ---------------------------------------------------- 42 Tableau 4. L'augmentation du CA.------------------------------------------------------------ 106 Tableau 5. Les modes de paiement.----------------------------------------------------------- 107 Tableau 6. La rduction de cots. ------------------------------------------------------------- 108 Tableau 7. Les diffrentes applications sur le net. ------------------------------------------ 108 Tableau 8. L'importance des lments intervenant lors d'une opration de commerce lectronique. -------------------------------------------------------------------------------- 109 Tableau 9. Rcapitulatif des traitements des observations.-------------------------------- 121 Tableau 10. Tableau crois : Intervention directe du vendeur * Intention dachat du consommateur tunisien. ------------------------------------------------------------------ 122 Tableau 11. Test de Khi deux. ----------------------------------------------------------------- 124 Tableau 12. Mesures symtriques. ------------------------------------------------------------ 124 Tableau 13. Rcapitulatif du traitement des observations. -------------------------------- 125 Tableau 14. Tableau crois Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien masculin. ------------------------------------------------------- 125 Tableau 15. Test de Khi deux. ----------------------------------------------------------------- 126 Tableau 16. Mesures symtriques. ------------------------------------------------------------ 126 Tableau 17. Rcapitulatif du traitement des observations. -------------------------------- 127 Tableau 18. Tableau crois Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien fminin. -------------------------------------------------------- 127 Tableau 19. Test de Khi deux. ----------------------------------------------------------------- 128 Tableau 20. Mesures symtriques. ------------------------------------------------------------ 128 Tableau 21. Rcapitulatif du traitement des observations. -------------------------------- 129 Tableau 22. Tableau crois Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien ayant une formation littraire. ------------------------------ 129 Tableau 23. Test de Khi deux. ----------------------------------------------------------------- 130 Tableau 24. Mesures symtriques. ------------------------------------------------------------ 130 Tableau 25. Rcapitulatif du traitement des observations. -------------------------------- 131 Tableau 26. Tableau crois Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien ayant une formation scientifique. -------------------------- 131 Tableau 27. Tableau de khi deux. ------------------------------------------------------------- 131 Tableau 28. Mesures symtriques. ------------------------------------------------------------ 132 Tableau 29. Corrlation de Spearman : lien entre le classement des applications sur Internet selon la formation. -------------------------------------------------------------- 132 Tableau 30. Corrlation de Spearman : lien entre le classement des applications sur Internet selon le sexe. --------------------------------------------------------------------- 133 Tableau 31. Corrlation de Spearman : lien entre le classement des modes de paiement selon la formation.------------------------------------------------------------------------- 134 Tableau 32. Corrlation de Pearson entre la baisse des prix et la quantit demande. 135
I. Talbi et M. Helaoui
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie
Liste des figures
Figure 1. Exemple de recherche en arborescence . --------------------------------------- 39 Figure 2. L'augmentation du CA. ------------------------------------------------------------- 106 Figure 3. Le commerce lectronique et les diffrents modes de paiement. ------------- 107 Figure 4. La rduction de cots. --------------------------------------------------------------- 108 Figure 5. Les diffrentes applications sur le net. -------------------------------------------- 109 Figure 6. Limportance des lments intervenant lors d'une opration de e-commerce. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 110 Figure 7. Lintention dachat du consommateur tunisien lors dune intervention directe du vendeur. --------------------------------------------------------------------------------- 123 Figure 8. Lintention d'achat du consommateur tunisien en absence d'une intervention directe du vendeur. ------------------------------------------------------------------------ 123
I. Talbi et M. Helaoui
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Ddicaces
A mon pre, A ma mre, A mes frres, A mes ami(e)s.
Imed.
A mes parents. A mon frre.
Maher
I. Talbi et M. Helaoui
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Remerciements
Au terme de ce travail, nous tenons exprimer notre reconnaissance toutes les personnes qui ont contribu de prs ou de loin la ralisation de cette mmoire.
Tout dabord, nous voudrions exprimer notre reconnaissance envers notre directeur de recherche Monsieur Samir JEMALI pour la qualit de son encadrement, la pertinence de ses directives et lextrme gnrosit dont il a fait preuve lors de llaboration de cette mmoire.
Nous avons lhonneur dexprimer toute notre gratitude envers les professeurs membres du Jury pour leur acceptation de lire et juger notre travail.
Nous tenons remercier galement les responsables de la bibliothque et tout le cadre enseignant de lEcole Suprieure de Commerce de Tunis pour leurs efforts considrables tout au long de notre recherche.
Nous remercions aussi les responsables du Magasin Gnral et en particulier Monsieur Kais DRIDI qui sest montr trs comprhensif en acceptant de rpondre notre entretien.
Finalement, un grand merci aux responsables administratifs de notre cole qui nous ont permis de raliser ce travail dans les meilleures conditions.
I. Talbi et M. Helaoui
10
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Introduction gnrale.
Nous vivons actuellement dans une des priodes de changement les plus excitantes de lhistoire humaine, or larrive de ce nouveau millnaire est caractrise par un bouleversement technologique autrefois imaginable. Pratiquement, tous les aspects de notre vie quotidienne, de notre travail jusqu nos structures de gouvernance subissent une transformation radicale. Cet ensemble de modifications informatiques se fait donc ressentir sur lconomie de telle sorte quon parle aujourdhui dune nouvelle conomie voire de lconomie numrique o limmatriel est en train de se placer sur le matriel. Cette rvolution numrique ne doit pas passer sans voquer la notion dInternet qui tait lorigine de ce bouleversement technologique qualifiant lconomie comme une nouvelle conomie des rseaux. LInternet, vedette incontestable de tout systme, sest impos donc au dbut comme un moyen de communication, il nest plus aujourdhui rserv uniquement aux scientifiques, il est de plus en plus utilis comme nouveau vecteur commercial faisant natre ainsi de nouveaux usages du fait dune utilisation laquelle il ntait pas initialement destin, donc son volution commerciale a engendr de nouvelles activits. La plus importante est le commerce travers le net ou ce quon appelle le commerce lectronique, qui devient dune importance immense et dune ncessit absolue pour toute conomie, ce qui est bien remarqu, or dans le monde entier, on voit que les entreprises commerciales se dmnent pour viter non seulement dtre laisses sur place par les nouvelles entreprises, mais aussi de perdre leurs marchs lheure o fournisseurs et clients adoptent des nouvelles manires de travailler 1 Cest ainsi que les entreprises seront obliges dexercer le commerce lectronique afin de protger leurs parts de march.
1
Finances et dveloppements, Dcembre 1999 (Don Topscott et David Agnew) p34/35.
I. Talbi et M. Helaoui
11
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
En effet, le commerce lectronique, dans cette mesure, est un lment vital pour nimporte quelle entreprise. Comment peut-on dfinir cet lment occupant une telle importance dans le monde conomique ? Le commerce lectronique a fait lobjet de diverses dfinitions, dont on cite : Une premire dfinition dont elle a t donn par lAssociation Franaise pour le Commerce et les Echanges Electroniques (lAFCEE) suivant laquelle : Le commerce lectronique regroupe tous les changes et toutes les transactions quune entreprise peut tre amene faire au travers dun mdia lectronique ou dun rseau. . Une deuxime dfinition a t prsente par monsieur SIDHOM Walid (Dpartement du commerce lectronique de lAgence Tunisienne dInternet) le 15/05/2001 lors de la soutenance dun expos intitul : Le commerce lectronique en Tunisie : La solution E-TIJARA ; La dfinition retenue est alors : Le commerce lectronique est lensemble des oprations dachats, de ventes et dchanges utilisant la fois linformatique et les tlcommunications. A partir de ces deux dfinitions, nous pouvons retenir que le commerce lectronique est tout simplement un commerce (opration dachat, de vente et dchange.) caractris par lutilisation des outils lectroniques (mdias lectronique, le rseau, linformatique et les tlcommunications.). Le commerce lectronique consiste vendre des produits sur Internet, ce qui implique des stratgies de marketing pour lentreprise assez complexes ceci suppose alors ; Tout dabord, la capacit dattirer les visiteurs. Puis, de veiller sur leurs intrts. Ensuite, de gnrer leur confiance et enfin, les entraner consommer. En effet, attirer lattention du visiteur ds quil arrive sur un site est gnralement la marque dun site du commerce lectronique. Donc, la diffusion du commerce lectronique dans une socit ncessite un effort au niveau du dveloppement de la communication et des outils de la tlcommunication.
I. Talbi et M. Helaoui
12
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
La Tunisie, comme beaucoup de pays mergents, a pris des mesures pour rduire ce que les rapports des organismes internationaux appellent "fracture numrique". En mai 2002, la Tunisie comptait 461 000 internautes et 57 000 comptes d'accs. Les utilisateurs domestiques ne reprsentent que 15% du total des abonns, contre 65% pour l'ducation. Le nombre de domaines avoisinait les 1333 ; le nombre de sites Web est de 692. La bande passante actuelle de 100 Mbits sera tendue 150 Mbits dbut 2003. Les transactions faites sur Internet restent, toutefois, trs faibles. Selon les dernires statistiques rendues publiques, les transactions lectroniques grce la monnaie lectronique, e-dinar, taient au nombre de 3609 pour une valeur de 168 220 dinars dont 44 057 dinars pour les inscriptions des tudiants en ligne et 88 887 dinars au profit de Tunisie Tlcom. (paiement des factures tlphoniques depuis novembre 2000)2. Sur le plan juridique, plusieurs lois ont vu le jour pour lencouragement du commerce lectronique en Tunisie, nous citons titre indicatif : L'amendement du Code des Obligations et des Contrats par la loi du 13 juin 2000 qui, entre autres, reconnat au document et la signature lectronique la mme valeur juridique que celle du document papier et de la signature manuscrite. La Loi n2000-83 du 09 aot 2000 relative aux Echanges et au Commerce Electronique qui, entre autres, a institu l'Agence Nationale de Certification Electronique et les services de certification lectronique. La Loi 2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du Code des Tlcommunications. Par ailleurs, une convention dont l'objet est la connexion entre le rseau TradeNet et le Systme d'Information Douanier Automatis
Malgr leffort du gouvernement tunisien, le commerce lectronique ne peut pas tre considr comme un lment important dans les transactions et les oprations dchange en Tunisie.
Source : lAgence Tunisienne dInternet. (ATI).
I. Talbi et M. Helaoui
13
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Ce qui nous a pouss de faire cette tude afin de dtecter les barrires qui peuvent tre rencontres et dont linfluence peut affecter le dveloppement de ce secteur. Quels sont donc les outils, le rgime juridique et lavenir du commerce lectronique en Tunisie ?
Dans une premire partie de cette tude nous allons examiner les outils du commerce lectronique. En effet, ce dernier consiste vendre sur Internet, ce qui suppose que les utilisateurs de ce nouveau mode de commerce doivent tre capables dutiliser les outils du commerce lectronique. Cest pour cela que nous avons choisi de les prsenter de la manire la plus simple.
Dans la deuxime partie, nous avons essay dtudier laspect juridique du commerce lectronique. Vu que le commerce lectronique utilise les nouvelles technologies dinformation et reprsente un nouveau mode rvolutif du commerce est-il alors ncessaire davoir un droit spcialis, en dautres termes le droit traditionnel est-il adapt au commerce lectronique ? Et permet-il dassurer la scurit juridique des consommateurs ?
Enfin , nous avons essay, dans une troisime partie, de procder une tude pratique, afin dtudier la situation actuelle du commerce lectronique, en Tunisie, sur le terrain pratique, en tudiant les problmes rencontrs par les entreprises et les suggestions des consommateurs, potentiels en ligne.
I. Talbi et M. Helaoui
14
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Chapitre prliminaire : Prsentation de lInternet et du commerce lectronique :
Le rseau Internet est dsormais un outil de communication et un espace d'change de biens, de marchandises et de services universel et prpondrant. D'un march de proximit dans la premire moiti du 20me sicle, l'on est pass une distribution de masse dans les annes 60-70 avec l'apparition des grandes surfaces, puis l'avnement de la VPC3, et du minitel. Chacune de ces tapes a contribu modifier un lment de l'acte d'achat, savoir: le choix et le prix bas avec les supermarchs et hypermarchs et l'absence de contraintes (se dplacer, respecter des horaires d'ouverture) avec l'achat depuis son domicile4. Mais ceci a caus dune autre part des problmes sur le plan juridique, ce qui est valable pour un contrat normal resterait valable pour un contrat sur Internet ? En cas de disfonctionnement qui prendra la responsabilit ?
Section 1 : Le concept du rseau Internet :
Lune des enqutes les plus connues relatives Internet, est LInternet Domain Survey , ralise deux fois par an par la socit Network Wizards. Les rsultats de cette enqute ont montr quen janvier 2000 plus de 72 millions dordinateurs taient connects Internet en marquant une croissance de 28% par rapport janvier 19995. Il est juste signaler que le nombre dinternautes est beaucoup plus lev celui du nombre dordinateurs.
VPC : vente par computer. Dduis partir des documents et articles raliss par web Agency et publis sur Internet, sur le site : www.supralogique.com 5 Pour des informations additionnelles vous pouvez visiter le site de Network Wizards : http://www.nw.com/.
4 3
I. Talbi et M. Helaoui
15
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
A partir de ce qui a t prsent, nous pouvons dire quInternet reprsente aujourdhui un moyen de communication et dchange de donnes la disposition de tout le monde.
I.
BREVE HISTOIRE DU RESEAU6 :
I-1 La naissance dARPANET :
LInternet a vu le jour en 1969, o le ministre amricain de dfense a construit un rseau informatique appel ARPANET (Le Programme scientifique et militaire), qui permettait de relier les installations militaires disperses sur le territoire amricain.
I-2 Internet et les annes 70 :
En 1970, lvolution rapide et importante dARPANET, a rendu la gestion de ce rseau de plus en plus difficile, do lide de diviser lusage dInternet en : usage militaire dont le nom est MILNET et usage civil gardant le nom dARPANET. Une nouvelle liaison rseau a vu le jour dans cette priode : Internet Protocole (IP) qui permettait la connexion de plusieurs ordinateurs en mme temps en leur permettant de communiquer entre eux.
I-3 La naissance de la NFSNET :
Au milieu des annes 80, on a assist la naissance de NFSNET : il sagit dun rseau de la fondation nationale de sciences permettant de relier les superordinateurs de NFS. Durant cette priode, le monde a connu un nouveau phnomne appel Internet qui signifie " Interconnected Networks " c'est--dire " rseaux interconnects ".
Cet historique est une synthse de ce qui a t prsent par LOWE Dong, dans son ouvrage Internet explorer 5.5 pour les nuls pages 5 et 6, et par lAFTEL, Internet. Les enjeux pour la France. Livre blanc rdig sous la direction de Daniel Kaplan, page 12.
I. Talbi et M. Helaoui
16
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
En 1993, lhistorique de lInternet a connu une tape importante par le lancement du logiciel de navigation "Mosaque" qui rend lutilisation du World Wide Web facile avec un ordinateur sous Windows ou un Macintosh. Enfin, il est noter que tous les experts saccordent dire que lInternet va connatre une volution de plus en plus folle, voire des bouleversements importants. Aujourdhui, la gestion structurelle dInternet est confie des socits prives ou ce quon appelle les fournisseurs daccs.
II.
INTERNET ET LA CROISSANCE PHENOMENALE :
II-1 Comparaison entre les utilisateurs du Net et ceux des autres mdias :
Aucun mdia na connu de croissance aussi remarquable que celle dInternet aujourdhui. Le tlphone a mis quarante ans pour relier dix millions dabonns, le tlcopieur a mis vingt ans pour simposer, le tlphone portable en a mis dix, alorsque lInternet a russi en quatre ans pour quil devienne un mdia connu et utilis par 10 millions dinternautes. Ensuite, en lan 2000, quelque 200 millions de personnes utilisent lInternet. LInternet a connu une croissance exponentielle7.
II-2 La distribution gographique des utilisateurs dInternet :
Aujourdhui, Internet est un mdia utilis par quiconque et dans le monde entier. Mais il est noter que les Etats-Unis sont en tte, lEurope est la trane, ces deux pays avec lAsie reprsentaient dj 80% des dpenses effectues dans le monde entier. Mais dune vitesse norme, lInternet est en train de couvrir le monde entier mme les pays en voie de dveloppement8.
7
Source : Benchmark Group, VUA, IDC, Forrester, analyses OC&C
I. Talbi et M. Helaoui
17
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
III.
INTERNET EN TUNISIE9 :
III-1 Historique de lInternet en Tunisie :
L'Internet en Tunisie est pass par plusieurs tapes depuis dix ans: En 1989, un nud EARN/BITNET a t install en utilisant une liaison X.25. En 1991, la Tunisie a t le premier pays arabe et africain connect Internet travers l'Institut Rgional des Sciences Informatiques et des
Tlcommunications (IRSIT) avec une connexion IP sur X.25 avec l'INRIA (France). En 1993, le Rseau National de Recherche et de Technologie (RNRT) a t cr pour connecter les centres de recherche tunisiens. En 1996, l'Agence tunisienne d'Internet a t cre pour promouvoir les services Internet et la technologie rseau en Tunisie et servir d'oprateur. En mars 1997, le ministre des technologies de la communication a mis en place des textes rglementant les services valeur ajoute des tlcommunications de type Internet. D'autre part, neuf Fournisseurs de Services Internet pour le secteur public et pour le secteur priv ont dmarr leur activit.
III-2 Infrastructure et communaut dInternet :
La connectivit Internet en Tunisie a connu des amliorations importantes. En effet, la liaison nationale a volue de 19.2Kps en 1991 avec EUNET 512Kps en 1996 avec Sprint US et en 1999 cette liaison est de 10Mbps.Elle a atteint 40Mbps la fin de l'an 2000. Pour les accs par ligne tlphonique, il existe un tarif unique applicable pour toutes les rgions de la Tunisie. Par ailleurs, un rseau Backbone national offre 7 points de prsences (POP) et permet l'accs Internet par les technologies: ATM, Frame Relay, RTC, lignes spcialises, X.25, RNIS et assure une bonne qualit des services Internet sur tout le territoire tunisien.
8 9
Source : Les nouveaux marchands du Net cris par GERBERT. P et AL p40. Source : Agence tunisienne d'Interne.
I. Talbi et M. Helaoui
18
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Le rseau Internet en Tunisie devient par suite de plus en plus important et le nombre dutilisateurs est en croissance.
En effet, La communaut Internet est entrain de s'accrotre de manire exponentielle: Le nombre d'abonns qui tait de 111 en fin 1996 a atteint 15.000 en Juin 1999 et 37.000 en Juin 2000. Par consquent, le nombre d'utilisateurs est estim plus que 300.000. L'objectif est d'atteindre 500.000 abonns en l'an 2004.
III-3 Fournisseurs de Services Internet (FSI) :
Nous citons 7 FSI pour le secteur public et 2 FSI pour le secteur priv : a) FSI pour le secteur public : Les principaux fournisseurs appartenant ce secteur sont : LATI pour connecter les institutions publiques (Ministres, offices...) (www.ati.tn). LIRSIT pour connecter les centres de recherches (www.irsit.rnrt.tn). Le CCK (Centre de Calcul Khawarizmi) pour connecter les institutions universitaires (www.cck.rnu.tn). LINBMI (Institut National de Bureautique et de Microinformatique) pour connecter les institutions relevant du ministre de l'ducation. Le CIMSP (Centre Informatique du Ministre de la Sant Publique) pour connecter les institutions relevant du ministre de la sant. LIRESA (Institut de la Recherche et de l'Enseignement Suprieur Agricole) pour connecter les institutions relevant du ministre de l'agriculture. Tunisie Telecom pour connecter les institutions relevant du ministre des technologies de la communication. b) FSI pour le secteur priv : Pour le secteur priv nous citons principalement : Planet Tunisie (www.planet.tn ). 3S Global Net (www.gnet.tn).
I. Talbi et M. Helaoui
19
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Ces FSI fournissent des accs Internet par lignes tlphoniques (RTC), lignes spcialises numriques et analogiques, lignes X-25 et lignes RNIS.
Section 2 : La notion du commerce lectronique et de sa ralit en Tunisie :
BEN AMOR Fayal dfinit le commerce lectronique comme tant, lensemble des changes numriss, en relation avec des activits commerciales soit entre entreprises et particuliers ce qui est connu sous le nom de (Business-to-Consumer) par lassemblage des magasins virtuels et les galeries marchandes sur le Net, soit entre les entreprises eux-mmes ou encore appeles (Business-to-Business) incluant lchange des donnes
informatises en profitant des moyens et des outils du commerce lectronique. Daprs cet auteur le commerce lectronique se base sur trois fondations : Dabord, la phase dinformation, tout ce qui concerne lchange des renseignements sur les produits, des prix, de la disponibilit, de la livraison Ensuite, la phase daccord, au cours de laquelle se fait laboutissement des ngociations dune part et la conclusion valable du contrat dautre part. Enfin, cest la phase dexcution qui aura lieu et elle concerne lchange du produit ou service achet contre une transaction financire, et bien videmment le service aprs vente et programmes de fidlisation I.
LE COMMERCE ELECTRONIQUE : MODE COMME UN AUTRE DU
COMMERCE INTERNATIONAL ET DOFFRE COMMERCIALE
I-1 Opportunits du commerce lectronique et dfis du commerce actuel:
GERBERT. P, KAAS. P et SCHNEIDER.D ont prsent dans leur ouvrage, Les nouveaux marchands du Net , les dfis du commerce actuel savoir : La demande locale est sature en causant des freins aux ouvertures.
I. Talbi et M. Helaoui
20
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Lvolution dmographique est dfavorable (pour les producteurs.) La croissance du pouvoir dachat est faible. La part des dpenses consacres aux biens de consommation est en baisse. Lintelligence de plus en plus remarquable du consommateur, en ce qui concerne le choix du produit de bonne qualit et au prix le plus bas. Labsence de vritables innovations. La perte de productivit des fournisseurs et des distributeurs. Ces auteurs ont, dautre part, analys lopportunit du e-commerce comme tant les solutions des dfis du commerce actuel. En effet, le commerce lectronique est caractris par une pntration trs rapide de lInternet cest dire un accs aux clients mondiaux pour chaque fournisseur et pour chaque consommateur. Ceci implique la chute des barrires, mme les barrires psychologiques. Donc le commerce lectronique permet une pntration de tous les groupes de clients et de tous les segments du march. De cette vision, le commerce en ligne est la solution efficace et idale pour les dfis du commerce actuel, ce qui a pouss ces auteurs considrer que le futur du commerce est en ligne. Mais il ne faut pas oublier quil y a plusieurs problmes pour rtablir le commerce lectronique. Ces problmes sont dorigine juridique, fiscale, technique
I-2 Une originalit de forme indniable :
Le commerce lectronique profite de linnovation technologique dans la nouvelle forme dchange. Avec lInternet, le commerce est mis en uvre rapidement et touche le march mondial. Le paiement, quant lui, prend un autre visage : il est lui aussi virtuel et lectronique. Des fonctions, comme lexcution des commandes et la livraison des distributeurs spcialiss, sont aujourdhui couramment utilises par de nombreuses entreprises via Internet et dans le monde entier. Des marchs
I. Talbi et M. Helaoui
21
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
spcifiques sont ainsi constitus sur Internet. Des nouveaux mtiers se crent, on parle sur Internet de vendeurs, dintermdiaires et des conseillers virtuels et donc du problme didentification des contractants, ils ne se connaissent pas, source dincertitudes en ce qui concerne le moment et le lieu de formation de contrat10. Par suite, on voit lapparition de nouveaux contrats. BENSOUSSAN Alain les qualifie de contrat cluse o on est pass dun droit de linformation un droit de comprhension11.
I-3 Le commerce lectronique et le droit traditionnel :
Le e-commerce est caractris par son aspect lectronique, multimdia, virtuel en se profitant des nouvelles technologies. La question qui se pose ce niveau est : le droit commercial traditionnel sapplique-t-il au commerce lectronique ? JEAN-BATISTE Michelle dans son ouvrage Crer et exploiter un commerce lectronique 12, a dmontr que le droit commercial traditionnel sapplique bien au commerce sur Internet. En effet, le Code de Commerce dans son titre premier des commerants, larticle premier dispose que : Le prsent code sapplique aux commerants et aux actes de commerce. . Pris la lettre, cet article dtermine le cadre de lapplication du Code du commerce ou encore du droit commercial traditionnel. Le code est appliqu aux commerants et aux actes de commerce indpendamment de la technologie employe. Dautre part, les articles 2 et 3 de ce mme code dfinissent respectivement le commerant titre professionnel et titre habituel en numrant les actes de commerce procds par ce dernier13. Ce-ci semble insuffisant vue le caractre rvolutionnaire du commerce lectronique, ce qui a pouss le gouvernement tunisien publier dautres lois tel
10 11
BEN AMOR Fayal, Les cls du commerce lectronique p99. JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique p 13 et p 14. 12 JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique , ditions Litec, 1998 p 14et 15. 13 La condition selon laquelle une personne est commerante si elle accomplit des actes de commerce PAULET Luc, Droit commercial, Ellipses ditions Marketing S.A, 2000, page 79.
I. Talbi et M. Helaoui
22
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
que la loi 2000-83 du 9 aot 2000,relative aux changes et au commerce lectronique.
II.
LINCIDENCE DU COMMERCE ELECTRONIQUE SUR LES PLANS
ECONOMIQUES, JURIDIQUES ET FISCAUX
II-1 La concurrence dans le march mondial :
a) La nouvelle concurrence sur Internet : En matire commerciale, lInternet est considre comme tant lapplication la plus extrme de la libre concurrence. La question qui se pose ce niveau est la suivante : quest-ce quil caractrise cette concurrence et peut-elle tre loyale sur ce nouveau march ouvert ? Certainement, cette libert va encourager les commerants utiliser certains procds illgaux dans leurs stratgies concurrentielles, en se basant sur limmatrialit du fait. Or en pensant que tout est libre et permis sur ce rseau ouvert, chaque commerant va essayer daffecter, bien sr dans le sens ngatif, limage de marque de ses concurrents, et leurs tours, les autres concurrents vont se comporter de la mme manire dont le but daccrotre leurs parts et poids sur le march. Parmi ces procds14 on y trouve par exemples le dnigrement qui consiste jeter le discrdit sur un concurrent en le critiquant, ceci est prohib, de mme que le fait de tenter de profiter de la renomme dun commerant en crant la confusion dans lesprit du client qui croit avoir affaire la mme entreprise ou encore le fait de dsorganiser une entreprise rivale en lui dtournant des commandes par exemple. Ces comportements dj cits, sont interdis en matire du commerce lectronique, bien que la libert les favorise. Ceci implique que la libert de concurrencer sur Internet nest pas et mme ne doit pas tre absolue, or il faut veiller tre loyale dans les politiques et les actions concurrentielles tout comme sur le march normal.
14
JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique , ditions Litec, 1998, p16.
I. Talbi et M. Helaoui
23
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
b) Lavenir de la distribution sur Internet : On parle aujourdhui dune distribution sur Internet. Certainement les modes de distribution traditionnels, que se soit slectives ou exclusives vont avoir des changements considrables, dans ce contexte et titre dexemple, le magasine de lARGUS de lautomobile15 titrait en avril 1997 comment Internet pourrait bouleverser la distribution des automobiles , donc il tait bien prvu quon aura une nouvelle politique de distribution, et comme commentaire lexemple prcit, on a pos plusieurs questions savoir : Comment viter la confusion des marques ? Comment faire respecter les principes de bonne foi et de loyaut ? Si nous voulons une distribution slective et exclusive de qualit tel que les constructeurs automobiles, les concessionnaires et les consommateurs la souhaitent. La distribution de lautomobile nest voque ici qu titre dexemples parmi plusieurs autres produits. Pour montrer que le commerce lectronique bouleverse mme lorganisation du march de distribution. En effet, lentreprise doit tre apte faire voluer son mode de distribution et sa stratgie de commercialisation par rapport lInternet. Enfin, on peut conclure que les distributions slectives et exclusives sont des systmes rvolus ce qui ncessite une grande mfiance de la part des responsables marketing pour mieux couler leurs productions sur le Net.
II-2 La fiscalit pour le commerce lectronique :
Le commerce lectronique constitue une activit commerciale qui ne peut pas chapper au domaine de la fiscalit bien quil y ait eu des propositions de faire dcharger le commerce lectronique de tout type de taxe16.
JEAN PIERRE Geneti, Comment Internet pourrait bouleverser la distribution des automobiles , LARGUS de lautomobile, 17 avril 1997, p7. 16 Lex-prsident des Etats-Unis, Bill Clinton, y a nonc ds 1997 : LInternet doit tre un endroit o lEtat sefforce de ne causer ni obstructions, ni problmes Nous voulons que le commerce sur Internet soit exempt de nouvelles taxes, de barrires douanires, de rgles pesantes, tout en tant labri des pirates
15
I. Talbi et M. Helaoui
24
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
A ce point, la question qui se pose est la suivante : comment les transactions lectroniques vont-elles tre taxes ? a) La TVA17 comme impt indirect : Etant donn que nous sommes dans une activit immatrielle, le commerce lectronique se trouve en face du problme didentification avec prcision de la personne redevable de la TVA. La TVA peut tre donc prleve sur les importations leur destination, elle est paye normalement par lacheteur. En ce qui concerne les marchandises non importes, il convient dajouter la TVA au prix des marchandises et de la dclarer ladministration fiscale tout comme pour les achats traditionnels. A ce niveau, le principe de territorialit18 doit tre respect lorsquil sagit dune opration du commerce lectronique, en des termes plus prcis : le rgime de la TVA applicable aux oprations portant sur des biens commands via Internet rsulte des rgles de la territorialit arrte par la sixime directive communautaire du 17/05/97 et transposes en droit interne. 19. Concrtement, si un consommateur X achte un produit via Internet, il est redevable de la TVA, il a dautre part le droit des dductions fiscales au titre des achats effectus en vue de la production de biens imposables. Deux remarques importantes peuvent tre rclames : La premire joue en faveur du client dans la mesure o il nexiste pas de facture transmise par le fournisseur qui permettrait de vrifier lintgrit de la comptabilit du client. La deuxime est au niveau de la trsorerie, puisque le client ne verse pas la TVA un fournisseur.
La TVA est un impt indirect sur la consommation collecte par lintermdiaire des personnes physiques ou morales exerant certains activits professionnelles : ( HAMMI Lotfi, cours de fiscalit , 3me ESC, lcole suprieure de commerce de Tunis, 2001-2002) 18 le principe de territorialit stipule que : Lapplication de la TVA est subordonne la ralisation de laffaire sur le territoire concern ( HAMMI Lotfi, cours de fiscalit , 3me ESC, lcole suprieure de commerce de Tunis, 2001-2002) 19 BENSOUSSAN.Alain, Internet aspects juridiques , ditions Herms-Paris, 1996.
17
I. Talbi et M. Helaoui
25
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
b) Limpt direct : Si on se lance dans le commerce lectronique que ce soit lchelle nationale ou internationale, on serait gnralement assujetti limpt sur le revenu, voir des taxes directes sur la valeur des marchandises ou des services vendus dans les pays o se trouve le local professionnel et o se droule lactivit gnratrice de revenu. Dans ce cadre comment se fait la taxation ? BEN SOUSSAN y apporte la rponse en disant que : En matire dimpt direct (impt direct et sur le revenu), la taxation sur les activits commerciales ralises sur le rseau dInternet seffectue par une application combine du droit interne et des conventions fiscales signes avec les Etats. De ces conventions, on peut tirer quune entreprise non rsidente ne va tre taxe que si et seulement si elle dispose dun tablissement stable, selon la convention fiscale de lorganisation de coopration et de dveloppement conomique (O.C.D.E) dans son article 5 : une installation fixe daffaires par lintermdiaire de laquelle exerce tout ou une partie de son activit. 20. c) Les droits de douane : Les taxes limportation ou les droits de douane sont gnralement prleves au port (aroport) de destination. Le paiement incombe au destinataire des marchandises et est normalement prlev par lorganisme expditeur. Mais, il existe aujourdhui un consensus gnral qui propose dexempter de droits de douane les prestations entirement effectues sur les rseaux de
tlcommunication, cest dire quaucune taxe ne frappe les marchandises numriques. En matire dimposition et de taxation lectronique, les autorits fiscales rencontrent des difficults lies au commerce lectronique. LUnion Europenne est entrain dtudier la question de savoir si des taxes propres au commerce lectronique ne seraient pas ncessaires.
20
Source : Les secrets du commerce lectronique : guide lIntention des PME exportatrices. .
I. Talbi et M. Helaoui
26
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
III. LA REALITE DU COMMERCE ELECTRONIQUE EN TUNISIE :
III-1 La Commission Nationale sur le Commerce Electronique (CNCE) :
Le gouvernement tunisien a accord un intrt particulier au commerce lectronique et a pris les dispositions ncessaires son dveloppement. Dans son discours annonc en novembre 1997, le Prsident de la Rpublique a ordonn la cration dune commission nationale pour le commerce lectronique. Cette commission fonctionne sous lgide de deux services ministriels, lun du commerce et lautre de la communication. La CNCE relve son existence de la collaboration de plusieurs autres organismes et institutions publiques tels que : Le Ministre du Tourisme, du Commerce et des produits artisanaux. Le Ministre des Technologies et de Tlcommunication. Le Ministre des Finances. Le Secrtariat dEtat la Recherche Scientifique. Le Secrtariat dEtat lInformation. La Banque Centrale de Tunisie. LAgence Tunisienne dInternet. Les diffrents fournisseurs dInternet.
La CNCE vient pour rpondre lambigut pose par la pratique du commerce lectronique en Tunisie et apporter des solutions possibles pour sa mise en place. Lactivit de la CNCE est rsume essentiellement en deux sous activits : La premire concerne ltude des enjeux du commerce lectronique et les diffrents problmes qui lui sont poss ainsi que leurs effets sur lconomie tunisienne. La deuxime se droule autour de la recherche des possibilits de dvelopper la pratique et llargissement de son champ dapplication.
I. Talbi et M. Helaoui
27
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Durant la priode sparant sa premire runion qui date du 28 novembre 1997 et la remise de son rapport dfinitif, le travail de la CNCE a concern plusieurs aspects : Les aspects commerciaux. Les aspects financiers et fiscaux. Les aspects juridiques et rglementaires. Les problmes de scurit lectronique des transactions commerciales. Les aspects techniques relatifs au dimensionnement et la scurisation rseau. LEDI21 et le recensement des projets nationaux. La sensibilisation et la formation. Les projets pilotes spcifiques et exprimentaux.
III-2 La stratgie tunisienne en matire de commerce lectronique :
En discutant le rapport de la CNCE en mai 1999 par le conseil ministriel, le gouvernement tunisien a pris des dcisions importantes visant la promotion et le dveloppement du commerce lectronique en Tunisie dont on cite : La promotion de lexportation travers le rseau Internet par la rvision de certaines procdures relatives au commerce extrieur. Lorganisation de journes dtudes priodiques sur le commerce lectronique dans le but de sensibiliser et de former. La poursuite du dveloppement du rseau national de communications en vue de ladapter aux exigences des changes lectroniques. Lamlioration du cadre juridique qui rglemente cette activit pour que la lgislation nationale soit capable de rpondre aux diffrents problmes poss par ce nouveau mode dchange commercial. Le lancement des projets pilotes.
Ces diffrentes mesures dj cites, montrent, bien quon est encore loin de la pratique du commerce lectronique, on est sur le chemin et on devra tre
21
Echange des donnes informatises.
I. Talbi et M. Helaoui
28
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
optimiste de la ncessit future du commerce lectronique. Dailleurs, le gouvernement tunisien a pris plusieurs mesures facilitant lintgration dans lconomie immatrielle. On peut en citer les actions suivantes : Faire bnficier, une chelle trs large, toutes les catgories sociales, mme dans les zones rurales et les quartiers populaires de savoir exploiter lInternet. Assurer de manire progressive et par voie lectronique certaines prestations administratives, commerciales et conomiques en utilisant les moyens de communication modernes. Mettre en place des moyens de paiements lectroniques scuriss en lanant la monnaie lectronique : e-dinar.
III-3 Les projets pilotes :
Bien quon ne puisse pas parler dune vente en ligne totale et proprement dite en Tunisie, tant donn que le volume des transactions lectroniques est encore trs faible, il existe des essais et des tentatives ralises par certaines entreprises tunisiennes aimant sintgrer dans ce nouveau march virtuel. a) Des sites virtuels touristiques : a.1 Le site commercial virtuel du groupe les orangers : Ce site est dorigine purement touristique puisquil fait partie du groupe touristique LES ORANGERS , il constitue une porte ouverte toutes les nationalits en vue de sinformer sur le tourisme tunisien, il prsente les diffrents services dhtellerie quoffre le groupe en facilitant la tche tous ceux qui veulent rserver leurs sjours en ligne. La particularit de ce site rside dans sa rdaction et reprsentation en plusieurs langues (Franais, Anglais, Italien)22
22
BEN AMOR Fayal, Les cls du commerce lectronique , dition CLE, 2001, p222.
I. Talbi et M. Helaoui
29
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
a.2 Le site commercial virtuel pour le secteur de lartisanat : Ce site expose les produits artisanaux tunisiens, il permet leurs acquisitions en ligne travers des moyens de paiements lectroniques. La page daccueil nous prsente ces produits, parmi eux on y trouve23 : .les verres souffls, .les bois dolivier, .les tapis, .les habits traditionnels a.3 Le site commercial virtuel pour le tourisme saharien : En crant leurs propres sites, les agences de voyages seront plus rapides dans la proposition de leurs services sur une porte ouverte mondiale24. En des termes plus prcis, ce site prsente le produit saharien tunisien aux agents concerns par le tourisme et permet nimporte qui, quel que soit sa destination, de rserver et de payer en direct tout en garantissant la scurit de ses coordonnes bancaires. Enfin il reste noter que ce projet a t mis en place par lOffice National du Tourisme Tunisien25. b) Des projets pilotes lexportation : b.1 La galerie marchande du CEPEX : Dans son nom propre, le CEPEX est le centre de promotion des exportations. Son programme daction reflte les dcisions du conseil suprieur de lexportation26. La galerie marchande du CEPEX regroupe des produits diversifis donnant lieu des pages reprsentant les entreprises concernes ainsi que le formulaire qui donne naissance la transaction. Il existe deux types de formulaires, un pour les ventes en dtail avec paiement en ligne et lautre pour les ventes en gros. La galerie marchande est bilingue (Franais et Anglais), dynamique et active.
Voir le site : www.cepex.nat.tn Voir le site : www.orangers.com.tn 25 Voir le site : www.socopa.com.tn 26 BEN SLIMEN Amira et NEHDI Yosra, Le commerce lectronique et son impact sur les entreprises : cas des entreprises tunisiennes , mmoire de fin dtudes pour lobtention de la matrise en gestion comptable, Institut Suprieur de Gestion de Tunis, 1999-2000, p67.
24
23
I. Talbi et M. Helaoui
30
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Ce projet bnficie de lassistance de lAgence Tunisienne de lInternet (ATI) qui hberge les projets pilotes depuis le 21mai1999. b.2 Le guichet unique virtuel : Il consiste en lchange lectronique des documents concernant le commerce extrieur, il porte donc essentiellement sur les oprations dimportations et
dexportations. On y trouve 4 oprations essentielles : Le titre de commerce, La dclaration en douane des marchandises, Le document de contrle technique linformation, Le manifeste (manifeste cargo de lembarquement de la marchandise). c) Le march virtuel pour le service postal et la consommation courante : c.1 Le site virtuel de la poste27 : Il prsente des services caractre, essentiellement postal : on peut acheter via Internet des produits comme les cartes postales, les timbres, les cartes de vux, comme il nous permet de suivre nos envois Rapide Poste ou mme dacheter un bouquet de fleurs. c.2 Le site BtoB et BtoC du magasin gnral28 : Le site commercial virtuel du magasin gnral est n le 25 janvier 2002, il permet de choisir et de demander parmi 2000 produits diffrents, que ce soient des produits alimentaires, des meubles, des articles lectroniques et mme de les dposer dans un chariot (virtuel) et de les faire livrer chez eux. Le site est prsent en deux langues : Arabe et franais, dune manire agrable. Il ne concerne pas seulement le commerce BTOC, car le magasin gnral a galement pour objet aussi bien la vente en gros que celle en dtail29. Ces diffrents essais visant lintgration des entreprises tunisiennes dans lconomie immatrielle montre que la capacit exploiter des opportunits du commerce lectronique devient une condition ncessaire de la comptitivit et
27 28
Voir le site : www.poste.tn Voir le site : www.smg.com.tn 29 Le manager , n68, mars 2002, p44.
I. Talbi et M. Helaoui
31
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
de la survie. Toutefois on remarque qu travers ces tentatives dj cites, le commerce lectronique en Tunisie se dirige en priorit vers lencouragement de lexportation via Internet.
I. Talbi et M. Helaoui
32
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Partie I - Les outils du commerce lectronique
Chapitre I : Les outils dchanges et de communication sur le Web :
Section 1 : Les outils dchanges et de discussion sur le Web :
I.
LES LIEUX DE DISCUSSION
Ils permettent la diffusion dune grande varit de sujets avec dautres internautes, de faire-part de leurs expriences ou de poser des questions.
I-1 Les listes de diffusion :
Une liste de diffusion est un moyen permettant la discussion dun sujet donn par lintermdiaire du courrier lectronique tout en tant abonn une liste de diffusion, on recevra automatiquement et par courrier lectronique toutes les contributions des autres abonns30. En effet, les listes de diffusion reprsentent lun des meilleurs moyens pour sinformer propos dun sujet donn, cest un moyen de disposition dune grande partie des connaissances afin quelles soient utilises par les internautes selon leur propre besoin. Ainsi, les listes de diffusion, comme outil de commerce lectronique, permettent la discussion entre lentreprise, ses consommateurs, ses fournisseurs et avec les intermdiaires sils existent. Si lentreprise dispose dun dpartement recherche et dveloppement, les listes de diffusion facilitent, aux chercheurs, la ralisation de leurs expriences. Elles aident lentreprise la dtermination de sa position sur le march (par la discussion avec les clients.) Les attributions des clients vis-vis du produit offert par lentreprise permettant cette dernire de rester
30
SNELL Ned, Internet , ditions Sams Publishing, 1999, pages 261-263.
I. Talbi et M. Helaoui
33
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
informe sur la perception des clients (le client peut donner son avis sur ce quil attend du produit.). Ceci aide lentreprise dvelopper son produit tout en respectant la volont des consommateurs.
II.
LES FORUMS DE DISCUSSION :
Certaines listes de diffusion envoient vingt messages ou mme plus par jour dont beaucoup sont sans intrt et par suite ces messages reprsentent une source de perte de temps. Les forums de discussion permettent de dbattre propos dun sujet de la mme manire que les listes de diffusion. Seulement, les forums de discussion diffrent des listes de diffusion par le fait quaux forums de discussion on doit aller jusqu ces groupes pour sinformer des discussions encours dans un forum, en faisant appel un logiciel de news31. Un logiciel de news permet de parcourir les messages existants et de ne lire que ceux appartenant aux champs dintrts de lutilisateur, dans notre cas aux champs dintrts de lentreprise au cours de sa recherche, ce qui reprsente un gain du temps considrable.
III. LE PROTOCOLE FTP:
Le mtier dun gestionnaire peut lamener tlcharger et transfrer frquemment une multitude de programmes, fichiers, images, son et vido. Gnralement, si la taille de ces outils est infrieure 2 Mo, le transfert peut tre effectu par e-mail. Si non, la boite peut se bloquer, dans ce cas nous pouvons affirmer que la messagerie lectronique est incapable de transfrer de gros fichiers. Le mode de transfert FTP reprsente une meilleure solution permettant le tlchargement et en priode beaucoup plus courte32. Finalement nous pouvons retenir la dfinition donne par SNELL Ned, cet auteur considre le protocole FTP (file transfer protocol ou encore protocole de transfert de fichiers) comme un langage entre deux ordinateurs permettant le transfert par Internet des fichiers de toutes sortes. Linternaute peut soit porter le fichier dun ordinateur vers son disque dur, soit lenvoyer de son ordinateur vers un serveur.
31 32
SNELL Ned, Internet , ditions Sams Publishing, 1999, pages 275et 276. PlaNet Magazine mars 2003, p 5.
I. Talbi et M. Helaoui
34
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Il existe deux types de serveurs : Les serveurs FTP qui sont protgs par un mot de passe afin de limiter laccs aux utilisateurs autoriss. Dautres serveurs FTP sont appels anonymes et ils ne requirent pas lemploi dun mot de passe.
IV.
LECHANGE DES PRODUITS33 :
IV-1 Les outils dachat :
Aujourdhui lachat est possible tout moment, les boutiques lectroniques sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans ce paragraphe nous essayons de prsenter les principaux outils permettant aux consommateurs de raliser leurs achats sur le Web. a) Les boutiques en ligne : Cest un outil pour sinformer sur le produit et ses caractristiques techniques en proposant des photos et des listes de caractristiques. b) Les outils de recherche : Ils permettent linternaute de trouver rapidement le produit dsir. Ceci est ncessaire surtout pour les sites dont la gamme des produits proposs est tendue. c) Les outils pour commander : Les formulaires de commandes permettent aux internautes de dfinir exactement le produit command. Ainsi le fabricant informatique Dell (voir page Web : http//edu2.eduverse.com/asp/edu-main.asp ) permet ses clients de constituer un PC la demande. En outre, sur la majorit des sites de voitures (haute classe) linternaute peut spcifier sa voiture selon ses besoins. d) Les listes de diffusion : Elles sont utilises par la majorit des entreprises spcialises dans le commerce en ligne. En effet, les clients, en sabonnant des listes de diffusion, seront informs des nouveauts et des offres spciales.
33
SNELL Ned, Internet , ditions Sams Publishing, 1999
I. Talbi et M. Helaoui
35
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
e) Les outils de paiement tels que la carte bancaire ( voir chapitre II) f) Les comptes et les Caddies : Afin de simplifier les achats en ligne, certaines boutiques imposent lusage de compte ou de Caddies : f.1 Les comptes : En crant un compte auprs dune boutique, les clients vitent de saisir les mmes informations chaque achat. Dans un compte le client indique son nom et son adresse de livraison : informations rptitives chaque achat. f.2 Le Caddie : Il permet de choisir et dacheter plusieurs produits la foi, il permet aussi de voir les dtails des articles choisis par le consommateur ainsi que la somme totale de la commande. Et bien sr la possibilit denlever un ou plusieurs articles est possible avec le Caddie. Ainsi assis sur son fauteuil derrire son PC, le consommateur peut visiter les boutiques lectroniques et comparer les prix pour trouver les meilleures affaires, il peut mme acheter ce quil dsire.
IV-2 Les outils de vente et de commercialisation :
a) La boutique virtuelle : Cest un excellent moyen pour se dvelopper pour les entreprises commercialisant des produits ou des services ciblant une large chelle gographique. b) La programmation : Pour traiter les informations remplies par les clients, la connaissance et lexprience dans les langages de programmation tels que Java demeurant aujourdhui de plus en plus utile pour lentreprise.
I. Talbi et M. Helaoui
36
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
c) Les outils de scurit : Une boutique virtuelle ncessite un engagement important de la part de lentreprise. Cest pour cela quelle doit protger son site Web. Il existe plusieurs protocoles assurant la scurit de lopration de commercialisation. d) Un service clientle spcialis : Tout comme le service clientle dans le commerce traditionnel, ce service a pour rle de traiter les questions et les plaintes des clients. Mais il est signaler que les clients qui achetaient sur le Web considrent le temps comme une contrainte dterminante. Pour cela, il est conseill de rpondre aux rclamations et aux commentaires (gnralement envoys par courrier lectronique) des internautes, dans un dlai ne dpassant pas les 48 heures do la ncessit dun service client spcialis. e) Une conception professionnelle : La conception est un outil dterminant dans la construction des sites Web. Lentreprise cherche crer un site apparence professionnelle comme celles de ses concurrents. Dans ce cas, lentreprise doit soit matriser la technique de conception soit recourir aux spcialistes dans le domaine.
V.
LA DOCUMENTATION SUR LE WEB
La recherche sur le Web est de plus en plus facile grce aux moteurs et guides de recherche, instruments indispensables la consultation rationnelle du Web. Bien que ces instruments ne donnent pas, toujours, lutilisateur, linformation recherche, vu la cration rcente des moteurs et guides de recherche. A titre dexemple la cration de Yahoo a eu lieu en avril 1994 et celle de Altavista en dcembre 199534. Pour avoir une information sur le Web linternaute peut utiliser plusieurs techniques :
GUINCHARD Serge, HARICHAUX Michle et DE TOURDONNET Renaud, Internet pour le droit , ditions Montchrestien, E.J.A, 1999,p 61.
34
I. Talbi et M. Helaoui
37
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
V-1 La recherche dun renseignement sur un serveur dont on connat ladresse URL :
La recherche de linformation se fait dans ce cas partir dun site de documentation particulier qui correspond au thme requis et dont on connat ladresse URL. (Comme par exemple le thme gnral du finance sur un serveur www.finance.org) La recherche dun renseignement sur un serveur combine entre la simplicit, la rapidit et lefficacit puisque les serveurs spcialiss actuels prsentent sur leurs pages daccueil plusieurs liens diffrents et trs utiles.
V-2 Recherche dun document sur un guide de recherche :
Un guide de recherche est connu aussi sous le nom de moteur thmatique. Comme son nom lindique, le rle de ce moteur est de classer par thme la base de donne disponible. Cette technique de recherche forme une arborescence dans la mesure o chaque thme trouv se subdivise lui-mme en sous thmes. Pour mieux comprendre le principe d arborescence , nous proposons un petit exemple de recherche qui se base sur cette technique : Soit une recherche sur Yahoo sur les cours boursiers, le rsultat de la recherche se prsente comme suit :
I. Talbi et M. Helaoui
38
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Sciences et technologies
Sant
Rfrences et annuaires
Institution et politique
Yahoo
Actualit et mdia Immobilit Lactualit
Divertissement
Finance Commerce et conomie
La bourse
Emploi
LEuro
Arts et Culture
Socit
Actualit et mdia
Figure 1. Exemple de recherche en arborescence .
Comme le montre ce schma, le thme commerce et conomie se divise en plusieurs thmes dont le thme finance, ce dernier son tour, se divise en plusieurs thmes dont la bourse Le tableau ci dessous nous prsente les principaux guides de recherches et leurs adresses URL :
I. Talbi et M. Helaoui
39
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Guide de recherche Yahoo Lycos Nomade Echo Lokace www.yahoo.fr www.lycos.fr www.nomade.fr www.echo.fr www.lokace.com
URL
Tableau 1. les principaux guides de recherches35.
Enfin, il reste prciser que, dans un guide, la recherche par mot cl peut tre combine avec la recherche par thme.
V-3 Recherche dun document sur un moteur de recherche :
Le moteur de recherche se base sur un robot dont le rle est de trouver, de classer en fonction du texte et des mots cls, toutes les pages Web disponibles dans le rseau, et de les intgrer dans une base de donne. Cette technique de recherche ne classe pas les pages trouves par thme, les rsultats sont, plutt, reprsents sous forme de listes tout en indiquant les premiers mots de chaque document. Le moteur de recherche le plus connu sur le Web est Altavista36. Le tableau ci dessous reprsente les principaux moteurs de recherche disponibles sur le Web :
GUINCHARD Serge, HARICHAUX Michle et DE TOURDONNET Renaud, Internet pour le droit , ditions Montchrestien, E.J.A, 1999, p 64. 36 Altavista : il est mis au point en 1995 par un franais luniversit de Palo Alto en Californie, cest la base de donnes, actuellement, la plus riche. (GUINCHARD Serge, HARICHAUX Michle et DE TOURDONNET Renaud, Internet pour le droit , ditions Montchrestien, E.J.A, 1999, p 65.)
35
I. Talbi et M. Helaoui
40
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Nom du moteur URL
Langue du site Recherche sur Recherche de recherche tout le Web restreinte aux sites
francophon es. Ecila Eurca Lokace Nomade Yahoo! France Voil Altavista Excite HotBot Infoseek Lycos Magellan Yahoo! www.ecila.fr www.eureka.fr.com www.lokace.com www.nomade.fr www.yahoo.fr www.voila.fr www.altavista.com www.excite.fr www.hotbot.com www.infoseek.fr www.lycos.fr www.mckinley.com www.yahoo.com franais anglais anglais oui oui oui oui non non franais franais franais franais franais anglais franais anglais non non non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
Tableau 2. les principaux moteurs de recherche37.
V-4 Recherche de documents par oprateur logique38 :
Lintrt essentiel de la recherche par oprateur logique cest daffiner la recherche, afin daboutir aux rsultats les plus performants que possible. Cette technologie se base sur les symboles dintersection (et, +), de runion (ou) ou dexclusion (sauf, plutt, non). Un calcul de pertinence , permettant de classer les rsultats par ordre dcroissant, est mis en uvre par cette technologie. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette technologie nous proposons lexemple suivant :
37 38
SNELL Ned, Internet , ditions Sams Publishing, 1999, p 173. La recherche par oprateur logique est la base des mathmatiques modernes.
I. Talbi et M. Helaoui
41
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Si linternaute tape le premier mot + un deuxime, les rsultats obtenus doivent ncessairement contenir les deux mots ensemble. Par contre, en labscence du signe +, linternaute obtient les documents contenant lun des deux mots taps en plus des documents contenant les deux mots combins.
V-5 Les nouvelles mthodes de recherche sur le Web :
Des nouveaux outils ont t rcemment crs pour aider linternaute tout au long de sa recherche. a) Les Mtas moteurs de recherche : Ils permettent la consultation simultanment de plusieurs serveurs de recherche. Le tableau ci dessous prsente certains mtas moteurs utiles avec leurs adresses URL : Mtas moteurs Profusion Meta crawler Meta search Savvy search debriefing URL www.designlab.ukans.edu/profusion www.metacrawler.com www.metasearch.com www.savvysearch.com www.debriefing.com
Tableau 3. Les principaux Mtas moteurs.
Nous citons en autre : Copernic prof2000 qui permet la consultation de plus de 40 moteurs de recherche en mme temps. Cest un logiciel non gratuit. b) Les Agents Intelligents : Ce sont de petits logiciels permettant de chercher tous les documents qui contiennent les mots cls indiqus par linternaute en lanant des dtectives sur le Web. Ils sont considrs comme des voisins des systmes dintelligence artificielle, comme ils sont capables damliorer le contenu de leur slection au fur et mesure de leur exprience.
I. Talbi et M. Helaoui
42
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Section 2 : Les outils de communication et de publication :
I.
LA POSTE ELECTRONIQUE
Cest lune des fonctionnalits les plus connues du rseau39. Grce au courrier lectronique, on peut transmettre des documents dune centaine de pages et mme des messages sonores (compresss) nimporte o dans ce monde et ceci seulement en quelque secondes. Sans doute, le courrier lectronique est loutil de messagerie, la fois, le plus rapide, le plus facile utiliser et le moins coteux que nimporte quel autre outil de messagerie40. Pour les entreprises, le courrier lectronique reprsente loutil le plus performant pour effectuer la communication entre les filiales, entre dirigeants et salaris, la communication avec le consommateur (rpondre aux questions des
consommateurs) et surtout, cest un outil idal pour les affaires dexportation et dimportation. En ralit aujourdhui, la contrainte temps, est dterminante pour lentreprise. Cest pour cela que le courrier lectronique a pris la place des autres outils. SMTP41 est un protocole standard permettant de transfrer le courrier d'un serveur un autre en connexion point point. Il s'agit d'un protocole fonctionnant en mode connect. Le courrier est remis directement au serveur de courrier du destinataire. Le protocole SMTP fonctionne grce des commandes textuelles envoyes au serveur SMTP. Chacune des commandes envoyes par le client est suivie d'une rponse du serveur SMTP compose d'un numro et d'un message descriptif. POP42 permet comme son nom l'indique d'aller rcuprer son courrier sur un serveur distant (le serveur POP) . Il est ncessaire pour les personnes n'tant pas
Le courrier lectronique reprsente 35% environ du volume des communications mondiales sur Internet. 40 GUINCHARD Serge, HARICHAUX Michle et DE TOURDONNET Renaud, Internet pour le droit , ditions Montchrestien, E.J.A, 1999. 41 Simple Mail Transfer Protocol, traduisez Protocole Simple de Transfert de Courrier. 42 Post Office Protocol que l'on peut traduire par Protocole de bureau de poste .
39
I. Talbi et M. Helaoui
43
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
connectes en permanence Internet afin de pouvoir collecter les mails reus hors connexion. Tout comme dans le cas du protocole SMTP, le protocole POP fonctionne grce des commandes textuelles envoyes au serveur POP. Chacune des commandes envoyes par le client est compose d'un mot-cl, ventuellement accompagn d'un ou plusieurs arguments et est suivie d'une rponse du serveur POP compose d'un numro et d'un message descriptif.
II.
LE CHAT ET LE CHAT VOCAL:
Cest aussi le dialogue direct entre plusieurs utilisateurs connects sur Internet. Pour cela on pourra utiliser le protocole Internet Relay Chat IRC . Le Chat est ralis sous sa forme habituelle en mode texte , mais la rvolution technologique nous permet, aujourdhui, de parler dautres changes de donnes tel que la voie et la vido43.
II-1 Le Chat :
Cest un moyen de discussion en temps actuel avec des correspondants du monde entier. Le Chat est connu aussi sous le nom de dialogue en direct . En effet, tout ce qui est tap, dabord par linternaute puis valid ensuite, apparat sur lcran de tous les autres participants. Ceci est possible par le logiciel mirc 44 par exemple. Le Chat peut tre utilis comme un moyen de ngociation avec les fournisseurs ou les clients sur les prix et les qualits exiges.
II-2 Le Chat vocal et visuel :
Pendant des annes, la transmission des messages audio vido ncessite le passage par les trois tapes suivantes : La demande de transmission. Le tlchargement complet des fichiers audio vido. La lecture de ces fichiers.
43 GUINCHARD Serge, HARICHAUX Michle et DE TOURDONNET Renaud, Internet pour le droit , ditions Montchrestien, E.J.A, 1999, pages 78, 79. 44 Voir site : www.mirc.co.uk
I. Talbi et M. Helaoui
44
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Il y a alors, un problme de temps perdu, mme si ce ci peut tre ignor, puisquen ralit, il y a la possibilit de transmettre des fichiers audio vido nimporte o dans le monde et cela en quelques heures seulement. Mme cette perte de temps est dpasse, aujourdhui, grce de nouveaux plug in permettant la diffusion de la squence (audio vido) au fur et mesure de son tlchargement. Nous parlons ainsi, daudio vido en temps rel grce aux nouvelles formes de compression tel que : Ral vido45. V doline46. Quick time47. Au moyen dune camra numrique, les reprsentants de lentreprise nimporte o dans le monde pourront raliser de petits reportages vido, les convertir dans lun des formats prcits et les diffuser sur des correspondants (FTP), ce qui permet aux multinationales une couverture mondiale, en utilisant les nouveaux logiciels de visioconfrence48.
III. LA PUBLICITE SUR LE WEB : EXEMPLE DE CREATION DE SITE WEB :
La publication joue un rle de plus en plus fondamental dans la cration dune
image de marque dun produit. Un site Web prsente, aujourdhui, un moyen idal de publication, mais aussi mme la vente est possible sur le net en profitant des apports des boutiques virtuelles. (Vente 7jours sur 7). Bien que, la majorit des entreprises tunisiennes se limite, ce moment, juste la publication sur le Web, il est probable dassister une rvolution conomique par la diffusion du commerce lectronique mme pour les petites entreprises. Le site Web est alors un moyen de publication et de vente, dans ce cas on parle de boutiques virtuelles.
45 46
Voir site : www.real.com Voir site : www.vdo.com 47 Voir site : www.quicktime.apple.com 48 SNELL Ned, Internet , ditions Sams Publishing, 1999, pages 338-351.
I. Talbi et M. Helaoui
45
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Un site Web est un ensemble de pages Web relies par des liens. La page daccueil dun site Web contient, en gnral, un lien pour chaque page du site ou pour un groupement de pages Web, dans le cas o le site serait grand. Elle doit guider les internautes durant leur visite. En plus, elle doit tre attirante. Comme un site Web est un groupement de pages Web, alors pour crer un site Web, il suffit de crer des pages Web puis les relier entre elles par des liens.
III-1 La phase de conception : les principes de cration de pages Web :
Une page Web nest quun fichier en forme html (Hypertext Markup Language). Un fichier html est compos de plusieurs lments formant la page Web : Le titre : il est affich dans la barre de titres de la fentre du navigateur. Len-tte : cest un titre affich, cette fois, lintrieur de la page. Il est juste signaler quune page Web peut avoir plusieurs en-ttes et il existe plusieurs niveaux de hirarchie pour les en-ttes. Le texte normal : il est utilis pour la rdaction du texte normal de la page. Les lignes horizontales : elles servent structurer le continu de la page. Les liens hypertextes : ils renvoient linternaute vers dautres pages Web, des fichiers multimdias, des documents ou vers dautres serveurs (FTP par exemple), ces liens peuvent aussi pointer vers un endroit prcis dans la mme page. Les images : lintgration des images sert rendre la page plus esthtique. Le fond : cest une image ou couleur unie en arrire plan de la page.
I. Talbi et M. Helaoui
46
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Les tableaux : ils sont utiliss dans le but dorganiser, en ranges et en colonnes, le texte et les images.
III-2 Les outils utiliss pour crer une page Web :
Ils sont appels les diteurs de pages Web, ils permettent de crer des pages en les montrant telles quelles apparatront dans la fentre du navigateur. Avec certains logiciels (Front page), il nest pas ncessaire que lutilisateur soit un expert en langage html pour quil puisse crer sa page Web. Il suffit dutiliser la barre doutil tout comme Microsoft Word.
III-3 Lhbergement de site Web49 :
Il ne pose pas, vraiment aujourdhui, de problme. En effet, PlaNet Tunisie50 a mis au point une grande gamme complte de prestation dhbergements fiables et volutifs. PlaNet propose principalement deux types dhbergement : hbergement mutualis et hbergement ddi. a) Lhbergement mutualis : PlaNet propose deux formules dhbergement mutualis qui sont rapidement mises en place, ne demandant pas de comptences informatiques pousses et dont les cots sont rduits. a.1 La premire formule d hbergement mutualis est Pack Pro : Hbergement dun site Web. 50 Mo despace disque dur. Tout langage de programmation accept. Dpt dun nom de domaine. 5 adresses e-mails personnalises. MAJ illimit par accs FTP. Sauvegarde de donnes incluses.
49 50
PlaNet magazine p 4 et 5. Le premier fournisseur daccs en Tunisie, pour plus dinformation vous pouvez visiter le site : www.planet.tn.
I. Talbi et M. Helaoui
47
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Possibilit dutiliser des bases de donnes Access,
MySQL ou SQL server. Tout ceci pour 250DTHT/an.
a.2 La deuxime formule dhbergement mutualis est Pack Pro + : Hbergement de 3 sites Web. 200 Mo despace disque dur. Tout langage de programmation accept. Dpt de trois noms de domaine. 10 adresses e-mails personnalises. MAJ illimit par accs FTP. Sauvegarde de donnes incluses. Possibilit dutiliser des bases de donnes Access,
MySQL ou SQL server. Et ceci pour 500 DTHT/an. Ces deux solutions prcites correspondent parfaitement aux besoins des particuliers, des associations et de PME/PMI. b) Lhbergement ddi : Cette solution permet lhbergement de plusieurs centaines de sites Web et leurs associer les services classiques (FTP, serveur de mail, PHP, SQL) Donc avec cette solution il est possible de : Crer autant de sites dsirs sans avoir payer de nouveau. Choisir la mmoire et lespace disque de chaque site. Attribuer ou non les possibilits volues (SQL, CGI, SSL) selon le choix des clients. Grer le serveur de messageries. Grer la facette administrative des domaines. La formule de lhbergement ddi est Pack Partner :
I. Talbi et M. Helaoui
48
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Hbergement ddi de la machine du client. Mise en conformit de la machine. Dpt de 5 noms de domaine. 15 adresses e-mails personnalises. Tout cela pour 95051DTHT/an.
Chapitre II : Les diffrents modes de paiement et les solutions proposes :
Section 1 : Les diffrents modes de paiement:
Comme pour le commerce traditionnel, une opration du commerce lectronique ne peut tre acheve quen prsence de certains modes de paiement dont les caractristiques sont rattaches la notion lectronique et donc sont relatifs aux transactions qui seffectuent en ligne 52. En des termes plus simples, lexpression du paiement lectronique dsigne toutes les techniques de paiement lectronique dachat des biens et services via Internet.
I.
LE PAIEMENT ELECTRONIQUE :
I-1 Le paiement direct :
Certains internautes optent pour ce mode de paiement, vu sa facilit. Cest un systme simple appliquer, il consiste en ce qui suit : Linternaute choisit ses produits sur le Web et paie par chque. Le commerant expdiera la commande ds rception du rglement 53 . Le paiement est ici, donc, en direct, il ne ncessite pas lintervention dun tiers pour assurer lopration. Il a t utilis au dpart et il prsente lavantage de la scurit du consommateur. Au plus tard, il y a lapparition des nouvelles formes de rglement via Internet qui sont purement numriques.
Il est signaler que les offres de Planet sont disponibles en mars 2003. BEN AMOR Fayal, Les cls du commerce lectronique , dition CLE, 2001, p106. 53 JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique , ditions Litec, 1998, p131.
52 51
I. Talbi et M. Helaoui
49
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
I-2 Le paiement par intermdiation financire :
Tel que son titre lindique, ce mode de paiement exige lintervention dun tiers dans la conclusion de lopration du commerce lectronique entre les personnes concernes. Le systme est simple, selon JEAN-BATISTE Michelle : Les parties ont recours une entreprise spcialise dans le tlpaiement qui joue le rle dintermdiaire entre la banque du client et celle du fournisseur afin dassurer le rglement. Le client doit ouvrir un compte auprs de cette entreprise sur la base duquel, elle va conclure la transaction commerciale en ligne. Une des socits les plus connues dans ce domaine est le First virtual Holdings Inc qui a mis en place le systme First virtual, qui, en lchange du numro de carte bancaire transmis par tlphone, dlivre par e-mail un identifiant spcifique lutilisateur pour que celui-ci puisse raliser des achats, les transactions sont, par la suite, conduites par courrier lectronique.
II.
LA MONNAIE VIRTUELLE54 :
II-1 Le porte-monnaie lectronique :
Sabatier Guy a dfini le porte monnaie lectronique comme tant, Un nouveau moyen de paiement scriptural utilis fondamentalement pour rgler les paiements de contact mais aussi sans contact, pour lesquels les montants sont faibles 55. Le systme consiste tlcharger un logiciel spcifique auprs dune banque, le porte-monnaie lectronique tant rempli, par la suite, en fonction des besoins des clients qui utilisent largent quil contient pour payer leurs achats en ligne. A ce niveau deux solutions sont prsentes :
La monnaie virtuelle correspond des logiciels qui permettent deffectuer des paiements sur les rseaux ouverts et notamment sur Internet. Dans ce cas la rserve de fonds pralablement constitue et stocke sur ordinateur, mais nest pas matrialise : dfinition donne par BEN AMOR Fayal dans son ouvrage : Les cls du commerce lectronique 55 SABATIER Guy, Le porte-monnaie lectronique et le porte monnaie virtuel , Puf, coll Que saisje ? , mai 1997, p32.
54
I. Talbi et M. Helaoui
50
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
a) La solution cybercash : Cybercash est fond en 1994, les utilisateurs de ce systme doivent obtenir une copie du logiciel56, le principe consiste en ce qui suit : le client choisit le produit ; le vendeur, et aprs ngociation du prix avec le premier, lui envoie une facture en ligne. A son tour, lacheteur note sur la facture ses coordonnes bancaires qui sont cryptes par cybercash et lenvoie au vendeur. Ce service permet aux entreprises de traiter un gros volume de petits paiements. b) La technique de G.Ctech : Ce systme permet, au surplus, les paiements en plusieurs devises et les transactions par micro-paiement57.
II-2 Le e-cash :
Ce systme a t labor par la socit hollandaise DIGIcash 58. Il permet de commander des produits sur Internet de faon totalement sre. Le processus de fonctionnement de DIGIcash est trs simple manipuler, il consiste en louverture dun compte chez une banque digitale sur Internet. Une fois Le compte est approvisionn, il va permettre son propritaire de faire des retraits de la banque et dobtenir de la monnaie lectronique. Aujourdhui, il y existe plus de trente mille comptes59 qui sont la First Digital Bank . Linconvnient majeur de e-cash rside dans le fait quil nest pas convertible, seule la banque amricaine Mark Twain Bank permet depuis le 23 octobre 1995 de convertir les e-cach en dollars mais sous la condition dy ouvrir un compte60.
Section 2 : Les solutions techniques et juridiques relatives aux problmes de paiement:
Du moment o on parle de lchange de donnes informatises (EDI) on voque certainement la notion de scurit sur lInternet. Or cet change ne peut tre
56 57
Pour plus dinformation, vous pouvez consulter le site www.cybercash.com BEN AMOR Fayal, Les cls du commerce lectronique , dition CLE, 2001, p119. 58 BRESSE.P, BEAURE.DANGERES.G et THUILLIER.S, Paiement numrique sur Internet , International Thomson Publishing, 1997, p12. 59 Voir louvrage prcit la note 45 page16. 60 JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique , ditions Litec, 1998, p133.
I. Talbi et M. Helaoui
51
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
compltement ou totalement garanti, cest pour cette raison, quil devient ncessaire de faire circuler une information confidentielle et authentifie entre les tiers concerns. Dans ce qui suit, nous allons essayer dtudier quelques techniques de scurisation en gnral, ainsi que leurs application en Tunisie.
I.
LA CRYPTOGRAPHIE :
Elle consiste transformer un message dune manire quil soit illisible pour toute personne qui ne dtient pas la mthode de dcryptage. Cest aussi : Lutilisation de codes ou signaux non usuels permettant la conversion des informations transmettre en des signaux incomprhensibles la lecture de linformation61. Typiquement, le processus de cryptage ntant ralis quen prsence de deux lments essentiels : Un algorithme et une cl. Il a connu une volution marque par lapparition dun nouveau systme dapplication. De l, on parle de deux types de cryptologie.
I-1 Le cryptage symtrique :
Celui-ci est le plus ancien, il ncessite une seule cl qui sert la fois crypter et dcrypter, il est appel aussi cryptage cl secrte. Le principe de fonctionnement est trs simple, il consiste en ce qui suit : lmetteur code le message par une cl dj connue par le rcepteur qui son tour lutilise pour le dcrypter. Malgr sa facilit mettre en uvre ainsi que sa rapidit, le cryptage symtrique ntait pas chapp de critique car il nous faut dautant de cls diffrentes si on correspond avec plusieurs personnes.
I-2 Le cryptage asymtrique :
lI est appel aussi cryptage cls publiques ou privs ; Cette appellation est explique par le fait quil existe en ralit deux cls, lune prive et personnelle qui est connue par son dtenteur lgitime qui lui permet de dchiffrer les
61
Dfinition donne par la loi n2000-839 aot 2000 dans son deuxime article.
I. Talbi et M. Helaoui
52
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
messages quil reoit, lautre est publique, elle appartient une personne et elle est connue par les autres internautes qui lutilisent pour coder les messages quils lui envoient. En Tunisie la notion de cryptologie nest pas encore assez dveloppe, elle est soumise un rgime dautorisation pralable62 chaque fois quelle assure une fonction de confidentialit, dintgrit ou dauthentification. Toute fois, larticle 13 du dcret n97-501 permet au Ministre de Communication deffectuer un contrle pour vrifier le respect du cadre de fonctionnement de la cryptologie. Enfin, on peut conclure quen Tunisie, on est bien positionn dans ce domaine par rapport aux autres pays arabes et africains, bien que la loi 2000-83 a t un peu restreinte en ce qui concerne le cryptage vu quelle ne lui consacre que deux articles seulement dont le premier voque la dfinition.
II.
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE :
La signature lectronique reflte le consentement final du contractant, cest un ensemble de donnes lectroniques et informatises qui peuvent identifier avec prcision le signataire dun tel message. Elle assure donc deux principales fonctions63 : lidentification de lauteur dune part et la manifestation de sa volont dune autre part. La signature lectronique prsente une garantie juge importante quune signature manuscrite quon attend toujours tre imite, elle nous permet de sassurer que le message na pas t modifi partir du moment o il est sign et mme au cours de sa transmission. Dans le monde entier, plusieurs lois ont voqu la notion de signature lectronique. En effet, dans les travaux de la CNUDCI64 , larticle 7 de sa loi type
Article 2 du dcret n 97-501du 14 Mars 1997relatif au service valeur ajoute des tlcommunications. 63 Serge GUINCHARD, Michle HARICHAUX, Renaud DE TOURDONNET Internet pour le droit (Connexion Recherche, Droit ). Montchrestien. E.J.A.1999 p212. 64 CNUDCI: la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International.
62
I. Talbi et M. Helaoui
53
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
stipule que lorsque la loi exige la signature dune certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas dun message de donnes : A/ Si une mthode est utilise pour identifier la personne en question et pour indiquer quelle approuve linformation contenue dans le message de donnes et : B/ Si la fiabilit de cette mthode est suffisante au regard de lobjet pour lequel le message a t cre ou communiqu, compte tenu de toutes les circonstances, y compris, de tout accord en la matire. La CNUDCI a montr, bel et bien, la validit de la signature lectronique. Aprs ladoption de sa loi type, la CNUDCI a orient ses proccupations65 prparer un projet de rgles uniformes sur les signatures numriques, il ya eu une forte prfrence adopter les techniques de la cl publique - cl prive. (Qui a t dj voque au paragraphe prcdent.) A son tour, la loi fdrale allemande du 13 juin 1997, retient dans son article 3 paragraphe 2 une signature lectronique base sur la mme technique choisie par la CNUDCI mais elle introduit lintervention dun tiers certificateur. Dans sa directive communautaire sur la signature lectronique du 13/12/1999, la Commission europenne a prcis que la validit dune telle signature lectronique dpend du degr de satisfaction des exigences suivantes : -Elle doit tre lie uniquement au signataire Elle permet de lidentifier. -Elle doit tre cre par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrle exclusif. -Elle doit tre lie aux donnes aux quelles elle se rapporte, de telle sorte que toute modification ultrieure des donnes soit dtectable. 66. En Tunisie la loi n2000-83 vient pour clairer et soulever lambigut due la notion de signature lectronique en lui consacrant tout un chapitre67 , et en rvisant larticle 453 du C.O.C modifi et larticle 453 bis du C.O.C.
Revue de la jurisprudence et de la lgislation n2 , Fvrier 2000. Mohamed Ali SIALA: Les problmes juridiques poss par le commerce lectroniques , mmoire de fin dtudes en tudes suprieures commerciales - ESCT - 2001-2002 p19. 67 Chapitre 2, intitul : "Du document lectronique et de la signature lectronique "
66
65
I. Talbi et M. Helaoui
54
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
En examinant la loi 2000-83, on peut dduire lattention accorde par le lgislateur tunisien quant la notion de la signature lectronique surtout en terme de cration et de vrification. Ainsi titre dexemple, larticle 5 stipule que : Chaque personne dsirant opposer sa signature lectronique sur un document peut crer cette signature par un dispositif fiable dont les caractristiques techniques sont fixes par arrt du ministre charg de tlcommunication. Dans ce mme contexte larticle 453 bis, aprs la dfinition de document lectronique, a montr que ce dernier ne fait preuve que sil est conserv dans sa forme dfinitive par un procd fiable et est renforc par une signature lectronique. Do on peut constater que la lgislation tunisienne a bel et bien volu en matire de signature lectronique qui reste un des principaux outils de la scurit sur lInternet surtout avec lintroduction, par la loi 2000-83 de certaines notions telles que le certificat lectronique, le fournisseur de certificat lectronique
III. LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE :
Vu notre besoin dune plus grande authentification, on a dvelopp un document lectronique appel certificat lectronique . Il reprsente : Une carte didentit des cls publiques : elle assure aux personnes recevant la cl de cryptage lidentit de lmetteur. Ainsi, il devient impossible denvoyer une cl publique sous le nom dun autre.
68
. Ce message lectronique contient des
informations, principalement, sur les identifiables de lutilisateur tels que son nom, son adresse ainsi que sur sa cl publique comme le numro de srie, les dates de dlivrance et dexpiration, il nous renseigne aussi sur le tiers metteur du certificat, car il est signe et ralis par ce dernier laide de cryptographie asymtrique. En mettant laccent sur ce dernier point, on remarque que la plupart des lgislations dans le monde ont accord une importance majeure lmetteur
68
ISRAEL MARC, CONSTRUIRE VOTRE SITE WEB COMMERCIAL , EDITIONS EFII, 75015 PARIS.
I. Talbi et M. Helaoui
55
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
du certificat lectronique. Dans ce contexte, Alain BENSOUSSAN crit Cest un nouveau mtier, le tiers certificateur, se profile sur INTERNET 69. Il apparat donc comme une solution fiable de scurisation des changes lectroniques Le fournisseur de certification prsente donc : Une entit charge par un ou plusieurs utilisateurs de crer leur cl publique et leur certificat 70. Il assume une double fonction, il est la fois le dpositaire des cls de cryptage et le certificateur des transactions lectroniques. En Tunisie, cest toujours la loi 2000-83 qui se charge de clarifier les notions se rattachant aux changes lectroniques. En examinant cette loi, on peut facilement soulever les prcautions du gouvernement et limportance accrue rserve aux termes : certificateur lectronique et certificat lectronique . En effet, larticle n8 prvoit la cration de l Agence nationale de certification lectronique,en effet, il dispose : est cre une entreprise publique caractre non administratif dote de la personnalit morale et de lautonomie financire, dnomme Agence nationale de certification lectronique et soumise, dans ses relations avec les tiers, la lgislation commerciale . . Ses fonctions71, se droulent principalement autour de loctroi de lautorisation pour lexercice de lactivit de certificateur ; le contrle du respect, par le fournisseur de service de certification lectronique des dispositions de la prsente loi et de ses textes dapplication, la fixation des caractristiques de dispositif de cration et de vrification de signature. La certification, proprement dite, reste donc laffaire du fournisseur de services , une fois il a obtenu laccord de lautorisation72 , les fonctions qui lui sont rattaches sont fixes par larticle 13 de la loi prcite. Cet article dispose : Le fournisseur de certification lectronique est tenu dutiliser des moyens fiables pour lmission, le dlivrance et la conservation des
69 70
Alain BEN SOUSSAN: On line journal , 15 dcembre 1995. Dfinition prsente par la recommandation n509 de lUnion Internationale des Tlcommunications . 71 Pour plus dinformations sur les missions de lagence nationale de certifications lectronique : voir article 9, chapitre 3 de la loi du 9 aot 2000 relative aux changes et au commerce lectronique. 72 Larticle 11 de la mme loi fixe les conditions de lobtention de lautorisation pralable de lagence nationale de certification lectronique.
I. Talbi et M. Helaoui
56
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
certificats ainsi que les moyens ncessaires pour les protger de la contre-faon et la falsification conformment au cahier de charges prvu par larticle 12 de la prsente loi . Ceci dit, nous constatons aussi que le fournisseur peut soit suspendre soit annuler le certificat et cela conformment aux conditions prvues respectivement par larticle 19 et larticle 20 de la prsente loi, comme il peut mettre fin son activit suivant larticle 24. On conclut donc, que limportance davoir recours un tiers certificateur ne cesse daugmenter. Toute fois, on remarque que la validit des certificats qui consiste vrifier en temps rel quun certificat lgalement mis na pas fait lobjet depuis sa cration, daucune mesure de rvocation ou de suspension susceptible de remettre en cause sa validit, cette fonction na t assure que dernirement par une nouvelle autorit appele, autorit de validation ou autorit denregistrement73.
73
E-Commerce : Digital Certificates A Valid argument for tighther certification CWW, 16 aot 1999, p 13.
I. Talbi et M. Helaoui
57
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Partie II - Le rgime juridique du contrat de commerce lectronique et l'incidence de son caractre mondial
Chapitre I : Le rgime juridique du contrat de commerce lectronique:
Lextension du commerce lectronique dans le monde a permis douvrir de vastes marges de manuvres et de liberts. Toutefois les diffrents agents qui participent la conclusion dune opration commerciale en ligne sont tenus de respecter certaines rgles du jeu, dont laccord entre les parties concernes constitue le premier axe. Ceci nous amne parler du contrat car le commerant, voulant exploiter son commerce lectronique, devra conclure des contrats avec ses clients ; cest un contrat en ligne qui est appel aussi cybercontrat .
Section 1 : La notion du contrat en ligne :
En Tunisie, le C.O.C na pas dfini le contrat. On retient le plus souvent la dfinition du code civil Franais qui a dfinit le contrat comme tant : Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autres donner, faire ou ne pas faire quelque chose 74. Cette dfinition tait lorigine de toutes autres concernant le contrat du commerce lectronique proprement dit dont Olivier ITEANU voque la dfinition suivante : Cest la rencontre dune offre de biens ou services qui sexprime sur un monde audiovisuel au travers dun rseau international de
74
Article 1104 du code civil Franais.
I. Talbi et M. Helaoui
58
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
tlcommunication et dune acceptation qui est susceptible de se manifester au moyen de linteractivit 75.
I.
UNE TYPOLOGIE DU COMMERCE ELECTRONIQUE:
Le contrat du commerce lectronique est le rsultant dune offre accepte. Il se diffre du contrat traditionnel au niveau de loutil utilis qui nest plus le papier mais cest plutt le numrique. De l on distingue deux types de contrat en ligne.
I-1 Les contrats du commerce lectronique : des contrats distance :
La vente par correspondance constitue la forme la plus justificative dun contrat distance, car elle ne ncessite pas une rencontre directe de volonts, entre acheteur et vendeur. En effet, il est possible dacheter des produits et de bnficier des services de nimporte quelle place du monde avec une grande rapidit et sans quil soit ncessaire de se dplacer, cest dire tout en restant chez soi. En Tunisie, il est possible de conclure distance. En effet, le C.O.C. tunisien
dispose: Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu o
celui qui a reu loffre rpond en lacceptant 76. On peut dduire de cela que le contrat distance est tablit, une fois o lacheteur reoit loffre et laccepte. Notons aussi que lInternet ne constitue pas le seul moyen qui dcrit ce mode de contrat, car il existait auparavant le commerce via la tlvision, appel aussi le tl achat , ou via le minitel ou encore plus simplement via tlphone. Enfin, le contrat dachat des biens de consommation courante, ngoci distance, nest pas le seul car on peut, et travers lInternet, louer un appartement ou mme prendre des cours distance, tel est le cas de luniversit virtuelle en Tunisie.
ITEANU Olivier, INTERNET et le droit. Aspects juridiques du commerce lectronique. Editions Eyrolles, 1996.
76 75
Article 28 du COC tunisien.
I. Talbi et M. Helaoui
59
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
I-2 Les contrats du commerce lectronique : des contrats commerciaux classiques :
On constate de nos jours, que la plupart des entreprises, qui sont spcialises dans la vente par correspondance, disposent leurs propres sites Web avec un catalogue virtuel et parfois mme des super vendeurs virtuels. Leur mission consiste guider et conseiller le consommateur internaute soit quil soit acheteur ou simple visiteur. La diffrence souleve ici est quil ya une rencontre des internautes acheteur et vendeur qui peuvent ngocier ensemble, travers le net, la possibilit de conclure un contrat lectronique dans les mme conditions quun contrat normal. En dautres termes, il ne sagissait pas dune simple commande par tlphone ou mme par Internet pour que lopration soit finie. On peut citer titre dexemple la socit Dcathlon, qui est une socit de vente darticles de sport, vend quant elle des cassettes vido sur son site. Le contrat qui lie alors le consommateur est un contrat de vente classique De mme Michelin, gant mondial de pneumatique, offre une aide au voyage sur son site en calculant litinraire demand par le client. Le contrat est alors un contrat de prestation de service 77. Se sont donc des contrats de commerce lectronique assimils des contrats classiques de ventes ou de prestation de services. Mais il ne faut jamais oublier que, si ces contrats sont classiques, ils prsentent la particularit dtre conclus lectroniquement.
II.
LA FORMATION DES CONTRATS:
Avant sa conclusion dfinitive, le contrat doit remplir certaines rgles juridiques prouvant sa validit. Ainsi, le contrat de vente inhrent au commerce lectronique retient plus dattention, puisquil soulve plusieurs questions spcifiques aux transactions lectroniques et lloignement des contractants. Pour cela, et avant sa conclusion dfinitive, on doit sassurer de sa structure juridique.
77
JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique , ditions Litec, 1998.
I. Talbi et M. Helaoui
60
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
II-1 Les conditions prliminaires de formation du contrat en ligne :
Plusieurs conditions sont juges indispensables pour la validit du contrat : a) Lidentification des parties : Identifier avec prcision les parties contractantes constitue un lment trs important pour la validit du contrat. En effet, le rseau ouvert est caractris par une communication o on a une absence physique des contractants. A ce niveau et comme souligne O.ITEANU Il ne saurait y avoir contrat sans la mise en relation dau moins deux personnes disposant dune personnalit juridique. La personne physique ou morale est physiquement absente cette rencontre alors quelle est juridiquement omniprsente. Cest bien videment elle seule capable de sengager juridiquement dans une relation contractuelle 78. Il faut donc tout dabord identifier son cocontractant, car on risque davoir un contractant non srieux ou mme un mineur qui joue par la passation de commandes irrelles. Lors de lidentification, on ne doit pas se contenter des renseignements qui sont fournies par ladresse lectronique, comme il faut sassurer dune variable dterminante qui est celle du pouvoir, cest dire vrifier que le cocontractant a vraiment le pouvoir de conclure le contrat et nest pas par exemple un simple reprsentant de la socit en question. Cest pour cette raison, et afin dviter lannulation de certaines commandes et la perturbation de la vie conomique des entreprises concernes par ces commandes, que la loi tunisienne exige une identification dtaille et complte des parties contractantes qui va mme la localisation de leurs rsidences. b) La capacit : Comme dans un contrat normal, la capacit doit tre justifie dans un contrat du commerce lectronique. En effet, le droit tunisien a trait cette notion de capacit en prcisant que : Toute personne est capable dobliger et de sobliger sauf si elle est dclare incapable par la loi 79.
78 79
Olivier ITEANU: Internet et le droit .Editions Eyrolles 1996 p 51. Article 3 du COC Tunisien.
I. Talbi et M. Helaoui
61
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Cest ainsi que ce nest pas nimporte qui peut sengager par obligation, cest seulement ceux dsigns capables par la loi. A ce sujet, sont jugs comme absolument incapables : -Les mineurs jusqu lage de treize ans rvolus. -Les majeurs atteints dalination mentale qui les prive compltement de leurs facults. -les personnes morales que la loi assimile aux mineurs 80. Toutefois larticle 6 du C.O.C, modifi par le dcret du 3 aot 1956, prvoit que certaines personnes ont une capacit limite savoir : -Les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu vingt ans rvolus, non assists par leur pre ou tuteur. -Les interdits pour faiblesse desprit ou prodigalit, non assists par le conseil judiciaire, dans le cas o la loi requerrait cette assistance. -Les interdits pour insolvabilit dclare. Cette question de capacit vient donc pour valider, ou annuler, les contrats ventuellement signs par des incapables majeurs ou bien des mineurs, dans tous les cas le contrat est nul, mais certains pensent que le contrat conclu par un mineur qui aurait d tre reprsent est en principe nul, or il ne sera en ralit annul que sil est lsionnaire81. Notons enfin, que pour vrifier la capacit dun contractant en ligne, il est ncessaire de connatre des informations juges personnelles savoir lidentit complte. c) Lacceptation et loffre : c.1 Lacceptation : Le consommateur, en gnral, ne se trouve dfinitivement engag que lorsquil reoit loffre, tout en acceptant les conditions de vente. En effet, La convention nest parfaite que par laccord des parties sur les lments de lobligation, ainsi
80 81
Article 5 du COC Tunisien. J.FLOUR et J.L .AUBERT, Les obligations , n240.
I. Talbi et M. Helaoui
62
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
que sur toutes les autres clauses licites que les parties considrent comme essentielles 82. En des termes simples, lacceptation signifie laccord donn par chaque partie aux conditions du contrat. Toutefois il est noter que le lgislateur tunisien na pas prcis le moment de lacceptation ni sa manifestation. Dans le cas du commerce lectronique, lacceptation du consommateur est exprim une fois il a cliqu sur OK , parfois oui ou daccord . Cette opration de cliquage traduit la volont et laccord de linternaute propos de son obligation. Ainsi et en se rfrant au droit commun des
contrats: lacceptation doit tre : -claire : Car elle suppose la connaissance du contenu du contrat. -pure et simple : Car toute rponse diffrente de loffre constitue une contre passation. -libre : On ne peut tre contraint daccepter un contrat. -expresse : Le principe est, en effet, que lacceptation ne rsulte pas du silence 83. Dune manire gnrale, lacceptation dans le contrat de commerce lectronique peut porter sur diffrents lments. En effet, linternaute acheteur doit, avant de sobliger, accepter loffre, le prix ainsi que toute autre condition du contrat. c.2 Loffre lectronique : Tout contrat ncessite lexistence dune offre qui, est une fois accepte, formera le contrat de commerce lectronique. Loffre exige donc la conclusion de deux obligations : la premire est celle de lidentification de loffrant et la deuxime concerne linformation du consommateur. Ainsi dans le cas de cybercontrat , loffrant doit exposer ses produits dans une vitrine virtuelle et cest au client visiteur du site ou de la galerie marchande, de choisir voire de commander ce quil veut. A son tour, loffrant ne doit pas exploiter la distance qui lloigne de son client pour mal prsenter sa marchandise. Au contraire, il doit respecter
82 83
Article 23, alina 1, du C.O.C.Tunisien. P.MALAURIE et L.AYNES, Droit civil .Les obligations .Editions Cujas,1990,p216.
I. Talbi et M. Helaoui
63
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
certaines dispositions rglementaires concernant par exemple les conditions normales de vente, la date limite de livraison et surtout bien prciser le prix. Dans ce contexte, le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposs au consommateur selon une technique de communication distance doit tre indiqu de faon prcise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat 84. Il est noter aussi que toutes les informations dclares par loffrant doivent tre exactes, ne contenant aucune source derreur, comme le prcise le professeur Guestin : Loffre doit tre suffisamment prcise, ferme et dpourvue dquivoque, pour que lacceptation de son destinataire suffise former le contrat. 85. Enfin et lors de lexposition, le commerant offrant peut recourir la publicit, or il existe un certain nombre de procds de messages publicitaires savoir : Mailing courrier lectronique, forums de discussion, sites Web spcialiss. 86.
II-2 La validit du contrat en ligne :
Nous avons trait, au paragraphe prcdent, les conditions de base ncessaires la formation du contrat. Or pour quil soit dfinitivement valable, le contrat doit remplir, dans sa forme, certaines autres clauses qui savrent trs importantes dans la mesure o les parties contractantes doivent respecter les normes de validit du contrat. a) Le consentement ne doit pas tre vici : Le consentement suppose que chacun des contractants doit savoir avec exactitude la volont de lautre. Cest pour cette raison quil est considr comme lorigine de la naissance des obligations. Pour pouvoir jouer ce rle, le consentement ne doit pas tre vici. Alors quen est il des vices de consentement ?
Article 14 de larrt franais du 3 dcembre 1987. J.GUESTIN, La notion du contrat . D.1990, chronique , p147. 86 Serge GUINCHARD, Michle HARICHAUX, Renaud DE TOURDONNET Internet pour le droit (Connexion Recherche, Droit). Montchrestien. E.J.A.1999. p 207.
85
84
I. Talbi et M. Helaoui
64
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Larticle 43 du COC nous donne la rponse en disposant : est annulable le consentement donn par erreur, surpris par dol, ou extorqu par violence . a.1 Lerreur : Cest une fausse reprsentation de la ralit qui peut toucher lun des lments du contrat. Elle est dfinie aussi comme tant le fait: de reprsenter inexactement lobjet dune obligation ou bien () elle est la discordance entre la volont interne et la volont dclare. 87. Lerreur constitue donc un jugement erron qui peut porter par exemple sur lge ou la capacit du contractant, sur le prix de la chose objet du contrat Certains droits88 retiennent deux types derreur : une erreur sur la substance, dans ce cas lacheteur sest tromp sur lune des qualits de lobjet du contrat sans laquelle il naurait pas contract et une erreur sur la prestation fournie, et dans les deux cas le contrat sera annul. Or ceci nest pas toujours admis car dans certains droits comme le droit anglais, les juristes ne font pas la distinction des erreurs sur la substance, sur la personne mais demandent plutt : -lerreur tait-elle due lautre partie ? -lerreur tait-elle commise par lautre partie aussi ? Et peut tre, -lerreur tait-elle connue de lautre partie ? 89. Dans tous les cas, lerreur est considre comme un vice de consentement qui a pour consquence lannulation du contrat. a.2 Le dol : Le dol constitue une manuvre dloyale ou frauduleuse, commise par un contractant au dtriment de lautre pour lamener la conclusion du contrat. En ralit cest le droit canonique qui a considr le dol comme un vice de consentement et la sanctionn en tant que tel, cest dire par la nullit relative du contrat, de mme faon quen ce qui concerne lerreur 90. Chacune des parties contractantes doit, donc, sabstenir se comporter dloyalement dans le but dinduire lautre partie en erreur. Ainsi lannulation du contrat pour dol, est
87 88
P.MALAURIE et L.AYNES. Droit civil. Les obligations .2me ditions, p 225. A savoir le droit franais, Allemand, Italien 89 J-A.JOLOWICZ. Droit anglais . Prcis Dalloz, 2me dition 1992 p 134 n 186. 90 LARROUMET Christian Droit civil 2me dition. Economica 1990 p 313.
I. Talbi et M. Helaoui
65
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
en ralit une sanction dune faute intentionnelle commise par lun des contractants. En dautres termes, il sagit bel et bien dune volont voire dune intention dinduire lautre partie en erreur. Toutefois, il est noter que le dol nest une cause de nullit que sil est vident que, sans ces manuvres, lautre partie naurait pas contract 91. Il faut donc vrifier que ces manuvres frauduleuses ont eu pour consquence la conclusion du contrat. a.3 La violence : La violence constitue une atteinte la libert individuelle des personnes. Elle est juridiquement dfinie comme tant un abus de force . A la diffrence du dol et de lerreur, la violence peut tre cause par un tiers, c'est--dire par une autre personne, que les parties contractantes. Elle suppose, donc, lexercice dune contrainte que ce soit morale, se traduisant par lexercice de menaces contre une personne, ou bien physique, en forant quelquun conclure le contrat sans tenir compte de son avis rel. Ainsi, chaque contractant doit dans la priode prcdant la conclusion, sabstenir dexercer envers lautre une contrainte abusive 92 . De toutes les manires, la violence doit tre dterminante pour quelle soit considre comme un vice de consentement. A dfaut, elle naura aucune influence sur la validit du contrat. b) Le contrat doit tre conforme lordre public conomique et social : LInternet est caractrise par la libre concurrence en matire commerciale. En effet, chaque entreprise va profiter des avantages fournis par ce rseau ouvert, pour attirer le maximum de clientles. Toutefois, un tel contrat du commerce lectronique doit tre conforme au droit de la concurrence. En dautres termes, la libre concurrence sur Internet doit tre loyale, elle ne doit porter atteinte aucune autre entreprise.
Article 1116 du code civil franais. SCHMIDT Joanna Ngociation et conclusion des contrats Jurisprudence gnrale, Dalloz 1982 p 156.
92
91
I. Talbi et M. Helaoui
66
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
En ce sens les contrats qui auraient pour objet ou pour consquence la constitution dententes seront nul de plein droit. 93 La nullit intervient ici, pour sanctionner les entreprises qui sentendent entres elles au dtriment dun autre concurrent. De la mme manire, il est interdit aux internautes commerants dexploiter lInternet pour nuire limage de marque dun autre commerant. De ce fait, et pour viter les prjudices probables, causs par les commerants sur le Net entres eux, il faut avoir des procdures qui organisent cet environnement ouvert. Or un tel contrat du commerce lectronique, doit respecter certainement les rgles du droit de la concurrence ainsi que le droit de la consommation et ce au niveau de lobjet du contrat, la dure et lacceptation de loffre, linformation exacte de lacheteur ou encore le respect des dlais de livraison. Sur le plan social, le contrat doit tre, son tour, conforme lordre public et aux bonnes murs. Ainsi le contrat qui a pour objet la perturbation de lordre public ou latteinte aux bonnes murs est sanctionn par la nullit. De mme un contrat qui contient des clauses abusives vis--vis dun consommateur, porte atteinte lordre public et sera sanctionn par la nullit. Remarquons donc que le contrat de commerce lectronique ne sera retenu dans sa finalit que sil remplit ces conditions dj cites. En effet, sa validit stend au respect du consommateur et de la socit en gnral.
Section 2 : Le rgime de preuve dans le contrat lectronique:
Etant donn la dmatrialisation des transactions qui est caractrise essentiellement par labsence du document crit, traditionnellement manifest par un papier, la question de la preuve devient dune importance accrue dans ce nouveau monde numrique.
93
JEANT-BAPTISTE p108
Michelle : Crer et exploiter un commerce lectronique , dition litec 1998,
I. Talbi et M. Helaoui
67
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
I.
LE REGIME LEGAL DE LA PREUVE :
I-1 La prminence de lcrit :
Lcrit est considr comme la base principale de tout moyen de preuve. Ainsi, dans la plupart des droits positifs du monde, lcrit constitue la preuve lgale et parfaite. Dans ce contexte, le droit civil franais pose que lcrit est roi 94. En effet, il doit tre pass par acte devant notaires ou sous signatures prives de toute chose excdant une somme ou une valeur fixe par dcret, mme pour dpts volontaires, et il nest reu aucune preuve par tmoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allgu avoir dit avant, lors ou depuis les actes, encore quil sagisse dune somme ou valeur moindre 95. En droit tunisien, larticle 473 du COC dispose que : Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de crer, de transfrer, de modifier ou d'teindre des obligations ou des droits, et excdant la somme ou valeur de mille dinars, ne peuvent tre prouvs par tmoins ; il doit en tre pass acte devant notaires ou sous seing priv. . Dans le cas du commerce lectronique, plusieurs questions relatives la conclusion des contrats en ligne ne cessent de se poser vu les difficults qui existent sur lInternet, concernant la dlimitation relle du lieu et du moment de laccord ou aussi concernant lidentification des parties ou mme la preuve du consentement. Pour palier ces problmes, lcrit reste toujours le moyen de preuve le plus adopt, du fait quon peut crire et envoyer un fax, un courrier lectronique, ce qui permet aux parties concernes de confirmer leur accord. Dans ce contexte la preuve littrale rsulte dun acte authentique ou dune criture sous seing priv. Elle peut rsulter galement de la correspondance, des tlgrammes et des livres des parties, des bordereaux 96. Ainsi on remarque que le lgislateur tunisien a utilis des termes se rattachant au domaine du contrat lectronique savoir la correspondance , le tlgramme , ce qui montre
94
Article 1341 du code civil franais
95
Le dcret n80-533 du 15 juillet 1980 fixe la somme ou la valeur vises larticle 1341 5000 francs. 96 Article 441 du C.O.C.Tunisien.
I. Talbi et M. Helaoui
68
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
quon a prsent lcrit comme moyen de preuve dans le cadre dun contrat distance, ceci va automatiquement amplifier sa position juridique. En outre, lcrit peut parfois tre lune des conditions de validit du contrat. Dans ce cas, et titre dexemple, larticle 1907, alina 2 du code civil Franais prvoit que le taux dintrt conventionnel doit tre fix par crit . Constatons, donc, le rle primordial de lcrit comme moyen de preuve en cas de litige. Mais cela nempche pas quil existe des cas o cette preuve littrale sera attnue.
I-2 Le commerce lectronique : une exception supplmentaire lexigence de lcrit:
Lvolution des technologies de linformation, ainsi que lapplication dun nouveau mode de transaction numrique, nous interroge sur lavenir de la preuve par crit dans ce monde virtuel. a) Les exceptions lgales au principe de la preuve par crit : La majorit des droits civils dans le monde retiennent la primaut de lcrit en matire de preuve. Toutefois, on peut facilement soulever certaines exceptions cette supriorit. En effet le droit tunisien, comme nous lavons dj vu, nimpose de preuve par crit que pour une chose excdant une somme de 1000 dinars97. En effet, dans ce cas la preuve par tmoin par exemple est rejeter tel quil a t citer par larticle 474 du COC : Il n'est reu entre les parties aucune preuve par tmoins contre et outre le contenu des actes, et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur infrieure mille dinars. Cette rgle reoit exception quant il s'agit de prouver des faits de nature tablir le sens des clauses obscures ou ambigus d'un acte, en dterminer la porte ou en constater l'excution. . Bien que la preuve par tmoin est en gnral refuser pour un conflit concernant une affaire dont la valeur dpasse 1000 dinars, dans certains exceptions (clauses obscures ou ambigus dun acte), le tmoin peut tre retenu par le juge comme moyen de preuve.
97
Suivant larticle 473 du COC.
I. Talbi et M. Helaoui
69
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Et par consquent la preuve sera libre pour toute somme infrieure au montant prcit. On peut dduire donc que la preuve par crit nest pas toujours obligatoire. Ceci nous amne parler de la preuve littrale en matire dchange lectronique. En effet, une convention sur la preuve en cas de paiement lectronique a t retenue, or les parties contractantes peuvent se mettre daccord sur des clauses relatives la preuve dans leur contrat. Mais la question qui se pose et qui tourne autour de la preuve en ligne est la suivante : Si un internaute veut se rfrer une page Web ou imprimer un courrier lectronique, peut-on assimiler ceci un commencement de preuve par crit ? A lheure actuelle, les juges ne se sont pas encore prononcs, mais certains auteurs98 et larticle 441 du COC estiment que limpression dune page Web ou dun courrier lectronique pourra tre considre comme un commencement de preuve par crit. En effet, larticle 441 du COC dclare quun tlgramme peut considrer une preuve pour le juge. En effet, le tribunal peut, au cours dune instance, ordonner la reprsentation des livres de commerce et de tous autres, des lettres ou tlgrammes de lune des parties ou de toutes99. Une autre exception lcrit est prvue par le lgislateur Franais larticle 1348, alina premier du code civil, cest Lorsque lune des parties, soit na pas eu la possibilit matrielle ou lui servait de preuve littrale, par suite dun cas fortuit ou de force majeure. Ce que nous pouvons conclure de ces exceptions la primaut de lcrit en tant quacte de preuve, cest quelles sont applicables mme sur Internet. b) Lincidence du caractre mondial du commerce lectronique en matire de preuve : La spcificit du commerce lectronique rside dans son caractre international et sans frontire. Ce qui va, automatiquement, changer sa procdure et son organisation juridique et ceci ne va pas passer sans incidence en matire de
98 99
Comme XAVIER Linant et A. HOLLANDE Droit de linformatique , Delmas 1990 Larticle 465 du COC : Le tribunal peut , au cours d'une instance, ordonner d'office la reprsentation des livres de commerce et de tous autres , des lettres ou tlgrammes de l'une des parties ou de toutes les deux
I. Talbi et M. Helaoui
70
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
preuve puisquon se situe sur un rseau ouvert dont on ne reoit pas, de la mme faon, les lments de preuve. Or certains pays exigent la prminence de lcrit, dautres voient le contraire et reconnaissent dautres procds de preuve. Ceci va engendrer bien videmment des problmes juridiques et cest aux juges de les rsoudre, par la vrification de tous les supports constituant des preuves, avant de prononcer le jugement final. Certains nexigent pas donc la prsence dun crit comme moyen de preuve. En effet, le contrat de vente na pas tre conclu ni constat par lcrit et nest soumis aucune condition de forme. Il peut tre prouv par tous les moyens y compris par tmoins 100. Une autre forme de preuve sajoute ici, cest celle par tmoins. En ce qui concerne ce type de preuve, il est noter que le lgislateur tunisien ne ladmet pas dans le cas dune obligation excdant la somme de mille dinars.101 On voit bien que lextension du commerce lectronique a largit la diffrence dinterprtation en matire de preuve entre les pays du monde, ce qui ncessite forcment la recherche dun vritable moyen de preuve international qui sera appliqu dans tous les pays et qui obit la mme interprtation.
II.
LA RECEVABILITE DE LA PREUVE INFORMATIQUE : LES
OBLIGATIONS TECHNIQUES
Dans ce monde numrique, se posent plusieurs questions relatives la valeur probante dun document informatique constituant une preuve. Cest dire quelle valeur pouvons nous donner limpression dune page Web ou dun courrier lectronique ? Est-ce quelle peut jouer chacune le rle dune preuve ? Et comment prouver quun simple clic me rend engag payer le prix dun produit offert dans une vitrine virtuelle ?
On a besoin donc dun moyen de preuve qui doit tre sr et fiable, afin de palier aux diffrents risques qui peuvent parvenir.
100 101
Article 11 de la convention de Vienne du 11 avril 1980. Suivant larticle 473 du C.O.C.Tunisien (modifi par la loi n2000-57 du 13 juin 2000).
I. Talbi et M. Helaoui
71
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
II-1 Linformatique et les avantages de lcrit :
Lcrit reste toujours le moyen de preuve le plus utilis et le plus reconnu dans la conclusion des contrats, en raison de ses deux caractristiques essentielles savoir la durabilit et la fiabilit. . En effet, lcrit est conserv une fois il est conclu, ainsi il contient des informations fidles et fiables qui ne sont pas critiquables. Or ces deux avantages qui ont, en ralit pour origine le papier, ne peuvent tre simuls que par linformatique 102. Ainsi en ce qui concerne la durabilit, les parties qui communiquent sur Internet le font au moyen dinformations gnralement affiches sur cran. Le transfert des informations comme la transaction elle-mme sopre donc sans fixation durable. Par contre en ce qui concerne lavantage li la fiabilit, linformatique permet autant que lcrit de fiabiliser en toute scurit la transmission des fichiers grce lutilisation de protocole ou de systme de cryptage 103, dj dvelopps. Ainsi, linformatique savre le moyen le plus proche de lcrit, voire elle le dpasse en ce qui concerne le degr de conservation des informations. En dautres termes, linformatique devient plus fidle et plus fiable que lcrit. Dans ce cadre, larticle 4 de la loi n2000-83 du 9 aot 2000 stipule que La conservation du document lectronique fait foi au mme titre que la conservation du document crit. Lmetteur sengage conserver le document lectronique dans la forme de lmission, le destinataire sengage conserver ce document dans la forme de la rception. Le document lectronique est conserv sur un support lectronique permettant : -la consultation de son contenu tout au long de la dure de sa validit, -sa conservation dans sa forme dfinitive de manire assurer lintgrit de son contenu, -la conservation des informations relatives son origine et sa destination ainsi que la date et le lieu de son mission ou de sa rception.
102 103
XAVIER Linant lInternet et la preuve des actes juridiques in expertises, juin juillet 1997, p 225. JEAN- BAPTISTE Michelle Crer et exploiter un commerce lectronique , dition litec, 1998, p 119.
I. Talbi et M. Helaoui
72
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
On remarque donc que le lgislateur tunisien tait trs exigent en la matire pour pouvoir prouver lectroniquement tout comme si on tait dans une situation contractuelle traditionnelle.
Enfin, prouver par document informatique ou par courrier lectronique est devenu le mode de preuve de nos jours. Toutefois il reste tudier la valeur de ces documents informatiques en tant que des moyens de preuve.
II-2 La valeur probante des documents informatiques :
Linformatique est caractrise essentiellement par sa mobilit dans le temps. La question qui se pose ce stade est la suivante : comment pouvons-nous convaincre les autres par linformatique ? Puisque le monde dInternet est volutif, connaissant des changements de linstant et de lautre. En effet, et pour prouver par le numrique, on doit avoir des documents informatiques qui servent comme moyen de preuve et qui doivent garder les deux caractristiques essentielles de la preuve littrale savoir la fidlit et la durabilit. Mais cela nempche pas quil faut innover en matire de preuve informatique sur Internet sans rejeter les documents numriques mme sils sont les plus traditionnels, comme moyen de preuve. Ce qui est justifi par le professeur XAVIER Linant , en disant que nous savons que la trace informatique sera une preuve. Il faut anticiper 104. Rejeter, donc, les autres documents informatiques comme moyen de preuve nest pas la solution. Ceci montre bien la valeur et la place des documents informatiques dans la hirarchie de preuve. En fait la trace informatique est asimule un document crit, cest dire une preuve littrale. Ce qui est appliqu par plusieurs droits du monde. Notons titre dexemple que Le droit allemand considre les documents informatiques soit comme des preuves crites sans signature, soit comme des preuves par observation 105. La question, de la valeur du document informatique ne rside pas forcment dans son acceptation ou non en tant que preuve, mais plutt cest la place de lcrit numrique mme dans la hirarchie de preuve qui pose le plus de problmes, ce qui incite les
104 105
Colloque organis par linstitut de formation continue du Barreau de Paris le 23 mai 1997. JEAN- BAPTISTE Michelle Crer et exploiter un commerce lectronique , dition litec, 1998, p 122.
I. Talbi et M. Helaoui
73
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
juristes bien examiner la preuve numrique. Le rapport de la CNUDCI concernant la valeur juridique des enregistrements informatiques va dans ce sens, puisquil recommande aux gouvernements : -de rexaminer les rgles juridiques touchant les enregistrements informatiques comme moyens de preuve en justice afin dliminer les obstacles superflus leur recevabilit, de sassurer que ces rgles sont compatibles avec le progrs technique et de donner aux tribunaux les moyens leur permettant dapprcier la fiabilit des donnes contenues dans ces enregistrements. -de rexaminer les rgles juridiques en vertu desquelles certaines transactions commerciales ou certains documents ayant trait au commerce doivent tre sous forme crite () On peut dduire de cela que les problmes juridiques de la preuve
lectronique doivent tre accessibles tous en simplifiant les lments de rponse aux parties qui veulent contracter, notamment en ce qui concerne la valeur probante du courrier lectronique.
II-3 La valeur probante du courrier lectronique :
Le courrier lectronique tend devenir la lettre de nos jours. En effet, il est assimil un courrier traditionnel. Mais il se spcifie par lutilisation dune technologie bien puissante pour envoyer les messages. Ainsi, il met en relation deux internautes. Lmetteur tape le message sur son ordinateur et lenvoie au destinataire, en des secondes, ce dernier peut ouvrir sa boite aux lettres et le consulter. Loriginal de message est, donc, entre les mains du destinataire tout comme une vritable lettre postale. A son tour lmetteur, et en cas de besoin, peut faire une copie. Malgr ses convergences avec le courrier lectronique, le courrier normal garde la spcificit dtre sign. Tandis quon a une absence totale de cet lment dans le courrier lectronique ce qui peut mettre en cause sa valeur en tant que moyen de preuve . Pour rsoudre ce problme, certains auteurs106 procdent par analogie avec la tlcopie ou avec la photocopie qui ont t utilises comme moyen de preuve. A son tour, cette solution na pas t renforce vu linscurit sur le Net dune part, dautre
106
SEDALLIAN Dont Valrie, dans son ouvrage Droit de lInternet , collection AUI, mai 1996 p 215.
I. Talbi et M. Helaoui
74
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
part, ces deux techniques dj cites ne constituent pas des originaux, par contre le courrier lectronique est un vritable original. Cest plutt son impression sur papier qui constitue une copie. Il faut donc, que les juristes se prononcent rapidement et clairement sur la valeur du courrier lectronique ainsi que sur sa validit en tant que moyen de preuve.
Chapitre II : Les incidences juridiques du caractre mondial du commerce lectronique :
Le commerce lectronique peut tre class comme tant un commerce international. En effet, un site Web peut tre visit par nimporte qui et nimporte o dans ce monde. Cest pour cela, que les conflits de lois sur lchelle internationale refltent lincidence du caractre mondial du commerce lectronique. Lconomie tunisienne tant dsormais ouverte et libralise Pour nous, le secteur de lInternet constituait une trs importante source de croissance Ensuite, la prsence de nombreuses infrastructures modernes fait de la Tunisie un lieu idal pour les investissements Nous avons dcid dtre ouverts et incorpors. Nous avons sign un accord de coopration avec lUnion europenne en 1995, et sommes membres de lOrganisation Mondiale de Commerce (O.M.C) depuis 1994 Tel taient les paroles de monsieur Mohamed Jouini, ministre du dveloppement et de la coopration internationale _Tunisie107. Monsieur Mohamed Jouini a insist sur lapproche librale et ouverte adopte par la Tunisie, tout en sappuyant sur le rle de lInternet dans la croissance de notre conomie, ce qui faisait de la Tunisie un lieu idal pour les investisseurs. Dans le cadre de cette approche, le ministre du dveloppement et de la coopration a annonc la signature de laccord tunisien avec lUnion europenne en 1995 et lintgration de notre pays dans lOrganisation Mondiale de Commerce
Le mensuel du monde arabe et de la francophonie : Arabies , mars 2003, La voie de la modernit , p66.
107
I. Talbi et M. Helaoui
75
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
(O.M.C108) dont la mission est dorganiser le commerce lchelle mondiale et ce depuis 1994.
Section 1 : Le problme du conflit de lois :
I. LES SOLUTIONS APPORTEES AU CONFLIT DE LOIS PAR LE
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Monsieur Mohamed El Arbi Hachem (a enseign la Facult de Droit et des Sciences Politiques de Tunis), dans son ouvrage Leons de droit international priv 109, a dfini le droit international priv comme tant : Le droit spcial applicable aux personnes prives impliques dans des relations juridiques internationales. Pour cet auteur, la mission du droit international priv est la rsolution des litiges de caractre international portant sur quatre questions : Conditions des trangers. Nationalit. Conflits de juridictions. Conflits de lois. Dans ce paragraphe nous essayons daborder la quatrime question : les solutions apportes au conflit de lois par le droit international priv tunisien en ce qui concerne le commerce lectronique.
108
O.M.C : LOrganisation Mondiale de Commerce : cre par laccord de Marrakech du 15 avril 1994 et entre en vigueur le 1er janvier 1995, elle a pour mission dorganiser le commerce lchelon mondial. Les rgles de base de lO.M.C sont : 1. Rgle de la nation, la plus favorise, tendre aux autres Etats membres et leurs ressortissants les avantages, faveurs, privilges ou immunits amenes aux ressortissants des autres pays. 2. Rgle de traitement national : accorder aux produits, aux services et aux ressortissants des autres Etats membres le mme traitement et le mme rgime juridique que celui accord lchelle nationale. 3. Le droit prendre des mesures de sauvegarde durgence pour viter de causer un prjudice grave lconomie du pays concern. CHATILLON Stphane, Droit des affaires internationales , collection gestion internationale, 2me dition, p13-17. HACHEM Mohamed El Arbi, Leons de droit international priv (Livre I : Les rgles materielles conditions des trangers et conditions de juridictions) , Centre dtudes, de recherches et de publications, 1996, p4.
109
I. Talbi et M. Helaoui
76
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
I-1 Les solutions apportes au conflit de lois en matire de proprit intellectuelle dans le droit international priv tunisien :
Le code du droit international priv tunisien (promulgu par la loi n98-97 du 27 novembre 1998) dispose dans son chapitre V portant sur les biens, article 58 que : la possession, la proprit et les autres droits rels sont rgis par la loi de la situation du bien. Donc en se basant sur cet article du code international priv, en cas de conflit de lois en matire de proprit intellectuelle, la loi applicable sera celle du territoire gographique o est visualise, reproduite ou exploite luvre de lesprit, cest aussi le principe en droit international franais qui se base sur lapplication de la loi o le bien est localis110. Dans le cadre dune affaire, la solution apporte par le code du droit international priv tunisien dans son chapitre VI : Les obligations, section I : Les obligations volontaires, larticle 69 dans son alina premier dispose que : A dfaut par les parties de dsigner un droit diffrent, les contrats portant sur la proprit intellectuelle sont rgis par le droit de l'Etat du lieu de rsidence habituelle de celui qui transfre ou concde le droit de proprit intellectuelle.. Ainsi, dans une affaire, le juge appliquera la loi de lEtat du lieu de rsidence habituelle de celui qui transfre ou accorde le droit de proprit intellectuelle. Donc la rsolution dun conflit, d une vente sur le Web rsultant dun transfert de proprit intellectuelle, est fonde sur lapplication de la loi de lEtat du lieu de rsidence habituelle de celui qui transfre ou accorde le droit de proprit.
I-2 Les solutions apportes au conflit de lois en matire de contrat :
Le principe dominant dans ce cas est celui de la loi dautonomie. En dautres termes, la loi applicable est la loi mentionne par le contrat, le problme ne se pose, alors, quen cas de silence du contrat. Dans ce cas, la solution apporte par le droit international priv est lapplication de la loi de lEtat du domicile de la partie engage ou sur laquelle pse lobligation contractuelle ou la loi du lieu de
110 En droit international franais, tous les biens, quils soient corporels ou incorporels, relvent de la loi de localisation du bien. JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique , ditions Litec, 1998, p24.
I. Talbi et M. Helaoui
77
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
son tablissement dans le cas o le contrat serait conclu dans le cadre de son activit professionnelle ou commerciale111.
I-3 Les solutions apportes au conflit de loi en matire dlictuelle :
Le principe dominant dans le choix de la loi applicable en matire dlictuelle par le droit international priv tunisien est celui de la territorialit du fait dommageable. En effet, larticle 70 du code international priv dispose que : La responsabilit extra-contractuelle est soumise la loi de lEtat sur le territoire duquel sest produit le fait dommageable. Toutefois, si le dommage sest produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable la demande de la victime. . Ainsi, la publication sur le Web des informations, articles ou images causant prjudice une personne pour atteinte la vie prive par exemple, la loi applicable sera, alors, celle du lieu o le dommage a t subi. Dans le cas o le dommage serait subi en plusieurs pays, tel est le cas de nimporte quelle publication sur le Web, rseau international publi dans tout le monde, la victime peut demander lapplication dautant de lois quil y a de lieux o le prjudice a t subi112.
II.
LES SOLUTIONS APPORTEES AU CONFLIT DE LOIS PAR LES
CONVENTIONS INTERNATIONALES EN VIGUEUR
Il y a deux conventions internationales applicables en Tunisie et qui concernent le commerce lectronique vu laccord entre la Tunisie et lUnion europenne :
Article 62 du code de droit international priv tunisien : Le contrat est rgi par le droit dsign par les parties. A dfaut par celles-ci de dsigner la loi applicable, le contrat est rgi par la loi de lEtat du domicile de la partie dont lobligation est dterminante pour la qualification du contrat ou celle du lieu de son tablissement, lorsque le contrat est conclu dans le cadre de son activit professionnelle ou commerciale. 112 Cest la position de la majeure partie de la doctrine dont monsieur le professeur Pierre Mayer : il est sans inconvnient dappliquer distributivement plusieurs lois aux divers prjudices rsultant dun mme acte. , JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique , ditions Litec, 1998, p25.
111
I. Talbi et M. Helaoui
78
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
La convention de Rome en matire dobligation et de protection des consommateurs. La convention de Vienne en matire de vente internationale de marchandises.
II-1 La convention de Rome en matire dobligation et de protection des consommateurs : (adopte le 19 juin 1980 par la Communaut Europenne.)
Au dpart, il est utile de signaler le caractre universel de la convention de Rome, du fait que la loi dsigne par cette convention sapplique mme sil sagit dune loi dun Etat non contractant113. Laccord entre la Tunisie et lUnion europenne rend systmatiquement cette convention applicable en Tunisie. En plus, linscription de la Tunisie dans lOrganisation Mondiale de Commerce loblige (implicitement) appliquer cette convention114, puisque les entreprises et les consommateurs tunisiens ont le droit de considrer cette convention comme un lment du rgime juridique international. Cette convention est conforme au droit international priv tunisien dans la mesure o elle retient le principe de lautonomie en prcisant dans son article 3 que les parties sont libres dans leur choix de la loi rgissant leur contrat. En cas de silence de contrat, la solution apporte par le droit international priv tunisien est encore valable, puisque la solution cite par la convention de Rome est : Le contrat est rgi par la loi du pays avec lequel il prsente les liens les plus troits. (Article 4, alina 1er.) Tout en expliquant les liens troits, par la
Larticle 2 de la convention de Rome dispose que : La loi dsigne par la prsente convention sapplique mme si la loi est celle dun Etat non contractant. 114 La deuxime rgle de lO.M.C : la rgle du traitement national, selon laquelle chaque Etat membre doit accorder aux produits, aux services et aux ressortissants des autres Etat membres le mme traitement, cest dire le mme rgime juridique, que celui quil accorde aux produits, aux services, aux fournisseurs de services et aux ressortissants nationaux.
113
I. Talbi et M. Helaoui
79
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
rsidence habituelle ou le lieu de ladministration sociale pour les socits, associations ou personnes morales115. Mais lalina 5 de cet article 4 de cette convention carte cette prsomption lorsque : Il rsulte de lensemble des circonstances que le contrat prsente des liens les plus troits avec un autre pays. En effet, selon JEAN-BATISTE Michelle, lexclusion de la prsomption se fait dans des cas exceptionnels en citant lexemple dune prestation de service rendue via Internet et dont le lieu de rception, dmission de la prestation ou le lieu o elle est effectue peut prsenter autant de liens troits avec le contrat. La convention a cit 4 exceptions, autres que celle cite par lalina 5 de larticle 4: La premire concerne les contrats dont lobjet est un droit rel immobilier ou un droit dusage dun immeuble, le juge appliquera la loi de la situation de limmeuble. (Article 4, alina 3.) Ce qui est conforme larticle 58 du droit international priv. La deuxime intresse les contrats de transport de
marchandises, dans ce cas, la loi applicable est celle du lieu de ltablissement principal de lexpditeur lors de concidence de ce lieu avec le pays de ltablissement principal du transporteur lors de la conclusion du contrat ou le lieu de chargement ou de dchargement. (Article 4, alina 4.) Lapport majeur de cette convention est celui de la 3me exception dont lobjet est la protection des consommateurs. En ce qui concerne les contrats conclus par les consommateurs, le juge appliquera la loi de la rsidence de ces derniers, mme sil existe des liens plus troits avec dautres pays. Ctait lobjet de larticle 5 de la convention : Le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour rsultat de priver le consommateur
115
Il est prsum que le contrat prsentant les liens les plus troits avec le pays ou la partie qui doit fournir la prestation caractristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa rsidence habituelle ou, sil sagit dune socit, association ou personne morale, son administration sociale. ( Article 4, alina 2 de la convention de Rome)
I. Talbi et M. Helaoui
80
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
de la protection que lui assurent les disposions impratives de la loi du pays dans lequel il a rsidence habituelle : Si la
conclusion du contrat a t prcde dans ce pays dune proposition spcialement faite ou dune publicit et si le consommateur a accompli dans ce pays des actes ncessaires la conclusion du contrat. Ceci implique que la protection des consommateurs prime au principe de lautonomie des contractants. La 4me exception concerne les contrats de travail, elle a pour objet de dfendre le droit du travailleur, la loi applicable est celle qui assure la protection du travailleur dfaut de choix.
II-2 La convention de Vienne en matire de vente internationale de marchandises :
Cest la deuxime convention internationale applicable en Tunisie, elle a t ngocie au sein des Nations Unis ds le 11 avril 1980. Ce qui rend cette convention plus ouverte, elle est applicable presque partout dans le monde. Elle a pour objet de poser des rgles au conflit de lois, mais en plus de grer la formation et lexcution des obligations nes du contrat de vente, elle concerne, uniquement, les affaires commerciales en excluant les ventes portant sur les marchandises achetes dans le cadre de lusage personnel, familial ou domestique. En effet, le commentaire du Secrtariat, portant sur cette convention dispose que : Les auteurs de la convention nont pas voulu quelle soit applicable aux achats des consommateurs. 116.
Section 2 : Le problme des conflits de juridictions :
Le second problme rencontr par le commerce lectronique, vu son caractre mondial, est celui des conflits de juridictions.
116
JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique , dition Litec, 1998, p31.
I. Talbi et M. Helaoui
81
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Lorsquun conflit est n la suite dune affaire conclue sur le Web, quel serait le tribunal comptent pour trancher ce genre de litige ? Est-il possible quun tribunal applique une loi trangre ?
I.
LES CHEFS DE COMPETENCE DES TRIBUNAUX TUNISIENS
Monsieur HACHEM Mohamed El Arbi, distingue entre les chefs de comptence ordinaire et les chefs de comptence extraordinaire. Selon cet auteur, les chefs de comptence ordinaire sont principalement : La rsidence du dfendeur. La nationalit tunisienne du dfendeur. Et les chefs de comptence extraordinaire, appele encore exorbitante sont : Lattitude du dfendeur ou encore sa comptence subjective. La comptence objective. La comptence au titre de la rciprocit.
I-1 Les chefs de comptence ordinaire :
Ils sont au nombre de deux, le premier, fond sur la rsidence du dfendeur, est retenu par la majorit des lgislations modernes, au contraire le deuxime, fond sur la nationalit du dfendeur, reprsente une source de discussion.
a) La comptence fonde sur la rsidence du dfendeur : Larticle 2 alina 1er du Code de Procdure Civile et Commerciale de 1959 dtermine la comptence des juridictions pour toutes les contestations civiles et commerciales entre toutes personnes rsidant en Tunisie indpendamment de leur nationalit117. En dautres termes, quelle que soit la nationalit des parties, la rfrence dterminante de la comptence de la juridiction est la rsidence du dfendeur. De mme et dans le mme sens, larticle 3 du Code du Droit International Priv, dans son titre II : La comptence des juridictions tunisiennes, dispose que : les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation,
Le texte de larticle 2 alina 1er du C.P.C.C est fond sur un principe commun Actor sequitur forum rei
117
I. Talbi et M. Helaoui
82
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
civile et commerciale entre toutes personnes quelle que soit leur nationalit, lorsque le dfendeur a son domicile en Tunisie. En effet, larticle 7 nouveau du Code de Procdure Civile et Commerciale a dfini le domicile rel dune personne physique par le lieu o elle rside habituellement et les articles 18 et 33 de ce mme code ont dfini de leur part le domicile sige de la personne morale par le lieu o se trouve la direction effective de la socit.
b) La comptence fonde sur la nationalit du dfendeur : Larticle 2 alina 2 du Code de Procdure Civile et Commerciale donne comptence aux tribunaux tunisiens pour les actions diriges contre le tunisien rsidant ltranger. Selon le professeur HACHEM Mohamed El Arbi, cet article considre la nationalit tunisienne comme un chef de comptence des tribunaux tunisiens. Dans ce mme cadre, le Code du Droit International priv ne considre pas la nationalit comme un critre de comptence des tribunaux tunisiens, mais, il dclare plutt le contraire : lincomptence des tribunaux tunisiens si lobjet du litige est un droit rel portant sur un immeuble situ hors du territoire tunisien118 indpendamment de la nationalit du dfendeur. En effet, larticle 4 du Droit International Priv montre la limite du principe de la comptence fonde sur la nationalit du dfendeur. En ce qui concerne le commerce lectronique, si la nationalit du dfendeur est un critre de comptence, alors les tribunaux tunisiens sont comptents pour nimporte quelle affaire sur le Web. Il suffit que le dfendeur soit de nationalit tunisienne. Do limportance de montrer la limite du principe de comptence fonde sur la nationalit.
I-2 Les chefs de comptence extraordinaire ou exorbitante :
Le champ de comptence des tribunaux tunisiens peut tre tendu dans certains cas exceptionnels. Le principe est normalement la rsidence, mais pour une
118
Larticle 4 du Code du Droit International priv.
I. Talbi et M. Helaoui
83
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
raison ou une autre (faciliter les activits), le tribunal tunisien peut tre qualifi comme comptent. a) Lattitude du dfendeur ou la comptence subjective : Dans le cas o le dfendeur ne serait pas de rsidence habituelle tunisienne, peut-on parler de comptence des tribunaux tunisiens ? La rponse est que lattitude du dfendeur peut fonder la comptence des tribunaux tunisiens. La manifestation de lattitude peut se faire par la volont et par le choix, on parle dacceptation, du dfendeur, de se faire juger par les tribunaux tunisiens et de llection de domicile en Tunisie ou de la dsignation dun reprsentant. a.1 La comptence fonde sur lacceptation volontaire du dfendeur : Larticle 2, alina 3, paragraphe 1er du Code de Procdure Civile et commerciale, de mme que larticle 4 du Code du Droit International Priv rclament la comptence des tribunaux tunisiens si le dfendeur accepte dtre jug par elles ( sauf bien sr si lobjet du litige est un droit rel portant sur un immeuble situ hors du territoire tunisien, comme on la dj expliqu ci dessus.) a.2 La comptence fonde sur llection de domicile en Tunisie ou la dsignation dun reprsentant : Larticle 2 alina 3 paragraphe 2 du C.P.C.C dispose que : Sil y a en Tunisie un domicile lu ou sil y a un reprsentant : la comptence des tribunaux tunisiens est fixe ici aussi par rfrence lattitude du dfendeur ou plutt son comportement, et cest ce comportement qui va traduire la volont du dfendeur ; mieux encore, il justifie la comptence par lexistence dun lien objectif qui va se manifester de deux manires : Llection de domicile en Tunisie. La dsignation dun reprsentant en Tunisie Le texte ci-dessus est destin au dfendeur de nationalit trangre et dont le domicile est ltranger, mais disposant, pour les besoins de ces relations (civiles, commerciales, juridiques), dune possibilit dlection de domicile en Tunisie ou bien la possibilit de dsigner un reprsentant qui, lui, rside
I. Talbi et M. Helaoui
84
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
habituellement en Tunisie, ce qui donne naissance, dans ce cas, la comptence des tribunaux tunisiens par rfrence la volont du dfendeur et donc par rfrence son attitude. Cette solution peut tre frquemment utilise dans le cadre du commerce lectronique o la rsidence est peu importante dans la rsolution des litiges. b) La comptence objective : Le rattachement de lobjet du litige lordre juridique tunisien peut donner naissance la comptence des tribunaux tunisiens. Larticle 3 dans son alina 3 du C.P.C.C119 rclame la comptence des tribunaux tunisiens Si laction porte sur des immeubles sis en Tunisie ou sur des meubles sy trouvant. La solution est ordinaire en ce qui concerne les immeubles, cest le principe de territorialit du bien qui sera appliqu. Mais cette solution trouve sa limite si on parle de bien meuble et surtout si on parle de bien virtuel comme la vente des livres virtuels sur le rseau. Dans ce cas, le principe de territorialit du bien na plus de sens. Bien que le juge puisse tablir des liens srieux entre un bien meuble et un lieu tel que le pays de limmatriculation pour les navires et les aronefs. Et mme pour les biens incorporels (Ils ressemblent beaucoup aux biens virtuels) tels que les marques de fabrique, les brevets dinvention, les dessins et les modles. La localisation la plus approprie serait celle du lieu de lenregistrement dudit bien. Cette solution peut tre acquise pour les biens virtuels, si un enregistrement ou autre chose quivalente est exige aux propritaires. La 2me forme de la comptence objective concerne les obligations. En effet, larticle 2 dans son alina 4 du mme code dispose que : Le tribunal tunisien est comptent lorsquil sagit dun accident qui a eu lieu en Tunisie ou dun contrat conclut, excut ou devant tre excut en Tunisie. Daprs ce texte le juge doit chercher localiser le contrat par lun de ces lments les plus importants :
119
C.P.C.C : Code de Procdure Civile et Commerciale.
I. Talbi et M. Helaoui
85
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
La conclusion du contrat : le lieu de la conclusion dtermine la comptence du tribunal. Lexcution du contrat : dans ce cas, il faut que lexcution constitue un lien srieux avec le litige, mme si cette solution savre inefficace pour les contrats complexes.
c) La comptence au titre de la rciprocit : Larticle 2 dans son alina 3, 7me paragraphe dclare que les tribunaux tunisiens sont comptents dans tous les cas o les tribunaux de ltranger se dclarent comptents pour statuer sur les actions diriges contre les tunisiens. Cest la comptence au titre de rciprocit. Lapplication de cette rgle pose des problmes dordre juridique, en posant le dlicat problme de la connaissance du droit tranger.
II.
LES EFFETS INTERNATIONAUX DES JUGEMENTS :
La question qui se pose ce niveau est la validit dun jugement, annonc dans un pays, sur lchelle internationale. Un problme de conflit dautorit se pose. Ceci peut poser un lien dincertitude pour le commerce international lectronique. Si nous nous rfrons au principe de Territorialit et celui de la Souverainet nous admettons que les dcisions judiciaires ont une valeur limite par le territoire. Sauf que, dune part, le droit commun a reconnu une certaine valeur aux dcisions trangres sous certaines contraintes. Dautre part, et sous le besoin de la coopration et de linternationalisation des principes directeurs, la conclusion des conventions bilatrales ou multilatrales aide la connaissance des dcisions trangres.
I. Talbi et M. Helaoui
86
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
II-1 Les solutions apportes au conflit de juridictions travers le droit commun :
Le principe est lexigence dune instance judiciaire (exequatur) qui a pour objet lexamen de la dcision judiciaire et la vrification des conditions exiges par le droit du pays o on cherche excuter ladite dcision. 120. Les dcisions dont on a parl ci dessus sont de deux ordres : Les dcisions judiciaires (a.) et les sentences arbitrales (b.) a) Les dcisions judiciaires : La pratique tunisienne est fonde sur le recours la procdure de lexequatur. Mme si les jugements peuvent faire foi des faits constats mme avant davoir t rendus excutoires, lexequatur reste un lment fondamental dans la validation et lexcution dun jugement tranger. Quelles sont alors les conditions de loctroi de lexequatur dun jugement tranger ? Les conditions sont au nombre de 4 : Conditions relatives la comptence juridictionnelle : il faut que la dcision exequaturer soit rendue par une autorit judiciaire comptente. On vrifie alors la comptence du tribunal qui a rendu ladite dcision. Conditions relatives la procdure suivie devant les juridictions trangres : une procdure bien dtermine doit tre contrle par le juge de lexequatur. Le juge doit contrler : La rgularit de lassignation du dfendeur. La rgularit du droulement du procs. Cest en quelque sorte le respect des droits de la dfense par lordre juridique tranger. Conditions relatives au jugement : elles sont au nombre de trois : La 1re condition concerne lexequatur et le statut dfinitif du jugement dans le pays o il a t rendu.
120
HACHEM Mohamed El Arbi, Leons de droit international priv , 1996, p 149.
I. Talbi et M. Helaoui
87
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Le jugement ne doit pas tre en contradiction avec un jugement tunisien rendu sur la mme question et entre les mmes parties. La non contradiction avec lordre public national. Mme si cette condition savre floue, la question qui se pose cest quoi lordre public ? Condition dcoulant du principe de la rciprocit : il sagit dune mesure de rtorsion () c'est--dire, si les lois du pays du jugement concern prescrivent dautres conditions pour loctroi de lexequatur des jugements tunisiens, ces conditions seront exiges pour loctroi de lexequatur dudit jugement. 121. Reste que ceci pose un problme au niveau de lapplication, puisquil suppose la vrification de toutes les conditions imposes par le droit du pays o le jugement a t rendu, cest dire la connaissance parfaite du droit tranger. b) Les sentences arbitrales : En se referant au Code de lArbitrage (avril 1993), il y a trois sortes de sentences : Sentence nationale locale. Sentence trangre (rendue dans un pays tranger). Sentence internationale : elle peut tre rendue en Tunisie ou ailleurs. On parle darbitrage international, si lune des trois hypothses suivantes est vrifie : La prsence de ltablissement des parties dans deux Etats diffrents, au moment de la conclusion de la convention. Si le lieu de larbitrage ou le lieu o doit tre excute une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel lobjet du diffrend a le lien le plus troit, est situ hors de lEtat dans lequel les parties ont leur tablissement.
121
HACHEM Mohamed El Arbi, Leons de Droit International Priv , imprimante officielle de la rpublique tunisienne, 1996, p153.
I. Talbi et M. Helaoui
88
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Si lobjet de la convention darbitrage a des liens avec plus dun pays. Enfin, loctroi de lexequatur ncessite la runion de plusieurs conditions numres par les articles 80, 81 et 82 du Code darbitrage.
II-2 Les solutions apportes au conflit de juridictions travers le droit conventionnel :
Vu la difficult rencontre au cours du contrle des conditions de loctroi de lexequatur des dcisions judiciaires par le droit commun, les Etats ont appliqu dautres solutions bases sur les conventions bilatrales et multilatrales.
a) Les conventions bilatrales : Elles sont nombreuses et elles ont pour objectifs : Lchange dinformations dordre juridique. La transmission des actes judiciaires : assignation, signification de dcisions judiciaires. La commission rogatoire pour entendre les tmoins. Reconnaissance et exequatur des dcisions judiciaires. Lobjectif fondamental est de faciliter la circulation des dcisions judiciaires entre les deux pays contractants.
b) Les conventions multilatrales : Lobjectif des conventions multilatrales est de crer un espace juridique plus large (le monde entier, dfaut une rgion.). La principale convention est celle de La Haye du 1er fvrier 1971 sur la reconnaissance et lexcution des jugements trangers en matire civile et commerciale. Ensuite, nous citons la convention de Bruxelles du 27/09/1968, est relative la comptence judiciaire et lexcution des dcisions en matire civile et
I. Talbi et M. Helaoui
89
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
commerciale dont lobjet principal est la libre circulation des jugements, entre les pays de lUnion europenne et la Tunisie, par une simplification de lexequatur. Enfin, dautres conventions ont t signes par la Tunisie et dont lobjet se trouve autour de : Lchange dinformations. Lassistance judiciaire. La transmission de pices et des documents. La position des rgles de comptence juridictionnelle directe en matire de droit rel, dtat et de capacit. La fixation des conditions de la reconnaissance et de lexequatur de jugement et de sentences arbitrales. Parmi ces conventions nous citons celle de RYADH (06/04/1983) ratifie par la Tunisie le 29/10/1985. Et celle de lunion du Maghreb arabe, qui t conclue au sommet de Ras Lanouf (en Libye) le 10/03/1991.
I. Talbi et M. Helaoui
90
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
LES HYPOTHESES :
Il ya un lien entre le classement des applications sur Internet selon les tudiants de formation scientifique et ceux de formation littraire.
Il existe un lien entre le classement des hommes et celui des femmes en ce qui concerne les applications sur Internet.
Il ya un lien entre le classement des moyens de paiement faits par les tudiants de formation scientifique et ceux de formation littraire.
Il existe un lien entre le classement des hommes et celui des femmes en ce qui concerne les moyens de paiement.
La variation du prix dun produit (dans notre cas il sagit dune boisson gazeuse) ; a un impact sur la quantit achete.
La prsence directe du vendeur influence lintention dachat du consommateur tunisien.
Les tarifs de connexion pratiqus en Tunisie favorisent le commerce lectronique.
Le consommateur est mal inform en ce qui concerne le commerce lectronique.
I. Talbi et M. Helaoui
91
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
La scurit des donnes personnelles explique de plus en plus la scurit sur Internet.
La vente en ligne peut devenir un jour une ncessit ou une utilit dexistence.
Le commerce lectronique est une nouvelle voie qui ncessite ladaptation du rgime juridique applicable au contrat en ligne.
I. Talbi et M. Helaoui
92
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Partie III - L'tude pratique des entreprises en ligne : leurs suggestions et celles du consommateur
Dans le cadre de notre tude empirique, nous examinerons la notion du commerce lectronique, en Tunisie sur le terrain. En dautres termes et tout au long de notre recherche, nous allons essayer danalyser et dexpliquer la ralit de cette notion dans notre pays. Pour cela, on va subdiviser notre travail en deux niveaux : le premier concerne lentreprise ou la socit tunisienne et son aptitude vendre en ligne. Le deuxime niveau concerne notamment le consommateur tunisien et son intention dachat en ligne. Nous commenons par la prsentation des hypothses :
Chapitre 1 : Lexprience des entreprises en ligne et leurs suggestions :
Du point de vue entreprise, et tant donn la raret remarquable des cas de vente en ligne, nous allons concentrer ltude sur lexprience de la principale socit qui a pris linitiative de crer son propre site Web commercial ayant pour but la vente en ligne en offrant au consommateur des produits concernant sa consommation courante ou autres, ce nest que la Socit Magasin Gnral (S.M.G), leader dans son domaine.
Section 1 : Cas de la Socit Magasin Gnral :
Lanalyse de lexprience de la SMG passe par 4 tapes : en premier lieu, nous prsenterons la socit dune manire gnrale. Ensuite, on va noncer les tapes
I. Talbi et M. Helaoui
93
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
suivre pour passer une commande sur Internet. La troisime tape concerne essentiellement le cadre juridique ainsi que les conditions gnrales de vente. Ces trois premires tapes ont pour but de prsenter le site ainsi que ses caractristiques. Enfin, on a pu dans une dernire tape dvelopper un entretien avec monsieur Dridi Kas, le responsable du site Web de la S.M.G et ceci pour bien clairer les notions et les interrogations qui peuvent tre poses par un consommateur voulant acheter en ligne.
I.
PRESENTATION DE LA SOCIETE :
Raison sociale : Socit Magasin Gnral Activit principale : Commerce rayons multiples Nombre d'tablissements : 43 points de vente rpartis travers tout le territoire tunisien. Capital social : 8.350.000 Dinars Nationalit : Tunisienne Registre du commerce : B 136551996 Matricule fiscal : 033128 W Rgime fiscal : Droit commun Forme juridique : Socit Anonyme P.D.G : M. Mohsen Laroui Cotation en bourse : 1er novembre 1999 Visa de CMF : 99.356 du 27 septembre 1999 La S.M.G est le Leader de la grande distribution par son chiffre d'affaires et le nombre de ses points de vente. En plus elle possde une superficie globale de vente d'environ 45 000 m. Elle est caractrise par une gamme large, qualits bonnes et prix tudis. Elle offre la possibilit dacheter avec facilits ou crdit aux meilleures conditions. La Socit Magasin Gnral affiche de bons ratios d'quilibre structurel, un fonds de roulement toujours positif et une trs bonne autonomie financire. Son chiffre d'affaires est en croissance soutenue.
I. Talbi et M. Helaoui
94
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Structure du Capital Office du Commerce de la Tunisie 34,13% Banque Nationale Agricole 30,71% Socit Tunisiennes des Industries Laitires 9,96% Autres Actionnaires minoritaires 25,20%. Evolution du Chiffre d'Affaires TTC Annes : 1997 1998 86 904 1999 86 436 2000 96 177
Chiffre d'Affaires TTC : 86 520 (Unit : 1000 TND)
II.
LES ETAPES A SUIVRE POUR PASSER UNE COMMANDE SUR INTERNET AUPRES DE LA S.M.G :
Pour passer une commande en ligne linternaute doit suivre les 5 tapes suivantes :
II-1 Trouver un article :
Le client en ligne de la S.M.G a plusieurs possibilits pour trouver un produit : a) Naviguer librement travers les rayons : Parcourir les rayons, familles et gammes de produits disponibles en ligne et lister tous les articles qui leur sont associs : Un article est gnralement prsent avec sa photo, un libell commercial, un prix de vente public, et un prix de vente promotionnel le cas chant. b) Se servir du moteur de recherche : En tapant un ou plusieurs termes relatifs ce que linternaute souhaite trouver. Exemple : "lessive liquide" ou "omo nadhif". Ce moteur tolre dans une certaine mesure les fautes dorthographe. Si plus de 20 articles rpondent vos critres de recherche, seuls les 20 premiers seront affichs. Vous pourrez alors affiner votre recherche.
I. Talbi et M. Helaoui
95
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
c) Enfin, lutilisation de la commande type du consommateur : La commande type est la liste des articles commande par linternaute le plus frquemment sur le site marchand de la S.M.G. Elle lui permet de passer une commande facilement partir des produits dj achets lors de ses prcdents achats.
II-2 Prparer et conclure une commande
Une fois la premire tape est acheve, il suffit d'indiquer le nombre d'articles dsir et de cliquer sur le bouton-picto pour mettre un produit dans le e-chariot. Le produit se met automatiquement dans le chariot d'achat final, et le sous-total est calcul dynamiquement. Pour ajouter, enlever, modifier la quantit d'un article du chariot, le client doit cliquer sur le lien "Votre Chariot". Tous les produits prslectionns safficheront alors pour permettre linternaute deffectuer les modifications ncessaires avant d'acheter (ajout, suppression, modification de quantit). Il est possible aussi denregistrer cette slection comme commande type, ou charger une commande type enregistre lors d'un prcdent achat. Enfin, 2 possibilits pour conclure une commande sont possibles : a) Prparer une offre de prix pour les produits slectionns ; b) Finaliser une commande sur le site ; Bien videmment, pour pouvoir conclure une commande dans les meilleures conditions ou enregistrer une commande type pour la relancer plus tard, il faudra sidentifier au pralable et enregistrer les donnes d'accs au systme en qualit de "Client identifi".
II-3 S'identifier :
L'identification est une opration qui se fait tout moment. Elle consiste crer un "Compte Client" sur le site et mettre jour les donnes relatives au client afin de lui permettre de bnficier de certains avantages outre le fait d'enregistrer ses coordonnes de facturation et de livraison.
I. Talbi et M. Helaoui
96
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Parmi ces avantages, on retient la sauvegarde du contenu du e-chariot mme en cas d'interruption pendant la commande, l'enregistrement de commandes types en vue de leur chargement lors des prochaines visites et surtout la mmorisation des coordonnes relatives au client pour un meilleur gain de temps.
II-4 Confirmer une commande :
Quand le client clique sur "commander", les informations concernant ses coordonnes de facturation et de livraison seront importes par dfaut dans le cas d'une commande passe par un compte valide. De mme qu'un rcapitulatif exhaustif de la commande finale comprenant : la dsignation de chaque article command ainsi que sa rfrence, le nombre darticles commands, le prix unitaire et le montant de la commande en hors taxe, la TVA, les frais de livraison et du timbre fiscal et le montant total payer. Le client pourra ensuite choisir lheure ainsi que les prfrences de sa livraison. Une slection enfin de son moyen de paiement parmi les deux options proposes on et off line : - Carte de paiement e-dinar ; - Paiement la livraison ; Il ne vous reste que de cliquer sur "Valider la commande".
II-5 Payer :
En choisissant l'option de paiement la livraison, un bon de commande lectronique - que le client pourrait imprimer - lui sera affich et fera preuve d'accus de rception. La commande, enregistre dans la base clientle, sera consulte immdiatement par l'administrateur du site qui prendra le soin de vrifier l'exactitude des donnes transmises avant d'ordonner la livraison de la marchandise son commanditaire. Le client reoit un message de confirmation de sa commande quelques secondes plus tard aprs la vrification et la validation de la commande passe.
I. Talbi et M. Helaoui
97
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Le client doit sassurer de bien recevoir la confirmation de transaction avant de quitter la boutique. Sa commande ne sera pas prise en compte si le message de confirmation ne saffiche pas. La transaction stant droul dans les meilleures conditions, la commande lui sera alors livr le lendemain ou sous un dlai de 48 h au plus tard. Sinon, et en cas de problme, le client sera avis.
En cas darticle manquant : Lorsque le client slectionne un produit chez la boutique de la S.M.G, il ne peut commander que la quantit dont cette dernire dispose en stocks. Il peut arriver exceptionnellement quun produit manque lors de la prparation de la commande (absence de livraison du fournisseur, produit abm..). Dans ce cas, le client sera inform immdiatement sur les contacts laisss, pour lui proposer certaines alternatives ou revoir sa commande passe.
En cas de problme : Dans le cas o le client rencontrerait une quelconque difficult ne de l'utilisation de la boutique marchande, il peut transmettre ses rclamations et problmes. La S.M.G propose dapporter l'aide et le soin ncessaires pour une meilleure utilisation de son site. De mme, elle offre ses clients la possibilit de la contacter n'importe quel moment de la journe pour nimporte quelles demandes d'informations complmentaires par lenvoi dun e-mail sur : info@smg.com.tn, ou en
contactant le service clientle par tlphone au : (216) 71 32 85 33 / 71 32 10 58.
III. CADRE JURIDIQUE ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE
III-1 Prambule :
Le site marchand contient une proposition commerciale de vente distance de produits sur le territoire tunisien.
I. Talbi et M. Helaoui
98
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
III-2 Prix :
Le prix global des produits, au vu des modalits spcifies audit site, est un prix dfinitif qui comprend le prix des produits, les frais de manutention, d'emballage et de transport, ainsi que la TVA. Ce prix est exprim en Dinar Tunisien.
III-3 Paiement :
Le paiement pourra se faire d'avance par la carte e-dinar au moment de la commande, par Dinar poste ou par chque / espce la livraison.
III-4 Dlai de livraison :
La commande est livre directement chez le client ou l'adresse de son choix dans un dlai de 24 heures maximum. Ce dlai exclue les jours fris.
III-5 Garantie :
Le vendeur garantit le client contre tout dfaut cach ventuel affectant le produit. En cas de non-conformit du bien livr l'offre, le vendeur s'engage y remdier ou rembourser le client. Toutefois, les rclamations sur le vice apparent ou sur la non conformit du produit livr ou produit command doivent tre formules par crit dans les sept jours qui suivent la livraison.
III-6 Risques :
Le client assume les risques des articles ds leur livraison, et notamment les risques de perte, d'avarie, de destruction et de dommage.
III-7 Rglement des litiges :
En cas de litige, l'acheteur s'adressera en priorit au vendeur pour obtenir une solution amiable.
I. Talbi et M. Helaoui
99
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
A dfaut, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement accept, les tribunaux du sige social du vendeur sont seuls comptents, pour le rglement des litiges pouvant natre entre les contractants.
IV.
ENTRETIEN AVEC LE RESPONSABLE DU SITE WEB DE LA
SMG :
Tunis, le 12 mai 2003. Le sige de la direction gnrale de la SMG
Entretien avec monsieur : DRIDI Kas (responsable du site Web de la SMG). Sujet de lentretien : lexprience de la SMG dans le domaine du commerce lectronique et les suggestions envers le futur de cette nouvelle technologie.
Cet entretien est labor dans le cadre dun mmoire de fin dtude pour lobtention de la matrise en Etudes Suprieures Commerciales intitul : Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
1. La Socit Magasin Gnral est quasiment le premier organisme tunisien qui a affront lexprience de vente en ligne. Quels sont les objectifs recherchs par une telle exprience ? Et quelles sont les opportunits estimes ?
Le but principal recherch est dtre leader sur le march en utilisant lInternet et les nouvelles technologies de linformation pour offrir au consommateur tunisien un produit en ligne quil peut acheter sans quil soit contraint de se dplacer chez nos points de vente. Cela lui permet de gagner le temps surtout que notre livraison se fait dans un dlai maximum de 24 heures.
I. Talbi et M. Helaoui
100
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
En plus, nous offrons une livraison tout fait gratuite. Cela nous permet, notamment, de renforcer notre image de marque et de gagner la fidlit et la confiance de notre clientle. Enfin, offrir un produit sur Internet va nous permettre de conqurir de nouveaux marchs.
2. Selon vous, la vente en ligne peut-elle devenir un jour une ncessit ou une utilit dexistence dans la mesure o son absence peut causer une perte considrable de clientle ?
Vu le dveloppement considrable des socits, ainsi que les nouvelles technologies de linformation, on peut estimer la ncessit du commerce lectronique surtout lorsquon ajoute ceci lintrt du consommateur tunisien vis--vis de lInternet. En effet, notre tablissement a lanc des compagnes publicitaires concernant la possibilit dacheter en ligne dans une scurit absolue. Dailleurs, nous sommes tout fait conscient que la scurit est le principal souci de notre clientle en ligne. Autre que lenvironnement encourageant, dont nous avons prpar, le consommateur tunisien, aujourdhui, se trouve de plus en plus press par le temps ceci lui encouragera acheter en ligne, et dailleurs nous avons prvu le dveloppement dune clientle assez considrable.
3. Quels sont les principales difficults actuelles rencontres par la SMG pendant les oprations de vente en ligne ?
Notre souci majeur, en se qui concerne la vente en ligne, se rattache lidentification des clients et la slection des commandes relles de celles errones. La solution que nous avons choisi pour le moment est simple mais elle est un peut coteuse. Nous vrifions une commande en appelant notre client et nous obtenons ainsi la confirmation de la commande. En outre, nous
I. Talbi et M. Helaoui
101
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
avons des problmes dordre technique se rattachant au dbit de la connexion, ainsi que des difficults dans la gestion du stock, vu le manque dinformation.
4. Dans quelles mesures la vente en ligne peut-elle reprsenter un avantage concurrentiel pour la SMG ?
Jusqu maintenant, nous ne sommes pas concurrencs et nous gardons bel et bien notre avantage de vente en ligne. Nous estimons une croissance du chiffre daffaire suite cette nouvelle activit.
5. En cas de litige : lacheteur sadresse en priorit au vendeur pour obtenir une solution amiable. Pouvez-vous nous donner une ide sur le fondement des solutions amiable proposes par votre socit ? Avez-vous un exemple rel ?
Pour mieux servir nos clients, nous nous rendons chez eux, nous les contactons par tlphone pour rsoudre tout problme pouvant intervenir. Dans nos relations avec les clients, nous accepterons sans problme le retour des articles refuss par le client mme, parfois, dans les situations o la dfaillance du produit est cause par lui. Nous essayons de faire le maximum pour le plaisir et la satisfaction de notre clientle.
6. Dans le cas o le client ne serait pas satisfait par la solution amiable, la SMG lui impose le recours aux tribunaux du sige social de votre socit quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement accept, pour le rglement des litiges pouvant natre entre les contractants. Ne pensez-vous pas quune telle contrainte peut freiner lintention dachat de linternaute ?
I. Talbi et M. Helaoui
102
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Jusqu maintenant, nous navons rencontr aucun cas de litige. Pour les tribunaux particuliers, je pense quil ny a pas des tribunaux particuliers pour la SMG, sauf pour lInternaute tranger, ce dernier doit forcment sadresser un tribunal tunisien.
7. La part du march de la SMG en ligne est-elle pesante par rapport sa part globale du march ?
Nous avons pu atteindre les prvisions estimes au dpart. Toutefois, nous sommes entrain de dvelopper le meilleur pour la SMG, et ceci par ltude des suggestions de notre clientle, qui ont demand un mode de paiement par carte de crdit, de revoir le seuil minimum dachat en ligne qui est de 20 DT. Le design du site a t critiqu son tour, le client demande ce stade une version en arabe, comme il ne faut pas oublier quune telle opration ncessite un effort de communication tout risque.
8. Comment la SMG peut-elle profiter de cette exprience pour largir son march ?
Notre socit prvoie dlargir le rseau de distribution du site en touchant dautres gouvernorats ( noter que le site actuel recouvre le grand Tunis seulement), ensuite, le site nous permet de communiquer nimporte quelle action, ainsi le site peut constituer une vitrine additionnelle et un bon support publicitaire.
9. La SMG est le leader de la grande distribution par son chiffre daffaires et le nombre de ses points de ventes. Ne pensez-vous pas que le
I. Talbi et M. Helaoui
103
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
dveloppement de la vente en ligne peut reprsenter une menace pour la S.M.G, dans la mesure o il rduit les barrires dentrer au secteur et limite les avantages concurrentiels de votre socit ?
La clientle en ligne est trs peu nombreuse, il est difficile dimaginer une socit spcialise dans la vente en ligne en Tunisie, le pourcentage de clientle acceptant dacheter en ligne est trs restreint. A mon avis personnel le dveloppement dun march spcialis en ligne est impossible au moins nos jours. Alors le problme ne se pose pas, la vente en ligne est une activit complmentaire, cest comme un service en plus. Et il est aussi signaler que mme si la clientle se dveloppera un jour, et deviendra de plus en plus importante, le problme de gestion de stock se pose toujours, dans les conditions du march tunisien cest hors de question de parler dun stock 0.
Nous remercions monsieur Kas DRIDI davoir accept de participer llaboration de ce travail.
V.
CONCLUSION :
La SMG, monopole dans son domaine en ligne, constate le commerce lectronique comme une activit complmentaire son activit principale : la vente traditionnelle en contact avec le client (Question 9). Lobjectif de cette activit est daccrotre le CA. Dautre part, la vente en ligne peut tre considre comme une force concurrentielle en facilitant la tache au consommateur. En effet, sans dplacement, il est possible de passer une commande auprs du site de la SMG et, au plus tard, dans 24 heures (Question 1), votre demande sera livre gratuitement, de plus, pour la scurit de paiement, le client peut se sentir 100% en scurit (confidentialit des donnes personnelles) puisquil a la possibilit de payer par chque aprs la rception de la commande. La solution de scurit choisie par la SMG est le paiement traditionnel par chque, bien que monsieur
I. Talbi et M. Helaoui
104
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
DRIDI Kas a insist sur le travail srieux, pnible et laborieux pour faire un site scuris, mais il est apparemment difficile de convaincre la clientle de la SMG par la scurisation du paiement lectronique. Bien que la SMG a beaucoup travaill pour encourager le commerce lectronique en offrant une livraison gratuite pour une commande de valeur suprieure 20DT (Question 7), les suggestions de la clientle sont toujours pesantes. En effet, les clients rclament la ncessit davoir la possibilit de payer par la carte de crdit et de rduire le seuil retenu pour lequel la livraison est gratuite (Question 7). Encas de problmes ou de conflits judiciaires la SMG propose une solution amiable (Question 5 : nous accepterons sans problme le retour des articles refuss par le client mme, parfois, dans les situations o la dfaillance du produit est cause par lui. Nous essayons de faire le maximum pour le plaisir et la satisfaction de notre clientle. ). Mais si la solution nest pas satisfaisante pour un client, nous posons linterrogation propos de lobjectif de la contrainte concernant les tribunaux du sige social du vendeur annonc par la SMG dans sa vitrine virtuelle : En cas de litige, l'acheteur s'adressera par priorit au vendeur pour obtenir une solution amiable. A dfaut, les tribunaux du sige social du vendeur sont seuls comptents, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement accept, pour le rglement des litiges pouvant natre entre les contractants. .
Section 2 : Etude sur lexprience de 13 entreprises tunisiennes :
Une tude a t faite sur un chantillon de 13 entreprises qui ont abord lexprience de vente en ligne, lors dune tude sur le commerce lectronique.
I. Talbi et M. Helaoui
105
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
I.
AU NIVEAU DE LAUGMENTATION DU CA :
Les entreprises dont le CA n'est pas tellement ralis Les entreprises dont le CA est moyennement ralis Les entreprises dont le CA est bien ralis Les entreprises dont le CA est parfaitement ralis 3 7 2 1
Tableau 4. L'augmentation du CA.
8% 15%
23%
Les entreprises dont l'augmentation du CA n'est pas tellement ralis Les entreprises dont l'augmentation d CA est moyennement ralis Les entreprises dont l'augmentation du CA est bien ralis Les entreprises dont l'augmentation du CA est parfaitement ralis
54%
Figure 2. L'augmentation du CA.
La commercialisation en ligne a permis toutes les entreprises daugmenter leurs chiffres daffaires. Toutefois la diffrentiation reste au niveau de la qualit car en remarque que la majorit des entreprises ont ralis une augmentation moyenne de leur CA alors que 23% dont laugmentation nest pas tellement ralise. A un niveau plus meilleure il ya deux entreprises qui ont bien augment leur CA et une seule entreprise qui a ralis une augmentation parfaite.
I. Talbi et M. Helaoui
106
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
II.
AU NIVEAU DES MOYENS UTILISES :
carte puce carte de crdit modes de paiement traditionnels monnaie lectronique 0% 46,20% 69,20% 100%
Tableau 5. Les modes de paiement.
100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% carte puce carte de crdit modes de paiement traditionnels monnaie lectronique 46,20% 69,20% carte de crdit modes de paiement traditionnels monnaie lectronique carte puce
S1
carte puce Srie1 0%
carte de crdit 46,20%
modes de paiement traditionnels 69,20%
monnaie lectronique 100%
Figure 3. Le commerce lectronique et les diffrents modes de paiement.
A ce niveau, toutes les entreprises interroges sont convaincues que la monnaie lectronique constitue le meilleur moyen pour effectuer des transactions en ligne. Ceci ne signifie jamais labsence des autres modes de paiement car on trouve 68 % des entreprises qui ont opt pour le mode de paiement traditionnel alors que 6 entreprises prfrent le paiement par carte de crdit lors de la conclusion dune opration en ligne mais on constate quaucune entreprise nutilise le paiement par carte puce.
I. Talbi et M. Helaoui
107
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
III. AU NIVEAU DE LA REDUCTION DES COUTS :
Les entreprises dont la rduction de cot n'est pas tellement ralise Les entreprises dont la rduction de cot est moyennement ralise Les entreprises dont la rduction de cot est bien ralise Les entreprises dont la rduction de cot n'est pas ralise 2 2 2 7
Tableau 6. La rduction de cots.
55%
15%
Les entreprises dont la rduction de cot n'est pas tellement ralise Les entreprises dont la rduction de cot est moyennement ralise Les entreprises dont la rduction de cot est bien ralise
15% 15% Les entreprises dont la rduction de cot n'est pas ralise
Figure 4. La rduction de cots.
La majorit des entreprises interroge (55%) nont pas ralis une rduction de cots la suite de leur implantation en ligne. Le reste se divise en trois groupes gaux, soit 15% pour chacun. Le premier groupe a ralis une mauvaise rduction de cots, le second est celui dont la rduction est moyennement ralis, le dernier a bnfici dune rduction de cot bien ralis.
IV.
AU NIVEAU DES APPLICATIONS SUR LE NET :
recherche d'information commerce lectronique messagerie lectronique 46% 100,00% 100,00%
Tableau 7. Les diffrentes applications sur le net.
I. Talbi et M. Helaoui
108
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
100% 90% 80% 70% 60% pourcentages 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 1 recherche d'information commerce lectronique messagerie lectronique 46% 100,00% 100,00% recherche d'information messagerie lectronique commerce lectronique applications recherche d'information commerce lectronique messagerie lectronique
Figure 5. Les diffrentes applications sur le net.
Bien quil existe des fins multiples pour utiliser lInternet, il ya deux applications seulement qui ont soulev plus dintrt savoir la recherche de linformation, l o on trouve que 46% des entreprises interroges ladmette, et la messagerie lectronique qui occupe lintrt de lensemble de lchantillons.
V.
AU NIVEAU DE LIMPORTANCE DES ELEMENTS INTERVENANT LORS DUNE OPERATION DE COMMERCE ELECTRONIQUE :
scurit de paiement problme de lgislation la preuve le contrat
84,60% 61,50% 23,10% 46,20%
Tableau 8. L'importance des lments intervenant lors d'une opration de commerce lectronique.
I. Talbi et M. Helaoui
109
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% scurit de paiem ent problm e de lgislation la preuve le contrat S1 scurit de paiement problme de lgislation la preuve le contrat
Figure 6. Limportance des lments intervenant lors d'une opration de ecommerce.
La majorit des entreprises pensent que la scurit de paiement constitue llment le plus important pour la russite dune opration de e- commerce. A un autre stade, presque 61.5% des entreprises voient quil faut en plus remdierer aux problmes de lgislation. Dun autre cot 6 entreprises mettent laccent sur limportance et la ncessit dun contrat lors de la conclusion dune opration en ligne alors que seulement 3 entreprises pensent que la preuve est llment le plus important.
Chapitre 2 : Les Internautes ou les consommateurs potentiels en ligne :
Section 1 : Mthodologie de recherche :
I.
DEFINITION DE LA POPULATION MERE :
I-1 Dfinition thorique :
Une population est un ensemble d'units statistiques sur lesquelles on procde des analyses. Dterminer la population mre revient donc choisir l'univers de
I. Talbi et M. Helaoui
110
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
l'enqute. Ceci est trs important tant donn que l'objectif de la recherche est d'tablir un savoir nouveau permettant de confirmer une thorie ou de proposer de nouvelles ides pouvant faire l'objet d'une thorisation se rapportant un univers donn et donc une population bien dtermine. I-2 Dtermination de la population mre dans notre tude : Notre tude se propose d'avoir une ide sur la perception et les attentes des consommateurs tunisiens du commerce lectronique, ainsi que les relations existantes entre les moyens disponibles au consommateur et sa mobilit vis vis de ce nouveau mode de commerce. C'est ainsi que notre population mre ne peut tre constitue que des consommateurs potentiels tunisiens en ligne.
II.
LES METHODES D'ECHANTILLONNAGE ET LE CHOIX DE
L'ECHANTILLON :
Une fois nous avons dfinit la population mre, il serait impossible (trop long et trop coteux) de raliser une tude exhaustive. Or les techniques
d'chantillonnage existantes nous permettent de fournir partir d'un petit nombre de personnes et avec une prcision satisfaisante, acceptable et cot raisonnable, des informations qui pourront tre gnralises l'ensemble de la population mre tudier. Nous distinguons deux grandes catgories de mthodes d'chantillonnage savoir les mthodes probabilistes et les mthodes non probabilistes.
II-1 Dfinition thorique de la mthode probabiliste choisie :
Nous avons choisit la mthode d'chantillon plusieurs degrs qui consiste effectuer des tirages successifs diffrents niveaux. Le premier degr correspond la slection d'lments appels " units primaires ". Au deuxime degr on slectionne de manire alatoire des sous ensembles appeles " units secondaires " au sein de chaque unit primaire retenue et ainsi de suite jusqu'au dernier degr. Les lments slectionns au dernier degr correspondent aux units d'analyse.
I. Talbi et M. Helaoui
111
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
II-2 Dtermination de l'chantillon :
Dans notre tude, le premier degr appel " units primaires " correspond la slection de 4 lments : Etudiants Littraires Masculins. Etudiants Littraires Fminins. Etudiants Scientifiques Masculins. Etudiants Scientifiques Fminins. La slection de ces quatre lments peut tre justifie par le fait que notre sujet est un sujet d'actualit qui ncessite une connaissance et une assez bonne matrise de lune des nouvelles technologies de l'information savoir l'Internet. Au deuxime degr nous avons slectionn de manire alatoire un chantillon de 20 individus au sein de chaque unit primaire qui vont tre nos units d'analyse. III.
PRESENTATION DE L'ELABORATION DU QUESTIONNAIRE :
III-1 Choix et test du questionnaire :
a) Choix des questions : Pour obtenir l'information utile, il existe diffrents types de questions possibles tels que les questions ouvertes ou fermes, les questions directes ou indirectes, et les questions assistes ou non assistes. Dans notre questionnaire, nous avons utilis principalement des questions fermes et une seule question ouverte. a.1 Les questions fermes : Ces questions sont de deux types ; -Les questions dichotomiques qui ne laissent la personne interroge que le choix entre deux rponses possibles " oui " ou " non ". -Les questions choix multiples qui laissent au participant la possibilit de choisir parmi plusieurs rponses celle qui lui convient le mieux.
I. Talbi et M. Helaoui
112
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Ce type de question permet, d'un ct un dpouillement facile et une bonne interprtation des rponses, et d'un autre ct une facilit de rponse pour l'interview.
a.2 Les questions ouvertes : Ce sont des questions lesquelles le rpondant peut rpondre librement. L'utilisation d'une telle question ouverte prsente plusieurs avantages : Le choix des rponses n'est pas restreint. Le rpondant rflchit plus longuement. Les rponses sont gnralement diversifies. Cependant, elle reprsente des limites dans le cas o la personne interroge peut prsenter des rponses superficielles lorsqu elle n'a pas eu un temps de rflexion suffisant..
b) Test du questionnaire : Quelque soit la simplicit apparante du questionnaire, ce dernier doit faire l'objet d'un test. Le test du questionnaire a pour objectif de s'assurer : -que les questions sont comprises par les interviews dans le sens voulu pour obtenir une rponse valable et non ambigu, dans le langage qu'il leur est habituel et en fonction de l'objectif de l'enqute. -que le questionnaire sans tre trs lourd, se droule dans un ordre qui ne droute pas l'interview et maintient son intrt. Dans notre cas et dans le but de vrifier le degr de comprhension des questions par les interviews, nous avons assist au moment o ils rpondent au questionnaire pour clairer et expliquer les diffrents problmes que ce soit de confusions ou de comprhension quils pouvaient rencontrer.
I. Talbi et M. Helaoui
113
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
III-2 Prsentation et laboration du questionnaire :
a) Prsentation du questionnaire :
Questionnaire :
Ce questionnaire est labor dans le cadre dun mmoire de fin dtude pour lobtention de la matrise en Etudes Suprieures Commerciales intitul : Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
1. Fiche signaltique : a. Votre formation b. Votre sexe littraire Masculin scientifique Fminin
2. Accdez-vous rgulirement Internet ? Oui Non
3. Veuillez classer ces applications sur Internet selon votre ordre dintrt : Messagerie lectronique. Chat. Forums de discussion. tudes et recherches. Commerce lectronique.
4. Pensez-vous que les tarifs de connexion pratiqus en Tunisie sont favorables pour effectuer le commerce lectronique ? Oui Non
I. Talbi et M. Helaoui
114
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
5. on suppose que le prix de votre produit (boisson gazeux) varie entre 1.2DT et 0.4DT, pouvez-vous indiquer votre quantit dachat pour chaque niveau de prix ? Prix Quantits achetes (pendent la mme priode : soit une semaine) 0.4DT 0.6DT 0.8DT 1.0DT 1.2DT
6. Au cours dune opration dachat : a. Si le vendeur essaye dinfluencer votre intention dachat, acceptezvous dacheter ? Oui Non
b. Si le vendeur nintervient pas, acceptez-vous dacheter ? Oui Non
7. A votre avis quest ce qui explique le plus la scurit sur Internet ? La preuve. Le contrat. Les modes de paiement. La scurit des donnes personnelles. Autres : ..
I. Talbi et M. Helaoui
115
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
8. Selon vous est-il possible de payer votre facture tlphonique sur Internet : Oui Non
9. Selon vous est-il possible de payer vos taxes municipales sur Internet : Oui Non
10. Connaissez-vous une entreprise tunisienne qui vend des produits en offrant des services en ligne ? Oui Si oui, laquelle ? ... Non
11. Veuillez classez par ordre dimportance, les moyens de paiement suivants : 1 pour le meilleur et 3 pour le plus mauvais. Le paiement par carte de crdit. Le paiement par chque. Le paiement par la monnaie lectronique. (e-dinar)
12. Selon vous, ya-t- il une loi approprie au commerce lectronique en Tunisie ? Oui Non Ne sais pas.
I. Talbi et M. Helaoui
116
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
13. Quelles sont vos suggestions en ce qui concerne le commerce lectronique en Tunisie ?
Nous vous remercions davoir accepter de participer llaboration de ce travail.
b) laboration du questionnaire : Question n 3 croise avec la question n1/a : Les deux questions nous permettent de savoir le classement des principales applications sur Internet et de voir limpact de la formation au niveau de ce classement. Ceci va nous aider rpondre lhypothse n1.
Question n 3 croise avec la question n1/b : Elles permettent de vrifier si le sexe influe sur le classement des diffrentes applications sur Internet. Ces deux questions permettent de rpondre lhypothse n 2.
Question n 4 : Elle nous renseigne sur le lien existant entre le cot de connexion lInternet et la pratique du commerce lectronique. Elle permet de rpondre lhypothse n7.
I. Talbi et M. Helaoui
117
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Question n 5 : Elle va nous renseigner sur la nature du lien existant entre la variation du prix dun tel produit et la variation De la quantit achete. Cette question va nous permettre de rpondre lhypothse n 5.
Question n 6 : Elle permet dinformer si la prsence dun tel vendeur a un impact sur lintention dachat du consommateur ce qui nous permet de rpondre lhypothse n6.
Question n 7 : Elle nous renseigne sur le moyen le plus significatif de la scurit sur Internet, ce qui permet de vrifier ou non lhypothse n 9.
Les questions n 8-9-10 et 12 : Elles donnent une ide sur le degr dinformation du consommateur tunisien en matire du commerce lectronique. Ces questions permettent ensemble de rpondre lhypothse n8.
Question n 11 croise avec la question n1/a : Elles relient le classement des moyens de paiement la formation du consommateur, ce qui permet de rpondre lhypothse n 3.
I. Talbi et M. Helaoui
118
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Question n 11 croise avec la question n1/b : Elles relient le classement des moyens dj cits au sexe du consommateur afin de rpondre lhypothse n4.
Question n 13 : Cette question nous permet de faire ressortir les diverses suggestions face aux diffrents problmes rencontrs.
Section 2 : Rsultats statistiques et interprtations :
Aprs la collecte des informations partir des rponses aux questionnaires faites par les tudiants, nous allons utiliser des mthodes danalyse de donnes tudie en utilisant un logiciel statistique spcialis : le SPSS et ceci afin dtablir des relations entre les diffrentes variables.
I.
LETUDE DES VARIABLES :
Les variables quantitatives : Il yen a deux types : Les variables
On a gnralement deux catgories de variables : quantitatives de Rapport qui ne sont pas limites par un intervalle, et les variables quantitatives dintervalles qui sont limites par des bornes suprieures et infrieures. Les variables qualitatives : Il y a principalement deux types de variables qualitatives : Nominales et Ordinales. Les variables nominales sont des variables l o on nomme des modalits ou des solutions. Tandis que les variables ordinales sont des variables l o on fait un classement.
I. Talbi et M. Helaoui
119
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
I-1
Etude de liens entre deux variables qualitatives nominales :
Quand on veut tudier les liens entre deux variables qualitatives nominales, on utilise le test de KHI DEUX et le coefficient de contingence corrig (CC) pour nous donner une ide sur lintensit des liens entre les deux variables. On part gnralement des hypothses suivantes : H 1 : Il y a un lien entre les deux variables. H 0 : Il ny a pas de lien entre les deux variables.
Aprs avoir obtenu le KHI DEUX calcul ( X2 C ) et le coefficient de contingence corrige (CC) (tape faite par SPSS ), on fait le classement suivant : CC CC CC 1 : le lien entre les variables est un lien fort. 0.5 : le lien entre les variables est un lien moyen. 1 : le lien entre les variables est un lien faible.
I-2 - Etude de liens entre deux variables qualitatives ordinales :
Pour tudier le liens entre deux variables qualitatives ordinales, on utilise le coefficient de corrlation de SPEARMAN (rs ) et on procde comme suit : H 1 : Il y a un lien entre les deux variables. H 0: Il ny a pas de lien entre les deux variables. Dans le cas o il y a un lien, ce dernier sera mesur par le coefficient corrlation de SPEARMAN (rs ) comme suit : IrsI IrsI IrsI 1 0 : lien fort. : lien faible. de
0.5 : lien moyen.
I. Talbi et M. Helaoui
120
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
I-3 - Etude de liens entre deux variables quantitatives :
Pour tudier le lien entre deux variables quantitatives on fait appel au coefficient de corrlation de PEARSON (R) et on procde comme suit : H 1 : Il y a un lien entre les deux variables. H 0 : Il ny a pas de lien entre les deux variables. Dans le cas o il y a un lien : - Si (r) 1 : corrlation parfaite positive : lien fort : les deux variables voluent dans le mme sens. - Si (r) - Si (r) 0 : pas de corrlation, pas de lien.
- 1 : corrlation parfaite ngative : lien fort : les deux variables voluent dans le sens inverse.
II.
LETUDE DE LIEN ENTRE LINTENTION DACHAT DU
CONSOMMATEUR TUNISIEN ET LINTERVENTION DIRECTE DU VENDEUR
Tableaux croiss
N Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien
Valide Pour cent 160 100,0%
Observations Manquante N Pour cent 0 ,0%
Total Pour cent 160 100,0%
Tableau 9. Rcapitulatif des traitements des observations.
I. Talbi et M. Helaoui
121
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Effectif Intention d'achat du consommateur tunisien ne pas acheter acheter Intervention directe du vendeur Total intervention directe du vendeur absence d'intervention directe du vendeur 18 68 86 62 12 74
Total 80 80 160
Tableau 10. Tableau crois : Intervention directe du vendeur * Intention dachat du consommateur tunisien.
Ces deux tableaux nous donnent les rsultats obtenus partir du codage du questionnaire. En effet, bien que lchantillon tait de 80 individus, le total des observations est de 160. Ceci sexplique par le fait quun individu nous donne deux observations diffrentes. Entre les 80 individus interrogs, 18 accepteront dacheter lors dune intervention directe du vendeur et 68 accepteront dacheter en absence dintervention directe du vendeur. Ceci implique quil y a 6 individus qui sont indiffrents de lintervention directe, ou non, du vendeur et dans les deux cas ils sont prts acheter. Et en gnral, vue que nous avons pris un chantillon selon les mthodes probabilistes, nous pouvons dduire que lintervention directe du vendeur peut dcourager ou encore influencer ngativement lintention dachat du
consommateur tunisien. Pour notre tude ce rsultat est trs intressant, puisque le commerce lectronique se fait en absence de lintervention directe du vendeur, donc si ce rsultat est encourageant pour le commerce lectronique, et le fait dabsence de lintervention directe du vendeur a un impact positif sur lintention dachat du consommateur tunisien. Les deux graphiques ci dessous nous permettent de mieux comprendre et prsenter les rsultats obtenus par le questionnaire et gnraliss lensemble de la population tunisienne.
I. Talbi et M. Helaoui
122
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
23%
accepter d'achter lors d'une intervention directe du vendeur 77% ne pas acheter lors d'une intervention directe du vendeur
Figure 7. Lintention dachat du consommateur tunisien lors dune intervention directe du vendeur.
La majorit de la population tunisienne (77%) naccepte pas dacheter lorsquil y a une intervention directe du vendeur, alors que seul 23% lacceptent.
accepter d'achter en absence d'une intervention directe du vendeur ne pas acheter en absence d'une intervention directe du vendeur
15%
85%
Figure 8. Lintention d'achat du consommateur tunisien en absence d'une intervention directe du vendeur.
La majorit de la population tunisienne accepte dacheter (85%) en labsence dune intervention directe du vendeur ce qui est en faveur du commerce lectronique. Donc labsence de lintervention du vendeur ne reprsente pas un obstacle pour le dveloppement et lvolution du commerce lectronique.
I. Talbi et M. Helaoui
123
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Pour mieux tudier le lien entre lintention dachat du consommateur tunisien et lintervention directe du vendeur, nous proposons dtudier le teste de khi deux et le coefficient de contingence.
Tests du Khi-deux Signification asymptotique (bilatrale) ,000 ,000 ,000 ,000 62,461 160 1 ,000 ,000 Signification exacte (bilatrale) Signification exacte (unilatrale)
Khi-deux de Pearson Correction pour la a continuit Rapport de vraisemblance Test exact de Fisher Association linaire par linaire Nombre d'observations valides
Valeur 62,854b 60,365 67,967
ddl 1 1 1
a. Calcul uniquement pour un tableau 2x2 b. 0 cellules (,0%) ont un effectif thorique infrieur 5. L'effectif thorique minimum est de 37,00.
Tableau 11. Test de Khi deux. Daprs le tableau ci-dessus, il existe bel et bien un lien entre lintention dachat du consommateur tunisien et lintervention directe du vendeur puisque le teste de student est significatif un risque largement infrieur 5%.
Valeur Nominal par Nominal Coefficient de contingence Nombre d'observations valides a. L'hypothse nulle n'est pas considre. ,531 160
Signification approche ,000
b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothse nulle.
Tableau 12. Mesures symtriques.
Le coefficient de contingence (corrig) est de 0.531, cette valeur est proche de 0.5, donc le lien entre les deux variables qualitatives nominales (lintervention directe du vendeur et lintention dachat du consommateur tunisien) est un lien moyen.
I. Talbi et M. Helaoui
124
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
En conclusion : il y a un lien entre lintervention direct du vendeur et lintention dachat du consommateur tunisien et lintensit de ce lien peut tre qualifie comme moyenne. En dautres termes, labsence dintervention du vendeur influence, encourage, dintensit moyenne lintention dachat du consommateur tunisien.
Pour mieux approfondir ce rsultat, nous allons dans ce qui suit essayer de dtecter lorigine de ce lien, est-il li au sexe ou li la formation du consommateur.
III. LE LIEN ENTRE INTERVENTION DIRECTE DU VENDEUR ET
LINTENTION DACHAT DU CONSOMMATEUR SELON LE SEXE
Tableaux croiss
Observations Manquante N Pour cent
N Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien masculin
Valide Pour cent
Total Pour cent
80
100,0%
,0%
80
100,0%
Tableau 13. Rcapitulatif du traitement des observations.
Effectif Intention d'achat du consommateur tunisien masculin ne pas acheter acheter Intervention directe du vendeur Total intervention directe du vendeur absence d'intervention directe du vendeur 6 34 40 34 6 40
Total 40 40 80
Tableau 14. Tableau crois Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien masculin.
I. Talbi et M. Helaoui
125
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Notre chantillon est compos de 40 tudiants masculins et 40 tudiantes. Comme chaque individu nous donne deux observations, le nombre dobservation total est de 80. 6 tudiants tunisiens masculins accepteront dacheter lors de lintervention directe du vendeur alors que 34 ne le font pas. Nous pouvons conclure que la majorit des tudiants tunisiens masculins accepteront dacheter en labsence dintervention directe du vendeur.
Khi-deux de Pearson Correction pour la a continuit Rapport de vraisemblance Test exact de Fisher Association linaire par linaire Nombre d'observations valides
Valeur 39,200b 36,450 43,270
ddl 1 1 1
Signification asymptotique (bilatrale) ,000 ,000 ,000
Signification exacte (bilatrale)
Signification exacte (unilatrale)
,000 38,710 80 1 ,000
,000
a. Calcul uniquement pour un tableau 2x2 b. 0 cellules (,0%) ont un effectif thorique infrieur 5. L'effectif thorique minimum est de 20,00.
Tableau 15. Test de Khi deux.
Le test de student est significatif, donc il y a un lien entre lintention dachat du consommateur masculin et lintervention du vendeur.
Valeur Nominal par Nominal Coefficient de contingence Nombre d'observations valides a. L'hypothse nulle n'est pas considre. ,573 80
Signification approche ,000
b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothse nulle.
Tableau 16. Mesures symtriques.
I. Talbi et M. Helaoui
126
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Le coefficient de contingence (corrig) est de 0.573, donc lintensit du lien est qualifie comme moyenne. Mais ce qui nous intresse ce stade cest que lintensit du lien entre lintervention du vendeur et lintension dachat du consommateur est plus forte pour les masculins (0.573>0.531) et le lien doit tre moins important pour les fminins.
Tableaux croiss
N Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien fminin
Valide Pour cent
Observations Manquante N Pour cent
Total Pour cent
80
100,0%
,0%
80
100,0%
Tableau 17. Rcapitulatif du traitement des observations.
Effectif Intention d'achat du consommateur tunisien fminin ne pas acheter acheter Intervention directe du vendeur Total intervention directe du vendeur absence d'intervention directe du vendeur 12 34 46 28 6 34
Total 40 40 80
Tableau 18. Tableau crois Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien fminin.
La conclusion est presque la mme, la majorit des consommateurs fminin accepteront dacheter en labsence dintervention directe du vendeur. Ce qui nous intresse cest lintensit de ce lien.
I. Talbi et M. Helaoui
127
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Tests du Khi-deux
Khi-deux de Pearson Correction pour la a continuit Rapport de vraisemblance Test exact de Fisher Association linaire par linaire Nombre d'observations valides
Valeur 24,757b 22,558 26,411
ddl 1 1 1
Signification asymptotique (bilatrale) ,000 ,000 ,000
Signification exacte (bilatrale)
Signification exacte (unilatrale)
,000 24,448 80 1 ,000
,000
a. Calcul uniquement pour un tableau 2x2 b. 0 cellules (,0%) ont un effectif thorique infrieur 5. L'effectif thorique minimum est de 17,00.
Tableau 19. Test de Khi deux.
A ce niveau nous pouvons conclure quil existe un lien entre lintention dachat du consommateur fminin et lintervention directe du vendeur, comme le test de student est significatif.
Valeur Nominal par Nominal Coefficient de contingence Nombre d'observations valides ,486 80
Signification approche ,000
a. L'hypothse nulle n'est pas considre. b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothse nulle.
Tableau 20. Mesures symtriques.
Les rsultats sont conforme ce qui a t prvu, lintensit du lien est moins importante pour les femmes que pour les hommes (0.486<0.573). Les hommes accepteront les plus dacheter en labsence dintervention du vendeur, le commerce lectronique a lgrement plus de chance pour russir dans un milieu form de plus dhommes. Mais la diffrence nest pas vraiment trs importante.
I. Talbi et M. Helaoui
128
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
IV.
LE LIEN ENTRE INTERVENTION DIRECTE DU VENDEUR ET
LINTENTION DACHAT DU CONSOMMATEUR SELON LA FORMATION
Tableaux croiss
Rcapitulatif du traitement des observations Observations Manquante N Pour cent
N Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien ayant une formation littraire
Valide Pour cent
Total Pour cent
80
100,0%
,0%
80
100,0%
Tableau 21. Rcapitulatif du traitement des observations.
Effectif Intention d'achat du consommateur tunisien ayant une formation littraire ne pas acheter acheter Intervention directe du vendeur Total intervention directe du vendeur absence d'intervention directe du vendeur 9 37 46 31 3 34
Total 40 40 80
Tableau 22. Tableau crois Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien ayant une formation littraire.
I. Talbi et M. Helaoui
129
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Signification asymptotique (bilatrale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Signification exacte (bilatrale) Signification exacte (unilatrale)
Khi-deux de Pearson Correction pour la a continuit Rapport de vraisemblance Test exact de Fisher Association linaire par linaire Nombre d'observations valides
Valeur 40,102b 37,289 45,133
ddl 1 1 1
39,601 80
,000
a. Calcul uniquement pour un tableau 2x2 b. 0 cellules (,0%) ont un effectif thorique infrieur 5. L'effectif thorique minimum est de 17,00.
Tableau 23. Test de Khi deux.
Le lien existe comme le test de student est significatif.
Mesures symtriques
Valeur Nominal par Nominal Coefficient de contingence Nombre d'observations valides a. L'hypothse nulle n'est pas considre. ,578 80
Signification approche ,000
b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothse nulle.
Tableau 24. Mesures symtriques.
Lintensit du lien est plus importante chez les littraires que chez les scientifiques (0.578>0.531). Les littraires accepteront le plus dacheter en absence dintervention du vendeur, do le commerce lectronique a lgrement plus de chance pour russir dans un milieu compos de littraires.
I. Talbi et M. Helaoui
130
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Tableaux croiss
Observations Manquante N Pour cent
N Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien ayant une formation scientifique
Valide Pour cent
Total Pour cent
80
100,0%
,0%
80
100,0%
Tableau 25. Rcapitulatif du traitement des observations.
Effectif Intention d'achat du consommateur tunisien ayant une formation scientifique ne pas acheter acheter Intervention directe du vendeur Total intervention directe du vendeur absence d'intervention directe du vendeur 9 31 40 31 9 40
Total 40 40 80
Tableau 26. Tableau crois Intervention directe du vendeur * Intention d'achat du consommateur tunisien ayant une formation scientifique.
Khi-deux de Pearson Correction pour la a continuit Rapport de vraisemblance Test exact de Fisher Association linaire par linaire Nombre d'observations valides
Valeur 24,200b 22,050 25,597
ddl 1 1 1
Signification asymptotique (bilatrale) ,000 ,000 ,000
Signification exacte (bilatrale)
Signification exacte (unilatrale)
,000 23,897 80 1 ,000
,000
a. Calcul uniquement pour un tableau 2x2 b. 0 cellules (,0%) ont un effectif thorique infrieur 5. L'effectif thorique minimum est de 20,00.
Tableau 27. Tableau de khi deux.
I. Talbi et M. Helaoui
131
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Le lien existe, le test de student est significatif.
Valeur Nominal par Nominal Coefficient de contingence Nombre d'observations valides a. L'hypothse nulle n'est pas considre. ,482 80
Signification approche ,000
b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothse nulle.
Tableau 28. Mesures symtriques.
0.482 est lgrement <0.573, donc le lien est lgrement moins intense chez les scientifiques, ce qui confirme que le commerce lectronique a lgrement moins de chance avec les scientifiques.
V.
LE LIEN ENTRE LE CLASSEMENT DES APPLICATIONS SUR INTERNET SELON LA FORMARTION :
Corrlations non paramtriques
Corrlations classement des applications sur internet selon les tudiants de formation littraire 1,000 , 5 ,900* ,019 5 classement des applications sur internet selon les tudiants de formation scientifique ,900* ,019 5 1,000 , 5
Rho de Spearman
classement des applications sur internet selon les tudiants de formation littraire classement des applications sur internet selon les tudiants de formation scientifique
Coefficient de corrlation Sig. (unilatrale) N Coefficient de corrlation Sig. (unilatrale) N
*. La corrlation est significative au niveau .05 (unilatral).
Tableau 29. Corrlation de Spearman : lien entre le classement des applications sur Internet selon la formation.
I. Talbi et M. Helaoui
132
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Les rsultats sont significatifs un risque derreur de 1.9% largement < au seuil derreur tolr 5%. Donc il y a un lien entre le classement des applications sur Internet des littraires et celui des scientifiques. Le coefficient de corrlation est de 0.9, il est proche de 1, do lintensit du lien est forte. Dans lesprit du consommateur tunisien, le classement des applications sur Internet est quasiment identique que se soit pour les littraires que pour les scientifiques.
VI.
LE LIEN ENTRE LE CLASSEMENT DES APPLICATIONS SUR
INTERNET SELON LE SEXE :
Corrlations non paramtriques
classement des applications sur internet selon les consommat eurs masculins Rho de Spearman classement des applications sur internet selon les consommateurs masculins classement des applications sur internet selon les consommateurs fminins Coefficient de corrlation Sig. (unilatrale) N Coefficient de corrlation Sig. (unilatrale) N 1,000 , 5 ,872* ,027 5
classement des applications sur internet selon les consommate urs fminins ,872* ,027 5 1,000 , 5
*. La corrlation est significative au niveau .05 (unilatral).
Tableau 30. Corrlation de Spearman : lien entre le classement des applications sur Internet selon le sexe.
I. Talbi et M. Helaoui
133
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Les rsultats sont significatifs un risque derreur de 2.7% largement < au seuil derreur tolr 5%. Donc il y a un lien entre le classement des applications sur Internet des hommes et celui des femmes. Le coefficient de corrlation est de 0.872, il est proche de 1, do lintensit du lien est forte. Dans lesprit du consommateur tunisien, le classement des applications sur Internet est quasiment identique que se soit pour les hommes que pour les femmes.
VII. LE LIEN ENTRE LE CLASSEMENT DES MODES DE PAIEMENT
SELON LA FORMATION
Corrlations non paramtriques
Rho de Spearman
classement des moyens de paiement selon les tudiants de formation littraire classement des moyens de paiement selon les tudiants de formation scientifique
Coefficient de corrlation Sig. (unilatrale) N Coefficient de corrlation Sig. (unilatrale) N
classement des moyens de paiement selon les tudiants de formation littraire 1,000 , 3 1,000** , 3
classement des moyens de paiement selon les tudiants de formation scientifique 1,000** , 3 1,000 , 3
**. La corrlation est significative au niveau .01 (unilatral).
Tableau 31. Corrlation de Spearman : lien entre le classement des modes de paiement selon la formation.
Les rsultats sont significatifs un risque derreur de 1% largement < au seuil derreur tolr 5%.
I. Talbi et M. Helaoui
134
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Donc il y a un lien entre le classement des moyens de paiement par ordre de prfrence des littraires et celui des scientifiques. Le coefficient de corrlation est de 1, do lintensit du lien est trs forte. Dans lesprit du consommateur tunisien, le classement des moyens de paiements est identique que se soit pour les scientifiques que pour les littraires.
VIII. LE COMMERCE ELECTRONIQUE ET LA REALISATION DES
PROFITS PLUS IMPORTANTS
Corrlations
Corrlations prix d'une bouteille de quantit boisson achete par gazeux semaine 1,000 -,981** , ,002 5 5 -,981** 1,000 ,002 , 5 5
prix d'une bouteille de boisson gazeux quantit achete par semaine
Corrlation de Pearson Sig. (unilatrale) N Corrlation de Pearson Sig. (unilatrale) N
**. La corrlation est significative au niveau 0.01 (unilatral).
Tableau 32. Corrlation de Pearson entre la baisse des prix et la quantit demande.
Les rsultats sont significatifs un risque derreur de 0.2% largement < au seuil derreur tolr 5%. Le coefficient de corrlation de Pearson est de -0.981, il est proche de -1, do lintensit de lien entre le prix dune bouteille de boisson gazeuse et la quantit achete par semaine est forte et elle est de sens ngatif. En dautres termes, une diminution des prix implique une importante augmentation des quantits achetes. Dautre part, le commerce lectronique permet une rduction trs importante au niveau des cots, en effet nous navons plus besoin des magasiniers, ni de local dexposition. La vitrine virtuelle cote beaucoup moins cher, do les frais fixes
I. Talbi et M. Helaoui
135
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
sont beaucoup moins importantes. Cette rduction peut engendrer une rduction au niveau des prix, et daprs le rsultat que nous avons trouv ci-dessus, la diminution des prix peut engendrer une augmentation des quantits vendues si la raction du consommateur tunisien est la mme aussi bien pour les boissons gazeuses que pour dautres produits. Ce qui implique une augmentation des gains raliss par une entreprise utilisant le e-commerce.
I. Talbi et M. Helaoui
136
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Conclusion :
LInternet a aid la mondialisation du commerce et llimination de tout type de frontires en ouvrant le march mondial nimporte quelle entreprise voudrant sintgrer dans ce domaine numrique. En effet, le commerce lectronique, ce nouveau n de lvolution technologique, ne cesse de se dvelopper justifiant une nouvelle voie du commerce traditionnel. Il a donc volu au cours de ces dernires annes dune manire exponentielle montrant que la mise en place dune telle solution de e-commerce nest pas un vnement ponctuel dans le temps ni une mode de nos jours, mais cest plutt un engagement long terme impliquant dune part une restructuration totale de lorganisation de lentreprise car un tel succs ne dpend pas seulement de la qualit du site Web propos, mais dpend aussi de laptitude stratgique de lentreprise positionner ses produits et ses services en fonction de la concurrence, entretenir de bonnes relations avec sa clientle, ses fournisseurs et ses partenaires. Dautre part, on compte trs bien sur la conscience du consommateur, sur son attitude et son aptitude sintgrer dans ce nouveau mode de transaction. Ceci est dit sans pour autant ngliger le rle majeur de lEtat dans la promotion et lencouragement des investissements se rattachant ce domaine. En effet, le gouvernement doit crer les conditions de la confiance des entreprises et des consommateurs dans le fonctionnement de ces nouveaux marchs. A ce niveau, laction de lEtat se droule essentiellement autour de la baisse des cots de communication afin de favoriser la connexion des particuliers, de la scurit des transactions assurant la confidentialit et lauthenticit de linformation et autour de la cration de textes juridiques adapts rglementant ce nouveau mode de transactions. Dans la pratique, le commerce lectronique prsente plusieurs avantages que ce soit pour lentreprise, qui lui permet daugmenter son chiffre daffaire, de
I. Talbi et M. Helaoui
137
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
dvelopper sa notorit, de rduire ses cots et dliminer presque tous les intermdiaires traditionnels, ou pour le consommateur, en effet, un internaute acheteur peut se procurer un certain nombre davantages tels que la commodit du fait que la boutique virtuelle est ouverte 24h/24 et 7 jours sur 7, aussi au niveau de linformation recueillie car les utilisateurs peuvent sinformer plus facilement, moindre cot et de manire plus dtaille. Enfin, il nexiste plus dharclement puisque la commande est passe domicile par lordinateur et la livraison se fait aussi domicile ou un endroit connu dans les meilleures conditions. Malgr ces diffrents avantages et leurs impacts remarquables sur le dveloppement de nimporte quelle conomie, nous avons pu dduire tout au long de notre tude, quen Tunisie, nous sommes encore en retard et loin de lconomie virtuelle. Certains considrent que nous sommes en phase dexprimentation bien quil existe des initiatives pratiques par quelques entreprises tunisiennes et qui ont montr que le commerce lectronique a permis de conqurir de nouveaux marchs qui offrent une clientle se trouvant partout dans le monde, nous pouvons citer lexportation des produits et des services touristique, permettant, ainsi, ces entreprises daugmenter leurs chiffres daffaires et de profiter des conomies dchelle. Toutefois, ce phnomne reste encore restreint, puisquil ntait pas utilis au mieux par les entreprises tunisiennes. En effet, cest encore trs rduit voir ngligeable davoir plus de 10 milles entreprises oprant dans lconomie tunisienne dont seulement 50 dentre elles sont intgres dans le commerce lectronique. Ceci peut tre du la politique suivie par ces socits ou mme la lgislation tunisienne qui reste, malheureusement, encore restreinte, ainsi quaux problme de la scurit des transactions. A un autre niveau, le dveloppement du commerce lectronique nest pas limit seulement aux entreprises car le cyber-consommateur joue un rle prpondrant dans la croissance et lmergence de ce nouveau mode de transactions. En effet, notre tude a dmontr que le consommateur tunisien nest pas encore conscient de la ncessit actuelle du commerce en ligne malgr limportance majeure, qui ne cesse daugmenter du jour au jour, des utilisateurs
I. Talbi et M. Helaoui
138
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
de lInternet dans notre pays. Pour cela, il faut rsoudre les diffrents problmes qui freinent lintention dachat via Internet. Ces difficults se droulent autour de la scurit sur le net, notamment celle des donnes personnelles, la confidentialit des moyens de paiement et essentiellement autour de la baisse des cots de tlcommunication. En train, une autre fois nous revenons au rle majeur de lEtat et des institutions concernes pour promouvoir ce type de commerce. Enfin et pour remdier lensemble de ces problmes qui freinent le dveloppement du commerce lectronique en Tunisie, les diffrentes autorits et institutions sont encours dtudier et de relever les facteurs qui sont lorigine du recul de ce secteur dans son tat dexprience. Certains pensent que ce problme est d au manque de conscience, de publicit et de formation, certains ont dautres voix que lutilisation dun seul moyen de paiement en ligne (le e-dinar) reste le principal lment justifiant le refus des entrepreneurs et des propritaires des entreprises sintgrer dans le rseau des transactions lectroniques, alors que dautres ont port la responsabilit labsence dun organisme national et unique spcialis dans lorganisation du commerce lectronique.
En attendant donc que nous trouvions des solutions possibles permettant de promouvoir les transactions commerciales lectroniques dans la pratique relle, nous comptons beaucoup sur les dernires procdures qui ont t entreprises par lEtat et concernant les baisses des cots dans les services dchanges des donnes, soit de 50% pour encourager et inciter les entreprises entrer dans le march virtuel.
I. Talbi et M. Helaoui
139
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Bibliographie
I.
OUVRAGES GENERAUX :
BAROUDI Carol, LEVINE Young Margaret et LEVINE Jhon. R, Internet pour les nuls , 5me dition SYBEX, 1998. GERARD Camille, Guide Internet en action , ditions First Interactive, Paris, 2000. IMMLER Christian et Claudia, Site Internet le guide 2001 , ditions Micro Application, 2000. JOLOWICZ.J.A. Droit anglais . Prcis Dalloz, 2me dition 1992. KAPLAN Daniel, Internet. Les enjeux pour la France . Livre blanc, 2000. LARROUMET Christian Economica 1990. LOWE Doug, Internet explorer 5.5 pour les nuls , ditions IDG Books Worl dwide, Inc, 2000. OULD AHMED ELY Mustapha, La recherche sur Internet mthodes et outils , Collection Internet, avril 1999.
Droit civil
2me dition.
PATAT Jean-Christophe, Internet & WWW , octobre 1996.
PAULET Luc, Droit commercial , Ellipses ditions Marketing S.A, 2000.
II.
OUVRAGES SPECIALISES :
BEN AMOR Fayal, Les cls du commerce lectronique , dition CLE, 2001.
I. Talbi et M. Helaoui
140
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
BENSOUSSAN Alin, Internet , aspects juridiques, ditions Herms-Paris, 1996. BENSOUSSAN Alin, Tlcoms aspects juridique , ditions Mondrian/Holzman Trust/ ADAGP, Paris, 1998. BRESSE.P, BEAURE.DANGERES.G et THUILLIER.S, paiement numrique sur Internet , International Thomson Publishing, 1997. CAPITANT Henri, Les grands arrts de la jurisprudence civile , Dalloz, 8me dition, 1984. CHATILLON Stphane, Droit des affaires internationales , collection gestion internationale, 2me dition. DREYFUS Michel, Crer votre page Web , ditions Simon & Schuster Macmillan, 1998. GERBERT Philippe, KAAS Philippe et SCHNEIDER Dirk, Les nouveaux marchands du Net , ditions Gnrales First, 2000. GUESTIN.J, La notion du contrat . chronique, D.1990, GUINCHARD Serge, HARICHAUX Michle et DE
TOURDONNET Renaud, Internet pour le droit , ditions Montchrestien, E.J.A, 1999. HACHEM Mohamed El Arbi, Leons de Droit International Priv , imprimante officielle de la rpublique tunisienne, 1996. ISRAEL Marc, Construire votre site Web commercial , ditions EFII, 75015 Paris. ITEANU Olivier, INTERNET et le droit. Aspects juridiques du commerce lectronique. Editions Eyrolles, 1996. JEAN-BATISTE Michelle, Crer et exploiter un commerce lectronique , ditions Litec, 1998.
MALAURIE Philippe et AYNES Laurent, Le droit des obligations. Les contrats , ditions Cujas, 1990.
SABATIER Guy, Le porte monnaie lectronique et le porte monnaie virtuel , Puf, collection que sais-je ? , Mai 1997.
I. Talbi et M. Helaoui
141
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
SCHMIDT Joanna Ngociation et conclusion des contrats Jurisprudence gnrale, Dalloz 1982. SEDALLIAN Dont Valrie, dans son ouvrage Droit de l'Internet , collection AUI, mai 1996.
SNELL Ned, Internet , ditions Sams Publishing, 1999.
XAVIER Linant et A. HOLLANDE Droit de l'informatique , Delmas 1990.
III.
THESES, MEMOIRES ET SEMINAIRES :
ATTIA Mohamed Othmen, Impact de la publicit sur Internet : sur les ventes en ligne de lentreprise , mmoire de fin dtudes pour lobtention de la matrise en tudes suprieures de commerce, Ecole Suprieure de Commerce de Tunis, 2000-2001. BEN SLIMEN Amira et NEHDI Yosra, Le commerce lectronique et son impact sur les entreprises : cas des entreprises tunisiennes , mmoire de fin dtudes pour lobtention de la matrise en gestion comptable, Institut Suprieur de Gestion de Tunis, 1999-2000. BLAISE Cyrile, Le commerce lectronique entre professionnels en rseau ouvert (Internet) , mmoire pour lobtention du D.E.A de droit des obligations civiles et commerciales, Facult de droit Universit Paris Descartes - Paris V, 1996-1997. BOUATTOUR Mouna, Le commerce lectronique : Dfis et opportunits , mmoire de fin dtudes pour lobtention de la matrise en gestion, option Commerce International, Ecole Suprieure de Commerce, 1999-2000. DACIER Marc, Le futur de la scurit sur Internet , Sminaire lInstitut Eurcom, juillet 2002
I. Talbi et M. Helaoui
142
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
DUHAMEL Pierre, STERN Jacques et QUISQUATER JeanJacques, La scurit sur la toile Internet, sance publique de lAcadmie des sciences , le lundi 21 janvier 2002, 15heures 23, quai de Conti, 75006 Paris - Salle des sciences. GUELLOUZ Ridha, L'approche tunisienne en matire de commerce lectronique , Sminaire UIT E. Commerce, Tunis, 15 mai 2001. JEAN PIERRE Geneti, comment Internet pourrait bouleverser la distribution des automobiles , LARGUS de lautomobile, 17 avril 1997,
SIALA Mohamed Ali, Les problmes juridiques poss par le commerce lectronique , mmoire de fin dtudes pour
lobtention de la matrise en gestion, option Commerce International, Ecole suprieure du commerce de Tunis, 1999-2000.
IV.
ARTICLES, GUIDES ET GROUPES DANALYSE :
Agence Tunisienne d'Internet, Commerce lectronique , 2002. AGNEW David et DON TOPSCOTT, Finances et
dveloppement , dcembre 1999. AUBERT.J.L et FLOUR.J, Les obligations , n240. AUROUX.L CAMUS.M, & GOUSSEAU.D, Vers une collecte pertinente des informations de scurit sur Internet , L.E.R.I.A, Laboratoire Epitech de Recherche en Informatique Applique, septembre 2002. Benchmark Group, VUA, IDC, Forrester, analyses OC&C. BEN SOUSSAN Alain: On line journal , 15 dcembre 1995. CHARBONNEAU Anne et MICHAUD Monique, La Chronique Internet , article publi sur le Web.
I. Talbi et M. Helaoui
143
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Colloque organis par l'institut de formation continue du Barreau de Paris le 23 mai 1997. E-Commerce : Digital Certificates A Valid argument tighther certification , CWW, 16 aot 1999. JEAN PIERRE Geneti, Comment Internet pourrait bouleverser la distribution des automobiles , L'ARGUS de l'automobile, 17 avril 1997. Le manager , n68, mars 2002. Le mensuel du monde arabe et de la francophonie : Arabies , mars 2003, La voie de la modernit . Les secrets du commerce lectronique : guide lIntention des PME exportatrices Ed. 2001. PlaNet Magazine , N35, mars 2003. PlaNet Tunisie, Scurit Informatique Ed. 2002. SENDRA Yves, Le droit face au Web, publi sur le Web : La scurit sur Internet par l'Universit du Maine.
for
Union Internationale des Tlcommunications, CONFRENCE MONDIALE DE DVELOPPEMENT DES TLCOMMUNICATIONS (CMDT-02) Istanbul, Turquie, Proposition pour les travaux de la confrence; La Tunisie et les technologies de la communication : la stratgie tunisienne , 1827 mars 2002.
XAVIER Linant L'Internet et la preuve des actes juridiques , in expertises, juin - juillet 1997.
V.
LOIS ET CONVENTIONS :
Loi n 2000-83 du 9 aot 2000, relative aux changes et au commerce lectroniques. Loi n 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du Code de droit international priv.
I. Talbi et M. Helaoui
144
Ecole Suprieure de Commerce de Tunis
Le commerce lectronique : ses outils, son aspect juridique et ses perspectives en Tunisie.
Les conventions de Bruxelles et de Lugano. Les conventions en matire de droits dauteur. La convention de Rome en matire dobligation et de protection des consommateurs. La convention de La Haye en matire de vente dobjets mobiliers corporels. La convention de Vienne en matire de vente internationale de marchandises.
VI.
LES SITES WEB :
www.planet.tn www.poste.tn www.quicktime.apple.com www.real.com www.smg.com.tn www.vdo.com
I. Talbi et M. Helaoui
145
Filename: Directory: Template:
Le commerce lectronique ses outils son aspect juridique et s D:\Maher Helaoui\Rapport Maitrise (2003)
C:\Users\Maher\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.d otm Title: Plan Subject: Author: Mohamed HELAOUI Keywords: Comments: Creation Date: 13/06/2003 4:00:00 AM Change Number: 152 Last Saved On: 29/06/2003 4:52:00 PM Last Saved By: Mohamed HELAOUI Total Editing Time: 3,586 Minutes Last Printed On: 25/04/2009 11:00:00 PM As of Last Complete Printing Number of Pages: 145 Number of Words: 34,004 (approx.) Number of Characters: 193,824 (approx.)
Vous aimerez peut-être aussi
- Routes de La Soie PDFDocument39 pagesRoutes de La Soie PDFSCORSAM1100% (2)
- Rapport de Création D'entrepriseDocument12 pagesRapport de Création D'entrepriseElba Med89% (9)
- Guide de Controle Des ComptesDocument60 pagesGuide de Controle Des Comptesrazani100% (1)
- Transition NumeriqueDocument60 pagesTransition NumeriqueWalid DakirPas encore d'évaluation
- Mémoire Mohamed Ver3Document94 pagesMémoire Mohamed Ver3Bachir BouchehitPas encore d'évaluation
- Facture La Fnac 1Document1 pageFacture La Fnac 1docteurboratePas encore d'évaluation
- Rapport Fibre OptiqueDocument33 pagesRapport Fibre OptiqueSafoine GabtniPas encore d'évaluation
- TD Hec Audit 3 Fin 2011Document5 pagesTD Hec Audit 3 Fin 2011Noureddine OmariPas encore d'évaluation
- Mémoire D MasterDocument83 pagesMémoire D MasterMeriem Bella100% (2)
- Cas DellDocument23 pagesCas DellAmira BlhPas encore d'évaluation
- Beton Armé IDocument49 pagesBeton Armé ISamuelPas encore d'évaluation
- Projet Kech FantasiaDocument38 pagesProjet Kech FantasiaAuberge Lecoqhardi LecoqhardiPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Hajar BEL MADANIDocument38 pagesRapport de Stage Hajar BEL MADANIHajja MorafikPas encore d'évaluation
- Partiels 2018 Lextenso Étudiant Jour 2 - L2 - Droit Des Obligations (Gualino - Annales Corrigées)Document4 pagesPartiels 2018 Lextenso Étudiant Jour 2 - L2 - Droit Des Obligations (Gualino - Annales Corrigées)stefPas encore d'évaluation
- Lexique Complet Tourisme PDFDocument41 pagesLexique Complet Tourisme PDFnasol100% (1)
- Les contrats immobiliers - 2e édition: Formalités et rédaction des clausesD'EverandLes contrats immobiliers - 2e édition: Formalités et rédaction des clausesPas encore d'évaluation
- Stratégie YRDocument23 pagesStratégie YRGICQUELPas encore d'évaluation
- BOUNOUNG ESSONO La Régulation Des Communications Électroniques À Lheure de La ConvergenceDocument138 pagesBOUNOUNG ESSONO La Régulation Des Communications Électroniques À Lheure de La ConvergencePeguy Edgard Wanda KandjaPas encore d'évaluation
- Table Des Matières: Chapitre 1: La Smart House PrésentationDocument79 pagesTable Des Matières: Chapitre 1: La Smart House PrésentationM'hamed El AzzaouiPas encore d'évaluation
- Support de Cours Sécurité1Document82 pagesSupport de Cours Sécurité1Black AkatsukiPas encore d'évaluation
- Memoir EnaDocument55 pagesMemoir EnaUnoeil SurfrontPas encore d'évaluation
- Internet CompressedDocument295 pagesInternet Compressedcentredoc2022Pas encore d'évaluation
- Cours Reseau 2022Document56 pagesCours Reseau 2022Tàs NîmePas encore d'évaluation
- La FiscalitéDocument64 pagesLa Fiscalitéalifdal elmostafaPas encore d'évaluation
- SommaireDocument73 pagesSommairedahdoh dahdohPas encore d'évaluation
- Table Des MatièresDocument84 pagesTable Des MatièresAyoub AyadiPas encore d'évaluation
- Evaluation Detaillee Materielle Et LogicielleDocument69 pagesEvaluation Detaillee Materielle Et LogicielleSteve NjengaPas encore d'évaluation
- Les Nouvelles Obligations en Matière de Publicités Et de Marketing Réalisées Par Le Biais Des Nouvelles TechnologiesDocument45 pagesLes Nouvelles Obligations en Matière de Publicités Et de Marketing Réalisées Par Le Biais Des Nouvelles TechnologiesulrichPas encore d'évaluation
- SNT 2de-Livre Du ProfesseurDocument96 pagesSNT 2de-Livre Du ProfesseurStéphaniePas encore d'évaluation
- Guide - Pratique - Injonction de Payer UEDocument32 pagesGuide - Pratique - Injonction de Payer UEissoufouPas encore d'évaluation
- Est Il Juste de Penser Que Le Bitcoin Favorise Les Actes Frauduleux Mémoire de Cécile LAURENTDocument76 pagesEst Il Juste de Penser Que Le Bitcoin Favorise Les Actes Frauduleux Mémoire de Cécile LAURENTMoubarek Salah AlleguePas encore d'évaluation
- Rapport D'information Sur La Neutralité de L'internet Et Des RéseauxDocument86 pagesRapport D'information Sur La Neutralité de L'internet Et Des RéseauxEcransPas encore d'évaluation
- Plaidoyer Logements SociauxDocument35 pagesPlaidoyer Logements SociauxJOEL LOICPas encore d'évaluation
- Cartau IndbDocument14 pagesCartau Indbsteve BOFENYUPas encore d'évaluation
- Rapport CF BlockchainDocument172 pagesRapport CF BlockchainAleks ÇAÇIPas encore d'évaluation
- MelinDocument56 pagesMelinFarah MerrasPas encore d'évaluation
- Rapportfinaletudefaisabilite UTBDocument77 pagesRapportfinaletudefaisabilite UTBKalosoiretrotchgmail.com KalosoPas encore d'évaluation
- Ahmfra 19 Abbn 587Document43 pagesAhmfra 19 Abbn 587Raja BensalemPas encore d'évaluation
- Clusif 2015 GT Gestionvulnerabilites Tome2 - VFDocument49 pagesClusif 2015 GT Gestionvulnerabilites Tome2 - VFMedHelmiPas encore d'évaluation
- Simulation Et Réalisation D'un Circuit Détecteur de Gaz Interfacé À La Carte ArduinoDocument43 pagesSimulation Et Réalisation D'un Circuit Détecteur de Gaz Interfacé À La Carte ArduinoBaha Eddine DridiPas encore d'évaluation
- Quick DevisDocument80 pagesQuick Devisscribd0019Pas encore d'évaluation
- FSTM LST GE2I S5 Electrotechnique CoursDocument46 pagesFSTM LST GE2I S5 Electrotechnique CoursDougo SIDIBEPas encore d'évaluation
- Cours - Cryptographie - Lipro ASRDocument58 pagesCours - Cryptographie - Lipro ASRMoïse DjemmoPas encore d'évaluation
- Cours - Techniques de Lintelligence ArtificielleDocument72 pagesCours - Techniques de Lintelligence Artificiellefarid saad0% (1)
- Monographie de La Region de Rabat Sale Kenitra FRDocument62 pagesMonographie de La Region de Rabat Sale Kenitra FRRajae ateilahPas encore d'évaluation
- Rapport Integre Usages Des Applications Developpees Pour Les MunicipalitesDocument105 pagesRapport Integre Usages Des Applications Developpees Pour Les MunicipalitesStambouli SohibPas encore d'évaluation
- Guide Cad WorkDocument40 pagesGuide Cad WorkyouçPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Bday YesmineDocument29 pagesRapport de Stage Bday YesmineHana HosniPas encore d'évaluation
- CNIL Cybersurveillance PDFDocument51 pagesCNIL Cybersurveillance PDFantifoPas encore d'évaluation
- Guide de Procédures de Passation de Marches Et Regles D'Attribution Des Contrats Finances Par La BoadDocument103 pagesGuide de Procédures de Passation de Marches Et Regles D'Attribution Des Contrats Finances Par La BoadYao Yves SowPas encore d'évaluation
- Cours Informatique 2Document110 pagesCours Informatique 2antoine messiPas encore d'évaluation
- Cours ANIDocument76 pagesCours ANIYàs SérPas encore d'évaluation
- Dette Exterieure Et RDCDocument93 pagesDette Exterieure Et RDCNDOLUKAPas encore d'évaluation
- Plds PDFDocument23 pagesPlds PDFMohamed Ali AsriPas encore d'évaluation
- MémoirDocument4 pagesMémoirChaimaa Chichi100% (1)
- Finale Pfe 200420131033Document43 pagesFinale Pfe 200420131033informatiquehageryahoo.frPas encore d'évaluation
- Guide-Doc 2Document124 pagesGuide-Doc 2thombilaPas encore d'évaluation
- 12Document94 pages12YassinPas encore d'évaluation
- Cours Architect Ordi Diarra 2020 PDFDocument64 pagesCours Architect Ordi Diarra 2020 PDFKouassi Francis KouamePas encore d'évaluation
- Reseaux 2 - ProtocolesDocument2 pagesReseaux 2 - ProtocolesasmaedjouadiPas encore d'évaluation
- UCOPIA Livre BlancDocument98 pagesUCOPIA Livre BlancStevePas encore d'évaluation
- Constitution JCI Congo 2019Document86 pagesConstitution JCI Congo 2019theophaneamourPas encore d'évaluation
- Conventions collectives et changements environnementauxD'EverandConventions collectives et changements environnementauxPas encore d'évaluation
- Les Régions périphériques: Défi au développement du QuébecD'EverandLes Régions périphériques: Défi au développement du QuébecPas encore d'évaluation
- Les Villes moyennes au Québec: Leur place dans le système socio-spatialD'EverandLes Villes moyennes au Québec: Leur place dans le système socio-spatialPas encore d'évaluation
- Syndicats, salaires et conjoncture économique: L'expérience des fronts communs du secteur public québécois de 1971 à 1983D'EverandSyndicats, salaires et conjoncture économique: L'expérience des fronts communs du secteur public québécois de 1971 à 1983Pas encore d'évaluation
- Facult Exercice de Revision 2011 Org ComptDocument2 pagesFacult Exercice de Revision 2011 Org ComptNoureddine OmariPas encore d'évaluation
- Comptabilité Générale S2 Amortissements Etudiant-Maroc - ComDocument5 pagesComptabilité Générale S2 Amortissements Etudiant-Maroc - Cometudmaroc95% (20)
- EcommerceDocument61 pagesEcommercepecknomjPas encore d'évaluation
- Studi CatalogueFormationsDocument34 pagesStudi CatalogueFormationsSidi Mohamed Ag BilalPas encore d'évaluation
- Examen PPPDocument26 pagesExamen PPPLe Père BéniPas encore d'évaluation
- TCVDocument2 pagesTCVAhmed DakounePas encore d'évaluation
- Le Prix de Cession Interne: Universite Hassan 1 Faculté Des Sciences Juridiques Economiques Et Sociales de SettatDocument14 pagesLe Prix de Cession Interne: Universite Hassan 1 Faculté Des Sciences Juridiques Economiques Et Sociales de Settatkaidi chaimaaPas encore d'évaluation
- La DistributionDocument15 pagesLa DistributionKapabli Poutiti100% (1)
- Conseiller ClienteleDocument4 pagesConseiller ClienteleAnass ChàhmîPas encore d'évaluation
- Divalto Weavy Force CommercialeDocument12 pagesDivalto Weavy Force Commercialezakaria abbadiPas encore d'évaluation
- (Template) Fed1 Preparation Rapport D'activite 2023 2025Document6 pages(Template) Fed1 Preparation Rapport D'activite 2023 2025adrien.di-sottoPas encore d'évaluation
- Date Facture Secteur Vendeur Montant Code Facture Code ClientDocument6 pagesDate Facture Secteur Vendeur Montant Code Facture Code ClientWafaa WafaaPas encore d'évaluation
- Memoiredefinitif Doc5Document151 pagesMemoiredefinitif Doc5Pat OyonoPas encore d'évaluation
- Le Marketing Achat-CoursDocument18 pagesLe Marketing Achat-CoursSafae Safsaf100% (1)
- Rapport-de-stage-Abdelatif (Récupéré)Document26 pagesRapport-de-stage-Abdelatif (Récupéré)Mohamed MahdiPas encore d'évaluation
- Qu'Est Ce Que L'e-Business (Complet)Document52 pagesQu'Est Ce Que L'e-Business (Complet)testarosaPas encore d'évaluation
- Résume Module EnvironnementDocument14 pagesRésume Module EnvironnementabdssamadPas encore d'évaluation
- Cours Partie Base de Données GE - GM 21 - 22Document164 pagesCours Partie Base de Données GE - GM 21 - 22mohaPas encore d'évaluation
- Wa0028Document57 pagesWa0028Salma BouarouaPas encore d'évaluation
- Sofrecom Comprendre Accompagner Transformation Num Rique 2018 FRDocument24 pagesSofrecom Comprendre Accompagner Transformation Num Rique 2018 FRgharbiaPas encore d'évaluation
- MemoireDocument109 pagesMemoirefilalk100% (1)
- ACCOUNTING Accounting and Financial Analysis in The Hospitality Industry (001-090)Document90 pagesACCOUNTING Accounting and Financial Analysis in The Hospitality Industry (001-090)Ghaouti ZidaniPas encore d'évaluation
- Rapport 2Document17 pagesRapport 2Benny MayambaPas encore d'évaluation
- Dictionnaire After EffectDocument1 pageDictionnaire After Effectkoum dibongue françois narcissePas encore d'évaluation