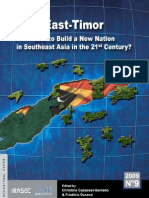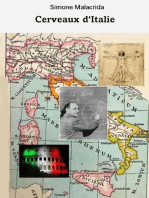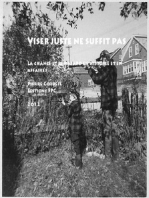Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CHRHC 719 100 Archives Et Histoire Orale Des Entreprises en Egypte Le Projet Du Centre de Recherches D Histoire Economique Et de Business Ebhrc
CHRHC 719 100 Archives Et Histoire Orale Des Entreprises en Egypte Le Projet Du Centre de Recherches D Histoire Economique Et de Business Ebhrc
Transféré par
roudoudou75Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
CHRHC 719 100 Archives Et Histoire Orale Des Entreprises en Egypte Le Projet Du Centre de Recherches D Histoire Economique Et de Business Ebhrc
CHRHC 719 100 Archives Et Histoire Orale Des Entreprises en Egypte Le Projet Du Centre de Recherches D Histoire Economique Et de Business Ebhrc
Transféré par
roudoudou75Droits d'auteur :
Formats disponibles
Cahiers d'histoire.
Revue d'histoire critique
100 (2007) La Rconciliation franco-allemande : les oublis de la mmoire
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Didier Monciaud
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches dHistoire conomique et de Business (EBHRC)
Interviewralise en arabe avec lquipe danimation du Centre le 27.07.05 au Caire
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Avertissement Le contenu de ce site relve de la lgislation franaise sur la proprit intellectuelle et est la proprit exclusive de l'diteur. Les uvres figurant sur ce site peuvent tre consultes et reproduites sur un support papier ou numrique sous rserve qu'elles soient strictement rserves un usage soit personnel, soit scientifique ou pdagogique excluant toute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'diteur, le nom de la revue, l'auteur et la rfrence du document. Toute autre reproduction est interdite sauf accord pralable de l'diteur, en dehors des cas prvus par la lgislation en vigueur en France.
Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales dvelopp par le Clo, Centre pour l'dition lectronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rfrence lectronique Didier Monciaud, Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches dHistoire conomique et de Business (EBHRC), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique [En ligne], 100|2007, mis en ligne le 01 janvier 2010, consult le 03 aot 2012. URL: http://chrhc.revues.org/719 diteur : Association Paul Langevin http://chrhc.revues.org http://www.revues.org Document accessible en ligne sur : http://chrhc.revues.org/719 Document gnr automatiquement le 03 aot 2012. La pagination ne correspond pas la pagination de l'dition papier. Tous droits rservs
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches d (...)
Didier Monciaud
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches dHistoire conomique et de Business (EBHRC)
Pagination de ldition papier : p. 147-158
1
Interview ralise en arabe avec lquipe danimation du Centre le 27.07.05 au Caire
Lquipe prsente se composait du Docteur Abdel Azz Ezz al Arab, professeur de sciences conomiques luniversit amricaine duCaire (AUC), spcialiste dhistoire conomique et dconomie politique, et dtudiants de luniversit, diplms de sciences conomiques et titulaire dun BA (quivalent dune licence) de luniversit amricaine du Caire, Karin Al Sayed, Wael Ismael, Mustafa Hefny et Dina Khalifa, sans oublier Lina Attallah, diplme de communication et Yasmine Samir, diplme de luniversit duCaire et nouvellement arrive dans le Centre 3. Ils occupent tous les fonctions de responsables de projet (project officers) dans le EBHRC.
Quelle est lorigine de votre projet de centre?
2 3
6 7 8
10
Abdel Azz Ezz al Arab: Cela est une trs longue histoire, car lide est ancienne. Pour aller vite, au dpart, il y a eu la proposition de luniversit de constituer un fond dhistoire conomique et de business. On a cherch quelquun pour assurer des cours. Le Doyen en sciences sociales ma personnellement contact pour les faire. Mais, depuis deux ou trois ans dj, jtais convaincu de cette ncessit. Lide tait de sortir de lhistoire globale, globalisante (igmlia) et dtudier plus prcisment des structures et cadres prcis. Il sagissait de prendre le business comme objet pour aller dcouvrir lhistoire sociale du pays. Bref, lobjectif initial tait ici de proposer une approche diffrente de celle de lhistoire globale. La dmarche pouvait tre, par exemple, de prendre une banque, ses activits et tudier ainsi les formes du nationalisme conomique. En gypte, le thme rcurrent est que Talat Harb est le pre du nationalisme conomique avec la cration de la Banque Misr. Pour comprendre ce nationalisme conomique, choisir dtudier une banque, ses structures et ses interventions, ncessite aussi de regarder lhistoire bancaire en Europe puis de retourner sur le terrain gyptien car la prsence et lactivit des banques europennes y ont t cruciales. Lide est donc ainsi dtudier une structure, ses interventions et de replacer celles-ci dans leur contexte. Lide dominante concernant lgypte est quil existe un lien entre la modernit, la mise en place du secteur du coton et les activits de dveloppement conomique. Notre ide est de focaliser les tudes sur des institutions particulires et daccder partir de ces tudes une comprhension globale de la priode. Les tudes sur les entreprises en gypte sont peu nombreuses; par exemple, il ny a rien ou presque rien sur la socit du Canal de Suez, al Moqaoloun al Arab 4. Dans dautres pays anciennement coloniss, comme lInde, cela nest pas le cas. Un jour, jai demand Bob Tignor5pourquoi on ne trouvait rien sur lhistoire des entreprises au Moyen-Orient. Il ma rpondu que cela aurait t considr comme des tudes marques par de la sympathie envers les entrepreneurs et les patrons. Dailleurs, la premire raction de Gall Amn6 notre projet a t la peur de sembler apporter un soutien au programme de privatisation en cours. Or, Herbert Thompson 7et moi-mme tions personnellement peu favorables une telle orientation.
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 100 | 2007
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches d (...)
11
12
13
En 2001 donc, ce ne sont pas finalement quelques cours, mais un vritable programme de recherche incluant le projet de constitution darchives qui a t propos. Pour les archives, lide de dpart tait quil existe des socits par actions depuis plus de cent ans en gypte. Laccs leurs documents, la protection mme de ces documents tait une question importante. Sans parler de leur classement et de leur accessibilit. Une srie de runions a t organise sur les diffrentes activits possibles. Finalement, jai prsent un projet en plus de onze cours. La recherche de fonds pour un tel projet dans le cadre de AUC, a t infructueuse. Finalement, par hasard, jai rencontr des historiens intresss par une telle ide: Robert Tignor, Bob Vitalis8 En gnral, il ne sagissait pas dconomistes ou de professeurs dconomie mais dhistoriens proccups dhistoire conomique. En fait, ce thme intressait vraiment, puisquen 2003, jai t invit par Robert Vitalis et luniversit de Pennsylvanie une table ronde laquelle participaient, entre autres, Bob Tignor, Vitalis, Goldberg9, Roger Owen10et un lve de Vitalis qui a fait sa thse sur lgypte. La table ronde sest tenue en janvier2004 Philadelphie. Les diffrentes institutions taient ds le dpart daccord pour aider financirement le projet, sauf Princeton, pour la simple raison que R. Tignor appartient au dpartement dhistoire alors que les autres universitaires sont responsables de dpartements dtudes du Moyen-Orient. Ce dernier doit alors rentrer en parler son universit. Si lUniversit amricaine duCaire ne dispose pas de fonds pour un tel projet, avec de tels appuis, au retour, il me reste simplement dfinir un projet pilote!
En mai2004, lide de runion se concrtise. Wael Ismal, Omar Shata et moi-mme lanons le travail initial.
14 15
16
17
18 19
20
21
22
Wael Ismal: Omar Chata et moi-mme devenons responsables de projet (project officers). Cest le dbut du travail dhistoire orale. Lobjectif initial est de dfinir les personnes cibles, leur rle, leurs expriences. Pour le domaine de lconomie gyptienne, on vise alors en priorit des personnes ges qui nauraient pas encore t interroges. On a dabord bien sr song Azz Sidq11et on a commenc par faire des recherches son sujet. En attendant de pouvoir entrer directement en contact avec lui, on a aussi travaill sur dautres personnalits. Pour entrer en contact avec elles, on a eu recours aux liens personnels, aux connaissances et quelquefois le hasard a bien fait les choses. Par exemple, on connaissait un tudiant dont le grand-pre tait Hassan Ragab, le reprsentant de Fiat en gypte. Cet homme a jou un rle cl dans la formation de lentreprise dautomobiles Nasr. Par lintermdiaire de son petit-fils, nous avons pu entrer en contact avec lui. De manire gnrale, la principale difficult pour les interviews est de pouvoir rencontrer ces personnalits alors que nous ne sommes que de simples tudiants. Ce nest pas simple. On a eu aussi, par exemple, des contacts avec un ancien responsable de la Fdration gyptienne des industries, Adel Al Gazarin, devenu ensuite ministre; avec lancien ministre de lIndustrie Mohamad Abdel Wahb, ou encore avec un ancien responsable de lentreprise de Mahalla al Kubra puis de la socit de sidrurgie. En gypte, souvent les anciens dirigeants dentreprises deviennent par la suite ministres, ce qui ne simplifie pas les prises de contacts. Interroger ces personnes permet davoir accs des informations, leur point de vue sur le secteur industriel, ses ralits, ses problmes. Ce secteur occupe une place de choix dans lhistoire de la politique gyptienne depuis Nasser. Par exemple avec des gens comme Azz Sidq ou encore Ismail Sabri Abdallah12. Lindustrialisation reste un sujet dont les enjeux sont importants. En mars-avril2003, on a intensifi les interviews. La prparation du premier forum13a aussi dbut. Lobjectif tait de montrer ce qui avait dj t ralis en matire dhistoire orale. On a mis en place le sminaire pour les jeunes chercheurs avec lide de montrer les documents raliss et de favoriser ainsi la recherche et la poursuite du projet. Par jeunes chercheurs, nous entendons les personnes qui dbutent des activits de recherche dans le cadre dun projet de carrire ou par intrt pour le thme. Deux ateliers ont t lancs autour du thme de lindustrialisation. Lun deux permettait de rencontrer des acteurs.
Combien de personnes ont assist ces ateliers?
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 100 | 2007
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches d (...)
23 24
25
Wael Ismal: Une trentaine. Le second atelier tait consacr la question des archives, des lois, des conditions de la constitution des fonds, de leur prservation, de laccs ces fonds Cest Khaled Fahm14qui la anim. Pour ces deux ateliers, des recherches avaient t prpares, par exemple sur la question des khawaga15ou de la modernit. En parallle ces deux initiatives se sont tenues des sessions ouvertes16.
Et votre place dans lUniversit amricaine?
26 27
28 29
30 31
32
33
34 35
Wael Ismal: Le travail reposait au dpart sur Dr Abdel Azz, Omar Chata et moi-mme. Dina Khalifa ntait pas encore salarie au centre mais y participait. Le forum de mai2004 a donc pu se tenir. Il a permis la formalisation de lexistence du centre qui est officiellement cr alors, au lendemain de cette initiative, en juin2004. Jusque-l, il sagissait dun projet pilote. Pendant, lt 2004, il ne sest pas pass grand-chose. Nous avons essentiellement poursuivi la transcription des entretiens pour lesquels on a choisi de garder larabe dialectal17. Le travail a repris la rentre scolaire 2004. Avec Karm al-Sayed, Dina Khalfa, Dina Wked, aujourdhui Harvard pour tudier le droit, Omar Chata, parti aussi depuis tudier aux tatsUnis, et Mustafa Hefn. Dina Khalfa: Ensuite, on a progress dans la dfinition du cadre de la recherche. Au dpart, il sagissait de la recherche de personnes cls. Il a fallu non seulement largir le nombre et le type de personnes mais aussi dfinir des domaines de recherche: industrie, finance, secteur bancaire Le principe est de choisir nous-mmes les personnes dont le tmoignage nous semble prsenter le plus grand intrt. Cest ainsi que lon a labor une liste de personnes des secteurs bancaire et industriel. Ensuite, il nous a fallu nous concentrer sur la prparation du second forum de 2005. Deux grands axes de travail ont t dfinis : augmenter le nombre des individus et des secteurs concerns (textile, banque, industrie automobile) et diversifier les niveaux de responsabilit des personnes interviewes en ne se limitant plus aux responsables de premier rang. Pour mai2005, un premier atelier a t organis avec Mohamad Abdel Wahab et Fouad Sultan autour du rcit historique18. Le second tait plus sectorielet traitait du textile, de la socit Nasr dautomobiles. ce moment, on a aussi dcid de se tourner vers les petites entreprises, les petites activits commerciales comme le Caf Riche ou les tudes sur Hliopolis. Il sagissait de changer dchelle. Karm al Sayed: On dispose aujourdhui au sein de luniversit de quatre project officers (responsables de projet) et dun poste dassistant administratif.
O sont les locauxdu Centre?
36 37
Dina Khalfa: Pour linstant, on est ici dans limmeuble Falaki et on dispose de cinq bureaux. Une pice est rserve aux archives. Notre collection est encore petite. Avec le dveloppement, la question de lespace se posera. Mais avec le futur campus, on devrait avoir plus de place19.
Quelle a t laudienceau second forum?
38 39
40 41 42 43
44
Dina Khalfa: Pour le forum de 2005, vingt invitations avaient t lances. Les sessions ouvertes ont accueilli une centaine de personnes, les sances fermes entre 20 et 50. Il y a eu plutt moins de monde quen 2004. Abdel Azz Ezz al Arab: Mais noublions pas que le premier forum en 2004 tait inaugural et avait un caractre, disons, plus festif Wael Ismal: Oui, le premier forum avait eu plus dampleur. Limplication de lAUC avait aussi t plus forte et il avait bnfici de la participation de nombreux enseignants de diffrentes facults. En 2005, le forum a davantage repos sur les intervenants extrieurs. Abdel Azz Ezz al Arab:
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 100 | 2007
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches d (...)
45 46 47
48 49
50
51 52 53
Ce nest pas une question de nombre, mais aussi de spcialisation dans le travail. Mustafa Hefnaw: On a organis, par ailleurs, deux sminaires pour poursuivre le travail avec les jeunes chercheurs. Il sagissait de discuter des papiers avec des professeurs, de faire une sorte de groupe de discussion. Lun des sminaires a t consacr lhistoire orale, les sens de ce concept, les techniques du travail, les problmes poss. Une autre sance a permis la rencontre des jeunes chercheurs avec Dalia Ghanem, membre du ministre de lconomie. Karim al Sayed: Avec le temps, les activits se sont spcialises. Les entretiens et la collection darchives aussi. On sintresse la fois aux papiers personnels, aux autobiographies, aux mmos, aux circulaires, aux lettres On a commenc aussi travailler avec la Bibliothque des Livres Rares de lAUC20. Wal Imal et Omar Chata ont travaill sur la question des sources en arabe: comment enregistrer, comment transcrire. On a donc rflchi sur linterview. Le Dr Abdel Azz a t invit Columbia au Centre dhistoire orale de cette universit. Avec le temps, on a dfini plus prcisment des objectifs, fait des choix, notamment dans le fonctionnement de la collecte de sources. Dina Khalfa: La question de la transcription a aussi t lobjet dune rflexion. On fonctionne selon le systme suivant: une transcription est donne la personne interviewe pour quelle relise et introduise, si ncessaire, changements et corrections.
Quels sont maintenant vos projets?
54 55
56 57
Dina Khalfa: On a tabli une liste de sujets et de personnes. On veut aller vers de nouveaux secteurs conomiques comme, par exemple, le secteur de la pharmacie, lindustrie militaire, les multinationales Wael Ismal: On a ralis pas mal de choses, mme si on aurait souhait bien sr en faire plus. On a eu des difficults, par exemple, pour contacter et tablir le lien avec Azz Sidq. Aujourdhui, la situation est meilleure tant pour les contacts que les moyens. Il nous faut cependant choisir, dfinir des priorits. Le travail est diffrent. Il est devenu plus sectoriel et varie selon les entreprises, le niveau de responsabilit des personnes, la prsence de minorits trangres, la localisation gographique de lentreprise. Le travail de Dina Khalfa sur Hliopolis, qui privilgie les petites entreprises, est une illustration de cette diversification croissante.
Pour raliser les entretiens, avez-vous besoin dun permis ou dune autorisation?
58 59
60 61
Karm al Sayed: On sest renseign auprs du Centre de recherche sociale 21et on a appris que le permis ntait ncessaire que dans le cas o lon faisait des enqutes quantitatives. Pour les entretiens individuels, il ny a pas demander dautorisation. Par contre, les difficults se prsentent au niveau du choix des questions. Par exemple, interroger sur lInfith 22pouvait gner nos interlocuteurs, entraner de lapprhension ou mme faire peur. Pour un tranger, cela serait sans doute encore plus compliqu de descendre dans la rue et dinterroger les gens avec un magntophone. Wael Ismal: En ce qui concerne la technique dentretien, elle varie selon les personnes que lon interroge. Les personnalits nont pas les mmes apprhensions que les gens ordinaires. La nature des questions, la faon de les poser, le fait denregistrer ou non, de transcrire ou non, sont autant denjeux redfinir chaque entretien.
Avez-vous dautres projets encore?
62 63
Dina Khalfa: On a pour projet de dvelopper le travail sur les autobiographies. Avec, par exemple, comme objectif, celle dconomistes comme Ismail Sabri Abdallah ou Heba Hendoussa23, de chefs
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 100 | 2007
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches d (...)
64 65
66
dentreprise comme Mohamad Taymour ou le directeur dElias24, sans oublier le responsable du garage armnien Papazian Hliopolis. Karm al Sayed: Parmi ces projets, sinscrit aussi notre participation la MESA 2005 en novembre Washington. On y va avec un atelier qui prsente diffrents travaux raliss au sein du Centre, histoire conomique, Caf Riche, Hliopolis, On continue animer un sminaire de recherche, deux fois par mois environ avec des sances publiques. On aura aussi dans les mois venir un sminaire de travail, ferm celui-ci.
Quand aura lieu le prochain forum?
67 68
Dina Khalfa: Pour les jeunes chercheurs, ce sera en fvrier2006. Lappel communication a dj t diffus. La date limite pour participer est la mi-novembre. Pour le Forum de mai, lide est encore vague: a tournera sans doute autour de lhistoire conomique et du business, et de la construction du Centre.
Que pouvez-vous ajouter par ailleurs propos de la publication de Chronicles?
69 70
71 72 73
Dina Khalfa: On a effectivement commenc la publication du premier numro de notre bulletin, qui aura pour le moment 32 pages. Je suis responsable de ce projet. Il sagit de transmettre le plus possible dinformation un plus large public. Dans ce bulletin, on informe sur nos activits, on reproduit des interviews, des annonces. Ce numro1 tait un coup dessai. On essaiera lavenir de le rendre plus universitaire, plus profond On doit lamliorer avec des rubriques, des sections, des articles, pour rendre mieux compte des activits et des ides du centre, pour mieux y parler des projets de recherches, des questions historiques, de lactualit On voudrait ajouter de nouveaux sujets, de nouvelles rubriques Le bulletin devrait ressortir en octobre. On souhaite lui donner terme une parution trimestrielle, conformment au rythme de lanne universitaire. Karm al Sayed: Par ailleurs, on a lanc une autre entreprise, la ralisation dun guide des ressources de presse sur les questions conomiques. Il sagit dun recensement des articles de la presse gyptienne en la matire. On a collect le plus possible darticles et denqutes dans les journaux et on a ralis un numro pilote. Mais on a t contraint darrter cause de la somme de travail que cela demandait, et cela sans aucun moyen financier. Aujourdhui, ce projet est donc au point mort.
Envisagez-vous de crer un site internet?
74 75
Karm al Sayed: On y a bien sr song et on devrait y venir mais cela doit passer par luniversit. Pour linstant, concernant la presse, on en est au clipping25.
Et en matire de publications, o en tes-vous?
76 77
78
Abdel Azz Ezz al Arab: On peut avancer si les travaux ont un bon niveau. Les recherches des Jeunes chercheurs prsentes aux Forums ont donn lieu des remarques et des commentaires. Ces chercheurs doivent donc reprendre et retravailler leurs papiers. Un autre aspect de la question concerne aussi les finances. On na pas actuellement les moyens de prendre en charge des publications. Mais si, par exemple, Cairo Social Sciences Papers 26veut les publier, on est bien sr daccord. Depuis que le Daily Star 27a crit sur nos activits, AUC Press 28nous a contacts et a propos de publier un ouvrage autour du thme de lhistoire orale.
Comment voyez-vous la place et le devenir de votre centre?
79 80
Abdel Azz Ezz al Arab: La question est : que faire ? Comment continuer ? LAUC na pas fait le centre. Cest lenthousiasme de personnalits extrieures pour notre ide qui a permis la cration et lanimation du centre au sein de lAUC. Les besoins financiers sont la cl du dveloppement
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 100 | 2007
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches d (...)
81
82
83
de nos activits. Dabord en termes de ressources humaines. Pour les dpenses par exemple, notre participation la MESA 2005 avec latelier cotera 50% de notre budget! Comment donc prserver lexistence du centre ? Cela signifie la fois prserver lenthousiasme des prsents actifs et aussi attirer de nouvelles personnes partir du travail dj ralis. Vritable base pour continuer et aller de lavant On peut parler dune absence de modle de construction. De mme, le Centre ne correspond pas un cadre juridique clair. Quant la question de notre place sur la scne gyptienne, on y existe, mais notre place est modeste ct dinstitutions comme la Gamayat tarikhya29, le Economic Research Forum30ou encore le journal Aym masrya31. Il faut noter la faiblesse de lorganisation du Centre: les enseignants, les tudiants quon y trouve ont tous des activits ct et ne travaillent pas temps plein pour le centre. Bref, il sagit dun projet jeune, de quelque treize mois seulement.
Comment vous situez-vous par rapport aux questions de mthode historique?
84 85
86 87
88 89
90 91
Abdel Azz Ezz al Arab: En fait, notre centre na pas de position dfinie. On rassemble des documents et nimporte quel chercheur peut venir les utiliser. Cela peut concerner aussi bien Gall Amn ou Khaled Fahm pour voquer des sensibilits diffrentes voire opposes. Notre proccupation centrale est le thawthiq (collecte darchives). Les intrts, les options, les mthodes ou les outils utiliss pour comprendre sont laffaire des chercheurs eux-mmes. Des gens trs diffrents sont intresss par notre projet. Des sujets diffrents les motivent, des coles et des approches diffrentes. Au sein de notre centre, on peut trouver Dina Khalfa et Lina Attalah qui travaillent sur les khawaga ou la ville dHliopolis32, Karm al Sayed sur le Caf Riche33, Mustafa Hefn sur les thories de lhistoire du business, Wal Ismal sur la Banque Misr Karim al Sayed: Il existe en fait diffrentes mthodes parmi les chercheurs au centre. Mais ce qui les rapproche, cest lintrt pour lhistoire orale, le souci daller trouver les tmoins encore en vie, de les interroger, de retrouver les dtails de la faon dont les choses se sont passes. Abdel Azz Ezz al Arab: Notre projet est centr sur les acteurs en tant que tmoins. Lhistoire orale est donc une entre dcisive de notre activit. Je citerais les exemples de Ali Negm, ancien gouverneur de la banque centrale dgypte, qui est une source essentielle pour comprendre comment sest pose dans les annes 1990 la question des socits islamiques de placement de fonds. Sans ngliger bien sr que lui-mme tait hostile ce phnomne. Donc les acteurs et leurs tmoignages nous importent beaucoup.
Peut-on dire, selon vous, que la priode actuelle joue un rle dans la constitution de ce projet?
92 93
Dina Khalfa: Je pense que les difficults daccs aux sources en gypte aujourdhui ont jou un rle dans la cristallisation du projet. Le besoin de documents a favoris lide daller les chercher et den crer avec lhistoire orale.
Coordonnes du Centre:
94 95 96 97 98 99
The Economic and Business History Research Center Rooms 307, 313 A, 314, 315 Old Falaki Universit Amricaine duCaire AUC LeCaire gypte e-mail: ebhrc@auceypt.edu Tel: 00 20 2979 56 03/56 02 Notes
1 Lide de linterview est ne lors de la rception par mail du premier numro du bulletin du Centre. Nous avions eu connaissance du projet. Nous avons pu mesurer alors lampleur des activits du centre et leur intrt pour la recherche historique. 2 Nous remercions ici lensemble de lquipe pour son accueil, sa gentillesse et sa gnrosit.
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 100 | 2007
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches d (...)
3 Cette dernire na dailleurs pas os intervenir dans linterview. 4 Socit de construction, quivalent gyptien de Bouygues, ayant dimportantes branches dintervention dans le monde arabe, notamment les riches pays du Golfe. 5 Historien spcialiste de lgypte et de la corne de lAfrique, professeur la clbre universit Princeton, auteur douvrages et darticles incontournables sur lhistoire conomique de lgypte. 6 conomiste brillant et intellectuel clbre connu pour son volution ultra-nationaliste au cours de la dernire priode aprs avoir t proche des analyses marxistes. Fils du penseur musulman libral Ahmed Amin, il est un redoutable orateur connu pour son humour et ses commentaires dvastateurs. 7 Enseignant lUniversit amricaine duCaire et membre du comit excutif du centre. 8 Universitaire amricain, auteur dune thse iconoclaste sur les capitalistes gyptiens. 9 Goldberg, Elis, universitaire amricain spcialiste des questions du travail en gypte. 10 Historien britannique, responsable du Centre dtude du Moyen-Orient Harvard. Il est spcialiste dhistoire conomique de lgypte et dhistoire de ltat au Moyen-Orient. 11 Haut fonctionnaire gyptien qui a jou un rle cl dans la politique nassrienne dindustrialisation et a occup plusieurs hautes responsabilits dont celles de Premier ministre. 12 conomiste gyptien, ancien militant communiste et dirigeant dun organisme de planification. 13 Ce forum sest tenu en mai 2004. 14 Jeune historien gyptien qui enseigne luniversit de New York. Spcialiste du XIXesicle, il est le promoteur dune lecture de lhistoire de lgypte en rupture avec la lecture nationaliste dominante. 15 Terme dorigine turque qui signifie les trangers dorigine europenne. 16 Voir note 13. 17 En arabe, il existe deux registres de langue: le dialecte employ couramment loral, qui diffre selon les pays et mme dans certains cas selon les rgions, et larabe classique, langue plus soutenue, que lon retrouve dans le domaine de lcrit, de la religion ou des discours officiels. 18 Ancien ministre du Tourisme et longtemps haut responsable du FMI. 19 LAUC a prvu partir de 2007 de quitter le centre ville duCaire pour de nouveaux et vastes locaux situs en grande priphrie dans une zone appele Nouveau Caire. Elle y disposera dun campus unique. 20 Bibliothque autonome dans lAUC qui regroupe les documents les plus anciens et les plus rares, ceux qui ne peuvent tre dans la bibliothque gnrale qui, comme la plupart des bibliothques amricaines, fonctionne selon le systme de laccs direct. 21 Centre de lAUC. 22 Terme qui signifie la politique conomique douverture au capital tranger. 23 conomiste et haute responsable au ministre de lIndustrie. Ancienne responsable de lEconomic Research Forum. 24 Socit ddition de livres, connue notamment pour ses dictionnaires. 25 On dcoupe et agrafe le texte au tableau dans le bureau du centre. 26 Srie de travaux en sciences humaines publis par lAUC, en anglais, sur une base trimestrielle. 27 Journal libanais en langue anglaise qui dispose dun supplment distribu dans ldition du International Herald Tribune au Moyen-Orient. 28 Maison ddition de luniversit amricaine duCaire. 29 Association historique gyptienne. 30 Centre de recherche en conomie. 31 Journal irrgulier qui republie des documents anciens. 32 En 1905, le baron Empain, symbole des forts intrts conomiques belges et europens en gypte, cre en plein dsert au nord du Caire une ville nouvelle, Hliopolis, devenue aujourdhui avec le dveloppement duCaire un quartier de la capitale. 33 Important et ancien caf situ au centre de la partie europenne de la ville duCaire qui fut longtemps un des hauts lieux de la vie intellectuelle.
Pour citer cet article Rfrence lectronique
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 100 | 2007
Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches d (...)
Didier Monciaud, Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches dHistoire conomique et de Business (EBHRC), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique [En ligne], 100|2007, mis en ligne le 01 janvier 2010, consult le 03 aot 2012. URL: http:// chrhc.revues.org/719
Rfrence papier Didier Monciaud, Archives et histoire orale des entreprises en gypte. Le projet du Centre de Recherches dHistoire conomique et de Business (EBHRC), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 100|2007, 147-158.
propos de lauteur
Didier Monciaud Chercheur associ au GREMAMO (Groupe de recherche sur le Maghreb et le Moyen-Orient), Paris VII
Droits dauteur Tous droits rservs Entres dindex Mots-cls :archives, conomie, enqute orale, entreprises Gographie :gypte Chronologie :XXe sicle, XXIe sicle
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 100 | 2007
Vous aimerez peut-être aussi
- Gunter Pauli - L'économie Bleue 3.0 (2019) PDFDocument482 pagesGunter Pauli - L'économie Bleue 3.0 (2019) PDFAmirouche Beddek100% (2)
- Portrait de L'homme D'affaires en PrédateurDocument296 pagesPortrait de L'homme D'affaires en PrédateurCaptain Trroie100% (1)
- Exposé - La Philosophie AfricaineDocument10 pagesExposé - La Philosophie AfricaineHamza WELGO88% (41)
- Le Conseil de sécurité des Nations Unies: Ambitions et limitesD'EverandLe Conseil de sécurité des Nations Unies: Ambitions et limitesPas encore d'évaluation
- Grammaire CE1Document27 pagesGrammaire CE1docteurgyneco100% (2)
- Histoire Et Developpement: Dr. Guessan KOUADIODocument10 pagesHistoire Et Developpement: Dr. Guessan KOUADIOLengani Kader EvaricePas encore d'évaluation
- Le Modèle Ivoirien en QuestionsDocument804 pagesLe Modèle Ivoirien en QuestionsNouna CoulibalyPas encore d'évaluation
- Nouvelles Acquisitions Pour Qui Sonne Le Glas Le Titre de Luvre DernestDocument12 pagesNouvelles Acquisitions Pour Qui Sonne Le Glas Le Titre de Luvre DernestVickel SileuPas encore d'évaluation
- Pairault AbidjanDocument31 pagesPairault AbidjanseydianPas encore d'évaluation
- Presses Universitaires de France Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To La Revue AdministrativeDocument2 pagesPresses Universitaires de France Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To La Revue Administrativenkbghftgqkshdy nbhncdchvdsjPas encore d'évaluation
- Al Andalus FrançaisDocument756 pagesAl Andalus FrançaisEmilio GFerrinPas encore d'évaluation
- Les Organisations Regionels AfricainesDocument474 pagesLes Organisations Regionels AfricainesGabrielPas encore d'évaluation
- Synthese DinitiationDocument40 pagesSynthese DinitiationUn être vivantPas encore d'évaluation
- Le Mali ContemporainDocument55 pagesLe Mali ContemporainAdel SAHNOUNPas encore d'évaluation
- CBA 5ème Collège Privé MontesquieuDocument217 pagesCBA 5ème Collège Privé MontesquieuLysongo OruPas encore d'évaluation
- Edgar Morin: La TransdisciplinariedadDocument6 pagesEdgar Morin: La TransdisciplinariedadJorge Del CristoPas encore d'évaluation
- Frontieres de la citoyennete et violence politique en Cote d'IvoireD'EverandFrontieres de la citoyennete et violence politique en Cote d'IvoireÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Ibn Khaldun Et Le Sens de L'histoireDocument77 pagesIbn Khaldun Et Le Sens de L'histoirevordevanPas encore d'évaluation
- Nomades Et CommandantsDocument249 pagesNomades Et CommandantsDuveyrierPas encore d'évaluation
- Exposé - La Philosophie AfricaineDocument10 pagesExposé - La Philosophie AfricaineHamza WELGO95% (19)
- Bulletin Cercle Victor Loret 3Document28 pagesBulletin Cercle Victor Loret 3lgabolde100% (1)
- Le Nouvel Elan Du Panafricanisme LemergeDocument20 pagesLe Nouvel Elan Du Panafricanisme Lemergeobart.africaPas encore d'évaluation
- Ouvrage Collectif Version Finale L'harmattanDocument144 pagesOuvrage Collectif Version Finale L'harmattanSala KontePas encore d'évaluation
- CR Assemblee Generale Recherche-ActionDocument40 pagesCR Assemblee Generale Recherche-ActionMoussa MbayePas encore d'évaluation
- Afriqueetsondveloppement 2Document32 pagesAfriqueetsondveloppement 2Abir EL OMARIPas encore d'évaluation
- Etudesafricaines 36030Document32 pagesEtudesafricaines 36030Fred MomboPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Eyoum NgangueDocument21 pagesEntretien Avec Eyoum NgangueBrahim QazzouPas encore d'évaluation
- Questionnaire Bilan-Forum Module Habitus L1 SSEPDocument2 pagesQuestionnaire Bilan-Forum Module Habitus L1 SSEPDina El boukhariPas encore d'évaluation
- 010063042Document374 pages0100630422realmadrid234567Pas encore d'évaluation
- RHCEntretien Avec Philippe Rygiel, Relu Et RéviséDocument10 pagesRHCEntretien Avec Philippe Rygiel, Relu Et Réviséclembloods66Pas encore d'évaluation
- S'Exercer Au Bonheur - La Voie - EyrollesDocument240 pagesS'Exercer Au Bonheur - La Voie - EyrollesCto Bjacht100% (2)
- Israël et la Chine - De la Route de la Soie à l'Autoroute de l'InnovationD'EverandIsraël et la Chine - De la Route de la Soie à l'Autoroute de l'InnovationPas encore d'évaluation
- Villages GabonDocument93 pagesVillages GabonAnonymous kNyVDtnx100% (1)
- Recherche Historique Et Mondialisation - Vrais Enjeux Et Fausses Questions.Document16 pagesRecherche Historique Et Mondialisation - Vrais Enjeux Et Fausses Questions.guipio21Pas encore d'évaluation
- Achille Mbembe & Rémy Riou & Séverine Kodjo Grandvaux Pour Un MondeDocument106 pagesAchille Mbembe & Rémy Riou & Séverine Kodjo Grandvaux Pour Un Mondesocrate nomoPas encore d'évaluation
- ET - How To Build A New Nation in Sotheast Asia in The 21th CenturyDocument306 pagesET - How To Build A New Nation in Sotheast Asia in The 21th CenturySofia MirandaPas encore d'évaluation
- Critique Du Concept D'artDocument20 pagesCritique Du Concept D'artgabin elougaPas encore d'évaluation
- Le Journalisme: Une Histoire Sans HistorienDocument15 pagesLe Journalisme: Une Histoire Sans HistorienLucia Santa CruzPas encore d'évaluation
- Livre1 2004Document160 pagesLivre1 2004Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- SALEILLES, Raymond. de La Personnalité Juridique Histoire Et Théories (1922) PDFDocument704 pagesSALEILLES, Raymond. de La Personnalité Juridique Histoire Et Théories (1922) PDFcirolourencoPas encore d'évaluation
- L'historiographie Et L'histoire Immédiates: L'expérience Latine de L'histoire en Débat (1993-2006)Document9 pagesL'historiographie Et L'histoire Immédiates: L'expérience Latine de L'histoire en Débat (1993-2006)Carlos BarrosPas encore d'évaluation
- Place Enfant SocieteDocument36 pagesPlace Enfant Societehabibaiz GbagboPas encore d'évaluation
- Corruption Et Politique, Rien D - Frederic MonierDocument137 pagesCorruption Et Politique, Rien D - Frederic MonierarmanPas encore d'évaluation
- Inch'allah L'islamisation A Visage Decouvert (2018)Document238 pagesInch'allah L'islamisation A Visage Decouvert (2018)Vkdiammond SaphirPas encore d'évaluation
- L'esclavage en Afrique PrecolonialeDocument595 pagesL'esclavage en Afrique PrecolonialeMopagrePas encore d'évaluation
- Introduction: Savoirs Historiques Au Maghreb. Constructions Et UsagesDocument5 pagesIntroduction: Savoirs Historiques Au Maghreb. Constructions Et UsagesCRASC100% (1)
- Un Vol., 4 Po. X 7, Broché, 128 Pages. - Paris, 1956: La Bureaucratie, Par Alfred Sauvy. (Collection Que Sais-Je? )Document3 pagesUn Vol., 4 Po. X 7, Broché, 128 Pages. - Paris, 1956: La Bureaucratie, Par Alfred Sauvy. (Collection Que Sais-Je? )life is beautiful MsPas encore d'évaluation
- Raynaud Diop Simonneau Repenser Les Moyens Dune Securisation FoDocument223 pagesRaynaud Diop Simonneau Repenser Les Moyens Dune Securisation FoKoumous Resmique ChanelPas encore d'évaluation
- PDFDocument20 pagesPDFamadou dialloPas encore d'évaluation
- Cheikh Salah MouradDocument41 pagesCheikh Salah MouradBocar DialloPas encore d'évaluation
- Université Du Québec À MontréalDocument434 pagesUniversité Du Québec À MontréalFred NicolasPas encore d'évaluation
- Mondia v2Document7 pagesMondia v2Lugmag TmtcPas encore d'évaluation
- Madsen Pirie-La MicropolitiqueDocument504 pagesMadsen Pirie-La MicropolitiqueVincentJappiPas encore d'évaluation
- De L'analyse Des Relations Professionnelles À La Théorie de La Régulation SocialeDocument10 pagesDe L'analyse Des Relations Professionnelles À La Théorie de La Régulation Socialedemop100% (6)
- PeopleDocument4 pagesPeoplechristianngoiekikuyuPas encore d'évaluation
- Géopolitique Top 7 Livres PDFDocument32 pagesGéopolitique Top 7 Livres PDFnzui MantoPas encore d'évaluation
- Garcia Herrero Et Al Influences Chinoises Afrique Part II 2022Document42 pagesGarcia Herrero Et Al Influences Chinoises Afrique Part II 2022Eliane ZHANGPas encore d'évaluation
- Traitement Primaire Des Effluents Fonctions Et Dimensionnement Des OuvragesDocument18 pagesTraitement Primaire Des Effluents Fonctions Et Dimensionnement Des OuvragespapesarrPas encore d'évaluation
- Introduction À L'économie Séance 9Document51 pagesIntroduction À L'économie Séance 9Mohamed El HajiPas encore d'évaluation
- Correction Evaluation 4 Type CoursDocument3 pagesCorrection Evaluation 4 Type CoursvictorPas encore d'évaluation
- Regulation Industrielle Cours4Document29 pagesRegulation Industrielle Cours4Pj le Welpi0% (1)
- Module CryptographiDocument35 pagesModule Cryptographisaidista2021Pas encore d'évaluation
- Logique td12 PDFDocument2 pagesLogique td12 PDFNoupa mike mikePas encore d'évaluation
- GRH 1 PDFDocument204 pagesGRH 1 PDFHafsa BenazzouzPas encore d'évaluation
- CNPN Cycle-Master Et Master Specialise VFDocument11 pagesCNPN Cycle-Master Et Master Specialise VFJoey El MoutawakilPas encore d'évaluation
- L'accréditation en FranceDocument2 pagesL'accréditation en Francelinedalineda2021Pas encore d'évaluation
- FIABILITÉ Chapitre1Document14 pagesFIABILITÉ Chapitre1FatenPas encore d'évaluation
- Axa TechDocument4 pagesAxa TechYounes PicsouPas encore d'évaluation
- Notes Cours Geostatistique Lineaires KechichedDocument9 pagesNotes Cours Geostatistique Lineaires Kechichedzouzou chemseddine100% (2)
- Dossier de Candidature Bintou Thiero-ConvertiDocument5 pagesDossier de Candidature Bintou Thiero-ConvertiSeydou kodioPas encore d'évaluation
- L'art, Le Beau Et La TechniqueDocument5 pagesL'art, Le Beau Et La TechniqueMehdi DPas encore d'évaluation
- Cours de Modélisation Et D'evaluation de PerformanceDocument31 pagesCours de Modélisation Et D'evaluation de PerformanceAdam BouhadmaPas encore d'évaluation
- Etude Métamorphique Des Micaschistes Et Gneiss de L'unité de Filali, Massif de Beni Bousera (Rif Interne, Maroc)Document26 pagesEtude Métamorphique Des Micaschistes Et Gneiss de L'unité de Filali, Massif de Beni Bousera (Rif Interne, Maroc)Abdelhak El MansourPas encore d'évaluation
- Le Traité de CroyanceDocument4 pagesLe Traité de Croyancebismillah03Pas encore d'évaluation
- 2 DualiteDocument29 pages2 DualitelaghribPas encore d'évaluation
- Cours 4 5 6 PDFDocument44 pagesCours 4 5 6 PDFRiadh HariziPas encore d'évaluation
- CPS-BPU-Voie de Contourenement de NadorDocument219 pagesCPS-BPU-Voie de Contourenement de NadorIssam SembatiPas encore d'évaluation
- Chapitre VI - Le Plan D'affaireDocument8 pagesChapitre VI - Le Plan D'affaireFaten YahiaouiPas encore d'évaluation
- Galaxie 028Document162 pagesGalaxie 028gabrielaPas encore d'évaluation
- Mec6214 - Devoir 01 - 2019-01-07Document3 pagesMec6214 - Devoir 01 - 2019-01-07FugulusPas encore d'évaluation
- Linguistique de La Langue Et Linguistique DU Discours: Deux Approches Complementaires de La Phrase Wolof, Unite Semantico-SyntaxiqueDocument14 pagesLinguistique de La Langue Et Linguistique DU Discours: Deux Approches Complementaires de La Phrase Wolof, Unite Semantico-SyntaxiqueStella WaelPas encore d'évaluation
- Utilisation Des Codes LDPC en StéganographieDocument7 pagesUtilisation Des Codes LDPC en StéganographieMamour BaPas encore d'évaluation
- Volmolaire - Chafou - CopieDocument10 pagesVolmolaire - Chafou - CopieMë RîëmPas encore d'évaluation