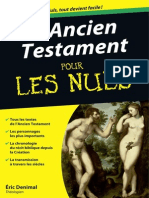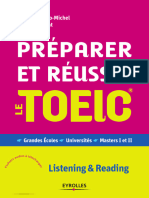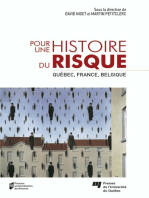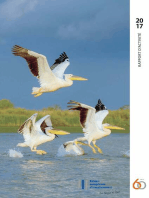Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cartographie Et Histoire
Cartographie Et Histoire
Transféré par
Shiler FleurimaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cartographie Et Histoire
Cartographie Et Histoire
Transféré par
Shiler FleurimaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 1/96
Manuel de Cartographie
Ecrit par Didier Poidevin
Extrait de son ouvrage La carte : moyen d`action aux editions Ellipses
Articque
Les Roches
37230 Fondettes
Tel : 33 2 47 49 90 49
Fax : 33 2 47 49 91 49
Web : http://www.articque.com
Email : inIoarticque.com
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 2/96
1
11A
AAB
BBL
LLE
EE D
DDE
EES
SS M
MMA
AA1
11I
IIE
EER
RRE
EES
SS
TABLE DES MATIERES ............................................................................................... 2
PRESENTATION............................................................................................................ 4
I CARTOGRAPHIES, CARTES ........................................................................................... 6
1) Quest ce que la cartographie ? ........................................................................... 6
2) La carte................................................................................................................ 8
3) Linformatique au service dune nouvelle cartographie ..................................... 11
4) Comment aborder la cartographie par ordinateur ? .......................................... 12
5) Les apports la cartographie par ordinateur ....................................................... 14
II L`ECHELLE ET LA GENERALISATION........................................................................ 18
1) Lechelle ............................................................................................................ 18
2) La generalisation ............................................................................................... 20
III LOCALISATION - IMPLANTATION............................................................................. 23
1) La localisation ................................................................................................... 23
2) Limplantation.................................................................................................... 23
IV LES VARIABLES VISUELLES..................................................................................... 29
1) 1
ere
variable visuelle . la taille............................................................................ 29
2) 2
eme
variable visuelle . la forme .......................................................................... 30
3) 3
eme
variable visuelle . la valeur......................................................................... 31
4) 4
eme
variable visuelle . le grain........................................................................... 33
5) 5
eme
variable visuelle . lorientation ................................................................... 33
6) 6
eme
variable visuelle . la couleur ....................................................................... 33
V QU`EXPRIME-T-ON AVEC LE LANGAGE CARTOGRAPHIQUE ....................................... 43
1) Des quantites, des proportions (information quantitative)............................... 43
2) Un classement, un ordre (information ordonnee) .............................................. 46
3) Une difference, une distinction (information qualitative) ................................... 47
4) En resume, pour une bonne utilisation des variables visuelles ........................... 50
VI RESPECTER LES REGLES.......................................................................................... 51
1) Etre rigoureux avec la collecte et le traitement des donnees .............................. 52
2) Le traitement graphique doit tre fudicieux (du bon usage de lexpression
cartographique).......................................................................................................... 53
3) Une carte doit tre lisible (nette et economique) ................................................ 53
4) Une carte doit tre complete .............................................................................. 55
5) Une carte thematique doit repondre a deux questions ........................................ 61
VII LES ETAPES......................................................................................................... 64
1) Se poser les questions pertinentes avant la conception....................................... 64
2) La construction dune carte................................................................................ 67
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 3/96
VIII LA MISE EN CLASSES DES SERIES STATISTIQUES .................................................... 69
1) La terminologie elementaire de la statistique..................................................... 69
2) Principes du decoupage en classes..................................................................... 71
3) Rappels de statistiques elementaires . les principaux indicateurs....................... 72
4) Les methodes de discretisation........................................................................... 75
IX LES CARTES D'ANALYSE ......................................................................................... 81
1) Les cartes en points............................................................................................ 81
2) Les cartes en proportions ................................................................................... 82
3) Les cartes en diagrammes .................................................................................. 84
4) Les cartes en svmboles ....................................................................................... 86
5) Les cartes de reseaux ......................................................................................... 87
6) Les cartes de flux................................................................................................ 89
7) Les cartes en plages ........................................................................................... 91
X LES AUTRES FORMES DE CARTES............................................................................. 93
1) Les cartes en carrovage ..................................................................................... 93
2) Les anamorphoses.............................................................................................. 94
3) Les cartes en trois dimensions............................................................................ 95
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 4/96
P
PPR
RRE
EES
SSE
EEN
NNT
TTA
AAT
TTI
IIO
OON
NN
La carte, Iamiliere, quotidienne, indispensable, est pourtant un outil dont les potentialites
sont meconnues voire inconnues par la plupart d`entre-nous.
Des generations d`eleves puis de proIessionnels assimilent encore la geographie et
indirectement la cartographie a des disciplines d`inventaires dont le seul but serait de
situer les lieux, les Iaits et phenomenes.
Cette vision limitee et Iortement stereotypee vient du Iait que l`ecole et l`enseignement
en general n`ont pas ete prepares a transmettre l`utilite operationnelle de la geographie et
de la cartographie. Parallelement, le marche de la carte, sa pratique et son utilisation
mediatique se sont considerablement accrus. La matrise de l`outil cartographique est
devenue un enjeu primordial dans tous les domaines se preoccupant de la connaissance et
de la gestion des territoires. Ce developpement prodigieux de la cartographie resulte
d`une part d`une prise de conscience des ses qualites d`aide a la decision et a la gestion,
de support de communication, d`analyse ou encore de simulation et d`autre part de la
montee en puissance de l`inIormatique. Celle-ci ouvre a la cartographie de vastes champs
d`application (et inversement) et donne theoriquement a tous la possibilite de concevoir
une carte.
Ayant resolu le probleme, delicat, de l`acquisition d`un logiciel, l`enjeu est maintenant
pour vous de travailler judicieusement avec les methodes cartographiques et d`analyse
exploratoire auquel Cartes & Donnes vous donne acces.
Toute carte devrait presenter des qualites de rigueur, de clarte et d`esthetique, en resume
ne pas ignorer les regles elementaires de la graphique. En tant que langage, la
cartographie ne s`improvise donc pas ; elle s`apprend et n`est eIIicace que si elle assure
au lecteur le maximum de clarte et de rapidite de comprehension. Les progres de
l`inIormatique et la democratisation induite ont tendance a le Iaire oublier et chaque jour,
de trop nombreuses cartes alimentent un sottisier dont on s`abstiendrait volontiers.
Lorsque l`on conoit ou que l`on apprend a concevoir une carte, il Iaut toujours garder a
l`esprit une des caracteristiques Iondamentales de l`outil cartographique : celui-ci utilise
un langage visuel dont les principes, les regles, les qualites et les limites resultent tous
des exigences physiologiques de l`oil humain.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 5/96
Ce livret a pour objectiIs d`enoncer les regles Iondamentales de l`expression
cartographique et ce en dix parties : la premiere donne les deIinitions indispensables
tandis que les quatre suivantes presentent les subtilites de l`expression cartographique.
Les sixieme et septieme parties insistent sur les regles et les etapes necessaires pour
concevoir et realiser une carte efficace. Les techniques de mise en classes (discretisation)
Iont l`objet d`une huitieme partie. EnIin, les diIIerents types de cartes, exemples a
l`appui, sont exposes dans deux dernieres parties.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 6/96
I Cartographies, cartes
- gnralits -
1) Qu`est ce que la cartographie ?
O La cartographie a pour but la representation de la Terre ou d`une autre planete sous
une Iorme geometrique et graphique grce a la conception, la preparation et la
realisation de cartes. La cartographie est a la Iois une science, un art et une
technique.
C`est une science, car ses bases sont mathematiques, notamment en ce qui
concerne la determination de la Iorme et des dimensions de la Terre puis le
report de la surIace courbe de la Terre sur un plan (la carte) grce au systeme des
projections et enIin l`etablissement d`un canevas planimetrique et altimetrique.
L`enjeu est la precision et la Iiabilite de la carte.
C`est un art, car en tant que mode d`expression graphique, la carte doit presenter
des qualites de Iorme (esthetique et didactique grce a la clarte du trait, a son
expressivite et sa lisibilite) aIin d`exploiter au mieux les capacites visuelles du
lecteur. Cela exige de la part du concepteur et du realisateur des choix dans la
representation.
C`est enIin une technique, car elle necessite d`amont en aval, l`emploi
d`instruments dont les progres ont bouleverse toute la Iiliere cartographique
(photographies aeriennes, satellites, ordinateurs, impression et diIIusion, etc.).
La deIinition de la cartographie suppose que la representation de la Terre s`accomplit
grce a un ensemble de techniques et de methodes. Il en resulte les deux grandes
branches de la cartographie.
O Les techniques precedent les methodes et engendrent une cartographie damont ou
une cartographie mathematique ou topographique , sachant que ces
qualiIicatiIs sont peu satisIaisants. Cette cartographie a pour Iinalite majeure
d`etablir les fonds de carte* necessaires a l`elaboration de toute carte. C`est la ou se
situent les Iondements mathematiques et geometriques de la cartographie.
Grce a l`astronomie, a la topographie, a la photogrammetrie*, a la geodesie*, a la
topometrie (ensemble des mesures Iaites sur le terrain pour la realisation des cartes
topographiques), a la teledetection* (decouverte de la Terre a distance) entre autres
et bien sr a l`exploration systematique du globe, on a pu donner de plus en plus
precisement au Iil du temps, les dimensions, la Iorme generale et une representation
a plat de la Terre. La connaissance de notre planete est a peine terminee et s`enrichit
encore aujourd`hui avec les progres de l`imagerie satellitaire.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 7/96
Cette cartographie demande des competences particulieres que possedent les
topographes ou les geometres par exemple. Pour le concepteur et realisateur de
cartes thematiques, les buts a atteindre sont diIIerents puisqu`il utilise des Ionds de
cartes deja etablis.
Les deux grandes branches de |a cartograhle contemoralne
L`enjeu est plutt de considerer la cartographie comme art d`expression et comme un
outil d`analyse, d`aide a la decision et de communication, d`ou le contenu de ce livre
axe essentiellement sur les methodes de la cartographie.
O Les mthodes de la cartographie, c`est-a-dire la demarche et la reIlexion
intellectuelle que supposent l`acte de concevoir, realiser puis lire des cartes
thematiques (cI. deIinition plus bas) necessitent d`autres competences. Lire une
carte thematique est en soit un acte complexe qui ne repond a aucune recette
predeterminee. L`experience du lecteur dans un domaine quelconque et sa capacite a
decrypter la trame de l`organisation de l`espace geographique sont les deux
Cartographie mathmatique
de reprage objectif et prcis et de
mesure de la Terre (gode)
Cartographie thmatique
Description et explication des distributions
spatiales de phnomnes gographiques
CARTOGRAPHI E
Mthodes Techni ques
O AstronomIe
O GeodesIe
O OceanographIe
O IhotogrammetrIe
O Systeme de projectIon
O TeIedetectIon
O TopometrIe
O TopographIe
O GeographIe
GeographIe physIque
IogeographIe, geomorphoIogIe,
cIImatoIogIe, hydroIogIe, gIacIoIogIe,
pedoIogIe, etc.
GeographIe humaIne
GeographIe urbaIne, economIque,
poIItIque, des transports, demographIe,
etc.
O conomIe, urbanIsme,
marketIng, amenagement,
hIstoIre, geopoIItIque,
statIstIques, etc.
Cartes gnrales
Cartes de base
Cartes spciales
Cartes thmatiques
p CoIIecte des donnees
p IreparatIon et
traItement des
donnees
p SemIoIogIe graphIque
p essIn
p mpressIon
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 8/96
Iacteurs-cleIs de la lecture eIIicace d`une carte. Il est par contre plus aise de cerner
les acquis que reclament la conception puis la realisation d`une carte thematique
puisqu`ils decoulent plus ou moins directement d`une logique dans le choix du
langage cartographique. Pour resumer, le respect d`une serie de regles et de
methodes est garant d`une cartographie thematique eIIicace et Iiable..
2) La carte
O Objet tres ancien, plus ou moins complexe, aux multiples Iacettes et utilisations, on
ne peut donner une seule deIinition de la carte. Toutes les cartes ont neanmoins un
point commun, celui de representer une portion de l`espace terrestre. Retenons deux
deIinitions de la carte :
o Selon F. Joly, une carte est une representation geometrique, plane,
simplifiee et conventionnelle de tout ou partie de la surface terrestre et cela
dans un rapport de similitude convenable quon appelle echelle .
o La carte est un dessin reduit et a plat du Monde ou d`une portion du Monde.
Elle peut tre aussi et d`autre part une representation sur un Iond de carte
geographique, d`un phenomene quelconque concret ou abstrait. Cette
representation est Iaite sur papier ou sur un autre support tel le verre, le bois
ou un ecran d`ordinateur. Une carte est conue a la main ou par une machine.
Les distances sur la carte sont toujours dans le mme rapport que sur le
terrain.
La notion de carte n`est pas a conIondre avec celle de plan* qui represente un espace
restreint. On parle de plans de maison, de quartier voire de ville mais jamais de plan de
France ou d`une region.
O De ces deIinitions se degagent cinq grands principes dont les consequences
pratiques guident ou devraient guider le travail de tout cartographe, proIessionnel ou
non.
o La carte est une representation, un dessin : la carte est donc un document
visuel. Ceci explique que la conception et la realisation d`une carte doivent
respecter des regles simples mais rigoureuses, issues des lois de la perception
visuelle.
o La carte est une representation plane : la carte materialise le passage de la
sphere terrestre a un plan. Ce passage est realise grce au procede des
projections. L`obligation de la projection implique qu`aucune carte n`est
Iidele a la Iorme reelle de la surIace terrestre. De plus, selon la projection
retenue, le visage du territoire projete sera tres diIIerent. Cette contrainte n`est
imperieuse que dans le cadre d`une cartographie de grandes etendues de
terrain (travail a petite echelle).
o La carte est une representation reduite : une carte n`a pas pour objectiI de
representer l`espace en vraie grandeur. Au contraire, le but est d`obtenir un
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 9/96
document maniable sur lequel est represente le terrain selon un rapport de
reduction : lechelle.
o La carte est une representation simpliIiee : la reduction impose une serie
d`operations graphiques que l`on regroupe sous le nom generique de
generalisation et qui visent a choisir les objets a representer et a remplacer
leurs Iormes observees sur le terrain par des Iigures conventionnels.
o La carte est une representation conventionnelle : le cartographe utilise un
langage, le langage cartographique, qui possede sa propre grammaire. Sa
connaissance permet de transmettre au mieux une inIormation geographique.
O De mme que la deIinition de la cartographie a laisse entrevoir les deux grandes
branches de cette discipline, celle de la carte diIIerencie deux grands types de
cartes : d`une part les cartes de base (appelees egalement cartes generales ou encore
cartes classiques) issues de la cartographie mathematique et d`autre part les cartes
speciales.
Des le 17
eme
siecle, l`homme a cartographie la Terre dans un but moins restrictiI que
celui de representer la topographie des pays et de decrire la Terre. Les cartes sont
devenues des instruments de connaissance, de decision, de prevision et de
planiIication au service des Etats. Sont donc apparues des cartes speciales ou cartes
specialisees aujourd`hui communement appelees cartes thematiques.
Une carte thematique a pour Iinalite de donner sur un Iond de carte une representation
conventionnelle de Iaits et de phenomenes presentant un aspect de distribution dans
l`espace et de leurs correlations, a l`aide de symboles qualitatiIs ou quantitatiIs,
geometriques ou IiguratiIs dont l`explication se trouve dans une legende.
Les phenomenes a representer etant illimites, les cartes thematiques et leurs applications
sont innombrables. C`est cette variete mme qui Iait certes la complexite mais aussi
l`intert d`un point de vue proIessionnel des cartes thematiques conues pour decrire,
comprendre et interpreter l`organisation de l`espace aIin, le cas echeant, d`agir.
O Le cartographe est un auteur qui propose un message au lecteur
Cet aspect devrait tre constamment dans l`esprit des concepteurs, realisateurs et
lecteurs de cartes. S`il en etait besoin, les uns y gagneraient en rigueur et en modestie,
les autres en prudence et en lucidite.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 10/96
La carte, une lnterretatlon du ree|
O C`est lors de la conception et de la realisation que se decide une tres grande part de
l`eIIet Iinal du document cartographique.
Le cartographe doit d`abord apprehender la realite du terrain aIin de repertorier
et d`organiser les objets geographiques, breI les donnees* quantitatives ou
qualitatives qui constituent la base de la carte. C`est le cartographe qui decide
quelles sont les donnees a conserver ou a escamoter. Cette selection est souvent
indispensable, car elle garantit la lisibilite du document Iinal. Elle est souvent
liee aussi au theme de la carte et le cas echeant au lectorat de la carte : un
technicien ou un ingenieur sera capable de lire (ou exigera) des cartes inIiniment
plus complexes que le neophyte.
A ce choix des donnees (pourvu que celles-ci soient Iiables et homogenes)
s`ajoutent generalement un traitement de celles-ci. La encore, le cartographe
s`aIIirme comme le seul matre a bord. Par exemple, parmi les methodes de
decoupage en classes des series statistiques, il Iaut savoir choisir, sachant que
chaque methode possede ses proprietes et surtout debouchent sur un resultat
cartographique exclusiI.
Les donnees etant selectionnees, le cas echeant veriIiees puis traitees, il Iaut
maintenant passer a la presentation du Iond de carte, une autre prise de decision
importante de la part du cartographe. Quelle projection choisir et surtout quelle
echelle et quel degre de generalisation retenir ? A priori, le nombre de solutions
est illimite mais le jugement du cartographe est encore une Iois generalement
guide par l`objectiI Iinal de la carte.
L`esprit d`initiative est encore de mise lors de la phase-cleI que constitue le
dessin de la carte. A la Iois attendu et redoute, ce passage des donnees a
l`expression cartographique a ete grandement simpliIie grce a l`inIormatique.
Obstacles
sinterposant
entre le lecteur et
le message
cartographique
Critres engendrant une
subjectivit dans le
travail du cartographe.
Le lecteur
Le cartographe
La carte
Habillage de la carte
Choix des variables visuelles
Slection dun fond de carte :
projection, chelle, gnralisation
Traitement des donnes
Erudition du
lecteur
Qualit des donnes
Slection des donnes
Habilet et
exprience du
lecteur dcrypter
des messages
visuels
Europe : croissance
dmographique
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 11/96
Mme les logiciels les plus perIectionnes laissent pourtant toute latitude au
cartographe pour decider de la couleur, de la Iorme des Iigures, de la
typographie...en deIinitive du style Iinal de la carte. La machine s`eIIace devant
les capacites et l`obligation creatrices du cartographe.
EnIin, il appartient au cartographe d`habiller la carte grce a la legende (ou la
placer, comment la presenter ?), a un cadre (doit-il limiter la carte ?), a
l`orientation, etc. Le choix d`un titre (souvent l`acte Iinal du cartographe) est loin
d`tre innocent. Aucun logiciel n`est capable, evidemment, de nommer une carte.
Il appartient a l`auteur de lui donner une tournure neutre et sobre ou a l`inverse
d`exprimer une pensee, une opinion. La taille des lettres, l`utilisation de Iigures
de pensee (exclamation, interrogation, enumeration...) sont des techniques plus
ou moins subtiles pour Iormuler un titre et au Iinal inIluencer le lecteur.
O Le decodage de la carte induit lui aussi une absence de spontaneite de la part du
lecteur. Tout lecteur a un vecu, une culture, une aisance et une Iormation qui Iont
que le message sera reu diIIeremment et plus ou moins Iidelement.
En conclusion, le cartographe, en selectionnant, le Iond de carte adapte, en
rassemblant et en traitant les donnees et en choisissant la maniere dont il les
represente graphiquement est un auteur. Organisateur, geometre, styliste et
rhetoricien, il exprime librement sa 'vision du monde
1
. Au-dela des biais que
peut entraner une telle intervention du cartographe, l`avantage reside dans le Iait
que la carte est un outil au service du lecteur. Ce dernier n`a qu`a en disposer pour
agir. En recevant le message cartographique (cela est vrai pour tout message, visuel
ou ecrit), le lecteur interprete lui aussi la structure du message originel.
Il appartient donc d`une part au cartographe d`apporter un maximum de rigueur aIin
d`attenuer les irregularites inherentes a toute demarche de communication et d`autre
part au lecteur d`tre conscient que la carte n`est pas un calque du monde.
3) L`informatique au service d`une nouvelle cartographie
L`apparition de l`inIormatique dans le domaine de la cartographie est deja ancienne
puisque les premieres cartes par ordinateur datent du debut des annees 60. Neanmoins, a
cette epoque, la technologie encore balbutiante et surtout les obstacles Iinanciers
empchaient l`expansion de la cartographie par ordinateur qui ne concernait qu`un noyau
de specialistes. Depuis, elle s`est perIectionnee sans cesse si bien qu`aujourd`hui,
concevoir une carte sur ordinateur est en passe de devenir un acte aussi ordinaire
qu`utiliser un traitement de texte. Cette (r)evolution a bouleverse toute la Iiliere
cartographique, d`amont en aval.
Pour le cartographe neophyte, la cartographie par ordinateur souleve un Ilot de questions,
car celle-ci possede son jargon, ses methodes et ses specialistes.
1
Remi Caron, Cartes et Figures de la Terre, 1980
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 12/96
A noter
Pour qualiIier l`elaboration d`une carte avec un ordinateur, on a invente une serie de
termes plus ou moins satisIaisants et speciIiques.
Le vocable cartographie assistee par ordinateur a le merite d`tre clair mais ses initiales
(C.A.O.*) etaient deja utilisees par conception assistee par ordinateur, discipline qui Iait
reIerence aux traitements graphiques en general.
L`expression cartographie automatique est souvent utilisee pour qualiIier toute la chane
de Iabrication d`une carte (des leves sur le terrain jusqu`au dessin et l`impression). On
obtient donc au Iinal une carte automatique. Il est vrai que l`ordinateur entrane une
automatisation de toutes les etapes de la realisation d`une carte : trace du Iond de carte,
traitement des donnees, dessin, legende automatique, impression, etc. Mais cette
expression de cartographie automatique est abusive tant le rle du cartographe reste
Iondamental a tous les stades de l`elaboration de la carte : choix du sujet, des objectiIs, des
traitements statistiques, de l`echelle, entree des donnees, retouche d`images, etc. Le jour
ou l`ordinateur pourra prendre en charge, sans intervention du cartographe, la creation
d`une carte est encore loin.
On rencontre egalement les vocables d`inIographie qui s`applique plus generalement
aux traitements graphiques de l`inIormation et de geomatique qui Iait reIerence a
l`ensemble des procedures de traitement de donnees geographiques par ordinateur dans
l`elaboration du cadastre* et de la carte topographique de base. Ces vocables sont peu
employes hors des milieux proIessionnels interesses.
Le neologisme cartomatique suggere par le geographe Roger Brunet est un compromis
entre cartographie assistee par ordinateur et cartographie automatique. On pourra
egalement utiliser sans crainte la Iormule de cartographie par ordinateur.
4) Comment aborder la cartographie par ordinateur ?
On peut distinguer quatre niveaux selon les Ionctionnalites des logiciels.
O Certains logiciels destines au grand public et plus particulierement aux curieux de
geographie ou aux milieux scolaires ne sont que des recueils de cartes passives
(des atlas*) historiques, geographiques, satellitaires. Ils ne permettent en aucun cas
de creer des cartes et ne sont donc pas des logiciels de cartographie.
O Les logiciels de dessin
La realisation de cartes grce un logiciel de dessin (Adobe Illustrator ou CorelDraw
par exemple) suppose le maniement plus ou moins experimente du Dessin Assiste
par Ordinateur (D.A.O.). Quatre cas se presentent :
le cartographe privilegie le travail graphique voire artistique et non pas la
conception de cartes supposant des traitements statistiques. Les logiciels de
dessin sont ainsi tout indiques pour concevoir des cartes Iictives, des cartes
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 13/96
destinees a la communication ou des cartes schematiques. Ces documents ne
necessitent pas en eIIet de liens entre objets graphiques de donnees statistiques
mais imposent generalement des Ionctions de dessins avancees.
Le cartographe travaille sur un logiciel de cartographie et retouche les cartes
dans un logiciel de dessin ou de presentation externe pour en ameliorer la
presentation et l`esthetique, mettre en Iorme les textes, etc. Les logiciels de
cartographie oIIrent ainsi la possibilite dexporter les cartes a diIIerents Iormats
(GIF, JPEG, WMF, Posctript...). Cette methode presente cependant
l`inconvenient de perdre les liens dynamiques entre objets graphiques et donnees
alphanumeriques. Dans le cas d`une mise a jour par exemple, une nouvelle
redaction de la carte s`impose. TouteIois, certains logiciels de cartographie
proposent des Ionctions internes d`edition cartographique preservant les liens
entre parametres d`habillage et base de donnees.
Le cartographe conoit sa carte manuellement , par exemple les traitements
statistiques a l`aide d`une calculatrice ou d`un tableur, et realise sa carte sur
logiciel de dessin.
Certains logiciels de dessin perIectionnes proposent, grce a des modules
integres, de nombreuses Ionctions permettant de traiter des donnees
geographiques. La barriere entre ces logiciels et les logiciels de cartographie est
mince.
Si l`on veut mettre en relation les donnees statistiques et les donnees
cartographiques et mettre en ouvre des Ionctions d`analyse geographique, en
resume tirer pleinement parti de la cartographie par ordinateur, il Iaut passer a la
vitesse superieure, c`est-a-dire aux logiciels de cartographie proprement dits.
O Les logiciels de cartographie
Les logiciels de cartographie sont complets et permettent de numeriser (ou
digitaliser ), c`est-a-dire enregistrer des Ionds de carte personnels. Ils creent,
structurent et gerent les bases de donnees cartographiques. Ils oIIrent ainsi toutes les
Ionctionnalites de rassemblement, de classement et de traitements mathematiques
des donnees a cartographier. Ils traduisent les donnees (chiIIrees ou non) en un
langage cartographique constitue de Iigures geometriques, de trames, de symboles,
de diagrammes, de couleurs..., puis ils permettent d`habiller la carte avec une
legende, un titre, un cadre, une couleur de Iond, etc. EnIin, les logiciels de
cartographie eIIectuent des analyses spatiales tres elaborees (intersections, selection
d`objets selon divers criteres, calculs d`itineraires, d`isochrones, analyses
Iactorielles, etc.). Les logiciels de cartographie ont gagne en ergonomie. AutreIois
trop compliques pour les cartographes occasionnels, ils sont aujourd`hui accessibles
au grand public moyennant une Iormation.
O Les systmes dinformations gographiques (S.I.G.)
Le but de ce paragraphe est uniquement et simplement de tirer au clair les grandes
lignes d`un secteur aux multiples ramiIications et en perpetuelle evolution. Le Iait
que la plupart des personnes exterieures a la problematique des systemes
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 14/96
d`inIormations geographiques et mme bon nombre de proIessionnels assimilent les
S.I.G. a des logiciels de cartographie est revelateur de la conIusion qui regne dans
ce domaine dont l`image et le Ionctionnement tendent a se brouiller un peu plus
chaque jour, particulierement aux yeux du cartographe occasionnel.
DeIinition du S.I.G.
Un S.I.G. est l`ensemble des structures, des methodes, des outils et des donnees
constitue pour rendre compte des phenomenes localisees dans un espace speciIique et
Iaciliter les decisions a prendre sur cet espace . (T. Joliveau).
Contrairement a une idee reue et tenace, les logiciels de cartographie et les systemes inIormatiques
permettant de rassembler stocker, manipuler, traiter, gerer et analyser les donnees spatiales ne sont que des
elements d`un ensemble beaucoup plus vaste, cet ensemble etant le S.I.G. proprement dit.
Cette deIinition insiste sur le Iait essentiel que les S.I.G. sont des systemes incluant a cte des outils materiels
et logiciels, d`autres composantes tout aussi Iondamentales : les structures, les methodes et les donnees.
5) Les apports la cartographie par ordinateur
O Les Iorces de la cartographie par ordinateur procedent inevitablement de la
puissance et de la vitesse de calcul toujours plus importantes, intrinseques aux
ordinateurs.
Les progres de l`inIormatique et surtout de la micro-inIormatique beneIicient a tous
les echelons de la cartographie par ordinateur. Sa preeminence sur la cartographie
manuelle se decline en sept points majeurs :
La rapidite d`execution.
A toutes les phases de la conception et de la realisation, l`ordinateur est
susceptible d`oIIrir aux cartographes proIessionnels ou amateurs un gain de
temps considerable. Traitement et reactualisation des donnees, dessin et
transIormation du Iond de carte, dessin de la carte, reproduction : tout le
processus est si rapide aujourd`hui qu`il est diIIicile d`imaginer un avant.
Il reste pourtant bien utile d`tre passe par la cartographie manuelle aIin de
mieux estimer et matriser la puissance de l`ordinateur ainsi que veriIier la
pertinence des resultats, notamment en ce qui concerne la partie graphique (choix
des variables visuelles, contrle de la legende par exemple).
Un potentiel enorme en matiere de stockage et de diIIusion.
L`epoque ou les cartes poussiereuses dormaient dans des armoires oubliees est
revolue. Les cartes sont emmagasinees et classees sur support magnetique, sur
disque dur, sur CD-ROM, etc. Les documents ne se degradent plus au contact de
l`air ou de l`humidite et de plus, le Iormat compact des disquettes ou des CD-
ROM par exemple permet d`extraire les cartes en un temps record puis de les
diIIuser tout aussi aisement. Les cots de stockage s`en trouvent donc minimises.
La diIIusion des cartes et de l`inIormation geographique acquiert actuellement
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 15/96
une nouvelle dimension avec le reseau Internet sur lequel on peut consulter,
importer et imprimer dans des logiciels specialises, des cartes de tout type.
La nettete du dessin et la qualite de la restitution.
Si au debut de la cartographie par ordinateur, le dessin de la carte et son
impression etaient souvent plus proches du brouillon que du document
cartographique, cet inconvenient est aujourd`hui disparu grce d`une part a des
outils d`edition cartographique tres proches des meilleurs logiciels de dessin
assiste par ordinateur et d`autre part a l`evolution technologique des
imprimantes.
o Les logiciels de cartographie automatisent le dessin de nombreux Iigures
cartographiques : plages de valeurs, symboles proportionnels, diagrammes,
etc.
o Les outils de dessin associes aux logiciels de cartographie evitent de savoir
dessiner (du moins, a la main). Sur papier, en eIIet, le dessin d`une carte
impose un apprentissage et une pratique soutenus pour dessiner des Iormes
geometriques parIois complexes et surtout une sensibilite aux arts graphiques
aIin d`assurer un rendu des couleurs honorable par exemple. Les logiciels de
cartographie integrent des aides au dessin avec lesquelles tracer et dessiner
des Iigures, des trames, des diagrammes ou des aplats* de couleurs ne
constituent plus vraiment un Irein. EnIin, les Ionctions de mise en page
permettent d`editer des documents clairs et synthetiques. Le cartographe y
gagne en temps, en precision et en rigueur.
o En revanche, le dessin par ordinateur ne s`apprend pas en quelques heures :
dessiner avec une souris n`epargne pas l`utilisateur d`une initiation au dessin
vectoriel (cI. Ci-dessous). Au moins, avec l`ordinateur, corriger une erreur de
dessin et tester des solutions jusqu'a satisIaction est un jeu d`enIant. Sur
papier au contraire, le droit a l`erreur est tres limite : une main tremblotante
entrane irremediablement une carte - et des heures de travail - dans une
corbeille a papier.
o EnIin, le rendu des imprimantes s`est considerablement ameliore ces
dernieres annees. Pour un prix modique (moins de 5000 FF), il est possible
maintenant de se procurer des imprimantes (laser, thermique, jet d`encre...)
dont les perIormances oIIrent une qualite d`impression etonnante non
seulement en noir et blanc mais aussi en couleur : au cartographe de tirer le
meilleur parti de ces petites merveilles de technologie.
Le traitement des donnees est lie directement a la partie graphique de la carte.
Cette Ionction, atout majeur des logiciels de cartographie, met en relation les
donnees statistiques presentes dans un tableur ou une base de donnees et les
Iigures graphiques et non graphiques (titre, legende, nomenclature) de la carte. Il
suIIit des lors de changer les donnees numeriques pour mettre a jour les cartes.
Une immense capacite de gestion, de traitement, d`analyse.
La cartographie par ordinateur oIIre a la recherche scientiIique et a de
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 16/96
nombreuses activites proIessionnelles (amenagement et urbanisme, prospective,
marketing, transport et circulation, etc.) une inIinite de possibilites de
croisements, de correlations, de calculs, des plus simples (divisions en classes,
calculs des moyennes, des ecarts-types, des taux) aux plus compliques (analyse
Iactorielle, tendances, potentiels et gravites, agregation...). L`etablissement de
modeles eventuels en est grandement Iacilite. La possibilite de Iormuler des
hypotheses constitue aussi une Iormidable avancee pour les scientiIiques,
notamment les geographes mais aussi pour tous les proIessionnels soucieux
d`optimiser l`organisation de l`espace. On aboutit a une autre Ionction essentielle
des S.I.G. : simuler.
La possibilite de realiser des cartes originales.
En alliant la puissance de calcul et la puissance graphique de l`ordinateur et des
logiciels, de nouvelles cartes sont nees, inconcevables ou tres diIIicilement
concevables a la main : il s`agit notamment des anamorphoses, des cartes en
3D et des cartes en carroyage. Ces cartes, au-dela de leur cte spectaculaire
ou peu commun, explorent de nouvelles Iormes de representations
cartographiques. Dans le meilleur des cas, elles permettent d`analyser des
phenomenes spatiaux jusqu`alors diIIicilement perceptibles, voire inconnus.
La possibilite de manipuler des bases de donnees cartographiques.
Les logiciels sont capables d`exploiter et de manipuler des cartes satellites et des
bases de donnees complexes issues des grands organismes producteurs de Ionds
de cartes (I.G.N., Michelin...).
O Cette serie d`avantages Iondamentaux explique dans bien des cas qu`on ne puisse
plus se passer de l`inIormatique lorsque l`on conoit et realise une carte.
Neanmoins, l`ordinateur et les logiciels de cartographie n`evitent pas une prise en
compte des regles de l`expression cartographique.
L`ordinateur et les logiciels de cartographie Iont tres souvent oublier, mme aux
proIessionnels, que l`inIormatique ne dispense pas du respect des regles de
construction d`une carte. A titre de comparaison, il serait tout aussi grotesque de
penser qu`un traitement de texte exempt des regles de construction d`une phrase ou
d`un texte.
Certes, tout comme un traitement de texte, le logiciel de cartographie propose des
aides : aide au dessin, legende automatique, aide a la generalisation, etc. Mais le
cartographe comme l`ecrivain reste le seul pilote a bord. Le logiciel de cartographie
Iait au Iinal ce qu`on lui dit de Iaire : si les donnees saisies sont Iausses par
exemple, la carte sera egalement completement Iausse. Les plus grosses lacunes se
retrouvent dans les choix graphiques. On note ainsi une contradiction grandissante
entre le niveau de sophistication de la cartographie theorique, mathematique et
automatique et l`ignorance des principes elementaires de la graphique (J.C.
Muller).
On voit donc Ileurir des centaines de cartes en apparence serieuses mais en Iait
totalement Iantaisistes et/ou illisibles. A la diIIerence d`un texte bourre de Iautes
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 17/96
d`orthographe et de style, ces cartes passent souvent aux travers des critiques, car
peu de lecteurs discernent le bon du mauvais.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 18/96
II L`chelle et la gnralisation
1) L`chelle
O L`chelle d`une carte est l`inverse du rapport d`une distance et de sa representation
(deIinition du C.F.C.).
L`echelle cartographique se presente sous deux Iormes :
Lechelle graphique : ligne droite ou abaque materialisant sur la carte, l`echelle numerique
(deIinition du C.F.C.).
L`echelle numerique est le rapport d`une distance mesuree sur la carte et sa valeur reelle sur le terrain.
Une echelle de 1/100 000 signiIie que 1 cm sur la carte represente 100 000 cm, soit 1000
metres (ou 1 kilometre) sur le terrain. En d`autres termes, un objet sur la carte sera 100 000 Iois plus
grand dans la realite. Le tableau suivant donne les echelles numeriques les plus courantes en France.
1/5 000
1 cm sur la carte represente 50 m sur le terrain Plans cadastraux
1/10 000
1 cm sur la carte represente 100 m sur le terrain Plans cadastraux
1/25 000
1 cm sur la carte represente 250 m sur le terrain Ex. : Serie Bleue IGN, 1750 cartes
topographiques tres detaillees pour couvrir
la France.
1/100
000
1 cm sur la carte represente 1 km sur le terrain Ex. : Serie Jerte I.G.N., 74 cartes pour
toute la France.
1/200
000
1 cm sur la carte represente 2 km sur le terrain Ex. : carte routiere Michelin
1/1 000
000
1 cm sur la carte represente 10 km sur le terrain Ex. carte d`Atlas detaillee,
carte routiere I.G.N.
1/5 000
000
1 cm sur la carte represente 50 km sur le terrain Ex. : cartes d`atlas*
N.B. : la production des cartes au 50 000
me
a rcemment t arrte en France.
5OOO cn
1 cn 5OOO cn
1 cn
Distance sur le
terrain
Representation sur
la carte
Inverse du rapport
2 1 7 3 6 5 4
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 19/96
O La notion d`echelle est tres relative. Une carte a 1/5 000 peut tre consideree a juste
titre comme une carte a grande echelle. Mais elle sera une carte a petite echelle si on
la compare a une carte a 1/500. Pour tenter d`etablir une convention, l`Institut
Geographique National a mis en place une terminologie aIin de classer les cartes
selon leurs echelles. Il en resulte trois categories :
les cartes a moyenne echelle : de 1/25 000 a 1/100 000 inclus,
les cartes a petite echelle : de 1/100 000 a 1/500 000 inclus,
les cartes a tres petite echelle : inIerieure ou egale au millionieme.
La plupart des cartographes sont conIrontes a des cartes a grande echelle (superieure au 25
000
eme
) car ils travaillent a l`echelle de la ville, du quartier, voire de l`lot. On parle alors
parIois de plans* : plan cadastral par exemple.
A retenir
Il convient de dire :
carte a 1/x, et non pas carte au 1/x,
echelle de 1/x, et non pas echelle au 1/x,
en chiIIres, on ecrira carte au 25000
eme
et echelle du 25000
eme
,
en toutes lettres, on ecrira carte au millionieme et echelle du millionieme.
Attention a la terminologie petite echelle et grande echelle. L`echelle est un rapport :
plus le denominateur sera important et donc le rapport petit, plus l`echelle sera petite.
Exemples :
Une carte a grande echelle represente une petite surIace mais avec beaucoup de details
tandis qu`une carte a petite echelle couvre une grande surIace en sacriIiant au detail de la
representation. De ce Iait, une carte a grande echelle autorise plus de detail et plus de
precision tandis qu`un document a petite echelle necessite une plus grande selectivite : il y
sera impossible de representer les Iaits par leur Iorme reelle. Cela implique la
generalisation du Iond de carte et des phenomenes representes (cI. Ci-dessous).
Lorsque l`on reduit ou agrandit une carte, l`echelle graphique est reduite ou agrandie
automatiquement, en mme temps que la carte. Par contre, l`echelle numerique est
modiIiee.
1
5 OOO OOO
1
5OO
Grand dnominateur =
petit rapport = petite
Petit dnominateur =
grand rapport =
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 20/96
2) La gnralisation
O La generalisation consiste en une simpliIication des traces des Ionds de carte et du
contenu de la carte lui-mme. C`est la reduction de l`echelle qui necessite la
generalisation : plus l`echelle sera petite (et donc la portion de terrain representee,
etendue), plus la generalisation devra tre importante - et inversement.
L`epaisseur du trait est a l`origine de ce phenomene. Cette epaisseur se relativise par
rapport a l`echelle de la carte : un trait de mme epaisseur couvrira une bande plus
large sur une carte a petite echelle que sur une carte a grande echelle. Par exemple, a
l`echelle du 50 000
eme
(1 cm 500 metres une carte de 20 metres de haut est
necessaire pour representer la France), un trait d`un dixieme de millimetre equivaut
a cinq metres sur le terrain. Ainsi, mme le plus Iin des traits ne pourra jamais tre
100 Iidele a la realite du terrain (sauI a l`echelle, absurde, de 1:1).
En consequence, si on generalise, c`est non seulement par la Iorce des choses mais
aussi et surtout pour gagner en lisibilite. En d`autres termes, plus l`echelle sera
grande, plus le cartographe sera a l`aise dans le choix de l`expression
cartographique mais quelle que soit l'echelle, une generalisation est toujours
necessaire.
O Generaliser n`est pas schematiser. Avec la schematisation, on remplace le contour
geographique par des contours simplement evocateurs de la Iorme initiale du
territoire en question (un hexagone pour la France par exemple).
O On generalise de quatre manieres.
On suit les traces lineaires et on les simpliIie en emoussant les sinuosites -
generalisation du Iond de carte -.
Par exemple, admettons que l`on ait a cartographier un phenomene a l`echelle de
la Bretagne sur une Ieuille A4 (2129,7). Il est impossible d`tre scrupuleux
quant aux contours des lignes de rivages et de Irontieres, au reseau routier, au
reseau hydrographique (Ileuves et rivieres). De ce Iait, on generalise le Iond de
carte en gommant les multiples indentations et ondulations de ces traces lineaires
On selectionne les principaux elements et on en enleve d`autres que l`on juge
inutiles ou gnants a petite echelle - generalisation par selection (Erreur! Source
du renvoi introuvable.).
Si au 50 000
eme
par exemple, il est possible de representer toutes les routes et
toutes les rivieres, il est evident qu`au 500 000
eme
par exemple, une selection
s`impose. Il suIIit par exemple de selectionner les rivieres ou les elements du
reseau routier les plus importants (en taille, en debit...).
On simpliIie les contours en regroupant les zones - generalisation structurale -
En reduisant l`echelle, les objets geographiques de la carte deviennent de plus en
plus illisibles. Le cartographe est donc amene a regrouper ces objets tout en
preservant leur structure initiale. Cependant, l`implantation reelle de l`objet n`est
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 21/96
plus respectee. Par exemple, sur la Iigure ci-dessous, le vignoble Bordelais
dispose d`une implantation zonale dans la realite : la premiere et la deuxieme
carte respectent cette implantation mais non la troisieme.
Autre exemple, au 5 000
eme
, tous les btiments d`un village sont cartographiables
avec precision. Au Iur et a mesure que l`echelle se reduit, on generalise en
regroupant ces btiments en zones. Puis a une echelle encore inIerieure (1/500
000 par exemple), toutes les zones et donc le village seront representes par un
Iigure ponctuel.
On represente le phenomene par une Iorme totalement diIIerente et tres
simpliIiee - generalisation conceptuelle -.
En reduisant encore l`echelle, la generalisation structurale ne suIIit plus : la zone
se transIorme en une tache dont on ne distingue plus la structure. On la remplace
par un signe ponctuel, geometrique ou IiguratiI.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 22/96
Genera|lsatlons structura|e et concetue||e
Le Bordelais
Le Sud-ouest
Le Languedoc-Roussillon
La Corse
La Savoie et
le Bugey
Les Ctes du Rhne
L'Alsace et l'Est La Champagne
La Jalle de la Loire
La Bourgogne
Le 1ura
La Provence-
Cte d'Azur
Dccuncn|
atan|
Limite de lappellation
0 100 km
Gcncra|isa|icn
Gcncra|isa|icn
Entre-Deux-Mers
Vayres
Cadillac
P
r
e
m
i
r
e
s
C
t
e
s
d
e
e
B
o
r
a
d
u x
Loupiac
Ctes de Blaye
Ctes de Bourg
Ctes de Francs
Mdoc
Haut-Mdoc
Craves
Sauternes
Pauillac
Saint-
Estphe
Saint-
Julien
Listrac
Moulis
Margaux
Lognan
Pessac
Bordeaux
Barsac
Pomerol
Fronsac
Saint-Emilion
Ctes de Bordeaux -
Saint-Macaire
Sainte-Foy-
Bordeaux
Le vignoble
0 20 km
Blaye
N
N
N
Lchelle diminue de nouveau. Il serait encore possible,
mais moins prcisment, de reprsenter le vignoble
Bordelais par un figur zonal comme ci- dessus. Mais le
cartographe dcide de le figurer par un symbole
vocateur : une grappe de raisin. Cest une gnralisation
conceptuelle car elle change le mode de reprsentation
(ici, figur zonal figur ponctuel) et limplantation (ici,
implantation zonale implantation ponctuelle)
La rduction d'chelle impose un nouveau mode de reprsentation : on sacrifie
au dtail de la carte prcdente en regroupant les appellations du vignoble
Bordelais en une seule et mme zone : cest une gnralisation structurale car
elle ne porte que sur les tracs.
Lchelle permet de localiser prcisment les
appellations du vignoble Bordelais ainsi que de les
les nommer.
0 20 km
Le vignoble
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 23/96
III Localisation - implantation
1) La localisation
Le premier eIIort du cartographe consiste a tracer sur sa carte, les objets geographiques.
Une carte constitue un plan de dessin a deux dimensions. Les objets geographiques y sont
localises par leurs coordonnees* x et y issues de leurs coordonnees geographiques sur la
sphere terrestre, respectivement la longitude* et la latitude*.
La !nca!IsatInn
Cette phase, consistant a reproduire l`ordre geographique des lieux, est rarement une etape
laborieuse, car il existe un nombre considerable de Ionds de carte (sous Iorme papier ou
numerique) : il suIIit de chercher et de trouver celui qui conviendra le mieux au travail
cartographique en question.
Encore Iaut-il rendre visibles sur le papier les objets geographiques et, dans le cadre de la
cartographie thematique, les donnees qui s`y rapportent. Pour cela, le cartographe dispose
des trois Iigures elementaires de la geometrie : le point, la ligne et la zone. A chaque Iigure
correspond une Imp!antatInn et des fIgurs symbn!Iqucs particuliers.
2) L`implantation
O L`implantation est la transcription cartographique d`un objet ou d`un phenomene
geographique sur un plan a deux dimensions. Il existe trois types d`implantation :
l`implantation ponctuelle pour des phenomenes peu etendus et localises
precisement dans l`espace (un point geodesique, une maison sur un plan
cadastral, la position d`un navire par exemple). Cette localisation est centree dans
y
X
Longitude
Latitude
Tout point sur la Terre est
lintersection d'un mridien
et dun parallle. Sur le plan
de la carte, les points sont
reprs par un systme de
coordonnes orthogonal ou
cartsien mis en
correspondance avec celui
des mridiens et des
parallles. Ils sont reports
en x et y.
La carte
La Terre
y
x
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 24/96
le plan de la carte sur un point, sans longueur, ni surIace. Le cartographe rend
visible ce point grce a un Iigure (rond, croix, dessin d`un navire...) qui peut
varier de taille, de valeur, de grain, de couleur, d`orientation et de Iorme.
L`implantation lineaire pour des phenomenes lineaires (routes, rivieres,
Irontieres, oleoducs, par exemple) localises par une ligne dans le plan de la carte.
Le cartographe rend visible cette ligne grce a un Iigure (une ligne) qui peut
varier de taille (en Iait de largeur), de valeur, de grain, de couleur, d`orientation
et de Iorme.
Les slgnes e|ementalres de |exresslon cartograhlque
L`implantation :onale pour des phenomenes etendus (un lac, un etat, une zone sur
un Plan d`Occupation des Sols par exemple) localises par une zone dans le plan de
la carte. Le cartographe rend visible cette zone grce a une plage de couleur ou un
aplat* qui peut varier de valeur, de grain et de couleur. Il ne peut en aucun cas varier
de taille, d`orientation ni de Iorme, car cela reviendrait a changer les dimensions de
la zone. TouteIois, si l`aplat est constitue de hachures ou de points par exemple, il
est possible de jouer sur la taille, l`orientation ou la Iorme, sans que les dimensions
de la zone ne soient aIIectees.
A noter
L'hnmngnIt du plan, que tout lecteur considere inconsciemment comme un Iait
acquis, entrane des consequences primordiales pour le travail du cartographe. Retenons
Le point
La zone
La ligne
Deux
dimensions
du plan
Troisime
dimension :
composante
de
qualification
W
W
W
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 25/96
que pour un mme Iait geographique, la representation et le traitement graphiques doivent
tre les mmes sur la carte. En cas de non respect de cette regle, le lecteur subdivisera
visuellement les diIIerents traitements et sera convaincu d`une heterogeneite spatiale qui
en realite n`existe pas.
Sur un mme plan, il est ainsi impossible d'assigner deux implantations diffrentes
un mme fait gographique. Par exemple, si une ville est positionne sur la carte
grce un point (implantation ponctuelle), les autres villes devront tre positionnes
de la mme manire.
Sur un mme plan, le decoupage administratiI sera similaire pour toutes les entites
geographiques representees : par exemple, la Belgique et les Pays-Bas divises en
provinces et non pas la Belgique dans sa totalite et les Pays-Bas en provinces. Autre
exemple, il serait Iaux de diviser sur une mme carte, une partie de la France en
departements et l`autre partie, en regions.
Compte tenu de l'homogeneite presumee du plan, il est Iortement deconseille de
caracteriser un phenomene par une absence de signes (un aplat blanc par exemple).
Toute la carte doit tre inIormee aIin que les blancs eventuels traduisent l`absence du
phenomene et non pas l`ignorance du phenomene qui est somme toute assez rare dans
les pays occidentaux.
Selon l`implantation, l`utilisation des variables visuelles sera plus ou moins aise et
eIIicace. En implantation zonale, les variations de couleur ou de valeur par exemple seront
plus visibles et potentiellement plus nuancees qu`en implantation ponctuelle ou lineaire,
car la tache visible par l`oil sera plus etendue.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 26/96
Homogenelte et contlnulte du |an de |a carte
Frquentation touristique
Source Atlas 2000
moins de 2 millions
2 - 7,5 millions
7,5 - 15 millions
plus de 15 millions
moins de 2 millions
2 - 7,5 millions
7,5 - 15 millions
plus de 15 millions
Belgique et Pays-Bas sont
diviss en Provinces. La
comparaison et
linterprtation sont
spontanes. Les Provinces
sont lquivalent des
Rgions en France (1
re
division administrative en
dessous de lEtat) mais
avec une superficie moindre
pour les premires
La Belgique est reprsente
dun seul tenant alors
que les Pays-Bas sont
diviss en Provinces. Cela
fausse le message de la
carte, car le lecteur spare
les deux pays alors que le
phnomne gographique
est identique.
Laisser en blanc une partie de la carte savre risqu, car visuellement,
labsence de signes transcrit soit labsence du phnomne, soit des
lacunes dans les donnes dont dispose le cartographe. Ici, cette solution
graphique nest donc pas logique.
o. a.
d. c.
Nombre de journes de vacances
par dpartement daccueil (moyenne
1981-1982)
Nombre de journes de vacances
par dpartement daccueil
(moyenne 1981-1982)
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 27/96
o A chaque type d'implantation correspond un type de Iigure.
Les figurs ponctuels : ce sont des constructions graphiques qui ont un contour
gomtrique (cercle, carre, rectangle, triangle, losange...) ou expressif, car ils
evoquent la Iorme reelle de la donnee representee (un avion pour un aeroport, une
croix pour une eglise...). Il existe bien sr une multitude de ces Iigures dits
expressiIs mais leur utilisation doit tre reIlechie.
Les figurs linaires : lignes simples ou Ileches, ces Iigures sont construits selon un
axe : ce sont des segments de droites ou des arcs de cercle.
Les figurs zonaux : appeles egalement figures de surface ou surfaciques, ils
couvrent une zone quelconque. On distingue les plages de couleurs des griss.
AutreIois cantonnees a la cartographie proIessionnelle, les plages de couleurs sont
aujourd`hui utilisables par tous. Leur expressivite est particulierement eIIicace et
implique des precautions d`usage.
Les grises permettent d`etaler sur une surIace, une gamme de teintes allant du blanc au
noir. Les grises regroupent l`aplat*, les hachures, droites paralleles dont on Iait varier
l`orientation, l`ecartement et la graisse, les trames (pointilles, quadrilles...) et les ponciIs,
Iigures repetees uniIormement et regulierement sur une surIace (une plante pour les
marais, des croix pour les cimetieres ou les terrains granitiques, etc.).
Les trols tes d'lm|antatlons en cartograhle et |es flgures corresondants
y
z
z
z
z
z
z
LATITUDL
Toutes les circonscriptions administratives (dpartements)
sont renseignes. Le message cartographique est fiable et
efficace.
Implantation lineaire
FIgur znna!
FIgur pnnctuc!
FIgur !InaIrc
Implantation ponctuelle
LONCITUDL
N
Implantation
zonale
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 28/96
x
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 29/96
IV Les variables visuelles
du langage cartographique
1) 1
re
variable visuelle : la taille
O Principes
On Iait varier la longueur, la largeur, la hauteur et par consequent la supcrficic du
Iigure. Ainsi, la variation de taille consiste en une variation de surIace.
En implantation ponctuelle, le Iigure peut tre geometrique ou IiguratiI. Il peut
egalement tre Iorme de morceaux accoles. En implantation lineaire, c`est
l`epaisseur de la ligne qui varie.
En implantation :onale, rappelons que l`on ne peut modiIier la surIace de la
zone. Cependant, les Iigures internes a la zone (points ou lignes) peuvent varier
en taille ou en nombre
Varlatlon de |a tal||e des flgures
O Conseils
Les tailles des Iigures seront bien diIIerenciees aIin que l`oil les peroive aisement et
rapidement.
Le nombre de paliers ne sera pas trop eleve : plus ce nombre sera grand, plus la legende
sera complexe et la carte diIIicile a lire.
A A A A A A
I n p I a n l a l i o n p o n c l u e I I e I n p I a n l a l i o n I i n e a i i e
I n p I a n l a l i o n z o n a I e
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 30/96
Le Iigure ayant la plus grande taille sera, sur la carte, place un niveau en dessous du
Iigure de moins grande taille et ainsi de suite.
La variation de taille n`est visible que pour des Iigures de valeur Ioncee. Il Iaudra donc
eviter les Iigures evides et blancs qui reduisent l`eIIet de la variation de taille
2) 2
me
variable visuelle : la forme
O Principes
Chaque Iigure possede une Iorme precise et determinee.
Changer la Iorme du Iigure en implantation ponctuelle et en implantation
lineaire consiste a changer son contour. Changer la Iorme d`un Iigure en
implantation :onale signiIie modiIier sa structure interne.
Les solutions sont illimitees : un Iigure geometrique tel qu`un losange peut
devenir un carre qui peut lui-mme tre transIorme en triangle...
Lorsque la structure d`un Iigure zonal est construite avec des elements
graphiques, des symboles ou un ensemble de symboles IiguratiIs (ou
evocateurs) aIin de signiIier l`etendue d`un Iait, on obtient un ponciI.
Varlatlon de |a forme des flgures
O Conseils
La multiplication des Iormes sur la carte nuit a la lecture et a la memorisation des
Iigures et necessite un recours trop Irequent a la legende.
La variable visuelle Iorme engendre parIois des eIIets
d`optique : a dimensions egales, un cercle paratra plus
petit qu`un carre ou qu`un triangle.
Alors que la variable visuelle Iorme est utilisee uniquement pour exprimer des differences,
cet eIIet d`optique peut suggerer une hierarchie.
I n p I a n l a l i o n I i n e a i i e I n p I a n l a l i o n p o n c l u e I I e
I n p I a n l a l i o n z o n a I e
L x e n p I e s d e p o n c i f s ( i n p I a n l a l i o n z o n a I e )
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 31/96
3) 3
me
variable visuelle : la valeur
O Principes
La valeur est le rapport entre la quantite de noir et de blanc sur une surIace donnee.
On agit donc sur la valeur en ajoutant du blanc ou du noir. Sur du papier blanc, c`est
le noir qui a la plus grande valeur. Mme si le Iait d`inIluer sur la valeur est parIois
delicat dans le cadre des travaux cartographiques manuels, cette variable visuelle est
la plus utilisee en cartographie apres la couleur.
Les logiciels et les trames vendues dans le commerce mesurent la valeur en
pourcentage : 100 correspond au noir, 0 au blanc tandis qu`un gris de 40
equivaut a 40 de noir et 60 de blanc. La variation de valeur est pour des raisons
pratiques plus usitee que la variation de grain, car elle n`impose pas un equilibre
entre le noir et le blanc.
Le cartographe dispose de quatre solutions (qui peuvent tre combinees entre elles
ou avec d`autres variables visuelles) pour varier la valeur :
o changer la trame (ou texture). La trame est la structure interne d`un Iigure.
o La variation de trame s`obtient en composant et en Iaisant varier des
ensembles d`elements graphiques simples, ponctuels ou lineaires, repartis de
Iaon parIaitement. La trame est donc une organisation, un dessin, de type
hachures, pointilles, croisillons, damiers, etc
o Changer la graisse, c`est-a-dire l`epaisseur des Iigures.
o Changer l`ecartement, c`est-a-dire la distance entre les elements de la trame des Iigures.
o Changer la teinte (ou la saturation)
La teinte est la quantite de blanc et de noir pour une couleur donnee. On agit donc sur la
teinte d`une couleur en y ajoutant du blanc ou du noir. La variation de teinte s`applique au
noir et a toutes les couleurs de l`arc-en-ciel. La variation de teinte est monochrome : le
passage du blanc au jaune pur est une variation de teinte et non de couleur.
Varlatlon de telnte (ou de saturatlon) et donc de |a ta|eur du b|anc au nolr
O Conseils et remarques
La valeur est, en noir et blanc ou combinee avec la couleur, la seule variable visuelle
capable de visualiser une serie ordonnee a partir d`une serie statistique divisee en classes
par exemple .
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 32/96
A l`inverse, la valeur ne doit jamais tre utilisee pour exprimer des quantites, car elle
n`autorise aucune evaluation de ces quantites.
|a ta|cur nc |radui| pas dcs quan|i|cs
Pour obtenir une meilleure selection des paliers, la bonne methode est de combiner la
variation de trame avec une variation de teinte et/ou une variation de l`orientation.
AIin de respecter la gradation de valeur, il Iaut toujours aller du clair au Ionce).
L`oil ne s`accommode que d`un nombre limite de paliers sinon il ne peroit pas ou mal
la variation de valeur : quatre au maximum en implantation ponctuelle et lineaire, sept ou
huit en implantation zonale. Il Iaut egalement prendre garde a bien diIIerencier les paliers.
Pour cela, il convient d`utiliser l`extension maximale de la gamme : celle du blanc au noir.
Eviter cependant l`usage du blanc qui laisse presumer au lecteur soit la non possession
de l`inIormation, soit un espace vide alors que ce n`est pas le cas.
La progression doit tre constante, c`est-a-dire visuellement equidistante, sauI si l`on
veut introduire une rupture entre deux valeurs aIin d`exprimer une rupture observee dans
la realite.
La ta|eur ne dolt as tre desordonnee
240 - 1500
1500 - 2500
2500 - 4500
4500 - 10700
Nombre dhabitants au
recensement de 1990
240 - 1500
1500 - 2500
2500 - 4500
4500 - 10700
les quantits sont traduites
par une variation de valeur :
pas dvaluation possible et
recours la lgende trop
contraignant
= erreur !
les quantits sont traduites par une
variation de taille (en fait de la
superficie) des ronds = lecture
immdiate et bonne mmorisation
Densit (au km) au
recensement de 1990
28 -71
71 - 130
338 - 900
les gris ne sont
pas ordonns
suivant lordre des
taux
= erreur !
130 338 130 338
28 -71
71 - 130
338 - 900
les gris sont
ordonns suivant
lordre des taux
= image fiable
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 33/96
4) 4
me
variable visuelle : le grain
O Principes
Faire varier le grain consiste a modiIier l`epaisseur des elements constitutiIs d`une trame
sans que l`equilibre noir (couleur du Iigure) - blanc (couleur de Iond) ne soit rompu.
O Conseils
Le grain trouve son expression optimale en implantation zonale mais un eIIet vibratoire
peut apparatre sur grande surIace.
Comme pour la valeur, les paliers doivent tre bien diIIerencies et peu nombreux (4 a 5
en implantation zonale, 3 a 4 en implantation lineaire, 2 a 3 en implantation ponctuelle).
5) 5
me
variable visuelle : l`orientation
O Principes
Cette variable visuelle s`applique particulierement aux hachures qui peuvent tre
verticales, horizontales ou obliques mais egalement aux quadrilles et aux Iigures
ponctuels.
O Conseils
L`orientation utilisee seule n`a aucun pouvoir visuel pour exprimer une variation de
valeur. On cherchera a la combiner avec d`autres variables visuelles telles que la graisse
ou l`ecartement.
L`orientation est tres eIIicace en implantation lineaire, un peu moins en implantation
ponctuelle et tres peu en implantation zonale.
Il est recommande, pour garantir l`eIIicacite visuelle, de ne pas depasser cinq
changements d`orientation (quatre etant le chiIIre optimal).
Varlatlon de |orlentatlon
6) 6
me
variable visuelle : la couleur
O La terminologie utile pour la cartographie
Des hachures
trop
rapproches
crent un effet
de vibration
dplaisant.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 34/96
Le vocabulaire de la couleur est abondant mais rarement utilise opportunement. Par
exemple, les vocables teinte, nuance, tonalite, luminosite ou clarte sont tous passes dans
le langage courant mais leur sens reste le plus souvent obscur. Dans le cadre de la
cartographie, seuls quatre termes sont a connatre et a retenir pour matriser cette variable
visuelle particulierement subtile qu`est la couleur : il s`agit de la couleur, de la valeur, du
ton et de la saturation.
La couleur
o La couleur est la sensation transmise a notre cerveau par la vision d`un objet colore eclaire. Trois elements
interviennent dans cette sensation de couleur : notre svsteme visuel recepteur (cerveau puis oil), la nature
de l`objet et la lumiere qui l`atteint. Ainsi une orange apparat de couleur orange lorsqu`elle est eclairee
d`une lumiere blanche ou approximativement blanche mais de couleur bruntre si la lumiere vire au bleu
ou au vert. Puisque la sensation de couleur est tributaire de la lumiere, il est toujours important de
consulter un document couleur avec des conditions de lumiere optimales (la lumiere blanche est la plus
neutre).
o Sur le spectre solaire, la sensibilite de notre oil aux couleurs issues de la decomposition de la lumiere
blanche par le prisme presente un maximum au niveau de la lumiere jaune (560 nanometres) et decrot
regulierement de part et d`autre de cette longueur d`onde pour s`annuler en dessous du violet (on atteint
les ultraviolets) et au-dela du rouge puis du pourpre (on atteint les inIrarouges).
La valeur (parIois appele intensite ou luminosite)
On rappelle que la valeur est le rapport entre les quantites de noir et de blanc
perues dans une surIace donnee. Les principes de la variable visuelle valeur en
noir et blanc sont identiques en couleur. On associe deux variables visuelles
distinctes (valeur et couleur) aIin de Iaire varier la quantite de noir ou de blanc dans
une couleur. On obtient ainsi une gradation de couleur.
Le ton ou tonalite
Le ton est la combinaison entre une couleur et une valeur. Aux grandes categories
de couleurs (dans l`ordre du spectre solaire, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge,
pourpre) auxquelles on ajoute le gris, on soumet des variations de valeur. Par
exemple, dans la couleur rouge, le rouge clair, le rouge sature et le rouge Ionce sont
trois tons diIIerents. De plus, il est possible d`assembler les couleurs entre elles, et
ce dans leur diIIerents pourcentages de valeur. Les solutions semblent inIinies
d`autant plus que l`oil humain est capable de distinguer, separer et deIinir un
nombre considerable de tons.
A noter
Le jaune est une tonalite qui oIIre un contraste tres Iaible avec le blanc, car elle est tres peu intense., le jaune
constitue un seuil physiologique en dessous duquel l`oil humain distingue les tons Iroids et au-dessus duquel il
distingue les tons chauds.
Les couleurs chaudes sont le jaune, l`orange, le rouge et leurs derives et les couleurs Iroides sont le violet et
surtout le bleu. Le rouge est la couleur la plus saillante, car elle excite nos sens tandis que le bleu est Iuyant et
reposant.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 35/96
La saturation
Chaque couleur contient une valeur centrale sans noir ni blanc : c`est le ton pur
ou sature. La saturation est mesuree (en pourcentage) par la quantite de blanc et
de noir que contient une couleur : une couleur saturee ou pure renIerme 0 de
blanc et 0 de noir ; elle apparat eclatante a nos yeux..
O Utilisation de la couleur en cartographie
Les couleurs ont vis-a-vis de notre psychisme des inIluences qui se maniIestent
par des reactions privilegiees. En eIIet, chaque couleur stimule des associations
d`idees et des eIIets psychologiques, physiques et physiologiques propres a
chaque individu selon son vecu, sa culture, sa religion et sa physiologie. Cette
caracteristique est decisive pour les cartes publicitaires et joue un rle notable
dans la conception de toutes les cartes en couleurs : cela rend leur conception
delicate mais passionnante. Il existe ainsi des couleurs qui donnent une
impression de chaleur et d`autres une impression de Iracheur. Les couleurs
chaudes sont le jaune, l`orange, le rouge et leurs derives et les couleurs Iroides
sont le violet et surtout le bleu.
De mme, on parle de couleurs evocatrices, parce qu`elles rappellent les couleurs
rencontrees dans la nature : le vert des Iorts, le jaune des cereales et du sable, le
bleu de l`eau, etc. Les couleurs chaudes symbolisent la chaleur, la secheresse,
ce qui est positiI tandis que les couleurs Iroides evoquent le Iroid,
l`humidite, ce qui est negatiI . Dessiner une industrie lourde en vert ou une
diminution en rouge n`est pas une Iaute technique mais complique la lecture.
Les cinq autres variables visuelles (taille - Iorme - valeur - grain - orientation)
sont assez eIIicaces pour transcrire tous les cas de Iigures possibles et
imaginables qu`il est possible de rencontrer en cartographie. En d`autres termes,
Il existe une telle variete de moyens visuels avec le noir et blanc que l`usage de
la couleur est loin d`tre indispensable en cartographie. Seules les cartes de
geographie physique ou d`occupation du sol complexes jouant sur le pouvoir
selectiI de la couleur (les cartes geologiques par exemple) sont diIIicilement
realisables voire irrealisables en noir et blanc.
TouteIois, la couleur est la variable visuelle qui possede le pouvoir diIIerentiel le
plus eIIicace, d`ou l`hegemonie de la couleur dans la cartographie de
l`inIormation qualitative. De plus, la couleur exprime mieux les hierarchies que
le noir et blanc car les variations de valeur en couleur sont plus Iaciles a saisir
que celles des trames de noir. Elle possede en outre une incontestable superiorite
esthetique sur les cinq autres variables visuelles. Elle seduit d`emblee notre oil
qui preIere un ciel bleu a un ciel gris. Les documents couleurs sont en outre plus
rapidement memorises que les documents noir et blanc. EnIin, objectivement, la
couleur Iacilite grandement le travail du cartographe pour qui le choix des trames
ou des grises en noir et blanc est parIois malaise.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 36/96
La democratisation et l`attrait de la couleur ne doivent pas Iaire oublier les
problemes et les subtilites inherents a son emploi. Hormis l`elevation des cots
qu`elle entrane (impression, duplication, diIIusion), les problemes viennent
souvent d`une meconnaissance des quatre parametres Iondamentaux decrits ci-
dessus et qui conduit dans le meilleur des cas a des cartes tres esthetiques mais
desastreuses d`un point de vue technique et donc inutiles.
Conseils pour lusage de la couleur en cartographie
Les couleurs, a valeur egale, sont opposables. La couleur est ainsi de tres loin la
variable visuelle la plus eIIicace pour cartographier des objets geographiques
qualitativement diIIerents (habitat urbain, industrie, espace vert par exemple) que l`on veut
opposer graphiquement. TouteIois, il convient de noter que le choix de la gamme des tons
purs (violet sature, bleu sature, vert sature, etc.) produit certes une variation de couleur
mais egalement une variation de valeur. En d`autres termes, un jaune sature ne sera pas au
mme niveau visuel qu`un rouge sature : cette particularite est a prendre en compte lorsque
l`on cartographie des diIIerences qualitatives, sinon l`oil lira avant tout un ordre (un
classement) et non une diIIerence. La deuxieme erreur a ne pas commettre est d`utiliser
une variation de couleur (sans variation de valeur) pour exprimer un ordre.
En eIIet, pour traduire un ordre, un classement, la couleur doit tre combinee avec la
valeur. L`enjeu est de communiquer le plus spontanement possible une sensation de
hierarchie traduite par exemple par une serie discretisee. Il Iaut respecter un principe de
base : une valeur Iorte est transcrite par une couleur intense ou sombre et une valeur Iaible
par une couleur claire. On doit obtenir une gradation de tons allant du plus clair au plus
Ionce (et inversement si l`ordre est decroissant). Cette gradation est obtenue a l`aide de
plusieurs procedes.
La premiere solution est le camaeu, appele egalement harmonie de valeurs. Le camaeu consiste en une
variation monochrome (c`est-a-dire une mme couleur) de valeur, du clair au Ionce ; par exemple, rouge tres
ple, ple, viI, sombre, tres sombre. Cette methode, tres simple, a pour merite d`eviter des erreurs parIois
commises avec les solutions suivantes.
La deuxieme solution est l`harmonie de nuances. La perception ordonnee s`accomplit a l`aide de plusieurs
couleurs voisines prises dans chaque moitie de l`arc-en-ciel ( gamme Iroide et gamme chaude )
auxquelles on peut ajouter une variation de valeur ; par exemple, jaune, jaune orange, orange, rouge orange,
rouge ( gamme chaude ).
Il est enIin possible d`enrichir un camaeu. Un camaeu de rouge (du rouge clair ou blanc au rouge sature) peut
se prolonger d`un jaune tres leger dans le bas et d`un violet dans le haut. Un camaeu de verts peut s`enrichir
d`un jaune tres clair dans le bas, de bleu Ionce ou de brun dans le haut. Il n`est pas interdit egalement de
commencer une gradation par du blanc (attention a l`usage du blanc qui transcrit une absence d`inIormation) et
de la terminer par du noir. Dans tous les cas, il Iaut respecter la gradation (du clair au Ionce) de tons et l`ordre
des couleurs dans l`arc-en-ciel.
Dans le cas d`une serie statistique comportant des valeurs positives et des valeurs
negatives (serie bipolaire), ou si l`on veut cartographier des ecarts a la moyenne, la
premiere methode est d`avoir recours a une gamme double, en utilisant tout l`arc-en-ciel.
On mise sur le contraste de deux demi-spectres : l`un constitue de couleurs chaudes
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 37/96
(du jaune clair au rouge par exemple) et l`autre de couleurs Iroides (du vert au bleu-
violet par exemple). L`autre solution, moins risquee, est d`aIIronter deux camaeux (par
exemple, le premier camaeu irait du rouge clair au rouge sature et le deuxieme camaeu,
du bleu clair au bleu sature). Par convention, les couleurs chaudes transcrivent la
croissance et les couleurs Iroides, la decroissance. Ainsi, dans une carte de variation de la
population, les augmentations sont souvent traduites en rouge et les diminutions en bleu.
Dans les deux cas (demi-spectres ou deux camaeux), un blanc ou un jaune leger peuvent
servir a exprimer la valeur zero (stagnation) ou la moyenne.
AIin que la gradation des couleurs et des valeurs transmettent le plus eIIicacement
possible une sensation d`ordre, il Iaut respecter l`ordre des couleurs dans l`arc-en-ciel et
une progression des valeurs. Cette erreur est classique chez les non-inities mais ses eIIets
sont redoutables, car elle annihile tout ou partie du message : un bleu intercale dans une
gamme de vert, une progression de oranges se terminant par des tons bleus, une valeur
placee en Iin de gamme plus claire que celle qui la precede sont des Iautes qui alterent la
lecture et la memorisation. De mme, il Iaut veiller a une diIIerenciation des paliers de
valeurs pour que l`oil discerne rapidement les seuils.
Il Iaut eviter les aplats de couleurs lumineuses, trop vives et saturees (notamment le
jaune, l`orange et le rouge) qui ressortent violemment et agressent le lecteur. Elles
occasionnent une Iatigue visuelle et nerveuse detournant le lecteur de la carte.
Certaines couleurs Iont paratre les Iigures cartographiques plus massiIs, ce sont le brun
et le noir, d`autres donnent au Iigure un aspect plus aerien, plus leger, ce sont les couleurs
pastels qui ont des teintes claires, le bleu ciel par exemple. Le voisinage de la couleur
inIluence beaucoup sa perception : une couleur entouree de noir apparat plus sombre que
lorsqu`elle est entouree de blanc ou d`une couleur tres claire. Les tons chauds ressortent
plus que les tons Iroids d`ou l`application des tons chauds aux valeurs Iortes, ou positives.
ParIois, il convient d`adapter la couleur au theme cartographie, au contexte et a la ou les
personnes susceptibles de lire la carte. Le rouge par exemple sera interprete par certains en
priorite comme une hausse ou un symbole de vitalite et de dynamisme. D`autres enIin y
verront un avertissement ou un danger. En outre, l`usage de la couleur est susceptible
d`tre guide par l`engagement du cartographe. Par exemple, il n`est pas rare de consulter
des cartes ou des baisses sont transcrites par des couleurs chaudes : l`auteur veut de cette
maniere insister sur un Iait qui selon lui est inquietant. Cet artiIice doit-il tre considere
comme une manipulation de l`inIormation geographique ou comme un moyen d`echapper
a des habitudes cartographiques ? En resume, l`usage de la couleur est particulierement
delicat. A l`inverse, le noir et blanc laisse inIiniment moins de place aux prouesses
techniques, aux interpretations voire aux fantaisies du cartographe.
Avant de concevoir une carte en couleurs, il Iaut poser le probleme de la reproduction :
une photocopie noir et blanc d`un document couleur est souvent tres decevante
esthetiquement et trahit parIois le document originel. En ce qui concerne les gradations
de couleurs du clair au sature et les camaeux, si le choix des gradations de couleurs et de
tons est satisIaisant, il doit tre possible de photocopier (ou d`imprimer en noir et blanc)
la carte couleur en noir et blanc sans perdre ses proprietes. Pour la diIIerenciation des
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 38/96
objets geographiques, le niveau de valeur entre les couleurs est constant. De ce Iait, le
passage en noir et blanc donnera des tons de gris quasiment semblables d`ou la perte
integrale de l`inIormation initiale.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 39/96
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 40/96
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 41/96
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 42/96
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 43/96
V Qu`exprime-t-on avec le langage cartographique
et avec quelles variables visuelles ?
Les donnees dont le cartographe dispose appartiennent a un systeme qui met en relation
n`importe quelle donnee avec les autres donnees. Une carte sert a visualiser ces relations
grce a des transIormations que l`on Iait subir aux points, aux lignes et aux zones a l`aide
des variables visuelles. Il existe trois types de relations : la proportionnalite, l`ordre et la
diIIerence. Si une donnee recouvrait l`integralite de la carte sans presenter aucune
variation (en importance, en nature, en densite...), alors la representation cartographique ne
serait d`aucune utilite. Le but d`une carte et notamment d`une carte thematique est de
visualiser outre la localisation des donnees, des conIigurations spatiales, des contrastes,
des Iormes issus des relations de proportionnalite, d`ordre (ou de classement) et de
diIIerence (ou d`association) qui existent entre les donnees. On aboutit alors a
l`inIormation geographique.
1) Des quantits, des proportions (information quantitative)
L`inIormation est quantitative quand elle donne une mesure chiIIree du phenomene.
On distingue deux types de quantites : les quantites en valeur absolue et les quantites en
taux. Leur representation cartographique n`est pas la mme.
O Les quantits en valeur absolue ou masses
Elles resultent d`un denombrement (exemple : 100 habitants, 70 000 tonnes, 50 000 ttes).
En implantation ponctuelle, les masses sont representees par des Iigures dont la
surIace est proportionnelle au nombre. La variable visuelle utilisee est la taille.
En implantation lineaire (debit d`une route, Ilux de migrants), les masses sont
transcrites par l`epaisseur des traits. La variable visuelle utilisee est la taille. Il est
conseille de commencer, pour les valeurs les moins elevees, avec des Iigures tres
Iins (du type tirete pour les valeurs les plus Iaibles). Cela evite d`encombrer le
Iond de carte avec des traits trop epais pour les valeurs les plus Iortes.
En implantation zonale, theoriquement, il n`est pas possible de visualiser les
masses sans tenir compte de la superIicie de la circonscription. Dans la pratique,
on assimile souvent, par souci de simplicite lors de la realisation graphique, la
circonscription a son centre qu`on traite comme un point : on regroupe les
quantites de la circonscription sur un seul Iigure et on utilise la variable visuelle
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 44/96
taille. La deuxieme solution consiste a repartir sur chaque circonscription des
points d`egale valeur en disposition homogene.
La taille est la seule variable visuelle capable de traduire correctement les quantites
absolues, car elle autorise la perception des proportions.
Exresslon cartograhlque de quantltes (en ta|eurs abso|ues)
200
20
10
10
100 60
50 10
50
10 50 100 200
Nombre dhabitants Trafic routier (vhicules/jour)
Nombre dhabitants
100
500
1000
2000
5500
9300
1250
1300
7500
100
725
500
500
1000
100
100
1000
2000
2000
Implantation ponctuelle Implantation linaire Implantation zonale
un point = 250 habitants
O Les taux
Ils sont calcules :
par rapport a une autre variable (pourcentage de bacheliers dans une classe d`ge,
depense municipale par habitant, nombre de vols de voitures par rapport au total
des habitants),
par rapport a un total auquel concourt la variable (pourcentages de cadres
superieurs dans la population active, nombre de beneIiciaires de l`allocation
logement par rapport au nombre de beneIiciaires de prestations Iamiliales),
par rapport a la superIicie de la circonscription (nombre d`habitants au km,
nombre de quintaux a l`hectare).
Un taux ne s`exprime donc pas seulement en pourcentage.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 45/96
En implantation ponctuelle, c`est-a-dire lorsque le taux est donne pour un point, on
centre le Iigure sur ce point et on Iait varier la valeur ou l`intensite de la couleur du
Iigure.
En implantation lineaire, les Iigures centres sur une ligne gardent la mme largeur
et on fait varier leur valeur ou l`intensite de leur couleur (par exemple, nombre de
voitures par kilometres de route, pourcentage de T.G.V. par rapport au traIic
Ierroviaire total).
En implantation zonale, on Iait varier la valeur ou l`intensite de la couleur du figur
de surface (par exemple, nombre de monuments classes au kilometre carre, nombre
de salles de cinema pour 10 000 habitants).
Exresslon cartograhlque de quantltes (en taux)
20
6
10
27
33
12
25
10
45
Frquentation des muses
(% de scolaires)
% de poids lourds
Densit de population
Nombre dhabitants au km
10-20
20-30
30-40
0-5
120
90
70
300
170
100
50
50-100
100-150
150-200
200-300
5-15
15-25
25-35
35-50
Implantation ponctuelle Implantation linaire Implantation zonale
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 46/96
2) Un classement, un ordre (information ordonne)
O En classant, on suppose qu`une inIormation est superieure ou inIerieure a une autre.
Il est par exemple courant de classer les villes selon leur niveau de Ionction
(capitale, preIecture, sous-preIecture, cheI-lieu de departement,...).
Les donnees se trouvent dans une relation d`ordre quand il est possible de deIinir et
de percevoir leur importance relative les unes par rapport aux autres.
Un ordre se represente techniquement sans trop de diIIicultes. Mais exprimer un
jugement de valeur (cette donnee est plus importante que celle-la ou cette donnee
vient en premier, celle-ci en deuxieme...) demande une grande circonspection au
niveau de la methodologie.
O L`echelle des valeurs doit tre tres precise (eviter les vocables bon ,
satisIaisant , mauvais ) mais il Iaut aussi et surtout tre tres attentiI a ne pas
hierarchiser des phenomenes dont l`egalite est une certitude. Les cartes ethniques ou
de religion ne seront pas hierarchiques, car elles peuvent tre assimilees a des
documents racistes ou antisemites. Dans ce cas, la seule option sera d`exprimer une
diIIerence, cartographiquement parlant.
Exresslon cartograhlque dun c|assement
Organisation administrative Rseau routier Structure par ge
DepailenenlaIe
NalionaIe
Auloioule
ConnunaIe
2O-5O jeunes
2O-3O aduIles
15-45 jeunes
25-35 aduIles
1O-3O jeunes
25-45 aduIles
5-15 jeunes
2O-3O aduIles
Chef-Iieu de canlon
Chef-Iieu
dAiiondissenenl
Chef-Iieu de depailenenl
C.C
C.C.
C.C.
C.C.
C.A.
C.A.
C.D.
Implantation ponctuelle Implantation linaire Implantation zonale
Dpartementale
Communale
Autoroute
Nationale
100
1
00
0
10
20
30
60
70
90
90 80 70 60 50 30 20 10
0
40 100
80
50
40
90
80
70
60
50
30
40
20
10
0
jeunes vieux
adultes
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 47/96
En implantation ponctuelle, on joue sur la valeur de la couleur des Iigures.
(exemples : hierarchie des campings selon leur nombre d`etoiles ; monuments
classes et monuments inscrits a l`inventaire)
En implantation lineaire, on Iait varier la valeur de la couleur des Iigures
(exemples : autoroute, route nationale et route departementale ; limite d`Etat, limite
de departement et limite d`arrondissement).
En implantation zonale, les variations sont basees sur la valeur de la couleur.
(exemples : zone Iortement urbanisee, zone d`habitat lche ; cultures intensives,
cultures extensives).
Si on veut exprimer un classement grce a la couleur, il Iaut soit utiliser un camaeu (par
exemple du bleu ciel au bleu marine), soit utiliser un demi-spectre (du jaune au rouge
Ionce par exemple).
La valeur est une variable visuelle qui permet de traduire un ordre, car l`oil classe les
taches grisees de la plus claire a la plus Ioncee. Il associe aux taches claires les valeurs les
plus Iaibles et aux taches Ioncees, les valeurs les plus Iortes.
Le grain peut exprimer un classement mais est rarement utilise.
La Iorme, utilisee seule, n`exprime pas une relation d`ordre.
3) Une diffrence, une distinction (information qualitative)
Exprimer une diIIerence est, a l`inverse d`un classement, simple au niveau de la methode
mais delicat dans la pratique : il est obligatoire que tous les Iigures aient la mme taille et
la mme valeur sinon une hierarchie apparat. L`habilete du cartographe reside dans le
choix des variables visuelles ayant des vertus separatives (qui permettent dexprimer une
difference).
En implantation ponctuelle, les contours des Iigures seront bien diIIerencies
(exemples : ecole privee et ecole publique, exploitation en Iermage et exploitation
en metayage).
On utilise les variables visuelles forme ou couleur (couleurs opposables).
En implantation lineaire (exemple : autoroutes gratuites et autoroutes payantes), on
ne joue ni sur la largeur de la ligne, ni sur la valeur. Il ne reste donc que deux
solutions, celles de Iaire varier la forme ou la couleur (couleurs opposables) du
Iigure.
En implantation zonale, les variables visuelles a utiliser sont soit la forme, soit la
couleur (couleurs opposables), soit l`orientation. Pour l`orientation, il Iaut prendre
garde a ce que l`espacement et l`epaisseur soient constants. (exemples : zone N et
zone U du P.O.S., culture de bles et culture de mas).
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 48/96
Exresslon cartograhlque de |a dlfference
Rseau routier Plan dOccupation des Sols
Roule
CanaI
Voie feiiee
Zone UA
Zone U
Zone NA
Cenlie sociaI
C.C.I.D.
Maison de Quailiei
CS
CS
MQ
MQ
MQ
CCPD
Les acteurs sociaux
UB
UB
UA
UB
UB
NA
NA
Implantation ponctuelle Implantation linaire Implantation zonale
Route
Voie ferre
Canal
Route
Route
Route
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 49/96
Exresslon cartograhlque des re|atlons de roortlonna|lte, dordre
et de dlfference entre |es donnees en nolr et b|anc - recaltu|atlf -
Implantation
linaire
Implantation
zonale
Implantation
ponctuelle
Masses Taux
4
-
]
^
+
V
V
V
V
Quantite Classement DiIIerence
IossiliIile duliIisei Ia laiIIe nais de
faon indicalive puisque non chiffiee
VarIab!cs vIsuc!!cs cn NB
Oiienlalion
Ioine
Ciain
VarIab!cs vIsuc!!cs cn NB
VaIeui
Ciain
VarIab!cs vIsuc!!cs cn NB
VaIeui
VarIab!cs vIsuc!!cs cn NB
TaiIIe
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 50/96
4) En rsum, pour une bonne utilisation des variables visuelles
Tab|eau recaltu|atlf de |'utl|lsatlon des slx tarlab|es
DIffrcnccs C!asscmcnt
Ordrc
PrnpnrtInns
cn va!cur
absn!uc
PrnpnrtInns
cn taux
TAILLE
VALEUR
COULEUR
ORIENTATION
FORME
GRAIN
: IntcrdIt : dcnnscI!! : bnn : Ida!
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 51/96
VI Respecter les rgles
pour concevoir une carte sans erreurs
O Il peut paratre subjectiI voire pretentieux d`aIIirmer qu`une carte puisse tre de
meilleure qualite qu`une autre. Quels sont en eIIet les criteres permettant de juger en
toute impartialite de la valeur d`une carte ? Ou, pose d`un point de vue
pedagogique, quelles sont les erreurs a eviter pour concevoir une carte de qualite ?
De l`amont a l`aval du processus de la conception et de la realisation d`une carte, il
est possible d`identiIier cinq erreurs majeures :
le manque de soin et de precision dans la collecte et le traitement des donnees,
une utilisation incorrecte du langage cartographique,
la realisation d`une carte surchargee et/ou illisible,
la realisation d`une carte incomplete,
la realisation d`une carte a lire, c`est-a-dire une carte qui n`est pas une carte.
O On peut s`etonner de ne pas trouver dans cette enumeration d`erreurs, le Iait de
realiser une carte mal presentee ou peu soignee. Cela renvoie donc au critere de
l`esthetique.
Le probleme est que l`esthetique est un critere subjectiI puis tributaire des moyens
techniques mis en oeuvre et enIin relatiI au type de carte en question. Dans tous les
cas, en tant que concepteur d`une image, le cartographe experimente n`est pas a
l`abri d`une Iaute de got tandis qu`une carte esthetiquement tres reussie n`est pas
Iorcement denuee d`erreurs. Il est donc diIIicile voire impossible de Iixer des limites
en matiere d`elegance de presentation.
TouteIois, mme en cartographie thematique, l`esthetique commande une bonne
partie de l`eIIicacite du message de la carte : une carte nette, sobre et graphiquement
bien conue, est regardee avec plus d'attention, car elle communique plus
eIIicacement qu`une carte peu soignee. En cela, l`inIormatique s`avere tre d`un
grand secours aux dessinateurs peu entranes.
Le manque de soin apporte a la realisation d`une carte n`est pas a proprement parle
une erreur mais plutt une maladresse dont les consequences sont Iorcement
nuisibles au resultat Iinal. Mme le cartographe le plus averti est susceptible de
commettre des maladresses mais les erreurs sont plus graves, car elles resultent d`un
non respect des regles de base d`ou l`importance d`observer scrupuleusement les
cinq commandements suivants.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 52/96
1) Etre rigoureux avec la collecte et le traitement des donnes
O Toutes les cartes sont le resultat d`observations et la transcription graphique de
donnees quantitatives ou qualitatives. Une carte topographique par exemple est
l`aboutissement de travaux de geodesie*, de planimetrie, de topographie, etc. Pour
les cartes thematiques, la transIormation de la donnee brute en une representation
cartographique apparat moins technique mais necessite tout autant de rigueur dans
le rassemblement et le traitement des donnees. Leur Iorme originelle ainsi que leur
provenance sont variables : statistiques, cartographiques, resultats d`enqutes,
recensement, leves, etudes de terrain, etc.
O Trop nombreuses pour tre directement cartographiees, les donnees doivent Iaire
l`objet de traitements (mathematiques, graphiques, statistiques et Irequemment
d`une mise en classes).
Rappel pour un bon usage de l`expression cartographique
0onnes : qua||tat|ves ou quant|tat|ves
Mise en adequalion de IinpIanlalion du figuie el des
vaiialIes visueIIes
Loca||sat|on gograph|que des donnes
6arte v|sue||ement pert|nente et eff|cace
Re|at|on entre |es donnes
IiopoilionnaIile
Oidie
Diffeience (ou associalion)
|mp|antat|on sur |e fond de carte des
donnes
Adaplei au nieux IinpIanlalion
au fond de caile (en fonclion de
IecheIIe}
F|gurat|on des donnes
6ho|x des var|ab|es v|sue||es
Choisii Ies vaiialIes visueIIes qui
liaduisenl au nieux Ies ieIalions
enlie Ies donnees.
Ciain
Oiienlalion
CouIeui
Ioine
TaiIIe
VaIeui
Iiguie ponclueI Iiguie Iineaiie
InpIanlalion ponclueIIe
InpIanlalion Iineaiie
InpIanlalion zonaIe
Analyse
et
traitement
des
donnees
Expression
visuelle
Creation de
la carte
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 53/96
O Quoiqu`il en soit, si le cartographe represente des donnees Iausses a cause de
sources douteuses, d`oublis ou de mauvais traitements statistiques par exemple, la
carte sera elle-mme Iaussee et les consequences peuvent tre graves notamment
pour les cartes d'aide a la decision. Le lecteur a tres peu de chances de detecter ce
type d`erreurs sauI s'il a acces a d`autres sources d`inIormations.
O TouteIois, dans le cadre d`une cartographie a usage interne, la precision a ses
limites. Les collectivites locales par exemple preIerent souvent avoir un ordre d`idee
sur les principaux indicateurs plutt que viser une rigueur scientiIique gaspilleuse de
temps et d`energie et souvent superIlue.
2) Le traitement graphique doit tre judicieux (du bon usage de
l`expression cartographique)
L`erreur la plus communement repandue tient a la representation graphique des donnees.
La quasi absence de conventions en cartographie pourrait laisser penser que tout est
possible. En theorie, oui, mais la vision humaine a ses proprietes ; si le cartographe n`a
pas respecte les regles du langage cartographique, la carte devient Iausse et/ou illisible et
de toute Iaon improductive.
3) Une carte doit tre lisible (nette et conomique)
L`un des apports majeurs de la carte est de contribuer a saisir immediatement une
problematique. A la diIIerence d`un tableau ou d`un texte, une carte est capable d`associer,
de simpliIier et de synthetiser les composantes d`un phenomene geographique. Ces
qualites apparaissent si le message est net et concis.
Conseils pour garantir la lisibilit dune carte
La presentation graphique doit tre soignee.
Ce postulat est celui qui rebute le plus les cartographes amateurs rarement sensibilises aux
arts graphiques. Avec Cartes & Donnes, c`est l`ordinateur qui dessine avec tout ce que
cela implique en terme de precision et de rapidite du trait.
Il Iaut travailler a l`economie.
Etrangement, une carte tres detaillee donne davantage conIiance, mme si elle est erronee.
Une carte epuree trouble le lecteur qui met en doute sa Iiabilite. Pourtant, les meilleures
cartes ne sont pas celles qui comportent le plus de signes, au contraire. Moins une carte est
surchargee, plus la carte est simple de lecture et plus le message est eIIicace. Le
cartographe est ainsi amene a eviter les legendes interminables. Lorsque les signes sont
nombreux, les superpositions deviennent inevitables et diIIiciles a gerer puis a lire. Il ne
Iaut donc pas utiliser plusieurs signes pour un mme Iait (un Iigure ponctuel et un Iigure
zonal par exemple).
Les Iigures doivent tre bien diIIerencies.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 54/96
La lisibilite d`une carte passe aussi par une bonne diIIerenciation des Iigures. C`est ce que
l`on nomme la separativite. Deux Iaits diIIerents seront identiIies sur la carte sans risque
de conIusion.
Les Iigures doivent tre hierarchises.
Une carte representant plusieurs phenomenes est lisible et expressive si elle est
hierarchique.
Si le lecteur n`est pas capable de trier et d'hierarchiser visuellement les inIormations
representees, en d`autres termes si aucune conIiguration spatiale ne se degage de la carte,
alors celle-ci n`aura pas atteint son objectiI. Pour garantir la hierarchisation des Iaits
representes et donc la hierarchisation des Iigures sur la carte, le concepteur doit se poser
deux questions :
Que faut-il montrer ?
Cela suppose de la part du cartographe, un eIIort de synthese : il doit decider des
phenomenes a representer et a eliminer. Cela aboutit a une simpliIication de la realite.
Que faut-il mettre en valeur ?
En Ionction du theme, de la destination de la carte et du public vise, le cartographe doit
assumer l`initiative d`une mise en relieI de certains Iaits et du retrait d`autres Iaits. Cette
mise en valeur et son contraire s`accomplissent grce a toutes les solutions oIIertes par le
langage cartographique et aux six variables visuelles.
La hierarchisation prend tout son sens lorsqu`il Iaut exprimer des diIIerences d`intensite
d`un phenomene grce a une gradation (en couleur ou en noir et blanc). Dans ce cas, le
choix des couleurs ou des grises (ou trames) doit tre logique : rappelons que les couleurs
se decomposent en couleurs Iroides : violet, bleu, vert... et en couleurs chaudes : jaune,
orange, rouge.... et qu`aux Iortes valeurs correspondra un ton chaud ou bien un grise (ou
une trame) sombre.
La legende doit tre ordonnee et presentee clairement.
Graphiquement, la legende doit tre claire et presentee avec rigueur et soin. De mme que
pour l`introduction d`un texte, la legende joue un rle Iondamental sur le jugement du
lecteur d`une carte.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 55/96
4) Une carte doit tre complte
Les e|ements ob|lgatolres et otlonne|s toute carte
Toute carte devrait posseder les elements indispensables a sa presentation et a sa
comprehension. Selon le type de carte, certains de ces elements sont optionnels mais la
plupart sont obligatoires.
O Le contenu de la carte : une carte sans lui serait un comble... C`est le seul element
dont on n'a jamais deplore l`absence, ce qui n`est pas le cas des suivants.
O L`orientation : orienter un Iond de carte est loin d`tre inutile surtout lorsque l`on
travaille a grande echelle ou sur des Ionds de carte dont les contours sont peu
connus. L`orientation permet le cas echeant de situer par rapport a des Iaits
physiques (vents, soleil...) et humains (banlieue nord - banlieue sud). On oriente
avec le Nord.
O CEAN
P A C I F I Q U E
Auckland
Manukau
Hamilton
Dunedin
Christchurch
Wellington
Ile du Nord
Ile du Sud
0 250 km 125
Legende
Titre
Coordonnees
Cadre
Contenu de
la carte
Source
Echelle
Orientation
Date
Nomenclature
Sources : Atlas 2000 Nathan et Encyclopdie Larousse
48sud
42sud
38sud
NOUVELLE -ZELANDE Ressources naturelles (1988)
Fort naturelle
Fort de plantation, industries
du bois et de la pte papier
Gaz naturel
Centrale gothermique
Centrale hydrolectrique
Centrale thermique
Houille
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 56/96
Que|ques reresentatlons de |'orlentatlon
Le Iond de carte peut avoir ete tourne pour des raisons de commodites si bien que le Nord
de la carte pointe parIois vers la gauche de la Ieuille par exemple. Par convention et
surtout si on le peut, il est preIerable que le nord de la carte pointe vers le haut de la
Ieuille.
O L`chelle
Elle devrait toujours tre presente, quelle que soit la carte. Elle permet d`evaluer les
dimensions du territoire cartographie. On peut la donner sous Iorme numerique (1/5000
e
,
1/10000
e
...) mais on preIerera une echelle graphique, car elle oIIre une plus grande
commodite d`emploi. De plus, elle reste operationnelle mme si la carte est reduite ou
agrandie (par photocopie par exemple).
Eche||es grahlques
O Un cadre
Le cadre etait extrmement travaille sur les cartes anciennes, (au point qu`il
occultait parIois le Iond de carte). Aujourd`hui, notamment en cartographie
thematique, un simple trait Iin noir suIIit pour materialiser le cadre.
Le cadre se place a une distance moyenne d`un centimetre du bord de la Ieuille.
Il n`apporte le plus souvent aucun plus au niveau de la technique cartographique
mais participe a l`agencement de la carte et donc a la qualite de sa presentation.
Lors de la realisation graphique, le cartographe se trouve conIronte a plusieurs
eventualites quant au dessin du cadre.
30 20 10 0 40 km
1000 m 0 500
1000 m 0
1000 m 0
40 km 30 20 10 0
1000 m
40 km
0
N
N
N
N
N
0 40 km
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 57/96
Les so|utlons our |lmlter |a carte
Le champ de la carte est delimite par des Irontieres juridiques, naturelles et/ou administratives deIinies : un
pays, une ville, un quartier, une Z.A.C., une le, etc. (a, b et c). Le cartographe dispose de deux choix.
Il preIere ne representer que le territoire concerne par la problematique de la carte. (a.). Dans ce cas, le
territoire devient une le mais cette solution presente les avantages de se soustraire a une trop grande
generalisation et donc de pouvoir tre precis, d`optimiser la nettete et d`eviter au cartographe de
renseigner les circonscriptions voisines.
AIin, par exemple, d`insister sur l`environnement geographique d`un territoire donne, le cartographe opte
pour la solution plus complexe de representer ce territoire et les territoires limitrophes (et au-dela, le cas
echeant). Avec cette solution, le cartographe s`expose a une charge plus lourde de travail, car il aura a
renseigner egalement les circonscriptions voisines (sauI s'il a recours a un artiIice graphique expose ci-
dessous). Les choix graphiques dependent ensuite des objectiIs du cartographe et surtout de l`echelle
retenue :
le cartographe limite le Iond de carte grce aux limites du ou des territoire(s) represente(s), (b.),
le cartographe limite le Iond de carte non pas par les limites du ou des territoire(s) represente(s) mais grce
au cadre : c`est une carte a fond perdu*, (c.). C`est une solution a eviter, car le message cartographique est
ampute d`une partie de son intert : etant donne que le phenomene n`est pas Iini dans l`espace, le cadre
limite ce phenomene et ne donne pas au lecteur la possibilite d`en saisir l`organisation spatiale.
Dans le cas ou le cartographe desire travailler a grande echelle, privilegier un territoire particulier et
representer une partie des territoires adjacents, il mettra graphiquement en retrait les circonscriptions
TITR
d.
TITR
a.
TITR
e.
Lgende
TITR
Cailon
f.
TITR
b.
TITR
c.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 58/96
voisines : le Iond de carte du territoire, sujet de la carte, en blanc et le Iond de carte des autres pays en grise
par exemple (d.). Mais cela n`apporte strictement rien a l`analyse.
Si le Iond de carte n`est pas delimite par des Irontieres administratives ou naturelles (une partie d`une quartier,
d`une ville, d`une region, etc.), le cartographe doit prolonger le Iond de carte jusqu`au cadre exterieur : c`est
egalement une carte a fond perdu*(e.).
A noter
Un carton (I.) est une carte complementaire a la carte principale, Iigurant sur la mme
Ieuille et dont l`echelle est le plus souvent diIIerente.
Le but du carton est en general de montrer a plus grande echelle une partie de la surIace
cartographiee, car le phenomene geographique traite y est plus dense et/ou notable).
Le carton est complementaire lorsqu`il Iournit des inIormations additionnelles et
distinctes a la carte principale. Un carton index situe la carte par rapport aux cartes
attenantes. Un carton administratif represente les Irontieres et les limites administratives.
Pour construire correctement le carton :
les Iigures doivent y avoir les mmes caracteristiques graphiques (couleur, taille, valeur...) que sur la carte
principale. En d`autres termes, si le carton montre le mme phenomene que la carte principale mais a une
echelle diIIerente (souvent agrandie), la legende doit y tre strictement identique pour permettre la
comparaison.
L`echelle, qu`elle soit reduite ou agrandie, doit tre imperativement mentionnee.
Les limites de la zone correspondant au carton doivent tre tracees (trait Iin) sur la carte principale.
Etant donne que le plan de la carte est considere comme homogene, les Iigures doivent apparatre (mme si la
densite des Iigures rend la lecture diIIicile) dans la zone concernee par le carton. A l`inverse, il ne Iaut pas
laisser cette zone en blanc, car cela signiIie, pour le lecteur, une absence de phenomenes alors qu`il n`en est
rien.
O Une legende
Element essentiel de la carte, la legende deIinit les symboles employes sur la carte. Sans
elle, aucune comprehension n`est possible. De la rigueur de la legende depend en grande
partie la rigueur de la carte.
Conseils pour la conception et la ralisation de la lgende
La legende doit tre exhaustive.
La legende doit presenter tous les signes utilises dans la carte. Certains Iaits sont
suIIisamment clairs et evidents pour que le cartographe omette de les Iaire Iigurer dans la
legende (trait bleu sinueux d`une riviere ou d`un Ileuve, aplats* bleus pour la mer) mais
ces phenomenes beneIicient d`un symbolisme naturel rarissime en cartographie.
La legende doit tre ordonnee.
AIin d`assurer la clarte et les qualites d`analyse de la legende, il est souhaitable de creer
des groupements par themes (reseau routier, habitat, donnees socio-demographiques...).
Certes, une telle presentation de la legende ne convient pas a certaines cartes, par exemple
les cartes a un theme, mais est necessaire pour les cartes polythematiques.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 59/96
La legende doit tre soignee graphiquement.
On a deja evoque le Iait que la legende gagne beaucoup en clarte si les Iigures et les textes
sont alignes.
Un echantillon de chaque Iigure zonal doit Iigurer dans un rectangle appele caisson*. A
cte de chaque caisson, on indique les valeurs ou les descriptions correspondantes.
Pour les valeurs numeriques (donnees quantitatives), les solutions de presentation sont nombreuses mais plus
ou moins judicieuses.
Pour les valeurs non numeriques (donnees qualitatives), les commentaires doivent tre breIs et precis :
Pour les donnees numeriques en implantation ponctuelle, on dessine les Iigures correspondants en ordre
croissant ou decroissant accompagnee des valeurs correspondantes.
La mise en page de la legende doit tre adaptee a lagencement de la carte.
La legende est le plus souvent placee en bas a droite de la carte mais aucune regle n`existe
a ce sujet. Elle est en tous cas rarement placee au-dessus de la carte et, sauI cas extrme d
a un manque de place sur le recto, il ne Iaut pas mettre la legende au dos de la carte ou sur
une Ieuille separee.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 60/96
Les rg|es resecter our |a constructlon de |a |egende
O Un titre
Egalement obligatoire, le titre expose dans le moins de mots possibles, le
contenu de la carte.
Le titre doit tre immediatement visible : souvent ecrit en capitales, on peut aussi
jouer sur la graisse et la taille des lettres.
2 FId!c : Ies signes iepeiloiies doivenl avoii Ies nne foines, laiIIes, couIeuis que sui Ia caile
(el vice-veisa).
1
ExhaustIvc: lous Ies signes uliIises pai Ia caile sonl iepeiloiies dans Ia Iegende.
3
C!aIrc : Ies signes el Ie lexle sonl aIignes, Ie lexle esl lien eciil, piecis el concis el iI ne faul pas
hesilei a decoupei Ia Iegende en sous-pailies.
5
4
C!assc par typc dc fIgurs : si possilIe, on essaye de iegioupei Ies figuies ponclueIs
enlie-eux, Ies figuies zonaux avec Ies figuies zonaux, elc.
C!assc par typc dc phnnmncs : on ciee des gioupenenls en nellanl des lilies
el des sous-lilies.
7
Lcs prngrcssInns dc va!cur dnIvcnt apparatrc. On piefie des vaIeuis
iondes a des vaIeuis queIconques.
6
Pnur !cs fIgurs prnpnrtInnnc!s, on Ies dessine lous si Ieui nonlie sui Ia caile
esl ieslieinl. Sinon, on ielienl queIques figuies iepies.
8
Lcs fIgurs znnaux snnt dcssIns dans dcs caIssnns (ieclangIes)
Rscau
Route quatre voies
(voie express)
Autre route importante
Rscau
de 2000 10000 habitants
de 10000 20000 habitants
de 20000 50000 habitants
de 50 000 100 000 habitants
plus de 100 000 habitants
Valeurs des apports en millions
de francs (1983)
ActIvIts
de 0 50
de 50 150
de 150 500
plus de 500
TnurIsmc ct !nIsIrs
B
Edifice religieux remarquable
Villes fortifies
Limite du Parc Rgional
BENODET
Commune possdant
une capacit daccueil
touristique de plus de
2000 personnes
Station balnaire
complte, dense
E!cvagc
De 50 65 vaches pour 100 ha de S.A.U.
De 65 80 vaches pour 100 ha de S.A.U.
De 80 90 vaches pour 100 ha de S.A.U.
Plus de 90 ha de S.A.U.
7
1
4
3
5
6
8
2
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 61/96
La tournure du titre est Ionction de l`objectiI de la carte : il sera seducteur pour
les depliants touristiques ou publicitaires ( une region aux mille Iacettes , un
carreIour de l`Europe ) mais objectiI et sans Iantaisies pour les cartes d`aide a la
decision.
Il doit en tout cas toujours tre breI et ne pas se presenter sous la Iorme d`une
phrase avec sujet, verbe et complement.
Il est inutile d`y Iaire Iigurer les mots localisation ou carte de , car par
deIinition une carte localise et le lecteur est assez sense pour savoir qu`il lit une
carte.
O Les coordonnes*
Les coordonnees (latitude et longitude) sont utiles pour les cartes a petite echelle, pour
certains themes (les climats par exemple) ou lorsque le territoire presente est lointain
et/ou peu connu. Dans ce cas, il est interessant de mentionner en lieu et place, des
coordonnees (souvent en dehors du cadre) voire le nom d`un lieu geographique celebre
situe a la mme latitude ou longitude que le territoire cartographie.
O La source
Indispensable pour les cartes statistiques, elle permet de veriIier l`origine de l`inIormation,
sa validite et sa marge de conIiance.
O La date
Elle est, quel que soit le type de carte, obligatoire. Sans date, on ne peut contrler le degre
d`anciennete de l`inIormation, ce qui est capital pour l`inIormation geographique en
perpetuelle evolution.
O La nomenclature
La nomenclature est l`ensemble des noms de lieux ou de Iaits geographiques
ecrits sur le Iond de carte. Elle est bien sr necessaire sur les cartes de
localisation pour lesquelles la liste des noms de lieux constitue une base.
Dans la plupart des cartes d`analyse, de synthese ou modeles, la nomenclature se
Iait discrete voire disparat. Il est parIois souhaitable de Iaire Iigurer au moins
quelques noms de points-cles (place, gare, cathedrale, riviere...) sur les cartes
statistiques a grande echelle. Cela aide le lecteur a se reperer. La nomenclature
sera toujours sobre aIin de ne pas nuire au message de la carte.
Pour varier la nomenclature selon l`importance et la nature des objets auxquels
elle se rapporte, le cartographe a le choix de jouer sur la Iorme, la taille, la valeur
et la couleur des lettres et des mots comme il le Ierait avec des Iigures ponctuels,
lineaires ou zonaux.
5) Une carte thmatique doit rpondre deux questions
O La qualite majeure d`une carte thematique est et devrait toujours tre d`apporter une
inIormation globale a son lecteur. Cette obligation resulte de la vocation mme des
cartes thematiques : celle d`aider l`analyse et la decision. Or, pour que cette
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 62/96
vocation soit respectee, une carte doit repondre a deux questions ; en d`autres
termes, le lecteur est en droit de reclamer de la carte, une reponse immediate et
Iiable a deux questions :
Au niveau du detail : a tel endroit, qu`y a-t-il ?
En parcourant une carte, le lecteur est amene a rechercher une inIormation
geographique a un point precis de la carte ; par exemple, quelle est la population
de cette ville ?, quels sont les prix du terrain au m dans ce quartier ?, quelle est
la capacite hteliere de ces stations balneaires ?, etc. Le plus souvent, toutes les
cartes repondent a cette question elementaire pour la simple raison que mme un
mauvais choix de variable visuelle n`altere pas la vision au niveau elementaire.
Au niveau general, tel phenomene, quelle est sa geographie ?
Une carte thematique, grce a une expression geographique adaptee, est conue
pour visualiser des formes, des ensembles spatiaux qui permettent au lecteur de
degager la regionalisation d`un phenomene geographique donne. Cette lecture se
Iait au niveau de l`ensemble de la carte et permet donc de deceler des ensembles
spatiaux.
O Carte lire et carte voir
En consequence, si la carte thematique ne repond qu`a la premiere de ces deux
questions, c`est une carte a lire. Rappelons que tout l`intert d`une carte
thematique est certes de situer mais egalement et en premier lieu de montrer
instantanement la distribution d`un phenomene. Si cette distribution n`apparat
pas, un texte ou un tableau sont plus appropries qu`une carte, car la conception
de celle-ci demande plus de temps. En resume, une carte a lire est sans objet, elle
represente un eIIort inutile a la Iois pour le concepteur et pour le lecteur qui doit
dechiIIrer la carte.
Si la carte repond rapidement a la deuxieme question, alors c`est une carte a voir.
Avec un temps minimum d`observation, le lecteur est capable d`une part
d`analyser un Iait quelconque puis d`autre part de dessiner mentalement ou
graphiquement s`il le desire une regionalisation. EnIin, il est apte a memoriser
l`image qu`il a en Iace des yeux. Pourtant, et c`est un signe de plus que la
pedagogie de la carte est tres deIiciente, paraissent encore trop de cartes a lire
totalement steriles n`autorisant aucune analyse.
Les cartes a lire peuvent tre etendus aux cartes en diagrammes ou aux cartes
representant l`ordre des quantites par un non-ordre (resultant d`une mauvaise
gradation de valeurs par exemple necessitant un recours constant a la legende).
Dans l`absolu, ces erreurs ont toujours pour origine un mauvais usage des regles
de l`expression cartographique.
Au Iinal, le probleme de la carte a lire souligne combien l`expression cartographique
procede de la physiologie de notre oil. Si le concepteur et realisateur de cartes n`admet
pas cette evidence, alors ses cartes - ses images - seront toujours illisibles.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 63/96
Linformation, cest--dire la capacit dhbergement des stations
de sports dhiver de Savoie est transcrite par des symboles dont
on fait varier la forme.
Sur cette carte, limage instantane est celle de la localisation
des stations de sports dhiver. Ce nest pas celle de leur capacit
dhbergement. Pour trouver une signification capacit
dhbergement , il faut diffrencier les formes des signes. Pour
analyser le fait capacits dhbergement des stations de
Savoie dans son ensemble, il faut lire les 60 signes, ce qui est
Commentaire de la carte a voir
La carte de droite rpond aux deux types de questions :
tel endroit ( Tignes), quelle est la capacit dhbergement ?
tel caractre (les capacits dhbergement), quelle est la
gographie?
Ainsi, le lecteur discerne trs nettement une rgionalisation des
stations de sports dhiver savoyardes : premier ensemble, les
stations de la Tarentaise avec quatre dentre elles dpassant les
30 000 lits ; deuxime ensemble au sud, les stations de la
Maurienne et de la Haute-Maurienne, plus modestes mais
nombreuses ; troisime ensemble, les stations du Val dArly au
Nord et enfin quatrime ensemble, les quelques stations de
louest du dpartement situes dans les massifs des Bauges et
de la Chartreuse plus tourns vers le ski de fond et lconomie
pastorale, o les altitudes sont moins leves.
Commentaire de la carte a lire
Exemple de carte a lire : mauvais usage des variables visuelles
Carte 1 : assage d'une carte |lre une carte tolr ar correctlon des tarlab|es tlsue||es
Plus de 30 000
5 000 - 15 000
50 - 1 000
40 000
30 000
20 000
10 000
5 000
2 000
500
250
1 000 - 5 000
Hry
Arches-Beaufort
Les Arcs -
BourgSt Maurice
Peisey Vallandry
Ste Foy
Tarentaise
Albiez Montrond
St Jean d'Arves
Valloire
St Sorlin
d'Arves
La Toussuire
Les Karellis
LeCorbier
Les Bottires
Montaimont
Bozel
Brides-les-Bains
Champagny enVanoise
Tignes
Val d'Isre
Pralognan la Vanoise
Courchevel
La Tania
LaPlagne
Plagne
Montalbert
Jarrier
Aussois
Orelle
Bramans
Sollires Sardires
Les Menuires
Val Thorens
Mribel
La Norma
Valfrjus
Valmeinier
Bessans
Val Cenis
Hauteluce
ND de Bellecombe
Crest Voland Cohennoz
LaGiettazen Aravis
Flumet St Nicolas
la Chapelle
Les Saisies
Valmorel
LaRosire
Sez
Les Aillons
LaFclaz
Valled'Entremonts
Le Revard
St Franois
de Sales
Bonneval-
sur-Arc
Montchavin
Les Coches
Les Versants
du Soleil
Doucy
Combelouvire
Termignon
la Vanoise
St Franois-
Longchamp
St Martin
de Belleville
St Colomban-
des Villards
Hry
Arches-Beaufort
Les Arcs -
BourgSt Maurice
Peisey Vallandry
SteFoy
Tarentaise
Albiez Montrond
St Jean d'Arves
Valloire
St Sorlin
d'Arves
La Toussuire
Les Karellis
Le Corbier
Les Bottires
Montaimont
Bozel
Brides-les-Bains
Champagny
en Vanoise
Tignes
Val d'Isre
Pralognan la Vanoise
Courchevel
La Tania
LaPlagne
Plagne
Montalbert
Jarrier
Aussois
Orelle
Bramans
Sollires
Sardires
Les Menuires
Val Thorens
Mribel
La Norma
Valfrjus
Valmeinier
Bessans
Val Cenis
Hauteluce
ND de Bellecombe
Crest VolandCohennoz
La Giettaz en Aravis
Les Saisies
Valmorel
La Rosire
Sez
Les Aillons
LaFclaz
Valle d'Entremonts
Le Revard
St Franois
de Sales
Bonneval-
sur-Arc
MontchavinLes Coches
Les Versants
du Soleil
Doucy
Combelouvire
Termignon
la Vanoise
St Franois-
Longchamp
St Martin
de Belleville
St Colomban-
des Villards
15 000 - 30 000
N
0 10 20 30 40 50 km
(Nombre de lit total) Saison hiver 1997
Source : Agence touristique dpartementale de Savoie
Carte a
Carte b
Capacit d'hbergement des stations de Savoie
Flumet St Nicolas
la Chapelle
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 64/96
VII Les tapes
de conception, de ralisation et de lecture d`une carte
1) Se poser les questions pertinentes avant la conception
O Faut-il faire une carte ?
Il Iaut peser le pour et le contre et surtout savoir juger de l`utilite de la carte en tant
qu`outil d`aide a la decision et a la comprehension d'un phenomene. Le Iait de Iaire ou
non une carte depend ensuite de la volonte et des acquis de chacun mais aussi des
donnees a analyser. Une carte est realisable si les donnees ont :
une dimension gographique.
Si les donnees ne sont pas localisees (ou spatialisees ou encore
geographiquement referencees dans le langage inIormatique), il sera
evidemment impossible de les cartographier.
Exemple : le nombre de medecins specialistes (dentistes, ophtalmologues,
gynecologues) pour 50 000 habitants dans une ville de 200 000 habitants.
1962 1972 1982 1992
Commune X
12 31 41 53
Type de spcialistes
D O G D O G D O G D O G
Nombre de spcialistes
10 2 0 25 4 2 29 7 5 37 9 7
Commune X 1982 1990 1982 1992
Centre 9 18 21 24
Quartier Nord 1 5 8 13
Quartier Est 1 2 3 6
Quartier Ouest 1 4 5 4
Quartier Sud 0 2 4 6
Une masse critique.
L`expressivite de la carte se Ionde sur son contenu. Si ce dernier n`oIIre pas
la possibilite de visualiser des distributions spatiales, la carte d`analyse est
inutile puisqu`elle ne permet plus l`analyse. Le nombre de donnees doit donc
tre suIIisant pour que l`apport de la carte soit signiIicatiI.
Pour les cartes de localisation, en revanche, on peut se contenter d`un nombre
restreint de donnees. La carte sera toujours plus Iructueuse pour dire qui Iait
quoi et ou est qui qu`un tableau ou du texte.
O Une carte, plusieurs cartes ou une carte de synthse ?
L`un des principaux soucis du cartographe est la synthese, c`est-a-dire etablir des
correspondances entre les composantes d`un ou de plusieurs Iaits geographiques.
Ce tableau ne contient
pas dinformations
spatiales. La cartographie
nest pas lordre du jour.
Ce tableau offre un facteur diffrentiel
gographique : les quartiers de la
ville. Il est donc possible de raliser
une carte aprs avoir ventuellement
trait les donnes.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 65/96
Dans le cas d`une representation d`une localisation ou d`une situation par exemple,
on aura tout intert a regrouper toutes les donnees sur un seul et mme support. La
remarque vaut egalement pour les cartes d`occupation et d`utilisation du sol et les
cartes de synthese regionale.
Pour les cartes statistiques, la demultiplication est le plus souvent conseillee (un seul
caractere par carte, deux tout au plus pour des raisons a la Iois de methode et de
clarte).
La premiere solution est de jouer sur la combinaison et la superposition des
Iigures. Cette alternative, on le sait, atteint tres vite des limites graphiques.
Les puristes, et ils n`ont pas tort, considerent cette solution comme une Iausse
synthese, car elle se contente de superposer. Plutt que de chercher a
deployer des tresors de virtuosite, il Iaut parIois se resoudre a concevoir un
recueil, une collection de cartes, chacune visualisant un caractere.
Neanmoins, la solution la plus aboutie, notamment pour les etudes
introduisant de multiples composantes, est la synthese capable d`etablir des
relations entre toutes ces composantes. Elle doit tre mrement reIlechie et
passe par un traitement des donnees.
O A quelle chelle travailler ?
Il Iaut adapter le choix de l`echelle a l`etendue du territoire a cartographier, au
Iormat de la Ieuille et a l`ordonnancement Iinal de la carte. Il serait dommage de
choisir une trop grande echelle et de ne plus avoir la place necessaire pour la
legende par exemple.
O Quel fond de carte choisir ?
La aussi, le type de carte commande le choix du Iond de carte. Pour les cartes de
situation, on recherchera des Ionds de cartes detailles et complets avec une
toponymie omnipresente. Pour les cartes statistiques, au contraire, on preIerera des
Ionds de cartes epures, Iortement generalises et contenant une base administrative
ou institutionnelle : pays, region, departement, commune, quartier ou lot de
recensement.
O Que veut-on montrer : quel langage graphique adopter ?
Une regle d`or : utiliser au mieux les Iacultes du cerveau et de l`oil humains. Il
suIIit des lors de savoir ce que l`on veut montrer (des proportions, un classement,
des diIIerences, une dynamique...) et d`obeir aux principes du langage
cartographique.
O Quel format ?
Le cartographe a le choix entre plusieurs Iormats de presentation. Au-dela du Iormat
A3 (4229,7), les cots de production augmentent et la maniabilite diminue.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 66/96
Les formats de feul||e
O En couleur ou en noir et blanc ?
Il est inutile de revenir sur les attraits indiscutables et les precautions d`emploi de la
couleur. Le choix repose sur le materiel a la disposition du cartographe : si en
cartographie manuelle, une vingtaine de crayons de couleurs suIIisent, la
cartographie par ordinateur necessite des investissements plus lourds (carte
graphique et ecran notamment) et surtout une imprimante et des papiers de bonne
qualite au risque d`tre deu entre le resultat a l`ecran et le resultat sur papier.
O Quelle mise en plage ?
Deux types de mises en page :
a la franaise (mode portrait dans les logiciels) : la page est dans le sens de la
hauteur.
a litalienne (mode pavsage dans les logiciels) : la page est dans le sens de la
largeur.
Le choix de la mise en page est le plus souvent guide par la Iorme et la taille du
Iond de carte. Elle inIluence evidemment la disposition des elements et la
conIiguration generale de la carte. Il Iaut de toute maniere eviter les vides sur la
page et rechercher un bon ordonnancement de l`ensemble, le plus souvent, selon
une diagonale.
A2
59,4
A1
59,4
84,1
A0
118,8
84,1
A5
14,8
21
A3
29,7
42
42
A4
29,7
21
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 67/96
Mlse en age de |a carte
O Sur quel matriau ?
Le choix du materiau est conditionne par les moyens mis en ouvre pour
cartographier. En cartographie par ordinateur, une table traante (surtout reservee a
la cartographie technique et au dessin industriel) travaille sur calque ou sur papier.
Une imprimante (laser, transIert thermique, a jet d`encre) exige un papier de qualite
(au-dessus de 80g/m).
Pour l`impression couleur, des papiers speciaux (papier couche ou papier glace)
garantissent un rendu optimal. Une impression couleur de qualite passe en eIIet
obligatoirement par une bonne adequation entre l`encre des imprimantes et le
papier. Sans papier special, l`encre bave, les couleurs sont ternes, le papier gondole.
2) La construction d`une carte
La Iigure ci-dessous presente la succession theorique des phases de la construction d`une
carte. Que cette carte soit conue a la main ou sur un ordinateur, les etapes sont
globalement les mmes : il Iaut collecter et analyser les donnees, les retravailler le cas
echeant et enIin dessiner la carte. Dans la pratique, ces phases sont interactives et
connectees.
Par exemple, les moyens et les procedes de reproduction (inIormatique, oIIset,
serigraphie...), contraintes majeures en cartographie, interIerent sur le choix de la couleur
ou du noir et blanc, du Iormat, des Iigures (trames, aplat*), etc.
De mme, selon le public vise, il Iaudra adapter les traitements statistiques et les choix
graphiques. EnIin, l`objectiI de la carte (publicite, recherche, etude d`amenagement*, aide
a la decision...) inIluence evidemment les choix graphiques ou le Iormat.
A l i t al i en n e A l a f r an a i s e
TITRE
TITRE
Lgende
Lgende
N
N
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 68/96
Les hases de |a concetlon et de |a rea|lsatlon d'une carte
En conclusion, il est indispensable d`avoir des le depart, une vision globale du processus,
de la premiere phase de la conception a la derniere phase de la realisation.
Dfinir lobjectif
Prciser la cible
Hirarchiser et traiter les donnes
Choisir le fond de carte
Dessiner la carte
Concevoir la lgende
Rechercher et collecter des donnes
Choix des figurs
Cartographie manuelle
cartographie par ordinateur
Prendre en compte les contraintes
Choisir la mise en page
Reproduction et diffusion
Conception
Ralisation
No ct Iunc ou coucu
uc onut
Su quc nutcuu
uc ucut-on cxnc
Aucc quccs uuuIcs usuccs
Agundsscncnt Hcducton
Gcncusuton
CIccIcus,ngcncus, tccInccns
Eus
Gund uIc
Usugc ntcnc ou cxtcnc
Dctcnnuton du stc dc cutc
Cartes conues pour lecture rapide
Reprsentation pure de linformation
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 69/96
JIII La mise en classes des sries statistiques
O La statistique est une science d`observation quantitative et une methode
mathematique d`analyse et d`interpretation de ces observations. De ce Iait, le terme
statistique recouvre deux acceptions :
la collecte, le regroupement et la mise en Iorme d`inIormations et de donnees sur
les activites humaines,
la statistique est aussi l`ensemble des methodes et des techniques qui permettent
de manipuler ces donnees, de decrire et d`organiser l`inIormation (statistique
descriptive) et de calculer des probabilites en introduisant des hypotheses
(statistique mathematique).
O Parce que la plupart des cartes contemporaines sont realisees a partir de donnees
chiIIrees, la cartographie (et la geographie) s`est tout naturellement tournee vers les
statistiques qui oIIrent un champ inepuisable pour les calculs de taux, les divisions
en classes, les calculs d`evolution, l`analyse Iactorielle, la construction de
diagrammes, breI, pour les traitements statistiques en general, des plus simples aux
plus complexes.
O Le but est d`etudier, le cas echeant, de transIormer les donnees chiIIrees brutes, puis
d`acceder au langage cartographique en respectant au mieux l`inIormation
geographique contenue dans la serie statistique et en garantissant la lisibilite de la
carte. Cartes & Donnes a encore accentue ce mariage de raison entre cartographie
et statistique. Il propose des Ionctionnalites parIois tres evoluees ; les cartographes
mme amateurs ont ainsi la possibilite d`acceder a un haut niveau d`analyse
statistique.
Ce vaste domaine parIois tres complique, n`est abordable que partiellement dans le
cadre de ce livre. Au mme titre que la cartographie, la statistique est une discipline
a part entiere et demande tres vite des connaissances pointues en mathematiques. La
bibliographie sur ce sujet est certes abondante mais s`adresse le plus souvent a des
personnes deja Iormees aux rudiments des statistiques.
TouteIois, il est indispensable, mme pour le cartographe novice, de posseder les
notions de bases ne serait ce que pour matriser un procede constamment usite et
Iondamental lorsque l`on conoit une carte d`analyse : le decoupage en classes ou
discretisation.
1) La terminologie lmentaire de la statistique
O Une inIormation est, d`un point de vue statistique, une serie de correspondances
entre des IndIvIdus et des attrIbuts.
x
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 70/96
Les IndIvIdus (ou unites statistiques) sont les objets, les elements observes. Ils
recouvrent des Iormes tres diverses (personne, animal, objets inanimes) mais
puisque, dans le cadre de cet ouvrage, nous raisonnons sur une inIormation
geographique, les individus sont des unites spatiales, c`est-a-dire des points ou
ont ete observes et mesures des Iaits geographiques : parcelles, communes,
departements, regions, etc.
L`ensemble des individus (ou unites spatiales en geographie) constitue une
pnpu!atInn.
Les attrIbuts sont des valeurs (ou modalites) decrivant un individu ; chaque
individu pouvant tre decrit par un ou plusieurs attributs.
La liste des attributs constitue une varIab!c. Il est commun d`utiliser comme
synonyme de variable, le terme de caractrc (J. Bertin dans son ouvrage
Semiologie Graphique qualiIie les attributs et individus de composantes d`une
inIormation).
Un couple individu-attribut Iorme une nbscrvatInn.
Si un individu est decrit par plusieurs attributs, on obtient une liste de variables.
Effectifs des collectivits en 1990
(quivalent temps complet)
Nombre dagents pour 1000 habitants
Alsace 24736 15,2
Aquitaine 53400 19,1
Auvergne 21559 16,3
Bourgogne 27269 16,9
Bretagne 45681 16,3
Centre 41864 17.7
Champagne-Ardenne 21428 15,9
Corse 5792 23,1
Franche-Comt 18295 16,7
Ile-de-France 262859 24,7
Languedoc-Roussillon 38898 18,4
Limousin 12691 17,6
Lorraine 34121 14,8
Midi-Pyrnes 44886 18,5
Nord-Pas-de-Calais 65321 16,5
Basse-Normandie 23278 16,7
Haute-Normandie 32962 19,0
Pays de la Loire 49981 16,3
Picardie 28400 15,7
Poitou-Charentes 28887 18,1
Provence-Alpes-Cte-d'Azur 99667 23,4
Rhne-Alpes 92706 17,3
O Conventionnellement, l`inIormation est presentee sous Iorme de tableau : les
individus (dans notre cas, les unites spatiales) remplissent la premiere colonne
tandis que les attributs Iorment les autres colonnes. Cette presentation en tableau
Var i abl es
Lect ur e hor i zont al e
gogr aphi que
Uni t s spat i al es
Dans cet exemple, les
units spatiales sont les
Dlgations Rgionales
du Centre National de la
Fonction Publique
Territoriale
Lect ur e ver t i cal e
st at i st i que
Popul at i on
( e nsembl e des
i ndi vi dus )
At t r i but s
( ou val eur , ou
moda l i t )
Source : INSEE
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 71/96
implique une double lecture : geographique (lecture horizontale) et statistique
(lecture verticale).
2) Principes du dcoupage en classes.
O Dfinition
Le decoupage en classes est un procede qui vise a transIormer une serie statistique brute
en une serie ordonnee divisee en classes. Cette operation est encore appelee discretisation,
dans la mesure ou elle consiste a rendre discrete, c`est-a-dire discontinue, une serie
mesuree d`abord sur une echelle continue de valeurs.
Il est en eIIet impossible, d`un point de vue cartographique, de garder telle quelle une serie
statistique, car cela reviendrait a cartographier toutes les valeurs, chose rendue
inconcevable par les regles de la perception visuelle qui exige, on le sait, visibilite et
clarte.
O Prsentation des classes dans la lgende
Dans un souci de clarte et de simplicite, le nombre de classes varie generalement
de 4 a 7. Si l`objet de la carte n`est pas d`exprimer une distribution mais juste
d`observer la progression comme dans les cartes de diIIusion, alors le nombre de
classes n`est pas limite.
Les classes sont identiIiees par leurs limites (ou bornes). Dans la legende, elles
sont inserees a cte des caissons* ou des signes.
Deux types de presentation sont possibles :
o on ecrit a cte de chaque signe ou caisson les valeurs de la borne inIerieure
et de la borne superieure,
|0 - 5|
|5 - 10|
|10 - 15|
|15 - 20|
5
5 a 10
10 a 15
~ 20
0 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
0 a 5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
De 0 a 5
de 5 a 10
de 10 a 15
de 15 a 20
ou ou ou ou
Le tiret peut tre
interprete comme le
signe moins
Presentation Iiable mais
rigide car mathematique
Le premier crochet
inclut, le deuxieme
exclut.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 72/96
o on ecrit les valeurs des bornes une Iois seulement entre deux signes ou
caissons successiIs.
Conseils pour les limites de classes
Les limites de classes couvriront l`ensemble du domaine de la variation de la serie
statistique et ne laisseront pas des valeurs en dehors du champ couvert par les bornes des
classes.
Par exemple .
A l`inverse, une valeur n`appartiendra qu`a une seule classe : il n`y aura pas de
recouvrement entre deux classes.
Par exemple .
EnIin, les valeurs utilisees comme limites de classes devront tre lues rapidement et
Iacilement memorisees. On preIerera donc les nombres entiers, le cas echeant arrondis
(50,2 50 ou 2,9 3) en evitant les decimales a plus d'un chiIIre derriere la virgule ne
servant strictement a rien sinon a compliquer la lecture de la carte.
3) Rappels de statistiques lmentaires : les principaux indicateurs
O Les principaux indicateurs utilises dans le decoupage en classes sont peu nombreux
mais Iondamentaux : il s`agit de la moyenne, de l`ecart-type et dans une moindre
mesure de la variance et de la mediane. Ces indicateurs ont deux utilites dominantes
en cartographie :
0
0
20
20
15 15
10
5
10
5
0
20
15
10
5
0 a 5
5 a 10
10 a 20
20 a 30
0 a 5
7 a 10
12 a 20
22 a 30
OUI NON
0 a 5
5 a 10
10 a 20
20 a 30
0 a 5
5 a 15
12 a 20
18 a 30
OUI NON
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 73/96
il est souhaitable pour le lecteur d`une carte d`analyse de disposer dans la
legende d`un ordre de grandeur du phenomene represente. Certes, les indications
chiIIrees situees a cte du caisson (cI. Ci-dessus) ou du symbole et resultant d`un
traitement statistique de la part du cartographe, Iournissent dans une certaine
mesure cet ordre de grandeur mais ces chiIIres sont rarement interpretables en
eux-mmes. Seule l`experience du lecteur dans un domaine particulier, permet de
juger, selon le contexte, si une moyenne de 200 habitants au km est une densite
Iaible ou elevee (aujourd`hui en France par exemple).
Il est donc toujours proIitable d`inserer en legende un ordre de grandeur se
rapportant a toute la distribution statistique : par exemple, moyenne nationale ou
ecart-type.
Plus encore que pour la lecture, ces parametres sont Iondamentaux pour la
conception des cartes a base de donnees statistiques : la moyenne et l`ecart-type
regissent la plupart des methodes de discretisation.
Mme si les calculatrices programmables et les tableurs (pour la cartographie
manuelle) et a fortiori et a fortiori le logiciel Cartes & Donnes calculent les
indicateurs expliques ci-dessous, cela ne dispense en rien le cartographe de
connatre le contenu et les Ionctions de ces indicateurs aIin de jauger leur valeur
et d`apprecier leur utilite dans tel ou tel contexte.
O La moyenne arithmtique ( x )
Le symbole x se lit x barre .
C`est la valeur centrale la plus utilisee pour resumer une distribution. On l`obtient
en eIIectuant la somme de toutes les valeurs de la serie statistique et en divisant le
resultat par le nombre d`observations.
O La variance (V)
La variance est la moyenne arithmetique des carres des ecarts a la moyenne.
O Lcart type ( )
L'ecart type est une mesure de la dispersion des valeurs par rapport a la moyenne
(valeur moyenne). Il correspond a la racine carree de la variance. Plus l`ecart-type
est eleve, plus les observations sont dispersees.
O
Ou
x
i
attributs avec i variant de 1 a n
N nombre d`observations
Ou
x
i
attributs avec i variant de 1 a n
N nombre d`observations
X
(x
i
)
N
(x
i
- x)
N
V
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 74/96
O La mdiane
La mediane est la valeur qui se trouve au centre d'un ensemble de nombres. Elle
partage la serie en deux classes d`egal eIIectiI. En d'autres termes, les valeurs
appartenant a la premiere moitie de l'ensemble ont une valeur inIerieure a la
mediane tandis que celles appartenant a l'autre moitie ont une valeur superieure a
la mediane.
D`une Iaon generale, on emploie la mediane comme valeur centrale pour
caracteriser une distribution dissymetrique dont la valeur moyenne est peu
representative.
Lors du calcul de la mediane, deux cas peuvent se presenter :
les observations ne sont pas groupees par classes.
Dans ce cas, le calcul de la mediane est simple : on ordonne la serie et on
denombre la moitie de l`eIIectiI total N : la mediane correspond a l`element
median de la distribution.
Par exemple,
o si l`eIIectiI est impair :
quand le nombre d`observations (N) est impair, la mediane existe dans la
serie :
MEDIANE (1; 2; 3; 4; 5) egale 3.
MEDIANE (711; 851; 862; 912; 922) egale 862.
o Si l`eIIectiI est pair :
quand le nombre d`observations (N) est pair, la mediane est la moyenne
des deux valeurs centrales :
MEDIANE (1; 2; 3; 4; 5; 6) egale 3,5, la moyenne de 3 et 4.
Les observations sont groupees par classes.
o On denombre les eIIectiIs par classes,
o on cumule les eIIectiIs n
i
des classes,
o on divise par deux le nombre cumule,
o on repere la classe qui possede l`element median,
la mediane est la moyenne des deux bornes de la classe.
ou
V
(x
i
- x)
N
Ou
x
i
attributs avec i variant de 1 a n
N nombre d`observations
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 75/96
L`exemple suivant mesure le produit des quatre taxes directes locales par region.
Produits des quatre taxes directes locales (en
francs / habitant)
Nombre de rgions
ni
Effectifs cumuls des rgions
2888 - 3100 6 6
3100 - 3300 8 14
3300 - 3500 2 16
3500 - 3800 4 20
3800 - 4163 2 22
Source : Direction Gnrale des Impts, Direction de la Comptabilit
Publique (1989)
Puisqu`il y a 22 regions, l`element median a le rang 11 (22/2). La valeur mediane se situe
donc dans la deuxieme classe : entre 3100 et 3300 Irancs. La mediane est donc egale a
3200 Irancs.
Donc, la moitie des regions ont une Iiscalite locale inIerieure a 3200 Irancs par habitants.
- Notons que la moyenne et la mediane inIorment souvent de maniere tres incomplete sur
l`ordre de grandeur d`une serie statistique. Par exemple, nous avons deux series
statistiques :
Ces deux series statistiques ont certes la mme moyenne (x 100) et la mme mediane
(M100) mais la seconde serie est beaucoup plus dispersee.
D`ou l`intert de l`ecart-type qui permet de connatre la dispersion des deux series :
pour la serie 1 : 4,1
pour la serie 2 : 39,5
4) Les mthodes de discrtisation
O Il existe plusieurs techniques de discretisation. Certaines sont spontanees,
empiriques et donc apparemment pratiques. Elles sont cependant hasardeuses, car
elles ne conservent pas ou peu l`inIormation apportee par les donnees. D`autres,
rationnelles, s`appuient sur les mathematiques et ont pour objectiIs de preserver
l`ordre de grandeur du phenomene represente, la Iorme de la distribution, sa
dispersion et l`existence eventuelle de cas particuliers.
Cartes g Donnes oIIre des outils d`aide a la discretisation et de visualisation des
resultats tres perIormants mais preserve la liberte de l`utilisateur quant au choix de
Srie 1 95 97 100 103 105
Srie 2 50 75 100 125 150
On cumule les
eIIectiIs.
On denombre les
eIIectiIs par classe
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 76/96
la methode. Sont presentees ici les methodes les plus repandues, Iaciles a utiliser et
couvrant largement les exigences des cartographes specialistes ou non.
O 1
re
mthode ( viter) : dcoupage lestime
Cette methode, certes tres commode et rapide, n`est viable qu`avec les series
statistiques simples comportant peu de valeurs. Avec cette methode, il s`agit de
decouper la serie statistique en reperant les ruptures dans la variation. Chaque
rupture marquera le debut et la Iin d`une classe.
Cette methode n`est pas tres sre mais necessite pourtant un entranement
soutenu dans la lecture des tableaux statistiques. Plus grave, elle engendre des
erreurs quant au decoupage : il arrive que des classes soient vides ou au contraire
trop pleines par exemple. On privilegiera les methodes suivantes, non seulement
plus Iiables mais egalement tres simples a mettre en ouvre.
O 2
me
mthode : discrtisation en classes damplitudes gales
Cette methode consiste a realiser des classes de mme etendue.
Pour cela, il Iaut calculer l`ecart entre le maximum et le minimum (e) puis
diviser cet ecart par le nombre de classes souhaite. On ajoute ensuite le resultat
au minimum puis on continue jusqu'a ce que l`on atteigne le maximum.
Exemple pour 4 classes :
Pour rendre la lecture de la legende plus aisee, on peut arrondir l`amplitude et
aIIecter egalement a la premiere borne une valeur arrondie.
La methode de representation par classes d`amplitudes egales a l`intert d`tre
vite comprise dans son principe par le lecteur et d`tre Iacile a realiser.
Cette methode convient bien aux distributions uniIormes mais est moins adaptee
aux distributions asymetriques comportant peu de valeurs elevees par exemple.
La carte serait dans ce cas couverte par des Iigures clairs.
O 3
me
mthode : discrtisation selon les moyennes embotes
La moyenne (x) divise la serie en deux groupes aIin de construire deux classes. A
leur tour, les moyennes de ces groupes, x
2a
et x
2b
, permettent un nouveau
decoupage en 4 classes, et ainsi de suite. De ce Iait, le nombre de classes sera
toujours avec cette methode un multiple de 2.
Exemples pour quatre classes :
Maximum Minimum
X
2b
X
2a
X
Maximum
Resultat 1 e/4 Resultat 2 e/4
Minimum
Minimum e/4
e maximum - minimum
Resultat 1 Resultat 2 Resultat 3
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 77/96
O 4
me
mthode : discrtisation selon les quantiles
Cette methode consiste a realiser des classes qui possedent (si possible) le mme
nombre d`individus. Faire des classes d`eIIectiIs egaux signiIie cependant que
l`on perde toute inIormation relative a la Iorme statistique de la distribution.
La methode est simple a appliquer :
o on divise le nombre d`observations (N) par le nombre de classes desire pour
obtenir l`eIIectiI de chaque classe.
o On determine ensuite les limites de chaque classe en comptant le nombre des
unites geographiques dans la serie ordonnee. Les limites de classes ainsi
constituees s`appellent des quantiles : quartiles lorsqu`on a quatre classes (la
mediane est alors une limite de classe) (n/4, 2n/4, 3n/4), quintiles s`il y en a cinq
(la mediane est alors incluse dans la classe centrale), (n/5, 2n/5, 3n/5, 4n/5),
octiles pour huit classes (n/8, 2n/8... 7n/8), deciles pour dix classes (n/10, 2n/10,...
9n/10), etc.
O 5
me
mthode : discrtisation standardise
Cette methode se reIere aux valeurs caracteristiques de la distribution - moyenne
et ecart-type - tres interessantes lorsqu`il s`agit d`eIIectuer des comparaisons
entre cartes.
La moyenne est utilisee comme centre ou comme limite de classe et l`ecart-type
pour calculer l`amplitude des classes. Les classes ont l`amplitude d`un ecart-
type.
Si on choisit un nombre pair de classes, la moyenne apparatra comme borne de
classe. Si le nombre de classes est impair, elle sera centre de classe.
Cette methode est sans doute la plus perIormante de toutes les methodes de
discretisation et est la plus employee en cartographie. Elle presente deux
avantages majeurs :
o elle produit des classes d`amplitude egale dont la memorisation est Iacile et la
logique de construction accessible mme au lecteur non averti.
o Elle a le gros avantage de permettre la comparaison entre cartes (construites
evidemment selon la mme methode et avec le mme nombre de classes).
La maniere de proceder est la suivante :
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 78/96
Pour 3 classes :
Pour 4 classes :
Pour 5 classes :
Pour 6 classes :
et ainsi de suite...
Conseils pour la discrtisation standardise
La discretisation standardisee et d`autant plus Iiable que la distribution statistique est
normale (gaussienne).
Les bornes de classes inscrites en legende doivent apparatre clairement (en chiIIre) et
non pas sous la Iorme moyenne plus un ecart-type .
Par contre, il est toujours interessant de Iaire Iigurer en legende la moyenne et l`ecart-
type qui donneront au lecteur une inIormation quant a l`ordre de grandeur et a la
dispersion de la distribution.
O 6
me
mthode : discrtisation selon le relief de lhistogramme
Dmarche
o On dresse un diagramme de type histogramme (diagramme en btons) sur
lequel sont rangees toutes les valeurs de la distribution statistique. On
represente les individus en abscisse et les valeurs en ordonnee.
o On eIIectue visuellement le decoupage la ou la serie presente des sauts (ou
seuils, ou paliers) de valeur.
La methode graphique est une methode simple et permet d`individualiser
rapidement chaque classe. TouteIois, elle presente quelques inconvenients qui la
rendent dans bien des cas, peu pertinente.
o En eIIet, les intervalles sont rarement distribues de telle maniere a ce que les
classes soient equilibrees. Le plus souvent, on est oblige de corriger cette
methode en reintroduisant d`autres coupures pour subdiviser une classe trop
grande ou au contraire en regroupant des valeurs isolees qui engendreraient
trop de classes peu representees sur la carte.
Maximum
Minimum X
X
X
-
X
Maximum Minimum
X
- X
X
-
Maximum
Minimum
X
X
X2
X- 2
1
2
1
2
X
X
X
-
Maximum Minimum
X
X
-
3
2
3
2
1
2
1
2
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 79/96
o EnIin et surtout, la methode graphique noIIre pas la possibilite de comparer
plusieurs cartes, chacune etant construite a partir d`un modele unique de serie
statistique.
discrtisation selon les moyennes
embotes
15,2 - 16,4
16,4 - 17,9
17,9 -20,5
20,5 - 24,7
discrtisation selon les quantiles
14,8 - 16,3
16,3 - 16,9
16,9 -18,4
18,4 - 24,7
discrtisation selon le relief de
l'histogramme
20 - 24,7
14,8 - 16
16 - 18
18 -20
Exemples de discrtisations : 2
me
colonne du tableau (nombre d'agents
pour 1 habitants)
discrtisations standardise
14,8 - 15,3
15,3 - 17,9
17,9 -20,5
20,5 - 24,7
discrtisation en classes d'amplitude
gale
14,8 - 17,3
17,3 - 19,8
19,8 -22,3
22,3 - 24,7
Classe vide !
Mthode non pertinente
2
me
seuil : 18 3
me
seuil : 2
25
20
15
10
5
0
1
er
seuil : 1
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 80/96
Quelques remarques
Dans le detail, les resultats cartographiques diIIerent selon la methode de
discretisation employee, preuve une Iois de plus que c`est bien le cartographe qui
decide avant tout du visage Iinal de la carte.
Les methodes de discretisation sont plus ou moins pertinentes selon le contenu et
la Iorme de la serie statistique a ordonner. Il suIIit que l`ecart-type soit plus
important que la moyenne (serie tres dissymetrique comme c`est le cas pour le
premier exercice) pour que la methode de la discretisation standardisee ne soit
plus utilisable par exemple. De mme, certaines methodes engendrent parIois des
classes vides ; il Iaut donc que le cartographe soit toujours vigilant mme en
cartographie par ordinateur.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 81/96
IX Les cartes d'analyse
Les cartes d`analyse (ou cartes analytiques) sont des cartes a un theme : elles representent
l`extension et la repartition d`un phenomene donne dans le but de preciser ses rapports
avec l`espace geographique. La variete des cartes d`analyse resulte de la diversite des
themes cartographiables (climat, milieu naturel, risques naturels, agriculture, urbanisme,
demographie...) qui n`ont en verite que les limites de l`activite humaine.
On distingue ici les cartes d`analyse selon leur mode de construction base sur les trois
signes elementaires du langage cartographique que sont le point, la ligne et la surIace
engendrant respectivement les Iigures ponctuels, les Iigures lineaires et les Iigures zonaux.
On diIIerencie ainsi sept types de cartes d`analyse : chacun presente, outre une
construction, des Iinalites speciIiques.
p Les cartes en points,
p les cartes en proportions,
p les cartes en diagrammes,
p les cartes en symboles,
p les cartes de reseaux,
p les cartes de Ilux,
p les cartes en plages.
1) Les cartes en points
O Principes et finalits
Les cartes en points utilisent un Iigure ponctuel simple, le point, aIin de signaler
la presence ou l`absence d`un objet : une mairie, un commerce, un service public,
un site touristique, le representant d`une espece animale, etc.
La variation en densite des points sur la carte indique la variation en densite de
l`objet geographique represente.
Si la carte en points et bien conue, l`oil peroit immediatement les diIIerences
de densites dans la distribution des points. Ce type de carte est utile si le nombre
de points est suIIisant : au-dessous d`un certain seuil, la carte en points n`est plus
expressive.
Cartes danalyse ralises partir de figurs
ponctuels.
Cartes danalyse ralises partir de figurs
Cartes danalyse ralises partir de figurs
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 82/96
Le nom generique de carte en points n`interdit cependant pas le recours a
d`autres Iormes geometriques : le carre, le losange ou le triangle sont egalement
utilisables. Leur precision est cependant moindre que le point.
O Ralisation graphique
Sur une mme carte, tous les points sont identiques : ils ont la mme taille et la
mme valeur numerique.
Un point peut designer deux choses :
o on assigne a chaque point un seul objet geographique.
o Chaque point correspond a une valeur numerique (plusieurs (n) objets
geographiques) et on porte sur la carte autant de points que la valeur est
contenue dans le nombre total.
Par exemple, si un point equivaut a n objets (cela peut tre un point pour 100 000 habitants, pour cent ttes de
bovins, pour dix cas de grippe, pour cinq impacts de Ioudre, pour trois cabines telephoniques, etc.) et que x objets
sont a representer, il Iaut dessiner x/n points.
La variation de la structure interne des points (couleurs opposables ou Iorme)
permet d`exprimer la nature des objets geographiques (un point bleu pour une plage
propre et un point noir pour une plage polluee par exemple).
En intervenant sur la taille des points (un point pour 10 habitants et un plus gros
pour 100 par exemple), on passe a un autre type de carte : la carte en proportions
(cI. Ci-dessous).
Si le cartographe diIIerencie les points selon leur Iorme (un carre pour tel objet et un
triangle pour un autre), il obtient une carte en svmboles (cI. Ci-dessous).
2) Les cartes en proportions
O Principes et finalits
L`objectiI des cartes en proportions est de visualiser les quantites en valeurs absolues
des composantes d`un Iait geographique grce a la variation de la surIace des symboles
exprimant ces quantites.
O Conception
La variable visuelle utilisee est la taille : la surIace d`un Iigure est
proportionnelle aux quantites. Il Iaut donc invariablement utiliser, pour les carres
ou pour les cercles proportionnels, la racine carree du ct ou du rayon afin de
matriser la proportionnalit des figurs.
Les proportions sont representees soit par des Iigures geometriques - les plus
repandus sont le cercle, le carre et dans une moindre mesure, le rectangle,
l`etoile, le losange... - soit par des Iigures expressiIs (appeles egalement Iigurines
ou pictogrammes). Le cercle est non seulement la Iigure la plus Iacile a
construire mais aussi la plus lisible. Il est en eIIet diIIicile de respecter la regle de
proportionnalite avec des Iormes complexes qui, de plus, entravent une vision
convenable de l`inIormation portee par les symboles.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 83/96
Reresentatlons de quantltes en ta|eurs abso|ues atec smbo|es geometrlques et
flguratlfs
20
20
20 20
40
40
40 40
80
80
80 80
Comment optimiser la relation entre les donnees statistiques et les Iigures
proportionnels ?
o Le principe est simple : la surIace des Iigures doit conserver le rapport des
quantites a representer. Par exemple, si ces quantites sont de 10 et de 100
(rapport de 1 a 10) alors les Iigures (cercles et carres de preIerence) devront
avoir 1 et 10 millimetres de rayon ou de cte pour que leur surIace conservent
le rapport de 1 a 10.
o Cartes g Donnes donne au processus de conception puis de realisation des
cartes en proportions une Iacilite et une rapidite tres avantageuses mais il Iaut
veriIier si le logiciel propose une solution graphique correcte.
O Ralisation graphique
Il Iaut adapter la taille des signes utilises a l`echelle de la carte et par consequent
a la taille du Iond de carte et/ou des circonscriptions.
Il Iaut eviter d`utiliser des Iigures diIIerents sur une mme carte en proportions :
l`oil peroit diIIicilement les variations de taille d`un carre, d`un triangle ou d`un
rectangle a la Iois.
|lgure 1 : adatatlon des flgures roortlonne|s au fond de carte
-
Bilan des migrations lintrieur de chaque dpartement de Midi-Pyrnes (1982 - 1990) Source : Insee 1994
De trop petits figurs proportionnels rendent difficile la perception et la diffrenciation des proportions (a.). A linverse, de trop grands figurs
proportionnels nuisent la clart de la carte, car ils se chevauchent et occultent le fond de carte (c.). Seule la figure b. garantit une bonne
lisibilit.
Ieile
Cain
c. b. a.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 84/96
Le diagramme semi-circulaire (demi-cercles aIIrontes)
Le cercle se divise en deux demi-cercles qui se Iont Iace. Ce type de diagramme
convient lorsqu`on doit opposer deux phenomenes avec leurs variables, en
particulier pour traiter des themes tels que : importation-exportation, achat-vente... Il
est aussi utilise pour exprimer l`evolution d`une mme variable sur deux periodes
(un demi-cercle bleu pour les diminutions, un demi-cercle rouge pour les
augmentations par exemple).
3) Les cartes en diagrammes
O Principes et finalits
Un diagramme est un graphique en deux ou en trois dimensions qui renseigne sur
la structure d`un phenomene.
Tres souvent, la representation de la structure est combinee avec celle de la
masse. Certains diagrammes sont en outre capables de suggerer l`evolution
temporelle d`un phenomene.
Une carte en diagrammes est donc un Iond de carte* sur lequel sont places des
diagrammes en implantation ponctuelle (structure de la population des grandes
villes d`une region par exemple), en implantation lineaire (evolution du debit
d`un cours d`eau par exemple) ou en implantation zonale (composition de la
production agricole d`un departement par exemple).
Hors cartographie, les diagrammes sont constamment utilises, car ils presentent
theoriquement un moyen eIIicace de visualiser les donnees statistiques tout en
Iacilitant leur interpretation. Comme la carte, le diagramme est une image qui
oIIre l`opportunite de communiquer rapidement un message. Comme la carte, un
diagramme doit respecter une grammaire visuelle et les donnees qu`il transcrit.
En cartographie, aux particularites du diagramme s`ajoutent celles de la carte si
bien que la Iormule de la carte en diagrammes cumule deux handicaps :
o Une carte en diagrammes n`est expressive que si les diagrammes sont
suIIisamment nombreux sinon la carte est inutile. Or, l`oil eprouve des
diIIicultes a lire plusieurs diagrammes en mme temps, a les comparer puis a
degager un quelconque message. De ce Iait, la carte en diagrammes est
deIinitivement plus proche de la carte a lire que de la carte a voir.
o La taille des diagrammes doit s`adapter au Iormat et a la presentation du Iond
de carte. Il est rare d`obtenir une bonne adequation entre le Iond de carte et la
disposition des diagrammes.
O Ralisation graphique
Concretement, il Iaut choisir le bon diagramme en Ionction de l`objectiI de la carte,
des donnees a notre disposition et de l`inIormation a visualiser.
Pour exprimer une repartition
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 85/96
o Le diagramme en barres ou histogramme est construit a partir de deux axes
orthogonaux (coordonnees cartesiennes). Sur un axe, Iigure la variable
representee, sur l`autre, l`echelle des valeurs (les quantites en valeurs
absolues ou plus rarement en pourcentages le plus souvent representees grce
aux diagrammes en secteurs). Le nombre d`individus est traduit par une barre
(un rectangle) dont la surIace est proportionnelle a ce nombre. Le sens du
proIil de construction des barres est horizontal ou vertical. La juxtaposition
des barres Iorme l`histogramme.
La conIiguration de l`axe de la variable diIIere selon que l`etendue de la
variable a ete decoupee en classes (une barre pour chaque classe) ou non (une
barre pour un individu de la variable, une barre pour une annee - cI. ci-
dessous - , etc.).
Diagrammes en barres ou histogrammes
o Le diagramme en secteurs, appele Iamilierement camemberts (pie graph en
anglais), est un diagramme en Iorme de cercle Iractionne en secteurs. La surIace
de chaque secteur est proportionnelle a une valeur numerique (le plus souvent
donnee en pourcentage) appartenant a un ensemble.
Trois presentations :
presentation en cercle qui se Iragmente en secteurs dont l`angle est
proportionnel au taux,
presentation en demi-cercle qui se Iragmente en secteurs selon le mme
principe lorsque le cartographe doit conIronter deux variables diIIerentes par
exemple (importation - exportation par exemple opposition de deux demi-
cercles).
Presentation en anneau (ou couronne). C`est un sous-type du graphique en
secteurs. Il peut contenir plusieurs series de donnees mais les proportions sont
plus diIIicilement lisibles.
E D C B A
Etendue de la variable
Quantites
(valeurs absolues
ou pourcentages)
E
D
C
B
A
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 86/96
Diagrammes en secteurs
Pour exprimer une evolution
o le diagramme en barre ou histogramme (cI. construction plus haut)
D`apres la hauteur des barres, on
observe la variation quantitative d`une
variable sur une periode donnee divisee
en jours, en mois ou en annees.
4) Les cartes en symboles
O Principes et finalits
Le symbole est un signe n`ayant plus de rapport avec la Iorme reelle (la
projection horizontale) de l`objet represente. Deux types de symboles :
o les symboles geometriques (cercles, carres, triangles...),
o les symboles IiguratiIs (ou expressiIs, ou evocateurs) : un epi pour la culture
du ble, un avion pour un aeroport, une cornue pour une usine chimique, etc.
La carte en symboles a pour but de visualiser la presence ou l`absence d`objets
localises grce a des symboles geometriques ou IiguratiIs. La variable visuelle
utilisee est donc la Iorme et suggere une diIIerence).
TouteIois, au niveau de la lecture d`ensemble d`une carte en symboles, l`oil
parvient mieux a distinguer la variation en densite des symboles que la variation
en Iorme des symboles.
Mme si les cartes en symboles sont avant tout des cartes d`inventaire, les
symboles sont un recours precieux pour les cartes de superposition (seance
suivante) et dans tous les cas ou le cartographe doit localiser de maniere simple
et rapide des objets geographiques divers.
E D C B A
Periode (divisee en jours, en mois, en
annees...)
Diagramme en barres
- ou histogramme -
Quantites
(valeurs absolues)
ou pourcentages
12
15
2O
31
22
Donnee 5
22
Donnee 1
12
Donnee 4
15
Donnee 2
31
Donnee 3
2O
Donnee 1
12
Donnee 5
22
Donnee 4
15
Donnee 2
31
Donnee 3
2O
Diagramme en secteurs
- en couronne -
Diagramme en secteurs
- en demi-cercle -
Diagramme en secteurs
- en cercle -
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 87/96
Cartes & Donnes simpliIie beaucoup la realisation des cartes en symboles,
particulierement des cartes en symboles expressiIs. Il propose des bibliotheques
de symboles et l`utilisateur peut en creer, les copier et les manipuler a l`inIini.
Une certaine analogie unit les cartes en symboles et les cartes en diagrammes :
elles ont toutes deux le vent en poupe notamment grce a l`ordinateur mais leur
intert cartographique est limite. De mme que les cartes en diagrammes, les
cartes en symboles n`oIIrent pas de contrastes assez appuyes pour suggerer des
Iormes spatiales et aider l`analyse.
Les cartes en symboles IiguratiIs sont une solution seduisante pour les cartes
publicitaires, les depliants touristiques dont les objectiIs sont entierement tournes
vers la communication et l`esthetique ou pour la presse qui doit distraire et
accrocher le lecteur (magazines de voyage, rubriques touristiques par
exemple). On les rencontre abondamment dans les atlas* pour enIants ou les
Ionds de cartes sont encombres par des dessins tres realistes qui captent
l`attention de l`enIant mais dont l`intert et la precision geographiques sont
parIois douteux.
O Ralisation graphique
Les Iigures geometriques repertorient des objets geographiques en les
conceptualisant, c`est-a-dire en les representant par une Iorme geometrique ou
evocatrice. Les Iigures expressiIs ont une inIinite de Iormes. Ils peuvent tre
depouilles ou au contraire tres acheves.
Le choix des Iigures est en Iait assez limite, car il Iaut les selectionner avec soin.
En eIIet, pour que la carte soit lisible, les Iormes des symboles doivent tre tres
distinctes : une association cercle, carre, etoile et croix est ainsi moins eIIicace
qu`une association cercle, etoile, triangle et rectangle.
Si on travaille en couleurs, on veillera a ce que les couleurs des Iigures soient
semblables ou opposables aIin de ne pas suggerer une hierarchie.
Pour garantir la clarte de la carte, il ne Iaut pas utiliser trop de symboles
diIIerents.
Les symboles expressiIs, souvent trop compliques, interdisent une bonne lecture
des proportions : la variation de taille d`un cercle ou d`un carre est bien plus
perceptible - c`est une question de lisibilite retinienne - que celle d`un arbre ou
d`une voiture.
Lorsque l`echelle le permet, il Iaut veiller a ne pas utiliser de symboles ponctuels
pour des phenomenes zonaux. Cette conIusion entrane invariablement une carte
a lire.
5) Les cartes de rseaux
O Principes et finalits
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 88/96
Un reseau est un
2
ensemble de lignes ou de relations entre des points.
Dans les Iaits, les reseaux ont des visages heteroclites mais leur Iorme mme
devoile tres souvent les particularites generales de l`organisation d`un espace. On
distingue les reseaux materiels et les reseaux immateriels.
o Les reseaux materiels ont une assise concrete et tangible : l`ensemble des
lignes de communication d`un territoire, d`une compagnie de transport -
reseau aerien, routier, Iluvial, Ierre, reseau de la S.N.C.F. -, les VRD (voiries
et reseaux divers) d`une commune, le reseau hydrographique, etc.
o Les reseaux immateriels sont intangibles : reseaux de communication,
urbains
3
, de services, des Iiliales d`une grande entreprise, etc.
Un reseau est donc constitue de lignes et de points. Les points (ou noeuds) sont
des lieux, des equipements, des inIrastructures (villes, ports, stations de metro,
centraux telephoniques, concessionnaires...). Par exemple, pour un reseau aerien,
les lignes sont les couloirs aeriens et les points, les aeroports.
Un reseau est hierarchise ou partiellement hierarchise si les relations entre deux
lieux d`un mme reseau ne sont pas directes mais passent par un noeud de rang
superieur : reseaux des grandes entreprises, reseaux de villes, etc. Dans un reseau
centralise (tel le reseau routier ou Ierre Iranais), les relations entre deux lieux
passent par le centre du reseau.
Les cartes de reseaux indiquent les liaisons et le tvpe de liaison entre deux lieux.
O Ralisation graphique
Les cartes de reseaux utilisent des Iigures lineaires pour exprimer les liaisons et
des Iigures ponctuels (symboles geometriques ou IiguratiIs, le nom du noeud)
pour localiser les noeuds.
Les cartes de reseaux sont plus ou moins generalisees. En d`autres termes, soit le
cartographe decide d`tre le plus proche possible de la realite du terrain en
respectant les distances et les traces des reseaux, les temps de parcours, soit au
contraire, il preIere s`abstraire de la realite sans respect des distances ou en
modelisant la Iorme du reseau.
Outre la localisation des relations et des noeuds, le cartographe peut suggerer
quatre choses sur une carte de reseaux :
o un classement du reseau en jouant sur la taille (simplement indicative et non
pas pour exprimer une quantite comme sur les cartes de Ilux), la couleur (le
ton) ou la valeur des lignes : par exemple, route departementale, nationale,
autoroute.
o La nature du reseau aIin d`exprimer une difference en variant la Iorme, la
couleur des Iigures lineaires: par exemple, relations privilegiees ou mauvaises
relations, voies Ierrees electriques ou non, etc.
o Une diIIerenciation des noeuds avec des signes geometriques, expressiIs ou le
nom du noeud.
2
Reseau urbain : ensemble, generalement hierarchise, de villes d`importance variable unies par des liens d`ordre economique, administratiI, culturel, etc.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 89/96
o Un classement des noeuds en Ionction de leur importance.
6) Les cartes de flux
O Principes et finalits
Un Ilux est la progression, la circulation d`un volume de biens ou de personnes.
o Un Ilux a une origine, une destination, un trajet.
o Si le Ilux emprunte un reseau materialisable et identiIie (routes, voies Ierrees,
routes aeriennes, etc.), on dit que le Ilux est materiel.
o Si on ne connat du Ilux que son point de depart et d`arrivee sans identiIier le
reseau qu`il suit, le Ilux est considere comme immateriel (Ilux de capitaux,
d`inIormations, de populations, etc.).
Une carte de Ilux visualise, comme la carte de reseaux, les liaisons entre un
certain nombre de points mais aussi l`ampleur et l`inegalite de ces liaisons.
O Ralisation graphique
Un Ilux est cartographie par un Iigure lineaire, generalement une Ileche.
o Des Ileches simples et claires Iacilitent la lecture (a.). De ce Iait, la tte des
Ileches doit tre proportionnelle au corps des Ileches (b.). EnIin, il Iaut eviter
de biseauter le debut du corps de la Ileche aIin d`obtenir une largeur constante
(c.).
NON
OU|
o. a.
c.
o Si le Ilux est exprime en valeur absolue (ampleur du Ilux en milliers de
tonnes, en nombre de vehicules, en millions de Irancs par exemple), le
principe est le mme que pour les Iigures proportionnels des cartes en
proportions : on joue sur la superficie du Iigure. Une quantite trois Iois plus
importante qu`une autre est cartographiee par un trait trois Iois plus epais.
L`epaisseur est donc proportionnelle a l`ampleur du Ilux. Cependant, la
multiplication des changements d`epaisseur peut nuire a la clarte de la lecture.
Il est possible d`avoir recours a une mise en classes (5 ou 6 au maximum) : on
perd de l`inIormation mais le lecteur memorisera plus Iacilement la carte.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 90/96
o S'il s`agit d`un taux (intensite des Ilux en nombre de vehicules par jour, en
tonnes par jour par exemple), on Iait varier la valeur ou l`intensite de la
couleur du Iigure.
o Il est possible egalement de combiner deux variables visuelles pour exprimer
soit l`ampleur et la nature du Ilux soit l`intensite et la nature du Ilux.
o Quand deux Ileches se croisent, le mme principe que pour les Iigures
proportionnels est adopte : la Ileche la plus Iine a la priorite sur la Ileche la
plus epaisse.
o Lorsque plusieurs Ilux convergent vers un mme lieu ou divergent d`un
mme lieu, on prend comme axe des Ileches, les rayons d`un cercle
imaginaire dont le centre est soit le point de depart, soit le point d`arrivee des
Ileches (a.). Dans la pratique, cette solution n`est pas toujours realisable, car
les Ileches (les Ilux dans la realite) s`organisent rarement regulierement
autour du point d`arrivee ou de depart. Dans ce cas, les Ileches sont coudees
de telle maniere a ce que soit les bases, soit les ttes de Ileches s`organisent
selon les rayons du cercle (b.).
a. o.
Cartographie des flux matriels
o Le Iigure lineaire est centre sur le trajet du Ilux. La tte de la Ileche ou une
Ileche dessinee parallelement au Iigure lineaire indique le sens du Ilux.
o Si le Ilux se divise en Ilux montant et en Ilux descendant entre deux points, on
identiIie ces deux Ilux soit en dessinant deux Ileches en sens inverse, soit en
accolant deux bandes.
o Un travail a petite echelle (une carte des Ilux migratoires a l`echelle d`un pays
par exemple) exige une generalisation et donc une simpliIication des Ilux.
Pour cela, on regroupe les points de depart et les points d`arrivee aIin de
limiter le nombre de Ileches.
Cartographie des flux immatriels
Les Ilux immateriels sont traites sans tenir compte des trajets reels tout en
conservant l`origine et la destination.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 91/96
7) Les cartes en plages
O Principes et finalits
Les cartes en plages sont a base de donnees numeriques.
Elles expriment graphiquement une variation ordonnee (un classement) par des
plages zonales de couleurs ou tramees, ordonnees.
Chaque plage recouvre une circonscription. Une circonscription est une division
administrative d`un territoire.
o En France, de nombreuses circonscriptions administratives se superposent :
coexistent en eIIet l`Etat, la region, le departement, la commune et les
structures de cooperations intercommunales (S.I.V.U., S.I.V.O.M., S.I.E.P.,
districts, communautes de communes et les communautes urbaines) auxquels
on doit ajouter les subdivisions administratives (arrondissements) , electorales
(cantons), statistiques (l`lot I.N.S.E.E.) et toutes les circonscriptions
speciIiques a une action, une administration ou une institution
(circonscriptions academiques, dioceses, etc.).
o Il Iaut noter qu`au 1
er
janvier 1992, la France compte 36 763 communes
(contre 32 000 pour l`Allemagne, l`Espagne et l`Italie reunies), 100
departements et 22 regions programmes (26 si on inclut la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique et la Reunion). Le nombre des collectivites territoriales
en France est superieur a celui des autres etats communautaires reunis.
O Ralisation graphique
Le Iond de carte
o Le nombre et la variete des circonscriptions en France et dans une moindre
mesure dans les autres pays europeens laisse au cartographe une grande
liberte quant au choix du Iond de carte.
Neanmoins, la base du Iond de carte doit tre homogene, c`est-a-dire qu`il ne
doit se Ionder que sur une circonscription et non plusieurs en mme temps.
o Une valeur doit correspondre a une circonscription de base consideree comme
uniIorme.
o Pour garantir cette uniIormite, la carte en plage ne peut tre utilisee que pour
des phenomenes couvrant toute la surIace des circonscriptions : par exemple
taux de chmage, densite de population, pourcentage de Iamilles nombreuses
ou pourcentage d`emplois tertiaires.
o Il ne Iaut pas trop appuyer graphiquement les contours des circonscriptions au
risque de mettre en retrait le message et de nuire a la comprehension de la
carte. Le compromis est de choisir un trait Iin, noir ou gris aIin d`identiIier
aisement les circonscriptions.
o Si on dispose de donnees pour une circonscription, le Iait de s`en servir a des
niveaux plus detailles est proscrit. Par exemple, on ne peut choisir comme
circonscription de base, le departement alors que l`on ne possede que des
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 92/96
donnees a l`echelle de la region. Le respect du lecteur doit aussi guider le
travail du cartographe.
o Sur une carte en plage, un traitement des donnees par un decoupage en classes
de la serie numerique est obligatoire selon les methodes expliquees par
ailleurs. Une valeur ou une couleur (consideree dans son intensite) correspond
a une classe.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 93/96
X Les autres formes de cartes
et les nouvelles cartes
Les apports recents de l`inIormatique, des statistiques et de la conqute spatiale ont donne
a la carte de nouveaux visages. Leur lecture et leur utilisation s`averent generalement
passionnantes mais leur conception et leur realisation sont encore reservees a des
specialistes (ingenieurs, geographes, statisticiens, demographes, ingenieurs cartographes,
etc.) car la matrise de techniques et de materiels tres pointus est indispensable.
TouteIois, une description mme breve s`impose, car ces nouvelles cartes se repandent
de plus en plus dans le monde des cartes thematiques. De plus, les Ionctionnalites de Cartes
& Donnes (notamment des versions Medium et Plus) Iont que ces cartes soient sinon
realisables, au moins utilisables par les cartographes occasionnels.
1) Les cartes en carroyage
O Principes et finalits
Les cartes en carroyage consistent a decouper un espace en unites regulieres
appelees carreaux. Dans chaque carreau (de Iorme generalement carre et parIois
rectangulaire voire hexagonale), on eIIectue un comptage de la variable retenue.
On a donc une relation entre les carreaux et l`inIormation geographique. Le
comptage peut se Iaire soit par des releves de terrain soit par des methodes
statistiques adaptees.
On reprsente les relations (relations de
diffrence, de proportionnalit, dordre)
entre les carreaux grce des variables
visuelles adaptes.
On applique une grille sur le territoire et on
procde au dnombrement des objets
cartographier dans chaque carreau
Carte du territoire
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 94/96
Les cartes en carroyage, tout comme les cartes lissees, se liberent des
circonscriptions de base. Cela aboutit a une neutralite du decoupage
particulierement interessante en ce qui concerne les donnees naturelles pour
lesquelles les limites administratives sont totalement artiIicielles. De plus, le
decoupage en carreaux presente des qualites de stabilite spatiale et temporelle
que n`ont pas les zones administratives. En outre, l`expression cartographique est
tres simple lorsque l`on utilise la cartographie par ordinateur. EnIin, l`egalite des
superIicies des carreaux permet des comparaisons Iiables et d`appliquer des tests
statistiques non tronques par l`heterogeneite des circonscriptions de base.
TouteIois, l`application d`une grille sur un territoire est un acte artiIiciel : un
leger deplacement de la grille conduit a une variation parIois importante des
comptages. Le probleme majeur est le choix de la taille du carreau : plus les
carreaux sont petits, plus l`inIormation est precise mais l`analyse est plus
diIIicile a realiser. Le cot de l`inIormation geographique augmente en mme
temps que le pas du carreau (un carre de 10 km de cte a un pas de 10 km)
diminue.
Les recensements des pays scandinaves et anglo-saxons sont accomplis selon le
procede du carroyage. En France, cette methode reste encore conIidentielle. Une
partie du prochain recensement eIIectue par l`INSEE utilisera vraisemblablement
le procede du carroyage.
Les cartes en carroyage, ainsi que les techniques cartographiques qui en
decoulent (lissage par exemple) sont parIaitement adaptees a la cartographie par
ordinateur). Elles exigent un recueil des donnees tres rigoureux et un maniement
experimente des statistiques et de l`inIormatique. Un apprentissage speciIique est
donc necessaire.
2) Les anamorphoses
O Les anamorphoses sont des cartes dont les unites spatiales ont ete deIormees aIin de
traduire graphiquement un phenomene quantitatiI dont la dimension spatiale
n`apparat plus. Ces cartes sont conues de telle Iaon a ce que la Iorme originelle
de l`espace etudie ne soit pas meconnaissable : le concepteur Iixe ainsi un seuil de
reconnaissance . Les anamorphoses sont elaborees de trois manieres :
les unites spatiales (pays, regions, carreaux, etc.) sont transIormees en polygones
(generalement des rectangles ou des Iormes rectangulaires) dont la surIace est
proportionnelle a une quantite (population, Produit Interieur Brut par exemple)
qui leur a ete attribuee. Les rectangles doivent rappeler la Iorme et surtout
respecter la disposition des unites spatiales originelles : ces anamorphoses sont
appelees anamorphoses simples .
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 95/96
En partant du decoupage zonal traditionnel (carte choroplethe) et a partir d`un
point d`origine, on Iait subir des distorsions aux contours des unites spatiales
grce a une Ionction mathematique : c`est une anamorphose unipolaire. Les
localisations relatives changent et la deIormation d`une unite spatiale se
repercute sur les autres unites spatiales. Ce type d`anamorphose atteint
rapidement la limite constituee par le decoupage administratiI.
Le troisieme type d`anamorphose resulte de la technique du carroyage. A chaque
circonscription sont aIIectees une, plusieurs ou des parties de carreaux. La
contraction d`une partie du carroyage agit sur le reste du carroyage, car la
nouvelle surIace qui doit tre attribuee a chaque carreau est calculee
progressivement de telle maniere a ce que la grille ne se rompe pas. Ces
anamorphoses nommees anamorphoses bipolaires sont les plus eIIicaces pour
exprimer des tendances spatiales
O Avantages et contraintes
Si le premier type d`anamorphose est realisable en cartographie manuelle, il n`en
est pas de mme pour les anamorphoses deIormant les contours des unites
geographiques et les localisations relatives. Celles-ci necessitent l`usage de
l`ordinateur et de logiciels adaptes dont les algorithmes derivent de la mecanique
des betons ou des metaux, les materiaux etant appeles de mme que les carreaux
de la carte a resister a certaines pressions.
Les anamorphoses presentent l`avantage d`eliminer les liens de cause a eIIet
existant entre la superIicie des territoires et la variable etudiee.
Cependant, les distorsions engendrees par les anamorphoses reclament de la part
du lecteur la connaissance de la Iorme originelle du territoire aIin bien sr qu`il
puisse estimer et mesurer visuellement les deIormations.
Qualite pour les uns, deIaut pour les autres, les anamorphoses ne Iournissent pas
une lecture de detail de l`inIormation geographique.
Les anamorphoses, de par leur aspect peu conventionnel, surprennent le lecteur.
Par consequent, elles Iacilitent la memorisation des tendances spatiales du
phenomene represente.
3) Les cartes en trois dimensions
O Les cartes en 3 D ne sont pas en relieI palpable : elles sont en Iait en
perspective. Aux deux dimensions x et y de la Ieuille s`ajoute la dimension z.
AutreIois realisees a la main pour representer le relieI, elles visualisent aujourd`hui
des themes divers et non plus seulement concrets (cartes thematiques). Les
methodes ont en eIIet evolue : les cartes en 3D sont aujourd`hui le monopole de
l`inIormatique, car ces cartes supposent des traitements de donnees tres puissants et
des representations graphiques non moins complexes que seuls les ordinateurs
peuvent reellement accomplir dans un laps de temps raisonnable.
Manuel de Cartographie
Manuel de Cartographie Copvright Articque 96/96
O Le but de ces cartes est d`assimiler une donnee altimetrique (donnee z ) a une
variable quantitative quelconque. Le probleme est l`adequation des maillages
administratiIs a la mise en perspective, car les circonscriptions les plus etendues
auront un volume superieur a celui des petites circonscriptions. Cela aboutit
generalement a des cartes peu claires. De ce Iait, la solution du carrovage puis du
passage a la troisieme dimension est la plus souvent retenue.
Vous aimerez peut-être aussi
- L Ancien TestamentDocument270 pagesL Ancien TestamentThomaasSankara100% (3)
- Formation Stratégie DigitaleDocument41 pagesFormation Stratégie DigitaleISAIAS AMORIM DE OLIVEIRA100% (3)
- Formation Initiation Autocad 2dDocument89 pagesFormation Initiation Autocad 2dranouwanisPas encore d'évaluation
- Yvan Castanou - Approvisionnez Votre Compte PDFDocument1 pageYvan Castanou - Approvisionnez Votre Compte PDFlynxnetPas encore d'évaluation
- 18 LIVRE C++ 1ère EDITIONDocument133 pages18 LIVRE C++ 1ère EDITIONIrchade DjabakatiePas encore d'évaluation
- Presentation Du CamerounDocument21 pagesPresentation Du CamerounlynxnetPas encore d'évaluation
- Preparer TOEICDocument193 pagesPreparer TOEICgorgui ndiayePas encore d'évaluation
- Entreprise BanqueDocument297 pagesEntreprise BanquesbraillonPas encore d'évaluation
- عمليات الاندماج والاستحواذ ودورها في تحقيق ميزة تنافسية وزيادة القيمة للمساهمين- مقاربة نظرية PDFDocument23 pagesعمليات الاندماج والاستحواذ ودورها في تحقيق ميزة تنافسية وزيادة القيمة للمساهمين- مقاربة نظرية PDFMohamed PrincePas encore d'évaluation
- 15 Les Enjeux de L'economie Circulaire ImpoDocument2 pages15 Les Enjeux de L'economie Circulaire ImpoSami CharafPas encore d'évaluation
- Aap 80003Document251 pagesAap 80003Mohamed GuerdanePas encore d'évaluation
- Cours 2021 - Missions Du RéviseurDocument330 pagesCours 2021 - Missions Du RéviseurkenPas encore d'évaluation
- Etude de Cas de VALEODocument4 pagesEtude de Cas de VALEOtomboPas encore d'évaluation
- C - Fichier Des EcrituresDocument93 pagesC - Fichier Des EcrituresOuani Ablo100% (1)
- Les Metiers de La Banque de La Finance Et de L Assurance 1Document148 pagesLes Metiers de La Banque de La Finance Et de L Assurance 1missydra78Pas encore d'évaluation
- Je ne sais rien... mais je dirai tout!: Mémoires d'un relationnisteD'EverandJe ne sais rien... mais je dirai tout!: Mémoires d'un relationnistePas encore d'évaluation
- Le Grand Livre Des Modèles de LettresDocument2 069 pagesLe Grand Livre Des Modèles de LettresGCAlgerie.comPas encore d'évaluation
- Marbre Une Industrie Encore A La TraineDocument2 pagesMarbre Une Industrie Encore A La TraineRania MoustaouiPas encore d'évaluation
- L'Essentiel Des Marchés Financiers by Éric Chardoillet Marc Salvat Henri Tournyol Du ClosDocument62 pagesL'Essentiel Des Marchés Financiers by Éric Chardoillet Marc Salvat Henri Tournyol Du Closamina mgharfaouiPas encore d'évaluation
- Top - secret.N39.Octobre Novembre.2008.OVNI Qui Sont Les Auteurs Des Cercles de CultureDocument68 pagesTop - secret.N39.Octobre Novembre.2008.OVNI Qui Sont Les Auteurs Des Cercles de CultureJulienB77100% (3)
- Exos PertDocument48 pagesExos PertOussama Hjira100% (2)
- Lbo 04Document13 pagesLbo 04mbm26366Pas encore d'évaluation
- Le Processus de Restauration DivineDocument1 pageLe Processus de Restauration DivinelynxnetPas encore d'évaluation
- 4 AuditDocument17 pages4 Auditkarim labidi100% (1)
- Business IntelligDocument434 pagesBusiness Intelligtolotra100% (1)
- 1 Analyse FonctionnelleDocument14 pages1 Analyse FonctionnelleASSINIE100% (1)
- Le Rapport Sur L'état Des Sols en FranceDocument192 pagesLe Rapport Sur L'état Des Sols en Francejulielesechos100% (1)
- 1990 011 FRDocument108 pages1990 011 FRPEIXOTO deanPas encore d'évaluation
- Pcu126 HDDocument100 pagesPcu126 HDleila.amamraaPas encore d'évaluation
- Ak Mfa2Document108 pagesAk Mfa2EFFAPas encore d'évaluation
- AF017Lanalyse Fin...Document216 pagesAF017Lanalyse Fin...zakiPas encore d'évaluation
- © 2015 Pearson France - Microéconomie - Risque, Finance, Assurance - Franck Bien, Thomas LanziDocument2 pages© 2015 Pearson France - Microéconomie - Risque, Finance, Assurance - Franck Bien, Thomas LanziKamilia LoukilPas encore d'évaluation
- SVM PDFDocument42 pagesSVM PDFprimerosePas encore d'évaluation
- UE5 - Management Des Systèmes D'Information: SESSION 2011Document4 pagesUE5 - Management Des Systèmes D'Information: SESSION 2011sirissrxPas encore d'évaluation
- 03 Cours Inequations Premier DegreDocument14 pages03 Cours Inequations Premier DegreJoseph Daniel MoungangPas encore d'évaluation
- Entreprise 2018Document299 pagesEntreprise 2018Duringer100% (45)
- La Problématique Du Chômage Le Vécu Et Les Pratiques Sociales Des Jeunes (Modéle Du Plan)Document123 pagesLa Problématique Du Chômage Le Vécu Et Les Pratiques Sociales Des Jeunes (Modéle Du Plan)chnz2001Pas encore d'évaluation
- Le BPADocument13 pagesLe BPAFabrice AkelePas encore d'évaluation
- Intro Forget PDFDocument6 pagesIntro Forget PDFKeNzaPas encore d'évaluation
- Plaquette Forum CentraleSupelecDocument234 pagesPlaquette Forum CentraleSupelecsoldola0% (1)
- Cours BD - S4 - BCG - V1Document41 pagesCours BD - S4 - BCG - V1Oukouran BrahimPas encore d'évaluation
- TD MicroDocument20 pagesTD Microabdelaziz19011984Pas encore d'évaluation
- Chapitre 3 La Théorie Des Probabilités Cours ÉtudiantsDocument36 pagesChapitre 3 La Théorie Des Probabilités Cours ÉtudiantsReda El Kati100% (1)
- Organisation Et Fonctionnement Des Banques (LAST) - 09.11.12Document263 pagesOrganisation Et Fonctionnement Des Banques (LAST) - 09.11.12fankamPas encore d'évaluation
- Abacus Manuel FRDocument50 pagesAbacus Manuel FRJohn Herbert Nobre PiresPas encore d'évaluation
- Cycle D'expertise Comptable - GROUPE ISCAEDocument1 pageCycle D'expertise Comptable - GROUPE ISCAEMounir AakibPas encore d'évaluation
- Master OCCDocument2 pagesMaster OCCfatimazaPas encore d'évaluation
- CFONB Codes OperationsDocument60 pagesCFONB Codes OperationsHabibPas encore d'évaluation
- 04 Cpart Ex2Document9 pages04 Cpart Ex2Saleh MohamedPas encore d'évaluation
- Cours1 CloisonsDocument34 pagesCours1 CloisonsAEMPas encore d'évaluation
- Memoire Relocalisation en France AnonymeDocument97 pagesMemoire Relocalisation en France AnonymeSoufiane SegPas encore d'évaluation
- Faire Signer Ses Clients Le Closing - Pascal Py (2012)Document284 pagesFaire Signer Ses Clients Le Closing - Pascal Py (2012)laurenzoPas encore d'évaluation
- François JOLIVET Manager L'entreprise Par ProjetsDocument198 pagesFrançois JOLIVET Manager L'entreprise Par ProjetsabdkadiriPas encore d'évaluation
- Vers Une Relocalisation Des Activités Industrielles ?Document6 pagesVers Une Relocalisation Des Activités Industrielles ?emmouhoudPas encore d'évaluation
- Methodologie Projet InnovantDocument69 pagesMethodologie Projet Innovantgsn92504Pas encore d'évaluation
- PsychologieDocument162 pagesPsychologiedocsemdPas encore d'évaluation
- M04 Papier Et CartonDocument38 pagesM04 Papier Et CartonAhmed Mlk100% (1)
- Henry Mintzberg - Gérer Dans L'actionDocument193 pagesHenry Mintzberg - Gérer Dans L'actionanselmezeufackPas encore d'évaluation
- Sika Finances 8Document104 pagesSika Finances 8Georges A. K. BANNERMANPas encore d'évaluation
- B50V300SGP-Importation Des Donnees Excel-1201Document128 pagesB50V300SGP-Importation Des Donnees Excel-1201Wail Bahou100% (1)
- Modélisation Facteur de RemboursementDocument27 pagesModélisation Facteur de RemboursementBoursiquot RicardoPas encore d'évaluation
- Choix Des InvestissementsDocument8 pagesChoix Des InvestissementsFlorian LabourPas encore d'évaluation
- Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleD'EverandAspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Directives volontaires sur le suivi des forêtsD'EverandDirectives volontaires sur le suivi des forêtsPas encore d'évaluation
- Rapport d'activité 2017 de la Banque européenne d'investissement: Un impact qui façonne l'avenirD'EverandRapport d'activité 2017 de la Banque européenne d'investissement: Un impact qui façonne l'avenirPas encore d'évaluation
- Situation des Forêts du monde 2014D'EverandSituation des Forêts du monde 2014Pas encore d'évaluation
- Évaluations nationales des acquis scolaires, Volume 3: Mettre en oeuvre une évaluation nationale des acquis scolairesD'EverandÉvaluations nationales des acquis scolaires, Volume 3: Mettre en oeuvre une évaluation nationale des acquis scolairesÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Les Découpages Du Territoire.Document439 pagesLes Découpages Du Territoire.lynxnetPas encore d'évaluation
- Laccueil Physique Cinq Etapes Pour Un Premier Contact ReussiDocument2 pagesLaccueil Physique Cinq Etapes Pour Un Premier Contact ReussilynxnetPas encore d'évaluation
- Cahier Economique Du Cameroun Vol1Document23 pagesCahier Economique Du Cameroun Vol1lynxnetPas encore d'évaluation
- Paul Ettori Mes Deux NaturesDocument1 pagePaul Ettori Mes Deux NatureslynxnetPas encore d'évaluation
- Famille Je Taime - Comment Pardonner La Pratique Du Pardon Partie PDFDocument4 pagesFamille Je Taime - Comment Pardonner La Pratique Du Pardon Partie PDFlynxnetPas encore d'évaluation
- Alain Aghedu Pourquoi Evangeliser Actes Des ApotresDocument2 pagesAlain Aghedu Pourquoi Evangeliser Actes Des ApotreslynxnetPas encore d'évaluation
- Philippe Landrevie PersecutionDocument3 pagesPhilippe Landrevie PersecutionlynxnetPas encore d'évaluation
- Rapportpfe Chatbot Kissa AlaaArbounDocument76 pagesRapportpfe Chatbot Kissa AlaaArbounboughjihen2Pas encore d'évaluation
- MAINTENANCIERDocument2 pagesMAINTENANCIERLassané KoudougouPas encore d'évaluation
- Correction Exam SEDocument10 pagesCorrection Exam SESoukaina NidbellaPas encore d'évaluation
- For 22 Fiche D'expression de Besoins D'achat de Matériel A Outiallage Pour Walid SalhiDocument2 pagesFor 22 Fiche D'expression de Besoins D'achat de Matériel A Outiallage Pour Walid Salhizaghdoud slim100% (2)
- Analyse R PDFDocument631 pagesAnalyse R PDFYacin LdyPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Oscillations Electrique LibreDocument32 pagesChapitre 3 Oscillations Electrique Libreرضا سهودةPas encore d'évaluation
- 5-Cours GSM SecuriteDocument11 pages5-Cours GSM SecuriteRami DridiPas encore d'évaluation
- Exercices Data Mining (Partie2) Avec SolutionDocument5 pagesExercices Data Mining (Partie2) Avec SolutionWail ChoukhairiPas encore d'évaluation
- Specifications Techniques de Conception Et de Mise en Oeuvre Des Reseaux...Document50 pagesSpecifications Techniques de Conception Et de Mise en Oeuvre Des Reseaux...Smocot ViorelPas encore d'évaluation
- RMI Avec Eclipse Pas À PasDocument10 pagesRMI Avec Eclipse Pas À Pasfree mahdoisPas encore d'évaluation
- Cours Ro Chap2 Pptefondpl KNTDocument42 pagesCours Ro Chap2 Pptefondpl KNTabdrahim el mellaquiPas encore d'évaluation
- Chapitre Eléments de PrésentationDocument5 pagesChapitre Eléments de PrésentationwalidbaPas encore d'évaluation
- Cours HTML5 - CSS3 3sti 2021 2022Document48 pagesCours HTML5 - CSS3 3sti 2021 2022zrellimohamed110Pas encore d'évaluation
- productTechnicalSheet MIELE KD 26022 WSDocument1 pageproductTechnicalSheet MIELE KD 26022 WSBrigitte LANDAISPas encore d'évaluation
- Elex N°15 - Octobre 1989Document57 pagesElex N°15 - Octobre 1989SquallLionPas encore d'évaluation
- Psoc PDFDocument19 pagesPsoc PDFHichem HamdiPas encore d'évaluation
- Audit Sécurité Support Elyes 2011Document24 pagesAudit Sécurité Support Elyes 2011Mahmoud TrabelsiPas encore d'évaluation
- 2-LCN Les Humanités NumériquesDocument21 pages2-LCN Les Humanités NumériquesMadie BlackPas encore d'évaluation
- Soigner Son Accueil Téléphonique - Fiche Pratique PDF À TéléchargerDocument1 pageSoigner Son Accueil Téléphonique - Fiche Pratique PDF À TéléchargerWatif kayPas encore d'évaluation
- VBAexcel FeuilleDeCalculDocument42 pagesVBAexcel FeuilleDeCalculMartin BraitPas encore d'évaluation
- Stargate ConflictDocument4 pagesStargate ConflictTakio SamaPas encore d'évaluation
- TD 9Document3 pagesTD 9jomalikePas encore d'évaluation
- Plan Detude Genie Civil PDFDocument1 pagePlan Detude Genie Civil PDFAziz SelamPas encore d'évaluation
- Mode D'emploi Traceur GPS Tracking GPRS GSM SOS Voiture Animaux Support AimantDocument12 pagesMode D'emploi Traceur GPS Tracking GPRS GSM SOS Voiture Animaux Support AimantHamed SOARAPas encore d'évaluation
- Active Directory 2008 R2 GPO PDFDocument12 pagesActive Directory 2008 R2 GPO PDFSDCXPas encore d'évaluation