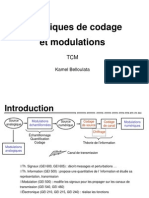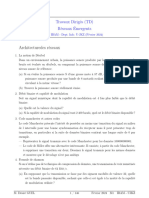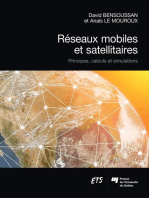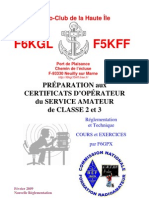Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
TV PDF
TV PDF
Transféré par
Ana SmaalTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
TV PDF
TV PDF
Transféré par
Ana SmaalDroits d'auteur :
Formats disponibles
DESS Systmes Electroniques option tlcom
FIUPSO 3 Electronique
Universit Paris XI
Systmes de Tlcommunications
Partie II : Tlvision
2003-2004
Arnaud BOURNEL
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
2003-2004
SysTl2
Universit Paris XI
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Table des matires
I.
CONCEPTS FONDAMENTAUX ......................................................................................................................... 5
1.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
5.
II.
L'IMPRESSION DE MOUVEMENT ............................................................................................................................. 5
LE BALAYAGE DE L'ECRAN POUR UNE IMAGE MONOCHROME ................................................................................ 5
Principe ........................................................................................................................................................... 5
Balayage entrelac .......................................................................................................................................... 6
Dfinition de l'image et bande passante .......................................................................................................... 6
CONSTITUTION DU SIGNAL VIDEO COMPOSITE ....................................................................................................... 7
Amplitude......................................................................................................................................................... 7
Synchronisation ............................................................................................................................................... 8
Correction de gamma ...................................................................................................................................... 9
Composante continue ...................................................................................................................................... 9
TRANSMISSION .................................................................................................................................................... 10
Son ................................................................................................................................................................. 10
Frquences porteuses .................................................................................................................................... 11
RESUME : CHAINES D'EMISSION ET RECEPTION ................................................................................................... 12
TELEVISION EN COULEURS .......................................................................................................................... 14
1.
2.
3.
a.
b.
4.
a.
b.
c.
III.
LES ECRANS ................................................................................................................................................... 20
1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
IV.
a.
b.
4.
a.
b.
c.
d.
VI.
LES ECRANS A TUBE CATHODIQUE (CRT) ........................................................................................................... 20
LES ECRANS PLATS .............................................................................................................................................. 21
Les crans cristaux liquides (LCD) ............................................................................................................ 21
Les crans plasma (PDP) ........................................................................................................................... 22
Les crans effet de champ (FED) ............................................................................................................... 23
Les crans lectroluminescents (ELD) .......................................................................................................... 24
Autres technologies en dveloppement .......................................................................................................... 24
VERS LA TELEVISION NUMERIQUE....................................................................................................... 24
1.
2.
3.
V.
PRINCIPES ........................................................................................................................................................... 14
ECRAN COULEUR ................................................................................................................................................. 14
SIGNAL VIDEO COULEUR ..................................................................................................................................... 15
Colorimtrie .................................................................................................................................................. 15
Aspect frquentiel .......................................................................................................................................... 15
LE DIFFERENTS STANDARDS ................................................................................................................................ 16
Systme NTSC................................................................................................................................................ 16
Systme PAL .................................................................................................................................................. 18
Systme SECAM ............................................................................................................................................ 19
ENJEUX ............................................................................................................................................................... 24
LES CONTRAINTES DU NUMERIQUE...................................................................................................................... 25
LES PREMIERES NORMES ..................................................................................................................................... 26
Normes MAC ................................................................................................................................................. 26
Techniques de compression d'images ............................................................................................................ 27
SYSTEMES DVB .................................................................................................................................................. 28
Le groupe DVB .............................................................................................................................................. 28
Codage source ............................................................................................................................................... 28
Le multiplexage.............................................................................................................................................. 30
Le codage canal............................................................................................................................................. 30
ANNEXE : RECEPTION HETERODYNE........................................................................................................ 33
SOURCES D'INSPIRATION.......................................................................................................................... 33
2003-2004
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
2003-2004
SysTl2
Universit Paris XI
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
I.
SysTl2
Universit Paris XI
Concepts fondamentaux
1. L'impression de mouvement
La transmission sur un canal, ou l'enregistrement sur un support magntique ou optique d'une image anime,
ncessitent de la mettre sous forme d'un signal lectrique dit signal vido. Une image anime peut tre considre
comme une fonction de 3 variables : "Information d'image" = I(x,y,t)
Dans le temps (t), on transmet un nombre suffisant d'images par seconde pour que l'il, qui ragit assez lentement,
ait l'impression d'un mouvement continu ; connu depuis plus d'un sicle, c'est le principe du cinma. Au cinma, la
frquence d'affichage est de 24 images par seconde. Pour la tlvision elle est gale la moiti de la frquence du
rseau lectrique, soit 25 images par seconde en Europe et dans le reste du monde, l'exception de l'Amrique du Nord,
du Japon, et d'une grande partie de l'Amrique du Sud pour lesquelles la frquence d'affichage est gale 30 images par
seconde. Les valeurs numriques que nous donnerons par la suite correspondront essentiellement aux normes
d'affichage "europennes".
Si l'image contient des frquences (temporelles ou spatiales) suprieures la moiti de la frquence
d'chantillonnage, on assiste des phnomnes de repliement de spectre trs nets : effet de moir dans le domaine
spatial, battements dans le domaine temporel (c'est pourquoi une roue tournant 24 ou 26 tours par seconde apparat
la tlvision comme faisant un tour par seconde, en sens inverse dans le premier cas).
2. Le balayage de l'cran pour une image monochrome
a. Principe
Une image monochrome dsigne une image "noir et blanc" (dite "achrome") mais aussi chaque composante d'une
image couleur, puisqu'on sait qu'une image couleur peut tre reconstitue par la superposition de trois couleurs
fondamentales (rouge, vert, bleu).
Dans l'espace (x,y), on dcompose l'image en un nombre suffisant de lignes horizontales, puis on l'analyse point par
point le long de chaque ligne. Ces principes d'analyses sont les mmes pour la tlcopie ou la transmission de
photographies : aprs l'chantillonnage dans le temps, on doit transmettre des images fixes. Les images sont converties
en signal lectrique commandant l'afficheur optique.
Au cinma, l'image est projete dans son ensemble sur l'cran. En tlvision, l'affichage en une seule fois de chaque
image ncessiterait des systmes vraiment trop complexes pour tre utilises en pratique dans un tube cathodique.
L'image est en fait analyse par lignes horizontales (trs lgrement obliques par rapport l'cran) lues de gauche
droite (cf. Figure I.1). Le balayage de la ligne se fait vitesse constante par un dispositif de lecture qui tait et est
encore dans certaines camras un faisceau d'lectrons dans un tube vide. Un temps mort correspondant au retour du
balayage spare la lecture de deux lignes. Simultanment un balayage vertical dcale les lignes analyses de haut en
bas. Un ensemble de lignes de haut en bas de l'image forme une trame ; la fin de celle-ci on a un autre temps mort d
au retour du balayage vertical, qui peut durer plusieurs lignes.
Figure I.1 : Principe du balayage de l'cran.
2003-2004
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
b. Balayage entrelac
Cependant, si l'il est incapable de percevoir des images spares si celles-ci sont affiches avec un taux de
rptition de 20 30 Hz, il reconnat pour cette gamme de frquences les variations de luminosit d'une image l'autre,
d'o un dsagrable effet de papillotement Pour viter cela, le taux de "rafrachissement" de l'ensemble des lignes
correspondant un balayage de l'cran doit tre gal au moins 50 Hz.
Pour conserver une frquence d'affichage des images gale seulement 25 Hz (un affichage 50 images par
seconde conduirait au doublement de la bande passante ncessaire pour transmettre le signal vido) une image est
analyse en deux trames entrelaces. Une ligne sur deux est analyse la premire trame, l'autre la trame suivante (cf.
Figure I.2). Comme il y a en gnral un nombre impair de lignes par image, chaque trame commence (cas des trames
impaires) ou finit (cas des trames paires) par une demi ligne. La frquence trame est donc le double de la frquence
image, soit en Europe, Ftrame = 50 Hz.
Dans certains tlviseurs haut de gamme, la frquence trame est mme double afin d'amliorer la stabilit de
l'image (balayage "100 Hz") et limiter encore plus le problme du papillotement. En pratique, chaque trame est mise
en mmoire pour tre projete deux fois 50 Hz.
Figure I.2 : Balayage entrelac.
c.
Dfinition de l'image et bande passante
La dfinition de l'image, ou dfinition verticale DV, est le nombre de lignes disponibles l'cran pour l'affichage
d'une image. Elle est de 625 lignes en Europe et 525 lignes en Amrique du Nord et Japon.
Un certain nombre de ces lignes ne transmet pas d'image : ce sont les lignes "noires", pendant la dure du retour
trame, qui correspond environ 10% de la dure d'une trame. Rendu ncessaire par la technologie des premiers
tlviseurs (inertie des oscillateurs de balayage), ce temps mort a d tre conserv pour garantir la compatibilit. Le
rapport entre le nombre de lignes "utiles" pour l'image (rsolution verticale effective) et le nombre de lignes totales de
l'cran, ou (rsolution apparente).
La dfinition horizontale est le nombre de points par ligne. Dans les systmes classiques il n'y a pas
d'chantillonnage le long d'une ligne ; ce nombre est fix par la bande passante affecte au signal. Si on appelle DH le
nombre de points par ligne, chaque "point" correspond une dure donne par = T/DH avec T = 1/fL dure d'une
ligne.
Pour un cran au format 4/3, la dfinition horizontale DH est gale pour le standard europen 4*625/3 = 833
"points" par ligne. La frquence de balayage ligne fL est quant elle gale 25*625 = 15625 Hz, ce qui quivaut une
dure T gale 64 s pour l'affichage d'une ligne. La dure correspondant la dure s'coulant entre l'affichage de
deux "points" successifs d'une ligne est quant elle gale environ 1/(25*625*4*625/3) s, soit environ 0,08 s.
Si les images taient constitues par l'ensemble des lignes disponibles l'cran, la bande passante qui serait requise
dans le standard europen pour transmettre un signal vido pourrait tre estime en calculant la frquence d'un signal en
crneaux de largeur (chaque ligne serait alors constitue d'une suite de points blancs et noirs alternativement) soit
1/(2) = 25 * 625 * 4*625/3 * = 6,5 MHz. Mais comme on l'a vu prcdemment, une partie des lignes d'une trame
sont des lignes "noires" et ne contribuent pas l'image, d'o une diminution de la bande passante minimale ncessaire.
En pratique, la bande passante est normalise environ 6 MHz (cette valeur varie suivant les standards). Notons enfin
2003-2004
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
que la priodisation lie l'affichage des lignes et trames induit une structure de "raies" dans l'allure du spectre du
signal vido.
3. Constitution du signal vido composite
Le signal vido en tlvision N&B est constitu par deux composantes (cf. Figure I.3) : d'une part des impulsions de
synchronisation dclenchant les balayages ligne et trame, et d'autre part par des niveaux de tension variables dits de
"luminance", reprsentatifs de la luminosit des diffrents points affichs l'cran. Voyons plus en dtails comment
s'organise ce signal.
Figure I.3 : Constitution du signal vido pour une ligne.
a. Amplitude
L'amplitude du signal vido varie dans une plage de 1 V crte crte (sur lignes adaptes 75 ). Les niveaux de
synchronisation occupent 30% de cette plage, les niveaux de luminance les 70% restants. Cette rpartition rsulte d'un
compromis entre la fiabilit de la synchronisation des balayages ligne et trame et la qualit de l'image. Elle permet de
plus de sparer facilement la rception les impulsions de synchronisation des niveaux de luminance par un simple
crtage.
Pour un signal dont l'amplitude varie entre 0 et 1 V, les impulsions de synchronisation apparaissent entre 0 et 0,3 V.
Ce niveau de 0,3 V est dsign comme le niveau de suppression (blanking). Il correspond un affichage noir l'cran.
Avec l'exemple prcdent, les niveaux de luminance s'chelonnent entre 0,3 V et 1 V. Plus le niveau de tension est
important, plus l'intensit du faisceau excitant le matriau luminescent (luminophores, en anglais phosphors) de l'cran
est grand et plus le point de l'cran apparat clair. Le niveau du "noir" peut concider ou non avec le niveau de
suppression, suivant que l'on souhaite obtenir la restitution sur l'cran une image plus ou moins lumineuse (cf. Figure
I.4). On peut tre galement conduit introduire un dcalage pour un problme li la non linarit de la rponse de
l'cran (cf. la partie I.3.c). Le niveau du noir peut alors tre situ 0,07 V au-dessus du niveau de suppression.
Figure I.4 : Choix du niveau de rfrence "noir" pour la luminance.
2003-2004
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
b. Synchronisation
Les impulsions de synchronisation marquent le dbut d'une trame ou d'une ligne. Elles dclenchent des signaux en
dent de scie qui permettent de reprer le balayage des lignes d'une trame ou les points d'une ligne. La diffrenciation
entre impulsion de synchronisation "trame" et "ligne" s'effectue partir de leurs dures respectives.
Les impulsions correspondant au balayage horizontal sont des impulsions de 0,3 V 0 V (suivant l'exemple
dvelopp dans la section prcdente) de dure 4,7 s 4,8 s (cf. Figure I.3). Cette impulsion est place 1,4 1,5 s
aprs la fin des variations du signal de luminance correspondant la ligne prcdente, et 5,4 6,4 s avant le dbut des
variations des niveaux de luminance de la ligne balayer, d'o une dure totale du "retour ligne" de l'ordre de 12 s.
Les intervalles de temps entre impulsions de synchronisation et niveaux de luminance (occupant pour une ligne les
52 s restantes) permettent d'viter les risques d'interfrence entre ces deux types de variations de tension. Pour ce qui
est de l'intervalle de 1,4 1,5 s (front porch en anglais), il assure de plus que l'instant de dclenchement du balayage
ligne ne soit pas perturb par le dernier niveau de luminance intervenant dans la ligne prcdente (cf. Figure I.5).
Figure I.5 : Intrt du "front porch" pour la synchronisation ligne.
Les "codages" des tlvisions page peuvent consister faire fluctuer selon un algorithme de cryptage la position
du front des impulsions de synchronisation de ligne.
Les impulsions de synchronisation de trame occupent elles-aussi deux niveaux (0,3 et 0 V) mais apparaissent
pendant la dure de plusieurs lignes. Elles se dcomposent en trois squences de 2,5 lignes (une trame comporte
312,5 lignes) : une premire avec 5 impulsions courtes apparaissant dans les 2,5 dernires lignes de la trame prcdente,
une deuxime avec 5 impulsions plus larges dans les 2,5 premires lignes de la nouvelle trame, et enfin ne troisime
avec de nouveau 5 impulsions courtes (cf. Figure I.6).
Figure I.6 : Dclenchement des trames pour un standard 625 lignes.
2003-2004
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
A ces 7,5 lignes supprimes par trame s'ajoutent encore une vingtaine de lignes "noires" ne transmettant pas
d'informations image mais par exemple des lignes test ou des informations codes (sous-titrage, tltexte dans les 12
premires lignes).
c.
Correction de gamma
Un problme se pose du point de vue du traitement du signal vido. Si les niveaux lectriques fournis par les
capteurs d'images (camra CCD) varient gnralement linairement avec le niveau de luminosit analys, il n'en va
pas de mme de la rponse des luminophores des crans cathodiques : la puissance lumineuse mise au niveau de
l'cran varie gnralement avec le niveau V du signal de commande comme V, o est une constante sans dimension
dpendant de l'cran utilis. Ce paramtre varie entre environ 2,2 pour les tubes monochromes et 2,8 pour les tubes
couleurs.
Si l'on ne prend pas garde cette caractristique des crans, les modifications du ton lumineux sont trs rduites
dans le domaine "sombre" du spectre lumineux et trs accentues dans le domaine "clair".
Afin de ne pas tre gn par la non-linarit de la caractristique intensit lumineuse-tension de commande des
crans, on effectue une "correction de gamma" : on insre dans la chane de transmission une loi en puissance de 1/c. Si
la valeur de c concide avec , la caractristique corrige du systme est parfaitement linaire (cf. Figure I.7).
Figure I.7 : Principe de la correction de gamma.
Nanmoins, pour accentuer les contrastes, on peut tre conduit utiliser une valeur de c lgrement diffrente de ,
de telle sorte que la loi corrige soit par exemple en V1,3.
Le correcteur de gamma est gnralement insr dans la chane d'mission, directement en sortie du capteur utilis,
et ce pour diverses raisons. La camra source de l'image est place dans un environnement bien contrl, ou auquel on
s'adapte, alors qu' l'autre bout de la chane on a des millions de rcepteurs de tlvision. Il est clair qu'un correcteur
prcis utilis au niveau de la camra est plus efficace que diffrents correcteurs, forcment moins coteux donc moins
efficaces, placs sur les rcepteurs. De plus, un bruit introduit dans la chane de transmission au niveau de la camra,
aprs que la correction a t effectue, est beaucoup moins probable qu'un bruit introduit aprs la correction. Or les
bruits les plus gnants la visualisation sur l'cran sont surtout ceux dans le domaine sombre. Ces bruits "sombres" sont
accentus par la caractristique du correcteur, alors qu'ils sont rduits par celle de l'cran, les bruits apparaissant aprs la
correction sont donc moins "ennuyeux" que ceux apparaissant avant celle-ci du point de vue de la qualit de l'image
l'cran.
d. Composante continue
La composante continue du signal vido est gnralement perdue la rception. Or la valeur moyenne de ce signal,
fluctue au cours du temps suivant la luminosit moyenne de l'image transmise (voir la moyenne d'un signal rapport
cyclique variable).
2003-2004
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Figure I.8 : Problme de restitution de l'image li la non transmission de la composante continue. En (a) dans le
cas d'un niveau moyen de luminance de ligne "sombre", le noir est interprt comme un gris. En (b), le niveau
moyen de luminance correspond bien avec celui de l'cran, la restitution est correcte. En (c), le niveau moyen de
luminance est "clair", on perd des dtails sombres la restitution.
Le niveau de suppression (ou/et le niveau du noir) fluctue donc dans le signal reu sur le tlviseur. Pour reprer ce
niveau et le faire concider avec le niveau d'extinction du tube, on reconstitue la rception la composante continue du
signal initial grce aux lignes noires : le signal est appliqu sur un montage dtecteur de crte (du type capacit en srie
avec une diode, soit le montage clamp) pendant les priodes sparant les impulsions de synchronisation des variations
des niveaux de luminance (back porch, cf. Figure I.9).
Figure I.9 : Principe de la rcupration de la composante continue du signal vido (chantillonnage durant le "back
porch") et exemple de circuit de ralisation.
4. Transmission
a. Son
Le signal sonore est multiplex avec le signal vido : il est modul en amplitude (systme franais pour la diffusion
hertzienne) ou en frquence (la plupart des autres systmes) sur une sous-porteuse d'environ 7,5 MHz dans le standard
europen. Il n'interfre pas alors avec la bande de base du signal vido qui occupe au maximum 6 MHz. A l'mission, la
puissance transmise correspondant au son est environ 5 fois plus faible que la puissance correspondant l'image.
2003-2004
10
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
b. Frquences porteuses
Pour transmettre le signal vido sur de longues distances, il faut le moduler. Les caractristiques de la modulation
employe varient selon la nature de la transmission (cf. Figure I.10).
Figure I.10 : Les diffrentes natures de la diffusion de la tlvision.
i)
Faisceaux hertziens
Dans le cas du transport sur faisceaux hertziens, soit de la source des programmes vers les metteurs rgionaux, on
utilise une modulation FM une frquence intermdiaire de 70 MHz, translate en hautes frquences dans les bandes 4,
8 ou 13 GHz.
ii) Diffusion hertzienne
La diffusion hertzienne entre les metteurs rgionaux et les rcepteurs de tlvision, distants de quelques m
environ 50 km, peut utiliser 3 bandes de frquence :
la bande I VHF (Very High Frequency) : elle s'tend entre 47 et 68 MHz et contient 3 canaux. Elle est peu
employe,
la bande III VHF : elle s'tend de 174 223 MHz et contient 6 canaux. Employe par l'ancienne "premire chane"
franaise, cette bande est actuellement utilise par Canal+,
la bande UHF (Ultra High Frequency) : elle s'tend de 470 860 MHz et contient 49 canaux avec un espacement
entre 8 MHz. C'est de loin la plus employe.
La modulation utilise est alors la modulation d'amplitude bande latrale attnue (BLA, cf. Figure I.11) qui
permet de rduire l'occupation spectrale tout en ne compliquant pas trop les filtrages requis (on utilise un filtre
passe-haut, filtre de Nyquist, aprs la modulation d'amplitude). En l'occurrence, on conserve 1,25 MHz de la bande
latrale infrieure.
2003-2004
11
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Spectres
0
Modulante en
bande de base
Spectres
0
Signal dmodul
f0
Signal modul en
AM
Filtrage pour
obtention BLA
f0
Signal modul en
BLA
Figure I.11 : Principes de la modulation BLA.
iii) Diffusion par satellite
La diffusion analogique par satellite repose essentiellement sur la modulation de frquence FM, en attendant le
numrique.
iv) Diffusion par cble
La diffusion analogique par cble repose sur la modulation BLA.
v) Fibre optique
La diffusion sur fibre optique analogique repose sur la modulation FM et le multiplexage, mais de plus en plus la
diffusion numrique prend le pas sur la diffusion analogique sur ce type de canal.
5. Rsum : Chanes d'mission et rception
Pour rsumer cette partie, on peut se rfrer aux schmas des chanes typiques d'mission et de rception,
respectivement reprsents sur la Figure I.12 et la Figure I.13.
Figure I.12 : Synoptique d'une chane d'mission en tlvision analogique.
2003-2004
12
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Figure I.13 : Synoptique d'un rcepteur en tlvision analogique (THT : trs haute tension, HP : haut-parleur).
Le slecteur de canaux, ou tuner, comporte un filtre passe-bande F et un mlangeur dont l'une des deux entres est la
sortie de F et l'autre un signal issu d'un oscillateur local dont la frquence fOL correspond au canal que l'on souhaite
regarder l'cran. On procde ensuite la dmodulation autour d'une frquence intermdiaire FI (par exemple
FI = 38,9 MHz pour la luminance et FI = 32,4 MHz pour le son modul en AM). Il s'agit d'une dtection htrodyne (cf.
l'annexe sur ce sujet dans la partie V). Le filtre F est en fait le filtre liminant la frquence image du signal analyser.
Ce filtre est accord par rapport fOL, grce l'utilisation d'une diode varicap.
Le principe de gnration du balayage ligne partir des impulsions de synchronisation ligne est schmatis sur la
Figure I.14. En (a), on a l'tat du montage au dbut du balayage d'une trame. En (b), l'interrupteur a t rendu passant au
moment de l'impulsion de synchronisation ligne, le courant IL dans l'inductance L augmente linairement avec le temps.
Au bout de 26 s, l'interrupteur se bloque, le faisceau a balay la premire demi-ligne (cf. la Figure I.2). Alors l'nergie
emmagasine dans L se dcharge dans la capacit C en parallle, et le courant IL diminue assez rapidement, comme
indiqu en (c). Il devient mme ngatif jusqu' ce que l'interrupteur redevienne nouveau passant 12 s aprs son
blocage. Le faisceau a effectu le "retour ligne". Puis IL crot nouveau linairement avec le temps. Au bout de 26 s,
en (d) sur la Figure I.14, le faisceau a balay une deuxime demi-ligne, l'interrupteur ne se bloque ensuite que 52 s
aprs le dernier blocage (d'o le balayage d'une ligne complte), on revient au mme tat qu'en (b) et le cycle se rpte
jusqu'au balayage de la dernire demi-ligne de la trame.
Figure I.14 : Principes de gnration du balayage ligne. IL est le courant traversant l'inductance L, UK la tension
aux bornes de l'interrupteur.
2003-2004
13
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Le balayage trame est obtenu en faisant traverser par un courant en dent de scie un diple form par une rsistance
(typiquement 15 ) en srie avec une inductance (typiquement 30 mH).
Un exemple de montage amplificateur vido (circuit mettant en forme les variations de la luminance pour gnrer le
faisceau d'lectrons dans le tube, cf. la Figure I.13) est donn sur la Figure I.15 suivante.
Figure I.15 : Exemple de montage amplificateur vido.
II.
Tlvision en couleurs
1. Principes
Conformment aux caractristiques de la vision humaine, le cerveau peut reconstituer la plupart des couleurs
visibles partir d'un mlange de 3 couleurs fondamentales situes dans le rouge, le vert et le bleu. C'est la trichromie
additive. L'image vido est donc dcompose par des filtres optiques en ces trois composantes fondamentales qui seront
analyses indpendamment pour donner trois signaux vido nots ER, EV et EB. On parle de liaison RVB, en anglais
RGB pour Red, Green, Blue.
2. Ecran couleur
Sur un cran couleur sont distribus trois types de "luminophores" mettant respectivement dans le rouge, le vert et
le bleu. Ces matriaux se rpartissent soit sous formes de grains, soit suivant des bandes. L'cran est balay par trois
faisceaux excitant ces matriaux, un faisceau par couleur. Les faisceaux passant au travers d'un masque trous ou d'une
grille fentes suivant le type de distribution des luminophores (cf. Figure II.1). La premire technologie est moins
coteuse et permet un affichage assez prcis mais la convergence des faisceaux est problmatique. La deuxime
technologie permet d'obtenir une image plus lumineuse et avec des couleurs mieux rendues puisque le nombre
d'lectrons frappant l'cran est plus grand.
Figure II.1 : Balayage d'un cran couleur. En (a) procd "shadow mask" ou "Invar", en (b) procd "Trinitron".
2003-2004
14
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
3. Signal vido couleur
a. Colorimtrie
Les 3 signaux ER, EV et EB sont quivalents des luminances et peuvent tre transmis sparment. C'est parfois le
cas en transmission locale, ou au niveau de la prise pritel des tlviseurs, magntoscopes, dcodeurs, etc Ce procd
n'est pas applicable en diffusion hertzienne ni en distribution cbl car il n'est pas compatible avec les tlviseurs noir et
blanc (problme fondamental lors de l'introduction de la tlvision couleur dans les annes 60 et 70) et il triple a priori
la largeur de bande ncessaire la transmission.
La compatibilit avec le noir et blanc est obtenue en remplaant les trois signaux ER, EV et EB par 3 autres. Le
premier est la luminance qui est la mme qu'en tlvision N&B. C'est donc le seul signal utile aux tlviseurs
monochromes. La luminance Y s'exprime sous la forme :
Y = 0,30 ER + 0,59 EV + 0,11 EB
(les coefficients proviennent de la diffrence de sensibilit de l'il selon les couleurs). Les deux autres signaux,
DB = EB - Y et DR = ER - Y, composent la chrominance qui portent l'information de coloration de l'image. Ces deux
signaux, qui peuvent tre ngatifs, suffisent ; DV = EV - Y (le plus souvent voisin de zro du fait de l'efficacit visuelle
de l'il) s'en dduit. On parle alors de "liaison composite YUV" (U et V tant respectivement associs DB et DR).
On peut reprsenter les composantes dans le plan de couleurs (DB ; DR). Pour une couleur "purement" rouge, soit
ER = 1 et EB = EV = 0, on a DB = -0,30 et DR = 0,7. Pour un bleu, soit EB = 1 et ER = EV = 0, on a DB = 0,89 et
DR = -0,11. Enfin pour un vert, soit EV = 1 et EB = ER = 0, on a DB = DR = -0,59.
DR
Rouge
(114)
0,7
Magenta
(45)
Jaune
(171)
DB
-0,30
Vert
(225)
Bleu
(351)
Cyan
(294)
Figure II.2 : Plan de couleurs.
Dans le plan de couleur, les points symtriques par rapport l'origine des points rouge, vert et bleu correspondent
respectivement aux couleurs cyan (bleu clair), magenta (rose pourpre) et jaune, soit les couleurs complmentaires de
rouge, vert et bleu (le cyan est obtenu par mlange du vert et du bleu, le magenta du rouge et du bleu, le jaune du rouge
et du vert).
b. Aspect frquentiel
A l'origine de la tlvision en couleur, la contrainte tait de ne pas modifier la rpartition en frquences des
metteurs. Il a donc fallu insrer les informations de chrominance dans le spectre de luminance. Le principe retenu dans
tous les systmes a donc t de moduler la chrominance sur une sous porteuse et de la multiplexer frquentiellement
avec la luminance. Pour cela il a donc t ncessaire de rduire fortement la bande passante occupe par la
chrominance. C'est possible sans trop de gne car l'il est beaucoup moins sensible aux variations de chrominance
qu'aux variations de luminance. L'acuit visuelle de l'il est en fait environ 4 fois plus importante pour la luminance
que pour la chrominance. En consquence, les signaux de chrominance sont tout d'abord filtrs environ le quart de la
bande passante vido, soit de l'ordre de 1,5 MHz.
Aprs quoi, les signaux de chrominance modulent une sous-porteuse vers les 3/4 de la bande passante vido, de
sorte que le spectre de la sous porteuse module se situe dans la moiti suprieure du spectre de la luminance. C'est dans
le choix de la frquence de la sous-porteuse et du type de modulation que se situe la diffrence entre les trois systmes
classiques de tlvision en couleurs : NTSC, PAL, SECAM.
2003-2004
15
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Il y a donc ncessairement rduction de la qualit du signal de luminance, dont une partie du spectre est occupe par
la chrominance. Cette rduction peut cependant tre limite car :
L'nergie de la luminance est contenue pour l'essentiel dans le bas de son spectre.
Compte tenu de la priodicit des images, donc des lignes, des demi-trames et de la synchronisation, le spectre vido
est un spectre de raies. La chrominance est aussi un spectre de raies. Si elle module une sous porteuse telle que les
raies de chrominance soient intercales avec celle de la luminance, il sera alors possible de les sparer avec un filtre
en "peigne". Si cela n'est pas le cas, au prix d'une acceptable altration de l'image (rcepteurs bas de gamme) il est
possible de filtrer la partie "haute" du spectre de luminance pour rcuprer les informations de chrominance.
Enfin, on transmet souvent ce spectre en modulation BLA, comme indiqu dj dans la section I.4.b.ii) pour la
diffusion hertzienne. A laide dun filtre passe-haut, on conserve la bande latrale suprieure et une partie de la bande
latrale infrieure ainsi que la porteuse f0 attnue (cf. Figure II.3). Les diffrents canaux de tlvision peuvent tre ainsi
espacs de 8 MHz. La prsence de la porteuse permet d'utiliser la dmodulation par dtection denveloppe, moyennant
une distorsion juge raisonnable, procd peu coteux. Cette mthode est cependant aujourd'hui supplante par la
dmodulation cohrente, la porteuse tant facilement rcuprable (transmission de salve de porteuse pendant la
transmission des niveaux de suppression, ou/et utilisation d'une boucle verrouillage de phase). Cest dans les basses
frquences de la bande de base que se trouvent les signaux de synchronisation lignes et trames, avec un faible niveau.
Le rsidu de la bande latrale infrieure permet de doubler leur puissance.
Porteuse f0
6 6,5 MHz
Filtre d'mission
Luminance
f
Synchro
Sous porteuse
chrominance
Porteuse(s)
son
8 MHz
Figure II.3 : Spectre du signal vido couleur modul (standard europen). Le son est gnralement modul en
frquence (systmes NTSC et PAL) ou en amplitude (SECAM) autour d'une sous-porteuse situe en dehors de la
bande de frquence occupe par le signal vido.
4. Le diffrents standards
a. Systme NTSC
Ce systme amricain (NTSC, National Television Standard Committee) est ancien ; il date des annes 50. Son
principe de base est la modulation d'amplitude en quadrature (MAQ) d'une sous-porteuse par les deux composantes de
la chrominance. Ce procd, illustr par le schma bloc de la Figure II.4, permet en effet de moduler deux signaux
indpendants I(t) et Q(t) sur la mme sous-porteuse fsp.
sI(t)
I(t)
p(t) = Asp cos(2fspt)
/2
Q(t)
s(t) = kAsp (I(t) cos(2fspt) + Q(t) sin(2fspt))
sQ(t)
Figure II.4 : Gnration d'une modulation d'amplitude en quadrature.
2003-2004
16
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Dans ce cas, les signaux modulants I(t) et Q(t) sont produits par un matriage des signaux de chrominance :
I = -0,27DB + 0,74 DR et Q = -0,41DB + 0,48 DR. Dans le plan de couleur (cf. la Figure II.5), la composante I se situe
dans la direction de l'orange o l'il est trs sensible aux variations de couleurs, et bnficie d'une bande passante plus
grande que Q (un peu plus de 1000 kHz de bande passante pour I contre seulement 700 kHz pour Q), qui correspond
une direction de faible sensibilit de l'il (magenta). La sous-porteuse est 3,58 MHz. L'avantage principal du systme
est son faible encombrement spectral (cf. la Figure II.6) : avec la sous-porteuse son multiplexe 4,5 MHz,
l'espacement entre canaux NTSC n'est que de 6 MHz en diffusion hertzienne.
DR
Rouge
I (123) (104)
Magenta
(61)
Spectre
Q (33)
Jaune
(168)
Salve
synchro
(180)
Porteuse
image
Luminance
DB
Bleu
(348)
Q
-1
Vert
(241)
Porteuse
son
2
3
4
Chrominance
f (MHz)
Cyan
(284)
Figure II.5 : Plan de couleurs NTSC. Les salves de
synchronisation sont transmises 180 de DB.
Figure II.6 : Plan de frquence NTSC. La bande
passante de la luminance est limite 4,2 MHz.
L'utilisation de la MAQ implique que l'on effectue une dmodulation cohrente la rception, comme illustr sur la
Figure II.7. L'inconvnient de cette mthode rside dans le fait qu'elle est trs sensible aux erreurs de phase en rception
(sur les sorties d1 et d2 du montage de la Figure II.7, les signaux ne peuvent tre retrouvs sparment que si la
sous-porteuse locale utilise la rception est en parfait synchronisme avec la sous-porteuse utilise l'mission, soit
un dphasage sur le schma nul), qui vont se traduire par une erreur de couleur. Bien que la rfrence de phase soit
transmise en dbut de chaque ligne par une salve de synchronisation (une dizaine de priodes sur le palier suivant
l'impulsion de synchronisation, cf. Figure II.8), cet effet reste le principal dfaut du systme NTSC. C'est peut-tre pour
cela qu'on l'avait surnomm Never Twice the Same Color (jamais deux fois la mme couleur).
s1(t)
d1(t) = cos() I(t) - sin() Q(t)
k
pr(t) = A1 cos(2f0t + )
sr(t)
/2
X
s2(t)
d2(t) = sin() I(t) + cos() Q(t)
Figure II.7 : Dmodulation cohrente d'un signal modul en quadrature.
Signal vido
Suppression ligne
t
Impulsion
synchronisation
ligne
Salves de porteuse
Figure II.8 : Salve de porteuse en dbut de ligne.
2003-2004
17
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Il est noter que du fait des valeurs relatives des frquences de balayage ligne (15734,27 Hz) et de la sous-porteuse
chrominance (3579454 Hz), le gnrateur de sous-porteuse la rception produit 227,55 cycles lors du balayage d'une
ligne. D'une ligne l'autre, la sous-porteuse chrominance rgnre grce aux salves est dphase d'environ 180 (une
demi-priode). On peut exploiter cette proprit pour concevoir un filtre peigne assez simple permettant de sparer les
signaux de chrominance de la luminance : par addition de deux lignes successives on isole la luminance et par
soustraction les deux composantes de la chrominance encore modules par la sous-porteuse fsp.
b. Systme PAL
Ce systme allemand, dvelopp chez Telefunken en 1963, a repris le principe du NTSC, la MAQ, en corrigeant son
principal dfaut, la sensibilit aux erreurs de phase en rception. Pour cela, la phase du signal DR modulant en
quadrature la sous-porteuse, est alterne chaque ligne (cf. Figure II.9), d'o le nom du procd : Phase Alternance
Line, ou PAL.
Ligne n
Salve
synchro
(135)
Lignes n-1 et n+1
DR
Rouge
DR invers
Magenta
Jaune
Vert
Rouge
Bleu
DB
Bleu
Vert
Cyan
DB
Jaune
Salve
synchro
(225)
Cyan
Magenta
Figure II.9 : Systme PAL, plan de couleurs.
A la rception, et avant la dmodulation, on spare les signaux DR et DB en faisant :
ligne n + ligne (n-1) = 2 DB
ligne n - ligne (n-1) = 2 DR, le signe dpendant de la parit de n.
A ce point, les deux signaux sont toujours moduls, mais ils sont spars. En contrepartie, la dfinition verticale est
rduite de moiti, puisque l'on fait la moyenne de deux lignes successives.
La porteuse est 4,434 MHz, et une salve est transmise pour la rfrence de phase en dbut de chaque ligne, avec
une alternance entre 3/4 et 5/4. Cette rfrence permet de dmoduler la voie DR avec sa phase correcte.
Les schmas des blocs d'mission et de rception su systme PAL sont donns sur la Figure II.10. Le dmodulateur
inclut une ligne retard (retard de la dure totale d'une ligne soit 64 s) pour obtenir simultanment les lignes n et n-1.
L'addition (ou la soustraction) de deux lignes successives cre l'effet de peigne qui amliore la sparation de la
luminance et de la chrominance
2003-2004
18
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Figure II.10 : Modulateur et dmodulateur PAL.
c.
Systme SECAM
Le systme franais SECAM (squentiel couleur mmoire, mis en service en octobre 1967) utilise la modulation
de frquence de la sous-porteuse de la chrominance. Un seul signal pouvant tre transmis de la sorte, on transmet
alternativement la composante DR et la composante DB. Au dcodage, la chrominance est reconstitue en utilisant la
composante reue et la composante complmentaire de la ligne prcdente qui a t mise en "mmoire", c'est--dire
retarde par une ligne retard de 64 s.
Comme en PAL, il y a rduction de moiti de la dfinition verticale, ce qui est en gnral peu visible. Un transitoire
brusque d'une ligne l'autre peut crer des erreurs de couleur, mais comme il y a alternance d'une trame l'autre de la
rpartition de DR et DB entre les lignes, cet effet est attnu.
La frquence centrale de la sous-porteuse et l'excursion en frquence ne sont pas les mmes pour DR et DB :
f0 = 4,406 MHz (soit 282 fois la frquence de balayage horizontal fL) et F = 280 kHz pour DR,
f0 = 4,250 MHz (soit 272 fois fL) et F = 230 kHz pour DB.
Ces frquences, asservies sur fL, sont transmises en salves en dbut de chaque ligne, ce qui permet l'identification de
la composante transmise. Au codage, un commutateur aiguille alternativement DR et DB vers l'mission (cf. Figure
II.11), tandis qu'au dcodage (cf. Figure II.12), un permutateur synchronis par l'identification des salves envoie le bon
signal l'entre de chaque dmodulateur.
2003-2004
19
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Figure II.11 : Modulateur SECAM.
Figure II.12 : Dmodulateur SECAM.
Comme il est classique en modulation de frquence, on utilise une praccentuation-dsaccentuation pour limiter
l'effet du bruit en hautes frquences.
Le spectre de chrominance s'tend environ de 3,9 4,7 MHz. Il n'apparat plus sous forme de raies du fait de la
modulation de frquence. Il est donc ncessaire de le sparer du spectre de la luminance par des filtrages
supplmentaires :
au codage, par un filtre coupe-bande centr autour de 4,285 MHz pour viter une prsence de la luminance dans la
chrominance,
au dcodage, le mme filtrage est effectu sur la voie de la luminance pour en enlever la chrominance, elle-mme
spare par un filtre passe-bande,
au codage, un filtre de mise en forme (dit "anti-cloche" car compens par un filtre en cloche au dcodage) permet
d'amliorer le rapport chrominance luminance pour des signaux loigns de la frquence centrale. Il en rsulte une
modulation artificielle d'amplitude de la chrominance, qui ne contient pas d'information utile.
III. Les crans
Le march international des crans se chiffre 70 milliards d' par an, avec environ 50% pour les crans
cathodiques et 50% pour les crans plats (en termes de volume la part des crans plats, gnralement plus coteux que
les crans cathodiques, est videmment infrieure 50%).
1. Les crans tube cathodique (CRT)
Le fonctionnement des crans tube cathodique (CRT, Cathode Ray Tube, cf. la Figure III.1) a dj t voqu dans
la premire partie. Leur invention date de 1897.
2003-2004
20
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Figure III.1 : Schma d'un cran tube cathodique.
2. Les crans plats
Les crans CRT devenant rapidement lourds et encombrants quand on augmente la surface d'affichage, on cherche
mettre en uvre des technologies crans plats quand les dimensions des crans augmentent. Ces technologies peuvent
se classer en deux grandes catgories : les crans de type passif et les crans de type missif. Les premiers doivent tre
clairs par une source externe pour produire la lumire qui sera ensuite filtre pour produire les couleurs. Les seconds
produisent eux-mmes la lumire visible, par exemple par excitation de luminophores comme dans le cas des CRT.
a. Les crans cristaux liquides (LCD)
Les cristaux liquides sont des matires organiques amorphes qui ont la proprit de modifier la propagation de la
lumire, plus exactement sa polarisation, si on leur applique un champ lectrique. Le dveloppement d'crans plats LCD
(Liquid Crystal Display) bass sur leur utilisation s'est effectu dans les annes 70 et 80.
Le principe de lcran LCD consiste placer des cristaux liquides en sandwich entre deux plaques graves et
orientes 90 l'une de l'autre (cf. Figure III.2). Les molcules de cristaux liquides, de forme allonge, s'orientent sur
chacune des plaques paralllement aux sillons de la plaque. Lcran est rtro-clair avec une lumire polarise
paralllement aux sillons de la premire plaque. Quand les molcules sont au repos (tension applique nulle), leur
orientation varie progressivement d'une plaque l'autre, modifiant galement progressivement la polarisation de la
lumire. La polarisation a tourn de 90 au niveau du second polariseur qui laisse alors passer l'intgralit de la lumire.
Sous leffet dune lectrode de commande, on oriente selon la tension applique une proportion plus ou moins
importante de molcules dans une seule et mme direction. Ces molcules ne modifient alors plus la polarisation
incidente et on contrle donc la quantit de lumire que laisse passer le second polariseur (ou celle dvie). Chaque
pixel de limage est constitu dune cellule de ce type devant laquelle est plac un filtre rouge, vert, ou bleu.
Figure III.2 : Principe des crans cristaux liquides.
2003-2004
21
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Au sein des crans LCD, on distingue deux types dcrans :
crans matrice simple (passive), STN (Super Twisted Nematic, nom provenant de la forme en hlice que forme
entre elles les molcules du cristal liquide en sandwich quand elles changent d'orientation d'une plaque l'autre, cf.
Figure III.2),
crans matrice active, TFT (Thin Film Transistor).
Les matrices passives sont le plus simples raliser. Une face comporte les lectrodes dadressage des lignes (X),
lautre face les lectrodes dadressage vertical (Y). Le dispositif de commande est extrieur. Le simple fait dimposer un
potentiel une lectrode X et une lectrode Y cre un champ lectrique au travers de la surface en vis vis de ces
lectrodes. La conception de ces matrices est simple, mais ce type de matrice reste inadapt aux applications
tlvisuelles, du fait de temps de rponse insuffisant (ralentissement li au multiplexage ligne-colonne). Ce type de
matrice tait principalement utilis sur les ordinateurs portables de bas de gamme (avec la variante Dual STN, matrice
passive double balayage assurant une meilleure qualit de l'image), actuellement elle l'est plutt dans les domaines des
"mini-ordinateurs" et autres "assistants personnels" PDA (Personal Digital Assistant) voire dans celui des nouveaux
tlphones portables.
La configuration en matrice active est la seule technologie mature qui permette actuellement la ralisation de
systmes de visualisation de type tlviseur. Pour ce type de matrice, la commande de chaque pixel de l'cran est
assure par des transistors effet de champ (transistors du type TFT couches de silicium amorphe) connects en srie
avec les cellules. La matrice TFT correspond en fait un "norme" circuit intgr (huge integrated circuit) associs
des composants lectroniques priphriques (drivers) moins coteux que ceux utiliss dans les matrices STN. En termes
"montaires", les crans TFT reprsentent actuellement 60 70% du march des crans plats.
Les crans LCD consomment peu de puissance par rapport aux crans CRT (environ 60% de moins), et ne dgagent
pas de chaleur. De plus, ils associent une absence de rayonnement qui entrane une suppression des interfrences avec
des appareils mettant des rayonnements lectromagntiques. Cependant, cette technologie commence montrer ses
limites ds que la diagonale de l'cran dpasse 20'' (soit 50,8 cm) : cot important du fait du faible rendement de
fabrication et pixels TFT non missifs, ce qui rduit la luminosit, l'angle de vue rduit des crans La
commercialisation d'crans plats LCD de 70 cm de diagonale a nanmoins commenc rcemment.
b. Les crans plasma (PDP)
Dans les crans plasma PDP (Plasma Display Panel, environ 3% en termes montaires du march des crans
plats), le principe de base est celui de la structure matricielle. Il repose sur l'utilisation de l'mission lumineuse (visible
ou dans l'UV) d'un mlange de gaz rares (Xe-Ne ou Xe-Ne-He) faiblement ionis et gnr par une dcharge lectrique
cre entre deux lectrodes. Ces lectrodes appartiennent aux rseaux parallles d'lectrodes lignes et colonnes
dposes en face interne de deux dalles de verre (cf. Figure III.3). Celles-ci sont scelles entre elles ce qui forme
l'espace gazeux de l'cran. Les lectrodes qui jouent alternativement les rles d'anode et de cathode sont recouvertes de
couches de dilectriques.
Figure III.3 : Schma d'un cran plasma.
L'mission de chaque pixel, dfini par la cellule de dcharge l'intersection d'une lectrode ligne et d'une lectrode
colonne, est utilise soit directement dans le cas des PDP monochromes, soit comme des sources d'excitation des
luminophores dposs sur la face arrire dans le cas des PDP couleur. Les luminophores utiliss actuellement en
panneaux plasma sont pour le bleu, le BAM (BaMgAl10O17:Eu2+), pour le vert, le Zn2SiO4:Mn2+, pour le rouge, le
Y2O3:Eu3+ ou le (Y-Gd)BO3:Eu3+.
2003-2004
22
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
La technologie des PDP possde des atouts incontestables : relative simplicit de fabrication, bonne qualit d'image,
angle de vue comparable aux CRT, conception adaptable aux grandes dimensions, plus faibles volumes et masses
comparativement aux CRT (un PDP de diagonale 42'' pse 25 kg et sa profondeur est infrieure 10 cm alors que pour
un cran CRT de mme surface d'affichage on a une masse de 150 kg pour une profondeur d'environ 100 cm). Mais de
nombreux points restent amliorer : dure de vie (les couches isolantes protectrices, en oxyde de magnsium MgO,
des lectrodes tant progressivement pulvrises par le plasma), rendement lumineux (encore un peu infrieurs
ceux obtenus dans les CRT), et cot de fabrication. Il est du reste noter que l'lectronique d'adressage des pixels est
assez complexe : un affichage en 16,7 millions de couleur suppose la modulation du nombre d'impulsions de courant
excitant chacun des pixels (les 256 niveaux requis pour chacune des couleurs primaires tant associs autant de
squences possibles d'impulsions).
c.
Les crans effet de champ (FED)
La technologie des crans effet de champ (FED, Field Emission Display) ou crans cathode froide tendue dont
l'exemple le plus connu est le rseau de micropointes, repose comme les crans CRT sur le principe de luminescence.
La diffrence se situe au niveau du mode d'mission lectronique. L'cran FED est un tube vide dlimit par deux
plaques de verre distantes de quelques centaines de m (cf. Figure III.4). La plaque arrire, ou cathode froide, comporte
un rseau d'metteurs d'lectrons effet de champ dispos en colonnes, en forme de micropointes agissant par effet de
champ comme des microcanons lectrons lors de la mise sous tension. La plaque avant est quant elle recouverte de
luminophores.
Figure III.4 : Principe des crans FED micropointes.
Figure III.5 : Micropointes observes l'aide d'un
microscope lectronique balayage (ralisation :
PixTech, "start-up" issue du laboratoire LETI du CEA).
La complexit de fabrication des micropointes (leur densit peut atteindre 40000 /mm2) rend toutefois ces crans
FED trs coteux. La dure de vie des micropointes est galement problmatique. Cette technologie ne semble en fait
pas viable d'un point de vue commercial. La socit PixTech, "jeune pousse" dpositaire d'une licence sur ce sujet en
1992, a ainsi t place en liquidation judiciaire en juin 2002.
Une deuxime gnration d'cran FED est actuellement en cours de dveloppement. Il s'agit de profiter du grand
facteur de forme des nanotubes de carbone (cf. Figure III.6) pour mettre par effet de champ un faisceau d'lectrons
intense la pointe du nanotube. La difficult principale tient dans la matrise de la croissance perpendiculaire la
surface d'un substrat d'un trs grand nombre de nanotubes (typiquement 200000 par cm2) aux proprits les plus
homognes possibles Si en 1999, une quipe de Samsung a publi dans la revue scientifique Applied Physics Letters
la ralisation d'un premier dmonstrateur d'cran FED nanotubes, le dveloppement de cette technologie requiert
encore des recherches intensives, y compris du point de vue fondamental.
Figure III.6 : Emission de champ l'extrmit d'un nanotube de carbone.
2003-2004
23
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
d. Les crans lectroluminescents (ELD)
La technologie des crans lectroluminescents (ELD, ElectroLuminescent Display) est base sur l'utilisation de
matriaux luminescents (par exemple ZnS:Mn) disposs entre des couches dilectriques transparentes et des lectrodes
lignes en Al (en face arrire) et colonnes transparentes (en face avant, ralis en oxyde d'indium et d'tain ITO, Indium
Tin Oxide, qui est la fois bon conducteur et transparent la lumire). Ces matriaux sont dposs sous un format
pixel. Lorsqu'une tension est applique sur un point de l'cran, le matriau lectroluminescent correspondant passe de
l'tat isolant l'tat conducteur, ce qui induit un courant lectrique et la dsexcitation une mission de lumire se
produit (cf. la Figure III.7 dans le cas de l'utilisation de matriaux organiques). La longueur d'onde mise dpend de la
nature du matriau utilis. L'adressage des pixels est effectu par une matrice de transistors TFT, gnralement raliss
en silicium polycristallin. Les crans ELD fonctionnent sous faible tension, sont robustes, dots d'un bon angle de vue
(160) et d'un excellent contraste, mais si le cot de fabrication est faible pour les affichages de faibles surfaces, il
devient trs lev quand les dimensions augmentent. Ils ne sont pas (encore ?) utiliss pour la tlvision.
Une piste de dveloppement est l'utilisation de matriaux organiques (polymres). Les premiers crans base
d'OLED (Organic Light Emitting Diode) commercialiss, par Kodak et Sanyo, ne sont pour l'instant utiliss que dans
les cas o une faible surface d'affichage est ncessaire (autoradio Pioneer, tlphone mobile Motorola). Pour de plus
grandes surfaces, des problmes de fiabilit et de dure de vie (dgradation des matriaux organiques, cause de
l'humidit par exemple) restent en effet rsoudre. En avril 2002, Toshiba/Matsushita a nanmoins diffus l'annonce de
la ralisation d'un cran OLED de 17'' de diagonale au format XGA (1024 par 768 pixels).
I
Electrode transparente
U
Organique lectroluminescent
100 nm
Al
Figure III.7 : Principe des crans ELD dans le cas de l'utilisation de matriaux organiques lectroluminescents.
e. Autres technologies en dveloppement
Dans ce domaine en plein essor, d'autres voies sont explores. Citons ainsi les technologies DLP (Digital Light
Processing, cf. www.dlp.com)mettant en uvre des matrices de micro-miroirs, e-ink (mouvement de particules de toner
dans une capsule sous l'influence de forces lectrostatiques) ou encore SED (Surface Emission Display) tudie
actuellement par Canon et dans laquelle l'mission d'lectrons se produirait au niveau de nano-craquelures favorisant le
passage d'lectrons par effet tunnel.
IV. Vers la tlvision numrique
1. Enjeux
On ne peut aujourdhui que constater lvolution rapide vers la numrisation du monde de laudiovisuel. Cette
numrisation est dabord apparue dans les quipements et rgies de production pour ensuite gagner les secteurs des
rseaux de transmission et de diffusion que sont le cble et le satellite. Aujourdhui, cest au tour des rseaux hertziens
terrestres dtre numriss.
Les raisons du passage au "tout numrique" sont nombreuses :
Les oprateurs TV sont trs favorables au numrique car il abaisse les cots de diffusion par rapport l'analogique.
L'harmonisation des techniques de diffusion et la compression numrique permet ainsi la diffusion de plusieurs
2003-2004
24
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
chanes au lieu d'une seule en analogique. Ces capacits supplmentaires offrent la possibilit aux oprateurs de
proposer des chanes de complment ou de diffuser plusieurs fois leurs programmes. On a l'exemple de Canal+ avec
ses dclinaisons (bleu, vert, jaune). En outre, la baisse des cots en numrique facilite le lancement et la russite de
nouveaux oprateurs dans le monde de la tlvision.
Les tlspectateurs ont un choix plus vaste de programmes et de services. Ils bnficient d'une qualit
(thoriquement) irrprochable de l'image et du son. Le numrique ouvre les portes du "cinma domicile" (home
cinema). Il est en effet possible de diffuser des programmes en format 16/9me et en Dolby Digital. Le numrique,
c'est aussi une nouvelle faon d'utiliser la tlvision, grce l'interactivit : guide des programmes, services la
carte (mto, informations, offres d'emplois...). Bref, le tlspectateur n'est plus passif (sic) devant son tlviseur.
La possibilit d'offrir Internet haut dbit, quel que soit le mode de transport utilis (cble, satellite, hertzien...)
La logique voudrait donc que la tlvision hertzienne se convertisse au numrique. Certains prvoient pour 2015
l'arrt de la tldiffusion analogique hertzienne.
2. Les contraintes du numrique
i)
Numrisation et HDTV
Pour numriser un signal vido analogique dont l'occupation spectrale est de 6 MHz, il faut tout dabord
lchantillonner avec une frquence dchantillonnage Fech au moins gale deux fois la frquence maximale du signal
(thorme de Shannon). Ceci permet dviter le phnomne de repliement de spectre (aliasing). Dans le cas dun signal
vido, le CCIR (Comit Consultatif International des Radiocommunications) prconise une frquence dchantillonnage
de 13,5 MHz.
En outre, la rsolution minimale est de 8 bits pour la quantification dun signal vido avec une qualit suffisante
pour sa diffusion vers un terminal de visualisation.
On aboutit alors un dbit brut gal 13,5*8 = 108 Mbits/s. Ce dbit est considrable. Cest pourquoi cette manire
de numriser le signal vido nest pratiquement pas utilise dans les applications de diffusion de tlvision (broadcast).
Pour certaines applications, on utilise dautres frquences dchantillonnage pour obtenir des pixels carrs facilitant
le mlange dimages vido et informatiques sans distorsion daspect (le rapport daspect tant dfini par le rapport
largeur sur hauteur).
Pour que les rsolutions horizontales et verticales soient identiques, il faut que le rapport entre le nombre de pixels
par ligne et le nombre de lignes utiles soit gal 4/3 ou 16/9. Par exemple, pour un tube de 625 lignes, 576 lignes utiles
constituent l'image, il faut alors 768 pixels par lignes si l'on respecte le format 4/3. Or on s'oriente plutt vers les
formats prvus pour la tlvision haute dfinition (HDTV, High Definition TeleVision), le nombre de lignes devient
suprieur 1000 et le format est le 16/9me. En Europe, le standard prvu en HDTV correspond 1250 lignes dont 1080
utiles, soit 1920 pixels par lignes. Mme si on suit les principes classiques pour la diffusion hertzienne analogique, la
bande passante requise pour transmettre un signal vido devient de l'ordre de 27 MHz, ce qui est difficilement
envisageable, mme pour les transmissions par satellite.
Notons aussi qu'en HDTV lvolution du son accompagne celle de limage. Le systme Nicam (Near
Instantaneously Compended Audio Multiplex, multiplex audio compress presque instantanment) permet la diffusion
dun son de haute fidlit, numrique et strophonique, intgr un signal vido analogique. Les canaux audio gauche
et droite sont insrs dans le spectre du signal vido en modulation QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) sur une
sous-porteuse 6,5 MHz.
ii)
Format 4:2:2
Une norme de numrisation a t adopte pour la vido professionnelle en 1982, la norme CCIR 601 plus connue
sous le nom "standard 4:2:2". Elle dfinit une frquence dchantillonnage de 13,5 MHz pour la luminance Y et de
6,75 MHz pour chacun des signaux relatifs la chrominance U et V (l'appellation 4:2:2 rappelle que les frquences
d'chantillonnage pour la luminance et les deux composantes couleurs sont dans le mme rapport que les chiffres 4, 2 et
2). Elle a galement fix la quantit de bits utiliss pour cette opration 8 bits dans un premier temps, puis 10 bits.
On peut ainsi calculer le dbit ncessaire vhiculer une image complte : (13,5 + 6,75 + 6,75) * 10 = 270 Mbits/s (ou
216 Mbits/s si on ne code que sur 8 bits).
Cette norme dtermine aussi que chaque ligne doit contenir 720 pixels pour la luminance et 360 pixels pour chacune
des composantes couleur. Cela signifie quun pixel sur deux ne contient pas dinformations couleur ; il est transmis en
noir et blanc (cf. Figure IV.1).
2003-2004
25
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Figure IV.1 : Standard 4:2:2.
Le dbit numrique correspondant la norme 4:2:2 ne rentre pas dans des canaux ordinaires : si l'on prend en
compte le critre de Nyquist, un dbit de 200 Mbits/s peut tre transmis dans un canal de 40 MHz avec une modulation
64QAM (modulation d'amplitude en quadrature 64 tats, soit 6 bits par tat) et on na le droit qu 8 MHz.
Le but est de rduire le dbit numrique pour que le canal soit le plus petit possible pour faire rentrer un ou plusieurs
programmes dans une bande de 8 MHz, do la ncessit dune compression par un facteur de 20, 30 ou 40.
Pour des applications moins exigeantes en rsolution et visant des dbits de transmission aussi faibles que possibles,
certains sous-produits du format 4:2:2 ont t dfinis : 4:2:1 et 4:2:0. La diffrence entre le 4:2:2. et ces formats drivs
concerne uniquement le traitement de la chrominance par rapport la luminance. Le principe du format 4:2:0 est ainsi
de "colorier" 2 lignes successives avec la mme chrominance. Ce format a servi de base au codage D2MAC
(Multiplexed Analog Components, multiplexage alterne des composantes des signaux de chrominance et de
luminance), que nous voquerons dans la partie suivante, et la norme de compression MPEG2 (Motion Picture Expert
Group).
3. Les premires normes
a. Normes MAC
Au dbut des annes 80, au sein de l'Union Europenne de Radiodiffusion (UER), a t conue une norme de
tldiffusion intermdiaire entre l'analogique et le numrique, "D2MAC Paquets". Cette norme reprsentait alors un
compromis lgant et intelligent entre ce que les technologies analogiques et numriques disponibles l'poque
pouvaient avoir de meilleur. Elle repose sur le multiplexage temporel d'chantillons analogiques de luminance et de
chrominance, ainsi que de donnes en paquets et de 4 canaux son numriques, le tout au dbit de 20,25 Mch/s (cf.
Figure IV.2). Ce signal est diffus en modulation de frquence.
1 ligne = 64 s
1V
0,8 V
0,2 V
Donnes
numriques
(99 bits)
0,5 V
Chrominance
349 chantillons
Luminance
697 chantillons
0V
Figure IV.2 : Format d'une ligne en D2MAC. Les donnes numriques comprennent les informations de
synchronisation, le son, et des donnes embrouilles et codes. La chrominance et la luminance sont des signaux
analogiques chantillonns multiplexs temporellement.
La norme D2MAC prsentait notamment l'avantage :
d'tre conforme la norme de production numrique internationale 4:2:2, base elle aussi sur la numrisation
spare des composantes de luminance et de chrominance ;
de supprimer ainsi, grce un multiplexage temporel et non plus frquentiel, les dfauts inhrents la
superposition de ces composantes, dans les systmes antrieurs ;
2003-2004
26
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
de disposer de plusieurs voies pour le son et de permettre la transmission de donnes complmentaires (sous titrage,
tltexte) ;
enfin, de faire l'objet d'un certain consensus de la part des industriels et des pouvoirs publics en Europe.
A l'origine, l'utilisation de ce format devait tre rserve la tldiffusion par satellite. Des variantes adaptes au
cble et mme l'espace hertzien terrestre en ont ensuite t conues.
En 1986, pour contrer la tentative des japonaises visant imposer au monde entier leur systme Muse (Multiple
Sub-Nyquist Encoding, standard 1125 lignes, 60 Hz, oprationnel depuis 1991), les Europens ont labor en toute
hte partir du D2MAC leur propre norme de tlvision haute dfinition, HDMAC. Ce systme utilise les techniques
de sous-chantillonnage, filtrage, brassage et compensation de mouvement, expliques dans la section suivante. Le
HDMAC, compatible avec le D2MAC, possde un systme de compensation de mouvement plus raffin que son rival
japonais et prvoit dj la transmission numrique de certaines donnes (assistance au dcodage et, comme pour le
D2MAC, son strophonique). La dmonstration du nouveau systme europen est effectue pour la premire fois au
salon international des diffuseurs de Brighton en 1988.
La crdibilit de l'alternative qu'il reprsente par rapport aux propositions japonaises est tablie et reconnue au
niveau international. Les normes MAC ont d'autres attraits : elles se prtent plus facilement au cryptage que les
systmes prcdents, alors que nat la tlvision page, et permettent l'utilisation du nouveau format 16/9me.
Elles demeurent cependant analogiques en ce qui concerne la transmission des images. Le D2MAC ne s'est en fait
pas impos avec la rapidit qu'exigeait sa viabilit en tant que norme transitoire, il n'a pas rencontr l'adhsion
ncessaire au-del de celle des industriels, des producteurs et des diffuseurs.
b. Techniques de compression d'images
Les mthodes de compression des donnes jouent sur le fait quune squence vido contient beaucoup
dinformations redondantes dune image une autre. On distingue deux types de compression :
spatiale (ou intra-image) : les informations sont similaires ou se rptent dans des zones de limage proches lune
de lautre ;
temporelle (ou inter-images, ou inter-trame) : les informations se ressemblent ou se rptent dans le temps dune
image une autre.
Plusieurs mthodes de compression ont t mises au point. Une premire catgorie de techniques de compression,
dites non dgradantes ou rversibles, vite de transmettre la mme information plusieurs fois. Malheureusement les taux
de compression obtenus ne sont gure importants. Les techniques "non dgradantes" sont :
Le sous-chantillonnage : on adapte les frquences d'chantillonnage (spatiale et temporelle) au contenu de l'image.
Ainsi, une zone fixe est transmise avec une dfinition "normale" et une frquence plus faible que la normale, alors
qu'au contraire une zone en mouvement est transmise avec une dfinition rduite et une frquence normale. En
HDMAC comme en Muse, on divise par 4 le nombre d'chantillons : dans les zones fixes, un point sur 4 est analys
chaque trame, avec dcalage la trame suivante des points analyss. En 4 trames (frquence quivalente de
6,25 Hz), tous les points ont t analyss, comme illustr par la Figure IV.3. Les points manquants sont reconstitus
par interpolation avec filtrage. Dans les zones mobiles, un point sur 4 est analys la frquence normale des 25 Hz.
Le HDMAC utilise de plus une catgorie intermdiaire de zones en "mouvement lent", analyse 12,5 Hz.
Figure IV.3 : Principe du sous-chantillonnage pour les zones fixes.
Le brassage, mlange de deux lignes voisines, qui assure la compatibilit avec la dfinition standard.
2003-2004
27
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Le codage diffrentiel avec prdiction, qui permet de profiter des fortes redondances d'une ligne l'autre et d'une
image la suivante. En vido, la prdiction est multidimensionnelle (utilisation des points, lignes et images
prcdents pour raliser la prdiction), elle est donc beaucoup plus efficace que pour le son qui est un signal
unidimensionnel.
Si on veut rduire considrablement le dbit des donnes, il faut appliquer des algorithmes de compression qui
induisent des pertes dinformations. En choisissant judicieusement le type dinformations qui seront perdues ou
dgrades, il est nanmoins possible de reconstruire des images dune qualit telle que lil humain ne pourra les
distinguer des images originales. Parmi ces techniques, on peut mentionner :
L'utilisation de transformations mathmatiques, comme la transforme en cosinus discrte (Discrete Cosine
Transform, DCT), qui transforme une reprsentation spatiale dun bloc de pixels en une reprsentation sous forme
mathmatique diffrente. En elle-mme, cette mthode ne comprime pas dimage, mais elle la reprsente
simplement sous une forme qui facilite sa compression. La DCT a pour proprit importante de niveler toute
information non pertinente. Ainsi tout bruit ou toute distorsion provenant de frquences parasites sont limins.
L'utilisation de "codes longueur variable" VLC (Variable Lengh Coding, comme les codages de Shannon,
Huffman), dits aussi codes entropiques. Dans ce type de codage, un mot est traduit par un code d'autant plus court
que ce mot est probable. Cette technique est intressante en codage diffrentiel, puisque dans ce cas les diffrences
faibles sont plus probables que les grandes.
4. Systmes DVB
a. Le groupe DVB
Le groupe DVB (Digital Video Broadcasting) est le nom du projet europen associant plus de 180 structures (des
industriels aux diffuseurs et aux instances de rgulation) de plus de 20 pays en Europe. Il a travaill llaboration de
spcifications techniques pour la diffusion numrique et la ralisation de normes compatibles aussi bien pour le cble
que pour le satellite et la transmission hertzienne (do les diffrentes appellations DVB-C, DVB-S, DVB-T).
La tlvision suivant le systme DVB permettra la transmission de plusieurs programmes sur un canal de
transmission classique, offrira plusieurs niveaux de qualit possibles partir dun seul signal, permettra la rception
stable avec des rcepteurs mobiles, autorisera la transmission de la tlvision haute dfinition (HDTV, High Definition
TeleVision) sur des rseaux terrestres...
Les diffrents groupes dtude ont travaill la normalisation des procds de modulations numriques, la mise en
place dun dispositif commun dinformation, la dfinition des systmes daccs conditionnels et de cryptage...
Compte tenu du nombre important de langues utilises en Europe, le systme DVB propose aussi plus de canaux
audio que le modle amricain quivalent.
Au del des retards entrans par la relative lenteur de lvolution du matriel, la compression de donnes va devenir
omniprsente. Lexplosion de la taille des donnes manipules va encore saccrotre avec lexplosion du multimdia et
toutes les mthodes de compression efficaces seront les bienvenues.
La compression des signaux audio et vido, la constitution du multiplex (multiplexage) et lembrouillage sont
communs tous les supports de diffusion (terrestre, cble, satellite). Il ny a que les techniques de transmission qui sont
spcifiquement adaptes.
Pour la compression des signaux audio et vido, DVB a retenu le standard MPEG2. Il est clair que MPEG possde
lavenir le plus prolifique car il est indpendant de tous les constructeurs et des architectures matrielles.
Pour le multiplexage, DVB a retenu le Transport Stream MPEG (flux de transport MPEG).
En ce qui concerne les systmes de contrle daccs, seul lembrouillage a t normalis.
b. Codage source
i)
Principes
La numrisation transforme une image vido composite en une somme gigantesque de donnes dont le transport
"brut" (c'est--dire sans traitement pralable) est impossible mme sur des supports comme le cble et le satellite. C'est
l qu'apparat la compression, ou "codage source", tape qui vise comprimer les donnes (quitte parfois perdre
quelques informations) afin qu'elles puissent tre vhicules sur ces mdia.
Le codage source est appliqu l'audio (Musicam) et la vido (MPEG2). Il a pour fonction de rduire la quantit
d'informations transmises. Le codage vido MPEG2, retenu comme norme, utilise l'estimation et la compensation de
mouvements entre images successives. Le codage audio est ralis grce au procd Musicam qui utilise les proprits
de l'oreille humaine pour permettre de coder uniquement les informations ncessaires.
Pour rsumer, le principe du MPEG est de ne pas transmettre ce qui l'a dj t et ce qu'on n'entend pas !
2003-2004
28
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
ii)
SysTl2
Universit Paris XI
Compression spatiale en vido
Lorsque l'on tudie une image anime on s'aperoit de la redondance des donnes : l'image est un signal trs
fortement corrl.
Or, il s'avre que les formats de compressions communs ne sont pas ce qu'il y a de plus puissant. On applique alors
la compression MPEG (extrapolation de la compression JPEG, Joint Photographic Expert Group, pour les images
fixes). Cette compression comprend 5 tapes dont 3 sont purement ddies la transformation des donnes et 2 qui sont
utilises pour la compression des donnes.
En premier lieu, on divise l'image en blocs de 8*8 pixels sur lesquels on applique une DCT. Les coefficients ainsi
calculs sont dbarrasss du bruit, seule l'information pertinente est conserve.
Ensuite, on passe une tape de quantification/seuillage qui dtermine les coefficients de la DCT prendre en
compte. En effet la DCT rduit largement les bruits mais des valeurs quasi-nulles demeurent dans les matrices de
coefficients. On les limine donc par l'tape du seuillage. Cette tape n'est pas rversible car on perd des informations,
mais comme elle tient compte des spcificits et surtout des dfauts de l'il, on ne peroit pas ou trs peu les
modifications (suivant la degr de compression appliqu).
Par la suite, on passe par de la compression dite statistique rversible et qui repose sur deux algorithmes que sont le
RLC (Run Length Coding) et le VLC. On lit au pralable en zig-zag les coefficients pr-traits, de telle sorte que les
coefficients soient rarrangs sous la forme d'un vecteur, plus commode transporter. Cette srialisation des 64
lments de la matrice est effective en commenant par les composantes basse frquence et en finissant par celles
hautes frquences.
L'algorithme RLC code le nombre d'occurrences des coefficients nuls et la valeur du prochain non nul, ce qui rduit
la quantit de donnes transmettre.
L'algorithme VLC ou d'Huffman permet de coder les coefficients avec une longueur d'autant plus courte qu'ils sont
plus frquents statistiquement.
Ces deux traitements associs permettent d'obtenir un facteur de compression variant entre 2 et 3 pour une image
fixe.
Au terme de la compression dite spatiale, un grand nombre des donnes ont t compresses. Pour passer une taille
encore plus rduite de donnes transmettre, il faut raliser un compression temporelle.
iii) Compression temporelle en vido
En fait de compression temporelle, on parle plutt de prdictions temporelles quand il s'agit de la norme de
compression MPEG.
La plupart des images animes d'une mme squence contiennent de nombreuses redondances. Cependant, le
codage d'une image ne dpend pas uniquement de l'image prcdente. Il existe trois types de codage pour traiter
l'ensemble des images d'une squence vido :
Le codage I (Intraframes) : on procde alors comme pour une image fixe, sans rfrence d'autres images, ce
traitement est ncessaire car la squence ncessite toujours un commencement
Le codage P (Predicted Frames) : l'image est calcule partir de l'image de type P ou I la plus rcemment calcule
(chaque bloc d'une image peut tre cod par des mthodes diffrentes). Le taux de compression d'une image du type
P est plus important que celui d'une image de type I.
Le codage B (Bidirectionnal Frames) : L'image est code partir des 2 images de type I ou P les plus rcentes,
l'une dans le pass, l'autre dans le futur. Trois calculs sont ncessaires pour connatre le meilleur codage possible :
partir de l'image antrieur, partir de l'image future, et partir de la moyenne des deux images. Le calcul des
images B est le plus complexe donc aussi le plus lent. Ce type dimage offre cependant le taux de compression le
plus lev.
iv) MPEG appliqu l'audio
L'audio numrique est bien connu depuis la mise sur le march du Compact Disc (CD) en 1984 : chantillonnage
16 bits 44,1 khz ; gamme de frquences de 20 Hz 20 kHz ; dbit gal 44,1 * 16 * 2 = 1411,2 kbits/s en stro.
Le principe de la compression audio consiste utiliser les faiblesses de laudition humaine pour rduire la quantit
dinformation transmettre sans pour autant dtriorer la qualit du signal audio.
La bande de frquence audio est divise en 32 sous-bandes gales en largeur et ingales en hauteur en fonction des
caractristiques de l'oreille humaine. Les signaux infrieurs au niveau des sous-bandes sont limins. Les zones o
l'oreille est la plus sensible peuvent ainsi quantifies, avec plus de prcision.
Le dbit fixe peut tre choisi entre 32 et 192 kbits/s par voie. La qualit hi-fi demande 64 kbits/s par voie, soit
128 kbits/s en stro ; c'est celle qui est retenue. Le taux de compression est de 1411,2/128 kbits/s = 11,025.
2003-2004
29
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
c.
SysTl2
Universit Paris XI
Le multiplexage
Les donnes audio et vido viennent de subir des oprations de rduction de dbit. Il est ncessaire maintenant
dorganiser ces donnes grce des codeurs audio et vido, afin de raliser le multiplexage de plusieurs squences
vido et de services varis sur un mme canal.
Les codeurs audio et vido fournissent leur sortie des trains lmentaires de donnes qui constituent la couche de
compression. Chaque train lmentaire ES (Elementary Stream) est divis en paquets qui constituent ainsi un PES
(Packetized Elementary Stream). Les PES sont obtenus en dcoupant le flux ES en morceaux plus ou moins longs. Un
en-tte est rajout chaque paquet PES pour lidentifier. Ces paquets restent de longueur importante et variable et ne
sont pas du tout adapts la transmission.
En transmission, on travaille avec des paquets de format court, fixe, et dbit constant. Cest pourquoi on ralise,
partir des flux de donnes PES, un flux de transport TS (Transport Stream) compos de paquets de 188 octets (4 octets
den-tte ou packet header, et 184 octets de donnes utiles ou payload). Ces paquets TS sont obtenus en dcoupant les
PES en petits morceaux de 184 octets (payload). La longueur des paquets est courte (188 octets) afin de permettre
lajout de dispositifs de correction derreurs mis en uvre dans le codage de canal.
Les PES vido sont dcoups en TS vido. Les PES audio sont dcoups en TS audio. Les PES audio et vido dun
mme programme sont multiplexs pour obtenir un STPS (Single Program Transport Stream). Les STPS de plusieurs
programmes peuvent tre ensuite multiplexs par un oprateur de multiplexage pour obtenir un MPTS (Multiple
Program Transport Stream).
Le multiplexage permet la diffusion dans un mme canal de plusieurs programmes de tlvision (quatre six)
organiss en "multiplex de programmes".
Toutes les donnes numriques organises en flux de transport STPS sont ensuite transmises loprateur de
multiplexage.
Une partie des missions numriques seront payantes. La norme DVB a donc dfini un algorithme commun
dembrouillage CSA (Common Scrambling Algorithm, ne pas confondre avec le Conseil Suprieur de
l'Audiovisuel) qui consiste transformer un signal numrique en un signal numrique alatoire en vue den faciliter
la transmission ou de le rendre inintelligible.
Lembrouillage peut intervenir deux niveaux :
soit au niveau paquet lmentaire de donnes PES,
soit au niveau paquet transport TS.
d. Le codage canal
i)
Gnralits
Le codage canal met en uvre des techniques anticipant les erreurs de transmission dues aux dfauts des mdia de
transport, augmentant de mme le nombre de bits transmettre, alors que le codage source stait vertu le diminuer.
Le codage de canal comporte trois quatre tapes, suivant le mdium utilis. Pour tous il inclut :
le brassage, qui permet dassurer la dispersion dnergie du spectre radiofrquence rayonn, cest--dire une
rpartition uniforme de lnergie dans le canal dmission. Pour viter de longues suites de 0 ou 1 le signal doit tre
rendu quasi alatoire, ceci au moyen dun embrouillage des donnes par une squence pseudo-alatoire de polynme
gnrateur 1+X14+X15 (dispositif simple registre dcalage 15 bits et XOR, cf. Figure IV.4) ;
le codage externe ou codage de Reed-Solomon (qualifi de "204, 188, T = 8", 204 tant le nombre doctets aprs
codage, 188 le nombre doctets utiles et 8 le nombre derreurs pouvant tre corriges). Il permet, avec ltape
dentrelacement qui le suit, la correction des erreurs en rafales introduites par le support de transmission. Il ajoute 16
octets de parit aux 187 octets dinformation et loctet de synchronisation daprs lesquels il est calcul. On ne
peut toutefois corriger plus de 8 octets errons.
Lentrelacement (interleaver). Il assure la dispersion temporelle des erreurs et vise augmenter lefficacit du
codage de Reed-Solomon. Le principe est de transmettre les diffrents caractres d'un mme mot au sein de paquets
distincts afin que les erreurs temporaires ventuelles (orage violent sur la station d'mission) ne portent pas sur la
totalit d'un mot mais que sur un nombre limit de caractres. Les paquets ne se suivent plus dans l'ordre
chronologique aprs cette tape.
2003-2004
30
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
Figure IV.4 : Brassage en DVB.
Dans le cas du cble (modulation 64QAM) il reste ensuite convertir le train de bits srie en deux signaux I et Q de
trois bits, chacun reprsentant des symboles de six bits, avant le filtrage et la modulation (symbol mapping).
Pour les cas de la diffusion terrestre mais aussi, voire surtout, du satellite, il faut anticiper et corriger au maximum
les erreurs alatoires qui peuvent dcouler des faibles rapports signal/bruit dans ces transmissions. Cest le rle du
codage interne, de type convolutif. Si l'on regarde bit bit le signal, aucun lien ne les relie. Chaque bit est
rigoureusement indpendant. L'ide du code convolutif est de lier un bit un ou plusieurs bits prcdents de sorte
pouvoir retrouver sa valeur en cas de problme. On peut pour cela raliser un codage "en treillis", comme illustr sur la
Figure IV.5. Il va permettre de retrouver la valeur la plus probable d'un bit en observant les bits prcdemment reus.
L'opration de dcodage est ralise en rception par le dcodeur de Viterbi.
Notons que dans le cas de l'utilisation du codage convolutif, on double le nombre de bits transmis, ce qui n'est pas
trs raisonnable tant donn tout ce que nous avons vu jusqu' prsent. On rduit le nombre de bits en effectuant une
opration de poinonnage, c'est--dire en ne transmettant pas certains bits sortant du codeur convolutif. Si trois bits se
prsente en entre de codeur, on va en retrouver 6 en sortie mais on n'en transmettra que 4. Le rendement sera alors de
3/4. On parle aussi de FEC 3/4 (FEC = Forward Correction Error).
Figure IV.5 : Code convolutif.
Dans le cas des missions terrestres en modulation OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), il faut
encore effectuer des oprations de "srialisation", dentrelacement interne et de symbol mapping pour adapter le train
srie au grand nombre de porteuses utilises.
Il ne reste plus qu' raliser la modulation "numrique", aprs filtrage de Nyquist. Le type de modulation utilis
dpend du canal de transmission tudi (satellite, cble ou diffusion hertzienne).
2003-2004
31
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
ii)
SysTl2
Universit Paris XI
Transmission par satellite
La largeur de canal disponible est frquemment gale 36 MHz. Un signal provenant d'un satellite subit une
attnuation de plus de 200 dB. On reoit donc un signal trs faible et bruit. On a dans ce cas choisi la modulation la
moins sensible aux distorsions d'amplitude : la modulation saut de phase en quadrature QPSK (cf. Figure IV.6).
10
00
I
11
01
Figure IV.6 : Constellation d'une modulation QPSK en prsence de bruit.
iii) Transmission par le cble
La largeur de canal est trs rduite, elle est gale 8 MHz. En revanche, le milieu de transmission est trs protg.
On choisit alors une modulation efficacit maximale, c'est--dire transportant un maximum de bits par symbole. En
pratique, la plupart des rseaux cbls travaillent en 64QAM (cf. Figure IV.7).
Figure IV.7 : Constellation d'une modulation 64QAM.
iv) Transmission hertzienne
La largeur de canal est galement limite 8 MHz. Le systme choisi doit de plus tre insensible aux phnomnes
d'chos. Transmettre un train numrique par voie hertzienne n'est pas une mince affaire et c'est pourquoi, c'est la
technologie qui a demande le plus de temps pour merger.
Le multiplexage utilis en DVB-T est le COFDM, pour Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex. Son
principe est de rpartir un flux haut dbit en plusieurs flux petit dbit.
Le dfi relever est qu' la rception on puisse retrouver les symboles transmis indpendamment des chemins
multiples (rflexions, chos, antenne recevant deux metteurs diffrents, effet Doppler dans le cas de la rception
mobile) emprunts depuis le ou les metteurs.
Par dfinition, les caractristiques d'un canal de transmission ne sont pas constantes dans le temps. Mais durant un
court laps de temps, les caractristiques d'un canal hertzien sont stables. Le COFDM dcoupe le canal en cellules selon
les axes du temps et des frquences.
Le canal est alors constitu d'une suite de sous-bandes de frquence et d'une suite de segments temporels. A chaque
cellule frquence/temps est attribue une porteuse ddie qui reprsente un symbole COFDM. On va donc rpartir
l'information transporter sur un ensemble de ces porteuses, module chacune faible dbit par une modulation du type
2003-2004
32
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
QPSK ou QAM. Deux choix existent, le mode dit 8k (6817 porteuses dans le canal) ou le mode dit 2k (1705 porteuses
dans le canal). Chacune des porteuses est orthogonale la prcdente.
V.
Annexe : rception htrodyne
La Figure V.1 rsume l'organisation gnrale d'une chane de rception en transmission hertzienne. L'antenne "large
bande" de rception permet de capter des signaux moduls autour de diffrentes frquences porteuses f0, f1, f2, f3... La
chane de rception doit donc obligatoirement comporter un filtre slectif pour choisir un signal modul autour d'une
porteuse en particulier, par exemple f0. Or l'encombrement en frquence des gammes d'onde rserves la
radiodiffusion et la tlvision exige une trs grande slectivit des rcepteurs. L'universalit des rcepteurs
accordables implique en outre que cette slectivit soit garantie la rception de chaque metteur. Pour la
radiodiffusion FM par exemple, cela implique qu'il faudrait pouvoir raliser des filtres slectifs de facteur de qualit de
l'ordre de 1000 accordables autour de 100 MHz, ce qui est impossible. Pour rsoudre cette difficult, on met en uvre
une rception "htrodyne", comme nous allons le dcrire dsormais.
f0
f1
f2
f3
PA
x(t)
X
F
OL
Accord
Figure V.1 : Chane de rception htrodyne. Des amplificateurs sont gnralement placs en amont et en aval du
dmodulateur qui suit le filtre passe-bande F. L'amplificateur en amont du dmodulateur fonctionne dans un
domaine de frquence situ autour de la frquence intermdiaire fFI, celui en aval dans la bande de base du signal
modulant initial x(t), c'est--dire basse frquence.
Aprs rception par l'antenne le signal est amplifi par un pramplificateur PA dont les performances vis--vis du
bruit doivent tre optimises (nous reviendrons sur ce problme dans la suite du cours). On ralise ensuite un mlange
avec un signal de frquence fOL issu de l'oscillateur local OL. Cette frquence fOL est ajuste de telle sorte que la
diffrence fOL - f0 soit gale une constante fFI appele frquence intermdiaire. Le signal est ensuite filtr par un
passe-bande slectif F centr en fFI, destin liminer tout autre signal que celui modul autour de f0, et on effectue
finalement la dmodulation. Comme fOL > f0, on parle alors de rception "superhtrodyne". Pour une gamme donne
de valeurs de f0, ce choix conduit une plage de variation relative plus faible pour fOL que si on avait choisi f0 > fOL,
d'o une facilit de ralisation plus grande.
Un problme se pose cependant : si on n'y prend garde, la frquence f0 = fOL + fFI traverse galement le filtre
passe-bande centr sur fFI, perturbant ainsi la dmodulation. Pour viter cela, il est ncessaire que le pramplificateur
assure galement le rle de filtre passe-bande afin d'liminer les composantes spectrales situes autour de la frquence
f0, dite frquence image de f0. Ce filtre doit donc tre accord sur f0, mais sa slectivit n'est cependant pas
ncessairement trs importante.
Les valeurs des frquences pour les diffrents systmes de diffusion ne font pas forcment l'objet de normes trs
prcises. Si pour la radiodiffusion en FM (f0 de 88 108 MHz) on a fFI = 10,7 MHz, la valeur de fFI varie entre 440 et
490 kHz en radiodiffusion AM (f0 de 530 1700 kHz).
VI. Sources d'inspiration
"Technologie des tlcoms", par Pierre Lecoy, collection Rseaux et Tlcommunications, dition Hermes
(abondamment pill...).
"Broadcast Television Fundamentals", par Michael Tancock, dition Pentech Press, 1991.
"Tlvision", par Georges Bernde, cours Suplec 3me anne, 1999 et "Tlvision", par Alain Azoulay, cours
Suplec, 2002.
"Electronique grand public, les bases de la tlvision", http://www.multimania.com/bftel/test/QUEST.htm.
2003-2004
33
DESS Syst. Elec. FIUPSO3 Elec.
SysTl2
Universit Paris XI
"Rparation d'Appareils lectroniques Audio-vido", par Michel St-Gelais, http://pages.infinit.net/niuton.
"L'cran plasma", http://pcml.univ-lyon1.fr/Luminophores/ecrplasm.html.
"Les
crans
plats",
par
Stphane
Pesque
et
http://www.utc.fr/dess/gti/accueil/05_techno_cles/ecrans_plats/ecranplat.htm.
"Technologies dcrans plats : Prsent et futur", par Gunther Hass (Thomson Multimdia), 13me Journe de la
Nanotechnologie, Paris, 16 janvier 2003.
"Les crans plats", par Yannick Corroenne, http://www.cst.fr/dtech/03-jan98/dtech03.html.
"Contribution l'tude de l'rosion de la magnsie d'un panneau plasma", par Christelle Mac, Thse de
l'Universit Paris Sud, avril 2001.
"Plasma display panel: physics, recent developments and key issues", par J. P. Boeuf, Journal of Physics D: Applied
Physics Volume 36, pages R53-R79 (2003).
"Fully sealed, high-brightness carbon-nanotube field-emission display", par W. B. Choi, D. S. Chung, J. H. Kang,
H. Y. Kim, Y. W. Jin, I. T. Han, Y. H. Lee, J. E. Jung, N. S. Lee, G. S. Park, J. M. Kim, Applied Physics Letters
Volume 75, Numro 20, pages 3129-3131, 15 novembre 1999.
"Large area electronics platform outline", par R. Meyer, Revue Annuelle du CEA-LETI, Grenoble, 24 juin 2003.
Prsentation disponible sur le site web du LETI : http://www-leti.cea.fr.
"Field emission display with carbon nano tubes", par J. Dijon, Revue Annuelle du CEA-LETI, Grenoble, 25 juin
2003. Prsentation disponible sur le site web du LETI : http://www-leti.cea.fr.
"Tlvision, le coup de Canon", par Ridha Loukil et Jean-Charles Guzel, Industrie et Technologies, n854, pages
14 et 15, janvier 2004.
"Les formats vido numriques", par Philippe Gasser, note technique du Centre National de Documentation
Pdagogique, avril 1996, http://www.cndp.fr/DOSSIERSIE/.
"Des pyramides du pouvoir au rseau de savoir - Tome 1", par Ren Trgout, Rapport d'information 331 du Snat,
1997, http://www.senat.fr/rap/r97-331-t1/r97-331-t160.html (pour les lments d'informations sur les systmes
MAC).
"DVB-T, principe de fonctionnement, perspectives d'implantation en France, et tat de dveloppement actuel des
rcepteurs", par Luc Grimaud, Conservatoire National des Arts et Mtiers (Dpartement Physique-Electronique),
oral probatoire du 2 dcembre 2000, http://perso.libertysurf.fr/IPhilGood/download/DVBT_france.pdf.
2003-2004
Brieu
de
Larrard,
34
Vous aimerez peut-être aussi
- Jerry Goldsmith - Basic InstinctDocument8 pagesJerry Goldsmith - Basic InstinctFotis Koutzagiotis100% (3)
- Exercices Serie01Document2 pagesExercices Serie01Sarra BenhammouPas encore d'évaluation
- Projet WDM Comsis TarmidiDocument31 pagesProjet WDM Comsis TarmidiKawtar Tarmidi100% (4)
- TD RéseauxDocument3 pagesTD RéseauxselmiPas encore d'évaluation
- Cours MontageDocument15 pagesCours MontageNour MeniiPas encore d'évaluation
- Cours Antenne Part 2Document42 pagesCours Antenne Part 2NADIA EL HATIMIPas encore d'évaluation
- Télévision NumériqueDocument5 pagesTélévision NumériqueprincePas encore d'évaluation
- Correction TVNumerique 5ptsDocument2 pagesCorrection TVNumerique 5ptssa raPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 La Pile Protocolaire TCP-IPDocument73 pagesChapitre 2 La Pile Protocolaire TCP-IPHammami Maha100% (1)
- DM Code de Cesar 4emeDocument2 pagesDM Code de Cesar 4emeNour brPas encore d'évaluation
- Codage Canal V2 PDFDocument68 pagesCodage Canal V2 PDFOussama DariàouiPas encore d'évaluation
- Techniques de CodageDocument105 pagesTechniques de CodageTamali JamelPas encore d'évaluation
- TP 2Document2 pagesTP 2JustinPas encore d'évaluation
- Examen TelecomDocument9 pagesExamen TelecomAlpha Ibrahima DialloPas encore d'évaluation
- TD 2Document2 pagesTD 2Riadh HOURRIGPas encore d'évaluation
- Supports de Transmission Chapitres 1 2 3Document56 pagesSupports de Transmission Chapitres 1 2 3Nacer Abdelghani100% (1)
- Chapitre IIIDocument57 pagesChapitre IIIrizlane korichiPas encore d'évaluation
- RTCPDocument8 pagesRTCPÃd ELPas encore d'évaluation
- Diffusion Multicast WifiDocument9 pagesDiffusion Multicast Wifiapi-270037984Pas encore d'évaluation
- Correction Examen Rachid 2010 PDFDocument4 pagesCorrection Examen Rachid 2010 PDFAzaiez AbdellatifPas encore d'évaluation
- Cours Transmission Optique Mme Batti Sal PDFDocument37 pagesCours Transmission Optique Mme Batti Sal PDFFathi KallelPas encore d'évaluation
- Rattrapage-Controle - Transmission NumeriqueDocument4 pagesRattrapage-Controle - Transmission NumeriqueVoundai Mahamat100% (1)
- Compte Rendu TP System de Communication OptiqueDocument6 pagesCompte Rendu TP System de Communication OptiqueBéjaoui DhiaPas encore d'évaluation
- Les Caracteristiques Des Supports de TransmissionDocument11 pagesLes Caracteristiques Des Supports de Transmissionoudet9977Pas encore d'évaluation
- La SecuriteDocument68 pagesLa SecuritehaggarfilsPas encore d'évaluation
- Telephonie RTC-PBXDocument168 pagesTelephonie RTC-PBXAbdoul zaho OuedraogoPas encore d'évaluation
- ST 33 2017-2018Document2 pagesST 33 2017-2018I Kedir100% (1)
- Support Cours TéléinfoDocument37 pagesSupport Cours TéléinfociscozyPas encore d'évaluation
- Physique Appliquée. Le Réseau GSM. Jean-Philippe Muller. Le Réseau GSM PDFDocument32 pagesPhysique Appliquée. Le Réseau GSM. Jean-Philippe Muller. Le Réseau GSM PDFmouhssinePas encore d'évaluation
- Chapitre 2 TVNDocument29 pagesChapitre 2 TVNkarim amiaPas encore d'évaluation
- Transmissiondata Chapitre1Document89 pagesTransmissiondata Chapitre1Faycel HamdiPas encore d'évaluation
- Architecturedes RéseauxDocument69 pagesArchitecturedes RéseauxMartin TraorePas encore d'évaluation
- Chapitre 4Document39 pagesChapitre 4Malek KeskesPas encore d'évaluation
- Mpeg 4Document26 pagesMpeg 4medPas encore d'évaluation
- Introduction TelecommunicationsDocument70 pagesIntroduction TelecommunicationsTresor BrouPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Les Composants OptiquesDocument23 pagesChapitre 4 Les Composants Optiqueszied100% (4)
- Techn-Protocoles-Multi-cc Avec Sol-19-20Document3 pagesTechn-Protocoles-Multi-cc Avec Sol-19-20Dehri Brahim100% (1)
- 01 Transmission de DonneesDocument57 pages01 Transmission de DonneesMarilyne MiganPas encore d'évaluation
- Chapitre 1-Réseaux Informatique LocauxDocument24 pagesChapitre 1-Réseaux Informatique Locauxjaci nthePas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Codage Source ReduitDocument58 pagesChapitre 1 - Codage Source ReduitFatima Zahra Moughraoui100% (1)
- 1 La Hierarchie SDH Et SonetDocument12 pages1 La Hierarchie SDH Et SonetMbengue OmarPas encore d'évaluation
- Compte Rendu TP 01Document4 pagesCompte Rendu TP 01Lydia TissoukaiPas encore d'évaluation
- Cours4 Compressionvideo PDFDocument75 pagesCours4 Compressionvideo PDFmatmatijamelPas encore d'évaluation
- TransmissionNumerique PDFDocument81 pagesTransmissionNumerique PDFAbdou SuperPas encore d'évaluation
- Modele D Examen Pour L2 S4 Decouvetre 1 Telecoms Et Applications 2016 2017Document3 pagesModele D Examen Pour L2 S4 Decouvetre 1 Telecoms Et Applications 2016 2017logicielo DzPas encore d'évaluation
- Cours Systemes Transmission v3Document136 pagesCours Systemes Transmission v3boutemzabet100% (1)
- Modulation PCM A2012Document68 pagesModulation PCM A2012asalmadPas encore d'évaluation
- These Abdellatif BERKATDocument180 pagesThese Abdellatif BERKATmaamriaPas encore d'évaluation
- Communications Numériques-Ensa - Ch2.1Document49 pagesCommunications Numériques-Ensa - Ch2.1Jawad MaalPas encore d'évaluation
- Mic 32voiesDocument18 pagesMic 32voiesSofiene BenPas encore d'évaluation
- Ofdm PDFDocument17 pagesOfdm PDFaimadjePas encore d'évaluation
- Modulation D AmplitudeDocument4 pagesModulation D Amplitudebadr talaminePas encore d'évaluation
- Theorie de L Information Et CodageDocument151 pagesTheorie de L Information Et CodageHisham BaskyPas encore d'évaluation
- Cours Reseaux Mobiles GSM 2022-2023Document80 pagesCours Reseaux Mobiles GSM 2022-2023Kratos OlympePas encore d'évaluation
- Communication AnalogiqueDocument13 pagesCommunication AnalogiqueAmina NadiaPas encore d'évaluation
- Réseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsD'EverandRéseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsPas encore d'évaluation
- TS Info App S2 - 240229 - 071104Document56 pagesTS Info App S2 - 240229 - 071104saad doudouPas encore d'évaluation
- M13304 PDFDocument85 pagesM13304 PDFÂmį ŇěPas encore d'évaluation
- These Temps Et Son Au Cinema PDFDocument119 pagesThese Temps Et Son Au Cinema PDFJey RotierPas encore d'évaluation
- Braeckman Voutsinos-SvilarichDocument85 pagesBraeckman Voutsinos-SvilarichBorisPas encore d'évaluation
- La Gloire de Mon PèreDocument24 pagesLa Gloire de Mon PèreFilou SocratePas encore d'évaluation
- ABCsonorisation SIDocument72 pagesABCsonorisation SIbouwazraPas encore d'évaluation
- Coco - Recuerdame PDFDocument2 pagesCoco - Recuerdame PDFErik Recuenco100% (1)
- Meu LarDocument5 pagesMeu LarMarcelo CarvalhoPas encore d'évaluation
- String Part Polotvzian DanceDocument1 pageString Part Polotvzian DanceChong Chun WengPas encore d'évaluation
- Mambo Italiano Bass PDFDocument2 pagesMambo Italiano Bass PDFharveydavidmPas encore d'évaluation
- Cookie Dingler - Femme LibéréeDocument5 pagesCookie Dingler - Femme Libéréedavid costanzoPas encore d'évaluation
- 2M (3e Copie)Document5 pages2M (3e Copie)badrPas encore d'évaluation
- Bertolt BrechtDocument9 pagesBertolt BrechtjohndeerePas encore d'évaluation
- TD Onde Et VibrationDocument5 pagesTD Onde Et VibrationfatiPas encore d'évaluation
- NI Diesetel G1-G2 PDFDocument12 pagesNI Diesetel G1-G2 PDFHamdiMidouPas encore d'évaluation
- Best of Gipsy Kings - Jirka Kadlec - Sax TenorDocument8 pagesBest of Gipsy Kings - Jirka Kadlec - Sax TenorDaniel DelgadoPas encore d'évaluation
- VER07 ctr16 Schéma ÉlectriqueDocument28 pagesVER07 ctr16 Schéma ÉlectriqueHenrique Correia NetoPas encore d'évaluation
- MonopoleDocument39 pagesMonopolekadeefaze27Pas encore d'évaluation
- O Mio Bambino Caro - Score and Parts PDFDocument4 pagesO Mio Bambino Caro - Score and Parts PDFLuke VellaPas encore d'évaluation
- Transmissions - Cat3828Document12 pagesTransmissions - Cat3828Houda GuedriPas encore d'évaluation
- Cours F6KGL v0903Document220 pagesCours F6KGL v0903the_citizen89Pas encore d'évaluation
- Questionnaire Gestion CulturelleDocument3 pagesQuestionnaire Gestion Culturelleberenice momoPas encore d'évaluation
- Other Afro-Cuban EssentialsDocument1 pageOther Afro-Cuban EssentialsDrum Code100% (1)
- Requiem Mozart LacrimosaDocument3 pagesRequiem Mozart LacrimosaCarine RamamonjisoaPas encore d'évaluation
- Prepositions A To ZDocument2 pagesPrepositions A To ZClément MartinelliPas encore d'évaluation
- Repertorio de Trompeta PDFDocument76 pagesRepertorio de Trompeta PDFWilfredo Ccahuana ValenzaPas encore d'évaluation
- Agnus DeiDocument1 pageAgnus DeiRegis Duarte MullerPas encore d'évaluation
- IMSLP449877-PMLP346467-Vivaldi Cello Concerto RV 399 F.III N 6 in C Major Mandozzi Score - Violoncello Solo PDFDocument5 pagesIMSLP449877-PMLP346467-Vivaldi Cello Concerto RV 399 F.III N 6 in C Major Mandozzi Score - Violoncello Solo PDFPablo Gonzalez MartinezPas encore d'évaluation
- Vers La Sénescence Par La MusicothérapieDocument157 pagesVers La Sénescence Par La Musicothérapieconcerti de vie100% (2)
- 23aa Ritmos de Murga Callejera-1Document1 page23aa Ritmos de Murga Callejera-1siete coloresPas encore d'évaluation
- IKO IKO TNT Brass Band BB - Soprano SaxDocument1 pageIKO IKO TNT Brass Band BB - Soprano SaxHenry BloodworthPas encore d'évaluation
- Non Rien de Rien Paroles - Recherche GoogleDocument1 pageNon Rien de Rien Paroles - Recherche GoogleMatteo MartinoPas encore d'évaluation
- Brahms Intermezzo Op. 118 No. 2Document7 pagesBrahms Intermezzo Op. 118 No. 2Mayang SariPas encore d'évaluation