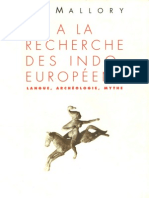Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Grammaire de L'Hebreu Biblique
Grammaire de L'Hebreu Biblique
Transféré par
EstebanAguileraCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Grammaire de L'Hebreu Biblique
Grammaire de L'Hebreu Biblique
Transféré par
EstebanAguileraDroits d'auteur :
Formats disponibles
GRAMMAIRE DE L'HEBREU BIBLIQUE
PAR
Ie P. PAUL JOOON S. J.
PROW&$SBUR A L'O' lNSTITUT BIBLIQUE POJlTU'lCAL
Deuneme edition
INSTITUT BIBLIQUE PONTIFICAL
PIAZZA DELLA PILOTT A 35
ROME 1947
GRAMMAIRE DE L'HEBREU BIBLIQUE
PRE/HIEIIF.
EDITIO.\', [)t:
1.92.3
IMPRIMERIE
DEUX/EAtf,'
L'lNSTlTUr
PIE IX - ROME
1.9/7
EI.JIT!O,V
ANASTATlQCE,
'OFl'ICiNt:
GRAFICHE
ITALlAl'\E'
. R.OME
GRAMMAIRE
DE L'HEBREU BIBLIQUE
DU M£ME AUTEUR
Le Cantique des Cantiques, Commentaire que (I909), Paris, G. Beauchesne. philologique et exegeriPAR
le P. PAUL JOOON S. J.
PROFESSEUR A L'INSTITUT 1l1BUQUE PONT'FICAL.
Ruth. Com mentaire phiJologique et exegetique (I924), Rome, Institut Biblique Pontifical. Libri Ruth textum hebraicum ad usum scholarum edidit Pontificium Institutum Biblicum, animadversion.bus criticis iHustravit P. Paulus joiion S. I., in eodem P.I.B. professor (I92I). L'Evangile de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Traduction et comrnentaire du texte original grec, compte tenu du substrat semitique (I930), Paris, Beauchesne .
.Nombreux
Qwtrage
couronne (P/'lX
par l'Institut
dp rrance
Volney)
Deuxieme edition an astatique ('orri~ee.
articles sur la phildogie sernitique dans les Melanges de la F aculte Orientale de Beyrouth, dans Orientalia et surtout dans Biblica, ainsi que sur le grec du Nouveau Testament dans les Recherches de Science Religieuse,
INSTITUT
'(PIAZZA
BIBLIQUE
PONTIFICAL
PILOTT A 35)
ROME
DELLA
1947
AVANT-PROPOS
L'essor pris de nos jours par les etudes bibliques a fait sentir plus universellement, en particulier chez les catholiques, la necessite d'une connaissance 'plus approfondie de la c langue sainte'. Les progres de la philologie semitique.xl' autre part, obligent etudier l'hebreu d'une rnaniere plus scientifique, comme on le fait depuis longtemps pour d'autres langues mortes, telles que le grec et le latin. C'est pour satisfaire au besoin d'une grammaire suffisamment complete et de caractere scientifique, souvent exprirne par nos eleves, d'abord la Faculte Orientale de l'Universite Saint-Joseph de Beyrouth, puis l'Institut Biblique de Rome, que nous nous sommes decide entreprendre ce travail. Ce qu'on nous demandait c'etait un livre interrnediaire entre les bonnes.grammaires elementaires et les ouvrages monumentaux comme le Leh» gebautie de E. Ki)~IG: Soit pour la mesure garder, so it pour la maniere d'exposer, nous avons eu en vue la categoric de plus en plus nombreuse des etudiants qui sentent la necessite de depasser le stade de la connaissance purement ernpifique C) et veulent se rendre capables de resoudreles multiples difficultes grammaticales du texte massoretique, au .lieu de sauter tout simplement par-dessus. Ils trouveront ici non seulement toutes les notions essentielles, mais encore la plupart des particularites d'irnportance secondaire. Quant aux menus details et aux anomalies si nombreuses qui peuvent rendre rebutante l'etude de l'hebreu, nous avons du nous limiter. L'important, du reste, pour l'etudiant, n'est pas tant de connaitre un tres grand nombre de minuties que de pouvoir se rendre compte d'une
AVIS
AU
LECTEUR
L'annee meme de la mort du R. P. Paul Jotion S. J. (ne a Nantes, le 6 [eurier I87I, il mourut dans cette ville, le I8 [eorier I940), la premiere edition de son ouvrage le plus apPV'ecie, la Gram" maire de l'hebreu biblique, allait etre epuisee. Vu son etat de sante, l'auteur n'avait pu songer a en preparer lui-meme une nouvelle edition, dans laquelle il aurait voulu utiliser les remarques de la critique, tres [aoorable d' ailleurs , pour ne pas dire enthousiaste, et les resultats de nouvelles recherches, dans le champ de la philologie hebraique. D'autres peut-etr«, apres sa mort, auraient pu se charger de publier cette nouvelle edition, si la guerre n'etait venue creer une situation peu propice a de pareils trauaux, Aujourd' hui le besoin d' une grammaire de la langue hebraique se fait de plus en plus sentir, et les demandes se multiplient. Aussi '10US sommes-nous decide Ii reimprimer, par lc precede anastatique= la Grammaire du Pere Joiion, apres en avail' corrige les erreurs typographiques. Elle contin uera, nous en sommes conuaincu, a rendre un precieux service aux hebraisants, desireu« d'approfondir leur connaissance de La langue des prosateurs et des poetes inspires de l' Ancien Testament.
LOUIS SEMKOW'SKI S. J.
a a
(I) Bien enten'du, la connaissance empirique des formes et des mots est le fondement indispensable de toute etude plus approfondie. 11faut assu-. rer la connaissance exacte des premiers elements: ecriture, lecture, paradigmes, vocabulaire usue!. Bien que cette grammaire so it, croyons-nous, parfaitement abordable pour tout esprit rnur et d'une culture philologique moyenne, il est possible que certains trouvent utile de s'Initier aux premiers elements dans un court resume. C'est l'Idee qui a guide M. TOI;ZARD quand il a fait preceder sa (jrmmnaire hebrafque abregee d'un rap ide expose des «Premiers elements », destine a orieuter rapidement les debutants.
VIII
AVANT-PROPOS
AVANT-PROPOS
IX
forme rare, de pouvoir juger si elle est explicable ou si elle est, au contraire, en dehors de toute analogie, anormale ou fautive. Mais quand un detail, meme minime, pouvait projeter un peu de lurniere sur quelque point obscur, nous n'avons pas hesite a Ie noter. On trouvera ici mainte particularite non si-' gnalee par E. KAUTZSCH; par contre, certains details donnes par ce grammairien ont ete deliberernent ornis. En evitant l'exces de details nous avons pu faire plus large la part de l'explication. Ceux merne qui ont l'esprit peu ouvert a la grammaire scientifique trouveront qu'une forme expliquee et comprise mord beaucoup mieux sur la memo ire. .Une solide initiation a la phonetique permet de retrouver facilement et exacternent une forme oubliee et preserve des vocalisations fautives. Pour ceux surtout qui commencent l'etude de l'hebreu un peu tardivement, l'explication rationnelle est un auxiliaire indispensable de la mernoire. Une langue sernitique comme l'hebreu donne l'impression d'un monde nouveau. Le systeme phonetique a des valeurs inconnues dans noslangues; la morphologie et la syntaxe ont des precedes tout differents des notres. Pour penetrer l'organisme et le genie de l'hebreu il faut se defaire de ses habitudes phonetiques (I) et grammaticalea, comme aussi de certaines idees suggerees par nos langues. Des les premiers elements, la nature des voyelles hebraiques, leur qualite (2) et leur quantite sont e~posees d'une facon qui differe assez notablement de l'enseignement de la plupart des gramrnairiens. Sur des points assez nombreux, par exemple dans la question si importante des temps, nous nous sommes ecarte de certaines vues generalernent adrnises, quand un exani.en serieux nous a montre qu'elles n'etaient pas suffisamment exactes. AU5Sibien ne cornprendrait-on guere qu'un livre de ce genre se bornat a un travail de compilation, d'agencement
(1) Et cela non senlement theoriquement, mais encore dune fa!;on pratique. L'etudiant devra s'astreindre, des Ie debut, lI. prononcer exactement: consonnes, voyelles (timbre, quantite, ton), a observer la division syllabique, etc. Le Francais devra notamment veiller a la prononciation exacte des voyelles fermees {! et (J en des positions oil ces voyelles repugnent aux lois phonetiques de notre langne. Ildevra aussi, des le debut, faire sentir fortement Ie ton mile'el qu'on a systematlquement marque dans ce livre, matgre la difficulte typographique. (t) L'importance capitale de la qualite dans les voyelles hebraiques exigeait pour leur transcription I'emploi de caracteres phonetiques,
au de mise au point et n'apportat pas un peu de nouveau ('). Sur les points controverses on n'a que rarernent mentionne les opinions divergentes. La nature du livre permettait encore rnoins d'entrer dans des discussions. Pour la bibliographie, en dehors des indications generales de l'lntroduc#on, on n'a donne de references que pour certains points plus importants, et a des travaux reellernent utiles (I) Dans le vaste champ des explications grammaticales on doit bien souvent se contenter, si ron veut etre sincere, de simples probabilites. Le lecteur sera sans doute surpris de voir revenir si souvent les mots probable, probablement (probt), peut-eb'e (p.-e.) qu'on n'est guere .accoutume -a trouver sous la plume des grammairiens. Mais, au risque de paraitre meticuleux, nous n'avons pas voulu donner au lecteur l'impression que toutes les explications sont egalement certaines. Sans avoir aucun respect superstitieux pour la vocalisation du texte massoretique, nous nous sornmes convaincu que, dans l'ensemble, elle est l'image fidele de la realite et partant offre une base grammaticale solide. Cette attitude conservatrice ne nous a pas ernpeche de' signaler ce qui nous a paru arbitraire, suspect ou fautif. Le lecteur aura vite rim pression que l'etude du texte massoretique ne peut etre que critique: elle. n'est pas faite pour des esprits trop jeunes. Malgre nos efforts pour ne pas submerger le lecteur sous un deluge d'infiniment petits, la nature merne de la langue et du texte massoretique obligeait a mentionner beaucoup de menus faits e). L'etudiant ne doit pas s'en effrayer. 11 fera bien de lire une premiere fois rapidement toute la grammaire, pour prendre une vue d'ensernble et comme une impression des choses. II reviendra ensuite a l'etude attentive du detail. Dans les paragraphes plus etendus, ceux des. verbes irreguliers, par exernple, les notions les plus importantes
(I) Certains de ces points nouveaux ont ete traites par nONS dans les Melanges de la Facuu« Orientale de Beyrollth eJ: dans Biblica; 110US reny voyons, a l'occasion, Ie lecteur qui voudrait avoir U11complement dinformation sur telle explication proposee. bibliographie, qui etait deja don nee assez abondante par se trouve enregistree d'une facon presque exhaustive dans la refoute de I'ouvrage par BERGSTRASSI!;R (I. Theil, 1918). (3) Bien entendu, tous les details proprement lexicologiques doivent etre cherches dans les bons dictionnaires.
KAl'TZSCH,
(2) La
AVANT-PROPOS
AVANT-PROPOS
XI
sont groupees au commencement, les details et les anomalies rejetes la fin. TOllS les details ne sont evidernment pas' retenir, surtout dans une premiere etude. L'etudiant les retrouvera en lis ant le texte biblique, ou il pourra les examiner au fur et mesure avec plus d'jnteret. La Phonetique, qui est une introduction necessaire la Morphologie. presente une difficulte pratique pour le debutant, lequel est suppose ne pas encore connaitre les formes, L'auteur, d' autre part, est expose dire dans la Phonetique des choses quil devra repeter dans lei Morphologic. Aussi avons-nous traite la Phonetique d'une facon aussi breve que possible, Pour une raison pedagogique, beaucoup d'exernples cites dans la Phonetique et laMorphologie sont ernpruntes aux paradigmes; certaines formes, meme non marquees de l'asterisque (*), peuvent done ne pas se trouver dans Ie texte biblique. Il en est de merne pour certains noms cites l'etat absolu, certains' verbes cites la 3" personne sg. rn., etc. Dans la Phonetique et dans la Morphologic nous n'avons pas traduit tous les mots cites, surtout ceux qui revenaient souvent (I). Dans quelques cas nous avons fait appel au latin pour rendre plus exactement une nuance. Nous avons cite parfois, pour comparaison, l'arabe, l'arameen et le syriaque : nous estimons, en effet, que les etudiants comprendront la necessite d'une connaissance au moins elernentaire de ces langues pour une pleine intelligence de l'hebreu. La Syntaxe, cette partie souvent si negligee de la grammaire hebraique, a recu les amples developpernents auxquels elle a droit (2). Nous avons tache d'en rendre la lecture plus aisee en dormant beaucoup d'exemples in extenso et traduits e), au lieu d'accumuler de simples references au texte biblique. Nous avons assez rarement vise donner la liste
(I) L' etude du vocabulaire doit naturellement aller de pair avec celie de la grammaire. L'etudiant pourra, par exemple, apprendre des mots groupes a divers points de vue (sens ou forme). Des quil pourra lire un texte facile, il fera bien d'apprendre quelques versets offrant un interet particulier pour les mots ou pour la syntaxe. (2) Quelques remarques de stylistique, se rattachimt etroiternent a la ' syntaxe, ont me me ete donnees a l'occasion. . (~) II est a peine besoin de faire remarquer que les traductions donnees ont un caractere strictement grammatical et visent a la litteralite, - Vers la fin de la Syntaxe, nous avons, dans une intention pedagogique, omis la vocalisation d'un petit nombre de mots qui reviennent tres souvent et que I'etudiant est cense connaitre,
complete des passages ou se rencontre un phenornene ; mais nous avons indique le degre relatif de frequence (I). Nous avons evite, d'une facon generale, de citer des exemples critiquernent douteux (2): leur discussion aurait deborde les limites de cette grammaire; elle releve plutot, d'ailleurs. du commentairephilologique. Pour la terrninologie nous avons generalement conserve les termes recus, sauf dans les cas ou ils suggerent une idee fausse. Les termes qui font partie du vocabulaire courant de la grammaire hebraique, par exemple, qai, nt/ai, pid, fuji! sont ecrits de la facon la plus simple, comme des mots francais. Nous faisons de merne pour les termes convention nels que nous employons dans la Syntaxe pour designer les temps, par exemple qatal pour le parfait, yiqtot pour le futur (cf. § tUb). Dans les Paradigrnes, qui pour la commodite de l'etudiant forment, avec les Index. un fascicule separe, on trouvera certaines innovations de caractere pedagogique. Dans les verbes, immediaternent apres le parfait nous avons mis le futur, ce second temps etant necessaire et suffisant pour definir une conjugaison. Puis vient l'imperatif, dont la voyelle caracteristique est celie du fntur. Viennent enfin les formes nominales-verbales: infinitifs et participes. Les deux infinitifs faisant souvent difficulte pour le debutant, nous avons fait preceder l'infinitif construit du ", lequel ne peut pas se trouver devant l'infinitif absolu. Dans un paradigme synoptique des verbes (Paradigme 16) on trouvera aux quatre formes qal, nifal, hifil, hofal, les verbes irreguliers qui peuvent plus facilement preter des confusions, L'impression du livre s'est faite dans des conditions par ticulierernent difficiles. Malgre Te soin donne la correction des epreuves, il est reste un certain nombre de fautes dont no us signalons, I' Errata, quelques-unes, plus facheuses pour l'etudiant, Le lecteur devra parfois compter avec quelque voyelle hebratque deplacee, tom bee ou brisee,
Je tiens exprimer ici rna vive reconnaissance au R. P. JOSEPH NEYRAND, S. j., professeur l'Institut Biblique, qui a bien voulu lire une epreuve et dont les observations si competentes m'o~t ete d'un grand profit.
(l) Un bon nombre dexemples ne se trouvent dans aucune Syntaxe , Pour certains textes, par exemple le livre de Ruth, l'abondance des citations equivaut presque a un commentaire grammatica( (2) Indiques par Ie point d'interrogation inverti ~
ABREVIATIONS G(e)n(ese), _ jos/ue), Is/ale), Jer(emie), Micl:l(ee), Nah(um), (achie); Rudl, Neh(emie), Psraumes). Lam(entations), Ex(ode), Lev/itique), N(om)b(res), D(eu)t(eronome); 2 Reois),Jon(as), Mal-
Jug(es),
1 S(amuel), Ez(echiel), Hab(acuc),
2 S(amuel), Soph(onie), Job,
1 R(ois),
Osree), Joel, Am(os), Abd(ias), C(an)t(ique
Agg'(ee), Zach(arie), D(a)n(iel),
INTRODUCTION
§ 1. Definition de la grammaire hebrafque.
La grammaire hebraique, telle qu'on l'entend generalement, et a
Pr(overbes), Eccl/esiaste),
des Cantiques), Esd(ras),
Esth(er),
1 Ch(roniques),
2 Cht roniques).
SIGNES Le point d'interrogation texte est suspect. L'asterisque
CONVENTIONNELS inverti indique que la forme ou le pas attestee
telle qu'on l'envisage traditionnel ecoles de Tiberiade signes indiquant certaines syllabique, lation.
dans ce livre, est la grammaire
au texte biblique juifs des b
dans la forme ou il a ete fixe par consonantique
les savants
vers le VII" siecle de I'ere chretienne. fut muni de nombreux la vocalisation, des consonnes, puis aussi la division consistant appeles par les et principalement
A cette epoque le texte
indique
que la forme n'est
(1) ..
d 'abord
Le signe > indique qu'une forme devient telle autre forme, par ex. § 17 b; ou qu'elle est plus frequente, par ex. Paradigme 2: Hofal. La croix N
modalites
dans la prononciation et notamment
Ie ton, la liaison des mots entre eux, les pauses, la modules signes des voyelles, du systeme en points
indique
qu'une
enumeration
est complete.
Ces signes,
. Note. des chapitres suivi I'usage et des versets de la Bible dans la Poedition de
principalement du texte Naqdanim Naqdanim lenneIle, cherche
(n~R~)'on parle souvent de la ponctuation
et les inventeurs La prononciation sont ainsi deterrninee
Pour fa numerotation hebraique exemple Iyglotte 1a Bible '(Berlin ler attribue nous avons de la Polyglotte hebraique 1910),
consonantique, (puncta/ores).
cornrnunernent
recu , celui par
STIER et THEILE (reproduite de remarquer celie de dans de l'usage qu'une
avec une minutie extreme est la prononciation musicale, en usage dans les offices religieux Cette pronor.ciation, qui com porte et une certaine em phase, a sans doute ont voulu noter que la tradition
soi-gnee, soreplus
VIGOUROUX). II est utile tres repandue, parfois s'ecarte
des synagogues une certaine details
LETTER IS (O"Vt:!V';) actuellement 1 Sam 24 recu. Dans le v. 1 est
de leur temps.
quelques fidelernent
31 le v. 1 est attribue au eli. 23.
au ch. 30;
ou moins artificiels: son ensemble. dation
mais il n'y a pas de raison de alors
1a suspecter dans
la pronon-
Les Naqdanim
de leur temps,
etait en peril, et l'on interne du systeme et la en faveur des
de la rnor-
peut croire qu'ils y ont reussi. La coherence
(1) Dans
Ie Paradigrne
4,
I'asterisque
a un autre
emploi
(,""il
1~
comparaison vocalisateurs.
avec les langues
apparentees hebraique
ternoignent et notammennt
note
p. 10*).
Le detail de la grammaire phologie et la suppose
P. joGON,
est fonde sur la vocalisation fidele,
bibl, Gramm, de I'hebreu
enregistree
par les Naqdanim
2a-d
Place de I'hebreu parmi les langues semitiques
2 e-k
§ 2. Place de l'hebreu parm, les langues semitiques (').
a
L'hebreu avant l'arrivee seulement par
est un developpement certaines (Haute gloses Egypte). egyptien, I'hebreu
de la langue parlee en Canaan langue de Canaan est connue babyloniennes d'alors, trouvees
L'hebreu a commence vent, d'apres
appartient
au groupe des langues que, depuis (cf Gn 10,21-31). geographique, (Babylonie,
1781, on
des Israelites. L'ancienne
a appeler
semitiques
Ces langues peu(terme parlee depuis
des lettres
leur repartition du nord-est
se diviser ainsi qu'il suit: Assyriej : l'akkadien langue non-semitique en akkadien
Tell el Amarna lonien,
Ces lettres, qui datent des environs le babyEll par des scribes du pays de Canaan de leur langue. ancien est representc surtout par
Groupe generique assyrien.
de 1400, sont ecrites dans la langue diplomatique au gouvernement parfois qui emploient l'inscription (cf. 2R3,4) des mots ou des formes
recent, s'opposant au sumerien, L'akkadien comprend On possede
aUSSI en Babylonie). la seconde moitie I'ere chretienne. c d Groupe L'arameen du
les dialectes babylonie1t.et environs de Syrie): l'ara-
des documents cuneiforrnes
dehors des textes bibliques,
du 3" millenaire nord-ouest
avant J.-C. jusqu'aux grande
de Siloe (vers 700). L'inscription (vers 850) est dansune legeres qui est represente particularites, par
de Mesa" roi de Moab
langue qui ne differe de I'hel'inscription du roi Klnw de Carthage I'ethiopiell. h
(Mesopotamie,
breu que par quelques Le phenicien,
meen, l' hebreu, le Phblicien.
(2), parle d'abord,
.I
semble-t-il, par des tribus du desert voisines
(IX· s.) et par des inscriptions assez nombreuses posterieures au V· s.,
est etroitement Groupe apparente meridional
syrien, se repandit Palestine.
peu
peu dans les regions
l'est et
a
de
a l'hebreu.
(Arabie,
Le dialecte punique, Abyssinie): I'arabe,
l'ouest. A I'epoque perse, il supplanta notamment la langue hebraique en Le plus ancien document ararneen connu est l'inscription Zkr, roi de I;Iama et de L<s, qui date du commencement du VIII" siecle. Les inscriptions trouvees orientaux (dans lesquels
et de ses colonies, se rattache
au phenicien. du roi Mar'ulqais peu
En arabe du nord on possede une inscription Syrie, en Babylonie les dialectes ararneens, qu'en Espagne, Les principaux sabecn, L'ethiopien et en Mesopotamia, en Egypte, dans
a Zindjirli
sont un peu posterieures (Vl I I" siecle), en de la 3" personne du futur
(32~ ap. T.-C.). Par les conquetes de l'Islam, l'arabe se repandit en
ou il supplanta I'Afrique
Les dialectes arameens est n), et occidentaux originairement ou nestorien, Talmud
des ages suivants peuvent se diviser
peu
la preforrnante
du nord,
et jus.
(qui ont
i comme l'ensemble
des langues se-
mitiques). Les principaux dialectes ararneens orientaux sont le syriaque, dialecte d'Edesse et syriaque (qui se subdivise eli syriaque oriental ou jacobite), A l'arameen le dialecte juif du occidental appartien(V" sieoccidental
dialectes
de l'arabe
du sud sont Ie minee»: et Ie d'une population qui emigra de se- j i
ou g e'ee est la langue en Abyssinie. des langues
de Babylone, le mandeen.
de I'Arabie meridionale Caracter iattquea mitiques ont certains autres . groupes en particulier certaines
Le plus ancien monument semittques, Les langues
nent le dialecte des papyrus de la colonie juive d'Elephantine de) et celui de quelques. chapitres et de Daniel (2,4-7,28); du Talmud (inscriptions de Jesusalem; d'autre d'Esdras (4,8-6,18; part le samaritain,
cette langue est"l'inscription
du roi "Ezana d' Aksum (IV' s. apres ].-C.). qui les differencient des de
7,12-26)'
puis les dialectes posterieurs des Targum et le palmyrenien
traits caracteristiques
de langues.
Parmi ces caracteristiques, -qui se trouvent en hebreu
du Ier au III" siecle apres J .-c.),' le nabateen (inscriptions
en hebreu, on peut enumerer celles-ci : 1)I'existence gutturales,
du lor siecle apres
(I) NOLDEKE,
J .-C.).
BROCKELMANN,
consonnes
"n,
'It,
Die semiiische« Sprachen 2 (1899);
Grundriss
A text(1910).
consonnes emphatiques, sature consonantique
en hebreu
t to, ~
V; 2) l'existence de
(q)
p;
3) les racines
der uerg ieichenden. Grammatik
LIDZBARSKI,
der semitischen Sprachen,
1 (1908), pp. 1·34;
COOKE,
sont pour la plupart purernent voyelles expriment
consonantiques
et trilitteres ;
4) l'os-
Handbuch der nordsemitischen Epigraphik (1898) ; book of north-semitic inscriptions (1903). (2)
Cf. J,-B. CHABOT,
du mot exprirne l'idee generale, les diverses modalites sernit ique avec d'autres
tandis que les cette idee. k
qui determinem
Les Iangues et les littiratures
arameennes
Affinite du groupe
Iangues , r;egyp-
2 k--3a
Histoire de l'hebreu biblique
s
nO\!3 permet tres peu de variations que
Histoire de l'hebreu biblique
3a-1i
tien ancien, les langues origine,
dont le copte est issu, a certains semitiques. On admet de tres qu'il bonne heure
traits
communs une
avec meme des inqui l'a avec
de constater
que
peu
DO
de variations
consonantiques
et
a avec celles-ci et soumis
vocaliques, les diverses zppartiennent,
Il est done fort probable parties
que Ie
mais que, separe modifie.
texte consonantique et il est certain quelque nagogale
a ete plus
moins uniforrnise
au cours des ages,
fluences etrangeres, profondement Plus eloignee (Bischari, Quant langues travaux apporte Saho,
i1 a subi une evolution
toute particuliere
du texte consonantique, la prononciation
a
unisy'"
siecle qu'elles
ont rec;:u une vocalisation
encore est la parente des langues semitiques modernes: langues berberes, langues semitiques (1) n'ont
forme. Les Naqdanir-i les plus recents,
du VII' siecle ont impose
les langues hamitiques
koushites avec les
de leur temps aux 'textcs les plus anciens comme aux textes pour lesquels seuls elle est substantiellement du texte consonantique uniforme imposee exacte. due aux il
<Afar, Somali). eloignee des langues
MOLLER
urie parente
En deb .irs de l'uniformisation copistes et de la vocalisation d'uniformite y a un element eux-rnemes.
indo-europeennes, recents, notamment une preuve
elle est tres problernatique, ceux de H. de parente (').
Les meilleurs pas encore
par les Naqdanim,
qui provient
de la volonte' des ecrivains si fort reflete tandis
convaincante
Si 13 .lngue des derniers
ecrits bibliques' ressemble la Mishna
a
de
celie des ecrit,
les plus anciens et differe tant, par contre, de celle s, ap. ~-C.), c'est que l'!1ebreude
§ 3. Histoire de I'hebreu biblique,
a Bien que nos siecles, la langue etonnante. elements vocabulaire d'epoque rences pares
I
de la Mishna :la langue quelque ciens. regarder la langue volution grande mative, langue langue; une uniformite les divers Le le plus les diffedes livres
Cr.'
textes bibliques
s'etendent
sur un bon nombre
parle : dans les ecoles mesure, le type
I' epoqu:.. de sa composition, ont generalement
dans laquelle ils sont ecrits presente n'affecte sont formes, syntaxe, d'ecrivain vocabulaire,
que les derniers ecrivains bibliques
voulu imiter, en des livres anl'image de l'eplus
Mais l'uniformite du langage.: et la phraseologie
pas au meme degre les elements
la fois sacre et classique soit-elle, epoque
phraseologie, qui varient
L'imitation, l'hebreu
si imparfaite biblique
nous 'emp@che de pouvoir comme
de la derniere combien
epoque,
ecrivain. quand
Les variations Cependant la syntaxe on considere Ainsi Chroniques, du texte
de syntaxe
parlee d'alors. il est difficile de connaitre apparaitra la date, encore de l'hebreu biblique. La difficulte
sont en general par
beaucoup.
moins
considerables,
De tout ceci il ressort si l'on considere de la composition hebratque deux
apparaissent un long
tres sensibles intervalle
des textes sediffere notablebiblique est le et
de temps.
que nous ignorons
meme approxiecrits ('). de la 6 et
historiques
-postexiliens,
Esdras, Nehernie, et des Rois (I). que l'uniformite la nature distinguer
ou de la redaction 'de certains done de distinguer periodes : la periode preexilienneesi s'altere, en partie
ment de celIe de Samuel C'est dans les formes plus grande. l'element stituent rapide Encore faut-il vocalique. un element
Nous nous contenterons consonantique le periode la periode postexilienne. postexilienne qui devient
dans l'histoire l'age
grandes
preexilienne
ici l'elernent
Etantdonne
merne des formes semitiet con-
La periode la langue
d'or de la
.c'est, si 1'0n peut dire, la periode de l'hebreu
classique. Dans sous l'i~f1uence le langage
parlaient les
ques, dans lesquelles riable, l'altiration
les consonnes sont com me une armature au cours
stable, tandis que les voyelles sont un ~lement vades voyelles, des siecles, a dO. @tre plus ne Or le texte qui nous est parvenu
I Teil:
de l'arameen,
de plus en plus exclusivement
que celIe des consonnes.
utld Indogennanisch,
. ~I) II serait aussi fort int~ressant de savoir queUe langue Israehtes au temps de l'Exode, ni~r p~int, on peut voir
SAUER
apres plusieurs siecles de sejour en Egypte, (His/or. Cramm,der IIelir. Spraclle, 1, p. 23)
(I) Semitiscll
Konsonanten (1997); VH"g"Iei1910, I, p. 313.
queUe langue ils parlaient au moment de leur entree ell Canaan. Sur ce derqUI opme pour I'ararnean, lequel rr'etait alors, d'apres lui, qu'un dialecte de l'arabe . Mais es raisons aUeguees ne sont pas convaincantes. 'I .
chendes ifldogenn.·setn.
Wt5rlerliuch (1911).
MEILLKT,
(2) Voir en particulier A. (3) KROl'AT, Die Syntax
dans la Ret'. critique, der CII,'oni/t (1909).
des Ausors
3c-4a ordinaire Outre des Juifs. d'Esther,
Histoire de l'hebreu bibhque
L'bebreu d'Esdras dues
postexilien
le plus altere
est celui de
(i).
du Fayyoum possedons
W
(t 942). Les principaux
grammairiens
juifs dont nous
l'Ecclesiaste,
et Nehernie,
des Chroniques de la langue
les ceuvres sont I:IAYYUG(vers 1000), ABU'L \V ALID MER-
les differences regions du sud
l'evolution
au cours dial~ctales
AN IBN GANAI;I (vers pour les eclairer
1030), IBN EZRA (t 1167), DAVID QIMJ:II
la connaissance hebraicis, de l'ararneen et de l'arabe. que remontent hebraique, chez res-
des siecles, l'hebreu dans les diverses du nord et celui Mais les elements preciser dialecte du sud.
a sans doute presente il aura
des particularites
\. vers 1235), son pere JOSEPH et son frere MOISE. Ces savants juifs t
avaient La premiere bon nombre grammaire publiee par un chretien est celle de JEAN
ou il etait parle (I). Ainsi entre le royaume existe des differences ne nous permettent d'un dialecte et grandement de langage. guere de
dont nous disposons et de parler autre ordre
REUCHLI:-I (De rudimentis des termes Le Juif ELIAS LEVITA
1506). C'est
usites
a lui
ces differences d'un
du nord et d'un importante en
techniques
en grammaire
(t 1549) contribua beaucoup, par ses ouvrages
Vne difference grammaire prose. propres, vent
et par son enseignement, les savants tent encore etroitement
repandre
la connaissance
de l'hebreu
est celle qui separe et parmi ararneen, soit par
la langue
de la poesie de celle de la qui lui sont se retroupour pour plusieurs
chretiens, JEAN BUXTORF (t 1629) et ses successeurs fideles
La poesie hebratque en
a des mots assez nombreux remarquable, pour C'N.
la doctrine
grammaticale met
des Juifs. Mais c'est et prend Sa gramtransla renvoient
'i)', n.t;l~
La poesie, souvent
ces mots, chose
Au XVIII" siecle A. SCHULTENS sance de I'arabe un aspect pour expliquer au XI~" siecle que la grammaire
(t 1750)
hebraique
profit sa connais-
p. ex. ~)N hom me recherche, longues soit
m~ chemin
metrique,
et approfondir
l'hebreu.
uenir pour Ni:ll. ~~:parole
pour ,?,:TMfIJ-voir par necessite ou archaiques.
n~.
se transforrne du mouvement. auquel
emploie =
de plus en plus scientifique.
des formes rares, anormales
Ainsi l'on trouve
W, GESENIUS
maire eut plusieurs formations, plupart
(t 1842)
editions;
fut I'initiateur
en poesie les formes
''1~ = ,~; ,'?~ = '='~
berte. syntaxe On serait
anciennes
des prepositions
"N
'='N:
lide
avec de nombreuses
et profondes
(§ 103
m); les finales '--:-'
i du nom 'C'§ 93/,;);
grande
elle devint
un livre quasi necessaire, de l'Ancien Testament. ed.) arneliorerent
les suffixes pronominaux notamment pour l'emploi meme uniquement
;0, ;0-;-, iO-;;- (§ 61 i). Pour la syntaxe,
des temps, la poesie use d'une de traiter certaines
(3). C'est
des commentateurs
E. RODIGER (14"sans relache l'ceuassez
21" ed.) et E. KAUTZSCH (22"-28" vre de GESENIUS. Les dernieres ferment restreint. complete. La doctrine Apres une masse tres considerable grammaticale clair et precis;
ernbarrasse
questions
editions donnees par KAUTZSCH rende : faits sous un volume est plutot conservatrice; du sujet est I'expose
d'apres d'esthetique
les textes poetiques ou de brievete l'article,
sans doute la
pour des raisons particule
que
la poesie emploie relative ,~, ...
-:
beau coup moins que la prose de I' accusatif l'IN .
la particule
est en general
la litterature
la mort de KAUTZSCH C'est en realite
r+
peu pres l'eeuvre nou-
1910), la 29" edition a ete transforrne entierernent
publiee par G. BERGSTRASSER, qui a profondernent
~ 4. Histoire de la grammaire
Les premiers travaux de grammaire
hebraique.
commencent au
de son predecesseur. veau, ou l'ordre c'est un livre beaucoup part bien plus large H. EWALD
un ouvrage
hebraique
merne des matieres differe notablement plus erudit, beaucoup plus critique,
de !'~~c:en; faisant une
X" siecle, sous l'influence de la grammaire
(I) L'etudiant
arabe, avec le Gaon SAeADIA
a l'histoire
du developpernent
de la langue ("). Sa grammaire (Aus-
ne devra lire ces lines qu'en dernier lieu, apres qu'i! aura acquis une connaissance suffisante de la bonne prose classique. (2) Du recit de Jug 12, 6 i! ressort que les Ephraimites pronon"aient la sifflante du mot Z'1~5=, autrement que les gens de Galaad. "." . (3) La grammaire, et en particulier la syntaxe, est fondee principalernertt sur les textes de la prose classique, specialement sur les bons textes narratifs.
(t 1875) chercha
des lois et
a expliquer
rarnener
les faits grammaticaux
celles-ci rationnellement.
(i) Cf. Biblica, 1 (1920). p. 1I1. Nous n'avons pu utiliser que Ie 1"' fascicule (Phonetique), 1918.
4c-
Histoire de la grammaire hebratque
Histoire de la grammaire hebraique
4d-.f
fu"lzrliches Lehrbuch der hebr. Sprache, encore utile, surtout pour la syntaxe.
88 [et derniere] ..
ed, 1870) est
lise on the use of the tenses in hebt'ew and some other syntactical questions (~. ed. 1892). II faut noter aussi la Stylistique de KONIG e (Stilistik, Rhetorik, Poetik, 1900), utile complement La lexicographic impo'rtants; mais il en reste encore de ses parties, allemandes de sa grammaire. Le Thesaurus
J. a
OLSHAUSEN
(t
1882) dans son Lehrbuch d'apres
der hebr. Sprache , cherche reder prirnitif, Lehrbuch (celle-ci
1861, qui ne renferme que la phonetique expliquer les formes de l'hebreu presente
et la morphologie, Ie semitique
a fait au XIX" et au XX" siecle des progres
faire beaucoup. de 1829 un tresor
generalement par l'arabe.
linguae hebraicae de W. GESENIUS (public son Ausfithrliches et la morphologie reste tres utile. 1879). La morphologie Cette du dans plusieurs beaucoup tort. peu reste encore de choses excellentes dont plusieurs du dictionnaire
1858), vieilli l'on trouve
F. BOTTCHER
hebr, Sprache, lement cornplet phologie du futur donner
t,
(t
1863)
dans
au
edite par F. MUHLAU (2 vol. 1866, 68) n'a pu egaque la phonetique et incomle plus est le repertoire
ont ete abandonnees
Les editions
de GESENIUS ont ete successifs. La derest particulierernent I'indi-
plete, cf.
2, p. VI). Tel quel, cet ouvrage
des formes,
peu profondement
rernaniees par les editeurs
ce titre
niere (168) edition donnee par F. BUHL est de 1915: W. Gesenius' hebr, und a1'tlm. Handworterbuch utile pour l'abondante cation des corrections
B. STADE
(t
1906) n'a publie aussi que la phonetique et la morder hr.br. Grammatik,
e·). Ce dictionnaire
citee, la partie Sur
(Lehrbuch
litterature
etymologique,
verbe renferme un repertoire et de I'imperatif, est commode lumes:
a peu
pres complet
des formes du parfait, disposition en trois voet verbe; : des formes.
de texte proposees,
ces points l' Oxford
classees par personnes. et la comparaison
Lexicon de BROWN, DRIVER et BRIGGS (A hebreto and en{[lish lexicon of the Old Testament, 1906) lui est inferieur. vent plus complet ticales, notamment lentes. II manque et plus soigne. les particules, malheureusement d'etre Les parties traitees par En revanche il est souspecialernent grammaexcelL'ordre a alDRIVER, sont
pour les recherches
E. KONIG a donne Lehrgebiiude t. 2 {1895) seurs;
une grammaire
tres considerable generale complet
der heiw. Sprache, t. 1 (1881) pronom morphologic plus critique. est non seulement joue II est souvent
nom et particule, de points
et phonetique
un index anglais-hebreu.
t. 3 (1-897) syntaxe. sur beapcoup c'est eminemment der Hebraische« maire historique, descriptive. derable; synthese voulu teinte d la partie
que ses predeces-
des mots par racines, de plus I'inconvenient phabetique Le dictionnaire beaucoup assidflment
parfois discutable
(cf. § 34 b) ou arbitraire, que I'ordre purement
il cite et discute les diverses opinions:
moins pratique
une grammaire
du Gesenius-Buhl. de KONIG (Hebr. mid aram. Worterbuch, 1910), que les precedents, de l'auteur. recente et aussi la (editio a l'avantage de renvoyer moins etendu
H. BAUER et P. LEANDER ont publie une Historische Grammatik Sprach« ('). Cet ouvrage comme I'indique descriptive, historique une gramle titre, mais encore une grammaire l'hypothese un l'Ole consiest riche nominale,
la Grammaire
Dans la partie
Parmi les Concordances hebrai'ques, la plus plus complete minor exempiis
l'
par ex. la formation utilisant les travaux comparee hebraique
est celle de S. MANDELKERN ( Veteris Testamenti Conabregee omissis) contient uniquement les references.
et tres soignee. Les auteurs, de grammaire elever Outre de signaler la grammaire ces travaux comme
8
de details et la grande de BROCKELMANN, ont scientifique , il convient de A. B. at-
cordantiae hebraicae atque chaldaicae, 1896). L'edition
semitique
la perfection
par la grammaire
des langues
indo-europeennes
(I) lie edition (reproduction
anastatique de la 16"), 1920.
d' ensemble de premiere ouvrage
importance,
particulierement
utiles la Hebrew Syntax
DAVIDSON (3 ed, 1912) et l'excellent
de DRIVER, A trea-
(I) Nous n'avons pu utiliser que les fascicules 1 (1918) et 2 (1919).
lU
TABLEAU COMPARATIF
DES
ALPHABETS -.
(916-7) =
II !'I
i~~=======t==========~~
M:sa~ lvers 850)
Sama~itain
=a
Papyrus d'Egypte CarreJetrogradI Rabbfnique
(S! - 3!
S.)
PREMIERE PARTIE ECRITURE ET PHONETIQUE
§ 5. Les consonnes: graphie et prononciation.
.9
Les phonemes se divisent
en consonnes et en voyelles. II faut a pas adequate; certaines
1 I
rt
T
.,
remarquer
toutefois que cette division n'est
voyelles (en hebreu i, u) peuvent devenir consonantiques hebreu), L'alphabet
Ci"!f')
('),
en b
et certaines consonnes peuvent devenir vocaliques (pas d'exemple
,
f
hebreu, comme 13.plupart des alphabets semitiques, de consonnes. Les caracteres de nos Bibles
se compose uniquement
imprimees ainsi que ceux de to us les manuscrits connus (2) ont une forme voisine du carre, d'ou le' nom 'd'ecriture carrie PlI'O :1l'l:il. Cette
'f:,: 1':
rt tJ
,
~
ecriture, qui s'est formee du IV· au II· siecle avo J.-C. environ, est
Ji
otJ
,,
)
:1
Ji
I
un developpement de I'ecriture arameenne,
adoptee peu
peu par les
Juifs, en meme temps que la langue arameenne (§ 3 b) apres le retour de la captivite de Babylone. Cette nouvelle ecriture de l'inscription remplaca l'ecriture ancienne, dite ecriture Izebrai"que (',:1P :1l'l:il), celle, par exemple, 0:. 1': de Siloe et de la stele de Mesae (§ 2 e) (3). L'ecriture ancienne continua L'ecriture
I
a etre
employee, maisn?tablement ou ecriture
modifiee, par les
JT
Samaritains apres leur separation des Juifs (fin du IV· siecle avo J .-c.). rabbinique de Raslzi est une modification dans les Bibles rabbic de l'ecriture carree, On I'emploie niques pour les commentaires l'introduction notamment
n..
!)~
1 w x
'f
Yr
r i
VI
imprirnes dans les marges. du ~).
Les lettres de I'alphabet hebreu S01lt au nombre de 22 (23 apres du point diacritique
(t) Voir aussi ~ 21 c (patah furtif), (2) Le plus ancien manuscrit date est Ie codex des Prophetes de Petrogr",~
(916-7).
Le papyrus
Nash, trouve en 1902, qui contient de I'an 100 ap. ].,C. et par consequent pretent
Ex 20, 2-17
(Dt':calogue) et Dt 6,4, date probablernent (3) Les lettres qui se ressemblent ne sont pas les memes dans
:n
confusion nouvelle. du texte.
l'ecriture ancienne
et dans l'ecriture
II faut tenir compte de ce fait pour cornprendre certaines alterations Voir le tableau comparatif des alphabets, p. 10..
5c
Consonnes
12
13
Consonnes
5d-h d
Lettres
Valeur ' numerique
I
~O:\1
Tram.
-------i 1 I l't :2
3
i
cripHOI
i
PRONONCIATION
DESCRIPTION
PHONETIQUE
elles sont
finales.
Cinq lettres ont 'line forme particuliere quand
la fin d'un mot. Ces cinq lettres sont renfermees
le mot mnemonique Opposez :l et premier
"alef beth b:
. hamze ~'b' lara \ de
I
e Oil .) gutturale sour de labiale sonore explosive
--;
1;
r~~~~ k9-m'n9Pf'f~
0, ~ et f'
I:)et
dans
« comme celui
t3 et
9, X et
r.
qui brise », le
Dans, la forme finale
'du mem le dernier trait est ramene en haut de facon trait et
i:ll
b francais (§ 0)
5! .
~ ghimel
!
'a,
bk g
I <,
francais
(3.0)
labiale sonore spirante palatale sonore explosive
0)
a _rejoindre
former ainsi une figure ferrnee.
Pour les quatre
g dur francais (§ 0)
y grec moderne
autres lettres, au contraire, Lettres dilatables.
dans la forme finale le dernier trait, .au s'ecrit de droite
4\i
.l
g, gk
daleth d (/, dh
k
(§
palatale sonore spirante dentale sonore explosive dentale sonore spirante gutturale sourde consonne vocalique labiale sifflante sonore gutturale sourde dentale velaire sourde explos. consonne vocalique palatale palatale sourde explosive palatale sourde spirante linguale sonore labiale s<?nore (et nasale) nasale sonore sifflante sourde gutturale sonore labiale sourde explosive labiale sourde spirante sifflante velaire sourde velaire sourde explosive
lieu d'etre inflechi vers la gauche, est prolonge vers le bas. L'hebreu
d francais
-
(§ 0)
,
gauche. A la e ~, 1::1,
b grec moderne (§ 0)
k angiais, all., , (§))
fin d'une:::--ligne,on ne coupe pas un mot. Pour eviter les blancs on augmente. la largeui de certaines lettres, Valeur
savoir M, ~,
n'.
f
waw zayin /.teth {eth z /.t t
w anglais (§ 7 d) z francais, j
numerique. 1-9 900 s'exprime
=
par
l't-tO;
P-l"I;
500 s'exprime par 400
10
20
:ll
yod
kaf lamed mem nun :l
t. y
k ~,kh I m s
(§ k) ~ (§ i)
C
600-800; 500-900 800
. etre
400
+ 100 . j'l"I; semblablement pour + 400 + 100 = Pl"Il"I. (Pour'
C, 700 Le nombre 15 devrait
10-90
,-X; 100-400
on se sert aussi des lettres finales: 500'1,60n
y francais (§ 7 d)
k francais I francais m francais n francais s francais (§ m) (§ 0) X grec moderne (§ 0)
9'
il'.
900
r)·
f,
Pour les milliers on se sert des lettres
des unites' abrege, on
surrnontees
de deux points, p. ex
it = 1000. -
Com me ce groupe represente le nom divin
exprime 15 {Jar 9
+ 6 = ,ro. De meme}ti
p. ex.
'I:)
mil'
devrait etre ". Comme
30 " 40 t3 50 j
70 V
ce groupe represente Ie nom divin dans les noms propres (p. ex.
N'aa
«Jehovah Abreviatione
(est) pere », on exprime 16 par 9
+7 =
::l~i'
ttO.
60 0 samekh
"avin
("). Comme signe 'd'abreviation on emploie un trait g
80
e e
t (§ k~
oblique (ou deux),
= ,~~ p'{~ni
=
et
« un tel », ~,
= '~i.l:.
pe
sad«
P ;P francais (§ 0) p, ph' f francais (§ 0)
u'gf/1u!r
« et ce qui complete
caetera»,
,"t:M Rashi (Rabbi
'!eat'im, kelugim.
sel{Jm(l Yii/.taqi),
1"jl"l = C'~~Mf '~~~ il1ir-l t~ra(h), C
90 X 100
200
,~
P
,
~
q
r
qof resh Sin sin taw
m) , .. (~ i) ! r italien, arabe
1..:1' (~
« Loi - Prophetes - Ecrits » (= la Bible hebraique), On ecrit p. ex.: uerbes f"I:), a savoir verbes dont la premiere radicale (representee par le
1:),
I. '"
;:) /
(§ n)' (§
m)
linguale sCIPore sifflante sourde sifflante sourde dentale. sourde explosive dentale sourde spirante
premiereiradicale Division des
du verbe '='VI:)) st un nun e); cf. § 40 c. e Les consonnes peuvent se grouper
h
300 \ .
(?) (§ m)
consonnes.
I'D
s
t
ch franc., sIt angl.
commodement de la facon suivante: Labiales : Dentales :
400 r-I
t francais (§ 0)
{t
::l,:t3, M
I:) (Mot mnemonique.
9~~:ll bum9-.f)
n!
1, th
grec moderne (§~)
to (velaire)
des abreviations
(1901).
1/.
(i) Voir
D~LMAN,
surtout
Ie dictionnaire
de
HANDLER,
dans
Aramaisch-neuheoraisches
Wilr/erou(h
(2) Prononcer u italien (= 011 francais) la voyelle sernitique transcrite par
5k-k
Consonnes
14
15
Consonnes
51<-1
Palataies : Velaires : Gutturales : Siffiantes: Linguales : Nasales: Velaires
I l"l, s 0, k ~.
:I ~
ro
at ", ~
(dentale),
It (sifflante), 11.
probable qu'autrefois tantot celle de lJ. Mais nim, si attentifs de les indiquer. rafe
le n a eu, selon les mots, tan tot la valeur de ll,
i1
l'epoque des Naqdanim le n representait unieu deux valeurs, les Naqda-
quement .le son ft. Si Ie signe n avait
t0
~
It (velaire), 'It' Ttf
noter les moindres nuances, comme par exemple des begadkifat du son lJ
la double prononciation Les trois consonnes
(§
0), n'auraient
pas neglige Le ,{:,
ou emphatiques. Elles
t ro, ~ It,
P (1)
L'existence
I'epoque ou existait le kaf
VOISIDS.
5 ,{:est- tres
improbable, les deux sons etant trop
sont dites emphatiques
par rapport aux trois consonnes correspondantes sont emises dans une region plus en arriere celles des
en effet, est la palatale spirante moderne XciQLC; ou dans l'allernand opposition tdUI"I','!;t (cf. prononcer pugne
sourde qu'on a p. ex. dans Ie grec nacb en prononciation correcte (par p. ex. dans n~~:o p~ exT.
(voile du palais) et avec une tension plus energique des o~ganes. Leurs valeurs, sans analogues emphatiques
j
celie des Suisses). Le detail de la vocalisation suppose «egorge}); ainsi encore le patate auxiliaire,
dans nos langues, sont exactement at (quand il est prononce) par l'occlusion instantanee C~~~ i~'-s'fm
(2)
le son !t et exclut le son lJ; ainsi le pata!;t furtif,
correspondantes L'alif
de l'arabe 1:., J, ",. Pour It voir' § m, est une guttubrusquement ce son il faut interrompre
&)
Gutturales.
dans Ie type ~Ij~
rale sourde. Pour produire I'emission de Ia voyelle
* sdl'}lJt< il
sdlt/!;t'ft< « tu (fern.) as envoye » (§ 70 f), car pour n'y aurait pas plus besoin de voyelle auxiliaire
de la glotte
ca).
que pour prononcer absolument
comrne
t;'I~~..,,~
analogue
''}I Irst< « ne bois pas ».
L'heureu
re-
C'est le son qu'on entend parfois dans le mot allemand ja' prononce avec sentiment (au lieu deja). Exemple: }ilar Ie signe ' (esprit doux du grec). Le he i1 est la gutturale k Le l.zelh nest Par comparaison un energique sourde qu'on a dans l'anglais sourde qui n'existe et allemand hand. Ce son n'existe pas en francais, une gutturale avec le
. langues. C'est exactement.Ie son du
au redoublernent
du son ,{: (5); il en serait de
«il se rendra ou non,
merne pour Ie son
8. Or le n, tout en rejetant le redoufaible); sonore il Ie prend merne parfois
coupable ». On transcrit conventionnellement
le N, prononce
blement reel, spontanement
toutes Ies gutturales, admet volontiers le redou-
blement virtuel (ou redoublement Le "ayin Vest dans ~ ~""" j}fu!tammad. pas dans nos une gutturale
(§§ 20 a, c) (I). Done Ie n suppose le son !;t.
qui n'existe pas dans nos ·1 eain « ceil ».
Iangues. C'est exactement .Ie son du t e arabe, dans ~ On a compare ce son charge de son bat comparaison
»
n,
c l.z arabe,
\J
« I'articulation
gutturale du chameau que l'on arabe, p. 139)
on peut dire que c'est un i1 emis avec
(HUART,
Litterature
C).
Par
Ia
resserrement
du larynx. des langues
bn l'a decrit assez exactement
on voit que le signe differents,
'.
des Iangues on voit que Ie signe P correspond
deux c'est so-
comme un siffiement pond
guttural
(GISMONLU).
Par la comparaison
sons semitiques notablement differents, representes en arabe corresen tres
par teet
tfh.
Cette derniere con sonne est une velaire spirante sonore;
deux sons semitiques notablement
representee
Ia spirante correspondant nore correspond ant Ie
un I{ velaire (ce·1{ etant lui-memeIa
arabe par
c lz
et
C G.
Le 1J est la velaire spirante sourde qu'on entend
la sourde q
P).
Il est .tres probable 'qu'autrefois
dans la bouche des Suisses prononcant p. ex. I'allemand nach, nest
Va
eu, seion les mots, tantot la valeur de t ., 'tantot celle de l'epoque des Naqdanim le p representait uniquement
Mais
(I) Le
t~h.
le son e.
i'
se transcrit soit parle dans l'hebreu
caractere q qui en provieat que nous connaissons,
graphique. (I) MeTe dans des cas QU.Ie M repond a un ~ primitif, p. ex. dans Q''1l! (rires (cf .. , 'ak'. . C ~I 1. f. (l) L'onornatopee e) t' u'u' imite Ie bruit du vomissement; cf. WRIGHTGOE)K, Arabic Grammar 3 1. p.295.
ment, soit par ~ (avec un point en bas comme Ies autres velaires). . (2) Pratiquement,
It n'est prononce
qu'apres une voyelle breve,
savoir quand il ferme la syl!abe;
cf. ~ 24 /).
(3) La glotte est la fente qui separe les cordes vocales.
5 i-
11
Consonnes
16
11
Consonnes:
begadkefat
Si Ie signe V avait eu deux valeurs, les Naqdanim, si attentifs Ies moindres nuances, n'auraient tence du palatale son
a noter
L'exis-
espagnol (,).
11 faut absolument
eviter
de prononcer
, comme
la
t q-h
pas neglige de les- indiquer. ou existait Ie ghimel rafe)
fricative gutturale
du francais moderne qu'on entend dans une grande n'autorise pas
l'epoque
g est tres
partie de la France, surtout dans les villes, Le fait que Ie , est traite en partie com me les gutturales une gutturale (cf. § 23). Les monique begadkefat. Les six consonnes renfermees dans Ie mot.mneune double prononciation: explosive, spirante.
0
improbable,
les deux sons etant trop .voisins. Le suppose Ie son
g, en effet, est la
le regarder
comme
spirante sonore qu'on a p. ex. dans le grec moderne yciAa.
e
Le detail de la vocalisation ainsi le patal}. furtif,
et exclut Ie son
p. ex. dans Jr-lt3~
core le patal). auxiliaire dans le ty~e (esprit rude du grec).
In
samu1e « entendu ~p~~ samt/e'lt' «
t !fit:
». ainsi entu ' (fern.) as
e
n~~~~ont
Explosives, elles ont la valeur des consonnes cor.respondantes du francais b, g (dur), d, k, p, t. Pour indiquer le son explosif on met dans l'interieur spirant, de la lettre un point nomrne dagesh (I). Spirantes, ou continus correspondants. Pour indiquer
nomrne
entendu » (§ 70 f). On transcrit conventionnellement Siffiantes. correspondant 2) si :It Le :It fest
le 17par le signe
elles ont le son de
une siffiante sourde velaire, l'emphatique
les sons spirants
a
=
0 s (§ m). On Ie prononce souvent, mais
Cette prononciation
is
+ s, un mot
est
a rejeter,
tort, ts.
on met sur la lettre un trait horizontal
rafe (I); ainsi
'car:
1) Ie son 'Is n'est pas semitique ; commencer, en fait, par deux Ie
font les manuscrits. dagesJz suffit
Mais dans les editions de la Bible, l'absence que la consonne est rafe.
pourrait
indiquer
Le sons spirants
consonnes, ce qui repugne au sernitique ; 3) on evite precisement groupe is: ainsi *kit~addfq Le ~ est actuellement
oS qu'on
sont les suivants:
devient par metathese prononce s comme
p:r~~i}(§
17 g).
0 (I); par to us les
5 ~, bh, 5 g, gh,
; g,
comme ~ grec moderne,
peu pres u francais.
comme y grec mod. dans yciAa (cf. § 1).
Juifs, et depuis line epoque immernoriale son intermediaire Portugais). breu;
e). Le
~ est la chuintante
dh, comme
grec mod. (th doux anglais).
a dans fro chou, ang!. shoe, all. Schuh. Entre s et II est possible qu'un son intermediaire
s il y
a un
(p. ex. J des Polonais, s des Espagnols, s final des ait existe en hece probableque le signe ~ veuille exprimer Ie, signe ~ exprimait
5 !!., D ft,
fl·
kh, comme X grec mod. dans ph, /. . comme <p grec mod.
xUQi.c; (cf. § k).
francais. exacte de la spiration p
=f
1, th, comme {}'grec mod. (th dur anglais). exige la prononciation regles concernant
mais il est fort douteux
La lecture correcte de l'hebreu ces 'six spirantes. Sur le dagesh
son. A I'epoque de son introduction ment 'so ~ -un ancien
serait une graphie etymologique
employee dans le cas ou mots bibliques
cf. § 10. Sur les
(ou un ancien J) etait devenu s. Plusieurs une fois l~~; ordinairement Thesaurus, par O.
des begadkefat rend spirante
cf. § 19; contentons-nous la begadkefat qui suit.
ici de donner Ia loi generale :
se trouvent recrits tantot avec 0, tan tot avec ~, p. ex. on a presque toujours l~O retrograder, 3 f.
n
Tout element vocalique, si rninime soit-il (p, ex. un shewa prononce),
ovi
irritation
~p~ (Cf.
Linguales,
GESENIUS,
sub 0). Dans l'hebre~ ~stbibliqu;
(I) Cf. Melanges de fa FacuiM orientale
(2)
le ~ est souvent supplante ou plusieurs vibrations
de Beyrouth, t. 51,(1911) p.383-8.
KAHLE,
Le , est une linguale, comme ". 11 consiste en une de la langue, comme le ) arabe, l'r italieri,
,,~"!dg~s, participe d
arameen, c percant .., d'apres
c dur
It.
dans
BAUER-
LEANDER,
1, 119. La con sonne explosive (ou instantanee)
est aussi appelee : est
par les anciens daresh ou encore M~
(I) 'Ainsi
~'~if;:rii
(S) '~; rdP~(Y), participe arameen, a ar; prudemment et
« relache ... La consonne spirante
~.~I?o! it
.
agi follement
(~54 d) Ie son
aussi appelee par les anciens rafe ou encore
'n
« mou
It.
se prononcent de la merne facon : hiskU. (2) Les unique
s.
Samaritains ont Ie signe unique
1:', auquel il donnent
P, JOCON, Gram~. de l'pebreu bibl.
6a-b
Voyelles: timbre
18
19
, 'V oyeltes ; timbre
En repartissant
ces
sept
timbres
en
trois classes,
d'apres
les
§ 6. Les voyeUes: graphie et prononciation.
a Les voyelles timbre. quantiti, a savoir se differencient par le temps essentiellement employe ales entre elles par Ie Le timbre dispour.
trois voyelles primitives suivant:
du semitique,
on a le groupement
phonetique
Deux voyelles
ayant le meme tim bre peuvent
differer par Ia
prononcer.
1· CLASSE a: 9· 2" CLASSE i: i, ~,
Ces sept timbres tions anciennes, l'hebreu
~.
par la tradition, les descripc
3· CLASSE u : u, p, p. nous sont connus la comparaison des Iangues. Ils ont leurs correspon-
(ou qua/iti) et la quantiti des voyelles doiventetre tingues, Nous examinerons L'echelle chacun, naturelle d'abord le timbre des principaux timbres,
rigoureusement en distinguant
des voyelles hebraiques. est la suivante:
dants exacts dans plusieurs un seul a (ouvert), fermees,
langues, vir ex. en italien qui a, comme mais deux e et deux 0;, et en francais mola distinction des voyelles ouvertes et
une nuance fermee et une nuance ouuerte,
~------------------.4'----------------~~.K~·~~~ i ~ f 9 II P p it u
Les voyelles en retrait, ouverte i et u sont les plus fermees (i avec la fermeture en avant) et la voyelle a est la plus primitif, com me on l'admet gei, a) u, les trois ou elles ont ete sept timbres, de-
derne qui a pousse a I'extreme des voyelles d'oreille La notation graphique des Naqdanim
de sept timbres et de la perfection
est un indice de la finesse de leur systerne (f"). On existant vers
e).
u (') avec la fermeture
peut croire que ce systeme renferme toutes les voyelles vocalique du semitique comportait des seulement le VIle siecle, de la quantite I'epoque represente tres
L'echelle neralement, L'echelle signa;
Tiberiade. des timbres: primitif, il ne tient pas compte p. ex. des voyelles. Ainsi _:_ (ecrit sou vent ;)
les trois voyelles
Ce systerne exprime seulement ni de l'origine souvent un a long
seules que note la vocalisation voyelles notees par les Naqdanirn
de I'arabe,
hebralques, de Tiberiade,
t6
non (du prip. ex. sdl~m
comportait
mitif Iii). Ainsi -;- represente bref prirnitif, p. ex. '(ltd{!)
sou vent un a bref primitif,
par les signes suivants:
ci~ paix (de *salam). Ainsi encore ~ represente assez souvent un a
b><~*--------------+·--------------*M~
i ~ ~ 9
,rnt
T ":,
un (pour
*·a.~ad), hlarim ~
c,.,vn
villes (pour *haCartm), ip;f!irm La prononciation des deux aucune difficulte.
c~"r, uotre
• T I·."
les d
main (pour *iadk(11z). i, -;- u n'offre
voyelles extremes
Ifireq
segot
Dans cette echelle
(I)
1'9 est la voyelle centrale.
(= ou francais),
La voyelle -::-- ~ est un e ferme, comme teration raisin (par. ouverture). Ainsi Ie primitif
dans le fro p'rl, bll, desir, degre c{nag d'al-
l'ital. nero. Ce son est voisin de i, dont il est le premier La transcription u represente la voyelle u de l'italien
non l'u francais.
(2) Par necessite typographique on emploie ici i,
u pour
la nuance fermee,
e).
* cinab
devient
:1)%'
TOO
La difference entre les deux nuances de i et . de u est beaucoup moins sensible que dans les autres voyelles a, e, o.
pour la nuance ouverte. (3) Le 1;101em, eule voyelle au-dessus de la lettre, s'omet, par economie, s quand il devrait etre tout proche du point diacritique du ftI et du Itt. Ainsi on ecrit prend ou
t,
La voyelle
=;
f est un e ouvert,
comme
dans le fro entre
pres,
regIe,
terrain, miel, I'ital. mifle. Ce son est intermediaire
=z: et -:-- ; pho-
(I) Le systerne de Tiberiade .mite problablement celui des Syriens orientaux qui cornprend aussi sept voyelles, tandis que celai des Syriens occidentau x n'en comprend que cinq. Cf. dico, sfno,capfllo
BERGSTRASSER, ~
nrc
11I9Sf(k)
«Moise ~ (non nrb), ftt 11"$9' «porter ». - Un at quiescent e tete », (mais cet usage n'est pas toujours observe).
droite le hclem de la consonne precedente : ftlah rif')s
« peches de»
mrr
9 c.
:nah!i!:l
(2) Comparer 1'!1italien provenant
de i latin, p. ex. dans vfrgine, vrnderive de cappa).
(') La voyelle u, quand eJle est longue, s'ecrit souvent • (skure'l).
(capillus .. opposer cappfllo
Voyelles:
timbre
20
21
Voyelles: quantite
6d-f
netiquement dans ,~
il appartient
Iii c1asse
1. Au point de vue de la pro-
La voyelle -
9 est un
ferrne, comme dans Ie fro dos, rose,
nonciation, il n'y a aucune difference entre le -;:- provenant de a, p.ex. b~ fils (de t~). crire etymologiquement
l'ita!' croce. Ce son est voisin de u, dont il est Ie premier degre d'alteration (par ouverture). Ainsi le primitif *kul devient k9("~ « tout» ("). On voit que dans le systerne vocalique de Tiberiade ~ 9, et les voyelles ouvertes f p. De la quantite le temps employe guer en hebreu des voyelles. la prononeer. La quantite d'une voyelle est e les voyelles extremes ferrnees i, u sont symetriquss, et de me me les voyelles fermees
r~
'4luid = ',luid et le --;- provenant de i ou {, p. ex. dans
r~,
Quand
4.
u provient
d'un a, le -;:- peut se trans-
La voyelle -:-- ~ est un a ouvert, voisin de la voyelle -;:- " avec laquelle il alteme frequemment ('). La voyelle -;- p est un
0
ouvert, comme dans le fro sort, pomme, all «tous»_
En dehors de la -pause (§ 32) ou
bonne, I'ita~. bupna, l'angl. dpll « poupee » (comp. p.ex.
toutes les voyelles recoivent un allongement secondaire, il faut distinquatre degres quantitatifs
avec un son d assez voisin). La voyelle -;- provient soit d'un u bref prim itif, soit d'un a' bref primitif. Quand elle provient d'un a on peut I'ecrire (conventionnellement) mologiquement) par timbre, (f se confond avec le detail, cf. §J).
(lJ Dans la prononciation
C:).
Vne voyelle peut etre
longue, moyenne (ou semi-longue), respeetives qui pourraient
breve, Ires breve, avec des durees Les voyelles longues
;;- avec meteg (§ 14), et la transcrire (etyau point de vue du
etre exprimees par deux temps, un temps
d. Mais phonetiquemenr,
et quart, un temps, un quart de temps (8). vent ecrit
p dans la tradition de Tiberiade (I). (Pour
babylonienne le 9 est devenu
sont souvent ecrites en ajoutant , ou , (mater lectionis); ainsi i est sou-
'--:-,? souvent ecrit i, it souverrt ecrit ~ ; d. § 7 c. Les voyelles
ecrites sans mater lectionis (').
a (= f);
fl.
cf. BAUER I'altera-
moyennes et breves sont generalement
1, p. 100. Nous verrons (~i) que dans la prononciation
de Tiberiade,
(=
tion a porte au contraire sur 1'!l ferrne, qui est devenu d des deux phenomenes est remarquable.
(I) Si 1'0n veut s'en tenir a la tradition
La symetrie
Les voyelles tres breves sont surtout les trois /late/: !tale! pata./.t --:;-(~), /.tate! segol ~ (1), /.tatef qames -;;- (V) (§ 9). Dans l'indication de la quantite, on peut, pour simplifier, se contenter d'indiquer
V.
les dans
de Tiberiade
il faut prononcer
tous les -;- avec Ie meme un a (et pratiquement
timbre
(mais avec une quantile variable suivant le 1<""' provenant d'un a primitif, comme L'origine de cette prononciation probablement de ne ou un souci pedagogique, babyloen deux que la
longues, p. ex.
?, et les tres breves, p. ex.
les cas). Beaucoup de Juifs prononcent comme le peut guere e~re une preoccupation
Les voyel1es, relativement les 3 classes phonetiques,
CLASSE
-=- 9)'
a la quanpte,
a'
peuvent se repartir
comme il suit:
CLASSE ,CLASSE U
etymologique
C'est un element d'une prononciation nienne, dans timbres plusieurs la prononciation recents.
non tiberienne, de 'I'iberiade,
de Tiberiade,
La distinction
Longues Moyennes Breves Tres breves
,-_
~, i (de ii), - ,T (de a)
"
(de ii, rar")
et a, contraire grammairiens
au systeme
est declaree 'fausse par
Deja Ibn Ezra (t 1167) reconnaissait question
- , -;- (de u)
"
prononciation Grammatiker,
du I<"" comme a est vicieuse. (Cf. BACHER; Ahr. 11m Ezra als 1892). Voir sur cette J. DERENBOUJlGdans Journal
.•:
1'1' italien provenant de u latin, p. ex. dans mplli, mog iie, cotto (de cultus; distingue opposer
asiatique, 6" serie, 13.(1869) p. 513 sq.; BERGSTltASSER, to a; BAUER,1, p. 100. ~ Pent-on esperer que la prononciation scientifique finira par l'emporter, chez les chretiens, tage pedagogique sur la prononciation C'est douteux, en particulier parce que la double prononciation vient d'un u ou d'un a. netiquemenr des transcriptions du -
(I) Comparer
du moins, a l 'avansi le _ pho-
sppra, vpllo ide vultus; cpllo de cog tierev.
opposer vpllo de volgere),
fautive devenue comme traditionnelle ?
(2) DAR~ESTETER,dans son Dictionnaire (3) On pourrait
giniral,
trois quanbreve.
d'obliger Ie debutant a reconnaitre immediatenie~t Dans cette grammaire nous transcrivons simplement a pour
tites dans les voyelles du francais modeene : longue, moyenne, exprimer symboliquement _ .:::
v ::;.
les quatre degres quantitatifs
par p, etymologiquemenr nous ecrivons
par p ou d selon les cas. En ~ehors d, selon l'usage qamef, ~f, au lieu de qdm~f,
de l'hebreu
(4)
par les symboles
p. ex. dans les termes de grammaire
¥l~i
recu;
lei nous employons la mater leclionis pour indiquer .la longue et nous pour indiquer la moyenne ou la breve.
I'omettons
6/-g
Voyelles:. q uan ti te
22
23
Voyelles: quantite
6g-i
On voit, par ce tableau, que dans la classe a l'hebreu n'a plus de voyelle 10n~"Ueni de voyelle moyenne: nairement elles ont passe, par alteration syrnetrique, dans la classe u. L'ii primitif long est devenu ordi-
D'autre part, les voyelles (moyennes) -;;-,
--=- , _:_
n'ont 'nullement
la duree des longues. Autrement it faudrait admettre qu'un tres grand nornbre de breves primitives seraient devenues des longues en hebreu, et seulement en hebreu. Ainsi, tandis qu'on a des voyelles breves dans arabe
if i, rarement 9 Cd) --;
I'
de merne l'a primitif bref est devenu
(en certaines positions) p (d) ~- (cf. ~ i). !y ,On voit aussi qu'une me me voyelle peut avoir plusieurs quantites. Ainsi i, 9,
u:
oi>
.".,
gaqan « barhe », syr. ~,
d'qan, akkad. ziqnu, on aurait deux egalement qu 'une
tongues dans heb,
fi?t
zdqtin. II est invraisemblable
long, bref. bref, tres bref.
voyeile qui est breve, par. exemple, en syllabe fermee devienne une vraie longue par Ie seul fait que la syllabe devient ouverte. Si l'on essaie de donner aux trois- voyelles moyennes la duree des longues on obtient une prononciation d'une lenteur invraisemblable et absoles volument impossible en pratique. Le fait que les voyelles moyennes n'ont pas sur une voyelle precedente primitive i, u l'effet qu'ont Iongue fait tomber un i primitif: yelles longues montre qu'elles ne sont pas Iongues, Ainsi une voyelle
r:
f': long (rar"), moyen, bref, tres bref. ~: long, moyen.
f: moyen.
La quantite notablement. g considerable. proviennent
indiquee dans Ie tableau est la quantite normale, Le legerement la duree, et la pause l'augmente ici les cas moins ordinaires). les longues et les moyennes est
ton (ou accent) augmente La difference
(Nous negligeons
de duree entre
*einab > !l?~ « raisin
MANN,
*~iriir > .,;''It « sac»; :
».
De meme *rultiib>
Au contraire la difference de duree entre les moyennes
Grundriss
1. p. 351), mais ·sucar
0,
> .,~~ horrible» ,«
!li"'1 « place
au contraire ,
» (BROCKEL-
(cf. § 30 d).
et les breves est legere
e).
La raison est que les longues hebraiques tandis -:-, que les moyennes et les '-:-, de la
REMARQUES.
1. La distinction de cinq voyelles longues ii,
e, l,
0, it,
de longues primitives,
et de ',cinq voyelles breves a, e, i,
u, introduite par Joseph Qimhi Elle a peut-etre
it
breves proviennent de breves primitives; i bref prirnitif devient normalement
z prirnitif devient --=-, -:;- selon la nature
ainsi
». . , ..
(XII· siecle) et generalement
recue jusqu'a nos jours, est une defor-
mation violente du systerne vocalique de Tiberiade. ou encore par l'arabe (qui distingue trois longues ii, i, a, i, u).
syllabe (I), p. ex. '"')f;lE? siPrl, de siprz « mon livre »,
« raisin »,
'l?71)
!l)~ ernM, de cinab
plus
ete suggeree par Ie dialecte roman parle par J. Qimhi, ou par Ie latin, et trois breves
ltflql, de !tilqz « rna' part
Le voyelles C moyennes) -;;- d, longues que les voyelles (breves) Cela ressort notamment legere. Ainsi (§ 92)
--=-
f, _:_ ~ sont normalement
correspondantes
-:- 9, -:;- f, -;- p.
2. Les questions relatives au timbre et 'Ii la quantite des voyelles de Tiberiade n'ont guere ete etudiees que depuis la fin du XIX· siecle. Voir en particulier H. Du timbre rapport
GRIMME,
du fait que les moyennes deviennent breves une vocalisation plus construit « siecle » devient'
dans des formes qui, de leur nature, demandent
Akzent und Vokallehre (1896), pp. 32 sqq. des voyelles hebratques par i
ou
C?;~ <9Idm'
la forme doit etre plus legere
» (etat
c'tl~ <919m a l'etat
et de la quantite primitives.
cause de la diminution ou en liaison etroite
aux voyeUes
(indiquee par le .rnaqqef § 13 c) -C~,
. ?
"l
de la perte du ton. De merne C~ « nom » (etat absolu et construit),
On admet que le sernitique primitif avait trois voyelles longues
« tout
absolu et construit)
deviennent ,
ii, i, U et trois voyelles breves a, i, u, En considerant
son ferme par rapport
le sort de
-":;'.
T
ces voyelles en hebreu, il semble que les voyelles longues avaient un aux ~oyenes breves correspondantes. ordinaires Le tableau suivant montre les principaux changements
(I) II est done peu utile de la noter graphiquement. cas la nature de la syllabe
rnoyenne ; cf. ~ 28.
Dans la plupart des ou
des voyelles sernitiques en voyelles hebrarques dans les diverses especes de syllabes (ouverte, fermee ; tonique, atone):
indique
c1airement si la voyelle est breve
(!) Sur la syllabe voir
** 27, 28.
6i-j CLASSE
Voyelles primitives et voyelles hebralques
CLASSE
24
U
25
Voyelles prlmlUves et voyeues neoraiques
Yay. ,IIIIIIIYes/ V.y. beiralques! Ea syllalJl
.Y
I
'/i
ouv.
,ouv,
l~f.rc
{l~(d)=P
Ii+---f -;-
CI.ASSE
~1I
du signe primitif 9- et pC)· Quant
OUV.
-:- compose du trait du patah et du point du holem. le son p.intermediaire entre
Ce symbole exprime assez heureusernent
pM'" ;t
fer.at,
i
ouv.
OUV.
son origine, la voyelle -;- provient tantot d'une voyelle ce dernier cas on peut l'ecrire
fer. at.
term. ferrnee
I'
I toniq.
fermee
ferrnee toniq
ouv ter.at. ferrnee toniq
primitive u, et alors elle est br~ve, tantot d'une voyelle primitive a. et alors elle est moyenne (I). Dans conventionnellement - pour indiquer qu'elle est moyenne, et la trans'T crire d pour indiquer qu'elle provient d'un a primitif, Le signe --;- exprime un timbre unique p. rnalgre sa double origine, -exacternent ,comme le signe ~, malgre sa double origine, que le systerne distinguer
0
fer. ton.
fer. ton.
fer, ton.
Il ressort de ce tableau que les longues gues en hebreu ; quant aux breves (en syllabe fermee), ou elles deviennent breves
primitives
restent lon-
primitives, ou elles res tent breves moyennes (en syll. ferrnee hebraren hebreu Les voyelles moyennes primitives devenues i,
exprime graphique
le timbre
unique
tonique [sou vent] et en syll. ouverte). ques sont done des voyelles Quant au timbre, servees en hebreu,
<, «
f'. II est invraisernbable et deux deux Naqdanim nomenes
de Tiberiade, qui
pousse la precision jusqu'a voyelles telles q\1e
deux nuances .de la voyelle e d'accuser les
un peu plus longues que les breves soit primitives, les voyelles tongues primitives p. ex. *iadin ~~ -« tuant»,
soit hebraiques.
nuances de la voyelle o. ait exprime par un signe unique et a. II semble temeraire montrent
l'fplnnd.
> f'!~ il jugera «
sont con-
il se levera paix
»,
»,
Mais Ii est devenu generalement
*qiitil>
9, p. ex. *saliim > ci'~ rarement d, p, ex, *kitiib> :ll/f
primitives a, i,
U
», ~iaqum
> C~p~
d'erreur phonetiques
sur un point aussi important. de detail
Plusieurs phereelle-
que le d sonnait
.ment p dans la bouche des Naqdanim. euphonique
Ainsi, dans le cas du dagesh le premier d en cette po..
« un ecrit » (mot aramai'sant).
Les voyelles breves
se maintiennent souvent (') en syllabe ferrnee atone, p. ex. type type "'£)0, 0;' ordinairernent l"1;Zl')~« meres », '~~ « mon droit (souvent) et en syllabe ouverte, altere; fermee tonique: ouverte :
T
'~7~'
(§ 18i), p. ex. Mi-n:l'
T T:
sition (syllabe aigue atone) a dfi .avoir la nuance ouverte p. Une nuance fermee, telle que g_, est aussi peu naturelle en cette position que les voyelles ferrnees comme on dit
•
en syllabe aigu~ atone, p. ex. C'Zl')' « mers », ._
».
Mais en syllabe ferrnee
{!.
tonique
e,
'0'
0:
Si 1'0n dit H3-n:l', comme T:
'I
on dit il-nll),...
et
leur timbre (comme leur quantite) est p. Exemples en syll. en syJlabe
(d)
»,
nr:'10,
-
c'est que le -
est une·-¢oyelle de nuance ouverte
elles deviennent les moyennes d (= p), C~ « mer
T •• T ;
(p) comme -;- ( et -:- 9- (cf.
§ 18i). Voir encore la 10i d'harmonisation
(~611; ibN; 9 e 2; 32
c;
»,
C~ « mere
>'
ph« droit»;
en
du type 1MH (§ 29 f).
T
D'autres indices revelateurs seront signales dans
C;~, ~):V, nn!l3
"0'
« haute des
{!,
de *gabuha(h). de
ij
la Phonetique 88 Bg; Cf). .devient plus en devenant des
et dans la Morphologic
On remarquera
que l'alteration
9 et celle de 9- enp
primitives
sont paralleles : chacune ferrnee de deux degres, primitives
(!.
deux voyelles
!1 s'ouvrent
L'alteration
de a primitif en p a un parallele
en arameen oeci- k
_!_ [ori-
Au contraire
les deux voyelles syrnetriques d'un degre,
dental, et done dan's fa merne region que l' hebreu, En arameen occidental ii primitif est devenu ginairement
i,
en devenant
ii ~ecfit -;- en ara~een biblique,
p s'ouvrent
de deux degres. -;- en patticulier. Cette voyelle presentant
0 Ilt'XQov] en syriaque occidental) '(3). L'alteration
de a
De la voyelle difficultes speciales, explications
I)
cause de sa double origine, demande
quelques
(I) Comparer les trois voyelles ~
-::- -;;- de la c1asse I avec un, deux,
I rae.
complementaires
(cf. d). Le signe --;- est une deformation
trois points. (2) Ainsi.J,:l:« mesure s (1540,12 t)
totalite de ,. de .~ kul, ,:
Mais u beaucoup moins souvent que a. i .. ainsi dans Ie type no,~~ , p. ex.
minal *qutl on a ordinairement ~~: plutot que ,~~:.
~R ; dans
= Nil
(rae;
,,= on ";').
,,;,)
= kpl;
mais ,~ «il a
le type verbal iuq/al on a
(3) Ainsi le primitif *lll
« non )~ devient
!ti
(= I~-') :
ammo bib!. ~ , syr.
~ (au eontraire en heb, l~ Ii').
"1" ..•
_;
2/
en
(soit p soit 9) est un phenomene
qui se retrouve
dans beaucoup
2) Le pluriel de sa quantite
1'1~$ ba/;'it
« maison » est
C,r.,~ odt-tim
garder
(~ 98 J'
de langues et de dialectes (Comp. p. ex. anglais un p comme dans llpl). Le passage de IJ primitif par un son interrnediaire Le --;;-provenant
Cf
what = ?fhp!, avec
avec d en syll. ferrnee atone. Le meteg invite de voyelle moyenne C~ l-l b). 3) La forme pausale de est
la voyelle
heb, p a dfi se faire probablement les Juifs du Yemen, long'
C).
Les Juifs allemands Ie prononcent fautiveautres pays Ie pronondes Hebraischen des fudende Aussprache 697-721). Le -;- provenant moyen,
II
'r-'1'::l~ sa!sol'tz
~~~T
'r-'1,5~
.: T
sdA'9tn
« je suis prive d'enfants
avec un p (pour 9' allonge secondairernent exemples ~ 32 cl. ou la quantite
et plus m
de a est prononce p par
1'9 (voir d'autres
de la Perse, du Daghestan. cent a. Cf. bet' Juden... I
IOELsQHN,
Cas pratique par la graphie.
du -;- est indiquee indireetement
ment 9 (qui est Ie son du _:_). Les Juifsdes Die gef{enwdrtige /ilr pp 527-545; dans Monatschrift pratiques bref;
La 3" personne
fern. du parfait est Ie type
i1?t?8qafld(h)
Gesch. und Wissensch,
division syllabique qd. Au contraire
tums, 1913 (75 Jahrgang), Remarques est normalernent (enleve). long;
sur les deux -;-.
on I'appelle
='1~!Ot;I r~~ qames
i1?~~ (I) sans meteg est qpt-lrl(h) « tue », a savoir l'imperatif 'bp avec i1. paragogique. l§ 48 d. CIa voyelle 9 a passe sous Ie i' et s'est abregee en p), p. ex. i1?~~
T
« elle a tue » du primitif *qa{<liat. Le meteg'
du qame~ indique ici la
abrege· (litter! : rarernent
Le --;;-provenant
on I'appelle .:lIT!
r~R qames
de a est ordinairement large.
« mange ». Le - precedant Ie hatef qames \. T~) est un 9 (rnalgre Ie meteg),
It
sauf dans le cas ou -;- represente la voyelle a de I'article (~), p. ex.
Le -;- tonique est moyen, et done provient de a, p. ex . .:l~~ < (?ndb',
"VS po<~/l « mon ceuvre
• T: IT .I
»,
de
'vb, ,~v~Np<'iml
• T: IT
(nom de femme) de elle soit
Cj?'!1 u9iid' q(?m. Le --;. atone en syllabe ouverte est moyen, done d, p. ex. ~S~~ qa-flft' ; en sTI1. ferrnee il es; bref, done p, p. ex. i1?~~'pli-la'(k)
« nourriture
»,
C~S «
suavite
».
Mais une forme telle que i1:~~~ est equivoque:
».
represente bd."llliijd(h)
soit b9'VniUd( It ) « dans (un) navire « dans Ie navire
».
sans l'artic1e.
C~
W!ljd' qom,
'~~t;I{z91l1l{?'1l1
« aie pi tie de moi ».
avec l'artic1e (~ 35 1'),
Done 9 ne se trouve
norrnalernent
qu'en syllabe ferrnee atone;
se trouve dans les antrr-s especes de syllabes, .• Les exceptions sont peu nornbreuses.
savoir
en syl1abe
~ 7. Des consonnes indiquant
Quelques voyelles,
(matres
Iectionis) des voyelles .
certaines a
ferrnee tonique et en syllnbc ouverte (tonique et atone). Voici les principales : 1) Aupres de la forme I'p a dli devenir que Ie • T T: T
Ie timbre
ou Ia quanrite
C'~18 (2)
q?cjaslm, on a
C'~1P.qp-cjdsim,
insolite suppose
consonnes indiquent,
bien qu'imparfaitement,
avec p en syllabe ouverte : mais en realite, moyen (cf l§ 2tl e), Cette
'
ici, en syllabe ouverte, graphie
• T IT
Ces consonnes sont " " i1 et plus rarernent
N. Elles sont mubill's c.va-d. timbres. Les b·
appelees matres lectionis centes c'est-a-dire
i1~''!p;:tl'1i~~ ; elles
sont appelees aussi quies- '
tl'~'~·cf. § 96 A g (4). ;
i'
a Ie son unique o. De merne on a C'~~
(3) so-ras'im, pour
.I
non prononcees
(par opposition
a
des
prononcees). Les matres lectlonis en tant quindiquant
etre velaire, L'9 velaire est
(I) L'9 provenant de a, a pu originairement la voyelle hornogene de la velaire noneer sans voyelle determinee, (%) Pluriel de ~~
(3)
i', celie
»,
raisons pour sont d'ordre
lesquelles phonetique,
telle vovelldordre
est indiquee par telle consonne pratique.
qu'on percoit quand on veut pro-
ct~'I11()logique ou d'ordre
i
q'!'f{s ~saintete
..1
Pluriel de Le mot
(4) DER,
Viltl sor'es c racine ~, ri~:,« aiguillon » est lu d9-1"'~n. *
...
selon les cas. Les voyelles u, i (en general comme longues
Cependant
BAUER
sont indiquees na-
et
LEAN-
1, p. 500, supposent dd. Malheureusement
l'etyrnologie est obscure. C'est (cf.
(I) Nous negligeons
lei, pour la simplicite , la question du shr-wa
moyen
un des tres rares cas OU J' origine du qarnes nous echappe.
48 d).
7h
Matres lectionis
28-
29 On trouve, rarement, 1a voyelle -;-, meil s (Ps 127,2, graphie
Matres lectionis
7b-d
turellement
par les consonnes
vocaliques
correspondantes
Y, " p. ex.
C'i' = C~i" i'":T = i'~ .
Les voyelles egalement al par', p, {, ~ (en general comme '; d'abord dans longues) -sont indiquees (a~ le cas de contraction
N non etymologtque arameenne s'ecrit
dans des' formes avec
.p. ex. CN~ (Os 10, 14 pour CR, N~ (§ 105 c)
S 80
k), N~~ « sompour rmeux
>? ?, p.
ex. C,' =
ci'
(de iaum),
n'l1 = n'~
par.
>
?J;
de
pour I"I~;;). avec N, peut-etre
(etat construit
La particule distinguer Les voyeUes. certains L'ecriture ture ennes indue). d'une arabe.
l"1~$),puis dans d'autres
La voyelle quent
cas.
finale p est parfois indiquee de ahu;
ii. Cette graphie est
de la fin~le I"I?du pluriel fern. au futur et a I'imperatif metres lectionls en tant qu'Indiquant 1a quantite des c De meme que les matres lectionis indiquent, timbres, elles indiquent pas aussi, arrivee imparfaitement, hebraique n'est imparfaitement, la quantite.
nee dans des cas ou p provient que i';l~; cf. § 94 h).
ainsi 1"1":1 =
m~(aussi
fre-
La voyelle finale Ii est indiquee
par 1"1. Cette graphie com me en arabe), indiquee
a da naitre etait
indiquer
to utes les longues comme le fait l'ecripas de mater lectiodes voyelles moylongues '-;-. ~,
I'etat
absolu xles noms en at. dont la forme pausale ancienne
ah (avec Iz prononce,
et seulement nis (scriptio
les longues par une lettre quiescente, Tres souvent de vraies longues n'ont dejectiva), et inversement, , pour indiquer quelquefois ont une mater
probablement
p. ex. ill't3
==
a
ill"t3 C).
T :
-La voyelle
finale e (?" ~) est
par 1"1. Cette graphie
ou breves
lectionis (Ia scriptio plena est alors les voyelles '---:-, '-::-,
Ii s'explique
pu etre suggeree
par les formes du futur avec suffixe de la 3" p., telles. telles que ~il1~' ~,
On emploie mater
i; on
par
que ~il'?~~, iJ~~:' les formes nominales et pies 1"1":1', 1"63; I"IW, I"I'~ . ... :' •• : '''1' .': En resume , peut indiquer , peut indiquer rarement _:_. avec toutes
~i~. Exemassez
emploie s pour indiquer les voyellesIongues lectionis pour la voyelle le fait que
L'absence
probablement
les voyelles les voyelles
i (2)
e~t rarement
long (p. ex. dans devenu
:ll/f
de *kilab § 96 D d). ainsi Sou-
, --:-' , -::-' ' -;- ; --::--' -:;;
car l'a primitif Certaines
est ordinairement formes frequentes ~~
?J en hebreu,
certaine
1"1 final peut indiquer L'.N peut etre quiescent il est ordinairement logique, epoque dans ra's avec alef prononce), ou la voyelle
»
les voyelles -;-' les voyelles; «tete
»
sont sou vent ecrites defective,'
», malgre la longueur
on ecrit generalement vent, par \ tendance
»
SdI?Js «trois
mais en realite (cf. arabe peut-etre pas etymod'une
du ?; de rneme Ie participe
actif qal, p. ex.
etymologique,
p. ex. ~~
\.~ ~'.>
a
~,,~
j
~p
qul?,1 de"':qa{il).
l'economie,
on omet la mater
lectionis quand, toujours C~
Dans certains
cas I'N ne semble
dans le meme mot, on a, ou '. Ainsi on ecrit presque « peuples On ecrit (pluriel). pour C'~,
p. ex. dans tot';! (= arabe ~ Iii). Cet N provient longue primitive
l"1~~ mif1;f?Ji « commandements
'1i9'/h « Dieu
»,
» pour l"1i~.
C't:1'~ 'U?Jhim Pr 6,'11. la mater (provenant de meme,
etait encore conservee De meme
»,
(c'est
toujours
mais
toujours
»
a111S1 que I'alef indique
l"ii long en arabe).
probablement
On trouve
toujours
"~Or:t~ « manque
ecrit plene, sauf dans
l"1Nt « celle-ci
,I)
(§ 36
a),
'N~ «outre n.
deux cas ou il y a un Par contre, lectionis ; ainsi
dans la for~e : du type~?;
i"b~ Dt 15. 8, ;:~
ont quelquefois 1, p. 302); ou l'p est moyen
BAUER
certaines le futur la forme
voyelles moyennes
La voyelle finale
est parfois sans
Ainsi on a 5 fois Ie ketib ~I:!
pour
I"I1'I1t
toi. On a sou vent
I pour m,
finale pI. fern. du futur, p, ex.
(* 44 d).T .;u parfait la tl'nale 2"~' sg. m.' est regulierement ~, p. ex. dant dans Ie verbe
0:
m~donner
on ecrit plutot :'I~~
* 42 f).
~7~i?(:cpe~-
r~~i?I:i
d'un u) est assez souvent ecrit avec i (cf mais rarement, posterieurs. supplee ainsi
~7
(imperatif devenir
et infinitif construit). plus frequente dans les livres et d dans les ecrits postbibliques pas employes
La scriptio plena
tend
:'I~~~:!f~ " ; j~l~~ Is 18,
(2) Dans quelques cas tres rares Ie 1 semble etre mater lectionis
du son
Elle est tres developpee
1 Ch 18, 10. Dans la Mishna et dans Ie Talmud
l'absence Quand
des signes vocaliques. Ie , et Ie , ne sont comme suiC'est le cas dans les groupes
on a 'parfois Ie , pour indiquer -;- (soit
p,
soit d. ce qui suppose Ie son uni-
Remarque. mater lectionis,
que 9)' Cf. S. KRAUSS, Zeitschr, der deutsche« morg: Gesellsclzajt, 67, p. 738, 1. 30..
ils se prononcent.
7d-
8IJ
Matres lectionis -
Shewa
3u
31
Shewa
8IJ-d
vants ou la voyelle qui precede 1-:-;
'-=-, '-;-,
est hCterogt:ne: 1---::-, 1 --;-, 1
l!'7~i? qaI9'I-td;
puanteur ».
m#-lJ:91 « commandements
»,
Wt;t~
bp'-s9
«sa
'i, ~. Dans ces groupes le 1 et le , ont probable-
ment (i) une valeur consonantique, p. ex. (non du). est quiescent,
'-=-
= 9/,
»
(non (Ii),
1 -,- = au
Le shezua mobile (c.va-d, shewa prolloncl: normal) consonne une petite syllabe (demi-syllabe) qd-f'-ld(h). Ce shewa est la reduction 2) a: "'qalalat). On a Ie shewa mobile: ouverte,
forme avec sa c
Dans le groupe l'-;-(suffixe 3" p. sg. m. duonom pl.) le , p. ex. 1'9~C « Tes chevaux de lui se prononce siisau:
p. ex. dans
n'?~~
d'une voyelle pleine (ici d'un 1) sous une consonne initiale:
§ 8. Du shewa.
a Le signe ---;-shewa
(2)
'='I!:lp
e):
<tlpl;
SOliS
une consonne qui suit une syllabe ouverte : le meteg); (d'ou la regie empirique: le second mobile); an~rmal)
1"1?~~
qd-t-Id(h) est un signe equivoque il represente en effet deux choses notablement differentes, Tantot il indique une voy-
(remarquer
3) sous une consonne qui suit nne de deux shewa 4) par conse(i).
syllabe ferrnee :
~'~i?~ iiq-t-Iu
moyen (c.va-d.
consecutifs Ie premier est quiescent, Leoshewa shewa quiescent Nous pouvons
elle incolore extrernement breve, tantot au contraire il indique I'absence absolue de voyelle (com me le sukiill araben "). A I'origine Ie presentait une voyelle
e
quent sous une consonne longue (redoublee) :
shezna prononce
~'I'$~q#-f-Iu
=; reo
qu'on
est ainsi apentre le
tres legere, une sorte de demi-voyelle, prononce
pele parce qu'il est com me interrnediaire et le shew a mobile. Le shewa moyen est prononce, shewa mobile, represente
(shewa medium)
peut comparer
a I'e muet
du francais dans p. ex. regard;
le roi. Puis l'usage du signe --;- a ete etendu au cas ou la consonne (prononcee) n'a pas de voyelle. Le shewa non prononce toute consonne prononcee, on I'ecrit permettant dans Ie se nomme quiescent. il est pratiquement On Ie met sous finales. Toutefois signe diacritique, sauf sous les consonnes
N ous Ie savons par la tradition. le une voyelle pleine primitive. qui suit, p. ex. la spiration n'a de
»,
le conclure du fait que le shewa moyen, comme generalement
Nous pouvons le conclure encore du fait que le shewa moyen, comme le shewa mobile, rend spirante la consonne begadkifat dans Ie type
'i
final.
ou
de distinguer
plus facilement
1 final
etant
de
final. Exernple : (§ 7 d) Ie
'?7~« rois
de
»;
quand, par exception,
N1~ sdlJ:C): .
, netant
le shewa (quiescent) est mis sous Ie 1 (qui est prononce), final, ri'ont pas de rien, ne s'indique
non sous I'N (qui n'est pas prononce). Dans 1',?~C susd(i)U pas prononce, et le 1 prononce shewa. Le shewa quiescent, n'etant pas dans les transcriptions. phonetiquement
pas lieu, p. ex. dans le mot
'~9~ kqs-P?
« pieces d'argent
c'est
que Ie shew a est devenu quiescent (cf. § 19). Le shewa moyen est un shewa mobile anormal, En effet, tan dis que Ie shewa mobile se trouve apres des syllabes ouverte, anormale (ni vraiment ouverte, ru vraiment normales (syllabe syllabe fermee), le shewa moyen se trouve apres une syllabe fermee ; cf. ~ 27 c).
Le shewa prononce se nomme mobile .. il se subdivise en normal et anormal. b Pour la cornrnodite, nous appellerons skewa mobile le shewa prononce normal; et shewa moyen le shewa prononce anormal. une syllabe, p. ex. dans
(I) Le shewa qu'on trouve parfois ecrit sous une consonne ~~~ qd!lJ
finale (cf. ? a)
Le shewa quiescent (c.-a-d. non prononce) est celui qui se trouve sous une consonne qui ferme (parfaitement)
(I) En faveur de cette vue, voir ~ 19 d.
(2)
ne peut etre qu'un shewa mobile. On I'a p. ex. dans Ie type de la 2" p. f. sg,
1te
(oil Ie shewa represente une ancienne. voyelle breve i); ; ~~~
Rtp~ UlJ.t~9sq·
~~
c et i1 abreuva » (fut. apoc. hifil de ;'R~)
1fl!iiis/Je
«et i1 emrnena captif»
~If', S'Ud, dapres
(fut, apoc. qal de ;,?~);
~~~~
« ne bois pas» auxiliaire -
(fut, apoc. q~ de ,'i~~);
hebreu 1 iblique M)~ e neant, rien », Le shewa indique
ou un rien au sens propre, ou un rien au sens figure,
(3) Le dagesh
a savoir
'lJft<' c toi » fern: (pour *alli). «tu
II en est de meme dans Ie type
"~~l:' sdllJ''J9te
presque rien,
(f.) as envoye .. avec un patah
tres bref sous I~ 3 \!"utturale
!,.~~
est aussi un signe equivoque (~ 10 a).
au lieu du shewa quiescent (cf. ~ 70 f). de la forme normale J'1'~l;
J'1K:lI
: 'I
A fortiori Ie -;- qu on trou ve quel-
(4) En reunissant ces deux emplois, on peut dire que Ie shewa indique I'absence de tout element vocalique colore (voyeUe pleine ou hatef) ,
quefois apres une syllabe ouverte doit etre prononce , p. ex. 2" p. f.
•T
a cote
cote de la fo;me normale TlN:lI,
,
,.
:8d-.f
Shewa moyen
32 entre Ie shewa mobile et le p. ex. apres-=-
33
Shewa moyen
8t£«f:~ ~C'~ ~
+ finale atqh~ ~.tet.f':"'"\
Le shewa moyen est intermediaire shewa quiescent. .dans Comme Ie shewa quiescent,
4) Dans le type n~~~1} ( vers la maison» (11~~
"AT-
le shewa mobile, il est· prononce ; comme
'~7~ me dans '~7~ mon roi », avec shewa quiescent). (com « Explication de I'exernple- '~7~ m9f#. Ce mot a deux syllabes, =
part ce n'est pas un 'shewa On ne ni en syllabe ouverte,
il vient apres une voyelle breve,
mais a la pause le shewa est probablement mobile nl1'~' k9b-bd'-i·-lJ~h); .;:.93 c '2\ \. a I,. t"'. \ • / tz!""'" cf • ~ Verbe: 5) A I'imperatif, p. ex. 'i5) § 4S c, d; avec su' '/~~{.-:' p. ex. C~~~, cf. § 64 a. Apres
ul
~ \;- ~
',
i::!
<,
~\
.: .
L£l,~~'cf
mais la division syllabique est impossible (cf. § 27 a). Le ::l etant spirant, Ie shewa doit etre prononce ; d'autre peut couper m9-fl!?, la petite voyelle' le groupe .e
1fl9f
6) A l'infinitif avec suffixes (generalement), apres , le shewa est generalement 7) Devant Ie shewa moyen, p. ex. quiescent,
p. ex.
i5ii) (§ 65
b).
!~Sp!"6positions ::1, ) gerreralement p. ex. '7b~::1, :~~);
p. ex. les suffixes lourds de la ~. pl. C~,
mobile normal, car il ne vient pas apres une syllabe ouverte. car
-=- ne peut
se trouver
l1ulz_e~?, car un shewa ne petit commencer une syllabe, Phonetiquement se rattache etroitement
la consonne precedente : etroite. une invention un trait
forme une unite phonetique C'est un phenomene dans
est moyen, cf. 3); S) Devant le suffixe primitives u, i, a .
C?~Rl¥ ~icfq9t!I.rm (ou le premier shewa C~~~;C?~~7:' C~~~j?,C~7~P~iqtpte!I.rm. i
,e~~ r~'
mais
(§ 4:9.f) (t).
aussi
on 'a toujours
9,
il faut
distinguer
les trois
voyelles
Remarques. des grammairiens, caracteristique a fait du metricien des begadkifat probablement
KAUTZSCH
1) Le shewa moyen n'est nullement
bien reel, constituant
Apres u primitif (qui devient ---;-), on a le shewa moyen, p. ex.
de I'hebreu,
SIEVERS.
On a done grand tort de Ie rejeter, comme sous l'influence dans le cas
9'rflP:iiqtpf!I.ti.
Apres i primitif ~oyen, p. ex. ~;; (qui devient --:;-) on a generalernent l~ shewa
la 2S- ed, de sa grammaire,
2) L'existence existence par analogie.
du shewa moyen apparait clairernent Ainsi les mots du type dans '~~~ .
97~~'(-::- et
Apres
97~j?,97~~~' Mais au parfait
a la
statif on a p. ex.
9?~~;
shewa mobile). on a le shewa mobile, p. ex.
(§ 19) (i). Dans les autres cas on peut conclure
~n ont
a primitif, au contraire,
,.5't3
comme ,~
iil-bd-se_~d. (la syllabe
Exception;
aj
3" p. f. sg. du pf., p. ex.
devant u, i.
~':1?~PqetdI9't~d
9v?#T.
le shewa moyen;
mais il a pu f~~:il~ment dis~a~~itre,
gardant
toujours le. ton).
comme de fait il a disparu 3) Ceneralement ventice, p. ex. dans ( Cas pratiques Nom:
En resume, devant prononce : generalement
9 (corn me
C?),
ie shewa est toujours
le shewa moyen represente une ancienne voycependant il est adle type. normal est
il est mobile apres une voyelle primitive a, etre redoublee et qui ce.:.
elle pleine, comme le shewa mobile. Quelquefois
moyen apres les voyelles primitives pendant ne l'est pas, p.rex. kise''i (pour '~!p~:*', de N~~, Remarques dans deux positions quiescent (§ 9 b).
'i~ (car
'~7~' '~'1P)·
9) Apres une consonne qui devrait
ou l'cn a le shewa moyen: (et aux p. ex.
:-
'~~:J IS m), (§
§
1) Dans les noms segoles, au pluriel construit
is m).·
'~~;:t(§
IS m, 102 k) 'NO) g
formes qui le contiennent),
,~,?~,~,~~~
•• : •
(cf 7); cf. § 96 A b.
1) Nous verrons que le shewa colore est employe analogues
2) Dans les noms ave~ deu~ voyelles breves primitives, type ':l'!'f « parole », pl. est, "::11 dil/,.? ; (ici
a celles
du shewa mobile et du shewa deux shewa prononces,
-=-
...,
xr
1'1'
« queue », pl. est. l1i5Jr
pour le normal -:-);
cf. ~ 96 B b. et la #t!'q91;
,2) On ne peut avoir l'un apres l'autre soit incolores, soit colores (cf. p. ex. § 102 m).
3) Dans les noms avec deux voyelles breves primitives finale fern. /'1 -;- , p. ex. nR1¥ «justice » (de *~adaqat); cst·l1R~ pI. cst. 11;~; n-?1~ « generosite », est, l1~i~; cf. § 97. B b.
(t) Dans les noms ayant un shewa sous la I" consonne
(t) Cf. NOLDEKR, Zeilschrift fur Assyriologie, 18, p. 71.
on a
'~'l, ,S'~. ,S'l,
:. -:.
-:'
cornme est. ':"T,
-:
P. joUoN, Gramm. de l'hebreu bib!'
~ a - a.
Snewas colores ou l;ta!ef
34
.35
~n~wa corores
uu ~a~el -- vagesn
'Jd -
lU
It
2) Generalement
sous une consonne interne « et elle Ie p~essa»
qui a perdu son Jug 16, 16 (piel).
~ 9. Des shewa colores ou ttatef.
a Les trois signes -:;- -:.:;--;;- (§ 6 e) sont appeles !tale! (aram. corripiens, enleuant, abregeant), Ce sont ou encore appelle ici shewa co/ores par opposition shewa simple comme prononce,
redoublement,
p. ex.
~~~~1
3) Sous S, "
dans certaines formes, apres une voyelle longue ou
9~':J
moyenne, devant Ie ton, p. ex. Gn 2, 12;
it~?~N~ n G
3,.17; '~~~ Ps 103, 1.
shezoa composes. On les
4) Sous une sifflante apres ~ « et '), p. ex. ~itt~ « et l'or de ... »
au shewa incolore c_-a-d. au
'ritR~'
« et embrasse-moi
» Gn 27, 26. p. ex.
--"
des voyelles
extremement breves,
peut les appeler demi-
Principaux
cas ou l'on a -;;- (hatef qames) :
e sommet de de sa
le shewa pro nonce ; de sorte qu'on tres sou vent sous les gutturales:
1) Pour raison d'etymologie,
tete > de *qudqud>
voyelles (par opposition aux voyeHes pleines). se trouvent
Les trois shewa colores' Jes regles seront donnees
'~'1R;C"!!i?, de it~~~1«
i'R1~« le
*qttds> tt1P(aupres
C~i?
qp-tjdfim
~ 6/).
2) Pour
a
b
propos des gutturales Comme le shewa Mobile, Moyen, p. ex. p. ex.
(§ 21 f-t).
simple prononce, le shewa colore peut _etre
raison d'harmonie:
Quelquefois devant une gutturale et elle sera appelee s Esth2, 1" 14;
ou une velaire avec ti, p. ex.
mobile ou moyen (cf. § 8 cod).
NrnR~~«je
bablement
voudrais embrasser » 1 R
t 9,20. Ce -;;- s'explique pro-
,bJ?,:,
'b~,~~r,tr, ~~~~,' 9r,t~~, ~)~P. piel). (
~to~ (irnper. : « egorgez »),
par le fait que le -,-;- etait prononce
1r,t~~'1~~':'I,
§ 10. Du dagesh.
~,~~ (piel), c Suus les non-gutturales lieu du shewa simple. precises, dautant
PUT.' ;'~~.
on a assez+souvent , donner
un shewa colore au
On ne saurait
ce sujet des regles dans
Le dagesh, dans une bef5adkifat (§ 50), p. ex. dans Ea, est un signe a equivoque (i). Tantot il indique que la begadkefat est explosive, p. ex.
que sou vent les manuscrits shewa,
varient (').
Sous les non-gutturales, plus forte que le simple
quand on doit avoir une voyelle un peu on ne met jamais -:.:;-, sans doute -:;-. a moins qu'il ou harmonie) de choisir -;;-.
« il jugera »; tantot il indique qu'elle est a la fois explosive et longue (redoublee), p. ex. dans iipppi « il tombera »
(pour qitl{l.
m~ iis-PPI c,s),.,
:.
senti com me trop faible ; on prend generalement n'y ait une cause speciale (etymologie voyelle primitive a ou u; p. ex. on a d . Principaux 1) Generalement II suit de la que ce -:;- et ce -;;- ne representent
de
XI).
T
Dans les autres consonnes le dagesh n'est pas p. ex. dans
,e~
equivoque:
il indique que la consonne est longue, la longueur dagesh .fort (2); au point dagesh de prolongation
~i?'
pas necessairernent une
n-?~i9 de
Le dagesh indiquant
ou. redoublement
de la conLe dagesh s'appelle
~io, itR?t~ PW~' de
sonne s'appelle peut l'appeler
de vue de sa fonction, on
cas ou l'on a -:;- (hatef patah) : sous une consonne
ou de redoublement,
p. ex. dans la flexion des verbes V'V: piel). Mais on dit par ex. moyen § 8 [8). pause
'1\".
;~1-?~il «
~~~;I?' «louez ~,,=p
qui est ensuite repetee, » (pour
qui, dans les begadkifat~ indique le son explosif ou instantane dagesh de simple explosion. un dagesh d'explosion Dans les begadkefat
~'~tI·,
(en
dagesh doua: e); au point de vue de sa fonction, on peut l'appeler le dagesh fort est prolongee. Dans l'hebreu vocalise par les Naq-
te benira » Gn 27, 10 (shewa
')~n, mit).
" •••
On a toujours '~ti}, ~)~i} (shewa moyen
s 8.f9)
(i) !--e shewa est aussi un signe equivoque (~8 a). \1) II est remarquable des Bwlish-Aramiiischen, que les usages. d~ I'hebreu biblique (cf. sur ce point conco~KAuTZSCH,
(2)
dent assez bien. avec ceux de I'arameen
Grammai1k
m 1t'?1;
on dit aussi .,~~ ~ dagesh lourd, traduction libre de
p.36). Il est fort possible que il y ait eu ici influence
(3) Dagesh doux
1"!~11t'~,1; on
dit aussi dageslt lege"
de la vocalisation de I'arameen sur celie de l'hebreu.
( ~p '''1).
10a-J3a
D~gesh -
Mappiq - Rafe -
Maqqef
36
danim il n'y a pas de consonne spirante
It
longue,
p. ex.
if.
37
Maqqef
13a-d
Ainsi ieee des
son nez » est necessairement Sur la quantite
'9Ppij (racine :pee). cf. § 18 a; sur la spiration
mot n'a plus de ton principal et ne peut plus avoir qu'un ton secondaire; il devient proclitique (i). L'union indiquee par le maqqef est geplus etroite que celIe indiquee par unir deux, trois et meme Gn 25, 5. du maqqef n'a pas de regles bien fixes. surtout apres Ies monosyllabes, avec maqqef toujours b g-eneralement Ainsi, parmi les un accent conjonctif. quatre mots, p. ex. Le maqqef peut neralement
des consonnes,
begadkefat,
d. § 19. § 11. Du mappiq,
i,-,~ee-';!~-nee •v -s
T
~...
Dans les Bibles imprimees se prononcer, ment » ); . avec p. ex.;:r¥!~ tuer»
le point nomrne
mappiq ne se trouve mais doit
L'emploi noms -n~
que dans le ;:r final, pour indiquer qu'il n'est pas quiescent, '9rfdh' « la terre ~~O et « tue-la » (opp, les racines
r:Qj
On l'emploie on a presque
d'elle » (opposer
mMic
-r~« fils » ,
'ar'fd(h) « vers la terre»);
« le cheval d'elle»
(opp. n9~o (:j~~ « tue » irnperatif
»,
« fille », Par contre on a rarement
avec maqqef c~ « mere »,
C;;
~R • la
"~R
paragogique
§ 48 d).
.suivantes : ;:r~ « etre haut
».
et C~ « nom », jamais ~ee (etat est, '~ee) « pere ». A l'etat est, _,~ est plus "frequent que ,~ «;out».· ' -: T Les particules
« jusque », -"
Le ~ se trouve dans
suivantes
ont presque «avec». Ii
~n~
c.-a-d.
(;:r~'~~~1) « hesiter », Le mot « faisant prononcer»
« briller »,. ;:r~n «s'etonner
« ne », -';!~ « vers », -Ca:c « si »,
-
i"~~,de l'arameen
~~
« sortir », signifie «faisant sortir»
« sur »
-C,
.
-r~ « de », -r~« de peur que », ..,!'
Les deux particules nee , dont .. de l'accusatif, toujours c sans maqqef n~ . proclitique. et I'autre l'exposant
toujours
Ie maqqef:
-,~
la co~sonne.
l'une est la preposition La particule precedee
« avec»
se trouvent souvent avec maqqef -n~ et souvent
§ .12. Du rafe.
a Le rafe est un trait horizontal sur la consonne. Ce trait exprime le contraire du point, au dagesh
atr «de
grace » (§ 105 c) est presque
du maqqef, et donc, rend Ie mot precedent
a savoir
du dagesh (fort ou doux) § 10, et du map1) Par opposition pour empecher la au dagesh p. ex.
Le mot qui precede le maqqef et cst.)
T
devenant proc1itique, tend a avoir devient -';!~R;
piq § 11. 11 a done, selon les cas, trois valeurs: on trouvedans prononciation doux,. il indique des manuscrits expressernent p. ex.
une vocalisation plus breve. Ainsi c;; (etat abs. et cst.), ,,~ (etat abs. deviennent -c~, » -';!~; l'inf. ~
fort, il indique que la consonne n'est pas redoublee, p. ex.
C"11!!
aveugles»
""; n~ « quoi?
T
-n~.
-
'T!
« main»
eiJfu<rtm (cf. § 18 m 4); 2) Par
opposition
Le mot C' « mer » (rac. C~', ticularite ni~-c~ remarquable.
n~'
T_T
§ 93d, pI. C'~') I ' .-
a une parp. ex. des Troseaux, d
'~7~ § 50); (cf.
b
que la begadkefat
est spirante,
Le qame~ se maintient (')
dans -C',
3) Par opposition au mappiq, il indique que le " final
« mer de Genesareth », sauf dans ~O-C! «mer
n'est pas prononce,
Ii? lil(h).
non ldh' (§ 25 a).
mer Rouge ~.
Sur le sens du mot rafe cf. § 5 o.
Remarque. Un nom a 1'etat absolupeut
par ex.
1'TPrt?«
'I"
etre suivi du maqqef,
in statutum
tibi.s
l'orphelin
Ex 12, 24 (sans rnaqqef
Ph) ;
§ 13. Du maqqef.
a Le maqqef (t) est un petit trait, indiquant analogue
n)~"N'1 cin~
l' T : :
« I'etranger,
et la veuve s Dt 27, 19. De
• l'
notre trait d'union, uni. Les
meme, on. peut avoir l'infinitif absolu, p. ex. c'~e"~n "0' ciem Pr 28,21 (cf. § 123 bJ.
cognoscere fa-
que deux mots forment un groupe tres etroitement
deux mots unis par Ie maqqef forment une unite phonetique : le premier
(i)
III~,
de I' arameen ~~~, signifie proprement unissant. Le prernier mot
enlourant,.
ici on entend qui se
generalement
est qualifie de
~! c rapide,
(i) Com~arer les proclitiques puyant sur Ie mot suivant: 0,
du grec, qui perdent etc. ; £V, £l;, aU etc.
leur accent en s'ap-
fJ
hate », dans Ie langage de la Massore (Revue Biblique. 1904, p. 536).
(2) Sous I'influence du .0; cf. l'adjectif
=~(rae.
=011), OUjOUfS t avec qames,
14a-c
Meteg
38
39
Meteg - Accents
14 c -
15 a
§ 14. Du meteg.
a Le meteg (j1'16frein), ...... neral de freiner qu'on met precipitee. comme Ie nom I'indique, a pour but ge-
C'V::l'Ni1) (i). De meme tion: ~ «et» ne prend
la voyelle de la 2- syllabe pas le
ouverte avant
un~' ~~;elle ayant Ie meteg, p. ex.
~'tI~~yt sa'Qu'q'jf!£(!m'. - Excepmeteg, p: ex. C'~?~;probablement
,bE.!; de meme ex. ~,~~! 22 c). (§
la prononciation.
C'est un petit trait perpendiculaire rapide et
parce que cet u est bref ('). Dans cet emploi, le meteg, outre que, comme toujours, 3) il protege la voyelle, indique un ton secondaire. par ex.
la gauche d'une
voyelle pour assurer sa prononciation
exacte, ou, negativernent,
pour ernpecher une prononciatiou
la voyelle qui precede un hatef
Mais de meme que les accents indiquent souvent la place (§ 15 d), bien que ce ne soit pas leur
dans le cas ou un ihatef devient voyelle pleine. p. 4) dans les verbes 1'1'i1 « @tre »,
1'1'
du ton principal ou secondaire
I'1'n
TT
« vivre », '~
la voyelle de exacte p. ex: devant d'abre-
but premier, de merne le meteg indique souvent le ton secondaire Dans certains cas aussi il se trouve Ni les manuscrits niles emplois les plus usuels ('). 6 Exemples:
ql't-Id(h)
e).
la 1r. syllabe fermee, pour en assurer la prononciation
indiquer
la division
syllabique. sur l'usage et les
1'1'1'1' iih-i(!(h)
.: : t'
«il
sera »;
dans les formes ,~,
seulement
grammairiens quelques
ne s'accordant
maqq'f
au quand elles ant l'accent 5) au qamel? de
du meteg, il suffira ici d'indiquer Dans
exemples pratiques
C't:l#
pashia.
« maisons
» pour :mpec~er
TIT T IT
bdUim
I'?~~ qa-f-Ia(h)
syllabique. Dans
ger le qames (S
. • t'~
b);
de meme
dans la particule i1~N, N~N : « ah l' devant une con sonne ayant redoubledevant " p. ex.
« elle a tue »
(§
1) le meteg
indique qu'il ne faut pas prononcer le qarnes bref comme dans indiquer condaire: prononcer
lieqa'19Ifi'
n'?~R
de grace » § 105 c. 6) au patab -de l'article rnerrt virtuel qui cache» 7) empecher Ps 138,21 Lev et shewa moyen, p. ex. i1~;J~p lZ9m(m)e!:95S(!(h) « celui
« tue », mais moyen. Par consequent, ici le meteg se trouve
aussi la division
qa'-f-Ia(h)'. -
De plus il indique un ton sele meteg avertit de
'~7~~1 43 a), (§
• 11'
3, 3;,
excepte
patah de l'adverbe
exactement Ie qames ; il indique de plus le ton secondaire:
(~c 2). De merne dans '5~N
interrogatif
'=l'
C''1tr,tl.
devant
De me~e maqqef,
au pour
p. ex. '~~ i1~~~p au longue,
Gn 18, 17.
une voyelle moyenne (non
(§ 39
a). -
(§ c 5) le meteg invite
a prononcer
Dans C'':'::l bdt-fim' • IT
de l'abreger,
p. ex. '~-1'1~ Gn
1, 25
sat-Ii (non spt-li);
~r,~
le qames comme moyen, bien qu'il
-r,~);
-1'1~ Job 41, 26 (non -l'1tt).
soit en syllabe ferrnee atone (§ 6 12).
Pr incipaux 1)
emplois:
Le meteg se met: ou longue suivie d'un shewa mo-
une voyelle moyenne craindront»
8
s
tonique au. accentuee, forcant le voix, Quand
"
15.
Des accents (8).
a une voyelle en avoir, de a
bile et de la syllabe tonique, p. ex. i1?~~ (voyelle moyenne), ~N;~~ou (defective) ~N'" «ils
u-
Tout mot hebreu, quand il n'est pas proclitique, c'est-a-dire prononcee
(opposez ~N'" ,#r-'u
:"
« ils verront »),
en elevant et surtout
Ce meteg, on le voit, peut etre discriminant. 2)
un mot est un peu long, il peut
la voyelle
de la 2 syllabe
ouverte
(ou serni-ouverte)
avant Ie ton, p. ex. C1~D'C'~~IJ' c?,:,p 3' syllabe ouverte avant le ton si la 2" syllabe
(I)
'~7~~1'
(a
la voyelle de la est fermee, p. ex.
(I) On peut formuler une regie pratique generale (englobaBt ,,:.I:;' i 1 et 2) : On met le meteg a la voyelle de la premiere syllabe ouverte (ou consideree ici comme ouverte) separee du ton au moins par un shewa mobile. p. ex.
C'est probablement a raison de ce fait que Ie meleg- est appele par certains grammairiens ga"ya ;"I:~; mugissement, elevation de la voix ». « (2) En dehors du texte biblique, on neglige souvent d'imprimer Ie meteg, sauf dans les cas ou il est utile pour distinguer une forme. On le marquera notamment dans les cas ou il sert a discriminer Ie 7' p. ex. it te revi/ira, (opp. "~R~it te tuera, sans meteg).
"·:.NI~."l'1I'''', ,'Zimk .
T • -r IT'
(t) Chez les poetes du moyen-age ~ est bref; cf.
IT
:I
LUZZATTO,
Gramma-
tica ebraica, (1853), p. 584. De meme on ecrit p. ex. '?~1 sans meteg, contrai1; mais on ecrit, avec meteg, p. ex. :lM ~ 9 d 4. -:1 Pour eviter des confusions, on reserve ici Ie mot accents aux signes graphiques (et aux neumes exprimes par ces signes), qui generalement indiquent la place du ton; et on appelle ton l'elevation et l'effort de la voix, bien
rement
;r~7~
ca)
15
a- e
Accents
40
...
la longueur des versets, quelques-uns la logique; ainsi parfois l'apodose trop sont fort courts (rnais pas moins pas toujours avec 11-12; 21,20-21~ est separee de sa protase pour 1 R3, de trois mots). La division en versets ne s'accorde eviter un verset long (Dt19,16-17;
plus, un ton secondaire, et merne deux s'il est tres long, comme p. ex. C:l'l"lV:lTV (cf § 14 c 2) ou Ie ton secondaire est indique par le meteg.
.,' •• :~ IT
La place du ton, principal ou secondaire, est generalement par des signes nomrnes accents l"lij'~~ « melodies» ).
b
indiquee ou
(C'~~~
litteralement
«gouts»
Ruth 1, 12-13). L'origine des accents est obscure. Leur but principal est de regler la modulation principalement ou recitation musicale de la Bible. Les accents sont des neumes ou groupes de notes. Certains de ces neumes les cesures ou coupes de la phrase. Enfin les ordi-
Dans l'etat de l'hebreu cipal ne se trouve
enregistre par les Naqdanim,
le ton prin-
plus que sur la derniere (ce qui est Ie cas de syllabe. Le ton he- .
beau coup le plus frequent) ou sur l'avant-derniere derniere syllabe s'appelle super, mil"ra (de I'aram. tionnel ~
ayant un caractere pausal (§ 32), il se trouve que les signes indiquant ces neumes, marquent signes du neume (pausal ou non) etant generalement nairement la place du ton. Les accents qui indiquent
ItS
. breu, dans son evolution, tend vers la fin du mot. Le ton sur l'avant-
,,~?~ mir{!l
(de l'aram.
i~+? +,,~ de=
en haul du mot); Ie ton sur la derniere syllabe s'appelle
i~ +?
+ p!~,
l'!?~
places sur la
syllabe tonique du mot, il se trouve que les accents marquent
par terre, deorsum, en bas du mot). par Ie signe convenp. ex. Ci?!1~fliid'-qpm
Dans cette grammaire (en grande (mile'el), C~1 Wfiidqpm'
c
le ton est indique par l'atnah ~)
cesures (pauses majeures, moyennes, ils separent en effet un mot du mot (. ; ,).Les autres
pause
(rnilera", en grande pause) importante;
e).
mineures) sont appeles disjonctifs; accents, au contraire, unissent
Sur les regles relatives a. la place du ton, cf. § 31. La place du ton est tres nante. Opposer p. ex. : elle est parfois de
... T T
suivant, comme font nos signes de ponctuation discrirninous »,
le mot au mot suivant et sont apqui ne se mettent J
'~~pleve-toi s «
et d Notre-Bible
i1t?~ « elle 't:1?~i?1«et
se leva»
~3~« ils batirent » et i1~i? « se levant»
,.
m~ et ~jil en «
(participe feminin) § 80 j ,
peles conjonctifs. Les quelques accents (disjonctifs ou oonjonctifs) pas sur la syllabe tonique sont ou prepositifs du mot, ou postpositifs aux accents pepositijs syllabe tonique repetent et poslposilifs,
j'ai tue s et fern. et
».
'~7~~1et «
,~~i'« mon
employe
c.-a.-d. mis tout a. l'avant
je tuerai » (avec le waw inversif), lever»,
c.-a.-!1.mis tout a. la fin du mot. Par opposition les accents qui se met~ent sur la Certains manuscrits dans (disetre appeles impositifs,
i1~z:,« parfai te
i1~~
« elle est parfaite »
peuvent
hebraique a deux systernes d'accents: dans 21 livres;
1) Ie systerne
l'accent prepositif ou postpositif sur la syllabe tonique;
ordinaire ou prosalque, mnemonique e versets
2) le systeme des
les editions ordinaires cela n'a lieu que pour l'accent postpositif
3 livres poetiques :l'~N Job, "W . Proverbes, . -: l"l~~ « verite »). L'accentuation
et C'~'r-1 Psaumes (mot .. : divise en dans
jonctif, cf. § g: Ab a) pashIa qu'on repete si le ton est mile'el, p. ex.
C~~'J«les
eaux
Gn 1, 7 (L'accent
etant postpositif s' ecrit sur la der-
suppose le texte biblique prealablement Bien qu'on ait vise a. une certaine
niere lettre du mot;
on a ici repete pashIa sur la syllabe tonique ma;
(C'j!I~).
egalite
h(!"!l.mfl'iim) ("). Pour les mots ayant un accent prepositif ou postpositif autre que pashta, le ton ne peut etre connu que par la grammaire.
que Ie ton en hebreu,
a la difference
du ton en grec et en latin anciens, soit
(I) Quand
plutot une augmentation
de force, I'elevation etant un element secondaire, ou de force,
comme dans le grec modeme, Ie latin populaire, I'allemand, l'anglais, I'italien, etc. Que I'accent de l'hebreu soit surtout un accent d'Intensite cela ressort de ses effets sur la vocalisation. (t) L'accent milel"a' etant de beaucoup Ie plus frequent, on omet gene. ralement, par economie, de I'Indiquer, p, ex. U:Dest cerise representer ~:D. .
mot, p. ex.
impositif azla (*
,'It~ .s :
un mot milera' a pashta, Ie signe _:_ etant .~ l'extremite Gn 1, 5, ne peut pas se confondre A 18) graphiquement
du
avec l'accent conjonctif , semblable, p. ex. r:A'11 R 18, 12.
43
Accents I-'l"garmeh •
15g-11 »:
s
1 -
A. Accents
du aysterne ordinaire Accents disjonctifs.
(des 21 livres)
13
avant 14 15 16a 16b 17
« pour lui-meme
vertical
c'est
l'accent Is 39,2
conj. munalz;
1
n? 14, avec trait
a. gauche,
l'I.~'.
silluq
(opp. le meteg § 14), au dernier mot du verset,
« fin du verset », Gn
le (!) sij/ pdsuq 2
I't. •
1, 1
v:
n~;;t.
Accents conjonctifs. ~ munalz (opp, mifr'kd, le disjonctif legarmeh n" 13), Gn 1, 1 N~~. _,;_ m"huj>pd!s (opp, le disjonctif y"fib prep. n" 8 b), Gn 1,7 Gn 1, 1 l'IN. k"/uld, m~M' N:,'_'l. double, Gn 27, 2EHi? ,~mlr"~d
atnah, au milieu du verset,
Gn 1, 1 C'~. A"
3a postp. 0\_- segoltd,
la 4" ou 5" cesure
avant l'atnalz,
Gn 1, 7
f'f.,'
~'p;p.
3b
I~
grand shalshelet (avec trait vertical pour segoltd, zdqif qtit(Jn, Gn 1, 14 C~~~;:r.
a gauche),
tres rare (7 f.)
en tete de la phrase,
Gn 19, 16
1j:t~i!t3l?~'
dargd, Gn 1,4
4a
4b
18
_:_ aeid, 1 R 18, 12 ryI'~I1;se nomme aussi qadmd, quand il est
assode au disjonctif q"tannd, gpph, Cn 1, 29 n'' 12). Gn 1, 9 C:~ij n" 8 a).
_':_ zdq~f gdg91, au lieu de ztiqif n' est pas conjonctif,
qdl(J':" si l'accent
Gn 1, 14
,"~.fj?.
,:
qui precede
~R~(opp.
le
disjonctif pashld 19 postp. • -- f'lishd
postpositif
-: liflui (ou larlul) Gn 1, 1 .n';;N,:!~; parfois a. la place de I'af1uzlz, surtout dans versets courts, Gn 3, 21 'i~(com parer m'ayyeld conjonctif n" 21).
n~,.,
(opposer
le disjonctif
f'lishd g"dijld prepositif
20
21
galgal pdzer
« disque»
ou yrralz
« lune
», rare
(16 fois) comme
Esth 7, 9 ~. (n" 1)
6 7
~
pestp.
reot", Gn 1, 2
_N_
n~I'1'
C,~.
,;&6
gddijl (n" 11 b auquel il est assode), dans des mots ou groupes
me'ayy"ld: secondaire
c'est le /iflzd (n'' 5) employe pour indiquer le ton qui ont silluq Gn 8, 18
zarqd, Gn 1, 7 pas hid,
8 a postp. -' 8b prep.
--<
Gn 1, 5
azld n'' 18).
(cf. § f)
(opposer
Ie conjonctif
ou atnalz (no 2), Nb 28, 26 C?"lj~~~, B. Accents
ry~-~.
It
y"/'ib (opp. Ie conjonctif m"huppd!s n? 15 qui n'est pas dans mots monosyllabes qui precede 1 2 4 5 double, rare Ie ton sur la Ire syllabe, si 'l'accent Gn 1, 11
du systeme poetique (des 3 livres Accents dlsjonctlfs.
l'I~~§ d)
prepositif ), au lieu de pashld, ou ayant 9' lOa n'est pas conjonctif,
•
~ ~ ~
st'lluq (cf. A 1 dans le tableau des accents du systerne ordinaire). c91~h w"yqr~d c montant rebzac gddql (cf. A 6). et descendant», plus fort que l' atnalz.
:IT;'~.
t"bir, Gn 1,8 C'~. Gn 1, 9
rw
3 -:_ atnalz (cf. A 2), moins fort que cijlfh w"yfrrd. ~ .
rein"""cmugrdslt, #nnfr c.-a.-d. rein"""c avec gfYfsh (opp, (zarqd, 19 et cf. A 3 b). cf. A 7). (Le #llnijrit se met sur une syllabe (cf. A 10 a).
.z: gfrrsh,
C7~"J.
(16 fois)
et si si le ton est sur la derniere syllabe
106
_:_ g"rdshayim
l'accent
(ou g~shayt'm),-gfYfsh
6 12.. gran_d shalshelet
pour grr'{sh,
conj. azld (n" 18) ~e precede
pas, Gn 1, 11
'1~.
P08tp.
N_
(n" 20), qui a la
ouverte devant
msme forme ~,
11 a
_:_ pdzer, ~ pdzer
Gn 1, 21 gddfl
l'I~b",.
"."... IT
11 b
12
Esth 7, 9 prep. __
0
r~'.
ou qarn? Idrd
« comes de vache », rare (16 f.)
mer"!sd (nO 12) ou m'huppd!s (n" 17»). 8 _:_rebzac qdl!Jn devant cqlfh w"yqrrd. 9 prep. --,
trlzi
Oll
#/!zd
prepost'tif (cf. A 5) (opp. le conjonctif n" 15). c.-a.-d. m·ltuppd/f (n" 17) avec trait
rlishd g"d9Id, Zach 4, 5
f~~ (opp,
le conjonctif
rlishd
10 _:_pdzer
11 a
1 ~-:--
(cf. A 11 a). l"garmeh, a. gauche. vertical
q"tannd n" 19).
m'huPPd!s
lSk-j
Accents
44
Accents
lSj-/
11 b
I--~_
azld l"garmeh, gauche.
c.-a.-d.
azld
(n" 18) avec
trait
vertical
t!onne
de traits
verticaux:
pour silluq et pour sego/td,
atnal;t qui par
lui est
pratiquement
Acceats cODjoactifs.
egal,
~!: pour
II pour
zqqef,lpour
rebi'": l'ac-
12 13 14
=:
=:
~
mer/sa
(cf, A 16 a).
cent tifltd precurseur les autres -rl~1 accents
de silluq et d'atnal,l e~t: indique pratiquement C~
muna!t (cf. A 14). Cilluy, ou muna/.t superieur.
precurseurs,
II, et tous ~gaux, par I.
15 : -:- tar!ta (opp. le disjonctif delzi prepositif nO 9). 16 -;- galgal ou Yfra!t (cf. A 20). 17 ~ mehupPd/s (opp. n" 11 a et cf. A 15).
18 _:.,. azla (opp. n" 11 b et cf. A 18).
I '
III ~n!Prr:-t'l CD'?~ n~~~ rI,~1 II "7;!l rI'.~_'~ I n~ I :l;~jft?!,jI rI.~~ I C'~~~I}-rl~':l!'!1} ~i1:Prr:-t C~O-N7 ,~~ 1 ,_~, i1'C1-~ illl "n"¥;~~ N~P? ,~~-I;!l II 1111 ir:'~~~-I;!t~~ i~'~~ : n
: 99~'J-rl~ rI',~-rl~ Comme on le voit, le verset est divise en deux moities par l'atnalt -;:. La premiere partie, qui precede tres ineseparees moitie est subdivisee le segoltd, etant dont la
I nn~?
19 :- petit shalshelet (opp. n~ 6). [20 __:_ ~innijrit, cf. nO 7].
i Emploi usuel des accents du systeme ordinaire. Le verset est terrnine par le silluq, suivi du sqf Pdstlq r c'est la pause la plus grande .. Le verset est divise en deux moities, qui peuvent par l'atna!t. subdivisee, accents Puis chaque moitie, selon la longueur, subdivisee ~, reb'iae ~, et chaque partie encore etre tres inegales, est de nouveau par Ies deaccents
gales,
par le segoltd ..::_: la ipremiere a. l' atnah, premiere qu'une est subdivisee
courte, n'est pas subdivisee ; au contraire a. son tour est subdivisee fois, par reb:r
e
la seconde partie, du segolta La seconde moitie
par le zaqef .', en deux portions par le rebi" ~.
du . verset, de l'alnal;t au silluq -,I . .
~:_.
etant assez courte, n'est subdivisee , l'atnal;t et le silluq on a le precurseur
__ ,
(dichotomie)
D~ plus, devant
.
suivants:
segolta ..::_, zaqif
dont la valeur
le precurseur meme segolta pashia ~dola '_; --"-,
tifl;td - .. lequel
a lui-rnerne zarqa des
_N
!'bir -.
croissants apparait graphiquement.
De plus, les deux grands (segoltd, zaqif,
a SOn precurseur
zdqif
a son precurseur
De
(silluq et atna/.t) et les trois sous-diviseurs
reb:zae) sont
le premier
gfr(!sk ~.
rebi" a pour Le choix
precurseurs.
differents
pazeT __~_,
!,Iiskd
precedes chacun, s'il y a lieu, par un accent disjonctif comme son precurseur:
faible, qui est
accents
disjonetifs,
ainsi que' des accents conjonctifs qui les precedent, logiques et syntaxiques; Lavconnaissance n'est pas rafe, beaucoup d'anomalies
est regIe par des lois pour lagramde "rI~N:n
l' .! .
1 silluq --;- et 2 atna/.t -;: ont pour pr'ecurseur
3 segoltd _., _
4 zdqif!~
5 -:- It/!td
7
_N_'
ont une cause m~sicale. k
[et shaishelet I_!_] ~
zarqa(ass.rares), pasta ~ yetib]
des accents est parfois importante
....
~>
~)
8' [
maire et aussi pour Ie sens, Ainsi dans le verset cite Ie.~ un accent ainsi : «Et non: «Vox blables, Cette «Et Dans disjonctif, Dans' Ruth 2, 14 l'accentuation du repas: du repas,
1:'
parce que la voyelle qui precede est separee.zlu invite
~b
~ par; couper
[5 lif/.td ~
,)
9 -;- t'b'ir] 10 .i: »
e fYfsk
Bo'az lui dit au .moment Bo'az lui dit : Au moment Is 40, 3 In deserto ... est toujours
Approche approche
ici, .. » et ici ... ».
[_:_ ~rdshayim] \ \ 11 _:_ pazer [~pazer gad?/] 12 __ t'liskd ~dijla
p
'~1~~ N~ii''i1el'accentuation
~>;-d'apres
invite -a. couper :
DELlTZSCH
clamantis: le premier loi apparait
la 10i: de deux. accents. sem-
l~ plus fort (cf.
bien dans Ruth 3, 9 ou Ie premier zdqe/
Exemple: l~s accents 1 Importance
Is 39, 2. Dan,S ce long verset, on a df employer relative des accents disjonctifs par un nombre
tous.
la vocalisation
pausale
9~~~'mais
empirique
non le second ztiqe/ pas prepositifs
19~!?~)'
a produit
in 'h, I.).
disjonctifs, meme le segoltd. Nous indiquons
graphiquement propor-
Pour laconnaissance puis que tous les accents
du ton, les accents sont fortutiles, ou postpositifs
qui' ne sont
15/-
16 a
Accents - Texte massoretique
46 pashIa I'inEn
47 d'autres rieur
Texte massoretique
et massore
16a-d
indiquent debut, pratique m mis
directernent
la place du ton, et que le postpositif
leurs sont posterieures, celui des/ Naqdanim
Le travail des massoretes
est peste-
dique indirectement mettre il convient
(§j). Le lecteur du texte sucre devra done, des le l'indiquent. de marquer fortement le ton mile<el, et legere-
le ten dans tous les cas ou les accents
et Ie suppose.
Les rnassoretes accompli-
rent leur ceuvre du VIII" au X" siecle ; Ie texte recu est generalement celui de Ben Asher (X· siecle),' qui a ete prefere Ben N aftali. Divisions importante chapib'es, du texte. Au point par les chretiens
ment le ton milero", Le Pdseq (i'I;?~ participe arameen : separant) est un trait vertical est rnateriellement semblable au grand shalshelet). Le paseq mariiere assez peu cohe-
a celui
de son rival la division en qui est
T •
de vue grammatical,
{,
gauche
d'un
mot. Ce signe
trait vertical a ete introduit
de certains accents (l'garmeh,
est la division introduite les Juifs
en uersets (C'e~O~§ 15 e). La division
a une'
epoque tardive et d'une de nos editions
dans la Vulgate, au XIII" siecle, Rabbi vers Nathan 1440.
rente, de sorte que son emploi n'est des 480 paseq environ pecher d'unir Jer 51, 37 vraisemblables, il indiquerait n deux mots, dans
pas bien clair. Dans la plupart
a ete recue par
(P1~ou '~IO'~R)' C'est
pour sa Concordance, de la lecture Une etre section ecrite
e), ce signe a pour but d'emdeterrninees, comme p. ex. dans un mot,
s'en est servi le premier, Le Pentateuque, divise quand la section
des circonstances Mais de nombreux et plusieurs pour il indiquerait petite glose; expliquer etc.
en vue
T TIT
dans la synagogue,
quand la meme consonne
il'~ I
C'?~7I ,,~-?
finit et commence
en 54 sections (~D). suivante
est dite ouuerte (nmn~)
doit
paseq ne semblent plus ou moins presence: abreviation
W. WICKES,
la ligne
suivante r elle sections
pas avoir ce role de separateur, paseq serait un signe critique; !'insertion d'une Sur les accents On the Accentuation Testament Prose Books
conjectures, leur
est dite jermee sont indiquees
(n~~nO)dans
le cas contraire.
Ces grandes par
£)
ont ete proposees
le ;
pa: tl~£) (p. ex. Ex 30, 11) ou 000 (p. ex. Ex 38,21). en petites sections indiquees ou 0 (p. ex. se d.
une ancienne sont
Elles sont subdivisees Gn 1,6; 3,16). Les observations trouvent soit en marge la fin de chaque tions ordinaires termes duction lyglotten minologie
les deux livres fondamentaux
de toute sorte convpilees par les massoretes de chaque page (llfaso1"a marginalis), Nous donnons Biblique soit
oj the Three so-called Poetical Books oj the' Old of the Ttuentv-one so-called aussi l'article J. DEEncyclopedia:
(1881) et On the Accentuation
livre ou de toute la Bil-le (lIfasiJra /inalis). n'en donnent que des extraits. dans Revue volume).
Les ediici les
of tlle Old Testament
(1887). Consulter
Accents de MAX L. MARGOLIS dans la Jewish
les plus usuels de la massore.
RENBOURG, Quelques obseruations sur I'acceutuation
(Journal .Asiatiqu«
(Voir HVVERNAT, Petite intro-
l'etude
de la Massore,
1902,551-61;
THEILE,
1870, t. 2, pp. 519-528); p.
(Zdtschrifl dcr deutschen
KAHLE,
Zur
Geschichte, der hebr. Accente
1903,529-49; 1904,521-46;
Bibel (appendices technique
1905,203,34); STIER und
au neo-hebreu
Po-
morgenl,
Gesellschajt,
1901, pp. 167-194).
a chaque
Les mots de. cette terou it I'arameen : ils
appartiennent
§ 16. Du texte massoretique et de la rnassore,
a Le texte de nos editions cularites, certaines
(I)
sont souvent ecrits en abrtge.
du texte hebreu, avec toutes ses partitexte massoretique (2). En realite aux massoretes ;
niN lettre ; N?l$ exceptt, si ce n' est __V~~~ milieu __~/ON = n?z:~ T'l~. ~~O p. ex. Ez 17, 15 9'ON N':I:ll c.-a-d. « on a qarnes bien
r~p
est appele particularites
cornmunement
qu'il n'y ait pas d'afnalt
ou de sij pasuq ». deux, p. ex. C'~~~ ':l deux accents r
de notre texte sont anterieures
La liste dans
WICKES,
Accentuation 0./ Prose Books (cf. § n), pp. 120 sq~.
forme recente i"l1\~~ou
,n:ll apes. l'
':l (com me signe numerique)
(2) iJfassore repond
T
a la
M1~O~ our p
•
't;'J~ f. ,
n~~'qui
T:
a un dagesi. (ou un. maj>piq); horsde
91 jeuille,.
page.
11~$~tradition,
du neo-hebreu 'CC tradere, Le mot n'a den decommun
aveCrT:I.6~ d'Ez.20,37t
"'~'r,. l't1'P.t petit. f
':'In' projane -,:
CV~ accent __
"r:' abundans, ,-
r;n
__'Q':! deficiens, defectizrus (cf. § 7 c). de trop.
16d-e
Massore - Qere-ketib
48
49
Massore - Qere perpetuel - Lectiones mixtae
16e-g
~p~ l' Ecriture : l'I¥p~ partie. K')= K?":!tI~K';t9~)autre exemplaire : pi. r?'j~ r':'9~:=:« exem~laires; rn. f. iln) quiescent (non prononce) ; '~I~~oint .. '~i': p r
K~ plein; plene scriptus (§ 7 c);
1" 1"'1 T
rK~ ici; :1'~? (§ e); '"
l'I'?' (de l'I'~
at?) il
1l
'y a pas, non est
qere ne pretend archaiques.
pas touiours
donner la lecon meilleure en soi, mais Souvent le ketib conserve des formes
meilleure d'apres les manuscrits.
Qere perpetuel, Pour quelques mots frequents, qui doivent etre Ius
autrernent que 'ne l'indique le texte consonantique, on a, par economie, le omis la note marginale indiquant les consonnes du qere, Voici ces mots: 1) Le nom divin iliil':
'I :
pomte.
we = C'!r::t~C'!~,?
du uerset,
d'autres :
livres;
,,~conjecture; nombre ; ~
f.lEtOV) symbote, mot mnemonique
C~9 compte,
r9'1?(0119ie fin
ketib (Dans plusieurs cas indique une lacune). mieux
est probablernent patah de ')1K -r
l' .... :
(I)
un
KR9~separation, interualle 'i' = '",7 (§ e); C"i' ou
qame~;
I'~~~
(d'apres
• :
le qere
est ')1K <, le Seigneur »,
'I -:
des temoignages precede
anciens). du mot
[On remarquera du hatef
T -:
que dans il~il~ on a etrangement
shewa simple au lieu la vocalisation du qere
9j?'!f r~R
T -
C1i?: avant; r~OR' f. ~Op
qui
J.
Si Ie nom i'11il' est deja
(§ 32/).
')1K, on ecrit iliil' : le qere est C'I~. 0.": ainsi 1a preposition
Naturellement
il:1'A mot (en tant que compose de lettres}: rrz:! correction; .. "r-l deux. e Qere-ketib. Les remarques massoretiques les plus importantes sont celles qui se rapportent massoretes, doit etre lue; le au qere et au kerib. Le
Kl'I~'. 'l'I~' grande.
.
T
des particules etc. devant iliil' suppose la prononciation
r~devient
T
'~ devant la gutturale:
il~~9
'?'~P
T •
')1~:
'':!p
(~ 103 d). De meme, par ex., au lieu de il~ 'j1K il~~ (§ 37 d).
T -: T T
on dit i11il~ il~~, a savoir le
(participe
2) Le pronom
de la 38 p. sg. f. K'il dans Ie Pentateuque:
passif arameen : lectum ou, ici, legendum) est la lecon qui, d'apres les
qere est K'/}, Ie ketib ~il du normal il,V)1- qu'on T-: une bizarrerie le Pentateuque graphique samaritain,
(§ 39
c).
:1'~f (participe passif arameen : :.criptum)
Le qere est indique a une note margiaux voyelles du renvoyant
3) Le substantif feminin 'V) jille dans le Pentateuque
T-: 1-
(au lieu pas dans or on a
est la lecon qui ressort du texte consonantique. par un petit .cercle au-dessus du mot, nale ou sont indiquees les consonnes du texte; vent etre restituees Ruth 3, 3 on trouve les consonnes a lire;
a seulement
Dt 22, 19).
C'est
probablement que ,~; ,ait ete
''I' :
(comme K'/}): car on attendrait
elle ne se trouve au pluriel C"V:;
quant
II semble peu probable
qere, ce sont celles du texte. Le ketib est represente uniquement par les voyelles ne sont pas indiquees : elles doiAinsi dans et en marge d'apres la forme du mot et le contexte.
employe au sens de fille, 4) Pour
l'Ii,V: (cf. Gn 24, 61; Ex 2, 5).
T:
;t;1~~
'i'
Cm,'
.T
le qere est
:
C'Ster.M',le ketib C~,
•l' :
Jerusalem.
:
l'IOWl c.-a-d, le qere est
~~~ -. orme normale de le 2", p. f.; le ketib est f et en note on ecrit
'z:!~~
5) Le nom propre nonce
forme archaique.
Q~a~d un mot du texte ne doit pas etn~ lu, on omet de le vocaliser
-o~ . (Gn
"i'
6) Pour C,~~, C'~~ deux cf. Lectiones qui fait supposer mixtae.
..
YiHd!plr
est ecrit
-ott'''''
T Y·'
"
l'
pour qu'on pro-
30, 18 etc.) .
§ 100 c et g.
g deux
K;' :1'l'I:l « ecrit, mais non lus p. ex. Ruth 3, 12
Certaines formes ont une vocalisation etrange la vocalisation de
.CM.. Inversement, si un mot doit Hre ajoute dans la lecture, on ecrit, dans le texte, les voyelles de ce mot, et on indique les consonnes en note,p. ex. dans Ruth 3, 17 on trouve toujours _.. ,~~ et en note
que_les vocalisateurs ont voulu par la indiquer
"i'
».
vocalisations possibles
.CZ). Ainsi
9~~
Ps 7, 6 indique
'~K il
(I) Dans nos traductions, au lieu de la forme (hypothetique)
:1'l'I:! K~' c.va-d. « ,~~ doit etre lu, bien qu'il ne soit pas ecrit Le qere_-ketib se rapporte represente deux variantes du texte consonantique.
au texte consonantique;
Tres souvent le C'est que le
nous avons employe la forme Jehovah (dapres la forme Iitteraire et usuelle du francais,
(2)
:'I~';lu
Ytlhwfh,
it tort i:"qUah) qui est .
.~ 4
qere donne une ley-on preferable en soi a celle du ketib : mais il y a des cas oir le ketib est aussi bon ou merne preferable.
Cf.
KAUTZSCH,
Hebr, Gramm, 27" ed. (p.V;
KONIG.
cette observation imporBERGSTRASSER,
tante a disparu dans la 28" ed.) ;
P. JoiioN, Gramm. de I'hebreu
1, p. 160;
b.
4
bib!.
16 g -
17 b
Texte massoretique - Changements
dans les consonnes
50
51
Changements
dans les consonnes
17b-g
qu'on peut lire soit le qal Iectiones mixtae h 11 reste massoretique, permet
9~~soit
d'expliquer
le piel d'une
9'n~.Cette
hypothese des certaines
Au point de vue lexicographique, la metathese, p. ex.
on peut observer agneau
quelquefois
facon plausible injustifiable (').
a cote
7 ~-
de l'usuel
formes dont la vocalisation
est, autrement,
a signaler
quelques menues parttcularttes
de notre texte
agnelle (8 f.) on a :~~ teau (30 f.) on a Chute au commencement
11~;;r, (16
(13 f.) et 11~1;'~'(1 f.); f.).' Le phenomene soit
Tt.';$.
(107 f.) et de rw:l!l , cote. de 11"~it' ';:a~~ .: . (syncope" soit
dont la signification n'est pas toujours claire, et qui du mis sur certaines consonnes, p. ex. une suppression. p. ex. Gen 2, 4. Ps 80, 14 (31
10-
de consonne.
est frequent en hebreu, soit c
reste sont en partie negligees par les editeurs. 1) Les points extraordinaires Gn 16,5 sur le yod posterieur de ~~,~~, ou sur des' mots entiers, par p. ex. Gen. 1, 1; Cant 1, 1 ; Lev 11, 42 et minuscules,
du mot (apherese),
a l'interieur
tomber rarement
la fin (apocope).
Les consonne~ qui peuvent tend
sont surtout faib!es N et le ". d
les deux consonnes vocaliques 11, le ~ (q~i en hebreu Apherese, peut tomber: p. ex.
, et " les deux gutturales
ex. Gn 33, 4. Ces points semblent toujours demander
l'assimilation),
2) Les Iettres majuscules,
Une consonne initiale " " ~, ", N sans voyelle pleine dans les verbes YD imper, :l~; dans les verbes imper, n~; au lieu de l'usuel
C'
indiquant le milieu du Pentateuque), le milieu du Psautier). 4) Enfin certaines lettres
3) Les iettres suspendues, p. ex. diquant ecrites
Jug
18,30;
Y'I) imper, ~~; dans le verbe nR? prendre, ~~n3N nous on a 6 fois un5. : - -: :-
d'une facon anormale pour
Syncope. causatives
Le 11 est ordinairement
syncope dans les conjugaisons
quelque raison subtile.
au futur et au participe, p. ex.
e).
"'~p~ pour ;;~p;"J'. (§ 54 a). *
11, '!I " ", p. ex.
: : :
[PHONETIQUE]
§ 17. Changements
a Consonne quelquefcis
t~~pour t~j7*(§ 35
nN':!p~ in
occursum pour du mot: Alif prosthelique. avec sa voyelle est ajoute p. ex. Apocope. M?,~ (1 f.); miler L'apocope
Le 11 de l'article
est syncope apres les prepositions
L'N est assez souvent syncope, mais reste generalement ecrit, p. ex.
dans les consonnes.
n~p7*;
de pcur
C~~ tache pour C~N~* (2 f. C~N~).
ajoutee au commencement non prononce) la prononciation, (2 f.)
est frequt:nte
Un alef initial (en realite pour faciliter
nominales des racines 11"', p. ex.
'iI~J:'I~ hier
(5 fois)
r~~~cause a
•
i~!~ et il,repondit
mv~"* .
~ -: 1-:
dans les form~s verbales et (rae.
mln a
'
pour g
cote de
'iI~z:,
(23 f.),
~i'i~ bras
cote de l'u~~~IVi'r (2). On .. fro esprit, esperer. p. ex. C'~~~
Assimilation.
La consonne ~ depourvue
de voyelle tend de la,
s'assi-
observe le me~e latin vulgaire Tres rarement melons b Metathese
phenome~~ phonetique
dans nos langues~ p: ex. en ouverte,
a la
consonne suivante,
iscientia,
istare, estatio, Estephanus
de la preposition et nominales
r~; ainsi r~+ c~ >
Iaquelle est alors redoublee,
C~~
r~+ 11r.>l1:r~ de
p. ex. le ~
on a alef formant demi-syllabe de consonne,
celui-ci, d'ici. Le phenornene de racines detail, cf. § 72) (').
-c
est ordinaire
dans les forme~ ve;baies
(ar. biitilJ
M) cf. § 88 L a. ";'
~"I), p. ex. ~~~* pour ~~~~* de
tt-".:n (pour Ie
j,
Dans la conjugaison hitpael, le 1"1 'per-
mute avec une premiere semitique
sifflante, p. ex. *hit-sl}mm{!r
Is. IS,
> ,~~~~ gar· se
L'assimilation
n'a pas lieu dans les verbes
T --
der, On evite ainsi les groupes commun (cf, § 53 e).
ts qui repugnaient
deja au'
Z!l~~~iu
a 3'
radicale
as habit;,. du premier ~).
exception I1f.'1r.~ as donne (sans douteia tu
p. ex. cause
Le 1"1 de la preform ante
(1) cr, ~ 75 s ':J~c;~ ~ 89 j .. 91 b (2) La voyelle initiale f a ete adoptee
z:-:~ s'assimile a
une dentale
suivante,
~;~11' ~
senti comme la vcyelle la plus faible, en cette position;
c:5?? .
probabiernent ~ 68 aN. cf. ~ 9 c .. :
parce que e etait cornme
!fate.!
tres faible; ~ 21 i-plus ... :
faible que -;
(I) Four ~ cMvre la racine T;~, qui n'apparait pas en hebreu, ne peut etre hduite que de la comparaison avec Ies langues apparentees, p. ex. ar. . "ane ;.;.; cf. ~ 96 A O.
-:
17 K' -
18 b
Redoublernent
des consonnes
52 partiel-
53 ouverte, p. ex. ~ longation le cas du
Redoublement
des consonnes
Illb-c
p. ex. *mitdf}bbf1' lement
a l'emphatique
> .,~'=!~; *kittf}mmd' '>
'It, c.-a-d. devient
N~~':1. 11 s'assimile
* (I).
Si clone la voyellede
syllabe aigue demeure, une .certaine progutturale (par ex. car alors
devient (avec metathese, § b) Le , est assirnile dans
~:!~¥q (cf. § 53 e). le verbe nR?, p. ex n~~ (§ 72j).
des consonnes.
des consonnes.
t emphatique, p.ex. *kitf9ddf!q
c'est qu'il y a en r~alit~ un certain redoublement, redoublement virtuel .spontane d'une
de la consonne ('). Cette raison est encore plus forte dans
c) ou l'on ne peut guere supposer un ancien redoublement
Le , est assimile dans 1'16~ une, de 'a/,ladt (§ 100 b).
C'MM, § 20
reel (1). La consonne § 18. Redoublement
a Redoublement ou allongement on aurait le dagesh; Bien que les
un peu prolongee n'est pas longue,
elle n'est pas breve, car alors la syllabe serait elle est done langue qui a
ouverte et 1'0n aurait une voyelle de syUabe ouverte; moyenne. 11 n'y a rien de bien etonnant nne serie de voyelles moyennes (-, graphiquement ou lu}y"" lddim. Le redoublement dans les cas suivants: fort (marque par le dagesh
I"
differences du temps employe coup moins sensibles que pour
a prononcer
une consonne soient beau-
a
~)
ce qu'une
les voyelles, on peut facilement dissont separees par un intervalle en repetant croire la lettre, que la
-,
.•
ait aussi des consonnes
Pour. indiquer
tinguer au moins deux quantites d'une consonne. Quand on prolonge une consonne, I'implosion et l'explosion sensible, et 1'0n a l'impression generalement d'une consonne double (I). On transcrit de laisser
moyennes, intermediaires entre la longue et la breve.
ce phenomene on pourrait transcrire, p. ex. k"i'ldgzm fort) peut ~tre c
une consonne longue ou redoublee ce qui a I'inconvenient
p, ex.
signe
;e~ 'f}p-P?,
logique
necessaire ou eupkonique (§ k) ('). Le redoublement
necessaire se trouve
consonne "est repe~e, gue, p. ex. 'f}P? (I).
alors qu'il y a en realite con sonne unique. Le serait celui de la voyelle londit, indique par le dagesh ditvirtuel, qui serait mieux CS), p. ex. dans 1'1~ exemples En fait, aigue,
de "la consonne longue
1) quand une consonne serait suivie immediatement de la meme consonne, p. ex. ndtf}n element vocalique);
+ nu = ~li~ -, (entre
+ ti
=
les deux ~ il n'y a aucun
Outre ce re'doublement appele semi-redoubtemen: il a corrompu le redoublement Generalement
proprement
ktirf}t
't:l1f
(§ 42 e).
fort, il y a en hebreu un redoublement (piel de 1'1Ml.f). proprement lieu,
2) quand il y a assimilation, 3) quand Ie redoublement
(t) Le raisonnement et la syllabe (cf. suppose
p. ex.
r~~ pour
iintf'"
ou redoublement.faible
est demande
par la nature meme de
la forme demanderait le redoublement: qu'on aurait s'il avait
C''1~1'J les enfants. Das ces * iilJ-lJf!l, * h9i-ieldgim.
savoir une voyelle
dit n'a pas lieu, mais la voyelle est celle
a 28 a).
qu'il y a un rapport etroit entre la voyelle finale, cf. n'etait
(') Pour le cas d'une consonne (3) De l'arameen redoublement, que
de syllabe
a I.
virtuel existe comme en virtuel, pas nul, mais etait un semi-
biblique, oil Ie redoublement moyenne.
on' suppose que le redoublement restee,
a existe
autrefois et aurait cesse, est est
hebreu, il ressort que ce redoublement une prolongation comme le redoublement fort, peut
a amene la voyelle de syllabe aigue ; puis le redoublement mais la voyelle de syllabe aigue serait soit maintenant ouverte. actuellement nul, mais sa uertu demeure. actuellement nul, on devrait actuellement
(t) ROUSSELOT,
En effet, ce redoublement
bien que la syllabe
etre resolu en n
+ consonne.
Dans cette explication 1e redoublement Mais si le redoublement
r'!!! * • r:!~*,
se resolvent en ~:,
/aire entre,- (inf. hafel de
(4) Ces termes
;;»)
r:!~~, une
en
forme comme
peut se resoudre
~~t~7Dan 4, 3). (
M?~P7pour
De meme
avoir une voyelle de syllabe
anciens (daK'eslt necessarium, daK'esh euplwnicum). con-
Principes de phonttique experimeniale, p.993; PASSV, Petite plzo,zttique comparee des prinetpates langues europeennes2, ~ ~44 sqq.
(2) Dans cette grammaire Ie signe
(3)
exprime Ie
spirant (= f),
2, ~
~ 50;,
Cf.
GISMONDI,
Lingua« ltebraicae grammatica
16 « mitior redu-
nlcessaire ne s'oppose nulJement ici a facutlatif. et parmi les dagesh nlcessaires tous (sauf Ie 3·, qui est organique) sont demandes par l'eupltonie . ..: Dans certains manuscrits on. trouv:e encore d'autres especes de dagesh, d'invention posterieure, qu'on peut appeler empltatigues (cf. LUZZATTO, Protegomeni ad una K'rammalica della linK'ua ebraica
serves ici, sont assez.imparfaits: (18361, p, 197 sq.).
plicatio »,
la forme: ainsi dans les formes intensives verbales dans les formes intensives nominales ~~ , 4) dans Ie cas de redoublement gutturale) d spontani consonne dfi
~i?' ~7' ~~::t;
etc .. (non Ce ni de d'une consonne (non-gutturale),
C'~~P,~ lieux profonds, § 96 C b. Remarquer I'adjectif
t;,1!3j? ~~
i1~~j?;
la forme parallele
fb:1?
C'~~~J n'a pas de feminin ni de pluriel (§ 99 d).
dans les noms monosyllabes
r~Rpetit,
pl.
On a le redoublement elle finale, tels que marais, pl. C'~~~. Le redouble~ent elle i, p. ex. dans trouve apres (de qatalan),
spontane
(§
010
myrte, pl.
d).
C'l?1W; r~ttemps,
a voyC'~~r; C~~
Redoublement redoublement cause extrinseque, cause intrinseque
spontane
d'une
spontane se trouve assez rarement apres la voy- g (forme qital); avec suff. est.
est appele spontane
parce qu'il
semble n'avoir
pas de
comme le redoublement com me Ie redoublement spontane Ainsi se trouve
l'assimiJation,
'll?~ obligation
H1q~. II se
r;',t@j?
voir § 20 c. notamment
un i secondaire p. ex.
dans les formes intensives. toujours pour la consonne des primitive breve u (a l'exception
Le redoublement gutturales (h. "j~) de meme en hebreu sive et du ,).
ri~~ souvenir,
(provenent
r;~r (§ 88 M b).
de a) dans
la forme
Sur le redoublement le redoublement gesh) dirimens par
spontane virtuel de la gutturale euphoniques, conjonctif (§ k). -
non-finale qui suit une voyelle 'primitive
un adjectif de la forme
* eagul
devient
Parmi les redoublements (ou dagesh) ou separant
Oll
on distingue
It
que la forme passive
c,~
«rond
» fait au fern.
« rouge ~, i1~I~;
"~?P, (non i17!lP' *)('), au pl. C'~?~; pb~ « profond », i1p'~p'. C'est ainsi
*qutal, avec la forme intensive pasou " elle ne peut etre redoup. ex. *gabuh
et le redoublement (ou daconjonctif est cause mots. II faut distinguer i
Le dagesh
l'union etroite D'/iiq (aram.
tres etroite de deux
du qal, qui est primitivement
~R
':tt!llP,
(§
deux cas, le cas du ti"}fiq et le cas du mrrq,!tlq (§j).
forme qui se confond
58 a).
{1
P'I}~) c.-a-d. comprimi (la voyelle est comme pressie
entre les deux mots). L~s conditions requises pour qu'il y ait d"liiq sont moyen en syllabe ouverte, les suivantes: 1) La voyelle finale du premier mot fait toujours avec i1). 2) Le ton du premier
Si la consonne est tine gutturale blee : alors u bref devient (h. ri!lJ) «haut»
T
doit etre ou -:;- (en fait
fait au ferninin ou ,.
i1i1!l3.
T :
toujours avec la mater lectionis i1), ou -;;- d apres shewa mobile (en en syllabe ouverte, secondairement mot serait milera", mais il disparait par un accent conjonctif. la premiere syllabe.
On voit qu'un p moyen ne peut se maintenir excepte devant gutturale se maintie~t, par exemple consonne non-gutturale
§ 32 d) C). II ressort de ceci qu'un ~ en syllabe ouverte devant une
est long, p. ex.
~"~-:r.
(Mais un p prolonge
en pause, et meme
rt?bir en prepause,
iT?i'it?
cause de la liaison tres etroite avec le mot suivant, laquelle 'est marquee par le maqqef ou, plus rarement, Exemples: 3) Le ton du second mot doit etre sur le frapperons » (Nb 22, 6). Dans les mots isoles, p. ex. moyennes;
"~i'q~tfl
(forme qatil);
« danse
» meMld(h), de la rac.
~n. C'~~
(3);
~-i1~7 [6!idn-na: « viens done » ; ;::l-i1~~ nf}kk~b-b9 «nous i1?7' i1~~ les voyelles -;;-' -;- sont
atone) elles deviennent Le phenomene
Le redoublement
spontane se trouve assez souvent apres la voy-
r~tV gerboise,
veteri, transcrit egalement
elle a, p. ex. ,~~ chameau, pl. pl. C'~~~;
:l;p,1! scorpion,
de Caere
plusieurs
noms de la forme
~R~'
pI.
C'~2P;_1;
par ex.
Cer-
avec le deQiq (en syllabe aigue traitement
(1) Le nom phenicien de la ville etrusque
(actuellement
breves. Le qames, en cette position, doit avoir une nuance ouverte p, comme I'; qui recoit Ie meme un a de nuance fermee (q,).
(1) Ainsi on a toujours au redoublement euphonique
environ 50 kil. au N-O de Rome; au sud du lac de Bracciano) est
W
(cf. § oj).
Ayui..J..a., 1. Agylla (= la ronde). Le redoublement en phenicien,
aurait done existe
It
n'a pas lieu avec les voyelles fermees f
e), p, et n'aurait pas lieu avec
(2) Certains adjectifs de la forme ~i~I;:" p. ex. &';'3 '" grand rement de la forme qatul .. !'!1 a ete allonge secondairement particulieres (cf. § 88 Dc). (xciJtT)i..~) est parfois ecrit, (3) Camelus (d. ital. cammello
sont original-
pour des causes
"f"!::r
(p. ex. Gn 19,8), une fois
~~::r
19,2 (var.:
accent conjonctif au lieu du maqqef), Cet exemple montre bien la repugnance
une epoque tardive, camellus
apres la voyelle fermee (.
avec deux redoublements
spontanes !).
lIH-J
Remarques ton, p. ex;
1':0
me-rm
1) Avec I"tf le redoublement
'1
a lieu sans egard ici.
au
57 Oagesh quelquefois
Dagesh dirimens. Omission du dagesh
18k-m
"0°:
« et voici son fruit»
Nb 13, 27 (le ton est sur
dirimens ou separant, Ce dagesh euphonique se trouve
dans une consonne
la seconde syllabe).
Ce cas ne rentre done pas proprement
a I'interieur
'~f!*
du mot. Le redoublement, com me une separation
2) Le cas de -1"tt3 (avec
patah) ne rentre pas ici; cf. § 37 c. dans son edition de loin »)
avec Ie shewa mobile qui en resulte, entre les syllabes. Ainsi, au lieu de
produit
3) Le detail des regles et des exceptions est complique ; cf. B.\'ER,
De primarum ,.
vocabulorum /iterarum dagessatione,
VII-XV.
ein'U? (avec shewa moyen), qui serait la forme attendue pour le pl. est, de :l:lJ' raisin, on trouve ':1317 "in-n'-U? (avec shewa mobile) Lev 25, 5; Dt 32, 32. De .0: •
on a 'oo
meme
du Lioer Proverbiorum (1880), pp.
De merne pour Ie m~r9ltiq
Mrr9ltiq (abrege de I'aram.
P'I}J~ 'tI~ « venant
a saLes
'~~f!"i'J-q'-U?, pI.
est. de :lj?~ talon. se trouve surtout dans les consonnes liquides
voir ton venant de loin (car le ton du premier mot est mile'el), conditions requises pour qu'il y ait mrr9ltiq sont les suivantes: _1) La voyelle finale du premier
Le dagesk dirimens
_", t3, :l, dans les sifHantes, et dans la velaire
ces memes consonnes on omet rare dans les begadkefat nonciation spirante), Omission A) Un dagesh du dagesh
p.
(Par contre, dans cf. § nt 3). 11 est la proI
mot doit etre ou -:;- (en fait mile'el, soit par nature,
sou vent le dagesh,
toujours avec la mater lectionis I"t), ou -;- d (ici avec ou sans 1"1). 2) Le ton du premier mot doit-etre soit par accident, non tres etroite; simplement
(ou son but peut etre d'empecher
:
p. ex. i:I~c (var. i:I:lC) jer 4, 7. fort,
: ;.
savoir par ascension du ton (en vertu de la loi il n'y a pas maqqef, mars syllabe.
N"sigak) (l). La liaison avec Ie mot suivant doit etie etroite, mais
et meme, generalement, accent conjonctif.
fort qui serait demande
par une consonne est
omis, si cette consonne est finale. Ainsi dans le verbe :l:lC entourer, -, on dit au fut, qal ~~b', mais :lb'; au iut. hifil ~~O"mais :lC'; dans
'I' T
.0
•• T
3) Le ton du second mot doit ,etre sur la premiere Exemples:
le verbe _~ etre leger (de la rae. cent
':I':IP) au
fut. qal
~'iIt~,~, ':Ij?~; dans mais
mais C~ et, avec acc'est-a-dire longue, a
j:111 r.l3t£)n ltdjlf1db-bdk'
«tu
l'aim'es-» Dt 21,14; '-& l"tiJJ' « faisant du
.:
le substantif peuple de la rae. Ct3V on dit '~~, disjonctif, CJ'. Une consonne , . redoublee, besoin d'un appui vocalique (I).
i';J Mn'l"t
I
l' :.11'
« elle etait
aT l~i:
Ps 68,
1 R 2, 15 (nesigah);
fruit
Gn 1, 11 (nesigah);
fait des captifs s « pourquoi donc?»
19...C ,;U; 'forme ·
• "'0"
':lW n':l~
« cepisti captivitatem » .« tu as
pausale de ':l~);
• :
"0" <
I"tf ,'~,
"0"
T l'
Les voyelles ---:-, -----:;(plus breves que -;;-, ~) con sonne au redoublement drait, p. ex. dans CJ! ,~ imper, l!:l~~ (pI. C'~~~);
:
qu'on, a souvent de la
(17 fois sans maqqef,
7 f. avec maqqef).
(surtout ---:-) en cette position indiquent au moins une tendance que le maintien de la voyelle ---:-' -:;- au lieu de -;-, ~
Les voyelles -:;- -;;- atones sont breves. Le qamel?, en cette position, doit avoir une nuance ouverte, comme le segol (cf. § i). Remarques dagesh euphonique 1) La difference se trouve principale entre ces deux cas du dans le ton du premier mot. Dans le dans le cas du ici sa couleur
ou allongement faible (cf. § b). Ainsi s'expliqu' on at tenet CVi1 ; comme cote de CJ' (avec accent disjonctif) , p. ex.
apocope de M~3t (opp.
.. -
,'':IN,
T ••
,:lV);
TT
les mots
..
cas du d"ltiq le ton serait milera", mais il disparait;
mrr9ltiq il est ou devient mile'el.
2) Le fait que le qames en s'abregeant montre que le phenomene
(i) Cf. § 31 c. D'apres
':It3,1I, ... garde secondaire
n~ de *bint, § 98 d
.
:-
(opp. p. ex. :l~);
n~~ de *'aminf;
.
m
avec suff. i';Jt3'lI . B) Un dagesh fort qui serait demande
par une consonne suivie
p, au lieu de devenir if (comme dans p. ex. C~, C~, '~~; Mrt, -M~) est d'origine
d'un shewa mobile est sou vent omis, sans doute parce que dans certains cas on repugne
CZ).
appuyer
une con sonne longue sur un appui voca-
cette loi, pour eviter Ie contact de deux tons, qultu'llp (pour qult(u) euphonique de l'hebreu
Ie premier remonte. (2) Un phenomene analogue au redoublement peut se constater dans nornbre de langues, p. ex. en arabe vulgaire de Syrie:
+ lp)
e je lui ai dit s , en francais moderne
(a l'analogie de it ra);
c tu l'as •
est souvent prononce tu lfas» (§ 8 c N), ~
nd!_lj"e.
cf. § 35 b N.
(1) Cet appui vocalique peut etre un simple shewa, p. ex. dans ~~ 'flit-
18m -196
Omission du dagesh - Begadkefat
58
59 prendre
Begadkefat - Les gutturales et Ie redoublement
19 6 - 20 a
lique aussi faible. serni-redoublement L'omission
La voyelle
qui precede reste breve; faible (§ b).
la consonne
la position
de moindre
ouverture
requise par une spirante
est done moyenne et le shewa devient moyen. C' est done un cas de ou redoublement du redoublement fort, autrement dit l'abregement de
que la position de fermeture requise par une explosive Au commencement d'un mot la begadkefat
e).
est explosive si le c
mot est en debut absolu ou si le mot precedent finit par une consonne. Si le mot precedent finit par une voyelle elle est spirante s'il y a liaison, elle est explosive s'il y a separation (accent disjonctif). Opposer p. ex. pas la spila spid
la consonne longue en consonne tout dans les cas suivants: 1) Principalement dans'
moyenne, devant shewa,
a lieu sur-
initial : a) au futur apres le waw fort
r~_'1}~1 n 1; 7 G
et ,~~~
'~1
Jug 11, 5 (zaqe.f gridql). generalement p. ex.
( 1),
toujours,
p. ex. ~~
• T:-
!flfi '~lfftrl
(§ 47 a).
apres l'article, p. ex. it ou "
C""'M, a
dans
';:t~1;b)
dans les noms
Les quiescentes
N. M, " " evidemment. n' ernpechent (cf. § 7 d) empechent
moins que la sec;nde consonne ne soit
ration. Mais " , prononces Lev 7,30;
p. ex. C'1~~;:t, C'~~~;:t (§ 35 c). 2) Regulierernent
ration (ce qui prouve leur caractere consonantique), piel et pual apres dagesh) (§ 35 c). dans les sif-
1'article, p. ex.
~w.~p (peut-etre
p.
t? initial
du participe
CM'S-,,=,,
-,' • T
Ps 22.
14.
M?'~~ "!
initiale 1, 14. e
De mernea
l'interieur
-
du mot, p. ex.
pour eviter deux
3) Souvent flantes et la velaire
dans les consonnes liquides cf. § k). Exemples:
'='. ~, ),
'))M
': •
'r-1"~Job 3, 26 . Exception. La spiration
• :T : ::'
n'a pas lieu dans la begadkefat voyelle, p. ex. j:lNi~~
T •
(Par contre, dans ces memes consonnes on a (en pause ')JlM);
"0\'"
des groupes ~~, El~, :l~, apres On evite ainsi deux spirantes Au milieu ou
'~1 Jug
...
souvent le dagesh dirimens,
.,
sernblables ou analogues. est explosive J apres une voyelle ou un shewa
~'='?;:t pour le hatef patah cf. § 9 d); ( d'en bas); premiere Jer 11,21);
M~R~etc.
~~
: •
M,=,,6~
T: :
d'en haut (mais
•
Mrs~lp~
T : •
la fin d'un mot, une begadkefat spirante
(souvent
dans ce verbe dans
T
omission de dagesh
T
C';;p;l~OhlfmebtJqeSim,Ex
." : • •••
~p.~;
meme apres une 4, 19;
apres un shewa quiescent. imper. pI. ~,~: (shewa moyen). Les exceptions verbes raison
prononce (mobile ou moyen). Exemples ,~~~ iilI-b(pj (shewa quiescent);
•
(fut. de N~) porter);. 'NC~ de N~~ trsne.
kiflgil (shewa moyen); parfait 3e fern.
4) Dans le " p. ex.
C'", (sing.
':.
,~, aveugle). ...
mobile);
,~?~ mr;l-ki
(shew a quiescent); sont
;-
'~7~ (shewa mr;'"1I?
T: IT
M'~~
ka-tl-tjri(h)_
§ 19. Spiration
a
des consonnes
begedkeiet.
principales
:
;
38 gutturale, pour r-1m~*) le shewa
ou
1) le type
~T::I~
(20 f~m: des ou, pour une du'r-1
le patah auxiliaire ne produit
La double prononciation et du raft,
des begadke.fat a ete indiquee § 50; nous explosive § 10, spirante
pas la spiration du r-1(~ 70./); speciale,
2) le mot
C:~~s·tlfiim
avons parle du dagesk doux, signe dela prononciation signe de la. prononciation
mobile ne produit
pas la spiration
§ 12.
(§ 100 c). § 20;~Les consonnes gutturales
Les gutturales N, M,
Loi premiere
des begadkefat. d'explosive
Sl Sl
Une consonne begadke.fat garde sa valeur
elle n'est precedee d'aucun element vocalique; elle est precedee d'un eleme·nt· vocalique, mobile ou moyen). si
(et ') et le redoublement.
sans doute etre en hebreu comme a
elle devient spirante
minime soit-il (p. ex. un shewa prononce
Cette loi est fondee sur la tendance naturelle des organes, verture. ouverture
a l'inertie.
L'emission
redoublees, c.va-d. prolongees, de l'hebreu
rr. , (§ 5 II) pouvaient a une certaine epoque,
explosive d'une begadkefat exige dans son premier D'autre
temps la fermeture une certaine ouexige une faire pour
en semitique commun et maintenant doublees, autrement
Cf.
encore en arabe. Mais au stade ne sont jamais relongues. Mais elles
tandis que l'emission spirante comporte
que nous connaissons les gutturales dit ne sont jamais vraiment
Met,.isclre Studie», 1, p. 15, N. 1.
part, I'emission d'une voyelle quelconque ont naturellement moins d'effort
notable des -organes. Apres une voyelle, les organes qui ont
la position d'ouverture
(1)
SIEVERS,
20a-c
Les gutturales et le redoublement
60
Gutturales
20c-21 d
peuvent, comme les consonnes non-gutturales, faible ou redoublement anterieur, virtuel, c.-a-d.
avoir un redoublement moyenne fort
2) dans le singulier de l'adjectif numeral 'MN un, f. nnN (mais "0' -T
avoir une longueur
pl. C"MN). • 1'-:
Forme qatal;
comp. ar. ~"a!zad. de l'adjectif
(§ 18 b). Ce redoublement
faible est Ie reste d'un' redoublement ni le redoublernent faible,
3) dans le singulier
'tt~ autre
Cf. § 100b. (rae, ~, "~r),
sauf dans le cas du redoublement
spontane du M (§ c). La fort (sauf de peut,
f. n,nN- (Mais pl. C"MN, n'nMN). Forme qatil. ... '0° .,. -: '0_: 4) dans la preposition
consonne linguale , ne peut avoir Vne forme avec redoublement p. ex. dans le futur piel ,~~~ aucun redoublement,
'6~apres
(§ 103 n) (proprement
est.
etat
tres rares exceptions, § 23 a) ni le redoublement
est, d'un substantif de forme qatal dont I'etat abs. n'existe pas; rac.
fort primitif de la gutturale
f-' "1]1') (Mais
§ 96 C b.
la preposition avec la forme deI'etat
T : •
pl. est ":\'=l~).
• : •
dans l'hebreu que nous connaisson~, ou garder un redoublement faible,
5) dans le nom MI!:l~~ confiance
avec
suffixes, p. ex. 'MI!:l~~
ieQt/p"
« il consumera », ou ne garder
p. ex. dans l'infinitif piel
,:v~.
•• T
La raison pour
laquelle on a tan tot Ie redoublement virtuel, tantot aucun redoublement. comme dans les deux exemples cites, n'apparait '~~~. (fut. nifal des verbes a ment virtuel (§ 68 c). L'aptitude des gutturales au redoublement Elle est grande pour M, assez grande pour pour N, nulle pour'. b dans et l'on ales L'ordre d'aptitude pas. DansIe type
§ 21. Influence des consonnes gutturales
L'influence des consonnes derable. Les gutturales aiment elles tendent a I'introduire ou decroissant, une gutturale d'action M~ gutturales la voyelle
sur les voyelles.
r-
gutturale) on n'a jamais le redoublevirtuel est tres inegale. faible pour :V, tres faible
a rapprocher
-=- qui
sur les voyelles est consi- a leur est homogene ;
les autres voyelles du son a.
n,
Le degre d'atfection des gutturales pour la voyelle
est done
M> n >:v > N >,.
:v> M> n > N.
-=- est,
dans l'ordre b
Quand il y a redoublement virtuel, la syllabe est censee fermee, voyelles de syllabe ferrnee aigue, p. ex. dans il n'y a aucun redoublement,
La voyelle
-=- supplante
souvent une voyelle primitive i, u devant tonique. Ainsi le futur du verbe le L'etat
~R~. Quand
'.!7~~comme
fermant enuoyer
une syllabe
la syllabe est 'ouverte, intensive
est en contexte M~~ (au lieu de *iiSlult); (au lieu de *i"sallilj, P. ·M~'). -h"-:
et 1'0n ales voyelles de syllabe ouverte (I), a savoir les voyelles moyennes --;;-, ~ , ....:_. Exemples avec': du verbe benir on a p. ex.: c Redoublement non-gutturales virtuel spontane, guere s'expliquer spontane Cette propriete
futur piel est en contexte M~' --,:
T!~~'n~ (P.
dans la conjugaison
est, de *mizbi!t est M~t~ (abs. M~t~ autel). _: • _'0: • .La voyelle -:- se glisse furtivement rales, devant une gutturale fermant aux guttujamais c une syllabe tonique finale, apres les voyelles heterogenes
't!~),
!1!~ (cf.
§ 18 e).
du M. De meme que les consonnes s'explique par la nature du son
(§ 18 d) la gutturale M prend parfois un redoublement
savoir
les voyelles longues ij, i, ii, qui ne peuvent et les voyelles moyennes
{!,
lr
etre supplantees,
(§ 5 k). Ce redoublement
est un phenomena
par l'atfaiblissement se trouve: de M~.frere
d'un redoublement
secondaire;
il ne peut fort , car il
constances, ne peuvent pas etre supplantees, Ceo pittoresque pata!t .furtif, cedente une diphtongue
:
-=-,
{)
qui, en certaines cirappele d'une facon bref; il est employe ruJ!t ou une syl- d
(!,
est un " extrernement descend ante, qui ferme primitives
se trouve en des mots ou la gutturale ment. Ce redoublement 1) dans Ie pluriel -:;- cf. § 29.f); cf. § 98 b.
ne demande pas de redouble-
ici en fonction consonantique, rita!t (1); info est. ~'. n _ labe atone,
c.va-d, qu'il forme avec la voyelle prep. ex. _'Y1' « esprit»
(ou est censee fermer)
(tt
"a!z~'im, et avec les suffixes legers, p. ex.
''='~ (P.
"a~)
a l'etat
abs. C'I}~
'!]~), "'J~ (pour Ie
compensatoire de la
Avant une gutturale les voyelles
i, u leviennent
1, p. 169. ce merne mot
en hebreu _,
p,
(1) II n'y a done pas lieu de parler d'allongement
(1) BROCKELMANN,
1, p. 198;
rU1/J.
BAUER
En arahe vulgaire ee
voyelle, car on n'a pas une voyelle longue, mais une voyelle moyenne, qui est normale dans eette position.
m eme phoneme
« va-t'en
I
existe,
par ex.daps
r')
c esprit.
et vulg.
», qu'on prononce
21 d-i
Gutturales
62
63
Hatef auxiliaire apres gutturale
21
i - 22 c
c.-a.-d. sont *it"'-sam *muc-mad>
rapprochees
du son 9- (assimilation coupable », *ii!t-zaq
» (").
partielle),
p. ex.
hatef est legerement Beyroufh, cf.§ 29 f.
renforce pour contrebalancer
le ton (cf Melanges
> C~a;t! «~l se rendra
'OPO « place
T T: IT
> P.!tr.. «
il sera fort »,
5 " p. 374).
Sur Ie changement d~
-=- en -:;- devant
gutturale suivie de qames, j
Remarque.
Bien entendu, une gutturale
n'influe pas sur la vode
calisation d'une syllabe precedente ; ainsi un shewa mobile precedent n'est 'pas modi fie. p. ex. e Apres une gutturale moindre. En syllabe ferrnee tonique on a assez souvent mitifs, p. ex. ~~
°
0"
~tnP, nlJ~' C'?~~(pluriel
"~e),r1~1J1'
est beau coup
§ 22. Du J.tatef auxiliaire apres
gutturale.
tout comme comme a
l'influence de la gutturale
Une gutturale. peut etre suivie du shewa quiescent, une non-gutturale; p. ex. au futur qal on trouve un hatef, on a ,~~~
-==;'
T; •
pour i, u pri:. -.-
i'!~ir!t-z9-q,
«il egorgera
pour
*iis(zut,
»,
~i"W' *; 'P;" pour
pour -:-, p. ex.
i.ili-bfpj. Mais tres souvent au lieu du shewa on a une voyelle
de la me me couleur que ainsi, au lieu du tres rare
,P"* (fut. inverti hifil de "P) «et il attesta
'1'-
auxiliaire tres breve, normalement la voyelle pleine;
En syllabe ferrnee atone on a assez souvent dans le parfait hifil des p. ex.
n'" on
n'l'
T:
'P7~ (de
P?~part), ''')r~(de '.~~ secours,
'~~IJdenude
','
a. cote de
n"~n;dans
anormal).
i'!~... 9Q· ir!tf-z
impossible ainsi
i'!~ on
a ordinairement
Ce hatef auxiliaire a pour but de faciliter le passage de
les noms,
la gutturale
la consonne suivante. Cette voyelle tres breve est parest
doublet fern.
n;~~); dans
tagee entre les deux syllabes, de sorte que la division syllabique
les verbes,
p. ex.
Is 47, 2 (dagesh
(cf. § 27 a), comme dans Ie cas du shewa moyen (§ 8 d); par
Apres une gutturale sonne non-gutturale A l'interieur
on a un !tate.! dans les cas ou une con-:;-.
aurait shewa mobile, p. ex.
~~or?:~,,~~;'b~: "b~.
= )~); _,
u.
'bp'~_peut s:exprimer graphiquement
L'emploi
irr~~d.
12.
En realite b
du mot Ie hatef est tres ordinairement
ce hatef est un shewa moyen colore. du hatef n'est pas regi par des lois strictes; il y a beauOn remarquera les points suivants: voyelle atone. et ne se trouve qu'apres volontiers peut le hatef ; favoriser coup de variations et d'incoherences, 1) Le hatef auxiliaire 3) N et P prennent volontiers.c, . hatef ; . ou non I'ernploi du difficulte -du passage de la gutturale ,~, une consonne de la nature de cette consonne. se trouvent (§ 96 A i), dans la flexion du verbe a. I' ,gutp.ex.
g ~ h
A l'initiale, apres pour i; -;;- pour de
n, n,
P on a -:;- pour a et i; assez rarement
u, Exemples: de C'j?1:!;
~it3'i?!'a cote
'~~ vaisseau
't!,
,~r,r maladie,
I
';00.
ane (de *!zimiir
'~P, misere
pour pI.
(formes qutl). i; -;;- pour 'ilah c~D;
A I'initiale, 'apres
N on a -:;- ,pour a; ~ Remarquer
2) Le hatef auxiliaire est plus frequent que Ie shewa quiescent.
Exemples : '~~ etat est. de ~~ pere " ~,~ (forme qull).
C';:r,~ (arab.
s'en passent
tUlj~ homme (de *'uniis> *'unqs, d'ou par dissimilation *'inqs > tUlj~, § 29 h).
encore ~ dans' Cependant dans les formes primitives (heb, ~~~) p. ex. qital (heb, ';!;~j?) et qiful ~, merne a. 'l'etat cst., au lieu de ~ on a generalement C~~~creche (cf. § 30 d). s'eloigne du ton, il devient generap. ~~:.
,-
en' effet, la '~'12 mon
4) La consonneeuivante
suivani:edepend
';r~ceinture,
Les applications mats pain
Quand, dans la flexion, ~ lement -c
tur~le (§ 68) et du nom segole Changement
a 2" gutturale,
SOil
, p. ex. C;'N, '01N; prep. "N, poet. "N, C:l"N. De meme
'.':
le grou~~ -,I','
devie~t
~en-~ralement -'" -,
-:
'l=l,5V~'Zach 3
• :.::
mais
'l=l,~pm Jer
. : - -'1-:
I'"
"
4 le
du \la!ef en voyelle pleine. Quand, dans la flexion, du mot, la voyelle qui vient apres le hatef le hatef devient voyelie pleine, p. ex.
i'~~
;'p,~son garron,
Aj).
auure (~96
15, 14. doit etre considere comme un renforcement:
par suite de l'allongement ,~~~,
Le phenomene
d~it devenir sl1ewa (prononce)
mais ~,~~~_. Le. shewa en cette ' position est moyen (opp. est impossible
ou le second shewa est mobile). Dans une forme comme ~'OP'
(I) Participe hofal. Opposer ~~~~ plus frequent que
~'~p~ la di-
~~R~ (§
57 a).
vision syllabique
(§ 27 a); elle l'est merne deux fois :
22 (-
23 b
Hatef -
Consonne ,
64
Gutturale
It
24a - d
1) Ie second patah est unevoyelle les deux consonnes entre les deux phiquement mais par
1
auxiliaire
qui est partagee
entre
V et ~; 2) Ie shewa est moyen, et done partage
~ et ,; Autres Ie mot peut done se rendre graexemples:
2
§ 24. De la gutturale
L'alef est la plus faible des gutturales. que nous connaissons, meme il disparait sur M maier tres souvent de I'ecriture.
M.
Au stade de la langue prononce : parfois de M voir § 5 j, a
consonnes
97V~ (Cornp.
;;:;;;;;e tj~.
i'p'~ mais
~~~;
i'p'~
§ 65 c et 96 Aj: ~ auxiliaire sans gutturale). Pour
ne s'emploie pas toujours,
il n'estplus
Ie meteg, cf. § 14 c 3.
(Sur la prononciation
De meme que Ie hatef auxiliaire
merne cette voyelle auxiliaire; J
ainsi a. cote de I'usuel
~pm~. trouve on
de
lectionis § 7 h). dans une syllabe fermee d'une fa- h dite, coupable » (la syllabe est fermee semi-fermee, p. ex. :l,'J~.! ~~., ». il fermee, c.-a.-d. apres un redou-. (') if « iI a commis l'adultere d'une syllabe qu'autrefois L'alef non c 1) dans une syllabe fermee proprement
L'alef est reellement prononce ~on quelconque, a. savoir: .'p. ex. comme blement
~l?r", dans Is 28, 22. ,; ...
?,
..
'n y
a quelquefois suppression
p. ex .
.,Sr:'?
au lieu de
1 Ch 15,26
(var. P.),
TT
"!bt!'?-* § 68 e; tres rarement apres f: .,r~~ tres rar' apres 1: "!~l!J Job 4, 2. Voir encore,
TT
secondaire du hatef apres la prep.
c~~~ir' -sf}m
d~~s ,~~).;
« il se rendra 2) en syllabe
(§ 22 a); 3) en 'syllabe virtuellement
virtue! (§ 20 a), p. ex.
avec les verbes il',' '~t il'n, 'Ies formes 'comdte
ni'", r
:
§ 79 S.
9~~ni'
Dans tous, les autres
cas l'alef n'est pas prononce.
§ 23.- La consonne ., comparee aux gutturales.
a bien La con sonne linguale ., est traitee en partie comme les gutturales, qu'elle ne soit pas gutturale Comme les gutturales le redoublement dagesh) ill'a 11~~ mpr;~i.· quelquefois certaines /) virtue!'
. prononce se trouve ou apres la voyelle d'une syllabe qu'autrefois il commencait
!e,rmait, p. ex. M¥~ de "masa' (alef quiescent); actuellement
ou devant la voyelle Ia syl-
C)l par ex . .,~~ de *'amar,
(§ 5 n).
II n'a jamais par Ie fort (indique
prononce dmf}r, comme si la voyelle cornmencait
Ie., repugne au redoublement. Quant au redoublement uu ? 1 S 10,24; Pr 14, 10; euphonique
labe; .,~~ « il expliqua»
hr-'rr
(prononce
br-rr
avec simple hiatus
"
tres rarement (jamais apres I'article). On trouve toujours
(3 fois) Cn'Niil
C)
avez-vous de»
:<- amertume
apres
'!n~l1~~-N'
(de!ziq
17, 25; 2 R 6, 32 +:
«ton cordon dans
entre les deux voyelles, comme en francais beat; Ie ,heros, prononce .- .. le-erp) (~); ~N")~~ ii-r'u <, ils craindront»; ~N")~ iir-'u « ils verront s ;
: 11'
ma-f"'u ;'NOl: •
De la quantite
kis"i
(avec shewa moyen §J8_m). .- ....... la voyelle qui precede N quiescent. Nlermant Une d la syllabe de~
de
ornbilical ne fut pas coupe » Ez 16, 4 ; '~Ni9 un dagesh editions.
«que rna tete » Ct 5, 2; ou m{!rf}(tiq),
voyelle primitivement vient normalement
breve qui precedaitun
moyenne, en syllabe ouverte, par suite de la quies-
"1?!1 de
Comme les gutturales,
Ie ., final aime la voyelle
"~O s'ecarter, pour le qal
"'?!1*
-=- (2).
cence de l'N; p . .ex. masa' Exemples: (§ 80k);
> M¥~;
miifl'"
> N¥b;
meiU'.>
(opp,
et pour Ie hifil
.,~*
...
ma#l'>~~).
(i) Dans ce cas I'lt est devenu un simple support de voyelle, comme
N"~' de ilN., voir (qal futur ilN.,,); (f~~~ apoc~ de il~"1~)i se confond avec '!M,
••
.,:It'.
-T
.,:lti', et il tint Ii l'etroit, hifil de .,:It, rae . .,.,:It, hifil -~Mais avecon a .,:lt~, et il fut etroit § 82 h; .,~~, § 73 d.
'.. .:'.-
"~!Jet /1 ~~sitgea, de .,~:lt, pour "¥!1*; la fo~me
"~k, "P~etc.
-
la forme se confond avec Ie hifil
l'alef arabe (I) sans hamze (~). 11serait tres etrange qu'au stade de la langue
on
l'alef n'etait
plus prononce en fin de mot [ou il est facile
prononcer) il beau-
ait.ete
prononce en commencement de mot on de syllabe. Cependant rneme au dernier stade de la'langue.
Dans les noms on a =:> p. ex.
(I) Le "
coup d'~uteurs admettent une valeur co~onantique. (I) Remarquer
pour alef en commencement de mot ou de syllabe nul, il
apres Ie 1"1 interrogatif,
n'est pas traite comme les gutturales ; parfois la voyelle a.
que, bien 'que It dans Mros' soit phonetiquement
ainsi I'on dit l'1'N-!1"1
as-tu vu.~ (§ 102 n).
a un effet phonetique dans des cas comme le ktros (non *1'Mros): Cet exemple peut aider a eomprendre ce qui s'est passe -pour at. , P. J060N, Gramm. d~ I'hebreu bibl.
(2) En sy~i~~~e r et merne I finals amenent
24d-25d
Gutturale
,. - Gutturale :1
66
67
Consonnes
vocaliques " '
26 a -: e
Rarement « tete ~ de ra's> fa'n (cf. arabe gement
la voyelle ras
devient
>~
longue -. Tel est le cas dans ~
(§ 98f) et dans
I
r~ «petit
betail • de mots l'allon(cf. § 98/).
§ 26. Des consonnes vocaliques 1, '.
Les consonnes sonantique, disparaissent devient vocaliques . 1, ' perdent sou vent leur valeur conparfois ii h a
ra's );
et t/a'n ;~). par
Dans ces deux
a peut-etre
•-: I
ete favorise
le monosyllabisme
se contractent completement
UJf
sou vent avec une voyelle precedente,
On a aussi
C'3rKt.3 • balance » (en arabe rae. Jf4Z4M). "'II;?iO « lien », de ina'sir (~ omis dans la graphie); cf. § 88 Lk.
11 faut noter de plus 1'11 de
'a' est devenu en semitique
Le groupe . conjonction
devient
',?N
(fut, 1· p.): ~ occasionne
le groupe
primitif
t, p. ex. iii,raJ
commun
's, d'ou heb, '11 (cf. § 73 h).
des contractions, ce~ta~nes mamtient parfois
> ~,~; avec
e. ,po ex.
*kul1Jab
> :l~'.
Le groupe .~, ~, ~,
les prepositions »: '~'~,
on a p. ex. avec ~~ « jours.de ii final peut devenir
'~,~,~,,?, '~'~,
r~et la
Contractions. p. ex.
Par sa quiescence
'b~.* > 'b~?, C'~~* > C'0'~? 103, h). Dans (§ formes du mot ri'~ apres f' f' 7, 1, la voyelle breve -=- se en syllabe ouverte, p. ex. ,?,~~,~,~~ 103 h). , (§
Deplacement des deplacements de voyelles. de voyelles,
.
'1?!
(cf. § 103 h). Le groupe M --::- p: ex. J"mimii (forme- qillil); tantot lamiinin
> M~b~
cf.
(cf.
arabe
ot,j) « huit »; M~~ « altie;» "" . Nominalhildung, p. xxx sqq.
Les groupes en
'B~RTH,
Par sa quiescence ~'occasionne p. ex. C~~~':' « 200»
•
a'll, ai tantot se maintiennent,
sont contractes l'etat est . l'etat
pour C~~~~lt (de pour M~~~*;
9, ? (moins souvent ?) :
A l'etat absolu on a
"NO~("Kt.3~)
r" ." I
rncO); '):l~&iMM Rubeaite s de «Ie
l'
r~~~!; M~N'?~ « affaire»
§ 21 k. M.
aussi tres prononce.
r,,6,
v
T
mais avec
ci', ~~, cilt
(d'apres
I
de *si",-'al. 'Sur la ~ocalisation de I'~ initial, cf.
§ 96 A I);
cst. souvent n'est-il
a l'etat cst. niO,
on a
ci',
•-
etc.
A l'etat absolu
n'i.
e).
i1 paragogique
Mn'i; a
T :-
§ 25. De la gutturale
a Le M est une gutturale pas prononce. assez faible;
n'~ e).
La particule negative
r.~devient rtt en
-1'
liaison (§ 160k).
'0" T
Le substantif sadai, poet. ,,~ etc. mais '~O dans
devient abs, ~
, est, ~.
..
Devant
.Le M
les suffixes, la forme du nom pluriel susai I'interieur
du mot est toujours Le M final en «haut », ~ 14k
devient 'E?~Odans ~)'~
1'~~. ~O, mnr-nth «
... _:_:.
§ 94 d.
au, ai etc. cf. devient
general est quiescent; «
aussi, quand par exception il doit etre prononce,
on le marque du mappiq
(§ 11 4), p. ex.
mot la massore que
13~ gagp4k
demande
Sur la prononciation forme apocopee de
des groupes
§ 7 d.
_:w_n
En finale. Jf, i, apres consonne, deviennent il adorera», '. devient,~
u, i; p. ex. 119-1iiJ/9-' lzl1, d
elle ». Pour ce dernier
dans Nb 32, 42; prononce ; rafe
Zach, 5, 11; c'est pourquoi, Autres h
i
Ruth 2, 14 (§ 103 f) du
le M ne soit pas
pour plus de clarte, on ecrit alors
Ii? avec
(§
(§ 79/);
devient
12 a).
'ne .-.0.0
sa'le'll «natation»
~nr.,~
u9-iiiSt9-'lzu « ingenu »
-
(Ez 47, 5);
pa'#.
exemples
suffixe fem. M -;- sans mappiq:
avec
Ie verbe
Reniarquer
que ces u, i brefs, sont
necessairement ~ c'est-a-dire
ecrits plene. la simple (cf. e
~\ 61 i, avec le nom Pour la syncope Au parfait
§ 94 h,
du M cf. § 17 e. syncope du M et redoudans. beaucoup de
La conjonction
1 devant
labiale
devient
blement du Le M du pronom formes, d p. ex. *Iaku kii
~,,~?~~par et, n) ~r-I?~~; M~5~~ § 62 d). (cf.
3· p. f. on a
voyelle u, probable~ent
breve (cf.
§ 14 c 2), p. ex.
t?~~mrt rls u
'1'1'~~ . ... .
;-
§ 104 c).
(l) On remarquera l'absence de contraction dans I'!;'~ injustice (sans
.suffixe 38 p. m. disparait 'a' devient 'ii
> lau > i'; Piku > 1'~ (pi'll).
>'9 (§ 24 d) le groupe
Exemple unique *kakl'ik
doute pour eviter la confusion avec I'!"I~ kolocauste) et da~~ I'!VlIZi cri au secours (pour 1'!"1Zi* de ~11Zi crier au sec~urs); cf. aussi § 79 a ... : -. (2) Remarquer l'absence de contraction
T :-
De merne que le groupe kak devient
> k9.
> '!J'~M (§ 75 g).
dans I'!"'''< nuit ~ 93 r N.
69
La syUabe .
27 c-
28a
Consonnes vocaliques ~ , ' - La syUabe
68
Le ~ initial. proprement ii, semble avoir ete prononce
simplement est ecrit ))
i, du mains dans certaines
~ dans
ecoles. Ainsi le nom propre ~ par
Haire .(§ 22 a), p. ex. 'bp'~_*i(l'fm{Jg; dans le cas d'une voyelle pleine . auxiliaire remplaeant un hatef auxiliaire (§ 22 c), p. ex. ~,~~~ i(lif-gu; dans Ie cas de. la voyelle auxiliaire des formes segolees, par exemple
1 Ch 2, 13. D'apres
Qimbi ~j?~ se prononce iqtpl.
f - . Un
If initial est supplante
i.
p.ex:
*Ifalad
> ,~~~enfanter
'.,.,0 ., de
sU' P' (proprement
Sf!'f",
(§ 75 a), de sorte qu'on ne trouve pas de mots commencant
,r",,,,
T" ... T
non la conjonction Lesverbes
1, l'usuel
3e
par " si-
rr,), ,. §79 y:.
t) ('). 2) 1a syllabe virtuellement fermee. p. ex.
§ 96 A h), ,~ '!fl}iiig'f' (forme apocopee .
C'est une simple variete de d
cas du redoublement
'; «crochet primitive
s , ·deux noms isoles et suspects If ont ete absorbes par les
la syllabe semi-fermee, celle virtuel,
qu'on a dans -Ie
et quelques
noms propres. radi~al~
~~1
'!fl}i·ql}#fl (§ 18 h), ,~~~ (§ 20 a); C'J:'1~ (redouble-
ment spontane,
verbes
a s-
radicale
i (§
k).
79 a). inais tres rare
§ 20 c). Remarques 1) Les demi-voyelles,
savoir le shewa mobile et des demi-syllabes, que des syllabes
A cote de la (orme normale forme rare
C~i? (de
~)
on a la
les hatef en position de shewa mobile, constituent p. ex. dans 'b~. Dans les lois rythmiques on ne tient pleines; ainsi dans dissyllabe (cf.
•• :1
C!i? (§ 80
~i?' ~R'
compte
§ 27. De la syllabe.
a En hebreu, comme n'est pas toujours labes normales; h· Une-syllabe a tue)) . riture» q4-f-ld(k), quand en d'autres langues, la division en syllabes
'i~",;; Ps 28, 1, le premier mot est compte comme § 31 c). De merne, on ne tientpas compte des voyelles § 22 c).
commencer toujours par une conla sylle cas avec du initial il eo est ainsi. Mais phonetiquement tel est souvent
••••
auxiliaires; p. ex. dans ,"'-AT mQX7~ Is 50, 8 le premier mot est compte T: -01• comme dissyllabe (cf. 2). Une syllabe est censee sonne, et graphiquement
possible (1). Quand elle est possible, on a des sylelle n'est pas possible, on ne peut parler que-dites ou anormales. est ouoerte oa fermee. dans ~~ « elle
de syllabes irnproprernent norrnale
labe- commence parfois par une voyelle;
'I
La .sylJabe ouuerte se termine" par une voyelle:
N, p. ex. dans des mots comme .,QN, 'N:!l ou l'N n'est pas prononce
qd et td sont des syllabes ouvertes.
La syllabe fermee se termine p~r une consonne: d~s 'p/!-lack), 'lI,Q « mon roi » ml}l-ki, Ies syllabes . . :-
.n?~~ nour«
·pif. ml}l sont
.. ~
(§ 24 c)" dans le cas du ~ initial (§ 26 e) et peut-etre
(§26 e).
fermees. Quand la consonne qui ferme la syllabe est longue, la syllabe . c est dite aigue', p. ex. ,~~ "am-mi, '~~'ji!~; M~?, ~.;IIJ!'
c
§ 28. Des voyelles par rapport aux diverses especes de syllabes.
~~>
<
II y a certains rapports :entre telle espece de voyelles et telle espece a
de syllabes (I). Certaines
Les syllabes anormales lement fermees. shewamoyen
(1) SEN,
en hebreu
sont des syllabes dans
imparfai~ le cas du hatef auxiJESPER'
voyelles sont impossibles ou exceptionnelles un tableau pratique
des rapj
On peut distinguer: 1) la· syllabe semi-fermee ('). Elle se trouve: (§ 8 d), p. ex. '~~
dans certaines positions. Nous donnerons
mfll"/!?; dans le casdu
(t) Dans ces formes la derniere voyelle est en realite tres breve oil Ie, -;- n 'est pas auxiliaire (division syllabique : un f ouvert. L'orthographe acadernique
au con-
traire, la voyelle finale est breve dans les formes comme :tzii, (du futur :tzi') Sur ce phenomene important de phonetique, voir notamment der Pkonetik (1912) p. 153, Lek,.huck
~i.-i.~I-jfg)."-,
..;.
Elementa,.huck
der PIwne~ik2 (1913)
(%) C'est ainsi qu'en francais moderne, e en syllabe fermse est toujours
p. 202, oil il donne de bons exemples de l'allemand, leurs analogues en hebreu, (2) Ce terme est preferable de syllabe fermee.
dont quelques-uns ont
ivitu:meni suppose la prononciation
e-vb,-ment.
de I'e muet et la division syllabique t-vi-ne-menlj en realite, I'e muet n'etant semi-ouuerte, car les voyelles sont celles plus prononce, Ie mot devient phonetiquement
28a -d
La syllabe
70
71
La syllabe
28d-e
ports les plus usuels, qui permettra grossieres -:-, dans la vocalisation voyelles -;-, qu'ont
a I'etudiant
d'eviter certaines fautes considerons ici les correspondantes (cf. l§ 6 g). Les ~ ne font pas ferrnee atone,
miere syUabe
qit
de ~j? et la premiere syllabe 6~ de breves et moyennes
'n~ sont a a
peu
des textes.
Nous
-::-, _:_ comme moyennes, ees voyelles
les voyelles atone syllabe
pres isochrones. 2) Les voyelles egale. Ainsi -;;- dans ,~~,
(§ a), dans les memes e
peu pres
-:;-, --;- comme breves; autrement normalement '--:-, ~ et les voyelles ne se trouvent
dit, nous supposons la quantite breves -:-' qu'en
conditions de syllabe et de ton, doivent avoir une quantite moyen comme le -::- de la forme normale
en syllabe
en syllabe fermee tonique, doit etre en realite
voyelles longues difficulte : ces p. ex. 6
dernieres
~~tr. est
~p.
et
De me me =; dans
moyen comme
le -::- de qM?~p~; -:; dans
"b~, "~~~.
A. I) En' syllabe ouverte atone on peut avoir des voyelles: 'iliih'im). une gut-
~~ sont moyens comme -::- et _:_ dans moyen comme -::- dans M'~.;--=- dans _:_ dans
~Q
tt+,p; =: dans
doit etre longue)
~?~ et
-:- <dans ,,~~ est -::-'
Longues: Moyennes: turale, § 18 ti). Breves: rement ~.
l'
l"9'~~i'~. ?'~'p~,,,~~ (de qii#f) , c'1f.'~ (de n Ci~, :l?~, nC'~ (mais _:_ seulement devant
seulement
rogatif § ~02 1l:
t'~p« irai-je
a
• T IT
dans des cas speciaux, p. ex. avec Ie ? »,
C?':'O
'1~7; Ie --;- anormal comme le - de c'~e
11' •
'~1' , ibR; --=~
de
TIT '
C't!'J1i? qp-ga.Jzm
(a cote de
dans
'~~p est
"~R est moyen
moyen
comme -;-'
comme -::- dans moyen etre
(§ 6 I)
pd.-rd.-Jim. (non primitivement doit
inter-
Une voyelle
posttonique
« num sapiens? »; tres ra')M « vaisseau ». T:
-c
breve, p. ex. --;- dans
M~6
p. ex. C'~I~ (§ 6 I);
mais cf. § c.
Tres breves:
Longues: Breves: c
savoir les hatef : ')M, ~)M, • -: ...:.
'a'nli, 'a'tti devenu z;t~);
'---:-
e)
C1J)'I!1~~R'M~~, M~~,
(comp.
dans
'l,=I7~R;~ (I)
dans ~)~}~, ~M~~~
2) En syllabe ouverte Moyennes :
n~a_t, ~~i?1' ~)'?~i?'~)?;~n?~i?~'~)r;?~C:amai~ _:_. j seulement dans des cas speciaux, p. ex. '~?~P'1J?~~;
mais cf. § e. atone on peut avoir des voyelles :
~t3~p:, n9ip~. ~Q'~'
tonique on peut avoir des voyelles :
(§ 26 d, 79 I) . De meme - est bref dans le cas du d"!zZq (§ 18 i) M;-M:l" et IT T:
du m~f!J.lzq (§ 18 j) Malgre I'identite que le
Mf ~¥~r:t.
l'
essentielle de quantite il a pu exister de legeres
differences; ainsi le -::- de
jamais --;- (ni --:-, ~);
"~P etait
considere comme un peu plus long
B. 1) En syllabe ferrnee
--=-
de la forme de liaison
"~i?(3).
devient en realite moyenne, voyelle devient breve (4), qu'une
Breves (seulement): ,~~, 2) En syllabe fermee tonique voyelles:
'P7ry, '~1R' CR~' '~~ry.
non finale on peut aVOIr des
3) De la nature energique du ton en hebreu (§ 15 a) on peut conclure qu'une voyelle
.en pause est longue
toni que breve
qu'une voyelle moyenne posttonique
Moyennes :' M?~~pf.j, M?7rOPZ:!' Breves: - normalement : n),i:!r-1; rarement
T : -: •
n~!.n~,?,
des degres divers. reelle des voyelles est une question la g.raphie (signes vocaliil faut, dans chaque cas, eonau ton. Pour la determiner,
4) On le voit, la quantite ...
et seulement en
complexe et delicate. ques, matres
syll. aigue, p. ex. dans les suffixes ~; -;-, '~-;- etc.; jamais -;- (ni --:-' ~ ). 3) En syllabe fermee Longues: tonique finale on peut avoir des voyelles :
lectionis) est insuffisante;
Moyennes : Breves: souvent ~: d ' Rema~ques'.
C~i'~. 'p~,c,;~i?' C '~1' ~, iiot?· ,
siderer la nature de la syllabe et sa position par rapport
(t) et (2) A la finale un (3) En arameen
i bref et un u bref demandaient une mater lectionis.
_:_ (cf.
"~R' ~p
.
biblique, en syllabe ferrnee tonique finale, les voyelles
(forme de liaison); assez rarement
-::-: ~'=J ' np~,,,~!~;uffixes s
C~, '1) En syllabe
P ; Ct', it'; jamais
atone, une voyelle
moyennes -,
sont censees un peu plus longues que -, Syrisclze Grammatik
Ci?7T, CI~~'
2,
e 47 d).
-=-;- (ni ---:-' ~).
primitive breve
Sur la quan~ite r6elle de _:_ et de 0 en syriaque, voir les rernarques instructives de N OLDEKE, comme jussi f
ee
47, 48.
reste breve en syllabe fermee et devient moyenne en syllabe ouverte. 11 se produit ainsi un certain isochronisme syllabique. Ainsi la pre-
t4) L'abregement
apparait c1airement, en syllabe ferrnee dans des cas
=t":' =t1;';
29a-d
Changements
de voyelles
72
73 les verbes quiescents de contexte
Changements
~!),
"~Mt
de voyelles
29d-f
est la forme pausale,
(§ 73 d). Dans la flexion du type
fi?t
"~a:t'la
forme
l'etat
est. est
f~!
§ 29. Changements de voyeUes.
a
(§ 96 B d) (') ..
A la penultieme fermee tonique On a souvent -::- pour -::-: ,~~,
Les changements de voyelles, soit par rapport aux voyelles primitives (§ 6 z), soit I'hebreu.
a l'interieur
de l'hebreu, sont extremement
frequents. de
1!'1~; ~~, 1!'~p,
z;t~i?'}*)' a 'sa~oir:
find reste
et semblablement
au hifil
z;t~j?t"
(pour
*hiqtilta,
chose,
La grande mobilite de la vocalisation est un rrait caracteristique des voyelles et la nature sontsouvent voye~les b des syllabes. Les changements
La finale pluriel fern'. du futur find devient au hifil
souvent ~lntl, quelque
Cette mobilite est du reste tres inegale, selon la quantite de voyelles dus au deplacement du ton (De meme les chutes de
i'I~~~l.:!afin (
de garder
de l'i caracteristique) : rind reste generalement l'hitpael on a generalement9lnd; peut-etre a toujours (malgre en pause (done comme dans les conjugaisons
au piel, tandis qu'a
au nifal on a toujo~rs 91nd, meme passives pual, hofal, et au qal des verbes ,.., on
§ 30).
.• Les voyelles longues generalement s'affaiblit souvent en verbes ,., au parfait: ousecondaire: sporadiquement et
(proven ant de ii ou de a~), U, i sont
l'analogie de ces conjugaisons); 9lnd:
tres stables ('). Cependant 9, en syllabe devenue atone,
u (Avec l'affaiblissement il y a un certain abre-·
i'I~~;;~.A 1'impe~~tif on trouve seulement i'I~~?t i'I?~?~)t le piel i'I~\~,? DE, § 612). On trouve une fois e (3fA
gement). Le phenomene est regulier dans la flexion du nifal 1'9 devient uquand
C~P?des
la forme .anormale rind ~
m't9.ir."
l' : ",' -
;-
Ez 13, 19.
7
il est prive du ton principal 80 I) (I). On observe
La voyelle breve -::- peut s'affaiblir soit en -:;-, soiten Ces deux degres d'affaiblissement ment la quantite. Le premier degre d'affaiblissement 11 se trouve: 1) dans le type segole nominal ~ (apocope de (cf. ,~~)
(§ g)~ e
i'l9iP?'Cl;I;~,??, mais 'z:!i6~p? (§
l'on passe ,fa nuit et et i'l0~~'(3). T:
-, ~
:
ne semblent pas affecter sensiblede -::- en -;- est frequent (2). et verbal
la rneme altemance dans certains doublets :
i'l1Jll~'~"9
lieu
ou
ni)~ repos
(avec
i'I?~'~, ;)9 foil: 0
suff. 'O~~) . .:
La voyelle mo:renne ment -: -. l' T
'~':f, etat est, '~':f;
C' mer, C'~'.
l' .:
en devenant atone. . devient normale-
i'I??!)ou
§ 96 A h.
-:;- tonique, pour -::-' est dil dans la plupart par exemple
"i
l'influence du
~,~.
l' •
La voyelle moyenne _:_ , en devenant atone, devient normalement ,,~, -';Ill; ~',
l'
-:;- auxiliaire,
ou (surtout en syllabe aigue)-:
~;
1'1'-
~~"
.1'
m'ior-l;
T·.·~:
2) probablement devant une non-gutturale, mination »
des formes mrqtdl, mrq(ldk
La voyelle moyenne -::- ' en devenant atone, devient normalement -::- ou (surtout en syllabe aigue) -:
•
rne, -rue;
•• ','
~C', ~o.,; ~::lO" m'ior-l;
•• T " T"T T '••• :
e).
i'I:n,~
TT : ....
« char »,
i'I~~~
l' 'I' :
...
« do-
3) dans « votre main)
quelques de "
»
I
T
cas isoles, dont le plus notable
-.
est
c~~
I
C~, ~~.' L'affaiblissement· de -::- en -::- a ete parfois trouve excessif; alors Ie ~ tet devient simplernent -::-. Ai~si, au pie1,
cst.".
(De
meme en arameen biblique on a -
~p
cl'n' .....
« leur main De plus, -
Esd 5, 8).
est la forme nor~ale
pausale, ~j? est une forme secondaire
(') Voir une exception four
de liaison
(§ 52 c). Dans
devient regulierement
~ devant une gutturale
vie du qames
moyen ou du hatef qames, Exemples:
C't:T~ mais
';r~,
sui-
9 ~ 89 t,
pour r ~ 89 f. frequente p. ex.
j
> u, p. ex. t16~ 1"I~~1?~;
(2) Cette altemance
9>U
a pu etre favorisee par l'altemance
(') Par contre -::- peut devenir ---;, p. ex. (2) Dans la prononciation (3) Devant une gutturale partielle d'un i primitifa poser
PM, '~,:,.
it n'existe pas de doublet, cf.
babylonienne Ie fJ est devenu Ie -:;- provient probablement
.,~::!. ~ry (~ 32 c). a (= f), ~ 6 d N.
de l'assimilation' » (op-.
(3) Dans certains mots, pour lesquels
1"1~~
inielligmce, l'u semble provenir d'un 9 (et done d'un a primitif) Bihlica 1,369. Voir aussi p. ex. des mots comme .,~C § 88 L e.
/"Im~c vision »).
la gutturale (~ 21 d), p. ex. dans
:"1.!r~« fenetre
29/ _;_
Changements
de voyelles. Harmonisation
voealique
74
,~
mais
repentira » ;
'Ott (§ 20 &); ~nn « le
1'1' ,...
15
Dissimilation ;_ Chutes de voyelles
291"- SOd
:l1'J~ mais :lX!~; CJ:I~~~*mais Cn~J;1~ il se «
sage» et « num sapiens?»; . en syllabe
».
~nn
V
mais
y:
«vou.e
$aDg-». (De meme en arameen targumique
,.
ona
Jb~1;
k
c~nn
•
1'1': lv
(§ 34 d).
p. ex. pas. de -::- en -;- ne peut guere etre considere ici Les deux timbres (,
d.
DALMAN,
Aram. Grammatik·, p.202).
Certaines voyelles ne peuvent s'expliquer que par
Dissimilation.
Si Ie qames est bref (done maintient, n'apparait
I'1O:)nn « la
l' :
fermee
atone) le -::- se
une tendance it eviter une suite de deux voyelles de timbre 'ldentique ou voisin. La t· voyelle est dissimilee
ttfi.)~
y-
sagesse
La raison de cette exception
Le changement ouvertes symetriques
com me un affaiblissement.
p sont deux voyelles
Jt3''=' de cst. ~z:I,
. ne.:. pas» quiescents,
dans dans
ri~
M71'
§ 21 h, ~
pour ~
ttfac-" ~I'r:t de de ~ttfi~ (nom propre).
de (4 fois; ,~ futur
rn,
La 2- voyelle est dissimilee de.~'
dans l'echelle vocalique de I'hebreu (§ 6 b): elles
sont en effet separees d'un degre de la voyelle centrale fl. La loi en question s'explique done par une tendance d' harmonisation vocalique. Cette suite vocalique (-p (') est tres aimee et se trouve encore en dehors de la loi citee, Ainsi: A) De'vant gutturale : 1)
1\1':
+ at;;
10 f.) «si
dans Ie type
·'?N du
des verbes M*£1
pour '~!!'ll (§ 73 c).
§ 30. Chutes de voyelles.
Les voyelles, soit primitives, soit hebratques, disparaissent sou- a
~n5.~p~ ais IJ~P~; 2) m
t
'
on a ~:l~_
venant de u, en pause, § 32 c); dans deux mots etroitement unis, p. ex.
« il liera », ~:lM", 1'-:,<"0" -
mais ~~r1' Job 5, 18
0"
(ou l'on a un 0 long, pro-
vent par l'effet du caractere energique du ton ou de son deplacement. La voyelle disparue laisse un leger vestige, le shewa (mobile ou moyen) ou ses substituts les hatef Ainsi le mot ,:l':T devient ~':T
•
'l'1'~V
.•
nt3 (pour nt3 (§ 37 c), nt3~n nV':T (pour nv':T; cievant un qarnes
T : T ... : T :
bref!)
Pr 24, 14 «connais B) Devant 2)
la sagesse ».
truit ou Ie ton principal ton passe sur im, Les voyelles tongues, pas; en ~ est egalement tres demeurent ""', ~
disparait,
et
non-gutturale:
allonge en pause); ~~;
go
4)
r!~(nom
t) ~Jr?~C,mais 1~~C (ici Ie =;: est ~J'~~C, C?''?~C mais 1'9~C; 3) ,!~, '~~~,mais
C"'~1au
T l'
I'etat cons-
pluriel absolu ou le b
propre) mais
n?~~(I).
de'
soit primitives, soit hebraiques, ne tombent PI.
: Le second degre d'affaiblissement
-=-
p. ex. dans le type :l'~'~ pour maitib les deux voyelles longues dans la flexion: est, :l'~'~, • ••
frequent. Un a primitif est devenu ---:-dans les parfaits fut.
C':l'~'t3, est, ':l,~'t3. • • I·· ••• I··
"~P!)' ~p
'~P?I ,,~P;:t(mais
dans le futur qal cst. pl.
Dans lesalternances
comme celle de: fut. indicatif
(en syllabe aigue, mais fut. ,~~);
des verbes d'action
'~1)pour
de
~7~(~41 e),
primitive de l'indicatif a une voyelle longue et la forme primitive jussif une voyelle breve. Les voyelles breves primitives ensyllabe pas, p. ex. *qudJi fermee
fut. inverti CI~' on a ....
a faire a
C~p:, fut. jussif
du c
des formes differentes : la forme
dans Ie type d'etat
"J~1(de
dans la aupres
da6r? (§ 96 B b).
de -:- en ---:- se trouve frequemment 1) dans les types
..:T:"
sont protegees
L'affaiblissement flexion nominale:
•• :•• :_.
'P~
aupres de ,~~,
T;-
,!.~
pat la nature meme de la syllabe; mais elles ne tombent Les voyelles breves
elles peuvent changer de timbre
,~,t3, 'l)Cl au pres de 'eCl), iTrt':l:D aupres de iTrt':ll). ainsi ·on a l'in(
>'V?1e .
finitif fern.
r~~~, r~~~ est, (ici
(I) En pariant
n?~P aupres
a
savoir
de
n?~i? §49
d) 2) dans la flexion du type 3) dans la forme
prim!tives en syllabe milera":
ouverte
sont exposees
tomber. Voici les principaux 1) La premiere
faits qu'on peut observer: breve
dissimilation;
cf. § 96 C c);
A) Dans les mots dissyllabes primitive (moyenne
T"
de cette suite voealique, nous transcrivons, le qames pro-
voyeUe demeure si la seconde est une hebralque),
••
venant de a, d'attirer
a, d'une
facon purement phonetique : p, puisqu'il s'agit 96 A
p. ex. *qatal> ,~~;
*dabar>
'?1;
l'attention
sur un phenornene phonetique,
(2) Voir encore
** 68 e, 79 e. 88 Lg, 93 c, 94 c,-d, h,
.cina6>:UV; *'ilai>"ac
« vers moi ». voyelle primi-
e. B/.
2) Si la seconde voyelle est longue, la premiere
30d-/
Chutes de voyelles
76-
Chutes de voyelles - Ton
30/-31 a
'tive a demeure ('), les voyelles primitives
i, u tombent,
p. ex, avec
1· voyelle 'a: *qatal>'t1~p
':r.I~i?(part.
'~irar >
gutturale, avec
,;,'¥
(§ 6 g), *ltimar <;~) > ,;t3'=! (avec hatef patah sous la § 21 g) [cependant dans les formes primitives qi/al et q#ul,
passif);
avec
i voyelle
8
(infin. absolu),*salam>C;"~,
i:
*zirac (ar, dirac ~~~ >
*qatul>
Au futnr avec suffixes
It
pretonique
se maintient, i et u tombent,
!'i't ;
p. ex,
(de
'~~f'r.( de ii/baS >
iiqtu/?, ~).
Rem~rque.
tf~~), mais '?~t;'~(de iittin > r1.:l~), '??tp~ .
tombe, comme dans la flexion g mais
Dans la flexion du futur l'a pretonique
radicale
8
M, l'i
ne tom,be pas, mais devient -::-' p. ex.
';r~, ~:l~, O
§ 21 k]; avec 1 voyelle u: *lubus>
passif~? e « revetu »); *gubUl > B) Dans les mots milera" Generalement pretonique (a la
ttr.!:l? «. vetement» ':r.I:l~« frontiere ».
de deux
les voyelles i, u, p. ex. ~Tt'f'r.' . D) Le traitement de Ia voyelle demande une consideration le A l'etat.absolu
~M'¥t?~; t;'~, ~M¥~~;~"tpp~. ~
moyenne
(opp. participesyllabes:
--=-
--=-
part. g~neralement;
se maintient
a l'etat
cst .•
de plus
la voyelle .pretonique
8
demeure et la voyelle ante>
place avant le ton) tombe, p. ex. *~adaqat> sage» ;*zaqinat
Mi?1'¥;
« cent », est. n~~; pI. abs. 1'I'1lCZ3 (l'etat est. serait niM~* ); C;;, niZ3;;, est, nit3yJ. Le --=- se maingeneralement il tombe. Ainsi *mi'at > M~~ tien; dans
*!takamat >
tem
M~~,=! « une
M?m
«vieille »; *qatal-
a I'etat
est. dans certai~s mots: dans les mots comme
'ir~ (§ 21 k);
n~~~~
> CJ:.l~i?
Mai~' d~s la flexio~ du parfait tombe, (sans suffixes) I'antepretonique p. ex. q~talat >
n!,1. « sueur
.tastrophe de »,
n~:!1~ profond «
a
de s, ~~
« l'etranger
(abstrait).
de »,
« cade »,
sommeil de », du type
~':!~ « piscine
~~~; *lzakamat > M~~p « elle
vieille». ment par une difference
demeure et la pretonique
rt7tp~; *qatalu>
rta1J7 -« tas de », etc,
- ..-Dans le verbe on a . Au participe du l'imperatif on a
est sage » ; *zaqinat>
M?m. « elle est
telle. que probable-
:l~: :l;;, ,~~, ~:l~ .
(surtout) (Ruth
La difference de traitement
d'une forme primitive
type "~,,
M?tp~ou M?~~ ou
n7~";
4" 15);
ltakamai, selon qu'elle est verbale ou nominale s'explique
dans la place du ton,
T : IT
'.'pI. C~~
l1:l~*,
(§ 50 g).
du type C'i?~ on a par ex. est, on a par ex.
Au participe pl.
:l'~~ V'1~ «
un stade anterieur
de la langue. La forme verbale
Mt3:'1n se rattacherait a un stade !ta'kapar la forme pausale
C':l~.
faisant mal»; le participe
• . Au partici~~ :du type:ll;?~:
mat anterieur
tAT ...
au stade
!taka'mat represente
Mt3:'1n* (cf. § 95 c).
La voyelle antepretonique a demeure dans certaines formes, p. ex.
1'1'
pI. C'~
D~s
(opposer
:l'~'~
avec?
long,
§ b).
l'adjectif du type.
~'?
on a 'P: ex. C~
« muet »" pI. C,~~~.
c~e
•
'f
11'
comme pluriel
« semaine » § 96 Db; « mon exil» § 88 M j; '~~ « mon refuge"» § 88 L e ; '~:lt3 « mon boucIier» § 88 L k. II faut remarquer
•• IT'
'z:!~,,~,
de
~e
«cheval»
§ 96 B b;
niV:lTt',
.. 11'
sg.
VoI:lTtt
T
§ 31. Du ton: place et deplacement,
, Les notions essentielles sur Ie ton ont ete donnees au § 15 a-c, a
surtout le pronom inversif
'5~M(§ 39 a)
• IT
et les formes du parfait avec le waw
\
'~~~1'~7~~1 43 a) (§
C) Dansles mots mile'el
proP9s des accents. La place
du
ton, nous l'avons vu, peut. etre des cas. Indedes
(2). de plus de deux syllabes, se rnamtient, on re-
connue materiellernent pendamment
par les accents, dans la plupart
des accents la connaissance du ton releve de la morphola place du ton depend de la nature des voyelles. On peut formuler les deux
marquera les cas pratiques suivants : Au parfait avec suffixes a pretonique p. ex. qataau
logie. D'une facon generale,
laini >
'??~~;
l'i
tombe «il
au piel, p. ex.
'?~'?'
syUabes et de la quantite
mais se maintient
qal, p. ex.
'lrbTt': . - ..
m'a oublie » (§ 61 e).
stable devant Ie ton
regles negatives suivantes sur les syllabes ferrnees : 1) Une syllabe penultieme ferrnee ne peut pas avoir le ton moins que la derniere syllabe ne soit ouverte; p. ex. on a
(') Le qames est particulierement
(qamefjYritonique).
IT ••
(2) D'une facon generale, la stabilite anormale d'une voyelle .:._ , _ n'est pas un indice infaillible de sa longueur.
, _._
C~7~~··
~'?~R'
mais
2) Inversement,
une syllabe derniere fermee ne peut etre privee
31
a-c
a moins
Les differentes
Ton: n<sigalt
78 p. ex. on a
79
NeSigak -AT
Pause
_ ....
31 c- 32&
du ton,
que la syllabe penultieme ne soit ouverte,
Citl, C;i1. mais
'~'r.1.~~.
tieme). De meme on dit p. ex. Vltll Wl1 Pr 1, 19 (Ie patah furtif ne compte pas). Cas anormaux. On trouve ia nesigalt dans des cas comme
formes prises par un mot dans la flexion, et cerproduire un deplace-
taines autres causes, comme la pause, peuvent !taut du mot (l'accent p. ex. monte); cf. § 15 b.
1 S 10,5, ill
~r:;r?1 Job
r~"fj~ d
pm~2
8, 18, en syllabe virtuellement fermee : ill
,ment du ton soit vers le bas du mot (I'accent descend), soit vers le Sou vent quand Ie mot s'allonge la nouvelle syllabe prend le ton,
Ex 4, 4 en syllabe semi-fermee, Par contre la nesigak, parfois.me elle est attendue, p. ex. se trouve pas dans des cas OU
\,ft
1'11'1'1'1Gn 1, 2.
"",,: IT
'~1' C'~~1: ton pI. Ie
descend sur im. A)a pause le ton descend
dans le cas du futur inverti:
C~_, mais C~ (§ 32 e).
§ 32. DeIa pause.
La pause est un arret, un repos notable cours et surtout retardement lentissement apres un mot dans le a com porte un certairi prononciation
Au parfait le ton est mile'el dans dans les fo(mes avec le waw remonte
Z;!~i?1
t;l7~R''t:17~R,' il descend mais inversif ~~i?':, '~7~~1 la pause il a
j
la fin d'un verset, Ce repos
(§ 32 e).
au futur inverti le ton remonte dans la mesure du
prealabl~ qui le prepare, et qu'on peut com parer au rad'un coureur qui se prepare fait:
Au contraire,
possible (cf. §a), p. ex. on dit
l7.~.,mais
m·-
a s'arreterrLa
A la pause le ton
d'uu mot en pause est lente, pleine, emphatique. Ce ralentissernent 1) que la voyelle tonique, quelle que soit de sorte que les formes ou plus voisines de a le ton. il y a souvent du reste sa couleur, est toujours plus longue qu'elle ne le serait en contexte; 2) que certaines voyelles tom bees reparaissent. pausales sont souvent De plus, correspondent l'etat primitif : ordinairement des formes ou primitives la voyelle restituee
monte dans quelques cas (§ 32 e).
De plus
le ton peut monter
pour une cause rythmique, le premier
a
..
savoir
pour eviter la rencontre de deux' syllabes toniques, ce qui arrive quand
de .deux mots unis par un accent conjonctif
la syllabe finale et le second sur l~ premiere La montee du ton pour causerythmique ou ndsiJg "dlJiJr ('iM~ )io~) ('), deux regles negatives ~ Ps 127,2;
a le ton sur
syllabe (t).
s'appelle nesigak « recul » en arriere ». des
a la a
pause, outre Ia difference quantitative, de quantite),
a savoir
ton « s'eloignant
dans les voyelles des changements des changements du ton. purernent cas il y a deplacement Changement quantite propre
de couleur (dont plusieurs
Pour qu~ la nesigah soit possible il faut, outre l'observation du § a, que, si la derniere el~e n'ait pas unevoyelle longue.' Exemples:
Enfin dans certains
syllabe ,«!~t_JeJJllee,
Cm '::IMf.lGn
~... .I
M~?'N-,~ Gn
3, 19; mais
~£)5 :l~'
-r v
i,5; '~'$~~
:
quantitatif. ajouter
Tres souvent l'effet de Ia b secondaire
~
.I•••
Ruth 4 '15
'
pause consiste uniquement 1'(' moyen de ~~. Jl ["11t remarquer les monosyllabes: l'afformante
un allongement
a
T
la ou
(avec i long). De plus, les suffixes Iourds ~, . :on. Mais les afformantes it; Cl'1"M Job 6, 21.
"•• .t•... :
de ,Ia voyelle, ainsi pour l'iJ long, p. ex. de que -:- reste souvent
ci'nf
verbales
ctt '
.
P; CiJ, flJ
r~ peuvent
gardent '
toujours Ie
le ceder, p. ex.
en pause, surtout
dans
Dans l'application
de la u'sigak,
comme des autres lois rythmi-
m,
T
ainsi on a •.:~j:)lIrs Vll'~, p. ex.
1'111; au futur, devant
m'll::If.I.
l' :"'-: •
~-.
.-
ques, il faut se rappeler qu'on ne tient compte que des voyelles pleines
Le -::- reste en pause dans p. ex 1'1t3N (§ 18/), tamment dans quelques noms du type ;;;ole
merne ~~~
(§ 27 d). Ainsi I'on dit
':Ii:l'1'1i~Ps
28, 1 UiJ est cense syllabe penul-
l?~' p. ~'~~-.dans
'E?R; ~7~R
I
~';:';
il reste nole nom r
(§ 96 A c).
de voyelles. souven~:;-, p. ex. ,~~,
(1) II n'y a done pas rencontre quand I'accent est disjonctif, p. ex. cttI1'I:tt!"
l' \'1"
Changements ~ ~evieDt< tres
1 R 2, 36; ni quand il y a maqqef, car alors Ie premier mot devient proclitique, (2) l'C~ participe nifal de lIC..
-
-I'"
'll::I', ';:';:", C't3, C't3; - :. "1': • .•.<\,.
.,v5-
l;17~~;
j'
'Vj . - "1'
32
c--/
-:;- devient -:; dans parfois du p. ex.
Pause la plupart des noms du type segole
p. ex. ~~, ~ grande L'hitpael
~~.
(§ 96A c). Le parfait
devient pause,
-=-,
p. ex. ~,
'f~devient 'f.~. '~.1; "1P.;::t, ~ry; .,~~,
en pause moyenne
<
n~.
I .,~~~.
80
81
Un meme mot peut avoir trois ff'Jrmes: forme de contexte, de pause, moyenne, bref,
T
Pause - Hiatus
.\
32/ - 33
forme
forme
de graade
pause,
l' AT
per ex.
iI~~ toi avec 9
type en 7 prend ~
et M en
:l~l:'~' :l~l:'!' :l~.t;1~(§ 53 t.;); Cml:'~ (§ 29 f).
mots, p. ex.
I ~~
_:_ devient -;- (ici 9) dans quelques Gn 43, 14 (§ 6 I) ; ~~ 49, 27 i ;~, forme pausale ~
Y-'I': '
;¥t. Dt
Job 5, 18 (§ 29 f);
'r:t7!)~"t:'~~V? 9"~~' :t~~n 9G
moyenne) .-
ilr-I~ avec 9 allonge secondairement, ilr-IMavec ti allonge secondairement (§ 39 a). On a de meme iI~V, ilr-IV, ilr-IV maintenant, Voir aussi 1a triple forme de :l~1'I'. § c. ..- :
T T T 0'\1'
Le ralentissement verbes
qui precede
la pause explique
que dans cer- g du l, par ex. l paragogique
tains cas on prefere, en pause, des formes plus longues. Ainsi, dans les
23,' 20; _.Pr.23,'32.
Dans Is 7, 11, au lieu de la avec n';1~O,?6nd'<'ld(h)
T .... T •
normale
n'ilKrI
Gn 42, 38, on a (en pause
~"¥?~ 72 b). (§
se trouvent
r£)
souvent, surtout
en pause,
on omet l'assimilation du futur
Les terminaisons
f~' f' -:- avec
$"o'ld(k), probable~;n~ mf) (I).
pour l'assonance
en pause (§ 44 e-f).
Voir aussi § 62 c , e.
(phonetiquement nitatem d
-,- devient - or dans la formule ~ (pqUr '~). de voyelles. R~stit~ion
'V,
......
1'
. C~
T :
« in saeculum et aeterParfait: ~,~~;
§ 33. De "hiatus. ,
Nous notons ici ce phenornene analogie avec la pause rythmique qui presente termine surtout quelque par une
Cas
usuels:
~"lPt-r.'~~
.. -:
M~~, .. M~; '
'laC, 'lMj
.. AT
iI?lP~' n?~R (');
(I) ;
n?lPP.'
iI?~i?;
"e, ~ ~n; ~n (forme
j
•: ."... • -, • ,...
r~?. ~7.
Futur:
~,~,~,
~lt;l~, ~l!:!~;
(p en prepause se maintient)
primitive'ltiy;).
4
e)·
e).
Quand
un mot mile'el se presente
voyelle est suivi d'un mot commencant le ton devient qui devient M?,; devient peratifs ~, milera", Le phenomene
par une des gutturales
M, ii, V
pour
.e
Deplacement du ton.
parfait inverti: ,~~~~; Le ton descend au futur inverti
'~7~R1'
Le ton monte dans p. ex.
'~l~, '~~~;au
C~, Cir.!.; son t
iI~7 (sans redoublement)
dans Go 29, 21
p. ex. C~~
It.!, ;~; ~,
,Les
dans des cas comme:
pauses (5) qui produisent pauses, ~ savoir Cependant
1~'
les effets enumeres ci-dessus
de la fin du .verset marquee pauses. p. une pause
iI~p, 10,35 (oil iliM' = "l'M).
18,11;
T':':
'~tr'~7'1"1~iI?,; de meme pour les im-' rq~~, p. ex. '?tt iI~~OJu~ 4, 18; n)iI~ iI~~p Nb
t
Contrairement
T
np?
iI~'
2 S 19,11 (§ 37
d).
l'accentuation
• J'
normale
"
on
les gfandes par l'accent cent atnah, peuvent particulier (d'ou
Ia pause
marquee par l'acmoyenne Tel est en ~ 11, 3;
trouve
enco;e 'par :xe~ple
M'SV ~~, Gn 26,22;
"0"
1 l'
'nN ~b~Gn
40 15'
silluq, et la pause du milieu du verset certains accents indiquant des effets des grandes frequente
CV'?~~'! Ex
0
~l'6)1~ Ps ~~
Ex 26, 33;
90, 8;
T
ill!l~
T •
~M~~ Zach
6, 10 (cf.
avoir quelques-uns
le cas de l 'accent zaqef, avec lequel souvent
la note massoretique
9i?!~rP.!'?,
-=- devient
§ 43 b) ; n::l,eil °°
T
""'=T:li'''
CniM ilN':lil' Lev 15, 29.
,•• :
Devant plus longue;
une gutturale,
on prefers
parfois,
semble-t-il,
une forme
ex. Gn
cf.§ 78 t, 79 m.
§ 16 d). Cas special de .'~~§ 39 a.
(i) Ce phenomene, com me tant d'autres,
suppose pour Ie signe --;- un
timbre unique $7 qui, a la pause, est necessairement long. Le changement de fen. a la pause, n'est pas plus etonnant que celui de ~ en ~ long. Ces _ de pause sont probablement les seuls ? longsprovenant- d'un u primitif. " (2) (3) (4) Un 9 allonge secondairement se maintient (cf. § 18 e). (5) Certains phenomenes s'expliquent par la prepause : syllabe precedant la syllabe pausale (~ d), ou encore mot precedant Ie mot pausal (p. ex. ~ 104 d).
(1) Faute .d'un meilleur terme, nous appelons ce phenomena hiatus: il y a contact entre la voyelle tonique finale et la gutturale initiale (sauf n, sans doute a cause la nature particuliere de cette gutturale, cf. ~ 5 k, 20 c).
r,
83
Generalites - Article
3U-3S h
bien c1airement; ainsi les lexicographes rapporte soit
hesitent assez souvent
propos
de certains verbes ,"P ou '''17; par exemple, le mot l"1iT~ ordonnance est
SECONDE PARTIE MORPHOLOGIE
~ 34. Oeneralites.
a La racine est l'element le plus simple d'un mot. On degage et de flexion, la
a la racine 'P', soit
(plus probablernent)
a la
racine
"V.
La racine de plusieurs mots est inconnue, par exemple "~t;I batOll,
l"1i'N ~
au sujet de. mots peuvent etre deforrnes par le jeu des lois phone: d'autres, semble mais
Certains
tiques ou par l'analogie, au point de rendre la racine -meconnaissable dans ce cas il y a racine apparente racine racine en eliminant sonnes, principalement tous les elements de derivation les sept consonnes (t) secondaire appartenira en realite cine de ~ et racine reelle (d'apres Ainsi le hitpael :l~~i} et racine primaire).
une racine :llt', tandis que la racine reelle est :llt~ (§ 77 b)., ce mot se rap porte au hifil
meme
te, sub\;tantif i1~"~ circuit semble appartenir
savoir, non seulement
toutes les voyelles, mais encore certaines
con« ils
"l"1 ~ ~ N i1 dites he'emalltidans Ie mot ~~~i?~i} done pas par Ie groupe consonantique
ques (du mot rnnemonique
"z:!?~~~). Ainsi
9i'~. De
e).
9'Ri} faire
une racine
9'i';
un circuit de la ra-
i1~~~~uictoire se rap porte au hifil ~~i1 sauuer
c
se sont sanctifies » la racine est constituee
~i'
qui exprime
I'idee
de saintete : n'appartiennent
La meme racine peuf 7avoir des formes verbales et des formes nominales. Si un nom derive d'un verbe oil est deverbal, si un verbe Ie verbe, derive d'un nom il est denomiual, Les parties du discours sont le pronom (avec l'article), Ie nom (substantif et adjectif), les particules (adverbe, conjonction, interjection).
la
racine: reflechie,
les voyelles, le redoublement ou causative,
du ':f (qui indique la 3" p. du pl.)
que I'action l'idee sous la dans
est intensive
§ 52 d), Ie groupe l"1i} (qui indique
§ 53 a),le
~ final (qui marque on enonce
e).
represente La
preposition,
Pour la commodite le verbe regulier les consonnes trilitteralite La plupart ou elle n'existait Cependant D'autre b
generalement
la racine
forme de la 3" p. sg. m. du de la racine,
parfait, p. ex. ,,~~ il a tue, qui, irreguliers, que les deux voyelles. sont trilitteres,
et dans une partie des'verbes n'y ajoutant des racines actuelles pas ou n'existait I'hebreu
CHAPITRE
I: ARTICLE § 35. Article.
ET PRONOM.
de l'hebreu
est un trait si propre de la langue que, dans certains cas plus, on l'a retablie racines secondairement. dont plua quelques quadrilitteres,
L'article hebreu est un ancien demonstratif . dans quelques cas, une valeur demonstrative le rattachons hebreu repond done au pronom demonstratif
(') et conserve encore, Nous l'article le sens,
faible (cf. ~ 137 f).
POUT
sieurs du reste sont d'origine part,certaines
secondaire
(cf. §§ 60 et 88 K). du moins dans un la racine avec certipas
racines sont bilitteres,
peu pres
I'article defini le du francais.
certain sens (cf. verbes V'P, YP); Pour la plupart des mots on peut indiquer tude. Mais il y a des cas assez nombreux ou la racine n'apparait
(t) Signifierait: preposition. (~) Voir les preformantes ~~88 M. des formes nominales ~ 88 L, les afformantes
« je l'ai cru » ; mais
La forme normale de l'article est·::r, et tend
a savoir
la consonne
n suivie
de la voyelle breve If laquelle fait pression
sur la consonne suivante
produire
le redoublernent,
p. ex.
o~l:)n, hassus
des
« Ie cheval ».
1'~~~ se
construit
toujours avec -une
(I) Ces mots ont ete formes
it I'analogie
mots de la forme taqtu! pronom de-
des racines 1". monstratif
~ 88 L s. des langues romanes provient ci'UI1
(2) De merne I'article
latin, p. ex. francais Ie du latin illum.
35iJ -
Article
84 ha (bref')
(t).
85
Article
Exception Autres frequent
remarquable:
TT
ry
tonique ne peut les memes,
avoir le redoubleet Ie doublet moms
La forme primitive faisant pressioll
hebraique
du pronom est simplement futur inverti ~~, de l'article
(com me le
1 du
ment virtnel, p. ex. ,,'M la montagne. exceptions: p. ex.
La tendance de la voyelle c Une con sonne non-gutturale du redoublement
§ 47a)
satisfaite.
C;::rry
produire
le redouble-
ment de la consonne suivante, n'est pas toujours suivie
•• : 1-
f. M~6;:r (1 S 17,28 t) e)· J1 generalement n'a pas Ie redoublement virtuel, par exemple
M~'5IJ; C'~~~
Cp;:r
du shewa
est souvent privee
le peuple, , p. ex.
les peuples,.
(§ 18 m), p. ex.
C'''I',;, les Leoites (pour le meteg
les deux cas suivants: p. ex. 'le dagesh, (opp.
"~;:r
la uille ;
~~~;:r 'Ie
soir,
~~p';:r.
Exception remarquable:
__:_ atone exige le redoublement virtuel, ~
cf. ~ 14 c 6). On remarquera 1) Dans , on omet en/ants, C'~~~ljles dagesh,
en particulier generalement M ou
nJ1~tt;'M le
T :-
secours, la vic/oire
M~~f.lM
T :-
C';;'M . T:-
C'!~P
les villes (peut-etre
les
meme sens); les Juifs,
Autres exceptions: p. ex.
a l'analogie du C'!WO les aveugles
type (Ie, M et
C'':IIJP)·
rafe § 18 m4),
moins que ne suive une gutturale fatigtds. 2) Dans
J1,p.
ex.
C'"f'Irt;1J
C'~ti7M
'! I -
qui abandonnent
Pr 2, 13,
1'1~r.i71J Pr
•• I
2, 17 ; etc.
Remarque. le redoublement , mot M et
T
Dans le cas ou les gutturales virtuel, p. ex. peuvent avoir
t? preform ante
',' : I-
sont traitees d'une facon symetrique : du participe piel et pual, on ometle
n et P toniques
J1 ont
~'
elles et ~ ~ En un vire
ne peuvent avoir
'IJIJ, TC~;:r;T au
virtuel, p. ex.
p. ex. Ms:l~M LXX: to xUtUxUAuxtOv,
te cachant (Lev 3, 3 ;
num telans.'1 p. ex.
atones exigent le redoublement
on a la merne forme Gn 18, 17 avec le M interrogatif':
§ 102 m). Devant M, J1 on a' ordinairernent
la cauerne, it~~M~MIe desordre.
T :-
le dagesh,
;"W~1j
ou '
J1 ne
T
a la
~;:r C'!;:rp, C'!~p.
contraire
fois le ton et le redoublement est syncopee
tuel, mais ils ont l'un ou l'autre.
Une consonne gutturale fort,mais ellepeut faible, L'aptitude n'a jamais
T
(et n) ne peut pas avoir le redoublement avoir le redoublement virtuel virtuel apres l'article a). Apres I'article lot , (De meme
(sauf lot et ,)
~, ~, ?, p. ex. ~?~?pour ~?~':t?* § 1? e); (cf.
[ours, lot'l}lj "lotl
La con sonne M de l'article
apres les prepositions
cry,:,
C'~~I en us memes
l'1P~ en
ce meme temps;
~~I:)~par !'epee,
~~D~'
on a p., ex. la merne
des gutturales au redoublement M> M>
Dans le cas ou la premiere consonne du nom a hatef II se rencontre deux cas ou la graphie avec l'article et sans article: 1) quand un virtuel; p. ex. pour bl;d;.','lij11l «dans 2) avec -;-, Remarque. Le
. -: r'
est, dans l'ordre decroissant, le redoublement
J1 (cf. § 20
com me le lion (opp. "lotl
virtuel, ni, bien entendu,
. -: I-
§ 103 b, sans article, comme un lion).
est materiellernent
apres M~). Quand il y a redoublement moyen ou du hatef qames (§ 29 f). M a presque toujours le redoublement
virtuel la voyelle de l'article
est -.:-; mais cet -.:- se colore en -:;- si la gutturale est sui vie du qames virtuel, p. ex. ~,nljle mois, I 'epee, raison
-=;- suit une gutturale qui prend Ie redoublement ci'='M::l peut etre pour bf}lt(Ij.)~lijm «dans Ie songe » ou
-: 1-
un songe
(cf.
'~i'='I.:1~)'
bd-·Vmi.idk «dans (cf. § 6 n). le
'.~,n,,;
• 1'1': ooOj\Y."
C~MM I·" les mois : M~::lnM la 1'MM le vivant (toujours
T : l' -
sagesse,
.
"'.
C::lMM Ie TTl·"
sage,.
ainsi, excepte ' Gn 6, 19
~,riM "." 'tTM sans
0." l'
p. ex. M~~~~-peut etrepour « dans un navire» surtout dans
navire » ou pour bp''lniiiak
.apparente
I). le redoublement virtue), p. ex.
M quelquefois
n'est pas syncope, p. ex.
C~;:r7
2 Ch 1 S 9,
M a generalement N~Mljle meme gatif:
;~'t10le temple ;
10, 7; les ,exemples se ,trouvent 13; Neh 5, 11 t-;
les livres posterieurs,
(on a 13. meme forme Nb23,
19 t avec le M interro-
On distingue C~l d'abord, p. ex. Gn 25: 31. et C~~
num ipse .~), N';:'1ljla meme
(I) Ce phenomene
,.C"MMI·"
• T
les moniagnes .
en
l'instant
cote ge M!iJ ci'~ eomme
(&eta est) aujourd'kui I'influence de l'article .
(encore) on a quelquefois
affi'rl.e; ~ Roma va te ne .- cf.
M!11 ci'rt~ avec
m~difiee
le meme sens.
SOUS
de pression (cf. Ie delfzq ~ 18 i) existe notamment appun'to, a lata> atta'to, a fine> daoue'ro : da mi >» dam'mi; en dialecte toscan a casa
Noms dont la voyelle 'est
(I) Remarquer
.f
italien : a punta
devient
prononce arro'ma ; da vera> si sigllore>siss£gno'r'!;
> vattene;
18jN.
I'asymetrte : sing . .an:'llj, lC';:Tljjmais
pl. c.j~ etc.
:» a.ccasa
35f-S6h
Article - Pronom demonstratif du --;- de I'article -;- sous la gutturale: les quatre mots suivants ale ",~, pause;
86
87
Pronom demonstratif - Pronom interrogatif Le pronom demonstratif
36c-
37 h
Sous l'influence turale tif~,
gut-
Mt eelui-ci
etc., apres un nom determine, alors I'ar-
~ry.
g
rn~
prennent
arehe (cf. toujours
o~l'iran),
Le mot 'JT') fete devient ~
n~
'ij,
Op (O.tJ avec accent disjonc-
devient
f
adjectif
demonstratif, de la 3' p. sens
et comme les adjectifs, prend
deviennent
O¥:,
~1
ticle, p. ex. MY-' ~~, . Le pronom
cet homme-d
en pause meme petite. toujours
Avec l'article Le mot ~ interrogene-
M\,
(§ 137 e).
at'M; Mti)'
• l' o.
OM;
••
ru.i
T ••
lui, ,elle; eus:,
on trouve (rarement gatif est ~ ralement
~O'
en fait toujours en petite devient l'article, la forme
dies, precede de l'article, pratiquement memes jours L'article
signifie proprement demonstratif parfois une faible, valeur (cf. 35 e).
Ie mhne etc. mais aboutit p. ex. OMM C't)'3 en les "1' '1'demonstrative faible (cf. e
.,.)
jeune
taureau 1) Devant
'~j avec l'article.
du pronom
Remarques: 2) Devant inalteree
a un = en
ces jours-Ia
(§ 37 e) .
I'article, la forme de la preposition
a garde
r~reste
§ 137 / 1).
(§ 103 d).
~ 37.
Pronom interrogatif.
aux deux genres et aux deux nombres: comme ,~ a
§ 36. Pronom demonstratit.
(1
Pour dit, et done ~~ nitif
les personnes. comme
L'hebreu ne distingue l'objet f. eloigne
n'a qu'un pronom pas le demonstratif (ille, celui-Ia). ordinaires
demonstratif de l'objet
proprement proche
quis '! '~s'emploie
sujet M~ ,~ quis venit'!, avec une preposition accusatif, genitif,
predicat
(hie, celui-cz) et de sont: Sg. m.
'~ quis ,est) hie vir f, comme accusatif
'~"l'1~ quem f, comme ge,~" cui , ,~~ ex quo.f! .: .. egab avec une preposition . za.
'~-l'1~ cujusnam ./ilia
Pour les choses
.'P,
Les forr-es
du pronom
demonstratif
l'1Mr; PI.
C01l1mUn
M'....Mc.
"
nr; ,.
on emploie M~ (avec diverses vocalisations), est ma. avec voyelle anceps (comp. longue ma dans
lement
com me sujet, predicat,
La' forme du pluriel gulier. Au contraire
meme forme primitive
n'a aucun rapport
avec les formes du sinsernblent provenir d'une
La forme primitive en arabe on a la forme dans li'ma ~). se trouve
les formes du singulier za. 'avec voyelle dans Dans
t.=,
§ 36 a;
ma de .::l
et la forme
breve
anceps, La forme breve zii n'a les formes fern. rares
En hebreu
la forme longue La
ma est devenue!
i~, qui
pu se maintenir La forme longue dans b
en hebreu qu'en se colorant en z~ (com me M~ § 37 b).
dans la forme poetique
I
i~.::l comme et dans les formes
l'1Mr = za
Formes
+ t du
za se trouve feminin.
m, it
et
avec suffixes, p. ex.
'~i~f3 103 g.
-
forme breve ma est devenu~
l'1Mr, I'M ne semble pas ety-
en hebreu M~, M~ I -M~:
mologique,
mais pure mater lectionis rares: Sg. f.
(3 7 b).
,,~~ e); et de pl~s 1 Ch
M~ tonique
probablement
M~ tonique
8 fois; it 2 fois; PI. commun 'M 8 foil;'
','
est moyen; est moyen
Mt3 atone est moyen avant le ton, mais
bref apres le ton (cf. que M~ est atone)
§ 28 e).
entre M~ et M~); M~ atone
dans Ie Pentateuque, 20, 8 saris article.
toujours avec l'article:
(mais it est cense un peu plus bref que
M9,
de sorte
intermediaire est bref.
La forme poetique s'emploie (surtout surtout
~t, pour Ies deux genres et les deux nombres,
renforce : m. M!~jou
est bref. -M~ (toujours En comparaison particule interrogative C'est que M~ est non II y a done trois cas clitique, II enclitique, avec la vocalisation de l'article (et celle de la de M~ est assez compliquee. (com me l'article), mais (non-clitique).
comme relatif.
II existe, en outre, un demonstratif
avec accent disjonctif fort);
t?/j (t)
f. ~t~ij (Ez 36, 35); par ex em pie
IJ)
la vocalisation
M!?ij ~~~
« cet homme-ci » Gn 24, 65.
~ulement
proclitique
encore enclitique (ou ex-enclitique),
(t) Compo c,,:!;; plus frequent que (2) Fern. dans 2 R 4, 25.
1'l~~1J' ~ 35 d.
et meme in dependant
considerer,
selon le triple role de M~: I pro-
III independant.
37c - d
Pronom interrogatif
itt)
88.
89
Pronom interrogatif -- Pronom relatif
37d-38
I ilO proclitique conjonctif). doublement
(generalement
avec maqqef, parfois avec accent
La vocalisation
normale est . iI~
savoir
I}
bref avec .re-
isolee, mais bien attestee reste enclitique
et qui repond
la forme de .l'arabe
H'ma,·
de la consonne suivante,
Cette voyelle fait pression comme
semble etre la forme premiere (avec accent mile'el), .dans laquelle ilO
la voyelle de l'article (§ 35 b) et celle du
(1 [; iI~
1 dans
Ie futur inverti
,toin
ilril~
e)
(§ 47 a), p. ex. l'1'l;';iI~ « que tu es belle! » Ct 7,7; Ex' 4, 2 ketib); C?~-il~ (1 f. C?~ D~vimt une gutturale de l'article
l'lNril~;
2) generalement III
iI~';
T
I~ 3, 15 ketib).
(§ 33) p, ex. C~~ iI~? 2
la vocalisation est assez sembI able virtuel, p. ex.
celle
no
5 19,
mais devant gutturale N, ii, P on a
11;
rt1i1':
il9?
e
iI~? Jug 21,3.
independant
(assez rare). av~c accent disjonctif, on a gene-
n a toujours
peccatum meum'
(§ 35 d) :
Ie redoublement
1) avant un mot, d'ordinaire ralement la forme moyenne
'~~tI iI~
quid (est)
iI~, p, ex.
;;p
iI~ 1 54, 14 (accent rblr).
en pause, on a iI~, p. ex.
Gn 31, 36.
'remarquable : Ie iI de l'article n'a pas Ie redou-
iI a generalement le redoublement virtuel, p. ex. N~n-il~ (comp.
ttD. ~n~' et
T : -: T
2) apres un mot, en fait toujours nos q~id (sumus) f Ex 16, 7.
~ilZJ).
Exception
En resume, virtuel; 2) apres et dans iI~",
l' T "
on a :
blementvirtuel
(une seule exception Ecd exceptions: mecum; p. ex. iI~TiI~,
2, 12
C1~O il9),
par ex.
ilO 1) comme proclitique devant gutturale sans redoublelnent
une 'preposition devant gutturale ou en grande pause;
"I
iWP~'-ilO
•v -:
I
Autr:s
quelle est i'aetion f Gn 44, 15 .
Cij-il~ (comp. iI~~jJ, CljjJ).
virtuel, par. exemple
',~pilO quid
'T • • • T
:D generalement
n'a pas le redoublement
il6,;
apres iun mot (assez rare). avec redoublement
Gn 31, 32.
E~~eption remarquable:
<...
r: ~ le redoublement
•
virtuel, par exemple virtuel, ni, bien en-
3) independant,
ilO 1) comme proc1itique devant gutturale ','
virtuel suivie de qames ; 2) apres une preposition, 3) independant devant une gutturale
'l'1~P ilO quid feci f Apres ilO Ie N n'a jamais le redoublement
tendu, , (De merne apres l'article). Remarque. Dans le cas de redoublement
d'une facon normale; et
devant un mot (assez rare). avec redoublement virtuel (non suivie de qames).
virtuel, si la gutturale vocalique ardor'
-il~ comme proc1itique devant une consonne nongutturale,
a qames, Ie ~ devient "":;" loi d'harmonisation (cf.
§ 29 f), p. ex.
Dt 29, 23.
'l'lNtOn no quid peccavi.~ 1 R 18,9;
• T
De '~lllS, on a parfois II ilO enclitique
I'~
'!'1 ilP' quid
§ 38. Pro nom relatif.
Sont employes co~me qUl semblent n'avoir l~' langue litteraire post-biblique prenom relatif les deux mots
meme quand la voyelle qui suit la gutse trouve apres une prepo-
turale n'est pas qames. d (ou ex-enclitique) sition (surtout ex-enclitique En general ~,
,t;f~ et
.;; •
originairement
rien de commun (!). Le relatif par ~~ . •
f)'
ilO est enc1itique quand il est prive du ton,
moyenne
•~ a dt1 exister de tout temps en hebreu dans la langue parlee. Dans il a ete supplante presque completernent avant l'exil. Apres I'exil, il apparait assez frequemment (Mishna) il supplanta completement
quand il a repris le ton. on a la forme ex.
iI~~, iI~
r~ (avec
M9 en
contexte:
iI~~
e).
e). A l'epoque
accent rebZ'fe Agg 1, 9). On a iI~ devant gut~urale
Ie litteraire ,~
ou en grande Avee ,'on
pause,p.
n~~ 1
R 22, 21 ; P,!~ iI~~ par qUOt sauCette forme
(I) Cf. Biblica 1 (1920) p. 363. (2)
rai-je.~ Gn 15, 8. a c 1) ilO', •••1' trois fois seulement (151,.8).
t1()3 c,
cr.
Milanges Beyroutk,
6, p. 129. dans
BROWN,
(3)
Voir la statistique detaillee
Lexicon,
s. v.• ~;
KONIG,
t. 2, p. 322. II n'est pas inutile de signaler I'erreur de lequel
KAUTZSCH,
~36., d'apres
(t) Opposer la vocalisation de p. ex. ~
.'! est
frequent dans Esdras (en realite 1 fois) et dans les Chroniques
BAUER
(en realite 2 fois). M~me erreur dans
et
LEANDER
~32 6.
38 - 39 a
Pronom relatif -
Pronom personnel
90
91
Pro nom personnel
39a-c
Au lieu de . u:; on a, tres rarement, devant N). La vo~elle breve, qui demande Ct 5, 2 (§ 23 a). encore employes comme sonne suivante, se maintient
. U:;,
une fois p. ex.
u:;
(Jug 6, 17, de la con-
2" PEKS. Pl. masc, La forme primitive ·'antumu n'est pas restee :
l'tt a ete supplante par l'i du feminin, se~ol!) d'ou
l~ redoublem:nt
* "antim
devenu
c~~ (avec
dans et
en toute position,
i'~~',~~,"l!~,
~t, M! et l'article
'~Ni~
2"
(cf BROCKELMANN, 1, 302).
PERS. Pl . .fem. La forme primitive *'antinna dans le :i. Enfin la voyelle posttonique se retrouve M~~~ Ez 13,20. Ailleurs on a (3 f.) M?~~, peut tomber, heb, N~M.
On trouve (cf. § 145 e-d).
relatif:
la forme unique (et suspecte) sans dagesh ron
§ 39. Pronom personnel.
(Paradigme 1).
a i~~Ez 34, 31 t (var. i~~)' 3" PERS. Sing. mase.: Forme primitive
* ku'a;
'.3" PERS. Sing'. (em.: Forme primitive
se trouve en akkadien, hebraique se maintient primitive En hebreu le S a ete supplante
* sla;
h. N'i}. Le J au fern.
A. Pronoms
l
separes, (commune). La forme En contexte le ton devient milera":
'
en mineen, en mehri (BROCKELMANN, 1, 303), par ie Iz du masculin. primitive
.....
1· PERS. Singulier est *'anii'ki> cependant ':!)N. . l Une autre
(rnerne petite)
':!)N (forme pausale). . ,,
3" PERS. Plur.
La forme la plus Les deux voyelles hebreu M~'. 3" P~~s. est
masc.: du
Forme
* humu;
l'article passe ont
h.
cry,
M~1'
1
la voyelle -,,
devenue antepretonique,
(§ 30 e):
frequente est M~h, mais avec fern. primitif
c'est CryM. au masculin
* Sinna
forme, qu'on trouve surtout dans les livres posterieurs, a evince ':!)N, • IT l'emphase) . La forme secondaire prirnaire ~)~~ est tres l'N est proest ':iN (I), en pause .-: conjonctif, p. ex. tou,~~, et parfois merne avec accent
et qui, dans l'hebreu postbiblique, . [ours dans
Plur . .fem.,: Forme du masculin. On remarquera formes: 2e
primitive
* Jinna;
h. M~6 (I). Le M
')N 'n
• T -
l'analogie Remarque,
vivens ego! (pour
.
que la finale M---;- se trouve au plu-
I" PERS. Pluriel (commune).
rare (5 foi.~~ill)n emploie bablement it l'analogie En pause la forme
~in)N,[.'U
: I\T
..
~)ry~~ ou
riel dans trois plus frequente}; Sur
3" f. M3h (forme unique);
plus frequente). de la 3° p. precedes
3" m. M~J (forme
N~M1j, N'MM; " Dans le texte on c
f: M?~~ (fo~~e
du singulier posttonique .
':iN (cf. BROCKELMANN, 1, p. 299). . -: est bref (cp. arabe nab-'nu; cf. § 28 e). "an'la reste mile'el
'M
les pronoms
de l'article
-r-
,,-,.
2" PERS. Sinj/
,-
masc. La forme primitive
en
OMM, M~'ii f M3nM voir § 36 d. .. '. D~ "k'etib ferninin dans
'N';'
le Pentateuque.
pause m~yeriile Ml=1N~.ex. Gn. 3, 19, et en grande pause Ml=1N 32.f). (§ En contexte, selon la ten dance generale de l'hebreu, le ton est milera": devient l=1N seulement
consonantique a la graphie toujours
du Pentateuque N,M non seul~ment
(mais non dans le Pent.
samaritain)
pour le masculin, rnais encore presque
.M~~n.
2" PERS. Sing . .fem. La forme primitive avec reduction § 8 c N); forme comme de la voyelle
: AT
(11 exceptions)
vraiment
pour 'le feminin, et alors les Naqdanim ~ 16(2), p. ex. N'1}tl
ecriCette
'an'li mile'el
posttonique
a un
• -
vent N'i} (qereperpetuel, particularite taine assez vraisemblable recension peut sup poser
r1~;:t Gn
s'expliquer
2,12.
simple shewa (prononce,
etrange peut, semble-t-il, de la facon suivante. primitive devinrent
d'une facon d'une cerauteurs on
pausale l=1N. La forme 'l=1N* se trouve (3)
Elle proviendrait Avec plusieurs
ketib (7 fois).
en pretonique on attendrait de
1)';I~~
posterieure du Pentateuque. que la graphie
(I) Le hatef de ';~ est anormal;
la voyelle (ou, d'autre
etait NM et pour le masc. qui en hebreu hu, M, la graphie
lat. h,IIC).
pleine '7'" :!4!lsq.)
(2)
Peut-etre Ie hatef est-il dli I'influence de I'ararneen
l'usure de la forme, ou (BAUER, , p. 1 ou
etait probablement
alors kii'a, et pour le fern. qui etait probablement
part, I'K est
n~,.
a I'influence
alors ki'a (,). Quand ces formes
(I) A distinguer de l'adverbe
I'analogie
de '~~). comme
On a 5 fois la graphie ~~ (ketib),
2· f.
n~~ ici (avec mouvement,
moabite d'Eshmunazar
(3) Pour Ie ton '~!:t' devait etre traite ancierme
'l"";~~~2 f
;,~!:t; com parer la forme
(2) On trouve
at" .dans~nscription phenicienne
de Mesa" (IX' s.) pour Ie (Ll l? s.) pour Ie ferninin.
masculin, dans I'inscription
39c-40a
Pronom personnel - Verbe
92 Conjugaisons - Temps et modes
40a-b
ati't fut trouvee
et quant
par
trop
iasuffisante,
Un scribe, peut-on
ii,
aura voulu indiquer
les voyelles longues
z et quant
supposer, la couleur, pluetait hebralques
t
une forme augmentee qu'elles expriment lite d'intensite (l'idee d'intensite
par rapport
a la
conjugaison ~~
simple, et l'action surajoutee : modail lua intensement 'de la seconde
la quantite
par les metres lectionis " '. Or pendant
comporte une modaliteobjective par exemple par est iexprimee
sieurs siecles, et notamment presque identique
l'epoque
des inscriptions
ou de causalite,
du Ie. au IV· siecle, en ecriture
carree, la forme de la lettre
le redoublement
a celle
de la lettre , (I). Un scribe, dans ces condi-
tions, voulant ajouter un , ou un , dans le groupe fait ajouter un caractere on n'aura groupe d qui pouvait passer partout tard, alors que la figure du , fut nettement
acn
se trouvait en de celie du "
radicale). De plus la conjugaison de l'action peut @tre
simple, intensive, ou causative., p. ex.
pour un ,. Plus
l'une des trois voix
active. passive, refiechie,
~~R
distinguee
il a eM tue intensement. .Le tableau des conjugaisons ples les parfaits du verbe inusite
VOIX :'
pas ose, par respect pour ce manuscrit, suffixes.
modifier l'aspect du
actuelles se presente de' la facon sU!-
ac",
dans Ie cas ou le sens indique Ie feminin.
vante (en employant les designations usuelles et en prenant comme exern-
B. Pronoms
ltee (suffixe verbal, prement
~~pe)
adopte
comme paradigme):
Les pronoms peuvent @tre suffixes d'un verbe, p. ex. ,~~~~ il'm'a
I
I
ACTIVE
PASSIVE
I'accusatif,
§ 61) ou d'un nom, p. ex. 't?qO propeuvent
Action simple
\ Qal ,,~~
It a tile
-_._--------.,.--
Cf. § 58 a
NtT~zl ,,~~~
le cheval de moi = mon cheval (suffixe nominal, augenitif,
§94). De plus les particules,
prendre des suffixes, p. ex. noms suffixes se ramenent
'? amoi, '?~r:t me void. Les
a celles
II: VERBE
et notamment les prepositions, des pronoms
i
Action intensive
ett tue
~------
II s'est tue : it a
I·~---
formes des prosepares,
pour la plupart
i pz"'e{'l
I
"~i?
!
I'
1
Pu"c,d
~i?
lis' est tue inlenstment
----I
i
CHAPITRE Action causative
II a tue intense-:' It a tie tui inmen: tensemeni=>
~~~I~
i Hif<U
I
\ HpFf/-1
§ ,40. Generatites et divisions. a
Conjugaisons. leger) et plusieurs Le verbe hebreu conjugaisons comprend plusieurs conjugai-
II a fait tiler
"~~IJ
Onl'afaittuer(2)
I
repondent en b (cf, § 111 b),
sons (2) (C'~!~~ Mtisses):
une conjugaison
simple, appelee qal La
("R
Temps hebreu
et modes.
A 5e que nous appelons temps faute demieux
deux formes que nous nommerons, if tuera.
deriver.s ou augmentees.
conjusimple, ont
parfait et futur, p. ex. dans la conjugaison it a lui; futur"~j?~ Au point de .~ue des modes, I'indicatif.
simple : parfait ,,~~ il tua,
gaison simple est bien nommee car, par rapport aux autres, est la plus simple et l'action p. ex . .,~~ 'il a lui
(3).
sa forme
qu'elle exprirne
est egalement
Les conjugaisons
derivees
ou augmenMes
le parfait ,,~~ et le futur dans beaucoup
"~rr.
sont
Le futur peut recevoir,
de formes, deux p. ex.
(t) D'autre part dans I'ecriture on tke kebrew uri of Ike Books (I) Ce mot, employe.icifaute
des manuscrits
dont se sont s~rvis les cf.
DRIVER,
modifications repondant p. ex.
LXX, Ie , et Ie , avaient· une forme presque of Samuel!
identique;
Noles
(1913) p. LXIV. francaise, souvent
M7~~ttje
personne,
"~p.~ qu'il
a deux
nuances volitives, constitue
d;ou le mode jussif, volitif de la 2'
fasse lucy! tue!
et (a la 1· pers.) Ie mode cohortatif le mode
uetsx: tuer, L'imperatif
de mieux, est pris, comme on le voit, dans de designer un verbe, on traduit p. ex. ~~
p. ex. ~~
un sens assez different de celui qu'i1 a engrammaire
. "{'-1, Quand il s'a$
la forme' du.parfalt
simplement
(t) Le verbe, ~~, emphatique tiques Ps 139,19;
,
usuel en arameen (et en arabe ~
qatala, avec Ie I non
3° p. par l'infinitif,
tuer, On designe genera-
primitif) ne se trouve que 3 fois en hebreu (dans des textes poeJob 13,15;24,14).
lement un verbe hebreu par la 3. p. sg. m, du qal, sauf les verbes ,., et,., qu'on designe par l'infinitif constT?i! (cf. f 80 c S).
c01ll.1tfeIJ"e un komiCide ~
(') Proprement : it a ttl fait tucy.
-.
Le 'mot usuel pour tuer est l~:;, pour
40ll-d
Formes atemporelles - Classes de verbes
94
95
Verbes actifs et verbes statifs
41a-ll
Outre ces formes temporelles et mod ales il y a deux formes atem-
porelles et amodales (et de plus imper~~nnelles) qui tiennent
du verbe et du nom: l'infinitif . et l'inf. construit. jectif; Le participe et le participe. tient
§ 41. Conjugaison qal.
La conjugaison qal comprend des verbes statifs d'action et des verbes p. ex. a
la fois
L'infinitif est un nom
d'action avec force verbale; on en distingue deux formes: l'Inf, absolu
(§ 40
b) .
la fois du verbe et de l'adactif) ou le parte que passif).
Les verbes
d' action
sont de la forme *qatal
il designe l'agmt, ce1ui qui fait l'action (participe Dans la conjugaison
J~9donner, :l~! s'asseoir, ";Itt
Au futur la seconde (§ 75 c), dans Ie type la premiere
> ~R" ~,
manger.
est generale'ment
patient, celui qui subit l'action (participe
voyelle
simple (qal) nous n'avons jusqu'ici
verbe fort. On 11la voyelle "i > -::-dans
d'action. Mais, en fait, outre 'Ies verbes d'action ou actifl; (I). comme ~i? il a tue, il y a des verbes d'etat ou statifs exprimant un etat
o~ 'une qualite,
C
".?Mt
J~
*u > ....:... Ie dans
(§ 72 i), dans Ie type :l~
cf.§ e.
(ici par dissimilation" cf. § 73 c). Quant
voyene. (voyelle de la preforrnante),
p. ex. ,~~ il est lourd, de verbes.
ua
ete lourd (§ 41 b)
ou faibles.
(I).
Les verbes d'action
expriment une action (transitive aussi l'action
ou intransi-
Classes
La plupart des verbes sont trilitteres. radicales inalterables.
Selon
tive). Quelques verbes peuvent exprimer
l'etat de Ia racine les verbes sont dits forts forts ont les troisconsonnes ~sente quelques particularites radicale est urie gutturale. de vocalisation Les verbes faibles
Les verbes
r~ laver
reflechie, p. ex.
et se laver, se baigner (de rnerne en latin lavare), '!f10.vers?,r,
Le verbe fort predans leur ra-
oindre et s'oindre ; ellipse, p. ex. Certains
n;;~ oindre
quand une (ou plusieurs) presentent
et se tremper. Dans certains cas Ie sens re6echi semble provenir
et (Am 6, 6) s'oindre ;
":l~ -
tremper
d'une
'~IJtourner
et se tourner
cine un element faible consonantique (ou vocalique). Pour designer ces verbes on se sert des lettres du verbe "S7D (poet.) faire (ancien paradigme (I) provenant de l~ grammaire arabe). Le
I)
-.
tenter et se sus/enter (1 R 13, 7
verbes d'action
ta
(Jug 20, 39 etc.),
SOil
'~9sus:l?).
savoir sus/enter
sont denominatifs, (de ~~ ("',~), °°
0
p. ex.
designe Ie l
er
. ment, le S7 le 2d, Ie" le 3· element de la racine. Ainsi un verbe
f'1) est
ete-
des briques
(,:lTb), .... ° °
0
("?~7)'~~ (1 f.) saler "nee (2 f.) planter la tente
-,
J~?fabriquer
b
caur
sel), ,~~ acheter du grain « tenter •.
un verbe dont la 18 lettre est un nun. Les autres verbes faibles sont
Les verbes
statifs,
qui sont des «adjectifs conjugues » (I) ont deux
designes semblablement:
designe par verbes "
M'I),"I),
ee"', .,.",
~'S7, ''S7 (cf. § 71). On
d8
formes, une forme plus frequente formeqt_ojns frequente du parf:Ot repond
* qatil,
p. ex.
les verbes gemines, dont la 2
radicale est re-
* qatul.
p. ex.
re,,?
il est petit. A ces deux formes
avec seconde voyelle Quant
,:n il est lourd et ...
a
une
petee, p. ex. ~ il a entoure. d Nous traiterons d'abord du verbe fort regulier, en commen<;ant par la conjugaison qat (conjugaisons Pour eviter les repetitions nous donnerons
une forme unique de futur,
a: ,~~
il sera Iourd,
r~~~sera petit. il
cf. ~ e.
la premiere voyelle
des
(voyelle de 13 preformante), A l'origine
la premiere occasion ce qui vaut pour toute une categorie de formes ou classes de verbes) ('). verbe actif, parfait actif, futur actif au sens de
tous les verbes statifs devaient
sans doute exprimer
c~ qui, au point de vue des Semites, statifs expriment actuellement p, ex, S7~~, ~~~ l'action,
etait concu plutot comme un
etat ou une qualite que comme une action.' Mais de nombreux verbes .
(1) Nous employons uerbe d'action, etc.; non au sens de verbe a la voix active (cf. ~a). . (!) La transiviti et l'intrtJltSiviti sont des phenomenes de syntaxe, qui ue deterrninent pas la vocalisation du verbe. (") D'ou proviennent les termes recus nif'al, les conjugaisons. (4) L'etudiant fera done bien,
hi{'ll,
ce qui .pour nous est vraiment une action,
entendre. Certains verbes, outre le sens purement statif, comme il est Iourd ('~~), ont des nuances qui se rapprochent de
comme il devient Iourd, il s'alourdit, D'un~~facon gene~ale on des verbes d'action
p.
etc. pour designer rapi-
peut dire que les verbes statifs tendent
a dev-nir
une premiere
lecture, de passer anticipes.
dement sur les formes on les details economiquement
(I) H. BAUER,
Die Tempo1'a irn Semitischeu
1910),
:B.
416-e
Verbes statifs
96
97
Verbes statiCs
41e
-f
verbes aetifs, i dans les verbes statifs. En hebreu ees voyelles appa· raissent quand la syllabe est ouverte, f. a~tif :lb!, f. statif f. statif
'R~(§ 82 h);
savoir:
dans les verbes V'l': f. aetif C~p:'
dans les verbes "V:
tzfi:l~ (pour ~(ihiiS, § 80 h). En syllabe fermee, la voyelle pris'est affaiblie en i, selon une tendanee
mitive a des verbes d'action les verbes statifs, p. ex. ,~~. semi-ferrnee),
tees generale (§ 29 g); *iaqtul (i) est devenu Cependant,
,roj?,
avec i comme dans (et 1) dans les verbes
merne en syllabe fermee
les voyelles primitives apparaissent:
i- gutturale, p. ex. f. actif 'b~~ , f. statif P!~, plIT.. (§ 21 d); 2) dans les verbes '''rJ (en syJlabe primitivement ferrnee), p.ex. f. actif :l~
(pour iaiSib), f. st2tifitV!'~ (pour izXras), cf. § 75 h, c. Liste des verbes I Qualit~s. c Pf. statifs les plus usuels, groupes d'apres le sens (2);
:litO, f. :l~'~ (rae. :l1O') info est, :litO; verbe defectif, § 85 a, ,
eire bon; adj. :li':O.
"3*, "3 (1 f_), '~"'3 (Job 31, 18'!) e. grand; qatul § 88 Dc).
"1' -.T • _ •• :
Vj, f. Vj~ eire mauuats ; adj. Vj.
adj.
';'3
T
(forme
~7 e. petit;
En pratique, p. ex. i,
{!
un verbe statif se reconnait dans certaines
du futur (pourvu que cet a ne soit pas du
surtout
a la .voyelle a
1'=1:3. haul; e
'I' .. l'
adj. adj. adj.
rto~et r~l? § 18.f.
j:l!l3.
T T T
une cause phonetique,
~tzf
e. bas;
une gutturale);
classes de verbes Par a).
la voyelle
{!
PiT;l,
de la preforrnante
(cf. § e); moinssonvent
ala voyelle
du pard'un
''=1,
•• T
Pin
'rJ~.
adj.
e./ort;
fait (laquelle a ete souvent supplantee adjectif verbal (types ,~~ de fait, les infinitifs des verbes statifs,
,~*,:l~ '
f.
-
"? e. faible;
T
Ptr:r (adj.
''=1.
verbal
i''-t;t
.
2 fois).
adj.
(1 fois)
e.
lourd ; adj. ':~
••
11 y a quelques autres indices secondaires,
p. ex. l'existence
,~,
f. ,~~
T 0\1' l'
~P-l n?~j?, "?ll?t7
de la
riO~), l'existence d'un infinitif en n - (car,
ne se trouvent guere q:e dans'
~Im, ...
-
pm e.
-.
e.
lef;t;r;
adj. '~.
loin; adj.
,~im (forme
l'
qatul § 88 Dc).
§ 49 d).
preformante du futur
dans les verbes probable,
a dans
:l'JR*' :l'1R' n?J~ e. ,9rt:s; adj. :li'l? (forme qatul § 88 Dc). ~~*, f. ,.;~, approcher (§ 72 g; verbe defectif R 85 b).
"'1 -
.e
actifs
De la voyelle
et statifs.
D'apres
une vue qui semble serieusement du futur etait. primitivement
la voyelle de la preformante
les
(i) Cf. Ver6es actifs et ver6es seatifs dans Melanges Beyr:.outk 5, p.356 sqq,
N'~e.
N~IO
," •• T rOOT
"l(!~ e.
i'~1' ,,:n p
adherer . pur; adj. 'in~ (forme qatul § 88 Dc). impur ; adj. N~tD.
.. T
i. plein; adj. N'~ (3).
des lettres de Tell el Amarna contraire. adj. (~1 e) on
pm lire
(2) Ici peut-etre
sous l'infiuence
loin, malgre l'adjectif
i""1j
du
p;
mais l'adj. verbal est ~.
adj. verbal
i'm
Compo
(i) Dans une glose cana.iecnne trouve la forme iazkur (228, 19).
(1 f.). favorise par Ie ~ de la
(3) Dans ces deux verbes l'a a- ete probablernent
(2) Le futur est en a,
syllabe .fermee,
e)
rnoins d'Indication
L 'antonyme
i. vide ne se trouve pas;
bibl,
P':! .
P. JoOo~. Gramm. de l'hebreu
41/ - 42a
Verbes statifs - Flexion du qal
98
Flexion du qal
42a-f
II Etat
de l'Arne.
0
0 •
ployee d'abord lourd-toi uouloir. ·du passe:
avec les verbes statifs, p. ex.
::lnN, ::lnN, f. ::lnN' aimer,
r~,:"
T
I'
f.
rer:~(§ b) aimer,
l' -
~1~ = ,~ + nt;1~:
une action on d'ou le sens
tu es lourd. Semblablement es un qui a tue
»,
pour exprimer
'0':,'.-
a dit, avec une forme telle que ,*qatal, «tu Le parfait des verbes d'action
t;17~~tueur-toi,
NJttt hair,
N'1',
"1'
tu as tue. est toujours du type *qatal, qui b En contexte
f. N'1" craindre. f.
'~',T
;,n, f. "n' trembler. ,ne trembler.
-T -''':1°."
T
'~J'rae. (
T
1"
,~)
redouter (1); verbe defectif, § 85 a.
devient norrnalement ~~
T •
(forme pausale), comme dans les noms p. ex. contextuelle),
*-dabar devient ,::l'=T parole (forme pausaleet en syllabe ouverte: La premiere
la forme est ,~~ avec --:- (t). Cette seconde voyelle a de *qatal tombe
n:l~*,
•• T
n:l~,
T.
~n:l~ oublier
" •• T
n?~~,
III Etat ~::l',
•• T T
du corps. ~::l' e. vetu.
""'1' -. T ,.. •• T
tll!I~~p',f~7~P'dont les afformantes lourdes ont Ie ton (§ 30 e).
adj. ::l~.
••
voyelle a tombe en syllabe ouverte antepretonique perd egalement son --::-dans
~'~~T'
-
mais reparait en pause :
n?~~,~,~~.
dans
V::lttt*, V::lttt, ~V::lttt e. rassasie ; adj. ;:~~. ::lV' avoir .faim;
•• .. T
~'::l:il. En syllabe fermee, :p
r~*, f. r~~dormir.
::l:l~, ::l:l~
T 1101' T
N~~ avoir soif ; adj. N~¥ .
~~,6~,~
n~~~, J~i?' En ~
. Le parfait
Le parfait statif .du type ,~
n1~?' c
dans
devient normalement
--:- (§ 29 d), p. ex.
(On a de meme statif du ty~ rare
'~i?' ~7~i?;"rpPI}· ~7~P'i}).
rioR
perd egalement son
-=_
e.
couche, se coucher ; info ::l;l~ § 49 de ses enfants, orbum esse.
syllabe fermee tonique __:_se maintient, en -;- en syllabe atone
par exemple pourras, on
,~~ '~',
e. prive
IV Varia.
~?~~; il s'abrege
tl~?~P" ~7~~T': tu et
keriter
-1' .
Au lieu de --:- on trouve quelquefois --:- (dans un ex. -:.:-) en syl- d
-
'~7s'habituer,
T
f. ':l~' (mais prob' fut. bofal § 751) pou1!oir! e. tapable de.
· labe fermee atone. Ainsi du verbe statif ~"
(pour ~'*)
"T
l"l~, f. l"l~~' (§ b) mourir, .. '~tp, demander (2).
'tt;;,
T
r~;;, ;;, f. r~~(§ b) p
"'. T
. 17~
apprendre.
trouve, p. ex. Cr-l~". ,. Dt 4, 1 etc., ou le i a pu etre , favorise par la .,: voyelle primitive et par la sifflante; du verbe statif demander (pour
,~*)
haMter.
17~~, 17~~ entendre,
ecouter,
21, 29'. (Cf. affaiblissement de a en -::-- § 29 e et en =: § 29 g). , .
La rencontre du J1 ou du J des afformantes avec un l"l ou un J e coupe Ex 34, .f avons donne Gn 34, 16 ql}~) . radical produit une contraction (~ 18 c), p. ex. 'r-l"~ j'ai •-y
"t:17t:t~ 1 S 1, 20 etc., C~7~~
'tt~
1 S 12,13;
25,5;
Job
§ 42. Flexion du parfait
a La flexion du parfait qal (etdes d'afformantes,
qal,
27 (l"l!~);
~6~
1lOUS
Remarques autres parfaits) se fait au moyen dans 1a plupart desquelles on reconnait facilement les
sur lespersonnes.
3" sing. {em. La forme primitive est qatalat. Le l"l est conserve' devant les suffixes (§ 62 a) et dans les verbes on trouve avec n. ,~ l"lnil~),
--:':
pronoms separes. Aux troisiemes llersonnes I~ pronom est sous-entendu; le fern. est marque par dk pour *al (comme dans les noms): le pluriel par it: ~,~~. La forme du parfait semble
nw;
• T-
(§ 79 d). De plus
T -:.JT
n7~~;
(2) et Tyr sera oubliee Is 23, 15; " l"l,rN
· la force
s'en est altee Dt 32, 36 (neslgah) : N'ttt~' l"l::l~ et elle reuienEz 46; 17 (verbe ::l'~;
Ie --:- de l'etat construit
avoir ete em-
dra au prince
p.-e. ~ 1-
(1) Le f. "~l: est traite Os
comme
verbe
d'action
(it craint ; cf.. Dt 32, 27;-
(l) Comparer de:meme
du nom, p. ex . .,~~ (~ 95 d). avec neslgah) 5, H, 12; 6,5,23.
io,
5; Job 41, 17); cf. ~b.
(2) II y a ziesigah ; la forme est segolisee, En ararneen biblique on trouve
(2) Compo
~?~, 'z:1?~ demend«
~ 97 B d.
~rt~~~l!aiM
trouvieT:!n 5,14 et(p.-e.
42/
Flexion du q~1 ~ sing. masc, Forme primitive
U)l
100
Fleaiondu
'qal-:"'Parfait inverti
42/-43,6'
Dans sans dans pour trouve
.t;l7~R I'd posttonique est bref, ce qui a. pu favoriser la graphie 11, au contre de 11t;1~(§ 39 a). La graphie avec n est usuelle 11~6~ (beaucoup plus frequent que ~6?; sorte de compensation
l'abregement graphique provenant de la contraction). On aussi sporadiquement,
qatalta, avec a final bref (i).
..de M pour " .peut-etre- sous I'influence de l'arameen, leque1 a garde 'Ia forme qatala ~devenue M~7) ('). laltim ~ plur. masc. La forme primitive du qaialtumu est devenue ,qa-
> C~~7 a l'analogie
~ plur·fem.
la
§ 39 a). L'u' est conserve
feminin (comme le 'pronom devant les suffixes (§ 62 a).
separe,
sans raison apparente, p. ex. Gn 21, 23; sans 11). De merne au hifil, par
La forme primitive Forme
2 S 2, 26; 2 R 9, 3 (apres 4 formes exemple 2 J{. 9, 7.
Pour la forme ~,,~~: cf. § 43. primitive
forme tres peu usitee ; comp. I" plur.commune.place na par nu,
rl.:l~ § 39 a.
qataltinna est devenue qatalna. L'hebreu
r~7~~'
a rem-
primitive
I'analogie
du prorrom separe et suffixe.
2" sing. fem.
ancienne Ezechiel.
VON
'~~R se trouve
Forme
qatalti, avec i bref. La forme par exemple Ruth 3,3,4 dans Jeremie ou on a (au et
§ 43. Parfait inverti
Avec le waw inversif duparfait niilera": mais en beaucoup
milieu de formes
t;'I7~R)~urtout,
sporadiquement, samaritain
,~?~~.
tend
chose remarquable,
le ton rnile'el descendre,
devenir
Dans Ie Pentateuque
'n
(voir Ted. or-
de cas cette tendance phonetique
n'est pas satisfaite.
GALL, p. LXVIII, .qui prefere Mais l'i reparait, allonge,
'n).
s'est affaiblie .en shewa (prononce): dinaire.
.t;l7~R qdtalt"
La voyelle
breve posttonique
A la 1· p. pl., ou le ton pourrail
sans qu'on -puisse voir la raison peut descendre,
8
it ne descend ja~ais;
de ce fait.
qui est ~a forme
devant
les suffixes (§ 62 a) (2) primitive est qatalku; quelp. ex. u est devenu i ~ ment, le ketib,
A la '3" p. fern. des verbes 17·'l1.(a 82 g) et ;~l1'(~ 801) leton
p. ex.
1" sing. commune. La forme. semitique l'analogie du pronom separe
lek est devenu t sous l'influence du t de la 2" pers.; q~efois la graphie Ps 140, 13. Pour la forme fois
A ta 1 p. sg. et
p. ex.
~7~ sans
'~7~j?'::cf
et suffixe de la 1· pers. On trouve " ordinairement dans
'~7~P.1' (I). ~?~~1
§ 30 e).
: les verbes
M~11' 19R1' 1
..
la 2" p. sg. m., Ie ton descend
(Dans ces formes le qarnes
nonnale-' ant~pre-
tonique se maintient,
.Exceptions
§ 43.
primitive suspect qatalu. On trouve ou fautif: trois toutefois Dt 8, 3, 16;
1) En pause, le ton ne descend 2) Dans
3' plur. commune.
Forme
at"" et
ft""
pas:
'~~m,t;l7~i?1'
ne descend On peu t b de lois strictes. ici comme relative-
sou vent' le ton
fI~~ avec
un nun paragogique
pas. A ce sujet on- ne peut guere remarquer ment plus longues long que les conjugaisons, gardent
formuler
Is 26, .16. Sur Ie nun paragogique
p'our le feminin, Ie semitique aurait • texte donne normalement certaines formes
du futur, cf. § 44 e. primitif avait une forme qatala qui dans pluriel, notre p. ex.
que les voyelles
considerees
le ton; or· ~ ~
rq~
nil~ Gn 49, 22;
117~~ ~~'1:21, 7 (qere-ketib). Dt
surtout
iT?~~qu~
en hebreu ;,~~ ... On trouve ont un sujet feminin
at -::-; '-:- plus long que
car la conjugaison
'-=-.
qal
est considere comme plus De plus,
it faut distinguer
special. Ceci
a un
traitement
Mais ces exern-
pose, nous pouvons
faire les remarques
suivantes:
pies (qui se rencontrent
comme ketib) sont en realite des 3" pers. cas i1 peut y avoi~ megraphie
(i) Sur cette question, voir·MAYER LAMBERT, serie de qeri lultb (1891), Une
sing! fern. (cf. § 150 h). Dans quelques
Dans les lettres de Tell el Arnarna on a toujours fa; cf. P. DHORME, RcvUe BiMique \,913, p. 388 sq. t.!a serait long d'apres BROCAELMANN 1,572, et d'autres, (2) Compo la forme ancienne du pronom 2· f. ,~l:t* a cote de ~M ~39 a.
(I)
. qui admet en hebreu une 3" p. pl. fern. en •, " . (t) Le waw inversif du parfait a la vocallsationfaible (au centre du waw inversif du futur ~ 47), a savoir shewa ou ses substituts: I devant labiale, 1 devant hatef patah, p, ex. ~1:Ii?q,l (cf.~ 104&;. Pour les sens duparfait inverti, cf. ~ 119; ici nous pouvons nous con tenter de traduire par le sens le plus usuel, celui du futur, p. ex. et je tuerai.
430-
44 0
Parfait inverti -
Flexion du futur qal
102
.03
2·
Flexion du futur qal
44 c -
Verbes voyelle ••
w';!: Au qal, la voyelle -;- des verbes d'action
_
et la
voyelle.
Com me nous l'~vons vu (§ 41 a) la 2· voyelle dans c est generalement
desverbes
statifs gardent Ie ton: '1'1~~,
• T
l'IN~'; '1'1N'1", Dans "1':
l' T T: T • ••
les verbes d'action
*u> _:_, quelquefois
*i >-::;
les autres
•
conjugaisons
Ie -
'0.
perd
Ie ton: liN'm~, 'liN~", : ,nN:!tin,. r' . - .. 1:
,
dans les verbes statifs (§ 41 b) toujours -:-. Ces voyelles, etant moyennes, peuvent tomber en syllabe ouverte et de fait tombent, nent en pause : assez frequente p. ex. ~,,~~~,
~h~~
...
Verbes
n"'=': Au qal, la voyelle ,-
,(8gexemples),
'l}~rn (20
ex.);
~'~;:t1'~'~;:t1' ' Dans
garde Ie ton, p. ex. l'I~V'T:
l' •
les autres c~nju40, 4.
lI)f;1~, "f;l~;
mais elles se maintie.n-
gaisons, generalement 'Remarque.' (cf. § 33). Ainsi 6, 10; au lieu de
'--;- garde Ie ton, '-::-, Ie perd; ainsi on a
Dt 27, 6; Jug 6, 26;. Jer 38, 10, mais Devant la gutturale
'~''?~~1 Ex
t1'7~~1
~"~~7' ~)[:)~,
':rI~~~avec,
(§ 32 d). L' 0 etant moyen, la graphie
doit etre consideree comme abusive, sauf comme anormales ou fautives trois formes nm "0%,1'11"'.... • -:
N la forme est volontiers milera'
dans les cas ou il y a aUongement secondaire. Doivent etre considerees avec ~: en "".
'~'Prt;:t1Dtil,
au lieu de l'IN5~ on a nN:i~ devant '10 . on a
'~'PV!i}1Nb
N, p. ex. Zach. 20, 8; jer 35,2.
~~~e~Ex
; •
18,26;
a6 Ruth
.
2, 8; e"~~~r-1 Pr ".. :. p.-e. les expliquer
14, 3. Si ces formes sont authentiques, ici, avec labiale, on aura prefere Remarques sur certaines
on pourrait
§ 44. Flexion a.
du futur qal.
ainsi : en prepause et en pause on aura voulu avoir une voyelle pleine ;
u a. ij.
personnes. d
La flexion du futur qal (et des autres futurs) se fait au moyen de preformantes mantes marquant marquant la personne et (dans 5 cas) par des afforDe merne que le parfait peut « temps Ie genre et Ie nombre.
Au pluriel fern. la 3· p. et la 2" p. ont la meme forme n?7~pt:1· Cette forme, comme 2· p., est tres rare (de meme la 2· pl. f. du parfait
etre decrit morphologiqu~ment "etre decrit « temps personnes, respondants; sont difficiles par
a afformantes
», Ie futur peut des 1·' cor-
i~~P)'
primitive
Dans n?76~~
3· p. on a deux fois la marque du fern. Le 1'1 (avec' comme en arabe, arameen occique trois fois: Gn 30, 38; 1 S 6,
preformantes ». Les preform antes Net) les .preforrnantes L'afformante
M)
T
est i~i d'origine
secondaire et provient du sing. 3· f. "i!:lp~. La forme
1'1 des 2·' personnes se retrouvent
contre expliquer.
dans les pronoms
devait etre n?~7~*
est la meme que dans
~"!!?~.Pour
, et 1'1 des 3·· personnes ~ du plur. masc. 3e et 2· p.
t
c-.
dental, etc.)': elle ne se rencontre 12; Dn 8,22. Aulieil de la graphie ~ dela
Ie fern. sing. on a l'afformante aux 3" et 2· personnes,
ordinaire n? on a souvent
J,
surtout dans
la 2· pers.;
pour Ie fern. pluriel
le Pentateuqueet d'un
notamment apres un waw inversif, p. ex. Gn 19,33,36.
Au contre du parfait, qui a un theme nominal et a l'aspect adjectif ou d'un substantif
A l'afformante ajoute souvent un , lite Ie
« conjugue »,le
essentiellement
futur
est forme sur un
theme verbal (p. ex. "i!:lP) qui generalemenj Le futur est done 'une forme comme I'imperatif, b
I·
se retrouve verbale,
l'imperatif
i appartientaux
i appele
3· p. pI. m. et 2" pl. m, ~"~p.~'~"~~t:1 on e nun paragogique c.-a.-d. ajoute. En reaon en et se trouve en arabe, en
formes primitives
des l'origine,
ararneen, etc. Les 305 exemples sont disperses un peu partout; trouve surtout dans Ie Deuteronome etre I'antiquite Ie Psaume forme en -ordinaire
(56), Isaie (37), Job (23), dans d'un texte, une recherche d'ar-
voyelle
(voy. de la preformante),
Dans la conjugaison actuelle
104 (15) (i). Les raisons qui expliquent la presence d'une
du qal du verbe regulier,
la voyelle est :-:- dans les verbes d'action
et dans les verbes d'etat, par exemple '='i!:l~, i~~; comme nous l'avons dit § 41 e, dans etait probablement a. voyelle f (t).
(1) L'explication n'etait de cet fest douteuse,
'~71~'Mais a l'origine,
d'action la voyelle avec la
i~ peuvent
chaisme, une influence arameenne, une raison metrique,
Mais la raison
les verbes
parait etre la preference pour une forme plus pleine et plus
A la I" p. sg. on a '='i!:lPtt,'~?tt
Ie cas de l'alef prosthetique
(i 17 a). Si
'mi?~a ete
prononce
iqWI (~ 26 e), la
sf
l'K, comme nous croyons,
prononciation (i)
fqWI
(lC non prononce)
serait discriminante.
plus prononce, on anra prefere f comme voyelle initiale, comme dans
DRIVER,
Notn on the Books of Samuel!, in 1 sg, 15 (p: 30).
44e -
456
Flexion du futur qal - Cohortatif
104
emphatique. qui precede (cr. § 32 d),
Ainsi s'explique est maintenue
qu'on
trouve
les-formes
en r~ surtout
105
Jussif - Futur inverti
!~
456-
47 a
la pause (en grande pause et en pause moyenne). et allongee 28,
En pause, la voyelle p. ex. r~"bP:
ticule de sentiment (donc) m'avancer L'imperatif
Nj , p. ex. N~-n"CN Ex 3, 3 (dehiq § 18 i) je ueu.x:
1 .., T T
secondairement, 13, 5, en contexte, p. ex.
(§ 105 c). peut aussi avoir le
f~~P?~104, Ps
i~~~1~t D
f~1~'r t D
ces formes se trouvent 2, 9 (pashta). Quand
parfois aussi
r~"~~~
4, 10. Mais Ruth la forme en
n --;-paragogique,
~ 48 d.
§ 46. Jussif
Le jussif est Ie mode volitif dans certains I'imperatif tend cas comme qui est Ie volitif propre une forme
"i;~~ .
il s'emploie
dUSSl
le sens demande le jussif on a tres rarement r~V'p~Job 31, 10;
fH
/
),
p.ex.
Semblablement, quelquefois
a l'afformante
f~~tCr"~ Is
,18;
de la 3' pers.;
26, 11.
de la 2" p. sg. fern. on ajoute
volitif de la 2" pers. (§ 11 t g, au lieu de de la 2' p.), tres rarernent celle de l'indicatif; Ainsi comme Le jussif._ mais
un nun paragogique.
Les exemples sont peu nombreux,
p. ex. r'Tp~f:I Ruth 3,4; Ce r, qui est egalement meen, est employe dans
r'~1~ 3,
primitif
f'b~1~ 21 f'i?~1~ 2, 2,8
analogues
volitif de -Ia 1" p. (dont le volitif propre est Ie cohortatif).
(tifha). et
prendre
plus breve que n'est pas
et qui se trouve
en, arabe et en araau precedent,
cette tendance regulier, les autres
tres souvent
satisfaite.
dans le verbe
des conditions
Ie futur qal "bp~ ne peut s'abreger futurs, excepte Ie futur en i
: il en est de merne dans pratiquement
et dans
doit etre juge de la me me facon,
hifil "~j?~ qui a une voyelle longue.
§ 45. Cohortatif
a,
i!?rpPtt.
Cette voyelle longue 'i s'abrege jussif ne peut apparaitre seulement parait taines
> -::-;one d
tuer!
on a "~P! ces futurs
qu 'ii fasse /uer! et "~Pl.:1 qu' elle fasse
On le voit, la forme du futurs,
Le cohortatif est le mode volitif de la I" pers. (2): 11 se forme en ajoutant traitee texte, (de reparalt un
gine sera expliquee dans la Syntaxe, § 116 b N. L'afformante comme les afformantes et la voyelle et prend moyenne ,~, ~ ; done elle prend tombe, p. ex. precedente
i! _:_ paragogique .
n?~~~, i!?~p~.
n-;- est
2,3
que dans certains
certaines
formes;
et encore dans ces formes le jussif n'ap-
(= ajoute) dont l'orile ton en con-
plus si elles ont des suffixes La possibilite classes de verbes aboutit faibles,
e).
de la forme du jussif se trouve surtout
dans cer-
P~~?)'i!?~~~ J er 3, 25
i!R~~~Ps
a
le
savoir 'If V et apocope
''''1'. Dans les verbes
p. ex. l'indicatif
'1't"';I l'abregement
une
(§ 17/),
(de :l~~~);
en pause la voyelle preceden te
n?,~p~.
b
precedente
mb~N Ps 59, 10. Une voyelle longue se maintient naturellemenr et garde le ton, p. ex. i!~~PN,
Ie ton, p. ex.
i!"~' fait
".0:.
au jussif "~" • ... Le jussif a tres rarement
paragogique
(§ 44 e).
§ 47. Futur inverti
Le futur· inverti, p. ex.
Com me on Ie verra
dans la Syntaxe, le cohortatif
a un emploi indirect ou
"to;r.2'
a
direct, p. ex. Que je /ue! Je veux tuer I , et un subordomte (avec '), p. ex .. atin que je tue pour Ie jussif. La nuance volitive du cohortatif
(n?~Ptt1) ..
emploi
'='toP~1et
il a tue a le waw fort, c.va-d. c) sur la consonne suivante,
II en est de meme par la parIe
un waw ayant la voyelle qui, ea consequence, ~. ex.
a laquelle fait pression (comme celle de l'ar-
ticle § 35 h, et celle . du pronom
n~ § 37
peut etre renforcee
(i) En arameen biblique oil I'on a toujours prime quand Ie sens demande Ie jussif. dans Is5, 19 :-rt::hM' qu'il hdte ], :-rM'l~ sera it normal.
T • TTl'
11 ;. .I'indicatif,
est sup-
'='rA~~1§ 18 m). (
est redoublee.
Le redoublernent
est omi- dans;.
Avec Ie waw inversif la forme verbale subit, dans la mesure ou le
(1) Ainsi s'explique probablement la tendance de la langue
(2) A la 3" p, on trouve tres rarement Ie :-r du cohortatif; qU'elie uienne t, auTieu
deux exemples du jussif, qui
negliger
la forme du jussif dans des. cas OU elle serait possible, au profit de la forme de l'indicatif, p. ex. dans les verbes :-r'~. Cf. ~ 114g N.
47 a -: d
Futur inverti
106
1~
Futur inverti - Irnperatif
47d-48a
permettent s'abrege,
les lois phonetiques,
deux chang_ements: 1) la voyelle finale changement,
u, ietait
un peu abregee, et par consequent d'une quantite et ->. -:- e). existe
interme-
com me au jussif (§' 46 a); 2) le ton monte, et en consequence
diaire entre ~, '-:n?~~ttl avec
la voyelle posttonique devient breve. Tantot on a Ie premi~ ne peut pas plus s'abreger § 31 a); ~~~ peut pasmonter); rement);
Outre la forme normale ~io~~~,il
tantot -Ie second, tantot aucun des deux. Exemples : ~ioi?1(la voyelle ici qu'au jussif; le ton ne peut pas monter s'abre~e comme au jussif; Ie ton ne comme au jussif (la voy. de"~~~
n~
une forme. secondaire
paragogique
(comme dans Ie cohortatif § 45) ayant et j'ai tue, et dans laquelle, par La forme particulier
absolument consequent,
Ie me me sens que ~~?ttl
n--;- 'a n
du
pas de valeur -~imantique.
n?~~~le s
dans :Daafin que je
Cir.J (la voyelle -de C~i'! s'abrege lavoyelle
trouve surtout dans certains livres posterieurs.en niel, Esdras et Nehemie (2). Le doute
CP!; rnais en pause Ie ton est milera", et l'!, est allonge secondaiCj?'1 (le ton monte; dans') (1). les lois phonetiques geneles il ne monte pas. On remarquera ,'.,:
.... ...
moyenne __:__, evenue posttod
nique, s'abrege en --;-); ~~~ du redoublement b
:
Jos 24,12 (piel};'
n~~J
l'analogie
n --;- u d
n --;- du
due
f~tur inverti n?~~tt,1 est sans
cohortatif indirect
(avec l'omission
tue ; son existence est probablement A la r" pers. plur. ~?~~, 21;
n~~~
une cause rythmique. est normale, par exemple e
Dans certains . cas ou Ie ton, d'apres rales (§31 a) pourrait cas suivants: 1) Dans Ie futur monter,
C~h On
la forme ordinaire
trouve aussi quelques rares formes avec l~
n --;-pan?~~~~
que
ragogique.
BOTTCHER
(t. 2, p. 199) cite 6 exemples : Gn 41, 11; 43,
Ps 90, 10; Esd 8, 23
qal en a des, verbes' "."
tti'j'!J, :l~'!J.
T .-
est probablement nous tuions.
(n~~~~n~qifj)
8, 31. Len indirect
l'analogie
du cohortatif
n~~~1afin
--;- de
2) Les formes avec
at final:
.0."
T-
at~.,;· Ni." Ni"1; N'1'~.
•• y-
3) Au nifal, generalement Mais ily a d; assez nombreuses on a 7 fois C~~ tonique
le ton ne monte
pas, p. ex. ,;:,., .
exceptions;
ainsi on a toujours
les formes ~
Cm''''
•• T
O-
§ 48. Imperatff,
L'imperatif est le mode volitif de la 2· personne, La 'flexion de l'imperatif se fait au moyen des afformantes , -'-, . de I'imperatif tu tueras. est celui du futur, p. t;x. ~? dans q,
Jug 20, 11
"~n
A la
guttrirale p. ex.
,?~, V~~I '11~1rrn, '~~f)~. ~cotede
t
on- a toujours la forme d it fut reuni aua: sims (toujours
(2 foi~ milera").
Remarquer
ave~'~
Nbl1,30;
n~ du
rnile'el dans la formule en fin de verset: cf. § 69 d.
91?~
tuecomme
futuro Le theme dans
~~r:t
.
Gn 25,
8, 17; 35, 29; 49, 33; Dt 32, 50 Pour Ie piel des verbes c d Dans les verbes
Ie
t).
aboutit
D'une facon genera~e, quand . du jussif, mode imperatif volitif,
un futur la forme
du jussif
2- gutturale,
differe de celle de l'indicatif, I'imperatif, mode volitif, prend la voyelle p. ex. dans le ~erbe regulier, au hifil.: on a au qal des verbes'rp
1':1"" l'abregement
~j,.
•••• 0":'
a une
apocope comme Devant la to~p. ex.
au jussif (§ 46 6), p. ex. ~~, ° personne sing.
~~1
avec' Ie -::- du jussif ~~~~; de rneme dans les verbes
il y a plusieurs particularites.
,'J7 on a Cj?1J comme Cj?!. Cependant
du jussif Op! on a (anormalernent) admet, avec certains philologues personne,
cote
~7~..
at, qui ne peut etre redoublee, l'a, en syllabe ouverte, est ,Le ton ne remonte pas (p. ex. defective
I'irnperatif
C~i' (§ 80 c). Si l'on
c\~) ('). Presque
modernes, ijue I'imperatlf
jours, dans les cas de ce .genre, on ecrit sans mater tectionis,
0R~~' C~~.
~~~
.
le futur, il faut dire que le jussif est un imperatif La voyelle de I'lmperatif est tres generalement
(I) En ararneen
a la
a precede
2' et
la 38
Cette graphie
semble indiquer
aussi
que la voyelle
p. ex.
la voyelle du futur
(1) La negation prohibitive ;~ tend 1 R 2, 20 (comparer ~~~.
(I) Pour les verbes
faire monter Ie ton,
~~~
Ex 23, 1, mais ,~,-;~ 2 R 23,18 (gutN:
biblique, _
moyenssont
,5j'yntar
consideres comme un peu
, turale) ~ 80 k N.
:'I';
cf.
* 79
plus longs que _
In
-::- (cf. q 28 ~ N):
KROPAT,
(2)
Pour. Ie detail voir
der CII1-onik, p. 75.
48a-d
(jussif), p. ex. exceptions futur pour ,,~~;,
~p
comme
"~P~I'~~
nifal
I
Irnperatif
108
comme ,~~~,
r~ comme m~·Les
au
109
Imperatlf - lnfinitif
48 d...,.. 49 a
paraissent
tres rares (I).
rarement Job 33,5; Cette
i17t?p., p.
ex.
rrp~ Gil 25, 31
(avec
gutturale, p. ex.
,
nS.,v
T
: '."
Dans les conjugaisons
derivees, I'irnperatif
hifil comme jussif Aux conjugaisons proprement
"~P1J
la vocalisation:
"~R'':Icomme "~R~' piel "~R com me "~p~ hitpael "~~~i} comme "~R::' ..
passives (pual, hofal) I'irnperatif
ressemb!e egalement
il1~~ p. ex. ;'~~~,
i1ilt?~ Nb 11, 16). Dans le type ':l::l'!!>n a naturellement i1~~~; exception n~~~ -6i~:i19 rnalgre :ljp (I). Ps ..afformante . i1 -;- est traitee comme les afformantes '-:-, ~
sont
(§§ b, c); ainsi les formes pausales
dinaire purement on a euphonique. fois
n,??p,
i11~~' i1~?:
semble d' orainsi plus
n'existe pas. On signale deux exceptions:
fierait probablement sois gisaut (cf
32 t);
~~CT(~) Jer
,~,
:If'Pt?
,':l:l)~i1 Ez 32, 19 qui sign iqu',~~ : couche, f(isant 2 R 4,
soyez tournes, ,_ ~.
La raison qui fait souvent preferer la forme en i1 _ L'usage
e~t du reste ties ~ariable; est b.eaucoup' a toujours
49, 8 qui signifierait
n?t;l
23 fois et_ f~ 16 fois;
que
Dans~, correspondants
f-!:lla voyelle est moyenne comme dans les futurs elle tombe devant les afformantes en pause, ab~sive. p. ex. d'ou par affaiblismoyen, comme la graphie mais se maintient
frequent
i1?7 (ec<rit 3
97). On
au contraire!p'
(§
44 e);
~'P.'?; '?f:! J s
e
(§ d), p. ex. '~j?;
~.,t~i~~, 26 ;
trouve
i1 _-
dont 7 dans Ps), i1~~':1 fais approeker (5 f.), Ps), i1P~Wi}ure j Job 33, 31).
m~viveilte-toi
n~n luUe-toi (8 f.,
(6 f., dans
4~, 6. L'!1 etant sur
'1I1Oj?, h~U'on
(5 'f.), i1-?~Rttprete l'oreille,' ecoute (9 f.; 1 f. :l~j?t} .
insensible, pour avoir Nl (cf. § 45 b), te prie de sentiment
parfois, doit etre consideree Remarques sement de a en i Dans Ie type '~,
La nuance ajoutee par i1-;- etant pratiquement un sens plus fort, on ajoute la particule
la flexion, on a forme *kabedi etc., ne s'est conserve que dans les verbes est
'1~ ('). L'a ~7
'IOmtJ .
• -t 1-
p. ex. Gn 27,9; (cf. § 105 e).
Nf'lJ'?
Nrn?7
Nb 23, 27 va done; va: je
2- gutturale,
p. ex.
Dans le type On a toujours
la forme syrnetrique avec le
attendue
cette forme en p avec les suffixes, p. ex.
,;?~~ 64'a) (§
"?~~avec
p: . :.' L'infinitif et d'apres
§ 49. Infinitif. (§ 40 b) est dit absolu ou construit (2) d'apres sa forme
syntaxique
et tres ordinairement .p. ex. effet
i1 --;- paragogique,
,_, .
par ex.
n?~~ d). (§
Au contra ire, avec Ies afformantes
~"tp~par ~j?, ~"~j? est
l'analogie d des types,,:l::l, 0: avec mais du Irnperatif emphatique, nuance.
',?~p:~~j?
'S,~ Jug
9 10; ~~~
I
~ la forme en , est assez rare ' 0 Ez 32, 20; les formes ordinaires sont en
son emploi
(§§ 123-124).
qui ont normaleL'inf. la
Dans la conjugaison distingues : inf. abs. actuellement port. ment cs_t
qal, les deux infiriitifs sont rigoureusement info est. ~j? (3). Ces deux formes, ~'ont originairement *qatiil, devenue forme nominale aucun rap-
(semblab:le~
a '1~, ~,~). La supplantation de "?~R' difficile a expliquer; peut-etre est-elle due a
r,;1O~,
q,~.
:•
une certaine ressemblance, (avec ij long; tres souvent comme I'imperatif
L'inf. abs. est une
i1 -;' paragogique.
Au sing. masc, on a souvent lequel -originairement souvent ajouter est aucune
.'1IIO~
une forme augrnentee Avec Ie type
i1 -;-
paragogique, ne semble
~'?,
~i?'
C')
graphie
defective ~j?).
vient de *qet~?l (l'p est moyen;
pratiquement
"~p la
forme est tres ordinairement
n'?t?~ (§ e),
(!) lei encore Ie shewa est moyen (cf, ~ eN). . il s'agit de I'infinitif construit, lequelest
(I) Dans le verbe fort je trouve seulement"~
Jug 19,8 (cf. v. 5) malgre
le futur
'~9~'
(2) Le shewa est moyen, et par consequent la begadkefat rafe (~ 19flo
De rneme, naturellement, dans les irnperatifs du type ~ioi?, p. ex. ,~~~. - La forme primitive semble etre *qutl, devenu *q'ful ~ioi?' L~ shewa m~yen serait Ie vestige de la voyelle postposee, D'autres aamettent une forme primitive *qutul.
>
Quand on dit (p. ex. dans cette grammaire) I'injinitif, sans epithete, I'infinitif ordinaire, l'infinitif absolu tie s'empIoyant que dans des cas tres speciaux, (3) Dans les paradigmes, afin de mieux distinguer les deux infinitifs, nous faisons preceder l'infinitif construit de la preposition (7), p. ex. ~ioi?(~)' C1P(?)' (4) L'usage est tres variable; ainsi on a ':j'I~o:t 34 fois, 'f.'o:t 12 f.; par contre ~'; 2 f., SZ"t; 11 f.. ,- I{At:TZSCH 45 a) dit it tort que la graphie ~~R (~ se trouv_e seulement c quelquefois » (de meme BAVER-LEANDER, 317): l,
, (%)
49a - c
Infinitif
110
111
Infinitif construit
49c-f
graphie sporadique longue dans
'il~~
est done abusive). Ilse trouve ainsi qu'actuelsyllabe la merne voyelle p, En considerant, de plus, l'opd'avoir et est, grand entre eux semble ab-
at"" on a
aa~ malgre
~~'.
Les verbes statifs, dont le futur est en
lement les deux formes -ont en derniere
a, ont done ~resque
to~~ ·l'inf. en p, p. ex .
.u~, "k~, ~b~,
~!l~;
'il~i?'
moyenne dans
position entre ~ et cienne grammaire, so/u, infinitif b
p,
~7'
ci=1,en, :l'.
Ainsi la forme ,,~~ est en~ahis~ante; la forme propre de l'infinitif construit ('). Infinitifs construits qal avec finale feminine elle est devenue com me d
les deux infinitifs ont l'air
la relation qu'il y a, p. ex., entre abs. peut-etre avoir admis cette relation comme construit ('). derivees Dans les conjugaisons creation secondaire.
'il'~
-';!;,~.L'an-
meme la conscience linguistique;
it --;-. it --;-, des
reelle, d'ou les noms infinitif
On trouve aussi au qal de certains verbes (en fait, presque uniquement de verbes statifs) un infinitif avec finale feminine types (d'ou, par affaiblissement) a cote de l'infinitif ordinaire. stantif: crainte)
l'infinitif absolu semble etre une des deux' infinitifs n'est-elle
it7~~'
it?~j?,et it?~~(ou 'P)' parfois
itt;t1~ craindre
Aussi la distinction
pas rigoureuse ,comme au qal. Bien plus, souvent la forme de l'infinitif construit peut etn~ employee nifal
Les exemples les plus frequents sont:
"~RI!,
com me" infinitif absolu, p. ex. au ainsi au hifil du verbe rigulier on
a cote
de
N"1~(deux fois selliement);
it~,~ aimer
(aussi' sub(aussi
au piel ~~.
Parfois -l'inf abs. ne differe de l'inf. est, que piel des verbes
, subst.; amour), une fois seul' :lh~?, Eccl 3, 8. [Au contraire pour l'antonyme kafr l'inf. est ordinairement
par une modification secondaire; a: est,
N)~, p. ex. 2 S 19, 7 (ou oppose
"'~~1j, .abs. "~~1j; au
IJ~
(forme legere), abs.
(forme lourde)
e).
a 3" gutturale:
est, ~
aM:lme); on a seul' deux fois la forme fern. (a l'etat est.), et cela
Les infinitifs abs. en p (avec p, sans doute long,
l'analogie de
~nkMit"
On d'origine
dan~ -d~ux cas ou le sujet de l'action est au genitif (§. 124 g): l'e~at c~t.) Ii la rencon;re de, d:'~u', avec valeur prepositi~nnelle, vant de (du verbe un substantif. trouve (comme l'inf.
n~~T;'~
a
au-de-
Dt 1,27; cniat inN);'~ 9,28]. La forme nN!j?~ (toujours
'ilTOi?)ne
se trouvent guere qu'au nifal: types ,,~~~ purement
('il~p?) et.~RI}.
par son
Dans les conjugaisons caractere hybride: c Voyelle sons derivees, p. ex, ~~ ~~;
passives (pual, hofal) les deux
~i? = rr;~ rencontrer
encore quelques Exernples :
~ 78 k) est employee comme
infinitifs sont rares. Au hofal l'inf. abs. gement de la 1• voyelle
"~p;:t est
remarquable _
Infinitif feminin piel § 52 c. rares infinitifs avec preforrnante ~ e semblent
C01lVO-
c'est l'inf. abs. du hifil
-=- en --;-.
"~j?tj passive
par Ie chan-
"~p~en
ararneen). Ces infinitifs aramaisants
de I'jnfirritif p. ex.
construit.
En general l'infinitif est, a la qal on a
posterieure.
it1~~ N';P~7Nb
10, 2 pour
meme voyelle que le futuro II en est ainsi dans toutes les conjugal-
quer l'assembtee
(partout
~p~. Mais
~'~PiJomrne "~P!. Au c
a
~P,
comme on a malgre
10, 2 (Dt 10, 11 +: le
-=- comme
ailleurs ~j?~ est subst. : convocation); infinitif (cf. § 95 d);
V~~
le subst. serait
aux futurs en a correspond assez rarement (statif; c'est l'exemple 28 gutturale
un info en a,
vm~*); N~ Nb 4, 24; 2 Ch 20, 25; 35, 3. Parfois la forme
u~ -sens T~lutot substantival, enuoi
de
"~i'~a
principal) (3); ordinairement on a ~~
p. ex.
'1Ji;-"~~~'~~N~~ 2 e
ni)~ ~~
~, ~,
Ch'19, 7
l'inf. en ~. Ainsi dans les verbes
tl{ception de persomzes et acceptation de cadeau x ; portions (ici forme miqtiil). avec les prepositions Infin~tifs
Esth 9, 19 la seex-
dans les verbes
38 gutt. ~
..
malgre ~;
dans les verbes
des emplois qui peut
~?, ~~
7. Quand
(') Chose curieuse, repondent assez bien absolue, cornme un nom
les deux
infinitifs ont en syntaxe
conde radicale est une begadkefat, elle reste ordinairernent ~epti~ns. Au contr:aire, apres Ps 118, 13; ~~~
(') Peut-etre;
rafe apres
a leurs
a
noms. L'infinitif absolu est employe' d'une facon l'infinitif construit
lI- et :D, p. ex. 'm)::I Job 4, 13; ,,~~~ 2 S 3, 34; il y a quelques
I'etat absolu; au contraire p. ex., abs.
'? elle 'devient
explosive, par exemple
se construire sur un nom ou un pronom, corn me un nom
(2) De meme qu'on a, au participe, (3) A l'exception
"b~~
l'etat
construit, suf-
Gn 34,7;
en partie,
'n y a quelques exceptions. Avec ", qui
de Ia relation supposeeentre ~Ic~ et ~~~ .
r:!7.!:i,
cst. ~jt;. qu'avec
de ~~~, les infinitifs en a ne se trouvent
fixe ou en liaison etroite avec le mot suivant,
a cause
49/ - 50 d
Participe et adjectif verbal
112
113
Participe - Coojugaison
nlfal
50d- 51 a
est beaucoup plus frequent (') devant I'inf. que ~, un sens tres formant faible ou merne me~e que
f'
et qUI souvent a comme le-type a pu (au
avec Ie sens de
'~1~ 39
n?,h
T
fois aussi); 1 fois
nul, la forme aura ete sentie cette forme avec shewa quiescent l'inf.
'",i?
n:lP esperant
comme
n'existe
pas);
esperant,
n~1Y? 3
-r :
(Ie participe f.;
du piel
i1I?~ I r.
participe I'analogie e
une unite plus etroite (I). Com parer, avec 1e gutturale,
e; de
CQ1lvrallt et passif ~O~ 1 f. couvert, comme nl:):J~, nl:):J~; passif
,eJ;1?
§ 68
etre favorisee par Ie futur
,e~,
~P7
'!f1'~beni
avec shewa quiescent
lieu du shewa moyen) a pu etre favorise
par Ie futur
~p~.
de l'antonyme maudit. Quelques participes 7-1~i? ont un sens actif ou vuisin du sens actif:
T
'~'N
(pual
n!lt?
"." 1 :
seulement
6 f.) probablement
MN dans
T
Cant 3, 8
§ 50. Partfcipe
a Le participe trouve
et adjectif
verbal.
Le participe Le participe verbal (§ 41 c). actif se pass if
./'epee; '~:Jt Ps 103, meen il y a d'assez actif, p. ex.
:l," 'tnN tenant .1: 14 t se souuenant
"..... •• 1-:
(ol'dinairement) (kabituellement), passifs
l'epee, armes de memor, En araauasens
est actif ou passif (§ -40 b). passives.
"~1et
nombreux
participes
"~i? employes
T
"I}~ qui correspondent
aux deux ex em pies cites,
dans les conjugaisons
actives et reflechies, avoir un adjectif
Iesquels sont probablement Conjugaisons
des aramai'smes. On a 1'~" dans Dt 1, 13,15 Dans Ies conjugaisons derivees ',~~. (sauf du ~ II y a ces deux voyelles, ,~~~.
se trouve dans les conjugaisons qal, les verbes statifs peuvent .b Qal. _L'adjectif verbal C'est de ces formes nominales sont que des « adjectifs I'on a tire Ie parfait jectif verbal que dans supplante Ie veritable verbal d'action
De plus, dans la conjugaison
au sens de qui (y connalt, homme entendu, gnarus. derivees.
a les formes qati(, qatul, p. ex. ,~, qu'on a fait les parfaits
I
tbi?'
ad-
nifal) le participe deux exceptions
./
se forme avec la preformante dans les verbes irreguliers les ,..1' on a de aussi sur
~. La voyelle
statifs, qui ne qatal, d'ou ou elle a du type p. ex. par Ie
est celle de la preform ante du futur, p. ex.
"~i?~ comme
conjugues ». La forme nominale les verbes '''1', participe p. ex. !C~ se levant,
: dans les verbes c).. Pour les autres p. ex.
11'1' on a
,,~~ ,ne se trouve employee comme (§ 80 d). L'adjectif ~~ au contraire verbal
:lp~ malgre
~ est
:l!?~; dans
formes
C'i?~ malgre C'P~ (dans
l'analogie
:l'~'~, § 76
Ie futur,
tbi?
est tres rare; on trouve du type N,:!~craignant, actif
L'adjectif participe c
t~:dormant,
ralement./crit
,?.~ est
,j: redoutant,
.le participe
se modele
'~R~com me
ayant honie,
,iN brillant.
La forme ancienne
du nifal, qui avait egalement
la preform ante p. ex. les et peut-etre g
assez frequent, supplante
Mais il a ete souvent
~i'~, avec
~oms
0, a ete rernplacee par la forme
~i?~'
C'est la forme merne du parfait
actif, p. ex. :ljk aimant,
N;t" haissant (§ 41 c). .
qiitil, simple extension de la I" voyelle, d'ou qijt~l, gene~ Pour la flexion, cf. § g. qatul, simple extension d' ~ de la 2" voyelle, p. ex.
'11' '~1~)· Dans
-;:- dCi au caractere comme
nominal du participe(comp.
Ie nifal on a donc la me me forme au partidans le qaI des verbes statifs, Exemples :
Le participe
a la forme primitive
de la forme qatil par allongernent defective Le participe
.Ii
'~p(§ 7 c).
cipe et au parfait, I'analogie Flexion
de ces verbes. des partici~es.
passif tantum.
a la forme primitive
de la forme qatul par allongement Participium que la conjugaison
ou "'~j?e).
ou
n?~~et .(surtout)
(surtout) §. 89 g).
l"I?~P(§ 97 C a); - ~1?;' C'7~p~; n?~i?~ et l"I7¢i?~;- "r;:lp~, C',?,r;:li?~;n,?,r;:l~~ et (surtout) l"I~p'~ (cf.
§ 51. Conjugaison nifal.
simple l'idee
'~p .C''?t?~ (§ 30 g); n~~
Assez sou vent le participe
existe, alors (39 fois,
qaI n'est pas attestee,
'?"'=1 parlant
a core
(I) M~me raison de frequence
pour Ie cas de ,CK'?,
de ,~~~ ~ 103 b. - :.
,~"!~, 103 b. ~
.
(2) Remarquer qti'avec un subst. cornme est .. ,~"t on a toujours .,~"U, -: , - :. (3) La forme 'llQ~ represente seule actuellement la conjugaison
'~'ll,
Le nifal est la conjugaison La caracterietique flechi. Apres Ie lest assimile une preforrnante,
r.eflechit de l'action
(§ 40 a). a
du reinfinitif,
idu nifal est on l.
iequel exprime
du passi(
et done aux futur, imperatif, de la
Ie
du qal. Il existe des restes
"~R
e 58 s.
d'un ancien participe
du passif du qal: quial>
la consonne suivante;
ces formes sont done caracteradicale.
8
risees par le redoublement
P. joUoN, Gramm. de I'hebreu bibl.
51 a-b
Conjugaison
nifal
114
115
Conjug~ison
nifal - Conjugaison
pie I
51c-52a
Parfatt. en
La forme primitive
est naqtal.
Le premi-e; a s'affaiblit type :l~~
t. d'ou
*nayJab
"~i?~ 29 g) e). Cependant I'a s'est maintenu dans le (§ > :l~) (§ 75 a), et, en syllabe ouverte, dans les types
~a forme primitive de est ianqatil, d'ou iinqatil
Sens. 'O~)signifie
Le sens premier, presque toujours p. ex.
\refiechi,
est souvent
.conserve.
Ainsi
ri~~' s'appuyer; tj.
dieter et Nifal interroger, tiquement
p~~t s'etrangler,
se gartler, C~~ presque cacher
tj. se venger;
1 f. D'autr~s nifal .ont en merne et e. cache; ,,~~ se ra-
(§ 82 c), Cip~ (§ 80f).
- , Futur. blissernent (par affai-
temps Ie sens. passif,
'l.:'19~se
e.
en i), d'ou ~~~. La preformante soit cette est M:' "~~;:t. On a la merne forme absolu on emploie soit la forme finale
{J
rachete, tolerativum.
Dans quelques cas le sens est celui de laisser efficace, p. ex.
Imperatif,
{aire, generalement lant de Dieu);
avec idee d'action se laisser avertir,
TV'!1~se
laisser
l'infinitif
construit.
A. l'infinitif
et cela efficacement,
d'ou pratiquement ;
,repondre
(en par-
de l'inf. est.
"~~;:t,
la forme
"~~;:t,soit
formante
b
"ro,7~faite
meme d'apres
forme avec la voyelle le parfait
,tjp
et cela efficacCi!ment, d'ou. pra-
(§ 49 b).
forme it preno-
tenir compte de i'aoertissement
'I;)i~ se laisser corriger , se
exaucer
Le participe minal du participe: Remarques Futur.
actuel,
qui a supplante Flexion
une ancienne
corriger ;
pOllrsoi;
'l.:'1~~se
laisser prier
(efficacement),
U)·
~ .. a la forme du parfait, mais avec -;- dQ. au caractere
"~p~ 50 f): (§
les diverses
Le nifai peut avoir le sens au moyen le sens reciproque , p. ex.
g-~.erc_ p. ex. ~~~~ demander
se consulter, dtliberer;' passif,
§ 50 g.
on a aussi souvent ,,~~~
sur
formes.
A la 1· p. sg.
cote de ~~~
se rencontrer (au rendez-vous); Tres souvent le nifal aboutit
Cr:r'?~combattre.
.i un
enseveli. (Pour
r-!!i)
'-!!i)
(avec i, .qui est normal en syllabe aigue) et toujoursaussi dans les verbes
re . type
,
M7~~~;toujours
''?i) ·e.
§ 58)
enfante,
naitre ;
'~p~ e.
sens purement
p. ex,
le passif
du qal cf.
:l"'~N (§ ,75 aN).
•• T •
Au pluriel fern. la finale est toujours Pour le futur inverti, Irnperatif. cf. § 46 b. On a toujours
m""':"
T: -
(2) .
(§ 29 d).
sans doute
Bien que le nifal soit proprement du qal, on le trouve et aussi du piel (dont aussi comme
le reflechi (et souvent le passif) (ou passif). du hifil
le refiechi
C)
l'analogie Infinitif apres
de l'usuel construit.
i? '~~i},
,~i;M avec le 'ton mile'el,
',' T
-0
ou il y a nesigah,
Cr:r~ au
hitpael,
le reflechi propre
est l'hitpael);
sens de se consoler est le reflechi du piel
cr:r~ consoler ; 'iJP
au
ainsi, le nifal
.On trouve quelques formes ou le M est synp. ex.
cope
une preposition,
(pour l"IiN1~7)' 9~~~ Lam 2, 11. Mais dan~ les deux exemples Ain~i dans Is 1, 12 on peut faut prob' lire Ie qal analogue est Infinitif absolu, lire le qal l"Ii~" co~~e
ni~"
TI"
pour
se montrer
Is 1; 12 cites,
se laisser auertir , le refiechi de "MtM avertir. .:. La plupart des sens du nifal se trouvent aussi, naturellement, qui est la conjugaison reflechie intensive.
comme aussi dans la plupart des autres, la vocalisation peut etre fautive. et dans Lam 2, 11 il Ps 61, 3 (Remarque Le piel est la :conjugaison La caractertatique active de l'actlon intensive du piel est le redoublement
9io~~ en languissant,
§ 52. Conjugaison
-piel.
pour le hifil, § 54 b). Dans le verbe regulier la forme la- plus frequente . on l'emploie s'il venait pour (forme de l'inf. cst.); motif d'assonance
(13
40 a).
(ou mieux allonge-
~~;:t
dans des cas comme ,~~
1 R 20, 39; cf. Nb 15,3 ~; Dt 4, 26;1 S ~7, 1. Au contraire, la forme ~i?~ (§ 49 b) est associee au parfait dans 1 S 2b, 6 ~l : _. ,,~): . if a instamment demande pour lui (comp.
(I) Peut-etre
,~;:t Ct:t
a manquer
(I) Co~parer-le
hifil de conseniemmt, p. ex.
'~'~tfrypreter (e 54 d).
fait double f.) domli. emploi avec Mais iI peut y
(2) Quand Ie nifal a Ie sens passif, Ie participe Ie participe
(2 f.), lu (1
passif du qal, p. ex .
r'~ (4 f.)
IC'I'R
§ 81 e et cf. § 123 P).
avoir differenciation de sens; ainsi
q.
= invite,
et
r~ (3
convoqtli, ei«, ~~~
nOnJllli
cet affaiblissernent a-t-il commence dans des formes comme
(3) Par ex. Neh 6, 1 ~ fut entendu par).
~~tf~it fut
fait entendre Ii
on apprit it (non: it
*n4qlaliem', loin du ton.
524-C
Conjugaison plel
116
117
Conjugaison piel
52c-d
ment) de la2° L'explication Futur. Parfait.
radicale,
L'intensite
du sens est tres
naturellement
Dans 3 verbes
on a la voyelle -: "0"
"...
,::1'1 it a parte, 'S::l i! a expi«, 0.". • v
»
exprirnee par l'allongement
de la consonne.
C::l.:l, et it iaucra (11 f., mais 2 f. C::1::ll). Ces anomalies sont difficiles
des formes doit commencer par Ie futuro ~;. (La .voyelle antepretonique Ie parfait du hifil § 54 a). du tutur (2), d'ou tom be, § 30 e).
a ·"e~'pliquer. En
La. forme primitive est iuqattil (conservee en arabe) qui est La forme primitive qatta! n'a conserve en hebreu aucun
.... :
et C~::l (2 S 19, 25 t). . ... Dans la flexion on a egalement --=- (§ 2~ d) qui n'est pas plus pause on trouve ,;~
devenue normalement
primitif que dans Futur.
"~p,
p. ex.
~7~P'
A la 1'" p. sg. au lieu de ~ on trouve cet - devient ..." ,
tres rarement
des deux a. (Comparer par --::-' qui provient
N , p. ex. dans mtN...: je disperserai ·tT
Lev 26, 33; Ez 5, 12.; 12, 14 dans C'l.'CN'
"-',T" ,
Le lor a s'est affaibli en i (§ 29 g) (1). Le 2d a a ete supplante
~j?
(devant qames, cf. § 29./); (comp. § 21 h).
Zach 7, 14'
L'Imperatjf ,~~~ ales voyelles du futuro On a la meme forme l'inf. est. A l'inf. abs. on emploie ordinairement la forme de l'inf.
Au plur. fern. la finale est ordinairement
n?1$1t;l
(en contexte et en pause). On a
n?7 ~
11)'~
T'
••
(§ 29 d), p. ex. 14; 'Is 3,16; Ez 13, 19.
dans 3 formes pau-
cst. ~~, rarement cette merne forme avec la voyelle finale p ~~ (cet p probablement long, § 49 b). i...e'participe Remarque p .. ex. ~~~ ~~);
C
sales sous l'influence Imperatif, :l~~ Ez 3?, 17. L'inf. construit dans
de causes particulieres est abrege en
(Os 4,13,
13, 18). On trouve nne fois la forme anormale . Le -::- de ~~
n~'''':'_
T:
"0"
ales. generate,
voyelles du futur: Le redoublement
"~~~. reel est assez souvent
--=-
d~ns ~~~ Ps 55, 10;
reduit au. redoublernent
virtuel quand la consonne a shewa (§ 18 m),
avec finale feminine "-;~~
(cf. ~ 49 d) se trouve
et sou vent dans Ie verbe~~~~ (mais toujours, sur Jes diverses formes.
a l'imper.,
.
M';IIp~Lev
26, 18; M~~! Ps 147, 1; avec suff. p. ex. 2 R 2, 11 La forme
l~P~~ Ez
16, 52.
toujours dans~",=p louez (hatef patah § 9 d). Remarques Parfait 3" p. sg. m. Bien que Ie --::-soit secondaire, (4)
L'inf, absolu de l'inf. est. ,,~~,
est rare. On se sert ordinairement de la forme
"~i?est
la
l'a est affaibli en i pour l'assonance : Participe. Ex 7,27;
MANN
forme propredu forme ~ surtout conjonctif fois
piel et la forme pausale (,). On a tres sou vent la Ie patah n'est pas l'a primitif, mais est un affaiblis-
r~~(toujours
'~111i'ijC'~?i~. l!l~~~r~?
est pour
Dans 2 S 12, 14
dans le groupe
pu
9, 2'; 10,4;
Jer 381.21)
r~~~*ar haplologie. p
p. ex.
nt;'1~
r~~-C~
La
sement de --::-(§ 29 d). La forme eriliaison vant maqqef), rarement fois
~'?,
forme plus legere, est employee et quand
(accent conjonctif).
~'?
vocalisation C'~~~ Jer 13, 10 semble fautive, pour '0. Cf. BROCKEL• -e 1IT 1, 264 sq. Sens. Le sens fondamental est celui dintensite,
perd Ie ton (de-
'P~ et 2 serait l'~.
on a toujours
t!~; la
'n~; avec
forme
avec accent disjonctif. Ainsi, avec un accent un accent disjonctif faible on a 2 (qui ne se rencontre pas) pausale
Pt1~* se
,~~
moquer de (qal: rire); ,~~ metire en Pieces (qal: defier (qal: ouvrir).
mendier
(1 fois; qal:
demander); compter);
briser);
'~L? *
raconter . (qal:
nl.:l~
Parfois l'intensite
est numerique : l'action s'etend
a de
it
nombreux sujets, p. ex. ou
(1) Peut-etre cet aftaiblissement a-toil commence dans des formes comme : *galtallem', loin du ton. Le patah se trouve conserve seulement dans '''') dans I'etymologie une forme archaique.
. '~p ensevelir
sitif ",
Jug 7, 6;
,~~*
demander 2 S 20, 18
de nombreux
t R 11, 15;
tn'a fait ouhlier pour l'assonance avec ~~~,
Gn 41, 51; c'est probablement
(3) Comparer
de ce '~~m,
r?t~
'"
objets. p. ex.
n~~
+: Pp.'?*lecher
Jug 20, 6;
enuoyer
couper Jug I, 6. Ainsi, d'un qal d'action tranenfanter :
= accoucher (en par-
Bien que le hifil soit la forme proprement causative (§ 54 d), le piel a assez souvent le sens ca:usatif.
-T
(2) De merne au hifil la 2" voyelle du parfait est
i'analogie du futuro
la forme avec suffixe
i~i?
enfanter on a: piel ';" de d'un
(') Les dictionnaires donnent fait, ne l'ont pas dans nos textes.
souvent la voyelle -,;;- it des piel' qui, de
lant d'une sage-femme); seigner ; -
,~?apprendre
faire
,~'? faire
apprendre,
T
en-
qal d'action
intransitif
ou d'etat:
de ':IN Peri,.,
52d-
53 a
Conjugaison piel - Conjugaison
hitpael
118
119
Conjugaison hitpael
53a
-f
dispamitre:
o
,~~ f. plrir,
tifier ; de
"j~ e. grand:
":r~rendre
se
f.disparaitre; rattacher
de tef:r~
e. saint:
tef~j? saneprovo.-
reste de la forme est 11i} se trouve on a ~~l}~avec Rernarques Ja voyelle aussi
grand, ' etever. (un elifant).
Autres impuni,
nuances pouvant
a I'irnperarif
les voyelles generales.
l'analogie
du futur, et
d'ou "t@Rl}"· Le groupe ,t@R~6 . Au participe en ~, duquel seul et rare qui a se mettre en s'abandonner imfncr, en ara. La forme hitpaal : ~~~I' ~~~~
b
a l'infinitif
I'idee
causative:
quer: -la colere C~~ (2 f.), fa jalousie
N?j? (1 f.); laisser :
r'
1'R~laisser
du futur. Outre ,Ie type ordinaire
it~T:llaisser uiure (= ne pas luer); garder : (1 f.)'tenir
r
it~t garder pur,
nous avons parle jusqu'ici, a au parfait, dans se trouve colere, 7 verbes, contenir,
•
il existe un type secondaire
'l.:1L?*
cache. declarer innocent
au futur et dont
Sens declaratif-estimatif: ded. impur N~ ~ Les piel denominatifs graisser
itR~, declo pur 'iJ~,
l'imperatif
3 verbesN"" se precipiter,
l' •
ont parfois un sens privati./, p. ex. =: r~~);
~~
r~~de(de
P!3~~~se
, T :
"~;~i}
mollement ; Nrsnl1i1 s'enieuer
le pecke, N~rsi1 (§ e) se rendre
(l'autel ,de ses cent/res grasses au, contraire N'~nit
deraciner
N~el1it se montrer etonnant '(?). La forme hitpaal est ordinaire en hebreu, ou elle est rare, elle est probablement pausales du type a, ont la voyelle Les formes l'imperatif,
~i;;
tt"!~!':T est
pous"er
des -r~cines);
N~ry enleuer le
rr:e~~ ;
a1amaisante moyenne, ~
C')·
pecM (de N~Ij; com parer Ie hitpael privatif aucontraire
•• ..:1···
N~ttl}i} s'enleuer ie peche);
en ~, au parfait, au futur et
est faire pecher. (au contre du hifil) est rare, p. ex. 11~~ agir de l'objet, comme l1'ry~I' § 54 d); l'ad-
savoir
-=-
a
en
c.
en pause
Le piel adverbial
grande pause (§ 32 c) p. ex. :l~~: ~"lse placera devient :l~~: Cette voyelle hitpaal, norite pausale a n'est en pause avec pas primitive; la voyelle elle provient
1 S 3, 10
du type de sa sod
mal, pechel' (probabl' par l'ellipse agir de facon inique (2 f.); verbe '1j~ uit«, § 102 e). Pour le pual,
~*
'iJ~au
(avec zaqef), :l~~~ Job 41,2; de meme N~n~~ devient N!~::: Nb 23,24. et supplante plus grande, Ie piel. Au parfait du piel, la l ' voyelle au hitde la forme de liaison a s'est affaiblie en i: t;~j?; Au parfait elle s'est maintenue
t(J
sens d'agir vite(d'ou
propre~,
a cause
passif du piel, voir § 56.
'Comparaison
§ 53. Conjugaison hitpael.
a Le hitpael est la coniugaison reflechie de l'action intensive (§ 40 a). Les deux caractertsttques conde -radicale reflechie (comme L'explication Futur: Parfait: sairement N) comme du hitpael sont Ie redoublement de la seI'idee all piel (§ 52 a) et un 11 qui exprime par Ie futuro . (comp. piel "t@R')'
primitivement pael:
"~~~i}.
du piel la voyelle
"~j? est abregee
du type devient
de -=-; dans le type "t@R~i} l'a est pausal,. et provient devant une sifHante, suivante,
l' •
"~Rl}i}.
p. .ex. hil-s9mm~
Le 11 subit l~' metathese
Ie ) du nifal § 51 a) (1). des formes doit commencer est j.i1q9tt~1 ~~~~
'~l.:1~i} (§
•• -.
17 b).
Le 11 s'assimile vient '.:l'=1~; *hit-t9mmd' l'emphatique lin ), 'It,
une- dentale devient
p. ex. *mit-d9bbr:r departiellement le 11 s'assimile
.0° •
La forme hebraique
N~tsi1. Il s'assimile
Le groupe i1, compose passe au parfait, et d'une
de la voyelle de la preform ante ou la voyelle doit etre neces-
·a
•
savoir
devient t ernphatique,
p. ex. *hit-~9dd~q de-
et du 1 caracteristique
vi~nt, avec metathese,
p~~~i} (§ 17 g). Quelquefois
•• : •
n, comme a
(I) La forme
.,. ,./0
precedee
consonne. Cette consonne est it (au lieu de
I'imperatif
a l'iuf.
p. ex. N.:l~it a cote de N.:l)l1it;
•• -
a un
::l, p. ex. i1~~z:'I Pr 26, 26;
cst. nifal (§ 51 a), d'ou 111}. Le
un tef -Eccl 7, 16 Au parfait,
c~iwz:1.
les
Remarques -sur
correspondante en arabe est tafa"ala ~, et non pas
diverses
formes. comme au piel, par exemple
r
une forme reflechie
dans la flexion on a -:.
'ifta'ala ~\. comme Ie note justement . ~ neus de son temps. (2) On a
M
Abu'I Walid contre les gramrnai(I) En arameen
la forme kitpaal est probablernent
dans '~I}~~ 2 Ch 20, 35 (patah final exception nell.
(lassivie secondairement ; cf. Biblica, 1, p. 354 sq.
ft3/ -
54 a
Conjugaison
hitpaeJ -
""'Jugaison
hifil
120
1:.11
54a-II
t;l?~Rr;i! ,·comme
L'explication Futur.
d~s formes doit commencer
par le futuro (avec i bref), ou il devient devient
on a ~7~j?
On
trouve
quelques
formes comme
'~7o::r~~;:'1Ez 38,23, 1
Futur.
La forme hebratque
premiere est ·j'kaqtil
avec affaiblissement de a en i en syllabe ferrnee atone.
Au plur, fern. la finale est ordinairement a la finale arameenne particulieres. dans Dan
m~_:..,p. ex.
T: -
'd'ou~ par syncope du (§ 17 e) *iaqtil. Ceti bref est conserve au jussif et normalement _. Mais
a I'Imperatif,
m:J~'l"ll1
T: -: •
(§ 29 d).
l'indicatif
L'inf. est,
II, 23
(§ 88
l"l~,~nl"ln :'_ : .
'p'~l")ij
. long ("'~l?~), ~robablement C'j?! (§ 80 g). Exception pas allonge,
;\f
j). en revue, etc., on a une forme du
I.
Remarques
l'analogie du hifil des verbes ,.., , p. ex. •. 'bL 1"t ne s 't : dans le type~! pour .{as! es
(I,
(sauf dans
n?7~~z:,)l'i
cause de la tendance
de la consonne finale des verbes
Dans le verbe 'R~ passer
e. passe
ell revue,
e. recense, a
sans redoublement
p,
du
''''
p. ex. Jug 20, 15,
au redoublement (cf, § 18/). Parfait. La forme primitive haqtal n'a conserve en hebreu aucun Ie parfait du piel § 52 a). I'a s'est conha~Sib, haitib devenus Le 1
er
1,7; 21, 9. ~apres
les uns, cette forme serait un hitpael ou le redoucause de la nature rare (seulement
blement aurait ete omis
p;
des deux a. (Comparer serve dans les types
mais on petit les se1, p. 529),. passivee
a s'est affaibli en i (§ 29 g) (1). Cependant au nifal, le type na~sab
objecter que le piel est tres On trouve aussi 4 fois condairement par
Is. 13, 4). D'apres
autres, on aurait ici un reflechi du qal (p. ex.
BROCKELMANN
(~ 76 c); comparer,
~'~~~iJ qui
est la forme ;'P~~i!
Le 2d a est devenu i
~'~n (§ 75 a), ~'~'IJ > ~~ § 51 a.
*hiqtil. Ceti
l'analogie
1
du futur, d'ou
le changement
de la 1· voyelle i en u (9); mais plus suspecte qu'elle a Ie meme sens 2, 33; 26, 62; 1 R 20, 27). dans Lev 341 6 en hotpaal
s'allonge (et garde le ton) aux 3. personnes
cette forme etrange est d'autant
e.
h
passe en revue,
e.
l'analogie
des
formes du futur "'~P::
",~i?t':t, n7'~i?t':t, ~"'~Pl!' ~"'~p:.. Exception: dans Ie "~i!-(§ 48 a).
de l'infi-
recense (Nb 1, 47; info O~~il e. lave .. - \ 24, 4, proprement
type
~rt
pour *hisibb, l'i ne s'est pas allonge. Aux autres personnes
La forme hitpael quelques cas tres rares: 13, 55, 56 ;
est passi'l.'ee secondairement
(sans nuance reflechie) pour
i (-::-) devient a, p. ex. ~7~PI!' L'imperatif "~j?tla la voyelle du futur jussif L'infinitif L'infinitif nitif construit abs.
nN~IS" Dt
T T !
on I' a .fait se souilier, mais
T:-~
peut-etre simplernent elie a ete souillee ; mr:;~", elle s'est engraissee. i Sens. se sanctifier Le sens fondamental (r:;':Ij? sanctifier).
1,5~':fn, Is
T:-:'
est, ";~Ptl a la voyelle du futur (~49 c).
"~i?':t est
une
modification
secondaire
(~ 49 b).
est le reflechi du piel, p. ex. r:;~R~;:'I D'une facon generale, l'hitpael peut du
Le pasticipe Remarques ordinaire quelques l'arameen, 11, 17 etc.; Cependant,
"'~p~a
avec
les voyelles du futur (cf. § 50 j). La syncope peut-etre du
generales.
n,
nous l'avons dit, est b on trouve
avoir Jes divers. sens du nifal, avec, en plus, les nuances propres piel. Ainsi il peut avoir le sens du moyen racher qc. Ex 32, 3. II peut aboutir
au futur et au participe. exemples
grec, p. ex. P':!~~i! s'arpur passif, p. ex.
e.
a un
•
oublie. II a parfois la nuance se .faire ou se moutrer tel ou tel, p. ex.
n~l1~n - -: . (vraiment ou
n,
Au futur Ps. 116,6
cependant (en pause),
en partie sous I'influence de
p. ex. ~,~~
1517,47;
faussement)
n~nl"ll' .faire
T :
Ie mala de 2 5 13, 5, 6. com me le piel Ie peche).
~"'5'n' Is 5'2, 5. A l'infinitif"i~ n apres une preposition
dans plusieurs exemples, Ie Is 29, 15 peut se vocafiser
cet alfaiblissement
n,i~ Neh
Comme denominatif,
il peut avoir le sens privatif te peche (comp.
• ••
(§ 52 d), p. ex.
NlSnl"li'l'enleuer s
T : •
N~n enleuer
se maintient, p. ex. "'~Ptl7' est syncope, p. ~x. "'~P?;
mais dans la plupart des cas la vocalisation est suspecte, par exemple,
§ 54. Conjugaison
a Le hifil est la conjugaison La caracteristique du hifil est un
hifil.
apres
'z:,9?
en piel
'~~7l"li~¥? et/"~~'? Nb i
serve dans
active de l'action causative (§ 40 a).
(1) Peut-etre
a-t-il commence dans des formes comme
Sf>
n,
qui tornbe ordinairement
*haqtaltem', Pour
loin du ton. Le patah cf. ~ c.
trn"""
rOll
'~'~::rl Nah
E, 5.
une afformante, et done au futur et au participe (~ b).
'V
54b-d
Conjugaison
hifil
1_22
123
Conjugaison
hifil
5~d-f
5, 22 peuvent se vocaliser
doit se vocaliser en qal c Remarques Parfait.
en qal
1'1;~~? et ;e~?; l'1h~~ Ex
formes.
13,.21
faire
66tir,
:I.,n -tuer
-1'
pour .faire
tuer,
n~p
T
faire, pour fa ire faire
(tous s'emquand
l'
l'1h??(Remarque' analogu~ pour ie nifal § 51 b).
ces verbes sans forme causative); ploie aussi pour faire frapper,
de merne Ie hifil i"tf1} frapper Dt 25, 2. intransitif, gras; ; a. savoir
sur les di verses
Au lieu de 'n on a p. ex, c:1j~;:!n... 1l0US Ies auons con. : -: fondus 1 5 25, i, sans raison bien apparente. On a 'n plusieurs fois dans les verbes Futur. mixta
Assez souvent Ie sens est causatif I'action reste dans le sujet, p. ex. rouge;
n""
'.'
p. ex. n":ln (§ 79 q).
T : ...
"~':'l)'deuenir
:l't!:l'n agir .~.. n~"n
T :.
sombre;
Dans
quelques rares exemples
I'i' long semble tomber lectio
t!:l'j?~;:tse
'iJ'!~mse prolonger
r'~~t:" deuenir
C'':I~Pdeuenir ~'!r::!P se taire;
(hifil adver-
tenir tranquille.
dans la flexion, p. ex.:
~i'f7:! 1 5
14, 22; il y a probablement
Parfois ce qui est produit bial), p. ex. bien;
(§ 16 g) donnant Ie choix entre le hifil et Ie qal. Compo Au pluriel fern. la finale est toujours ;'1)' _:_ (§ 29 d). T: .. Irnperatif Au lieu de
§ 63 C.
V2~ agir
i"~;:t
mechamment
lWWn. agir mal (de.meme 1'1~ § 52 d); .: ... . ; "'.f~I':T agir prudemment; "'~9;:t· agir follement
beaucoup (§ 141 h); r!l'p~nfaire
' • : '.
est une maniere d'agir
;,~Ptt,
p. ex. 2 R 8, 6; peut-etre
,~Ptt on a, rarement, la graphie anormale la vocalisation rare "~~iJ, p. ex. ~'p';n Ps
(cf. § 124 n);
faire
peu.
p. ex. (estimer
Au sens causatif se rattache le sens declaratif-eatimatif, declarer juste; qn. leger),
94, 1, est
fautive pour
Inf. cst. 21, 3~ "'~1};
Au lieu de Dt 7, 24
119tpl}
"'~PiJ on
"~PI':I.a quelquefois
"'~Pt:",
p. ex. Nb
r'!~~ redouter. *
~'~;;:t
declarer coupable ; (esiimer qu. fort).
;j2~ mepriser
(cf. 28, 48; Jos 11, 14 et opp. Jos 23,
Un sens assez particulier est celui de consentir mee par la racine, p. ex.
15; 11, 20 etc.); mais cet i est suspect (t).
L'infinitif construit a la finale arameenne dans Ez 24, 26 (§ 88 Mj). Au lieu de Inf. abs. Cette graphie Participe. Sens. faire
l'
,,~;:t
-
consentir
T
a. la chose expriAux qal
• '.': ,'"
une -demande, se laisser emprunter).
T: "."
l'1~l1~~n'
T : :
demander emprunter
qc. (I), d'ou preter
m"
TT
('N~ demander, les hifil preter
r!l:lP correspondent
T
m;n* , t!:l':lpn*.
des racines
"~PiJ on
"0" :-:-
a rarernent
'~j?tt,
p. ex. Dt 32, 8, d' ou,
Dans de nombreux hifil denominatifs verbale est objet ou effet de l'action, p. ex. (de
le nom d'ou derive la forme
avec a dans la flexion C:!.,lItn Ez 21, 29. Au lieu de
~,.,~npousser
'~P'I:ton a assez
§ 50 g.
sou vent la graphie
"~Ptt·
N'~n
voir, pas;
ferait penser que l' ~ etait long ou tendait a. le devenir. Pour la flexion, cf. ;'~~Dfaire est celui du causatif, tomber); p. ex.
Le sens fondamental
sortir
(N¥! sortir);
voir);
manger, donner Ii manger, nourrir,
T
r''!p;:t receooir, auoir des cornes (nR); O'!~;:t avoir Ie sabot fendu (n9~~); "'~~;:t produire de la pluie, faire pleuuoir (.,~~) et C'~~I':T f. (C~~). II y a quelques 1 hifil denominatifs de noms de temps ou de lieu, p. ex. :l,.,pn * faire qc. Ie soir (:lj~); f'~'~aller a droite (f'~~ cole droit); "'N~~t:" alter
~tt;; au contraire ~~
= deraciner
§ 52
d);
<
~~
(;;lt~mal1ger); montrer faire
"'~I} faire - tomber ('Cj
i"tN"1nfaire
T :
gauche
(;N~~ cote gauche;
de l'ellipse
quadrilittere, de l'objet,
§60).
.
e
(n~':1
"~iJ rendre amer (.,~ amer et il est amer). Mais
de faire ne s'exprime
"0'
Le sens intransitif ce sens provient incliner
T T
de certains hifil peut parattre etrange. Parfois p. ex. :l'~P1}ecouter, reiourner c.-a.-d. (Ia parole c.-i.-d. faire
faire telle action, au sens d'ordonner simplement '~~.
"'~~I} ne doit done pas se traduire it a ordonne de tuer, Pour cette
idee on dirait Ainsi on a le qat
(/'oreille);
:l'~lj repondre,
bonne (I' action agir
i1?f
66~ir pour
,:l'=T). La
p. ex. mauuaise
merne explication
peut valoir pour certains hifil adverbiaux
~'~'1J ffire
(/'actioll
(I) S'Il etait authentique, de a. On a toujours (7 fois) pu facilement s'affaiblir; lesivoisins) Nb21,35; Quelques grammairiens
""~tf::r ';'I7~~(avec
a tort,
it faudrait I'expliquer comme un affaiblissement maqqef; !'a, loin du ton, a
n?'?p.) =
;?P,~) =
mal (§ d).
a![z'r bien ;
l'1'I}~;:t faire
'
Dans d'autres
cas, ou le sens n'est pas celui d'un
hifil mais d'un / En effet, dans
I'i a pu aussi etre favorise par la sifllante et par Dt3,3;Jos8,22; voient, 10,33; 11,8;2RIO,11tdans ces formes, des parfaits 3· p.
qal, il peut y avoir hifil secondaire ou pseudo-hifil.
(I) Comparer Ie nifal toleratiuum ~ 51 C.
cr.
KONIG, 1, pp, 212, 276; 3 (SyntIU'H~ 385 t, 401 v; DRIVER, in Deut. 3, 3; 7, 24.
54/-
56c
Conjugaisons
passives - Conjugaison
pual
124
le cas notamment blait
des verbes
125
Conjugaison
hofal--
Passif du qal
56c - 58a
futur qal en oasser
tin hifil, a pu facilement pseudo-hifil
t, la forme, qui ressem-
la forme hifil, Il y a pro-
De meme, certaines pual sans ~ appartiennent
T ~
formes en
quiont
l'apparence
d'un
participe
bablernent
rp s'eveiller
injurier, sembler,
dans les verbes
suivants:
N'p.
uomir (§ 81 c),
realite au passif du qal, par exemole
r~~.cacher,
;'P-! afouter m) repousser ; nm conduire, P' pousser des cris de joie,
TT
(§. 76 d),
~'':1 disputer,
C'T?' mettre; "~ et "El SeParey; (§ 75 f) 1"1,: jeter (§ 75 .r» V'l1' saztv~r, C,~
~~) placer,
'liM (§ 58 b). -Le sens du pual est celui d'un passif du piel,
,no cacher, 'nl~ras-
§ 57. Conjugaison
Pour la formation. Le cf.
hofal.
a
ni''l1 abreuuer,
passives.
pour l'action intensive
§ 55.
le hifil
§ 55. Les conjugaisons a
L'hebreu une conjugaison
h
est syncope
commedans
(§ 54
b).
a une conjugaison
et pour l'action causative et au futur s'est confondue Formation. du qal) la
t8
'~PiJ.
passive
~p,
§ 58 a.
La 1~ voyelle,
primitivement
u, se .rnaintient en syllabe assez generalement.
aigue, et
done dans les verhes ou la
Pour Faction simple il avait autrefois avec le pual. Ie passif primitive
rEl,
2- radicale est redoublee, comme les verbes
au participe sous que '
p. ex.
'l1~~. 11 se 'maintieat
(*qutal) qui, au parfait, s'est confondue Dans les conjugaisons voyelle, au parfait passives
l'influence trement, que"~Rt1'
de 1a labiale .~. d'ou .,~~~ ,- plus frequent en syllabefermee, on a no~alement ~~
~P,?·
avec le hofal, comme il sera explique (y compris et au futur, est la voyelle primitive
p : ,~Rt'
~ir,.
~P! plutot
Au-
Le choix de la voyelleest
u : *quta£. *iuqtal (§ 58 a); La 2- voyelle, au futur, les verbes La qutila, et prob' sapplantee statifs,
~R' ~R~; '~in(~)''~m(~)·
est la voyelle
au parfait du verbe
'!J'W on trouve
r.t:l~n
assez variable;
.~~m J6-
22, 28;
a, comme pour
: : L:inf. est, est verbe regulier. L'inf. abs.'~~C"
et probablement
d~ ~~e '~PO, mais' aun caractere
Is 14, 19;
'f:l;I5~n Ps
T
Dn 8, 11; n;a pas
n?.?.YJ~ Ez
a111S1
19. 12:'
dans le b
22, 11.
d'exemple
l'analogie
de ces verbes. i (com parer en arabe
2- voyelle, au parfait, etait primitivernent
quttila,
hybride:
8
c'est l'inf
'uqtila),
comme dans les verbes statifs de la l' espece, de ces verbes, de En hebreu, cette voyelle i a ete
;~i?" passive
p. ex.
l'analogie
par la voyelle a,
rem place far
'~7' ~I'analogie
cf.
a l'analogie
'~R~ .
du futur,
p. ex. *quttit a
ete
Ez 16, 4; ,~~ Jos 9, 24. Sur l'imperatif, cf. § 48 a. Certaines formes, qui ont l'apparence au passif du qal, p. ex .. realite
"!l':iJ
par. le changement
de la 1 voyelle
-=- en
abs. du hifil -;-
(§ 49
b),
nenten
§ 56. Conjugaison
a
pual.
r~~ 58 a). (§
d'un futur hofal appartienhifil: '~PC" proprement
Le sens du hofal est celui, d'un passif'du 'il a eie fait tuer
Pour la formation, La I" voyelle sonnes,
§ 55.
toujours u, qui est normal en syllabe con-,-
on I' a fait
tuer.
est presque
aigue. Quelquefois I'u secolore
en p sous l'influence de certaines
§. 58. Le passif du gal.
En semitique Futur. avec syncope
(I)
p. ex. C1N~ colore en rouge (toujours,
s
c
:§ 23
a);
i~f Ps
TT
p. ex. Ex 25, 5); n1l1
primitif, comme actuellement
en arabe, le passif de a Or cette
72, 20.
on a seulenrement qui ont l'appareace
,
I'action simple etait du type: pi. qut£l(a) (1), fut. iuqtat(u).
En hebreu la forme primitive du est restee'~i?:'(:)' forme est materiellement
L'inf. cst., qui est sans. exemple ('), serait Comme Certaines info absolu formes
~7'
pual appar-
:lb~ Gn 40, 15.
d'~n parfait
n:
"~p: '~pr;'"
pour
1,
semblable
celle qu'aprise
ie futur hofal
(2).
tiennent en realite
(I)
au passif du qal, p. ex.' ,~~
est.
, (§ ~8 a).
Ra1Jdglossen).
cr.
BROCKEL:>IANN,
p. 537. qal iaqtul et le futur
Dans Lev 14. 43 it faut lire l'inf.
r~r;(EHRLICH,
(2) Semblablement
en arabe Ie futur
du causatif
iugtil ont au passif la meme forme i,uqtal.
58 a
Passif du qal Parfait: En hebreu la forme primitive qutil est devenu
,126
127
Passif du qal - Conjugaisons Au parfait qat passif
rares
!i8b ~ 59 b
quial, con-
~'?
correspond
un participe ,~, (pour
avec 2° voyelle a, jugaisons passives
l'analogie
du futur, com me dans les autres
au parfait ~i?~correspond consume, Ex '3,
un participe
(§ 55 b). Or un u en syllabe ouverte ne se mainde la consonne (non-gutturale), cf.
2,
"~i?~'Ainsi
"~i?'
comme ne, Jug
on a ,~~ mange,
repondant
au parfait ,~~;
tient pas; la syllabe doit done devenir fermee, ce qui se fait par un redoublement blable secondaire
13, 8 repondant dant au parfait Quelques
§ 18 e;
sern-
n~?(cf. § 56 c).
infin'itifs
au parfait ,~,;
n~7pris,
.
aussi
'?:)
~mporte, 2 R 2, appartenir
10, reponc
qulal doit done devenir quttal. Or cette forme est materiellernent au parfait pual
semblent
au passif du qal,
~i?'
qu'actuellement, toutes les formes au parfait, Ie passif du des pual, formes Ie hofal. Aussi les anciens
ainsi 1'I,Ij., naitre,
Ainsi done, il se trouve grammairiens et toutes peuvent considerent-ils
naissance (cf Bib/ica ...... \ 2 S 14, 7; Job 20, 4. disparut peu
1, 360), C'~
e.
mis (ib. 36~) d
qal se confond avec le pual, au futur,avec les formes
Le passif du qal dont it reste encore, comme on Ie voit, quelques vestiges,
"~i?~ commedes
particulieres
"~i? comme
pen de la conscience linguistique et aussi rendu parce
de l'hebreu que Ie nifal inutile.
hofal, Mais,' en, soi,ces pour lesquelles pas, tandis
pour les raisons ayant _pris peu
aussi bien etre des passifs du qal. II faut done, dans chaque les raisons la forme peut, donnee une forme
phonetiques .indiquees
peu le sens passif, l'avait
peupres
.cas, examiner
ou ne peut pas, etre un passif du qal. Etant
~R'
plusieurs tachent
§ 59. Conjugaisons
Outre les conjugaisons conjugaisons ordinaires intensive.
rares.
ci-dessus, l'hebreu aa
si la conjugaison
active piel n'existe
que Ie qal existe,et etre rele qal
enurnerees rares, dont
si le sens n'est pas celui d'un passif du piel, la forme devra
plus ou moins
la plupart
se rat-
gardee comme un passif du qal. De meme, etant donnee une forme
"~i?~'si
existe, Ainsi bablement
la conjugaison
la conjugaison comme
active
hifil n'existe
pas,
tandis
que
1) La plus frequente P99-1,- reflechi hijP9fl.
est la conjugaison
P?fl
e") qui
represente
et si Ie sensn'est
pas celui d'un et
passif du hifil, la forme devra
diverses formes. Dans le verbe fort, P?fl est proprement Les formes primitives du futur, comme fut. juqatil(u). fait Au futur la forme devient l'analogie normalement si souvent
un P9 fl,- passif
etre regardee
n~7it
un passif du qal.
a ete pris
n~~il
de l'actif sont pf. qatal(a),
sera pris sens n'est
(§ 72j)
sont jres propassif et de le simple;
de~ passifs du qal, car'le
pas celui d'un
~ii'
est
"~ii'~;Ie
en hebreu,
parLa avec
du piel ou du hifil, mais celui plus Ie piel et Ie hifil n'existent Ie parfait ,." (sage-femme, il a ete enfante,
du pass if de l'action il est ne est
forme qatala avec l'aUongement l'allongement de la 2· consonne, site. Exemple : prement discutee
de la 1· voyelle, comme qattala exprime un jugemeitt
pas, tandis que Ie qal existe. De merne un passif du qal ('): signifie accoucher
une certaine nuance d'intenenuers moi Job 9, 15 (S). de cette forme est
'roCitj~ exer{ant
': I :
sens est celui du passif du qal, non du piel iequel
Dans les verbes
,..V, ou eUe est usueUe, la forme P?fl est pro-
§ 52d)
(!). De meme encore Ie futur rl.:1~(8) il sera don.ne
(§ 72 i): Ie sens est celui du passif du qal, et Ie hifil n'existe pas;
de merne Ie parfait ,,~~ il a eM mange: un bon nombre d'exemples plus ou moins modernes. sign ales dans les dictionnaires Ie piel n'existe probables pas. II y a trouvera qu'on
un P?l{l, p. ex"
c~ii' rei ever.
L'origine
(§ 80 h).
V..V, 011 e1le n'est pas frequente, p. ex.
t':
Dans les verbes .est proprement un
la forme P?{l
ptl,
:1;;0 entourer, L'origine de cette forme
de a en i : pi'ld)
est aussi _discutt~e (§ 82 e). 2) La forme P9-c1fl (ou avec affaiblissement
il est tte.
(I) Comparer en arabe.Ie (2) Cf. Biblita (3) Dans les lettres
parfait Ifulida ~,
a pour passif pu"l91 et pour reflechi hitP9-~lfl. Exem pIes:
r~~e. tranquille
&
1, p. 359 sq.
de Tell el Amarna on a 3 fois iu"lia-atl «it a ete
donne
».
(1) Nous designons par cette transcription imprecise les formes it- 1e voyelle q et 2· voyelle f.
129 59" 61 a
Verbe avec suffixes
Conjug. rares - Verbes quadrilitteres (de I'adj.
61a-d
- Verbe avec suffixes
128
(de l'adj. L'kilpr/lfl
f?~), t~P,' e. uerdoyant
n'est guere represente (de I"TTW § 79 t).
f?P,,); passif '?~~ jletrir. se
1"T1r:)P~1} adorer,
de Ia I" et de Ia derniere un Dans rouler un pzpl. 'P'??!llire
suffixes personnels meme, p. ex. mandent de ona
(§ 103 k)jp.
ex. il'lN
'~R ill'a
a la
lue; tantot,
et de-
e'est 'Ie plus souvent, I'emploi
les suffixes sont ajoutes
forme verbale elleavec Ie suffixe
que par Ie frequent
i~~ il l'a tuc. Certaines circonstancessyntaxiques
de l'IN (§ 125 e sqq.). Au parfait,
se prosterner c pilp~l, consonne, plusieurs et '~'~I"T
3) La forme pilpfl, se trouve et dans les verbes
avec repetition
la 2" p. pl. on a presque toujours
r,N (on' trouve seulement
Ia
dans Ies verbes
'''X' ou elle est proprement
I" p. pI.
c?~)7~~).· vent Sou
it y a liberte ; ainsi pour et il les frappa 15, 8; 1 S 5, 6 ; trancais, p. ex. b
X'''X' ou elle est proprement
cas il est diffieile de decider entre ees deux classes de verbes.
15 fois C~~ et seulernent 3 fois C(1iN ,~ Jug 2 R25, 21 (sans raison apparente). Le pronom emploie Ies personnel 'objet d'un pas par verbe refiechi Ie suffixe verbal
.
Le passif est pulpffl et Ie reflechi hi1Pfflp~l. Exemples:
se prccipiter
•• : •
en roulant
(de ,,~);
-: l'
,~?~ lancer
dans
(de ;,to);
: : •
it se sancti.fia, ne se rend formesrefIechies
(§ 146k) ion
~,
Ie f~~~~~nt ,~,~ d
entretenir
qn, passif ,~,~
(prob'
de ,,:1); ::t~'~l'Il'
hesi!er (racine ?). 4) La forme tres rare pec9-1cffl se trouve Ps. 38, 11 (harmonie e 5) 011 trouve bablement est denominatif imitative); passif
,~~r,t e. en
formes
'tT:t1l?
~i?~:'1.
.. par ex. ICI Q~elques verbes au qal peuvent avoir le sens reflechi (§ 41 a);
'r
du verbe:
nifai
kz't""anl
palpiter
de meme p. ex. Ie piel se terminepar toujours Ie ton; precede moyen) d'une
1"T1f~ se reuetir Gn 38, 14 (cf.
EHRLICH
ink.
I.). c 1 et
effervescence Lam
La forme des suffixes verbaux une voyelle
varie selon que la forme verbale
1. 20; 2,11; deoenir rouge (autre racine;
de plus certaines denominatives, guide
Job 16,16). isolees qui sont pro.
ou par une con sonne (cf Paradigrnes jamais
3) .. Au point de vue du ton, Ies suffixes lourds C? J' les suffixes '~" q), ~,' et .;; n'ont type voye~Ie n'a pas Ie ton, precede
cry (t1' t~) ont
Ie ton; ~ (mObile ou
d
p. ex. mnl'll'1: tu t'eckauffes; v -: t"
disputes Jer 12,5
d'un mnr-l* qui se trouve dans Ben Sira 31, 29; 40,5;
'''-:1-
'r-I,i'r-I j'ai
f
Ez 23, 48
les pas Os 11,3. au hitpael, se trouverait dans
il a Ie ton' :exception:
.:- :La forme du neo- hebreu ni!p,/c ~l, pour le reflechi de l' intensif,
forme hybride "avec Ie l du nifal ajoute
9l!~~P§d). '
du shewa
La forme elle de liaison a provient serait prob
~'El)m
o~ peut vocalis~':
IMEl)Vm?) et elles se Iaisseront corriger (mais en nifal IM9~1) et dans Dt 21, 8 'f?~~1 (pour i~~N:?)
(pour fautif pour
verbale terrninee par une consonl1e s'unit par une voyausuffixe commell~antpar une consonne. Au parfait des verbes I"T"', p. ex. q)~~ a dans Ie parfait
cette v~yelle est t a '( -;;- ou -=-) p. ex. q)7~~' I'a final qu'on
'~?~~ '~?~p.Cet , mais
et il sera exPie (mais probablement
'~?"p.
e» d'apres
d'aut~es
ce
arabe qatala.
§ 60. Verbes quadellitteres.
Les verbes logie du piel: quadrilitteres sont tres peu nombreux. traduire, alter On a, passif
. Au futur
et < aux autres
a l'ana-
p.
ex.
l"T~bo~' ilIa
Ie typeC~i~*
CF1lJ~*, C~??*,
Ii ;a~ci,e;
"~~~
Cnt'~,
n'"
ou -;-),
t
p. ex.
ql"T?~i?~' mais
V?~~(§ 29 f).
temps (') la voyelle de liaison est e ( -::C~t e provient des verbes
p. ex, qI"TS~', I"TS~,.
E"Xception~';'
;\ I'analo~~
d~hifiI: "~~I}*
devore Ps. 80, 14; ,~~~
revetu 1 Ch 15,27;
~:~~t
Ies suffiXes C~ et ; il n'}'"a-pas de voyelle de
cope de N) info
~~~tt *; ~,~~tt; ,~~~
(Paradigme
3).
et (avec sYJ1·
(I) En faveur de cette
(cf, § 54 d).
vue on pent invoquer provenant
l'analogie· du futur, oil la voyelle fin~le
• £,'
It;-
vo:e~l~ de liaison vient des verbes .l"!.~ (cf.: infra),. non d'une
§ 61. Le verbe avec suffixes..
a Le pronom
Mat aocelee
,pnmltlve. Autres cas de voyelle ~. . , rences du §' 94 N.
des. verbes~'"
-
.. . ',-,
.. f!.
et
. .Les re
personnel
objet du verbe,
qui serait
ji
I'accusatif
en
.,
'. (t) L~
voyeUe
de liaison
se trouve etre disc::rimante,de la forms dans le ; ex. '?f.7~'envoie~moi (opp.
latin, peut s'exprimer
de deux facons, Tantot
on emploie la partieule prend les
~~ de I'imp~ratif sf m'a envoy').'
en a (<;levant gutturale),p
bibl,
'.
,)r.ht:;
T:
eX/Josant de l'afcusahf{nota
accusa/t"vz') laquelle
P. )oGON, Gramm. de l'hebreu
01 d --
Verbe avec suffixes
130
131
Verbe avec suffixes - Parfait avec suffixes
(!1lJza
OIJ - 62 a
liaison, mais seulement un shewa prononcetd'ou
le :l est toujours
rafe,
p. ex. innd sera devenu pr~viellt des verbes
(I). Maisil
§ 8 f),
savoir: est toujours moyen, p. ex.
1) 'Devant C?, le shewa prononce
ml' ..
:'
11"',.
p. ex.
~3i~:, j~:~(§ 79 nf~!:'
certains
no us semble
que
cet _
k), d'apres
etc. L'ernploi des formes avec ) energique n'est pas soumis
C?~~P~, C~~~r(I), C?~~~.
It
des lois
2) Devant ;, en contexte, le. shewa pro nonce est moyen apres primitif qui devient --;-, p. ex.' Generalement aussi apres i
fixes. On peut cependant
constater
usages (2). Ainsi,
prirnitif qui devient --;-, p. ex. on. a p. ex. exception: Devant
1?m~, 17~~( =: etshewa a
17~P(2), 1?~r.:; mais
mobile).
9'?~r~.
la 3" : ie
p. sg. m. avec Ie suff de la 3· p. sg. m. on trouve
au parfait statif
~3?~P:it
generalement qu'it
le tuera, mais plutot que rares
~ti?tpfr.J et
it le tua et
~11?tpP:1pour
lite. Avec Ie suffixe de la 2" p. on a en contexte
Le shewa pro nonce est mobile ap:es a primitif, par exemple
9,
la 3" p. f sg. on a
1Z;?~R' shewa moyen (§ 62 d) (:1). avec
a
savoir, generaparfait la forme attendue du futur des verbes
e).
17~R;
j?'~p:ca)
1?~p~.
-r
17~P~.; n e
pause'
Formes
avec
3. A la I" p. sg. on a les formes '3~
on trouve, rarement
et
'3~
It
en pause, il y a voyelle de liaison,
qui sont rares. A la 1· p. pI. ~3~ rement, la graphie i1:ll _:_ •
T
est douteux, A la 2; P.- on :: r~- g (et presque
lement -:::;:-,p. ex.
1?.~P~' (au 1?~R
rare). Cet -;;; provient e Chute de voyelle
probablernent
(dans les noms on a de meme p. ex.
1~~ 94 §
1Z~P est 11"": 1?~~
en la exemple
En style eleve ou toujours
poetique,
la pause), des formes avec)
(sans assimilation), par exemple
devant suffixe, au futur (et
a I'Jmperatif'),
par au contraire
syllabe ouverte. Les voyelles primitives
u, i tombent,
Dt 32,10 (en contexte); J.er 5:22 (en pause);~?i? .. t;l.~ Jer __ ,2'4 (S). La forme (avec --;-) Ps 50,23 est unique.
~~?~~~~ 15,2; Ex
Formes pour
'~np~;
"rop~,'~?~P:;~R;' '~?~R':;!:l~, ,~~t;1:; fl=l· ~115.t;1; " f
,
voyelle primitive a se maintient, voyelle primitive au qal (statif),
p. ex.
~1l'" , ')~1l".
:. .,. T : ..
i tom be au piel, p. ex. p. ex.
'~6'?'~ (par
) energique,
'~r,~5~p;lle se maintient ' e
(et
Au . parfait la
l~);1~
rares
des suffixes (4). Sing. 2' m.:
Is. 55, 5; 2' f.:
1--;-(pour 1--::-rarement, )
mappiq'§
e
11~~
(graphic
rare' i
surtout
en pause, par exemple Is 60, 9; 54, 6; '~ Ps 103, 4; ':l':_ Ps 137 6.
necessite) (cf. ,§ 30 f) .. Au futur Ce J.
3e m,: if Ex 32, 25; Nb 23,8; 3e
Jer 44, 19; Am 1. 11 (nesigah),
r , " --;-sans (
Plur.
25 a) E~ ;,'3;
assonance).
Suffixes
avec
l'irnperatif) indiquait
on pro-
3 m.: les formes en i~ sont
trouve aussi une serie de suffixes avec un ) appele ou encore epenlMtique (= intercalei.
nun energique Mais actuelque la
.
poetiques : dans Ex 15, 5 on a ~~ dans
~~~f?~;.:e. pour (p .
l'origine,
§ 62. Parfait
Pour (--::-)§61e
a vee suffixes.
3).
bablernent un certain sens energique (comme en arabe)('). prononciation. L'origine avec -;-, Les formes usuelles sont ~3 .:_.
','
\Paradigme
lement il n'a plus de valeur sernantique ; il n'y a d'energique 113 ~ _,
T '0-
'lI ~
'I' "';0
la voyelle de liaison a cf.
§ 61 d; chute de la voyelle z a
du parfait ont une forme On a 3e sg.
du segol est discutee. Peut-etre est-il ne.dans les formes
par tendance
I'harmonisation
vocalique. (cf.
§ ''29 f);
puis
- Devant les suffixes, certaines personnes plus voisine de la fonne primitive
il se sera propage aux autres formes (cf. BAUER-LEANDER, 1, p. 216),
(I) (2) Au lieu du --;-' en cette position. on a parfois --:-' p. ex, au futur 1 S 15, 6
(§ 42 f).
f. l'l'tO~
- .1:
i~~
(cf. DRIVER, in h. l.); Is 25, 1; Ps 30, 2; 145, 1; au' participe Compo dans le~ noms p. ex.
(~) En arame~n ~iblique on a inn, p. ex. ~j?~:ilia dontlera (=heb.i"I~2~!) . () Pour Ie detail, voir MAYERLAMBERT.De l'emploi des SUffixes nomtnauxavee Etudes jtiives, noun et sans nou« au futu,. etal'impt,.atif 46 (1903) pp, 178.163.
p~o.
Ex 31,13;
aI'infinitif Is 1,15.
'If~!p
Ps 145,1.
dans Revue des (D~ <14,13).
(3) Opposer, dans IJs noms, p7 ex.
(4'; En arabe Ie futur ernphatique
'If~r.71:' ta ,.eine.·
est en anna ou en an. En hebreu les un seul n : .fnhu
formes s'expliquent (!tIM
> ~nnd. pika > ~kkd.
plus facilement
en supposant
> fnnu,
,. _ (~).La forme pausale ,-;;:;- se trouve merne avec Ie parfait
I infinitif (Dt 4, 36; 23,5; Job 33,32), Ie participe (Dt 8,5; 12, 14,28; Job 5, 1). (.) Com parer les formes rares de suffixes dans Ie nom § 94 h:
62a~-
Parfait avec suffixes
132
133
2"
Futur,
imperatif
avec suffixes
Ht.
62f-64
(forme prim. qalalal); 6 La forme verbale, modifications
:Je sg . .f..
'z:!~R
des
(I)(forme
prim. qataltl);
2' pl.
sing. fern. Avec le suff. 3' p. sg.
on trouve seulement
la
m. (I) ~f.l?~P (forme prim. qataltumu). du fait de l'adjonctio'ndes voyelles. La nouvelle disposition Les voyelles naturellement les personnes, personnes. on a '~?~P avec protegees suffixes, recoit des Ainsi a la 3' p. sg. des voyel1esest peutU dans 1;1 disposition l'analo,gie
forme non syncopee ~1"I'~7~P (2 fois). Jos 2, 17,20 ;Callt Jer2,27.
On trouve en pause
~j!,¥~~;:t
5, 9 avec -;-, difficile
a expliquer;
de merne i:l~1?:'
"f.. ~~,
~tre due
devient l'1~p.
t'a lui et
trouve
9:?1 tajar-ole.
hifil,
du nom avec suffixes; com parer p. ex. 1?~P leur place
1
1" sing.
qu~ il"l'~7~P'
La forme, avec syncope La raison
du 1"1, "f:'l7~P est plus usuelle g guere ; cornparer p. ex.
par leur position ou par suite, il se des voyelles
du choix n'apparait
, par leur longueur' qu'au reste invariable. Remarques 3- sing. . verte tonique, (comparer
gardent
2 S 7, 10 et 1 Ch 17,9 (parall.). § 63. Futur avec suffixes.
3),
toutes
1a disposition
'Paradigrne
sur certaines En contexte contre la norme et
tftasc.
-=-
Pour la voyelle de liaison e cf. § 61 d ; chute de la voyelle § 61 e; en syllabe ou(p.:~.
a ,
~R
'~R). Dans
devant
generaTe (§ 28 6), en pause Gn 30, 6; Ps 118,18 on a ,~~ nom divin). -
'~h~J?
suffixes avec 3 § 61 _(, avec de liaison fois ,~ -;-,
§ 61 h. -
Au lieu de la forme t'~76t7f:'l ainsi on a plusieurs Ex 29,30.
.
on ernploie ~'~Pf:'l : J er 2, 19; Job 19, 1~; Ct 1,6. Au lieu de la voyelle e on a parfois a (comme p. ex. Gn 19, 19; 29,32; suffixes: ~'~~ au parfait); Ex 33,20, parfois ,~-;- Gn 27, 19 Gn 37, 33; C~f7. pause Ex 20, 5; Dt 5, 9; en pause en pause c'!ll1f.l*.
.......-: 1-
pour, raison d'emphase,
Av~c le suff. 3e p. sg. avec
m. la forme premiere ~1"I7~Pne se trouve qu'une fois dans le verbe
fort, Jer 20, 15 (en pause); syncope d partout ailleurs on a la forme i'~p,
(§ 61 g). Avec d'autres
•• : T IT
et contraction § e.
fern. ~ing.
de ahu en
9 (com,Parer, ala 2' p. m. it'~7~P
l'1?~P est traitee d'une facon tres 2) devant un sufhxe commencant 3) devant est 1'9 final-de la forme verbale voyelle posttonique (she~a: moyen § 6 ~ d), 1"Il!l?~p'j
On trouve C,:lVf.l en grande qu'on ait voulu eviter C~~).
et if.l~i?),
moyenne (zaqef) Ex 23, 24, Cl~~~ en grande pause Dt 13,3. 11 semble la forme attendue dumot L'p imperatif rarement c a passe au commencement avec la couleur p (comp.
3-
La forme verbale le ton; elle ne prend
speciale:
1) elle a toujours
par une 'coosonne devient abregee.
les autres suffixes, on a
l07~R'
pas la voyelle de liaison; CtI?~p: ton,etla
"tot?,
Au hifil, l't long (mais secondairemenr devant suffixe : ~3~V'
... : :-
§ 54 a) tombe
-
en syll. ouverte, gardeIe
1 S 17, 25; m'~Vf.l
l' '.': :
Ps 65, 10. Compo § 54 c.
;~h7~~; et (avec ~1"I~~i?
2"
Ainsi l'on a '~~~p,
'?~.?~p;'"~5~p i
§ 64. Imperatlf
Pour la voyelle
avec suffixes.
3).
tt pour th) ir-l?~i?(8)
;O~?~P* d'ou
':l~7~P'
(Paradigme
U~~p. '~~!=l~R'se trouve sing.
de liaison e, comme
au futur, -
cf. ~ 61 d; ~~.,
chute p. ex. telles
masc, En contexte on a ici egalement
Avec Ie suff
e
en pause
de Ia voyelle
§ 61 e; suffixes avec 3 § 61 f:
est moyen, comme
Au lieu de la forme devient
quune
3 p, sg. "111.. 'la' forme premiere ~1"Il!l7~i? ne fois dans Ie verbe fort, Ez 43,20 '(en pausejj par(comp, 1~3· p. sg. m, § c).
avec la forme actuelle de la 1c (f.)l'a
1"I~76t7on emploie ~~.
La forme du sg. m, ,~
,~?~~; shewa le
. L~: forme
il apparait dans les formes probablernent,
tout, ailleurs on a la forme;f.l~~
(I) La 20 p. f. vient ainsia p.• d'ou les formes equivoques (2) Cette forme sertaussf (3) M~me,phenomene +lJt~ devient qatatattu
que C51'1:3J r 3,3; P (cornp, fut. ':l~ll").
7,3 .
devieudrait p. ex. ':ltt;:l,* qu~ 'd~~s Is 6, 8; Mais il -~'y a d'exernpies, semble-t-il,
sezconfondre
en a, p. ex. ~:l'
~n'~~i? lu
tue, je
l'ai luI,-
~'~7~R; C'~?~R'
pour, le feminin.
dans le dialecte arabe de Bevrouth, p. ex. qat.rliit
les verbes a' 3° gutturale, Jer 36, 15.
'~~P
2: ~~
p. ex. M~MN Pr 4, 6; ':l~
....• '.':
.... :
«elle I i
rue-»
Les formes
'~~p, ,~ devant ~
suffixes se maintiennent.
6J b-
65 d
Imperatif,
.infinitif avec suffixes
134
13b
.Ver:bes gutturaux
_ Verbes
.,e gutturale
66 --'- 68 a
b
'.
Rarernent,
, : T_
comme
au futur (§ 63 a). la voyelle
de liaison est a, Levparticipe,
§ 66. Participe
avec suffixes.
prend toujours au pluriel le suffixe a
p. ex. j:t::l"I::l Is 30, 8. Au hifil,
"~PCl,
non
"~PCl(de
la 2"
p. sg. m., la forme verbale devant suffixes est
meme q lie dans la flexion on a 8.
qui est un nom verbal,
'7'~PI}, ~"'~PCl)
Ie suffixe nominal : '~~~qui ment le suffixe nominal: verbal :
p. ex. ~1'1~',!P1J Mall,
'~'?l?~' p.
'7l?~ qui
me iuent.
Au singulier
on a ordinaire-
me tue, assez rarement
ex·'~tftp
celuiqui
m' a fail Job 31. 15. Avec l'article
§ 65. Infinitif
avec suffixes.
3).
on a necessairement Cf. § 121 k. les suffixes verC'est seulement
le suffixe verbal:
');mt31'1 ,- qui me ceint Ps 18,,33. . -:
":
(Paradigme a
Dans Is 47, 10 on a la forme anorrnale A I'infinitif baux ou objectifs par les suffixes (constrnit), nominaux qui est un nom verbal, ou subjectifs s'est au (genitif). On trouve tres rarement gique, dans de (accusatif') ont ete presque entierernent supplantes p. ex. meme
,~~., (comparer
§ 63.a).
le suffixe du participe
avec le nun tmer·
la Ie pel-so que le suffixe verbal (au contraire
'7"PR
maintenu,
'~~~R me
a 'la
dans
j:;: Dt 8, 5; 12, 14, 28; Job 5, 1. - Comparer la flexion
:l!k § 96 C c.
§ 67. Verbes gutturaux.
Les verbes gutturaux
8
tuer 't3~,
1
mon action de luer).' Et encore, nominal lieu
l" pers.
.trouve-ton le suffixe m' epouser Dt 25, 7; suffixe .verbal, b p. ex. (comp. p. ex. 4, 10 (§ b). Aux autres
du suffixe
verbal
'.t:1~ ~e
laisser
Nb 22, 13; '~~~ m' aifliger on a le ·suffixe nominal 2 Ch 32, 1, comme shewa
'Ch
sont ceux dont
la racine a une gutturale
O~p~les fendre
i5t;'f
personnes
au lieu du Am 1, 13 est ordinaiquiescent, devient
com me 1 cents. verbe
8", ~
ou 3 radicale,
a savoir n,
p et aussi M et 1'1 non ~uies-
La linguale regulier
, est traitee en partie comme les gutturales les verbes gutturaux de la gutturale donnes
(§ 23).
du
leur action de fendre ; il"l!:l1J 1 S 20, 33 Ie frapper La forme de l'inf. est, rement moyen, p. ex. Jer 45, 1; rarement
'~7devient '~i?; le
;top, '7~P)'
(cf. § 124 i).
Au point de vue des consonnes, reel. Par contre, sur les gutturales
ne difterent
que par l'incapacite
au redoublement est tres partila Phonetique
il devient
I&. vocalisation
(§§20 sqq.).
des verbesgutturaux dans
'~~V 1 Ch
4, 10 (§ a). Quelquefois
l'infinitif
~'?
'l!;lj? i'm)
culiere ; elle est reglee par les principes
la flexion de l'imr.eratif
de tromper Ex 21, 8; C"1:lt3 Am 2, 2 S 1, 10 (a cote de Ez 30, 18; 34, 27 De l'infinitif j:t~;t c p. ex. Devant deplacement Gn 19. ~3. 35 ena
i~)
dans de
6 (a
p. ex. i,~(i)
son acfi~1l
~ote de ;:n;:,t3 Ex 21, 8); toujours regulier .: . 11, 19 et de
1 S 29,3);
Zach 3, 1. Ie verbe
T~:ltU 'Lev 26, 26;
on trouve seulement
§ 68. Verbes
(Paradigme
1" gutturale.
t; i)ro~ :.
4 : .,~~ se lenir debouf).
Lois phonetiques 11 Apres on a hatef patah, patah;
qui ont ici leur application:
a du shewa mobile, pas hatef
a cote
~f7';; Dt 6,7;
les suffixes ~, C~, au lieu de de la voyelle, sans doute 17. Une autre
i~'i' Ruth 3, 4. '~i? on. a parfois '~pavec
la prononciation, la prononciation consonne, p. ex.
une gutturale p. ex. imper,
'Op.
initiale,
au lieu
Cependant
N n'exige
9'?~~Gn 2,
pour faciliter
et merne ordinairement
c),
il prend hatef segol e), p. ex. imper. En syllabe ouverte i devient -::-'
maniere de faciliter
'b~ (§ 73
est de donner d On trouve gique, dans
un p auxiliaire tres rarement Dt 4,36;
qprpfl'1!rm Dt 20,2 (comp. p. ex.
97~~ action t~n
la seconde
§ 22 c;
9~~8§ 96 Aj).
C?1~8
,t~.
une gutturale:
2) Devant
'p. ex. nif. fut. *ii-camrd>
,t3P'
••
I'·
. En syllabe fermee (ou semi-ferrnee)
Ie suffixe de l'infinitif avec le nun ener23, 5; Job 33,32.
:t~:
(i) Comme voyelle la plus faible, I'alef n'etant Compo infra, ~ b (fin) "b!:~.·7 On distingue
tl et ~~~ repondez
\~.r.chante»
pas prononce
: cf. ~ 17 a N. Ps;147,
(Nb 21,17;
(1 S 12, 3t).
68a:""
Verbes
I" guttnrale
U
136
r» -:;-,p. ex.
(coIIlP. ,~~~
*iJ!t-zaq
> i'm'I~; > -;-: p.
que
137
Verbes
moms frequent
'~i?~; cf.
ex.
*mu'mad
> ,r"pr"
§ 21 d).
1'1':11'
parer les futurs correspondants ces formes.
l}
,er:~, !1~ry~, ~~~
T -:
I",
2" gutturale
68 e-
69 a
'qui ont pu favoriser
Cf. § 22 d. ~, --:;-;:- est frequente, car le son f? tend au nifal, p. ex. ~pj, I"1n~:v.:l, Iil"l~:V).
T : ".' (.' T
3) Souvent elle pleine quand
on a Ie hatef auxiiiaire le mot s'allonge, voyelles, les
(§ 22 b), qui devient voy-
L'alternance sous l'influence
- l"
a devenir
,poex. 'b~~c' ~,~~~ (§ 22 c). entre les verbes actifs et statifs ap-
de la gutturale.Ainsi
I'"
on a au qal, p. ex. I:Jb~I~'"
'6
Qat.
Au futur la distinction
~arait dans les deux (§ 41 e) (,). Cependant depend dans de la nature
p. ex. iflmud
> 'b~~
; ii!tzaq
> p !.r,t~. .
'tlONr-I; par contre,
•:
fait hifil (') ~ --
de la 1° et de la 2" personne devient regulierement meme isi le ton ne descend
. <
"'I '::,'.' Au parpas, .p. ex,
verbes
M'" la voyelle Devant M~V'; v -u-
de la preformante I'1'M', M'n'+' ....er... :
l!l1?~OJob
d'ou
-j
••
-:
1-
apres le waw inversif, 14,19,
mais '~1~~P1
Lev
23,30.et .
souvent ; 9'~1;l~p:
de la gutturale.
1'1, n on a -::- ;-devant exceptions:
P on a -::-' p. ex. M1I1'1', v : ',' MOM'; ...rv (§ 79 s). Dans les verbes
mv',
'.'-:,-
Is 43, 23, mais 9'~1~~mJer Au hifil, dans quelques A'!1VI"1). Le ralentissement,
T :''':1','
17,4. -,
-:
formes avec p,
\._ T
la 1e syll. est ouverte •
:-
le P prend norrnalement pour but d'assurer
-a
p. ex. r-I,5V1'1Jo!; 7,7 (au lieu de -:1"' anorrnale, 2 Ch 20, exacte du :V. De merne
T -: I
Wtl actifs, done avec la 2" voyelle p, la voyelle
de la preforrnante est -:;-, p. ex. '~~~., de I'imperatif, p. ex. 't~ (2). Ala
c
... -
'b~> !1"~
v : rv
qui amene une division syllabique la prononciation
IT
r,
p.-e.
l'analogie
a probabl'
au hofal on a --' M'VK. 1'1~VK.
't.... : ".. .: '."'! ,'0'
pour --
Y:
dans p. ex. 1'1'Vh Jug 6,28; irreguliers
1" p. sg. on a K (non K): ,bPM,
-'":1'''
34 (Phenomene Sur
sembI able . dans les noms § 96 A j). des verbes 1"1'1'1 1'1'n cf. § 79 s. et
TT T~
Nifal. les verbes
Le parfait ,t3P.:l vient de la forme l'inf. absolu on a ';t3~~. parfaits M'" il y a quelques Ie type ,r"V' .
- 'I,"
secondaire
ni"mf1-d =
'~i?~; mais a
on a toujours d e
la vocalisation
Autrement, avec --,
-
-::- est rare, Dans p. ex. 1'1Tt1P.:l.
T
Au futur, en fait, il n'~ a pas d'exemple
-:1-
§ 69. Verbes
de redoublement
virtuel: )zi"mi"d _ Lois phonetlques
2" gutturale.
(Paradigme ~: to~ -'gorgeT).
"~p., .
.
Hifil. 'Le parfait "t3VM vient de la forme secondaire
•• ..:1·..
qui. ont ici. leur application des formes
: du
1) Au lieu du shewa mobile de detail. qal
correspond~ntes (comp.
Remarques
A l'Irnperatif tend faiblement tluence du -, une seeonde A l'mf, type .. ~
T
a devenir
,
ri
verbe regulier en syllabe fermee atone,
T :
qui suit la gutturale,
: •
(comp. tend
~; p. ex. on a ~tlOK mais MtlOK (p ..e. sous l'in-r
~~i?~)'~~tJ!: (comp.
la voyelle de cette tendance, ~~
on a -:;-: (§ 21 f), la gutturale,
2) Apres
~'~m~)·
p. ex. ~~~
~'~i?)' .~~~~
la voyelle a 9
en syll. ferrnee tonique,
cf. § 29 f); Jrntturale cst. qal,
~'P mais M.::l'P; 'e~n (cf. § 21 e). T : 0' •• : ",' on a p. ex. ~!1"K, ~rnK.
!"
Avec le
a supplanter
primitive
ou la voyelle normale (§ 21 e). statifs e), par ex. to us les on n'a
(Comp.
,e~,?§ 49 f)
'::,'.'
'::1''-
En vertu
le futur et I' imperatif des verbes d'action
cote du type normal ,bp, Presque
-r
1-
on a parfois
sont generalement
en a,. comme ceux des verbes
tons les exemples sont avec
n: !1~,:,? (touj., 4 f.), !1~,:,? (t~)Uj., 2 f.),
.
9~~
~~~, ~;:np (pour
verbes
*, ~h~ *). Mais l'inf. est, garde la voyelle
Agg.,2,
16; nir-lr;t? (de Ruth 2, 12).
(de' meme dans les verbes
3" gutt.
r:t'tp
et dans presque hitpaeI): Avec'
I"1nn) Is 30 ,14; nio", : - Is 30,2 (maisn1On, -:,- Ps 118, 8,9; ; D'une facon generale le n se passe volontiers
statifs, § 49 c), p. ex.
~h~.
(piel,pual,
du hatef, § 22b. Com-
3) AUK formes intensives
(I) Autres verbes statifs : pable, b~ar.;
1~ manquer,
;)tI~ <'CO
aimer ; ;),:r~I~"; ~ c
(,:~!)se reudrecou-
(I) Cf. DRIVER:
Notes
011
the hebrew text .... of Sanueel» (in 1 S 15,18).
.,~.
(!) Verbes statifs: ::ltl~ (~-:!) aimer, ::l:!~I~)'~ i
(2) Dans les formes nominates on a p. ex. ;)~~ embuscade.
;)p;
auoir faim .. ~~
(~)
demE_nder,
i?~,tf·
(~)-etre
loin ;
'::!19 t. pur;
69a -70 b
. Verbes
2",
3" gutturale
138
139
Verbes
3· gutturale
70b~J
jamais digme
C)
le redoublement
5,. on
piel
n~(n~ 52 c), ''J~~;pual ·n~· §
virtuel, p. ex. dans le verbe ~:1 virtuel
du para-
(opp, ;;,~); ~ ~.
hifil imper,
~ry
(opp, ~~j?tj); l'etat
~iel info c,st.. generalement cf. § e, 9, par exemple et cf.
(opp. "~j?), partie. Exceptions:
est .• M?~ (opp. ~P);
Avec'
tot on a le redoublement
l'ad._ultere, <virtuel,
..
'9~~ lommettre
le redoublement conduire; bRemarques
•••
r~~ outrager,
nrjv?
•• -:
dans les deux seuls 'verbes mepriser.
A l'inf. est. qal on a presque toujours
(de merne dans les verbes
2" gutturale devenue
JO~,
$i 49 c);
Avec les gutturales "11'::1 consumer,
M, 1'1 et.meme p. ex. fut. "11':1', en 9:
V • (§ 20 a) on a generalement
cf. infra, tient,
§ d.
corrompre ;
er:p
••
(2) consoler ; :t1'J~
l'
2) .La voyeUe pnrmtive mais en subissant plus lourdes, le participe l'etat abs. relativement
z,
normalemeut
-::-:, se mainles for~nes
mais info est, "11'::1.
l'intrusion
du patah furtif, absolu,
dans
de detail.
Qal. Exemples de futurs cote de
13, 17; Jug c
rhtot Ex 4, 4 ; Z S 2, 21 ; fern. 'tntot Ruth 3, 15 (avec 9 moyen
... : • T: 1°"
rnw ..
eM)' ilrugira,
t •
rhtot' il prendra. (rare;
.::
§ 73j.). Irnperatifs
en p : seulemeut
"V):
1'0'
l'inf. abs., partie.
uerrouiiie
2S
tT?~.
a savoir
l'etat
: les formes du verbe fini en pause,
p. ex. -""_ : in/f. abs. ~;.. _ La voyelle primitive 1t ne se maintient qu'a
m~;
abrege en p tres bref);pluriel
19,8. Dans la flexion l'Imper. . peuvent se confondre
-: 1-
~t~~ Neh 7,3,
~rr,~ Cant
2, 15;
-'!'t?
l'inf. est. H';!~ (t). . -: A fortiori les voyelles longues 2, U, indicatif M'''~; part. passif
en a, p. ex. tOM~ devient -: piel
'~J
m~;
9 se maintiennent, p. ex. hifil info abs, Mi"tf.
• -: 1-
~tO~, -: 1virtuel;
la vofelle a passant au commencement avec I'rmper.
-: t"
du mot (cf. § 48 c). Ces formes avec redoublement etre des piel; n'a pas
On Ie' ~6it, les distincti;ns ~ntre les for~es Tlegeres et ies formes lourdes sont de deux sortes: dans les formes finies la distinction porte sur le contexte et la pause; truit et l'absolu. Au futur qal (et dans l'infinitif et le participe sur, le consc d seulement en
>
p. ex. les qal if Pie!.
~li:mGn' 18, 4, ~'VC
Gn 18, 5 pourraient
le piel '''Ii't~ Gn 18, 6 pourrait
.-,,-
Hre un qal.
l'imperatif)
en contexte et en pause, les verbes tous ont la yoy. --:-, -;;;:-.
Au futur inverti virtuel,
on a, dans Ie cas ou la gutturale
d'action se confondent avec les verbes statifst"): Remarques L'infinitif liaison etroite de detail.
Ie redoublement
p. ex.
~'J~~1 Jos
24, 12 (§ 47 a),
~1~~1'
en a est tres rare (§ 49 c) et se trouve avec le mot suivant:
,
.
§ 70. Verbes
(Paradigme
3" gutturale.
Nb 20, 3 VU; Is' 58, 9 M~.: ._: T
6: M~!f ~llvoyer),
Avec les suffixes l'inf. a soit la voyelle -,
p. ex,
'Mr,~ Nb
• : y
32. 8,
Loi
phonetique
qui a ici son application: par la gutturale, la voyelle --:-, homogene en supplantant la voyelle entre la voyelle par '1 dans
'1mv?
Gn 38, 17;
En syllabe aux gutturales, primitive et la gutturale
ferrnee
Ez 37, 13;
s'introduit : 1) ou violemment,
(§ 21 b); 2) ou furtivement, (§ 21
c).
en se glissant
'1p.i?1 Ez .. II'y
e~p~Am
soit
la voyelle -;-,
p. ex.
~IJ~~ Jer.
48, 7,
'I}~!!l
1, 13; soit
(rarement)
la voyelle '--:-. p. ex. donnees au §' b. e ~ Ex 10, 4; ~~*)
25, 6.
a quelques exceptions aux normes '.generales cornme info est. .piel (en contexte): on a p. ex.
Ainsi on trouve
1) Les voyelles les formes relativement fi~'i (parfait.. futur, construit, p. ex. ~
primitives plus (opp.
i, u sont supplantees
M:.IE)" 2 Ch 2, 6.
- .. -:A la 26 p. sg. fern. des parfaits avec un patah auxiliaire ne produisant
Iegeres,
a savoir:
les formes du ,verbe
~r:r?vt (pour
.I
irnper.)
en contexte, l'inf. cst., le participe
l'etat M~~~
pas la spiration
du r.! (~ 19f)·
"toR~); M~
(opp, ~?,);
hifiljussif
reel. ,
(I) La voyelle primitive (I) Dans l'I~~ Ez 16, 4 (~23a)
II n'est
done pas traitee
eomtp~ la voyelIe syest
i1 y a un redoublement avoir les memes voyelles
(~) Ce piel en a se trouve chang erii'auis,
que Ie nifal
Crr~
metrique i, Ainsi la forme pausale du futur d'action (2) Verbes statifs; ; pt;2~,
MZ"r':,
non
~:*.
se repenti» (~ 72 b).
l'~;~ i. rassasie
~Pfentendre,
~;~
t.
haul;
r::t?~ *, M?~,
ecotiter,
lM?,.!fouotier ;
~~r*, P;~.
70/-71c
Verbes
38 gutturale
- Verbes
faibles
140
141
Verbes
·t'li
C' est ainsi que ~~~ (prepos.
s
qn~ k
? + info t1ljP- § 72 f).
tu as pris
se distingue .
de t'lljR7 pour Pid:
prendre
. ~ 72. Verbes
(Paradigme
7:
Voyelles pau~ales dans la flexion:
Exemples:
n~, !:l~~'
t"!). It'~* approch~r), a
m~*, ~n~.
~T :_
Jug 1,25. 'QaI:
n'?vf.tn~>
~n?~t:12
R 2, 16; imp~·m~
t
au mais , ,~
j,
La faiblesse
du ~ initial de ces verbes a deux effets, I'un propre l'autre accidente1,
F ormes avec suffixes: Exemples : il m' envoya) ;
,~Jj~
1tt~~; 1t10~~ .
'~6?~~, (envoie-moi; '~6?~
savoir ,1'assimilation;
savoir l'apherese. sui- b
L;assimilation .. Exceptions:
du ~, depourvu
de voyelle, it la .consonne
vante est tres frequente 1) En pause, ou
et meme ordinaire
1'00
(§ 17 g), p. ex. iin~(Jr
>
-§ 71. Verbes .faibles aLes quant quant verbes qui s'ecartent du type normal
aime les formes plus longues (§ 32 g), generalement il n'y a pas d'assimi-
~R
non' seulement mais encore consonax:tique divers.
souvent 1'assimilation n'a pas lieu, p. ex. ~,~~~. 2) Devant une gutturale lation, p. ex. C"~~. 11 y a assimilation dans le nifal Clj~ comme dans 3) II n'y a pas d'assimilation 4) Le verbe au nifal dans la forme ordinaire
la vocalisation,
comme
Ies verbes verbes
gutturaux, faibles
auxconsonnes,sont
appeles
(') '(§ 40 c). Ces
verbes presentent
dans leur racine
un element jaibie mais
tous ies nifal (pour eviter deux ~) (t). de 1'inf. .cst, du type ~~ avec "~po ex.
(ou vocalique dans les verbes Le 1 l'est partioulierement. du mot (§ 26 f): est supplante 3eradicale bpar "
'''11. '''11).
'Les consonnes 1, " N,' ~ sont faibles, ou bien iljombe, p. ex .. :l~.
des degres
II Ile peut se maintenir Dans les verbes
au commencement
n~7:qui
qui se
'e~,?
(§ 49 f)
est traite co~me -un verbe t"!) (§j) fait nous prendrons, qal futur). seconc et est un phenomene, accidentel,
p. ex. :l~- (de :l~*),
n"',
ou bien il le.s verbes
n~~~,sans
.assimilation. (Opp, ~~
primitive
~ ont ete absorbes par les verbes (1, ~) peut tomber, p. ex.-:l~
a 3°radicale
(de :l~*),
a i.
~~
'L'aph~rese
~,~
(§ 174)
daire et analogique, est, de c~rtains verbes toujours l'imper.
produit seulernent
Les effets de' la faiblesse 1) La consonne de ~~). cedente, p.ex.
I '
d'une consonne sont divers:
a futur
a I'imperatif a
l'inf.
en a. Ainsi, dans ces verbes on a presque
du type ~~ (I), assez souvent l'inf. est, d~ type t'I~~ dans les verbes
(§ k). L'apherese
desverbes imper. ~~ a 't"!) ,ou
r'l) est
probablement
l'analogie
2) La con sonne (1. ') peut etre contractee p. ex. :l'~i1 3) La consollne (i) peut etre assimilee ttf3' (pour iink'!}).
avec.la voyellepre-, la consonne suivante,
elle est ordinaire.
De plus, une forme' telle que. par fut, ~~~ .ou le n dispafeminin,
BARTH (');
(pour haijsib), :l'~'1J (pour. kailib).
pu
etre facilement suggeree
rait, puis se propager
l'infinitif:
gaS, d'out'l~~
e).
d de
L'infinitif" apheretique
'1'I~~ est .forme
de ,gas et duj
4)' La
consonne (N) peut'devenir' faibles:
quiescente, p. ex. :l~.
'~K',~~'.
ajoute pour retablir la trilitteralite
(loi de compensation
Division des ve~es 1) Verbes 2) Verbes
~uis *gast a ete segolis« en -t'I~~ (comme, dan~ les noms *malk en
'I?~
a
a
l~e. adicale r
faible : ttf~ *, '~~.
§ 96 A b). Avec une gutturale on a IX ex.l'I~~ (cornme, p. ex., ,~~).
(') Le nifal clj~ cllang-er d'avis, se repentir. a ies memes voyelles que Ie piel en a
(!
3° radicale .faible :
~t?,
n~~.
entre lesquelles, dans
3) Verbes avec deux consonnes'radicales,
I'etat normal .de la racine, il y a une voyelle longue I'etat normal de la racine (p. ex.
e, i:
C~p,
r~·
'
err?
cossoter
(~ 69)a). lIl-bas: suite vocalique f·p(cf. ~ 29j); pourquoi I'apherese p:.e.aussi
4) Verbes avec deux consonnes radicales, dont la seconde, dans
(I) Gn 19, 9 favorise par la sifflante, futur en-(J.A ;~;
n~r!va
l'Imper. pl. ~216), est longue:
:l~.
.(') On peut se demander verbesa maintenu
ne se produit pas dans les (cf, ~ k) aura (1~94). n,
XII
I'infinitif,
la tenacite de laf~rme;lci? on aura garde ;~~ in den semitiscken
(I) On voit dans quel seus 'on peut les appeler irriguliers.
puis, par analogie,
l'imperatif, sq.
(') Cf. Die Nomi1lfzlbildung
Sprachen
72e-j e En pratique, imperatif ,..~ (p.ex. ou d'un d'apres
Verbes
I'E)
d'etre dit, en presence on pensera d'abord
142
143
Verbes l'll- Verbes It'll
72j - 73 b
ce qui vient ken second
inf. apheretique, particulieres.
d'un , un verbe
raison d'analogie. semantique donner MR,
Vo!,~;' ~~~
lieu seulement peuvent
un verbe ,"C.
r~~ (avec
.su~vante:ti'apres .on a 'forme ~~ parf. 2" f.·
l'inf.
nlJR' nr::rR7
assimilation) (opp,
z:,IJR? §
e); d'ou
le' futu~ de I'antonyme
l'jmperatif '
70 f).
Remarques p. ~x.
Au nifal MR'?~il n'y a pas assimilation etre identiques, innacent ;
'(§ b 4).
. Dans .les verbes
f'C le nifal et le piel
n~~(verbe
M"')
.nifal : etre impuni,
defectif
piel.: declarer
Le parfait ~7' du qal (§ 58 a, b).' Verbe irregulier
le participe
MR7et ,
Ie futur M~~ sont des passifs , etc.; M~, voir § i8 I. k
Om (§
If
2).
statif
M'D~ porter, prendre
T T
Le verbe proprement
Ttf3j·,~3j,
~~*, .~~~ est
au parfait temps
(§ ~5 b). Le qal signifie
on emploie le nifal le
.
Sur les verbes f'C ~meme copees reduites Comparaison L'asaimilatlon formes verbales, conduite, comme
temps cf.
qui ont des formes apo1
eire proche ('), approcher, aux autres(futur,
le nifal se rendre proche, s'aP'-
une seule radicale, avec ies formes
§ 79 i, j.
procher .. Pratiquement, qal
et au participe
-
nominales. comme ~W' il plantera ,. MC~~'
• , T .....
-.
Ttf~, ~~,
...-
Au parfait futuriactif h maintenu 'Le type de l'infinitif ~~ et 2 f.
:-
,}l~
--
imper., info cst.) on emploie n~~. Les formes avec 5 rafe sonrdonc .evitees. statif ,~~ se jietrir,
•• T
a lieu dans les formes nominales comme dans les
T -
p. ex. ~W~ plantation,
tomber (jleurs,feuilles)
repond le
percussion; jleau, comme .~~ il frappera;
mais, devant gutturale, ' l'origine
(§ 41 b).
~1'Jt~onduire c
l't~
de
(un char).
'!oj?,
.
qui est la forme quasi propre
.'
de l'inf. cst., s'est
• L'apherese
n'a pas lieu, ce qui' confirme apheretiques des verbesa
secondaire
parfois
dans les verbes : ainsi
a
011'.
futur en a, soit seul, soit a toujours intransitif,
T'T
cote
I'imper. et de I'inf.
futur en a.
-apheretique
~b~ (4J.) decamper;
,
dans le~.verbe d'action, -
n~i; dalis
ordinairement -
le verbe
irregulier M'D~ porter
,,~~ toucher on a 6 f. -y
(§ 78 I) bn a
Nest ,..C
.l'
-73. Verbes WC.
(Sans paradigme).
seulement i
4 f.
M'D~ a cote de l'usuel nN~. : .. :
Verbe irregulier son futur en i (type ~~):
n~
't;lz:, mon tit > 1'1~.
\10 passif ri{i.up)li,
de
* tiut
m7
> -::-,qu'on
'j
rtl~placer,
imper,
donner. Ce verbe est remarquablepar guere que dans les verbes De merne la form: de I'inf. est, est
quiescent
_ T
au futur qal des 5 verbes'!lN
.' " -., T .T T _ '.
manger,
.,ON dire,
T
't:
. ne trouve
d'ou
r~.
'~N errer, perir, laquelle, (§68)
M~N uouioir, MCN cuire quiescent,
(Ie pain). La
raison
pour
.
dans ces 5 verbes, mais devient
N n'est pas traite comme une I" gut~lIrale est sans doute le~r grand usage. D'une
b
(tin +t), d'ou
titt (qu'on par1a
devant Ies suffixes, par ex, c.essation
action de d01lner), d'ou, Au futur du, qal (§
m~ correspond
5B
a).
le passif
rt::l~il
'
du redoublement, sera donne, qui est :
fa\~n generale, Explication
les formes les plus usitees sont aUSSI les plus usees, du fut.
'!IN'. , ..
Au p~rfait,~ le , p. ex. L'infinitif -. Gn 38, 9
final s'assimile
Ia consonnesuivante
M~5? (beaucoup en pse
plus frequent que trouve seulement
'z:,~R!' Z!'~~~).
~6? § 42 f),
't;1b?
pour
I" voyelle. La voyel!e p est n~ la l" p. sg., OU se trouvaient originairement deux: alef. La forme prim~tive est 'a'kul (avec l·voy-
etc. (Opposer
elle a des verbes d'action ....§ 41 e). Or, en semitique, yient 'ii; puis- 'likul est devenuen autres personnes. (Cf.. ,1,239,591)
le groupe 'a' de-
'::9.
dans .Nb '20,21 l'unique
rt9
h~breu.* '?kpl. Erinn
ra
passe aux
et dims
BROCKELMA~N,
(2). '
j
traite
yerbe
irregulier un rC.
MR? prendre .. C'est Ce traltement
statifdans
verbe ~"C qui soit est prob' dli
comme
tout particulier
Job 41, 8.
a la
(I)
D'apres
1
UNGNA'D,
B'Ntrtig-t: f. Assyr.;
cf.
BERGSTRASSER
5,
p ..2i!l, suivi par
BROCKELMANN, 1
Crundriss, 11 'y
a p.·e. aussi I'influence
(') En arabe on a
p, 176,293;
§,19 a,
BAUER-LEANDER
§ 52p.
de ~it'~,It~' qui signifie aussi prendre.
~,T
(I) Ce sens absolumeut
a la 'I e
'a~
~,mais
p. ex.
la 2" p, la'lul
,j"G
73&-f
2"
Verbes at'~
144
Verbes IC"~ -
Verbes
"1)
73f-74
voyelle.
1t
Dans Ie verbe
,,~!C la
seconde voyelle prrrmtive
du
En dehors des 5 verbes, N est quiescent quelques autres verbes: Dans Ie verbe rlJ~ prendre. a (rarement'rhN' Nest
sporadiquement
dans
futur est
(cf aram. bibl. ,,~~,
arabe j,a'kul),
comme cela ressort
de l'imperatif";~ s~cond pa
(') (comp.',~).-A
les deux voyelles se trouvaient avoir la meme couleur; par suite 'le ete dissimile en {, d'ou de la
2"
§ 29 h.
d Variations voyelle.
"~k,
Ceit~
la I" personne, au stade *'~kpl (qui est la forme pausale). nouvelle voyelle {, qui a
souvent quiescent. A la
I" p.,
18
ou l'~ est plus naturel (cf § b), on a rIJN; mais
',':,'.'
a
a
~ote de mW on
('). Au total, dans ce verbe, N est quiescent
fois, et pro nonce 3 fois. Dans le verbe statif. :lCltc, :l.!-1t;t, :lIj~,' aimer, :lI'N(l
-
la 18 pers. on a
supplante la voyelle primitive u (> p) est la voyelle normale dans
";J~, ,~~
"~tc·
Elle peut s'affaiblir
deux degres : en
-=- (affaiblisC). C).
f. :li'1N § g).
hT"
Dans le verbe 9Qtc reunir, il y a 4 exemples dans 1esquels Nest quiescent et merne est omis dans la ~Taphie, p. ex. Ps. 104, 29 pour ~~. parence'iie formes de rac. 90'. particulieres.
'0': I'"
sement mineur) et en -:;- (affaiblissement majeur); toujours. On a ',?M', L'affaiblissement
cf. § 29 d.
9~l:1
g
La voyelle -:- ne se maintient qu'en grande pause, et encore pas
Ces formes (dont l'une ou l'autre est suspecte) ont l'ap-
1;W, 'pNr-l
(2 f.); mais
'~W. '~k~
majeur de -::- en --:; ne se' trouve que dans cause de l'extrem~ usage de cette forme (pour Ie verbe ':IN pas d'exemple).
Remarques
"~N~,probablement a
Au contraire on a cas: L'affaiblissement La voyelle
1) Le groupe .-
est contracte en -
';Jit~
-
/Jour dire, en disant, sans doute forme (opp. p. ex. ;;N');
":: I'" e
a cause
44..
dans .,bN' (pour .,bN;)
'.':,'.'
de I'extrerne usage de cette
'~W, .,~, 7
mineur de -::- en
---=- se trouve dans les autres
cf. § 103 b.
AT"
-=- est
,:lW.
La meme contraction se trouve dans :li'1N Pr 8, 17 done la voyelle ordinaire. exception
t,
i'1MNr-l, Mich
... ••
.(, 8 ; .,AN' Gn 32, 5.
"IT
De tout ceci i1 ressort que : La voy. tonique en grande pause est -; La voyelle posttonique est Les differences futurs '~N' et '''~N' peuvent
2) Les deux verbes i'1:lNet i'1DN etant en meme temps i'1";,
T T T T
.,~W ,"~N!I'l.
le futur est i'1-?N',i'1~W*. Comparaison avec les formes de ma'sir (N omis dans la graphie); nominales. minales Nest tres rarement quiescent, p. ex.
La voyelle tonique en dehors de 1a g~~nde pause est
--'<
.z..
A-
de traitement de la 28 voyelle
ou
--<
c'5t~
.-: I
Dans 1es formes no- h balance,
-,oi~ lien
..,
entre les deux trois
cf. §,88 L k.
se resumer ainsi, en distinguant
degres (fort, moyen, faible) de prononciation: Degre
§ 74. Verbes ,HEl en general.
Les verbes avec 1", radicale , se subdivisent en 3 classes: 1) Les verbes avec, formes O'''El) (§ 75). 2) Les verbes avec' primitif ("·D). Ils sont peunombreux hebreu comme en arabe (§ 76). 3) Entin il y a une categorie speciale de verbes "D dont la 2· radicale est un ~, 1equel est redouble dans certaines formes. Ces en primitif supplante par
i'
,~W
A"
fort
Degre
moyen
Degre
faible
;;JW
.,~W
.,~,
";J~
dans certaines
,~~quiescent, par ex. ""~kJer
En dehors du qal, Nest
rarement
46, 8 je ueux perdre ; nifal ~tnN'I Nb 32, 30 ; Jos 22, 9 -s
(1) Pour le -:;;- cf. ~ 68 a! De merne, Ie livre de Job, OU 1'0n a '~N_' 3, 2 etc. (3.} Compo ,~, .. .,~~
•
~:,!!.
dan~
I'infinitif on a ~:,.~ plutot que
verbes (~'''D), peu nombreux, sont. probablement tous des, verbesavec , primitif (~ 77).
(') Pour la vovelle --:,:-. f. ~ 68 b. c
P. jOiiON. Gramm, de I'hebreu bib!.
IO
(2) Excepte dans les formules introduisant les discours':poetiquesi
t. ti,.oit ("~.~
,-
82 tA
75a-
Verbes ,,..)
146
147
Verbes ,"EI
75c-e
§ 75. Verbes
'HE)
primitivement
,...£1 (-
""£1).
Futur
actif .::l~.
La 2· voyelle --::-provient de la voyelle primi-
(Paradigrne 8 : :l;i~ s'asseoir,
demeureri.
tive ides futurs d'action tres rare (par exemple
(§ 41 a). En dehors des verbes '''£1 le --::-est
Dans les verbes prirnitivement jugaisons
'''£1, le , se maintient dans les con-
ff:!:).
de nombreux *iisib grammairiens, viendrait serait une forme
La I' voyelle -::-' d'anres de i. Dans .~ radicale, ~
derivees nifal, hifil et hofal. Au qal, ou bien il est supplante avec': Nifal. La for'me premiere est na1jsab avec .::l~. Au
. par Ie " ou bien il tombe. Au piel et au pual il est supplante par le '. 1) Formes la preformante Hifil. Hofal. Qal: qal, .::l~; pour primitivena (~ 51 a), d'ou par contraction (comme "~~:).
cette
hypothese
comme le futur arabe des '''£1 J.ahdu ~. plus probable
..
.,,,,'
syncopee sans ,''''' (de ~alada ..>J,).
11 semble beaucoup ment long. En effet:
que ce --::-vient de ai et est vraipro-
futur Ie , est redouble .::l~: ha1;fszb, if;r.1j;Sw
e)
L'a primitif de la preforrnante
(§ 54 a) est conserve, d'ou u l~ng (~.
1) Au futur statif ~': vient de ii; l'analogie 2) I' voyelle f soit egalement
-Ia I' voyelle zest longue, carelle que dans la formedu lefutur longue, et done provienne de ai.
> .::l'~n,
demande
futur actif la actif et Ie futur
.::l'~'.
La forme theorique aux futurs
~i'
,rry"
~u~sab devient .::l~n avec (§jJ:
E~ hebreu,
d'une facon generale,
st~tif different, par '. Dans ,la conjugaison statif
quand c'est possible, non seulement 1· voyelle
quant ~ la 2", mais
2) Formes partie .
ou le , est supplante du
encore quant ia-Ia
(§
41 e). 11 est don~ normal qu'au futur s'oppose un futur actif *iaJ,"Sibavec
au commencement
mot, quand il .~·a ~me voyelle : Parfait,
.::IT!?',
* iiiras
avec 1· voyellei
.::lW!" De plus, au futur .::l~ (qui est probablement ona 1 ou " p. ex. n1~;:t confesser cf. §77 b. cdu ,. Dans laconjugaison qat, shewa: imper, (assez frequent), de ~)
I
i~jjw. § c).
Au hitpael se faire inscrire dans un,egbzealogie . . (denorninatif
l' voyelle: a. 3) En 'laveur de'ai on peut invoquer le parallelisme des formes ~" le (pour ia~sifJ et
~l'In • •• -.
Nb'I, ,
M1"
d'u
(§f)
=:'
qui sont des futurs qal dans lesque1s est rendue probable par Ie fait qu'Il ne connaitrai ". ("),
-c
J primitm s' est conserve .
. 4) La longueur on dit, 'p. ex. Avec
I'S. Pour/~~l};:t , 3) Formes
avec apherese
tornbe jamais; , Remarque. Futur indiquent
au commencement
du .mot, .le 1 tombe quand ilaurait *Sib, d"ou avec 'let
1~1~ te je
le waw inversif.::l~
devient .::l;t~ (De meme
.::l~ (~our .::lTti~):' info est,
feminin (§ 72 d) *Sibt. (").
C~tte forme;"s~golisee, donnerait
1'1;;;*
(§ S9 k). En fait on a h~~, pA.
au hifil on a ~~.,)., ... statif
l'analogie Verbes
de l'infinitif en a, pi·ex. actifs et statifs.Parfaits ar.
1'1~
th". Comme il a .ete dit (§ c), les deux voyelles d
que dans ~,~ le ton ne re-
deraS~t
"
Ie futur statif. du tOI)., on remarquera
statlfs-.' aMt craindre, .~ do~i laforme
OU'w
pre-
A l'egard p. ex .
redouter. miere , est
Dans le paradigme ,
W:1!*
(comp.
uari!a ~;).'
on a cite ,~,.~ Mriter . et les.verbes
monte pas (§ 47 b). II en e~t de meme dans
!l~'~ (§ 76 b) ; opposer,
.,Jj1
(de
mn, § 79 zj.
semblent d'origine secondaire. Apres e on attendrait au hifil jussif le 1 primitif,' comme dans ~~l,
Au futur,'les
verbes d'action
statifs different inon
Les deux futu~s qal .::ltP.~, ~ ~ la preforrnante de ressembler
seulem~nt par la 2', mais encore par Ia '1'·voyel~e(§. d'action 'est *iaiSib
> .::l~;
le futur statif est*1iir'aJ
(i 51 0).: etn:
>~~ ;
41 e). Le futur
.::l~~", Mais une fo~me telle que i.a~!ib
etc. p. ex. (i) II est rernarquable .
> .::l~i' *
.::l~n.,
avait I'inconvenient
, (i) A la 1. p, on a ~ (non ~) type :l~
(%) Cet U a passe dans les verbes
-,z,~.,.~, ~~
devenir
et au participe
actif du qal. Cependant
,.,
~1':"I(f 80 II), :l~:"I (. &2 d). '
le 1 a ete conserve dans ~~,
90.;' .(~j).
jamais ecrit pour'2!: avec .
(3) D'une facon generale ~ (=
~? + n);
-la finale n .,' : tend
n., :'
cf. .89 II. Comparer la contamination
de 1a forme gill par
que ce --::- longn'est
mater
'lJaIl f 96 Af·
Jec/~nis, saul, pzobablement,
Ps 138, 6 on il faut lire
»"!'!
75f-g
Verbes
''''1:1
148
149
Verbes,,.i)
75g-i
fFutur
qal avec, 1) Le futur
primitif
des verbes
n1!jeter
et
rryi'
9I?!
ajouter.
De meme que Ie groupe 'a' est devenu 'ii>'?
est en realite un qal. Comme il a l'apparence considere comme un hifil ; de
parfaite d'un hifil,· on l'a, secondairement, d'ou
> k?,
hak qu'on a dans d'ou'lj',?irt. p. ex. :l'~n,
* kakltk,
(§ 73 b), le groupe
forme anterieure
du hifil, est devenu kii imp. 9 etc.
Cette forme etant sernblable au hifil des verbes '''C, I!ause on a 'lj~ Ps 73,9 (§ 32 c): L'hitpae1 est r~ulier:
le
participe
rryit.3 synonyme
9r;?i' est
celle d'un
rryi'('). a
celle ete
2) Le futur est semblable Itifilise en
en realite un qal qui s'est conserve dans hifil jussif, et presgue semblable
l?, info rt~'i. En
'1~tt~i}. On
on a donne a 'lj?v les formes des ,."C: fut. 'lj~,
Gn 4, 12; Dt 13, 1; Joel 2, 2; Nb 22, 19 t (cf. § 114 g). La forme
trouve quelques formes fortes, p. ex.
'f'r;r.. Ps,58,
La forme 'lj?Of1Ex 9,23;
d'un hifil indicatif
9'l;)i'.
A cause de cette ressemblance
9_t?i' a
9'l;)i!.
Puis, d'apres
9'l?i'
on a forme le parfait '(rare, 6 f.)
dormant Ie ChOlXentre et tlJ~Z:!· Verbes statifs, sur le type ~'*, ~':
'f'.'f:'
est p.-e. une lectio m.{_cta (§ 16 g) k
9'D.in,
au futur
l'inf. est,
9'l?in
(4 f.), le par tic.
9'l?it3 (1
f.). Le verbe
done quasi defectif (§ 85 b). Les formes usuelles sont: au
90'- est parfait 91;);'
,~~
r~* dormir
~:*etre fatigue.
N'i' craindre -T
; info
rw"?
"y
Eccl 5,
11 t·
9'l;'i', a
l'inf. cst.
9'l?in
(2). sont done des hifil se.
r~:, rp.~ conseiller,
statifs -,) redouter,
T
avec a
a
a
cause de la gutturale. ~,~,;
yo_
Des formes telles que verbes "P, § 81 c).
"1it3, 9'l;'i~, 9'!'in
(en merne temps N",): fut.~", Y" cote de l'usuel avec la voyelle u
imp. ~',T: 49 d). i de la racine
condaires ou des pseudo-hifil (§ 54 f; voir d'autres exemples dans les
(non qN!~*); info N"1~ (2 f.,
,_ Verbes
Verbes Verbes ",
-.T
usuels: d'action, ; ,~ sur le type :l~:
T
Le futur et l'imperatif
> _:_: 'it!', -ru viennent
T
n~~ ,§
apparentee ,~;
'?! enfanter
P1!
savoir. N~ sortir, un ~~,
descandre, est passif du qal (§ 58 a). la 3° gutturale on a f. A c~usede ).
III
ttJp! tendre
a
Ie verbe est done defectif, § 85 a. un piege, denorninatif de Le sens de la racine
r,:,!pouuoir,
r,~,semble
ttJip~ oiseleur
: sans futuro (surtout
etre celui de capacit«.
P'Y. e), imp. P'=!,
ni ' comme (pour
Comparer la racine apparentee Quant la capacite);
fu
(ou plutot r,,;;,) mesurer
inf.l'Ip~ (avec voyelle -
hifil: contenir,
Ce verbe n'est traite
comme un ~ ... ~,
mais com me un ,... C:
fut. N~;
'imp. N~; info rt~
L'adjectif verbal r,:,' ne se trouve pas dans notre texte massore. tique, mais il doit etre lu dans jer 38.5 (t). L'inf est. 1'I?5~est d'un type tres rare, qu'on ne trouve QUE'dans l'I~S~ Le futur exprimant
n~*). Pour les formes du parfait inverti ef. § 43 b, du futur inverti
§ 46 b (formes anormales rares: N~,
~;:r
imper,
N'¥in
§ 78 i).
aller. C'est l'unique verbe
n""D qui soit traite comme un ,...13.
par le fait que d'autres t. 37, p. 142;
r,~~,est
it~ sec,
encore
Gn 8, 7 (cf. § 76 d).
explique de diverses manieres :
1) D'apres les uns ce serait un passif du qal, Mais un verbe un etat ne peut guere aVOIr de passif, puisque Ie passif se d'autres ce serait un futur qal, pour i?~'fl, qui ils'est dit d'une action subie. 2) D'apres viendrait maintenu dans de ,~a~kal. Mais ' 1) 0 se serait maintenu comme
·Ce .traiternent tout particulier
(I) Le .passage
doh probablement s'expliquer ainsi ('):
du qal au hifil a pu etre favorise
yerbes jeter sont au hili I : (2) Cf. t. 33, p~ 154.
':J'~::r
et ~,t;llj (tous deux sans qal).
MAYER LAMBERT dans Revue des Etudes.juives, lesfuturs
(3) Comparer, dans les verb-s !itatifs'r"', ,(4) Cf. PRATORIUS dans Z. fur
tels que~m.,
allies/am. Wissenscko/I,
,2,
"1~.
r,~~ (§
73 IJ-), etc.; 2) dans les verbes statifs la voyelle
p. 310; Baoc-
~e la preformante est i
t~ +l
e).
i", h. l.. En neo hebreu
KELMANN1, p. 585; BERGSTRASSER§ 16 a; BAUER-LEANDER 1, p. 214. D'apres d'autres, ~urait ~te traite ;il'analope de verbes tels que~:, ::~:; cr. UNGNAD, Be%t1'iigefu1'Assyriotogie, 5, p. 278; MAYERLAMBERT,Rev. des Etudes
':J?~
(I) Cf. EHRLICH, Randgtossen.
;::" s,e trouve
T •
au
;uives, 27, p. 137 n.
sens de possible; cf. DALMAN, Aram. Neultebr. Worlerbuclt.
75i-k
Verbes ,,~
150
l,Sl
Verbes "'1) -
Verbes "'I)
75k -76b
3) L'opinion un futur hofa!' prudent concilier a La
la plus probable
semble encore etre l'opinion an-
cienne et commune (Ewald, Olshausen, etc.), d'apres laquelle forme en elle-rneme indique un hofal,
';l~' est
ainsi
hiatus § 33), 1 fois dernieres blement: Infinitifs forts:
:1.',
-
et au pl.
~~,;
T'
sg. f. ,~"
.,
Dans
ces deux
I
et il est
formes l'a se maintient . la longueur
T :.
,b; fonder
... :
(opp. V':t , ~V':t, 'V':t). -: .. : dans
de ne pas c~ercher autre chose, si Ie sens z"lpourra 'peut se avec la forme causative passive. On peut se representer s'affaiblir en if deviendra du hofal il sera rendu capable capable, il sera capable, d'ou evano'ui (I).
passe de la voy.
,b'7 (aussi '1::>'7 avec redoua la consonne) : tM; (2 f., a cote
(cf. § a).
T •
de l'usuel I1N." ,§ Comparaison
49 d); l"l'S"
§ i.
nominales m
le proces sernantique. Le sens premier
eu facilernent
avec les formes
••
enfin il fJourra
C).
Le sens causatif se sera graduellement
De .meme Ie hofal causatif et signifie .' Le verbe un hofalLe il a disparu. active en u :
'i?~'proprement e. mis en flammes perd son sens e. en flammes, e. enfiamm«, comme Ie qal 'i?;*, ,~'~.
done defectif': le parfait est un qal, Ie futur est
1) Formes avec Y: 'Vi~ rendez-vous ('V' determiner [Ie temps, ie lieu]); .:It;;;~ habitation; ",ir-1 louange (rae. n,', hif. n1in louer).
T T T
Dans to utes ces formes, 9 vient de a?t. 2) Formes (adverbe). 3) Forme (aussi infinitif); syr. I;emld conseii : avec apherese du , (type 11"):
.....
ou le , est supplante
par'.
Au commencement
r,~, est
du mot, p. ex. I'N." crainte (aussi infinitif § 49 d),
'CI~en menre temps
11" enfantement
TO. ..
futur normal du qal serait En ararneen biblique 41 b).
r,~~*.Nous
ignorons pourquoi (statif) est ,~~, le line f~rme
ou le parfait
futur statif a egalernent disparu;
il a ete' rem place par
n~n
chaleur, fureur
(du tres rare
eM' e.
en chaleur, cf.
r,~~ (comp. §
Remarques Futur Futur ~~. ~'.'.
particulierea, La finale du pluriel fern. est toujours f}lnd (§ 29 d). On a souvent la graphie defective t;;.", la division
1).
m t;;
T ••
?~
);"I1'V
(l) rendez-vous,
asscmblee (cf. e~tjtd
T •• T ••
?f~);
n'llV
T"
sommei'" (cf. sentd ?~);
/"IV':t science; I1vr* s~eur.
Cette forme est celle de l'inf. du type sib mars avec la finale feminine
#s craindront ,(avec meteg indiquant opp. ~~~ ,#r-'u «ils k Irnperatifs verront
»,
syllabique
-.
p. ex. qN."
li-r~'u';
a cote de l"l";
pur substantif,
':'..
/"IV':! a cote de l"lV~. L'inf. f1.:ltt; est employe comme
T" ......
I'~,
p. ex. lid
+ dh
+ t > l"l?~
(§ a 3),
= 111~' On a 1117
§ 14 c
p. ex. 1 R 10, 19 sieg~ (du trone de Salomon).
forts:
N;; crains ;
i'~ verse
(du
tres irregulier
i'~:
§ 76. Verbes
I, Paradigme
qui est traite aussi comme 'll'''~ § 77 b). Au sing.masc. 'lTf1(cL§48d).' Du verbe inusite surtout on a sou vent le 11T
paragogique,
p. ex. M.:lt;;,
T:
'H~
primitifs
("He).
9: ::110" etre bon).
:1.=,:* donner,
au sing. la forme
I'-?' (3) (rnais
I'hebreu n'a que I'imperatif, On trouve devant N, Gn 29, 21
Les verbes avec I" radicale , prirnitif ne sont qu'au qal et au hifil, Dans le paradigme Qal. 2 Futur */zj)ab
nombre de
n:li1,
TT
sept. Tous sont statifs (2) (futur en a). On ne trouve d'exernples qu'au on a cite .:lro' * dont le parfait n'existe pas (§ d). dans toutes les formes. (cornp.
(I)
C'est ainsi qu'en allemand
beftihigt peut prendre un sens voisin de comrne
/dhig c capable» Ftihigkeit.
; d,e, me me on a Beft'ihigung au sens de « c~pacite»
Le , primitif se maintient
> .:l~':
t;;j': § 75 b), avec la 1· et la 6
que dans
(!) En l~eo-hebreu, en ararneen juif, en syriaque, beaucoup de participes causatifs passifs sont employes comme de purs adjectifs, sans aucune nuance causative, expliqul). p. ex. neo-heb.
voyelle du futur statif (~ 41 e). A l'egard du ton on remarquera
"'~:l9 clair,
evident (originairement
rendu clair,
.:lfb'~, le ton ne re-
monte pas (cf. § 75 d).
(1)
(3) On attendrait
:'I?~ ". La vocalisation plus forte de cet imperatif vient
~ 105 e; par analogie
Opp. :'I";i?, fern. de ,~ temoin (rae. "P) § 80 s; 97 E b.
p.·e. de ce qu'il est aussi employe comme interjection on a aussi 1::'1, ,5:'1, mais milera",
T • T
(2) Est-ce pur hasard, ou bien a-t-on evite de former des verbes d'action avec la racine "t?
76c-e
Verbes
"!)
152
153
Verbes ,~
77 a-II
Hifil. Futur *iaj,ttb Parfait *haittb sa longueur. Participe Remarque. preformante, pour les rap porter
> :l'~'~.
(avec l'a primitif)
> :l'~'~.
Cette voyelle
? s'est
§ 77. Verbes Y"D (i).
(Sans paradigme) ..
propagee aux parfaits C'PO (§ 80 g) et :lQ~ (§ 82 d), mais en perdant
Dans six verbes "E) 'dont la 2· radicale est ~, le ~ apres voyelle est prolonge, dans ce, raines formes. La sifHante emphatique X ,par sa nature meme, est faciiement fut. prolongeable. L'allongementest ne dal1s les. formes ou se trouvait une voyelle longue devant of, p. ex. au qal
* mait'lb
> :l'~'~.
Cette voyelle ? s'est sa longueur.
propagee
aux
participes C'P~ et :lQ~, mais en perdant p. ex. :l'~~,
Dans Ie verbe i/re bon, les formes sans , apres la :1'~~, de soi, appartiennent au verbe :1;~; ecrites avec
*i491 > j,iH9t;
au hofal futur
la racine :110' il faudrait done
supposer une graphie
hofal
e).
* j,Uof9< i'UH9<; de >
meme au parfait
of
Il y a done eu rnetathese de quantite : la longueur a passe
of
defective. En fait, les formes du hifil sont generalement , apres la preformante : elle appartiennent Les 7 verbes
•• 1" -
de la voyelle au
ca).
De ces formes l'allongement. du
s'est proet meme
a la
'"
racine :1~' (§ d 4). f. j,alba.su .; encore dans
"E) primitifs:
•
a 1a
page aux autres Les 6 verbes
formes, p. ex. au mfal l"I~~, au hifil ~'~
forme nominale
:OW.
T -
1) r;:1', f. r;:1" Inf. r;:l' (1 f.) et
e.
sec (cf. ar. j,abisa .;.;;., seulement
;~?).
n?5~
Hifil ,,, ."
~"E).
N. B. Les formes attestees sont peu, nom- b la racine n'est pas absolument
nr;5,
(1 f.; ce type
breuses. Pour deux verbes l"I~ et J~ I) l"I~ s!a/lumer. pourrait etre l"I~). 2) )~ placer. pourrait ~tre )~). Qal f.
§ 75 i): Le hifil a ~n~rmalement tf pour
2) p~!* (cf. syr. j,ineq ~
i:
r;'~ii1 dessecher (i).
certaine : pour un verbe la racine :l~' est secondaire. La racine n'est pas absolument certaine : elle
,akk. ene~u), f.
p~'~ suceriteter,
P'~'tIdonner a
3)
~!,
teter, allaiter. f. ~~ e. droit (cf. ar. [asira ;.;.,
n~;
nif. pf. l"I~~ (§ 85 b); hif. l"I'~ij n'est pas absolument hofal f. J~.
,n'~.
La racine
certaine.; elle
f. j,aj,saru ~.).
4) :110'* e. bon. Le parfait n'existe pas: ceserait :1~!* ou :1io!*. II est supplee par le parfait :1ilO, ~:1ie (§ 80 q). Futur :l~'~. ' Hifil : :1'10'1'1,:1'10"; moins sou vent :1'~i1, :1'10' (§ c). ... 5)' fP'* s'eueiller, Le p~~fait ~'~xiste pas; ce serait fP.!* (ef. ar. iaqiza.
Hifil )'~i1, J'~;
3) :1~, seulement au hitpael :l~~1} se placer. La veritable racine est :1~) qui a un nifal :1~~, un hifil:1'~'} et un hofal :l~~ . Comme ces formes sont semblables hitpael :1~~1} 4) ~, 5)
celles d'une racine :l~',
on "a cree un norninale
f:..Aj).
II est supplee par le parfait ~ifil f'PO (rae.
r'P)
qui 1 f.
e).
etendre. Hifil f. Qal f.
est prob' un pseudo-hifil (cf 54 f). Futur fP'~ (rar! f'P!),
rR'~Gn 9,24.
6) 7)
fP'~'
!"~;
hofal f. 11~.
Forme
t'W (1 f.) couche,
T -
L'action causative eveiller
est exprirnee
par "VO ("11).
P¥~verser.
p-~;
hifil f. p'~.
n· y
a aussi des formes
ft3'*
'fft*
Hifil ""1'1 gemir,' Hifil r'~;o"ailer avec les formes ~~:
fut. anormal nominales.
"'?~~2). (
Le
t
avec ~ non prolonge, ainsi toutes les formes du hofal p~i1, Au qal il y a des formes anormales, telles que 6)
~ droite (denominatif 'de
i'~!ote droit). c
,;r;'~
P~~(s)
<
P¥~, p~t3.
1 R 22, 35. < e ,~ ( ).
Comparaison plaine,
tient comme dans les formes verbales, p. ex. :11O't3 .. meiileure part,
f9'~ sud,
Ie sec, la ./, ore ferme;
primitif se main-
'¥~ former,
Qal f. ~~:
forme anormale ,~,~,
Remarque.
Le verbe N~: n'est pas traite comme un X"E) , § 75g.
(I) Dans ce symbole commode Ie
(2)
:It represente
la seconde radicale.
Cf. Cf.
BROCKELMANN, BAUER,
1, p. 601. I, p. 601;
BAUER,
(3) Cf.
Ii)
1, p. 218, 379. Comparer 11'~}etc., § 80 p.
La me me forme Iti'~\n est hifil metaplastique (§ 80 q). P.-e. pour
du verbe tt'\:lI auoir honie
(4)
BROCKELMANN,
et signifie (comme Ie qal) avoir honk
(2)
(S) (6) L'i est long; opposer ,~,..- de "'
~'~'1!~ qu'on
a, de fait, 1 f. Is 52,5.
,:It'.. it _
sera ttroit (rae.
,,:It i 82
"f. f. apocope
h).
1, p. 379. qal de
n7~' ~ 79 i. Rapprocher
78a-c
Verbes IC"'
154
155
Verbes IC"'
78c -If
s 78.
IParadigme
Verbes
10:
~.
le peehe, N~~i1 serendre impur, Nr;,el"li1se montrer etonnant (?). Com me
T • T: •
K~9 trouver).
I
dans le verbe fort, le type en -::- prend a en pause, p. ex- NW~t;l: devient N;"~l"l' Nb 23, 24.
hT :•
A la conjugaison la gutturaJe
des verbes N"' s'applique de une syllabe les voyelles
dit),
ce qui a ete dit sur l'alef n'est plus par ~ ouverte
T :
Remarques L'N,
11" .
generales support de voyelle, p. ex. suffixe, par exemcas de-
N § 24. Dans la flexion et prend
ces verbes primitivement
sans etre prononce, est souvent
prononce ; en consequence, devient ouverte (sans allongement Qal. en --::-. Parfait statif:
fermee
i1N~O (§. 24 c). Ainsi en est-il generalement devant pie
(moyennes)
de syllabe
,~~¥~:, 9~~t?:.
La seule occasion ou N soit prononce N~~ creani, est dans certains Ez 28, 13 (inf. nifal N'J~;:t i. cree), ereateur), C?~~~ Lev 18, 28 (inf est serni-fermee acci- e
proprement
Au parfait, d'action:
outre la forme active, il y a une forme stative la forme primitive ,n syllabe N7~ i. plein' ouverte. Parfait
"masa" avec deux a brefs (i bref devient p.ex. lieu
vant les suffixes 9, C?, p. ex. 9~~r:t 9~~~ Is 4::1, 1 (partie. (cf. §24 b).
devient N¥~ trouuer avec deux ti moyens, la forme primitive
"7
piel N~~ souiller). Dans ces cas, en effet, la syllabe Le fait que N n'est pas dentelles : 1) que Nest
* mali'
devient (i).
normalement Futur. futur p.-e. d'action
en syllabe
ouverte)
Le futur statif est en a, comme toujours, est egalement en a, p. ex. N¥~: (au du futur *iiglai, d'ou provienti1?~:,
~?~:. e L
de ~~:*),
prononce a comrne consequences les verbes
T "0°
parfois omis dans l'ecriture ; 2) que les verbes
N", sont assez souvent traites comme correctement
c.
l'analogie
§ 79 e.
1) N omis dans l'ecriture, Exemples: comme 2) Les i1"', Formes verb~~ ayant
.o'
mWr-I'
.-
1'1"',:
Ruth 1,14 (ecrit comme les retente
La forme pl. fern, en i1~N _:_, qu'on a au' qal et dans les conjugaisons derivees, est i1~"lr-l. L'imperatif
'f .:: •
v. 9); ':IN 1 R 21,29 (ecrit correct' N':lN dans le merne v.). N"' sont
assez
a l'analo~ie
des verbes i1"" p. ex. du futur: ~.
i1t~t?t:'
souvent
~r~ites
verbes a la voyelle
{J :
soit phonetiquement, la vocalisation
soit graphiquement
j'}:
Mais l'infinitif est en
N~t?, la
§ 49 e.
forme
'~7etant
des. 1'1"': p. ex. '~N~f j'ai
T •
devenue comme
.Ps 119, 101 ; N~in ptchant Ecc12, 26 etc. ; N';!O il a rempli Jer 51, 3'a; 'l'1~e, j'ai
• ••
la forme propre
c Nifal:
T T : •
de l'infinitif,
N~O~ . Dans la flexion, au lieu des formes attendues
.. .':.
"\, * Z:N¥~~
gueri
2 R 2, 21 ; i1l"lN'E:I~ (patah anormal;
T : : •
comp. la forme 6,
pau~le
i1(1'?'~~ 79 d) elle Jut §
grande
2 S 1, 26 (Mel. Be/routh
etc., on a l"lN~O~ etc., avec un --::- qui provient
T •• :.
des"'verbes .1'1'" ~ par
p. 177) ; N,E:li1 it a Jait grand T; • Formes ayant la graphie rirai i1~~ Jer~, 22; I'E:I' gueris
T :
Dt 28, 59 .: i1 des verbes i1u,:
•• T
p. ex. i1S'N je gueT : ...
exemp1e l"l'Sl~. Piel: N~~ (2). Dans la flexion on a naturellem-ent
par.exem-
pie l"lN:ltO. Hilil: N'~Oi1 . Dans la flexion on a, p. ex. l"lN¥~r:t avec --::-' corn me
T • : • T. ' _
Ps 60, 4; i1:lni1 se eacher 1 R 22, 25; t" aux I'"': l'influence p. ex. l"lO~' et quand tu
• T :
remplira Job 8,21. entierernent 1 S 6, 10;
T
Formes ils retinrent Gn 23,6;
semblables
SOliS
dans les autres Hitpael.
conjugaisons Comme
derivees,'
et non pas '--:-. dans N~r:tt;lr:t s'enleuer
auras soif Ruth
2, 9 (p.-e.
dans le verbe fort (§ 53 b) 'outre le type ordi-
,~p,,~ m'as . .. tu
:
de l"l'l'1tehqui suit); ~,~
• T :
retenu 25; 33; I".:I~ il retiendra -: : 2 R 2, 22. a reellernent posterieure.
naire en -::-' on a le type rare en a (ici -;-)
~E:I'~' et ils furent
1"-
gueris
II est difficile de dire si telle de ces formes anormales existe ou si elle est due
une megraphie
(1) Autres verbes statifs : ~: NOlO
"T
craindre f.
ar;'~(en merne
.
terrips 1"1)§ 75 h),
pichi.
e.
impur, Nitt' hair, KO~ auoir soif : (2) Ex. : K~~·· 1'empli;: N.~~ e. jaloux,
N~1psouiller,
~n enlever te
(i).Parfois,
inversement,
les :-t.~ sont traites cornme les N·~.
I;
79 I.
78.4 -
Verbes ~
156
157
Verbes ~
- Verbes
1'1'"
18h-796
Remarques Le eohortatif Le partieipe
sur certaines (i!tt~t:!N,
T : : ...
formes. est evite (§ 114 b N). info 1'1N'Da ro~e de l'1Nit";: .•• : •• T
Les autres renee, sort.
formes nominales
se rattachent
I""~"IT ' P • ex • I_I .Jlt~ occur..... 1 I'"
r
Sur la forme du parfait
inverti cf. ~ 43 b ; du futur inve~ti § 46 b. n~t:!J)
T : : •
Le verbe N~~ porter etc. est en merne temps
rD: fut. N~:;
Tt
imper,
fern. sg. est generaP du type l'1N~b (pour l'1N~b*);
plus rar' on a le type l'1N~b (comp. •• : I
§ I, et
avec on a
(apheretique) N~. L'inf.. est rar ' (4 f.) Nit'~ (§ 72 h); ord Oil a la forme apheretique. La forme primitive * sa~+ test devenue d'abord
par segolisation, l'1N~?; 1'1~~* qui est devenu nN~*, forme qu'on a dan~ sans " on a la forme 1'1~~, avec la voyelle
le type ,tt:ll § 88 C t). Au pl., au lieu de c'~b :., on a rar' c~b .. : . M quiescent. Au partie. souvent i
."
la fin cornme
pI. m. du nifal, au lieu du type normal C'tt~t:!l
• T :
le type C'N~t:!J ; p. ex. on a presque toujours .: :.
C'N~t:!J et C'H:llJ '): . .:. au lieu de la Imper. ~,~
• T
p. ex. dans Ie subst. ,~~ Pits cote de l'1N¥b § k) (I).
§ '88 C i (comparer
le type l'1~~b .:r
(ef. § 96 C b). Au hifil, voyelle
I'imper., on
au jussif et au futur inverti, a, rar',
1
§ 79. Verbes n-',.
(Paradigme
11 : 1"1'1
TT
normale •
long. Exemples:
Jer Les verbes
dicouvrir). parce qu'ils sont actuellement a
V);N:l:;lI')Ps .-
17,18 et N':l:in Is 43,8 (tous deux devant V);' N':l~' Neh S, 2 (dev, 105,43 (dev.V):Nronl'1,lR 16,2;21,22 (dev. N); . -: ,-"T-
n"" sont ainsi appeles
N¥i~J Dt 4, 20; 2 I<. 11, 12 (dev. N); N~T;1~J2 R 6,29 (dev. N). Dans ces cas, la voyelle 1 (qui du reste est suspecte mater lectionis ') pourrait non-gutturale s'expliquer plus longue devant la gutturale quand il n'y a pas de aussi 1 devant une paralleles Dans ces par le desir d'avoir une voyelle Mais (ecrit
011
ecrits avec un n final (quiescent) au parfait 3" p. sg. m.: n"~; en e a li ,w ee sont des verbes a 3" radicalc v A eotc des verbes r Itt; il a existe autrefois en hebreu, ces verbes ete, ont ete comme en arabe, par les ,,,,,, quelques comme verbes
,n"; mais
,n"
TT
C).
trouve
absorbes
les verbes
'''D ont
: Is 36, 14 jussif N~
2 R 18,29; 2 Ch 32, 15); Nron', . -:,-cas 1'l, s'il est authentique, est difficile
j
N'1P~ dans les textes :2 R 21,11; N~~',- Ps 78, 16. .
a
.
certaines
formes, supplantes la forme
par 1es '''D (§ 75 a). Comme vestige
des verbes ~.." on trouve ,-compo
'r-l,,,i; Job
• :_ T
expliquer,
(.t? Iranqu%ue,
V"V ~§8~./)
Verbes
specialernent
Irreguliers,
aura it, par exemple, verbes formisee les .,"", verbes
'l}'''~;'(pour
nJ7W tranquil/itt) gdla~tz)
3 '>6' je stcts tr anqut 'Z'.e . T (2). Avec la contraction on
,..
e), forme qui a existe, ear
de liaison
elle a donne naissance
aux formes avec la voyelle
et '''1] (§ 80 i), p. ex.
La conjugaison des verbes comme on
nn"
'tl1.:ll?, '-!"Ii6'i?O'
J
.
des
est en hebreu 2) au qal, plus;
radicaiement uni- IJ par des la distinction
('). En effet : 1) les anciens vient de Ie dire; actifs et des verbes st~fs
verbes. ,"" on ete absorbes
n'apparait
3) dans les conju-
(I) Remarquer
les 3 infinitifs en -::-: Zl!, § 72 ij l'tlel § 75
s, flitit'.
Outre Ie verbe
I N~R appt:ier, crier, il y a un verbe II
"1i?
alier
(I) Dans la stele de Mesa', I. 5 on trouve le futur lJ~' u oPpril1;~~a d' rae. ,,~ (= m1') d'ou h ., • .' . une umble, ~ humtl#e. Au contraire, 1a racine m1' rifJondre est originairement ''P. TT
.. '
':¥
la rencontre de qui a sou vent 1a forme ,,~~,
A 1a forme N~~ se
rattache le subst. verbal
(I) Comparer
nNjj??
a la
rencontre de, au deuant de (§ 49 d)_
"7
(3) Le verbe ;,~~ lui-meme decouorir ; ~.viler, aller en exit est prob! un i imitif ......, f. i.ag~ ~ pnmttt ; cornp. ar. gala ~, 'riviler.
"(f) En "arabe l'uniformisation
Ie phenorneue
du hiatus § 33, et cf.
* 79 m.
n'est
pas grande;
en arameen
elle est
mediocre,
79b-d
Verbes M'~
158
159
verbes n~
79d-k
gaisons derivees, est celie du qal, en c types
a a
tous leg. temps (sauf l'inf. abs.), la voyelle finale savoir: tous les parfaits sont en
Remarque. de reconnaitre originairement Remarques.
Ala
3" pI. ~,~, la forme syncopee (a, i).
ne permet c'est
pas
i1--;-,
lcs futurs
la voyelle primitive
i1-:;-, les imperatifs en i1-::-, les info est. en l"Ii. Tous Yes participes (rnerne passifs, .sauf '~'3) sont en i1-, cornrne i1'~. v: ".'
l'
Futur .. La forme
i1?~:vient 'probablement
de iiglai:
done e
UI1e forme de verbe statif. La preuve se trouve dans
La 3" radieale
actuelle
, apparait:
1) dans le participe
passif
Ies formes rares telles que peut pas reconnaitre
2) Le
~"j"
T :.
,~,~; 2) dans certaines
formes rares, surtout en pause, telles que les
l'
~,S~ pour
T l'
l'usuel ~,~,
4,Sj'
T: •
pour l'usuel
4,j' .
• ..: '. T ' .. : •
1) Dans les formes la voyelle primitive.
syncopees
~'?:''?~17l' on
ne
Le , est latent dans les formes telles que 'l"I,Sjj (? pour aD, i1)',jr-l
i1-::-' provenant de ai est originairement
p. ex.
long;' mais il
(? pour a.O, ,~,~~ (1 pour 1/).
Le , tombe dans les formes
~
semble ~voir ete traite comme voyelle dans le cas du dagesh euphonique,
moyenne, car il devient bref
syncopees,
p. ex. ~,~ pour *gala,{u, p. Tex. ,j' de
;~-i1f~ § 18 i.
dans les verbes
assez
~'j' pour *l~{[la.{u; et dans
(= *iigla{). Le , est quiescent
les formes
apocopees,
i1,j'
v:•
3) Sur la voyelle de la preforrnante gutturale, cf. § 68 b.
4) Au jussif et au futur Imperatif. Inf. absolu: L'inf. inverti de I'indicatif (§ m), m:ais ordinairement
i1"' a 1·
la fin du mot
dans p. ex. *galai
if
devenu latent)
on a
sou vent la forme
gald, et ecrit i1?~. Comparer dans la flexion nominale les formes en
i1'~, cst. i11~; v:
T •• :
exemple
d
"Tf', 91~(et
•• T
~i1'~,
T· ': T
(avec'
Au lieu de f ouvert du futur, on a f ferrne :
i1'~ (§ 96 B f),
et les formes syncopees, par verbales avec suffixe
rapprocher
les formes
est. est
I"'~'
a
comme
la forme apocopee (§ 1).
I'analogie
de
,;ro~ (cf.
a
§ P).
i1,?~)· .f C .
l"I;'~, forme dont l'origine n'est pas ~Iaire. Peut-
~: 97~'97~:)·
Parfait.
etre la langue, considerant l'inf. abs. com me une sorte de nom abs., et l'inf. est. aura-t-elle Partic. Partie. associe une sorte de nom l'etat
I'etat
Conjugaison
qal.
cst. (§ 49 a),
Certaines formes proviennent des verbes actifs, les autre's provenant ramii). des ueroes- actifs: 3" sg. m.
des verbes statifs. 1) Formes ~~ jeter, prononce
l"I;'~ i i1";t, com me, p. ex. l"IJt;; a i1jt;; (cf. § P). actif. 1'7.~), c;t. I'?~, f. I'?~; pI. ~~~~, / 'l"I;'~(cf. § p). e
passif: ,~,~, avee , prononce (§ c); cf. § p. der ivees. D'une facon generale, eomme il a ete '-g
i1'~ pour
TT
*galai e); le , est quiescent, comme N dans N~9 (comp. ar. rama(D La 3" f. est forrnee forme rare
Conjugaisons
dit (§ b), dans les eonjugaisons derivees, (fern.
a tous
les temps (sauf it I'inf.
directernentde la 3" m. : *gala
+ t > l"I7~'
abs.) la voyelle finale est eelle du qaI. Ainsi le partie. nifal est
I"jj .
i1-,
T
C). Generalement on ajoute un second element ferninin d'ou i1l"1'~,qui est la forme pausale, d'ou la forme contextuelle
T n1'1'
i1?~~);comp, i17.~ (fern. i1?~, cf. §P). .". Alternanee des voyelles ?, 1 dans les conjugaisons derivees ca)· A
II faut distinguer les conjugaisons actives: piel, hifil, hitpael ; et pual, hofa!' Le nifal est traite comme les conjug.
i1I;l7~ (comp. i1?~~, i1?t?P.)'
La forme rare 3" pluriel ~) ,Formes
''I
~'S~.
TT •
'
les conjug. passives: passives.
prov.enant des verbes statifs : toutes les formes en
.>
T'1 ~)
l"I"~, par exemple l"I,53(comp, ar. radiia ::
etre content).
du statif ra4iia '.". --:)"
~'"
(I) En ilhale ~. semble
moins
= i~ moins
en hebreu *ga/e; l'a est p.-e. du
(I) On attendrait
oarfaits actifs ~~~ etc. Compo le substantif masc.
l"I1,o
a l'analogie
rasoir
= serf·
long que c i'aie ..
= if;
long que f. Comp., en francais : «j'ai .. «serai»
= sere
moins long que c serais s p.
XXXI)
des autres '
(t) De galii. D'apres (3)' Cf.
t~
qatil) selon
BARTH
(Nominalbildung,
0/
et d'autres.
de mqraJ. ~ 89 'h..
une autre explication de galai.
DRIVER,
' Samue/2; p. 183 (in 1523, 2).
(2) Cette forme en Z"I s'impose devant les suffixes.
Notes on the hebrew text
7911 - i
Verbes :1.1:0
160
161
Verbes ;,.l,
Dans les conjug. passives ~'~~1Gn 24, ~; de plus,
on a partout
? (Au nifal, une exception
seulement
t:
Hifil. devient
La forme deI'indicatif parfois est
l~ I" pI. on trouve
'l"~~
a
n'J',,'
~:-
,',
79i-1
par le retranchernent
1,514, 8; Ex 33,16). .: . Dans les conjug. actives la 1" pl. ~l'~; 3) touj,
~l'''tll
??~, qui
~~:, La
segolise 11.4
en
"a! (com me
qal). le
de 1'1-, ~
*11lalk en
'?~ ).
de
on. peu: toujours avoir t; en fait on a
Exemples:
ptd!1, ~;:J R ~
i- gutturale forme
'1'".'
(aussi qal), ~~ (de
n~~); '~~.1'
i plus souvent que ? On a i: 1) toujours devant suffixes; 2) touj.
,~~}, ..,Z?~}; avec
Nifal.
"l?~}(aussi
T •
la 2· sg. piel
.t;l'7~, r"~3; 4)
presque touj. est tres P '.'sg e .
de l'indicatif
a.la 2· pl. Clj' =::
AUx hifil et hitpael, et grande. notables: est tres frequent; tres freque:lt"(aU D'apres
n -,
.:
1"1?~~,par
retranchement
devient '3', Piel.
par exemple '~r-l Is 47,3.
la 1 p. sg. piel la variation 6 • . On peut faire les remarques suivantes : 1) au~ 1 ..
8
De merne
n':-J': devient ,J',
".' -:
ainsi au piel la forme ordinaire est 'l}'~~' Exceptions f.; ? 5 f.);
'n'~~ (~o
'l}'W (6 f. ; ? 2 f.);
2) aux 2. sg. i est
. sg.
piel il est constant,
comme on l'a ~it).
c:nry, ::l,:)'7;avec Ie gntt. '11,', rtl on a "j, ~,j.
......... < •
Imperatif : Hifil. La forme ",J",- par le retranchement de ..: .. devient *hagl, forme qui est toujours segolisee en 'JM, par exemple
-
-:
p. ex. ,~". - ;....
n -,
Dans les verbes
n'"
•
'.' ,.
en meme
temps
tout ceci Ia flexion du piel est: 2 sg . ord.);
'l}'~~ (forme
i
.t;l,~~,n'~~;
inverti
Piel.
La forme ,,~~, par le retranchement De meme au hitpael, devant On a suffixes on a
AT:
du
2 pl. Ctl'~~; 1 pI. ~),~~.
Au "f IUSSI
p. ex. '3, '~. ainsi qu'a Formes Parfait. par Ie retranchement petite;
,"nn
12):
n ~,
devient
'!'
k
2 S 13, 5. pause, cornme
merne
Formes I'imperatn Futur: de
aoocooees
et au futur
(Paradigme
on a souvent des rormes apocopees : Qal. La forme de l'indicatif devient d'abord
n _,
'?~: (forme
"?~:'
rare);
puis
??~ (forme
9?~forme
92~:'
'??~
(comrne
'??~P)
mais
assez
Futur: en pause Dans
'~5~: vientde
syncopee comrne iigle
+ ni
91~'
,~?~ en
en pause
d);
92~et
,?~.
(cet e a passe
rare). 'Ordiriairement a ,~
n, parfois 'i. Exemples:
"~" ::l1;.
I
on a ci~s formes segotisees: le plus sou~ent ~n
de liaison dans tous les autres verbes, les formes -:;-' d'apres
§ 61
.p~~1; ~~,
'?~1'
a
TI~; ::l~:, r:;~;
a
la
97~:forme
,"_
voyelle
syncopee,
'J~::r::l'"
2:.·~.
a cote
Vlj~
(a~ec 38 gutt.), V~~.
La forme ,~~ est tres rare
avec Ie ) energique
(~~r ex~;~ple ~':)~), mais ~ cot~ de de
~ilon a ::l1~1; a cclte de ,~~ on a '?'~1;avec 2" gutt.
1· gutturale on a ordinairement
r~~on
r~~l' i~~.1' ~~J; r
J~l~ avec
, ~, p. ex.
Au futur et Participe.
n~?:etc.
• ..'
on a p. ex.
~~y".n~M""
"0': • T/OoO :.
(cf § 61 f). tres rar', Ia igraphie abusive frudijierGn fa seduwnt 48, 4; Os
j:!~
T
l'imper,
on trouve,
'?,$.iJ frappe-moi
Exemples: 33,
1 R 20, 35, 37.
.
(2).
'~!1'r~~,iJ~l' "
Avec
une
--=--=-:
p. ex.
Ttt~~,
la faisant (Comparer
ler
9!~~ Ie fait qui 2 : ;:t,~~~ (avec' abusif)
formes sernblables
des hifi~; mais l'i se maintient
les formes norninales en generales.
n -:;-avec
2, ,16.
suffixes § 96 B f). tende
dans "I}~ rtT~, I (cornp. Ie r-l de § Dans les verbes iI'" en me me temps Le verbe
1ry
r-ll}?v?
=
ttl
70:11.
on a
Remarques
r~; ~.
~
Bien que la canjugaison des verbes iI""
a envahir
n~' a les
t
formes apocopees et it fit voir
N1~'~~1' ~'~J'mais
et it montra).
~,,, (§ 78
comme
g), on trouve,
par contre, certaines 16, 12;
formes de
n'"
celle des traitees Formes 6. 14
(aussi hifil, 2 R\Tl, 4
les N"",
ecrites avec ~:
~?t.7~.1 Ch 2
aVEC
soit graphiquement,
< 96 A s Dans (1) Opposer la forme nominale ":~? de s~r" . maintenu prob' sous I'influence -du '. - Opposer les formes de
*;.. ~
,ii
-r'''I)
l'i s'est (avec.
Formes
avec la vocalisation des
N'1P? (suivi de 'l}"1P~)2 5 1, ~"": ~)~~~Jl~r3, 22;iI';I:lr-l1 R iz,
T T T : •
soit phonetiquernent,
(p.-e. pour assonance
'Ort1). Formes entierernent sernblables aux 13, 15.
long)
§ 76 d, '"!~ ~ 77 b. (!): Rernarque ' )'aSY1netrie des formes d'un meme temps.
ri?'~
W·,,: Ni,'? 2 Cb 26, 15;
w~~~
bibl.
as
P. Jolio", Gramm. de l'hcbreu
l'Jm-p
Verbes n'~
162
16$
Verbes
1"1""
79;-s
Formesnon-apocopees etre considere: .comme fautif. Parfois la forme longue gutturale 16,25: f. n'v~' 19, 2 R 3,2; 18,32;
au futur inverti
et au jussif.
Le phe-
On a, rar'; la 3" rad. Hifil: (cf § 54 Parfait.
c);
!{
pour
l, p. ex. Wp Job 41, 25 (pour:
nomene est si frequent, surtout
la 1" p. sg., (') qu'il ne peut guere devant une On a 2
'dirtlf), l"li~~p' (ketib) 1 S 25, 18. A ctlte de la forme n,)n ainsi
semble avoir ete preferee
a
•
cf>te de nR~i!'
,,~p~; n?~,':1on
T :• :
on a assez souvent n,l' a n~ry, ni?~",
e), ou avec un accent disjonctiJ. On a 4 fois n~p,~1 1 R
13, 11; Ez 18, 19 (partout 2 Ch 26,6 devant gutt.). 1 R 16. 17; 18,42 (partout dey. gutt.). On a 3 f. n~~~1Jos (partout dey. gutt.). On a 3 fois n?p,~1 1 R 10,29 avec accent disjonctif. ~~ ler 28,6 (dev. gutt.);
On a -:_:-surtout quand la 2" voy. est --;- (suite vocalique {-p § 29 f), p. ex. toujours n,~~ (excepte 2 R 24, 14 n,,)j'h)
T •
mais l"l,,)n etc.; touT • : •
'50'~ R 1
jours ,'~'n,
mais l"l'N,n etc.; on a ')~'n
Inf. :~bs. La dans le verbe
T
1 R 22,35;
Jer 44,21 (dev. gutt.);
,,:1, e. nombreu:x,
T
io;m'~ordinaire
mais ')N,n;
i)N-1,', c~n.·
est .;;~~;~(com~.- ~~Ptt)~E'~cep;i~~: beaucoup, l'inf, abs. est n:b,n (3 f.),
T :-
Jussif: n~1~ Gn 1,9 (dev. gutt.);
"~P,~
parce que la forme n~:,'J s'est specialisee (propr' en .faisant Comparaison Formes '"' tranquille (comp. ,~ beaucollp~ (§ 102 e) avec les formes nn~
niM~ Gn. 41,34.
:-
Les formes longues sont particulierement On trouve
frequentes un certain Jos
Ii
e).
au sens adverbial beaucoup cf. § t. (cf. §
c).
1l
dans les livres des Rois. Formes anormales avec n - .. pour n -. .: nombre d'exemples
Sur la forme hitpa'lel de la racine nn0 dans lesquelles
nominales
e)
OU l'on a la voyelle --::-' comme en arameen
Jer 40, 16 (qere}; n~~m Jos9, 24. Dans 18, 7
et p.-e., en partie, sous l'influence de I'arameen, p. ex, n~p'~-n~ 7, 9; n~vf.'l-"~ 2 S 13,12; un groupe o L~
.. -'1-
'~1?~ a); §
Ie 1 apparait : nudite
m"TtJ tranqu illite , 1';!TtJ
(plus i-;e-quent que
n:1~);
':1TtJ
:de
de textes
du Levitique on a n~~~
'?~ humble, nJ?p. humilite; Formes et
l"liO~ couuer ture, (negation);
§ 88 M j.
lion; - vision,
la pause: 20,19.
(7 b n~~z:1); vv. 12,13,14,15
Ii_
a- (15 b n?~r:')' 16,17'; ~rn!9~
i1!~~ capiivite; ,'?~ neant
"
dans lesquelle~ le , apparatt : ,,~ et n"~ ji'Jr:t,
·~~t. ji'i~
d
dU
cohortatif Gn 1,26;
est inusite dans les verbes n""; Je veux Dt 32,20; Is 41,23. inverti
on ern-
*lzaz[a]ian (forme qataidn; avec ou sans syncope du 2 a: cf. § R8 Mb); l"l':J::l deuil, § 88 M' i . .: Formes dans lesquelles le » est latent: "'~ (a cote de champ, pour
ploie la for~e de I'indicatif, p. ex. n~:~) et voir Ex 3,3;
m 'auancer d'as-
2 R 14,8. On trouve seule-· pour une recherche cf. § 43 b.
ment 3 cohortatifs. er n --;-, probablement sonance: Ps. 77,4: 119,117; Pour la place du ton dans Ie parfait
(poet.}; n~R extremite extremite; n~); de
ri? fin
':1'
de rae.
r~p).
"'D
-
'I'
Formes dans lesquelles Ie , est tornbe : Formes syncopees : n1ir-l loi de ta1;fraiat (rae. 1;ft'i,cf. aram. ~l"l"i~); formes.
n¥i?
jim vision
Remarques On trouve
parficulieres
sur diverses
Qal: A I'inf. abs., , au lieu de r-r,3 on a parfois la graphie i"~ .
tres rar' la forme l"liC,3 22,.13; 42, 20; Hab 3, 13). (Is A l'i~f. cst., Au partie. fois en poesie, Is 41,23. Le partie. a'u lieu de l"li,,~T a parfois on
§ 88 M b; ji~ iniquite.
Formes apocopees : }'j cr;mp~~non (a TceMde
1"'I~p,~intention
Verbes
,~~ en ~a;;t (a co~e de n?P,9 montee); j}'~7
cause de (a cote
etc.); j~ parce que; ,~ negation poet .. 'z:!7~7 negaM!" eire et n!'J vivre.
actif n?i,
a cfM' du
;-r,~ou
i"~.
tion de l'inf.: cst., § 93 q. irreguliers Ces deux verbes de forme analogue, turale,
fern. syncope n7i on a quelque-
1"1!'?~,po
passif
ex'. n!!~ (toujours, 4f.); n!~f Lam 1,16; ni'l}~
'i'~
"v
et n"", sont traites
la fois verbes
1· gut-
peu pres de la meme maniere,
a la flexion reguliere
.f1!ic'~, b~q.,~,
ni~"~,
Ils presentent de nombreuses particularites : 1) La gutturale n'influe presque jamais sur la voy. de la pre-
(1) A la 1" p. sg. il y a grande variation, p. ex.
T ' • ••• T •
nrn. 20 f., M:)~ 15 f.;
4 •
l"I'1"I.n 9 f. '1'!.n 12 f.; 1'!it'lmI 2 f., ~~~ 5 f.; ~~ 5 f., ,~. 1 f.. ~:I.: :11' ... ",:°.°11' °11' ·1 (2) Comparer Ie phenomene du hiatus § 33, et comp. § 78 S. (3) Dans plusieurs cas les editions varient.
(1) On a parfois la forme de I'inf. est.
n'c,~::!comme
inf.: abs., § 123 q.
165
79s-t
Verbes ,."
8Oa-h
Verbes ,,,-f,
16(
formante, p. ex. /"I'M', ~~ (comp. 1"I'~1"I q)~::' §
T: "0'
(opp. 1"I~rr., M9~ § 68 b);
M~I~?;mais M:IJQ
(cf. § 81 a en pause
N);
.§ 80. Verbes ,'V.
(Paradigme 13:
2) Le , de ces deux '''11 est consonantique
3) Les formes apocopees ,~,
il
eli'
se lever) .•
n'est .quiescent que dans les formes apocopees ,,}~, 'M'.
'rr deviennent
"1,,: 'n'
du ,
Les verbes communernent appeles '''V (,ayin-waw) la racine. il y a une voyelle longue u, p. ex.qum
sont des verbes «se lever» (L).
{l
avec deux ·consonnes radicales, entre lesquelles, dans l'etat normal de La racine de ces verbes ne se presente pas dans un etat unique, mais dans un triple etat, et cela, semble-t-il, des l'origine (I). L'element
11., ~.
(comp. ';,;a, ';,;a pleurs). 4) Au lieu de qui suit, p. ex.
7,""
on a gener' --:;;- -probabl' ,
sous I'influence
~1J, Clj':1J, ni,!,:~.
prob' so us l'influence a le shewa quiescent; p. ex.
5) Les particules p;~fixee~'ont la voyelle du '; la gutturale On a: M'm,
•0:'0."
et (d'apres ces formes) Remarque.
ni';;9
n;',~(,n;'~~§ 103
intermediaire
entre les deux consonnes peut etre de la racine, l'element
u,
b,
Dans l'etat normal
intermediaire
est la
§ 103 d,
C~':17)'~'~~§ 104
'tt,
,
c. Exception:
voyelle longue u: *iaqum> *laqum
/"I'm avec - ... prob' so us l'influence de -::- • ":1'"
Au parfait qal du verbe vivre, on trouve rarement de la racine (24 f.) est
t:J!1p!
(indicatif). intermediaire est la voyeJle breve l'element
11.:
Dans l'etat reduit, l'element
(7 f.) la forme M'n; fa forme ordinaire TT Sur le meteg de 1"I'M', '1"1" etc. cf. ...: t' • :1t Verbe adorer La racine est pnrmnvernent ,gaison esthilpaclel exprime l'action
> cP:
(jussif). in-
Dans un 3" etat, qu'on peut appeler consonantique, terrnediaire sonantique
•••.
geminee iJajaj (comp. le parfait statif Cz:,)
C)·
14 c 4 .
•
S
1-:
est la consonne U" p. ex. C~i? t§ 11.). En hebreu, I'etat conest rare dans le verbe; mais ilest (pour frequent dans le nom"
1"I~:
forme
hitpa'Iel
mnr-le1"l se courber, se prosterner,
~:
g. ex. ,~V aveugle, L'etat
n,5
... T
mort,
ci'
* ia1J:m) iour
(§ s).
En effet 1a
'n~,
avec u· doit etre considere comme l'etat normal. peut remarquer que
done ,,,, (cf, § a). La conju-
it se trouve, au futur, dans fa forme de l'indicatif, qui est le futur normal, p. ex. CqP!. On
(§ 59 b) avec repetition de la
3 radicale. ~a [or,me
8
*jaqum
a
a
peu pres
intensive refiechie se courber, seprosterner. comrne .*g.da'lj est devenu *galaj>1"I7~. ~l. Le futur forme
, m~me. mesure que, Ie futur du verbe regulier *jaqtul;
Au parfait la forme primitive est hista!zllau. La finale est. devenue
ai.,
.d'ou 1"1-,
peu pres equivalente
la consonne t
+ u, L'etat
u a une quantite
avec uapparait maintenir
*jista!zuau
e~t devenu
* jistalzuaj > i110~~~ (3·
~'O~~:)·~a
aussi comme etat normal du fait que la langue tend liaison, p; ex. dans 1"I?'~~pt;l(§ b). Qal. L'explication peratif, Futur.
dans la mesure du possible, merne au prix d'une voyelle adventice de des formes se fait dans cet ordre: futur, im- b
apocopee- est *jista'!z1J:" puis Ie 'lj consonne devient la voyelle (breve
28
e) u:
~n~~~!.
Dans 2 R 5, 18
Recarque.
'~:1r.rz::~t:'I Tinf.
a ete vocalise
a l'ara-
infinitif, adjectif verbal, parfait. , II y a une forme active et une forme stative, avec dis-
meenne (fautivement,
du reste, ,c;ar av~c 'les suffixes on ernploie .l'inf, d. Biblisch-Aram:5, A,am'.',
en ut,. cf. STRAcK,.Gramm.
§ 8 n; DALMAN,Gram,"!,
d: jttdisch-'Paitlstiniscken
megarde ", faut lire-ra 1;,13' p.)
i79). Un scribe ayant ecrit par
tinction des deux voyelles (cf. § 41 e). Le futur actif est *laqum
(i)
ce groupe ~ut vocalise rnecaniquement
l'arameenne..
> C~P!' avec
I'll de I'etat
normal.
1ni'tI~~I! (2).
*eia _..J,;... .
9
2" radicale If consonantique,
(I)
En syriaque plusieurs formes du verbe
proviennent
d'une Fa·
eir-e g~tninee, p. ex. fut. nelflfe ~. ,·'afel 'alflfi ..:./. (2) Autre infinitif arameen § 80 n.
§ 177, Opposer les verbes avec comme Ml; e. large; 1I1~ ourir : m~, ~~ or-donner; m :i1P, il~,? attendre : iln abreuuer, <In, ~;;: , dans les.juels le , est traite comme une consonne forte. (2) Comparer Ie cas analogue des verbes 11'11 § 82 a.
NuLDEKE,
CL
Syrisrhe Grammatik2,
80b - d
Verbes ,',
166
167
Verbes est mo~enne
"]7
80d-g
Le futur statif est *iibiis. La seconde voyelle a des verbes statifs est longue, malement comme la voyelle u des actifs. La forme est devenue norpar
me en (j). La voyelle ~ formes symetriques
comme les voyelles ~, cependant l'analogie de
_:_ des
(2~; elles se maintiennent
au pl. cst.:
TDi:l~ avec q long
devenu
(venant
de ii) (').
'~p., 'D~'
Le participe tres rare (p. ex. Parfait. un sens intransitif. pasaif est
Le jussif ex. *jaqum, cet,?
a prirnitivement norrnalemenr en
la voyelle breve u (etat reduit), posttonique, p. ex.
O~P avec u a
'1-1!O~.II est-
O~: avec !7 moyen, Au fulur inverti
~~r.3 circoncis), laplupart
des verbes ,"1' (et '''1') ayant sans ') sont les adjecufs le verbeiregulier. lei encore Si le IT
devient p bref
position
pause la voyelle !7 se maintient: Au plur. fern. on a general' normal recours dans cette forme
~~!J *. "?'~~Pt;l.
0p.h;
mais
la
Les parfaits statifs
n~, ~~ (ecrit OJ?
Pour conserver l'u de l'etat la langue a eu des verbes .,,,,
verbaux
n~, TDi~ « conjugues
», cornme dans secondaire.
De
afformante
consonantique,
rneme le par(ait O~ est l'adjectif Verbal jectif verbal
une voyelle de liaison
{, laquelle provient
O~,
le parfait
Op. est
-c
« conjugue ». Com me I'adla voyelle etait long on
(§ 79
c). Autrement,
en cette position
{J:
(syll. fermee tonique), on doit cette forme I'etat normal par
-;;- est moyen'le. aurait
Avec un ii long on aura it Oip*, forme. qui a prob' dans le nifal
avoir la voyelle moyenne ex. Ez 16,55: normale deux fois
"?~PJ;l. Dans
pI. (sans
existe, car elle est contenue dans la flexion, p. ex.
OiP).
T
est sacrifie : on a l'etat reduit.
Cette forme se trouve quelquefois,
ljir.3p'* avec une voyelle de liaison, comme t;I~~
.
a vee voyelle
"?'?~~ pI. 2·
J~i&J;I 3·
n, ~ 44 d),
puis la forme
au nifal et au ihifil. Or on. a
breve,
comme
on a (
Irnperatif
(en ar. qum ~;
.,
(cf. '§ z}. La forme primitive est *qum avec voyelle breve imper. hifil
"J;I~
de l"1~. Nifal ~ Parfait
:0".
O;P~'
Lit preforinante
pnmiuve
*na se maintient
~;, ~qp ou
L'inf. L'inf. tl L'adjectif
(cf. pI.. f.
.,?~P). En
cst. absolu
comp.
CiA.,);
on attendrait
done O~* des formes du futuro
en syllabe
ouverte
fait l'u est allonge, p.-e.
a l'analogie
la voyelle de
ar. 'inqiim(a) Le futur un qal de Hifil: bref, de~icnt Parfait
rW~,
(§ 51 d). L'elernent est probablement p. ex,
Oip (de *qiim), qu'on a dans l'anci~nne forme du parfait qal. le parfait, parfait
I'u, en syllabe ouverte. est ordinairernent est
est normalement
long.
Oip~ semble
etre forme d'apres
Oip
avec
O~P (2) avec q a l'analogie
du qal des verbes
t"'£)
';!O~ .
t"'£) CS).
Au futur
'F£)?, ,e~,le
O;P?
l'analogie
ressemblant
a
g
verbal
est O~; il s'emploie
en fonction de participe. *mit, *bus devenus 1'1~ , des adjectifs verbaux qatil, i, u. 1\ l'analogie de >(omit, re-
la forme primitive
est *jaqtm
Dans les verbes statifs, les adjectifs verbaux
a passe dans le verbe fort:
t¥t~ (ecrit avec ,) ont ete crees
qatui, pondant en prenant
a l'analogi.e
PP'~-; futur
"~i'~ (§
> O'P!.
L't long Avec i on a Opt'!
inverti longue est
C~.
54 a). Au jussif, De meme
*jaqim,
a I'imperatif
la voyelle caracteristique qatal, (p. ex. du semitique,
(opp. O~~ avec voyelle La voyelle --::-(moyenne)
§ c).
du futur (de meme dans le verbe fort). 1'analogie de
*6us, .on a cree dans les verbes d'action
l'adjectif participe
O?':' sage).
conserve
une forme *qam
> Op.,
O~~lj. L'j provient
Cette forme a supplante p. ex. en arabe. en ara-
le veritable
(I)
(§ 76 c).
e).
a
a
:l'~'1:1 ou elle est longue
de
De merne le participe tt'1~.~ aurahonte est Ie seul exemple sur de futur statif: 'i!t.~ 2 5 il 2, 32 est plutot' un qal qu'un nlfal ; est un futur actif (§ r). (2) C'est d'apres l'infinitif construit qu'on .a coutume de designer les veroes '" et ~", p. ex. verbe ClIp, verbe r"'!. Cet usage est facheux. car l'infinitif (qui du reste est aussi nominal que verbal) ne presente pas toujours l'element caracteristique de la racine. Ainsi Ie verbe de la racine CI'i' a l'inf CI\i' (§ 81 b). il conviendrait de designer ces verbes par I'Imperatif par ex., verbe 01:")- verbe CI'~.
aI~:
Lehofal
O~~., a
a
O'j?~ est
long
l'analogie de
:l'!O'~
(cf § 50 f).
l'analogie
:l~~" (§ 75 a).
avec
jj
(t) Pi-e.
a-t-on un ancien participe dans
CI'I?I:!I Zach 10,5
venant de a.
(2) Compo § 28 e 2.
(3) (t)
Merrie explication pour les verbes "P, ~ 82 C. Dans Ie verbe ~IIC Ie hirit ~'lO~ est semblable a ~~~'~ hifil de ~~', sauf pour la quantite de la voyelle f (cf ~ 76 c).
80h - k
Verbes
,.»
dans comme en arameen. ernpruntes semblent 9,21
168
1611
Verbes ,.,
80 k
It
A la conjugaison Ps 119, 61; exernples, C~i? etablir, ailleurs statuer
intensive on a
(aram,
on a ~ consonantique au lieu de'?f
'~l?enlace".
Les
(adj. verbal) du partieipe
toN" cache Jug
T -c_
4,21; -
U;N,_Pauzwe 2 5 12, 1,4.
l'
Cet N
est p.-e. dG.a
I'ararneen ; mais Dans C'~N~
dans le parfait CNR 05 Ez 28, 24, 26, ni~N~ de ~'U; mepriser; isolee
assez rares et posterieurs, C~~) Esth
a
4,7;
I'arameen : Ps 1 is.
10, 14 (~ 7 b) ii est inexplicable 16,57 les vocalisateurs Au futur Gn 6,3 mais il faut prob' vocaliser
etc., Ruth
ont sans doute vu des participes
• -: I
28, 106; :l~1}reudre debiteur
Dn I, 10
e).
est
C'toNtO de toNU; attaquer, harceler .
Mais la forme usuelle de l'intensif (un mouranti ; C~;, Neve1'. Passif: euoir honte, '~iV~1} s'exciter, i Voyelle
1'1 long
Pi?~/, iei proprem'
P9lel
acheuer
on a la voyelle o,n
q pour
tire emu,
it dans
la forme
ri,;
(§ 59 a), p. ex. C~ip releuer : ntlit3 donner Ie coup de mort,
c~i' e.
?,
t.
Dans le vetbe
avoir compassion,
on n'ala
Neve. Reflechi : ~!Jl1I' au futur qal (~ b), conserver en cette po~:
voyelle it que dans Jer 21, 7 01~t6 deux au sens indicatif). Partout une defense (ou p.-e. le sens Dt 7, 16; 13,9; indicatif Ez 5,
et Is 13, 18 C~'p. 01n{1-N" (tons
T
ailleurs on. trouve o;nn a pu suggerer 9,10
N", soit dans
() du jussif):
de liaison.
Au futur hifil, comme de liaison on
T:
la voyelle
on a all pl. fern. la voyelle caracteristique sition (syllabe Au parfait, conserver futur, verbes p. ex. on a egalement
afin de pouvoir a~oir la voyelle
de la forme:
M~'~'i?f:l' Autrement.
doit
•• T
fermee' tonique),
.
M~~i?~,
t.~; 7,4,9;
Gn27, atone
19,13,21;
25, 12, soit merne avec un sens purement 8,18;
(t). est etrange ou fautif;
Le jussif:~~! Le~ "
31, au lieu de Cr>
forme qu'on a dans Job 20,10
m:li;l=I.
nifal et hifil, afin de pouvoii
de merne U;t?i:'~tug 6, 18;
dans les coniugaisons une voyelle de liaison, des verbes " eomme longue M~,
la voyelle longue dans les formes
a afformaute
est iei
brei
•
'I?! Pr
9, 4, 16. '(Compo Cp~~ ~ 47 d).
•
du fu'tui- inverti devient
-=-
de~antgutturale
et du
eonsonantique parfait des Cl)~t31P?' devient Job 31,
qui
9. Comme I'? di
p. ex.n~n,
eet ~ provient
savoir de l'ancien
hifil § n); meurer partout il.lut
,~!~ assiegea et it
generalement
V~~ (');
'~1 et
il se retira (forme identique
(cf § 23 b). Mais on a
'?:1 de I
S.
a celle
3· radieale
'z:!'IS~"(§
79 a): p. ex. 20.25
'z:!~'pq,
Ii l'etraJ;LTer et de II ,~ redouter, On trouve 4 fois dans un contexte epuise (autre suspect) Jug 4,21; dans
KONIG,
~h (mais
'~;J de-
Au hifil, la voyelle 21) (cf. § m). Com parer j Ton. importance, qu'aupartie. quefois
est parfois sacrifiee et la forme (mais
1 5 14,28,31; Wcrterbuch,
2 5 21, v. 9'V).
'f:l?~ij (comp, 'f:l?~i?'!):l!I~~ij Ex
la voyelle
,z:!i!),?O a
15; on adrnet A la
que la forme visee est ordinaire est CR~~'
9~~Jour 9~'~!t p e
explication
de liaison dans les verbes
V"V § 82.f.
cause de
SOil
1· p. la forme on trouve
sans :materlectionis
D'une
facon generale
a le ton, p. ex.
'~~Pl!l'~~.
la syllabe
radicale,
(S
47 d).
Au parfait on a Mt?~ (tandis ~t3~ (opp. ~'~). On a. quel-
9 pour it dans 'V(I~ Mi 4, i3 (pourquoi P). A l'inf. est. on a quelquefois 9 pour it: toit3.p Ps38, 17; 46, 3 (ell
A I'imperatif liaison); ni)!J Nb 11,25;
:
fern. on a M~~) et general' ex. Is 28, 7 ~~ (apres on peut avoir
Jos 3, 13 (enliaison),mais mais Ct3;':l~
T:
~6R' p.
des formes du type ~,,~); spe-
PU:p
[5
7,2
•
(en liaison) avec nVt3);
¥
~m?(toujours,
Ez 10, 17
m)"
T
2521,10; (p.-e. :lr;
4 f.); riV? Is 30,2 pour euphonic}:
cialement Au parfait
devant une gutturale inverti
V ou N, p. ex. Ps 131, 1 (hiatus ~ 33).
Au parfait L'imper, Remarques Qal.
inverti
on a regulierement sur diverses
n~m,16m, ~~m,~~m, '
gutturale
assonance Jos 2,16
(p.-e.
(en liaison). l'inf. cst. en ~ est normal dans le verbe statif (dent (§ q).
futur a pu supplanter
'~it3'~Q~'
Par contre, Ie futur est en
M~qp devient M~qp devant de detail
(§ 33).
sons , CN;?, p. ex. participe
cf. SMEND, Die
i? venant de
il):
:lito: ~.'ll
conjugai
(I) A cote de OIM il.a peut-etre existe une racine COM repoudant it l'arabe
Au lieu de C~ on a, rar", la graphie
!Jassa ..;:...;... enti,', etc., dontIe s
futur serait
on~*. Ce
parfois Ie futur OIM~ de O'IM. On a
(I) Plusieurs exernples dans Ben Sira:
on~dans
Ps 72 13 it aura compassion (Ia
8,6; 30,12,23;
vocalisation avec () est probablement
due it l'ecriture defective).
Weiskeit des Jes?,s Sir-ad
(1906), p. XLIV.
(2) Opp. '~~a:! 2 R 23, 18, (§ 47 aN).
801-n
Verbes '"
170
171
Verbes '7
80n-p
Nifal: principal
Oll
Parfait~
L'?" de oip? devient
quand it est prive du ton mais
Avec
"toe
le ton remonte, p. ex. :J~~-"~
1 R 2, 20 (§ 47 aN).
secondaire;
on a l1~iP?' Ct1;~m,
'~;O~i'~ (l:\
+.
29 b) ~0~••
Ala 1· p. la forme ordinaire est Cp~~. sans mater lectionis (l:\47 <I); on trouve aussi, par exernple :J'~~~ Neh 2. 20, et plus rarement, p. ex .
IT
p. ex. 'f1~~O)j' ai recul« Is 50, 5. ..... : Le participe
11l
1i:J?* a le pluriel C':J~~ Ex 14, 3 L'z long tend 3. s'abreger en ,3. savoir:
{?
Jos 14, 7. cst., on a la forme arameenne dans 11~?OIs 30,28 on trouve I'~~C! (cf. Dn 5,,20 (cf. § 88 L b) (i).
0,
Hifil:
Parfait.
(moyen), en po-
A l'infinitif 117!Os'enorgueiltir) Contamination onto
sition antepretonique, dans le parfait inverti;
3. la 2" p. pl., avec certains suffixes,
mais il n'y a pas de loi stricte.
Comme info abs.
i'?;:t
Ez 7, 14 (si texte c~rrect).
A la 2· P: pl, m., on trouve 5 formes avec .i et 2 formes avec
{?,
des ,"1' par les 1'''1'. Ces deux classes de verbes
p. ex. Ct1;""~~ (2 f.), Ct1;:J~~ (2 f.); ;f1b81~ Ps 89, 44; ~b8q~ Ex
l'etat normal de la racine, quelque chose de commun, d'un element.
a savoir
sont sou-
26,30;
30,1
t mais
<:
Dt 27,2
t.
mais to~jours
•
(22 f.) '~i~'8~'l;
-:1-
~~~qJDt
t mais
4.39;
la longueur
Dans les '''11 il y a voyelle iongue, dans la 2", parfois la I" dans
toujours (10 f.) 'f1~'0;";
I'
j-
fib,;"
T
1"' -:1-
Nb 31, 28
toujours
les 1'''1' il y a consonne longue (generalement les formes aramaisantes
(4 f.) 'f1;""£);" . On remarquera . t' -: et la 2" p. (cas d'asyrnetrie). Voyelle
la difference de traitement entre la Ie le --::-, ne se maintient
§ 82 h). Les formes
l'etat
reduit
vent sernblables : p. ex. qal: fut. jussif Cp~ et fut. :Jb~; hifil: f. jussif Cp'~ et fut. ::ll;;)~; hofal CPi" et :JI:?~I'. A cause de ces multiples ressemblances, les deux classes de verbes se contaminent Exemples de contamination C" mutuellement. de verbes ,"1' par les 11"1': t~ Zach 4, 10 p. ex. i~;'.: Ez 10, 17. (Pour la C'est probablemenra l'existence bien redoublee, l'in- p de qu'on (nifal par ex. ;:J'01' 1 R 13, 20, 23, 26
du 11. En pusition antepretonique parfois en -,
pas; il s'abrege
+:
.~i~'t;fl' Ps
85, 4; mais le pl~~ souvent on a' .. . ' p. ex. ryo'!C!, '~6'!C!, ~ on a t~ujours -:::-' par' exempie .
'~6'PQ'
.n~01"
'1'
A la 38 place avant le ton (cf. supra). avec le ~ tnterrogatif, j'ai suscit« Is 41" 25;
(pour 9); ~~P? Ez 6, 9 (pour ~roP?) e); toutes les forme-s du nifal de semblent venir d'une racine C~', Formes nombreuses trouve parf., partic.; avec formes
I"
r -:,-
J?~P irai-jer
Devant gutturale le -:::- s'allonge en =: (comparer les formes comme
contamination
des 1'''1' par les '''1' cf. § 82 0). radicale redoublee. aramaisantes des 1'''1' qu'est due
'~'M'PPj'ai
sont'~i"~:,=,
§ 102 n). Les seuls exemples adjurt Dt 4, 26; 8, 19; 30, 19; Jer 11, 7; 42, 19;
fluence des formes
~'I1~"'Ptt 5, 4
13 (Cf. merne phenomene
de '''1' avec I" radicale dans les ,"1' mente
dans les verbes 1'''1', § 82 n). Formes sans voyeUe de liaison la < forme est normalement (cf. § 1). Sans voyelle de liaison, --:-, ,p. ex.
ce redoublement
certains temps
hifil parf., irnper.) ou .il n'existe pas dans ies 11"1'. On
~~?r.t2
-c
'z:1~~r.tavec
cf.
'~7~mer J
T •• -: 1-
16, 13;.
peut done ici aussi appeler ces formes aramaisautes, bien qu'elles ne le scient qu'indirectement. Le groupe Ie plus important de ces formes se trouve au hifil gnifie: deux hifil, qui ont des sens differents. 1) deposer q<.; 2) procurer redoublement,
(I) Autre
Ch 29, 19 (ici par haplologie pour 11l?;n'~*,
pour ~))':J11 1 Ch 29, 16), 11l=1011
(haplologie
-c
BROCKELMANN·i'.
... • -:
265). L'9 peut ~,~-
I" rad. redoublee
faiblir en i en perdant le ton (§ 29 g). .p. ex. Cl=1~I1.I"f.!~;" etc., mais 11l=1~m 'l=1~m(i). I l" : . - I" :
T -
du verbe ryt) se reposer . Dans ce verbe il existe Le I" hifil, regulier.
lJ'~tt si-
Eutur. turale et ,.
Le -:;- b:ef du futur inverti Ci?~ devient -:- devant p. ex. nt'll
gut-
du repos
a (").
Le 2
hifiI, avec
'Q~ et it retira,
itoigna,
celle du qal § k (cf. 23 b); apres gutturale:
(I)
'~:1.
forme identique 3.-
r:t'~I}signifie : 1) me/Ire, placer (com me jD?, dont il a
infinitif ararneen ~ 7') t. d'un qal de
1'!~~;::r eile
(2) Job 10, 1 :'1~R~ a I'apparence a excite 1 R 21. 25 est vocalise par meprise en 2" p,; vopar la tendance des Naqdanim
I't
lequel serait forme sur
un nifal de 11'11!Ci2~*, :'1~~~*) ani aurait supplante ( du digout, akkad. IUllfdtu
c:
le nifal normal !CI~~ de !C,~
FRIED.
caliser :'1~~::r . Cette faute peut s'expliquer donner aux groupes consonantiques
auoir horreur, Un qal !Ci2~ a pu reellernent exister : cornp. aram. juif !C~~ auoir auoir horreur
» (cf. DELlTZSCH ilt
la vocalisation
la plus obvie.
h. I.).
80p-r
Verbes 1"»
172
la plupart des senst ; 2)' Iaisser la; 3) laisser inf.l}'~tt; part.
qn tranquille, le laisser
173
. Verbesl"
80r-s
/aire. Formes du 2d hifil : parf. I}'~;:t; f. I}'~~.,n~~;mper, n~I'J, ~M'~tt; i
stative bii'a turale verbes
r::t'~~ (avec
1° voyelle du futur : opp-.
r::t,~~). Au
part.
;4 a
serait Nb'· (comp. U;~~ pour jibiis); le fntur en u des verbes le mais de l'u d'action,
3)
.en arabe
Ie verbe la gut-
et cela malgre
il n'y a pas de voyelle de liaison, p. ex. 'f.'In~i1 (opp. 'rlin'Ji1). . :- . . ,.-: mi'1, m~.
~ T ~
Hofal:
qui suit. Done dans ~~ statifs,
_:_ ne vient pas de l'a primitif des d'actionqui, en pour une raison et info cst. ont
des verbes
Le verbe rl'O ..({)u rl'O?) ment
a au hifil des
formes avec
redoublerl'l?! :
ccM des formes norm ales : rl'l:?iJ ou rl',?t:'l inciter, exciter; avec
particuliere, ne s'est pas' ici allonge egaJement _:_: N:ll, Nil.
u e).
Imper.
ou rl'~'; rl'~~. ..Le verbe :I~O au hifil n'a que des formes
Pour les formes du parfait inverti cf. § 43 b, du futur inverti § 47 b. Voyelle de liaison .. Au futur qal on a, tres la forme ordinaire
T T
redoublement l'allonDans
rarement,
i'1~'Ni:lf.'l;
T ',' : T ',' • :
)''?~reculer
gement
qc., )'~~;
hofal
:l1:?t':.
verbes la sifflante .a pu favoriser la forme est p.-e. due
est i1~l6r-!. Au futur hifil on trouve
seul' i1l,N':lf.'l. moins
Dans ces deux derniers comme dans M'bi1 la differenciation mettra, ptacera. Au nifal ment (qui de
Au parfait' hifilles formes avec voyelle de liaison sont beaucoup nombreuses que les autres,
les verbes 3t'''£l (§ 77 a) p. ex. :I'¥;:t, ~~.
la difference
du
sens. Au futur I}'~~ la forme a pu etre favorisee par l'analogue
tz::t~ il
formes rliN':li1, . . ,. .-: . -: ne se trouvent que devant suffixes. Voyelle du i1 (cf §m). En 'position antepretonique Ie ~ se maintient dans les formes sans suffixe, p. ex. r,N::lI"n; dans les formes avec suffixe, a la 3" p. sg. il s'abrege en -, leurs en ~, p. ex. ~Jr,N:lI" m1k':li1. ... ,
-: T •• • . T"
'niw::lI'
par ex. cniN':li1-, I fois, CrlN:li1 10 f.; les ... I' ... ..-,
r' :
on trouve la forme Ciji'~ (pour CiP?) avec le redoublep.-e. du futur Ciji':) dans 'i~J (avec I" gutturale). verbe statif en il fut Ce type circoncis; de nifal le
provient
p. ex. '~N':li'1; partout ,- ....,
ail-
-r
I· -:
cpo ";1'~ Zach 2, 17 s'bJeiller s'est developpe q verbe verbal Verbes en neo-hebreu, statifs. qui Comme du
Sur les formes anormales N':l~' cf. § 78 i. . rOn trouve I'inf. N':l; avec avec
de I'imperatif syncope
N'~~ et du futur inverti
p. ex. ~'=I~ il fut juge. on a seulement stative qu'a ..l'adjectif
.
n~~ mourir,
~ T
reste n'a la forme
39,7;
2Ch31,10.
Comparaison Formes avec ,: sans '.
..
du " (cf. § 5.:1 b) dans Jer (cf. §§ a-b). *ia?fm) jour;
•••
et au parfait rl~. Au fntur on a la . forme des verbes ...
d'action
les formes
nominales
(cf. § 41 b)
n~~',d'ou
imper, -et info est.
-
n~~.Sur
i1f.'16i1etc., cf. § I.
T _ •• T
'~l!aueugle,
T
rlJ~ mort, Ci'(pour
Com me verbes Inf.~:ll
statifs en _:_ on a:
nij~ et i1mj~ (§ 29 b) repos ; M,~1'f.'l attestation (de "1','
T:
avoir honte,
f. t&!:l~(pour libiis). A cf>te il existe un hifil metaplastique Inf. ,iN* nifal) : adjectif partient r car: etait
du
pf. ~:ll (pour bus), adjectif verbal ~:ll, hifil regulier
0'~j causer de la honte
Formes nuage. temuin, f.
Comme
Cj?:
'! etranger,
p
attester). :l~
i1';t. prostitute,
e)
~'~ii1 auoir honte (comrne Ie qal) sem•• T
Comme rl~: ,~.etranger,
blable au hili! ~':l;i'1 il dessech a de ~:l'
e.
§ 76 d.
f. ,iN:' (qal plutot que Le futur :l~'~ ap- •
."v. temoin,
i~migre,
(adj.)
droit, ,~ lampe,
'v.
temoignage (3t
iumineu:x,
briller, pf. ,iN;
Mots du type quI § 88 Bf: :l~t!:!Ie bien, ,~~ rocher.
verbal ,iN. :lie' (§ 76 d). des verbes d'action; s'il
(l) Voir Ie detail dans Biblica, 1, 357-9. , exernple
Inf. :lit!:! e. bon, pf. :lit!:!(et seul' 3" pI. ~ro)
la racine apparentee irregulier
Verbe
N:ll, Ni:ll entrer.iuenir, C'est un verbe d'action,
(2) Etat cst. ~~ plutot que ~~ (cf. K6NIG, 2, p. 75) Pas d'autre du type OR a I'etat est, (3) Opp.
iT~
1) Ie parfait
est N~. avec la voyelle
statif on aurait N~* (comp. N?t?) ou N:ll*; 2), Ie futur est a des verbes d'action§
~!
rendez-oous,
assemblie de
~! ~ 75 m,
97 E b.
(15 f. Ni:l~), avec 1° voyelle
41 e; la forme
81 a-b
Verbes "P
174
'
175
Verbes'"
81 b
§ 81. Verbes '''V (Paradigme 14: l~ jtiger).
a Ce qui a ete dit pour l'explication des verbes YV vaut pour les '''V, verbes avec deux consonnes radicales, entre lesquelles, dans moins l'etat normal de laracine, il v a une voyelle longue 1., p. ex. din « juger» Les verbes ,uV sont beaucoup on enenumere comme tent generalement
passer la nuit (6 f.; 1 f. Le participe L'adjectif passif verbal,
r'? dans
Gn 24, 23 ~
r"t? ~l7'p.-e.
(1 f.).
pour eviter
une seconde suite -vocalique d-u);
.se reiouir
est tres rare: C'~ ('), CR);
C~tt? (? cf. 2 S 13, 32).
est comme dans
les verbes YV, p. ex. Le parfait normal les YV (§ 80 e).
C)·
r~(comme
f~ est
avec valeur de participe, sur le type
passant la nuit, Neh 13, 21 (cornp. les adj.
'T. orgueiileux;
n~ on
trouve r~ r~insolent).
nombreux que les verbes '''17 ; qui ont une tendance
forme de l'adjectif verbal, comme dans
une quinzaine En realite il y en a plus que ne l'anmetles lexicographes,
,nv
donner
Le nifal est comme dans les YV (~ 80 f), p. ex. ~,~, Le hifil est comme dans les YV (§ 80 g), p. ex. r'~/j. Remarque. apparent considere
ri~~.
des racines pour lesquelles il y a doute ou merne ignola racine de p. ex.
rance complete, faute d'indices suffisants. Les indices suffisants manquent pour determiner
r~presser,
e. droit
Dans ces verbes le hifil est parfois secondaire ou
"~/j e.changer;
(pseudo-hifil
§ 54 j'), p. ex.
9'?/j agiter, n'~/j inciter, x!',,!I'j crier. D'apres l'analogie de l'arabe la rae. de ''='l mesurer serait plutot '="l. Mais la comparaison des langues
T •
qal), Le futur qal, p. ex.
M'P!,
N'p:::t
vomir (avec Ie sens du un parfait M'j?/j. d
ayant l'apparence d'un hifil, de ce futar (§ 76 d), C,~~, ~,!/j. Ie sens compr endre la forme ordi-
n'est pas toujours concluarue : ainst, pour syr. .o~ ont ~. tandis que l'arabe
et
l'hebreu
P'~ et
comme un hifil on a forme secondairement irregulier l'apparence
Ie et
Autres exemples probables: Verbe
¢aq
Jw,
a /. Dans certains cas
f'~. Pour
r'piJ
la racine '''V et la racine '''V semblent avoir coexiste, p. ex. ~,
tth-T fouler, m,
prement en
naire et ancienne est r'~/j; done 16 futur
11" souffler (2). C'est surtout dans les formes proqu'apparait la racine. Ainsi (cf. § 80 cN), orgueill~ux l'infinitif anormal
f'~!ayant
f'~: est
un hifi!. Cette forme
d'un qal, d'apres ce futur on a cree secondaicomprendre \.dont les exernples sont tres rares). encore plus secondaire
verb ales du futur et de l'irnperatif
rement un parfait
ff
il faut statuer les racines C'tt? (3), f''=', tt?'tt? malgre
Outre ce parfait qal II y en a un autre (seulernent 2 fois: Dn 9,2; d' apres Ie parf.
f'~
u (§ b) C~tt? mettre, r~'='passer
quelque
la nuit, tr-ltt? se rejouir
10, 1). C'est une ferrne hybride creee comme lui: Dn 9, 2 '~)'~ (cf. Job 33, 13
ou malgre (cf, adj.
b
forme isolee et p.·e. fautive. 11 faut tres proba-
blement statuer la racine
*tE.n; jussif t1! avec l'etat reduit *di~. Ces formes sont semblables au hifil soit' des '''V, soit des YV. L'irnperatif f'~ a, anormal', la voy. longue (comme C~p !§ 80 c).
Qal: Futur: l'etat normal
fi,'T. =
P" e. uide, ~" e. indigent, "t e.
f'~j,et flechie
ni~"),
T h •
zaid+9n).
r'1! avec
Le hifil distinction, parfaits
f'~,
outre le sens caorprendre (originairernent faire une a le sens faire
distinguer)
secondaires
ff'
deux sens, en reservant Les formes Remarques Parfait. . Futur.
r'~est
comprendre.
La creation des les
n~
L'infinitif cst. a generalement la voyelle du futur, p. ex. f'~' . placer. Dans 3 verbes l'inf. est en U (4): C~tt? mettre (35 f.); r''='
(I) Opposer
r'~jle
p.-e. due au desir de distinguer sens faire formes. comprendre (!).
r~i~, i~~,}sont com me dans les '"V § 80 h. p
sur quelques (La plupart des particulae
les verbes
avec.!. consonantique
~'K (pf.
part. ~~. ennemi); 1i:.~ (?) e. fatigue; * (2) Du reste les deux consonnes
i1;~et i1;~~ 79 s.
vocaliques ~ et
,~?~Ex
23, 22 ; Ie
rites ou anomalies se trouvent aussi dans les '"V). Dans Zach 5, 4 Jussif:
-
i
9
etant analogues,
abrege en.--:;- (comp. '='ac: n~~-'='ac
',0"
n?~ a cote
'''T',''1
mS
pour de
"." T
n~?~ 37 d).
m'='
TT
il a nesigah : l~ T
s'est
passage de I' une it I 'autre est facile: ainsi it l'intensif des "P,
au lieu du type
z
p. ex. C~,
mais
-
,~f.I,
-'1-
devant n Jug. 5, 1; avec
CI~~ on
a plutot
CI'i?
(§ 80 h).
(3) En syriaque, ce verbe a la 2° radicale
(4) Probablement Biblica, 1, 370
pf. F'.f· JWD-" sous "influence de quelque forme nominale en u; cf.
i:
Ex 23, 1; Ctt?r.,-'='M 1 S 9, 20 (§ 47 aN).
-
(I)
CI''P
cornme infinitif passif, ~ 58 C.
(2) Cf. Biblica., 1, p_ 356-7.
8~ e - 82 a
Verbes ,., - Verbes ,.,
176
177
Verbes ,.,
82a -b
Inf. absolu.
Au lieu de la forme propre en ij, p. ex. ~., Jug 11,25.
la· mesure liaison, L'etat
du possible, meme au prix d'une
voyelle
adventice
de
on a l'infinitif est. en fonction d'inf. abs. Pr 23, 1 pour l'assonance
~''!~ Jer ~'!
50, 34;
j'~t;I j;~
p. ex. dans normal
l/;~I?, n?'~t?t;1 (§ f)·
se trouve generalement toutes les fois qu'il est
(cornp. § 51 b et cf. § 123 q). les formes nominales. proces, "~ (antique;
Comparaison Formes avec':
avec
n~'~inteliigence,
relle (rae. qatalii1l
r~jugement,
chantre;
phonetiquement
possible,
savoir quand une voyelle suit, p. ex. d-ans
~'! dispute,
imper. ~!lb, futuro i!lb:; pf. statif 3· p. f. et pl. au pf. actif, 3' p. f. et pl. on a l'etat dissocie
§ 88 Be.
n~~, i~~. Exception: n~~c(1), i~~, prob'
T -: IT -: IT
Formes sans' : ,~
comrne
j"); j;~ joie (sas
+ afformante
OJ?,
'f. orgueilleux,
f?
insolent; qatal);
j;'~quede
merne
pour distinguer des verbes statifs. A la 3" p. sg. m. on a I'etat dissocie ~~
·T
les adjectifs verbaux
n imitent
*iin;' cette forme imite
dans les actifs, mais l' eiat reduit Or-! (de *tamima
-
devenu *tamma;
cf. § 88 B g N) dans les statifs. L'etat reduit se trouve quand une voyelle ne suit pas, p. ex.
ji't orgueit, ji'lt7 insolence (cf. § 88 M b).
~>
~b. La consonne, bien qu'actuellernent breve, a une certaine tendance
a
§ 82. Verbes 1'#1'.
(Paradigme 15:
la longueur
(redoublement).
sv: se trouve
L'etat dissocie cl'utilite, sont des verbes avec Ie parfait Qal: les participes ~~b,
guere que par raison de necessite ou pour former est
b
::l~9 entourers.
Ainsi la repetition
•• T
de la consonne est necessaire
' T
-IlL
Les verbes racine (p. ex.
1'''1'
e)
~i~C, I'inf. abs.~.;~C ; elle est utile pour distinguer I'etat dissocie
ou verbes gernines
actif ~~C du pf. statif Or-!. Autrement, Parfait.
deux consonnes radicales, dont la seconde, dans I'etat normal de la
assez rare (§ k). Generalement les verbes d'action ont I'etat dissocie
l'irnper.
pI. ~!lb), est longue. (Com parer la definition
analogue des verbes ,"1' § 80 a et '''V § 81 a). La racine -de ces verbes ne se preserite pas dan; un etat unique, mais dans un triple etat, et cela, semble-t-il, Dans l'etat normal dans l'etat .L'etat de cette appeler dissocie des l'origine e): La 2" consonne de la racine de la racine, la 2· consonne est longue: s-bb; peut peut etre longue, breve, repetee. redu'it elle est breve: s-b ; .dans un 3" etat, qu'on (3), elle est re{>etee: sob-b. En effet cette consonne longue est caracteristique
~~9(de
*sabab[aJ) et les verbes statifs l'etat reduit O~ (de *tamim[aJ); La distinction des verbes actifs et des verbes statifs apparait
exceptions § k. Futur. 110n seulement dans la 2" voyelle mais encore dans la 1· (cf.§ 41 e):
~b~ e), "j?~ (3). .cr.
po,:
il brisera
et
V':I~ il
Avec le waw inversif on a
~-
~9!J, mais
A~
"f?l (rnilera":
sera mauvais). comp,
0~'~J),
,~~, et il fut etroit, En pause ~b"l . L'Imperatif
du type s-bb,' avec 2· consonne longue, doit etre considere
~b a la voyelle du futur.
a gencralement l'etat reduit ~, parfois I'etat dissocie classes de verbes (cf. § I). ~,
comme I'etat normal. -caracteristique
classe de verbes, comme p. ex.la de la forme intensive
"~i? L'etat
2" con sonne longue est
du type
s-bb
apparait
~!lt? (§ k).
L'inf, ~i~C.
T
L'inf.
est,
La voyelle p, comme dans les autres abs. a I'etat dissocie ~;~;
aussi com me normal du fait que la langue tend
(1) Le symbole ,.,
(§ -l9 c), a envahi les verbes statifs, p. ex, of:!, On,~.,
Ie maintenir dans
de merne les par ticipes
veut dire que la 2. radicale est repetee, ~ 40
C.
(!) Comparer Ie cas analogue des verbes- ,., § 80 a. (3) Dissocie : ce terme metaphorique .aussi, mais moins clairement: indique que la consonne longue (cf. (1) Le .~, au lieu du -;-,
BARTH,
a cause
de la repetition de Lacons onne, ~ 9 d.
norntale bb semble dissociee en deux e1e~ents' separes !f-b. On pourraitdire etat dilate ou itendu. Rapprocher la dissociation .d'une consonne longue en ararneen , p. ex; *iidda'
> '1~: saura. il
e
P.
(2) Un exemple probable de futur actif 41 a). D'apres (3) Avec Ie redoublement
lOtiON,
a ,.
voyelle i est p. ex.
"~I.
H~il
couurira .
jL y en aurait d'autres,
aramaisant *i.iqal devient "~~:p.
ex. ~
Gramm. de I'hebreu bibl.
'1','2 b -- d
Verbes l"l'
17l'i
179 A l'Imperatif, Remarque. tendance
Verbes P'II
82 d
-)z
L'a dj. verbal
Oll
se trouve
~O).
dans~'
1 S 14.19:
:z
S 1:'>.12; MQ*
Mry* 1 S 2, 4; jer 46, 5. Nifal: Parfait La preform ante primitive qal des verbes
"na se maintient
I'inf.
est. et
l'inf.
abs.
on a ~Oit .
On voit /que. dans
i:
les verbes 1'''1',
..
cause
de la la
c
ell
de la consonne
finale au redoublement,
,j
on n'a
jamais a).
syllabe ouverte
(§ 51 a). Le futur ~~: semble etre forme d'apres
du reJ (p. ex. semblable
Ie parfait, parfait militude,
~I?? etant
qui
l'analogie
un qal de reJ
e J.
~~? *,
voyelle longue Le hofal la ,forme Nfl, flechi : ~~ir-lO,', Vo¥el1e I'etat normal
~~:),
le
~O~it a it long ici proprement de liaison.
l'analogie
de ~~~i'1 (§
75
A cause de cette sinifal cornme O~~ fut. O~' gram-
A la conjugaison
intensive,
on a, soit la forme qittfl
~~I? ,soit
la langue ont
a ete jusqu'a l'apparence
creer des parfaits
pf' f': ~~io (§ 59 a). Passif': ~~io. Re-I
se fondre,
d'un qal statif de reJ; d'ou certains
(semblable
a ~~~)
avec la voyelle a du statif (,2); cf. etre, aussi nifal, d'apres
§ m. Le futur
la meme
Aux futurs et aux parfaits, afin de conserver
en 9 ~~: serait, forme O~?,
d
ou pourrait (f. it7j?~)·
de la racine dans les formes
afformante consonantique,
mairiens ; cf. § h et m N. Au participe
on a naturellement
de
'P.?
on a une voyelle de liaison (de me me dans les ,."1' § 80 b, :i). Au futur on a la voyelle it)'::IOr-l, it)'::IOr-l. v•:
T ',':: T -c " <
Inf. est, ~tl?I}' O~I} (~ Hifil: Avec waw Parfait. Futur inversif Le ~
l'analogie
'~R;:t ).
i (bref) devenu
?, laquelle
provient des verbes i'1'" (§ 79 c): des anciens verbes
~£?~, avec la voyelle
primitive
Au parfait ''''
.
on a la voyelle
7 -
9, qui provient
~O~'. v
T-
du futur a passe au parfait ~£?tt:
"ry~ il
a com-
(cf. § 19 a). p. ex. Mi~o. Parfois l'etat normal de la racine est sacrifie, et il n'y a pas de, cf, § j. Ton, Dans les formes avec voyelle de liaison, cette voyelle a le g
mence, ,eJit il a rompu (en pause ,eJi'1 § 32 c). Mais on a general' .. .. ,,- .. dans les verbes statifs: P:ttt ca)· '~iJ, '¥O, 'i?tt, ~~tt ('). La voyelle --::- du i'1 est probablement est lui-rneme
=:
voyelle de liaison; ton, p. ex.
l'analogie
C'P::t, lequel
g).
l'analogie
de
~'rp'~ (ou
Ie
?, de ai, est long, § 80
C'j?O serait done symetrique a celIe du participe ~£?~ (avec Ie voyelle ~ malgre le futur ~I?~, § 50 f) qui est a l'analogie
La formation de de
Mi~o. sauf bien entendu, avec affixe lourd, p. ex. Ctli::ll?' Au parfait inv~rti on a ordinairement ~i::lQ1' '~i::l1?1' .
Autrement, en penultierne, la syllabe aigue a generalement . normales ~,
T'
le ton,
c'i?~,
lequel est lui-merne
p. ex.: fut. ~::Ib~; pf. i'1?~, ~'='R(mais souvent~'='i?)' Ie ton peut descendre, A l'imperatif, T
Au parfait inverti telles que '::Ib, Ulb et avec voyelle
T • '.
l'analogie
de ~'~'~
(5).
p. ex. it~".
T -:
(I) Meme explication pour les verbes "11,
80 f
all lieu des formes normal, p. ex. toujours
(2) Les formes ~~~, ~?~ peuvent etre aussi des futurs qal ararnaisants (~h, ; c'est dapres
(3)
on a parfois des formes milera' (sans raison apparente), au lieu du ';
Ie sens quon
peut juger si telle forme est lin qal ou un nifa l,
(3 f '\, 3 f. ,~, mais 2 f. ,~,. de la syllabe aigue devient hebraiques a'aulres est de la 2' p. ex. en du verbe ces
A cote du verbe statif': pf.
i''':!,
fut. non atteste
i''':!~*, il
y a un verbe
Remarque. normalernent Formes
8
La voyelle tonique, f. aramarsantes. radicale aramaisantes, conserve, qu'elles neb/J{JzI~
{J
actif: pi. non atteste i'i?1*' fut. i"!' - (4) La presence de cet a au hifil des verbes statifs peut s'expliquer ainsi. Pour I'adjectif (servant aussi d'adjectif verbal) on a la voyelle rz. p. ex.
i, u en perdant
Ie ton: ~::I~~,it.?'~I?~; ~::I6~, i'1?'~~r-l. Outre les formes proprement est longue dans tantot sont (redoublee), lesquelles supprime. norm ales menu la il existe
1'':1, ''?,
etc. Cette merne
II.
ou la 2 consonne formes, consonne ararneen appelees esttantot parce biblique redoublee.
forme est egalement celle du parfait statif. Enfin au futur statif, on a encore
'i?~-' L'a
du hifil serait du
I'analogie de ces formes en
l" consonne
Ainsi, on aura dit '1;1~ it a rendu amer -e I'analogie de "1;1 amer , it est amer , et de ,~~ il sera amer (cf. Bibtica, favorise par la consonne suivante.
(5) On dit generalement
Dans les formes
aramaisantes,
Ie redoublement en ararneen,
1, p. 354). Dans certains cas l'a a pu etre
Ces formes sont dites
aramaisantes
que Ie
r'
est
l'analogie du ~ de
'Il?P~.
Mais
alors au nifal
011
devrait avoir
~~~*a
I'analogie de
''?~?
PP,),
p~~dIe
brisera
Dn 2, 40 (Hafel (verbe
ell syriaque
if pillera
bzz). En hebreu
181
Verbes Autres futurs qal enp:
JI'JI
82k
-It
82 k
Verbes "." dues aI'influence deI'arameen par l'analogie
1-80
C':r se taire (mais C'3~ e. aneanti est un
formes sont probablement cas elles ont pu etre formes ararnaisantes
; dans certains Les
favorisees
des verbes re.
nifal); ~~. maudire, ,~: s'incliner, Autres futurs qal en a: e. faible ; probablement
'':I:
n~
se courber:. i
se trou vent aux futurs qal, hifil, hofal; p. ex. qal acheu«, jini, qui semblent
Exemples de hifil (et hofal): mencer on a'~ p.-e. lire Ie piel ,~~);, Ex 13. 18; -, l'l~:
Futur:
A cote de I'usuel ,~comE'z 39, 7 (rnais hofal
:11:>'. (' ),~~';
. hifil :lr:>', i~',- ~~6'. .. : .. Exemples (2). Dans le verbe statif C13 e. parfait,
:
violer Nb' 30, 3, 'I}~ je profanerai
ecraser Dt 1, 44; Nb 14, 45;
consume il y a un futur en a C13:, et un futur en ce verbe on a 'partout le redoublement douteuse). A la 3e seulement i~z:l\. :. Le verbe :1;0 presente sens actif transitif ~tourer, se retourner, -semble se detourner,
ci=l:
(ou passif du qal) l'l:!l' Is 24, 12 etc.; hofal (ou passif du qal) nifal 'I}~ *
bien synonymes. Le verbe etant statif, Ie futur en a est normal. Dans ararnaisant (sauf Ps 19, 14, forme 1 fois pl. on a 5 fois ~~~: avec le 2d redoublement,
9~;e.
.:l~~ forme frequente , p. ex. couvert. Ez 'l, 24; 22, 16; .25, 3; Parfois il n'y a pas J Exemples: Qal: ~j~~
En dehors du futur qal .et hifil on trouve quelques formes aramaisantes, p. ex. parfait
e. pro/ane
des difficultes speciales, Le qal :1:10 a un d'ou simplement passer Ii, aller, venir. II de fait, Ie nifal est assez rare
"11}~ bruIt Ps 69,4; 1~2, 4. e. Formes sans voyelle de liaison de voyelle de liaison; grace
(d. § f).
faire Ie tour, et un sens reflechi se ~o~rner,
I'etat normal de,la Jer44,
T • -:
racine, qui etait maintenu
a la
voyelle de liaison, devient etat reduit.
des lors qu'un nifal est inutile;
(pour ~jibr:_1)Nb 17,28;
T : -..
18 (forme sernblable
T :-
~j~~); Hifil: On a encore n~l?j
T • IT
et semble secondaire. Dans tous les exemples du nifal on pourrait avoir le qal, et merne on I'attendrait Gn 19,4; le pi. Jug 19,22 dans les cas ou le sens est entourer (opp. 20, 5
z:l,r,n Jug 16, 10 (pour l'li~l'ln); r-,"1en, 2 S 15,34.
I"~ :
-c
l'etat
1" T
reduit
_T :
dans d'autres
cas, p. ex. Qal:
1"1"
nt!lj
~~b;);Jos
7, 9. Le futur :1~: se
n-r~ ); nS:1j Gn 11, 7 (pour n~~);
:1"
~~r' 11, 6 (p~u~
:,1"
~~t, ).Nifal:
l'
1 S 14, 36 (pour
retourner, se detourner (employe seulement dans Ez, qui emploie aussi
Ez 41, 7 (pour n~6j ).
T T
~?)
est un nifal. Le
futur frequent
:1ID:, qui s'emploie seuun qal (evident seulement le futur ~: dans au
Etat
dissocie
et etat non-dissocie
lement au sells reflechi, est originairement
sens actif transitif (sauf Jer 41, 14, ou faut;f), facilement,
A I'inf
cst. (§ b),
C).
cote de la forme normale :lb (cornp. futur
1 S 22, 18, apres :1b). Comme le futur :1b' s'ernploie
aura pu
:lb~) on a parfois, surtout avec " I'etat dissocie :1!l9 (comme ,top), p. ex : 1 f. :b Dt 2,3, 1 f. :1~0' . Nb 21, 4; ,;,~, : . jer 47, 4; rr~ : .
1 S 25,2, 12, 13) ,,~
T T
a une
•
certaine epoque, etre senti comme un nifal et amener :10j; comp., dans un contexte
T
rrj, Gn
: •
31,19,
mais r~' 38, 13; toujours(ls
T T:
10,6;
Ez 38, I'etat
la creation d'un parfait correspondant
T
,~"
mais (ibid.) r~ r!l" (assonance). d~s verbes
IT -: IT
semblable, :ll;)' Nb 36, 7 et :10j J er 6, i2;
Au parfait epouvante (homme).
,.
qal
T -:
d'action
on a generalement
e. desole (terre
Ez 12,19;
Le verbe statifC;;
* (fern. n~p'~)
e. stupejie,
dissocie : :1:lO, n:1:1o·, ~:1:10. Avecles
• -
suffixes on prefere parfois l'etat
• l' :
etc.) a un futur normal C~
*, qui est rare (Gn 47, 19;
normal, plus court, p. ex. 'j~ilO (4 f.; 'jb:1t> 8 f.). A cote du regulier ~jif~ Dt 3, 7 on a l 'etat dissocie ~~rb 2,35. _ :-1' Au parfait ,~, de n~R' qal des verbes d'etat on a generalement statif CW· les types
19,7; cf. 6, 6). Le' futur CW: est un qal; c'est p.-e. d'apres -,
:l!!,~ sont
ce futur considere com me un nifal qu'on a cree le parfait nifal C~j* (sans futur) qui a le sens du qal.
il)
~'lr138,
~~R;mais
T
il y a des exceptions, p. ex.
~'71 19, 6 a cote Is
011
14; Job 28, 4. Dans le verbe
a toujours il traitera
Les futurs qal aramaisants des types ~~,
semhlables au nif;l,
§ c: De plus, ces formes sont semblables au qal des I'El: ~b.l. ~~;. (t) Taus les exemples sont reunis dans KAUTZSCH, sog enannte« aramaiDie sierenden Formen der Verba JI'JI im Hebraischen, dans les Orientalische Studien
~~~~, -: IT
1~~~. .....
Le futur qal statif avec I'etat dissocie
rm~Am
r
5.15
TH. N6LDEKE gewidmet (1906), t. 2, pp. 771-780). KAUTZSCHattenue les eon-' a elusions de cette etude dans la derniere (28") edition de sa Grammaire, ~ 67 g.
(I) Camp. en froJ 'acquerrai e t anciennement j'acquirer~i
(Corneille.
82k-
Verbes ".,
182
183
Verbes
l)"
8~m-p
gracieusement
est pour
r~*
au
rl}~'" C'est .
r~ry, jn!.
verbe, lequel signifie originairement qn gracieusement Au hifil
partie, O'~~~ a arnene
e. gracieux.
(cf.
la seule forme stative de ce Le sens frequent trailer
BROCKELMANN
nation des '''1'), p. ex. Eccl 12,6 (fut,
ri'~ 29, 7 pour Ez
*
(i).
~6?Am
3, 11 (fut. tillt:1 Is 24,3
avec i);
r'~
tirrN). De plus, d'apres les futurs les parfaits
la transitivite
2. 286)
pillz:1 Is 24, 3, pi'.: Pr II, 15; 13, 20, on peut restituer
correspondants Dans du de
et les formes de verbe d'action
011
trouve avec I'etat dissocie : inf.
c~tV,} Mich 6, 13;
Ez 3, 15; toutes les formes du verbe sur diverses
l , 6 ils
p'"
p. ex.
~j'h'},
"n~p:Jr, t'!?
Lev 21,9 Ie
20;
elle se pro.fane, on aurait
{?
un cas unique'
de futur nifal avec 2" voyelle
{?
f'~~~ faire
I
resonner, Remarques de detail en
(7:
Qal: Parfaits au passif
~'rIs
conjugaisons.
Oil!
"tO~;:'1);
.• tT
'tO~:(comme
.... .. T
Cet
{?
(si authentique)
{?
de l'inf. est.,
',,1}, O~i} est a l'analogie
serait
a l'analogie
de
du qal; prohablement
~::l~':mais ~1l' Gn 49, 23 ils ant tire (?) est );
de penser info
est.
a ussi
~W,
efe presses est un passif ils
Oil!
'n~' Ez 22,
Hifil.
mais I' {? est ici tres suspect, car ailleurs on a la voyelle a:
"n' Is
48, 11.
Job 24,24
ete eleves (s'oppose difficile
On trouve un futur avec l'etat dissocie dans Job 11. t2 11 y a quelques 17,19; du Ps 33, ]0
r
~::l~~
n
ex-
formes avec i (contamination
(cf. 89,34): ararnaisant).
des Y'1'): -
pliquer (le sens actif interdit Futurs De Pr 8,2'7. d'action en
ii merne
une forme stative),
(par contamination des verbes '"1'), p. ex.
cornme
r~'; 29.6. Pr
,'tli1
Ez
i'T;',j
as le
8,4;
c't;-J~ Jer
i(_J, 20 (avec redaublement
on trouve
en it: '~1l Eccl 9, 1 ; dans quelques
ii'~~
Voyelle , longe en -;
-
i.
En position antepretonique -:
-: T • -:
=: ne se maintient
-:
L'inf. est, en a, qui a ete supplante (p.-e. fautivement):
par I'inf. en p dans les verbes me
pas; il devient ordinairement 31: 3,24; t S 22,15;
verbes statifs (§ b), se trouve,
'~:l1 ' ' 7
9, 1); se courber.
c,~"
TT :
chose etrange, pieds;
l'li~O,'. Devant gutturale Ie - s'alles seuls exemples sont l'l~ni1, 'l'l~ni1 commencer Dt 2,
T • ,••
1-
Eccl 3, 18 pour les eprou-zoer(opp,
au:x
Is 45, 1 pour fouler ,,~ Ps 119,22
BARTH).
1~~J er
5, 26
rom
z:f.1":'}
Esth
6,13
(comp.
inf. c';!n"1- Gn 11,6)
T •
et
Is 9.3.
o •
(Cp. me me phenornene
dans les verbes ,"1', ~ 80 m, pas redevant n).
0
L'irnperatif
(a cote de ~3) est p.-e. abrege de
"t
p. ex. 'l'l1,1','.
J-
Cornme devant ce l' il n'y a tres probablement
doublement
virtuel, il n'y en a pas non plus, probablement,
(cf. § b N, d'apre~
Contamination
des 1'''1' par les '''1'. De merne que dans les verbes ont
Dans Nb 22, 11, 17, all lieu de eviter deux redoublements) !2, 6; 23, 7 on a '" nifal Nifal. statifs en
'~-;-'?~ qpl!a-lti
'~-"~P" on
a (sans doute pour merne dans
,'1' il y a de nombreuses formes contarninees par les 1'''1' (§ 80 0), il y a
aussi beaucoup de formes 1"1' contaminees par les ,"1'. Plusieurs ete citees aux §§ I, m, n: on en trouvera dictionnaire Naqdanim un 1'''1', ou la Concordance. Le verbe murmurer, beau coup d'autres dans _Ie vocalise par les
(i). En syllabe ouverte, l'p
bref devient moyen, comme dans p. ex.
'~-/"I"J~'pra-Ilz
un qal de
C'~1~§ ·28 e. De
pour 'ur(r)a-lIl.
c,
Dans Nb 23, 13 ij~R considerant Ie parfait
pour qul!n9, il y a un j epenthetique
(comp. ij~~ § 102 k). la langue,
comme si la racine etait j~';est probablernent
a l'origine
con-
~I?? comme
{?,
Com me il a ete dit §
a savoir
f"£),
p'
(cf. derive
a cree, par analogie, des parfaits
par exemple O~? se fondre, f. O~~. On trouve encore
(4 fois; plutot comme adjectif verbal que cornme.parfait), On a un parfait statif correspondent
T T
a cote
de
'll* e. route dans Is 34, 4 ~';!3j, car le futur Cip?, Cijil~ (contamii) la forme
'm.
'p.~
tami~e par les ,"1' e): Nif. Ui~z:1; hif. ~j'~~' A cote de tVtV~ palper, qui semble la racine primitive, il existe probablement en hebreu (et en arameen) une racine secondaire par quelques formes Gn 27,21; avec Jug 16,26; Ps 115,7. (cf. § a). Comparaison Ies formes
••
ji't' "
l'li~7z:1 murmures), entierement
C~~'7'"
r7h·
p
tV~~arrestee
est en a: ,,~~ Am 5, 24. Par contre, il y a des parfaits en p auxquels des futurs en 9, done sur le type
nominales
T
En dehors des participes ~~b, ~~~O et de l'inf. abs.
(i) D''apres tout ceci il semble
~i~o, I'etat
T
douteux
qu'il y ait des futurs nifal 1"11
(i) Le second qames ayant aussi la couleur
f (~ 18
sonne
avec !' moyen. (2) Cf. Bibtica, 1, p. 361.
f/'l~'l-lli dans la prononciation
de Tiberiade.
82p-
83d
Comparaison .des diverses classes de verbes
18,(
185
Parente des verbes faibles entre eux
83d-
85 a
dissocie
est assez rare dans les formes nominales,
C,!~IJ,* poet.,
p. ex. Ct3TOdesoi«, .. on
cote de C''!Q montagnes ; au lieu de C'~~ peuples
4) Auhifil Premiere
jussif en general,
p. ex.
"~p~, j?!, C
•• l'
5) Au hifil indicatif
des verbes V"v.: ~O', ::l0'. 4,_
. a, tres rarement, L'etat. normal que dans le verbe: ,~r:t; qutl: C,!~, Cp, C'~p, _:_ Forn~e commencer); de penelrer.'I' ph
q'~I?p' (comp.
droit
aram,
bib!. N~~~l!). conditions
voyelle --:- au futur.: des verbes statifs V"V:
et I'etat reduit existent dans les memes Forme qatl: Cl! peuple (et CV.) '~l!; qitl:
1) Au qal des verbes aetifs ,"'1:): ~;;~.
iT:'! grace
pluriel Compo
"R~'
'j:?~. -
Forme
qatl avec ,: ,~ prince,
2) Au hifil des verbes '''I:): ~'~".
'!.~(pour
sarr?;
le --;-, en cette position se maintient. (~e' rapporte protection,
'~p (§ 80 d), et opposer,
T •
p. ex. mTO annee, pl. C')TO, ')TO).
•.
~ 84. Parente
Les verbes ments forts ils
des verbes faibles entre eux.
par le fait qu'a cote d'elefaible, il est arrive sou vent elements
a
ta~t£lah: i1;r:tz:1commencement forme maqtal: (avec redoublernent
au 'hifil ;ni1
• •••
19~couuerture,
ararnaisant).
faibles etant caracterises contiennent
un
P'W~ action
element
que, pour exprimer forts un eUrpent
une rneme idee, on a associe aux memes faible variable. Ainsi pour tendre un
§ 83. Comparaison
(I
des diverses classes de verbes,
(Paradigme 16).
pzh:e la base
Nous groupons diverses la racine. L'etudiant
ici quelques pourra
observations aider
synthetiques
sur les de
stable TOp a eteemployee avec un l " element faible ! ou ), d'ou TO~' TO I-T et R~. De meme pour disjoindre on a VP) et Vp'. Quand il s'agit de verbes dont il se trouve peu de formes dans la Bible, il est parfois difficile de dire s'il y a vraiment certaines phonetique l'hitpael breu, d'une formes ne sont survenu pas est le cas notamment pour deux racines apparentees ou bien si tel Un accident (1). Une ainsi de en hel'existence b dues
classes de verbes,
qui pourront facilement ouverte:
la determination
en ajouter d'autres.
,b
Preforrnante
en syllabe
qal C~p> qal qal
line simple
contamination:
1) Dans les ,'V, p.ex,
TOi~~; nif. C;P?; hif. C'i?i} , C'i?~; hof.Cj?~n.
certains
verbes
,..V et V"V.
2) Dans les V..V, p. ex.
3) Dans les '''I:),p.ex. c Consonne
~b!o
::l~~,
"R~;nif.
~Q~; hif.
~~i0'
~O'; hof. ~0~i1.
"1' -
une forme peut causer pas
un metaplasrne racine; l'existence,
TO"l'~~ nif.~~); apres p. ex.
hif. :l'~i1, hif.~'~'r:t; :
::l'~' i hof. :l~~i1. ~,~"
forme isolee n'autorise
adrnettre
une veritable
~~~;;t (~ 77
racine
b) on ne peut
pas conclure
redoublee I' gutturale),
preforrnante
d'une Exemples
racine ~~,
I) Au nifal (futur 2) Regulierement 3) Dans les verbes
etc.) de tous les verbes
(sauf les verbes fut.TO~~, TO'~!.
1'" a
N:l';
cote de ~~),
cote de
,?/J (§ 75 g).
ni du futur
,7:. a
C",
'~R~'C~p>
V'¥~.
d'une base employee
avec divers eleme~ltS faibles : ecra-
dans les verbes ~"I:), p. ex.
rl:), p. ex.
::l~~.
ser : ,:l" mepriser: Autres
Tl',
r'~ et
e. nombreux
: !J::l' et i1::l,;
1"Ir~: r encontrer : N'P et
mp.
e. coi:
CO"
i1t3,;
4) Dans les formes aramaisantes 5) Dans les formes aramaisantes Derniere voyelle --:- au futui: 1) Generalement
des V"V, p. ex. fut. ~~:. des '''V, p. ex.
"':1:;
::l~!.
exemples
dans Ie cas des verbes
defectifs §·85.
ry'~/}, ry'~~§ 80p.
Parfois, une partie
~ 85. Verbes defectifs. pour exprimer la merne idee verbale, la langue temps) emprunte a
2) Au nifal: 3) Au qal des verbes actifs ,'1:): ::lTO'. de quelques des verbes
(1\
"~R~'
aux piel et hitpael:
"W.R~'"W.R~~·
p. ex.
"..
des formes (conjugaisons,
une racine", et le reste
autres
verbes,
r~~
N"I:) en pause (1) : ":lK',
secondaire, ~ 73 e.
,~tt" ,0Nr-l. "'.. "..
(1) C'est ainsi qu'en
f. ytU]id, par
arabe de Syrie waqada f qid ~ / prononce . qu, (c.
~A
.:i.i; allumer
LANDBERG,
devient Prouerbes
qad, de
I'imperatif
Mais ici l'~ est dorigine
Sayda, p. 290).
85a-
86
Verbes
defectifs
Nom
186
187
Nom -
Formation
nominale
86 -
87 h
une autre racine. avoir honte : s' eveiller: boire:
Chacun des deux verbes est dit difectif.
Voici
les cas (nominatif, accusatif, genitif de declinaison,
§ 93 b), il n'y a pas proprement
les verbes detectifs les plus usuels:
Les relations logiques exprimees par le nominatif, l'ac-
~i::J* § 80 q ~t ~::l' § 76 d. itre bon: ::lito §80 qet ::lro' § 76 d. .. '
cusatif et Ie genitif apparaissent par la position du nom dans la phrase. Pour le genitif cependant, sou vent le premier nom, qui reJ?it le second, a une forme speciale, appelee etat construit, par opposition
fP'
§ 76 d et
f'P.
a la forme
de I'al-
redouter .. ,~~ § 75 i et
''13
(cf
§ 41/ N)..
ordinaire, nornmee etat absolu (§ 92 a). Les modifications dans la voparente eloignee certains calisation du nom
nl/~;
verbes
faire
ooire, abreuuer .
n~~;:t(une
l'etat construit et celles qui proviennent
entre les deux racines est douteuse),
b
longement du mot par les finales du pluriel, du duel, du feminin, et
D'autres
sont defectifs quant aux conjugaisons,
temps etant ernpruntes
une conjugaison,
9P!
ajouter est qua:>id~fectif, § 75/:
a une- autre: • Pf. (qal) 9P!; f. (hif.) 9't?i',
Ie· reste ~;;:J~); f. (nif.)
par les suffixes, sont dues au deplacement ments dans la vocalisation constituent flexion, tres delicate, des formes norninales moins reguliere
du ton. Tous ces changeduo nom § 95 a. Cette celle
la flexion
que celle du verbe, <\emande, noms hebreux.
l'l~' s'aliumer : Pf. (nif.) l'l~q, f. (qal) l'l~ (§ 77 b). '~:J chanceler : Pf. (qal) partie. (nif.)
~jj "~:Jj.
T : •
pour etre comprise, outre la connaissance des lois phonetiques,
~Wf (rarernent
~~f~'
primitives des differents
s'approcher: (§ 72 g).
Pf. (nif.) ~~~; f. (qal) ~~~, ilnper. (qal) ~~
§ 87. Formation
nominale.
T ••
nM) 1m
conduire ; Pf. (qal] se repandre : Pf.
n,:,?; f. (hif.) I'ry~!. (nif.) l~~; f. (qal) lz:,'.
fi£l?; f. (q~l)r~£l!. ._ que les.deuxfo.rmes ~.r<!sseliibl~.nt (t).
f,£l se disperser;
Pf.(nif.)
~j' ~i.·:
a
la
Les noms sont ou primitifs,
com me ::IN pere, eN mere, (de
~N"1 tete, a
pied, ou derives. Les noms derivent ou d'un autre nom, par ex.
l'li~ll'~ lieu des pieds (de : :-
,j,), 'VTD partier ....,. ..
'Vt;-
porte) ou d'un de sup-
On remarquera que dal~s plusieurs cas Cl'l~', ~ll, ..11'1j) on a Ie nifal au parfait et le qat au futur.ret c Pour Ie pllrticipium taiztllm;· au qal, cf.
verbe. Ces derniers
sont tres nombreux,
mais il est gratuit
poser que tous les noms proviennent d'un verbe. Beaucoup de verbes, au contraire, proviennent priorite. Certaines formes nominales se rattachent bales, p. ex. au piel d'un nom (verbes denominatifs). Pour beaucoup de racines il est impossible de voir qui, du verbe ou du nom,
_s
50 d;
CHAPITRE
ru.
NOM;.
a certaines
formes verla
. ~ 86. Generalites~
Le nom, en grammai·rehebra19ue seulernent Ie substantif, et sernitique; comprend non effet;.
9~':T~ insulte ~~I":Ilouer. Par
se rattache au piel
9:!~ insulter, n~r:tr-l louange
faites pour ramener
contre, Ies tentatives
plus grande partie des formes nominales aux temps du verbe (parfait et irnperatif d'apres DE LAGARDE(t), parfait et futur d'apres BARTH)(t), ne sont pas concluantes. Tandis que les formes verbales chaque
(I)
mais encore l'adjectif
e).
L'adjectif,en
dans sa formation et dans sa flexion, ne differe .pas du 'substantif
e).
Le nom, en hebreu, ayant perdu les voyelles finales qui indiquaient
(I)
(conjugaisons
S 40
a) sont peu II
nombreuses, les formes nominales sont multiples et varices. Alors que forme verbale n'exprime guere qu'une idee- (p. ex, Ie piel:
Arabische« und Hebrdischen
Cf,
MAYER
LAMBERT •
Revue des Et~desjuives, 4t, p. 212. II·y "anssi.
le cas de
line certaine
(2)
ressemblancedans sens large, et les participes,
ri~j: '~'; ,j" ,u' ~a. r
T T T ,.
Au
Ie nom comprend
encore
les noms
verbaux,
a savoir
(jbersicht fiher die im Aramaischen, Nomina (1891).
les infinitifs
ubliche Bildung'der
(ef. ~ 87 C).
(3) Mais les adjectifs n ont pas toutes les formes des substautifs
(2) Die Nominatbildung in den semitische« Sp,·achen (1891).
Vous aimerez peut-être aussi
- Comment étudier: Méthodes pédagogiques et astuces didactiquesD'EverandComment étudier: Méthodes pédagogiques et astuces didactiquesPas encore d'évaluation
- La Syntaxe Du Francais PDFDocument128 pagesLa Syntaxe Du Francais PDFMihai Mihai100% (3)
- Dictionnaire du bon langage: Contenant les difficultés de la langue française, les règles et les fautes de prononciation, les locutions vicieuses, les wallonnismes, les flandricismes, etcD'EverandDictionnaire du bon langage: Contenant les difficultés de la langue française, les règles et les fautes de prononciation, les locutions vicieuses, les wallonnismes, les flandricismes, etcPas encore d'évaluation
- Le Bon Usage Grammaire Francaise 14e EdDocument1 602 pagesLe Bon Usage Grammaire Francaise 14e EdWladimir Farias OcaPas encore d'évaluation
- Aristote - CatégoriesDocument607 pagesAristote - CatégoriesChafik Graiguer100% (1)
- Dictionnaire Étymologique de La Langue Latine PDFDocument427 pagesDictionnaire Étymologique de La Langue Latine PDFdailhar100% (1)
- Grammaire Élémentaire de L'ancien FrançaisDocument363 pagesGrammaire Élémentaire de L'ancien FrançaisRoman MaurerPas encore d'évaluation
- Les Successions de Consonnes en Latin (Thèse)Document1 101 pagesLes Successions de Consonnes en Latin (Thèse)BenjaminPas encore d'évaluation
- Éléments de Grammaire Comparée Du Grec Et Du LatinDocument380 pagesÉléments de Grammaire Comparée Du Grec Et Du LatinSARAPas encore d'évaluation
- Breve Histoire de Linguistique RobinsDocument241 pagesBreve Histoire de Linguistique Robinshmayda riad100% (2)
- Meyer Lübke, Grammaire Des Langues Romanes, I Phonétique, Paris 1890Document642 pagesMeyer Lübke, Grammaire Des Langues Romanes, I Phonétique, Paris 1890José Antonio Bellido Díaz100% (1)
- A La Recherche Des Indo-EuropeensDocument369 pagesA La Recherche Des Indo-EuropeensAsterRisk100% (2)
- Grammaire Comparée Des Langues Indo-Européennes (... )Document521 pagesGrammaire Comparée Des Langues Indo-Européennes (... )lidija100% (1)
- Glossaire Des Mots Arabes Dans La Langue Espagnole Et Portugaise (Doty)Document450 pagesGlossaire Des Mots Arabes Dans La Langue Espagnole Et Portugaise (Doty)Diana Vieira HilárioPas encore d'évaluation
- Introduction A La Chronologie Du Latin Vulgaire Mohl Paris 1899Document360 pagesIntroduction A La Chronologie Du Latin Vulgaire Mohl Paris 1899José Antonio Bellido DíazPas encore d'évaluation
- Dictionnaire Etymologique LatinDocument480 pagesDictionnaire Etymologique Latinjamil pimentelPas encore d'évaluation
- Oeuvres Complètes de Tacite. Avec La Traduction en Français. Publiées Sous La Direction de M. Nisard - Tacitus, CorneliusDocument618 pagesOeuvres Complètes de Tacite. Avec La Traduction en Français. Publiées Sous La Direction de M. Nisard - Tacitus, CorneliusAhmed Berrouho100% (1)
- Introduction Au Latin VulgaireDocument147 pagesIntroduction Au Latin Vulgairestrajder7100% (2)
- Lefebvre, Gustave - Grammaire de Légyptien Classique (1955Document814 pagesLefebvre, Gustave - Grammaire de Légyptien Classique (1955Manuel Melendo100% (1)
- Alfred Ernout, Antoine Meillet - Dictionnaire Étymologique de La Langue Latine - Histoire Des Mots (4e Éd.) - Klincksieck (2001)Document853 pagesAlfred Ernout, Antoine Meillet - Dictionnaire Étymologique de La Langue Latine - Histoire Des Mots (4e Éd.) - Klincksieck (2001)Angie Marcela Claro MeloPas encore d'évaluation
- Humbert Syntaxe GrequeDocument480 pagesHumbert Syntaxe GrequeOctavian Gordon67% (3)
- NIEDERMANN, Max. Phonetique Historique Du LatinDocument178 pagesNIEDERMANN, Max. Phonetique Historique Du LatinAntonio MarcosPas encore d'évaluation
- можеDocument412 pagesможеKsushaKorolkovaPas encore d'évaluation
- BalsanComplet TextDocument467 pagesBalsanComplet TextmfarpPas encore d'évaluation
- Grammaire Comparée Des Langues Indo-Européennes - Tome IDocument542 pagesGrammaire Comparée Des Langues Indo-Européennes - Tome IPascalPas encore d'évaluation
- DiphtongaisonDocument71 pagesDiphtongaisonDelphine ViellardPas encore d'évaluation
- Grammaire Latine: Gilbert FRANÇOISDocument389 pagesGrammaire Latine: Gilbert FRANÇOISGeorgios TsamourasPas encore d'évaluation
- Mallon. Grammaire Copte: Avec Bibliographie, Chrestomathie Et Vocabulaire. 1907.Document526 pagesMallon. Grammaire Copte: Avec Bibliographie, Chrestomathie Et Vocabulaire. 1907.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Thèmes Grecs Et Latins (Montesquieu)Document114 pagesThèmes Grecs Et Latins (Montesquieu)Padasas31100% (1)
- CARNOY, A. Le Latin D'espagne D'après Les Inscriptions. Étude Linguistique PDFDocument302 pagesCARNOY, A. Le Latin D'espagne D'après Les Inscriptions. Étude Linguistique PDFelannion17Pas encore d'évaluation
- Troubetzkoy - Principes de PhonologieDocument446 pagesTroubetzkoy - Principes de PhonologieRayco GonzálezPas encore d'évaluation
- Bäumer. Histoire Du Bréviaire. 1905. Volume 1.Document472 pagesBäumer. Histoire Du Bréviaire. 1905. Volume 1.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Muzerelle 1985 - Vocabulaire CodicologiqueDocument163 pagesMuzerelle 1985 - Vocabulaire Codicologiqueack67194771Pas encore d'évaluation
- Bibliothquedel 122 EcolDocument360 pagesBibliothquedel 122 EcolFrancophilus VerusPas encore d'évaluation
- Bibliothquedel 78 EcolDocument330 pagesBibliothquedel 78 EcolFrancophilus VerusPas encore d'évaluation
- Meyer-Lübke, Rabiet, A. Doutrepont, G. Doutrepont. Grammaire Des Langues Romanes. 1890. Volume 1.Document644 pagesMeyer-Lübke, Rabiet, A. Doutrepont, G. Doutrepont. Grammaire Des Langues Romanes. 1890. Volume 1.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument25 pagesExtraitlazhorPas encore d'évaluation
- Herodote Morceaux ChoisisDocument340 pagesHerodote Morceaux ChoisisDionisie Constantin PirvuloiuPas encore d'évaluation
- Bibliothquedel 139 EcolDocument542 pagesBibliothquedel 139 EcolFrancophilus VerusPas encore d'évaluation
- Exercices Grecs Illustrés Sur La (... ) Petitmangin Henri Bpt6k6529578fDocument318 pagesExercices Grecs Illustrés Sur La (... ) Petitmangin Henri Bpt6k6529578fjebaclePas encore d'évaluation
- Niedermann - Phonetique Historique Du LatinDocument169 pagesNiedermann - Phonetique Historique Du LatinVerónica Díaz Pereyro100% (1)
- Sallustius de Conjuratione Catilinae EtDocument311 pagesSallustius de Conjuratione Catilinae EtTeodor LazarPas encore d'évaluation
- Matsuzawa CG1Document22 pagesMatsuzawa CG1جعفر يايوشPas encore d'évaluation
- Bourciez Edouard Elements de Linguistique RomaneDocument410 pagesBourciez Edouard Elements de Linguistique RomanegréalPas encore d'évaluation
- De Lingua LatinaDocument15 pagesDe Lingua LatinaMatwei Lisitsov100% (1)
- Nouveaudictionna00suck PDFDocument776 pagesNouveaudictionna00suck PDFLuxor TermanPas encore d'évaluation
- (Gerard Moignet) Les Signes de L'exception Dans L'Document124 pages(Gerard Moignet) Les Signes de L'exception Dans L'Jean-Philippe BABUPas encore d'évaluation
- Blachère Grammaire Arabe PDFDocument498 pagesBlachère Grammaire Arabe PDFDavid BramoulléPas encore d'évaluation
- Primeros Pinitos (Classes de Première Année) - E. Dibie - A. Fouret. Didier, 1912Document249 pagesPrimeros Pinitos (Classes de Première Année) - E. Dibie - A. Fouret. Didier, 1912Hispanalia En FrancePas encore d'évaluation
- SCHLEGEL-Cours de Littérature Dramatique-1814 PDFDocument448 pagesSCHLEGEL-Cours de Littérature Dramatique-1814 PDFAnonymous uWo9lMa100% (1)
- Yvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementDocument24 pagesYvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementALBERTO PAULO NETOPas encore d'évaluation
- Reinach 1880Document423 pagesReinach 1880pascale.hummel.israelPas encore d'évaluation
- Comment on Prononce le Français: Traité complet de prononciation pratique avec le noms propres et les mots étrangersD'EverandComment on Prononce le Français: Traité complet de prononciation pratique avec le noms propres et les mots étrangersPas encore d'évaluation
- Texte Traductologique #2 (TF1) 2021-IDocument2 pagesTexte Traductologique #2 (TF1) 2021-IPaola CárdenasPas encore d'évaluation
- Abrégé de La Nouvelle Grammaire FrançDocument171 pagesAbrégé de La Nouvelle Grammaire Françjd.gti9195Pas encore d'évaluation
- Grammairetextuelle NATHANDocument6 pagesGrammairetextuelle NATHANsou2106Pas encore d'évaluation