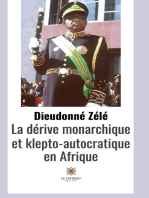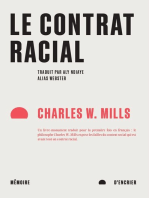Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
EPROUVER L'UNIVERSEL. - Essai de Géophilosophie
Transféré par
turun4Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
EPROUVER L'UNIVERSEL. - Essai de Géophilosophie
Transféré par
turun4Droits d'auteur :
Formats disponibles
EPROUVER L'UNIVERSEL
AVANT-PROPOS
Cet essai propose au lecteur un voyage travers des thses et des argu-
ments philosophiques, un parcours de territoires conceptuels. C'est pour-
quoi l'ordre d'exposition est celui de la dcouverte, ou encore l'ordre des
raisons. Il n'est peut-tre pas vain de le prciser avant, de sorte que ne nous
soient pas attribues certaines positions que nous adoptons, titre stricte-
ment provisoire, et de manire les rfuter. Au demeurant la brivet de
l'ouvrage nous enhardit jusqu' oser demander cet effort de retenue qui
consiste ne juger nos intentions qu'aprs. Nous avons en effet crois sur
notre route plthore de clichs - ce que Hegel appelle le bien connu, qu'il
considre pour cette raison mal connu.
Hegel ajoute qu'il est impossible de ne pas en passer par l, et nous par-
tageons ce point de vue. C'est dire que les tapes de notre voyage philoso-
phique sont ces clichs mmes, au moins ceux qui regardent notre entrepri-
se. Pllitt que de les dnoncer ou de les ignorer, nous avons choisi de les
mettre l'preuve.
travers ce voyage, nous cherchons honorer la prtention de la phi-
losophie l'universel, en tablissant les conditions de possibilit d'un pas-
sage des concepts d'un monde historique un autre, ou en tout cas des
moins triviaux d'entre eux, ceux qui permettent une communaut humai-
ne de se dfinir. Ce faisant, il nous a paru ncessaire d'abandonner une
conception de la communication pense comme change, selon un code ou
une procdure normati ve, pour en dfendre une autre, construite sur le
modle de la rencontre, modle dans lequel nous croyons apercevoir un
devenir possible, et souhaitable, de l'activit philosophique en ces temps de
mondialisation.
Cet essai n'a donc pas pour ambition premire de dcrire le Japon, ni
mme de prsenter des penseurs japonais. Une telle ambition serait de toute
faon incompatible avec le fonnat de ce livre et exigerait des comptences
que nous n'avons pas. Qu'il soit ici question du Japon est affaire de contin-
gences. On ne choisit ni son lieu de naissance, ni les hasards des rencontres.
Il n'y a pas d'exception japonaise en philosophie, sauf dans le sens o
toutes les traditions de penses singulires sont exceptionnelles. C'est la
raison pour laquelle le Japon peut fournir au lecteur occidental l'occasion
d'un vritable dcentrement qui permette d'prouver l'universel.
Ajoutons que si nous nous sommes permis de convoquer des auteurs
japonais sans prtendre parler du Japon, c'est parce que, aprs tout, il doit
tre possible de citer Kant sans avoir de thse dfendre sur l'Allemagne.
6 prouver l'universel
Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance Jean Robelin qui
nous a honor de sa confiance en nous offrant l'occasion d'crire ce livre et
a eu la gentillesse de nous faire part de prcieuses remarques, Batrice
Charri qui a eu la bienveillance de nous accueillir dans sa collection,
Stphane Haber, Marie-lisabeth Handman, Pierre Lavelle et Pascal
Ludwig qui ont eu la patience de relire le texte et de nous en signaler les
imperfections, ainsi qu' Laurent Gerbier, Miyake Yoshio, Momma Mika,
Ohji Mutsumi et Toshi, Sugimoto Keiko, Tagllchi Takumi, Yamajo
Hirotsugu qui, des titres divers, nous ont apport une aide prcieuse.
Nous respectons la coutume japonaise relative aux noms propres de
donner dans l'ordre le nom de fa.mille puis le- nom personnel. Nous adop-
tons la transcription gnralement en usage des mots japonais en franais,
selon laquelle chaque voyelle a une valeur phontique indpendante, les
accents circonflexes indiquent des voyelles longues, le ch se prononce tch,
la consonne g se prononce gu, le h est toujours aspir et la consonne s est
toujours sourde.
INTRODUCTION
Commerce, tourisme et philosophie
Je suis ngociant ; en parcourant la province pour mes affaires (le
commerce du fer), j'ai eu l'ide d'crire unjoumal.
Et encore, quelques lignes plus loin :
Paris on est assailli d'ides toutes faites sur tou ; on dirait qu'on
veut, bon gr, mal gr, nous viter la peine de penser, et ne nous laisser que
le plaisir de bien dire. 1
Stendhal est un singulier touriste: il n'est pas en vacances et se dpla-
ce pour les besoins du ngoce, mais quitter Paris o il vit depuis vingt ans
est un prcieux aiguillon pour la pense. Dcidment, il mlange tout ;
d'aillurs, ses mmoires sont fictives et, en fait, ce n'est pas
ce qu'il veut dire. Stendhal n'aime pas les touristes, il les trouve trop pres-
ss, trop affairs, trop commerants. J'ai accompli ce matin ce que l'on
peut appeler les corves du mtier de touriste ; j'ai vu une fabrique de savon
et un chaix ou fabrique de vins, en rive neuve. 2 Un mtier donc, comme
celui de ngociant. Exactement le contraire de cette activit de temps libre
qu'est la pense. Stendhal le sent bien d'ailleurs, touriste-ngociant ou cri-
vain-voyageur, il faut choisir: je n'en ai pas le temps. J'prouve mon
grand regret que je ne suis pas un curieux, mais un marchand. Aussi, je
comprends mieux que personne ce qui me manque pour oser donner au
public un essai de voyage en France. 3
Les choses se compliquent. Voil que le temps et la curiosit, qui man-
quent au touriste comme au commerant, sont des attributs ncessaires du
voyage. Le touriste, comme le commerant, ne voyagent donc pas, ils font
des tours. C'est le curieux, libr des urgences du monde, celui qui se lais-
se entraner au plaisir de flner dans les rues , parce que c'est sans
contredit la meilleure manire d'employer son temps quand on est loin de
Paris 4, qui seul peut prtendre savoir vraiment voyager.
Du ct des affaires, donc, le ngoce et le tourisme ; du ct des oisifs,
le voyage et la philosophie. Stendhal se conforme en tbuSpOhtsm l' tymo-
logie, qui permet d'ajouter un terme l'opposition: l'absence de tradition.
Selon mile Benveniste en effet, les affaires commerciales n'ont pas de
nom; on ne peut pas les dfinir positivement. Nulle parton ne trouve une
expression propre les qualifier d'une manire spcifique; parce que - au
8 prouver l'universel
moins l'origine - c'est une occupation qui ne rpond aucune des acti-
vits consacres et traditionnelles 5. Quant au tourisme, n'en parlons pas,
c'est un nologisme qui, semble-t-il, fait son apparition en France en 1816
6
D'ailleurs, pour ce qui est du commerce, c'est l'oisivet qui, faute de par-
rains, lui donne ngativement son nom de baptme: Il n'y a aucune dif-
ficult dans la formation mme du terme negotium, de nec-otium, littrale-
ment " absence de loisir " (... ]. Le fait essentiel que nous proposons d'ta-
blir est que negotium n'est pas autre chose qu'une traduction du grec askho-
lia (ascolia). Il concide entirement avec askholia qui signifie littralement
" le fait de n'avoir pas de loisirs " et " l'occupation ". Le mot est ancien
[... ]. En outre askholia " occupations " signifie aussi " difficults, soucis "
dans l'expression askholfan parkhein " crer des soucis, des difficul-
ts "
7
L'opposition que travaille Stendhal n'est donc ni fortuite ni rcente,
c'est la racine mme des mots qui s'obstine distinguer flneries et affaires,
curiosit et soucis, ngoce et skholia.
Pourtant, est-il certain que cette clbre ligne d'affrontement, qui cul-
mine dans le face--face de la philosophie et du travail, doive ncessaire-
ment passer par le couple tourisme/voyage, comme Stendhal semble s'y
rsoudre? Le touriste est-il condamn au ngoce, ne peut-il se librer des
soucis ? Mme Stendhal, comme on l'a vu, reconnat que le commerant
fictif qu'il est peut flner.
Sans compter que depuis, les choses se sont srieusement compli-
ques: non seulement les activits qui n'ont pas de nom faute d'tre consa-
cres se sont imposes au cur de la cit, mais elles s'tendent charitable-
ment, et depuis bien longtemps, toutes sortes d'activits nouvelles. Ds le
XVIe sicle le commerce entre les hommes est synonyme de frquentation
et dsigne gnriquement toutes les relations qu'ils entretiennent.
C'est dire que Raynal indique de trs profonds changements sman-
tiques quand il fait la remarque suivante:
Il n' y a point eu d'vnement aussi intressant pour l'espce
humaine en gnral & pour les peuples de l'Europe en particulier,
que la dcouverte du Nouveau-Monde & le passage aux Indes par le
Cap de Bonne-Esprance. Alors a commenc une rvolution dans le
commerce, dans la puissance des nations, dans les murs, l'industrie
et le gouvernement de tous les peuples. 8
Comme si en s'tendant par del les mers, le commerce avait certes conquis
l'enviable place de moteur des changements sociaux, mais au prix d'une
concentration sur le seul ngoce.
Introduction 9
Cette rvolution dans le commerce ne rside pas seulement dans la
mondialisation des affaires et des soucis qu'autorise la fabrication de grands
voiliers, c'est aussi un dbordement du modle du commerce recentr sur
son noyau dur, l'change marchand hors des affaires strictement ngo-
ciantes. La chose n'est au demeurant peut-tre pas tout fait nouvelle,
puisque comme Benveniste le fait remarquer:
askholia signifie bien " les affaires, occupations publiques ou pri-
ves ", mais sans cette orientation nette vers les affaires commerciales
que comporte negotium. Les Latins eux-mmes nous qu'ils
ont forg ces termes l'imitation du grec. [... ] C'est ds lors l'imi-
tation du grec prgma que toute drivation nouvelle de negotium s'est
organise. On assiste ainsi un curieux procd smantique : nego-
tium, partir de ce moment l, prend tous les sens du grec prgma, il
peut signifier comme prgma " chose ", et mme " personne " 9.
Reste que Raynal est un prcieux tmoin et qu'il se passe bien quelque
chose dans la seconde moiti du XVIIIe sicle : en l'occurrence, c'est une
rvolution. Celle de la circulation des productions : les productions des
climats placs sous l'quateur se consomment dans les climats voisins du
pole, l'industrie du Nord est transporte au Sud; les toffes de l'Orient sont
devenues le luxe des Occidentaux 10, mais pas seulement: par-tout les
hommes ont fait un change mutuel de leurs opinions, de leurs loix, de leurs
usages, de leurs maladies, de leurs remdes, de leurs vertus & de leurs
vices. 11.
On peut certes encore, en 1780, qualifier une discussion de commerce,
et Raynal ne s'en prive pas, mais - place grandissante du ngoce oblige-
le terme voque de plus en plus les affaires, le travail, et une figure non pas
nouvelle, mais renouvele: l'intrt... Il convient de moins en moins
l'change dsintress d'ides brillantes, d'honneurs et de nobles senti-
ments
12
Pour tout dire, il faut un nouveau mot. La nature ayant horreur du
vide, on commence parler de commUl1ication.
Mais l'histoire est parfois tortueuse: en se rabougrissant, le commerce
recentr sur ses origines tymologiques impose cependant l'change
comme modle de tous les rapports humains qu'il n'exprime plus. On par-
lera dsormais de moins en moins de commerce pour dsigner une conver-
mais on pensera la conversation dans le cadre thorique de l'cono-
mie linguistique - au risque de faire vaciller la distinction entre skholia et
askholia.
Ainsi, la communication n'a jamais t l'autre du commerce; tout au
plus sa spcification, en une espce particulire d'change, celui - mutuel
10 prouver l'universel
- d'opinions. Elle ne dsigne pas l' askholia, l'oisivet et le jeu dsint-
ress, mais plutt l'intrt pour l'change d'opinion, la discussion comme
acti vit, le fait d'tre affair pratiquer l'art de la conversation.
Et pourtant, depuis lors, elle prtend donner le change, se faire passer
pour l'autre du commerce, qu'elle n'est pas... Il faut attendre l'actuel
renouveau de l'expansion commerciale pour qu'elle soit rattrape une fois
encore par le ngoce et que devienne manifeste leur communaut d'origine
et leur parent catgorielle : c'est ce dont tmoigne, selon Stendhal, le no-
logisme tourisme qui devrait tre une flnerie et se dcouvre tre un mtier,
l o le touriste devrait se dbarrasser du ngoce pour tre vraiment lui-
mme, voyageur, flneur et curieux, donc dispos penser. Est-ce une rgle
qu' chaque rvolution commerciale, l'expansion smantique et politique
du ngoce manque chaque fois de faire verser le voyage dans le ngoce,
la skholia dans l' askholia ?
Mais revenons Stendhal.
Si l'on veut bien, par souci de rigueur, garder l'esprit que le touriste
est habit de cette tension originelle, il convient de le dfinir comme celui
qui, parce qu'il est hant par la figure du commerce, communicationnel et
marchand, doit s'arracher l' askholia pour devenir vraiment voyageur.
La philosophie non plus (c'est le moins qu'on puisse dire... ) n'ajamais
t indiffrente ces considrations tymologiques, elle qui se dfinit -
combien scolastiquement - dans et contre l'change mutuel d'opinions,
comme jeu srieux, du ct de la skholia
13
Apparat un rapport inattendu entre le tourisme et la philosophie : l'un
et l'autre ont en partage un ennemi intime commun, le ngoce, qui manque
tout moment de les faire verser dans le commerce, l'change mutuel des
opinions, la circulation des prgmata. Partager un ennemi commun, c'est
beaucoup. Tandis que le commerce ne cesse d'oprer ses rvolutions, peut-
tre l'avenir de la philosophie a-t-elle partie lie avec le tourisme?
C'est donc tout naturellement que ce livre va commencer par le com-
mentaire philosophique d'une anecdote de voyage.
Anecdotes typiques
Toutes les anecdotes de voyage ne se ressemblent pas. Il y a celles qui
relvent de ce qu'il y a de voyageur dans le tourisme et les autres qui,
n'ayant pas su s'arracher au commerce, ne peuvent tre prsentes au
public faute d'intrt. L encore, c'est Stendhal qui invente la distinction:
Ce n'est donc qu' mon corps dfendant que je vais voir les muses
de province, le vulgaire des glises gothiques et tout ce que les sots
Introduction Il
appellent des curiosits. Ce qui est curieux pour moi, c'est ce qui se
passe dans la rue et qui ne semble curieux aucun homme du pays. 14
La distinction est tnue cependant, et facilement rversible: qu'une
vritable curiosit, un ce qlJ.i se passe dans la rue soit aperu et transmis, le
voil happ par le commerce, transform en curiosit, en bien commercial.
Le commerce touristique moderne s'puise dans la recherche de l'exotique
et la ligne d'opposition entre voyage et commerce se prolonge dans le
couple curieux/curiosit.
De ces petits riens singuliers mais tellement significatifs naissent des
anecdotes qui, parce qu'elles se rptent inlassablement, parce qu'elles pr-
sentent une indiffrence certaine la personnalit du touriste, parce que la
mmoire touristique les transmet de voyageur en voyageur, de guide de
voyage en guide de voyage, sont susceptibles de devenir des anecdotes
typiques, des proverbes, des curiosits.
Notre point de dpart sera donc une anecdote qui saisit un de ces petits
riens, une curiosit stendhalienne. C'est pourquoi nous irons la chercher
dans un guide de voyage sur le Japon, le meilleur disponible en langue fran-
aise, peut-tre:
L'agressivit et le spiritualisme guerrier d'avant-guerre n'tant plus
de mise, il y a une autre manire pour le Japon d'affirmer son identi-
t : c'est dese vouloir" impntrable ". Prserver une opacit, ce n'est
pas tre ferm, mais ce n'est pas moins tre sur la dfensive. Toutes
vos intrusions dans le " domaine rserv " seront repousses, non pas
certes sur le mode du " vous vous trompez " mais sur celui, sans appel
du " vous ne pouvez pas comprendre ". Cette attitude commence
inconsciemment lorsque l'tranger parle japonais: il est regard avec
surprise et, au dpart, on lui rpondra dans un anglais approximatif ou
par des mimiques signifiant qu'on ne saisit pas. Elle s'exprime plus
clairement lorsque les Japonais vous affirment que les trangers " ne
peuvent pas comprendre " un jardin zen ou la potique de Bash
15
-
alors que votre interlocuteur vous expliquera volontiers Mallarm ou
Baudelaire. Loin de nous au demeurant la pense que l'art des potes
lui soit inaccessible. 16
Et Philippe Pons ajoute : le principe de rciprocit serait nanmoins
souhaitable 17.
L'auteur de ce guide de voyage est correspondant du quotidien Le
Monde en Extrme-Orient, et n'a sans aucun doute de got ni pour la psy-
chologie des peuples ni pour l'exotisme. Il est unanimement reconnu pour
12 prouver l'universel
la rigueur de ses analyses faites de distance et de respect, et le type de com-
portement qu'il dcrit, s'il n'est videmment confirm par aucune statis-
tique rigoureuse, prsente pour tous les touristes qui sont dj alls au Japon
un degr suffisant de vraisemblance pour avoir sa place dans un guide de
voyage.
Cette anecdote ne change, bien sr, pas pour autant de registre : le
domaine de validit des anecdotes n'est ni la sociologie ni l'histoire des
mentalits, mais le tourisme. Elle se charge de dcrire une exprience vcue
par des touristes et colporte pour des touristes. C'est dire combien elle en
dit d'autant moins sur le Japon actuel qu'elle a dj presque vingt ans: mais
le propre des anecdotes n'est-il pas de vivre beaucoup plus longtemps que
les comportements qui lui ont donn naissance?
C'est prcisment la raison pour laquelle elle est de quelque intrt
pour la philosophie: comme indice de quelque chose qui la concerne, dans
son rapport au commerce et au tourisme.
En effet, le commerce, le tourisme et la philosophie n'ont pas seule-
ment en commun de se jouer dans leur rapport l'oisivet et aux affaires,
ils prtendent tous trois l'universalit.
Pour ce qui est du commerce, comme ngoce, il est certain qu'il dis-
pose des moyens de ses prtentions: parmi les divers prgmata, il en est un
qui assure l'universelle convertibilit des autres, et par l mme leur circu-
lation. Tout cela semble assez simple, en tout cas assez balis depuis
Shakespeare relu par Marx, entres autres :
[L]'argent, qui possde la qualit de pouvoir tout acheter et tout s'ap-
proprier, est minemment l'objet de la possession. L'universalit de sa
qualit en fait la toute-puissance [... ]. [1]1 est la prostitue universelle,
l'universel entremetteur des hommes et des peuples. 18
L'existence d'un tel prgma, rend le commerce universel non seule-
ment possible mais bien rel. On peut acheter et vendre l'chelle plan-
taire.
Quant au touriste, il revendique aussi l'universalit de ses affaires:
existe-t-il un lieu qui ne puisse devenir l'objet d'un tour? Cette universali-
t-l serait celle de la reprsentation des choses et des lieux sous la forme
de curiosits. Mais cette seconde prtention est moins arme que la pre-
mire: si l'on en croit le tourisme n'a pas la fluidit de l'chan-
ge marchand, quelque chose rsiste, ne se laisse pas changer.
Car c'est bien d'change qu'il s'agit, et Philippe Pons ne l'ignore pas
qui rclame la rciprocit, principe de l'change juste. Raynal serait donc
all un peu vite en voquant la gnralisation des changes mutuels, de
Introduction 13
leurs opinions, de leurs lois, de leurs usages, de leurs maladies, de leurs
remdes, de leurs vertus et de leurs vices 19. la diffrence du ngoce, on
ne dispose pas ici d'un convertisseur universel qui pourrait assurer l'uni-
verselle mutualit de comprhension, pourtant ncessaire la circulation
curiositaire des touristes.
Voil donc un Japonais, poli mais ttu, qui ne veut pas changer son
Bash et son jardin zen, mme contre un Baudelaire et un Mallarm. On
peut considrer que ce japonais reprsente un type , en deux sens.
Comme exemple de l'espce japonais dans un guide de voyage crit
pour des touristes occidentaux ~ n e part et comme figure d'une attitude
qui n'est pas dnue de porte philosophique, celle du refus de l'change de
comprhension d'autre part. C'est ce second sens qui fait que l'anecdote
n'est pas sans lien avec la philosophie.
Les petits riens de Stendhal, ceux que les autochtones n'ont mme pas
remarqu et qui les saisissent dans ce qu'ils ont de plus curieux, ne sont ici
d'aucun secours: ils sont peut-tre devenus la monnaie du tourisme com-
mercialis, mais cette montarisation les a engloutis dans l'insignifiance,
comme dmontiss. Or, et c'est tout son problme, notre touriste se sait
aussi travaill de l'intrieur par la philosophie et par la curiosit; il est en
qute d'objets de valeur. Fermement partisan d'une gnralisation de
l'change mutuel de comprhension, au nom de l'absence de limites de sa
curiosit, il n'a pourtant que faire d'un exotisme marchand, de la transfor-
mation de Bash en bien commercial. Les complications viennent donc de
ce qu'il revendique deux choses la fois: la gnralisation du commerce
communicationnel comme change mutuel de comprhension, et sa dis-
tinction nette du commerce marchand.
Notre touriste est donc tout fait fidle lui-mme et sa dualit ori-
ginelle. Issu du ngoce, il en conserve la prtention l'universalit, mais
s'arrachant lui, il vise la connaissance contre la consommation.
Le Japonais typique ne semble pas convaincu de la validit du princi-
pe de libre exercice de la curiosit touristique illimite, impliquant la rci-
procit. Pourquoi ? On en est rduit aux conjectures.
Curiosits
Serait-ce que le Japonais douterait de" l'quivalence relle des termes
de l'change, soit en considrant que Mallarm et Baudelaire sont de la
camelote en comparaison de Bash ou du jardin zen, soit l'inverse, qu'il
considre ces derniers comme indignes des potes franais? La premire
option constitue une forme trop extrme de japonocentrisme pour tre
14 prouver l'universel
typique, et la seconde est exclure d'office puisqu'il est patent que le seul
point d'accord entre le touriste et son hte porte prcisment sur la grande
valeur de Bash et du jardin zen.
De toute faon l'une et l'autre supposent rsolue la question du conver-
tisseur -universel, le plan commun et le principe de convertibilit de Bash
et Mallarm en un quivalent de comprhension. Plutt donc que- de scru-
ter les intentions du Japonais, ne faut-il pas essayer en premier lieu de
rendre compte de l'asymtrie d'o surgit la difficult ?
De ce point de vue, deux hypothses sont exclure: la premire serait
de considrer qu'il y a bien quelque chose d'universel chez Baudelaire et
Mallarm, en quoi rside la possibilit pour le Japonais d'tre un grand
amateur de posie franaise, et que ce quelque chose serait susceptible
d'tre dfini avec une prcision suffisante pour servir d'talon universel.
Outre qu'il faudrait admettre que ce quelque chose n'est pas dans le jardin
zen, il semble que la philosophie pr-critique se soit puise chercher une
telle dfinition sans y parvenir. La seconde ferait rsider le principe univer-
sel recherch dans le sujet esthtique. Ce serait l une autre manire de faire
dire au Japonais que-les trangers sont trop btes pour percer les charmes
du Haku. Hypothse improbable: ce genre de classifications a t invent
en Europe, et ses partisans au Japon ne sont pas assez nombreux pour sus-
citer un intrt touristique.
Aussi, est-ce bien sur la possibilit mme de la comprhension de
Bash et du jardin zen que porte la discussion, ou plutt sur ce qu'ils repr-
sentent. Comme Pons le fait remarquer, c'est moins Bash et le jardin zen
qui sont en question que la revendication d'un domaine rserv , d'un
lieu, qu'on peut appeler une intimit, qui rsiste l'universalisation de
l'change mutuel. Le choix d'exemples tirs de la posie indique peut-tre
que les Japonais situent plus facilement cette intimit dans leur posie
qu'ailleurs, mais il ne doit pas cacher la vritable nature du problme : ce
qui fait la valeur de Bash ou du jardin zen doit tre cherch dans un
domaine rserv et n'est pas universellement communicable. Autrement dit,
ces uvres sont sans doute des chefs-d' uvres, mais ce qui fait leur valeur,
objective ou subjective, n'est pas universel, et c'est bien pour cela qu'elles
ne peuvent faire l'objet d'un change mutuel de comprhension.
Dire qu'un chef-d'uvre n'est pas universel ouvre deux sortes de pro-
blmes qu'il convient de distinguer soigneusement. Dans le sens confr
par le Japonais typique, l'universalit de l'uvre dsigne sa capacit tre
apprcie en tous lieux et en tous temps.
Mais il y a peut tre plus. Dire qu'un chef-d'uvre n'est pas universel,
sans pour autant lui dnier sa valeur de chef-d'uvre, c'est refuser de faire
rsider sa valeur dans son universalit mme. Il n'est plus seulement ques-
Introduction 15
tian de porte, mais du principe de valorisation lui-mme: le vous ne pou-
vez pas comprendre nippon laisse sous-entendre que l'universel pourrait
n'tre pas le seul principe qui confre leur valeur aux choses. Au contraire,
il suggre que les chef-d'uvres en question tirent leur valeur du domai-
ne rserv . Serait-ce dans la particularit qu'il faudrait chercher un mode
de valorisation alternatif l'universel comme principe confrant leur valeur
aux choses?
Il n'y a donc pas un mais deux obstacles la prtention touristique
l'universel: la diversit des gots et des couleurs, mais aussi l'hypothse
d'une pluralit de modles de valorisation.
Si le ngoce peut prtendre l'universalit - par del toutes sortes de
subtilits mtaphysiques - en louant simplement les services de la prosti-
tue universelle, ses rsultats sont la mesure de la trivialit des moyens
qu'il se donne, et le tourisme dgnre en change gnralis de curiosits,
contredisant sa prtention la comprhension. Mais l'universalit de
l'change mutuel de comprhension se heurte au constat empirique de la
pluralit des modles de valorisation, comme l'absence de convertisseur
universel (certes, concrtement, personne n'empche le touriste d'aimer le
jardin zen, mme sans le comprendre, le problme est ici tout thorique). Le
touriste, s'il ne veut pas renoncer l'universalit de la comprhension, qui
le sauve du ngoce comme de la limitation de ses apptences curiositaires,
est en droit d'affirmer au contraire que doit exister un convertisseur uni-
versel de comprhension tel que l'affirmation vous ne pouvez pas com-
prendre et le refus de la discussion qu'il implique puissent tre consid-
rs comme illgitimes, et que soit ainsi justifie l'exigence de rciprocit.
On accordera volontiers que seule la philosophie peut venir en aide
notre touriste, parce que seule cette discipline peut asseoir la lgitimit de
l'exigence de rciprocit dans l'change touristique mutuel en dmontrant
qu'existe un convertisseur universel de comprhension qui rfute la prten-
tion japonaise une valorisation par la particularit.
La philosophie prsente en effet le double avantage de ne pas avoir
besoin de validations par l'exprience, en l'espce difficiles raliser
l'chelle de la plante, et de prtendre cependant validit de
ses thses.
Le touriste occidental s'arme donc de livres et va chercher dans l'uni-
versalisme philosophique de quoi dfendre sa prtention aimer la posie
japonaise. Il n'est pas sans savoir que l'universalisme a beaucoup chang
depuis le XVIIIe sicle. Il ne confond plus navement l'universel et ses
prppres valeurs particulires, comme le faisaient les modernes, qui n'hsi-
taient pas confrer leurs valeurs, au contenu fortement marqu par leur
origine occidentale, une porte universelle en arguant pour se justifier de'
16 prouver l'universel
thses mtaphysiques non moins stigmatises par leur origine.
C'est donc en toute connaissance de cause que le touriste se tourne
pour dfendre sa cause vers le relev contemporain de l'uni versalisme
. .
devenu - travers la critique de la modernit - procdural et communi-
cationnel.
La question que la philosophie doit rsoudre est la suivante: existe-t-iI
un convertisseur universel qui permette l'change mutuel de comprhen-
sion?
De la comprhension, on peut retenir la dfinition ci-dessous:
Accder une comprhension humaine d'autrui [... ] implique d'tre
capable d'appliquer ce que j'aimerais appeler (en suivant Elizabeth
Anscombe) les " caractres de dsidrabilit" (desirability characteri-
sation) qui dfinissent son monde. Je parviens comprendre quelqu'un
lorsque je comprends ses motions, ses aspirations, ce qu'il trouve
admirable ou condamnable chez lui et chez les autres, ce qui l'attire ou
ce qui lui rpugne, etc. 20
Cette dfinition n'inclut pas seulement les valeurs esthtiques concer-
nes par l'anecdote de Philippe Pons, mais l'ensemble des valeurs qui per-
mettent une communaut humaine de se dfinir. Il convient aussi de dis-
tinguer soigneusement le ngoce du commerce communicationel, seul le
premier tant marchand et pouvant donc avoir recours l'argent comme
convertisseur. Le second renvoie un autre sens du mot commerce, celui
d'change mutuel d'opinions, c'est--dire de communication. Au sein
mme du commerce communicationnel, il convient encore de distinguer
l'change communicationnel en gnral, et sa spcialisation en change
mutuel en vue de la comprhellsion, qui seul intresse notre touriste.
Introduction 17
NOTES
1Stendhal, Mmoires d'un touriste (1838), in Voyages en France, Paris, Gallimard,
1992, p. 3.
2 Stendhal, Voyage en France, in Voyages en France, op. cit., p. 533.
3 Stendhal, Mmoires ... op. cit., p. 144.
4 Stendhal, Voyage... op. cit., p. 513.
5 mile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-europennes, Paris,
Minuit, 1969, T. l, p. 145.
6 V. dei Litto, Introduction Stendhal, Voyage en France, op. cit., p. XXXIV
7 . Benveniste, Vocabulaire... , op.cit., p. 142 et 143.
8 Guillaume Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des tablissemens
et du commerce des Europens dans les deux-I!ldes, Genve, J.-L. Pellet, 1780
~ ~ m dition), T. I, p. 1 et 2.
E. Benveniste, Vocabulaire ... , op. cit., p. 144.
10 G.-T. Raynal, Histoire ... , op. cit., p. 2
Il Ibid.
12 Sur le sens moderne du mot intrt, cf. Albert. O. Hirschman, Les Passions et
les Intrts - Justifications politiques du capitalisme avant son apoge, trad. P.
Andler, Paris, PUF, 1980 (1977).
13 [Les philosophes] ont toujours du loisir et conversent ensemble en paix tout
leur aise. Ils font comme nous qui venons de passer pour la troisime fois d'un
propos un autre, lorsque le propos qui survient leur plat, comme nous, plus que
celui qui est sur le tapis. Que la discussion soit longue ou brve, que leur importe,
pourvu qu'ils atteignent le vrai? Les autres au contraire n'ont jamais de temps
perdre, quand ils parlent. Presss par l'eau qui coule, ils ne peuvent parler de ce
qu'ils voudraient Platon, Thtte, 172 d, trad. . Chambry, Paris, GF
Flammarion, 1967, p. 107- 108. Sur ce texte, on lira la stimulante anti-philosophie
de Pierre Bourdieu, Mditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997.
14 Stendhal, Voyage en France, op. cit., p. 518.
15 Bash (1644-1694) est considr comme un des plus grands auteurs de posie
classique (le Haku). Ses uvres sont disponibles en franais, en particulier: le
Haka selon Bash, Paris, Presses Orientalistes de France, 1976, et Les sept livres
de l'cole de Bash, trad. R. Sieffert, Paris, POF, 1986.
16 Philippe Pons, Le Japon, Point Seuil, 1981, rdition 1988, p. 203.
17 Ibid., p. 203.
18 Karl Marx Manuscrits de 44, in Philosophie, Trad. M. Rubel, Folio, Gallimard,
1968, p. 189 et 191. Marx s'inspire de la tirade de Timon: [ ... ] ce jaune esclave
va reserrer et dissoudre les religions, bnir les maudits, faire adorer la lpre
blanche, donner des places aux voleurs, les faire asseoir parmi les snateurs, avec
titres, gnuflexions et louanges: c'est lui qui fait se remarier la veuve moisie, et qui
parfume et embaume comme un mois d'avril celle devant laquelle rendrait gorge
l'hpital et les ulcres en personne. Allons fange damne, putain commune tout
le genre humain, qui sme les dissensions parmi la multitude des nations, je vais te
faire travailler selon ta nature. [... ] TImon d'Athnes, Acte IV, scne III, in
Shakespeare, uvres Compltes, trad. mile Montgut, Paris, Hachette, 1870, T.
III, p. 96.
19 GT. Raynal, Histoire ... , op. cit., p. 2.
20 Charles Taylor, Comprhension et ethnocentrisme (1983), in La libert des
Modernes, trad. Philippe de Lara, Paris, PUF, 1997, p. 199.
CHAPITRE 1
FRANKFURT
ou
l'Universel et ses prtentions
Le touriste n'a aucune difficult trouver cette dernire distinction
dans la philosophie universaliste contemporaine, puisque c'est son point de
dpart. Ainsi, parcourant l'uvre d'un de ses reprsentants les plus mi-
nents, le philosophe allemand Jrgen Habermas, il peut lire:
Les interactions sociales sont plus ou moins coopratives et
stables, plus ou moins conflictuelles ou instables. [... ] [D]ans le cas
o les acteurs s'orientent exclusivement vers le succs, autrement dit
lorsqu'ils se concentrent exclusivement sur les consquences de
leurs actions, ils essayent de parvenir aux fins qui o t v ~ n t leur
action, en influant pour ce faire, - par des moyens extrieurs, usant
de la " carotte et du bton ", de menaces ou de promesses sdui-
santes - sur les termes qui dfinissent la situation et, en l' occur-
rence, sur les dcisions ou les motifs de son vis--vis. A cela j'op-
poserais ce que j'appelle " l'activit communicationnelle " qui se
produit lorsque les acteurs acceptent d'accorder leurs projets d' ac-
tion de l'intrieur et de ne tendre vers leurs buts respectifs qu' la
seule condition qu'une entente sur la situation et les conditions
escomptes existe ou puisse tre mnage [... ]. Cette entente ne peut
pas tre impose l'autre partie, pas plus qu'elle ne peut tre extor-
que au partenaire par une quelconque manipulation ; [... ] Celle-ci
repose constamment sur des convictions communes. 1
C'est tout fait dans cette direction que le touriste souhaite chercher.
La comprhension des valeurs du prtendu domaine rserv du Japon
n'est en aucun cas une activit stratgique , comme le commerce mar-
chand par exemple, c'est bien une activit oriente vers l'intercomprhen-
sion, dont la finalit est la ralisation d'une entente, qui permet toute sorte
d'actions conjointes, commencer par celle du plaisir partag jusqu' l'or-
ganisation de sminaires de littrature compare.
L'activit communicationnelle est donc une espce du genre com-
merce coordonne par des actes de langages orients vers la ralisation de
l'entente selon le modle de l'intercomprhension qui suppose que les
parties prenantes de l'interaction s'accordent sur la validit de leurs expres-
20 prouver l'universel
sions 2. Un commerce qui s'est arrach des finalits stratgiques du ngo-
ce et rinstalle en son sein mme la tension entre skholia et askholia.
Peut-on trouver dans ce commerce la preuve de
l'existence de ce convertisseur universel qui assurerait l'universalit des
changes mutuels en vue de la comprhension ?
Si oui, la preuve doit tre dans l'administration de la preuve. Le
Japonais typique rechigne discuter de Bash, mais pas de philosophie;
cette dernire n'appartient pas au domaine rserv . Il doit donc tre pos-
sible, c'est d'ailleurs le sens de l'appel la rciprocit de Philippe Pons, de
le convaincre d'accepter l'change de comprhension mutuelle quant aux
valeurs du domaine rserv et le Japonais, une fois convaincu, ne pour-
ra nier que l'entente est universellement possible, puisqu'il aura t
convaincu. Si le touriste parvient prouver l'existence d'un convertisseur
universel qui permet l'change mutuel en vue de la comprhension, c'est
qu'il est possible de s'entendre aussi sur la preuve et sa dmonstration.
Le touriste considrera donc, avec raison, que le Japonais typique est
de bonne foi et qu'il est dispos entrer dans une discussion philosophique.
Au terme de cette discussion, il sera admis qu'un convertisseur universel de
comprhension existe bien si la preuve en a t administre et si cette preu-
ve est recevable du point de vue du Japonais. Influenc par la lecture de
Habermas, le touriste propose son interlocuteur d'organiser la dispute en
plusieurs manches . Dans la premire, le touriste fera tat des preuves
avances par l'universalisme pour prouver l'existence de l'entremetteur
recherch. Dans la seconde, il s'attachera prouver qu'il n'est pas possible
de nier la dmonstration effectue dans la premire. La troisime valuera
les rsultats des deux prcdentes.
Premire manche
(U), le principe d'universalisation
Pour Habermas, dont le touriste commence par lire ses Notes pour
fonder une thique de la discussion, dans un acte de parole motiv par une
activit communicationnelle, c'est--dire qui n'est pas orient vers la rali-
sation d'un objectif stratgique, mais dont le tlos est au contraire de par-
venir une intercomprhension entre les participants en vue de l'entente,
l'entre en discussion est toujours possible. En effet:
Grce au fond de validit que suppose la communication destine
l'intercomprhension, un locuteur peut donc, en garantissant
qu'une exigence de validit critiquable sera respecte, convaincre un
Frankfurt 21
auditeur d'accepter l'acte de parole qu'il lui propose et obtenir ainsi,
en vue de la poursuite de l'interaction, un effet de "couplage" assu-
rant l'entre en communication. 3
On comprend trs bien que le touriste puisse d'ores et dj consid-
rer que la preuve est administre. N'est-il pas en train de discuter philoso-
phie avec le Japonais typique ? Cette disc'ussion ne suppose-t-elle pas
l'existence d'un fond de validit sans lequel il n'y aurait pas de discus-
sion? Ce fond de validit, qui rside dans la garantie qu'une exigence de
validit critiquable sera respecte, devrait suffire convaincre le Japonais
d'entrer en discussion, indpendamment du contenu de celle-ci, y compris,
par consquent, propos des valeurs du domaine rserv. L'argument
semble convainquant au touriste, mais de toute vidence, mme nonc
sous sa forme amicale et le moins directive possible, il n'a pas convaincu le
Japonais typique. Pourquoi?
Selon Habermas, les exigences de validit requises pour la discus-
sion en vue de l'entente supposent un principe moral conu de telle sorte
que les normes qui ne pourraient pas rencontrer l'adhsion qualifie de
toutes les personnes concernes sont considres comme non valides, et ds
lors, exclues 4. Quel peut bien tre ce principe moral commun au Japonais
et au touriste, qui est susceptible de servir de rgle argumentative princi-
pielle et de convaincre le premier? Ce doit tre un principe qui contraint
quiconque est concern adopter, suite une dlibration sur les intrts,
la perspective de tous les autres 5. Un principe imposant l'change uni-
versel des rles 6. Ce principe, Habermas l'appelle (U), le principe d'uni-
versalisation. Il prsente les qualits requises pour constituer une norme
ncessaire permettant de dgager un modle lgitime d'change entre les
personnes, voir entre les cultures, quelque chose comme un convertisseur
communicationnel universel.
On voit d'o procde le malentendu. Le touriste considre que le fait
mme d'engager la discussion administre la preuve qu'un change mutuel
en vue de l'entente est possible, puisque le fait mme de la discussion attes-
te d'un fond de validit accept par les interlocuteurs. Mais il s'avre que
ce fond de validit suppose 1' change univers.el des rles , qui contraint
quiconque est concern adopter la perspective de tous les autres , par
quoi il faut entendre la possibilit de se dcentrer par rapport ses propres
intrts, mettre en quelque sorte entre parenthses ses valeurs propres. C'est
justement ce que refuse le Japonais en revendiquant un domaine rser-
v .
Ce refus rejaillit bien sur le statut de la discussion philosophique. Il
est certain que le Japonais n'acceptera pas de se laisser convaincre en met-
22 prouver l'universel
tant ses valeurs dans sa poche, c'est--dire en adoptant le point de vue uni-
versaliste de tous les interlocuteurs la fois. Par contre, il sera certainement
convaincu de la ncessit d'abandonner son domaine rserv .par des argu-
ments acceptables du point de vue de son domaine rserv.
Paradoxalement, seuls de tels arguments sont susceptibles de lui dmontrer
qu'un tel domaine n'existe pas. Cette contrainte argumentative impose au
touriste n'est pas inacceptable du point de vue touristique, puisque produi-
re un argument satisfaisant du point de vue japonais ne signifie bien sr pas
s' y rallier entirement, ce qui reviendrait laisser partir vau-l'eau tout
universalisme. Conformment l'exigence habermasienne de mise entre
parenthses de ses valeurs, le touriste doit tre capable d'noncer des argu-
ments en faveur de l'change universel des rles comprhensibles du point
de vue japonais.
Reste que pour le moment, il n'est mme plus certain qu'on ait vrai-
ment commenc discuter. Il faut donc revenir cette entre en discus-
sion , 1' effet de couplage dont parle Habermas et qui semble plus dif-
ficile obtenir que prvu. Le touriste est universaliste et, ce titre, il se fait
fort d'obtenir l'adhsion du Japonais typique, puisque lui n'hsite pas une
seconde changer universellement les rles.
Il faut pourtant convenir que la discussion tourne en rond.
_______ __ __ses__ surmon-
ter la difficult de l'entre en discussion, ds lors que dans la situation ini-
tiale le Japonais typique ne veut pas se dpouiller de son domaine ?
Comment convaincre quelqu'un qui refuse d'accorder que la rciprocit
soit un fond de validit suffisant pour entrer en discussion, parce qu'il refu-
se d'changer les rles? La disposition du touriste universaliste l'chan-
ge rciproque ne peut pas convaincre le Japonais qui prcisment met en
doute la rciprocit: ce qui n'tait pas prvu, c'est que la difficult surgis-
se avant mme l'entre en discussion.
Il faut dissiper ce malentendu. Peut-tre le Japonais n'a-t-il pas bien
compris ce qu'on appelle change universel des rles ? Il ne s'agit pas
de contenu, mais de procdure, l'universalisme contemporain ne confond
plus du tout les valeurs de la modernit europenne et l'universel. C'est un
change. structural des rles.
Au lieu d'imposer tous les autres une maxime dont je veux qu'elle
soit universelle, je dois soumettre ma maxime tous les autres afin
d'examiner par la discussion sa prtention l'universalit. Ainsi
s'opre un glissement: le centre de gravit ne rside plus dans ce que
chacun peut souhaiter faire valoir, sans tre contredit, comme tant
une loi universelle, mais dans ce que tous peuvent unanimement
reconnatre comme une norme universelle. 7
Frankfurt 23
Le principe d'universalisation (U) n'est ~ une manire de faire
accepter par la bande un particularisme dguis en universel, puisqu'il n'a
pas de contenu. Toutes les opinions et les valeurs particulires de chaque
communaut humaine particulire sont discutables et l'entremetteur uni ver-
sel rside justement dans l'indiffrence du principe d'universalisation (U)
au contenu. Il n'est donc pas pertinent de parler de point de vue japonais,
puisque tous les participants abandonnent leur point de vue particulier pour
examiner la validit des valeurs susceptibles d'tre reconnues comme uni-
verselles. Les valeurs au nom desquelles on peut dire que la posie de Bash
est belle sont sans doute dignes d'tre reconnues universellement, tout
comme celles qui permettent de dire la mme chose propos de Baudelaire.
Du point de vue procdural des rgles de la discussion, il n'y a plus de point
de vue japonais.
La procduralisation de l'universalisme suffit-elle engager le
Japonais typique abandonner son point de vue, ou plutt l'changer avec
les autres? Sans aucun doute oui, s'il peut accepter, du point de vue japo-
nais, les prsupposs de cette procduralisation.
La distinction entre procdure et contenu ne lui pose aucun probl-
me, cette objection l ne mne d'ailleurs pas trs loin. En partisan convain-
cu de l'importance de la procdure, le Japonais typique relit avec soin la
citation qu'on lui a soumise et y dcouvre que Habermas ne parle pas des
valeurs en gnral, mais des seules valeurs qui intressent les normes d' ac-
tion, qu'il oppose aux valeurs culturelles. Le Japonais remarque aussi, c'est
un troisime prsuppos, que ces dernires sont exclues du champs de
l'thique de la discussion. La distinction entre les valeurs qui norment l' ac-
tion et celles qui norment la culture permet Habermas de faire justice au
domaine rserv du Japonais typique, d'en reconnatre l'existence et de
l'exclure de la discussion. Une telle exclusion restreint le champs de
l'thique de la discussion la seule possibilit d'agir en commun partir
d'une entente ralise par del les diffrences culturelles qui doivent juste-
ment tre mises entre parenthse pour l'occasion. La comprhension est
restreinte ce qui est requis par l'action en commun. Le touriste doit
constater au passage que le plaisir du partage de la comprhension des
valeurs culturelles ne semble pas entrer dans le champs de ces actions.
La rticence du Japonais typique s'claire : il y a bien un cot d' en-
tre - trs lev - dans la discussion habermasienne, savoir la distinc-
"tion entre valeurs esthtiques et valeurs normatives du point de vue de leur
mode de lgitimation. Les valeurs normatives sont juges lgitimes ds lors
qu'elles se soumettent victorieusement la procdure de validation de leur
prtention l'universalit, travers la discussion. Le critre de la distinc-
tion est la prtention de ces valeurs l'universalit. C'est cette prtention
24 prouver l'universel
qui conduit engager la discussion sur des normes d'action particulires
dans le but de confirmer ou infirmer leur universalit.
Pour I,e Japonais, il y a donc deux pilules avaler d'entre de jeu. La
possibilit de diffrencier le traitement des valeurs esthtiques et norma-
tives au point de les traiter sparment les unes des autres, et l'adoption de
(U) comme modle de valorisation des normes d'actions. Il semble bien
qu'il faille avoir des prtentions pour discuter. On ne voit pas en quoi notre
Japonais typique, qui ne distingue pas ses valeurs esthtiques et ses normes
d'action, qui de toute faon ne prtend l'universalit ni des unes ni des
autres, mais qui cependant fait grand cas de la valeur des unes comme des
autres, trouverait dans ces prsuppositions de quoi tre convaincu. Pour le
Japonais, la comprhension n'est pas dcoupable en morceaux.
Le touriste n'est toujours pas parvenu ses fins, mais au moins com-
prend-il un peu mieux le refus de son interlocuteur. Si le point de vue japo-
nais ne peut se confondre avec celui des participants une discussion qui
considrent qu'une opinion vaut la hauteur de sa capacit honorer sa
prtention l'universalit, il faut poser la question quelque peu vertigineu-
se : n'est-ce pas que la prtention l'universalit, comme modle de lgiti-
mation des normes d'action, n'est pas universelle?
Le symptme de ce vertige, n'est pas inconnu au touriste, il a prou-
v un jour qu'il assistait un cours de Pierre Bourdieu au Collge de
France, durant lequel ce dernier, faisant part de ses hsitations, pariait plus
qu'il ne montrait que la question pose par le Japonais typique peut tre
rapidement referme, empiriquement : Il reste poser une question que
j'hsite soulever: comment se fait-il que l'on observe peu prs univer-
sellement qu'il y a des profits se soumettre l'universel? Je crois qu'une
anthropologie compare permettrait de dire qu'il y a une reconnaissance
universelle de la reconnaissance de l'universel; que c'est un universel des
pratiques sociales de reconnatre comme valables les conduites qui ont pour
principe la soumission, mme apparente, l'universel 8.
Sans se dcourager, le touriste voit dans cette hsitation un appel
soulever la question et se replonge fbrilement dans Habermas la
recherche d'une justification de la distinction entre valeurs esthtiques et
normes d'action, qui puisse convaincre le Japonais typique.
De ces lectures, il retire de trs nombreuses affirmations de l' exis-
tence de la distinction, mais assez peu de justifications. Il lui semble cepen-
dant que pour Habermas, il s'agit au fond de deux sortes de conversations
diffrentes. D'un ct, serait la discussion rationnelle en vue d'un agir com-
mun 'et, de l'autre, la critique esthtique qui n'a pas pour objet l'entente en
vue d'un agir commun, mais simplement l'obtention d'un assentiment
culturel gnralis 9. Le Japonais confondrait donc deux registres de l'ar-
gumentation.
Frankfurt 25
[] la diffrence des normes d'action les valeurs culturelles ne
comportent pas de prtention l'universalit. Tout au plus se portent-
elles cal'ldidates, pour des interprtations l'aide desquelles un
cercle d'intress peut, le cas C/lant, dcrire un intrt commun et
en faire un nonne [... ]. [L]a fonction propre des raisons produites
dans ce contexte [la critique esthtique] est de rendre compte d'une
uvre ou d'une de telle manire qu'elle puisse tre per-
ue comme l'authentique expression d'une exprience exemplaire,
en un mot d'une prtention l'authenticit. 10
Dcidment, le touriste n'avance gure: faire passer une distinction
que le Japonais typique ne fait pas l'aide d'une diffrenciation entre des
prtentions qu'il n'a pas non plus, voil qui n'arrange gure les choses ... Il
a au contraire tout perdre en entrant dans la discussion habermasienne qui
veut bien lui reconnatre un domaine rserv , mais la double condition
de ne le peupler que de culture et de normes validit restreinte, soumises
aux normes d'action qui prtendent valablement l'universalit.
Le touriste non plus n'y trouve pas son compte, puisqu'il devrait
admettre que le domaine rserv - limit aux valeurs culturelles - peut
chapper sa comprhension. Quant au convertisseur universel qu'est le
principe d'universalisation (U) propos par Habermas, sa garantie ne per-
met pas d'assurer l'entre en discussion, puisque le Japonais typique non
seulement ne peut accepter les distinctions qui prtendent imposer le cadre
de la discussion, mais de toute faon a tout perdre en les acceptant.
Le touriste retient donc de cette manche qu'il n'est pas possible
de revendiquer l'universalit du principe d'universalisation (U) comme
garantie d'un fond de validit critiquable de l'change communicationnel
en vue de la comprhension parce que le champ de validit du principe
d'universalisation (U) suppose un traitement diffrenci de la comprhen-
sion en vue de l'action et de la comprhension en vue du partage esthtique,
ce qui revient considrer que l'activit esthtique n'entre pas dans le
champ des actions communes, c'est--dire rduire l'activit esthtique
une conception trs dcharne de la cration artistique. Il retient de surcrot
que mme pour ce qui concerne les seules normes d'actions, si tant est
qu'elles puissent "tre distingues des autres, l'argument habermasien ne
permet pas l'entre en discussion, puisque le principe d'universalisation (U)
est solidaire de la prtention l'universalit des opinions candidates la
lgitimation qui sont discutes, mais que cette prtention elle-mme n'est
peut-tre pas ul1iverselle.
26 prouver l'universel
A ce point de la dispute, il reste au touriste chercher revenir en
de de cette difficult et montrer au Japonais typique qu'il n'est pas pos-
sible de tenir la position qu'il.tient, qu'un tel refus d'entrer en discussion
n'est pas srieux.
Seconde manche
Le refus de la discussion est-il srieux ?
Le commerce communicationnel ne suppose pas un ensemble de
valeurs universelles, mais un ensemble de rgles procdurales d'universali-
sation de valeurs qui prtendent l'universalit. Mais il serait naf de pen-
ser que les actes mentaux qui permettent l'universalisation de toutes les
valeurs sont inns. Au vrai, la thorie de l'agir communicationnel ne peut
se passer d'une thorie de l'apprentissage, c'est--dire d'une thorie psy-
chologique du dveloppement moral. Le touriste dcouvre que c'est
Kohlberg qui la fournit Habermas
ll
. D'aprs un commentateur:
[D]ans le prolongement du Piaget du Jugement moral chez l'enfant,
[Kohlberg] a tent de prouver l'existence de stades de dveloppe-
ment ncessaires et universels (reprables dans toutes les cultures) de
la pense morale. Selon lui, partout et ges identiques, on va de
l'absence de rgles au respect conformiste de celles-ci, puis, de l,
une thique dontologique galitariste, fonde sur le respect des per-
sonnes et " post-conventionnelle " (c'est--dire capable de distance
critique l'gard des coutumes et des pratiques de la socit existan-
te). 12
Pour parvenir la conscience et l'usage du principe d'universali-
sation (U), il faut donc tre capable de pratiquer l'change idal des rles,
c'est--dire tout simplement de se mettre la place de son interlocuteur, ce
que Kohlberg appelle la Rgle d'Or concrte 13. Si notre Japonais typique
possde ce degr d'ducation, il doit pouvoir comprendre la proposition qui
lui est faite comme fonde sur le principe de rciprocit empirique. Le refus
de l'change des rles n'est pas acceptable parce qu'il doit tre possible
un adulte duqu de le pratiquer. La question se pose donc, le Japonais est-
il un adolescent mal lev '1
Frankfurt
Le Japonais est-il un adolescent mal lev ?
27
Pour comprendre le sens du principe d'universalisation (U), il faut
tre capable d'adopter le point de vue thique universel, que toute l'hu-
manit devrait respecter 14. Pour cela il est ncessaire de distancier la
socit concrte 15 tout en tant capable d'examiner la validit des
normes existantes 16. L'adoption de ce point de vue moral n'est ni plus ni
moins un dcentrement qui se produit dans la comprhension du
monde 17 ce dcentrement prsuppose par consquent, la diffrenciation
des manires de se rfrer au monde, celle des exigences de validit et celle
des attitudes fondamentales 18. Une telle diffrenciation conduit sparer
le monde vcu du monde social d'une part et le monde social du monde
objectif d'autre part. L'apprentissage de la morale est un cheminement vers
l'objectivit.
Or, selon Kohlberg et Habermas tout ce processus d'apprentissage
devrait, en gnral, tre termin vers quinze ans.
Ou bien donc notre Japonais typique est un adolescent mal lev,
auquel cas il convient de lui apprendre universaliser son point de vue en
abandonnant la perspective de son seul monde vcu pour adopter celle du
monde objectif, ou bien il faut admettre qu'il peut mais ne veut pas recon-
natre le principe d'universalisation (U) comme universel.
Dans le premier cas, il s'expose une leon de morale. Mais le tou-
riste hsite s'engager dans cette voie; il est touriste, en effet, pas pros-
lyte, et c'est la raison pour laquelle il a choisi de dfendre une version
contemporaine et critique de l'universalisme.
Dans le second cas, ce n'est pas en qualifiant l'attitude du Japonais
d'infantile que le touriste parviendra le convaincre, l o les arguments
prcdents n'y sont pas parvenus.
Il faut donc formuler une nouvelle hypothse. Le touriste se tourne
alors vers le second cas de refus de la discussion envisag par Habermas, le
cas du sceptique.
Le Japonais est-il sceptique ?
Habermas a livr dispute avec le scepticisme dans les Notes pour
fonder une thique de la discussiolt
19
D'aprs la premire objection sceptique, on se servirait [du princi-
pe d'universalisation (U)] pour procder une gnralisation htive des
intuitions ,morales de notre propre culture occidentale. 20
On voit bien que cet argument est moins fort que ceux qu'implique
28 prouver l'universel
l'attitude du Japonais typique, et qu'il ne convient pas la situation: il ne
remet pas en cause l'universalit du principe d'universalisation (U), mais
son usage. Une critique classique de l'idologie somme, qui met le doigt
sur les impostures possibles commises au nom de ce principe. Mais il est
facile de rpondre que d'aucuns ont bien pu essayer de faire passer en
contrebande le contenu particulier de certains noncs sous une forme uni-
verselle, cela n'invalide en rien l'universalit de la forme elle-mme, celle
de la procdure d'nonciation. C'est la rponse de Habermas: comme il est
question dans la thorie de l'agir communicationnel de procdures for-
melles qui recouvrent en fait tout ce qui est ncessaire une recherche
cooprative de la vrit, organise sous la forme de comptition, telle par
exemple, la reconnaissance de la comptence et de la bonne foi de tous les
participants 21; pour nier cette universalit-l, il faudrait douter que l'uni-
versalit des rgles formelles de la pratique du langage suffise assurer
l'inter-comprhension, en s'inspirant par exemple de l'argument des lions
de Ludwig Wittgenstein. D'aprs cet argument, mme si les lions pouvaient
parler, nous ne pourrions les comprendre, parce que la comprhension sup-
pose que l'on ne partage pas seulement un langage.
22
Habermas n'envisage
pas cette hypothse et s'autorise une premire victoire, qu'on peut trouver
trop facile, dans la discussion du scepticisme. Pour facile qu'elle soit, elle
doit suffire au touriste, puisqu'il est certain que le Japonais typique n'est en
rien assimilable un lion et qu'en acceptant la discussion philosophique
prsente (et mme ds qu'il a rpondu vous ne pouvez pas comprendre ),
il s'est interdit de recourir l'argument des lions wittgensteiniens.
En somme, le sceptique de Habermas commence par se tromper
d'universalisme, il en reste au rejet de celui, navement eurocentr, que cri-
tique prcisment la thorie de l'agir communicationnel. Dans cette pre-
mire bataille, Habermas ne s'est pas donn trop de mal pour l' emporter
23
On peut mme conjecturer que notre Japonais est fru de sciences
exactes et considre srement, au mme titre que ses collgues scientifiques
occidentaux, que nier l'universalit des noncs qui parviennent dfendre
leur prtention l'universalit selon les rgles qu'impose la scientificit de
la procdure, est un non-sens. Le Japonais admet aussi volontiers qu'il n'est
pas possible d'affirmer qu'une vrit et sa justification sont la fois rela-
tives une culture, un discours et absolues par rapport ceux-ci. Cette
position ne demande aucun ralliement la position universaliste du com-
merce communicationnel, puisqu'on peut prcisment la dduire de l' argu-
ment du langage priv de Wittgenstein, dont on sait qu'il n'est pas prcis-
ment universaliste
24
Si l'on en croit Hillary Putnam, cet argument est un
excellent argument contre le relativisme en gnral parce qu'il montre
que le relativiste ne peut pas, au bout du compte, donner un sens la dis-
Frankfurt 29
tinction entre avoir raison et penser qu'on a raison, et cela veut dire qu'il
n'y a aucune diffrence entre, d'une part, le fait d'affirmer quelque chose et
de penser, et, d'autre part le fait d'mettre des bruits (ou de produire des
inlages mentales) ; mais une telle critique du relativisme ne suggre en
elle mme aucun ralliement quelque universalisme moral que ce soit
puisque distinguer avoir raison et penser qu'on a raison ne requiert rien
d'autre que l'examen des facteurs qui font qu'il est rationnellement accep-
table de dire que quelque chose est vrai 25. Le Japonais pense donc que la
prtention des scientifiques produire des noncs universellement vrais
est lgitime. Mais il pense aussi que cette question, qui est celle de l' objec-
tivit des noncs scientifiques, est sans rapport avec le dfi lanc par le
touriste.
Ce que Habermas lui-mme accorde, avec d'autant plus d'empresse-
ment qu'il joue l'existence mme de la philosophie morale face la psy-
chologie: le dernier niveau de dveloppement moral, le stade post-conven-
tionnel, n'est pas un stade de dveloppement naturel : les valeurs ne sont
pas susceptibles de devenir des objets pour les sciences de la nature, et l' ob-
jectivit en la matire ne peut tre celle de la rationalit cognitive.
Je partage avec Kohlberg la conception selon laquelle les
approches cognitivistes issues de la tradition piagtienne ncessitent
un tat final de l'apprentissage, caractris normati vernent ; en oppo-
sition avec lui, je ne vois cependant pas pourquoi le stade moral le
plus lev devrait tre conu, l'image des stades 1 4, comme un
stade naturel. 26
Ainsi, les question morales, ne se laissent dcider que dans le
champs de l'argumentation philosophique, mais non dans celui de la psy-
cllulugie du dveloppement .27 En d'autres termes, la rationalit cognitive
est peut-tre universelle, elle ne peut cependant fournir le convertisseur uni-
versel recherch qu'au prix d'une hypostase difficile admettre, dans
laquelle Habermas voit l'essence du scientisme. Ayant constat l'accord de
Habermas sur ce point, il ne reste plus au touriste qu' remarquer que la cri-
tique du sceptisme tombe plat et qu'il n'est pas possible de faire monter
l'universalit de la rationalit cognitive au secours de l'universalit mena-
ce de la rationalit communicationnelle.
Le touriste fait donc le choix de se consacrer 'la question de l'uni-
versalit de la rationalit communicationnelle ; une fois encore, les pre-
mires pages de la Thorie de l'agir communicationnellui sont d'un grand
secours et, prcisment, le philosophe y fait appel aux sciences sociales, en
particulier l'anthropologie culturelle, et plus prcis.ment aux travaux de
30 prouver l'universel
l'anthropologue Evans-Pritchard
28
Sauf rabattre les sciences sociales sur
celles de la nature, dont on a vu qu'elles ne peuvent receler le convertisseur
recherch, le touriste introduit bien quelque chose de
dans la discussion.
Dans ces pages, il est question des Azande, une tribu africaine. Les
Azande sont animistes et ce titre croient dans la sorcellerie. Evans-
Pritchard fait remarquer que les Azande peuvent bien, en recourant leur
croyance dans la sorcellerie, expliquer les contradictions patentes, par
exemple entre deux prsages, ou entre une prdiction de l'oracle et l' v-
nement qui se produit, mais que cette capacit d'explication est nanmoins
limite. 29 En effet, Evans-Pritchard ne laisse subsister aucun doute sur
le fait que les Azande eux-mmes se sentent embarrasss par ces absurdits
inluctables, ds lors qu'ils s'engagent sous un contrle serr de leur
consistance, comme le pratique l'anthropologue 30. En consquence, ils
s' y drobent 31. De mme que le Japonais typique refuse l'examen ration-
nel des valeurs qu'il considre comme faisant partie d'un domaine rserv
incomprhensible aux trangers. Le touriste doit donc poser la question:
n'est-ce pas un reste de primitivisme qui dtermine l'attitude anti-commu-
nicationnelle des Japonais ?
Le Japonais est-il primitif ?
Habermas est un uni versaliste tout fait contemporain, et sa critique
des navets de ses prdcesseurs le place au-dessus tout soupon. C'est
pourquoi il accorde que les socits tribales primitives sont en pril1cipe
capables de produire les mmes oprations fonnelles que les ressortissants
des socits modernes 32; c'est d'ailleurs la condition pour que son princi-
pe d'universalisation (U) soit empiriquement universel, comme il le reven-
dique. [E]ncore que, ajoute-t-il cependant, dans les socits primitives les
comptences de stade suprieur se manifestent moins frquemment et plus
slectivement c'est--dire qu'elles sont employs dans des domaines plus
restreints de la vie 33.
La socit japonaise serait-elle l'image du monde azande ? Elle
reclerait bien sr, comme tous les actes communicationnels socialiss les
actes de langage requis pour affirmer que le principe d'universalisation (U)
est universel, manifestant cependant un stade infrieur de comptence qui
interdirait, ou du moins rendrait beaucoup plus difficile, aux mmes
membres de cette socit de formaliser ce qu'ils font, ou plutt ce qu'ils
disent?
Notre Japonais ne serait certes pas incapable au sens strict de rali-
Frankfurt 31
ser les formalisations ncessaires la dcouverte du principe d'universali-
sation (U), mais ses comptences se manifesteraient moins frquemment et
plus slectivement que chez notre touriste, ce qui expliquerait la difficult
prouve par ce dernier le convaincre de leur universalit. C'est donc de
nouveau par une thorie des stades de dveloppement, non plus cette fois
au niveau individuel, mais l'chelle des communauts humaines, que le
touriste va chercher convaincre le Japonais typique d'accepter les garan-
ties qui rendent universellement acceptable l'entre en discussion. Cet argu-
ment est celui de la modernisation des mondes vcus.
Le Japonais est-il la fois primitif et mal lev ?
Il s'agit donc de l'application de certains rsultats tirs de la psycho-
logie du dveloppement de l'enfant un schma d'anthropologie volu-
tionniste: o l'on retrouve ce qu'il faut bien appeler de la psychologie des
peuples, qui ne se distingue de celle qu'on avait carte lors de la prsenta-
tion de l'anecdote initiale que par les efforts qu'elle consent produire pour
masquer sa navet... L'accusation peut paratre grave. La psychologie des
peuples est considre avec raison comme une discipline idologique inca-
pable de convaincre de sa scientificit et trop implique dans la lgitimation
de l'expansion coloniale pour servir de base une thorie srieuse. On sait
d'ailleurs les ravages que de telles idologies ont pu produire dans le cadre
d'un schma tlologique: si les primitifs sont des enfants, il convient d'ac-
tualiser leurs comptences virtuelles travers un processus d'apprentissage
dans lequel c'est l'adulte occidental qui jouera le rle du matre civilisateur.
Qu'on en soit conscient ou non, la hirarchisation des peuples selon leur
rationalit ne peut qu'tre associe la lgitimation de rapports de domina-
tion entre peuples suprieurs et infrieurs . Dans le sens courant du
terme, c'est ce qu'on appelle du racisme.
C'est la raison pour laquelle il ne devrait pas tre possible de trouver
de tels arguments dans un relev contemporain et critique de l'universalis-
me. Pourtant, c'est dans le tome II de la Thorie de l'agir communication-
nel, la page 190, que le touriste prend connaissance des remarques sui-
vantes, qui forment un commentaire de la thorie des stades moraux de
dveloppement de l'enfant :
Comme on le sait, Kohlberg distingue trois niveaux de consci.ence
morale: le niveau pr-conventionnel o seules les consquences de
l'action sont juges la lumire des principes, le niveau convention-
nel, o le sont l'orientation partir de normes et l'atteinte aux
32 prouver l'universel
normes, et enfin le niveau post-conventionnel, o les normes elles-
mmes le sont partir des principes. 34
Il va sans dire qu'un relev contemporain de l'universalisme ne peut
que refuser comme non critiques et brutalement idologiques les mta-
phores de l'enfance, comme celles de l'animalit pour rendre compte de la
diversit des socits humaines. II ne doit pas pouvoir tre question d'ap-
pliql-ler aux pel-lples la tllorie des stades psychologiql-les du dveloppement
moral. Et pourtant, le touriste doit bien reconnatre que c'est sous la plume
de Habermas qu'il trouve la citation suivante: K. Eder a dmontr l'exis-
tence de structures de conscience homologues pour le dveloppement de la
morale et du droit dans les socits archaques, traditionnelles et
modernes. Choqu par ce a dmontr qui avalise l'ide qu'on peut
considrer les socits non modernes, i.e. non europennes, comme puriles
ou adolescentes, le touriste attend une critique, une remarque ironique, au
moins une distance qui, hlas., ne viendra pas. La seule glose est la suivan-
te : Et comme nous l'avons vu, W. Schluchter a interprt dans ces pers-
pectives les typologies juridiques que Max Weber appuyait sur l'histoire. Je
me contente d'en redonner le schma. 35 Il n'est donc malheureusement pas
tout fait impossible d'attribuer Habermas l'opinion selon laquelle, du
point de vue moral, les Azande sont des enfants et les Japonais des adoles-
cents, puisqu'il se contente d'exposer des rsultats qu'il considre comme
dmontrs.
Il n'est donc pas possible non plus, la lecture de la Thorie de l'agir
communicationnel, de laver la thorie de Habermas du soupon de replier
l'volutionnisme psychologique sur l'volutionnisme anthropologique,
selon une de ces bonnes vieilles mthodes qui ont si profondment discr-
dit l'anthropologie pr-scientifique
36
Le touriste est un peu dsempar. Pour tout dire, il n'en revient pas
d'avoir trouv de telles choses chez un philosophe connu pour avoir consa-
cr son uvre la critique de l'idologie. Est-il possible de considrer
srieusement que notre Japonais typique se tait parce que le Japon est une
socit moralement sous-dveloppe, que collectivement, de mme que des
adolescents mal levs au niveau individuel, les Japonais ne sont pas
capables de jugements moraux fonds sur des principes universels?
Chez Habermas la capacit des primitifs produire des oprations
formelles tarit mettre en regard de celle des ressortissants des socits
modernes , le lien entre modernit et rationalit est constitutif puisque la
modernisation est un processus historique de rationalisation des mondes
vcus. Or, par un trange hasard, il se trouve que ce processus s'origine en
Occident. Les modernes sont plus rationnels que les primitifs parce que la
Frankfurt 33
modernit rationalise plus que tous les autres mondes vcus, et les premiers
modernes sont des occidentaux.
La thse selon laquelle les Japonais seraient plus intuitifs et les
Occidentaux rationnels est trs rpandue, elle court tous les mauvais rcits
de voyage depuis le XIXe sicle, comme les mauvais nihonjinron, essais
sur la particularit japonaise, genre journalistique trs pris dans l'archipel.
La plupart de ces ouvrages insistent sur une tendance, parlent le disposi-
tion, mettent l'accent sur... , mais rares sont ceux qui formalisent leurs
intuitions jusqu' se hisser au niveau de pseudo-thories anthropolo-
glques...
Reste qu'aucun anthropologue srieux, aucun sociologue digne de ce
nom ne peut crire sous le contrle de ses pairs que le Japon d'aujourd'hui
n'est pas moderne. Notre Japonais typique ne peut mme pas tre consid-
r comme la butte-tmoin d'un monde vcu traditionnel pas encore tout
fait rationalis puisque, comme le fait remarquer Philippe Pons dans
l'anecdote cite, la revendication d'un domaine rserv est une attitude
rcente, qui correspond selon lui une recherche contemporaine d' affirma-
tion identitaire et srement pas la survivance d'un stade antrieur de dve-
loppement.
Le touriste doit en convenir, l'universalisme communicationnel a
chou conVaincre le Japonais typique d'entrer en discussion. Tout au
contraire, c'est sa patience qui a t mise l'preuve ...
Ainsi, la seconde manche a convaincu le touriste qu'il n'tait pas
possible d'imputer le refus de la discussion sur ses valeurs du Japonais
typique une pathologie: infantilisme, irrationalisme, primitivisme ou une
combinaison des trois. De cette seconde manche, il faut aussi conclure que
les bonnes intentions critiques ne prservent pas de navets, qui se paient
comptant sur le terrain pratique, et qu' dfaut d'tre convaincu, le Japonais
typique a toutes les raisons de se sentir solidaire des Azande et d'tre
constern par la hirarchisation des peuples que lui proposent les thories
du dveloppement.
La situation est donc critique pour le touriste, puisque, dans ces deux
manches, il a non seulement puis les ressources argumentatives que lui
propose Habermas, mais dcouvert qu' il lui tait ncessaire de les critiquer
pour parvenir ses fins. Violant quelque peu ses origines ngociantes, il est
donc contraint d'adjoindre son titre de touriste celui de philosophe.
Je ne suis jamais sorti vainqueur d'une discussion. Je perds la partie
immanquablement. Je me laisse abattre par la puissance de conviction et
l'crasante assurance de mon interlocuteur. Et je me tais. Puis, en y repen-
sant, je me rends compte de la partialit de l'autre et je finis par m' aperce-
voir que la raison n'est pas toute entire de son ct. Mais quant on a le des-
sous dans une conversation, s'entter la poursuivre, c'est d'un inlgant!
Sans compter que l'affrontement verbal me plonge pour longtemps, autant
qu'un change de coups de poing, dans un profond ressentiment. C'est pour
cela que, tout en tremblant de colre, je me mets rire, puis je me tais. Une
foule de penses m'assaillent et, invitablement, j'en arrive boire le sak
du dsespoir.
DAZAI Osamu (1909-1948)
Les cerises, in Anthologie de nouvelles japonaises contemporaines, trad.
Yko Brunet et Isabelle Py Balibar, Paris, Gallimard, NRF, 1987, p. 337.
NOTES
1 Jrgen Habermas, Conscience morale et activit communicationnelle , in MoraLe
et communicatioll, Paris, Cerf, 1986, p. 148 et 149. Cet essai sera not CMAC par la
suite.
2 Jrgen Habermas, Thorie de l'agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, T. I,
115. Cet ouvrage sera not TAC par la suite. .
J. H., Notes pour fonder une thique de la discussion , in MoraLe et COl11munica-
tion, op. cit., p. 79. Cet essai sera not NFED par la suite.
4 1. H., NFED, p. 84.
5 1. H., NFED, p. 86.
6 1. H., NFED, p. 86.
7 J. H., NFED, p. 88 et 89.
8 Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, Paris, Seuil, 1994, p. 164. Nous soulignons l'ex-
Bression que j'hsite soulever .
J. H., TAC, T. l, p. 36.
10 Ibid.
Il Cf. J. H., CMAC.
gStphane Haber, Habermas et la sociologie, Paris, PUF, 1998, p. 102.
14 1. H., CMAC, p. 143.
15 1. H., CMAC, p. 140.
J. H., CMAC, p. 146.
16 1. H., CMAC, p. 146.
17 1. H., CMAC, p. 147.
18 .
J. H., CMAC, p. 152. .
19 Le touriste ne retient, pour la discussion prsente, que les deux dernires des six
examines.
2 1. H., NFED, p. 98.
21 1. H., NFED, p. 109.
22 Ludwig Wittgenstein, Investigations philosophiques, trad. P. Klossowski, in
Tractatus Logico-philosophicus suivi de Investigations phiLosophiques, Paris,
Gallimard, 1961, p. 356.
23 Tellement peu qu'il lui est loisible de rpondre en puisant ses arguments dans une
thorie universaliste, fondationnelle et transcendantale - celle de K.-O. Apel - qu'il
lui-mme insuffisamment critique.
Sur cet argument, Saul Kripke, RgLes et langage priv, trad. T. Marchaisse, Paris,
Seuil, 1996.
Hillary Putnam, histoire et vrit, Paris, Minuit, 1984, p. 138 et svtes.
J. Habermas, De l'Ethique de la discussion, trad. M. Hunyadi, Paris, Cerf, 1992,
51. Cet ouvrage sera not ED par la suite.
7 1. H., ED, p. 53.
28 Edward Evans-Pritchard, Sorcellerie, oracles et magie chez les Azande, Paris,
Gallimard, 1972.
Cit par 1. Habermas, TCA, T. l, p. 76.
31 Ibid.
Ibid.
32 1. H., TAC, T. l, p.61, c'est nous qui soulignons le en principe, en nous retenant
cependant d'attirer l'attention du Japonais typique sur ces deux mots, de peur qu'il se
refuse toute discussion, y compris celle en cours ...
Ibid.
35 1. H., TAC, T. II, p. 190.
J. H., TAC, T. II, p. 190.
36 Mme s'il n'est pas possible non plus de lui imputer toute la thse d'Eder, qu'il se
contente de reproduire. K. Eder, Die Entstehung staatLich organisierter
GeselLschaften, FranckfurtlMain, 1976, cit par Habermas, TAC, T. II, p. 190, note 80.
CHAPITRE II
KONIGSBERG
ou
Le problme philosophique de l'entre en communication
La premire de ces critiques de l'universalisme contemporain est
une consquence directe des rsultats prcdents. Il y a bien un problme
philosophique de l'entre en communication que Habermas ne voit pas,
mais que le touriste devenu philosophe doit prendre en charge. C'est pour
ce faire qu'il se penche une nouvelle fois sur les Notes pour fonder une
tlzique de la discussion.
Grce au fond de validit, [... ] un locuteur peut donc [... ]
convaincre un auditeur d'accepter l'acte de parole qu'il lui propose
et obtenir ainsi, en vue de la poursuite de l'interaction un effet de
" couplage " assurant l'entre en communication. 1
Pourquoi ce fond de validit permet-il de convaincre un audi-
teur ?Aucun argument n'est avanc, cela relve pour le philosophe alle-
mand de l'vidence. Or l'anecdote typique illustre expressment le contrai-
re. L'oubli de la question est lourd de consquences, comme le touriste-phi-
losophe a pu le constater dans la seconde manche, puisqu'il revient iden-
tifier les refus d'entrer en discussion des pathologies : infantilisme, irra-
tionalisme, primitivisme.
Selon Habermas, l'universalisme communicationnel est normatif, et
il est normal qu'il n'y ait pas de problme spcifique relatif l'entre en
discussion, ds lors que tous les checs raliser 1' effet de couplage
peuvent tre lus comme autant d'obstacles une action commune. Les
remdes sont varis : pour ce qui est des adolescents mal levs, ils ont
besoin d'un matre. Les primitifs doivent tre confronts une comprhen-
sion rationalise des monde vcus, c'est--dire la rationalit moderne, et
le philosophe sceptique sera battu sur le seul terrain acceptable en philoso-
phie, la discussion rationnelle. Ces trois remdes reviennent d'ailleurs au
mme : l'adulte enseigne la rationalit communicationnelle l'enfant, le
moderne confronte la vision mythique du monde une comprhension du
monde rationalise selon la rationalit communicationnelle et c'est encore
selon les rgles argumentati ves que dicte la rationalit communicationnelle
qu'est.donne l'hallali au sceptique.
38 prouver l'universel
En bref, toutes les figures du refus de la discussion se ramnent selon
Habermas un refus de la rationalit communicationnelle, un relativisme.
A trop vouloir se donner les mmes ennemis, on finit par se ressembler: en
. .
identifiant toute critique de l'universalisme communicationnel un rejet de
la rationalit en gnral, la thorie de Habermas produit les mmes effets
que le scientisme qu'il prtend critiquer. Le touriste-philosophe n'a pas de
mal trouver l'origine de cet aveuglement: tous les efforts du philosophe
allemand sont tendus vers la dfense et l'illustration de la rationalit com-
municationnelle en dehors laquelle c'est la possibilit de justifier la morale
qui s'effondrerait. Son ambition philosophique tout fait louable de sauver
la raison, parce qu'elle le conduit identifier toute remise en question de
l'universalisme une attaque contre la rationalit, le pousse confondre la
question de l'universalit des noncs scientifiques et celle du commerce
communicationnel.
Pourtant, et c'est justement tout son intrt philosophique, l' anecdo-
te typique met en scne la dissociation des deux questions. La rationalit
cognitive peut bien tre universellement valide, il en faut plus pour que le
commerce communicationnel soit universellement possible. La question de
l'entre en discussion n'est pas celle du rationalisme, et il est parfaitement
possible de refuser de discuter sans engager sa position dans le dbat rela-
tivisme/rationalisme.
Le touriste-philosophe sait dj au. moins que s'il a chou
convaincre le Japonais typique d'entrer en discussion, c'est parce qu'en
suivant Habermas de trop prs, il n'a pas encore abord la vritable diffi-
cult. Mais avant d'y venir, il lui semble bon de se demander pourquoi le
relev contemporain de l'universalisme a chou de la sorte convaincre le
Japonais de se dprendre de son domaine rserv ; pourquoi la solution
fournie la question de l'universalit du commerce communicationel,
savoir le principe d'universalisation (U) comme entremetteur universel,
n'est pas acceptable du point de vue japonais.
Invitablement, le touriste-philosophe en vient la question suivan-
te : cette nouvelle version de l'universalisme s'est-elle vritablement pur-
ge de l' eurocentrisme qui, depuis le XVIIIe sicle, polluait les versions
prcdentes? Et c'est consciencieusement qu'il se replonge dans la lecture
de Habermas, pour une troisime manche o il semble bien qu'il ait chan-
g de camp.
Konigsberg
Troisime manche
L'universalisme procdural et communicationnel
est-il eurocentr ?
39
Habermas rompant avec une conception navement anhistorique de
la raison et de la nature humaine considre la rationalit comme un proces-
sus, psychologique et social, de dveloppement. On peut ainsi distinguer
des degrs de rationalit.
Nous nommons rationnelle une personne qui interprte la nature de
ses besoins la lumire des standards culturellement en vigueur;
mais nous le faisons plus encore si elle peut adopter une attitude
rflexive l'gard des valeurs standards elles-mmes qui interpr-
tent les besoins. la diffrence des normes d'actions, les valeurs
culturelles ne comportent pas de prtention l'universalit. Tout au
plus se portent-elles candidates pour des interprtations l'aide des-
quelles un cercle d'intresss peut, le cas chant, dcrire un intrt
commun et en faire une norme. 2
Un adulte ou un moderne qui peuvent dcentrer leur comprhension
du monde, en adoptant une attitude rflexive par rapport aux valeurs cultu-
relles de leur communaut, sont donc, on l'a vu, plus encore rationnels que
les membres des socits archaques ou traditionnelles, que les adolescents
mal levs. La rationalit de cette personne ne rside pas seulement dans la
possibilit abstraite d'adopter cette attitude rflexive, mais dans son adop-
tion relle, pratique, au cours des actes communicationnels qui requirent
une telle attitude.
La validit des normes d'action, labores travers l'examen, le
contrle serr, des prtentions la validit universelle des valeurs cultu-
relles candidates, dpend donc la fois de la rationalit du contrle et de
l'adoption relle de cette attitude rflexive, plus rationnelle, par les acteurs
de la discussion eux-mmes. C'est d'ailleurs ce que dclare trs fermement
Habermas dans Droit et dmocratie:
[L]'ide de la possibilit d'honorer les prtentions la validit cri-
tiquable requiert des idalisations qui soient opres par les acteurs
de la communication eux-mmes et se trouvent du mme coup, non
plus au ciel transcendantal, mais sur le terrain du monde vcu. 3
Il n'est donc pas indiffrent de savoir comment, du point de vue
pragmatique, s'oprent ces idalisations, et en quoi consiste l'attitude
40 prouver l'universel
rflexive, rationnelle puisque c'est en dernier ressort ce niveau que l'uni-
versalisme de Habermas trouve sa justification. Il faut donc bien distinguer
deux niveaux pour reconstituer l'argument habermasien. Celui de la ratio-
nalisation des pratiques langagires spontanes travers le processus histo-
rique qu'est la modernisation et celui des pratiques langagires spontanes
elles-mmes, dont l'tude relve de la pragmatique formelle, et qui met au
jour des proprits de l'agir communicationnel qu'on peut considrer
comme indiffrentes l'histoire des communauts humaines. C'est cette
indiffrence qui assure l'universalit de fait de la thorie:
[1]1 n'existe aucune forme de vie socio-culturelle qui ne soit orga-
nise, ne serait-ce qu'implicitement, de telle sorte que l'activit com-
municationnelle ne puisse se poursuivre par des voies argumenta-
tives si rudimentaires que puissent tre les formes de l'argumenta-
tion. 4
C'est donc ce niveau qui permet d'affirmer l'universalit relle,
concrte, de la prtention l'universel comme mode de lgitimation des
valeurs. La citation prcdente voque la possibilit d'un usage exclusive-
ment implicite de ces rgles. En effet, le constat de l'anthropologie cultu-
relle est que toutes les socits humaines n'ont pas, de fait, ralis cette
explicitation. C'est le cas des Azande par exemple. L'explicitation, c'est--
dire l'adoption d'une attitude rflexive, rationnelle, qui permet aux acteurs
eux-mmes d'oprer les idalisations idoines a-t-elle une histoire ? La
rponse est videmment positive, puisque cette attitude rflexive enga-
ge tout le processus de rationalisation des mondes vcus, c'est--dire
l'mergence et le dveloppement de la modernit dans l'histoire mondiale,
processus qui est l'objet mme de la Thorie de l'qgir communicationnel
5
Ainsi, de tous temps, et comme Monsieur Jourdain, les hommes pr-
supposeraient les rgles de l'argumentation, mais c'est par la rationalisation
des images de leurs mondes vcus qu'ils sont parvenus, actualisant une
comptence sous-utilise, les formaliser et leur confrer la tche de sou-
tenir l'thique de la discussion. Ce faisant, ils sont devenus modernes,.c'est-
-dire reflexivement rationnels, comme rationnels au carr, encore plus
rationnels donc. Les rgles en elles-mmes, le principe d'universalisation
(U), la prtention l'universalit ont l'universalit de la nature, mais leur
fonctionnement dans un discours de lgitimation, lui, a bien une histoire,
celle de la modernisation.
Dans cette histoire, la formalisation de ces rgles dans une philoso-
phie morale universaliste n'est pas l'vnement le moins important. Cette
formalisation dans un systme philosophique, prtendant la validit uni-
Konigsberg 41
verselle, savoir l'thique de la discussion, est ralise par le systme
habermasien. Non pas par hasard, mais du fait que le processus de rationa-
lisation est parvenu un point de son dveloppement objectif tel qu'il
devient possible de raliser cette formalisation en un systme. En effet, pour
Habermas:
Il faudrait montrer avec ma thorie de la communication comment
le capitalisme avanc a rempli objectivement les conditions pour que
nous puissions reconnatre que l'universalit non seulement se trou-
ve dans les structures d'intelligibilit du langage, mais qu'elles se
donne mme la u t ~ mesure d'une critique qui ne peut dsormais
plus se fonder sur la philosophie de l'histoire. 6
Cette citation n'est pas tire d'un ouvrage fondamental et ne saurait
avoir l'autorit des prcdentes
7
Elle est cependant la source d'une indica-
tion trs prcieuse aux yeux du touriste-philosophe: l'histoire de la moder-
nit, i.e. l'histoire de la rationalisation des mondes vcus, a partie lie avec
l'expansion commerciale; le dveloppement du capitalisme est la condition
de possibilit historique de l'explicitation des rgles uni verselles de l' argu-
mentation, en rendant pensables les idalisations ncessaires et leur forma-
lisation ultime dans une thique de la discussion universellement valable.
Il y a donc bien une histoire du principe d'universalisation (U) com-
pris comme convertisseur universel justifiant la discussion sur les valeurs.
Cette histoire a de surcrot une origine, la mme que le capitalisme -
l'Occident. Non pas certes que des processus de rationalisation n'ait pas eu
lieu dans d'autres parties du monde, mais c'est en Europe qu'ils ont connus
le dveloppement et la puissance d'expansion qu'on leur connat, ce qui
permet Habermas, toujours la suite de Weber, de parler tout au long de
la Thorie de l'agir communicationnel de la rationalit occidelztale tout
en considrant cette rationalit comme universellement valable. Le cur de
cette rationalisation est chercher dans la rationalisation des dcisions, ou
encore dans l'adoption d'un mode rationnel de valorisation des opinions,
c'est--dire encore dans l'adoption du principe d'universalisation (U)
comme rfrence ultime de tout mode lgitime de valorisation des opinions.
Il n'a pas chapp au touriste-philosophe que Habermas s'inscrit
dans le cadre d'une critique du capitalisme, qui pour tre la condition de
possibilit de la modernisation du monde n'en est pas moins synonyme de
.bureaucratisation et de montarisation des rapports sociaux, de sorte que
l'agir communicationnel se prsente comme une rsistance la colonisa-
tion intrieure 8. Le cadre que la critique se donne elle-mme en dessine
les limites : l'absence totale de prise en compte de la colonisation extrieu-
42 prouver l'universel
re conduit accepter sans ciller que rationalit, rationalit occidentale et
modernit soient synonymes.
La prtention l'universel serait donc tout la fois la comprhension
implicite de l'Occident et ce qui assure l'universalit relle du modle de
valorisation des normes d'action selon l'thique de la discussion, et l' ind-
pendance des ~ o r s thiques par rapport toute dtermination historique
et gographique. Ainsi, Habermas crit que Nous nommons universaliste
une thique qui affirme que ce principe moral [le principe d'universalisa-
tion (U)] (ou un autre analogue) n'expriment pas seulement les intuitions
d'une culture ou d'une poque dtermines, mais vaut de faon universel-
le 9.
Le philosophe allemand peut donc affirmer, sans contradiction, et
sans recourir une conception mtaphysique de l'universel, que la prten-
tion l'universalit est la particularit de l'Occident, et le critre de validi-
t de normes valables partout et toujours. Peut-il ds lors affirmer, comme
il le fait, avoir purg l'universalisme de tout eurocentrisme ?
Non.
Il ne suffit en effet pas d'arguer de l'universalit de la nature humai-
ne, du travail ou du langage pour raliser cette purge. On pourrait rpondre
oui si l'universalisme tait une thse strictement descriptive se proccupant
exclusivement de savoir si de tous temps les hommes ont eu deux pieds sans
plumes, ont parl et travaill. Mais l'universalisme est une thse normative
de philosophie morale qui cherche faire adopter uni versellement une ou
des rgles morales au titre qu'il est lgitime qu'elles soient universellement
appliques. L'origine de leur contenu est certes un lment dterminant de
la discussion; on a vu que Habermas avait, de ce point de vue, ralis un
progrs certain sur l'eurocentrisme naf. Mais qu'en est-il de l'origine de
leurs conditions d'nonciation qui, c'est un truisme, conditionne l'origine
de leur nonciation ? Habermas est parfaitement conscient de ce que pour
purger sa thorie de tout eurocentrisme il est ncessaire que l'nonciation
des rgles universelles se fasse par les acteurs eux-mmes. Ce faisant il dis-
socie les rgles argumentatives de la rationalit universelle. Mais il doit
admettre que les conditions de cette nonciation sont imposes de l'ext-
rieur par le processus de rationalisation qu'induit l'expansion d'origine
europenne du mode de production capitaliste.
On pourrait - ce que Habermas ne fait pas puisqu'il ne voit pas le
problme - tenter de concilier les niveaux de la nature et de l'histoire, en
maintenant que mme si les conditions de l'nonciation des rgles univer-
selles viennent de l'extrieur, ce sont les acteurs eux-mmes qui les non-
cent. Il faudrait pour ce faire qu'idalement, partout o le capitalisme s'est
impos, les acteurs, spontanment, oprent la formalisation de leurs actes
Konigsberg 43
de langage. Mais a-t-on jamais entendu parler d'un cas historique concret
o auraient t dissocies les conditions de possibilit objectives de l' non-
ciation des rgles universelles (le dveloppement du mode de production
capitaliste), et l'nonciation concrte de ces rgles (le processus de rationa-
lisation des mondes vcus lui-mme) ?
C'est mme tout le contraire. Partout, l'intgration de nouveaux ter-
ritoires aux marchs capitalistes s'est accompagne d'une rationalisation
impose de l'extrieur. Existe-t-il une partie du monde o l'on pourrait dis-
socier la colonisation conomique de la colonisation scolaire pour pouvoir
asseoir une philosophie morale sur cette distinction ? D'ailleurs, les
contrles serrs que Evans-Pritchard fait subir aux Azande sans que
Habermas y voie autre chose qu'une preuve de leur irrationalit en dit assez
long sur la futilit de telles distinctions. Si les conditions objectives de
l'nonciation des rgles universelles sont imposes de l'extrieur, et il faut
ajouter par la force - aucun historien srieux ne songeant nier la violen-
ce de l'expansion coloniale et de l'ouverture de nouveaux marchs - alors
l'nonciation de ces rgles, la rflexion sur les mondes vcus et leur ratio-
nalisation est, elle aussi, impose de l'extrieur, par la force. L' attitude
rflexive des acteurs eux-mmes est devenue universelle sur fond de
conqllte. Peut-on soutenir que c'est sans incidences su:r la lgitimit des
modles de valorisation qui sont par l rendu possible?
La pense de Habermas, son systme, sont en permanente volution.
La rcente indiffrence, dcelable la lecture de Droit et d,11ocratie, pour
la problmatique de la modemit
10
, qui fut au cur de ses recherches pr-
cdentes, semble tre l'indice de cette difficult. La modernit est un
concept qui ne peut pas nier son histoire, son origine commerciale, ses
limites, non seulement temporelles mais aussi gographiques.
L'identification, constante dans la Thorie de l'agir communicationnel, de
la modernit et de la comprhension europenne
11
du monde, de cette com-
prhension et de la rationalit, condamnait d'avance son universalisme
moderne tre eurocentr. Plutt que d'affronter le risque de mettre en
question l'universalisme rel de l'thique de la discussion, il semble que le
philosophe allemand ait prfr se dbarrasser d'un concept encombrant,
charg du souvenir de ses impurets.
S'explique aussi maintenant le rle que joue la querelle de l'irratio-
nalisme dans le systme. C'est la rponse, toujours la mme, faite toute
mise en question de l'universalisme rel de la thorie. Poser la question de
la lgitimit d'un modle de valorisation n de la conqute doit revenir
sombrer dans l'irrationalisme. Le pliage de cette question sur celle de l'en-
tre en discussion permet d'occulter tout examen des conditions objectives
relles d'universalisation des rgles de l'argumentation et du principe qui
44 prouver l'universel
en constitue le cur, la prtention l'universalit de J'universel comme
rfrent ultime de toute les normes d'action.
On comprend mal qu'un tel impens ait pu subsister dans un syst-
me d'une telle ampleur. D'ailleurs, un passage du livre laisse penser que
Habermas a aperu le problme: voquant le rationalisme moderne sous sa
forme classique, celui-l mme dont il se propose de formuler une version
contemporaine, il fait tat des prsupposs de la pense d'un de ses mi-
nents reprsentants, Condorcet, et porte le jugement suivant sur son uvre:
Condorcet, enfant du XVIIIe sicle, n'a pas clarifi la porte de la
prtention universaliste qu'il pose en concevant l'unit de J'histoire
de l'humanit par rfrence une rationalit reprsente par la
science moderne. Condorcet ne doute pas que toutes les nations
" doivent se rapprocher un jour de l'tat de civilisation o sont par-
venus les peuples les plus clairs, les plus libres, les plus affranchis
de prjugs, les Franais et les Anglo-Amricains. " 12
Pour justifier cette conviction, il invoque en dfinitive le fait que la
rationalit apparue avec les sciences de la nature ne reflte pas simplement
les standards particuliers de la civilisation occidentale, mais qu'elle est
inhrente l'esprit humain en gnral 13.
On pourrait s'attendre ce que l'universalisme contemporain rali-
se cette clarification et tout le moins prenne des distances les confu-
sions nes de l'oubli de s'interroger sur la porte de la prtention univer-
saliste . Mais pour Habermas :
(C]ette prsupposition d'une raison universelle fut mise en ques-
tion d'abord par l'cole historique, et plus tard par l'anthropologie
culturelle. Elle est de nos jours un thme de controverse, comme le
montre le dbat sur la rationalit. 14
Ce dbat sur la rationalit est explicitement celui que mne
Habermas dans le mme ouvrage: il faut se rendre l'vidence, dfaut
d'une prise de distance avec l'universalisme eurocentr, le philosophe alle-
mand s' y identifie en confondant dans l'expression raison universelle
non pas un mais deux thmes de controverse, celui sur la rationalit et celui
sur l'universalit. Pour toute rponse sa mise en cause de l'eurocentrisme,
le touriste-philosophe est donc convi revenir la manche prcdente, et
rejoindre le camp des dfenseurs du rationalisme. C'est se demander qui
du philosophe occidental et du Japonais typique est celui qui refuse le plus
opinitrement de discuter de ses valeurs ...
Konigsberg 45
Mais peut-tre, se dit le touriste-philosophe, l'accusation d'eurocen-
trisme est-elle encore trop rapide. Mme s'il est avr que Habermas ne
s'est pas interrog sur le fait que la rationalisation impose violemment par
l'expansion commerciale d'origine europenne ait pu avoir des cons-
quences sur la lgitimit des processus de valorisation qu'elle entrane, cela
ne suffit pas montrer que cette origine europenne joue un rle constitutif
dans la thorie. C'est pourtant le cas, comme le touriste-philosophe pour-
suivant sa lecture doit le constater.
Selon les principes universels de sa philosophie morale, l'thique de
la discussion, une valeur est lgitimement une norme d'action si elle hono-
re sa prtention l'universalit dans une discussion rationnelle. Mais dans
les premires pages de la Thorie de l'agir communicationnel, Habermas
cherche dfinir la rationalit et part en qute des implicites de la compr-
hension occidentale du monde. Selon lui :
En nous guidant sur les emplois possibles de l'expression " ration-
nel " pour tenter d'lucider le concept de rationalit, nous devions
nous appuyer sur une prcomprhension qui se trouve ancre dans
les positions modernes de la conscience. Jusqu' prsent nous pro-
cdions de cette prsupposition nave que dans la comprhension
moderne du monde s'expriment des structures de conscience appar-
tenant un monde vcu rationalis, et rendant en principe possible
une conduite rationnelle de vie. Implicitement nous lions notre
conception occidentale du monde une prtention l'universalit. 15
Pour Habermas, l'implicite de la vision occidentale du monde est
que le concept de rationalit prsuppos par la comprhension moderne du
monde est universel et c'est sur l'hypostase de cet implicite que fleurit
l'universalisme naf, qu'il faut clarifier en discutant les arguments de
l'anthropologie culturelle. Cependant Habermas omet de remarquer un
point important. Si la comprhension occidentale du monde considre
implicitement ses valeurs comme universelles, c'est qu'il n'y a non pas un
mais deux implicites dans cette comprhension du monde : celui selon
lequel les valeurs occidentales sont universelles et celui selon lequel c'est
dans l des valeurs que rside leur lgitimit. La prtention
l'universel n'est pas seulement l'hypostase implicite de ses valeurs particu-
lires, c'est aussi celle de leur mode de lgitimation. Ou pour le dire autre-
ment, la comprhension occidentale du monde est deux fois normative, la
premire - disons navement - en confondant ses valeurs particulires et
l'universel, la seconde moins navement, mais tout aussi efficacement, en
considrant que l'universel est la rfrence ultime des processus lgitimes
46 prouver l'universel
de valorisation. Habermas ne donne l'expression prtention l'univer-
salit que le premier sens et, omettant la seconde thse implicite, choue
la critiquer. La question que Bourdieu hsitait soulever, Habermas n'h-
site pas l'ensevelir.
Ds lors, pour critiquer l'implicite de la comprhension occidentale
du monde, s'arme-t-il d'un dtour chez les primitifs:
Pour voir en quoi consiste cette prtention l'universalit [i.e. de
la rationalit occidentale, pas de la prtention l'universalit elle-
mme], il est indiqu de procder une comparaison avec la com-
prhension mythique du monde. Les mythes dans les socits
archaques sont de bons exemples de la fonction unifiante que rem-
plissent les images du monde. En mme temps, l'intrieur des tra-
ditions culturelles qui nous sont accessibles, ces mythes forment le
contraste le plus aigu avec la comprhension du monde qui domine
les socits modernes. Les images mythiques du monde sont loin de
rendre possibles les orientations rationnelles de vie, elles constituent
une antithse la comprhension moderne du monde. C'est pourquoi
dans le miroir de la pense mythique nous devrions pouvoir rendre
manifestes les prsuppositions, jusqu'ici non thmatises, de la pen-
se moderne. 16
Que voit Habermas dans ce miroir que lui tend l'anthropologie cul-
turelle ?L'irrationalit des Azande qui tombe point pour confirmer l'uni-
versalit de la rationalit occidentale et aussi la confirmation implicite que
les Azande prfrant leurs valeurs celles de Evans-Pritchard, prtendent
eux-aussi l'universel. Dcidment, l'image du miroir est parfaitement
exacte : dans ce rapport spculaire non critiqu, Habermas a navement
attribu chaque communaut humaine cette prtention l'universalit de
leurs valeurs qu'il avait dcele dans la comprhension europenne du
monde (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le principe d'universalisation
(U) est jug empiriquement universel). Il est donc lgitime d'organiser la
comptition entre les valeurs candidates, et (U) joue le rle du convertisseur
universellement valable qui rend la discussion possible.
Au dtail prs que cette prtention l'universel est une projection
implicite de la comprhension europenne du monde. Peut-tre n'est-il pas
exclu que d'autres communauts humaines partagent cet implicite, ou une
croyance quivalente. Le touriste-philosophe a entendu parler du mono-
thisme de l'Islam ou du sinocentrisme de l'Empire du Milieu. Mais aucu-
ne tude empirique, aucun argument ne vient le confirmer ou l'infirmer
sous la plume de Habermas. Hors de cette projection pourtant, la lgitimit
Konigsberg 43
de langage. Mais a-t-on jamais entendu parler d'un cas historique concret
o auraient t dissocies les conditions de possibilit objectives de l'non-
ciation des rgles universelles (le dveloppement du mode de production
capitaliste), et l'nonciation concrte de ces rgles (le processus de rationa-
lisation des mondes vcus lui-mme) ?
C'est mme tout le contraire. Partout, l'intgration de nouveaux ter-
ritoires aux marchs capitalistes s'est accompagne d'une rationalisation
impose de l'extrieur. Existe-t-il une partie du monde o l'on pourrait dis-
socier la colonisation conomique de la colonisation scolaire pour pouvoir
asseoir une philosophie morale sur cette distinction ? D'ailleurs, les
contrles serrs que Evans-Pritchard fait subir aux Azande sans que
Habermas y voie autre chose qu'une preuve de leur irrationalit en dit assez
long sur la futilit de telles distinctions. Si les conditions objectives de
l'nonciation des rgles universelles sont imposes de l'extrieur, et il faut
ajouter par la force - aucun historien srieux ne songeant nier la violen-
ce de l'expansion coloniale et de l'ouverture de nouveaux marchs - alors
l'nonciation de ces rgles, la rflexion sur les mondes vcus et leur ratio-
nalisation est, elle aussi, impose de l'extrieur, par la force. L' attitude
rflexive des acteurs eux-mmes est devenue universelle sur fond de
conql.tte. Peut-on soutenir que c'est sans incidences su:r la lgitimit des
modles de valorisation qui sont par l rendu possible?
La pense de Habermas, son systme, sont en permanente volution.
La rcente indiffrence, dcelable la lecture de Droit et d,11ocratie, pour
la problmatique de la modernit
10
, qui fut au cur de ses recherches pr-
cdentes, semble tre l'indice de cette difficult. La modernit est un
concept qui ne peut pas nier son histoire, son origine commerciale, ses
limites, non seulement temporelles mais aussi gographiques.
L'identification, constante dans la Thorie de l'agir communicationnel, de
la modernit et de la comprhension europenne
l1
du monde, de cette com-
prhension et de la rationalit, condamnait d'avance son universalisme
moderne tre eurocentr. Plutt que d'affronter le risque de mettre en
question l'universalisme rel de l'thique de la discussion, il semble que le
philosophe allemand ait prfr se dbarrasser d'un concept encombrant,
charg du souvenir de ses impurets.
S'explique aussi maintenant le rle que joue la querelle de l'irratio-
nalisme dans le systme. C'est,la rponse, toujours la mme, faite toute
mise en q.uestion de l'universalisme rel de la thorie. Poser la question de
la lgitimit d'un modle de valorisation n de la conqute doit revenir
sombrer dans l'irrationalisme. Le pliage de cette question sur celle de l'en-
tre en discussion permet d'occulter tout examen des conditions objectives
relles d'universalisation des rgles de l'argumentation et du principe qui
44 prouver l'universel
en constitue le cur, la prtention l'universalit de l'universel comme
rfrent ultime de toute les normes d'action.
On comprend mal qu'un tel impens ait pu subsister dans un syst-
me d'une telle ampleur. D'ailleurs, un passage du livre laisse penser que
Habermas a aperu le problme: voquant le rationalisme moderne sous sa
forme classique, celui-l mme dont il se propose de formuler une version
contemporaine, il fait tat des prsupposs de la pense d'un de ses mi-
nents reprsentants, Condorcet, et porte le jugement suivant sur son uvre:
Condorcet, enfant du XVIIIe sicle, n'a pas clarifi la porte de la
prtention universaliste qu'il pose en concevant l'unit de l'histoire
de l'humanit par rfrence une rationalit reprsente par la
science moderne. Condorcet ne doute pas que toutes les nations
" doivent se rapprocher un jour de l'tat de civilisation o sont par-
venus les peuples les plus clairs, les plus libres, les plus affranchis
de prjugs, les Franais et les Anglo-Amricains. " 12
Pour justifier cette conviction, il invoque en dfiniti ve le fait que la
rationalit apparue avec les sciences de la nature ne reflte pas simplement
les standards particuliers de la civilisation occidentale, mais qu'elle est
inhrente l'esprit humain en gnral 13.
On pourrait s'attendre ce que l'universalisme contemporain rali-
se cette clarification et tout le moins prenne des distances les confu-
sions nes de l'oubli de s'interroger sur la porte de la prtention univer-
saliste . Mais pour Habermas :
(C]ette prsupposition d'une raison universelle fut mise en ques-
tion d'abord par l'cole historique, et plus tard par l'anthropologie
culturelle. Elle est de rios jours un thme de controverse, comme le
montre le dbat sur la rationalit. 14
Ce dbat sur la rationalit est explicitement celui que mne
Habermas dans le mme ouvrage: il faut se rendre l'vidence, dfaut
d'une prise de distance avec l'universalisme eurocentr, le philosophe alle-
mand s' y identifie en confondant dans l'expression raison universelle
non pas un mais deux thmes de controverse, celui sur la rationalit et celui
sur l'universalit. Pour toute rponse sa mise en cause de l'eurocentrisme,
le touriste-philosophe est donc convi revenir la manche prcdente, et
rejoindre le camp des dfenseurs du rationalisme. C'est se demander qui
du philosophe occidental et du Japonais typique est celui qui refuse le plus
opinitrement de discuter de ses valeurs ...
Konigsberg 45
Mais peut-tre, se dit le touriste-philosophe, l'accusation d'eurocen-
trisme est-elle encore trop rapide. Mme s'il est avr que Habermas ne
s'est pas interrog sur le fait que la rationalisation impose violemment par
l'expansion commerciale d'origine europenne ait pu avoir des cons-
quences sur la lgitimit des processus de valorisation qu'elle entrane, cela
ne suffit pas montrer que cette origine europenne joue un rle constitutif
dans la thorie. C'est pourtant le cas, comme le touriste-philosophe pour-
suivant sa lecture doit le constater.
Selon les principes universels de sa philosophie morale, l'thique de
la discussion, une valeur est lgitimement une norme d'action si elle hono-
re sa prtention l'universalit dans une discussion rationnelle. Mais dans
les premires pages de la Thorie de l'agir communicationnel, Habermas
cherche dfinir la rationalit et part en qute des implicites de la compr-
hension occidentale du monde. Selon lui:
En nous guidant sur les emplois possibles de l'expression " ration-
nel " pour tenter d'lucider le concept de rationalit, nous devions
nous appuyer sur une prcomprhension qui se trouve ancre dans
les positions modernes de la conscience. Jusqu' prsent nous pro-
cdions de cette prsupposition nave que dans la comprhension
moderne du monde s'expriment des structures de conscience appar-
tenant un monde vcu rationalis, et rendant en principe possible
une conduite rationnelle de vie. Implicitement nous lions notre
conception occidentale du monde une prtention l'universalit. 15
Pour Habermas, l'implicite de la vision occidentale du monde est
que le concept de rationalit prsuppos par la comprhension moderne du
monde est universel et c'est sur l'hypostase de cet implicite que fleurit
l'universalisme naf, qu'il faut clarifier en discutant les argunlellts de
l'anthropologie culturelle. Cependant Habermas omet de remarquer un
point important. Si la comprhension occidentale du monde considre
implicitement ses valeurs comme universelles, c'est qu'il n'y a non pas un
mais deux implicites dans cette comprhension du monde : celui selon
lequel les valeurs occidentales sont universelles et celui selon lequel c'est
dans des valeurs que rside leur lgitimit. La prtention
l'universel n'est pas seulement l'hypostase implicite de ses valeurs particu-
lires, c'est aussi celle de leur mode de lgitimation. Ou pour le dire autre-
ment, la comprhension occidentale du monde est deux fois normative, la
premire - disons navement - en confondant ses valeurs particulires et
l'universel, la seconde moins navement, mais tout aussi efficacement, en
considrant que l'universel est la rfrence ultime des processus lgitimes
46 prouver l'universel
de valorisation. Habermas ne donne l'expression prtention l'univer-
salit que le premier sens et, omettant la seconde thse implicite, choue
la critiquer. La question que Bourdieu hsitait soulever, Habermas n'h-
site pas l'ensevelir.
Ds lors, pour critiquer l'implicite de la comprhension occidentale
du monde, s'arme-t-il d'un dtour chez les primitifs:
Pour voir en quoi consiste cette prtention l'universalit [i.e. de
la rationalit occidentale, pas de la prtention l'universalit elle-
mme], il est indiqu de procder une comparaison avec la com-
prhension mythique du monde. Les mythes dans les socits
archaques sont de bons exemples de la fonction unifiante que rem-
plissent les images du monde. En mme temps, l'intrieur des tra-
ditions culturelles qui nous sont accessibles, ces mythes forment le
contraste le plus aigu avec la comprhension du monde qui domine
les socits modernes. Les images mythiques du monde sont loin de
rendre possibles les orientations rationnelles de vie, elles constituent
une antithse la comprhension moderne du monde. C'est pourquoi
dans le miroir de la pense mythique nous devrions pouvoir rendre
manifestes les prsuppositions, jusqu'ici non thmatises, de la pen-
se moderne. 16
Que voit Habermas dans ce miroir que lui tend l'anthropologie cul-
turelle ? L'irrationalit des Azande qui tombe point pour confirmer l'uni-
versalit de la rationalit occidentale et aussi la confirmation implicite que
les Azande prfrant leurs valeurs celles de Evans-Pritchard, prtendent
eux-aussi l'universel. Dcidment, l'image du miroir est parfaitement
exacte : dans ce rapport spculaire non critiqu, Habermas a navement
attribu chaque COl11111ul1aut Ilul11aitle cette l'uni versalit de
leurs valeurs qu'il avait dcele dans la comprhension europenne du
monde (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le principe d'universalisation
(U) est jug empiriquement universel). Il est donc lgitime d'organiser la
comptition entre les valeurs candidates, et (U) joue le rle du convertisseur
universellement valable qui rend la discussion possible.
Au dtail prs que cette prtention l'universel est une projection
implicite de la comprhension europenne du monde. Peut-tre n'est-il pas
exclu que d'autres communauts humaines partagent cet implicite, ou une
croyance quivalente. Le touriste-philosophe a entendu parler du mono-
thisme de l'Islam ou du sinocentrisme de l'Empire du Milieu. Mais aucu-
ne tude empirique, aucun argument ne vient le confirmer ou l'infirmer
sous la plume de Habermas. Hors de cette projection pourtant, la lgitimit
Konigsberg 47
de l'universalisation du processus de lgitimation des valeurs par l' argu-
mentation est suspendue dans le vide.
En matire d' eurocentrisme, la crainte trop forte de devoir renoncer
l'universalit de la rationalit, comprise - avec raison pense le touriste-
philosophe - comme un acquis fondamental de la modernit, a conduit
Habermas confondre la querelle du rationalisme et celle de l'entre en dis-
cussion ; cette confusion lui interdit de purger son universalisme d'un euro-
centrisme qu'il sait pourtant hrit de Condorcet et l'empche de mener
bien sa critique de l'implicite de la comprhension occidentale du monde en
projetant unilatralement un lment dterminant de celle-ci, la prtention
l'universalit comme modle de lgitimation des valeurs, sur la vision du
monde de chaque communaut humaine. C'est cette seule condition qu'il
lui est possible d'affirmer que le principe d'universalisation (U) est une loi
universelle de l'argumentation en vue de l'entente. Habermas n'imagine en
effet pas de meilleur processus de lgitimation des normes que de tester leur
prtention l'universalit, parce que les modles de valorisation qui ne font
pas intervenir (U) sont jugs par lui moins lgitimes.
Le touriste-philosophe doit en conclure que c'est de l'intrieur, et
trs profondment, que l'eurocentrisme mine l'universalisme procdural et
communicationnel. Le refus de la discussion est autant dans la revendica-
tion d'un domaine rserv par le Japonais typique que dans le refus de
considrer l'entre en discussion comme un problme philosophique ou,
pour le dire autrement, dans le fait d'imposer a priori, unilatralement et
sans justification, la prtention occidentale la valorisation par l'universel-
le.
Les rticences du Japonais typique entrer en discussion s'clairent
d'un jour nouveau. Non seulement l'universalisme communicationnel est
incapable de lui fournir un motif rationnel suffisant pour se dfaire de son
domaine rserv dans l'change universel des rles, puisqu'il lui faudrait
trier ses valeurs selon qu'elles sont esthtiques ou normatives et soumettre
ces dernires un modle communicationnel et procdural de lgitimation
mais encore que le modle propos, aussi bien que le principe du tri, loin
d'tre universels, sont indissociables de l'expansion commerciale d'origine
europenne et lui sont unilatralement imposs de l'extrieur.
Pour le Japonais typique, le cot d'entre dans la discussion haber-
masienne est donc tout fait exhorbitant puisqu'il suppose l'abandon du
modle de valorisation qui est le sien au profit du modle europen, avec
pour consquence empirique la limitation de son domaine rserv aux
seules valeurs culturelles, c'est--dire la soumission un universalisme nor-
matif d'origine occidentale ayant pour seule co'ntrepartie la constitution
d'une rserve, celle o chaque communaut intersubjective est libre d'en-
48 prouver l'universel
treposer sa diversit culturelle, comme on cultive de sympathiques idiosyn-
crasies qui ne prtent pas consquence puisqu'il n'est pas question
qu'elles orientent l'action. La diversit culturelle est ainsi la fois circons-
crite et lgitime au titre de patrimoine culturel, quelque chose comme un
territoire protg, la condition qu'on en sorte pas, qui joue le rle de stock
d'opinions concurrentes dans la grande discussion publique mondiale que
l'universalisme communicationnel appelle de ses vux.
Habermas pense avoir fait justice l'exigence d'inter-comprhen-
sion accordant la possibilit chacun de cultiver un pluralisme de rserve.
Mais mme le touriste-philosophe ne peut s'y retrouver: en fait de com-
prhension, l'change idal des rles se limite l'adoption par chacun du
POillt de vue moral, celui de la mise entre parenthses de ses propres valeurs
et du retrait de la discussion de ses propres valeurs culturelles.
L'universaliste ne parvient jamais adopter vraiment le point de vue du
Japonais typique, c'est pourquoi il n'imagine mme pas ses raisons de refu-
ser la discussion.
On comprend pourquoi, la conception de l'inter-comprhension qui
dcoule de l'thique de la discussion est la suivante:
Dans les argumentations, les participants doivent pragmatiquement
prsupposer qu'en principe tous les concerns participent en tant
qu'tres libres et gaux une recherche coopratrice de la vrit o
ne vaut que la seule force de l'argument meilleur. C'est sur cet tat
de fait pragmatique-universel que repose le principe de l'thique de
la discussion. [... ] La discussion pratique se laisse concevoir comme
un processus d'inter-comprhension qui d'aprs sa forme mme,
c'est--dire uniquement sur la base des invitables prsuppositions
universelles de l'argumentation, pousse tous les concerns une
adoption idale de rle. 17
Nous sommes trs loin de la dfinition que propose Taylor, pour qui
comprendre quelqu'un c'est comprendre ses motions, ses aspirations, ce
qu'il trouve admirable ou condamnable chez lui et chez les autres, ce qui
l'attire ou ce qui lui rpugne etc. 18. L'universalisme communicationnel ne
permet pas de comprendre, au sens complet du terme, l'attitude du Japonais
typique et c'est dans cette incomprhension fondamentale, organise, nour-
rie et justifie par la thorie elle-mme que s'origine l'aveuglement de
Habermas sur la ralit du cot d'entre en discussion.
Il faut donc se rendre l'vidence, faute de comprhension relle du
point de vue de l'interlocuteur, il n'y a pas de vritable dcentrement dans
la thorie universaliste. Ce que Habermas appelle l'abandon du point de vue
Konigsberg 49
gocentr se rsume l'abandon d'un point de vue particulier au profit d'un
point de vue universaliste qui a le "lme centre.
Le touriste-philosophe, emport peut-tre par son origine ngocian-
te, a commenc par revendiquer l'universalit du tourisme, c'est--dire
l'universalit du commerce communicationnel comme change mutuel de
comprhension relativement aux valeurs. Se heurtant au refus du Japonais
typique de lui accorder la possibilit mme de comprendre les valeurs nip-
pones qui entrent dans le domaine rserv de l'identit communautaire, il a
demand l'aide de la philosophie universaliste pour convaincre son interlo-
cuteur de l'existence d'un convertisseur universel qui assure la possibilit
d'un commerce communicationnel universel. L'chec est peu prs total.
L'universalisme s'est rvl tre le relev contemporain de l' eurocentrisme,
et ses invitations la discussion tournent vide faute de comprhension
relle du point de vue des autres participants. Le touriste-philosophe doit en
tirer deux leons : il est ncessaire de pouvoir distinguer rationalit, com-
prhension occidentale du monde et modernit pour faire apparatre le pro-
blme de l'entre en discussion, et la prtention l'universalit n'est pas un
modle universel de lgitimation des valeurs et ne peut donc fournir le
convertisseur recherch. Ou pour le dire autrement, prtendre l'universel
n'est pas un moyen universellement reu pour juger du caractre dsint-
ress d'une action. Ou pour le dire encore autrement, il n'est pas impossible
- l'enqute reste mener - que la lgitimation des normes d'action par
l'universel soit une idiosyncrasie particulire.
Cet chec n'est pas sans consquences sur la philosophie elle-mme.
En affirmant sa comptence relative la discussion morale, comme cham-
pionne de l'universalit des valeurs normatives, ne risque-t-elle pas, en
chouant produire un universalisme moral consquent, d'tre discrdit
avec lui?
Puur le touriste-philosophe, une telle conclusion sonnerait le glas de
ses prtentions et la ngation de l'effort de critique philosophique de l'uni-
versalisme habermasien dans lequel il s'est lanc. Refusant de renoncer
aussi vite ses prtentions l'universel comme son titre nouvellement
conquis de philosophe, il n'a d'autre choix que de poursuivre ses tribula-
tions, en s'essayant mieux comprendre son interlocuteur japonais, au
risque de soumettre ses opinions, ses valeurs et ses concepts l'preuve du
dmnagement.
Quant la philosophie, ellen'a d'autre choix, pour rester fidle sa
prtention l'universel, que celui de le suivre dans ses priples; de se faire
voyageuse en quelque sorte, sans prtentions, la manire du touriste, par
curiosit, en changeant de centre.
Mais n'a-t-elle fien perdre en s'associant au touriste? La rponse
50 prouver l'universel
videment positive cette question met jour une destine commune au
tourisme et la philosophie : le premier ne saurait viter de dgnrer en
commerce de curiosits qu'en se faisant voyageur, et la seconde se dvalo-
riserait - ce qui s'appelle, en franais, faire de la philosophie en touriste
- si elle n'tait capable de s'imposer, loin de chez elle, les exigences de
rigueur du raisonnement, de clart de l'expression et d'rudition qui font,
chez elle, sa raison d'tre.
Le touriste-philosophe, parce qu'il accepte de se soumettre ces exi-
gences de bonne grce, et pour signifier cette soumission, revendiquera
dsormais un nouveau titre: celui de voyageur-philosophe pour bien mar-
quer ainsi le refus de ses origines ngociantes, et des ambiguts qu'elles
portent.
Muni d'un tel titre, raccourcit pour les besoins du voyage en simple
voyageur , c'est presque naturellement chez Kant qu'il cherche prci-
ser l'objet de son voyage
19
Commerce et inhospitalit
L'entre en communication n'est pas seulement le point de dpart,
l'origine de la communication, elle est surtout ce que requiert tout instant
le processus communicationnel, sa condition historique de possibilit. Pour
Habermas le dveloppement de l'expansion commerciale assurant le
contact, sa critique interne de la modernit par la thorie communication-
nelle offre les garanties requises contre tout enrocentrisme. Or, il ne suffit
pas pour assurer cet effet de couplage de mettre en contact des interlocu-
teurs, ni mme de proposer que chacun d'entre eux se soumette au principe
d'universalisation. En effet, l'histoire de l'expansion commerciale n'est ni
celle de la modernisation ni celle de la ( ratiollalisatiorl , c'est d'abord
et avant tout une conqute - Kant l'a bien vu.
Si on compare cela [le droit d'hospitalit] la conduite inhospita-
lire des tats civiliss et particulirement des tats commerants de notre
partie du monde, l'injustice dont ils font preuve, quand ils visitent des pays
et des peuples trangers (visite qui pour eux signifie la mme chose que la
conqute) va jusqu' l'horreur. L'Amrique, les pays des Ngres, les les
aux pices, le Cap, etc. taient leurs y x ~ quand ils les dcouvrirent, des
pays qui n'appartenaient personne; ils ne tenaient aucun compte des habi-
tants. En Inde orientale (en Hindoustan) ils introduisirent, sous le prtexte
d'un simple projet de comptoirs commerciaux, des troupes trangres ce
qui provoqua l'oppression des indignes, le soulvement des divers tats de
Konigsberg 51
ce pays et jusqu'aux guerres largement tendues, la famine, la rbellion, la
trahison et toute la litanie des maux qui oppriment le genre humain qu'on
peut continuer grener 20.
Il n'y a pas de commerce, marchand ou communicationnel, qui soit
lgitime dans ce contexte. Il n'y a donc pas non plus de lgitimit a priori
des intentions commerciales de ceux qui imposrent les premiers contacts,
non plus que de ceux qui cherchrent les corriger en dis.cutant. C'est dire
que le commerce communicationnel n'est pas une fin en soi, mme si de
Raynal Habermas, tout l'effort de la philosophie est de chercher le dis-
socier de la conqute commerciale pour les opposer l'un l'autre. C'est
pourquoi, selon Kant, l'tranger qui vient de passer le cap de Bonne-
Esprance, n'est-il d qu'un droit de visite, au nom de l'hospitalit univer-
selle:
(C]e droit, d tous les hommes, est celui de se proposer la socit, en
vertu de la commune possession de la surface de la terre, sur laquelle, puis-
qu'elle est sphrique, il ne peuvent se disperser l'infini mais doivent fina-
lement se supporter les uns ct des autres. 21
Le droit de visite est une consquence ncessaire du droit de jouir de
la surface du globe. Mais ce droit d'hospitalit, ajoute Kant, et c'est essen-
tiel s'arrte la recherche des conditions de possibilit d'un comnzerce
avec les anciens habitants. 22
On ne saurait mieux formuler la question. Pour Kant, il est certain
que l'tablissement de relations commerciales entre les divers continents,
celles-ci devenant publiques et lgales, rapprochent toujours d'avantage
le genre humain d'une constitution cosmopolitique 23, c'est--dire de l'uni-
fication de la communaut humaine en une communaut politique parfaite.
qui constitue le but de l'histoire universelle
24
Le dveloppement du com-
merce mondial contribue l'unification politique de l'espce humaine et est
ce titre tout fait souhaitable. Mais un tel souhait n'est en aucun cas une
obligation lgale ou morale de commercer, c'est tout au plus une obligation
de rechercher les conditions de possibilit du commerce. Et s'il existe une
raison morale pour prfrer le commerce l'absence de relation, puisque le
commerce contribue au but final de l'humanit, cette raison ne fait en aucu-
ne manire oublier que le commerce est soumis au respect du droit de visi-
te.
C'est dire que le respect du droit et l'intelligence du but final de
l'Humanit ne justifient pas en eux-mmes et tout prix le commerce, et
sont, au contraire, autant d'incitations prendre le temps de se demander
.quels en sont les pralables. L o Habermas ne dduit rien de la violence
52 prouver l'universel
des conditions historiques de possibilit du commerce, le droit de visite
kantien permet de s'ouvrir au problme philosophique de l'entre en com-
merce.
Le souhait de voir se dvelopper les rapports politiques entre les
membres de la mme espce doit donc conduire les protagonistes se
demander, et ne jamais cesser de se demander, comment le commerce est
possible, rechercher inlassablement ses conditions empiriques de possibi-
lits. Comme l'indique Kant, les conditions du commerce sont toutes
entires dans leur recherche mme, c'est--dire dans le respect du droit de
visite. Le commerce n'est possible que si de part et d'autre ou en recherche
tout moment les conditions de possibilit. Mais qu'est-ce que rechercher
les conditions de possibilit du commerce?
Le voyageur sait dj que les prtentions de l'universalisme sont
incapables d'assurer l'entre en discussion parce qu'elles n'organisent pas
la recherche des conditions de possibilit de la discussion mais cherchent
imposer unilatralement leurs propres rgles. De cet chec il est possible de
dduire que la recherche des conditions de possibilit du .commerce suppo-
se bien l'inter-comprhension, mais dans un sens beaucoup plus large que
la version qu'en donne Habermas, qui englobe la comprhension empirique
des motions, aspirations, gots et motivations de l'interlocuteur.
Mais il y a plus. Kant non seulement invite au respect des rgles de
l'hospitalit, mais considre qu'au cas o celles-ci seraient bafoues, le
refus du commerce devient lgitime:
La Chine et le Japon (Nippon) qui avaient fait l'exprience de tels
htes [les tats commerants], leur ont en consquence, sagement
permis, en ce qui concerne la Chine, l'accs certes mais non l'entre
et, en ce qui concerne le Japon, il en a permis l'accs mais un seul
peuple europen: les Hollandais qu'ils excluent cependant comme
des prisonniers de toute communaut avec les indignes .25
Faut-il comprendre que dans un contexte de conqute inhospitalire,
le refus d'entrer en discussion selon les canons du commerce communiea-
tionnel pourrait bien tre une des voies pour rtablir les conditions empi-
riques de possibilit du commerce qui ne sont pas runies?
En tout cas, le mpris du droit de visite, l'inhospitalit, terme qui
rsonne encore, sous la plume de Kant, de l'indignation souleve par les
horreurs de l'agression europenne, constitue une situation assez excep-
tionnelle pour mriter un traitement distinct des figures du commerce lgi-
time. L'inhospitalit des tats commerciaux a t telle qu'il peut tre consi-
dr comme tout fait sage d'aller jusqu' refuser toute communaut
Konigsberg 53
avec les indignes .
C'est un vritable tour de force que ralise le philosophe de
Konigsberg, puisqu'il parvient concilier l'affirmation de l'existence du
point de vue moral , consolateur et universel, sans condamner en son
nom le refus du commerce communicationnel, c'est--dire sans rintrodui-
re le point de vue normatif et eurocentr qui pousse l'universalisme com-
muncationnel faire des silences japonais les symptmes d'une pathologie
sociale. En qualifiant la fermeture de dcision sage, un pas important a t
franchi dans la direction d'une comprhension relle du point de vue de
}-' autre interlocuteur.
Reste que ce pas en avant, qui intresse le voyageur au premier chef,
est un dfi la cohrence de la doctrine kantienne du commerce mondial,
dont il est bien connu qu'elle devrait tre indissociable de l'adoption du
point de vue moral qu'est celui de l'Histoire universelle. Le voyageur doit
examiner cette thse et chercher la concilier avec le jugement port sur la
sagesse de la politique de fermeture ou, tout le moins, d'ouverture stric-
tement parcimonieuse de la Chine et du Japon.
Cette question, le voyageur le sent bien, engage la dfinition du
voyage philosophique lui-mme. La philosophie, qui s'identifie au point de
vue moral universel, doit pouvoir rendre compte de la rationalit de cette
sagesse, rationalit qui n'apparat justement que si l'on comprend relle-
ment le point de vue de la Chine et du Japon. Or cette comprhension exclut
non seulement le faux universalisme des tats commerants, trop superfi-
ciel pour qu'on n'y lise pas clairement la particularit des apptits qui les
animent, mais aussi un point de vue universel surplombant qui considre-
rait le dtour par les motivations des uns et des autres comme une dchan-
ce, une chute dans l'irrationalit des intrts particuliers. C'est la possibili-
t mme d'un vritable dcentrement qui est enjeu dans cette tension. Reste
donc au voyageur se deillailder ell quoi consiste cette sagesse, et quelle
tension elle introduit dans le systme kantien.
L'hypothse de l'isolement
Revenant au texte, il ne fait aucun doute que Kant dsapprouve la
conqute qu'il identifie l'horreur et la litanie des maux qui oppriment le
genre humain. C'est la raison pour laquelle la politique de fermeture de la
Chine et du Japon relve de la prudence politique. Mais qui la juge telle, et
plus prcisment, d'o? Dire que la fermeture est sage, n'est-ce pas se pla-
cer du point de vue des seules victimes potentielles des horreurs de la
conqute et des spectateurs qui les prennent en piti ? Pour la philosophie,
54 prouver l'universel
qui chausse les lunettes de l'histoire universelle, l'horreur elle-mme ne
constitue-t-elle pas une relation, la pire qu'on puisse imaginer certes, mais
une relation tout de mme qui contribue, ft-ce ngativement, l'unifica-
tion du monde, sous l'gide d'une constitution politique parfaite
26
?
L'horreur est la fois un fait et un jugement de valeur. Ce jugement de
valeur mme est l pour montrer que l'oppression du genre humain ne va
pas sans la prise de conscience des droits cosmopolitiques de tous les habi-
tants du monde. Il faudrait alors comprendre que le commerce, ft-il celui
des armes et du bois d'bne, hte la ralisation de l'unification de l'esp-
ce. Une telle lecture de Kant interdirait donc de donner la sagesse poli-
tique des Extrmes-Orientaux une quelconque porte systmatique.
Les textes clbres sur l'insociable sociabilit vont dans le sens de
cette thse. En effet, le philosophe de Konigsberg affirme dans L'Ide d'une
histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique que:
[L]e moyen dont se sert la nature pour mener bien le dveloppe-
ment de toutes ses dispositions [de l'homme] est leur antagonisme
au sein de la Socit, pour autant que celui-.ci est cependant en fin de
compte la cause d'une ordonnance rgulire de cette Socit. 27
Ce serait l quelque chose comme ce que Hegel appellera plus tard
une ruse de la Raison, o l'intrt particulier des commerants peut bien
tre irrationnel, il n'en contribue pas moins, et trs paradoxalement, au
devenir d'un monde rationnel. Ainsi, la fermeture, le refus du commerce ne
pourrait tre juge sage que du seul point de vue chinois et japonais,
quelque chose comme une rgle politique prudentielle et particulire qui ne
saurait tre celle du philosophe, qui juge, lui, du point de vue de l'univer-
sel, celui-l mme qui absout l'expansion commerciale au titre qu'elle hte
la ralisation dll bllt final de l'humanit en rendant possible. un agir com-
municationnel conscient de lui-mme.
Une telle interprtation, outre qu'elle est trs hglianisante et assez
sommaire, anantirait la fconde tension mise jour par le voyageur ; fait
assez bon march de tout le mal que Kant pensait des raisonnements du type
la fin justifie les moyens , comme de son attachement au caractre incon-
ditionnellement respectable de la personne humaine, pour le moins mis
mal dans la conqute.
Aussi .le voyageur refuse-t-il cette lecture et s'attache-t-il dfinir
plus rigoureusement le jeu kantien de l'insociable sociabilit. La lecture du
texte canonique en la matire lui ouvre la possibilit de donner l'insocia-
bilit un sens plus large que la seule dfense d'intrts commerciaux parti-
culiers :
Konigsberg 55
J'entends ici par antagonisme l'insociable sociabilit des hommes,
c'est--dire leur inclination entrer en socit, inclination qui est
cependant double d'une rpulsion gnrale le faire, menaant
constamment de dsagrger cette socit. L'homme a un penchant
s'associer, il se sent plus qu'homme par le dveloppement de ses dis-
positions naturelles. Mais il manifeste aussi une grande propension
se dtacher (s'isoler), car il trouve dans le mme temps en lui le
caractre d'insociabilit qui le pousse vouloir tout diriger dans son
sens. 28
L'insociabilit est certes un intrt, goste parce que particulier et
attach la dfense exclusive de cette particularit, mais pas ncessaire-
ment tourn vers la conqute militaire, marchande ou communicationnelle.
Il peut conduire tout aussi bien s'isoler des autres
29
Les dsirs de riches-
se, de profit ou de reconnaissance ne sont pas les seuls ressorts de l' inso-
ciabilit, puisqu'il est possible, avec Kant, de faire sa place une insocia-
bilit dfensive, prenant la forme d'une rsistance:
[E]t, de ce fait [la propension s'isoler] il s'attend rencontrer des
rsistances de tous cts, de mme qu'il se sait par lui-mme enclin
rsister aux autres 30.
Si l'on considre que l'insociable sociabilit est cette disposition
contradictoire s'associer et se dtacher, on comprend beaucoup mieux
en quoi la politique de fermeture de la Chine et du Japon n'est pas une
sagesse .prudentielle des seuls points de vue chinois et japonais, mais tout
aussi bien du point de vue philosophique et consolateur de l'histoire uni-
verselle. S'il faut bien que l'histoire paie son tribut l'insociabilit, il faut
mme dire que la fermeture en est une modalit bien plus lgitime que le
commerce inhospitalier, parce qu'elle est sage.
Refuser de rduire l'insociable sociabilit la dialectique du dsir et
du droit, admettre que l'isolement est aux cts. du commerce une des
figures possibles de l'insociabilit, c'est accepter que la dynamique de
l'histoire ne soit pas seulement celle qui oppose la particularit des intrts
l'universalit des normes, et q.ue la recherche des conditions de possibili-
t du commerce selon les rgles de l'hospitalit puisse passer par la ferme-
ture.
C'est ce qui sauve au demeurant la philosophie de n'tre qu'une lgi-
timation a posteriori des horreurs de la conqute. Mais il convient d'en tirer
les consquences et de marquer que Kant distingue le commerce lgitime et
la conqute, faisant du premier une ncessit certes peu morale mais bien
56 prouver l'universel
utile au dveloppement des dispositions de l'espce et de la seconde la
ngation brutale de l'humanit mme de l'homme.
Il faut donc, avec Kant, raffirmer que la conqute n'a jamais enfan-
t que l'oppression du genre humain. Ce n'est pas l'expansion coloniale qui
porte en elle la ralisation de l'unification de l'espce, c'est le commerce
dans le respect de ses conditions de possibilit, c'est--dire dans l'hospita-
lit, et son refus lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Quand
Habermas fait du dveloppement du capitalisme une condition de possibi-
lit historique de l'agir communicationnel, sans distinguer le commerce
selon les rgles de l'hospitalit et la conqute, il ne peut plus comprendre le
refus de la discussion.
On objectera pourtant que chez Kant, il n' y aurait pas eu de ferme-
ture sans conqute, que l'inhospitalit des tats commerants est un pra-
lable logique et chronologique au refus du commerce. L'objection ne rsis-
te pas la lecture. D'aprs Kant, la fermeture n'est pas une rsistance
l'horreur de la conqute, mais l'horizon de son attente. Kant prcise en
effet que cette rsistance, l'homme la trouve en lui:
[1]1 trouve en mme temps en lui le caractre d'insociabilit qui le
pousse vouloir tout diriger dans son sens; et, de ce fait, il s'attend
rencontrer des rsistances de tous cts, de mme qu'il se sait lui-
mme enclin rsister aux autres. 31
Il n'est pas ncessaire de faire l'exprience de l'agression pour en
craindre la possibilit. C'est dire que la conqute n'est pas mme la condi-
tion historique de la mise en jeu de la rsistance et que, dcidment, y com-
pris du point de vue universel et consolateur de la philosophie, elle ne sert
rien et ne peut tre confondue ni avec la modernisation ni avec la ratio-
11alisatioll.
Tout cela ne fait certes pas de la politique de fermeture une panace
destine hter le rapprochement des membres de l'espce, mais explique
qu'il soit possible de condamner les tats commerciaux et de juger sage la
politique de la Chine et du Japon du point de vue philosophique. La ferme-
ture est sage parce qu'elle permet de faire l'conomie de la litanie des maux
qui oppriment le genre humain - qui ne peuvent tre considrs comme
une relation - et parce qu'elle oblige revenir sur les conditions de possi-
bilit d'un commerce qui procde vritablement d'un rapport entre les par-
ties du monde spares par les mers, un commerce hospitalier.
L o chez Habermas les termes du choix faire sont le commerce
militaire et marchand d'une part, la communication de l'autre, Kant
dcouvre l'antriorit logique et chronologique d'un contexte propice au
Konigsberg 57
commerce (marchand et communicationnel) par la recherche de ses condi-
tions empiriques de possibilit, en l'absence de quoi son refus est lgitime.
C'est dire que la dfense inconditionne du commerce, marchand ou com-
municationnel, n'est pas une figure impose de la philosophie et qu'il ne
faut pas refuser le dcentrement vritable, celui qui passe par la compr-
hension relle de l'interlocuteur au titre que le point de vue moral serait
incompatible la prise en charge d'un point de vue particulier.
Au del de sa doctrine elle-mme, le philosophe de Konigsberg pro-
pose une leon de courage intellectuel, en n'hsitant pas devenir chinois
et japonais, l'espace d'un instant, l'occasion d'une vertueuse colre. Ce
faisant, il ouvre une voie.
On objectera que Kant est le penseur de l'universalit de la commu-
nication, et l'on citera l'appui de cette objection la Critique de la Facult
de Juger. Une lecture attentive du paragraphe trente-neuf de cet ouvrage
enseigne cependant que Kant n'est pas tant le penseur de la communication,
que de la communicabilit universelle. La dduction transcendantale du
jugement de got permet sans aucun doute d'affirmer, a priori, qu'il est
possible de communiquer, mais, et c'est l l'essentiel, ne dit pas comment
empiriquement, et ne se prononce donc pas sur l'existence d'un convertis-
seur universel pour ce qui concerne la communication des sensations. C'est
une des grandes forces du philosophe de Konigsberg que d'avoir su garder
toujours ouverte la possibilit transcendantale de la communication sans
faire de cette possibilit une ncessit empirique.
Certes, chez Kant, la Raison comme facult du sujet transcendantal
permet de faire jouer aux catgories de l'entendement, compris comme des
universaux de la Raison, le rle de convertisseur. Habermas rejette cette
ide et en dduit la ncessit de trouver dans la communication l'quivalent
de ce qu'il vient d'abandonner la critique de la modernit; mais ce fai-
sant, il perd le bnfice de la dissociation entre possibilit et ncessit de la
communication et s'interdit la comprhension de tous ceux qui ne discutent
pas, parce ce qu'ils font le choix de ne pas discuter.
Le voyageur n'estime donc pas tre infidle Kant en suivant son
exemple, et en puisant dans la lecture de son uvre le courage ncessaire
pour s'aventurer dans la comprhension relle du point de vue de l'autre
sans cependant abandonner la prtention l'universel constitutive de la phi-
losophie.
58 prouver l'universel
L'appel de Konigsberg
ou
La voie du voyage
C'est pourquoi, il fait sienne la maxime kantienne de recherche des
conditions de possibilit du commerce et, tirant les leons des checs de
l'universalisme communicationnel, identifie cette recherche avec la possi-
bilit de comprendre rellement l'interlocuteur, de se dcentrer vraiment.
La voie ouverte par Kant est d'entre fconde puisqu'elle permet de
rendre compte du refus de discuter du Japonais typique autrement qu'en
terme de pathologie. L o l'universalisme communicationnel ne peut y
voir qu'une raction sans doute prvisible, mais aussi dsespre que peu
lgitime, visant sauver l'intgrit d'un monde vcu clos sur lui-mme et
destin disparatre, un frein la modernit, ou encore une rsistance de la
tradition, il est possible d' Ydceler une rsistance la traditionalisation,
c'est--dire la dvalorisation qu'entrane l'adoption du mode de valorisa-
tion par l'universel et la hirarchie des valeurs qu'il induit et la dsigna-
tion de son monde vcu comme traditionnel.
Ainsi le Japonais typique ne ractive pas, sur le mode exotique, la
Querelle des anciens et des modernes en opposant un Japon ternel et inson-
dable au commerce occidental, mais fait bien plutt merger le problme de
l'entre en communication en faisant resurgir les horreurs et les crimes de
la conqute. Considrer son attitude comme la rsistance qu'une conception
traditionnelle du monde oppose la modernisation, c'est avoir fait sienne
une conception universaliste de l'Histoire comme devenir-monde du com-
merce, sans distinguer le commerce lgitime de la conqute, et c'est avoir
pous la .hirarchisation des valeurs qu'il porte en lui. Dans cette hirar-
chie, toute rsistance au commerce est passiste, relve du traditionnalisme
de rserve..
Cette position est intenable. En effet, pour n'tre pas, on l'a vu, le
produit de la conqute mais celui de sa seule possibilit, le point de vue de
l'isolement n'en est pas moins contemporain de l'entre en contact, et donc
au moins aussi moderne que le commerce lui-mme. L'universalisme com-
municationnel d'origine europenne conteste sa lgitimit en le saisissant
comme pr-moderne, au sens habermasien, et y voit les dcombres suran-
ns d'un monde en voie de disparition. La rsistance par la tradition fait
appel au pathos d'un pass autochtone, parce que celui-ci a dj t dtruit
par l'ouverture; la rsistance la traditionalisation, par la fermeture, ne sai-
sit pas le particulier comme pass et ne se prte aucun pathos nostalgique,
il est strictement contemporain de l'ouverture.
Pour honorer la prtention l'universalit de la philosophie, il
convient donc de faire justice l'exigence de comprhension .du point de
Konigsberg 59
vue de l'autre, c'est--dire non seulement adopter le point de vue intres-
s de celui qui vise convaincre de la lgitimit de l'expansion d'une mora-
le universelle, mais le point de vue rellement dsintress de celui qui a le
temps de faire les dtours ncessaires pour comprendre le point de vue de
son interlocuteur.
L'exprience de la discussion avorte avec le Japonais typique, et la
volont de s'inscrire dans l'asymtrie du contexte de la conqute que
Habermas nglige et que Kant souligne, incitent le voyageur se tourner
vers le Japon.
Cette voie n'est pas de tout repos. Parce qu'elle suppose non seule-
ment la mise entre parenthses du point de vue gocentr, mais aussi celle
du point de vue universaliste, au profit d'un autre centre. Aussi bien logi-
quement que chronologiquement, l'adoption d'un autre centre suspend tout
jugement, ne tolrant tout au plus qu'une dontologie provisoire, celle
qu'imposent les exigences propres de la philosophie et du voyage.
Autant dire que la voie est troite et risque: en cas d'chec dans la
comprhension, donc dans la recherche des conditions de possibilit du
commerce, aucun principe ne pourra tre oppos la possibilit de la guer-
re.
Le voyageur n'est pas belliciste. II ne trouve aucun intrt au roman-
tisme guerrier ni aucune posie aux champs de bataille. Aussi est-ce dans
l'espoir que l'examen philosophique des conditions de l'entre en commer-
ce, du point de vue japonais, lui offrira les moyens de s'en prserver, ou en
tout cas de lgitimer les concepts qui la condamne, qu'il choisit de ne pas
renoncer au dcentrement.
60 prouver l'universel
NOTES
1 J. H., NFED, p. 79. Cf. supra note n 3, p. 21.
2 J. H., TAC, T. l, p. 36. Nous soulignons pLus encore, tandis que candidates et Le
cas chant sont souligns par Habermas. .
3 J. Habermas, Droit et dmocratie, trad. R. Rochlitz et Ch. Bouchindhomme, Paris,
Gallimard, 1997, p. 33. C'est nous qui soulignons.
4 1. H., TAC, T. l, p. 121.
5 Jrgen Habermas utilise le terme de rationalisation dans mme sens que Max
Weber, et en propose, dans un ouvrage un peu antrieur, la dfinition suivante:
Max Weber a introduit le concept de " rationalit" pour caractriser la fonne capi-
taliste de l'activit conomique, la forme bourgeoise des changes au niveau du droit
priv et la forme bureaucratique de la domination. La rationalit dsigne tout
d'abord l'extention des domaines de la socit qui sont soumis aux critres de dci-
sion rationnelle , La tech/tique et la science comnze idologie, trad. J.-R. Ladmiral,
Paris, Denol, 1973, p. 3.
6 Jrgen Habermas, Dialectique de la rationalisation , in Cahiers de philosophie,
n 3, 1986, p. 66. Dans le mme entretien, Habermas fait explicitement rfrence
l'analogie qu'entretient sa thse avec celle que dfend K. Marx dans l'Introduction
dite de 1857 la Critique de l'conomie politique, selon laquelle c'est dans le capi-
talisme que le travail devient abstrait et qu'il devient possible de penser le travail en
gnral, et d'en faire le concept central de l'anthropologie. Il y a bien l quelque
chose comme une dialectique historique de la connaissance, mais chez Marx le tra-
vail aussi a une histoire, tandis que chez Habermas, les pratiques langagires sont un
horizon anthropologique assez stable pour justifier l'universalit de procdures de
validation de normes morales.
7 Pour une formulation moins explicite dans un ouvrage plus central : le dvelop-
pement de la socit elle-mme doit faire apparatre des problmatiques qui ouvrent
objectivement aux contemporains un accs privilgi aux structures de leur monde
vcu , in TAC, T. II, p. 444.
8 1. H., TAC, T. II, p. 367. L'expression est de Marx.
9 J. H., ED, p. 18.
10 Cf. Stphane Haber, Habermas ... , op. cit., p. 124.
Il L'expression est ici - chez Habermas - synonyme d'Occident.
12 Citation tire de Condorcet, Esquisse d'un tabLeau des progrs de l'esprit
humain, Paris, ditions Sociales, 1973, p. 130.
13 J. H., TAC, T. l, p. 165.
14 Ibid.
15 J. H., TAC, T.I, p. 60. C'est Habermas qui souligne.
16 J. H., TAC, T. I, p. 60.
17 1. H., ED, p. 61.
18 Cf. supra, p. 16.
19 Naturellement, parce que Kant - qui n'a parat-il jamais quitt Konigsberg -
fut un formidable voyageur. ce propos, cf. M. Crampe-Canabet, Le voyageur de
Konigsberg , prface la Description physique de la terre, in Philosophie, n 5,
Paris, 1985. On pourra aussi consulter l'dition rcente de quelques-uns des cours
de gographie qu'il a donn l'Universit; Kant, Gographie, trad. M. Cohen
Halimi, M. Marcuzzi, V. Seroussi, Paris, Aubier, 1999.
20 E. Kant, Vers La paix perptueLLe, trad. F. Proust et 1.-F. Poirier, Paris, GF
Flammarion, 1991, p. 94. Cet ouvrage sera not VPP par la suite. Jacques Derrida
Konigsberg 61
parle son endroit de grand petit texte dans Le droit la philosophie du point de
vue cosmopoLitique, Paris, UnescoNerdier, 1997, p. 12.
21 E. K, VPP, p. 94.
22 E. K, VPP, p. 94. C'est nous qui soulignons.
23 E. K, VPP, p. 94.
24 E. K, Ide d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, in
Opuscules sur l'histoire, trad. S. Piobetta, Paris, OF Flammarion, 1990, p. 86. Selon
la neuvime proposition: Une tentative philosophique pour traiter l'histoire uni-
verselle en fonction du plan de la nature, qui vise une unification politique totale dans
l'espce humaine, doit tre envisage comme possible et mme comme avantageuse
pour ce dessein de la nature. Sur la question du dessein de la nature , en parti-
culier sur la distinction entre l'unification cosmopolitique, et la ralisation du souve-
rain bien comme ralisation d'une communaut morale, cf. Yirmiyahu Yovel, Kant
et la philosophie de l'histoire, Paris, Klincksiek, 1989.
25 E. K., VPP, p. 94 96. Nous soulignons l'expression sagement permis. Kant fait
allusion la politique de fermeture - sakoku - durant laquelle les Japonais n'ont
pas le droit de se rendre l'tranger ni les trangers au Japon, l'exception de la
rception priodique de diplomates et de commerants chinois et corens et au main-
tien de relations commerciales avec la Hollande. Les Hollandais devaient dbarquer
dans l'le artificielle de Deshima, en face du port de Nagasaki, et interdiction leur
tait faite d'en sortir. Aussi ne pouvaient-ils avoir contacts autoriss qu'avec les
envoys officiels du Shgun et leurs interprtes. Cependant, la leve de l'interdiction
sur les livres trangers en 1720 donne naissance aux tudes Hollandaises , qui
joueront un rle non ngligeable dans le dveloppement de la pense japonaise. C'est
en se liant avec son interprte que le mdecin Engelbert Kempfer obtint de se faire
raconter le Japon et publia un ouvrage qui, pendant tout le XVIIIe sicle, fut la rf-
rence principale et la source d'information la plus srieuse sur ce pays. Publi en
1712 en latin sous le titre Amoenitatum Exoticarunl, dans le Ve fascicule, il en cir-
cule en Europe diverses traductions et abrgs. Kant s'en inspire lorsque, dans ses
cours de gographie physique professs l'Universit de Konigsberg, il aborde le
Japon. [Je remercie le Professeur Nakagawa Hisayasu de m'avoir appris l'existence
de ces textes et permis de les consulter, M. X.]. Sur la reprsentation du Japon par
les Europens, du XVIe au XVIIIe sicle, on consultera Jacques Proust, L'Europe au
Rr.isme du Japon, Paris, Albin Michel, 1998.
26 Kant ajoute en effet au constat de l'horreur de la conqute la remarque suivante:
Cependant, la communaut (plus ou moins troite) forme par les peuples de la
terre ayant globalement gagn du terrain, on est arriv au point o toute atteinte au
droit en un seul lieu de la terre est ressentie en tous. Aussi bien l'ide d'un droit cos-
mopolitique n'est pas un mode de reprsentation fantaisiste et extravagant du droit.
VPP, p. 96.
27 E. K., L'ide ... , op.cit., p.74.
28 Ibid. Selon Y. Yovel, le conflit des volonts particuliers n'est pas strictement uti-
litaire, cf. Kant ... , op. cit., le chapitre trois.
29 Kant parle aussi, bien sr de l'impulsion de l'ambition, de l'instinct de domi- .
nation ou de cupidit qui pousse l'homme se frayer une place parmi ses com-
pagnons qu'il supporte de mauvais gr, mais dont il ne peut se passer. , ibid.
L'insociabilit peut sans doute prendre la forme de l'agressivit, mais sans exclusi-
ve.
30 Ibid.
31 E. K, Ibid. L'histoire du Japon illustre d'ailleurs parfaitement le propos kantien.
62 prouver l'universel
Au moment o le Shgunat dcide la fermeture du pays, le Japon vient peine de
renoncer - la suite de revers militaires cuisants - la colonisation de la Core.
Les intentions des puissances europennes lui sont d'autant plus accessibles qu'il les
partage.
CHAPITRE III
KYTO
ou
Peut-on tre Japonais et philosophe?
L'adoption d'un point de vue japonais ne va pas sans s'y prparer.
Le premier rflexe de qui se prtend voyageur est de renoncer au tourisme,
c'est--dire chercher des curiosits. Il ne faut donc pas hsiter congdier
le Japonais typique. Il a sans doute t parfait pour mettre au jour le pro-
blme de l'entre en commerce, il s'est prt avec grce aux manches
que la lecture de Habermas suggrait au touriste, mais justement parce que
c'est un type, il est non seulement devenu inutile, mais mme franchement
dangereux. Un type ne pourra jamais - et par dfinition - faire autre
chose que figurer une espce en gnral, et il n'y a pas de point de vue japo-
nais en gnral. Le Japonais typique est une l'usage des tou-
ristes occidentaux (un touriste chinois aurait-il t attentif cette typicit
l ?). Or le touriste, on l'a vu, pour conqurir le titre de voyageur doit renon-
cer au ngoce comme la philosophie communicationnelle, puisque c'est
pour chapper au commerce des opinions qu'il veut devenir philosophe: un
touriste peut sans doute discuter l'opinion d'un type, mais la philosophie-
elle - s'y perdrait. C'est dire combien il se fait dsormais un devoir' de
mettre mort le Japonais typique, considrant que cette mise mort est la
condition d'un dcentrement qui se veut tre l'adoption d'un point de vue
philosophique.
Le voyageur se tourne donc vers le Japon la recherche d'une pen-
se philosophique japonaise de l'entre en comme,ree. Ce qui fait surgir une
multitude de difficults, commencer par celle-ci : comment aborder une
pense non occidentale, quand on cherche se dcentrer, mais qu'on en est
encore au seul point de vue de la philosophie occidentale, ce qui est le cas
de notre voyageur? Et cette autre, en mme temps: y a-t-il dans la pense
japonaise quelque chose qui puisse tre considr par la philosophie comme
de la philosophie ?
Du bon usa$e de la distance en philosophie
Si Habermas ne parvient pas penser le dcentrement, c'est
d'abord et avant tout parce qu'il est trop intress lgitimer l'universalit
de sa thorie. Les Azande mme pas dans son uvre le statut
64 prouver l'universel
de figurant, tout au plus celui de faire-valoir, quelque chose comme l'occa-
sion d'un change d'arguments avec des collgues relativistes. Dans ce pro-
cs, les deux parties usent la distance comme d'un instrument rhtorique,
aid en cela par la mtaphore rcurrente du miroir. L'usage spculaire de la
diffrence dit bien de quel regard l'autre est le reflet, et ce qu'on est cens
y voir. Un miroir reflte un point de vue sans le transformer. D'ailleurs
Habermas ne se cache pas de ne faire appel aux Azande que pour s' y mirer."
Les contrastes, qui indiquent en optique des variations entre colorations
distinctes et s'opposent en anthropologie aux similitudes, sont ici convo-
qus pour marquer des diffrences (et pas n'importe lesquelles, puisque
Habermas parle d' antithse ), et conforter par l une identit. Dans cette
spcularit, on a simplement escamot le dcentrement.
Le voyageur qui n'a ni thse ni identit dfendre, cultivera le
dsintressement pour se garder de voir des diffrences, et a fortiori des
antithses, l o il n'y a que des contrastes, fussent-ils violents. Il se garde-
ra donc de considrer le point de vue japonais recherch comme un miroir.
D'ailleurs, ce point de vue n'offre pas le mme confort visuel que la pense
dite sauvage. Le jeu spculaire n'a pas les mmes effets partout : aux
seconds revient la tche d'incarner la simplicit bucolique des premiers
ges, tandis qu'on reconnat au moins aux penseurs japonais la complexit,
attribut essentiel de l'impntrabilit de l'Asie mystrieuse dont on sait le
rle qu'elle joue dans la construction occidentale du japonisme
l
. De sur-
crot, les reprsentations europennes du Japon ont toujours t assez
contradictoires pour que ce soit moins l'image du miroir qui vienne l' es-
prit des- amateurs de regards croiss que celle du prisme. On peut consid-
rer qu'il s'agit d'un progrs dans la mesure o le prisme fait au moins l'hon-
neur la socit en question de n'tre pas parfaitement lisse, mais il reste
que c'est encore soi-mme qu'on y va chercher. Jacques Proust, qui
emprunte l'image Paul Claudel, et en fait le titre de son dernier ouvrage,
a l'immense mrite d'en faire l'objet mme de son tude, et de prendre la
prcaution de souligner qu' en dpit des apparences, ce livre-ci ne parle
pas du Japon, mais de l'Europe [... ]. C'est de l'Europe que je parle et en
E
' ')
uropeen -.
Il faut encore noter que l'usage de la mtaphore du miroir et le jeu
des regards rflchis n'est en rien l'apanage de l'universalisme. Comme
dans tout bon procs, ds lors qu'un argument est introduit par une des par-
ties, il peut l'tre aussi par l'autre: on se perdrait savoir qui des relati-
vistes ou des universalistes ont fait usage les premiers de l'loignement sp-
culaire pour faire progresser leur cause ; que le miroir soit fidle ou dfor-
mant, qu'il renvoie une image de soi conforme celle que l'on souhaite y
trouver par l'identit ou au contraire par la diffrence, c'est toujours le
Kyto 65
mme mouvement de soi soi sans passer par l'autre.
D'ailleurs, chez les plus fins rhteurs, on peut trouver les deux
lignes argumentatives la fois. C'est le cas de Habermas qui fait des
Azande le lieu de confirmation de la rationalit occidentale prouve par l'ir-
rationalit sauvage, mais qui accorde cette pense, prcisment parce
qu'elle est irrationnelle et dvalorise, la gloire d'tre la face disparue de la
pense moderne, sorte de monde enchant des rapports potiques et imma-
nents la nature, d'o sourd une nostalgie dans laquelle s'origine un pathos
relativiste, dont Habermas convient qu'il faille lui faire justice
3
La hirar-
chisation des valeurs que permet la distinction normative entre valeurs
esthtiques et normes d'action permet de concilier les deux lignes en pr-
servant le point de vue universaliste.
Le point de vue relativiste, pour triompher, n'a donc pas besoin de
critiquer la projection narcissique l'origine de l'argument, tout au plus lui
suffit-il d'inverser les termes de cette hirarchisation: la pense de l'autre,
de pr-moderne qu'elle tait - correspondant un stade infrieur de la
modernisation du monde - sera dsormais qualifie de post-moderne pour
entrer au service de la mise en forme du projet - occidental- d'un dpas-
sement de la modernit occidentale.
De toute faon, ce n'est pas la pense japonaise en gnral qui
intresse le voyageur directement, ce sont des positions - ncessairement
singulires puisque philosophiques - qui lui fournissent les outils pour
penser l'entre en commerce, savoir celles de philosophes japonais. Ces
positions - est-il besoin de le prciser? - sont trop contradictoires entre
elles pour reprsenter une quelconque unit de la pense japonaise. Cette
dernire n'existe d'ailleurs pas autrement que comme objet construit par les
sciences sociales. ce titre son examen est ncessaire dans la proportion
selon laquelle l'analyse d'un contexte conditionne l'intelligibilit d'une
uvre.
Faire ses bagages
Le voyageur ne fera donc pas de la pense japonaise un tout homo-
gne, non plus qu'un ailleurs radicalement diffrent, quelque chose comme
une le philosophique, un nouveau monde sans rapport avec l'ancien, ce qui
ne serait jamais qu'une nouvelle variation sur le thme du miroir. Cette
remarque est d'autant plus importante que la socit japonaise et sa com-
plexit , (ses critures, ses religions, ses classes et ses castes, ses bureau-
craties, ses armes... ) semble tre une machine de guerre idale contre la
modernit, au nom de la post-modernit
4
La question est bien plutt la sui-
66 prouver l'universel
vante: comment mettre en place une lecture qui chappe toutes les formes
de spcularisation instrumentalisante de la pense tudie ?
Ce choix de comprendre l' altrit ~ o contraste, en de du
couple de la diffrence et de l'identit, lui semble tre le seul moyen de
dsintresser la vision. L'autre n'est ni pr- ni post- moderne mais simulta-
n la modernit. Il ne sera donc pas question de se mettre en qute d'une
pense philosophique japonaise purifie de toute influence occidentale, ori-
ginellement japonaise. C'est pourquoi le voyageur prend trs au srieux la
remarque de l'historien des ides Pierre Lavelle :
La pense du Japon ne s'est jamais rduite aux uvres produites
sur son sol. [Elle] est faite de choix oprs parmi les penses tran-
gres, d'interprtations de celles-ci et de crations originales. Si, du
Shint primitif l'ge du post-modernisme, elle est parcourue, selon
l'expression de Maruyama Masa0
5
, d'un basso ostinato qui lui est
propre, la rduire celle-ci serait rpter une trop frquente erreur. 6
De Pierre Lavelle, notre voyageur retient aussi l'avertissement sui-
vant - fonnul propos d'une cole philosophique japonaise, dite cole
de Kyto, mais de porte sans aucun doute gnrale:
Pour viter la navet toute discussion doit examiner, au point de
vue philosophique et religieux, les lments non seulement de conti-
nuit mais aussi de rupture entre les reprsentants actuels de l'cole
de Kyto, les penseurs originaux qui les ont prcds ; le bouddhis-
me rform contemporain, les formes prmodernes du zen et de
l'amidisme, l'ensemble du bouddhisme la culture japonaise et,
puisque les penses de ces auteurs et leurs interprtations du boud-
dhisme sont devenus le principal pont culturel entre le Japon et
l'Occident, les modalits de la rception du zen et de la culture japo-
naise par celui-ci, et au point de vue politique, non seulment les
similitudes mais aussi les diffrences entre les idologies dominantes
du Japon ultra-nationaliste et de ses allis europens et leur dlgiti-
mation par celles des dmocraties occidentales et japonaises
actuelles. 7
Il n'y a l au fond rien que le voyageur ne sache dj. Pour que la
philosophie reste fidle elle-mme dans le voyage, elle doit honorer les
mmes prtentions la rigueur du raisonnement, la clart de l'expression
et l'rudition savante qu'en Europe. C'est ce prix que le touriste devient
voyageur. Reste que la matrialisation des efforts requis pour y parvenir lui
Kyto 67
fait tout de mme l'effet d'un choc. Et qu' tout prendre, pour salutaire que
soit ce choc, l'avertissement n'est cependant pas prendre au pied de la
lettre. Si c'tait le cas, notre voyageur devrait non seulement renoncer
adopter le point de vue de la philosophie japonaise, mais la philosophie
tout court. Il lui faut en effet confesser que sa lecture des auteurs occiden-
taux ne s'appuie pas sur un examen de leurs uvres dont la minutie inter-
dirait quiconque d'y pntrer s'il n'tait historien des ides
8
L'histoire des hritages intellectuels, du contexte et de la rception
d'une uvre sont des lments essentiels mais pas strictement ncessaires
une lecture philosophique de textes philosophiques aussi bien japonais
qu'occidentaux. Une telle lecture peut donc tre entreprise par quiconque
dispose d'une culture politique, religieuse et philosophique d'honnte
homme. C'est dire qu'une condition du dcentrement philosophique est de
pouvoir acqurir honntement au moins deux de ces honntes cultures au
cours de sa vie. Il semble au voyageur que c'est dj beaucoup demander.
Pour assouplies qu'elles doivent tre, les recommandations de Pierre
Lavelle ne sont en aucun cas ignorer. La projection spculaire ad' abord
son origine dans l'ignorance de l' histoire des doctrines (les lments non
seulement de continuit mais aussi de rupture ), du contexte historique qui
les voit natre (les modalits de [leur] rception ) et des enjeux de leur
rception (au point de vue politique, non seulement les similitudes mais
aussi les diffrences entre les idologies dominantes [... ] et leur dlgiti-
mation [... ] actuelle ).
Est-il ncessaire d'ajouter que plus d'un sicle d'influence occiden-
tale sont l'origine d'une considrable asymtrie, que dvoile l'anecdote
relate par Philippe Pons : on connat infiniment mieux Baudelaire ou
Mallarm au Japon que Bash en Europe. Non pas que la culture nipponne
soit sans influences sur l'Occident, loin de l, mais tout le moins pour ce
qui concerne la philosophie, la pense europenne fait montre jusqu'
aujourd'hui d'un impressionnant manque de curiosit que la relative diffi-
cult d'approche n'explique pas entirement. Cette formidable asymtrie
9
rend urgente l'ouverture de voies d'accs la pense philosophique japo-
naise qui ne soient pas rserves la japonologie, sans jamais cependant
perdre de vue que la philosophie n'est pas justifie s'manciper de l'his-
toire au motif qu'elle voyage. Un bagage est donc requis, mais lger et pra-
tique.
68 prouver l'universel
Remde prcaire au problme de l'asymtrie,
sous forme d'introduction une gophilosophie
S'il apparat possible de djouer les piges de la spcularit, il va
sans dire qu'une certaine conception de la philosophie est enjeu dans l'en-
treprise du voyageur. Elle implique d'en refuser deux conceptions sia-
moises. L'une consiste gommer l'origine europenne de la philosophie
pour en faire une discipline intellectuelle prsente dans toutes les civilisa-
tions, sans autres considrations gophilosophiques. Au nom de la relativi-
sation critique de la philosophie occidentale, on qualifie les penses non
occidentales avec les catgories de l'Occident, en pleine cohrence avec
l'expansion commerciale qui trouve ainsi de quoi penser ce qu'elle trouve.
Prive du secours de l'anthropologie, la colonisation eut-elle t ralisable?
La seconde conception consiste tre a priori persuad de ne pas
rencontrer de philosophie ailleurs qu'en Occident. Cette thse peut passer
par la valorisation de la philosophie et peut bien vite verser dans la Nime
version d'un eurocentrisme vulgaire, que l'ignorance des penses non-
occidentales n'excuse pas, mme chez les grands philosophes; ou bien,
passer par la limitation de la porte des thories philoso'phiques au seul
monde occidental et implique de renoncer leur universalit.
Aussi le voyageur prfre-t-il considrer que la philosophie n'est ni
strictement occidentale ni mondiale: ne en Grce, elle a beaucoup voya-
g, dans les wagons du commerce avec lequel elle n'a jamais cess la fois
de partager une communaut de destin et de s'employer nier cette com-
munaut pour ne pas s'y dissoudre
1o
On n'chappe pas la gophilosophie,
non plus qu' son histoire et son devenir. La dtermination d'une philo-
sophie japonaise passe donc par l'examen du contexte historique dans
lequel s'inscrit l'entre en commerce entre l'Europe et le Japon.
Fort de cette conviction, le voyageur concentre donc sa recherche
d'une philosophie japonaise sur la priode qu'inaugure la premire ouver-
ture moderne l'expansion commerciale des puissances europennes, en
1543 quand les Portugais introduisent les armes feu dans un pays dchir
par les guerres entre suzerainets rivales.
Il devait revenir l'un de ces suzerains, Oda Nobunaga, d'avoir su
le premier organiser des tro'upes armes de fusils, ce qui lui .permit
d'tendre son pouvoir sur tout le Japon central et de former le projet d'uni-
fier le pays. Mais Oda Nobunaga est assassin, et le projet est repris par son
gnral Toyotomi Hideyoshi qui le ralise au point de parvenir, en 1588,
confisquer toutes les armes, et institutionaliser le monopole lgal de la
violence. En 1600, tous les suzerains font allgeance son successeur
Tokugawa leyasu. La pax Takugawana s'instaure pour prs de deux sicles
. .
Kyto 69
et demi, durant lesquels le Japon, aprs avoir t sensible aux influences
chrtienne et europenne, se ferme quasi totalement
ll
. Cette priode, dite
d'do, sera celle de l'dification d'une bureaucratie solide, d'un commerce
florissant l'intrieur, d'un systme social rigidement hirarchis constitu
de quatre ordres: les guerriers, les paysans, les artisans, les marchands. Ds
le XVIIIe sicle, le dveloppement conomique de grands centres urbains
et la puissance nouvelle des marchands se heurtent d'autant plus violem-
ment cette hirarchie que les guerriers, devenus fonctionnaires domes-
tiques des seigneurs, sont enferms dans l'tiquette pointilleuse d'une
socit de cour comparable celle qu'analyse Norbert lias
12
Les
valeurs communes de ce nouveau monde trouvent leur origine dans le no-
confucianisme, l'thique fodale et le bouddhisme.
quelle modernit aurait conduit ce dveloppement intrieur
13
1
Nul ne le saura jamais puisque, en 1853, quand le cuirass du Commandant
Perry s'approche de la baie d'Uraga, l'avance technologique et militaire
des Occidentaux ne fait aucun doute. Le rve, n des sages prcautions
prises face l'inhospitalit des tats commerants, d'un dveloppement
indpendant du reste du monde, s'effondre. La pression extrieure pro-
voque la chute du Shgunat et la Restauration 14 de l'Empereur l're de
Meiji qui inaugure la fondation d'un tat-Nation sur le modle europen,
tout particulirement prussien
l5
, et l'ouverture force du pays au commerce
international, c'est--dire aux traits ingaux iinposs de mme qu' la
Chine. Ds lors, le Japon n'aura de cesse de comprendre ce qui fait la force
militaire des Occidentaux pour la reproduire et ainsi rattraper l'imprialis-
me europen et s'en librer. La victoire contre la Russie (1904-1905) four-
nit l'occasion de faire tat du nouveau rapport de forces et, en 1911, le
Japon est le seul pays oriental a avoir conquis l'galit diplomatique avec
les puissances occidentales.
Le fruit de cette histoire est la rencontre indite entre les prodromes
d'une modernit indigne et une occidentalisation choisie sous la pression
extrieure, d'o merge une socit hybride, tout fait dconcertante aux
yeux de ceux qui confondent occident et modemit
16
C'est sans doute ce
qui explique que la modernit japonaise ne puisse tre rduite l' occiden-
talisation, mais que l'identit du Japon moderne soit pourtant sans cesse
confronte l'Histoire mondiale assimile au devenir-monde de l'Occident.
Ainsi, selon Maruyama11 :
Ni au Japon ni en Chine il n'y a eu de dveloppement continu de
la conscience nationale, au sens moderne, dans une " socit inter-
nationale" dont l'environnement serait une vidence, mais l'un et
l'autre ont t confronts tout d'un coup, un moment donn de
70 prouver l'universel
l'Histoire, au problme de la stabilit de la nation dans les relations
internationales, face une " socit internationale "qui se dressait,
pour ~ s dire, en corps uni et de l'extrieur, les forant ainsi la
prise de conscience de " Soi " et du " Monde ". Les lments cultu-
rels divers issus du long dveloppement europen - le christianis-
me et le " capital ", les maisons de retraite et les canons ou les cui-
rasss, l'ducation obligatoire et la " tlgraphie", la souverainet de
l'tat et le systme lectoral - ont fait brusquement irruption sous
la forme d'une masse norme qu'on a appel" Occident ". Face cet
" Occident ", dont le systme de valeur et les traditions diffraient du
tout au tout, s'est pos la question de savoir s'il fallait en bloc s'y
soumettre ou le refuser pour persvrer dans un systme autarcique
- ce dilemme a constitu la question cruciale de l'" Ouverture du
Pays ", et les manires diffrentes d'y rpondre ont dtermin les dif-
frents destins historiques suivis par le Japon et la Chine (ou par
d'autres pays d'Asie). 18
La rponse ngative cette question de "l'ouverture n'a dcidment
rien d'un reste condamn de tradition pr-moderne, c'est au contraire,
depuis cent cinquante ans, et dans le mme temps, le lieu de constitution et
de la mise en question de la modernit japonaise. La fermeture constitue
toujours une des rfrences du dbat politique et idologique de l'archipel,
mme si le choix constant de l'ouverture depuis l're Meiji interdit en fait
la fermeture (en quoi - entre autres - le destin du Japon se distingue de
celui de la Chine). Il n'y a donc pas de point de vue japonais, en tout cas
depuis deux sicles, en dehors d'un processus de modernisation d'abord
distinct, puis associ, sous la pression mais de l'intrieur, l'occidentalisa-
tion. Le voyageur peut donc, en suivant les analyses de Kat Shichi
19
,
considrer le XIXe sicle comme un tournant 20 dans l'histoire intellec-
tuelle du Japon, et en suivre les inflexions en les prenant pour guide.
La premire de ces inflexions s'incarne peut tre dans la figure de
Sakuma Shzan, coup sr un des premiers avoir pris la mesure du dfi
que constitue le surgissement de l'Occident dans l'horizon japonais.
Sakuma Shzan
21
, penseur
22
et homme politique, commence par
s'opposer l'ouverture, fidle en cela l'inspiration confucenne qui lui
fait considrer l'Empire comme le centre du monde et son Extrieur comme
la Barbarie [Kai Shis, dans la transcription japonaise]. Shzan se rallie
donc au slogan Chasser les Barbares trangers . Le Shgunat ne sera
jamais capable d'appliquer ce programme et c'est ce constat qui conduit
Shzan changer d'avis: face la supriorit militaire des Occidentaux, il
convient de s'approprier leur art, et pour ce faire de renoncer l' exclusio-
Kyto 71
nisme. Shzan propose alors au Shgunat de ne plus' utiliser le terme
Barbares dans les textes officiels. Le raisonnement peut sembler para-
doxal, presque tortueux : tout en prenant acte de la diffrence radicale entre
la morale pratique orientale, d'inspiration no-confucenne, et l'art occi-
dental qui anime la science et les techniques, notamment militaires, Shzan
propose, par del leur opposition, d'utiliser les secondes pour prserver la
premire de la conqute. Il y a bien l un tournant intellectuel, puisque se
pose pour la premire fois dans ces termes la question de l'identit de la
nation japonaise. Non seulement Shzan pose la question, mais sa rponse
vite d'opposer en bloc la morale pratique orientale (dont il fait l'attribut
principal de l'identit japonaise) et la technique occidentale arrime aux
universaux qu'elle sous-tend. Au contraire, l'identit japonaise est juge
susceptible de les accueillir. Autant dire que l'identit nationale japonaise,
ce Soi que l'irruption du Monde force penser, est dsormais cher-
cher dans un entre-deux, celui que constitue le contact de deux visions du
monde, 1 orientale et l'occidentale. Shzan paiera ce tournant de sa vie
puisqu'il sera assassin par les exclusionnistes bien avant que la chute du
Shgunat et la restauration impriale ne fassent triompher le choix de l'ou-
verture.
Mais ce tournant n'est pas pour autant une rupture : selon
Maruyama, la dmarcation originale que constitue la pense de l'entre-deux
n'est possible qu' partir du cadre original de la pense no-confucenne
qui se dveloppe dans le Japn du XVIIIe sicle en s'loignant de ses ori-
gines continentales. C'est en effet la situation marginale de l'archipel dans
le monde chinois qui explique que certains penseurs, tels que Shzan, aient
pu dissocier l'Empire, l'Univers et le principe de l'universalisme pratique,
le li
123
Le confucianisme chinois n'oprera pas avec, la mme aisance cette
dissociation qui autorise l'utilisation de l'art et de la cosmologie physique
occidentaux salIS se dpattir d'ulle position qui prserve politiquement le
nationalisme japonais. C'est en faisant du li le principe qui transcende
l'Empire lui-mme, et en y soumettant la rationalit scientifique et tech-
nique, que Shzan parvient concilier cultures orientale et occidentale au
sein de'l'identit japonaise. Au demeurant, cette conciliation permet de
raffirmer la permanence du Moi japonais, en quoi elle constitue un
plaidoyer pro domo tout fait opportun.
Ds la gnration suivante, le climat se transforme considrable-
ment. Toujours selon Maruyama, Fukuzawa Yukichi (1834-1901)24 par
exemple n'est dj plus imprgn de la culture no-confucenne qu'il rejet-
te, pour faire sienne les thses venues d'Occident
25
Non pas qu'il consid-
re que ces dernires sont incompatibles avec l'identit japonaise, mais bien
plutt que cette dernire ne peut tre prserve politiquement sans se sou-
72 prouver l'uni versel
mettre aux valeurs occidentales.
Ici encore, comme chez Shzan, il s'agit d'accepter l' occidentalisa-
tion au nom des impratifs de la. dfense nationale, mais Fukuzawa n'est
dj plus dans l'entre-deux, ce n'est plus au nom de l'universalit du li des
no-confucens qu'il lance son invitation l'acquisition des connaissances
en provenance de l'Occident, mais au nom de la civilisation [bunlneikai-
kaF6, ce qui le conduit dfendre l'ide moderne de l'tat-Nation et le droit
international. D'ailleurs la victoire du Japon dans la guerre qui l'oppose
la Chine (1894-1895) bouleverse l'opposition politique Orient/Occident et
tend lui substituer une double opposition Japon/Asie et JaponlEurope.
Fukuzawa dfend alors le slogan Sortir de l'Asie, Entrer en Europe , et
admet la ncessit pour le Japon de rompre avec ses voisins pour rattraper
le retard civilisationnel qui le spare de l'Europe et se prserver de la colo-
nisation, concrtement en se librant des traits ingaux. Son ambition poli-
tique est de pouvoir rapidement faire du Japon un membre influent du grou-
pe des pays civiliss.
Fukuzawa n'est certes pas un occidentaliste idoltre, comme beau-
coup, et il refuse de se contenter de singer superficiellement les murs des
dominants, appelant les Japonais en saisir l' esprit , qu'il va chercher
dans le soutien populaire la promotion de la science et de la morale. Il
reste que son uvre est tourne vers l'occidentalisation du Japon, identifie
la civilisation, qu'il souhaite la plus profonde possible, et si sa position ne
peut se rsumer dans le slogan officiel me japonaise, technique occiden-
tale , c'est parce qu'il a la lucidit de considrer que la technique est indis-
sociable de son esprit.
L o Shzan adopte le point de vue no-confucen pour penser le
rapport du Japon au Monde, la gnration de Fukuzawa fait le grand saut en
se situant du point de vue occidental de l'histoire mondiale, c'est--dire du
point de vue de la modernit europellile. Ce saut irlduit une hirarchisation
des valeurs contre laquelle les nationalistes s'insurgent ds 1880. L' cole
romantique japonaise constitue partir de 1930 une des plus remar-
quables expressions de cette indignation, sur le mode ironique qu'engendre
la pleine conscience de l' inexorabilit des bouleversements sociaux. Elle
fait des intellectuels acquis la civilisation la cible favorite de ses sar-
casmes et fustige la servitude de ses contemporains l'gard de la pense
occidentale jusqu' faire de cette posture d'esthte ironiste la vritable
incarnation de l'identit japoilais
27
Pour le voyageur en qute d'une philosophie japonaise de l'entre en
commerce, les intellectuels de la jeunesse de Meiji 28 sont peut-tre les
premiers penseurs vritablement hybrides : par leur ducation, ils sont aussi
proches - ou aussi lointain, comme on voudra - du no-confucianisme et
Kyto 73
du bouddhisme que de l'idalisme allemand et du positivisme scientifique,
et ils peuvent prtendre parvenir une critique interne de la modernit occi-
dentale du point de vue de la pense japonaise. C'est cette gnration qui
voit s'accomplir l'uvre de Nishida Kitar (1870-1945), considr comme
le premier et le plus grand des philosophes (au sens proprement occidental)
japonais
29
la diffrence de Shzan, le projet thorique de Nishida Kitar
n'est pas de penser l'entre-deux, mais de s'installer dans la rationalit occi-
dentale, et plus prcisement philosophique, pour penser en japonais les
catgories de la pense japonaise en tant que catgories philosophiques, au
sens strict, occidental du terme. Il s'agit ni plus ni moins que de faire mer-
ger un systme philosophique d'origine non occidentale, quelque chose
comme une philosophie orientale. L'expression relve sans doute de l'in-
terprtation : Nishida parle de culture orientale, d'esprit oriental, mais
considre qu'il n'y a qu'une philosophie. Reste que son projet est de conti-
nuer la philosophie partir de cet esprit oriental, par del la philosophie
occidentale, comme il le dit dans un entretien avec un de ses disciples, Miki
Kiyoshi, en 1935. Il n'est pas choquant de parler de philosophie orientale
pour qualifier cette ambition:
Il faut traverser la pllilosophie occidentale. Car la philosophie doit
savoir se prsenter sous une forme scientifique. En Chine, il yale
confucianisme ou la doctrine des mutations
30
, mais mon avis, on ne
saurait passer par l. Le bouddhisme est trs intressant, mais lui non
plus ne nous permet pas d'aller plus loin. Donc il faut qu'une pense
particulire naisse de cette traverse de la philosophie occidentale et
saisisse ce que nous portons dans notre cur. Aujourd'hui, les armes
japonaises sont puissantes parce qu'elles ont appris la stratgie de
1" Occident et non celle de Shingen ou de Kusunoki Masashige
31
Il est
sidrant de soutenir que cette mthode ne s'appliquerait pas aux
tudes. Il faut faire des tudes la manire des Occidentaux, de mme
que les militaires ont adopt les mthodes occidentales. L'important
tant de traverser. 32
L'ide d'une philosophie orientale qui satisfasse les exigences de
rigueur, de clart et d'rudition de la philosophie sans adjectifs, mais qui
prenne en charge la gographisation constitutive de la critique de l'univer-
salisme eurocentr est-elle l'aboutissement de la qute du voyageur, le point
de vue la fois philosophique et japonais tant recherch? Pour le voyageur,
le parallle entre la forme philosophique et les techniques militaires est
douteux. Surtout, la prtention l'universalit de la philosophie ne lui inter-
74 prouver l'universel
dit-elle pas d'tre orientale, occidentale, septentrionale ou mridionale? De
l'adoption d'un point de vue la qualification gographique, il y a peut-tre
un long chemin, et le voyageur, ne sachant pas o il. mne, ne s'y aventure-
ra pas sans examen philosophique approfondi. Ce qui revient admettre
qu' tout le moins la pertinence du projet de Nishida doit faire l'objet de cet
examen.
Nishida appartient sans doute la jeunesse de Meiji mais sa lon-
gvit permet d'associer la ralisation de son projet de fondation d'une dis-
cipline nouvelle aux intellectuels de 1' ge industriel . Son nom est en
particulier intimement li l'Universit Impriale de Kyto, cre en 1897,
o il dispensera son enseignement. Les philosophes qui le suivent s'em-
ploient raliser ce projet et forment l'cole de Kyto, dont le rayonnement
est important dans les annes trente et quarante
33
Chronologiquement, l'cole de Kyto est l'hritire critique de la
notion de civilisation. Par civilisation, la gnration de Meiji, particulire-
ment Fukuzawa, entend l'identification de l'Occident, de la modernit et de
la universelle, et associe l'avenir du Japon son dveloppement
civilisationnel, c'est--dire sa modernisation, comprise comme rationali-
sation sur le modle occidental. L'cole de Kyto partage cette dfinition
de la notion de civilisation, mais, en l'articulant une philosophie de l'his-
toire, se propose de la dpasser. Elle s'inscrit donc explicitement dans la
Crise des Sciences Europennes , dans la crise de la philosophie elle-
mme, celle en tout cas que dcouvre Nishida travers Bergson, Husserl,
Heidegger ou Marx.
Le projet de constituer une philosophie orientale s'articule d'une part
autour de la critique interne de la philosophie occidentale, en dbusquant
les concepts marqus par l' eurocentrisme pour l'en dbarrasser ; c'est ce
qui conduit Nishida faire rsider le cur de l'occidentalit dans l'ide
de substance et se proposer de dsubstantialiser la philosophie et
d'autre part, il s'agit de reformuler la pense orientale dans le langage de la
logique et de la philosophie, ce qui suppose un immense effort de clarifi-
cation , qui fait subir ce fond oriental une formidable violence.
L'mergence de la philosophie orientale est aussi contemporaine du
dveloppement de l'ultra-nationalisme, de la militarisation et de la guerre,
et s'est de surcrot fortement compromise en fournissant au rgime les
assises idologiques qui lui manquaient pour obtenir l'adhsion des intel-
lectuels et des tudiants
34
Le dbat d'aprs-guerre sur le degr de compromission de l'cole de
Kyto avec le rgime militaire n'a pas manqu de puiser des arguments
dans l'examen de leurs prises de positions contre la modernit occidentale.
L'cole elle-mme reste d'ailleurs troitement associe la participation et
Kyto 75
l'organisation de deux symposiums, tristement fameux 35 parce qu'ils
taient conus, en tout cas par quelques uns des organisateurs, comme une
lgitimation de la politique d'agression du rgime. Lors du premier de ces
symposiums, intitul Dpassemellt de la Il0
l'un des reprsentants de l'cole, Suzuki Shigetaka (1907-1988) dfinit le
sens de l'expression comme suit:
[L]e dpassement de la modernit est dans la politique le dpasse-
ment de la dmocratie, dans l'conomie le dpassement du capitalis-
me et dans la philosophie le dpassement du libralisme. [... ] Dans
le cas du Japon la question du dpassement de la modernit se
superpose la question spcifique du dpassement de la domination
du monde par l'Europe et le problme devient plus compliqu. 37
La complication en question, fait l'objet du second symposium, qui
s'inscrit dans la mme problmatique que le prcdent, et s'intitule Le point
de vue de l'Histoire mondiale et le Japon [Sekaishiteki Tachiba to
Nippon] 38. Dans ce second symposium, il est beaucoup plus directement
question de lgitimer l'agression japonaise. Si l'on excepte donc le cas de
son fondateur, Nishida Kitar lui-mme, qui a fait couler trop d'encre pour
faire l'objet d'une prise de position sans discussion approfondie, il ne fait
aucun doute que le projet philosophique mme de l'cole est lourdement
hypothqu par les prises de positions idologiques de ses membres en
faveur de la guerre.
Pour le voyageur, on ne peut pas dire que cette hypothque tombe
prcisment bien. Outre le peu d'inclination politique qu'il prouve pour le
militarisme japonais, il sait qu'ayant congdi l'universalisme moral pour
sauver l'universalit de la philosophie, il s'expose dsormais l'argument
politique du chaos: il n'y aurait, hors de la lgitimation des normes par
l'universel, que la guerre, le fascisme et l'oppression de la libert
39
Si tel tait le cas, les hsitations de Bourdieu soulever la ques-
tion de l'universalit des modles de valorisation seraient justifies par
des considrations de prudence politique. Le voyageur voit plutt dans cet
argument deux erreurs, l'une philosophique et l'autre politique.
Philosophiquement, la question de la lgitimation des valeurs et la
critique de l'universalit n'a rien de nouveau, ni de tellement effrayant, on
peut mme dire que cette dispute existe depuis qu'il y a de la philosophie.
Politiquement, il est illusoire de penser consolider les idaux de la dmo-
cratie dans le monde en cherchant les imposer sous une forme qui n'est
pas susceptible de convaincre ceux qui sont censs les mettre en uvre et
en bnficier.
76 prouver l'universel
Le voyageur surmonte donc ses propres craintes et persvre dans la
suspension de son jugement, dot pour toute morale provisoire des exi-
de rigueur, de clart et d'rudition qui sont celles de la
C'est dans cette capacit surmonter ces craintes que se joue la possibilit
d'un vritable dsintressement, qui seul ouvre la voie la comprhension.
De surcrot, le Dpassenlent de la modernit n'est pas seulement le
thme d'un symposium clbre, c'est une proccupation centrale de la pen-
se japonaise moderne
40
Le constat de cette centralit devrait suffire -
sauf considrer que tous les japonais sont fascistes depuis cent cinquante
ans - en finir avec cette objection politique, pour se tourner vers les pen-
seurs de l'cole de Kyto qui sont ceux qui ont pos le problme de l'en-
tre en commerce frontalement, dans les termes mme de la philosophie.
Comme Kant, ces penseurs cherchent adopter un point de vue qui
s'manciperait de la particularit, le point de vue universel de l'Histoire
mondiale. Que peut bien tre une philosophie de l'universel qui s'origine
ailleurs qu'en Europe, et se construit aussi partir de catgories non euro-
pennes, mais qui, formule dans les termes de la philosophie, en reven-
dique le titre, et par consquent l'universalit?
L'unit de l'cole de Kyto tant matire dbat, le voyageur se doit
de choisir, par souci de cohrence, un seul de ses membres. Son choix se
porte sur celui chez qui on trouve traite la question de l'entre en com-
merce, et de ses conditions de possibilit de la manire la plus explicite, et
la plus accessible (parce qu'il est plus pondr dans l'usage du fond
oriental ?) : Kyama Iwao (1905-1993), auteur d'un ouvrage intitul
Philosophie de l'histoire mondiale [Sekaishi no tetsugaku].
Le choix de Kyama ne contribue pas simplifier la nature du rap-
port entre l'adoption du point de vue japonais et la lgitimation de la guer-
re. Il est tellement peu tranger au soutien idologique au rgime ultra-
nationaliste qu'un commentateur contemporain pourra dire de lui que la
rationalisation de la guerre culmine dans [s]a philosophie de l'histoire 41.
La philosophie de l'histoire de Kyama
S'inscrivant dans ce projet de constitution d'une philosophie orien-
tale, Kyamas'emploie dans sa Philosophie de l'Histoire mondiale la cri-
tique des philosophies de l'Histoire qui rationalisent et lgitiment, en l'ap-
pelant Histoire universelle, l'europanisation du Monde. Son point de
dpart correspond donc prcisment la faille que Kant met en lumire
dans le texte sur le droit de visite : l'expansion des tats commerciaux ne
peut tre identifie navement au dveloppement de la civilisation moder-
ne.
Kyto 77
Mais il considre aussi que mme si l'expansion commerciale et les
consquences qu'elle porte s'origine dans la vision europenne du monde,
il n'est pas possible de s'en tenir une critique de l'histoire mondiale
comme simple hypostase de la particularit europenne.
En effet, il faut, selon lui, accorder que l'europanisation du monde
joue un rle dterminant dans la constitution d'une universalit concrte:
l'Europe en devenant le monde, cesse d'tre un continent particulier pour
devenir le lieu de l'unification de l'histoire mondiale. Ainsi:
[T]outes les puissances europennes, quelles que soient les diff-
rences de degr, sont des tats qui contiennent des lments non
europens. 42
Mais l o l'universalisme communicationnel associe le devenir-
monde de l'Europe la cration des conditions objectives requises pour
l'nonciation de normes universellement valides, Kyama prfre insister,
lui, sur le paradoxe inextricable qui en rsulte : l'introduction d'lments
non europens dans le monde europen renforce la dpendance de l'Europe
vis--vis du non-europen, et c'est justement cette dpendance l qui rend
possible le devenir-mon'de de l'Europe.
En inscrivant ce devenir-monde dans un processus paradoxal,
Kyama met jour une rupture, un moment essentiel de l' histoire: sa mon-
dialisation. L'mergence de la mondialit de l'histoire mondiale, le moment
o l'histoire mondiale n'est pas seulement unie par le dveloppement de la
particularit europenne, mais o s'opre le retournement par lequel
l'Europe, en devenant monde, cesse d'tre elle-mme, lieu du surgissement
du non europen dans l'histoire, non pas seulement comme lment de
l'histoire europenne, mais en tant que non europen.
Ce surgissement correspond au tournant qui inaugure vritablement
la mondialisation de l'histoire mondiale, condition relle et ncessaire pour
que la pense europenne, et particulirement la philosophie, puisse s' af-
franchir de l'eurocentrisme qui mine de l'intrieur sa prtention l'univer-
salit.
[ ] [L]a philosophie de I'histoire doit tre une philosophie de
l'histoire mondiale- c'est l'ide qui est au fondement de ma philo-
sophie de l'histoire, et qui reprsente, me semble-t-il, la tendance
historique de l'poque contemporaine. Cette tche est plutt celle
des chercheurs de notre pays qui appartient au monde non europen
que celle des chercheurs europens, et je ne dis pas cela par suffi-
sance subjective, mais en regard de la trop vidente ncessit qu'en-
78 prouver l'universel
gendre la mondialisation de l'histoire mondiale issue de l'indpen-
dance du monde non europen. La tendance actuelle de l'histoire
mondiale exige ncessairement de n<?us la critique de la thorie de
l'histoire labore par les chercheurs europens jusqu' nos jours. 43
Kyama pose donc une condition la ralisation de l'entre en com-
merce : la reconnaissance du moment de la mondialisation comme surgis-
sement du non europen en tant que tel, comme rupture inaugurant l'histoi-
re vraiment mondiale du monde, quand il convient de cesser de parler de
l'universel qui se ralise dans l'histoire, parce que l'histoire universelle est
trop compromise dans le devenir europen du monde.
Pour rendre compte de cette opposition, Kyama distingue nettement
unification et mondialisation du monde et refuse de considrer que l'unifi-
cation europenne du monde, ralise par la colonisation, suffise rendre
l'histoire vraiment mondiale, parce que l'interdpendance commerciale ne
suffit pas en elle-mme assurer le caractre vraiment mondial de l'histoi-
re, dans la mesure o cette unification relve de la soumission du non euro-
pen l'europen. En quoi consiste le moment de la rupture dans l'histoire
mondiale? C'est un vnement politique, la ngation de l'ordre exclusive-
ment europen qui introduit le passage historique du Monde Moderne au
Monde Contemporain:
Que nous rvle le sisme actuel du monde, ce grand tournant de
l'histoire mondiale? C'est, me semble-t-il, la tendance ou le fait que
le monde non occidental se rend indpendant par rapport au monde
occidental. Les tats non occidentaux, qui paraissaient peu prs
incorpors dans le monde occidental la fin du XIXe sicle ou au
dbut du XXe sicle s'en sont progressivement affranchis et se sont
manifests comme existence transcendante, commencer par notre
Japon. On s'est aperu partir de l que le monde occidental, consi-
dr purement et simplement jusqu'ici comme le monde mme,
n'tait en vrit qu'un monde moderne [... ]. Cela signifie justement
que le monde non occidental rclame peu peu une existence gale
celle du monde occidental et que le monde contemporain [gendai
sekai] dont l'ordre et la structure sont diffrents de ceux du monde
moderne, le monde de l'histoire mondiale au sens vritable du
terme, commence devenir effeCtif. 44
Le monde contemporain est une pluralit de mondes qui revendi-
quent l'galit de statut avec l'Europe. Ce pluralisme-ci se distingue de
celui de Habermas en ce qu'il est sans hirarchie, ni du point de vue de la
Kyto 79
rationalit, ni du point de vue de la modernit, ni du point de vue du dve-
loppement moral. Une hirarchisation supposerait que ces mondes soient
considrs selon une temporalit unique et ordonns dans cette temporalit
en fonction de stades de dveloppement. Mais c'est justement l'homog-
nit de cette temporalit que le moment de la rupture a pour fonction de
briser. La contemporanit chez Kyama est une unit topique qui enve-
loppe de multiples temporalits.
Ce refus de penser l'histoire comme une continuit linaire est au
cur de sa critique de la philosophie allemande de l'histoire, dont on aura
compris qu'il s'inspire trs largement. Pour lui, aussi bien Ranke que Hegel
et Marx, associant historicit et temporalit, considrent l'histoire mondia-
le du seul point de vue de l'unification du monde. Ce point de vue, Kyama
le nomme pense moniste du Monde [Sekai iclzigen ron] et le juge naf
et pr-critique :
Une telle conception, me semble-t-il, fut le prsuppos considr
comme vident de nombre d'historiens de l'histoire mondiale, et ne
fut gure thmatis en vue d'tre critiqu. Ce que j'appelle une pen-
se moniste du monde est celle qui conoit le monde comme un
depuis le dbut (dans les cas les plus nafs, l'espace gographique
naturel du globe est considr comme suffisant pour constituer la
mondialit du monde), et qui conoit le monde Ilistorique existant
comme dj accompli. 45
La conception moniste serait donc construite sur un prsuppos
implicite et non critiqu, l'unit dj donne de la temporalit historique.
D'aprs Kyama, il convient au contraire de considrer que l'unit du
monde, qui seule rend possible un universalisme vritable, ne prexiste pas
son accomplissement historique. n'est pas la ralisation d'un
procs tlologique dont la fin est donne ds le dpart, c'est un processus
ouvert qui peut tout aussi bien maintenir la pluralit radicale des mondes et
de leur histoires respectives. Rompre avec la conception moniste de l'his-
toire est la seule manire de prendre en compte la pluralit du monde,
comme la ralisation et le dveloppement historiques de chacun de ces
mondes 46.
L'opration de substitution d'un monde contemporain - celui de la
coexistance de devenirs-monde pluriels au monde moderne produit par
l'europanisation commerciale passe donc par une gographisation de
l'histoire. Kyama ne reproche pas la philosophie de l'histoire d'ignorer
la gographie comme diffrenciation spatiale, mais de penser la gographie
dans le cadre d'une histoire moniste:
80 prouver l'uni versel
Il est ncessaire de critiquer l'ide selon laquelle l'historicit
serait temporalit, et insister sur le fait que l'historicit ne peut tre
rduite la seule temporalit, et doit inclure la s p t l ~ [kkansei]
(rgionalit [chikisei] et gographicit [chirisei]) comme un moment
ncessaire de sa constitution. 47
L'histoire mondiale ne rencontre pas seulement la diffrenciation
spatiale comme autant d'tapes d'un dveloppement historique dont l'uni-
t est assure par l'unicit de la temporalit historique, mais doit, pour pr-
tendre la mondialit, assumer - comme un moment ncessaire de sa
constitution - la gographisation de l'histoire. La temporalit n'apparat
que mdiatise par la spatialit, et prend la figure d'une histoire mondiale
qui se prsente comme coexistence d'une pluralit de mondes, compris
comme pluralit d'units historiques. La consquence de cette gographi-
sation constitutive de l'histoire est l'impossibilit d'enfermer le contact
entre ces mondes historiques diffrencis dans un processus unique, a for-
tiori tlologis. Dans le monde contemporain de Kyama, l'histoire uni-
verselle de l'unification commerciale du monde est remplace par une map-
pemonde sur laquelle des continents drivent et se heurtent.
La thorie de l'histoire de Kyama n'est pourtant pas rductible un
pluralisme radical des mondes historiques incommensurables et la spatiali-
sation de l'histoire n'est pas synonyme de relativisme strict, puisque
Kyama non seulement ne renonce pas penser l'universel, pas plus que
l'unit du monde, mais prtend mme y parvenir mieux que la philosophie
allemande.
Pour lui l'universel authentique se constitue dans le processus de
mondialisation des mondes historiques juxtaposs, mondialisation distincte
de l'unification par l'expansion commerciale en ce qu'elle se fait sur fond
de pluralit des mondes. La rupture historique qu'est le surgissement du
non europen une fois ralise :
[P]our la premire fois l'ge contemporain, les temps historiques
et les mondes ont dpass la juxtaposition d'autrefois et ainsi sur-
mont la communaut formelle pour s'unir au sens vritable du terme
[... ]. Nous ne pouvons penser l'histoire mondiale d'aujourd'hui [i.e.
aprs la rupture] sans tenir compte du progrs qui va de l'histoire
mondiale moderne et europenne l'histoire mondiale authentique-
ment mondiale [... ]. Ce qui est vraiment universel est envelopp
dans la tendance de l'histoire mondiale d'aujourd'hui et non dans
l'histoire mondiale moderne et europenne, pas plus que dans les
histoires mondiales particulires d'antan. [... ] L'universalit concr-
Kyto 81
te n'est autre chose que la mOfldialit historique, c'est--dire la fnon-
dialit de l'histoire nlondiale. 48
Chez Kyama, l'universalit concrte n'est pas incarne par un tel
ou tel acteur de l'histoire mondiale, mais consiste en la coexistence des dif-
frents mondes historiques, et l'histoire mondiale est le lieu de cette coexis-
tence. C'est la scne elle-mme qui garantit l'unit d'action entre ces
mondes en relatiol1 les uns avec les autres. On peut parler de topisme,
comme on parle d'historisme. Ce topisme ne le conduit pas prner leur
fermeture ou leur incommensurabilit, bien au contraire, la cration histo-
rique qui ralise l'universalit concrte rside dans leur rapport, dans le
choc de leurs contacts. Mais la diffrence de l'universalisme communica-
tionnel, Kyama ne prsuppose pas de langage commun qui prexisterait
ces contacts et les rendrait possibles
49
En quoi Kyama chappe-t-il au relativisme? Rpondre cette ques-
tion est d'autant plus difficile qu'il se rclame explicitement la fois de
l'universalisme et du relativisme.
L'universalisme concret apparat en effet comme un rapport, une ten-
sion entre mondes distincts, ce qui le relativise comme rapport relatif entre
mondes distincts et aussi vis--vis de l'universel absolu: le monde histo-
rique en tant qu'historique ne peut pas ne pas tre relatif . L'unit du
monde terrestre, la mondialit de l'histoire mondiale, comme le dit
Kyama, tient prcisment dans les relations qu'entretiennent les mondes.
Il faut de surcrot ajouter que ces rapports ne sont pas perptuels,
mais historiques et contingents. Kyama va au-del de l'historisme en cri-
tiquant le monisme des philosophies de l'histoire, mais en conserve cepen-
dant l'ide centrale selon laquelle rien de ce qui est dans l'histoire n'chap-
pe l'historicit,. et donc la relativit: la relativit constitue une des
essellces du 111011de historique, un monde qui ne serait pas relatif ne serait
pas historique. 50
L'universel est donc deux fois relatif. N'est-ce pas l un paralogis-
me ? Kyama connat, semble-t-il, la critique de l'argument sceptique selon
laquelle nier universellement l'universel, c'est encore affirmer une thse
universaliste. La logique voudrait que, relativiste, il nie que son relativisme
soit universel ou que, universaliste, il nie que son universalisme soit relatif.
Sa ligne argumentative opre strictement l'inverse: il revendique un rela-
tivisme historique et gographique radical au nom d'une universalit
absolue qui fait que mme le monde universel contemporain reste un parti-
culier et que le rnonde historique en gnral reste relatif et particulier 51.
Cette universalit absolue doit tre naturellement ce qui transcende le
monde historique, c'est--dire le supramondial. 52 Ou encore le Nant
82 prouver l'universel
absolu 53.
L'universalisme concret pens comme universalit de rapports rela-
tifs n'puise donc pas toute pense de l'universalit. Ce qui est au demeu-
rant impliqu logiquement dans la revendication de l'universalit de rap-
ports relatifs entre mondes particuliers, et apparat aux yeux du voyageur
comme la ralisation d'un exploit : apporter un nouvel argument dans cette
ancienne querelle.
L'universel concret, comme ralit de rapports relatifs les uns aux
autres, et eux-mmes relativiss parce qu'historiciss, ne peut puiser la
question de l'universel, car l'universalit du caractre relatif de ces rapports
les transcende et fait donc appel un principe transcendantal, mais, et c'est
l l'originalit de l'argumentation, ce transcendantal, n'est pas un plein, un
contenu ou une forme, mais un vide pouss l'absolu.
Le Nant absolu ne se ralise pas dans l'histoire, il est le lieu de toute
ralisation: c'est pourquoi il n'est pas possible de dsigner l'anhistorique
comme ce qui est permanent - selon le langage de l'universalisme euro-
pen - mais au contraire rside dans le fond vide d'o mergent les v-
nements contingents qui font l'histoire. Ce -fond vide peut bien tre dit
anhistorique Kyama prfre quant lui parler de supra-mondial pour dis-
tinguer avec prcision la gnralisation abusive d'un contenu particulier et
la vacuit ontologique de l'universel absolu. Il fait aussi usage de l'expres-
sion anhistorique pour indiquer que si le Nant absolu se rvle dans l'his-
toire comme principe de singularisation de l'vnement historique, il le
transcende, ou pour le dire encore autrement s'y rvle mais ngativement.
Kyama ne peut ainsi pas tre tax de relativisme, mme s'il considre que
le monde historique est absolument relatif et que l'histoire mondiale n'offre
rien d'assez permanent pour parler d'universel, sinon son impermanence.
La nouveaut de l'argument rside dans la dsubstantialisation du
principe transcendantal constitutif de l'universalit du monde. Bien que sai-
sissable et reprsentable, par la philosophie - orientale en l'occurrence, la
ngativit pure de ce transcendantal le rend compatible avec une pense
strictement pluraliste au niveau de l'Histoire.
Par del l'intrt que prsente l'introduction de l'argument du Nant
absolu dans la querelle de l'universalisme, le Nant absolu joue dans la
thorie une double fonction qui porte directement sur le problme de l' en-
tre en commerce d'une part, il permet de rompre avec toute tlologie, en
rendant pensables d'autres mondes possibles que ceux raliss dans l'his- .
toire. Cette rupture permet de penser le contact pour lui-mme, dans sa
contingence radicale, sans rfrence externe des- valeurs ou un mode de
valorisation particulier cens orienter la relation. D'autre part, l'universali-
t absolue, parce qu'elle est strictement ngative, ne fonctionne pas comme
Kyto 83
un principe transcendant l'histoire mondiale, mais ce principe au contraire
reste strictement immanent chaque acte particulier: le Nant absolu fonc-
tionne comme immanentisation de la transcendance, qui permet d' absoluti-
ser l'immanence. En effet le nant absolu transcende toutes les substantia-
lits ancres dans la particularit, quelque que soit leur prtention chap-
per la relativit historique. Mais cette transcendance n'est pas n'importe
quelle transcendance, c'est le Nant absolu, c'est--dire, strictement par-
ler, rien. Par consquent ce transcendantal est absolument immanent ce
qu'il transcende ngativement, c'est--dire l'histoire mondiale:
L'Absolu transcende le Monde, de mme que l'ternel transcende
le Temps. En gnral, c'est de l que nat la conscience de la relati-
vit historique. C'est aussi de l que naissent la relativit de
l'Histoire mondiale universelle et sa priodicit historique. Et pour-
tant, quand on y rflchit bien, l'Absolu et l'ternel qui transcendent
le Monde et le Temps se rvlent dj sous la figure du Monde et de
l'poque, ou plutt sous celle de l'Histoire Mondiale du Monde
Historique, en fournissant le fondement ncessaire la prise de
conscience de la relativit et de la particularit du Monde et du
Temps. S'ils ne se rvlaient pas dans l'Histoire Mondiale, il n'y
aurait pas de lieu de rvlation de l'Absolu et l'ternel. Si l'Absolu
se sparait absolument du relatif pour s'y opposer, il resterait une
sorte de relatif et ne serait pas absolu. Le vrai Absolu se rvle dans
le relatif, et enveloppe le relatif comme son contenu. L'Histoire
Mondiale est le lieu de la rvlation de l'Absolu et de l'ternel. 54
Et en effet, le Nant absolu n'est pas compltement rductible
l'universalit concrte qui se ralise dans l'histoire mondiale; c'est pour-
quoi Kyama prtend chapper au relati visIIle. Le Nallt absolu est en rap-
port l'universalit concrte comme le virtuel l'actuel, ou comme une
infinit de mondes possibles au monde rel unique, mais cette irrductibili-
t du Nant absolu l'effectu n'est pas contradictoire avec l'affirmation du
caractre absolument immanent du Nant absolu, puisque ce monde rel est
absolument ralis tel qu'il est, sans qu'il soit possible ou ncessaire de se
demander pourquoi c'est ce monde-ci et pas un autre, ni si c'est le meilleur
possible, puisque, tant le seul monde absolument rel c'est ncessairement
le meilleur possible, ce qui n'empche pas, bien entendu, de penser la
coexistence de ce monde rel avec d'autres compossibles virtuels. Il n'y a
pas vritablement de thodice dans cette thorie, plutt une acceptation de
la ralit comme dtermination suprieure par rapport la virtualit.
Ce que dcouvre le voyageur, c'est donc que la dsubstantialisation
84 prouver l'uni versel
du transcendantal, en lui tant tout contenu, rend certes possible son imma-
nentisation, mais permet aussi de donner n'importe quel contenu l'actua-
lisation du Nant absolu. Loin d'associer l'universalit du Nant absolu
un quelconque mode de valorisation, Kyama promeut au contraire l'iden-
tification de toute ralit historique une actualisation de l'universel abso-
lu. Ce dernier est axiologiquement neutralis.
En toute rigueur, Kyama ne devrait donc pas hirarchiser les cra-
tions historiques selon les valeurs qu'elles actualisent, en rapport avec le
Nant absolu. C'est pourtant ce qu'il fait, en tirant toutes les consquences
de la logique du Nant absolu: ds lors que toute ralit historique est l' ac-
tualisation du Nant absolu, il existe une correspondance profonde entre les
niveaux empiriques de l'histoire concrte et le niveau logico-ontologique :
toutes les crations historiques revtent un sens philosophique. Ainsi, le
Nant absolu est-il le lieu d'o surgit l'histoire mondiale, qui elle-mme est
le lieu d'o surgissent les mondes historiques en tant qu'tats, d'o surgis-
sent les Peuples, d'o surgissent les Familles, d'o surgissent les indivi-
dus ... Entre poupes russes et organicisme, ce jeu logique permet d'attri-
buer peu prs n'importe quelle dtermination ontologique n'importe
quelle ralit historique.
Cette logique, dite du Nant ou de l'auto-identit des contradictions
absolues
55
[zettai mujunteki jikoditsu], est sans doute l'un des concept cen-
traux de l' uvre de Nishida et l'un des points de ralliement fondamentaux
des membres de l'cole de Kyto. Ne disposant que d'un bagage lger, le
voyageur prfre suspendre son jugement quant la pertinence de ce
concept du point de vue logique, mais il doit constater que, transpos dans
le champs de la philosophie politique, et utilis par le disciple de celui qui
l'a conu, il autorise absolument n'importe quoi
56
Au point que le voyageur
finit par se poser la question de savoir si la meilleure lecture de son uvre
ne devrait pas partir des Jllotivations politiques et idologiques qui l'ani-
ment pour se demander quels bricolages logiques sont requis afin de justi-
fier ce qui peine l'tre. Mais s'tant dplac jusqu'ici, c'est par la critique
philosophique qu'il entend discuter Kyama.
Du pluralisme des mondes historiques au militarisme japonais, il y a
une thse: celle qui fait des tat-Nations les acteurs privilgis de l'histoi-
re. Selon Kyama, les individus sont trop abstraits, les Peuples ne prsen-
tent pas les mdiations ncessaires, seules les Nations - dont l'tat est la
seule expression politique' extrieure - peuvent prtendre incarner les
communauts humaines particulires qui habitent la scne mondiale.
Plus prcisment, comme le remarque le commentateur Takahashi
Tetsuya
57
, chacun de ces mondes particuliers se transforme dans le passage
du monde moderne au monde contemporain. La rupture qu'est l' mergen-
Kyto 85
ce de mondes non europens a des consquences sur l'organisation interne
de chacun d'eux :
La tendance fondamentale que manifeste l'histoire mondiale
contemporaine par laquelle l'Asie et l'Europe sont en train de se
rformer dcle d'une certaine manire le dynamisme fondamental
de l'auto-rforme des mondes particuliers. [... ] Un monde particu-
lier tend visiblement la fermeture et l'auto-suffisance. Son fon-
dement est dans l'autarcie conomique, dans la solidarit politique,
dans l'affinit raciale et ethnique, dans la liaison troite de culture
et de destin, etc. Il est vident que la base en est la communaut par-
ticulire, rgionale ou climatique d'une part, historique ou destina-
le d'autre part. Ce qui distingue essentiellement le monde particu-
lier contemporain de l'ancien, c'est l'existence ou non d'une prise
de conscience de cette base, savoir si la formation de ce monde
particulier se fait naturellement ou consciemment. 58
S'il est certain que Kyama pense au dveloppement des rgimes
autoritaires, fascistes et nazi, la rfrence la parent raciale et ethnique ne
doit pas conduire identifier ses thses au racisme national-socialiste qu'il
rejette explicitement : une telle pense est l pour justifier au fond la
domination du monde par les Europens, et pour la fonder thorique-
ment. 59
Considrant que le racisme opre la confusion entre des concepts
biologiques, culturels et axiologiques 60, il juge qu' ils [i.e. le concept bio-
logique de race et le concept culturel de peuple] restent l'un et l'autre trop
abstraits pour le point de vue qui permet de saisir la ralit historique et
qu'au contraire, la Nation est plus concrte, c'est pourquoi elle doit tre
conue comme l'acteur originel de la ralit historique. La Nation est un
concept politique. En ce sens, nous devrions accorder au politique un carac-
tre originel dans la ralit historique. 61
En effet la Nation est le lieu de la mdiation du temporel et du spa-
tial, lieu de formation - travers le temps de la gnration - d'un corps
social en un environnement particulier, climatique et gographique. Cette
communaut ne devient cependant une Nation que par la mdiation de l'-
tat, qui suppose qu'elle entre en contact avec d'autres communauts:
Ici la communaut, en opposition perptuelle aux autres commu-
nauts, est oblige de se constituer elle-mme en une organisation
solide, dans ses rapports aux autres. [... ] Cette organisation est la
fois interne et externe, et ncessite dans sa totalit une structure syn-
86 prouver l'universel
thtique de l'unit et de la diversit. Ce n'est rien d'autre que l'or-
ganisation politique, et ici se ralise l'tat au sens strict du terme. 62
Le pluralisme n'est donc pas un pluralisme de civilisations (bun/llei),
mais un pluralisme d'tat-Nations (o le Peuple et l'tat sont distincts
63
),
ce qui permet d'expliquer le paradoxe de l'unification du monde par l'ex-
pansion commerciale qui - parce qu'eurocentr - est le contraire de la
mondialisation, mais qui, en multipliant les contacts entre communauts,
contribue les politiser et, htant la formation d'tats, rend ncessaire la
rupture - politique - et l'entre dans le monde contemporain. L'entre en
commerce est donc, pour chaque communaut historique et gographique,
le moment fondamental de la naissance du politique sous la forme de l'-
tat.
ce point de la lecture de Kyama, le voyageur comprend mal ce
qui peut sauver ce dernier d'une contradiction et d'une troitesse certaine.
La contradiction est dans l'articulation entre thorie de l'tat et tho-
rie de l'histoire. On voit mal, si le pluralisme entre mondes historiques est
aussi radical que le laisse supposer la critique du monisme historique, pour-
quoi la constitution de l'tat serait un passage oblig dans le processus his-
torique de tous les mondes historiques. On comprend la ncessit de
contacts entre les mondes historiques, il n'est pas impossible d'accorder
que ces contacts jouent un rle dans la constitution de l'identit de chaque
communaut, mais pourquoi ces contacts doivent-ils ncessairement engen-
drer la forme politique de l'tat? La transversalit du concept d'tat chez
Kyama contredit le pluralisme qu'il institue, comme la contingence des
liens qui devraient unir les mondes historiques entre eux.
la source de cette contradiction gt la rduction de tout contact
entre mondes historiques distincts une opposition. Selon Kyama, la natu-
re de ces contacts est chercher dans le rapport qu'entretiennent les com-
munauts humaines leurs territoires respectifs. Aucune communaut ne
peut se passer de territoire, parce que c'est une condition requise pour sa
survie. Ainsi,
Afin d'assurer la conservation de soi de chaque communaut, il va
sans dire que la possession de la terre revt une signification extr-
mement importante. Et pourtant, la terre susceptible d'tre approprie
est limite, c'est la raison pour laquelle la possession d'un territoire
est tout particulirement une source ncessaire de conflits - mme
si, en gnral, l'objet possd est born et qu'une possession est
exclusive. 64
Kyto 87
Cette exclusivit conduit ainsi rabattre mcaniquement la diversi-
t des mondes historiques et de leurs rapport une forme unique, la lutte
entre les tats, c'est--dire la guerre.
Il est donc patent que Kyama fait intervenir un troisime universel,
sur le plan de l' histoire mondiale, qui n'est ni l'universalit concrte de
l'ouverture de l'histoire l'vnementialit, ni le Nant absolu, mais doit
tre cherch dans le principe exclusif qui gouverne les rapports inter-ta-
tiques - la force.
En quoi consiste cette force?
Les tats, considrs comme l'identit politique des mondes histo-
riques, reproduisent dans le domaine des relations internationales les imp-
ratifs de la seule survie. Ce terme de survie n'est pas entendre dans un
sens strictement biologique - on a vu que Kyama critique vigoureuse-
ment le socio-biologisme nazi. S'il n'est pas impossible de voir une analo-
gie entre la mondialit du monde chez Kyama et un tat de nature de fac-
ture hobbesienne, il faut garder l'esprit que la survie est aussi bien spiri-
tuelle, et fait appel au concept d'nergie morale [dgiteki seiryoku /mora-
lische Energie], emprunt Ranke:
De mme que Ranke associe l'tat au rel-spirituel [das
Realgeistige], il y a une vie originelle qui gt au fond de l'tat et
c'est toujours la force spirituelle qui travaille en son sein. Cette force
spirituelle, Ranke l'appelle moralische Energie. [... ] Cela dit, l'tat
n'est pas un Etre intermdiaire [entre la nature terrestre et le spiri-
tuel divin], mais une substance synthtique qui a sa nature propre,
ou encore c'est ce qu'on appelle un " individu ". [... ] L'tat en soi
est sui generis, c'est une ralit ultime et synthtique. Son indivi-
dualit est organique et indiffrencie, indcomposable selon le
point de vue de la connaissance classificatrice ou typologique. 65
Ainsi comme substance synthtique sui generis, l'tat rintroduit un
principe universel qui gouverne le commerce inter-tatique, savoir l'-
nergie morale, comprise de la manire suivante :
[L]'tat a pour substrat naturelle territoire national et les hommes,
en mme temps qu'il est une organisation spirituelle, parce que juri-
dique et thique. L'tat n'existe que comme synthse de l'aspect
naturel et de l'aspect spirituel. L'tat veut maintenir le territoire
national et la Nation pour que perdure l'existence de l'tat lui-
mme. C'est un corps vivant: sur ce point, l'tat n'est pas une per-
sonne conue d'un point de vue simplement rationnel. Et cette exi-
88 prouver l'universel
gence d'existence de l'tat apparat comme une force, qui s'expri-
me vers l'extrieur dans la dfense ou dans la guerre et vers l' int-
rieur comme la force policire du maintien de l'ordre, dans le but de
garantir le droit et la morale. 66
partir d'une troitesse originelle, Kyama opre donc une succes-
sion de rductions: un premier niveau, les multiples contacts possibles
entre mondes historiques deviennent les seuls rapports inter-tatiques et les
multiples rapports inter-tatiques possibles - et rels - ne sont plus que
des rapports de force dicts par la puissance de l'nergie morale.
De plus, selon Kyama, dissocier la force et la morale est le propre
d'une pense classificatrice incapable de saisir la substance synthtique de
l'tat: L'tat est une synthse du naturel et du spirituel, c'est--dire une
synthse de la force et de la morale, et l'opration de synthse de ces deux
aspects n'est rien que ce qu'on appelle la politique. 67
Cette synthse de la morale et de la force dans l'acte politique n'est
pas la recherche d'une force de la morale, c'est bien plutt une moralisation
de la politique de la force : l'acte politique cratif est un coup de force, et
la mtaphysique de l'tat synthtique intervient point nomm pour lui
donner les atours de la morale ; mais cette morale n'est que la morale de la
force et ne se substitue pas aux dterminations qu'imposeraient les seuls
rapports entre les forces morales.
C'est l oprer une troisime rduction; celle de la politique la
seule expression de cette force spirituelle : La politique est donc la syn-
thse du naturel et du spirituel, ou de la vie et de l'esprit, et ainsi n'est autre
chose que l'activit synthtique de la.force et de la morale. 68
La politique devient donc le rapport des amis et des ennemis, pour
parler comme Carl Schmitt, dans le jeu de la constitution de blocs en lutte.
Comme synthse de la morale et de la force, la guerre se trouve justifie en
ce qu'elle est un acte politique, expression de l'nergie morale dans l'his-
toire.
C'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'tonner que l'acte politique qui
inaugure l'entre dans le monde contemporain, la rupture qui inaugure
l'vnement de la mondialit du monde, le tournant dans l'histoire qui inau-
gure l'poque contemporaine et la fin du monde moderne en signifiant aux
puissances europennes l'existence du non europen soit le retrait du Japon
de la S.D.N. :
[L]es principes de l'ordre mondial de l'aprs-guerre qui est n de
la Confrence de Versailles ne relvent nullement d'une vision du
monde nouvelle mais du principe moderne, rsultat de la guerre. Ce
Kyto 89
n'est rien d'autre qu'un systme constitu des nations victorieuses
sur l'ordre des faits tablis par la force. 69
Ce qui fait de la force capable de mettre jour la vritable nature de
l'histoire mondiale unifie par l'Europe une force morale:
Dans la constitution lgale de la Socit des Nations, la vision du
monde propre l'Europe moderne qui y prvalait instituait chacun
des tats comme sujets de droit gaux [... ]. [C]'tait l un phno-
mne inou dans l'Histoire [... ], le Monde semblait tre devenu un
monde historiquement uni. Ainsi, la fondation de la S.D.N. peut tre
interprte d'un ct comme l'expression d'un approfondissement
de la dpendance de l'Europe dans le monde. Mais en mme temps,
en tant qu'elle est l'expression du fait brutal de la domination euro-
penne sur le monde, c'est trs prcisment une organisation char-
ge d'assurer le maintien de la domination de fait des nations victo-
rieuses sur les nations vaincues. 70
En quittant la S.D.N., le Japon aurait ralis le passage de l'unifica-
tion du monde sa mondialisation vritable.
Il n' y a pas l de quoi satisfaire le voyageur. Ce n'est pas tant
d'ailleurs l'opportunisme politique de Kyama qui disqualifie ses thses
philosophiques que leur parfait embotement, selon l'usage qu'il fait de la
logique du Nant.
ce point du raisonnement, il ne reste plus Kyama qu' justifier
l'imprialisme japonais, ce que la distinction entre tat et Nation ne fait
qu'autoriser, l o Kyama cherche lgitimer. C'est pourquoi il procde
une quatrime rduction, des multiples mondes historiques rels aux blocs
politiques, en ajoutant que si les acteurs les plus dynamiques de l'histoire
mondiale sont les tat-Nations, ds lors qu'il est question de mondes parti-
culiers, ce sont les Sphres qui sont au centre de la cration historique :
Passant les frontires nationales au sens traditionnel du terme, les
tats d'aujourd'hui exigent ce qu'on appelle les lignes vitales pour
en faire leurs frontires de fait. [... ] Le fait que l'tat contemporain
ait besoin pour exister de la construction d'un monde particulier et
. que ces deux choses soient insparables est incomprhensible selon
le concept d'tat en usage jusqu' aujourd'hui. En d'autres termes,
l'tat contemporain apportera une grande modification aux concepts
d'tat et de souverainet en usage. La conception selon laquelle l'-
tat moderne possde la souverainet en propre n'est capable de fon-
90 prouver l'universel
der ni le monde particulier qu'est la Sphre de Coprosprit
Asiatique, ni l'tat contemporain. Le monde particulier n'est ni l'-
tat, ni une association d'tats, ni l'Empire au sens moderne non plus.
D'une certaine faon, il reste un monde historique comportant une
pluralit d'tats. Mais il doit avoir une troite et solide unit poli-
tique s'appuyant sur une communaut unie par une solidarit go-
graphique, historique et conomique, ou sur une affinit raciale, eth-
nique et culturelle. 71
Kyama pense les relations entre mondes particuliers selon une
logique de blocs. Le point de vue du Japon englobe celui de toute l'Asie
Orientale, de mme qu'aucune distinction n'est faite entre les diverses
nations europennes. Ici encore, l'infinie souplesse de la logique du Nant
rend de prcieux services: chaque communaut humaine s'incarne politi-
quement dans un tat, la tendance contemporaine exige l'troite unit de
mondes voisins, l'expression politique de cette troite unit doit donc trans-
cender les frontires d'un tat unique... L'embotement des universaux les
uns dans les autres qu'autorise la logique du Nant joue plein pour justi-
fier la cration d'un monde particulier sous direction japonaise.
Ainsi, parce que l'cole de Kyto reste malgr tout hritire d'une
conception de la civilisation qui, en associant modernit, rationalit et
Occident, ft-ce dans un contexte de rsistance la conqute, en vient
identifier valorisation et puissance (Kyama dirait force morale) - que
celle-ci soit conomique, politique ou militaire - l o l'universalisme
eurocentr identifie valorisation et rationalisation. Le modle de valorisa-
tion n'est certes plus le mme (y a-t-on gagn ?), mais sa prtention lgi-
timer universellement et a priori toutes les valeurs, dans tous les mondes
historiques, reste intacte.
Ainsi, bien que Kyama ait fait surgir le problme de l'entre en
commerce, il choue compltement le penser : dveloppant un concept de
mondialisation du monde alternatif l'europanisation commerciale du
monde, il offre un cadre philosophique qui permet de poser la question,
mais ce cadre s'avre tre l'examen non pas celui de possibles rencontres,
mais un champ de bataille gnralis, o s'affrontent et se mesurent la force
spirituelle des tats.
Pour le voyageur, c'est une grande dception. Le premier contact
avec le projet de constituer une philosophie orientale le ramne en de de
Kant, c'est--dire en de de la communicabilit universelle. Pour Kant en
effet, la ralisation empirique de cette communicabilit ne peut se rduire
la guerre, le langage des armes n'est pas le seul possible, et surtout, c'est le
moins souhaitable.
Kyto 91
De plus, l o le commerce communicationnel hirarchise les com-
munauts humaines selon le stade de dveloppement moral qu'elles ont
atteint, la philosophie de Kyama obtient peu prs le mme rsultat en
rintroduisant un universalisme abstrait, celui de la force morale, qui vient
remplacer - assez peu avantageusement - celui de la rationalit commu-
nicationnelle. Kyama n'est pas au del de la philosophie universaliste
eurocentre, il y revient, un peu piteusement, aprs avoir donn l'impres-
sion d'tre parvenu s'en dgager.
Les consquences pratiques de cette hirarchisation clairent le but
poursuivi, comme le dit Takahashi :
[A]ux yeux de Kyama, c'est parce que le Japon l'emporte sur la
Chine en " nergie spirituelle " [... ] que le premier et non pas la
seconde, a pu se mettre au premier rang parmi les puissances anti-
occidentales l'issue de la guerre sino-japonaise. 72
La suite du livre de Kyama nous offre une pitoyable et laborieuse
justification de l'annexion de la Mandchourie et de l'invasion de la Chine
73
Il n'y a pas lieu de s'en tonner; ds lors que l'enjeu historique est de ra-
liser le tournant de l'histoire mondiale et que de fait, c'est le Japon qui est
le mieux plac pour s'opposer l'Europe, il devient lgitime, dans le cadre
d'une politique de blocs, de soumettre les voisins la ralisation de cette
grandiose ambition. La confusion entre le Japon et l'Asie, le mpris pour la
souverainet des tats voisins (dj considrablement mise mal, il faut le
prciser, par la colonisation occidentale laquelle n'chappaient que la
Chine et la Thalande), une distinction factice dans les faits entre l'impria-
lisme europen et la protection de la sphre de coprosprit : tous les argu-
ments du rvisionnisme contemporain sont en place
74
Ce naufrage thorique conduit le voyageur se demander si le pro-
jet de philosophie orientale n'est pas aussi une manire de nier aux
autres penses d'Asie orientale, commencer par les penses chinoises et
corennes, la possibilit de s'exprimer dans les formes de la philosophie.
En confondant l'oriental et le japonais, l'cole de Kyto projette dans la
philosophie l'ordre qu'il souhaite voir s'instaurer dans les relations interna-
tionales, mais qui n'a aucun rapport avec la philosophie. Le voyageur pr-
frera donc dsormais parler de philosophie japonaise.
Pour le il devient possible de prciser les causes qui prsi-
dent aux errances idologiques de Kyama. La logique du Nant absolu, en
n'adoptant de la rigueur philosophique que ses aspects logiques et formels
transforme le projet de critiquer la philosophie occidentale avec ses propres
armes en une vulgaire projection, sur le plan de la philosophie, de l' ambi-
92 prouver l'universel
tion des militaires japonais, qui consiste justement imiter les hauts faits
guerriers des puissances europennes pour s'en librer et pour asservir ses
VOISIns.
Sans doute faut-il ajouter, comme le faisait dj remarquer en 1908
Okakura Tenshin
75
, que si la modernit japonaise conduisit au dsastre, la
responsabilit n'en choit pas aux seuls militaires japonais:
'Les Occidentaux considraient le Japon comme un pays barbare,
lorsqu'il se li vrait paisiblement d'innocents plaisirs littraires.
C'est depuis qu'il a commenc perptrer de terribles massacres en
Mandchourie qu'ils en parlent comme d'un pays civilis. 76
Alors que la fermeture pouvait tre considre, du point de vue de la
philosophie, comme une sagesse politique, le Japon d'aprs Meiji, en
rpondant l'insociabilit des tats commerants inhospitaliers par les
mmes armes, enclenche la Inauvaise dialectique de l'insociable sociabili-
t, celle de la litanie des maux qui oppriment le genre humain auxquels
rpondent les prtentions unilatrales de l'universalisme eurocentr, et se
place ainsi en position de n'tre plus qu'un moment de l'unification du
monde par l'expansion du commerce europen et de ses mthodes, qu'il a
faites siennes.
La philosophie de l'histoire de Kyama est donc pour une large part
la projection idologique des dsirs politiques les moins recommandables,
mais elle ne se rduit cependant pas un usage opportuniste de la logique
du Nant absolu, et offre la possibilit de penser dans l'histoire, et d'un
point de vue universel, le vritablement dcentrement recherch.
Pour le voyageur, il faut donc retenir quelque chose de tout cela : il
est ncessaire de penser la mondialisation en alternative l'europanisation
commerciale du monde, c'est--dire de penser une rupture dans le proces-
sus d'expansion des tats commerants. Mais outre que cette rupture n'est
pas identifiable un vnement historique particulier, elle ne peut tre un
conflit arm dans la mesure o une guerre ne permet pas plus que la
conqute d'entrer en commerce et ne permet pas de penser l'universel
autrement que sous la forme abstraite et pauvre de la gnralisation du seul
principe de la politique de la force.
De sorte que Kyama choue l o Habermas avait lui aussi chou.
Ossifiant les contrastes en diffrences, faisant jouer ces diffrences dans la
dtermination d'une identit, celle de l'tat, il ne parvient pas penser la
fois le pluralisme radical qu'induisent l'existence mme de ces contrastes
entre mondes historiques rellement distincts et la fluidit de leurs rapports
qui seule permet d'viter que le contact ne dgnre en confrontation. Une
Kyto 93
telle confrontation interdit le dsintressement, ferme toute possibilit de
comprhension vritable.
Au passage, le voyageur remarque que la faiblesse de la thorie de
Kyama n'est pas particulire aux penseurs non europens: on trouve exac-
tement les mmes rflexes chez certains penseurs occidentaux contempo-
rains, le plus souvent sous couvert de bons sentiments multiculturalistes.
Ainsi de i h ~ r d Rorty qui rejette l'universalisme et se garde cependant du
relativisme en proposant une dfense ouvertement ethnocentriste des
valeurs occidentales. Rorty en effet limite la porte de toutes les valeurs aux
frontires de la communaut humaine qui les revendique. Selon lui, elles ne
sont en effet fondes que sur:
les croyances, les dsirs et les motions qui [... ] constituent la clef
de vote [des loyauts et convictions morales] recoupent partielle-
ment celles d'un grand nombre d'autres membres du groupe avec
lequel nous nous identifions sur le plan de nos dlibrations morales
et politiques, quoi il faut ajouter le fait qu'il s'agit de traits spci-
fiques du groupe considr, utiliss par celui-ci pour construire son
image de lui-mme travers ce qui l'oppose d'autres groupes. 77
C'est pourquoi il lui est possible d'affirmer en s'inspirant de Hegel,
que:
la " dignit humaine intrinsque "consiste dans la dignit compa-
rative du groupe avec lequel la personne s'identifie. Les nations, les
glises, ou les mouvements, dans une telle conception, sont des
exemples historiques resplendissants non par la lumire qu'ils reoi-
vent d'une source plus leve mais en raison des effets de contraste
que leur .comparaison avec d'autres communauts, de qualit plus
mdiocre, fait apparatre. 78
Mais en quoi rside cette mdiocrit (worse communities), ds
lors que la tlologie hglienne a t rcuse ? Des prjugs de ses
membres ? On pourrait le croire, mais de l'ide strictement descriptive
d'une construction identitaire dans et par le seul contraste, Rorty passe rapi-
dement celle, normative, de hirarchisation. Sous sa plume s'opre un
glissement qui conduit la justification de l'ethnocentrisme de la commu-
naut des libraux bourgeois postmoderne au titre que cette commu-
naut est celle qui, plus que toutes les autres, a ralis la critique de l' eth-
nocentrisme :
94 prouver l'universel
Ce qui soustrait cet ethnocentrisme l'anathme, ce n'est pas que
le plus grand groupe de cette espce soit l'" humanit" ou " tous les
tres rationnels" (... ] mais plutt qu'il s'agit de l'ethnocentrisme
d'un " nous " (" nous libraux ") qui est vou s'largir, crer un
ethos toujours plus vaste et diversifi. C'est le nous de ceux qui ont
appris se mfier de l'ethnocentrisme. 79
Dcidment, la critique ironiste de l'universalisme en reconduit l'ar-
rogance, celle de l'ignorant qui prtend tablie la supriorit des valeurs de
son groupe avant de s'tre enquis de celles des autres: Rorty est assur
d'incarner l'attitude la plus chaleureusement accueillante la diversit cul-
turelle, la plus ouverte l'tranger. Dans cette version un peu tortueuse du
complexe de supriorit occidental, la force critique de l'ironie est dsa-
morce au profit d'un pangyrique du libralisme bourgeois et post-moder-
ne qui se confond avec l'gocentrisme revendiqu de l'auteur. Bien sr,
l'ethnocentrisme rortien est considrablement plus raffin que celui de
Christophe Colomb, mais ses consquences ne prsentent pas de nettes dif-
frences : il rend possible, comme les autres ethnocentrismes, une classifi-
cation axiologique des socits humaines - en l'occurrence selon leur
degr de distance vis--vis de l'ethnocentrisme de premier degr -
< Parmi les communauts humaines, il en est qui correspondent de telles
monades [ monades smantiques, peu prs sans fentres ] d'autres
non 80), c'est--dire selon qu'elles sont plus ou moins sympathiques et tol-
rantes, sans considrations aucunes pour les raisons historiques qui
nent certaines communauts humaines ne pas se montrer sympathiques et
tolrantes aux libraux bourgeois - modernes ou post modernes...
Cette classification axiologique permet d'imposer comme une vi-
dence les distinctions conceptuelles de la socit la plus ouverte, sympa-
thique et tolrante, celle de Richard Rorty :
il est permis de suggrer l'UNESCO de considrer la diversit
culturelle l'chelle mondiale comme nos anctres du XVIIe et du
XVIIIe sicle considraient la diversit religieuse l'chelle atlan-
tique, c'est--dire comme une chose qui devait tre ignore lorqu'il
s'agit de former des institutions politiques. 81
Ce qui choque le voyageur.dans ce novateur plaidoyer en faveur de
l'ethnocentrisme raffin, ce n'est ni l'historicisation des valeurs ni la recon-
naissance de leur pluralit. Au demeurant l'attitude intellectuelle, celle d'un
John Rawls par exemple, qui rduire la porte de son discours
philosophique au seul cadre trac par les limites de son monde historique,
est sans doute anime par un scrupule dontologique des plus louables :
Kyto 95
l'impossibilit de gnraliser l'usage de concepts forgs dans une tradition
particulire, tant que l'on reste dans l'ignorance des autres mondes histo-
riques. Mais le constat - minimal - de l'existence de ces contrastes ne
satisfait pas l'exigence kantienne - elle aussi minimale - de ree/lere/le
des conditions de possibilit du commerce. En d'autres termes, il ne suffit
pas de reconnatre la prsence de l'autre, encore faut-il chercher la ren-
contre. Or, la radicalisation ironiste des scrupules occidentaux conduit
affirmer qu'un philosophe se rclamant du pragmatisme rortien :
ne peut pas rpondre la question "qu'est-ce que l'Europe peut
bien avoir de si particulier ? " et s'en sort en disant " avez-vous
quelque chose suggrer qui convienne mieux nos intentions
d'Europens? " 82
En sous-entendant qu' l'vidence, la rponse est ngative.
C'est dans cette vidence que se mesure l'tendue du narcissisme
rortien : il n'est en effet pas du tout vident que le libral bourgeois post-
moderne ne puisse faire son miel d'auteurs, de thories ou de concepts la-
bors dans d'autres mondes historiques, de mme qu'il n'est pas du tout
vident que ces rencontres ne le conduisent mettre en question son ethos
et ses valeurs de libral bourgeois postmoderne, possibilit que Rorty ne
veut (ne peut ?) pas envisager. Il y a quelque chose de dsespr dans l' ar-
rogance de l'ironisme, quelque chose qui rapproche Rorty d'un Mishima:
la pleine conscience de la faiblesse politique de la position dfendue, et l'in-
capacit narcissique en dfendre une autre.
Le voyageur ne partage pas l'tat d'esprit des philosophes qui voient
dans la prise de conscience de l'existence de mondes historiques non euro-
pens un dfi politique et moral qu'il faudrait absolument surmonter soit
dans une frileuse rfutation du relativisme, soit dans l'arrogance d'un eth-
nocentrisme parvenu la conscience de lui-mme, mais pas moins born
que les autres. Au contraire, c'est dans cette crispation qu'il voit un danger,
et dans la possibilit d'en dmonter les mcanismes qu'il a l'intuition que
se joue l'avenir de la philosophie. Le voyageur retient de cela qu'il ne suf-
fit pas de renoncer l'universalisme pour dsarmer ses prtentions et
revient au Japon.
L'chec de l'cole de Kyto est-il dfinitif?
Face la conqute militaire et commerciale, la rsistance japonaise
a commenc par s'installer dans la fermeture, quitte revendiquer le retard
du point de vue du dveloppement du commerce communicationnel,
ouvrant la possibilit d'inscrire dans ce retard une autre histoire mondiale
que celle de l'Europe. Mais depuis Meiji, guid par le ressentiment de la
96 prouver l'universel
dfaite, cette rsistance, en se rclamant de la civilisation, s'est inscrite dans
l'unification europenne du monde, pour le meilleur et pour le pire selon
que l ~ n considre que l'hybridation du Japon est la cration historique ~
plus stimulante du XXe sicle ou le processus tragique d'une lente coloni-
sation impose mais volontaire. Hybridation en tout cas paradoxale, puis-
qu'elle est la fois le produit d'un commerce et qu'elle scrte la guerre,
ds lors que l'tat japonais, rpondant l'agressivit des tats commer-
ants, se proccupe aussi peu qu'eux de la recherche des conditions de pos-
sibilit du commerce, et s'intresse surtout l'acquisition des moyens de
forcer les frontires.
Un tel chec n'est en tout cas pas de nature faire rebrousser chemin
au voyageur, mais l'incite plutt s'enqurir d'une critique japonaise de la
dgnrescence des thories proposes par l'cole de Kyto en ombres pro-
jetes de slogans politiques, de sorte qu'il puisse poursuivre sa recherche
d'une philosophie japonaise de l'entre en commerce qui soit purge de tout
eurocentrisme, comme de toute mtaphysique simpliste de la guerre. Ou
comment penser la mondialisation, sur fond de pluralit des mondes histo-
riques, sans faire appel un convertisseur universel qui n'est jamais qu'un
reliquat eurocentr, tout en vitant la guerre, dont on a vu avec Kyama que
leur fcondit politique interne se limite l'instauration de l'tat policier?
Comment penser des rapports qui permettent de sauver l'universalit de la
philosophie, sans en faire une discipline intresse la seule lgitimation de
valeurs? Ou encore, penser la possibilit d'un voyage des concepts, d'un
monde historique l'autre? Il faudrait alors penser la rencontre.
Entre le commerce communicationel et la guerre, c'est la possibilit
d'une telle rencontre qu'il s'agit de faire surgir, en poursuivant le voyage.
y aura-t-il encore une guerre? Regardez-vous,
Europens, regardez-vous.
Rien n'est paisible dans votre expression.
Tout est lutte, dsir, avidit.
Mme la paix, vous la voulez violemment.
Henri Michaux (1899-1984)
Un barbare en Asie, Gallimard, 1967, p. 214.
98 prouver l'universel
NOTES
1 Il Yaurait beaucoup dire sur la validit de la distinction entre socit simple et
socit complexe pourtant gnralement reue par la sociologie et l'anthropologie.
Ainsi Talcott Parsons (cf. Socits - essai sur leur volution compare, trad. G.
Prunier, Paris, Dunod, 1973), dont les travaux occupent une large place dans la
thorie de l'agir communicationnel de Habermas, fait-il porter la discussion sur le
critre qui permet de distinguer le caractre simple ou complexe d'une socit mais
considre la distinction elle-mme comme allant de soi. Sauf erreur de notre part,
elle apparat dans l'uvre de Herbert Spencer qui oppose deux modles biologiques
d'volution; le simple et le complexe (<< L o les seules forces en jeu sont celles
qui tendent directement produire l'agrgation ou la diffusion [... ] L'opration de
l'volution [... ] sera simple ; l'inverse, si en mme temps que les changements
constituant l'agrgation, d'autres pren[nent] place. L'volution au lieu d'tre
simple, sera compose ), in Les premiers principes, trad. M. Guymiot, Paris,
Costes, 1930, p. 247. Spencer applique ensuite ces modles aux socits humaines:
bien que l'on ne puisse pas dire que l'volution des produits varis de l'activit
sociale fournisse des exemples directs d'intgration de la matire et de dissipation
de mouvement, elle en fournit pourtant des exemples indirects. Car le progrs du
langage de la science et des arts industriels et esthtiques, est une manifestation
objective des changements subjectifs , ibid., p. 273. Cette application lui permet
de hirarchiser ces socits selon le rapport qu'elles entretiennent la loi univer-
selle de l'volution, ce qui permet d'obtenir des noncs de ce type: Les contes
des temps primitifs, tels que ceux avec lesquels les conteurs d'Orient amusent enco-
re leurs auditeurs, sont forms d'vnements successifs pour la plupart non naturels
et n'ayant pas de rapports naturels: ce sont seulement des aventures spares,
runies sans ncessit dans leur succession. Mais dans une bonne uvre d'imagi-
nation moderne, les vnements sont les produits propres des caractres placs dans
des conditions donnes et ne peuvent tre changes volont [... ] , ibid., p. 280
et 281. La solidarit originaire qu'entretiennent l'usage de la classification des
socits selon la simplicit et la complexit d'une pait, le transfert pour le
moins rapide de concepts de la biologie vers l'anthropologie d'autre part, et les hi-
rarchisations idologiques politiquement lies l'entreprise coloniale enfin
devraient, tout le moins, inviter les utilisateurs de ces termes la prudence cri-
tique.
2 Jacques Proust, L'Europe au prisme du Japon, op. cit., p. 8 et 9. En exergue du
livre, on trouve la citation suivante de Paul Claudel, Connaissance de l'Est (1900) :
Un vase plein d'eau ou le prisme, par l'interposition d'un milieu transparent et
dense et le jeu contrari des facettes nous permettent de prendre sur le fait cette
action: le rayon libre et direct demeure invari ; la couleur apparat ds qu'il y a
une rpercussion captive, ds que la matire assume une fonction propre ; le pris-
me, d3.ns l'cartement calcul de ses trois angles et le concert de son triple miroir
didrique, enclt tout le jeu possible de la rflexion et restitue la lumire son qui-
valent color.
3 1. H.,TAC, T. l, p. 81 et 82.
4 C'est sans doute la raison des rcents, mais fragiles, progrs de la curiosit occi-
dentale son gard.
S Maruyama Masao (1914-1996), philosophe politique, est une des plus minentes
figures intellectuelles du Japon d'aprs-guerre. Ancien professeur de l'Universit
de Tky, il peut tre considr comme le fondateur de l'histoire des ides poli-
tiques au Japon. Ses tudes ont port essentiellement sur la constitution de la
Kyto 99
modernit au Japon, de l'poque d'do jusqu' l'actualit contemporaine. Son ana-
lyse critique du militarisme japonais a puissamment influenc la pense japonaise.
Sont disponibles en langues europennes certaines de ses uvres majeures panni
lesquelles: Thought and Behavior in Modern Japanese Politics, trad. 1. 1. Morris,
Tky/Oxford, Oxford UP, 1963 ; Denken in Japan, trad. W. Schamoni et W.
Seifert, Frankfurt, Suhrkamp, 1988 ; Les intellectuels dans le Japon moderne ,
trad. J. Joly, in Cent ans de pense au Japon, Paris, Picquier, 1996, T. II, p. 273
331 ; Studies in. the lntellectual History of Tokugawa Japan, trad. M. Hane, Tky,
University of Tky Press, 1974 ; Essai sur l'histoire de la pense politique au
Japon, trad. J. Joly, Paris, PUF, 1996.
6 Pierre Lavelle, La pense japonaise, Paris, PUF, 1997, p. 5. L'ouvrage sera not
PJ par la suite.
7 P. L., PJ, p. 103.
8 Si l'on prend l'exemple de la pense politique de Kant, il serait ncessaire pour la
comprendre et la discuter, d'avoir une solide connaissance de l'conomie politique
classique, particulirement des cossais, de la tradition rpublicaine, des Florentins
Rousseau en passant par le puritanisme des Whigs, des principaux auteurs de l' -
cole du Droit Naturel - en particulier Grotius, Pufendorff, Leibniz et Wolff -, de
savoir s'orienter dans la thologie chrtienne, particulirement rforme, et bien sr
de pouvoir identifier les influences des classiques de la philosophie politique depuis
Platon et Aristote jusqu' Hume sans oublier les Lumires allemandes, de Lessing
Herder. quoi il faudrait ajouter la capacit de situer cette pense aussi bien dans
le contexte politique de l'Europe de la fin du XVIIIe sicle que dans les enjeux ido-
logiques de sa rception depuis lors. Une telle exigence rduirait le cercle des lec-
teurs de Kant aux historiens les plus rudits de la pense kantienne.
9 L'honntet exige de prciser que cette asymtrie, tout particulirement dans le
domaine de la comptence linguistique, a lourdement pes sur l'laboration du pr-
sent livre.
10 Pourquoi la philosophie survit-elle la Grce? On ne peut pas dire que le capi-
talisme travers le Moyen ge soit la suite de la cit grecque (... ]. Mais sous des
raisons toujours contingentes, le capitalisme entrane l'Europe dans une fantastique
dterritorialisation relative qui renvoie d'abord des villes-cits, et qui procde elle
aussi par immanence. (... ] Le lien de la philosophie moderne avec le capitalisme est
donc du mme genre que celui de la philosophie antique avec la Grce : la
connexion d'un plan d'immanence absolue avec un milieu social relatif qui proc-
de aussi par immanence. , Gilles Deleuze et Flix Guattari, Qu'est-ce que la phi-
losophie ?, op.cit., p. 92 et 93. Cet ouvrage sera not QLP par la suite.
Il Sur le sakoku, cf. supra, note 25, p. 52.
12 Norbert lias, La socit de cour, trad. par P. Kamnitzer et J. tor, Paris,
Champs Flammarion, 1985.
13 L'expression est de Natsume Sseki, le clbre crivain et penseur, dont on pour-
ra lire en franais La Civilisation japonaise moderne (Gendai Nihon no
Kaika](1911), trad. . Suetsugu, in Cent ans de pense au Japon, Paris, Picquier, T.
l, p.127 157. Cet ouvrage sera not par la suite CAPJ. Par ailleurs, les uvres
romanesques de Sseki sont largement traduites en franais.
14 Il n'est pas possible de parler de rvolution dans la mesure o ce terme voque
par trop les traits progressistes des Rvolutions franaise et amricaine, mais le
terme de restauration ne suggre pas assez que le retour de l'Empereur correspond
la fondation tout fait indite au Japon u ~ e souverainet moderne et d'une
100 prouver l'universel
bureaucratie efficace. Au demeurant, Ishin voque plus un Renouveau
total qu'un retour ou une restauration et cette dernire traduction n'a pour
elle que de parer l'Empereur de la Gloire que confre la continuit.
15 L'autocratisme imprial n'est pas un produit de la tradition japonaise , c'est
au contraire la copie des monarchies autoritaires europennes modernes. la fin de
la seconde guerre mondiale, les Occidentaux, et particulirement les Amricains,
ont - sous couvert de respect des traditions culturelles - protg l'institution imp-
riale pour des raisons de Realpolitik qui n'ont rien voir avec le respect de l'iden-
tit japonaise. Ce soutien a contribu empcher depuis 1945 et jusqu' aujour-
d'hui une vritable rflexion collective, politique sur le pass militariste du Japon.
16 L'expression est de Kat Shichi, cf. Japan as an hybrid culture , in Review
of Japanese Culture and Society, Center for Inter-Cultural Studies and Education,
Josai University, l, n 1, Octobre 1986. Kat Shicru (1919-), mdecin, critique lit-
traire et historien des ides, essayiste, crivain dmocrate et pacifiste engag ;
l' uvre de celui qui symbolise avec quelques autres le renouveau intellectuel du
Japon d'aprs-guerre est aussi riche qu'clectique. Comme Maruyama dont il est
proche, il consacre ses rflexions d'historien lucider les origines du militarisme
{afonais et l'analyse des traits propres la civilisation japonaise.
Cf. note 5, p. 66.
18 Maruyama Masao, Kakoku [L'Ouverture du Pays] (1959) in Chusei to
Hangyaku [La Loyaut et la Rvolte], Tky, Chikuma Shobo, 1998, p. 196-197.
19 Cf. note 16, p. 69.
20 En l'occurrence, le quatrime. Kat Shichi, Histoire de la Littrature
Japonaise, Paris, Fayard, 1986, T. III, p. 9. Cet ouvrage sera not HLJ par la suite.
21 Sakuma Shzan (1811-1864) travaille longtemps pour le seigneuriat de
Matsumae, dans le nord de l'archipel. Il tudie le confucianisme, puis se tourne
aprs la crise politique provoque par le Commandant Perry, vers la science mili-
taire occidentale et ouvre les tudes Hollandaises aux samouras (cf. note 25,
~ 5 ~ Prnant l'ouverture du pays, il sera assassin par les isolationnistes.
2 A ce titre, et mme si l'on hsite le qualifier de philosophe, son uvre peut
sans aucun doute faire l'objet d'une lecture philosophique, c'est--dire d'une inter-
rogation problmatique des concepts qu'il utilise : c'est au demeurant ce que
Franois Julien ralise avec bonheur, propos de Wang Fuzhi, penseur chinois no-
confucen du XVIIe sicle (Franois Julien, Procs Ott cration, Paris, Seuil, 1989).
Mais une chose est de lire en posant des problmes philosophiques aux textes, une
autre de considrer ces textes comme intrinsquement philosophiques. Gilles
Deleuze et Felix Guattari qualifient la pense chinoise de pr-philosophique , au
titre qu'elle reste figurative l o la philosophie procde par concepts: Certes le
transcendant produit par projection une absolutisation de l'immanence, comme
Franois Julien le montrait dj pour la pense chinoise. Mais toute autre est l'im-
manence de l'absolu dont se rclame la philosophie. (G. Deleuze et F. Guattari,
QLP, p. 88). Outre que le critre de la distinction n'est pas aussi prcis que la for-
mule, l'expression pr-philosophie est particulirement malheureuse, puis-
qu'elle laisse entendre que la pense chinoise serait incomplte, faute d'tre
convertie en philosophie... Il faut redire que la pense non philosophique peut bien
faire l'objet de lectures philosophiques, mais n'en devient pas pour autant pr- ou
~ s t - philosophique.
3 p.L., Pl, p. 17 : Le li [... ] est un principe la fois ontologique et thique, Li
du Ciel ou Fate suprme universel et principe des choses particulires, dans cha-
cune desquelles il est entirement prsent ; pour l' homme c'est la nature humaine
Kyto 101
[... ] le li se dcouvre la fois de l'extrieur par l'tude des matres et l'observation
du monde et l'intrieur par l'esprit personnel. Voir sur l' histoire de ce concept
depuis le fondateur du no-confucianisme chinois moderne, Zhin -Xi, jusqu'aux no-
confucens japonais du XVIIIe sicle, Maruyama Masao, Essai sur l'histoire de la
pense politique au Japon (1952), vol.l, trad. J. Joly, Paris, PUF, 1996. [Je remercie
Jacques Joly de m'avoir permis de lire le manuscrit de cette traduction avant sa paru-
tion. M. X.]
24 Fukuzawa Yukichi (1835-1901), penseur et ducateur de l'poque de Meiji. Fils
de petit fonctionnaire d'un seigneuriat du Kysh, il se consacre trs tt aux tudes
Hollandaises (cf. note 25, p. chapitre II). Durant le Shgunat, il devient diplomate et
voyage aux tats-Unis et en Europe d'o il revient libral et rformateur. Se consa-
crant la diffusion de la science, il fonde la clbre universit Kei, s'engage dans
la propagation de ses ides par le journalisme. Sa contribution la civilisation de
l'poque de Meiji est immense.
25 Maruyama Masao, Fukuzawa, Okakura, Uchimura - Seika to Chishiki-
jin - [Fukuzawa, Okakura, Uchinlura - L'occidentalisation et les intellectuels]
&1958), in Chsei to Hangyaku, op.cit., p. 329-352.
6 En japonais bunmei dsigne communment une entit culturelle, sociale, institu-
tionnelle et bunmeikaka est le terme technique utilis depuis l're Meiji pour tradui-
re l'expression "civilization and enlightement ".
27 Yasuda Yojr (1910-1981), son chef de file incontest, crit: Ces temps-ci,
alors qu'on parle beaucoup de nipponisme, nous prenons conscience qu'il n'y a
jamais eu rien d'autre dans l'intelligence de la culture moderne de ces dix dernires
annes, voire mme dans la logique de la culture tout court, que la logique de la civi-
lisation. [... ] Une logique proprement japonaise de la culture n'tait pas possible, ce
que reflte la situation internationale o se trouve le Japon depuis l'Ouverture du
Pays, o la culture japonaise n'est qu'un produit de la colonisation anglaise et am-
ricaine , Yasuda Yojr, Bunmeikaika no Ronri no Shen nitsuite [Sur la fin de la
logique de la civilisation], in Yasuda Yojr Chosakush [uvres de Yasuda Yojr],
Tky, Nanbokusha, 1968, T. II, p. 554-555. En Europe, l'ironisme romantiquejapo-
nais est connu grce Mishima Yukio, mais il semble que nombre de ses laudateurs
aient reus au premier degr ses rodomontades sur la voie des guerriers en quoi
consisterait l'essence du Japon ternel, et que ce malentendu ne soit pas pour rien
dans le succs de son uvre. Suprme ironie ?
28 L're dite de Meiji (1867 1912) inaugure le retour de l'Empereur au pouvoir
la chute du Shgunat.
2 Nishida Kitar (1870-1945) est unanimement reconnu comme le premier et le plus
grand philosophe - au sens occidental du terme - de la modernit japonaise. Ds
son premier livre, tudes sur le Bien [zen no kenky] (1911), il tente de fonder une
thique universaliste sur l'exprience pure. Son uvre, impressionnante, porte sur
tous les champs de la philosophie. II commence faire l'objet de traduction et de
commentaires en langues europennes. Pour une bibliographie de ces travaux, on
consultera P. Lavelle, PJ, p. 97-102 ; en ajoutant que les Osiris viennent de
publier La logique du Lieu [Bash], trad. S. Yasuhiko et S. Cardonnel, Paris, Osiris,
1999 et tudes sur le bien, chapitre 1et Il, trad. H. Oshima, Paris, Osiris, 1997.
30 Ekigaku (yixue), doctrine des mutations ou doctrine du ying et du yang ,
celle du Ekiky (yijing) ou Classique des mutations. .
31 Grands guerriers du moyen ge japonais.
32 Entretien de Nishida Kitar avec Miki Kiyoshi, cit in Hiromatsu Wataru,
Kindai no Chkoku ron, [Essai sur le Dpassement de la Modernit ] (1980),
102 prouver l'universel
Tky, Kodansha, 1989, p. 209. (Cet entretien a t publi pour la premire fois
dans le journal Yomiuri en 1935. Hiromatsu renvoie Miki Kiyoshi zensh [uvres
compltes de Miki Ki)'osbi], Tky, Iwanami, T. XVII, p. 482-486.
33 Au sens troit, l'Ecole de Kyto est compose de Tanabe Hajime [(1885-
1962)], des autres successeurs directs de Nishida [ savoir Ksaka Masaaki (1900-
1965), Nishitani Keiji (1900-1990) et Kyama Iwao (1905-1993)] et de leurs
propres successeurs , PJ, p. 102. Nous conserverons l'acception troite du terme,
mais il faut cependant ajouter qu'il existait une aile gauche de l'cole de Kyto,
qui en fait un des relais de la tradition hgliano-marxiste au Japon, et dont les prin-
cipaux reprsentants sont Tosaka Jun (1900-1945) et Miki Kiyoshi (1897-1945).
Tosaka Jun, disciple de Nishida et de Tanabe, ayant fait ses tudes l'Universit de
Kyto, se tourne rapidement vers le no-kantisme, puis le marxisme. Emprisonn
par le rgime militariste, il meurt en prison le 9 aot 1945. Miki Kiyoshi (1897-
1945) est aussi lve de Nishida et de Tanabe. Il suit l'enseignement de Heidegger
Heidelberg et s'attache construire une anthropologie qu'il qualifie de marxiste,
dans laquelle la philosophie de l'histoire occupe une place essentielle. Durant sa
collaboration avec le rservoir d'ides du premier ministre Kono Fumimaro, arti-
san du renforcement du contrle de l'tat sur la socit, il contribue laborer
l'idal de la Sphre de Coprosprit de l'Asie de l'Est. Suspect d'avoir protg un
marxiste, il est emprisonn et meurt en dtention.
34 Mme s'il convient de prciser que ce projet oblige distinguer l'cole de
Kyto de soutiens au rgime beaucoup plus extrmistes qu'elle, qui prnaient un
soutien dlibrment irrationnel au rgif!le ultra-tatiste, considrant que l'intellec-
tualit tait trangre au gnie national japonais.
35 L'expression est de Takahashi Tetsuya, Philosophie de l'histoire mondiale,
logique du nationalisme philosophique japonais , in Marie-Louise Mallet (dir.), Le
passage des frontires - autour du travail de Jacques Derrida, Paris, Galile,
1994, p. 105.
36 Le symposium sur le Dpassement de la Modernit (traduction aujourd'hui
consacre de Kindai no Chkoku) est organis en juillet 1942 par la revue
Bungakukai", sous la prsidence de Kawakami Tetsutar, qui en est alors le rdac-
teur en chef. L'intention initiale de Kawakami est de parvenir dans ce symposium
une collaboration intellectuelle en vue de formuler une ligne pour la culture
contemporaine du Japon qui soit clairement dtermine en ces temps o la guer-
re fait rage. Pearl Harbor a en effet eu lieu le 8 dcembre prcdent. Kawakami ras-
semble donc de jeunes intellectuels, ns au tournant du sicle, qu'on classe habi-
tuellement en trois catgories : les modernistes de la revue Bungakuka, les natio-
nalistes de l'cole Romantique Japonaise et les penseurs de l'cole de Kyto. Ce
symposium se conclut, de l'aveu.du Prsident lui-mme, dans une totale confusion.
C'est sans doute la persistence des malentendus entre les participants qui explique
qu'on continue s'y intresser: s'y agitent en effet les problmatiques intellec-
tuelles des annes 30 qui rsument les volutions de la pense japonaise moderne
depuis l'Ouverture du Pays. Selon Takeuchi Yoshimi, (cf. note 5, p. 108) : Le
Dpassement de la Modernit tait pour ainsi dire un concentr des apories du
Japon Moderne. La restauration du pass et la rforme radicale, le culte de
l'Empereur et le refoulement des barbares, la fermeture et l'ouverture du pays, le
purisme nationaliste et la civilisation-occidentalisation, l'Orient et l'Occident :
toutes ces rivalits qui furent les axes traditionnels de la pense clatent en autant
de problmes au moment o l'laboration d'un idal de la guerre ternelle se pose
comme un devoir de la pense, au moment de la guerre totale. , Kinda'i no
Kyto 103
Chkoku [ Le Dpassement de la Modernit] (1959), in Nihon to Ajia [Le Japon et
l'Asie], Tky, Chikuma Shob, 1993 p. 225-226). C'est pourquoi le second sym-
posium, organis exclusivement par l'cole de Kyto, est en gnral discut par les
commentateurs dans le contexte du premier. Nous nous confonnerons ce choix.
37 Kindai no Chkoku [Le Dpassement de la Modernitl, numro spcial de la
revue Bungakukai, septembre et octobre, 1942. Nous utilisons la rdition,
Kawakami Tetsutar et al., Kindai no Chkoku, [Le Dpassement de la Modernit],
Tky, Fuzanb, 1979. La citation prsente est tire de Hiromatsu, Kindai no
Chkoku ron, op.cit., p.18.
38 Ces actes ont t publis ensemble dans le livre de Ksaka Masaaki, Nishitani
Keiji, Kyama Iwao, Suzuki Shigetaka, Sekaishiteki Tachiba to Nippon, Tky,
Chkron, 1943.
39 Pour une version de cet argument qui a le mrite de la franchise et montre quels
usages stratgiques peuvent tre fait de la pense de Habermas, cf. le liminaire du
traducteur de l'dition franaise de De l'thique de la discussion, qui n'hsite pas
juger aprs avoir lu Deleuze et Guattari qu' vacuer toute notion de vrit au pro-
fit de la cration ou de la vie, on dfend non seulement une position autorfutative,
mais encore no-fasciste in De l'thique de la discussion, op. cit., p. 7.
40 Centrale, mais pas exclusive puisque de nombreux intellectuels japonais depuis
Meiji, et tout particulirement dans les annes d'aprs-guerre, se rclament de la
modernit. C'est le cas de ou d'intellectuels comme Kat Shichi,
Maruyama Masao ou encore du laurat du prix Nobel de Littrature O Kenzaburo
(1935- ), entre autres. Parmi les tudes les plus marquantes sur ce sujet, outre les
articles de Takeuchi et de Hiromatsu dj cits, on peut consulter Hashikawa Bunz,
Nihon Rmanha Hihan Josetsu [Introduction la critique du Romantisme Japonais]
(1960), Tky, Kodansha, 1998 ; Karatani Kjin, Kindai no Chkoku [Le
Dpassement de la Modernit] in Senzen no Shik [La Pense de l' Avant-
Guerre] (1993), Tky, Bungeishunj, 1994. Par ailleurs Hanada Kiyoteru, critique
littraire marxiste qui a suivi les cours de Nishida et de Tanabe l'Universit
Impriale de Kyto, a intitul son essai sur l'art d'avant-garde Kindai no Chkoku
[Le Dpassement de la modenit], Tky, Kdansha, 1993.
1 Hiromatsu Wataru, Kindai no Chkoku ron, op.cit., p. 79.
42 Kyama Iwao, Sekaishi no Tetsugaku [La philosophie de l'Histoire Mondiale],
Tky, Iwanami, 1942, p. 423. Cet ouvrage sera not par la suite PHM.
43 K.!., PHM, p. 4.
44 K. 1., PHM, p. 2-3. Nous nous inspirons de la traduction de ce paragraphe de
Takahashi Tetsuya, Philosophie" de l'Histoire mondiale... , op.cit., p.I05, en la
modifiant cependant quelque peu. En particulier, nous traduisons gendai sekai par
monde contemporain l o Takahashi prfre monde actueL, parce qu'il nous semble
que chez Kyama, la contemporanit est une priode inaugure par le tournant dans
l'histoire mondiale, mais qui se prolonge bien au ce que contemporain exprime
mieux qu'actuel, dans le sens commun qu'ont ces termes en franais.
45 K.!., PHM, p. 6.
. 46 K.!., PHM, p. 6. ..
47 K.!., PHM, p. 5. Les thses de Kyama sur la spatialit, pour tre dveloppes,
devraient tre mises en regard avec le concept de lieu [bash] tel qu'il est labor
dans la philosophie de Nishida. Surtout, l'influence la plus marquante est celle de
Watsuji Tetsur, et plus particulirement son ouvrage majeur, Fdo [Le climat], qui
constitue la tentative de penser la particularit en terme d'espace et d'ouvrir la voie
une dfinition gographique de l'identit japonaise que l'on peut considrer comme
104 prouver l'universel
une version labore de psychologie des peuples.
48 K. 1., PHM, p. 515-516. C'est Kyama qui souligne.
49 Jean-Franois Lyotard voit dans la philosophie de l'histoire mondiale une
mtaphysique de l'Empire , in La terre n'a pas de chemins par elle-mme ,
Reprsentations, n03, Tky, p. 8. Cette interprtation est dnonce par Takahashi
dans son article, Philosophie de l'histoire mondiale... , art. cit., p. 105 : Il ne
faudrait sans doute pas trop simplifier les c,hoses. Comment peut-on dire, en effet,
que cette philosophie affirme l'unicit de l' histoire mondiale alors qu'elle souligne
leur pluralit irrductible? Kyama ne se contente pas de reprendre le schma de
l'histoire universelle et de proposer que le Japon endosse les habits du Sujet rali-
sant l'histoire, il refuse ce schma et en propose un autre, qui, pour lgitimateur
~ u i l soit est inassimilable un Grand Rcit lyotardien.
oK. I., PHM, p. 517.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 K. I., PHM, p. 518.
54 K. I., PHM, p. 520 et 521.
55 Nous empruntons cette traduction Pierre Lavelle.
56 Pour Tosaka Jun, la philosophie de Nishida procde d'un idalisme radical qui
la rapproche du romantisme allemand, en particulier: la logique du Nant ne trai-
te que du sens des faits, et non des faits eux-mmes l ... ] [L]a question est toujours
de savoir "comment les choses peuvent tre penses". Il ne s'agit pas de savoir
comment sont les choses en fait, mais de savoir quel "sens" une chose doit avoir
pour mriter le nom de cette chose. Il ne s'agit pas de savoir comment sont la soci-
t, l'histoire, la nature en fait, mais qu'elle significations elles ont et quel statut
elles peuvent ac,qurir dans le systme catgoriel du sens , in Mu no ronri ,
wa ronri dearuka [ " La logique du nant" est-elle logique? ] in Nihon ideo-
lo..r ron [Idologies japonaises] (1935), Tky, Iwanarni, 1977, p. 246.
5 Takahashi Tetsuya, Philosophie de l'histoire ... , art. cit., p. 106 et svtes.
58 K. 1., PHM, p. 453-454. Nous empruntons la traduction Takahashi Tetsuya,
Philosophie de l'histoire... , art. cit., p. 109. Cf. note 35, chapitre III.
59 K. 1., PHM, p. 188.
60 K. I., PHM, p. 191.
61 K. 1., P M ~ p. 210-211.
62 .
K. 1., PHM, p. 213.
63 Dans le contexte historique, il s'agit sans doute de laisser ouverte la possibilit
de lgitimer la Sphre de Coprosprit de la Grande Asie de l'Est, dnomination
officielle des projets de l'imprialisme japonais. cf. K. 1., PHM, p. 226-227.
64 K. 1., PHM, p. 213.
65 K. I., PHM, p. 223-224.
66 K. 1., PHM, p. 351.
67 Ibid.
68 Ibid.
69 K. I.,PHM, p. 434.
70 K. 1., PHM, p. 435.
71 K. 1., PHM, p. 455 et 457-458, la traduction est de Takahashi, La philosophie
de l'histoire... , art. cit., p. 110, lgrement remanie.
72 Takahashi Tetsuya, La philosophie de l'histoire... , art. cit., p. 107.
73 K. 1., PHM, p. 491 et svtes.
74 Aujourd'hui encore, certains hommes politiques et historiens japonais soutien-
Kyto 105
nent la thse selon laquelle le Japon a entrepris en Chine une guerre de libration
anti-coloniale et s'opposent, avec un succs certain la reconnaissance officielle de
la responsabilit du Japon dans l'agression de ses voisins. D'o l'importance poli-
tique de la reconnaissance du caractre imprialiste et colonisateur du Japon
d'avant-guerre.
75 Okakura Kakuz (1862-1913), dit Okakura Tenshin, est un penseur de l'esth-
tique japonaise et une des figures principales de l'Asiatisme ; il publia tous ses livres
en anglais.
76 Okakura Kakuz, Cha no hOll [Le Livre du th], trad. M. Hiroshi, Iwanami,
Tky, 1961, p. 23. Nous citons d'aprs la traduction japonaise de l'original
anglais(The Book of Tea, New York, 1908). Il existe une traduction franaise de C.
Atlan et Z. Bianu, Le Livre du Th, ditions Picquier, 1996 (rd.Picquier-poche,
1998).
77 Richard Rorty, Le libralisme bourgeois postmodeme , in Objectivisme, rela-
tivisnle et vrit, trad. J.-P. Cometti, Paris, PUF, 1994, p. 238.
78 Ibid.
79 R. Rorty, Contingence, ironie et solidarit, trad. P.-E. Dauzat, Paris, Annand
Colin, 1993, p. 271.
80 R. Rorty, Sur l'ethnocentrisme: rponse Clifford Geertz , in Objectivisme... ,
op. cit., p. 234. Dans ce texte Rorty remarque, pour se fliciter de ce que les U.S.A.
sont une socit librale, et que par consquent En Amrique, l'alcoolisme parmi
les Indiens tait beaucoup plus rpandu, il y a une centaine d'annes qu' prsent,
mais les antllfopologues l'taient moins et que c'est la raison pour laquelle les
Indiens alcooliques ne faisaient pas partie de l'Amrique du XIXe sicle, ce qui veut
dire que la grande majorit des Amricains cette poque-l ne leur prtaient pas
plus d'attention qu'aux criminels psychopathes ou aux idiots des villages. (p. 238).
On peut savoir gr au libralisme de faire cas des criminels, des alcooliques et des
psychopathes; pour autant est-il acceptable, du point de vue libral lui-mme, de ne
pas faire mention des causes historiques de l'alcoolisme des Indiens et prcisment
du lien entre le dveloppement de l'alcoolisme et la conqute des terres indiennes,
condition historique de possibilit du dveloppement du libralisme aux U.S.A. ?
81 Ibid., p. 243.
82 R. Rorty, Pragmatism, Relativism, Irrationalism , in Consequences of prag-
nlatism, New York, Harvester, 1991, p. 174. Nous traduisons.
CHAPITRE IV
TKY
ou
La rencontre
La rencontre, pour le voyageur, est donc ce qui permet le dcen-
trement vritable et dtermine une solution satisfaisante au problme philo-
sophique de l'entre en commerce, parce qu'elle constitue l'vnement sus-
ceptible d'initier une vritable comprhension du point de vue de l'autre,
par del la diversit radicale des mondes historiques.
Or, les expriences prcdentes du voyageur en attestent, ce chan-
gement de centre doit se faire en de de la fixation de l'altrit en diff-
rence, l o les contrastes sont encore assez fluides pour qu'il soit possible
de se recentrer dans un autre monde historique sans se nier. Cette exigence
nouvelle, qui ne peut apparatre qu' ce point prcis de la recherche, rend
ncessaire une refonnulation du but de voyage. Il s'agit toujours de sauver
l'universalit de la philosophie en parvenant une comprhension vritable
de l'altrit, mais la fidlit l'ambition philosophique invite adopter en
cours de route une dfinition de la comprhension la hauteur de cette
ambition.
L o l'universalisme communicationnel veut comprendre que
ce qu'il a pralablement tri selon des protocoles labors par lui, le voya-
geur maintenait la formulation taylorienne de la comprhension < tre
capable d'appliquer [... ] les " caractres de dsidrabilit " (desirability
characterisatiort) qui dfinissent son monde. Je parviens comprendre
quelqu'un lorsque je comprends ses motions, ses aspirations, ce qu'il trou-
ve admirable ou condamnable chez lui et chez les autres, ce qui l'attire ou
ce qui lui rpugne, etc. 1). Il lui semble dsormais ncessaire de prciser
que dans l'expression comprendre ses motions... , il n'est pas seule-
ment question d'entendre, c'est--dire de caractriser le sens d'un compor-
tement selon ses propres concepts, mais de parvenir, sans renoncer soi-
mme (c'est pourquoi il est impratif de se situer en de du couple identi-
t/diffrence), prouver. ce comportement, comme les concepts qui lui
confrent son sens.
D'aprs Charles Taylor, comprendre ce n'est pas seulement res-
sentir de l'empathie. Car ce dont nous parlons ici est une comprhension
discursive. Nous pouvons bien sr tre parfois " sur la mme longueur
d'onde " que quelqu'un, prouver son gard une sorte de prcomprhen-
108 prouver l'universel
sion informule, mais ce n'est pas le genre de chose dont nous avons besoin
pour une explication thorique 2.
La problmatique dans laquelle s'inscrit cet auteur est assez res-
treinte puisqu'il ne traite que de la comprhension dans les sciences sociales
et c'est sans doute la raison pour laquelle il oppose l'empathie, qu'il asso-
cie la prcomprhension informule, quoiqu'il ne juge pas que l'une soit
incompatible avec l'autre. Avec la nouvelle dfinition adopte par le voya-
geur, l'exprience de la comprhension n'oppose pas les affections et leur
formulation, ni ces affections aux concepts explicatifs: on peut tre affect
par des concepts. La comprhension ne se rduit pas l'empathie, mais elle
ne peut s'en passer. .
L'universalisme. ne manquera pas d'tre effray: l'abandon de son
centre coupe l'herbe sous le pied de tout jugement du comportement d'au-
trui, interdit qu'on le corrige. C'est vrai, dans l'en de de la dtermination
spculaire de soi par l'autre, personne n'a besoin d'une bonne correction, la
rencontre est vritablement dsintresse.
C'est l'tape suivante du voyageur.
Passer de la ncessit de la guerre la possibilit de la rencontre :
Nakamura Mitsuo.
L'chec de l'cole de Kyto des annes trente
3
penser la possi-
bilit d'une rencontre s'origine dans l'hritage d'une thorie de la civilisa-
tion qui identifie modernit, rationalit et Occident, et fait de la philosophie
japonaise un stade post moderne suprieur de la rationalit; en bref, qui
confond la question du dcentrement et celle du Dpassement de la
Modernit.
Un des reprsentants de l'cole au symposium du mme nom, le
philosophe Nishitani Keiji (1900-1990), pose clairement qu'il faut entendre
par l'expression Dpassemellt de la Modernit le dpassement de la moder-
nit occidentale. Et tandis que Kyama essaie de conserver la rationalit de
la philosophie pour nier son occidentalit, Nishitani n'hsite pas faire
appel au zen pour proposer en fait de dpassement quelque chose comme
une remonte spirituelle vers un en de de la modernit.
Tous les participants au symposium
4
n'ont pas eu cette faiblesse.
C'est sans doute ce qui explique, selon le mot clbre de Takeuchi
Yoshimi
5
, qu'il n'ait mme pas t capable de fournir au rgime l'idologie
officielle qu'il rclamait. C'est en particulier le cas de Nakamura Mitsu0
6
,
dont les intentions politiques sont clairement critiques. Dans une contribu-
tion au symposium, rdige postrieurement, il commence par mettre en
Tky
doute l'expression mme de Dpassement de la modernit :
109
Jusqu' prsent, on utilise dans notre p ~ y s le terme moderne peu
prs comme un synonyme d'occidental. Cette ide reue floue, qui
circule dans la socit et domine encore imprieusement notre
conscience, pourrait bien avoir comme fondement relles deux faits
suivants:
Le premier est que dans notre pays, tous les phnomnes jugs
" modernes " sont des importations occidentales. Le second est que
nous n'avons su voir de l' "Occident" que sa "modernit ~ Il va sans
dire que la " modernit " est un caractre trs marqu de la culture
[Bunka] europenne contemporaine, mais au fond, elle n'est qu'un
aspect de cette culture et ne l'puise pas dans sa totalit. [... ]
Pourquoi ce constat fort simple est-il inacceptable pour le sens
commun de notre pays ? Pourquoi l'opinion superficielle qui identi-
fie l'" Occident " la " Modernit " est-elle aussi obstinment enra-
cine dans les curs ?
7
En refusant d'identifier l'Occident sa modernit, Nakamura se fraie
un passage que l'universalisme communicationnel a condamn: penser la
possibilit d'une modernit non europenne.
Parce que la modernit n'puise pas la culture europenne contem-
poraineS et parce que le choix fait sous Meiji d'importer la civilisation occi-
dentale ne relgue pas non plus d'un coup toute l'histoire du Japon au
magasin des antiquits, tous les phnomnes modernes ne sont pas nces-
sairement d'origine occidentale. Ce simple constat est lourd de cons-
quences.
[1]1 est facile de poser la question de telle faon qu'on identifie par
avance le moderne et l'occidental, comme on le fait communment
dans notre pays jusqu' aujourd'hui encore, et qu'on en dduise le
dclin de l'Occident et la prise de conscience de soi du Japon.
Emprunter un concept l'Occident pour nier l'Occident n'est-ce pas
dj une inadmissible contradiction ? 9
Ce que pointe Nakamura, c'est le risque d'une critique extrieure, et
donc superficielle, de la modernit; une critique contrainte d'importer aussi
ses armes, de sorte qu' l'intrieur elle est dpourvue de toute efficace.
Mais comment estimer qu'il serait possible de dpasser la modernit en
crant une identit japonaise ou orientale qui emprunterait l'Occident son
auto-critique ?
110 prouver l'universel
L'cole de Kyto, et beaucoup d'autres qui sont moins dignes d'at-
tention, ont associ cette auto-critique - ou crise - de l'Occident,
comme prise de conscience de ses propres limites, et d'une
japonit qui en constituerait l' alternative
1o
Selon Nakamura, l'erreur nat de
la confusion entre l'origine et la nature du phnomne: la modernisation du
Japon peut bien tre lie l'occidentalisation, les expriences historiques
du Japon et de l'Europe restent tout fait inassimilables. En effet:
Si l'on considre qu'en Europe, l'esprit moderne s'affirme claire-
ment pour la premire fois la Renaissance, il lui faut au moins cinq
sicles pour parvenir au plein panouissement du XIXe sicle. Tous
les phnomnes culturels qui caractrisent l'Histoire Moderne [... ]
constituent une immense exprience de l'esprit humain, l'chelle
de la socit toute entire. Ainsi, quels qu'en soient les rsultats,
ceux-ci sont les vritables rcoltes semes par l'esprit moderne. [... ]
Lorsque les Europens nient l'ordre (ou dsordre) de l'esprit humain
qu'on appelle la modernit, cela suppose certainement qu'ils ont
vcu cet ordre (ou dsordre) fond. Quand ils affirment qu'il n'y a
plus rien en esprer, leur dsespoir voisine avec la conviction d'en
avoir puis toutes les possibilits. Par contre, pour ce qui nous
concerne, nous est-il permis face la modernit d'prouver ce sain
dsespoir, cette sainte conviction, dont la force vient de leur enraci-
nement dans la vie quotidienne elle-mme? Avons-nous rellement
fait l'exprience de la Modernit, en sentons-nous vraiment le
poids? 11
Cette remarque met en lumire l'existence d'un diffrentiel, nglig
par l'universalisme communicationnel autant que par l'cole de Kyto :
l'importation des techniques, des institutions et des concepts de la moder-
nit occidentale au Japon n'est pas la rptition de la mme histoire, parce
qu'elle n'est pas et ne peut pas tre la mme exprience historique.
L'expansion commerciale a peut-tre export les traits caractristiques de la
modernit europenne, mais elle a dans le mme temps cr une irrduc-
tible asymtrie qui rend ncessaire la distinction de deux modernits,
comme deux expriences historiques distinctes de la mme modernit :
l'une superficielle, htive et inaccomplie -lajaponaise -, l'autre profon-
de, relle, et pour ainsi dire intime - l'europenne. .
On peut donc dire qu'il y a deux modernits non pas au sens o il y
aurait deux processus historiques htrognes d'expansion du capitalisme
et de rationalisation, mais au sens o l'exprience de ce processus de ratio-
nalisation est essentiellement diffrente au Japon et en Europe, l'un tant
. .
Tky 111
l'artefact improbable de l'autre.
Ce qui ne veut pas dire que la modernisation du Japon soit insigni-
.fiante et qu'il soit possible de s'en dbarrasser comme on se l v r ~ i t d'une
impuret superficielle, au contraire, il faut reconnatre que le Japon a atteint
depuis l'ouverture un point de non-retour:
Dans la vie des Japonais modernes, il n'y a presque plus de place
pour les souvenirs de l'poque avant Meiji, que ce soit dans les
murs, l'conomie, la politique ou la culture. La spcificit la plus
sidrante de la modernit de notre pays, n'est-ce pas que cette rvo-
lution tonnante des modes de vie ait t accomplie depuis l' ouver-
ture du pays sous la Restauration de Meiji en seulement quatre-
vingts ans, soit en une priode si courte qu'elle ne couvre mme pas
la dure de vie d'un vieillard? (... ] Sur ce point, un tel changement
a certes t provoqu par l'influence de l'Occident, mais il est tout
fait inou, mme pour l'Occident. 12
Le Japon n'est donc ni la coexistence d'un rsidu traditionnel et
d'une modernit importe, ni un bloc historique immmorial lgrement
souill par une culture d'occupation, c'est un pays engag irrmdiable-
ment dans un processus de modernisation indissociablement associ
l' extrieur et pourtant tout fait distinct de lui, au point que les termes
de propre et d' tranger perdent toute pertinence analytique.
Irrmdiable, mais en mme temps inassimilable- sa seule origine
parce qu'elle s'inscrit dans une autre temporalit ; c'est la modernit japo-
naise elle-mme qui interdit la structuration des contrastes en diffrences
identitaires.
L o Kyama insiste sur l'importance des relations entre commu-
nauts humaines dans la formation de l'tat comme prise de conscience de
soi travers l'exprience de la diffrence, au prix de la fixation des
contrastes dans un rapport de diffrenciation entre le soi et l'autre,
Nakamura parvient maintenir la fluidit des rapports entre les contrastes,
parce qu'il refuse de ramener ces contrastes du mme (une seule et unique
modernit occidentale) ou du diffrent (la modernit occidentale face la
tradition japonaise). Cette fluidit mnage la possibilit de passages que les
surdterminations identitaires interdisent, et ces passages sont autant de
transformations des uns par les autres. Kyama peut bien penser que l'tat
japonais n'existe que dans le rapport l'autre, ce rapport reste extrieur et
pour ainsi dire ngatif, de sorte que n'est jamais envisage la possibilit
d'une affection positive et constitutive de l'autre dans la dtermination de
soi, et l'ocidentalisation n'affecte au fond pas l'identit japonaise elle-
112 prouver l'universel
mme. C'est la raison pour laquelle il choue penser le paradoxe consti-
tutif de la modernit japonaise - son hybridation.
C.' est aussi la raison pour laquelle Kyama, en parfaite conformit
avec les slogans officiels, voit dans le Japon le seul tat-Nation disposant
de l'nergie morale ncessaire pour faire surgir le non europen dans l' his-
toire mondiale. Le scepticisme de Nakamura attire plutt l'attention sur le
fait que le Japon est lui-mme tellement constitu d' tranger qu'il n'y
a plus lieu de distinguer ses traits constitutifs selon leur origine gogra-
phique.
ce titre, l'ennemi serait plutt chercher dans cette volont qu'ont
les nationalistes de purifier au plus vite le Japon, en distinguant ce qui lui
est propre et ce qui ne l'est pas, volont qui ne fait jamais que reproduire en
les inversant les confusions des occidentalistes idoltres13.
Pour le voyageur, cette critique que Nakamura adresse l'cole de
Kyto lve une des hypothques qui pse sur la philosophie de l'histoire de
Kyama et permet de penser une rencontre, du point de vue japonais
l4
Contre les prtentions universalistes europennes, il affirme une modernit
japonaise s'inscrivant dans une temporalit irrductiblement singulire qui
interdit d'en faire un simple pisode dans le dveloppement du commerce
europen. L'expansion commerciale, en se heurtant une limite extrieure
qu'elle n'a pas su comprendre (ni mme percevoir, bien souvent ... ), a pro-
duit un devenir original, inou, qui lui est autre, mais qui n'est pas pensable
sans elle.
Nakamura adresse donc la mme critique l'universalisme du com-
merce communicationnel et au pluralisme belliciste de l'cole de Kyto.
L'un et l'autre identifient pareillement modernit, rationalit et Occident,
seulles distingue le jugement de valeur qu'ils portent sur cette totalit.
Ds lors plutt que de chercher dpasser la modernit, il est bien
plus urgent de s'attacher la faire mrir, c'est--dire l'inscrire dans la
dure requise pour en exprimenter la complexit. On ne dpasse pas la
modernit en la niant, pas plus qu'on ne la rattrape en la copiant. S'il
convient de s'assigner une tche son propos, c'est de la traverser, non pas
au sens d'aller au del comme l'entendait Nishida, mais plutt en la remon-
tant dans le sens de la longueur, en cherchant parvenir une vritable
connaissance de l'Occident :
Nous chapperons compltement l'idoltrie comme aux vaines
craintes que l'on prouve pour quelque chose ou pour quelqu'un ds
lors que nous connatrons clairement la vritable figure d'un tel
objet. 15
Tky 113
Nakamura rejoint ici une ide kantienne qu'il largit: il n'est pas
ncessaire d'tre conquis pour craindre la conqute et s'en prmunir par la
fermeture ou la g ~ r r La peur est le premier obstacle la recherche des
conditions de possibilit du commerce. Nakamura accorderait ce point, et y
ajouterait deux prcisions. La peur et l'ignorance sont dans un rapport de
dtermination rciproque: on ne cherche pas connatre ce qu'on craint et
l'on craint ce qu'on ne connat pas. Il ajouterait qu'une des figures de
l'ignorance peut tre l'idoltrie, et qu'elle aussi se nourrit de l'ignorance
qu'elle cultive en retour.
Le voyageur, ce point de ses lectures, se fait la remarque suivante:
un lien unit ces dialectiques de l'ignorance, de la crainte ou de l'idoltrie,
c'est l'inscription des diffrences constates dans une hirarchie. Habermas
cherche l'image de la modernit occidentale dans le miroir de socits dont
le stade de dveloppement est infrieur; Kyama voit le salut de l'identit
japonaise dans l'adoption de techniques occidentales qui ont fait la preuve
de leur supriorit dans la guerre. Or on ne sort des cercles vicieux de
l'ignorance, de la crainte ou de l'idoltrie qu'en refusant de se mesurer
l'autre.
Il faut donc dire que la connaissance que Nakamura appelle de ses
vux, qui correspond la dfinition de la comprhension du voyageur,
passe par l'exprience de la rencontre, et constitue le moyen de faire recu-
ler la crainte et l'idoltrie. C'est ce prix que les conditions kantiennes de
possibilit du commerce peuvent tre remplies.
L'entreprise est extrmement difficile, puisque la hirarchisation des
contrastes ossifis en diffrences n'est pas seulement le fruit d'troitesses
thoriques, mais d'abord et avant tout celui d'un processus historique qui
dresse un dcor, celui de la conqute, et distribue ingalement les rles,
d'aprs les forces militaires en prsence. Nakamura n'ignore pas que le
contexte de toute rencontre a partie lie la violence. Mais s'il est peu ra-
liste de penser pouvoir en suspendre les effets le temps de la rencontre, il
n'est pas interdit de chercher les limiter, de guetter les moments o le
devoir d'hospitalit kantien n'est pas trop mis mal. Il se trouve que depuis
la rengociation des traits ingaux, et la reconnaissance diplomatique du
Japon par les puissances occidentales, c'est peu prs le cas :
Si la confusion culturelle que notre pays a d traverser .depuis
Meiji tait fonde principalement sur le dsquilibre du rapport des
forces entre l'Occident et le Japon et sur une comprhension tout fait
insuffisante d'un Occident dform, n'est-ce pas l'poque contem-
poraine [i.e. en 1942], quand le rapport des forces est devenu si sub-
tilement quilibr et que nous ne sentons plus cette pression fbrile,
qu'il est possible de comprendre vraiment l'Occident? 16
114 prouver l'universel
Si le contexte est celui d'un rapport de force quilibr, il reste
cependant marqu par une asymtrie originelle. Dans la voie que choisit
Nakamura, cette asymtrie est l'obstacle principal la possibilit d'une
rencontre. Comment parvenir la comprhension vritable de l'autre
quand tout, y compris les outils conceptuels fondamentaux de cette connais-
sance, porte les stigmates de l'asymtrie originelle de relations inities dans
l'invasion et poursuivies dans la domination qui en est rsult?
Un premier lment de rponse peut tre tir des analyses de
Nakamura lui-mme.
Surmonter la crainte et l'idoltrie par la connaissance est une exp-
rience difficile, qui prend du temps. Ce temps l, celui dans lequel la ren-
contre est possible, doit tre arrach l'histoire comprise comme dvelop-
pement de l'expansion commerciale et des ractions bellicistes qu'elle
engendre. Dans le choc du contact, sous la menace de la conqute, et pour
parvenir conjurer le risque de guerre, il convient de ne pas se presser, de
prendre son temps. La peur qu'il s'agit de conjurer n'est pas seulement la
peur de l'autre, c'est aussi la peur d'arriver en retard
17
C'est dire combien
la temporalit de la rencontre est paradoxale. On aurait sans doute souhait
que les choses se soient passes autrement et que seule la curiosit dsint-
resse ait pouss les europens hors d'Europe, malheureusement, la dyna-
mique de l'Occident a beaucoup voir avec la prtention idiosyncrasique
l'universalit, la recherche de l'hgmonie et l'appt du gain. Au demeu-
rant, aucun autre monde historique n'a jamais os penser l'univers comme
lui tant immanent, ni su formuler l'ambition d'tendre et de propager ses
foyers d'immanence... 18
Le lieu de la rencontre n'est donc pas la frontire trace par les
limites de la propagation du commerce europen. Sur cette frontire l, il
n'y a que le choc des projections eurocentres de l'universalisme et les
rsistances qu'elles provoquent, l'invasion et la guerre. La rencontre, pour
s'panouir, suppose quelque chose comme un retour de la modernisation
sur elle-mme, la reconnaissance a posteriori d'une ncessaire diffrencia-
tion, qu'il aurait certes fallu faire avant mais qui n'est, hlas, rendue pos-
sible qu'aprs avoir t nie. Le Japon, lieu d'exprimentation d'une
modernit hybride, fruit de la conqute et de la rsistance, est un univers
conceptuel qui offre un milieu propice un tel retour sur soi, o peut se
jouer l'universalit de la philosophie.
Tky
Les nouveaux territoires gophilosophiques
de Kobayashi Hido
115
Si Nakamura a su viter le pige d'une critique qui reproduit son
objet, c'est sans doute parce que ce jeune homme est sous l'influence d'un
des fondateurs et principaux animateurs de la revue Bungakukai [Le "lande
littraire] sans conteste une des figures principales de la pense japonaise
du XXe sicle, le critique littraire Kobayashi Hido
l9
Pour le voyageur la
lecture de son uvre est l'occasion de se dmarquer de l'univers intellec-
tuel de l'cole de Kyto.
Kobayashi est lui aussi prsent au symposium, sur le Dpassement
de la Modernit, mais ne produit pas de contribution crite
20
L o
Nakamura exprime des doutes quant la pertinence de la question pose,
Kobayashi propose une thorie qui en bouleverse le sens :
De mon point de vue le dpassement de la modernit ne peut pas
tre le remplacement d'une mauvaise modernit par autre chose: les
modernes ne surmonterons la modernit que par la modernit elle-
mme. Nous n'avons pour matriaux que ceux qui nous sont donns
aujourd'hui et je crois que c'est dans ces matriaux mme que doit
se trouver la clef de la russite de. l'entreprise. 21
Il s'agit pour Kobayashi, tout comme pour Nishida, de traverser la
modernit, mais non plus dans le sens d'aller au del, en passant travers,
mais bien plutt en la parcourant tant et plus, en l'explorant de fond en
comble, jusqu' ses extrmes limites, jusqu' puiser toutes les potentiali-
ts qu'elle recle.
Traverser la modernit en l'puisant. Le projet n'est pas sans ensei- .
gnements du point de vue des conditions de possibilit de l'entre en com-
merce, puisqu'il indique une mthode pour parvenir la comprhension de
l'altrit. Il y a en effet deux sortes d'explorations possibles, contradictoires
entre elles. La premire est celle que choisit le positivisme historique
22
en
gnral et l'cole de Kyto en particulier (mais l'volutionnisme sociolo-
gique tomberait sans aucun doute sous le coup de la mme critique) qui
consiste chercher dcouvrir les lois du dveloppement social d'une
socit donne, et recourir pour cela des catgories comme celle de
classe , ou d' tat , de mme qu'elle cherche dfinir l'univers intel-
lectuel de ces mondes historiques en dterminant des idologies comme
l' individualisme ou le rationalisme et s'assigne pour tche de les
prsenter dans un ordre logique de succession.
116 prouver l'universel
Une telle mthode est selon Kobayashi tout fait strile du point de
vue de la comprhension, parce qu'elle ne permet en aucun cas de se fami-
liariser avec le monde historique tudi, et mme, au contraire, obstacle
cette familiarisation. Cette mthode ne permet pas de traverser le monde
historique en question, tout au plus de le survoler.
Kobayashi attribue cet chec deux ensembles de raisons : les
concepts l'uvre dans les thories de l'histoire et du dveloppement
social en restent au niveau des gnralits et ne parviennent donc pas
atteindre la ralit de ce qu'elles cherchent dcrire d'une part, et, d'autre
part, ces thories, en faisant de chaque vnement singulier l'illustration
d'une loi ou d'une tendance gnrale, se mprennent sur la valeur heuris-
tique de la reprsentation. Les deux questions sont lies : ces se
voulant tre la reprsentation de la ralit qu'elles tudient sont contraintes
de procder par gnralisation, distinctions et analogies ce qui leur interdit
l'accs la singularit de chaque vnement rel. Ainsi, selon Kobayashi la
comprhension exige un dsarmement radical du regard qui n'impose pas
seulement de renoncer l'usage spculaire de la diffrence, mais plus radi-
calement s'interdire de subsumer les vnements du monde historique
tudi, les lments (uvres, auteurs, problmes ... ) de son univers mental
sous des catgories gnrales. Une uvre d'art ne reprsente pas un concept
en -isme, un grand homme n'incarne pas une idologie ou un courant poli-
tique, un vnement historique n'illustre aucune tendance ou aucune loi,
parce qu'il n'est absolument pas ritrable. C'est autour de l'histoire de la
littrature et plus particulirement du cas de Dostoevski, dont il est le bio-
graphe et le commentateur, que Kobayashi organise ses arguments.
[ ] Dostoevski n'a pas exprim la socit russe moderne ou le
XIXe sicle russe. Non. C'est plutt quelqu'un qui, en luttant contre,
est parvenu les surmonter. Ses uvres sont pour ainsi dire les rap-
ports de ses victoires. [... ] Le principal dfaut de la conception de la
littrature comme expression d'une socit ou d'une poque, c'est
qu'on passe ct de la victoire des crivains. Mis part les cri-
vains mdiocres, les crivains de premier ordre sont toujours parve-
nus surmonter les ides reues de leur poque ou de la socit dans
laquelle ils vivaient. 23
Dire que Dostoevski exprime la socit russe du XIXe sicle, c'est
passer ct de tout ce qui fait l'intrt de cet auteur, savoir sa capacit
surmonter les conditions gnrales de son poque, instituer une tension
fconde entre un univers singulier et les conditions gnrales auxquelles il
parvient s'arracher.
Tky 117
On peut dire, grosso modo que la vision moderne de l'histoire est
celle de la thorie du changement historique, laquelle je serais tent d'op-
poser la possibilit d'une thorie du non-changement, historique. Ainsi en
mcanique, on appelle dynamique la thorie qui porte sur les changement
de'la force, et statique la thorie de son quilibre. Il me semble que le point
faible des modernes rside dans ce qu'ils sont englus dans l'tude dyna-
mique des forces historiques et perdent de vue leur statique. [... ] Un grand
ne se plie pas son poque, pas plus qu'il n'en sort - il entretient une ten-
sion statique avec elle. Ainsi, j'ai dcouvert une analogie extrmement
srieuse entre les classiques et les grands crivains, de tous les pays et de
toutes les poques. De ce point de vue, je me suis engag dans la remise en
question de la vision de l'Histoire qui se saisit exclusivement du change-
ment et du progrs. L'homme ne cesse de se battre contre la mme chose-
celui qui s'y efforce avec persvrance est, en bref, un personnage ter-
nel 24.
La comprhension d'une uvre ou d'un auteur porte avant tout sur
cette tension mme, ce en quoi elle est relle. Ds lors qu'elle est appr-
hende comme l'illustration d'un schma explicatif, elle perd son sens. Il
n'y a donc de comprhension et de t r v ~ r s possible d'un monde histo-
rique que comme dpassement par le singulier. C'est ce niveau que se
joue la comprhension, et pas ailleurs. Le voyageur qui a dlaiss le
Japonais typique pour des raisons analogues ne peut qu'acquiescer.
Pour Kobayashi, la leon de nominalisme la japonaise ne vaut pas
seulement pour l'histoire de la littrature ou de la philosophie, puisque au
sens strict: 1' tat , les classes , ou l' individualisme n'existent pas,
ne sont que des termes commodes qu'on utilise pour conjurer l'irrductible
contingence de chaque chose, ce qui en dit plus sur ce que nous appelons
vrit que sur la ralit des choses elles-mmes.
Que l'Histoire se rpte, c'est une mtaphore dont les historiens
aiment nous repatre. Mais c'est une vrit grave dans nos curs
que ce qui s'est produit une fois est irrcuprable, jamais. Aussi
sommes-nous attachs au pass. L'Histoire pourrait tre compare
une immense rancur qu'prouve l'Humanit. Si les vnements
taient ritrables, nous n'aurions pas su inventer un mot aussi riche
de nuances multiples que" souvenir ", c'estbien vident. Il nous fau-
drait apprendre fixer notre attention sur ce caractre singulier et
unique de l'vnement, pour savoir combien il est profondment
ancr dans notre vie qui ne connat pas la certitude. L'amour, et la
haine, et le respect ne cherchent jamais que des personnes uniques et
118 prouver l'universel
incomparables. Si l'on tient vraiment se dsintresser des
hommes, il suffit d'en faire des strotypes. 25
La saisie de l'altrit comme objet travers les catgories de la gn-
ralit n'chappe pas ses propres contradictions, qui sont celles de tout his-
toricisme inconsquent: comment affirmer la fois que les schmas labo-
rs par les historiens sont des lois de l'histoire et accorder en mme temps
que rien n'chappe l'histoire? C'est cette inconsquence qui conduit
Kyama s'inscrire dans un relativisme historique radical, mais se
contredire en accordant une validit transversale infonde au concept d'-
tat. Il n' y a pas de thorie de l' histoire ou du dveloppement social qui ne
finisse par cder la tentation de se soustraire l'historicisme radical qu'el-
le a institu - le mariage de l'universalisme communicationnel et de la
psychologie du dveloppement en est une illustration contemporaine. Non
pas que la prtention la vrit, ou la validit des noncs, qui prside
la constitution intersubjective de l'objectivit ne puisse tre considre
comme lgitime, tout au contraire: la rationalit scientifique est bien vi-
demment rationnelle et les lois qu'elle permet d'noncer sont sans aucun
doute objectives, mais c'est trs prcisment leur limite: la ralit de la
chose n'est pas tout entire dans l'objet et le penser, c'est vouloir soustrai-
re la pratique scientifique au temps. Mme la science, et mme ses lois ont
une histoire; elles peuvent tre leur tour saisies comme objet, mais sur-
tout, comme tous les vnements humains, c'est dans leur contingence
absolue, laquelle on chappe dcidment pas, que rside leur ralit:
[L]a vrit en gnral n'apparat que l o il yale "Sujet" [ga,
terme bouddhique qui dsigne aussi le Soi]. Donc [... ] il Y a des
vrits diffrentes selon les diffrentes conditions humaines. Mme
la loi de causalit, qui est la moins humaine des vrits, relve de la
persvrance de l'entendement, qui relve d'une condition tout
fait humaine. La loi de causalit serait une vrit, mais pas le tatha-
t [la relle manire d'tre des choses, notion emprunte au boud-
dhisme]. Elle est truth, mais non reality. L'important n'est pas de
dlimiter la ralit selon la vrit, mais de purifier l'exprience de
la ralit telle qu'elle est donne: il ne s'agit pas de procder par
abstractions de la pense partir de ce qu'on voit; il s'agit de puri-
fier notre vision jusqu' ce que voir s'identifie penser. 26
Quelle que soit par ailleurs la validit des rsultats obtenus, il ne suf-
fit donc pas de dfinir et d'expliquer objectivement un monde historique
pour le comprendre. La ralit, qui est dans l'irrductible singularit des
Tky 119
choses, ne peut tre apprhende via la gnralit des concepts opratoires
dans les sciences humaines et historiques; plutt que de chercher circon-
venir. cette singularit en la ramenant, par distinction, analogie et gnr3:li-
sation, une vrit d'ordre gnral, il convient de la rendre, c'est--dire
d'essayer de faire prouver son absolue unicit. Parce que l'uvre de
Dostoevski est bien l'expression d'un effort cratif tout fait indit, qui
n'est certes pas indiffrent au contexte dans lequel il a lieu, mais qui prci-
sment le surmonte et ne peut s'y rduire, le travail du biographe consiste
moins expliquer en quoi l'univers de Dostoevski reflte son poque qu'
ritrer l'arrachement de l' uvre aux conditions qui la voient natre, de
sorte que soit ractive cette tension dans laquelle rside sa capacit pro-
voquer des motions. C'est pourquoi on ne raconte pas l'histoire de la litt-
rature ou de la philosophie: redonner vie un geste thorique ou esthtique
contingent n'est possible qu'en faisant resurgir l'vnement qu'il constitue,
et en permettant aux contemporains de l'prouver
27
La conception kobayashienne de la comprhension se prcise. Elle a
lieu dans un rapport qui met enjeu des individualits singulires, elle ouvre
la ralit des choses en de de leur inscription dans des schmes, et ne
peut tre dissocie des affects qu'elle engendre. En ce sens, elle est d'es-
sence esthtique. Tous ces traits sont lis les uns les autres, c'est parce que
l'univers de Dostoevski n'est pas le simple symptme de la modernit
occidentale, mais qu'il parvient la surmonter que son uvre est irrducti-
blement singulire, et qu'elle est susceptible d'affecter celui qui parviendra
se hisser jusqu'aux limites o se positionnent ceux qui ne se plient ni ne
sortent de leur poque, mme si ce dernier n'appartient pas au mme monde
historique. C'est dans cet enchanement qu'est la puissance dostoevskien-
ne d'affecter un lecteur japonais, prcisment parce que cette tension sta-
tique , inscrite dans l'uvre, laquelle parvient un grand crivain en s'ar-
rachant son poque, est non seulement perceptible mais mouvante au-
del des frontires que dessinent les mondes historiques, et ce justement
parce qu'elle les dplace et les rorganise. Comprendre, c'est donc accder
la ralit singulire des choses et les prouver.
Or, chez Kobayashi, prouver n'est pas seulement ptir, c'est surtout
bouger.
Toute construction de reprsentation n'est qu'un manuel si elle ne
suscite chez les hommes de passion pour la ralit. Avec un manuel,
on peut indiquer que pour aller la ville il faut tourner droite, mais
on ne peut se faire lever un homme assis. Les hommes ne bougent
pas avec des manuels, ce sont les vnements qui bougent les
hommes. 28
120 prouver l'universel
Parce que les catgories des thories sociales maintiennent intactes
le foss qui spare le sujet de l'objet, elles interdisent que l'exprience
esthtique de comprhension puisse mtamorphoser celui qui s'y livre.
Or, la comprhension vritable n'est pas une exprience passive, mais pos-
sde bien plutt la capacit de bouleverser la ligne de sparation des
contrastes : on comprend pourquoi il y a quelque chose de Dostoevski
chez Kobayashi.
C'est dire que c'est la ralit de la chose apprhende et comprise
qui impose Kobayashi sa conception de l'histoire comme re-cration:
comprendre un univers intellectuel, c'est en quelque sorte le voir, en tre
affect et trouver les mots qui sont susceptibles d'affecter semblablement
les lecteurs contemporains. De sorte qu'on peut tre philosophe, critique ou
historien, on n'chappe pas l'exigence d'tre avant tout, et toujours, cri-
vaIn.
Le propos de Kobayashi a des vertus dissolvantes certaines quant au
problme de l'universalisme. L o Kyama voyait la ralisation de l'uni-
versel concret dans l'avnement d'une histoire vraiment mondiale,
Kobayashi en parlant d'exploration des limites de la modernit occidentale
rappelle que l'universel n'est accessible qu' des sujets singuliers en rsis-
tance aux conditions particulires et gnrales de leur poque. La philoso-
phie de l'histoire de l'cole de Kyto, parce qu'elle met en scne des sujets
abstraits, dans le cadre d'une histoire gnrale de l'Humanit est tout sim-
plement hors du sujet, parce que, ce niveau l, on ne rencontre jamais que
les catgories qu'on a soi-mme poses. Au demeurant, ce qui lasse consi-
drablement Kobayashi dans le discours des philosophes de Kyto, c'est
leur incapacit rencontrer autre chose qu'eux-mmes et leurs thories
29
De plus:
Nous parlons du Dpassement de la Modernit car nous vivons
l'poque moderne - mais il me semble vident que de tous temps,
toutes les personnalits de premier ordre ont trouvs leur raison
d'tre dans le dpassement de leur poque. 30
Ds lors, la tche de comprendre fond la modernit est strictement
indiffrente la nationalit de celui qui s' y emploie. Il ne revient donc pas
une quelconque communaut humaine (les chercheurs japonais de
Kyama, une classe, un peuple ou un tat ... ) de raliser l'avnement de
l'aprs-modernit, mais c'est une question en droit partage mondialement
par tous les contemporains mme d'explorer la modernit avec assez de
persvrance pour l'puiser, et qui peut tre rsolue diffrement par chacun
d'eux. La gographie de Kobayashi, la diffrence de celle de Kyama,
Tky 121
n'est plus ni naturelle ni politique, c'est celle que figure le trac d'espaces
mentaux qui sont non pas des blocs, mais la lente sdimentation d' exp-
riences assez voisines pour entrer en rsonance et constituer des traditions
qui, s'enchevtrant, forment un univers intellectuel
31
Ou pour le dire avec
les mots de Deleuze et Guattari, dans la gographie kobayashienne l'uvre
se dterritoriaLise : dans cette gographie-l, il appartient ceux qui le peu-
vent de dplacer les frontires, en s'arrachant leurs dterminations spa-
tiales et temporelles et non en les refltant dans d'abstraites constructions:
Les imposants schmas de l'Histoire comme les cartes de
Gographie dont les modernes nous remplissent la tte ne sont que
des dmons qu'il faut dchirer dans l'effort consacr atteindre une
certaine ralit. 32
Ici, deux fils se dnouent : la comprhension de l'autre, en l' occur-
rence de l'Occident pour les penseurs japonais, ne s'inscrit plus dans le pro-
jet de constitution d'une philosophie japonaise ou orientale, justement parce
que la ralisation de cette comprhension vritable en rend le projet futile
33
De mme que si Habermas avait compris les Azande il aurait sans doute t
conduit abandonner ses prjugs universalistes, la tche des penseurs
japonais qui sont en position de comprendre srieusement l'Occident ne
peut plus tre celle de constituer une alternative pr- ou post- moderne la
philosophie occidentale, ou de raliser une quelconque tche politique ou
idologique assigne par les circonstances historiques. La comprhension
de l'altrit impose ceux qui y accdent de faire ce que tous les philo-
sophes ont toujours eu faire : explorer fond une poque, en sonder les
limites, jusqu' pouvoir dessiner les contours d'un univers mental singulier,
qui ne se rduit ni n'chappe vraiment au contexte dans lequel il s'inscrit,
mais qui rend possible la rencontre entre individus singuliers par del les
frontires des mondes historiques, et contribuent ainsi en modifier le
trac.
Ainsi la problmatique du Dpassement de la Modernit est cong-
die au profit d'une dfinition de la rencontre comme.affection active d'o
mergent des mondes historiques indits. Le voyageur peut en tirer la
conclusion suivante : si l'entre en commerce est conditionne par la
recherche des conditions qui la rendent possible, l'effectivit de la ren-
contre est la premire de ces conditions.
Ce rsultat est trs contraignant, puisqu'il fait de la comprhension,
entendue au sens le plus fort, une condition de l'entre en commerce, et
s'expose la critique : n e ~ t i l pas compltement dpourvu de sens de
conditionner l'entre en commerce par la rencontre qui suppose dj un
122 prouver l'universel
commerce? Parce que la rencontre n'est pas vide de contenu, elle n'est pas
instantane et requiert au contraire l'inscription dans une dure qui en fait
une condition paradoxale qui suppose ce qu'elle conditionne.
La difficult est relle, mais il apparat au voyageur que le paralo-
gisme est chercher du ct de cette objection plutt que chez Kobayashi.
Cette difficult est celle de la temporalit de la rencontre, et porte sur les
modalits d'inscription de la rencontre dans le temps de l'histoire. Quant
l'erreur de raisonnement, elle rside dans la confusion entre commerce et
rencontre: la rencontre est une condition de possibilit du commerce, mais
loin de le supposer, elle exige au contraire de penser les rapports entre inter-
locuteurs sur un autre modle que celui de l'change, commercial ou com-
municationnel. Non pas que la communication sur le modle de l'change
soit impossible (mme s'il faut parfois faire l'exprience du mutisme d'un
Japonais typique pour prendre conscience de l'extrme difficult de
l' change) ou illgitime dans certains cas (c'est encore un autre probl-
me... ), mais elle n'est srement pas assure immdiatement par la seule
mise en contact d'tre parlants, comme le pense l'universalisme communi-
cationnel. Il faut s'tre compris pour changer sans sombrer dans le dia-
logue de sourds. Autant dire que la rencontre ne peut tre pense comme
une spcification de la communication, par exemple dans le domaine cultu-
rel ou artistique. Outre que Kobayashi refuse la distinction entre valeurs
culturelles et normes d'action que propose l'universalisme communication-
nel, son propos prtend couvrir tout le champ des activits humaines
34
Pour
le dire autrement, Kobayashi fait de l'exprience esthtique active qu'est la
rencontre un modle de valorisation de porte tout fait universelle, puis-
qu'il n'est pas d'activit humaine qui ne soit essentiellement esthtique
l'exception de la pratique des sciences de la nature, dont illimite cependant
la porte une rgion particulire, la recherche de la vrit des choses.
Chez Kobayashi, la communicabilit universelle s'explique en de du lan-
gage, dans ce que la philosophie pourrait appeler un sens esthtique com-
mun, que Kobayashi, s'il s'tait pos la question en ces termes, interprte-
rait comme une puissance universelle d'affecter et d'tre affect et qu'il
associerait sans doute au corps, et leur co-prsence dans la mme ralit
par del les contrastes entre les mondes.
Le voyageur note donc que la rencontre offre un paradigme opra-
toire pour penser le voyage des concepts philosophiques d'un monde histo-
rique l'autre et s'astreint maintenir fermement la distinction entre ren-
contre et commerce pour aborder le problme crucial de cette thorie : en
dfinissant la rencontre comme une affection active qui met en prsence des
singularits, n'en fait-on pas un modle inconditionn de relation, qui tom-
berait sous le coup des arguments kantiens dont on a vu qu'ils interdisent
Tky 123
de penser une relation entre monde historiques distincts en dehors d'un
contexte historique dtermin?
Replongeant dans Kobayashi, le voyageur trouve sans difficult dans
son uvre de quoi rfuter une lecture trop unilatralement singulariste, on
pourrait dire hroque. La ncessit d'inscrire cette rencontre dans son
contexte historique est au contraire mainte fois raffirme, il faut pouvoir
accder la rencontre et cette possibilit est ouverte par un processus his-
torique, celui que Nakamura voque en parlant de mrissement.
Le mrissement consiste en l'accumulation d'expriences singu-
lires, c'est le fruit d'une frquentation toujours plus rgulire, d'une
imprgnation toujours plus profonde, par laquelle on acquiert une proximi-
t, une familiarit avec un monde historique, son univers intellectuel, la
diversit et le raffinement de ses traditions de penses, de ses coles... Ce
mrissement s'inscrit ncessairement dans la dure. C'est la raison pour
laquelle Kobayashi partage avec Kyama l'impression de vivre un moment
clef de l'histoire du Japon, non pas qu'un vnement contemporain quel-
conque inaugurerait une re nouvelle dans l'histoire mondiale, mais plus
simplement parce que, pour la premire fois, la somme des connaissances
relatives l'Occident est suffisante pour qu'il soit envisageable de le ren-
contrer vraiment :
Quand nous [ la gnration de Kobayashi ] avons commenc
nous plonger dans la littrature, il y avait dj tellement de traduc-
tions d'uvres occidentales qu'il tait impossible de tout lire
[... ] Maintenant que nous avons perdu les caractristiques et l'indi-
vidualit du pays dans lequel nous sommes ns, que nous reste-t-il
perdre ? Il fut une poque o le conflit entre les choses occidentales
et orientales pouvait intresser la cration artistique - en comparai-
son avec ceux qui avaient encore quelque chose perdre, nous avons
le cur lger. Mme s'il est vrai que nous sommes des jeunes sans
jeunesse, qui embrassons une littrature sans patrie, nous sommes en
droit de prtendre que c'est ce prix que nous sommes parvenus
comprendre les caractres de la culture occidentale qui relvent de
traditions, sans la dformer, que nous sommes ainsi les premiers lui
tre fidle. 35
Nakamura rtorquait ceux qui identifient modernit et Occident
que la brivet et la superficialit de la modernit japonaise la rendaient
inassimilable la modernit europenne. La premire et la plus fondamen-
tale des leons tirer de l'existence de ce diffrentiel irrductible qui fait la
singularit de l'exprience historique de la modernisation du Japon est que
124 prouver l'universel
la comprhension de l'autre prend du temps. La leon vaut pour l'universa-
lisme communicationnel aussi bien que pour l'cole de Kyto : l'entre en
commerce n'est pas immdiate, ce n'est ni la o n s ~ q u n mcanique d'un
quelconque effet de couplage , ni un moment particulier de l'histoi-
re mondiale, mais le fruit, trs mr, de la multiplication d'expriences qui,
seule, confre la densit historique requise pour viter les lnalentel'zdus. Du
point de vue des conditions kantiennes de possibilit d'entre en commer-
ce, il faut donc ajouter que la rencontre elle-mme suppose une dure. En
l'occurrence, celle de l'approfondissement de la modernit japonaise, son
devenir-tradition. Le mrissement est la seconde condition de possibilit de
l'entre en commerce.
Peut-on prtendre avoir rpondu l'objection? Sans doute est-il
impossible de dire que Kobayashi est indiffrent au contexte historique, ou
qu'il ne tient pas compte des conditions historiques dans lesquelles se tien-
nent les rencontres. Mais comment affirmer en mme temps que la ren-
contre est tout entire dans l'immdiatet d'une relation esthtique active et
irrcuprable entre singularits irrductibles et lui confrer une dure, c'est-
-dire rintroduire la mdiation d'une tradition? Suffit-il de juxtaposer les
deux affirmations pour les rendre cohrentes? N'est-ce pas rintroduire
l'historicisme par la fentre aprs l'avoir congdi avec fracas par la porte?
Le voyageur se replonge dans sa lecture de Kobayashi.
L'immdiatet de la rencontre: la vision.
Quand j'ai rencontr Rimbaud pour la premire fois, c'tait le prin-
temps et j'avais vingt-trois ans. Je crois pouvoir dire que j'tais pr-
cisment en train de flner dans le quartier de Kanda. Un inconnu
s'est approch et m'a jet terre, par surprise. Je ne m'y attendais
pas du tout. Jamais je n'aurais imagin qu'une telle charge explosi-
ve fut contenue dans une aussi misrable version de poche d'Une
Saison en Enfer, aux ditions Mercure, que j'ai trouve par hasard
chez un bouquiniste. La mche de cette bombe tait tellement sen-
sible qu'elle a presque eu raison de mon pitre franais. Le livre de
poche a explos, formidablement, et m'a plong pour quelques
annes au cur d'un vnement bouleversant, Rimbaud. a, c'est un
vrai vnement, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que c'est que la lit-
trature pour les autres ; au moins, pour moi, la littrature signifie
qu'une pense, une ide, mme un mot peuvent tre de rels vne-
ments - c'est, je crois, ce que Rimbaud le premier m'a appris. 36
Tky 125
La premire chose qui frappe le voyageur, c'est que dans l'immdia-
tet de la rencontre rside un mystre, celui que - dans le cas prcis - les
historiens de la pense s'chinent rduire, et qui o n s s t ~ comprendre
comment ce jeune tudiant de vingt-trois ans a pu lire si intensment
Rimbaud malgr une aussi pitre connaissance du franais ...
De tels chocs, Kobayashi en aura plusieurs dans sa vie
3
? Il est frap-
p par le mouvement d'une symphonie de Mozart en pleine rue Osaka,
alors qu'il errait - plong dans les affres d'une dception amoureuse; la
copie d'un tableau de Van Gogh le renverse - littralement - dans une
exposition... On peut sourire de la navet de l'expression, l'authenticit
des faits est certaine: Kobayashi est vraiment tomb...
Pour Kobayashi, la rencontre se prsente comme un vnement
concret trop brusque pour autoriser la dlibration. C'est non seulement par
hasard que se produit la rencontre, mais c'est en elle et non pas dans la per-
sonne qu'est son principe d'affection. La rencontre bouleverse considra-
blement le sujet sur qui elle s'abat, en l'obligeant entrer dans un rapport
actif aux choses rencontres. Ce bouleversement est affectif, par quoi il ne
faut videmment pas entendre l'exclusion des facults intellectuelles, mais
soumettre leur force de conviction leur capacit mouvoir. De sorte que
la rencontre ne peut tre rduite une exprience de la conscience : elle
n'est pas un spectacle, puisqu'elle bombarde le sujet de l'extrieur et pul-
vrise la reprsentation qu'il a de lui-mme comme spectateur et du monde
comme spectacle, fut-il enthousiasmant. L'immdiatet de la rencontre est
d'abord dans cette collusion, il faudrait dire dans le devenir-chose du sujet
et de l'objet.
Chez Kobayashi le passage du spectacle la rencontre est le chemin
qui le conduit de Baudelaire Rimbaud:
cette poque [i.e. de sa rencontre avec Rimbaud], ce sont les
Fleurs du mal de Baudelaire qui remplissaient mon cur. Pour dire
les choses plus prcisment, j'tais enferm dans une cathdrale,
incomparablement raffine, la manire d'un insecte [... ],. C'tait
certes un spectacle formidable, mais je fus bientt oblig de m'aper-
cevoir que ce systme raffin dont j'tais prisonnier m'touffait. 38
Il faut donc distinguer le spectacle, et l'exprience de la vision qui
consiste prcisment carter toutes les mdiations susceptibles de faire
cran entre la chose et le sujet de la rencontre... C'est dans cette exprien-
ce de la vision que Kobayashi commence par distinguer les idogrammes
de voir (kan) et regarder (ken), en donnant l'idogramme kan un sens
longuement travaill par la pense bouddhique:
126 prouver l'universel
La perception se forme selon les besoins de notre vie, selon les
actions que nous menons face aux choses extrieures. [... ] Nous
vivons au cur de la ralit. Et il est indubitable que cette ralit
nous est donne toute entire dans l'exprience immdiate. Mais
pour supporter ce monde si riche de l'exprience immdiate, il nous
faudrait faire un effort exceptionnel. Ainsi les besoins de notre vie
ordinaire enferment ce monde dans des limites extrmement bor-
nes. [... ] Autrement dit, la perception distincte n'est rien d'autre
que la constitution de schmes de nos actions possible. Il n'est donc
pas tonnant que les peintres qui s'efforcent de se librer des restric-
tions imposes par de tels schmes et cherchent se consacrer uni-
quement la vision, finissent par voir des choses tonnantes. Cet
effort tant une remonte vers une exprience originelle o la ralit
est donne dans son intgralit, il est invitable que la perception
ainsi libre revte l'apparence d'une illusion pour le sens commun.
Aussi Bergson appelle-t-il cette perception largie vision plutt que
perception. 39
La perception ordinaire ralise ainsi une rduction de la ralit de
l'tre comme multiplicit infinie de l'exprience immdiate un objet
peru dans un rapport au sujet percevant finalis par l'agir de ce dernier.
Voir la ralit, c'est opposer cette perception schmatique des tres
quelque chose comme une intuition intellectuelle
40
qui n'a d'autre fin qu'el-
le-mme. La remonte de la perception la vision exige du sujet percevant
qu'il renonce volontairement ses prrogatives de sujet constituant des
schmes, pour laisser l'infinie multiplicit des tres envahir entirement le
champ de la vision.
41
L'exigence de perception des contrastes en de de leur inscription
dans la finalisation de l'agir d'un sujet dtermin est ici remplie. Dans l'ex-
prience de la vision, le sujet renonce lui-mme comme sujet constituant
et agissant, et laisse venir librement lui la ralit des choses extrieures,
en de de toute schmatisation. La vision est donc l'exprience paradoxa-
le d'un effort constant du sujet pour parvenir l'immdiatet d'un rapport
la ralit de la chose. L'immdiatet de la vision suppose l'accomplisse-
ment d'une purification de la perception et se donne donc comme un rsul-
tat inscrit dans une dure (au sens le plus courant du terme). Si la tempora-
lit de la rencontre est dans l'ternelle prsence du devenir des choses, cette
ternit est une conqute ralise par le sujet (ou inter-subjectivement par
la communaut des sujets) au cur de l'histoire comme temporalit consti-
tue, conqute qu'on peut dfinir comme arrachement l'histoire; dans
l'histoire, mais contre elle.
Tky 127
Dans cet en de de l'activit schmatisante du sujet percevant, la
ralit est donc vue non plus dans l'histoire, mais dans une immdiatet o
la seule dtermination qui reste attache la chose est celle de la variabili-
t de ses multiplicits, c'est--dire son absolue mutabilit, ou encore, pour
utiliser un terme labor dans les traditions bouddhiques, son impermanen-
ce (muj]. L'impermanence n'a pas d'histoire, elle est d'ternit, mais par-
venir l' impermanence est sans conteste un vnement historique.
C'est dans cette critique de la schmatisation du sujet percevant que
s'origine la critique de l'historicisme. Critique inverse, si l'on peut dire,
par rapport celle qui lui est souvent faite dans la tradition occidentale,
puisque c'est moins la corruption de tous les principes juridiques et moraux
universels qu'il engendre, et le scepticisme qui en dcoule que rcuse
Kobayashi, que sa prtention laisser le sujet historien hors de l'absolue
mutabilit de toutes choses: dans l'assignation la ralit des choses d'une
temporalit historienne, leur phnomnaJisation, le sujet reste en dehors des
schmes qu'il produit, et l'on s'puiserait vouloir rsoudre le problme en
transformant son tour ce sujet en objet, qui ne ferait que dplacer le point
aveugle de la perception vers un nouveau sujet, l'historien de l'histoire. Au
demeurant, la critique de Kobayashi se veut moins une contribution
l'pistmologie qu'une remarque de bon sens :
J'ai crit de nombreuses occasions mes penses sur l'histoire,
mais je n'en ai jamais parl comme historien, comme philosophe de
J'histoire, tout ce que je me suis content de faire, c'est de rpter
inlassablement le bon sens qui veut que Hegel soit un personnage
historique et non pas que l'histoire elle-mme soit dans le systme
hglien. 42
En d'autres termes, c'est parce qu'on ne rsiste pas au devenir, parce
que tout coule, qu'il est illusoire de chercher extraire les schmes de la
perception de ce devenir. Illusoire et rducteur, puisque cette perception
schmatisante est incapable de saisir la principale dtermination de toutes
choses savoir justement qu'elles coulent. Saisir les choses dans leur deve-
nir, dans leur incessante variation, revient en saisir la ralit.
La ralit des choses est donc la chose elle-mme en tant qu'elle est
impermanente. L'arrachement kobayashien l'histoire ne cherche pas
atteindre des constantes surplombant le devenir humain (que celles-ci
soient les lois de l'histoire, celles du dveloppement social ou la formalisa-
tion des constantes pragmatiques de la communication... ), mais au contrai-
re dcouvrir derrire toutes les dterminations assignes aux choses la
mutabilit de ces dterminations mme, comme de tout le monde humain.
128 prouver l'universel
C'est cette mutabilit des choses qui confre chacune d'entre elle son ir-
ductible singularit.
Le principe mutabilit de toutes les dterminations historiques de
l'objet comme du sujet constituant l'objet rend de la mme manire tout
fait vaines les constructions mtaphysiques qui chercheraient sauver
l'Etre de la chose en l'inscrivant dans une temporalit sempiternelle, et rela-
tivise considrablement le naturalisme scientifique, en pensant l'imperma-
nence des constantes et des rgularits qu'elle nonce, mais sans interroger
les limites de sa sphre de validit. Kobayashi ne reproche pas la science
moderne
43
d'tre relati ve ou subjective, et ne doute pas qu'un usage rigou-
reux de l'entendement permette d'noncer des propositions vraies sur les
objets perus, mais en opposant deux sortes de perceptions, celles qui
mnent la vrit de l'objet et celles qui ouvrent la ralit de la chose, il
dessine des champs d'application diffrents, celui de la science et celui de
la rhtorique, ou littrature, mais aussi un ordre de priorit: la ralit ulti-
me de la science elle-mme rsidant dans la vision de la ralit des choses;
il est puisant et assez vain d'inscrire sa pense dans l'horizon ultime de
cette dernire.
Toutes les entreprises humaines, tous les sentiments humains, et
mme toutes les penses que produisent prtentieusement les tres
humains pour se plaindre ou se rjouir de l' impermanence de toutes
les choses, tout, absolument tout, doit se soumettre la loi inhumai-
ne des causes et des effets qui rgit l'apparition de tel chose en tel
lieu et la disparition de telle autre en tel autre lieu. Au bout du comp-
te, le sujet qui considre qu'une telle loi est la vrit n'est jamais
qu'un maillon de la chane des causes et des effets. Aucune loi,
aucun tre n'est substantiel. Tout est vide. La vie humaine n'est que
le songe d'une nuit de printemps, mais la loi de succession des
causes et des effets qui tisse la toile de ce songe n'est-elle, non plus,
rien d'autre qu'un songe. 44
Le voyageur, qui se souvient de quelques sentences dfinitives de
l'cclsiaste doit admettre que si chez Kobayashi, le constat est le mme,
la tonalit qui en rsulte est en tout point diffrente. L'impermanence, on
pourrait dire la vacuit de toutes choses, n'ouvre pas chez lui une version
orientale de l'argos logos, l'argument paresseux que Leibniz et tant d'autres
ont nergiquement combattu, selon lequel tout tant vain, tout est gal.
C'est prcisment le contraire qui se produit: ds lors que la vie humaine
n'est que le songe d'une nuit de printemps, il est tout fait urgent de se
consacrer ce songe avec l'attention, la minutie et la concentration qu'on
Tky 129
accorde aux choses exceptionnelles, qui sont tout entires dans l'instant qui
les contient, instant dont on sait qu'ils ne se reproduira pas.
L'impermanence des tres n'.est pas une raison de dsesprer ou une justi-
fication de l'indiffrence, c'est un puissant motif pour agir. C'est ce qui dif-
frencie fortement la vision d'une contemplation. Cette exprience esth-
tique totale est irrductible la seule intuition intellectuelle de la ralit, et
c'est d'ailleurs ce qui interdit la paresse: la paresse est rendue possible par
l'affirmation d'un point de vue partir duquel il est possible de transcender
toutes choses en les contemplant de l'extrieur. Parce que la vision est l'ex-
prience de l'immanence saisie comme perptuelle mutation, il n'y a pas de
position qui soit assez stable pour autoriser la contemplation. La vision est
une action et exige la mise en mouvement du sujet parce que la ralit n'est
que dans le devenir, dans l'action. L o la contemplation se veut tre le
fondement et la mthode de la mtaphysique, la vision interdit toute fonda-
tion mtaphysique parce qu'elle rvle que le seul absolu est l'imperma-
nence des choses.
Voir la ralit des choses est donc strictement indissociable d'un agir
thique: la ralit des choses vues, ds lors que cette vision est en de de
la relation d'un sujet un objet, affecte directement et immdiatement le
voyant, le modifie, le transforme, et lui impose dans ses actions de ne pas
revenir en de de la critique du schmatisme intress qu'il a vaincu. C'est
la raison pour laquelle l'effort qu'exige la vision est thique, il interdit la
rification de ce qui est vu, ou son apprhension en objet. Le rapport l' al-
trit que rend possible la vision est un rapport immanent et dsarm de
l'utilitarisme de la perception usuelle. La vision est donc la relation imm-
diate d'un sujet percevant et de la ralit de la chose, mais elle est deux fois
mdiatise, par l'effort volontaire de purification de la vision et par l'agir
qu'elle engendre et impose.
Ainsi, la rencontre s'inscrit dans une processualit complexe au cur
de laquelle trne la vision. La rencontre passe par la vision parce que c'est
la vision qui dsarme le sujet et, en le conduisant agir, le pousse la ren-
contre. Non seulement l'immdiatet a une histoire, celle des efforts qu'el-
le requiert, mais elle retourne l'histoire, selon l'exigence thique de rins-
cription de la rencontre dans le processus de l'agir t i q u ~ C'est ce second
point que le voyageur doit dsormais approfondir.
La tradition dans la langue
L'immdiatet de la rencontre passe par la mdiation de l'effort de
purification de la vision, un processus qui est celui de la comprhen-
130 prouver l'universel
sion. Mais comment considrer que la comprhension puisse se jouer tout
entire dans l'exprience que ralise un individu? Les rencontres sont-elles
empilables ? Et comment l'tre, si elles doi vent l'tre puis-
qu'elles sont irrductiblement singulires?
Si par empilable il faut entendre que les rencontres ont des traits
communs qui les unissent et qu'il suffirait de distinguer ces traits communs
pour constituer un hritage, il faudrait admettre que le passage de l'indivi-
duel au collectif, de l'immdiatet de la rencontre singulire l'accumula-
tion historique passe par l'abstraction et la gnralisation, ce qui n'est
jamais qu'une autre manire de dire qu'il n'y a de ralit que dans l'instant.
Ce n'est pas le choix de Kobayashi pour qui il n'est pas impossible de pen-
ser l'empilement de rencontres sur le mode mme de la rencontre. C'est ce
que Kobayashi appelle la tradition, au prix d'un remaniement considrable
du concept.
Le point de vue moderne sur le monde, parce qu'il n'chappe pas
l'histoire, dfinit la tradition en rfrence au pass, comme perptuation
d'une habitude. L'habitude naturalise les valeurs ; ce faisant elle constitue
un mode de valorisation dont le fonctionnement ne suppose pas des sujets
concerns la pleine conscience de ce qu'ils font; tout au plus, la commu-
naut humaine concerne doit-elle partager un ensemble de pratiques et la
vision du monde qui y est associe, un sens commun.
Kobayashi prend le contre-pied de cette dfinition en opposant la tra-
dition et l'habitude d'une part, et en rservant le terme de sens commun
un usage polmique, comme critique de l'abstraction thorique, c'est--dire
comme bon sens. La tradition se distingue de l'habitude prcisment en ce
qu'elle n'est pas une seconde nature, puisqu'elle implique du sujet un agir
conscient, volontaire et cratif l o l'habitude relve de la rptition passi-
ve:
La tradition et l'habitude se ressemblent beaucoup. Mais elles sont
diffrentes. Plus notre insouciance nous empche de prendre
conscience de ce que nous faisons, plus l'habitude est forte; tandis
que la tradition exige l'effort de la faire revivre de notre part, et
qu'on ait conscience d'elle. Nous ne manquons jamais de remarquer
les habitudes, mais la tradition, elle, chappe aux regards
indolents. 45
La tradition n'est pas la reproduction mcanique et passive du mme
comportement, mais doit au contraire tre activement redcouverte pour
tre ractive. C'est dire qu'elle n'existe pas en tant que telle, et ne vit que
quand on se porte sa rencontre :
Tky 131
La tradition n'existe que l o l'hritage culturel du pass se
transmet et renat au prsent. La comprhension des caractres de
l'hritage culturel du pass n'est qu'une face du problme que pose
la tradition, et ce problme reste intact si l'on ne pense pas sa
renaissance dans le prsent. De plus, cette renaissance de la tradi-
tion, il ne nous est pas possible de l'apprhender objectivement.
Elle est notre charge, elle dpend de notre effort et de notre action.
Et comme la tradition ne vit que dans nos actes, il est pertinent d' af-
firmer que ceux qui ne s'efforcent pas faire renatre l'hritage du
pass ne pourront jamais dcouvrir ce qu'est la tradition. 46
Le voyageur tire deux enseignements de ce remaniement. En premier
lieu, le rapport de l'exprience singulire la tradition, le lien entre un indi-
vidu et la somme des expriences passes qui le prcde ne peut tre appr-
hend objectivement, ou plutt peut l'tre, mais ce serait rater sa ralit.
C'est pourquoi il ne peut y avoir empilement de rencontre que par des ren-
contres. Kobayashi est ici trs proche de la clbre formule de Marx:
Les hommes font leurs propre histoire mais ils ne la font pas de
leur plein gr, dans des circonstances librement choisies ; celles-ci
ils les trouvent au contraire toutes faites, donnes, hritage du pass.
La tradition de toutes les gnrations mortes pse comme un cau-
chemar sur le cerveau des vivants. Et au moment prcis o ils sem-
blent occups se transformer eux-mmes et bouleverser la rali-
t, crer l'absolument nouveau, c'est justement ces poques de
crises rvolutionnaires qu'ils voquent anxieusement et appellent
leur rescousse les mnes des anctres, qu'ils empruntent leurs noms
mots d'ordre, costumes, afin de jouer la nouvelle pice historique
sous cet antique et vnrable traverstissement et avec ce langage
d'emprunt. 47
En second lieu, la tradition apparat comme le lieu o se rassemblent
des productions singulires qui dclenchent des rencontres en chane et
crent ainsi une communaut de rencontres qui permet de penser le passa-
ge du singulier au collectif: combien de Japonais ont-ils dsirs com-
prendre aprs avoir dvor le Dosutoefusukii de Kobayashi ?
Et combien sont-ils s'tre prcipits poui le lire?
De sorte que tout spare la tradition kobayashienne de celle des tra-
ditionnalistes :
132 prouver l'universel
Je pense que l'erreur qui consiste faire de la tradition une habi-
tude est l'origine de ceux qu'on appelle traditionnalistes et qui se
dvouent obstinment la cause de la conservation des anciens et de
la dtestation du nouveau, tout comme de ceux qu'on appelle pro-
gressistes mprisent superficiellement ce qui est ancien. 48
Chez Kobayashi, c'est dans l'immdiatet de la rencontre que les
choses acquirent une .valeur, et la tradition n'chappe pas cette rgle.
Parce qu'elle n'est rien d'autre qu'une multiplicit de rencontres en attente
d'tre ractives, elle n'a d'intrt et ne mrite qu'on s'en proccupe que si
elle fait l'objet d'une recration d'expriences singulires, propage des
visions travers une multiplicit d'efforts pour les faire renatre, doit tre
pense comme une multiplicit d'actions singulires. Ce sont les traditio-
nalistes qui faisant de la pense japonaise une seconde nature qu'il suffirait
d'couter pour y tre fidle, tombent dans l' argos logos et commettent une
erreur symtrique aux modernes. Les classiques japonais ne sont pas plus
naturellement accessibles aux penseurs japonais contemporains que les tra-
ditions occidentales,. et il convient de tirer toutes les consquences de la
dterritorialisation des uvres: la tradition fonctionne comme un rservoir
de rencontres singulires, une bibliothque dont l'agencement dpend des
frquentations de chacun, pas de son lieu de naissance.
Le propos est essentiel parce qu'il ne limite pas la rencontre un
vnement unique et singulier, quelque chose comme un pont
49
lanc entre
les mondes historiques, mais permet au contraire de penser la construction
de traditions nouvelles, c'est--dire le surgissement de territoires mentaux
nouveaux, comme autant de mondes historiques possibles et venir.
Ainsi du Japon qui se dcouvre des traditions indites, celles de sa
propre modernit parce qu'ont t ralises assez de rencontres singulires
avec les choses occidentales pour qu'il soit possible un jeune, n au tour-
nant du sicle, de se former et de grandir en les dcouvrant activement, et
qu'elles sont assez riches et assez compltes pour constituer un univers
mental digne de ce nom.
C'est la raison pour laquelle pour Kobayashi un univers mental s'ins-
crit dans une langue. L'univers mental, comme agencement de traditions
noues entre elles par des rencontres, forme des contrastes qui le distingue
d'autres univers mentaux construits selon d'autres rencontres. Et parce qu'il
n' y a pas de vision sans expression, pas de rencontre sans les mots pour le
dire, l'univers mental d'un individu est troitement associ sa langue. La
gographie de Kobayashi est mentale, c'est--dire langagire.
Il faut ajouter tout de suite que les langues, parce qu'elles sont des
prcipits de traditions, dessinent des contrastes, et surtout pas des blocs.
Une frontire n'est pas seulement une sparation, c'est aussi un lieu de pas-
Tky 133
sage: chaque rencontre, parce qu'elle rejoue le trac des frontires est non
seulement un pont entre deux mondes historiques, mais aussi un appel la
constitution d'un monde historique nouveau, proprement inou.
Ractiv tant et plus dans la multiplication des rencontres, cet appel devient
la matrice de la constitution de traditions nouvelles et d'agencements
indits entre ces traditions. De ce point de vue, l'univers mental du Japon
moderne est exemplaire. Cet appel peut tre ou ne pas tre entendu, l' mer-
gence de mondes nouveaux est strictement contingente ; il garantit cepen-
dant que la gographie mentale et langagire n'est pas le thtre de l' af-
frontement entre des res linguistiques constitues en blocs.
La rencontre, pour tre singulire et immdiate, doit donc tre
mdiatise par la langue, dans l'histoire. Elle est historiquement constituti-
ve, comme exprience des limites d'un monde et appel au surgissement de
mondes nouveaux, et historiquement conditionne, comme travail de rac-
tivation de la langue.
Au passage, la thorie permet de qualifier l'exigence
de comprhension de la modernit occidentale comme une entreprise de
dmantlement des blocs, puisque c'est sous la figure d'une masse nor-
me - comme le fait remarquer Maruyama
SO
- que le Japon a commenc
recevoir la modernit occidentale, dmantlement conditionn par l'mer-
gence d'une gnration qui est la premire habiter vraiment ce monde
nouveau qu'est le Japon moderne.
Pour le voyageur, la conception kobayashienne de la tradition
comme ractivation de rencontres n'est pas sans consquences sur la dis-
pute du relativisme et de l'universalisme. Celle-ci met en place une alter-
native assez sommaire: ou bien il existe un convertisseur communication-
nel universel (code ou formes procdurales normatives) qui permet non
seulement de partager des ides triviales, ce dont personne ne doute, mais
aussi de raliser l'inter-comprhension propos des concepts travers les-
quelles les communauts humaines concernes se dfinissent, auquel cas la
communication entre mondes historiques peut avoir lieu; ou bien les mots
n'ont pas de sens en dehors du monde historique qui les a vu natre et alors
l'incommunicabilit rgne, et les frontires entre les mondes historiques
sont tanches. Dans une telle alternative on comprend qu'il soit difficile
d'abandonner l'universalisme : la figure pratique de l'incommunicabilit
n'est jamais la coexistence dans l'ignorance rciproque, c'est bien plutt la
guerre.
Mais la critique de l'universalisme communicationnel rend la pre-
mire position intenable, et le concept de rencontre invite ne pas se rsi-
gner la seconde, en ouvrant une voie qui permette de franchir les fron-
tires sans les nier : celle de la traduction.
134 prouver l'universel
Le dsir de traduction
.Voyager, Kobayashi le sait, est une entreprise difficile. La difficult.
peut tre formule de la manire suivante: soit la traduction fait appel un
convertisseur commun, et elle dgnre en technique, soit elle est logique-
ment impossible. Et pourtant, il y a des traductions ...
Quand j'ai entrepris la traduction de ses uvres [Rimbaud], j'tais
encore tudiant l'Universit. la rflexion, je me dis maintenant
que c'tait un acte d'une audace extrme. Aujourd'hui, un tel coura-
ge me ferait dfaut. Mais, en y rflchissant plus encore, je me dis
aussi que la jeunesse s'enfuit de nous avec ses immenses richesses,
parmi lesquelles l'audace 51
Du succs de cette audacieuse entreprise, Kobayashi dit lui-mme
qu'il y a l, tout le moins, un sujet d'tonnement et propose de s'en expli-
quer en invoquant le fait que la force du texte rimbaldien rside justement
dans sa capacit dpasser le seul cadre de la langue franaise. Il propose
d'expliquer le paradoxe en montrant que c'est parce que l'criture rimbal-
dienne pousse la langue franaise hors de ses limites, c'est--dire parce que
certaines uvres explorent toutes les possibilits de la langue dans laquelle
elles sont exprimes qu'elles sont capables d'mouvoir au del de la com-
munaut humaine de ceux qui pensent dans cette langue. Paradoxalement,
c'est l'opacit de l' uvre qui rend sa traduction possible, ncessaire
mme:
Je ne doute pas de ce que mon audace d'autrefois, comme celle de
beaucoup d'autres, contnt quelque chose comme une intuition pn-
trante, mais il n'est pas facile d'crire ce propos avec toute l'exac-
titude requise. Il est prfrable de tourner ses penses vers l'opacit
de Rimbaud, qui a exig de moi quelque chose et ne m'a pas laiss
rester passif. Qui pourrait tre aussi audacieux devant une uvre
transparente ? 52
Soit un jeune Japonais qui tudie la littrature franaise et tombe par
hasard sur un recueil de posie qui lui semble d'autant plus opaque que sa
matrise du franais est assez alatoire, mais suffisante pour que germe en
lui l'intuition que cette uvre recle quelque chose de trs important et le
dsir d'y accder. Il y a sans aucun doute un dcalage entre la volont br-
lante de comprendre un texte et la capacit linguistique d'en lucider le
sens, et une inconscience dans le geste qui consiste faire fi de ce dcala-
Tky 135
ge, mais aussi une trs grande fcondit dans cette posture apparemment
difficile puisqu'elle impose que le traducteur se replie sur la seule chose
laquelle il ait vr.aiment accs: ce qu'en japonais, on appelle le corps de la
p/lrase (buntai), c'est--dire le style. Un style assez singulier pour ne pas
s'enfermer dans les frontires prdessines du monde franais, assez puis-
sant pour imposer un mode de fonctionnement du langage qui lui est propre.
Ainsi, ce qu'on traduit, ce n'est pas le sens, qui ne prexiste pas la
lecture, mais prcisment son inachvement. Et ds lors que le passage
d'une langue l'autre ne peut s'effectuer via le sens, Kobayashi n'a gure
d'autre choix que de passer en de de la fonction de reprsentation du lan-
gage, de s'attacher aux rythmes, aux sonorits, la texture des mots et de
leurs agencements, l o s'labore la possibilit mme de la communica-
tion, dans un rapport esthtique matriel au corps du texte. Sa traduction
vise rendre la violence du texte rimbaldien, ce qu'il appelle sa nudit.
On comprend pourquoi Kobayashi associe directement traduction et
vision. On ne peut traduire qu' partir de ce qu'on voit. Ce retour la ra-
lit des mots, des textes est le moyen de contourner par en bas l'interdit
logique qui pse sur la traduction et de rester fidle l'exigence kantienne
d'une communicabilit universelle, en faisant un ncessaire dtour par le
corps. Il n'y a d'universalit relle que des corps, mais le rapport esthtique
qui les lie est indcidable a priori: la rencontre se fait, ou pas. Cette contin-
gence qui agace la philosophie universaliste imprgne les traductions rus-
sies de mystre et invite avoir recours la mtaphore du miracle. Il faut
plutt dire que l'indcidable immdiatet de la mise en rapport esthtique
des corps est susceptible de forger l'empathie ncessaire la recherche des
condition de possibilit du commerce et que cette empathie n'est ni un
dtail ni un luxe, mais la condition et la matrice d'un retour vers le sens et
la fonction reprsentative du langage: au demeurant, comment pourrait-on
mme en arriver au sens sans en passer par le corps des phrases ? La thse
peut paratre triviale, elle infirme cependant l'universalisme communica-
tionnel en condamnant la conception par trop nave du langage qu'elle vhi-
cule.
L'empathie n'est donc pas l'informul dont parle Charles Taylor,
c'est le point de passage oblig entre deux mondes historiques, via les
langues. Il n'y a pas de miracle dans la traduction de Kobayashi, mais il y
a la puissance de l'affection ressentie, et l'imprieux besoin d'agir selon
cette affection. La fonction reprsentative du langage est seconde, et enser-
r par sa capacit affecter.
En d'autres termes, l'opacit du texte rimbaldien a permis
Kobayashi de rompre l'habitude communicationnelle qui consiste cher-
cher naturellement le sens dans les mots. Le vritable sens de la vision
136 prouver l'universel
comme purification de la perception relativement la langue est donc de
dvoiler la fausse vidence de la communication, celle qui nat de l'habitu-
de d'attribuer un sens ~ mot. La critique kobayashienne expose au grand
jour le ftichisme de la communication.
Le commerce communicationnel peut bien se distinguer du com-
merce marchand en ce qu'il n'est pas stratgique, il reste tributaire d'une
certaine conception de l'change, commune l'un et l'autre. Depuis
Shakespeare et Marx, on sait que le commerce marchand loue les services
de l'argent, l'entremetteuse universelle. Mais depuis Marx, on sait aussi
qu'il n' y a pas de marchandise sans ftiche. 53
La leon vaut pour la communication. L'change communicationnel
prend la forme de la sujtion des protagonistes des rgles objectives
(parce que formalises) qui leur prexistent. L'universalisme communica-
tionnel, en faisant rsider la valeur de ce qui est chang dans le respect de
ces rgles, reste prisonnier de l'apparence selon laquelle ces rgles sont
indpendantes des rapports sociaux et, par consquent, naturellement parta-
ges par tous. Sans doute, les acteurs de la communication supposent-ils
chez leur interlocuteur la possibilit de communiquer ; on accorde que la
communication exige l'imputation rciproque d'une intentionalit. Il n'est
de surcrot pas impossible que cette imputation prenne la forme de la pr-
supposition d'un code ou de procdures normatives c o m m u ~ s Mais cette
imputation ncessaire la communication, ce besoin de faire comme si pour
que a marche, ne peut tre confondue avec la ralit. Refuser cette confu-
sion, c'est accorder que le ftichisme n'est pas une simple illusion, qu'il
s'origine dans le processus rel de l'change
54
, mais que ce constat n'auto-
rise pas pour autant la confusion thorique. En l'occurrence, sur le terrain
des concepts de valeur, les consquences d'une telle confusion sont dsas-
treuses, puisqu'elle conduit faire de la communication elle-mme l'origi-
ne de la valeur des concepts, et dpossder ainsi les interlocuteurs de leur
pouvoir propre de valorisation. De plus, cette confusion interdit toute pos-
sibilit de comprhension au sens large, puisque la comprhension exige
que la perception de l'altrit soit dsarme, qu'elle devienne vritablement
dsintresse, pour saisir l'autre en de de son objectalit gnralisante, ce
qui n'est possible que dans un effort pour dissoudre 55 l'effet ftiche de
la communication qui institue naturellement l'interlocuteur en type
indiffrent la singularit relle des individus. L'universalisme communi-
cationnel reste prisonnier d'une conception reprsentative de l'acte com-
municationnel.
Ainsi, de mme que chez Marx, Kobayashi fait porter sa critique sur
le caractre fantasmagorique de la perception dans la communication pen-
se sur le modle de l'change. Le parallle peut bien surprendre
s6
, le voya-
Tky 137
geur se l'autorise d'autant plus volontiers que Kobayashi ne cache pas son
admiration pour Marx qui il reconnat la mme opinitret dans la critique
de l'abstraction et dans la recherc.he de la ralit qu' Dostoevski, ce qui
est sans doute un des plus beaux compliments qu'il ait jamais fait
57
Chez Kobayashi, comme chez Marx d'ailleurs, la critique du fti-
chisme est aussi une reconnaissance de la ncessit des mcanismes qui
l'engendrent, c'est un trait fondamental de la socit moderne que cette
croyance dans l'objectivit de la communication comme agir naturel com-
mun tous les hommes. Aussi, cette critique ne pousse-t-elle pas s'af-
franchir de toute communication entre mondes historiques distincts, mais
la recherche de l'expression de rapports communicationnels dftichiss.
Une fois dvoils les mcanismes qui prsident au ftichisme, encore faut-
il exprimer ce qu'ils voilent. C'est l que les chemins de Marx et de
Kobayashi se sparent: le premier cherche construirOe une science imma-
nente la pratique, le second pense accder la ralit par la vision.
C'est--dire qu'une fois vu Rimbaud, il reste le transcrire en japo-
naIs.
De mme que l'immdiatet de la rencontre singulire est condition-
ne par une traduction, de mme la vision laquelle ouvre le corps de la
phrase et le dsir que cette vision suscite n'ont de matrialit qu'inscrite
dans une langue. C'est aussi la raison pour laquelle il ne suffit pas de dvo-
rer fivreusement Une Saison en Ellfer pour devenir traducteur de Rimbaud
en japonais. Parce que la rencontre est indissociablement vision et trans-
cription de la chose vue, si la traduction exige le dtour par l' affection des
corps, cette affection doit trouver son expression matrielle dans une langue
qui puisse rendre le style vu.
Cette question recoupe, pour la trs grande majorit des tres
humains
58
, celle de la langue maternelle, en l'occurrence pour Kobayashi, le
japonais. En effet, et encore une fois sauf exceptions, on ne choisit pas la
langue dans laquelle on nat et c'est dans celle-ci qu'on pense le mieux:
Nous avons notre destin, nous sommes ns japonais. Vous n'avez
pas choisi d'tre tel que vous tes. C'tait dcid; quelqu'un en a
dcid. Impossible de vivre autrement. Ainsi, vous ne pourrez expri-
mer vraiment vos tats d'mes qu'en japonais. 59
Ce destin est ici videmment synonyme de contingence et non de
fatalit, et c'est sans doute pour ne pas assez distinguer les deux sens que
nombre de commentateurs font de Kobayashi un occidentaliste ramen sur
le tard au japonisme par sa langue, alors qu'il n'a jamais cess de rencon-
trer auteurs occidentaux et classiques japonais sans tre enchan la ques-
138 prouver l'universel
tion de leur origine, mais en cherchant toujours les faire revivre el1 japo-
nais. L'exigence d'inscription de la rencontre dans une tradition langagire
n'est pas un retour au traditionalisme, e ~ t la ncessaire expression de la
rencontre dans la seule langue que Kobayashi matrise fond, et c'est le tra-
hir sans scrupules que de l'instrumentaliser dans la cause du retour la tra-
dition.
Natre dans une langue, c'est faire les rencontres qui forment les
murs d'un univers intellectuel assez complexe pour qu'on y pense l'aise,
et qu'on s'y exprime finement. Il n'y a pas de passage d'un monde histo-
rique un autre qui ne suppose que la chose passe ne trouve sa place dans
le monde qu'elle rejoint.
Il ne faut pas cacher la difficult: cette place n'est pas donne, elle
est conqurir. Rimbaud n'est pas japonais et aurait pu ne jamais le deve-
nir si Kobayashi ne lui avait pas fait une place. Ici encore, tout est affaire
de style: le traducteur peut ne pas tre un tratre, s'il parvient faire prou-
ver ce qu'il traduit en le re-crant. Cette re-cration exige de faire subir la
langue maternelle du traducteur une violence, tendre les limites du japo-
nais jusqu' Rimbaud.
Cette extension, analogue la violence que Rimbaud fait subir au
franais est un arrachement au japonais courant, mais en aucun cas la cra-
tion d'une nouvelle langue. Le point est d'importance pour le voyageur.
t o ~ s les universalismes, parfois critiques, qui appellent de leur vux, et
s'attellent parfois la fabrication de langues communes nouvelles
60
,
Kobayashi rtorquerait sans doute que, pour sa part, il est trop idiot
61
pour
s'aventurer dans une telle tche et qu'il prfre se contenter de parcourir
inlassablement les ressources que lui offre sa langue maternelle. La langue
maternelle est en effet riche de toutes les significations que lui confre
l'usage quotidien, et la nouveaut du style n'est pas dissociable de la rac-
ti vation indite de cette richesse. L'emploi rcurrent de nologismes est
pour Kobayashi le symptme de l'immaturit de la modernit japonaise.
Parce que les rencontres singulires ne dessinent de nouvelles frontires
qu'en sdimentant, la nouveaut d'un style n'a de profondeur que quand il
est capable de faire surgir ou resurgir d'une langue use une saveur indite
ou oublie ...
Peut-on tre japonais et philosophe (II) ?
Tout cela n'est pas sans relation avec la critique du projet.de consti-
tution d'une expression du fond de la pense japonaise dans la langue
de la philosophie. Un tel projet ne peut conduire qu'au jargon, et dsigne
par l sa propre superficialit.
Tky 139
Pour nous [crivains], les philosophes semblent tout fait inat-
tentifs au destin qui nous oblige crire en japonais. Quelque rigou-
reuse et logique que soit une expression, si ~ est crite en japonais,
elle ne peut manquer d'acqurir la saveur d'un style propre aujapo-
nais. C'est d'ailleurs cette saveur que visent les crivains dans leur
travail quotidien. C'est de ce style que dpend la capacit d'une
uvre mouvoir les hommes. La pense elle-mme ne peut s'en
passer. Malgr l'indiffrence des philosophes cet gard, je pense
que la philosophie, au Japon, ne pourra renatre comme philosophie
japonaise avant que ce problme soit surmont. Qu'en pensez-
vous? 62
Le reproche est cruel, mais juste. Le jargon est le plus grand pch
des philosophes de l'cole de Kyto. Leur projet de traduction de la
pense japonaise dans la langue prsume universelle de la philosophie
conduit un rsultat pnible la lecture. En l'occurrence le jargon ne pro-
vient pas d'une trop grande singularisation du style (en tout cas chez les
disciples de Nishida, le cas de ce dernier tant plus complexe), mais tout au
contraire de l'usage vhiculaire et communicationnel d'une langue laquel-
le on a assign en monopole le caractre philosophique; ce jargon dsigne
et condamne le caractre htif et mal-assimil de la philosophie occidenta-
le dont le premier signe est d'imaginer que le style de la philosophie est
unique et qu'il suffit de parler le philosophique pour faire de la philosophie.
Il s'loigne un tel point de ce qu'on appelle communment le japonais
qu'on en vient douter si les concepts exprims dans ces uvres sont ceux
de la pense japonaise...
L'cole de Kyto saute pieds joints dans les fantasmagories du fti-
chisme communicationnel, et peut bien se donner comme ambition de cri-
tiquer la modernit, elle adopte en tout point sa conception de l'change
langagier, or, comme chacun sait depuis Marx
63
, la rptition en histoire
relve du genre comique :
La modernit occidentale est une tragdie, il y a donc de grands
acteurs tragiques. Mais la modernit japonaise qui s'est hte de
l'imiter n'est qu'une comdie, et il n'y a de grands comiques que sur
" [ ] 64
scene ...
Sans compter que ds lors que la philosophie jargonne, elle s'isole;
Kobayashi y voit la raison principale de son enfermement dans des cercles
restreints et confins, o elle se replie sur l'exgse universitaire des textes
canoniques occidentaux et la transcription de la pense japonaise en salmi-
140 prouver l'universel
gondi fabriqu pour l'occasion. En consquence de quoi, la philosophie ne
peut trouver au Japon le public qu'elle serait en droit d'avoir, et se trouve
dangereusement associe au fonctionnariat
65
La critique du jargon se double d'une critique de l'institutionnalisa-
tion de la philosophie au Japon, et de sa confiscation par des coles.
Kobayashi travaille en effet l'opposition entre une pense prive, dbarras-
se de toute contraintes d'ordre institutionnel ou social et les professeurs
publics, particulirement les philosophes universitaires, dpositaires d'un
savoir connu et reconnu, perptu conformment un usage ~ u tire sa lgi-
timit de sa rptition et de l'autorit de ceux qui s'en font les gardiens.
Kobayashi en digne lecteur de Descartes et de Dostoevski affronte le jar-
gon scolaire par l'indiffrence, en jouant le rle de celui qui ne comprend
pas le sens reu des mots et en s'excusant de ne disposer pour comprendre
d'aucune autre ressource intellectuelle que ses seules facults individuelles,
limites et incertaines. Ou pour le dire autrement, le personnage conceptuel
de Kobayashi, c'est l'Idiot - au sens o Gilles Deleuze et Felix Guattari
disent de Descartes qu'il fait l'ldiot
66
La philosophie japonaise doit donc trouver son style
67
C'est possible, si l'on y travaille et cette possibilit est celle du voya-
ge des concepts, autrement que dans les wagons-marchandises de la com-
munication. Au passage, le fait qu'elle n'y soit toujours pas parvenue n'est
pas sans rapport avec le constat de ce qu'au Japon aujourd'hui on philo-
sophe toujours /lors de la philosophie, dans la critique littraire, les
sciences sociales ou la littrature...
Il faut tirer les enseignements de cette remarque: les concepts philo-
sophiques se mtamorphosent en voyageant, au point qu'ils peuvent deve-
nir mconnaissables. Cette mtamorphose va bien au del de l'adaptation,
elle est u-ne re-cration. Certains en Europe sont inquiets pour l'avenir de la
philosophie qu'ils voient dans un perptuel retour sur soi, tout ayant dj
t dit. La possibilit pour les concepts philosophiques de traverser les fron-
tires de leur monde d'origine pour aller s'inscrire dans des traditions
indites, les rencontres conceptuelles qui peuvent en rsulter, avec pour
consquence l'mergence de mondes philosophiques indits - qui sont
autant de nouveaux styles - devrait les rassurer: il y a un devenir-voyage
de la philosophie.
L'occursivit contre le commerce
Les universaux communicationnels s'laborent autour de la supposi-
tion qu'existe un entremetteur universel commun, dont disposeraient des
Tky 141
interlocuteurs idalement interchangeables, que l'intercomprhension en
matire de concepts ayant traits aux valeurs pourrait tre pense grce au
de l'change commercial, selon les notions d'change, de rci-
procit, d'quivalent universel ... Ces universaux chouent honorer leur
prtention l'universalit parce que l'entremetteur fait dfaut, que l'chan-
ge idal ignore de cruelles asymtries qui s' originent dans la violence des
rapports sociaux, parce qu'ils s'puisent dans des reprsentations ftiches
de la communication qui rifient le processus rel de valorisation.
La rencontre ne suppose aucun entremetteur commun, aucune valeur
commune, mais permet de penser la manire de les produire. Elle dpasse
les apories de l'incommunicabilit entre mondes historiques en montrant
que les concepts ne sont pas importables ou exportables, mais qu'ils peu-
vent voyager, parce qu'ils peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet
d'une re-cration qui, la fois, en est la mtamorphose et la meilleur mani-
re de lui tre fidle. La rencontre fait donc appel une qualit des concepts
qui n'est pas leur applicabilit, mais leur capacit tre re-crs ailleurs. On
peut appeler cette qualit de faire l'objet de rencontres l' occursivit des
concepts.
Cette occursivit s'oppose point par point la fongibilit commer-
ciale. Elle est ce qui n'est pas rductible au commerce dans le transfert des
concepts. Dans le commerce, les choses, les concepts, les ides circulent, au
sens o elles passent de l'un l'autre, deviennent communes, au sens de
gnrales, et ncessairement se dvalorisent. Leur fongibilit rside prci-
sment dans cette capacit devenir gnral, dont on ne voit pas en quoi
elle constituerait un mode lgitime et universel de valorisation. Ou pour le
dire avec Kobayashi : Toutes les penses, l'image des monnaies s'ab-
ment et se salissent en passant d'une main l'autre 68.
L'occursivit au contraire, parce qu'elle fait appel la rencontre et
non un entremetteur universel, permet de rejouer la valeur des choses, des
affects et des ides qui passent, sans la faire rsider dans leur fongibilit.
C'est la grande faiblesse de l'universalisme communicationnel que de
confondre la fongibilit comme puissance de gnralisation selon des rgles
et l'universel proprement dit, qui, par dfinition, s'origine dans la ren-
contre. Ds lors que l'universalisme communicationnel fait rsider l'origi-
ne des valeurs dans leur circulation communicationnelle, les concepts de
valeur sont diffrencis et hirarchiss selon leur plus ou moins grande
. capacit circuler, selon leur fongibilit. En dernier lieu, la valorisation par
la discussion selon le principe d'universalisation (U) est une valorisation
par la fongibilit des valeurs. De la sorte, ne voyage que ce qui est gnral,
la singularit reste quai.
Dans la rencontre au contraire, c'est l'occursivit des choses, comme
142 prouver l'universel
qualit de provoquer des crations en affectant qui fait la diffrence, sans
hirarchiser. La rencontre est sans aucun doute de peu d'intrt pour orga-
niser la des marchandises, et ne prtend pas se substituer en tous
points au commerce, mais c'est sans doute le seul moyen de prserver la
vise universelle des concepts de valeur, ce qui est important, quant au
devenir de la philosophie. C'est de l'occursivit des concepts que dpend la
possibilit de sauvegarder la singularit qui leur confre leur force, leur
puissance d' affecter,de convaincre, en un mot leur valeur jusque dans
l'preuve du dmnagement, d'un monde historique vers un autre.
L'occursivit des concepts n'est pas susceptible de mesure, tant
quantitative que qualitative. Le nombre et l'intensit des rencontres qu'un
concept peut provoquer ne dpend en effet pas seulement de sa composition
interne, mais aussi d'une infinit de facteurs contextuels. Les transferts de
concepts font en effet intervenir l' occursivit des concepts, mais aussi toute
une cohue bigarre, celle de l'histoire des relations concrtes entre mondes
historiques. Comme cette histoire est rarement paisible, la diffusion d'un
concept est aussi l'indice de la puissance de son monde d' origine. Peut-tre,
cependant, de trs longues temporalits autorisent-elles, ex post facto,
constater que certain concepts sont plus occursifs que d'autres. Produire de
tels concepts serait alors la vise consciente dans laquelle pourrait lgiti-
mement rsider la prtention des philosophes l'universel.
De l'art de la rencontre comme vertu
On peut - on le doit, sans doute - tre attentif aux conditions his-
toriques qui rendent les voyages possibles; il n'en reste pas moins qu'on ne
sait jamais vraiment pourquoi ni comment a Commence. Comme si initier
un voyage tait toujours un peu le fait du hasard, ce que Diderot a par
ailleurs fort bien compris :
Comment s'taient-ils rencontr ? Par hasard, comme tout le
monde. Comment s'appelaient-ils ? Que vous importe ? D'o
venaient-ils? Du lieu le plus prochain. O allaient-ils? Est-ce qu'on
sait o on va ? Que disaient-ils? Le matre ne disait rien; et Jacques
disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et
de mal ici-bas tait crit l-haut. 69
Ce ct hasardeux des grands dparts n'est pas trop mystrieux : les
rencontres, comme les questionnements qui les stimulent viennent du
dehors. D'ailleurs, chez Platon, c'est l'tranger qui pose les question
70
Rien
Tky 143
d'tonnant ds lors qu'on ait l'impression que a vous tombe dessus sans
prvenir.
De toute o n ~ l'occasion, dcidment bonne fille, ne peut fournir
que ce qu'elle a. On ne voyage pas en ne s'en remettant qu' ses soins: les
occasions sont faites pour tres saisies. Peut-tre est-ce l le plus grave
reproche qu'on puisse faire l'universalisme commercial : il s'attache
mticuleusement ignorer les occasions, rduire les hasards. On a bien
sr le droit de ne pas aimer les surprises, mais c'est faire preuve d'un
manque de curiosit dplorable aussi bien pour les touristes que pour les
philosophes, qui, depuis Platon, prtendent exercer le mtier d'tonn per-
ptuel.
vrai dire, on comprend: est-ce qu'on sait o l'on va ? comme
dirai t Diderot. Si l'occasion peut tre bonne fille, la curiosi t, elle, est la
folle du logis. Ne pas savoir o l'on va est un luxe que l'universalisme com-
municationnel, parce qu'il est pargnant, refuse de s'offrir. D'autant qu'on
est jamais curieux de nature, et qu'il convient en la matire d'entretenir
avec soin toutes ses dispositions voyageuses. Ou p'our le dire avec Philippe
Pons propos du Japon :
[A]ller au Japon, c'est peut-tre mieux qu'ailleurs tre en situation
de comprendre que le voyage commence o cesse d'exister le spec-
taculaire. Non qu'il n'y ait pas de pittoresque nippon, au contraire,
on doit s'attendre en tre submerg. Mais c'est prcisment le
pige majeur : celui de l'exotisme qui fige le diffrent dans l' tran-
ge [... ].Voyage!; ce n'est donc pas entretel1ir une positiofl d'tran-
ger, mais apprendre le devenir .71
Comment entretenir la curiosit sans entretenir une position d'tran-
ger ? Comment apprend-on devenir tranger ? Si l'on en croit Pons il y
aurait quelque chose comme un art de la rencontre, celui d'viter les piges
de l'trange, et cet art s'enseignerait.
Comme toujours l'apprenti-voyageur fera son miel de la lecture de
Kant car qui dit art de la rencontre dit sociabilit, qualit dont on sait qu'el-
le regroupe des vertus, dont la liste exhaustive a t dment tablie par le
philosophe de Konigsberg.
la disponibilit, l'humeur communicative, la courtoisie, l'hospita-
lit, l'indulgence (en pratiquant la controverse sans se quereller) 72.
Tout est dit dans ces deux lignes. Pas de rencontre sans disponibilit
s'engager dans la voie que suggre la prsence fortuite mais relle de
144 prouver l'universel
l'tranger, sans laisser se former un milieu - en de de toute communi-
cation commerciale -, quelque chose comme une ambiance, une atmo-
sphre propre nourrir l' l n ~ u r requise pour chercher les conditions de
possibilit du commerce. Il convient en effet que soit donne chacun l'en-
vie de respecter le devoir d' Ilospitalit ; ce qui requiert une attitude cour-
toise, comme gage de sa capacit adopter des rgles dans la relation
venir, sans pour autant que ces rgles soient imposes a priori, puisqu'elles
s'chafaudent dans la rencontre mme, c'est--dire sans chercher s'impo-
ser l'autre, ce qui suppose de le considrer avec indulgence.
L'universalisme communicationnel pour sa part prne la force sans
contrainte du mei lIeur argument 73 et exige des interlocuteurs l'adoption de
ses procdures et de sa hirarchie axiologique, il n'prouve aucune gne
taler ses prtentions au titre qu'elles lui semblent honorables. Il exige
qu'on en fasse - avant toutes choses, et au mpris des lois de l'hospitalit
- le sujet principal de la conversation et rige ces procds en modle de
communication idale, au titre que, parat-il, ils seraient reus dans la com-
munaut savante.
Pourtant, selon les rgles de l'art de la rencontre, chacun des termes
de l'numration kantienne doit tre pris trs au srieux, class minutieuse-
ment, et les philosophes qui souhaitent s'ouvrir d'autres mondes histo-
riques devraient y prendre garde: ces termes sont autant de conditions de
possibilit empirique de la discussion.
De la courtoisie, on ne retient pas la dialectique de l'tre et de l' ap-
parence (dans laquelle l'enferme le sens commun occidental, et parfois
aussi, il faut le reconnatre, le voyageur de Konigsberg), pour en faire la
forme pure d'une disposition la modestie, c'est--dire d'une modration
dans les prtentions en gnral 74. La courtoisie, parce qu'elle est la forme
pure de la retenue, encadre la subjectivit en la limitant, interdit de trop fou-
gueuses et trop voyantes projections narcissiques qui sont dcidment dso-
bligeantes, et rend aussi possible la perception de l'interlocuteur, ce qui
constitue un bon dbut. Elle permet de constater l'existence de contrastes.
L'humeur, que Kant appelle tort communicative, l o il entend
synesthsique, c'est--dire empathique, en tant qu'elle associe de proche en
proche des affections est l'accessoire indispensable de la courtoisie, son
prolongement ncessaire sans lequel elle dgnre en code, voir en proc-
dure, et sombre dans les ambiguts du commerce. Mais il serait htif de ne
voir dans l'humeur synesthsique qu'un simple accessoire, dans la mesure
o s'origine en elle le lieu de naissance naturel des rencontres, au point
qu'on peut presque dire qu'elle les appelle, en associant au constat de
l'existence de contrastes un sentiment positif de joie.
L'hospitalit parce qu'elle est rciproquement contraignante, est le
Tky 145
premier moment de la rencontre proprement dite. En tant que recherche
mutuelle des conditions empiriques de possibilit du commerce, elle en est
la condition. Les rencontres s'initient ~ s doute par hasard, mais il faut
bien plus que du hasard pour qu'elles se ralisent compltement. Le devoir
d'hospitalit en engageant la recherche des rgles qui rendent la commu-
nication possible, en interdisant donc d'en faire la prsupposition a priori,
lve l'hypothque d'un possible blocage du processus de la rencontre par
excs de prtention d'une des parties. L'hospitalit interdit la rduction uni-
latrale des contrastes.
Dans la recherche de ces rgles, la seule rgle est la recherche elle-
mme. Elle exige de chacun qu'il fasse preuve d'indulgence, en tant que
capacit surmonter les diffrends sans faire usage ni de la force ni de la
contrainte, les accepter et, pour tout dire, faire avec. Ce point est essen-
tiel, l'indulgence est la vertu qui permet de comprendre vraiment son inter-
locuteur, parce qu'elle rend tolrable de se laisser affecter par l'autre, en
renonant le juger. L'indulgence dsarme la tentation d'ossifier les
contrastes en diffrences, dont on finit toujours par faire un miroir, pour le
pIre.'
L'indulgence convoque donc la disponibilit, au sens le plus fort,
comme capacit se mettre en question, ainsi que ses opinions, les valeurs
qui les lgitiment, mais aussi le modle de valorisation partir duquel ces
dernires sont labores. Etre disponible, c'est accepter de questionner l'in-
disponible. En terre occidentale, c'est ne pas hsiter soulever la grande
question de l'universalit de l'universalisation comme principe de lgiti-
mation des normes. Ne pas hsiter soulever la grande question, c'est
accepter d'voquer la possibilit que ce principe ne soit pas universellement
lgitime, sans y voir un prlude au chaos ou la tyrannie. Etre disponible,
c'est accepter de soumettre toutes ses prtentions la question, c'est tre
libre de tirer toutes les leons du constat de l'existence de contrastes.
Sans disponibilit, l'indulgence pourrait dgnrer en manuvre
rhtorique: il ne faut pourtant pas confondre le suspens comme procd qui
consiste retarder le plus possible un dnouement connu et la suspension
du jugement, dont il faut rappeler que chez Descartes et selon l'ordre des
raisons, elle prcde la garantie divine et ne va donc pas sans risque. De la
curiosit la disponibilit, il faut aussi conjurer la peur, ce qui requiert par-
fois un effort surhumain, quand le contexte de la rencontre est tragique.
Ces vertus de courtoisie, d'hospitalit, d'indulgence et de disponibi-
lit rendent possibles les rencontres qui transgressent les frontires men-
tales, jusqu' les dplacer, en tracer de nouvelles, l encore pour le meilleur
et pour le pire, peut-tre, mais en produisant l'occasion des diffrenciels
de contrastes tout fait jubilatoires.
146 prouver l'universel
C'est pourquoi les rencontres appellent la philosophie, ou plus exac-
tement une philosophie dbarrasse de ses universaux. Pourquoi la philo-
sophie? Parce qu'il n'y a que la philosophie qui. puisse renoncer ses uni-
versaux sans renoncer l'universalit. Parce que justement la philosophie
s'est constitu au fil des sicles de srieuses rfrences pour ce qui est de
chercher querelle aux universaux. Parce qu'elle peut accueillir les concepts
au gr de la contingence des rencontres et de la libert de ceux qui s' y
livrent sans se nier. Encore faut-il qu'elle ait la gnrosit ncessaire, qu'el-
le cesse de se dfinir elle-mme selon un objet, une raison ou un langage
unIque.
La perspective du devenir-voyage de la philosophie est donc une
invite l'affranchir de ses sujtions commerciales, en particulier de la
rduction de toute communication l'change, faute de quoi les rencontres
iront se dire ailleurs, et peut-tre un peu moins bien, et la philosophie rsis-
tera moins opinitrement la tentation sans cesse prsente de chercher
construire son avenir dans un ternel retour sur soi et sur sa propre glose (ce
qui ne saurait tre confondu avec la ractivation de ses traditions - fertile
horizon de voyages). Il y aurait alors fort parier que de rabougrissements
en enroulements sur ces rabougrissements, elle ne devienne doctrine insti-
tutionnelle au service de lgitimations sans doute encore trs diverses, mais
dont le point commun sera d'avoir partie lie avec le commerce et ses
expansions futures.
C'est dire combien le devenir-voyage de la philosophie est une ques-
tion politiquement importante. Il n'est pas politiquement indiffrent de pou-
voir dire les rencontres autrement qu' l'aide de vhicules commerciaux,
surtout dans le contexte historique de la mondialisation du capitalisme
d'origine europenne, porteur de .guerres comme les nues d'orage, comme
le faisait remarquer un connaisseur. Cela pos, on peut - on doit, mme,
peut-tre - prfrer la concurrence commerciale au commerce des armes,
le concert des nations la concurrence commerciale, l'agir communica-
tionnel des opinions publiques mondiales au concert des nations. Mais ces
choix du moindre mal sont loin d'puiser la question et n'y parviendront
d'ailleurs jamais pour la simple raison que toutes ces alternatives s'inscri-
vent dans la mme temporalit, celle que produit l'expansion commerciale.
Or, il doit aussi tre question de gagner du temps, c'est--dire d'en perdre,
d'arracher des retards cette expansion. Pour ce faire, rien n'est compa-
rable aux rencontres et leur trs paradoxale temporalit. Toutes consid-
rations faites, y a-t-il une tche politique plus urgente pour la philosophie
que d'inciter penser une mondialisation du monde qui ne soit pas celle de
son unification sous la bannire de l'expansion commerciale? Sans comp-
ter que, de toute faon, la philosophie s'puise elle-mme mimer les justes
Tky 147
inquitudes de l 'humanisme dmocratique et ne remplacera jamais, pour le
dfendre, une campagne de presse, une manifestation, un rsultat lectoral
encourageant. .
L'avenir de la philosophie est donc ailleurs. Cet ailleurs n'est vi-
demment pas seulement gographique, au sens naturel et politique du
terme: on peut faire des rencontres ct de chez soi, chez soi aussi, dans
son pass, son impens, son pas-encore-revisit, ses traditions ...
Mais tout de mme, les dcentrements gographiques, quelle fra-
cheur!
C'est la raison pour laquelle, si le voyageur doit tre un peu philo-
sophe, le philosophe ne peut pas ne pas tre voyageur. Dans le voyage, le
philosophe accorde crdit des penses dont il ne souponnait pas l' exis-
tence, apprend s'orienter dans des territoires qu'il confondait jusqu' pr-
sent avec ses placards personnels (la religion et la littrature sont deux
inusables placards classiques ... ). Son voyage permet d'en faire la carte, de
donner voir les paysages singuliers qu'il dcouvre, de sorte que soit pro-
pose aux sdentaires l'occasion de voyager leur tour, pour peu qu'ils en
aient envie.
Sur ce point, il faut souligner que l'Occident, parce qu'il a longtemps
pens n'en avoir pas besoin, et qu'il a oubli les rares moments durant les-
quels il a ressenti ce besoin
75
, reste dans l'ensemble trs assis, comme dirait
Rimbaud. Comme il ne suffit pas de le regretter, il nous faut, au terme de
cet essai, oser une suggestion.
La pense indienne lit Shakespeare, la pense arabe se plonge dans
Freud, la japonaise connat Rimbaud, et la chinoise s'initie Adam Smith;
mais l'apprentissage d'une seule langue dite rare (comment peut-on quali-
fier de rares l'hindie, l'arabe, le japonais ou le chinois ?)- n'est tou-
jours pas considr comme ncessaire la formation des jeunes penseurs
europens. Aussi, nous semble-t-il qu'il serait temps, en prvision du jour
o il ne sera plus possible de philosopher autrement, d'introduire dans les
cursus universitaires philosophiques l'obligation de recevoir
l'enseignement de quelques langues non europennes ...
148 prouver l'universel
NOTES
1 Cf. supra, Charles Taylor, Comprhension et ethnocentrisme (1983), art.cit.,
~ . 199.
. Ibid.
3 Le cas des penseurs se rclamant aujourd'hui de l'cole de Kyto (dite
Nouvelle cole de Kyto ), ou pouvant y tre associs, est plus complexe: ils
continuent sans doute nourrir idologiquement les forces politiques les plus
conservatrices du Japon, mais ces dernires ont chang entre temps. Il n'est plus
question de faire du Japon la puissance autre qui se dresse face l'Occident, quit-
te le copier, mais d'en faire le champion d'un monde mondialis domin par les
lois du march, aux cts des USA et de l'Europe, et de prfrence devant eux.
C'est la raison pour laquelle 1' ouverture ,1' internationalisation , la com-
munication et l' individualisme sont les piliers de l'idologie officielle depuis
les annes 80. Mais c'est toujours de volont de puissance dont il est question, pas
de rencontre.
4 Kyama Iwao et Ksaka Masaaki ne participaient pas au symposium.
5 Takeuchi Yoshimi (1910-1977) : critique littraire et l'un des fondateurs des
tudes de littrature chinoise moderne au Japon; il dveloppe une conception ori-
ginale de l'asiatisme dans le contexte du marxisme d'aprs-guerre. Il est l'auteur
d'un commentaire critique devenu classique du symposium sur le Dpassement de
la Modernit (voir note 36, p. 102) intitul Kindai no Chkoku [le Dpassement
de la Modernit] (1959) in Nihon to Ajia [Le Japon et l'Asie], op. cit. On trouve une
traduction franaise de P. De Vos, de Chgoku no kindai to nihon no kindai- Rojin
wo tegakaritoshite [La modernit chinoise et la modernit japonaise - la lumi-
re de Lu Xun] (1948) dans CAPJ, op. cit. , T. II, p. 131-182.
6 Nakamura Mitsuo (1911-1988) : critique littraire et romancier, aprs des tudes
de droit et de littrature franaise l'Universit de Tky il se revendique un temps
du marxisme et commence frquenter Kobayashi Hideo (cf. note 19, chapitre IV).
Il effectue un voyage d'tudes en France en 1940-1941, et collabore avec le grou-
pe de la revue Bungakukai dont il est, selon Takeuchi Yoshimi, le reprsentant le
plus fidle au symposium sur le Dpassement de la Modernit. Aprs la guerre, il
J?ursuit ses travaux d'historien des littratures franaise et japonaise.
Nakamura Mitsuo, H Kindai " enD giwaku [la" Modernit" en question]
~ 1 9 4 2 in Kawakami et al., Kindai no Chokoku, p. 155-156. .
La Grce, Rome ou le Christianisme, tous ces lments qui ont contribu for-
mer l'Occident dans un lointaint pass sont autant de courants de pense constitu-
tifs de l'esprit contemporain des Europens. Ainsi, pourquoi dans le domaine de la
culture menons-nous continuellement des cabales en faveur de la " nouveaut "
sans rien comprendre l'antiquit de la culture europenne? , ibid.
9N. M., Kindai..., op. cit., p. 150.
10 Au passage, il faut souligner combien la remarque de Nakamura vise juste: les
auto-critiques de la modernit occidentale fonctionnent comme des nihonjinron en
ngatif, (cf. supra, p. 33) annonciatrices du surgissement du Japon et de la pense
japonaise sur la scne mondiale. Avant-hier le thme spenglerien du Dclin de
l'Occident, hier la critiqlle heideggerienne de la mtaphysique, plus rcemment la
Pense franaise contemporaine post moderne ont connu des succs d'estime (et de
librairie... ) qui s'expliquent aussi, pour une part, par le dsir de lire la chance du
Japon dans les crises de l'Occident. De ce point de vue, le dbat sur le Dpassement
de la modernit est d'une brlante actualit au Japon: parce que la modernit japo-
naise est hybride, la tentation de confondre l'auto-critique de l'Occident et l'affir-
Tky 149
mation de soi reste aujourd'hui encore trs prsente; Nakamura n'a rien perdu de
sa pertinence. ce sujet, cf. les analyses de Suga Hidemi, Bi kara Zatsu e [Du Beau
l'Embrouille], in Shsetsu teki Kydo [Intensit Romanesque], Tky, Fukutake
Shoten, 1990, p. 9 31.
11 Ibid., p. 151.
12 Ibid., p. 154.
13 ce propos, peu prs la mme poque, le tmoignage d'un Voyageur, sans
doute, malgr les apparences, parmi les plus lucides : " Donnez-nous la
Mandchourie, battons la Russie et les tats-Unis, et puis nous serons tranquilles. "
Cette dclaration d'un Japonais m'avais tellement frapp, ce dsir de nettoyer. / Le
Japon a la manie de nettoyer. / Or un lavage, comme une guerre, a quelque chose de
puril, parce qu'il faut recommencer aprs quelque temps. / Mais le Japonais aime
l'eau, et le " Samoura ", l'honneur et la vengeance. Le " Samourai " lave dans le
sang. Le Japonais lave mme le ciel. Dans quel tableau japonais avez-vous vu un
ciel sale ? Et pourtant ! Henri Michaux, Un barbare en Asie, (1933), Paris,
Gallimard, 1967, p. 204-205.
14 Il faut souligner l'incroyable lucidit de ce jeune homme de trente-et-un ans qui
ose vouloir une rencontre vritable avec l'Occident tandis que la "Guerre du
Pacifique fait rage et que la propagande" anti-tranger " se dchane dans un pays
o toute possibilit de rsistance publique a t dtruite depuis la fin des annes
trente.
15 Ibid., p. 164.
16 Ibid.
17 Dans son essai sur La modernit Japonaise et la modernit chinoise... in CAPJ,
op. cit., T. II, p. 131, Takeuchi Yoshimi cherche lui aussi - quoique trs diffrem-
ment - valoriser le retard comme rsistance. C'est au demeurant Takeuchi qui fut
le premier reconsidrer l'intrt du symposium sur le Dpassement de la moder-
nit aprs la guerre.
18 L'expression est de G. Deleuze et F. Guattari, cf. note 10, chapitre III.
19 L'importance de la pense de Kobayashi Hideo (1902-1983) dans le Japon du
XXe sicle est unanimement reconnue au Japon. Son uvre est partiellement dis-
ponible en franais grce au livre rcent de Ninomiya Masayuki, La pense de
Kobayashi Hideo, un intellectuel japonais au tournant de l'Histoire, Genve, Droz,
1995, qui COll1porte elltre autres les traductiollS de la prface de Dosutoefusukii 110
seikatsu [la Vie de Dostoevski] (1939), intitule Rekishini tsuite [Sur l' Histoire],
de Taima (1942), de Muj to iu koto [Ce qu'on appelle l'impermanence] (1942) et
de Watashi no jinshei kan [ma vision de la vie] (1949). Cet ouvrage sera not par la
suite PKH. On trouvera par ailleurs, toujours traduit par Ninomiya Masayuki, X eno
teganli [Lettre X] (1932) dans Y.-M. Allioux (dir.), CAPl, T.I, p.189-218. Une
bibliographie de langues franaise et anglaise des tudes relatives Kobayashi
Hideo et sa pense est donne dans la bibliographie gnrale du second tome. Le
livre de Ninomiya comporte aussi une importante bibliographie. Toutes les citations
sont traduites par nos soins, et la rfrence leur dition franaise prcise quand
elle existe.
20 Sur le rle de Kobayashi Hideo dans la fondation, la direction de la revue
Bungakukai et sur sa participation au symposium, cf. PKH, p. 15 39.
21 T. Kawakami et al., Kindai no Chkoku, op. cit. , p. 254.
22 Quand Kobayashi commence sa carrire littraire la fin des annes vingt, le
positivisme historique - celui de Taine ou du marxisme historiciste - domine les
sciences sociales et la critique littraire.
150 prouver l'universel
23 Kindai no Chkoku, op. cit., p. 218
24 Kindai no chkoku, op. cit., p. 219-220.
25 K. H., Rekishi ni tsuite [Sur l'Histoire] in Prface Dosutoefusukii no seikatsu
[la vie de Dostoevski] (1939) in Kobayashi Hideo Zensh [ uvres Compltes de
Kobayashi Hideo ] Tky, Schinch, T. V, p. 15. Cet ouvrage sera not CK par
la suite. Nous traduisons. On trouvera une traduction intgrale de ce texte dans
Ninomiya, PKH, p. 60 et svtes.
26 Watashi no jinsei kan [Ma vision de la vie], (1949) in CK, T. IX, p. 25.
Ninomiya, PKH, p. 227. Ce texte y est intgralement traduit sous le titre Ma mani-
re de voir la vie. Nous avons prfr traduire jinsei kan par vision de la vie, la
vision chez Kobayashi tant bien autre chose qu'une manire de voir.
27 L'Histoire de la philosophie est comparable l'art du portrait: il ne s'agit pas
de faire ressemblant, c'est--dire de rpter ce que le philosophe a dit, mais de pro-
duire la ressemblance en dgageant la fois le plan d'immanence qu'il a instaur
et les nouveaux concepts qu'il a crs. , G. Deleuze et F. Guattari, QLP, p. 55.
28 K. H. Samazamanaru Ish [Diverses modes] (1929), in CK, T. l, p. 16.
29 Il faut remarquer que le reproche est un peu injuste, les philosophes de l'cole
de Kyto savent faire place l'vnement rel, c'est mme cette confusion des
plans empirique et thorique qui les fait sombrer dans l'idologie la plus verbeuse.
Un peu injuste seulement, puisque cet vnement rel est immdiatement r-inscrit
dans les schmes instrumentaux d'un sujet intress.
30 Ibid., p. 219.
31 [L]a gographie ne se contente pas de fournir une matire et des lieux
variables la forme historique. Elle n'est pas seulement physique et humaine, mais
mentale, comme le paysage. Elle arrache l' histoire au culte de la ncessit pour
faire valoir l'irrductibilt de la contingence. Elle l'arrache au culte des origines
pour affirmer la puissance d'un" milieu" [... ]. Elle l'arrache aux structures [... ].
Enfin elle arrache l'histoire elle-mme pour dcouvrir les devenirs, qui ne sont
~ s l'histoire mme s'ils y retombent. G. Deleuze et F. Guattari, QLP, p. 92.
2 Kindai no Chkoku, op. cit., p. 230.
33 Alors, laissons l les bavardages inutiles propos de l'Esprit japonais ou
l'Esprit oriental. O qu'on cherche, on ne trouvera nulle part de telles choses, et si
on les trouvait, elles ne vaudraient pas la peine qu'on s'est donn les chercher.
K. H., Koky 0 usinatta Bungaku [Littrature sans patrie] (1933), <ECK, T. III,
~ 36.
4 propos de rencontres amoureuses : Mme si je ne trouve aucun homme,
aucune femme respecter dans ce monde, le champ de leur rencontre me parat
ce point digne que je ne puis m'en approcher que difficilement. Il ne faudrait
d'ailleurs pas limiter ce problme aux seules relations passionnelles entre les
hommes et les femmes; lorsqu'un pont magnifique relie un cur un autre,
comme dans l'amiti ou dans les relations familiales, la seule chose vraiment
importante, n'est-ce pas prcisment ce pont? En dehors de lui, le sentiment ainsi
que l'intelligence humaines ne sont-ils pas de vains garde-fous? Si l'on a person-
ne aimer, ni un homme ni une femme, n'est-il pas insignifiant de se demander qui
on est? Mme l'expression" la dcomposition du Moi chez l'homme moderne"
n'est qu'une mtaphore, ce qu'on appelle le Moi ne saurait tre assez solide pour
soutenir un pont. K. H., X enD regarni, [ Lettre X], (1932), CECK, T. II, p. 80
102. Ce texte est traduit en franais par Ninomiya dans CAPI, T. 1., p. 191 217.
Nous remanions lgrement c ~ t t e traduction.
Tky 151
35 K. H., Koky 0 usinatta bungaku [Littrature sans patrie] (1933), CK, T. III,
38.
6 Kobayashi Hideo, Ramb III [Rimbaud III] (1947), in CK, T. II, p. 152.
37 Mais la rencontre avec Rimbaud a ceci de singulier que c'est la premire, celle
laquelle Kobayashi cherchera rester fidle sa vie durant. Son uvre est l' expres-
sion de cette fidlit en mme temps qu'elle introduit la critique littraire au Japon,
aportant ainsi la dfinition de ce genre une remarquable contribution.
3 K. H., Ramb Ill, CK, T. II, p. 153.
39 K. H., Watashi no jinsei kan [Ma vision de la vie], op. cit., CK, T. IX, p. 46.
Ninomiya, PKH, p. 256. Dans Ranlb Ill, in CK, T. II, p.165-167, Kobayashi
commente la Lettre du voyant, en la comparant certains aspects de la pense de
Bergson.
40 La vision fait appel aux yeux de l'me et on trouve cette ide aussi bien chez
Kobayashi (<< Les yeux ordinaires essayent de regarder tandis "que l'me n'a pas
d'effort faire pour voir; il n'empche que l'me possde des yeux: c'est ce qu'on
appelle les yeux de l'me in K. H., ibid., p. 239.), que chez Descartes ( Par intui-
tion j'entends non point le tmoignage instable des sens, ni le jugement trompeur de
l'imagination qui opre des compositions sans valeur, mais une reprsentation qui
est le fait de l'intelligence pure et attentive, reprsentation (... ) qui nat de la seule
lumire de la Raison , Ren Descartes, Rgles pour la direction de l'esprit, in
uvres, dition de F. Alqui, Paris, Bordas, Classiques Garnier, 1988, T. 1., p. 87).
41 Ce qui est le plus surprenant pour un artiste est de voir le monde tel qu'il est.
Voir le monde tel qu'il est ne peut avoir qu'une signification: l'artiste finit par voir
les choses avec une modestie parfaite et s'oublier soi-mme. in Akutagawa
Rynosuke no bishin to shukumei [La muse et le destin de Akutagawa Rynosuke],
in K. H., CK, T. II, p. 38, cit par Ninomiya, PKH, p. 201.
42 K. H., Seiji 10 bungaku, [La politique et la littrature] (1951), CK, T. IX, p. 72.
43 Kobayashi connait bien les thories scientifiques qui lui sont contemporaines et
discute particulirement celles d'Einstein, ou de Heisenberg.
44 K. H., Watashi no jinsei kan [ Ma vision de la vie], op. cit.,CK, T. IX, p. 22-
23 ; Ninomiya, PKH, p. 223-224.
45 K. H., Denl, [Tradition] (1941), CK, T. VII, p. 227.
46 Ibid., p. 227.
47 Karl Marx, Le 18 brumaire de Louis-Napolon Bonaparte, in uvres IV, poli-
tigue, trad. M. Rubel, Paris, Gallimard, 1994, p. 437.
4 K. H. Dent, op. cil., p. 228
49 Kobayashi utilise l'expression dans X eno tegami [Lettre X], op. cit., p. 91;
Ninomiya, CAPI, T. II, p. 205.
50 Cf. supra, p. 70. .
51 K. H., Ramb Ill, op. cil., T. II, p. 168.
52 Ibid.
53 Ce qu'il y a de mystrieux dans la fonne marchandise consiste donc simple-
ment en ceci qu'elle renvoie aux hommes l'image des caractres sociaux de leur
propre travail comme ds caractres objectifs des produits du travail eux-mmes,
comme des qualits sociales des choses possdes par nature [... ]. De la mme
faon, l'impression lumineuse du nerf optique ne se donne pas comme l'excitation
du nerf optique proprement dit, mais comme forme objective d'une chose l'ext-
rieur de l' il. Simplement dans la vision il y a effectivement de la lumire qui est
projete d'une chose, l'objet extrieur, yers une autre, l'il. C'est un rapport phy-
152 prouver l'universel
sique entre deux choses physiques. Tandis que la forme marchandise et le rapport
de valeur des produits du travail dans lequel elle s'expose n'ont absolument rien
voir ni avec sa nature physique, ni avec les relations matrielles qui en rsultent.
C'est seulement le rapport social dtermin des hommes eux-mmes qui prend ici
pour eux la forme fantasmagorique d'un rapport entre choses. [... ] J'appelle cela le
ftichisme. K. Marx, Le Capital, T. l, Livre 1 4 (trad. J.-P. Lefebvre et . Balibar,
in . Balibar, La philosophie de Marx, Paris, La Dcouverte, 1983, p. 56).
54 Sur ce point, tienne Balibar, La philosophie de Marx, op. cit., p. 60 et svtes :
le ftichisme n'est pas [... ] un phnomne subjectif, une perception fausse de la
ralit. Il constitue plutt la faon dont la ralit (une certaine forme ou structure
sociale) ne peut pas ne pas apparatre. Et cet" apparatre" actif ( la fois Schein et
Erscheinung, c'est--dire un leurre et un phnomne) constitue une mdiation ou
fonction ncessaire sans laquelle, dans des conditions historiques donnes, la vie de
la socit serait tout simplement impossible. Supprimer l'apparence, c'est abolir le
rarport social.
5 L'expression est d'. Balibar, La philosophie de Marx, op. cit. , p. 60
56 Ce parallle a dj t suggr par le critique Karatani Kjin : Ce qui est
remarquable, c'est que, mme si Kobayashi le nie, sa critique doit en fait beaucoup
sa rencontre avec le marxisme et se dveloppe en rapport avec lui. Il critique le
marxisme la manire de Marx. Diverses modes est une critique marxienne :0 Marx
disait que les philosophes confondent leurs penses et la ralit telle qu'elle est.
Kobayashi dit la mme chose contre ceux chez qui la conversion au marxisme reste
idaliste: " il est clair que la conscience d'une poque n'est ni plus, ni moins gran-
de que la conscience de soi ", c'est dire que sortir du globe de la conscience de soi
ne veut pas dire adopter la thorie marxiste, qui n'est qu'une autre forme de la
mme conscience. , Kindai nihon no hihy, Showa Zenki l, [La critique du Japon
moderne, les dbuts de la priode ShowaI (1926 1935)], Tky, Kdansha, 1997,
36 et 37.
7 Marx a commenc par la prise de conscience de soi de la socit pour aller jus-
qu'au terme de cette prise de conscience. Dostoevski par exemple, a suivi le che-
min inverse. La figure de ces deux matres me semble se croiser perptuellement ,
Marukusu no Godatsu [L'veil de Marx] (1931), CK, T. l, p.l08-110.
58 Parmi les exceptions, on peut citer ceux qui n'ont, comme Jacques Derrida, pas
de langue maternelle, ou cellX qlli de Bergson Borges pourraient en revendiquer
deux.
59 K. H. Discussion avec les tudiants , publication posthume in Shinch, avril
1983, p. 63-64.
60 Faut-il compter Charles Taylor parmi ces aventuriers? Cherchant promouvoir
un lallgage des constrastes dans les thories interculturelles, il le dfinit comme
suit: Serions-nous vous invitablement l'ethnocentrisme? [... ] L'erreur ici est
de penser que le langage d'une thorie interculturelle doit tre soit le ntre, soit le
leur. [... ] Dans la plupart des cas, le langage adquat pour comprendre une autre
socit n'est ni notre langage de comprhension ni le leur, mais plutt ce qu'on
pourrait appeler un langage de clarification des contrastes [... ] c'est un langage
dans lequel nous pourrions fonnuler notre mode de vie et le leur en tant que possi-
bilits alternatives, relies certaines constantes humaines l'uvre dans les deux.
C'est un langage dans lequel les variations possibles de l'humanit pourraient tre
fonnules de telle sorte que notre forme de vie et la leur pourraient tre toutes deux
dcrites de faon claire, comme des alternatives l'intrieur de ce champ de varia-
tion. Ce langage de contraste pourra rvler que leur langage de comprhension est
Tky 153
dform ou inadquat certains gards, ou qu'il en est de mme du ntre. ,
Comprhension et ethnocentrisme , in La libert des modern.es, op. cit., p. 208.
Faut-il en conclure qu'il est la disposition des chercheurs en science sociales de
fabriquer des langages? Dans quelles langues se disent ces langages? Le voyageur,
n'exclut pas d'avoir mal compris la thorie propose, reste trs dubitatif.
1 Cf. note 66, chapitre IV.
62 Kindai no Chkoku, op. cit., p. 248.
63 Hegel note quelque part que tous les grands vnements et personnages histo-
riques surviennent pour ainsi dire deux fois. Il a oubli d'ajouter: une fois comme
tragdie et la fois d'aprs comme farce. , K. Marx, Le 18 bruI11aire... , op.cit.,
Kindai no Chkoku, op. cit., p. 219. Les jeux de mots de Kobayashi ne doivent
cependant pas occulter le fait que lui mme considre qu'il n'y a pas de vritable
rencontre sans perte de soi proprement parler tragique, et qu'il considre juste-
ment la nostalgie passiste des traditionalistes comme une raction bouffonne face
au destin tragique du Japon moderne.
65 Kobayashi reconnat Nishida la force d'avoir su mener bien son projet phi-
losophique, mais dplore son isolement et ses consquences, savoir une uvre
crite dans une langue qui n'est ni du ni quelque langue trangre que
ce soit . Selon lui, ce jargon a contribu attirer vers lui un groupe de disciples qui
a renforc son isolement, K. H., Gakush to Kanry [Savants et Fonctionnaires],
CK, T. VII; p. 84. Cet isolement n'est au demeurant pas le propre de l'cole de
Kyto. La philosophie a t importe et implante selon la trs directi ve volont de
l'tat de Meiji dsireux de copier la modernit occidentale, elle a toujours t rser-
ve de petites lites universitaires, et reprsente, aux yeux de l'honnte homme
jagonais, un exercice spirituel aussi trange qu'tranger.
{) L'idiot c'est le penseur priv par opposition au professeur public (le scolas-
tique) : le professeur ne cesse de renvoyer des concepts enseigns (l'homme-ani-
mal raisonnable) tandis que le penseur priv forme un concept avec les forces
innes que chacun possde en droit pour son compte (la lumire naturelle) [... ]
l'idiot est un personnage conceptuel [... ] l'idiot rapparat dans une autre poque,
dans un autre contexte, encore chrtien, mais russe. En devenant slave l'idiot est
rest le singulier, le penseur priv, mais il a chang de singularit. C'est Chestov qui
trouve dalls Dostoevski la puissance d'une nouvelle opposition du penseur priv et
du professeur public. [... ] G. Deleuze, F. Guattari, QLP, p. 61. Kobayashi a ren-
contr aussi bien Descartes que Chestov et surtout Dostoevski: aprs le voyage de
Descartes en Russie, celui de Dostoevski au Japon? En tout cas, selon Kobayashi
lui-mme juste aprs la guerre, j'ai fait une boutade dans une confrence, en affir-
mant que tous pouvaient bien rflchir [ leur attitude pendant la guerre, i.e. se
repentir] tant qu'ils voulaient, parce que tous taient trs intelligents, mais que pour
ma part, j'tais trop idiot pour a in K. H., Seiji to Bungaku [La politique et la lit-
trature], CK, T. IX, p. 80. Par ailleurs, Kobayashi voque, propos de Bergson,
la " dcision cartsienne " de considrer que la langue de tous les jours suffit
penser avec prcision ; dcision insparable d'une mfiance totale envers une
chose aussi ambige que l'histoire de la philosophie K. H., Watashi no jinsei kan
vision de la vie ], CK, T. IX, p. 51.
7 L'intention kobayashienne de faire de lagophilosophie une affaire de style n'est
pas un cas isol. Pascal Engel propose de caractriser les contrastes intra-europens
entre philosophie anglo-saxonne dite analytique et philosophie suppose continen-
tale de la manire suivante: [ l depuis les annes 60 environ, ce qui pouvait
154 prouver l'universel
encore constituer une forme d'unit doctrinale, thmatique et mthodique a dispa-
ru au sein du courant analytique. La plupart des thses du positivisme logique ont
t rejetes, et l'on peut aujourd'hui trouver, au sein du courant analytique, des
reprsentants de nombreuses tendances doctrinales (... l. Les thmes se sont largis
(... l. Le courant a aussi, en son sein, des contestataires. (... 1L'unit gographique
elle-mme a disparu: il fut un temps o la philosophie analytique tait essentielle-
ment de langue anglaise et amricaine. Elle le reste majoritairement, mais ce n'est
plus tout fait le cas (... l, c'est pourquoi l'appellation de " philosophie continen-
tale ne dsigne pas tant une localisation gographique qu'un certain style irl
P. Magnard et Y.-C. Zarka, La recherche p/lilpsophique ell France - bilan et pers-
pective, Rapport au Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche,
Septembre 1996, rdition juin 1997, p. 89 et 90.
68 K.H., Watashi no jinsei kan, [Ma vision de la vie], CK, T. IX, p. 26. Trad.
Ninomiya, PKH, p. 229.
69 Denis Diderot, Jacques le fataliste, in uvres Compltes, Paris, Hermann,
T. XXIII, 1981, p. 23.
70 ce propos, Jacques Derrida, Question d'tranger: venue de l'tranger , in
De l'hospitalit, Paris, Calmann-Lvy, 1997, p. Il et svtes.
71 Philippe Pons, Le Japon, op. cit. , p. 7. Nous soulignons.
72 E. Kant, Doctrine de la vertu in Mtaphysique des murs, trad. A. Renaut, Paris,
G-F-Flammarion, 1994, T. II, p. 348. Dans ce texte, Kant fait de ces grces des
uvres extrieures ou accessoires (parenga) qui donne une belle apparence de la
vertu ( 48), mais outre que ces grces, parce qu' elles rendent la vertu aimable
sont elles aussi des devoir de vertu, l'on a vu que dans VPP, il donne l' hospitali-
t non plus le rle de moyen au titre des bonnes manires du commerce ( 48)
mais de condition de possibilit empirique de celui-ci.
73 J. H., E.D., p. 19.
74 E. Kant, Doctrine de la vertu, op. cit., 37, p. 332.
75 Sur le devenir de la philosophie indienne en Occident, dcouverte au dbut du
XIXe sicle puis consciencieusement oublie... cf. Roger-Pol Droit, L'oubli de
l'Inde: une amnsie philosophique, Paris, PUF, 1989.
TABLE DES MATIRES
V ~ P R O P O S 5
INTRODUCTION 7
CHAPITRE 1:
Frankfurt
L'Universel et ses prtentions 19
CHAPITRE II :
Konigsberg
Le problme philosophique de l'entre en communication 37
CHAPITRE III :
Kyto
Peut-on tre japonais et philosophe ? 63
CHAPITRE IV :
Tky
La rencontre 107
TABLE DES MATIRES 155
Vous aimerez peut-être aussi
- UntitledDocument224 pagesUntitledGraziella Hermionne DJEKINPas encore d'évaluation
- Un Navire français explose à Cuba: Enquête inédite sur un attentat oubliéD'EverandUn Navire français explose à Cuba: Enquête inédite sur un attentat oubliéPas encore d'évaluation
- Critique Leopold IIDocument43 pagesCritique Leopold IIVictor Rosez100% (1)
- Essai sur l’impact du double langage de l’international dans la politique haïtienneD'EverandEssai sur l’impact du double langage de l’international dans la politique haïtiennePas encore d'évaluation
- La Contagion de La Mondialisation - Adel SamaraDocument255 pagesLa Contagion de La Mondialisation - Adel SamaraAlba Granada North Africa CoordinationPas encore d'évaluation
- L'afrique Au Delà Du MiroirDocument151 pagesL'afrique Au Delà Du MiroirIgnace RenaudPas encore d'évaluation
- Violences et ordre social en Haïti: Essai sur le vivre-ensemble dans une société postcolonialeD'EverandViolences et ordre social en Haïti: Essai sur le vivre-ensemble dans une société postcolonialePas encore d'évaluation
- Education en Afrique 2019Document437 pagesEducation en Afrique 2019Bouta chrysPas encore d'évaluation
- La dérive monarchique et klepto-autocratique en Afrique: EssaiD'EverandLa dérive monarchique et klepto-autocratique en Afrique: EssaiPas encore d'évaluation
- Regards Sur La Société Africaine - Ki ZerboDocument206 pagesRegards Sur La Société Africaine - Ki ZerboismaelPas encore d'évaluation
- Andre Schwarz Bart La Mulatresse SolitudeDocument131 pagesAndre Schwarz Bart La Mulatresse SolitudeMarcelle de LemosPas encore d'évaluation
- Financement de la santé et efficacité de l’aide internationale: Enjeux, défis et perspectivesD'EverandFinancement de la santé et efficacité de l’aide internationale: Enjeux, défis et perspectivesPas encore d'évaluation
- NDOYE - Cheikh PDFDocument389 pagesNDOYE - Cheikh PDFIbrahim Hawa BagayokoPas encore d'évaluation
- FDocument313 pagesFpazoiePas encore d'évaluation
- 4 5791896400908258391Document259 pages4 5791896400908258391Tchonbe Albert TchonbePas encore d'évaluation
- Là Où Tout Se Tait by Jean HatzfeldDocument186 pagesLà Où Tout Se Tait by Jean HatzfeldinouPas encore d'évaluation
- F XVL A Franc AfriqueDocument356 pagesF XVL A Franc AfriquePapa Moustapha DialloPas encore d'évaluation
- (Racines Du Présent) Ruben Um Nyobè - J.A. Mbembe (Achille Mbembe) - Écrits Sous Maquis (1989, Éditions L'Harmattan) - Libgen - LiDocument296 pages(Racines Du Présent) Ruben Um Nyobè - J.A. Mbembe (Achille Mbembe) - Écrits Sous Maquis (1989, Éditions L'Harmattan) - Libgen - LiValere FonkouPas encore d'évaluation
- La Françafrique Le Plus Long Scandale de La République (François-Xavier Verschave)Document386 pagesLa Françafrique Le Plus Long Scandale de La République (François-Xavier Verschave)Service AdministratifPas encore d'évaluation
- FranceRwanda-60-81 ThimonierDocument157 pagesFranceRwanda-60-81 Thimoniersl.aswad8331Pas encore d'évaluation
- Qui A Inventé La Lutte Contre Les Fake News - Antipresse - MediumDocument7 pagesQui A Inventé La Lutte Contre Les Fake News - Antipresse - MediumBernardo1871Pas encore d'évaluation
- Le Passé, Modes D'emploi (PDFDrive)Document109 pagesLe Passé, Modes D'emploi (PDFDrive)enagnonPas encore d'évaluation
- El Kairouani, Histoire de L'afrique, Traduction Pellissier & RémusatDocument534 pagesEl Kairouani, Histoire de L'afrique, Traduction Pellissier & RémusatSlim El Memmi100% (1)
- Aminata Traoré - L'Afrique HumiliéeDocument188 pagesAminata Traoré - L'Afrique HumiliéepersonhabilitePas encore d'évaluation
- Gaston Kelman Au Dela Du Noir Et BlancDocument9 pagesGaston Kelman Au Dela Du Noir Et BlancSa MeniPas encore d'évaluation
- Paradis 2021 Abdulrazak - GurnahDocument227 pagesParadis 2021 Abdulrazak - GurnahFd MtPas encore d'évaluation
- Lazzarato Maurizio - Le Capital Déteste Tout Le Monde. Fascisme Ou RévolutionDocument176 pagesLazzarato Maurizio - Le Capital Déteste Tout Le Monde. Fascisme Ou RévolutionAmaru TextosPas encore d'évaluation
- Thomas Sankara Un Nouveau Pouvoir Africain Jean Ziegler, Jean PhilippeDocument155 pagesThomas Sankara Un Nouveau Pouvoir Africain Jean Ziegler, Jean PhilippeBado BazombiéPas encore d'évaluation
- LAfrique Noire Pré-Coloniale (Cheikh Anta Diop) (Z-Library)Document256 pagesLAfrique Noire Pré-Coloniale (Cheikh Anta Diop) (Z-Library)willbaPas encore d'évaluation
- TombouctouDocument11 pagesTombouctouMamadou Saïdou DialloPas encore d'évaluation
- Zeïn Saad - Jean Ziegler - Mohamed Ould Rahal - Lisa Pierre - Les Chemins Sahraouis de l'espérance-L'Harmattan (1987)Document191 pagesZeïn Saad - Jean Ziegler - Mohamed Ould Rahal - Lisa Pierre - Les Chemins Sahraouis de l'espérance-L'Harmattan (1987)Kenny THELUSMAPas encore d'évaluation
- LE FIGARO HISTOIRE - Octobre Novembre 2023Document132 pagesLE FIGARO HISTOIRE - Octobre Novembre 2023sqcq cqqPas encore d'évaluation
- Economie Du Developpement Tome IDocument332 pagesEconomie Du Developpement Tome INehemie MerilienPas encore d'évaluation
- Bandung Du NordDocument124 pagesBandung Du NordazPas encore d'évaluation
- L'Empire Du Chaos - 2Document142 pagesL'Empire Du Chaos - 2Fathi Kammoun100% (1)
- Ethno-Politique CamerounaiseDocument3 pagesEthno-Politique CamerounaiseFaustin EtoukePas encore d'évaluation
- Pour Comprendre Les Discriminations Racistes. Dialogue Imaginaire Entre Deux HabitantsDocument14 pagesPour Comprendre Les Discriminations Racistes. Dialogue Imaginaire Entre Deux HabitantsbakuninjaPas encore d'évaluation
- Fontes Historiae Africanae 03 Vellut2Document410 pagesFontes Historiae Africanae 03 Vellut2Mbutu AlainPas encore d'évaluation
- 2 - La Chine Des SongDocument21 pages2 - La Chine Des SongVirginie DelaruePas encore d'évaluation
- 2020 Monnaie Unique CedeaoDocument2 pages2020 Monnaie Unique CedeaoKAYA charly100% (1)
- African History - Histoire Africaine (Defi) Batir La Medecine Kamite de DemainDocument6 pagesAfrican History - Histoire Africaine (Defi) Batir La Medecine Kamite de DemainDavid AhouaPas encore d'évaluation
- Repenser Le Pouvoir Dans Les Theories de PDFDocument654 pagesRepenser Le Pouvoir Dans Les Theories de PDFMorteza KhakshoorPas encore d'évaluation
- Aux Sources HistoireDocument139 pagesAux Sources Histoiretoopee1Pas encore d'évaluation
- Mon Dictionnaire Déconomie Comprendre, Se Positionner, Débattre (Thomas Porcher) (Z-Library)Document189 pagesMon Dictionnaire Déconomie Comprendre, Se Positionner, Débattre (Thomas Porcher) (Z-Library)paulin patrick noukam ngoboPas encore d'évaluation
- V.Y. Mudimbe Et La Ré-Invention de L'afrique. Poétique Et Politique de La Décolonisation Des Sciences Humaines (Francopolyphonies 4) (PDFDrive)Document422 pagesV.Y. Mudimbe Et La Ré-Invention de L'afrique. Poétique Et Politique de La Décolonisation Des Sciences Humaines (Francopolyphonies 4) (PDFDrive)Bouta chrysPas encore d'évaluation
- La Lute Contre RacismeDocument491 pagesLa Lute Contre Racismemechergui100% (2)
- Le Nord-Cameroun À Travers Ses MotsDocument337 pagesLe Nord-Cameroun À Travers Ses MotsAlef BetPas encore d'évaluation
- Antenor Firmin Etudes Sociologiques Historiques Litteraires PDFDocument325 pagesAntenor Firmin Etudes Sociologiques Historiques Litteraires PDFMarcio GoldmanPas encore d'évaluation
- De L'égalité Des Races Humaines - Antenor FirminDocument686 pagesDe L'égalité Des Races Humaines - Antenor FirminPensées Noires100% (1)
- L'Epopee de SounjaraDocument217 pagesL'Epopee de SounjaraJuanfra Carrillo100% (1)
- Langues Nationales Et Système ÉducatifDocument53 pagesLangues Nationales Et Système ÉducatifAbaay2013Pas encore d'évaluation
- Afrique: La Fracture Scientifique: Africa: The Scientific DivideDocument68 pagesAfrique: La Fracture Scientifique: Africa: The Scientific DivideAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Tradition Orale Et Archives de La Traite Négrière.Document143 pagesTradition Orale Et Archives de La Traite Négrière.slonsy100% (1)
- La Pensée Politique de Cheikh Anta Diop: AfricainesDocument1 pageLa Pensée Politique de Cheikh Anta Diop: AfricainesNwar MatPas encore d'évaluation
- Kadhafi ONU 2009Document41 pagesKadhafi ONU 2009Jerry MambouanaPas encore d'évaluation
- Fanny Pigeaud Au Cameroun de Paul Biya PDFDocument2 pagesFanny Pigeaud Au Cameroun de Paul Biya PDFNikki0% (1)
- Financing in Higher EducationDocument35 pagesFinancing in Higher Educationyaoamanimarcel8Pas encore d'évaluation
- Annuaire Ese PFEDocument2 pagesAnnuaire Ese PFEKhlifi AssilPas encore d'évaluation
- Reunion Rentree L2P 2023 2024Document24 pagesReunion Rentree L2P 2023 2024davenelson180603Pas encore d'évaluation
- Projet DidactiqueDocument3 pagesProjet DidactiqueCarmen Elena IvănușPas encore d'évaluation
- Fiche de Scolarite UPL 2022 2023Document1 pageFiche de Scolarite UPL 2022 2023David TshilerPas encore d'évaluation
- Portrait Factory Michel PaysantDocument3 pagesPortrait Factory Michel PaysantMichel PaysantPas encore d'évaluation
- SuitesDocument37 pagesSuitesbeebac2009100% (1)
- Laurence Lehmann-Ortega, Frédéric Leroy, Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Rodolphe Durand (Dir.) - Strategor - Toute La Stratégie d'Entreprise-Dunod (2016)Document847 pagesLaurence Lehmann-Ortega, Frédéric Leroy, Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Rodolphe Durand (Dir.) - Strategor - Toute La Stratégie d'Entreprise-Dunod (2016)Essouan Clement100% (1)
- Arbre Des Problèmes GuyaneDocument26 pagesArbre Des Problèmes GuyaneSamanta NovellaPas encore d'évaluation
- Brochure Artistique 16-17 PDFDocument88 pagesBrochure Artistique 16-17 PDFEvelyn VergaraPas encore d'évaluation
- Exposé1 - GpNadia - Gestion Du Double AgendaDocument9 pagesExposé1 - GpNadia - Gestion Du Double AgendaRAKOTOMALALAPas encore d'évaluation
- La Pédagogie de L'intégration - Des Systèmes D'éducation Et de Formation Au Coeur de Nos SociétésDocument341 pagesLa Pédagogie de L'intégration - Des Systèmes D'éducation Et de Formation Au Coeur de Nos SociétésAmine Azair100% (1)
- Rapport AmendisDocument34 pagesRapport AmendisBERROHOU67% (3)
- Les Cles Du Succes Des Systemes Scolaires Les Plus PerformantsDocument56 pagesLes Cles Du Succes Des Systemes Scolaires Les Plus PerformantsRaice 36Pas encore d'évaluation
- Sartre L Ecrivain Et Sa Langue PDFDocument22 pagesSartre L Ecrivain Et Sa Langue PDFLuiza HilgertPas encore d'évaluation
- Pierre Bourdieu La Domination Masculine Paris Seuil 1998 Coll Liber 134 PDocument6 pagesPierre Bourdieu La Domination Masculine Paris Seuil 1998 Coll Liber 134 PanirhamidPas encore d'évaluation
- La Traduction Anglais-FrançaisDocument50 pagesLa Traduction Anglais-FrançaisPascal75% (4)
- Introduction À La Psychologie GénéraleDocument68 pagesIntroduction À La Psychologie Généralemachhour100% (1)
- ANNEXE 3 Rapport de StageDocument12 pagesANNEXE 3 Rapport de Stagelenoiraciste97430Pas encore d'évaluation
- Module n09 Lecture Et Interpretation de Dessin TSGC OfpptDocument106 pagesModule n09 Lecture Et Interpretation de Dessin TSGC OfpptMohamed Amine Najmi100% (1)
- Musee Du LouvruDocument4 pagesMusee Du LouvruIrinaGG1024Pas encore d'évaluation