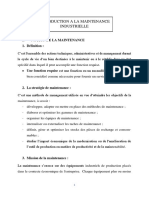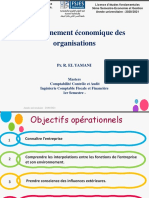Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
A2. Definitions de L'entrepreneur
A2. Definitions de L'entrepreneur
Transféré par
violina0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues2 pagesTitre original
A2. Definitions de l'entrepreneur.docx
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues2 pagesA2. Definitions de L'entrepreneur
A2. Definitions de L'entrepreneur
Transféré par
violinaDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 2
Définition de l'entrepreneur
En entreprenariat, il y a trois grands pionniers qui, à travers leurs écritures, ont pu
comprendre mieux la notion de d'entrepreneur:
Richard Cantillon était un français économiste et auteur d’Essai sur la nature du Commerce
en Général, physiocrate, né en 1680 et influencé par William Petty, John Locke, John Law etc...
Contrairement à ce que certains historiens de la pensée économique, le terme «entrepreneur»
n’était absolument pas nouveau à l’époque de Richard Cantillon. Le terme était déjà attesté au
XVIIème siècle. On peut le trouver par exemple dans le Parfait Négociant de Savary, datant de
1675. Il faut alors conclure que le terme entrepreneur n'est pas inventé par Cantillon.
En premier regard, le terme entrepreneur recouvre une réalité qui peut nous apparaître assez
floue: il est chez lui celui qui apporte les fonds pour mettre en œuvre un projet industriel ou
commercial, que celui qui dirige ce projet de manière concrète. Peu importe pour Cantillon si
l’entrepreneur apporte ou non les fonds. Ce qui caractérise l’entrepreneur chez Cantillon est le
preneur du risque. Le mot incertain, incertitude, revient beaucoup dans l’œuvre de l’Essai
consacrées à l’entrepreneur.
Cantillon défini ainsi deux classes: d’un côté ceux qui prennent des risques; de l’autre, ceux
qui n’en prennent pas: «Tous les habitants d’un État peuvent se diviser en deux classes, savoir en
entrepreneurs, et en gens à gages; les entrepreneurs sont comme à gages incertains, et tous les
autres à gages certains pour le temps qu’ils en jouissent, bien que leurs fonctions et leur rang
soient très disproportionnés. Le général qui a une paie, le courtisan qui a une pension, et le
domestique qui a des gages, tombent sous cette dernière espèce. Tous les autres sont
entrepreneurs, soit qu’ils s’établissent avec un fond pour conduire leur entreprise, soit qu’ils
soient entrepreneurs de leur propre travail sans aucuns fonds, et ils peuvent être considérés
comme vivant à l’incertain ; les gueux même et les voleurs sont des entrepreneurs de cette
classe.» Pour Cantillon, le fermier qui représente la classe productive est un entrepreneur, car il
prend un risque: «Le fermier est un entrepreneur qui promet de payer au propriétaire, pour sa
ferme ou terre, une somme fixe d’argent (qu’on suppose ordinairement égale en valeur au tiers
du produit de la terre), sans avoir de certitude de l’avantage qu’il tirera de cette entreprise».
D'après ces aperçus, on peut constater que l'entrepreneur chez Cantillon est celui, dans son
activité productive, fait face à une incertitude, à un risque. La seconde importance est de savoir si
l'entrepreneur utilise son propre capital ou un capital emprunté. On peut alors considérer que
Cantillon est parmi les économistes les plus clairvoyants de son siècle en observant la fonction
qui, dans une économie de marché, était la plus décisive et pourtant la plus discrète, celle de
l’entrepreneur.
Jean-Baptiste Say
Jean-Baptiste Say était un économiste français et entrepreneur. Il avait des opinions
classiquement libérales et faveur de la concurrence, du libre-échange et de la levée des
restrictions sur les affaires. Influencer par Richard Cantillon, Adam Smith, née 1767 et mort en
1832. On réduit la théorie de Say de l'entrepreneure plus souvent à une conception de
l'entrepreneur entendu comme gestionnaire de la production. Alors pour lui, l'entrepreneur a
essentiellement pour tâche de combiner au mieux les services producteurs qu'il loue sur les
différents marchés. L'entrepreneur, ajoute Say, agit comme un intermédiaire entre les vendeurs et
les acheteurs, appliquant des facteurs de production proportionnels à la demande pour les
produits. La demande pour les produits, à son tour, est proportionnelle à leurs utilités et à la
quantité d'autres produits échangés pour eux. L'entrepreneur compare constamment les prix de
vente des produits avec leurs coûts de production; s'il décide de produire plus, sa demande de
facteurs productifs augmentera. Cette théorie est en contraste prononcé avec ce que l'on peut
appeler la «tradition Cantillon Knight» où l'entrepreneur est essentiellement défini par rapport
l'incertitude. La conception que Say propose de l'entrepreneur est incomplète car elle repose trop
exclusivement sur l'étude de sa théorie de la production.
Joseph Alois Schumpeter est un économiste qui a marqué l'économie, connu pour ses théories
sur les fluctuations économiques, la destruction créatrice et l'innovation. Un entrepreneur est une
personne qui est désireuse et capable de convertir une nouvelle idée ou invention en une
innovation réussie. L'esprit d'entrepreneur emploie ce que Schumpeter appelle «le vent de la
destruction créatrice» pour remplacer en tout ou en partie des innovations de qualité inférieure
sur les marchés et les industries, créant simultanément de nouveaux produits. L'entrepreneur joue
le rôle de «destruction créatrice» dans l'économie: lancer des innovations qui détruisent
simultanément les vieilles industries tout en introduisant de nouvelles industries et approches.
Pour Schumpeter, les changements et les «déséquilibres dynamiques engendrés par
l'entrepreneur innovant sont la norme d'une économie saine. Pour Schumpeter, l'entrepreneur ne
supporte pas le risque: le capitaliste le fait. Schumpeter croyait que l'équilibre était imparfait.
Schumpeter (1934) a démontré que l'environnement changeant fournit continuellement de
nouvelles informations sur l'allocation optimale des ressources pour améliorer la rentabilité.
Certaines personnes acquièrent la nouvelle information avant d'autres et recombinent les
ressources pour obtenir un profit entrepreneurial. Schumpeter était d'avis que les entrepreneurs
déplacent la courbe des possibilités de production à un niveau plus élevé en utilisant des
innovations.
Vous aimerez peut-être aussi
- 2004 - Les Nombres Pour Réussir Dans Les Affaires PDFDocument151 pages2004 - Les Nombres Pour Réussir Dans Les Affaires PDFKone Assane80% (5)
- Plan D'affaires de La Minoterie. Équipement de Broyage de FarineDocument26 pagesPlan D'affaires de La Minoterie. Équipement de Broyage de FarineBEUGRE Prosper100% (2)
- MKGHLDocument2 pagesMKGHLviolinaPas encore d'évaluation
- Amoo Lab5Document6 pagesAmoo Lab5violinaPas encore d'évaluation
- Amoo Lab2Document6 pagesAmoo Lab2violinaPas encore d'évaluation
- Amoo Lab1Document6 pagesAmoo Lab1violinaPas encore d'évaluation
- LaboratorBDNr 1Document9 pagesLaboratorBDNr 1violinaPas encore d'évaluation
- Plan de Développement de La Filière Ouabri 17 02 2017Document31 pagesPlan de Développement de La Filière Ouabri 17 02 2017Redjeb AyadPas encore d'évaluation
- Cours de Compta Anal PCGDocument50 pagesCours de Compta Anal PCGURICH NJINGUETPas encore d'évaluation
- La LogistiqueDocument15 pagesLa LogistiquecilekkoksuPas encore d'évaluation
- SM GIM Chap 7 Technologie de Groupe Et Systèmes Manufacturiers CellulairesDocument27 pagesSM GIM Chap 7 Technologie de Groupe Et Systèmes Manufacturiers CellulairesrlekcirPas encore d'évaluation
- Entrepreneuriat Et Création Des EntreprisesDocument53 pagesEntrepreneuriat Et Création Des EntreprisesDarel YokaPas encore d'évaluation
- Programme Géographie 3è Et 4è AnnéeDocument18 pagesProgramme Géographie 3è Et 4è AnnéeSOULÉ NGBATOUPas encore d'évaluation
- Indicateurs de PerfDocument5 pagesIndicateurs de PerfGisePas encore d'évaluation
- Un PfeDocument257 pagesUn PfeFadwa BourfounPas encore d'évaluation
- Organisationion Des Entreprises Benhida s1 Semestre 1 PDFDocument22 pagesOrganisationion Des Entreprises Benhida s1 Semestre 1 PDFJamal BendaoudPas encore d'évaluation
- Gestion de La ProductionDocument34 pagesGestion de La ProductionCharlotte HoudaerPas encore d'évaluation
- Economie Générale Cours N 1Document7 pagesEconomie Générale Cours N 1Amal DriciPas encore d'évaluation
- PréambuleDocument4 pagesPréambuleRajae BoujemaouiPas encore d'évaluation
- CH2 Nabbar Jihane Et HalimaDocument23 pagesCH2 Nabbar Jihane Et HalimanabbarjihanePas encore d'évaluation
- Introduction Au Management IndustrielDocument8 pagesIntroduction Au Management IndustrielALHASSANE ADAMA DialloPas encore d'évaluation
- AderdarDocument43 pagesAderdarSalma SalmaPas encore d'évaluation
- Théorie de La ContingenceDocument2 pagesThéorie de La ContingenceMeriem CrPas encore d'évaluation
- Le ContrôleDocument4 pagesLe ContrôlemagicmagicmagicPas encore d'évaluation
- Cours Gestion Des Stocks 2021 1Document45 pagesCours Gestion Des Stocks 2021 1sadounehacene2019Pas encore d'évaluation
- Cours Gestion Resume OkDocument48 pagesCours Gestion Resume OkSyrine LabidiPas encore d'évaluation
- Notes de Cours Socio Conso 2023Document19 pagesNotes de Cours Socio Conso 2023Alexis BilzerianPas encore d'évaluation
- GESTION DES STOCKS 1ère Année BT Gestion de ProductionDocument27 pagesGESTION DES STOCKS 1ère Année BT Gestion de Productionbruno boguiPas encore d'évaluation
- Rapport Stage Risque AchatDocument66 pagesRapport Stage Risque AchatWidad Birani0% (1)
- 2018 These Toublanc TDocument156 pages2018 These Toublanc TEric FORTINPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document11 pagesChapitre 1Jana UniPas encore d'évaluation
- Cours M.JP Introduction À La Maintenance PDFDocument26 pagesCours M.JP Introduction À La Maintenance PDFMOUANDA EmmanuelPas encore d'évaluation
- Séance 2-Cours Environnement Économique Des OrganisationsDocument33 pagesSéance 2-Cours Environnement Économique Des OrganisationsSemlali Fatima zahraePas encore d'évaluation
- BiPEN 2013 Définitif Bon PDFDocument134 pagesBiPEN 2013 Définitif Bon PDFAurèle ChabiPas encore d'évaluation
- Gestion de ProductionDocument9 pagesGestion de ProductionYasser El Adrazi IIPas encore d'évaluation