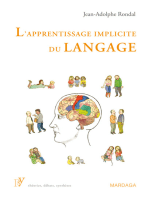Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CLSL 13
CLSL 13
Transféré par
gmihaitaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
CLSL 13
CLSL 13
Transféré par
gmihaitaDroits d'auteur :
Formats disponibles
DESCRPTIONS GRAMTICALES
ET ENSEIGNEMENT
DE LA GRAMIRE
EN FRANAIS LANGUE TGR
Cahiers de }'ILSL N13
Imprim au Presses Centales de Lausanne, SA
,
Rue de Genve 7, Case postale 3513
,
CH 1002 Lausanne
Ont dj paru dans cette srie:
Cahiers de l'ISL
Lectres de l'ige (1992, 1)
Lague, littrature et altrit (1992,2)
Relations inter- et intaprdicatives(1993, 3)
Travaux d'tudiats (1993
,
4)
L'Ecole de Prague: l'appor pistmologique (1994,5)
Fondements de la recherche linguistique:
perspectives pistmologiques (1995, 6)
Formes linguistiques et dyniques interactionelles (1995, 7)
Lague et nation n Europe centale et orientale (1996, 8)
Jaobson ente l'Est et l'Ouest, 1915-1939 (1997, 9)
Le tavail du chercheur sur le terain (1998, 10)
Mlages en hommage M. Mamoudia (1998, Il)
Le paradoxe du sujet: les propositions impersonnelles das les langues
slaves et romanes (2000, 12)
DESCRIPTIONS GRAMTICALES
ET ENSEIGNEMENT
DE LA GRAMIRE
EN FRNAIS LANGUE TRANGRE
Institut de linguistique et des
sciences du lagage
numro dit par
Raymond Capr
et Ccile F omerod
Cahier n013, 2002
.L A
Les cahiers de l'ILSL (ISSN 1019-9446)
sont une publication de l'Institut de Linguistique et
des Sciences du Langage de l'Unversit de Lausanne
Institut de Linguistique et des Sciences du Lagage
Facult des lettes
Btiment des Facults de Sciences Humaines 2
Universit de Lausanne
CH - 1015 Lausanne
Cahiers de l 'ILSL, N13, 2002, pp. 1-4
Prsentation
Raymond Capr
Universit de Lausanne, Ecole defanais moderne
Lorsque sont paues les premires mthodes dites communicatives, la
fn des annes 70 ou au dbut des anes 80, bien des enseignants ont t
perturbs. Ils n' y trouvaient plus ni les tableaux structuraux auxquels ils
taient habitus, ni les drills de substitution ou de transformation, ni mme
les dialogues rpter et jouer. Certes, la gdaire tait toujours
prsente, mais sous d' autres fores, lie principalement des activits
d'change, des rfexions faites pa l'ensemble du groupe-classe, des
contrastes metant en valeur, en situation, la signifcation des formes
utiliser. Bref la grdaire tait intge dans ces activits que l ' on a
grossirement qualifes de communicatives.
A la mme poque, plusieurs approches globales, qualifes souvent
d' alteratives semblaient s' imposer a et l, en paiculier aux Etats
Unis. Parmi elles, La mthode naturelle 1 , inspire des tavaux d
Steven Krashen, afmnait avec fore que, pour aprendre une lague
tangre, l'tude de la gammaire tait inutile . . . voire mme nuisible.
Pour appuyer cete afation, Krahen dmontrait l'efet inhibant des
rgles de grammaire -sa feuse hypothse des fltes afectifs - sur le
locuteur qui veut tenter de s' exprimer dans une langue trangre.
La gmmaire allait-elle dispaate des manuels de fnais langue
trangre ? Il n' en a rien t. Les tavaux de Krashen n'ont eu qu' une
infuence limite en France, tout comme dans les autres teritoies de la
fcophonie. Croire ainsi que la gmaire allait disparate des manuels
et des cours, c' tait mconnatre la fois la fore de la tradition -il y a
une vritable culture de l'tude de la gdaire de la langue materelle
dans nos pays -et celle non moins fore de la conviction que rien de
srieux ne peut s' acqurir en langue fnaise sans une solide base
grmmaticale.
Ainsi, malg les changements mentionns plus haut, la grmmaire
est reste trs prsente dans les manuels, sous une forme ou sous une aute.
1 Krashen S. & Terre} T. The Natural Approach: Language Acquisition in the
Classroom, Oxford: Pergamon Press, 1 983.
2 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
Les auteurs les plus hardis du renouveau des anes 80, tels Richterich et
Suter avec leur Cartes sur tab/e
l
, l ' ont relgue dans un recueil en fm de
volume avec des renvois dans les diffrentes leons, alors que la plupat des
autres la maintenaient au cur de leurs ouvrages, l ' intrieur des units.
Les institutions telles que la ntre3 ont toujours gad une place
importante, dans leurs programmes, pour un enseigement de gmaire
substantiel . Ces derires annes, les thories de l' acquisition d'une langue
tagre ont fortement remis au got du jour la rfexion, la construction
des connaissances, la ncessit de comprendre ce que l ' on apprend, et tout
naturellement les proccupations concerat la gammaire s' en sont
touves renforces tant dans les manuels destins aux apprenats de FLE
que dans les progammes des institutions.
Toutefois, de nombreuses questions demeurent. Quelle gmaire
devons-nous enseiger ? Quelle doit te sa place ? Faut-il enseiger
l ' ensemble du systme ou une collection de micro-systmes est-elle
envisageable ? Comment lier l' tude de points de gammaire des
activits de lectre, de production orale ou crite, des chages
communicatifs dans la classe ? Et dans les phases d' explication, quelle
devrait tre la part du mtalagage, sans paler d'une question souvent et
longuement dbattue, quel mtalangage ?
Le colloque de l ' EFM d' avril 2002 n' avait, bien sr, pas pour
ambition de livrer des rponses toutes faites ces questions. Il s' agissait
bien plus de dbatte de certains de ces points, d' esquisser des pistes, de
proposer des hypothses et d' exposer des manires de fair; de quoi nourir
la rfexion des participants et les inciter dcouvrir d' autres pratiques que
celles auxquelles ils font habitellement confance. L'occasion aussi de voir
les directions vers lesquelles se dirigent aussi bien des chercheur
chevronns que des enseigants aux prises avec la ralit quotidienne de
leurs classes, ou encore les points d' intrts d' tdiants en foration
didactique.
Ainsi, ce numro des Cahiers de /'ILSL parvient runir des
tavaux fort divers, qui tous tiennent compte, des degs difrents, de la
ralit de la salle de classe, de la ralit de cet change peranent ente un
enseignant qui possde -ou devrait possder -une culture gammaticale
solide et varie et un apprenat la rcheche de notions, de rgles, de
systmes, dont il espre qu' ils pourront l' aider matriser la langue cible.
Dans le premier aicle de ce numro, Jean-Louis Chiss situe
d' ailleurs fort bien le dbat en mettant en gade les enseignants de FLE
contre deux tendances peu productives : 1. La reproduction des catgories
et des analyses de la gmaire traditionnelle. 2. Les transpositions de
thories linguistiques ou d'hypothses linguistiques en outils didactiques.
A ces reproductions et ces transpositions, il faudrait pfrr de vritables
2
Richterich, R. et Suter, B. Cartes sur table, Paris : Hachete, 1 981 .
3 Ecole de franais modere de l ' Universit de Lausanne (= franais langue
trangre)
R. Capr : Prsentation
3
grammaires d' enseigement et tenter de concilier les nombreuses
contradictions qui ne manquent pas de se prsenter au didacticien : la
question des choix, celle des simplifcations qui doivent se faire sans e
la complexit des problmes, celle qui consiste concilier fone et sens,
celle qui consiste tenir compte de l' utilisation relle de la langue tout en
gardant des proccupations gramaticales. En afnat clairement que,
dans un parcours d' enseigementapprentissage de FLE, la gamaire de
phrase reste un pralable pour aborder d' autres tpes de
grammaire -grammaire de texte par exemple -, Jean-Louis Chiss se
fait galement le dfenseur d'une culture gammaticale de la lague cible
qui devrait progressivement se constire dans la salle de classe.
C' est prcisment sur cette notion de culture gammaticale que
Daielle Leeman insiste galement dans son intervention. Intitule La
construction du sens par la gammaire, son intervention met en vidence
la relativit des rgles de gramaire: leur exactitude n'est jamais avr !
Une multitude d' exemples viennent appuyer cette constatation. Une solide
culture gramaticale de l' enseignant devrait lui penete d'aborder d
maire critique les rgles de gammaire nonces dans les manuels, d
nuancer prsentations et exercices et de dvelopper curiosit et esprit de
dcouvere chez l ' apprenant. Enseignants et apprenants devraient
constamment se soucier du sens et viter de proposer des rgles ou des
schmas qui ignorent ce rapport au sens.
C' est galement l' aspect ts abitaire des rgles de grmaire
enseignes dans les manuels ainsi que leur fquente inadquation pa
rapport des ralits linguistiques obserables qui servent de point de
dpar la contribution de Trse Jeaneret consacre aux constructions
prfabriques. Loin de penser que de telles constctions sont totalement
fges et ne relveraient que du lexique, l' auteure nous propose, tvers
des exemples, une approche syntaxique des constructions prfabriques et
nous montre de nombreux cas o de telles constructions sont
utilises -voire ncessaires -das la rdaction du texte dlibratif.
Deux interventions des collaboratices de l' Ecole de fais
modere sont consacres des questions liant traduction et gmaire.
Myriam Moraz nous livre une rfexion en profondeur sur la temporalit en
anglais et en fais. Basant son intervention sur des proccupations
didactiques, elle met en vidence cette question : Quelle reprsentation
transmetre de ces temporalits?. Question qu' elle taite
essentiellement -mais pas seulement -en fonction de cette double
alterance : pass simple / pass compos en fais versus simple past /
present perfee! en anglais. Et l ' auteure de nous mette en garde contre un
traitement linaire de la question, pour nous proposer, tavers de
nombreux exemples originaux tirs de textes et d'aalyses contrastes, une
approche globale base sur une comprhension paite des textes et des
contextes.
Sous le titre nigatique Au (d)tour du thme : la grammaire,
Marine Nicollerat et Claudine Reymond nous prsentent une exprence
4 Cahiers de / '/LSL, N 1 3, 2002
originale mene l ' Ecole de fais modere : le cours intitul Autour
des textes traduits qui s' adresse des tudiants de langues materelles
difrentes, la plupart d' entre elles inconnues des enseigantes et a fortiori
de la majorit des autes apprenants. L' exercice -qui est un exercice de
traduction en fanais -ncessite une gande attention au sens du texte. Il
est indispensable que les personnes qui vont recevoir ce texte -les
enseigantes et les tudiants -en comprennent d' abord le sens. Ensuite,
une sore de va-et-vient ente le sens global et les points de dtails -la
grammaire en pariculier -va progessivement aliorer le texte. Les
auteures nous montrent comment sont abordes les questions de gammaire
dans cette perspective, comment la grammaire surgit au dtour du thme
au travers de nombreux exemples tirs de leur exprience du terain.
Enfn, la contribution d' une tudiante de l ' Ecole de fas
modere nous rjouit pariculirement. Pendant l ' anne acadmique 2001 -
2002, le cours Analyse critique et production de matriels
pdagogiques, a propos aux tudiants d'examiner, das des manuels de
gammaire et dans des mthodes de fais langue tgre, la maire
dont tel ou tel point de gamaire tait tait.
Fuyo Amino nous a ainsi livr une contribution dans laquelle elle
examine la manire de taiter les pronoms personnels dans quatre manuels
de gramaire destins des apprenants de FLE et dans trois mthodes
destines des apprenants dbutats. Les tableaux qu' elle nous fouit
constituent de prcieuses analyses sur la base desquelles elle a pu
caractriser les difrentes approches d'un thme gdatical.
Cette joure consacre aux descriptions gammaticales et
l' enseignement de la grammaire en classe de fais lague tagre nous
a montr diverses faons d' aborder les questions de gdaire et nous a
apport plusieurs pistes de rfexion. Pani celles-ci, relevons celles qui
sont mises en vidence par plusieurs auteurs : 1. La prudence l'gard des
rgles toutes faites. 2. La ncessit de se construire, pour soi et pour ses
apprenants, une culture grdaticale. 3. L' extme soin apporer au sens
ds qu' on se lance das des systmisations.
Nous tenons remercier celles et ceux qui ont contibu au succs
de cette joure, les auteurs des contibutions, mais aussi Stephanie
Panentier-Schuijt qui a assum les dtails de l'organisation, et Jea-Louis
Chiss qui s' est intress au projet ds les premires esquisses et qui nous a
fouri maints conseils et suggestions pour la mise sur pied du progme
dfnitif.
Que les pistes proposes dans les aicles de ce numro soient
fcondes, que les rfexions proposes se poursuivent, et que le lecteur
prenne plaisir dcouvrir ces textes autant que nous lorsque nous avons
suivi ces communications, tels sont nos souhaits.
Cahiers de l'ILSL, N 13, 2002, pp. 5-1 6
Dbats dans l'enseignement/apprentissage
de la grammaire
Jean-Louis Chiss
Universit de Paris 3 Sorbonne Nouvele
et Universit de Lauanne
Toute rfexion en didactique de la gmmaire implique d'envisager
conjointement la dimension de l ' enseignement (relations ente thories et
mthodologies) et celle de l ' apprentissage (obstacles et russites das
l'appropriation scolaire) ainsi que le rle de cette discipline dans
l ' interaction enseigantapprenant au sein de la clase de langue. Sur
difrents aspects, les tavaux centrs sur la didactique de la gmmaire en
langues tangres, paiculirement en fais langue tagre (Besse et
Porquier, 1 984; Moirand, Porquier et Vivs, 1 989; Cuq, 1 996; Germain et
Seguin, 1998; Puren, 2001 ) croisent cerines des proccupations du
fais langue materelle (Charand, 1 995; Grossman et Vagas, 1 996;
Chiss et Meleuc, 2001). L'optique adopte ici privilgiera la conception, le
rle.et la place de la gammaire en FLE sans ngliger l'apport du FLM, ne
serit-ce que pour disposer d'lments propres envisager les relations
ente langue trangre et langue materelle.
1. SITUATION ACTUELLE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA
GRAMMAIRE
Les avances en didactique du fanais langue materelle et langue tngre
peuvent aujoUrd'hui reposer sur U double consensus pour ce qui concere
la grammaire, tant entendu qu' on se prononce moins pair des ralits
empiriques des classes, toujours difciles apprhender, que des directions
actuelles de la didactique comme discipline de rfexion et d'intervention.
Il s' agit d' abord de ne pas reconduire les catgories et modes de
pense de la gamaire traditionnelle qui se maintient, de fait, dans de
nombreuses classes de langue materelle malgr les instructions ofcielles
du collge en Frace (1995-1998), en paiculier la tripaition gammaire
de phrase / grammaire de tete / gammaire de discours dont
6 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
l ' appropriation par les enseigants n' est pas vidente et qui ne rgle pas,
de toutes faons, la question des contenus de la gammaire de phrase (cf
Chiss et Meleuc, 2001). On pourait mme s' interroger, dans les nouveaux
programmes de l ' cole primaire faise (2002) sur les orientations de la
rubrique Observation rfchie de la langue fanaise qui conduisent, de
mon point de vue, une fone de rgression vers les catgories de la
gamaire traditionnelle en abadonnant la description en tenes
distributionnels de la phrase fanaise.
En FLE, un examen de certaines mthodes s' inspirant de l'approche
communicative montre une tendace la marginalisation de la gm aire
sous la fone d' appendices gmaticaux et s ' il Y a retour de la
grammaire, aprs une phase d' abandon, il s' agit le plus souvent du retour
des rgles de la gdaire traditionnelle. On peut voir ici le symptme
d' une croyance encore largement partage : il y aurait une contradiction
entre le but attribu aujourd ' hui l ' enseignement d'une lague
tangre - savoir la comptence de communication -et
l ' enseignement de la gammaire, alors que l' accent sur les fores et la
relation forme/sens -qui est au cente du tavail grdatical -est, e
ralit, indispensable pour acter la production/rception des noncs.
Il me semble que l ' loignement de la gammaire dans l ' optique
communicative peut tre, en premier lieu, attibu la primaut de fait de
l' oral alors que la gamaire tait rpute cente sur l ' crit et utile
prioritairement pour la lecte/critue. Dans ce dispositif, le manque de
didactisation des travaux sur la gm aire du fais pal a jou un rle
ngatif Pourquoi, dans les gmaires pdagogiques et pafois das
certines grammaires de rfrce, aprs un sicle de l inguistique, la
question de la df rce des marques linguistiques l' crit et l ' oral
n' est-elle pas intgre ? Ds 1 970, J. Peytard avait alert les enseignants d
fnais sur cette question en prenat pour exemples l 'accord des adjectfs
ou la prsentation des conjugaisons . . . La seconde raison de la distance
prise vis--vis de la gammaire tient sas doute l ' assimilation acestale
de cette discipline la connaissace des rgles et leur verbalisation : de
point de vue, un dbat oppose ceux qui (comme Cuq, 2001) considrent
que les rgles, cause de leur cactr nonnatif, sont un factu
d' inscurit pour l 'apprenat et ceux qui (come Wilmet, 2001) estiment
au contraire que les rgles scurisent, donnent conface aux apprenats de
langue tagre. Si l ' on attbue d' autes rles la gmaire dans
l ' appropriation linguistique, alors la question de la rgle norative se
relativise au proft du raisonnement et de l' intriorisation des
fonctionnements.
L' aute facet du consensus au sein de la rcherche en didactique
consiste dsorais rfse la reconduction des transpositions htives de
certaines thories l inguistiques. Ce point est particulirement dlicat ca,
au-del de la gamaie, il pose un problme cental pour toute la
didactique des langues. En lague materelle, tout un courant a critiqu,
juste titre mais pafois de faon excessive ou incatatoire,
`
J.-L. Chiss : Dbats dans l 'enseignementapprentissage de la grammaire 7
l' applicationnisme, en particulier le tsfer direct de procdues
descriptives de la linguistique stucturale et gnrative l 'enseignement du
fanais (les fameuses descriptions sous fone d' arbres par exemple). En
langue tangre, la critique de la linguistique applique a touch les
domaines de la phontique, du lexique ou de la syntaxe mais, de maire
en appaence curieuse, semble avoir pag d' autres applications,
mon sens tout aussi massives, par exemple celles de la thorie des actes d
langage, pour le coup caricature dans de nombreuses mthodes de FLE o
le concept s' est dilu par extension illimite. La question, trs gnrale, est
sans doute d' inverser le mouvement en substituant une logique ascendat
la logique descendate : partir d' une difcult, d' un problm didactique
pour solliciter sur des bases prcises, telle ou telle thorie linguistique.
2. LES CONTENUS ET LA M
TALANGUE
C' est partir de ce double prsuppos (rfs symtrique de la gmaire
scolaire traditionnelle et de l 'application des linguistiques) qu' il faut poser
le problme des contenus gammaticaux enseiger, toute gmaire
d' enseignement devant rfchir la consistance de ses savoirs, leur
organisation, leur disposition suivant une progression, ainsi qu'
l'efcacit de ses techniques. O peut, pa souci d' exemplifcation,
numrer quelques diffcults classiques :
- les fontires souvent discutables entre catgories gammaticales
alors mme que les gram aies se prsentent depuis l'Antiquit comme
des typologies de parties du discours, par exemple celles ent
adjectif et participe pass (Pierre est fatigu / C'est un homme fatigu),
entre adverbe et conjonction (adverbe de liaison / cononction de
coordination). Le but pour l' apprenant est-il de typologiser avec sret et
avec le mtalangage adquat ou bien de comprendre les phnomnes de
coordination/connexion ? Faut-il qu' il identife les appositions ou qu' il
sache reconnatre et employer les constructions dtaches?
- la question de la consistace de certaines catgorisations : le
temps, le mode, l ' aspect mais aussi les pronoms personnels, ave
le problme de l' htrognit intere de cette derire catgorie (noms
personnels - pronoms du dialogue, etc. ).
- la question de la pertinence relative des dfmitions : partitif
comme parie d'un ensemble n'explique rien contrairement la prise W
compte des traits smantiques des noms (a exemple, comptable vs -
comptable).
- la rparition et la dnomination souvent fossilises dans la cultur
scolaire grammaticale: les tripartitions potentiel/irrel du prsent / irrel
du pass; stle direct / indirect / indirect libre; les trois groupes de la
conjugaison auxquels on pourait substituer les bases morhologiques des
verbes. Les solutions sont tout autant dans le regoupement d' lments
sous une catgorie gnrale (le dterminant) que dans le dgoupement
8 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
d' lments disparates homogniss l ' intrieur d' une catgorie, celle
d'aderbe par exemple.
Sans doute l' efor de reconstruction et de rationalisation est-il la
mesure d' une situation marque par l' infation des fonctions gamaticales
depuis le XIe sicle et l ' incroyable abondance du mtalangage (cf
Chervel, 1 977) qui perdure encore aujourd'hui. Une enqute mene par J-P.
Cuq (2001 ) sur les progammes ofciels de FLM et les mthodes de FLE
fait apparate en France la prsence de 373 lexies, 252 au Qubec, 1 86 W
Belgique et seulement 66 en Suisse mais ce derier rsultat peut te
relativis si l ' on admet qu' on y utilise souvent des mthodes de FLE
faises. Il faut aussi intger cette rfexion la relation du fnas
enseig comme langue tgre aux autres langues. D. Willems ( 1 999),
dans un article prnant une unifcation tenninologique, met en vidence les
non-recouvements ente les terminologies linguistiques europennes :
attribut dans la tradition gdaticale genaique serait note
pithte et notre attribut serait appel prdicatif; alors que la
bipartition fnaise ente objet indirect et objet direct repose sur la
prsence/absence de la prposition, la gdaire anglaise distinguerait
complment direct, complment indirect et complment prpositionnel l
o la prposition est obligatoire. Il me semble qu' il s' agit l d' un point
nodal dans la didactique scolaire des langues car il importe de savoir si
l ' on peut s' appuyer au plan mtalinguistique sur la lague materelle et
selon quelles procdures.
Dans le processus de slection des contenus prcdemment
voqu et en particulier pour le FLE, il faut encore insister sur la prise W
compte de la rele diversit des structures de la langue. On atend
videmment d' une gd aire, comme d' un dictionnaire d' ailleurs, qu' ils
rendent compte de l' atest, c'est--dire de la pluralit des catgories
gammaticales appeles occuper la fonction sujet, de la diversit des
constructions rompant avec l'ordre caonique SVO (sujet-verbe-objet) : les
impersonnels, les prs entati fs, les structures inverses (A cela s'aoute
quelque chose. Au milieu de la pice trnait le sapin de Nol), les
structures avec dislocation (la terre, c 'est beau), avec dtachement (Il fait
beau, Paris) De ce point de vue, on fit l'hypothse qu'un apprenat
de FLE a plus besoin d' un inventaire des contuctions verbales du
fais que d' un listing des complments du verb avec le rfnement d
leurs dnominations (cf. supra). On pourait d' ailleurs, ce propos,
extrapoler du domaine gamatical vers le domaine lexical en notant que la
question des constrctions ou des fonulations est sans doute plus
fondamentale que la notion de stock lexical, traduite dans l' enseignement
par les listes de vocabulaire orgaises thmatiquement ou mme
morphologiquement. En FLE l ' vidence, mais aussi en FLM, tout ce qui
est de l ' ordre de la locution, de la collocation, du syntagme fg est
pariculirement important, s' il est vrai que le pasage de la comptence
linguistique la comptence de communication se fait travers la matise
-relative - de l ' idiomaticit. Les associations ritualises pafois
J.-L. Chiss : Dbats dans l'enseignement/apprentissage de la grammaire 9
devenues clichs ou quasi-citations font paie intgrante de la
grammaire que l ' apprenant doit intrioriser, qu' il s' agisse des
associations verbes + adverbes (on disserte longuement, on applaudit
fntiquement) ou noms adjectifs (de la dfaite cinglante et du travail
acharn au clibataire endurci). Prendre en compte ces lments, c'est
encore poser la question de l' enseigable, des choix oprer dans les
contenus linguistiques.
3. ENTRER DANS LA GRAMAIRE
Le problme des contenus ne peut te spar du dbat sur les entres W
gamaire et sur la relation fonnes/sens (Leem a , 2001 ). On a coutume,
surtout en FLE, d' opposer les entres forelles aux entes notionnelles
(smantiques). C' est l une approche mthodologique, didactique, qui ne
porte pas sur le rel de la lague o sens et fonne sont indissociables. O
peut ainsi imaginer des grammaires double ente qui penettaient le
va-et-vient entre les deux ordres de proccupations. Il ne s' agit pas, pour
l ' instant, d'largir radicalement le cadre de l ' analyse au-del de la phrse
vers le texte ou le discours. Certes les ncessits d'une co-textualisation et
d' une contextualisation peuvent s' imposer et s' imposent de fait dans la
dmarche pdagogique. Mais il faut d' abord souligner qu' au sein mme de
la phrase -dans la varit de ses ralisations, les noncs -existe la
dimension nonciative et smantique. C' est pourquoi on peut, pour les
mmes contenus, entrer pa la notion de type de phrase o seront
examines les dimensions phontiques, gaphiques et syntaxiques pour
aller vers le sens communicatif port pa chacun de ces types ou
entrer par la notion de modalit d' nonciation spcifat la natue de
l' interaction ente le locuteur et l' allocutaire pour retouver les marques
linguistiques qui caractrisent les tpes. Pas l ' un ou l' aute mais u va-et
vient ente les deux entes. La dmache unilatrale de beaucoup de
mthodes FLE entrat seulement par les actes de langage (avec le fou li
cette notion, cf. supra) me semble inadquate.
On peut aussi comprendre les obstacles qui s' attachent des entes
notionnelles telles qu' elles ont t mises en uvre pa Un Niveau Seuil
(Courtillon, 1 996), P. Charaudeau (1 992) ou G. -D. de Salins ( 1 996).
Evidemment, sur le plan torique, on reconnatra trs volontiers, avec des
auteurs comme M. Wilmet (das la tadition de la gmaire
philosophique du Xile sicle, Beauze pa exemple) l ' intrt ts
heuristique de notions comme dtermination ou quantication et la remise
en cause que produisent ces notions de la bipartition ente les catgories,
par exemple la difrence ente dteninats et adjectifs. Mais, sur le tern
de l' enseignement, les entes notionnelles se caractrisent paadoxalement
par une abstraction trs forte pour les apprenats (surtout quad ils ne sont
pas ou peu grdaticaliss dans leur langue materelle) et un loigement
du rel de la langue, de son empirique, de ses formes. Ca soit l ' on discute
1 0 Cahiers de / 'ILSL, N 1 3, 2002
rellement la notion -et alors que de difcults pour la dterination p
exemple -soit l'on retombe dans une conception traditionnelle de
l' approche gramaticale en teres d'expression de la consquence, du
but, de la concession etc., approhe trs caactristique de la
grammaire scolaire, celle de l' infation des complments et des
propositions.
Il semble surtout essentiel, si l' on admet la ncessit d'une
rfexion grammaticale, de prendre conscience de la diversit des nieau
d'analyse: l' analyse forelle d'une phrase en catgories gammaticales
doit te distingue de son aalyse logique en sujet/prdicat avec la
question des arguments du vere (donc la dimension gammaticale du
lexique), distingue aussi de l' analyse fonctionelle ou communicative W
thmerhme pa exemple. Ce traitement pluriel d'un problme
grammatical trouverait s' illustrer avec de nombreux autres exemples, les
dterminants ou les temps verbaux. Peut-tre alors l' tude de la gmaire
s' largit-elle l' tude de la langue puisqu' il faudrait prendre en compte ici
les aspects textuels et discursifs. Il est vident que la productionrception
des messages crits et oraux ncessite une matrise des phnomnes
transphrastiques, ceux qui relvent de la gamaire textuelle,
phnomnes de cohrence, cohsion, connexit, gestion de la progession
ncessitant l' tude des reprises pa les dterminats, les pronoms, les
connecteurs, composante lexicale avec les reprises nominales, etc. Il est
aussi vident que nous avons besoin d'une contextualisation dans la
mesure o la situation de communication contraint l' emploi de telle ou
telle forme linguistique: tavailler sur la dfc ente le et un implique
le contexte, en pariculier le rfnt connu/inconnu ( Vous n'aez pas vu le
chat? est une question qui s' adresse des proches; Vous n'avez pas vu un
chat? est une question qui s' adresse aux passants dans la rue).
4. TRAJETS DE
D'ENSEIGNEMNT
L'APPRNANT ET PROGRESSION
Il nous faut ici dplacer l' agle d'attaque pour aborder les dimensions lies
l'apprentissage das la complmentarit qu' implique la conceptualisation
didactique o les problmes poss pa la progession, celle que met e
uvre le savoir enseigant, s' articulent aux questionements lis aux
progrs de l' lve, son tajet dans l' appropriation d'une comptence
gramaticale en langue tgre, dans l' intriorisation de cete
gammaire si l' on veut dire autement.
Acqurir la gammaire d'une lague, au sens de sa structure, de
son fonctionnement est un processus d' accommodation des containtes
telles par exemple qu' une table ser dsige pa il en anglais et p
elle en fanais; ds u sens plus lage, c'est aussi connatre l' espace d
choi ouvert pa l' emploi d' une fone linguistique, pa exemple merci
qui en fnais peut vouloir die non, Insensiblement, nous passerions
J.-L. Chiss : Dbats dans l ' enseignementapprentissage de la grammaire Il
ainsi de la comptence . linguistique stricto sensu une comptence de
communication impliquant un usage social et culturel des fonne
linguistiques. On ne peut envisager l'exercice de cette comptence de
communication sans appui sur la comptence linguistique, en tout ca si
l' on poursuit l' objectif d' une vritable matrise de la langue tragre en
production et comprhension. Toute la question est de savoir comment i l
s' agit de procder dans l' espace didactique, c' est--dire l a classe de lague.
Dans l 'histoire de l'enseigement des langues existe un dbat
refonul de difrentes maires et qui en gros oppose, fontalement ou
avec toutes sores de nuances, les tenants de la pratique et les tenants de la
rfexion, les tenants de la routine, de l' exercice et les tenats de la
formulation des rgles, dbat proche de celui en langue materelle ent
grammaire implicite et gmaire explicite. On suivra le rappel pa H.
Besse ( 1 998, 200 1 ) de quelques principes simples : on ne peut pa
inculquer un dbutant en langue tgre une reprsentation
grammaticale savate de cette lague-cible sinon en pure pere; il faut que
les apprenats aient dj intrioris cerins microsystmes de la lague
tngre pour qu' ils soient mme de raisonner gramaticalement.
C' est dire que beaucoup de choses dpendent de leur deg de
grammaticalisation scolaire antrieure en langue materelle ou dans une
autre lague tangre. La conceptualisation qui peut les aener ue
comprhension du systme et pas forcment l' nonc d' une
rgle -seulement au constat de rgulaits -est un travail long qui
dpend non seulement de cette grammaticalisation antrieure mais
d'lments pdagogiques comme le temps imparti, le tpe de pdagogie
mis en uvre (pas fontale mais cooprative pa exemple). Il est vident
que, sans ce travail spcifque, la comptence linguistique reste une
potentialit.
Kshen fait remaquer que tout dpend des fmalits poursuivies :
l' analyse des rsultats obtenus en immersion montre que la centration sur
la comprhension du fnas comme langue des disciplines implique une
attention rduite la correction gammaticale sticto sensu, ce qui peut
afetr les petonnaces en production crite et orale. Cerains spcialistes
de l'acquisition (Pienemann, 1 989) insistent sur les contraites de l' ordre
d' acquisition dans la langue trangre. Il s'agit de montrer que l' apprenant,
quelle que soit sa langue d' origine, suit le mme ordre d' acquisition, pa
exemple pour acquri la ngation en anglais. S' il rsiste l' appropriation
de ceraines formes linguistiques alors qu' il en a appris d' autres facilement,
c'est qu' il n' a pas atteint le stade requis. D' o la thorie de
l' enseignabilit ou de la non-enseignabilit de toutes les fones
grammaticales en langue tagre. Evidemment, cete direction plutt
oriente vers la conception de la gammaire universelle (eu agumente
dans le cade facophone) se heure une conception de la progression et
des obstacles fonde sur la dimension contrative (a exemple sur l' ide de
zone de plus ou moins grande vulnrabilit entre les systmes linguistiques
pour tel ou tel apprenant, cf Bailly, 1 989). Il est vrai que le professeur de
1 2 Cahiers de l 'ILSL, N1 3, 2002
FLE peut bon droit s' interoger propos de tel sous-systme, les relaifs
par exemple, sur certains faits: on peut rapporter les ereus de choix ente
que et qui et leur caactre extrmement rsistant des dimensions
interfrentielles qui se sont fossilises pa exemple chez des hispanophones,
lusophones, italophones; on peut aussi penser que, pour tous les
apprenants de FLE, la matrise de dont est un problme comme elle l' est
aussi pour de nombreux natifs.
Ces obstacles et ces rsistances une fois reconus, se pose alors le
problme de la progression d' enseigement laborer et celui de la nature
du travail faire effectuer par les apprenants de FLE. O l' on voit revenir le
dbat ente rgles et routies, prceptes et usages, rfexion et pratique.
Certaines des rponses ces difcults peuvent tre rappeles :
- la rptition/imprgnation de strctes gdaticales dont on
attend l' intriorisation par conditionnement (le tout renvoyat une
conception behavioriste de l' apprentissage);
- le passage pa l'explication gdaticale de l'enseignant qui
repose la question du recours une gmaire de rfrnce d' origine
scolaire ou savante : taiter le relatif avec la problmatique de la gmaire
traditionnelle, celle des fonctions et de la notion d' antcdent; le taiter e
recourant U concept thorique dont le potentiel didactique peut s' avrer
opratoire (pa exemple la notion de transformation dans la premire
version de la GGT) mais avec tous les problmes de transposition
didactique que nous connaissons.
Si le problme du mtalagage revient, c' est qu' i l est prcisment
indissociable du mode de taitement gamatical. L' enseignant va dfni,
expliquer non dans la mtalague du linguiste mais dans un (<langage
paragrammatical (selon l ' expression de Gerain et Seguin, 1 998). J.
David et moi-mme (2001 ) avons explicit, propos de notre gammaire
(2000), des choix terminologiques qui s' inscrivent dans cette direction. O
sait que c' est cete gammaire interactive (fait de simplifcations, d
conventions, de rptitions, d' adaptations, paois de mtaphores) qu' est
expos l' apprenant das la classe plus qu' aux gamaires de rfrce ou
aux grammaires pdagogiques, mme si l' enseignant s'est, lui, appuy sur
elles pour construire sa dmarche. Il est vrai que nous manquons aussi de
travaux dans le domaine des conduites langagires mises en uvre dans les
classes propos du traitement des notions grmmaticales - en tout cas e
langue tagre.
5. DE LA GRAMMAIRE LA CULTURE GRAMMATICALE
La rfxion su l' enseigementapprentissage de la gammaie ne saurait se
limiter au domaine traditionnellement ciconscrit pa certains faits de
langue, ceux que le dcoupage intradisciplinaire rage sous l' tiquette
morphosyntaxe. Toutes les dimensions de l' enseignement d' une langue
tagre se trouvent af e par la culture grammaticale qui
J.-L. Chiss : Dbats dans l 'enseignement/apprentissage de la grammaire 1 3
accompage cette langue, surtout quand i l s' agit de langues dont la
grammatisation est acienne et qui s'ofent donc l' enseignement ave
leurs conventions et distinctions allant du dcoupage en mots aux clichs
linguistiques que nous avons voqus. Cette question de la culture
grammaticale et des fmalits de l ' enseignement de la gmaire f
toujours en langue materelle, comme en langue trangre, l ' objet de
dbats rcurents dans lesquels on se sitera, pour conclure, de quadple
manire.
- Apprendre la gamaire d'une langue tangre, enseiger la
gramaire d' une langue des trangers, des non-natifs est une tche
cognitivement et culturellement intressante. La fonction de
dnaturalisation pa rapport la langue materelle est primordiale, c'est
-dire l'attention aux pseudo-vidences, l' ide que ce qui a t acquis
naturellement doit tre enseign. D' o la question d' une slection ou
d'une insistance sur des problmes qui ne font pas l'objet de la mme
attention en langue materelle (les prpositions ou l' ordre des mots). Il est
important aussi dans cette gmmaire d'apprentissage d' ausculter la natue
des ereurs commises pa les apprenats, de les aalyser eu gard, je n' y
reviens pas, la langue materelle, aux difcults spcifques de la lague
cible, la conception qu' on se fait des trajets des apprenats (problme de
l'ordre des acquisitions, etc. ).
- La vocation d'une gmaire en langue tgre est de pennette
l' accs une comptence de communication o se trouvent asocies les
structures grammaticales et les tches communicatives (d' o la proposition
de grammaires double ente). La reconnaissance et la production des
marques et des fonctionnements linguistiques l' crit et l' oral est
indispensable. Elle passe pa un efor de rfeiit qui en tant que tel a
une valeur cognitive et intellectelle gnrle mais qui est surout
indispensable pour sunonter les obstacles et pennette une
intriorisation de la structure de la langue-cible.
- Cette mthodologie rfexive fonde sur le raisonnement
gamatical plus que sur l' nonc des rgles, sur l ' attention la
dialectique du systme et des vaiations, paicipe d'une fonction ducative
globale en interrogeant la relation entre containtes et relativit. La rfexion
et les exercices sur un couple comme gammaticalit/acceptabilit ouvre
sur l' apprciation de sa propre paole et de celle de autres, lment de la
sociabilit langagire.
- Enfn, cette conception de la gmaire s' iscrit dans ce que B.
Combettes ( 1 982) a appel un nouvel esprit gmmatical reprenant des
perspectives linguistiques et psychopdagogiques que des rfonateu
avaient inities au dbut du Xe sicle, contre la sclrose de
l' enseignement grdatical du XIXe. On pense F. Brunot ou Ch. Bally
qui, tous deux, palaient de la ncessit non pas tant d' apprendre la
gamaire que d'veiler le sentiment grammaticab>, une perception
reprise aussi par les tenants contemporains du language awaeness, c' est-
14 Cahiers de ['[LSL, N1 3, 2002
-dire la prise de conscience du fonctionnement du langage tavers
l' ouverture la multiplicit des langues.
R
RENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Bailly D. ( 1 989). Domaines linguistiques de vulnrabilit dans
l' apprentissage des lagues secondes par les facophones, in A. Cain
(d.), L 'analyse d'erreurs, acs au stratgies d'apprentissage. Un
tude interlangues, Paris : IR.
Besse H. (1998). De la 'culture grmaticale' d'une lague trangre,
in G. Legad (d.), Pour l'enseignement de la gammaire, Lille :
CRDP du Nord-Pas-de Calais, p. 1 01 -11 5.
Besse H. (2001 ). Peut-on 'naturaliser' l ' enseignement des langues e
gnral, et celui du fnais en particulier ?, Le Franais dans le
Monde nO spcial Thories linguistiques et enseigement du fais
aux non-fcophones, p. 29-57.
Besse H. & Porquier R. ( 1 984). Grammaires et didactique des langues,
Paris: CRDIF/Hatier.
Chaad S. G. ( 1 995). Pour un nouvel enseigement de la grammaire,
Montral : Editions Logiques.
Charaudeau P. ( 1 992). Grammaire du sens et de l 'epression, Paris :
Hachette.
Chervel A. ( 1 977). Et i fallut apprendre crire tous les petits
Franais . . . Histoire de /a grammaire seo/aire, Paris : Payot.
J. -L. Chiss: Dbats dans l'enseignementapprentissage de la grammaire 1 5
Chiss l-L. & Meleuc S. ds. (2001 ). Et la gmaire de phrase ?, Le
fanais aujourd'hui n0 1 35, Paris : AFEF.
Chiss J. -L. & David J. (2000). Grammaire et orthographe, Paris : le
Robert et Nathan.
Chiss J.-L. & David J. (2001 ). Faire une grammaire : organisation du
champ et prise en compte de l ' apprenant, in Demar-Wae et
Rousseau (ds. ), p. 46-55.
Combettes B. d. ( 1 982). Pratiques n033, Grammaires.
Courtillon J. ( 1 976). Grammaire in Un Nieau Seuil, Stasbourg :
Conseil de l 'Europe, p. 225-306.
Cuq J.-P. (2001 ). Quels contenus et quel statut pour la gd aire das
l' enseignement du fais langue materelle et tangre ?, Actes du
Xe congrs de la FIPF, Svres : CIEP, p. 294-300.
Cuq J.-P. (1 996). Une introduction la didactique de la grammaire en
fanais langue tangre, Paris : Didierlatier.
Demary-Warze J. & Rousseau J. ds. (2001 ). Faire une gramaire, f
de la grammaire, Les Cahiers du CIEP, Pais : Didier.
Gerain C. & Sguin H. ( 1 998). Le point sur la grammaire, Paris : CLE
Interational.
Gro
s
smann F. & Vagas C. ds. ( 1 996). La gmaire l' cole.
Pourquoi en faire ? Pour quoi faire ?, Repres n0 1 4, Paris : IR.
Leema D. (2001 ). Quand les fones inforent : de la gmaire la
smantique in Chiss et Meleuc ds. , p. 1 2- 1 9.
Moirand S., Porquier R. & Vives R. ds. ( 1 989). . . . et la grammaire,
Le Franais dans le Monde, n spcial, Paris : Hachette.
Pey tard l ( 1 970). Oral et scriptural : deux ordres de sitations et d
descriptions linguistiques, Langue fanaise n06, Paris : Laousse,
p. 35-47.
Pienemann M. ( 1 989). Is Laguage Teachable ? Psycholinguistic
Experiments and Hypotheses, Applied Linguistics, 1 0. 1 , p. 52-79.
1 6 Cahiers de l 'ILSL, N13, 2002
Puren C. d. (2001). Pratiques de l' enseignement et de l ' apprentissage de
la grammaire, Etudes de linguistique applique n0 1 22, Paris: Didier
Erdition.
Salins G. -D. (de) (1 996). Grammaire pour l 'enseignement/apprentissage
du FLE, Paris : Didierlatier.
Willems D. (1 999). Pour une terminologie grammaticale euopenne.
Dfense et illustration, Travau neuchtelois de linguistique n03 1 , p.
1 29- 142.
Wilmet M. (2001 ). Pourquoi une Grammaire critique du fanais ?, in
Demar-Warze et Rousseau ds. , p. 5- 1 1 .
Cahiers de ['ILSL, N1 3, 2002, pp. 1 7-36
La construction du sens
par la grammaire
Daielle Leema
Universit de Paris X UR 7114 (CNR)
Le mot grammaire peut renvoyer au fonctionnement de la langue ou la
description du fonctionnement de la lague telle qu' on la trouve dans des
ouvrages prcisment appels gammaires. Dans cette description sont
inventories les fonnes de la lague -les classes de mots, les
constctions . . . -et il en est propos une interprtation, pa exemple le
nom dsigne des tres ou des choses, le subjonctif indique que l ' action
n' est pas relle mais simplement envisage ou la phae interogative
sert poser une question.
La description gammaticale consiste donc cactriser des fones
linguistiques et leur attibuer u sens, c qui corespond au prsuppos,
que je ne mets pas en cause, que la lague est prcisment un systme de
formes vhiculant du sens; mais ce qu' il faut bien avoir l'esprit, c' est que
la description grammaticale est toujours hypothtique, mme si elle b
prsente sous la fone d' afnations (comme celles qui prcdent), d'une
part parce que l' on n' est jamais sr d'avoir inventori toutes les fones, et
d'autre part pace que, si les fones peuvent donner lieu observation, en
revanche le sens, lui, reste inaccessible (on ne peut donc jamais vrer
tangiblement ce que l' on dit son propos).
1. SI ET LE CONITIONEL
Par exemple tout le monde sait qu' on ne peut pas, noralement, combiner
le si hypothtique avec le conditionnel :
[ 1 ] Si je serais riche, je m' achterais une maison
* En cho la sollicitation de M. Raymond Capr, cet expos dveloppe une des
thmatiques abordes dans D. Leeman, 2001. Je remercie pour leurs questions
ou remarques l es parti cipants du colloque, qui m'ont ainsi permis de prciser
ma pense.
18 Cahiers de ['/LSL, N 1 3, 2002
Cela a donn lieu des recetes mnmotechniques du type les si
mangent les rais (Viau 1 997 . 80).
1 .1 . LA
R
GLE ET SES CONS
QUENCES
Mais en fait, si hypothtique n' exclut pas seulement le conditionnel, donc
la recette -qui est un moyen pdagogique de stnogaphier une rgle de
grmaire -est incomplte; la conjonction ne se combine en effet pas non
plus avec le ftur, ftur morphologique, comme dans :
[ 2] Si tu viendras tt, on pourra dner dehors
ou ftur priphrastique :
[3] Si U vas venir tt, on peut dner dehors
et si exclut aussi le pass simple; on a bien:
[4] Si U venais plus tt, on pourrait dner dehors
[5] Si tu es arriv 8 heures, on pourra regarder le match
mais non :
[6] S' il arriva tt, ils pourraient dner dehors
On voit donc que la rgle que forule la recette
les si mangent les rais est fonde sur une observation exacte, certes,
mais partielle puisqu' elle ne correspond qu' l ' un des cas seulement o la
conjonction exclut U temps particulier.
Mais de plus, si l ' on obit cete rgle telle qu' elle est forule,
on ne peut plus exprimer d' interogation indirecte de tpe:
[7] Je me demande si elle serait d'accord
o la combinaison est paaitement acceptable, de mme d'ailleurs qu'avec
le ftur ou le pass simple :
[8] Je ne sais pas si nous viendrons
[9] J' ignore si ce train va partir
[10] Sait-on si le pote mourut en 1850 ?
D. Leeman : La construction du sens par la grammaire 19
Et il Y a aussi une fone d' emphase : c'est tout juste si, c 'est
peine si, tout au plus si (qui ne sont pas des hypothtiques, donc), o si
peut trs bien tre suivi des temps qu' il exclut das les propositions
conditionnelles :
[ Il] J'ai tellement vieilli que c' est tout juste si U me reconnatrais
[12] Il m' en veut tellement que c'est peine s' il U saluerait s' i l U
rencontrait
On voit, donc, comment ue rgle peut te fonnule de telle sorte
que, ou bien elle empche de produire des noncs pount acceptables, ou
bien -faute de prendre en compte toutes les fonnes possibles -ell,
permet de produire des squences agmmaticales (comme si et le ft ou
le pass simple). D' o un premier principe en ce qui concere
l ' enseignement : ne soyons pas trop press de donner des rgles, voire de
les faie apprendre, ca leur exactitude n' est jamais avre et, dans le
domaine du fais appris comme lague tgre, l' lve n' a pas ue
comptence pralable acquise indpendamment qui lui permettrit d' en
compenser les insufsaces.
1 .2. LE SENS
Du ct du sens, on va dire que si indique pa exemple l ' hypothse. Je
n' ai pas vu d' explications du fait que, en ce sens, cette conjonction ne b
combine pas avec le conditionnel. Ayat dfni ce temps comme indiquant
l'ventualit, l' imaginaire, P. Charaudeau remarque ( 1 992 : 474) :
Le fameux Sij'aurais su, j'aurais pas venu, du langage enfantin, est d' une
parfaite logique (pour ce qui concere l ' emploi du conditionnel) si l ' on
considre que ces deux vnements (<savoir et venir) ne sont
qu' imaginaires. Il se trouve cependant que, dans le systme franais de
l ' hypothse, c' est la marque de si accompagne de l ' imparfait (ou du pl us
que-parfait) qui l ' exprime.
Incomprhension, donc ! On a afect si et au conditionnel un sens
qui devrait les rendre compatibles l' un avec l' autre, et l ' on constate leur
incompatibilit: de l paler de l ' illogisme de la lague ou des caprices
de l 'usage, il n' y a qu' un pas. M. Wilmet (1 998: 354) n'hsite pas
afne que la combinaison n' est pas condamner, provenant le plus
souvent d'un souci de clafcation temporelle : la rgle ne serait que
l' cho de la fnsie codifcatce des grammairiens; ainsi les locuteurs
ne commettraient-ils pas de faut en associant si et le conditionel : ils
exploiteraient en fait une possibilit du systme que n' auraient pas
reconnue les gramairiens.
Mais comme pour les formes tout l'heure, on peut se demader si
20 Cahiers de [ '/LSL, N 1 3, 2002
les gamaires forulent corectement l ' identit smantique de la
conjonction ou des temps; autrement dit, la dfmition qu' on nous propose
corespond-elle bien au sens tel qu' il est construit pa la grammaire de la
langue elle-mme ? Admettons l' tiquette hypothse ou
hypothtique pour le sens de si et le sens du conditionnel : ce qu' il f
savoir, c' est comment l ' un et l ' autre prsentent l'hypothse; il y a sans
doute dans ces deux modes de prsentation une dif rnce ou une
contradiction qui les rend incompatibles. Mais comment la trouver ?
Uniquement parir des formes, qui sont seules observables comme on l ' a
dit, mais qui ne livrent pas directement leur interprtation. Donc, essayons
de raisonner . . .
L'observation, c' est que si hypothtique ne se combine pas avec le
conditionnel, le ft (morhologique ou priphrastique) et le pass simple.
Pour touver la raison de cette contrainte, pour russir l' interprter, on
peut se fxer l' objectif de rpondre la question : qu' est-ce qui peut
rassembler ces trois temps, qui les rendrait incompatibles avec si ?
1 .2.1 . SI
Commenons pa si; on a admis que cette conjonction introduit une
hypothse : qu' est-ce qu' une hypothse ? C' est une proposition
provisoirement admise pour vraie (dfnition des dictionnaires que je
prends pour base de mon raisonnement) et partir de laquelle on tient pour
vrai ce qui l ' accompage; disant :
[13] Si tu viens ce soir, j ' achterai des hutres
je me place dans la situation o tu viens ce soin> et je vois ce qui W
dcoule: <<' achterai des hutres. Quand on dit si, pa consquent, on
s' installe dans un certain cadre, on mime la situation au mme titre qu' on
vivrait la situation relle corespondante - en quelque sorte si marque
l ' engagement du locuteur qui assume l' hypothse et ses consquences.
1 . 2. 2. CONDITIONEL ET FUTUR
Du ct des temps, maintenant, le conditionnel et le ft renvoient
qui n' est pas ralis ( l' inactuel), on pourait dire qu' ils ne garantissent
pas l ' accomplissement de l' vnement. Disant :
[ 1 4] Il va pleuvoir
je suppute mais ne contrle en rien l ' arive de la pluie. Disant :
[ 1 5] Ne t' inquite pas pour le jardin, il pleuvra bientt
D. Leeman : La construction du sens par la gammaire 2 1
je rassure bon compte (demain, on rse gratis ! ). Le ft donc n' engage
pas le locuteur : ce derier annonce mais rien ne garatit que les choses b
passeront comme il le dit. Mme si le locuteur est de bonne foi lorsqu' il
promet Je viendrai demain, il ne contrle pas tout ce qui peut se passer
entre le moment o il parle et celui o il situe sa venue, et ventuellement
l'empcher de raliser sa promesse : il ne contrle pas l ' vnement, qui
n' est (par dfmition) qu'une prvision. Ce commentaire sur le ft rejoint
ce que l' on peut dire du conditionnel, dont on sait qu' il marque la distance
de celui qui parle; disant :
[1 6] L' accident aurait fait trois mors
le joualiste indique qu' il n'est pas sr de l' information et qu' i l ne
l ' assume pas.
A ce stade donc, on peut penser avoir trouv c qui peut justifer
que si ne se combine pas avec le conditionnel et le ft: c' est qu' il y a W
quelque sore contradiction entre les deux faons de prsenter les choses; les
deux cas concerent une hypothse, mais si maque une hypothse
assume, qui engage le locuteur (il s' installe efectivement dans un nouveau
cadre mental), tandis que ft et conditionnel marquent une hypothse qui
n' engage pas le locuteur (ft) ou avec laquelle il prend ses distces
( conditionnel).
1 . 2. 3. PASS
SIMPLE
Dans le cadre explicatif ainsi dessin, le pass simple - galement
incompatible avec si pose un problme ca, de l ' avis de toutes les
gammaires et autres tvaux linguistiques, le pass simple prsente
l ' vnement comme s' tant efectivement produit : i l n'y a pas l
d'hypothse, d' incertitude, de report un moment ultrieur, qui
permettraient de fair le lien avec le conditionnel et le ft. Toutefois, si
l ' on se rappelle les tavaux d' E. Benveniste sur les temps (tavaux
lagement prcds par J. Damourete & E. Pichon et G. Guillaume), on
peut expliquer selon la mme logique l' incompatibilit de si avec le pas
simple. En efet, E. Benveniste oppose d' un ct le prsent et le pas
compos, temps de l ' nonciation (ou du discours), temps des
vnements rappors en tant qu' ils concerent celui qui parle, et d' un
autre ct le pass simple, temps de l' nonc (ou de l'histoire), c'est-
dire des vnements en tant qu' ils sont coups de celui qui parle. On
retrouve donc l' opposition que nous avons nous-mme utilise pour dfnir
le ft et le conditionnel (en tant qu' ils n'engagent pas le locuteur) - et
l' on remaque de fait que si est compatible avec le prsent et le pass
compos (donc temps du discours, qui concerent celui qui parle) :
[13] Si tu viens ce soir, j 'achterai des hutres
22 Cahiers de ,'ILSL, N 1 3, 2002
[5] Si tu es arriv 8 heures, on pourra regarder le match
L' imparfait, lui, n' est pas affect un plan spcifque, il peut rlever
du discours, de l' nonciation :
[ 1 7] Max m' a tlphon hier, quand je regardais le match
ou de l'histoire, de l' nonc :
[ 1 8] Max tlphona ce soir-l, alors qu' on regardait le match
et il est galement compatible avec si :
[4] Si U venais plus tt, on pourrait dner dehors
1 . 3. NOUVELLE HYPOTH
SE
On a donc une explication de l ' incompatibilit de si avec le ftu, le
conditionnel et le pass simple (dfmis indpendament), compare sa
compatibilit avec le prsent, le pass compos ou l ' imparfait. Pour
rsumer notre thorie, si nonce une hypothse assume par celui qui pale
(ce derier se transpore dans une situation qu' il sait fctive mais il joue le
jeu de bonne foi) tandis que le ftur, le conditionnel et le pass simple sont
des temps qui ont ceci de commun que, au contraire, ils supposent un non
engagement ou une mise distance : ils sont donc contradictoires avec si
dans l a manire de prsenter ou de prendre en considration l' vnement.
Cete explication laquelle j ' aboutis est - si j ' ose dire -
hypothtique : on l ' a Y. c' est l' aboutissement d' un certain raisonnement,
opr parir d' un cerain corus et d'une ceraine ide de la dfnition de
si et des temps. Mais, si cette ide est cohrente, elle n' est pas forent
exacte en ceci que rien ne garantit qu' il s' agisse rellement de l' identit
se/on la langue de si et des temps en question. D' ailleurs, on peut touver
d' autres formes qui obligent prciser, aender, et peut-te un jour - qui
sait - abandonner l' hypothse. Par exemple, dans un certain contexte, on
peut trs bien dire :
[ 1 9] S' il va pleuvoir, j ' arrose pas le j ardin
Quel est le contexte ? Par exemple je viens d'entendre la radio
que la mto prvoit qu' il va pleuvoir : je peux ts bien enchaer Ah
bon ben puisque c' est comme / Ah bon ben s' il va pleuvoir, j 'arrose
pas le jardin ! . Mais en l' occurence il ne s' agit pas d'une prvision d
ma part : il y a un garant, la mto, dont je reprends mon compte
l ' inforation. Donc [ 1 9] n' invalide pas l' explication propose
prcdemment, puisque si redevient compatible avec le ftr justement
D. Leeman : La construction du sens par la grammaire 2 3
parce que celui qui pale assume ce qu' il dit dans la mesure o il rprnd
les dires d'une instace en laquelle il a conface : en fait [ 1 9] quivaut
Si l' on me dit qu' il va pleuvoir . . . . De mme [20] pose un problme a
priori :
[20] La accepta-t-elle la demande en maiage de Ma? En tout cas, si elle
accepta, ils furent coup sr les plus heureux du monde !
On a si et le pass simple, qui semble bien taduire une hypothse;
d' aprs M. Grevisse (1 993) cependant, qui relve des exemples du mme
type mais avec le ftur et le conditionnel, la compatibilit s' explique pa le
fait que si ne porte pas sur le verbe explicite (acepta) mais sur un ve
implicite : i l faut supposer sous si ele accepta quelque chose comme s 'il
s 'arait (qu 'elle accepta) ou s 'il est vrai (qu 'elle accepta); efectivement,
on ne pourrait pas restituer de tels verbes sous [6] - moins d' en chager
le sens :
[61 ] 7 S' il est vrai qu' il arriva plus tt 1 S' i l s' avrait qu' il arriva plus tt,
ils purent dner dehors
Ainsi, dans [20] en fait, si introduit plutt la supposition (e
suppose qu' elle accepta) et par consquent un deg d'engagement plus
grand : tant admis qu' el le accepta, alors on peut conclure coup sr
qu' ils frent heureux (on retrouve le raisonement tenu propos de [ 1 9] : il
y a ou on se donne un garant, du coup on n' est plus dans le domaine de la
pure hypothse).
1.4. RTOUR L' INTITUL
DE L' EXPOS
ET CONS
QUENCES POUR
L' ENSEIGNEMENT DU FRANAIS COMME LANGUE
TRANG
RE
Quand je parle de la construction du sens pa la grammaire (sous
entendu : la gramaire de la langue elle-mme), j ' entends par l que l ' on a
un systme de fones dont les compatibilits et incompatibilits sont des
indices que fourit la langue sur leur identit smatique. Mais des indices
seulement : la langue ne donne pas le moyen d' interrter ce que l ' on
observe, c' est l'observateur de raisonner et d' avancer des hypothses
cohrentes - je dis bien des hypothses, ca on ne peut jamais ac e
directement l' identit smantique telle que l' institue la lague elle
mme.
Ce cactr hypothtique des rsultats que l ' on pense obtenir fi
que, comme pour les fonnes que l ' on a vues tout l'heure, il me parat
trs problmatique de donner des rgles et des dfmitions des lves - et
surout des lves qui n' ont pas le fnais comme langue materelle -,
car les rgles et les dfmitions fgent les choses et les gnralisent, or nous
avons vu que ce que l' on touve dans les gm aires peut n'tre que
24 Cahiers de [ 'ILSL, N1 3, 2002
partiellement exact et sujet vaiation. Ce qui est cens aider les
apprenants se construire une comptence linguistique peut les conduire
adopter des ides fausses sur le fonctionement linguistique et donc
commettre des ereu d' autant plus difciles coriger qu' elles reposent
sur des rgles : Quand il y en a plusieurs, on met U -s vous rpond
l ' enfant qui vous demandez pourquoi il a mis un -s poil dans Le poil
de mon chien est luisant, ne faisat rien d' autre que d'appliquer la rgle
qu' on lui a enseigne.
Ce que l ' on trouve das les manuels, les mthodes, les outils
gnral, n' est jamais faux proprement paler (il y a toujours des
exemples pour l ' illustrer) et apparat mme opratoire pour bon nombre de
cas : l' cueil viter est celui de l ' extrapolation, de la gnralisation
abusive, on l' a vu pour si, qui n' exclut pas forcment le conditionnel dans
tous ses emplois, malgr ce que laisse entendre la recete les si magent
les rais. Il ne faudrait pas croire non plus que toute construction
hypothtique exclut le conditionnel das la subordone; pa exemple au
cas o a un comportement diffrent de si puisque, si cette conjonction n' est
pas compatible avec le ft et le pass simple, elle introduit le
conditionnel - et ne peut d' ailleurs introduire que le conditionnel :
[21 ] Au cas o il pleuvrait, prends ton parapluie
[22] ?? Au cas o il pleuvra, prends ton parapluie
?? Au cas o il va pleuvoir, prends ton parapluie
[23] ?? Au cas o il plut, il prit son parapluie
?? Au cas o il pleuvait, il prenait son parapluie
[24] ?? Au cas o il pleut, il met ses bottes
?? Au cas o il a plu, il met ses bottes
Et les autres synonymes de si hypothtique (ceux du moins
auxquels renvoient les gammaies et les dictionnaires) sont, eux, suivis du
subjonctif :
[25] En supposant / admettant que tu aies raison, le train ne devrait pas
tarder arriver
[26] A supposer / Suppos que tu aies raison . . .
y compris si tant est que qui, pourtant, pourrait passer pour une vaiante de
si :
[27] Paul nous dira ce qu' il en pense - si tant est qu' il soit l !
D. Leeman : La construction du sens par la gammaire 2 5
Cette difrnce distributionnelle nous alerte sur le fait que c
conjonctions n' ont pas la mme identit smantique : il reste tenter
d' interprter cette observation pour aller plus loin dans la dfnition de leur
sens mme.
2. LES CONJONCTIONS SUIVIES DU SEUL CONDITIONNEL : AU
CAS O
, DANS LE CAS O
, POUR LE CAS O
, DANS
L 'HYPOTH
SE O
, DANS L '
VENTUALIT
O
. . .
Puisque au cas o (qui reprsentera dsormais le paadige) peret le
conditionnel alors que si le rejette, les deux conjonctions ne peuvent pas
tre dcrites comme identiques. A partir de ce qui prcde, il est permis de
penser que, par opposition si, au cas o n'engage pas - ou engage moins
- le locuteur; mais alors, on devait touver aprs au cas o aussi bien le
conditionnel que le ftur et le pass simple, or on ne touve (noralement)
que le conditionnel : la question est alors de savoir ce qui distingue le
conditionnel des deux autres temps - ce qui perettra du mme coup de
prciser la dfmition de au cas o. Compaons pour ce faire :
[28] Il pleuvra ( Perpignan)
[29] Il plut ( Perpignan)
[30] Il pleuvrait ( Perpignan)
Ce qui distingue les tois fonulations, c' est que [28] et [29] sont
prsents avec assurance, comme des certitdes, tadis que par [30] , celui
qui parle montre qu' il n' est pas sr d' avoir raison en nonant ce qu' il
nonce; autrement dit, i pleurai sigife peu prs <<e ne suis pas s( e)
d'tre en droit de dire qu' il pleut. De mme la fone interogative, je
pose les questions
[3 1 ] Pleuvra-t-il ?
[32] Plut-il ?
pour savoir s' il pleuvra ou s' il plut, mais
[33] Pleuvrait-il ?
n' interoge pas sur l'existence de la pluie elle-mme : ici la question
suppose que je pense qu' il pleut et porte sur le fait que je me demande si
j ' ai raison de penser qu' il pleut.
Par consquent, si au cas o n'est compatible qu' avec le
2 6 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
conditionnel, cela signife que cete conjonction prsente l'hypothse
comme inceraine das l' esprit mme de celui qui l 'avance : le locuteur
n' assume pas (contrairement ce qu' implique la conjonction si).
A ce stade, toutes les conjonctions du paadige s'quivalent
(s' opposent de la mme maire si); il y a certainement un lien tablir
entre cette similitude et la constitution morphologique (eUes contienent
toutes U nom, relay par le pronom relatif o), la prposition introduisant,
elle, une difrence : pa exemple on a au cas o mais non / 'hpothse
o, cela signife ncessairement quelque chose . . . Pour dteniner quoi, il
faut avoir une ide de l ' identit de , ce qui n' est pas donn d' avance !
3. LES CONJONCTIONS SUIVIES DU SUBJONCTIF
A la conjonction si, les dictionnaires et les gmmaires renvoient aussi,
comme variates synonymiques, aux conjonctions en supposant que,
supposer que, suppos que, en admettant que, elles suivies du subjonctif
l
.
A mon avis, elles peuvent aussi intoduire l ' indicatif-il ne me semble
ainsi pas scandaleux de dire :
[34] En admettant que Paul est parti 8 heures, il sera ici 1 7 heures au
plus tard
[35] A supposer que Paul par au bureau 8 heures, il devrait s' y trouver
une demi-heure plus tard
[36] En supposant que tu d raison dans tes calculs, on peut partir quinze
j ours en vacances
Les phrases [34,35,36] ne vhiculent videmment pas l' hypothse
de la mme maire que si le verbe tait au subjonctif : elles impliquent
que celui qui parle prend acte de constats ou afnations antrieurs, et donc
apparataient dans un contexte difrnt de celui qu' voquent
[34' , 35 ' ,36' ], o le locuteur paat ne partir de rien, ne s' appuyer sur
aucun pralable :
[34' ] En admetant que Paul soit parti 8 heures, il sera ici 1 7 heures au
plus tard
[35' ] A supposer que Paul parte au bureau 8 heures, il devrait s' y trouver
1 Dans l'ancienne langue et j usqu'au 1 7e sicle, si pouvait tre suivi du
subjonctif; le systme est ramnag avec l'apparition de nouvelles
conjonctions, engendrant de nouvelles manires de foruler une hypothse.
Je ni ai aucune explication fourir sur cette volution : la plus tentante serait
de dire que la langue enregistre les progrs que nous faisons dans l a
conceptualisation -de plus en plus fne -que nous avons du monde.
D. Leeman : La construction du sens par la grammaire 2 7
une demi-heure plus tard
[36' ] En supposant que tu aies raison dans tes calculs, on peut partir
quinze jours en vacances
Comme prcdemment, il fat donc se doner une thorie du
subjonctif et de l' indicatifpour interprter les combinaisons admises par les
conjonctions et voir ce qui les distingue de si et au CU o. Remaquons
que les conjonctions sont construites sur des verbes qui, eux, se combinent
avec l' indicatif, du moins dans la phrase dclarative afnative :
[37] Je suppose que Paul est dj arriv
soit dj arriv
[38] Supposez-vous que Paul soit dj arriv ?
est dj arriv ?
[39] Nous admettrons que Paul est arriv l 'heure ce jour-l
soit arriv
[40]. Admettons que Paul soit arriv l' heure ce jour-l
est arriv
[41 ]. Nous n' admettrons pas que Paul est arriv l'heure ce jour-l
soit arriv
3 . 1 . LE SUBJONCTIF DANS U OUVRGE DE GRMMAIRE
Le manuel Ouvrir la grammaire ne donne pas de dfnition de l 'indicatif,
mais le subjonctif et l' infmitif apparaissent dans des notes, d' o il ressort
que le subjonctif n' est pas compatible avec l' assertion (p. 1 28) ou que
l' infnitif et le subjonctif n'expriment pas une assertion (p. 1 39, p. 1 45).
On est donc renvoy la dfmition de l ' assertion, qui est un nonc qui
consiste communiquer une infonation que l ' on donne pour vraie :
Le temps se lve
Genve est plus grande que Neuchtel
On appellera assertion cet acte de parole par lequel l ' metteur soit donne
2 8 Cahiers de / '/LSL, N1 3, 2002
un renseignement, soit fonule un jugement. Cet acte de parole ralise une
opration fondamentale de l ' esprit, qui consiste avancer une afrmation
propos de quelqu' un ou de quelque chose (p. 1 9). Asserter est un acte
de parole qui se caractrise par le fait que son contenu peut tre reconnu
vrai ou faux (p. 20).
La fone tpique de l' nonc asserif est la fonne dclative
associant sujet et prdicat (p. 52) :
Chlo a pris une bonne dcision. - C' est vrai (ou faux).
Il est difcile de dire d' aprs ces dfnitions si le conditionnel
exprime une asserion (cf. [30] . Il pleuvrait Perpignan) -l' auteur
n' aborde pas cete question. Le problme que pose le subjonctif est qu' il
n'apparat qu' en subordination, si bien qu' on ne peut juger du contenu de
la proposition o il apparat indpendamment de ce qui l ' introduit, et de
point de vue, on ne s' explique pas une opposition telle que :
[42] Il est vrai que Paul est un garon patient
[43] Il est faux que Paul soit un garon patient
Dans le premier cas, confonment aux dfmitions fouies plus
haut, on dira que Paul est un garon patient est une assertion dont je
reconnais le contenu comme vrai. Mais je devrais pouvoir tenir le mme
raisonnement dans le deuxime cas, or c' est impossible puisque le ver
est au subjonctif, ce qui oblige conclure qu' en l'occurence la patience de
Paul ne fait pas l' objet d'une assertion : pourtant la situation paat
semblable la prcdente, l 'nonc consistant ici reconnate le contenu
de la proposition comme faux. Mme perplexit propos de :
[44] Il est vident que Paul est un garon patient
[45] Il est heureux que Paul soit un garon patient
Intuitivement, on a bien l' impression que la patience de Paul est
donne pour vraie dans les deux cas, ce qui corespond la dfnition de
l ' assertion (p. 1 9), mais comme en [45] la phrase est au subjonctif, il y a
une contradiction avec l ' impression initiale mais qu' on ne sait pa
comment rsoudre. Il en va de mme pour :
[46] Je sais que Paul est un garon patient
[47] Je suppose que Paul est un garon patient
En [46] la patience de Paul est efectvement donne pour vraie,
mais peut-on dire qu'elle est afme en [47] ? Inversement pour :
D. Leeman : La construction du sens par la grammaire 2 9
[48] Je doute que Paul soit un garon patient
[49] Je regrette que Paul soit un garon patient
En [48] la patience de Paul est prsente comme inceraine, celui
qui parle envisage que Paul puisse te dit patient mais ne va pas jusqu'
l' admetre ni jusqu' le nier - donc on comprend la prsence du subjonctif.
En revanche en [49] on comprend que, selon le locuteur, il est vrai que
Paul est patient - pa consquent, on ne comprend pas la prsence du
subjonctif. De mme on s' attendrait c que si ou au cas o, dans
l 'hypothse o, etc. introduisent le subjonctif puisque, disant si ou au ca
o, je n' ai pas l' impression d'asserter la patience de Paul, or c
conjonctions ne sont pas suivies du subjonctif :
[50] Si Paul est patient, il rcoltera le fuit de son travail
3.2. UNE AUTRE PROPOSITION, ISSUE DE G. GUILLAUME (CF.
LEEMAN 1 994)
Le linguiste G. Guillaume tablit trois manires possibles de concevoi un
vnement ou une situation, selon que celui qui pale le prsente comme
cerain, probable ou simplement possible :
[5 1 ] Il est certain / Je sais que Max est malade
[52] Il est probable / Je crois que Max est malade
[53] Il est possible que Ma soit malade
Le probable suppose que l ' on n'est pas entirement sr, mais que
l ' on a des raisons de penser que l'vnement est le cas. En fnais, le
probable est du ct du certain, et das les deux cas, on a l' indicatif (cf
[46] et [47]). Prenons en revache l'exemple des verbes de volont : disant
je veu quelque chose, je manifeste que je ne sais absolument pas si cela b
ralisera ou non mais que c que je souhaite, c' est que cela se ralise; le
subjonctif indique que l' vnement est galement possible et impossible :
[54] Je veux / souhaite que tu comprennes
Malgr les apparences, esprer n' est pas dfir comme vouloir,
souhaiter ou dsirer car si l ' on espre, c' est que quelque chose donne
de l' espoir, c'est--dire fait pencher la balance d' un certain ct, celui du
probable :
[55] J'espre que t comprends
3 0 Cahiers de / 'ILSL, N 1 3, 2002
Cette analyse confme ce que l ' on a dit des conjonctions si et au
cas o (qui n' introduisent pas le subjonctif : eUes fonulent une
hypothse, c' est--dire une prise de position - du coup, les deux
possibilits ne sont pas galit : on est du ct du probable (soit assum,
avec si, soit non assum, avec au cas o).
Le subjonctif, lui, ne se prononce pas sur les chaces de la
ralisation de l' vnement : il prend en compte les deux possibilits et les
met face face, tmoignant que le locuteur ne peut pas s' engager (Chiss et
David 2000 : 1 82). C' est cette alterative qui explique le subjonctif en [48]
et [49] : en [48], le locuteur oppose un doute l' ventualit Paul est
patient; dans la mme perspective, on aurit le subjonctif aprs je nie que,
je refuse que, ca ces noncs consistent s' inscrire en faux conte
l' atmnation inverse. C' est ce qui explique, je pense, [43] pa rapport
[42] : il est fau s' oppose une afnaion pralable (quelqu' un a dit que
Paul est un gaon patient) tdis que i est vrai ne prsuppose pas que
quelqu'un ait dit le contire antrieurement. L'nonc [49] dcrit l' efet
que me produit le constat que Paul est patient . je regette fonnule le
rsultat d' une compaaison entre ce que me fait de savoir que Paul est
patient pa rapport ce que m' aurait fait de savoir que Paul n' est pa
patient (donc inclut la confontation des deux possibilits); tous les verbes
dits de sentiment introduisent le subjonctif pour la mme raison (e
rjouis, je m 'tonne, je m 'indigne, je dplore . . . ) : c' est que, pour pouvoir
dire l'efet que me produit fmalement tel vnement, il faut que j'value
mentalement l'efet que cela m' aurait fait s' il n' avait pas eu lieu. Ainsi
peut-on expliquer [45] Il est heureux que Paul soit un garon patient o Il
est heureux dcrit ce que ressent celui qui porte le jugement, alors que [4]
I est vident enregiste une certitude, comme Il est certain ou Je sais. (Il
resterait expliquer la df c entre Il est heureu que et Heureuement
que, qui fait que l ' on a le subjonctif dans le premier ca mais l' indicatif
dans le second . . . )
Globalement, il me semble que la dfmition du subjonctif et de
l'indicatif dans une perspective guillaumienne est plus adquate que celle
qui utilise la notion d' assertion (du moins telle qu' elle a t dfnie
dans l' ouvrage considr), en ceci qu' elle penet de rpondre de maire
cohrente aux problmes que l ' on s' tait poss, de rsoudre de maire
plus satisfaisante les contre-exemples que l ' on avait renconts.
On peut de mme expliquer le pasage de l'indicatif au subjonctif
dans le cas de phses assertives devenat interogatives, impratives ou
ngatives :
[56] Je crois que Paul est ariv
[57] Crois-tu que Paul soit arriv ?
[58] Je ne crois pa que Paul soit arriv
D. Leeman : La construction du sens par la gammaire 3 1
Pour celui qui pose la question en [57] , les deux possibilits que
Paul soit ou ne soit pas arv sont envisages galit. On rmaquer que
lorsque l' interogation est de structre dclaative, donc intge une
assertion, on ne peut avoir le subjonctif (* Tu crois que Paul soit arriv ?,
* Est-ce que tu crois que Paul soit arriv ?).
En [58] , la ngation -comme on l ' a vu plus haut propos de [43]
Il est fau que -prsuppose l'afation pralable, et donc prsente une
opposition ente la possibilit retenue et la possibilit non retenue. L
valeur de l' impratif est comparable celle de l' interrogation; au moment
oje donne l'ordre, o j ' engage faire quelque chose, les deux possibilits
que cela soit fait ou non sont ouvertes :
[38] Supposons que Paul soit dj arriv
[59] Admetons que Paul soit parti l'heure
On voit, partir de l, comment dfmir les conjonctions
introduisant l'hypothse qui sont suivies du subjonctif : celles qui
demandent l ' indicatif indiquent que celui qui pale croit un minimum la
plausibilit de l'hypothse, tandis que celles qui rclaent le subjonctif
expriment le fait que le locuteur ne peut pas choisir entre les deux
possibilits : peut-te alors le tere conjectre serait-il plus appropri
que hypothse, en pensant des expressions telles que se perdre en
conectures qui montrent que la conject ne livre en soi aucune
probabilit, aucun argument permettant de f pencher la balace d' un
ct ou de l' autre. L' ide, ce serait donc que, disant [60], le locuteur pense
que Paul pouvait venir, avait une chace de veni, il privilgie la
possibil it de la venue par rapport celle de la non-venue :
[60] Si Paul tait venu, on aurait pu jouer au bridge
mais disant [61 ], le locuteur au contaire n' a aucun moyen de dire si Paul
aurait pu venir - rien ne peut l' amener avoir un point de vue dans un
sens plutt que dans l' autre :
[61 ] A supposer que Paul soit venu, on aurait pu jouer au bridge
La venue de Paul est ici une pure conjecture, une hypothse gratuite qui ne
repose ou ne peut s' appuyer sur rien. Ce qui oppose [60] et [61 ] , ce n' est
pas le fait rel (dans les deux cas, Paul n' est pas venu) mais b
prsentation, le deg de plausibilit accord la venue de Paul : [60] dit
que, selon celui qui parle, la venue de Paul tait dans l' ordre des
probabilits, des choses concevables, envisageables; tandis que [61 ] dit
que, selon celui qui parle, la venue de Paul n' tait pas plus prvisible que
sa non-venue.
3 2 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
De mme si tant est que ajoute si un doute qui anule la pa de
probabilit que contient si :
[62] Paul viendra s' i l le veut
[63] Paul viendra si tant est qu' il le veuille
[63] marque clairement que celui qui parle ne saurait af e si Paul
veut venir ou non, il ne peut se prononcer das un sens ou dans l' autre
(voir le geste et la mimique qui assortissent gnralement ce tpe de
formulation); l' exemple donn par le G. L. L.F. :
[64] Il parat que la situation s' amliore, si tant est que l ' on doive se fer
ce joural (G. L.L. F. )
marque ainsi par deux fois (il parait que et si tant est que) le peu de crdit
que l ' on doit accorder l' affrmation la situation s' amliore.
On a donc le moyen de dfnir globalement les conjonctions suivies
du subjonctif mais, comme pour la srie de au CU o tout l' heure, il f
ensuite les difrencier les unes par rappor aux autres, ce qui implique e
paiculier d' interprter les fores morphologiques : en supposant que est
form sur un participe prsent, supposer que sur un infnitif, suppos que
sur un paicipe pass, or ces trois modes prsentent videmment
l' vnement chacun leur maire; on doit donc pouvoir opposer les trois
formulations selon la dfnition que l ' on peut donner l' infnitif et aux
paicipes. Il faut aussi s' interoger sur la prposition : on a en supposant
mais supposer et non * supposant ni * en supposer et sur le ft
que le paricipe pass est, lui, auto-sufsant : suppos que vs * en suppos
que, * suppos que. En fonction de ce qui a dj t dit sur les uns et les
autes, l' ide serait peut tre que supposer que ouve une perspective ( :
destination, perspective . . . ), tandis que en supposant que installe une
conjecture en cours, en tain de s' accomplir, et suppos que la prsente
passe, accomplie. Tout cela bien sr est tavailler et vrifer sur des
corpus. Il en va de mme pour si tant est que o tant est que tablit la
quantit, l a distance qui spare l' hypothse si de c qu' elle concere : on
s' loigne de la plausibilit que contient si et du coup l' vnement devient
hautement problmatique.
4.
C
ONCLUSION
Revenons l' intitul de cet expos : la constrction du sens pa la
grammaire. Tout le monde est d'accord pour dire que la lague est ue
fore qui vhicule du sens, et que pa consquent l' enseignement de la
grammaire ne doit pas se limiter aux formes mais aussi montrer ce que c
fones signifent. D'accord, mais le problme, c' est qu' on ne sait pas
D. Leeman : La construction du sens par la grammaire 3 3
qu' elles signifent -ce qu' elles sigifent dan le sstme de la langue
ele-mme.
Cela vaut dj pour le lexique, o pourtant nous avons des
intuitions trs claires : si on vous demande ce que veut dire le mot oiseau,
vous rpondrez spontament qu' il dsige ces petits animaux qui volent
dans le cieL . . Si un enft ne sait pas ce que sigife le mot naire, vous
lui direz qu'un navire, c' est U bateau. Ce sont d' ailleurs les dfmitions
qui apparaissent dans les dictionnaires, et eUes nous paraissent videntes.
Et pourtant, on n' a pas en fait donn le sens du mot en langue, on a
seulement foui l ' un des emplois possibles, la dfmition de oiseau
vaut peut-te pour [65], mais elle ne vaut pas pour [66] :
[65] Un oiseau a fait son nid sous la gouttire
[66] La a pous un drle d' oiseau
Et de mme, dire qu'un navire c' est un bateau est trompeur, p
que le mot naire ne se compore pas comme le mot bateau :
[67] Prendre le bateau / Aller Tunis en bateau / pa bateau
[68] ?? Prendre le navire / ?? Aller Tunis en navire / par navire
En quoi est-ce trompeur ? En ce que le sens que l ' on attbue
spontanment naire (ou bateau, ou oiseau) consiste f coresponde
au mot ce qu' il dsigne : son rfent; or la dfnition rfrentielle ne se
proccupe pas du statut du mot das le systme de la langue, qui
conditionne pourtant l' emploi du mot (c' est ainsi qu' une de mes
tudiantes, allemande, touvait [68] tout fait acceptable : elle avait tor
infr de la similitude rfrentielle un navire c' est un bateau la
similitude de comporement linguistique des mots naire et bateau). Dire
que c' est la gammaie qui constuit le sens, c' est au contraire considrer
que c' est pair des emplois des mots que l ' on peut accder leur sens
(en langue). Mais l tout se complique . . .
On peut efectivement obserer les emplois des mots, les fores et
leurs compatibilits ou incompatibilits, comme en [67] et [68] . De la
difrnce de forme, on postule une dif ce de sens : il y a deux mots
bateau et naire, et ils ne se comportent pas de la mme manire, donc ils
n' ont pas la mme identit smantique. Ce qui est compliqu, c' est
d' interprter la df rce forelle pour en dduire une dfnition
smantique : qu' est-ce que signife, pour le sens de bateau et navire, le f
qu' on peut dire prendre le bateau et non prendre le navire ? ou y aller par
bateau et non y aller par navire ? L, on est dmuni, on n' a aucune
rponse intuitive : on ne peut que ttonner, en avaat des hypotses
successives. La solution laquelle on s' arte un moment donn n'est
rien d'autre qu'une hypothse provisoire, qui vaut tat qu' on n' a pas
34 Cahiers de [ 'ILSL, N 13, 2002
trouv de contre-exemples.
Le problme est encore plus pineux en morphologie ou en syntaxe,
parce que, souvent, on n' a mme pas d' intuition rfrentielle : quel est le
sens de , ou celui de l ' infmitif, ou celui du subjonctif ? On est bien
oblig d' en passer par l' observation de formes, la comparaison des noncs
o elles entrent, pour essayer de dgager une identit smantique; c'est
que font les gammairiens et les linguistes : chacun peut ar iver propser
quelque chose, mais ce n' est jamais une rgle au sens o il serait prouv
dfnitivement que c' est bien comme cela que fonctionne la langue - la
preuve en est qu' il y a des dsaccords, des critiques, des propositions
nouvelles.
Ce que j ' ai dit aujourd' hui n'chappe pas cete loi : c'est un
certain point de vue que j ' ai avanc, qui me parait plus adquat que ce que
l' on trouve gnralement das les gammaires
- parce que mes propositions rsolvent les problmes que posent les
autres descriptions ou explications (du moins quand explication il y a)
donc mon hypothse est plus puissante, elle rend compte de davantage de
fones (mais rien ne garantit qu' elle rende compte de toutes les fones :
elle n' est plus adquate que les autes que dans la mesure o on ne lui a
pas encore touv de conte-exemple);
- mes propositions me paaissent plus adquates aussi en
qu' elles exploitent le fonctionnement de la lague comme systme : on a
mis en relation les conjonctions et les modes ou les temps; ce que l ' on a
dit du conditionnel ne vaut pas seulement pour l'expression d
l 'hypothse, et de mme l ' explication que l ' on a foue du subjonctif
s' appuie sur une dfmition gnrale du mode qui se retrouve avec les autes
conjonctions et dans les autes subordinations. Je veux bien croie p
exemple que, avec supposer que, en supposant que, suppos que,
l 'hypothse est choisie par le locuteur, tandis que au cas o, dans le
cas o seraient plus insistants, pour le cas o signalerait une
hypothse peu crdible, dans l 'hpothse o que l' hypothse ne
dpend pas du locuteur (Ruquet et Quoy-Bodin 1 988 : 71 ) : il y a peut
te l une intuition juste mais ce qui gnant, c' est prcisment qu' il ne
s' agit que d' intuition, et que le lien n'est pas tabli avec la fore mme de
la conjonction ni le mode de la proposition qu' elle introduit.
Quelles conclusions en tirer pour l 'enseignement du fais comme
langue tragre ? Je dirais pour rsumer : une trs gnde dfance
l ' gard de ce qui est avac comme rgle mme si cela a toutes les
apparences de la vrit (le mot nire aussi a bien l ' air d' tre synonyme de
bateau : on a vu ce qu' il peut en te de ce gen d'vidence). Mais aussi
deuximement : l'enseigant doit avoir une solide culte linguistique,
non seulement pour connate les fores et les interprtations qu' on peut
leur attribuer, mais aussi justement pour pouvoir valuer la pertinence des
rgles qui sont avances dans les manuels. Oui, je sais : les aalyses
linguistiques ne sont pas d' un accs facile, au propre comme au fgur ! Il
ne faut pas rester isol f l' immensit de la tche mais au contaie
D. Leeman : La constuction du sens par la gammaire 3 5
organiser des groupes de tavail pour prparer les cours ensemble, compar
ce que chacun comprend de telle ou telle lecture, changer les points de vue
sur l a manire de l ' utiliser et, bien sr, ne pas maquer de profter de
colloques tel que celui-ci !
RFRNCES BmLIOGRHIQUES
Benveniste E. (1 966). Problmes de linguistique gnrale, Paris :
Gallimard, chap. 1 9.
Chaaudeau P. ( 1 992). Grammaire du sen et de l 'epression, Paris :
Hachette.
Chiss J. -L. et David J. (2000). Grammaire et orthogaphe, Paris : L
Robert et Nathan.
Damourete J. et Pichon E. (1 936). Des mots la pense, Tome V, Paris :
D' Artrey.
Dendale P. et Tasmowski L. eds. (2001 ). Le conditionnel en fanais,
Recherches linguistiques 25, Metz.
Genevay E. (1 994). Ouvrir la grammaire, Lausanne : LEP.
GLLF : Grand Larousse de la langue fanaise ( 1 971 - 1 978), Paris.
Grevisse M. ( 1 993). Le bon usage, 1 3e dition rmaie par A. Goosse,
Louvain-la-Neuve : Duculot.
Guillaume G. ( 1 929 rd. 1 984). Temps et Verbe, Paris : Champion.
Leeman-Bouix D. ( 1 994). Grammaire du verbe fanais. Des formes au
sens, Paris : Nathan.
Leeman D. (2001 ). Quand les fonnes inforent : de la gamaire la
smantique, Le fanais aujourd'hui 1 35, Paris : AFEF.
Ruquet M. et Quoy-Bodin J. -L. (1988). Raisonner la franaise : tud
des articulations logiques, Paris : Cl interational, Comment
dire ?.
3 6 Cahiers de l 'IL8L, N 1 3, 2002
Soutet O. (2000). Le subjoncti en fanais, Paris : Ophrys.
Trvise A. ed. (1 999). L 'hpothtique, Lin 41 , Paris X Nanterre.
Vi au R. ( 1 997). La motivation en contexte scolaire, Bruxelles : De Boeck.
Wilmet M. (1 998). Grammaire critique dufanais, Paris : Hachette.
Cahiers de / 'ILSL, N1 3, 2002, pp. 37-49
Structures grammaticales et constructions
prfabriques, quelques enjeux didactiques
Trse Jeaneret
Universits de Neuchtel et de Fribourg
Les mthodes des grammairiens et des rhteurs sont
peut-tre moins absurdes que je ne le pensais l ' poque
o j 'y tais assujetti. La gDaire, avec son mlange de
rgle logique et d' usage arbitaire, propose au j eune
esprit un avant-got de ce que lui ofiront plus tard l es
sciences de la conduite humaine, le droit ou la morale,
tous les systmes o l ' homme a codif son exprience 1 ,
Marguerite Yourcenar, Mmoires d 'Hadrien,
La Pliade, p. 3 1 1
Cet article se propose de rfchir ceraines limites que l ' on assigne e
gnral la gammaire et parant son enseignement. En particulier, on va
s' attacher mettre en vidence c que pourrait apporer la didactique du
fais langue tgre une conception de la gamaire comme couvrant
un champ large, incluant certaines zones limites entre la libert
combinatoire et le fgement. Pour ce faire, on partira des objectifs assigs
un enseignement de gammaire dans une classe de langue et on montera
qu' ils posent le problme de l'adquation du modle grammatical enseig
aux observables. La rfexion propose ici s' appuie sur celle de Chevallard
( 1 99 1 : 39) autour de la notion de transposition didactique dfmie comme
le travail qui, d' un objet de savoir enseiger, fait un objet
d' enseignement. D' une certaine maire, c' est une rduction de l' ca
entre l 'objet d' enseignement (la gmaire du fais langue tgre) et
l ' objet de savoir (la linguistique descriptive du fais) qui est prconise
1
L'ide de cete citation a t emprnte Besse & Porquier ( 1 991 ).
3 8 Cahiers de l'IL8L, N 1 3, 2002
1 . POURQUOI ENSEIGNER DE LA GRAMMAIRE ?
En schmatisant, je parrai du postulat qu' il y a deux ordres de
lgitimation l ' enseignement de la gmmaire dans les cursus de fais
langue tangre :
le premier est relatif un objectif d' intriorisation pa l' apprenat
de la gammaire du fais selon un processus qui l' amne s' approprier
des stuctures linguistiques;
le second tient l' activit de rfexion sur la langue qu'of la
perspective grammaticale, pa exemple en crant des occasions d
compaaison ente langue source et lague-cible, ce qui permet un
ensemble d' activits de conceptualisation de se metre en place.
Le premier ordre de lgitimation est l i l ' ide que la
familiarisation avec une description gammaticale favorise l' intriorisation
d' une grammaire
3
. Dans le second orde de lgitimation, on admet que la
rfexion sur la langue paicipe de l' apprentissage de la langue.
Je ne discuterai pas ici ces deux fondements de l' enseignement de la
grammaire, non qu' ils ne puissent l'tre mais plutt qu' une joue de
rfexion sur l' enseignement de la gammaire n' est pas le lieu d'une telle
discussion.
On peut noter rapidement que dans les enseigements de FLE
l'universit, du moins en Suisse romande, on assige, il me semble, tour
tour l' enseignement de la gammaie une premire puis une seconde
fonction qui sont bases sur les deux ordres de lgitimation ci-dessus : on
considre das un premier temps qu' il fut enseiger la gammaire pour
que les tudiant-e-s intriorisent progressivement une gmaire adquate
du fanais puis dans un second temps (dans la deuxime parie des cursus),
on enseige la gmaire pour les pousser rfchir sur la langue et
augenter ainsi la fois leur savoir en et sur le fais
4
.
Une maire de lier ces deux efe attendus d' un enseigement de
gamaire est de rfchir l' adquation du modle de description de la
langue choisi, en d' autres mots au tye de gmaire enseige et a
modle de description du fais qu' elle sous-tend. En efet, si l ' on se
limite donner pour objectif l' enseigement de gmaire de favoriser
2
Mme s'il est bien clair qu'un cart est constitutif de la notion me de
transposition didactique.
3
Cette expression ne dit rien sur la fone de cette gmaire intriorise et
n'exclut en aucune manire la (re)confguration de la gmmaire par l es
expriences interactives de l'apprenant.
4
Il va de soi que les rfexions des tudiant-e-s sur la langue ne s'enclenchent
pas seulement au moment o on les institue en objet d'enseignement, mais
c'est ainsi que les programmes sont envisags.
T. Jeanneret : Constructions prfabriques 3 9
l' intriorisation pa l' apprenant de contraintes sur la linarisation des
constituants et l ' agencement des squences, il suft que ces contraintes
soient formules clairement, qu'elles reposent sur des procdurs explicites
d' application et enfn qu'elles peretent de ne fabriquer que (si possible ! )
des suites gammaticales. En bref, c'est le cactre oprtoire de la rgle
qui va tre jug imporant.
Ainsi, on prsentera la relation ente un syntagme nominal et son
pronom correspondat comme une opration de pronominalisation et on
expliquera les rapports entre il renonce lui et il renonce son fls ou il y
renonce et il renonce ses vacances par l ' application d'une rgle simple
qui associe au syntagme son fls le tait smantique + anim et ses
vacances le trait - anim.
Au contraire, si l ' on veut aussi exercer chez l ' apprenant des fcults
de rfexion sur la langue-cible, alors il impore que ces containtes soient
sous-tendues par une description cohrente de cette langue. On ne voudrait
pas que l'tudiant-e rfchisse sur la langue avec modle inadquat, ne
rendant compte que d'une faon pacellaire et iexacte de la lague-cible, en
l'occurrence le fanais, laissant dans l' ombre certains de ses aspects jugs
primordiaux et constitutifs.
Ainsi pour l ' exemple prcit, la rgle propose ne peret pas d
rfchir intelligemment sur le faais pour plusieurs raisons :
- d' abord pace qu' elle sous-entend et qu' elle donne comme
modle de fonctionnement linguistique (comme bon nombre d'exercices de
remplacement du syntagme nominal par le pronom idoine, d' ailleurs) une
incompatibilit d' occurrence ente les fores lexicales et les clitiques. Or la
cooccur ence du matriel lexical et du clitique est fquente en fais
S
:
elle s' actualise pa exemple dans les confgurations dnommes
dislocation.
- ensuite parce qu'elle impose de rejeter de la description baucoup
d' emplois : d'une part ceux que l'on appelle volontiers mtaphoriques
c'est--dire recouvrant tous les noncs du genre mon ordinateur j 'ai pen
lui toute la nuit et d' autre part ceux que l ' on juge familiers,
relchs comme j y pense, mes tudiants.
Au contaire une" description de ces faits linguistiques qui s'appuie
sur les propositions faites par Blache-Benveniste (1 978) montrera :
- que les verbes qui oft l'alterative, le choix entre lui ou y
(comme penser, par exemple) lient ce choix une interprtation
individualisante ou non individualisante du syntage nominal plein.
Ainsi, tout lexme pouvant se prter une dsindividualisation ser
compatible avec l ' utilisation de y, au contraire de lexmes ne s' y prtt
5 Il est important que des apprenants germanophones par exemple s'en rendent
compte puisque l'allemand utilise d'autres procds que la co occurrence entre
fore lexicale et clitique (ainsi les structures types den Bericht habe ich
gelesen, voi r Pekarek Doehler, 2001 ).
40 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
pas. La pluralisation, notamment, peut perettre facilement ue
interprtation non individualisante. C' est ce qui se passe dans l ' nonc j'
renonce sans reget des amis aussi peu fdles alors que *j y renonce
chacun est impossible pace que le trait + individuel empche le choix
du pronom y. Au contaire dans des noncs comme : sa maison adore,
va-t-il renoncer elle ?, la maison est dote d'une imporance telle qu' elle
peut se voir confrer un tait individualisant.
- que ce que Blanche-Benveniste appelle les formes de
redondance entre clitique et lexme perettent une sorte de reclasifcation
contextuelle du lexique, sorte d' isotopie engendre pa le noyau clitique
verbe : ainsi le choix de y dans l' nonc ci-dessus permet que des amis
aussi peu fdles soient dsindividualiss
6
.
Ainsi la premire rgle gamaticale propose sous-tend un modle
de la langue inadquat, laissat dans l ' ombre des proprits centales du
fais. Ceci dit, elle est plus ou moins opratoire en fonction de c que
l' on considre comme des faits reprsentatifs du fais, et pourrait donc,
la limite, tre considre comme adquate dans le cadre d'u enseigement
de la gramaire se donnant pour but de fair acqurir aux apprenants une
grammaire intriorise, cense uniquement leur peretre de ne produire
que des stuctures gd aticales ou dans ce cas paiculier un sous
ensemble des structures possibles.
2. OBSERVABLES LANGAGIERS ET AD
QUATION DES
DESCRIPTIONS GRAMMATICALES
Remarquons que dans des cursus o l ' on adopte successivement l' un puis
l ' autre objectif assig l' enseignement de gramaire, rien n' empche en
thorie que l' on choisisse d' abord de privilgier l' oprationnalit puis que,
dans un second temps, l' on change de modle pour mete l' accent sur son
adquation aux obserables langagiers. D' autant que souvent les
enseignants changent aux difrents niveaux. Il me semble nanmoins
qu' une certaine cohrence dans l' enseignement de la gramaire ne peut t
que proftable et bnfque, reposante mme !
C' est la raison pour laquelle l' adquation d' une description
grammaticale pa rapport des obserables langagiers est une question
6
Notons que, son tour, l 'explication laisse dans l ' ombre un pan imporant du
fonctionnement du fraais . En effet, dans un nonc commej y pense, mon
petit fls, il est diffcile de faire abstraction de l ' impossibilit de commutation
de y avec la fone lui : je pense lui, mon petit fls ne s' interprte pas
comme une dislocation. On peut donc faire l ' hypothse que parfois les
contraintes pragmatiques qui imposent une dislocation droite slectionnent
pa l mme un choix syntaxique, contraignent une corfrence et consti tuent
donc un cas o la pragmatique reconfgurerait la syntaxe.
T. Jeanneret : Constructions prfabriques 4 1
centale en didactique. Das cet article, je
atacherai un ensemble
d' observables qui sont repousss aux confms de la gmaire et je tenterai
de les y resiter au centre. C' est donc un largissement du champ des
obserables grammaticaux que je prconise.
Il me semble en efe que l ' on lie trop troitement la gammaire
une conception de la lague comme prioritairement fond sur la libert
combinatoire. Dans cette conception, que je juge restictive, ce qu' une
grammaire vise principalement c'est, dans un premier temps didactique, la
prsentation et l ' explication de schmas syntaxiques dsincars et dans un
second temps, l ' incaration de ces schmas travers des exercices.
Par exemple, on va enseigner la stcte NI V N2 puis
l'exercer tavers les exemples : la vache regarde le train, la linguiste
plante ses lgumes, le voisin perd ses cls, etc. L' existence de prdicats
verbaux domaine ts rduit, tel un verbe comme ressemeler Ge reprend
un exemple de Gross, 1 996), qui ne se combine gure qu' avec chausures
et quelques-uns de ses hyponymes n' est pas assez prise en compte.
Pourtant bon nombre de prdicats verbaux dsigant des actions
techniques : scier, raboter, raccommodr, etc. entrent dans cette catgore.
Bien sr, il y a un aspect de rentabilit : enseiger un schma et montrer
qu' il permet de produire une gnde quantit d'noncs est plus gtifat
que d' insister sur l ' aspect extmement rduit de certaines combinatoires.
Ceci dit, ce faisat on oblitre un aspect quand mme trs important des
langues et en particulier du fnais : on vacue de l ' enseignement de la
gammaire des squences d' units qui sont plus ou moins prfabriques,
c' est--dire au sein desquelles, selon la dfnition de Moreau ( 1 986) les
concur ences paradigatiques et syntagatiques sont afaiblies.
L' tude des squences prfabrques taverse de nombreux champs
de la linguistique : des tudes sur le lexique aux tdes sur les actes d
langage indirects et de la stylistique aux routines conversationnelles. On
peut se rfrer Glich & Kf( 1 997) pour un inventaire circonscrit mais
dj rvlateur des difrnts chaps pouvat te concers pa cette
problmatique. Pour ma part, je vais limiter ma rfexion sur les squences
prfabriques en me contentant de souligner deux aspects que je juge ts
importants pour la didactique : d' une part leur compatibilit avec une
approche syntaxique et d' autre part leur impornce dans les activits
rdactionnelles.
3. POUR U SYTAXE DE LA CONSTRUCTION
PR
FABRIQU
E
On juge parois que les constructions prfabriqus sont spcialises das
l' expression de la langue de bois et qu'il ne fat donc pas les enseiger ou
alors qu'elles relvent du lexique et donc de l' enseigement du vocabulaire.
Ce faisant, on oppose ainsi deux mondes : celui de la phrasologie das
lequel les squences sont fxes et celui de la gmaire dans lequel des
42 Cahiers de l '/LSL, N 1 3, 2002
paadiges productifs sont labors. Il me semble ainsi que depuis les
anes soixante et le triomphe de la grmmaie gnrtive on a une
conception top compositionnelle de la syntaxe -et peut-te est-ce
d' ailleurs fire trop de crdit la gamaie gnrative, les taditions
distbutionnelles ne sont srement pas tragres cette infuence.
L'largissement au prfariqu linguistique des observables
pertinents pour la description gmmaticale permet de dpasser la simple
constatation d' un phnomne de fgement, d' absence de possibilits de
choix et son tiquetage locution ou unit phrasologique. En efet, si l ' on
examine o et comment ces units mnagent des occasions de cration p
exemple gce l ' insertion de matriel dans leur schma syntaxique
intere, on se convainc rapidement de l ' existence de possibilits de
dfgement qui perettent de fa de la syntaxe : ainsi une expression
comme aoir quelque chose porte de la main serait une excellente
occasion de faire un certain type de grmmaire. Prsente ainsi, avec la
seule indication qu' elle rgit diectement son complment (c qu' indique
le qqch), cette unit prfarique est une locution, une unit
phrasologique, etc. O ne voit pas quelle gamaire on peut imaginer
son sujet, une fois la notion de rection directe intoduite.
Or, les choses s 'clairent si on commence f rfchir les
apprenats sur le type d'units susceptibles de venir s' insrer dans la
construction : elle a ses lunettes porte de la main, son livre, son verre
d'eau, etc. et sur les liens ente cette premire srie d' noncs et la
seconde srie : le verre, les lunettes, etc. est/sont sa porte dont le
schma sera raen quelque chose est la porte d quelqu 'un. La mise
en uvre d' une opration de commutation propos cete fois du premier
constituant nominal de cette seconde construction va fa appaate des
syntagmes comme un livre, une rfeion, un raisonnement . . . est sa
porte. On poura alors souligner la ruptue de palllisme dont tmoige
l ' impossibilit de *j 'ai une rfexion porte de la main. Cette maire
d' ouvrir la gramaire l 'tude de la phrasologie est ts inspire des
travaux de Fiala (1 987) et d' Achad & Fiala ( 1 997) : elle se distingue
simplement pa son orientation. Pour ces auteurs, il s' agit de fae entr
des observations relevat de la syntae dans le monde de la phrasologie.
Pour moi c' est le contaire : je propose de f enter de la phrasologie
dans la gramaire.
4. CONSTRUCTIONS
R
DACTIONNELLES
PR
FABRIQU
ES ET ACTIVIT
S
Pour aborder les liens ente activits d' critre et constctions
prfabriques j ' ai choisi de pair de deux ereurs d' apprenantes :
Mon premier exemple vient d' un texte rdig pa une tudiate
roumanophone pair d'un vers de M. Eminescu ti de Mlancolie : Je
cherche en vain mon univers, ma tte est lasse. Cete tudiate ouvre un
T. J eanneret : Constructions prfabriques 43
nouveau paagaphe par ce segment : Dan la manire platonicienne
d'envisager cette chose-ci, . . . La corection : dans la conception
platonicienne des choses, s' appuie sur la matrise d' une constction
prfabrique, qui se renconte fquemment, me semble-t-il, dans ce que
j 'appelle en suivant Perelman & Olbrechts-Tyteca (1 958), le tete
dlibrati Ce genre de texte (que je dfnirai comme un texte dont le but
est de montrer quelle position doit se dgaer f tel ou tel problme)
fait trs fquemment 1' objet d' enseignement dans les cursus de FLE
1'universit
7
. Comme tout genre il se caactrise, ente autres, par des
confgurations d' units linguistiques qui lui sont troitement attaches et
dont dans la conception . . . . ds choses fait parie. Notons qu' ici encore, on
poura exploiter les variations possibles sur ce schma : dans un
conception gnreue des choses, dns une conception troite des choses,
dans la conception de Freud, etc.
Mon second exemple m' a t ofe pa une tudiate hispanophone
dans un texte dlibrant sur cette ide de Michel Foucault : On dit
souvent qu'il faut rfchir avant d'agir, mais il faut surtout rfhir mme
sans agir. Elle y a crit . Je me pose une question : est-ce qu 'on rfchit
tout le temps ? A mon avis je pense que pa tellement car. . . Cet exemple
va me perette de faire deux obserations.
La premire, trs proche de la prcdente, concerer les expressions
consacres en fnais pour rpondre ngativement une question dans un
texte dlibratif : i me semble que non ou mon sens, non qui auraient
appropries ici. A nouveau il y aurait l des ensembles paradigmatiques
exploiter grammaticalement : il me semble que non, il me semble que cela
n'est pas le ca, par opposition i semble que non, i semble que cela n
soit pas le cas, etc.
Mais ces deux confgurations, il me semble que (suivi de l'indicatif
et i semble que (suivi du subjonctif s'opposent galement sur un aut
plan: la premire induit un positionnement de l'nonciateur qui rane
lui l'expression de l'opinion, alors que la seconde impose un
positionnement plus dtch, plus neutalis. Cette remarque m' amne
ma seconde obseration.
Ces constructions prfabriques peuvent ainsi te abordes en tant
que schmatismes inducteurs (Blumenthal, 1 999). En efe, une fois
slectionnes pa le scripteur, elles contaignent certains choix efe
par la suite. Dans l'exemple prcdent, il s'agissait de choix nonciatifs. O
remarquera que la corection de la rponse dans le sens propos impose en
7
Je fais l ' hypothse que l'enseignement de ce genre dlibratif dans les cursus
de FLE a pour but de former les tudiants ce que Borel ( 1 985) appelle le
discours argumenta/i crit et qu' elle dfnit comme un discours dans lequel
on expose des savoirs et on dbat d' ides sous une fonne raisonne. Une fois
acquise leur cerifcation en FLE et s' ils poursuivent leurs tudes, Un
demandera aux tudiants de convertir leur matrise du genre dlibratif en
matrise du discours argumentatif crit dans la discipline qu' ils auront
choi si e.
44 Cahiers de 1 '1LSL, N 1 3, 2002
retour une correction de la question. Cete logique me fe proposer
l ' tudiante de remplacer son je me pose une question pa un on peut se
poser la question suivante. On voit donc qu' en rappor avec la didactique
du texte dlibratif, la gdaire devrait metre l' accent sur toute une srie
de constructions plus ou moins prfabriques qui sont spontanment
utilises par tout scripteur expriment quand il produit un texte dlibratif.
L'exemple prcdent permet de noter que la production de textes
dlibratifs impose en fais la matrise des difrentes interprtations lies
au morphme on. Sans enter ici dans les dtails des difrentes lectures de
on, je retiendrai juste l'ide que on sous-tend des prises en chae
nonciatives assez contrastes : une expression comme on dit souvent, p
exemple, est un schmatisme inducteur qui organise, me semble-t-il, une
squence forme d'un segent de texte dont le scripteur se distanciera qui
sera suivie d' un second segent auquel il adhrera (en tout cas dans un
premier temps, le texte dlibratif tant strctur par des mouvements
d' adhsion puis de distance du scripteur certaines ides). Le morphme
on condense ainsi des descriptions gmaticales et nonciatives (voir
Auricchio, Masseron & Perin-Schirmer, 1 992). Un module
d'enseignement autour de on offirait ainsi l'occasion d'intger :
d'une par des observations gamaticales classiques, pa exemple les
fones de redondance nous - on (voir Leeman-Bouix, 1 994 pour une
rfexion sur les rappors entre nous et on das ces formes de redondance);
d'autre pa de la gamaire des constructions prfabriques, par exemple
travers les expressions idiomatiques on dit (souvent) que, on admet (en
gnral) que, on soutient (arfois) l 'ide que, etc.
et enfm de la grammaire du texte (ici dlibratif, pa exemple autour des
schmatismes inducteurs opposs des deux sries paadigatiques
labores parir de : on dit souvent que pour la mise distace d'une
rfexion dj efectue, ratife et on dira que pour l ' assertion, assume p
le scripteur, d'un principe, d' une rfexion qui est en train de se faire. O
rencontre l, avec les verbes au ftur, un on qui associe le scripteur et son
lecteur qui est alors impliqu (voir Boutet, 1 994 pour une rfexion sur les
difrentes interprtations de on). Souvent utiliss avec des verbes dnotat
des processus cogitifs, on et le ftur se rencontent dans les expressions
prfabriques suivantes : on ne s 'tonnera pas ds lors que. . . ou on notera
avec intrt que . 4 4 On admeta (! ) le caactre sdiment de ces deux
paradigmes, l'un servant l ' expression plus ou moins distancie et l' autre
serant l' implication du scripteur et de l ' auditoire.
En suivant Atkinson ( 1 990), on pourrait concevoir que ces deux
paradigmes reprsentent des solutions qui ont t trouves pour rsoudre
les problmes poss par l ' expression d'une plus ou moins gde distce
pa rapport des opinions, des penses, et pa l' implication plus ou
moins dlibre de l' nonciateur et de l' auditoire dans les procs voqus.
Ces solutions se sont progressivement sdimentes et ont t socialement
T. Jeanneret : Constructions prfabriques 4 5
reconnues comme adquates.
Il est clair que ces solutions socialement reconnues comme
adquates ont partie lie avec la notion de genre de texte. D' une part le
genre peret de les slectionner et d' en conformer la fore. D'autre pat, le
genre est un stabilisateur des pratiques et c titre, il est un gnrateur de
constructions prfabriques.
On devrait donc tirer les leons didactiques de cet tat de fait et
enseigner, donner voir ces sries d' units. phrasologiques en explicitat
et en difrenciant bien leur fonctionnement.
Ceci permettrait l ' tudiante de l'exemple ci-dessous d' organiser le
dialogue entre deux points de vue qu' elle cherche laborer : vous UU
l 'intention de me reprocher deviendrait : on admet en gnral qu'il y a . 4 4
Puis nous voulons rpondre serait remplac par certes, mais lorsque le
cereau. . . qui permetta d' exprimer le point de vue dfendu pa la
scriptrice :
Mon monde est reprsent par l'tendue de ce que je conquiers par mon
intel ligence. Vous avez l ' intention de U reprocher qu' il y a quand m
un monde harmonis pa le sens commun [ . . . ] Nous voulons rpondre que
surout lorsque le cerveau est fatigu, [ ... ] il a la facult d' entrer dans un
monde qui va au-del du sens commun.
On peut avoir l' impression que je me suis beaucoup care de la
grammaire, mais je ne le crois pas. Si l' identifcation de structes
prfabriques requiert efectivement des outils autes que ceux de la
gammaire, pa exemple une pragatique textuelle, leur didactisation
repose sur des pratiques essentiellement grdaticales : le balayage sur
l' axe paradigmatique (en d' autres mots, la commutation) et l' insertion
dans des schmas de formulation (en d'autres mots une insertion
syntagmatique).
5. UE
BAUCHE D' EXERCICE
L' bauche d' exercice propose ci-dessous devrait perettre de s'en
convaincre :
A partir de la phrase . Quand on dit que le monde appartient ceu
qui se lent tt, on souscrit une reprsentation du monde que les
Suisses connaissent bien'
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Quand on dit que le on souscrit une que les Suisses
monde appartient ceu reprsentation d u connaissent bien.
qui se lvent tt, monde
Construisez difrnts introductions une problmatique en insrant les
46 Cahiers de Z 'ILSL, N 1 3, 2002
segments suivants dans la colonne 1 . Faites le cas chant, les
modifcations ncessaires :
L 'avortement est un crime
Le problme du nuclaire ce sont les dchets
Il y a trop d'trangers en Suisse
Et dans la colonne 2
On simplie un problme
On commet une erreur
On exprime une opinion
Et dans la colonne 3
Qui est beaucoup plus complexe (. o ) que l 'on ne pense
Que l 'on (ne) peut (as) expliquer
Dont je souhaite traiter dans ce texte
Ces exercices paadiges fenns reprsentent donc ce que je
considre comme des bribes plus ou moins sdimentes. Un scripteur
expriment recour spontament ces bribes si on lui demade de
produire un texte dlibratif.
Ce tpe d' exercice est la fois, on en conviendra, un exercice de
gramaire au sens habitel (la colonne 3, ente aute, implique la matrise
de la relativisation), un exercice de maiement de stctres plus ou moins
prfabriques et un exercice de constction du texte qui, ce titre, rlve
de la grammaire du texte.
6.
C
ONCLUSION
Dans cet aicle, une rfexion sur les obserables linguistiques justifat
d' un enseigement de gmaire m' a conduite metre en relation ue
didactique des units phrasologiques et du texte, en paiculier dlibrtif.
Ce lien entre phrasologie et texte n' est pas le simple fit de mes intrts,
il a sa justifcation propre : en efe, si la description des units
phrasologiques relve en paie de la gamaire, leur slection impose de
se situer dans un genre de discours paiculier. Beaucoup de squences ne
sont pas fges en elles-mmes mais pa rapport au gene de discours o
elles surviennent.
Pa ailleurs, cet aicle a cherch montrer qu' il existe des
structurations de natue morhosyntaxique du chap phrasologique qui
perettent de regrouper les units phrasologiques, de les classer selon leur
schma syntaxique intere, de les aiculer d' autres units
phrasologiques et d'tablir leur propos ce que Achad et Fiala (1 997)
T. Jeanneret : Constructions prfabriques 4 7
appellent des treillis d' ordres partiels organiss en fonction des
substitutions et/ou des insertions qu'elles perettent
8
.
En dfmitive, pour slectionner les champs o devraient s' exercer la
description et l' enseignement grammatical, il ne faut pas tenter de t
une fontire ente les constructions das lesquelles la commutation sur
l ' axe paradigatique et la libert de composition sur l' axe syntagatique
sont libres et les constructions qui ne relvent pas de la gammaire p
que la libert combinatoire y est nulle
9
. Il faut admettre qu' il y a un chap
immense de constructions o les concurences paadigatiques sont
affaiblies mais non inexistantes, o les mcaismes de construction relvent
la fois de la gammaire et du lexique et doivent donc reposer la fois sur
la matrise de mcaismes combinatoires constitutifs du fais et sur la
mmorisation. En d'autres mots, il faut ouvrir l'enseigement de la
gramaire l'enseigement du vocabulaire d'une pat, celui d
l'expression crite d'aute part.
8
Au del de sa maladresse ventuelle, cet exemple tir du mmoire d' une
tudiante francophone illustre ce jeu potentiel entre prstructuration (au fil
du temps) et rutilisation du schma (au fl de travail, au fl de sjours
linguistiques ( ?)) : C'est au fl du temps, de travail et aussi peut-tre de
sjours linguistiques en pays francophones, que l 'apprenant va pouvoir
acqurir une plus grande connaissance de la langue.
9
Notons en passant que l a frontire entre pr- et noconstruction est srement
fuctuante tous les niveaux de la description linguistique (syntaxe, lexique,
phonologie, pragmatique, etc. ) mais pas au mme degr.
48 Cahiers de l 'LSL, N1 3, 2002
R
RENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Achard P. & Fiala P. ( 1 997). La locutionalit gomtrie variable, in
P. Fiala, P. Lafon & M. -F. Piguet, La locution : entre lexique, sntae
et pragmatique, Paris : Klincksieck, p. 273-284.
Atkinson D. ( 1 990). Discourse Analysis ad Written Discourse
Conventions, Annual Review ofApplied Linguistics I l , p. 57-76.
Auricchio A., Masseron C. & Per-Schirer C. ( 1 992). La polyphonie
des discours argumentatifs : propositions didactiques, Pratiques 73,
p. 7-50.
Besse H. & Porquier R. ( 1 991 ). Grammaires et didactique des langues,
Paris : Hatier.
Blanche-Benveniste C. (1 978). A propos des traits smantiques utiliss
en syntaxe : critique du tait +/- humain, Cahiers de linguistique 8,
p. 1 - 1 5 .
Blumenthal P. ( 1 999). Schmatismes dans les commentaires de presse :
analyse contrastive, in : G. Grciao (d.), Micro- et macroleme et
leur fgement discursi Louvain : Editions Peeters, p. 1 07- 1 28.
Borel M. -J. ( 1 985). Plans du discours : propos de l'enseignement de la
dissertation de philosophie, Revue internationale de philosophie 1 55,
p. 401 -41 2.
Boutet J. ( 1 994). Construire le sens, Bere : Peter Lang.
Chevallard Y. ( 1 991 ). La transposition didactique. Du savoir saant au
saoir enseign, Paris : Editions la pense sauvage.
Fiala P. (1987). Pour une approche discursive de la phrasologie.
Remarques en vrac sur la locutionalit et quelques points de vue qui s'y
rapportent, sans doute, Langage et socit 42, p. 27-44.
Gross G. ( 1 996). Les expressions fges enfanais, Paris : Ophrys.
Glich E. & Kraff U. ( 1 997). Le rle du prfabriqu dans les processus
de production discursive, in : M. Mains-Baltar (d.), La locution
entre langue et usages, p. 241 -276.
Leeman-Bouix D. ( 1 994). Les fautes de fanais existent-elles ?, Paris . L
Seuil.
T. Jeanneret : Constructions prfabriques 49
Moreau M. -L. ( 1 986). Les squences prformes : entre les combinaisons
libres et les idiomatismes Le cas de la ngation avec ou sans ne, Le
fanais moderne 54, p. 1 37- 1 60.
Pekarek Doehler S. (2001 ). Dislocation gauche et
organisation conversationnelle, Marges Linguistiques 2,
www.marges-linguistiques.com.
Perelman C. & Olbrechts-Tyteca L. ( 1 958). Trait de [ 'argumentation,
Bruxelles : Universit libre.
Cahiers de 1 tILSL, N 1 3, 2002, pp. 5 1 -83
Traduction anglais-franais et temporalit :
quelle reprsentation transmettre ?
Essai d' extrapolation vers une reprsentation didactique
Myria Mor
Universi de Lausanne, Ecole d fanais moderne
1 . INTRODUCTION
Cette rfexion est ne des difcults des apprenants de fnais langue
tangre, fquentant le cours de traduction aglais-fais l' EFM,
comprendre et matiser le systme tempor@l du fais. La pratique de la
taduction rvle avec pertinence les carts ente les deux lagues. Loin d
la spontanit de l' oral ou de l' apprentissage unilatral d
l ' crit -l' tudiant ne travaillat que dans la langue cible -, la traduction
met en relief l'nigme du passage de la langue 1 , lague repr de
l ' tudiant la lague cible. Il apparat clairement que la manire de
percevoir et de traiter les aspects temporels est trs difnte en anglais et
en fais. Il est en efe indispensable de tenir compte des rfexes ou
dveloppements cognitifs vhiculs par la langue premire. C' est das
sens que la pratique de la traduction reprsente u excellent moyen
auxiliaire d' aborder une langue seconde en ce qui concere les aspects o
les deux langues difrent. L' analyse contrastive peret de mete en
lumire le fonctionnement spcifque du systme temporel de la langue
cible, sous-tendu par celui de la langue premire.
L' tude de la temporalit en fnais reste probablement le noyau
fondamental de l'apprentissage du fais de mme qu'un problme
majeur dans la matrise de cette langue. L'une des interogations d
l ' enseignant concere la reprsentation temporelle tansmettre. Le but de
cette intervention est de tenter de s' carer d' une approche linaire telle
qu' elle continue tre vhicule communment. Celle-ci s' avre le plus
souvent insatisfaisante L elle n'of pas une vue d'ensemble mais f
appel un grand nombre de traits distinctifs ponctuels en vue d' efecter le
5 2 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
choix d' un temps verbal. L' apprenant est aen utiliser c que l ' on
nomme habituellement des recettes de cuisine. Cette pratique est
gnate parce que faillible pa essence; en outre, elle requiert de mmoriser
un gad nombre d'occurences pour perette ensuite le choix pa
balayage et limination. Il s' agit donc de prsenter la temporalit dans un
contexte global qui perete l' apprenant de rsoudre n' importe quelle
situation temporelle en prenat appui sur sa langue premire pour s' en
dtacher ensuite aprs avoir compris les mcanismes en jeu.
Dans ce but, nous nous proposons d'examiner l' alterance pass
simple (PS) / pass compos (PC) en fais en regard de l'alterance
simple past (SP) / present perleet (PP) en anglais en nous appuyant sur les
recherches efete en linguistique et en gramaire. Nous aborderons
galement l' imparfait (lMP) tant donn qu' il est indissociable du simple
past ds que l ' on traduit ce derier en fais. De plus, il est
automatiquement prsent en arire-fond si l' on traite du pass simple et du
pass compos. L' analyse contaste d' un document utilis dans les cour
de traduction ainsi que des extraits de romans actuels illustreront les
dveloppements thoriques. Comme la direction de cete intervention se
veut plutt didactique, nous viterons de nous attarder trop longuement sur
les thories linguistiques faises que tout le monde connat. Nous ne
survolerons donc que les tavaux essentiels : ceux de Benveniste (1 966)
dont les rfexions sur la temporalit
l
constituent le point de dpart toute
rfexion sur le systme temporel du fais; ceux de Weinrich ( 1 989) qui
a montr l' importance d'une gamaire textuelle et non pas seulement
phrastique. Ceci lui a permis de prsenter une mise en perspective du
systme temporel en fanais. Paralllement, il faut galement tenir compte
du ramnagement des catgories discours/rcit labore pa Ada
( 1 997), faisat apparate un PC nar tif aux cts du PS. Dans une
orientation plus spcifquement didactique, Vigeron ( 1 999) caactrise PC
et PS d' une manire simple et directement utilisable par les apprenats de
FLE. Une synthse des plus pertinentes -das la perspective de
l' enseignement du FLE -est prsente pa Bourdet ( 1 991 ). Le choix
n' est pas gratuit; tous les travaux mentionns penetent d' laborer une
vue d' ensemble du systme temporel et vitent une reprsentation linaire
ainsi que les caactristiques ponctuelles des difrents temps du fais . .
1 . 1 . TRAITEMENT DU PS ET DU PC PAR BENVENISTE ET
MERGENCE
D
'
UN PC NARRATIF D
VELOPP
PAR ADAM
Pour rendre compte de l'alterance PS/PC, il est indispensable de remonter
la distinction qu'a tablie Benveniste ( 1 966 : 238) ente deux plans
d'nonciation qu'il dsige par histoire et discours et selon lesquels il
1 E. Benveniste, Problmes de linguistique gnrale, 1966, volume l, chapitre
1 9.
M. Moraz : Traduction anglais-fanais et temporalit 5 3
distribue les diffrents temps du faais.
Le temps de base de l' nonciation historique, le pass simple, que
Benveniste dsige pa le tere de aoriste, a pour consquence d
gommer en quelque sorte la prsence du nar teur, comme il l' explique en
commentant des exemples d' nonciation historique ( 1 966 : 241 ). A
l ' inverse, le PC (que Benveniste dsigne pa le tere de paait) est
prsent comme le temps du tmoignage, de la prsence indispensable du
locuteur ou narateur (1 966 : 244).
Nanmoins, bien qu' il classe le pafait (PC) dans la catgorie des
temps du discours, Benveniste voque le rle nar tif du paait dans une
note dans laquelle il justife le choix des termes histoire et discours
pour dsigner les deux types . d'nonciation qu' il distingue ( 1 966 : 242,
note 2) :
Nous parlons toujours des temps du rcit historique pour viter le tenne
temps narratifs qui a cr tant de confusion. Dans la perspective que
nous traons ici, l ' aoriste est un temps narratif, mais le parfait peut aussi
en tre un, ce qui obscurcirait la distinction essentielle entre l es deux plans
d' nonciation.
En ce qui concere les temps composs, Benveniste montre qu' ils
maquent d' un ct une valeur d' accompli et de l' autre un rport
d' antriorit. Cette distinction s'avre importante pour dfmir et prciser
l ' emploi du PC
2
.
Cependant, ces fones ne contiennent pas en elles l' expression de
l' antriorit comme c'est le cas pour leur valeur d' accompli (P.L. G. l,
1 966, p. 247):
[ 8 4 o ] l' antriorit [des fonnes composes] se dtermine toujours et seulement
par rapport au temps simple corrlatif. Elle cre un rapport logique et intra
linguistique, elle ne refte pas un rapport chronologique qui serait pos
dans la ralit objective.
Un exemple avec le PC explique ce glissement (1 966 : 249) :
Ainsi de la forme de parfait j 'ai lu ce /ivre, o j 'ai lu est un accompli de
prsent, on glisse l a fore temporelle de pass j'ai l u ce /ivre l 'anne
dernire;j'ai lu ce /ivre ds qu 'il a paru.
2
1 0 Les temps composs s'opposent un un aux temps simples en tant que
chaque temps compos fourit chaque temps simple un corrlat au parfait.
Nous appelons parfait la classe entire des fore composes (avec avoir
et tre), dont la fonction -sommairement dfnie, mais cela suft
ici -consiste prsenter la notion comme accomplie par rapport au
moment considr, [ 4 o ] .
20 Les temps composs ont une autre fonction, distincte de l a prcdente : i l s
indiquent l ' antriorit. ( 1 966 : 246)
5 4 Cahiers de / '/LSL, N1 3, 2002
L'mergence d' un pass compos nar atif ( 1 966 : 242, note 2) est
fondamentale. La mise en vidence d'un PC nar atif dans le paysage
temporel du fanais a trouv un cho dans les travaux mens par Adam
propos de L'Etranger de Camus. Les schmas qu' il prsente (1 997)
montrent l' mergence de deux PC, PC 1 et PC2 qui rorientent
l'apprhension du systme temporel et permettent un rglage plus fn. L
PC 1 est considr dans sa valeur d'accompli, distanci du PC2 qui devient
temps du pass et acquier vritablement un statut nar tif pouvant
fonctionner en parallle avec le PS.
Le PC fait partie de ce que Adam nomme le monde actuel
(<discours), le PS de ce qu' il nomme le monde non-actuel (<histoire ou
rcit). Or, pour rende compte de l' utilisation du PC dans un cae
fctionnel, il tait impratif d' isoler un PC narratif aux cts du PS das un
ensemble rebaptis mondes rvolus (passs ou fctifs)>. Il s' agit donc de
deux faons dif rentes de raconter. La premire, ou digtisation lie,
indique la dpendance de ce qui est nar par rapport l' nonciateur, tandis
que la seconde, ou digtisation autonome, montre ce qui est nar
comme dtach de son nonciateur (Ada, 1 997 : 1 56) :
Pour construire un monde rvolu pass ou fctif, on a le choix entre une
digtisation sur un mode actualis -c'est--dire rattache, lie
l'actualit d'un narrateur -, et une digtisation sur un mode non
actualis -c'est--dire dtaches de l' actualit de la voix nonciative. En
franais, ces deux modes de digtisation correspondent l'opposition du
PC et du PS car, comme le notait dj Benveniste de faon certes encore un
peu succincte : Le repre temporel du parfait [PC] est le moment du
discours, alors que le repre de l'aoriste [PS] est le moment de l'vnement
( 1 966 . 244).
Comme nous le verons plus loin, la distinction qui s' tablit e
faais entre le pass compos et le pass simple n' apparait pas en anglais,
langue qui utilise le simple past ds qu'il y a dcrochae pa rapport a
moment de l'nonciation. Le mode nonciatif est stable en anglais. Il n'y a
pas de rancrage dictique. Que l'on emploie yesterday (<hier) ou, in
those days (< cette poque), on choisira toujours le simple past ca ces
organisateurs temporels marquent de toute faon dcrohage par rappor
au moment de l'nonciation. En fais, le choix du temps se fait e
fonction du contexte nonciatif, ce qui implique un acrae dictique
difrnt. Les deux indicateurs temporels mentionns ci-dessus en anglais
paricipent, en fais, de deux modes nonciatifs difrnts.
Hier -dans son interrtation dictique
3
-paricipe d'un mode
3
Il est important de prciser le sens dans lequel est employ l ' adverbe hi er.
En efet i l peut galement dsigner l e pass de manire gnrale, devenant
alors synonyme de autrefois. Uti lis dans cette acception, il ne participe
pas d' un mode nonciatif actualis et peut apparatre au ct d' un pass
M. Moraz : Traduction anglais-fanais et temporalit 5 5
nonciatif actualis et accompage le pass compos, alors que cete
poque est li au pass simple et fait partie d'un mode nonciatif
actualis. Si dans le mode nonciatif actualis Il ancrage nonciatif est e
relation avec la source nonciative, la sitation que le pass simple donne
envisager est tout fait difrente :
Dans le second mode de digtisation -aussi bien envisag, lui, par
Benveniste que par Weinrich -, l'ancrage des vnements peut tre di t
non-actualis. La trame temporelle, indpendante de l'actualit de
l'nonciateur, est prsente comme autonome par rappor l a situation de
production. Le rseau des rfrences est intere au monde construit par l e
texte. On peut dire que l'nonc cre ses propres points de repre. (Adam :
1 57- 1 5 8)
1. 2. L' IMPARFAIT PR
SENT
PAR H. WEINRICH AU TRAVERS DE LA
MISE EN RELIEF
Le choix de citer H. Weinrich n' est pas innocent; en efet, dans b
Grammaire textuele dufanais, il considre les problmes de langue das
une perspective textuelle et non pas seulement phrastique. Une telle
approche penet de s'loigner d' une prsentation linaire de la temporalit
en fais. Weinrich consacre le chapite 4 l'tude des difrnts temps
grammaticaux. Au deuxime paragraphe (1 989 . 1 1 7), l'auteur introduit une
distinction trs intressante concerant le sujet que nous traitons :
Le concept de temps recouvre dans la langue fanaise trois dimensions
smantiques : la perspective temporelle, le registre temporel et le relief
temporel.
Ce derier nous intresse plus pariculirement il traite des ef
de focalisation traduits par les temps, efet essentiels lorsqu' il s' agit
d' aborder l' imparfait. La mtaphore du thtre peut serir illustrer cette
derire dimension. Ainsi, les dcors correspondent l'arrire-pla tandis
que la scne, sur laquel1e se droule l' action, est comparable au premier
plan
4
.
La distinction entre arire-plan et premier plan reprsente un apport
simple, comme en atteste l 'exemple suivant : hier il gagna de grands tournoi s,
aujourd' hui il jouit d' un repos mrit.
Dans le cadre de ce travail, hier sera toujours compris comme un adverbe
dictique dans le sens de jour prcdent.
4
Cete reprsentation image se rvle tout fait perinente pour permettre des
apprenants dbutants moyens de visualiser les relations qu' entretient
l ' IMP avec le PS et le PC. Elle ofe directement une vision d' ensemble de la
situation et vite de propager les caractristiques ponctuelles de l ' IMP
souvent voques (telles que l ' ide de rptition, prsent dans l e pass, etc.)
pour dfnir ses emplois.
5 6 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
considrable l ' tude de la temporalit, ca elle pennet de caactriser les
rapports que l ' IMP entretient avec le PS et le PC, comme l' explique
Weinrich lorsqu' il traite exclusivement de l' IMP ( 1 973 : 142) :
L' imparfait est neutre pour ce qui est de la perspective temporelle. C' est
pourquoi il sert avant tout dsigner l ' arrire-plan dans les rcits. Quand
il participe la fonction de mise en relief, il altere avec l e pass simple [ . . . ]
et avec le pass compos et/ou avec le prsent [ . . . ].
L' IMP construit le dcor sur lequel les vnements vont s' inscrire
au moyen du PS, du PC ou encore du PRo
2. POUR LA PR TIQUE DE CLASSE : UNE APPROCHE
DIDACTIQUE
Dans une perspective didactique, il est indispensable de mentionner
l ' interprtation du couple PS/PC que donne Vigneron ( 1 999)
5
. L'auteur
compare le couple PS/PC la relation qu'entretiennent personnage et
personne. Ces deux dsignations vont penettre - des apprenats
mme dbutants -de dcrypter les spcifcits du PS et du PC. Alors que
le mot personne se matrialise dans la vie courte de chacun de nous,
personnage voque immdiatement une construction. Pour exister, le
personnage a besoin d' un crateur; la personne, quant elle, nous la
ctoyons tous les jours, dans la vie courante. Ainsi, A. Vigneron arive
cette conclusion ( 1 999 : 37) :
[ ... ] le pass simple met en scne des personnages, tandis que le pass
compos nous prsente des personnes. Voil pourquoi la di stinction
crit/oral n' est qu' une consquence et non une cause. En efet, pourquoi le
pass simple se rencontre-t-il le plus souvent l ' crit ? Parce que le lieu de
l a cration et de la mise en scne par excellence, est la litrature.
2. 1 . DEUX EXEMPLES LITT
RAIRES POUR PLACER LES
APPRENANTS EN PRISE DIRECTE AVEC LA PRATIQUE
Deux exemples tirs de la littratre pennettent d' illustrer les efe
produits par l' emploi du pass simple et du pass compos en fanais.
5
Annie Vigneron, Pass simple, pass compos, imparfait : pour y voir pl us
clair, Le Franais dans le Monde, n0307 (novembre 1 999).
M. Moraz : Traduction anglais-faais et temporalit 5 7
2. 2. DANIEL PENNAC, L PETITE MARCHANDE DE PROSE
Le premier exemple, tir de La petite marchan d prose
6
de D. Pennac,
illustre parfaitement le cas de l' intrusion du "rcit" dans le "discours".
Le passage slectionn
7
clt la partie II intitule, Clara se marie, das
laquelle Malaussne, le personnage nar ateur, relate sa rticence voir b
jeune sur prf pouser le directeur d'une prison de trente ans environ
son an. Dans le fagent en question, Clara, en robe de marie, arrive la
prison en compagnie de sa famille, ses tmoins et ses invits pour clbrr
son mariage. Elle dcouvre alors, pa l'interdiaire de la police, que son
ft mari a t assassin. Les forces de l'ordre n'ayant aucun moyen d
s'opposer la fene dtermination de Claa voir le corps, elle est
autorise entrer et constater les dgts, derire scne du chapite.
Cette scne est spae du reste du chapitre par un astrisque. L
coupure est donc maque typographiquement. Paralllement, ce passage
est presque entirement naratif, avec une seule phrase au discours direct (1.
39), alors que le reste du chapite qui prcde est compos en majorit d
dialogues.
D'un point de vue temporel, le temps de base de la parie qui
prcde l'astrisque (. 72-75) est le prsent :
Une pori re de voiture claque derrire le commandant de gendarmerie. El l e
claque for. Un type long Ce un faucheux s' avance vers nous [ .44 ]. I l se
pointe [ . o 4 ] . Celui-I nous dpasse, [ A . ], et se plante fnalement [ 4 o . ] (p. 72)
et dans les deriers paagraphes avat la coupure :
En efet, le commissaire divisionnaire Coudrier a tout l'air de penser [ . ]
(p. 74)
Le commissaire divisionnaire hoche douloureusement la tte [ ... ]. (p. 75)
Le lecteur est aen vivre l'pisode comme s'il y participait. En
revache, la derire partie du chapite 7 commence pa quate verbes a
PC :
Deux gendarmes ont cart les herses qui ont ray le silence.
J'ai pris le bras de Clara. Elle s' est dgage. (1. 1 -3)
Ces PC font basculer la naration dans le pass alors que jusqu' ici,
le lecteur suivait les vnements en direct. L'efe de personne
6
Voir Annexe 1
7
Daniel Pennac, La petite marchande de prose, Gallimard, coll. Folio 1 989,
pp. 75-77.
5 8 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
(Vigeron, 1 999) est toujours prsent.
La rupture temporelle survient la lige 6, o le texte passe
soudain au PS, d'une phrase l'autre, sans mme qu' il n'y ait chagement
de paragraphe. Le contenu smantique est li; le verbe l'infmitif prcdant
le point est repris directement aprs au PS : Coudrier et moi n'avions qu'
suivre. Nous suivmes (1. 5-6). La rupture est d'autt plus fore que le
PS est la premire personne du pluriel, persone qui est inaccoutme
avec le PS. Le nous reprsente ici deux personnages de la digse qui
vont se couler dans ce bref tableau.
Pourquoi avoir situ la rpture la ligne 6 alors que le passage a
PS aurait pu se fa directement aprs l'astrisque ? Il Y a probablement
une intention de mise en relief. La fore de PS la premire personne ne
risque pas de passer inaerue alors que, la lige 2, associe une
troisime personne, elle s'en serait touve banalise. En outre, cette ruptue
temporelle accompage galement une rptre d'actat. Ce n'est plus
Malaussne, le narrateur, qui mne le jeu mais sa sur. Le nar ateur ne f
que suivre le mouvement induit pa Clara. Cette derire gage ici son
autonomie pa rapport ce qui lui arrive. Elle n'accepte pas de soutien
extrieur, mme pas celui de son fre : J'ai pris le bras de Claa. Elle s'est
dgage. Elle voulait macher seule. Seule devat (1. 3-4). Tous les
lments sont donns dans ces trois phrases, montant que Clara devient
agent. Ds la rupture de temps, son prnom n'appaat plus - part das
le discours direct que lui adesse le gardien. Elle est dsige par : une
jeune maie (1. 7) et la marie (1. 1 0, 1 2, 1 5, 1 6, 22, 23, 26, 34, 47,
55, 57). Le dsigateur devient donc impersonnel. Le personnage perd son
identit propre pour ne garder que le statut temporaire de marie qui est le
sien dans ce chapite. Cette dpersonnalisation nous rend tout coup le
personnage moins familier, moins proche. Perdat le cr intime d'une
personne connue, il regage les rangs du personnage purement fctionnel,
impression que ne dment pas l'usage du PS qui, lui aussi sigale la
fction.
Le passage en lui-mme, das la faon dont il est dcrit rvle aussi
une ceraine impersonnalit. Elle est dnote d'ente de jeu, pa les deux
forules impersonnelles de prsentation de la scne, ce ft (1. 6) suivi de
ce ft (1. I l ), introduisant chacue une srie de verbes l'IMP qui
dessinent le dcor. Le passage s'achve galement avec une forule
impersonnelle : i l y eut (1. 63). Les actions qui ont lieu ente les deux
semblent elles aussi dpourues d'agents comme le montre l'emploi d
verbes pronominaux :
La pore s' ouvrit d'elle-mme [ . . . ] (1. 1 7)
Au milieu de la cour, un piano queue se consumait doucement [ . .,]
(1. 1 8- 1 9).
de mme que remploi de synecdoques qui reprsentent, pa des attributs
inaims, les agents anims que la marie croise sur son passage :
M. Moraz : Traduction anglais-franais et temporalit 5 9
Les casquettes des gardiens tombrent [ .4. ] (1. 21 ). Quelques moustaches
fmirent (1. 22). Le dos d' une main crasa une larme. (1. 22)
Dans ce dcor, le personnage cental du drae se dtache par b
mobilit :
1. 33-34 : . . . la marie parcourut, gravit, hata
l. 40 : elle repoussa et pntra
l. 49 : elle repoussa . . . et se retrouva
l. 57 : la marie ft un geste
En mme temps, elle est l'obserateur principal ca c'est elle que
s' appliquent les verbes de vision :
1. 16 : La marie ne regarda . . . . La marie fxait . . .
1. 55 : La marie contempla longuement ce qu'elle tait venue voir.
l. 60 : Elle pl aqua contre son il . . .
l . 62 : elle fixa une seconde encore . . .
Le fait que la marie se dtache de toute cette scne est aussi d la
manire dont elle est qualife, fgu de blancheur et de solitude (1.25-26,
1. 50-5 1 , 161 )e Le narrateur utilise mme la mtaphore de la neige -1. 1 0 :
il neigeait -pour remplir l'atmosphre de cette couleur blanche que
l'on retrouve tout aussi englobante la 1. 6 1 : . . . surgi on ne sait
comment de toute cette blancheur. La fgure de la mae devient
presque fantasmagorique comme l'indique le verbe fotter (1 . 26),
accentu par les deux adjectifs qualifcatifs fottante et silencieuse (1. 33).
Deux personnages, le gardien et le prtre, tentent d'agir e
s'opposant la marie. Leur opposition est illusoire. Celle du gadien,
exprime au subjonctif, reste inefcace. Celle du prte, plus nergique et
plus impressionnante n'en demeure pas moins sans efet. La dtenination
insufe par l'aour tiomphe de l'obstacle reprsent par les fores de
l' ordre et par la religion. La maie vient donc facilement bout des deux
uniques opposants anims placs sur son chemin.
La vitesse du rcit est rgulire, la proportion d'IMP et de PS est
quasiment quivalente 25 IMP conte 22 PS. Ce petit pisode avace au
moyen des PS. Nanmoins, la progession temporelle est renfore a
dbut par le connecteur puis (1. I l ) et dans le derier paaphe par le
mme connecteur employ deux fois (1. 57 et 63), c qui maque une
acclration. L'pisode s'achve d'ailleurs sur un rythme rapide scad pa
la succession de six PS, que ne feinent pas les deux uniques IMP de U
6 0 Cahiers de [ 'ILSL, N 1 3, 2002
derier paragraphe.
L'ensemble de l'pisode tudi s' inscrit dans un contexte nonciatif
difrent de ce qui prcde. D'un mode nonciatif actualis (Adam 1 997 :
1 52) le texte passe un mode nonciatif non-actualis (Adam 1 997 :
1 57) dont l'emploi du PS est l'indice manifeste.
Dans ce paysage nar tif, un adverbe habituellement considr
comme dictique, maintenant (1.23), vaut la peine d'tre analys ca sa
place ici parat incongre V que les dictiques pointent le monde actuel
(Adam 1 997 : 1 52 et 1 59).
Or ce fent se situe das un monde rvolu. Comment ds
lors rendre compte de l'association de maintenant avec l'IMP ? Macel
Vuillaume dans Grammaire temporele des rcits cite ce sujet A. Klum
( 1 961 ) et le commente la suite :
maintenant [ o o e ] cre immdiatement, en contact avec une actualit passe,
exprime l'aide de l'imparfait, un centre allocentrique qui [ ... ] donne
l'impression d' un transpor de l' actualit prsente [ . . . ]. D'o le sentiment net
d'une proximit psychologique. (KIum 1 96 1 : 1 64)
Ce qui signife qu' il y a pour le lecteur deux actualits : l'une solidaire du
processus de lecture, l'autre contemporaine des vnements narrs et, par
consquent, situe dans le pass. (p. 33-34)
Ce maintenant renvoie au prsent de Malaussne qui, jusque-l a
principalement racont l'histoire en digtisation lie dans un mode
nonciatif actualis, mode qui donne un efe de rel ca il ne maque pas
de rupture nette avec le moment de l'nonciation. Paralllement, cet
adverbe donne l ' illusion au lecteur de voir l' pisode se drouler sous ses
yeux, malgr le choix d'un mode nonciatif non-actualis.
L' pisode se dtache du reste du texte et donne l'impression d'un
ar t sur image. Cela peut parate contradictoire avec la caactristique
intrinsque du PS, temps qui fait avacer le rcit pae qu'indiquant un
enchaement naratif. Ceres c'est sa fonction au sein mme du passage,
mais le PS tsfone globalement cet pisode en un tableau par,
distinct du mode nonciaif actualis dans lequel le nar ateur a rcont
son histoire jusque-l. L'ar t sur image est confn la f du texte
lorsque la mae sor son appareil photographique. Ainsi se terine le
chapitre : . . . , puis il y eut le grsillement d'un fash, et une lueur
d'terit. (1.63-64). Le dclenchement de l'appaeil photographique ft
enter la scne dans l'terit, de mme que le PS la fait enter das
l'immortalit de la fction, l'istalle dans le hors-temps.
M. Moraz : Traduction anglais-fanais et temporalit 6 1
2. 3. J.-M. -G. LE CL
ZIO, CELUI QUI N'AVAIT JAMAIS VU LA MER : UN
CAS D
'
ALTERNANCE PS
/
PC COMPLEXE
Sans avoir le loisir de l'explorer dans le dtail, il est intressant d'examiner
ici une nouvelle de J.-M.-G. Le Clzio qui vient dtruire l'ide rue
habituellement que PC et PS ne peuvent se ctoyer au sein du mme texte.
La nouvelle en question intitule Celui qui n'aait jamais vu la mer
dans le recueil Mondo et autres histoires relate l'aventure d'un lve de
Lyce qui quitte l' interat pour aller dcouvrir la mer dont il rve depuis
longtemps. L'histoire est nare par un de ses camades; curieusement
l'histoire continue sans interruptions mme aprs le dpa du protagoniste
pour la mer. Cependant, la fn du texte, le lecteur est nouveau confont,
comme au dbut, un nar ateu ignorant, demeur au Lyce. L
narateur de l'histoire de Daniel, une fois que ce derier s'est mis en chemin
pour la mer, est donc diffcile dteriner. L'hypothse d'un rve de la pa
de son caare nar ateur n'est pas soutenue pa le choix des temps
employs PS et PC, alors que le conditionnel et convenu ou peut-te
l' IMP. Elle est cependant suggre par le nar ateur la f de la premire
partie au PC :
Les professeurs et les surveillants rptaient cete petite phrase, en
haussant les paules, comme si c'tait la chose la plus banale du monde,
mais nous, quand on l'a entendue, cela nous a fait rver, cela a commenc au
fond de nous-mmes un rve secret et envotant qui n'est pas encore
termin. (p. 1 70, l. 26-3 1 )
Il faut remarquer galement que le narateur n'est pas catgorique sur
ce que Daniel a vcu aprs son dpart comme par exemple la page 1 70,
ligne 33 . Quand Daiel est ariv, c'tait sOrement la nuit. L'adverbe
srement implique u doute de la part du narrateur.
Cet adverbe est galement rvlateur d'un certain niveau de langue.
En efet, srement, dans le sens de certainement trahit un emploi
plutt familier; le narateur lycen appose ainsi sa sigature stylistique. L
processus est identique dans les pages qui prcdent o le PC donne une
rsonance quelque peu enfantine, perceptible dans un passage comme :
Les parents de Daniel se sont consols, parce qu' ils taient trs pauvres et
qu' il n'y avait rien d' autre faire. Les policiers ont class l'afaire, c'est ce
qu'il ont dit eux-mmes, et ils ont ajout quelque chose que les professeurs
et les surveillants ont rpt, comme si c'tait normal, et qui nous a paru,
nous autres, bien extraordinaire. (p. 1 70, 1 . 1 7-23)
Cette fore de constrction linaire du rcit o les phrases se
succdent relies pa la conjonction de coordination additive et, rlve
de la naration enfatine qui rconte au PC de mme que les nombreuses
mises en relief c'est . . . que, typiques de la manire de raconter de
l'enfat.
62 Cahiers de [ 'ILSL, Nl 3, 2002
La partie centrle du rcit racontat l'avente solitaire de Daniel
dcouvrant la mer est difcilement attribuable au nar teur lycen du dbut
p. 1 67- 1 70 et de la fm p. 1 87- 1 88 qui semble ne pas avoir quit le Lyce.
Cependant, le style et la manire de nar er ne changent pas immdiatement
comme le montre la premire phrase du derier paphe p. 1 70
commente ci-dessus. L'explication concerat la circulation des tains d
marchandises (p. 1 70, 1. 35 - p. 1 71 , l. 3) est galement celle d'un enfant :
Les trains de marchandises circulent surtout la nuit, parce qu' ils sont trs
longs et qu'ils vont trs lentement, d'un nud ferroviaire l'autre.
Le reprae des temps ente PS et PC est tout fait rvlateur.
Toute la parie introductive (p. 1 67, 1. 1 - p. 1 70, 1 . 3 1 ), atibuable sas
conteste au nar ateur lycen, est au PC. Survient ensuite une phae d
transition (p. 1 70, 1. 33 - p. 1 72, 1. 28) dans laquelle se mlent PC et PS.
Aprs les paoles de Daniel qui rpte "La mer, la mer, la mer . . . " (p.
1 72, 1. 28) est nar un premier pisode au PS concerat justement la mer,
qute ultime de Daniel (p. 1 72, 1. 29 - p. 1 77, 1. 1 4). Le rcit s' autonomise
comme l'atteste la prsence exclusive du PS -au dtiment du PC. L
paragraphe qui suit vient troubler cet ordre mlat nouveau PS et PC (p.
1 77, 1. 1 6-22); il est introducteur d'un nouvel pisode de la renconte ente
Daniel et la mer (p. 1 77, 1 . 23 - p. 1 86, 1. 35), pisode rdig au PS
comme le premier. La conclusion, dans laquelle sont rapportes les
interrogations du nar ateur lycen ainsi que les d
.f
rnts ractions du
public face au destin de Daniel, est au PC.
Cela donne la reprsentation schmatique suivate :
PC
A
PC/PS B
PS C
PS/PC B
PS C
PC
A
Cette structure schmatique rthme la nouvelle dans son ensemble
l'image d'une rime embrasse contenant deux rimes alteres.
Dans les deux passages o n'est employ que le PS, le stle change.
La fquence de la conjonction et pour relier les propositions ente elles
est plus faible, de mme que l'occurence de la fone cactr oral c'est
. . . que. Le vocabulaire ainsi que les images sont plus recherchs comme
par exemple p. 1 73 , 1 . 5-7 :
Elle (la mer) brillait dans la lumire, elle changeait de couleur et d'aspect,
tendue bleue, puis grise, verte, presque noire, bancs de sable ocre, ourlets
blancs des vagues.
ou p. 1 80, 1. 6-8 :
M. Moraz : Traduction anglais-fanais et temporalit 63
Dans l a lumire brise du soleil phmre, les yeux jaunes du poul pe
brillaient comme du mtal sous les sourcils prominents.
Nanmoins, l'alterance PS et PC demeure problmatique.
Comment l'expliquer et la justifer ? En se rfrt aux schmas de
l' annexe l , le cadre gnrl peut tre dfni comme celui des mondes
rvolus. Cependant, la narration oscille ente mode nonciatif actualis
et mode nonciatif non-actualis. Elle rvle une hsitation du nar teur
s'ef pour laisser le texte paler seul, pour laisser les vnements b
drouler de manire autonome, appels -la premire fois tout au
moins -par Daniel, comme on demade un conte "La mer, la mer, la
mer . . . N (p. 1 72, 1. 28). Ce genre de forule incatatoire rappelle un rituel
d'ouverture classique auquel le narateur cde en produisant un rcit.
Le nar ateu lycen rappaat ensuite le temps d'un brf paphe,
p. 1 77, 1 . 1 6-22, pou introduire la seconde exprience de Daniel fae la
mer. On reconnat le lycen, non seulement l'emploi d'un PC entre deux
PS, mais encore la forule de mise en rlief c'est l que . . . qui est
employe deux fois sur les sept lignes que compte le paragraphe.
Comme il a dj t mentionn, les deux passages o sont mls
PS et PC servent de transition. Le premier peret de passer de la baale
fgue des expriences au cactre quasi initiatique ou mythique entre un
enfat et le mystre de la mer. Il constitue le lien ente le fait divers et
l'exaltation de l'aventre et, pour aller plus loin entre la ralit construite
en tant que ralit en digtisation lie (donc narre au PC), et l'aventre
fctionnelle, en digtisation autonome (relate au PS).
Le second passage, constitu d'un paphe seulement, maque
une courte pause ente les deux expriences de Daniel, expriences dont
l'intensit augmente. Ces deux tansitions i solent et mettent donc en
vidence la confontation entre Daniel et la mer.
L'alterance PSIPC est galement lie au problme du narateur,
dont le statut change tout au long de la nouvelle Y qu'il reprsente, d'une
part, un caaade de Daniel en focalisation intere et d'autre part, un
narateur au style plus labor, en focalisation zro. Le premier passage o
PS et PC sont mls, laisse au narateur le temps de changer de costume.
La transition s'efetue de manire quasi imperceptible, de sorte que le
lecteur peu attentif se laisse prendre au pige.
3. PRATIQUE DE CLASSE (VISANT DES
M
TALINGUISTIQUES) : ABORDER LES TEMPS
REPR
SENTATION TEMPORELLE NON-LIN
AIRE
ACTIVIT
S
PAR U
Dans la perspective de l'enseignement du systme temporel en FLE, une
synthse perinente est prsente par Bourdet (1 991 ). L'une des inovations
est le fait d'avoir abandonn la reprsentation linaire des temps, o PS -
PC - IMP se retouvent invitablement du ct du pass, pour une
64 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
reprsentation en triangle avec le prsent (PR) au centre que Bourdet
considre comme le temps source. Une telle approhe of aux tudiants la
possibilit de se construire elx-mmes une reprsentation schmatique du
systme temporel. Cette activit demande une rfexion mtalinguistique
sur les difrentes relations qu' entetiennent entre eux les temps du fais;
c' est dans ce sens qu' elle s' avre utile des apprenants avancs, ca il ne
s' agit plus d' appliquer un systme dj conu un document existant,
mais de crer une reprsentation spatio-temporelle partir de pates
donns que sont les temps verbaux :
Un tel schma p en et de visualiser deux types de relations :
1 ) Les relations dictiques : celles que chacun de ces trois temps entretient
avec le prsent source : en allant du centre du triangle vers ses angles.
2) Les relations anaphoriques (ou spcifquement chronologiques) : celles
que chaque temps entretient avec les deux autres; prsentant ainsi des
couples complmentaires : Impaait / Pass compos, Impaait / Pass
simple et Pass compos / Pass simple; si l' on suit les cts du triangle.
(Bourdet 1 991 . 55)
Les relations indissociables, comme celles qu' entretient l ' IMP ave
le PS et le PC de mme qu' avec le PR, sont mises en vidence, ce qui
explique sa position au sommet du triangle.
.
En s' appuyant sur les apports de Weinrich (1 989) concerant
l' arrire-plan oppos au premier plan, Bourdet ( 1 991 ) cnr l ' IMP une
valeur chaire :
Arrire-plan du pass compos comme du pass simple, il joue le rle d' une
transition entre l'un et l'autre et penet leur difrence d'tre aussi une
complmentarit [ . . . ].
Cete caactristique se vrife au dbut du pasage tir de la Petite
marchande de prse de Pennac (1 989 : 75) :
Deux gendannes ont cart les herses qui ont ray le silence.
J' ai pris le bras de Clara. Elle s' est dgage. Elle voulait marcher seule.
Seule devant. Ell e connaissait le chemin des appartements de Saint-Hiver.
Coudrier et moi n' avions qu' suivre. Nous suivmes.
L' IMP permet la transition entre le PC et le PS, corespondant e
cela au temps du passage voqu par Bourdet
8
. L' auteur difncie ainsi
PR et IMP vitant la simplifcation qui consiste dire que l'IMP est un
8
On peut donc conclure sur l'imparfait en le dfnissant comme temps du
passage (aussi bien en ce qu'on ne peut vraiment l e saisir qu'en ce qu' il assure
les transitions indispensables). Il est ainsi la cl de vote architectonique du
systme temporel, si le prsent en est la source. (Bourdet, 1 991 )
M. Moraz : Traduction anglais-fanais et temporalit 6 5
PR du pass. Le rle de l' IMP poura te considr pour lui-mme, dans
la dimension et les spcifcits qui lui sont propres. Il est vident que la
notion d'arrire-plan, introduite par Weinrich pour caactriser l' IMP, rest
toujours prsente dans quelque emploi que ce soit. Ainsi Bourdet parle non
seulement de temps du passage mais aussi, de temps de l'efacement,
celui par lequel l' action voque se voit repousse hors de toute
actualisation possible :
Ce rle [celui de l'efacement] reste d'ailleurs identique selon que l ' on
considre l'imparfait sous l'angle des relations dictiques (il est l ' arrire
plan d'un prsent auquel il s'oppose et qu' il manifeste en creux) ou sous
celui des relations anaphoriques (il est l'arrire-plan d' vnements
raliss par des temps de premier plan : le pass compos ou le pass
simple, qu' il vient ainsi complter). (p. 55-56)
Parler d' efacement des limites revient saisir l' IMP dans son
aspect imprfectif en dpassant la dfmition gnralement admise pa
laquelle l' IMP dsigne un procs pass dans son droulement sans en
spcifer les limites. Cet ef aboutit une dlocalisation du temps
9
qui pen et galement d' expliquer comment l' adverbe dictique
maintenant se retouve aux cts de l' IMP das l ' extrait ci-dessous
(Pennac, 1 989 : 75-76) :
Quelques moustaches fmirent. Le dos d' une main crasa une lane. La
maie, maintenant, glissait dans les couloirs d'une prison silencieuse au
point qu' on pouvait la croire l ' abandon.
Si dans une reprsentation gaphique de la temporalit, l' IMP est
plac en toile de fond partir du sommet du triangle, le PS et le PC se
distribuent invitablement de chaque ct d' aprs la catgorisation
introduite par Benveniste (1 966) tant donn que leur difrenciation n'est
pas chronologique. Comme le suggre Leeman-Bouix ( 1 994), le PS ne
renvoie pas un pass plus lointain que le PC en juger par l'exemple que
donne Bourdet : Au temps o les Bourbons rgaient sur la France,
Louis XIV exera (a exer) le pouvoir de 1 662 1 7 1 5 (1 991 : 57). L
PS convient ici aussi bien que le PC. La df c entre PC et PS est
purement dictique et nonciative 1
0
. Ainsi, c'est dans le tpe de
rappors qu'ils (PS - PC - IMP) entretiennent avec le prsent qu'ils peuvent
te difrencis ( 1 99 1 : 57). Il note galement le rapport complmentaire
9
C'est ce qui se passe notamment dans Imparfait des Exercices d stle de
Queneau.
1 0
Comme le mentionne dj Benveniste ( 1 966), la nature de la diffrenciation se
vrife dans la morphologie verbale. Le PS est clairement difrenci du PR
par sa terminaison alors que le PC conserve la trace du PR dans l'auxiliaire
dont il est fonn, ce qui contraint l'interprter d'abord cmme un accompli
du PR, entranant sa suite la valeur passe de ce mme temps.
66 Cahiers de Z '/LSL, N 13, 2002
qu'entretiennent PC et PS. L'exemple illustrant le point de vue de Bourdet
confne d'ailleurs que la difrence ente PC et PS est purement dictique
et nonciative et elle s'exprime dans les relations entetenues avec le
prsent source (Bourdet, 1 991 : 58). La difrenciaion est mise e
vidence par la rpture ou non avec la source nonciative. Utiliser le PC ou
le PS marque une prise de position par rappor la source nonciative,
comme l' avait dj fonnul Benveniste ( 1 966 : 59).
Le PR, quant lui, est non maqu; il est donc possible de le
distribuer aussi bien au-dessus de la fontire sparant arrire-pla et
premier plan qu' droite ou gauche de celle qui spae rcit de ce que,
reprenant la teninologie de Weinrich, Bourdet nomme commentaire.
Une reprsentation linaire ne perettrait pas de rendre compte de la
souplesse du PRo
Dans un but didactique, il est intressant de proposer des
apprenants -quel que soit leur niveau -d' laborer un schma du
systme temporel du fais parir du triangle de base prsent p
Bourdet et d' un cerain nombre de temps donns. Un tel exercice pen et de
travailler chaque temps individuellement dans les relations qu' il entetient
avec les autres. Il sera galement ncessaire de leur demader d' illustrer
toutes les relations reprsentes pa un ou plusieurs exemples prcis et
dteninants ou de confonter leur schma des textes dj existants. L
but de l ' enseignement consistera guider la rcherche ainsi qu'
dvelopper toutes les extensions possibles pour exploiter au mieux ue
reprsentation schmatique de ce tpe. Elle ne tient videmment pa
compte des composantes psychologiques ni des vises stlistiques qui
peuvent infuencer l ' emploi d' un temps verbal, mais propose une bae
permetant l 'tudiant de dteniner quel temps choisir lorsqu' il traduit.
En laborant lui-mme un tel schma, l 'apprenant a la possibilit de se
rendre compte que le choix des temps n'est pas dict par des rgles isoles
qui s' appliqueraient au cas par cas et de raliser concrtement une vision
globale du systme temporel du fanais.
A titre d'exemple, nous prsentons ci-dessous une des
reprsentations schmatiques envisageables. Il est possible de proposer
d' autres solutions; en fait, chaque apprenat constira celle qui lui est
propre, c' est pourquoi il est indispensable de discuter chaque proposition
individuellement et de faire justifer les difrents choix.
La place du prsent n' est pas forcment aussi vidente dteniner
qu' il y parat au premier abord (sera-t-il galement un temps d' arre
plan). Le ft antrieur est difcile placer ca il a une vise rt
prospective. Nanmoins, si le travail de justifcation est f d' une
prsentation thorique et d' une mise l' preuve du texte, une
reprsentation de ce type penet de clarifer certaines relations temporelles.
M. Moraz : Traduction anglais-fanais et temporalit 67
Au tere de cette prsentation, il est incontestablement judicieux de
rejeter une reprsentation linaire des temps qui ne penet pas de rend
compte des positions du PC et du PS Y qu' ils ne s' opposent pas sur des
critres temporels-chronologiques. En efet, le PS prsente ceraines
cactristiques paticulires comme l'efet de mise distance afeive ou
comme le dsige A. Vigneron l'efet de personnage alors que le PC
renvoie U rapport plus personnel.
La cla d'une telle explication, de mme que sa reprsentation
image en fait son atrait. Les concepts prsents pa A. Vigeron b
rvlent accessibles n' importe quel apprenant mme dbutant, lui ofnt
des outils concrets pour matiser un rapport temporel paois difcile
saisir.
4. LE SYST
ME TEMPOREL DE L
'
ANGLAIS EN REGAR DE
CELUI DU FRANAIS
Ente l'anglais et le fais, l'apprhension de la temporalit est tout f
distincte. Les ereurs d' apprenants anglophones en fnais s' expliquent
notdent par le fait qu'il n'existe pas de corespondance litrale entre les
temps anglais et fanais et que leur usage en sitation difre.
Les difnces appaissent dj dans la maire de catgoriser la
temporalit. Alors que le fais ne possde qu'un seul terme, temps
6 8 Cahiers de l 'ILSL, N1 3, 2002
pour dsiger le temps qui passe (ass - prsent ft) et les fonnes
temporelles grammaticales, l'anglais, quant lui, utilise time pour le
temps qui passe et (denses pour les temps gmaticaux comme le
prcise Trvise ( 1 994 : 1 9) :
Les tenses s'organisent de faons diffrentes suivant les langues. L' angl ai s
ne di spose que de deux fones temporelles : le prsent et le pass. Le
franais, langue morphologiquement plus riche, en a davantage : le prsent,
le pas simple, l' imparfait, le ftur, etc.
La temporalit de base de l'anglais se construit donc en fonction du prsent
et du pass. Or, elle ne peut se concevoir sans faire appel la noti on
d'aspect et de modalit, notions avec lesquelles le francophone n'est gure
familiaris -mme si elles sont galement perinentes en fanais
l l
.
En anglais, le seul vritable temps du pass est le simple pas! (SP)
(Trvise 1 994 : 48) .
On s' intresse au pass, au rvolu en tant que tel. On s'intresse aux
vnements passs dans leur cadre pass. On exclut toute rfrence au
moment o l'on parle ou crit, toute rfren<ce now.
C' est cette valeur de dcrochage, valeur de base du prtrit, qui explique
ses emplois non temporels dans lesquels on retrouve cette valeur de
dcrochage, mais par rapport la ralit, [ 4 . +].
Cette valeur de dcrochage pa rappor la ralit est illustre p
des exemples d'noncs maquat l'hypothtique
l2
, le souhait
l 3
, contenat
l'expression it's time
l 4
, ou la fonne de politesse
l 5
. Revenat la valeur
temporelle du SP, l ' auteur ajoute :
1 1
Ce point est d' ailleurs relev par les auteurs de La grammaire
d'aujourd'hui ( 1 986) : En outre le fanais ne confre pas de marque
morphologique certaines oppositi ons aspectuelles marques dans d' autres
langues. C' est ce qui explique que la catgorie de l ' aspect a longtemps t,
dans la tradition grmaticale franaise, occulte par celle du temps.
1
2
If 1 didn't show up, he would simply walk over to my place and knock on the
door. (Auster, 1 992 : 90)
Si je ne U montrais pas, il viendrait chez moi fapper U porte. (Auster,
1 993 : 1 53)
1
3
1 wish 1 had a car to visit the countr
si seulement j ' avais une voiture pour visiter le pays.
1
4
It's time we went home
il est temps que nous rentrions la maison.
1
5
1 wanted to ask you a question
je voulais vous poser une question.
M. Moraz : Traduction anglais-fanais et temporalit 69
La valeur temporelle de dcrochage, quant elle, implique que l'on se rfre
quelque chose qui s'est produit avant le moment o l'on parle, un
moment donn du pass. L'vnement mentionn n'a rien voi r avec
maintenant, je n'en fais pas le bilan par exemple, comme avec le present
perlee! qui est une forme en rapport direct avec l'actuel, avec now.
Plutt que de parler de rupture de reprae avec le moment de
l'nonciation (Bouscaren, 1 99 1 . 24), il semble prfble d'employer la
notion de dcrochage par rapport au moment o l' on parle (moment
de l'nonciation)> (Trvise, 1 994 . 48), pour dfmir la valeur temporelle du
SP. L'auteur explique de maire claire la raison de ce choix, choix qui
met galement en relief la df rnce entre le prtrit anglais et le pass
simple (Trvise, 1 994 : 50) :
Contrairement au pass simple franais, le prtrit peut tre employ avec
des dterminants temporels dictiques, c'est--dire qui prennent un sens par
rappor au maintenant du sujet nonciateur comme dans l'exemple suivant :
1 bought i yesterda.
Yesterday est d'une certaine faon li avec now puisqu' il en tire son sens
(c' est--dire le jour avant le jour o je parle), mais il exclut le moment
prsent. L'action d'acheter est vue cmme en dcrochage par rapport
maintenant : je m'intresse cette action rvolue, dans son cadre rvolu.
C'est la raison pour laquelle il vaut sans doute mieux parler de valeur de
dcrochage que de rupture, pour expliquer les emplois du prtrit dans de
tels contextes o l'on utilise le pass compos en franais [ . . . ]
La conjonction temporelle yesterday, ou hier en fnais est
dictique et participe donc d'un mode d' nonciation actualis, ce qui exclut
son emploi avec le PS fanais qui lui ne peut se concevoir dans un mode
d'nonciation non-actualis.
Au contraire du SP, le pp n'est pas un temps du pass mais un
aspect (Bouscaren, 1 99 1 : 27-28) :
Il s'agit de l'aspect accompli. L'nonciateur prsente le procs comme ayant
atteint son terme. [ ... ] Sa valeur est celle d'un bilan dans le prsent de
quelque chose qui a eu l ieu antrieurement. [ . e ] Le repre est bien le moment
de l'nonciation; il n'y a pas comme dans le cas du prtrit de rupture avec
le moment de l'nonciation, mais il n'y a pas concomitance entre le moment
de l'nonciation et le moment o l' vnement s'est produit.
L'auteur contedit ensuite l'ide vhicule pa les grmmaires
traditionnelles selon laquelle le pp indique qu'une action ou un tat pass
se continue forcment dans le prsent ( 1 991 . 30). D'aprs elle, le pet
implique toujours un tat rsultant (id.).
Cette ide se trouve confmne et illustre pa A. Joly et D. Q'Kelly
70 Cahiers de l 'ILSL, N 13, 2002
(1 990 . 283-284) :
[ 4 4 ], l prsent parfait signale essentiellement le rsultat prsent d' un
vnement pass et l'exprience que cela peut reprsenter pour le sujet de
l' nonc :
[8] 1 have lived in Chelsea
[9] 1 have fnished my work
[ 1 0] l've forgotten my glasses
4. 1 DISTINCTION ENTRE LE pp ET LE SP
(= 1 kow al about it).
(= so now 1 can go to the cinema).
(= as a result 1 can't see properly).
La distinction ente le pp et le SP peut s'expliquer en comparat deux
phrases semblables, une fois au pp et l'autre fois au SP (Trvise, 1 994 :
1 6) :
l've lost my gloves
1 lost my gloves
Vu qu'aucune prcision n'est donne pa l'emploi de connectus
temporels ou spatiaux, pp et SP sont possibles dans c cas. Nanmoins,
l'vnement est focalis de manire difrente selon que l'on utilise le pp ou
le SP. L'emploi du pp insiste sur le fait que le locuteur est sas gants
tat rsultant de l'vnement rvolu perte des gants; Ive /ost my g/oves
pourrait rpondre une constatation telle que : <<our hand are co/.
Le SP, quant lui, mentionne uniquement l'vnement pass das
son cade pass mais ne dit rien de l'tat actuel du locuteur qui pourait
avoir foid aux mains, consquence directe de l'absence de gants.
Par consquent, la vise est difrt selon que l'on emploie le pp
ou l e SP. C'est ce que metent en vidence Joly et O' Kelly ( 1 990 : 286-
87) :
Le prsent parfait situe donc le sujet de l'nonc dans l'aprs de
l'vnement exprim par le verbe lexical, C qui implique avec le prsent de
parole un lien interprtable en termes de suite, de rsultat, pl us
gnralement d' efet. Si ce lien n'est pas tabli, le prsent paait est
abandonn au proft du prtrit.
Que l ' on parle de bilan dans le prsent (Bouscaren, 1 991 ), d
rsultat prsent d' un vnement pass (Joly et O'Kelly, 1 990 : 283-284)
ou d' effet (Joly et O'Kelly, 1 990 : 286-87), la dmache revient dfir
une valeur identique sous des agles difrents. Das tous les cas, il s' agit
de prsenter les consquences, dans le prsent, d' un vnement qui a eu
lieu auparavat. Le bilan donne une vision rtoactive plus dfmitive alors
que parler en termes d'efet marque la continuit; cependat, tous deux
M. Moraz : Traduction anglais-franais et temporalit 7 1
s' attachent la consquence.
Joly et O' Kelly illustrent ainsi leurs propos ( 1 990 : 286-287) :
Imaginons qu' la suite d'un accident de voiture, Peter soit immobil is avec
une jambe casse. On dira Peter has broken his leg, ce qui signifie
qu'actuellement Peter has a brokn leg. Mais, avec une autre vise, on peut
dire aussi Peter brok his leg. Dans ce cas, c'est l'vnement lui-mme qui
est focal is, et non son rsultat, i.e. l' immobilit de Peter, bien que cel le-ci
soit dduite du contexte de situation, [ . . . ].
En fanais, ce gene de nuances implicites ne peuvent s' exprimer au
travers du temps verbal comme c' est le cas en anglais. Il fada recourir
un verbe d'tat Peter a une jambe casse pour traduire l' efet donn pa
le present perfet (<Peter has brokn his leg) et un verbe pronominal
Peter s' est cass une jambe) pour rende le simple past (<Peter brok
his leg).
Dans les exemples ci-dessous, on emploiera le PC pour rendre les
deux noncs mis en situation dans un dialogue, c'est--dire dans ue
situation d' nonciation de discours :
[8] 1 have /ived in Chelsea
j ' ai habit le quarier de Chelsea
[ 1 0] l've forgotten my glasses
= j ' ai oubli mes lunettes
l've lost my gloves
= j 'ai perdu mes gats
v. s. 1 lived in Chelsea
v.s. 1 forgot my glasses
v. s. 1 lost my gloves
En anglais, le choix du temps verbal implique une activit de
dcodage de la part de l' allocutaire. Le sens implicite exprim en anglais b
perd lors du passage au fanais. Pour rendre ces nuaces en fais, il ser
ncessaire de recourir des modalisateurs, des constructions
priphrastiques ou toute aute fone d'explications. Ainsi, l've /ved in
Chelsea pourait se rende par : j 'ai habit Chelsea pendant un certain
temps (si l ' implication est uniquement temporelle) ou peut-tre par : j 'ai
quand mme habit Chelsea (si, l' afrmation ou la question laquelle le
locuteur rpond, sous-entend qu' il ne connat pas le quarier de Chelsea). Il
est vident que choisir des phrases isoles illustre clairement les df c
entre l'anglais et le fanais mais ne permet pas de trouver des solutions ou
de justifer telle ou telle taduction en fanais.
Cependant, la traduction du present perfct (PP) ne peut se rend
systmatiquement par U pass compos en fanais -d'autant plus que la
valeur de ces deux fores n'est pas identique. Il est des cas o le present
perect sera traduit par un prsent (PR), pa un IMP ou mme par un ft
antrieur comme l'illustrent les exemples suivants :
72
[ I I ] We have come to help you
nous sommes venus vous aider
nous venons vous aider
[ 1 2] They have arrived
ils sont arrivs (valeur d'accompli)
ils arrivent l' instant (= ils sont l)
[ 1 2' ] They have just arrived
ils viennent d'arriver
ils arrivent l ' instant
Cahiers de 1 'ILSL, N 1 3, 2002
[ 1 3] Emma : You haven't discovered any new writers, while l've been
away ?
(Pinter, Be trayal in Bouscaren, 1 991 : 3 1 )
Emma : Tu n'as pas dcouvert de nouveaux crivains pendant que j' tais
absente ?
Emma : Tu n'as pas dcouver de nouveaux crivains pendant mon
absence ?
[ 1 4] will lend you this book when 1 have read i t
J e te prterai ce livre quand j e l' aurai lu
L'emploi du present pereet ne corespond donc qu'en parie
l'usage que le fais fait du PC. Cependat, il est noter que, part les
exemples [ 1 1 ] et [ 1 2] qui ne contiennent aucun indicateur temporel
extrieur, la taduction du present perleet pa un PR en [ 1 2' ], un IMP e
[13] et un ftu atrieur en [ 1 4] , interviennent dans des circonstces
modifes temporellement. Dans l'exemple [ 1 2' ] c'est l'adverbe just qui
contraint l'emploi du PRo Notons que la stucture priphrastique venir
de est un cas particulier ca elle exprime un pass rcent et ne peut
s'employer ni au pass compos ni au pass simple en fanais. En outre, la
traduction respectivement pa l'IMP et pa le ftur atrieur dans les
exemples [ 1 3] et [ 1 4] est due l'emploi du present perfet das des
subordonnes temporelles. Das l' exemple [ 1 3], l' IMP peut te remplac
par un substantif -comme le monte la deuxime possibilit de taduction
avec mon absence. Il s' agit, dans ce cas, d' exprimer une dure non
bore dans le pass, certes, mais galement l'arire-pla, cade temporel
de la dcouvere de nouveaux crivains; en fais, cette continte
implique l' emploi de l ' IM. Quant l' exemple [ 1 4], il obit des rgles
de concordance des temps spcifques.
Si , pour les exemples [ 1 1 ] et [ 1 2] le fais accepte soit le pass
compos soit le PR, il n' en est pas de mme en anglais. Certains usages
du PR fais se taduisent obligatoirement par un present perleet e
anglais. Ainsi, exemple du tpe <<e vous apporte le livre que . . . ou je
viens rparer ton vlo sera ncessairement taduit par le present perfet e
M. Moraz : Traduction anglais-fanais et temporalit 7 3
anglais
l
6
. Paralllement, il vit l'tranger depuis deux ans se traduit
par he' s lived abroad for two years (resent perfect), alors que cett
proposition en anglais admet galement une traduction au pass compos
en fais i l a vcu l ' trager pendant deux ans compte tenu d' une
modifcation du maqueur temporel.
La traduction du SP est plus complexe; J. Bouscaren et J .
Chuquet 1 7 , indiquent trois possibilits :
Si en anglais le prtrit (= SP) est touj ours signe de dcrochage, quand on
traduit en franais, i l faudra choisir entre l e pass simple, l'imparfait et l e
pass compos.
Signalons encore une quatime possibilit
1 8
de traduction pa le
plus-que-parfait comme das les exemples suivats :
- 1 am a doctor you know. - Je suis mdecin, tu sais.
- Oh, you never told me. - Oh, tu ne me l' avais jamais dit.
o u
He asked me when we came.
Il m'a demand quand nous tions arrivs.
Le schma qui suit illustre concrtement ces difrentes possibilits :
il a march
He walked il marcha
il marchait
il avait march
En fait, le simple past employ pour paler d'un fait compltement
rvolu dans le pass, exprime toujours un dcrochage pa rappor au
moment de l' nonciation. On dira donc, he went to the movie
yesterday, l o le fnais emploiera un pass compos il est all au
1
6
<
l've brought you the book that. . . , <l've come to fx your bike.
17 Grammaire et textes anglais, guide pour l'analyse linguistique : remarque
du bas de la page 25.
1 8
Le SP peut galement se traduire par le subjonctif comme dans it ' s hi gh
time we went home qui signife i l est grand temps que nous rentrions la
maison mais l 'on quitte ici le domaine de la temporalit; c' est pourquoi
nous ne faisons que mentionner cette possibilit.
74 Cahiers de [ 'ILSL, N 1 3, 2002
cinma hier. L'indice du simple past est ici le dictique temporel
yesterday. En fais, le dictique hier est l ' indice du PC ca i l
paricipe d' une dixis primaire, lie un mode nonciatif actualis.
En comparant quelques exemples contrasts donns dans une
gammaie lmentaire de l'anglais (Eastwood & Mackin, 1 987 : 1 6), on
remarque que tous les exemples au simple past sont marqus par la
prsence d'un indicateur temporel prcis qui tablit comme rvolu, le
moment (pass) de l'action dcrit pa le verbe.
[ 1 5] They
'
ve opened the new road
Ils ont ouvert la nouvelle route
[ 1 6] 1 haven 't seen the exhibition yet
Je n' ai pas encore vu l' exposition
[ 1 7] It hasn ' t rained today
Il n' a pas plu aujourd' hui
[ 1 5] Yes, they opened it last week
Oui, ils l ' ont ouverte la semaine
passe
[1 6] Tom saw it in town on Saturday
Tom l' a vue samedi en ville
[1 7] And it didn't raiD yesterday
Et il n'a pas plu hier non plus
[ 1 8] Have you ever travelled by [1 8] Yes, we travelled to London by
pl ane ? plane six months ago.
Avez-vous dj pris l ' avion ? Oui, nous avons pris l ' avion pour
Londres il y a six mois
En fais, les exemples des deux colonnes se taduisent au pass
compos car ces phrases font toutes paie d'un mode nonciatif actuel ou
actualis comme le signalent les orgaisateurs temporels. Ces derier
dsignent des repres en relation avec le moment de l'nonciation et
participent donc d'une dixis primaire (Ada 1 997). En fais, le
reprage dictique dtenine la situation d'nonciation et, par consquent,
le choix du temps ente le pass simple et le pass compos. L' alterance
pass simple / pass compos en fais s' tablit donc en fonction d' un
cadre nonciatif lage. Tant que la situation d'nonciation demeure
inchange, il n' y a pas de raison de passer du pass simple au pas
compos et inversement -sauf efe stlistiques spciaux. La distinction
ne s'tablit pas de la mme maire en anglais qu' en fais. L'alterance
simple past / present perleet en anglais, est dfnie pa rapport
l' vnement qui peut te en dcrochage ou non avec un repre T 0 ,
corespondant au prsent de l'nonciateur. Ainsi, dans les exemples ci
dessus, yesterday, last week ou six months ago indiquent toujours
un dcrochage par rapport au moment de l'nonciation. L' intervalle peut
tre minime comme a minute ago; nanmoins, ds que le moment
prsent n' est plus pris en compte, il est nessaire d' employer le simple
past, qu' il s' agisse d' un passage purement narf ou d'un dialogue
comme l ' illustrent les extraits ci-dessous.
M. Moraz : Traduction anglais-franais et temporalit 7 5
4.2. ILLUSTRATION DES PARTICULARIT
S DU SP EN ANGLAIS ET DE
SA TRADUCTION EN FRANAIS
4.2. 1 . PATRICIA HIGHSMITH, BROKEN GLASS
L'exemple qui suit est tir d'une nouvelle de Patricia Highsmith, Brokn
Glass, ( 1 986 : 66, 70); il prsente deux applications du simple past dans
U contexte narratif. Sa transposition en fanais met en relief les difrnce
existant entre l ' anglais et le fanais. Il s' agit du mme pisode prsent
dans des situations d' nonciation difrentes. La premire fois ( 1 986 : 66),
la scne est dcrite la troisime personne par U narrateur extrieur :
Andrew was almost aIl the way home, when he saw the same black boy i n
the sae blue denim j acket coming towards him hands i n his pockets,
wh istling, swinging his feet out like a sai lor.
[ . 4 ] Then the big eyes of the boy met Andrew's, and his fgure cae on, sure
that Andrew would step aside for him. His hands and anns swung fe ,
maybe ready to give Andrew a shock by spreading out, as i he intended to
crash into Andrew. Now Andrew' s right hand clenched the bottom of hi s
package fnnly and pointed a corer forward, and this time Andrew did not
step aside. He simply kept his course. The boy's an s few out to make him
jump. Andrew was ready for the blow. He saw the point of the package hi t
near the white buttons on the blue shirt.
La mme scne est reprise page 70 dans un dialogue entre Andrew
et Kate o le protagoniste raconte ce qui lui est arriv ;
She (Kate) washed up the tea things, so Andrew would not get his hand
weter. Then he let her take the old bandage of When she saw that four
fngers had been cut she was very surprised. WeIl, it didn't happen the
way 1 toid il, Andrew said; 1 -this moring 1 saw this sae taU fel l ow
coming at U again -just to scare me out of his way as usuaI, 1 suppose.
But 1 didn't step out of his way, 1 let him walk right into the glass-point.
Dans les deux extraits, l' aglais utilise le simple past, sans tenir
compte des difrnces de contexte nonciatif. Cet aspect est
particulirement fappant si l ' on compare les passages identiques - narration
la troisime personne et rcit d'Andrew.
Narration la troisime personne : Dialogue :
when he saw the same black boy in the this moring 1 saw this sme taU
same blue denim j acket coming fellow coming at me again
towards him
and this time Andrew did not step But 1 didn't step out of his way
aside
76 Cahiers de l 'ILSL, N1 3, 2002
Le fais utilise le pass simple dans la naration la toisime
personne et le pass compos dans le dialogue lorsque Andrew raconte son
aventure car on se touve dans deux tes d'nonciation difrents.
Naration la troisime personne : Dialogue :
quand i l vit le mme jeune homme ce matin j
'
ai vu le mme grad tpe . . .
noir e . o
Et cette fois-ci, Andrew ne se retira Mais je ne me suis pas retir
pas
Il est clair que l e point de pivot n' est pas l e mme en anglais qu' en
fanais. En anglais, le dcrochage s'efectue en fonction d' un repre T 0 ,
corespondant au moment de l'nonciation, et se redfmit pour chaque
vnement. En fais, l'alterance entre pass simple et pass compos
s' tablit en fonction du systme nonciatif mis en place. De plus, le temps
choisi reste identique tant que le contexte nonciatif ne chage pas, moins
qu'un efet stylistique ne soit vis.
4. 2. 2. PAUL AUSTER, L
VIATHAN
A l' inverse, on peut obserer un rcit deux voix lors du passage de
l ' anglais au fais comme l' illustre la traduction d' un roman de Paul
Auster, Lviathan. Il s' agit d' un roman des anes quatre-vingt
dix - 1 992 pour le texte original et 1 993 pour la traduction. Le rcit est
crit la premire personne. Le narteur rconte la vie d'un ami crivain,
Sachs, son amiti avec lui ainsi que leurs diverses interactions. L
traduction s' ouvre sur un pass compos, pari pris de traduction
probablement en vue d' accentuer l'efet de tmoigage sur le vif ou de
feindre le fait divers. Ce pass compos taduit une fone de simple past
impos par l' organisateur temporel six days ago qui implique un
dcrochage par rappor au moment de l' nonciation :
Il Y a six jours, un homme a t tu par une explosion, au bord d'une route,
dans le nord du Wisconsin. [0 0 ']
'
(p. 1 3)
Six days ago, a ma blew himself up by the side of a road in northern
Wisconsin. [ . . . ] (p. 1 )
Or, plusieurs reprses au cours du rcit i l y a intrusion du pass
simple. Il ne s' agit pas de passs simples isols, mais de passages entiers
traduits au pass simple, formant un tout cohrent. Utilis de cette manire,
le pass simple permet de dtacher cerains passages, de les mettre en scne
pa rapport la naration au pass compos. L' pisode qui raconte la
premire renconte ente Sachs et le nar ateur dans un ba new
yorkais -dans lequel tous deux devaient f une lecture de leurs uves
M. Moraz : Traduction anglais-franais et temporalit 7 7
respectives -donne un exemple reprsentatif d' un passage au pass
simple, insr dans une narration au pass compos. L' introduction de la
rencontre est relate au pass compos :
La premire fois que nous nous sommes rencontrs, il neigeait. [0 0 ' ] C' tait
un samedi aprs-midi de fvrier ou de mars, et nous avions tous deux t
invits donner une lecture de nos uvres dans un bar du West Village.
[ . . . ] (p. 26-27)
The frst time we met, it was snowing. [ ... ] It was a Saturday afemoon i n
February or March, and the two of us had been invited to give a j oi nt
reading of our work at a bar in the West Village. [ . . ] (p. 9)
Suit un passage au plus-que-parfait (PQP) o le narrteu prcise les
circonstances dans lesquelles il a accept de participer cette lectre, ainsi
que ses recherches propos de l' uvre de son confre. La rencontre en
elle-mme dbute au pass simple :
Le hasard voulut que cette lecture n'eut jamais l ieu. Une formidable tempte
arriva du Midwest le vendredi soir et le samedi matin cinquante centimtres
de neige taient tombs sur la ville. [ . . . ] (p. 28)
As chance would have it, an immense storm blew in fm the Midwest on
Friday night, and by Saturday moming a foot and a half of snow had fallen
on the cit. [ . . o] (p. 1 0)
Le rcit des prparatifs, du tajet jusqu' au bar, des vnements qui
s 'y droulent est galement au pass simple :
Je m' emmitoufai dans mon manteau, enflai des galoches, fourrai le
manuscrit de mon dernier rcit dans une des poches de mon manteau, pui s
me lanai dans Riverside Drive, [ .. e ]. J' arrivai ce bar dnomm Nashe 's
Tavern deux heures dix. [ . . . ] Je m' installai sur un tabouret et commandai un
bourbon. [ . . . ] Alors que j 'en tais l a moiti de ce verre, un autre cl ient
entra dans le bar. [ . . . ] (pp. 28-29)
1 bundled up in my overcoat and galoshes, stuck the manuscript of my most
recent story into one of the coat pockets, and then tramped out onto
Riverside Drive, [0 0'] . 1 made it to Nashe 's Tavern at ten past two. [ . . . ] 1 sat
down on one of the barstools and ordered a bourbon. [ ... ] Midway through
that second bourbon, another customer walked into the bar. [ e + . ] (pp. 1 0- 1 1 )
Une conversation s' engage alors ente le barman, Sachs et le
narrateur. Les verbes introduisant les diverses rp liques au discours direct
sont aussi au pass simple :
-Pas tout fait, rpliqua l' homme la tte enroule d' une charpe. [ . 8 . ]
(p. 3 1 )
78 Cahiers d [ 'ILSL, Nl 3, 2002
Not quite, said the man with the scarf wrapped around his head. [ . . . ]
(p. 1 2)
Ce n' est qu' la f de cete interaction que le pass compos
rapparat, au moment o l' amiti entre Sachs et le nar ateur est scelle :
C' est ainsi que notre aiti a commenc : sur les tabourets de ce ba dsert,
o nous nous sommes mutuellement ofert boire jusqu' ce que nos fonds
tous deux soient puiss. [ . . . ] (p. 32)
That was how our friendship began -sitting in that desered bar ffeen
years ago, each one buying drinks for the other until we both m out of
money. [ . . . ] (p. 1 3)
Le narateur donne ensuite son opInIon propos de Sachs. L
rappor ce qu' il dit est videmment plus personnel.
Dans tous les passages cits ci-dessus, l' anglais emploie le simple
past comme temps principal de la naration. Aucune variation n' est
possible tant donn que les faits relats sont invitablement en drochae
par rapport au moment de l' nonciation. En faais, le choix entre le pass
simple et le pass compos relve d' un pari pris de traduction (Chistine
Le Buf 1 993). Utiliser le pass simple pour l ' pisode de la lecture
littraire contribue le tenir distance; cela revient mettre cet pisode e
fction. Le nar ateu y acquiert un statut de personnage. Cet exemple
illustre paaitement l'efet de personnage c par le pass simple
(Vigneron, 1 999). Le pass compos, quant lui, permet de raconter de
personne personne. Le choix de Christine Le Buf est sigifcatif. Ds
que les propos deviennent plus personnels, que le nar ateur relate des
vnements avec lesquels il se sent directement li, le pass compos
appaat das le texte en faais.
5. CONCLUSION
Au terme de cette prsentation, diverses conclusions s' imposent. Force est
de constater qu' exposer les temps du fais l' aide d' une reprsentation
linaire ne refte pas rellement les rapports qu'entretienent ces temps
ente eux. Etant don que leur difrenciation ne se ralise pas forcment de
maire chronologique, opposer pass lointain pour le PS pass proche
pour le PC n' est pas un critre pertinent. En outre, une reprsentation
linaire ne rend pas compte de la position ni des caractristiques de l ' IMP
qui peut exprimer l' ar ire-pla -qualit spatiale et non pa
temporelle -ou servir dlocaliser le temps, suspendre le cours des
vnements. Repenser la temporalit en fais conduit donc l 'enseignant
remettre en question les reprsentations linaires taditionnelles. Pour
faie, il est impratif de recourir des exemples concrets extraits de la
M. Moraz : Traduction anglais-franais et temporalit 79
littrature, d' articles de jouaux ou mme de documents oraux, qui
permettent l' apprenant d'observer concrtement les interactions ente les
temps, ainsi que les efets des organisateurs temporels dans un contexte
spcifque donn.
Pour obtenir une vision d' ensemble, il sera imporant de travailler
partir d' exemples textuels consquents, la phrase tant trop resteinte et
limitative. Le fonctionnement textuel du fais ne se laisse pas enfen er
dans U ensemble de rgles ou de catgories rigides, ni rduire une srie
de recettes de cuisine. Il est ncessaire que les apprenants le constatent pa
eux-mmes en se confontant aux textes. Pour dpasser le seuil du constat,
il faud donner l' apprenant la possibilit de construire sa propre
reprsentation de la temporalit, ce qu' il fe au travers d' une rfexion
mtalinguistique. La difcult consiste ici viter de retomber dans des
visions traditionnelles fondes sur une conception syntaico-gramaticale
fagente, pour conserver la vue d' ensemble ofere par l' approche
textuelle. L' ide que l 'apprenant se constrise U schma personnel pair
d'une stcture de base en triangle care une reprsentation linaire, tout en
laissant une certaine autonomie dans la disposition des difrnts temps.
Les deux dmarches, activits pratiques et rfexion mtalinguistique sont
ncessaires l' apprentissage.
Quant la pratique de la traduction, elle met en lumire les
difrences ente la langue premire et la lague cible. A condition de ne pas
constituer elle seule la technique d' apprentissage -ce qui n' est
heureusement plus le cas depuis de nombreuses anes -elle reprsente
une tape relais. Cela permet d' enter dans la temporalit pa l ' angle du
connu, c'est--dire avec un sentiment de conface renfor. Le recours la
traduction met en lumire les limites du systme temporel de chacune des
deux langues, ainsi que les paicularits de son fonctionnement. L
traduction illustre le fait que la lague est une matire vivante, qu' il f
modeler et qui ne se laisse pas emprisonner das des stctures pr
tablies -ce qui droute d' ailleurs les apprenats qui aimeraient pouvoir
s' appuyer sur des moyens d' analyse plus noratifs. Si des exercices
ponctuels sont utiles pour mettre en place certaines notions, il convient
galement de privilgier des exercices textuel s qui ofet une vue
d' ensemble. L'apprenant poura ainsi vrifer par lui-mme l' importance
d' analyser non seulement la forme verbale en elle-mme, mais galement le
contexte nonciatif dans lequel elle se situe, ainsi que les marqueurs
temporels qui l'accompagent. Le passage, de l' anglais au fnais en U
qui nous concere, ncessite une aalyse de la situation dans la langue
source, de mme que dans la lague cible. Examiner les difrnces ou les
particularits d' une langue en prenat sa propre lague comme rfce
permet l ' apprenat de consolider les fondations de la langue tgr
qu' il tudie, vu que la situation de dpar lui est familire. C' est pourquoi,
le recours la traduction se rvle un moyen auxiliaire utile pour complter
et approfondir les apprentissages dans une langue trangre.
8 0 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
R
RENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1 . Edition de rfrence des textes tudis :
Auster P. ( 1 992). Leviathan, London-Boston : faber and faber.
Auster P. ( 1 993). Lviathan, traduit de l'amricain pa Christine Le Buf,
Arles : Babel.
.
Highsmith P. (1 976). Brokn Glass and Other Stories, Copenhagen :
Grafsk Forlag, Easy Readers.
Le Clzio J. -M. -G. ( 1 982). Celui qui n'avait jamais vu la mer in Mondo et
autres histoires, Paris : Gallimad, folio.
Pennac D. ( 1 989). La petite marchande de prose, Paris : Gallimard, folio.
2. Dictionnaire
Robert P. ( 1 978). Le petit Robert, Paris : Socit du nouveau Litr.
3. Grammaires de franais langue trangre
J udge A. & Heoley F. G. ( 1 983). A Reference Grammar ofModern French,
London : Arold.
Weinrich H. ( 1 989). Grammaire textuele du fanais, Paris :
DidierlHatier.
4. Grammaires de franais langue premire
Arriv M. , Gadet F. & Galmiche M. ( 1 986). La gammaire d'aujourd'hui,
Paris : Flamarion.
Leeman-Bouix D. ( 1 994). Grammaire du verbe franais, Paris : Natan
Universit, fac. Linguistique.
Ru quet , M. & Quoy-Bodin J.-L. ( 1 988). Raisonner la fanaise : tue
des articulations logiques, Paris : Cl interational, Comment
dire ?.
5. Grammaires anglaises
Bouscaren J. & Chuquet J. ( 1 987). Grammaire et tetes anglais, guide
pour l'analyse linguistique, Paris : OPHRYS.
M. Moraz : Traduction anglais-franais et temporalit 8 1
Bouscaren J. (1 991 ). Linguistique anglaise, initiation une grammaire d
l 'nonciation, Paris : OPHRYS.
Eastwood J. & Mackin R. ( 1 982). A basic English Grammar, Oford
University Press-
Joly A. & O'Kelly D. ( 1 990). Grammaire systmatique de l'anglais,
Paris : Nathan Universit, Langues trangres.
6. Ouvrages et articles critiques
Adam J. -M. ( 1 992). Les Textes , tpes et prototpes, Paris : Natha
Universit, fac. Linguistique.
Adam J. -M. ( 1 985). Le texte narrati Paris : Nathan.
Adam J. -M. Rolad Barhes et le pass simple : un trs beau cadeau la
linguistique ?, Mlanges oferts Jean Pe tard, Etudes de Lettres.
Adam J.-M. (1 994). Pass simple et pass compos : une opposition
temporelle ou nonciative ?, Etudes de Lettres, janvier-mars, 1 994,
pp. 61 3-640.
Adam J. -M. (1 997). Le stle dans la langue, Lausanne-Paris : Delachau
et Niestl.
Benveniste E. ( 1 966). Problmes de linguistique gnrale, l, Paris :
Gallimard.
Benveniste E. (1 974). Problmes de linguistique gnrale, II, Paris,
Gallimard.
Bourdet J. -F. ( 1 99 1 ). Le systme temporel du fanais, pour une approche
pdagogique, Le Franais dans le Mond 244, octobre 1 991 , pp. 54-
64.
Herschberg-Pierrot A. ( 1 993). Stlistique de la prose, Paris : Belin.
Vigeron A. (1 999). Pass simple, pass compos, imparfait : pour y
voir plus clair, Le Franais dans le Monde 307, (novembre 1 999).
Weinrich H. (1 973). Le temps, Paris : Seuil.
8 2 Cahiers de l '/LSL, N 1 3, 2002
ANX 1
La petite marchande de prose (p. 75-77)
Deux gendanes ont ca les herses qui ont ray le silence.
J' ai pris le bras de Clara Elle s' est dgage. Elle voulait macher seule.
Seule devant. Elle connaissait le chemin des appartements de Saint-Hiver.
Coudrier et moi n' avions qu' suivre. Nous suivmes. Ce ft come si une
jeune marie passait la gendanerie nationale en revue. Les gendarmes se
redressaient en baissant la tte. Les gendarmes pleuraient le deuil de la
marie. Il neigeait sur la gendarmerie fanaise. Puis, ce ft au tour des
Compagnons Rpublicains de Scurit, le mousqueton au pied, de voi r l a
marie fendre leurs rangs. Eux qui venaient de caser allgrement du
prisonnier rvolt, ils sentaient maintenant leur cur battre dans leur
casque. La marie ne regarda ni les uns ni les autres. La marie fxait la haute
porte grise. La porte s' ouvrit d' elle-mme sur la cour d' honneur de la
prison. Au milieu de la cour, un piano queue se consumait doucement
pari des chaises renverses. Une f droite l ' envoyait au ciel. Les
casquettes des gardiens tombrent au passage de l a marie. Quelques
moustaches fmirent. Le dos d' une main crasa une larme. La maie,
maintenant, glissait dans les couloirs d' une prison silencieuse au poi nt
qu' on pouvait la croire l ' abandon. Blanche et seule, la maie fottait
comme un souvenir des vieux murs, les meubles, autour d' elle, semblaient
renverss depuis toujours, et les photos dchires qui jonchaient le sol (un
ftiste la tte penche, le poing d' un sculpteur autour du fe de son
ciseau . . . une corbeille papiers dbordant de brouillons tonnamment
propres, criture sere, ratures tires la rgle) des photos trs anciennes.
Ai nsi fottante et silencieuse, la maie parcourut les couloirs, gravit des
colimaons, hanta des galeries, jusqu' ce qu' enfn la porte qui tait le but
de ce voyage se dresst devat elle et qu'un vieux gardien aux yeux rougis,
aux mains tremblantes tentt de l'arrter :
- Il ne faut pas, mademoiselle Clara . . .
Mai s el le repoussa le gardien et pntra dans la pice. 1 y avait l des
hommes blousons de cuir qui prenaient des mesures, d' autres, un petit
pi nceau au bout de leurs doigts gants, qui poussetaient des millimtres, i l
y avait un prtre en prire, mais qui se redressa soudain, aube aveuglante,
chasuble dploye, tole folle, entre la marie et C qu' elle avait dcid de
voir.
Elle repoussa le prtre avec moins de mnagement que le vieux gardien et se
retrouva seule, absolument seule, cette fois, devant une fone dtruite. Cela
tait tordu, fg. Le corps montrait ses os. Cela n' avait plus de visage. Mais
cela semblait crier encore.
M. Moraz : Traduction anglais-fanais et temporalit 8 3
La marie contempla longuement ce qu'elle tait venue voir. Aucun des
hommes prsents n'osait mme respirer. Puis, la marie ft un geste dont i l s
durent creuser l e mystre, tous autant qu' ils taient, docteur et prtre y
compris, jusqu' la fn de leurs propres vies. Elle plaqua contre son il un
petit appareil photo noir, surgi on ne sait comment de toute cette blancheur,
elle fa une seconde encore le cadavre supplici, puis il y eut le
grsillement d' un fash, et une lueur d' terit.
Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002, pp. 85- 98
Au(d)tour du- thme : la grammaire
Martine Nicollerat & Claudine Reymond
Universit de Lausanne, Ecole de fanais moderne
Et si nous commencions par dfmir les mots du sujet ?
Au(d)tour : notre cours s'intitule Autour des textes traduits et c'est pa
le biais d'un travail de reforulation de textes traduits que nous allons
renconter la grammaire.
Thme : traduction de la langue materelle vers une langue trangre.
Grammaire : ensemble de rgles qui dterminent la maire selon laquelle
des lments (mots ou phrases) peuvent se combiner dans une langue et
le type d'inforations qui doivent tre explicites pour que les noncs
soient clairs (traduction personnelle de la dfmition de Mona Baker, In
other words, p. 83).
Notre propos ici est de dcrire quelques aspects grammaticaux pour
et de la traduction toutes langues. Nous partirons de la stcture du
cours tel qu'il a t imagin pour ensuite prsenter, partir d'exemples,
certaines catgories d'ereurs et les procds mis en place pour y remdier.
1 . TRDUCTION
Pour voquer la traduction dans une institution qui enseigne le fnais
comme langue tangre, deux adjectifs reviennent souvent : pdagogique et
difcile.
.
1 . 1 . UNE TRADUCTION PUREMENT P
DAGOGIQUE ?
Christine Durieu das Le Franais dans le monde, n0243, dfnit ainsi la
traduction pdagogique : C' est un exercice entirement ax sur u n
couple de langues en prsence et sur des corespondances linguistiques
prtablies. De plus, elle pore sur des textes ou des fagents de textes
fabriqus ou choisis pour la structure des noncs. Le critre de
8 6 Cahiers de l '/LSL, N 1 3, 2002
conception ou de slection des textes est qu' ils se prtent un exercice
de traduction pdagogique. Ce type d'exercice, orient vers le texte d
dpar, intervient donc en amont de toute sensibilisation la traduction
professionnelle. [C'est nous qui souligons.]
Ceres, nous sommes confontes un couple de langues ave
l'tudiantl qui prsente l'exercice, mais aussi une quinzine d'autes
langues. Quant aux textes, ce n' est pas nous qui les choisissons mais les
tudiants. Enfm, le goupe tat htrogne, la rfexion sur le choix du
texte, l'analyse du texte de dpa est trs difrt selon les personnes;
nous faisons avec le texte propos par l'tudiant. Mais le fait que le texe
traduire et sa (premire) traduction soient prsents la classe oblige celui
qui choisit se proccuper de la rception du texte. La traduction est de
toute faon faite en fonction d'un public qui ne sera pas satisfait s'il ne
comprend pas ce texte. Il y a automatiquement un accent mis sur le
message, le sens du texte, et pas seulement sur la langue.
Quand une tudiante chinoise doit traduire le mot sige lorsqu'il s' agit
de train, elle doit prendre en compte sa qualit : dur, mi-dur, mou. Si le texte
traduire voque un voyage en train pour aller d'un point un autre, peu
impore l a prcision. On achte un billet pour une place de Pkin
Shanga. Par contre s'il s'agit d'expliquer les modifcations de tarif en
fonction du sige, il faudra expliciter la difrence entre les types de siges
dans les trains chinois en ayant recours par exemple la notion de classe,
plus familire l'ensemble des personnes prsentes. Quoi qu'il en soit, i l
faut en tout cas voquer dans l a prsentation en classe l e fait qu'il y a
plusieurs types de siges dans les trains chinois.
La situation mme de la classe nous conduit mettre en vidence le
sens, le contenu du message autat que sa corection linguistique. Les
textes employs n' ont pas t tsfors dans un but pdagogique, leur
traduction est immdiatement lue pa dif rnts destinataires qui vont la
tester en quelque sorte. Notre cours se situe donc mi-chemin ente la
traduction pdagogique qui vise amliorer la comptence linguistique de
celui qui la pratique et la traduction professionnelle qui privilgie autant la
comprhension du texte de dpa que la mise en fore du texte d'arive.
1 . 2. UN EXERCICE PARTICULI
REMENT DIFFICILE ?
Nous travaillons dans le sens du thme, traduction de la langue tgre
vers le fanais, ce qui reprsente une difcult certine pour l'tudiant aussi
bien pour le lexique que pour la syntae : le sens d'un mot en contexte
n'est souvent pas le premier que propose le dictionnaire d'o une exigence
de persvrance dans la reherhe du bon mot qui dcourge vite les
1
Pour viter l ' inconfort de lecture, nous avons volontairement omis l a
fminisation des noms.
Nicollerat et Reymond : Au (d)tour du thme: la grammaire 8 7
tudiants. I l en va de mme pour la syntaxe trop souvent rendue par une
traduction littrale.
Aprs une premire correction de surface, les textes proposs sont
soumis la classe. La sigifcation du message est ainsi teste
immdiatement : si elle ne passe pas, on prcisera le sens d'un mot, d'un
goupe de mots. Mais le plus souvent, i1 s'agit de problmes plus
complexes qui obligent les participants mettre en question des schmas
solidement installs. Rappelons que si le changement lexical est rapide, le
changement gammatical se mesure l'aune d'une vie humaine. [Que l'on
songe, pour le fanais, l'emploi de plus en plus courant du subjonctif
avec aprs que : pour Riegel dans la Grammaire mthodique du franais,
on est contraint de constater que le subjonctif se rpand dans les
subordonnes introduites pa aprs que contre la logique et la corection
des puristes (p. 507).] L'infuence de la grammaire de la langue materelle
est d'autant plus prsente que les tudiants travaillent partir de cete
langue -qu'ils sont souvent les seuls conatre -, que les questions
poses par les autres participants les obligent revenir au texte de dpart,
le dcortiquer, le paraphraser puis f de mme avec le texte en
faais. Il faut bien admettre que la souplesse gmaticale exige pour
faire le pont d'une langue l'autre est une gymnastique salutaire mais
difcile.
Cependant, l'ouverture sur d'autres paysages linguistiques reprsente
l'un des attraits principaux du cours pour les tudiants. La classe comprend
en moyenne 1 5 langues difrentes; il y a en gnral quelques petits goupes
de personnes palat des lagues slaves, le chinois, le sudois, le
portugais; parmi les langues plus rares, l'hbreu, le farsi, le fnnois, l'arabe.
Les tudiants dcouvrent ainsi que dans certaines lagues l'ordre des mots
peut te trs souple, que des catgories de base de certaines lagues
n'existent pas dans d'autres ou sont plus riches : le genre, le nombre ou le
temps entre autres. Et encor n' avons-nous pas d'tdiant Navao, dont la
langue emploie la forme d'un objet comme catgorie gamaticale !
En outre, notre statut n'est pas celui du professeur de traduction :
nous ne possdons pas les cls du texte de dpa; le seul (ou
ventuellement les seuls s' il y a plusieurs tudiants de mme langue
materelle) les avoir est l'tudiat qui prsente le texte aux autres. Ds
lors, la relation qui s'instaure entre l'auteur de la traduction et nous, est trs
difrent de la relation enseigat-enseig traditionnelle. Nous devons
avoir recours aux connaissaces, la comptence de l'tudiat. Nous ne
pouvons que souponnen> certaines incohrences, certaines erreurs lies au
contexte, la culture, etc.
Ainsi cette traduction d'un titre d'un article de joural chinois :
Le premier rabais de billet de train,
85 % sur la ligne Sakura
En lisant ce titre et le texte qui reprend l'erreur, nous sommes intrigues par
8 8 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
l'ampleur du rabais. En discutant avec le groupe d'tudiants chinoi s, i l
s'avre que le rabais est de 1 5 % et non de 85 %. La traduction a invers l a
proportion.
1. 3. COMMENT S' ORGANISE CE COURS ?
Pratiquement, pendat les premires semaines du cours, pour laisser aux
tudiants le temps de trouver des textes, nous proposons divers exerice
de sensibilisation la traduction et travaillons sur certins aspects
linguistiques qui seront utiles aux tudiants, comme l'agencement des
phrases, l'ordre des complments, la place des adjectifs, la ponctuation, le
balisage du texte de dpart (technique qui consiste prvoir les endroits
qui vont poser problme en lisant le texte en langue source).
L'exemple suivant fait partie des exercices de sensibilisation. Nous
donnons la traduction littrale d'un passage et demandons aux tudiants
d' en proposer une version acceptable.
Traduction littrale
exemple fnnois - fanais
Ku
Lorsque
maatien
de la route
hetken
laidalla
au bord
Istuimme
tions assis pendant un moment
olin minakin vapaa
j 'tais moi aussi libre
ja sydamelta
et de cur
ja mielelta
et d'esprit lger.
iloinen
j
oeu
Traduction propose
Nous nous tions assis un moment au bord de la route; je me sentais
libre, j 'aais le cur joyeu et l 'esprit lger
2
.
2
A l'issue de notre prsentation, une tudiante fnlandaise nous a interpelles
pour nous dire que notre traduction ne rendait absolument pas la qual it
potique de ce faent ! Cette raction spontane illustre bien nos yeux
l' intrt passionn que peut soulever ce travail.
Nicollerat et Reymond : Au (d)tour du thme: la grammaire 8 9
Pour ar iver cete version, il y a eu en clase toute une srie de
fonnulations qui ont fait l'objet d'une valuation, de discussions. Cete
dmarche est bien reprsentative du type de travail qui se fait das le cours.
Par la suite, les deux heures hebdomadaires sont consacres la
prsentation de traductions par les tudiants. Chaque prsentation consiste
d'abord donner quelques indications sur l' auteur - raement connu ! -,
puis situer l' extrait, c' est--dire infoter sur le cadre nonciatif, la
structure, le ton, le registre, etc., enfn exposer les difcults poses par b
traduction.
Le texte de la traduction ainsi que le texte source sont remis
l' enseignant une semaine l' avace au moins afm qu' il puisse en faire une
correction et prpaer le matriel pour la sance. En efe, chaque paicipat
dispose du texte traduit. Les personnes de mme lague materelle
reoivent aussi le texte source. Les paicipats ont ainsi la possibilit de
poser des questions lies aussi bien la lague qu'au sens ou aux
rfrences culturelles et de suggrer des aliorations.
2. GRAMMAIR
Comme nous l'avons anonc au dbut, notre propos est avat tout de
montrer par des exemples prcis la maire dont nous abordons la
grammaire dans le cours Autour des textes traduits. Nous
commencerons pa des exemples d'ereurs ponctuelles pour lesquelles on
peut se contenter d'une aalyse (gmmaticale) du texte en franais a
d' apporer une correction.
2. 1 . LES D
TERMINANTS
Il y a dans toute la culture une sorte de pantomime et on doit prsenter au
monde entier l'aspect oriental de la pantomime. [du farsi]
L'tudiante a introduit un aicle dfni . . . mais on est ici dans le
o le nom est considr comme une notion, dans sa plus gde
gnralit : l'aicle zro constitue la solution. (Comparer : La culture d
cette rgion, si culture i y a, est trs pauvre. )
Il observait avec horreur son invite, laquelle poussait les cris perants
comme une marchande et exigeait la rponse afrmative. [du russe]
La solution propose par Adaczewski de considrer le choix ente
l'aricle dfmi et l'aicle indfmi comme un choix ente une valeur
9 0 Cahiers de l '/LSL, N 1 3, 2002
thmatique et rhmatique
3
ou comme un choix ente un retour en ar re,
un rappel, et une anonce de quelque chose de nouveau, constitue pu
nous une manire conomique d'envisager ce problme avec les tudiats.
Dans c cas, cris perants et rponse afnative sont envisags
comme des lments nouveaux pour le lecteur, on emploie donc raicle
indfni.
Notre corpus, pourtt vaste, ne comprend que for peu d'ereurs
d'emploi de rindfmi pour le dfmi. On peut observer pa ailleurs que
raabe n'a pas d'aicle indfni, le polonais, le russe non plus, le chinois,
le japonais, le vietnaien n'ont pas d'aticle. Sans l'avoir vrife, nous
avons une hypothse : en cas de doute, les tudiats recourent raicle le
plus. . . simple ou raicle de leur apprentissage du fnais (cf. la
prsentation du vocabulaire dans les mthodes de langue).
Une fois que les tudiants ont pris l'habitude du balisage, c'est-
dire du repre des problmes poss dans le texte taduire, nous leur
demandons de pratiquer rexercice tout seuls. Nous avons ainsi un corpus
imporant d'erreurs analyses, dont nous tirerons parfois des exemples :
l ' picerie elle a achet du saumon f, de l ' asperge, le faisan et l a
bouteille de champagne d' une bonne qualit. [du slovaque]
Remarque de Jl tudiante . chez nous l'asperge est un lgume si cher qu 'il
ne serait pas trange de n'en acheter qu'une. J'ai donc choisi la solution
du singulier
4
.
Le paitif n'est pas vraiment une bonne solution, mais cela pat
moins insolite qu' une aperge ! Par conte le fan et la bouteille d
champagne n'ont pas t bien analyss, sans parler d' une bonne qualit.
Ne pensez me pas faire une remarque votre agresseur, le baboui n
peut facilement vous mordre une parie du corps avec ses grands crocs. [du
russe]
Remarque de l' tudiante : dans le texte original, c'tait une partie de
votre corps. Je n'tais pas sre : soit laisser ainsi, soit changer. J'ai opt
pour le changement.
Le raisonnement complet n'est pas formul; renseignant optimiste
3 Nous reprenons ici la dfnition de ces deux notions dues l'cole de Prague :
thme et rhme entretiennent un rapport relationnel, le thme est ce dont o n
parle et J e rhme ce qu'on dit du thme. Le thme est gnralement quelque
chose de connu ou de prvisible grce au contexte alors que le rhme est une
information nouvelle.
4 A ce sujet encore, une tudiante est venue aprs notre prsentation nous
prciser que l' hypothse est valable seulement s' il s'agit de quelqu'un qui
habite en ville; car dans les campagnes, les asperges ne sont pas chres !
Nicollerat et ReYJnond : Au (d)tour du thme: la grammaire 9 1
peut esprer que cette solution a bien t choisie pour viter la rdondance
de l'inforation.
2. 2. LES RELATIFS
Par sa tiple fonction (gdaticale, de pronom et de subordonnant), le
relatif est d' un emploi difcile .
. . . et il porta avec lui les nuages, eux aussi de quatre couleurs, desquelles
tomba la pluie. [de l ' italien]
Dans cet exemple, c' est la fonction de pronom qui est vrifer : la
pluie tombe-t-elle vraiment des quatre couleurs ? Quand l ' on sait que
nuage est fminin en italien, on comprend l'ereur. Ce type d'ereur
peret galement de rppeler l' existence des fores simples du rlaf
pafois ngliges au proft des fores composes.
Quoi qu' il en soit, c' est souvent la fonction gmaticale du rlatif
qui est l'origine de l' erreur comme dans les exemples suivants :
J'tais si nerveux que je ne vis pas un bus que venait. J'eus tellement peur
que je laissai tomber un paquet que le bus roula dessus. [du portugais]
La remdiation passe pa le recours l ' analyse gammaticale de la
phrase, analyse facilite pa la reforulationltasforation de la phrase
complexe en deux phrases simples. Ce travail de dmontage peret
d' une part l'tudiant d'exprimer clairement chaque ide ou vnement
dans une structure simple et de mieux saisir les liens qui organisent c
ides ou vnements. Il lui penet d' autre part, en jouat sur des structues
du fanais, de prendr de la distance pa rapport aux strctes
gammaticales de sa lague materelle.
Dans le cas du relatif sujet, la dmonstration est simple : . . . je N
vis pas un bus. Le bus venait. Lorsqu' il s' agit d'un complment intoduit
par une prposition, il fut souliger l'importance de la prposition qui
introduit, dans la subordonne, le mot remplac. La deuxime phrase peut
te tsforme en . J'eu telement peur que je laissai tomber un paquet.
Le bus roula sur le paquet.
Ce tavail of aussi l' occasion de reforuler l 'vnement rouler
sur qqch. On dcouvre ainsi le verbe craser qqch. et on peut constater
que cette constrction autorise l' emploi du relatif que : . . . je laissai tomber
un paquet que le bus crasa.
La mre singe vint aussi et amena son petit chez lequel visage tait rid. [du
russe]
Ici galement la reforulationltansforation en deux phrases est
ncessaire pour une reconstction adquate : La mre singe vint aussi et
92 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
amena son petit. Le visage du petit tait rid. - La mre singe vint aussi
et amena son petit dont le visage tait rid.
On notera que fonuler la deuxime phrse en employat la
prposition chez est plutt maladroit : Le visage chz le petit tait rid.
On peut aller plus loin et constater que la phrase : Le visage du
petit tait rid peut aussi te fonule : Le petit avait un visage rid
ou encore C' tait un petit au visage rid. Ainsi la relative peut t
remplace par un complment prpositionnel : La mre singe vint aussi et
amena son petit au visage rid.
A ce point, il faut se demander si la fonulation est acceptable das
le contexte, ca le possessif son prend un aute sens : la mre singe
aurait-elle des petits qui n' ont pas le visage rid ?
Re fonu 1er, paaphraser, tsfoner pour dmonter sont autat
d' outils qui penettent l'tudiant de prendre de la distace, de s' loigner
des structures gdaticales du texte de dpa pour touver une
constuction faise adquate.
Ds que l'on aborde les catgories suivates, la source et l'tendue
de l'ereur ne peuvent plus te analyses partir du seul texte dans la
langue d'arive et il fat prendre en compte le texte dans la langue de
dpa.
2. 3. LE PASSIF
L'emploi de la voix passive des fns prcises (viter de mentionner le
responsable d'une action, prserer en position de sujet l'lment principal
d'un texte, faciliter le lien ave la phse suivate, etc. ) est u choix
stylistique auquel les tudiats ont peu recours. De plus, pour un certai
nombre de nos tudiants (chinois, japonais, vietnamiens), le passif est
connot ngativement : on le rsere un vnement nfate. Le premier
exemple cit prouve cet usage paticulier.
D'aprs ce qu'on rappore, cause de l'ouverture de l'autoroute, le nombre
de passagers du train Qi -Lu de Jinan Qingdao a t trs infuenc,
l' occupation n'est plus que de 40 50% auj ourd'hui. [du chinois]
Le passif n'a pas vraiment de raison d'tre tat donn que l'agent
responsable est explicite dans la phrase et peut devenir sujet du verb
l'actif : l'ouvertue de l'autoroute a infuenc le nombre de passagers du
train . . . Mais on sent bien ici la connotation ngative issue de l'emploi du
passif chinois.
Le reprsentant ft invit sorir dans le mpris gnral. Personne ne lui ft
de mal, car son geste ie contenait dj en lui la pire des punitions. En
efe i l fut retrouv peine une heure aprs dans les toilettes d ' un
restoroute de Modne. [de l ' italien]
Nicollerat et Reymond : Au (d)tour du thme: la grammaire 93
Le deuxime emploi du passif n' est pas la meilleure solution. En
efet le hros de cette histoire perd, au fl du texte, son statut de position
sujet pour devenir l'objet de la situation. Dans la derire phrase,
l'accent est mis sur l'endroit o a lieu l'vnement. Ainsi traduire pa on
le retrouva plus conforme au fanais est plus en accord avec la naration :
on dnie mme au reprsentant le statut de sujet grammatical. Voici
comment une de nos tudiantes rfchit ce problme :
[Lennart Rinder] signale que les lois concerant les soins forcs ne
prennent pas en compte le ftus. [du sudois]
Remarques de l'tudiante : Est-ce que l'expression (<lagarna inte tr
skivnt for) est claire ? En sudois cela veut dire : les lois ne sont pas
crites pour + a e
L sens est le suivant : <des lois qui existent ne sont pas rdiges pour
prendre en compte . . . Mais la phrase est inncessairement (sic) longue.
J'ai donc dcid de faire une petite modication donnant : les lois ne
prennent pas en compte.
Le commentaire ne souligne pas la suppression du passif et son
remplacement pa une fone de sens quivalent, mais clest bien de cela
qu'il s'agit. Par contre l'expression soins forcs das cette mme phrase,
nia pas provoqu de raction. Et pourtat l'analyse du verbe forcer
montre que dans le sens obliger qqn f qqch. , cette construction est
erone . . .
2. 4. L' ORGANISATION DE LA PHRASE
2.4. 1 . ORDRE DES MOTS
L'exemple qui suit nous fait mieux prendre conscience de l'efor ncessaire
pour parvenir recomposer la phrase fanaise.
Traduction lttrale du japonais
"
*
l
;
je f\
.
r: >
.
94 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
L'une des premires recettes que nous essayons de proposer au
tudiants pour rsoudre les difcults poses pa l'organisation de la phrse
et en paiculier l'ordre des mots en fais est d'avoir recours la
transposition. Nous dfmissons de la sorte, et d'une maire lage (! ), le
changement de catgorie gamaticale d'une lague l'aute.
Ainsi une expression telle que cause de ses ides opposes a
rgime turc . . . peut te aliore en transposat le paicipe pass e
nom : cause de son opposition au rgime turc . . . .
Autres exemples :
L' association est en train de renforcer ses lments de scurit pour se
dissocier plus des imitations [du polonais] .
Le goupe verbal renforcer ses lments de scurit peut t
remplac par le nom protection; quant l'infmitive de but, on peut lui
substituer la prposition contre : L'association est en train de ror
la protection contre les imitations.
2.4. 2. TH
ME/RH
ME
Certaines langues marquent clairement le statut rhmatique d'un lment e
le plaant au dbut de la phrase. L'exemple ci-aprs le montre bien.
Des vrits comme cela, Kadar a dit beaucoup. [de l'albanais]
La traduction littrale ne corespond pas du tout l'ordre habitel
des mots en fais. La place de l'lment d'information nouveau est e
principe aprs le verb et le sujet. Seule une mise en vidence trs for
pourrait te employe de cette faon, mais avec une reprise de l'lment p
le pronom en devant le verbe.
2.4. 3. ORDRE DES COMPL
MENTS
Autre problme fquent, J'ordre des complments, en particulier des
circonstanciels. Les phrases o l'on commence autement qu'avec le sujet
posent toutes sores de problmes celui qui traduit en fanais.
l'cole primaire Pioneer, l'ancien lve s'est rendu aprs avoir parl avec
des agents de police spcialiss dans cette sorte de crime. [de l'anglais]
La place des lments rend cete phrase ambigu : on peut
comprendre que l'lve a accept d'tre remis la police (d'autant plus qu' i l
Nicollerat et Reymond : Au (d)tour du thme: la grammaire 9 5
est question d'un crime) ou qu'il a mach jusqu' l'cole . . . ce qui tait le
sens de la phrase anglaise.
2.4.4. CONNECTEURS
L' organisation de la phrase tient aussi au bon emploi des connecteurs.
Le premier exemple concere le connecteur mais.
Mais le sol sous ses pieds tait immobile, il a me eu l ' impression de
vaciller en avanant. [du russe]
L' tudiat ne comprenait pas que l' on puisse voir dans cette phre
une contradiction. Nous avons procd par dconstruction et reforul les
units de sens en phrases simples :
- Le sol sous ses pied tait immobile.
-Il avanait.
-JI a eu l 'impression de vaciler.
(Il tait clair que le possessif ses et il renvoyaient la mme
personne.)
Cette refonulation met en vidence que avoir l' impression de
vaciller est en opposition avec le constat pos dans la premire phrase.
Ds lors, pour foruler corectement la phrase, il faut la reconstruire en
plaant le mais qui introduit l'opposition avant l' unit de sens avoir
l' impression de vaciller et employer le connecteur quand mme ou le
supprimer tout fait : Le sol sous ses pieds tait immobile mais il a
(quand mme) eu l' impression de vaciller. L' unit de sens i l avanait
peut efectivement se taduire par le grondif.
L' exercice a aussi penis de chercher des quivalents du mais,
dit de concession, comme pouant, cependant.
Le deuxime exemple concere le connecteur et.
Un des esclaves vit le vieux roi s'asseyant d'une faon bizrre dans un coi n
de sa chambre, repli sur ses jambes et son derrire royal frlait l e tapi s
brod. [de l'hbreu]
Voil une phrase dont la construction cre un sentiment d'tranget.
L encore en dconstuisant et reformulant, on comprend mieux o se
situent les problmes. Prenons les lments/ides pas pas :
- Un des esclaves vit le vieu roi. Rien signaler pour cet lment.
- Le vieu roi s 'aseant d'une faon bizarre dan un coin de sa chambre,
peut tre refonul en : Le vieu roi s 'aseait d'unefaon bizarre dans un
coin de sa chambre.
Dans cette premire phrase, le roi est sujet et il agit.
- Repli sur ses jambes peut tre reforul en . Le roi tait repli sur ses
96 Cahiers de l '/LSL, N 1 3, 2002
jambes. On constate que le roi est toujours sujet, mais qu' il n' agit pas :
on indique un tat.
- Son derrire royal frlait l tapis brod. Dans c troisime lment, on
constate que ce n' est plus le roi qui est sujet, mais son royal derrire . . .
La dconstction montre que la phrase de la traduction numre
trois lments l' aide d' une virgule et du connecteur et. Le problme est
que de l'un l' autre on change de point de vue : d'abord on a une action,
puis un tat et enfn un aute sujet. C' est l une progession manquant de
cohrence.
Pour reconstrire ces lments en une phase complexe, il faut donc
choisir un point de vue prcis et indiquer clairement tout changement de
thmatisation par un connecteur (qui peut te un subordonnant) ou une
ponctuation fore. Par exemple :
a) Un des esclaves vit le vieu roi s 'asseant d'une faon bizarre dans un
coin de sa chambre et (re)pliant ses jambes au point que son derrire
royal frlait le tapis brod.
Actions du roi et consquence, rsultat de ces actions.
b) Un des esclaes vit le vieu roi assis d'une faon bizarre dans un coin
de sa chambre, (re)pli sur ses jambes de sore que son derrire royal
frlait le tapis brod.
Etat, position du roi et consquence de cete position.
c) Un des esclaves vit le vieu roi s'asseoir d'une faon bizarre dans un
coin de sa chambre et (re)plier ses jambes; son derrire royal flait le
tapis brod.
Ces difrnts versions sont discuter avec l'tudiat pour voir laquelle
correspond le mieux au texte original.
Dans ces exemples, la remdiation passe pa le dcoupage en units
de sens ainsi que par l' analyse des liens logiques qui existent entre elles et
du point de vue adopt dans leur formulation.
2.4. 5. DE LA PHRASE AU TEXTE
Souvent aussi, il faut dpasser le niveau de l'organisation de la phe pour
aller celui du texte :
On a ordonn de nouveau des coupures de courant en Califorie cause de
la chaleur intense. Selon les experts, cet arrt de courant lundi, touchant
250-300 milles (sic) de consommateurs, n'tait qu'un faible chantillon de
ce qu'on peut s'attendre en t.
En arrtant les frmes qui ont U rabais sur le courant qu'elles reoivent, on
a pu maintenir la prestation de Plectricit lundi matin, mais avec la chaleur
augmentante, la situation est devenue intenable dans l'aprs-midi. [du
hongrois]
La premire phrase prsente un lment d'information nouveau : la
Nicollerat et Reymond : Au (d)tour du thme: la grammaire 97
coupure de courant. Dans une progression linaire, c rhme devient le
thme de la phe suivante, comme c'est bien le cas dans la deuxime
phrase. Au dbut du paphe suivant toutefois, la progression
thmatique devient difcile suivre. A cause d'une reprise incomplte du
thme prcdent, le sens est ambigu : les entreprises sont-elles ar tes
dlibrment ou le sont-elles pace qu'elles ne sont plus alimentes en
courant ? De plus une information n'est pas explicite : le fait que le rabais
est accord aux gros consommateurs.
Les ruptures et les maladresses au niveau thmatique ainsi que les
occurences de connaissances non parages, font partie des erur
globales, par opposition aux erreurs locales, deux catgories dcrites
par Shirley Carer-Tomas, dans La Cohrence Textuele. Si l'ereur
thmatique est certaiement due une maladresse de traduction, le cas de
connaissace non pae relve peut-te du texte de dpart. Difcile de
tracher, car ce travail n'a pas t discut en classe. Pour nous il est certain
que ce type d'analyse pourrait tre utile aux tudiants. Hlas, le temps nous
manque en gnral pour en arriver ce niveau-l.
3. CONCLUSION
Notre cours Autour des textes traduits a pour but de sensibiliser les
paricipants la traduction, c n' est donc pas le lieu de fair un cours de
grammaire. Cependant, comme on ne peut pas traduire sans recourir la
grammaire, ce cours donne l' occasion de (re)voir certains points
gammaticaux mais dans une perspective aute que celle adopte dans les
cours de langue.
Des outils comme la reformulation, la paraphrase, la transposition,
la dconstrction en units de sens, favorisent autant la rcherche dans le
vocabulaire que dans la syntae et permetent l' tudiant de dvelopper ses
moyens d' expression, d'acqurir plus de souplesse dans ses forulations
et, par l mme, de prendre de la distance par rapport au texte de dpar.
Dans U tel cours, l' tudiant est vraiment plac au cente de son
apprentissage : il est seul mme de compaer la gmaire de sa langue
materelle et celle du fanais. Il peut ainsi renforer ses connaissances en
fanais tout en se (r)appropriant sa langue materelle.
Quant l' enseignant, qui n' a plus toutes les cls, il se touve dans
une situation quelque peu inhabituelle mais idale pour instaurer une
relation trs dynamique avec les paricipants. Son rle est de les
questionner, de les mettre sur la piste tout en leur donnant des outils et
des explications claires, un fl d'Ariane, pour leur perette de matriser
le systme du fanais.
Nous avons beaucoup apprci l ' aricle de Lance Hewson :
L' avenir du thme l' universit qui propos de cet exercice dit
justement :
9 8 Cahiers de [ 'ILSL, N 13, 2002
Le thme [0 0 ' ] reste un exercice primordial qui met en jeu, de faon
permanente, les capacits de l ' apprenant explorer une autre [langue
culture], faire un travail de gnration et de slection motiv. Ca le thme
est l ' unique occasion, dans le parcours universitaire, de tavailler l a
deuxime langue en profondeur tout en tenant compte des contraintes trs
spcifques du texte de dpart.
A l ' EFM, le thme a rsist tous les alas des modes
pdagogiques et notre pratique de l'exercice du thme dans le U
Autour des textes traduits est un df que nous avons du plaisir
relever.
RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Adamczwski H. ( 1 991 ). Le fanais dchif , cl du langage et d
langues, Paris : Armand Colin.
Baker M. ( 1 992). In Other Word, a Coursebook on Translation, Londres
et New York : RoutIedge.
Carer-Thomas S. (2000). La cohrence tetuelle. Pour une nouvelle
pdagogie de [ 'crit, Paris : L' Harattan, coll. Langue et parole.
Durieu C. ( 1 991 ). Traduction pdagogique et pdagogie de la
traduction, Le Franais dans le Monde 243, aotsept 1 99 1 .
Hewson L. ( 1 993). L' avenir du thme l ' universit, i La traduction
l 'universit. Recherches et propositions didactiques, Presses Universitaires
de Lille.
99 Cahiers de l '/LSL, N 1 3, 2002
Les pronoms personnels
dans le matriel didactique du FLE
Fuyo Amino
Universit de Lausanne, Ecole de fanais moderne
INTRODUCTION
Comme pour toutes les autes brches scientifques, la didactique est
alimente par des recherches issues d' autres domaines tels que la psycholo
gie, la sociologie, l' anthropologie et par excellence la linguistique; certains
donnent en efet l' appellation de linguistique applique la mthodolo
gie de l ' enseignement des langues, qui est une partie imporante de la
discipline didactique, mais pas pour autant l' entier de cete discipline.
Etant donn les objectifs difrents, les points de vue d'un linguiste et d' un
enseignant de la langue ne sont pas toujours compatibles. Alors, das
quelle mesure leurs perspectives concident-elles ou divergent-elles ? Et
dans le cas de divergences, qu1est-ce qui peret de choisir telle ou telle
solution ?
Dans cet expos, je tenterai donc de dgager comment les notions
proposes par les linguistes durat ces derires annes sont prsentes, ou
non, dans les gammaires et les mthodes de fais. Pour une telle aa
lyse, les problmes concerant la personne et surtout les pronoms person
nels me paraissent paiculirement intressants, pae que leurs tiquettes
mmes sont depuis quelque temps contoverses et les usages spcifques
des pronoms personnels tels que le nous de majest ou de modestie,
le choix du tu et du vous de politesse ne sont pas aiss thoriser ou
contextualiser dans l' enseignement. l'examinerai avant tout le matriel
didactique du fanais lague tangre, que j ' appellerai ci-aprs FLE. Etant
donn que ce tpe de matriel est conu pour les apprenants non fcopho
nes, et donc susceptible d'tre utilis dans un milieu exolingue, il est
cens prsenter de maire plus explicite des rgles et des usages pratiques
langagiers, qui paraissent parfois vidents aux yeux des locuteurs natifs.
Cette dmarche me permetra d'apprhender la possibilit d' une
meilleure exploitation de la gmaire didactique dans l ' enseignement du
FLE.
1 00 Cahiers de l'IL8L, N 1 3, 2002
1 . TYPOLOGIE DES GRAMAIRES
Etant donn qu' il est impossible de recouvrir tous les lments linguisti
ques dans toutes les sitations de communication, la grammaire, e
d' autres termes les connaissances intriorises que possde le locuteur
d'une langue, n' est jamais intelligible sous la fonne d' un dictionnaire, ou
d' un ouvrage de grdaire. Pour une telle ralisation, on doit forcment
slectionner les lments les plus importants. En fonction du public vis,
les deux tpes de grammaires, linguistique - et didactique, difrnt ou doi
vent difrer naturellement. Cette perspective ser reprsente l' aide d' un
schma comme ci-dessous tabli pa Claude Gerain & Hubert Sguin,
tir de leur ouvrage Le point sur la grammaire en didactique des langues
( 1 995 . 48)
1
.
GRAMMAIRE
connaissance intriorise
(comptence grammatcale)
Grammaire didactique
Grammaire
d'apprentissage
.
Grmaire
d'enseigement
- de l 'usager
- de l 'enseigant
- de l'apprenant
Grammaire linguistique
Grammaire
de rfrnce
Grammaire
descriptive
Toutefois, il Y a dans ce schma une modifcation de teriologie
de ma part : tant donn que ma prsentation tient compte du contenu du
matriel de l' enseignement du FLE, et non de la pratique relle de ce mat
riel, ni des procds et techniques d' enseignement, j ' ai remplac p
grammaire didactique le tere de grammaire pdagogique que Ger
main & Sguin ont employ dans leur typologie. Pour l'analyse que nous
allons voir dans les pages qui suivent, c' est la gmaire
d' apprentissage, une des sous-catgories de la gammaire didactique, que
l' on aura afaire.
1 Il faut signaler ici que cette classifcation est plutt conceptuelle, sinon tho
rique, comme l' afrment d' ailleurs les auteurs. Si tous les ouvrages de gam
maire peuvent tre plus ou moins rangs dans tel ou tel type, leurs diffrences
ne sont toutefois pas toujours nettes.
F. Amino : Les pronoms personnels dans le matriel du FLE 1 0 1
2 . MATRIEL EXAMINER
Je passerai maintenant l ' examen du matriel didactique du FLE sur la
prsentation des pronoms personnels sujets en fais. Le choix du mat
riel a t dterin par la disponibilit de ce qui a t publi durant ces
derires anes.
Voici les 4 ouvrages que j ' ai choisis2:
- Grammaire la carte ( 1 982, R1 985) Spiegeleer, J. de & H. Weekers.
public vis : apprenants du FLE au niveau moyen
- Grammaire vivante du fanais ( 1 987) Callamand, M.
public vis : apprenants du FLE d'un niveau moyen ou confrm
- Grammaire utile dufanais ( 1 989) Brard, E. & C. Lavenne.
public vis : apprenants du FLE interdiaire / avanc et enseignants
Grammaire dufanais ( 1 991 ) Delatour, Y. et al.
public vis : apprenants du FLE.
Quant aux mthodes, j 'ai opt pour trois d' entre elles :
- Libre change 1 (1 991 ) Courtillon, 1. & G. -D. de Salins.
public vis : apprenants du FLE de niveaux dbutants ou faux dbutants
Le nouvel Espaces 1 ( 1 995) Capelle, G. & N. Gidon.
public vis : apprenants du FLE grands adolescents et adultes
- Tempo 1 ( 1 996) Brard, E; C. Yves. & C. Lavenne.
public vis : apprenants du FLE vrais dbutants, adolescents et adultes.
3. MATIRES EXAMINER
En ce qui concere les matires examiner, partant de l'lment principal
pronoms personnels sujets, j ' ai choisi quelques notions importantes,
telles qu' nonciation, pronom, pronom personnel, personne, et nombre d
personne ainsi que les usages particuliers des pronoms personnels dans le
discours.
- Notion d' nonciation
- Notions de pronom et de pronom personnel
- Notion de personne
- Nombre de personne : singulier / pluriel
- Usages particuliers des pronoms personnels sujets dans le discours
2 Il faudrait mentionner ici un autre ouvrage, Grammaire pour l 'enseignement /
apprentissage du FLE de Genevive-Dominique de Salins, qui s' annonce
comme une grammaire smantique. Certes, c' est une approche intressante,
mais je ne l ' ai pas intgr dans mon analyse, car l 'ouvrage s'adresse en prin
cipe aux tudiants en formation dans les programmes de didactique du FLE, et
non aux apprenants. Cela ne correspondait donc pas mes critres de slec
ti on.
1 02 Cahiers de l 'ILSL, N 1 3, 2002
J'aimerais ici regader de prs le derier point. Ce que j' appelle les
usages pariculiers corespond ce que Michel de Forel considre
comme les emplois rhtoriques, c' est--die les emplois non prototypi
ques des pronoms personnels. Il af e que presque n' impore quel pro
nom peut te utilis pour renvoyer une aute personne que celle la
quelle il renvoie habituellement ( 1 986 : 24). Catherine Kerrt
Orecchioni, quant elle, le dfmit comme l' nallage de personne, soit la
substitution d'une forme pronomlale une autre plus normale ( 1 992 :
46).
En tant que sujet parlant, nous savons d' ailleurs intuitivement que
l'usage rel des pronoms est plus complexe que ce qui est prsent ordinai
rement dans les ouvrages de grdaire. Cette intuition n' est en efe pa
loin de la ralit langagire; par exemple l'usage courant du vous de poli
tesse, du nous de majest ou de modestie et du on comme fone
courante ou familire de nous en sont les exemples typiques.
Si l' enseignement des langues envisage la pratique efectve de ces
mmes langues, on doit s'eforer d' enseiger galement certains emplois
non ordinaires ou non thoriques. J' ai donc exain plus pariculirement
dans quelle mesure les gammaires didactiques tiennent compte de ces
usages pariculiers des pronoms personnels.
4. EXAMEN DU MATRIEL DIDACTIQUE DU FLE
4. 1 . OUVRAGES DE GRAMMAIRE (voir le tableau 1 , p. I 08- I 09)
Comme le montre le tableau l, les grammaires examines se divisent gos
so modo en deux types : le premier comprend Grammaire la carte,
Grammaire vivante du fanais et Grammaire du fanais, et le deuxime,
Grammaire utile dufranais.
Le premier goupe se prsente das un style plutt traditionnel ;
l' organisation se base sur l' aspect formel de l a langue (parties du discours,
types de phrases, etc. ), et l' emploi des tiquettes classiques (1re, 2e, 3e
personnes, singulier/pluriel). Il of de ce fait une description thorique
inspire de la tradition gmaticale; les constituants linguistiques sont
rangs dans le but de faire intrioriser aux apprenats les rgles gmatica
les.
Quant la Grammaire utile du franais, elle est conue de maire
difrente : en tenat compte des apports rcents de la linguistique et de la
pragmatique, l' ouvrage tente de prsenter la langue das une perspective
nonciative : il contient des explications sur la rfrnce dictique des pro
noms je, tu, nous, vous et cotextuelle ou aaphorique du il. Il comprend
galement des descriptions pratiques sur la distinction du T/V et des
prsentations dtailles de la pratique langagire, comme par exemple des
expressions pour passer du V au T du tpe on se tutoie ?. En efe,
F. Amino : Les pronoms personnels dans le matriel du FLE 1 03
l ' ouvrage peut te considr comme la premire tentative de grmaire
notionnelle-fonctionnelle, ou si l ' on prfre, de grammaire communica
tive. Son organisation en fonction des actes de lagage s'avre alors aa
logue une mthode d' apprentissage.
4. 2. MTHODES (voir le tableau 2, p. I I O- I I I )
A la difrence des ouvrages de gammaire que nous venons de voir, les
mthodes comprennent moins de descriptions mtalinguistiques; parmi les
trois mthodes, le Nouvel Espaces 1 est celle qui en contient le plus (1re,
2e, 3e personnes, singulier/pluriel, pronom personnel indfini pour le on,
etc.), sans toutefois employer de vocabulaire spcifque.
Concerant les usages pariculiers des pronoms personnels, leur
contenu est riche et vari. Les trois mthodes se ressemblent passablement
quant la maire de prsentation qui peut se rsumer en quelques tapes
d'apprentissage.
- Prsentation des emplois das diffrentes situations
- Mise au point des rgles
- Exercices, activits
On peut donc constater la vise communicative et pragatique de
ces mthodes. Elle se ralise pa l' accent por sur des descriptions de
l'usage langagier en contexte et des remarques pratiques pour une meilleure
matrise de la langue, en tenant compte de la relation interpersonnelle des
sujets parlants plutt que de l ' acquisition des rgles et des notions thori
ques.
5. GRAMMAIRE LINGUISTIQUE ET GRAMMAIRE DIDACTIQUE
5. 1 . DE LA GRAMMAIRE LINGUISTIQUE LA GRAMMAIRE
DIDACTIQUE
L' observation ponctuelle tant faite, on pour a reprsenter, en mettant en
vidence d' une maire approximative toutefois, quel type de comptence
de communication
3
chaque tpe de matriel didactique se consacre ou tente
de dcrire :
3
Je reprends ici, pani plusieurs dfnitions, la classifcation des composantes
des comptences communicatives langagires propose par le Conseil de
l ' Europe (2000 : 86- 1 01 ).
1 04
Cor ptences linguistiques
- la connaissance des ressources fonelles
partir desquelles des messages corects et
signifants peuvent te labors et fonuls,
et la capacit les utiliser. (comptence lexi
cale, grammaticale, smantique, phonologi-
ortho
.
v
Cor ptences sociolingu istiques
- la connaissance et les habilets exiges pour
faire fonctionner la langue dans sa dimension
sociale. (marqueurs des relations sociales,
rgles de politesse, dif nce de registe,
Comptences pragmatiques
- la connaissance que l ' utilisateur/apprenant a
des principes selon lesquels les messages
sont organiss (comptence discursive), uti
liss pour la ralisation de fonctions commu
nicatives, et segents selon des schmas
interactionnels.
Cahiers de l'IL8L, N 13, 2002
Mthodes
Les cases de couleur fonce reprsentent l ' accent mis sur ces comptences
das chaque matriel.
Comme le monte ce tableau, les deux types de matriel didactique
se prsentent avec leur complmentarit; d' un ct les ouvrages de gm
maire explicitent les rgles gamaticales et dcrivent le fonctionnement
fonnel de la langue, de l ' autre, les mthodes tentent de les prsenter das
des usages en contexte et les faire intrioriser aux apprenats.
Except le cas de Grammaire utie du franais, qui, comme nous
l ' avons constat, se trouve mi-chemin ente ces deux approches, la df
rence ente les deux types de matriel est assez nete, alors que le contenu
des ouvrages de grammaire se range plutt du ct de la grammaire linguis
tique, avec cependant moins de tenes mtalinguistiques et de descriptions
spcifques et dtailles.
Qu' ofent alors les ouvrages de gammaire la place ?
A ce propos, Genain & Sguin constatent que l ' imporance
dmesure accorde [ . . . ] aux parties du discours dans la gammaire scolaire
montre bien que les langues, sur le plan pdagogique, ne sont toujours
vues que comme de simples nomenclatures ( 1 995 : 1 05- 1 06), et ces a
teurs qualifent une telle grammaire d' assemblage htroclite de parties du
F. Amino : Les pronoms personnels dans le matriel du FLE 1 05
discours fondes sur une varit de critres soit smantique, syntaxique,
morphologique ou logique (ibid. 1 06).
Efectivement, la classifcation des paies du discours dt d'une
grammaire l' autre; selon la vision qu' il a du systme de la langue, cha
que auteur classe en efe l' lment dit pronom dans des places dif
tes : voir le schma en annexe Classifcations des lments linguistiques
(p. 1 1 2). Dans Grammaire la carte, les pronoms personnels sont intgs
dans le groupe nominal, alors que dans Grammaire vivante, ils se trou
vent dans le groupe du verbe. Grammaire du fanais les rage ct
du groupe du nom. Ce qu' il faut aussi remaquer ici, c' est la place du
on; il est rang dans le mme goupe que les pronoms personnels suj ets
dans Grammaire la carte et Grammaire vivante, alors que Grammaire du
franais le classe pai les pronoms indfmis, donc das la mme
catgorie que quelqu 'un, personne, rien.
Gennain & Sguin rclament enfn une thorie cohrente et unife
de la grammaire et esprent que pour cela la linguistique puisse servir de
modle de dveloppement. Etant donn les difrentes thories et modles
existant chez de nombreux linguistes, il me semble qu'une unifcation
ventuelle de la terminologie et de la classifcation gmmaticale n' est pas
une tche aise, pour ne pas dire quelque chose d' impossible. La profsion
des points de vue divergents sur le mme objet, la langue, montre en ef
que la complexit de son systme est loin d'tre intelligible.
Par ailleurs, le Conseil de l'Europe (2000) admet cet clectisme : il
se refse en efet proposer une orthodoxie didactique et prsente un ca
non dogatique mais cohrent et qui n' est ratach aucune des approches
concurrentes de l' enseignement et de l' apprentissage.
5.2. GRAMMAIRE DIDACTIQUE
Dans tous les cas, l' objectif de la linguistique et celui de la didactique ne
sont pas les mmes; les didacticiens ont naturellement une vision de la
langue dans une perspective d' enseignement et se sont rendu compte que la
seule acquisition des connaissances grdaticales n' entrae pas forcment
les comptences de communication.
Et c' est l que se trouve le champ des recherches didactiques : i l
faut une observation prcise et une identifcation analytique de l' apprenant,
pa exemple sa langue 1 , son niveau de connaissance et de scolarit, ses
habitudes d' apprentissage, son habilet intellectelle, son ge, son objectif
d' apprentissage, son environnement, ainsi que d' autres facteurs psycholo
giques. A tavers cette analyse, l ' enseignat doit dgager un ou plusieurs
modes d' enseignement appropris. C' est seulement aprs une telle aalyse
que les connaissances grammaticales feront l' objet d'une rfexion.
Concerant la comptence de communication, ce qu' il faut prendre
en compte d' emble, c' est qu'un apprenant est pa nature dj un sujet
parlant dans sa LI , quelle que soit sa capacit linguistique et communica-
1 06 Cahiers de [ 'ILSL, N13, 2002
tive; il est donc essentiel de dteniner les savoirs et comptences que l ' on
doit lui enseigner. Dans cette optique, tant que le mcanisme de la pratique
langagire de la langue cible fonctionne de la mme manire que la LI de
l' apprenant, les notions fondamentales du langage telles qu' nonciation,
personne, et le fonctionnement des dictiques vont de soi, et ne s' avrent
pas tre une matire (r)enseiger. Il me semble que c' est pour cete rai
son que le matriel didactique ne les aborde gure.
Quant la relation ente LI et L2, suivat le modle de la gm
maire universelle, l'apprentissage d'une L2 implique une modifcation des
valeurs des paramtres langagiers dj assigns lors de l' acquisition d'une
LI . Si les grammaires des deux langues partagent une certaine partie de c
valeurs assignes, on poura se concentrer sur l ' acquisition des paries
divergentes afn d' assigner une deuxime valeur aux paamtres existats,
ou alors crer de nouveaux paratres spcifques la L2.
L' ge de l' apprenant est galement un fateur important. Les rhe
ches psycholinguistiques ont confn la difrnc cogitive ente enfat
et adultes qui apprennent une lague nouvelle. A ce propos, Michel Pier
rard constte que les enfants font f deux tches quand ils apprennent
une langue : construire une reprsentation de leur univers et construire une
reprsentation de la structure du systme linguistique, incluant des pro
dures de contrle qui permettent l' accs ces reprsentations. Les adultes
par contre doivent seulement matriser les aalyses et les contles propres
au systme de la lague cible ( 1 997 : 90). On pourrait alors prdire que
les savoirs gammaticaux serviront, pour certains apprenats adultes,
d' outils d' analyse et de contrle bien davantage que chez les jeunes
apprenants.
Le reste des faceurs dterminant les matires gammaticales
d'apprentissage pourra galement tre exain d'une telle manire, c'est-
dire toujours et ncessaiement dans une perspective metat l' accent sur
l' apprenant.
CONCLUSION
Les ouvrages de grammaire et les mthodes conus l'chelle d'un public
relativement vaste ne peuvent pas recouvri tous les cas concevables. Il
s' agit d' une tche de l' enseignant qui est sur place et se retrouve f
l' apprenant; tout en proftant des moyens existants il est cens exploiter et
crer un matriel plus appropri pour favoriser l'apprentissage de ses lves.
Car, c' est cette prise en compte de l' apprenant qui ncessite, voire justife,
le domaine autonome de la didactique, tout en conservat son interdisci
plinarit avec les domaines voisins.
Comme il n' existe de nos jours aucun domaine scientifque
achev, nos recherches sont toujours en voie de dveloppement. Das
cette optique, il est tout fait pertient de s' investir d'une part das
l ' approfondissement de l' tude, et d' avoir d' autre pa une perspective
F. Amino : Les pronoms personnels dans le matriel du FLE 1 07
dgage afn de bnfcier des travaux des domaines voisins qui voluent
eux aussi constamment. Dans le cadre de la didactique, non seulement la
linguistique, mais aussi la sociologie, la psychologie et l ' anthropologie
ofent bien des indications utiles; la didactique, quant elle, poura gaIe
ment fourir des travaux intressants pour ces autres disciplines.
Voir les tableaux annexs dans les pages suivantes :
Tableau 1 . Examen des ouvrages de grammaire du FLE (p. 1 08- 1 09)
Tableau 2. Examen des mthodes du FLE (p. l 1 0- 1 1 1 )
Tableau 3. Classifcations des lments linguistiques (p. 1 1 2)
Cahiers de / 'ILSL, N l 3, 2002
Tableau 1 . Examen des ouvrages de grammaire du FLE
Gramre la care Gram re Gramre d franai
vivante
1. Enonciation
-
-
-
2. Pronom, - On peut remplacer - Le groupe nominal peut tre
Pronom per- le groupe nominal par remplac par un pronom dmons-
sonnel un substitut ( pro tratif, possessif, indfni, person-
nom). (Intoduction)
-
nel. (87)
- Le pronom person- - Les pronoms personnels rem-
nel dsigne les parti- placent un nom ou un groupe de
cipants la commu- mots dj mentionns, ce qui
nication. (
29) permet d'viter une rptition.
(147)
3. Personne - 1re personne : - 1re personne
la(les) personne(s) - 2e personne
qui parle(nt) - 3e personne
- 2e personne : (36)
la(les) personne(s)
qui on parle
- 3e personne :
la(les) personne(s), la -
(les) chose(s) dont on
; parle (
29
)
9- Nombre: - singulier / pluriel - singulier / - singulier / pluriel (148)
singulier/pluriel (29) pluriel (36)
Gramire ute
-
- les pronoms personnels reprsentent :
des personnes (celle qui parle, celle ou celles 'qui l'on
parle)
ex.)je, t, nous, vou.
soit une ou plusieurs personnes soit une ou plusieurs
choses.
ex.) i elle il, elle ( 1 0)
-je: personne qui parle
- t: personne qui l'on parle
- vous: une ou plusieurs personnes qui l'on parle (ossi-
bilit du rfrent non personne humaine : personnifcation)
- nou: groupe minimum de 2 personnes dont celui qui
parle fait partie
- Impossibilit (e, m, nou, vou) et possibilit (il, ele, ils,
elles) d'te remplacs pa un aute mot
- Rfrenciation cotextuelle (aaphorique) de il ( 1 1)
- il(s): quelqu'un ou quelque chose dont on jarle (1
2
1
- nous: groupe minimum de 2 personnes dont celui qui
parle fait partie (1 1 )
,.
1
1
F. Amino : Les pronoms personnels dans le matriel du FLE
Gramre 0la care Gramre Gramre d franai
vivante
5. Usages parti- - t, te, toi: formes - on = nou - pronom neutre singulier, tou-
culiers familires (etu, jevous) jours sujet
- vous: forme de Le participe - on = le gen
politesse et du pluriel pass prend la - on = une ou plusieurs personnes
- On signife : marque du plu- indtermines
le gens, ceran, riel. - on = nous (langue familire)
quelqu'un (= Je p. - on = quequ'un - accord avec adjectif et participe
sing. masc.) tout le mond, pas ( 136)
nous, t, vou, il(s), chacun, le gen, - t: un proche (membre de la
elle(s) (dans le F.P. peronne famille ou ami)
familier) Le participe - vou: une personne qu'on ne
*on a les mmes pass ne prend connai pas bien ou qui et plus
rapports avec le pas la marque du ge ( 1 48)
verbe que ; donc le pluriel
verbe sera la Je p.s. - on =je
(36) - on = t (ironie,
reproche) (36)
..
Gramre ute
- on = nous (celui qui parle fait partie du groupe)
- on les gens, etc (celui qui parle ne fait pas partie du
groupe) ( 1 1 )
- i = une ou plusieurs personnes dont on ne prcise pas
l'identit (dans le langage familier) ( 12)
- vous en public: situations administratives et ofcielles,
lieux publics, avec des personnes inconnues
- t en priv: situations amicales, familires, familiales,
intimes (4)
- incitation commencer pa vous (risque d'tre vu
comme impoli)
- expressions pour passer du vous au m(On se ttoie?,
etc.) (44)
- facteurs favorables au m .
ge (moins de 25 ans), statut social,
cadre non formel (vacances, etc.),
absence de rapport hirarchique,
avec un enfant (45)
- exemples das divers situations :
faille, travail, cole
- facteurs de slection de T N :
o, qui, registres (formel, standad, failier) (45-46)
- asociation avec les salutations :
vous - bonjour, au revoir, Monsieur
tu - salut, ciao (46-47)
- 3e persone vous (7)
&. .
Les chifres ente paenthses correspondent aux paes auxquelles les matires sont prsentes das chaque ouvrage. Les parties en gra sont, quelques
modifcations prs, les termes et descriptions tels qu' ils sont prsents das les ouvrages.
Cahiers de l 'ILSL, N l 3, 2002
Tableau 2. Examen des mthodes du FLE
Libre Ecllange I Nouvel Espaces I Temo I
1. Enonciation -
-
2. Pronom, (sur le pronom tonique) Le pronom tonique renforce le
Pronom
w
pronom personnel. (14) -
peronnel
3. Personne - 1re peronne, 2e peronne, 3e personne
- politesse
- rfrence cotextuelle de u(en compaaison de c 'est): II
- est se rfre une personne ou une chose dj -
prsente. (14)
4. Nombre: - intoduction difre: je, tu, il, elle en Unit 1 , - introduction difre: fore du singulier (1r, 2e, 3e et
singulierl les autres en Unit 2. politesse) en Dossier O. du pluriel en Dossier 2. cf. adjec-
plurel * das la prsentation des conjugaisons verbales tifs possessifs (notre, leur) intoduits en Dossier 1 .
de tre, toutes les personnes sont indiques en - explicitation des constituants des fones du pluriel (30)
Unit 1, mais sas emploi das les dialogues, - Thierr et moi nous. Maryse et toi * vous, Christian
exercices. et Thierr U
- difrenciation de 2 types de vous
- vous (forme de politese) 1 personne
w
- vous (forme de la 2e personne du plurel) 2 peronnes
ou plus
- conseil de l'intoduction contextuelle du nous : geste
circulaire engbant le profeseur (GP31 )
. Usages - 2 fones de l'impratf: N ( 1 1 ) - distincton ente bonjour et salut associat avec /V (8) - 3 dialogues enegists avec (1 1 )
1
'
particulier - distinction de manires ( 1 2) : - identifcation du type de rpport interperonnels - plusieus situations avec et V ( 12,13)
pour parer un copain, aux autr (intoduc- dpendant de l'ge, du statut social, et surtout du der - plusieus situations associat avec V
ton prliminaire du choix N. explications de distance qu'ils souhaitent maintenir entre eux. (GP13) (41 ,42)
dtailles sont en Unit 4. ) - T : forme familire. V : forme de politese (8)
- conseil de l'emploi du vous pour le prof, du tu - 4 dialogues enregists: 2& 2V (9)
pou les caaades (GPl l ) - exercice: 2 dialogues mlags, , V. (1 0)
- situations diverses: failire - , professionnelle - 3 situations dessines: , V, V (1 1)
- V (20.21 )
aa
F. Amino : Les pronoms personnels dans le matriel du FLE
Libre Echange I Nouvel Espaces I Tempo I
. Usages - introduction prliminaire du choix T/V (28): - exercice: distinction bonjour/sa
l
ut associat avec T/V Le choix entre le tU et le <<ous est
particuliers entre copains / dans la vie professionnelle ( 1 6) : dlicat. Incitation 8 simplifer la distinction:
(suite) - phrases impratives, ncessit de choisir TN bonjour + V, salut + T, bonjour + T - \. situations ofcielles ou avec des peron-
(30) -T ou V quand on se connat, s'il y a la mme relation nes inconnues
- situations diverses (35): failire (ente co- hirarchique - T: situations amicales, familiales (GP42)
pains) -T, professionnelle, soutenue -V - \. si la relation hirarchique et difrente, jusqu' ce Pour aller plus loin, rfrence 8La gram-
- situations diverses, niveaux de langue (52): que la peronne nous autorise la tutoyer maire utile du franais des mmes auteurs
failire (avec des mots failiers) - T, formelle, - T: quand on se connat trs bien et qu'il y a une - expressions pour aborder qqn: emploi du V
soutenue - V relation afective (GP22) uniquement (GP42)
- distinction de T/V (situatons, exercices): - 2 fores d'adresse: Forme de politesse -V, familire -T. - T/V association avec salutations (43)
J- ais conus, membres de faille (24) - T: bonjour+prnom, salut, a va?, tu va
V- prof, nouveaux ais, tager (60,61,63-65) - distinction ente T/V, du V au T entre les mmes person- bien?
- explication sur le T/V (67) nages suggrat le chagement du rappor interpersonnel - \ bonjour, au revoir, Monsieur, Mme,
- T: aux personnes qu'on connat bien. Les (3 1) Mle etc.
jeune se tutoient preque toujour. - contenu linguistique; distinction entre le tu et le vous - plusieurs situations avec T/V (44)
- \. qqn qu'on connat moins, qui et plus - contenu socioculturel: rpports interperonnels, le - exercices sur l 'identifcation des situations et
g ou qui a un statut social suprieur. vouvoiement et le tutoiement (GP34) registres (46)
- \: plusieur peronne. - explications schmatiques de T/V (32) - exercices complmentaires sur le choix T IV
' Jacque Prvert, in Barbara, Paroles. - T: entre membres de la mme famille, entre amis, entre (60) * mais, plutt exercices des conjugaisons
Je dis tu a tous ceux que j'aime. collgues - intoduction du on dans l 'expression On
Je dis tu tous ceux qui s'aiment. - \: la premire rencontre, entre peronnes d'ge ou peut + infnitif (67)
- situations diverses, niveaux de lague (70): de conditions sociales difrents - 2 types du on (inclusif, exclusif:
failire (avec des mots failiers) - T, - question pour faire rfchir: A qui et-ce que vous dites On est souvent utilis la place de
soutenue - V <du et <<vous? nous dans la langue parle.
- distnction des sens du on (94,95, 1 01 ): - exercices portat sur la distncton T/V (33) - on = nous : un groupe d'au moins deux
on nous. - exercice portat sur plusieurs sens du on (44) personnes
on les gens en gnrl ou quelqu'un Quel pronom remplace on? - on = quelqu'un, le gens . une peronne
* mais son emploi devace 8 plusieurs reprises - emploi de plusieurs sens du on das la B.D. (45) inconnue ou un groupe de peronnes o
son introduction das les consignes des exerci- - Le pronom peronnel indfni on peut remplacer celui qui parle ne se trouve pas.(68)
ces ou les textes sur la civilisation franco{hone. d'autre peronnes' (n ="!es gens (52)
Les chifres entre paenthses corespondent aux pages auxquelles les matires sont prsentes das chaque ouvage.
Les parties en gras sont, 8 quelques modifcations prs, les teres et descriptions tels qu'ils sont prsents dans les ouvrages.
Les abrviations GP, T et V signifent respectivement le guide pdagogique de la mthode corespondate, l' emploi du tU et du vous.
Cahiers de / '1LSL, N 1 3, 2002
Tableau 3. Classifcations des lments linguistiques
Urg 0gcgmcre
G' .... n;n .
L Gup ver
-
sbsttfet ajectifquaifcaf
dteninats et substut (pronom)
nur
1
aicle
pronom personnel (e, tu, i, nous, vous, is, on
ajecf et prnomdmonstrf
ajectfet pronompssssifs
adjectife prnom indfinis
prnomrlaf
Gmvi d f
1
dn
_
-
L G"dn _b{
G"du f
Ve
lmentatpss
lmenpsss
lmentantposs prnoms intrgaf prnoms dmonf
f pronoms sujets pronoms personnels (je, tu, i/, nous, vous ils, on
lmentpsss
prnoms prMels complment prnoms psessif
. prnoms rlaif prnoms indfnis
dn --' 1
nom
ajecfquaifcfet ajecfnumJ
acles
dmonsf: ajectife proms
pssssif: ajecfe prnoms
indfmis: ajectfe pronoms
prODoms pronnels
1
pronom neutre sinplier ( on)
prODoms sujets (je tu, . nous vous, &)
prnoms toniques
Motinvaales
prnms comlments
NB : Nous avons rprut les teneutliss les tois ouves ayss
1 1 3 Cahiers de 1 '1LSL, N 1 3, 2002
R
RENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ouvrages de rfrence
Conseil de l' Europe, Division des langues vivantes (2001 ). Un care
europen commun de rfrence pour les langues : apprendre, enei
gner, valuer, Pais : Didier.
Forel M. de ( 1 986). Socio-pragatique des pronoms personnels et inf
rence conversationnelle, Etudes de linguistique applique 63, juillet
septembre, pp. 23-39.
Germain C. & Sguin H. ( 1 995). Le point sur la grammaire en didctique
des langues, Anjou : Centre Educatif et Culturel.
Kerbrat-Orecchioni C. ( 1 992). Les interactions verbales, II, Paris : Anad
Colin.
Pierard M. ( 1 997). Une place pour la linguistique dans la fonnation
initiale des professeurs de fanais. in Boone A. & Pierard M. (ds.),
Linguistique et formation d'eneignants de FLM et FLE, Pa
ris/Bruxelles : AimavlDidier Erudition, pp. 87-94.
Ouvrages de grammaire analyss
De Spiegeleer J. & Weekers H. ( 1 982). Grammaire la carte, Denges :
Delta & Spes.
Callamand M. ( 1 987). Grammaire vivante du franais, Paris : Larousse.
Brard E. & Lavenne C. ( 1 989). Grammaire utile du franais, Paris :
Hatier.
Delatour Y. et al. ( 1 991 ). Grammaire dufranais, Paris : Hachette.
Mthodes de FLE analyses
Courtillon J. & De Salins G. -D. ( 1 991 ). Libre change 1 , Paris : Didier.
Capelle G. & Gidon N. ( 1 995). Le nouvel Espaces 1 , Paris : CLE Intera
tional .
Brard E. , Yves C. & Lavenne C. ( 1 996). Tempo 1, Paris : Hatier/Didier.
Sommare
Raymond Capr :
J ean-Louis Chiss :
Danielle Leema :
Thrse Jeanneret :
Myriam Moraz :
Marine Nicollerat et
Claudine Reymond :
Fuyo Amino :
1 1 5
Sommaire
Prsentatio W B l
Dbats dans l' enseigement / apprentissage
de la gatnmaire W W W W 05
La constuction du sens par la grammaire W 1 7
Structures gramaticales et constctions
prfabriques, quelques enjeux didactiques. W W 37
Traduction anglais-fanais et temporalit :
quelle reprsentation transmette ?
Extait d'extrapolation vers une
reprsentation didactique . W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W . 5 1
Au dtour du thme : la grammaire W W 85
Les pronoms personnels dans le matriel
didactique du FLE W W W W 99
Sommaire W W 1 1 5
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Textes Littéraire en ClasseDocument38 pagesLes Textes Littéraire en ClasseKyo AyonPas encore d'évaluation
- Le prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesD'EverandLe prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesPas encore d'évaluation
- Enseigner le français langue étrangère et seconde: Approche humaniste de la didactique des langues et des culturesD'EverandEnseigner le français langue étrangère et seconde: Approche humaniste de la didactique des langues et des culturesPas encore d'évaluation
- Le Sens GrammaticalDocument243 pagesLe Sens GrammaticaldavidvincenttPas encore d'évaluation
- 2022 Cavalla Mangiante FDLM Lexique PrefabriqueDocument14 pages2022 Cavalla Mangiante FDLM Lexique Prefabriqueelodie.ghyselsPas encore d'évaluation
- FR T1 Évolution Didactique Des LanguesDocument30 pagesFR T1 Évolution Didactique Des LanguesMarie Canas100% (1)
- Tema 14 de Las Oposiciones Secundaria FrancésDocument14 pagesTema 14 de Las Oposiciones Secundaria FrancésMarta MichansPas encore d'évaluation
- Didactique Des Activités Lexicales À L'écoleDocument224 pagesDidactique Des Activités Lexicales À L'écolemennadd100% (1)
- Debyser Analyse ContrastiveDocument32 pagesDebyser Analyse ContrastiveMichèle MichèlePas encore d'évaluation
- Sur La GrammaireDocument12 pagesSur La GrammaireMourad RoudjPas encore d'évaluation
- Referentiel 3e VersionDocument421 pagesReferentiel 3e VersionyudiPas encore d'évaluation
- VocabulaireDocument20 pagesVocabulaireProf rachidPas encore d'évaluation
- DFV - 02 - Lefeuvre-Weber-tiré À PartDocument22 pagesDFV - 02 - Lefeuvre-Weber-tiré À PartMafer GonzálezPas encore d'évaluation
- Pratiques 1247Document20 pagesPratiques 1247youssef chadimiPas encore d'évaluation
- DidactiqueDocument316 pagesDidactiqueissambezzari100% (1)
- Apprentissage Lexical en FLEDocument24 pagesApprentissage Lexical en FLENitu GeorgePas encore d'évaluation
- Le Sens GrammaticalDocument444 pagesLe Sens Grammaticalmzt messPas encore d'évaluation
- Linguistique Et Grammaire de Langlais (Lapaire, Jean-Rémi) (Z-Library)Document738 pagesLinguistique Et Grammaire de Langlais (Lapaire, Jean-Rémi) (Z-Library)simonesiondrePas encore d'évaluation
- Correspondance Une Approche Plurilingue Pour Favoriser Lapprentissage Du Vocabulaire Chez Les Cegepiens AllophonesDocument9 pagesCorrespondance Une Approche Plurilingue Pour Favoriser Lapprentissage Du Vocabulaire Chez Les Cegepiens Allophonesgallasceline757Pas encore d'évaluation
- Cracovie 2022 Module 01 IntroductionPDFDocument19 pagesCracovie 2022 Module 01 IntroductionPDFkkrasnyPas encore d'évaluation
- Les Exercices Grammaticaux, Outils Didactiques IndispensablesDocument10 pagesLes Exercices Grammaticaux, Outils Didactiques Indispensableszeynep ışıksoyPas encore d'évaluation
- Igram 0222-9838 2010 Num 126 1 4104Document6 pagesIgram 0222-9838 2010 Num 126 1 4104Francis Cabrel Simeu kenmognePas encore d'évaluation
- Les Apports Du Structuralisme Au FleDocument7 pagesLes Apports Du Structuralisme Au FleKheribeche Nasser EddinePas encore d'évaluation
- Reper 1157-1330 1998 Num 17 1 2242Document7 pagesReper 1157-1330 1998 Num 17 1 2242Federica De GennaroPas encore d'évaluation
- Chularat, Journal Manager, 03-Artwork-LucDocument16 pagesChularat, Journal Manager, 03-Artwork-LucDeliuDianaPas encore d'évaluation
- Beacco - La Didactique de La GrammaireDocument15 pagesBeacco - La Didactique de La GrammaireSarah50% (2)
- Verbe - Didactique D'enseignementDocument31 pagesVerbe - Didactique D'enseignementRania BouazizPas encore d'évaluation
- DidaqtiqueDocument61 pagesDidaqtiqueZaid ShahidPas encore d'évaluation
- Chiss, J.L Didactique Du Français. Fondements D'une DisciplineDocument9 pagesChiss, J.L Didactique Du Français. Fondements D'une DisciplineMaribel AmayoPas encore d'évaluation
- Vers Une Grammaire Scientifique Et Didactique en CDocument18 pagesVers Une Grammaire Scientifique Et Didactique en CAndreea SavescuPas encore d'évaluation
- Beacco y Darot - Analyse - de - Discours - Et - Textes - de - Specialité PDFDocument50 pagesBeacco y Darot - Analyse - de - Discours - Et - Textes - de - Specialité PDFvic_kymeras_entusojos4442Pas encore d'évaluation
- Le Fondement Dune Grammaire Du Sens A PaDocument14 pagesLe Fondement Dune Grammaire Du Sens A PaAnass El JanatiPas encore d'évaluation
- Cours1 - Tech - Dexp 1Document13 pagesCours1 - Tech - Dexp 1Mar chePas encore d'évaluation
- Tab 05Document2 pagesTab 05Khalid ASSOUPas encore d'évaluation
- Recherches Sur L Apprentissage Des LanguDocument18 pagesRecherches Sur L Apprentissage Des LanguDuany Et DaniloPas encore d'évaluation
- BeaccoDocument7 pagesBeaccoEka KutateladzePas encore d'évaluation
- 1 - Enseigner La GrammaireDocument77 pages1 - Enseigner La GrammaireJason Jesus Torres ReyesPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument11 pages1 PBAmine oulmekkiPas encore d'évaluation
- Ext 1639 5 PDFDocument35 pagesExt 1639 5 PDFEl Arbi El AdlouniPas encore d'évaluation
- Referent I ElDocument461 pagesReferent I ElAnonymous 9XNBx3uziPas encore d'évaluation
- L'évolution de La Didactique Du Fle en Trois PériodesDocument9 pagesL'évolution de La Didactique Du Fle en Trois Périodesken ZaPas encore d'évaluation
- Moyens de Contrôle de La Compréhension D'un Texte Lu en Langue ÉtrangèreDocument10 pagesMoyens de Contrôle de La Compréhension D'un Texte Lu en Langue ÉtrangèremasropjaloyanPas encore d'évaluation
- Une Approche Communicative de L' Enseignement/ Apprentissage Du Fran Ais Langue!trang"re, Une Alternative Possible en Contexte Universitaire JaponaisDocument16 pagesUne Approche Communicative de L' Enseignement/ Apprentissage Du Fran Ais Langue!trang"re, Une Alternative Possible en Contexte Universitaire Japonaishanyshady348Pas encore d'évaluation
- 21 Serge Dreyer-TaiwanDocument5 pages21 Serge Dreyer-TaiwanAurora MacoveiPas encore d'évaluation
- Une Grammaire Contrastive RenovéeDocument19 pagesUne Grammaire Contrastive RenovéeEka Kutateladze100% (2)
- Pratiques TextuellesDocument328 pagesPratiques TextuellesERIPas encore d'évaluation
- 006 Methode Active Citation CLOSSET Annexe3 D2Document2 pages006 Methode Active Citation CLOSSET Annexe3 D2genuturo8961Pas encore d'évaluation
- LFR 0023-8368 1985 Num 68 1 6357Document16 pagesLFR 0023-8368 1985 Num 68 1 6357djilahPas encore d'évaluation
- 3 StylistiqueDocument2 pages3 StylistiqueJenny SantosPas encore d'évaluation
- ContribDocument7 pagesContribElhasbis ZakariaPas encore d'évaluation
- Apprentissage de Litalien Langue ÉtrangereDocument28 pagesApprentissage de Litalien Langue ÉtrangereYosr GhannouchiPas encore d'évaluation
- Approche Du TLDocument12 pagesApproche Du TLlilianaclaraPas encore d'évaluation
- Acquisition de Postures Normatives L'orthographeDocument10 pagesAcquisition de Postures Normatives L'orthographeJamaa BoussaidPas encore d'évaluation
- De Linnovation en Didactique Du FrancaisDocument10 pagesDe Linnovation en Didactique Du Francaisحبيب الشاعر100% (1)
- Une Demarche Strategique Pour EnseignerDocument20 pagesUne Demarche Strategique Pour EnseignerJoseph Grand PierrePas encore d'évaluation
- 58656ac PDFDocument6 pages58656ac PDFMohamed ChedlyPas encore d'évaluation
- L'apprentissage implicite du langage: Étude des liens entre facteurs psycholinguistiques et langageD'EverandL'apprentissage implicite du langage: Étude des liens entre facteurs psycholinguistiques et langagePas encore d'évaluation
- Voies multiples de la didactique du français: Entretiens avec Suzanne-G. Chartrand, Jean-Louis Chiss et Claude GermainD'EverandVoies multiples de la didactique du français: Entretiens avec Suzanne-G. Chartrand, Jean-Louis Chiss et Claude GermainPas encore d'évaluation
- Comment enseigner efficacement la grammaire du CP au CM2 pour mieux comprendre et écrire la langue française ?: Les cents ciels (l’essentiel) de la grand-mère (grammaire)D'EverandComment enseigner efficacement la grammaire du CP au CM2 pour mieux comprendre et écrire la langue française ?: Les cents ciels (l’essentiel) de la grand-mère (grammaire)Pas encore d'évaluation
- Les Livres de DieuDocument3 pagesLes Livres de DieuAbdallah ibn aliPas encore d'évaluation
- BassetDocument60 pagesBassetdln2510100% (1)
- Viveiros de Castro - Comptes Rendus - Désveaux, Emmanuel. - Sous Le Signe de L'ours. Mythes Et Temporalité Chez Les Ojibwa Septentrionaux PDFDocument5 pagesViveiros de Castro - Comptes Rendus - Désveaux, Emmanuel. - Sous Le Signe de L'ours. Mythes Et Temporalité Chez Les Ojibwa Septentrionaux PDFEVIP1Pas encore d'évaluation
- Lumiere Martiniste PDFDocument0 pageLumiere Martiniste PDFspinoza007Pas encore d'évaluation
- Communication Au USADocument6 pagesCommunication Au USAsobanAllahPas encore d'évaluation
- Le Dialectique, La Dialectique, Les DialectiquesDocument16 pagesLe Dialectique, La Dialectique, Les DialectiquesAntonio RochaPas encore d'évaluation
- Pourquoi Pas 1 Fiches de Travail PDFDocument27 pagesPourquoi Pas 1 Fiches de Travail PDFFernando Prokopiuk100% (1)
- Bac 2 ImmmppDocument4 pagesBac 2 ImmmppAmal MoutaoukilPas encore d'évaluation
- Évangile de Jean 4Document18 pagesÉvangile de Jean 4Tiago Alexandre da SilvaPas encore d'évaluation
- Adjectifs NationalitéDocument6 pagesAdjectifs NationalitéJuanPas encore d'évaluation
- Présupposés Et Conséquences Interprétation Ésotériste (Brisson)Document22 pagesPrésupposés Et Conséquences Interprétation Ésotériste (Brisson)xfgcb qdljrkfglePas encore d'évaluation
- M03 - Dessin Technique REM-MRMMDTDocument40 pagesM03 - Dessin Technique REM-MRMMDTdouda777767% (9)
- L'éducation Corporelle Dans L'enseignement de La RythmiqueDocument77 pagesL'éducation Corporelle Dans L'enseignement de La RythmiqueEliton PereiraPas encore d'évaluation
- Projet de ClasseDocument5 pagesProjet de ClasseabderrahimprofPas encore d'évaluation
- Pfe AjmakDocument30 pagesPfe Ajmakمحمد أمجوضPas encore d'évaluation
- Guide Pratique de La MeditationDocument77 pagesGuide Pratique de La Meditationlouis300089% (9)
- FR 1as C2 15 16 15 16Document2 pagesFR 1as C2 15 16 15 16Amine BouzidPas encore d'évaluation
- Bibliographie MaupassantDocument64 pagesBibliographie MaupassantchatteblanchePas encore d'évaluation
- Universala LIDocument7 pagesUniversala LIDiana TreastinPas encore d'évaluation
- JaponaisWikiBook PDFDocument116 pagesJaponaisWikiBook PDFnivaldia0% (1)
- Dialogue Comolli Dec2007Document17 pagesDialogue Comolli Dec2007atomgobiPas encore d'évaluation
- 6 7360 5527d304 PDFDocument26 pages6 7360 5527d304 PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation
- Compte Rendu Paroles D'orDocument16 pagesCompte Rendu Paroles D'orSoolay100% (4)
- St. Theophane Le Reclus - Lettres de Direction Spirituelle - SRCH .Adb CompressedDocument267 pagesSt. Theophane Le Reclus - Lettres de Direction Spirituelle - SRCH .Adb CompressedSursum CordaPas encore d'évaluation
- Les Systèmes Grammaticaux - 2Document41 pagesLes Systèmes Grammaticaux - 2billyboy100% (12)
- Programme Complet V3Document52 pagesProgramme Complet V3allaurusPas encore d'évaluation
- Ecoles Des Arts Du CirqueDocument21 pagesEcoles Des Arts Du CirqueRoroPas encore d'évaluation