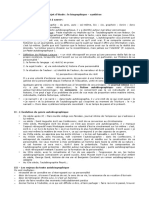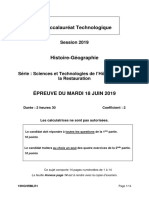Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Discours Halimi Question D'interprétation
Transféré par
sylvain lenormand0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
65 vues2 pagesTitre original
Discours Halimi Question d'Interprétation
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
65 vues2 pagesDiscours Halimi Question D'interprétation
Transféré par
sylvain lenormandDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 2
HLP.
Question d’interprétation à propos d’un discours.
Il s’agit de l’extrait de la plaidoirie prononcée à la fin du célèbre procès de Bobigny en
1972. Gisèle Halimi défend une jeune femme poursuivie pour avoir avorté à la suite d’un
viol, l’IVG étant alors considéré comme un crime en France, et dans la plupart des pays du
monde.
« Monsieur le président, Messieurs du tribunal,
Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier
qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. (…). Que fait-on pour
elles ? On les traites de putains. On leur enlève leurs enfants, on les oblige, la plupart du
temps, à les abandonner ; on leur prend 80% de leur salaire, on ne se préoccupe pas du
fait qu’elles sont dans l’obligation d’abandonner leurs études. C’est une véritable répres-
sion qui s’abat sur les mères célibataires. Il y a là une incohérence au plan de la loi elle-
même.
J’en arrive à ce qui me paraît le plus important dans la condamnation de cette loi. Cette
loi, Messieurs, elle ne peut pas survivre et, si l’on m’écoutait, elle ne pourrait pas survivre
une seconde de plus : Pourquoi ? Pour ma part, je pourrais me borner à dire : parce
qu’elle est contraire, fondamentalement, à la liberté de la femme, cet être, depuis toujours
opprimé. La femme était esclave disait Bebel, avant même que l’esclavage fût né. Quand
le christianisme devint une religion d’État, la femme devint le « démon », la « tentatrice ».
Au Moyen Âge, la femme n’est rien. La femme du serf n’est même pas un être humain.
C’est une bête de somme. Et malgré la Révolution où la femme émerge, parle, tricote, va
aux barricades, on ne lui reconnaît pas la qualité d’être humain à part entière. Pas même
le droit de vote. Pendant la Commune, aux canons, dans les assemblées, elle fait mer-
veille. Mais une Louise Michelle et une Hortense David ne changeront pas fondamentale-
ment la condition de la femme.
Quand la femme, avec l’ère industrielle, devient travailleur, elle est bien sûr – nous n’ou-
blions pas cette analyse fondamentale – exploitée comme les autres travailleurs.
Mais à l’exploitation dont souffre le travailleur, s’ajoute un coefficient de surexploitation de
la femme par l’homme, et cela dans toutes les classes.
La femme est plus qu’exploitée. Elle est surexploitée. Et l’oppression – Simone de Beau-
voir le disait tout à l’heure à la barre – n’est pas seulement celle de l’économie.
Elle n’est pas seulement celle de l’économie, parce que les choses seraient trop simples,
et on aurait tendance à schématiser, à rendre plus globale une lutte qui se doit, à un cer-
tain moment, d’être fractionnée. L’oppression est dans la décision vieille de plusieurs
siècles de soumettre la femme à l’homme. « Ménagère ou courtisane », disait d’ailleurs
Proudhon qui n’aimait ni les juifs, ni les femmes. Pour trouver le moyen de cette soumis-
sion, Messieurs, comment faire ? Simone de Beauvoir vous l’a très bien expliqué. On fa-
brique à la femme un destin : un destin biologique, un destin auquel aucune d’entre nous
ne peut ou n’a le droit d’échapper. Notre destin à toutes, ici, c’est la maternité. Un homme
se définit, existe, se réalise, par son travail, par sa création, par l’insertion qu’il a dans le
monde social. Une femme, elle, ne se définit que par l’homme qu’elle a épousé et les en-
fants qu’elle a eus.
Telle est l’idéologie de ce système que nous récusons.
Savez-vous, Messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, avaient
écrit ceci et c’est tout le destin de la femme : « La femme est donnée à l’homme pour
qu’elle fasse des enfants… Elle est donc sa propriété comme l’arbre à fruits est celle du
jardinier. » Certes, le Code civil a changé, et nous nous en réjouissons. Mais il est un point
fondamental, absolument fondamental sur lequel la femme reste opprimée, et il faut, ce
soir, que vous fassiez l’effort de nous comprendre.
Nous n’avons pas le droit de disposer de nous-mêmes.
S’il reste encore au monde un serf, c’est la femme, c’est la serve, puisqu’elle comparaît
devant vous, Messieurs, quand elle n’a pas obéi à votre loi, quand elle avorte. Compa-
raître devant vous. N’est-ce pas déjà le signe le plus certain de notre oppression ? Par-
donnez-moi, Messieurs, mais j’ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-
nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes… Et pour parler de quoi ?
De sondes, d’utérus, de ventres, de grossesses, et d’avortements !...
- Croyez-vous que l’injustice fondamentale et intolérable n’est pas déjà là ?
- Ces quatre femmes devant ces quatre hommes !
- Ne croyez-vous pas que c’est là le signe de ce système oppressif que subit la femme ?
Comment voulez-vous que ces femmes puissent avoir envie de faire passer tout ce
qu’elles ressentent jusqu’à vous ? Elles ont tenté de le faire, bien sûr, mais quelle que soit
votre bonne volonté pour les comprendre – et je ne la mets pas en doute – elles ne
peuvent pas le faire. Elles parlent d’elles-mêmes, elles parlent de leur corps, de leur condi-
tion de femmes, et elles en parlent à quatre hommes qui vont tout à l’heure les juger.
Cette revendication élémentaire, physique, première, disposer de nous-mêmes, disposer
de notre corps, quand nous la formulons, nous la formulons auprès de qui ? Auprès
d’hommes. C’est à vous que nous nous adressons.
- Nous vous disons : « Nous, les femmes, nous ne voulons plus être des serves ».
Est-ce que vous accepteriez, vous, Messieurs, de comparaître devant des tribunaux de
femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ?... Cela est démentiel !
Accepter que nous soyons à ce point aliénées, accepter que nous ne puissions pas dispo-
ser de notre corps, ce serait accepter, Messieurs, que nous soyons de véritables boîtes,
des réceptacles dans lesquels on sème par surprise, par erreur, par ignorance, dans les-
quels on sème un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous soyons des bêtes de re-
production sans que nous ayons un mot à dire.
L’acte de procréation est l’acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les liber-
tés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi,
Messieurs, personne n’a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé
de ne pas le faire.
En jugeant aujourd’hui, vous allez vous déterminer à l’égard de l’avortement et à l’égard
de cette loi et de cette répression, et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui
est fondamentale. Est-ce qu’un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer
de lui-même ? Nous n’avons plus le droit de l’éviter.
J’en ai terminé et je pris le tribunal d’excuser la longueur de mes explications. Je vous di-
rai seulement encore deux mots : a-t-on encore, aujourd’hui, le droit, en France, dans un
pays que l’on dit "civilisé", de condamner des femmes pour avoir disposé d’elles-mêmes
ou pour avoir aidé l’une d’entre elles à disposer d’elle-même ? Ce jugement, Messieurs,
vous le savez – je ne fuis pas la difficulté, et c’est pour cela que je parle de courage – ce
jugement de relaxe sera irréversible, et à votre suite, le législateur s’en préoccupera. Nous
vous le disons, il faut le prononcer, parce que nous, les femmes, nous, la moitié de l’hu-
manité, nous sommes mises en marche. Je crois que nous n’accepterons plus que se
perpétue cette oppression.
Messieurs, il vous appartient aujourd’hui de dire que l’ère d’un monde fini commence. »
Discours de Gisèle Halimi, procès de Bobigny, 1972.
Question d’interprétation : « En quoi ce discours est-il puissant sur le plan rhéto-
rique ? »
Vous aimerez peut-être aussi
- Gisèle Halimi Question de Réflexion AnnotéeDocument5 pagesGisèle Halimi Question de Réflexion AnnotéeLinaPas encore d'évaluation
- Baby-sitter blues de Marie-Aude Murail (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandBaby-sitter blues de Marie-Aude Murail (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Lamartine Par Lui MemeDocument428 pagesLamartine Par Lui MemeLECOUTREPas encore d'évaluation
- La petite sirène - Hans Christian Andersen (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLa petite sirène - Hans Christian Andersen (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Anthologie Sur La Mort Français 1ereDocument17 pagesAnthologie Sur La Mort Français 1eremedinaPas encore d'évaluation
- Etre Raisonnable Est-Ce Renoncer À Ses Désirs? MéthodologieDocument3 pagesEtre Raisonnable Est-Ce Renoncer À Ses Désirs? Méthodologiebeebac2009Pas encore d'évaluation
- Lge Femmes A2 ProfDocument3 pagesLge Femmes A2 ProfShelothaWinaDinarPas encore d'évaluation
- Corrigés Bac Philo 2001Document3 pagesCorrigés Bac Philo 2001Abdillahi MahadPas encore d'évaluation
- Conseil Pour Les Sujets de Rédaction de BrevetDocument7 pagesConseil Pour Les Sujets de Rédaction de BrevetyouyouPas encore d'évaluation
- Correction Philo S Dissertation 1Document2 pagesCorrection Philo S Dissertation 1rhom138100% (10)
- HLP Récit de VoyageDocument2 pagesHLP Récit de VoyagematelbrtPas encore d'évaluation
- Sujet de Reflexion 3e 1Document28 pagesSujet de Reflexion 3e 1devlinPas encore d'évaluation
- Corrigé de L'essai - ReluDocument2 pagesCorrigé de L'essai - ReluMini KillerPas encore d'évaluation
- Bourdieu, Kant Et La Critique Du JugementDocument9 pagesBourdieu, Kant Et La Critique Du JugementGKF1789Pas encore d'évaluation
- Synthèse AutobiographieDocument2 pagesSynthèse AutobiographieionikaPas encore d'évaluation
- Sujet de DissertationDocument64 pagesSujet de DissertationElisaveta StefanovaPas encore d'évaluation
- La PoésieDocument8 pagesLa Poésiemasar7Pas encore d'évaluation
- Règles, Techniques Et PratiquesDocument1 pageRègles, Techniques Et PratiquesEssan François Boris KakouPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Jeune Professionnel Par AdelineDocument4 pagesFiche de Lecture Jeune Professionnel Par AdelineMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- 5 - ESPAGNOL Progression Terminale 2020-2021Document2 pages5 - ESPAGNOL Progression Terminale 2020-2021MK MOSKOUPas encore d'évaluation
- Nationalite CitoyenDocument3 pagesNationalite Citoyentessa dunormePas encore d'évaluation
- TD de Recherche DocumentaireDocument3 pagesTD de Recherche Documentairedegasquet100% (1)
- Économie TerminalDocument21 pagesÉconomie TerminalJoseph Yomba OuamounoPas encore d'évaluation
- Dossier Méthodologie Du Travail Universitaire 1Document54 pagesDossier Méthodologie Du Travail Universitaire 1Abraham PérezPas encore d'évaluation
- Mode D'emploi - Phase D'admissionDocument16 pagesMode D'emploi - Phase D'admissionJerome COUTONPas encore d'évaluation
- Résumé de Texte Annales - OfficiellesDocument10 pagesRésumé de Texte Annales - OfficiellesHien CorneillePas encore d'évaluation
- Accords de Yalta 02 PDFDocument1 pageAccords de Yalta 02 PDFSaid Rudani100% (1)
- Production Ecrite PDFDocument27 pagesProduction Ecrite PDFMaximwell MaxPas encore d'évaluation
- Les Temps de L Espace Public Urbain Construction Transformation Et UtilisationDocument31 pagesLes Temps de L Espace Public Urbain Construction Transformation Et UtilisationValeriaTellezNiemeyerPas encore d'évaluation
- Méthodologie DissertationDocument4 pagesMéthodologie DissertationGhita RafaïPas encore d'évaluation
- Grand Oral MathsDocument4 pagesGrand Oral MathsEliasPas encore d'évaluation
- Histoire 5emeDocument12 pagesHistoire 5emekiki02Pas encore d'évaluation
- Felix Et La Source Invisible Interro Lecture 3TQ CorrectifDocument3 pagesFelix Et La Source Invisible Interro Lecture 3TQ CorrectifMorgagniPas encore d'évaluation
- EXPOSE ExistentialismeDocument5 pagesEXPOSE ExistentialismeMotchian Yves J-mPas encore d'évaluation
- Mains SalesDocument21 pagesMains SalesLorenzPas encore d'évaluation
- Les Grandes Plaidoiries Des Ténors Du Barreau - AronDocument373 pagesLes Grandes Plaidoiries Des Ténors Du Barreau - AronSORRHE KARENSENPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture 2Document4 pagesFiche de Lecture 2Natascha ThorntonPas encore d'évaluation
- H3 2 GM France 40 À 46 Interro 2 CoorectionDocument2 pagesH3 2 GM France 40 À 46 Interro 2 CoorectionAnonymous s90gIPYVePas encore d'évaluation
- Techniques D'expression Et de CommunicationDocument73 pagesTechniques D'expression Et de CommunicationLeila El KarkouriPas encore d'évaluation
- Banque de Mots PortraitDocument4 pagesBanque de Mots Portraittigga100% (1)
- Fiche Pedagogique Le Langage Des OiseauxDocument2 pagesFiche Pedagogique Le Langage Des OiseauxCazellesPas encore d'évaluation
- Corrigés Bac Philo 2009Document2 pagesCorrigés Bac Philo 2009Abdillahi MahadPas encore d'évaluation
- Commentaire PhilosophieDocument3 pagesCommentaire Philosophieboby azaPas encore d'évaluation
- Methode Comment A Ire Compose 2Document2 pagesMethode Comment A Ire Compose 2Laurent AlibertPas encore d'évaluation
- Le Langage - Cours de Philosophie - Ma PhiloDocument9 pagesLe Langage - Cours de Philosophie - Ma PhiloAndré Constantino YazbekPas encore d'évaluation
- (Guide) 4 Étapes À Suivre Pour Devenir Un Entrepreneur Charismatique Et ÉloquentDocument21 pages(Guide) 4 Étapes À Suivre Pour Devenir Un Entrepreneur Charismatique Et ÉloquentKifak ThierryPas encore d'évaluation
- Les 93 Proverbes Sur Le TravailDocument2 pagesLes 93 Proverbes Sur Le TravailradoniainaPas encore d'évaluation
- Exercices LogiquesDocument2 pagesExercices LogiquesMadi Ha100% (1)
- Méthodologie de La Synthèse de DocumentsDocument3 pagesMéthodologie de La Synthèse de DocumentsABDELMASSIHPas encore d'évaluation
- Quatrevingt-Treize - Victor HugoDocument928 pagesQuatrevingt-Treize - Victor HugoBabayevPas encore d'évaluation
- Qu Est Ce Qu Un EssaiDocument5 pagesQu Est Ce Qu Un EssaiSilvia CorolencoPas encore d'évaluation
- Beispiel C1Document29 pagesBeispiel C1oxymaure100% (1)
- VICTOR HUGO-Le Dernier Jour Dun Condamne - (Atramenta - Net)Document106 pagesVICTOR HUGO-Le Dernier Jour Dun Condamne - (Atramenta - Net)sebastien100% (1)
- Résumé de L Etranger PDFDocument2 pagesRésumé de L Etranger PDFlibrexport2476Pas encore d'évaluation
- Petit Livre de Trucs Et Astuces Pour Écrire Sans Faute (Julien Soulié)Document135 pagesPetit Livre de Trucs Et Astuces Pour Écrire Sans Faute (Julien Soulié)Remi LouisPas encore d'évaluation
- Anaphore NominaleDocument20 pagesAnaphore Nominaleangela666Pas encore d'évaluation
- Roman AfricainDocument55 pagesRoman AfricainFranz Blum VanPas encore d'évaluation
- Dissertation PhilosophiqueDocument2 pagesDissertation PhilosophiqueFred AymerickPas encore d'évaluation
- Baccalauréat 2019: Épreuve D'histoire-Géographie (STHR)Document14 pagesBaccalauréat 2019: Épreuve D'histoire-Géographie (STHR)franceinfoPas encore d'évaluation
- Cours Ethique Droit Et Déontologie Polytech 2021Document39 pagesCours Ethique Droit Et Déontologie Polytech 2021Flavien BakanganaPas encore d'évaluation
- NXIVM - Le Culte Puissant Qui Transforme Les Femmes Riches en Esclaves Contrôlés Par L'esprit - Le Citoyen VigilantDocument16 pagesNXIVM - Le Culte Puissant Qui Transforme Les Femmes Riches en Esclaves Contrôlés Par L'esprit - Le Citoyen VigilantWal WalterPas encore d'évaluation
- Motivation 3.0 - Trois Facteurs À Connaître Pour Motiver Ses ÉquipesDocument6 pagesMotivation 3.0 - Trois Facteurs À Connaître Pour Motiver Ses ÉquipesBassirou LoPas encore d'évaluation
- Politique Sociale - Wikipédia - 1608308746792 PDFDocument19 pagesPolitique Sociale - Wikipédia - 1608308746792 PDFAli MaimounaPas encore d'évaluation
- 18 Partecipation Et CausalitéDocument649 pages18 Partecipation Et CausalitéSole Gonzalez100% (1)
- Legislation TableauxDocument13 pagesLegislation TableauxIulia Mariana PurcaruPas encore d'évaluation
- Inegalite Du Genre Et Les Institutions Sociales en RDCDocument11 pagesInegalite Du Genre Et Les Institutions Sociales en RDCLorraine M. ThompsonPas encore d'évaluation
- ContinuitéDocument2 pagesContinuitéayashidorPas encore d'évaluation
- Lhomme T RafiqueDocument224 pagesLhomme T Rafiquekkader_4Pas encore d'évaluation
- Le Livre de L Imitation de Jésus ChristDocument487 pagesLe Livre de L Imitation de Jésus ChristDoru MarariuPas encore d'évaluation
- Spiritisme Allan Kardec (Français) La Revue Spirite 1869Document392 pagesSpiritisme Allan Kardec (Français) La Revue Spirite 1869Yves Saurin100% (1)
- Recueil D'outils Gestion Des Émotions Et Des Comportements ViolentsDocument27 pagesRecueil D'outils Gestion Des Émotions Et Des Comportements Violentsapi-208153126Pas encore d'évaluation
- El Watan 22.03.2014Document29 pagesEl Watan 22.03.2014log1313Pas encore d'évaluation
- CCN 51Document517 pagesCCN 51MickaelPas encore d'évaluation
- Force MajeurDocument97 pagesForce MajeurLovena Sookarah ThakoorPas encore d'évaluation
- 3177 - Lettre Francois BechieauDocument2 pages3177 - Lettre Francois BechieauMUProgresssitePas encore d'évaluation
- Sociologie Africaine PDFDocument146 pagesSociologie Africaine PDFMihaela AzamfireiPas encore d'évaluation
- BEJAIADocument5 pagesBEJAIArezaPas encore d'évaluation
- Philo 1ère - Leç 4 - Lessai de ProblématisationDocument5 pagesPhilo 1ère - Leç 4 - Lessai de ProblématisationALI CAMARAPas encore d'évaluation