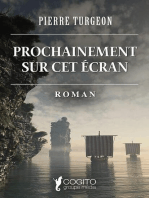Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Analyse Jaws Jerome Momcilovic
Transféré par
Couannault PhilippeCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Analyse Jaws Jerome Momcilovic
Transféré par
Couannault PhilippeDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Dents de la mer de Steven Spielberg (1975)
Analyse de Jérôme Momcilovic
(critique de cinéma et enseignant)
Au sujet de ce film qui devait inaugurer l’ère des « blockbusters » et produire chez ses
spectateurs l’effroi que l’on sait, Spielberg déclarait : « Je savais que j'allais faire un film primal,
comme on le dit d'un cri. » Ou encore : « C’était comme guider le public avec un petit bâton
électrifié ». De fait, Les dents de la mer n’est pas seulement un film terrifiant : c’est un film qui
nous offre, comme rarement, d’étudier les mécanismes de la peur au cinéma et cette « direction de
spectateur » dont Hitchcock avait fait la règle de ses propres films. Cela implique de poser deux
questions:
Comment faire peur ?
Les questions de l’épouvante touchent à l’essence même de la mise en scène de cinéma :
affaire de temps (le suspense), affaire d’espace (le cadre), enjeu toujours recommencé : faut-il
montrer ou non (le monstre) ? L’efficacité des Dents de la mer tient pour la plus grande part au jeu
de cache-cache entretenu entre le spectateur et le requin qui tarde à se montrer mais, longtemps
invisible, se manifeste puissamment dans les détails de l’image, dans le hors champ, dans la bande
sonore.
L’ouverture du film est à ce titre significative, qui rappelle combien, dans l’épouvante, tout
est toujours question de frontières. Frontière entre deux mondes (celui du monstre / celui des
hommes), qui ne tardera pas à être transgressée. En nous immergeant d’emblée dans le monde du
requin (ces eaux presque gothiques, pareilles à une ondoyante forêt de conte), le film commence par
nous rappeler qu’un autre monde, effrayant, existe à deux pas du notre. Dès lors, le film ne cessera
de décupler les figurations de cette frontière : c’est aussi bien la ligne formée par le rivage
(séparation la plus nette entre les deux mondes), que la surface de l’eau (qui coupe littéralement les
corps en deux), ou encore la coque d’un bateau (quand surgit le cadavre énucléé qui effraie
Hooper / quand le requin, à la toute fin, brise la coque pour dévorer Brody) ou les contours de la
cage avec laquelle Hooper s’enfonce dans le monde du monstre. C’est surtout, avant tout chose, la
gueule du requin lui-même, véritable puits de ténèbres, porte d’entrée fatale vers un autre monde :
l’affiche du film, qui la figure comme un trou béant, ne dit rien d’autre. D’ailleurs, le titre français
du film est, une fois n’est pas coutume, très pertinent. C’est bien la mer qui avale les personnages,
autant que le squale.
Le film entier est à l’image de cette affiche : génialement rudimentaire, puissamment
abstrait. Le panneau touristique vandalisé qui accueille les visiteurs en offre un parfait résumé. Le
jaune du matelas, du soleil au sourire forcé et des contours du panneau, est l’expression de
l’insouciance forcenée, toute commerciale, d’Amity : l’image d’une innocence qui sera fatalement
battue en brèche. Le requin, lui, est un simple motif géométrique (un triangle pour figurer l’aileron,
mais le triangle c’est aussi : ses dents et son museau tel que le représente l’affiche) et un véritable
trou noir dans l’image. Le requin « blanc », paradoxalement, est d’abord ici l’idée des ténèbres qui
s’abattent sur Amity ; c’est le noir du deuil que porte la mère de l’enfant sacrifié, Alex Kintner.
D’ailleurs Quint n’évoque-t-il pas ses yeux noirs, « comme des yeux de poupées » ? Et le
journaliste dépêché sur place le 4 juillet ne résume-t-il pas : « Ces derniers jours, un nuage est
apparu au-dessus de cette magnifique station balnéaire. Un nuage en forme de requin meurtrier » ?
Ce nuage est en vérité présent tout au long du film, ou presque, en dépit de l’invisibilité du
squale. C’est une règle essentielle de l’épouvante : ne pas montrer, c’est tout de même toujours
montrer un peu. Il en est ainsi de ces plans subjectifs du requin qui signalent sa présence sans le
montrer dans le cadre (pire : ils nous identifient à sa pulsion meurtrière), ou de ces nombreux motifs
qui, par métonymie, signalent sa présence (exemplairement, les barils jaunes autour desquels toute
la deuxième moitié du film construit sa mise en scène).
Qu’est-ce qui fait peur ?
« Ce n'était pas Jack l'Éventreur », dit Hooper après avoir ausculté la dépouille de la
première victime. Pourtant, le grand blanc de Spielberg partage avec le tueur de Whitechapel d'être
à la fois réel et une pure créature de cauchemar : un monstre de conte (que l'on songe au plan qui
montre sa dépouille rejoignant les abysses sur une musique féérique), un authentique croquemitaine
comme celui dont Brody, à table, mime la grimace à son fils.
Le monstre, singulièrement chez Spielberg, produit chez le spectateur un mélange d’effroi et
de fascination. Et si la figure du monstre nous fascine depuis toujours, c’est qu’elle nous invite à
interroger, en retour, notre propre humanité. A ce titre, il convient de se poser cette question a priori
aberrante : le requin des Dents de la mer est-il bien un requin ? Plutôt : n’est-il que ça ? Si le film a
produit un tel effroi parmi son public, c’est de toute évidence parce que le squale n’y est qu’une
surface de projection pour nos peurs les plus enfouies… Le film ne commence pas pour rien de
nuit, rejoignant en cela les plus grands films fantastiques : les profondeurs de l’océan sont un autre
genre de nuit. Autrement dit: un réservoir de peur, une image de notre nuit intérieure, de notre
inconscient. Dès lors, il est possible d’interpréter cette figure de monstre de multiples façons.
Il est particulièrement intéressant, à ce titre, que Spielberg ait dit de son film qu’il avait la
morale suivante : « Il n'y a aucun endroit au monde où l'on est en totale sécurité ». Etrange, pour un
film qui circonscrit aussi précisément le territoire du monstre (si le monstre est dans l’eau, alors il
devrait suffire, pour être en sécurité, de ne pas se baigner…). Un simple raccord vient confirmer les
mots de Spielberg. Après la première attaque, un fondu nous fait passer d’un plan large et nocturne
de l’océan, qui vient d’être décrit comme un monde cauchemardesque, à une semblable image, de
jour cette fois, et perçue depuis l’intérieur de la maison de Brody. Autrement dit : la maison de
Brody est intégralement cernée par le cauchemar. Et pour Brody, ce cauchemar est d’abord un
cauchemar d’enfant. Il n’est pas innocent que Spielberg insiste autant sur la phobie de l’eau du
shérif, phobie venue d’un traumatisme enfantin (une noyade). Le vrai duel de ce quasi-western se
joue moins entre le shérif et le requin, qu’entre le shérif et l’océan lui-même - plusieurs plans en
attestent de manière très explicite. Aussi, la trame narrative du film relève-t-elle pleinement du récit
d’apprentissage. Quand Brody le phobique consent à partir en mer pour chasser le requin, c’est sa
peur d’enfant qu’il va affronter. C’est à cette aune qu’il faut entendre sa toute dernière réplique,
après qu’il ait triomphé simultanément du monstre et de sa peur de l’océan: « Avant, je détestais
l’eau ». Les dents de la mer n’est peut-être, en définitive, rien d’autre que l’histoire d’un enfant qui
apprend, tardivement, à nager.
Vous aimerez peut-être aussi
- Jacques Aumont Du Visage Au Cinema PDFDocument112 pagesJacques Aumont Du Visage Au Cinema PDFhhhsuzuki100% (4)
- Toto Le Héros (Jaco Van Dormael, 1991) : AnalyseDocument63 pagesToto Le Héros (Jaco Van Dormael, 1991) : AnalyseMargaux De RéPas encore d'évaluation
- Niney François L'épreuve Du Réel À L'écran 8Document15 pagesNiney François L'épreuve Du Réel À L'écran 8Chiko VadouPas encore d'évaluation
- Nacache Lacteur de CinemaDocument94 pagesNacache Lacteur de Cinema75manicouPas encore d'évaluation
- Dossier Pedagogique Au Revoir La Haut 6Document37 pagesDossier Pedagogique Au Revoir La Haut 6Nino CohenPas encore d'évaluation
- Les Dents de La Mer Fiche InteractiveDocument13 pagesLes Dents de La Mer Fiche InteractiveCouannault PhilippePas encore d'évaluation
- La Regard Et La VoixDocument88 pagesLa Regard Et La VoixAlessandra FrancescaPas encore d'évaluation
- CineRSS: 365 Critiques de FilmsDocument111 pagesCineRSS: 365 Critiques de FilmsCineRSS100% (6)
- Cauchemar - Darwin - Dossier Peda FilmDocument7 pagesCauchemar - Darwin - Dossier Peda Filmmarion77chapuisPas encore d'évaluation
- Pre-Les Contes de La NuitDocument4 pagesPre-Les Contes de La Nuit毛文茜Pas encore d'évaluation
- Dokumen - Tips - Ateliers de Montages Des Fuses v2 Le Mtrage Nibiru Connaissant Sa ManireDocument12 pagesDokumen - Tips - Ateliers de Montages Des Fuses v2 Le Mtrage Nibiru Connaissant Sa ManireFONDJA LEDAGAPas encore d'évaluation
- Les Dents de La MerDocument24 pagesLes Dents de La MerM.W.1Pas encore d'évaluation
- Vieil Homme Et La Mer-Cinema ParlantDocument3 pagesVieil Homme Et La Mer-Cinema ParlantVideale.Pas encore d'évaluation
- Bazin Montage InterditDocument6 pagesBazin Montage InterditlaFoudrePas encore d'évaluation
- AUMONT Dieu Est Dans Les Détails PDFDocument8 pagesAUMONT Dieu Est Dans Les Détails PDFinadequacaoPas encore d'évaluation
- Presse Medias Et CinemaDocument4 pagesPresse Medias Et CinemaMariePas encore d'évaluation
- Analyse Du Film "Midnight in The Garden of Good and Evil" - Théories Du CinémaDocument9 pagesAnalyse Du Film "Midnight in The Garden of Good and Evil" - Théories Du CinémaBaptiste GuenaisPas encore d'évaluation
- Lexique Du ScenarioDocument19 pagesLexique Du Scenarioadeldu69Pas encore d'évaluation
- Cul de BouteilleDocument18 pagesCul de Bouteillealonso9691Pas encore d'évaluation
- Nouvelle Revue de Psychanlyse - pdf2Document22 pagesNouvelle Revue de Psychanlyse - pdf2Hocine KaraPas encore d'évaluation
- Le Cinéma SaturéDocument148 pagesLe Cinéma SaturéAlessandra FrancescaPas encore d'évaluation
- UntitledDocument1 pageUntitledGoldenJayPas encore d'évaluation
- MobyDick PDFDocument4 pagesMobyDick PDFeterlouPas encore d'évaluation
- Alien-Fiche InteractiveDocument13 pagesAlien-Fiche InteractiveAurore MeïPas encore d'évaluation
- Codes Du Film Dhorreur Jérôme PeyrelDocument6 pagesCodes Du Film Dhorreur Jérôme Peyrelludovic.lheureuxPas encore d'évaluation
- Analyse Du Film "Le Masque Du Démon" - Culture Et Documentation Du CinémaDocument14 pagesAnalyse Du Film "Le Masque Du Démon" - Culture Et Documentation Du CinémaBaptiste GuenaisPas encore d'évaluation
- Imaginaire en Courts-Métrages (Luis Nieto - Francois Vogel - Danny de Vent - Mikhail Kobakhidze - Yvon Marciano - Michel Gondry)Document24 pagesImaginaire en Courts-Métrages (Luis Nieto - Francois Vogel - Danny de Vent - Mikhail Kobakhidze - Yvon Marciano - Michel Gondry)Yann SinicPas encore d'évaluation
- 4 5 6 Mélie Pain D'épice Dossier PédagogiqueDocument9 pages4 5 6 Mélie Pain D'épice Dossier PédagogiqueVideale.Pas encore d'évaluation
- L Ecriture Du Scenario Eyrolles ExtraitsDocument13 pagesL Ecriture Du Scenario Eyrolles ExtraitsAbdelhadi SdedekePas encore d'évaluation
- 100 Films Du Roman A L Ecran 2011 (Henri Mitterand) 9782847364989Document344 pages100 Films Du Roman A L Ecran 2011 (Henri Mitterand) 9782847364989Belkadi TahirPas encore d'évaluation
- Qu'est-Ce Que Le Cinéma VéritéDocument7 pagesQu'est-Ce Que Le Cinéma VéritéluisaPas encore d'évaluation
- MimosavilleDocument14 pagesMimosavillealPas encore d'évaluation
- 2 PrierePourUneMitaineDocument4 pages2 PrierePourUneMitainesamuel campeau rivardPas encore d'évaluation
- Perron - Cinema InteractifDocument11 pagesPerron - Cinema Interactif12georgia10Pas encore d'évaluation
- Talm ThéoDocument3 pagesTalm Théopoignée officielPas encore d'évaluation
- AndersonDocument183 pagesAndersonemassot1Pas encore d'évaluation
- Images Mobiles (Jean Louis Schefer)Document261 pagesImages Mobiles (Jean Louis Schefer)cuetoPas encore d'évaluation
- Le Roi Et L Oiseau DossierDocument8 pagesLe Roi Et L Oiseau DossierAriciePas encore d'évaluation
- VVVVDocument2 pagesVVVVNet.Pas encore d'évaluation
- Amistad SpielbergDocument42 pagesAmistad SpielbergTA GaraPas encore d'évaluation
- Methodologie de L Analyse de FilmsDocument5 pagesMethodologie de L Analyse de FilmsscribdcarlotaPas encore d'évaluation
- Histoire du cinéma: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandHistoire du cinéma: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le MéprIs de JLGDocument2 pagesLe MéprIs de JLGThieo Abrahaam BayePas encore d'évaluation
- 082Document68 pages082z74h80st2Pas encore d'évaluation
- Je m’appelle Paul, John, Monika, Scottie, Mark… et papa ou une petite histoire du cinéma - Tome 1: De 1895 à 1969D'EverandJe m’appelle Paul, John, Monika, Scottie, Mark… et papa ou une petite histoire du cinéma - Tome 1: De 1895 à 1969Pas encore d'évaluation
- Chris Marker Une Impression Freudienne RDocument15 pagesChris Marker Une Impression Freudienne RlegeomaticienPas encore d'évaluation
- A Comedie Du Langage Jean TardieuDocument5 pagesA Comedie Du Langage Jean TardieuAhlam Madih MakyPas encore d'évaluation
- Lecture Facultative - Sonic - Ethnographies - Leviathan - and - New - Ma FRDocument20 pagesLecture Facultative - Sonic - Ethnographies - Leviathan - and - New - Ma FRNicolas FouquePas encore d'évaluation
- Chion Michel Le Complexe de CyranoDocument260 pagesChion Michel Le Complexe de CyranoCarlos López CharlesPas encore d'évaluation
- Echelle Au CinemaDocument31 pagesEchelle Au CinemadarouchkaPas encore d'évaluation
- L’OEuvre de Makoto Shinkai: L’orfèvre de l’animation japonaiseD'EverandL’OEuvre de Makoto Shinkai: L’orfèvre de l’animation japonaisePas encore d'évaluation
- Dossier Peda Film Jeunesse Pas-Si-MonstresDocument28 pagesDossier Peda Film Jeunesse Pas-Si-Monstresmarion77chapuisPas encore d'évaluation
- Tous les matins du monde (film) d'Alain Corneau (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandTous les matins du monde (film) d'Alain Corneau (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Cahiers 31Document68 pagesCahiers 31emassot1Pas encore d'évaluation
- 075Document68 pages075z74h80st2Pas encore d'évaluation
- EssaiDocument112 pagesEssaicasimirbendjina59Pas encore d'évaluation
- Hybridations Et Mascarades PhotographiquesDocument7 pagesHybridations Et Mascarades PhotographiquesChiko VadouPas encore d'évaluation
- Jean-Luc Nancy L Intrus Selon Claire DenisDocument8 pagesJean-Luc Nancy L Intrus Selon Claire DenisrhaissampPas encore d'évaluation
- Fantastic MR FoxDocument1 pageFantastic MR FoxCouannault PhilippePas encore d'évaluation
- PWP Lycéens Au Cinéma 2021Document5 pagesPWP Lycéens Au Cinéma 2021Couannault PhilippePas encore d'évaluation
- Les Dents de La MerDocument24 pagesLes Dents de La MerM.W.1Pas encore d'évaluation
- Programmation 2021 2022Document5 pagesProgrammation 2021 2022Couannault PhilippePas encore d'évaluation
- Fiche Buffet FroidDocument1 pageFiche Buffet FroidCouannault PhilippePas encore d'évaluation
- Fiche OlympiaDocument1 pageFiche OlympiaCouannault PhilippePas encore d'évaluation
- Parcours Dans Le Vieil Orléans Médiéval Et Renaissance Xiè - Xviè SiècleDocument5 pagesParcours Dans Le Vieil Orléans Médiéval Et Renaissance Xiè - Xviè SiècleCouannault PhilippePas encore d'évaluation
- Fiche Bon Brute Et TruandDocument1 pageFiche Bon Brute Et TruandCouannault PhilippePas encore d'évaluation
- Fiche Sortie Orléans 29 MarsDocument4 pagesFiche Sortie Orléans 29 MarsCouannault PhilippePas encore d'évaluation
- Press Book ImidiwanDocument4 pagesPress Book ImidiwanTêlLe Mêrê TêlLê FiLlePas encore d'évaluation
- Cintreuses Hydrauliques Et Coudes A 90Document14 pagesCintreuses Hydrauliques Et Coudes A 90fhfhbfhgcbfghdhPas encore d'évaluation
- Exprimer Le But Et La ConsequenceDocument4 pagesExprimer Le But Et La ConsequenceIulia IgnatPas encore d'évaluation
- Ptines Et Chansons Autour Du Visage Et de CarnavalDocument1 pagePtines Et Chansons Autour Du Visage Et de Carnavalismahane78Pas encore d'évaluation
- Realiser Une Maquette NumeriqueDocument3 pagesRealiser Une Maquette NumeriqueKaled MRASSIPas encore d'évaluation
- Grillhouse À Joliette Bâton Rouge Joliette Grillhouse & BarDocument1 pageGrillhouse À Joliette Bâton Rouge Joliette Grillhouse & BarMathis LangevinPas encore d'évaluation
- DrakeideDocument3 pagesDrakeidej615p365Pas encore d'évaluation
- Gammes de Blues Au Saxophone TénorDocument2 pagesGammes de Blues Au Saxophone TénorMOUTON DominiquePas encore d'évaluation
- Office Des CompliesDocument61 pagesOffice Des CompliesemmadrdflPas encore d'évaluation
- Phrase Simple Et Phrase Complexe - Devoir 6CDocument3 pagesPhrase Simple Et Phrase Complexe - Devoir 6CAli BPas encore d'évaluation
- Instinct - OM - FR-garmin InstinctDocument32 pagesInstinct - OM - FR-garmin InstinctyopPas encore d'évaluation
- Messe Basse G Faure SSADocument12 pagesMesse Basse G Faure SSAEquiPrac100% (1)
- Bondade de Deus - Base ADocument2 pagesBondade de Deus - Base AIgreja Batista na Praia do MorroPas encore d'évaluation
- Aliouane - Recherche GoogleDocument1 pageAliouane - Recherche GoogleLxrd GarxuPas encore d'évaluation
- D&D Module X1 L'Ile de La Terreur 9043FDocument38 pagesD&D Module X1 L'Ile de La Terreur 9043FEmmanuel PicardatPas encore d'évaluation
- Triathlon Des Settons 2020Document9 pagesTriathlon Des Settons 2020Le Journal du CentrePas encore d'évaluation
- Projet Thèse OSPINADocument8 pagesProjet Thèse OSPINAalejandra ospinaPas encore d'évaluation
- GuerrierDocument6 pagesGuerrierYgJyxPas encore d'évaluation
- Ingelec MusikDocument24 pagesIngelec MusikSITCA SARLPas encore d'évaluation
- Le Théâtre - 2Document77 pagesLe Théâtre - 2manel kenafPas encore d'évaluation
- Demander Des RenseignementsDocument2 pagesDemander Des RenseignementsIsabelle GorgeuPas encore d'évaluation
- OptimaDocument2 pagesOptimachbardPas encore d'évaluation
- Accompagner Chants TaizeDocument2 pagesAccompagner Chants Taizedark musPas encore d'évaluation
- Guide de Léducateur U12 U13Document17 pagesGuide de Léducateur U12 U13AFEIPas encore d'évaluation
- JDR DeathwatchDocument5 pagesJDR DeathwatchTataPas encore d'évaluation
- Examen de Psychologie de L'espace-1Document14 pagesExamen de Psychologie de L'espace-1Douae El hadriPas encore d'évaluation
- Brochure DDB 16 OkDocument39 pagesBrochure DDB 16 Okapi-244828589Pas encore d'évaluation
- Citroen-C4 Maj Carto Mapcare Smeg rt6 290318 (2) .290641Document4 pagesCitroen-C4 Maj Carto Mapcare Smeg rt6 290318 (2) .290641lbnPas encore d'évaluation
- Odoo Partnership Brochure Emea FRDocument42 pagesOdoo Partnership Brochure Emea FRMerouane AmraouiPas encore d'évaluation
- Git Et Github - Exposé Par Camel DjoulakoDocument25 pagesGit Et Github - Exposé Par Camel DjoulakoCamel Léonce DjoulakoPas encore d'évaluation