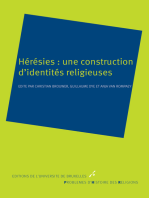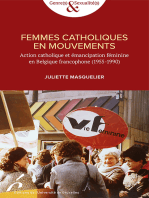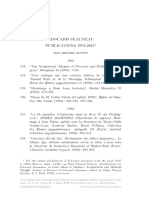Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Assr 1166
Transféré par
pilacin steeveTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Assr 1166
Transféré par
pilacin steeveDroits d'auteur :
Formats disponibles
Archives de sciences sociales des religions
130 | avril - juin 2005
Les Saints et les Anges...
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/assr/1166
DOI : 10.4000/assr.1166
ISSN : 1777-5825
Éditeur
Éditions de l’EHESS
Édition imprimée
Date de publication : 1 avril 2005
ISBN : 2-7132-2044-0
ISSN : 0335-5985
Référence électronique
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005, « Les Saints et les Anges... » [En ligne],
mis en ligne le 23 février 2006, consulté le 19 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/assr/
1166 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.1166
Ce document a été généré automatiquement le 19 mars 2021.
Archives de sciences sociales des religions
1
SOMMAIRE
Les Saints et les Anges...
André Mary
« Tes anges ne sont pas les miens ! »
De l’ange gardien à l’ange haziélien
Anne Manevy
Le sanctuaire Saint Pantaléon à Buenos Aires
La régulation institutionnelle d'un culte thérapeutique
Christine Laigneau
Ivan et Iakov – Deux saints étranges de la région des marais (Novgorod)
Traduit du russe par Yvette Lambert
Alexandr A. Pančenko
Practices of Praise and Social Constructions of Identity: The Bards of North-West India
Helene Basu
Note critique
Saints, héros et martyrs dans le monde musulman
A propos de : Mayeur-Jaouen Catherine, dir., Saints et héros du Moyen-Orient contemporain, Paris, Maisonneuve et
Larose, 2002, 353 p. / Khosrokhavar Farhad, Les nouveaux martyrs d'Allah, Paris, Flammarion, 2002, 369 p.
Malika Zeghal
Comptes rendus
Helene Basu, Von Barden und Königen. Ethnologische Studien zur Göttin und zum
Gedächtnis in Kacch (Indien)
Francfort/Main, Peter Lang, 2004, 350 p.
André Padoux
Edith L. Blumhofer, Religion, Politics and the American Experience
Tulcaloosa, (Al.), The University of Alabama Press, 2002, 147 p.
Isabelle Richet
Roland J. Campiche, Les deux visages de la religion
(avec la collaboration de R. Broquet, A. Dubach et J. Stolz). Genève, Labor et Fides, 2004, 283 p.
Enzo Pace
Yvonne P. Chireau, Black Magic. Religion and the African American Conjuring
Tradition
Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 2003, 222 p.
Véronique Duchesne
Élisabeth Claverie, Les guerres de la Vierge ; une anthropologie des apparitions
Paris, Gallimard, 2003, 452 p.
Nicolas de Bremond d’Ars
Christèle Dedebant, Le voile et la bannière. L'avant-garde féministe au Pakistan
Paris, CNRS éditions, 2003, 388 p. (coll. « Monde Indien Sciences Sociales »)
Luc Bellon
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
2
Robert Deliège, Les castes en Inde aujourd'hui
Paris, Presses Universitaires de France, 2004, 275 p.
Roland Lardinois
Françoise Dunand, Voir les Dieux. Voir Dieu
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2002, 208 p. (coll. « Sciences de l'histoire »)
Isabelle Saint-Martin
Marie-Hélène Froeschlé-Chopard, Itinéraires pèlerins de l'ancienne Provence
La Thune, Marseille, 2002, 281 p.
Elena Zapponi
Pierre Gisel, Théories de la religion
Genève, Labor et Fides, 2002, 414 p.
Vincent Delecroix
Jean Greisch, Le Buisson ardent et les Lumières de la raison. L'invention de la
philosophie de la religion
Paris, Cerf, 2002-2004 (coll. « Philosophie et Théologie »)Tome I : Héritages et héritiers du XIXe siècle, 626 p.Tome II :
Les approches phénoménologiques et analytiques, 555 p.Tome III : Vers un paradigme herméneutique, 1025 p.
Vincent Delecroix
Yusuf Fadl Hasan, Richard Gray (eds.), Religion and Conflict in Sudan
Nairobi, Paulines Publications Africa, 2002, 208 p.
Claude Arditi
Bertrand Hell, Le tourbillon des génies. Au Maroc avec les Gnâwa
Paris, Flammarion, 2002, 371 p.
Constant Hamès
Patricia Hidiroglou (éd.), Entre héritage et devenir. La construction de la famille juive.
Études offertes à Joseph Mélèze-Modrzejewski
Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, 416 p. (coll. « Homme et société » 28. Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Régine Azria
Laënnec Hurbon, Religion et lien social. L'Église et l'État moderne en Haïti
Paris, Cerf, 2004, 317 p.
Nathalie Luca
Stephanie Levine Wellen, Mystics, Mavericks, and Merrymakers. An Intimate Journey
Among Hasidic Girls
New York-Londres, New York University Press, 2003, XIV + 255 p.
Jacques Gutwirth
David Machacek, Global Citizens. The Soka Gakkai Buddhist Movement in the World
Oxford University Press, New York, 2000, 442 p.
Nathalie Luca
La Indiferencia religiosa en España. ¿ Qué futuro tiene el cristianismo ?
Madrid, Ediciones Hoac, 2003, 174 p.
Verónica Giménez Béliveau
Catherine MAYEUR-JAOUEN, Histoire d'un pèlerinage légendaire en islam. Le mouled
de Tantâ du xiiie siècle à nos jours
Paris, Aubier, 2004, 270 p.
Emma Aubin-Boltanski
Jean-Marie Moeglin, L'Intercession du Moyen Âge à l'époque moderne. Autour d'une
pratique sociale
Genève, Droz, 2004, 362 p. (coll. « École pratique des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques. V. Hautes
études médiévales et modernes »)
Bénédicte Sère
Abderrahmane Moussaoui, Espace et sacré au Sahara. Ksour et oasis du sud-ouest
algérien
Paris, CNRS Éditions, 2002, 291 p. (coll. « CNRS Anthropologie »)
Constant Hamès
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
3
Mette Ramstad, Conversion in the Pacific. Eastern Polynesian Latter-day Saints'
Conversion Accounts and their Development of a LDS Identity
Bergen, Høyskoleforlaget (Norwegian Academic Press), 2003, 303 p. (Coll. « Studia Humanitatis Bergensia », no 19)
Yannick Fer
Arskal SalimAzyumardi Azra (eds.), Shari'a and Politics in Modern Indonesia
Singapour, ISEAS, 2003, 363 p.
Rémy Madinier
Bruno Saura, La société tahitienne au miroir d'Israël. Un peuple en métaphore
Paris, CNRS éditions, 2004, 302 p. (coll. « CNRS ethnologie »)
Yannick Fer
Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le XIIIe siècle
Paris, Flammarion, Nouvelle édition augmentée, 2004 (1re édition : 1979), 282 p. (coll. « Champs »)
Marlène Albert-Llorca
Martine Sévegrand, Vers une Église sans prêtres. La crise du clergé séculier en France
(1945-1978)
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, 325 p. (coll. « Histoire »)
Céline Béraud
Rodney Stark, One True God. Historical Consequences of Monotheism
Princetown-Oxford, Princetown University Press, 2003, 319 p.
Yves Lambert
David J. Stuart-Fox, Pura Besakih. Temple, Religion and Society in Bali
Leyde, KITLV, 2002, XII+470 p ; (coll. « Verhandelingen van het koninklijk institut voor taal –, lan – en
Volkenkunde », no 193
Claude Guillot
Bernard Van Meenen, Qu'est-ce que la religion ?
Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint Louis, 2004, 143 p.
Vincent Delecroix
Informations bibliographiques
Ming Anthony, Des plantes et des dieux dans les cultes afro-brésiliens. Essai
d'ethnobotanique comparative Afrique-Brésil
Paris, L'Harmattan, 2001, 233 p. (coll. « Recherches et documents Amériques latines »)
Erwan Dianteill
Martine Balard, Dahomey 1930 : mission catholique et culte vodoun. L'œuvre de
Francis Aupiais (1877-1945), missionnaire et ethnographe
Paris, L'Harmattan, 1999, 356 p. (coll. « Les tropiques entre mythe et réalité »)
Erwan Dianteill
Paul Balta, La Méditerranée des juifs Exodes et enracinements
Paris, L'Harmattan, 2003, 312 p. (coll. « les Cahiers de Confluences »)
Régine Azria
Carlo Brezzi, Democrazia e cultura religiosa. Studi in onore di Pietro Scoppola
Bologna, Il Mulino, 2002, 554 p.
Patrick Harismendy
Gérald Bronner, L'empire des croyances
Paris, PUF, 2003, 281 p. (coll. « Sociologie »)
Yves Lambert
Werner J. Cahnman, Jews and Gentiles. A Historical Sociology of their Relations
Judith T. Marcus and Zoltan Tarr, eds., New Brunswick, Transaction Publishers, 2004, 253 p.
Michael Löwy
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
4
Hubert Cancik, Antisemitismus, Paganismus, Völkische Religion (Anti-Semitisme,
Paganism, voelkish Religion)
Münich, K. G. Saur, 2004, 172 p.
Doris Bensimon
Philip Clart, Religion in Modern Taiwan. Tradition and Innovation in a Changing
Society
Honolulu, University of Hawai'i Press, 2003, x + 333 p.
Vincent Goossaert
Marcel Drach (éd.), L'argent ; croyance, mesure, spéculation
Paris, La Découverte, 2004, 297 p., (coll. « Recherches »)
Nicolas de Bremond d’Ars
Calvin Goldscheider, Studying the Jewish Future
Seattle-Londres, University of Washington Press, 2004, 152 p.
Régine Azria
Virginia HookerNorani Othman (eds.), Malaysia, Islam Society and Politics
Singapour, ISEAS, 265 p.
Rémy Madinier
Carol Iancu, Les mythes fondateurs de l'antisémitisme. De l'Antiquité à nos jours
Toulouse, Privat, 2003, 189 p. (coll. « Bibliothèque Historique »)
Doris Bensimon
John R. McRae, Seeing through Zen. Encounter, Transformation, and Genealogy in
Chinese Chan Buddhism
Berkeley, University of California Press, 2003, xx + 204 p.
Vincent Goossaert
Abdallah Makrerougrass, L'extrémisme pluriel. Le cas de l'Algérie
Paris, L'Harmattan, 2001, 320 p. (coll. « Histoires et Perspectives Méditerranéennes »)
Constant Hamès
Ural Manço (éd.), Reconnaissance et discrimination. Présence de l'islam en Europe
occidentale et en Amérique du Nord
Paris, L'Harmattan, 2004, 371 p. (coll. « Compétences Interculturelles »)
Nikola Tietze
Paul Mattei, Le christianisme antique (Ier-Ve siècles)
Paris, Ellipses, 2003, 176 p. (coll. « L'Antiquité : une histoire »)
Rémi Gounelle
Jean-François Mayer, Reender Kranenborg (eds.), La naissance des nouvelles religions
Genève, Georg Éditeur, 2004, 212 p.
Nadia Garnoussi
Charles Mopsik, Chemins de la cabale. Vingt-cinq études sur la mystique juive
Paris, Éditions de l'éclat, 2004, 468 p.
Maurice-Ruben Hayoun
Amanda Porterfield, Peter E. Williams, American Religious History /Perspectives on
American Religion and Culture
Malden, Mass., Blackwell, 2002, 338 p. (coll. « Blackwell Readers in American Social and Cultural History »)/ Malden,
Mass., Blackwell, 1999, 418 p.
Isabelle Richet
Geneviève Poujol, Un féminisme sous tutelle. Les protestantes françaises (1810-1960)
Paris, Les éditions de Paris – Max Chaleil, 2003, 286 p.
Patrick Harismendy
Freddy Raphael, Regards sur la culture judéo-alsacienne. Des identités en partage
Strasbourg, La nuée bleue, 2001, 287 p.
Régine Azria
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
5
Bernard Rigo, Altérité polynésienne, ou les métamorphoses de l'espace-temps
Paris, CNRS éditions, 2004, 350 p. (coll. « CNRS communication »)
Yannick Fer
Wade Clark Roof (ed.), Contemporary American Religion
2 vols., New York, MacMillan, 2000, 861 p.
Isabelle Richet
Islam, Sectarianism and Politics in Sudan since the Mahdiyya
Hurst & Company, Londres, 2003, 252 p.
Claude Arditi
Robert Wuthnow, All in Sync. How Music and Art Are Revitalizing American Religion
Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 2003, 284 p.
François Picard
Livres reçus
Livres reçus 130
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
6
Les Saints et les Anges...
André Mary
1 Ce dossier de varia n'a pas les prétentions d'un numéro thématique savamment
préparé. Venus d'Argentine, de Russie, d'Inde, du Moyen-Orient, et de France, ces
articles se sont ordonnés d'eux-mêmes autour du thème des Saints et des Anges,
auxquels sont associés les Héros et les Martyrs. Tous les anges ne sont pas des saints,
tous les morts éminents ne sont pas voués à être des saints hommes, et tous les héros
ou les saints ne sont pas des martyrs. La plasticité et la multiplicité de ces êtres extra-
ordinaires, construits à la frontière du monde des dieux et des hommes, du sacré et du
politique, de la mystique et de la guérison, permettent néanmoins de comprendre les
vertus de médiation et d'intercession, qui en font, plus que jamais, des acteurs de la
modernité religieuse.
2 La typologie des anges, comme la topographie des saints, offre aux besoins
d'identification des individus les ressources d'imaginaire qui alimentent un bricolage
privé ou familial de toute sorte de dispositifs cultuels, même si la régulation
institutionnelle s'exerce aussi sur ces marges et ces espaces alternatifs. Les figures
revisitées des saints, héros et martyrs, sont aussi au fondement de l'invention moderne
de nouvelles traditions locales, et servent de relais à une culture de pèlerinage urbaine
et contemporaine qui traduit aussi bien les affirmations identitaires des groupes
ethniques ou nationaux que les contradictions de l'impératif de l'individualité.
3 Les anges de la littérature ésotérique dont nous parle A. Manevy ne sont pas les saints
anges, archanges ou bons anges, « canonisés » par la tradition catholique, ni les
« génies » d'un monde païen réhabilité par le monde moderne ; ils s'inscrivent dans la
continuité des ressources psychologiques et morales qu'incarnaient les « anges
gardiens » mais en opérant un déplacement significatif. La typologie des anges nommés
et individualisés fonctionne dans le monde haziélien comme une caractérologie au
service du souci de soi et de l'accomplissement personnel. Si l'on peut parler d'un
« bricolage » ésotérique de traditions hétérogènes (catholiques, hébraïques), ce droit
revendiqué au mélange n'est pas sans contrainte : la conscience morale que
représentait l'ange gardien fait place à l'impératif de la réalisation de soi et aux
nouvelles normes de compétence et de performance de l'individu. La logique du cumul
appliqué aux ressources de la médication savante et de la guérison miraculeuse est
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
7
aussi au cœur de l'évolution du culte argentin de Saint Pantaléon que nous décrit
C. Laigneau. Confronté à la concurrence des Églises pentecôtistes et au défi des groupes
charismatiques, le catholicisme argentin, comme bien d'autres, est conduit à redonner
vie, à la marge, aux réponses que les sanctuaires et les saints guérisseurs apportent aux
attentes privées et individuelles des fidèles souffrants. L'enjeu reste néanmoins le
contrôle institutionnel des charismes qui passe par le monopole clérical de l'imposition
des mains et la bénédiction de l'onction.
4 A. A. Panˇcenko met toute sa compétence reconnue d'ethnologue des pratiques
religieuses des campagnes de Russie pour nous montrer, à propos du culte rendu à deux
« enfants-saints » guérisseurs, que l'individualisation de longue date des formes de
dévotion populaire, – leur repli sur la vie privée et familiale –, n'est pas incompatible
avec la persistance d'une matrice culturelle paysanne, comme l'illustrent les structures
narratives des récits d'enfants martyrs et thaumaturges et leur extraordinaire
diffusion. Les malentendus surgissent avec la demande croissante de pèlerinage de
populations urbaines confinées, sous le régime de l'athéisme d'État, à une forme de
religiosité latente ou invisible. Là encore le clergé local s'efforce de gérer une « religion
pèlerine » plus soucieuse de l'investissement des ressources rituelles et thérapeutiques
des lieux saints des campagnes que des enjeux de la « mémoire collective » paysanne.
5 Les pratiques de prière que nous présente H. Basu s'inscrivent dans un tout autre
contexte, celui d'une région du nord-ouest de l'Inde (Kacch), où ces chants poétiques de
louange étaient traditionnellement la spécialité d'une caste de « bardes » qui rendaient
ainsi rituellement hommage dans la cour royale à leur maître et héros légendaire (roi
chasseur ou guerrier). Après la dissolution de la royauté Rajput et la perte de pouvoir
social de la caste dans la période coloniale et postcoloniale, le même habitus de caste
contribue à la redéfinition identitaire d'une nouvelle communauté de mémoire et de
sentiment. Mais le déplacement est là aussi significatif : le culte des héros royaux laisse
place à la dévotion et aux louanges de « déesses humaines », figures historiques
porteuses des valeurs ascétiques d'un réformisme social contemporain, et médiums
dispensateurs des dons qui offrent les ressources de l'accomplissement individuel
autant que de l'affirmation identitaire.
6 La note critique de Malika Zeghal sur les saints, héros et martyrs du monde musulman
vient à point nommé pour ouvrir sur d'autres enjeux identitaires plus radicalement
politiques et religieux abordés par quelques ouvrages récents (C. Mayeur-Jaouen, F.
Khosrokhavar). La plasticité et la circularité de ces figures d'identification collective ou
individuelle ne prennent tout leur sens que par les contraintes qui pèsent sur le jeu des
écarts et des transformations possibles au sein de cette typologie triangulaire, au
dessus de laquelle plane la figure du prophète. Le culte de la personne qui entoure les
chefs d'État du monde arabe conduit à en faire des héros nationaux mais pas
automatiquement des saints ou des martyrs, et les relais qu'offre le sacré par rapport
au politique restent ambigus. Enfin comme l'illustrent les figures récentes des martyrs
médiatiques ou virtuels, les figures du saint ou du martyr ne franchissent pas
impunément les frontières et ne s'exportent pas dans n'importe quel contexte. En
passant des cultes locaux aux espaces nationaux, et encore plus aux réseaux
transnationaux, les vertus d'identification ou d'intercession qu'on leur prête tendent à
s'épuiser ou même à se retourner. Entre le réel et le virtuel, l'imaginaire des anges
rejoint celui des démons.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
8
« Tes anges ne sont pas les miens ! »
De l’ange gardien à l’ange haziélien
Anne Manevy
De l'ange gardien à l'ange haziélien
1 Il existe actuellement, dans les librairies spécialisées dans la littérature dite
« ésotérique », de très nombreux ouvrages sur les anges. L'un des auteurs les plus
productifs dans ce domaine est un dénommé Haziel 1. Il a écrit au moins une douzaine
de livres, dont je ne citerai que quelques-uns : Les Anges planétaires et les jours de la
semaine ; Répertoire des Anges ; Le pouvoir des Archanges ; Le memento des Anges ; Le Monde
des Anges et des Archanges ; Notre Ange Gardien existe ; Communiquer avec son Ange Gardien,
etc. Ces titres suggèrent, à eux seuls, que nous sommes ici dans une production typique
de cet aspect de la modernité religieuse qui est son caractère syncrétique. Certains
termes rappellent en effet explicitement la tradition catholique, tandis que d'autres lui
sont étrangers, de même que l'idée d'établir un « répertoire » des anges ou encore la
question de savoir comment on peut communiquer avec eux. Qui sont donc les anges,
archanges ou anges gardiens dont il est question, quelles fonctions leur assigne-t-on et
quel rapport entretiennent-ils avec les anges canoniquement définis par l'Église et,
surtout, avec sa conception de l'ange gardien ? Pour répondre à ces questions, je me
propose d'examiner le contenu et les sources de quelques ouvrages signés Haziel et,
d'autre part, d'analyser la façon dont ils sont lus et utilisés par ceux qui se mettent sous
la protection de ces « nouveaux » anges.
L'onomastique angélique
2 Les livres de Haziel et de ses émules postulent l'existence de soixante-douze anges,
associés aux astres et « régissant » chaque individu en fonction de sa date de naissance.
Chacun de ces anges porte un nom terminé par les suffixes el ou iah. On trouve par
exemple un ange nommé Caliel, un autre Véhuiah, un Nanael, etc. Ces noms sont
construits sur le même modèle que ceux issus de la mystique juive, les suffixes el et yah
servant à qualifier « Dieu » et « Seigneur » 2. Chacun de ces noms est assigné à l'un des
neuf chœurs d'anges théorisés par le pseudo-Denys dans sa Hiérarchie céleste 3.
Présentés sous forme de répertoires, ces ouvrages définissent la nature, les attributs et
les pouvoirs de chaque ange. Voici, par exemple, le portrait qui est donné de l'ange
Vasariah :
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
9
32 – Vasariah
Ange Gardien des personnes nées entre le 29 août et le 2 septembre.
Ange Gardien relié aux puissances lunaires ; il agit dans le niveau vibratoire le plus
bas du Chœur des Dominations, le plus pétrifié, et, par conséquent, il est le Gardien
qui manifeste son influence le plus intensément ; il est celui qui peut nous aider le
plus radicalement. Les énergies de Jupiter (Richesse, Bien-être, Joie) sont
transmises par cet Ange lunaire, avec force et vigueur, dans le for intérieur de ses
protégés. Étant donné que la vie extérieure, quotidienne, n'est rien d'autre que
l'image concrète de notre réalité intérieure, la personne, sous l'influence de cet
Ange Gardien (surtout en lui adressant sa Prière), sera orientée vers des situations
heureuses. C'est l'Ange Gardien des Grands de ce Monde (selon les statistiques), et
cela explique que le Texte Traditionnel indique, qu'en priant cet ange, on obtient
faveurs et avantages des Rois, Présidents, et personnes puissantes 4.
3 Chaque portrait met en avant, comme celui que l'on vient de citer, les pouvoirs
cosmiques de ces anges : ces « entités supérieures », ces « grands », ces « forces
conscientes » sont supposés canaliser et orienter toutes les énergies du système solaire.
Les hommes peuvent donc bénéficier de ces « forces sidérales » car ils leur sont
naturellement reliés. Le lexique utilisé est emprunté, d'une part, à la religion officielle
(on fait référence aux neuf chœurs angéliques, le terme « Seigneur » est préconisé pour
s'adresser à l'ange, etc.) ; d'autre part, au discours scientifique (notamment avec
l'utilisation du vocable « énergies »). En outre, Haziel souligne fortement le caractère
logique de sa démonstration (« par conséquent », « étant donné que » ...) et cite
volontiers des preuves « scientifiques » (« selon les statistiques »). On ne sera pas
renseigné sur la source ni la nature de ces fameuses statistiques ; on n'en saura pas
davantage sur le « Texte traditionnel », posé comme une caution et évoqué de façon
systématique. Rien de très original dans ces procédés : de nombreuses études sur les
« parasciences » ont établi qu'elles se référaient explicitement à la « culture
dominante » et à ses moyens de légitimation officiels 5.
4 On remarque, par ailleurs, que les verbes sont des verbes d'influence (régir, capter,
pousser, obtenir...) et que certains termes reviennent avec une fréquence surprenante :
conscience, vérité, énergie, réalisation. Également récurrents, les procédés
typographiques mis en œuvre pour appuyer le propos : une surenchère de majuscules,
de parenthèses et de caractères gras. Quant au temps utilisé, c'est le présent ou encore
le futur (de la prédiction et, d'une certaine façon, de l'inévitable).
5 Pour comprendre cette typologie et ses nombreux avatars, il nous faut remonter au
début du xixe siècle. À l'époque, en 1823, un dénommé Lenain publie un ouvrage
intitulé La Science cabalistique ou l'art de connaître les bons génies, ouvrage qui sera réédité
en 1909, préfacé par le Docteur Papus 6. Au chapitre VI, Lenain explique les
« influences » des soixante-douze « génies », qu'il appelle aussi, mais plus rarement,
« anges ». C'est cette nomenclature que reprend Haziel au xxe siècle, ainsi que tous les
auteurs d'ouvrages du même ordre, utilisant les mêmes noms et les mêmes attributs,
les mettant, si besoin, « au goût du jour ». Lenain, pour sa part, reprenait déjà à son
compte les soixante-douze noms répertoriés, à la Renaissance, par l'un des pères
fondateurs de la kabbale chrétienne 7, Johannes Reuchlin (1455-1522) qui, au livre
troisième de son De arte cabalistica, nomme les soixante-douze anges et décrit leurs
« signatures » magiques. La démonstration de Reuchlin s'appuie sur la manipulation
arithmétique de l'alphabet hébreu servie par des procédés de permutation, opérations
ardues que je ne développerai pas ici. Notons encore que les suffixes el et iah sont déjà
présents. Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535 ?), un autre kabbaliste
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
10
de renom, énumère lui aussi ces anges ainsi que leurs correspondances avec les astres 8.
Lenain, fort de cette liste de noms, la parachève, affectant chacun des soixante-douze
génies à un chœur angélique particulier et lui attribuant ce qu'il appelle une
« nation » 9 ainsi qu'un horaire précis.
6 La typologie du pseudo-Denys, théoricien des premiers siècles du christianisme, a été
ensuite articulée aux spéculations des kabbalistes chrétiens de la Renaissance. Cette
tradition prend une nouvelle vigueur au xixe siècle, époque marquée par le spiritisme,
l'attrait pour l'Orient, l'égyptologie, etc., et où un certain nombre de sociétés secrètes
se constituent. C'est d'ailleurs dans la première moitié du xix e siècle qu'apparaissent les
néologismes ésotérisme et occultisme 10. Inscrite dans la continuité de ces courants,
l'angélologie de Haziel est évidemment différente de la doctrine de l'Église. Celle-ci a
notamment marqué son opposition à l'idée qu'on pourrait dénombrer et nommer les
anges.
La critique des autorités
7 Alors que la mystique juive et les écrits intertestamentaires, le livre d'Hénoch en
particulier, nomment les anges, l'Église, quant à elle, récuse cette opération, les seuls
anges nommés étant les trois archanges cités dans les textes canoniques 11. Très tôt
dans l'histoire du christianisme est affirmée la prohibition des noms d'anges. Le concile
d'Aix-la-Chapelle (789) rappelle cette interdiction : « Conformément au canon trente-
cinquième de Laodicée, on ne doit invoquer que les anges dont les noms sont connus :
Michel, Raphaël et Gabriel sont seuls dans ce cas 12. » Au xviie siècle, Jean-Baptiste
Thiers, dans son Traité des superstitions, n'a pas manqué de critiquer l'onomastique
angélique et toutes les pratiques accompagnant la récitation de formules. Étant donné
le soin méticuleux qu'il apportait à leur retranscription à des fins d'exhaustivité, la
méthode utilisée par l'abbé Thiers nous renseigne en outre sur la nature de certaines
conjurations. Au livre troisième, est ainsi mentionnée la pratique « superstitieuse » qui
consiste à invoquer des « génies » : les Anges Uriel, Iniel, Assiniel et Jediel, liés à chacun
des quatre points cardinaux 13. L'avantage de l'abbé Thiers est d'expliciter très
clairement ce qui est redouté par l'Église à savoir que, si on nomme les anges, on les
confond avec les « génies », on revient au paganisme antique. Aussi peut-on penser,
comme le fait l'historien P. Faure, que l'Église a voulu, en acceptant uniquement la
dénomination des trois archanges, canaliser un culte « sauvage », réglementation
particulièrement profitable au culte de saint Michel archange 14. L'autorité canonique
intègre archanges et bons anges dans le cadre de ses prérogatives, les déclarant saints.
L'épisode des sept archanges est à cet égard significatif : en 1523, suite à la découverte
d'une fresque, à Palerme, représentant sept archanges dont quatre apocryphes, Uriel,
Jehudiel, Barachiel et Sealtiel, une église leur est consacrée et Rome, par l'intermédiaire
du pape Pie IV, semble approuver la nouvelle dévotion puisqu'on lui consacre Sainte-
Marie-aux-Sept-Archanges en 1561. Très vite, cependant, l'Église revient sur ses
positions et les noms des quatre anges illégitimes sont effacés des retables, seuls
demeurent Michel, Gabriel et Raphaël 15.
8 Dans sa lutte contre la superstition, l'Église du temps de l'abbé Thiers ne pouvait que
condamner le culte des génies. L'autorité romaine post-tridentine a donc encore durci
sa position face aux « faux noms » tandis qu'elle mettait à l'honneur une dévotion
nouvelle, la dévotion « au saint ange gardien ». Étendue à toute l'Église au xvii e siècle,
la fête des anges gardiens est fixée au 2 octobre. Bien que discrète par rapport à
d'autres dévotions plus éclatantes comme le Rosaire, elle s'institutionnalise en
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
11
s'organisant au sein de confréries, dont certaines ont perduré jusqu'à nos jours. Dans la
piété tridentine, l'ange gardien, le « bon ange », le « saint ange », comme on l'appelle
alors, est surtout un auxiliaire de la « bonne mort » dont la préparation embrasse tout
le temps de « l'épreuve ». Il apparaît dans les testaments, dans les préparations à la mort
et est donc réservé au chrétien préoccupé par son salut. Du même coup, il est aussi
celui qui protège contre la mort subite et, par sa veille accrue, prévient les accidents.
De plus, la dévotion aux anges, à travers les multiples formes qu'elle est susceptible de
revêtir (prière, affiliation à une confrérie, port d'une médaille, etc.), permet au fidèle de
bénéficier d'un certain nombre d'indulgences et, surtout, l'oriente vers les cultes
centraux du catholicisme (le Christ et la Vierge). Progressivement, l'ange gardien va
participer d'un système d'édification : il est proposé aux enfants comme conscience
morale, censé encourager la modestie et la bonne conduite, bref, tout ce qui maintient
le chrétien dans « le droit chemin ». Dès lors, il est vivement encouragé de se
recommander sans cesse à ce compagnon invisible, ce « fidèle ami », auxiliaire de la
persévérance. L'institution ecclésiale s'est donc appliquée à promouvoir et valider la
figure du bon ange, s'appuyant sur ces référents faisant autorité que sont les sources
testamentaires, patristiques, théologiques et pontificales et posant les limites
normatives de la dévotion. Aujourd'hui encore, sont réitérées les mêmes mises en
garde : Le Directoire sur la piété populaire et la liturgie réprouve « l'usage de donner aux
Anges des noms particuliers que la Sainte Écriture ignore hormis ceux de Michel,
Gabriel et Raphaël 16 ». En aucun cas, les anges gardiens du catholicisme ne peuvent
être énumérés, ils sont des protecteurs tutélaires, certes, mais anonymes.
9 Ce qui caractérise donc la position de l'Église, c'est le refus de dénombrer et
d'individualiser, en les nommant, les anges et plus particulièrement les anges gardiens.
Ce refus, comme on l'a dit, a été initialement inspiré par la volonté de lutter contre le
paganisme. Ce combat n'est plus d'actualité. Personne ne croit encore aux « génies » et
il est significatif, de ce point de vue, que le terme soit présent dans l'ouvrage de Lenain
mais qu'il disparaisse du lexique de Haziel qui parle uniquement d'anges, archanges ou
anges gardiens. Pour mieux comprendre pourquoi l'on a pu reprendre à la tradition
catholique ces désignations et pour mieux saisir, aussi, ce qui rompt avec elle dans
l'usage qui en est fait, il faut examiner maintenant quel type de pratiques se rattachent
à ces figures 17.
« Prendre un peu de tout »
10 Rose est une femme d'une quarantaine d'années à l'image de son intérieur, habillée et
maquillée avec soin, très enjouée. Elle est surtout, depuis l'âge de douze ans, une
collectionneuse d'anges et affirme conserver plus de cinq cent soixante-dix statuettes.
On ne peut manquer d'être étonné par la profusion de figurines, soigneusement
contenues dans des vitrines et exposées dans le salon. Les anges parvenus jusqu'aux
pièces que l'on montre moins, comme la cuisine, la salle de bain ou la chambre,
s'intègrent plutôt en tant qu'objets fonctionnels (accessoires pour rideaux, moules à
gâteau, etc.) 18. Elle se plaît à commenter celles de ses figurines qu'elle juge les plus
remarquables : tel ange en provenance du Mexique, tel autre en pâte à sel ou encore
peint à la main. La plupart de ces objets lui ont été offerts et leur évocation suscite alors
un discours sur le donateur, la provenance, l'occasion. En outre, elle reprend à son
compte le lexique des théoriciens des premiers siècles du christianisme afin de décrire
sa propre collection de statuettes d'anges gardiens, opération parfois surprenante où se
multiplient les hésitations et les confusions. Ainsi, pour un ange en tenue d'apparat elle
dira « Ça, c'est un chœur des Principautés » ; à l'égard d'une statuette de saint Michel
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
12
en armes, elle soutiendra « Ça, c'est un chœur des Puissances » ; « Le chœur des Vertus,
c'est aussi des anges-enfants mais on ne voit que les têtes avec des morceaux d'ailes ».
11 Peintre de profession, Rose a récemment organisé une exposition comptant soixante-
douze tableaux, soit un pour chacun des soixante-douze anges immanquablement
répertoriés dans les ouvrages spécialisés. Pour faciliter la diffusion de son travail, elle a
reproduit chacun de ces tableaux sous forme de cartes postales de deux formats
différents avec, pour chaque ange, une note explicative inspirée des ouvrages signés
Haziel. Passant de la collection à la représentation figurée, Rose illustre à sa manière la
figure de l'ange gardien, offrant une interprétation très personnelle.
Grande discussion avec ma belle-mère à ce propos. Mon mari est d'une famille
catholique pratiquante mais à tel point que, avec ma belle-mère, bon... quand on a
décidé de faire l'expo elle ne comprenait pas du tout, elle disait :
– Tes anges ne sont pas les miens !
Or, quand on sait qu'ils sont cités plus de huit cents fois dans la Bible...
12 Les anges qu'elle a représentés sont de jeunes enfants presque ou complètement nus,
potelés et affublés de petites ailes. Est-ce cette iconographie un peu mièvre, calquée sur
le traditionnel modèle du putto qui contrarie sa belle-mère, fervente catholique ? N'y a-
t-il pas plutôt un désaccord plus profond, portant sur la nature même de ces anges, leur
individualisation et les pouvoirs qu'on leur prête ? Le discours officiel de l'Église
catholique sur les anges gardiens et la prohibition des noms permettent de mieux saisir
ce qui est en jeu dans cette querelle. Ce sont les tentatives de « bricolage » religieux qui
sont critiquées :
Ce que je trouve toujours curieux c'est qu'en fait on fait un syncrétisme, c'est très
curieux. Vous avez l'Église qui dit quelque chose alors on prend un peu dans la
religion catholique, un peu chez les bouddhistes, un peu chez les juifs, on mélange
et on se fait sa religion de supermarché, vous savez, à la carte... Et voilà « Ben ça,
c'est la mienne ! », tendance un peu New Age (...) en plus vous avez des tendances
panthéistes. Moi je trouve ça absurde de raisonner comme ça pour éviter les
contraintes que pose toute religion (...) Se faire sa petite religion à soi, c'est
terriblement réducteur et je trouve que c'est pas très respectueux pour tous ces
gens qui ont pu mourir, pour une religion ou pour une autre d'ailleurs, et qui se
battent pour leur foi !
13 Ainsi s'exprime Chantal, une fervente catholique invoquant régulièrement son ange
gardien, avant de clore son propos par une évocation du martyre de sainte Blandine
« dans la fosse aux lions ». Les éléments de réprobation avancés constituent le lot
commun de la critique à l'encontre des « Nouveaux Mouvements Religieux » :
« Métaphore du bricolage ou plutôt référence au bricolage : le terme, en effet, s'est
imposé sans réelle réflexion sur sa signification, sans notamment être confronté à ses
usages antérieurs, et dûment pensés, par Claude Lévi-Strauss et Roger Bastide, tout
particulièrement. Il est en fait utilisé dans le sens de “religion à la carte” signifiant le
refus de prendre en bloc la religion des traditions instituées. Une autre métaphore est
également couramment employée, celle du “supermarché spirituel”, métaphore,
incontestablement, elle, chargée de connotations dépréciatives, laissant entendre une
perte par rapport aux synthèses religieuses instituées » écrit Françoise Champion 19. Or,
c'est ce même droit au mélange que revendiquent justement ceux qui invoquent un
ange gardien dénommé : « Je suis catholique mais je prends dans les anges hébraïques,
je prends dans le Coran, je prends un peu de tout » explique Mireille. « Prendre un peu
de tout » fonctionne alors comme une preuve de curiosité intellectuelle. Il s'agit
d'embrasser le plus grand nombre de « techniques » pensées comme interdépendantes :
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
13
« Numérologie, astrologie ... J'essaie bon ... Comme dans la kabbale, de tout
rassembler. » (Rose). Claude Fischler, étudiant la genèse de l'horoscope zodiacal
moderne, remarque que la rubrique astrologique intègre « dans une publicité
abondante et syncrétique tous les secteurs de l'occulte et du magique : voyance,
astrologie, désenvoûtement, retour d'affection, amulettes, etc. 20 ».
14 Ainsi, l'accumulation des procédés est-elle envisagée comme une opération légitime et
nécessaire. À l'opposé de cette diversification considérée comme bénéfique, la même
démarche se voit accusée de récupération facile et la thématique du prélèvement sert
alors la critique à l'encontre de cette « petite cuisine », « à la carte » et autre « religion
de supermarché », caractérisée par des carences et une évidente facilité. S'opère alors
un prodigieux dialogue de sourds, les uns cherchant à découvrir « le nom » de leur ange
gardien ; les autres considérant ces tentatives comme des « dérapages ésotériques ».
Dans cet insoluble va-et-vient, ce qui pose toujours problème c'est, on l'a dit,
l'identification précise de ces anges et leur instrumentalisation, identification qui passe
bien entendu par ces procédés à risques que sont l'appellation et le comptage. La
manipulation des noms angéliques n'est certes pas une invention récente ; ce qui est
nouveau, en revanche, c'est la distribution de l'humanité entière en soixante-douze
« types », démarche qui s'apparente, comme on va le voir, au procédé classificatoire
utilisé par l'astrologie individuelle moderne.
L'autoportrait
15 L'adéquation entre le « caractère » supposé d'un individu et la description de son ange
gardien est pour Rose un sujet de fierté et elle encourage les visiteurs de son exposition
à se prononcer sur l'acuité de ses portraits : « Ce qui est assez sympa c'est quand des
journalistes ou des gens qui sont passés dans l'expo se sont bien retrouvés. Il y a très
peu de personnes qui ont dit “Ah ! Non, non ! Ça ne me ressemble pas.” Et, en fait, ceux-
là, quand c'est moi qui les avais en relation, je leur disais “Bon, voilà : Soyez vraiment
honnêtes et je vais tâcher de vous expliquer.” Et il n'y en a qu'une seule qui ne s'est pas
reconnue. » Ce que Rose appelle « se retrouver » consiste à relever une propriété
constitutive de la personne, propriété généralement signifiée par l'usage du
complément du nom. Il y a par exemple un ange « de communication », un ange « de
justice », etc. L'attribut qui est alors mis en avant dénote la prédisposition principale de
l'individu. D'autre part, avec le nom de l'ange, on a parfois un travail sur l'identité
proche de la fusion. Rose a ainsi décidé d'utiliser le nom de son ange gardien comme
pseudonyme et c'est désormais sous le nom de Anauel qu'elle signe toutes ses œuvres.
L'homonymie qui en résulte fonctionne davantage comme un faire-valoir, signe d'un
désir de singularité, que comme un camouflage de l'identité réelle.
16 L'établissement précis de l'identité et de la spécialité de cet ange gardien a le mérite
d'offrir un autoportrait à l'individu désigné, technique couramment utilisée par les
horoscopes actuels. Il s'agit avant tout de se reconnaître dans l'image, généralement
valorisante, qui est donnée. On est dans un système qui valorise très fortement
l'individu, celui-ci ayant assez d'importance pour être doté d'un protecteur propre
d'origine surnaturelle et dont il paraît légitime d'attendre des bénéfices. La référence à
l'astrologie, si présente dans la typologie des soixante-douze anges, renvoie surtout à
l'astrologie « de masse » telle qu'elle se met en place dans la presse féminine au milieu
du xxe siècle, à son versant caractérologique, et surtout à son découpage en douze
signes du zodiaque. L'astrologie moderne est, à ses débuts, météorologique et
collective ; les seules prémices d'individualité transparaissent dans des conseils
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
14
pratiques de portée individuelle. C'est avec l'invention de l'horoscope zodiacal que
s'opère la véritable individualisation, l'humanité étant divisée en douze types puis
trente-six avec la subdivision en décans 21. Les soixante-douze noms critiqués par l'abbé
Thiers donnaient lieu à des invocations et des conjurations, non pas à un système de
correspondances subdivisant l'humanité entière en soixante-douze types : si des listes
d'anges ou de génies étaient courantes dans les ouvrages kabbalistiques chrétiens de la
Renaissance, il faut attendre le début du xixe siècle pour qu'apparaisse véritablement
un champ, non plus seulement classificatoire, mais désormais caractérologique. C'est
sur un modèle analogue à celui de la classification zodiacale apparue dans les
horoscopes individuels au milieu du xxe siècle que la répartition inaugurée par Lenain
semble s'être opérée, assignant à chacun son ange.
17 De même que les horoscopes de presse distinguent volontiers « signe » 22 et
« ascendant » 23 et subdivisent la nomenclature zodiacale en décans, cette assignation
peut se complexifier avec l'entrée en scène d'un deuxième ange. Ainsi, Mireille, qui
exerce une activité de médium de manière professionnelle, estime bénéficier de deux
anges : un « ange de la naissance » et un « ange du jour ». Elle affirme que son ange de
naissance est « un ange de rétablissement » (Nanael, dans la typologie établie par
Haziel) et ajoute : « Le jour où je suis née, c'était l'ange de ma sœur qui gérait ma
journée. » Ce deuxième ange, dit du jour, est « un ange de la guérison » (Rochel).
Mireille donc, avant même de mentionner le nom de l'ange, s'attache à définir la
spécialité de ce dernier au moyen d'un complément du nom. De mon propre ange
gardien (Mikael, toujours au regard des mêmes critères temporels d'attribution), elle
dira : « C'est l'ange de la justice. » Dans une opposition désormais classique, Paul
Ricœur fait état de l'identité ipse, qu'il appelle « ipséité », et de l'identité idem, la
« mêmeté ». Selon lui, le caractère, et, partant, ce qui a été nommé caractérologie,
relèvent de l'ordre du même : « J'entends ici par caractère l'ensemble des marques
distinctives qui permettent de réidentifier un individu humain comme étant le même.
Par les traits descriptifs que l'on va dire, il cumule l'identité numérique et qualitative,
la continuité ininterrompue et la permanence dans le temps. C'est par là qu'il désigne
de façon emblématique la mêmeté de la personne 24. » L'ange gardien définit cette
« mêmeté ». Il induit à ce titre une propension chez l'individu, propension qui peut être
latente mais qu'il ne tient qu'à la personne protégée – éventuellement à l'un de ses
proches – de savoir reconnaître comme disposition permanente et de mettre à profit.
La multiplication des anges gardiens possibles accroît justement les chances de « se
reconnaître ».
18 Ainsi, si Mireille invoque ses deux anges lorsqu'elle « fait du travail à la bougie » 25, c'est
qu'ils correspondent précisément à l'idée qu'elle se fait des qualités que doit posséder
une personne exerçant son activité : son don est d'une certaine manière cautionné par
son ange de rétablissement et par son ange de guérison. Du reste, pour Mireille, dire
« J'ai un ange de guérison » revient à dire « J'ai un don de guérison », c'est cela qui est
primordial. De plus, il arrive qu'elle évoque « l'ange de ma sœur » plutôt que de dire
« mon ange de guérison ». Ce référent est significatif puisque, par l'intermédiaire de ce
même ange, elle partage certaines propriétés stables (identité idem, dans le langage de
P. Ricœur) avec sa sœur. Sa sœur ne lui ressemble pas à proprement parler (bien au
contraire, Mireille insiste sur leurs différences physiques) mais elle aussi, selon
Mireille, « a un don » ; c'est une manière de se reconnaître en l'autre, de trouver de
l'identique et, tout compte fait, de se valoriser mutuellement. C'est aussi une façon
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
15
d'affirmer ce don comme propriété constitutive et, d'une certaine manière, héréditaire,
les deux germaines étant dotées d'un même ange gardien.
19 Le catholicisme a fortement encouragé l'exercice de l'examen de conscience dans l'idée
qu'une telle pratique stimulait l'aveu, donc le pardon. « S'examiner souvent » oblige le
chrétien à traquer ses moindres fautes et imperfections. L'ange gardien mis en exergue
au xixe siècle devait inspirer le respect (et tenir, précisément, les enfants en respect) ;
corollaire de l'examen de conscience, de la confession et de la contrition, il permettait
au chrétien de se corriger et de demander pardon, au terme d'une démarche réflexive
et récapitulative. Avec les anges dénommés, cette attitude moralisante disparaît, seules
demeurent les propriétés et les compétences. Il ne s'agit pas de dénoncer (portrait de
l'autre) ni d'avouer (ses fautes) mais de se conforter dans ce que l'on croit savoir de soi-
même ou de ce que l'on souhaite être. Pour ce faire, la taxinomie des anges repose sur
une rhétorique de l'épithète. La traque constante du défaut – l'orgueil en particulier – a
été remplacée par une quête des potentialités. Dans le système des soixante-douze
anges, la supposée connaissance de soi permet assurance et amélioration des
compétences, rien a voir, donc, avec la correction. Identifier avec précision son ange
gardien et lui assigner un trait de caractère c'est, du même coup, attribuer à l'individu
qu'il protège et détermine une sorte d'unité ontologique, une cohérence stable et
permanente même si celle-ci doit parfois être découverte ou, pour le moins, reconnue.
La compétence professionnelle
20 Tous ces efforts typologiques entendent caractériser un individu sur mesure, rassuré
dans sa singularité. Autre procédé de catégorisation courant, dérivant du modèle des
patronages professionnels institutionnalisés dans le catholicisme qui attribue à chaque
corps de métier un saint particulier, on trouve également une forme de patronage
angélique. Au xve siècle, Marsile Ficin, kabbaliste chrétien selon lequel un « Ange »,
« Démon » ou « Génie » associé à une « Estoille » est attribué à l'homme dès sa
naissance, entrevoyait l'importance d'une adéquation entre le « métier » et l'ange
gardien personnel. « Il y a donc deux sortes d'hommes infortunez par dessus tous les
autres, écrivait-il. L'un de ceux qui ne faisans aucune profession ne font rien. L'autre de
ceux qui entreprennent profession estrange à leur naturel et contraire à leur génie » 26.
21 Intarissable sur la question du « travail », Haziel détermine ainsi, pour chacun des
anges gardiens, un certain nombre de secteurs professionnels pour lesquels l'individu
présente des aptitudes manifestes.
Fait réussir dans les activités concernant le bâtiment, l'immobilier, les ciments, les
textiles, l'agriculture ; et également aide à l'avancement dans la police, dans
l'administration locale et dans la diplomatie. (Jeliel) – La personne peut inventer,
découvrir, innover ; vendre des appareils électroménagers ; mener une action de
modernisation dans l'aviation et surtout dans les Chemins de Fer. (Lelahel) – elle
pourra gagner beaucoup d'argent, en travaillant dans l'agriculture ou les Grands
magasins (deux domaines lunaires de la compétence, encore de son Gardien) : elle
pourra posséder des terres, des champs, avoir des récoltes satisfaisantes,
abondantes. (Cahetel) – Le Texte traditionnel dit que la personne peut avoir une
grande réussite dans la carrière militaire (Yelahiah) 27.
22 La présentation des qualités s'opère conjointement avec l'établissement de
« domaines » dans lesquels l'individu est susceptible de « réussir ». Rassurantes, ces
listes n'en appellent pas moins à un idéal de conformité sociale et surtout à l'idée que
l'effort et le respect de la hiérarchie seront justement récompensés :
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
16
En juste retour, il sera largement payé et considéré ; il jouira de la pleine confiance
de ses supérieurs, qui lui accorderont toutes sortes de récompenses, quoique
toujours liées au travail. Lehahiah, aime les gens qui travaillent durement ; mais il
donne la totale sécurité de l'emploi, la continuité du travail.
23 L'individu mérite donc de bien gagner sa vie et d'être estimé de ses supérieurs. Dans les
années 1950, la référence fréquente à ces « supérieurs » avait déjà été relevée par
Théodor Adorno dans son étude sur la rubrique astrologique du Los Angeles Times 28.
Cette insistance sur la volonté et l'effort individuels renvoie encore une fois à la
rhétorique optimiste des horoscopes de presse : « Les désagréments de l'existence ne
sont jamais irrévocables, jamais irrémédiables : l'horoscope les nie ou les minimise
mais, surtout, il assure que le courage et la volonté, associés à quelques recettes
simples, en viendront à bout » écrit Claude Fischler 29. Corollairement, l'insatisfaction
professionnelle est elle aussi envisagée :
L'individu devra réaliser un travail ardu de reconsidération de soi-même, et cela se
manifestera par un travail professionnel dur, étranger à sa personnalité, à ses
possibilités (Menadel).
24 L'étendue des domaines énumérés ouvre le champ à des potentialités inexploitées.
Certains métiers, considérés comme particulièrement ardus et prestigieux, seront
habilement présentés avec des probabilités moindres :
Ces individus sont des juges-nés, même s'ils n'exercent pas cette profession ; ils
sont les meilleurs avocats pour nous défendre (avec titre ou sans titre) (Daniel).
25 Les « carrières » dans la justice et la magistrature tiennent en effet une place de choix,
avec sept occurrences sur les soixante-douze anges, tandis que « le soutien aux
prisonniers » est mentionné pour trois anges au moins. Un autre secteur est
particulièrement valorisé, celui de la médecine. Bien entendu, Haziel sous-entend qu'il
peut s'agir d'une activité non officielle et, dans tous les cas, les individus sont voués à
guérir aussi bien « le corps », que « l'âme ». De nombreux « scientifiques » également,
dans cette nomenclature, et une valorisation certaine du travail « intellectuel ». Enfin,
il est beaucoup question de « réussite » de « réalisation », de « succès », de « richesse »,
de « renommée », de « respect », de « puissance », etc.
26 L'un des ouvrages de Joeliah, Les Anges de lumière et la vie professionnelle 30, propose quant
à lui un index vertigineux qui laisse songeur quand on sait qu'il répertorie et associe à
chacun des soixante-douze anges plus de deux cent soixante métiers dont des
spécialités aussi diverses qu'anthropologue, champion, cueilleur d'herbes médicinales,
chasseur de nuisibles, charmeur de serpents, intellectuel, peintre cubiste, premier
Ministre, président d'association, prophète, star, surveillant de baignade ou travailleur
à la chaîne, pour n'en citer que quelques-unes.
27 Claude Fischler avait mis en évidence l'idée d'un « opportunisme horoscopique » : on
attend de l'individu qu'il soit « raisonnable » mais qu'il se tienne « à l'affût », prêt à
saisir au vol « l'occasion » 31, il en va de même avec la typologie des soixante-douze
anges énumérant des compétences en attente d'être reconnues et exploitées.
Les « influences » selon Lenain
28 On peut à bon droit s'interroger sur les domaines de prédilection cités par Haziel.
Pourquoi certaines professions (la justice, la médecine...) sont-elles récurrentes et
spécifiquement valorisées ? Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir sur le
contenu de La Science cabalistique de Lenain. Ce dernier, qui fait paraître son ouvrage au
début du xixe siècle, affectionne les faits d'armes, la bravoure, la fidélité conjugale, la
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
17
diplomatie, la piété, les « remèdes merveilleux », la jurisprudence et autres
jurisconsultes, l'important étant de se « distinguer » (terme cher à Lenain) par quelque
talent ou action éclatante. Examinons plus en détail deux exemples :
29 Concernant la médecine, Lenain dit du génie Aladiah :
Il est bon pour ceux qui ont des crimes cachés et qui craignent d'être découverts. Ce
génie domine contre la rage et la peste, et influe sur la guérison des maladies.
30 Ce que Haziel exprime de la façon suivante :
Régénération du corps, en tout premier lieu, guérir les autres et soi-même (les os,
surtout, régis par Saturne), puis régénération morale et, avec elle, effacement de
toutes les fautes et erreurs du passé.
31 Quant au génie Ieiazel :
Ce génie domine sur l'imprimerie et la librairie ; il influe sur les hommes de lettres
et les artistes (Lenain, p. 72).
Il a pouvoir sur l'édition, les disques, la presse, la radio, la télévision et le cinéma
(Haziel, p. 102).
32 Cette liste, loin d'être exhaustive, illustre les emprunts faits par Haziel à Lenain,
emprunts qui sont parfois « bricolés » ou encore édulcorés. Ainsi, Lenain est-il très
prolixe sur les valeurs religieuses : « Il sert contre les ennemis de la religion et pour
convertir les peuples au christianisme. Ce génie domine la religion, la théologie et la
morale ; il influe sur la chasteté et la piété et sur ceux dont la vocation est pour l'état
ecclésiastique » écrit-il à propos du génie Pahaliah. Haziel n'évoque, pour ce même
ange, ni la piété ni la conversion, encore moins l'état ecclésiastique ou le
christianisme ; il parle au contraire « d'Ordre universel » et de « Vérité ». Bien entendu,
la justice et la carrière dans la magistrature sont très fréquentes chez Lenain, qui n'est
pas avare de précisions : « Ce génie [Vasariah] domine la justice ; il influe sur la
noblesse, les jurisconsultes, les magistrats et les avocats. » Une autre catégorie est
spécifiquement valorisée par Lenain, celle qui consiste à « mériter la confiance de son
prince », sujet sur lequel Lenain est des plus prolixes :
elle [la personne] aura la confiance et les faveurs de son prince, qu'elle méritera par
son dévouement, sa fidélité, et les grands services qu'elle lui rendra (p. 67).
elle aura beaucoup de réputation parmi les savants, se distinguera par ses vertus et
méritera la confiance de son prince (p. 83).
33 Il est d'ailleurs un génie, Iehhuiah, qui, chez Lenain, « protège tous les princes
chrétiens ». Chez Haziel, ces princes deviennent à la rigueur des « grands » mais, plus
souvent encore, des « chefs » ou des « supérieurs ».
34 Ainsi, si la justice, la magistrature, la science, la médecine, la diplomatie sont toujours
en bonne place chez Haziel, l'état militaire a, pour sa part, moins de poids tandis que la
piété et l'exercice des vertus chrétiennes s'effacent complètement au profit de la
« Vérité ». Quant à l'estime du « Prince », sans doute fort à propos à l'époque où Lenain
rédige son ouvrage, elle paraîtrait aujourd'hui pour le moins incongrue ; aussi est-elle
judicieusement remplacée par l'entente avec les « grands de ce monde » ou, plus
prosaïquement, la considération des supérieurs hiérarchiques.
35 Tel qu'il était présenté dans la littérature de piété, le bon ange du catholicisme tendait
à proposer un modèle idéal du bon chrétien invité à faire pour le mieux selon « l'état »
où la Providence l'avait placé. Avec cette énumération des compétences
professionnelles et cette idée de réussite sociale on est loin de la « spiritualité des états
de vie » des moralistes chrétiens 32. Il n'est plus question ici d'une quelconque
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
18
sanctification par la condition et encore moins d'une morale du travail propres au
champ catholique.
Signes d'élection
36 Penser l'ange gardien en termes de propension donc, dans une certaine mesure,
d'élection, c'est bien entendu une façon de valoriser l'individu ainsi favorisé.
L'attribution de l'ange se fait, on l'a dit, de façon automatique, selon la date de
naissance. Tous les individus sont donc, à leur insu, dotés d'au moins un ange gardien.
Or, certains semblent plus aptes que d'autres à accéder à cette figure tutélaire.
37 Le catholicisme a eu, il est vrai, ses souffrants et surtout ses souffrantes, et leur a donné
un cadre propre à valoriser leurs peines et même à en redemander 33. Ici, nous ne
sommes pas, en revanche, dans cette optique du sacrifice, la souffrance n'étant pas
valorisée en tant que telle mais plutôt posée comme une épreuve que les individus sont
parvenus à surmonter, avec ou sans aide surnaturelle, et qui semble avoir favorisé une
certaine acuité dans la « communication extra-sensorielle » : « J'étais très malade il y a
deux ans. J'ai vu un halo et une source de lumière blanche descendre sur mon lit et moi
qui étais dans la pénombre la plus totale, j'ai ressenti de l'amour » raconte Mireille.
Rose, quant à elle, évoque spontanément une longue maladie, qui l'obligea à rester
alitée de longs mois, durant laquelle elle s'est intéressée aux anges gardiens. On a déjà
constaté combien la notion de force individuelle avait pris de l'importance, les anges
renforçant encore cette confirmation identitaire. La morbidité, lorsque l'on en
réchappe, joue un rôle analogue : la souffrance, la maladie semblent induire une
propension accrue, transformer l'individu et instaurer des conditions favorisant l'accès
à l'ange.
38 La guerre et la persécution sont elles aussi susceptibles de fonctionner comme des
épreuves qualifiantes : les fameux Dialogues avec l'ange recueillis en Hongrie entre 1943
et 1944 par un groupe de quatre amis en sont une illustration 34. Ces Dialogues paraissent
en 1976, rédigés par Gitta Mallasz, la seule non juive du groupe, et relatent les auditions
d'une voix, figure syncrétique où se mêlent les « influences orientales, ésotériques,
chrétiennes », illustrant ce que Françoise Champion appelle la « psychologisation de la
figure de l'ange » 35. Enfin, quand bien même Gitta Mallasz insiste justement sur le
caractère ordinaire de leur vie, il est question d'un message dispensé à un groupe
d'élus.
39 Finalement, tout se passe comme si l'expérience de la maladie et l'évitement de la mort
étaient avancés pour légitimer le discours sur les anges. Quelqu'un qui est « passé par
là » a quelque chose « en plus ». Du reste, cette relation entre maladie et désignation
d'un individu hors normes doté de pouvoirs spécifiques a été abondamment relevée par
des enquêtes ethnographiques exotiques, notamment sur la question du chamanisme 36,
d'où l'importance conférée au récit de ces déboires organiques envisagés, dès lors,
comme des signes. Non plus simple intermédiaire de la miséricorde divine, l'ange est
désormais posé comme une propension, une faculté individuelle et singulière. Cette
tendance à naturaliser l'ange gardien dans une thématique, même discrète et sous-
entendue, d'élection, aboutit tout compte fait à une valorisation de l'individu affirmé
comme remarquable et apte à un accès privilégié. On quitte alors l'anonymat, essentiel
aux yeux de l'institution ecclésiale, pour entrer dans la sphère de l'individualisation et
de la protection justifiées. Ce qui importe, c'est bien le lien singulier entre ego et son
protecteur, lien qui peut prendre différentes formes mais qui est indispensable à
l'affirmation des deux autonomies. C'est l'aptitude à déceler cette relation singulière et
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
19
à savoir en tirer profit qui est en jeu, d'où la valorisation de la maîtrise et du mérite
personnel.
40 Ce qui est vraiment nouveau avec l'ange gardien dénommé et qualifié, c'est la part
accordée aux notions de force et d'aptitude individuelles. On a, d'une part, des
dispositions semblables à celles de l'ange (et sur lesquelles celui-ci peut avoir une
influence) ; d'autre part, l'idée d'un mérite personnel dont les épreuves qualifiantes
comme la maladie, la guerre ou, simplement, une propension familiale sont les
meilleurs garants 37. Étant donné de telles qualités, l'individu doit les mettre à profit.
Disparue, donc, l'idée de surveillance et de menace morale.
L'immanence
41 Si l'ange gardien est donné par la naissance et détermine le « profil » de l'individu, rien
n'interdit cependant de solliciter quelque autre ange, à volonté, en fonction du bénéfice
recherché, c'est-à-dire en tenant compte de sa spécialité. « Il est évident que suivant la
situation dans laquelle on se trouve, il faut solliciter l'ange de la situation. Par exemple,
quand on n'a pas d'argent, il faut solliciter euh... Poyel » explique Rose. Le répertoire
des soixante-douze noms décline autant de « spécialités » et autorise l'accès à d'autres
anges, en fonction du bénéfice recherché tandis que les titres mêmes des divers
ouvrages spécialisés dans la quête et la sollicitation angéliques s'appuient sur ce
fondement empirique. Tout en marquant la distance et l'étrangeté, les sous-titres,
davantage encore, affirment ce postulat d'accessibilité, très souvent par l'emploi de
l'adverbe « comment » (« Comment leur parler ?, Comment les contacter ? ») ou,
directement, par un infinitif explicite (connaître, prévoir, résoudre ...). Ces ouvrages
promettent donc un traitement foncièrement pragmatique, le procédé le plus efficace
étant la prière ou, plus exactement, l'invocation. Mais, théoriquement, pour être
efficaces, ces invocations ne doivent pas être récitées n'importe comment ni à
n'importe quel moment. On a là un traitement assez banal de complexification,
de ritualisation pourrait-on dire, qui vise surtout à valider le bien-fondé de ces prières.
Mahasiah : Ne permets pas que les vertus, et les pouvoirs que tu déposes dans mon
âme, deviennent des obstacles à mon évolution.
Fais que je comprenne, Mahasiah qu'avant de réussir, je doive me réconcilier avec
ceux qui ont été jadis, mes compagnons de Vie (amis ou adversaires). Aide-moi
Seigneur, à dépasser les épreuves, afin que je ne m'identifie pas à la tribulation. Et
lorsque tes énergies auront nettoyé tous les recoins de mon âme, Accepte-moi,
Seigneur, comme ton ministre sur Terre ; comme porteur de l'Amour, de la Paix, et
de la Richesse (morale et matérielle) que tu représentes, et que tu m'accordes
(Haziel, p. 32).
42 Dans les prières rédigées par Haziel, on retrouve une forme d'imploration
traditionnelle (« Permets-moi Seigneur », « Accorde-moi, Seigneur »...) servie par un
vocabulaire qui, dans un autre contexte, serait des plus orthodoxes avec des termes tels
que âme, frères, épreuves, tribulation, ministre, vertus, amour, paix, etc. Selon Haziel,
il convient de respecter une distribution temporelle très précise : les jours de la
semaine sont spécifiquement désignés pour invoquer les anges selon leur appartenance
à un chœur particulier (ce qui implique de se référer à la classification aréopagitique
des neuf chœurs d'anges). Le dénommé Joeliah propose pour sa part des modèles de
prières qui rappellent les formes d'oraison préconisées dans les livres de piété
catholiques : prière du lever, prière du soir et prière pour les enfants 38, détaillant
également les opérations à effectuer avant chaque invocation (ablutions, bougie,
encens, etc.)
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
20
43 Enfin, les anges sont eux mêmes spécialisés : Haziel répertorie ainsi quatre grands
thèmes : l'amour (catégorie qui, chez Lenain, était représentée par l'appellation
« félicité conjugale »), l'argent, la santé, le travail. Cette distribution renvoie aux
préoccupations valorisées par toutes les techniques astrologiques ou numérologiques
actuelles : « De la vie décrite par l'horoscope et des modèles qu'il suggère se dégage
l'idéal d'un bonheur fondé sur le triptyque travail-amour-santé, impliquant
consommation, bien-être et confort » écrit Claude Fischler à propos des horoscopes
individuels zodiacaux 39. Cette immanence est caractéristique de ce que Françoise
Champion appelle la « nébuleuse mystique-ésotérique », mouvement « pro-mondain »
et orienté vers « la recherche du bonheur privé ici-bas et ici-et-maintenant 40 ». En cela
également, ces anges énumérables et susceptibles d'être sollicités à volonté s'opposent
à l'institution catholique qui a toujours marqué, avec plus ou moins d'intensité il est
vrai, sa défiance à l'égard du « monde », plein de ces tentations contre lesquelles le bon
ange aide justement son protégé à lutter. Avec la typologie des soixante-douze anges il
n'est plus question de salut, comme dans le catholicisme, mais d'immanence et de
prospérité. L'au-delà n'intéresse pas Haziel qui annonce « Absolument rien n'est
impossible à la volonté décidée à agir avec son ange gardien ». Cette insistance sur la
« volonté » est d'ailleurs largement partagée par les horoscopes zodiacaux,
encourageant constamment leurs lecteurs à faire preuve de résolution.
44 Grossièrement, on a donc un découpage des propriétés angéliques selon des thèmes
désormais classiques et présentés comme les composants indispensables à la réussite
d'une vie. Cet équilibre biographique idéalisé passe par des succès, ou plutôt des
accomplissements, d'ordre affectif, social, professionnel, financier. Finalement, il s'agit
d'un système extrêmement normatif dans le sens où on a une valorisation très moderne
du bonheur individuel à poursuivre. Grâce aux anges, en quelque sorte, il est possible
de se donner les moyens d'atteindre cet idéal. À sa manière pourtant, la littérature de
piété catholique a elle aussi consenti une forme de particularisation, encourageant
notamment la prière à toute une série d'anges gardiens, notamment aux anges gardiens
de cette catégorie si chère à l'institution ecclésiale, celle du prochain, et énumérant, au
moyen de prières diverses, les occasions de les invoquer.
Les spécialistes
45 La lecture des ouvrages spécialisés révèle qu'un ange paraît tout spécialement voué à
prévenir les accidents : « Un individu, avec Séhéiah comme Gardien, dans un avion,
dans un bateau, dans une voiture, un train... évitera tout accident 41 ». L'ange Séhaliah,
quant à lui, présente une ressemblance frappante avec sainte Rita, patronne des causes
désespérées : « Il faut prier cet Ange qui, par sa force, donnera la santé aux malades, la
fécondité aux stériles ; les marginalisés, les dégradés, les humiliés, seront élevés, haut
placés, et le grand espoir brillera dans tous les cœurs » explique encore Haziel 42. L'un
des anges de Mireille, son « ange du rétablissement », aide aussi à « trouver les places
de parking, les objets... ». Pour Mireille, il y a donc une réelle analogie entre le
rétablissement (recouvrer la santé) et le fait de retrouver des objets égarés ou, tout
bonnement, de trouver une place de stationnement. Avec cet ange Rochel, qu'il est
recommandé d'invoquer afin de retrouver un objet égaré, on pense aussitôt à saint
Antoine, spécialisé pour un recours similaire. Il est donc temps à présent de revenir sur
cette question du saint et sur les rapports complexes qu'il entretient avec la figure de
l'ange gardien.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
21
46 La spécialisation thérapeutique du saint s'enracine bien souvent, en effet, dans sa
biographie supposée (avec une prédilection pour la façon dont il a trouvé la mort,
notamment à travers le martyre tel saint Laurent qui périt sur son gril, invoqué contre
le mal des ardents) ou encore dans des éléments phoniques, directement liés à la
prononciation de son nom (à la manière des saints Clair et Claire, traditionnellement
invoqués contre les maux d'yeux). Le statut du saint, élu de Dieu, est directement lié à
la capacité qu'il a eue, de son vivant, à surmonter les épreuves terrestres, le martyre
demeurant une catégorie hautement valorisée. Surtout, le personnage d'exception qui
jouit d'une réputation de sainteté est toujours marqué par une légende, officielle ou
légendaire, qu'on serait bien en peine d'établir pour chacun des soixante-douze anges.
47 Ce qui fait en outre défaut aux anges gardiens, c'est le paradigme de proximité, au
principe même de la sollicitation. Le recours traditionnel aux pouvoirs
thaumaturgiques du saint implique de se rendre sur place et, généralement, d'offrir un
ex-voto qui sera déposé « le plus près possible » de la statue ou des reliques. C'est le
« His locus est » relevé par Peter Brown 43, où toucher, baiser ou frotter un objet sur la
relique ou l'image sont des actes nécessaires : la sollicitation du saint privilégie un
contact direct (pèlerinages, reliques, etc.) 44. Cette importance topique est tout à fait
manifeste, ne serait-ce que pour exercer l'action de grâces : « Quand je perds quelque
chose, j'invoque saint Antoine et après, quand je vais au bourg, je mets dix francs dans
son urne » explique ma propre grand-mère. Lorsque, suite à la Réforme, se met en place
la dévotion à l'ange gardien, protecteur individuel et anonyme, on peut sans doute la
considérer comme l'une des nombreuses réactions de l'autorité ecclésiastique à
l'encontre de ce foisonnement populaire de saints dits « thérapeutes », auxquels sont
associées des pratiques considérées par les prélats avec la plus grande méfiance et
volontiers qualifiées de « superstitieuses ». La dévotion post-tridentine à l'ange
gardien, qui postule une vigilance diffuse et discrète, a donc été favorisée par rapport
aux « saints du terroir », très spécialisés et relégués dans le « bas » du sanctuaire 45.
Bien adapté au contexte de la Contre-Réforme, l'ange gardien n'implique ni statue, ni
reliques, ni ex-voto encombrant, ni procession spectaculaire, ni pèlerinage aux confins
du terroir, pas même de formules à réciter pour faire venir la pluie ou guérir les
animaux. Comment, dès lors, accepter ces invocations à des anges dénommés et pensés
comme efficaces ? Le premier culte officiel rendu à l'ange gardien fut d'ailleurs un culte
public instauré sur la base d'une relation de patronage entre une communauté et son
protecteur angélique 46. Cette dévotion collective a cependant périclité au profit de la
figure du bon ange individuel, universellement distribué. Dans le même temps, Rome
exerçait un contrôle de plus en plus rigoureux sur l'accréditation de la sainteté. La
prétention à l'universalisation de l'ange gardien personnel a pu favoriser cette
utilisation hors du champ catholique tandis que le saint s'est bien souvent maintenu
dans un processus d'élection local et coutumier.
48 Avec l'ange gardien de la piété catholique, le contact a été remplacé par une proximité
affective : il est l'ami, le compagnon, le confident de tous les instants. Les soixante-
douze anges, en revanche, forts de leur éventail de spécialisations, rappellent
l'autonomie de certains saints. À la différence des anges, ces derniers, même les moins
canoniques, demeurent pourtant des figures propres au catholicisme car absents du
paganisme antique et de la tradition hébraïque.
Le revers
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
22
49 Le culte des saints met en jeu le pouvoir propre du saint, apte à soulager le mal qu'il
peut aussi donner. Savoir « à quel saint se vouer » nécessite de mettre à jour cette
relation d'imputation entre un mal donné et tel ou tel saint susceptible de l'avoir
provoqué, pratique volontiers qualifiée de « populaire » et pour le moins suspecte aux
yeux de l'orthodoxie. L'onomastique angélique, par un usage malveillant ou imprudent,
peut elle aussi s'avérer néfaste. C'est alors le verbe même qui est dangereux : Mireille
évoque ainsi la grande nocivité des anges « si on s'en sert à l'envers » mais elle refuse
catégoriquement de s'expliquer davantage : « Je ne prononce pas les noms parce que
j'en ai très peur. » Il existe donc de « mauvais anges » pour lesquels, selon Mireille, un
discours neutre est impossible. La mention discursive n'a pas lieu d'être car elle
s'apparenterait d'emblée à une invocation et il y a toujours le risque d'utiliser ces anges
« à mauvais escient ». Sur son terrain dans le Bocage où elle espérait étudier des
pratiques de sorcellerie, Jeanne Favret-Saada a eu à affronter une économie de parole
assez semblable 47. Le paradigme du secret est alors réservé aux seuls « mauvais
anges », encore qu'on s'interdise, non d'évoquer leur existence comme l'exprime, dans
un souffle craintif, l'appellation « les anges de l'abîme », mais, plus fondamentalement,
de proférer leurs noms. On connaît bien, en effet, depuis J. L. Austin 48, la valeur
performative du langage : les « utiliser à l'envers » consiste à invoquer d'autres noms,
associés aux mêmes dates que les bons anges, et dont l'évocation même ne peut être
anodine. Généralement, cette inversion s'opère en retournant le « profil », la qualité
essentielle de l'ange. Haziel nomme « contreparties » ces puissances négatives qu'il
répartit en neuf « légions », sur le modèle des neuf chœurs angéliques, et,
vraisemblablement, en référence aux légions de démons de la théologie catholique.
Ainsi, l'expansion, la réalisation (Sitael) ont pour contrepartie l'avidité et l'excès
(Kimrah), l'ange de la réconciliation (Haziel) peut devenir rancœur et vengeance
(Chochariel), etc. En 1823, Lenain évoquait pour sa part, sans le nommer, le « génie
contraire » opposé à chaque bon génie et susceptible de provoquer l'effet inverse. Tout
aussi efficaces que les bons anges, les « Anges de l'Abîme » bénéficient des mêmes
procédés empiriques et leur dénomination est donc une condition indispensable au
fonctionnement du système. Mais que les anges soient bons ou mauvais, ce paradigme
d'imputation ne peut trouver grâce aux yeux de l'institution ecclésiale qui confine les
saints anges dans leur rôle d'intercesseurs, au service du Créateur.
Conclusion
50 Pour l'Église de l'époque post-tridentine, les « génies » kabbalistiques réveillaient la
vieille crainte du paganisme. Aujourd'hui, sont surtout à redouter les dérives
superstitieuses et syncrétiques. Les listes d'anges diffusées au xix e siècle s'appuient,
certes, sur des traditions antérieures mais s'en détachent nettement par leur
orientation principale qui est, à mon sens, la distribution de l'humanité selon soixante-
douze classes, démarche caractérologique également propre aux horoscopes qui se
mettront en place au milieu du xxe siècle. On repère aussi une forme de spécialisation
qui n'est pas sans rappeler une version moderne du culte des saints. Ces anges offrent à
l'individu l'occasion d'un discours sur soi et l'expression d'une singularité. Trouver ou
encore « connaître » son ange gardien participent alors d'une opération légitime et
congruente, l'établissement, finalement, d'un autoportrait.
51 Ces anges gardiens sont fort différents de ceux traditionnellement mis en avant par la
catéchèse catholique. Il ne s'agit plus tant de bien faire que d'être favorisé, le rôle de
tutelle morale disparaît au profit de la protection personnelle permanente. Ce n'est
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
23
plus l'espoir de rédemption qui prime mais la réussite et la fortune, bref ce qu'il est
convenu d'appeler le « bonheur ». Avec l'établissement d'une typologie censée épuiser
tous les tempéraments humains, l'ange gardien s'efface en tant que moyen de salut
pour devenir un instrument de félicité et, partant, s'individualise. Mais cette
individualisation fait question au sein d'un catholicisme qui, justement, l'a favorisée,
reconnaissant le « propre ange » de chacun tout en exprimant son refus du nom et de
l'énumération. Un ange qui n'est plus un intercesseur mais qui est autonome et
puissant est une dérive relevant de « la superstition » : il concurrence le Très-Haut mais
aussi une autre figure exemplaire et souvent spécialisée, celle du saint intercesseur.
BIBLIOGRAPHIE
Adorno Theodor W., Des Étoiles à terre. La rubrique astrologique du « Los Angeles Times ». Étude
sur une superstition secondaire, traduit de l'américain par G. Berton, Paris, Exils, 2000.
AGRIPPA VON NETTESHEIM Heinrich Cornelius, De occulta philosophia libri tres, V. Perrone
compagni (éd.), Studies in the History of Christian Thought, vol. XLVIII, Leyde-New York-Köln,
Brill, 1992.
Albert Jean-Pierre, Le sang et le ciel. Les saintes mystiques dans le monde chrétien, Paris, Aubier,
1997.
AUSTIN John Langshaw, Quand dire c'est faire, Paris, Seuil, 1991 (trad. de How to Do Things with
Words, 1955).
Boudon Henri-Marie, La Dévotion aux neuf chœurs des saints Anges et en particulier aux saints
Anges Gardiens, Nancy, Nicolas Baltazard, 1717.
Brown Peter, Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, trad. de
A. Roussel, Paris, Cerf, 1984.
Champion Françoise, « La “nébuleuse mystique-ésotérique” : une décomposition du religieux
entre humanisme revisité, magique, psychologique » in Jean-Baptiste Martin et François
Laplantine, éds., Le défi magique. Ésotérisme, occultisme, spiritisme, vol. I, Presses Universitaires
de Lyon, 1994, p. 315-326.
Champion Françoise, « Du côté du New Age », Autrement, no 162, mars 1996, p. 52-61.
Champion Françoise, « La religion à l'épreuve des Nouveaux Mouvements Religieux », Ethnologie
française, XXX, no 4, 2000, p. 525-533.
Chevalier Gérard, « Parasciences et procédés de légitimation », Revue française de sociologie, vol.
XXVII, 1986, p. 205-219.
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Directoire sur la piété populaire
et la liturgie. Principes et orientations, Paris, Téqui, 2002.
Coret Jacques, L'ange gardien protecteur des mourans, Liège, Pierre Danthez, 1686.
Delumeau Jean, Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, Paris,
Fayard, 1989.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
24
Denys l'Aréopagite, La hiérarchie céleste, trad. par M. de Gandillac, Paris, Cerf, 1958 (coll.
« Sources Chrétiennes »).
Dompnier Bernard, « Des anges et des signes. Littérature de dévotion à l'ange gardien et image
des anges au xviie siècle » in Les signes de Dieu aux XVIe et XVIIe siècles, Clermont-Ferrand, Faculté
de lettres et sciences humaines, Université Blaise Pascal, fasc. 41, 1993, p. 211-223.
Doury Marianne, Analyse de l'argumentation dans le débat autour des « parasciences »,
Université de Lyon, thèse microfilmée, 1994.
Faure Philippe, « L'ange du haut Moyen Âge occidental (iv e-ixe siècles) : création ou tradition ? »,
Médiévales, no 15, 1988, p. 31-49.
Favret-Saada Jeanne, Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977.
Ficin Marsile, Les trois livres de la vie, trad. par Guy le Fèvre de la Boderie (Paris, 1582), Paris,
Fayard, 2000.
Fischler Claude, « L'astrologie de masse » in La croyance astrologique moderne, Groupe de
Diagnostic sociologique, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1982, p. 43-63.
Frère-Michelat Claude, « Collectionneurs dans leurs murs », Autrement, n o 13, mai 1993,
p. 197-208.
Froeschlé-Chopard Marie-Hélène, La religion populaire en Provence orientale au XVIIIe siècle,
Paris, Beauchesne, 1980.
Haziel, Notre Ange Gardien existe. Connaître son nom et sa prière pour profiter de son aide
toute-puissante (Amour, Santé, Argent, Travail, Intelligence, Sagesse), Paris, Bussière, 1994.
Hefele Karl Joseph von, Histoire des conciles, Paris, Letouzey et Ané éditeurs, 1907 (1909).
Joeliah, Les anges de lumière et la vie professionnelle, Paris, Bussière, 1994.
Laplantine François, « “Tirer les saints” et “faire les voyages” : étude de deux pratiques rituelles
dans le Bas Berry aujourd'hui » in La religion populaire, Paris, Éditions du CNRS, 1979, p. 212-220.
Laurant Jean-Pierre, « La question de l'ésotérisme chrétien en France aux xix e et xxe siècles » in
Jean-Baptiste Martin et François Laplantine, éds., Le défi magique. Ésotérisme, occultisme,
spiritisme, vol. I, Presses Universitaires de Lyon, 1994, p. 57-62.
Lenain, La science cabalistique ou l'art de connaître les bons génies, Paris, Éditions
Traditionnelles, 1982 (1re éd. Amiens, 1823).
Maître Jacques, « Astrologie dans la société contemporaine », Diogène, n o 58, janvier-mars 1966,
p. 92-109.
Mâle Émile, L'art religieux de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Étude sur
l'iconographie après le Concile de Trente, Paris, Armand Colin, 1951.
Mallasz Gitta, Dialogues avec l'ange, Paris, Aubier, 1990.
Martin Henri-Jean, Livre, pouvoir et société à Paris, t. I, Genève, Droz, 1969.
Perrin Michel, Le chamanisme, Paris, PUF, 1995.
Ricœur Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.
Rocchi Valérie, « Du Nouvel Âge aux réseaux psychomystiques », Ethnologie française, XXX, n o 4,
2000, p. 583-590.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
25
Scholem Gershom, La kabbale. Une introduction : origines, thèmes et biographies, Paris, Cerf,
1998.
Secret François, Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, Paris, Dunod, 1964.
Teyssèdre Bernard, Anges, astres et cieux. Figures de la destinée et du Salut. Paris, Albin Michel,
1986.
Thiers Jean-Baptiste, Traité des superstitions. Croyances populaires et rationalité à l'Âge
classique, texte établi, présenté et annoté par Jean-Marie Goulemot, Le Sycomore, 1984.
Vernus Michel, « Un best-seller de la littérature religieuse : L'Ange Conducteur (du xvii e au xixe
siècle) » in Transmettre la foi : XVIe-XXe siècles, vol. 1 : Pastorale et prédication en France, Paris,
CTHS, 1984, p. 231-243.
NOTES
1. Il ne m'est pas possible de dire qui est cet auteur, ni si ce nom désigne une seule
personne. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'usage de ce nom suggère que chaque
livre a été écrit par un ange. Haziel est en effet l'un des soixante-douze gardiens et son
utilisation éponyme dépasse la seule volonté d'anonymat : « En plus de notre prénom
habituel, il est utile de prendre, comme deuxième prénom, le Nom de notre Ange
Gardien, ou de l'Ange qui favorise le mieux nos projets », recommande-t-il
expressément (1994, p. 11). Cette littérature connaît à l'évidence de nombreux avatars
puisque la même maison d'édition (Bussière, spécialisée dans les publications
« ésotériques ») publie également des ouvrages sur les anges gardiens attribués à un
certain Joeliah. Ce dernier est présenté comme un « disciple de Haziel ». Son nom n'est
pas puisé dans la typologie des soixante-douze anges mais il est construit sur le même
modèle.
2. Teyssèdre (1986, p. 323-324) cite un certain nombre de noms d'anges du judaïsme
antique, expliquant leurs racines par des opérations de transcription, déformation,
fonction, équivalence numérique, contresens, etc. Hormis Mikaël, Raphaël et Gabriel, ce
ne sont pas ces mêmes noms que l'on retrouve dans la typologie de Haziel où seul
demeure le procédé de la désinence.
3. Le pseudo-Denys l'Aréopagite (1958), prétendument disciple de saint Paul et
confondu avec le premier évêque de Paris, établit en effet, au v e siècle, la liste des neuf
chœurs angéliques eux-mêmes subdivisés en trois ordres. Ainsi, dans la première
hiérarchie se trouvent les Séraphins, les Chérubins et les Trônes ; dans la deuxième, les
Vertus, les Dominations et les Puissances ; les Principautés, Archanges et Anges
composant la dernière hiérarchie. Cet ordonnancement fit autorité puisqu'il est repris
par saint Thomas d'Aquin et, par la suite, largement associé à la dévotion à l'ange
gardien.
4. Haziel, 1994, p. 86.
5. En premier lieu, le discours scientifique, cf. Chevalier, 1986 ; Doury, 1994.
6. L'édition originale comporte encore en sous-titre : Qui influent sur la destinée des
hommes ; avec l'explication de leurs talismans et caractères mystérieux, et la véritable manière
de les composer ; suivant la doctrine des anciens Mages Égyptiens, Arabes et Chaldéens, recueillie
d'après les Auteurs les plus célèbres qui ont écrit sur les Hautes Sciences. J'utilise pour ma part
une nouvelle édition (Paris, Éditions Traditionnelles, 1982). Le docteur Papus (Gérard
Encausse pour l'état-civil, 1868-1916), dans un chapitre intitulé « la Kabbale pratique »,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
26
cite explicitement Lenain et reprend sa typologie in La cabbale, tradition secrète de
l'Occident, Anvers, Éditions Lumen, [s.d.]
7. Le terme « kabbale » désigne l'ensemble des doctrines mystico-ésotériques du
judaïsme qui se développent à partir du xiie siècle. La kabbale dite « chrétienne », quant
à elle, trouve son origine au xve siècle chez un certain nombre d'érudits chrétiens
« cherchant à prouver que le véritable sens caché des doctrines de la kabbale tendait à
révéler des orientations chrétiennes » (Scholem, 1998, p. 312).
8. De occulta philosophia, Cologne, 1533, en particulier chap. XXIVss (1992).
9. Voici quelques-unes de ces nations énumérées par Lenain : les « Moscovites », « les
Bohémiens », les « Sarrazins », les « Péruviens », les « Californiens », les
« Samaritains », lesquels ne représentent, bien-sûr, qu'un petit échantillon et qui
correspondent respectivement aux génies Pahaliah, Nelchael, Haaiah, Reiiel, Veualiah
et Daniel.
10. Laurant, 1994, p. 57.
11. À savoir, l'Ancien et le Nouveau Testament. Une remarque à ce sujet : l'épisode
vétéro-testamentaire de Tobie et, partant, l'intervention de l'archange Raphaël qui fait
office de modèle à l'Ange Gardien, notamment au plan iconographique, n'est
généralement pas intégré dans les éditions protestantes de la Bible, au même titre que
les autres livres ou parties de livres de la traduction dite des Septante.
12. HEFELE, 1909, t. III, p. 1029.
13. THIERS, 1984, p. 98-99.
14. Telle est l'opinion de Faure, 1988.
15. Mâle, 1951, p. 298-301.
16. Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements (2002), p. 182.
17. La lecture de ces différents traités complète en effet une enquête de terrain. Cet
article fait notamment référence à deux entretiens, l'un réalisé auprès de Rose, artiste-
peintre, auteur d'une exposition comptant les représentations des 72 anges ; l'autre
auprès de Mireille, qui se définit elle-même comme « médium », et qui a régulièrement
recours aux ouvrages de Haziel. J'utiliserai également un extrait issu d'un entretien
avec une jeune femme catholique, Chantal, qui se décrit comme ayant une grande
dévotion à l'ange gardien, cet ange gardien anonyme et bienveillant que l'Église lui
enseigne d'invoquer et de respecter. Tous ces prénoms sont des noms de substitution.
18. Frère-Michelat (1993) dégage deux principes de la collection : la superposition et
l'intégration. Vient ensuite la notion de colonisation (p. 203) : on montre d'abord les belles
pièces (au salon) puis a lieu l'extension, généralement sous forme de gadgets qui
envahissent tout le domicile.
19. Champion, 2000, p. 531.
20. Fischler, 1982, p. 47.
21. Sur l'astrologie moderne, on peut consulter : Maître, 1966 ; Fischler, 1982.
22. Les signes du zodiaque sont nommés d'après les constellations. L'année est divisée
en douze signes : respectivement, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge,
Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons.
23. La définition que donne le Petit Robert de l'ascendant astrologique est la suivante :
« Degré du zodiaque qui monte sur l'horizon au moment de la naissance de quelqu'un,
et auquel correspond l'un des six grands cercles à l'aide desquels l'astrologue dresse le
thème de la nativité. »
24. Ricœur, 1990, p. 144.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
27
25. Entre autres techniques, Mireille utilise une bougie dans ses consultations de
voyance. Par ailleurs, il lui arrive de « prescrire » à un client la prière à son ange
gardien, forme qui s'apparente en quelque sorte à celle, officielle, de l'ordonnance
médicale.
26. Ficin, 2000, p. 236.
27. Ces extraits, ainsi que ceux qui vont suivre, sont tirés de Haziel, Notre Ange Gardien
existe, 1994.
28. ADORNO, 2000.
29. FISCHLER, 1982, p. 54.
30. JOELIAH, 1994.
31. Fischler, 1982, p. 56.
32. Genre dans lequel les Jésuites s'étaient spécialisés, adaptant leur discours à chaque
« condition » ou « état » (religieux, de célibat, de mariage, de viduité…) et qui, selon H.-
J. Martin (1969, t. I, p. 144), avait le mérite de s'adresser particulièrement aux femmes.
33. Cf. Albert, 1997, sur la sainteté mystique féminine.
34. Mallasz, 1990.
35. Champion, 1996, p. 55-60.
36. « Être fréquemment la victime de telles maladies est donc la preuve d'une relation
“privilégiée”, si l'on ose dire, avec le monde-autre. C'est l'indice d'une éventuelle
élection chamanique. Voilà pourquoi, dans leurs histoires de vie, les chamanes
évoquent souvent les maladies répétées de leur jeunesse », Perrin, 1995, p. 30-31.
37. Et rappellent, dans un autre contexte, les conditions sociologiques traditionnelles
d'accès à la réputation de sainteté.
38. Joeliah, 1994, p. 16-19.
39. Fischler, 1982, p. 54-55. Voir aussi Maître, 1966, p. 105.
40. Champion, 1994, p. 320.
41. Haziel, 1994, p. 78.
42. Ibid., p. 112.
43. « Hic locus est : “c'est ici le lieu”, ou simplement hic, est un refrain qui court dans les
inscriptions sur les plus anciens sanctuaires des martyrs en Afrique du Nord. Le sacré
pouvait être atteint en un lieu précis », c'est ce que P. Brown appelle la Praesentia (1984,
p. 113).
44. La pratique qui consiste à « tirer les saints » vise à établir le diagnostic d'un mal
(une maladie infantile le plus souvent), attribué alors à un saint régional en particulier.
Le problème est ensuite de déterminer avec précision « de quel saint il s'agit » car
certains saints ont, sur le territoire, plusieurs sanctuaires et il importe de définir
exactement le lieu où doit être effectué le « voyage ». Cf., Laplantine, 1979, p. 212-220.
45. Cf. Froeschlé-Chopard, 1980, p. 74-78 ; 396-397.
46. Delumeau, 1989, chap. « Un géant magnanime ».
47. « Or la sorcellerie, c'est de la parole, mais une parole qui est pouvoir et non savoir
ou information », Favret-Saada, 1977, p. 26.
48. Austin, 1955.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
28
RÉSUMÉS
En marge de la liturgie des saints anges et de la figure anonyme de l'ange gardien que le
catholicisme affecte à la protection de chaque fidèle, existe aujourd'hui une angélologie
postulant l'existence de soixante-douze anges gardiens nommés et spécialisés, assignés à
l'humanité entière en fonction de la date de naissance de l'individu. À travers l'étude des
ouvrages concernant ces anges et de quelques entretiens, cet article analyse la construction de
cette figure de l'ange, différente de celle que reconnaît l'Église. Cette production syncrétique
reprend certains éléments de la conception catholique moderne de l'ange tutélaire et du saint,
mais s'inspire aussi des spéculations théologiques des premiers siècles sur les anges, des
doctrines kabbalistiques de la Renaissance, de l'occultisme du XIXe siècle et de l'astrologie
zodiacale moderne.
At the frontiers of the liturgy of the Holy Angels and the nameless figure of the guardian angel
that catholicism assigns to protect each of the faithful, an angelology has now emerged,
proposing the existence of seventy-two guardian angels each with their own name and
specialized role, assigned to all humanity according to each person's date of birth. Studying
published works on these angels and in the course of a number of interviews, the present article
analyses the construction of this figure of the angel, an image that differs from the one
recognized by the Catholic Church. This syncretic production takes up certain elements of the
modern catholic conception of the angel as guardian and of the saints, but bases itself also on the
theoretical speculations on the angels during the first centuries, on the kabbalistic doctrines of
the Renaissance, on 19th century occultism and the modern astrology of the zodiac.
Al margen de la liturgia de los santos ángeles y de la figura anónima del ángel custodio que el
catolicismo destina a la protección de cada fiel, existen hoy especulaciones postulando la
existencia de setenta y dos ángeles : cada uno tiene una especialidad y un nombre propio y es
asignado a cada individuo en función de su fecha de nacimiento. A través del estudio de los libros
que tratan de estos ángeles y de unas entrevistas con adeptos de esas concepciones, este artículo
analiza la contrucción de esta figura del ángel, muy distinta de la de la Iglesia. Esta producción
sincrética recoge algunos elementos de la concepción católica moderna del ángel tutelar y el
santo, pero se inspira también en las especulaciones teológicas de los primeros siglos sobre los
ángeles, de las doctrinas cabalísticas del Renacimiento, del ocultismo del siglo XIX y de la
astrología zodiacal moderna.
INDEX
Mots-clés : ange gardien, angéologie, astrologie, liturgie des saints
AUTEUR
ANNE MANEVY
Centre d'Anthropologie – Toulouse
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
29
Le sanctuaire Saint Pantaléon à
Buenos Aires
La régulation institutionnelle d'un culte thérapeutique
Christine Laigneau
La régulation institutionnelle d'un culte thérapeutique
1 Le culte des saints occupe en Argentine une place singulière. Il a en effet une visibilité
et un succès importants 1 et il fait l'objet de la part de l'Institution ecclésiastique d'une
attention croissante. Une partie du clergé s'est intéressée aux pratiques de dévotion
populaires dans le cadre de la « pastorale populaire » ou encore « pastorale des
sanctuaires », afin d'encadrer institutionnellement des pratiques qui justement
peuvent se passer de l'Institution. C'est là un revirement manifeste étant donné les
réserves formulées par le Concile de Vatican II à l'encontre du culte des saints.
2 Nous proposons ici 2 une description du culte des saints qui est un aspect du
catholicisme argentin. C'est pourquoi nous présenterons l'encadrement institutionnel,
puis les discours et pratiques des dévots, et enfin le sanctuaire Saint Pantaléon. Saint
Pantaléon est considéré comme un saint guérisseur, et on peut observer en son
sanctuaire des pratiques de dévotion caractéristiques du culte des saints traditionnel.
Les dévots y sont nombreux et leur affluence régulière. Comme les autres sanctuaires
de Buenos Aires, Saint Pantaléon est une paroisse urbaine 3. Nous nous intéresserons
plus particulièrement à l'administration du sacrement de l'onction des malades, une
initiative du clergé qui prend acte de la demande de guérison.
Une pastorale des sanctuaires
3 Un faisceau d'initiatives institutionnelles traduit, autour de 1969, la préoccupation du
clergé argentin pour les phénomènes liés à la « religiosité populaire ». La première
réunion des recteurs de sanctuaires à l'échelle du continent a lieu en 1969 ; à partir de
là, des rencontres auront lieu régulièrement, tant pour échanger des réflexions sur les
actions mises en œuvre que pour élaborer de nouvelles orientations pastorales. Les
résultats d'une grande enquête sur le catholicisme populaire en Argentine, conduite
par A. J. Büntig 4, sont publiés la même année. Ce sociologue se situe explicitement dans
une perspective apologétique : « Mon travail n'a pas d'autre objectif que de servir
l'Église », précise-t-il dans l'introduction. Après avoir déterminé ce qu'il entend par
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
30
« catholicisme populaire » et élaboré une série d'hypothèses concernant la genèse des
différentes formes observées en Argentine, il présente les résultats de son enquête. Elle
concerne toute l'Argentine, mais certains cultes ont été étudiés de manière plus
systématique, notamment les cultes adressés à saint Cayetano 5 et à la Vierge de Luján 6,
qui sont les plus importants. Büntig décrit dans le détail l'ensemble des pratiques qui
s'écartent de la norme et déplore notamment l'absence du clergé sur les lieux de culte.
Quelques remarques s'imposent à propos des hypothèses proposées par Aldo Büntig
pour expliquer les pratiques qualifiées de « populaires ». Parmi celles-ci, l'usage que les
dévots font des sacramentaux, tels que bénédictions d'objets, usages de l'eau bénite,
aurait pour origine des pratiques précolombiennes. Autrement dit, ces usages
hétérodoxes auraient une origine extérieure à la logique catholique. On a là un
argument classique, qui consiste à considérer que l'hétérodoxie vient du dehors : du
paganisme, de syncrétismes. Sans vouloir nier la part de ces éléments hérités des
religions précolombiennes, nous voudrions remarquer que ces usages peuvent aussi
être compris dans le cadre de la symbolique chrétienne. Les pratiques témoignent de ce
que les implications symboliques des transformations subies par la substance dans le
cadre du rituel sont prises au sérieux : on a un produit sacré, il convient de le traiter
comme tel. Il en va de même pour le rituel de la bénédiction : les gestes et paroles du
prêtre sont investis d'un pouvoir qui lui est propre et qui tient à son statut. Ces
manipulations prennent dès lors un caractère magique, au sens où elles sont
mécaniquement efficaces : la bénédiction a le pouvoir d'éloigner les maléfices, elle joue
un rôle protecteur. L'eau bénite change elle aussi de nature en vertu des manipulations
auxquelles elle a été soumise. Elle a le pouvoir de « faire les baptisés » : il n'est pas
étonnant qu'elle soit considérée comme sacrée, ou du moins investie de pouvoirs
surnaturels (pouvoir de guérison, de purification, de protection contre les sorts, etc.).
4 La dixième rencontre des responsables de sanctuaires eut lieu en mai 1990. La note de
synthèse rédigée à cette occasion présente « un bilan du chemin parcouru (...) par la
pastorale de la religiosité populaire des sanctuaires » 7. Parmi les points positifs, les
auteurs mentionnent la prise de conscience de la « capacité particulière
d'évangélisation qu'a le sanctuaire dans la vie du peuple fidèle » ; ils indiquent en outre
qu'une réussite significative concerne l'avancée dans l'étude de « phénomènes de
religiosité populaire comme les bénédictions, les promesses ou demandes, les
processions et autres manifestations de ce type ». Mieux connaître ces phénomènes,
continuent-ils, « nous a aidés à les considérer avec plus de respect, à leur donner un
traitement pédagogique pastoral » et à « avoir une plus grande lucidité pour purifier
tout ce qui pourrait être ambigu ou déformé ». Ils célèbrent les progrès réalisés dans la
liturgie : « à travers un langage fait de paroles et de signes qui parlent à l'homme
intégral s'est créée une atmosphère de fête de la foi, procurant une intégration
croissante des rites et du style de la liturgie avec les symboles et rites de la religiosité
populaire ». Les préoccupations formulées concernent essentiellement les enjeux
théologiques sous-jacents à ce type de pastorale. Il s'agit donc aussi bien de mettre en
place des initiatives en termes de liturgie que d'accompagner la demande des dévots
qui se rendent aux sanctuaires et de tenter d'exercer un contrôle. Précisons que,
relativement aux pratiques taxées d'hétérodoxie, la position de l'Institution s'est
considérablement assouplie. Un curé de paroisse nous a confié qu'il fallait tenir compte
de la sensibilité du peuple, auquel un catholicisme trop intellectualisé comme celui de
Vatican II ne convient pas.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
31
5 Le développement de la pastorale des sanctuaires en Argentine doit également être
compris dans le contexte particulier de l'histoire de l'Église dans ce pays. Alors que la
Théologie de la Libération était active dans d'autres pays d'Amérique latine, elle a eu
une influence limitée en Argentine du fait de la répression que lui a fait subir la
dictature. Sans doute peut-on voir en la pastorale des sanctuaires une alternative à la
Théologie de la Libération.
6 Comment cette pastorale se manifeste-t-elle ? L'action pastorale consiste d'abord en un
encadrement renforcé. Les jours d'affluence, des prêtres supplémentaires sont envoyés
sur les lieux de manière à fournir une offre de sacrements plus importante : plusieurs
prêtres assurent par roulement des confessions permanentes, dans l'église de saint
Cayetano comme dans celle de saint Pantaléon. De même le nombre des messes est
augmenté : à Saint Pantaléon, on célèbre deux messes les jours de semaine, cinq le
dimanche, sept le 27 de chaque mois, « jour du saint ». En plus des messes, ou entre les
messes suivant les lieux, des bénédictions de personnes ou d'objets sont proposées.
Durant le pèlerinage annuel à la Vierge de Luján le clergé assure une présence
« mobile » : en effet à quelques kilomètres de l'arrivée, sous un pont, des prêtres
effectuent des bénédictions à la demande, ou proposent des confessions dans des
petites tentes installées pour l'occasion.
7 L'encadrement n'est pas le seul fait du clergé. Dans chaque sanctuaire, et à l'occasion
de chaque événement religieux, des équipes de volontaires laïques effectuent un
« service » qui consiste à distribuer des estampes, à canaliser la circulation sur les lieux,
et à délivrer des renseignements aux nouveaux venus. Ce sont les servidores. Leur
nombre varie selon les besoins ; on distingue en général un noyau fixe de personnes
engagées qui se retrouvent chaque mois, et un volant qui fluctue, recruté directement
sur place. Être serviteur marque un degré supplémentaire dans la dévotion au saint,
mais fait aussi passer du statut de simple pèlerin à celui de membre de la communauté
qui se forme autour du saint. Cette communauté se distingue cependant des anciennes
cofradias, ou confréries 8 ; à notre connaissance, les sanctuaires urbains que nous avons
étudiés n'en ont pas. Cela est certainement à mettre sur le compte de la
« romanisation » de l'Église argentine, qui s'est éloignée du modèle colonial hispanique.
Les confréries fonctionnent peut-être encore, mais autour de cultes plus anciens.
8 Une démarche pédagogique s'ajoute à cet effort dans l'encadrement. En effet la liturgie
est adaptée au public « humble et simple » 9 des sanctuaires. C'est le cas sur le
sanctuaire Saint Pantaléon : le style de la messe est participatif, la pédagogie à l'œuvre
transforme l'homélie en leçon de catéchisme. Les moments de la liturgie universelle
sont réduits autant que possible pour laisser une plus grande place à l'invocation de
saint Pantaléon.
9 Cependant tous les dévots n'assistent pas à la messe. Des prospectus distribués d'un
mois sur l'autre présentent les différentes étapes d'une catéchèse. L'accès aux
sacrements qui « font le catholique » est simplifié : pour ceux qui souhaitent
régulariser leur situation par un mariage, une première communion, un baptême ou
une confirmation, une catéchèse accélérée est proposée ; le tout peut être effectué en
trois mois. Autre exemple, les exigences tatillonnes de l'Institution concernant les
certificats de baptême pour qui veut se marier à l'église peuvent être contournées.
10 Enfin, la pastorale des sanctuaires requiert une réflexion sur l'organisation des
prestations dans l'espace. Les lieux ne permettent pas toujours une coexistence aisée de
la célébration de la messe, de l'administration des bénédictions et du déroulement de la
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
32
dévotion. L'église paroissiale Saint Cayetano à Belgrano semble avoir été conçue pour
résoudre ce problème. Le « lieu des saints » est séparé du lieu du culte dominical. Les
images se trouvent disposées le long d'une coursive qui domine d'un étage la salle
principale et à laquelle on accède directement depuis l'extérieur par des escaliers
latéraux. C'est évidemment un schéma idéal puisque l'office n'est pas dérangé par les
déplacements des dévots. Ce dispositif vertical semble paradigmatique de la séparation
qu'effectue le clergé entre un culte des saints toléré et une assistance à la messe
souhaitée. Il trouve son pendant horizontal au sanctuaire Saint Pantaléon qui est
constitué de deux bâtiments, l'ancienne chapelle, où se trouve l'image vénérée, et
l'église moderne.
L'espace du saint
11 Précisons ce qui est désigné ici par « sanctuaire ». Les sanctuaires de Buenos Aires sont
des églises paroissiales qui ont acquis le statut de sanctuaire. Ainsi la paroisse Saint
Cayetano de Liniers « fonctionne comme sanctuaire depuis 40 ans », nous dit le Père
Fernando Maletti, et a été décrétée sanctuaire depuis 25 ans. La décision est prise par
l'évêque « lorsque certaines caractéristiques sont réunies. Par exemple, la plus
importante est que de nombreuses personnes s'y rendent, venant de partout, c'est-à-
dire qu'elle ne reçoit pas seulement des gens de ce lieu, de ce quartier, de cette ville »,
ce qui le distingue de la paroisse. De la même manière, la chapelle Saint Pantaléon a
commencé à fonctionner comme sanctuaire dans les années soixante, aux dires du père
Sábate, l'actuel recteur. Le statut de sanctuaire est accordé a posteriori ; aux conditions
énoncées par le père Maletti, qui concernent le recrutement extérieur au territoire de
la paroisse et l'affluence, on pourrait ajouter la périodicité, qui ne recouvre pas la seule
pratique dominicale.
12 Le sanctuaire Saint Pantaléon est particulièrement représentatif de ces sanctuaires
urbains, puisqu'il a été construit en fonction des besoins du culte, et ce récemment.
Saint Pantaléon 10 a d'abord été vénéré dans une église du quartier de Villa Urquiza, à
Buenos Aires, consacrée à saint Roch. Pour faire face à l'affluence des dévots, l'évêché a
décidé de la construction d'un sanctuaire propre : d'abord une petite chapelle en 1964,
puis une église plus grande en 1988.
13 L'ensemble, chapelle et église, se trouve dans le quartier de Mataderos, à la périphérie
de la Ville Autonome de Buenos Aires, près d'un pâté d'immeubles modestes. Le
quartier – « Mataderos » signifie « abattoirs » en français – tient son nom de l'activité
qui s'y déroule encore : le bétail arrive par camions de la Pampa pour y être abattu. Non
loin du sanctuaire se trouvent d'immenses corrals. Le dimanche a lieu sur la place de
Mataderos une feria où l'on peut manger des grillades, se procurer de l'artisanat
gaucho, assister à des courses de chevaux. Cela situe le sanctuaire sur une trajectoire de
loisir urbain : une dévote confiait profiter du fait que ses petits enfants soient occupés
par la feria pour aller voir saint Pantaléon.
14 Le sanctuaire est constitué de plusieurs bâtiments juxtaposés entre lesquels circulent
les dévots : sur la gauche de l'église, un ensemble comprend le secrétariat, la santeria –
la boutique, la sacristie et des salles d'accueil. La chapelle dans laquelle se trouve la
plus ancienne statue du saint est derrière l'église. Elle est accessible par une porte au
fond de l'église et elle est entourée d'une petite cour. L'espace est conçu pour assurer la
circulation d'un public important, canalisé par des barrières blanches. Les servidores
sont reconnaissables à leur tunique sommaire, de couleurs variables, au nom de saint
Pantaléon. De la rue, on accède directement à l'église, après une volée de marches. Elle
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
33
est assez grande, carrée ; l'autel, surélevé, se trouve sur la gauche lorsqu'on entre.
L'entrée principale donne directement sur un couloir isolé du reste de la salle par une
barrière, le long duquel se trouvent des reproductions de saints : saint Cayetano, la
Vierge de Luján, qui accueille sur son piédestal les ex-voto adressés à saint Pantaléon,
saint Roch, représenté avec un chien à ses côtés. Le piédestal de ce dernier saint est
orné de photos de chiens et de chats, avec parfois un petit mot : on demande
d'intercéder pour qu'un chien soit retrouvé, qu'un autre guérisse. Son rôle de
protecteur contre la peste est oublié, comme c'est souvent le cas lorsqu'un saint
originellement rural arrive en ville : on lui a trouvé une autre spécialité, inspirée par
son compagnon. Saint Pantaléon se trouve sur le pan de mur qui fait face à l'entrée,
près de la porte qui donne sur l'arrière. Mais ce n'est pas la « vraie » statue, et ce à
double titre : la vraie est dans la chapelle en position centrale cette fois et non en
position de « saint de la porte » ; et surtout, l'image qui se trouvait là a brûlé deux
années auparavant, et a été remplacée par une copie. Pour Rosa, dévote depuis quatre
ans, ce n'est plus tout à fait pareil : « Je vais te dire : avant, celle de devant était la plus
belle. Mais il y a deux ans, elle a brûlé. (...) Ils ont dû l'enlever et en mettre une autre ;
(...) ils en ont mis une qui ne me plaît pas tant, je la regarde autrement, pas comme celle
qu'il y avait avant ». Aux côtés de ce saint Pantaléon, deux cahiers sont disposés sur un
pupitre. Les gens passent devant le saint en file, le touchent parfois, écrivent leurs
demandes. La porte qui donne sur la cour et la chapelle est tout près du saint.
15 Dans la cour, des barrières orientent le flux des dévots. Il faut choisir entre aller voir la
statue du saint, par un couloir qui fait le tour de la chapelle et permet d'y accéder
directement, ou aller dans la chapelle où ont lieu des « bénédictions permanentes » 11.
Chaque bénédiction dure une dizaine de minutes, la chapelle est toujours pleine. À
l'entrée de la chapelle sur la gauche se trouvent deux autres cahiers, des ex-voto, mais
aussi des écritures « sauvages », ex-voto ou requêtes graffités sur le piédestal du Christ
qui se trouve là, sur le tissu qui recouvre en partie le piédestal, et même sur la feuille de
matière plastique destinée à le protéger. Pour aller voir le saint, il faut encore prendre
sa place dans la file d'attente. L'étroit couloir aménagé au fond de la chapelle juste au-
dessous de la statue est lui aussi empli d'ex-voto, souvent plus sommaires que ceux de
l'église : un simple papier, une petite lettre, une photo, de petits objets suspendus.
Après être passé devant le saint, on accède directement à l'extérieur par une porte qui
donne sur la cour. À la sortie, des servidores offrent un gobelet de mate cocido 12 ; il y a un
banc, et une petite salle dans laquelle on peut aller se reposer. Enfin, l'un des murs de la
cour est occupé par plusieurs robinets reliés à un bidon d'eau bénite. Certains s'en
approchent, se passent de l'eau sur le corps. Beaucoup ont avec eux des bouteilles qu'ils
remplissent. Le circuit est complété par un couloir souterrain qui rejoint la santeria, le
secrétariat, et la sortie.
16 L'espace du sanctuaire est donc subdivisé et permet des parcours différenciés. La
dévotion s'organise en plusieurs étapes. L'église, que l'on peut contourner de
l'intérieur, est le lieu de la messe et des confessions. Les saints y occupent une place
marginale, le long des murs, les dévotions privées peuvent continuer pendant l'office
sans le perturber. La chapelle est le lieu de la dévotion au saint et des bénédictions,
c'est-à-dire de rituels qui ont, dans la hiérarchie des prestations ecclésiales, un statut
inférieur : ce ne sont pas des sacrements. Implicitement, c'est donc une hiérarchie des
formes de culte qui est mise en place, qui reflète la position du clergé face aux
dévotions observables sur les lieux.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
34
Entre religion et superstition : la dévotion
17 Les pratiques qui gouvernent le culte des saints sont essentiellement privées et
individuelles. Et c'est bien parce qu'elles semblent pouvoir se passer de la médiation de
l'Institution qu'elles sont régulièrement suspectées d'hétérodoxie, taxées de
« religiosité populaire », sujettes à régulation. Elles présentent néanmoins des
régularités : les circulations, la périodisation, les manipulations rituelles obéissent à des
normes implicites, quoique différentes de celles qu'impose l'Institution.
18 Quelle dénomination adopter pour désigner les visiteurs des sanctuaires ? La
dénomination « sanctuaire » supposerait de qualifier celui qui le fréquente de
« pèlerin » plutôt que de « paroissien ». C'est de cette manière que les visiteurs sont
désignés par le personnel des sanctuaires. Nous pouvons ici reprendre l'opposition
établie par Danièle Hervieu-Léger 13 qui vaut aussi pour la figure traditionnelle du
pèlerin : les pratiques du pèlerin et du paroissien s'opposent par leur temporalité
(régularité et inscription dans le quotidien pour l'un, caractère extraordinaire et
ponctuel pour l'autre) ; par le lieu (la paroisse est voisine, le sanctuaire, souvent
lointain) ; par le rapport qu'ils entretiennent à l'autorité, plus lâche dans le cas du
second ; par le rapport à la règle : le premier s'y soumet, le second au contraire est
volontaire. Or, si certains visiteurs entrent indéniablement dans la catégorie des
« pèlerins » (ils viennent en groupes, s'organisent par paroisses pour affréter des bus),
tous ne qualifient pas leur visite de « pèlerinage » 14. Les pratiques observées
s'apparentent plutôt aux pratiques de dévotion ordinaires, décrites par exemple par
Elisabeth Blanc s'agissant du culte à saint Antoine de Padoue 15. Dès lors, même si tous
se déplacent, nous opterons pour la dénomination adoptée par les visiteurs : celle de
« dévots ». Interrogés sur le type de relation entretenu avec le saint, tous répondent :
« je suis très dévot (devoto), ou très dévote (devota), de saint Pantaléon, etc. ». « Être
dévot » ne présuppose pas une forme de dévotion particulière : pèlerinage, adoration
d'une image. En revanche, cela définit un type de relation à l'entité surnaturelle
considérée : « dévouement » ou vénération. Celui qui se voue à un saint se lie à lui, et le
lie à lui, par une promesse ou un vœu. La dévotion peut présenter des degrés divers sur
un axe qui va de la « dulie », ou vénération, au simple usage (saint Antoine sert à
retrouver les objets perdus, saint Pantaléon à guérir, etc.).
19 Les normes qui régulent la dévotion se manifestent d'abord dans sa périodisation.
Chaque saint a son jour. Le 7 pour saint Cayetano, le 22 pour sainte Rita, le 27 pour saint
Pantaléon, etc. Ce jour correspond au jour de plus grande affluence dans le mois.
Interrogés sur la raison de leur visite à cette date précise, les dévots répondaient
immanquablement : « Parce que c'est le jour du saint ! ». Cette périodisation n'est pas
sans rapport avec le calendrier liturgique puisque le jour correspond à celui de la fête
patronale, le « vrai jour du saint », cette fois. Pour saint Pantaléon, il s'agit du 27 juillet.
Ce qui diffère, c'est la fréquence, puisque le jour du saint revient chaque mois. À côté de
ces saints mensuels, il y a des saints hebdomadaires : E. Zamora Acosta 16 en mentionne
quelques-uns pour l'Espagne : saint Nicolas et saint Pancrace se visitent le lundi, sainte
Marthe le mardi. En revanche, nous n'en avons pas rencontré en Argentine.
20 Que signifie cette périodisation du culte ? Que certaines pratiques, certains gestes, sont
requis ce jour-là, dont la visite à l'endroit où se trouve l'image. La norme peut
présenter néanmoins une plus ou moins grande élasticité, de l'obligation de venir à la
dispense totale. L'obligation peut elle-même faire l'objet d'interprétations. Sara,
interrogée sur le sanctuaire Saint Cayetano, nous explique qu'elle vient le 7 de chaque
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
35
mois depuis environ trois ans : « oui, je travaille, mais je peux venir. Par exemple, si le 7
tombe un vendredi – c'est le vendredi que je travaille – je travaille le matin, et je viens
l'après-midi. Ça ne m'empêche pas de venir ». Et en cas d'empêchement majeur, il est
possible de s'arranger : « Et si vraiment je ne peux pas venir le 7, je viens le 17 » ; et
d'ajouter : « le 7, le 17, le 27 : c'est pareil ». C'est autour de ce type d'observances que
s'effectue le glissement de la religion à la superstition. Dans un article où il examine la
relation qu'entretient la religion avec cette dernière 17, Jean-Pierre Albert montre que
la superstition n'est pas une forme archaïque de la religion mais un dérivé de la religion
qui se met en place lorsque le discours autorisé disparaît. D'autres fluctuations autour
de la date sont permises : on peut aussi venir quelques jours avant ou quelques jours
après comme Marjorita, dévote de sainte Rita : « Si je ne peux pas venir le 22 je viens
le... parce que ma promesse est comme ça : non pas venir le 22... durant le mois, je
viens. Le 22, je dois venir ; mais l'église est toujours ouverte : si je ne peux pas venir le
22, je viens le 23, le 24, le 21. Ça m'est arrivé parfois ».
21 Un contretemps le « jour du saint » ne dispense donc pas de venir. Marjorita, qui a pu
trouver jusqu'ici de quoi payer son trajet en bus grâce à la sainte, évoque une seule
exception : « à un moment, j'ai eu une promesse très, très importante, et c'est quand je
me suis cassé la jambe, et avec ma jambe, comme ça, alitée, je lui demandais pardon de
ne pas pouvoir venir... ». Quelle est la raison d'une telle obligation ? Il faut distinguer
ici entre la promesse et le remerciement d'un vœu satisfait. Dans le cas de la promesse,
si le dévot ne remplit pas sa partie du contrat le risque est que le saint ne remplisse pas
la sienne. Aller voir le saint fait partie des conditions de réalisation du vœu. Dans le cas
d'un remerciement le saint a déjà octroyé ce qui lui a été demandé. Or, ce qui a été
donné peut être repris, comme l'exprime de manière concise le dicton qui caractérise le
pouvoir de Rita : « sainte Rita donne et reprend ».
22 Que se passe-t-il si l'on oublie ? Nous avons posé la question à Rosa, dévote de saint
Pantaléon, et sa réponse ne laisse pas de doute : on ne peut pas oublier. « Je commence
à y penser, à me dire : je vais aller voir saint Pantaléon, deux ou trois jours avant. Et le
matin, au réveil, je me dis : ah, c'est le jour de saint Pantaléon... ». Elle confie sa crainte
de laisser passer la date, et à notre question « que se passe-t-il si tu oublies ? », sa
réponse est immédiate : « si j'oublie, j'y vais l'après-midi au lieu d'y aller le matin ! » ;
« si tu oublies », cela ne peut pas être « si tu oublies d'y aller le 27 ».
23 Même si de petits arrangements sont possibles, même si le contrat peut être souple
quant à la détermination de la date, l'obligation n'en demeure pas moins : il faut y aller,
et y aller régulièrement, sans faillir. La logique qui gouverne ces visites n'est pas celle,
pragmatique, de la moindre peine.
24 Effet de cette périodisation, l'affluence régulière 18 sur le lieu du sanctuaire donne au
culte l'apparence d'un culte collectif. Mais cette apparence ne résiste pas à
l'observation. Chaque visite reste l'élément d'une transaction individuelle avec le saint.
On ne vient pas parce qu'une cérémonie est organisée sur le site ; en général, hormis les
messes et bénédictions, il n'y en a pas. Les processions n'ont pas lieu en chaque
sanctuaire. Lorsqu'elles sont organisées, le rythme annuel prévaut. Même lorsque
célébration de la messe et dévotion au saint se tiennent en des lieux différents, comme
dans l'église récemment construite qui double la petite chapelle de saint Pantaléon,
suffisamment grande pour délimiter des espaces de circulation, les pratiques
individuelles dominent. La circulation devant les images ne cesse pas pendant la
célébration ; les confessions continuent ; et surtout, la pluralité des espaces permet à
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
36
chacun d'organiser sa visite suivant une temporalité qu'il choisit : assister à la messe ou
commencer par aller voir le saint ; faire bénir ses objets dans la chapelle réservée à cet
effet ; se livrer à des ablutions devant les robinets d'eau bénite.
25 Des normes apparaissent également dans les manipulations qu'occasionne la visite au
sanctuaire. Manipulations d'objets tout d'abord : les sanctuaires distribuent aux dévots
des estampes bénies ; en outre, on y fait bénir des objets religieux achetés ailleurs
(statues, etc.) ou des objets tout à fait profanes. À Liniers, sur le sanctuaire Saint
Cayetano, à la fin d'une messe, nous avons entendu le prêtre inviter les dévots à élever
vers le ciel leurs porte-clefs pour qu'ils soient bénis. Pour que les clefs protègent mieux
les maisons, on les orne d'une reproduction miniature de la Vierge ou d'un saint.
Marta, une vieille femme devenue dévote de la Vierge Desata Nudos 19, insiste sur
l'importance de la bénédiction : « j'ai tout qui est béni, tout. Regarde : elle [la Vierge
Desata Nudos], je l'ai sur le porte-clefs... ». Une image qui ne serait pas bénie n'aurait
aucune valeur, comme l'indique Rosa : « si on ne la faisait pas bénir, ce serait seulement
un morceau de papier » ; bénie, elle devient en quelque sorte sacrée, elle a quelque
chose du saint. Les images qui viennent du sanctuaire acquièrent un statut particulier.
Mais étant donné le nombre des visites, chaque dévot en est déjà largement pourvu :
une pour le portefeuille, une pour la table de chevet, etc. Et il semble qu'on ne puisse
les multiplier indéfiniment : ce serait sans doute mettre en péril l'unité de la figure
représentée. Jeter une image n'est pas envisageable, pas plus qu'une statue abîmée,
selon Natalia, dévote de saint Pantaléon : c'est un objet sacré, on lui doit du respect. On
les fait donc circuler : on les offre à des proches, on les dépose dans des lieux publics,
bref, on diffuse la dévotion. Dans le cas de saint Pantaléon, cette obligation de faire
circuler l'image fabrique du « miracle ». On invoque en effet, à son propos, l'apparition
miraculeuse d'images dans les hôpitaux, précisément dans les moments où l'on peut
avoir besoin de lui.
26 C'est l'eau bénite, ensuite, qui fait l'objet de manipulations. On a déjà décrit les
fontaines d'eau bénite de Saint Pantaléon ; ailleurs, on peut emporter un flacon. C'est
un aspect important de l'offre de sacré : venir au sanctuaire, c'est faire provision d'eau
bénite. L'eau bénite, comme les images, fait l'objet de transactions : elle est mise en
circulation, on en prend non seulement pour soi mais aussi pour offrir ; les proches du
pèlerin ne manquent pas de lui passer commande. Il y a, là aussi, obligation de donner :
« j'en prends pour moi, et puis pour offrir », « j'en prends toujours pour offrir, j'ai
toujours de l'eau bénite chez moi pour offrir ». Chaque bénédiction à l'intérieur du
sanctuaire se termine par une aspersion d'eau bénite. Remarquons que l'eau bénite a
un statut paradoxal. Son usage n'est pas réservé au clergé, ni administré
nécessairement par la médiation du clergé. Elle est donc un enjeu dans la question de
savoir qui a l'usage du sacré. Néanmoins, si le clergé peut ainsi la mettre à disposition
du profane, c'est parce qu'il a le monopole de sa fabrication : l'eau bénite a été bénie, et
le rituel de bénédiction doit être effectué par un prêtre pour être efficace. Ainsi, si l'on
peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un « sacramental » qui permet un usage autonome,
du « sacré en libre service », il faut bien remarquer que ce sacré n'est tel que par
l'intervention de l'Institution 20. Il en va de même pour les images, estampes ou
statuettes, objets de dévotion privée : si elles permettent un contact direct et immédiat
avec une entité surnaturelle, c'est parce qu'elles ont d'abord fait l'objet d'une
manipulation dont le clergé garde le monopole. Il y a sur ce point unanimité parmi les
dévots : pour que les images soient objets de dévotion, il faut qu'elles aient été bénies.
Ici, ce n'est pas à cause de la proximité du saint que ces objets acquièrent des propriétés
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
37
particulières, mais à cause d'une opération symbolique : un rituel, des paroles
prononcées par un prêtre. Favoriser la diffusion des images et de l'eau bénite, proposer
des sacrements et sacramentaux sur les sanctuaires, permet donc au clergé
d'accompagner la dévotion populaire tout en rappelant la nécessité de sa médiation.
27 Passer par le sanctuaire, enfin, transforme ceux qui s'y sont rendus. C'est un effet sur
soi qui est recherché, produit d'abord par le lieu. Guillermo, venu voir la Vierge Desata
Nudos avec son fils et sa femme, l'exprime clairement : « Avant, (il fallait) venir à
l'église le dimanche. Mais maintenant, il y a le besoin de recourir à quelqu'un, de se
sentir bien, ne serait-ce que dix minutes ou une demi-heure, se sentir bien
intérieurement. Je crois qu'on vient à l'église parce qu'on en sent la nécessité, on y
reste un moment parce que l'on se sent bien. On ressent comme une paix intérieure ».
Les rituels de bénédiction agissent eux aussi. Sara, qui se reposait un instant avant
d'aller reprendre sa place dans la file d'attente pour aller voir le saint, commente ainsi
les services offerts dans l'église Saint Cayetano : « Tu écoutes la messe qu'ils te
donnent, ils t'aspergent... tu sors bénie, parce qu'ils t'aspergent d'eau bénite, et c'est
comme... moi, j'en sors... je sais pas, avec une autre, une autre... je me sens bien. En un
mot, je me sens bien. Et je transmets toute cette force à mes enfants, à mon mari, à mes
frères et sœurs... ». Pendant le pèlerinage à la Vierge de Luján 21, nos compagnons de
marche n'ont pas hésité à se faire bénir deux fois par les prêtres qui attendaient la
procession sous le pont. Pourquoi deux fois ? Parce que la bénédiction « donne des
forces », de même d'ailleurs que les rosaires récités pendant la marche à intervalles
réguliers. Cette logique de l'accumulation n'est pas sans rappeler la logique
thérapeutique qui, selon Sylvie Fainzang 22, est à l'œuvre dans la construction de
l'efficacité de la prière. On comprend alors pourquoi les rituels peuvent, et même
doivent, être cumulés, de même que l'on peut cumuler les types de médication sans y
voir de contradiction. Et ce n'est pas un hasard si c'est sur le sanctuaire Saint
Pantaléon, spécialisé dans les problèmes de guérison, que l'on trouve l'offre de rituels
la plus importante. Les effets attendus ne sont pas seulement spirituels : on recherche
également des transformations psychologiques, et même physiologiques. Nombre de
dévots, à la question de la raison de leur présence sur les lieux, répondaient en
décrivant précisément des changements intervenus dans l'état de leur corps : de
l'arthrose qui cesse ou s'améliore, une plus grande facilité dans les déplacements, etc.
L'efficacité thérapeutique de l'onction
28 Saint Pantaléon, de médecin miraculeux, officiellement patron des médecins 23, est
devenu par un glissement tout à fait compréhensible saint guérisseur. Un comptage
effectué à partir des cahiers d'intentions de prière donne les résultats suivants : sur une
centaine de demandes, soixante-dix concernent la santé. Cela va de la demande de
miracle à la demande de protection au moment d'une opération. En tant que patron des
médecins, saint Pantaléon devient inspirateur des chirurgiens : « Saint Pantaléon, guide
les mains du médecin chirurgien Docteur José Florentino qui va opérer Juan Gomar
Fernandez le 06-12-00 des intestins ». Saint Pantaléon n'est pas le seul sanctuaire à
vocation thérapeutique. À Lourdes, de même, les infrastructures qui permettent de
prendre en charge l'accueil des malades, la présence des brancardiers, et surtout l'eau
réputée miraculeuse de la source, témoignent de la spécialité du sanctuaire. Mais, si la
Vierge de Lourdes est réputée pour ses miracles dans le domaine médical, si le
sanctuaire abrite une source dont l'eau opérerait des guérisons miraculeuses, on ne va
cependant pas à Lourdes pour y consulter des médecins. D'autre part, il ne semble pas
que les rituels qui prennent place dans les offices célébrés sur place aient eux-mêmes
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
38
une vocation thérapeutique. Or, la spécialité de saint Pantaléon a donné lieu, en
Argentine au moins, à des expériences visant à transformer le sanctuaire en lieu de
soins. Il s'agit de redoubler, par des propositions qui émanent du clergé, l'intervention
du saint.
29 Dans les années soixante-dix, le sanctuaire abritait un centre médical où l'on pouvait
consulter en acupuncture, iridologie et homéopathie 24. La conjonction du catholicisme
et de ces médecines douces revient à réunir deux univers culturels dont on n'attendrait
pas nécessairement qu'ils se rencontrent, celui, traditionnel et populaire, du culte des
saints, et celui, moderne, de la contre-culture qui s'est développée à cette époque. Plus
en accord avec la symbolique catholique, des rituels d'exorcisme collectifs avaient lieu
sur le sanctuaire. Le malheur contre lequel on lutte n'est plus la maladie mais sa cause,
la possession. Le sanctuaire procédait à une campagne d'annonces dans la presse :
« Maléfice : demain 27, à dix heures, bénédiction spéciale contre tout type de mal au
sanctuaire Saint Pantaléon. Si on vous a causé un dommage, ou si vous le pensez, ne
manquez pas de venir ». Il n'y a plus trace aujourd'hui de ce traitement de la maladie
sur le sanctuaire Saint Pantaléon, ce qui ne veut pas dire que la préoccupation de la
possession ait disparu de l'horizon culturel argentin. C'est une gestion plus spirituelle
de la maladie qui est proposée aujourd'hui. À la fin de chaque office est pratiqué un
rituel d'imposition des mains, semblable à ceux que pratiquent les charismatiques et les
évangélistes 25. Lorsque la messe est terminée, l'assemblée s'avance vers l'autel ; le
prêtre et les deux laïcs qui l'ont secondé pendant la liturgie reçoivent chaque personne
individuellement et posent leurs deux mains sur les fronts qui se tendent vers eux. Ce
rituel est distinct de celui de la bénédiction finale, auquel il succède.
30 Le second rituel a lieu un samedi matin par mois, le troisième, en alternance avec une
messe consacrée aux femmes enceintes et aux malades. Il ne s'agit pas cette fois d'une
bénédiction qui s'adresserait à un public spécifique, ni d'une pratique importée, mais
d'un sacrement administré à un groupe de volontaires : l'onction des malades. Ce
samedi là, l'office de 10 heures est entièrement consacré à cette cérémonie. Le public
est constitué d'une part de ceux qui doivent recevoir l'onction, d'autre part du « groupe
de l'onction », groupe de volontaires qui participent à l'organisation de la cérémonie.
L'onction des malades, sacrement revu par Vatican II, remplace l'ancien sacrement de
l'extrême-onction. Voyons de quelle manière les modalités de son administration et les
conditions à remplir pour en bénéficier en font un rituel thérapeutique pour ceux qui le
reçoivent.
31 Les réformes mises en place par Vatican II ont eu pour finalité d'opérer une
métaphorisation du sens du rituel de l'onction. F. A. Isambert, qui consacre le chapitre
IV de son ouvrage Rite et efficacité symbolique (1979) à une analyse précise du sens du
rituel avant et après la réforme, suggère que le rituel de l'onction perd en efficacité
pour ceux qui le reçoivent. À partir d'une analyse sémiologique du rituel de l'extrême-
onction, il montre que le rituel met en scène le combat du Christ et de Satan au pied du
lit du mourant, pour s'approprier son âme. La victoire finale, grâce à la confession,
revient au Christ. Alors que l'ancien rituel possédait un caractère « magique » 26, au
sens où il permettait l'obtention immédiate d'un effet (le salut), le nouveau rituel, outre
qu'il a changé de dénomination (de rituel « des mourants » il devient rituel « des
malades »), présente un scénario différent. Le combat final est métaphorisé, le
déroulement n'est plus centré sur le sort du mourant mais sur la communauté et le rôle
qu'elle joue en l'entourant. Le passage de l'ancien au nouveau rituel traduit, selon
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
39
Isambert, « à la fois le désir d'occultation, au moins relative, de la mort, et l'attention
portée, dans notre univers, à la santé et à la maladie. Mais en même temps, les
frustrations que risque de traduire ce déplacement ne sont pas mesurées » 27. L'onction
perd en efficacité immédiate. On en attend la guérison et non plus le salut, sans que l'on
sache très bien si l'effet doit être miraculeux ou simplement psychologique 28.
32 Or, la manière dont ce sacrement se déroule sur le sanctuaire Saint Pantaléon permet
de redonner au rituel de l'onction de l'efficacité. Nous en retiendrons deux aspects : le
sens que prend l'onction pour ceux qui la reçoivent ; le sens que l'équipe et le prêtre
qui s'en chargent donnent à la cérémonie.
33 Le 27 de chaque mois, une petite table est installée près du secrétariat du sanctuaire,
où, à tour de rôle, les membres du groupe de l'onction reçoivent les demandes des
volontaires. Une annonce à la fin de la messe rappelle à la fois l'existence du sacrement
collectif et les conditions requises pour en bénéficier. Les personnes de plus de soixante
ans y ont droit une fois par an ; on peut y prétendre également en cas d'opération ou de
maladie grave. Or, ces conditions, qui sont des conditions restrictives, se transforment
dans le discours des récipiendaires en prescriptions : recevoir le sacrement de l'onction
fait partie de ce qu'il convient de faire dans les circonstances évoquées. Le 16
décembre, après avoir assisté à la cérémonie, nous avons demandé à l'une des
participantes pour quelle raison elle avait reçu le sacrement : « Eh bien ... tu vois, j'ai
soixante-dix ans et demi, et d'après mon amie [qui lui a fait connaître saint Pantaléon],
l'onction, c'est pour fortifier la santé... ». Maria Eugenia, elle, fait partie du groupe de
l'onction. Elle nous a raconté la manière dont le groupe a insisté pour qu'elle reçoive le
sacrement avant son opération des yeux, et sa résistance au début : « ce n'est pas pour
moi, moi, j'accompagne, je ne suis pas là pour recevoir... ». C'est bien d'une logique
thérapeutique qu'il s'agit : de même qu'il faut, pour guérir, aller voir le saint, mettre
une bougie, faire une promesse, se faire bénir, recevoir l'imposition des mains,
effectuer des manipulations avec de l'eau bénite ; il faut recevoir le sacrement de
l'onction. Tant le discours des récipiendaires que celui des membres du groupe de
l'onction est significatif sur ce point.
34 Faut-il penser que faire partie du groupe de l'onction est une manière de se prémunir
contre les aléas médicaux ? Sans aller jusque-là, il semble cependant que ce soit la
garantie d'un soutien dans l'adversité. « C'est une communauté très spéciale », nous dit
une autre membre du groupe, « en ce moment, avec mon mari, nous traversons une
passe difficile, mon père est malade. Et d'être là, on t'entoure, on t'aide... ». Ils sont une
quinzaine en tout, et présentent leur rôle comme un engagement de tous les instants :
« Comme serviteurs de l'onction, nous sommes serviteurs en permanence. Une fois, il y
a eu un accident dans la rue, et... je me suis agenouillé pour prier pour les victimes.
Tout le monde s'éloigne, et nous, comme serviteurs... ».
35 Pendant l'office, le groupe intervient de manière active. À tour de rôle, un membre du
groupe lit le « guide de l'onction » qui redouble, en la précédant et en la commentant,
la parole rituelle du prêtre. L'accompagnement des récipiendaires qui suppose
attention, assistance, gestes « charismatiques », est une autre manière de faire
participer la communauté à l'efficacité du rituel. En cela, le groupe de l'onction
fonctionne comme une communauté réduite, qui s'organise autour du saint non pas
pour le servir, comme le faisaient les confréries, mais pour le seconder dans son
intervention. On a également une lecture du rituel de l'onction qui prend au sérieux le
rôle de la communauté dans le soutien au malade promu par la réforme de Vatican II.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
40
L'efficacité rituelle des gestes et paroles du prêtre est diluée dans l'efficacité de l'action
du groupe. Tout, dans la mise en scène, vise à donner à la cérémonie le sens d'une fête ;
il s'agit de faire de l'onction des malades un rituel de vie et non un rituel réservé aux
mourants comme l'était l'extrême-onction. On peut se demander s'il ne prend pas dès
lors le sens d'une sorte de « baptême des vieux » : il leur est en principe réservé, et
remplit en cela un vide. « L'onction, c'est quelque chose qui est pour les personnes
âgées, et il n'y en a pas tant que ça, contrairement à ce qui se passe pour les enfants »,
nous dit un membre du groupe.
36 L'onction des malades, dans ce sanctuaire, est donc administrée de manière collective,
c'est-à-dire à la fois à un groupe, les récipiendaires, et par un groupe, du moins
symboliquement. Elle prend place dans une série d'expériences qui ont pour sens un
relais, par l'Institution, du rôle thaumaturgique du saint.
Conclusion : fidéliser les « dévots »
37 Les initiatives de la pastorale des sanctuaires, dont les objectifs affichés sont avant tout
de réguler et d'encadrer les pratiques de dévotion « populaires », c'est-à-dire de
transformer les dévots en fidèles, ont finalement des effets complexes.
38 Elles contribuent d'une part à une mise à disposition du sacré et semblent en cela
encourager paradoxalement des manipulations autonomes. Les pratiques de dévotion,
nous l'avons vu, n'en sont pas moins normées ; les initiatives individuelles s'inscrivent
dans un cadre traditionnel, celui du culte des saints. Dès lors, si ces pratiques relèvent
de la dévotion traditionnelle, et ont peu à voir avec les pratiques pèlerines de la
modernité religieuse décrites par Danièle Hervieu-Léger, le culte des saints connaît
cependant à Buenos Aires des aménagements qui prennent acte des demandes de la
modernité religieuse, notamment la demande de guérison.
39 Dans le contexte argentin où le catholicisme subit, comme ailleurs en Amérique latine,
la concurrence des néo-pentecôtismes 29, ces initiatives prennent également un autre
sens : elles rendent la présence de l'Institution indispensable, puisque les bénédictions
et sacrements requièrent la médiation du clergé. Cela est particulièrement vrai de
l'offre de rituels proposée sur le sanctuaire Saint Pantaléon qui vient redoubler les
pouvoirs thérapeutiques du saint. Ainsi, le rituel d'imposition des mains, réintégré dans
la liturgie catholique, suppose une intervention du clergé, qu'il soit administré par un
prêtre ou par un laïc consacré, alors que pour les charismatiques, comme pour les
évangélistes, il peut être effectué par n'importe quel fidèle. Il en va de même pour le
sacrement de l'onction des malades, véritable rituel thérapeutique orchestré par le
clergé.
NOTES
1. Les Argentins font davantage confiance à Saint Cayetano, patron du pain et du
travail, qu'au ministère du Travail, pour trouver un emploi, constatent non sans
humour Roberto Di Stefano et Loris Zanatta, dans leur histoire de l'Église en Argentine
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
41
(Roberto Di Stefano, Loris Zanatta, Historia de la Iglesia argentina, Buenos Aires,
Mondadori, 2000, p. 568).
2. Cet article reprend en partie les résultats d'une enquête effectuée de septembre à
décembre 2000 auprès de quatre sanctuaires urbains de Buenos Aires, et qui a fait
l'objet d'un DEA (Christine Laigneau, « Le culte des saints en milieu urbain : une
comparaison France-Argentine », sous la direction de Jean-Pierre Albert, EHESS-
Université Toulouse le Mirail, 2001).
3. Il se rapproche en cela de cultes urbains européens comme celui qui a lieu en la
chapelle Sainte Rita, place Blanche, à Paris, ou en l'église Saint Jérôme à Toulouse.
4. Aldo Jesús Büntig, « El catolicismo popular en la Argentina », Criterio, n o 1560, XLI,
28-11-68, 1969, p. 862-869 ; et El catolicismo popular en la Argentina I, Buenos Aires,
Bonum, 1969.
5. Il s'agit en fait de Gaétan de Tiene. Nous gardons la terminologie espagnole : saint
Cayetano est un personnage pleinement argentin. Son sanctuaire est le plus important
de Buenos Aires. Dans un contexte de crise économique et sociale, jusqu'à un million de
personnes s'y retrouvent le jour de sa fête, le 7 juillet, aux dires de l'actuel Recteur.
6. Patronne de l'Argentine.
7. Nous traduisons des extraits de cette note citée dans la revue Servicio 145, 1990,
p. 156-157.
8. Ce sont des associations de fidèles formées à l'origine dans un objectif dévotionnel :
culte d'un saint, récitation de rosaires, etc. L'entrée peut en être restreinte à un groupe
donné, social ou, en Argentine, ethnique. Des liens de solidarité s'y forment ; être
membre d'une cofradia garantit par exemple une mort digne : c'est la confrérie qui
prend en charge le rituel et les frais du culte des morts (Roberto Di Stefano, Loris
Zanatta, op. cit., p. 70-78).
9. L'expression est empruntée à l'un des prêtres interrogés et revient souvent dans la
littérature consacrée à la pastorale des sanctuaires.
10. Pantaléon est un martyr des premiers temps de l'Église, vraisemblablement
légendaire : le récit de son martyre comprend tous les stéréotypes en usage. Il est fêté
le 27 juillet.
11. L'expression est celle de la secrétaire qui nous fait visiter les lieux.
12. Le mate est une plante à partir de laquelle on confectionne une infusion très
populaire en Argentine et en Uruguay. On le boit en général très concentré, dans une
calebasse, à l'aide d'une paille métallique appelée bombilla. On peut aussi en faire une
boisson qui ressemble à du thé : le mate cocido.
13. Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti, Paris, Flammarion, 2001 (1 re édition
1999), p. 109 (coll. « Champs »).
14. C'est pourtant le cas pour certains, qui choisissent de faire plusieurs heures de
marche pour gagner le sanctuaire.
15. Dans son mémoire de DEA, « La dévotion à saint Antoine de Padoue », sous la
direction de Daniel Fabre, EHESS Toulouse, 1991.
16. Elias Zamora-Acosta, « Aproximación a la religiosidad popular en el mundo urbano:
el culto a los santos en la ciudad de Sevilla », in Carlos Alvarez Santalo, Joaquín Alvarez
Barrientos, Maria Jesús Buxo Rey, Salvador Rodriguez Becerra, dirs., La Religiosidad
popular, coord. t. I, Barcelone, Anthropos, 1989, p. 534.
17. Jean-Pierre Albert, « La “chaîne de saint-Antoine” : religion ou superstition ? », in
Nicole Belmont et Françoise Lautman, dirs., Ethnologie des faits religieux en Europe, Paris,
Éditions du CTHS, 1993, p. 207-220.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
42
18. Plusieurs milliers de personnes se rendent le 7 de chaque mois au sanctuaire Saint
Cayetano, plusieurs centaines le 27 de chaque mois au sanctuaire Saint Pantaléon.
19. Nous gardons l'appellation argentine qu'a reçue cette vierge venue d'Allemagne, et
qui signifie : Vierge qui Défait les Nœuds.
20. Nous empruntons cette remarque à Élisabeth Blanc, qui montre, à propos du culte
rendu à sainte Héléna dans un cimetière toulousain, en marge de l'Institution, que
l'usage de l'eau bénite impose une forme de recours à cette dernière (« Héléna, la sainte
du cimetière », Terrain 24, mars 1995, p. 33-42).
21. Ce pèlerinage a lieu tous les ans, à la fin du mois de septembre. Les pèlerins
parcourent environ 80 kilomètres, d'une traite, et marchent entre 15 et 20 heures.
22. Sylvie Fainzang, « Suppliques à Notre Dame de Bonne garde. Construire l'efficacité
des prières de guérison », Archives de Sciences Sociales des Religions 73, janvier-mars 1991,
p. 63-79.
23. Louis Reau, Iconographie de l'art chrétien, t. III, Iconographie des saints, t. II, Paris, PUF,
1958.
24. Alfredo MOFFATT, Psicoterapia del oprimido. Ideología y tecnica de la psiquiatría popular,
Buenos Aires, Editorial libreria, 1975.
25. Sur l'emprunt de ce rituel par les charismatiques aux mouvements évangéliques,
voir Giordana Charuty, « Les rituels curatifs du catholicisme pentecôtiste », in Martine
Segalen, dir., Anthropologie sociale et ethnologie de la France, Louvain la Neuve, Peeters,
1989, p. 335-338 (« Bibliothèque des cahiers de l'Institut Linguistique de Louvain »).
26. François André Isambert, Rite et efficacité symbolique : essai d'anthropologie sociologique,
Paris, Cerf, 1979, p. 155 (coll. « Lex Orandi »).
27. Ibid., p. 115.
28. Ibid., p. 152.
29. Le pluralisme religieux en Argentine est un phénomène ancien, comme le rappelle
Floreal Forni dans un article consacré aux nouveaux mouvements religieux en
Argentine, « Nuevos movimientos religiosos en Argentina », in Alejandro Frigerio
(comp.), Nuevos movimientos religiosos y ciencias sociales, Buenos Aires, Centro Editor de
America Latina, 1993, p. 7-23. Cf. également Roberto Di Stefano, Loris Zanatta, op. cit. Ce
qui est récent, en revanche, c'est l'explosion de nouveaux cultes protestants : voir Pablo
Seman et Hilario Wynarczyk, « Campo evangélico y pentecostalismo en la Argentina »,
in Alejandro Frigerio (comp.), El Pentecostalismo en la Argentina, Buenos Aires, Centro
Editor de America Latina, 1994, p. 10-29.
RÉSUMÉS
Le sanctuaire Saint Pantaléon, situé en périphérie de Buenos Aires et consacré à un saint
guérisseur, représente un lieu d'observation privilégié de pratiques de dévotion populaires et de
la manière dont l'Institution s'efforce de les encadrer et de les canaliser. Ces initiatives
s'inscrivent dans le cadre de la « pastorale des sanctuaires », dont l'objectif affiché est de fidéliser
les dévots. Si l'on peut parler de « modernité » à propos des phénomènes observés, ce n'est pas
parce que les discours des dévots témoignent d'une certaine autonomie relativement à l'autorité,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
43
mais parce que le clergé prend acte d'une demande de la modernité religieuse : la demande de
guérison. Dans ce cas précis, le clergé met à profit le culte rendu à saint Pantaléon pour mettre
en place des rituels qui ont un sens thérapeutique.
The Saint Pantaleon sanctuary, dedicated to a healer saint and located in Buenos Aires, is an
appropriate place to observe practices of popular devotion and the way the Institution attempts
at controlling those practices. As part of the “pastoral of sanctuaries”, this control explicitly aims
at turning the worshippers of Saint Pantaleon into regular believers. One can consider the
observed phenomena as “modern”. It is not due to what the worshippers say about their own
practices, which reveals some kind of autonomy toward the authorities. What really makes the
modernity of this phenomena is the answer of the clergy to the modern demand of the
worshippers, being healed. In this particular case, the clergy takes advantage of the worship to
offer mere therapeutic rituals.
El santuario de San Pantaleón, situado en la periferie de Buenos Aires, es un lugar idóneo para la
observación de prácticas de devoción populares. Es también de notar la manera como la
Institución, dentro del marco de la “pastoral de los santuarios” cuyo objetivo declarado es
tranformar los devotos en fieles, se esfuerza en controlar y encauzar esas prácticas. Los
fenómenos observados pueden calficarse de “modernos”. No por la autonomía con respecto a la
autoridad que los discursos de los devotos demuestran, sino porque el clero toma en cuenta una
demanda de la modernidad religiosa : la demanda de curación. En este caso, el clero saca
provecho del culto rendido a San Pantaleón para proponer rituales que adquieren un sentido
terapeútico.
INDEX
Mots-clés : Argentine, dévotion populaire, guérison miraculeuse, sanctuaire
AUTEUR
CHRISTINE LAIGNEAU
EHESS – Toulouse
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
44
Ivan et Iakov – Deux saints étranges
de la région des marais (Novgorod)*1
Traduit du russe par Yvette Lambert
Alexandr A. Pančenko
Institut de littérature russe, Académie des sciences de Russie
1 L’un des traits spécifiques de l’histoire religieuse de la Russie à partir, au moins, de
Pierre le Grand et de Théophane Prokopovič, est une sorte de « repli » et de
« camouflage » des pratiques religieuses paysannes, des « formes élémentaires » de la
vie religieuse de la communauté agraire, s’appuyant essentiellement sur le paysage
local et le cycle annuel du calendrier agricole comme ressources sémiotiques primitives
pour l’adaptation de l’expérience religieuse et la construction de contenus religieux à
signification collective ou personnelle2. Apparemment, la « réforme des rites»
entreprise par Pierre le Grand a fortement contribué à repousser ce genre de pratiques
religieuses vers la périphérie de la vie sociale russe pendant la période synodale en
déclarant d’un coup illégales et passibles de poursuites les principales formes de
pratiques religieuses de masse3.
La résistance des pratiques paysannes
2 Je ne prendrai pas sur moi de juger dans quelle mesure Robert Muchenbled a raison
quand il affirme que les cultures religieuses paysannes en Europe occidentale ont subi
une transformation radicale au XVIIIe siècle quand « des légions de missionnaires
zélés » ont concentré leurs efforts d’acculturation sur « la destruction du système de
vision du monde populaire »4. Cependant, il est tout à fait évident que dans la Russie du
XVIIIe siècle il ne s’est rien produit de semblable. Aussi bien l’activité réformatrice de
Pierre le Grand, que la politique adoptée par la suite par les autorités religieuses et
laïques des XVIII-XIXe siècles ont abouti, non à une transformation, mais à une
coloration locale des formes de la religion paysanne. Le prêtre de paroisse a, ici, joué un
rôle prépondérant, en s’identifiant, pendant presque toute la période synodale, à l’élite
du pouvoir, en qualité, non pas de missionnaire-prédicateur, mais de fonctionnaire de
l’État de rang subalterne servant d’intermédiaire entre la communauté paysanne et les
autorités religieuses et laïques. C’est pourquoi les tentatives d’« isolation du sacré »,
pour employer l’expression de G. Freeze5, amorcées par les élites russes du XVIIIe
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
45
siècle, sont restées lettre morte, ou bien ont constitué une frontière assez fragile et
poreuse entre les pratiques religieuses «prescrites » et les pratiques « hors-normes ».
En ce qui concerne le XIXe siècle, l’activité missionnaire de l’Église de cette époque
était orientée en priorité vers les vieux-croyants et les membres des « sectes russes ».
Cette question représente, d’ailleurs, une page à part de l’histoire de la vie religieuse
russe, et nous ne nous y attarderons pas dans cet article.
3 Incomparablement plus forte fut l’influence exercée sur les pratiques religieuses
rurales par la « campagne d’athéisme » des années 1920-1930. C’est probablement
l’unique occasion où les efforts des élites au pouvoir, ayant pour but l’acculturation des
pratiques religieuses de masse, ont trouvé un soutien à l’intérieur même de la culture
paysanne. Il s’agit des Komsomol ruraux qui, peu nombreux, représentent l’unique
groupe rural, il est vrai, qui se soit affilié de façon systématique au pouvoir soviétique
après la fin de la Guerre civile. L’analyse socio-historique du mouvement komsomol des
années 1920, menée par I. Tirado, a montré que ce mouvement de la jeunesse rurale,
qui recrutait essentiellement parmi les représentants de groupes marginaux, a joué le
rôle d’une sorte de médiateur culturel entre les paysans et le nouveau pouvoir, le rôle
particulier des Komsomol consistant en l’interprétation et la popularisation du discours
communiste6. Bien que l’objet de « l’herméneutique komsomol » ne fût ni le
Pentateuque ni le Nouveau Testament, mais les œuvres de Lénine et Trotski, les décrets
du pouvoir soviétique, les articles publiés dans les revues du Parti et autres, les
stratégies de conduite de ce groupe dans la vie courante (en particulier la lutte contre
les rituels religieux et la tradition de célébration des fêtes, ainsi que la profanation
démonstrative des objets et des lieux sacrés) avaient un caractère missionnaire et
d’acculturation. Mais les pratiques religieuses rurales ont survécu victorieusement à la
campagne d’athéisme, compensant la profanation et la destruction des choses sacrées
par toute une série de récits sur les sacrilèges. Ces récits constituent une part
significative du folklore religieux contemporain de la campagne russe 7.
4 Bien que la période soviétique ait été une époque « d’athéisme d’État », de persécution
administrative à l’égard d’un grand nombre de formes d’activité religieuse courante et
de sévère réduction de l’influence de toutes les confessions, on pourrait difficilement la
qualifier d’époque sans religion. Dans la période d’après-guerre, et, plus précisément
dans les années 1960-1980, dans le milieu urbain « athéisé », s’élaborent diverses
formes de pratiques religieuses qui s’apparentent à ce que T. Luckman 8 appelle « la
religion invisible » ou que M. Maffesoli appelle «l’enchantement du monde » 9. C’est
justement dans cette « religiosité latente » de la ville à la période soviétique
tardive10qu’il convient, à ce qu’il me semble, de chercher une explication à bon nombre
de phénomènes religieux de la Russie actuelle, depuis les nouveaux mouvements
religieux autochtones jusqu’aux particularités que revêt la construction d’une culture
et d’une identité confessionnelles dans le milieu des « nouveaux paroissiens » de
l’Église orthodoxe russe. J’ajouterai que cette « religiosité latente » exerce une certaine
influence également sur les stratégies de conduite des représentants « officiels » de
l’Église, en particulier quand il est question des prêtres de paroisse issus de la classe
urbaine moyenne (« l’intelligentsia technique » et autres groupes du même genre) et
qui se sont ralliés à l’Eglise à une date assez récente, après la chute de l’empire
soviétique.
5 Il me semble que cette résistance constante des pratiques religieuses paysannes face
aux tentatives d’acculturation venant de l’extérieur est due à l’incorporation de
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
46
« religions locales » dans la stratégie générale de mythologisation de l’espace et du
temps propre aux cultures agraires de l’Europe catholique et orthodoxe. Il est difficile
de se représenter les saints, émergeant de l’eau ou des airs et apparaissant dans les
rêves, les icônes, les croix de pierre et autres, non seulement dans un espace culturel
urbanisé, mais également dans des régions où il n’existerait pas, ou pas sur de grandes
surfaces, une partie « naturelle » du paysage, non soumise à l’exploitation agricole (que
ce soit la forêt, la steppe, les massifs montagneux ou les bassins aquatiques) 11. Il est
clair que l’histoire de la vénération des saints locaux et d’autres cultes du même genre
dans la tradition paysanne du nord de la Russie a pour origine l’histoire de la culture
paysanne en tant que telle. De plus, il convient d’avoir présent à l’esprit le fait que, au
cours de la dernière décennie, les pratiques religieuses paysannes ont vu apparaître un
nouveau « rival, facteur d’acculturation » – la culture urbaine des pèlerins, de plus en
plus populaire et encouragée par l’Église orthodoxe russe. Cette situation, dans laquelle
on voit différents types de discours – « le discours des autochtones », celui « des
pèlerins » et celui «du clergé » – interagir sous diverses formes dans la lutte pour le
contrôle symbolique des objets sacrés locaux, a déjà été étudiée dans des travaux
récents réalisés par Ž.V. Kormina sur l’un des saints locaux du nord de la région de
Pskov12. En se fondant sur l’analyse des matériaux d’enquête sur le terrain, l’auteur en
arrive à conclure à l’existence « de différentes traditions religieuses ou de discours »,
« apparaissant dans les pratiques de vénération des saints et les récits religieux » 13.
Selon l’opinion de Ž.V.Kormina, « les différents groupes de croyants accordent leur
préférence à diverses modalités de sanction d’un culte existant…, les représentants des
différentes traditions religieuses restant par ailleurs hermétiques aux récits les uns des
autres, c’est-à-dire incapables de les assimiler et de les reproduire » 14.
6 On peut être d’accord avec ces considérations, en faisant toutefois quelques réserves.
En fait, les différents discours religieux, tout en s’opposant et interférant les uns avec
les autres sur le terrain de la vénération de tel ou tel saint, ne sont pas si
« hermétiques » les uns aux autres. Bien sûr, certaines formes de pratiques religieuses
peuvent en effet susciter une incompréhension mutuelle et même des conflits entre les
paysans, le prêtre et les pèlerins venus de la ville. Cependant, il est tout aussi probable
que les différents discours qui se heurtent dans de telles occasions vont s’influencer
mutuellement, et d’une façon ou d’une autre, contribuer à la formation de nouvelles
pratiques et de nouveaux types de discours religieux. Qui plus est, quand on parle de
folklore en général (y compris le folklore religieux), il faut garder présent à l’esprit le
fait que, dans une société à l’organisation complexe, constituée de groupes culturels et
sociaux hétérogènes, les pratiques et les objets dotés d’un statut symbolique
particulier, sont toujours le lieu d’interactions concurrentielles des différents discours.
En conséquence, on peut vraisemblablement affirmer que le folklore contemporain en
tant que tel est non seulement l’objet, mais aussi l’effet de la concurrence sociale –
d’une forme de « lutte pour l’authenticité », qui hiérarchise l’espace intertextuel de la
culture de masse et lui donne un sens social.
La vénération locale de deux enfants martyrs
7 De toute manière, de tels contacts entre cultures religieuses de type différent
n’aboutissent pas forcément à des conflits latents ou ouverts. Apparemment, il existe
des possibilités de coexistence relativement pacifique et d’interaction des différents
discours, utilisant un seul et même objet de culte local comme ressource symbolique.
J’aimerais citer en exemple quelques observations concernant l’histoire et les pratiques
d’un objet de vénération locale de l’ouest de la région de Novgorod. Il s’agit du culte de
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
47
deux enfants, les saints Ioann et Iakov du village de Menjuša, dont la mémoire est
célébrée le 7 juillet, le jour de la naissance de saint-Jean-le-Précurseur, et dont les
reliques reposent dans l’église du même village, situé à 50 km en direction du sud-ouest
de Novgorod, au bord de la petite rivière Strupenka, affluent de la rivière Šelon’. À une
date ancienne se trouvait à cet endroit le monastère des hommes de la Trinité,
mentionné pour la première fois dans des documents historiques de 1598 15. Le
monastère fut fermé en 176416. Apparemment, il existait là un village dépendant du
monastère, qui a occupé ensuite la place de celui-ci. Mais au début des années 1820, cet
endroit a été inclus dans une zone de colonies militaires 17, ce qui entraîna un afflux de
nouveaux habitants, qui n’appartenaient pas à la tradition culturelle locale. Encore à
l’époque actuelle, le village de Menjuša frappe par ses dimensions importantes (il
s’étend sur plus de quatre kilomètres de long), inhabituelles pour les agglomérations
rurales de cette région. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au XIXe siècle se sont
succédé à cet endroit plusieurs églises, dont les autels principaux étaient consacrés à la
Trinité18. Dans la première moitié des années 1890, le village de Menjuša a vu la
construction d’une église en pierre dédiée aux saints enfants Ioann et Iakov 19. Elle
existe encore de nos jours.
8 Ioann et Iakov sont les derniers saints qui aient été inclus dans le calendrier russe. Le
plus probable, c’est qu’ils n’ont pas été canonisés officiellement, on a simplement
procédé à l’examen de leurs reliques (« sous le règne de Petr et Ioann Aleksejevič,
Kornilij étant métropolite de Novgorod », c’est-à-dire entre 1682 et 1695). Cela
explique, très certainement, l’indigence et le caractère contradictoire des données sur
la mort « des enfants innocents de Menjuša » ; dans les calendriers actuels on apprend
simplement que « Iakov et Ioann de Menjuša étaient frères de sang, enfants des pieux
époux Isidor et Varvara. Iakov, à l’âge de trois ans, et Ioann, à l’âge de cinq ans ont été
occis par des malfaiteurs». Cependant, cette information, relativement tardive, est
fausse20. Il existe en effet un texte détaillé, le «Récit sur les saints Ioann et Iakov,
thaumaturges de Menjuša ». Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il a été plusieurs fois
relaté dans la presse par des chercheurs travaillant sur les antiquités religieuses de la
région de Novgorod21, mais, à ma connaissance, jamais publié in extenso. Au XXe siècle,
rien n’a été écrit sur le culte des enfants thaumaturges de Menjuša, et c’est seulement à
la fin des années 1980 que la chercheuse américaine Eve Levin s’est penchée sur le texte
du Récit, contenu dans un recueil de manuscrits de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
de la bibliothèque du musée de Novgorod. Dans son livre « La double foi et la religion
populaire » (1993), E. Levin s’est arrêtée brièvement sur le culte de Ioann et Iakov et a
tenté de mettre en rapport l’histoire de leur mort et de leurs miracles posthumes avec
le culte de Boris et Gleb dans l’ancienne Russie22.
9 J’ai eu la possibilité de prendre connaissance de l’original de ce texte au musée de
Novgorod23 (une autre variante de la même rédaction, datée de 1793, se trouve à la
bibliothèque de l’Académie des Sciences de Russie à Saint-Pétersbourg, contenue dans
un recueil de chroniques de Novgorod, constitué à la fin du XVIIIe-début du XIXe
siècle24). Selon le Récit, Ioann et Iakov étaient les enfants des pieux époux Isidor et
Varvara du village de Prihon dans la paroisse de Medved’ (situés l’un comme l’autre à
une quinzaine de kilomètres de Menjuša). En automne 1570, alors que Ioann avait cinq
ans et Iakov trois, les enfants sont morts dans des circonstances très particulières.
Leurs parents étaient partis au travail. Peu de temps auparavant, le pieux Isidore avait
tué un mouton. « Ayant vu ce que leur père avait fait, ils pensèrent dans leur
entendement puéril que c’était un jeu et l’aîné Ioann dit à son frère : « Frère Iakov, nous
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
48
allons faire comme notre père ». Ensuite, selon le texte du Récit, « Ioann prit un
gourdin et en frappa son cadet à la tête et Iakov tomba mort. Voyant que son frère était
mort, Ioann fut effrayé, et ne sachant que faire, saisi de peur, car c’était encore un
enfant, il s’introduisit dans le poêle qui était plein de bûches, en effet c’était un
automne pluvieux ». Rentrés à la maison, les parents allumèrent le poêle, et Ioann fut
asphyxié par la fumée, mais quand on découvrit son corps, on s’aperçut qu’il n’avait pas
été touché par le feu. Les enfants furent enterrés dans le cimetière paroissial de l’église
de Medved’. Cependant, peu après leur enterrement, leurs deux cercueils furent
aperçus sur un marais lacustre des environs de Menjuša « par des habitants des
environs ayant l’habitude de parcourir les forêts pour chasser oiseaux et bêtes
sauvages. Leur habitude était la suivante : le matin de partir à la chasse, et le soir de
rentrer chez eux, mais ce jour-là, non plus que le lendemain, ils ne retrouvèrent pas le
chemin de leur maison. Le troisième jour enfin, ayant débouché sur un petit lac, ils
virent deux petits cercueils qui flottaient à la surface ». Les cercueils les aidèrent d’une
façon miraculeuse à rentrer à la maison. Après cela, les reliques des deux enfants furent
ramenées solennellement au cimetière de Medved’. Mais les enfants apparurent à ces
mêmes chasseurs en rêve et déclarèrent qu’il fallait déposer leurs corps « en cet endroit
désert de Menjuša, là où dans les temps anciens se trouvait le monastère ». On se
conforma à leur exigence, et au-dessus de leurs tombes, on édifia une petite chapelle,
où commencèrent à se rendre des pèlerins, dans l’espoir de guérir de leurs maladies.
10 Quelque temps après cet événement, un moine qui voyageait de Pskov à Novgorod,
passa par Menjuša. Il tomba inopinément gravement malade, mais recouvra la santé
après avoir prié dans la petite chapelle au-dessus des tombes de Ioann et Iakov. « Plein
de reconnaissance, il demeura près des reliques des deux bienheureux, expliquant aux
gens le miracle de sa guérison et recueillant les dons des pèlerins pour la construction
d’une église, voulant rétablir le monastère de Menjuša … ».
Le pèlerinage de Menjuša et les traditions orales
11 Apparemment, le culte de Ioann et Iakov est resté stable pendant le XVIIIe siècle,
échappant miraculeusement aux conséquences de la « réforme des rites » de Pierre le
Grand. La situation a peu changé, semble-t-il, après la formation de la cinquième région
de colonies militaires, dont le centre était situé à Medved’, ce qui fit de Menjuša un lieu
de cantonnement des colons militaires (par la suite - soldats laboureurs) du Premier
régiment de carabiniers. En tout cas, à la fin du XIXe siècle, la vénération des deux
saints était largement répandue dans la région, et officiellement encouragée par le
clergé local. En 1895, l’archevêque de Novgorod, Feognost, prit part à la cérémonie de
consécration de la nouvelle église, dédiée aux deux jeunes thaumaturges de Menjuša 25.
Aussi bien à Menjuša qu’à Medved’, on tenait en grande vénération les icônes
représentant l’effigie des deux enfants et différents épisodes du récit (l’une de ces
icônes s’est conservée jusqu’à nos jours, mais il en sera question un peu plus loin). Le
territoire d’où les pèlerins se rendaient en pèlerinage à Menjuša était assez vaste. C’est
ainsi qu’on a pu enregistrer en 1997 le récit d’une paysanne de 86 ans, originaire du
village de Melkoviči, situé à une cinquantaine de kilomètres de Menjuša :
Et bien, c’est Ivan et Iakov, tu vois, dans les marais de Menjusa. Et dans les marais
de Menjuša, tu vois, sont arrivés des chasseurs, voilà, moi aussi je l’ai entendu
comme ça. Les chasseurs arrivent et les deux petits cercueils qui flottent. Voilà.
Ivan et Iakov. Deux petits cercueils, tu vois. Ce sont les marais de Menjuša, quand
on va par là dans les marais de Menjuša, il y a un lac. Il y avait une chapelle là. On
allait là-bas aussi pour prier Dieu. À pied et autrement.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
49
Et cette chapelle, à ce qu’on dit, c’est surtout les enfants qu’on y baignait. Il faut
absolument mettre l’enfant dans l’eau sous la chapelle. Quelqu’un doit le mettre
sous cette chapelle. Dans l’année. L’enfant. Elle est bâtie sur l’eau, comme ça. Sur
l’eau, et il y a un petit escalier pour y aller. Et voilà, on le descend sur l’escalier et
on se baigne aussi. On se baigne aussi26.
12 Il existe par ailleurs un témoignage indirect qui permet d’envisager une diffusion bien
plus large des récits de pèlerinage concernant les enfants de Menjuša – c’est le récit
oral inclus par P.P. Čubinskij dans le recueil « Contes de Petite Russie » (1878), sous le
titre de « Nedogljad »27. Ce thème est mentionné dans le répertoire « Le conte chez les
Slaves de l’Est »28 sous le numéro 939B* (« Une tragédie familiale »), toutefois les
auteurs du répertoire ont fixé une seule variante du sujet – le texte du recueil de
Čubinskij. À proprement parler, l’histoire de « Nedogljad » est identique à la première
partie du récit concernant les enfants de Menjuša : un paysan égorge un mouton et part
avec sa femme au travail. Le fils aîné, voulant imiter son père, égorge le cadet couché
dans le berceau et ensuite se cache dans le poêle. « La mère est arrivée et n’a pas
regardé tout de suite dans le berceau : elle s’est tout de suite occupée du poêle, elle a
pris du feu et elle a allumé, et là le fils qui était dans le poêle a brûlé et il est mort, et le
feu s’est répandu dans la maison. Elle a regardé : le fils aîné est mort brûlé ; elle a
regardé dans le berceau : l’autre est égorgé». Ce récit est dépourvu de toute
connotation religieuse et écrit dans un ton tragique, trahissant un « caractère de
ballade ». Quand le mari revient à la maison, il pense que c’est sa femme qui a tué les
deux enfants, et, à son tour, il la tue à coups de hache, après quoi il se pend. Il y a tout
lieu de penser que le texte publié par Čubinskij est secondaire par rapport au récit écrit
et aux variantes orales relatives à Ioann et Iakov, et qu’il est parvenu jusqu’en Ukraine
précisément grâce aux pèlerins qui se sont rendus à Menjuša et ont entendu sur place
l’histoire des deux enfants.
13 En ce qui concerne la tradition orale actuelle, elle montre l’extraordinaire diffusion des
récits sur les enfants thaumaturges. Presque tous les paysans des environs, avec
lesquels j’ai eu l’occasion de m’entretenir connaissaient l’histoire de la mort et de
l’apparition miraculeuse des deux enfants. Cela s’explique, vraisemblablement, par
l’existence d’icônes reproduisant non seulement les différents épisodes du récit, mais
aussi le texte complet de ce même récit. L’une de ces icônes (que l’on peut dater
approximativement du début du XIXe siècle, restaurée en 1844 et ornée d’un
revêtement métallique datant de 1862) se trouve actuellement dans l’église du village
de Medved’. Dans la partie centrale de l’icône sont représentés les enfants, Ioann et
Iakov, debout sur le fond d’un endroit désert, avec, au-dessus d’eux sur un nuage – le
Dieu Pantocrator. Dans cinq médaillons, entourant la scène centrale, à droite, à gauche
et au-dessus, figurent les principaux épisodes du récit : Ioann tue Iakov d’un coup de
gourdin ; Isidor et Varvara trouvent Iakov mort ; les chasseurs voient les deux petits
cercueils flottant sur le lac ; on transporte les cercueils du lac jusqu’au cimetière du
village de Medved’; on enterre les enfants à Menjuša. Tous les médaillons sont
accompagnés de brèves explications empruntées au texte du récit. Enfin, dans la partie
inférieure de l’icône, est reproduit in extenso le texte du récit, dans cette même
rédaction mentionnée dans les copies de la bibliothèque du musée de Novgorod et de la
bibliothèque de l’académie des sciences de russie.
14 En outre, on trouve dans la tradition locale, aussi bien écrite qu’orale, quelques poésies
spirituelles sur le sujet du récit. Au cours des missions de recherches de 2002 et 2003,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
50
une de ces poésies a pu être enregistrée en entier (une variante orale et deux
manuscrites), et une autre a été enregistrée de façon fragmentaire.
15 Il n’y a aucun doute que ces poésies appartiennent au folklore religieux local et ont été
composées au XIXe siècle ou au début du XXe. Elles sont conformes à la tradition des
poésies spirituelles tardives composées en vers syllabo-toniques, connues également
comme psaumes ou cantiques, et qui ont cours encore de nos jours dans certaines
régions de Russie29. On peut noter que, dans le village de Menjuša, les termes de
« psaumes » et « cantiques » sont inconnus : les poésies spirituelles sont simplement
appelées « poésies ». L’apparition de poésies sur Ioann et Iakov dans le folklore
religieux du village est due à la création du clergé local ou de paysans « proches de
l’église ». Il ne me semble pas que ces textes se réfèrent à une tradition monastique plus
ancienne : il faut se souvenir, en effet, que le monastère de Menjuša a été supprimé en
1764, alors que les particularités formelles des deux textes cités permettent de les dater
d’une époque bien plus tardive. Quoi qu’il en soit, les matériaux recueillis à la suite
d’enquêtes de terrain mettent en lumière la grande popularité, à Menjuša et dans les
environs, de ces poésies (au même titre que d’autres textes n’ayant aucun rapport avec
le culte de Ioann et Iakov) : on les recopiait et on les apprenait par cœur, on les chantait
pendant les travaux collectifs et les veillées. En ce qui concerne les résumés en prose du
Récit, ils présentent un intérêt particulier comme témoignages d’une sorte
« d’herméneutique paysanne » - de pratiques d’une interprétation « folklorique » d’un
texte écrit : c’est ainsi que les chasseurs du texte du Récit se transforment, dans les
récits des paysans en « chasseurs d’enfants » - on précise qu’on doit « attraper « les
cercueils, qu’on n’y arrive pas, et qu’en fin de compte, ce sont eux qui « se laissent
attraper » seulement par la procession venue de Menjuša :
Et là où il y a maintenant le lac, à cet endroit, il n’y avait pas de lac du tout, il n’y
avait pas de lac, et les chasseurs y allaient. Et là, longtemps après, les chasseurs y
vont, et ils voient un lac qui brille, et ils sortent vers ce lac, et ils voient deux petits
cercueils qui flottent. Et puis ils ont dit où c’était, ils ont expliqué et ci et ça, deux
petits cercueils qui flottent. Et on a dû le dire aux parents, en tout cas ils sont
venus, on a attrapé les cercueils, ils les ont reconnus, et on les a enterrés à nouveau
au même endroit, à Medved’. Et qu’est-ce qu’ils ont fait ? Et une deuxième fois, de la
même façon, ils sont partis, et à nouveau ils flottent sur le lac, pour la troisième
fois, pour la troisième fois quand on a essayé de les attraper, impossible d’y arriver,
quand on a essayé de les attraper pour la troisième fois. Ensuite, là, on a fait une
procession ici à Menjuša, et les habitants de Medved’, là-bas il y avait une église, et
ils sont partis en procession vers le lac. Alors on les a attrapés, et maintenant il y
avait une inscription sur les cercueils : il faut nous enterrer à Menjuša. Et puis on
les a enterrés, en bas, là ou les gens viennent, il n’y avait pas la petite église, elle
n’existait pas, on les a enterrés simplement près de l’église, c’est là qu’on les a
enterrés30.
C’est la Saint-Ivan. Chez nous, on fête la Saint-Ivan… Il y avait chez nous des
enfants. Deux enfants. On les a attrapés sur le lac – deux petits cercueils. Ils ne
voulaient pas être enterrés ailleurs, ils voulaient être enterrés ici, à Menjuša. Et
voilà, on les a attrapés, on a apporté les deux cercueils ici dans l’église, et on les a
enterrés ici31.
Et comme ça ils ont raconté que… Ils apparaissaient, on voulait les attraper,
quelqu’un voulait les attraper, et à nouveau ils se cachaient, à ce qu’on dit. C’est…
Ce sont les vieux qui racontent. Mais qui sait ? Peut-être que les vieux non plus ne
savent pas au juste32.
16 De ce point de vue, les récits oraux « secondaires » présentent également de l’intérêt.
En plus des récits traditionnels pour la campagne russe sur la profanation et le
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
51
châtiment qui en résulte, ainsi que les guérisons miraculeuses, réalisées par les deux
enfants, on a enregistré à Menjuša, en 2002 et 2003, des textes mentionnant l’apparition
de Ioann et Iakov la nuit dans l’église ; d’autres racontant comment ils ont accompagné
à sa dernière demeure le prêtre défunt du village ; comment ils ont sauvé une fillette,
maudite par ses parents et tombée au pouvoir des forces « impures » de la forêt.
Et la guérison – voilà, on a parlé de guérison. Moi, j’étais petite à l’époque. Une
mère s’est mise à pleurer... Sa fille n’y voyait plus. Elle a fait dire une messe pour les
enfants. Et encore il y en a qui disent que ce sont des histoires ! Et la petite fille a
recouvré la vue. « Maman, qu’elle dit, quel bel habit il a le père ! » Et toutes les
femmes se sont mises à pleurer, parce qu’elle avait recouvré la vue. Avant elle n’y
voyait rien, et là… « Il est beau, elle dit, il est beau ! » Et elle…Et sa mère : « Tais-toi,
elle lui dit, tais-toi ». Voilà ce…ça, je l’ai vu. On était petits, on était avec ma grand-
mère33.
Et puis il y avait chez nous une pauvre vieille. Elle n’était pas d’ici. Je ne sais pas
d’où elle venait, elle était toute tordue. Tout, les bras, les jambes. Et son visage aussi
était déformé. Elle errait à travers le village. Elle demandait l’aumône. Et cette
vieille, on l’enfermait dans l’église pour la Saint-Ivan. Et elle disait qu’elle les avait
vus, un matin tôt, ils marchaient dans l’église avec un encensoir 34.
L’enquêteur : Et est-ce que les enfants sont apparus ici aux gens en rêve ou en
réalité ? est-ce que ça s’est produit ?
L’informateur : Oui… c’est arrivé…Ils sont apparus à mon beau-père /…/ Cette porte,
on ne l’ouvrait pas, seulement pour la Saint-Ivan. « Et tout à coup, il dit, je vois qu’il
y en a un avec un cierge, et l’autre avec l’encensoir. Et moi, il dit, tout de suite je me
suis assis /.../, et puis ils n’y étaient plus, et après non plus, ils n’étaient plus là. »
Voilà exactement ce qui s’est passé, mon beau-père, c’est sûr, n’était pas un
menteur /…/ Et après, j’ai entendu encore quand j’étais petite. Ma mère est arrivée
et elle a dit qu’ils avaient accompagné le prêtre. On avait un prêtre qui disait
l’office, il est tombé malade. En trente ou en vingt-neuf que c’était. Et donc, les
enfants, elle disait, l’avaient accompagné, loin ils l’avaient accompagné. L’un avec
un cierge, et l’autre avec une lampe. Et… est-ce que quelqu’un le lui avait dit, ou
bien, est-ce qu’elle l’avait vu elle-même, je ne lui ai pas demandé. Maintenant je me
demande pourquoi, j’étais déjà grande, je comprenais déjà les choses. Et elle ne m’a
pas dit, aucun mot là-dessus, et moi je ne lui ai pas demandé.
L’enquêteur : Et où ils l’ont accompagné ?
L’informateur : À Medved’. C’est là qu’il est enterré, le père Vladimir 35.
L’informateur : C’était avant, la maison en face, là. Et puis il y avait plus loin par là-
bas un village, Bazlovka, vers Borki, des hameaux. La mère, à ce qu’on disait, avait
maudit sa fille. Et la fille jouait par ici. Et tout d’un coup, ça l’a pris /…/ Et la fille
s’est mise à courir là-bas en direction du potager. « Maša, Maša, où vas-tu ? » crie la
mère. » Et elle, elle court par là sans se retourner /… / Et elle a dit après, une fois
revenue : « Deux petits garçons m’ont portée dans leurs bras, ils chantaient le Notre
Père et ils m’ont déposée sur le rebord du poêle./…/ Et le diable ne cessait de me
demander : « Donne-moi ta croix ». Mais moi, elle disait, je ne l’ai pas donnée, je me
tenais le cou, et je disais : « Vous ne toucherez pas à mon cou », et après, j’ai
dit : « Seigneur, aide-moi », et là, l’autre, le diable, a été désemparé ». Ça, c’est ma
mère qui me l’a raconté, elle était amie avec Maša./…/
L’enquêteur : Et ces petits garçons, qui étaient-ils ?
L’informateur : Les enfants, biensûr, les innocents de Menjuša.
L’enquêteur : Et ils l’ont sauvée.
L’informateur : Ils l’ont sauvée. Et ils l’ont portée dans l’isba, ils l’ont assise sur le
rebord du poêle et ils ont fermé la porte au verrou 36.
17 Le récit sur la fille maudite, sauvée par Ioann et Iakov, présente, dans notre contexte,
un intérêt particulier. Les récits de malédiction parentale, à la suite de laquelle l’enfant
est emmené ou emporté par « l’esprit impur », ou par le démon de la forêt, sont
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
52
largement répandus dans le folklore des Slaves de l’Est 37. Ils sont encore en usage dans
les traditions orales actuelles des paysans de Novgorod38. Parfois dans les histoires de ce
genre, on trouve mentionnées seulement les conséquences de la malédiction : l’enfant
disparaît et personne ne peut le faire revenir. On connaît aussi un certain nombre de
récits qui se terminent par le retour de l’enfant maudit : pour le délivrer du pouvoir des
démons, il faut jeter sur lui une petite croix et une ceinture, « faire un vœu sur
l’icône », faire sonner la cloche ou avoir recours à une pratique spéciale de magie.
Cependant, l’aide d’un saint ou de plusieurs est un motif qui n’est pas caractéristique de
tels récits39. Il est évident qu’une telle transformation du sujet dans le folklore de
Menjuša témoigne d’une forte influence du culte des deux enfants Ioann et Iakov sur la
tradition orale locale.
Saints fratricides et thaumaturges
18 L’interprétation historique et phénoménologique du culte de Ioann et Iakov de Meniuša
requiert une analyse particulière et détaillée ; dans cet article, je me bornerai à de
brèves remarques préalables. Tout d’abord, il faut noter le caractère contestable de
l’idée d’Eve Levin concernant un lien entre le Récit sur Ioann et Iakov et le culte de
Boris et Gleb. En fait, ce rapprochement est fondé uniquement sur le motif du
fratricide, qui figure dans les deux histoires40. On pourrait à ce propos rappeler
également l’histoire de Caïn et d’Abel, ainsi que diverses variantes de leur
interprétation folklorique41. Cependant, le motif du fratricide, qui a une grande
importance dans l’histoire de Ioann et Iakov, n’y joue pas un rôle dominant. De plus, la
mort tragique des enfants de Menjuša ne revêt, dans le Récit, aucune signification
éthique ou métaphorique, c’est pourquoi le parallèle avancé entre Iakov jouant le rôle
du mouton dans « le jeu des enfants » et l’Agneau de Dieu me semble insuffisamment
fondé.
19 Bien que la genèse de l’histoire du saint fratricide nécessite une étude particulière, on
peut admettre en théorie que l’intrigue du Récit décrit un fait réel de la vie
quotidienne, qui s’est réellement produit dans le village de Prihon et qui a frappé
l’imagination des habitants des environs par son caractère inhabituel. Cependant, les
épisodes suivants du Récit (l’apparition miraculeuse des cercueils sur le lac et le retour
qui a suivi, le rêve des chasseurs, les guérisons sur la tombe des enfants à Menjuša)
portent visiblement l’empreinte de la tradition paysanne orale. On peut leur trouver
nombre de parallèles dans les récits sur les lieux sacrés de la campagne et les saints
faisant l’objet d’un culte local42, ce qui permet de parler des racines paysannes et
religieuses populaires du culte de Ioann et Iakov. Tout aussi important ici est le
contexte « historico-hagiologique » immédiat - les matériaux concernant la vénération
qui entoure les saints de la Russie du nord aux XVI-XVIIe siècles, dont le culte est
apparu uniquement grâce à la mort inhabituelle et /ou à la conservation des reliques de
ces thaumaturges d’apparition récente. L’un des plus connus dans cette catégorie de
saints est le juste Artemij de Verkola, tué par un éclair en 1544 à l’âge de douze ans 43.
Les paysans de Verkola laissèrent son corps « dans un endroit désert dans la forêt »,
sans sépulture, « car, dit le texte, ces gens tués par la foudre ou les éclairs leur inspirent
du dégoût ». Trente-trois ans plus tard, le corps d’Artemij fut découvert intact et
transféré dans l’église du village. Les guérisons ne tardèrent pas à se produire près de la
sépulture du nouveau saint44. Des saints de ce type apparaissent également aux XVI-
XVIIe siècles à Novgorod et dans la région environnante. Parmi eux, Iakov de Borovici,
dont le corps nu fut charrié par la débâcle sur la rivière Msta 45. Quand, en 1544,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
53
l’archevêque Feodosij dépêcha à Boroviči le prêtre de la cathédrale Sainte-Sophie
« pour examiner les reliques de Iakov », il s’avéra que personne ne savait rien de la vie
de Iakov, bien que sa tombe fût le lieu de nombreuses guérisons 46. Il est significatif,
d’ailleurs, que sur l’icône « Réunion de tous les saints de Novgorod », les enfants de
Menjuša et le thaumaturge de Boroviči sont représentés ensemble : Iakov de Boroviči
est représenté nu, debout, entre Ioann et Iakov de Menjuša. Enfin, il existe un parallèle
encore plus intéressant avec le culte que nous étudions. Il s’agit d’un saint local, vénéré
dans la première moitié du XVIIIe siècle dans le diocèse de Holmogory, appelé de façon
hypothétique Dmitrij de Jurom par A.S. Lavrov47. Les circonstances de sa mort
apparaissent dans le « kontakion », où l’on s’adresse au saint en ces termes : « Et ton
corps intact après avoir été étranglé par ta marâtre…. » . Il est question, visiblement,
d’un enfant ou d’un adolescent étranglé par sa marâtre et dont le corps est resté intact.
Il est probable que c’est justement cette circonstance (ainsi que des guérisons
miraculeuses près du corps resté intact) qui ont entraîné l’apparition du culte du saint
de Jurom.
20 La mise en parallèle de ces données avec le culte des enfants de Menjuša permet
d’avancer que nous avons affaire à une vénération particulière à l’égard des enfants
assassinés, qui a connu un certain développement dans la culture paysanne du nord de
la Russie aux XVII-XVIIIe siècles. D’ailleurs, d’autres parallèles typologiques plus larges
s’imposent ici : de toute évidence, la vénération qui entoure Ioann et Iakov, ainsi que
les cultes analogues de « saints sans récit hagiographique» du nord de la Russie sont à
rapprocher des représentations des Slaves de l’Est au sujet des défunts possédés du
démon (dits « založnye ») ainsi qu’avec certaines formes spécifiques d’attitude
paysanne à l’égard des monuments funéraires anciens48. D’après une théorie, formulée
par D.K. Zelenin, il existe dans la culture paysanne des Slaves de l’Est « deux catégories
de morts », bien distinctes l’une de l’autre : les parents («les ascendants morts de
vieillesse », « les défunts vénérés et respectés » et les « založnye » (« morts
prématurément d’une mort non naturelle », « les défunts impurs…, et même souvent
nuisibles et dangereux »). « Les « založnye » ne vivent pas du tout là où reposent les
parents, mais près des gens : à l’endroit de leur mort violente ou à l’endroit de leur
sépulture. Ils conservent après la mort leurs mœurs, et toutes les nécessités et
caractéristiques humaines qu’ils avaient pendant leur vie, et en particulier, la capacité
à se déplacer. Ils se montrent souvent aux vivants, et presque toujours, ils leur font du
mal49. Ceci dit, à l’heure actuelle, l’opposition proposée par Zelenin entre parents et
« založnye » ne semble plus aussi convaincante. Apparemment, le problème du
maintien d’un équilibre symbolique entre le monde des vivants et le monde des morts
se fait, non pas en s’appuyant sur l’opposition stable de différentes catégories de morts,
mais à l’aide de stratégies souples et variables d’interaction rituelle avec les morts.
C’est pourquoi les différents « types » ou « catégories » de morts s’avèrent, eux aussi,
extrêmement variables : un individu, mort de façon non naturelle, peut se transformer
aussi bien en défunt nuisible qu’en saint thaumaturge. Il convient de rappeler encore
une fois que dans l’histoire des enfants de Menjuša, le thème de la violence et du
fratricide n’est revêtu d’aucune signification éthique ou symbolique. Sans partager, de
façon générale, la théorie de « la violence fondatrice », formulée il y a un quart de
siècle par René Girard50, je suis tout à fait d’accord avec cette idée que, dans les cultures
religieuses archaïques, le marqueur de la nature sacrée de tel ou tel acte de violence est
son caractère arbitraire et fortuit51. D’ailleurs, René Girard envisageait « la violence
arbitraire » appliquée à la « victime expiatoire ». Dans la situation qui nous occupe,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
54
aussi bien dans les variantes écrites que dans les récits des paysans, l’idée de sacrifice
est absente. Le fratricide et la mort fortuite du « juste Ioann » n’exigent ni explication
logique ni motifs mystiques particuliers. Si l’auteur du Récit tente quand même
d’expliquer pourquoi Ioann et Iakov sont devenus des saints52, en revanche, une
paysanne de Menjuša, interrogée en 2003, n’éprouve pas cette nécessité :
L’enquêteur : Et sur ces enfants, qu’est-ce qu’on dit ?
L’informateur : Sur ces enfants… Ce que j’en sais, ça me vient des récits de ma grand-
mère. Ils étaient nés à Prihon. C’étaient, donc, Ivan et Iakov. Le père et la mère sont
partis travailler. Ils les ont laissés seuls tous les deux à la maison. Mais l’aîné, Vanja
donc, avait vu son père tuer un mouton. Avec un maillet. Quand ils sont partis, le
petit, Iakov, était couché dans le berceau et le grand a décidé d’essayer, pour voir ce
que ça donnerait. Il a pris une bûche, il l’a frappé et il voit qu’il l’a tué. Il l’a tué et il
s’est caché dans le poêle. Les parents sont rentrés – personne dans la maison. L’un
est étendu mort et l’autre a disparu. Et voilà. Le matin, la mère a allumé le poêle,
elle y avait mis des bûches la veille au soir, le matin elle a allumé le poêle, et elle
voit – il est assis au fond. Et il avait brûlé, le garçon. On l’a enterré à Medved’. C’est
à Medved’ qu’on l’a enterré, et on pensait, ils sont là, couchés dans la tombe 53.
21 Ainsi, la mort tragique de Ioann et Iakov est perçue par les habitants actuels de
Menjuša et des environs en totale conformité avec les normes de la culture religieuse
paysanne : comme l’intervention de forces sacrées, « l’arbitraire divin », ne nécessitant
aucune recherche de sens, ni, à plus forte raison, aucune justification en termes du
monde profane. Il est probable que la réception de cette histoire était la même au cours
des siècles précédents. D’ailleurs, dans les pratiques religieuses paysannes, ce ne sont
pas, en général, les récits « de type primaire », exposant l’histoire et les circonstance de
l’apparition de tel ou tel objet de culte, qui ont le plus d’importance, mais les récits
dynamiques, « de type secondaire », « dans lesquels sont décrits des épisodes
complémentaires ou nouveaux, ou simplement des nouvelles fraîches ou des rumeurs
au sujet d’un phénomène déjà connu de l’auditeur 54 » « …Les deux premiers types de
transmission (l’exposition de la représentation elle-même ou bien un corps
d’explication en rapport avec lui), note Čistov – ont essentiellement un caractère
exotérique, c’est-à-dire qu’ils sont mis en œuvre par des narrateurs en contact avec des
auditeurs non familiarisés avec les systèmes de représentations auxquels se rattachent
ces récits, - des gens nouveaux à cet endroit, des représentants d’autres groupes
sociaux, des enfants, etc… (entre autres, des folkloristes). Les sujets dynamiques ou
« récits secondaires » ont, au contraire, en général, un caractère ésotérique, c’est-à-dire
qu’ils ont cours dans un milieu qui est porteur collectivement du système de
représentations qui leur donne naissance. Ce sont justement eux qui représentent le
type le plus courant de « récit folklorique55 ». Qui plus est, on trouve fréquemment des
situations, où le sujet « primaire », racontant l’apparition de tel ou tel objet de culte,
devient totalement virtuel et n’existe dans le folklore local que comme somme
d’interprétations « secondaires ». Dans ce cas, l’explication de la représentation ou du
sujet « de départ » est produite non pas par un représentant de la culture locale en
situation de communication exotérique, mais par « un interprète de second ordre » : un
prêtre, un pèlerin, un folkloriste. De ce point de vue, une si large propagation des
versions orales de l’histoire de Ioann et Iakov à Menjuša et dans les villages avoisinants
apparaît, si l’on peut dire, comme « pléthorique ». On peut penser qu’elle s’explique par
deux facteurs : l’existence des icônes mentionnées plus haut, qui reproduisent in
extenso le texte du Récit, ainsi que l’afflux de pèlerins, qui créent les conditions d’une
communication de type exotérique. Dans le contexte donné, l’histoire de ce sujet est
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
55
assez curieuse. Le texte le plus ancien que je connaisse du Récit est daté de 1793, alors
que l’examen des reliques des enfants a eu lieu à la toute fin du XVIIe siècle, il est
permis de penser que le Récit a été composé à la fin du XVIIe siècle ou au XVIIIe – peut-
être au monastère de la Trinité de Menjuša avant sa suppression. Le compilateur a
utilisé, vraisemblablement, les légendes du monastère ainsi que les récits des paysans
des environs. Ainsi, l’histoire de Ioann et de Iakov a subi des métamorphoses assez
originales : elle est d’abord passée de la culture paysanne orale à la culture écrite du
monastère, pour tomber ensuite dans le folklore, sous forme de résumés oraux du texte
du récit. De ce point de vue, une analyse détaillée de ces formes offre de grandes
perspectives dans un contexte narratologique. Le contexte socioculturel n’est pas
moins important : nous observons ici non pas une opposition, mais une interaction
assez pacifique des différents discours religieux, utilisant le potentiel sémiotique d’un
seul et même objet de culte. C’est ainsi, en tout cas, que l’on peut voir la situation dans
une perspective diachronique.
Des pratiques de récit au pèlerinage contemporain
22 Pour ce qui est des observations synchroniques, qui concernent, donc, la situation
culturelle de nos jours, ici, l’interaction des différents discours n’est pas aussi pacifique,
sans être pour autant excessivement conflictuelle. À proprement parler, les groupes de
croyants appartenant à des sphères sociales et culturelles différentes se rencontrent
auprès des objets de culte de Menjuša seulement une fois par an – le jour de la
commémoration des enfants Ioann et Iakov, le 7 juillet. Au moins à partir du XIXe
siècle, avait lieu ce jour-là une procession au lac de Kamenskoe, sur lequel avaient été
autrefois aperçus les cercueils avec les corps des enfants flottant à la surface de l’eau. Il
y avait en réalité deux processions : l’une venait de l’église du village de Medved’,
l’autre de l’église de Menjuša. Elles se rencontraient sur la route du lac et faisaient
route ensemble. Au bord du lac (à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il y avait là
une baignade spéciale) on récitait une prière (moleben) de bénédiction de l’eau, à la
suite de quoi les pèlerins rentraient dans leurs villages. La liste des actions rituelles,
exécutées près du lac sacré, est tout à fait typique des pratiques de vénération de tels
objets de culte dans la Russie du nord. Adultes et enfants se baignaient dans le lac (le
bain des enfants, en particulier des nourrissons de l’année, était une pratique rituelle
particulièrement marquée, dans la mesure où, à Menjuša même comme dans les
environs, ce lieu de culte était considéré comme dédié aux enfants, et particulièrement
bénéfique aux malades comme aux bien portants). Les malades laissaient leurs
vêtements sur le lac, « pour que la maladie soit emportée par l’eau ». Du lac, les pèlerins
emportaient deux sortes de « choses sacrées » : de l’eau et des nénuphars. À partir de la
fin des années 1870 et, apparemment, jusqu’aux années 1930, on allait en procession au
lac également le jour de la fête « des douze apôtres » (Synaxe des douze saints glorieux
et illustres apôtres, le 13 juillet). Cette procession avait été inaugurée au moment d’une
épizootie56.
23 Au cours de la deuxième moitié des années 1930, les églises de la région ont été fermées
et les prêtres déportés. Cependant, les paysans de Menjuša ont continué à se rendre en
procession au lac, et pendant la campagne d’athéisme militant sous Khroutchev, ils
sont même entrés en conflit ouvert aves les autorités de la région, qui tentaient
d’interdire totalement le culte de Ioann et Iakov. Apparemment, à l’époque soviétique,
il y avait également des pèlerins de la ville qui venaient à Menjuša, mais probablement
en petit nombre. Parmi les récits contemporains sur les guérisons miraculeuses opérées
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
56
par les deux enfants, se détache en particulier l’histoire de la guérison de la femme
d’un responsable du Parti communiste d’une ville voisine, qui emmenait régulièrement
son épouse au lac sacré, ce qui lui coûta son poste et sa situation dans le Parti. De cette
façon, des formes d’interaction entre les pèlerins venus de l’extérieur et les gens du
pays qui vénéraient les deux enfants se sont conservées même à l’époque soviétique. On
peut supposer que le contrôle du lieu sacré et des pratiques de sa vénération revenait
entièrement à cette époque aux leaders religieux locaux.
24 Après l’effondrement de l’empire soviétique, dans la région de Šimsk, un certain
nombre de paroisses religieuses ont été rétablies. Mais l’église de Menjuša est restée
comme auparavant sans prêtre. L’église a subi des dommages importants et se trouve
en triste état, sa reconstruction exigerait des moyens substantiels, dont le diocèse de
Novgorod ne dispose apparemment pas. À l’heure actuelle, Menjuša est rattaché à la
paroisse de Medved’. L’église de Medved’ est détruite, mais on y a construit une maison
de prière orthodoxe et un prêtre y officie de façon régulière. Parallèlement, depuis le
début des années 1990, le clergé diocésain a commencé à s’intéresser au lieu de culte de
Menjuša. Tous les ans, le jour de la fête des deux enfants de Menjuša, s’y déroule une
liturgie, avec une prière de bénédiction des eaux, et parfois une procession au lac est
organisée. À plusieurs reprises, l’archevêque de Novgorod et Staraja Rusa a assisté à la
fête. Le nombre des pèlerins a également augmenté : le lieu de culte de Menjuša devient
peu à peu l’un des buts du « tourisme de pèlerinage » contemporain.
25 Les observations faites au cours de la fête des deux enfants, le 7 Juillet 2004 permettent
de juger du rapport actuel des différentes formes et pratiques contemporaines du culte
des deux saints. Cette fois-ci, l’archevêque n’assistait pas à la fête, la messe était
célébrée par trois prêtres : le titulaire de la maison de prière de Medved’, le père
Evgenij, le père Mihail, prêtre de la cathédrale Saint-Élie de la ville de Sol’cy,
(blagočinnyj) des paroisses de Sol’cy, et le prêtre de l’église Saint-Alexandre-Nevski à
Novgorod, le père Serge. Une soixantaine de pèlerins étaient venus de Sol’cy, de
Novgorod et de Saint-Pétersbourg. Il n’y a pas eu de procession au lac, mais la plupart
des pèlerins s’y sont rendus à la fin de l’office. En schématisant un peu, on peut
distinguer trois types de comportement ou de discours caractéristiques des
participants à la fête : le discours des « autochtones », le discours du « clergé » et le
discours des « pèlerins ». Pour les autochtones, les paysans de la région, la célébration
religieuse de la fête a une signification qui ne revient pas seulement et pas
essentiellement au rituel, lié au culte de Ioann et Iakov, mais représente un moyen de
participer à la culture religieuse institutionnelle en général. Les paysannes âgées, qui
constituent la majeure partie de ce groupe, n’ont pas la possibilité de fréquenter
régulièrement la maison de prière, qui se trouve à 15 kilomètres de Menjuša. Aussi, la
fête de Ioann et Iakov représente l’une des rares opportunités pour elles de participer à
l’office religieux, de se confesser et de communier, et de se procurer de l’eau bénie par
le prêtre. En même temps, elles comprennent bien que c’est précisément l’existence
d’un lieu de culte local qui donne une importance religieuse particulière à leur village,
et elles se considèrent toujours, probablement, comme des « gardiennes » en quelque
sorte, du culte de Ioann et Iakov. Il est significatif, en particulier, que l’icône
représentant les enfants de Menjuša, déposée sur le lutrin pendant la cérémonie, est
empruntée à l’une des familles paysannes du village, ce qui est considéré par les autres
propriétaires d’icônes semblables comme un signe particulier d’honneur et de prestige.
D’ailleurs, le principal moyen d’observer le culte de Menjuša pour les paysans du lieu
reste la pratique du récit oral, aussi bien dans des conditions de communication
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
57
exotériques qu’ésotériques. Apparemment, les reprises orales du sujet du Récit, ainsi
que les narrations de type « secondaires » servent aux autochtones de moyen principal
pour attester socialement leur lien avec le lieu de culte de Menjuša. En ce qui concerne
les actes rituels du culte, les paysans du lieu se caractérisent par une non observance
des rituels collectifs qui entourent les enfants de Menjuša. La pratique dominante est
constituée de rites à caractère personnel - vœux individuels prononcés au moment de
différentes situations de crise57.
26 Il convient cependant de souligner qu’une telle « individualisation » des pratiques
rituelles, liées au lieu de culte local, apparaît comme un trait spécifique de la culture
religieuse contemporaine de la campagne russe. Nous savons que, aussi bien au XIXe
qu’au début du XXe siècle, les vœux pouvaient être individuels (familiaux) ou collectifs,
pris en charge par toute la communauté. En général, ces derniers s’exprimaient sous
forme d’engagement à célébrer telle ou telle fête votive – à Menjuša, ce jour était la fête
des « douze apôtres » déjà mentionnée, instituée en 1870 après une épidémie qui avait
décimé le bétail. Il n’était pas rare qu’un vœu collectif fasse appel à des formes
religieuses institutionnalisées : à ces occasions, on demandait au prêtre de faire une
procession au lieu de culte, de célébrer un office à l’église ou dans des maisons du
village, etc… Il est évident qu’à la période soviétique la pratique des vœux collectifs
avait quasiment disparu des usages de la campagne : la plupart des paroisses rurales
avaient perdu leurs prêtres, les églises étaient fermées, et les formes essentielles de
l’activité religieuse se sont avérées impraticables et passibles de poursuites dans le
cadre de la structure socio-économique du kolkhoze et du sovkhoze. La « lutte contre
les fêtes religieuses » était une composante de première importance, aussi bien du
« mouvement sans-Dieu » que de la collectivisation et des campagnes anti-religieuses
d’après-guerre. D’ailleurs, comme nous l’avons vu, cette lutte est souvent restée sans
effet : la place des prêtres était occupée par des leaders religieux locaux d’origine
paysanne – les « dévotes », les «bigotes», qui possédaient le minimum de connaissances
indispensable sur le catéchisme et la liturgie, et qui continuaient à organiser sous une
forme ou sous une autre processions et offices de fêtes. Après la disparition du régime
soviétique et le rétablissement partiel du système religieux paroissial dans les
campagnes, ces leaders ont naturellement perdu leur toute-puissance. De plus, il faut
avoir présent à l’esprit que la crise de la culture paysanne, observée en Russie au moins
depuis les années 1970, faisait obstacle à la reconduction du traditionnel leadership
religieux non officiel : dans un grand nombre de régions rurales il n’y a pas eu de
nouvelles générations de « dévots ». En conséquence, en Russie contemporaine, les
pratiques religieuses paysannes ont pris un caractère essentiellement privé, individuel
et familial, tout en conservant un grand nombre de traits spécifiques de la culture
religieuse rurale de la fin du XIXe-début du XXe siècle. En ce qui concerne les pratiques
religieuses de caractère collectif, elles sont plutôt le fait, depuis les dernières
décennies, de la population urbanisée et se déroulent essentiellement dans le cadre de
la culture de paroisse et de pèlerinage.
27 À la différence des paysans de Menjuša, les pèlerins qui viennent pour la fête de Ioann
et Iakov, s’orientent justement vers les actions rituelles qui constituent le pèlerinage
(assistance à la cérémonie religieuse, procession collective au lac sacré, où les malades
laissent leurs vêtements, se baignent, font provision d’eau, de nénuphars et même de
morceaux de bois). La collecte de « matériaux sacrés » (en plus des objets sacrés déjà
cités on peut encore mentionner le sable prélevé sur la tombe des enfants de Menjuša,
ainsi que diverses herbes cueillies près de l’église) revêt une importance particulière
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
58
dans l’ensemble du rituel du pèlerinage. Ces matériaux remplissent non seulement des
fonctions prophylactiques et thérapeutiques, mais représentent des sortes de
« souvenirs sacrés » liés au souvenir du pèlerinage et élevant le statut de leur
propriétaire au sein de son propre groupe religieux (paroisse religieuse ou autre). En
même temps, le discours « des pèlerins » se distingue par un faible niveau
d’information sur l’origine et l’histoire du lieu de culte lui-même : les pèlerins ignorent
pratiquement l’histoire de Ioann et Iakov, et le plus souvent ils délèguent aux prêtres la
compétence dans ce domaine. Voici, par exemple, la réponse donnée par une femme
d’une quarantaine d’années, venue en pèlerinage de Novgorod, à la question sur
l’origine du lieu saint de Menjuša : « Il y a différentes versions, certains disent une
chose, d’autres une autre. Certains disent que ce sont des ennemis qui les ont tués,
d’autres que c’est la mère, moi je ne peux pas savoir. Demandez plutôt aux prêtres, là,
demandez-leur »58. Ce qui intéresse particulièrement les pèlerins, ce sont les
informations sur les propriétés « fonctionnelles et thérapeutiques » du lieu saint : ils
veulent savoir de quelles maladies et quels péchés il « soulage ».
28 En ce qui concerne le discours du « clergé » (dans la mesure où on peut parler, ici, d’un
discours constant), la stratégie de conduite des prêtres, dans la circonstance qui nous
intéresse, consiste, apparemment, à maintenir une sorte d’équilibre entre la culture
locale et la culture des pèlerins. Dans la mesure où la version « officielle » de l’histoire
de Ioann et Iakov, présentée dans les calendriers actuels, laisse entendre que les deux
frères ont été assassinés par des malfaiteurs, alors que la version « locale » du culte de
Menjuša est fondée sur une connaissance et des reprises détaillées du sujet du Récit, le
père Mihail, dans une brève homélie prononcée à la fin de la cérémonie, a préféré
passer sous silence les détails pittoresques du culte de Menjuša et s’est gardé de
reprendre l’une ou l’autre des versions relatant l’origine du lieu sacré :
Aujourd’hui nous élevons une prière aux deux saints enfants Ioann et Iakov, qui ont
terminé leur vie en martyrs et se sont présentés devant le Seigneur. Et aujourd’hui,
nous crions vers eux et nous les implorons d’intercéder, au pied du trône du
Seigneur, pour nous, pécheurs sur la terre. Ils sont là-bas au ciel, dans l’Église
Triomphante, nous sommes ici, dans l’Église Combattante et parce que nous
combattons contre le péché, nous leur demandons de nous aider dans notre
combat59.
29 Cependant, il semble que ce soit justement l’histoire de la mort de Ioann et Iakov qui
représente un objet de conflit et de concurrence entre les pèlerins et les paysans du
lieu. En témoigne un fragment d’interview d’une femme âgée habitant Menjuša, qui
réfute avec indignation une version de la fin des deux enfants, entendue de la bouche
des pèlerins :
L’informateur : .. .Mais moi je dis : je n’ai pas entendu ça. J’ai entendu seulement qu’il
avait tué un mouton, et … et le garçon…, mais pas dans une dispute. Quelle dispute
ils pouvaient avoir ! Il y en avait un qui était couché dans le berceau !
L’enquêteur : Mais qui disait ça à l’église ? C’étaient les pèlerins qui disaient ça, ou les
gens d’ici ?
L’informateur : Les pèlerins. Ce sont les pèlerins qui disent ça. Ça, j’ai entendu des
gens de passage qui le disaient. Je venais d’arriver, et ils m’ont demandé. Je leur
dis : « Je ne… C’est seulement vous que j’entends dire que ça s’est passé comme ça ».
L’enquêteur : Et eux, ils l’ont entendu où ?
L’informateur : Et eux ils disent que c’est écrit quelque part. J’ai demandé : » Et vous,
j’ai demandé comme ça, où vous avez appris ça ? » - « Mais c’est écrit quelque part.
C’est d’après…, d’après les Saintes Écritures ». Et je leur dis « Peut-être que
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
59
quelqu’un a écrit quelque chose qui n’est pas vrai ». C’est que maintenant, il y a
aussi toute sorte de gens60.
Discours autochtone et culture pèlerine
30 Et donc, bien que différents groupes de dévots du lieu de culte de Menjuša soient
orientés vers différentes pratiques rituelles et narratives, leurs discours n’apparaissent
pas comme « intraduisibles » entre eux. Je pense que, dans de telles situations, le
« rapport de force » dépend pour beaucoup du contexte socioculturel et culturel qui
entoure la vénération de tel ou tel objet de culte. Si le groupe de croyants
« autochtone » est assez nombreux et puissant pour exprimer son rapport à l’égard du
lieu de culte par le truchement de procédés rituels et narratifs, il peut fréquemment
s’opposer avec succès aux tentatives d’acculturation venant de la culture urbanisée des
pèlerins. Les deux traditions religieuses sont d’ailleurs parfaitement capables de
s’influencer mutuellement, en échangeant des sujets et des motifs de folklore religieux,
différents types de conduites rituelles, etc… Il est évident que pareille interaction
implique souvent un certain degré de tension sociale et culturelle et peut s’exercer sous
une forme assez conflictuelle. Cependant, des modes pacifiques de coexistence et
d’influence mutuelle peuvent également exister. Bien sûr, dans de telles situations,
beaucoup de choses dépendent de la façon dont le clergé local exerce son autorité
institutionnelle. Si le prêtre de la paroisse intervient activement dans les pratiques de
vénération de l’objet du culte local et prend parti pour l’un ou l’autre groupe de
croyants, son attitude mènera inévitablement à l’exacerbation des situations
conflictuelles et à la probable répression de l’une de ces traditions. Dans la situation qui
nous occupe, la position du clergé local apparaît comme assez souple, et susceptible de
favoriser l’interaction pacifique des deux discours, le discours des « autochtones » et le
discours des « pèlerins ». Aussi peut-on avancer que le culte de Menjuša fonctionne
actuellement non comme une survivance d’un phénomène archaïque d’une religion
populaire, mais comme un culte local, comme une composante potentielle d’un futur
marché « confessionnel ». Il est tout à fait probable que la popularisation grandissante
du culte des enfants Ioann et Iakov amènera, non la disparition ou l’évincement des
pratiques paysannes qui s’y rattachent, mais l’interpénétration progressive des
différents discours religieux et, par voie de conséquence, leur transformation mutuelle.
NOTES
*. Traduit du russe par Yvette Lambert
1. Ce travail a été entrepris avec le soutien du Fonds des sciences humaines de Russie,
projet n° 04-04-00069a. Les matériaux d’enquête sur le terrain, utilisés dans cet article,
ont été recueillis au cours d’une mission de recherche dirigée par l’auteur en 2002 et
2003. Je profite de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à Alexandr Lvov,
Ekaterina Melnikova, Elena A. Migunova, Viktorija Pančenko, Il’ja Petrov, Oksana
Filičeva qui ont participé à la collecte et à l’étude des matériaux. Je tiens à exprimer
une reconnaissance particulière à Maria Guseva, directrice de l’administration rurale
de Gornoveret’e de l’arrondissement de Šimsk, qui a tout fait pour faciliter les travaux
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
60
de la mission. Ce texte a été présenté lors du colloque organisé en novembre 2003 par
Alexandre Agadjanian et Kathy Rousselet au Centre franco-russe en sciences sociales et
humaines de Moscou sur les pratiques religieuses en Russie ; il a été traduit avec le
soutien financier du Centre.
2. Pour plus de détails sur ma conception des pratiques religieuses, voir : Aleksandr A.
PANČENKO, Hristovščina i Skopčestvo : Fol’klor i tradicionnaja kul’tura russkih mističeskih sektov (Khlysty
et castrats : Folklore et culture traditionnelle des sectes mystiques russes) , Moscou, OGI, 2002, p.
63-100.
3. Voir : Alexandr S. LAVROV, Koldovstvo i religija v Rossii. 1700-1740 (Sorcellerie et religion en Russie.
1700-1740), Moscou, Drevlehranilišče, 2000, p. 341-435.
4. Citation d’après Elena B. SMILJANSKAJA, Volšebniki. Bogohul’niki. Eretiki. Narodnaja religioznost’ i
« duhovnye prestuplenija » v Rossii XVIII v. (Sorciers. Blasphémateurs. Hérétiques. Religiosité populaire et
« crimes religieux » dans la Russie du XVIIIe siècle), Moscou, Indrik, 2003, p.14.
5. Gregory Freeze, « Institutionalizing Piety: The Church and Popular Religion,
1750-1850 », in Jane Burbank, David L. Ransel, eds, Imperial Russia. New Histories for
the Empire, Bloomington, Indiana University Press, 1998, p. 221-222.
6. Isabel Tirado, « Peasants into Soviets: Reconstructing Komsomol Identity in the
Russian Countryside of the 1920 s », Acta Slavica Iaponica ,Vol. 18, 2001, p. 42-63.
7. Voir, par exemple V.E. DOBROVOLSKAJA, « Neskazočnaja proza o razrušenii cerkvej »
(Les récits folkloriques sur la destruction des églises), Russkij fol’klor, T. XXX, p. 500-512.
8. Thomas Luckman, The Invisible Religion, New York, Macmillan, 1967.
9. Michel MAFFESOLI : « L’enchantement du monde ou le social divin », Socio-logos :
Sociologija. Antropologija. Metafizika, Fasc. 1, Moscou, Progress, 1991, p. 274-283.
10. Pour plus de détails sur cette question, voir : Aleksandr A. PANČENKO, « Novye
religioznye dviženija i rabota fol’klorista » (Les nouveaux mouvements religieux et le
travail du folkloriste) in Issledovanija po narodnoj religioznosti : sovremennoe sostojanie i perspektivy
razvitija (Recherches sur la religiosité populaire : situation actuelle et perspectives de développement)
(sous presse).
11. Sur la vénération des lieux de culte locaux, voir : Aleksandr A. PANČENKO, Issledovanija
v oblasti narodnogo pravoslavija. Derevenskie svjatyni Severo-Zapada Rossii (Recherches dans le domaine
de l’orthodoxie populaire. Les lieux saints des campagnes du Nord-Ouest de la Russie), Saint-
Pétersbourg, 1998 ; Tat’jana B. ŠČEPANSKAJA, Kul’tura dorogi v russkoj miforitual’noj tradicii
(Culture de la route dans la tradition russe des mythes et rituels aux XIX-XX e siècles), Moscou, Indrik,
2003, p. 244-317.
12. Žanna V. Kormina : «Peščorka », Živaja starina, n° 3, 2003, p. 25-28. Du même auteur :
« Religioznost’ russkoj provincii : k voprosu o funkcii sel’skih svjatyn’ » (La religiosité
de la province russe : la question de la fonction des lieux de culte villageois), in
Issledovanija po narodnoj religioznosti : sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija (Recherches sur la
religiosité populaire : situation actuelle et perspectives de développement) (sous presse). Voir
également des considérations similaires, exprimées à propos d’un matériau comparatif
plus large : John EADE, Michael J. SALLNOW, « Introduction », in Contesting the Sacred ; the
Anthropology of Christian Pilgrinage, Londres-New York, Routledge, 1991, p. 1-29.
13. Žanna V. Kormina, « Religioznost’ russkoj provincii », art. cit.
14. Ibid.
15. Arhiv Sankt-Peterburgskogo Instituta istorii RAN (Archives de l’Institut d’histoire
de l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Kol. 2, op(is’) 1, d(elo) 12, l(ist) 61
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
61
ob(orotnoe). Je profite de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à A.A. Selin,
qui a aimablement mis à ma disposition les copies des matériaux d’archives.
16. Slovar’ istoričeskij o svjatyh, proslavlennyh v Rossijskoj cerkvi i o nekotoryh podvižnikah blagočestija,
mestno čtimykh (Dictionnaire historique des saints vénérés par l’Église orthodoxe russe et de quelques
confesseurs de la foi, vénérés dans certaines régions), Saint-Pétersbourg, 1862, (réedition,
Moscou, Kniga, 1990), p. 109 ; Skazanie o svjatyh otrokah Ioanne i Iakove Menjuških čudotvorcah,
počivajuščih v cerkvi vo imja Živonačal’noj Troicy v sele Menjušah Novgorodskoj gubernii i uezda (Récit sur
les saints enfants Ioann et Iakov, les thaumaturges de Menjuša, qui reposent dans l’église de la Trinité au
village de Menjuša dans le gouvernement et le district de Novgorod ), red. Ivan F. TOKMAKOV, Moscou,
M. Ja. Pastuškova, 1895, p. 6.
17. Sur l’histoire des colonies militaires dans cette région, voir : Pavel P. EVSTAF’EV,
Vosstanie voennyh poseljan Novgorodskoj gubernii v 1831 g. (Le soulèvement des habitants des colonies
militaires du gouvernement de Novgorod en 1831), Moscou, Izd-vo Vsesojuznogo ob-va
politkatoržan i ssylno-poselencev, 1934 ; Oleg V. MATVEEV. Les colonies militaires. Idées.
Projets. Réalisation. (d’après l’exemple des colonies militaires du gouvernement de
Novgorod. 1816-1831). Résumé d’une thèse pour l’obtention du grade de candidat ès-
sciences historiques. Novgorod, 1999.
18. Fedor NIKOL’SKIJ, « Iz sela Menjuš Novgorodskogo uezda (En provenance du village de
Menjuša, district de Novgorod) », Novgorodskie eparhial’nye vedomosti, n° 21,1895.Čast’
neoficial’naja, p. 1214-1224 ; « Skazanie o svjatyh otrokah… », op. cit., p. 6-10. Dans la
publication de Tokmakov, il est affirmé que l’autel principal était consacré à Ioann et
Iakov déjà dans l’église de pierre construite en 1841, cependant, dans la
correspondance du prêtre de Menjuša, Fedor Nikol’skij, cette information est réfutée.
19. Il s’est produit une inversion entre la consécration principale et la consécration
secondaire : l’autel principal était consacré à Iakov et Ioann, et l’un des autels latéraux
– à la Trinité. Voir : Fedor NIKOL’SKIJ , « Iz sela Menjuš Novgorodskogo uezda », art. cit., p.
1214-1224.
20. Sans m’arrêter plus longuement sur cette question, je noterai que, probablement,
cette version s’est répandue après la parution de l’ouvrage Kniga glagolemaja Opisanie o
Rossijskih Svjatyh, (Livre dit de la Description des Saints Russes) dans l’édition de Mihail V. TOLSTOJ
(1887). Dans ses commentaires, Tolstoj raconte brièvement le contenu du « Récit sur les
saints Ioann et Iakov » d’après le Mesjaceslov Novgorodskih svjatyh (Calendrier des saints de
Novgorod), du prêtre Krasnjanskij (cf. note 21), pour proposer ensuite son interprétation
personnelle de cette histoire : « d’ailleurs, le plus probable, c’est que les enfants-
martyrs ont été occis par des malfaiteurs » (Mihail V. TOLSTOJ Kniga glagolemaja Opisanie o
Rossijskih svjatyh, gde i v kotorom grade ili oblasti ili monastyre i pustyni pozive i čjudesa sotvori, vsjakogo
čina svjatyh (Livre dit de la Description des Saints Russes, où et dans quelle ville ou région ou monastère et
ermitage ont vécu et accompli des miracles des saints de tout rang) .Renseignements biographiques
complétés par le comte Mihail V. TOLSTOJ, Moscou, Universitetskaja tipofrafija 1887, p.
46).
21. Gavriil D. KRASNJANSKIJ, prêtre, Mesjaceslov Novgorodskih svjatyh ugodnikov božih, otkryto i pod
spudom počivajuščikh v soborah, cerkvah, casovnjah i monastyrjah ne tol’ko Novgoroda i ego bližajsih
okrestnostej, no i vsej Novgorodskoj eparhii, s istoričeskimi, hronologičeskimi i geografičeskimi svedenjami
o mestah ih počivanija i ukazatel’ čudotvornyh ikonah, sohranjajuščih takže ne v odnih tol’ko svjaščennyh
mestah Novgoroda i ego okrestnostej, no i nekotoryh uezdnyh gorodov i sel eparhii, s takovymi že, kak i o
svjatykh ugodnikah, svedenjami o sih ikonah, ravno kak i o mestah ih nahoždenja (Calendrier des saints
Novgorodiens aimés de Dieu, reposant de façon officielle ou secrètement dans les cathédrales, les églises,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
62
chapelles et monastères, non seulement de Novgorod et des environs, mais aussi de tout le diocèse, avec tous
les renseignements historiques, chronologiques et géographiques sur leur lieu de sépulture et le répertoire
des icônes miraculeuses, conservées non seulement dans les lieux sacrés de Novgorod et des environs, mais
également de certains chef-lieux de district et de villages du diocèse, avec, comme pour les saints, tous
renseignements sur ces icônes, ainsi que sur leur emplacement) Novgorod, Gubernskaja tipografija,
1876, p. 101-106 ; « Skazanie o svjatyh otrokah… », op. cit.
22. Eve Levin, « Dvoeverie and Popular Religion » in Stephen K. Batalden, ed., Seaking
God. The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine and Georgia,
DeKalb, Northern Illinois University Press, 1993, p. 41-42.
23. Ce recueil contient essentiellement des vies de saints de Novgorod, voir
bibliothèque scientifique du musée d’État de Novgorod. Département des manuscrits.
KP 30056-212 / KR 247. l. 221ob-224. Le texte du Récit cité plus loin est celui de cette
variante.
24. Département des manuscrits de la bibliothèque de l’Académie des sciences de
Russie (Saint-Pétersbourg). 17.8.25, l. 376-379ob.
25. Fedor NIKOL’SKIJ, « Iz sela Menjuš… », art. cit.
26. Tradicionnyj fol’klor Novgorodskoj oblasti. Skazki. Legendy. Predanija. Bylički. Zagovory ( po zapisjam
1963-1999) (Folklore traditionnel de la région de Novgorod. Contes. Légendes. Récits traditionnels. Faits
divers. Conjurations. (d’après des enregistrements de 1963-1999), Saint-Pétersbourg, Aleteia, 2001,
p. 210 (n° 160). Voir également les enregistrements concernant ce même sujet dans les
régions de Šimsk et Staraja Rusa, publiés par Tat’jana ŠČEPANSKAJA : Tat’jana ŠČEPANSKAJA.
Kul’tura dorogi…, op. cit., p. 301-302.
27. Trudy Etnografičesko- Statističeskoj ekspedicii v Zapadno-russkij kraj, snarjažennoj Imperatorskim
Russkim geografičeskim obsčestvom. Jugozapadnyj otdel. Materialy i issledovanija, sobrannye P.P.
Čubinskim (Travaux de l’expédition Ethnographico-Statistique dans les régions de l’ouest de la Russie,
organisée par la Société Impériale de Géographie de Russie. Département du Sud-Ouest. Matériaux et
études, rassemblés par P.P. Čubinskij. T. II. Contes de Petite Russie), Saint-Pétersbourg, Tipografija
imp. Akademii Nauk, 1878, ot(del) II, (n° 42), p. 557.
28. Lev G. BARAG et alii, Sravnitel’nyi ukazatel’ sjužetov : Vostočnoslavjanskaja skazka (Répertoire
comparatif des sujets : Le conte chez les Slaves de l’Est), Leningrad., Nauka, 1978.
29. Voir par exemple : Elena A. BUČKILINA, ed., Duhovnye stihi. Kanty (Sbornik duhovnyh stihov
Nižegorodskoj oblasti) (Poésies spirituelles. Chants (Recueil de poésies spirituelles de la région de
Nižegorod), Moscou, Nasledie, 1999.
30. Arhiv Fakul’teta etnologii Evropejskogo Universiteta v Sankt-Peterburge (Archives
de la Faculté européenne d’ethnologie de Saint-Pétersbourg, cité infra FE EU SPb).
Enregistré le 06.07.2003 auprès d’une femme née en 1930, n° du phonogramme EU-
Šimsk-03-PF-2.
31. Archives de la Faculté européenne d’ethnologie de Saint-Pétersbourg. Enregistré le
11.07.2003 auprès d’une femme née en 1920 n° du phonogramme EU-Šimsk-03-PF-8.
32. Archives de la Faculté européenne d’ethnologie de Saint-Pétersbourg. Enregistré le
17.072002 dans le village de Staroe Veret’e auprès d’un homme né en 1930. N° du
phonogramme EU-Šimsk-02-PF-1.
33.Archives de la Faculté européenne d’ethnologie de Saint-Pétersbourg. Enregistré le
11.07.2003 au village de Menjuša auprès d’une femme née en 1922. N° du phonogramme
EU-Šimsk-03-PF-1.
34.Archives de la Faculté européenne d’ethnologie de Saint-Pétersbourg. Enregistré le
18.07.2002 auprès d’une femme née en 1930. N° du phonogramme EU-Šimsk-02-PF-3.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
63
35. Archives de la Faculté européenne d’ethnologie de Saint-Pétersbourg. Enregistré le
11.07.2003 au village de Menjuša auprès d’une femme née en 1922. N° du phonogramme
EU-Šimsk-03-PF-1.
36.Archives de la Faculté européenne d’ethnologie de Saint-Pétersbourg. Enregistré le
22.07.2002 au village de Menjuša auprès d’une femme née en 1926. N° du phonogramme
EU-Šimsk-02-PF-13.
37. Pour un large corpus de matériaux folkloriques et ethnographiques sur les
malédictions, voir : Marina N. VLASOVA, Russkie sueverija. Enciklopedičeskij slovar’(Les
superstitions russes. Dictionnaire encyclopédique), Saint-Pétersbourg, Azbuka, 1998, p. 428-437.
38. Voir par exemple : Ol’ga A. ČEREPANOVA, ed., Mifologičeskie rasskazy i legendy Russkogo
Severa (Récits mythologiques et légendes de la Russie du Nord) , Saint-Pétersbourg, Izdatel’stvo
Sankt-Petergurgskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 1996, pp. 32-38 ; Tradicionnyj
fol’klor Novgorodskoj oblasti , op. cit., p. 320-324.
39. L’un des rares parallèles avec notre histoire est « le miracle du vénérable Nikodim
au sujet d’un berger », extrait de la vie de Nikodim de Kožeezersk (XVIIe siècle). Cet
extrait raconte comment le saint sauva le berger Grigorij Vasil’ev, entraîné dans la
forêt par un démon « habillé de gris », avec une petite clochette dans la main. « Alors
que Grigorij chantait des chansons sous un arbre, il voit : un vieillard l’appelle vers lui
et lui ordonne de se signer du signe de la sainte croix. Et pendant qu’il faisait le signe de
croix, le démon de la forêt était invisible, et le vieillard s’approchait de lui… »
(Mifologičeskie rasskazy i legendy Russkogo Severa, op. cit., p.186-187). On peut également
mentionner le « miracle du vénérable Iov d’Uščel’ de 1655 » où l’on voit le saint de
Mezen sauver des paysans naviguant dans une barque des mains d’un « démon des
eaux » qui tentait de les noyer (Voir Vasilij O. KLJUČEVSKIJ, Drevnerusskie žitija svjatykh kak
istoričeskij istočnik (Les vies de saints de l’ancienne Russie comme source historique) , Moscou, K.
Soldatenkov, 1871, p. 464). Cependant, dans les deux cas nous avons affaire à une
adaptation littéraire du folklore paysan. Le récit de la petite fille maudite de Menjuša
représente un exemple plus intéressant et plus rare du processus inverse : ici, c’est le
topo « vie de saint »qui est incorporé dans un récit mythologique paysan.
40. Il existe également, il est vrai, certains parallèles de caractère personnel, liés à la
mort et à la découverte de reliques de Gleb : le cuisinier tue le jeune prince « comme un
agneau innocent ». D’après la « Lecture » de Nestor, ce sont des « chasseurs » qui
trouvent le corps intact de Gleb « dans un endroit désert sous un cercueil creusé dans
un tronc d’arbre ». Cependant, à ce qu’il me semble, ces coïncidences ne suffisent pas à
affirmer une succession génétique entre l’histoire de Boris et Gleb et le récit sur Ioann
et Iakov.
41. Au sujet des correspondances entre l’histoire de Boris et Gleb et le récit biblique sur
Caïn et Abel, voir Boris A. USPENSKIJ. Boris i Gleb : Vosprijatie istorii v Drevnej Rusi (Boris et Gleb : La
perception de l’histoire dans l’ancienne Russie), Moscou, Jazyki russkoj kul’tury, 2000, p. 22-39.
42. Voir Aleksandr. A. PANČENKO. Issledovanija v oblasti narodnogo pravoslavija…, op. cit., p.
70-179.
43. Voir Vasilij O. KLJUČEVSKIJ. Drevnerusskie žitija svjatyh… op. cit., p. 323-324. Lev A.
Dmitriev, Žitijnye povesti Russkogo Severa kak pamjatniki literatury XIII-XVIII vv. (Les Récits de vies de
saints de la Russie du Nord comme monuments littéraires du XIII e au XVIIe siècle), Leningrad, Nauka,
1973, p. 249-261.
44. Lev A. Dmitriev. Ibid, p. 254.
45. Voir : Gavriil D. Krasnjanskij, prêtre, Mesjaceslov Novgorodskih svjatyh , op. cit., p.
145-148.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
64
46. Vasilij O. Ključevskij, Drevnerusskie žitija…, op. cit., p. 425.
47. Alexandr S. Lavrov Koldovstvo i religja, op ; cit., p. 214
48. Voir : Sergej A. ŠTYRKOV. « Svjatye bez žitij » i zabuduščie roditeli : cerkovnaja
kanonizacija i narodnaja tradicija » (Les « saints sans récit hagiographique» et les
parents qui oublient : canonisation de l’Église et tradition populaire) in O. V. BELOVA,
dir., Koncept čuda v slavjanskoj i evrejskoj kul’turnoj tradicii (Le concept de miracle dans la tradition
culturelle slave et juive), Moscou, 2001, p. 130-155.
49. Dmitrij K. Zelenin. Izbrannye trudy. Očerki russkoj mifologii. Umeršie
neestestvennoj smert’ju i rusalki (Œuvres choisies. Essais sur la mythologie russe : les défunts
morts de mort non naturelle et les ondines), Moscou, Indrik, 1995. p. 39-40.
50. Voir René GIRARD, La violence et le sacré, traduit du français par G. Daševskij, Moscou,
2000.
51. Ibid., p. 377-387.
52. Cette explication semble également assez artificielle : « Dieu qui voit toute chose,
considérant du haut de sa sainteté toute vie sur la terre, ayant vu la douceur et
l’innocence de ces enfants, a voulu glorifier en eux son saint nom, en les comptant au
nombre de ses saints et en épargnant à leurs jeunes corps purs et innocents la
décomposition » (Bibliothèque scientifique du musée d’État de Novgorod. Département
des manuscrits. K.P. 30056-212 / KP 247 l. 222ob (orotnoe)
53. Archives de la Faculté européenne d’ethnologie. Enregistré le 06.07.2003 à Menjuša
auprès d’une femme née dans le village en 1930, n° du phonogramme EU-Šimsk-03.PF-2.
54. Voir : Kirill V. ČISTOV, Russkaja narodnaja utopija (genesis i funkcii social’no-utopičeskie legendy)
(L’utopie populaire russe [genèse et fonctions des légendes sociales utopiques] , Saint-Pétersbourg,
Dmitrij Bulanin, 2003, p. 34.
55. Ibid., p. 34-35
56.« Skazanie o svjatyh otrokah… », art. cit., p. 10-11.
57. Une situation de ce genre est mentionnée dans les travaux cités plus haut de Žanna
V. KORMINA. Sur la pratique paysanne des vœux, voir : Aleksandr A. PANČENKO, Issledovanija
v oblasti narodnogo pravoslavija, op. cit., ; Tat’jana B. ŠČEPANSKAJA, Kul’tura dorog…, op. cit.
58. Archives de la Faculté européenne d’ethnologie à Saint-Pétersbourg. Enregistré le
07.07.2003 dans le village de Menjuša. Code du phonogramme EU-Šimsk-03-PF-3.
59. Archives de la Faculté européenne d’ethnologie à Saint-Pétersbourg. Enregistré le
07.07.2003 dans le village de Menjuša. Code du phonogramme EU-Šimsk-03-PF-1.
60. Enregistré le 11.07.2003 dans le village de Menjuša auprès d’une femme née dans ce
village en 1922. Code du phonogramme EU-Šimsk-03-PF-9.
RÉSUMÉS
L’article aborde l’état actuel de la pratique religieuse populaire en Russie. La dynamique de
l’ « Orthodoxie populaire » contemporaine est illustrée à partir de l’exemple du culte local de
deux saints frères, Ioann et Iakov Meniushskie. Le culte est apparu à la fin du dix-septième siècle
et a survécu à la fois aux réformes de l’Eglise opérées par Pierre le Grand et aux campagnes
« athées » du régime soviétique. L’article étudie l’histoire, les racines culturelles et les fonctions
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
65
du culte et analyse son développement actuel à partir d’un travail de terrain mené entre 2002 et
2004. Le folklore religieux russe contemporain est considéré, dans cet article, comme une sphère
de compétition entre différents discours et groupes sociaux.
The essay deals with contemporary state of popular religious praxis in Russia. The dynamics of
nowadays “popular Orthodoxy” is demonstrated on the example of local cult of holy brothers
Ioann and Iakov Meniushskie. The cult had arisen in the late 17th century and survived both the
church reforms by Peter the Great and the Soviet “atheistic” campaigns. The essay includes the
study of the history, cultural roots and functions of the cult along with analysis of its
contemporary state based upon field observations of 2002-04. Contemporary Russian religious
folklore is viewed in the essay as a sphere of competition between various discourses and social
groups.
El artículo aborda el estado actual de la práctica religiosa popular en Rusia. La dinámica de la
« ortodoxia popular » contemporánea es ilustrada a partir del ejemplo del culto local de dos
santos hermanos, Ioann e Iakov Meniushkie. El culto apareció a fines del siglo XVII y sobrevivió a
la vez a las reformas de la Iglesia llevadas a cabo por Pedro el Grande y a las campañas « ateas »
del régimen soviético. El artículo estudia la historia, las raíces culturales y las funciones del culto
y analiza su desarrollo actual a partir de un trabajo de campo realizado entre 2002 y 204. El
folklore religioso ruso contemporáneo es considerado, en este artículo, como una esfera de
competencia entre diferentes discursos y grupos sociales.
INDEX
Mots-clés : Eglise Orthodoxe, folklore religieux, pèlerinage, Russie, saint guérisseur
AUTEUR
ALEXANDR A. PANČENKO
Institut de littérature russe, Académie des sciences de Russie
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
66
Practices of Praise and Social
Constructions of Identity: The Bards
of North-West India *
Helene Basu
Introduction
1 In Kacch in western India, wākan karvun, to applaud, glorify, adore or eulogize the
qualities of an exalted being – a deity, person, or king – is considered a vocal art which
professional bards are particularly good at mastering. In this paper I shall explore
cultural practices of praise in relation to social constructions of identity embedded in
ethnographic realities of caste. The notion of « caste » (nyātā) as used in contemporary
Kacch refers primarily to kinship relationships constituting a field for social action
through which aspects of a collective social identity are constituted. Thus, in the self-
understanding of Chāra½ the ability to master vocal forms of praise is considered a
significant mark of their social identity. Here, I am specifically interested in the ways in
which caste as a meaningful social reality is brought into being though practice, that is
as routinised action embedded in the habitus of professional bards in Kacch 1. By
looking at the historical transformations of the contexts in which praise was practised
by Chāra½ bards, a close relationship between constellations of power, religion and
social constructions of identity comes to the fore.
2 In the context of Indian culture, praise is met with in both formal and informal social
configurations. Praise being a variable practice, at the informal end of the scale it easily
merges with flattery and boasting2. In everyday public behaviour, praise as flattery
announces the superiority and achievements of political leaders, business magnates or
popular celebrities such as film stars. The position of the « big man » (or « big woman
») requires subordinates to acknowledge and enhance the prestige of the ambitious
leader by flattery and praise of his or her virtues. At the other end of the scale, one
finds more formalised practices of praise that affirm not only the superiority of the
praised object but also the accomplishments of the one who is giving voice to the
praise. This is particularly true of professional practitioners of praise such as Chāra½
in western India (Rajasthan, Kacch and Saurashtra). In the former Rajput polities, the
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
67
term « Chāra½ « referred simultaneously to people (nyātā, caste) and to a special
genre of medieval poetic literature, much of which was devoted to praise. In Kacch,
aptitude, proficiency and competence in composing and reciting praise poetry are itself
considered praiseworthy qualities that have become part of the cultural constructions
of the « nature » (svabhāv) of Chāra½.
3 Practices of praise do not simply build upon culturally constructed ritual, aesthetic and
emotional aspects3, but also serve as important procedures in the social production of
memory in which Chāra½ specialised professionally. In medieval regional literatures, a
special genre of vīra kāvya or heroic poetry emerged, which was dedicated to the praise
of heroic kings and warriors4. Medieval praise poetry composed in western India
(Rajasthan and Gujarat) by Chāra½ poets is highly diversified according to different
principles of poetic language, metres, styles of recitation and narrative, etc. 5 Panegyrics
praise acts of bravery by kings on the battlefield, speak in hyperbolic terms of royal
victories over enemies, commend royal generosity and, above all, glorify the sacrifice
of death on the battlefield. Heroic praise poetry is, moreover, expressive of the desire
for fame. A king or a warrior qualifies for fame by displaying prowess and heroism
which gives him a unique identity and guarantees that his name will survive his death 6.
Acts of praise and the promulgation of fame are further embedded in the formal
framework of genealogies. The fame of a hero/king is enhanced by giving him a
glorious name and linking him with the pedigree of other famous names, ultimately
leading back to a divine origin. Through the promulgation of fame, individual kings and
events are remembered in which an indigenous memorial tradition is established.
Embedded within the learned tradition of Indian aesthetics (bhāva–rasa theory), heroic
praise is tuned according to the emotion of courage (utsāha), thus evoking the
corresponding heroic mood (vāra rasa). In a devotional context, praise poetry seeks to
inspire diverse forms of bhakti rasa, emotions of love, in which praise in the heroic
mode creates vāāra rasa, emotions of energy, vigour and courage (utsāha bhāva). From
the point of view of social interaction, praise involves an emotional bond between the
singers of praise and the object of their admiration in which « communities of
sentiment » are brought into being.
4 In the former Rajput kingdoms in Kacch and Saurashtra, heroic praise poetry and royal
genealogies memorialise the founding and conquering of medieval kingdoms, the
existence of kingdoms through time, their interactions and relationships as mediated
by kinship, marriage and war, and the establishment of ties of loyalty between Rajput
patrons and dependent subjects7. It also depicts a social hierarchy which takes as its
reference point the royal lineage and the king, making proximity to either of them a
critical criterion for evaluating the rank and social status of other castes. The «
community of sentiment » created by heroic praise and the promulgation of fame is at
the same time a « community of memory », constituted by the mutually
interdependent qualities of feeling and remembering.
5 This article is grounded in fieldwork carried out in the second half of the 1990s in
Kacch and Saurashtra. For many people in this region, Rajput kings and the kingdom of
their original settlement provide an important frame of reference in constructing a
local caste identity. This is also true of Chāra½ bards, who professionally remember
local discourses of kingship in the present. Here, I shall confine myself to the Chāra½
caste in the former Rajput kingdom of Bhuj/Kacch. My analytic focus is directed at the
relationship between practising praise in the sense of a « caste habitus » against the
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
68
changing contexts and objects of Chāran forms of praise. In this Rajput kingdom, praise
was produced as a ritual offering in two major contexts: 1) in royal court culture
(darbār); 2) in the worship of the goddess. In the first context, it was directed primarily
at the king, in the second at the many local manifestations of the goddess, including
her human incarnations. British colonial domination of Kacch in the form of « indirect
rule » transformed the basis of power to which heroic praise in the royal context was
directed and thus affected productions of praise. In the postcolonial context the major
object of Chāra½ praise is no longer the king, but an idealised image of the caste itself,
epitomised in the embodiments of « human goddesses » (Chāra½ Mātājīs). By
contextualising practices of praise historically, it will be shown how a new reality of
caste has emerged in post-independent Kacch. Thus, in the first section of the paper I
shall situate Chāra½ practitioners of praise in the historical kingdom of Kacch.
Secondly, a recent human goddess, Āī Śrī Sonal Mātā, will be introduced whose cult
today plays a pivotal role in the self-definition of the Chāra½ caste of this region.
Constructions of status related to the goddess and material living conditions of Kacchi
Chāra½s are considered in the third section. In the last section, I shall examine a major
contemporary caste ritual designed to commemorate the actions and teachings of the
Chāran human goddess Āī Śrī Sonal Mātā. The birthday celebrations held in the name
of this human goddess provide a major arena for the performance of Chāra½ ascetics,
singers and poets. Examples of their poetic productions are found in Appendix 1 and 2.
Through strategies of ritualisation, I argue, new commemorative caste rituals have
been created that depend on practices of praise. In this way, the lived reality of the
contemporary Chāra½ caste is produced, manifesting one facet of the diverse social
and local realities of caste in postcolonial India.
Practitioners of praise in the historical kingdom of Kacch
6 The gādī (throne) of Bhuj goes back to the sixteenth century. It was the throne of Jādejā
kings who later became identified with the whole peninsular of Kacch in the most
western part of Gujarat, forming a link between the Saurashtra peninsula and Sindh (in
Pakistan). Kacch was one of several Rajput polities that consolidated themselves in the
1500s from Rajasthan to Saurashtra, forming a hierarchy of rule. These Rajput
kingdoms were situated at the periphery and under the sovereignty of Delhi or of
regional sultanates and Mughal dominions (Ahmadabad). In the light of the emergence
of different traditions of rule on the Indian subcontinent, polities in Western India
were dominated by Rajput styles of kingship implying closely interwoven webs of
kinship in combination with patron-client-relationships8. Interactions between Rajput
kings were governed by attempts to enlarge their respective spheres of rule through
conquest, war and strategically placed marriage alliances. The sphere of rule of the
Jādejā kings of Bhuj was more or less confined to the peninsula. Like other Rajput
kingdoms in neighbouring Saurashtra, the prosperity of the gādī (throne) of Bhuj
depended largely on trade and merchant activities9. In the eighteenth century, five
flourishing ports contributed considerably to the power of the throne of Bhuj. The
towns of Kacch were important commercial centres connecting long-distance inland
trade-routes with transatlantic sea routes. The most prosperous merchant
communities were Hindu-Lohana, Jain-Vania and Muslim-Memon, who controlled
different trading activities. Rajput court culture and trade worked together in
favouring the development of artisan crafts. Steel products (swords, daggers, knives),
textile and woollen handicrafts and leatherwork were manufactured for export as well
as for the Rajput aristocracy. In addition to artisans, a large part of the population of
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
69
Kacch were pastoralists and herdsmen, such as Ahīr raising cows, Chāra½ raising water
buffaloes and horses, Rabāri breeding camels, and Bharvād keeping sheep and goats.
Agricultural production was pursued by members of artisan and pastoralist castes,
whereas peasant castes such as the Leva Kanbi (Patidar) from mainland Gujarat settled
in significant numbers in Kacch only in the nineteenth century.
7 The overall relationship between the king (rajā) and his subjects (prajā) was determined
by the exchange of gifts and services. Seen as the supreme givers of gifts, Jādejā kings
compelled their subjects to loyalty through the bestowal of royal land grants and the
granting of privileges, whereas the subjects in turn were obliged to pay tribute,
revenue, and taxes and to provide military and other services. The relationships
between the king and the people were concretised and personalised in the context of
the royal court (darbār), which was composed of individual members of the various
social groupings constituting the royal subjects. For example, the ministerial post of
the dīvān, second in power only to the king, was held in Bhuj for generations by a
member of one of the merchant castes, most often a Lohanā (sometimes Jain or
Memon). The dīvān was responsible for the administration of the kingdom, especially
for the collection of taxes, his main obligation being that he apply his caste-inherited
skills (his « merchant habitus ») to generating greater monetary wealth for the king.
While the dīvān derived his importance from the immediate economic and political
aspects of royal power, the ritual and ceremonial dimensions of royal power were made
manifest by the work of praise of the bards (poets) and genealogists. For generations,
members of the Chāran caste held a post called rājkavi, royal poet/bard, at the Bhuj
darbār. The rājkavi offered dānastuti, heroic praise representing a symbolic tribute
offered to the king. The value that was attached to Chāra½ bards in the royal context
may be also inferred from a grant made by a Jādejā king in the eighteenth century,
which allowed Chāra½ literati to establish a formal school dedicated to the teaching of
literature10.
8 According to Kacchi conceptions of kingship, the lineage of the Jādejā kings was
empowered to rule by a goddess called Āśāpūrā. By her grace, Jādejā Rajput warriors
were made kings and provided with the śakti (power) of the goddess. The consecration
of the king thus depended upon notions of sacred power, as conceived in the term śakti.
At the royal court, Chāra½ bards were part of a circle of ritual experts each of whom
contributed to the annual consecration of the king during the royal celebrations of
Navrātrī, the feast of the « Nine Nights of the Goddess ». A sacrificial symbolic order
was thus created locally in which the ritually and politically powerful king required
assistance from specialists such as bards and ascetics. This sacrificial order was
anchored in the pattern of worshipping the single goddess.
9 Brahman priests played a secondary, almost non-existent role in the ritual scheme of
Jādejā kingship in Kacch. They were, of course, present at the royal court. The services
of Brahman priests (Rājgor) were particularly important for the performance of royal
life-cycle rituals; moreover, queens often maintained intimate relationships with their
Brahman astrologers, who served as personal confidantes. But in the most important
rituals of kingship, especially those of Navrātrī, in which the symbolic power of the
king was regenerated and reproduced by performing buffalo sacrifices for the goddess,
Brahmans had no important role to play. Instead, priestly functions were assumed by
ascetics of the Kāpdīa and Kānphata orders (who both worship F0 20 śakti as the supreme
being and Śiva in his androgynous form). In the sacrificial rituals performed by the
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
70
king at the royal state temple of Āśāpūrā during Navrātrī, Kāpdīa and Kānphata
ascetics served as priests of the goddess. Moreover, the buffalo sacrifice performed by
the king, and by Rajputs in general, required a special ritual service from Chāra½ – in
this case not from male bards, but from women. The first blood flowing from the neck
of a sacrificed buffalo had to be received by a Chāra½ woman. After consuming the
sacrificial blood she hosted the goddess in trance, whom she in this way incarnated or
embodied for the duration of the royal sacrifice.
10 This practice of a Chāra½ī drinking the blood of the sacrificial victim, being possessed
by her and therefore turning into an incarnation of the goddess – anchors a vital
regional belief in rituals of kingship, namely, that the goddess be born in a Chāra½
woman and thus transforms her into a « human » or « living » goddess. This is the
second pre-colonial context in which Chāra½ bards produced poems and songs of
praise, in this case stutis praising the goddess. Stutis are addressed to the many Chāra½
Mātājīs, or « human goddesses » of the past, who helped the Jādejā kings gain power,
destroy their enemies or save their soldiers from hunger and thirst by miraculously
producing food and water11. Not only in Kacch, but all over Saurashtra and Gujarat too,
temples for goddesses are found who are believed to have been a historical woman, a
Chāranī, who was transformed into a powerful Devī (one famous temple is that of
Bahuchārya Mātājī in northern Saurashtra). Such women are deified as Chāra½
Mātājīs. They are seen as having guaranteed the moral rule of kings, commanding a
double-edged power (śakti): the power to punish an immoral king by cursing him, and
the power to reward him with āśīrvād and acknowledge his justness, generosity and
rule in accordance with dharmic principles. Chāra½ Mātājīs, moreover, guaranteed the
moral status not only of the king but also of the men of their own caste, of the bards
and poets whose words represent truth. Consecrated Chāra½ femininity was required
by the king as much as by their men. Thus, one finds a close connection between the
consecration of a Rajput king and the consecration of the status of Chāra½ bards.
Ultimately, all qualities of Chāra½ expertise, but especially their power of speech, are
explained by the special relationship that binds Chāra½ identity to various
manifestations of the goddess, particularly to Sarasvatī and Pārvatī. I shall return to
this point.
11 Colonialism changed the overall dynamics that infused the social reality of the pre-
colonial kingdom of Kacch. As a local power who might prove of use in their own
schemes, Kacch came into British cognisance comparatively late, at first mainly for
strategic reasons in terms of providing a closer route to Sindh. At the beginning of the
nineteenth century, the numerous little kingdoms of Saurashtra were turned into «
pacified » territories by Colonel Walkers » settlement policy. Only afterwards did the
British become aware of Kacch as a « lawless », « disorderly » region from where «
pirates » by sea and « dacoits » by land threatened the newly established order of
indirect rule in Saurashtra. The king of Bhuj was accused of harbouring and protecting
« criminals » in his kingdom and thus violating « British interests ». As long as the
kings of Kacch did not accept British terms of rule, the kingdom was perceived as a
disturbing and threatening presence that had to be subjugated. After years of tedious
struggle with resisting kings and dīvāns in Bhuj, the British finally succeeded in placing
a British Resident at the court in Bhuj in 1812. A royal successor was found, who was
only fourteen years old and thus could still be moulded by British-monitored
education. From the first half of the nineteenth century onwards, every Jādejā king was
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
71
educated under special British guidance, in order to make him an appropriate « native
ruler » by colonial standards. The Jādejā kings of Bhuj ultimately became most loyal
allies of the British.
12 After the British succeeded in acquiring influence and ultimately control over the
throne of Bhuj, the organisational structure of the kingdom was frozen into a fixed, «
traditional » form of royal rule. Colonial subjugation made Bhuj the capital of the
Princely State of Kacch operating under British sovereignty, and thus turned the gādī
(throne) into one of the numerous « hollow crowns » and « theatre states » which
emerged in response to colonial domination all over India 12. The king was now the
administrator of his kingdom, no longer the ruler of a state. The more his real power
declined, the greater became the pomp and the ceremonial displays that surrounded
the king. While on the one hand the Rajput aristocracy was socialised into British
colonial modernity, on the other hand the king continued to represent ritual power in
his kingdom. Royal sacrifices and the performances of Chāra½ praise singers remained
vital in the ceremonial realms of court life throughout the period of colonial
domination. But they now performed « theatre praise », replacing, for example, heroic
battle with the favourite colonial pastime of hunting. The Rajput king was now praised
for the bravery and intelligence of the hunter, instead of the heroism of the warrior.
Ritually, the kingdom continued to exist, and Chāra½ were amongst its most ardent
defenders, praising its past fame and glory.
13 Colonial modernity affected people in Kacch to different degrees. Brahmans, Hindu and
Jain merchants and the Rajput aristocracy were vitally involved in negotiating,
contesting, utilising and capitalizing on colonialism, thus transforming their practices
and forms of habitus to different degrees. In the case of the Chāran the confrontation
with colonialism resulted in the disentanglement or fragmentation of formerly closely
related and context dependent practices. Thus, the Chāran »s aptitude for poetry and
singing was associated with a claim to truth which in turn provided a rationale for two
more important roles fulfilled by men and women: to guarantee the moral order by acts
of self-inflicted violence (trāgu) and the embodiment of the goddess through women. As
in the Rajasthani kingdom of Sirohi studied by Vidal, in Kacch and Saurashtra too the
practice of trāgu was criminalized by the colonial government 13. While remembering
the past, praising kings and female embodiments of the goddess in royal sacrifices
became part of the Chāra½ »s role in the « theatre kingdom », in their poetic
productions Chāra½ lamented the decline of « culture » 14. It is interesting to note that
there is an apparent gap in the memorization of deified Chāra½īs of medieval and
modern times15. No famous Mātājī (human goddess) born in the nineteenth century is
remembered in the Chāra½ caste in Kacch. It is only in the 1920s that a powerful living
goddess was born again. This was Āī Śrī Sonal Mātā who was not so much connected to
life under colonial conditions, but more so to the abolition of the kingdom and the
necessity of reforming Chāra½ customs after independence.
14 Thus, while Kacchi traders settled in Bombay and elsewhere in India became active
supporters of Mahatma Gandhi and the Indian nationalist movement, the latter did not
gain great popularity in Kacch itself. Members of the Chāran caste remember as most
severe the changes they experienced as a consequence of the abolition of princely
states and royal rule. It was in these times that the human goddess Āī Śrī Sonal Mātā
entered the world in order to guide her people along the route to modernity.
Transformations of praise after independence
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
72
15 In postcolonial Kacch, heroic praise of kings was transformed into devotional praise
lauding the prestige of the caste and Chāra½ human goddesses. After the reality and
social relevance of their former ritual role was lost to them, Chāra½ responded to the
political changes affecting their local life-worlds through the medium of a new type of
human goddess, Chāra½ Mātājīs who advocated asceticism and the social reform of
customs and life-style.16 In this social context, the place and importance accorded to
nationalist leaders and reformative thinkers in the Indian middle classes is taken by Āī
Śrī Sonal Mātājī who is transformed by praise and fame into an icon of Chāra½ caste
modernity.
16 Āī Śrī Sonal Mātājī is the « human goddess » who is most immediately associated with
independence and social change. She enjoys great popularity and her actions are seen
as exemplary by many contemporary Chāra½ women, who are now following an
ascetic life-style and are also venerated as « human goddesses ». While in the past
Chāra½ Mātājīs have always been marked as unmarried, the importance of the act of
world renunciation has received an increased emphasis in contemporary discourse.
Ordinary women, who are married, raise children, work in the fields and dutifully
participate in the cycles of gift exchange constitutive of the universe of kin
relationships (vevarik sambandh), are never raised to being an object of praise. Although
in principle śakti resides in every woman, only those who have actively enhanced their
power by leading a life of asceticism may qualify for the performance of public praise
by Chāra½ men. Chāra ½ Mātājīs are praised for their renunciation of sexuality
(ideally a Mātājī never marries), their restricted diet (only milk products, no grains),
individual penances (keeping vows of silence, undertaking pilgrimages) and exercises
of meditation.17 A woman »s reputation and fame grows in accordance with the
perceived degree of power (śakti) she has achieved by performing ascetic acts.
Conversely too, the more praise a Mātājī receives, the greater is her śakti thought to be.
The turn to asceticism as the major quality of a Chāra½ Mātājīis also communicated by
the saffron colour of her dress, the colour of the Hindu ascetic. While old Chāran
Mātājīis are never represented in the saffron colour of the male Hindu ascetic,
contemporary « human goddesses » are always recognisable by their dress having this
colour.18
17 Āī Śrī Sonal Mātājī, the most venerated and praised Chāran Mātājī of recent memory,
was born in the 1920s into a Chāran subcaste in Saurashtra whose members derived
their livelihood from pastoralism. Rejecting marriage, Āī Śrī Sonal Mātājī professed a
new kind of asceticism which stressed, in addition to penances, meditation and
worship, personal manual work. Growing up in close vicinity to Porbandar, Gandhi »s
home town, her hagiographers claim that she met Gandhi in person and to have been
influenced by his ideas, especially his ethics of labour. The human goddess is not only
credited with having induced her own immediate caste to change to settled agriculture
instead of raising cattle, but also with a host of other suggestions for reforming Chāran
habits. Most of Āī Śrī Sonal Mātājī »s messages and demands for reform echo familiar
issues of the 1950s and 1960s in post-independent India described under the heading of
« Sanskritisation ». She preached vegetarianism and anti-alcoholism, rejected blood
sacrifices, rebuffed the ideas and practices of possession by the goddess, and, most
importantly, urged her caste to educate their children. Until her death in 1975, she
regularly toured « her territory », that is, Chāran settlements all over Saurashtra,
Kacch and parts of south Rajasthan. In Kacch, her passionate lectures were particularly
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
73
well received, leaving a distinct mark in the contemporary social life of the caste, as
will be shown in the last section, that deals with a commemorative ritual performed for
this human goddess.
18 The changing political circumstances affected cultural constructions of Chāran Mātājīs
and the objects of praise, but less so the dispositions of the Chāran, that is, the wish and
ambition of individuals to develop expertise in performing praise poetry. Poets
continue to compose praise poetry, and singers continue to celebrate a praised object.
But nowadays praise is only rarely directed at Rajputs or heroic warriors, except when
old poetry is recited, or in the context of genealogical performances at marriages, when
lineage ancestors are remembered. Objects of contemporary acts of Chāran praise are
more often gods and goddesses, individuals (patrons) of any superior standing (a
merchant, a sādhu, a politician), or sādhus and female ascetics venerated as human
goddess. Most importantly, however, the Chāran caste (nyātī) has itself become a
favourite object of praise.
19 Chāran practices of praise are now performed mainly in the context of caste. This also
leads to the peculiar situation that although female and male ascetics have « left the
world » in mind and life-style, they still live in close proximity to that same world of
their birth and caste. Sādhus (ascetics) and Mātājīs, along with poets and singers,
constitute the « sacred face » of the Chāran nyātī, who worships her own consecrated
and deified image in the form of the « human goddess ». It is thus no longer the king
who symbolises entry to the larger social world by providing the position to become a
praiser; rather, ascetic females and males have taken over this role. As a corollary,
ascetics open the way to contemporary social and political networks that extend
beyond the boundaries of close kinship circles of caste.
The praisers ´ caste
20 About 35,000 people identify themselves as belonging to the Chāran caste in Kacch,
which now represents the largest district in the state of Gujarat. Here, most Chāran are
called by the name « Gadhvi ». Gadhvi people are convinced that all those who belong
by birth to the Chāran caste (nyātī) are « of the same kind ». Being of the same kind
implies certain dispositions, such as the ability to compose poetry, recite it in many
different styles, the capacity to remember historical knowledge, a love of the play of
words, and above all, strong inclinations in both men and women towards asceticism.
While not every single caste member may turn out to be a gifted singer, a poet or a
Mātājī, it is generally believed that from no other caste were so many proficient artists
and charismatic religious personalities born. Singing and reciting poetry is a favourite
activity pursued regularly not only by artists, ascetic women and male ascetics, but also
by many ordinary people. In some villages, poetry and singing competitions are held
almost daily. Large groups of young men aspire to become a recognised Chāran artist, a
karlekār, either as a singer, musician or orator. A specific caste habitus is thus socialised
and internalised by everyday practices of singing, reciting and remembering.
21 In the context of the urban middle-classes in Kacch, among people mostly of Brahman,
Patidar, Lohanā and other merchant-caste backgrounds, the Gadhvi presence is
peripheral. From a middle-class perspective, Gadhvis are stereotypically seen as «
rustic rurals », easily identifiable by their uniform dress: men in white with a coloured
shawl, women in black skirts, colourful blouses and a red headscarf. Their art, however,
is appreciated even by the middle classes. Since the 1970s, the local radio station
(Ākāśvā½ī) has run a popular programme called “lok gīt” (folk music), in which
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
74
performances by individual Chāra½ musicians and vocal artists are regularly
broadcasted (along with those of other Kacchi musicians).
22 The majority of Gadhvi people have settled in villages in the southern half of the Kacchi
peninsula, where well irrigation built in the 1950s facilitates the agricultural
production of cash crops. Economically, Gadhvi peasants have profited from land
reforms and the green revolution that occurred all over Gujarat. They grow cotton,
groundnuts and, most importantly, maintain orchards in which dates, chikku, bananas
and other fruits are produced. While the richest section of the Gadhvi caste is
represented by landowners controlling thirty acres or more, the poorest are landless.
Landless Gadhvi tend to seek employment from wealthier landowners of their own
caste. On the whole, Gadhvis have acquired modest economic affluence, which,
however, cannot compare with the wealth of rich capitalist farmers from the Leva
Kanbi that is, the Patidar caste in other villages. Much of their wealth comes from
remittances sent by migrants. Whereas few Chāra½ have migrated from Kacch, a large
percentage of Patidar live abroad, in East Africa, Great Britain or the USA. Patidar
peasants in Kacch were able to use these remittances to invest more economic capital
in artificial irrigation projects, highbred seeds and the latest agricultural technology
than any other peasants.
23 According to Gadhvi conceptions, the Chāra½ have received their special dispositions
from the goddess, the Devī. They perceive themselves as instruments of a specific
power, namely the F0 20 śakti of Sarasvatī, the goddess of language, knowledge and
learning. The first definition of a Chāra½ is: he/she is a devīputra, or a devīputrī, a « son
/daughter of the goddess ». The origin of the Chāra½ caste is connected to the goddess
Pārvatī. By defining their status as devīputra, the caste charter situates the Chāra½
consciously outside the Brahmanic, varna- based definition of social status. Rather, the
distinct status of a devīputra is defined by female sacrality, by the human goddesses, the
past and present Chāra½ Mātājīs, who populate the symbolic landscape in Saurashtra
and Kacch. What for analytic purposes can be translated as habitus is, according to
Chāra½ notions, engendered in their svabhāv, the nature given by the goddess as a gift.
24 These talents or « caste powers » (śakti), the gift of the goddess and the specificity of a
Chāra½ habitus are engrained in the body, being anchored in speech patterns, rhythm
mnemonics and writing. Embodied knowledge and skills are transmitted in closely knit
networks of kinship and caste. Moreover, this habitus makes sense only in a social field
in which singing, reciting poetry and narrating histories are valued actions. While the
caste has become a significant audience, artists also contribute in a wider social field to
the production of local public culture. Performing for the local radio station, writing
for the local newspaper or singing before a multi-caste audience at religious festivals
provide ways for Gadhvi to act according to their dispositions.
25 In this way, a specific cultural capital of the Chāra½ caste is produced. The local Gadhvi
elite consists of those who control the cultural capital of the Chāra½, that is, those who
command competence in the fields of historical knowledge and the mnemonic
techniques of praise accumulated over time. The top urbanised elite of the caste in
Kacch is formed of a small number of college teachers, lawyers, government employees,
politicians, and rich landowners. In addition to their respective jobs, many of them
spend time cultivating one or several of the traditional arts and forms of knowledge
cultivated in their caste. Moreover, Chāra½ poets and literati often command several
languages, such as Kacchi, Gujarati, Hindi and even Sanskrit. The language most
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
75
esteemed by Chāra½ poets however, is Brj bhāsā. A college teacher of Sanskrit may
composes verses in Sanskrit, but in a metre which accords with the rules of Chāra½
literature; a lawyer might be a gifted singer, etc. Whatever their formal profession may
be, the greatest respect is accorded to a writer of a caste history, a writer of a
hagiography of a Mātājī, a famous ascetic, poet or renowned singer, or a highly
esteemed female ascetic (human goddess). Individual achievement in terms of
mastering a Chāra½ art increases the prestige and influence of a person within and
beyond the caste. Referred to by common people as « our big people » (vadil loko), the
elite rules over the rest of the caste. Big people write in newspapers, journals and books
about the history of the Chāra½, they publicly recite praise, sing bhajans and other
devotional music, or else teach religion, especially if they assume the role of an ascetic
or a « goddess in a human body ». Thus, those who control the cultural capital are those
whose names are famous, at least in Kacch, those whose voices are heard, whose
opinions on political issues matter. Caste leaders invest the cultural capital of their
Chāra½ identity in the competition with other castes over political influence and
power.
26 The formal organisation of the caste on the district level, the « Kacch Chāra½ Samāj »,
is controlled by these leaders. Positions of caste leadership are dominated by men, big
landowners, lawyers and teachers. The head organisation of the « Chāra½ Samāj »
represents the political interests of the caste in relation to the state, especially in
mediating demands in regard to affirmative action (Chāra½ now are classified as OBC,
[Other Backward Caste »s]). The organisation also administers funds collected regularly
from every Gadhvi household for the maintenance of social institutions benefiting the
caste. Educational scholarships are given to students from poorer families from caste
funds. In the 1970s, a hostel was built in the town of Mandvi for Gadhvi village boys
enabling them to go on to higher education. More recently, a hostel for girls has been
added. In addition, the caste council also intervenes in the customary life-style of its
members. The Chāra½ Samāj regulates the dress code to be followed by Gadhvi women
– for example, allowing girls to wear a salwār kamāz when going to school, but
demanding they wear « Chāra½-style dress » when attending formal gatherings of the
caste. The « Chāra½ Samāj » also implements the reform of specific practices, such as
the abolition of bride-wealth payments before marriage. Divorce and violations of
norms of endogamy are also brought before the caste council. In extreme cases
violators of norms are officially expelled from the caste. This happened only ten years
ago to a Gadhvi woman who went for higher studies and married a Brahman man. On
the whole, the caste council controls the behaviour of caste members and demands
conformity to caste norms19. A vital occasion for demonstrating the validity and moral
superiority of these norms is provided by the celebrations commemorating the human
goddess Āī Śrī Sonal Mātājī.
The ritualisation of praise: celebrating caste
27 The annual birthday celebrations in honour of Āī Śrī Sonal Mātājī are a major occasion
at which contemporary Chāra½ adepts practice the art of praise. Institutionalised by
the caste council (the Kacch Chāra½ Samāj) from the beginning of the 1980s,
commemorative celebrations held in the name of Āī Śrī Sonal Mātājī are referred to as
« Sonal Bīj » (bīj = first sickle of the moon, birthday). The « Sonal Bīj » festival provides
staged performances and speeches given by caste historians, vocal reciters, bhajan
singers, ascetics, Mātājīs and caste leaders. Except for a few selected guests (for
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
76
example, prominent devotees of a Chāra½ ascetic or a local politician), the audience
consists almost entirely of Gadhvi from the district of Kacch. By listening to the
speeches of their vadil loko, or « big people », ordinary Gadhvi are taught about the
historical greatness and the fame of the caste to which they belong. The rhetoric of
praise permeates the speeches, poetry recitals and songs, and elevates the Chāra½
caste. A Mātājī is praised by evoking her birth as a Chāra½ī and vice versa, and the
greatness of the caste is applauded by commemorating the many famous sacred
women, the human goddesses, of the Chāra½. The celebrations of the birthday of Sonal
Mātājī present themselves as the outcome of ritual strategies or ritualisation through
which the modern Chāra½ caste defines itself.
28 The ritual performances celebrating the modern Chāra½ caste are held in the building
of the « Chāra½ Boarding », the boy »s hostel in Mandvi. This building also serves as
the administrative head office of the district organisation of the caste (the Kacchi
Chāra½ Samāj). It houses a small temple dedicated to Āī Śrī Sonal Mātājī, where her
photographs, a triśūl and a small icon of Jagdambā Devī are kept. Visitors to the
Chāra½ Boarding are first brought to this temple and told the story of how Āī Śrī Sonal
Mātājī had come to preach in Kacch in the 1950s and 1960s and then prompted the
local Gadhvi to provide their sons with education. She herself, so the story goes, had
collected the funds to enable the building of the boy »s hostel.
29 In the course of my fieldwork, I could witness « Sonal bīj » twice, in 1996 and in 1998.
Each time, the two-day celebrations of « Sonal bīj » were organised by the caste
leadership. An organising committee was entrusted with the organisation of the actual
event. The tasks of the committee included sending invitations to prominent
performers, organising a work force of Gadhvi boys and men to cook and serve at the
feast, selecting people to bestow flowers and ceremonial gifts upon the most
prestigious performers at the beginning and end of the celebrations, and finally
drawing up the actual schedule.
30 During « Sonal bīj », praise remains the most important ritual act, performed in
different fashions, modes and genres. In these ritualised performances, we meet with
four dimensions of praise: praise in the form of a ritual offering, praise in the form of
spreading fame, praise in the aesthetic formal framework, and praise as an emotion by
which a community of memory and sentiment is forged. The beginning of the
ceremonial programme is marked by praise being offered ritually to the goddess Āī Śrī
Sonal Mātājī. These are called Mātājī na stuti (devotional praise of the goddess). Praise
poetry of the Mātājī na stuti type are composed by individual poets and recited publicly
by devoted men and women of the Gadhvi caste. They contain verses like the following:
31 You have vowed to give your beautiful body, day after day
32 Taking is not (in your nature), you wonderful, wonderful Sonal Mātājī
33 After the inauguration of the programme with ritual offerings of Mātājī na stuti, learned
men give lectures and speeches on the history (itihās) of the Chāra½ caste. In contrast
to praise performed in the context of the darbār, the royal court, which celebrated the
king and the hero, the elevated object of praise is here the caste itself. The origin of the
Chāra½ on the peaks of the Himalayas, high up in the realm of the devlok, is used as a
metaphor for the high status that Chāra½ may also claim in the lower world on earth
and in the present. The lectures then go on to detail the wanderings of the ancestors,
how they came to earth, which routes they took, how they began to breed water
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
77
buffaloes, how they attached themselves to Rajput heroes, how Chāra½ warriors and
Mātājīs helped Rajput kings to found their kingdoms and finally, how local Gadhvi
villages were established in Kacch. A recurrent theme in historical narratives is the
close relationship that bound Chāra½ to Rajput patrons. Praise of Rajput heroism not
only elevates the status of the patron but also enhances the respect enjoyed by the
producers of fame. Narrators dwell at length on the privileges that Chāra½ ancestors
had enjoyed in recognition of their services, such as revenue-free villages, huge
amounts of royal gifts (dān), close access to the court and other favours. What narrators
praise most, however, is the readiness of a Chāra½ to sacrifice his or her life in order to
remain truthful, as well as for the moral benefit of the patron (trāgu). Towards the end
of their aggrandised accounts of the history of the caste, speechmakers draw lessons
for the present: loyalty to leaders, readiness to sacrifice one »s life for a moral cause,
and honouring the customs of the caste (rīt rivāj), which was created by the ancestors
for the good of their descendents. These remain the moral duties of any living Chāra½
today.
34 While historical lectures are given during the day, the evening is reserved for the
performance of poetry and devotional music by renowned artists (karlekār). Invited like
the learned lecturers, the top layer of performing Gadhvi artists are those whose names
and reputations extend far across the boundaries of the Chāra½ caste. The utmost
respect is given to ascetic artists. Although asceticism posits that the renouncer severs
all ties with his former life, especially with his family, relatives and caste, male and
female ascetics of the Gadhvi still remain bound to their caste, even if in a transformed
way. Male and female ascetics remain unmarried and live beyond their families, but
their first audience, those who acknowledge their claim to a superior, consecrated
status, are from their own immediate caste. Only when they spread his or her fame are
members of other castes likely to be attracted too. One of the most prestigious Chāra½
ascetics is Nārāyan Svāmī, a follower of the path set by the Nāgā branch of the Dasnāmī
order, who commands a large following of devotees, including migrants in Britain 20. All
his devotees venerate him not only for being a fierce and spiritually powerful ascetic,
20 śakti, of his music. Nārāyan Svāmī excelled as a famous
but also for the power, the F0
singer of bhajans, which he performed with a group of musicians, and his devotees were
ardent consumers of his tapes. Tapes of bhajans sung by Nārāyan Svāmī were and are
produced in a studio owned by the ascetic. Situated in the city of Rajkot in Saurashtra,
the studio produces and sells audio-tapes of both live performances and studio
recordings. Nārāyan Svāmī performed at all the major religious festivals in Gujarat, his
performance at the « Sonal Bīj » celebrations being considered a great attraction.
35 While the genre of bhajan is a popular form of devotional music practised widely in
Kacch and India, both on stage and spontaneously, there are other genres of artistic
vocal performances that the Chāra½ claim as « their own » . These are literary, poetic
and recital styles, commonly summarised as Chāra½ sāhitya, or Chāra½ literature. The
formal aesthetic frame in which the different forms of praise are embedded are defined
by considerations of metre and other rules for composing poetry. The aim of
contemporary Gadhvi artists is not to dislocate « old » forms and create new ones so
much as to devise a strategy to make oneself a name, by achieving perfection and
mastery over a particular style or genre. This does not mean that no variation is
possible in poetic forms; on the contrary, mastery over style is displayed in able
improvisations, that is, by individualising the application of formal rules.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
78
36 At the celebrations of the birthday of the goddess, composers and reciters of poetry
display old and new creations, drawing on the whole register of Chāra½ styles of
recital. The majority of performers are men, although a few gifted women singers also
display their skills. In addition to duho (two-line songs) and bhajan singing 21, a favourite
genre of poetry recital is called cā½d. It is also associated with the Goddess, and is the
traditional metre form for composing praise poetry in her name. Cā½d expresses the
different contexts, moods and themes of a poem through a special style of rhythmic
recitation. It may sound like aggressive shouting, being recited on the pitch of the
voice, being a type of poetry which was sung on the battlefield in order to instil bravery
and a mood to fight in soldiers, or like drops of water or the voice of a bird, creating a
vocal image of a garden in which the goddess is residing. Many cā½d are recited in
praise of Sonal Mātājī. In the poem Cā½d Bhujangi, for example, every line starts with
"namah" (adoration to): then specifying her qualities (a light in the darkness), ending
the verse by: "« namah Sonal Āī mahā » (« the greatest »). The life-history of Sonal
Mātājī is poetically recorded in a total of eight long verses, which are recited for about
an hour. Often, moreover, not only different genres of speech recitation, bhajan, duho
and cā½d but also languages (Kacchi, Brj, Gujarati, Sanskrit) are mixed in one
performance22.
37 As the night of « Sonal Bīj » proceeds, more and more of the younger and less reputed
Gadhvi artists display their knowledge and mastery of the vocal arts. The staged
performances heighten competition between younger Gadhvi artists. Fame, a well-
known name, public reputation – many young Gadhvi men aspire to these goals. A road
to fame may also be found by addressing new ideological issues in the code of Chāra½
praise. Thus, even praise songs for the Hindu nationalist goddess Bhārat Mātājī may be
heard occasionally. In recent years, some politically ambitious young men have begun
to deploy their talents for the benefit of the type of Hinduism which is being
propagated by the Vishwa Hindu Parishad and the RSS 23.
38 The second and final day of the celebrations is reserved for speeches (bhāsan) given by
the most prestigious local Mātājīs (ascetic women) and by caste leaders. These concern
the present state of the caste. Mātājīs in particular make themselves heard by the
opposite of praise: they complain and grumble and point out all the moral flaws in the
everyday behaviour of Gadhvi that call for severe rebuke. Playing cards, drinking
alcohol, men beating their wives, women gossiping instead of doing work and similar
issues of the everyday are passionately castigated in the speeches made by ascetic
women, who urge their caste members instead to lead a hard working life, to look after
the education of their children, to serve (sevā) the goddess, to act piously, and to seek
the wisdom and advice of ascetics. Like knowledgeable men and vocal artists, women
ascetics also compete for recognition and veneration as human goddesses. Since Sonal
Mātājī embodies an ideal, preaching social reform like her is a common strategy
employed by ascetic women, even though currently few of the « human goddesses »
seem to be as charismatically inspired. Moreover, most of the critical issues that Sonal
Mātājī addressed – especially blood sacrifice and possession – have lost much of their
vigour because they are hardly practised any more. Yet, having morally reprimanded
their unreasonable and stubborn fellow humans, Mātājīs conclude the event by
bestowing blessings (āśrvād) on the audience.
39 On the whole, acts of praise performed in commemoration of Āī Śrī Sonal Mātājī evoke
feelings of belonging and shared emotions of love and adoration for the goddess
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
79
through caste practices. Caste may then be experienced as a « community of sentiment
». Sentiments extend to a heroic past which is brought into the present by Chāran
Mātājīs. All the displays of caste knowledge and performative skills are ultimately seen
as a form of sevā or worship, that is, of religious service being rendered out of
devotional love (bhakti). The sharing of sounds and meaningful words uttered in sevā
can be understood as embodied love, prem, as the Chāra½ say. Sevā, worship or ritual
service, is rendered out of feelings of devotional love. Thus, through strategically
placed acts of praise and remembering, the idealisation of the caste-self may be
experienced creatively in a « community of sentiment and memory ». The sentimental
bonds and emotions that are evoked by singing, listening to historical stories and to
poetry contribute to a heightened awareness of the svabhāv of the Chāra½ caste, and
their « nature » – or habitus.
Conclusion: on the diversity of the social realities of caste in modern India
40 I hope to have shown that looking at caste through the prism of praise reveals how
caste is created as a lived reality in the present by people who act strategically in order
to reach culturally defined goals. I have attempted to build a genealogy of praise as a
caste practice. In the precolonial Rajput kingdom of Kacch, praise was a ritualised
practice performed in the context of the darbār (royal court). Through praise, the king
was elevated to a superior, heroic and ultimately consecrated position. Chāra½ bards,
of course, were not the only praisers in the region, many other castes also practise
praise singing.24 But a Chāran most often held the seat of the rājkavi, the post of the
royal poet, as at the court of Bhuj, which gave them a higher social status in relation to
other bards. Moreover, royal rituals were found to hold the key to an important
regional religious practice: the veneration of human goddesses (Chāra½ Mātājīs). The
consideration of the ritual royal order in Kacch revealed that bardic women played a
ritual role (drinking blood) in the royal sacrifices for the goddess.
41 The modernisation theories of the 1960s and 1970s used to predict that caste would
vanish under the forces of modernity. However, this belief has been firmly dislodged,
caste now generally being acknowledged as an important contemporary category
shaping diverse social realities in postcolonial India. There is, moreover, a considerable
level of debate going on in the social sciences as to how the contemporary phenomenon
of caste should be understood. Many of these debates are guided by the dichotomy
between « religion » and the « secular », in which caste is equated with religion.
Change, then, may be understood in terms of democratic political processes which will
ultimately lead to the « secularisation » of caste25. A similar implicit dichotomy is
found in the work of ethnohistorians arguing against the Dumontian paradigm of the
separation of status and power and for the proliferation of regional systems of caste
based upon royal power and institutions of kingship26. The ongoing controversy
between Dumontians and ethnohistorians concerns the constitution of caste whether it
is a religious hierarchy or a system of power and dominance ruled by the king. For
understanding contemporary processes of caste, however, the notion of «
substantialisation » in terms of a « transition from structure to substance » as
suggested by Dumont still seems to provide a useful category for understanding the
fusion of ritual and political dimensions in the lived reality of caste in contemporary
times27. The frame of reference defining the status of Chāran in their own eyes remains
locked into the former institution of kingship encompassed by the power of the
goddess. Thus, the respect accorded to court poets in the past is still considered the
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
80
foundation upon which the status of the Chāra½ caste rests in the present. But at the
very moment when the outside context of kingship vanished, praise, advice and rebuke
ceased to be addressed to the king and began to be focused on the entire caste instead.
Castes in their turn may no longer be seen as integrated parts of social systems, as
social configurations organised along the lines of hierarchy or patron-client
relationships embedded in the institution of kingship, instead manifesting themselves
as social universes in their own right. This process is, moreover, strengthened by the
politics of affirmative action and the creation of the administrative category of the «
Other Backward Castes » (OCB) which includes the Chāra½.
42 Considering also the critique raised by postcolonial studies namely that many of the
categories that anthropologists work with heuristically owe their explanatory force to
the fact that they are colonial constructions28, an investigation of indigenous
constructions of caste as those articulated by poets may be instructive. These
representations do not only speak of the power of the king as instrumental in creating
a social order of caste identities (the sacrificial order of kingship) but also of the power
of the goddess. The celebrations of the birthday of Sonal Mātājī evoke realities of caste
in terms of a community of sentiments through strategies of ritualisation. In this way,
moreover, a distinction within the caste between the elite and commoners is created,
guaranteeing at the same time the power of the caste over its members. In this case at
least, practices of praise are the means whereby contemporary constructions of
identity of a Chāra½ caste are sustained.
NOTES
*. I am grateful to Angelika Malinar for her interest in the subject and a host of valuable
suggestions. Bob Parkin I would like to thank for his careful reading of the manuscript.
1. Pierre BOURDIEU, Entwurf einer Theorie der Praxis, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1979;
The Field of Cultural Production, Cambridge, Polity Press, 1993
2. Arjun Appadurai, « Topographies of the Self: Praise and Emotion in India », in
Catherine LUTZ and Lila Abu-Lughod, Language and the Politics of Emotion,
Cambridge,Cambridge University Press, 1990, p. 92 –112.
3. First of all, praise in the form of stotra is a ritual offering dedicated to a deity; in the
form of dānastuti, praise is rendered as a symbolic tribute offered to a patron.
Secondly, praise constitutes an art that is embedded in formal aesthetic frameworks.
4. S. Settar and M.M. Kalaburgi, « The Hero Cult: A Study of Kannada Literature from
9th to 13th Century », in S. Settar and Günther Sontheimer, eds., Memorial Stones. A
Study of their Origin Significance and Variety, Dharwad-Heidelberg, Institute of Indian
Art History Karnatak University, 1982, p. 17-36.
5. Hiralal Maheshvari, History of Rajasthani Literature, Delhi, Sahitya Akademi, 1980, p.
10-12.
6. Friedhelm Hardy, The Religious Culture of India: Power, Love and Wisdom,
Cambridge, Cambridge University Press, 1995
p. 112.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
81
7. Helene BASU, Von Barden und ihren Königen: Studien zur Göttin und zum Gedächtnis in
Kacch (Indien), Berlin, Peter Lang Verlag, 2004.
8. See also Satish SABERWAL, « On the Diversity of Ruling Traditions », in Sudipta
KAVIRAJ, ed. Polotics in India, Delhi, Oxford University Press, 1997.
9. Harald Tambs-Lyche, Power, Profit and Poetry: Traditional Society in Kathiawar,
Western India, Delhi, Monohar, 1997, p. 224ff.
1.0 Francoise Mallison, « Braj, Gujarati and Bardic Poetry Patronised by the Rulers of
Kutch: The Bhuj-Braj-Bhasha Pathshala (1749-1949) », Paper presented at the
Symposium Journées Gujarat, Paris 2003.
1.1 See for Saurashtra Harald TAMBS-LYCHE, « Le roi et les enfants de la déesse. Quelques
contes du Saurashtra », Cahiers de Littérature Orale, 1991, 20, p. 61.85. Helene BASU, op. cit.
2004, p. 85-92.
1.2 Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali, Princeton,
Princeton University Press, 1980. Nicholas B. Dirks, The Hollow Crown: Ethnohistory of
an Indian Kingdom, Cambridge, Cambridge Unviersity Press, 1987.
1.3 Trāgu, i.e. cutting the body with a dagger, causing it to bleed, in extreme cases until
death, was a means of pressure that a Chāran could resort to in order to enforce an
agreement between opponents. Trāgu as a form of self-sacrifice was performed either
against one »s own body or against the body of a close family member, most often an
old woman or a young girl. These acts could be used as a means of protest (Denis Vidal ,
Violence and Truth: A Rajasthani Kingdom Confronts Colonial Authority , Delhi, Oxford
University Press, 1997, p. 15). In addition, in Kacch trāgu was part of a special type of
service that Chāran people provided and by which they stood security for a contract.
No contract between kings after a war, or between patrons and clients agreeing the
terms whereby services be rendered, nor any other contract was considered valid
without a Chāran guaranteeing on his own and/or the life of his family that the
terms agreed upon would be fulfilled. They provided the same service for merchants
and traders on their long treks through the desert up north, when they accompanied
caravans for their protection against plundering bandits. Owing to the popular
conviction that the spilling of the blood of a Chāran is an even greater sin than killing a
Brahman, men and women of the caste who threatened to wound or kill themselves
provided an effective protection against attackers of all sorts. Colonial discourse,
however, defined acts of trāgu as murder and in the British-controlled parts of Gujarat
the practice was soon declared a criminal act, for which individual Chāran were sent to
prison. For a detailed analyses of the impact of colonialism upon this aspect of Chāran
identity.
1.4 Cf. Appendix 2.
F0
1.5 See for medieval deified Chāran women, Harald Tambs-Lyche, 20 Shakti. « The
sacred powers of Chāran women in Gujarat », Paper presented for the 12th European
Conference of South Asian Studies, Berlin 1992. For symbolic transformations of the
representation of Chāran Mātājis of the past, Helene BASU, op. cit.,, 2004, p. 195-198.
1.6 Chāran human goddesses represent one variant of diverse traditions of female
asceticism in India, for other models cf. Catherine Cl Émentin-Ojha, « Feminine
Ascetism in Hinduism: Its tradition and present condition », Man in India, 1981, 61, 3,
p. 254-285. Lynn Teskey Denton, Varieties of Female Ascetism, in Julia Leslie, ed., Roles
and Rituals for Women, Delhi, Motilal Banarsidass, 1992, p. 211-231.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
82
1.7 Helene Basu, « Local Concepts of Women Ascetics: Living Goddesses of the Chāran »,
Journal of the Social Sciences (Delhi), 2000, Vol. 4, 4, p. 313-321.
1.8 While elsewhere in Gujarat ascetic women wear a saffron-coloured sari, Chāran
Mātājīs communicate their consecrated Chāran femaleness by using the proper items
(skirt, blouse, headscarf) of Chāran dress, though not in the original colours of red and
black. As Gadhvi men and women themselves recognise, the wearing of saffron-
coloured clothes by Chāran Mātājīs s is a recent invention, perhaps stimulated partly by
the marked increase in prestige offered publicly to Hindu ascetics (sādhu, samnyāsin )
and the colour signifying their status.
1.9 The public recognition of the decisions of the caste council and the open display of
conformity do not mean, however, that all people actually agree or in their personal
behaviour actually conform to everything proposed by the Chāran Samāj. «Small
people » may secretly mock and ridicule the presumptuous air of «big people », but one
would not openly defy those in authority nor question their norms, so long as one lives
embedded in face-to-face-relationships with other Gadhvi.
2.0 It has to be noted with sorrow that by the time of writing this article Nārāyan Srāmī
has passed away.
2.1 For an example of a poem in the duho style composed by a local poet, see Appendix
1.
2.2 For an example of such a vocal performance, see Appendix 2.
2.3 Thus, in several villages cells of the RSS have established śākhā-training camps. In
one village, the organisation is run by a striving young poet and teacher who has
opened a RSS village-school. Elsewhere in Kacch, Chāran young men run local
organisations of the Shiv Sena. An analysis of the ideological transformations re-
formulating local conceptions of the goddess in terms of a nationalist paradigm would
require a separate study. I have dealt with this issue in more detail in another article,
cf. Helene Basu, « Göttin in Indien – Indien als Göttin? » Historische Anthropologie,
12-1, 2004, p. 123-133.
2.4 A.M. Shah and R.G. Shroff, « The Vahivanca Barots of Gujarat: A Caste of
Genealogers and Mythographers », in Milton Singer, ed., Traditional India Structure
and Change, Philadelphia, American Folklore Society, 1959, p. 40-70.
2.5 Rajni Kothari, « Caste and Modern Politics », in Sudipta Kaviraj, ed., Politics in
India. Delhi, Oxford University Press, 1997, p. 57-70, p. 69.
2.6 Cf. Gloria Goodwin Raheja, « India: Caste Kingship and Dominance Reconsidered »,
Annual Review of Anthropology, 1988, 17, p. 497-522. Declan Quigley, The
Interpretation of Caste, Oxford, Clarendon Press, 1993.
2.7 Louis Dumont, Homo hierarchicus: The Caste System and its Implications. Chicago,
The Univesity of Chicago Press, 1980, p. 226.
2.8 Nicholas Dirks, Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India,
Princeton, Princeton University Press, 2001.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
83
RÉSUMÉS
Il s'agit dans cet article d'une analyse de rites de louanges célébrés par les bardes traditionnels
des anciens rois Rajput au Kacch. Après l'abolition de la royauté Rajput de nouveaux rituels
commémoratifs en rapport avec les pratiques de louanges sont apparues, dans lesquels on
retrouve la réalité vécue de la caste Chn¯contemporaine.
ara . Alors que la louange était une pratique
importante consacrant le rôle du roi Rajput, dans le Kacch post-indépendant, un déplacement
significatif en ce qui concerne l'objet des louanges s'est produit. Ce n'est plus sur le roi que la
louange se concentre mais sur la déesse incarnée par des femmes Ch n.¯ .La description d'un rituel
ara
célébré pour une déesse Chn¯vivante,
ara . vénérée également comme réformatrice sociale, dessine des
processus qui redéfinissent la caste dans le cadre de l'Inde postcoloniale.
This paper presents an analysis of performances of praise practiced by traditional bards of
former Rajput kings in Kacch. After the abolition of Rajput kingship, new commemorative rituals
have come into being that depend on practices of praise whereby the lived reality of the
contemporary Chn¯caste
ara . is produced. While praise was an important practice legitimating the role
of the Rajput king, in post-independent Kacch a noticeable shift has taken place in regard to the
object of praise. It is no longer the king upon whom praise is centred but the goddess embodied
in Chn¯ .women. The description of a ritual performed for a living Goddess of the Ch
ara n¯ .who is
ara
venerated at the same time as a social reformer delineates processes of re-defining cast in
postcolonial Indian settings.
Este artículo ofrece un análisis de las representaciones de alabanza o elogio practicadas por los
bardos tradicionales de los antíguos reyes Rajput en Kacch. Tras la abolición de la monarquía
Rajput han surjido nuevos rituales conmemorativos, que dependen de prácticas de elogio, las
cuales a su vez producen la realidad vivida por la casta Chn¯contemporánea.
ara . Si bien el elogio fué
una importante práctica que legitimaba el rol del rey Rajput, en el Kacch post-independiente ha
tenido lugar un notorio cambio con repecto al objeto de alabanza, que ya no se centra en el rey,
sino en la deidad personificada por la mujer Chn.¯ .La descripción de un ritual representado para
ara
una diosa viviente de los Chn,¯ .que al mismo tiempo es venerada como reformadora social, delinea
ara
procesos de redefinición de castas en las circunstancias dadas en la India postcolonial.
AUTEUR
HELENE BASU
Freie Universitaet Berlin
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
84
Note critique
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
85
Saints, héros et martyrs dans le
monde musulman
A propos de : Mayeur-Jaouen Catherine, dir., Saints et héros du Moyen-
Orient contemporain, Paris, Maisonneuve et Larose, 2002, 353 p. /
Khosrokhavar Farhad, Les nouveaux martyrs d'Allah, Paris, Flammarion,
2002, 369 p.
Malika Zeghal
1 La figure du martyr musulman est aujourd'hui amplement discutée. La guerre entre
l'Irak et l'Iran dans les années 1980, le conflit israélo-palestinien, les attentats du 11
septembre 2001 ou encore la guerre actuelle en Irak ont mis en avant cette figure
individuelle qui émerge de ces grands conflits. Deux ouvrages publiés en 2002 posent la
question du statut du martyr dans le monde musulman : le volume dirigé par Catherine
Mayeur-Jaouen, quoique centré sur les héros et les saints, nous invite à comprendre la
diversité des figures individuelles – des plus truculentes aux plus tragiques – qui
peuvent être historiquement construites, admirées ou vénérées en rapport avec des
identités collectives nationales, politiques ou religieuses. L'ouvrage de Farhad
Khosrokhavar, quant à lui, se concentre sur la figure singulière et les manifestations
plus récentes du martyr en reprenant les exemples iranien et palestinien, ainsi que la
figure du martyr d'al-Qaida, et développe une réflexion sur le statut de l'individu et la
modernité en pays d'islam.
Saints et héros : nationalisme, islam et transformations religieuses
2 Catherine Mayeur-Jaouen nous introduit dans le monde des héros et des saints au
Moyen-Orient, en dessinant une typologie très flexible. Celle-ci détaille les grands traits
des héros, des saints et des martyrs et permet de comprendre les passages d'un type à
un autre ainsi que leurs interpénétrations, souvent à l'origine de transfigurations. Elle
nous décrit ces figures admirées ou vénérées vers lesquelles les citoyens ou les croyants
se tournent : personnages politiques ou religieux, qui peuvent représenter une
communauté, une nation, ou un idéal qui peut les transporter jusqu'au sacrifice de soi.
Une très riche iconographie illustre les diverses contributions et nous introduit,
parallèlement au découpage thématique des chapitres, dans l'univers de la mise en
scène des grands hommes ou la représentation d'individus plus anonymes transfigurés
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
86
par la mort. Ne pouvant, dans le cadre de cette recension, rendre justice à l'ensemble,
très riche, des contributions, nous ne reprendrons ici que certaines d'entre elles. La
première partie traite du sacré et du politique à travers l'exemple de la figure des
grands héros nationaux, et de l'examen de la relation entre le chef politique et la
sacralisation de sa personne, voire de la nation qu'il dirige. Les héros et les grands
hommes occidentaux construits par et pour la mémoire des nations européennes,
résonnent au xixe siècle dans les esprits du Moyen-Orient. Anne Laure Dupont,
revenant au moment de la Nahdha égyptienne, nous montre que l'Europe fut le terreau
dans lequel journalistes et hommes de lettres égyptiens puisèrent pour construire les
biographies de leurs grands hommes, exemples de l'exceptionalité et de
l'accomplissement de la supériorité, au moment même où de nouvelles élites urbaines
émergent et diffusent l'idéal de mobilité sociale. Mais alors que le nationalisme se
développe, c'est aussi chez soi que l'on recherche la figure du héros, notamment dans
l'islam, à travers la figure du prophète, de ses compagnons et des premiers califes, à
partir desquels se profilent les grands traits de ce que sera plus tard le grand héros
national arabe. Les continuités sont soulignées : Nasser récupéra les mécanismes
utilisés par le roi Farouk pour diffuser le culte de sa personne, et s'il ne fut pas à ses
débuts un homme populaire, il sut utiliser les circonstances historiques à son profit
pour se construire une posture de héros national et arabe. La défaite de 1967 ne le priva
pas de l'admiration et de la vénération des foules : elle le transforma en martyr.
L'exemple de Bourguiba, « combattant suprême », analysé par Elias Fekih, montre bien
que la relation entre le chef charismatique nationaliste et le sacré, reste ambiguë.
« Saint de la sécularisation tunisienne », il détruisit nombre de symboles de l'islam
populaire mais préserva les tombeaux des saints les plus importants. S'il eut une
attitude souvent négative par rapport à l'islam, elle fut faite aussi de compromis et de
peur. D'ailleurs Ataturk, plus sécularisateur, fut plus « divinisé » que Bourguiba, comme
le montre l'article d'É. Copaux. Fekih constate que la biographie officielle de Bourguiba
n'hésite pas à utiliser des thèmes islamiques : mihna, hijra, jihâd, mais plus original
encore, il développe le concept d'« anthropophagie bourguibienne » : au fond, le héros
national n'accepta jamais que d'autres aient son statut, ce que l'auteur illustre dans la
confrontation rêvée entre le chef de l'État et le saint Amor El-Fayyache. C'est ce qui
explique que sa succession ne fut jamais assurée, et que ses funérailles amputées lui
donnèrent, alors que son capital d'héroïsme s'était depuis longtemps émoussé, une
posture nouvelle de martyr.
3 La deuxième partie de l'ouvrage s'intéresse aux saints et approfondit le thème du lien
entre le sacré et le politique. Ici, le religieux devient omniprésent : il est intrinsèque à
la personne du saint, alors que le héros pouvait se définir en dehors du religieux, tout
en se l'appropriant, et osciller entre la posture du héros politique et la sainteté
« temporaire ». Brigitte Voile nous décrit ainsi le face à face entre un héros politique,
Nasser, et le saint, ancien moine devenu Cyrille VI, ayant accédé au trône patriarcal en
1959. Deux charismes de nature différente, celui du nationaliste et celui de
l'intercesseur auprès des fidèles, déteignent l'un sur l'autre. Le saint, cependant, reste
« hors du temps », et la construction de son charisme est plus durable, comme le
montre Valérie Hoffman dans sa contribution sur le cheikh égyptien Radwan. Rachida
Chih et Catherine Mayeur-Jaouen, revenant sur l'exemple du cheikh Sha'râwî,
décrivent l'importance du saint populaire et la marchandisation de son image, portée
par les éphémérides, les autocollants, les porte-clés et autres objets : « De ces images,
nul n'attend une baraka directe. Aucun rapport avec les icônes, ou même avec les
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
87
petites photos de saints musulmans que tant de dévots soufis gardent dans leur
portefeuille. (...) Le poster de Sha'râwî, dans bien des boutiques, a remplacé le Coran
que l'on plaçait en évidence dans la vitrine ou dans la salle : l'image du cheikh tient
finalement le même rôle affirmatif, en moins encombrant et moins cher ». Il y a, dans
cet exemple, peu de rapports directs au pouvoir politique, mais surtout la constitution
d'espaces de pouvoir propres au saint lui-même, vivant ou mort.
4 Ces exemples, qui traitent de cas spécifiques à l'Égypte ou au Liban, en passant par la
Turquie, nous montrent la plasticité, l'adaptabilité de la sainteté, qui se raccorde au
politique, à l'économique tout autant qu'à un fondement religieux, et prend des formes
diverses tout à fait compatibles avec la modernité, comme l'illustrent les analyses des
rapports entre sainteté et constructions nationales. En particulier, le culte des saints,
toujours associé à un territoire se fait autour du tombeau, de la sâha, et d'autres
territorialités locales, mais aussi autour de territoires plus larges : le Mont Liban pour
saint Charbel, la ville de Tunis pour Sayyida Mannoubiyya, ou la nation pour d'autres.
Cette identification spatiale est flexible, changeante, et s'adosse aux parcours
transnationaux, comme dans le passage du culte des saints juifs marocains vers Israël.
5 L'un des grands thèmes qui parcourt cette collection est bien celui de la circulation, du
transfert, et des transformations qui s'expriment dans l'espace comme dans les
marques physiques et corporelles. Ainsi les traits physiques sont-ils le reflet d'un statut
extraordinaire : tels les yeux verts et perçant de Musa Sadr dont Sabrina Mervin dresse
le portrait. Mais le héros n'est pas toujours transformable en saint, ni en martyr. Si la
sainteté semble détenir le statut le plus enraciné et le plus durable dans cette typologie
triangulaire, la figure du martyr reste spécifique et liée à un contexte historique bien
particulier.
Martyrs : l'individu, la souffrance et la modernité
6 Pour Farhad Khosrokhavar, la figure du martyr est la manifestation extrême de
l'individu dans une société déstructurée, un individu paradoxalement plongé dans un
état de crise profonde et disposant d'une capacité d'expression démesurée de cette
individualité, qui va jusqu'au désir de mort et au sacrifice de soi. Ce paradoxe entre
d'une part l'épanouissement de l'individualité en contexte de modernité et d'autre part
sa crise et sa désarticulation profondes, court dans tout l'ouvrage. L'islamisme a donné
en général une place à l'individu dans une société structurée par la référence à un
système transcendantal, mais aussi façonnée par une culture du ressentiment, qui
oppose islam et Occident, et où l'individu musulman est perçu comme une victime.
L'islamisme « dénature l'intersubjectivité en la subordonnant à un credo sacré et en la
surinvestissant par un manichéisme où celui qui s'écarte de la norme assume le rôle
maléfique » (p. 98). L'auteur rappelle avec raison que cette figure se rencontre dans
tous les extrémismes qu'ils soient religieux – et qu'elle peut se manifester dans d'autres
religions que l'islam – ou qu'elle se déploie dans des domaines plus profanes, comme le
nationalisme. À ce sujet, F. Khosrokhavar oppose la « martyropathie » qui s'exprime au
niveau national à celle qui se manifeste de manière plus générale au niveau de la
communauté des croyants, renvoyant à deux exemples concrets : les types différenciés
du martyr palestinien et iranien d'une part, qui se réfèrent à une idéologie nationaliste,
celui qui est relié à un réseau radical transnational comme al-Qaida d'autre part. Le
martyr lié au groupe national est tragique. Dans l'umma, en revanche, dont se
réclament les martyrs d'al-Qaida par exemple, le tragique est effacé par l'abstraction de
l'umma mythique, opposée à l'Occident. À l'intérieur de cette première dichotomie,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
88
l'auteur en expose une seconde qui différencie, au sein de la catégorie du martyr
« national », ceux qui opèrent dans le cadre d'un État, et ceux qui s'expriment dans le
contexte d'une absence de l'État, confrontant ainsi la figure du martyr palestinien à
celle du martyr iranien. Ce dernier est décrit dans le modèle du Bassidji, du « fou de
Dieu » instrumentalisé par l'État révolutionnaire, minoritaire, mais important
symboliquement, puisqu'il est le fer de lance de la révolution. On y trouve le pessimiste
radical en situation de désarroi, mais aussi des figures plus « positives » comme celui
qui entre en guerre dans un rite de passage et qui y trouve une dimension ludique, ou
l'opportuniste en recherche d'ascension sociale. Comme dans les articles du volume
dirigé par C. Mayeur-Jaouen, l'auteur décrit un rapport au corps et au sang : « Le corps
martyropathe iranien est habité par un intense sentiment de péché, écrit
F. Khosrokhavar. Une relation ternaire s'instaure entre le corps, le sang et le péché.
Pour que le corps se purifie, il doit se libérer de son sang. De même, pour que le sujet
puisse racheter ses péchés, il doit se purifier en se séparant de son corps. (...) La guerre,
est, en l'occurrence, une occasion pour se délester de ses péchés par la suppression
sanglante de son corps » (p. 159). La riche iconographie présentée dans le volume dirigé
par C. Mayeur-Jaouen illustre bien les propos de F. Khosrokhavar, qui font écho aux
descriptions d'Éric Butel, dans sa contribution sur « Martyre et sainteté dans la
littérature de guerre Iran-Irak » : comparant l'iconographie du martyr iranien à
l'apparition du macabre dans l'art funéraire occidental à la fin du Moyen Âge, et
constatant la rencontre entre les deux formes esthétiques du macabre et du sublime, il
écrit : « le corps porte en sa corruption la preuve de sa nature profondément
pécheresse et révèle finalement le mal de vivre du nouvel individu (...) non comme une
régression, mais comme une des phases essentielles et incontournables de la conquête
progressive de la liberté. (...) L'explosion du macabre ne relève donc pas, en Iran, d'une
contre-modernisation conjoncturelle (...), mais d'une rupture fondamentale et
douloureuse avec la société traditionnelle » (p. 313-314). Les deux auteurs constatent
l'épuisement de ce modèle du martyr, qui ne parvient pas, souligne É. Butel, à trouver
sa place dans le culte des saints.
7 Le martyr d'al-Qaida, qui entre dans la catégorie des martyrs « transnationaux », ne se
rattache pas, quant à lui, à un État, mais se recrute au sein de réseaux décentralisés,
lâches, flexibles et mobiles. Politiquement, il n'a pas de projet explicite. Il vise la
construction d'une umma transnationale rêvée dans l'opposition radicale face à un
Occident diabolisé. Il peut venir du jihâd afghan, des grandes villes occidentales, du
Moyen Orient ou du Maghreb, peut avoir reçu une éducation supérieure et maîtriser les
codes culturels occidentaux, comme le montre l'enquête qu'a pu mener
F. Khosrokhavar auprès de prisonniers accusés de fomenter des attentats terroristes.
Mais si on apprend beaucoup sur la psychologie de ces membres de réseaux terroristes
et sur les causes, inscrites dans la modernité, qui les emportent dans ce genre
d'activités et d'interprétations, on sent bien que leur statut de martyr n'apparaît pas de
manière explicite. L'auteur ne définit pas leur statut de martyr, un peu comme si ce
statut s'anéantissait dans leur disparition même, alors qu'on pourrait croire que cette
« hyper-secte » qu'est al-Qaida pourrait mener aux formes ultimes du martyr. Or il n'en
est rien. Si Ben Laden est parfois transformé par les attributs de saint vivant qu'on lui
reconnaît dans certaines parties du Pakistan par exemple, le statut de martyr des
guerriers d'al-Qaida n'est pas clairement explicité. Comme le dit l'auteur, ceux-ci
s'expriment au sein d'un monde quasi-virtuel, et apparaissent de même. Dans le cas du
martyr national, la mort sacrée indique une rupture, elle est « visible », repérable,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
89
marque la différence et le passage. « Chez le martyr de la néo-umma, (...) le passage de
la vie à la mort perd une grande part de son aspérité dans ce monde qui tend à oblitérer
la différence fondamentale entre le réel et l'imaginaire » (p. 323).
8 C'est dire si ce type de martyr, plutôt qu'une donnée intrinsèque à l'islam, est
l'expression des contradictions de la modernité, en particulier de la mondialisation qui,
en effaçant les imaginaires nationaux de certaines minorités, les poussent à se
radicaliser dans une opposition fondamentale à l'Occident.
9 Ces deux ouvrages viennent ainsi considérablement enrichir notre compréhension des
grandes figures religieuses contemporaines en régime de modernité.
AUTEUR
MALIKA ZEGHAL
Centre d'Études Interdisciplinaires des Faits Religieux – CNRS
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
90
Comptes rendus
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
91
Helene Basu, Von Barden und Königen.
Ethnologische Studien zur Göttin und
zum Gedächtnis in Kacch (Indien)
Francfort/Main, Peter Lang, 2004, 350 p.
André Padoux
1 Par sa dimension théorique, l’intérêt de cette étude dépasse de loin celle d’un groupe
social particulier de la région du Kacch (dans l’État du Gujerat, proche du Pakistan), où
Helene Basu a, à plusieurs reprises, séjourné et enquêté et dont elle a une excellente
connaissance.
2 Ce travail, indique H. Basu dans l’introduction, se situe dans le champ de tension
entre remémoration, qui est actualisation du passé et conscience d’un présent que le
rappel conscient de ce passé éclaire et contribue à construire. À cet égard la caste
hindoue des Charan, pasteurs et bardes, qu’elle étudie ici, joue un rôle essentiel. En
effet, en tant que bardes, gardiens et porte-parole du passé de la royauté rajpoute qui a
gouverné la région jusqu’à l’indépendance de l’Inde, donc en tant que « producteurs de
la mémoire culturelle de la région », les bardes Charan, en même temps qu’ils
préservent la mémoire de l’identité rajpoute traditionnelle, contribuent au maintien
actuel de la structure de la caste et donc à la (re)construction de son identité culturelle.
3 Dans le monde rajpoute précolonial du Kacch, où dominaient les valeurs guerrières et
héroïques, le rôle des bardes était d’exalter par des chants et des récits, les hauts faits
du monarque, la puissance du guerrier k±atriya et de chanter la gloire de sa lignée. Les
Charan avaient aussi (et ont encore en quelque mesure) pour fonction sociale d’être les
garants des contrats et engagements, qu’ils veillent à faire respecter en allant
éventuellement, pour cela, jusqu’à se sacrifier : c’est un des cas à inclure dans « la
panoplie des pratiques d’automutilation et d’autosacrifice dont l’Inde s’est fait une
spécialité », pour parler comme C. Weinberger-Thomas dans sa remarquable étude de
la crémation des veuves (Cf. Cendres d’immortalité. La crémation des veuves en Inde, Paris
Seuil, 1996 [cf. Arch. 96.78]). Si les Charan mâles ont deux rôles essentiels (nous sommes
dans un monde avant tout masculin), leurs femmes les ont aussi, non seulement en ce
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
92
qu’elles peuvent se sacrifier comme eux, mais surtout parce que certaines d’entre elles
incarnent un aspect important du culte des déesses. Le Kacch est en effet une région où
la Déesse (sous une de ses formes redoutables : Kālī, Durgā, Hinglaj, etc.), la Puissance
divine féminine, la śakti, est omniprésente. Elle y apparaît sous trois aspects. Elle est
deśdevī, la Déesse du pays ; à cet égard elle a été, sous la forme d’Āsāpūrā la divinité
protectrice, donneuse de puissance, des rois rajpoutes Jādejā et elle reste, de ce fait, la
divinité principale de la région. Elle est aussi kuldevī, déesse de lignage, protégeant et
assurant la survivance tant du clan royal que des groupes sociaux locaux, reliant ainsi
le prince et ses sujets par un même culte. Elle se manifeste enfin d’une façon concrète
sous la forme des jīvan mātājī des déesses vivantes, en s’incarnant en certaines femmes
Charan, dont le rôle social et religieux est, comme on va le voir, de prime importance.
En plus de cette triple présence divine, H. Basu remarque que le discours des Charan en
tant que bardes, ouvriers de la parole poétique chantant la gloire de la Déesse et
appelant à sa dévotion, utilise, manipule et répand l’énergie divine, la śakti, sous la
forme de la parole. Or, en Inde, depuis le Veda, la Parole, toute-puissante, est féminine.
4 H. Basu a, entre 1993 et 1998, passé chaque année plusieurs mois au Kacch durant la
période d’automne-hiver au cours de laquelle tombe la grande fête de la Déesse, le
Navrātī, et où se célèbrent les mariages et diverses fêtes importantes. C’est donc le
moment où les éléments formant la base de sa recherche sont les plus visibles, où la
référence consciente au passé est la plus présente. Son travail d’observation
participante s’appuie en même temps sur des documents écrits (les textes des Charan
notamment, mais aussi d’autres sources).
5 Ce qui caractérise toutefois cet ouvrage est que les matériaux ainsi recueillis y sont
présentés et y prennent leur sens à travers le schème interprétatif de « mémoire
culturelle » (kulturelle Gedächtnis) tel qu’il a été élaboré par J. Assman à partir de la
notion de conscience sociale de Maurice Halbwachs. La mémoire culturelle, précise
ainsi Helene Basu, n’est pas la mise en archive de faits historiques, mais la mémoire
d’une histoire qui dès lors devient mythe, et c’est lors de cette transformation de
l’histoire en mythe que la mémoire culturelle acquiert sa force normative et
formatrice. Or cette mémoire apparaît comme liée à – et comme s’exprimant par – une
« mnémo-technique » institutionnalisée que possèdent les spécialistes de la
communication que sont notamment les bardes Charan, mais aussi à travers les rites
(qui contribuent à « ancrer la mémoire dans les corps ». C’est là, dit l’auteur, « l’aspect
performatif de la mémoire »). À côté de cette mémoire, H. Basu pose avec J. Assman
l’existence d’une « mémoire communicative » (kommunikative Gedächtnis) qui, elle,
repose non sur un passé mythifié, mais sur un passé commun expérimenté par les
individus qui rapportent ce qu’ils ont vécu. Ces deux pôles de la mémoire collective
contribuent par leur co-présence et leur dynamisme propre, par la « sémiotisation du
passé » qu’ils réalisent, à la construction de l’identité sociale et culturelle collective du
groupe concerné, qui vit ainsi son identité dans un présent tout entier marqué par ces
références vécues à un passé sans cesse rappelé à la conscience. L’auteur souligne
l’importance de la caste comme cadre de cette mémoire, chaque caste ayant ses propres
références historiques identifiantes. Elle fait remarquer à ce propos que les Rajpoutes,
clan dominant dans la région, pratiquent (comme les Indiens du sud, dravidiens) le
mariage avec la cousine croisée, alors que les brahmanes et marchands, autre groupe
important (et au rôle aujourd’hui croissant), sont fidèles à la rigoureuse exogamie
nord-indienne – les systèmes de parenté et leur terminologie tiennent une place
appréciable dans ce travail. Les institutions ou organisations ainsi que les
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
93
rassemblements religieux sont aussi des « Gedächtnisrahmen » (dirons-nous des «
cadres mémoriaux » ?), notamment ceux concernant le culte des déesses, dont
l’importance est grande au Kacch. Depuis environ le XIIe siècle, en effet, une forme de la
Déesse, déité śivaïte tantrique, est presque toujours (à côté d’un dieu officiel plus
« orthodoxe ») la divinité protectrice (parfois secrète, mais toute-puissante) de tout
royaume hindou. C’est le cas au Kacch, où elle s’affirme dans la conscience collective
par les temples et cultes qui lui sont dédiés et, de façon particulièrement sensible, par
son incarnation dans les déesses vivantes – les jīvan mātājī – ; cependant que sa gloire,
avec celle des rois anciens, ses dévots, est exaltée (et donc rappelée à la mémoire
collective) par les bardes Charan. Dans le rapport de ces derniers au roi rajpoute du
Kacch, la Déesse et ses incarnations vivantes ont un rôle central. Ces dernières
symbolisent en effet les éléments du passé que rappellent les bardes et contribuent à
assurer le lien entre le plan de la royauté, celui de la caste et la puissance, la śakti.
Incarnant celle-ci, les mātājī sont des renonçantes, leur puissance spirituelle étant
d’autant plus grande que leur ascèse est plus poussée. Leur place peut surprendre, mais
en contexte śivaïte tantrique, où la śakti joue un rôle essentiel, les femmes-ascètes sont
plus présentes qu’en milieu viśnouite ou généralement orthodoxe. Celles du Kacch
(d’autrefois comme d’aujourd’hui) ne se posent pas pour autant en contestatrices de
l’ordre traditionnel, même si leur statut ascétique les libère du rôle inférieur,
dépendant, qui est normalement celui de la femme hindoue. Elles auraient plutôt,
parmi leurs fonctions, celle de renforcer la caste dans la mesure où, en l’incarnant, elles
rendent présente la déesse du clan, la kuldevī, et où, ce faisant, elles font apparaître
comme propre aux Charan une aptitude particulière au renoncement et à l’ascèse.
6 Les deux premiers chapitres décrivent la vision du royaume des Jādejā du Kacch – et
donc la reconstruction du passé – telle qu’elle apparaît dans les textes élaborés par les
Charan, en montrant, à travers notamment la terminologie utilisée, que cette
conception relève de la conception classique hindoue du royaume, ou plus exactement
de la puissance royale, qui est ici celle du trône (gādī), lequel est en même temps le
royaume et une forme de la déesse Āsāpūrā, protectrice de la lignée. D’où une
monarchie reposant sur la lignée royale plutôt que sur le territoire, et c’est celle-là que
les bardes Charan louent et renforcent de leur parole en mettant l’accent sur les
rapports d’hérédité et de famille présentés selon les catégories du système familial et
d’alliance des Rajpoutes dont la complexe terminologie est attentivement décrite,
comme l’est d’ailleurs aussi le rapport des Charan aux Rajpoutes. Sont également
examinés tant l’histoire que la situation actuelle et les problèmes et conflits internes ou
externes des royaumes rajpoutes de la région (le Saurashtra), qui ont dû d’ailleurs,
jusqu’à l’indépendance de l’Inde, composer avec des royaumes locaux musulmans.
7
8 Le troisième chapitre, sous le titre de « Paysages sacrés de la mémoire et rituels
royaux », traite, avec la même approche très théorisante, d’abord du patronage royal
des temples et des déesses, notamment de la déesse Āsāpūrā qui est à la fois la déesse
du royaume, deśdevī, et celle de la lignée royale des Jādejā, kuldevī, puis des lieux –
ermitages ou temples – où se trouvent des ascètes śivaïtes. Ce sont là deux sortes de
lieux de mémoire à propos desquels se pose la question du rôle actuel de la Déesse et
celle de son rapport au dieu śiva, mais au sujet desquels on doit noter le caractère de
plus en plus visible de survivance d’un autre âge qu’a ce patronage par un prince qui,
dans l’Inde postcoloniale, n’a plus de pouvoir politique. On voit là – et pas seulement
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
94
pour le patronage royal – un univers de la mémoire dont certaines des composantes
essentielles sont en train de disparaître.
9 C’est la mémoire fondatrice de l’identité de la caste des Charan – qui sont des Gadhvī,
des pasteurs – , telle qu’elle apparaît dans les textes qu’ils produisent, qu’envisage le 4 e
chapitre, qu’il s’agisse de leur mythe fondateur ou du fondement également mythique
des règles gouvernant leur système de parenté et d’alliance. Cette affirmation de
l’identité collective par la mémoire se fait par le culte des déesses de la caste, déesse
proprement divine comme Hinglaj, ou déesses incarnées telle Ai Sona Mātajī qui vécut
au XVIIIe siècle et dont on célèbre toujours l’anniversaire, ou telles les diverses Mātajī
qui lui ont succédé jusqu’à nos jours. Ce sont ainsi, paradoxalement, des femmes
ascètes qui incarnent la mémoire de la caste alors que celle-ci est, par nature,
essentiellement masculine. H. Basu décrit ensuite (chap. 5) la vie des Gadhvī telle
qu’elle l’a observée dans un village de la région. Elle y montre combien l’existence
quotidienne des habitants, les relations familiales et sociales, les règles du mariage et
de l’échange matrimonial et même la structure de l’espace villageois sont gouvernées
par des normes rendues toujours présentes par la mémoire collective de la caste avec sa
sacralisation du passé. Elle revient, à cette occasion, sur les règles de mariage et de
l’échange matrimonial propres aux Gadhvī. Elle décrit également le déroulement rituel
du mariage (où les généalogistes jouent un rôle particulier).
10 Après avoir fait apparaître tout au long de l’ouvrage le caractère contraignant des
croyances et des pratiques sociales gouvernant la vie des Charan, H. Basu, dans un
dernier chapitre consacré aux « ruptures et transformations ascétiques », envisage
différentes circonstances où des individus se libèrent de ces contraintes. Elle décrit
ainsi le cas de femmes qui se séparent de leur mari (et qui peuvent d’ailleurs se
remarier) ; celui d’hommes alcooliques, donc asociaux ; le cas, enfin, – et c’est le plus
important – des « poètes et des saints », dont elle rapporte plusieurs exemples. Dans
cette catégorie se trouvent en particulier les femmes-ascètes, les Mātajī, dont le choix
personnel du renoncement affirme l’indépendance à l’égard des hommes, cependant
que, par le respect général qui entoure leur statut de renonçantes, celui-ci peut être
pour elles un moyen d’ascension sociale. Il est à noter que, bien qu’elles échappent (par
le haut) à l’emprise contraignante de la caste, puisqu’elles sont renonçantes, et
quoiqu’elles incarnent des déesses tantriques, les Mātajī sont loin d’adopter des
positions transgressives. Elles contribuent plutôt à renforcer le système social. Elles ont
aussi tendance, même si elles incarnent un des aspects de la présence du passé dans le
présent, à appuyer de leur autorité l’évolution ‘brahmanisante’ que connaît
actuellement l’hindouisme : condamnant les sacrifices sanglants, prônant le
végétarianisme.
11 Dans ses remarques finales, H. Basu revient sur les points importants de son travail,
qu’ils concernent ce qui peut subsister du rôle rituel du roi, l’évolution moderne de la
caste dans l’Inde d’aujourd’hui, le rôle des déesses ou plus généralement de la femme
dans le monde hindou : chacun de ces points, et d’autres encore, mériteraient d’être
repris ici, ce qui n’est toutefois pas possible dans le cadre d’une recension.
12
13 Il reste que ce travail ambitieux, philosophiquement très étudié, apporte une approche
nouvelle et féconde à l’anthropologie de l’Inde. Il est d’un intérêt exceptionnel. Il ouvre
des perspectives nouvelles. On ne saurait trop en recommander la lecture – même si
celle-ci n’est pas facile : une traduction anglaise est à souhaiter, qui le rendrait
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
95
accessible à davantage de lecteurs et lui donnerait l’audience et le retentissement qu’il
mérite.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
96
Edith L. Blumhofer, Religion, Politics
and the American Experience
Tulcaloosa, (Al.), The University of Alabama Press, 2002, 147 p.
Isabelle Richet
1 Le rôle public de la religion aux États-Unis est à la fois objet d'étude et objet de débat et
les nombreux ouvrages qui y sont consacrés ne distinguent pas toujours ces deux
dimensions, mêlant analyses et prises de position normatives, d'autant plus aisément
que les auteurs sont souvent à la fois des chercheurs et des acteurs du débat qu'ils
étudient. On en a un bon exemple avec ce petit ouvrage issu d'un projet d'étude de la
Divinity School de l'université de Chicago sur la « religion publique ». Les textes
rassemblés abordent huit thèmes : religion et démocratie, l'influence du contexte sur
l'engagement politique de la religion, l'évolution historique du principe de séparation,
les responsables politiques et la religion publique, les rapports entre religion et médias,
les congrégations comme creuset de la vie civique, les évangéliques et la politique dans
le passé et le présent, la contribution de la « théologie publique » au débat civique.
Comme c'est souvent le cas dans ce type d'ouvrage, les contributions sont inégales et
l'ensemble manque de cohérence, mais certaines études apportent des éclairages
intéressants sur l'articulation entre recherche et débat. Laura Olson, faisant le point sur
une vingtaine d'années de recherche, tente d'expliquer le décalage entre la grande
sophistication atteinte par les méthodes quantitatives et les enquêtes descriptives et le
petit nombre des modèles interprétatifs permettant de comprendre le pourquoi et le
comment de l'interaction entre religion et politique. Selon elle, trois éléments
expliquent ce décalage : les chercheurs ont une approche ecclésiastique de la religion,
ils concentrent leurs travaux sur les élites et embrassent leurs conceptions absolutistes
des « valeurs » religieuses qui mènent au modèle simpliste des « guerres culturelles ».
Or une telle approche ne permet pas de rendre compte des différences politiques au
sein même des traditions religieuses, et souligne la nécessité de porter attention à
l'importance des contextes qui mènent certains groupes religieux à s'engager dans
l'arène politique et qui déterminent les positions qu'ils y défendent. Le texte de Mark
Noll, fait en partie écho à ces remarques en discutant les limites du terme
« évangélique », défini à partir d'un certain nombre de croyances, pour faire sens de
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
97
l'engagement politique de certains courants religieux au cours des récentes décennies,
tant il est vrai que ceux qui adhèrent aux « croyances » évangéliques se retrouvent
souvent dans des camps opposés sur un grand nombre de questions (l'exemple le plus
frappant étant bien sûr celui des évangéliques blancs et des évangéliques noirs). Lui
aussi attire l'attention sur le contexte en soulignant que, au-delà des croyances, c'est
l'insertion au sein de groupes religieux conservateurs et la perception par ceux-ci
d'une remise en cause de leur mode de vie traditionnel par le gouvernement fédéral qui
ont motivé l'engagement politique des évangéliques blancs du Sud. Après cette
incursion dans le présent, l'historien de Wheaton cherche à éclairer la position actuelle
des évangéliques en la reliant à leur lecture de l'histoire des relations entre religion et
politique aux États-Unis, qui nourrit leur conviction que ces derniers, fondés comme
une nation chrétienne, ont été récemment détournés de cette tradition par des élites
laïques. Il rappelle que les principes des textes fondateurs ne s'inspirent en rien de la
religion qui leur est chère et que la Constitution est en fait ce qui se rapproche le plus
d'un texte laïque. Par contre, il leur donne raison lorsqu'ils expliquent que les pères
fondateurs pensaient que les Églises pouvaient contribuer à façonner les valeurs
morales nécessaires au bon fonctionnement du système républicain. Mais elles devaient
le faire par leur action propre, indépendamment du gouvernement. Dans ce sens,
conclut-il, les campagnes actuelles des chrétiens conservateurs visant à légiférer leur
moralité sont en rupture avec la vision des pères fondateurs. Et d'avertir ses
coreligionnaires, comme il l'a déjà fait dans d'autres ouvrages, du danger de
l'identification des croyances religieuses à des positions politiques particulières, en
rappelant comment cette tendance a contribué à la division du pays lors de la guerre
civile et au déclin de l'hégémonie culturelle du protestantisme évangélique lui-même.
Edward L. Queen s'intéresse, pour sa part, à la façon dont les institutions religieuses
locales (congrégations, associations bénévoles) contribuent à la formation des valeurs
civiques et fonctionnent comme des « écoles de citoyenneté ». C'est là un thème
important à l'heure où tous les observateurs s'alarment du fort déclin du « capital
social » et de la participation citoyenne des Américains. Comment réconcilier ce
constat plutôt pessimiste et l'analyse de l'auteur qui valorise fortement le rôle des
congrégations en affirmant, peut-être avec quelque exagération, que ce sont les lieux
« où la plus grande partie de la vie politique des Américains se déroule » (p. 95) ? Il
fournit des éléments de réponse en montrant comment, en devenant des « enclaves de
mode de vie » – pour reprendre l'expression de Robert Bellah – de plus en plus
homogènes, les congrégations ne peuvent plus jouer leur rôle civique en formant leurs
membres au débat démocratique car celui-ci implique la confrontation d'idées avec des
gens qui pensent et agissent différemment. Or l'évolution actuelle ne le rend guère
optimiste, alors que les congrégations elles-mêmes se fragmentent en petits groupes
d'individus aux préoccupations et problèmes identiques qui trouvent là le plus souvent
un refuge et non le souhait de s'engager dans la société environnante. Si ces tendances
s'accentuaient, au lieu de contribuer à la revitalisation du débat civique et de l'action
citoyenne, les congrégations pourraient bien contribuer elles aussi à leur dégradation
ultérieure. E. L. Queen souligne donc lui aussi l'importance des contextes concrets où se
tissent les relations entre religion et politique et c'est là une approche bien plus
fructueuse que la répétition de quelques généralisations abstraites que l'on peut
trouver dans d'autres études.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
98
Roland J. Campiche, Les deux visages
de la religion
(avec la collaboration de R. Broquet, A. Dubach et J. Stolz). Genève, Labor
et Fides, 2004, 283 p.
Enzo Pace
1 Au sein d'une équipe reconnue de chercheurs de l'Université de Lausanne, Campiche
lançait en 1989 le premier grand sondage national sur la religiosité des Suisses.
L'enquête avait été alors saluée comme une importante contribution scientifique. La
société helvétique, en raison de sa nature pluraliste que ce soit pour l'organisation de
ses institutions que pour sa composition socioreligieuse (protestante et catholique),
pouvait constituer le terrain idéal pour mesurer si et jusqu'à quel point les théories de
l'individualisation de la religion étaient en mesure d'interpréter les changements
éventuellement intervenus.
2 Dix ans après, Campiche reprend le canevas déjà utilisé lors de son enquête précédente
pour vérifier si les conclusions auxquelles il était arrivé en 1989 – à savoir une forte
poussée vers l'individualisation du croire et l'affaiblissement des frontières entre les
deux principales confessions religieuses – doivent être revues ou intégrées.
Généralement, l'utilité d'une recherche longitudinale (panel) repose sur le fait qu'à
travers elle, on tente de souligner le mouvement dans le temps des attitudes, des valeurs
et des comportements qui, sinon, seraient froidement cloués sur les tableaux de la
contingence des enquêtes ponctuelles et circonscrites dans une période et un espace
déterminés. La sociologie de la religion a toujours dû se confronter à la difficulté de
réfléchir sur un objet (la religion) qui, sous bien des aspects, s'apparente aux archives
de la mémoire collective (tout en restant répertoire de sentiments et d'actions
individuelles), en se servant d'instruments (questionnaires standardisés et techniques
de régression statistique) qui ont tendance à ne sélectionner au sein de ces archives
idéales que quelques documents, ceux qui sont habituellement plus faciles à observer et
à traduire en variables ou en corrélation entre variables. Le mérite de cette nouvelle
recherche, dont l'auteur présente les principaux résultats dans six chapitres denses
(tandis que les données détaillées sont reportées dans les annexes à la fin du volume)
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
99
consiste dans le choix de procéder par essais et erreurs, une méthode souvent utilisée par
nos collègues suisses.
3 Si, dans la première recherche, la théorie de l'individualisation de la religion constituait
en effet la grille d'interprétation la mieux adaptée pour déchiffrer les résultats d'une
enquête empirique, dans la seconde, cette approche théorique est dénaturée sur
plusieurs points et il faut alors se tourner vers d'autres directions pour mieux
comprendre la complexité et l'ambivalence d'un phénomène socioreligieux comme
celui qui émerge de cette enquête en territoire helvétique à la fin du second millénaire.
4 Dans le premier chapitre, R. J. Campiche propose donc d'intégrer la notion
d'individualisation du croire avec le concept de la dualisation de la religion. Pour l'auteur,
cette notion peut servir à rendre compte de l'écart croissant entre religion
institutionnelle d'un côté et affirmation d'une autonomie du croire, individuelle et
privatisée de l'autre ; un écart que les sujets interviewés semblent toutefois en mesure
de franchir en maintenant ensemble deux aspects qui, d'un point de vue abstrait,
pourraient sembler en contradiction l'un avec l'autre. La religion, même lorsqu'elle
tend dans la modernité tardive à s'individualiser, reste de toute façon une affaire sociale
capable de produire un lien social, du moment que, comme le montrent d'ailleurs les
données de la recherche, les Suisses, tout en se mettant à leur compte en matière de religion,
conservent certains liens avec leur religion de naissance (qu'il s'agisse d'un sentiment
d'attachement pour leur propre paroisse ou communauté religieuse ou d'une fidélité
pour certains rites de passage, du consensus diffus sur le rôle éducatif des Églises ou de
cette volonté persistante de s'auto-représenter comme appartenant en majorité aux
deux Églises historiques – protestante ou catholique).
5 Dans le second chapitre, écrit par Jörg Stolz, est exposée de manière brillante la
méthode par essais et erreurs citée précédemment. Stolz, en effet, passe en revue les
principaux modèles d'interprétation présents sur le marché scientifique (de la théorie
structurale-fonctionnelle au rational choice) en indiquant à chaque fois, à la lumière des
données combien ils sont dénaturés. La conclusion à laquelle parvient notre collègue de
Lausanne est que la théorie orthodoxe de la sécularisation – intégrée à l'analyse
classique des variables sociostructurales – semble beaucoup mieux adaptée que la
théorie des biens religieux pour expliquer les comportements des Suisses en matière de
religion.
6 Les chapitres qui suivent de R. J. Campiche et de A. Dubach (chap. 4 : sur les types
d'appartenance à l'Église) sont une véritable mine de données et offrent des indications
méthodologiques précieuses à celui qui voudrait se lancer dans un sondage et pour
vaincre les difficultés bien connues liées à la standardisation des données et à
l'application de traitements statistiques particulièrement efficaces et puissants dans la
découverte des dimensions cachées au sein d'un échantillon représentatif. Je fais ici
allusion à l'analyse factorielle (p. 93-97) sur l'évolution des croyances (1989/1999) à
travers laquelle il est facile de donner une idée de la pluralité des formes du croire : des
croyances chrétiennes au sens propre (qui enregistrent un léger retrait) aux croyances
non chrétiennes en l'au-delà (qui sont en revanche en légère augmentation), des
croyances humanistes-religieuses (elles aussi légèrement en hausse) à la croyance en
des formes surnaturelles plus génériques (la substance inchangée), de l'optimisme (foi
en la science nettement en hausse ces dix dernières années) à la conception hédoniste
(elle aussi en forte augmentation). Cette analyse est aussi convaincante qu'efficace
lorsqu'il s'agit de décrire la fragmentation croissante des choix individuels en matière
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
100
de religion. Elle se fonde sur la cluster analysis finalisée par la construction de types-
idéaux de croyants, entre les non-croyants qui augmentent et les chrétiens exclusifs qui
au contraire perdent poids de manière importante et qui sont en partie compensés par
les chrétiens inclusifs. Entre les deux, il y a une catégorie importante de chrétiens qui ne
font pas directement référence au christianisme (en hausse) ou dont les points de
référence se sont affaiblis, les tièdes (en diminution). L'intérêt de cette méthode réside
justement dans le fait que le type-idéal de chrétien inclusif a cette tendance
caractéristique « à combiner le christianisme avec d'autres traditions religieuses ». Si
nous les additionnons sous forme de pourcentages avec les tièdes, presque un Suisse
sur deux aujourd'hui semble se croire sous des formes autonomes, sans pour autant
vouloir vraiment se débrancher de la matrice de valeurs et de symboles que la tradition
chrétienne, dans ses variantes historiques protestantes et catholiques, continue à
alimenter de manière diffuse dans la conscience collective. Le chapitre soigné par
Dubach le confirme avec son habituelle finesse analytique lorsqu'il souligne, bien à
propos, que « la comparaison des résultats de l'enquête de 1999 avec ceux de 1989 fait
apparaître que les types d'appartenance se maintiennent et que leurs pourcentages
dans la population n'ont guère changé. Les résultats n'amènent ni à diagnostiquer une
nette augmentation de la prise de distance à l'égard des Églises ni à conclure au
développement d'une religion individuelle » (p. 175).
7 R. J. Campiche et son équipe, face au rébus de la croissance actuelle d'autonomie du
croire de la part des individus et le maintien des liens d'appartenance aux Églises
institutionnelles que l'enquête suisse fait apparaître, finissent par souligner que la
solution doit être recherchée au moyen d'un instrument d'analyse qui serait par
définition complexe, c'est-à-dire en mesure de contrôler au moins deux variables : la
croyance et l'appartenance, en partant de cette constatation que les deux dimensions
n'apparaissent pas très dissociées, comme elles le sont en revanche dans d'autres
contextes européens (en Grande-Bretagne, par exemple, décrite par Grace Davie, à
plusieurs reprises, dans ses travaux les plus récents). En d'autres termes, la notion de
dualisation fait allusion – outre peut-être aux intentions explicites que Campiche révèle
dans les pages conclusives du livre (p. 270-272) – à la nécessité pour les sociologues de
la religion de se libérer du paradigme cause-effet dans l'étude des phénomènes
socioreligieux. Pourquoi alors ne pas adopter complètement le point de vue de la
complexité, c'est-à-dire de la coexistence nécessaire entre un système de croyance,
historiquement constitué d'un côté, et de l'autre, un milieu socioreligieux, par
définition, multiple, caractérisé par des degrés de liberté individuelle, qui ne sont pas
complètement réductibles, ni même par un système ? C'est ce qui permettrait
probablement de considérer structural et non contingent le fait que les croyances
obligatoires, pour reprendre le langage de Durkheim, élaborées par une institution
religieuse qui s'efforce de les inculquer (comme habitus et styles de vie et pas
seulement en termes gnoséologiques) doivent interagir continuellement avec la
variabilité fondamentalement irréductible des croyances facultatives, pour reprendre
encore un célèbre passage de l'article de Durkheim, Pour une définition des phénomènes
religieux de 1898.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
101
Yvonne P. Chireau, Black Magic.
Religion and the African American
Conjuring Tradition
Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 2003, 222 p.
Véronique Duchesne
1 Yvonne Chireau, maître de conférences à Swarthmore College aux États-Unis, signe
son second ouvrage consacré à la religion des Africains américains (plus communément
appelés Afro-américains dans la littérature française), publié avec le concours de la
Fondation George Gund. Cette fois, elle apporte un éclairage historique tout à fait
original sur la culture religieuse noire américaine de la période de l'esclavage jusqu'au
XXe siècle. Son titre avec toute l'ambiguïté qu'il véhicule – Black Magic, magie noire ou
magie des Noirs – est très suggestif de son propos. L'auteure a en effet choisi d'étudier
l'origine, le sens et les usages d'une tradition noire américaine appelée conjuring
tradition, dont la traduction par « illusionnisme » en français n'est absolument pas
satisfaisante. Dans l'histoire des Africains américains, le mot conjuring implique le
recours à une pratique magique dans laquelle un pouvoir spirituel est invoqué pour
obtenir guérison ou protection. Ceux qui la pratiquent, appelés conjurer ou encore
conjuring doctor (parfois même simplement doctor) sont des devins, voyants, guérisseurs,
spécialistes du surnaturel.
2 Les sources sollicitées pour cette étude sont des documents de première et de seconde
main : récits autobiographiques d'esclaves ou descendants d'esclaves et textes du
folklore noir américain. En cela, la démarche est tout à fait originale : des documents
négligés jusqu'alors parce que considérés par les universitaires comme relevant du
folklore servent de base à l'analyse. Ce parti pris de rendre compte de façon centrale du
point de vue des Africains américains est également perceptible dans les titres des
différents chapitres de l'ouvrage, qui reprennent des expressions orales en langue
vernaculaire, tout à fait parlantes : « Our Religion and Superstition Was All Mixed Up »
(chap. 1), « Africa Was a Land a “Magic Power Since de Beginnin” a History » (chap. 2),
« Folks Can Do Yuh Lots of Harm » (chap. 3), « Medical Doctors can't Do You No Good »
(chap. 4), « We All believed in Hoodoo » (chap. 5). Soulignons qu'une iconographie
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
102
particulièrement intéressante (couvertures d'ouvrages et de prospectus d'époque)
agrémente agréablement le livre. Elle n'est malheureusement pas suffisamment
exploitée dans le texte.
3 L'auteure réfute le point de vue de la plupart des études académiques portant sur la
religion des Africains américains qui opposent les traditions « chrétiennes » aux
traditions « non chrétiennes » sans s'intéresser aux relations entre les deux. Le
surnaturel n'est pas ici envisagé comme un domaine marginal de la religion africaine
américaine. La magie tient en effet une place centrale dans la religion africaine
américaine – la religion étant considérée alors dans un sens large de « religion
vivante » (en référence à David Hall) comprenant des activités non institutionnalisées.
Magie et religion sont alors appréhendées comme deux éléments d'un même système
culturel. Ne pouvant séparer les pratiques religieuses des pratiques magiques, l'auteure
suggère de les regrouper sous l'appellation « actes et croyances magicoreligieux ».
4 Précisons qu'avant le XIXe siècle, le terme « Conjurer » faisait référence aux magiciens
ambulants et était aussi utilisé pour désigner les esclaves, plutôt des hommes, reconnus
comme ayant des pouvoirs surnaturels. À partir du XIXe siècle, les mots Hoodoos et
Rootworkers sont plus communément utilisés pour désigner les personnes qui
manipulent des forces invisibles ou qui « travaillent avec les esprits ». En Louisiane et
au Mississipi, les conjurers noirs étaient encore appelés Voodoos. Voodooism est employé
aux États-Unis pour qualifier toute pratique supposée originaire d'Afrique et faisant
intervenir le surnaturel.
5 Durant la période de l'esclavage, les pratiques magico-religieuses ont été utilisées
comme des stratégies de résistance par les esclaves. Cela ressort particulièrement des
différentes biographies présentées. D'une manière générale, les esclaves chefs de
rébellion étaient tous reconnus comme ayant des dons de vision. Plusieurs étaient aussi
des hommes d'Église ayant fusionné chrétienté et surnaturel pour mener des
insurrections. Autre point intéressant, la croyance dans le pouvoir des praticiens
magico-religieux noirs transcendait les frontières raciales : Américains noirs et blancs
partageaient les mêmes croyances et avaient recours aux mêmes pratiques. Celles-ci
étant d'ailleurs composées à la fois d'éléments africains, européens et américains. Le
christianisme et les croyances et pratiques magiques apparaissent comme ayant
toujours été étroitement mêlés.
6 Pour les générations suivantes, les pratiques dites surnaturelles, considérées comme
venant d'Afrique, ont été fortement associées aux Africains. L'histoire de ces pratiques
renvoie finalement à la mémoire de la relation de la spiritualité noire américaine avec à
la fois son passé africain et son présent américain. L'auteure réfute le lien avec une
origine africaine essentialisée et parle de « lignage hybride constamment recréé ». Elle
développe également le paradoxe associé aux pratiques magico-religieuses africaines
américaines (conjuring) : celles-ci peuvent faire du bien ou faire du mal, à la fois soigner
ou nuire.
7 Y. P. Chireau souligne fort justement dans sa conclusion que les traditions faisant appel
au surnaturel perdurent dans l'Amérique contemporaine et que la magie africaine
américaine reste présente dans nombre de manifestations (rituelles ou artistiques) sans
que l'on en connaisse toujours l'origine et l'histoire. Les traditions surnaturelles
africaines américaines doivent donc être comprises en tant que production dynamique
de la spiritualité noire dans son contexte social. Et la diversité de ces pratiques et
croyances devrait inciter à repenser les catégories utilisées pour étudier aujourd'hui la
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
103
religion aux États-Unis. Le surnaturel (ou magico-religieux) ne doit plus être étudié
comme un domaine à part mais doit être situé plutôt de façon centrale au niveau social
et culturel.
8 Ce livre éclaire véritablement un domaine mal compris par les chercheurs et le grand
public. Sa lecture est indispensable à tous ceux qui travaillent sur la religion des
Américains (Noirs ou Blancs) aux États-Unis. On peut préciser que l'auteure est elle-
même africaine américaine (ceci n'est pas du tout mis en avant, seul le portrait
photographique à la fin du livre nous le révèle). Une faiblesse tout de même : la
distinction magie/religion posée dès l'introduction comme étant problématique n'est
pas traitée de façon frontale. Cette question théorique qui a fait couler beaucoup
d'encre en anthropologie religieuse méritait pourtant d'être reposée ici
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
104
Élisabeth Claverie, Les guerres de la
Vierge ; une anthropologie des
apparitions
Paris, Gallimard, 2003, 452 p.
Nicolas de Bremond d’Ars
1 Élisabeth Claverie publie dans cet ouvrage une enquête fouillée et passionnante sur les
apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, et sur les
mouvements de pèlerinages qui lui sont associés. C'est dire combien l'ouvrage permet
d'interroger à la fois un objet – les apparitions récurrentes d'un personnage sacré, la
Vierge – et une série d'objets qui lui sont consubstantiels : les voyants eux-mêmes, les
pèlerins qui accréditent l'existence de l'objet, le contexte socio-historique en tant que
condition de possibilité, et enfin la théologie propre à la Vierge en tant que condition
de véridiction interne au groupe de pèlerins.
2 Ces apparitions ont commencé en juin 1981, se sont poursuivies pendant la guerre dans
l'ancienne Yougoslavie, et durent encore à ce jour. Quelques adolescents d'un village de
Bosnie-Herzégovine ont une apparition de la « Gospa », la Vierge, sur une colline
proche. Cette portion de territoire est confiée depuis des siècles aux franciscains par
l'évêque du lieu. La mobilisation provoquée par l'événement (récurrent) met en branle
les habitants (certains y croient, d'autres pas), l'administration ecclésiastique dont les
conflits internes s'exacerbent (l'évêque contre les franciscains de la province, ces
derniers contre leur généralat), les autorités politiques communistes, qui voient
resurgir les conflits nationalistes mis sous le boisseau par Tito (Croates contre Serbes,
musulmans), et crée un vaste réseau international de dévotion constitué largement au-
delà des problématiques théologiques et socio-historiques locales. La guerre de
Yougoslavie intervient sans interrompre les pratiques pèlerines, et l'Église catholique
maintient une position de retrait à l'égard de ce qui apparaît comme un plébiscite : en
2004, les apparitions ne sont toujours pas reconnues officiellement.
3 Le livre est construit en trois parties : épreuves dévotionnelles, épreuves d'apparition,
épreuves [théologiques] : faire à Dieu une mère.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
105
4 Dans le premier temps, les pèlerins constituent l'objet-construisant-l'objet : l'auteure
souligne la puissance de l'objet « Vierge » dès lors qu'il est pris dans le discours des
pèlerins. La Gospa des jeunes voyants devient « elle », sorte de nœud inquestionnable
qui réorganise l'être croyant des pèlerins. La transformation des plaintes avec
lesquelles arrivent les pèlerins est un effet dévotionnel qui est produit par une mise en
sens des histoires personnelles : « Dans les descriptions qu'en font les pèlerins de façon
récurrente [...], ce monde-ci, à la fois familier et impuissant à réagir, est vu comme celui
des destins inexorables, des causalités fermées. C'est de ce monde-là que l'avion va
bientôt les couper [...] Par l'emploi du terme “elle”, ils ouvrent une brèche dans ce bon
sens » (p. 58). Un monde d'intermédiaires, parfois en concurrence, contribue à
l'édification d'un système de preuves interne au groupe croyant. Il voit transiter des
objets dévotionnels et des récits, permet aux croyants de parcourir un espace rituel
(par les routines de déplacement) qui élabore une topographie sacrée. É. Claverie.
choisit ici un parcours de participant qui rend compte de cette construction
progressive.
5 L'histoire des apparitions et le contexte de leur émergence constituent alors le second
moment de l'enquête. L'auteure s'attache particulièrement aux discours portés sur
l'objet (discours des voyants, des ecclésiastiques) au cours de la mise en procès par les
différentes autorités. L'histoire locale n'est pas négligée, qui fait la part des rancunes
ancestrales entre villages, entre ethnies et religions. Nous apprenons que la
topographie tient une place non négligeable – cimetières, charniers consécutifs à des
massacres (bonne note sur les fantômes des massacres, p. 211 ss), etc. – et que la
négociation/bras de fer entre l'Église et le Parti va conduire à déplacer le lieu de
l'apparition : à la colline incontrôlable se substitue l'église paroissiale (p. 188-194), dans
une violence symbolique et physique forte. Notons au passage que le géographique
occupe une place essentielle dans l'ensemble de l'affaire, puisque le conflit entre les
franciscains et l'évêque prend sa source dans l'organisation du territoire diocésain,
partagé entre eux, et que Medjugorje est presque au centre des territoires contestés
entre Croates, Serbes et Bosniaques musulmans, en zone frontière (carte p. 431). Au
final, on peut affirmer que l'objet « apparition » s'est dédoublé en : apparition –
voyants – histoire d'un pays. L'auteure a délibérément adopté un point de vue
épistémologique, tant il est vrai que le mystère de l'objet devient le mystère de ceux qui
le construisent. On ne s'étonnera donc pas du recours approfondi aux philosophies du
langage, et d'une interrogation sur le statut du chercheur, soumis à une redoutable
critique épistémologique. Dans la mesure où l'objet premier : « les apparitions », est par
définition réservé à des voyants, il est inaccessible au chercheur comme au pèlerin.
Mais le pèlerin « y croit », et donne donc un accès médiatisé au chercheur. La croyance
en devient un objet second. Cependant, le chercheur ne peut manquer d'étudier la
contradiction apportée par les autorités ecclésiales, qui refusent de valider l'objet
premier – sans toutefois mettre en doute la qualité de l'objet second. Un effet
d'autovalidation produite par l'effet dévotionnel intervient alors : une boucle est mise en
place, validée par les autorités ecclésiales au nom de l'effet, et pas au nom de la cause.
6 D'où la troisième partie de l'enquête autour de la position ecclésiale. Comment s'est
construit l'objet dévotionnel d'un point de vue théologique ? L'auteure livre ici le fruit
de longues études auprès de spécialistes de la patristique, qui fera date pour ceux qui
auront à faire aux apparitions nombreuses de la Vierge. Ce dossier solidement étayé de
la théologie catholique devrait être utile pendant longtemps.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
106
7 En finale, l'auteure s'interroge sur le statut scientifique du type de recherches
anthropologiques menées : quel rapport le chercheur doit-il entretenir avec l'objet
premier, inaccessible et pourtant constamment présent ? Doit-il se limiter au
pèlerinage, l'objet second, au risque de manquer l'étude sur ce qui le met en branle ?
Belles questions...
8 À la suite de cette lecture surgissent des interrogations, qui n'infirment pas la qualité
du travail, mais pourraient peut-être faire l'objet de recherches complémentaires.
9 Première série de questionnements. Sur le statut du chercheur, on comprend bien
l'impasse produite par les contradictions internes de ce type d'objet dévotionnel.
L'étude de la théologie, donc des critères internes de validation, vise à dépasser
l'impasse épistémologique démasquée par É. Claverie. Il serait possible de prolonger ce
qui est ici largement amorcé : quel statut le chercheur en sciences sociales doit-il
accorder à la théologie ? Trouver les critères internes pourrait s'accompagner d'un
regard critique, portant notamment sur la pertinence sociale de la régulation
théologique. Lors de l'élaboration des données théologiques, qui ont produit un corpus
normatif, des enjeux sociaux et sociétaux étaient présents. Citons, par exemple, la
régulation de la vie sociale par la figuration mariale de l'Institution : Vierge Marie et
Église entretiennent, dans la pensée chrétienne, des rapports étroits, à la fois de
distanciation (les perfections de la Vierge ne se retrouvent pas intégralement dans
l'Église terrestre) et de proximité (comme la Vierge, l'Église est une Mère « chaste et
pleine de pudeur »). Dans le cas de Medjugorje, on pourrait chercher en quoi la
négociation pour que la Vierge « descende » dans l'église paroissiale est un parallèle de
la négociation, plus diffuse, pour que l'Église change son rapport avec le Parti (p. 192).
Ou encore : quel est le statut du curé dans sa dimension politique (p. 179) ? En
poursuivant dans cette direction, il faudrait interroger la place de l'apparition dans la
lutte que se livrent franciscains et Église diocésaine, avec en ligne de mire la
recomposition de la place de l'Église face au politique et à l'économique. Pour le dire
autrement : n'y a-t-il pas une fonction « kairotique » de l'apparition, qui serait de
favoriser un déplacement décisif du religieux dans l'espace politique, et, par là, de
produire une remise en jeu des acteurs sociaux dans une situation de blocage sociétal ?
Auquel cas, les pèlerins ne seraient-ils pas l'acteur imprévu, pratique, concret, qui
obligerait à cette recomposition en s'introduisant dans un jeu bloqué ?
10 Toujours à partir de la place délicate de la théologie, il me semble qu'on pourrait
chercher à comprendre – mais cela dépasse largement l'objet du livre – les conflits
internes à l'Église catholique à partir de cette production d'images nouvelles. Comme si
une construction théologique majoritairement centrée sur la figure (masculine) du
Christ était réinterrogée par une figure féminine. Cela a déjà été largement le cas par le
passé, et la canonicité de la représentation est l'aboutissement de ces conflits : une
vierge ne peut pas être représentée sans son fils (la statue de Lourdes a été refusée par
sainte Bernadette – voir Documents authentiques – parce qu'elle ne portait pas
d'enfant). Dans Les Guerres de la Vierge, nous avons une discussion sur la représentation :
p. 110, elle a un enfant (un bébé ?) ; p. 115, elle n'a pas de pieds mais elle est entourée
d'étoiles ; p.118, elle n'a pas d'enfant.
11 En troisième lieu, il apparaît qu'une partie de l'événement religieux peut être
appréhendée dans son cousinage avec deux grandes pistes du religieux : le rapport à la
sorcellerie et le rapport à l'ésotérisme. L'auteure montre clairement que la demande
produisant le pèlerinage est liée à un rapport au mal. L'itinéraire valide (authentique),
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
107
comprenant ces papiers de prière remis à un voyant, parfois brûlés pour, en quelque
sorte, faire « sortir » le mal, ressemble à un itinéraire d'exorcisme. S'il est question de
sortir du quotidien, il est aussi question d'éloigner le mal tel qu'il fait partie de
l'expérience d'un monde clos. En ce cas, le pèlerinage s'apparenterait à une mise en
musique ecclésialement crédible de la demande d'exorcisme.
12 Ce que viendrait confirmer la dimension ésotérique de l'affaire Medjugorje. Les voyants
savent, ils « voient », mais une série de personnages, note l'auteure, ont aussi qualité
pour déterminer ce qui est juste. Des intermédiaires – les initiés – « savent » ce qu'il
convient de faire, connaissent des processus. On leur fait confiance, d'autant plus que le
pèlerinage, non reconnu par l'Église, a besoin d'une procédure de validation. On
pourrait se demander si le pèlerinage ne marche pas également parce que non reconnu :
il permettrait de socialiser une demande d'ésotérisme, toujours repoussée offi-
ciellement par l'Église catholique.
13 Au sortir du livre, on est habité par un petit frisson de perplexité, qui devrait ouvrir sur
de nouvelles études : finalement, qu'est-ce que le divin ? Les Guerres de la Vierge est en
tous points un livre majeur pour manifester les ambiguïtés du soupçon. Qu'Élisabeth
Claverie en soit remerciée.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
108
Christèle Dedebant, Le voile et la
bannière. L'avant-garde féministe au
Pakistan
Paris, CNRS éditions, 2003, 388 p. (coll. « Monde Indien Sciences
Sociales »)
Luc Bellon
1 Alors que l'Inde a pu faire l'objet d'une littérature abondante, les écrits en sciences
sociales ayant le Pakistan pour objet sont plus rares. Voici donc un ouvrage qui lève
littéralement le voile sur une réalité peu connue (peut-être même peu soupçonnée) : le
mouvement féministe pakistanais. Par une érudition remarquable, l'auteure retrace la
gestation d'un mouvement polymorphe, suivant pas à pas celle d'un pays nouveau ; un
rapport dialectique lumineux entre l'évolution des revendications féministes et les
façonnements successifs d'un État.
2 Cette dialectique est d'autant plus aisée que « l'avant-garde » dont il est question est
principalement composée d'une élite dont les membres appartiennent soit à une
bourgeoisie montante « éclairée », soit à la « société des Ashrâf » (p. 37 et ss), c'est-à-
dire issue de (ou assimilée aux) lignages musulmans prestigieux du sous-continent
indien. Garante d'une morale – dont les règles de comportement édictées par l'adab
(bienséance) font partie des prérogatives principales (p. 39 ; 212) – et liée de près aux
instances de pouvoir, elle est idéalement placée pour mener une bataille intellectuelle,
politique ou idéologique. Prenant le contre-pied des « Subaltern Studies » – dont les
avancées notoires sont néanmoins saluées (p. 11) – l'auteure s'engage à décrire la
constitution « par le haut » d'une revendication sociale d'un genre particulier.
3 Le mouvement féminin ou féministe se serait développé suivant trois grandes lignes
directives successives. Avant les années 1920-1930, les avocats de la cause féminine se
sont positionnés contre les critiques des prosélytes chrétiens qui fustigeaient le
traitement réservé au sexe faible comme un signe d'archaïsme de la société indigène.
Bien que minoritaires, les zélateurs de la cause féminine ont voulu réifier les préceptes
moraux et religieux existants, les mœurs et les pratiques conformes aux prescriptions
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
109
du ‘ibadat (culte) et des règles de l'adab. Loin de vouloir aménager une place nouvelle à
la gente féminine, il s'agissait de réaffirmer et de revaloriser celle qui leur était déjà
faite. L'accès à l'éducation, en aucun cas interdit par la religion musulmane, en était
l'une des revendications principales. Mouvement minoritaire, il allait se structurer en
association dont les fers de lance étaient la All-India Muslim Ladies' Conference, fondée à
Aligarh en 1914, la Women's Indian Association, née en 1917 et la All-India Women's
Conference de 1927 (p. 76-80).
4 C'est à partir des années trente que le mouvement se fragmente et se politise. Tel est le
cas, par exemple, de l'Anjman-i Khawateen-i Islam, branche de la All-India Muslim Ladies'
Conference : au départ vitrine du Mouvement d'Aligarh au Punjab, elle devient une
branche féminine de la Ligue musulmane dès 1935 et milite pour la création du
Pakistan (p. 81). Droit des femmes et droit des musulmans se rejoignent alors dans un
même combat. C'est sur la base d'un islam « égalitaire » que la cause féministe participe
à l'élaboration des contours d'un nouveau projet de société (p. 90 ss ; p. 109). C'est
autour de la Ligue musulmane, Mohammad Ali Jinnah en tête, que s'est fédérée une
nébuleuse de forces réformatrices. Mais si l'islam était le ferment initial de cette union,
il en devint vite un facteur de désolidarisation. Les divergences d'interprétation sont en
effet pléthoriques et se transforment en points de tension.
5 Il faut souligner que le « féminisme » du sous-continent se fonde sur une lutte qui est
d'abord juridico-légale (p. 184). Qu'il s'agisse d'une cause ou d'une conséquence de la
prégnance d'une certaine élite, la réforme sociale et la prise en considération des
situations et vexations quotidiennes ne sont devenues une base de revendication que
plus tard. Ce débat légal mettait en scène une opposition majeure entre les juristes
nantis d'une éducation forgée sur le modèle anglo-saxon d'un côté, et les oulémas
spécialistes du droit islamique et, au départ, du droit familial de l'autre (p. 107).
L'immuabilité de la loi islamique est pourtant entérinée par le Shariat Application Act
(1937), et le Muslim Dissolution of Mariages Act (1939). Le domaine « personnel » est
définitivement intégré au « politique » depuis le Muslim Family Law Ordinance de 1961
(p. 113-117). Dans leur combat contre les « coutumes » qui leur sont défavorables, les
avocat(e)s de la condition féminine y souscrivent pleinement ; jusqu'à ce que la
situation ne se renverse (p. 286) et entame un divorce avec les rouages de l'État.
6 Le point de contentieux le plus flagrant est l'apparition, sous le régime du dictateur
militaire Zia ul-Haq (1977-1988), des très controversées Ordonnances Hudood (1977).
Celles-ci couvrent un ensemble de crimes et châtiments expressément définis par le
Coran et la Sunna tels le vol, le viol, la fornication, l'adultère, le mensonge, etc.
(p. 141-147). Alors que l'époque tumultueuse de Zulfikar Ali Bhutto entretenait, en
dépit des évidences, l'espoir d'une « modernisation » et d'une « laïcisation » de l'État
(p. 121-132), Zia avait officiellement opté pour une islamisation radicale. En réaction,
les mouvements féministes se sont détachés du pouvoir pour investir la vaste scène des
Organisations Non Gouvernementales (ONG). D'après l'auteure, la radicalisation de
l'État aura renforcé ces mouvements, au lieu de les affaiblir. La confrontation explicite
au choix idéologique dominant leur aura permis de s'affranchir, quelque peu, des
contradictions inhérentes à l'aménagement de la place des femmes au sein d'un islam
politisé. Les « activistes des droits des femmes, les champions de la démocratie et/ou
les défenseurs de la laïcité » auraient véritablement connu « l'état de grâce –
mobilisateur et solidaire – durant le régime ouvertement adverse de Zia ul-Haq »
(p. 168-169). Un « jeu de qui perd gagne » où, parallèlement, le départ des cercles
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
110
décisionnaires, à grand bruit, de cette mouvance féministe affirme l'orientation
islamique – pourtant contestée par les partis musulmans radicaux – de la politique de
Zia ul-Haq.
7 Ainsi, après avoir fait usage des arguties religieuses pour garantir le droit et l'éducation
des femmes dans l'appareil juridico-légal, les « groupes de pression féminins »
construisent, contre Zia ul-Haq, une argumentation fondée aussi sur une rhétorique
laïque. Toutefois, le « féminisme » pakistanais, dans son ensemble, n'abandonne pas la
religion. Seule une minorité de militant(e)s s'affirme « laïque », voire même « athée » ;
les autres continuent de se référer à un islam « moderne ». Se révèlent alors, de
manière poignante, les frictions induites par le fait que l'État « des Purs » est l'un des
deux seuls pays au monde à légitimer son existence sur une appartenance religieuse. De
nombreux débats ont été engagés pour fonder les revendications féministes en droit
islamique ; débats, là encore, dominés par une élite éduquée – et émigrée ! – telle que la
représentent Riffat Hassan ou Farhat Hashmi. La réorientation officiellement
« démocratique » des régimes qui ont suivi la mort de Zia ul-Haq a ravivé le débat
religieux pour les avocats du féminisme. La prise de pouvoir du général Musharaff et
ses déclarations « modernistes » avaient donné espoir à certains « zélateurs de la cause
féministe » de renouer avec les chambres et anti-chambres du pouvoir.
8 Il reste que le féminisme pakistanais, aussi « avant-gardiste » qu'il puisse être, n'a
jamais su constituer, en tant que tel, un groupe de pression réellement conséquent sur
la scène politique. Il n'a pas reçu, non plus, un écho de grande ampleur dans les strates
moins privilégiées de la société. Ainsi aura-t-on découvert, grâce à l'ouvrage
remarquablement documenté de C. Dedebant, une mouvance, active mais peu visible,
de la société pakistanaise. Par la mise en perspective permanente avec les évolutions de
l'État, l'ouvrage constitue une contribution importante à la connaissance de l'histoire
du Pakistan. Il nous offre également un regard sans pareil sur le rôle de ferment social
joué par l'islam. Reste à découvrir les complexités du contexte sociologique duquel ces
revendications féministes sont nées et dans lequel elles sont lancées ; évoquées tout au
long de l'ouvrage, ces complexités ne sont jamais explicitées. Les explications sur le
registre symbolique auquel la Femme est assignée sont trop générales et peu
éclairantes sur le sujet. Cela est vrai aussi des activistes elles-mêmes (il s'agit
exclusivement – ou presque – de femmes) dont on ne sait pas toujours si les actions
illustrent un mouvement plus général ou si elles ne sont que le fruit d'un effort
particulier. Enfin, si l'auteure revendique le fait de faire une sociologie de l'élite, la
société pakistanaise apparaît souvent dans son entier, laissant sur leur faim ceux des
lecteurs qui aimeraient comprendre les échos (ou leur absence) que de telles
revendications suscitent dans l'opinion publique.
9 Outre le fait d'avoir accumulé une vaste connaissance, l'auteure manie une verve
remarquablement riche, précise et variée, dotée d'un art grammaticalement
irréprochable. Tandis que cela sert indéniablement la valeur littéraire de l'ouvrage, on
regrettera certaines circonvolutions qui la conduisent parfois à tenir des thèses ou des
propositions contradictoires ; devant l'intérêt de chacune, le lecteur ne sait pas
toujours à quel saint se vouer.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
111
Robert Deliège, Les castes en Inde
aujourd'hui
Paris, Presses Universitaires de France, 2004, 275 p.
Roland Lardinois
1 Il faut dire dès l'abord que participant pour une part aux débats qu'expose R. Deliège, je
suis bien placé pour apprécier l'intérêt de cet ouvrage mais trop bien informé et de son
sujet et des travaux passés de son auteur pour n'en pas voir les faiblesses. Mon
appréciation d'ensemble étant négative, je m'efforcerai d'argumenter avec précision
quelques-unes des raisons sur lesquelles je fonde mon point de vue.
2 Ce livre m'apparaît à maints égards trompeur, par son titre et par les matériaux
présentés. Il est d'abord trompeur par son titre. Alors que l'auteur annonce une étude
sur la structure de caste de la société indienne contemporaine, le lecteur découvre un
ouvrage qui porte, pour les trois quarts de son propos (exactement les 3 premières
parties, soit 200 pages sur les 250 qui font le corps du livre), sur les différentes théories
du système des castes développées depuis la fin du XIXe siècle par les anthropologues –
et que R. Deliège limite de manière quasi exclusive à l'école française de sociologie,
représentée il est vrai par les études d'Émile Senart et de Célestin Bouglé et, surtout,
par l'ouvrage inégalé de Louis Dumont, Homo hierarchicus. Le système des castes et ses
implications. Paris, Gallimard, 1979 (coll. « Tel »), qui a totalement renouvelé notre
compréhension de la caste. Dans une première partie intitulée « Généralités », après un
rappel des notions élémentaires (chap. 1) sur les sources textuelles et les catégories de
varna et de jâti, l'auteur expose de manière très convenue la théorie de Louis Dumont
sur le système des castes (chap. 2), en tenant compte des critiques qui ont été adressées
aux travaux de ce dernier. Par très convenue, j'entends que R. Deliège ne fait aucun
effort de mise en perspective sociologique et historique de son propos. Mais
probablement n'était-ce pas ce que l'éditeur attendait de cet ouvrage. Cependant, je ne
suis pas certain que l'auteur ait bien compris toutes les critiques adressées à Dumont.
En outre, la séparation opérée dans l'œuvre de Dumont entre, d'un côté, la partie
indianiste (seule considérée ici) et, de l'autre, les études comparatives, répond
certainement aux finalités scolaires de l'ouvrage, mais cela ne me semble pas la
meilleure manière de rendre compte du projet dumontien. En tout cas, cela ne
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
112
correspond pas à la cohérence que Dumont a voulu donner à ses analyses. Dans la
deuxième partie sur « L'organisation interne », l'auteur distingue d'abord les débats sur
caste et race (chap. 3) puis présente les données sur la famille et la parenté (chap. 4),
occasion d'évoquer la théorie ancienne du sanscritiste Émile Senart qui considérait la
caste comme un cas particulier de la « gens ». Quant à la troisième partie, « Les
relations entre les castes », l'auteur y reprend deux questions débattues dans la
sociologie des castes, d'une part, « l'idéologie du pur et de l'impur » (chap. 5) et, d'autre
part, la relation que l'on peut établir ou pas entre caste et classe (chap. 6). On trouve
dans ces deux chapitres un résumé des données classiques de la littérature sociologique
et anthropologique de l'Inde, depuis l'étude de Célestin Bouglé jusqu'aux travaux des
anthropologues indiens. On cherche en vain une idée originale dans les perspectives
dessinées par R. Deliège qui reprend, à juste titre d'ailleurs, les considérations d'Hocart
sur la notion de royauté rituelle, et expose les données collectées en Inde du nord par le
couple missionnaire américain, les Wiser, sur le système des échanges socio-
économiques dit jajmani – les travaux des Wiser datant de la fin des années 1930,
comme l'indique la bibliographie, et non des années 1960 comme le texte le laisse
penser maladroitement. Au demeurant, personne ne nie, depuis Marcel Mauss qui a
introduit Arthur Hocart en France en 1938 (comme le rappelle au passage l'auteur) et
Louis Dumont qui a longuement commenté tous ces travaux anthropologiques dans les
années 1960, l'intérêt sociologique de cette littérature, qui appellerait une mise en
contexte historique. Mais arrivé à la page 200 de l'ouvrage de R. Deliège, il faut
admettre que nous sommes encore loin de considérations sur l'état du système des
castes dans l'Inde d'aujourd'hui. Reste la quatrième et dernière partie (« Le devenir
contemporain », soit 50 pages) censée répondre au titre annoncé de l'ouvrage. Le
chapitre 7 (« Les transformations récentes ») expose les transformations socio-
économiques observées par les chercheurs à l'occasion des études de villages menées
dans les années 1950 et 1960, et théorisées alors par l'anthropologue indien
M. N. Srinivas sous la notion de « sanskritisation ». Enfin, il faut arriver au chapitre 8
(« La caste dans le système politique contemporain », soit les 20 dernières pages) pour
voir aborder des questions qui relèvent de l'Inde d'aujourd'hui et, encore, sous l'angle
limité du jeu politique.
3 Au regard du propos ambitieux annoncé par le titre, c'est peu de dire qu'il n'est pas
tenu. On ne peut pourtant soupçonner l'auteur d'être étranger à son sujet puisqu'il a
mené des enquêtes auprès des basses castes du pays tamoul en Inde du Sud, au début
des années 1980, et publié plusieurs livres sur les Intouchables ainsi qu'un Que sais-je ?
sur Le système des castes, en 1993 (cf. Arch. 88.94), mais qui n'est pas mentionné dans la
bibliographie. La raison probable de cette absence est que l'ouvrage ici recensé se
présente tout simplement comme le développement de ce Que sais-je ? dont il suit le
même plan, conservant parfois les mêmes titres ou presque (« varna et jâti »,
« L'idéologie du pur et de l'impur », « Les transformations contemporaines », « Caste et
démocratie », etc.). Il est vrai qu'il est peut-être difficile d'innover, à dix ans d'écart,
lorsqu'on enseigne régulièrement ces questions à un public d'étudiants (R. Deliège est
professeur à l'université libre de Louvain). Reconnaissons que les lecteurs ont
maintenant le choix de s'initier au système des castes, chez le même éditeur, soit dans
une version courte soit dans une version longue, actualisée il est vrai, mais de manière
très partiale.
4 Car là réside un autre caractère trompeur de l'ouvrage qui est loin de se situer, comme
il le prétend, « au-delà de toute polémique ». On peut défendre l'utilité d'un livre de
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
113
seconde main qui se voudrait une introduction à la sociologie de l'Inde moderne et
contemporaine, comme le suggère la quatrième de couverture. Mais restreindre le sujet
à la seule compréhension du système des castes est une vue un peu étroite au regard de
l'évolution du monde social indien et de la richesse de la production contemporaine en
sciences sociales sur l'Inde. Toutefois, en admettant de circonscrire le propos au
système des castes, on attend de l'auteur une connaissance de l'état le plus récent de la
littérature, une présentation de l'ensemble des débats et une bibliographie sans
manques flagrants, en particulier au regard des publications que peut atteindre
facilement un public francophone auquel cet ouvrage s'adresse. Or, force est de dire
que cette synthèse datée et lacunaire affiche des partis pris plus personnels que
scientifiques. Admettons que quelques livres, tout juste publiés lorsque l'auteur
rédigeait son ouvrage, n'aient pu être inclus à temps dans la bibliographie. Ce peut-être
le cas de deux études en langue anglaise : d'une part, l'ouvrage de Robert Parkin, Louis
Dumont and Hierarchical Opposition (Berghahn Books, New York, Oxford, 2003) une
analyse interne de l'œuvre qui mérite d'être signalée, au moins au titre de la vitalité
des débats que suscite toujours le travail de Louis Dumont ; d'autre part, celui de
Christophe Jaffrelot, India's Silent Revolution. The Rise of the Lower Castes in North India
(Hurst & Company, Londres, 2003), qui se fonde sur des matériaux empiriques et porte
précisément sur les profonds bouleversements sociopolitiques de l'Inde
contemporaine.
5 Plus incompréhensible est l'oubli de travaux publiés en français que R. Deliège n'ignore
pas. Il s'agit d'abord de la monographie de Raymond Jamous, La relation frère-sœur :
parenté et rites chez les Meo de l'Inde du Nord (Paris, Éditions de l'École des Hautes Études
en Sciences Sociales, 1991) : cet ouvrage porte sur un groupe social tout à fait original,
celui d'une basse caste convertie à l'islam, et analyse un lien de parenté très valorisée
en Inde du nord. Il s'agit ensuite des deux études portant sur Ambedkar, leader
nationaliste indien d'origine intouchable, avocat, contemporain de Gandhi et de Nehru,
et dont les analyses méconnues sur le système des castes, développées dès les années
1910, s'opposent déjà aux thèses sociologiques dominantes : le premier est l'article
novateur d'Olivier Herrenschmidt, « “L'inégalité graduée” ou la pire des inégalités.
L'analyse de la société hindoue par Ambedkar », paru dans Archives européennes de
sociologie, 37, 1, 1996, p. 3-22 ; le second est l'ouvrage de Christophe Jaffrelot, Dr
Ambedkar. Leader intouchable et père de la constitution indienne (Presses de Sciences Po,
Paris, 2000) qui fait fond sur le travail d'Herrenschmidt élaboré au début des années
1990. L'auteur évoque pourtant à plusieurs reprises l'action politique d'Ambedkar et sa
critique du système des castes, mais il préfère se référer à un article en anglais de
Timothy Fitzgerald publié en Inde dans la revue Contributions to Indian Sociology ; cet
article est pourtant moins bien informé que celui d'Herrenschmidt sur la sociologie
d'Ambedkar et de Dumont dont traite aussi Fitzgerald. Il s'agit ensuite du problème de
la caste chez les musulmans indiens, évoqué en passant. Mais le lecteur ignorera que
cette question a été longuement traitée par un anthropologue français spécialiste de
l'islam dans le sous-continent indien, Marc Gaborieau, dont aucun titre n'est cité dans
la bibliographie : le lecteur se reportera donc en particulier à Ni brahmanes, ni ancêtres.
Colporteurs musulmans du Népal (Nanterre, Société d'ethnologie, 1993 [cf. Arch. 96.34]). Au
passage, signalons que les sikhs ne font même pas l'objet d'une entrée dans l'index
(bien détaillé pour les castes mentionnées), alors même que le problème de la caste est
également discuté à leur propos par les anthropologues. Au regard de ces silences pour
lesquels les partis pris de R. Deliège sont trop flagrants, les autres oublis paraîtraient
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
114
presque secondaires. Mentionnons cependant que la relation entre caste et classe a fait
l'objet, il y a vingt ans, d'un volume édité par Jacques Pouchepadass, « Caste et classe en
Asie du Sud », Purusârtha, 6, 1982. Par ailleurs et sans vouloir allonger indûment la
bibliographie sur ce point, on ne peut exposer les critiques adressées à Louis Dumont
sans citer l'article de l'anthropologue du Népal Richard Burghard, « Ethnographers and
their local counterparts in India », dans R. Fardon, ed., Localizing Strategies. Regional
Traditions of Ethnographic Writing (Edinbourg, Scottish Academic Press, Washington,
Smithsonian Institution, 1990, p. 260-279). Enfin, on aurait aimé voir figurer dans la
bibliographie deux autres ouvrages, l'un édité et introduit par M. N. Srinivas, Caste. Its
Twentieth Century Avatar, Viking, New Delhi, 1996, l'autre édité par Chris Fuller, Caste
Today, Oxford University Press, New Delhi, 1996, mentionné il est vrai, mais
indirectement dans les références aux travaux de R. Deliège qui a contribué à cet
ouvrage. D'autant que l'on s'interroge sur la mention d'un essai du journaliste et
romancier Pascal Bruckner au sein de toutes ces références anthropologiques.
6 Mais une autre lacune inexcusable est l'ignorance des travaux de Max Weber sur l'Inde
et sur « L'éthique économique des grandes religions mondiales ». R. Deliège, il est vrai,
si l'on se fonde sur ses publications antérieures, n'a jamais manifesté une très grande
familiarité avec ce sociologue dont les analyses ne sont ici même pas exposées, Weber
n'étant mentionné en tout et pour tout que deux fois, en passant. Le lecteur qui a la
curiosité de se reporter à la bibliographie est surpris d'apprendre que Max Weber
semble être l'auteur d'un ouvrage en anglais, The Religion of India. Sociology of Hinduism
and Buddhism, paru à New York en 1958, dont rien n'indique que c'est une traduction de
l'allemand. Nous n'en saurons pas plus sur Weber. Il faut donc encore une fois
compléter la bibliographie de l'auteur et informer le lecteur qu'on dispose maintenant
d'une traduction en français de l'ouvrage imposant (au moins par sa longueur) de Max
Weber, Hindouisme et Bouddhisme, traduit de l'allemand par Isabelle Kalinowski avec la
collaboration de Roland Lardinois, Flammarion, Champs, Paris, 2003 (1 re édition en
allemand 1921, le livre étant quasiment achevé dès 1913) (cf. Arch. 126.28). Mais on ne
peut ignorer non plus les textes réunis et traduits par Jean-Pierre Grossein sous le titre
Max Weber, Sociologie des religions, Gallimard, Paris, 1996, et encore, du même sociologue,
Confucianisme et taoïsme, traduit de l'allemand par Catherine Colliot-Thélène et Jean-
Pierre Grossein (Paris, Gallimard, 2000) (cf. Arch. 108.89), et dont il suffit de consulter les
index pour prendre la mesure de la place de l'Inde dans les réflexions comparatives de
Max Weber (pour se limiter à ces seuls ouvrages). Nul sociologue, anthropologue ou
historien n'est tenu d'être wébérien. Encore faut-il au moins savoir que Weber a
contribué de manière notable à notre compréhension du système des castes et de
l'hindouisme, pour le moins, et que sa contribution mérite d'être mise en parallèle avec
celles de Bouglé et, surtout, de Dumont – qui avait lu attentivement Weber –, en
particulier dans un ouvrage qui entend exposer les différentes théories sociologiques et
anthropologiques sur le système des castes.
7 D'aucune manière, ce livre n'est donc une synthèse sur la question des castes dans
l'Inde d'aujourd'hui. Les analyses de R. Deliège ne présentent pas la moindre idée neuve
ou l'ébauche de nouveaux questionnements alors même que l'immense littérature dont
on dispose permettrait d'esquisser une vision d'ensemble des bouleversements qui
travaillent le monde social indien depuis plus d'un demi-siècle. L'ouvrage est une
introduction très scolaire au système des castes considéré d'un point de vue
étroitement anthropologique, un cours qui, avec ses lacunes et ses partis pris, peut
naturellement constituer une première lecture pour des personnes ignorantes du sujet
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
115
et qui doivent tout apprendre. Mais alors, une simple mise à jour du Que sais-je de cet
auteur aurait amplement répondu à cette fin.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
116
Françoise Dunand, Voir les Dieux.
Voir Dieu
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2002, 208 p. (coll.
« Sciences de l'histoire »)
Isabelle Saint-Martin
1 Contempler ce qui échappe au commun des regards ! L'ambition du propos pourrait ici
donner lieu à un ensemble fort disparate puisque dès le titre est affirmée une
perspective comparatiste qui ne se limitera pas au Dieu des monothéismes. L'unité
apparaît pourtant dans la démarche qui a réuni autour d'un même objet d'étude – non
pas toutes formes de visions mais bien la vision des Dieux ou de Dieu – des chercheurs
de différentes disciplines dans le cadre d'un séminaire, puis d'un colloque, organisé par
le Centre de recherche d'Histoire des religions de l'université Marc Bloch (Strasbourg).
Historiens, historiens de l'art, archéologues et théologiens ont confronté leurs
approches d'une expérience religieuse certes particulière, mais bien attestée dans
différentes cultures, depuis les dieux des polythéismes dont on pourrait penser que la
manifestation est plus aisément reçue, jusqu'au Dieu unique de la bible réputé
inconnaissable. Toutefois, si l'ouvrage est divisé en trois parties (Antiquité « païenne »,
Antiquité judéo-chrétienne, Moyen Âge chrétien), on notera que le christianisme
domine ici avec sept communications sur les onze que forme l'ensemble. Mais en dépit
de leur caractère nécessairement parcellaire, les trois études de cas sur l'Inde, l'Égypte
et la Grèce contribuent de façon féconde à la mise en évidence du questionnement. La
confrontation des témoignages et récits de vision interroge cette forme de rencontre
avec le divin : qui voit et comment, selon quelles modalités ? Quelles sont les attentes
visionnaires, en quoi la réception de la vision forme-t-elle un modèle ensuite
reproductible dans d'autres expériences ? Sylvain Mazars s'attache à donner
succinctement pour l'Inde ancienne une évocation des caractéristiques, contenus et
fonctions sociales ou politiques des formes de visions, spontanées, ou provoquées par
les techniques du yoga notamment, et note que si les premières visions des dieux sont
sonores, celles-ci sont ensuite fortement marquées par l'iconographie et un
symbolisme très tôt défini. Le cas égyptien que retient Françoise Dunand s'inscrit dans
une période (Ier-IIIe siècles) où l'expérience de vision n'est plus seulement réservée au
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
117
pouvoir royal. Le récit, qui se donne comme aventure individuelle, d'une vision au
temple de Kalabscha, ressort aussi à l'évidence par son vocabulaire et son schéma
narratif d'un genre littéraire. Il est exemplaire en ce qu'il témoigne d'un désir,
apparemment répandu, de connaître Dieu, d'en recevoir « des signes éclatants », ce qui
suppose une mise en condition et une purification morale afin d'être apte à partager
par cette révélation un peu de la condition divine, ou tout au moins à dépasser la
condition humaine par la connaissance de la nature du dieu. Dans le cadre des romans
grecs, telles les aventures de Leucippe et Clitophon étudiées par Pascaline Mangin, les
visions rythment le récit et sont également révélatrices du rapport des hommes aux
dieux. Elles interviennent principalement dans les songes, lieu de présence de la
divinité, avec un rôle prémonitoire qui annonce aux hommes ce qu'ils vont subir afin
de s'y préparer et non de l'éviter puisqu'on ne peut guère échapper au Destin. La vision
est ce qui donne cohérence au monde, signe de la toute-puissance des dieux et de la
Fortune sur le cours des choses, elle est aussi dans le ressort romanesque le masque de
l'auteur, ici véritable démiurge.
2 À la différence des théophanies des polythéismes, les visions du monde judéo-chrétien
sont marquées par deux récits fondateurs, la théophanie du Sinaï et les apparitions du
Ressuscité, récits qui ouvrent la seconde partie de l'ouvrage. À partir d'une analyse de
la structure narrative de Exode 19, André Wénin dégage le processus de révélation de
Dieu rendu possible par l'alliance. La rencontre avec le Tout Autre, rencontre qui ne
sera ni fusion ni annexion, suppose une rupture avec le profane et une juste distance
qu'illustre la manifestation par le feu (à approcher d'assez près pour sentir sa chaleur
et sa lumière mais d'assez loin pour ne pas s'y consumer). Si les signes que sont les
orages et éruptions volcaniques sont courants en histoire des religions, l'originalité du
traitement du motif réside dans la nuée d'orage et l'écran de fumée, marques d'un Dieu
qui se cache et se révèle en même temps. Nuée et feu dont A. Wénin montre qu'ils
peuvent être lus comme métaphores de la Loi qui pose des limites pour permettre
l'alliance. Il reste que cette apparition au Sinaï est plus un « mode de présence » qu'une
théophanie au sens strict, le Dieu biblique ne réside ni dans la nuée ni dans l'orage qui
ne sont que signes de sa manifestation. Les apparitions du Christ relatées dans les
Évangiles relèvent d'un autre type d'expérience. Michel Deneken souligne qu'elles sont
« données à voir », le marqueur verbal « ôphtê » de forme passive en note l'origine
divine. En outre, la vue s'accompagne, pour ceux qui doutent, de l'ouie et c'est la parole
qui convainc de la nature du Ressuscité. Mais c'est bien, dans la tradition chrétienne,
l'expérience de « voir le Seigneur » qui s'affirme comme évènement de
« connaissance » de la victoire sur la mort. La foi pascale s'ancre dans la Christophanie.
Dans cette perspective, « le contenu de la vision imaginative est Dieu lui-même en tant
que manifesté en Christ », ce qui la distingue des autres visions.
3 La littérature ancienne abonde en effet en récits de vision, Madeleine Scopello relève,
chez les penseurs gnostiques, le changement d'état qui marque le visionnaire.
Transporté qu'il est dans l'espace du sacré, l'initié devient médiateur de la vision entre
Dieu et les hommes, lourde responsabilité car celui qui ne respecterait pas les règles de
transmission, et se méprendrait en croyant par là connaître l'inconnaissable, se
condamnerait à l'aveuglement. Dans les récits des pères du désert, Françoise Dunand
note également que la vision, décrite comme moment d'extase, reste un phénomène
ambigu, elle peut être la marque d'une sollicitude divine mais aussi conduire à une
forme d'orgueil spirituel qui mène à la perte. Enfin, cette partie sur l'Antiquité judéo-
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
118
chrétienne se clôt par la théorie d'Augustin qui distingue trois espèces de vue : selon les
yeux du corps (ex. l'apparition à Mambré), selon les yeux de l'imagination (vision
d'Isaïe), selon les yeux de l'esprit qui permettent de voir en intelligence la vérité et la
sagesse, conditions d'un dévoilement parfait. Goulven Madec éclaire ici de façon
précise le vocabulaire augustinien qui fera référence dans l'expérience chrétienne du
voir.
4 La dernière partie traite du vaste corpus des récits de visionnaires médiévaux. Le Livre
des révélations célestes de Brigitte de Suède en est un exemple célèbre que Véronique
Germanier accompagne de l'étude des illustrations réalisées en Italie peu après la
rédaction du texte. Le symbolisme complexe des visions trinitaires est souvent
commenté et expliqué à Brigitte par la Vierge qui demeure son interlocutrice
principale. Ce rôle intercesseur se retrouve de façon très nette dans le Dialogus
Miraculorum de Césaire d'Heisterbach analysé par Sylvie Barnay, où la vision de la
Vierge conduit à la vision divine. Elle guide l'âme vers la ressemblance avec Dieu et
tient même dans certains récits un rôle de « Vierge-Père » qui fait régner l'ordre en
figure inverse de celle du « Christ-Mère » qui se développe alors dans la pensée
cistercienne. En étudiant les visions de la Trinité de trois moniales d'Unterlinden,
François Boespflug souligne l'ampleur d'un phénomène dont il saisit ici une forme
exemplaire, à mi-distance entre l'exceptionnel et les multiples manifestations
ordinaires. Décrites sur le mode extatique du rapt mystique, ces visions « au plus haut
niveau » de Dieu et de la Trinité apparaissent comme un terrain d'affirmation féminine.
Ce ne sont pas seulement les plus célèbres, telles Élisabeth de Shönau ou Hildegarde de
Bingen, mais aussi, avec une certaine banalisation de la chose, de simples moniales qui
rivalisent alors largement avec les hommes.
5 À travers ces études sont analysés des récits de vision de forme « documentaire »,
comptes-rendus d'expérience individuelle, ou plus littéraire – sans que les deux
approches soient d'ailleurs totalement distinctes – et non le statut psychique des
visionnaires ou la « réalité effective » de la vision en elle-même. Si l'on peut regretter
que le comparatisme n'ait pu être poussé davantage, que le cas des rêves et visions en
monde musulman n'ait pu y être abordé, ou que l'ouvrage ne fasse pas mention de
l'existence, ou de la rareté, de visions en monde juif, autres que les seuls cas des
théophanies bibliques, il faut déjà saluer le mérite d'en avoir tenté l'approche. De tous
ces récits de vision issus de cultures diverses, ce ne sont pas d'abord les éventuelles
analogies, lesquelles peuvent n'être qu'apparentes, qui retiennent l'attention, mais
bien la manifestation d'un profond désir de « voir » le dieu et l'affirmation parallèle de
son impossibilité pour les yeux mortels. L'expérience, tant en milieu païen où pourtant
les dieux interviennent plus facilement – mais reste à savoir sous quelle forme ils se
manifestent – que dans les contextes culturels où elle est particulièrement valorisée
comme au Moyen Âge chrétien, demeure toujours de l'ordre de l'exceptionnel et d'une
certaine manière elle est redoutée. Celui qui en bénéficie éprouve une autre forme de
connaissance du divin qui l'amène à dépasser sa propre nature. Comme y invitent les
auteurs, ces études ouvrent à une « histoire du surnaturel » conçue comme « révélateur
de la transformation des attitudes mentales » et de la relation des hommes à leur dieu.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
119
Marie-Hélène Froeschlé-Chopard,
Itinéraires pèlerins de l'ancienne
Provence
La Thune, Marseille, 2002, 281 p.
Elena Zapponi
1 M.-H. Froeschlé-Chopard propose dans cet ouvrage une vision d'ensemble des
pèlerinages provençaux sous l'Ancien Régime. Elle s'est déjà intéressée à plusieurs
reprises à la profusion de saintes dans cette région ; l'enjeu principal, est de reprendre
le dossier de cette « terre de chapelle », en utilisant certains documents de quelques
sites privilégiés restés inexploités jusqu'ici.
2 L'ouvrage considère la métamorphose de la piété baroque en Provence en analysant
quatre lieux pèlerins : la Marie-Madeleine à Notre-Dame de Baume ; Notre-Dame de
Moustiers ; Notre-Dame de Laghet ; Notre-Dame du Laus. La période étudiée s'étend de
la fin du XVIe au XVIIIe siècle. À cette époque, l'hostilité envers les miracles et les
phénomènes du merveilleux conduit à des descriptions que l'on ne trouve en aucun
autre temps. Les « hauts lieux » pris en considération, sont choisis en raison de la
richesse ethnographique des documents anciens : « dictionnaires » d'érudits locaux
gagnés par la philosophie du siècle, documents émanant de l'autorité ecclésiastique et
récits pèlerins seront les sources exploitées par les auteurs de ces itinéraires pèlerins.
Le voyage du lecteur vers ces lieux de merveilles est introduit par deux contributions
de M.-H. Froeschlé-Chopard qui définit le phénomène du pèlerinage et de la spécificité
de la Provence dans l'histoire du pèlerinage occidental.
3 Dans « Le pèlerinage au fil des siècles », l'auteur considère les deux données
fondamentales composant cette pratique dans le contexte chrétien de l'Europe
occidentale : « l'aller vers » et la « rencontre » avec l'au-delà, au bout du chemin.
4 Dans l'essai, « La Provence, terre de romérages », M.-H. Froeschlé-Chopard présente la
« Description historique, géographique et topographique des villes, bourgs, villages et
hameaux de la Provence ancienne et moderne » du médecin de Marseille C.-F. Achard.
Ce « dictionnaire » des lieux de dévotion est, selon l'auteure, une source idéale pour
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
120
comprendre les communautés locales de l'ancienne Provence. Le ton n'est pas étranger
à l'ironie de l'Encyclopédie où à l'article « pèlerinage », on lit un « voyage de dévotion
mal entendue » et un « empressement d'aller visiter des lieux lointains, pour y obtenir
des secours dont on peut bien mieux trouver chez soi par des bonnes œuvres et une
dévotion éclairée. » Achard, fauteur de ce dernier type de dévotion intérieure, décrit
les superstitions populaires de la Provence en s'attardant sur le « romérage ». Le
Roumavagi (romieu – pèlerin allant à Rome – et viaggi, voyage) est une transposition en
mineur du voyage vers les grands sanctuaires chrétiens. M.-H. Froeschlé-Chopard
décrit les sanctuaires de « pèlerinage-romérage » provençaux en termes de chapelles
rurales, « hauts lieux » cosmiques aux limites du diocèse, marqués par le « sacré
sauvage et le sacré populaire ». Dans cet espace, la communauté est projetée au-delà de
la quotidienneté pour un « moment d'éternité » (on remarque, ici comme ailleurs dans
l'ouvrage, un écho de la phénoménologie du sacré d'Alphonse Dupront). Pendant ce
temps, les barrières des jours ordinaires, les frontières sociales et le contexte
ecclésiastique paroissial urbain éclatent. En raison de ce « débordement », le clergé
post-tridentin s'opposera à la bravade du romérage dont le rayonnement diminuera
progressivement au cours du XVIIIe siècle, le repli sur le territoire paroissial
s'accompagnant d'un silence des sources sur les miracles désormais suspects.
5 « Le pèlerinage à Marie-Madeleine en Provence » par B. Montagnes exploite cinq
sources pèlerines. Il s'agit des récits du XVe siècle d'un chartreux flamand, d'un
bourgeois saxon, d'un médecin bavarois qui fuit la peste, d'un dominicain piémontais et
de celui plus tardif, datant de 1586, adressé par le minime aixois Guillaume Durant aux
sœurs du couvent de Notre-Dame de Soisson. L'intérêt de la contribution réside dans
l'analyse de ces documents qui révèle un terrain solide pour l'étude de l'histoire des
croyances et des sensibilités religieuses. Des récits, le pèlerinage à la Madeleine
apparaît comme une expérience du sacré qui se fait à la fois par la contemplation et le
contact physique. Nombreux sont les gestes rituels physiques (circumambulation,
vénération et contact avec les reliques) qui témoignent d'un rapport de réciprocité
intime entre la sainte et le pèlerin. La passion dévote pour la « pécheresse pardonnée »
est évidente sous la plume de G. Durant, témoin oculaire du miracle de la liquéfaction
du contenu de la Sainte Ampoule. Tout au long de ces pages de « doctrine spirituelle »,
nous remarquons que le propos apologétique procédant d'une « dévotion éclairée », est
toutefois encore fortement imprégné d'un univers du croire baroque. Celui-ci émerge
dans la narration de la vision du pèlerin. G. Durant dialogue avec la Madeleine, en la
nommant « Fontaine des saintes larmes, mer profonde de la charité, miroir de
pénitence » tandis que la sainte l'appelle « mon frère » et lui raconte l'histoire de sa
« métamorphose ».
6 La contribution « Pousser les portes du paradis. Le sanctuaire “à répit” de Notre-Dame
de Beauvoir à Moustiers-Sainte-Marie » (1640-1670) est de J. Gélis. Ce lieu de pèlerinage,
situé en Haute-Provence existe depuis le Moyen Âge. Il s'agit d'un sanctuaire de recours
où se célèbre le miracle du retour temporaire de la mort à la vie des morts-nés. Les
sources utilisées sont les registres des archives de Moustiers-Sainte-Marie rapportant
les « marques de vie » des corps suscités et la mention des baptêmes célébrés après la
mort des enfants. J. Gélis décrit la « vie du sanctuaire » en insistant sur l'originalité de
la « société du répit » de Notre-Dame de Beauvoir. Ce scénario humain composé par le
noyau d'accueil de permanents de Moustiers – l'ermite, le curé, les paroissiens et la
sage-femme – et par le groupe des pèlerins qui arrivent au sanctuaire pour y exposer la
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
121
dépouille de l'enfant mort, assume une fonction de caution pour le bon déroulement de
l'événement miraculeux de ce « rituel panique ». Face à cette scène de « création
collective du prodigieux », l'attitude de l'Église est ambivalente. Le clivage essentiel
s'opère entre les accommodants (souvent le clergé local, lié à l'horizon culturel
populaire et à la société des pèlerins) et les rigoristes (de saint Augustin au concile de
Trente et jusqu'à la condamnation de la Curie en 1729). La question du « répit »
participe des stratégies de reconquête de la contre-réforme catholique et plus tard, la
pastorale du culte marial du XIXe siècle fera de ce rituel la pratique d'une nouvelle
« religion en sentiments ». Par un singulier retournement, alors, le souvenir du répit,
presque disparu, contribuera à l'exaltation d'un âge d'or, où le miracle faisait partie du
quotidien.
7 Selon J. Gélis, la dynamique pèlerine de Notre-Dame de Beauvoir (l'histoire de ses
innocents et de ses miracles) indique une scène socioreligieuse qui témoigne de
l'évolution de la conscience de la vie et de la mort en Europe occidentale. Dans la
logique des populations rurales, le rituel du « répit » est une pratique collective de
réintégration de l'individu au sein de la communauté et de la famille. L'auteur souligne
l'action sociale du miracle de la « suscitation ». Celui-ci rend possible la sépulture du
corps en terre consacrée et par conséquent le travail de deuil et le contrôle d'une
irruption du désordre dans la descendance du groupe villageois. Malgré l'opposition
ecclésiastique officielle, la mémoire du « répit » ne disparaît pas. Notre-Dame de
Beauvoir restera tout au long des XIXe et XXe siècles un lieu de dévotion en faveur des
enfants. Un dernier avatar de cette pratique du salut se manifeste en 1996. C'est alors
qu'un moine ermite, installé près de Moustiers-Sainte-Marie, militant contre
l'interruption volontaire de grossesse, prétend restaurer ce « rituel de vie ».
8 L'itinéraire « Les merveilles de Notre-Dame de Laghet », est tracé à deux mains
par V. Frantz et M.-H. Froeschlé-Chopard. Ce sanctuaire marial des Alpes-Maritimes est
situé dans un microcosme naturel de pierres, arbres et eau, dans un territoire à la
frontière des anciens diocèses de Nice et Vintimille, disputé entre plusieurs communes.
Les sources exploitées sont ici les livres des miracles, notamment le récit apologétique
de 1654 du père Francesco da Sestri, capucin contemporain des événements, auquel
tous les ouvrages successifs feront référence. Comme l'indiquent les auteures, ce
prédicateur de l'âge baroque donne un « effet dramatique » à son récit : le vocabulaire
utilisé a pour but d'émouvoir le lecteur pour brosser le portrait du miraculé et du
pèlerin modèle.
9 L'analyse critique des sources fait ressortir la construction sociale de la réalité du
miracle. Des premiers récits, qui sont souvent des procès-verbaux choisis par des
membres du clergé en temps de contre-réforme, émerge un univers où le merveilleux
fait partie intégrante de la vie quotidienne. Les déclarations des pèlerins, remaniées par
l'écriture ecclésiastique, témoignent du rôle des fidèles dans le déroulement du
miracle. Laghet, comme Notre-Dame de Beauvoir, apparaît comme un théâtre du
religieux où se déroule un « drame de l'affliction et de la dévotion ». Les acteurs
pèlerins semblent y solliciter la Vierge et la contraindre à agir, comme l'indiquent les
auteures à travers une analyse sémantique des nombreux verbes d'action présents dans
les récits. L'évolution de la courbe miraculaire témoigne par ailleurs de l'intérêt et du
soin mis par les autorités religieuses dans l'enregistrement des miracles. Ceux-ci
abondent pendant les premières années ; ensuite, de 1690 à 1730, lorsque le pèlerinage
est bien établi, la collecte perd son urgence. L'Église hésite à utiliser le mot « miracle »
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
122
dans les transcriptions des dépositions pèlerines ; on parle plutôt de « grâces » et
« merveilles ». À cette époque, le lieu sera valorisé par le pouvoir politique de la Maison
de Savoie. Victor-Amédée II, le « roi pèlerin » soucieux d'établir un point d'appui
stratégique pour contrôler la zone maritime proche de Nice appellera le sanctuaire et
ses miracles à jouer un rôle de construction nationale. Le corps piémontais des Carmes
déchaux, installé dans le lieu par le souverain, enregistre les miracles en gommant les
merveilles baroques (les guérisons des maux évangéliques) et insiste sur un pèlerinage
de conversion intérieure. L'analyse montre la richesse d'une source tels que les récits
des miracles, documents complexes qui peuvent témoigner de la spiritualité des clercs,
des laïcs et de l'écho des stratégies politiques.
10 Enfin, nous sommes conduits par M.-H. Froeschlé-Chopard, à « Notre-Dame du Laus,
refuge des pécheurs ». Le lieu, à la frontière de la Provence et du Dauphiné et des deux
diocèses d'Aix et Embrun, est présenté comme un espace de transition entre les anciens
pèlerinages de recours et les pèlerinages de dévotion du XIXe siècle. La figure de la jeune
bergère Benoîte Rencurel (à laquelle la Vierge apparaît en 1664) assume ici un rôle de
direction spirituelle exceptionnel pour une femme laïque lorsque dans la pastorale du
siècle, le témoignage du voyant autorisait la dévotion, puis s'effaçait en laissant la prise
en charge du sanctuaire au clergé. Les sources de l'itinéraire sont le texte d'un
dominicain d'Avignon contemporain des événements et les « manuscrits de Laus »,
conservés au sanctuaire, écrits du vivant de la bergère et axés sur son rôle. Parmi les
auteurs des manuscrits, M.-H. Froeschlé-Chopard considère surtout la contribution de
l'archidiacre de la cathédrale de Gap, premier directeur du sanctuaire du Laus. Le
manuscrit, qui se réfère à la première décennie du XVIIIe siècle, s'intéresse aux multiples
vies des saintes du XVIIe siècle ; le but, énoncé dans la préface est de raconter « la
lumière de vérité » sur la réalité des apparitions et la « vertu héroïque » de la sainte à
un clergé réticent, influencé par le rigorisme janséniste de la région. Dans ces
montagnes du Dauphiné, où se sont multipliés les procès en sorcellerie au XVe siècle, la
voyante est soupçonnée de possession diabolique et soumise aux procès-verbaux par les
autorités diocésaines dès ses premières visions. Dans ce climat institutionnel de
méfiance envers les mysticismes des « voyants indiscrets », Benoîte, qui affirme voir la
Vierge et les anges, qui répand des parfums, qui a le don de la clairvoyance et de
prédiction de l'avenir, sera enfin identifiée comme « sainte » par le milieu
socioreligieux de son temps. M.-H. Froeschlé-Chopard s'interroge sur les raisons de
cette reconnaissance et souligne l'originalité du sanctuaire du Laus par rapport aux
pèlerinages du siècle. Celle-ci réside dans la construction sociale du nouveau rôle de
confesseur et missionnaire de la sainte-voyante, figure d'intermédiaire auprès d'un
sanctuaire constitué en un lieu de lutte contre la « hantise du péché d'impureté ». Selon
l'auteure, la présence croissante des pèlerins « pécheurs endurcis » au XVIIIe siècle,
traduit le mouvement de dévotion suscité par l'effort pastoral du clergé post-tridentin,
opérant (via la conversion et la confession) pour la composition d'une religion de la
régénération individuelle. Ainsi, le « message du Laus », affirmant que le miracle n'est
pas seulement la victoire sur la maladie mais aussi et surtout sur le péché, marque
le passage général de cette fin de siècle, du « pèlerinage-recours » au « pèlerinage-
mission ». L'auteure note que la religion du pardon et de l'espoir qui émerge ici
préfigure les sanctuaires marials à venir : La Salette et Lourdes.
11 L'intérêt de ces itinéraires pèlerins de la Provence ancienne est dans l'analyse de la
construction sociale de la réalité du merveilleux. Du décodage des sources officielles,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
123
émerge une scène socioreligieuse en mouvement ; la « vie des sanctuaires » ressort du
regard constant porté sur l'affrontement entre une religion populaire prolifique et
mobile et une culture pastorale soucieuse de surveiller les espaces d'autonomie des
diocèses et des sanctuaires locaux. Malgré le travail considérable d'interprétation des
documents, on regrettera toutefois un certain « baroquisme descriptif », enclin à une
phénoménologie du sacré (dans les notions de « lieu cosmique », « hauts lieux »,
« éternité », « espoir », « sacré sauvage », « sacré populaire ») qui risque de perdre
l'analyse sociologique de la recomposition du croire dans la « passion » des détails de
chaque sanctuaire.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
124
Pierre Gisel, Théories de la religion
Genève, Labor et Fides, 2002, 414 p.
Vincent Delecroix
1 La crise des religions institutionnelles dans la modernité occidentale, le redéploiement
et la réorganisation, sous des modalités nouvelles, de l'agir religieux ont eu un puissant
effet retour sur la constitution de l'objet « religion » dans les sciences
traditionnellement ou nouvellement préoccupées par cet objet. Rien d'étonnant à cela,
puisque l'interrogation même sur la religion qui a donné naissance à ces sciences,
parties intégrantes des sciences de la société et de la culture, est intrinsèquement liée à
la modernité elle-même. Tel est en quelque sorte le constat et le point de départ de la
réflexion épistémologique mise en œuvre de façon extrêmement variée dans cet
ouvrage essentiel. Réunissant sous la direction de Jean-Marc Tétaz et Pierre Gisel des
contributions représentant chacune un horizon disciplinaire (philosophie, sociologie,
anthropologie, psychologie, théologie, sans parler de plaidoyers pour de nouvelles
disciplines comme les Ritual studies), il propose bien plus qu'un simple état des lieux des
problèmes et des mutations effectifs dans ces disciplines. C'est l'idée de quelque chose
comme une théorie de la religion qui est interrogée sous cet horizon de la modernité,
son statut, sa méthode, son objet, sa légitimité voire sa possibilité qui sont ici discutés.
Que signifie une théorie de la religion ? Quelles formes légitimes (à la fois fécondes et
valides) peut-elle prendre ? L'idée d'une théorie de la religion est-elle encore viable ?
Ces questions ne sont certes pas nouvelles, et, pour certaines des approches
scientifiques convoquées ici, elles sont consubstantielles à leur démarche,
indifféremment descriptives, interprétatives et réflexives. Mais le livre a le mérite de
les revivifier et d'en montrer les enjeux actuels, à la fois pour les disciplines et pour
l'intelligibilité de la modernité. Car la modernité religieuse en Occident est étroitement
liée au développement de ces sciences et c'est « la religion à l'âge des sciences des
religions » qui constitue l'une des spécificités de cette modernité.
2 Cette interrogation générale conduit alors à une double approche, reprise au fil de
chacune de ces contributions, à la fois théorique et historique. Théorique, voire
problématique, au sens où, à chaque fois, il s'agit d'envisager les formes et les principes
légitimes d'une théorie portant sur l'objet religieux ; historique, parce que l'histoire de
la discipline explique à la fois ces principes et les limites auxquels se trouvent
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
125
irrémédiablement confrontées des théories qui se sont bâties à partir de modèles de la
religion à la fois fortement ethnocentrées et constituées sur des conceptions
historiquement déterminées de la science. Cette histoire des sciences du religieux n'a
pas seulement statut d'une historiographie du second degré, elle est constituante de
l'histoire de son objet : comme le fait remarquer J.-M. Tétaz, « l'histoire des sciences du
religieux fait partie intégrante de l'histoire de la religion ». Toute théorie de la religion
donc, appartenant au champ des sciences de la culture et de la société, se trouve
déterminée, dans son statut, par les conditions historiques de son élaboration,
précisément celles de la modernité occidentale. Cette marque de naissance est-elle
encore supportable pour une théorie de la religion ?
3 La forme que revêt l'ouvrage constitue déjà une tentative de réponse à l'interrogation
portant sur la nature d'une théorie, en faisant jouer et dialoguer les champs
disciplinaires. Cette pluralité, à condition qu'elle ne devienne pas cacophonique, offre
évidemment une planche de salut à qui nourrit le soupçon grandissant d'une
obsolescence irrémédiable de toute théorie de la religion. À condition évidemment de
ne pas s'aveugler sur le danger des prétentions hégémoniques de telle ou telle
approche. C'est l'un des grands mérites de certaines de ces contributions que de
reconnaître au contraire, pour leur propre discipline, la nécessaire limitation
(limitation qui les rend d'autant plus opératoires) de leur champ d'investigation
comme de leur méthode, c'est-à-dire en définitive le caractère partiel, dans le bon sens
du terme, de l'objet qu'elles construisent, que ce soit par exemple pour l'anthropologie
(C. Bernand), la phénoménologie (E. Figl) ou pour la psychologie (P.-Y. Brandt) : l'idée
d'une théorie totale et unique de la religion a fait long feu, si elle a jamais été formulée.
Comme le montre toutefois la troisième partie du livre, il faut se garder d'un angélisme
sans aucun fondement historique ou scientifique : le dialogue est parfois rude.
4 Mais au sein de chacun de ces champs, une même logique de redéfinition est à l'œuvre,
motivée à la fois par l'histoire de la discipline (et les facteurs de sa genèse) et par les
problématiques nouvelles (ou réactualisées) soulevées par les formes du fait religieux
en modernité. Si ces approches ne sont évidemment pas confrontées à des problèmes
identiques, elles ont toutes en commun, dans une perspective critique, de reconnaître
un moment de crise nécessaire et de refondation au moins partielle.
5 L'ouvrage se compose de trois parties. Une première partie porte essentiellement sur le
concept de religion, objet de ces sciences. Une deuxième partie présente quelques
aperçus sur les approches contemporaines de cet objet dans les sciences religieuses. La
troisième enfin fournit un panorama restreint des relations (parfois nettement
conflictuelles) entre ces différents champs disciplinaires. On l'aura compris, la
première partie, et en particulier les deux premières contributions en philosophie de la
religion de J.-M. Tétaz et Ulrich Barth, est en quelque sorte décisive, puisqu'il s'agit de
déterminer ce que peut être l'objet de cette théorie. Par là, on entend plus précisément
la manière dont cet objet est épistémologiquement constitué. Or ce mode de
constitution, relatif au cadre classique de la définition (visant l'essence), entraîne les
difficultés et les apories que l'on sait : si les philosophies de la religion ont marqué leur
limite dans l'appréhension des phénomènes contemporains du religieux, c'est que le
concept de la religion n'est pas adéquat. Il faut donc se sortir d'un « schéma intension/
extension auquel ressortit la théorie classique du concept » (p. 46) qui a fourni la base
constitutive de l'essentiel des concepts issus des Lumières. Un modèle alternatif peut
être alors fourni par le Wittgenstein des Investigations philosophiques : au lieu d'analyser
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
126
l'emploi d'un concept à partir de ses caractères intensionnels, on se rend attentif « aux
réseaux de ressemblances que trace l'usage de la langue », ce que Wittgenstein nomme
des « airs de familles ». On remplace ainsi une conception intentionnelle de la
définition par une conception exemplaire, en décrivant à partir d'exemples bien choisis
de l'usage du mot les règles auxquelles obéit son usage compétent. Établie ainsi à partir
d'une logique de l'appréciation, la notion de religion est ramenée à un mode de validité
spécifique qu'il s'agit alors de décrire, dans le cadre général d'une saisie des modes de
validité des pratiques humaines.
6 U. Barth essaie de délimiter « la religion », à partir d'une approche plus traditionnelle
(de type kantienne), mais renouvelée. Elle s'intéresse ainsi aux structures catégorielles
mises en œuvre dans la conscience religieuse, laissant de côté la description inefficace
d'objets prétendument spécifiques à la religion. Or, d'une part, ces structures ne visent
précisément pas un objet particulier, mais organisent au contraire, au second degré, la
totalité de l'expérience, dont elles essayent d'intégrer les divers modes (sous le schème
de l'inconditionné) : « la religion est interprétation de l'expérience sous l'horizon de
l'Idée de l'Inconditionné ». D'un point de vue subjectif, d'autre part, elles organisent
une « interprétation-de-soi » du sujet.
7 La seconde partie de l'ouvrage reprend ce type d'interrogation au sein de chacune des
disciplines occupées par cet objet. Une approche en termes d'histoire des sciences
s'avère largement féconde. Il est nécessaire en effet, d'une manière générale,
d'historiciser les concepts utilisés par toute théorie de la religion, non seulement en
rendant raison du cadre épistémologique et culturel dans lequel ils ont pris naissance,
mais également en les liant au type même des religions dont ils sont issus : c'est la
fécondité d'une approche comme celle de Jan Assman qui vise à décrire comment le
monothéisme « invente des catégories centrales de la compréhension occidentale de la
religion ». Ainsi la contribution de Carmen Bernand place-t-elle, elle aussi, l'accent sur
les déterminations historiques du concept de religion tel que le construit une
anthropologie qui s'est elle-même constituée dans le cadre idéologique rationaliste des
Lumières, cadre caractérisé par un discrédit jeté sur les formes populaires de la
religion. Il lui faut alors réexaminer les différentes catégories anthropologiques censées
spécifier l'objet religieux et qui sont issues de cette fondation : système de croyance,
rituels (également objets de la contribution de Michael Strausberg), chamanisme,
représentations matérielles..., mais aussi l'idée même de religion comme phénomène
universel. De fait, la conscience des limites inhérentes à ces types de catégories (en
raison de leurs déterminations historiques) n'invalide pas mais, au contraire, peut
renforcer leur caractère opératoire au sein de ces limites précisément perçues. Cette
idée trouve également une application exemplaire lorsque l'on se penche, par exemple,
sur les approches phénoménologique ou psychologique. Cette dernière, comme le
montre P.-Y. Brandt, a paradoxalement tout à gagner à reconnaître son caractère
ethnocentrique (en limitant de facto son champ d'application) et son caractère
« partiel » (limité aux aspects individuels du phénomène religieux). La sociologie de la
religion, bien évidemment, n'échappe pas à cette nécessaire perspective historique : la
contribution de Volkhard Krech peut ainsi montrer non seulement le rôle particulier
qu'a joué la sociologie de la religion dans la constitution de la sociologie, mais aussi
combien la question du devenir de la religion dans les sociétés modernes a constitué
par son interrogation un élément déterminant dans la naissance de la sociologie de la
religion. La perspective historique n'est cependant pas une fin en soi : elle doit
permettre d'éclairer les principes de l'analyse sociologique du phénomène religieux et,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
127
de cette façon, offrir un nouvel aperçu sur ce que peut être une théorie de la religion
(écart méthodologique par rapport à la pratique religieuse et par rapport à la manière
dont la religion tente de se comprendre, abstraction et réduction, conscience du
caractère partiel de l'explication, dialogue des disciplines entre elles, etc.).
8 L'approche historique resterait incomplète si elle ne prenait en compte, dans la genèse
de ces différentes sciences, de leur méthode et de leurs objets respectifs, les
interactions qui les lient depuis leur origine. C'est l'objet de la troisième partie qui
focalise particulièrement l'attention sur les rapports entre théologie, philosophie de la
religion et sciences religieuses. Ainsi la contribution de Burkhard Gladigow essaie
d'analyser la genèse de ces trois branches (et le devenir de leurs rapports) comme
relevant du procès de rationalisation caractéristique de la modernité en Occident et
plus particulièrement de l'histoire moderne de la religion, procès qui, en l'occurrence,
est pensé en termes de professionnalisation. Double procès de professionalisation en
réalité, puisqu'il affecte à la fois la formation des « trois cultures » que sont théologie,
philosophie de la religion et sciences religieuses, et la religion elle-même. Mais en
réalité, il semble que le dessein sous-jacent de cette partie – qui contribue à nourrir un
soupçon rétrospectif sur l'ensemble du livre – soit d'affirmer l'importance de la
théologie – une importance d'ailleurs d'ordre pratique (Ingolf Dalferth) – dans le
concert parfois discordant des sciences du religieux au temps des sciences de la culture
et de la société. On reste à cet égard relativement dubitatif devant la démonstration de
Raphaël Célis qui vise à faire de la théologie un rempart critique contre une pensée
philosophique de l'éthique souterrainement surinvestie de théologie (Lévinas, Derrida)
qui aurait pour conséquence de fragiliser l'ordre éthique. Et il semble que se trouve en
définitive entretenue une certaine confusion entre l'interrogation épistémologique
légitime sur les principes des sciences du religieux et la question de la nécessité
fonctionnelle en modernité de la religion (en réalité du modèle occidental de la
religion). On peut être ainsi surpris de constater qu'un ouvrage qui s'est préoccupé de
repenser critiquement la portée des théories de la religion, reconduise plus ou moins
subrepticement des catégories et des représentations de la religion qu'il s'agissait au
contraire d'interroger. Il n'en reste pas moins cependant que l'ouvrage réunit un
faisceau d'interrogations principielles et essentielles pour qui veut penser la nature
d'une théorie de la religion.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
128
Jean Greisch, Le Buisson ardent et les
Lumières de la raison. L'invention de la
philosophie de la religion
Paris, Cerf, 2002-2004 (coll. « Philosophie et Théologie »)Tome I :
Héritages et héritiers du XIXe siècle, 626 p.Tome II : Les approches
phénoménologiques et analytiques, 555 p.Tome III : Vers un paradigme
herméneutique, 1025 p.
Vincent Delecroix
1 On peut dire qu'en mettant le point final au troisième tome du Buisson ardent..., Jean
Greisch a achevé ce qui pourrait bien être considéré comme un monument de la
philosophie de la religion. Fruits d'un enseignement dispensé à l'Institut Catholique de
Paris, les trois volumes de ce monumental ouvrage ont en réalité dépassé les ambitions
apparemment modestes affichées lors de la publication du premier tome. Certes, il
s'agit de fournir une introduction à la philosophie de la religion et plus précisément à
« l'invention » de la philosophie de la religion à partir du XVIIIe siècle. À ce titre et
compte tenu de la précision et de la richesse d'informations qu'il contient, il devient la
somme incontournable et un des livres de référence pour qui prétend entrer dans le
champ de la philosophie de la religion. Mais, et par la méthode et par le contenu,
l'ouvrage ne se borne pas à une simple description doxographique, aussi ample et
fouillée soit-elle (mais évidemment pas exhaustive). Constamment spéculatif, le livre,
derrière la présentation successive des différentes doctrines, fait jouer et teste des
hypothèses philosophiques. Et le souci de neutralité et de probité lié à cette
présentation s'accompagne sans cesse, et de manière féconde, d'engagements
philosophiques et de discussions serrées non seulement concernant telle ou telle
hypothèse, mais le projet lui-même et la mise en œuvre de quelque chose comme une
philosophie de la religion.
2 L'idée de philosophie de la religion rencontre en effet sa difficulté principielle dans la
tension constitutive entre « le buisson ardent », comme mode d'apparaître spécifique
et irréductible de la vérité religieuse, et « les lumières de la raison », dans leur tâche
notamment critique, comme mode de construction de la vérité philosophique et dont la
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
129
philosophie de la religion est l'héritière directe et immédiate. Une telle tension, si elle
ne doit pas déboucher sur une impasse, fixe en quelque sorte la tâche de la philosophie
de la religion, que l'auteur peut liminairement découper en plusieurs chantiers : le
problème de l'essence de la religion, le problème du sens de la pluralité et de la
succession historique des religions positives, le problème de la teneur de vérité des
différentes religions, enfin « la quête d'une hypothétique “religion absolue” » (Tome I,
p. 33). Telles sont les tâches qui donnent sa spécificité au discours philosophique sur la
religion. Ces chantiers sont évidemment dynamiques et leur articulation est tributaire
de l'histoire de la philosophie elle-même, en ce qu'elle imprime sur leur délimitation
des cadres épistémologiques spécifiques et successifs (ou historiquement coexistants) :
cette articulation et cette délimitation varient par exemple considérablement selon que
l'on a affaire à une philosophie informée par la conscience critique ou informée par la
conscience historique. Par ailleurs, dans l'organisation de ces chantiers, la philosophie
rencontre également des interlocuteurs extérieurs avec lesquels elle a à dialoguer :
c'est un des signes de la modernité propre à l'invention de la philosophie de la religion
que cette « conversation triangulaire » qui lie philosophie de la religion, théologie et
sciences du religieux sur laquelle l'auteur revient maintes fois. Enfin, c'est au devenir
de la religion que sont liées l'invention comme l'évolution de la philosophie de la
religion et notamment, comme le fait remarquer l'auteur dans son introduction
générale, au phénomène de la sécularisation. Ce lien substantiel entre philosophie de la
religion et devenir de la religion fait que l'ouvrage de J. Greisch ne se limite pas à une
« simple » exposition des figures principales de cette histoire ; il se trouve
constamment et heureusement sommé d'interroger le présent de la religion dans le
cadre de chacune de ces figures. Ouvrage donc d'historien de la philosophie, mais
également de philosophe et de philosophe de la religion qui pense la nature
problématique de son objet – tâche qui se marque particulièrement dans le troisième et
considérable volume de cette trilogie – et qui, à l'occasion, ne cache pas, ou mal, ses
prises de position concernant l'intelligence du fait religieux dans la modernité.
3 C'est donc un panorama de l'histoire de la philosophie de la religion qui nous est offert
ici, dont les trois volumes épousent tant soit peu un développement chronologique,
partant des « héritages et héritiers du XIXe siècle » (Tome I), passant par la constitution
des « approches phénoménologique et analytique » (Tome II), pour parvenir à
l'élaboration, pour partie programmatique, d'un « paradigme herméneutique » (Tome
III). Mais si la méthode historique est acquise, elle évite cependant méthodiquement
d'une part une simple exposition chronologique de ses différentes figures et d'autre
part la tentation d'un historicisme qui véhiculerait subrepticement une hiérarchisation
par moments ou par étapes censée mener à une « vraie » philosophie de la religion.
Certes, une sélection est bien opérée dans ce matériau considérable, avec cette
injonction de se limiter « aux auteurs dont la pensée continue à influencer, directement
ou indirectement, les débats philosophiques et théologiques contemporains » (Tome I,
p. 60). Certes, une autre limitation, qui n'est en réalité pas si stricte, intervient, qui
consiste à privilégier « dans une certaine mesure les questions qui se rapportent à
l'interprétation de la foi chrétienne, comprise comme attitude du sujet (fides qua) ou
d'après ses contenus doctrinaux (fides quae) » – ce qui n'empêche nullement de
consacrer évidemment des chapitres essentiels aux philosophies dont l'objet principal
n'est certes pas la foi chrétienne, comme celle d'Hermann Cohen, de Franz Rozensweig,
de Mircea Éliade ou d'Emmanuel Lévinas. Un choix est bien opéré, qui peut se justifier
partiellement (mais pas intégralement) par le lieu et le contexte historique qui
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
130
président à la formation de la philosophie de la religion dans la modernité occidentale.
Le point de vue christiano-centré est apparent, il limite le champ mais n'en invalide en
rien l'exploration. Par ailleurs, le champ étudié de la philosophie de la religion, se voit
lui-même limité à l'aire décrite par les philosophies française, allemande et anglo-
saxonne. Mais, nonobstant ces limitations qu'il faut garder en mémoire, le refus d'un
historicisme plat se traduit surtout par le choix d'une méthode « idéaltypique » (Tome
I, p. 60) qui, à l'étude et à la présentation partiellement stérile des grands philosophes
de la religion, préfère une approche par paradigme « dont chacun présuppose un
concept spécifique de la raison elle-même » (Tome I, p. 61). J. Greisch en énonce cinq
qui donneront leur structure à l'ensemble des trois volumes : spéculatif, critique (Tome
I), phénoménologique, analytique (Tome II) et enfin herméneutique qui forme à lui seul
le contenu du tome III.
4 Chacun de ces paradigmes est exposé à partir d'une présentation générale et surtout de
l'étude fouillée de quelques philosophies dont J. Greisch estime qu'elles sont les plus
représentatives de ces formes spécifiques de raison. Une telle exposition ne néglige pas
d'ailleurs d'annexer des philosophes ou des penseurs bien antérieurs à la constitution
historique de ces paradigmes et de la philosophie de la religion comme discipline
spécifique, mais dont on peut regretter, par exemple pour Spinoza (Tome III) ou pour
Hume, malheureusement très succinctement évoqués dans le Tome I, qu'ils ne fassent
pas l'objet d'une étude pour eux-mêmes. Mais l'ampleur d'une telle étude explique et
atténue considérablement ces inconvénients.
5 L'avantage d'une telle méthode est précisément qu'elle permet de briser la tentation
d'une histoire spéculative (au sens hégélien) de la philosophie de la religion, puisque
non seulement ces paradigmes peuvent coexister dans la modernité la plus récente (par
exemple dans leur expression phénoménologique et analytique et même critique), mais
qu'ils peuvent s'articuler sur plus de deux siècles (ainsi pour le paradigme critique par
exemple). Là aussi cependant se dévoilent certaines limites de la méthode, car il y a
parfois quelque artificialité à faire entrer presque de force dans l'un ou l'autre
paradigme tel ou tel philosophe. Le cas du paradigme critique, de ce point de vue, est
significatif : on comprend évidemment la filiation qui unit la critique kantienne,
fondatrice, à l'idée d'un a priori religieux chez Troeltsch ou à la métamorphose du
kantisme dans la philosophie d'Hermann Cohen ; il paraît plus difficile en revanche de
faire coexister dans le même paradigme la philosophie d'un Kant et celle d'un
Feuerbach, qui pourrait aussi bien ressortir, par son imprégnation hégélienne, au
paradigme spéculatif (quitte à le pousser jusqu'à son exténuation et son renversement)
ou d'un Nietzsche plus fortement marqué par la naissance de la conscience historique
que par le développement du criticisme – à moins de jouer, comme le fait l'auteur, sur
un concept très large du mot « critique », mais dans ce cas, ce qu'il gagne en extension,
il le perd en pertinence. L'enjeu n'est pas ici simplement taxinomique ou classificatoire,
mais consiste bien à rendre raison de la spécificité irréductible de ces philosophies :
d'autres filiations feraient saillir d'autres traits. Le choix de cette paradigmatique
conduit par ailleurs irrémédiablement à marginaliser certains auteurs qui y
rentreraient avec difficulté.
6 Il paraît également que, en raison du critère constitué par le concept herméneutique
d'« histoire de l'efficience » invoqué dans l'introduction générale, ces paradigmes ne
revêtent pas pour l'auteur la même importance ou la même fécondité. C'est d'ailleurs le
mérite d'une telle présentation de clore la plupart de ces larges aperçus par une série
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
131
de questions qui en interrogent à la fois les difficultés, les limites et la fécondité au
regard des débats contemporains et de leurs propres prémisses. Même s'ils ne sont pas
jaugés uniquement en fonction d'une « histoire de la réception » ou plus simplement
d'un progrès éventuel des sciences du religieux, ils ne manquent pas d'être pris dans
une histoire qui les juge. La notion d'héritage attachée à la présentation des
paradigmes spéculatif ou critique, par exemple, laisse bien apercevoir à la fois leur
caractère fondateur et leurs limites historiques. On voit aussi dans le développement
très important consacré au paradigme phénoménologique (Tome II) et à ses
ramifications dans la phénoménologie française contemporaine l'orientation
souterraine qui guide ce panorama général et que confirme nettement le troisième
tome consacré au paradigme herméneutique. C'est un choix qui se manifeste également
dans le traitement nettement plus critique, par exemple, du paradigme analytique (en
particulier du pragmatisme anglo-saxon), dont la fécondité actuelle est pourtant, dans
le champ de la philosophie de la religion, largement avérée. Même si Husserl,
Wittgenstein et Heidegger, constituent pour l'auteur les trois phares qui éclairent le
champ de la philosophie contemporaine, il semble finalement qu'ils ne brillent pas avec
la même intensité dans l'esprit de l'auteur.
7 En réalité, le véritable tournant de cette étude est pris dans le troisième et considérable
volume consacré au paradigme herméneutique, domaine propre de la philosophie de
J. Greisch depuis de nombreuses années. Il s'agit alors pour lui d'appliquer à la
philosophie de la religion les principes de cette orientation herméneutique de la
philosophie au développement de laquelle il a personnellement, avec Paul Ricœur,
largement contribué en France. On a bien affaire alors à un changement de cap et
l'enquête revêt un tour nettement programmatique, ouverture que l'auteur rappelle
encore dans sa présentation finale de la philosophie de Paul Ricœur : « C'est en
pratiquant à mon tour une “dialectique à synthèse ajournée” que j'achèverai mon
enquête, qui, elle aussi, ne débouchera pas sur un “mot de la fin” » (Tome III, p. 735).
C'est que la constitution du paradigme herméneutique oblige l'auteur à une « reprise »
générale de l'histoire de la philosophie de la religion parcourue jusque-là pour la
comprendre et l'ouvrir à un horizon nouveau. L'auteur est conscient du risque
encouru : « Elle pourrait induire le malentendu d'après lequel le paradigme
herméneutique se présenterait comme la “relève” (Aufhebung) des autres paradigmes »
(Tome III, p. 161). Le risque d'une telle perspective hégélienne est-il tout à fait écarté
par ces déclarations d'intention ? C'est la question que l'on peut se poser au regard
même de la méthode pratiquée qui consiste alors à reconsidérer chaque paradigme
pour y « sonder les potentialités herméneutiques ». Et l'irréductibilité reconnue de ces
autres paradigmes à l'égard de leur inscription dans le champ herméneutique n'éloigne
pas davantage ce risque.
8 Reprenant l'histoire de l'herméneutique depuis ses origines techniques dans
l'herméneutique biblique et même en deçà, dans le signalement présocratique et
platonicien du problème de l'interprétation, pour déboucher sur la constitution
historique d'une herméneutique philosophique universelle avec W. Dilthey et H.-G.
Gadamer, J. Greisch parcourt alors à nouveaux frais quelques-unes des grandes figures
étudiées dans les tomes précédents à la recherche « d'indices ». Dans une telle
relecture, les paradigmes spéculatif, critique, mais plus encore phénoménologique (qui
pratique la « greffe » définitive) se voient, dans leurs limites propres, offrir leurs
services pour la constitution de cet ultime paradigme. Or il ne s'agit pas
d'herméneutique en général, mais bien d'un modèle herméneutique pour la philosophie
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
132
de la religion, raison pour laquelle d'autres orientations ou d'autres « passeurs » sont
requis, dont certains sont paradoxalement aussi éloignés qu'on peut l'être de la
philosophie herméneutique, comme l'est Bergson (malgré tout réinvesti par le biais de
cette approche phénoménologique qui occupe tant, depuis un certain temps, les études
bergsoniennes). Mais c'est essentiellement avec M. Heidegger d'une part et P. Ricœur
d'autre part que le paradigme herméneutique en philosophie de la religion trouve sa
pleine expansion, alors même qu'on ne trouve ni chez l'un, ni chez l'autre, la
constitution spécifique d'une philosophie de la religion. C'est d'ailleurs ce qui permet à
l'auteur de considérer la philosophie herméneutique de la religion comme une Terre
promise au bord de laquelle il est contraint de s'arrêter sans y pénétrer (« L'avenir seul
nous dira si [elle] (...) portera fruit, ou non »), Terre promise qui n'est pas elle-même
sans limite, puisqu'elle participe d'une philosophie de la religion qui, selon l'auteur, se
tient sur « l'autre rive », contemplant avec les yeux de la raison critique l'embrasement
mystérieux du buisson ardent.
9 Il reste que, dans de telles déclarations, se laisse voir le risque d'une philosophie de la
religion dont la frontière avec la philosophie religieuse n'est pas toujours très nette,
quels que soient les avertissements liminaires que l'auteur a pu prononcer à ce sujet. Or
la philosophie herméneutique de la religion n'est peut-être pas effectivement le mot de
la fin. Le fait, par exemple, que l'auteur ait intentionnellement négligé un autre
paradigme possible que constituerait la raison communicationnelle, au motif que celle-
ci n'aurait pas pour le moment produit de fruits en ce domaine, ce qui est bien
discutable et ce qui d'ailleurs ne permet pas, comme pour l'herméneutique, d'en
ignorer l'éventuelle fécondité à venir, pourrait être interprété comme un refus
présenté à toute philosophie qui se tiendrait résolument à couvert de toute tentation
religieuse. Mais c'est toujours le mérite d'un grand livre que de susciter des
interrogations, ce qui démontre une fois de plus que derrière cet historique de la
philosophie de la religion qui fera date s'exerce une puissante réflexion philosophique.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
133
Yusuf Fadl Hasan, Richard Gray
(eds.), Religion and Conflict in Sudan
Nairobi, Paulines Publications Africa, 2002, 208 p.
Claude Arditi
1 Ce livre regroupe des communications présentées lors d'un colloque tenu à l'université
de Yale en 1999. Le Soudan est depuis 1955 le lieu de guerres civiles qui sont
responsables de la mort et du malheur de millions de personnes qui ont failli, à diverses
reprises, détruire l'État et la société. Ces guerres sont le plus souvent vues comme
l'expression de conflits entre le nord musulman et le sud, en grande partie chrétien.
Cependant des analyses plus approfondies ont mis l'accent sur d'autres causes qui
ressortissent à l'histoire précoloniale et coloniale du Soudan. La violence a été très
présente au XIXe siècle et la paix imposée par le colonisateur anglais sur l'ensemble du
pays a révélé que des régions, particulièrement le sud, n'avaient guère été préparées à
accéder à l'indépendance politique. De plus une forte compétition s'est manifestée pour
l'utilisation de ressources rares telles que les terres cultivables, les pâturages, les eaux
du Nil et plus récemment le pétrole. Les conflits religieux ne sont le plus souvent
compréhensibles qu'en rapport avec ces enjeux économiques.
2 Au Soudan, comme dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, la religion a été utilisée
aussi bien pour justifier une implacable répression armée que pour servir de base à des
initiatives pour ramener la paix et la justice dans le pays. Le gouvernement actuel, à la
suite d'autres, a justifié ses actions en se référant à l'islam, certes défini de manière
étroite, mais s'est aussi servi de celui-ci pour atteindre ses objectifs politiques.
3 Dans un chapitre introductif qui retrace à grands traits les moments les plus
importants de l'histoire du Soudan, indispensables à la compréhension de la situation
actuelle, R. Gray et Y. F. Hassan s'intéressent aux trois grandes traditions religieuses du
pays (islam, christianisme et animisme) et à leur rencontre avec la modernité (p. 13-21).
La pénétration de l'islam a été le fait de pasteurs arabes et de commerçants musulmans.
Elle s'est étalée sur une longue période qui a commencé au Xe siècle par l'arrivée de
petits groupes dont certains s'installèrent dans la vallée du Nil tandis que d'autres
poursuivaient leur route vers l'Ouest. Les royaumes chrétiens de Nubie résistèrent à
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
134
cette pénétration jusqu'au début du XIVe siècle mais en 1317 un prince arabisé et
musulman fut installé sur le trône à Dongola. Le christianisme survécut pourtant de
manière résiduelle jusqu'au XIXe siècle. Les pasteurs arabes pénétrèrent en grand
nombre au Soudan et furent les artisans d'un double processus d'islamisation et
d'arabisation des populations locales qui se traduisit par l'adoption de coutumes et de
généalogies arabes et surtout de l'arabe qui devint lingua franca de la plus grande partie
du Nord du pays. Les migrations vers l'Ouest se sont poursuivies et explique qu'on
trouve de nos jours des Arabes au Tchad, au Cameroun et au Nigeria. Ce processus fut
mis en œuvre par deux types d'acteurs. D'une part des soufis (mystiques) conciliants et
pacifiques et des oulémas (hommes instruits dans les études islamiques) qui
enseignaient les principes de l'islam et de la shari'a. Les uns et les autres furent bien
accueillis par les sultans et les chefs Funj. L'école coranique et la mosquée ont constitué
les bases de l'enseignement islamique dans le sultanat Funj et ont peu à peu attiré des
étudiants originaires d'autres régions (Kordofan, Darfour, Bornu). En outre, des
étudiants partaient étudier en Égypte et en Arabie. La poursuite de ce processus
d'arabisation et d'islamisation fut telle qu'en 1800 la frontière des États musulmans
coïncidait avec la latitude dix degrés nord et que des raids esclavagistes étaient lancés
en direction du Dar Fertit et du Dar Banda. Peu à peu cette influence gagna aussi les
monts Nuba (sud Kordofan) dans lesquels vivaient depuis très longtemps des
populations ayant peu de contacts avec l'extérieur. Le développement d'une identité
musulmane soudanaise se fit de manière très progressive avec une alternance de
périodes d'avancée et de stagnation, voire de recul. Parmi les populations du Nil, seuls
les Shilluk occupaient un territoire densément peuplé dans lequel ils contrôlaient des
lieux stratégiques. Au-delà se trouvaient les Nuer et les Dinka, populations de pasteurs
désireux de préserver leur indépendance comme le remarquait Evans-Pritchard qui fut
le premier anthropologue à les étudier. La modernité fit irruption dans ce monde
isolé avec la conquête du Sennar en 1820 par le régime turco-égyptien de Muhammad
Ali dont la supériorité militaire (armes à feu) et technique eut rapidement raison des
résistances locales et permit une pénétration vers le Sud du pays, initiant ainsi une
période de capitalisme mercantile liée à la révolution industrielle en Europe. La
politique de modernité fut incarnée par le règne d'Ismail (1863-1879), petit-fils de
Muhammad Ali, qui développa les communications, recruta des administrateurs et
techniciens européens et étendit les frontières de son royaume jusqu'aux sources du
Nil. Simultanément sous la pression occidentale, il favorisa les tentatives de lutte
contre l'esclavage. Pendant le régime turco-égyptien, des oulémas chargés d'appliquer
la shari'a émergèrent mais ils ne parvinrent pas à éliminer les soufis qui avaient les
faveurs du peuple. La révolution mahdiste, qui fut l'une des manifestations de
rénovation qui traversa le monde musulman aux XVIIIIe et XIXe siècles, renversa le
régime avec l'objectif de retourner aux bases de l'islam : le Coran et la Sunna. Cette
période marqua profondément la société soudanaise. En 1898 les Anglais remplacèrent
le régime turco-égyptien et cherchèrent à demeurer neutres en matière religieuse.
L'islam devait être, comme en Inde, réservé à la sphère privée mais la venue de
missions catholiques dans le Sud n'était pas souhaitée par le pouvoir colonial bien que
leur action ait été tolérée par le régime précédent. En conséquence jusqu'à
l'indépendance les missions catholiques avaient eu très peu d'influence dans le Sud.
L'élite, composée en grande partie de nordistes, qui prit le pouvoir à l'indépendance
possédait un héritage culturel et religieux complexe. C'est à partir de ce contexte que
les contributeurs ont développé leurs interventions. Certains d'entre eux ont montré
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
135
comment le gouvernement du NIF (National Islamic Front) qui prit le pouvoir en 1989 a
utilisé la proclamation du jihad et la restriction de droits bien implantés dans la société
civile pour mobiliser ses partisans (Abdel Salam Sid Ahmed, Azza Anis). D'autres ont
étudié la religion et les conflits dans les monts Nuba (Hunud Abia Kadouf) en montrant
l'existence d'un pluralisme religieux dans la mesure où la religion traditionnelle a pu
cohabiter avec l'islam ou le christianisme. Plusieurs exemples montrent comment la
religion a été manipulée pour des raisons « ethniques » ou « raciales ». Ainsi la
proclamation du jihad dans les monts Nuba ne peut se comprendre sans se référer à
l'armement en 1986 par le gouvernement de milices armées chez les Arabes Baggara
chargées de protéger ces derniers des attaques du Sudan Popular Liberation Army, dans
le but de masquer une situation politique bloquée. Conjointement une politique
d'arabisation et d'islamisation des populations des monts Nuba fut instaurée dans
l'intention de créer une « ceinture arabe » pour résoudre des problèmes strictement
politiques. Il est difficile de présenter ici en détail tout l'intérêt des autres
communications qui traitent de questions aussi diverses que le développement du
christianisme dans le sud (Richard Gray), l'expérience religieuse des populations Kuku
parties en exil en Ouganda (Scopas Sekwat Poggo), les dimensions religieuses de la plus
longue et meurtrière guerre civile (Sharon Elaine Hutchinson) ou enfin la conversion
au christianisme dans la province de l'est du Nil (Marc R. Nikkel).
4 Dans un dernier chapitre (Épilogue) R. Gray remarque que, quelle que soit leur qualité
intrinsèque, les communications reflètent mal une situation économique et sociale qui
évolue très rapidement. Il pense particulièrement à l'impact de la production pétrolière
en pays Nuer et Dinka qui assure au gouvernement de Khartoum des revenus très
importants qui, au lieu d'être utilisés pour un développement harmonieux du pays,
servent à équiper l'armée en matériel moderne. Celui-ci est utilisé pour tenter
d'anéantir les populations rurales ou de leur faire quitter la région. En résumé,
l'ensemble des communications s'accorde à constater que si les facteurs religieux ont
joué un rôle secondaire dans la survenue des conflits au Soudan, ils n'en ont pas moins
permis l'émergence d'idéologies, qui en sont directement issues et qui ont toutes
permis de légitimer la violence.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
136
Bertrand Hell, Le tourbillon des génies.
Au Maroc avec les Gnâwa
Paris, Flammarion, 2002, 371 p.
Constant Hamès
1 Rapporter de façon vivante la vie et les pratiques cérémonielles des groupes des Gnâwa
et de leurs affiliés au Maroc, semble être, à la lecture, un des objectifs de cet écrit.
« Ausculter froidement ? Voilà effectivement l'écueil que j'ai souhaité éviter », indique
l'auteur dans son introduction. Si des années d'enquêtes parmi les Gnâwa se sont faites
avec une implication personnelle forte de l'auteur, le résultat en forme de livre
s'efforce d'en restituer le vécu, le palpable, le sensible, le communiel. Mais le discours
n'en est pas pour autant échevelé, au contraire, il est très construit, très élaboré, un
peu sans doute à la manière des Gnâwa eux-mêmes qui font une large part dans leurs
rituels, à l'émotion, au terrible, au ludique, à l'affreux mais qui l'extériorisent de façon
contrôlée, concertée, codifiée. Des sentiments, oui, extrêmes parfois, mais canalisés.
2 Chacun – ou presque – des quatorze chapitres débute, en dehors d'un listing
impressionnant de citations liminaires, par une page ou l'autre d'un journal de bord
tenu par le chercheur, au plus près du rendu immédiat des séances rituelles des Gnâwa
auxquelles il a assisté, année après année, ville après ville, nuit après nuit. Le vécu, le
« direct » est donc bien là et la description des personnages, acteurs ou amateurs,
l'ambiance, le concret verbal (dialecte marocain ou langage codé gnâwa),
l'environnement social et matériel sont restitués dans un style de littérature vivante.
3 En vérité, cette introduction quasi-touristique sur les lieux de déroulement d'un
cérémoniel particulier, le plus souvent privé, apparaît comme un prétexte
pédagogique, un éveil de la curiosité, pour développer les différents thèmes de « la
réalité profonde des rituels de possession » (p. 13).
4 L'ordre suivi reproduit celui de l'ensemble d'une nuit cérémonielle (lîla) et se focalise,
cha-pitre après chapitre, sur des analyses historico-anthropologiques des entités et
êtres de toute nature intervenant plus particulièrement à tel ou tel stade de
l'avancement du rituel. Que les Gnâwa soient noirs de peau, qu'ils aient des rapports
avec l'Afrique, qu'ils fassent partie de l'histoire du Maroc ou de ses mythes, qu'ils
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
137
instillent de la « sauvagerie » nocturne dans un consensus islamique conformiste et
réservé, voilà qui nourrit les réflexions de plusieurs chapitres. D'autres sont plus
centrés : « Les maîtres de la baraka » (chap. X) analyse les voies de circulation de cette
« force vitale », entre hérédité et contagion sociale (mais, pourrait-on objecter,
l'hérédité n'est-elle pas la première et la plus importante des contagions ?).
« Le protecteur, le porte-drapeau » (chap. VI) insiste sur les rapports, à la fois
de légitimation et de protection, entretenus par les groupements gnâwa avec
l'archétype du saint et de l'initiateur des confréries islamiques, Abd al-Qâdir al-Jilânî.
Mais les chapitres centraux et au-delà, les thèmes les plus fournis en analyses et
perspectives, concernent les manifestations de « l'invisible » sur lesquelles et avec
lesquelles « travaillent » les Gnâwa, à savoir ces êtres protéiformes, jinn ou génies, qui
incarnent, à travers leurs serviteurs possédés, tout le kaléidoscope de la nature
humaine, de « l'animalité dévorante », de « la bestialité » et des « transgressions
rituelles » jusqu'aux joies ludiques, au « feu de la connaissance », au « flux vital »
(vocabulaire bergsonien ?). Offerts aux participants – au sens fort du terme – ces
parcours existentiels fortement cathartiques s'adressent souvent à un public en état de
souffrance, physique ou sociale. Mais si l'indication thérapeutique est présente, elle
apparaît comme logiquement secondaire car ici la maladie est vécue « comme le point
de départ du cheminement initiatique », l'épreuve obligatoire d'entrée dans la
profession, suivant une règle habituelle des sociétés secrètes ou de l'initiation à la
magie.
5 Les chapitres finaux marquent une rupture avec une anthropologie classique – si elle
existe – qui s'en serait peut-être tenue au cœur des rites et de leur fonctionnement. En
effet, les rituels gnâwa, dans le Maroc touristique de la fin du XXe siècle, se
transforment de plus en plus en exhibitions festivalières ou hôtelières où le secret
devient public et banal, où le temps de la cérémonie se rétrécit et se disloque, où les
accessoires centraux disparaissent, bref où le sacré devient profane et est profané, si
l'on interprète à peine la pensée de l'auteur qui scrute avec une certaine anxiété ces
« transformations du culte », cette « perte des savoirs » et ces « pots renversés ».
Ultime indice de l'évolution : la possession rituelle, inséparable d'un vécu social
collectif et participatif, se réduit à une sorte de « transe » individualisée dont le modèle
ressemblerait fort à celui des « raves-parties occidentales » (p. 355).
6 On comprend que ce livre propose une immersion complète dans l'univers gnâwa et
que son mérite consiste surtout à offrir une transcription et traduction écrites
élaborées des rituels, des acteurs et de leurs multiples interactions et significations.
7 Pour autant, l'on n'est pas obligé de suivre certaines tentations de la « subjectivité
assumée » de l'auteur et de penser que, par exemple, « la pensée occidentale ne dispose
pas de tous les outils pour déchiffrer le mécanisme culturel du “ravissement” et que “le
rituel des Gnâwa pose toujours une énigme à la science” » (p. 15). On voit poindre, à
travers quelques-uns de ces propos – discrets et limités à l'introduction – une sorte de
jdanovisme qui opposerait non une science marxiste à une science bourgeoise mais un
mode de connaissance gnâwa à un mode de connaissance scientifique. C'est une
question très générale. Les registres ne sont pas du tout les mêmes. La connaissance
scientifique n'a pas vocation à réduire « l'énigme » d'un autre mode de connaissance
mais plutôt à en rendre compte et à le transcrire dans un langage aux caractéristiques
non pas particulières mais universelles. Il aurait été souhaitable d'aborder cette
question de front et non par quelques allusions elliptiques.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
138
8 Quelques autres remarques. L'éditeur a sans doute sa part de responsabilité dans le fait
que le lecteur soit privé de toutes les références des informations autres que celles de
l'enquête directe et qui obligent à prendre pour argent comptant un certain nombre
d'indications. Dans le même esprit, la bibliographie reste succincte.
9 Quelques coquilles dans les transcriptions de l'arabe (dont le système reste aléatoire) :
il est écrit « Shurshtariya » pour Shushtariya (p. 101), « Naqshandiya » pour
Naqshbandiya (p. 166) et « la racine BKR signifiant bénir » pour BRK (p. 231). Sur ce
dernier point, dire que « dans la pensée antéislamique, le terme de “baraka” renvoie
étymologiquement aux idées d'accroupissement (du chameau) » (p. 232) est exact mais
il est toujours en vigueur au XXIe siècle (le français baraque, baraquement en provient
car le lieu où l'on fait baraquer son chameau est le lieu où l'on réside, même
temporairement). Par contre, on ne voit pas le rapport entre cette « étymologie » et la
notion de « baraka » comme « influx invisible ». Les termes en provenance d'une même
racine arabe peuvent avoir des significations très diverses, voire opposées, sans lien
apparent. Une coquille en français (p. 123) : « vivre exclusivement des dons qu'il
recueille dans sa sibylle » (pour sébile).
10 Il y a anachronisme à parler des agglomérations de Taodéni ou de Walâta à l'époque
almohade (p. 77) et sans doute aussi à évoquer la « clarinette » dans des propos
attribués au Prophète de l'islam (p. 99). À cette même page, il y a probablement une
confusion à propos du « cheikh marocain Sirhindi (XVIIe siècle) » car Ahmad Sirhindî
(1564-1624) est né et mort à Sirhind, Penjâb indien, à l'époque moghole.
11 Sur le plan d'une anthropologie des sociétés musulmanes, deux questions de fond
auraient mérité d'être traitées. D'abord celle du modèle socioreligieux représenté par
les groupements gnâwa. L'ouvrage donne le change car il y est question, tout au long,
de la « confrérie » des Gnâwa (p. 83 ; 114, « populaire » p. 123) et les rapports avec AQ
al-Jilânî sont soulignés, les parallèles avec d'autres « confréries » établis, allant jusqu'à
suggérer des identités religieuse et sociale à travers des lieux de culte (zâwiya de
Tamgrût). Mais il n'est pas dit en quoi cette notion de « confrérie », traduction de
l'arabe tarîqa, est pertinente ou non dans le cas des groupements gnâwa. L'ouvrage,
comme on vient de le voir, suggère des rapprochements mais il ne souligne ni n'analyse
les points de divergence, plus importants. Pas de généalogie spirituelle, de maître en
disciple, jusqu'à un éponyme fondateur qui donne en général son nom à la tarîqa-
confrérie, ce qui n'est pas le cas du terme identitaire gnâwa. Les références centrales
des groupes des Gnâwa ne se font pas en direction des saints de la confrérie (et du
Prophète) mais bien en direction des jinn. Les cérémonies nocturnes des lîla n'ont, sur le
fond religieux, pas de rapport avec les séances de dhikr du vendredi après-midi des
confréries. Les Gnâwa ne rentrent donc pas dans le modèle religieux des turuq, ils ne
trouvent pas leur origine dans la logique de ce système. Par contre, ce modèle étant le
seul à fonctionner institutionnellement et légitimement dans l'espace musulman, les
groupements gnâwa s'en sont rapprochés au mieux, au fil du temps. Leur modèle
d'origine, centré sur le phénomène de la « possession », relève, au moins dans nombre
de ses aspects, de rites sahéliens ouest-africains (voir p. 262 ss).
12 L'autre question concerne l'utilisation, sans définition, de la notion de « magico-
religieux », reprise à différents moments, par exemple, p. 80 : « les Gnâwa revendiquent
une puissance magico-religieuse », p. 121 : « jouer d'une altérité magico-religieuse ».
L'expression n'aide en rien, au contraire, à clarifier ce qui est en jeu dans le cérémoniel
gnâwa. Que penser, dans ce sens, de la réflexion : « Les Gnâwa se meuvent sur la marge
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
139
de la licité (pour licéité) religieuse, dans cet espace flou où religion et magie devraient
se disjoindre » ? Est-ce un acquiescement à la thèse de la magie, marge de la religion ?
Ou une indication encore de l'existence d'une « énigme » gnâwa ?
13 On voit que les questions suscitées par cet ouvrage vivant et élaboré, avec un apport
très riche en données et analyses de terrain, permettent de cerner mieux, à défaut de
les résoudre, les spécificités (et les généralités) du fonctionnement et de l'évolution des
groupements gnâwa au Maroc.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
140
Patricia Hidiroglou (éd.), Entre
héritage et devenir. La construction de
la famille juive. Études offertes à Joseph
Mélèze-Modrzejewski
Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, 416 p. (coll. « Homme et
société » 28. Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Régine Azria
1 Que dit le judaïsme de la famille, du système matrimonial, du contrat de mariage, du
lévirat, de l'inceste, de la sexualité, de l'héritage, de la filiation, de la transmission du
nom, de l'éducation des enfants ? Comment les lois sur le mariage et celles relatives à sa
dissolution, comment le lévirat (qui introduit l'éventualité de la bigamie), s'accordent-
ils avec le droit moderne, notamment la loi française ? Ce recueil d'études réunies par
P. Hidiroglou apporte des réponses à quelques-unes de ces questions ou ouvre des
pistes. Il s'inscrit dans la foulée des travaux d'histoire et d'anthropologie consacrés à la
famille et à la vie privée menés depuis ces quelque vingt dernières années. Partant
d'une réflexion sur la famille contemporaine, les auteurs-contributeurs ont été appelés
à s'interroger sur « un certain nombre d'invariants propres à toute culture mais
différemment résolus par les sociétés juives dans l'espace et le temps ». C'est ainsi que
l'introduction présente cette entreprise collective. Trois invariants ont été retenus qui
structurent l'ouvrage en trois parties :
2 1) le contrat social que représente toute alliance est le premier d'entre eux. Sont
traités dans ce cadre des questions relatives à l'héritage des femmes, étudié ici à partir
de sources documentaires anciennes : bible, épigraphie et papyrologie ; aux fiançailles
et au mariage à l'époque hellénistique et romaine ; à la ‘halitsah, cérémonie du
déchaussement qui libère la veuve sans enfants et son beau-frère de l'obligation du
mariage léviratique ;
3 2) le second invariant concerne l'éducation des enfants et la transmission de l'identité.
Jean Baumgarten y attire notre attention sur la place centrale qu'accordent à la famille
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
141
les livres de morale en yiddish destinés aux juifs simples ou peu cultivés rédigés aux
XVIe-XVIIIe siècles, une période de profondes mutations de la société juive traditionnelle,
marquée, nous dit l'auteure, par une certaine forme de privatisation de l'éducation due
à la crise des institutions scolaires juives traditionnelles et aux déficiences des
instances communautaires. Kathy Hazan, de son côté, étudie la prise en charge par des
organisations juives des enfants de déportés juifs devenus orphelins. Si toutes les
organisations de sauvetage manifestent la même volonté de maintenir les enfants dans
le judaïsme, les contenus diffèrent de l'une à l'autre en fonction de leur « obédience »,
religieuse ou laïque, sioniste, bundiste ou communiste. L'auteure analyse les succès et
les limites de ces structures d'encadrement qui n'avaient certes pas vocation à
remplacer les parents mais qui se sont efforcé de recréer au moins une ambiance
familiale et d'assurer une transmission « juive ». Enric Porqueres i Gené nous introduit
à la complexité de la transmission identitaire au sein des familles conversos des Xuetes
de Majorque, une complexité liée aux divergences religieuses au sein des fratries elles-
mêmes autant qu'aux stratégies matrimoniales, une transmission qui se faisait, le plus
souvent au sortir de l'adolescence au moment du mariage. Patricia Hidiroglou, quant à
elle, nous livre l'analyse approfondie d'une enquête qu'elle a menée autour d'une
tradition judéo-tunisienne tombée en désuétude depuis quelques générations puis
reprise depuis les années 1990 : l'envoi à la future mariée par la belle-famille de sept
paires de chaussures en cuir, à l'occasion de la cérémonie du henné (qui précède le
mariage) ;
4 3) le troisième invariant enfin concerne les représentations et les modèles familiaux
confrontés aux réalités. Ce qui nous permet de faire la connaissance des Kaminski, une
famille pour le moins atypique d'acteurs de théâtre. Véritable dynastie de femmes, la
mère Esther-Rachel et la fille Ida, entourées et épaulées par les autres membres de la
famille, ont été les créatrices et les promotrices d'un théâtre yiddish de qualité. Le
théâtre juif d'État créé à Varsovie par Ida, après la Deuxième Guerre mondiale, porte le
nom de la mère, Esther-Rachel, un nom qu'il conserve jusqu'à ce jour. Dans un article
sur le cinéma et la famille juive, Claude Singer étudie l'évolution de la représentation
de la famille, un thème récurrent dans les films où il est question des juifs. La famille y
apparaît successivement, selon la classification opérée par C. Singer, en tant que
cellule-refuge dans un environnement hostile, comme vecteur de la transmission et de
l'identité, enfin comme modèle, contesté peut-être, mais demeurant une référence
incontournable. L'article de Simone Mrejen O'Hana nous propose une étude longue et
fouillée des sources, méthodes, thématiques et conclusions apportées par la
démographie historique juive (XVIIIe-XXe siècles). Entre autres apports intéressants,
cette étude met à mal le mythe de la « prolifération » juive – un mythe malveillant
probablement lié à l'existence effective de familles nombreuses particulièrement
visibles mais non représentatives de l'ensemble, à la forte concentration des
populations juives dans des périmètres réduits, à l'immigration et à une moindre
mortalité des juifs – et montre à l'inverse que la taille des familles juives,
majoritairement de type nucléaire, différait peu de celle des familles non-juives
européennes, la natalité juive connaissant même un net fléchissement qui devait
anticiper la transition démographique moderne des sociétés européennes. Enfin, ce
recueil riche et divers se clôt sur la présentation d'une étude de Lisa Antéby-Yémini sur
la transition du système matrimonial des juifs éthiopiens consécutive à leur migration
en Israël. Dans leur pays d'origine les pratiques matrimoniales et familiales des Beta
Israel étaient proches à la fois des modèles bibliques (famille étendue et ignorance de la
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
142
halakhah du judaïsme rabbinique), éthiopiens et chrétiens. L'auteure montre comment,
confrontés au système matrimonial rabbinique occidental, les Éthiopiens d'Israël en
sont venus à « préfigurer de nouveaux systèmes de conjugalité et de parenté, inventant
à leur manière la famille postmoderne – et postnucléaire – avant l'heure ». Alors que la
société occidentale (en l'occurrence israélienne) ne fait que découvrir l'ampleur des
phénomènes de divorces, de relations hors mariage, de naissances hors couple, de
recompositions familiales, ces pratiques sont depuis longtemps familières aux juifs
éthiopiens. En effet, nous dit-elle, leurs modèles familiaux, étendus et aux contours
flexibles, étant plus souples que ceux de la famille israélienne, ils semblent mieux
préparés à faire face aux nouvelles questions de parentalité : parentés multiples,
biologique et sociale, familles recomposées, etc. auxquelles nos sociétés dites avancées
se trouvent confrontées.
5 On attend avec impatience la parution d'un éventuel second volume. Comme le lecteur
aura pu le constater, le chantier ici ouvert est vaste, et déjà largement défriché (toutes
les contributions n'ont pas été évoquées dans ce compte-rendu), mais bien d'autres
questions encore attendent d'être traitées comme ici, c'est-à-dire dans le souci de
l'érudition, de la comparaison, de la mise en perspective (historique, juridique,
géographique), de l'actualisation : redéfinitions de l'identité et de la famille juive dans
le contexte du judaïsme pluriel, conversion, mariage mixte dans le contexte des
sociétés ouvertes et technologiquement avancées d'aujourd'hui. Rendez-vous est pris !
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
143
Laënnec Hurbon, Religion et lien
social. L'Église et l'État moderne en
Haïti
Paris, Cerf, 2004, 317 p.
Nathalie Luca
1 Laënnec Hurbon nous offre, à travers cet ouvrage, un regard passionnant, riche et
touchant sur la société haïtienne dont il dévoile la profonde crise d'identité. Soulevant
chaque parcelle de son histoire, plongeant au cœur de ses souffrances, il nous livre une
analyse remarquable sur la place ambiguë de la religion, et plus encore du
christianisme, dans la construction d'une nation peu certaine de ses frontières
symboliques. Les colons voyaient dans l'évangélisation des Caraïbes le moyen d'obtenir
la docilité des esclaves. Ceux-ci ont vu dans leur conversion le moyen de leur échapper,
de leur résister, soumettant la nouvelle croyance à leur propre culture au point d'en
faire un instrument de leur indépendance. L'histoire est connue. On l'approfondit avec
plaisir sous la plume alerte de l'auteur qui s'en sert pour percer la société
d'aujourd'hui.
2 Très tôt, les églises ont donné aux esclaves un espace public où se réunir et consolider
un lien social secrètement tissé par les croyances et pratiques rituelles africaines
unifiées autour du vaudou. Pourtant, quand la Constitution de 1801, œuvre de
Toussaint Louverture, vient dessiner les contours du futur État indépendant, le vaudou
est fermement tenu à l'écart. L'Église catholique assoit sa position privilégiée, devenant
le seul culte reconnu. Dessalines, par qui l'indépendance est proclamée le 1 er janvier
1804, opère, au niveau constitutionnel, une laïcisation de la société, tolérant la liberté
des cultes, et ne pourvoyant pas à leur entretien. En réalité, ce « Père » de la nation vise
la soumission de toutes les religions au nouvel État, ce qui passe par une distance
affichée face au Vatican dont l'ingérence est refusée. Cette situation se durcit sous le
gouvernement Boyer (1818-1843). Il participe à l'indigénisation d'une Église de plus en
plus soumise à l'État. Elle devient, avec Soulouque (1847-1959), Église nationale. Ce
dernier fait régner une telle terreur sur l'ensemble de la population que sa chute
participe à une amélioration des relations entre l'État haïtien et le Vatican. Un
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
144
concordat est signé en 1860. Il permet à l'Église de « mettre en œuvre sa propre
discipline et de gérer ses biens sans empiètement de l'État ». Elle demeure néanmoins
adossée à l'État, évêques et archevêques étant nommés par le Président. Elle le sert en
assumant l'éducation et l'instruction d'une élite occidentalisée, vitrine civilisée
assurant « la reconnaissance du pays à l'étranger ».
3 On arrive alors au cœur du problème qui persiste jusqu'à nos jours. Le vaudou a été
considéré incapable, aux yeux des autorités haïtiennes, d'assurer à la nation une
respectabilité internationale. Elles lui ont donc préféré la religion du colon, seul
instrument apte à entretenir selon elles un lien civilisationnel solide entre Haïti et les
puissances occidentales. Sur cette déchirure culturelle se sont construites les frontières
symboliques de cette nation, frontières empruntées aux colons, frontières oublieuses
du rôle du vaudou dans l'indépendance du pays, frontières incapables de lier
durablement à l'élite une population paysanne défavorisée, restée attachée à sa culture.
Les paysans, soit 90 % de la population, furent déclarés inférieurs, ce qui justifia qu'ils
ne bénéficient pas du droit de vote. Parce qu'ils souillaient la réputation d'Haïti en se
liant à la « sauvagerie africaine », ils furent régulièrement insultés et sévèrement
réprimés. Le vaudou fut maintenu à l'extérieur des villes, ce qui renforça la scission
entre deux cultures devenues concurrentes. Il fut exploité dans les conflits entre les
différentes factions politiques, jusqu'à ce qu'anarchie s'en suive, affaiblisse le pays et
permette l'occupation américaine (1915-1934). Les Américains, chez eux si sensibles
aux notions de libertés religieuses, profitent de la honte d'une partie des Haïtiens pour
leur propre culture pour porter un message civilisateur : ils sont là pour faire « œuvre
civilisatrice », pour faire taire la sauvagerie. Ils obtiennent ainsi sans la moindre
résistance la collaboration de l'Église catholique depuis longtemps acquise à cette
nécessité. En revanche ils se heurtent tout aussi logiquement à la résistance des
paysans. La libération ne change rien aux faits et la situation ne cesse de s'aggraver. Le
président Elie Lescot (1941-1946) renforce l'opposition entre les villageois et les
urbains. Il soutient l'Église dans ses « campagnes anti-supersitieuses » et continue de
voir en elle le seul véhicule civilisationnel possible, le seul lieu raisonnable d'expression
de l'identité nationale.
4 La chute d'Élie Lescot et la venue au pouvoir du médecin et ethnologue François
Duvalier semblent changer la donne. Duvalier s'était en effet élevé dans plusieurs écrits
« contre la campagne antisuperstitieuse et en faveur de la reconnaissance du vaudou
comme partie intégrante de la culture nationale ». Des prêtres et évêques sont chassés
du pays. Pourtant, Duvalier ne change rien « à la position de subordination
traditionnelle du vaudou par rapport au catholicisme ». Il ne touche pas aux pouvoirs
et privilèges de l'Église qu'il veut soumettre à ses desseins politiques. Il met en place
une hiérarchie catholique indigène qui lui est entièrement acquise. Les nouveaux
prêtres et évêques, jusqu'alors tenus à l'écart du pouvoir, voient en lui la main de la
providence. C'est néanmoins l'Église qui causera la chute de son régime despotique en
introduisant chez elle l'expérience démocratique que la théologie de la libération
inspirait aux prêtres de base. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'accession à la
présidence du religieux salésien, Aristide.
5 Un tel exposé amène logiquement l'auteur à plaider en faveur d'une véritable
neutralité de l'État en matière de religion et du retrait de la responsabilité de l'Église
dans l'éducation nationale. L'importance du rôle que l'État haïtien a donné à l'Église
révèle sa faiblesse, son incapacité à encadrer par lui-même la population. Aussi, sans
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
145
l'Église, constate Laënnec Hurbon, « l'État apparaît presque nu [...]. N'étant pas un État
administratif, ni un État providence, et ne pouvant plus exercer directement un rôle de
répression, l'État ne parvient à sauver la face qu'en remettant son sort aux mains des
institutions internationales. Si l'on fait par exemple le bilan de la présence des
organisations non gouvernementales (ONG) en Haïti, on s'apercevra que celles-ci
remplacent peu à peu l'Église et se situent presque dans un face-à-face avec l'État [...].
Comme si les rapports Église-État se déplaçaient et se transformaient en rapports État-
ONG » (p. 258-259). Ce sont ses nouvelles béquilles. Il les utilise sur tous les fronts
(santé, éducation, environnement...), empêchant une fois de plus la nation de trouver
ses propres fondements.
6 Cette défaillance permet en partie de comprendre le succès actuel des nouveaux
mouvements religieux et des sectes qui met un point final à l'hégémonie du
catholicisme mais ne règle pas pour autant l'ancienne fissure culturelle apparue dès la
naissance du pays. On ne peut alors que se rappeler l'article publié par le même auteur
en 1989 (« Les mouvements religieux dans la Caraïbe », p. 309-354, in Laënnec Hurbon
dir., Le phénomène religieux dans la Caraïbe : Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique,
Montréal, CIDIHCA, 1989). Il y faisait déjà un état des lieux quant au développement des
groupes à caractère sectaire dans l'ensemble de la Caraïbe. Il montrait combien ceux-ci
récupéraient à leur profit la volonté fort ancienne de construire les fondements d'un
vivre-ensemble resté en friche, et tournant, inlassablement autour de la perception
donnée du vaudou. À travers ces groupes se rejoue la lutte serrée entre partisans de
traditions perçues comme peu adaptées aux valeurs modernes et adhérents de la
culture occidentale, perçue comme participant de l'hégémonie uniformisante d'un
système dominant. Ces groupes renforcent davantage encore la fracture sociale d'une
société inlassablement en quête de repères et d'identité mais trop honteuse de ses
origines pour que celles-ci parviennent à la souder.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
146
Stephanie Levine Wellen, Mystics,
Mavericks, and Merrymakers. An
Intimate Journey Among Hasidic Girls
New York-Londres, New York University Press, 2003, XIV + 255 p.
Jacques Gutwirth
1 Voici un livre sur le hassidisme comme on en voit trop rarement. Grâce à une enquête
par observation participante de plus d'un an, S. Levine Wellen nous fait pénétrer
l'univers des jeunes femmes Loubavitch à Crown Heights, New York, et en même temps
nous livre de nombreuses remarques ethnographiques et sociologiques sur la société
Loubavitch qui, du fait de sa constitution spécifique au sein du hassidisme – elle compte
de nombreux adhérents récents, des « repentis », juifs venus à la piété – est assez
particulière.
2 Pour l'essentiel, l'auteure présente, au sein de ce milieu ultra-religieux, des portraits de
jeunes femmes âgées de 18 à 22 ans environ ; elle dépeint leur psychologie, leurs soucis,
leurs relations avec leurs camarades et amies, leur insertion dans leur famille. Parmi
elles il y a telle jeune femme ultra pieuse et mystique, mais aussi des jeunes femmes
« ordinaires » et nullement frondeuses, mais qui n'hésitent pas à faire un tour à
Manhattan pour y jouer au billard, qui fréquentent des institutions universitaires plus
ou moins religieuses ; enfin il y a telle déviante, qui se retrouve avec d'autres jeunes
Loubavitch des deux sexes dans un local où elles fument cigarettes et haschisch,
discutent de philosophie profane, mettent en question le mode d'être Loubavitch.
D'ailleurs, après cette étape contestataire, la plupart quittent par la suite Crown
Heights et le milieu hassidique.
3 Tout au long de ces chapitres consacrés aux portraits et quelques autres plus globaux
on apprend aussi beaucoup sur la vie familiale et la société Loubavitch. Notamment, sur
la manière dont les mariages, qui ont lieu généralement entre 19 et 21 ans pour les
jeunes filles, 21 à 24 ans pour les jeunes gens, sont conclus. À l'initiative des familles,
avec la collaboration de marieurs plus ou moins professionnels, les éventuels futurs
couples se rencontrent en tête à tête entre quatre et huit fois, durant une période de
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
147
deux à six mois, généralement dans un hall d'hôtel ou un restaurant. Ils font savoir à
leur famille s'ils se plaisent ou non ; dans le premier cas le mariage pourra se faire, dans
le second, ce système, avec intermédiaires, permet aux deux protagonistes de ne pas
perdre la face. Si les questions professionnelles et économiques jouent dans ces choix
respectifs – les marieurs font de véritables enquêtes, « dignes du FBI » à ce sujet –
d'autres facteurs propres au hassidisme Loubavitch comptent également. Une jeune
femme de vieille famille Loubavitch, généralement d'origine russe, plus ou moins
apparentée à des leaders, rèbbes hassidiques, dispose d'un yichus, d'un lignage religieux
prestigieux, gros avantage au mariage, ce dont ne bénéficient généralement pas les
baalei tshouve, les repentis nouveaux venus au mouvement. On se doute que les
mariages conclus, qui ne doivent rien à des rencontres individuelles au hasard de la vie
en société, maintiennent largement une séparation entre les « patriciens » et les
nouveaux venus. Aujourd'hui, un autre facteur de division joue également. Le
mouvement Loubavitch est traversé depuis la mort en 1994 de leur dernier leader, le
rèbbe Menachem Mendel Schneerson, par un sérieux clivage au sujet de ce chef
spirituel extrêmement vénéré qui, d'ailleurs contrairement aux traditions dynastiques
hassidiques, n'a pas eu de successeur. En effet, dès 1990 la plupart des fidèles se mirent
à croire que l'ère messianique était proche et que leur leader révéré, qui avait
contribué par ses dires à cette croyance, était lui-même le Messie. Après son décès une
bonne partie des fidèles se mirent à penser et à affirmer que Schneerson ressusciterait
dans un proche avenir, en tant que Rédempteur... Nombre de familles, selon leur
conviction ou leur incrédulité face à un tel augure, refusent une alliance matrimoniale
avec leurs contradicteurs. Par ailleurs, l'auteure offre aussi quelques intéressantes
descriptions de festivités de mariage et la manière dont celles-ci sont préparées et
vécues par les jeunes femmes.
4 On pourrait dire, en usant le vocabulaire des DVD, que toutes ces connaissances sont
des « bonus », face aux portraits individuels fascinants des jeunes femmes. L'auteure
indique que le Tanya, publié en 1814, œuvre du fondateur du hassidisme, Shnéour
Zalman de Lady, comporte un véritable guide pour l'examen de soi, pour l'auto-analyse
de chacun et que les jeunes filles, qui ont étudié ces textes dans les écoles Loubavitch,
en tirent un grand profit pour fortifier leur vie intérieure. Un autre facteur qui
différencie ces jeune femmes de la plupart des autres jeunes filles américaines, c'est
que leur monde est monolithiquement féminin, ce qui notamment leur évite, malgré
une coquetterie évidente, de vivre en fonction du regard sexuel masculin et leur assure
un excellent épanouissement. Ces jeunes femmes disposeraient ainsi à la fois d'une
forte structuration psychologique, mais aussi d'une intense insertion communautaire
qui est le propre des communautés hassidiques. Pour encore améliorer ce dispositif
protecteur, les jeunes femmes comptent généralement une maspiach, conseillère, sorte
de confidente et de mentor spirituel, avec qui elles peuvent partager tous leurs
dilemmes et insécurités.
5 Cela dit, l'auteure montre à foison, que malgré ce dispositif d'insertion psychologique
et social qu'elle juge d'une grande efficacité, les déviations de tous ordres sont
courantes parmi les jeunes femmes ; l'une d'elles ne va-t-elle pas jusqu'à gagner
l'argent pour ses études en travaillant comme serveuse dans un bar à strip-tease ! Par
ailleurs, si Stephanie Levine Wellen admire ce mode de vie, elle ne souhaite nullement
le partager car trop saturé de certitudes et de rigidités. Elle signale aussi que son
enquête a particulièrement bien réussi car son approche, qui faisait une large place aux
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
148
questions quant à l'auto-analyse et aux buts dans la vie des jeunes filles, se trouvait
précisément en affinité avec leur propre quête intérieure permanente.
6 Voilà donc un livre certes un peu trop foisonnant mais qui apporte beaucoup à la
connaissance du monde féminin hassidique. J'espère que d'autres chercheurs et
chercheuses produiront bientôt des travaux nous permettant de mieux connaître le
monde féminin dans d'autres mouvements hassidiques.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
149
David Machacek, Global Citizens. The
Soka Gakkai Buddhist Movement in the
World
Oxford University Press, New York, 2000, 442 p.
Nathalie Luca
1 Ce recueil d'articles, co-dirigé par D. Machacek et B. Wilson, s'attache à montrer les
diverses facettes de la mondialisation et de la transnationalité de la Soka Gakkai,
nouveau mouvement religieux japonais, dont l'expansion internationale est
impressionnante. L'ouvrage est divisé en deux parties. La première se concentre sur
l'influence du groupe au Japon, la seconde étudie son établissement dans d'autres pays
tels que les États-Unis, le Brésil, la Grande Bretagne, l'Italie et l'Asie du sud. L'ensemble
forme un support incontournable pour qui s'intéresse à ce type de groupes.
2 Dans l'introduction les éditeurs constatent que l'influence du Japon n'est pas
uniquement le fait de sa puissance économique, scientifique et technologique. Elle
passe également par la propagation d'une éthique et d'une morale divulguées par ses
nouvelles religions dont la Soka Gakkai est la plus illustre représentante. Créée avant la
Seconde Guerre mondiale par un instituteur, Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), elle
s'est déjà fait remarquer par la volonté de son fondateur à insuffler un idéal humaniste
au système éducatif japonais. Après la guerre, son successeur, Josei Toda (1900-1958),
tente pour sa part, avec une volonté toute politique, d'étendre cet esprit réformateur à
l'ensemble de la société. Son troisième président, Daisaku Ikeda (1928- ),
internationalise ce concept de « révolution humaniste », résumé par l'idée d'un monde
de paix ou par celle de la construction d'une « troisième civilisation » reposant sur des
efforts individuels d'amélioration de soi. Le salut de chacun repose sur ses capacités à
s'engager dans le monde afin de participer à sa réformation. Cette perspective
intramondaine donne une dimension intrinsèquement anti-institutionnelle à ce type de
mouvements, capable d'expliquer, selon les auteurs, leur succès partout où les religions
institutionnelles ont perdu leur influence, c'est-à-dire, partout où la modernité a placé
le changement à l'ordre du jour. Elle permet également de comprendre l'inéluctable
rupture de la Soka Gakkai avec la Nichiren Shoshu, secte bouddhiste apparue au XIIIe
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
150
siècle dont elle tire son enseignement philosophique. Cette rupture était nécessaire
pour qu'elle puisse développer pleinement cette nature intramondaine qui lui permet
d'engendrer des « citoyens du monde », c'est-à-dire des individus conscients de
l'impact de leur vie sur celle des autres et de la responsabilité que cela leur donne.
3 Noriyoshi Tamaru (université de Tokyo) retrace, pour sa part, l'histoire nationale de ce
mouvement présent dans plus d'une centaine de pays et très largement fréquenté par
des non-Japonais. Il y aurait plusieurs millions de membres au Japon, et quelques
dizaines de milliers à l'étranger. La nature transnationale de la philosophie de la Soka
Gakkai lui a valu d'être fortement réprimée au Japon durant la Seconde Guerre
mondiale. Le groupe n'avait alors que quelques centaines de membres (d'autres
contributions indiquent 3 000 membres, ce qui montre la difficulté d'obtenir un chiffre
fiable). À l'époque, le nationalisme japonais se concrétisait notamment par des rites
shintoïstes accomplis en l'honneur de la famille impériale. Refusant l'accomplissement
de ces rites, contraire à la doctrine de Nichiren, Makigushi fut arrêté en 1943 pour
crime de lèse-majesté et pour violation de l'Acte de maintenance de l'Ordre public,
utilisé par le Régime militaire pour contrôler la liberté d'expression et de pensée. Il
meurt en prison l'année suivante. Son successeur, Toda, comme vingt autres leaders du
mouvement, fut également arrêté et fortement maltraité. La majorité des prisonniers
renièrent alors leur foi pour être relâchés, mais Toda resta fidèle à l'enseignement de
Nichiren Shoshu. Il est cependant libéré peu de temps avant la capitulation japonaise.
C'est avec lui que le mouvement passe d'un petit groupe d'instituteurs principalement
intéressés par des réformes scolaires à une organisation d'envergure nationale, à la fois
religieuse et idéologique. Il profite largement de l'accélération de l'urbanisation et de
l'industrialisation du pays qui créent, ici comme ailleurs, une déstructuration des
repères sociaux et encourage l'émergence de nouvelles perspectives politiques. Dans la
seconde moitié des années cinquante, Toda se lance ainsi dans les campagnes
d'élection, d'abord au niveau local, puis national. En 1961, il crée le Komei Seiji Renmei
(ligue pour un gouvernement propre). Sa nature ouvertement religieuse le place
cependant en infraction au principe de séparation de la religion et de l'État inscrit dans
la Constitution japonaise et l'oblige à se séparer de la Soka Gakkai dès 1964. Il devient
en 1970, le troisième parti japonais. Après un scandale condamnant les liens étroits
qu'il continuait à entretenir avec la Soka Gakkai, il est obligé de se défaire entièrement
de son identité bouddhiste pour devenir un parti ouvert à tous. Il devenait impossible
pour qui avait des responsabilités dans le mouvement religieux, d'en avoir également
dans le parti politique. La Soka Gakkai se recentre alors sur des activités
socioculturelles, ouvrant, entre autres exemples, sa première université en 1971, ou
s'engageant dans des campagnes sur la paix dans le monde.
4 Hiroshi Aruga (université de Tokyo) s'arrête plus longuement sur les liens entre la Soka
Gakkai et les politiques japonaises. Il constate que la période de développement la plus
rapide du mouvement (1950-1970) coïncide avec celle du décollage économique du pays
et lie les deux phénomènes entre eux. Les années 1950 ont été interprétées par le
mouvement comme celles de la fin des temps. La déstructuration sociale confirmait
cette croyance. Le salut de l'individu dépendant du salut de la société, il mit en place
une action politique forte capable d'annoncer et de participer à l'avènement de la
nouvelle civilisation, tout en soulignant la dégradation de l'ordre existant. Cette
campagne fut un succès. Elle toucha des individus que l'urbanisation avait isolés et qui
restaient nostalgiques de leur ancienne communauté de vie. Elle toucha des individus
non atteints par la prospérité naissante ; des individus frustrés et insatisfaits. À ceux-ci,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
151
elle offrit un nouvel ordre communautaire, des principes éthiques issus du
bouddhisme, et la possibilité d'obtenir à leur tour les bénéfices matériels dont ils se
sentaient exclus, à la condition de leur engagement social. C'est ce lien très particulier
placé entre les bénéfices personnels et la participation individuelle à l'amélioration
de la société qui explique l'implication et la réussite politique et économique de la Soka
Gakkai, aspect la rapprochant très largement de mouvements messianiques telle que
l'Église de l'Unification. Le Komeito, par ailleurs, a profité des crises du LDP (Liberal
Democratic Party), parti au pouvoir depuis les premières élections après-guerre, dont il
avait dénoncé les cas de corruption, pour augmenter son influence. En 1994, il se lie
avec d'autres partis de l'opposition (le JSP – Japan Socialist Party – et le Démocratic
Socialist Party), pour créer un gouvernement de coalition qui exclut le seul parti
communiste et met fin aux 38 ans de parti unique. Ce gouvernement ne dura cependant
que onze mois. Dans une de ses contributions à l'ouvrage, Daniel Métraux revient sur le
rôle du Komeito à partir des années 1990, soit au moment de l'affaiblissement du LPD et
de la naissance des partis de coalition.
5 En conclusion, Hiroshi Aruga constate qu'un nouveau défi guette autant la Soka Gakkai
que le parti Komeito. Si ce NMR a séduit à la base les insatisfaits, il les a également
accompagnés dans leur insertion sociale, ce qui a participé à la diversification de son
public. Cela complique la tâche du Komeito qui doit à son tour diversifier son message
pour toucher une fourchette plus large de strates sociales correspondant à l'ensemble
des membres de la Soka Gakkai. Les deux perdent ainsi en force de conviction.
6 Takesato Watanabe (Doshisha University) s'intéresse au regard que les media japonais
portent sur ce mouvement. Le fait que la Soka Gakkai ait été, dès le départ, en tension
avec les pouvoirs établis et avec le système impérial a rendu délicate sa relation aux
media alors largement encadrés par les uns et l'autre. Aujourd'hui, la recrudescence
des tendances nationalistes ne facilite pas non plus cette relation, la perspective
globalisante de l'organisation étant loin de faire l'unanimité. Le fait que la Soka Gakkai
ait touché au départ les plus démunis et les moins intégrés socialement lui a valu la
réputation médiatisée d'être une religion dangereuse. L'une des campagnes
d'opposition à la Sokka Gakai s'est déroulée au moment où le LPD était en difficulté et
où le Komeito fusionnait avec d'autres partis d'opposition pour former le Shinshinto.
Cette campagne a profité de la crise de confiance dans les NMR qui s'est développée
suite à l'attentat au gaz sarin du métro de Tokyo perpétré par Aum Shinrikyo. Des
représentants du LPD ont accusé le Komeito d'exploiter le Shinshinto pour imposer sa
croyance en tant que religion d'État. Lors de la campagne électorale générale de 1996,
le responsable des relations publiques du LPD a déclaré qu'il y avait « seulement deux
groupes religieux qui cherchaient à prendre le contrôle de la nation : Aum Shinrikyo et
la Soka Gakkai. Aum avait utilisé le sarin pour arriver à ses fins, la Soka Gakkai utilisait
la politique ». La presse occidentale a repris à son compte la confusion ainsi créée entre
les deux groupes, servant en dernier ressort les sentiments anti-japonais d'une certaine
audience. L'auteur, en conclusion, estime que les responsables socio-économiques
japonais manipulent les media de telle sorte que la Soka Gakkai ne puisse jamais se
développer au point de devenir une menace pour leurs propres influence et pouvoir.
7 La première partie se termine par un article de Karel Dobbelaere sur l'organisation
« par piliers » de la Soka Gakkai. On emploie cette expression pour décrire des
structures religieuses, idéologiques, politiques formées de différents organes impliqués
dans le monde séculier et leur permettant de fonctionner avec une relative autonomie.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
152
Plus la structure multiplie ces piliers et plus elle est autonome. L'auteur prend pour
exemple typique l'Église catholique en Belgique. Celle-ci a ses propres écoles, hôpitaux,
magazines, mouvements de jeunesse, librairies, son mouvement politique, ses banques,
etc. Elle peut donc fonctionner de façon autarcique. Ce modèle d'organisation est une
réaction radicale à la sécularisation et à la différenciation des institutions que la
modernisation des sociétés a entraînées dès la seconde moitié du XIXe siècle et qui a nui
au contrôle que l'Église exerçait jusqu'alors sur ses fidèles. La Soka Gakkai fonctionne
également en réseau. Elle est composée d'un ensemble de groupes plus ou moins libres
coordonnés entre eux par leurs leaders respectifs. Les divisions s'opèrent à différents
niveaux : tranches d'âge, sexe, professions, ou encore, dans certains pays, nationalités,
entreprises, groupes d'immeubles, habitudes sexuelles, etc. Elle a son propre système
d'éducation, ses musées et collections d'art, ses ONG, son parti politique. La toile est
suffisamment large et différenciée pour encadrer la vie sociale et privée des fidèles sans
les frustrer. Le tout fonctionne à un niveau international et permet la « gouvernance
d'une société globale ».
8 Après une présentation générale de David Machacek et de Kerry Mitchell du public
intéressé par la Soka Gakkai internationale aux États-Unis (SGI-USA), David Machacek
s'arrête sur l'isomorphisme de cette branche. Il constate déjà que, contrairement à
l'Église de l'Unification, la Mission de la lumière divine, ou encore la Scientologie, cette
organisation, considérée comme une menace publique au Japon, a été fort peu
controversée aux États-Unis. Cela s'expliquerait, en partie seulement, par la très grande
congruence entre sa philosophie du bonheur et son sens éthique de la responsabilité
avec la société méritocratique américaine et sa culture de la consommation. Mais cette
quasi absence de controverse serait davantage encore due, selon l'auteur, à la capacité
du groupe à se fondre dans la culture américaine et à en adopter le style de vie. En bref,
au contact des États-Unis, la SGI n'a pas hésité à s'américaniser, à s'investir dans la vie
publique américaine, à uniformiser ses activités avec celles des Américains, au point
que leur conversion n'apporte pas grand bouleversement dans leur mode de vie. Le
président Ikeda, en visite aux États-Unis, a d'ailleurs affirmé l'indépendance de la SGI-
USA par rapport à l'organisation japonaise, ce qui se traduit concrètement par la
présence de plus en plus importante de leaders américains au sein de l'organisation.
Les articles de Peter Clarke (King's College) sur la Soka Gakkai international au Brésil
(SGIB), de Bryan Wilson (Université d'Oxford) sur la SGI en Grande-Bretagne ou de
Maria Immacolata Macioti (Université de Rome) sur la SGI italienne, vont dans le même
sens, chacun montrant la remarquable capacité d'adaptation du mouvement à son
environnement culturel.
9 Enfin, Daniel Métraux (Mary Baldwin College, Virginie) décrit la Soka Gakkai telle
qu'elle s'est développée en Asie du Sud, où le bouddhisme est déjà très présent. Dans ce
cas, la conversion traduit le désir de trouver une doctrine mieux adaptée à la vie
moderne que celle des écoles bouddhistes préexistantes. Les prises de position contre la
guerre du premier président de l'organisation lui ont également valu la sympathie des
populations dont le Japon a menacé l'autonomie. L'auteur constate que les convertis
asiatiques sont plus zélés et dévoués à la SG que leurs confrères internationaux et
explique cela par leur plus grand nombre et par la plus grande diversité des activités,
alors mieux à même d'encadrer leur vie. Il n'en demeure pas moins que, en Asie comme
ailleurs, son succès et sa bonne intégration sociale relèvent de sa capacité à s'investir
dans les débats sociaux et à participer aux événements locaux.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
153
10 Bien sûr on retrouve ici des défauts propres aux ouvrages collectifs : de nombreuses
répétitions, des chiffres ou des dates différents d'un article à l'autre, l'absence d'une
conclusion synthétique – mais l'introduction sert bien l'ensemble du propos. Les
démonstrations sont plus ou moins convaincantes, et les thèses peu innovantes. Il n'en
demeure pas moins que ce livre, dont tous les articles n'ont pu être résumés ici, est une
synthèse très complète des travaux existant sur la Soka Gakkai.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
154
La Indiferencia religiosa en España.
¿ Qué futuro tiene el cristianismo ?
Madrid, Ediciones Hoac, 2003, 174 p.
Verónica Giménez Béliveau
1 J. M. Mardones présente un volume riche en données sur la situation religieuse en
Espagne contemporaine. La première partie étudie l'indifférence religieuse en Espagne,
tandis que la seconde en analyse les facteurs. La troisième porte sur les défis que cette
indifférence pose au christianisme. Enfin, l'épilogue s'interroge sur l'avenir d'un
christianisme européen de plus en plus dépourvu de fidèles et pourtant si enraciné
dans le substrat culturel et sociopolitique de l'Europe occidentale.
2 Au constat de la permanence du religieux et de ses transformations dans le monde
contemporain, s'ajoute celui, non moins évident, de l'éloignement progressif de la
population européenne occidentale de la religion. Ce phénomène est plus visible encore
chez les jeunes générations. L'auteure tente de caractériser l'indifférence religieuse en
Espagne, dans la société en général, puis chez les jeunes et dans l'espace culturel. Bien
que les sondages d'opinion présentent une Espagne encore catholique dans sa majorité,
il s'agit d'un catholicisme qui reste une référence socioculturelle, et qui ne se traduit
pas nécessairement dans le vécu d'une expérience religieuse. « Liberté d'interprétation
des individus » et « flexibilité dogmatique » (p. 18) caractérisent désormais le
catholicisme espagnol contemporain, qui tend vers l'individualisation et la
subjectivisation des croyances. Lentement mais inexorablement, la croyance décline,
tout comme la pratique religieuse : l'éloignement de la religion institutionnelle est plus
visible dans les zones plus urbanisées, comme la Catalogne, Valence, Madrid, le
Pays Basque, que dans les régions de Galice, Andalousie ou les deux Castilles. Les
personnes non religieuses sont plus nombreuses parmi les hommes, les jeunes, les
universitaires et ceux qui se positionnent à gauche de l'échiquier politique.
L'indifférence religieuse est liée à l'absence d'intérêt religieux, et au manque de
pertinence de la dimension religieuse dans la vie des personnes.
3 L'observation des jeunes espagnols amène l'auteure à conclure que ceux-ci n'ont qu'un
faible intérêt pour les manifestations et la sensibilité religieuse. Elle compare les
statistiques sur la pratique religieuse hebdomadaire et constate son effondrement au
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
155
cours de la deuxième moitié du siècle dernier : en 1960, 91 % des jeunes se déclaraient
« très pratiquants », tandis qu'ils ne représentent plus que 12 % en 1999.
L'affaiblissement de la pratique régulière s'explique par l'éloignement de l'institution
ecclésiastique et la croissance des « formes religieuses individuelles, marginales ou de
pèlerinage » (p. 33). L'évolution des jeunes ne se présente pas sous la forme d'une
rupture explicite avec le christianisme, mais comme une reconstruction de sens axée
sur l'individu.
4 La désinstitutionalisation de l'Église catholique et la croissance de l'incroyance
constituent le miroir des changements de la société espagnole des dernières décennies.
Vers la fin de la dictature de Franco, l'Espagne se voit bouleversée par des
transformations profondes qui touchent les principes de l'autorité, et qui entraînent
une rupture de la transmission de la tradition religieuse dans le post-franquisme : les
bouleversements de la structure familiale, l'entrée des femmes sur le marché du travail,
la légalisation du divorce, ne sont que des exemples évidents de ces transformations. La
discontinuité de la socialisation religieuse des jeunes a été plus soudaine et rapide en
Espagne que dans d'autres pays d'Europe, les chiffres de décatholicisation étant
proches de ceux des pays du nord de l'Europe. Selon l'auteure, cette situation transpire
dans l'espace de la culture, où les références religieuses sont désormais remplacées par
une valorisation excessive de la culture matérialiste de la consommation.
5 La deuxième partie du volume analyse les causes de cette mise à distance de la religion
dans les sociétés contemporaines. Le rapport entre religion et modernité est au cœur
des réflexions de l'auteure. Le phénomène de l'incroyance des sociétés européennes
occidentales s'inscrit selon elle dans le lien profond entre catholicisme et modernité. Le
christianisme a en effet accompagné, depuis ses origines, un mouvement de
désacralisation, induit par la vision d'un monde conçu comme séparé de Dieu. Il devient
ainsi un monde désenchanté et « démythologisé ». Le christianisme implique donc une
cosmovision dans laquelle « l'expérience de Dieu se fait à l'intérieur du monde
profane » (p. 76). Ce « dynamisme sécularisateur chrétien » (p. 74) a finalement abouti à
la non religiosité. Ainsi, la prédominance de la rationalité fonctionnelle naît de
l'environnement religieux qui encourage le développement de la science. Le modèle de
pensée scientifique contribue à son tour à la création d'un statu quo qui n'a pas besoin
de Dieu ni de la religion. Cette « ère de l'incertitude », cette « société du risque »
(p. 82), génère, selon l'auteure, une superstition renouvelée, appuyée sur une culture de
la consommation et de la sensualité, qui impose aux individus de parvenir à une
construction originale de soi. La religion devient, dans ce contexte, un espace
exclusivement personnel d'épanouissement et de quête d'expériences.
6 L'analyse de la sécularisation amène l'auteure à s'interroger sur la portée du processus
de croissance de la non religiosité. S'appuyant sur les études de P. Berger,
J. M. Mardones pose l'hypothèse de « l'eurosécularisation » : dans le monde
contemporain, la religion serait présente, à deux exceptions près. La première,
géographique, concerne la zone de l'Europe occidentale et centrale. La seconde,
sociologique, touche les secteurs sociaux ayant adopté un mode de vie occidental. Dans
ce monde culturel occidental, le religieux ne fait plus partie de l'identité publique, et la
croyance perd sa crédibilité sociale et culturelle. Elle glisse du centre aux marges du
système, et même si l'auteure est prête à soutenir le caractère « fondamentalement
religieux de l'être humain » (p. 115), elle assume également le caractère historique de
toute religiosité. Or, quelles seraient les caractéristiques de la religiosité dans le
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
156
contexte de croissance de l'indifférence religieuse ? Les sensibilités contemporaines se
centrent sur le sujet, et la religion suit ce mouvement adoptant une « inclinaison à
l'immanence » (p. 117). Le sacré se recompose en une spiritualité non transcendante,
qui se développe à partir de l'humanisation du divin et de la divinisation de l'humanité,
du corps, de la subjectivité. La religiosité se caractérise par « le ton individualiste, sans
credo et sans Église » (p. 124). Elle s'oriente vers la soif de mystère, la spiritualité
pèlerine, la mystique et le vécu de l'expérience, en même temps qu'elle écarte toute la
structuration institutionnelle des croyances.
7 Dans la troisième partie du volume, J. M. Mardones réfléchit sur les enseignements que
le christianisme devrait tirer de cette situation de recul de la religiosité. L'engagement
de l'auteure vis-à-vis de l'avenir du christianisme est évident surtout dans ses dernières
réflexions, à travers lesquelles elle invite les lecteurs à parcourir les possibilités qui
restent offertes à la religion dans cet univers culturel dominé par l'incroyance. Selon
elle, la tâche prioritaire des chrétiens en vue de l'évangélisation est de contribuer à
réveiller le fond religieux de l'être humain contemporain, engourdi par le style de vie
signé par « la consommation des sensations » (p. 141). Transformer le christianisme en
un facteur critique de la société, et le chrétien lui-même en un agitateur des
consciences est l'une des lignes d'action qu'elle propose. Le christianisme du futur sera,
selon l'auteure, minoritaire et fragile, métis et pluriel, traversé de tensions multiples
tels que l'autorité et l'exercice du pouvoir, la place de la femme, et l'équilibre incertain
entre tradition et changement.
8 L'analyse précise de la situation de la religion et du catholicisme en Espagne et la
conceptualisation de la notion d'indifférence sont les grands atouts de ce volume,
même si on ne partage pas nécessairement l'engagement de son auteure pour une
revitalisation du christianisme.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
157
Catherine MAYEUR-JAOUEN, Histoire
d'un pèlerinage légendaire en islam. Le
mouled de Tantâ du xiiie siècle à nos
jours
Paris, Aubier, 2004, 270 p.
Emma Aubin-Boltanski
1 Ce livre se propose de faire l'histoire et l'anthropologie de la religion populaire
égyptienne à travers un événement religieux majeur, « un merveilleux observatoire des
mutations de l'Égypte depuis la période mamelouke » : le pèlerinage (mouled) de Sayyid
al-Badawî (m. 1276). La fête se déroule à Tantâ, la quatrième ville d'Égypte, située à mi-
chemin entre Le Caire et Alexandrie. Elle est fixée sur le calendrier solaire, en octobre,
au moment de la récolte du coton. Alors qu'historiens et anthropologues des années
1970 et 1980 prévoyaient, comme conséquence inéluctable du Réformisme musulman,
la disparition progressive des dévotions entourant les saints, Catherine Mayeur-Jaouen
démontre, dans cet ouvrage, que le culte des saints constitue toujours aujourd'hui une
part importante de la religion ordinaire de la grande majorité des Égyptiens.
2 En six chapitres, l'auteure, historienne et arabisante, dresse le portrait du saint le plus
populaire d'Égypte, Sayyid al-Badawî (2e chap.), offre une description détaillée de la
confrérie que ses disciples fondèrent peu après sa mort (3 e chap.) et fait l'historique des
principales phases de l'évolution du mouled entre le XIIIe et le XXe siècle (4e, 5e et
6e chap.). Le propos est illustré par des photographies prises lors des mouleds de 1992
et de 2002, ainsi que par des cartes du Delta et de la ville de Tantâ.
3 L'ouvrage commence par un exposé minutieux du mouled de Tantâ en 2002. Par cette
description au rythme saccadé et haletant, l'auteure nous fait pénétrer dans le monde
tourbillonnant du pèlerinage. Le lecteur suit les pèlerins dans leurs préparatifs et leur
installation dans le campement de Sîgar, situé à proximité de Tantâ. La fête débute un
vendredi et s'achève le jeudi soir suivant par la « Grande nuit », une montée en
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
158
intensité progressive rythmée par les dhikrs et les dévotions rendues au saint par une
foule immense.
4 « Un saint ne devient pas saint, il l'est de toute éternité, et toute sa vie n'est qu'un
dévoilement progressif de son identité, parfois d'abord cachée », explique C. Mayeur-
Jaouen. Qui fut Sayyid al-Badawî ? Comment faire la part entre le personnage mythique
façonné au fil des siècles et le Badawî historique ? Comment ce saint, dont la renommée
de son vivant ne dépassait pas les frontières de Tantâ, en est-il venu à devenir « un
saint musulman archétypal et le saint égyptien par excellence » ? C. Mayeur-Jaouen
retrace les principaux traits de la vie du saint en s'appuyant sur l'hagiographie
foisonnante qui lui fut consacrée. Cette littérature prit toute son ampleur tardivement,
entre le XVe et le XVIIe siècles, sous la plume de disciples tels que Sha‘ranî (m. 1565), ‘Abd
al-Samad (écrite en 1619) et Halabî (m. 1635). Du personnage historique on sait peu de
choses si ce n'est à quelle période il vécut et la date de sa mort. Au regard de l'Histoire,
cette figure sainte constitue donc un mystère : elle s'est construite peu à peu, par
hagiographies successives modulées en fonction des époques.
5 Dans les premières hagiographies, qui lui sont consacrées, Badawî est présenté comme
un saint échevelé, hirsute, fou, aux jeûnes sévères, aux yeux flamboyants. Il est
« l'Homme à la bedaine », l'homme des excès, tout à la fois capable d'une formidable
gloutonnerie et d'une ascèse extraordinaire : il peut jeûner 40 jours et 40 nuits. Son
visage est dissimulé par deux voiles, ce qui lui vaut un second surnom : « l'Homme aux
deux voiles ». Certains de ses disciples expliquent cet accoutrement peu ordinaire par
son origine bédouine que son nom, « Badawî », atteste. Pour d'autres, le saint masquait
ainsi son visage irradié par la lumière divine et l'éclat trop aveuglant de son regard
capable de foudroyer ses disciples. Il est également « l'Homme de la terrasse », un
étrange soufi qui vécut sur un toit de Tantâ. De cette hauteur, il se consacrait à la
contemplation du soleil et recevait ses disciples, ainsi que des dévots venus chercher
réconfort auprès de lui. La puissance de ce saint exceptionnel est également attestée
par son célibat. Ce trait n'est pas, en islam, une condition nécessaire de la sainteté.
Dans le cas de Badawî, paradoxalement, il constitue la preuve d'une virilité telle
qu'aucun mariage ne peut l'endiguer. Il fait de lui le saint par excellence des filles à
marier, des femmes en mal d'enfant ou torturées par les douleurs de l'enfantement.
6 À la fin de la période mamelouke (1450-1500), alors que l'Ahmadiyya, la confrérie
fondée par le principal disciple de Badawî, ‘Abd al-‘Âl (m. 1333), connaît un grand
succès, les dévots du saint sont amenés à une relecture et une réécriture de la vie du
Maître. Les disciples insistent tout particulièrement sur la généalogie du saint que l'on
dit originaire de La Mecque et descendant du Prophète. Ils s'emploient également à
souligner sa filiation rifâ‘ite en lui attribuant un passage initiatique en Irak. Les
hagiographies de cette époque renforcent les liens du Maître avec Ahmad al-Rifâ‘î (m.
1175) et ‘Abd al-Qâdir al-Jilânî (m. 1166) les fondateurs des deux grandes confréries, la
Rifâ‘iyya et la Qâdiriyya. Le saint hirsute devient alors un pôle puissant et gigantesque.
7 Au XIXe siècle, orientalistes et archéologues européens se sont également emparés du
personnage pour, sous couvert de scientificité, contribuer fortement à l'élaboration
d'une nouvelle facette de son mythe. Certains ont fait de lui la trace d'un dieu païen et
de son pèlerinage, les restes d'une fête de l'Antiquité. D'autres ont cru découvrir sous
les voiles de Badawî un saint chrétien islamisé. Pour étayer ces reconstructions
historicistes, aucune preuve ne peut être avancée. À la fin du XIXe siècle, deux thèses
adverses apparaissent. Également infondées, elles trouvent leur explication dans le
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
159
contexte de l'occupation britannique (à partir de 1882) et de la présence européenne
croissante en Égypte. Toutes deux visent à récupérer le souvenir des croisades du
XIIIe siècle et à le cristalliser autour du saint : pour les Européens d'Égypte, Badawî fut
l'un des croisés de Saint-Louis, converti à l'islam ; pour les Égyptiens, au contraire, il
n'était autre qu'un valeureux soldat menant le jihad contre les croisés. Le Badawî
adversaire des croisés, ennemi des chrétiens et des Européens, rencontre une très large
adhésion. Son succès est à peine écorné par les virulentes accusations des réformistes
musulmans adversaires du culte des saints. Ces derniers propagent une nouvelle
théorie au début du XXe siècle faisant de Badawî un « espion chi'ite » qui aurait joué un
rôle occulte pour le compte des Fatimides ismaéliens. À partir de cette époque, le
Maître de Tantâ devient « le saint le plus aimé et le plus honni d'Égypte ».
8 Autour du culte d'Ahmad al-Badawî s'est formée l'une des plus importantes confréries
soufies d'Égypte, l'Ahmadiyya. L'une des grandes forces de cet ouvrage est de
démontrer que c'est à la fois par le biais de son assise terrienne et grâce à l'appui des
puissants que l'Ahmadiyya acquit l'essentiel de sa force. À l'origine, les disciples de
Badawî ne forment pas une confrérie organisée, mais un cercle attaché à la figure
charismatique de leur Maître. Ils sont communément appelés les « Compagnons de la
Terrasse ». Ce n'est qu'après 1450 que le terme Ahmadiyya commence à désigner la
confrérie. Au début, cette dernière rassemble surtout des ruraux paillards et illettrés.
Les premiers Ahmadî sont volontiers provocants, réputés être des transgresseurs de la
loi. Ils font scandale. Ils sont accusés de mœurs suspectes. Les critiques à leur encontre
apparaissent dès l'époque mamelouke. À ces accusations la confrérie elle-même répond
par des réformes. C'est qu'elle n'est pas uniquement composée de disciples ignorants et
frustres. La réalité est bien plus complexe et le temps joue en faveur d'un recrutement
de plus en plus diversifié et large. À l'époque ottomane, parmi les Ahmadî notoires,
apparaissent en nombre ulémas et écrivains. Des soufis de formation Khalwatî, une
confrérie réputée pour son austérité et son orthodoxie, deviennent Ahmadîs. Au
XIXe siècle, la dévotion pour le Maître de Tantâ est si massive qu'elle unit tous les
Égyptiens dans un même flot. À cette époque, Badawî devient le saint national, et
l'Ahmadiyya constitue la confrérie égyptienne type. C. Mayeur-Jaouen décrit les
rouages de cette organisation, dirigée par un khalifa réputé descendre du principal
disciple de Badawî, ‘Abd al-‘Âl. Elle constitue la confrérie soufie la plus nombreuse
d'Égypte par la quantité de branches depuis longtemps indépendantes. Une fédération
lâche dont le mouled forme l'épine dorsale.
9 Selon la légende, le mouled de Badawî est né peu après les obsèques du saint mort le
jour anniversaire du Prophète Muhammad : le 12 rabî‘ I. Dans un premier temps, il
semble que ce soit avant tout le mawlid al-Nabî (anniversaire de Muhammad) qui ait été
célébré auprès de Badawî. Ce qui vaut à ce dernier cet autre surnom : « Porte du
Prophète ». Parce qu'elle connaît une immense popularité au XVe siècle, la fête
s'autonomise par rapport au mawlid al-Nabî. Elle est alors fixée sur le calendrier
solaire. Signe de son succès, la fête locale devient un « petit hajj » pour les dévots qui ne
peuvent faire le déplacement à La Mecque. La légende veut que sept mouleds au
tombeau de Badawî équivalent au hajj. Le mouled né de la ferveur populaire n'a pris
son ampleur que grâce au pouvoir politique. En retraçant l'histoire du pèlerinage,
l'auteure met en lumière l'alliance étroite entre pouvoir politique et religion
populaire ; entre confrérie et gouverneur, entre cheikhs et émirs.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
160
10 Au XIXe siècle, le mouled atteint son apogée comme foire et comme fête. Jamais il n'a
déplacé autant de monde, jamais il n'a été aussi indiscuté. Il bénéficie de la pacification
du Delta par la mise au pas des Bédouins et des mutations décisives que connaît
l'Égypte sous la dynastie des vice-rois et des khédives issus de Méhémet Ali. À cette
époque l'extension de la culture du coton permet l'accentuation du rôle commercial de
Tantâ et son essor démographique. L'arrivée du chemin de fer en 1854-1856 joue un
rôle décisif. La ville de Badawî devient alors une étape importante entre le Caire et
Alexandrie. Le mouled est l'occasion d'une grande foire internationale où se côtoient
des marchands de toutes nationalités. Tantâ devient florissante et acquiert une grande
notoriété. C'est à cette époque que l'hagiographie transforme Badawî en héros guerrier
vainqueur des croisés et que, pour les Européens, Tantâ gagne une solide réputation de
fanatisme.
11 Au XXe siècle, le mouled connaît une métamorphose radicale : sécularisation,
désenchantement du monde, politisation de l'islam, rejet du culte des saints,
accélération des rythmes agraires, exode rural vont contribuer à mettre fin à son
immense éclat : aujourd'hui il « n'est plus que l'ombre de son prodigieux passé ».
Badawî lui-même est comme ébranlé : « il n'est plus le géant intangible à l'intercession
eschatologique duquel tous ajoutaient foi ». Le héros, vainqueur des croisés, est affaibli
par le succès insolent des Européens. Il devient la cible privilégiée des adversaires du
culte des saints. Le saint perd de sa plasticité et de son infinie capacité à incarner de
multiples islams : islam des pauvres, des riches, des ignorants, des Ulemas... Au XXe
siècle, ses nombreuses facettes deviennent « contradictions » et s'excluent l'une
l'autre : « soufis réformés des villes, paysans sans instruction, islamistes de combat,
bourgeois sécularisés, jeunesse sans avenir, c'est à chacun son Badawî ». Ce phénomène
est, entre autres, le résultat de l'immense diffusion qu'a connu son hagiographie au
XIXe siècle grâce au développement de l'imprimerie. La tradition écrite prend le pas sur
la tradition orale et tend à figer le personnage dans un rôle et une posture définitive.
12 Depuis les années 1950, les pèlerins du mouled sont moins nombreux. Les causes de ce
déclin sont multiples et de différentes natures, politique, religieuse et économique. Au
moment de la création des États nations, le tracé des frontières constitue une entrave
au déplacement des dévots. La foire internationale disparaît pour être remplacée par le
petit commerce local. Elle devient un marché régional dont l'importance, à l'échelle
même du Delta, diminue. La crise économique, que connaît l'Égypte depuis les années
1980, n'a fait qu'accentuer ce phénomène de repli. De plus, le Réformisme musulman a
eu un impact non négligeable sur la fête. On assiste à une désaffection progressive
d'une grande partie des villageois du Delta pour des rites perçus comme inutiles et
contraignants. De leur côté, les citadins affichent de plus en plus ouvertement leur
mépris pour des coutumes associées aux ruraux.
13 Cependant l'affection que l'on voue au saint de Tantâ en Égypte n'a pas disparu. Le
pèlerinage n'engage plus l'ensemble de la communauté mais devient une affaire
personnelle. Signe de ce glissement du collectif vers l'individuel, le déclin du mouled
n'implique en rien celui des visites pieuses individuelles (ziyâra) qui peuvent se faire à
tout moment de l'année. De plus, le mouled fait aujourd'hui partie intégrante du
« patrimoine » national. Il symbolise l'attachement des Égyptiens à leurs saints et aux
descendants du prophète. À ce titre il reste un événement important pour l'Égypte. Une
nouvelle sorte de pèlerins est apparue : pendant le mouled, des urbains désorientés
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
161
viennent chercher à Tantâ des racines culturelles et religieuses dont ils pressentent
qu'elles sont celles de l'Égypte même.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
162
Jean-Marie Moeglin, L'Intercession du
Moyen Âge à l'époque moderne. Autour
d'une pratique sociale
Genève, Droz, 2004, 362 p. (coll. « École pratique des Hautes Études.
Sciences historiques et philologiques. V. Hautes études médiévales et
modernes »)
Bénédicte Sère
1 Nodale dans les sociétés anciennes, la notion d'intercession attendait sa table ronde. De
l'Antiquité chrétienne au XVIIe siècle, quinze historiens approchent les différents
visages de l'intercession. Leurs études sont réunies par Jean-Marie Moeglin.
2 D'emblée, le vocabulaire de l'intercession s'avère inattendu. Les auteurs signalent la
faible occurrence des termes intercedere ou intercessor. Il faut se tourner vers d'autres
radicaux pour capter la chose : interpellare, rogare pro, orare pro, interponere ou encore
advocatus, portitor precum, interpres, adsertor, protector, interpellatio, suffragia. Malgré la
fluctuation sémantique, Barbara Faes de Mottoni esquisse une définition. Intercéder
signifie intervenir en faveur de quelqu'un. D'où quelques caractéristiques :
1) l'intercession suppose la présence de trois personnes, celui auprès de qui on
intercède, celui qui intercède et celui en faveur de qui on intercède ; 2) une relation de
médiation instaurée par l'intercesseur avec ses référents ; 3) une requête ou demande
de quelque chose non pas pour soi-même, mais pour quelqu'un d'autre. Surtout,
l'intercession s'avère une pratique plus qu'une institution, et, partant, obéit à des
principes, des rituels et des règles tacites de fonctionnement. Claude Gauvard suggère
de lire l'intercession comme un « comportement » ; Jean-Marie Moeglin parle d'un
« système de l'intercession ».
3 L'intercession semble, en effet, une pratique qui recoupe plusieurs champs. Pratique
religieuse tout d'abord, elle est liée au culte des saints dont Yvette Duval pointe
l'émergence au tournant des IIe et IIIe siècles et retrace la mise en place officielle à partir
du IVe siècle. L'Église intègre cette forme de la piété typiquement chrétienne ; elle
réfléchit sur la signification des reliques (corps, parties du corps ou reliques de contact
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
163
au second degré) et canalise leur vénération en écartant les réactions superstitieuses.
Saint Augustin, en effet, précise que le secours des saints est une aide et non une
assurance de salut, que seules les prières touchent le saint et non le contact physique
avec le cadavre ou la relique. Plus largement, l'intercession se décline autour de quatre
types de relations qui unissent : les vivants entre eux ; les morts entre eux ; les vivants
aux morts (prière en faveur des défunts) ; les morts aux vivants (culte des saints). Ainsi,
l'intercession est tout aussi liée à la prière pour les défunts et Herbert Schneider étudie
la place de la commémoration des morts dans la liturgie des synodes à l'époque du haut
Moyen-Âge. À côté des aumônes et des jeûnes, il précise le rôle central de la messe pour
les défunts, multiplié par les confraternités de prières. Les psalmodies aux intentions
des défunts, notamment le psaume 129 – De profundis – et l'innovation liturgique de la
litania sont autant de prières d'intercession qui structurent le cadre cérémoniel des
assemblées synodales. Pour le Moyen-Âge central, Nicole Bériou développe ce lien entre
l'intercession et la prière pour les défunts, laquelle est qualifiée de « pratique sociale
particulièrement visible et de plus en plus conquérante » qui peut prendre plusieurs
formes : la prière universelle pendant la messe, les prières du prône (oratio communis
fidelium), les litanies en faveur des trépassés et des âmes du Purgatoire, les invocations
quotidiennes d'un saint à Prime... Aussi la fête de la Toussaint et le jour du 2 novembre,
consacré à la commémoration des défunts, sont-ils les lieux de choix d'un
enseignement sur l'intercession dans le cadre homilétique. Pour le Moyen-Âge tardif,
Catherine Vincent parle d'une « insatiable quête d'intercession » qu'elle observe à
travers les réseaux de solidarité de salut (confréries, chapellenies, fondations de
messes...) lesquels attestent d'un élargissement de la prière d'intercession. En effet, si
les spécialistes de la prière restent des intercesseurs privilégiés (moines et moniales,
mendiants, communautés canoniales, pauvres), la conviction s'impose que tout fidèle,
quels que soient ses mérites, peut intercéder pour le salut de ses frères. Et l'auteur
insiste sur la longue durée des pratiques de l'intercession qui pénètrent profondément
le tissu quotidien des hommes et des femmes en cette fin de Moyen-Âge : vénération
des tombeaux de saints et des collections de reliques, diffusion des images pour le culte
de tel saint, commémoration au jour anniversaire, processions, pèlerinages, ex-voto,
récitations organisées de prières pour le défunt, etc. Cette liste, Jean-Loup Lemaître
l'illustre d'un exemple précis, la dévotion à saint Martial, premier saint du Limousin, à
travers les récits de miracles de 1388. Il note l'attachement des fidèles pour leur saint,
lequel leur apparaît souvent plus proche que Dieu lui-même.
4 Pour autant, l'intercession n'en est pas moins une « pratique sociale », comme l'indique
le sous-titre du volume, voire une pratique sociopolitique au sein des relations
horizontales. En effet, elle joue un rôle décisif dans la résolution des conflits et dans les
négociations infrajudiciaires de paix. Parce qu'il jouit de la double confiance des
parties, l'intercesseur est un chef de négociations dans les processus de réconciliation
qu'étudie Henk Teunis à partir des récits de plaids, dans les pays de la Loire aux XIe et
XIIe siècles : l'« intercesseur de confiance » (vertrauenswürdige Fürsprecher) permet la
réconciliation sans attenter aux dignités sociales et à l'honneur en jeu. Aussi
comprend-on qu'« il [soit] impossible de se passer des intercesseurs » dans ce contexte.
Au Moyen-Âge classique, Hermann Kamp montre comment l'intercession est un moyen
politique qui utilise les relations personnelles en vue de faire avancer les intérêts
propres de l'intercesseur ; c'est une pratique courante acceptée par toute la classe
politique. Pour le début du XIVe siècle, Stéphane Péquinot rapproche les notions de
médiation, d'arbitrage et d'intercession (interponere partes suas) en considérant le projet
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
164
politique et diplomatique de Jacques II, roi d'Aragon, dont l'historien suit les complexes
négociations en vue d'une alliance entre la cour de Naples et la cour de Majorque.
Ultimement, les « bons offices » du roi médiateur ont pour objet de servir sa propre
légitimité politique dans le royaume d'Aragon et d'accroître son honneur en cas
d'aboutissement. À l'époque moderne, Lucien Bély relie l'intercession aux pratiques
diplomatiques dont il a évoqué ailleurs « l'invention ». Il retrace les subtilités d'un
cérémonial précis et les expériences nouvelles des ambassadeurs, notamment en
dehors de l'Europe, entre la France et le Siam. Enfin, Albrecht Burkardt, en soulignant
les réactions de l'Inquisition romaine contre les habitudes de recommandation, en
reconstitue, en creux, les pratiques au XVIIe siècle. En matière juridique, la
recommandation était monnaie courante dans une société où les relations personnelles
(liens de sang et d'amitié, solidarités spirituelles, rapports de fidélité, systèmes de
clientèle) dominaient. Un art des « lettres de recommandation » permet d'en saisir les
stratégies argumentatives. Désormais, explique l'auteur, l'intercession qui joue des
réseaux interpersonnels se voit interdite du fait qu'elle s'oppose aux procédures
juridiques de l'État moderne et à son idée du bon fonctionnement de la justice.
5 Pratique religieuse et pratique sociopolitique, l'intercession a donc pour spécificité
d'être un concept commun aux deux ordres de réalité qui structurent l'anthropologie
des sociétés chrétiennes : l'ici-bas et l'au-delà. Elle régit autant les rapports entre le Ciel
et la Terre qu'elle produit du lien social au sein de la communauté terrestre. Au
fondement de cette double pertinence de l'intercession se dresse le dogme central de la
Communion des Saints : le discours sur l'intercession s'appuie en effet sur l'image de
l'Église comme corps mystique du Christ, constitué de parties distinctes et solidaires
entre lesquelles des liens étroits sont tissés. Entre l'Église triomphante du ciel et l'Église
militante de la terre, auxquelles se joint l'Église souffrante du Purgatoire, l'essentiel
relève de la circulation de la charité et de l'échange mutuel de services et de grâces.
L'efficacité des œuvres et des mérites d'une partie rejaillit sur les autres membres du
corps. Les hommes de la terre sont les commembra des saints. Mieux, ils en sont les
amis et les frères. Nicole Bériou souligne en effet comment le lien d'amitié est choisi
pour signifier cette relation de charité affectueuse qui soude les différentes parties de
l'Église : intercesseurs par excellence, les saints sont à la fois les amis de Dieu et les
amis des hommes. Au XIIIe siècle, les réflexions théologiques sur l'intercession portent
leur accent tantôt sur la charité du corps mystique, tantôt sur l'ordonnancement
hiérarchique de ce même corps. Barbare Faes de Mottoni montre en effet, la diversité
d'approches entre le discours de Bonaventure et celui de saint Thomas sur
l'intercession. Pour le franciscain, l'intercession est une médiation ascendante : les
hommes prient l'Esprit saint qu'il vienne soutenir leurs requêtes ; ils prient les saints et
comptent sur leurs mérites et leur charité. Pour le dominicain, l'intercession est une
médiation descendante : l'Esprit saint intercède en rendant l'homme capable de
s'adresser à Dieu par ses propres forces. En une tonalité néo-platonicienne, l'Aquinate
affirme que les saints aident les hommes. Les prier, c'est respecter l'ordre hiérarchique
du monde au sein duquel les réalités supérieures irradient et élèvent les réalités
inférieures.
6 « Autour d'une pratique sociale ». Le sous-titre du recueil semble donc légèrement
inadéquat au regard des riches acquis qui précisent la notion au fil des quinze études.
En réalité, il semblerait que deux approches dominantes se dessinent entre les
historiens. Les spécialistes d'histoire religieuse tendent à insister sur l'acception de
l'intercession comme pratique religieuse autonome, distincte des procédés qui se
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
165
vivent socialement (clientélisme, réseaux de solidarités, etc.). L'intercession relève
d'une « logique interne à la révélation », précise Catherine Vincent. Son vocabulaire
renvoie à l'idéal apostolique plus qu'aux pratiques sociales. L'intercession n'est pas un
simple décalque des réalités mondaines. La pertinence de la notion est inhérente et
spécifique au christianisme. De la même manière, mais en sens inverse, Henk Teunis
maintient tout aussi distinctement les deux sphères, la sphère religieuse et la sphère
politique : l'intercession politique n'est pas, selon lui, un transfert du modèle de la
pénitence et de l'intercession religieuse. Dans le même ordre d'idées, Yvette Duval
conteste les interprétations trop sociologisantes de Peter Brown concernant le culte
des saints : elle entend redonner à l'intercession sa dimension spirituelle en définissant
l'Église comme la communauté des membra Christi et non pas seulement comme une
institution sociale puissante. Nicole Bériou, enfin, pose les mêmes conclusions : les
sermons sur la Toussaint n'ont pas un enjeu politique de légitimation des pouvoirs ; ils
ont une visée uniquement pédagogique, ce qui ne les prive pas, pour autant, d'utiliser
des métaphores de la vie sociale, comme celle de la cour du paradis.
7 Avec une autre sensibilité, les historiens qui abordent le phénomène sous un angle
résolument anthropologique, parlent volontiers d'« une osmose entre le politique et le
religieux ». Les glissements d'un terrain à l'autre sont épinglés : supplier, prier, « faire
requête » sont des expressions qui s'appliquent à Dieu mais qui concernent également
le roi au moment où se développe la royauté sacrée. À l'inverse, l'avocat ou le médecin,
compris comme intercesseurs (D. Jacquart et Marylin Nicoud), viennent de la société
civile pour envahir le domaine religieux. Ce qui unifie les deux champs, dans cette
position épistémologique, c'est la notion de sacralité. « L'intercession touche au sacré »,
écrit Claude Gauvard. Appliquée au pouvoir sacré, l'intercession est l'autre nom de la
médiation qui éduque à l'obéissance et écarte les risques de contact immédiat :
obéissance aux corps intermédiaires de la hiérarchie cléricale pour parer aux déviances
mystiques de ceux qui prétendent communiquer directement avec Dieu ; obéissance
aux représentants et aux intermédiaires administratifs d'un roi sacré et donc,
nécessairement, de plus en plus distant. En sollicitant la grâce, l'intercession permet
non seulement au pouvoir d'exister mais elle en atténue surtout la tension. Elle s'avère
le liant nécessaire pour un équilibre entre justice et miséricorde, ira et gratia .
L'intercession donne au pouvoir la souplesse qui le rendra à la fois supportable et
effectif. En définitive, la thématique de l'intercession repose, avec acuité, la question de
l'articulation entre les deux ordres de réalité, l'ici-bas et l'au-delà, le sacré et le
profane ; elle retrace la manière dont les sociétés anciennes déjà et l'historiographie
actuelle encore pensent cette articulation.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
166
Abderrahmane Moussaoui, Espace et
sacré au Sahara. Ksour et oasis du sud-
ouest algérien
Paris, CNRS Éditions, 2002, 291 p. (coll. « CNRS Anthropologie »)
Constant Hamès
1 On est heureux de saluer la publication d'un ouvrage d'anthropologie sur une région
saharienne de l'Algérie (sud-ouest) qui est restée trop à l'écart de la recherche
scientifique. Depuis la mince littérature d'époque coloniale, on ne trouve que trois
thèses soutenues en France, une au Maroc et les travaux de Mouloud Mammeri sur les
cérémonies de l'Ahellîl du Gourara. Ces derniers ne figurent pas dans la bibliographie
de l'ouvrage qui ne signale pas non plus la thèse d'État de Abdelkader Boualga,
Timimoun, l'oasis rouge du Gourara, Université Paris V, novembre 1981 (sous la direction
de V. Monteil).
2 Les enquêtes de terrain, approfondies et accompagnées de dépouillement de documents
et de manuscrits arabes, ont été menées, entre 1990 et 1994, dans deux régions du vaste
sud-ouest algérien, à Kenadsa, dans la Saoura et à Timimoun, dans le Gourara, éloignées
l'une de l'autre de plus de 350 km (l'échelle de la carte p. 21 doit être au moins
multipliée par deux).
3 L'idée centrale qui se développe tout au long des pistes et des thèmes de recherche
consiste à prendre le contre-pied d'une géographie déterministe qui voudrait que les
structures de l'espace habité soient étroitement tributaires des contraintes écologiques
qui pèsent sur lui. Pour l'auteur, la détermination de la configuration de l'espace vient
plutôt du sacré, entendu ici sous ses formes institutionnelles islamiques et, en
particulier, sous la forme de l'empreinte de la vie de saints personnages. « La
géographie du sacré » (p. 165) s'exprime de manière privilégiée, selon l'auteur, dans le
déploiement festif du mawlid (ou mulûd) qui célèbre, sous couvert d'anniversaire du
Prophète, celui du saint « patron » de l'agglomération ou des saints « patrons » de la
région.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
167
4 Avant d'entamer l'analyse du déroulement concret des mawlid locaux, une mise au
point et une réflexion sont menées sur cette notion et sur la « fête » qui a été instaurée
dans le monde musulman à cette occasion. On trouve ici une des démarches
intéressantes de ce travail, à savoir un va-et-vient permanent entre les données de
l'enquête de terrain, l'histoire locale des pratiques et des croyances et l'analyse
anthropologique de ces mêmes pratiques et croyances dans l'histoire plus générale (ou
fondamentale) de l'islam. On voit, par exemple, poindre, à propos du mawlid musulman,
l'idée que son institutionnalisation pourrait avoir quelque rapport avec une réaction
contre le sentiment d'une invasion des festivités de la naissance de Jésus-Christ
(croisades en Orient, reconquista espagnole en Occident). Sur le déroulement des
festivités sacrées et profanes du mawlid, tant à Kenadsa que dans les oasis de Timimoun,
le tableau ethnographique dressé se révèle abondant, vivant et – force de l'enquête
directe – à l'écoute attentive des paroles échangées, des textes psalmodiés, que l'auteur
décortique linguistiquement et anthropologiquement sur le champ ou dans l'un des
chapitres suivants. La prise en compte de la langue locale et de la langue plus littéraire
des textes permet assurément une compréhension et un questionnement plus profonds
des phénomènes.
5 Mais l'exercice mérite contrôle. Ainsi (p. 51) l'idée que la notion de ‘îd (fête) « provient
de ‘awd (retour) » est tentante mais apparemment non fondée linguistiquement, à cause
d'un yâ' radical d'un côté et d'un wâw de l'autre. Ailleurs (p. 230), à propos du terme
ksar, pl. ksour, de l'arabe qasr, pluriel qusûr, le rapport supposé avec le radical arabe qsr
qui désigne l'écourtement, le rapetissement, le rétrécissement, est étranger au terme
qui n'est qu'une adaptation arabe du latin castrum (camp fortifié). Par contre, l'analyse
est payante pour les noms et surnoms des populations, des quartiers, de la topographie,
des dénominations des catégories sociales etc. Par exemple, il est instructif de lire que
le terme de hrâtîn (esclaves affranchis) ou celui de mrâbtîn (« marabouts ») sont
présents ici comme ailleurs au Sahara.
6 En remontant aux « saints patrons » qui sont à l'origine de ces cérémonies festives, on
découvre avec intérêt qu'il s'agit d'une catégorie de saints nouvelle à l'époque ( XVe-
XVIIIe s.), celle de saints lettrés. Autre constat : tous ces saints oasiens s'inscrivent dans
des réseaux confrériques et en sont parfois les créateurs, comme Ben Bûzyân, le saint
de Kenadsa, à l'origine d'une branche confrérique qui porte son nom, la Zyâniyya. Or,
indique l'auteur à propos de la diffusion du mawlid du Prophète, « les confréries
religieuses joueront un grand rôle dans la popularisation d'un tel événement » (p. 39).
Le paradoxe a voulu que le mawlid, propagé par des saints confrériques en l'honneur du
Prophète, se soit reconverti en célébration de leur propre anniversaire. Sur le maillage
confrérique des oasis et de leurs saints, les informations concernant Ben Bûzyân de
Kenadsa et sa Zyâniyya sont précises et bien documentées ; en effet, il est le disciple des
deux fondateurs de la confrérie Nâsiriyya de Tamgrût (Oued Dar'a, Maroc) dont le rôle
de diffuseurs de la doctrine shâdhilî a été capital aux XVIIe-XVIIIe siècles, non seulement
au Sahara marocain et algérien mais aussi mauritanien et malien. Quant aux saints de la
région de Timimoun et à leurs confréries de rattachement, malgré la diversité des
étiquettes, toutes relèvent de la même Nâsiriyya-Shâdhiliyya, ce qu'il aurait peut-être
fallu souligner davantage au niveau des conséquences. En effet, les caractéristiques
religieuses observées et annotées sont spécifiquement celles véhiculées depuis les
origines (XIIIe siècle) par le courant de la Shâdhiliyya. Celui-ci s'est construit en prônant
une mystique très retenue, opposée aux manifestations extatiques collectives (danse,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
168
transe etc.) et insistant par contre beaucoup plus sur l'observation de la religion légale.
D'où l'importance, pour ce courant, de l'instruction et des livres, ce qui a produit les
« saints lettrés » en question. L'autre point caractéristique de la Shâdhiliyya et des
confréries qui en sont issues consiste bien, comme l'ouvrage l'a constaté, dans une
vénération du Prophète qui confine parfois au culte et en conséquence on comprend
mieux l'essor du mawlid prophétique à travers leurs réseaux.
7 L'ouvrage n'est pas seulement riche de l'apport de données de terrain et des réflexions
qui en découlent mais il s'attache aussi à des problématiques plus larges sur certaines
notions centrales de la sociologie ou de l'anthropologie du religieux. Sacré,
topographie, architecture, fête, sont quelques-uns des concepts qui s'entrelacent dans
le parcours intellectuel accompli à travers les oasis et leurs cérémonies du mawlid. Ces
concepts sont retravaillés d'abord à la lumière des auteurs classiques des sciences
sociales, comme Halbwachs, Otto, Brown, Durand, Dupront etc. Mais ils sont aussi, par
la force des choses, confrontés aux situations à la fois saharienne et islamique qui ne
correspondent pas aux références culturelles et religieuses sur lesquelles se sont
appuyés les auteurs dits classiques. Ainsi, les conclusions tirées de l'ouvrage de
F. Isambert, Le sens du sacré. Fête et religion populaire (Paris, Les éditions de Minuit, 1982
[coll. « Le Sens commun »]), « ne pourraient, en aucun cas, être reconduites pour une
fête comme celle du mawlid » car « elles demeurent circonscrites à l'aire géographique
qui lui a servi de base d'étude » (p. 182). Il nous semble que ce type de réflexion
épistémologique gagnerait à être étendu pour permettre de dégager ce qui, dans les
théories des sciences sociales, relève subrepticement d'un conditionnement chrétien
des concepts. Ainsi, par exemple, la notion de pèlerinage (p. 185), reprise telle quelle à
Dupront dans son acception chrétienne, nous paraît empêcher l'analyse du sens socio-
islamique des pratiques locales ; dans sa réflexion, l'auteur en arrive à devoir effectuer
un glissement de sens (p. 185-186), en passant de « procession » à « pèlerinage », pour
pouvoir retrouver les thèses de Dupront. Mais le mouvement de pensée qui confronte
les « classiques » des sciences sociales aux données ethnographiques des paysages
culturels musulmans est en marche et affleure à plusieurs endroits de ce travail.
Souhaitons que ces avancées permettent dans le futur de rendre plus universels des
concepts et des notions trop rapidement qualifiés de « classiques » parce que trop euro-
chritianisés à la naissance.
8 Le glossaire (p. 275-278), bien venu, aurait pu, augmenté des noms propres et de lieux,
fournir un index bien utile pour un travail aussi riche.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
169
Mette Ramstad, Conversion in the
Pacific. Eastern Polynesian Latter-day
Saints' Conversion Accounts and their
Development of a LDS Identity
Bergen, Høyskoleforlaget (Norwegian Academic Press), 2003, 303 p. (Coll.
« Studia Humanitatis Bergensia », no 19)
Yannick Fer
1 Tiré d'une thèse de doctorat en histoire des religions soutenue en 2000 à l'université
norvégienne de Bergen, ce livre se présente au premier abord comme un compte rendu
minutieux des recherches historiques et ethnographiques conduites par M. Ramstad de
1992 à 1995. L'auteure insiste d'ailleurs en introduction sur sa volonté de présenter un
« matériel empirique » en le « laissant parler par lui-même » (p. 17). Or, comme on le
sait, aucun fait n'a jamais « parlé par lui-même » et c'est bien l'angle d'approche
construit par M. Ramstad, les outils d'analyse qu'elle mobilise et sa volonté farouche de
ne jamais enfermer son objet d'étude dans des idées préconçues qui font de ce livre une
contribution majeure à la compréhension des évolutions contemporaines du
christianisme en Océanie.
2 Dans une longue introduction – près de cent pages – l'auteure prend le temps de poser
un à un les fondements méthodologiques et théoriques de sa réflexion. Celle-ci s'appuie
en premier lieu sur une observation de plain-pied de l'Église mormone de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours à Hawaï, en Nouvelle-Zélande et en Polynésie française, et
sur de nombreux entretiens (avec les fidèles mormons, mais aussi avec quelques
observateurs extérieurs). Comme le souligne M. Ramstad elle-même, il manque à ces
données une prise en compte plus approfondie des caractéristiques sociologiques de ces
trois sociétés et de la position sociale des convertis, qui aurait enrichi, au chapitre 3,
l'analyse des parcours de conversion, conduite essentiellement sous l'angle des
circonstances personnelles et des conditions culturelles de plausibilité du message
mormon.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
170
3 Le second fondement consiste en de précieuses synthèses concernant d'une part les
travaux produits par les sciences sociales et les auteurs mormons sur le mormonisme
en Polynésie ; d'autre part les différentes élaborations théoriques qui, dans le champ
universitaire anglophone, cherchent à préciser les processus liés à la conversion et aux
changements d'affiliation religieuse, notamment en contexte interculturel. La typologie
des conversions de Lewis Rambo permet ainsi de rappeler que la conversion au
mormonisme, en Polynésie contemporaine, relève avant tout d'une « institutional
transition » ou « denomination switching », mouvement d'affiliation/désaffiliation qui
se joue dans les limites d'une culture chrétienne partagée constituant aujourd'hui un
élément central des identités polynésiennes. Par ailleurs, en combinant les modèles
explicatifs de Rambo et ceux de John Lofland et Rodney Stark (p. 24 ss), l'auteure met en
place un schéma en dix étapes qui, bien qu'un peu trop mécanique et linéaire (une crise
ou une tension entraînant une recherche de solutions débouchant sur de nouvelles
interactions), n'est pas dénué de toute portée heuristique mais lui apparaîtra
finalement inadéquat pour rendre compte des parcours de conversion observés (p. 272
ss).
4 Enfin, l'étude s'appuie sur une réelle familiarité avec le corpus théologique mormon, un
atout essentiel pour saisir toutes les dimensions de l'acte d'adhésion – qui repose aussi,
souligne M. Ramstad, sur des argumentations et des raisonnements propres à emporter
la conviction de Polynésiens habitués à lire la bible – et pour comprendre l'importance
que revêt, dans le système de croyances mormon, l'établissement d'un lien
généalogique entre les Polynésiens et la tribu des Néphites, héritiers des promesses de
Dieu au peuple d'Israël.
5 Au fil des développements qui suivent cette partie introductive, on comprend que
l'hypothèse ayant présidé aux recherches de l'auteure consistait, plutôt que de
considérer a priori le mormonisme comme une religion contraire à la culture
polynésienne (reproche qu'elle adresse à l'universitaire américaine Tamar Gordon,
auteure d'une thèse sur le mormonisme à Tonga, à paraître aux Duke University Press), à
mesurer au contraire la portée des correspondances, voire des continuités entre
mormonisme et croyances polynésiennes anciennes. Cette hypothèse s'accorde assez
mal avec la christianisation massive et déjà ancienne de la Polynésie et elle suppose une
connaissance fine des religions polynésiennes pré-chrétiennes – vaste champ
d'investigation que M. Ramstad ne peut que survoler. Pourtant, c'est en suivant peu ou
prou ce fil rouge qu'elle parvient finalement à plusieurs conclusions intéressantes et ce,
pour deux raisons : d'une part, parce que cette hypothèse repose malgré tout sur
quelques arguments crédibles, bien mis en évidence ; d'autre part parce que
M. Ramstad a l'intelligence de ne pas s'y cramponner à tout prix et peut donc intégrer à
sa réflexion les réponses négatives que lui renvoie l'observation de terrain.
6 Premier point, donc, que reste-t-il de l'hypothèse d'une affinité particulière entre
mormonisme et croyances polynésiennes anciennes ? Sur les trois terrains étudiés,
c'est l'inscription des individus dans une lignée généalogique qui fait le plus clairement
écho aux attentes culturelles traditionnelles. La nécessité, dans la théologie mormone,
d'identifier les ascendants pour reconstituer le lien avec les tribus d'Israël et pour
assurer le salut, l'unité de la famille au-delà de la mort répond en effet, sous des formes
variables selon les pays, à une croyance forte que le christianisme n'a pas effacée : la
présence, néfaste ou bénéfique, des esprits des morts auprès des vivants.
L'identification à Israël ne se retrouve pas avec la même vigueur chez les Maoris (où
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
171
elle est présente dès les premiers temps de l'implantation mormone, au XIXe siècle), à
Hawaï (qui occupe ici une position intermédiaire) et en Polynésie française (où cette
idée ne rencontre quasiment aucun écho). À Hawaï, la quête généalogique aboutit
surtout à une réaffirmation de l'identité culturelle autochtone en autorisant la
réhabilitation symbolique des ancêtres, puisque retrouver la culture d'autrefois, c'est
désormais renouer avec l'Ancien Testament. Ce mouvement s'est concrétisé dans les
années 1960 par l'ouverture d'un Polynesian Cultural Center mormon. En Polynésie
française, toute forme de continuité avec la culture pré-chrétienne est en revanche
refusée par les convertis et c'est d'abord la possibilité de rétablir l'unité et l'harmonie
avec les parents défunts qui fait sens à leurs yeux.
7 Mais ce que montre surtout l'analyse attentive des conversions contemporaines au
mormonisme en Polynésie – et qui n'était pas attendu par M. Ramstad – c'est à quel
point ce réinvestissement religieux de l'ascendance et/ou de l'appartenance à un
peuple et une culture passe par un engagement personnel et une individualisation de
l'expérience religieuse. Comme l'ensemble des Églises combinant le baptême d'adulte
et une rigoureuse orthopraxie, l'Église mormone peut compter attirer à elle des
croyants espérant « changer de vie », rompre avec l'alcool ou surmonter des épreuves
personnelles. Comme toute Église prophétique, elle doit aussi s'attacher plus que
d'autres à démontrer qu'elle n'est pas une hérésie mais bien la « vraie » Église,
restaurée dans tous ses fondements (organisation, doctrines et prophètes) et donc
capable de produire ici et maintenant les signes de la puissance divine.
8 Cet effort prosélyte passe par trois canaux : les activités culturelles et sportives en
direction des jeunes ; les missionnaires ; la famille et les amis (p. 159 ss). Les deux
derniers retiennent particulièrement l'attention. En effet, explique M. Ramstad,
lorsqu'il s'agit des missionnaires, les prémisses de l'adhésion se mettent en place non
dans l'église mais à domicile, dans une discussion intime, une écoute et un
apprentissage de la prière personnelle qui encouragent chacun à entrer dans une
communication avec Dieu et ouvrent la possibilité d'« apprendre plus » par soi-même
(p. 174). Cette dimension personnelle a encore été renforcée, à partir de 1981 à Tahiti
(c'est-à-dire au cours de la décennie où l'Église mormone y a connu sa plus forte
progression) par une évolution des méthodes missionnaires : le porte-à-porte étant
désormais de plus en plus vécu comme une intrusion dans la vie privée, l'Église décide
alors officiellement d'évoluer vers une politique de « friendshiping », empruntant les
réseaux de la sociabilité familiale et amicale. On voit ainsi, de façon saisissante,
comment le mormonisme parvient à concilier, en Polynésie, la quête généalogique –
voire le militantisme culturel – avec une « privatisation de l'expérience spirituelle »
(p. 206), par le biais d'invitations à des « soirées familiales » (p. 159), de discussions et
de travaux personnels : « The LDS church challenged people and got them involved in
the church by giving them homework in manual and scriptures » (p. 203).
9 Ce dernier point mériterait d'ailleurs d'être observé de plus près car – sans doute du
fait d'une élévation continue du niveau de scolarisation – la volonté d'« apprendre
plus », d'élargir ses connaissances religieuses en recevant une formation plus
« approfondie » sous la forme d'un enseignement personnalisé apparaît aujourd'hui
comme une motivation de tout premier plan dans les parcours de conversion
polynésiens conduisant au mormonisme, mais aussi au pentecôtisme, à l'adventisme ou
à la foi baha'i.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
172
Arskal SalimAzyumardi Azra (eds.),
Shari'a and Politics in Modern
Indonesia
Singapour, ISEAS, 2003, 363 p.
Rémy Madinier
1 La place de la charia dans les institutions est une question récurrente de la politique
indonésienne depuis l'adoption, puis le rejet, en juin et août 1945 de ce qui fut plus tard
connu sous le nom de Charte de Jakarta. Cet accord – conclu entre responsables
nationalistes et dirigeants de l'islam politique – prévoyait de faire figurer dans le
préambule de la constitution l'obligation, pour les musulmans, de se conformer aux
principes de la loi islamique. L'abandon de cette formulation, au profit de la simple
affirmation de l'inspiration monothéiste de l'idéologie d'État (le Pancasila) n'a pas, bien
au contraire, éteint les polémiques à ce sujet. De très nombreux écrits relatifs à la
charia ont été publiés, depuis lors, en indonésien. Le plus souvent militante, parfois
plus scientifique, cette littérature n'est pas accessible au lecteur anglophone. Les
publications en anglais sont, elles, plus rares et surtout dispersées dans diverses revues
et ouvrages collectifs. À ce titre, il convient de saluer l'initiative prise par Arskal Salim
et Azyumardi Azra, tous deux enseignant à l'université islamique d'État de Jakarta, qui
ont voulu rassembler une dizaine de contributions parues sur le sujet dans les quinze
dernières années. Cette compilation est accompagnée d'une solide introduction, d'une
bonne bibliographie et d'un épilogue fort utile puisqu'il procède à une analyse des
changements intervenus au cours des dernières années et particulièrement durant les
présidences de Yusuf Habibie (mai 1998-octobre 1999) et d'Abdurahman Wahid (octobre
1999-juillet 2001). L'ouvrage propose enfin, en annexe, une traduction des principaux
textes législatifs de la période (la loi sur le mariage de 1974, la loi sur l'organisation du
système judiciaire, le décret présidentiel sur la compilation du droit islamique, le
décret de 1977 sur le waqf). Ce livre comble indiscutablement un manque, mais il ne le
fait qu'imparfaitement dans la mesure où les contributions rassemblées sont issues de
sources disparates et n'ont pas été écrites pour être publiées ensemble. D'où de
nombreuses répétitions et, parfois, quelques manques qui ne faciliteront pas la tâche
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
173
du lecteur en quête d'une synthèse sur l'évolution de la place du droit islamique dans le
droit positif indonésien.
2 Malgré cette matière quelque peu décousue, le volume permet de reconstituer l'histoire
contemporaine de la charia en Indonésie, à travers quelques-uns de ses moments
importants. La contribution de M. B. Hooker (« The State's legal policy and the
development of islamic law in Indonesia's New Order ») retrace ainsi les affrontements
ayant opposé les partisans de la suprématie de la loi coutumière (l'adat) aux défenseurs
du droit islamique, au sein de l'administration coloniale, entre les années 1880 et la
Seconde Guerre mondiale. La victoire des premiers sur les seconds entraîna, en 1937,
une importante restriction des compétences des tribunaux islamiques reconnus par
une loi de 1882 et désormais compétents pour les seules affaires matrimoniales. Plus
tard, au moment de l'indépendance, comme le rappelle Ratno Lukito, (« Law and
Politics in Post-independance Indonesia : a case Study of Religious and Adat courts »)
malgré (ou à cause ?) de leurs compétences limitées, ces tribunaux islamiques
survécurent au processus d'unification des juridictions indonésiennes, alors même que
les tribunaux coutumiers disparaissaient. Cette mesure conservatoire inaugura ce que
l'auteur qualifie de « résilience » des cours religieuses dans des contextes politiques
changeants. Sur la période de l'Ordre nouveau (1966-1998), les communications de
Arskal Salim (Zakat Administration in Politics of Indonesian New Order), Nur Ahmad
Fadhil Lubis (« The State's Legal Policy and the Development of Islamic Law in
Indonesia's New Order ») et Azyumardi Azra (« The Indonesian Marriage Law of 1974:
an Institutionalization of the Shari'a for Social Changes ») invitent à reconsidérer la
chronologie classique de la période. On distingue en effet habituellement trois phases
dans les rapports du régime à l'islam : une première dite antagoniste de 1967 à 1982,
une seconde de critiques réciproques entre 1982 et 1985 et enfin une phase
d'accommodation au cours de laquelle le régime chercha, auprès de la communauté
musulmane, un soutien désormais quelque peu défaillant au sein des forces armées. Or,
à considérer de près chacune des évolutions relatives au rapport entre loi islamique et
droit positif, on constate que ce cadre général mériterait d'être nuancé. La loi sur le
mariage, adoptée dans une période présentée comme très sombre pour l'islam
politique, sanctionna en fait un recul important de la part du pouvoir. Voulue par les
nationalistes et les organisations de défense de la femme, la nouvelle législation
entendait réduire l'important taux de divorce (souvent par répudiation) qui
caractérisait alors la société indonésienne, en soumettant systématiquement la loi
islamique au droit civil. Elle prévoyait ainsi l'enregistrement civil nécessaire pour la
validité d'un mariage musulman et l'autorisation d'une cour civile pour un divorce ou
un mariage polygame ; elle affirmait la possibilité d'unions interconfessionnelles et
donnait aux enfants adoptés un statut équivalent à celui des enfants naturels. Sur tous
ces points, le texte présenté au parlement fut considéré comme blasphématoire par la
plupart des organisations musulmanes. À la suite de leurs protestations et de
manifestations diverses, le pouvoir recula. Le texte de loi fut vidé de sa substance
première et tous les points litigieux furent tranchés en faveur du droit islamique.
3 Mais la question de la place de la charia ne se limite pas, en Indonésie, à une
intervention de l'État. Comme le rappelle Nadirsyah Hosen (« Fatwas and Politics in
Indonesia »), l'application de normes islamiques relève également des fatwas prises par
les grandes organisations islamiques (Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah depuis
l'entre-deux-guerres, Majelis Ulama Indonesia depuis 1975). Contrairement à l'Égypte
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
174
et l'Arabie Saoudite, l'Indonésie n'a pas de grand mufti. Contrairement à la Malaisie, les
fatwas, pour être valables, ne requièrent pas l'approbation d'une autorité
gouvernementale. Il en résulte une autorité moindre de ces édits religieux qui relèvent
plus souvent de l'injonction que de l'obligation. Les oulémas indonésiens sont avant
tout des autorités morales dont les conseils et la vie exemplaire dessinent un chemin de
perfection que le simple fidèle est invité à emprunter. D'où aussi leur plus grande
liberté à l'égard du pouvoir : leurs fatwas peuvent soutenir la politique du
gouvernement (ce fut le cas à propos de la régulation des naissances) mais aussi aller à
son encontre (ainsi du Conseil des oulémas d'Indonésie interdisant aux musulmans de
fêter Noël avec les chrétiens, en opposition aux efforts d'entente cordiale du
gouvernement).
4 Le second apport de l'ouvrage est de permettre d'apprécier, au-delà des vicissitudes
d'une histoire souvent complexe quelques tendances lourdes de l'application de la
charia en Indonésie. Par une sorte d'accord tacite entre le pouvoir et les grandes
organisations religieuses, elle a longtemps été limitée aux questions relatives au statut
personnel (mariage, héritage,...) ainsi qu'à la régulation de certaines pratiques
économiques. Dans ces domaines, les contributions de Mark Cammack (« Indonesia's
1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of
Islam? ») de Ahmad Imam Mawardi, (« The Political Backdrop of the Enactment of the
Compilation of Islamic Laws in Indonesia ») et de Robert W. Hefner, (« Islamizing
Capitalism: On the Founding of Indonesia's First Islamik Bank ») montrent comment les
pouvoirs publics, en organisant l'application des principes islamiques, leur ont souvent
donné un caractère optionnel. Les dons effectués, dans le cadre de la zakat, sont
déductibles du revenu imposable mais ne sont pas obligatoires ; la loi donne
compétence aux cours religieuses pour statuer sur l'héritage, les testaments et les dons
mais seulement si ces derniers sont réalisés conformément à la loi islamique, ce qui
revient à offrir un choix de juridiction aux parties. Au regard de cette attitude du
pouvoir, plaçant la notion d'arbitrage permanent au cœur du processus d'application
de la charia en Indonésie, Howard Federspiel (« Islamic Values, Law and expectations in
Contemporary indonesia ») concluait, en 1998, qu'on était bien loin d'un État islamique
en Indonésie.
5 Les évènements survenus depuis la chute de Suharto, en mai 1998, méritent d'être
replacés dans cette perspective. Arskal Salim, dans son épilogue, montre bien les
espoirs retrouvés des partisans d'une application intégrale de la charia dans l'Archipel,
ie tant dans la prescription de normes sociales, que dans le droit pénal et la conduite
des affaires du pays. Jusque-là privés de toute perspective d'avenir par l'alliance tacite
entre représentants de l'État et les grandes organisations musulmanes, ils ont su
s'engouffrer dans les brèches ouvertes par les lois de décentralisation. En faisant
pression sur les responsables de districts (kabupaten) désormais largement autonomes,
ils ont pu obtenir (à défaut de règlements toujours applicables car portant sur des
domaines dans lesquels la compétence de l'État demeure la règle) le vote de motions
témoignant d'un respect total de la norme islamique. Cette stratégie de contournement
par le local mise en œuvre par les islamistes indonésiens a même reçu les
encouragements involontaires d'un État pris au piège de ses contradictions politiques.
Des lois adoptées en 1999 et 2001 ont ainsi conféré à la province d'Aceh, devenue
Nanggroe Aceh Darussalam, un statut d'autonomie prévoyant l'application de la charia.
Espérant, par cette mesure symbolique, éteindre les velléités indépendantistes de cette
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
175
région de Sumatra-Nord, le gouvernement indonésien a surtout contribué à replacer la
question de la charia au cœur de la vie politique indonésienne.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
176
Bruno Saura, La société tahitienne au
miroir d'Israël. Un peuple en métaphore
Paris, CNRS éditions, 2004, 302 p. (coll. « CNRS ethnologie »)
Yannick Fer
1 Visiblement inspiré par les nombreuses analyses anthropologiques du christianisme et
des Églises prophétiques maori – auxquelles l'auteur a abondamment recours,
consacrant même un chapitre entier à ce « détour par la Nouvelle-Zélande »
(chap. 12) – ce livre se présente comme une exploration des liens rapprochant les
Tahitiens et Israël, dans la littérature occidentale et surtout dans l'imaginaire tahitien.
Cette tentative, qui paraît de prime abord assez pertinente, ne débouche finalement sur
rien de très nouveau ni de très convaincant et l'on doit se contenter ici d'un assemblage
de données disparates, rarement détaillées, et de réflexions souvent approximatives.
2 B. Saura s'attarde assez longuement sur les Églises et la théologie mormones, sans
doute convaincu d'y trouver la forme la plus évidente d'une identification polynésienne
au peuple juif. Mais l'histoire du mormonisme en Polynésie française, hormis les
réinterprétations prophétiques qui ont émergé au milieu du XIXe siècle dans quelques
archipels des Tuamotu (et qui auraient mérité des développements plus conséquents,
chap. 11), n'a que peu à voir avec celle du mormonisme maori. Le premier n'a vu le
nombre de ses membres croître significativement qu'au cours des années 1970-1980 et
cette croissance doit être comprise au regard d'un glissement plus général du
christianisme polynésien vers des formes de sociabilité religieuse de type professant,
tandis que le second rassemblait déjà 10 % de la population maori en 1896 et se
constituait ainsi en une Église communautaire maori. Dans une remarquable étude
comparative des conversions au mormonisme dans le Pacifique – publiée en 2003 par la
Norwegian Academic Press et malheureusement ignorée par B. Saura – l'universitaire
norvégienne Mette Ramstad note d'ailleurs que les fidèles hawaiiens ou maori qu'elle a
rencontrés « were much more preoccupied with the American and Israel connection
than the French Polynesians », qui ne témoignaient pas d'un grand intérêt pour ces
questions (p. 217).
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
177
3 Les passages traitant du protestantisme polynésien ne sont pas mieux étayés : l'auteur
revient sans cesse aux écrits du théologien Turo Raapoto (centrés sur le peuple ma'ohi,
élu de Dieu et défini à travers sa terre et sa langue), qu'il semble vouloir à tout prix
disqualifier, en les décrivant comme un « mormonisme indigène » (p. 14) ou une pensée
millénariste « racialiste » (p. 224). Il aurait été utile de mieux évaluer le poids de cette
production au sein de l'Église protestante polynésienne d'aujourd'hui, plutôt que d'y
voir simplement « le discours officiel de la direction de l'Église » ; et de la replacer dans
le cadre plus général d'un mouvement de contextualisation qui a fait émerger un très
riche corpus de théologies protestantes océaniennes (à peine mentionnées, p. 241 à
244).
4 Pourtant familiarisé de longue date avec le protestantisme polynésien (auquel il s'est
intéressé dès 1990 dans une thèse de science politique publiée en 1993 sous le titre
Politique et Religion à Tahiti), B. Saura néglige à plusieurs reprises des clés de
compréhension essentielles. Soucieux de définir ce que le protestantisme polynésien
doit à la culture et l'histoire polynésiennes, il en oublie presque complètement ce que
celui-ci doit tout simplement au protestantisme en général : en particulier, un rapport
spécifique au judaïsme, à l'Ancien Testament et à Israël, rappelé notamment par
P. Cabanel dans son étude des « affinités électives » entre juifs et protestants en France
(Fayard, 2004). De même, trop pressé de trouver dans les quelques « parcours
individuels surprenants » de protestants polynésiens « amoureux d'Israël » (p. 92 ss)
une confirmation des liens spécifiques unissant les Polynésiens à la Terre Sainte, il ne
s'aperçoit pas que les cas qu'il cite concernent la frange la plus avancée d'un
protestantisme charismatique inspiré par Jeunesse en mission et le dispensationalisme
du « sionisme » évangélique nord-américain (analysé par Sébastien Fath dans Militants
de la Bible aux États-Unis, Paris, Autrement, 2004).
5 La quatrième partie, consacrée à « la signification politique d'Israël en Polynésie »
reprend en grande partie des publications précédentes, en évoquant notamment
Pouvanaa Opaa, nationaliste polynésien des années 1950 et référence centrale de la
culture politique polynésienne moderne. Elle ouvre quelques perspectives de réflexion
intéressantes, qui ne concernent pas seulement une éventuelle identification au peuple
juif et au destin d'Israël, mais plus largement une culture politique marquée en
profondeur par le christianisme et l'histoire missionnaire.
6 Mais les définitions qui auraient dû logiquement fournir au livre son fil conducteur ne
sont véritablement données qu'en conclusion : d'une part, celle de la métaphore
(annoncée en sous-titre), que l'on distingue finalement assez mal de la notion
d'identification ; d'autre part – et surtout – les différentes compréhensions possibles
d'Israël (référence au destin singulier d'un peuple, à une vocation universelle, à la
Terre Sainte ou à la matrice historique du christianisme). Si bien qu'en refermant le
livre, on ne peut s'empêcher d'imaginer ce qu'il aurait pu être si ces deux repères
avaient été d'emblée mobilisés pour rassembler de manière plus cohérente et
approfondie tout ce qui, dans l'histoire et l'imaginaire contemporain polynésiens, se
reflète, en effet, « au miroir d'Israël ».
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
178
Le saint lévrier. Guinefort,
guérisseur d'enfants depuis le
XIIIe siècle
Paris, Flammarion, Nouvelle édition augmentée, 2004 (1re édition : 1979),
282 p. (coll. « Champs »)
Marlène Albert-Llorca
1 Dans le recueil d'exempla qu'il rédige dans les années 1250, le dominicain Étienne de
Bourbon consacre un chapitre à l'étrange « superstition » qu'il a découverte dans la
Dombes, au nord de Lyon. Les paysans y vénèrent « tel un martyr » un « chien lévrier »
enterré dans un bois où s'élevait jadis un château. Un jour, alors qu'il dormait dans son
berceau, le fils du seigneur de ce château fut menacé par un « grand serpent ». Le
lévrier du seigneur, qui se trouvait dans la chambre, s'interposa et, après une lutte
acharnée, il tua le serpent. Quand le seigneur entra dans la chambre, il vit le chien
ensanglanté et, croyant qu'il avait dévoré son enfant, il le tua d'un coup d'épée.
Comprenant ensuite sa méprise, il fit mettre le lévrier en terre et fit planter des arbres
à l'endroit de son inhumation. C'est dans ce bois que les femmes de la région, à l'époque
de la prédication d'Étienne de Bourbon, « portaient leurs enfants [malades] à saint
Guinefort ». Guidées par une vieille femme qui leur indiquait les actes à accomplir, elles
effectuaient divers rituels destinés à obtenir la guérison de leur enfant. Il leur arrivait
notamment d'adjurer « les faunes qui étaient dans la forêt de Rimite de prendre cet
enfant malade et affaibli qui, disaient-elles, était à eux ; et leur enfant, qu'elles avaient
emporté avec eux, de le leur rendre gras et gros, sain et sauf ». Étienne de Bourbon
décida d'arrêter ce culte « superstitieux » : il fit exhumer les restes du chien et couper
le bosquet, ordonna que l'on brûle le tout et interdit à quiconque de perpétuer les
pratiques jusqu'alors en usage.
2 C'est ce document, témoignage sur un culte tout à fait surprenant puisqu'il repose sur
l'identification d'un saint martyr connu par ailleurs, Guinefort, et d'un lévrier,
qu'étudie l'auteur dans cet ouvrage. Initialement publié en 1979, il est aujourd'hui
réédité, avec quelques ajouts, dans la collection « Champs » de Flammarion. Ce choix
éditorial prend acte du rayonnement du livre, dont témoigne, entre autres indices, le
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
179
nombre de traductions qui en ont été faites : on en compte sept, dont une en 2004, au
Brésil.
3 L'ouvrage doit sans doute son succès au caractère exceptionnel du cas qu'il étudie :
qu'un chien (un lévrier, certes...) ait pu être en quelque sorte canonisé, fût-ce par des
paysans du XIIIe siècle, a de quoi surprendre dans une religion qui a pris soin de
distinguer radicalement l'homme de l'animal. Un fait, cependant, ne devient significatif
qu'à partir du moment où l'on dispose des moyens théoriques et méthodologiques de
lui donner sens. Le destin du texte d'Étienne de Bourbon confirme cette proposition
d'épistémologie élémentaire. Comme le souligne l'auteur, il était connu des érudits
depuis le milieu du XIXe siècle mais nul n'avait cherché à l'interpréter dans son
ensemble. Si l'auteur a pu se proposer de le faire, précisément dans les années 1970,
c'est – comme il l'indique lui-même dans sa préface à la nouvelle édition – que le
contexte intellectuel le lui permettait. Le contexte intellectuel, c'est-à-dire à la fois les
partis pris théoriques et méthodologiques des historiens (ou, du moins, d'une partie
d'entre eux) dans ces années-là. Plutôt que de revenir sur le détail de l'analyse de J.-C.
Schmitt, je voudrais rappeler les principes sur lesquels elle se fonde. Ce sont eux, en
effet, qui ont donné à ce livre – et ce, parce que l'auteur les a appliqués avec une
rigueur peu commune – son audience. Sa réédition invite, en même temps, à
s'interroger sur leur actualité.
4 Le premier choix théorique concerne le débat (sur lequel existe, comme on le sait, une
abondante littérature) sur le rapport entre religion ou, plus largement, culture
« savante » et religion ou culture « populaire ». L'auteur préfère, à cette dernière
expression, celle de « culture folklorique » en arguant qu'elle permet « d'éviter les
ambiguïtés de “populaire”, sans lever il est vrai celles qui s'attachent au mot
“folklore” » (p. 19). Et l'on pourrait en effet discuter la pertinence de ce choix
terminologique. L'essentiel, cependant, est moins la terminologie adoptée que le choix
(également discutable, et déjà discuté alors [Daniel Fabre, par exemple, s'attache à
nuancer cette distinction dans la note critique de l'ouvrage parue dans Critique, n o 419,
avril 1982, p. 295-311]) de marquer une distinction radicale entre ces deux sphères. On
comprend mieux qu'il ait été fait si l'on rappelle – comme le fait l'auteur dans sa
préface – que les historiens se partageaient à cette époque entre ceux qui voyaient dans
la religion populaire « une forme dégradée, “vulgarisée” voire pervertie de la religion
savante et orthodoxe des clercs » et ceux qui pensaient qu'elle avait une « logique »
propre qu'il convenait de dégager (p. II). Or, ce que le livre se propose d'établir, c'est
bien la « logique », c'est-à-dire la cohérence des réseaux symboliques qui ont permis
d'identifier le lévrier de la légende à saint Guinefort, et d'articuler à la légende un rite
destiné à savoir si les enfants malades étaient ou non des « changelins », des enfants
des faunes ou autres entités non-humaines substitués par eux aux enfants des hommes.
Aberrant à première vue, le culte du « saint lévrier » devenait une pierre de touche de
la validité de la problématique adoptée sur la « religion folklorique ».
5 Le second choix, qui a inspiré le sous-titre de l'ouvrage : « Guinefort, guérisseur
d'enfants depuis le XIIIe siècle », est d'étudier le culte dans la longue durée. Comme
Jacques Le Goff, l'auteur estime en effet qu'il existe un « long Moyen Âge » allant de la
période médiévale, telle que la délimite l'historiographie traditionnelle, au XIXe siècle.
La validité de cette perspective est parfois présupposée par l'analyse : il en est ainsi
lorsque l'auteur s'appuie sur les enquêtes des folkloristes du XIXe siècle pour dégager la
valeur symbolique de certains éléments naturels utilisés dans le rite de guérison des
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
180
enfants (le sureau, les fourmilières, etc.). C'est que la comparaison des textes
médiévaux et des collectes des folkloristes invitait à supposer une certaine permanence
des représentations et des rites : les pratiques décrites par Étienne de Bourbon (faire
passer l'enfant malade entre deux arbres, par exemple) sont largement attestées, avec
d'inévitables variantes, au XIXe siècle ; l'est également la croyance selon laquelle les
enfants malingres seraient des « changelins ». Restait à savoir si le culte du saint lévrier
avait subsisté en Dombes au-delà du XIIIe siècle. Un folkloriste, A. Vayssières, l'affirme
en 1879. Sans doute peut-on reprocher à l'auteur, comme le fit P. Geary dans la
recension du livre qu'il fit pour les Annales, d'avoir accepté sans réserves l'affirmation
de Vayssières. Cela conduisit en tout cas l'historien à sortir de son cabinet pour faire
une « enquête ethnographique en Dombes » (c'est le titre du chapitre III de la troisième
partie), enquête doublée de fouilles archéologiques dans le bois – dont il avait retrouvé
l'emplacement – de saint Guinefort. L'une et l'autre enquête attestèrent la permanence
de rituels de guérison d'enfants en ce lieu jusqu'au début du XXe siècle ; au moment de
l'enquête ne subsistait plus, en revanche, aucun souvenir d'un culte à un saint identifié
à un chien. L'historien redevint donc historien pour expliquer la disparition du culte.
6 Au recours aux méthodes de l'histoire, de l'archéologie, de l'ethnographie, il faut
ajouter le recours aux procédures d'analyse de l'anthropologie structurale. Tel est le
troisième choix qui caractérise l'ouvrage. D'ordre méthodologique, il est évidemment
en relation avec le projet, d'une part d'étudier son objet dans la « longue durée », ce qui
signifie en dégager les « permanences structurelles » (p. 243) et, d'autre part, de mettre
en lumière la « logique » de la « religion folklorique », la « logique », c'est-à-dire,
comme je l'ai déjà signalé, les systèmes symboliques qui sous-tendent les croyances et
les pratiques. Après les spécialistes de l'Antiquité regroupés autour de Jean-Pierre
Vernant, les médiévistes s'employaient ainsi à construire une « anthropologie
historique ».
7 L'intérêt de cette nouvelle édition est de rappeler l'importance qu'eût ce projet et la
qualité des travaux qu'il suscita. Force est, cependant, de constater que cette ambition
d'articuler l'anthropologie et l'histoire a du mal à survivre aux critiques qu'ont
adressées au structuralisme et, plus précisément, à l'analyse du symbolisme inaugurée
par Claude Lévi-Strauss, les historiens et, aussi, les ethnologues. Sans doute faut-il la
repenser sur d'autres bases. La chose reste, en partie, à faire.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
181
Martine Sévegrand, Vers une Église
sans prêtres. La crise du clergé séculier
en France (1945-1978)
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, 325 p. (coll. « Histoire »)
Céline Béraud
1 M. Sévegrand reprend ici le titre d'un ouvrage de Jacques Duquesne formulé en 1968
sous la forme interrogative : Demain une Église sans prêtres ? Mais, c'est davantage dans
l'héritage du chanoine Boulard qu'elle s'inscrit. Cette question générale qui fait l'objet
de la première partie de l'ouvrage, est suivie d'une monographie portant sur le diocèse
« sinistré » de Dijon qui se distingue par l'intensité de la crise cléricale qui s'y déroule.
2 Les principaux symptômes de cette crise du clergé séculier sont les difficultés
croissantes à recruter des candidats à la prêtrise d'une part, les vagues importantes de
défections d'autre part. Le premier point est bien connu : la « crise des vocations » est
un serpent de mer pour l'épiscopat français qui, depuis le XIXe siècle n'a cessé de s'en
inquiéter. Rappelons qu'au cours de la période étudiée, la rupture concernant le
nombre d'ordinations se produit tôt, dès la fin des années 1940. Le travail de l'auteure
sur la question des départs complète et précise celui de Julien Potel. Environ 1 500
prêtres quittent leur ministère entre la fin des années 1960 et le début des années 1980.
Si des départs sont enregistrés bien avant cette période, le phénomène, véritable fait
social, atteint son apogée en 1972. Les défections sont particulièrement nombreuses
pour les prêtres ordonnés entre 1960 et 1964, le taux de départ s'élevant à 20,3 %. La
proportion est encore plus importante chez ceux qui ont accédé à la prêtrise entre 1965
et 1969, puisqu'elle atteint 26,7 %. L'auteure note l'écart entre l'élaboration précoce
d'un discours épiscopal portant sur le déclin des vocations et le relatif silence de la
hiérarchie catholique par rapport aux départs (constat qui est encore valable pour la
période actuelle).
3 Les bornes quantitatives de l'étude qui débordent très largement celles du concile,
n'ont pas été choisies au hasard. En aval, l'année 1978 (date de la fin du pontificat de
Paul VI) a été adoptée par l'auteure En amont, M. Sévegrand a choisi 1945 (dans son
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
182
texte, certaines de ses analyses relèvent d'un temps encore plus long) pour éviter tout
rapprochement hâtif entre la « crise du clergé » qu'elle décrit et Vatican II. Les années
qui suivent le concile apparaissent ainsi comme le moment paroxystique d'un malaise
sacerdotal aux origines plus anciennes. Les causes les plus souvent évoquées en interne
sont la médiocrité de la formation ainsi que les difficiles conditions de vie marquées en
milieu rural par l'isolement et la misère. Mais selon l'auteure, la principale source de la
crise est ailleurs. Il s'agit de l'incapacité de l'Église catholique à définir une spiritualité
propre aux prêtres séculiers, spiritualité encore très fortement influencée par celle des
religieux. Or cette dernière entre en contradiction avec une nouvelle conception de la
mission. Le projet d'immersion dans le monde est développé dès les années 1930 par les
aumôniers des mouvements d'Action Catholique Spécialisée, puis pendant la guerre
vécu par les prêtres qui font l'expérience du STO. L'atteinte portée à l'intégrité
sacerdotale par l'incarnation mondaine que la vie en milieu ouvrier exige, au moins
autant que les liens tissés sur le terrain avec le marxisme en plein contexte de guerre
froide, amène Pie XII à condamner l'expérience des prêtres ouvriers. La crise qui éclate
au grand jour dans les années 1960 est étroitement liée à cette controverse récurrente
depuis l'entre-deux-guerres : « La “spiritualité” qui se cherche veut conjuguer
sacerdoce et incarnation, vie liturgique et action, prière et évangélisation ; elle dessine
un prêtre diocésain qui s'éloigne du statut du religieux pour retrouver les hommes
dans le concret de leur existence » (p. 33). Le concile qui suscite un immense espoir
chez les partisans du changement, conduit certes à une conception rééquilibrée du rôle
du prêtre, entre évangélisation et prise en charge des fonctions liturgiques. De plus, dès
1966, s'engage une réorganisation en profondeur des séminaires. Cependant, les
déceptions qui se font alors jour, sont liées à l'absence de renouvellement en
profondeur de la spiritualité du prêtre ainsi qu'au refus manifesté par l'institution
ecclésiale de diversifier les voies d'accès à ce ministère. Les principaux axes des
revendications portées par le groupe « Échanges et Dialogue » (accès au monde du
travail, possibilité de se marier, droit à l'engagement politique et remise en cause de ce
qui est vécu comme un autoritarisme ecclésial) constituent selon l'auteure les signes
d'un rejet de la part de ces prêtres diocésains de la voie de sanctification personnelle
marquée par les exigences de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.
4 La question du célibat est, à juste titre, longuement abordée. Elle cristallise en effet
cette incapacité à se départir du modèle du religieux. De fait, elle occupe une place
croissante dans la contestation cléricale des années 1960. Le sexe devient au cours de la
période l'un des derniers domaines dans lequel s'affirme sans concession l'autorité
romaine. M. Sévegrand, auteure de deux ouvrages sur l'Église catholique et la sexualité,
retrouve ici l'un de ses sujets de prédilection. Elle met en parallèle la double
confirmation du célibat sacerdotal (en 1967 dans l'encyclique Sacerdotalis coelibatus, puis
en 1971 lors du synode romain) et l'interdiction de l'usage des méthodes de
contraception dites « non naturelles » dans Humanae vitae en 1968. L'auteure s'attache
aussi à expliciter le lien entre défections et mariage, afin d'éviter tout rapprochement
simpliste. Certes, la très grande majorité des prêtres partis se sont mariés. Cependant
tous n'ont pas quitté l'état clérical pour cette raison.
5 Grâce à sa monographie dijonnaise, l'auteure met en évidence l'importance des
contextes locaux quant à l'ampleur de la contestation et celle des défections (deux
phénomènes pas nécessairement corrélés). En bonne historienne, elle livre une
chronologie fine qui présente l'impact dans l'Église de Côte d'Or d'évènements tels que
la guerre d'Algérie, le concile et mai 1968. Elle distingue les différents moments de
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
183
l'action collective qui culmine au tournant des années 1968-1969 et s'essouffle quelques
mois plus tard, puis se trouve confrontée à la normalisation menée localement à partir
de 1971 par Monseigneur Decourtray.
6 M. Sévegrand se livre avec rigueur et précision à des analyses statistiques
particulièrement éclairantes. Le recueil de données a été réalisé dans plus de soixante-
dix diocèses et permis le calcul de taux de défection par années d'ordination. D'un
point de vue méthodologique, il faut tenir compte dans l'interprétation des effets de
distorsion entre ceux qui ont régularisé leur situation auprès de la hiérarchie en
demandant à Rome le rescrit et ceux qui se trouvent dans un état d'abandon de fait non
officialisé. M. Sévegrand décrit ces itinéraires interlopes qui sont dans certains
cas encouragés par l'épiscopat, dans d'autres vécus comme une défiance faite à
l'institution (il s'agit ainsi, pour certains prêtres, de manifester que même mariés, ils
entendent continuer à exercer leur ministère). De plus, l'écart entre le moment effectif
des départs et celui de leur reconnaissance officielle, explique que les statistiques
diocésaines ne reflètent, qu'avec un certain décalage temporel, les défections.
7 Parallèlement à cette objectivation quantitative de la crise, l'auteure met à disposition
du lecteur onze lettres datées de 1970 à 1976, dans lesquelles des prêtres expliquent les
raisons de leur départ (chap. XII). Elle offre ainsi la possibilité d'une approche
compréhensive de ces nombreuses défections. On saisit alors les drames humains qui
ont pu se jouer par-delà la contestation militante.
8 Ce remarquable travail de M. Sévegrand, à la lecture passionnante, participe avec
d'autres (dont l'ouvrage de référence de Denis Pelletier sur La crise catholique : religion,
société, politique en France (1965-1978), Paris, Payot, 2002 [coll. « Payot-Histoire »] [cf. Arch.
120.30]) à une meilleure connaissance des années de l'après-concile, indispensable à une
sociologie du clergé actuel. Les caractéristiques démographiques du corps sacerdotal
ont, en effet, continué à se dégrader après 1978. En une vingtaine d'années, le nombre
de prêtres diocésains a diminué de moitié. Le phénomène de défections a perduré,
certes à une moindre ampleur. Si des prêtres s'en vont aujourd'hui, ce n'est pas pour
marquer avec révolte leur rupture idéologique et politique avec l'institution comme le
font un grand nombre des clercs étudiés par M. Sévegrand Leur expérience est
désormais vécue sur le mode strictement personnel de l'accomplissement de soi.
L'action collective est de fait rendue peu probable. Le droit à la réversibilité
de l'engagement a socialement fortement gagné en légitimité. La logique quasi-
contractuelle propre aux modes d'implication personnelle dans la modernité tardive
entre ainsi en tension avec celle du don total et définitif conditionné par un
engagement passé irréversible tel que l'ordination, le sacrement de l'ordre étant
canoniquement indélébile. Elle engage un autre rapport de l'individu à la temporalité.
Ces phénomènes de récessions des vocations et de défections dépassent donc le strict
cadre de l'institution catholique et de ses crises internes.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
184
Rodney Stark, One True God.
Historical Consequences of Monotheism
Princetown-Oxford, Princetown University Press, 2003, 319 p.
Yves Lambert
1 Déjà auteur de nombreux livres importants, comme The Future of Religion: Secularization,
Revival and Cult Formation (Berkeley and Los Angeles, University of California Press,
1983) ; avec William Sim Bainbridge, A Theory of Religion (New Brunswick, N.J., Rutgers
University Press, 1987), The Rise of Christianity. A Sociologist Reconsiders History
(Princetown, N.J., and Chichester, G.B., University of Princetown Press, 1996) (cf. Arch.
104.52) ; avec Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion (Berkeley
and Los Angeles, University of California Press, 2000), R. Stark se pose avec One True God
comme le principal spécialiste de la sociologie historique du monothéisme, d'autant
que ce livre est suivi d'un second volume, For The Glory of God: How Monotheism Led to
Reformations, Science, Witch Hunts, And The End Of Slavery (idem, 2004).
2 « More than three thousands years ago, somewhere a group of people began to worship
One God. Wether they were Jews, Persians, Egyptians or someone else will probably
never be known, but perhaps no other simple innovation had so much impact on
history (...) a great deal of history – triumphs as well as disasters – have been made on
behalf of One True God » (p. 1), commence par souligner l'auteur. À part les religions
monothéistes, aucune religion n'a eu cette capacité à mobiliser les individus et les
sociétés, avec, notamment, comme conséquence, de les unir davantage mais aussi de les
diviser davantage tant à l'intérieur de chaque monothéisme que vis-à-vis des autres
religions. Prenant pour objet le judaïsme, le christianisme et l'islam, l'ouvrage propose
une analyse des principales phases de missions (chap. 2), de conflits (chap. 3) et de
pacifications (chap. 5), depuis les débuts jusqu'à nos jours, et il cherche à expliquer
pourquoi le judaïsme a survécu à près de deux mille ans de diaspora et d'hostilité
(chap. 4). Le second volume aborde la Réforme, la chasse aux sorcières, l'esclavage et la
science.
3 Toujours soucieux de bien définir ses concepts, R. Stark rappelle au préalable (chap. 1)
les grandes lignes de la théorie de la religion qu'il a élaborée avec William S. Bainbridge
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
185
et avec Roger Finke (Acts of Faith). Le point de départ est le fait que le surnaturel est la
seule source plausible de bienfaits (benefits) que l'on désire fortement mais qui, soit
existent seulement en quantité limitée (la réputation, la chance, la richesse, etc.), soit
sont inaccessibles (par exemple, la santé pour quelqu'un qui est victime d'un handicap
ou d'une maladie incurables, l'immortalité). La religion permet précisément de
transcender toutes ces limites. Elle apporte des « récompenses » (rewards) mais elle
comporte des « coûts » (costs) en temps, en argent, etc. Sur le marché (marketplace) du
spirituel, chacun proportionne de manière à peu près raisonnable son implication
religieuse à ce qu'il en attend et à son degré de conviction, en conformité avec la
Rational Choice Theory des économistes.
4 Les religions monothéistes, par la relation qu'elles instaurent avec Un Seul Vrai Dieu,
créateur de l'univers, maître de tout, juge suprême, clé d'un salut éternel, sont tout
particulièrement mobilisatrices, en tout cas beaucoup plus que les religions dont le
surnaturel repose sur une essence plus ou moins abstraite (bouddhisme, confucianisme,
taoïsme, dans leur forme originelle). Sachant, prend soin d'ajouter R. Stark, que ces
dernières religions se sont donné des dieux, sans quoi elles n'auraient pas réussi à
gagner les masses, et qu'il n'existe pas de monothéisme pur puisqu'il faut au moins un
principe du mal pour expliquer que la création par ce Dieu parfait et tout-puissant ne
soit pas parfaite. Une religion fondée sur une révélation faite par un Dieu unique
implique beaucoup plus qu'une religion fondée sur une expérience et une intuition
purement humaines (bouddhisme, confucianisme, taoïsme, hindouisme métaphysique).
5 L'une des conséquences de la croyance en un « One True God » est l'incitation au
prosélytisme en vue de convertir à la vérité et d'apporter le salut (chap. 2). La
conversion suppose un abandon de toute autre religion ou divinité. La première
mission fut celle d'Akhénaton. À cet égard, les religions monothéistes se différencient
nettement tant des religions polythéistes, où l'on peut à loisir emprunter ou
abandonner des dieux, des rites, sans quitter sa religion, que des religions référées à
une essence, qui coexistent en général entre elles et avec l'animisme (de manière
officielle au Japon avec le shintoïsme). Certes, note l'auteur, le bouddhisme a suscité
des missions, l'hindouisme dévotionnel aussi, mais elles n'ont pas eu l'ampleur des
missions monothéistes. R. Stark rappelle l'intensité et le succès des efforts
missionnaires des juifs au sein du monde romain jusqu'à ce que le triomphe du
christianisme ne vienne y mettre un terme en leur interdisant tout prosélytisme. Il
montre que, après avoir pratiqué d'efficaces et authentiques conversions par l'exemple
et « par le bas », le christianisme, une fois établi en religion officielle (avec l'empereur
Constantin) puis exclusive (sous l'empereur Théodose), s'est plutôt attaché à des
conversions « par le haut », en particulier auprès des peuples « barbares » (cf. le cas des
Francs) et par la force (sous peine de bannissement, d'excommunication) ; le bras
séculier garantissait la conformité à l'Église et celle-ci légitimait le pouvoir politique.
Du coup, la christianisation en profondeur des masses paysannes ne s'est pas vraiment
opérée, surtout dans le cas des peuples du nord de l'Europe, derniers « convertis »,
comme l'attestent les témoignages occasionnés par la Réforme protestante et la Contre-
Réforme catholique aux XVIe et XVIIe siècles (cf. Jean Delumeau, etc.). Résultat ? « Today
levels of church attendance are strongly predicted by the date at which they are said to
have been christianized – the latter, the lower their current rate of attendance »
(p. 78). Preuve ultime, remarque judicieuse, quoiqu'à nuancer. Il est vrai que les pays
nordiques présentent les niveaux de pratique les plus bas d'Europe, mais ils sont
talonnés par la France, la Belgique et la Grande-Bretagne, dont la christianisation est
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
186
ancienne (mais aussi la sécularisation), tandis que la Pologne, la Lituanie et la
Slovaquie, de christianisation beaucoup plus récente, ont un niveau élevé de pratique
(lié à l'identification de la nation au catholicisme et à une sécularisation plus récente)
(cf. Y. Lambert, « A Turning Point in Religious Evolution in Europe », Journal of
Contemporary Religion, vol. 19, no 1, 2004, p. 29-45). Par ailleurs, très critique vis-à-vis des
conversions « par le haut », l'auteur semble épouser jusqu'à l'excès la thèse à la mode
d'un Moyen-Âge peu chrétien, une thèse qui rectifie le mythe d'un Moyen-Âge très
chrétien mais qui vise aussi à minimiser le recul actuel, comme l'a reconnu Jean
Delumeau (cf. Guetter l'aurore, Paris, Grasset, 2003, p. 20-21).
6 Le livre passe rapidement en revue le cas de l'islam, à l'extension si rapide, montrant
que, là aussi, à en juger notamment par une étude sur la diffusion des prénoms
musulmans, diffusion très lente, la conversion réelle a pris des siècles. Il traite le
renouveau des missions chrétiennes à l'époque contemporaine, en particulier
l'explosion des missions protestantes américaines depuis la seconde moitié du XIXe
siècle : en 1996, on comptait 40 000 missionnaires protestants américains à l'étranger,
dont 12 000 en Amérique latine et 7 400 en Europe, plus 64 000 missionnaires
temporaires (pour un an ou moins), non compris les Mormons et les Témoins de
Jéhovah ! En même temps, la mission a été abandonnée par les courants libéraux,
convaincus désormais que le christianisme n'est pas supérieur aux autres grandes
religions, au grand profit des courants évangéliques. Quelques pages sont consacrées
aux missions hindoues, pour rappeler les efforts de diffusion de l'hindouisme en Asie
du sud-est, à l'origine, et les récentes tentatives d'implantation en Occident de
mouvements hindous, sans grand succès (International Society of Krishna
Consciousness, Society for Transcendal Meditation, Rajneesh...). Au passage, l'auteur
souligne, à propos des peuples d'Amérique latine, que leur très faible niveau de
vocations sacerdotales, leur forte propension au syncrétisme et leur grande ouverture à
l'évangélisme résultent du caractère coercitif de leur conversion passée au
catholicisme. Ce chapitre est sans doute l'apport le plus original de l'ouvrage. On
pourra regretter que les missions catholiques ne soient pas traitées mais ce n'était pas
indispensable à la démonstration de la thèse du prosélytisme. Par contre, on peut
s'étonner que le bouddhisme soit négligé, comme s'il s'était répandu sans mission, ce
qui affaiblit la thèse par omission, cette religion étant manifestement sous-estimée par
l'auteur qui va jusqu'à affirmer qu'il n'existe pas de lien entre la moralité et la religion
quand le surnaturel se réfère à une essence (p. 26), comme si la « voie du juste milieu »
n'était pas éthique ! On peut aussi s'étonner de ne rencontrer qu'une allusion à
l'islamisme, d'autant que cela renforcerait cette thèse et appuierait en outre la seconde
thèse, celle de la croyance en Un Seul Vrai Dieu comme source de conflits violents.
7 R. Stark commence par exposer une théorie des conflits selon laquelle ceux-ci seront
d'autant plus vifs s'il existe un petit nombre d'organisations religieuses puissantes et
particularistes (exclusivistes), le climat de conflit diminuant en outre la tolérance
envers les groupes qui ne représentent pas une menace (chap. 3). Dans le cas du
christianisme, après avoir rappelé que les persécutés des origines sont eux-mêmes
devenus persécuteurs après leur triomphe, à l'encontre des « païens » puis des
« hérétiques » et des « infidèles », R. Stark donne une synthèse magistrale sur les
conflits religieux jusqu'à la fin du Moyen-Âge, surtout sur les violences collectives anti-
sémites, ce qui fait regretter qu'il laisse de côté le schisme orthodoxe, la période de la
Réforme, il est vrai réservée au second volume, et surtout la situation actuelle, mises à
part de brèves allusions. Il apparaît qu'après une phase de relative tranquillité allant de
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
187
500 environ jusqu'au milieu du XIe siècle, on entre dans une phase de violences qui dure
jusqu'au traité de Westphalie en 1648 : croisades, massacres de juifs, inquisition,
reconquête catholique en Espagne, « guerres de religion ». Or, montre l'auteur, les
violences anti-juives se produisent toujours dans un contexte de conflit aigu au sein du
christianisme (répression des hérésies, de la sorcellerie) ou dans ses rapports avec
l'islam (croisades, reconquista), et les violences islamiques anti-juives sont elles-mêmes
à l'unisson des guerres entre chrétiens et musulmans : il en conclut qu'il s'agit des
effets « collatéraux » d'un climat d'exacerbation, effets du reste désapprouvés par les
papes, une interprétation en partie novatrice. La « redécouverte » des hérésies,
lesquelles n'avaient en réalité pas cessé, paraît elle-même liée aux conflits avec l'islam
(à propos de la Terre sainte, de l'Espagne ou des Balkans) et au fait qu'elles mettent
désormais en jeu le pouvoir établi de l'Église. Là encore, l'auteur apporte des vues
nouvelles et prend le contre-pied de la thèse dominante selon laquelle les croisades
auraient été motivées avant tout par l'intérêt matériel, alors que, montre-t-il, ces
entreprises étaient lointaines et ruineuses, quand des croisades en Espagne, demandées
par le pape dès 1063, auraient été proches et sources de richesses ; au passage l'auteur
relativise aussi l'interprétation des hérésies en tant que luttes de classe, au nom de leur
diffusion dans tous les milieux sociaux. Si l'on essayait d'appliquer ce modèle aux
violences contemporaines, on s'apercevrait que les violences internes à une religion
sont devenues rares alors que les violences anti-religieuses ont fait leur apparition sur
une grande échelle, avec une origine idéologique (persécutions communistes, génocide
juif), un phénomène inédit, cependant que les violences entre religions monothéistes
ont elles-mêmes pris un tour nettement idéologique (nationalisme, rejet de l'Occident).
8 Je passerai rapidement sur les deux derniers chapitres, qui sont moins novateurs.
S'agissant de la persistance du judaïsme envers et contre tout (chap. 4), R. Stark
souligne le rôle fondamental joué, parmi d'autres facteurs, par la croyance en Un Dieu
Unique, dont Israël est le Peuple choisi, dont la Terre d'Israël est le don, et qui enverra
un Messie établir Son règne sur la terre. Le dernier chapitre (God's Grace: Pluralism and
Civility) commence par une théorie du pluralisme selon laquelle la « civilité religieuse »
(la coexistence pacifique entre groupes religieux) est d'autant plus poussée qu'il existe
davantage de groupes religieux, dont aucun ne soit prépondérant, ce qui prend le
contre-pied des positions de Thomas Hobbes et de David Hume, au profit de celle
d'Adam Smith. Il faut, pense l'auteur, au minimum quatre groupes religieux à peu près
équilibrés, comme aux Pays-Bas. L'existence de trois groupes risque de conduire à
l'union de deux d'entre eux contre le troisième. Le duopole engendre une rivalité sans
merci, et le monopole incite à l'exclusivisme. Suit un développement concernant la
situation américaine, manifestement tenue pour la meilleure avec sa séparation des
Églises et de l'État, sa religion civile transversale et son grand nombre de groupes
religieux, une multiplicité qui, loin de relativiser le religieux, crée une concurrence
bénéfique. Deux métaphores éloquentes symbolisent cette situation, celle du dais
commun de l'American Way of Life et de la religion civile (cf. Peter Berger et Robert
Bellah), et, en complément, celle des parapluies individuels (umbrellas, cf. Christian
Smith). R. Stark avance qu'il n'existe pas de lien entre moralité et religion, évoquant un
travail à venir sur cette question.
9 Aux yeux d'un Européen, cette analyse paraîtra forcément orientée, américano-
centrique, disons, déjà par le modèle économique sous-jacent à la théorie, mais laissons
cet aspect de côté. Tout en trouvant ce large panorama passionnant et pertinent, on
pourra penser que le niveau actuel de « civilité religieuse » n'est pas moins élevé dans
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
188
les pays européens mono-confessionnels (luthériens comme les pays scandinaves,
catholiques comme ceux du sud, et certains pays orthodoxes), bi-confessionnels
(Allemagne, Belgique, Hongrie, Estonie, voire, Autriche et Tchéquie), ou tri-
confessionnels (Grande-Bretagne, Lettonie). En outre, R. Stark fait comme si les
processus de démocratisation et de modernisation jouaient un rôle négligeable dans
cette évolution vers la civilité religieuse. On peut penser au contraire qu'ils en sont les
principaux promoteurs, aux États-Unis comme en Europe ou ailleurs dans le monde.
L'ancienneté de ces processus est même, ici, un bon indicateur du niveau de civilité
atteint (les Églises de l'ex-Union soviétique sont souvent restées plus exclusivistes,
comme la Pologne et la plupart des pays orthodoxes). R. Stark souligne le rôle joué par
les courants protestants libéraux et par les courants déistes (les deux se recoupent en
partie) dans cette évolution, or cela ne renvoie-t-il pas à ces mêmes processus ? Enfin, il
n'est pas dit un mot de la laïcité, ni de l'athéisme, ni de l'existence éventuelle de
conceptions séculières du monde insérées dans un pluralisme officiel (cas de la
Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne).
10 Ces réserves n'empêchent pas de considérer que ce livre constitue un apport essentiel
et considérable, qui ne nécessite pas d'être exhaustif et qui préfère traiter à fond des
exemples significatifs, sans oublier qu'il est complété par un second volume.
Simplement, s'il brossait un tableau d'ensemble, fût-ce rapidement, la démonstration
gagnerait en force de conviction. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire ! En tout cas,
voilà un travail qui tient une position d'équilibre entre les « bons » et les « mauvais »
côtés du rôle historique des monothéismes, à l'encontre de la tendance des historiens
des années soixante et soixante-dix à privilégier les seconds. Le volume suivant est
encore plus innovateur, sinon provocateur : il montre que le christianisme a joué un
rôle clé dans l'émergence de la science moderne, notamment dans le prolongement de
l'esprit de rationalité théologique et de l'idée que Dieu était l'auteur de la raison ; que la
chasse aux sorcières est entre autres un effet « collatéral » des progrès de la pensée
scientifique ; ou que les chasseurs de sorcières ont aussi compté parmi les premiers
abolitionnistes. Ce qui n'a pas manqué de susciter de stimulants débats.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
189
David J. Stuart-Fox, Pura Besakih.
Temple, Religion and Society in Bali
Leyde, KITLV, 2002, XII+470 p ; (coll. « Verhandelingen van het koninklijk
institut voor taal –, lan – en Volkenkunde », no 193
Claude Guillot
1 Bali constitue une exception dans le monde insulindien auquel il appartient. Alors que
les autres îles ont très majoritairement adopté l'islam et quelques-unes le
christianisme, Bali a préservé son héritage « hindouiste » au point de passer, en grande
partie à tort, pour un conservatoire de la civilisation javanaise antérieure à
l'islamisation. Ce particularisme se traduit dans le paysage par une profusion de
temples et templions qui rythment l'horizon des villes, des villages et des champs et
par une intense activité rituelle accompagnant chaque moment de la vie. Deux traits
qui n'ont pas peu contribué à attirer les touristes en quête de dépaysement.
2 Dans ce livre, David Stuart-Fox a cherché à analyser les rapports entre religion et
société à Bali. Se refusant à une observation de l'ensemble de l'île, il a préféré limiter
ses recherches à un cas précis, celui du célèbre complexe de sanctuaires de Besakih.
Situé dans le nord-est de l'île, sur les flancs du plus haut volcan de Bali, le Gunung
Agung (« La Grande Montagne »), cet ensemble est, aujourd'hui, considéré comme le
temple suprême de l'hindouisme, pour toute l'île de Bali et même pour l'Indonésie.
3 Après une description liminaire du cadre physique dans lequel se trouve le temple,
l'auteur s'est attaché à retrouver, au-delà des changements administratifs et des divers
mouvements de population survenus au cours des temps, ce qu'il appelle le village-adat
ou village « primitif » tel, en tout cas, qu'en a été conservée la mémoire à travers le
rituel. Dans les deux chapitres suivants, il passe à l'analyse détaillée de la structure de
l'ensemble des sanctuaires de Besakih pour démontrer que, malgré leur regroupement
sur un seul site, les nombreux édifices religieux – près de 90 – ont des fonctions et des
statuts spécifiques correspondant à une hiérarchie du rayonnement. Ainsi, se
distinguent trois catégories : les temples de villages, destinés aux cérémonies purement
locales, les temples de lignées, réservés aux descendants, géographiquement
disséminés, d'ancêtres communs et enfin, ce que l'auteur appelle les « temples
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
190
publics », constituant des centres cérémoniels pour les fidèles externes aux deux
cercles précédents. Le fait que les temples publics soient au nombre de deux, dans le
vénérable ensemble de Besakih, reflèterait, selon l'auteur, un dualisme fortement ancré
dans la pensée balinaise dont on trouve trace dans de multiples domaines.
4 À travers l'étude des rites accomplis dans ces temples (chap. VI-IX), l'auteur montre
que ces deux temples forment « le » temple public de Besakih et que celui-ci « exprime
l'unité de tout l'ensemble religieux ». Par ailleurs, l'analyse de la responsabilité,
pratique et financière, de l'accomplissement de ces rites, lui permet de déterminer
l'étendue, sociale et géographique, de la sacralité du sanctuaire. L'implication, non
seulement, du village administratif mais aussi, du village « primitif » et, plus largement
encore, d'un ensemble de villages des alentours serait l'indice que le temple de Besakih
jouit d'un rayonnement régional, dont le statut est, en quelque sorte, officialisé par la
participation des gouvernants à son entretien et à l'organisation des cérémonies, sous
forme de fondations foncières autrefois et de fonds en numéraire plus récemment.
5 Dans le dernier volet, l'auteur s'attache à l'analyse de ces relations entre Besakih et
l'État. Si les pages précédentes relevaient fondamentalement de l'anthropologie, c'est à
l'histoire qu'il est fait appel dans cette dernière partie, pour déterminer si la
suprématie de Besakih parmi les temples de Bali, incontestable aujourd'hui, s'est
imposée récemment, avec le renouveau hindouiste ou au contraire perpétue une
tradition séculaire. À partir de rituels « anciens » (début du XIXe siècle ?), tel que le Raja
Purana Pura Besakih et d'histoires légendaires, l'auteur essaie de reconstituer l'histoire
du temple : avant la prise de Bali par le royaume javanais de Majapahit en 1343, puis à
l'époque des États « traditionnels » du XVe au XIXe siècle, enfin au XXe siècle, à l'époque
coloniale et dans le cadre de la République indonésienne. Si les documents sont trop
rares ou les sources trop peu fiables pour parvenir à des conclusions indiscutables pour
les périodes anciennes, il apparaît que le temple fut d'abord, sans doute dès le
XVe siècle, le sanctuaire principal d'une dynastie régionale, avant de passer, sans doute
au XIXe siècle, au statut de « symbole d'unité, transcendant les divisions des cours en
lutte » (p. 293). Ce rôle ne fit que se renforcer au cours du XXe siècle, quand le pouvoir
colonial organisa, en 1938, l'intronisation de tous les princes (zelfbestuurders) de Bali
lors d'une cérémonie à Besakih ou quand, dans les années 1950, pour faire accepter « la
religion de Bali » parmi les cultes officiels, les savants locaux, s'efforçant d'organiser
une sorte d'Église, réussirent à convaincre le gouvernement républicain de reconnaître
Besakih comme « le seul temple honoré par tous les fidèles de la religion “Hindu-Bali”
auquel il devait, en tant qu'héritier des cours balinaises, apporter son soutien »
(p. 316). Cette officialisation aboutit, en 1963, à la réactivation à Besakih d'une
cérémonie quelque peu oubliée, « Ekadasa Rudra » qui, pour la première fois, concernait
toute la population hindoue de Bali. La même cérémonie fut à nouveau célébrée en
1979, en présence, cette fois-ci, du président de la République indonésienne qui
apportait ainsi la reconnaissance gouvernementale de la religion hindouiste de Bali et
du statut prééminent du temple pour tous ses fidèles.
6 Bien que sa lecture ne soit pas toujours aisée pour ceux qui ne sont pas familiers avec la
culture et la religion balinaises, cette minutieuse étude constitue, à n'en pas douter, un
excellent cas de figure pour ceux qui s'interrogent sur (ou que dérangent) les religions
où les rites l'emportent, de loin, sur la réflexion théologique ou la recherche spirituelle.
L'exemple de Besakih apporte, peut-être, des éléments de réponse sur l'attrait que peut
exercer une religion fondamentalement sociale qui, en tant que telle, permet l'abandon
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
191
de la responsabilité individuelle au profit d'un groupe en qui on a foi. Il faut savoir gré
aussi à l'auteur d'avoir user d'infinies précautions dans l'approche de son sujet. Il
montre qu'il a parfaitement conscience – ce qui n'est malheureusement pas le cas
général – que les traditions, pour anciennes et vénérables qu'elles puissent paraître,
loin d'être immuables, sont soumises à de perpétuelles évolutions et réinterprétations.
7 Les regrets que l'on pourrait formuler sont ceux que suscite toute monographie.
L'auteur annonce clairement qu'il a volontairement choisi de limiter son sujet au
complexe de Besakih. On ne saurait donc lui en faire grief. Mais devant la qualité du
travail, on aurait aimé qu'il élargisse la réflexion, par exemple, par des comparaisons
avec ces cultes royaux rendus sur les montagnes sacrées qui ont existé dans presque
tout l'archipel insulindien. Nul doute que cet ouvrage constituera un excellent point de
départ pour une recherche de ce type.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
192
Bernard Van Meenen, Qu'est-ce que
la religion ?
Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint Louis, 2004, 143
p.
Vincent Delecroix
1 Ce petit volume rassemble les communications présentées à la session annuelle de
l'École des sciences philosophiques et religieuses à Bruxelles autour de la question :
« Qu'est-ce que la religion ? ». Dans cet ensemble assez hétéroclite, on ne cherchera pas
à trouver une réponse définitive, bien évidemment, en termes de théorie de la religion.
Comprise dans un cadre théologique, la question interroge davantage « les articulations
et corrélations fondamentales entre théologie et religion » (p. 8), mais son traitement
souffre, manifestement, à la fois de perspectives assez éloignées et peut-être d'un
dialogue peu précis avec les approches des autres sciences du religieux. Voulant mêler
diverses disciplines (philosophie de la religion, sociologie, psychanalyse) et différentes
traditions religieuses (christianisme, judaïsme, bouddhisme), l'ouvrage semble parfois
perdre de vue sa question initiale ou n'y trouver qu'un prétexte. On regrettera
également que, sous couvert de la « difficulté » et de la « permanence » de la question,
beaucoup des auteurs s'épargnent le soin de discuter un certain nombre des catégories
qu'ils utilisent pour penser « la religion ». Soulever de nouveau, par exemple, la
question de savoir si le bouddhisme est une religion, nécessite de préciser tant soit peu
ce qu'on entend justement par religion et de veiller à ne pas reconduire trop aisément
des critères définitoires largement marquées par la tradition occidentale et que la
tradition occidentale cherche précisément à remettre en question désormais. C'est ce
que s'emploie à faire pour partie Jacques Scheuer : si l'on entend la religion dans son
acception « traditionnelle » (mais qui, désormais, use sans les interroger de tels critères
traditionnels ?), le bouddhisme n'est pas une religion (ni un humanisme, ni une
« anthropologie »). Aussi propose-t-il de comprendre la religion comme « itinéraire »,
ce qui permet au bouddhisme d'en être une. Mais que signifie précisément ce concept ?
De quoi relève-t-il ? On hésite, à lire J. Scheuer, à faire de cette notion un concept
relevant d'une phénoménologie du religieux, un concept théologique ou même, à lire la
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
193
fin de l'article, la simple formulation d'un vœu (pieux !) concernant le dialogue
nécessaire entre les croyants de différentes traditions.
2 Si l'on renonce donc à chercher une avancée dans le traitement de la question initiale
et que l'on prend alors chaque communication pour elle-même, on retiendra, en dehors
du traitement même de la question initiale, quelques contributions intéressantes. On
trouvera ainsi dans le texte de Jean Greisch une nouvelle esquisse de ce paradigme
herméneutique en philosophie de la religion qu'il s'emploie depuis longtemps à
déterminer, cette fois mis à contribution pour penser les concepts de violence et de
tolérance. Question évidemment considérable pour penser la religion en modernité,
aussi bien dans son rapport à la vie sociale que dans le dialogue des religions entre
elles. Dans le droit fil de la pensée de P. Ricœur, il a ainsi le mérite de distinguer
clairement différentes strates de sens du concept de tolérance et de nommer les
problématiques, parfois fort anciennes, qui leur sont liées. Chacune d'elles en effet sont
« constitué(e)s par des signifiants aussi incommensurables que “vérité”, “liberté”,
“justice”, “solidarité” et “bienveillance” » (p. 30). Clarifier ces distinctions permet alors
d'évaluer respectivement ces principes de tolérance qui ont pour dessein d'éviter au
principe d'absoluité que revendiquent par essence la religion, ou plutôt les religions, de
dégénérer en violence illégitime et, à l'autre extrême, de s'empêtrer dans un
relativisme moralement désastreux. Mais dissocier vérité et justice n'est peut-être pas
d'ailleurs le dernier mot d'un concept acceptable de tolérance ; ainsi, reprenant
Ricœur, évoque-t-il un seuil supplémentaire, consistant « à accepter de suspendre le
jugement d'approbation et de désapprobation, pour admettre l'hypothèse d'après
laquelle les raisons de vivre d'autrui peuvent refléter un rapport au bien que la finitude
de toute compréhension humaine (...) m'empêche de discerner. » (p. 34) La frontière
reste ténue, cependant, entre une telle hypothèse et le relativisme dévastateur dénoncé
plus haut et qui constitue l'adversaire avéré contre lequel lutte le propos de J. Greisch.
3 Dans une tout autre perspective, on relèvera aussi la contribution de R. Azria, à cheval
entre histoire de la théologie et sociologie de la connaissance. Son propos très
synthétique consiste à marquer précisément les moments constitutifs de la théologie
juive comme théologie « contrainte ». La question initiale est ainsi retournée, quand il
s'agit plutôt de comprendre sous quelles conditions (et dans quelles circonstances) le
judaïsme se pense et s'est pensé comme religion. Or l'élaboration de cette auto-
compréhension dans la théologie ne se fait pas de façon autonome : elle a lieu dans un
contexte socio-historique qui dicte la perspective dans laquelle elle détermine
ses concepts. R. Azria distingue ainsi trois moments : celui d'une théologie captive de
l'altérité, celui d'une théologie captive de l'émancipation et celui d'une théologie
soumise au risque d'une nouvelle captivité, celle de l'identité (p. 96-97). Dans le premier
moment la théologie juive répond, historiquement contrainte, à la sommation de
« justifier la persistance de l'existence juive » (p. 97). Le second correspond au moment
où « la théologie juive s'émancipe du joug de l'Église », mais elle devient « marginale
dans l'existence des juifs ». Il est surtout marqué par le défi théologique difficilement
articulable que provoque la Shoah et qui bouleverse également le rapport de la
théologie chrétienne au judaïsme. Le troisième moment est pour R. Azria le lieu d'une
inquiétude, celle de voir, en quelque sorte, la théologie juive de nouveau prisonnière de
l'histoire, cette fois par la création de l'État d'Israël. Nouveau défi, à vrai dire, car il
oblige à « reconnaître, dans des situations données et en se référant à des précédents
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
194
issus de la tradition, le lieu précis et l'instant fugace où l'élection dont les juifs se
revendiquent (...) et la justice s'unissent... » (p. 112).
4 Enfin la contribution de Bernard Hort nous fait authentiquement pénétrer dans la
difficulté qui occupe les sciences du religieux, la philosophie et la théologie,
précisément la question de l'essence de la religion. C'est par le biais d'une interrogation
portant sur l'opposition traditionnelle, dans la théologie moderne, entre foi et religion
qu'il cherche à mettre en évidence comment le discours théologique a pu « contribuer à
installer un concept particulier et incritiqué de la religion » (p. 117). Bel exemple, et
fécond, d'autocritique de la théologie qui doit permettre de remettre en cause une
forme de « paradigme tacite » (ibid.) issu de « propositions proprement
confessionnelles ou spirituelles » ou reconduit par elles, plus précisément issu de la
théologie protestante, selon l'auteur, et dont la vocation implicitement normative n'est
pas le moindre danger. C'est donc à une analyse synthétique et rapide de l'histoire de la
théologie moderne que se livre B. Hort. Il expose l'opposition entre foi et religion
particulièrement marquée dans la théologie dialectique d'un Karl Barth par exemple,
qui selon l'auteur « appartient à une époque révolue. » Il présente la mise en œuvre
d'un concept « faible » de religion, approche « particularisante et disséminante »
(p. 126) et qui n'est pas elle-même, dans ses excès, sans soulever de nombreux
problèmes : il n'est pas sûr d'ailleurs que ces approches contemporaines, « anti-
fondationalistes », survalorisant « le vécu et l'histoire d'un groupe sur fond de
communautarisme plus ou moins tempéré » (p. 127) ne relèvent pas encore de cette
historique opposition entre foi et religion. La solution de ces apories semble alors
résider, selon l'auteur, dans l'élaboration d'un concept qui permette de dépasser une
telle opposition, celui de « sagesse » entre « une religion qui parle trop et une foi (ou un
religieux d'individuation antitotalitaire) qui quelquefois parle trop peu » (p. 131) –
concept néanmoins plus programmatique que clairement déterminé.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
195
Informations bibliographiques
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
196
Ming Anthony, Des plantes et des
dieux dans les cultes afro-brésiliens.
Essai d'ethnobotanique comparative
Afrique-Brésil
Paris, L'Harmattan, 2001, 233 p. (coll. « Recherches et documents
Amériques latines »)
Erwan Dianteill
1 Cet ouvrage se situe dans la lignée des recherches de Pierre Verger sur l'usage des
plantes en pays yoruba (Sud-ouest du Nigeria) et au Brésil. Les deux premiers chapitres
présentent « les cultes afro-brésiliens et leur dynamique » ainsi que « le panthéon
yoruba » en tant que système classificatoire. On retiendra un bon exposé des formes
cultuelles dans un temple d'Umbanda ayant adopté une stratégie
d'internationalisation, mais l'essentiel de ces deux chapitres n'apporte rien de
vraiment neuf par rapport à l'imposante bibliographie sur ces sujets. Les chapitres
suivants, qui sont consacrés à l'ethnobotanique, présentent en revanche plus d'intérêt
(même si on perçoit bien que l'on a affaire à une collection d'articles plutôt qu'à un
ouvrage unifié). Le travail de comparaison entre les plantes utilisées au Brésil et en
Afrique est utile, car Pierre Verger avait tendance à ne pas distinguer les deux aires
culturelles, pour mieux en montrer l'unité. Dans le dernier chapitre, l'auteur
s'intéresse à deux lieux privilégiés de collecte des plantes. L'un d'entre eux est un parc
qui se trouve à Bahia. On y voit bien que la mise en valeur de cet espace n'est pas
exclusivement un problème religieux et thérapeutique : de nombreux enjeux politiques
sont aussi présents. On aurait aimé qu'une véritable analyse sociologique des agents en
présence soit faite ; elle n'est qu'esquissée. Au total, l'ouvrage présente un intérêt
certain pour l'ethnobotanique comparée, et pour les études afro-américaines.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
197
Martine Balard, Dahomey 1930 :
mission catholique et culte vodoun.
L'œuvre de Francis Aupiais (1877-1945),
missionnaire et ethnographe
Paris, L'Harmattan, 1999, 356 p. (coll. « Les tropiques entre mythe et
réalité »)
Erwan Dianteill
1 L'ouvrage présente un personnage remarquable, à la fois missionnaire, collectionneur
d'art africain, photographe, cinéaste et ethnographe de la religion des vodoun au
Dahomey. Francis Aupiais est loin d'être le seul religieux anthropologue de l'histoire de
l'Afrique (Karl Laman, grand spécialiste des Kongo, était un missionnaire suédois au
début du XXe siècle, par exemple), mais il fut peut-être plus prudent que ses
« collègues » sur le plan épistémologique : son travail est moins ethnocentrique que
beaucoup d'autres. Il fut envoyé au Dahomey en 1903, où il resta plus de vingt ans.
Les textes qu'il publia pour réhabiliter les « sociétés noires » lui valurent les foudres de
la hiérarchie catholique. En effet, loin de concevoir le culte des vodoun comme
l'emprise du diable sur la population, il le considère comme un ferment évangélique,
une sorte de préfiguration du christianisme. Cette position théologique le mit en
position d'approcher la religion des Fon autrement que sur le mode de la condamnation
morale. L'auteure a su exploiter, outre les écrits d'Aupiais (certains inédits), les
Archives de la Société des Missions Africaines de Lyon et d'autres archives
ecclésiastiques, ainsi que des sources orales au Bénin et en France. L'ensemble fait un
livre passionnant sur les « détours » théologiques de l'ethnologie.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
198
Paul Balta, La Méditerranée des juifs
Exodes et enracinements
Paris, L'Harmattan, 2003, 312 p. (coll. « les Cahiers de Confluences »)
Régine Azria
1 Ce recueil de 25 textes rassemble des études historiques, des souvenirs, des
témoignages personnels qui nous entraînent dans un voyage autour de la mare nostrum,
où se croisent, se combinent et se répondent érudition, histoire et mémoire. Leurs
auteurs, spécialistes ou autodidactes, sont pour la plupart d'entre eux originaires des
lieux dont il est ici question. D'où l'émotion et la nostalgie, voire la colère parfois, qui
parcourent ces pages, dont certaines sont particulièrement fortes.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
199
Carlo Brezzi, Democrazia e cultura
religiosa. Studi in onore di Pietro
Scoppola
Bologna, Il Mulino, 2002, 554 p.
Patrick Harismendy
1 Dans ce volume de mélanges offert à Pietro Scoppola, et publiés par les soins avertis
d'Il Mulino, les directeurs d'ouvrage ont réuni 22 auteurs italiens et 2 français (É. Poulat,
J.-M. Mayeur). Le volume s'ouvre par une brève biographie, mais serrée, de Scoppola –
inscrit comme on le sait dans cette tradition italienne d'universitaires accédant aux
plus hautes fonctions politiques – et comporte à la fin une bibliographie complète de
ses travaux (p. 513-540). Il ne faut naturellement pas rechercher d'unité à ce type
d'ouvrage, aux contributions de très inégal intérêt, voire d'inégale qualité. Néanmoins,
s'il est ici surtout question des systèmes et des idéologies ecclésiastiques, la place
accordée aux relations entre Église catholique et État est essentielle, tout comme les
réflexions relevant de l'histoire des idées (11 articles relèvent à des titres divers de la
biographie intellectuelle). Le plan adopté – une partie consacrée au XIXe siècle
(6 articles), l'autre au XXe siècle (18 contributions) – indique le choix d'une progression
temporelle allant des années 1860 (en fait) au début des années 1970. On aurait pu
préférer d'autres regroupements autour des formes d'intransigeantisme catholique, du
substrat chrétien de l'Europe ou de la démocratie chrétienne (incluant deux articles
consacrés à Aldo Moro qui clôturent l'ouvrage et éclairent les conditions intellectuelles
par lesquelles ce dernier a poussé au « compromis historique » avec la gauche
italienne)... À l'inverse, les deux premiers articles, l'un de F. Traniello, l'autre de
G. Tognon présentent les destinées spirituelles de Rosmini, Manzoni et Cattaneo
(1801-1869) dans une perspective historiographique, en soulignant que leur
modérantisme (sur certains aspects de la question italienne, comme des rapports entre
Église et État), comme leur appel constant à la responsabilité individuelle ont contribué
à leur occultation relative, face à l'ascendant des Gramsci et Croce. Parmi les réflexions
consacrées au XIXe siècle, signalons celle du père Giacomo Martina analysant en termes
très évocateurs la Critica sociale de Filippo Turati (1857-1932), député socialiste de 1895 à
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
200
1926 (on s'étonne, p. 97, de voir daté le procès en révision de Dreyfus à Rennes en 1890).
Revue de combat de l'anti-catholicisme (tant sur le plan spirituel que social ou encore
caritatif), la Critica sociale fut aussi attentive aux expérimentations laïques françaises,
espagnoles puis mexicaines. Mais, dans le même temps, l'auteur montre la complexité
de ce courant qui ne saurait être qualifié d'anticlérical, la Première Guerre mondiale et
le changement de génération préparant la maturation d'un socialisme chrétien. Quant
à Jean-Marie Mayeur, il s'intéresse à la réception des idées de Toniolo en France,
montrant à la fois la très sincère conversion de divers milieux catholiques à une
démocratie faite « pour le peuple », mais qui, prisonniers de leur catholicisme intégral,
ne purent dépasser Graves de communi frappant d'interdit l'engagement politique.
2 Parmi les articles consacrés au XXe siècle – bizarrement ouvert par une très vigoureuse
réflexion biblio-historiographique d'A. Riccardi sur « christianisme, guerre et
violence » axée sur les théologies de la paix qu'on aurait plutôt vue à la fin – plusieurs
se signalent à l'attention. Outre la présentation (L. Pazzaglia) d'éléments suggestifs de
la correspondance Fogazzaro-Laberthonnière (dont 12 lettres attachantes datant de
1905-1907 qui éclairent la venue de Fogazzaro à Paris), et que complète une étude de
N. Raponi sur une biographie de Fogazzaro publiée en 1920, un article substantiel de
Renato Moro met en lumière la question méconnue de l'anti-protestantisme catholique
italien dans les années 1920 (jusqu'alors seulement esquissée chez Spini et Rochat ou
abordée, tel chez Scoppola, à travers l'unique filtre fasciste) ; alors que l'antisémitisme
fut loin d'être partagé (devenant même un marqueur de différenciation entre
catholiques philo-fascistes et démocrates-chrétiens), la dénonciation du « péril
protestant » fut globale, arguant d'une opposition charnelle et irréductible depuis la
Réforme. Néanmoins, la violence perceptible à la « Semaine sociale » de 1928 peut aussi
se lire dans le temps court préludant aux accords du Latran. Ceux-ci font justement
l'objet de deux analyses. C. Brezzi, étudie ainsi la « désillusion » croissante de Pie XI,
pris au piège d'un rêve de restauration de la catholicité italienne très savamment
entretenu par Mussolini. Finalement réduit à gouverner un État microscopique, le pape
pourra seulement protester, en 1931, dans Non abbiamo bisogno – l'une des premières
mesures adoptées par l'État fasciste au lendemain des accords étant, comme on sait
l'interdiction de la Civiltà Cattolica – dont on perçoit certains matériaux dans une
conférence prononcée en octobre 1929, à Lugano par E. L. Ferrari (M. C. Giuntella). Les
rapports entre le Saint-Siège et l'État italien sont encore l'objet d'une très intéressante
étude de M. Casella. À travers les archives diplomatiques du ministère des Affaires
étrangères, une nouvelle pièce est versée au dossier de l'objectif quasi obsessionnel de
Pie XII à vouloir préserver la paix – sur fond d'indécision personnelle à trancher les
termes moraux du débat – et dont se joue l'entourage de Ciano, par ailleurs
remarquablement secondé par d'excellents analystes. Si le volume paraît alors quelque
peu orphelin de ne pas s'ouvrir à la période du second conflit mondial, la dopoguerra est
examinée notamment à travers quatre contributions stimulantes. Dans un article très
nuancé, F. Malgeri examine d'abord la double naissance (24 août 1944 ; 15 juin 1946) de
l'« Ueci » (Union des éditeurs catholiques italiens) qui marque certes un progrès par
rapport à l'avant-guerre dans le désir d'une action commune, mais dont les capacités
d'action se révèlent limitées. Ce profil de témoin engagé sied d'ailleurs bien à
P. Mazzolari (étudié par M. Guasco) en ce que, commentateur attentif du travail de
Gasperi, ses articles dans La Rescosa par exemple ont contribué à décomplexer les
catholiques italiens de l'après-guerre. C'est alors avec un certain intérêt que l'on
pourra lire la réflexion de G. Vecchio montrant le relatif désarroi initial de la hiérarchie
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
201
catholique face à l'arrivée de la télévision. Mais, au fil de correspondances avec les
évêques italiens, la doctrine de l'Église se construit pas à pas, donnant naissance en
1956 à l'Associazone Italiana degli Ascoltatori Radiofonici e Tetlespertatori, approuvée par la
Commission épiscopale et la direction de l'Action catholique. Il n'en reste pas moins
vrai que la dépendance de programmation n'a évidemment pu donner tout son sens à
de telles mesures. C'est un peu dans le même ordre d'idée que C. Dau Novelli s'attarde
sur les années cinquante et les relations entre les industriels (catholiques) et la
politique, soulignant la relative impréparation intellectuelle des dirigeants à accepter
l'interventionnisme étatique. Ce n'est qu'au milieu des années 1960 que le conflit se
résorbe, ce qui éclaire d'une certaine manière la fonction cristalisatrice assumée par
l'économie dans le débat public naguère largement déterminé par les options
spirituelles.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
202
Gérald Bronner, L'empire des
croyances
Paris, PUF, 2003, 281 p. (coll. « Sociologie »)
Yves Lambert
1 Cet ouvrage apporte une contribution très éclairante à la question clé qu'il pose
d'entrée de jeu : « les progrès de la science, et de la connaissance en général, sont-ils en
mesure de faire disparaître les croyances ? » Il s'agit des croyances au sens large, en
tout domaine. G. Bronner constate qu'en fait, non seulement celles-ci ne disparaissent
pas mais qu'elles se portent très bien. Comment expliquer ce paradoxe ?
2 L'auteur commence par rejeter l'idée selon laquelle les croyances relèveraient de
l'irrationnel, du passionnel, même si c'est parfois le cas. Ce qui les caractérise d'abord,
montre-t-il dans une première partie, se référant notamment à Raymond Boudon, c'est
qu'elles relèvent d'une rationalité subjective, alors que la science relève d'une
rationalité objective. Les croyances ont leur logique, qu'il s'agit de découvrir par-delà
les « opacités » qui peuvent nous les faire apparaître comme irrationnelles, opacités
dont il analyse les principales formes.
3 Une seconde partie recherche précisément quelles sont les « conditions d'émergence
des croyances ». « Les individus ne peuvent acquérir la qualité de croyants, avance
alors Bronner, que pour autant qu'ils n'aient pas, sur un sujet, accès à la claire et
complète information » (p. 84). Or, « aucun individu n'est en mesure d'accéder à
l'information pure et parfaite qui est la condition de l'état de connaissance » (p. 186),
état qui est en fait une utopie, ce qui explique « qu'il puisse y avoir progrès de la
connaissance humaine et persistance d'un empire polymorphe des croyances » (idem).
Les croyances émergent des limites de l'accès à la connaissance : limites
dimensionnelles (spatiales, temporelles), culturelles (filtres interprétatifs), cognitives
(illusions perceptives, impossibilité de saisir une question dans toute sa complexité,
etc.). L'auteur étaye sa démonstration par un grand nombre d'exemples allant des
mythes des origines (cinquante d'entre eux sont cités !) aux travaux de la psychologie
expérimentale, travaux auxquels il est souvent fait référence, d'une manière générale.
Ces mythes, tout comme les représentations de l'après-mort, illustrent le fait que
l'homme ne peut rester sans réponse devant certaines questions fondamentales, même
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
203
s'il ne possède que « quelques indices dérisoires » (p. 118). La connaissance scientifique
elle-même n'est considérée que comme la plus « probablement vraie » et la plus
« complètement argumentée », mais elle est susceptible de changer (cf. les
changements de « paradigme » de Kuhn).
4 Toutefois, ces limites ne sont que des conditions nécessaires à la croyance, et non des
conditions suffisantes : il faut en plus que soient remplies certaines conditions
d'émission et de réception sur le « marché cognitif », conditions qui sont examinées
dans une troisième et dernière partie. L'auteur pense que « les échanges cognitifs (dont
font partie les croyances) peuvent être décrits comme des processus d'offre, de
demande, de concurrence, de monopole, etc. » (p. 184). Il passe en revue les principaux
types de situation : monopole, oligopole, concurrence ouverte, tout en soulignant les
limites de la métaphore du marché (absence de monnaie, d'équilibre offre-demande,
etc.). Il souligne que l'une des caractéristiques de notre marché cognitif contemporain
est la « saturation » et la « dissémination » de l'information, « un fait inédit dans
l'histoire de l'humanité, et qui donne une forme à l'empire des croyances inédite elle
aussi » (p. 172).
5 On le voit, il s'agit d'une approche originale et souvent pertinente surtout pour le
spécialiste des religions, qu'elle oblige à prendre du recul. Originale, encore que notre
domaine ait déjà vu des analyses de ce type en particulier chez Martin (analyse des
situations confessionnelles des pays occidentaux en terme de monopole, oligopole,
duopole, etc.), Iannacone (application d'un modèle micro-économique à
l'investissement personnel dans les activités religieuses), Stark et Bainbridge
(développement de la demande en situation de concurrence), des travaux que Gérald
Bronner n'évoque pas.
6 Si je devais mentionner des points faibles, j'en verrais deux. Tout d'abord, l'auteur
rejette un peu facilement, me semble-t-il, les analyses expliquant les croyances par les
fonctions qu'elles remplissent (Marx, Malinowski, Durkheim, Mauss, Bourdieu,
Moscovici). Il précise que ces analyses relèvent d'un modèle lamarckien (selon lequel
un individu peut s'adapter à son environnement et transmettre cette adaptation), alors
que les croyances correspondraient plutôt à un modèle darwinien (selon lequel, du
hasard de la production des mutations, émergent les individus les mieux adaptés).
Outre que cette opposition est fortement relativisée par les dernières découvertes
scientifiques en matière d'évolution (cf. les travaux de Radman et de Lindquist), on ne
la voit pas appliquée par l'auteur aux croyances. Or on sait qu'un individu peut changer
ses croyances, et même radicalement (conversion religieuse), qu'il peut transmettre ces
changements, que des sociétés entières peuvent le faire (effondrement du
communisme). Ces changements seraient d'ailleurs de plus en plus courants si le
marché cognitif contemporain est ce qu'en dit l'auteur. Le second point concerne la
description des caractéristiques du médiateur, du récepteur et du message, où j'ai eu
l'impression d'en rester au niveau des généralités, sinon, des banalités : ainsi,
l'adhésion cognitive sera plus facile (son prix sera moins élevé) si le récepteur a un
rapport affectif avec le médiateur, si ce dernier a une compétence reconnue, s'il n'a pas
d'intérêt propre dans l'affaire ; si le contenu du message génère un effet d'implication
(intérêt matériel ou cognitif, côté spectaculaire, mise en scène d'une dimension de
l'identité) ou un effet de dévoilement. Ici, la méfiance envers les fonctions remplies par
la croyance semble empêcher d'aller plus loin. Ces réserves sont autant d'invitations à
des approfondissements prometteurs.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
204
Werner J. Cahnman, Jews and
Gentiles. A Historical Sociology of their
Relations
Judith T. Marcus and Zoltan Tarr, eds., New Brunswick, Transaction
Publishers, 2004, 253 p.
Michael Löwy
1 Werner Cahnman (1902-1980) est un sociologue juif allemand émigré aux États-Unis,
formé à la grande école de la sociologie historique allemande, et auteur d'importants
essais sur Weber et Toennies. C'est grâce aux éditeurs, Judith Marcus et Zoltan Tarr,
que cet ouvrage inédit a pu être publié à titre posthume.
2 Il s'agit d'une ambitieuse synthèse socio-historique des rapports entre juifs et non-juifs
(Gentiles), depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours ; malgré l'absence de notes en bas de
page, ce n'est pas simplement une œuvre de vulgarisation, mais une tentative
d'interprétation sociologique – inspirée de la méthode idéal-typique de Weber – qui
met l'accent, comme l'observent les éditeurs dans leur introduction, sur la tension
entre symbiose et conflit, contacts mutuels et antagonismes violents. Selon l'auteur,
l'antagonisme théologique initial entre l'Église et la Synagogue s'est transformé, à
partir du Haut Moyen-Âge, en un conflit fondamentalement socio-économique entre les
communautés juive et chrétienne. L'hypothèse de base de l'ouvrage, proposée dès le
premier chapitre, est que la norme essentielle (pattern) des relations entre juifs et non-
juifs s'est cristallisée dans une forme paradigmatique au cours des Xe-XIVe siècles : les
développements postérieurs en Espagne, en Pologne, en Europe ou en Amérique ne
seraient que des « variations de cette norme, des modifications à partir de ce type
central ». La proposition est intéressante, mais discutable, dans la mesure où elle sous-
estime la profondeur des changements que représentent l'émancipation des juifs d'une
part, et le génocide de l'autre.
3 Comment définir cette situation paradigmatique des juifs dans les sociétés chrétiennes,
telle qu'elle s'est installée dès l'époque des Croisades ? Cahnman refuse la définition
wébérienne des juifs diasporiques comme peuple paria : l'absence d'une séparation
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
205
rituelle imposée du dehors et le refus, par les juifs, de la religion dominante les
distinguent radicalement des groupes parias indiens. Il préfère utiliser le concept du
sociologue américain Robert Park, « peuple commerçant marginal », ou alors celui
d'étranger au sens de Simmel – curieusement le nom de cet auteur n'est pas
mentionné – c'est-à-dire non celui qui traverse une contrée mais celui qui « arrive
aujourd'hui et reste demain ». Peu à peu, au cours du Moyen Âge, le juif s'est vu
cantonné au rôle de marchand, intermédiaire, parfois usurier ; il est devenu un outsider
suspect, présent partout sans être chez lui nulle part.
4 Persécutés et chassés de l'Allemagne médiévale, les juifs trouveront refuge en Pologne
et en Europe de l'Est, emportant avec eux leur langage allemand archaïque truffé de
mots hébreux : le yiddish. L'émancipation, d'abord en France et plus tard, en
Allemagne, a ouvert les portes de la société aux juifs, mais seulement comme individus,
pas comme communauté. C'est le moment où, selon Hannah Arendt, les juifs se divisent
en parvenus ou parias. L'auteur mentionne cette distinction, mais préfère utiliser, pour
désigner les intellectuels juifs marginalisés – les parias conscients selon Arendt –
comme Heinrich Heine par le concept bien discutable de « transfuges frustrés ». Bientôt
le libéralisme cède le pas au racisme, et l'Europe parcourt le chemin qui conduit, selon
l'écrivain autrichien Franz Grillparzer, « de l'humanité à la bestialité, en passant par la
nationalité ». Un des chapitres les plus intéressants du livre est celui qui examine les
représentations du « Juif mythique », depuis les œuvres littéraires de Walter Scott et
Charles Dickens jusqu'aux Protocoles des Sages de Sion.
5 Avec l'essor du racisme biologique, l'antisémitisme change de nature : les anciennes
représentations manichéennes du juif comme figure diabolique cessent d'être
religieuses : la rédemption par le Christ est « scientifiquement » niée par le concept de
race. Tout en reconnaissant la nouveauté de cet antisémitisme raciste, l'auteur le
présente néanmoins comme une sécularisation de l'ancien manichéisme religieux – un
concept qui risque, à mon avis, de brouiller les frontières entre l'antijudaïsme
traditionnel et l'antisémitisme moderne. En esquissant un parallèle entre les massacres
médiévaux et le génocide nazi, l'auteur met en évidence le caractère spontané des
atrocités anciennes et celui, planifié par les autorités, de l'extermination hitlérienne.
6 Des chapitres inachevés et forcément datés sur les juifs en Union Soviétique, en
Amérique du Nord et en Israël complètent l'ouvrage, ainsi qu'une bibliographie
générale et la liste des publications de Werner Cahnman, les deux préparées par les
éditeurs.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
206
Hubert Cancik, Antisemitismus,
Paganismus, Völkische Religion (Anti-
Semitisme, Paganism, voelkish Religion)
Münich, K. G. Saur, 2004, 172 p.
Doris Bensimon
1 Cet ouvrage collectif est le résultat de recherches récentes menées par une équipe
allemande pluridisciplinaire composée de philologues, d'historiens, de sociologues et
de spécialistes en sciences de la religion. Le livre est bilingue : les articles sont publiés
en allemand ou en anglais, sans doute avec l'intention de dépasser le public des lecteurs
germanophones. Les contributions sont centrées sur l'antisémitisme en liaison avec le
nationalisme allemand et l'émergence d'un nouveau paganisme aux XIXe et XXe siècles.
Toutefois, certains auteurs élargissent leurs analyses à d'autres pays européens dont la
France.
2 Les mythes anti-juifs remontent à l'Antiquité. Selon Tacite, par l'affirmation du
monothéisme, Moïse a séparé les juifs des autres peuples. Tacite attaque aussi les
premiers chrétiens. L'antijudaïsme chrétien est connu. Il affuble les juifs de nombreux
stéréotypes négatifs. L'antijudaïsme chrétien est européen. Le juif est l'Autre,
l'Étranger, l'exclu, le persécuté. Ces préjugés persistent et deviennent l'antisémitisme
social, culturel et racial.
3 Dans la première partie de ce livre, les auteurs étudient les différents aspects de
l'antisémitisme qui est d'abord la critique du long processus de l'émancipation civique
des juifs dans les pays allemands unifiés dans le II e Reich en 1871. En France, les juifs
sont devenus citoyens grâce à la Révolution de 1789. Dans quelques régions allemandes,
les juifs ont été émancipés sous la pression des « révolutionnaires » des guerres
napoléoniennes. Ces juifs sont donc considérés comme des « traîtres ». De plus, depuis
la fin du XVIIIe siècle, dans l'esprit des Lumières, écoles et universités leur étaient
ouvertes. Cette scolarisation en langue allemande avait pour conséquence l'émergence
d'une bourgeoisie juive cultivée qui s'urbanise plus rapidement que l'ensemble de la
population. Dans le contexte de l'industrialisation et des transformations de l'économie
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
207
capitaliste, les juifs sont considérés comme des pionniers de la modernité. En effet,
certains ont joué un rôle important dans la modernisation économique et culturelle de
l'Allemagne depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à la prise du pouvoir par les national-
socialistes.
4 Immédiatement, ce rôle est critiqué, contesté et condamné par des idéologues et une
partie de la population allemande. Il est perçu comme une menace pour les traditions
et la germanité du peuple allemand. Des conservateurs élaborent les thèses du
« völkisch », terme intraduisible en français. « Völkisch » est l'adjectif de « Volk »,
peuple. Mais ce mot est chargé d'une idéologie qui dépasse la traduction littérale :
« national ». Au XIXe siècle, « völkisch » est d'abord l'accent mis sur le caractère
exceptionnel du peuple allemand et l'urgence du maintien de ses traditions. C'est
ensuite l'affirmation de la supériorité de la race germanique, aryenne et
l'appartenance, par le sang, à la parenté allemande. Les protagonistes des mouvements
« völkisch » rejettent toutes les influences étrangères, en particulier française et slave,
mais surtout celle des juifs : l'antisémitisme racial est un élément essentiel de cette
idéologie.
5 Les adeptes du mouvement « völkisch » multiplient les critiques vis-à-vis du
christianisme. À la fin du XIXe siècle, Paul de Lagarde s'opposait avec violence aux
Églises chrétiennes et à leurs références à l'Ancien Testament. Dans ses écrits
théologico-politiques, il réclame l'unification du peuple allemand par une nouvelle
religion. Dès cette époque émergent des libres penseurs protestants. Au début du
XXe siècle, la « communauté religieuse germanique » propage une religion fondée sur
« l'esprit et la force de l'histoire allemande ». Après la Première Guerre mondiale,
l'instabilité de la République de Weimar favorise le développement de publications qui
nourrissent l'opposition à la démocratie et la haine des juifs. Le mouvement
« völkisch » se radicalise, mais contrairement à ses espérances, il est interdit après la
prise du pouvoir par les national-socialistes.
6 Les trois derniers articles de cet ouvrage sont consacrés à la naissance d'un néo-
paganisme en Allemagne depuis 1945. Les Alliés occidentaux ont interné dans des
camps des militants national-socialistes en vue de leur « rééducation ». Les Alliés
coopèrent avec les Églises qui se considèrent comme les victimes du national-
socialisme. Des aumôniers protestants et catholiques étaient admis dans les camps où
se créent des communautés religieuses, mais aussi de libres penseurs. Autour d'anciens
membres de la SS se constituent des groupes soutenus par des Unitariens considérés
aux États-Unis comme des chrétiens libéraux. En 1950, ces groupes fondent la
communauté religieuse unitarienne allemande qui rejoint, en 1970, l'association
internationale de la religion et de la liberté. D'autres groupes naissent : ils reprennent
des éléments de l'idéologie « völkisch » et certains de leurs dirigeants participent
activement à la création des partis politiques d'extrême droite.
7 L'opposition aux religions monothéistes, judaïsme, christianisme et plus récemment
islam se radicalise. Les premiers groupes de néo-païens ont été fondés au début du
XXe siècle. Mais d'autres s'organisent dans les années 1970-1980. Des groupuscules
créent une nouvelle sous-culture païenne : ils étudient la mythologie germanique,
inventent leurs rites, se réunissent sur d'anciens sites païens pour des conférences et
des célébrations. Ils glorifient la nature et voudraient jouer un rôle dans l'actualité des
mouvements écologiques, mais leur idéologie est plutôt proche des partis politiques
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
208
d'extrême droite. Ils s'organisent en réseaux en Allemagne et dans d'autres pays
européens.
8 Cet ouvrage apporte de nombreuses informations sur la spécificité allemande de
l'antisémitisme. Il est un témoignage sur les « démons » qui hantent toujours
l'Allemagne, qui, pourtant, est aujourd'hui un pilier de l'Union Européenne. Chaque
article est soigneusement annoté. On regrette cependant l'absence d'une bibliographie
systématique qui aurait facilité à d'autres chercheurs l'approfondissement de leurs
connaissances.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
209
Philip Clart, Religion in Modern
Taiwan. Tradition and Innovation in a
Changing Society
Honolulu, University of Hawai'i Press, 2003, x + 333 p.
Vincent Goossaert
1 La récente libéralisation sociale et politique à Taiwan, avec notamment la levée de la loi
martiale en 1987, s'est accompagnée d'une forte augmentation, en nombre et en
variété, des formes de renouveau religieux, ainsi que d'une véritable explosion des
recherches sur la religion des Taïwanais. En effet, la reconnaissance politique des
identités culturelles locales propres à Taïwan a permis l'éclosion de travaux
historiques, sociologiques et anthropologiques sur la culture et la société taïwanaise,
dont beaucoup concernent directement la religion. Le présent ouvrage n'est donc pas le
premier à traiter de la spécificité de la religion des Chinois de Taïwan, mais il est
néanmoins très bienvenu par sa capacité à donner une synthèse claire, nuancée et de
qualité dans ce domaine en pleine effervescence.
2 Les deux éditeurs, deux jeunes chercheurs travaillant dans des universités américaines
et ayant mené des recherches historiques et sur le terrain, ont rassemblé onze articles.
Charles Jones brosse un panorama de l'évolution de la situation religieuse sous
l'occupation japonaise (1895-1945). Julian Pas, en dessous de la qualité générale de
l'ouvrage, s'interroge sur la vitalité économique de la religion des temples depuis les
années 1950. Christian Jochim explore en détail ce que signifie en pratique le
confucianisme aujourd'hui à Taïwan, distingue les différents acteurs qui s'identifient
comme tels et leur rôle dans l'interprétation des textes confucianistes. Philip Clart
analyse les textes de morale révélés par l'écriture inspirée et l'évolution de leurs
discours par rapport à la modernisation sociale (évolution des rapports de genre
notamment). Paul Katz présente les cultes aux seigneurs royaux (dieux des épidémies)
et l'évolution de leur culte dans un contexte de changement profond des besoins des
populations en terme de système de santé et de protection face aux dangers de
l'existence. Lee Fong-mao décrit le rôle social du clergé taoïste et son rapport aux
identités ethniques et locales. André Laliberté analyse le rapport des différentes
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
210
institutions bouddhiques à la politique et aux partis. Barbara Reed, dans une approche
plus « micro » que la plupart des articles, analyse des récits d'aide miraculeuse offerte
par Guanyin et de conversion au bouddhisme de la part de laïcs taïwanais depuis 1945.
Murray Rubinstein détaille l'histoire de l'Église presbytérienne taïwanaise et son rôle
dans les luttes pour la défense de l'identité linguistique et culturelle des Taïwanais, et
pour la démocratie. Huang Shiun-wey offre une analyse anthropologique d'une
communauté d'Ami (l'une des populations aborigènes de l'île), et défend la thèse d'une
adaptation de la culture et de l'identité Ami au travers de la conversion au
christianisme. Enfin, Randall Nadeau et Chang Hsun font l'histoire de la religion
taïwanaise comme objet scientifique (essentiellement chez les ethnologues).
3 Même si les deux éditeurs s'en défendent, disant n'avoir composé qu'une mosaïque
incomplète, le panorama est en réalité large et passe en revue les phénomènes les plus
saillants de l'histoire religieuse de l'île depuis 1945, et les principales questions en
débat dans le milieu religieux et chez les scientifiques aujourd'hui. Seuls peut-être,
parmi les thèmes importants qui permettraient d'analyser le changement religieux, les
questions des pratiques individuelles de salut (méditation, techniques du corps) et la
vogue des maîtres spirituels, la grande diffusion du végétarisme et l'évolution des rites
familiaux (mariage, mort), manquent au tableau. Du point de vue des institutions
religieuses, en revanche, le panorama offert par l'ensemble des onze articles est très
complet. Les thèmes transversaux les plus saillants sont le rapport au politique très
différencié entre les différentes institutions religieuses (confrontation chez les
presbytériens, collaboration chez les bouddhistes), et l'évolution progressive de la
société vers une importance de plus en plus marquée des groupes religieux de type
congrégation (communautés de croyance réparties à travers l'île) par opposition aux
communautés locales (lignage, guildes, temples territoriaux), évolution favorisée par la
mobilité physique, sociale et économique. Le thème de l'évolution religieuse au travers
de soixante années de croissance économique et de modernisation sociopolitique
constitue une sorte de fil rouge au travers des articles, et se trouve traité de façon
nuancée : la grande capacité de résistance des communautés traditionnelles (temples
de village, notamment) est soulignée en même temps que leur adaptation à de
nouveaux besoins de la population, tandis que la remarquable variété des formes de
communautés religieuses d'apparition récente suggère un impact profond de la
modernisation sur le champ religieux.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
211
Marcel Drach (éd.), L'argent ;
croyance, mesure, spéculation
Paris, La Découverte, 2004, 297 p., (coll. « Recherches »)
Nicolas de Bremond d’Ars
1 Marcel Drach met à la disposition du public un ouvrage issu d'un colloque organisé en
novembre 2001. À l'occasion du passage à la monnaie unique, l'euro, son objectif est de
fournir un certain nombre de pistes explorant le rapport à l'argent. Une vingtaine de
spécialistes ont fourni des contributions dans quatre domaines de recherche :
philosophie, économie, anthropologie, psychanalyse.
2 « L'intention de cet ouvrage est de questionner à nouveau la complexité de l'argent à
partir de la thèse qu'il est un fait de langage » (avant-propos, p. 7). Il est organisé en
cinq volets, respectivement intitulés : Le tiers : la croyance et la dette ; la mesure ; la
spéculation ; l'esprit de l'argent ; la philosophie de l'euro. Les trois premières parties
cherchent à embrasser diverses approches, tant théoriques (philosophie, psychanalyse)
que pratiques (dossiers historiques, et ethnographiques par exemple) ; une discussion
avec Jacques Derrida s'efforce de nouer la thèse ; enfin une ouverture sur les enjeux du
passage à l'euro introduit dans des questions plus pragmatiques.
3 Il est impossible de résumer l'ensemble de ces contributions qui représentent un
excellent inventaire des moyens intellectuels disponibles pour évoquer la question de
l'argent. Les économistes occupent bien sûr une place de choix : sur les seize auteurs,
neuf ont une compétence en économie. Mais, bien que l'histoire des idées et des
pratiques autour de l'argent le montre abondamment (cf. Michel Aglietta et André
Orléan, dirs., La violence de la monnaie, Paris, Odile Jacob, 1998), le domaine religieux
n'est pas représenté, bien que l'auteur remarque à plusieurs reprises cette dimension
(« Or, demande Berns, sur quoi cette croyance est-elle fondée ? Sur l'État, lui-même
adossé, soit à Dieu, sous l'Ancien Régime, soit sur un contrat social, dans la tradition de
la philosophie politique. » Avant-propos p. 19 ; dans « Les deux faces de l'euro », Denis
Guénoun réussit le tour de force de prendre appui sur un écrit religieux (Évangile) et
d'en évacuer la dimension religieuse). Le lecteur ne doit pas s'attendre, non plus, à une
histoire de la relation à l'argent ni de la monnaie, malgré les excellents travaux
disponibles (Par exemple : Georges Le Rider, La naissance de la monnaie, Paris, PUF 2001
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
212
et Alain Testart, dir., Aux origines de la monnaie, Paris, Errance 2001 – ces deux ouvrages
ayant été sans doute publiés trop tardivement pour une prise en compte par les
organisateurs du colloque). Cela montre les limites dans lesquelles le colloque a voulu
se contenir, pour accentuer la portée des interventions.
4 De fait, la philosophie et la psychanalyse colorent très clairement les contributions. Qui
chercherait une intelligibilité du phénomène monétaire en modernité serait peut-être
déçu. Ainsi Christian Arnsperger (« L'estimable valeur de l'autre : argent, altérité et
socialité »), envisage par exemple la question de la temporalité du crédit à partir des
propositions de Lévinas, soit comme une forme de méditation sur la difficile rencontre
de l'autre : « C'est l'horizon de la réciprocité à travers le temps, pas nécessairement
envers celui qui m'a donné l'argent, mais envers celui à qui j'achèterai à mon tour ce
dont j'ai besoin – confiance dans le fait qu'à l'avenir il y aura là quelqu'un qui pourra me
rendre sous forme de biens et de services la valeur des biens et des services que j'ai
provisoirement vendus contre de l'argent. » (p. 49). Arnaud Berthoud (« Monnaie et
mesure chez Aristote ») met à la disposition du lecteur une analyse très serrée des
propositions aristotéliciennes : « Dans l'échange naturel présenté selon son essence
dans l'Éthique à Nicomaque et selon son histoire et sa pratique dans le Politique, la
monnaie est le nom d'un dispositif conventionnel dont les formes matérielles assurent
trois fonctions différentes et servent à ce titre d'instrument pratique » (p. 87). La
rupture moderne est alors présentée par Antoine Rebeyrol (« Valeur, équivalent
général et numéraire : “le mot franc est le nom d'une chose qui n'existe pas” ») et Jean-
Joseph Goux (« Marx et Walras : un déplacement éthique ») sur le mode d'une mise en
évidence de la répudiation de toute préoccupation éthique à partir de Walras, là où
même Marx conservait un accrochage de l'argent avec une forme de transcendance
(travail ou besoin).
5 Une mention particulière doit être attribuée à la contribution de Christian Walter, qui
présente ses recherches sur l'épistémologie de la théorie financière. Elle contrebalance
quelque peu les approches de type psychanalytique (Pierre Bruno, Pierre-Laurent
Assoun), en ce qu'elle associe étroitement les modalités sous lesquelles l'argent circule
– ici, dans le monde restreint du marché financier – et la construction intellectuelle qui
organise cette circulation. L'auteure montre que la modification des points d'appui
théoriques (mathématiques et statistiques) transforme radicalement l'appréhension de
l'influence de la circulation monétaire sur le social. Parler de l'argent ou de la monnaie
comme langage, selon le projet du colloque, c'est aussi interroger les conditions de
formation du langage : « Il est possible de reformuler le problème moral de la
spéculation, tel qu'il est posé dans les préoccupations éthiques développées sur ce
sujet, en questionnement théorique sur la capacité des marchés de capitaux à
transmettre dans les prix une information pertinente sur l'économie réelle, aspect
théorique qui, par ses implications pratiques, devient le versant “vérifiable” de la
question éthique » (p. 150). Pour un sociologue, l'apport majeur de C. Walter tient en ce
qu'il permet de réintroduire l'instance sociale de formation de l'opinion technique
et, par ricochet, de l'opinion commune. Ce qui constitue, dans ce colloque, une certaine
originalité.
6 Michel Aglietta (« Espoirs et inquiétudes de l'euro »), Jean-Michel Servet (« Promesses
et angoisses d'une transition monétaire ») et Egidius Berns (« L'euro et le politique »)
nous permettent eux aussi d'ancrer des préoccupations philosophiques ou morales
dans l'événement historique du changement de monnaie. Les thèses des uns et des
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
213
autres, toujours clairement posées, ramènent, là encore, le sociologue à des
préoccupations cousinant avec sa discipline : problème de mémoire culturelle, place du
politique, éthos monétaire, etc. Dans cette perspective, on peut s'étonner que place
n'ait pas pu être faite aux travaux critiques, comme ceux de Pierre-Noël Giraud (Le
commerce des promesses, Paris, Seuil, 2001) ou Jacques Sapir (Les trous noirs de la science
économique, Paris, Albin Michel, 2000) – il est vrai que leurs publications sont
contemporaines du colloque. À notre sens, peut-être que la discussion avec Jacques
Derrida, qui porte, on s'en serait douté, bien plus sur des considérations philosophiques
que sur les aspects sociaux (4e partie), aurait gagné à s'appuyer sur ces perspectives
plus pragmatiques (ce qui ne veut pas dire moins théoriquement élaborées).
7 Concluons en déplorant que Denis Guénoun (« Les deux faces de l'euro »), n'ait pas
appuyé son travail sur les travaux essentiels de Marie-José Mondzain (Image, icône,
économie, Paris Seuil, 1996). Cela lui aurait permis de dépasser un point de vue de
critique littéraire pour se hisser au niveau philosophique que l'intitulé de sa
communication supposait.
8 Au total, ce livre intéressera ceux dont les préoccupations ont à voir avec une
épistémologie de l'argent. Malheureusement, comme il se présente plutôt sous la forme
d'une volonté discutante, réflexive, il ne peut servir que de livre d'éveil. Son apport à la
construction d'une intelligibilité de la circulation monétaire en situation de modernité,
en raison de l'absence de références historiques, et à l'exception de telle ou telle
contribution, demeure limité. On se demandera en particulier comment les chercheurs
qui œuvrent sur les questions de souveraineté, de lien social, d'anthropologie du don
et, surtout, de faits religieux pourront tirer profit de ces exposés.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
214
Calvin Goldscheider, Studying the
Jewish Future
Seattle-Londres, University of Washington Press, 2004, 152 p.
Régine Azria
1 Dans cet ouvrage de dimensions modestes, l'auteur, spécialiste du judaïsme américain,
dont certaines des précédentes publications ont fait l'objet de recensions dans les
Archives, n'apporte pas d'éléments nouveaux. Les analyses qu'il développe se fondent
sur des travaux et des enquêtes publiés, abondamment commentés et débattus dans les
milieux concernés. Aussi l'intérêt principal de ce livre se trouve-t-il ailleurs, en
l'occurrence, dans la démarche, comparative – États-Unis, Israël, Europe – (modeste et
assez faiblement documentée, s'agissant de l'Europe, en particulier de la France) et,
plus encore, dans sa dimension critique, voire iconoclaste. De fait, C. Goldscheider
reprend ici, à rebrousse poil, les interprétations généralement reçues, admises,
considérées comme des évidences par ses pairs sociologues et démographes anglo-
saxons et israéliens, lesquels, fondant leurs interprétations sur des données statistiques
en sont venus à considérer que l'avenir des juifs serait mieux assuré en Israël qu'aux
États-Unis, mieux assuré aux États-Unis qu'en Europe. Pour faire bref, mesuré à l'aune
des chiffres, de la démographie et des projections statistiques, l'avenir des juifs en
diaspora serait compromis à plus ou moins court terme. Or, l'auteur entend démontrer
que les méthodes de recueil et l'usage des données statistiques sur lesquelles se fondent
ces conclusions sont biaisées par les préconceptions idéologiques des chercheurs et des
milieux communautaires commanditaires ou bénéficiaires des enquêtes. Anticiper
l'érosion de la population juive reflèterait davantage, selon lui, une idéologie du déclin
communautaire et de la nécessité d'assurer l'assise démographique juive d'Israël, que le
résultat d'une analyse statistique objective et impartiale. À l'inverse de la plupart
des études produites par les instituts de démographie juifs et/ou israéliens, l'auteur
affirme que l'avenir démographique des juifs n'est menacé ni en diaspora ni en Israël.
La question de fond de cet avenir concernerait davantage la qualité de la vie juive
plutôt que l'évolution quantitative de la population juive. Ce qui ne fait que déplacer la
difficulté, car comment « évaluer » la qualité de la vie juive et quels sont les critères
supposés la définir ? À l'évidence, nous nous trouvons là face à une question sensible.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
215
Car à ce jour, aucun indicateur ne fait l'unanimité parmi les responsables juifs, les uns
privilégiant l'observance religieuse, d'autres les principes éthiques, d'autres encore
l'attachement à Israël, etc. Ce constat cependant a un mérite : il nous instruit sur la
complexité de la vie juive. Or, pour affronter cette complexité, l'auteur nous réserve
une surprise (et, avouons-le, une certaine déception quant au choix qu'il opère !).
Abandonnant provisoirement la statistique et les chiffres et « cédant à la pression de
ses amis anthropologues », il part à la recherche de valeurs juives « en situation ». Pour
ce faire, il se tourne vers l'histoire orale et l'interprétation des textes, autrement dit
vers une approche empathique et qualitative. De cette immersion, il retient deux
valeurs phares propres à assurer la continuité de la vie juive : l'adaptation au contexte
et l'implication communautaire : le judaïsme est un processus capable d'intégrer les
apports du monde extérieur et qui exige la participation active de chacun sans
exclusion.
2 De fait, ici comme dans ses travaux antérieurs, l'auteur refuse la thèse de la perte et du
déclin pour lui substituer celle de la recomposition, car il admet bien volontiers que les
juifs d'aujourd'hui ne se comportent plus comme ceux d'hier. S'il est incontestable que
les juifs d'aujourd'hui ont délaissé certaines pratiques constitutives de leur identité
(comme la pratique religieuse ou l'endogamie : « Cessons, nous exhorte-t-il, de
considérer que le mariage mixte se solde nécessairement par l'éloignement de la vie
juive ! »), il est tout aussi important de noter, ce à quoi il nous invite, qu'ils les ont
remplacées par d'autres attitudes, telles que le rapport à Israël, la participation aux
affaires de la cité, la mémoire, l'éducation, l'acceptation et la pratique du pluralisme
interne. Autrement dit, l'évaluation doit se donner des instruments de mesure et des
critères eux-mêmes évolutifs et adaptés aux recompositions socioculturelles. Mais ce
débat n'est pas nouveau et il n'est pas l'apanage des juifs. Si la volonté manifestée par
l'auteur de rompre avec une certaine « langue de bois » catastrophiste et idéologique
rend sa démarche plutôt sympathique, la démonstration n'en reste pas moins, et
malheureusement, peu convaincante.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
216
Virginia HookerNorani Othman
(eds.), Malaysia, Islam Society and
Politics
Singapour, ISEAS, 265 p.
Rémy Madinier
1 Sous un titre quelque peu attrape-tout, les éditeurs ont rassemblé ici des mélanges
offerts à la mémoire de Clive S. Kessler. Ce spécialiste de l'anthropologie historique a
consacré une large partie de sa carrière à la Malaisie. Il fut pendant près de vingt ans
professeur à l'université de Nouvelle-Galles du Sud, après avoir enseigné à la London
School of Economics and Political Science ainsi qu'à l'université de Columbia. Bien
qu'abordant des thèmes variés, les auteurs dont les textes sont rassemblés ici ont
presque tous voulu partir des quelques conclusions fortes de l'ouvrage séminal de Clive
S. Kessler, Islam and Politic in a Malay State, Kelantan 1938-1968, publié en 1978. Leurs
contributions portent pour la plupart sur des questions afférentes à la place de l'islam
dans le pays, d'où le caractère un peu artificiel du plan retenu pour l'ouvrage (I. Islam,
II. Société, III. Politique).
2 Une interrogation récurrente, très en vogue ces derniers temps dans la littérature sur
l'Asie du Sud-Est, traverse la quasi-totalité des articles, à l'exception de celui de William
R. Roff (« Social Science Approaches to Understanding Religious Practice: The Special
Case of the Hajj ») qui ne porte que sur le séjour à La Mecque. Comment s'organise
l'arbitrage entre les cultures locales et les valeurs d'un monde désormais globalisé ?
3 Pour répondre à cette question, la plupart des contributions s'attachent à envisager le
rôle de l'islam dans ce processus. Kikue Hamayotsu (« Politics of Syarah Reform: The
Making of the State Religio-Legal Apparatus ») se livre à une analyse convaincante de
l'institutionnalisation de la charia en Malaisie, au cours des vingt dernières années. Il
montre, en particulier, comment le gouvernement fédéral, avec l'autorité du JAKIM
(Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, département du développement islamique), s'est
efforcé de minimiser les tendances séparatistes des autorités religieuses des États
composant la fédération de Malaisie. La progression du droit musulman en Malaisie a
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
217
ainsi largement relevé d'une véritable surenchère engagée entre représentants des
sultanats et gouvernement central. Amrita Malhi (« The PAS-BN Conflict in the 1990s:
Islamism and Modernity ») analyse les prolongements politiques de ce processus, et
relate quelques-uns des moments forts de la compétition ayant opposé la coalition au
pouvoir (Barisan Nasional – BN) au Parti islamique pan-malais (Partai Islam-Se-
Malaysia). M.B. Hooker (« Submission to Allah? The Kelantan Syariah Criminal Code (II)
1993 ») revient sur l'un des épisodes emblématiques de cette rivalité et montre
comment le code pénal adopté par le Kelantan, totalement inapplicable dans le cadre
constitutionnel en vigueur, a d'abord eu pour objectif de stigmatiser les résistances à la
loi de Dieu. Farish A. Noor (« The Localization of Islamist Discourse in The Tafsir of
Tuan Guru Nik Aziz Nik Mat, Murshid'ul Am of PAS ») revient, quant à lui, sur l'exégèse
coranique du principal leader spirituel du Parti pan-malais, montrant comment ce
dernier a su transmettre, selon des schémas compréhensibles aux paysans du nord de la
Malaisie, une lecture du texte sacré d'inspiration déobandie. L'audience très
importante de son discours (qui lui valut le poste de chief minister du Kelantan lorsque
le PAS y remporta les élections de 1990) entraîna une érosion de la culture kelantanaise
traditionnelle, désormais considérée comme peu islamique mais elle flatta dans le
même temps la fierté régionale en donnant une dimension universelle à ce que l'on
considérait comme des enjeux purement locaux.
4 Les autres contributions se penchent sur des aspects non spécifiquement religieux du
rapport qu'entretient la société malaise au processus d'occidentalisation. La stimulante
communication de Shamsul A.B. (« The Malay World: The concept of Malay Studies and
National Identity Formation ») s'attache à situer les études malaises et les études sur le
monde malais au sein du canevas plus large de la construction de la connaissance
coloniale puis de la formation de l'État malais postcolonial. Il analyse en particulier les
travaux conduits depuis une trentaine d'années au sein de l'Institut du monde malais et
de la civilisation (connu sous son acronyme malais ATMA). Il montre en particulier
comment cette institution, après s'être concentrée sur les études islamiques dans les
années 1970, a inauguré depuis une série de projets sur la diaspora malaise, tentant
ainsi de dépasser la définition coloniale classique d'études malaises centrées sur la
Malaisie pour adopter une vision plus nationale fondée sur la malayité. Maila Stivens
(« (Re)Framing Women's Rights Claims in Malaysia ») s'intéresse, à travers une étude
des mouvements féministes malais à l'un des hauts-lieux de ce choc des identités.
5 Tous finalement, à l'instar d'Anthony Milner (« How traditional » is the Malaysian
Monarchy) et de Virginia Hooker dans sa conclusion « The Way Forward: Social Science
and Malaysia in the Twenty-first Century ») montrent des recompositions tant sociales
qu'institutionnelles à la fois complexes et subtiles, bien loin d'un simple processus
d'homogénéisation culturelle.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
218
Carol Iancu, Les mythes fondateurs de
l'antisémitisme. De l'Antiquité à nos
jours
Toulouse, Privat, 2003, 189 p. (coll. « Bibliothèque Historique »)
Doris Bensimon
1 Un mythe est une légende. Pour l'auteur, les mythes fondateurs de l'antisémitisme sont
« la projection de complexes engendrés par l'intolérance à l'égard de l'altérité juive ».
Carol Iancu, historien, retrace l'histoire de « la plus longue haine » dans le temps et
dans l'espace.
2 Le peuple hébreu a inventé le monothéisme. Dans l'Antiquité égyptienne et grecque, les
juifs s'opposent aux dieux païens. Aussi, dès le IVe siècle avant l'ère chrétienne, ils sont
considérés comme différents des autres peuples. Leurs lois et coutumes sont contestées
par le monde païen. Mais l'antisémitisme naît surtout dans le christianisme et l'islam,
les deux religions issues du monothéisme juif.
3 Les chrétiens accusent le peuple juif de déicide, mais un « reste d'Israël » doit survivre
comme témoin. L'antijudaïsme est d'abord théologique. Il s'exprime dans les écrits des
pères de l'Église cités en grand nombre par l'auteur. Pendant les premiers siècles,
prosélytismes juif et chrétien se concurrencent. Le christianisme l'emporte et devient
religion d'État après la conversion de Constantin en 313. L'empire chrétien féodal
succède en Europe à l'Empire romain. À partir de cette époque et pendant de nombreux
siècles, les conciles élaborent une législation antijuive : les juifs sont discriminés dans
les activités économiques, dans l'habitat (le ghetto), dans la tenue vestimentaire et par
le serment more judaico. À ce rejet légal s'ajoute la haine populaire qui affuble les juifs
des crimes les plus invraisemblables : le meurtre rituel, la profanation d'hosties,
l'empoisonnement des puits. Le juif est perfide et démoniaque. Expulsé, il devient le
« juif errant », l'étranger à jamais puni pour son refus du message chrétien. C. Iancu
décrit en détail la naissance des « mythes » antijuifs qui, dans leur application concrète,
sont le sort quotidien des populations juives ou de massacres en période de crise.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
219
4 Un tournant semble se dessiner au siècle des Lumières suivi par l'émancipation civique
des juifs en France (1791), en Angleterre (1866), en Autriche-Hongrie (1867), en Italie
(1870), en Allemagne (1871). Avec l'émancipation, on pouvait s'attendre en Europe
centrale et occidentale à l'intégration des juifs dans la société. Pourtant, l'antijudaïsme
chrétien persiste dans ces pays. Il est complété par des thèmes nouveaux : nation et
race. Il devient l'antisémitisme moderne. Par la presse, la littérature, l'action
parlementaire, les antisémites mènent leur combat contre l'émancipation des juifs.
Cette tendance est très nette en Allemagne. En France elle culmine avec l'affaire
Dreyfus.
5 Dans les dernières décennies du XIXe siècle, l'antisémitisme prend de nouvelles
orientations. L'anticapitalisme socialiste est représenté en Allemagne par Ludwig
Feuerbach, Bruno Bauer, Karl Marx et en France, par Charles Fourrier, Alphonse
Toussenel et Pierre Proudhon. Chacun, à sa manière, s'attaque aux banquiers juifs et
ignore les masses juives pauvres de son pays comme celles d'Europe orientale, victimes
de pogroms. À partir du milieu du XIXe siècle paraissent des publications sur les
inégalités des races. La race indo-européenne serait supérieure à la race sémite. Parmi
les précurseurs des théories raciales, C. Iancu cite en France le comte Arthur de
Gobineau, Ernest Renan. Edouard Drumont diffuse le mythe de l'antagonisme Aryen/
Sémite. En Allemagne, ces théories sont amplifiées. En 1879, Wilhelm Marr, auteur du
pamphlet La victoire du judaïsme sur le germanisme aurait inventé le mot
« antisémitisme ». Le gendre anglais de Richard Wagner, Stewart Houston Chamberlain
publie en 1899 La Genèse du XIXe siècle, un panégyrique de la race aryenne dont la
meilleure part serait les Germains. Les théories de l'antisémitisme racial circulent en
Europe occidentale et centrale. Elles préparent les voies aux national-socialistes.
6 À cette même époque, le mythe de la conspiration juive contre le monde chrétien est
repris par celui du complot judéo-maçonnique. Ce mythe devient la conspiration
mondiale dans les tristement célèbres Protocoles des Sages de Sion. Ce pamphlet a été
fabriqué à Paris par la police secrète du tsar de Russie. Entre 1919 et 1920, il fut traduit
dans la plupart des langues européennes. Aujourd'hui, il circule non seulement en
Europe et Amérique, mais encore, traduit en arabe, au Proche et Moyen Orient.
7 La haine accumulée par l'antijudaïsme chrétien et par les idéologies de l'antisémitisme
moderne aboutit à la Shoah, l'extermination d'un tiers du peuple juif par les nazis et
leurs comparses.
8 Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale s'amorce un dialogue entre les Églises
chrétiennes et les représentants du judaïsme. Les relations entre juifs et chrétiens
s'améliorent, mais elles ne sont pas à l'abri de nouvelles flambées d'antisémitisme.
9 Dans la première partie de ce livre, C. Iancu évoque brièvement les relations entre
musulmans et juifs. L'islam partage avec le judaïsme le strict monothéisme. Mais juifs
et chrétiens refusent l'adhésion à la nouvelle religion prêchée par Mahomet. Quelques
sourates du Coran condamnent leur « incroyance ». Pourtant, juifs et chrétiens sont
considérés comme les « gens du Livre » (la Bible). Ils deviennent des dhimmi par leur
soumission au pacte de protection appelé la charte d'Omar. Le dhimmi pouvait résider
en terre d'islam, pratiquer son culte et bénéficier d'une autonomie concernant son
droit privé. En contrepartie, le dhimmi devait accepter son infériorité par rapport aux
musulmans, payer des impôts spécifiques, porter un signe distinctif sur son vêtement,
jaune pour les juifs, bleu pour les chrétiens. La dhimma fut appliquée avec plus ou
moins de rigueur selon les pays et les époques, pendant plus d'un millénaire dans
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
220
l'espace conquis par l'islam. Dans ce contexte, les juifs connurent des périodes de
coexistence paisible, mais aussi de persécutions.
10 Les deux derniers chapitres de ce livre sont consacrés à l'antisionisme et au « nouvel »
antisémitisme. L'auteur relate brièvement la naissance du mouvement sioniste, de la
création d'un Foyer national juif sous mandat britannique décidée en 1919 à la
fondation de l'État d'Israël.
11 En Russie, pendant le régime tsariste, l'antisémitisme était une institution d'État. En
1917, les juifs obtiennent la pleine égalité civile et politique. Lénine condamne
l'antisémitisme, mais les associations juives et parmi elles les groupements sionistes
doivent cesser leurs activités. Pourtant, en 1947, l'Union soviétique a voté le partage de
la Palestine mandataire. Elle fut l'un des premiers pays à reconnaître l'État d'Israël. Ce
soutien fut de courte durée. L'antisémitisme n'a pas disparu en URSS et le sionisme
était toujours condamné. À partir de 1950, la propagande soviétique élabore
l'amalgame entre l'antisémitisme et le sionisme : cette nouvelle idéologie est reprise
par les pays d'Europe de l'Est, membres du bloc de Varsovie.
12 Dans le contexte des guerres israélo-arabes et du conflit entre Israéliens et Palestiniens,
les relations entre juifs et musulmans se sont gravement détériorées. Les arabo-
musulmans ont intégré dans leurs discours et leurs actions l'ensemble des « mythes »
antisémites et antisionistes européens.
13 Aujourd'hui, en Europe, mais aussi en Amérique, le « nouvel » antisémitisme est un
amalgame entre les retombées du conflit israélo-palestinien, la résurgence des
mouvements d'extrême droite et leur rencontre avec des groupes d'extrême gauche.
14 C. Iancu dresse le tableau presque exhaustif des multiples expressions de la « haine la
plus longue de l'histoire ». Il cite des faits. Mais il ne démolit peut-être pas avec assez
de force les mythes. En guise de conclusion, il affirme qu'il ne voulait pas écrire une
« histoire larmoyante » du peuple juif. L'histoire positive des relations entre juifs et
non-juifs devrait, elle aussi, être écrite.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
221
John R. McRae, Seeing through Zen.
Encounter, Transformation, and
Genealogy in Chinese Chan Buddhism
Berkeley, University of California Press, 2003, xx + 204 p.
Vincent Goossaert
1 La constitution du bouddhisme Chan (jap. Zen) en école entre le VIe et le XXe siècle et
l'élaboration de ses institutions, notamment autour d'une relation maître à disciple
spécifique, sont des sujets très débattus. Ils ont été traités en France (Jacques Gernet,
Bernard Faure), en Europe et aux États-Unis par d'éminents spécialistes et bien plus
encore en Chine et au Japon, où ils ont fait couler autant d'encre que les origines et le
développement du christianisme dans les universités européennes. Le présent livre, d'à
peine deux cents pages et doté d'un appareil critique de taille raisonnable (au vu des
traditions bouddhologiques) se veut davantage un essai offrant de nouvelles
interprétations d'ensemble plutôt qu'une avancée dans l'érudition.
2 L'auteur, en effet, se fait fort de donner enfin sens aux travaux de ses collègues et ne
brille pas par sa modestie : il ouvre le livre en édictant les « McRae's Rules of Zen
Studies »... À plusieurs reprises dans le cours de l'ouvrage (par exemple p. 103), il
annonce de façon tonitruante la portée radicale de sa réinterprétation de l'histoire du
bouddhisme, et s'acharne plus qu'il n'est utile sur les moins savants de ses
prédécesseurs (notamment H. Dumoulin). Des rappels de vérités bien connues sont
présentés de façon prétentieuse. Cette attitude agaçante, qui n'est pas sans rappeler
parfois la posture de certains maîtres Chan, est sans doute le principal défaut de
l'ouvrage. Elle est sans doute à mettre au compte de l'ambition de l'auteur de s'adresser
aux adeptes occidentaux du Zen (dont il fait partie et auxquels il enseigne
fréquemment, mais en tant qu'universitaire) et de leur faire adopter un regard critique
sur l'hagiographie propre à leur tradition. Cependant, dans la mesure où il revendique
une posture totalement scientifique, l'auteur aurait mieux fait de discuter les débats
récents de la meilleure historiographie du Chan plutôt que de citer longuement, pour
les ridiculiser ensuite, des opuscules hagiographiques écrits il y a déjà quelque temps
pour le grand public.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
222
3 En dépit de ses prétentions excessives, Seeing through Zen reste un ouvrage très utile et
bienvenu. Il constitue en fait, même si l'auteur s'en défend avec virulence, une histoire
du Chan des origines au XIIIe siècle : une histoire qui ne suit pas toujours la chronologie
et néglige le fil des événements, c'est-à-dire une bonne histoire, qui va droit aux
mutations fondamentales et aux traits essentiels. Une telle histoire du Chan, dans un
format réduit et lisible, restait à écrire, et le présent ouvrage en tiendra utilement lieu.
Plutôt que de suivre la succession hagiographique des patriarches (on se demande
pourquoi l'auteur, dans sa remise en cause de l'hagiographie Chan, ne va pas jusqu'à
mettre en question l'historicité des premiers patriarches), J. R. McRae découpe
l'évolution du Chan en phases caractérisées par des types de textes et de milieux
sociaux qui, chronologiquement, se recoupent en partie : le Proto-Chan (500-600)
autour de Bodhidharma, le Early Chan (600-900) autour des différentes factions se
réclamant de Hongren (le « cinquième patriarche »), le Middle Chan (750-1000)
caractérisé par l'importance pédagogique du dialogue maître-disciple (encounter
dialogue) et le Chan de la dynastie Song (950-1300) qui a conquis une position
dominante dans l'institution bouddhique. Les caractéristiques sociales et spirituelles de
chacune de ces phases (surtout les premières, le dernier chapitre, sur les Song,
manquant des qualités de synthèse des chapitres précédents) sont traitées de façon
claire et lucide.
4 Un point, déjà esquissé par d'autres, mais ici particulièrement mis en valeur, est que les
acteurs de chaque phase ont « inventé » la phase précédente en écrivant a posteriori
leurs textes fondamentaux. Les passages entre les phases sont largement expliqués par
des ruptures épistémologiques : ainsi, les grands maîtres du Early Chan auraient mis
par écrit et diffusé des techniques d'enseignement jusqu'alors confinées à l'oralité à
l'intérieur de la communauté de pratiquants ; de même le Chan classique aurait vu le
jour en incluant les disciples, avec leur personnalité et leurs questions dans des textes
qui jusque-là ne mettaient en scène que des maîtres.
5 Au-delà de son découpage de l'évolution du Chan en différentes phases, l'auteur insiste
sur une caractéristique fondamentale qui traverse toute son histoire : il s'agit d'un
enseignement « fundamentally genealogical, [that is] derived from a genealogically
understood encounter experience that is relational, generational, and reiterative »
(p. 8). Il théorise donc un passage d'une vision du salut (dans le bouddhisme non Chan)
basée sur l'effort individuel à une vision fondée sur la relation maître-disciple ; une
telle conception permet une lecture pertinente et accessible de l'ensemble des textes
du Chan. Il me semble cependant que si l'auteur a raison d'insister sur le caractère
généalogique du discours Chan, il est loin de tirer toutes les conséquences qu'une telle
observation implique. Le terme de « lignage » est ici utilisé comme presque toujours en
histoire religieuse chinoise, de façon imprécise, pour désigner toute lignée, toute
succession où se transmettent un savoir religieux et des avantages symboliques et
matériels qui l'accompagnent. Mais l'histoire et l'anthropologie des lignages et de la
parenté en Chine ont montré qu'il existe de très nombreuses formes d'organisation
fondées sur la descendance agnatique, et dont certaines se forment à la même époque
que le Chan (et d'autres lignages spirituels chinois). Une attention plus précise et
approfondie au contexte et aux spécificités de l'organisation lignagère du Chan (quels
types de transmission, de cultes aux ancêtres spirituels, quels rapports aux rituels
funéraires, à l'adoption, quel contrôle patriarcal sur les descendants, quels partages et
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
223
gestions des biens matériels et symboliques etc.) aurait encore enrichi l'analyse du
Chan comme une religion « généalogique ».
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
224
Abdallah Makrerougrass,
L'extrémisme pluriel. Le cas de l'Algérie
Paris, L'Harmattan, 2001, 320 p. (coll. « Histoires et Perspectives
Méditerranéennes »)
Constant Hamès
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
225
1 Cet essai de réflexion critique part, d'une certaine façon, de l'idée « qu'il y a toujours de
la naïveté (ou parti pris) à penser que le politique en contexte islamique est celui que
dit le religieux ou inversement, et que l'idéal ab intra du fait coranique est préfiguré par
la réalité vécue du fait islamique » (p. 6), qu'en conséquence, « le temps semble venu
maintenant de soumettre les Instances du religieux et du politique au crible des
questionnements des sciences de l'homme et de la société » (p. 7). Si l'on y ajoute
l'appel, en vue de l'analyse des « discours et représentations, à l'anthropologie,
l'ethnopsychologie et la socio-sémiologie », on n'aura guère de doute sur le modèle
épistémologique de référence, représenté par les travaux de Mohamed Arkoun.
2 L'essai se concentre sur l'Algérie, principalement sur « les idées politiques islamiques
telles qu'elles ont influencé le cours de l'histoire contemporaine de l'Algérie ». La
méthode suivie consiste dans la présentation – parfois la traduction – d'un échantillon
de textes algériens, soigneusement choisis, en ordre chronologique, et commentés dans
l'optique indiquée plus haut. Les textes proviennent : 1) de l'émir Abd el-Kader ; 2) des
idées des « ulamâ » réformistes (islâh) ; 3) du journal al-Moudjahid ; 4) de la revue al-
Asâla ; 5) des discours et textes de l'islamiste Alî ben Hadj.
3 Le cadre épistémologique de la réflexion mêle philosophie, linguistique, histoire et une
certaine psychologie. On trouvera des vues pénétrantes sur des sujets variés, allant de
l'exégèse coranique, comme cette interprétation étonnante mais non invraisemblable
de la sourate al-kawthar, jusqu'aux confréries islamiques, à la démocratie, à la sexualité,
bref, à tout ce que charrient des textes en rapport avec les pouvoirs religieux ou
politiques. On regrettera à de trop nombreuses reprises des formulations
incompréhensibles, par mauvais usage de la langue française et par usage abusif de
l'abstraction, de l'ellipse, du condensé, etc. La transcription de l'arabe date et est
accompagnée de bizarreries.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
226
Ural Manço (éd.), Reconnaissance et
discrimination. Présence de l'islam en
Europe occidentale et en Amérique du
Nord
Paris, L'Harmattan, 2004, 371 p. (coll. « Compétences Interculturelles »)
Nikola Tietze
1 Le livre a pour objectif d'identifier les enjeux de la lutte contre les discriminations que
subissent les populations de confession islamique dans un certain nombre de pays de
l'Union européenne (Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie), au
Canada et aux États-Unis. Dans cette perspective, les auteurs décrivent l'histoire de
l'installation des musulmans dans chacun de ces pays, les profils de leur pratique
religieuse, le degré de l'institutionnalisation de l'islam dans le système de régulation
nationale et les représentations de l'islam qui émergent dans les débats publics
nationaux (concernant ce dernier aspect notamment, cf. le chapitre d'Omero
Marongiu-Perria qui résume d'une manière remarquable l'évolution de l'image des
musulmans en France). Ils tentent ainsi d'articuler la situation et l'organisation des
croyants aux discriminations dont ils peuvent être victimes, notamment après les
attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington.
2 L'enchaînement de problématiques permet d'introduire une réflexion sur les liens
possibles entre l'histoire de l'immigration, les situations socio-économiques des
populations musulmanes et la régulation politique ou juridique de la religion en
général. Grâce à des contributions – comme celle de Jocelyne Cesari (« Islams américain
et européen, modèles divergents mais politiques convergentes dans l'après 11
septembre 2001 ») et celle de Sami Zemmi (« Islamophobie. Clé de lecture de l'exclusion
sociale et politique des musulmans en Occident ») – et à la conclusion particulièrement
intéressante d'U. Manço (sur les différents modes nationaux d'institutionnalisation de
l'islam et qui propose des explications généralisées concernant le traitement
différentiel ou discriminatoire de l'islam par rapport aux autres cultes), l'ouvrage
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
227
collectif surmonte le risque de se restreindre à une juxtaposition des conditions
nationales des musulmans.
3 Par ailleurs, les chapitres concernant chaque pays révèlent des particularités
intéressantes comme par exemple la difficulté des musulmans en Grande-Bretagne à
trouver une place dans le dispositif bien développé de la lutte contre les
discriminations, cette lutte s'articulant autour de la notion de races (ethnicité et origine
nationale), et non autour de celle de religion (cf. Ceri Peach : « Royaume-Uni.
Reconnaissance de l'islam, mais marginalité sociale des musulmans »). Enrique E. Raya
Lozano et Marta Pasadas del Amo décrivent d'une manière convaincante la situation en
Espagne. Ils insistent sur le fait singulier de l'émergence d'un islamo-régionalisme en
Andalousie à la fin des années 1970, porté par quelques désenchantés des mouvements
de gauche et par certains membres de la mouvance alternative. Le rôle des convertis
(pas seulement d'origine espagnole, mais aussi de l'Europe entière qui sont attirés par
des villes comme Grenade, Cordoue ou Séville) semble en outre être plus important
dans l'islam espagnol que dans d'autres pays européens. Denise Helly souligne la forte
hétérogénéité des conditions socio-économiques, des origines ethniques, des pays de
provenance et des courants religieux de l'islam au Canada. Elle empêcherait la
structuration communautaire dans le pays et rendrait la lutte contre les
discriminations particulièrement difficile. Cette auteure apporte par ailleurs une
analyse détaillée des conséquences de la loi antiterroriste canadienne, adoptée après
les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Alors que Claire de Galembert décrit
les imbrications entre le développement de l'islam, la politique de régulation allemande
et la Turquie, Dominik Hanf résume brillamment la gestion de l'islam par la juridiction
allemande qui a longtemps comblé les lacunes, voire l'absence de la politique. Giuliana
Candia met en évidence la rapidité avec laquelle les organisations islamiques se sont
développées en Italie, et souligne leur discours sur la Umma, censée faire lien en dépit
des origines nationales des musulmans dans ce pays. U. Manço et Meryem Kammaz
insistent, en revanche, sur la concurrence entre les organisations islamiques belges qui
entrave l'institutionnalisation de l'islam, déjà défavorisée par un climat de méfiance et
d'ingérence des autorités gouvernementales. Dans cet ensemble de mise en perspective
des situations nationales particulières, il est quelque peu regrettable qu'aucun chapitre
ne soit consacré à des dispositifs anti-discriminatoires supranationaux, telles que les
directives et politiques de régulation au niveau de l'Union Européenne ou du Conseil de
l'Europe.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
228
Paul Mattei, Le christianisme antique
(Ier-Ve siècles)
Paris, Ellipses, 2003, 176 p. (coll. « L'Antiquité : une histoire »)
Rémi Gounelle
1 L'ouvrage que Paul Mattei vient de faire paraître dans la collection « L'Antiquité : une
histoire » est une synthèse introductive sur les cinq premiers siècles du christianisme,
destinée aux étudiants en lettres et en histoire des deux premiers cycles universitaires
et, plus largement, au grand public. Après une présentation du judaïsme du Second
Temple et des paganismes, il s'ouvre par une présentation des questions relatives à
Jésus et à ses disciples ; les deux parties suivantes sont consacrées à « L'Église dans
l'Empire païen (IIe-IIIe siècles) », puis à « L'Église dans l'Empire chrétien ( IVe-Ve
siècles) » ; un bref épilogue présente « l'aube du Moyen-Âge ». En annexe figurent une
carte, un glossaire, une bibliographie et divers documents utiles.
2 Cet ouvrage souffre de plusieurs déficiences sur le plan pédagogique. En premier lieu, le
glossaire ne porte que sur le vocabulaire trinitaire et christologique ; de nombreux
termes techniques utilisés dans l'ouvrage n'y sont pas expliqués, alors même qu'ils sont
absents des dictionnaires courants, comme « hénothéisme », « poliade »,
« hérésiologue » ; d'autres termes tout aussi abscons pour le lectorat visé, ou placés
entre guillemets par l'auteur, vraisemblablement pour attirer l'attention sur les
problèmes de définition qu'ils posent, sont employés avant d'être définis, sans
qu'aucun renvoi ne localise la définition (ainsi p. 61, « apologistes », défini p. 69-70 ;
Hippolyte, employé entre guillemets p. 66, n'est explicité que p. 77 ; p. 105, l'astérisque
suivant « marcellien » renvoie au glossaire, mais la définition se trouve en réalité
p. 109, etc.) ; pour certains de ces termes, comme, sauf erreur, « philosophe », l'auteur
ne prend jamais la peine de préciser, pour le lecteur profane, en quoi ils posent
problème ni où il pourra trouver plus ample information sur leur signification.
3 En second lieu, sur beaucoup de sujets, Paul Mattei en dit trop ou trop peu. Ainsi écrit-il
p. 23 : « peut-être » le troisième siècle « fut-il un “âge d'angoisse” », sans expliquer ce à
quoi cette expression renvoie et en ne signalant que grâce à un discret « peut-être »
quelles réserves elle peut susciter. Il aurait été plus pédagogique soit de supprimer ce
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
229
clin d'œil savant mais incompréhensible pour le lectorat visé, soit de prendre quelques
lignes pour en dire plus. De même, p. 147, écrire que, « dans la théologie, à côté de
l'argument scripturaire, l'argument patristique se développe », sans expliquer de quoi
il s'agit, est supposer, de la part du lectorat visé, une surprenante connaissance
préalable du sujet.
4 En troisième lieu, le souci – légitime – de simplification des données historiques qui
anime Paul Mattei l'a parfois conduit à des énoncés abusifs. Ainsi, p. 67, affirmer que le
« retour au calme » après les persécutions « fut définitif avec le prétendu “édit de
Milan” (313) », sur lequel le lecteur ne saura rien de plus, est au mieux trompeur ; les
politiques antichrétiennes de Maximin Daïa et de Licinius seraient-elles donc quantité
négligeable ? Il aurait été plus correct – et pas moins concis – d'écrire que le « retour au
calme » après les persécutions « commença avec le prétendu “édit de Milan” ». Dans
d'autres cas, cet essai de simplication aboutit à des résultats peu heureux : il est déjà
surprenant d'apprendre qu'il existe des « homéens de droite » et « de gauche », mais
que penser lorsqu'on lit p. 110 que les « homéens de gauche » sont « en fait ariens » et
que ceux « de droite » sont « en fait orthodoxes » ?
5 On regrettera, enfin, les jugements à l'emporte-pièce formulés par Paul Mattei, pour
qui, par exemple, le « formalisme » de la religion traditionnelle « ne satisfait sans doute
aucun besoin religieux intime » (p. 22) ou le monothélisme est une « cote mal taillée
entre le chalcédonianisme (...) et le monophysisme » (p. 161).
6 Sur un plan scientifique, et nonobstant les raccourcis signalés précédemment,
l'ouvrage ne tient pas toujours compte des développements récents sur le sujet. C'est
en particulier le cas pour ce qui concerne la religion traditionnelle païenne et le
phénomène de conversion, où les travaux de R. McMullen et d'autres ne semblent avoir
guère laissé de trace. L'auteur définit ainsi la « nouvelle religiosité » comme la « quête
d'un salut individuel » (p. 23), sans préciser qu'il s'agissait d'un salut matériel (santé,
bonnes récoltes...) recherché dans l'ici-bas. Le dernier paragraphe de la p. 25, sur les
différences entre cette religiosité et le christianisme, est teinté des anciens acquis de la
science des religions et passe à côté des divergences perceptibles dans l'univers mental
des païens et des chrétiens des IIe-IIIe siècles ; les rapports entre christianisme et
religion traditionnelle à cette époque n'étaient en effet qu'exceptionnellement pensés
en termes de « métaphysique », pour reprendre un terme employé par Paul Mattei
(p. 63) ; ce regard biaisé le contraint d'ailleurs à expliquer par une pirouette douteuse
l'absence d'exposé sur les « spécificités dogmatiques » dans l'œuvre des apologistes
(p. 70). De même, p. 56, le résumé des motifs de conversion au christianisme est centré
sur le témoignage des seuls intellectuels (Justin, Cyprien, Tertullien), que l'on ne
saurait considérer comme représentatif ; il met insuffisamment en valeur le rôle joué
par les martyrs et gomme l'importance des miracles, dont on connaît pourtant la
prégnance aux IIe-IIIe siècles, et pas seulement pour le développement du christianisme.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
230
Jean-François Mayer, Reender
Kranenborg (eds.), La naissance des
nouvelles religions
Genève, Georg Éditeur, 2004, 212 p.
Nadia Garnoussi
1 Cet ouvrage collectif qui rassemble sept études de cas, s'attache à une question de fond
pour la sociologie des nouveaux mouvements religieux : quels outils et quels critères
utiliser aujourd'hui pour distinguer les nouveaux mouvements qui restent inscrits dans
la continuité d'une tradition religieuse antérieure des mouvements suffisamment
novateurs et originaux pour prétendre au statut de « nouvelle religion » ?
2 Comme nous le fait remarquer J.-F. Mayer, le terme même de « NMR » est actuellement
employé pour désigner à l'intérieur du champ religieux contemporain un foisonnement
de courants qui s'écartent plus ou moins nettement des traditions religieuses
classiques. Le développement particulièrement rapide des « NMR » depuis quelques
décennies, accentué par le processus encore récent de la globalisation, a très
certainement contribué à la difficulté de dégager les spécificités de chacun de ces
mouvements. D'autant plus que la légitimité de ces objets d'étude dans une sociologie
dominée par l'étude des traditions séculaires ne s'est pas imposée comme une
évidence ; ainsi le caractère marginal des mouvements en question peut continuer de
l'emporter sur la considération de leur potentiel à s'établir de façon durable et à
constituer dans l'avenir une nouvelle tradition.
3 Pour identifier dans le champ très vaste et mouvant des « NMR », ces religions en train
de se faire, J.-F. Mayer dégage plusieurs paramètres majeurs à partir desquels peut
s'opérer une véritable classification sociologique des différents mouvements en évitant
le piège de s'en remettre à des critères d'ordre théologique : la relation et la place
accordée aux livres sacrés (lesquelles assurent ou non la continuité avec la tradition
antérieure), la question des sources et de leur éclectisme (l'auteur insiste sur la
distinction entre le syncrétisme classique qui naît de la rencontre entre plusieurs
traditions et le « néo-syncrétisme » qui consiste à emprunter délibérément à diverses
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
231
traditions lointaines), la structure de l'organisation (plus ou moins en rupture avec la
tradition), les doctrines et les croyances, les rites et les pratiques, et enfin les
interactions avec la culture religieuse et séculière dominante. L'ensemble de ces
paramètres met en exergue l'importance des apports de l'histoire des religions et la
nécessité pour la sociologie des nouveaux mouvements religieux de s'y référer
constamment. C'est une exigence à laquelle répondent précisément les sept études de
cas qui constituent un éventail de terrains divers et originaux : l'Église de l'unification
(G. D. Chryssides), le caodaïsme (C. Hartney), le mormonisme (M. Introvigne), les
Brahma Kumaris (R. Kranenborg), la Révélation d'Arès (J.-F. Mayer), la religion baha'ie
(M. Warburg), et l'aumisme (P. L. Zoccatelli).
4 Les études s'appuient sur une réflexion théorique synthétique et sur des observations
détaillées du terrain expliquant la genèse des mouvements, leurs conditions
d'émergence, les évolutions des pratiques, des rites et des croyances dans le temps ainsi
que leurs éventuelles stratégies adaptative. Chacune exemplifie des modalités
particulières d'adaptation, de rupture ou d'assimilation d'un mouvement donné avec la
tradition religieuse qui l'a vu naître et interroge sa capacité à devenir à son tour une
nouvelle religion. Le cas de l'Église de l'unification pose le problème d'une
confrontation entre l'auto-définition du mouvement comme composante du
christianisme et la volonté de l'Église officielle de l'en exclure. Dans ce cas, l'évolution
du mouvement peut conduire soit à une différenciation plus nette, soit à un
rapprochement progressif avec la tradition qui freinerait son caractère véritablement
novateur, comme cela a pu se produire dans le mormonisme devenu une « nouvelle
tradition religieuse dans le christianisme ». L'inscription en arrière-plan dans une ou
plusieurs traditions anciennes peut également qualifier une « foi nouvelle » et
syncrétique ; c'est le cas du caodaïsme qui s'est développé en période de crise sociale
dans le contexte du Vietnam colonial. Mais d'autres mouvements attestent d'une
rupture plus radicale, posant en d'autres termes la question de leur statut. Ainsi, la
Révélation d'Arès, en France, qui se présente comme une « voie spirituelle » et non pas
comme une religion pour ses adeptes, est, d'un point de vue sociologique, suffisamment
novatrice pour constituer un « embryon » de nouvelle religion (c'est-à-dire un
« ensemble de croyances, doctrines, pratiques et rites permettant à des êtres humains
de définir leurs relations avec des dimensions considérées comme transcendantes ainsi
que d'interpréter l'origine et la finalité de l'existence », p. 142). Un autre cas
d'émancipation des traditions et d'élaboration d'un régime propre et unifié de
croyances et de pratiques est représenté par le mouvement des Brahma Kumaris
apparu en Inde. En intégrant des influences occidentales et une orientation
psychologique, il incarnerait potentiellement une « nouvelle religion mondiale » ; en
effet, on assiste dans ce cas à une diffusion transnationale du mouvement qui l'éloigne
progressivement de son terreau religieux originel. Mais, certains « nouveaux
mouvements » ne seraient-ils pas déjà devenus des religions à part entière ? C'est ce
que suggère l'étude du babisme, issu d'une branche dissidente du chiisme dans l'Iran
des années 1840 ; sa volonté d'indépendance en fait un cas isolé dans l'histoire de
l'islam et lui a permis de se développer en tant que religion « de plein droit », qui est
implantée aujourd'hui dans le monde entier avec plus de 5 millions de membres. Enfin,
la dernière étude de cas rend compte de la structure doctrinale et symbolique de
l'aumisme. Elle propose de sortir des catégories propres au champ religieux pour
désigner un nouveau contexte contenant d'autres « réalités spirituelles » au sens large,
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
232
dans lequel s'affirmerait le « paradigme ésotérique » dont l'aumisme serait une
déclinaison possible.
5 La diversité des cas analysés dans cet ouvrage permet ainsi d'élargir et d'approfondir
un certain nombre de perspectives ayant trait au champ aujourd'hui très vaste des
mouvements religieux en marge des traditions classiques. L'un des apports des travaux
réunis ici est la mise en évidence de la pluralité des stratégies et des options adoptées
par les NMR qui, au-delà de leurs convergences, doivent être replacés dans un contexte
social, culturel et religieux précis. Mais ils manifestent également la nécessité d'affiner
les outils théoriques et conceptuels de la sociologie, afin de parvenir à distinguer dans
un espace très mouvant les éléments susceptibles de constituer dans un avenir plus ou
moins proche une tradition, ou un credo, amenés à se diffuser plus largement dans une
ou des sociétés qui voient circuler désormais des ressources religieuses de tous
horizons. Reste à savoir s'il appartient au sociologue de prédire l'avenir des groupes
qu'il étudie.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
233
Charles Mopsik, Chemins de la cabale.
Vingt-cinq études sur la mystique juive
Paris, Éditions de l'éclat, 2004, 468 p.
Maurice-Ruben Hayoun
1 Ce n'est pas sans émotion que le recenseur ouvre cet ouvrage du regretté Charles
Mopsik, disparu avant d'avoir pu donner toute sa mesure mais dont l'œuvre, ici comme
à l'étranger, restera inséparable des recherches pionnières en matière d'études
kabbalistiques. Rien, à l'origine, ne destinait cet homme, venu d'horizons si éloignés à
faire œuvre dans le domaine des études juives et à entamer avec un courage frisant
l'audace, la traduction du Sefer ha-Zohar (Livre de la splendeur).
2 Les vingt-cinq études et articles ici réunis nous présentent l'auteur sous divers aspects ;
on y lit un chercheur qui se confronte à une matière réputée difficile, armé des
instruments de la critique historique et philologique et l'on y découvre aussi un
penseur qui n'hésite pas à se poser des questions et à nous livrer ses réflexions
personnelles : c'est le cas de la première contribution portant sur la philosophie et le
souci philosophique. Mopsik conteste avec raison la dichotomie injustifiée entre
philosophie et kabbale, et souligne que l'écriture de l'histoire de cette philosophie ne
coïncide pas toujours avec les développements de la spéculation réelle...
3 On peut faire la même observation concernant l'esquisse d'une « philosophie
d'Auschwitz » : partant de textes antiques et médiévaux, Mopsik tente de brosser un
tableau des relations complexes dans le judaïsme entre la faute, le châtiment et la
théodicée, ce qui contribue à faire naître une pensée juive vivante et non plus
simplement de l'histoire ou une archéologie de la pensée juive.
4 Il ne faut pas commettre de contre sens : la plupart des textes ici allégués ne
prétendent pas traiter les sujets qu'ils annoncent mais ouvrent des perspectives
intéressantes sur des sujets tels que Maimonide et la kabbale, la lecture de l'invisible ou
les relations entre l'oralité et la transmission écrite de mystères de la Tora dont
l'élucidation est proposée par un magguid, un mentor céleste... Ceci nous vaut des
quelques pages consacrées à la symbolique des couleurs alors que Gershom Scholem
avait rédigé une très savante et très complète dissertation sur le sujet... Autrement plus
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
234
sérieuse est l'étude qui traite (sur près de trente pages) de l'unité de l'être et de l'unité
de Dieu où de copieuses citations tirées d'œuvres mystiques classiques forment une
armature considérable... La forme suprême de l'unité divine est symbolisée par une
hiérogamie, une union intime du masculin et du féminin, préfigurant celle de l'homme
et de son épouse ici bas, la veille du sabbat. Certaines études, brèves et concises,
centrées autour de la littérature zoharique, ouvrent des chantiers qui s'avèreront utiles
pour les chercheurs futurs. Notamment celle portant sur les controverses autour du
Zohar. Dans ces cas précis, Ch. Mopsik donne toute sa mesure. Comme il le fit d'ailleurs
dans ses traductions qui ne manqueront pas de rendre des services précieux aux
chercheurs à venir.
5 À cet homme et à son œuvre s'applique le vers poignant de la poétesse, ashré ha-zor'im
we-eynam kotsrim : bienheureux ceux qui sèment mais ne récoltent pas.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
235
Amanda Porterfield, Peter
E. Williams, American Religious
History /Perspectives on American
Religion and Culture
Malden, Mass., Blackwell, 2002, 338 p. (coll. « Blackwell Readers in
American Social and Cultural History »)/ Malden, Mass., Blackwell, 1999,
418 p.
Isabelle Richet
1 L'intérêt croissant pour l'étude du fait religieux dans les premiers cycles universitaires
d'Études américaines et d'histoire des États-Unis, outre-Atlantique comme au
Royaume-Uni, explique la multiplication des recueils de textes ou d'articles
thématiques alors que, depuis les ouvrages de Sidney Ahlstrom en 1972 et de Catherine
Albanese en 1981, aucun auteur ne se risque plus à offrir une synthèse d'un phénomène
dont l'étude est désormais dominée par le paradigme pluraliste. On a là deux exemples
complémentaires du type de manuels publiés aujourd'hui qui offrent une solide
introduction à l'histoire de la religion aux États-Unis. L'ouvrage dirigé par Amanda
Porterfield regroupe des sources primaires et des études historiques devenues depuis
longtemps des classiques. Dans une introduction très dense, l'auteure présente ce
qu'elle considère comme les quatre éléments fondateurs de l'histoire de la religion aux
États-Unis : la liberté religieuse, l'expérience individuelle, la vie familiale et les
réformes sociales. Ces thèmes ont structuré les choix à la fois des essais historiques et
des sources primaires. La première partie regroupe neuf textes allant d'une étude
classique de Perry Miller sur les puritains à un article portant sur les femmes
musulmanes dans les États-Unis contemporains ; les autres textes portent sur
l'émergence du courant évangélique au dix-neuvième siècle, l'establishment protestant
libéral, le fondamentalisme, le catholicisme, le judaïsme et le bouddhisme. Chacun de
ces textes, écrits par les meilleurs spécialistes, étudie ces traditions du point de vue de
leur expérience particulière. Par contre, le texte de Catherine Albanese, « Exchanging
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
236
selves, exchanging souls » traite de la rencontre entre différentes traditions et des
rapports entre diversité et syncrétisme dans l'histoire religieuse des États-Unis.
2 La seconde partie présente trente-quatre sources primaires et on imagine aisément les
dilemmes qui ont dû accompagner leur sélection, étant données la grande richesse et
diversité de cette histoire. L'ensemble offre une lecture très stimulante, même si
certains choix ne sont pas toujours convaincants. Ainsi les puritains monopolisent les
cinq textes consacrés à la période coloniale, ce qui ne rend pas compte de nombreuses
autres expériences qui ont participé de l'aspiration à la liberté religieuse, présentée
dans l'introduction comme un des quatre thèmes structurants de cet ouvrage. La même
remarque peut s'appliquer au choix de documents pour la période révolutionnaire qui
se limite au texte de la loi de Jefferson sur la liberté religieuse en Virginie. Par contre,
les réveils et la diversification de l'expérience religieuse au dix-neuvième siècle sont
mieux couverts, même si on regrettera l'absence de textes rendant compte de
l'expérience des immigrants catholiques et protestants et des esclaves noirs, tout
comme des puissants mouvements de réforme d'inspiration religieuse (abolitionnisme,
tempérance, droit des femmes) alors qu'il s'agit d'un autre des thèmes fondateurs
présentés dans l'introduction. Le vingtième siècle est de loin le mieux couvert avec une
sélection de textes qui rend compte à la fois du dynamisme et de la fragmentation de
l'expérience religieuse des Américains, même si, encore une fois, on pourra
questionner certains oublis (le pentecôtisme ?). Mais ces manques reflètent surtout la
difficulté de restituer dans un seul ouvrage l'extrême diversité de l'expérience
religieuse étasunienne et ne diminuent en rien l'intérêt de la sélection présentée par
A. Porterfield.
3 Peter Willliams a, lui, fait un choix différent, tout d'abord en centrant son ouvrage sur
l'interaction entre religion et culture au cours de l'histoire étasunienne, ensuite en
demandant à certains des chercheurs les plus innovateurs du moment d'écrire des
essais originaux pour ce manuel, ce qui donne une grande cohérence à l'ensemble
présenté. Les textes sont regroupés en sept parties : diversité religieuse et pluralisme,
les racines religieuses de la culture américaine, les cultures religieuses en transition, la
culture populaire et matérielle, les questions raciales et ethniques, le genre et la
famille, la vie intellectuelle et littéraire. L'accent est mis avant tout sur les apports
récents de la recherche qui ont rejeté les grands récits privilégiant les approches
institutionnelles et le prisme puritain comme principe organisateur de la dynamique de
la religion aux États-Unis, en faveur d'une approche interdisciplinaire s'intéressant
avant tout au pluralisme, à la culture populaire et à la religion vécue. Introduction
stimulante aux évolutions de la recherche, l'ouvrage permet aussi, par la diversité et
l'originalité des thèmes abordés, de saisir dans toute son épaisseur l'expérience
religieuse étasunienne.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
237
Geneviève Poujol, Un féminisme sous
tutelle. Les protestantes françaises
(1810-1960)
Paris, Les éditions de Paris – Max Chaleil, 2003, 286 p.
Patrick Harismendy
1 Spécialiste incontestée de sociologie des organisations religieuses, l'auteure livre ici un
ouvrage original à plus d'un titre. D'abord par sa forme. En effet, deux parties
chronologiques et analytiques (1914 servant de césure de part et d'autre) sont suivies
d'un ample « répertoire biographique » de 135 noms qui complète utilement le
Dictionnaire du monde religieux contemporain – Les protestants dont on aurait pu reprocher
la misogynie tant y étaient rares les femmes présentées. Le choix de photos bien venues
et placées en discrètes vignettes accroît d'ailleurs le plaisir de lecture et renforce le
caractère vivant du propos. Et c'est justement le fond même de l'enquête qui s'avère
intéressant. Loin des clichés ou de corrections sociologiques très récentes (et encore
accentuées par les initiatives venues de l'étranger), l'auteure préfère la prudence pour
ne pas surévaluer un rôle et une éventuelle « avance » des protestantes sur le terrain
du féminisme (ou des formes d'émancipation). Il n'en reste pas moins que l'étude
s'attache surtout aux militantes.
2 Après une rapide mise en place du décor, consacré aux grandes lignes du
protestantisme français au début de l'époque contemporaine, G. Poujol s'attache à
décrire deux mouvements temporels qui lui semblent pouvoir rendre compte du
dossier. Selon elle – et c'est la justification du titre – le long XIXe siècle allant jusqu'en
1914, aurait, malgré l'émergence de structures d'autonomisation (comme les UCJF
[Unions chrétiennes des jeunes filles]) été marqué par une constante dépendance des
femmes à l'égard d'un encadrement masculin pesant. Le phénomène – qui n'est tout de
même pas spécifique au protestantisme et encore moins au protestantisme français –
est en effet significatif au cours des deux premiers tiers du XIXe siècle. Au mieux,
observe-t-elle au sein d'œuvres purement féminines (Les Amies de la jeune fille, la Société
des fourmis...), que leur naissance comme structures d'Églises les priva de
développements potentiels. Entre le contrôle pastoral – assez inattendu et fort bien mis
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
238
en lumière, venant du christianisme social – ou les clivages entre militantes HSP (Haute
société protestante) (Sarah Monod, Julie Siegfried...) et déléguées plus ambitieuses, on
comprend mieux la timidité à réclamer le droit de suffrage politique (accordé pour les
élections presbytérales en 1905), la relative inefficacité du Conseil national des femmes
françaises né en 1901 sur le modèle américain, le tout dicté par la crainte d'offrir les
électrices catholiques en offrande à l'Église ! Cette impasse explique pour la seconde
période allant jusqu'à la fin des années 1960, le redéploiement des initiatives au service
des femmes elles-mêmes et non plus comme pièces adventices du service d'Église. La
longue filiation reliant l'École Florence Nightingale (1903) à la Cimade ou aux diverses
maisons de santé protestantes souligne un vrai domaine d'excellence. G. Poujol signale
avec raison que de telles structures n'auraient pu perdurer sans un constant
rajeunissement idéologique et l'investissement de nouveaux champs. À cet égard, les
pages consacrées à l'entre-deux guerres font mieux comprendre l'apparition du
Planning familial et la naissance du mouvement Jeunes femmes. On savait déjà
l'importance de la matrice unioniste et de la Fédération française des éclaireuses. On
savait moins l'importance de débats intellectuels touchant à la morale familiale, à la
définition de l'équité dans le couple, à la crainte puis à la volonté parfois missionnaire
de choisir un époux non-protestant. L'auteure souligne aussi la permanence, sinon de
conflits, du moins de sévères rivalités entre diverses formes d'engagements qui
prolongent en plein XXe siècle des concurrences anciennes. Dans une conclusion à la
fois nuancée et récapitulative de « générations » qu'elle croit pouvoir distinguer, elle
s'interroge finalement sur l'originalité éventuelle du « féminisme protestant ». Elle en
signale deux traits : d'une part que la dimension militante en faveur de droits négociés
de la femme a prévalu sur un féminisme fourre-tout, mal circonscrit et peu
émancipateur ; d'autre part, que minorité d'une minorité, les femmes protestantes ont
dû se frayer un chemin entre la subculture républicaine et les relents de modèles
étrangers. Dans ces conditions, une voie française serait identifiable.
3 Bien documenté et synthétique de travaux souvent dispersés, cet ouvrage commode
pêche cependant peut-être par excès de pessimisme concernant le XIXe siècle. S'il est en
effet évident qu'une forme d'aliénation ait frappé les femmes à cette époque, même
dans leurs gestes ou leurs initiatives d'émancipation, une lecture globale des
conformismes, incluant donc les inerties pesant aussi sur les hommes aurait sans doute
permis de nuancer (et de renforcer) le propos, car les postures sociales furent également
extrêmement contraignantes pour les hommes.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
239
Freddy Raphael, Regards sur la
culture judéo-alsacienne. Des identités
en partage
Strasbourg, La nuée bleue, 2001, 287 p.
Régine Azria
1 De cet ouvrage collectif, l'idée forte qui reste est celle de l'ambivalence entre
l'attachement à une région où la présence juive remonte au Moyen Âge, et la mémoire
des persécutions et des discriminations que les juifs y ont subies. Ce judaïsme
populaire, composé de marchands de bestiaux et de grains, de bouchers, de colporteurs,
de fripiers, largement rural quoique non paysan en raison de l'interdiction faite aux
juifs de posséder et de cultiver des terres, a laissé peu de traces en matière
d'architecture : de petites synagogues de campagne (plus de 150 édifiées au XIXe siècle),
des pierres tombales, de vieux cimetières, souvent abandonnés faute d'une présence
juive restée sur place. Et pourtant l'identité judéo-alsacienne est revendiquée avec
force, une identité également inscrite dans une langue, le judéo-alsacien (langue-
mémoire et langue-conservatoire selon F. Raphaël) parlée par des générations de juifs.
Les pages de ce volume en témoignent. Si cette région a fourni de nombreux rabbins et
responsables communautaires à l'ensemble du judaïsme français, à commencer par
David Sintzheim, le président du Grand Sanhédrin convoqué par Napoléon I er et qui fut
le premier grand rabbin de France, il demeure que cette fraction du judaïsme français
doit une part de sa singularité au statut concordataire qui a survécu au retour de
l'Alsace à la France. Pourtant le XXe siècle a provoqué de profonds bouleversements : de
rural (à la veille de la Première Guerre mondiale, les deux tiers des juifs d'Alsace
vivaient encore dans des villages et des bourgades), le judaïsme alsacien est devenu
essentiellement citadin ; le génocide l'a privé d'une partie de ses forces vives ; quant à
l'État d'Israël, il a attiré une partie de ses élites, de ses cadres communautaires et
religieux, ainsi qu'une fraction de sa jeunesse, alors même que Paris en avait déjà attiré
bien d'autres qui avaient fait le choix de la France en 1870 ; pertes en partie
compensées par l'arrivée de juifs d'Europe du centre et de l'Est puis d'Afrique du Nord.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
240
2 C'est à une visite guidée au sein de cette histoire et de cette mémoire que nous convient
les quinze contributions de ce recueil, élégamment encadrées par une introduction et
une conclusion de F. Raphaël, le maître d'œuvre. L'ensemble est issu d'un colloque tenu
à Strasbourg en 2000 à l'initiative du Consistoire du Bas-Rhin, avec le partenariat de la
ville de Strasbourg, du Conseil régional d'Alsace, du Conseil général du Bas-Rhin, de
l'Université Marc-Bloch de Strasbourg et de la Société d'histoire des israélites d'Alsace
et de Lorraine.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
241
Bernard Rigo, Altérité polynésienne,
ou les métamorphoses de l'espace-temps
Paris, CNRS éditions, 2004, 350 p. (coll. « CNRS communication »)
Yannick Fer
1 Ce livre ne manque pas d'ambition, puisqu'il s'agit en quelque sorte de (ré)inventer le
regard anthropologique : « le sujet occidental [parlant] surtout de lui quand il prétend
parler de l'Autre » (p. 8). B. Rigo se propose d'explorer cet « autre » en s'intéressant
« au fond même de la sacralité polynésienne », débarrassée des projections occidentales
qui voient toujours l'autre sous les aspects du même. Ce qui est une autre manière –
simplement inversée – de projeter sur la culture polynésienne un ensemble de
présupposés : la langue, la mythologie et même le christianisme contemporain
renverraient ainsi, en Polynésie française, à une altérité a-historique, irréductible et
indépassable, signalée par une série de concepts sans équivalents dans la pensée
occidentale, mana, hau et tapu étant les plus connus. Il faudrait donc envisager l'identité
polynésienne à travers des notions spécifiques telles que le « continuum vertical », une
« vision énergétique [qui] implique de penser à la fois la continuité, l'instabilité, la
pluralité et le discontinu » (chap. 3).
2 Il n'est pas forcément inutile de pointer les biais ethnocentriques qui persistent à
détourner bon nombre d'analyses anthropologiques des réalités de la société
polynésienne contemporaine, ce à quoi l'auteur s'est d'ailleurs employé avec un certain
succès dans un livre précédent (Lieux-dits d'un malentendu culturel, éd. Au Vent des îles,
Papeete, 1993). Mais à trop vouloir se défaire de cet ethnocentrisme, l'auteur prend ici
le risque de tomber dans un autre travers, celui d'une sorte d'« ethnocentrisme
inversé » faisant de l'altérité polynésienne – qui n'est que relative – un absolu, au point
de rendre finalement impossible toute entreprise de traduction.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
242
Wade Clark Roof (ed.), Contemporary
American Religion
2 vols., New York, MacMillan, 2000, 861 p.
Isabelle Richet
1 Avec cette encyclopédie en deux volumes Wade Clark Roof et ses auteurs offrent aux
chercheurs un outil fort utile pour se repérer dans l'incroyable foisonnement de la
scène religieuse étasunienne contemporaine. La sélection de plus de 500 entrées a été
guidée par le souci de rendre compte des grandes tendances qui définissent, au début
de ce millénaire, la vie religieuse des Américains. La première est le processus de
désinstitutionnalisation de la religion, qui amène les auteurs à s'intéresser avant tout
aux manifestations populaires de la foi et des pratiques. La religion vécue n'est donc
pas simplement une entrée, mais un des fils rouges reliant beaucoup des articles qui
mettent l'accent sur la religion en tant qu'expérience, sur les pratiques religieuses
ordinaires, sur la façon dont les croyances religieuses affectent les décisions des
croyants dans leur vie quotidienne. Une seconde tendance est le pluralisme croissant
de la scène religieuse, certes caractéristique de l'histoire de la religion aux États-Unis
depuis le départ, mais qui a connu une expansion nouvelle après les lois de 1965
libéralisant l'immigration. Le souci, là, a été de présenter dans toute leur diversité les
organisations, les croyances, les pratiques des nouvelles religions dont la présence est
de plus en plus visible dans les communautés américaines, mais aussi de présenter les
religions « américaines » – indigènes ou d'origine européenne – aux nouveaux venus.
Enfin, les entrées s'efforcent aussi de rendre compte de la façon dont la croissance de
l'autonomie individuelle des croyants nourrit une quête religieuse caractérisée par un
très grand éclectisme. Toutes les entrées sont accompagnées d'une brève bibliographie
présentant les ouvrages essentiels sur la notion, ainsi que des références croisées
permettant de saisir les liens entre les phénomènes analysés séparément. Enfin près de
200 photographies apportent une illustration visuelle bienvenue de beaucoup des
notions et pratiques discutées.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
243
Islam, Sectarianism and Politics in
Sudan since the Mahdiyya
Hurst & Company, Londres, 2003, 252 p.
Claude Arditi
1 Cet ouvrage est précédé de plusieurs autres que l'auteur a consacrés à l'islam et à
la politique au Soudan et en Égypte. Celui-ci qui condense les résultats de trente ans de
recherches est consacré à une situation très particulière qui est celle du mouvement de
la Mahdiyya au XIXe siècle. Elle constitue un cas unique d'État islamique ayant réussi à
expulser les occupants étrangers et à connaître des succès avant que les intérêts de
l'impérialisme britannique ne parviennent à le détruire. En 1898 le consul général
britannique du Caire élabora « un condominium agreement » qui réglementait les
conditions dans lesquelles le Soudan anglo-égyptien devait être administré. Les
dirigeants turco-égyptiens qui avaient gouverné le Soudan auparavant avaient été
battus par un mouvement politique musulman et avaient dû quitter le pays dans les
années 1880. Un État islamique avait été instauré. Il paraît normal dans ces conditions
que le pouvoir colonial qui dirigeait le Soudan ait voulu extirper l'islam de la vie
politique ou pour utiliser une terminologie occidentale séparer l'Église et l'État. Si les
musulmans furent autorisés à pratiquer leur religion et à établir une justice fondée sur
la shari'a dont les tribunaux traitaient les affaires relevant de la sphère privée, un
gouvernement séculier composé d'administrateurs anglais aidés de quelques Égyptiens
exerça le pouvoir politique. Il était prévu, sans autre précision, qu'une démocratie de
type britannique soit progressivement instaurée dans le pays ainsi que dans les autres
pays africains sous influence anglaise. Ce scénario ne s'est pas produit et l'auteur se
demande si cet échec doit être imputé au colonisateur ou au fait que l'idée de séparer
religion et politique est, dans le monde musulman, une contradiction dans les termes.
En réalité l'auteur pense que les musulmans n'étaient pas désireux ou pas encore prêts
à accepter la démocratie propagée par les colonisateurs.
2 C'est ce thème qui constitue le sujet principal de l'ouvrage et bien que ne soit étudié
ici que le Soudan, cette question se pose aussi dans l'ensemble du monde musulman.
L'auteur a déjà approfondi ce thème dans d'autres ouvrages. Il se limite ici à analyser le
rôle de l'islam dans la vie politique du Soudan depuis la Mahdiyya jusqu'à
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
244
l'indépendance en 1956. Il remarque que l'étude du Soudan depuis l'indépendance
s'avère beaucoup plus problématique que l'étude de la période du coup d'État islamiste,
perpétré par des militaires en 1989. Dans un dernier chapitre intitulé « Islam et
démocratie » l'auteur examine les travaux qui ont été consacrés à cette question.
3 Dans les sociétés qui sont profondément marquées par des divisions religieuses,
culturelles, linguistiques etc., la flexibilité nécessaire à l'émergence d'une démocratie
est absente, remarque A. Lijphart, (Democraties: Patterns of Majoritarian and Consensus
Government in Twenty-one Countries, Londres,Yale University Press, 1984). D'autres
auteurs tels que J. Esposito et J. Voll (Islam and Democracy, Oxford, Oxford University
Press, 1983) adoptent des points de vue contraires et soutiennent que les mouvements
religieux de la fin du XXe siècle ont favorisé la formation de systèmes politiques plus
démocratiques. Bien que les travaux de ces auteurs ne soient, ni consacrés au Soudan,
ni à la diversité culturelle, Warburg les trouve pertinents pour comprendre les pays
multireligieux. Si une majorité impose ses convictions religieuses à une minorité, est-
on toujours en démocratie, se demande t-il ? Le statut de ahl al-dhimmah qui est proposé
aux non-musulmans dans un État islamique est-il démocratique ? Le nationalisme
ethnique, fondé sur l'idéal de l'arabité, qui a dominé la vie politique du Soudan depuis
l'indépendance conduit-il à la coexistence avec les autres religions dans un contexte
démocratique ? Telles sont les principales questions que se pose Warburg. Pour
Esposito et Voll il n'y pas d'opposition de principe entre islam et démocratie mais le
problème réside plutôt dans les différentes manières dont ces deux entités sont reliées
l'une à l'autre. En conclusion, Warburg évoque les opinions d'observateurs soudanais
sur ces questions. Pour Muhammad Ibrahim Khalil, qui enseigne le droit musulman,
l'échec de la démocratie est à mettre en relation avec le faible niveau d'éducation. Mais
ce dernier ne constitue pas un obstacle insurmontable. Pour cet auteur seuls les
fondamentalistes pensent que islam et démocratie sont incompatibles. Il ajoute qu'une
lecture attentive du Coran montre qu'une démocratie et un gouvernement
constitutionnel ne sont nullement en contradiction avec l'esprit du livre saint et qu'une
constitution laïque peut en être extraite.
4 Si un État basé sur l'islam peut être démocratique, pourquoi a-t-on connu autant
d'échecs au Soudan et ailleurs, se demande alors Warburg. Mohamed Ahmed Mahgoub,
premier Ministre dans les années 1960, répond (Democracy on Tria: Reflections on Arab and
Africa Politics, Londres, Deutsch, 1974) que le démocratie a échoué dans toute l'Afrique
et pas seulement au Soudan. Les raisons doivent en être cherchées, selon lui, dans
l'incapacité des politiciens à formuler des politiques cohérentes, dans des rivalités de
personnes et dans la recherche du profit à court terme. Pourtant le cas du Soudan
présente deux particularités : d'une part sa première expérience historique de l'État est
intervenue dans le cadre d'un État islamique et de l'autre les confréries, conséquence
du néo-mahdisme, ont joué un rôle de premier plan aussi bien à l'époque coloniale
qu'après l'indépendance. En conséquence, de nombreux auteurs soudanais et
occidentaux attribuent l'échec de la démocratie aux confréries plutôt qu'à l'islam.
5 B. Lewis, quant à lui, reconnaît avec une certaine tristesse que la tolérance pratiquée
par l'islam traditionnel n'existe plus et que les minorités non-musulmanes ont de nos
jours moins de droits que dans le passé. Considérant qu'il n'existe pas de contradiction
entre islam et démocratie, il pense que la doctrine islamique est autocratique mais non
dictatoriale et que ses dirigeants ne sont pas au-dessus des lois.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
245
AUTEUR
CLAUDE ARDITI
Gabriel Warburg
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
246
Robert Wuthnow, All in Sync. How
Music and Art Are Revitalizing
American Religion
Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 2003, 284
p.
François Picard
1 L'auteur part du constat que les Églises américaines n'ont pas subi au cours des trois
dernières décennies du XXe siècle le déclin annoncé. Il établit, références statistiques à
l'appui, que la participation aux services (churchgoing) n'a pas diminué, puis il explique
pourquoi (urbanisation, divorce, travail des femmes, déménagements, niveau d'études)
les observateurs s'attendaient à un déclin. Il rejette néanmoins ces explications tout
autant que les tentatives d'expliquer la vitalité religieuse par le conservatisme, la
création de megachurches ou l'originalité des confessions évangéliques. Enfin, il met en
doute la pertinence de la théorie de la secularization et de la privatization de la religion,
suggérant (p. 19) que l'intérêt croissant pour les arts (musique, arts plastiques, poésie)
a été capté (absorbed) par les Églises.
2 L'ouvrage est complété par un appendice méthodologique et un index. L'étude s'appuie
sur de grandes études comme celle de la General Social Surveys ou sur d'autres études à
grande échelle, et sur des entretiens approfondis. Elle complète celle sur les relations
entre spiritualité et les arts chez des artistes professionnels, publiée sous le titre
Creative Spirituality: The Way of the Artists, University of California Press, 2001.
3 L'auteur interroge des concepts ou des faits sociaux aussi différents que la religion et la
morale ou encore « spirituality » et « religion », « sacred » et « religious ». Il examine
(chap. 2) ensuite ce que signifie pour un Américain la « spirituality », montrant (p. 46)
la convergence entre l'intérêt pour celle-ci et la pratique de la prière, plus encore que
de la méditation. Puis, il examine la place des arts (chap. 3) dans l'enfance, à l'école et
dans la vie adulte, montrant notamment que l'intérêt pour un art particulier va de pair
avec celui des arts en général, et que cet intérêt est en relation directe avec la
spiritualité, les activités pieuses, les religions et l'expérience de Dieu (tableau 12, p. 71).
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
247
4 Mais pour ce qui est de la raison pour laquelle l'art, les arts permettent ce lien, et
non pas le sport, la cuisine, le jardinage ou la coiffure, on n'en saura guère plus que de
vagues banalités (p. 77), développées tout au long du chapitre 4 sans tentative aucune
de comparer arts et sport, ou cuisine, etc. C'est à croire que les fidèles ne font jamais de
gâteaux qu'ils ou elles partagent lors des réunions des congrégations, et que faire
l'amour n'est jamais une expérience spirituelle pour un(e) Américain(e). Le chapitre 5
examine d'un point de vue quasi ethnographique la place de la musique et dans une
moindre mesure d'autres arts dans diverses communautés religieuses à Philadelphie,
Boston, en Pennsylvanie ou dans l'Oregon, son rapport à l'émotion, aux goûts de la
jeunesse. Le chapitre 6 examine une tout autre relation entre religion et arts, la place
faite à l'imagination, définie de manière assez surprenante (tableau 32, p. 186) comme la
capacité à placer des images mentales sur Dieu, le ciel, les anges... Le chapitre 7
interroge enfin l'opinion que les gens entretiennent sur les œuvres et les artistes
contemporains pour découvrir que cette image est plus négative chez les évangélistes
et fondamentalistes que chez les protestants mainline ou les catholiques. Pour conclure
(chap. 8), c'est bien d'une approche généralisée et vague des arts qu'il s'agit ici, dont
l'artiste est exclu au nom du précepte « The Artist in Everyone ».
5 Cet ouvrage est essentiellement constitué d'un mélange de sociologie des religions et de
réflexions d'un Américain sur l'attitude de ses concitoyens et de sa propre société vis-à-
vis de « la » religion américaine, entendue essentiellement comme chrétienne. Une part
de l'infime pourcentage restant de l'ouvrage concerne les arts (principalement la
musique, le chant collectif) en tant qu'art. De plus, le livre oscille – à l'américaine ? –
entre l'exploitation de données statistiques sous forme de tableaux commentés,
d'anecdotes vivantes (absorbing narrative) tirées d'entretiens et de considérations
générales déconnectées de toute donnée empirique (« Throughout most of our nation's
history, spirituality gave people a sense of continuity with the past », p. 27). En fin de
compte, et assez logiquement, pour le lecteur européen, le livre est plus convaincant
quand il apporte des corrélations statistiques que quand il se propose d'apporter des
recettes aux Églises pour profiter de l'art sans pour autant se laisser perturber par les
artistes.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
248
Livres reçus
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
249
Livres reçus 130
AHDAR Rex, Worlds Colliding: Conservative Christians and the Law. Aldershot, Ashgate
Dartmouth, 2001, 296 p.
Amato Pierandrea, Ciaramelli Fabio, Encel Stéphane, Forget Philippe, Hannoun Hubert,
Jöchler Cristina, Pinchard Bruno, Roëls Claude, Salza Luca, Samama Claude-Raphaël,
« Penser le Prophétisme – Le clair et l'obscur », L'Art du Comprendre, n o 13, juin 2004,
218 p.
Borgeaud Philippe, Exercices de mythologie. Genève, Labor et Fides, 2004, 218 p.
Bremond d'Ars Nicolas de, Le Maire Jean-Marie, Marsaux Jacky, La foi de Vatican II.
Parcours d'humanité. Paris, Karthala, 2004, 304 p.
Bulletin du centre André Latreille, Chrétiens et Sociétés. XVIe-XXe siècles, no 11, Lyon, Centre
André Latreille et Institut d'histoire du christianisme, 2004, 249 p.
DAVIS Derek, W OOD Jr. James E., eds., The Role of Religion in the Making of Public Policy,
Waco (TX), Baylor University Press, J. M. Dawson Institute of Church-State Studies,
2004, 257 p.
GAMWELL Franklin I., Politics as Christian Vocation. Faith and Democracy Today. Cambridge,
Cambridge University Press, 2005, 185 p.
HETTEMA T. L., VAN DER K OOIJ A., Papers presented to the second Internationnal Conference of
the Leiden Institute for the Study of Religions. (LISOR) Held at Leiden, 27-28 April. Assen, Van
Gorcum, 2004, 597 p.
Leroy Béatrice, Le Triomphe de l'Espagne Catholique à la fin du Moyen Âge. Écrits et
témoignages. Limoges, Pulim, 2004, 213 p.
Longère Jean, dir., Marie dans les récits apocryphes chrétiens. Tome I. Paris, Médiaspaul,
2004, 285 p.
Makrides Vasilios N., Rupke Jörg, Religionen im Konflikt. Vom Bürgerkrieg über Ökogewalt
bis zur Gewalterinnerung im Ritual. Münster, Aschendorff Medien, 2005, 288 p.
Marchand Jacques, Sagesses : Enquête historique sur la recherche de l'autonomie du bonheur,
vol. 3, et L'idéologie biblique. Aux sources du fondamentalisme occidental. Montréal, Liber,
2005, 600 p.
Sardella Louis-Pierre, Mgr Eudoxe Irénée Mignot (1842-1918). Paris, Cerf, 2004, 743 p.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
250
Swetschinski Daniel M., Reluctant Cosmopolitans. The Portugese Jews of Seventeenth-Century.
Amsterdam. Oxford, Littman, 2004, 380 p.
Thiel Marie-Jo, dir., Europe, sprirtualités et culture face au racisme. Colloque international
tenu au Parlement Européen de Strasbourg les 28, 29, 30 août 2003. Paris-Lit Verlag, Cerf,
2004, 490 p.
WOLFFE John, ed., Religion in history. Conflict, Conversion and Coexistence. Manchester,
Manchester University Press, 2004, 335 p.
Archives de sciences sociales des religions, 130 | avril - juin 2005
Vous aimerez peut-être aussi
- Jean Pierre Laurant BiobliographieDocument8 pagesJean Pierre Laurant BiobliographiereussavelPas encore d'évaluation
- Bibliographie Colloque Graphè Les Tentations Du Christ - 18 - 19 - Mars - 2021Document8 pagesBibliographie Colloque Graphè Les Tentations Du Christ - 18 - 19 - Mars - 2021françois paulin gaston TELETIGLOKPAPas encore d'évaluation
- Jan Peter Schouten, Revolution of The Mystics. On The Social Aspects of Vïrasaivism, 1991Document3 pagesJan Peter Schouten, Revolution of The Mystics. On The Social Aspects of Vïrasaivism, 1991Joop-le-philosophePas encore d'évaluation
- LivresDocument7 pagesLivresDon MassimoPas encore d'évaluation
- Mimouni Simon PublicationsDocument16 pagesMimouni Simon PublicationsSadek TaboubiPas encore d'évaluation
- Hérésies: une construction d'identités religieuses: Histoire des religionsD'EverandHérésies: une construction d'identités religieuses: Histoire des religionsPas encore d'évaluation
- M Behe-Eb 4 00102Document20 pagesM Behe-Eb 4 00102Yao OuffouePas encore d'évaluation
- La Sainte famille: Sexualité, filiation et parentalité dans l’Eglise catholiqueD'EverandLa Sainte famille: Sexualité, filiation et parentalité dans l’Eglise catholiquePas encore d'évaluation
- S Mimouni Bibliographie2019Document20 pagesS Mimouni Bibliographie2019Marcus TulliusPas encore d'évaluation
- Des voix dans le siècle: Culture et engagement catholique en Belgique francophone depuis 1945D'EverandDes voix dans le siècle: Culture et engagement catholique en Belgique francophone depuis 1945Pas encore d'évaluation
- "Vous n'en mangerez point": L'alimentation comme distinction religieuseD'Everand"Vous n'en mangerez point": L'alimentation comme distinction religieusePas encore d'évaluation
- Biblio Éthique Gén + SSLM Sélestat CB 2020Document6 pagesBiblio Éthique Gén + SSLM Sélestat CB 2020Ann PascalePas encore d'évaluation
- Soufisme Métissage CulturelDocument25 pagesSoufisme Métissage CulturelFifiPas encore d'évaluation
- Balandier, Georges - Le Sacré Par Le Détour Des Sociétés de La TraditionDocument16 pagesBalandier, Georges - Le Sacré Par Le Détour Des Sociétés de La Traditionvincit2100% (1)
- Biblio MystiqueDocument14 pagesBiblio MystiqueChunming WangPas encore d'évaluation
- Pasquier DCDocument684 pagesPasquier DCGuidson AlexandrePas encore d'évaluation
- Patrologii Bulletin 2005Document81 pagesPatrologii Bulletin 2005Nichifor TanasePas encore d'évaluation
- Publications Olivier Thomas Venard 1Document17 pagesPublications Olivier Thomas Venard 1Bill DoorPas encore d'évaluation
- Mark J. Sedgwick, Le Soufisme. Traduit de L'anglais Par Jean-François Mayer, Cerf, 2001Document3 pagesMark J. Sedgwick, Le Soufisme. Traduit de L'anglais Par Jean-François Mayer, Cerf, 2001Joop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Chercheurs de dieux dans l'espace public - Frontier Religions in Public SpaceD'EverandChercheurs de dieux dans l'espace public - Frontier Religions in Public SpacePas encore d'évaluation
- Voyage au pays du Catholicisme français contemporain: Un dictionnaire du Concile Vatican II (1962-65) à 2023D'EverandVoyage au pays du Catholicisme français contemporain: Un dictionnaire du Concile Vatican II (1962-65) à 2023Pas encore d'évaluation
- Bibliographie Complete de Christoph Theobald SJDocument12 pagesBibliographie Complete de Christoph Theobald SJCamilo Andres Paez PuentesPas encore d'évaluation
- Musique Rituel Significations PDFDocument30 pagesMusique Rituel Significations PDFFlip Lopes Ivanicska100% (1)
- Bulletin D'informationDocument227 pagesBulletin D'informationIooooooooPas encore d'évaluation
- 00 WIKI - Jean Daniélou (FR)Document5 pages00 WIKI - Jean Daniélou (FR)Arturo CampilloPas encore d'évaluation
- Cths 301Document198 pagesCths 301Yehia FayoudPas encore d'évaluation
- À la recherche de miracles: Pèlerines, religion vécue et la Roumanie postcommunisteD'EverandÀ la recherche de miracles: Pèlerines, religion vécue et la Roumanie postcommunistePas encore d'évaluation
- Références BibliographiquesDocument4 pagesRéférences Bibliographiquesالاسراء و المعراجPas encore d'évaluation
- Presses Universitaires de France Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To Revue D'histoire Littéraire de La FranceDocument2 pagesPresses Universitaires de France Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To Revue D'histoire Littéraire de La FranceJoaoPas encore d'évaluation
- Bibliographie. Licence 2. Anthropologie PDFDocument5 pagesBibliographie. Licence 2. Anthropologie PDFdindanayPas encore d'évaluation
- M. M. Davy (Éd.), Encyclopédie Des Mystiques, T. I À IV, 1996Document2 pagesM. M. Davy (Éd.), Encyclopédie Des Mystiques, T. I À IV, 1996Joop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Assr122 2003Document11 pagesAssr122 2003Sibiri SANOUPas encore d'évaluation
- Femmes catholiques en mouvements: Action catholique et émancipation féminine en Belgique francophone (1955-1990)D'EverandFemmes catholiques en mouvements: Action catholique et émancipation féminine en Belgique francophone (1955-1990)Pas encore d'évaluation
- Les Services Religieux Féminins en Grèce de L'époque PDFDocument600 pagesLes Services Religieux Féminins en Grèce de L'époque PDFChloé MallevaeyPas encore d'évaluation
- Salmanticensis 1955 Volumen 2 N.º 3 Libri Ad Redationem MissiDocument2 pagesSalmanticensis 1955 Volumen 2 N.º 3 Libri Ad Redationem MissigerhardtroderichPas encore d'évaluation
- Norvège Vues de L'intérieurDocument2 pagesNorvège Vues de L'intérieurOlivier RandrianjakaPas encore d'évaluation
- Biblio GilliotDocument41 pagesBiblio GilliothighrangePas encore d'évaluation
- Introduction LiturgiologieDocument163 pagesIntroduction LiturgiologieHis Life is mine100% (1)
- Senses and AppearencesDocument256 pagesSenses and Appearencesantonio_ponce_1Pas encore d'évaluation
- Dimesions Sociales de La ReligionDocument168 pagesDimesions Sociales de La ReligionAbdeltif100% (1)
- Brach Jean Pierre CVDocument4 pagesBrach Jean Pierre CVMartnPas encore d'évaluation
- Bibliografia Gilson PDFDocument20 pagesBibliografia Gilson PDFJuan C.Pas encore d'évaluation
- Psorbonne 2165Document349 pagesPsorbonne 2165IoanAlexandruTofan100% (1)
- 7 Albert Llorca Les Apparitions Et Leur HistoireDocument15 pages7 Albert Llorca Les Apparitions Et Leur HistoireJavier PerellóPas encore d'évaluation
- Ouvrages Reçus À La Rédaction: Laval Théologique Et PhilosophiqueDocument4 pagesOuvrages Reçus À La Rédaction: Laval Théologique Et PhilosophiqueinjesusrichPas encore d'évaluation
- Ésotérisme Et InitiationDocument5 pagesÉsotérisme Et Initiationplessiosaurus100% (1)
- Publications Scientifiques de M. Ayissi LucienDocument7 pagesPublications Scientifiques de M. Ayissi LucienValery Lionel NangaPas encore d'évaluation
- Jeauneau - Publications 1991-2014Document12 pagesJeauneau - Publications 1991-2014RupertoPas encore d'évaluation
- Patrologie FTC EtdDocument6 pagesPatrologie FTC EtdAkasawaPas encore d'évaluation
- AnthropoctonieDocument40 pagesAnthropoctoniepartageuxPas encore d'évaluation
- RHR 5265 2 Vies Et Metamorphoses de La Sibylle P 253 271Document21 pagesRHR 5265 2 Vies Et Metamorphoses de La Sibylle P 253 271xavivax20078797Pas encore d'évaluation
- UPL9170942196939570129 BiblioTRnumDocument19 pagesUPL9170942196939570129 BiblioTRnumJosePas encore d'évaluation
- Pierre Bonte PublicationsDocument20 pagesPierre Bonte PublicationscentrerePas encore d'évaluation
- Panther, Oscar - Augustin Et La ManichéismeDocument0 pagePanther, Oscar - Augustin Et La ManichéismeThomas XPas encore d'évaluation
- Larchet Personne Nature PDFDocument408 pagesLarchet Personne Nature PDFEmanuel EmyPas encore d'évaluation
- Publications Didier FoucaultDocument4 pagesPublications Didier FoucaultSbastienPoublancPas encore d'évaluation
- La Theologie Et Les SciencesDocument49 pagesLa Theologie Et Les SciencesOscar BeltránPas encore d'évaluation
- L'Homme NouveauDocument3 pagesL'Homme NouveauGedeon NdongPas encore d'évaluation
- Paroles de Sagesses de L'imâm Mâlik Ibn AnasDocument3 pagesParoles de Sagesses de L'imâm Mâlik Ibn Anasbismillah03Pas encore d'évaluation
- Les Non-Dits Prophétiques de La Convocation Du 14 Mai 2020Document6 pagesLes Non-Dits Prophétiques de La Convocation Du 14 Mai 2020Chris Hedvi DansouPas encore d'évaluation
- Le Nouveau Livre Du Rose-CrouxDocument411 pagesLe Nouveau Livre Du Rose-CrouxSilvio Alves Branco100% (3)
- La Terre Et Son Caractère SacréDocument6 pagesLa Terre Et Son Caractère Sacréchapter2008100% (1)
- Ce Que Croient Les AdventistesDocument29 pagesCe Que Croient Les AdventistesCarchemine François Irelson100% (1)
- La Tradition Johannique Dans L'apocryphe de Jean - Dubois, Jean-Daniel PDFDocument11 pagesLa Tradition Johannique Dans L'apocryphe de Jean - Dubois, Jean-Daniel PDFPricopi VictorPas encore d'évaluation
- Vérités Vatican 2Document21 pagesVérités Vatican 2sedenoPas encore d'évaluation
- Ivre FinalDocument148 pagesIvre FinalDaouda GouemPas encore d'évaluation
- Interprétation - Biblique Craig KeenerDocument163 pagesInterprétation - Biblique Craig KeenerCiczioPas encore d'évaluation
- RajabDocument4 pagesRajabfodekambalouPas encore d'évaluation
- 60 Les 10 Vierges 11-12-60 (64p)Document33 pages60 Les 10 Vierges 11-12-60 (64p)DavidPas encore d'évaluation
- DR Saliou Ndiaye, Etapes Et États Spirituels de Cheikh Bamba Dans Son Poème HuqqaDocument16 pagesDR Saliou Ndiaye, Etapes Et États Spirituels de Cheikh Bamba Dans Son Poème HuqqaAnnalesPas encore d'évaluation
- Chevillon Le Vrai Visage de La FMDocument33 pagesChevillon Le Vrai Visage de La FMOMO.SCPas encore d'évaluation
- Islamopsychose - Thomas GuenoleDocument220 pagesIslamopsychose - Thomas GuenoleAbdelkrim BENAMERPas encore d'évaluation
- Léon Daudet - Le Stupide XIXe Siècle, Expose Des Insanités Meurtrières Qui Se Sont Abattues Sur La France Depuis 130 ANS, 1789-1919Document321 pagesLéon Daudet - Le Stupide XIXe Siècle, Expose Des Insanités Meurtrières Qui Se Sont Abattues Sur La France Depuis 130 ANS, 1789-1919Zelarwen100% (1)
- Jesus A Annonce Le Plan Du SalutDocument4 pagesJesus A Annonce Le Plan Du SalutCharbel AdamazePas encore d'évaluation
- Toute Bid'Ah Est EgarementDocument164 pagesToute Bid'Ah Est EgarementAbou_Issa_138Pas encore d'évaluation
- Ta Place Est Dans LegliseDocument5 pagesTa Place Est Dans LeglisejulioPas encore d'évaluation
- Orientation Lacanienne III, 5. Un Effort de Poésie Jacques-Alain MillerDocument12 pagesOrientation Lacanienne III, 5. Un Effort de Poésie Jacques-Alain MillerKeisukeItoPas encore d'évaluation
- John Henry Newman, L'Antichrist, 1835 - 02 La Religion de L'antichristDocument9 pagesJohn Henry Newman, L'Antichrist, 1835 - 02 La Religion de L'antichristCaveNeCadasPas encore d'évaluation
- 19810830-Certainement Je Te Benirai - 20050318Document26 pages19810830-Certainement Je Te Benirai - 20050318Aristide Bechie100% (1)
- La Mort T'exhorte de L'imam Ad-DahabiDocument47 pagesLa Mort T'exhorte de L'imam Ad-DahabiAqidatoulMouwahidine100% (1)
- Préparer Son TémoignageDocument2 pagesPréparer Son TémoignageSecrétariatIbbPas encore d'évaluation
- Une Spiritualite Laique PDFDocument225 pagesUne Spiritualite Laique PDFFiat LuxPas encore d'évaluation
- Abrégé de La Foi Catholique PDFDocument21 pagesAbrégé de La Foi Catholique PDFfrancis3ndourPas encore d'évaluation
- Abd Al-Qâdir Al-Jazâ'irî, Livre Des Haltes Tome 3 - Trad. Max GiraudDocument180 pagesAbd Al-Qâdir Al-Jazâ'irî, Livre Des Haltes Tome 3 - Trad. Max GiraudScienza Sacra100% (2)
- L'homme en Face de Dieu Selon 'Abd Al-Razzāq Al-QāšānīDocument34 pagesL'homme en Face de Dieu Selon 'Abd Al-Razzāq Al-QāšānīccshamiPas encore d'évaluation
- Troisième ŒilDocument4 pagesTroisième Œilcoucou8949Pas encore d'évaluation
- 22 La VocationDocument4 pages22 La VocationsedenoPas encore d'évaluation