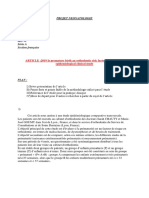Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Soins Infirmiers
Les Soins Infirmiers
Transféré par
Nihal Zenine0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
1 vues9 pagesTitre original
Les-Soins-Infirmiers
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format docx, pdf ou txt
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
1 vues9 pagesLes Soins Infirmiers
Les Soins Infirmiers
Transféré par
Nihal ZenineDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format docx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 9
Apres avoir eu une bonne formation theorique et plusieurs stage
pratique durant 3ANS d’études on a constaté une controverse sur la
pose de la sonde nasogastrique entre les differnts services et entre le
staff medicales et paramedicale
Suite à une discussion avec les infirmiers du services et nos
enseignants nous avons pu constater que le sujet de la pose de
la sonde nasogastrique nous amène à ce questionner :
-
-
-
quels sont les obstacles des infirmiers devant la pose d’une sonde
nasogastrique ?
Les sondes nasogastriques sont courrament utilisé dans les hapitaux et
les etablissements de soins pour diverses indications
médicalestherapeutique ou diagnostique.
La sonde naso-gastrique est une technique qui consiste à introduire
une sonde spécifiquement par le nez jusqu'à l'Estomac
Dans un article publié en 3septembre 2016 par Pauline Bart-Rommé
a, Delphine Cabelguenne a, Corinne Béal b, Véronique Chambost c,
Teddy Novais a, Bénédicte Bertoni-Talin a, Cécile Chambrier d,
Didier Barnoud e L’étude a pour but de déterminer et hiérarchiser les
critères techniques de choix d’une sonde nasogastrique (SNG) pour la
nutrition entérale.
Un groupe de travail était mis en place comprenant un cadre de santé,
un médecin spécialisé en nutrition artificielle et deux pharmaciens.
Les différents critères techniques des SNG étaient répertoriés,
analysés puis hiérarchisés selon les données de la littérature, les fiches
techniques des fournisseurs et le retour d’expérience des soignants.
La SNG idéale pourrait être en polyuréthane, pré-lubrifiée et
comporter un lest de poids suffisant pour la maintenir en place tout en
restant bien tolérée par le patient à la pose. Pour limiter l’obstruction,
le groupe retenait que la configuration optimale des orifices distaux
serait de type « multiples perforations ». La dénomination et la taille
devraient être lisibles, et la longueur et les graduations devraient être
renseignées sur la sonde. Ces éléments semblaient essentiels pour la
pose et le contrôle du bon positionnement. L’identification en
proximal permettrait d’optimiser le relais de la prise en charge du
patient d’une équipe à l’autre. Enfin, un étiquetage clair et précis
semblerait constituer une aide pour les soignants dans le choix de la
SNG. Le constat était également fait de l’hétérogénéité des
informations techniques et de la diversité des références proposées.
La multidisciplinarité du groupe de travail a permis de confronter les
points de vue et d’optimiser le choix technique afin de répondre aux
besoins en termes de pose et d’utilisation par le personnel soignant
dans un objectif de sécurité thérapeutique pour le patient.
Évaluer la performance de trois tests différents dans leurs capacités à
prédire le positionnement intragastrique de la sonde nasogastrique
(SNG).
Une étude en France publié en janvier 2018 en vue de l’obtention du
diplôme de fin d’étude Au sein des services de neurologie, les
soignants prennent en charge des patients victimes d'un AVC, qui
entraînent parfois la pose d'une sonde nasogastrique. Chaque service
possède ses propres pratiques. Celles-ci sont parfois différentes d'un
service à un autre. Le but de ce mémoire est de faire un état des lieux
sur les similitudes et les divergences entre les pratiques, en ce qui
concerne la pose et le maintien de la sonde, au sein de différents
services de neurologie en France. Le travail de recherche s'est articulé
autour d'un recueil de données à l'aide de questionnaires, envoyés aux
neurologues, aux infirmiers et aux orthophonistes exerçant au sein
d'un service de neurologie. Les résultats démontrent des similitudes
entre les pratiques mais avec des formes protocolaires différentes en
ce qui concerne l'évaluation des troubles de la déglutition. Les
résultats nous apprennent également l'existence de divergences entre
les pratiques sur la mise en place et le délai de maintien de la sonde.
Cependant, les professionnels s'accordent sur la présence de
complications (physiques et/ou morales) dues à cette sonde. Cette
étude a également permis de mettre en avant de nombreuses
interrogations au sujet de la sonde nasogastrique. Pour tenter de pallier
ces interrogations autour de la sonde nasogastrique, une réflexion
entre professionnels peut être envisagée
En juin 2005 Une Étude prospective d'observation en réanimationa
était faite par . P. Seguin a, V. Le Bouquin a, D. Aguillon a, A.
Maurice a, B. Laviolle b, Y. Mallédant a
– Tous les patients pour lesquels la pose d'une SNG était retenue
étaient inclus. Une fois la SNG posée, trois tests étaient
successivement réalisés : l'aspiration de liquide digestif, le pH et
l'insufflation d'air avec auscultation épigastrique. La faisabilité et les
résultats obtenus pour chaque test étaient notés et comparés à ceux du
cliché thoracique (CT), examen de référence. Le CT permettait de
caractériser les complications et de les classer comme majeures ou
mineures.
– Un total de 419 poses de SNG (202 sondes double courant et 217
sondes d'alimentation entérale) était analysé chez 280 patients. Les
malpositions représentaient 10 % des insertions (majeures, n = 11 et
mineures, n = 31). L'aspiration gastrique et la mesure du pH du liquide
aspiré étaient peu sensibles (respectivement 77 et 49 %) et peu
spécifique (respectivement 38 et 74 %). L'insufflation était sensible
(96 %) mais peu spécifique (17 %). L'association des trois tests
n'améliorait pas leurs performances. Deux complications graves
étaient uniquement décelées par le CT (sonde intrapleurale et un
pneumothorax).
Aucun des tests évalués, pris isolement ou en association, n'était
suffisamment fiable pour se substituer au contrôle radiologique. La
présence de complications, rares mais potentiellement graves non
détectées par ces tests renforce cette opinion.
Les sondes d'alimentation entérale les plus fréquemment utilisées sont
les sondes nasogastriques. Cependant, les sondes naso-entérales,
nasoduodénales et surtout nasojéjunales, ont des indications de plus en
plus fréquentes. Leur efficacité est maintenant bien démontrée dans
deux situations : la réanimation postopératoire ou post-traumatique et
les pancréatites aiguës. Une troisième indication potentielle est le
remplacement d'une sonde nasogastrique par une sonde nasojéjunale
en cas de pneumopathies d'inhalation répétées. En effet, les
pneumopathies d'inhalation chez le malade alimenté par sonde
nasogastrique peuvent avoir deux origines : l'inhalation des sécrétions
oropharyngées et le reflux gastro-œsophagien. C'est uniquement dans
ce dernier cas que la sonde nasojéjunale a un intérêt mais la mise en
évidence du reflux gastro-œsophagien est difficile. Son incidence est
très variable selon les études. Son origine est multifactorielle. Pour le
choix de la sonde, le matériau choisi peut être le polyuréthane ou le
silicone. La pose de la sonde d'alimentation doit être effectuée en
position assise ou semi-assise. La pose de la sonde nasogastrique est
un acte infirmier effectué sur prescription médicale, la pose de la
sonde nasojéjunale est un acte médical effectué sous endoscopie (sauf
pour la sonde Bengmark à extrémité enroulée). Le contrôle de la
bonne position de la sonde nasogastrique doit idéalement être effectué
radiologiquement, mais il est difficile à réaliser en pratique et la
méthode d'auscultation est la plus fréquemment utilisée. En
conclusion, les progrès techniques de la nutrition entérale ont rendu sa
pratique plus simple et moins risquée et ses indications de plus en plus
importantes par rapport à celles de la nutrition parentérale.
En Algérie SID Chahrazed et HACHEMI Yasmine Imene ont
effectué une étude de mémoire fin d’etude en vue de l’obtention de
diplôme de docteur en pharamcie s'inscrit dans le cadre d'un
programme de bonne pratique du support nutritionnel chez les patients
dénutris.
Leurs démarche consiste en une mise au point des stratégies
d'assistance nutritionnelle pour la mise en place d'une méthodologie
adaptée à l'état nutritionnel du patient, sur la base d’une évaluation
adéquate de l'état nutritionnel, de critères validés de définition de la
dénutrition et d’une technique d'alimentation entérale couramment
appliquée.
L'aspect pratique de leurs étude a porté sur l’observation de la mise en
œuvre de support nutritionnel pour les patients hospitalisés au sein du
service d’oncologie du CAC de Blida; à cet effet, les différentes
étapes de la nutrition entérale ont été suivies
(pose de sonde, emploi des solutions nutritives, médication entérale et
formes galéniques, mélanges, conditionnement, évolution de l’état
nutritionnel des malades)
Par ailleurs, à la lumière des données recueillies au sein du service
d’oncologie du CAC Blida, ce travail a été enrichi par des
propositions de médication entérale
En Algerie le 11 juin 2014 lors d’un mémoire de fin d’etude en vue de
l’obtention de diplôme de docteur en pharmacie realisé par Mr.
BENZERDJEB Mohammed et Mr. BENHABIB Malik Adel
Le mode d’alimentation Parentérale se pose de nos jours
avec acuité tant les maladies digestives deviennent
plurielles et ne trouvent que cette seule alternative comme
solution définitive pour nourrir les patients. Le problème
posé consiste en l’administration des aliments selon un
processus non-physiologique qui règle le problème posé
mais pas de façon définitive dans la mesure où les organes
qui ont l’habitude de gérer la digestion ainsi que le transit
intestinal vont voir réduire, voire arrêter leurs
fonctionnalités. Ainsi, l’objet de cette recherche sera
présenté en trois chapitres. Dans le premier, seront
examinés les différents types de nutrition ainsi que leurs
caractéristiques, qui sera suivi dans un deuxième chapitre,
par un exposé sur l’alimentation parentérale en milieu
chirurgical tout en mettant en exergue ses principes de
fonctionnement, ses indications pré et post opératoires ainsi
que les produits utilisés. Les avantages et les inconvénients
de cette technique de nutrition y sont nettement présentés.
Le troisième chapitre est consacré à une étude contextuelle
sur une population de patients du service de chirurgie B du
CHU de Tlemcen Les résultats de notre recherche montrent
que ce mode artificiel de nutrition devrait être adapté aux
exigences de chaque malade pour éviter les effets
secondaires négatifs touchant les malades chroniques.
Service des maladies de l'appareil digestif,, GRAD, hOpital Charles-
Nicolle, 76031 Rouen cedex, France Les sondes d'alimentation
enterale les plus fr6quemment utilis6es sont les sondes nasogastriques.
Cependant, les sondes naso-enterales, nasoduod6nales et surtout
nasoj~junales, ont des indications
de plus en plus fr6quentes. Leur efficacite est maintenant bien
d~montree dans deux situations" la reanimation postoperatoire ou
post-traumatique et les pancreatites aigu~s, Une troisi~me indication
potentielle est le remplacement d'une sonde nasogastrique par une
sonde nasoj6junale en cas de
pneumopathies d'inhalation rep6t6es. En effet, les pneumopathies
d'inhalation chez le malade aliment~
par sonde nasogastrique peuvent avoir deux origines : rinhalation des
s~cr~tions oropharyng~es et le
reflux gastro-o~sophagien. C'est uniquement dans ce demier casque la
sonde nasojejunale a un int6r6t
mais la mise en ~vidence du reflux gastro-o~sophagien est difficile.
Son incidence est tr~s variable
selon les 6tudes. Son origine est multifactorielle. Pour le choix de la
sonde, le mat6riau choisi peut ~tre
le polyur6thane ou le silicone. La pose de la sonde d'alimentation dolt
~tre effectuee en position assise
ou semi-assise. La pose de la sonde nasogastrique est un acte infirmier
effectue sur prescription medicale, la pose de la sonde nasoj6junale est
un acte m6dical effectu6 sous endoscopie (saul pour la
sonde Bengmark & extr6mit~ enroul~e). Le contr61e de la bonne
position de la sonde nasogastrique dolt
id~atement ~tre effectu6 radiologiquement, mais il est difficile &
realiser en pratique et la m~thode
d'auscultation est la plus fr6quemment utilisee. En conclusion, les
progres techniques de la nutrition
enterale ont rendu sa pratique plus simple et moins risqu6e et ses
indications de plus en plus importantes par rapport & celles de la
nutrition parent6rale. © 2000 I~ditions scientifiques et m~dicales
En France à la faculté de medecine de Nancy2011 lors d’une
thése doctoral faite par Cecile BECHARD une etude a était faite sur
l’alimentation enterale et ils ont conclue que Le recours à la nutrition
entérale à domicile est en constante augmentation. Cette croissance
semble en lien d’une part avec le vieillissement de la population et
d’autre part avec le développement de l’hospitalisation à domicile.
Elle nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et une
coordination entre la ville et l’hôpital avec un rôle important du
médecin traitant. Selon notre étude, les médecins généralistes jugent la
coordination avec les différents services hospitaliers ainsi que les
informations sur la nutrition entérale des patients satisfaisantes. Ils se
sentent concernés par la nutrition malgré la faible activité que cela
représente dans leur pratique quotidienne. Cependant, ils ne se jugent
pas assez formés dans ce domaine et plus particulièrement en ce qui
concerne la nutrition entérale. Ainsi la réalisation de l’évaluation
nutritionnelle de leurs patients, des prescriptions et la gestion des
complications de ce type de nutrition artificielle semble complexe
pour les médecins généralistes. Les résultats de l’enquête mettent en
avant la nécessité d’améliorer la formation initiale et continue des
médecins dans ce domaine. D’autres facteurs semblent expliquer la
difficulté des médecins traitants dans la prise en charge nutritionnelle
de leurs patients. Le caractère chronophage du suivi des patients en
nutrition entérale à domicile s’oppose au manque de temps des
médecins généralistes notamment dans les zones de faible
démographie médicale. L’absence de prise en charge par la sécurité
sociale des consultations auprès des diététiciens libéraux limite leur
accès alors qu’elles pourraient permettre de compléter et d’améliorer
le suivi des patients. La nutrition est un déterminant majeur de l’état
de santé de la population. Il est établi que l’alimentation et l’état
nutritionnel participent de façon essentielle au développement de
nombreuses maladies répandues dans les pays industrialisés : les
maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, l’ostéoporose et les
tumeurs malignes. De ce fait, une formation renforcée et plus
complète sur la nutrition pourrait leur permettre d’améliorer la
prévention, le dépistage et le traitement de la dénutrition mais
également de ces maladies avec une répercussion sur l’état de santé de
la population.
Vous aimerez peut-être aussi
- Analyse Pratique Du RCF Rythme Cardiaque Foetal 2020Document137 pagesAnalyse Pratique Du RCF Rythme Cardiaque Foetal 2020Mohamed takiy-eddine el moustafa SEGHIERPas encore d'évaluation
- 2016 Echo Gyn CR MinimumDocument19 pages2016 Echo Gyn CR MinimumzinebPas encore d'évaluation
- Chromo EndoscopieDocument15 pagesChromo EndoscopieMarieta DavidPas encore d'évaluation
- Problematiquee 1Document6 pagesProblematiquee 1Nihal ZeninePas encore d'évaluation
- 0307 Reanimation Vol12 N5 p360 - 364Document5 pages0307 Reanimation Vol12 N5 p360 - 364Meriame LaazizPas encore d'évaluation
- Appendicite de L Adulte - Recommandations Pour La Pratique C - 2021 - Journal deDocument11 pagesAppendicite de L Adulte - Recommandations Pour La Pratique C - 2021 - Journal deMohamed BoudouPas encore d'évaluation
- 1 32Document21 pages1 32Amin-Florin El-KharoubiPas encore d'évaluation
- Disfagia y ParkinsonDocument14 pagesDisfagia y ParkinsonJose Alfonso Szabo CalvoPas encore d'évaluation
- 2 - RFE Gestion Des VAS de Lenfant postCA PDFDocument32 pages2 - RFE Gestion Des VAS de Lenfant postCA PDFblanjeanPas encore d'évaluation
- Affections Buccodentaires Et Grossesse DR KanéDocument10 pagesAffections Buccodentaires Et Grossesse DR KanéDrissa KonatéPas encore d'évaluation
- Le Maillon Faible - Radiologie, Echographie de L'Appareil LocomoteurDocument109 pagesLe Maillon Faible - Radiologie, Echographie de L'Appareil LocomoteurAthanassios CharitosPas encore d'évaluation
- Oxygene Aigu Chro 0Document9 pagesOxygene Aigu Chro 0amédée junior wawaPas encore d'évaluation
- MJS2019Document29 pagesMJS2019drraja.gtPas encore d'évaluation
- Nom Du Fichier PerduDocument20 pagesNom Du Fichier PerduafakprodzPas encore d'évaluation
- RPC9 Imagerie Rocher SyntheseDocument13 pagesRPC9 Imagerie Rocher SyntheseCzPas encore d'évaluation
- 2 - AFAR - Nutrition Artificielle Perioperatoire en Chirurgie Programmee de Ladulte PDFDocument9 pages2 - AFAR - Nutrition Artificielle Perioperatoire en Chirurgie Programmee de Ladulte PDFMalek KhemiliPas encore d'évaluation
- JOURDAN 337xzptek564zpdn362ppz102hsdf THDocument232 pagesJOURDAN 337xzptek564zpdn362ppz102hsdf THElie ZRAPas encore d'évaluation
- Beaulier Heloise Cesariennes Programmees AphmDocument68 pagesBeaulier Heloise Cesariennes Programmees Aphmornellabimuloko53Pas encore d'évaluation
- Maitrise Statistique Des Processus en Sante Guide 2005Document92 pagesMaitrise Statistique Des Processus en Sante Guide 2005abdoul aziz zabrePas encore d'évaluation
- Recommandations - Paralysies Récurrentielles de L'adulte - 2002Document11 pagesRecommandations - Paralysies Récurrentielles de L'adulte - 2002BOUILLEAUPas encore d'évaluation
- C4. Chap 8. EcoffeyDocument17 pagesC4. Chap 8. EcoffeyboblenazePas encore d'évaluation
- Article Prévention de L'infectionDocument10 pagesArticle Prévention de L'infectionHamidou SAVADOGOPas encore d'évaluation
- Bpa Pec1212sondevesDocument14 pagesBpa Pec1212sondevescarlos.ntakobajira28Pas encore d'évaluation
- 6 SIDIBE Implantation Check List de Sécurité Chirurgicale Au CHUDocument103 pages6 SIDIBE Implantation Check List de Sécurité Chirurgicale Au CHUAhmed BahPas encore d'évaluation
- CC-Pancreatite-Aigue-2001 AfsapsDocument10 pagesCC-Pancreatite-Aigue-2001 Afsapsbenjelloun touimi khalidPas encore d'évaluation
- 003l01280222v6n1 M Wade Et Al. EpisiotomieDocument10 pages003l01280222v6n1 M Wade Et Al. EpisiotomieAouf Ayouba Ousseini MaigaPas encore d'évaluation
- 2b AFAR Texte-LongDocument15 pages2b AFAR Texte-LongJulesPas encore d'évaluation
- 2 - AFAR - Prise en Charge Des Infections Intra Abdominales PDFDocument25 pages2 - AFAR - Prise en Charge Des Infections Intra Abdominales PDFDavid HernándezPas encore d'évaluation
- La NasofibroscopieDocument7 pagesLa NasofibroscopiembadendongPas encore d'évaluation
- Rôle Du Lavage Utérin Dans Le Diagnostic Et Le Traitement de L'infertilitéDocument147 pagesRôle Du Lavage Utérin Dans Le Diagnostic Et Le Traitement de L'infertilitévantivaPas encore d'évaluation
- Évaluation de La Dose Patient en Scanographie Pédiatrique Dans Deux Hôpitaux Universitaires À Yaoundé CamerounDocument10 pagesÉvaluation de La Dose Patient en Scanographie Pédiatrique Dans Deux Hôpitaux Universitaires À Yaoundé CamerounTonyy BqPas encore d'évaluation
- INESSS Algorithme Traitement Cancer RectumDocument295 pagesINESSS Algorithme Traitement Cancer RectumAlilou Le DucPas encore d'évaluation
- SondesDocument54 pagesSondesMichele Ba'anaPas encore d'évaluation
- Approche Chirurgicale de L'incontinence Anale de L'adulte PDFDocument12 pagesApproche Chirurgicale de L'incontinence Anale de L'adulte PDFMohamed Amine MansouriPas encore d'évaluation
- Soust 2019Document7 pagesSoust 2019Putri Rizky AmaliaPas encore d'évaluation
- PancreatiteDocument16 pagesPancreatiteAbdelghani BitamPas encore d'évaluation
- L'administration Intraveineuse Des Substances de Contraste en Imagerie Médicale Au CHUQDocument87 pagesL'administration Intraveineuse Des Substances de Contraste en Imagerie Médicale Au CHUQCH BtissamPas encore d'évaluation
- NEONATDocument3 pagesNEONATLAALAM MOHAMMED AMINEPas encore d'évaluation
- Xpert 10.1016@j.rmr.2017.01.003Document7 pagesXpert 10.1016@j.rmr.2017.01.003christianPas encore d'évaluation
- Techs de Desencombrement PDFDocument9 pagesTechs de Desencombrement PDFPopa AlinaPas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S0929693X10002824 Main PDFDocument10 pages1 s2.0 S0929693X10002824 Main PDFPaula UrsuPas encore d'évaluation
- Sdationintraveineuseencabinetdentaire placeduMdecinAnesthsiste-RanimateurDocument5 pagesSdationintraveineuseencabinetdentaire placeduMdecinAnesthsiste-RanimateurlaibothmanePas encore d'évaluation
- Cours - Protocoles en ScannographieDocument125 pagesCours - Protocoles en Scannographieayachachoua11100% (3)
- Examens Laboratoire Word NV - CopieDocument60 pagesExamens Laboratoire Word NV - CopieMarouane ChamaPas encore d'évaluation
- Le Devenir Des Dents CouronneesDocument37 pagesLe Devenir Des Dents CouronneesCarmen StoicaPas encore d'évaluation
- Dépistage Des Cancers de La Cavité Buccale1 DR S.AMAROUCHEDocument5 pagesDépistage Des Cancers de La Cavité Buccale1 DR S.AMAROUCHENova FlowerPas encore d'évaluation
- Rfe Intubation Extubation2016Document41 pagesRfe Intubation Extubation2016Salma DridiPas encore d'évaluation
- Article 1 - Combien D'échographies Pour Le Suivi Des Grossesses A' Bas RisqueDocument6 pagesArticle 1 - Combien D'échographies Pour Le Suivi Des Grossesses A' Bas Risqueyanel TchoboPas encore d'évaluation
- CR Echo Gynco 2015 CNGOFDocument22 pagesCR Echo Gynco 2015 CNGOFMartine MAILLOTPas encore d'évaluation
- Saos 10Document9 pagesSaos 10Eli AhoblePas encore d'évaluation
- Chenet 14h00Document22 pagesChenet 14h00choaybPas encore d'évaluation
- OrthophonieDocument80 pagesOrthophoniewissem mahrezPas encore d'évaluation
- Trauma Cheville EnfantDocument5 pagesTrauma Cheville EnfantLucas LeclercqPas encore d'évaluation
- ABC-265926-Nouvelles Du Comite Scientifique Et Des Groupes de Travail-VTa9c38AAQEAAHh4r-GAAAAHDocument5 pagesABC-265926-Nouvelles Du Comite Scientifique Et Des Groupes de Travail-VTa9c38AAQEAAHh4r-GAAAAHchatxxnoir4263Pas encore d'évaluation
- Prothèses Digestives Et ImagerieDocument10 pagesProthèses Digestives Et ImagerieRaouf AbbesPas encore d'évaluation
- Effets Gastro Intestinaux Majeurs Des Anti Inflammatoires Non Steroidiens Ains Etude Prospective Marocaine-U9Mk2n8AAQEAAA6pPtYAAAABDocument5 pagesEffets Gastro Intestinaux Majeurs Des Anti Inflammatoires Non Steroidiens Ains Etude Prospective Marocaine-U9Mk2n8AAQEAAA6pPtYAAAABAziz ZakariaPas encore d'évaluation
- Fertiloscopy Tunisian ExperimentDocument7 pagesFertiloscopy Tunisian ExperimentFatehMoussaPas encore d'évaluation
- Maladie Parondontale-FrDocument27 pagesMaladie Parondontale-FrHina HinsPas encore d'évaluation
- Guide de L Orthophoniste Volume 1 Savoirs Fondamentaux de L Orthophoniste SommaireDocument14 pagesGuide de L Orthophoniste Volume 1 Savoirs Fondamentaux de L Orthophoniste SommaireEHOUMANPas encore d'évaluation
- Aide SoignantDocument2 pagesAide Soignantmessaoud.ts06Pas encore d'évaluation
- DASRI Guide ADEME Tri Dechets Secteur Diffus 07 2012Document19 pagesDASRI Guide ADEME Tri Dechets Secteur Diffus 07 2012c. O. STELPas encore d'évaluation
- Referentiel VM CompletDocument23 pagesReferentiel VM CompletDavid RockfelerPas encore d'évaluation
- Perspectives Numériques, Intelligence Artificielle: ChapitreDocument8 pagesPerspectives Numériques, Intelligence Artificielle: Chapitrepopotahar35Pas encore d'évaluation
- Décret #0121-PR-MS Fixant Les Modalités D'organisation Et de Délivrance Des Diplomes Des Professions ParamédicalesDocument7 pagesDécret #0121-PR-MS Fixant Les Modalités D'organisation Et de Délivrance Des Diplomes Des Professions ParamédicalesMO JOPas encore d'évaluation
- Liste Regl Berufe FDocument22 pagesListe Regl Berufe FJovana IlicPas encore d'évaluation
- Violences Obstétricales. Le Rapport Du Haut Conseil À L'égalitéDocument174 pagesViolences Obstétricales. Le Rapport Du Haut Conseil À L'égalitéAnonymous fqa7PO8oPas encore d'évaluation
- Digitalisation Du Segment KLORANE BébéDocument105 pagesDigitalisation Du Segment KLORANE BébéOnline TeChPas encore d'évaluation
- La Ptme A Kinshasa RDC Rashidi Amboko FinalDocument18 pagesLa Ptme A Kinshasa RDC Rashidi Amboko FinalambokoPas encore d'évaluation
- 3083 PDFDocument3 pages3083 PDFanousa494Pas encore d'évaluation
- ANAP Notice Outil Diagnostic DMS V2.0Document17 pagesANAP Notice Outil Diagnostic DMS V2.0Imane AlaabouchePas encore d'évaluation
- Chirurgie Pratique-1Document129 pagesChirurgie Pratique-1FARTIN JustinPas encore d'évaluation
- Soigner, Le Premier Art de La VieDocument18 pagesSoigner, Le Premier Art de La VieARNAUDAUBRYPas encore d'évaluation
- Les Droits Du PatientDocument4 pagesLes Droits Du PatientJean Mouloud L'arabePas encore d'évaluation
- 010020535Document40 pages010020535Maître BiwenguaPas encore d'évaluation
- Rapport PFE Ghizlane Ech-ChiguerDocument107 pagesRapport PFE Ghizlane Ech-ChiguerkawtarlawthiPas encore d'évaluation
- Dossier Inscription Brancardier 2022Document10 pagesDossier Inscription Brancardier 2022Luiz BritoPas encore d'évaluation
- 01.ortoph Anaes 2001-2Document80 pages01.ortoph Anaes 2001-2Abdessamad Le CavalierPas encore d'évaluation
- FICHE 1 Secret ProfessionnelDocument2 pagesFICHE 1 Secret Professionnelwissal.zliga09Pas encore d'évaluation
- 6-F Bouhour F Daidj 12h25Document12 pages6-F Bouhour F Daidj 12h25eldecox11Pas encore d'évaluation
- Tfe Cecile CastellaDocument30 pagesTfe Cecile Castellaۥٰۥٰۥٰ ۥٰۥٰۥٰPas encore d'évaluation
- Principes Et Regles D'ErgonomieDocument36 pagesPrincipes Et Regles D'ErgonomieAhmadou Dame GAYEPas encore d'évaluation
- La Prise en Soins Interdisciplinaire Du Patient Porteur D'escarre(s) - 2Document1 pageLa Prise en Soins Interdisciplinaire Du Patient Porteur D'escarre(s) - 2jady00Pas encore d'évaluation
- U.E 2.7 Cas Concret Sclérose en PlaquesDocument6 pagesU.E 2.7 Cas Concret Sclérose en PlaquesAnaïs ThuaudetPas encore d'évaluation
- Demande Prestations Assurance Maladie QUEBECDocument2 pagesDemande Prestations Assurance Maladie QUEBECRed HsePas encore d'évaluation
- ANS - DMN - Arbre de Decision DMN V6 - 20231127Document1 pageANS - DMN - Arbre de Decision DMN V6 - 20231127chdPas encore d'évaluation
- Pédiatrie - Pour Le Praticien 2020 PDF - PDF - Hôpital - Professionnel de La SanDocument1 539 pagesPédiatrie - Pour Le Praticien 2020 PDF - PDF - Hôpital - Professionnel de La SananomenatantelyPas encore d'évaluation
- Guide Cassiopee 2016Document120 pagesGuide Cassiopee 2016thierryPas encore d'évaluation
- Anthropologie Pharmaceutique - Prof JMB - Unikin - 2022Document37 pagesAnthropologie Pharmaceutique - Prof JMB - Unikin - 2022Médi MenakuntimaPas encore d'évaluation