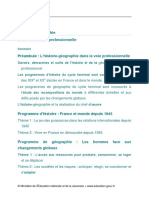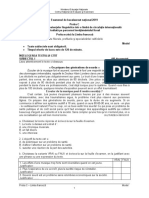Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
NECHAD Abdelhamid
NECHAD Abdelhamid
Transféré par
Hicham AltosCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
NECHAD Abdelhamid
NECHAD Abdelhamid
Transféré par
Hicham AltosDroits d'auteur :
Formats disponibles
COLLOQUE INTERNATIONAL MIGRATION MAGHREBINE : ENJEUX ET CONTENTIEUX OUJDA LE 24 ET 25 NOVEMBRE 2005
Pauvret et immigration clandestine : Cas du Maroc
Prsenter par : Abdelhamid NECHAD Professeur dconomie la facult de Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Universit Mohammed Ier, Oujda (Maroc) Chercheur Associ Au Groupe de Recherche sur les Economies Locales, Universit du Littoral (France)
Prs de 2 millions de marocains vivent et travaillent actuellement en Europe. LEurope continue dattirer les marocains, et les marocains rvent de lEurope non pas seulement pour des raisons conomiques, comme ctait le cas dans le pass, mais galement pour des raisons psychologiques. Dans limaginaire marocain, lEurope est une terre de rve. Ils rvent dune Europe comme celle quils voient la tlvision. Une Europe o domine labondance, la prosprit et la dmocratie. Pour ces jeunes, migrer cest fuir la misre, la pauvret et la privation, fuir une socit archaque qui noffre, selon eux, aucune perspective davenir. A travers notre contribution ; nous essayerons, dans un premier paragraphe, de survoler basse altitude les caractristiques ainsi que lhistoire du mouvement migratoire marocain, Pour analyser dans un second paragraphe les principaux traits de la pauvret au Maroc. Le troisime et dernier paragraphe est consacr au lien de causalit ; pauvret- immigration clandestine, dans sa dimension conomique et sociale. Historique et caractristiques de lmigration marocaine : Vivre ltranger fait rver une grande partie de la population marocaine tel point que limmigration est devenu un mot dordre, une sorte despoir collectif. Partir cest la nouvelle cl de la russite, une forme de ralisation de soi. La migration des marocains a commenc pendant les annes 60 dans le but de rpondre aux besoins de reconstruction de lEurope de laprs deuxime guerre mondiale. La principale caractristique de lmigration de cet poque cest quelle avait un aspect proltaire, les candidats au dpart se recrutaient surtout parmi les ouvriers, les agriculteurs et les sans emplois. Aprs la deuxime guerre mondiale, limmigration dans les pays de lunion europenne sinscrivait essentiellement dans le cadre des programmes de recrutement dune mainduvre considre comme temporaire. Mais au fils des jours, le retour des immigrants au pays dorigine est devenu moins systmatique et de plus en plus rare. Ces travailleurs se sont fait rejoindre par leurs familles. Ainsi, ce mouvement a pris une nouvelle forme savoir la
migration fminine et sest poursuivi durant la dernire dcennie du sicle dernier, par la fuite des cerveaux. On peut distinguer quatre priodes diffrentes qui nous permettent de caractriser le processus du mouvement migratoire marocain ltranger : La premire priode se situe entre les deux guerres. Il sagit des premires tentatives de limmigration collective organise. Cette priode a t caractrise par une immigration des travailleurs originaires des rgions de Sous et du Rif, recruts sur contrats, affects principalement pour une dure temporaire aux usines darmement, aux mines et au secteur agricole. La deuxime priode commence ds le lendemain de la deuxime guerre mondiale jusqu larrt de limmigration dcid par certains pays daccueil cause du ralentissement de leur croissance conomique au dbut des annes 70. Jusquici ; limmigration tait considre comme un produit marocain dexportation et un choix stratgique et structurel pour limiter les pressions dmographiques, conomiques, politiques et sociales. La troisime phase, couvre la priode de 1974 1985. En 1974, le ralentissement de la croissance conomique conduit les pays rcepteurs dcider de mettre fin limmigration, sauf dans le cadre de regroupement familial et de demandes spcifiques manant demployeurs. Cest partir de cette date charnire que limmigration va connatre des mutations profondes dans sa structure, sa composition, ses difficults, ses revendications, son volution, etc. Enfin la quatrime phase stale de 1985 nos jours. Les fondements des accords de Schengen I (1985) et de Schengen II (1990) remontent 1984 et visent labolition des formalits de douane et de police quant aux frontires internes des tats membres. En 1985, les accords de Schengen I impliquaient seulement cinq pays : Belgique, Pays-
Bas, France et Allemagne. En 1990 sy joint lItalie. LEspagne et le Portugal viendront en 1991 et la Grce en 1992. Les accords de Schengen visent : La suppression des contrles aux frontires internes ; le renforcement des contrles aux frontires externes ; luniformisation de la politique de visa.
Nous ne disposons pas de donnes adquates concernant le nombre dmigrs marocains vivant ltranger, mais des estimations avancent le chiffre de 3 millions de personne. Cette population qui sest tabli dans sa majorit dans les pays de lunion europenne se concentre plus particulirement dans six pays europens, savoir la France, les Pays-Bas, la Belgique, lItalie, lEspagne et lAllemagne. La communaut marocaine installe dans ces pays reprsente 78% de la totalit de la population ltranger. La France qui tait pendant longtemps la destination privilgie de lmigration marocaine accueille actuellement, elle seule 39% de la population marocaine ltranger et prs de 50% de la population tablie au sein de lunion europenne. On soulignera cependant que les flux migratoires vers lEurope ont connu des inflexions assez remarquables ces deux dernires dcennies en faveur des pays de lEurope du Sud, particulirement lEspagne et lItalie, qui ont progressivement pris le relais des destinations traditionnelles de lmigration marocaine. La part de la population migr dans les pays arabes reste limite et ne dpasse pas 14% des marocains ltranger. Enfin, les pays dAmrique accueillent au total prs de 5% de la population marocaine tablies ltranger, soit quelque 120000 personnes rparties presque galit entre le Canada et les Etats-Unis, deux nouvelles destinations exerant une forte attractivit sur les jeunes se prvalant de comptences scientifiques et techniques. Comme nous venons de le signaler, lmigration vers lextrieur nest pas un phnomne nouveau pour les marocains puisque leur dpart vers lEurope remonte des sicles. Mais au
fil des annes et depuis prs dun demi-sicle, le phnomne migratoire marocain ne cesse de se transformer et de se sdentariser. Il a chang de nature, il se renouvelle constamment : dune immigration de main duvre temporaire une immigration durable et dfinitive, dune immigration individuelle compose dhommes une immigration familiale compose pour lessentiel de femmes et denfants ; dune immigration masculine une immigration htrogne et diversifie (rajeunissement, fminisation, mobilit sociale, naturalisation, etc.). Tous ces indicateurs tmoignent de la transformation profonde que limmigration a connu au fil des annes. Ainsi, nous pouvons dire que les candidats au dpart changent de direction, ils regardent dsormais de lautre ct de lAtlantique. Aussi, ce mouvement migratoire, vers cette nouvelle destination, prendra-t-il des proportions plus importantes mesure que les pays europens renforcent leurs frontires et bloquent limmigration en provenance des pays du tiers-monde et principalement du continent africain. Certes, le rythme de limmigration sacclre au cours des annes croire que tout le monde veut migrer. Cela renseigne sur le malaise profond qui ronge le pays. On parle partout de cette nouvelle forme dmigration, de la fuite des cerveaux et de llite. Le manque de confiance et labsence de perspectives davenir sont avancs pour justifier cette hmorragie.
Lhistoire ainsi que les caractristiques du mouvement migratoire marocain nous poussent se poser des questions quant aux origines du phnomne et les facteurs layant acclr. Il ny a aucun doute que la pauvret figure en ttes listes concernant les principales raisons de dpart. Quen ai-t-il donc de cette pauvret et quels sont ces principaux traits ? La pauvret au Maroc : quelques chiffres Le Maroc urbain appartient cette catgorie de pays en voie de dveloppement avancs. Toutefois, cette prouesse dissimule la ralit vcue par de larges couches de la socit marocaine. Ceci provient du fait que les chiffres ne donnent aucune ide sur ceux qui sont
exclus de la socit de consommation et qui sont beaucoup plus nombreux. En effet, depuis le dbut des annes quatre-vingt-dix, le Maroc sest trouv confront une situation sociale en perptuelle dgradation, caractrise la fois par une pauvret grandissante et un creusement des ingalits. La proportion de la population vivant en dessous du seuil national de pauvret atteint 19 % en 2003, contre 13 % en 1997. En outre, les ingalits sont criantes. Selon un rapport publi par lOCDE1, 10 % des plus pauvres dtiennent 2,6 % de la richesse nationale, tandis que 10 % des plus riches en possdent 30,9 %. Daprs une tude non diffuse ralise par une socit prive de Casablanca, seuls 30% des foyers bnficient dun pouvoir dachat susceptible dintresser les producteurs et les distributeurs de biens de consommation modernes. En effet, 15 % dentre eux ont un revenu mensuel suprieur 15 000 dirhams (soit environ 1400 euros) et 15 % ont entre 8000 et 14 000 dirhams par mois. Cette frange de la population, qui compte environ huit millions de personnes, rside pour sa majorit dans les grandes villes. Une deuxime tranche de 30 % dispose dun revenu mensuel qui varie entre 3000 et 7000 dirhams. Pour ces mnages, le budget consacr la consommation saccapare la part la plus importante de leurs revenus. Toutefois, quelques dpenses de luxe peuvent tre exceptionnellement ralises. Enfin, 40 % des foyers ont un pouvoir dachat infrieur 3000 dirhams par mois. Le souci principal pour ce genre de mnages est plutt la survie que la consommation. Il convient de signaler que le nombre de personnes vivant dans les mnages pauvres est plus important que celui de ceux qui vivent dans les foyers aiss, ce qui vient aggraver ces donnes. Aussi, et comme cest toujours le cas avec lanalyse en termes de pauvret montaire, la consommation moyenne annuelle par foyer, que lon peut estimer 46 300 dirhams, prsente dimportantes ingalits.
OCDE, Perspectives conomiques en Afrique2002, site web :http// :www.ocde.org
En effet, les 20 % les plus aises ralisent la moiti des dpenses totales, tandis que les 40 % les plus pauvres nassurent que 17,15 % des dpenses. La principale discrimination seffectue donc par le biais de la consommation. Ce qui rejoint dailleurs les propos de Majid Rahnema, lors dune confrence tenue lUniversit du Littoral Cte dOpale en octobre 2002 o il a insist sur laspect agressif que revtent les dpenses effectues par les couches les plus favorises et qui contribuent nourrir les frustrations parmi les populations vulnrables.
Le sort de ceux quon qualifie d enfants des rues est encore plus frustrant. Mohamed Abid Slaoui, dans son livre les enfants de la pauvret2, note quon comptait prs de 400 000 enfants des rues en 2000. Selon une autre enqute ralise par une ONG de Tanger, ces enfants viennent la plupart du temps de familles clates. Dhabitude, ils ont entre 10 et 14 ans, analphabtes 85 %, et plus de 40 % ont quitt leur famille loccasion dune violence physique ou dun abus sexuel exercs leur gard. Depuis 1995, plusieurs milliers dentre eux dbarquent Tanger dans lespoir de traverser le dtroit et de rejoindre lautre rive de la mditerrane. De la pauvret limmigration clandestine La fivre de limmigration clandestine ne sapaise pas. Les clandestins de nationalit marocaine dtiennent le record du nombre le plus important des voyageurs sans papiers, non seulement en Espagne, mais aussi au Portugal. Ce dernier reprsente un tremplin vers dautres destinations privilgies comme le Canada ou les Etats-Unis. Cest en tout cas ce quont attest les statistiques publies par le service des trangers et des frontires franais la fin de lanne 2001 et au dbut de lanne 2002. Il ny a aucun chiffre officiel relatif au nombre de Marocains qui essaient de migrer illgalement en Espagne. Toutefois, selon un article de Nizar Al-Ali les observateurs disent
2
Cit par Chaara T., 400 000 enfants mineurs vagabondent dans les rues, Al Ittihal Al Ichtiraki, n6368, 15 janvier 2001.
quau moins deux cents marocains entreprennent chaque mois ce voyage dangereux. Nul ne sait combien de personnes arrivent faire la traverse3. Selon Jean-Pierre Tuquoi du quotidien Le Monde : En moins de vingt-quatre heures, les cadavres de treize migrs clandestins partis du Maroc ont t retrouvs sur les ctes espagnoles. Mercredi 22 aot 2001, quatre corps avaient t reprs quelques mtres dune plage dAlmeria, dans le sud du pays ; le lendemain, neuf autres cadavres taient rcuprs sur les ctes de Fuerteventura, lle de larchipel des Canaries la plus proche du continent africain4. Le mme quotidien ajoute que tant les ctes de lEspagne que les les Canaries voient dbarquer de plus en plus dimmigrants clandestins. En 2001, prs de 8500 personnes ont t arrtes par la police espagnole, soit deux fois plus quen 2000. Parfois, ces immigrants narrivent pas leur destination parce que leurs petits bateaux de pche sont submergs deau ou parce que lun des capitaines profite de lobscurit et dbarque ses passagers sur des ctes marocaines en leurs faisant croire que cest lEurope. Le transport des immigrants clandestins vers lEspagne est devenu un commerce en pleine expansion au Maroc. Ce commerce est contrl par des bandes qui sont payes entre 10 000 et 30 000 dirhams pour aider les passagers faire le voyage, sans que ces derniers ne soient srs darriver sains et saufs destinations, et donc dchapper leur situation de prcarit. Nizar Al-Ali signale que, selon des sources officielles, un millier de personnes se sont noyes lanne dernire dans le dtroit, tandis que certains avancent des chiffres plus alarmants. Un sondage ralis en 2002 par Le Journal, un journal indpendant, montre que 90% des jeunes marocains veulent migrer et vivre ltranger. Selon le mme sondage, 89 % des jeunes de vingt vingt-neuf ans souhaitent migrer. Ce taux descend 71 % pour les personnes
Al-Ali N., Des jeunes dsesprs tentent de quitter lenfer pour les pays de lespoir, site web :www.oneworld.org/owe/news/ips/13_17_134.html 4 Tuquoi J-P., Limmigration clandestine crispe les relations entre le Maroc et lEspagne, site web : www.lemonde.fr/article/0,5987,3210216612-,00.html
entre trente et trente-neuf ans. Les femmes ne font pas exception, puisque Le Journal souligne que 68 % des femmes interviewes dclarent quelles nhsiteront pas quitter le Maroc pour rejoindre lEurope ou le Canada. Le phnomne de limmigration clandestine est massif et concerne pratiquement toutes les catgories sociales. Le cas des migrants ruraux peut sexpliquer par leurs conditions de vie difficiles et par les annes de scheresse qui se sont rabattu sur le pays, contraignant ainsi les jeunes lexil. Or, la fivre de limmigration concerne galement les citadins dont les aspirations au dpart sont pratiquement les mmes dans les petites villes que dans les grandes agglomrations. Cette tendance touche aussi bien les jeunes des bidonvilles que ceux des classes moyennes diplms et touchs par le chmage. Mohammed, un jeune de Fs, a termin ses tudes universitaires il y a six ans. Aprs avoir dcroch une licence en sciences conomiques, il sest retrouv face une situation de chmage. Mohammed se dit prt tout pour partir en Europe, mme sil sagit de prendre le large bord dun patera. Il se plaint en disant quil ne peut plus continuer dpendre de son pre qui fait vivre une famille de sept personnes avec une pension de retraite qui ne dpasse pas 3000 dirhams. Mohammed pense amrement plusieurs de ses amis denfance qui se sont tablis en France et en Grande-Bretagne. Ceux-ci retournent chaque t au Maroc et font une dmonstration de leur confortable situation matrielle: des voitures, des cartes de crdit, etc. Toutefois, il convient de signaler que lapparente abondance que vivent ces jeunes immigrs dissimule parfois des situations qui peuvent parfois savrer calamiteuses. Les vnements quont connus les banlieues franaises en novembre 2005 en sont lexemple le plus frappant. En effet, travers une enqute que nous avions mens, en lan 2002, dans la ville de Roubaix qui se situe une dizaine de kilomtres de Lille, nous avions pu constater que les familles dimmigrants sont statistiquement les plus pauvres. Elles ont souvent souffrir des problmes
de scolarisation et de niveaux dducation infrieurs la moyenne, elles sont plus mal loges et se trouvent virtuellement confines dans des ghettos, la formation professionnelle de leur membres est infrieure, et elles connaissent des taux de chmage suprieurs la moyenne. Tous ces facteurs se traduisent par une activit anormale dans les trafics illicite en tout genre, par la formation des gangs et par la petite criminalit. Sil faut dire leur crdit que la trs grande majorit de ces immigrants ne participe pas des activits illgales, il nen reste pas moins prt, en gnral, travailler au noir pour des salaires de misre et sans protection sociale. Qui dit emploi illgal dit employeurs illgaux ; ceux-ci sont parfois en cheville avec des mafias vivant de la contrebande de personnes, phnomne tolr par le gouvernement qui a conscience que ses entreprises ont besoin de cette main duvre bon march pour rester comptitives. On ferme les yeux, la corruption stend, les crimes restent impunis et, tort ou raison, les travailleurs immigrs sont perus comme des concurrents pour lemploi qui, en outre, tire les salaires la baisse. Dune manire gnrale, ce genre de pratiques stimule les politiques extrmistes qui fleurissent des deux cts. Certains immigrants peuvent chercher refuge dans des pratiques culturelles et religieuses exacerbes qui les rendent encore moins acceptables aux yeux de la population locale, ce qui cre un cercle vicieux de la haine. Ces trangers, que les Etats du Nord trouvent dj difficiles assimiler, ne reprsentent quune petite fraction de ceux qui vont bientt chercher migrer sous leffet de la pression exerce par les carte de crdit et les voitures de luxe dans lesquels circulent les cousins et les cousines vivant ltranger et qui renvoie un mode de vie ou lopulence est le matre du jeu. Susan Gorge estime dans son ouvrage Le Rapport Lugano 5, que les phnomnes de la surpopulation dans le Sud et de la prsence de plus en plus marque de migrants venus du Sud dans le Nord impliquent terme de graves confrontations culturelles et des implosions. Le
George S., Le Rapport Lugano , Fayard, Paris, 2000.
scnario du Choc des civilisations opposant lOccident au reste du monde a, juste titre, attir fortement lattention.
Il est vident que laspiration sexiler sexplique par laccroissement du dcalage du niveau de vie entre le Nord et le Sud de la plante, mais aussi par des raisons plus profondes. Dune part, il y a limage vhicule par les mdias et qui sest rvle trompeuse plusieurs reprises. Dautre part, le poids des conflits intergnrationnels, sources de vives tensions entre un pre lev dans un monde communautaire et son enfant qui aspire lindpendance.
Grce au dveloppement des tlcommunications et de linformation, la tlvision internationale met en interaction les nationalits et les cultures les plus diverses. Elle diffuse partout sur la plante limage dun mode de vie occidental comportant une consommation leve, un confort matriel et un divertissement permanent (musique, films, vido). Cependant, la diffusion mondiale des valeurs dmocratiques et du respect des droits de lHomme, la substance mme de la civilisation occidentale, est moins massive. On observe une certaine homognisation culturelle chez les nouvelles gnrations sduites par la satisfaction immdiate des besoins matriels. Ce phnomne ne saccompagne pas ncessairement dune nouvelle thique plantaire par ce quil ne relgue au second rang la cohsion sociale et les habitudes de consommation cologiques. Pour Oswaldo De Rivero, ancien ambassadeur du Prou aux Nations Unis le confort capitaliste peut cohabiter aujourdhui avec la barbarie 6. Aucun Etat-nation aujourdhui nest labri des images transnationales sduisantes faisant primer la satisfaction individuelle immdiate sur lgalit et la solidarit. Dans tous es pays, la version individualiste la plus radicale du capitalisme est prsente comme lunique paradigme
6
DE RIVERO O., Le mythe du dveloppement : Les conomies non viable du XXIme sicle , Tarik Edition, Casablanca, Collection Enjeux Plante, Casablanca, 2003.
du bonheur. Les gens lacceptent et le dsirent, malgr le risque dexclusion sociale, parce quil gardent lespoir de faire partie un jour de cette lite mondiale. En fin de compte ce sont des les millions de jeunes sans emplois de ces pays sous-dvelopps ayant accd lindpendance dans la deuxime moiti du vingtime sicle qui payent aujourdhui le prix de cette banalisation du mode de consommation occidental, eux qui ne pensent qu migrer vers lancienne mtropole coloniale contre laquelle ironiquement leurs parents et grands parents sinsurgrent pour leur donner un Etat- nation. Il nest donc pas surprenant que les habitants du Puerto Rico de lle de Palau dans lOcan Pacifique ne veulent pas se sparer des EtatsUnis et que les habitants des le Comores affichent vouloir tre recoloniss par la France.
Avec les succs des mouvements populistes en Europe, les responsables sont dtermins faire face laugmentation du nombre dmigrants clandestins. En effet, les chefs dEtat et de gouvernement de lUnion europenne ont adopt le 22 juin 2002 Sville un plan daction pour la lutte contre limmigration illgale. Le mme sommet a dcid de mettre en place une gestion coordonne et intgre des frontires extrieures. Il a demand aux Etats membres de mettre en uvre des oprations conjointes aux frontires extrieures, le lancement immdiat de projets pilotes ouverts tout les Etats membres intresss et la cration dun rseau dofficiers de liaison dimmigration des Etats membres en juin 2003.
Les dirigeants europens ont considr que la lutte contre limmigration clandestine ncessite un effort accru de la part de lUnion europenne et une approche cible du phnomne. Ils ont soulign quil importe dassurer la coopration des pays dorigine et de transit, notamment le Maroc, en matire de gestion conjointe et de contrle des frontires. Ajout cela les actions de certains gouvernements europens. Ainsi, par exemple, avec larrive au pouvoir, en Hollande, du gouvernement actuel en 2002, un nouveau ministre a
t cre auprs du ministre de la justice : le ministre dimmigration et dintgration. On a fond ce ministre parce quon avait constat que la politique en gnral avait nglig les effets de limmigration sur la socit hollandaise. Lide gnrale, exprim surtout par un candidat nationaliste pour les lections de 2002, Pim Fortuyn (qui tait assassin juste avant les lections) tait que la politique dintgration avec maintient didentit navait pas fonctionn. Selon Judith Richters7, du Centre dEtudes Pdagogiques Chrtiennes dUtrecht ; cette politique avait eu comme effet que les immigrs ntaient pas forcs sintgrer dans la socit et que les hollandais dans les grandes villes ne sentaient plus laise dans leur propre banlieue.
Selon un article publi par Le Monde, ce ne sont pas uniquement les jeunes qui rvent dmigrer, mais aussi leurs ans, diplms et ayant dj un emploi stable. Les candidats lexil ne sont plus seulement des dshrits qui partent chaque t, au pril de leur vie, dans des embarcations de fortune, destination de Gibraltar ou des Canaries, mais aussi des cadres, remarque un chef dentreprise install Casablanca. Il enchane en disant : Je comprends quon veuille quitter lAlgrie et ses gnraux, la Tunisie et sa dictature, mais le Maroc, au moment o les perspectives sont infiniment meilleures quautrefois je ladmets mal!8. Le Maroc du dbut du XXIme sicle risque donc de se voir priv de llite de sa jeunesse. Beaucoup parmi eux se sont montrs prts faire leur vie ltranger. En mobilisant leurs avantages comparatifs, savoir leurs diplmes, ils bnficient de la mondialisation conomique et de la rvolution des tlcommunications qui acclrent le phnomne de la fuite des cerveaux. Quant aux non-diplms, et aussi les diplms des facults de lettres et de Droit, Ils ne peuvent que tenter dautres pistes pour migrer.
7 8
Beaug F., De plus en plus de Marocains rvent de partir pour mieux vivre, avec ou sans visa, web : www.lemonde.fr/article/0,5987,3212261630-,00.html
site
Conclusion La fivre de limmigration clandestine naffecte pas uniquement le Maroc. La grande majorit des pays sous-dvelopps et en voie de dveloppement est concerne par ce flau. La rsolution de ce phnomne ncessite, lengagement et la collaboration des acteurs concerns. Les pays de la rive nord de la mditerrane sont appels collaborer avec le sud en vue de mettre en place est une vraie stratgie de co-dveloppement comme ctait le cas pour les pays de lEurope de lEst avant leur adhsion lunion europenne. Il convient donc de repenser la politique de coopration de manire la rendre plus dynamique afin de soutenir la croissance dans les pays du dpart et crer par consquent des emplois, seul moyen susceptible dattnuer la pression migratoire. Si lon tient lvolution conomique prvisible des pays du tiers-monde, leur capacit ne serait pas ne mesure, dans les conditions actuelles, dabsorber la masse des sans travail et trouver de lembauche pour les jeunes demandeurs demplois. Do, lmigration doit demeurer, dans ces pays, terme un facteur de rgulation et absorber une partie de cette offre additionnelle de travail. Face cette situation les pays daccueil surtout, ne doivent pas se limiter llaboration de stratgies scuritaires (fermeture des frontires, rpression et rapatriement des immigrs en situation irrgulires) mais ils sont appel investir dans les pays metteurs. Ceci peut constituer une lutte plus dynamique et plus efficace contre ce flau. La lutte contre limmigration clandestine ne peut se limiter des oprations ponctuelles de police qui savrent suffisantes au regard dune situation aussi complexe. Seule une approche de codveloppement efficace pourrait dgager des solutions satisfaisantes aussi bien pour les pays dorigine et de transit que pour les pays daccueil.
Bibliographie : Al-Ali N., Des jeunes dsesprs tentent de quitter lenfer pour les pays de lespoir, site web :www.oneworld.org/owe/news/ips/13_17_134.html Beaug F., De plus en plus de Marocains rvent de partir pour mieux vivre, avec ou sans visa, site web : www.lemonde.fr/article/0,5987,3212261630Chaara T., 400 000 enfants mineurs vagabondent dans les rues , Al Ittihal Al Ichtiraki, n6368, 15 janvier 2001. George S., Le Rapport Lugano , Fayard, Paris, 2000. George S., Un autre monde est possible si , Fayard, Paris, 2004. De Rivero O., Le mythe du dveloppement : Les conomies non viable du XXIme sicle , Tarik Edition, Casablanca, Collection Enjeux Plante, Casablanca, 2003. Nechad A., Analyse Critique des thories et des indicateurs de la pauvret : appui lexprience marocaine , thse de Doctorat, Universit du Littoral Cte dOpale, Dunkerque, 16 mai 2003. Nechad A., De la pauvret situe , Communication au colloque internationale de lEcole Suprieur de Technologie, Amnagement territoriale et dveloppement durable : acteurs et supports, Oujda, mai 2006. OCDE, Perspectives conomiques en Afrique2002, site web :http// :www.ocde.org Rahnema M., Quand la misre chasse la pauvret , Fayard, Paris, 2003. Stiglitz J., Un autre monde : contre le fanatisme du march , Fayard, 2006. Tuquoi J-P., Limmigration clandestine crispe les relations entre le Maroc et lEspagne, site web : www.lemonde.fr/article/0,5987,3210216612-,00.html Ziegler J., Lempire de la honte , Fayard, Paris, 2005. Ziegler J, Les nouveaux matres du monde , Fayard, Paris, 2002.
Vous aimerez peut-être aussi
- Histoire Cooperation Eco Sénégal MarocDocument1 pageHistoire Cooperation Eco Sénégal MarocKhalil NaouiPas encore d'évaluation
- Guide Des Programmes de Financement Et D'appui Pour Les Entreprises Marocaines - Cluster SolaireDocument51 pagesGuide Des Programmes de Financement Et D'appui Pour Les Entreprises Marocaines - Cluster SolaireIBTISSAM OUMEZLOUGPas encore d'évaluation
- Version FinaleDocument23 pagesVersion FinaleNicolas ReymondPas encore d'évaluation
- Guide-Investisseur Ecosystemes Offshoring-2Document13 pagesGuide-Investisseur Ecosystemes Offshoring-2youssefelabbassi0% (1)
- 1 PBDocument24 pages1 PBGOKOPas encore d'évaluation
- Magazine Conjoncture 981 Mai 2016Document60 pagesMagazine Conjoncture 981 Mai 2016مول لكيت - Moul L'KitPas encore d'évaluation
- Etude Pays Maroc 27.08.10 - tcm449-104373Document79 pagesEtude Pays Maroc 27.08.10 - tcm449-104373Mohamed ZoubairPas encore d'évaluation
- Droit BoursierDocument5 pagesDroit Boursierfelix mignon OndayePas encore d'évaluation
- HANAA MOUAZEN - Présentation PPT COMM MARRAKECHDocument17 pagesHANAA MOUAZEN - Présentation PPT COMM MARRAKECHMouazen HanaaPas encore d'évaluation
- Des Fonds D'investissement Et Des Fonds VautoursDocument30 pagesDes Fonds D'investissement Et Des Fonds VautoursBOUKAKA JeanPas encore d'évaluation
- Memoire Pour L'Obtention de La Licence Fondamentale Filière: Sciences Economiques & GestionDocument58 pagesMemoire Pour L'Obtention de La Licence Fondamentale Filière: Sciences Economiques & GestionYasmine KallefPas encore d'évaluation
- 1re Spe 2 Cours Soft Power Linguistique 2022-07Document12 pages1re Spe 2 Cours Soft Power Linguistique 2022-07Guilherme MARINHO DE MIRANDAPas encore d'évaluation
- Kingdom of Morocco NUA Report 18 March 2022Document137 pagesKingdom of Morocco NUA Report 18 March 2022resaPas encore d'évaluation
- BMCI GestionDocument56 pagesBMCI GestionMarcoonanaPas encore d'évaluation
- Guide CréationDocument103 pagesGuide CréationoxxwoodPas encore d'évaluation
- Cours Droit Boursier 29 MarsDocument6 pagesCours Droit Boursier 29 MarsBrahim BenmoussaPas encore d'évaluation
- DEVD3140 - Les Accords de Pêche Le Cas Du Partenariat Maroc - Union EuropéenneDocument14 pagesDEVD3140 - Les Accords de Pêche Le Cas Du Partenariat Maroc - Union Européenneunmec12Pas encore d'évaluation
- Transparence Fiscale en Afrique 2021Document88 pagesTransparence Fiscale en Afrique 2021Hassan MhtPas encore d'évaluation
- Nouveau Partenariat Pour L'insertion Socio-Professionnelle Des Réfugiés Au MarocDocument2 pagesNouveau Partenariat Pour L'insertion Socio-Professionnelle Des Réfugiés Au MarocUNHCR MAROCPas encore d'évaluation
- Prescrition Entre Droit Civ Et ComDocument9 pagesPrescrition Entre Droit Civ Et ComSaid ZiraouiPas encore d'évaluation
- Introduction Au Droit Du TransportDocument2 pagesIntroduction Au Droit Du TransportMounir TahiriPas encore d'évaluation
- Les Enjeux de L Union AfricaineDocument62 pagesLes Enjeux de L Union AfricaineCheikh Talibouya NiangPas encore d'évaluation
- Femme Et Crime 1979Document245 pagesFemme Et Crime 1979sunsiarePas encore d'évaluation
- Etude IDS Maroc VFDocument33 pagesEtude IDS Maroc VFAli Amar100% (4)
- Secret Des Affaires: La Proposition de Loi SocialisteDocument20 pagesSecret Des Affaires: La Proposition de Loi SocialisteLaurent MAUDUITPas encore d'évaluation
- Etude Migrations MineursDocument52 pagesEtude Migrations MineursChaymae JabranePas encore d'évaluation
- Livre Blanc Sur Le Règlement en Ligne Des Litiges de Moins de 4000 EurosDocument44 pagesLivre Blanc Sur Le Règlement en Ligne Des Litiges de Moins de 4000 EurosArnaud DumourierPas encore d'évaluation
- Le Partenariat Public Privé Comme Un Nouveau Mode de Gestion Du Foncier Public FoncierDocument11 pagesLe Partenariat Public Privé Comme Un Nouveau Mode de Gestion Du Foncier Public FoncierLebbar MohcineePas encore d'évaluation
- Rapport Oxfam 2019 Un Maroc Egalitaire Une Taxation JusteDocument54 pagesRapport Oxfam 2019 Un Maroc Egalitaire Une Taxation JusteAli Amar50% (2)
- B2406070923 PDFDocument15 pagesB2406070923 PDFFerhat DerrouichePas encore d'évaluation
- Maroc: Entre Rafles Et Régularisations, Bilan D'une Politique Migratoire IndéciseDocument32 pagesMaroc: Entre Rafles Et Régularisations, Bilan D'une Politique Migratoire IndécisePress FidhPas encore d'évaluation
- Etude Sur Le Statut Juridique Des Terres CollectivesDocument100 pagesEtude Sur Le Statut Juridique Des Terres CollectivesBoujemaa Rbii100% (1)
- Les Dessous de La Diplomatie Économique Marocaine en AfriqueDocument4 pagesLes Dessous de La Diplomatie Économique Marocaine en AfriqueMeryem Chahli100% (1)
- Financement PME CAE - RapportPMEDocument102 pagesFinancement PME CAE - RapportPMESaloua ChachouaPas encore d'évaluation
- L - Islam Source D - Inspiration Du Droit MarocainDocument17 pagesL - Islam Source D - Inspiration Du Droit MarocainYounes IlahianePas encore d'évaluation
- Mission DiplomatiqueDocument13 pagesMission DiplomatiqueoumaimaPas encore d'évaluation
- SNIA 2017 CompletDocument150 pagesSNIA 2017 CompletOtameo100% (1)
- Les Instruments Juridiques de La Coopération InternationaleDocument5 pagesLes Instruments Juridiques de La Coopération Internationaledocisitt100% (1)
- InvestissementDocument3 pagesInvestissementlebanesefreePas encore d'évaluation
- Meilleur Memoire Defense Caip2022Document55 pagesMeilleur Memoire Defense Caip2022Antoine CpnsPas encore d'évaluation
- Juridictions Internationales Et Contentieux de LenvirronnementDocument42 pagesJuridictions Internationales Et Contentieux de LenvirronnementEloundouPas encore d'évaluation
- Industrie Commerce Economie Verte Et NumeriqueDocument71 pagesIndustrie Commerce Economie Verte Et NumeriqueGagAnasPas encore d'évaluation
- La Politique D'investissement CadreDocument19 pagesLa Politique D'investissement CadreserponPas encore d'évaluation
- Memoire Tanoh Ed TirageDocument60 pagesMemoire Tanoh Ed TirageMutanga ShemnyPas encore d'évaluation
- Plan D'acceleration IndustrielleDocument2 pagesPlan D'acceleration IndustrielleIsmail El AlamiPas encore d'évaluation
- Chap3-Les Communautés Économiques Régionales (CER) PDFDocument24 pagesChap3-Les Communautés Économiques Régionales (CER) PDFOumar BaPas encore d'évaluation
- Almaliya 54 PDFDocument60 pagesAlmaliya 54 PDFsimo100% (2)
- OMPICDocument1 pageOMPICazweegooPas encore d'évaluation
- Maroc Omc Wto Morocco Réponse Gvtg329 - FDocument20 pagesMaroc Omc Wto Morocco Réponse Gvtg329 - Fusinemaroc100% (1)
- Le Maroc BMondiale PDFDocument72 pagesLe Maroc BMondiale PDFAbderrazak OualiPas encore d'évaluation
- Les Enjeux Du Développement Durable PDFDocument16 pagesLes Enjeux Du Développement Durable PDFMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Strategie OMPIC 2020 FRDocument40 pagesStrategie OMPIC 2020 FRnizPas encore d'évaluation
- Statut de DirigeantDocument7 pagesStatut de DirigeantDacquinPas encore d'évaluation
- Section 2Document10 pagesSection 2coolmarouanePas encore d'évaluation
- Politique Marocaine AgriDocument20 pagesPolitique Marocaine AgriseranolamPas encore d'évaluation
- L'indépendance Dans L'interdépendanceDocument4 pagesL'indépendance Dans L'interdépendanceAyoub MabroukPas encore d'évaluation
- Droit Du Sport FinalDocument5 pagesDroit Du Sport FinalOtmane EnnajmiPas encore d'évaluation
- L’Interruption Volontaire De Grossesse: État De La Question, Suivi Du Problème De StérilisationD'EverandL’Interruption Volontaire De Grossesse: État De La Question, Suivi Du Problème De StérilisationPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument4 pagesIntroductionahmedPas encore d'évaluation
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةDocument3 pagesالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةRyma HamriPas encore d'évaluation
- Guide de Participation Citoyenne Lors de Projets D'urbanisme PDFDocument6 pagesGuide de Participation Citoyenne Lors de Projets D'urbanisme PDFLaura 123Pas encore d'évaluation
- REVOLUTION AGROECOLOGIQUE: Le Mouvement de Campesino A Campesino de l'ANAP Á CubaDocument184 pagesREVOLUTION AGROECOLOGIQUE: Le Mouvement de Campesino A Campesino de l'ANAP Á CubaPeter RossetPas encore d'évaluation
- Idéologie Et Appareils Idéologiques D'étatDocument57 pagesIdéologie Et Appareils Idéologiques D'étatOnze Wu100% (1)
- FRSHD PUB 00000012 DC attFRSHD PUB 00000012Document240 pagesFRSHD PUB 00000012 DC attFRSHD PUB 00000012beebac2009Pas encore d'évaluation
- Identité Et Violence D'amartya SenDocument5 pagesIdentité Et Violence D'amartya SenGuillaume VandecasteelePas encore d'évaluation
- Spe002 Annexe2 1239851Document11 pagesSpe002 Annexe2 1239851Fallou DiopPas encore d'évaluation
- Corée Du SudDocument17 pagesCorée Du Sudthymy magouilleslandPas encore d'évaluation
- Comment Prononcer Le - Ed en Anglais - Wall Street EnglishDocument11 pagesComment Prononcer Le - Ed en Anglais - Wall Street EnglishAdamPas encore d'évaluation
- La Lauseta: Almanach Du Patriote Latin Pour L'espagne, La France, (... ) 1878Document302 pagesLa Lauseta: Almanach Du Patriote Latin Pour L'espagne, La France, (... ) 1878Occitanica Médiathèque Numérique OccitanePas encore d'évaluation
- Vincent BounoureDocument7 pagesVincent BounourejuliomcPas encore d'évaluation
- Alain Laurent Abia ABOADocument10 pagesAlain Laurent Abia ABOAdulzuraliciousPas encore d'évaluation
- Test de FrancezăDocument4 pagesTest de Francezădstefoglo65Pas encore d'évaluation
- Cours - L3 - SOC AF - La Stratification SocialeDocument13 pagesCours - L3 - SOC AF - La Stratification Socialewelidiouf07Pas encore d'évaluation
- Nord UbangiDocument549 pagesNord UbangiNaud Balho100% (1)
- L'aménagement Du Territoire, Facteur Du Développement Économique Et Social Marocain, Entre L'héritage Colonial Et La Globalisation ÉconomiqueDocument14 pagesL'aménagement Du Territoire, Facteur Du Développement Économique Et Social Marocain, Entre L'héritage Colonial Et La Globalisation Économiqueأحمد أحمدPas encore d'évaluation
- Mohammed Boudjellal - Le Troisième Secteur : Un Segment de L'activité Sociétale Porteur de Justice ÉconomiqueDocument6 pagesMohammed Boudjellal - Le Troisième Secteur : Un Segment de L'activité Sociétale Porteur de Justice ÉconomiqueFondation Singer-PolignacPas encore d'évaluation
- 1597 20150202 PDFDocument20 pages1597 20150202 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Fausse Interview de "Luc Chatel" Par AtlanticoDocument3 pagesFausse Interview de "Luc Chatel" Par Atlanticotristan_bertelootPas encore d'évaluation
- Révision Bac VipDocument7 pagesRévision Bac VipAbdelWackyl HamoudPas encore d'évaluation
- Le Journal 12 Septembre 2010Document148 pagesLe Journal 12 Septembre 2010stefanoPas encore d'évaluation
- Institution Judiciare SenegalaisDocument37 pagesInstitution Judiciare SenegalaisMaimouna DoumbouyaPas encore d'évaluation
- HDR Talahite Janvier2010Document145 pagesHDR Talahite Janvier2010rafik94Pas encore d'évaluation