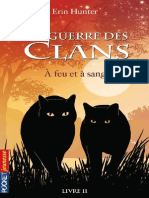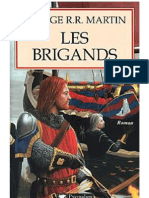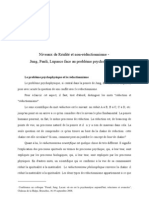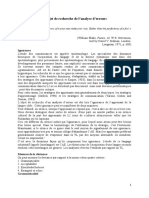Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Conscience A-T-Elle Une Orig - Bitbol, Michel PDF
Transféré par
Christian Tellier100%(3)100% ont trouvé ce document utile (3 votes)
1K vues769 pagesTitre original
La conscience a-t-elle une orig - Bitbol, Michel.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
100%(3)100% ont trouvé ce document utile (3 votes)
1K vues769 pagesLa Conscience A-T-Elle Une Orig - Bitbol, Michel PDF
Transféré par
Christian TellierDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 769
Michel Bitbol
La conscience a-t-elle une origine ?
Des neurosciences la pleine conscience : une nouvelle
approche de l'esprit
Flammarion
Maison ddition : ditions FLAMMARION
Flammarion, 2014
Dpt lgal : fvrier 2014
ISBN numrique : 978-2-0813-3426-7
ISBN du pdf web : 978-2-0813-3427-4
Le livre a t imprim sous les rfrences :
ISBN : 978-2-0813-3008-5
Ce document numrique a t ralis par Nord Compo.
Prsentation de lditeur :
Ce livre renouvelle le dbat sculaire sur la possibilit de rduire la
conscience un processus neuronal. Il fait du lecteur larbitre de lenqute,
non seulement en tant que spectateur rationnel, mais aussi en tant quacteur
apte se reconnatre conscient aux moments dcisifs de largumentation. Le
fin mot de lnigme ne se dissimulerait-il pas dans lvidence que la question
sur lorigine de la conscience a une conscience pour origine ?
Au cours de cette investigation qui mobilise la phnomnologie, la mta-
physique, les pratiques contemplatives, les neurosciences et la thorie de
lvolution, chaque thse sur la conscience est alors mise lpreuve dun
questionnement lancinant : pour qui vaut-elle et dans quel tat de conscience
doit-on tre pour la soutenir ? Lobjectif nest pas dopposer entre elles les
doctrines (physicaliste ou dualiste), les stratgies de recherche (objective ou
rflexive) et les directions dtude (physiologique ou introspective), mais de
les rapporter aux postures existentielles divergentes do elles tirent leur
pouvoir de persuasion. Une rflexion singulire sur et au coeur de la
conscience.
Michel Bitbol, directeur de recherche au CNRS (Archives Husserl, cole
normale suprieure), a reu une formation en mdecine, en physique et en
philosophie. Il est notamment lauteur aux ditions Flammarion de Mcanique
quantique. Une introduction philosophique (1996), LAveuglante Proximit du
rel (1998), Physique et philosophie de lesprit (2000) et De lintrieur du
monde. Pour une philosophie et une science des relations (2010).
DU MME AUTEUR
Erwin Schrdinger. Philosophie et naissance de la mcanique quantique
(avec O. Darrigol, sous la dir.), Gif-sur-Yvette, Frontires, 1993.
Mcanique quantique. Une introduction philosophique, Paris, Flammarion,
1996 ; rd. coll. Champs , 1997.
Physique et Ralit. Un dbat avec B. dEspagnat (avec S. Laugier, sous la
dir.), Gif-sur-Yvette, Paris, Frontires-Diderot, 1997.
LAveuglante Proximit du rel. Ralisme et quasi-ralisme en physique ,
Paris, Flammarion, coll. Champs , 1998.
Physique et Philosophie de lesprit, Paris, Flammarion, 2000 ; rd. Coll.
Champs , 2005.
Lpistmologie franaise, 1830-1970 (avec J. Gayon, sous la dir.), Paris,
PUF, 2006.
Thorie quantique et Sciences humaines (sous la dir.), Paris, CNRS, 2009.
De lintrieur du monde. Pour une philosophie et une science des relations,
Paris, Flammarion, 2010.
la mmoire de mon pre, Gaston Bitbol,
Ce livre, son dernier rve
LA CONSCIENCE
A-T-ELLE UNE ORIGINE ?
Introduction
Sintresser la philosophie, rflchir
loccasion sur des questions de vrit et
mme y travailler continuellement, ce nest
pas encore tre philosophe []. Ce qui y
manque, cest le radicalisme de la volont
prte lultime exigence.
E. Husserl
La question que nous abordons est celle de la conscience, ou plus
prcisment (nous comprendrons la raison de ce choix lors des essais de
dfinition), celle de lexprience consciente voire de lexprience pure.
Quest-ce que lexprience consciente ; do provient-elle ; est-elle
linverse la provenance du o ? Il ne sagit pas l dune question
quelconque, mais plutt de lune des appellations les plus plausibles de la
question dernire, de la question-limite, de la question-dfi qui nous habite.
Une question qui, ds quon consent sy livrer, se montre exemplairement
aportique : il est impossible de savancer intact travers elle, au-del delle,
vers une rponse plausible. La poser dans toute son ampleur, cest prendre le
risque damorcer un retournement lancinant sur soi-mme, jusqu ce que
lauto-ralisation qui sensuit devienne rponse substitutive.
Cette question est-elle dailleurs formulable bon droit ? Lusage de
mots pour lexprimer na-t-il pas pour seul effet de nous y rendre aveugles ?
Deux chapitres seront consacrs cet cart fondateur du disant et du dire, qui
menace de trancher la base toute prtention de parler ou dcrire au sujet de
lexprience consciente. Mais rien nempche den offrir un avant-got en
commentant une formulation sibylline de Wittgenstein. Aprs une srie de
remarques sur labsence dun rfrent auquel renverraient les termes
douleur , sensation , exprience , Wittgenstein se prte un dialogue
contradictoire avec un interlocuteur imaginaire : Vous ne cessez den
arriver la conclusion que la sensation elle-mme nest rien. Pas du tout.
Elle nest pas quelque chose, mais elle nest pas rien
1
! Lexclamation
finale devient moins hermtique pour peu quon dresse un inventaire des
choses qui peuvent tre indiques au moyen du langage : objets,
proprits, phnomnes. Tout dabord, lexprience nest pas un objet.
Lobjet est une entit suppose exister par-del les situations, les tats
subjectifs et ltre-prsent. Au contraire, lexprience consciente est situe,
elle est ce que cela fait dtre en ce moment. Lexprience nest pas
davantage une proprit, puisque, au lieu de lattribuer nos interlocuteurs
aprs avoir cherch (en vain) prouver quils en ont une
2
, nous nous
contentons de la prsupposer dans une coprsence empathique. Enfin,
lexprience nest pas un phnomne, car celui-ci ne se spcifie pas mieux
que comme une apparition au sein de lexprience. Ainsi, lexprience
consciente nest pas quelque chose disolable par une dnomination ou une
prdication. Elle nest ni un objet, ni une proprit, ni un phnomne. Et
pourtant, elle nest pas rien ! Pour nous, cet instant, pendant que jcris ces
lignes ou pendant que vous les lisez, lexprience pourrait mme tre tout.
Elle nest pas quelque chose de spar, mais le dploiement entier du sans
distance. Elle nest pas une caractristique que nous avons, mais infiltre ce
que nous sommes. Elle nest pas un apparaissant, mais le fait intgral de
lapparatre.
Aucune de ces difficults rencontres dentre de jeu, ni le caractre
aportique et rflexif de la question de lexprience consciente, ni
linterrogation pralable sur la lgitimit mme de la nommer, ne devrait
cependant nous dcourager. Y a-t-il aprs tout un autre genre de question qui
vaille autant la peine dtre soulev par lenqute philosophique ? Y a-t-il un
autre thme dinvestigation qui justifie si bien la singularit de la philosophie
parmi les disciplines de la pense ? Une tche centrale de la philosophie est
doprer la critique des prsupposs de la connaissance et des conduites
humaines, et de nous rimmerger dans leur filon productif. Elle nous affranchit
par l des rigidits que les conventions indiscutes imposent notre manire
dtre au monde, elle ouvre la voie aux articulations transdisciplinaires des
savoirs ou leurs refontes rvolutionnaires, elle incite chercher en leur
source le principe dune unit systmatique. Les retraites successives de la
philosophie devant lavance des sciences qui en sont nes ne peuvent donc
que buter sur la demeure et le lieu de recherche inalinable de cette discipline
des confins, sur le point dinterrogation en-de duquel on ne saurait remonter
parce quil est len-de. Or, ce prrequis des prrequis, cet amont effectif de
chaque investigation et de chaque attribution de sens laction, cest cela vers
quoi on cherche (plus ou moins habilement) faire signe par la locution
exprience consciente. La philosophie peut bien se voir un jour dpossde
de toutes les questions dont elle a prpar la transfiguration en champ
objectiv pour les sciences particulires au cours de son histoire, elle ne se
fera pas drober la question radicale, la question du fait massif, premier,
prcompris par tous les autres faits, de lexprience.
La question de lexprience consciente savre philosophique en un sens
si minent, si extrme, quelle peut tre perue comme redoutable. Elle met la
philosophie, et le philosophe lui-mme, dans un tat de tension maximale o il
peut lui sembler incommode de se tenir, et troublant de prolonger son sjour.
Si bien des philosophes hsitent en prendre la pleine mesure, sils cherchent
une chappatoire pour ne pas avoir sy heurter de plein fouet, sils
prtendent attendre sa solution dans un horizon de dveloppement indfini
de la recherche scientifique ou de la spculation rationnelle, cest que la
question de lexprience consciente, lorsquelle nest pas lude mais prise
bras le corps, a le pouvoir de les mettre eux-mmes en question. Il ne sagit
pas du genre de question dont on peut se dlivrer aprs en avoir exhib une
rponse externalise, couche sur du papier ou un cran, mais dune question
qui ne cesse de sactiver jusqu faonner intimement celui qui sest laiss
attirer par sa lumire nigmatique. Heidegger suggre quelque chose de cet
ordre lorsquil crit qu aucune question mtaphysique ne peut tre
questionne sans que le questionnant comme tel soit lui-mme compris
dans la question
3
. Merleau-Ponty le confirme en identifiant la philosophie
Lensemble des questions o celui qui questionne est lui-mme mis en cause
par la question
4
. Dans la phrase de Heidegger, se laisser comprendre
dans la question renvoie lacte dtre pris l (da) avec la question
5
. tre
compris dans la question ne doit donc pas ici sentendre au sens dune simple
inclusion verbale ou thorique. tre avec la question signifie stablir au lieu
prcis o elle vibre, tre tiss delle de manire ne pas pouvoir en extraire
intact le fil de sa propre personnalit, avoir renonc pour cela au processus de
dtachement grce auquel un objet de perplexit est pos l-devant, distance
de scurit. Si le questionnant est l avec la question, sil est subjugu par la
question jusqu en devenir solidaire, cest quil a consenti se faire
processus et laisser advenir en lui chacune des transmutations a priori
imprvisibles que lui imposeront les perces de son enqute. Le questionnant
ne sera plus le mme aprs avoir chemin avec une question comme celle de
lexprience consciente. La question aura rinvent son questionnant. Lui na
sans doute rien dessentiel perdre dans laventure, mais il ne le sait pas
encore. Il a mme toutes les raisons apparentes de craindre de se perdre en
affrontant la question ultime, parce quil avait jusqu prsent utilis le moyen
du questionnement dans lunique espoir de se voir confort par des rponses
subordonnes ses propres fins, alors que cette question, loin dtre utilisable
pour soi, le rapproche vertigineusement de l o ne cesse de se reconfigurer
le soi.
Rencontrer nouveau la question de lexprience consciente, aprs stre
longtemps laiss projeter hors de soi par les prescriptions de la vie pratique
ou les intrications de la recherche scientifique, cela comporte en bref les
saveurs mles dune dsalination et dune dstabilisation. Limpression de
dsalination vient de ce quon sest rapatri dans un milieu dexistence
auquel il avait dabord fallu tourner le dos, afin de sinstrumentaliser soi-
mme en un agent capable de dfinir des invariants perceptifs et de les
soumettre une manipulation efficace. Le choc de la dstabilisation est le
contrecoup du rapatriement : si je ne suis plus (seulement) ce soi-agent, je
perds le point dappui dextriorit que je mtais forg, je ne peux plus me
dfinir fermement comme terme subjectiv dune relation tablie avec sa
sphre objective, et jentre alors dans le creuset imprvisible de la refonte
de lexister.
Il est une situation de la vie, rare mais pas exceptionnelle, o sunissent
galement ces deux saveurs. Elle a suffisamment de points communs avec le
thme du retour lexprience consciente pour servir damplificateur
analogique dans lenqute philosophique qui nous occupe. Cette situation
perturbante sannonce de la manire la plus banale. Un jour, dans la foule
dune gare ou dun caf surchauff, vous apercevez au loin une silhouette
vaguement familire. De qui pourrait-il sagir : un ami, un acteur de srie
tlvise, ou peut-tre quelquun qui ressemble assez lune de vos
connaissances pour avoir accroch votre attention ? Vous vous approchez, et
il sapproche aussi. Un malaise sempare de vous au fur et mesure que ses
traits se prcisent. Quelque chose ne tourne pas rond dans son comportement,
son allure dgage une impression de plus en plus nette de dj-vu, et en mme
temps vous le ressentez comme profondment inassimilable, inacceptable,
presque antipathique. Ses gestes sont rvoltants et incomprhensibles. Il ne
fait pas que vous imiter, il se calque sur vous. Cest vous-mme ! Vous-mme
vu sur une paroi dont vous comprenez prsent quelle est couverte de
miroirs
6
. La surface rflchissante accroissait ltendue apparente du lieu
clos o vous vous trouviez, et vous reprsentait votre insu comme lun des
individus anonymes de la multitude qui vous entourait. Mais la confuse
impression de dsarroi que vous avez prouve durant la brve priode
intermdiaire sparant la perception dun sosie et la reconnaissance que
ctait vous ne sest pas dissipe sur le champ. Elle laisse sa suite une
trane amre. Alors, vous dites-vous avec dpit, je suis ainsi lorsque je ne
me sais pas regard, jai cet air gauche et presque perdu, ce front pliss et ces
yeux vagues ? Vous vous sentez encore un peu rserv vis--vis de ce
masque qui est pourtant votre persona, comme le serait un artiste-peintre
ayant d admettre regret la justesse de son autoportrait le plus clinique. Pour
vous accepter nouveau, pour vous reconnatre pleinement, vous devez revoir
votre reflet plusieurs fois, en prenant cette fois de multiples poses
involontaires aptes vous redfinir vos propres yeux (cest--dire ce que
vous pensez tre les yeux des autres) comme grave, rsolu, souriant, tendu
vers un projet qui pour lheure vous chappe, ou simplement tendre ou
comique. La reconnaissance entire, loin dtre immdiate, a t pour vous un
processus de reconfiguration et dauto-attribution dintentions avouables
devant la socit ou au cabinet dun mdecin. ce stade, vous tes
partiellement dsalin (vous vous tes retrouv aprs vous tre pris pour
quelquun dautre), et en mme temps dstabilis (qui tes-vous vraiment, sil
vous faut jouer un personnage jusque devant le miroir ?).
Examinons dun peu plus prs ce moment fugace dun entre-deux : entre
penser voir un autre et se voir soi-mme, dans les limbes de la pr-
reconnaissance. Ce nest pas sans raison que Freud a accol cette phase
transitoire du rapport limage spculaire le sentiment de l inquitante
tranget
7
, traduction franaise courante du vocable Unheimlichkeit
employ galement par Heidegger. Loin de sidentifier ce qui nous est le
plus lointain, le plus tranger, l trangement inquitant est souvent le plus
insidieusement familier
8
; mais un familier qui a t repouss larrire-plan
de notre champ habituel dattention, un sanctuaire si proche et peut-tre si
gnant quil se trouve simplement travers, nglig, ignor. Vous tes pour
vous-mme la plus extrme intimit. Les sensations discrtes de ce corps
propre, le centre de perspective quil vous impose, vous soufflent bas bruit
le caractre irrmdiable de votre prsence au monde. Mais vous vous
prcipitez dans lexistence en passant travers lui, en le laissant comme
derrire vous dans un oubli prcaire. Et soudain, cette translucidit voulue,
travaille, recherche du soi corporel, se retourne en lopacit dun objet vu
dans ce que vous ne savez pas encore tre un miroir. Cest cela votre
vtement invisible, et il se donne tout dun coup voir sans que vous ayez eu
le temps de lapprter aux regards, den faire un costume que vous jugiez
socialement prsentable. Vous vous htez alors de le rendre endossable, de
vous le rapproprier, de le dclarer vtre, mais vous sentez que, mme ainsi,
quelque chose ne tourne pas rond. Vous tes rassur, et pourtant cet
apaisement recouvre mal le trouble antrieur qui sonnait au fond plus juste que
lui. Ltre-au-monde rassur-familier, crit Heidegger, est un mode de
ltrang(r)et du Dasein et non pas linverse
9
. Dans lcart temporel qui
sest ouvert entre lloignement dun prsum autre et la reconnaissance
rverbrante de soi, votre trang(r)et sest rvle. Elle ne pourra plus tre
entirement recouverte, car il apparat dsormais que votre identit telle que
la montre le miroir est fabrique, en flux, en redfinition constante, l mme
o vous auriez pens trouver une confirmation et une rassurance : un reflet de
ce que vous tes vraiment.
Le miroir, dirait Michel Foucault
10
, a opr dans ce cas la fois comme
une utopie et comme une htrotopie . Il a t utopique, dans la mesure o
il vous a prsent un lieu qui nexiste pas, un lieu inaccessible aux gestes de
prhension, un lieu dfinitivement ferm votre motricit par une surface
vitre ne dbouchant sur rien. Il a aussi t htrotopique parce que, au moins
sur le plan optique, il sagit bien dun espace, avec ses lignes de fuite et ses
objets visibles ; mais un espace subtilement dcal par rapport lespace que
vous habitez, capable dun effet en retour sur ce dernier. Car le miroir ne
sest pas content de vous montrer quelque chose, un corps parmi les corps.
Le quelque chose quil vous a montr vous a pouss, par son mimtisme
aveugle, revenir vers le vous du corps propre, assum, expressif, que
vous aviez presque gar dans la prcipitation des jours. Sous ce regard
mme et vide qui vous examinait de votre propre vue, vous vous tes
lentement recompos en cette origine des lieux appele ici . Puis le
caractre indolent, laborieux, et au fond inachev de cette recomposition, vous
a manifest que votre nature est de ne pas encore, toujours pas-encore, avoir
de nature. Le lieu htrotopique vous a parl du lieu o vous vous trouvez,
cest--dire des sables mouvants de lidentit.
Si linstant o nat le soupon que lautre nest pas autre, mais simple
reflet de soi, semble ce point troublant, cest quil arrte brusquement un
processus crucial par lequel vous vous auto-dfinissez en assumant un rle
vis--vis de vos partenaires de transaction. Ce processus, dcrit par de
nombreux sociologues
11
et psychiatres
12
, saccomplit tous les niveaux du
geste, de la parole, et de la projection imaginative. Le sujet sy confirme
travers un systme tag de renvois mutuels intersubjectifs impliquant tantt
des formes labores de mimsis, tantt des discours harmoniss en rponse
un environnement tenu pour commun, tantt encore des suppositions sur les
penses que lautre entretient propos de soi. Un tel procd de construction
de chacun par prise dappui sur autrui a t qualifi de miroir social
13
.
Curieusement, la dcouverte quil y a un miroir de verre en face de vous et
que le personnage peine aperu ntait que votre reflet, a pour premier effet
de briser ce miroir dun genre diffrent, celui que vous tend la collectivit des
alter-ego pour vous permettre de vous structurer en adoptant une manire
dtre convenable. Cet individu, l-bas, naccorde pas sa gestuelle la vtre,
mais nen montre que la copie servile ; il ne peut pas diriger sa parole et ses
actes vers les constituants dun monde partag, mais seulement rpter votre
parole et vos actes sans sortir de lenclos de votre monde ; il ne pense rien de
vous, parce que vous tes le penseur de toutes ses penses. Limage l-devant
ne vous offre donc que des repres dtourns ou reconstruits pour savoir
comment vous tes peru par dautres, et ce que vous devriez faire pour
obtenir la confirmation de leur regard. peine vous tes-vous reconnu dans la
glace, vous avez perdu ce que vous croyiez tre votre appui externalis, et
vous vous retrouvez dans la vacance de la simple prsence soi. Vous seul,
cet instant, avez la possibilit doprer comme rfrence indirecte pour vous-
mme, partir de votre reprsentation intriorise du regard des autres. Vous
espriez ajouter une pierre ldifice collectivement construit du moi -
objet, et vous tes inopinment rejet dans lindfinie plasticit du je -
sujet.
Cette anxit de louvert sans borne, cette perte de la scurit procure
par lobjectivation (voire lhypostase) de soi, voil peut-tre ce que le
schizophrne ne peut plus supporter. Lui reste pig dans latmosphre
d inquitante tranget , et peine durablement franchir ltape consistant
se reconnatre dans le miroir
14
. Sur un plan cognitif, le schizophrne souffre
dun dfaut dagentivit ; autrement dit, il ne se peroit pas comme agent de
ses propres actes ou de ses propres penses, mais comme manipul,
comment, ou observ par quelquun dautre
15
. Sur un plan
phnomnologique, le schizophrne a perdu son aptitude la
transpassibilit
16
: pas plus quil ne peut accueillir la nouveaut de ce qui
arrive, il nest assez abandonn sa propre productivit imprvisible,
suffisamment passi f devant la spontanit de ses propres actions, pour
pouvoir sattribuer aprs coup chacun de ses gestes et de ses intentions.
ct dautres troubles associs, cela le conduit se sur-objectiver en des
moi allognes hallucins lautorisant ne pas subir le vertige dun je
latent linventivit droutante ; et, linverse, se demander si quelque
chose existe en dehors de lui
17
, tant lirruption dauthentique extriorit est
bloque une fois pour toutes, et tant les limites entre lagissant et lagi se sont
estompes. Le dfaut de transpassibilit suscite aussi bien la
dpersonnalisation du schizophrne, en le rendant tranger son incoercible
crativit, que son penchant la dralisation, en le privant de la possibilit
de reconnatre quil y a l un donn irrductible lui-mme. Cest en vain
que le Je demande au schizophrne dadhrer son devenir, dtre
reconnu spculairement comme identique lui, car son dbordement novateur
ne semble assimilable ce patient que sil est tenu pour luvre de dcideurs
vaguement et incompltement trangers. Comme vous, le schizophrne
prouve le malaise vital de la reconnaissance de soi ; contrairement vous, il
na pas les moyens (quelle quen soit la raison) de le prendre en charge.
Le saisissement multiforme qui vous assaille quand vous vous
reconnaissez dans le miroir aprs un assez long garement a son quivalent
exact dans une certaine tape dcisive de la recherche sur lexprience
consciente. Une commotion du mme ordre survient lorsque vous ralisez
quinterroger la conscience en lanant votre regard, par habitude, vers lavant,
vous tire irrsistiblement rebours, en votre tre-conscient ltat naissant.
Comme dans la phase hsitante de la rencontre avec votre reflet, vous avez
alors du mal vous identifier. Ce grand dsordre de perceptions, ces penses
ou ces dsirs contradictoires, ces demandes sans rponses, ces longs blancs
de perplexit que vous constatez au creux dexprience o votre interrogation
vous reconduit, est-ce bien vous ? Ne vous croyiez-vous pas une personne
dote dun positionnement intellectuel et moral prcis, tant que vous
demeuriez un autre pour vous-mme ? Comme dans lexprience du miroir,
galement, vous perdez limpression de scurit dynamique que vous tiriez de
la projection ritre de votre attention hors de vous. L o vous trouviez un
soutien dans la perception de formes ou de complicits prsentes, vous
ondoyez maintenant dans le vaste volume de prsence qui les enveloppe. Ce
qui se montre et la monstration perdent de leur distinction et flottent dans un
curieux ressac. Une sorte de tremblement se produit, un trouble diplopique qui
pousse lun vers lautre le visant et le vis, puisque ce qui est vis par ltude
de la conscience nest autre que le visant. La question de lorigine renvoie ici
automatiquement lorigine de la question.
Il est certes permis de vouloir chapper cette convulsion de la
connaissance, sa rotation incoercible autour de son propre axe. Mais sy
drober en se rfugiant trop vite dans un mode plus courant du fonctionnement
de lintelligence reviendrait perdre lopportunit la plus authentique de
trouver la faille, si ce nest la rsolution, du problme de la conscience.
Linquitude, limpression de perdre pied et mme la rticence que vous
prouvez peut-tre en vous sentant ramen au plus prs de vous-mme au
moment prcis o vous croyez porter lattention vers une cible dtude ne sont
pas un obstacle, mais au contraire un auxiliaire prcieux de votre qute. Elles
sont autant de voix tmoignant quen vous engageant dans cette recherche,
vous nen resterez pas aux cendres froides de la question de la conscience,
mais que vous irez toucher sa flamme, et que vous atteindrez la temprature
voulue pour faire entrer en fusion votre pense trop exclusivement discipline
pour lobjectivit. Elles annoncent que vous allez tre invit vous exposer,
monter sur la scne o se droule le dbat sur la conscience, car celui-ci
resterait teint, vide, et strilement abstrait, sans votre participation entire.
Lemploi rpt de la deuxime personne du pluriel, et celui plus discret de la
premire personne du singulier, est un indice de ce qui va tre continuellement
en cause dans ce livre, y compris dans ses parties les plus thoriques, y
compris lorsquil soumettra lexamen des raisonnements et des
exprimentations scientifiques. Cest vous, cest moi qui allons tre mis en
jeu, dans ce que nous avons de plus propre et de plus proche. Vous et moi en
tant que points de dpart, et non pas en tant que points de mire, de toute vise.
Vous et moi dans ce qui nous est le plus intimement commun (car lintime
nest dj plus le personnel), plutt que dans ce que nous reconnaissons
intellectuellement comme universel. Vous et moi ayant surmont un symptme
civilisationnel dallure quasi psychotique : la sur-objectivation, voire la
rification, de tout ce qui nous regarde, y compris de cette condition de
possibilit des imputations dobjectivit et dextriorit quest lexprience
consciente. Vous et moi dcouvert, parce que la question de la conscience
na de chances de se laisser approcher que si nous reconnaissons chaud
lentrelacement qui nous lie elle.
Le choc que vous prouvez lorsquun miroir dnonciation vous enjoint de
vous re-connatre conscient, en vous saisissant au vol dans votre geste mme
doutrepasser ce constat, ne sera donc pas esquiv. Au contraire, il sera
priodiquement remis vif, travaill, amplifi. Il se verra trait (vous vous
verrez trait pendant quil vous percute) comme un protagoniste part entire
du dbat engag avec les neurosciences et la mtaphysique analytique de la
conscience. Ce partenaire vivace, gnralement nglig parce quinarticul,
parce que voyant plutt que visible, va savrer dcisif dans la controverse.
Sa seule disponibilit, pourvu quelle soit manifeste au moment opportun,
suffira inactiver les arguments les mieux affts en faveur de la rduction ou
de lmergence physico-physiologique de lexprience consciente.
Mais, pour commencer, nous allons reformuler une par une les questions
sur la conscience, et demeurer longtemps au seuil du questionnement.
Questionner nous resensibilise la singularit de notre condition, tandis que
se hter de rpondre dilue lclat du singulier en linscrivant dans le maillage
dune rgle.
QUESTION 1
Quel langage pour la conscience ?
Le philosophe parle, mais cest une faiblesse en lui, et une
faiblesse inexplicable : il devrait se taire, concider en
silence, et rejoindre dans ltre une philosophie qui y est
dj faite. Tout se passe au contraire comme sil voulait
mettre en mots un certain silence en lui quil coute. Son
uvre entire est cet effort absurde.
M. Merleau-Ponty
Approchons-nous au plus prs. valuons pour cela le pont de traces
vocatrices qui nous unit en ce moment mme : la langue philosophique. Il a
t signal en introduction, de manire encore insuffisamment justifie, que le
langage dans son maniement ordinaire convient mal pour cerner la question de
la conscience. Si lexprience consciente nest pas une chose dtache de
nous qui se prte la dsignation et la caractrisation, si elle se confond
avec ce que nous vivons pendant que nous prtendons en parler, alors une
certaine modalit courante de la langue lui est manifestement inadapte.
Pourtant, quai-je fait linstant mme, au fil de la dngation ? Jai
utilis les noms communs conscience et exprience. Je nai mme pas vit
den prdiquer quelque chose, daccoler un attribut ces substantifs : jai
crit ce que la conscience nest pas, et mme indirectement ce quelle est (ce
quoi elle sidentifie). Ne suis-je pas tomb ainsi dans le travers que je
dnonce ? Est-ce que je peux vraiment continuer mexprimer sur
lexprience consciente, y compris pour noncer la raison qui empche den
dire quelque chose de sens, sans contrevenir aux rgles du bon usage de ce
terme et du langage en gnral ? Est-ce que le trouble concernant la possibilit
de pointer laide du langage vers lexprience consciente dans son entier
nest pas encore plus massif et plus auto-destructeur que le doute rpandu sur
la possibilit dutiliser un langage dintrospection pour dcrire des contenus
dexprience
1
? Ici, le langage est la fois une composante du problme et le
moyen de le poser, ce qui prcipite la dmarche philosophique dans le
dsarroi et la force ne mettre aucune de ses prmisses labri de la
discussion ; pas mme le choix fondateur de parler ou dcrire.
Il y a en fait au moins deux traits du langage dans sa modalit locutoire
2
qui rendent inoprant, pour ne pas dire dvoyant, le discours sur lexprience
consciente. Le premier trait est tout simplement quil est signifiant, cest--
dire quil vise autre chose que sa propre actualit crite ou sonore, quil a
pour fonction de nous transporter ailleurs, plus loin que sa figure ou sa
vibration. Le deuxime trait inappropri est que, comme le souligne le
structuralisme depuis Saussure, le langage fonctionne comme un dispositif
diffrentiel et non pas essentiel. Il ne parvient signifier quen articulant les
diffrences mutuelles (ou les oppositions) entre les phnomnes viss, aux
diffrences (et aux oppositions) entre les formes graphiques et acoustiques qui
les visent.
Considrons dabord la caractristique lmentaire qua le langage de
signifier. On a du mal se figurer que ce soit l un dfaut du langage ; on
inclinerait mme penser que cest sa qualit la plus propre. Il est amusant
de remarquer, crivait Wittgenstein, que, dans le cours ordinaire de la vie,
nous navons jamais limpression davoir nous rsigner quelque chose
du seul fait duser du langage ordinaire
3
. La contrainte lmentaire
quexerce le langage, nous prescrivant des renoncements notre insu, cest le
rseau dvidences partages et de certitudes inquestionnes qui simprime en
creux dans les rgles limitatives de son bon emploi. Mais une seconde
contrainte, plus profonde et plus invisible encore, nous est impose par le
pouvoir de signifier ; un vritable carcan plaqu sur le libre jeu des modalits
de notre exister, qui nous gare et nous empche de nous comprendre ds que
la question de la conscience est formule. la lumire de la dfinition
prcdente de la signification, il est facile de voir comment cet garement se
produit. En accomplissant lacte de nommer, y compris lorsque je nomme
lexprience consciente, je vous pousse en avant, je vous attire autre part, je
vous lance vers un futur proche, je fais mine de vous demander de rtrcir
votre champ attentionnel et daller chercher quelque chose que vous navez
pas directement sous la main. Mais chacun de ces dplacements vous
fourvoie, nous fourvoie. Lexprience consciente, ce nest pas un cela l-
bas, cest ce L (au sens dun ici) qui nous submerge, ce l o nous nous
tenons, entirement et sans rsidu ; un l dautant plus prgnant que, loin
doccuper un espace, il est ltoffe mme dont est fait lespace avant que sa
forme gomtrique nait investi les choses dans un rseau positionnel
4
.
Lexprience nest pas ailleurs ; elle est plus ici que quoi que ce soit
dautre ; plus ici que tous ses contenus, plus ici que nimporte quelle chose
que lon pourrait nommer ; plus ici encore que lici spatial. Elle noccupe pas
davantage un futur proche ou lointain ; elle est coalescente la prsence, y
compris la prsence de la tension vers le futur. En outre, lexprience nest
pas en avant, pas plus quen arrire ; elle occupe un lieu intermdiaire, le
lieu de lquilibre incertain du vivre, un lieu qui se perd lui-mme de vue en
sabsorbant dans le projet, et qui ne sait se r-apercevoir quune fois
dsinvesti, accompli, et remplac par un autre qui lenglobe. Lexprience
nest rien qui puisse tomber dans le champ de lattention ; car lattention est
seulement le nom de son intensification et de sa restructuration topographique
en un centre intense et une priphrie estompe. Enfin, dire que lexprience
est sous la main est un euphmisme ; elle enveloppe plutt la main de sa
limpidit, mais aussi le corps et les choses, jusqu se faire compltement
oublier mesure de son omni-prsence ; lomniprsence de la prsence elle-
mme.
Et, si limproprit recommence des noncs du genre lexprience
est vous frappe, une possibilit intressante et smantiquement productive
souvre vous. Un grand pas vers la cure du langage de la conscience est
franchi, aussitt que lordre du substantif et du prdicat a t interverti. Non
pas lexprience est ce L, mais L est lexprience. Ce l inqualifi do
tout se montre, ce l partir duquel chaque chose est pose et dans lequel les
mutations saccomplissent, cela quaucune pantomime du doigt ne saurait
indiquer, parce quelle sefforce vers une clture alors que l est louverture
ce qui advient, voil (vois-l) ce quon appelle lexprience. Voil celle
quon aimerait appeler et qui reste sourde, parce que lappel monte dune
gorge et sen va dans les valles dchos, alors quil ny a aucune faille entre
l e l quelle est, les intentions mettrices, et les combes rsonantes. L est
lexprience ne signifie pas : l gt lexprience, l se trouve lexprience, l
et pas ailleurs se rencontre lexprience ; mais l se lve en tant
quexprience, l se dcouvre exprience, l qui enveloppe tous ses ailleurs
est capacit de rencontre, cest--dire exprience.
Y tes-vous ? tes-vous maintenant au contact de cette exprience dont
jessaie paradoxalement de vous dire quelque chose en vous mettant en garde
contre les garements ou les fuites en avant de la parole ? tes-vous revenu l
do jai commenc par vous loigner par le simple fait de signifier, et o jai
essay de vous reconduire en repliant sur lui-mme le jeu de la signification ?
Si vous ltes, alors vous ne devez rien apprhender dautre que votre
environnement, son mobilier de choses, les caractres imprims sur ce livre et
le bruit de la rue ou du vent, les mouvements intimes de votre corps, les
rythmes daccord et de dsaccord dans nos faons de voir, les distractions
sous forme de projections et de souvenirs. Rien dautre, mais peut-tre avec
une force, une expansion et une saveur accrue, comme si vous ntiez plus
projet hors de la prsence par sa propre impulsion signifiante, mais que vous
flottiez plutt en son sein. Il ny a pas dintervalle, pas la moindre dhiscence,
entre lexprience et tout ce dont il y a exprience. Encore faut-il se rendre
rceptif au fait sans pareil de cette totalit.
Cest en tout tat de cause cette absence de distance entre exprience et
prsence qui explique limpossibilit de mettre un terme, encore aujourdhui,
des dbats thoriques qui sont ns avec la philosophie elle-mme. une
internalisation cartsienne puis empiriste de lexprience qui a culmin avec
limmatrialisme de Berkeley a rpondu rcemment sa plus extrme
externalisation. une distorsion historique qui revient introjecter la
prsence, rplique une distorsion oppose qui consiste lextrojecter. Pour un
courant reprsentationnaliste contemporain de la philosophie de lesprit, il
ny a pas autre chose indiquer de lexprience que ses objets externes et
physiques. Il ny a rien y trouver de plus parce quelle est absolument
transparente ce qui sy manifeste
5
. Une varit exacerbe de cette thse
a t formule sous la dnomination de no-ralisme , ou d externalisme
radical
6
. Selon le no-ralisme , lexprience consciente doit tre
identifie une proprit de lenvironnement extrieur. Il ny a pas dun ct
les proprits des objets extrieurs et de lautre lexprience subjective quon
en a, mais les proprits des objets extrieurs sont demble exprience. Et
les contenus dexprience consciente ne sont rien dautre que des parties de
lenvironnement en interaction avec un organisme. Au gr dune allgorie due
Franois Tonneau, si mon exprience de ma grand-mre prsente les traits
perceptibles que ma grand-mre a rellement, alors mon exprience de ma
grand-mre doit tre localise l o ma grand-mre elle-mme est
localise : hors de ma tte. La tentative est intressante en dpit du biais
manifeste quelle introduit, parce quon y saisit sur le vif comment la
philosophie analytique contemporaine apprhende collectivement avec finesse
les enjeux majeurs de la question-limite de lexprience, mais la laisse glisser
de ses mains au dernier moment cause de son prjug objectiviste et crypto-
dualiste. Si elle exprime juste titre linterconvertibilit de lexprience et de
la prsence, cest seulement travers une dcision mal avise consistant
nier dabord que lexprience appartienne lintrieur (du sujet) et
lattribuer ensuite aux objets extrieurs. Dans ce mouvement de balancier
htif allant du sujet qui quelque chose se prsente vers lobjet qui lui est
prsent, la prsence est traverse dans les deux sens, brivement reconnue, et
aussitt oublie. Pas plus que son oppose dialectique, la thorie no-raliste
ne rsiste alors longtemps leffet dissolvant de sa propre logique. Ce nest
pas seulement que les deux thses, linternalisme extrme et lexternalisme
extrme, apparaissent comme lavers et le revers lune de lautre, laissant
penser quelles nont pas saisi la racine de leur fausse opposition. Cest
quelles finissent par se contredire elles-mmes, lune aprs lautre, par le
double excs qui les dfinit. Sil ny a rien dautre que des ides et des
perceptions, comme le propose Berkeley, au nom de quoi refuser de nommer
ces ides et ces perceptions des choses , comme dans le langage courant ?
linverse, si lexprience consciente est une proprit de lenvironnement
extrieur, au nom de quoi la qualifier justement dextrieure, puisquelle fait
corps avec cet environnement et nest donc ni intrieure ni extrieure quoi
que ce soit, mais coextensive ce quil y a ?
Cette coextensivit de lexprience et de ce qui est expriment, cette
impossibilit de distinguer les thses opposes de la philosophie de lesprit
autrement que par des mots en -isme et par des attitudes philosophiques
artificiellement antinomiques, cest exactement ce que dnonait Wittgenstein
dans un aphorisme universel qui en volatilisait la polarit : Lidalisme,
rigoureusement dvelopp, conduit au ralisme
7
. Et, faudrait-il ajouter, le
ralisme pouss jusqu ses extrmes consquences (cest--dire lorsquil
parvient une prcision maximale dans la description de tout ce qui arrive
la prsence, sans surimposition interprtative) se prend ressembler un
idalisme, comme cela a t le cas de la phnomnologie husserlienne dans sa
priode centrale. De telles volutes de la raison en prise avec elle-mme sont
une traduction discursive du fait que lexprience ne se distingue pas du
monde ambiant tel que nous le vivons tant que nous restons obnubils par son
actualit au lieu de juger de son existence. Lexprience est sans second, sans
recul, sans profondeur ; elle adhre, et elle adhre sans cesse, la prsence ;
elle ne dispose daucun instrument pour se montrer prsentement elle-mme
comme une partie delle-mme. Mais, par ailleurs, lexprience est la fois
bien moins et bien plus que le monde tel que nous le percevons dans
ltroitesse de la vie quotidienne, tel que nous le concevons par lintelligence,
et tel que le lgalisent les sciences. Bien moins parce quune fois un monde
objectiv, conu, et cristallis en choses, lexprience se caractrise
rtrospectivement comme une simple vue sur le monde, jete en un secteur
infinitsimal de ce monde. Bien plus que le monde conu et objectiv
galement, parce que lexprience recle un abme de richesses vcues
partir duquel seule une procdure de slection restrictive permet de constituer
un monde par le biais de catgories ou de formalismes. En bref, laune de
lentreprise darraisonnement de notre environnement, lexprience balance
entre le rien dun point de vue situ et le tout dun tre-au-monde. Tel est le
signe discret mais sans quivoque que lexprience chappe compltement
lunivers enrgiment de lattitude naturelle, des sciences qui lextrapolent, et
de lpistmologie qui la justifie. Il sagit de la retrouver en son entiret, de
ne plus en tre alin, et pour cela les dtours dun langage performatif et les
convulsions de lacte de signifier ne seront pas de trop. Il sera question de cet
emploi alternatif du langage un peu plus bas dans ce chapitre.
Venons-en avant cela au second trait qui rend le langage en son emploi
courant incapable de se saisir de lexprience consciente sans laffadir ou en
minimiser la prgnance : le jeu des contrastes et diffrences qui lui est
consubstantiel. Par contraste avec quoi peut-on faire ressortir lexprience
consciente ? Sur quelle structure doppositions appuyer lusage de la locution
exprience consciente ? Avant den venir aux ncessaires compromis de
lexpression quotidienne, il faut insister sur la version la plus exigeante de la
question, la plus proche du fait enttant, ininterprt, mais aussi massif que
possible, de lactualit vcue de lexprience. Par opposition avec quoi
circonscrire le champ entier de lexprience prsente, si ce nest, de manire
faible, avec des contenus reconfigurs, imagins, conceptualiss, ou rvs de
cette mme exprience ? Je peux lopposer un tat pass dabsence ou
dvanouissement ; mais cet tat pass nest compris comme tel que dans et
pour mon exprience prsente. Je peux mettre lexprience consciente en
contraste avec linconscient freudien, mais Freud lui-mme reconnat que
linconscient ne se laisse apprhender que comme conscient, une fois quil a
subi une transposition ou traduction en conscient
8
. Lexprience consciente
reste, souligne Freud, le point de dpart
9
des recherches cliniques de la
psychanalyse et plus largement de toute recherche humaine. Au regard de ce
point de dpart, linconscient apparat comme une simple figuration des
lacunes de lexprience consciente, utile pour interprter les actes manqus et
les activits oniriques. Jai alors envie de pousser mon avantage et de vous
demander : essayez donc dvoquer quelque chose qui soit vraiment diffrent
de lexprience prsente, qui nen soit ni un contenu, ni un objet, ni une
structure, ni une lacune perue, ni une remmoration, ni une laboration
imaginative, ni une reconstruction rationnelle, ni une croyance ressentie et
apparemment partage. Vous ne le pouvez pas ? Alors, ma proposition est
acquise : la rponse la varit exigeante de la question sur lexprience
consciente est que nous sommes incapables de trouver quoi que ce soit
mettre en contraste avec elle. Vous le pouvez ? Vous pouvez vous figurer un
tel domaine tranger toutes les modalits de lexprience consciente ?
Alors, ma proposition est galement acquise, car vous venez par l de (vous)
dmontrer que ce domaine tranger se manifeste au sein de votre exprience
consciente actuelle. En vous figurant dans lexprience ce qui est extrieur
lexprience, vous avouez immdiatement que cela nest en fait pas extrieur
lexprience ! La proposition est acquise dans tous les cas, signalant une
vrit qui nest fragilisable par aucune volution de la connaissance parce
quelle gravite autour de sa source.
Pas de contraste, donc, entre lexprience consciente et autre chose,
aucune relation avec quoi que ce soit de vritablement extrieur elle. Cest
ainsi que lon peut entendre quelques remarques cryptiques et superbes de
Wittgenstein dans ses Carnets, dans son Tractatus, puis dans ses notes
ultrieures de philosophie de lesprit ; cest ainsi galement quon aboutit
une interrogation sans rponse sur la terminologie employer lorsque les
oppositions manquent.
Dans ces textes, Wittgenstein tablit une triple quivalence entre la
conscience, la vie (vcue), et le monde compris comme ce qui nadmet aucun
dehors. Mais le trac de cette quivalence est dessin par petites touches, par
identifications deux deux accompagnes de correctifs permettant de librer
les mots de leur sens diffrentiel ordinaire. Pour commencer, Le monde et la
vie ne font quun
10
. Cela se comprend condition que la vie ne soit pas
envisage comme quelque rgion circonscrite du monde : La vie
physiologique, prcise Wittgenstein, nest naturellement pas la vie. Pas plus
que la vie psychologique. La vie est le monde. La proposition la vie est le
monde ne fait pas que redoubler le monde est la vie ; elle rtablit la
symtrie de lidentit et fait signe vers une nouvelle comprhension
mondise de la vie. Il ny a l aucun amalgame htif, aucune approximation
intellectuelle, pour peu quon saffranchisse de lacception chosifie du mot
vie , quon adhre ce que Michel Henry ou Renaud Barbaras appellent
une phnomnologie de la vie, quon revienne en somme au plus prs de la
vie telle quelle est vcue par ltre vivant : cette vie prouve qui anticipe si
bien le jeu de bascule obstin de lintrieur et de lextrieur quelle ignore ce
que le monde serait sans elle et ce quelle serait sans monde. Et, sil fallait
une confirmation que cest bien cela dont il est question, la voici : Cette
conscience, cest la vie mme
11
. La vie non physiologique et non
psychologique dsigne la conscience-de-monde et le monde en tant que donn
la conscience.
travers ces exercices gradus de qualification et didentification,
Wittgenstein semble nous souffler que ce dont on ne peut pas parler en raison
de son omniprsence, on nest pas forc de le taire entirement. On peut au
moins le mettre en relief par les moirs et les renvois mutuels dun groupe
htrogne de signifiants soigneusement choisis : monde, vie, conscience.
Wittgenstein frotte ces trois mots lun contre lautre de manire rpte,
comme pour faire jaillir de leur contact lclair dune ralisation, comme pour
puiser leur signification et en rintgrer la signifiance. Ce sont encore ces
mots quil fait jouer jusqu lamalgame, quand il cherche se disculper de
laccusation de behaviorisme trop souvent porte contre lui : Il semble que
je nglige la vie. Non pas la vie physiologiquement comprise, mais la vie
comme conscience. Et la conscience elle-mme comprise non pas
physiologiquement, ou du dehors, mais la conscience comme lessence mme
de lexprience, lapparatre du monde, le monde
12
. Dans cette dernire
phrase comme dans les prcdentes, lobjectif que sassigne Wittgenstein est
darracher les signifiants vie et conscience leur acception partielle,
chosique, faussement distancie, afin de les rimmerger dans cette ubiquit de
prsence et dengagement qui est notre condition. Cest pour atteindre ce but
quil rend vie et conscience co-signifiants du mot monde. Car le
monde porte en lui, dans son sens le plus lmentaire, lillimitation (par
absence dun ailleurs plutt que par infinit) ; et cette illimitation de fait est
aussi celle de lexprience consciente actuelle qui na dautres dehors que
ceux qui sont figurs ou pressentis en elle. Du coup, il devient paradoxalement
possible de formuler par mtonymie la raison pour laquelle il serait vain de
vouloir signifier lexprience consciente ou la vie vcue selon le procd
essentiel du langage quest lopposition : sil fallait que jajoute le monde
mon langage, il faudrait quexiste un seul signe pour le tout du langage, lequel
signe pourrait en consquence tre laiss de ct
13
. Le monde absorbe en lui
tout ce qui peut se prsenter et na donc pas dautre distinguable de lui dans
le jeu des diffrences structurales sur lequel se calque la langue. Sil en va
ainsi, le monde est en droit innommable, insignifiable ; et sil est tout de mme
nomm, cest titre de point de fuite de lactivit didentification croissante
de ses contenus (utilisant ainsi un ultime contraste entre ce qui sest dj
prsent jusque-l, et lhorizon sans cesse en recul de la prsentation venir).
Telle est la version wittgensteinienne de la critique kantienne du concept de
monde , qui ne devrait tre pens, selon la Critique de la raison pure, que
comme idal rgulateur apte guider le dveloppement sans fin assignable de
lexprience. Lexprience-monde, la vie vcue intgrale, hritent de cet
excs qui les rend insignifiables, si ce nest par contraste entre les
phnomnes qui les composent et lhorizon de la phnomnalit entire. tant
en droit insignifiables, leur signe surabondant tant laiss de ct,
lexprience consciente et la vie vcue se voient invitablement ngliges .
On saperoit au terme de cet itinraire que, si Wittgenstein se dtourne ds
quil le peut du thme de lexprience consciente, ce nest en aucune manire
par scientisme ou par behaviorisme ; cest au contraire sur fond dune pleine
aperception de luni-totalit-en-expansion de ce qui se vit, et dune puissante
comprhension de limpossibilit de lopposer quoi que ce soit dautre pour
la dire.
Tout de mme, il y a peut-tre moyen dutiliser le langage, non pas pour
faire rfrence lexprience consciente, mais pour y reconduire ceux qui
lcoutent. Je nai pas cess jusque-l de faire des tentatives dans ce sens, et
vous tes seul juge de leur succs ou de leur chec. En tout tat de cause, quel
que soit le degr de russite de ces essais, il faut aller plus loin, ne pas se
contenter dutiliser (peut-tre maladroitement) linstrument verbal annonc, et
tenter den dresser un inventaire et une rgle. Afin dintroduire lanalyse de
cette modalit peu familire du langage, je commencerai par retravailler une
vieille allgorie qui a lintrt de remonter lorigine du dire. Chacun connat
ce proverbe dorigine incertaine
14
: Quand le sage montre la Lune, ltre naf
regarde le doigt. premire vue, laphorisme se contente de rappeler que la
langue (et son prototype quest la deixis, le dmonstratif gestuel) invite
dplacer lattention, glisser sur la dsignation pour aller vers ce qui est
dsign. Il confirme quapprendre parler et communiquer, cest sexercer
traverser la varit des gestes, des sons, et des points de vue, en direction
dun objet unique de vise commune ; quutiliser le langage, cest accepter de
se dcentrer, de se dsactualiser pour prendre lan vers le foyer idal dun
possible accord universel. Au-del de ce sens manifeste, pourtant, le proverbe
veut nous suggrer autre chose, au sujet dun en-de de la parole plutt que
de son au-del ; au sujet dun contact renouvel avec lexprience actuelle
plutt que dune fuite en avant ; au sujet de la ncessit dentendre les propos
dun sage comme un appel la rcollection plutt qu lvasion. Il exige
dtre interprt lenvers, comme une injonction revenir au disant plutt
qu se laisser envoter par ce qui est dit. Mais comprendre cette rsonance
en retour du proverbe, cela revient admettre que limage par laquelle il nous
instruit est plus quapproximative : elle est compltement intervertie. Dans
lhypothse o cest le recueillement qui est recherch, le sage est plus naf
que ltre naf, car il se prcipite vers les lointains au lieu de se dployer
dans le proche ; et ltre naf a au moins la sagesse dhabiter son monde-de-
la-vie mitoyen au lieu de courir sur les sentiers de lunivers. Si le sage, pour
ne pas cder la navet, voulait dpasser le geste et la parole, cela devrait
tre vers leur amont, vers lexprience immdiate de leur ralisation, plutt
que vers leur aval et vers des futurs incertains. Il devrait demander au verbe
de le reconduire sa source vive plutt que de lgarer en le jetant la
poursuite de ses projets. Et il lui faudrait pour cela inventer une modalit de
la langue o la profration concide avec son intention, et o laudition opre
comme un miroir de ce que vit lauditeur. Il sagit l dune modalit que lon
peut appeler rflexive, auto-rfrentielle, tautologique ou encore
identifiante
15
. Une modalit de la langue de laquelle on ne peut pas
participer en se mettant en tension pour saisir ce quelle veut dire, mais en
creusant sa propre rceptivit pour tre ce quelle suscite.
Parmi les actes de langage rpertoris par John Austin (locutoire,
illocutoire, perlocutoire), cest peut-tre le dernier type qui est le plus proche,
et en mme temps le plus oppos, lacte de langage identifiant. Un acte de
langage per-locutoire, cest une invitation faire quelque chose ; le locuteur
nous fait faire quelque chose en parlant (par exemple en sexclamant : Va
me chercher la chaise qui se trouve dans la pice ct ! ). Cela se lit dj
dans le prfixe per-, qui signifie travers. Lacte de langage perlocutoire
pousse traverser la parole, et au-del de la parole ce quelle dnote, pour se
porter derrire elle vers le geste accomplir. Du point de vue de ce prfixe,
lacte perlocutoire est bien loppos de lacte de langage identifiant, parce
que ce dernier semploie surtout viter que nous passions au travers de quoi
que ce soit. Lacte de langage identifiant vise antithtiquement nous retenir
dans notre course habituelle, nous ramener l o nous sommes, nous
recueillir au plus prs dici, nous reconduire ltat mme qui prside son
audition ou son mission. Lacte de langage identifiant est rflexif en un sens
trs particulier, parce quil ne laisse subsister aucune paisseur entre le
rflchi et le rflchissant. Sil fallait le nommer par opposition avec lacte
de langage perlocutoire, on devrait le qualifier dauto-locutoire. Mais il y a
aussi un autre point de vue considrer, qui justifie lanalogie et le
rapprochement entre les actes de langage perlocutoire et auto-locutoire. Lacte
de langage perlocutoire ne dit pas quelque chose, il ne dcrit rien, il ne
dsigne aucun objet (contrairement un acte locutoire) ; il se contente
daltrer nos dispositions, en nous enjoignant de faire, de transformer, de
bouger. Lacte auto-locutoire ne dit, ne dcrit, ni ne dsigne rien non plus ; il
tend aussi rorganiser nos dispositions et nous enjoindre en quelque
manire. Simplement, au lieu de nous enjoindre de faire, il nous enjoint de d-
faire ; de dfaire la reprsentation didalit qui nous fascine et nous entrane
hors de nous. Au lieu de nous inviter agir, lacte auto-locutoire nous invite
tre et raliser cet tre qui lui est contemporain. En nous rendant infiniment
voisins du cur de ce que nous vivons pendant quil est profr, lacte de
langage auto-locutoire nous change ; et il nous change de la manire la plus
complte qui soit puisquil nous fait concider avec la racine unique de nos
puissances de voir, de comprendre, de dcider, nous librant par l de tout
enfermement dans une vision, une comprhension, ou une dcision
particulires.
Comment sy prend-il pour cela ? Lacte de langage auto-locutoire utilise
plusieurs procds, ruses, et tactiques de contournement, destins
surcompenser le pouvoir darrachement soi que dtient la signification. Une
famille de procds raffins de cette sorte a t mise au point depuis
longtemps dans la tradition Zen, en toute connaissance de sa capacit
provoquer un choc dauto-concidence : il sagit des propositions ou
historiettes nigmatiques connues sous le nom de koans . Chaque koan
saisit lesprit en voie dviction de soi un point prcis, si possible
personnalis et unique, de son itinraire, afin de le repositionner l o il se
trouve sans sen rendre compte. Mais, parmi tous les koans qui ont t
raconts et crits
16
, on peut en distinguer deux grandes classes, qui quivalent
autant de mthodes dauto-locution.
La premire classe de koans est faite de phrases trs brves, le plus
souvent interrogatives, destines dsorienter lavance de celui qui les
coute en brisant son lan vers des finalits et des buts loigns. Ces koans
sont capables dempcher la langue mise en uvre de servir de catapulte
extravertissante, laissant ainsi les attentes de leurs auditeurs compltement
tales, dboussoles, resdimentes dans lattendre lui-mme. Des koans
clbres comme jteins la lumire, o va-t-elle ? , lorsquil ny rien
faire, que faites-vous ? , quel bruit fait le claquement dune seule main ? ,
attirent volontairement la vise intentionnelle sur une fausse piste : la lumire
comme chose , le faire comme processus constant, le bruit presque dj
entendu avant quil ne slve. Puis ils mettent en pices cette vise
malicieusement suscite, en la prcipitant contre un mur : la lumire ne va
nulle part, le faire savre sans objet, la percussion qui provoque le son na
rien pour se produire. Ici, lauditeur est dabord invit svader de sa
condition actuelle par lintention et par la signification, pour mieux se
confronter ensuite linanit de lchappe vers un point de mire
manifestement absurde. Durant un bref instant, il est alors prt lauto-
ralisation ; il est disponible pour un enseignement feutr qui invite la
percevoir et la cultiver comme telle. Un koan comme Je regarde le miroir,
le miroir me regarde peut aider cette dernire tape en nouant troitement
la dsorientation, le sentiment dtranget (dtrangret du reflet corporel), et
le mouvement rflexif
17
.
La seconde classe de koans tend provoquer directement chez
linterlocuteur un ressaut, un contrecoup, un bond en arrire, des retrouvailles
avec une mitoyennet perdue, sans sattarder sur la phase initiale dgarement.
Un exemple lmentaire dacte de langage provoquant lembarde
rflchissante est offert par ce modeste dialogue :
Quest-ce quune question ?
Prcisment cela !
La rplique prcisment cela ! ne rpond pas la question en offrant
un aliment apte satisfaire la tension du demandeur vers quelque chose que sa
parole interrogative nenferme pas, mais simplement en repliant son attention
sur les mots quil vient de prononcer, et peut-tre, mieux encore, vers lacte
dinterroger quil vient de vivre. Elle a un effet immdiatement auto-locutoire.
Mais une telle illustration semble encore trs plate. Elle est loin dpuiser
toutes les potentialits de la stratgie de dclenchement dun ressaut, qui
consiste ramener lattention non seulement du thme discursif vers lacte de
discourir, mais plus profondment de lentendu vers lentendant du discours,
par la vive lacune dun refus apparent de rpondre. Le dialogue Zen suivant
est dj plus riche cet gard :
Disciple : Matre, quel son met le vide ?
Matre : Quel son met le vide ?
Disciple : Mais, matre, je nai pas la rponse, sans cela je ne
taurais pas interrog !
Matre : silence.
Ne sattardant pas sur lespiglerie qui le pousse peut-tre confronter
son matre un koan du premier type, le disciple attend ici une rponse ,
cest--dire un fait absent dsign par une parole prsente. Il espre recevoir
une rplique du genre : le son que fait le vide est , ou plus
vraisemblablement le vide nmet aucun son . la place de cela, il
nentend quun cho de sa propre demande, et pense quil sagit dune fin de
non-recevoir. Or, lcho se veut rponse, et cest ce que cherche faire
entendre le grave silence qui le suit. Lcho montre dabord le son envisag
sans le signifier comme tel. Il rapatrie lesprit exil du disciple dans ce quil
y a, savoir le son mme de la question rpte, au lieu de le laisser
vagabonder vers la promesse dune rplique plausible. Il apaise la
signification pour faire ressortir le signifiant. Mais, au-del de cet usage
minimal, semblable celui de lexemple lmentaire, il est sous-entendu que
le son mis titre de repartie est celui que restitue lesprit vide du matre
travers par la question, la manire dune grotte marine qui accueillerait les
vagues de louragan et les retransmettrait intactes sans se laisser branler par
elles. Ce quexhibe alors lcho, ce nest pas seulement le son requis, cest
aussi le vide accueillant, louverture ce qui vient, que le disciple na plus
qu reconnatre en lui-mme ce moment o il est presque tangible.
Un autre procd dauto-locution parmi ceux de la seconde classe, qui
provoquent le ressaut, nous est plus familier. Cest celui quon peut nommer le
constat de contradiction existentielle . Pour mieux faire ressortir ce quest
cette forme de contradiction, je rappellerai dabord limportance
philosophique dun constat voisin, celui de la contradiction performative .
La contradiction performative est au premier degr une contradiction entre ce
quun sujet dclare faire et ce quil fait effectivement. Cest le cas sil prtend
marcher tout en restant assis, ou sil affirme quaucune proposition nest vraie
tout en prtendant implicitement, du fait mme de son affirmation, la vrit.
Karl-Otto Apel fait de labsence dune telle contradiction le critre permettant
didentifier les prsuppositions ultimes, indiscutes, transcendantales, du
discours : la prsupposition transcendantale, crit-il, est ce que lon ne peut
pas contester sans contradiction performative
18
. Ainsi, je ne peux pas
argumenter contre la validit des arguments en gnral sans contradiction
performative, do il sensuit que la possibilit de largumentation et de sa
validit compte parmi les prsuppositions transcendantales du discours. Par
analogie, la contradiction existentielle est une contradiction entre ce que le
sujet dclare tre (ou ne pas tre) et ce quil sait tre de manire vidente, par
concidence de lui lui dans le geste mme de dclarer ou de savoir.
Larchtype en a t offert par Descartes, au moyen de son clbre argument
du cogito. Un tel argument est transcendantal en un sens presque identique
celui dApel, puisquil infre la proposition Je suis de limpossibilit de
penser son contraire sans contradiction existentielle. Mais par-del
linfrence
19
, cet argument recouvre en fait une performance
20
, une
rflexion agissante, ou mieux encore un vcu non conventionnel ayant valeur
auto-ralisante. Quelques-uns des verbes et des prpositions quemploie
Descartes appuient cette lecture performative du cogito : Je pris garde que,
pendant que je voulais ainsi penser que tout tait faux, il fallait ncessairement
que moi qui le pensais fusse quelque chose
21
. Je pris garde est
lannonce dune exprience, dun saisissement, plutt que dun simple rapport
dinfrence. Pendant que je voulais ainsi penser signale la simultanit
confondante de lacte de mise en doute exhaustive, et du constat vcu que le
pouvoir de cet acte sarrte prcisment l o se tient lacteur. Cette
simultanit est dailleurs rendue manifeste par Descartes dans une version
particulire, intentionnellement tlescope, du raisonnement du cogito : non
pl us je pense, donc je suis, qui semble encore laisser persister un cart
temporel entre le doute, le constat que douter revient penser, et la conclusion
que tire le penseur de sa propre existence ; mais dun seul souffle : cest une
chose qui de soi est si simple et si naturelle infrer, quon est, de ce quon
doute
22
. La pense dubitative entre si instantanment en collision avec elle-
mme dans lacte de la penser, quelle entrane une impression de sidration
et une volte-face vers sa propre prsence. Plus encore que simple et
naturelle , la ralisation du je suis y est imprieuse et invitable. Cest
en cela que largument du cogito opre comme un acte de langage auto-
locutoire : il tire profit de leffort de dngation pour ramener sans dlai celui
qui laccomplit au cur de ce quil lui faut tre pour laccomplir ; il fait faire
son auditeur lpreuve de lintransgressabilit de lprouver. Une telle
exprience en retour est parmi les plus denses quon puisse avoir. Se
nourrissant de la tentative de justifier son contraire, la certitude prouve
surpasse chacune des justifications qui pourraient en tre offertes. Toute
tentative den sortir par le doute y renvoyant de manire spculaire
23
, elle ne
soppose rien dautre. Le fruit de lauto-locution pourrait cause de cela
tre qualifi de vrit absolue, si le simple fait de lui trouver une formulation
verbale ne suffisait larracher lactualit piphanique o rside sa seule et
indniable garantie. Ds que lon a consenti nommer lvidence du cogito,
il est dj trop tard pour en capturer la plnitude inconditionne
24
. Sa vrit
silencieuse satomise alors dans les quivoques doctrinales de la
mtaphysique ; elle devient un objet de dbat et un motif de schisme.
Labsoluit de la ralisation instantane induite par lacte de langage auto-
locutoire est tellement criante quon a pu se demander sil ntait pas
rducteur de la qualifier seulement dexprience de quelque chose (comme si
cela entrait en contraste avec la chose dont il y a exprience
25
). Cest
pourquoi Nishida Kitar
26
, fondateur de lcole de Kyto, considre que la
dmarche de Descartes conduisant du doute hyperbolique la certitude
inbranlable du cogito a un sens ontologique plutt qupistmologique
27
.
Selon lui, par-del la connaissance dun fait par le sujet (sa propre existence),
ce quoi conduit le performatif cartsien est rien de moins que lauto-
rvlation de ltre. Le philosophe japonais rejoint ici lantcdent
parmnidien de largument de Descartes, suivant lequel la pense est
simultanment affirmation dtre, puisquen se rflchissant celle-ci ne peut
manquer dapercevoir quelle est
28
. Par-del ce constat, Nishida offre aussi
une justification prcieuse de sa version pr-gotique et ontologique de
largument du cogito. Ce quil y a vraiment, ce qui est en-de des figurations
thoriques ou des structures nomatiques et les prconditionne, ce qui
prexiste aux oppositions conceptuelles ou nominales et leur donne naissance,
note Nishida, doit avoir pour marque distinctive d inclure lauto-
ngation
29
. Or, cest prcisment dans une association synergique dauto-
ngation et dauto-affirmation qumerge la certitude du cogito, et cest donc
par cette dernire que se manifeste ltre lui-mme.
Mais, au fait, quest-ce qui justifie la thse prliminaire selon laquelle
ltre se caractrise obligatoirement par linclusion de lauto-ngation ? On
peut le comprendre sous deux angles au moins ; un angle faible et un angle
fort.
Sous langle faible, on sait que les actes de discrimination, gnrateurs
dun champ de dterminations signifiantes selon le paradigme structuraliste,
impliquent autant de ngations
30
. Attribuer un prdicat quelque chose
effectue une partition du continuum des caractrisations possibles, et dnie
ainsi ce quelque chose tout ce que ne recouvre pas le prdicat choisi. Le
seul moyen de reconnatre lillimitation de ce quil y a consiste donc lui
permettre dintgrer en lui-mme le prdicat complmentaire qui, dans une
premire approximation dfinitionnelle, apparat le nier.
Cependant, il sagit l encore dune vision extrieure, tacitement
objectivante, et donc invitablement tronque, de ltre. Ce quil y a vraiment
ne saurait se borner quelque chose de reprsent, de projet en avant, de
susceptible de prdication ; son illimit ne peut pas tre restreint couvrir le
domaine entier de la reprsentation et de la prdication. Car dans cette option
mme se lit irrsistiblement une nouvelle dtermination, et donc une nouvelle
ngation : cela et non pas soi ; l-devant et non pas ici ; le reprsent et non
pas le reprsentant ; le prdicable plutt que le prdicant non prdicable ;
lillimit paradoxalement limit ne couvrir que lenclos de la figuration, en
excluant le figurant. Si cette dernire modalit de ngation se voit moins, cest
quelle est universelle. Elle est constitutive du fait mme dexister, et par
extrapolation elle est aussi inhrente au simple fait de signifier. Ex-sister
31
,
au sens heideggerien ou sartrien, cest tymologiquement sextraire de larrt,
du sur-place, de la position actuelle, cest sortir du reposer en soi et
sextravertir dans un projet assign soi, cest sextravaser du fait dtre pour
poursuivre un objet ; cest donc se nier soi-mme en tant que prsent au profit
dune activit tourne vers des buts poss en un l-bas venir. Signifier fait
ricocher la pulsion dexister, en chassant lattention non seulement de
lactualit pure vers cela qui est dpos devant, mais encore de cette trace
dencre visible juste en face, vers son rfrent encore plus lointain et peut-tre
absent. La signification, pourrait-on dire, redouble lalination de lexistence,
le devenir-autre quelle suscite. Signifier revient se nier une seconde fois,
en laissant le signifiant immdiat dans linaperu au profit dun signifi mdi
par lui. Cest seulement en revenant en amont de ces deux ngations que nous
allons pouvoir envisager la thse de Nishida sous son angle fort.
Reconsidrons dans cette perspective les deux premires Mditations de
Descartes. Leur tape initiale fait fond sur une auto-ngation en cascade qui
part de lexister et se prolonge dans le signifier. Les choses, la feuille de
papier sur laquelle la plume doie tenue par Descartes trace des graphmes, le
feu qui crpite, sa main, son corps
32
, tout cela est le terme dune vise
intentionnelle et dune dnomination. Le connaissant, dabord extrait du
continuum vcu par un processus de polarisation dans leffort de cette vise,
en vient soublier lui-mme, se nier, travers lattention exclusive quil
prte son objet connu et nomm. Mais peu aprs, presque dans la foule de
cette double ngation que chacun dentre nous accomplit de manire
irrflchie, Descartes surimpose une nouvelle ngation : la ngation
hypothtique des objets poss, de leur tre propre. Ces objets viss, aussi
bien que les prdicats que nous leur attribuons, pourraient ne pas tre, et
pourtant apparatre comme sils taient. Limpulsion initiale de chercher une
chappatoire dans ce qui se donne en vis--vis, la force mme de lexister
relaye par le signifier, se dcouvrent alors brises, affaiblies, droutes. La
ngation de la double ngation, la ngation sceptique de la ngation
smantico-existentielle, dbouche sur une affirmation qui ne se sait pas encore
comme telle et na donc pas encore commis lerreur de se qualifier : celle
dun prsent de dsorientation, dun vcu rehauss par la suspension de ses
propres perspectives. Si lon pouvait se tenir sur ce plateau dsertique dune
existence se redcouvrant elle-mme la faveur de ladirectionnalit de son
effort dcontenanc, la vrit silencieuse dont il a t question prcdemment
serait consomme. Mais cest rarement le cas. Une dernire tape reste
franchir pour que lauto-affirmation devienne impossible ignorer, et pour
viter que linquitude de lultime ngation dubitative ne retrouve trop vite
une issue alinante dans la course vers des choses perues ou signifies. Cette
tape, nous le savons, consiste ne pas reculer devant le vertige du
dpaysement, mais au contraire lamplifier, sy livrer, tendre la
ngation sceptique jusquau ngateur, et provoquer par l une sorte de
commotion rsultant du choc de laffirmer et du nier. Laffirmer sauto-rvle
par un impossible contraste avec ce nier qui ne peut pas latteindre ; car
laffirmer se reconnat dans lacte mme de la ngation. Ce quil y a nest plus
exil de soi par la distension smantico-existentielle, sans pour autant tre
retomb dans la masse obtuse davant cette distension ; Nishida crit que
ltre est alors veill soi
33
.
Faisons prsent tomber de plusieurs degrs la temprature de lexigence
de pense, en revenant au fonctionnement locutoire standard de la langue et
son paradigme structuraliste. Il reste vrai que nous nommons la conscience,
lexprience vcue, malgr toutes les bonnes raisons que nous avons de ne pas
forger de signe pour elle, et malgr nos penchants la ngliger dans le
dsquilibre de lex-sistence. Nous la signifions et cherchons lopposer ce
qui nest pas elle, tandis que nous rservons lauto-locution des situations-
limites de la qute de vrit. Mme si lentente ce propos reste vacillante et
relve plus de lincertaine complicit prouve que de la comprhension par
pleine fixation de sens, elle est loin dtre absente. Je naurais dailleurs
mme pas pu crire quelque chose sur lexprience consciente ds
lintroduction de ce livre si je navais pas su pouvoir compter sur votre
connivence. En labsence de rfrent et de dfinition digne de ce nom
(chapitre II), cette connivence offre lambiance adquate pour laborer un
discours sur la conscience deux niveaux. Au premier niveau, celui des
accidents de la vie courante et de la pratique clinique, on discute sans
garantie, mais sans obstacle majeur, sur le point de savoir si telle personne est
consciente. Au second niveau, celui de la pense conceptuelle, on construit
des thories mtaphysiques ou scientifiques de la conscience qui ont au moins
lavantage doffrir un terrain de mise lpreuve de la terminologie en
vigueur par la multiplication des contextes dusage des mots qui la composent.
Le procd pour parvenir un lexique communment accept, on la vu,
consiste utiliser des contrastes partiels ou drivs (faute de contraste total et
direct) : le contraste entre notre tat prsent de vigilance et un tat lthargique
situ dans le pass, entre le comportement actif de quelquun et son inertie
corporelle, et par extension entre une configuration neurophysiologique
dynamique et un tat neurophysiologique altr.
Considrons le premier genre de contraste partiel, celui dont chacun
dentre nous est familier pour soi-mme. Je sais que je suis conscient plutt
que non conscient, vous savez que vous tes conscients plutt que non
conscients. Comment en acqurons-nous un savoir spcifique, comment
pouvons-nous laffirmer plutt que le nier, quel genre dopposition mettons-
nous en uvre pour cela ? Navons-nous pas cru comprendre (dans le sillage
de la thse no-raliste ou externaliste) quil est impossible dapprhender
que ce qui se prsente est saisi dans une exprience consciente, de mme
quil serait impossible de savoir que le champ visuel est vu par un il si on
ne disposait pas de miroirs pour le mettre en vidence
34
? Justement,
reprenons cet exemple wittgensteinien. Contrairement ce qui vient dtre
suggr, il y a une manire alternative, non spculaire, oblique, et au
demeurant banale, de sapercevoir que le champ visuel est vu par un il :
cest de mettre les mains devant ses yeux et davoir alors lexprience de la
non-vision, juste aprs lexprience de la vision. Le raisonnement
exprimental qui sensuit est imparable : lorsque le parcours entre lil et les
choses est bloqu, les choses deviennent invisibles, tandis que lorsque ce
parcours est libre, les choses sont visibles ; le globe palp sous les paupires
est donc lorgane du visible, et la vision suppose de ne pas faire obstacle
son rapport avec les choses. cela sajoute quun indice interne au champ
visuel renvoie obliquement quelque chose comme un il voyant : cest sa
structuration perspective, faite de lignes convergeant vers un point de fuite,
dont la seule explication plausible est le caractre localis de lorigine du
voir. Ces mthodes sappliquent-elles lexprience ? La seconde mthode
prend un tour abyssal lorsquelle est extrapole du voir en particulier
lprouver en gnral. Elle demande de sapercevoir du caractre situ de ce
qui se prsente, et de son sens inhrent de la finitude
35
, permettant que le
l de la situation se rvle en tant quexprience. La premire mthode,
quant elle, serait plus aisment transposable si un geste analogue celui de
se couvrir les yeux, par exemple le geste de sendormir profondment,
occasionnait lexprience dabsence de conscience plutt que la simple
absence dexprience. Lexistence dune telle exprience-dabsence-de-
conscience, apparemment paradoxale, se trouve rarement affirme dans notre
sphre culturelle. Elle lest pourtant assez couramment en Inde, probablement
sur la base dune pratique intensive du yoga, prolonge dans les diverses
phases du sommeil
36
. akara, le fondateur de ladvaita vednta ( savoir
ultime non dualiste ) sen prvaut ainsi sans hsitation dans un dialogue
philosophique : Ce pouvoir de perception qui, dans le sommeil profond, te
permet de constater il ny a rien voir ici ne fait quun avec ta propre
essence consciente
37
. Mais supposons mme quau lieu dune exprience
dabsence, on ne considre rien de plus quune absence dexprience. Aprs
tout, on peut attester indirectement dans lexprience actuelle une telle
absence passe dexprience, en faisant ressortir les lacunes du rcit auto-
biographique sur fond dun compte rendu collectivement agr de ce qui est
arriv. Il devient alors lgitime daffirmer que ce qui apparat est objet
dexprience, sur la base dun contraste entre ce qui se passe actuellement et
les moments o le monde (tel quattest par les autres) persistait sans
quaucune prsence nait t atteste par soi.
Une autre circonstance, encore plus courante, autorise ltablissement
raisonn de contrastes fragmentaires : non pas celui entre la prsence et
labsence dexprience, mais entre la totalit de cette exprience et certaines
rgions de focalisation attentionnelle. Il arrive souvent quon ne fasse pas
attention un secteur accessible de lapparatre, et quon se rende compte de
cette lacune aprs coup. Cest le cas par exemple lorsquon traverse un parc
en tant si perdu dans ses penses quon ne prend pas garde aux parterres de
fleurs pourtant placs dans le champ visuel, et quon saperoit ensuite en y
repensant quon na rien vu des plantations. Ici encore, la question peut se
poser de savoir si on na vritablement eu aucune exprience des parterres de
fleurs, ou bien plutt si on a eu une forme dexprience lmentaire et
appauvrie qui laisse un signe dabsence et qui peut mme ventuellement tre
ravive par des mthodes appropries (hypnose, entretien dtaill). Nous
approfondirons ce point au chapitre II propos dune rflexion importante de
Descartes sur la conscience des animaux. Mais cela importe assez peu pour
notre enqute structuraliste, car il suffit dans ce cas de pouvoir tablir un
contraste entre lacte prsent de pleine exprience consciente et autre chose :
forme fruste dexprience ou absence dexprience rtrospectivement infre.
Laxe central du rseau des contrastes partiels et drivs qui permettent de
donner son sens courant aux mots conscience ou exprience consciente
est toutefois constitu des signes objectifs, en troisime personne, de
vigilance. Typiquement, nous considrons comme consciente une personne qui
semble active, et plus finement une personne qui rpond nos sollicitations
par des gestes et des paroles. linverse nous considrons comme non
consciente une personne inerte, couche, aux paupires habituellement
baisses, et qui ne rpond pas nos sollicitations. Lchelle clinique des tats
de coma la plus courante, dite chelle de Glasgow
38
, affine ces critres, sans
les mettre en cause. Elle sappuie sur une gradation quantitative des
circonstances douverture des yeux, de la qualit de la rponse verbale face
diverses demandes, et de la coordination des ractions motrices des
sollicitations plus ou moins spcifiques.
Il faut cependant souligner que de tels signes extrieurs sont ambigus.
Nous y reviendrons propos de divers tats neurologiques altrs, mais
retenons ds maintenant que labsence de rponse nest pas la preuve dune
absence de conscience (il suffit de penser au locked-in syndrome et des cas
de conscience maintenue malgr lanesthsie gnrale
39
). linverse, une
rponse coordonne ne prouve pas formellement la conscience normale (cest
le cas dans le somnambulisme, ou plus partiellement dans le blindsight ou
vision aveugle , et ce serait massivement le cas dans la situation
hypothtique des zombies ). En pratique, malgr toutes sortes
dexplorations fonctionnelles neurophysiologiques qui prtendent prendre sa
place mais nacquirent leur autorit quen la drivant de lui, lultime critre
utilis pour la prsence ou labsence de conscience est celui dun rapport
verbal a posteriori des vnements expriments pendant la priode de non-
rponse (ou de rponse altre). Labsence de raction un moment donn
peut tre rtrospectivement associe la conscience au nom dun rapport
verbal tmoignant dune exprience de ce moment-l ; et une rponse
coordonne peut tre rtrospectivement associe labsence probable de
conscience sil ny a pas moyen dobtenir un rapport verbal sur les
motivations et les expriences associes cette rponse passe. L encore, il
faudra valuer ce critre, le soumettre la critique, prendre la mesure du biais
mthodologique quil impose, mais pour linstant notre seule proccupation
est den tirer les consquences pour le sens des termes conscience et
exprience consciente
40
.
La consquence principale qui dcoule de ltat des lieux rapide peine
effectu est que le sens ordinaire du mot conscience est labor
lintersection de deux ordres de contrastes partiels au sein de lexprience
prsente : contraste rflchi entre les priodes de prsence constate et
dabsence reconstruite dans ma propre exprience, et contraste perceptible
entre les tats dinactivit silencieuse et dactivit accompagne de rapport
verbal chez les autres tres humains. Dautres mapprennent (sauf en cas de
somnambulisme) que jtais dans un tat dinactivit silencieuse durant ma
priode reconstruite dabsence ; inversement (sauf en cas de locked-in
syndrome) chacun de nous constate que notre priode actuelle de prsence est
aussi celle o nous sommes ractifs et capables dtablir des rapports
verbaux ou gestuels. Cest sur cette sorte de conjonction des critres en
premire et en troisime personne que sappuie notre capacit dapprendre, et
denseigner aux autres la signification minimale des mots conscience et
exprience consciente . Ainsi ces mots sont-ils utilisables, alors mme
quils ne dsignent pas quelque chose que lon puisse distinguer dautre
chose, et encore moins une chose spare du dsignant.
Il sagit l dun cas limite de la procdure dapprentissage et de donation
de sens aux mots dsignant des tats de conscience, telle que la dcrite
Wittgenstein. Nous apprenons lenfant, crit-il, employer lexpression
jai mal aux dents en lieu et place de ses gmissements
41
. Si nous pouvons
le faire de manire rgle et intersubjectivement reconnaissable, cest la
suite dun croisement mutuel des comportements visibles et de certaines
expriences vcues qui lui sont corrles. Il est vrai qu premire vue, le
procd de Wittgenstein est bas sur le seul comportement (le gmissement).
Cela le conduit prter le flanc laccusation dtre behavioriste, dont il se
dfend par avance : Ai-je donn la dfinition le mal aux dents est tel ou tel
comportement ? Manifestement, voil qui contredit totalement lusage normal
du mot
42
! Au-del de cette simple dngation, il y a bien quelque chose qui
permet de mettre Wittgenstein formellement labri de limputation de
behaviorisme. Cest son insistance sur la possibilit dutiliser lexpression
mal aux dents et les comportements associs, tantt bon escient, tantt en
jouant la comdie. Utiliser cette expression en jouant la comdie, cest
gesticuler, gmir et grimacer sans avoir lexprience de la douleur. Pour
autant, Wittgenstein se garde bien de dclarer que, par lexpression mal aux
dents , je fais rfrence un certain type dexprience reproductible chez
chacun dentre nous, et identique chez tous. Il nest pas question selon lui de
dsigner une telle exprience, parce quil nest pas question de la montrer du
doigt ; pas question de comparer une exprience actuelle avec cette
exprience plus tard pour sassurer de son identit ; pas question non plus de
comparer mon exprience dun certain type avec la vtre pour attester
quelles sont semblables. Sans ostension, sans identit travers le temps, et
sans similitude intersubjective, lacte de faire rfrence reste inoprant. Une
exprience est tout au plus considrer comme une atmosphre
43
,
justifiant lemploi dune expression dans un jeu de langage qui nest ni celui
de la comdie ni celui du mensonge ; certainement pas comme le rfrent de
cette expression. Dun ct, confirme Wittgenstein, lexprience nest
dcidment pas quelque chose que lon peut nommer, signifier,
discriminer bon droit. Dun autre ct, pourtant, le langage de lexprience
est partageable, reconnaissable, enseignable.
En somme, les expressions exprientielles manifestent encore plus
clairement que dautres lquivalence qutablit Wittgenstein entre sens et
usage : connatre le sens dune expression exprientielle comme mal aux
dents , ou, plus largement, dune expression comme exprience
consciente , ce nest rien dautre que savoir lutiliser bon escient dans un
jeu dchange intersubjectif, et dinterconvertibilit des circonstances
vcues en premire personne avec les circonstances associes descriptibles
en troisime personne. Je qualifierai ce statut smantique que se voient
attribuer les expressions exprientielles d intersubjectivement
pragmatique , en le distinguant ainsi du statut indicativement pragmatique
dautres termes sur lesquels laccord sobtient par la mdiation de la vise
commune dun but objectiv. La diffrence principale entre ces deux classes
lexicales est que les circonstances du bon usage des termes dexprience sont
hors du contrle des locuteurs (elles sont simplement l), tandis quelles
peuvent tre volontairement instaures par un dplacement du corps et un
geste ostensif pour les termes dobjets. Il rsulte de ce statut particulier une
certaine latitude, un degr de libert (et donc dopacit) accru de la
signification des termes dexprience : Comment sais-je que jai appris que
lexpression mal de dents signifie ce que les autres voulaient me voir
exprimer ? Je devrais dire que je crois que je lai appris
44
! En ce qui
concerne lexpression globale exprience consciente , encore plus que
lexpression locale mal aux dents , il se pourrait que je ne fasse que croire
avoir appris ce que nous sommes tous censs entendre par l ; et qu cause
de cela je me confronte jour aprs jour des incomprhensions, dont le dbat
sur la rductibilit ou lirrductibilit de lexprience consciente un
processus physico-biologique est peut-tre lun des plus purs symptmes.
Dans la mesure o les malentendus de ce dbat jouent sur des variantes,
ambiguts et polysmies du mot conscience , un travail de dfinition aussi
prcis que possible reste accomplir (pour peu que des obstacles de principe
ne sy opposent pas).
QUESTION 2
Peut-on dfinir la conscience ?
Il y a en nous comme un principe dagilit et duniverselle
inquitude qui permet notre esprit de ne jamais concider
avec soi, de se rflchir sur lui-mme indfiniment.
V. Janklvitch
Aprs une entre en matire aussi circonspecte lgard du langage, offrir
une dfinition de la conscience semble plus quun dfi : une contradiction
interne. D-finir requiert de dlimiter et dopposer. Or, dans le cas qui nous
occupe, les limites ne peuvent tre traces quau sein de ce quon voudrait y
enfermer ; et les oppositions ne surgissent que de cela mme quon aimerait
opposer autre chose. Dlimiter le domaine de la conscience, opposer la
conscience ce qui nest pas elle, sont aprs tout autant dactes de
conscience.
quelquun qui insisterait, qui soulignerait quaucun savoir de la
conscience ne peut tre difi si lon ne peut pas dfinir son objet , et qui
sobstinerait donc demander ce que lon peut bien entendre par le mot
conscience, il conviendrait dabord de rpliquer sereinement : Qui pose
cette question ? Car seul le rflchissement de linterrogation vers sa
provenance a une chance, non pas certes de satisfaire lexigence du
demandeur, mais de le remettre en prsence du thme entier de sa requte.
Une telle question sur la question semble absurde, il est vrai. Le qui
de qui pose la question de la dfinition de la conscience ? apparat trop
bien identifi pour quon sen proccupe : il sagit de la personne dont la voix
interroge. Cest moi ! peut navement rpondre le demandeur de dfinition
celui qui la refuse en lui tendant, par sa question rebours, un miroir intime.
Cest cependant cette trivialit mme qui rend la question efficace en tant
quacte de langage auto-locutoire. Car la rponse immdiate qui vient dtre
suggre est dcevante dans son vidence, si platement vidente quelle ne
saurait remplir toute lampleur de lattente creuse par la question Qui ? .
Le demandeur sen aperoit vite et, aprs avoir agit la question dans tous les
sens pour en saisir la porte, il ne peut viter de se laisser glisser sans frein
vers larrire, en direction de ce que Cassirer appelle avec tant dacuit le
but auquel toute la connaissance tourne le dos
1
. Qui ? a pour vertu de
laspirer dans ce but qui est simultanment origine. Il est alors comme
sdiment en cet ici partir duquel germe lespace, redpos l do il ne
souvenait pas tre parti, clair par un jour qui ne se reconnat plus dans le
nom conscience ni dans quelque autre phonme, tant son actualit sans
reste laisse bouche ouverte. la question quelle est la dfinition de la
conscience ? , cest la conscience (sa conscience, votre conscience) qui a
rpondu ; et elle a rpondu par le seul idiome quelle connaisse : le langage
inarticul de la pure manifestation.
Il y a pourtant moyen, non pas certes de fournir une dfinition intensive
satisfaisante de la conscience, mais de dbroussailler un peu lcheveau
dusages attach ce mot. Lacte lmentaire danalyse pragmatique dun tel
signe peut suffire mettre au jour la principale raison voque des
divergences qui apparaissent dans la science et la philosophie de la
conscience : le fait que, par conscience , les protagonistes du dbat
entendent des choses bien diffrentes ; ou plus exactement le fait quen
prononant le mot conscience , ils stabilisent leur attention diverses
tapes du chemin qui les reconduit en leur propre source. Malgr ses
insuffisances videntes, une premire bauche de distinction smantique base
sur une division de ce chemin va nous guider. Elle sera ensuite raffine par
rfrence son histoire philosophique, puis surtout en sappuyant sur les
dveloppements rcents quelle a connus dans les sciences cognitives.
En mettant part le cas de la conscience morale dont il sera peine
question, la conscience peut tre entendue (au moins) de trois manires :
1) comme pure exprience (on lappelle aussi conscience primaire ou
conscience phnomnale en philosophie analytique de lesprit) ;
2) comme exprience en retour de lexprience, ou plus pragmatiquement
comme savoir quelle exprience il y a (on lappellera conscience
rflexive ) ;
3) comme apprhension de soi-mme en tant que sujet durable de ses actes
et centre de perspective de sa propre exprience (on lappellera
conscience de soi ).
La premire caractrisation de la conscience, primaire ou phnomnale,
est la plus fondamentale, la plus proche du cur aportique de la question
souleve en introduction, et la plus inaccessible par principe toutes les
tentatives darraisonnement thorique. Cest donc la plus intressante des
trois. En mme temps, il y aurait un paradoxe sen tenir elle. Comment en
effet pourrions-nous lavoir en vue si ce nest parce que nous nous mouvons
en ce moment mme dans une autre forme, drive, de conscience : la
conscience rflexive ? Et comment pourrions-nous crire quelque chose son
sujet si ce nest parce que les graphmes sont une extriorisation de lacte
fondamental de la signifier qui sesquisse dans la rflexion ? Si nous nous
contentions davoir lexprience de ce qui arrive, nous nen apercevrions rien
et nen dirions rien. Sans la conscience rflexive, il ny aurait rien de tel
quune vue visible et dicible sur le monde, mais seulement une adhsion
extatique lapparatre. Pour dire ou crire quelque chose de la conscience
primaire, nous ne cessons donc dosciller entre la signification rflexive et la
signification de limpossibilit de la signifier, puisque la signifier, cest sen
carter.
Tirant parti du point de vue de la rflexivit, essayons quand mme de
cerner lexprience, la conscience primaire, de faon plus prcise. La
littrature ce sujet est pauvre, sans doute paralyse par linsaisissabilit de
son thme , et rendue quasi-mutique par son excessive proximit. Les rares
penseurs qui labordent le font soit au nom dune discipline du ressourcement,
soit loccasion dun recommencement philosophique.
Cest le cas de Nishida Kitar, qui allie les deux motivations. Dans son
premier ouvrage, o conflue le fruit dune pratique mditative Zen de tradition
japonaise avec lapport des philosophies idalistes occidentales du XIX
e
sicle, il caractrise lexprience pure de manire presque entirement
ngative, et pourtant riche dans cet art de la ngation qui lui est familier.
Lexprience pure y est dcrite comme affranchie de toute discrimination
rflexive , dnue de jugement sur ce que sont les choses, prive de distance
vis--vis de son objet, dpouille de toute signification, adhrant aux faits tels
quils sont, ne reconnaissant ni pass ni futur si ce nest en tant que sentiment
prsent
2
. Aucun acte de conscience (y compris rflexif, conceptuel, ou
anticipatif) nest pour autant exclu du continuum de lexprience pure, pour
peu quil soit considr en son surgissement, dans sa simple actualit plutt
que dans sa complexe stratification.
Un autre recours, en vue dune caractrisation de lexprience, nous est
offert par Husserl ds le premier paragraphe de sa cinquime Recherche
logique. Husserl tablit dans ce texte la liste suivante de trois termes (dans
laquelle seul lordre dnumration a t modifi) : 1) La conscience comme
dsignation des vcus, en particulier intentionnels, 2) la conscience comme
tissu des vcus dans lunit de leur flux, et 3) la conscience comme
perception interne des vcus. Le troisime et dernier lment de la liste de
Husserl, la conscience comme perception interne des vcus (ou comme vcu
des vcus), correspond assez nettement au deuxime terme de notre liste, la
conscience rflexive. Mais les deux premiers termes de la liste de Husserl ont
lintrt de dsagrger un peu le concept compact dexprience ou de
conscience primaire. La conscience primaire ne dsigne rien dautre, dans la
premire acception, que le fait mme de loccurrence actuelle dun vcu. Mais
quentend-on au juste par vcu ? Husserl ne peut mieux faire, pour aider
comprendre ce vocable, que dinventorier plusieurs mots issus de la
psychologie quotidienne. Les vcus, ce sont les perceptions, les fictions et
les reprsentations imaginaires, les actes de la pense conceptuelle, les
suppositions et les doutes, les joies et les souffrances, les esprances et les
craintes
3
. Lanalogie avec la dfinition numrative du cogito que propose
Descartes dans sa seconde Mditation mtaphysique, est vidente : Quest-
ce quune chose qui pense ? Cest--dire une chose qui doute, qui conoit, qui
affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent
4
. Une
diffrence majeure entre les deux auteurs est que Husserl nomme directement
des tats et contenus de conscience en utilisant des substantifs, alors que
Descartes en fait de simples attributs processuels de la substance pensante,
mettant en uvre une liste de verbes pour les dsigner. Mais cette divergence
dorientation mtaphysique masque mal une similitude majeure : tous les
termes numrs par Husserl aussi bien que par Descartes font partie de ceux
qui ont t appris par nous non pas au moyen dune procdure dostension
(comme les objets visibles et manipulables), mais par le biais dune
contrainte dusage qui croise apprhension en premire personne et critres
en troisime personne. Tous les termes numrs par les deux auteurs ont la
mme origine et le mme statut que lexpression mal aux dents sur laquelle
sest concentr Wittgenstein : leur signification appartient la classe qui a t
qualifie au chapitre prcdent d intersubjectivement pragmatique . Chez
Husserl comme chez Descartes, la caractrisation par numration a pour effet
de transfrer la conscience phnomnale entire, ou exprience pure, ce
statut singulier des termes numrs. Lexpression conscience
phnomnale oprerait donc selon eux comme le point dintersection, le
foyer de rassemblement, dune abondante terminologie intersubjectivement
pragmatique dont lemploi bon escient permet de singulariser chaque type de
vcu.
Apprendre et comprendre lexpression mal aux dents , nous lavons vu,
cest tre capable de lemployer aussi bien pour exprimer certaines
expriences douloureuses vcues en premire personne, que pour en faire la
marque de reconnaissance empathique de certains comportements (gestes et
grimaces) observs en troisime personne. Cest surtout avoir intgr cette
exprience et ces comportements particuliers jusqu en faire lendroit et
lenvers dun seul ple de signification. Par extension, apprendre et
comprendre les expressions conscience primaire ou exprience pure ,
cest tre capable de les employer aussi bien pour exprimer le fait total de ce
qui se vit en premire personne, que pour en faire la marque de
reconnaissance du comportement en gnral, constat en troisime personne
mais diffrenci dun simple mouvement
5
. Cest surtout les faire agir comme
un oprateur tablissant linterconvertibilit du vcu gnrique et du
comportement gnrique : lexprience sexpose dans le comportement, et le
comportement traduit lexprience. Si, comme lcrit Merleau-Ponty, nous
voyons le comportement dun organisme (humain ou animal) non pas comme
un simple trait de ce qui est, mais comme un creux
6
mnag dans ltre,
cest qu travers loprateur verbal dinterconvertibilit, nous sommes
simultanment en prise avec son envers corporel et avec son endroit
dexprience : nous solidarisons ltant qui se comporte dune manire
dtermine, avec ce qui est vcu par lui. Ainsi nous sommes-nous donn des
mots pour dire obliquement la source des mots.
La deuxime dfinition husserlienne de la conscience commence nous
loigner de la stricte adhsion aux vcus, et de la liste des expressions de
vcus. La conscience primaire nest plus dans ce cas un vcu, chaque vcu,
ou le vcu prsent, mais lunit de leur flux. Elle est encore moins une
collection de vcus, mais le tissu qui les sous-tend tous. Cest galement
ainsi que William James dsignait le fait fondamental de la conscience :
celui de ne pas se prter une caractrisation atomiste, un procd
daccumulation, mais seulement une description dynamique intgre : une
conscience suit son cours , crit-il ; elle se dploie lgal de processus
atmosphriques comme le vent et la pluie. On pourrait dire dans ces
conditions : il exprience ou mieux a exprience limpersonnel,
comme on dit il vente et il pleut
7
. a exprience ceci ou cela, une
pense ou une hallucination visuelle, une joie ou un tonnement, une pulsion
ou du dpit ; mais a exprience toujours, imperturbablement, en de des
moirs et des preuves fugaces. Non pas que lexprience-toffe doive tre
comprise comme un quelconque substrat ( stuff , dirait justement William
James), mais simplement comme linvariant insaisissable, incaractrisable, et
pourtant plus insidieusement prsent que toutes ses guises, de la varit sans
limite de ce qui se manifeste.
Remarquons que cette approche de la conscience phnomnale comme
unit dun flux suppose, elle aussi, une conscience rflexive. De mme que
chaque vcu se dit seulement en tant quexpression dun vcu rflexif
particulier, le flux des vcus se dit en tant quexpression dun vcu rflexif
gnral. Le flux des vcus, le tissu constant du chatoiement sans fin de ce qui
sprouve, se donne une espce singulire de rflexivit quon pourrait
appel er indiscrimine. Cette sorte de rflexivit se garde de toute
discrimination parce quelle se rend seulement attentive au fait neutre quil y
a de lexprience, et non pas comment est chacune de ses nuances ; elle
sapplique par soustraction la donne constante mais vide de lexprience,
et non pas la variation de son remplissement par des contenus ; elle nignore
pas que lexprience est transparente et coextensive la prsence, comme
cela a t signal prcdemment, mais elle relve cette transparence mme
comme un vnement excdant chacune des apparences qui limprgne.
Rflchir lunit du flux de la conscience revient donc chercher un horizon
de permanence fleur de la plus extrme instabilit qui soit. Le mode de
donne du vcu temporel, crit Husserl, est lui-mme son tour un vcu,
quoique dune espce nouvelle et dune dimension nouvelle
8
. Mais quen
est-il de ce vcu de dimension nouvelle ? Quel est son rapport avec le
temps ? Dun ct, il participe du flux quil a pour mission de saisir : il
apparat et disparat, il peut se faire jour en laissant merger une perception
du temps vcu, puis svanouir pour laisser place au vcu primaire instable.
Dun autre ct, lorsquil se manifeste, il constitue un fond sur lequel ressort
la succession entire des vcus. En tant que vcu, il est dans le temps, mais en
tant que fond de vcus (y compris le sien), il est atemporel ou prototemporel ;
il est ce par contraste avec quoi le temps devient le thme dune rflexion. On
pourrait lui donner un nom, disons le nom latin nunc stans
9
, pour ne pas
oublier sa teneur de limite extrme de la conscience rflexive et en signaler
lantcdence absolue.
Sil est avantageux dopposer la conscience primaire, ou lexprience
pure, des acceptions diffrentes du mot conscience comme la conscience
rflexive et la conscience de soi, cest que cela permet de rectifier quelques
prjugs anciens, que Bertrand Russell signale dans le premier chapitre de
son ouvrage The Analysis of Mind. Trs critique vis--vis des philosophies
idalistes classiques, Russell conteste vigoureusement leurs conceptions de la
conscience comme relation dapprhension des objets, ou bien comme qualit
attache tout processus psychique. Il critique dabord la conception
troitement intentionnelle de la conscience, en invoquant entre autres les
contre-exemples du plaisir, de langoisse, ou de la douleur qui ne sont dirigs
vers rien mais se donnent comme pures tonalits dexprience. Il critique
galement, en faisant rfrence la psychanalyse, la certitude que tout tat
mental, y compris sensible, soit (rflexivement) conscient de lui-mme. Il
oppose alors ce modle traditionnel de la conscience celui de William
James, qui dcouvre la ncessit de repartir dun sol plus lmentaire quelle,
qualifi dexprience pure. Lexprience pure peut sorganiser, mais dans
certains cas seulement, en exprience dobjet ; et elle peut galement, mais
dans certains cas seulement, se redoubler en conscience dun tat mental. De
ce fait, lexprience pure est plus vaste que la conscience et en est la
condition ; elle est le prrequis de sa vise dobjets aussi bien que de son
itration en conscience delle-mme.
Cela nous conduit naturellement aborder le cur smantique, et lorigine
historique, du mot conscience , qui sidentifie la conscience rflexive ;
ce quun neurologue anglais appelle the awareness of awareness
10
,
lexprience de lexprience. La dfinition de la conscience qunonce le
psychiatre-philosophe Henri Ey atteste en peu de mots cette composante de
signification, en lui prtant lexclusivit : tre conscient, cest connatre sa
propre exprience
11
. Une telle prfrence pour la dfinition rflexive de la
conscience se comprend, dans la mesure o, comme on la signal
prcdemment, la rflexivit sous-tend la possibilit mme de parler dune
exprience consciente. Si lexprience pure est un sol radical, la conscience
rflexive est le sol effectif de la ralisation quil y a exprience, et de la
discursivit son propos. Dans et pour le discours, la conscience rflexive
est donc obligatoirement centrale. Puisque ce qui se dit de lexprience est dit
partir de la rflexion, le dire de lexprience tient par mthode la
conscience rflexive pour un fait premier. Cet ordre de priorits pourrait en
somme rsulter de ce quon appelle en cosmologie un effet de slection
12
,
cest--dire dun biais frquent consistant tenir pour premier et ncessaire
un fait circonstanciel li la situation de qui en parle, et lincapacit de ce
dernier de sen rendre compte. Il nest pas impossible quon tienne ici pour
premier et ncessaire le fait de la conscience rflexive, simplement en raison
de ltat obligatoirement rflchissant des sujets qui en parlent, et du fait que
ces sujets ne vont pas toujours jusqu une forme de rflchissement au second
degr, le rflchissement sur lacte de rflchir. Mais il ne sagit sans doute l
encore que dune comprhension superficielle de la position stratgique
quoccupe la conscience rflexive. Loin de ne pouvoir tre comprise que
comme lune de nos proprits contingentes, il y a quelque motif de la tenir
pour partie intgrante de notre essence dtres humains ; de notre humanit en
tant que mode spcifique douverture un monde, et non pas en tant que
configuration biologique. En termes heideggeriens, il appartient la
constitution dtre du Dasein davoir en son tre un rapport dtre cet tre .
Sil en va ainsi, le Dasein nest plus seulement prsent lui-mme, mais
proccup de lui-mme : il y va en son tre de cet tre
13
. Il est essentiel
lHomme en tant qutre le l
14
(Dasein) de se savoir lui-mme sachant, et
dtre habit de la proccupation de soi. Plutt que bipde raisonnant,
lHomme est celui qui saperoit de ce quil est, et peut partir de l projeter
ce quil a tre.
Il ny a rien dtonnant dans ces conditions que la connotation de
rflexivit ait t demble luvre dans le vocabulaire philosophique du
milieu du XVII
e
sicle, ds quun usage psycho-phnomnologique du mot
conscience a diverg de son acception courante, initialement morale dans
les langues vernaculaires. La conscience nest plus seulement, cette poque,
une certaine capacit juger le bien et le mal dfinie antrieurement en
franais par Jean Calvin
15
; elle est connaissance rflexive de sa propre
exprience, avec parfois (mais trs secondairement, comme par inadvertance),
une nuance qui lui fait signifier galement la pure exprience. Dans la langue
franaise, le mot conscience , hritage lointain dune utilisation de
Montaigne
16
, est utilis dans ce sens par le philosophe post-cartsien Louis de
La Forge ds 1666 : La pense [est] cette perception, conscience ou
connaissance intrieure que chacun de nous ressent immdiatement par soi-
mme quand il saperoit de ce quil fait ou de ce qui se passe en lui
17
.
Dans la langue anglaise, cest semble-t-il dabord chez le no-platonicien de
Cambridge Ralph Cudworth, en 1678, puis chez Locke qui en avait assimil le
vocabulaire, que se rencontre systmatiquement le substantif
consciousness au sens de conscience rflexive. Dans le premier volume
de son ouvrage The True Intellectual System of the Universe
18
, Cudworth
emploie abondamment ce mot consciousness (on en relve plus de vingt
occurrences) sans presque le dfinir, ce qui laisse supposer que cet auteur
comptait dj sur la comprhension immdiate de ses lecteurs. La raison de
cette confiance est vraisemblablement que ladjectif conscious tait
couramment utilis dans les uvres des no-platoniciens de Cambridge (en
particulier Henry More
19
) ds les annes 1650, et que sa substantivation
ntait quun pas lexical mineur. Dans lun de ses emplois, le sens de
consciousness devient immdiatement clair. Ici, Cudworth critique une
varit de doctrine panpsychiste selon laquelle, dit-il, les diverses parties de
la matire sont dotes dun certain genre de perception naturelle, laquelle
est nanmoins prive de conscience rflexive (reflexive consciousness)
20
.
La simple perception (que lon peut tenir pour lquivalent de lexprience
pure, ou conscience primaire) est ici attribuable quelque chose, sans que la
conscience rflexive le soit. La conscience primaire est donc distingue (bien
que sous un autre nom) de la conscience secondaire quest la rflexion. Quen
est-il alors des phrases o le substantif consciousness est utilis
isolment, sans ladjectif reflexive ? Quel est, dans ces phrases, le sens du
mo t consciousness ? Dans plusieurs passages
21
, Cudworth attribue le
savoir ou le sentir ( sentience ) quelque tre, tout en lui dniant la
conscience ( consciousness ). Lopposition tant isomorphe celle de la
perception et de la rflexivit, cela implique clairement que la conscience
tout court est tenue ici pour lquivalent exact de la conscience rflexive.
Cependant, on trouve dautres passages du mme ouvrage
22
qui mettent en
uvre une expression renforce (conscience redouble, redoubled
consciousness ), comprise comme synonyme dauto-perception ( self-
perception ) ou dauto-jouissance ( self-enjoyment ). Cela sous-entend
soit que la conscience simple, oppose la conscience redouble, se rsout
en exprience pure, soit que la conscience redouble, prise comme synonyme
de conscience de soi , slve encore au-dessus de la conscience rflexive.
Lusage du mot conscience reste ici hsitant entre une acception nettement
dominante de conscience rflexive , son arrire-plan peine suggr de
pure exprience, et lvocation possible de la conscience de soi. Ce nest que
plus tard, au dbut du XVIII
e
sicle, que certaines de ces ambiguts ont t
leves dans une tentative de clarification dun dbat omniprsent sur
limmortalit de lme. John Maxwell, commentateur du Treatise of the Laws
of Nature du penseur londonien Richard Cumberland, considrait ainsi que le
dbat navait de chance dtre tranch qu partir dun criblage soigneux des
significations du mot conscience . Par conscience, dclare Maxwell, le
lecteur peut entendre indiffremment soit (i) lacte de rflexion par lequel un
homme connat ses penses comme tant les siennes propres (ce qui
reprsente le sens strict et le plus propre du mot) ; soit (ii) lacte direct de
penser, le pouvoir ou la capacit de penser, ou (ce qui revient au mme) la
simple sensation ; soit (iii) laptitude se mouvoir soi-mme ou amorcer un
mouvement par la volont
23
. La rflexivit est ici dtache comme acception
premire du substantif conscience , mais lexprience pure et linscription
dans le vouloir en sont galement dsignes comme des composantes de sens
acceptables.
Le mme fil rouge peut tre suivi chez Locke, dont lutilisation de
ladjectif conscious et du substantif consciousness est encore plus
massive que chez Cudworth. Sa dfinition de la conscience est sans
quivoque : La conscience est la perception de ce qui se passe dans le
propre esprit dun Homme
24
. Lesprit peut comporter des perceptions, mais
parmi celles-ci, la perception auto-dirige, la perception des vnements
mentaux, est ce que Locke dsigne par conscience. Locke suggre ainsi une
quivalence entre prise de conscience et perception du domaine mental, dont
la tradition a t transmise jusqu Freud. Chez Freud comme chez Locke, la
venue la conscience dun processus mental est lanalogue intrieur de la
perception du monde extrieur
25
. Prendre conscience quivaut pour Freud
percevoir un acte psychique, qui pourrait aussi bien se drouler hors du
champ auto-perceptif et demeurer alors inconscient. La conscience, crit
Freud, ne procure chacun dentre nous que la connaissance de ses propres
tats psychiques
26
. Elle claire ceux-ci et les extrait, de manire rsistible,
de leur nuit inconsciente. Le concept traditionnel dintro-spection, comme
inspection ou perception intrieure, que nous examinerons en temps utile, est
directement issu de ce schma locken repris par Freud. Par contraste, la
conception de la conscience que soutient Malebranche sinscrit en faux contre
la vision standard de lintrospection comme rvlation observationnelle ou
perceptive dun monde de lesprit. Car, loin de la distance quasi-objective
que pose Locke entre la consciousness et son thme mental, Malebranche
qualifie laccs conscient que nous avons notre me , de vague
sentiment intrieur ttonnant, ne rvlant presque rien de ce quelle est
en elle-mme
27
. La conscience est chez Malebranche le paradigme dune
connaissance trop intime pour ne pas tre radicalement imparfaite, et elle
soppose en cela la connaissance des corps suppose parfaite parce que
mdie par la vision en Dieu de leurs proprits intelligibles
28
.
Lquivalence lockenne entre la conscience dtre le sige dun
processus psychique et une perception intrieure quivaut en tout tat de cause
une forme de rflexivit ; car, si percevoir est une exprience, percevoir
quon peroit, ou percevoir quon pense, est une exprience redouble de
lexprience. Cest probablement Leibniz qui a le mieux articul cette
distinction, en jouant habilement du vocabulaire de la perception, et en
redfinissant cette occasion le mot franais conscience . Selon lui, il faut
distinguer entre la perception immdiate des monades et leur aperception, qui
est la perception des perceptions. Or, cest justement laperception qui est
l a conscience, ou la connaissance rflexive de cet tat intrieur
29
. La
remarque prcieuse quajoute Leibniz cette dfinition de la conscience par
laperception est que labsence de conscience prise au sens rflexif
nquivaut pas labsence pure et simple dexprience ; labsence de
rflexivit nest pas une totale inconscience. Le dfaut de conscience
rflexive chez les animaux nempche pas en effet de leur attribuer une
perception accompagne de mmoire que Leibniz qualifie de
sentiment , ou au minimum une perception fugace, peu discrimine et
pratiquement inaperue. Ce sentiment au sens leibnizien va bien au-del de ce
que Descartes a appel le premier degr du sentiment , cest--dire un
mouvement du cerveau , un vnement purement mcanique qui nous est
commun avec les btes
30
; il est exprience pr-rflexive plutt que simple
irritabilit rflexe. Par extension, on peut se demander si une lecture
leibnizienne de la thse freudienne ne serait pas plus approprie que sa vision
lockenne ; on peut se demander, en dautres termes, si les processus
psychiques prsums inconscients , au sens o ils manquent dauto-
perception, ne seraient pas affects de conscience primaire, cest--dire de
pure exprience. Nous reviendrons priodiquement sur ce dplacement crucial
des lignes dfinitionnelles, et sur ses consquences pour le dbat concernant
la rductibilit ou lirrductibilit de la conscience un processus
neurobiologique.
La vraie diffrence entre Freud et Locke est que pour le second, mais pas
pour le premier (ni pour Leibniz, au demeurant), tout vnement mental est
automatiquement accompagn de conscience, sous-entendu de conscience
rflexive. Selon Locke, [il] est aussi inintelligible de dire quun corps est
tendu sans avoir de partie, que de dire quune chose quelconque pense sans
tre consciente ou sans percevoir quelle le fait
31
. La pense, lactivit
mentale, est ici rendue coextensive son auto-rvlation. De linconcevabilit
du contraire on passe lnonc du fait : Quand nous voyons, entendons,
humons, gotons, sentons, mditons, ou voulons quoi que ce soit, nous savons
que nous le faisons
32
. Cela implique-t-il pour autant que la conscience
consiste prendre pour objet un vnement mental ? Toute conscience
rflexive consiste-t-elle en une image en miroir explicite, objectivante,
distancie, du processus mental quelle rvle ? Plusieurs arguments vont
contre cette interprtation de la conscience rflexive en tant quempilement
dactes dobservation dobjets mentaux
33
. Que les processus mentaux
comportent immdiatement leur auto-rflexivit, nquivaut pas dire quun
second processus mental doit obligatoirement tre mis en uvre afin de
rflchir le premier. Cest ce que plusieurs autres auteurs post-cartsiens de
la seconde moiti du XVII
e
sicle ont soulign expressment en enrichissant par
la mme occasion le lexique de la rflexion. Ainsi, Louis de La Forge, aprs
avoir dclar que la conscience est ce tmoignage, ou ce sentiment intrieur,
par lequel lesprit est averti de tout ce quil fait et quil souffre, et
gnralement de tout ce qui se passe immdiatement en lui
34
, introduit un
correctif en signalant limportance de ladverbe immdiatement dans la
phrase prcdente. Limmdiatet de lauto-tmoignage soppose ici la
mdiation quon utilise pour obtenir le tmoignage dautrui sur une chose ou
un vnement. Elle exclut en particulier le dcalage temporel de ce
tmoignage, le fait quil porte sur le pass plutt que sur le prsent. Jai dit
dans le temps mme quil agit ou quil souffre, afin que vous ne pensiez pas
[] quil soit ncessaire quil se ressouvienne davoir agi, et de sen tre
aperu
35
. La conscience rflexive quvoque La Forge ne comporte pas de
retour diffr sur le rflchi ; elle nest pas rflexion a posteriori, mais co-
avnement rflchissant. Plus clairement encore, Antoine Arnauld rserve le
nom de rflexion virtuelle lacte auto-rvlateur du processus mental, et
il le distingue de la rflexion expresse qui dsigne un retour tardif sur ce
qui a t accompli dans le pass : Outre cette rflexion quon peut appeler
virtuelle, qui se rencontre dans toutes nos perceptions, il y en a une autre plus
expresse, par laquelle nous examinons notre perception par une autre
perception
36
. Ainsi, laperception consciente au sens leibnizien nquivaut
pas toujours une perception de la perception ; elle est dfinie plus finement,
chez certains auteurs, comme une auto-perception co-survenant avec la
perception.
En amont des dfinitions et nuances apportes par les philosophes
rationalistes de la fin du XVII
e
sicle, cest Descartes qui est le vrai initiateur
de cet lan collectif de rflexion sur la conscience. Si cela nest pas
immdiatement apparent, la raison en est que Descartes use trs peu du mot
franais conscience . Et, mme lorsquil emploie, plus souvent, le vocable
latin conscientia ou ladjectif latin conscius , ses premiers traducteurs
prfrent dans bien des cas conscience des quivalents approximatifs.
Labb Picot rend lattribution du substantif conscientia par le verbe
apercevoir
37
. Et Clerselier, se calquant sur une phrase latine de Descartes,
remplace ladjectif latin conscii par le mot franais connaissants :
Par le nom de pense, je comprends tout ce qui est tellement en nous que
nous en sommes immdiatement connaissants (conscii)
38
. Aperception et
connaissance (du domaine mental), remplacent la plupart du temps
39
dans le
franais de lpoque cartsienne le mot conscience .
Quoi quil en soit, lorsque Descartes crit en latin, toute ambigut
disparat. Il est bien lauteur de cette conception dune rflexivit strictement
immanente lactivit mentale, quArnauld a nomme rflexion virtuelle
et quil a distingue de la rflexion expresse portant sur un objet rflchi.
Pour commencer, rien ne peut tre en moi, cest--dire dans mon esprit, sans
que jen sois conscient
40
, crit Descartes Mersenne. Il persiste peu aprs,
dans sa rponse aux Septimes Objections du pre Bourdin aux Mditations
mtaphysiques, lorsquil affirme que le fait mme de penser enveloppe en lui
la connaissance de cette pense. Cest cette connaissance de second ordre,
cette connaissance de la pense connaissante, qui se voit nommer,
conformment lusage latin, conscientia . Mais attention. Il ne nous est
pas ncessaire, crit par ailleurs Descartes, daccomplir un acte
supplmentaire de rflexion volontaire pour que notre me pense quelle
pense, ou quelle ait une conscience intrieure de sa pense [] car la
premire pense, quelle quelle soit, par laquelle nous apercevons quelque
chose, ne diffre pas davantage de la seconde, par laquelle nous apercevons
que nous lavons dj auparavant aperue, que celle-ci diffre de la troisime
par laquelle nous apercevons que nous avons dj aperu avoir aperu
auparavant cette chose
41
. Cest seulement cette condition de non-
diffrence de lacte rflchi et de sa rflexion quon peut chapper la
rfutation de la rflexivit par largument de la rgression linfini (sil faut
une pense seconde pour clairer la pense premire, ne faut-il pas une
pense troisime pour clairer la pense seconde, et ainsi de suite ?). Un tel
argument ntait pas quune simple possibilit intellectuelle au XVII
e
sicle. Il
a t oppos Descartes dans les Siximes Objections, et sa rponse a
emprunt la voie de lauto-rflexion immanente. Pour acqurir la certitude
que je pense , crit Descartes, il nest pas besoin dune science rflchie
[] mais il suffit de [savoir] cela par cette sorte de connaissance intrieure
qui prcde toujours lacquise
42
. Lobjecteur (ici, il sagit de Burman)
amorce le spectre de la rgression linfini par la simple imputation dun
retard de la pense rflchissante par rapport la pense rflchie : on a en
dfinitive conscience, non de penser, mais davoir pens
43
. cela,
Descartes rplique en deux temps. En admettant dabord qu avoir
conscience, certes, cest penser et rflchir sur sa pense ; puis en affirmant
la simultanit de la pense et de sa propre rflexion : Il est faux que cette
rflexion soit impossible tant que persiste la premire pense puisque []
lme est capable de penser plusieurs choses la fois
44
. La concomitance,
pour ne pas dire lintrication, de la pense et de la pense sur cette pense, est
prcisment ce quon appelle ici conscience.
La thse de la cognrativit de lexprience et de son auto-rflexion, de
la conscience primaire et de la conscience rflexive, a t abondamment
reprise en phnomnologie. Ainsi, selon Sartre, la conscience nest pas une
forme en miroir du connatre, mais ni plus ni moins que la dimension dtre
transphnomnale du sujet . Cela signifie que la conscience nest pas un acte
secondaire et laborieux de retournement du sujet connaissant sur lui-mme,
dauto-externalisation du sujet comme sil devenait objet de lui-mme. Elle
est un mode dtre primaire qui enveloppe immdiatement la capacit de se
savoir tre. En bref, [toute] conscience positionnelle dobjet est en mme
temps conscience non positionnelle delle-mme
45
. Pour la conscience, tre
simultanment conscience non positionnelle delle-mme, cest se savoir tre
sans se poser comme thme dun tel savoir.
Laffirmation cartsienne que la pense va toujours de pair avec une auto-
connaissance de la pense, ou que la conscience sidentifie une rflexivit
toujours-dj luvre dans lactivit mentale, ne va cependant pas sans
quelques consquences discutables. Elle pourrait bien tre la source commune
involontaire du dualisme et du physicalisme. Car elle force reconnatre une
discontinuit entre des processus non rflexifs, cest--dire non
conscients, qui relvent de la seule physique, et des processus intrinsquement
rflexifs qui relvent de la seule sphre mentale. Dun ct, le simple fait
dadmettre cette discontinuit justifie intellectuellement le clivage dualiste
entre res extensa et res cogitans, par-del le contraste vcu entre les contenus
dexprience et lexprience intgrale. Dun autre ct, la nature particulire
de la discontinuit allgue donne au physicalisme une raison de croire
quelle peut aisment tre surmonte : ne suffit-il pas dintroduire une
rcursion, une boucle de mta-cognition, pour faire natre la conscience
partir de rien, ou plus prcisment partir de droulements objectifs qui nen
comportent initialement aucun quivalent proche ou lointain ? Et sil en va
ainsi, ne peut-on pas situer lorigine de la conscience quelque part sur
lchelle de lvolution animale, voire au passage entre lanimalit et
lhumanit, au moment prcis o la premire rcursivit (celle qui sauto-
produit dans la pense) sest mise en place ? linverse, ne pas identifier la
conscience la seule conscience rflexive, ft-elle non positionnelle,
reconnatre la manire de Leibniz lhorizon dune exprience pure sous-
jacente, dun sentir nu irrflchi, est susceptible daffaiblir simultanment les
deux doctrines dominantes que sont le monisme physicaliste et le dualisme
(des proprits et des substances). Nous allons commencer nous en
apercevoir en examinant de prs la thse cartsienne controverse des
animaux-machines.
Lide en est exprime dans le Discours de la mthode
46
, et dveloppe
dans une lettre Froidmont du 3 octobre 1637 : Les btes ne voient pas
comme nous quand nous sentons que nous voyons ; mais seulement quand nous
avons lesprit ailleurs : alors, bien que les images des objets extrieurs se
peignent sur notre rtine, et que peut-tre aussi les impressions faites par elles
sur les nerfs optiques dterminent dans nos membres divers mouvements, nous
ne sentons absolument rien de tout cela ; et en ce cas nous non plus ne nous
mouvons pas autrement que des automates
47
. Il peut donc arriver, selon
Descartes, que nous voyions sans sentir (sans savoir, sans nous apercevoir,
sans tre conscient) que nous voyons. Ces tats, loin dtre rares, sont ceux
pendant lesquels nous avons lesprit ailleurs , pendant lesquels nous
sommes distraits. Dans ces tats, nous ne prtons pas attention ce qui se
montre visuellement, mais nous dflchissons cette attention soit vers des
penses, soit vers une conversation, soit vers quelque chose qui se montre par
dautres voies sensorielles ; et cependant nous agissons le plus souvent
comme si nous voyions, de manire assez raisonnablement prcise et efficace
pour que nimporte quel tmoin extrieur ait la certitude que nous voyons.
Pour rcapituler, Descartes fait trois pas dcisifs au fil du texte cit (trois pas
qui ont suscit assez de malentendus pour figer le dbat sur lalternative
dualisme-physicalisme) :
(1) Il suggre que nous voyons, mme si nous ne nous sentons pas voir, ce qui
(sans les prcisions ultrieures) pourrait sinterprter comme un
dcouplage de lexprience et de sa rflexion consciente ;
(2) Il considre que nous agissons alors comme de purs et simples
automates, ce qui suppose que non seulement nous ne sommes pas
conscients de voir, mais sans doute aussi que nous navons aucune
exprience visuelle. Linterprtation suggre au point (1) semble partir
de l rfute. Sous lhypothse (2), voir sans se sentir voir, ce nest pas
avoir lexprience visuelle sans sa conscience rflexive ; cest
simplement tre le sige dun processus de vision aveugle au sens le
plus littral de lexpression (avoir un comportement dtre voyant mais
tre priv de toute exprience de la vision) ;
(3) Il affirme enfin que les animaux, voyant sans tre conscients de voir,
ne sont en permanence que des automates.
Lobservation initiale sur la vision en tat de distraction est cruciale, mais
elle est biaise par des surinterprtations mal fondes, et cause de cela le
raisonnement qui la suit reste contestable. Tout dabord, au nom de quoi
Descartes dit-il que nous voyons dans ces cas o nous ne sommes pas
conscients de voir ? Pas vraiment au nom dune tude phnomnologique de la
vision distraite , car cela serait contradictoire : si nous ne savons pas que
nous voyons, comment pouvons-nous rapporter verbalement que nous
voyons ? Il est vrai quil est peut-tre possible de rapporter verbalement que
nous avons v u quelque chose dans le pass, en mobilisant des modalits
priphriques de la mmoire qui, bien quelles naient pas immdiatement
cristallis en souvenirs dobjets vus durant la priode dexprience visuelle,
peuvent ressurgir ultrieurement. Mais Descartes, auteur de la Dioptrique,
nenvisage pas cette option. Il sappuie au lieu de cela sur des donnes extra-
phnomnologiques, de nature scientifique, en signalant que les images des
objets extrieurs se projettent sur notre rtine et excitent nos nerfs. Affirmer
que quelquun voit exige seulement selon lui de pouvoir attester le
droulement dun certain processus objectif, dordre comportemental et/ou
neuro-physiologique. Il sen tient en somme une dfinition exclusivement
physiologique, naturalise, de la vision. Lexprience vcue est si bien mise
hors jeu dans cette caractrisation du voir que nous sommes conforts dans la
rfutation de linterprtation (1) et donc dans notre impression que, selon
Descartes, une personne distraite na strictement aucune exprience de ce
quelle voit
48
. Si lon retient cette lecture, limpression de contradiction que
risque de donner la confrontation entre la lettre Froidmont et la rponse au
pre Bourdin est dissipe. Descartes peut soutenir, comme dans sa rponse au
pre Bourdin, que lexprience saccompagne immdiatement de sa rflexion
consciente. Et il peut simultanment soutenir, comme dans sa lettre
Froidmont, que lon peut voir sans tre (rflexivement) conscient de voir. La
double condition de cet accord est (a) que voir nquivaut pas avoir
lexprience de la vision, mais seulement tre le sige dun processus
biologique allant des photorcepteurs oculaires aux aires corticales recevant
les affrences rtiniennes ; (b) inversement, que lorsquil ny a pas de
conscience rflexive dune exprience, cela implique quil ny a pas du tout
dexprience. Cest seulement sous ces deux prmisses discutables quil
devient impratif daffirmer que, quand nous voyons sans tre conscients de
voir, nous agissons comme des automates. Le pur voir ayant t dfini par
Descartes sur un mode physiologique-mcaniste, les actes qui sensuivent ne
peuvent eux-mmes tre dcrits que sur le mode physiologique-mcaniste : le
genre mme de description qui sapplique des automates comme les statues
hydrauliques, ou plus tard le canard de Vaucanson. Dautres arguments extra-
physiologiques auraient certes pu tre avancs par Descartes lappui de sa
thse, comme le fait que les actions dune personne distraite (par exemple
dun conducteur de vhicule en train de parler avec un interlocuteur) sont
habituellement moins adaptes, plus rigides, moins cratives face des
situations indites, en un mot plus automatiques . Mais cela naurait pas
davantage suffi son argument. Lexpression plus automatiques nest en
effet dans ce dernier cas quune mtaphore ; elle nquivaut pas du tout
laffirmation littrale que le conducteur distrait nest quun automate. Elle
nexclut pas, comme cela a t propos prcdemment, que ce conducteur ait
une exprience visuelle, mme si celle-ci nest pas (rflexivement)
consciente, et que lexprience irrflchie soit susceptible de rminiscence
ultrieure. Dans ce dernier cas, le conducteur nest pas une simple
mcanique ; il demeure un tre sensible, y compris au sein de son activit
distraite.
La dernire affirmation de Descartes est tout aussi dlicate : pourquoi se
croit-il en droit daffirmer que les animaux ne voient que comme nous-mmes
lorsque nous avons lesprit ailleurs ? Est-ce seulement parce quils ne
rapportent pas leur exprience verbalement (un argument qui, sil tait
employ, manifesterait lun des effets de slection les plus universels
parmi ceux qui dforment notre perspective de connaissance) ? Ou bien est-ce
par analogie avec le cas des enfants qui, nayant pas de souvenirs verbalement
rapportables de ce quils ont vcu avant trois ans, sont parfois supposs ne
pas avoir t conscients de leur exprience
49
? Biais mthodologique dans un
cas, esquisse dhypothse explicative dans lautre, aucun de ces deux
arguments nest vraiment concluant. En y ajoutant les critiques prcdentes sur
les premires tapes du raisonnement de Descartes, cela suffit empcher de
prendre au srieux lhypothse des animaux-machines qui est la fois le
corrlat immdiat et le pivot de son dualisme des substances. Descartes lui-
mme tait dailleurs loin dtre dogmatique ou naf ce sujet. Revenant sa
premire inclination phnomnologique aprs une incursion dans la
physiologie sensorielle, il reconnaissait juste titre limpossibilit de
dmontrer labsence de penses (conscientes) chez les animaux parce que
lesprit humain ne peut pntrer dans leur cur pour savoir ce qui sy
passe
50
.
Mais la critique de lanimal-machine est un effet philosophique collatral
qui ne nous concerne pas directement ici
51
. Le plus important pour notre
propos est de revenir une dernire fois sur laffirmation cartsienne, soutenue
contre le pre Bourdin, que toute exprience est immdiatement rflchie, et
dtendre une suggestion dj faite deux reprises pour llargir. Nous avons
vu que, selon Descartes, il ny a que deux possibilits : soit nous avons une
exprience et alors nous savons, sentons , ou sommes rflexivement
conscients que nous lavons (en tant que res cogitans) ; soit, si nous ne
sommes pas rflexivement conscients, nous navons aucune exprience et
sommes alors de purs automates (relevant de la seule res extensa). Une option
intermdiaire, apte estomper le clivage dualiste, a pourtant t voque en
passant : lexprience peut se faire jour sans tre rflexivement consciente
durant son droulement, puis (parfois) accder rtrospectivement la
conscience rflexive partir dun usage largi et tardif de la mmoire.
Cette dernire option nous met en tout tat de cause sur une piste
importante, dj assez bien explore par les sciences cognitives, et qui sera
discute et taye plus tard propos de lanesthsie gnrale et de
lintrospection : la rflexivit consciente de lexprience a sans doute partie
intimement lie avec la mmoire ; une mmoire dabord immdiate, une
mmoire-cho involontaire, qui prconditionne la mmoire long terme des
pisodes vcus. La mmoire pisodique nintervient que pour une partie
infime des vcus, mais elle peut souvent tre active a posteriori, en
focalisant rtrospectivement lattention sur lun ou lautre des engrammes
passifs
52
qui sont recueillis par inadvertance au cours de la vie diurne titre
de rsidus de la mmoire immdiate. Bertrand Russell pressentait cela
lorsquil signalait qu une sensation [] devient un objet de conscience ds
quon commence sen souvenir
53
. Henri Bergson galement, qui tablissait
un lien proche de lidentit entre conscience et mmoire
54
, sur la base dune
opposition entre lcart limmdiatet quaccomplissent les tres
biologiquement volus, et linstantanit aveugle des monades leibniziennes
les plus lmentaires. Enfin et peut-tre surtout, ce lien est le thme central
des travaux du psychologue exprimental Envel Tulving
55
, qui fait dpendre
ses trois modes principaux de la conscience (correspondant partiellement la
trichotomie exprience-rflexion-autorflexion
56
) de trois modalits de la
mmoire (procdurale, smantique, et pisodique
57
). De faon gnrale, on
peut prsumer quune exprience devient rflexivement consciente lorsque sa
mmorisation vient la redoubler sans dlai ; et quelle est secondairement
recrute parmi les lments de la biographie assume lorsque ce souvenir
court terme est stabilis puis articul des pisodes qui le prcdent et qui le
suivent.
De mme que le cas banal de la conduite dun vhicule en tat de
distraction a servi de paradigme vcu la discussion de la dichotomie entre
conscience rflexive et exprience pure (plutt quentre processus mentaux
concients et inconscients), une autre configuration courante servira de point
dappui phnomnologique pour valuer la connexion peine bauche entre
mmoire et conscience rflexive. Ce nouveau rcit de la vie ordinaire va tre
racont en premire personne concrte : celle de lauteur du prsent livre.
Presque chaque jour, en sortant de chez moi, je ferme la porte de mon
appartement de manire distraite, en pensant autre chose : lpisode
dcriture peine achev, une question pendante de philosophie qui se rsout
(malicieusement) ds que je ne suis plus en mesure de prendre de notes, le
rendez-vous de fin daprs-midi avec lun de mes doctorants, ou
lorganisation dun voyage. Je fuis constamment linstant rptitif de la
rotation de la cl dans la serrure, pour mvader dans les bilans et les projets.
Peu de temps aprs, lorsque je marche dj dans la rue, je me demande si jai
bien ferm la porte dentre ; et je maperois que je nen ai aucune ide. Le
claquement du pne, lextraction des cls hors de ma poche, leur tintement et
leur insertion dans le verrou semblent navoir jamais eu lieu. Tout se passe
comme si cette squence entire stait teinte dans un profond silence du
temps, ou comme si elle avait t aspire par un point aveugle de la
perception. cela sajoute la quasi-certitude davoir en fait ferm la porte,
mais une certitude immotive, fonde sur aucune esquisse de reprsentation de
ce qui sest pass. Parfois, en faisant grand effort pour revivre exactement
latmosphre de gestes et de distractions qui a accompagn ma sortie de
lappartement (par exemple le mouvement rare consistant rarranger mon
charpe juste aprs avoir remis les cls dans ma poche), je parviens
retrouver quelques paves vagues et anecdotiques dune lucidit naufrage.
Dautres fois, lorsque mon doute est trop grand, je reviens sur mes pas, je
vrifie distraitement que la porte est ferme, et le cycle des perplexits
recommence.
Que se passe-t-il donc ce moment, presque hypnotisant par son enjeu, et
invisible du fait de son recommencement ? Nai-je jamais eu aucune
exprience davoir tir le battant et actionn les cls ; ai-je t un parfait
automate pendant que jaccomplissais ces mouvements cent fois rpts ? Ou
au contraire ai-je eu lexprience davoir ferm la porte, mais une exprience
si immdiatement oublie quelle na presque pas t rflexivement
consciente ou du moins quelle ne sest pas tresse long terme mon fil
mnmonique ? La thse de lautomatisme, de la complte inconscience de
certains gestes habituels ou experts , est dominante dans les sciences
cognitives contemporaines
58
. Mais elle ne fait peut-tre quhriter
souterrainement de la conception cartsienne, qui solidarise demble
exprience et rflexivit, rflexivit consciente et rapportabilit verbale. La
thse oppose de lexprience fugace, irrflchie ou transitoirement rflchie,
a pour sa part quelque crdit phnomnologique. On peut dabord avancer en
sa faveur ltrange conviction, injustifie, davoir bien accompli les actes
manquants. Il est vrai que cette conviction pourrait ntre leffet que dune
simple inertie inductive (jai toujours ferm ma porte dentre dans le pass,
et jai donc bien d le faire cette fois-ci galement) ; mais la trace dune
rflexion phmre, dsormais subliminale, a galement pu linstiller en mon
esprit. Encore ne sagit-il l que dune simple suspicion allant dans le sens de
la seconde thse. Un autre signe, beaucoup plus fort, de sa validit, ressort de
lexercice dattention auquel je mefforce souvent durant les brefs moments
qui sparent mes gestes de leur disparition du champ de la conscience.
plusieurs reprises, je me suis pris la main dans le sac , en train de perdre
de vue les gestes de traction du battant de porte et de rotation des cls, et de
mabsorber dans une distraction. Ces ralisations sont survenues des
distances temporelles variables (mais toujours brves, proches de la seconde)
de la fin du geste quotidien, et des degrs galement variables de
leffritement du souvenir court terme qui lui correspond. Saisie au vol ces
stades prcoces, la mmoire sur le point de svanouir peut encore tre
ractive, affermie, et tenue disposition pour des rappels ultrieurs. Une
exprience passagrement rflexive est ainsi transforme en rflexion
constitue, mobilisable en permanence.
Si on prend ces constats phnomnologiques au pied de la lettre (et
pourquoi ne le ferait-on pas, puisque nulle donne objective ne pourra leur
tre substitue pour nous apprendre si nous avons ou navons pas une
exprience ?), on aboutit une dcomposition squentielle de lpisode de
distraction. Celui-ci comprendrait : (1) une exprience perceptive et volitive
pure, compltement phmre ; (2) une rflexion court terme de chaque
exprience de ce type, favorisant une concatnation des fragments de gestes
habituels en une action complte ; (3) une dissipation rapide de cette premire
rflexion, dont schappe rapidement lattention pour faire place des
proccupations plus indites ; (4a) une perte complte (ou quasi-complte, la
laissant dans limplicite ou dans le difficilement ractivable) de la mmoire
court terme qui accompagnait lexprience initiale ; ou bien (4b) une fixation
de la rflexion par un renforcement dattention suffisamment prcoce (avant
que ltape (3) ne soit termine), suivie de ltablissement dun souvenir
durable. Lexprience immdiate, avec ou sans rflexion, faiblement ou
fortement rflchie, maintenue de manire brve ou longue dans le champ de
lattention, accdant ou non la mmoire smantique de ce qui est arriv,
isole ou raccorde la chane narrative cohrente de la mmoire pisodique,
est laxe central de cette interprtation. Lautomate biologique absolu
napparat ici que comme une vue de lesprit favorise par un effet de
slection particulirement triqu : celui qui consiste voir le champ de la
conscience partir de son seul noyau rcursif, affermi et stabilis par des
choix attentionnels ; et ne pas prendre garde aux innombrables lambeaux
gars dexprience, aux clairs-obscurs des perceptions fugaces, aux
battements de paupires de la vie vcue. Par extrapolation, on souponne
quen aucun cas de distraction nous nagissons comme des automates, mais
simplement comme des sujets extatiques, fluents, percevant dans linstant sans
sapercevoir des instants qui senchanent. On devine aussi que lanalogie
avec les animaux pourrait continuer de valoir, quoique sur un mode bien
diffrent de celui quavait avanc Descartes et plus proche de Leibniz : pas
plus que des sujet humains distraits, les animaux (y compris infrieurs) ne sont
sans doute des automates entirement inconscients, mais des tres capables
dexpriences peu ou pas rflchies, mmorises dans limplicite agi plutt
que sous forme de souvenirs pisodiques, existant dans louvert immdiat
59
plutt que dans une histoire.
Comme cela a t annonc prcdemment, choisir pour pivot de la
conscience lexprience totale, incarne, extatique, qui prconditionne la
rflexion et laccumulation mnmonique, entrane la dstabilisation simultane
des doctrines dualiste et physicaliste. Sous le rgime de ce dernier choix, le
dualisme manque dun lieu de sparation nette, dune frontire abrupte au-del
de laquelle la conscience svanouit entirement, et en de de laquelle elle
est ralise dans toutes ses dimensions mta-cognitives. Le glissement continu
des degrs, des formes, et des aperceptions plus ou moins intenses de
lexprience, labsence de bornes clairement marques dans lintervalle qui
stend entre laube prsume dune exprience phmre et sa pleine auto-
ralisation rflexive stabilise nautorisent aucun dcret de sparation tanche
entre le conscient et linconscient, lintentionnel et lautomatique, le pensant et
ltendu. Par ricochet, le physicalisme ne parvient plus identifier la base
inerte, non mentale, strictement matrielle quil veut se donner pour point de
dpart de son entreprise de drivation de proprits supposes mergentes.
Cest quil ne peut emprunter cette base qu lun des deux ples de
lalternative dualiste, et que le dualisme sest justement vu priv de sa
polarit caractristique, de sa scission nette, en faveur de transitions
insensibles. quel point de lchelle des tres, ou plus exactement des
niveaux dorganisation, commencent et finissent les degrs de rcursivit
consciente puis la pure exprience ? Quel processus biologique ou physico-
chimique peut-il tre pris comme le paradigme du non-vcu (de labsence
complte dun ce que cela fait dtre lui ) partir duquel sont censs natre
des vcus ? Sans certitude ce propos, la prtention physicaliste didentifier
le point de passage entre lobjectif et le subjectif, entre lobscurit des choses
et la lumire de leur manifestation, est prive de repre et de motif.
Il reste la troisime modalit et la troisime approche de la conscience
traiter : la conscience de soi. Un pralable pour cela est de ne pas confondre
la conscience de soi avec la conscience rflexive. Contrairement ce que
pousse croire lusage du pronom personnel dans le je pense donc je suis
de Descartes, sapercevoir de la pense ou du doute, ce nest pas encore
sapercevoir de soi . La premire aperception est plus lmentaire, moins
labore que la seconde, et rien dautre quelle nest garanti par lauto-
ralisation du doutant : non pas que je suis, mais quil y a, comme le propose
Nietzsche
60
. Seul un acte complexe (et contestable) de lentendement, savoir
lidentification catgorielle des choses mises en doute et de lexprience du
doute dont il est ostensiblement impossible de douter, assimile cette dernire
une chose pensante. En labsence dun tel acte intellectuel, dans le simple
aperu dune activit de questionnement au fond de labme creus par la
question sceptique, ce quon trouve nest pas soi , et encore moins un tant
(une chose), mais ce quil y a en tant que pur apparatre
61
.
Une fois admise cette distinction entre rflexion simple et auto-
aperception du sujet rflchissant, un nouveau problme doit tre affront : de
quoi ai-je conscience quand jai conscience de moi ? Quest-ce que ce
moi dont je suis cens avoir conscience ? Si la question se pose, cest
justement que moi nest pas quelque chose. De la critique kantienne de la
substantialit du moi dans les Paralogismes de la raison pure la critique
sartrienne puis structuraliste du sujet, cela dont il sagit de prendre conscience
a perdu une part considrable de la consistance que lui attribuait Descartes en
extrapolant sur un mode substantialiste lexprience auto-attribue du cogito.
Un aphorisme sartrien, repris par Merleau-Ponty dans Le Visible et
lInvisible, ne cesse de fragiliser les illusions substantialistes par son pouvoir
de fascination, et de proposer de les expliquer par son second segment :
Ntant rien, jai tre ma situation
62
. Je ne suis rien de dtermin
maintenant, parce que je ne suis mme pas sr de ce que je vais faire un
moment aprs, parce que si jai dcid de faire quelque chose, je ne sais pas
si je vais men tenir ma dcision, et parce que mme si je men tiens ma
dcision, je ne sais pas ce que je vais dcider ultrieurement ; parce qu cet
instant prcis jignore le dtail de ce que je vais crire la ligne suivante au-
del de quelques mots (a scrit, jvalue si les phrases affiches concordent
ou non avec un sentiment vague de projection puis dadquation que jappelle
rtrospectivement mon intention , et je dclenche ensuite un processus de
correction rcursif si le texte scarte de lintention informule). Au
demeurant, je ne ralise mme pas en permanence que ce qui est vcu est vcu
par moi, pas davantage que je ne ralise en permanence que ce qui se montre
dans le champ visuel est vu par des yeux. De mme que la conscience
rflexive manque durant les moments de distraction, la conscience de soi
manque durant une bonne part de lactivit, y compris lorsque celle-ci nest
pas distraite
63
. Seul lveil priphrique dune conscience rflexive du
caractre spatialement et socialement situ de ce qui est vcu, de son raccord
des anticipations et des rtentions particulires, de la concatnation des
projets et souvenirs en une narration personnelle cohrente insre dans le
contexte dune histoire universelle, permet que je me ressaisisse de loin en
loin en tant que moi qui suis en train de vivre cette exprience . Reposons
alors la question un peu diffremment : si je ne suis rien, de quoi puis-je donc
avoir conscience lorsque jai conscience de moi ? En tirant les
consquences de ce qui vient dtre dit, on peut avancer la rponse suivante :
jai alors conscience dun rseau de relations sensibles et de repres
intelligibles qui savre trou, au point-origine quon appelle ici , dune
fentre dapparatre, dune possibilit daccs ce qui se prsente, et dune
opportunit de manipulation active de ce qui peut servir ou faire obstacle
des dsirs et des besoins. Ce rseau ayant plusieurs dimensions et plusieurs
aspects pertinents, la conscience de soi se dcline en autant de modalits. On
en distinguera cinq, dans ce qui suit, sans prtendre quelles sont limitatives,
et sans exclure que leurs interactions soient au moins aussi dterminantes que
leur mise en uvre spcifique. Lorsque jai conscience de moi , je peux
mapercevoir :
1) Dun centre de perspective (ou dun point de vue) rattachable un
corps parmi les corps ; mais un corps qui, la diffrence de tout autre
corps, se manifeste constamment par des proprioceptions ;
2) Dun statut et dune position social(e) ;
3) Dune image idale de moi qui dtermine ce que je pense devoir faire ;
4) Dune biographie assume, non pas au sens premier o je la reconnais
comme mienne, ce qui serait circulaire, mais au sens second et rciproque
o lassumer contribue me dfinir et midentifier comme ce moi
qui la vcue ;
5) Dun ensemble de dispositions se comporter prfrentiellement de
telle et telle manire dans des circonstances spcifies. Ces dispositions
sont saisissables de mon point de vue ltat naissant, elles sont
repres la longue par ceux qui me connaissent, et elles sont acceptes
comme un invitable fardeau seulement capable dinflexions long terme
(celui de mon caractre ).
Si le concept dun soi substantiel peut acqurir une certaine crdibilit
malgr sa critique philosophique et son caractre diaphane, cest quaussi
fluents et partiels que soient ces dterminants de situation, il arrive quils se
renforcent mutuellement dans les configurations stationnaires de la vie, et
quils acquirent ensemble une forme dautonomie dynamique.
Explorons la premire modalit, qui est aussi le premier dterminant de
situation. Avoir conscience de soi, dans ce cas, signifie saisir ce quimplique
le simple fait de dire je . Je nest certainement pas une expression
rfrentielle ; ce mot ne dsigne rien proprement parler. Au lieu de cela, sa
fonction est dindexer un discours, ou un geste, par une situation. Jai mal, je
marche grands pas, je voudrais, je promets : le mal concerne celui qui
lexprime, la marche celui qui se dplace, le dsir celui qui sapprte le
satisfaire, la promesse celui qui sengage. Lusage du mot je signale
seulement que le lieu-origine par rapport auquel sont reprs les vnements
dsigns, les actes accomplis, les sensations exprimes, et les valuations
avances dans le discours, concide avec le possesseur de la bouche qui le
prononce ; et que ce possesseur est assimilable une zone de prsence
cnesthsique
64
confuse qui ne se laisse reconnatre comme mon corps
qu ltape suivante. Ltape supplmentaire dans la prise de conscience de
soi comme centre de perspective consiste localiser ce centre dans un espace
articulant toutes les perspectives, cest--dire dans un espace objectif dot
dun systme de coordonnes fixe et dune origine conventionnelle, plutt que
de dplacer sans cesse des bauches de systmes de coordonnes de manire
que la troue de lici en demeure lorigine privilgie. Un tel passage est si
crucial pour lmergence dune conscience de soi, quil mrite dtre
dvelopp.
Tant que je reste immerg dans un tre-au-monde situ, je maperois au
plus du caractre la fois unique et limit de mon point de vue. Je ne peux pas
choisir, remarquait Wittgenstein, la bouche qui dit Je
65
. Cette bouche
mest impose, je concide avec elle, elle est un fait contingent de ce que je
vis ; elle est un aspect du sens que nous avons dtre jets quelque part, en un
lieu, une poque, et une chair cnesthsique que nous navons pas voulus et
que personne na voulus pour nous. Je peux toutefois aussi, par le biais du
miroir ou de la dlgation de regard mes alter-ego, acqurir un point de vue
extrieur sur mon propre point de vue. partir de l, ce qui relevait de la plus
absolue singularit, de la contingence vertigineuse, se transforme en simple
particularit : tiens, cest l que je suis plutt quailleurs ; tiens, je vis au
XXI
e
sicle plutt quau Moyen ge ; tiens, cest celui-ci mon corps, plutt que
tel autre ; tiens, cette cnesthsie ttue est une forme particulire de perception
que je peux qualifier de proprioception, parce quelle concerne le corps-
propre et non pas les corps des autres . La question pralable poser au
sujet de ce passage du singulier au particulier est de savoir si, et quelles
conditions, il mest permis de reconnatre, dans ce corps-objet reflt
spculairement, ma chair vue de lextrieur plutt quun corps quelconque.
Une telle reconnaissance (affectivement et existentiellement dlicate, comme
nous lavons vu en introduction) suppose au minimum lidentification des
mouvements vus sur le reflet avec les mouvements perus par proprioception
et amorcs par volition. Et cette identification, son tour, est facilite par le
constat dune adquation immdiate entre le corps reflt et les gestes
volontaires : ds que je veux et sens ce geste, limage l-bas ou le rcit
dautrui le (re)produit exactement ; ce qui ne serait pas le cas du corps dun
autre. En somme, je me reconnais lorsque je peux faire correspondre terme
terme la chane des motifs dagir ressentis, la chane apparente des tapes
du mouvement de limage ou de ce quen dit autrui. partir du moment o une
rciprocit entre le corps-propre et un corps-objet est tablie (quelle soit
atteste ou non par lusage du miroir
66
), toutes sortes de ressources
dexpressions et de comportements sociaux se font jour ; comme par exemple
lusage des pronoms personnels et les jeux de rles, travers lesquels un
corps-objet est reconnu comme le corps-propre de quelquun dautre, tout
autant que mon corps-propre a t dabord apprhend comme corps-objet par
dautres que moi.
Une telle reconnaissance de rciprocit semble banale dans les changes
entre tres humains, mais elle est rarement acquise dans le monde animal
67
.
On peut tablir une liste assez courte de phyla danimaux qui en sont
capables. Les chimpanzs, les orang-outangs, et sans doute les gorilles,
parviennent assez souvent se reconnatre dans un miroir (au sens o ils
tentent deffacer sur eux-mmes une tache dencre quils voient sur leur
image spculaire
68
) ; simplement, ils y arrivent vers lge de deux-trois ans
69
,
cest--dire un peu plus tard que les jeunes tres humains qui se
reconnaissent vers dix-huit mois. Les lphants et les dauphins semblent
aussi avoir cette aptitude
70
, ainsi que quelques lignes de petits singes
71
ou
certains oiseaux, comme les pies
72
, les perroquets, et les corbeaux. Et cest
peu prs tout. Encore lauto-reconnaissance du corps propre dans un miroir ne
concerne-t-elle que lune des multiples capacits dlaboration de lidentit
par entrecroisement daxes situationnels. La question de savoir si certains de
ces animaux aptes distinguer leur propre reflet ont, nont pas ou ont
partiellement une certaine forme de conscience de soi reste donc prement
dispute
73
.
On devine partir de cette raret phylogntique des composants de la
conscience de soi, que la capacit de reconnatre le corps propre dans un
corps objet est fabrique, et donc minemment fragile, y compris dans les
espces animales qui lont dveloppe au plus haut point. Des fragments
quelconques dobjets corporels peuvent facilement tre pris pour des parties
de notre corps propre, et inversement, un affect projet sur quelque partie du
corps propre peut se heurter labsence de cette partie dans le corps objet. Le
second cas est illustr par l illusion des amputs . Quant au premier cas, il
est manifest par de nombreuses autres illusions , allant de celle de la main
en caoutchouc celle du corps virtuel. Dans lillusion de la main en
caoutchouc
74
, la main droite du sujet lui est visuellement dissimule derrire
un cran, et une main en caoutchouc vaguement ressemblante lui est substitue.
Le dos des deux mains (la vraie et linerte) subissent alors des stimulations
identiques et simultanes, se rduisant habituellement un dlicat
chatouillement au moyen de deux pinceaux. Leur regard tant fix sur la main
en caoutchouc, et sur le pinceau qui se dplace sa surface, les sujets sentent
gnralement le stimulus lemplacement spatial de la main en caoutchouc, et
non pas celui de leur vraie main. Une illusion voisine est a priori plus
surprenante, car elle ne sappuie mme pas sur la ressemblance visuelle entre
la main naturelle et la main artificielle : cest celle de la table de
Ramachandran
75
. Ici, la main droite du sujet est cache sous la table, des
stimuli identiques sont appliqus sur la table et sur la main ; et les sensations
sont localises par les sujets la surface de la table visible plutt qu celle
de la main invisible. Dans une exprience ultrieure, on fait mine dassner un
grand coup de marteau sur la table ; le sujet ressent alors une forte frayeur
(objective par llectrodermogramme), exactement comme si on menaait de
frapper sa vraie main. Mais lillusion (si illusion il y a) peut encore tre
amplifie, et loigne autant quon veut du corps propre biologique, par le
biais des environnements de ralit virtuelle. De puissantes expriences de
sortie du corps de chair, et didentification une image-de-corps sur un cran,
peuvent tre suscites par la coordination troite et instantane des
mouvements de cette image aux volitions du sujet
76
.
La conclusion que V.S. Ramachandran tire de cette classe dexpriences
approfondit la remise en question de la naturalit de lidentification de soi
au corps biologique : Durant votre vie entire, vous vous tes dplacs en
supposant que votre soi est ancr un unique corps qui reste stable et
permanent jusqu votre mort. [] Mais ces expriences suggrent
exactement le contraire que votre image du corps, en dpit de son allure de
permanence, est une construction interne entirement transitoire qui peut tre
profondment modifie laide dastuces trs simples
77
. Au lieu de
conscience du soi , il faudrait ds lors parler du fragile tissage dun soi sur
une trame corporelle gomtrie variable. Cela na rien dtonnant, lorsque
nous repensons au bilan phnomnologique initial : si notre soi nest rien
(rien de substantiel), il ny a rien en lui dont nous puissions prendre
conscience. Il y a en revanche abondance daxes de rfrentiels spatiaux, et
daccs aussi bien proprioceptifs quextroceptifs un certain corps prolong
par des prothses, dont le matriau est disponible pour luvre
dengendrement dun soi. Llaboration dun tel complexe auto-centr est
affermie et enrichie par les degrs de libert additionnels quoffre la vie
mentale organise par le langage, avec ses jalons identitaires et
institutionnels. Lappropriation dune biographie, que jendosse comme ma
biographie, assure en particulier lidentit travers le temps de ce soi
assembl au foyer dun espace de configuration pluridimensionnel ; elle
semble lui assurer par dlgation le trait principal qui dfinit une substance,
savoir la permanence dune mme personne travers lhistoire.
L, bien sr, ne sarrte pas laventure de lauto-constitution. Dautres
traits voquant le concept dune substance sajoutent ce cur de dfinition et
le renforcent ; des traits qui, vus de loin, peuvent passer pour des proprits
essentielles sarticulant au noyau permanent de lidentit historique. Sont
souvent perues comme proprits essentielles du soi les dterminations des
cinquime et seconde dimensions du rseau situationnel dont il est le centre. Il
sagit dabord des dterminations qui font partie de ce quon a appel le
caractre , ces tendances lourdes dispositionnelles qui nous poussent agir
de manire relativement constante dans des contextes semblables. Il sagit
aussi des lments de la fonction sociale qui, mesure quils me
constituent, sexacerbent progressivement et se renforcent en un jeu de rle
public que je tends assumer. Ces deux ordres de proprits prtendant
linhrence sont prsents phnomnologiquement de faon trs concrte et
trs immdiate. De mme que je peux me sentir affect par un marteau
frappant mon avatar corporel dans un jeu de ralit virtuelle, je peux me sentir
mis en cause lorsque mes traits de caractre supposs ou le rle que je joue en
socit sont viss par une critique. Ainsi, lorsque quelquun dnonce la
timidit en gnral, je ressens une rtraction, une motion ; je me sens
personnellement touch parce que je me juge (et quon ma souvent jug)
timide. linverse, lorsque quelquun valorise la vocation dcrivain, je me
sens moi-mme valoris, grandi, confirm (la rtraction se mue en expansion
et en auto-affirmation).
Mais cest sans aucun doute la troisime dimension situationnelle de la
conscience de soi qui noue lensemble de la construction en un tout cohrent,
mesure quelle montre son caractre prospectif, dsir, utopique. Le rapport
conscient que jai moi-mme ne revient pas seulement ressentir un poids,
une fatalit dessence, un pass inaltrable ; il consiste aussi en un avoir
tre ce que je voudrais tre, et ce que je devrais tre, pour me respecter au
nom de valeurs que jai empruntes aussi bien un fonds collectif qu un
sens incarn de leur justesse. Lavoir tre dtermine ce que Ricur appelle
mon ipsit , autrement dit ce qui midentifie par un projet et une aspiration
plutt que par un pass et un destin ; elle massure un principe dynamique de
stabilisation par fidlit une image idalise, qui fortifie au moins autant ma
subtantialisation fonctionnelle que ne le fait mon rattachement une
biographie historique. Avoir tre est constitutif de ce que je suis, en tant que
je vise ce que je ne suis pas encore, ce que je ne serai peut-tre jamais-
encore. Tellement constitutif, en fait, que Heidegger en a fait lessence, non
pas simplement de moi dans ma singularit, mais du Dasein qui est la part
universelle de notre condition : Lessence [du Dasein] consiste en ceci quil
a chaque fois tre son tre en tant que sien
78
. On comprend partir de l
que lavoir tre rtroagisse sur toutes les autres modalits de la conscience
de soi, du moins sur celles qui impliquent une certaine facticit, un certain
dessein dauto-constitution. Il rtroagit sur lidentit biographique, car, si une
tension se fait jour entre ce que jai tre et le rcit par lequel je me prsente
au seuil de ce projet, il arrive que je rvise lhistoire ; pas forcment en
mentant ou en altrant mes souvenirs, mais simplement en oprant une
slection dans le matriau historique et en faisant ressortir prioritairement les
vnements qui donnent sens a posteriori ce que je me donne maintenant
comme ayant tre. Lavoir tre rtroagit en outre sur les dterminants
essentiels dordre relationnel, par exemple sous la forme dun sens de la
responsabilit devant autrui. Il inflchit en particulier le positionnement
psychosocial, comme lillustre lanalyse de Sartre sur linauthenticit et la
mauvaise foi
79
. Ce que jai tre si je veux me garantir une place dans la
socit, cest aussi ce personnage dont jai accept dendosser les habits et
que je ne suis pourtant pas. Mais avoir tre lui va finir par oprer comme
tre lui, et par consquent moffrir un lment artificiel de dfinition, une
forme didentit contraignante dont jaurai le plus grand mal maffranchir le
jour o une crise personnelle exigera de moi un complet renouveau. Seule
alors une souffrance intense brisant tout sur son passage, ou lintervention
dun thrapeute me reconduisant vers le lieu de plasticit universelle o je
peux me rinventer
80
me permettra de faire craquer la camisole de jeu social
que je me suis inflig.
Il est vrai que tous les philosophes sont loin dendosser la conviction
dconstructrice qui sous-tend lanalyse prcdente de llaboration dun soi.
Ceux qui ne le font pas accordent davantage de place, et mme de consistance
phnomnologique, la conscience de soi que ce qui vient dtre propos
81
.
Pour eux, le soi nest pas atteint lissue dune procdure mdiate de
retournement identificateur vers un complexe de reprage psycho-social ; sous
une forme lmentaire, le soi est immdiatement prsent chaque exprience,
car, soutiennent-ils, toute exprience est vcue uniment comme
exprience-mienne-de-quelque-chose. Plus que le je pense kantien qui
doit pouvoir accompagner toute reprsentation, il est ici question dun je
biranien inchoatif qui constitue indissolublement la face proximale de toute
figuration dun objet distal
82
. Que penser de cette conception alternative ? Il
nest pas impossible que les choses se prsentent sous la forme fusionnelle et
automatiquement dualisante quelle indique, dans notre exprience dadultes
compltement forms (ou d-forms) par un travail antrieur didentification.
Une fois consomme ladhsion une chair cnesthsique et un nud de
coordonnes auto-situantes, une fois intriorise et mille fois rejoue
lidentit demprunt, celle-ci devient comme lenvers immanent du dcor de
lapparatre, comme lcho individuant dune exprience a priori sans nom et
sans propritaire. Lenjeu dune bonne enqute phnomnologique est
cependant de ne pas se contenter de cette constatation de tard-venus. Pour
aller au bout de lenqute, il faut pousser la suspension du jugement et des
rflexes acquis aussi loin que possible, et sappuyer sur elle pour fouiller
larchologie du soi , pour approfondir les strates constitutives de
lexprience-mienne-de-quelque-chose. Une fois ces strates exprientielles
mises au jour, le sdiment quy a laiss un processus didentification multiple
au point-source de lici corporel, au rle social, aux dispositions
caractrielles, au projet dtre, a toutes les chances de se rendre visible. De
cette visibilit dcoule une conception moins solidaire, la fois plus
analytique et plus progressive, de la concordance entre exprience et
imputation didentit. Lexprience offre un riche matriau pour sidentifier ;
elle peut appeler automatiquement, un stade avanc de lducation, sa
doublure didentification ; mais elle ne porte pas demble la marque de
lidentit. Ds quon a reconnu cela, ds quon a laiss seffranger la tresse du
soi vcu devant un regard sceptique largi par lpoch
83
, on sapproche
de la conception que dfend le premier Sartre dans la Transcendance de
lego : Lego [] se borne reflter une unit idale [] peut-tre son rle
essentiel est-il de masquer la conscience sa propre spontanit
84
. Lidal
du rassemblement des dispositions agir en un soi dissimule et bride la
ralit crative et multiple qui est son sol. Lunit des aspirations, la cohsion
de lavoir tre, est un atout fonctionnel pour la vie collective ; mais elle
reprsente aussi un rtrcissement par rapport au fonds pratiquement sans
bornes des potentialits dtre, dont elle privilgie une seule direction. La
dissimulation, le rtrcissement, sont dautant plus efficaces quils ne se
savent pas produits par un besoin de cohsion, mais quils se prvalent de
laffirmation dune identit rtroactivement fige en une entit dote dtre
propre.
Cette observation desprit sartrien ne doit pas tre lue comme une
exhortation retrouver quelque utopique exprience sauvage, ou sinscrire
de manire dsordonne dans lorage des impulsions antrieurement inhibes
par la persona sociale ; seulement amplifier le degr de conscience
rflexive qui est le sceau de lhumanisation, rflchir sur la conscience de
soi comme la conscience de soi rflchit sur les composantes de ltre-en-
situation et, par ce geste de mise au jour, ne plus en tre le jouet mais
lironiste. Remarquons que la sur-rflexivit propose se rapproche, mais
avec une tape dpoch davance, de celle qui ouvre la conscience morale.
La conscience morale entretient une relation troite avec la conscience de soi,
mme si on ne peut pas la confondre avec elle : Conscience morale, crit
Husserl, est le nom dsignant une classe de ce genre de rfrences rflexives
soi-mme en tant que prises de position affectives du moi lgard de lui-
mme, qui peuvent alors se muer en jugements sur soi-mme
85
. La
conscience morale combine en somme, au premier degr la conscience de soi,
et au second degr le jugement (conforme une chelle de valeurs acquise ou
admise) sur ce soi mis en exergue par la conscience de soi. Par rapport cela,
la sur-rflexivit esquisse se situe encore une tape plus loin. linstar de la
conscience morale, la sur-rflexivit ralise une forme de conscience de la
conscience de soi ; mais, la diffrence de la conscience morale, elle y ajoute
la conscience de la fabrication du soi selon les normes dun soi projet, et la
suspension du jugement sur soi qui nest souvent quune introjection des
jugements rducteurs dautrui. Quelques questions perturbantes ne peuvent
manquer de se faire jour partir de l : des comportements thiques sont-ils
mme concevables, dans cette configuration de profond agnosticisme
axiologique ? Comment se guider soi-mme vers de tels comportements aprs
avoir suspendu tout jugement sur soi ? La rponse ces questions qui se
veulent drangeantes na rien de trivial, mais elle sinscrit en faux contre ce
quelles tendent suggrer par implicatures
86
. Non seulement les
comportements thiques sont concevables en labsence de jugement sur soi,
mais ils savrent sans doute plus naturels. Car ils sont alors dtermins par
un savoir-faire qui infuse sans effort et sans dlibration, dans le
comportement quotidien, les consquences dune pleine conscience rflexive
du caractre fabriqu du soi
87
. Sans soi vritable, il ny a pas
d autre authentique, et par consquent aucune raison de survaluer ce soi
au dtriment de lautre. Labsence de jugement sur soi, si elle est sous-tendue
par une absence de croyance en un soi substantiel, accomplit curieusement
la fonction morale de lexamen de conscience, dune manire plus forte et plus
fluide que ne le feraient sa prsence et sa prescription au nom dune norme
transcendante.
La mise en place de lanalyse ternaire de la conscience (exprience,
rflexivit, conscience de soi) tant acheve, notre but doit tre prsent de la
dpasser. Aprs tout, la taxinomie contemporaine des degrs de conscience
est la fois plus riche, plus finement analytique, et plus confuse que cette
classification trois strates propose en dbut de chapitre sur la base dun
survol de lhistoire de la philosophie. Les avances de la psychologie
cognitive exprimentale, plus que celles de la neurophysiologie, permettent de
rsoudre lcheveau de ce qui se vit en un feuilletage abondant de niveaux, de
formes, et dorientations de la conscience. Sans mettre compltement en cause
lchelle simple qui monte de la conscience lmentaire la conscience de
soi en passant par lchelon intermdiaire de la conscience rflexive, ces
disciplines introduisent des subdivisions supplmentaires, des marques
additionnelles de distinction, et des modles opratoires de lagencement des
degrs de conscience. ct de cela, leur vocabulaire et leur systme de
catgories associ est si incertain quil varie dun auteur lautre, et quil
engendre des malentendus hautement dommageables une valuation claire du
rapport entre strates de conscience et dynamiques neuronales. Le besoin sest
alors fait sentir de travaux rcapitulatifs ayant pour seule fonction dtablir un
minimum dordre dans cette jungle de mots et de concepts
88
. Mais les
tentatives de structuration du vocabulaire menes jusque-l restent
imparfaites, sans doute parce que la vraie raison de sa dispersion est plus
profonde quon ne ladmet. Cette raison ne rside pas tant dans le relatif
cloisonnement des quipes de recherche qui formulent leurs terminologies
indpendamment les unes des autres que dans la divergence des prsupposs
implicites qui les sous-tendent, et dans le fait que les critres de distinction
entre modalits et degrs de la conscience ont une multiplicit non reconnue.
Au moins peut-on discerner quelques caractristiques saillantes de ces
critres. Le principal dentre eux, qui justifie le schma hirarchique des
degrs de conscience, est lordre de rcursivit, ou le nombre de fois o
lexprience se retourne sur elle-mme. Un second critre est ltendue
variable du champ de conscience : pour un ordre de rcursivit donn, le
nombre de moments de conscience dordre infrieur envelopps par lacte
rflexif dordre suprieur peut tre plus ou moins grand, et plus ou moins tal
dans lespace ou dans le temps. Un troisime critre, complmentaire du
second et spcifiquement dirig vers lexplicitation de la conscience de soi,
est le type des moments de conscience dordre infrieur envelopps par lacte
rflexif dordre suprieur : ceux-ci peuvent concerner des traits physiques ou
des traits mentaux, accessibles de manire tantt publique tantt prive.
Quen est-il dabord du degr zro de rcursivit, celui de lexprience
pure ? Ce niveau lmentaire nest pas toujours reconnu par les chercheurs en
psychologie cognitive. Et mme quand il lest, il se voit parfois catgoris de
manire telle quil semble perdre tout lien avec la constellation gnrale des
actes conscients. Mais avant de sintresser de nouveau ce que rvlent ces
cas descamotage de la modalit de base de la conscience, il est important de
prendre un bon point de dpart en travaillant sur lune des descriptions les
plus prcises qui en aient t donnes : celle du psychologue du
dveloppement Philip Zelazo. Cet auteur se sert abondamment dun concept
dexprience pure pour remonter vers des tapes trs prcoces de
lontogense de la conscience. Il en fait un cas limite, un cas-plancher de la
conscience, et la nomme en consquence conscience minimale . La
conscience minimale se voit caractrise par lui comme irrflexive, oriente
vers le prsent, et ne comportant aucune rfrence un concept du soi
89
. Les
trois caractristiques dnombres sont cruciales : lantriorit de lexprience
lmentaire lgard de tout regard rflexif, ladhsion troite ce qui arrive
sans la trane dun pass biographique et sans prolongement vers un futur
dvocation ou de projet, louverture vive dnue dancrage dans un complexe
egologique qui la limiterait. Cette exprience pure ou conscience minimale est
attribue aux nouveaux-ns (voire aux ftus) et des adultes dont lattention
est dflchie loin des tches concernes, ou qui nont simplement pas eu le
temps de concentrer cette attention lorsquils en sont aux phases les plus
prcoces de laffection sensible. Ni les nouveaux-ns ni les adultes distraits
ntant considrs par Zelazo comme de simples machines, une nouvelle
catgorie dtres, ni rflexivement conscients ni strictement inconscients, se
voit dlimite, et trouve un quivalent chez plusieurs autres chercheurs
contemporains.
En labsence de vocabulaire clairement fix, ce genre dtres fait lobjet
de dnominations baroques qui varient dun auteur lautre. Lune des plus
curieuses est automate conscient
90
, qui ressemble un oxymore et qui
contrevient en tout tat de cause ce que Descartes entendait par
automate . Dautres systmes de dnominations, portant plutt sur la
stratification de la conscience que sur les tres qui en incarnent les strates,
singularisent le niveau lmentaire, irrflexif, de la conscience en lui accolant
des vocables alternatifs. Jonathan Schooler qualifie ainsi lexprience pure de
conscience tout court, en tant quoppose aux couches rflexives de la
mta-conscience ou de la conscience tourne vers elle-mme
91
. La
conscience consiste ici avoir une exprience , tandis que la mta-
conscience implique de savoir quon a une exprience . Cest dans le
prolongement de ce choix lexical que peut se justifier lemploi de
lexpression hsitante exprience consciente qui a t choisie en
introduction pour dsigner laspect le plus problmatique, voire le plus
aportique, de la question de la conscience : lexprience pure, ou la
conscience considre indpendamment de sa mta-conscience.
Aucun consensus nest cependant acquis sur lassimilation de la
conscience minimale une forme de conscience. Car on trouve linverse
des travaux qualifiant lexprience la plus lmentaire, la simple sensation
recueillie ltat vigile mais maintenue lcart du cercle attentionnel et de
la rflexivit, d esprit non conscient
92
. ct de cela, la locution
conscience primaire , qui a t mobilise prcdemment pour dnoter la
pure exprience isole dans les cas de distraction, peut tre utilise
alternativement pour dsigner une forme inaugurale de conscience non
distraite dans laquelle lattention est effectivement dirige vers tel objet
sensible sans pour autant se reployer rflexivement sur elle-mme
93
. Non-
conscience et conscience primaire dsignent donc dans ce systme
lexical deux modalits, non distingues auparavant, de lexprience pure.
Lexprience pure se voit partir de l range dans un domaine incertain,
quelque part en-de et juste au-del du seuil de la conscience. En sa phase la
plus native, la moins spcifique, elle est tire vers les rgions oblitres de la
non-conscience, tandis quen sa phase de rassemblement attentionnel mais
pr-rflexif, elle se voit reconnatre le titre de forme primitive de conscience.
Encore sagit-il l dune position nuance sur le statut de lexprience ;
une position qui introduit un lment de discrimination fine lintrieur mme
de son champ. Une option plus extrme consiste dnier implicitement
lappartenance de toute exprience non rflchie, quelle soit distraite ou non
distraite, attentionnelle ou pr-attentionnelle, au cercle de la conscience. Cette
option ressort en ngatif de la dichotomie dsormais clbre qua tablie
Antonio Damasio
94
entre conscience-cur et conscience tendue . Ici,
la conscience-cur implique non seulement la saisie sensible instantane
mais une forme peu labore de rflexion sur soi. Elle quivaut la pense
mme de vous le sentiment mme de vous en tant qutre individuel
impliqu dans le processus de connaissance de votre propre existence et de
celle des autres
95
. La conscience tendue ajoute cela laptitude
llaboration temporelle dun soi biographique. Et si les deux, conscience-
cur et conscience tendue, sont supposes prcdes par quelque chose,
cest par un proto-soi non conscient, seulement capable dvaluer
automatiquement ltat homostatique de lorganisme. Tout se passe dans ce
cas comme si la totalit des formes lmentaires dexprience non rflexive
taient repousses sans le dire hors des limites de la conscience stricto sensu,
puisque le degr le plus bas qui ait t assign la conscience inclut demble
une forme assez volue de rflexivit et dauto-reconnaissance. Or, cette
dernire dcision consistant pr-positionner les dfinitions de la conscience
des degrs variables, mais toujours non nuls, de rcursivit, na rien de
philosophiquement anodin, puisquelle semble faite pour favoriser en sous-
main la recherche dune origine de la conscience des niveaux eux-mmes
levs dorganisation biologique. Comme nous lavons dj signal propos
de lhypothse de lanimal-machine, une dfinition de haut niveau de la
conscience, qui met entre parenthses sa composante dexprience pure, et qui
insiste sur le seul repliement rflexif, est exactement ce quil faut aux thses
neuro-rductionnistes et neuro-mergentistes pour viter les rvocations en
doute de leur pertinence. Car si le fait brut dprouver na aucune contrepartie
physiologique connue ou envisageable, la bascule cyclique, la mcanique
mta-symbolique, noppose quant elle aucun obstacle srieux lanalyse
rductive ou mergente. Assigner la conscience la seule fonction dun self-
monitoring (dune surveillance de lorganisme par lui-mme), et rendre
raison de cette fonction en termes objectifs, nest de toute vidence pas hors
de porte de la neurologie ni mme de la robotique ; alors qulucider la
cause physique du ce que cela fait dtre , mettre au jour la provenance
biologique de la circonstance la fois banale et stupfiante que tout cela
(accueil sensible aussi bien quauto-sensible) apparat ou sprouve, reste
compltement hors daccs et mme de concevabilit. Tel est le coup de force
dfinitionnel auquel nous nallons plus cesser de nous heurter : une pseudo-
caractrisation tronque est retenue pour la conscience, afin de rendre
plausible la qute de sa gense par un mcanisme biologique et/ou
physique. Lexprience pure tant intentionnellement repousse dans langle
mort du travail scientifique, la question-limite de son origine se voit
remplace par la question moins radicale de lapparition progressive de la
rflexivit ; et ce remplacement est rendu assez discret pour donner
limpression fausse quon a ainsi affront le problme dans toute son ampleur.
De manire prvisible, cest donc la rflexivit qui focalise la majorit
des caractrisations de la conscience en psychologie cognitive (comme ctait
le cas dans la philosophie classique de la connaissance), et cest aussi elle
qui rassemble le plus grand nombre de dnominations divergentes. Lauto-
nose
96
, la mta-cognition
97
, les penses dordre suprieur
98
, voire la
mindfulness
99
ou pleine conscience comptent parmi ces
dnominations. Chacune dentre elles couvre un domaine qui ne recoupe pas
exactement celui des autres, allant jusqu la contradiction mutuelle. Ainsi,
lauto-nose implique la mmoire pisodique long terme, qui nintervient
pas ncessairement dans la mta-cognition, pas plus que dans la rflexivit
immdiate de lexprience consciente. Par ailleurs, lgal de celle des
penses dordre suprieur , la dfinition de la mta-cognition se dploie
sur le seul terrain de la troisime personne. Rien nempche donc a priori un
acte mta-cognitif de saccomplir en labsence dexprience vcue de cet
acte. Les concepts de mta-cognition et de penses dordre suprieur sont de
ce fait une occasion renouvele daffirmer la prminence des processus
mentaux inconscients jusques et y compris dans les actes rflexifs, et den
trouver la trace omniprsente dans les fonctionnements
neurophysiologiques
100
. Il en rsulte que la mta-cognition nquivaut pas
lauto-nose et encore moins la pleine conscience. Mais il en rsulte aussi
que les concepts mta-cognitifs sont les tmoins involontaires de la vanit des
thses qui font de lapparition des processus rcursifs neuro-corticaux la
marque de lorigine de la conscience : la rcursivit conditionne une
rflexivit cognitive objective, mais elle ne suffit pas a priori faire surgir
le noyau de la conscience qui consiste en une exprience rflexive, en un vcu
sur les vcus. Lorigine de la rflexion, du sur les , laisse en somme dans
lombre celle de lexprience rflchie, celle du vcu sur les vcus ; car ce
dernier demeure prcisment une occurrence prouve, dont la teneur est trs
loin dtre puise par un simple ordre de rflexivit. Enfin, la
mindfulness , ou pleine conscience, se situe pratiquement aux antipodes de
la mta-cognition sur le spectre qui stend de la rcursivit lexprience
pure. Si la mta-cognition quivaut une forme de rcursivit sans
exprience, la mindfulness est rciproquement une forme largie
dexprience caractrise par un investissement entier et dfocalis dans
lactivit en cours, qui ninclut pas la mta-apprhension rcursive de cette
exprience comme objet second dattention
101
mais plutt comme moment
delle-mme.
Bien plus que lexprience pure, la rflexivit se prte une analyse
dtaille propre en distinguer de multiples varits. Cette analyse na rien
dabstrait ni dartificiel, pour peu quelle soit mise lpreuve sur le terrain
de la psychologie exprimentale du dveloppement. Cest en effet chez les
jeunes enfants quon saisit les processus rcursifs ltat naissant, ou quon
est au contraire frapp de leur absence, par comparaison avec les ractions
dadultes faisant face aux mmes tches. Le modle de niveaux de
conscience propos par Philip Zelazo
102
a t labor et test dans ce
contexte, et la stratification qui en rsulte savre la fois particulirement
fine, et taye tape aprs tape par les performances denfants de divers ges
en rponse des sollicitations calibres. Ce modle assez complexe
comprend deux colonnes principales, dont la seconde se voit ensuite
dcompose presque linfini :
1. La colonne des expriences, ou consciences minimales en flux, sans
cesse remplaces par dautres.
2. La colonne des tiquettes qui sont galement des expriences ; mais
des expriences ractivables travers la mmoire de travail ; et des
expriences dotes de surcrot dune valeur smantique, puisque chacune
dentre elles renvoie une srie dautres expriences gnralement plus
lmentaires.
Chaque conscience minimale en flux peut tre prise comme thme rflexif
(et/ou signifie) par une seconde conscience minimale initialement provisoire
mais affermissable par rptition rcursive. La seconde conscience minimale
peut tre signifie son tour par une troisime, et ainsi de suite, sans autre
limite que celle quimpose la capacit dembotement ou de rtention
hirarchique propre chaque individu. Une question qui peut tre souleve
ds prsent consiste savoir si rflchir au moyen de consciences ayant
valeur smantique quivaut forcment entretenir des croyances explicites,
formulables dans un jugement, propos des tats de conscience dordre
infrieur. Rosenthal ladmet, dans son propre schma fortement intellectualiste
des niveaux de conscience, quil appelle dailleurs des niveaux de pense
103
.
En revanche, Zelazo rfute cette conception logico-linguistique de la
stratification des niveaux de conscience, en considrant que la rflexion
nimplique pas dentretenir des jugements et des croyances discursivement
dvelopps au sujet dtats psychiques vcus, mais plutt de les prendre
leur tour pour quasi-objets dexprience. Lcart par rapport
lintellectualisme ne sarrte cependant pas l. Dans un style merleau-pontien,
on peut en effet supposer que, pas plus que la perception nimplique une
conceptualisation du sensible, la rflexion nimplique une catgorisation
objectivante des niveaux de conscience rflchis. Nest-ce pas dailleurs ce
que suggre le statut smantique faible des tiquettes de Zelazo, qui se
contentent de renvoyer immdiatement dautres expriences sans
obligatoirement faire une synthse conceptuelle de celles-ci comme
lexigerait lobjectivation au sens kantien ? Pour quune exprience dordre
suprieur opre comme tiquette , il lui suffit de tenir lieu de certaines
expriences tiquetes, de signifier ces expriences isoles en se substituant
elles et en tant capables den rengendrer certains aspects, sans toujours les
regrouper en classes rigides. Par rapport aux consciences minimales
signifies, les tiquettes signifiantes ont lavantage dun certain degr de
permanence et dun pouvoir gnratif propre au symbole ; mais elles gardent
habituellement une plasticit et une gnrativit proto-objectivante, et ne
cristallisent en formes stables dobjets quaux niveaux de rflexivit les plus
levs
104
.
Une tiquette est une varit dexprience dordre rcursif suprieur,
mais elle nest pas seulement cela ; elle est une exprience slectionne,
renforce et stabilise pour sa capacit renvoyer un vaste complexe
dexpriences tels que souvenirs, savoir-faire, ractions affectives, etc.,
collectivement pertinents en vue daccomplir de manire optimale une tche
actuellement donne. En labsence de rcursivit et de fixation smantique, les
actions seraient strotypes et suivraient immdiatement les sollicitations
sensorielles. linverse, la profondeur rcursive et la polyvalence des
expriences dordre suprieur qui tiennent lieu densembles variables
dexpriences primaires, favorisent la crativit des comportements en les
basant sur un large rpertoire de motifs possibles. Elles ouvrent galement
un espace considrablement agrandi de vcus qui ne cessent de se faire cho
les uns aux autres. La cascade de rsonances prouves qui en rsulte a pour
horizon provisoire lexprience de dernier degr, lexprience des
expriences, aveugle elle-mme mais manifestant au prsent lchelle
entire de ses rflexions et de ses rtentions.
Le procd des rcursions et des stabilisations smantiques volue au
cours de lontogense mentale dans le sens dun ordre de multiplicit
rflexive croissant, et il ouvre en fin de parcours sur un nud dynamique
unifi, sur une rsonance globale rptitive, quil est dj plausible de
rapprocher de la conscience de soi . Le sens de la conscience de soi se
trouve clair par ce procd de gestation, qui est du mme coup le procd
par lequel se trouve constitu un soi (au moins un soi pr-
biographique, le cas du soi complet, dot dune biographie, tant trait
plus bas).
Pour suivre le fil de cette gestation telle que la dcrit Zelazo, considrons
dabord le cas dun jeune enfant (g de deux quatre ans) auquel on demande
de ranger des objets selon une rgle (disons du plus grand au plus petit). Cette
tche requiert deux oprations mta-cognitives :
a. Une rflexion, cest--dire la capacit de sapercevoir que lon voit
une chose dote de ses caractristiques, et non pas se contenter de la voir
extatiquement ;
b. Un tiquetage smantique, qui revient substituer la chose telle
quelle se montre avec des nuances changeantes, sa catgorie permanente
emprunte aux critres de la classification propose. Une fois ltiquetage
accompli, lenfant ne voit plus un simple tableau perceptif, mais un type ;
il ne voit plus (sauf en surimposition plie) ce seau en plastique de
couleur bleu marine avec ses reflets, ses dcorations dtoiles de mer, et
ses lgres rayures, mais avant tout un grand objet.
Ce sont en somme ces tiquettes , ces expriences la fois rflexives
et symboliques dont certaines ont une valeur catgoriale, qui sont
majoritairement prsentes un enfant en train deffectuer son rangement, plutt
que les expriences immdiates.
Il na toutefois t question jusque-l que dun dcollement lmentaire
par rapport la phase primordiale (peut-tre nonatale) dimmersion
irrflchie dans ce qui advient. Supposons prsent quon demande au mme
enfant dalterner les classements suivant trois rgles profondment diffrentes,
voire imbriques lune dans lautre ; par exemple de trier les objets tantt sur
le critre du clair et du sombre, tantt sur celui du lourd et du lger, tantt sur
celui du rang de classement dans les deux premiers jeux (les premiers choisis
et les derniers choisis dans les deux jeux). Changer de critre de rangement
demande non seulement de sapercevoir que lon voit chaque chose, mais
aussi de sapercevoir de la rgle de classement quon applique aux choses.
Cela exige dtre capable de substituer lexprience-dune-catgorie
lexprience-de-chose, et aussi de sapercevoir quon est en train deffectuer
une telle substitution afin de se donner ensuite la latitude de changer de
catgorie. Enfin, ranger les objets selon le rang du choix opr durant les deux
premires oprations de rangement suppose encore un chelon additionnel de
rflexivit par rapport au prcdent : il ne faut pas uniquement sapercevoir
de la rgle de classement, mais en plus que cette rgle de classement a t
aperue, et dans quel ordre les deux rgles ont t utilises. Ici, les boucles
de rcursivit ncessaires pour venir bout de la tche se multiplient, et les
checs ou les succs dans son accomplissement manifestent la capacit quont
les enfants dges variables les mettre en place.
Mais ce nest pas encore tout. Au fur et mesure que les aptitudes aux
rflexivits et aux tiquetages exprientiels dordre suprieur se
dveloppent, il devient possible de les appliquer non plus une multitude
dobjets ou dvnements quasi-contemporains, mais des objets ou des
vnements passs voire imaginaires. Ltalement dans lespace-temps des
moments de conscience dordre infrieur placs dans le champ
denveloppement dun acte rflexif dordre suprieur sen trouve
progressivement accru, par tapes pouvant tre dcomposes comme suit
105
.
Surmontant la conscience minimale dans sa stricte actualit (premier stade),
les jeunes enfants commencent par faire la diffrence entre ce qui, en elle, est
porte de la main, et ce qui est objet de dsir. Puis, rflchissant sur les
expriences lmentaires du saisir et du convoiter, ils leur substituent des
tiquettes dordre suprieur renvoyant deux ensembles de vcus qui les
articulent de manire diffrencie : lensemble des expriences davoir dj
obtenu quelque chose despr (le pass), et celui des expriences davoir
besoin de quelque chose sans lavoir encore captur dans la sphre de
manipulation (le futur). ce deuxime stade, cependant, la conscience de
lenfant demeure compltement immerge dans son propre point de vue proto-
spatio-temporel (lici et maintenant), ntant parvenue tiqueter que ses
acquis attests et la teneur de ses souhaits non encore raliss ; mais pas, un
degr de distanciation supplmentaire, les tats mentaux consistant tantt se
souvenir davoir acquis une chose tantt continuer de souhaiter autre chose.
Un niveau supplmentaire de rflexivit est requis pour cela, ainsi quun tage
suprieur dtiquetage, qui regroupe les tats mentaux de plus ou moins grande
satisfaction en des squences successives incluant ltat prsent sans tre
centres sur lui. Le prsent nest alors plus trait comme lorigine invisible
des perspectives rtentionnelles et protentionnelles, mais comme tel moment
thmatisable, parmi dautres moments dune squence temporelle
dexpriences propres. Encore, au troisime stade de rflexivit
temporalisante qui vient dtre dcrit, aucune diffrence nest-elle faite entre
lactualit vcue et linstant prsent du monde, entre lautobiographie et
lhistoire, entre la suite des expriences et la suite des vnements objectifs.
Une telle distinction additionnelle exige des niveaux ultrieurs de rcursivit
qui impliquent laperception des rciprocits sociales, la rflexion de soi-
mme comme une personne parmi dautres, et la mise part de ce qui nest
arriv qu moi et de ce qui est arriv dautres simultanment ou de faon
diffre. ce niveau lev de rcursivit (le quatrime de ceux qui sont
rpertoris), lautobiographie est le champ des occurrences singulires, tandis
que lhistoire est le champ des occurrences comprises comme
intersubjectivement partageables. tre conscient de soi, au sens dsormais
plein du terme, cest tre conscient de lunicit dune biographie, de sa
situation dans lentrelacs des biographies des autres, et dune double
localisation dans le temps de lhistoire et dans lespace des coordonnes
multiples dont on se posait de facto comme lorigine avant davoir parachev
la tche consistant sen dsolidariser. Cest aussi (au stade du miroir) se
dcentrer suffisamment pour pouvoir identifier une figure de mouvements
visibles avec une image des proprioceptions
106
, et pour tablir une
correspondance tantt conceptuelle tantt incarne entre des comportements
observs chez les autres et une aperception des motions immdiatement
vcues
107
.
Ce modle stratifi des niveaux de conscience, issu dune interprtation
des expriences de psychologie du comportement, peut assez facilement tre
mis en regard de faits neurobiologiques isomorphes. Cela ne prjuge en rien
de la rductibilit des premiers aux seconds, condition de ne pas oublier que
cest la stratification des niveaux de la conscience des chercheurs qui a
conduit la constitution de faits objectifs tels que les processus neuronaux,
avant quun compte rendu des niveaux de conscience net pu tre donn en
des termes neurophysiologiques. Dans ce registre, on peut par exemple mettre
en correspondance les niveaux de rcursivit de la conscience avec les
boucles de rtroaction des cartes rentrantes corticales, qui impliquent des
interactions rciproques entre les aires primaires sensori-motrices et les aires
associatives
108
. On peut galement mettre en relation lenchanement
chronologique de la conscience minimale irrflexive et des niveaux ultrieurs
de la conscience rflexive, avec la cascade lectro-encphalographique des
potentiels voqus successifs qui suivent dans des dlais variables un
stimulus sensoriel
109
.
Mais, parce que ces tudes de psychologie cognitive traitent aprs tout
dtats de conscience, dont le fait de les vivre ne peut pas tre dissoci sans
artifice, le dveloppement le plus pertinent qui puisse en tre offert consiste
se demander si le modle auquel elles aboutissent possde une traduction
phnomnologique. A-t-on vraiment lexprience dune multiplicit de
niveaux rflexifs, et de la procdure dtiquetage symbolique dune pluralit
de vcus ? Ou ne sagit-il l que dune construction thorique permettant de
rendre raison dun matriau exprimental objectiv ? De mme que, dans la
discussion prcdente sur la conscience de soi, il faut se rendre compte que
tout ce dont nous disposons pour rpondre cette question est une exprience
de tard-venus. Nous vivons actuellement une exprience fortement intgre
dadultes, qui est certes capable de hauts niveaux rflexifs nous rendant aptes
nous retourner sur nos propres oprations, mais qui effectue les premiers
gestes de cette rflexivit avec un degr tel defficacit, de spontanit, et de
rapidit quils en deviennent pratiquement insaisissables et indiscriminables.
Le genre dexprience que nous vivons est organis pour lessentiel sur le
mode symbolique et rflexif plutt que minimal ou extatique, car les
tapes initiales supposes du choc sensible ou de limage non catgorise sont
presque immdiatement reprises des niveaux levs dinterprtation. cela
sajoute que les phases extatiques ou ininterprtes de lexprience sont de
toute manire exclues dune mmorisation qui serait seule capable de les
maintenir assez durablement en tant que telles dans le foyer de lattention
pour en faire des objets de conscience. Ds quelles sont mmorises, ds
quelles parviennent au niveau de traitement cognitif qui convient pour tre
stabilises et pour devenir un thme de narration, elles cessent dtre perues
comme telles et ne le sont plus qu travers leur symbole rflexif. Ainsi, le
dploiement entier de la chane des niveaux de conscience nous est
habituellement inaccessible ; cette chane nous apparat comme ramasse dans
un bloc de conscience unissant indissolublement des lments daffection
primaire et des moments de rflexivit dordres successifs. Il existe cependant
certaines circonstances qui favorisent la dcomposition du lien entre les
divers moments de lexprience, et qui permettent la manifestation spare de
phases de conscience minimale et de phases de reploiement rflexif. La
premire de ces circonstances est tout simplement le caractre labor et
intellectualis de la rflexion. Supposons que nous ayons faire effort pour
accomplir une tche de niveau rcursif trs lev, par exemple pour dgager
une rgle gouvernant lensemble des rgles des jeux de socit. Dans ce cas,
lexprience de dernier degr rflexif a une qualit dinstabilit particulire,
une prgnance seulement transitoire dans le champ de la conscience qui la
rend immdiatement reconnaissable sur fond dexpriences plus durables de
niveaux infrieurs. Ici, cest par sa difficult excessive, par son audacieuse
exploration des limites de nos ressources mentales, que la rflexion se fait
involontairement visible. La deuxime circonstance favorable est ltranget,
le caractre parfois hautement inhabituel et donc difficilement catgorisable
de lexprience initiale. La rsistance dune telle exprience la
catgorisation introduit un dlai chronologique parfois considrable, de
lordre de la seconde ou davantage, entre sa premire apprhension et sa
rflexion symbolique. Ce dlai de dsorientation maintient, comme par
inadvertance, et malgr tous les efforts pour en sortir, un tat dexprience peu
ou pas rflexif qui adhre longtemps la teneur inanalyse du stimulus et la
saveur sensible du moment vcu. Un exemple de cette situation peut tre
trouv dans lcoute de sons bizarres qui droute la catgorisation et qui
bloque les interprtations usuelles en termes de sources de ces sons et de
motivations de leur mission
110
. Lattention tant comme sidre par
ltranget du son, et se trouvant dans lincapacit de choisir les cadres
conceptuels qui conviendraient pour le comprendre, elle demeure pour ainsi
dire fige sur place, et se contente dexplorer les qualits prouves du
vibrato qui vient de steindre sans pouvoir passer travers lui pour
identifier son origine ou sa signification pratique. Si une rflexion survient,
cest une pense dordre suprieur sur limpossibilit dinterprter les sons
perus, qui est bien spare de lexprience perceptive elle-mme et reste
donc reconnaissable comme telle. La troisime circonstance favorable, enfin,
est plus subtile. Elle exige un travail labor de suspension du jugement, dont
il sera plus longuement question au chapitre suivant. Suspendre le jugement
jusquau bout, cela revient surseoir au caractre signifiant des expriences
rflexives de type tiquette ; cela revient se contenter de les goter
pleinement en tant que vcus, plutt que de sen servir comme tremplin vers
dautres expriences. Pour bien comprendre ce point, rappelons que ces
expriences rflexives teneur symbolique ont pour trait distinctif de
favoriser leur propre dpassement en direction des expriences quelles
symbolisent ; au lieu de valoir pour elles-mmes, elles tiennent lieu dun
faisceau dautres expriences de niveau rflexif infrieur. En dautres termes,
dans la configuration phnomnologique qui leur correspond, lexprience
vcue nest pas identique lexprience avec laquelle on se trouve en prise.
Ici, lexprience que lon vit est lexprience rflexive valeur symbolique,
tandis que lexprience avec laquelle on se trouve en prise est lune des
expriences symbolises par la premire, cest--dire lune de celles vers
lesquelles nous expulse la premire. Tout se passe comme si
lexprience- tiquette nous entranait fuir vers lavant, vers lailleurs,
vers les expriences tiquetes qui sont des occurrences passes ou futures, en
la perdant elle-mme de vue. Une suspension du jugement pleinement
accomplie neutralise le courant de cette fuite et nous reconduit lexprience
actuelle, quel que soit son niveau de rflexivit ; elle permet dapprhender
toute exprience, y compris une exprience teneur symbolique, comme ce
quelle est ; savoir, justement, comme une exprience plutt quun simple
tenant-lieu-de quelque chose dautre quelle-mme. Nimporte quelle
exprience, nimporte quel niveau de rflexivit, peut ainsi tre saisie dans
une sorte d arrt sur image phnomnologique, et dploye dans ses
diverses dimensions, sensible, perceptive, symbolique, intentionnelle, ou
formelle, au lieu de lautoriser se rendre transparente comme une simple
fentre sur quelque autre exprience. Et mme si cette saisie est dlicate et
phmre, mme si larrt sur image est fugace, mme si peine accomplie
elle laisse place de nouvelles expriences qui se prtent leur tour des
drobades rptes, il est possible de sentraner ractiver sans cesse le
processus dadhsion scrupuleuse chacune des phases o le flux des vcus
vient de parvenir. Dchappe en chappe et de reprise en reprise, cest un
corps--corps patient avec le vcu qui se poursuit. Ainsi peut-on entrer en
contact avec chaque exprience en tant que telle, soit en tant quacte vcu
rflexif soit en tant quactualit sensible en attente de rflexion, mais toujours
dans sa qualit dtre prsente. On comprend mieux ainsi la spcification
initiale, encore un peu cryptique, de lexprience offerte au chapitre I : Rien
dautre [que lenvironnement et vos penses], mais peut-tre avec une force,
une expansion, et une saveur accrue, comme si vous ntiez plus projet hors
de la prsence par sa propre impulsion signifiante. Du modle
psychologique des niveaux de conscience, on passe la ralisation directe
dune conscience stratifie.
Une trace de ce dploiement des modalits de la conscience se retrouve,
confuse et disperse mais lisible, dans les vocabulaires de la plupart des
langues. Mme si on a de fortes rserves vis--vis dune tendance
heideggerienne vouloir lucider de manire dfinitive les concepts par une
tymologie allemande ou grecque pousse jusqu ses dernires racines
relles ou imaginaires, on doit reconnatre que lanalyse dun assez grand
nombre dtymologies compares peut receler des leons philosophiques.
titre dintroduction une telle rflexion, le tableau ci-dessous explicite le
lexique de la conscience dans 9 langues : le franais, langlais, litalien, le
danois (avec lallemand), le russe, le hongrois, le chinois, lingessana (une
langue africaine), et enfin le sanskrit
111
.
Chaque langue est dpositaire dun rseau dusages sociaux et personnels
qui donne sens ses mots par le jeu de la diffrenciation pragmatique. La
thse de l auto-rfrence du sens dcoule de cette remarque : selon elle,
comprendre un nonc ou un mot, cest avoir identifi les genres dactes et
dexpriences qui accompagnent ou qui justifient son emploi
112
. Tel est le cas
en particulier des prdicats mentaux, dont ladjectif conscient fait partie.
Un sujet auquel sapplique le prdicat mental P ne se conduit pas de la mme
faon quun sujet auquel sapplique le prdicat mental P ; et il apprend le
plus souvent comment appliquer ces prdicats lui-mme lorsque ces
conduites sont identifies chez lui par dautres pendant quil vit les tats
mentaux correspondants. Le sens des prdicats mentaux, y compris du prdicat
conscient , est circonscrit (selon lanalyse wittgensteinienne dveloppe
la fin du chapitre I) par le renvoi mutuel des comportements et des vcus qui
justifient leur emploi socialement autoris. Or, une culture se dfinit, entre
autres, par le primtre des comportements quelle admet et des expriences
quelle accueille. Les comportements accepts peuvent par exemple inclure,
dans certaines cultures, les convulsions de transes prmonitoires, ou bien ils
peuvent les exclure, dans dautres cultures, au profit de la seule raideur dun
examen rationnel du futur. Des expriences reconnues dans notre culture,
comme laboulie dpressive ou la haine de soi , ne sont pas catgorises
comme telles ou sont perues comme dviantes dans certaines socits
asiatiques, tandis que dautres expriences rpandues dans les socits dites
premires , comme le voyage chamanique, manquent de rpondant et de
crdibilit dans le cadre dune culture occidentale moderne. Mme lhistoire
de notre propre civilisation manifeste une altration, assez rapide avec le
temps, du cercle des expriences reconnaissables ou tolrables. Ainsi, la
dfiance lgard de lexprience mystique sest considrablement accrue
partir de la fin du XVII
e
sicle dans les pays europens, se traduisant dabord
par la querelle du quitisme et la prise de position sans appel de Bossuet
113
contre Jeanne Guyon, puis senracinant dans lespace extra-religieux durant
lpoque des Lumires. Tout ce que lon disait avant ce tournant historique
propos de lexprience mystique semble comme fan, teint, voire fossilis
aux yeux dun lecteur contemporain nostalgique
114
; seuls des travaux
archologiques ou des renouveaux artificiels parviennent la faire revenir au
jour. Ses vocables (comme le mot me , en lente dshrence dans certains
contextes, ou encore possession , ravissement , extase ) sont
dsactivs et progressivement abandonns, mme sils sont parfois
remploys dans un sursaut de rminiscence. Ce sont les tendances lourdes de
ces inclusions et exclusions, de ces expriences agres ou mises au ban, de
ces comportements associs lisibles ou illisibles, qui se dposent
vraisemblablement comme un sdiment dans la structure tymologique de la
terminologie mentaliste. Et cest cela vers quoi on peut linverse remonter
en croisant une multiplicit dtymologies des mots de lesprit.
Lempreinte de la culture est particulirement lisible dans le choix et
ltymologie des prdicats ou des substantifs de conscience. Dans nos cultures
et dans nos langues occidentales, la varit des usages de ces mots est
relativement limite, et leurs tymologies sont rares et strotypes. La langue
chinoise est dj plus riche cet gard, et la langue sanskrite (calque mot
pour mot par la langue philosophique tibtaine qui la traduit) bat des records
de raffinement dans la combinaison des racines et les nuances de signification.
Si le sanskrit
115
apparat ainsi comme la langue de la conscience, cest que la
culture entire qui a port sa parole sest tourne vers lenseignement dune
discipline de modulation psycho-corporelle des moments de la conscience (le
yoga). La civilisation indienne, dclare Roberto Calasso
116
, est ce moment
singulier de laventure humaine dont le projet unique a t dengendrer et de
consolider un certain genre dtat de conscience, et de faire graviter autour de
lui les gestes et les paroles dune vie sociale perue cause de cela comme
anhistorique.
Pour tirer quelques enseignements de ce tableau, repartons du mot
commun conscience , consciousness , coscienza . Il est
manifestement compos dun prfixe de rassemblement con- (en latin
cum- ) et du substantif science , driv du latin scientia ,
connaissance. Dans le lexique latin, conscientia est assez polysmique. Il
est parfois strictement synonyme de connaissance , penche dautres fois
vers la signification de connaissance partage (avec dautres) , et dsigne
dans certains cas une forme de connaissance intime, ou de connaissance de
ses propres tats mentaux assez proche de notre conscience. La connaissance
partage se transforme dans ce dernier usage en une connaissance ramasse,
recueillie. Mditant le connatre-ensemble proclam sur le Forum, on en
arrive prendre silencieusement contre soi ce qui se prsente dans le refuge
dune connaissance intriorise. Cette alliance du substantif connaissance
et dun prfixe de rassemblement est trs rpandue dans les langues indo-
europennes. On la retrouve en russe, sous les formes so-sznanie et so-vest ;
en grec avec (sun-gnosis, syn-gnose ) ; et plus encore en
sanskrit, avec plusieurs termes drivs de sam-ja et sam-vid. Sam-ja est le
correspondant exact, racine pour racine, du grec (connatre-
ensemble) tandis que sam-vid utilise une racine verbale indo-europenne
diffrente qui signifie galement connatre mais qui sapparente au verbe latin
video (voir). La mme racine vid se retrouve en danois, dans le terme Be-
vid-sthed qui signifie conscience, et aussi, bien que de manire moins
vidente, en allemand, dans le terme analogue Be-wusst-sein o se reconnat
une flexion du verbe wissen qui signifie savoir mais aussi originairement
voir . Le grec comporte pour sa part des vocables isomorphes
(sun-aisthese, syn-esthse ), (sun-eidese) qui se dcryptent
comme sentir-ensemble et voir-ensemble , et qui sont des analogues
tardifs (dpoque hellnistique) du latin con-scientia. La conscience oscille
ainsi entre un voir et un connatre partags ou rassembleurs. Cette
concentration sur le voir, parmi toutes les modalits sensibles, na rien
dindiffrent. Voir est une manire de sentir qui a demble pour trait singulier
le regroupement de plusieurs objets dans la forme unique dun champ spatial.
Dautres modes de la sensibilit, comme laudition, peuvent galement
prsenter leur objet dans un champ spatial, mais celui-ci est plus flou, moins
rigoureux dans son mode de rpartition que celui de la vision. Sous le toucher,
le pouvoir de rassemblement saffaiblit encore puisque lobjet palp est
unique et nentretient pas de connexion immdiate avec dautres objets. Dans
les termes qui impliquent la racine indo-europenne vid , la conscience
hrite donc la connotation de clart, et de pouvoir de synthse dans un seul
domaine plac sous le regard, qui distingue la vision dautres modalits
perceptives. On cherche peut-tre lui faire traduire lexprience dun regard
intrieur, qui prcde de facto celui de lorgane visuel et en conditionne le
pouvoir de ralliement
117
. Mais, dans dautres termes qui voquent une
composante quasi-tactile de la conscience (M/Mara en sanskrit), la
civilisation indienne manifeste quelle a aussi appris pouser les contours
de ltre-conscient en leffleurant, quelle sest donn les moyens de
lexplorer ttons dans la plus grande intimit sans se hter dapprhender
son unit abstraite par un effet de distanciation.
Quen est-il prsent de connatre ? La connaissance nest pas
seulement une composante smantique du mot conscience ; elle confine
la synonymie. Perdre connaissance, cest perdre conscience ; la conscience
est dfinie par le Trsor de la langue franaise comme une facult nous
permettant davoir connaissance de nos propres tats ; et le hongrois tablit
une quivalence pure et simple entre conscience et connaissance. Encore faut-
il distinguer des modalits du connatre. Il y a des formes de connaissance
directes, sensibles, tantt visuelles (comme dans le sam-vid sanskrit, le
Bewusstsein allemand, et le Den soudanais), tantt tactiles (comme dans
les termes sanskrits vi-mara e t pratyavavamara), tantt intermodales
(comme dans le sanskrit indriyajna) ; autrement dit des connaissances
silencieuses par contemplation perceptive ou par contact troit. Et il y a
linverse des connaissances indirectes pouvant tre mdies par des symboles
et des propositions, des connaissances-que scartant des seules consciences-
de. Sans compter des formes de connaissance intermdiaires entre le direct et
lindirect, assez bien voques par certains usages de ladjectif italien
consapevole . Le sens de ce dernier mot est proche de cosciente
(conscient), et son tymologie en est quasi-indiscernable puisquelle se
contente de substituer un verbe savoir au verbe connatre ; mais il
sutilise dans des contextes un peu diffrents, tenant aussi bien de la
conscience que de la connaissance. On peut tre consapevole de quelque
chose (comme on est conscient de ce quelque chose) ; et on peut aussi tre
consapevole quun fait sest produit ou quun contenu propositionnel est
vrai (comme on sait que cela est arriv)
118
.
Mais distinguer les varits de connaissance, opposer les connaissances
proches ou lointaines, par connivence ou par recul, est-ce suffisant ? Est-on
ainsi parvenu connatre la connaissance ? En un sens, oui. Car au fond,
quest-ce que connatre ? Avant tout mettre part, discriminer, catgoriser ;
autrement dit sortir de lindistinct, refuser de demeurer sidr devant
limpressionnante singularit de ltant total, discerner des lignes de partage
qui lclatent en une pluralit de fragments, ou construire un espace modal qui
en fait une actualit particulire parmi dautres possibles. Discriminer des
types de connaissance, cest donc accumuler des lments de connaissance de
la connaissance ; et caractriser la connaissance comme discriminative par
contraste avec un mode de saisie inarticul, cest la connatre mieux encore
en layant globalement distingue dautre chose. Tel est en tout tat de cause
le sens principal du mot sanskrit vi-jana : connaissance (gnose, jana)
discriminante (vi-, prfixe de sparation dichotomique). Ce vocable est
souvent traduit par conscience , mais il porte avec lui une trace
tymologique qui voque lopration analytique. Il sapparente en cela au mot
pratisakhy , correspondant galement notre conscience, mais
renvoyant lacte de compter, dvaluer, littralement de dclarer
ensemble . Les deux termes ne peuvent manquer de sopposer dautres qui
indiquent une forme de conscience la fois plus primitive et plus largement
englobante.
Parmi les termes alternatifs pr-discriminants qui viennent dtre
invoqus, on relve en sanskrit bodha (veil) ou praksa (luminosit)
qui voquent la simple hospitalit aux contours du monde, la pure prsence
vcue soigneusement mise part de la forme distinctive de ce qui est prsent.
La langue tibtaine rend cette composante de signification par des mtaphores
de transparence illimite : espace, ocan, ou miroir sans bords
119
; un miroir
capable de porter tous les reflets des phnomnes puis de les laisser
disparatre, sans jamais rester color par eux. La mme sphre de sens se
reconnat nouveau dans le chinois Qing Xing , avec sa clart et sa
translucidit compares celle dun ciel immacul, vierge de nuages mais
immensment accueillant leurs possibles vapeurs. Il sagit dans tous les cas
de faire signe vers un arrire-plan de lumire rvlante ou vers une tendue
rceptive lapparatre. Cette gaze limpide est considre comme une
condition si universelle de chaque apparition, dans les cultures de lInde ou
dans celles qui en drivent, quelle est discrtement identifie la texture
mme de ce quil y a. Sattva, anubhava, deux autres termes sanskrits traduits
par conscience, drivent des deux racines (As et Bh) qui correspondent au
verbe tre indo-europen
120
. La conscience nue, lumineuse et spacieuse,
indiscrimine et irrflchie, assimilable lexprience pure, est ici
coextensive au simple fait dtre.
Une telle diffrence tablie entre les variantes mentalises,
discriminatives ou valuatives de la conscience, et son fond de radiance,
permet en tout tat de cause de rsoudre quelques problmes dune pense
indienne voue la conceptualisation de lexprience contemplative.
Considrons par exemple la liste dlments la plus commune dans la
tradition bouddhique : celle des dharma , regroups en cinq sous-
ensembles ou agrgats ( skandha )
121
. Le cinquime skandha est compos
de vijana , inattentivement traduit par conscience . Mais si lon admet
(comme tant la moins inapproprie
122
) la catgorisation des dharma comme
phnomnes, et celle des skandha comme agrgats de phnomnes, quel sens
y a-t-il dire que la conscience elle-mme est phnomne ? Cela ne revient-il
pas, de manire absurde, faire de lapparatre une apparition ? On ne peut
alors comprendre le systme des skandha que si on dsarticule le signifiant
conscience le long des lignes de partage que lui mnage la langue
sanskrite (ou la langue pli qui en est drive). En se souvenant de
ltymologie du mot qui dsigne le cinquime skandha, on saperoit que la
conscience-phnomne qui le compose nest que lacte mme de diffrencier
cognitivement (vi-ja) au sein de ce qui se prsente, aprs sen tre aperu.
Ce qui se montre dans le phnomne du cinquime skandha, cest une
squence dactes daperception et de slectivit discriminante, et rien dautre.
Reste en dehors delle, en position transcendantale, la monstration elle-
mme : un moment de conscience conditionnante plutt que conditionne,
assimilable une mtaphorique luminosit ou un espace de phnomnalit.
La monstration ne se montre pas, la conscience-lumire (praksa) nest pas
claire, la conscience-espace nest pas tendue, la phnomnalit nest pas
phnomne ; elle pouse ltre (sattva) et nest reconductible aucun tant
particulier. En parler, lui confrer involontairement la fonction dun tant par
le seul fait dy faire rfrence, serait encore trop. Cest sans doute pourquoi
elle est gnralement passe sous silence dans lnonc numratif des
dharma et des skandha.
mi-chemin entre la discrimination et louverture sans borne, on trouve
lattention. Lattention inquite, directive, voire dfensive, est connote par
ladjectif anglais aware , dont la source est voque par lavertissement
verbal beware : fais attention, reste sur tes gardes. Il sagit de la forme de
conscience utile un guerrier saxon : prvenir le danger, tre en alarme. En
anglais, les adjectifs conscious et aware sont frquemment utiliss
pour se dfinir lun lautre, sur le mode circulaire typique des dictionnaires,
mais avec un degr de proximit en plus. Conscious est par exemple
dfini par la locution intrieurement aware , et inversement
awareness est identifi avoir connaissance ou conscience de .
Pourtant, lemploi de ladjectif aware scarte quelque peu de
conscious , dans deux directions opposes : la direction dj signale de
lattention focalise, et inversement la direction de laccueil, de la pure et
neutre veille sensible. Dans cette dernire direction, awareness signifie
selon lOxford English Dictionary un tat de conscience lmentaire et
indiffrenci, que William James a propos de traduire en franais par
aperception dans son article La conscience existe-t-elle ?
123
Les
termes sanskrits drivs de cit semblent jouer un rle analogue. Issus dun
verbe ayant parmi ses composantes de signification le percevoir, le se tenir
attentif, ils finissent par dsigner dans la pense de ladvaita vednta
124
, la
conscience absolue, non personnelle, et auto-lumineuse, cest--dire
virtuellement rflexive, sans aucune distanciation objectivante vis--vis
delle-mme. De lattention cible qui prpare la discrimination, on passe par
transitions insensibles au pur tre-attentif en expansion qui rejoint lvasement
diaphane du ciel chinois.
Le vocabulaire de la conscience de soi, enfin, reste la fois ambigu et peu
diffrenci dans les langues occidentales : cherche-t-on dsigner une simple
connaissance dtache prenant pour objet le soi , comme le suggre la
forme intentionnelle conscience-de ? La diffrenciation entre deux sens de
langlais self-consciousness laisse dj souponner que les choses sont
plus subtiles que cela ; si lun de ces sens peut bien se rendre par
connaissance de soi , lautre voque une altration du comportement par
excs daffectation, par laboration dune image artificielle de soi lusage
dautrui. Cette dernire nuance est bien vhicule par le terme chinois Niu
ni , qui dsigne une charge excessive au cur due la ncessit dassumer
l a persona, le masque du jeu social, contre louverture cleste des
possibles, contre la disponibilit sans limites dune vie de sage
125
. Et elle est
explicite par la terminologie sanskrite, qui y dnonce une vritable
fabrication , celle du faire-le-soi ( aham-kra ), celle du mime dun
soi capable non seulement de faire bonne figure dans une assemble, mais
aussi dintrojecter son image extrieure jusqu se leurrer lui-mme et se
prendre pour ce quil nest pas (une chose intrinsquement existante). Le
soi limit de la personne, ici, nest pas tant connu quassembl de toutes
pices, comme une sorte de pantin dnu de consistance propre mais pas de
pouvoir de fascination. Dans la perspective hindoue, si le soi individuel
manufactur a une qualit par-del son oprativit dans les relations
humaines, cest seulement celle de masquer le vrai soi absolu (tman),
partag, anonyme, qui clt dans lattention bante du cit ou caitanya
sanskrit
126
. Ainsi traverse-t-on plusieurs reprises, dans les sonorits
distilles par la varit des cultures, la conscience de soi et la conscience
rflexive pour retrouver leur prsuppos obsdant quest lexprience pure.
QUESTION 3
Comment changer dtat de conscience ?
Nous parlons avec tant de faste, en lettres majuscules,
dun Matin Mexico. Tout cela se rduit pourtant un
petit individu regardant un fragment de ciel et darbres,
puis se penchant sur la page de ce cahier.
D.H. Lawrence
La rduction transcendantale au sens de Husserl est premire vue une
systmatisation de la conscience rflexive, une installation dans la prsence
lexprience. Cette stabilisation de la rflexion suppose quon accomplisse
pralablement lpoch, la suspension du jugement ou de la croyance propos
des objets dexprience. L poch neutralise la tension dengagement vis--
vis du monde des objets, et la rduction tire profit de cette abstention
instaure pour se rendre manifestes les actes de conscience tendus. En
affermissant la posture rflexive, la rduction est un instrument primordial
dtude de lexprience consciente, puisquelle seule y donne immdiatement
accs. Aucun discours, aucune pense, et mme aucune tude neuro-
scientifique sur lexprience consciente ne saurait en faire lconomie,
puisque sen passer reviendrait se couper du thme mme dun tel discours,
et finalement parler dautre chose ou ne parler de rien.
La rduction transcendantale reprsente la mthode centrale de la
phnomnologie, celle qui conduit directement son champ propre
dinvestigation. Heidegger le fait ressortir de manire saisissante en
travaillant ltymologie du nom phnomnologie . Phnomne et logos :
discours, ou science, sur les apparences ? Ce serait rater lessentiel, et le
rater doublement. Phnomne, dabord, ne dsigne pas ce quon entend le plus
couramment par l, savoir une simple apparence. Le phnomne, au sens de
la phnomnologie, nest pas le signe indirect, apparent , de quelque chose
qui ne se montre pas vraiment, pas en entier, savoir un objet dans sa ralit
transcendante. Le phnomne de la phnomnologie est apparatre plutt
quapparence ; il ne montre pas, il se montre (pour reprendre une expression
wittgensteinienne) ; et sil se montre cest au sens dun se montrer en soi-
mme
1
, et non pas dune disposition tre montr de lextrieur. Le
phnomne, cest en somme ce qui se montre de soi-mme, dans toute sa
plnitude et sa nudit, sans aucune marque dincompltude ou de dsignation
imparfaite de quelque chose dautre. Et le logos ? Logos, habituellement
traduit par discours , a plusieurs connotations, et plusieurs origines
tymologiques probables, que Heidegger a largement exploites dans son
uvre tardive. Mais dans tre et Temps , il se contente de tirer toutes les
consquences dune caractrisation due Aristote : le logos est apo-
phainesthai
2
. Ce dernier mot est li au nom apophantique , qui dsigne
la partie de la logique concernant le jugement ; on lapplique
traditionnellement la thorie du jugement en tant quil peut tre vrai ou faux.
Mais il est galement vident quil est compos du verbe mme
phainesthai do est issu le nom phnomne , et dun prfixe apo- (
partir de). Le logos, par consquent, montre, fait apparatre, ce dont il parle ;
et, partir du montrer, il tablit ce quil nonce. Que je demande imaginez
une rose ou nimaginez pas une rose , dans les deux cas la rose se
manifeste vous par-del les syllabes. Et, la rose stant manifeste, le
jugement la rose est une fleur est apprhend comme vrai. La
phnomnologie, le logos du phnomne, lapophantique du phnomne, est
donc le faire apparatre lapparatre. Heidegger lcrit ainsi :
Phnomnologie veut dire [] faire voir partir de lui-mme ce qui se
montre tel quil se montre partir de lui-mme
3
. On ne peut signifier de
manire plus insistante la rflexivit ; une rflexivit immanente ( partir de
lui-mme ) active par la discipline dtre et de pense quest la
phnomnologie. La rflexivit est au centre de la mthode phnomnologique
travers le procd de la rduction transcendantale, et elle est incluse au
cur de son nom. Dans la vie ordinaire, lapparatre se contente de faire
paratre son contenu ; mais la phnomnologie fait apparatre son tour
lapparatre comme tel. Elle exhibe lapparatre qui autrement schapperait
lui-mme tant il se reporte trop vite vers ce dont il est apparatre.
Nous allons maintenant analyser la rduction transcendantale en cinq
actes. (1) Prciser en quoi elle consiste par-del sa caractrisation un peu
rapide comme attitude rflexive, tout en faisant ressortir sa diffrence avec
lpoch que lon confond parfois avec elle. (2) Se demander vers quel
domaine dtre ou de manifestation elle conduit linvestigation, quoi elle
rduit lexprience ordinaire dont elle part. (3) clairer la motivation de
lacte de rduire, en se demandant si celle-ci est seulement dordre
philosophique. (4) Esquisser des pistes mthodologiques, donner quelques
indications sur la manire daccomplir la rduction. (5) La replacer dans
lensemble plus vaste des modifications actives des tats de conscience.
titre prliminaire, Husserl souligne un fait lmentaire concernant la
conscience ordinaire, celle de lattitude naturelle entirement dirige vers
ses objets dexploration et de manipulation, absorbe, voire fascine par eux,
arrache elle-mme par sa propension suivre les mandres de son
parcours auto-trac sur les sentiers dun monde jet l-devant. Ce fait est que
la conscience ordinaire traverse successivement plusieurs degrs ou cibles de
concentration, et plusieurs secteurs dintrt. Prenant pour point de dpart
effectif ce processus spontan de variation directionnelle de la conscience, il
est possible daccomplir le geste particulier de la rduction transcendantale.
Car, pour rduire , il suffit a priori de matriser, de diriger cette variation,
puis de slectionner lun des intrts varis.
Husserl numre quatre modes entre lesquels circule une conscience
ordinaire, ou naturelle
4
, quatre postures fondamentales qui constituent son
espace de transformation :
L a co-prsence consiste se rendre compte que des objets me sont
donns, que ce soit dans lintuition ou limagination ; sentir que les
objets sont l pour moi , au travers de leur apprhension sensible. Il
sagit dune simple attestation de prsence, non focalise, de tout cela qui
est dispos autour de moi. La co-prsence est un mode passif de
conscience, ouverte et rceptive ce qui se prsente ;
Lattention
5
est pour sa part un mode de relation spcifique avec chaque
objet ; elle suppose une activit, une dcision, un choix. Elle relve dun
tat de conscience focalis, tendu-vers (comme ltymologie le suggre),
troit, mtaphoriquement compar au cercle dont lintrieur est clair par
le rayon du regard. Elle ne se confond pas avec lintentionnalit, terme
plus vaste qui implique certes la directionnalit de la conscience mais pas
forcment ltre-remarqu
6
des objets vers lesquels elle se dirige ;
En-de de la co-prsence et de lattention se tient, comme leur condition,
un tat plus vaste de la conscience. La vigilance, qui est un mode de
relation non spcifique et non slectif avec le monde ambiant dans toutes
ses dimensions : lensemble des objets prsents, mais aussi limaginaire,
le domaine cnesthsique, les valeurs, et les apprciations esthtiques ;
Enfin, il y a un autre mode de conscience qui suppose galement la
vigilance mais ne se ramne pas lattention focalise ou dfocalise vis-
-vis des objets. Husserl le nomme accueil . Il sagit de la disposition
entrer en relation avec les alter-ego, avec nos semblables. Lespce de
directionnalit requise est trs diffrente de celle qui concerne les objets,
car laccueil des autres suppose la rciprocit, lchange des rles, la
comprhension (ou lincomprhension) mutuelle. Laccueil est galement
ouvert un avenir inattendu de spontanit et de crativit de lautre,
contrairement lattention des objets dont les proprits sont soit
enfermes dans le pass dune exploration, soit contraintes par des lois
dvolution.
Mais le mode attentif de la conscience a peut-tre t prsent de
manire trop exclusive. Se rendre attentif de manire slective tel ou tel
objet nest pas la seule manire de focaliser lexprience consciente, de la
faire changer de circonscription, de dplacer sa zone de nettet, pour ainsi
dire. Il existe une manire la fois plus vaste et plus prcise de concevoir les
variations de direction ou de niveau dapprhension de la conscience. Husserl
appelle cette manire dveloppe de diriger les actes de conscience
lintrt , et il en fait linstrument indispensable de la rduction
7
.
Supposons que notre attention se dirige vers une fleur, disons une tulipe. On
peut dire aussi la rigueur que notre intrt se concentre sur la fleur. En
vrit, lintrt dborde lobjet ; il concerne les modalits dapprhension des
objets en gnral et de cet objet en particulier. Notre intrt pour la tulipe
laquelle nous sommes attentifs peut tre dordre scientifique, esthtique, ou
commercial, voire financier (comme dans la tulipomania de la Hollande du
XVII
e
sicle
8
). lintrieur de ces champs dintrt, des subdivisions
apparaissent. Lintrt scientifique peut se spcialiser en intrts botanique,
taxinomique, histologique, biochimique, ou gntique. Lintrt esthtique peut
quant lui se dcliner en intrt pour la beaut manifeste de la fleur, pour la
possibilit de la peindre, ou pour lclat des pigments en extraire. Ces
divers intrts ne sont pas purement fonctionnels ; ils dnotent autant de
modulations de la conscience. On ne voit littralement pas la mme fleur
suivant quon souhaite la peindre, ou quon cherche en tudier les
dterminants gntiques. Selon les divers intrts, on nest pas dans les
mmes dispositions, dans la mme attitude, dans le mme cadre de rfrence,
dans le mme univers dexprience, vis--vis de cette fleur. Les intrts
scientifiques ou commerciaux traversent rapidement le phnomne de fleur
pour anticiper des activits de catgorisation, de dissection, dextraction, de
distillation, de transport, ou de transaction. Les intrts esthtiques, en
revanche, sappesantissent sur lopacit charnelle des ptales de la tulipe, sur
la texture de ses duvets, sur lexhalaison de ses rares parfums, sur la fermet
moite de ses surfaces, sur le vertige absorbant de ses pourpres dcoups sur
des veinures blanches ; ils mobilisent au cur de lexprience tout un trsor
de mmoire corporelle latente fait de bien-tre ou dvocations rves, auquel
on permet de sveiller et de se rpandre cette occasion. Il est vrai que
plusieurs strates dintrt peuvent coexister en un seul acte de conscience
(Husserl voque ce propos lentrelacs
9
du vcu). Le botaniste, press
par lurgence de sa tche de sparation molculaire et par la perspective
dune publication, peut par exemple garder galement en prise le souvenir
distrait de la beaut du matriel floral dexprimentation quil a reu le matin.
Mme ainsi, cependant, il reste ce que Husserl nomme un intrt dominant ,
une coloration massive de lexprience auprs de laquelle ses composantes
entrelaces napparaissent que comme autant dallusions diaphanes.
Il ne sagit pourtant l encore que dune faon restreinte, rgionale, de
traiter lintrt. long terme, le fait de sentraner lun ou lautre des
intrts, ou des attitudes, peut inflchir les formations de caractre du moi,
et crer un biais permanent. La totalit du monde-vie-conscience est en fait
susceptible de se teinter progressivement de latmosphre dun intrt plus
scientifique questhtique, ou plus pictural que commercial. Lorsque tout le
champ vcu en est pntr, lorsque la conscience entire est concerne,
altre, transforme, lintrt devient un tat de conscience part entire,
plutt que lune de ses modalits directionnelles ou lune de ses oprations.
Parmi les options qui lui sont accessibles, cet intrt global progressivement
ou priodiquement install peut se porter soit sur des objets intentionnels de la
conscience, soit, rflexivement, sur les actes de vise de ses contenus
objectivs. Par rapport l attitude naturelle qui consiste stablir dans
la posture intentionnelle, la rflexion est qualifie par Husserl de
modification de conscience , de changement dattitude qui [fait] subir une
transmutation au vcu pralablement donn
10
. Lorsque cette transmutation a
eu lieu, lorsque ltat de conscience sest durablement install dans lintrt
rflexif, on dit quon a accompli la rduction .
Mais ce qui prpare la rduction, ce qui constitue ltape prliminaire de
la transmutation recherche, cest ce quon pourrait appeler une d-
mutation , cest--dire la neutralisation et la dtente des ressorts dune
mutation inaugurale qui aurait par hypothse transform une exprience
universellement ouverte en un tat de conscience oprationnel arc-bout vers
laccomplissement dactes de saisie (manuelle ou mentale) dobjets. Cette
d-mutation , cette dissolution des nuds focaliss de lagir, cet
puisement consenti des croyances ncessaires une vie pratique, est
qualifie dpoch par Husserl au nom de son analogie prsume avec la
dmarche sceptique
11
. Rappelons que la dmarche de clarification de la
connaissance prconise par le scepticisme pyrrhonien et acadmique
comporte la suspension, voire larrt, de tout jugement, en grec lpoch,
titre de geste de prudence et de motion de dfiance. La prudence est de rigueur
au vu des erreurs passes et des illusions finalement identifies mais
initialement fascinantes. Quant la dfiance, elle simpose a priori en vertu
du pouvoir demporter la conviction quont des raisonnements pourtant
antinomiques, et en raison de la relativit de chacune de leurs conclusions
des points de vue particuliers.
Selon Husserl, il y a cependant des diffrences majeures entre les deux
poch. Dans leur tonalit dabord. Si la suspension sceptique conduit au
doute, comme sa dnomination lexige, la suspension phnomnologique se
borne la stricte quanimit, la simple abstention, ni doute ni croyance.
Dans leur thmatique ensuite. L poch sceptique suspend en principe des
jugements discursifs, tourns vers la qualification des objets. Au maximum de
sa porte, elle prend pour cible la croyance gnrale, entretenue par certaines
philosophies ralistes ou dogmatiques, que nos connaissances atteignent la
nature des choses telles quelles sont en elles-mmes, et elle affecte cette
croyance dun fort coefficient de doute. En revanche, lpoch proprement
phnomnologique porte sur des vcus. Elle suspend la valeur pr-discursive
de position dobjets de ces vcus ; elle neutralise la validit de la croyance
tacite, dite naturelle , en un monde extrieur rel ; elle descend en somme
un tage cognitif plus bas que lpoch sceptique. L poch husserlienne
diffre aussi de lpoch sceptique par sa finalit immdiate. Le but dclar
de lpoch phnomnologique, fort peu sceptique, est dexposer au regard le
fondement ultime de toute science, ce fondement ferme et absolu
12
parce
quauto-fond et auto-vident quest le prsent-vivant. Mme si nous ralisons
aujourdhui que le genre dabsolu silencieux atteint par lauto-aperception na
pas les ressources ncessaires pour mettre une science discursivo-formelle
labri des remises en question, il reste quil opre bien comme humus de
luvre de connaissance, et que la ngligence frquente de ce fait est lune
des raisons les plus identifiables des garements des chercheurs lgard du
sens et de la porte de leurs savoirs. Ne se contentant pas de suspendre la
saisie dobjets et la croyance en un monde pr-ordonn, nallant dailleurs pas
jusqu les mettre explicitement en doute, lpoch phnomnologique invite
celui qui sy livre surmonter cette ngligence. Elle le prpare valuer
rflexivement la structure des vcus afin de placer sous la lumire de
lattention lacte mme de poser des objets et le motif des croyances
entretenues. Car, si un vcu ordinaire est tendu vers son objet, un vcu dlivr
de sa tension habituelle par la pratique de lpoch phnomnologique
acquiert la possibilit de dployer ses orientations dans plus dune direction,
et de se porter aussi en retour vers ltre-intentionnel des vcus. Un tel regard
rflexif permet certes de critiquer les actes de vise dun objet et les motifs de
croire en son existence, mais il le fait avec pour but avou dexhumer
lorigine de leur prtention la validit, et de rouvrir le chantier dun
renforcement de celle-ci par la clarification qui sensuit.
Il y a enfin une autre diffrence entre les deux poch, qui porte sur leur
finalit dernire, mais qui se retourne en dernier ressort en une tonnante
ressemblance par-del les millnaires. En bref, lpoch sceptique a un
dessein existentiel, alors que lpoch phnomnologique a une priorit
affiche dordre gnosologique. Pour autant, nous allons le voir, la
phnomnologie nest pas prive de projet existentiel ; non seulement parce
quelle a eu son moment existentialiste avec Heidegger et Sartre, mais aussi
parce que cette motivation tait prsente ds sa source husserlienne.
Le fruit principal de lacte suspensif quaccomplit lpoch sceptique est
la tranquillit , lataraxie
13
, un tat quon est tent dopposer aux
agitations anxieuses de ceux qui soutiennent une certaine opinion dogmatique
en nayant de cesse den convaincre les autres et den vrifier la conformit
ce qui arrive. Autrement dit, dans le scepticisme, laboutissement dsir dun
certain tat de conscience volontairement cultiv (la suspension), est lui-
mme un tat de conscience : la quitude. Cette espce de finalit pratique est
conforme celle dune part cruciale de la philosophie antique telle que la
restitue Pierre Hadot
14
, et le but quelle sassigne est rien de moins quune
vie transfigure
15
. Quen est-il prsent de lpoch phnomnologique, par-
del son affichage thorique fidle lesprit de la philosophie occidentale
moderne ? Son motif sous-jacent nest en fait pas compltement tranger aux
idaux de la philosophie antique, y compris dans sa composante sceptique.
Husserl ncrit-il pas que la perspective du philosophe qui sest engag dans
la recherche phnomnologique est de sidentifier lui-mme au bien
suprme
16
? Et cette demande dexemplarit du philosophe dans sa
recherche de la vie bonne nest-elle pas conforme la rgle que se sont
fixe les amants de la sagesse grecs, depuis Socrate jusqu Epictte ? En
suivant ce fil rouge dexigence travers luvre dEdmund Husserl et de son
plus proche successeur, Eugen Fink, on est la fois surpris et impressionn
dy trouver une varit moderne du travail de soi sur soi que prconisaient
chacun leur manire les philosophes sceptiques, picuriens, stociens ou
no-platoniciens, afin dapprendre vivre et mourir. Le programme latent
de la phnomnologie subordonne en effet la rvlation dune vrit rflexive
sur lorigine vcue de la connaissance, lauto-transformation pense et
voulue du philosophe. La mtamorphose dsire par le phnomnologue tend
instaurer une vie philosophique ne se confondant avec nulle autre ; une vie
qui savance sous la frule dune continuelle responsabilit de soi
17
, et
qui tend incorporer au cur delle-mme, dans le battement de ses jours, la
co-naissance de labsolu qui survient en son premier acte cartsien. La vie du
philosophe, dclare Husserl, est une vie par vocation absolue
18
. Or,
lauto-transformation qui soutient cette vie-l ne sobtient que moyennant une
qute asctique, au sens tymologique dun exercice de matrise de soi-mme
en vue dincarner un idal. Selon lune des formulations les plus frappantes de
Fink, en phnomnologie, la mise en place des fondations dune philosophie
sidentifie au commencement originaire du philosophe lui-mme
19
.
Autrement dit, la transmutation du vcu conscutive lpoch nest pas une
circonstance accessoire, ni un simple instrument permettant de mettre au jour
quelque domaine dinvestigation dont le philosophe pourrait ensuite
sloigner son gr pour passer des activits plus banales. La vritable
approche philosophique ne mnage pas de distance entre le chercheur et le
cherch, pas de diffrence entre son accs au terrain dtude et le labour de la
terre quil est. Le sol de la philosophie nest autre que le philosophe en route
vers son recommencement.
Un chemin destinal sensuit, insparable du chemin de connaissance. Un
chemin qui exige une proccupation quotidienne vis--vis de sa propre faon
dexister, et pas seulement vis--vis de la teneur dun savoir abstrait.
Lpoch ne se limite pas une technique de laboratoire parmi dautres, se
distinguant seulement des autres en ce que le laboratoire en serait
intrieur ; elle nest pas quune pratique incluse dans la panoplie des
gestes dune existence par ailleurs intouche ; elle ne se borne pas carter
provisoirement le chercheur de ses autres occupations pour lintroduire dans
une activit professionnelle spcialise. Elle reprsente un mode de vie part
entire ; et un mode de vie qui sempare du philosophe de manire
dfinitive
20
, parce que, partir de linstant o il a ralis la plnitude dtre
laquelle il souvre par son biais, et la radicalit de la dcision qui en permet
linstauration, il peut difficilement sempcher den suivre la pente jusquaux
extrmits o celle-ci lentrane. Ce sont seulement les premiers pas (parfois
interminables) de ce chemin qui sont difficiles, et mme pnibles, amorcer.
Sil en va ainsi, cest que le chemin nouveau emprunter est un sentier de
traverse fait dcarts la norme, pour ne pas dire de dissidences. peine la
bifurcation passe, la premire chose quon aperoit nest pas la promesse de
clarification et daccomplissement existentiel que comporte cet acte, mais
plutt la menace associe de bannissement lgard de la bien-pensance
sociale ; un bannissement qui nest dailleurs pas tant prononc par autrui que
douloureusement ressenti par soi-mme en un certain lieu secret
dintriorisation des rgles et des valeurs transmises par lducation. Ce que
lon perd par lpoch, ou plutt ce dont on se libre si lon en croit sa vision
pleinement panouie, ce nest rien de moins que le travestissement voilant
de ltre-homme
21
. Ce quon commence par accomplir en pratiquant
lpoch, cest briser la normalit de cette vie
22
. Or, cette brisure, cette
dchirure du voile dune humanit irrflchie, na rien danodin ; elle
commence par tre un tourment, parce quavant davoir introduit une forme
indite de transparence et de communaut dtre entre ceux qui y ont consenti,
puis une ouverture si polyvalente quelle rejoint une forme inaugurale
duniversalisme, elle engendre la solitude face au sentiment
dincomprhension que lui opposent ceux qui sy refusent encore.
Le rejet du pacte de communication le plus courant commence par affecter
un niveau lev de lactivit conceptuelle, et il stend de proche en proche
jusquau quotidien des conventions pr-conceptuelles. Tout dabord, une
espce dpoch de degr suprieur est souvent ralise lors des poques de
crise de luvre scientifique. Il arrive en effet priodiquement quun
consensus antrieur propos dun systme dentits thoriques permettant de
sorienter efficacement dans le milieu naturel et technique soit mis en
difficult par de nouveaux rsultats exprimentaux et de nouvelles pratiques
qui ont fait effraction par inadvertance hors du domaine de validit du
paradigme scientifique admis. Les entits thoriques, manipules
prcdemment comme si elles figuraient autant d objets rels , sont tout
coup (re)vues comme des constructions intellectuelles prcaires, se
substituant mal leur soubassement performatif. Le jugement leur propos se
voit suspendre, et le discours scientifique subit une rduction praxique
consistant restreindre sa validit au niveau des pratiques symboliques,
technologiques, et exprimentales. Loprationalisme mthodologique
dEinstein en 1905, et de Heisenberg en 1925, illustre de manire frappante la
tendance rcurrente des sciences physiques rduire leurs savoirs lenclos
concret du laboratoire, de latelier et de la vie active. Cette phase est toutefois
tenue pour provisoire par la plupart des chercheurs, qui sempressent de
pousser leur ingniosit constructive dans toutes les directions imaginables
afin de forger un nouveau paradigme et un nouveau systme dentits
thoriques crdibles, doffrir un domaine de vise jusque-l insouponn
leur flche intentionnelle, et de rendre ainsi caduque la suspension du
jugement scientifique. Ce qui suscite souvent leur sentiment
dincomprhension, ce nest donc pas la ncessit reconnue dune poch
temporaire permettant dassurer la transition dun paradigme scientifique
son successeur, mais une attitude minemment philosophique qui tend
prenniser la suspension du jugement propos des entits thoriques, au nom
de la mise au jour des processus de leur gense passe. quelques minentes
exceptions prs (comme Hermann Weyl
23
), peu de chercheurs acceptent de
neutraliser en permanence leur chappe intentionnelle vers un monde
dentits thoriques, et encore moins den revenir sans cesse au monde de la
vie quotidienne en tant que seule source productrice de leur reprsentation
scientifique. Ils assimilent la neutralisation un parti pris instrumentaliste ou
empiriste. Ils considrent de ce fait quelle revient les priver dun corpus de
convictions partages propos dun domaine de reprsentations accept par
tous, ainsi que de voies de communication efficaces appuyes sur des
certitudes restant indiscutes dans leur communaut. Ils craignent en somme de
perdre le bnfice la fois heuristique et mobilisateur du travestissement
voilant de ltre-scientifique sils consentent briser la normalit figurative
des procds dentente entre chercheurs. Dans leur crainte, ils confondent
cependant le geste phnomnologique de lpoch avec ltape suivante de
rduction stricto sensu. L poch leur demande seulement de ne plus sexiler
dans un monde reprsent, et de prendre pleinement conscience de tous les
biais mentaux qui conduisent sy croire en exil. Elle nexige dliminer
aucune composante de leur connaissance, pas mme les constructions
symboliques, les actes dextraversion ou lattitude dadhsion aux contenus
reprsentatifs, mais seulement de ne pas continuer en tre dupe.
Il ne sagit pourtant l que dune premire vague de lpoch, appelant
irrsistiblement son approfondissement en direction de strates plus
lmentaires du savoir. Comme lcrit en effet Husserl, [dans]
laccomplissement de cette poch (savante), il est manifeste que nous
continuons malgr tout nous tenir sur le terrain du monde ; ce monde est
maintenant rduit au monde de la vie qui vaut pour nous pr-
scientifiquement
24
. L poch corrosive des sciences naffecte pas
loutillage concret de la vie courante. La mise en question du monde de la
reprsentation scientifique laisse intacte lassomption dun monde en gnral,
puisquelle change seulement le niveau et le contenu du monde assum. Or, ce
monde-de-la-vie, ce monde des choses la porte de la main qui prcde
et conditionne llaboration dun monde des objets de science, est lui aussi
une tape, il est lui aussi un point darrt temporaire et instable des formations
de croyance (mme si ce temporaire pourrait sidentifier lhistoire quasi
entire de lhumanit). Pour tre plus dissimules, parce que plus proches,
plus immdiates, plus irrflchies, les tapes de la constitution des formes
manipulables de la vie courante nen invitent pas moins un acte renouvel de
neutralisation typique de lpoch. Mais procder cette poch ultrieure,
cela revient du mme coup largir le cercle social dont on risque de se
couper cause delle ; cela risque daccrotre les risques dincomprhension
par refus dvidences partages. Aprs avoir accompli la premire vague de
lpoch, et stre alin ainsi la plus grande partie de la communaut
scientifique qui tient garder son travestissement voilant professionnel, on
risque de susciter, par sa seconde vague, le repli dfensif dune fraction plus
grande encore de la communaut humaine sur un noyau de convictions
inculques. De l vient la tentation, prsente toutes les tapes de lpoch,
dun arrt de son processus dissolvant avant quil nait tout emport sur son
passage, avant quil nait abouti une liqufaction conceptuelle si entire que
nous en soyons reconduits par lui un tat primordial hypothtique de pure
stupeur devant linconnu sans fond.
La phase de rduction qui suit lpoch reprsente, bien malgr elle,
cette tentation darrt. Rduire, cest bloquer le regard dexprience en voie
de transmutation , cest lui dsigner un champ de manifestation comme
fondement ultime et a priori indpassable du processus de constitution
dobjectivit. Rduire, cest stopper en route le processus de dissolution
universelle de lpoch, en rcuprant les matriaux dissous un stade
intermdiaire, en reconstituant partir deux un paysage explorer, et parfois,
dans une phase de durcissement ontologique, en le dsignant comme seul
existant. Tel est lesprit dans lequel Fink distingue formellement lpoch de
ce quil appelle lactivit de rduction proprement dite
25
. Dans lpoch,
chaque prtention la validit (dune vise intentionnelle ou dun jugement)
est mise entre parenthses, suspendue, inhibe. Mais, dans la rduction
proprement dite, le croire positionnel est pris comme thme renouvel dun
croire rflexif, la prtention premire la validit est prise comme question
rsoudre pour la vague seconde de la connaissance phnomnologique. Le
geste initial de neutralisation du regard engendre un nouveau regard non
neutre, ayant simplement ajust sa distance focale pour examiner quelque
chose comme le cercle des actes de conscience, ou le champ manifeste de
limmanence. Le domaine fluidifi se voit recristalliser par la rduction, en un
domaine neuf o une classe indite de jugements peut se faire jour.
Il faut prsent redoubler dexigence et de souci de la prcision. Quest-
ce exactement que la rduction phnomnologique ? Jusque-l, nous
navons fait que leffleurer, en lopposant lpoch qui la prpare, ou en
lesquissant par mtaphores. Il a t tantt question de rflexion, et daccs
aux tats de conscience, tantt de transmutation du vcu conscient. Alors,
sagit-il dun point de vue sur la conscience, ou dun tat de conscience part
entire ? La mtaphore dualiste du point de vue est-elle compatible avec la
description moniste de laltration ? Et la diffrence entre les deux, point de
vue ou tat, ne constitue-t-elle pas lun des traits principaux qui distinguent la
psychologie de la phnomnologie ? Ce dont la rduction phnomnologique
se dmarque aprs lavoir prise pour modle, nest-ce pas prcisment la
rduction psychologique
26
, o le psychologue exprimental commence par
suspendre toute question sur la validit dun jugement de perception dclar,
pour orienter son enqute vers les actes de reconnaissance perceptive ou de
conviction ontique qui appartiennent la conscience de son sujet ?
Dans certains passages de luvre de Husserl, les choses semblent trs
simples, proches de limage banale dun regard redoubl, dun regard
retourn vers lacte de regarder
27
. Aprs tout, cest seulement dans la mesure
de cette simplicit quune pdagogie efficace de la rduction peut tre
vhicule par lcriture philosophique, quitte dfaire ensuite ses
reprsentations lmentaires initialement acceptes et la redfinir avec plus
de volont discriminatrice. Ainsi, dans le cours de 1923-1924 publi sous le
t i t r e Philosophie premire, Husserl avance la reprsentation la plus
lmentaire de la rduction, sans lassortir immdiatement de correctifs. Il
distingue, dans le moi , un moi sous-jacent et un moi rflchissant ,
admettant par le biais de cet acte diffrentiel la possibilit dune scission du
moi
28
. Le moi sous-jacent est intress par lobjet de sa vise consciente, il
est totalement pris dans sa croyance en lexistence de cet objet, et reste par
suite incapable de jeter un regard critique sur elle. Le moi rflchissant, quant
lui, saisit lacte de vise consciente ; il est intress exclusivement par cet
acte comme tel, et reste par contraste totalement non intress par lobjet
de lacte ; il sabstient dy croire (comme dailleurs de ne pas y croire) en
tant que chose transcendante, et se penche au lieu de cela sur les procds
immanents de gense de la croyance. Le moi rflchissant, rcapitule
Husserl, est le spectateur de moi-mme , du moins le spectateur du moi
sous-jacent . Il est du mme coup explorateur dun royaume jamais foul
aux pieds, celui des mres de la connaissance
29
, celui des germes des
croyances et des thories constitues. En tant que spectateur, le moi
rflchissant ne participe pas aux passions doxiques du personnage unique du
spectacle, il ne partage ni ses opinions ni ses convictions. Mais peut-tre en
entretient-il dautres ; et quel moi plus distanci encore pourrait alors les
mettre en vidence leur tour et dsamorcer leur prjug occulte ?
Lobjection ritre dune rgression linfini, amorce partir du moment
o le moi rflchissant peut devenir son tour le rflchi dun moi
rflchissant dordre suprieur, est aborde de front et rcuse par Husserl.
Pour lui, il nest pas question de se laisser impressionner par un argument
purement logique alors que la phnomnologie a pour principe de sen tenir
ce qui se vit effectivement. Or, sur le plan du vcu, la rgression linfini ne
se donne pas, si ce nest comme une idalit
30
. Le jeu des rflexions a beau
navoir en droit aucune limite, il sarrte en fait au point o lon ne parvient
plus tenir ensemble ses multiples niveaux en une exprience unique et
synthtique. La scission du moi est donc de facto ralisable, mme si elle
est logiquement contestable.
Mais cette image du ddoublement contenu des vises intentionnelle et
rflexive de lego noffre en vrit quune premire esquisse schmatique de
la procdure de rduction phnomnologique. Pour lucider toute la porte de
la rduction, il faut aller plus loin, interroger labondante production textuelle
de Husserl et de sa postrit, et tenter de donner sens leurs esquisses et
leurs correctifs en identifiant les chos de ce ttonnement dans notre propre
exprience. Quel genre de rflexion sagit-il de pratiquer lorsquon engage la
rduction ? Cette rflexion aboutit-elle une rduction au sens banal du
terme, cest--dire une restriction du champ de conscience, par-del la re-
duction, la duction
31
ritre, la reconduite de lattention vers son propre
tremplin ? Quelles sont les limites quil faut imposer limage dune scission
du moi ? Vers quoi ramne exactement la rduction, une fois quelle a t
pratique ; vers la subjectivit pure comme lcrit Husserl, vers le
ressouvenir de ltre comme le soutient Heidegger, ou vers autre chose qui ne
cesse dtre recherch ?
La rduction, pour commencer, ne consiste pas en un acte quelconque de
rflexion ; elle ne se borne pas la rflexion que pourrait mettre en uvre un
pratiquant de lexamen intrieur. Autrement dit, la rflexion
phnomnologique nest pas une rflexion de psychologie introspective (pas
plus, bien entendu, quelle nest une rflexion de psychologie exprimentale).
Mais quelle est au juste la diffrence entre les deux types de rflexion,
phnomnologique et introspective ? Quelle est au moins leur diffrence au
premier degr, telle quon peut la dgager dune dfinition standardise de
lintrospection que nous remplacerons, au chapitre XIII de ce livre, par une
acception plus crdible et plus respectueuse de la leon de la
phnomnologie ? La diffrence est brivement explique par Husserl au
paragraphe 51 des Ides directrices : la rflexion psychologique opre,
comme toutes les enqutes menes par les sciences de la nature, en dlimitant
puis en extrayant son objet dans le champ total de lapparatre ; elle restreint
donc la rgion attentionnelle de lexprience consciente, et la concentre sur un
lambeau delle-mme. Par contraste, [la] rduction phnomnologique ne
consiste pas limiter le jugement un fragment prlev sur la totalit de ltre
rel
32
. La rduction phnomnologique, et la rflexion en quoi elle consiste,
nont pas proprement parler dobjet, mais nous invitent revenir au champ
entier de lexprience pure dont tout objet, tout morceau de nature, est le
corrlat intentionnel. Ce champ dexprience pure tant le tout de ltre
absolu
33
, il ny a rien pour le dlimiter, rien qui permette de lidentifier un
objet de connaissance particulier.
Un problme de classification doctrinale doit tre abord brivement
avant daller plus loin : cette identit tablie entre le champ de lexprience
pure et le tout de ltre absolu nquivaut-elle pas un idalisme
34
? Husserl
le reconnat, mais il revendique pour son idalisme un statut dexterritorialit
qui le met automatiquement labri de la controverse spculative.
Lidalisme, crit-il, nest pas une substruction mtaphysique [] mais la
seule vrit possible et absolue [] dun moi se recueillant sur son propre
faire et sa propre donation de sens
35
. Lidalisme husserlien, en dautres
termes, nest pas une thorie (comme le serait sans doute un idalisme
berkeleyien), mais lexpression authentique dune posture de
recueillement dans les eaux de lexprience pure. Cest en tant que posture
quil soppose diamtralement lattitude naturelle dont le principe est
lextrusion de lattention hors de ce champ, vers les objets quelle dlimite et
quelle vise. Lidalisme husserlien est le nom faussement mtaphysique, le
nom trompeur et inutile parce que ne lopposant rien dautre, dune vie
dsaline delle-mme, dune vie qui a dcid de revenir sur son geste
fondateur de proscription hors de soi.
Penchons-nous prsent sur le verbe (se) recueillir , car son emploi en
lieu et place de rflchir est rvlateur dune importante inflexion, dun
correctif, ou du moins dun raffinement de la caractrisation husserlienne de la
rduction phnomnologique. Dsormais, la rduction nest plus tant
compare un ddoublement, un dcollement vis--vis des croyances du
moi sous-jacent fascin par les vises objectivantes de lattitude naturelle
qu une absorption respectueuse dans sa vie mme. Il sagit davantage de
demeurer vigilant au milieu du flux de lexprience consciente que de sen
loigner et de le contempler partir dun point de vue neutre, loignement qui
aprs tout ressemblerait davantage un mode dexister scientifique quau
mode dexister phnomnologique que Husserl souhaite lui opposer dans une
large mesure
36
. S lever au-dessus
37
de ltre naturel et des choses de la
nature ne consiste donc pas scarter de lexprience, mais au contraire
savoir lhabiter dans toute son envergure et la reconnatre comme telle ; cela
ne revient pas se couper du monde, mais le voir panoramiquement comme
ce quil est, cest--dire comme phnomne
38
. La tentation de partialiser
cette vigilance, de lui donner un thme et une sphre restreinte dattention,
demeure, il est vrai, toujours prsente. L enfant du monde
39
quest
lhomme de lattitude naturelle, a du mal parfaire sa mue en adulte-au-
monde. Il peine se dpouiller entirement de sa pulsion de saisie,
didentification, et de manipulation de petits galets de lapparatre, mme
lorsquil a surmont la tentation de lauto-objectivation globale
40
, mme
lorsquil a eu accs au champ entier dexprience pure lissue de lpoch ;
car alors, sous lemprise des habitudes naturelles, [il considre] le domaine
nouveau des donnes phnomnologiques qui vient de se rvler comme un
analogon des donnes objectives
41
. Ce qui demeure aprs la mise hors-
circuit des vises extraverties, et aprs limmersion vigilante dans un amnios
dexprience pure, tend son tour tre fix, circonscrit, et projet en une
pluralit de quasi-objets. Plus dlicat encore, la caractrisation mme de la
circonscription rduite laide de vocables comme moi ,
subjectivit , ou psych sappuie subrepticement sur des composantes
de validit objective intouches
42
, sur des secteurs dexprience non
affects par lpoch. Pour considrer cette exprience comme (seulement)
mienne, il faut en effet lassocier ce corps organique objectif,
diffrenci des corps tien et sien ; pour la considrer comme (purement)
subjective ou psychique, il faut la localiser lavers du corps propre en tant
quoppos au revers morphologique du corps objet. Linterruption de
lactivit corrosive de lpoch par une phase de rduction, a ds lors pour
consquence lapparition de savoirs phnomnologiques hybrides, combins
avec des savoirs psycho-physiologiques naturels encore insuffisamment
interrogs. Le lexique mme de la phnomnologie sapproprie celui des
connaissances objectives qui lui sont hybrides. On peut, temporairement ou
par mthode, se satisfaire dun tel mtissage phnomno-scientifique, mais on
peut aussi ressentir le besoin de pousser plus loin le geste combin de la
suspension du jugement et de la rduction, en cherchant lui faire atteindre
des domaines de plus en plus originaires, et de mieux en mieux affranchis des
emprunts des catgories naturalistes . Telle est la double tendance quon
voit luvre au fil des textes de Husserl sur la rduction phnomnologique.
Le vocabulaire hybride sy voit reconnatre le mrite de la familiarit et de la
vertu didactique, tandis que lapprofondissement des gestes fondateurs y est
recherch dans les moments de plus grande radicalit. Approfondir veut dire
ici tendre lpoch aux champs rduits eux-mmes, et trouver pour eux de
nouveaux plans de rduction encore plus lmentaires ; pratiquer en somme
une cascade de rductions, soutenue par une salve de suspensions. Cest ainsi
par exemple que la rduction au flux de lexprience pure est relaye par une
poch des expriences passes et futures, et se trouve parfaite en une
rduction de ce quil y a la seule exprience prsente
43
. Cest ainsi
galement qu chaque phase de la rduction, le phnomnologue travaille
dans la perspective dune suspension encore plus complte du jugement dont
lidal jamais atteint est une poch universelle
44
.
Quelle position le phnomnologue pratiquant la rduction doit-il alors
prendre vis--vis des croyances ordinaires, et des imputations de ralit que
ne cesse de produire la conscience dans sa pulsion irrpressible dattitude
naturelle ? Doit-il purement et simplement les rcuser ? Pas vraiment, crit
Husserl. Ne pas sy donner pleinement, ne pas sy plonger de tout son cur
45
,
sans doute, mais demeurer dans la sphre donne de lattitude naturelle, car il
ny a en pratique pas dautre terrain disponible
46
. Ne pas nier les vises
dobjets, mais les identifier comme telles et les interroger, prcise Eugen
Fink
47
. Mme si lhorizon peut-tre utopique de lpoch universelle tait
atteint, il porterait encore la trace formelle fantomatique dun domaine
naturel , dont les contours rsiduels seraient la marque dun lan de saisie
dsormais allg de sa crance et coup de sa force dvidence aveugle. La
conviction naturelle de lexistence des objets resterait en place, mais elle
serait dsamorce, constate sur un pur plan dimmanence, vide de son sens
transcendant, par lpoch : [La thse] demeure en elle-mme ce quelle est,
mais nous la mettons pour ainsi dire hors jeu, hors circuit, entre
parenthses. [] La thse est encore un vcu, mais nous nen faisons aucun
usage
48
. Nous nusons pas dune thse ontique dans lpoch ; nous nous
contentons de vivre de part en part lacte de la poser. Nous nous rendons alors
si complices de ce vivre, nous nous faisons si aptes pouser ses
ramifications, ses closions, ses battements de prsence, que nous percevons
partout son impulsion amorce vers les ailleurs dun monde. Nous nous tenons
au centre de rgnration et dorientation de ce monde envisag, l o il se
trouve la fois dtermin dans sa forme gnrale et accueilli dans sa part
dimprvisibilit, sans pour autant nous garer sur ses chemins. Le rapport au
monde de qui a pratiqu lpoch se tient donc sur le fil du rasoir. Dun ct,
[la] rduction est une rvolution intrieure, [] une manire pour lesprit
dexister conformment sa propre vocation et en somme dtre libre par
rapport au monde
49
. Dun autre ct, cependant, cette libration ne se
confond nullement avec une dsertion : [Par lpoch] ce que nous perdons,
ce nest pas le monde mais notre emprisonnement dans le monde
50
. En
pratiquant lpoch, nous ne nous absentons pas du thtre du monde, corrlat
intentionnel de lexprience consciente ; mais nous nen sommes plus un
public captif parce que nous savons justement le voir en tant que corrlat
intentionnel, parce que nous pouvons circuler librement entre lactivit de le
penser et la passivit de nous faire surprendre par lui, entre son envers de
mondisation et son endroit de donation
51
. tre libre vis--vis du monde
nimplique pas de sen absenter, mais au contraire dtre admis dans ses
coulisses constitutives aussi bien que sur sa scne manifestement ordonne. La
diffrence entre lattitude phnomnologique et lattitude naturelle est en bref
que lune reconnat le pralable de notre rapport conditionnant un monde, en
plus du monde conditionn, tandis que lautre fait usage de cette condition
sans la reconnatre comme telle
52
et senivre du simple pouvoir de rarranger
le mobilier mondain son profit.
Mais sil en va ainsi, la rduction phnomnologique prend lallure de
son oppos smantique (malgr lemploi par Husserl dexpressions
trompeuses, comme celle de rsidu
53
, pour en caractriser le fruit). Loin
de rduire lexprience consciente, elle en largit le paysage ; elle la soigne
de sa myopie existentielle, de son instinct dchappe vers le cne visible, de
sa concentration exclusive sur le cercle troit de ses objets dintervention
active ; elle lamplifie
54
jusqu lui faire envisager dun seul tenant sa propre
dynamique, la finesse de son grain actuel, le corpus de ses prsuppositions, sa
manire de constituer et de poser des objets intentionnels. Si elle affranchit
ses convictions explicites comme ses certitudes implicites de leur troitesse
naturelle , cest par un regard plus enveloppant que rducteur. Ds
quelle a t une fois accomplie , confirme Husserl, lattitude
transcendantale se rvle la seule lgitime, et celle qui englobe tout ce qui
est concevable et connaissable
55
. Ma nouvelle sphre dattention, celle
laquelle je suis introduit par le geste transcendantal, est rien de moins
quomni-englobante. La rduction laquelle ouvre la rflexion ne me rend pas
aveugle lobjet, insiste Husserl, mais plutt clairvoyant pour toutes
choses
56
. Une fois tabli dans le cur rduit de la conscience, une fois
capable de minscrire loisir dans la peau du moi rflchissant aussi bien que
dans celle du moi sous-jacent, je demeure clairvoyant sur lobjet naturel tout
en ne ltant plus seulement sur lui. Le fameux ddoublement du moi, en
un versant rflchissant et un versant rflchi, acquiert partir de l une
signification bien diffrente de celle quon lui prte dinstinct en faisant trop
confiance limage dualiste quil voque. Car la simultanit des points de
vue gnosologiques y remplace leur exclusivit prsume. Dans cette
scission du moi, je suis tabli la fois comme sujet voyant simplement, et
comme sujet exerant une pure connaissance de soi-mme
57
. La scission du
moi savre non pas tant sparatrice quincorporante : partir delle
jamplifie mon champ dexprience pour inclure aussi bien la vise que sa
prise de conscience rflexive ; je ne me scinde en deux que pour mieux capter
toutes les facettes de mon acte de conscience par-del le seul profil apparent
de ce quoi il me donne accs. Je me divise non pas pour me dissocier, en
rflchissant, dune part rflchie de moi-mme, mais pour maffranchir des
limitations que minflige ma propre discipline objectivante, et pour renatre en
fin de parcours sur le mode agrandi de l veil soi au sens de Nishida
Kitar
58
. Il se confirme en rsum que la posture dtre qui rsulte de la
rduction phnomnologique nest pas diminue, mais accrue, par rapport
lattitude naturelle
59
; elle porte cette dernire en elle comme une orientation
spcifique, comme une rgion particulire, et elle en expose les ressorts dans
la pleine transparence de son espace dilat.
quoi, prsent, la procdure de rduction phnomnologique nous
donne-t-elle accs ? Il sagit dune question plus dlicate quil y parat, et que
nous navons fait queffleurer jusque-l. Dans notre tentative dtablir une
distinction aussi nette que possible entre la rduction et lpoch (plus nette,
vrai dire, que dans bien des textes husserliens
60
), nous avons propos que la
rduction soit comprise comme blocage du parcours dsactivant de lpoch
lune de ses tapes, et quelle dsigne une aire dintrt particulire comme
rsiduellement active. Laccs procur par la rduction est donc a priori
tag ; il dpend du niveau auquel la dissolution des validits de vises et de
jugements par lpoch est (temporairement) arrt. Mais ce nest pas tout. La
question de laccs est dlicate pour une autre raison, qui tient la
connotation de mouvement et de chose atteindre vhicule par ce mot. La
consquence de la rduction ne peut tre qualifie d accs , plutt que de
contact, daperception, ou de rvlation, quau nom de lesquisse
dobjectivation substitutive qui laccompagne. Tel est le principal cueil, dj
identifi, dune comprhension lmentaire de la rduction : elle incline
subrepticement (et contre son gr) faire de laire dintrt quelle dsigne
une nouvelle circonscription dobjets, ctoyant ainsi le risque de remplacer la
transmutation dtre-au-monde ncessaire par un simple ajustement du
regard intentionnel.
Prenant acte de cet tagement, la rduction phnomnologique au sens de
Husserl sest clairement positionne par contraste avec des rductions
antrieures, par opposition des dfinitions trop triques et trop
manifestement objectivantes du champ rduit quil sagit dexplorer aprs
avoir suspendu une certaine classe de jugements. Elle sest dfinie contre la
rduction empiriste un pur domaine de sensations, contre la rduction de
lidalisme dogmatique une sphre monadologique, contre la rduction
psychologique un ensemble dactes mentaux nomms et rpertoris. Car
toutes ces rductions sont soit restrictives et liminatives, soit
incorrigiblement naturalistes. La rduction empiriste exclut en gnral de son
cercle ce qui sort du domaine sensible, laissant ainsi de ct tout un pan
dexprience qui concerne les idalits, les volitions, les intentions, etc. Ce
nest quen apparence que [lempirisme] revient lexprience
61
dnonce
Husserl, puisque lempirisme classique limite lintuition sa seule dimension
sensualiste, et quil minimise de ce fait la prsence massive des corrlats de
lactivit rationnelle au sein de lexprience vcue. La rduction idaliste
dogmatique se laisse pour sa part fasciner par un cercle dobjets de facture
mtaphysique, comme les monades ou lesprit absolu. La rduction
psychologique, enfin, se prsente comme un moyen daccder un secteur
intrieur , jusque-l ignor, de la nature objective ; et il ny a donc rien
dtonnant que sa critique serre, anti-naturaliste, ait t le vritable acte de
naissance de la phnomnologie dans lentre en matire des Recherches
logiques
62
.
Ce quoi il sagit de rduire le donn total, corrige alors Husserl, est le
champ de la conscience pure. L poch, lit-on dans les Mditations
cartsiennes, est la mthode universelle et radicale par laquelle je me saisis
comme moi pur, avec la vie de conscience pure qui mest propre, vie dans et
par laquelle le monde objectif tout entier existe pour moi, tel justement quil
existe pour moi
63
. Ici, ladjectif-cl, deux fois employ, est pur . Que
signifie pur dans les locutions moi pur et conscience pure ? Chez
Kant, qui ce concept est emprunt, lintuition pure et lentendement pur sont
des formes a priori, aptes organiser le domaine empirique sans avoir elles-
mmes le moindre contenu empirique ; elles sont pures de tout lment
sensible, dnues de toute contamination factuelle
64
. De faon plus gnrale,
la purification dont il est question ici consiste rechercher puis nommer
un domaine qui nappartienne pas la nature mais qui en conditionne la
possibilit ; un domaine qualifi cause de cela de transcendantal
65
. Or,
cest bien cela que Husserl entend par ladjectif pur : non pas un
affranchissement lgard des contenus dexprience, mais une retraite vers
ce que prsuppose lexistence naturelle , savoir le domaine
transcendantal de tout ce qui sprouve agissant
66
, avant de stre auto-
limit par lintrt troit de la manipulation des entits utiles la vie
biologique. La conscience pure rpond cette spcification : ayant t mise au
jour par lopration de rduction en tant que prcondition de la constitution de
tout objet, elle ne saurait elle-mme se voir confondre avec un objet naturel.
On ne saurait alors mieux caractriser la conscience pure, reprend Husserl,
quen lidentifiant lempire de ltre absolu
67
, voire ce qui existe
en soi
68
. Tout autre terme que la conscience pure lui est secondaire,
relatif, puisque sil est dot dun tre, celui-ci sannonce seulement par et
dans la conscience. Telle est lamorce dune conception phnomnologique de
lontologie (ou dune approche ontologique de la phnomnologie), qui a t
dveloppe lextrme par Heidegger ; tellement dveloppe que le
vocabulaire psychologisant des vcus et de la conscience en a t
intentionnellement banni. Aprs tout, si la conscience pure au sens de
Husserl ne se confond en rien avec la conscience en tant quobjet dlimit
dtude pour le psychologue, si lacte mme de la rduction transcendantale
impose dlargir le sens du mot conscience jusqu le rendre
mconnaissable (peut-tre jusqu cette conscience-vie-monde quvoquait
Wittgenstein), si la conscience se confond alors avec l tre absolu ,
pourquoi ne pas entriner cette volution en faisant basculer le vocabulaire
phnomnologique de la conscience vers ltre ?
Cest ce mouvement que parachve Heidegger, en dclarant que pratiquer
l a rduction phnomnologique revient surmonter loubli de ltre. La
rduction phnomnologique, au sens renouvel o lentend le philosophe de
Todtnauberg, consiste se dtourner de ltant et se laisser reconduire
son tre
69
. Les mots sont diffrents de ceux de Husserl. Mais on peut les
prendre, selon les indications laisses par Heidegger lui-mme, comme une
traduction terme terme, et une gnralisation, des vocables originaux de la
phnomnologie. Chez lui, se dtourner de ltant veut dire scarter de
lattitude naturelle de lhomme absorb dans la vise des choses ; et se
laisser reconduire ltre signifie un panouissement du mouvement
husserlien consistant re-connatre la vie transcendantale de la
conscience
70
, qui vite de sinscrire dans une polarit du connaissant et du
connu, de la conscience et de ce dont il y a conscience. Heidegger poursuit en
notant que la rduction phnomnologique nest pas acheve lorsquelle se
contente de susciter cette rvolution de lattention. Il faut aussi quelle sy
installe et quelle se porte durablement vers ltre. Mais voil encore une
ambigut, un garement possible : la prposition vers suggre que ltre
est quelque chose atteindre. En va-t-il vraiment ainsi ? Y a-t-il une
orientation adopter, une nouvelle pousse exercer, pour rejoindre le
domaine de ltre ? Ou cette thmatique du chemin parcourir, de leffort
faire (en direction de ltre), nest-elle quune mtaphore incertaine de plus ?
Mtaphore pour mtaphore, la plus approprie nest pas se porter vers
ltre , mais une fois de plus largir le champ dattention jusqu
sapercevoir non seulement de ltant, mais du fait de son tre. viter de se
laisser entirement captiver par le chatoiement local et la particularit des
choses actuellement donnes, pour affronter aussi leur actualit de donation.
Scarter de leur ordre de multiplicit et de comment elles sont, pour
accueillir dans lespace cr par ce retrait le fait lmentaire quelles sont.
Devenir assez ample pour sentir limpact de leur quod (cette vanouissante
merveille domniprsence , crit Vladimir Janklvitch
71
) en-de de leur
quid. Se rendre sensible ce qui se montre de soi-mme (le phnomne),
plutt que prendre ce phnomne la lgre comme sil tait une contingente
apparition-de.
Basculer dune attention aigu ce qui est vers la ralisation dilate de
son tre, ou de lidentification dune chose vers le constat de sa simple
factualit, tel est donc le fruit de la procdure de rduction phnomnologique
en ce sens alternatif. Rduire , ici, cest persvrer assez dans la vigilance
dilate pour se laisser imprgner par la prsence de ce qui est prsent. Or, la
prsence entire de ce qui est prsent est charge dune grande richesse
qualitative, motive, esthtique, axiologique, thique, voire dune tonalit
gnrale dtonnement, de dcouverte ou dindiffrence, et pas seulement
dune information positionnelle et quantitative. Limprgnation requise est
donc totale, indiscrimine, polydimensionnelle, confuse et pleine la fois,
abandonne tous les ressacs de ce flot dexprience. Objecter cela que les
premiers traits de la liste, motion, beaut, valeurs, jugement moral relvent
de la conscience du sujet, tandis que les derniers traits, position et quantit,
sont seuls relever de lobjet lui-mme, et que par consquent il ne faut pas
attribuer la prsence des objets ce qui est projet sur eux par la conscience
du sujet, ce serait prendre le problme lenvers, partir de son issue
conventionnellement accepte. Cest ce que lon fait trop souvent, en
acceptant sa solution strotype offerte par un sens commun coul dans
l attitude naturelle , et en la corroborant par lhistoire philosophique de la
coupure entre qualits secondes et qualits premires. La prsence donne
enveloppe bel et bien tout cela, avant mme les mots qui servent cribler et
rpartir ses composantes sur les deux rives de la grande division de la nature.
Cest seulement lissue dune procdure de dpouillement, dextraction du
constant et du partageable par tous, que des objets se voient caractriss par
leurs seules position et quantit, et quune conscience au sens psychologique,
une conscience de sujet personnel, est dfinie par ce qui reste aprs
soustraction de linvariant au sein de la prsence
72
.
Si la rduction phnomnologique commence par nous faire glisser dun
plan rduit un autre, avant de saffaiblir dans une controverse indcise
sur la nature du plan privilgier (faits empiriques, conscience pure, ou tre
cliv des tants par la diffrence ontologique), cest sans doute quelle na
pas pris la pleine mesure de sa radicalit. La rduction vise arrter la
descente vers linconnu de lpoch, il est vrai, mais seule une poch
ininterrompue peut introduire au sens ultime de la rduction. Or, ce sens
accompli est daccoster aux rives dun univers compltement priv des
repres et des automatismes naturalistes, daccder des expriences qui sont
dstabilisantes bien avant dtre rvlatrices, daffronter linexplicable vcu
o senracinent les principes dexplication du peru. Si cet univers nouveau
est trange, sil chappe aux travaux de la dnomination et aux commodits de
la catgorisation, cest quil ne montre rien mais quil est ostension, cest
quil ne saisit rien mais se confond avec le saisir, cest quil ne sexpose pas
moyennant une dhiscence avec qui cherche le connatre, mais enveloppe
celui-ci dune toile serre, impntrable, contigu, attenante. Husserl a
cherch exprimer cette approche de linsu en usant dune mtaphore
frappante, bien que partiellement trompeuse : Par rapport notre vie
originaire pure [] nous sommes initialement dans une situation analogue
celle de laveugle de naissance quon vient doprer de la cataracte et qui,
littralement, doit maintenant commencer par apprendre voir
73
. certains
gards, cette image nous loigne de la difficult affronter parce que, une fois
la distension intentionnelle apaise par lpoch, il ne devrait plus tre
question dun voir. dautres gards, elle nous guide comparativement, en
signalant quexplorer le champ rduit de lexprience pure quivaut dassez
prs apprendre lusage dune modalit sensorielle jusque-l insouponne.
Ce que nous ne pouvons plus voir, dsigner, manipuler, nous devons le frler
comme une ombre, y accommoder notre attention jusque-l distraite par la
prgnance des objets, nous y rendre rceptifs en-de de louverture sensible,
nous en pntrer faute de latteindre. Ce que nous ne pouvons pas encore
reconnatre faute de catgories adaptes, nous avons dabord le raliser,
puis y duquer notre facult discriminatrice afin que celle-ci sache oprer
dans ce qui est discerner plutt que devant lui. Figurons-nous un ailleurs
infiniment voisin que nous naurions jamais remarqu en raison de sa
translucidit.
Conformment sa tactique de compromis lexical avec une part restante
d attitude naturelle , Husserl suggre une pdagogie progressive pour
apprendre sorienter dans le nouveau milieu qualifi, faute de mieux, de
subjectivit pure ou de vie transcendantale
74
. De mme que le monde
physique est donn aux physiciens dbutants comme un domaine dexprience
portant sur les choses spatiales connues depuis lenfance
75
, lunivers
daprs la rduction est initialement prsent au phnomnologue novice par
le biais dexemples et dinstruments conceptuels emprunts la psychologie
du sens commun. En phnomnologie comme en physique, le monde inexplor
doit tre abord avec un outillage emprunt aux sentiers antrieurement battus.
En phnomnologie comme en physique, ldifice conceptuel btir doit
sappuyer sur un chafaudage de catgories anciennes. Le sort de la
phnomnologie ressemble celui de la physique quantique qui, nayant pas
fini daffranchir son arsenal symbolique vis--vis de larchtype du corps
matriel, dissimule de manire persistante que son nouvel objet ne sidentifie
justement plus une entit permanente localise dans lespace-temps
76
, et
ouvre ainsi une bote de Pandore de paradoxes laissant croire, tort,
quelle est une science imparfaite ou incomplte. Cest ce genre de
malentendu qui, en dpit des dngations et des distinctions soigneuses, tend
faire prendre la phnomnologie pour un simple regard intrieur oppos,
sur un mode dualiste, au regard extrieur.
Lemprunt presque forc de catgories un champ dinvestigation
naturel nest cependant que la manifestation marginale dune difficult
plus profonde. Quelle raison peut-on avoir de pratiquer lpoch et la
rduction phnomnologique tant quon se trouve absorb dans lattitude
naturelle ? Lattitude naturelle nest-elle pas auto-suffisante, et ne peut-elle
pas rpondre dans ses propres termes toutes les interrogations qui se coulent
dans ses formes ? L poch nest-elle pas tout simplement infigurable dans le
cadre naturaliste ? La rsistance dj signale des chercheurs scientifiques
une culture de lpoch en est le signe. Lattitude naturelle, mme perturbe
par des obstacles sa progression, ne voit dissue que dans une exacerbation
de la fuite en avant. Cela se comprend si, comme lcrit Husserl, la vie
naturelle saccomplit [] comme un tat dgarement dans le monde, tat au
dbut absolument inluctable
77
. gars dans le monde par lirrsistible
option naturaliste, et sans doute par les nombreux avantages que nous y
trouvons
78
, nous avons perdu les cls de notre entre en lui. Projets dans le
monde des objets, nous dsirons rarement ressaisir ltendue entire de notre
vie donatrice dobjectivit, pour la simple raison que nous ne savons mme
plus quoi dsirer dautre que ce qui a t pralablement projet comme objet
de dsir. Sil en va ainsi, la qute phnomnologique semble plus que
dsespre : immotive. Cest ce que pense Fink, lorsquil signale que [des]
voies vers la phnomnologie, au sens dune motivation continuelle
commenant dans lattitude naturelle et conduisant de manire cohrente et
contraignante lattitude transcendantale, il ny en a pas
79
. Lattitude
naturelle na tout simplement pas en elle de quoi nous contraindre la
dserter. Seule une graine daltrit radicale cache dans ses interstices est
susceptible de fissurer les cadres de sa trop parfaite logique interne. Telle est
alors lhypothse de Fink : que lattitude naturelle est en vrit impure, qu
ses marges se dissimule un savoir phnomnologique pralable
80
toujours-dj luvre. Ce savoir est suppos ractiv la pointe extrme de
la recherche naturaliste, lorsque celle-ci a atteint par ses propres moyens les
limites ignores de son entreprise, et se retourne ainsi son corps dfendant
vers ses propres prconditions. Il suffit par exemple de sapercevoir, sur un
mode sensualiste, que nos connaissances reviennent mettre en ordre des
irritations de surface
81
ectodermique, ou, sur un mode neuroscientifique,
que nos modles du monde sont suspendus une organisation crbrale, pour
ne plus pouvoir viter de mettre en suspens leurs prtentions naves la
reprsentation en miroir dune ralit extrieure pr-donne. Si lon ajoute
cela que la connaissance mme des structures ectodermiques (peau, organes
des sens, et systme nerveux) dpend circulairement de ces mmes structures,
mettant en cause la reprsentation du processus pistmique tout autant que les
autres reprsentations naturalises, le doute se transforme en vertigineuse
perplexit. Lorsquil ne se laisse pas apaiser par un constat de cohrence et
defficacit des actions menes sous la supposition de ces reprsentations, le
doute mentionn se gnralise en un inconfort intime auquel seule la dmarche
phnomnologique peut donner sa pleine expression et sa rponse non
conventionnelle, en remplaant lexprience subie de la perplexit par une
poch matrise. La disponibilit de lattitude transcendantale aux marges
(ou larrire-plan) de lattitude naturelle se manifeste alors, et sa
problmatique entirement orthogonale aux recherches naturalistes est prte
se dployer.
Nanmoins, comme nous lavons signal prcdemment, ni les plus
cuisants checs cognitifs de l attitude naturelle ni les plus profondes
raisons auto-gnres de scepticisme son gard ne suffisent la faire quitter
dfinitivement par ceux qui se sont vous un progrs du genre de
connaissance qui sobtient dans son cadre. Remettre aux progrs futurs ce qui
ne peut pas tre atteint par la recherche prsente est la stratgie la plus
commune pour prolonger lgarement dans le monde . Afin de forcer
durablement la porte de lattitude phnomnologique et de vouloir sy
installer, il faut plus que quelques checs intellectuels, plus que du
scepticisme pens. Il faut tre all (au moins un moment, favoris par quelque
rupture de lexistence) jusqu percevoir la faillite du systme entier de la vie
courante, jusqu perdre ses repres, jusqu ne plus pouvoir empcher le
sentiment de labsurde de se rpandre flots sur tout ce qui arrive, en un mot
jusqu ressentir un sentiment dchec universel. Il faut avoir peru un jour la
totale infamiliarit du monde, dont seules des trames structurales sont saisies
par les sciences, il faut lavoir vu redevenir lui-mme dans son hermtique et
incomprhensible prsence en dpit des jalons de lhabitude
82
pour tre prt
tout recommencer ab initio, en stablissant sur le sol chaotique et
prcatgorial mis au jour par lpoch. Faute de motivation interne lattitude
naturelle pour adopter une approche phnomnologique, cest de ses plus
larges failles, pour ne pas dire de sa menace anxieuse danantissement
83
, que
vient limpulsion. Tel est le ver dans le fruit naturaliste, le savoir
phnomnologique pralable mais longtemps touff, do luvre de la
rduction transcendantale prend son essor.
La motivation de la rduction tant trouve, peut-on suggrer quelques
pistes pour la pratiquer ? Cela ne va malheureusement pas de soi. La pauvret
des indications de mthode est sans doute la plus grande faiblesse, et la lacune
majeure, de la phnomnologie. On le comprend aisment. Dcrire la voie de
lpoch frise la contradiction, pour la mme raison que dsigner et dfinir la
conscience confine lantinomie. Ici, nous cherchons paradoxalement
utiliser le discours pour passer dun tre-au-monde conforme lattitude
discursive, vers un tre-au-monde plus vaste que celui qui permet de se
raconter des histoires . Parfois, quand lauditeur ou le lecteur est prt au
basculement, un artifice verbal de ce genre (ou moins encore) peut suffire.
Mais dautres fois, lorsque le destinataire du discours est trop loign de ce
quon voudrait lui laisser entrevoir, parler ou crire devient contre-productif.
Le sentiment sinsinue chez cet auditeur ou chez ce lecteur distant que, dans la
mesure o le dploiement verbal autour de la rduction phnomnologique lui
demeure obscur, il doit seulement sagir dun flatus vocis, dune gesticulation
verbale de philosophes continentaux aboyant autour du silence (comme me
la joliment dit un jour un ami anglais, philosophe analytique). La rduction
phnomnologique, si elle ne se manifeste pas au cur de lexprience de
chacun, a toutes les chances de se voir ravale au rang de simple procd
rhtorique. Pire, ses formules caractristiques, fourmillant dadjectifs dcals
comme pur , transcendantal , ou mondain , risquent dtre perues
comme provenant dun idiolecte ayant pour seule fonction dassurer ceux qui
lemploient une forme de distinction dans un cercle professionnel restreint.
Des paragraphes entiers des crits phnomnologiques ntant
comprhensibles que sous condition daccomplissement vcu et engag dune
forme dpoch, ceux-ci sexposent tre vigoureusement critiqus comme
autant de preuves de la prsomption confuse de ceux qui les formulent, par les
non-spcialistes aussi bien que par des philosophes ne partageant pas lthos
qui leur donne sens. Un exemple clbre parce que paroxystique est celui de
la proposition heideggerienne cest le nant lui-mme qui nantit
84
.
Appuye sur une distinction soigneuse motivation existentielle entre le
nologisme nantir et le verbe courant anantir , elle a cependant t
brandie comme parfaite illustration dune verbosit mtaphysique dnue
de sens par Carnap
85
et ses successeurs, au nom de sa seule absence de
contenu empirique. Cette critique a t mise sans quait t srieusement
souleve la question de savoir si la phrase incrimine pouvait au moins avoir
un intrt pour exprimer des aspects massifs mais ngligs dun vcu
signifiant comme celui de langoisse ; si sa pertinence ntait pas en somme
exprientielle plutt quexprimentale. Dautres propositions de la tradition
phnomnologique, comme je suis ce qui na pas de nature
86
de Merleau-
Ponty, risquent pour leur part dtre taxes darbitraires par une philosophie
non pas tant bien-pensante que trop troitement pensante, qui ne sest pas
laiss saisir par un sens vertigineux dabsence lapproche de son propre
pivot gologique. Mais poursuivons, sans nous laisser impressionner par les
obstacles de principe. Nous jugerons de la possibilit de dire comment
pratiquer la rduction par ses rsultats, plutt quin abstracto.
Il y a en fait une vision pessimiste et une vision optimiste de la voie
suivre pour pratiquer la rduction phnomnologique. La plus pessimiste
(bien que la plus dtaille) est sans doute celle de Husserl et de Fink ; la plus
optimiste, celle de Heidegger et surtout de Sartre.
Husserl nous parle bien dun geste de retrait indispensable pour accomplir
la rduction phnomnologique , mais ce geste lui semble contre
nature
87
. Le geste peine bauch, nous abordons un terrain parsem
dembches, sur lequel nous courons sans cesse le risque de retomber
subrepticement dans lornire de lattitude naturelle (cest--dire de lattitude
extra-vertie, trangre elle-mme), y compris au cur de lopration de
rflexion, et de redonner ainsi un sens seulement psychologique aux concepts
phnomnologiques. Il est difficile, quand on dbute dans la
phnomnologie, dapprendre matriser sur le plan de la rflexion les
diffrentes attitudes de la conscience.
88
Mais peut-tre la ralisation de
cette difficult est-elle chez Husserl un dbut de mthode : commencer par
suspendre la croyance aux entits objectives de lattitude naturelle ; tourner
le regard rflexif vers les actes de conscience ; se rendre compte quon tend
alors traiter ces actes eux-mmes comme des entits objectives pour une
science psychologique ; apporter un correctif cette tendance en suspendant la
croyance aux nouvelles entits ; et ainsi de suite. Le procd est ici celui de
lextrme rigueur dans la rectification ritre de lattitude initialement
incertaine du chercheur ; il sappuie en somme sur une succession matrise
dessais et derreurs. On commence par un essai dpoch et dhabitation du
prsent-vivant, on commet des erreurs partielles par rechute dans la vise
dun avant-futur travesti en objet psychique, puis on se retourne rflexivement
sur ces erreurs pour les transfigurer en nouveaux succs dordre suprieur et
en nouvelles occasions de rechuter dans un pan dattitude naturelle. La
mthode dexplicitation de lexprience, qui sera prsente en dtail au
chapitre XIII, utilise (jusqu un certain point) ce genre de mthode auto-
correctrice et itrative en lappuyant sur le dialogue avec un expert. Celui-ci
commence par laisser son sujet parler dun certain moment dexprience vcu
par lui ; il lui permet cette occasion de sgarer dans ses vises et ses
jugements ; puis il le reconduit de manire insistante vers le centre de son
exprience, vers ce que le sujet peut retrouver delle en la revivant, vers le
pur dploiement de son comment dpouill patiemment, couche aprs
couche, des noncs de finalits ou des discours auto-justificateurs.
Lune des analyses les plus approfondies et les plus claires qui aient t
donnes dans la littrature phnomnologique du processus dpoch et de
rduction peut tre lue dans cet esprit. Selon elle, lpoch se droule en trois
phases : une phase de suspension du jugement, une phase de rorientation
rflexive de lattention, et enfin une phase de lcher-prise ou daccueil de
lexprience
89
. La suspension du jugement est la dnomination franaise de
lpoch. La rorientation de lattention est rendue possible par larrt de la
dissolution suspensive, qui aboutit dsigner un certain plan rduit, et le
rendre disponible pour lexploration rflexive. Mais quen est-il de la
troisime phase, celle de lcher-prise et daccueil ? Ne fait-elle pas double
emploi avec la premire phase de suspension ? Il ny a en fait aucune
redondance si cette tape finale est comprise, la lumire de linterprtation
prcdente de la mthode husserlienne de rduction, en termes ditration
auto-correctrice, en termes de retour amplifi ltape qui prpare la
rflexion. Elle peut tre lue comme un acte de rectification de ce qui risquerait
darriver si, au dcours de la suspension du jugement inaugurale, on sen
tenait lexamen rflexif. La rflexion, nous lavons vu, tend irrsistiblement
prendre la forme lmentaire dun nouveau regard objectivant dirig vers le
domaine dtre intrieur ou psychique ; elle tend naturaliser
subrepticement la phnomnologie par le biais de sa psychologisation. Pour
viter cela, un geste additionnel compltant et amplifiant la suspension initiale
est requis. Cest ce dernier geste qui peut tre appel lcher-prise . Il
consiste aborder le champ dexprience mis au jour par la rduction, dans
un tat desprit authentiquement transcendantal ; cest--dire dans une posture
constamment expansive d ouverture soi-mme
90
, de contact,
dexploration latrale, ou dinfrence rgressive partant de nimporte quel
objet pour remonter vers lorigine de sa vise en acte, plutt que de
distanciation vis--vis dune part de sa propre activit consciente et de
focalisation attentive sur elle. Le lcher-prise permet de passer, dans le
processus de rflexion, dun aller chercher un laisser venir
91
. Il
tablit la zone de silence
92
a-conceptuelle quexige la dcouverte dune
rgion inoue de la connaissance, dune rgion quaucune prformation
catgoriale adapte lexploration dune nature objective ou dune
psychologie naturalise ne saurait capturer. Pour que les aveugles de
naissance que nous sommes lgard de notre propre champ de conscience
pure puissent se dplacer sans entrave dans lunivers insu qui leur est
dsormais ouvert, il faut quils abandonnent les instruments dorientation qui
leur servaient dans leur condition initiale, et surtout quils sabandonnent
labsolue nouveaut de leur milieu de vie accru.
Eugen Fink souligne galement limmense difficult de lacte de rduction.
Selon lui, ltre humain absorb dans lattitude naturelle ne cde pas aisment
lattrait de lpoch. Aprs tout, le souci dobtenir la victoire contre le
doute, le projet de trouver de bonnes raisons de croire aux choses poses
devant, lui ont t inculqus comme sa raison dtre. Pour qui est absorb
dans lattitude naturelle, sa face cache quest la rduction est labsolument
insaisissable dans la mesure o elle soppose littralement lui
93
. La
rduction est donc la fois l, porte de la main, et insupportable parce que
sinscrivant en faux contre leffort dune vie, contre une ducation entirement
concentre vers le projet, vers lentreprendre, vers laller de lavant, vers la
position inter-subjective dobjets efficacement manipulables. La rduction est
l, mais inacceptable parce que pour en recueillir le fruit il faut dfaire tout ce
quon nous a appris faire, et tout ce dont semble dpendre notre scurit
intrieure dans un environnement social qui prend ce faire comme valeur.
Seule, une nouvelle fois, la perte accidentelle de cette scurit peut donner le
sentiment quil ny a plus rien perdre larguer les amarres du
reconnaissable et se laisser flotter dans ltranget de linfiniment proche.
D-faire : cest exactement cela quil faut russir en priorit pour
pratiquer la rduction , selon Heidegger et Sartre.
Heidegger le suggre
94
par quelques phrases concentres la fin de sa
confrence de 1929 Quest-ce que la mtaphysique ? La philosophie
(autrement dit la phnomnologie revue et corrige par lui), commence
Heidegger, ne se mettrait pas en marche sans un saut-dedans . Ds la
lecture de ce mot, un sens de lnigme se fait jour. Que doit-on entendre par
saut-dedans (Einsprung en allemand), que la traduction franaise la plus
courante affaiblit en insertion ? Certainement pas un saut dans lintriorit
psychique, pralablement distingue du monde l-dehors. Plutt un saut
nayant aucun lieu atteindre, un saut immobile qui saccomplit dans la chair
de lexister et la fait se rvler elle-mme dans toute son tendue, jusque-l
ignore au profit des secteurs restreints de sa vise intresse. Le saut,
poursuit dailleurs Heidegger, vise projeter mon existence dans la totalit
des puissances du Dasein, de l tre-le-l
95
. Le saut dlie le l, ltre-
situ, de son enrgimentement catgoriel, de son mouvement exclusif vers
llucidation et la manipulation de ce qui est (de ltant)
96
. Il le met au contact
de certaines potentialits latentes qui sont les siennes, mais quil ignore ou
quil refoule dans la vie ordinaire si lon excepte laperu que lui en donne la
tonalit de langoisse
97
: son tre en sursis, son ouverture indfinie et cause
de cela troublante, son retrait imperceptible vis--vis dun tant qui
loppresse par le seul fait de sa prsence faussement familire. Pour
accomplir ce saut-dedans, on doit dabord donner de lespace ltant dans
son entiret ; ensuite sabandonner dans le rien, cest--dire se librer des
idoles que chacun de nous possde [] ; enfin laisser aller les oscillations de
cet tat de suspens, afin quelles nous ramnent sans cesse la question
fondamentale de la mtaphysique
98
. Autrement dit, afin de raliser les
pleines capacits du Dasein, il faut en premier lieu largir le champ de
lapprhension jusqu y englober tout ce qui est, cest--dire tout ce qui se
montre ; car ce nest que lorsque ltant ne se trouve pas analys, scrut
slectivement, pris dans le dtail touffu de ses relations internes appeles les
lois de la nature, mais affront intgralement, envisag panoramiquement, que
sa singularit proprement stupfiante se manifeste. Il faut aussi, simultanment,
donner de lespace ce qui est, lui permettre de se dtacher sur la toile
dune possibilit prouve quil ne soit pas, par-del son actualit ; car cest
la condition de ce lger cart avec le pouvoir-ne-pas-tre quil se rvle
comme rien dautre qutant, sans autre trait saillant que dtre. En second
lieu, comme chez Fink, il convient de dfaire lcheveau des pr-jugs (les
idoles de la pense) jusqu atteindre un fond sans fond, sans repre, sans
encadrement conceptuel ; celui-l mme auquel nous cherchons ordinairement
chapper lorsque nous balayons lanxit dun revers de la main et revenons
des occupations senses (cest--dire focalises, limites, divertissantes
au sens de Pascal). Se laisser ondoyer dans ce non-savoir plus que
socratique
99
, sy abandonner non seulement parce que cest le seul moyen de
sorienter dans le nouveau milieu quil reprsente sans le fardeau daucune
connaissance pralable, mais aussi parce que ce milieu pourrait bien se
confondre avec ltat mme de labandon. En troisime et dernier lieu, sy
tablir demeure pour ne pas laisser chapper, au profit dune srie de
questions cibles et parcellaires sur les rapports entre phnomnes, la
question dernire qui nous hante : pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Pourquoi
quelque chose remplit-elle lattente abyssale qui nous taraude au lieu de
lavoir laisse jamais inassouvie ? Et pourquoi mme une attente creuse-t-
elle cela en ce l que nous sommes ?
Telle est la mthode heideggerienne dpoch radicale, trop succincte
pour ne pas avoir t nglige, mais trop limpide pour ne pas pouvoir tre
utilise.
Le procd de mise en poch que suggre Sartre dans La Transcendance
de lego nest gure plus dtaill que celui de Heidegger, mais il a assez
daffinits avec lui pour susciter un sentiment de cohrence. Sartre commence
par contester ce quil pense tre le pessimisme de Husserl et de Fink : On
sait que Fink [] avoue non sans mlancolie que, tant quon en reste
lattitude naturelle, il ny a pas de raison, pas de motif de pratiquer lpoch
[] Ainsi lpoch apparat dans la phnomnologie de Husserl comme un
miracle [] Elle apparat comme une opration savante, ce qui lui confre
une sorte de gratuit. Au moins lpoch parat-elle Husserl dcouler dun
travail ardu de dconstruction, que celui-ci soit le fait du philosophe ou celui
de lartiste qui sexerce capturer lapparatre sans son travestissement de
concepts
100
. Dans le sillage de cette critique, Sartre revisite lattitude
naturelle et identifie, la diffrence de Fink, une raison pour laquelle il est
non seulement possible mais invitable quon lui chappe par la rduction
phnomnologique : Si lattitude naturelle apparat tout entire comme un
effort que la conscience fait pour schapper elle-mme en se projetant dans
le Moi et en sy absorbant, et si cet effort nest jamais compltement
rcompens, [] lpoch nest plus un miracle, elle nest plus une mthode
intellectuelle, un procd savant : cest une angoisse qui simpose nous et
que nous ne pouvons viter, cest la fois un vnement pur dorigine
transcendantale et un accident toujours possible de la vie quotidienne
101
. La
position dentits transcendantes, que ce soit celle des objets de manipulation
ou celle dun objet moi qui est leur corrlat manipulant, est fabrique ;
elle dcoule dun effort symtrique pour extraire des invariants de
lexprience (les choses) et pour structurer un ple constant de
proprioceptions, de statuts et dhabitus (le moi) plac en vis--vis des
choses. Sil y a besoin de sefforcer, cest que cette double tentative de mise
en ordre spuise face un double excs : lexcs de nouveaut et de
gnrativit de ce qui se donne dans lapparatre, capable de faire craquer
priodiquement les cadres interprtatifs proposs pour le conformer la
raison performative ; et lexcs de spontanit de ce Je qui est la face
agissante obscure du moi-personnage
102
, celle qui ne cesse de craqueler son
i mage sociale intriorise. En de des sphres ordonnes par les deux
fabrications, tapi au plus prs de lacte de fabriquer, affleure le sol tumultueux
do tout cela provient. Un sol communment ignor au profit de son fruit,
mais qui se laisse apercevoir ds que les activits fabricatrices
saffaiblissent, tantt par la ralisation de leurs limites, tantt par
lamoindrissement de la tension dexister. Ce sol, Sartre lappelle la
conscience ou le champ transcendantal. Il est lexistant absolu force
dinexistence
103
tant il prconditionne lexistence, ou encore un rien qui
est tout
104
parce quil est exprience de toute chose sans tre lui-mme une
chose. Il est surtout le lieu de manifestation des puissances dtre ; non pas
des simples possibilits abstraites, mais de cette authentique crativit
prcdemment souligne qui, du ct de son ple objet, ne se laisse pas
entirement prvoir par des thories, et, du ct de son ple sujet, ne se laisse
pas entirement enfermer dans des conventions. Plutt que dun savoir
phnomnologique pralable, comme le souponnait Fink, il est question chez
Sartre dune ruption phnomnologique sauvage antrieure tout savoir,
quun simple affaiblissement de la pulsion de savoir laisse nu. Dans ces
conditions, il ny a mme pas besoin, pour accomplir lpoch, de penser
dnouer patiemment la toile des prconceptions constitutives de la vie
ordinaire ; il suffit de laisser se dfaire toute seule une tentative
darraisonnement trop chancelante pour se perptuer sans artifice. La plus
petite lassitude, le plus lger abandon, le premier relchement dans la pousse
du rocher de Sisyphe quest ltablissement dun monde et dun moi face lui,
suffisent ici laisser survenir l accident de lauto-rvlation du champ
transcendantal. ceci prs que ce dernier nest pas toujours reconnu comme
tel, et quil ne se manifeste alors qu travers des biais motifs, voire
psychiatriques, dont lanxit nest que le plus simple et le plus courant.
Au terme de cet examen dune modalit transmute de la conscience
quon appelle la rduction transcendantale, nous allons prendre davantage de
recul en la comparant une autre classe dtats de conscience volontairement
cultivs : ceux quinstaure la vie contemplative. Le rapprochement simpose
dautant plus que les fondateurs de la phnomnologie en taient discrtement
nourris. Levinas na-t-il pas qualifi la rduction transcendantale de
rvolution intrieure introduite par une mthode de vie spirituelle
105
?
Et Husserl lui-mme na-t-il pas soulign que lattitude phnomnologique se
traduit par un changement personnel complet qui serait comparer en
premire analyse avec une conversion religieuse
106
? Cela sans compter les
discrtes affinits de la pense de Heidegger avec la mystique rhnane de
matre Eckhart
107
, autour du thme de labandon. vrai dire, la comparaison
pourrait bien devoir stablir en sens inverse. Loin que la rduction
transcendantale ne puisse tre envisage que comme une varit lacise
dtat contemplatif vise gnosologique, les tats dabsorption spirituelle
pourraient tre mieux compris sils taient tenus pour autant de formes de
rduction transcendantale vise existentielle. Un tel retournement priverait
sans doute la parole sur la pratique contemplative de sa solennit
numineuse
108
, mais la contrepartie satisfaisante en serait une comprhension
unifie des divers aspects de ltre-Homme. Il ninviterait scarter du
tournant thologique
109
de la phnomnologie, quen faveur dun
approfondissement phnomnologique des tudes sur le fait spirituel
certainement moins simplificateur que le recours la neurothologie
110
.
Un parallle allgorique confirme lintrt de la confrontation, en donnant
un signe additionnel de parent entre les dmarches confrontes. Nous avons
signal que Husserl compare la situation du pratiquant de lpoch parvenu
dans son univers de conscience neutralis celle dun aveugle de naissance
ayant sorienter dans un environnement tranger peu aprs avoir recouvr la
vue. Or, la mme image a t propose au sujet de la situation dun mditant
qui dcouvre le paysage contemplatif : Au dbut [de notre exploration des
tats mditatifs], nous sommes comme le jeune garon [n aveugle] qui vit de
nouvelles expriences, mais na aucun moyen de les comprendre
111
.
Phnomnologues et mditants abordent une terra incognita, un vcu
inarticul. Ils sont dautant plus dsarms en sa prsence que toute tentative
den re-faire un objet dexamen est vaine, pour la simple raison quil suffit de
lobjectiver pour annihiler sa spcificit. Ainsi que lcrit Claude Romano, la
version la plus authentique de la rduction est immersion dans lapparatre
plutt que prise de distance rflexive vis--vis de celui-ci
112
. Le
phnomnologue et le mditant ont ds lors pour impratif commun de se
laisser aller sans crainte, mais aussi sans abdiquer la lucidit quils ont pu
acqurir au cours de leur vie pratique, la plonge dans le courant total de ce
qui se montre.
ct de ces similitudes, phnomnologues et mditants ont des priorits
et des attitudes divergentes. Lune des diffrences majeures entre les deux
tient au comportement des explorateurs sur leur continent inconnu. Tandis que
les phnomnologues imposent presque toujours
113
un coup arrt effectif la
dconstruction catgoriale induite par lpoch, en dsignant un domaine de
rduction, les pratiquants dtats mditatifs ont pour horizon de perfection
lacatgorialit intgrale dune poch sans limite. Alors que les
phnomnologues sont prts des accommodements avec le langage de
lattitude naturelle (quitte lenrichir de nologismes, comme nome et
nose ) afin de pouvoir parler du terrain rduit, les mditants ont pour
principe de ne pas trop verbaliser leur exprience, afin dviter
lintellectualisation htive de son sens, et de ne pas bloquer ainsi laction
corrosive de lpoch avant quelle nait achev son uvre quils considrent
comme sotriologique par-del lpistmique. Les phnomnologues sont
gnralement discrets sur les mthodes permettant de cultiver la rduction
transcendantale, et sattardent loisir sur la description textuelle de son
rsultat. linverse, les pratiquants de la mditation sont assez prolixes
propos des techniques mentales permettant datteindre les fruits de la
contemplation
114
, alors que leur attitude vis--vis de la possibilit de les
dcrire oscille entre lambivalence et la rticence. Les allusions
lexprience mditative ne manquent certes pas ; mais elles demeurent souvent
potiques et allgoriques
115
, ou bien elles seffectuent (comme dans
lAbhidharma bouddhique
116
) sur un mode abstrait, numratif et taxinomique
qui rend difficile la reconnaissance de ce que vivent les mditants, ou bien
encore (comme dans lcole Mdhyamika) elles se voient critiques en raison
de leur usage de concepts et de distinctions incapables de capturer la vrit
de sens ultime
117
qui satteint travers l enstase
118
mditative, ou bien
enfin (comme dans le Zen) elles sont purement et simplement rcuses comme
autant dobstacles la ralisation la plus haute, qui est en de des mots
119
. Il
est vrai que cette mise en contraste vaut surtout pour une discipline
contemplative particulire. Dautres disciplines contemplatives divergent de
la phnomnologie dune manire distincte de la mditation bouddhiste,
parfois diamtralement oppose cette dernire. Comme nous venons de le
voir, la manire bouddhiste de se dmarquer de la concession dialectique
quaccorde la phnomnologie un lexique et des concepts dtourns de
leur usage naturalisant revient viter un compromis de ce genre et incliner
(non sans nuances et drogations) vers la suspension progressive de lusage
descriptif du langage. Mais, si la plupart des autres stratgies contemplatives
religieuses scartent aussi de la phnomnologie, cest en substituant une
reprsentation une autre, et un langage descriptif un autre. En lieu et place
dun discours aux sonorits quasi scientifiques ou empathique, ce que mettent
en uvre les approches contemplatives fidistes nest pas la sche taxinomie
exprientielle de lAbhidharma, la dconstruction Mdhyamika, lnigme
lapidaire du Koan ou le mutisme dune posture assise, mais un abondant rcit
dramatique emprunt leur mythologie propre, tout juste dsamorc par
lchappatoire dun apophatisme. Moins de paroles quen phnomnologie au
cur de lune des traditions contemplatives, davantage de narrations
enveloppantes dans les autres. Un point commun nen demeure pas moins entre
ces deux carts inverses par rapport la phnomnologie, le demi-silence
bouddhique et le verbe thologique : cest quils cherchent lun comme lautre
prparer les esprits rencontrer linou et linnomm en eux-mmes,
lvoquant dans un cas comme une proto-nature, et le peignant dans lautre cas
sous les traits dune sur-nature.
Une brve analyse de quelques-unes des mthodes de la vie contemplative
va permettre daffiner le parallle, et damorcer une synergie avec lapproche
phnomnologique
120
. Les pratiques contemplatives sont multiples, y compris
au sein dune mme obdience. Il nest pourtant pas trop artificiel den
discerner trois grandes varits calques sur les trois temps de lpoch que
sont la suspension, la rorientation et laccueil. En sinspirant des principales
techniques et attitudes de la voie bouddhiste
121
(et sans hsiter tlescoper
ses diverses branches historiques et culturelles, du Theravda sri-lankais au
Vajrayna tibtain), ces varits correspondent respectivement : la pure
concentration de lattention (amatha en sanskrit), lexamen rflexif
soigneux des phnomnes (vipayan en sanskrit), et la prsence ouverte
(rig-pa en tibtain)
122
. La premire conduit suspendre la direction
attentionnelle habituellement porte vers les multiples objets de manipulation,
en lui substituant un objet unique dnu de finalit pratique. La deuxime
rflchit cette attention, ds quelle a t suffisamment discipline, vers le
grain fin de ce qui se vit. Enfin, favorise par les deux tapes prcdentes, la
troisime consiste en une posture daccueil si universelle quelle stend
elle-mme. Sur un plan gnosologique, la premire favorise une critique
incarne de lobjet, en dplaant volont lattention et en faisant voir cette
occasion que cest la focalisation attentive, la vise du mme dans le divers
(comme le dirait Husserl), qui en soutient la prtention lexistence. La
seconde dclenche une critique du sujet, en rvlant son caractre fabriqu
partir dun matriau vcu proto-personnel. La troisime introduit au domaine
inexplor et cependant intimement familier de lexprience pure non duelle.
ceci prs que, par-del ces diffrences, les trois espces de pratiques
contemplatives se recouvrent dans une large mesure, chacune delles tant
prpare par la prcdente et capable de savancer sur le terrain des deux
autres.
Outre les trois temps contemplatifs principaux qui viennent dtre
distingus, dautres mthodes favorisent latralement leurs desseins tout en
poursuivant des objectifs plus immdiatement thiques ou sotriologiques.
Cest particulirement le cas de la pratique de compassion non
directionnelle
123
, qui promeut la dissolution du sujet egotique en engendrant
volontairement lempathie pour autrui ainsi que laspiration soulager sa
souffrance, et en dissolvant par l lauto-centration des affects
124
. La
compassion est ici la fois une fin et un moyen : une fin thique et un moyen
de connaissance qui se renforcent lun lautre. La tension thique favorise la
(re)connaissance lucide de linsubstantialit de lego, et cette connaissance
rend par ricochet plus naturel le tour altruiste de lthique
125
. Initie comme
un simple conditionnement difiant, la pratique de la compassion se donne
pour objectif denclencher un cercle vertueux dans lequel le vrai et le bien se
soutiennent mutuellement jusqu se confondre.
Nous avons vu que la pratique mditative de base, celle de stabilisation
de lattention, a pour principe central la concentration sur un objet unique et
constant. Il peut sagir dune chose visible, dun objet dimagination ou de
remmoration dont les dtails sont progressivement dploys, dune phrase
indfiniment rpte, et plus souvent dun thme corporel proprioceptif,
comme les auto-sensations qui accompagnent les quilibres musculo-
squelettiques de la position assise
126
ou le flux alternant de la respiration.
Cette dernire mthode remonte (au moins) au Bouddha historique, Siddhrtha
Gautama, qui la dcrit sobrement ses plus proches disciples : Mobilisant
toute sa vigilance, il inspire en sachant quil inspire, il expire en sachant quil
expire
127
. Elle a t anticipe ou complte par les mthodes sophistiques
de contrle de la respiration quemploie le yoga (appeles Pryma en
sanskrit)
128
. Et elle a t dcouverte, ou redcouverte, par bien dautres
traditions spirituelles, en particulier chrtiennes. Ainsi, la prire du cur
orthodoxe sappuie sur le rythme de la respiration, soigneusement accord la
rcitation scande dun nonc pieux
129
. La rcitation est ici un moyen
complmentaire de recueillement, apparente aux mthodes du ressassement
des mantra quutilisent lhindouisme et le bouddhisme afin de contraindre
lesprit discursif lextrme concentration, voire au droutement de son lan
naturellement port vers la signification, sous couvert dun pouvoir librateur
allgu des sons qui les composent. Son quivalent peut tre trouv dans
certains procds contemplatifs ns dans lambiance du catholicisme, mais
parfois tenus pour hrtiques en raison de leur statut de technique active dans
un contexte o lattente rceptive de la grce est pose comme norme ou
comme aspiration. Ces procds reposent sur lintriorisation insistante dun
extrait de texte sacr : Aprs stre mis en prsence de Dieu par un acte de
foi vive, prescrit Jeanne Guyon, il faut lire quelque chose de substantiel et
sarrter doucement dessus non avec raisonnement, mais seulement pour fixer
lesprit
130
. En droit et en fait, nimporte quel thme dattention soutenue
pourrait convenir pour fixer lesprit ; seul le lieu particulier ou ltat
motif dans lequel lesprit se fixe dpend de la varit des orientations
spirituelles, qui expriment leurs diffrences par le choix dun type dobjet
privilgi. Le but universellement poursuivi par la mise en uvre de ces
procds est de dompter lintrt de la conscience au sens de Husserl. Pour
cela, on simpose dadopter une direction unique, itrative, dnue de ce tout
ce quon appelle habituellement un intrt au sens de la nouveaut et de la
stimulation. On prend le contrle de lintrt en bridant sa spontanit instable
et en lui fixant une orientation quasi arbitraire, mais souvent investie
dmotions idalisantes. On met lcart tous les intrts ordinaires pour
linsolite et le variable, et tout intrt pour ce qui me concerne
personnellement (cest--dire pour mon propre intrt), en leur substituant un
seul centre fixe dintrt dlibrment choisi.
Puis quelque chose se passe, quelque chose da priori inattendu qui nest
pas toujours recherch pour lui-mme, mais au moins comme moyen
(facultatif) de parcourir les tapes ultrieures : ce quon pourrait appeler le
premier fruit de la pratique. Ce fruit initial na cependant rien dunivoque ni
dautomatique. Il dpend fortement des multiples circonstances entourant le
thme central de la focalisation sur un objet
131
. Les circonstances antcdentes
sont le contexte culturel, pdagogique et moral de la pratique mditative. Les
circonstances adjacentes sont la posture corporelle et ltat de lesprit, qui
doit adopter un juste quilibre entre dtente et vigilance, vitant par l le
double cueil de la dispersion et de la somnolence. Les circonstances
subsquentes, enfin, sont les remdes apports aux dfauts dquilibre mental,
et laide apporte par lexprience antrieure de la mditation
132
.
Les descriptions de ce premier fruit quoffrent les pratiquants des diverses
traditions spirituelles nen ont pas moins un certain air de famille. La
consquence presque unanimement rapporte de la concentration de lattention
et de la matrise de lintrt est ce quon pourrait appeler un tat
dabsorption. Il survient un certain stade de lvolution contemplative des
tats de la conscience, que sainte Thrse dAvila voque par une mtaphore
architecturale. Thrse compare lme un chteau, et les tapes volutives
de ses tats des demeures successives, dont la cinquime (sur les sept
dnombres) est particulirement pertinente. En voici lexpos : Ici, nos
puissances sont endormies par rapport toutes les choses du monde et nous-
mmes. Et, en vrit, lme est comme prive de sentiment durant le peu de
temps que dure cette oraison dunion ; et le voudrait-elle, il lui serait
impossible de penser rien dici-bas [] si elle aime, elle est dans un tel
sommeil quelle ignore comment elle aime ; elle ne sait mme pas ce quelle
aime ni ce quelle voudrait. [] Je dis [pourtant] que ce ntait pas un
sommeil, parce que, dans la demeure dont jai parl, lme, tant quelle na
pas une longue exprience, se demande avec anxit ce qui a lieu
133
. Ce qui
est endormi dans cette cinquime demeure, ce sont les intrts pour les
choses et pour soi-mme ; il reste en revanche lintrt (anxieux ou non) pour
lexprience en cours. Lattention reste soutenue, mme si elle a t
entirement retire de la vie ordinaire ; cest une attention pure, une attention
ltre-attentif, et surtout une attention pour ce qui sannonce sans se nommer.
Un autre exemple est celui de Jeanne Guyon, mystique chrtienne du XVII
e
sicle, amie de Fnelon, qui crit : Si lme tourne toute sa vigueur et sa
force au-dedans delle, elle la spare par cette seule action des sens ;
employant toute sa force et sa vigueur au dedans, elle laisse les sens sans
vigueur
134
. Ici encore, les sens sont endormis, sans que le sommeil ait si peu
que ce soit gagn la conscience. Cette rorientation de la force de lme
vers lintrieur (ou plus exactement vers ce qui ne s t pas pos comme
extrieur) survient la suite dune double opration : non seulement, comme
annonc, la fixation de lesprit sur une pense ou un affect ; mais aussi
labandon [qui] est la cl de tout lintrieur
135
. Labandon consiste
laisser tomber les intrts courants, bien sr, mais il dsamorce plus
particulirement lintrt sous-jacent tous les autres, savoir celui quon a
pour le soin de soi. Tandis que la fixation de lesprit a pour fonction de
drouter le fil des intrts banals en lextnuant, labandon permet de relcher
le ressort gnral des intrts et de se faire rceptif au simple fait dtre-l,
qui les prcde tous.
Si le premier rsultat vcu de lactivit contemplative (labsorption) a t
voqu en mettant autant que possible entre parenthses le contenu
thophanique quil a dans les traditions fidistes, cest que cette approche
prudente permet dobserver des similitudes entre ces dernires et dautres
itinraires contemplatifs. Tel est le cas du scepticisme grec, dj voqu, et
aussi celui des diverses coles bouddhistes. Dans le bouddhisme, la fixation
discipline de lattention, couple lacte dabandon, amorce un itinraire
comprenant huit tapes, appeles en sanskrit les dhyna (Chan en chinois,
Zen en japonais). Ces huit tapes sont divises en deux groupes de quatre : les
dhyna de la forme
136
, et les dhyna sans forme
137
. La premire tape des
dhyna de la forme permet la neutralisation des motions et la concentration
de lnergie mentale ; la seconde comporte la suspension des penses
discursives et laccroissement de la concentration sur la vie intime et apaise
du corps, qui se traduit par une forme de flicit ; la troisime voit le retrait
complet de la conscience par rapport toutes les sensations corporelles, y
compris celles qui taient vcues comme agrables dans ltape prcdente,
sans pour autant que le fond antrieur de flicit se dissipe (elle correspond
assez bien la cinquime demeure de Thrse dAvila, la tonalit
affective prs) ; la quatrime aboutit lquanimit, passant outre lagrment,
le dsagrment, et mme la flicit. Au-del encore, dans le domaine sans
forme, satteignent les tats de ralisation de linfinit de lespace vcu et de
linsubstantialit de tout objet de conscience, qui culminent dans le
ravissement de cessation (nirodha en sanskrit) ni perception ni non-
perception
138
. Un cho de cet aboutissement de labsorption se retrouve
peut-tre dans la brve caractrisation de la septime demeure de Thrse
dvila : un tel oubli de soi, que lme semble vritablement navoir plus
dtre
139
. Dans lun comme lautre cas, labsorption aboutit un curieux
compromis entre auto-abolition et absence danantissement, puisquil y a ici
encore un sembler qui peut tre rapport (labsorption nantit sans
anantir, a-t-on envie de dire en utilisant dautres fins le nologisme
heideggerien). La cessation, ou l oubli , devient quoi quil en soit presque
facile obtenir une fois que le parcours qui y mne est devenu coutumier
140
;
et cette facilit, cette diminution progressive de leffort accomplir pour
entrer en tat dabsorption, signe lauto-transformation du pratiquant. La
sotriologie exige la reconfiguration de son sujet, de manire encore plus
pressante que la philosophie ne se fonde sur le (re)commencement du
philosophe.
Mais ce fruit initial de la contemplation, encore loign du terrain
phnomnologique, tout au plus prparatoire de son exploration travers
lacte fort de suspension radicale des intrts communs
141
, est-il bien le
seul ? Sagit-il l de laboutissement recherch des disciplines
contemplatives, de leur exprience rve ? Pour plusieurs dentre elles, il
semble que ce soit le cas. La clbre seconde strophe dfinitionnelle des
Yogastra de Patajali le laisse entendre (au moins si on sarrte elle), en
dclarant que le yoga est la cessation (nirodha) des processus mentaux
142
.
Les raisons de cette possible identification du but de la contemplation
labolition de lactivit mentale ont des ramifications multiples, mais elles
sont toutes rapportes des vcus peine dicibles auxquels des mythmes
prtent une voix.
La plus lmentaire des raisons avances est quen arrtant son activit
propre de pense, lindividu humain sagrandit au-del de ses limites
personnelles et se fait rceptif un tout autre qui pourrait saisir loccasion
pour se manifester en lui
143
; quil se met lcoute de lintime , cest--
dire de ce qui est plus intrieur encore que son intriorit prive ; quil fait
silence pour se rendre attentif un verbe suppos navoir rien de commun
avec les mots du langage articul
144
. Une autre raison connexe est que Dieu,
cet idal rgulateur de la plupart des courants de la vie contemplative comme
de la morale kantienne, nest peut-tre autre que ce qui se montre la
conscience ordinaire comme vertige dabsence. Lhomme, dclarent ainsi les
fondateurs du judasme hassidique en joignant les deux raisons mentionnes,
doit devenir aussi creux quune corne de blier vide servant de trompe
annonciatrice (un shofar en hbreu), sil veut permettre la voix divine de
rsonner en lui
145
. Il doit annuler son moi, se vider de lui-mme pour
raliser enfin quil habite au sein mme du nant de la vie
divine
146
. Lauteur anonyme du texte mystique anglais mdival The Cloud of
Unknowing ne dit pas autre chose, lorsquil signale que la pratique de
loraison a pour unique but dtendre un nuage doubli entre vous et toute la
cration
147
, et de vous prparer par l contempler ce rien dans son
nulle part , que le sens intrieur reconnat comme tant tout
148
.
Une dernire raison, enfin, explicite la prcdente tout en la corrigeant de
son reste de navet. Au lieu daffirmer que Dieu ne possde pas ltre bien
qu linverse tout ce qui est se trouve hant de lui
149
, au lieu de dclarer quil
nest rien de ce qui est
150
, on ralise soudain que continuer voquer
Dieu jusque dans cette ngation (en lopposant autre chose quil nest
pas, et en le brandissant nolens volens comme une entit part) revient
paradoxalement rester prisonnier du moule intellectuel qui nous le rend
inaccessible. Afin de surmonter cet ultime obstacle inattendu, il faut avoir le
cran de remplacer ntre rien par rien ; rien de dfini qui puisse tre
prdiqu de quoi que ce soit par le biais de la copule est ; un rien peut-
tre apparent celui de lexprience pure, qui conditionne la manifestation
sans tre quoi que ce soit de manifeste. Ds lors, pour comprendre cette vrit
dernire qui ne se dcouvre quen perdant sa dernire et minente
dnomination, signale Matre Eckhart
151
, on doit se faire semblable elle, la
laisser dteindre sur soi jusqu effacer les limites entre la connaissance,
lapparition, et ltre du vrai. Le genre de vrit dont il sagit ici est proche
de lextase du sentir dont seuls les artistes sont capables dexprimer
lintensit ; elle sapparente cette stupeur du contact sensible o le sujet
mme de la sensation disparat en elle, o il meurt noy dans son
ocanique clat, et o il ne renat quen sopposant (temporairement) elle
152
.
ceci prs que la vrit eckhartienne exige une gnralisation de la stupeur,
dans laquelle chaque modalit de la conscience puisse acqurir lintensit et
le srieux du sentir, aprs avoir dfait les crans interprtatifs qui risqueraient
de len distancier. Toutes les interprtations doivent tre mises plat,
traverses, et finalement dissipes comme un voile de brume, pour permettre
ce ravissement aphone du vrai. Avant quil y ait des cratures , crit
Eckhart (cest--dire avant toute possibilit dinterprtation et de
catgorisation par elles), Dieu ntait pas Dieu, il tait ce quil tait
153
.
Lininterprt, lacatgorial par excellence, ne se laisse pas capturer par une
catgorie part, et surtout pas par une catgorie thologique qui inciterait
exclure quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Il est ce quil est ; il est tel ; et
tel volatilise jusquau il qui lintroduit. On voit mieux ici comment
interprter les paradoxes de lauteur du Cloud of Unknowing : ne pas tre
ceci ou cela nquivaut pas se rduire nant ( sanantir), mais
simplement, presque innocemment, tre tel ; cest--dire tre plnitude de
dterminations non limite par quelque dtermination particulire que ce soit,
et en fin de compte tre gros de tout. Ds lors, pour me couler en lui, pour
devenir semblable sa vrit dsire, pour me laisser colorer ou stupfier par
cette vrit sans prtendre la saisir (car ce serait la perdre), je prie Dieu de
me librer de Dieu
154
. Je le prie (mais qui le , qui il ?) de
maffranchir des entraves mentales qui me poussent prier lui plutt quun
autre, de mviter de donner forme de prire ma qute plutt quune autre
forme ou aucune forme, autrement dit de me garder de le dterminer en
acte. Si jemprunte (ventuellement) le vhicule de laffect de croyance
reprsent ici par lattitude de prire, cest seulement pour me transporter loin
de ses troitesses, au seuil de la source gnrative qui se joue des limites et
du vocable mme qui cherche en vain la dsigner.
En anticipant sur la fin de ce chapitre, nous dcouvrons que ltat
dabsorption, une fois pouss ses extrmits, dbouche sur un territoire qui
na rien dtranger, et qui ne semble insolite que parce quil sest vu
dpouiller de son quadrillage cadastral : ce qui est, tel quil est. Lascse,
qui promettait une issue hors du monde, un aperu extatique de la
transcendance, sest avre tre la fois bien moins et bien plus que cela ;
non pas une porte vers quelque ailleurs, mais un rvlateur de lici comme on
ne savait plus le rencontrer force de trop savoir. Voil qui nous reconduit
insensiblement lun des principaux aspects de la dcouverte du Bouddha
kyamuni
155
, celle qui la conduit passer outre lenseignement de sa
tradition contemplative brahmanique et en inventer une nouvelle : que les
tapes mditatives et leurs tats dabsorption, dj connus avant lui, ne sont
encore quautant dtats de conscience particuliers ; que ces tats ne
dtiennent pas eux seuls la cl libratoire de nimporte quelle forme de
conscience, de nimporte quelle exprience possible ; que la notion asctique
mme de litinraire accomplir, de lchappe, du passage autre part (et du
rejet corrlatif de lordinaire), nous empche daffronter le problme de
lexistence dans sa pleine extension, qui couvre rien de moins que tout ce qui
se prsente, tel que cela se donne, o que lon se trouve, dans quelque tat
de conscience que ce soit. Cest donc selon lui seulement en cessant de tenir
la pratique contemplative pour une fin, en la transformant en simple moyen de
voir et de vivre en pleine lucidit ce qui arrive, que l issue se manifeste.
Cette innovation bouddhique reprsente une dilatation a priori inattendue
de la voie contemplative, qui la rend coextensive lexister avec la
pntration en plus. Elle nest cependant pas compltement sans quivalents,
puisquune esquisse un peu cryptique en est reconnaissable dans la tradition
indienne pr-bouddhiste. En quelques mots claquants, vite oublis derrire
son texte en flux, la Chndogya Upanishad suggre dj quelques-uns de ses
traits : la mditation (dhyna) est plus que la conscience (citta) ; le
discernement (ou la conscience discriminante) (vijna) est plus que la
mditation (dhyna)
156
. Ainsi, selon les matres de lInde vdique tardive,
dont les crits sont antrieurs lenseignement du Bouddha (ou parfois
contemporains de lui), il y a quelque chose de plus crucial que la mditation,
de plus important que les tats dabsorption nomms dhyna. Et ce quelque
chose est la capacit dhabiter si bien le milieu dexprience actuel quon
arrive discerner son grain exquis avant quil namorce la pulsion de saisie-
vitement typique de la perception, et avant quil ne soit travaill par les
gnralisations et les oppositions de lintelligence. Ce redressement de la
hirarchie des tats de conscience offre une excellente transition pour en
arriver au second tage de ldifice contemplatif, lexamen analytique de
lexprience, la vision pntrante (vipayan).
La technique contemplative, si elle nest pas auto-impose comme un
carcan mais laisse toutes ses potentialits, donne aprs tout accs un
domaine infiniment plus vaste que celui du simple tat dabsorption. La suite
de la versification prescriptive du Bouddha lindique sans quivoque :
Jinspire et je suis conscient de lesprit ; jexpire et je suis conscient de
lesprit
157
. En dautres termes, la focalisation sur lobjet rptitif quest le
va-et-vient respiratoire na pas vocation au monopole ; elle peut servir de
point dappui de lattention, de repre de ses garements frquents, de
boussole pour sorienter dans lactivit mentale
158
, daxe
psychosomatique encourageant se rendre vigilant ce qui tourne autour de
lui dans lexprience. chaque fois que je perds le fil de lattention la
respiration, je peux savoir que je me suis gar, alors que, sans cette
boussole , je me contenterais de sauter dune thmatique mentale une
autre sans men rendre compte. Et chaque fois que je reviens ce guide
attentionnel, jatteins un mode stable de lexister qui me rvle, sa
priphrie, quantit dvnements et de qualits vcues dlicates et fugaces
auxquelles je naurais pas accord la moindre importance sans cela. Mieux, la
ncessit de reprer les circonstances durant lesquelles mon attention divague,
afin de la reconduire plus vite son axe ou sa boussole respiratoire,
devient un excellent guide pour tudier les formations mentales ltat
naissant, en ce point o elles se peroivent encore comme de purs
phnomnes fluents, o elles nont pas t outrepasses en direction de
quelque objet de vise si bien catgoris quil en acquiert la solidit
adamantine dune ide platonicienne.
Or, ltape ultrieure de la prescription bouddhique est bien celle-l :
Dans ce que tu vois, vois seulement ce qui est donn voir ; dans ce que tu
entends, entends seulement ce qui est donn entendre
159
. Voir et entendre
les phnomnes ltat nu, sans dcoupage conceptuel surimpos mais pas
sans aptitude au discernement vigilant, voil le principe de la vision
pntrante. Cest ce prix que la rorientation de lattention, deuxime temps
de la procdure initie par lpoch aprs le premier quest la suspension des
intrts ordinaires, est pleinement ralise. Car la rorientation, redisons-le,
ne revient pas reployer lintentionnalit vers lintrieur, mais relaxer les
collimations de lattention jusqu se rendre rceptif tout ce qui se manifeste
sans lui ajouter de discrimination : pas plus la discrimination intrieur-
extrieur
160
que les sur-discriminations de lactivit signifiante. La
rorientation est accueil et acceptation sans borne ; une acceptation si vaste
quelle ne renvoie pas immdiatement chaque occurrence vcue une autre
qui serait souhaite, crainte, ou simplement attendue, mais qui sattarde sur
elle en la gotant et en la soupesant telle quelle est, qui lexamine avec une
curiosit neutre et vaguement bienveillante dans tous ses aspects prouvs. La
rorientation ne consiste pas refuser quoi que ce soit, pas plus dailleurs
lintentionnalit et la surfocalisation attentionnelle que nimporte quoi dautre,
mais se mettre en situation de reconnatre ces tats de conscience comme
tels aprs les avoir agrs plus pleinement que jamais. Ici, comme dans le
processus de rduction transcendantale, nous ne cherchons pas perdre le
monde ( vrai dire, nous lavons plus que regagn aprs le temps prliminaire
extrme de labsorption), mais nous dsincarcrer de ses sentiers battus en
nous rendant toute son vidence. Pour favoriser cette reconnaissance et cette
nouvelle libert, il faut dune part engendrer une lgre dhiscence ou
dfocalisation de lattention afin de la rendre plus ample que nimporte
laquelle de ses cibles, et dautre part avoir stabilis cette attention juste avant
son largissement. Le dploiement du cercle attentionnel survient presque
automatiquement comme consquence secondaire de la suspension des
objectifs pratiques, et de la relaxation des myopies mentales que favorise leur
poursuite. Quant la stabilit de lattention, elle sobtient comme effet
collatral de limposition rgulire dun monopole cristallisateur de lintrt.
Trop rarement pointe du doigt en phnomnologie, cette stabilit est
pourtant une importante condition prliminaire de lanalyse soigneuse des
formations mentales. Le bon examen phnomnologique de lexprience vcue
nest-il pas puissamment favoris par une constance de son terrain daccueil
attentionnel ? Et lentranement de cette constance naurait-elle pas alors
valeur propdeutique pour la recherche phnomnologique ? Une analogie
(mme imparfaite) avec les instruments dobservation de la science
exprimentale peut rendre ce besoin de stabilit presque palpable. De mme
quun microscope pos sur une table branlante donnera voir moins de dtails
fins que le mme microscope protg des vibrations
161
, un espace
dexprience travers par des perturbations non matrises noffrira pas autant
de nettet et de disponibilit attentionnelle pour tudier les formations
mentales, quun espace dexprience apais . La ralisation rcente de ce
besoin de stabilit attentionnelle, dans plusieurs domaines de recherche allant
des sciences cognitives aux psychothrapies, est en passe de confrer la
pratique mditative de type vision pntrante (vipayan) le statut dun
outil de travail. En sciences cognitives, o la mobilisation conjointe des
tudes physiologiques en troisime personne et des donnes en premire
personne simpose bon gr mal gr comme une mthode fondatrice,
lamlioration des donnes en premire personne promise par la stabilisation
mditative de lexprience est hautement souhaitable. On sattend en effet que
les sujets experts en vision pntrante amliorent la reproductibilit dtats
mentaux courants dont les corrlats neurologiques sont tudis, et aussi quils
engendrent des types indits dtats mentaux pouvant tre considrs comme
des varits intensifies et purifies (parce que non perturbes par des
distractions) de leurs contreparties ordinaires
162
. Par ailleurs, dans les
disciplines cliniques vise psychothrapique, cela fait dj quelques
dizaines dannes que les techniques mditatives ont t adoptes comme un
moyen facilement enseignable permettant doffrir aux patients atteints de
certains troubles de lauto-valuation, un instrument de leur possible gurison.
Des pathologies aussi courantes que la nvrose anxieuse, la dpression, ou le
traumatisme conscutif la rvlation dune maladie grave, sont de plus en
plus souvent traites avec succs par un genre de thrapie connue sous son
acronyme MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy, cest--dire
Thrapie Cognitive Base sur la Pleine Conscience)
163
. La mindfulness ,
ou pleine conscience, dnote ici une varit simplifie de mditation de type
vision pntrante (vipayan) , transmise aux patients par quelques
sances collectives en milieu hospitalier prolonges par des exercices
domicile. Elle tend faire atteindre aux patients une conscience nette de
chacun de leurs moments vcus dexprience, en y accueillant les sensations
extro- et intro-ceptives aussi bien que les percepts et les penses, en
encourageant la curiosit et lacceptation, et en suspendant donc autant que
possible les jugements leur gard. En examinant leurs penses (anxieuses ou
joyeuses, ngatives ou positives), les patients les remettent en quelque sorte
leur place comme tant de simples penses et non pas comme lentrevision
dune charge trop lourde assumer. Face au constat que la rumination du
pass suscite ou accompagne la dpression
164
, et que la proccupation pour le
futur provoque lanxit, lhypothse dsormais bien corrobore de la MBCT
est quun simple retour la qualit entire de lexprience prsente permet de
dsamorcer le pouvoir pathogne de ces penchants schapper de ce qui se
donne. Cette hypothse, notons-le, na rien de banal dans le champ
psychothrapique. Face la cure psychanalytique, qui se donne pour idal de
remonter lorigine traumatique du trouble, et la diffrence des thrapies
comportementales et cognitives standard qui poussent cultiver les penses
ou les comportements positifs tout en rprimant (en dconditionnant) les
penses et comportements ngatifs, la MBCT se contente dinviter les patients
reconnatre leurs penses et leurs affects spontans quelle quen soit la
tonalit, et raliser ainsi quil ne sagit que de penses et daffects. Elle vise
accomplir ce projet psychothrapique quon peut qualifier dintgral parce
quil est aussi un projet dexistence : abandonner nos soucis de comprendre
et de grer nos vies, descendre l o le changement se fera de lui-mme, parce
que nous laisserons faire
165
. Laisser faire, laisser penser, et tre pleinement
conscient de ce qui est fait et pens ; ainsi rejoint-on le terrain fcond des
transformations.
Mais au fait, quoi nous ouvrent la rceptivit ce qui se montre et le
pouvoir dexamen neutre et attentif de la vision pntrante ? Quest-ce que
lon voit, quest-ce que lon entend lorsquon se concentre seulement sur ce
qui est donn voir et entendre ? quelle structure dtaille dapparatre le
microscope vipayan donne-t-il accs ? Cest ces questions que vise
rpondre ce quon pourrait appeler la proto-phnomnologie de
lAbhidharma
166
du bouddhisme indien prcoce
167
, complte par ses
commentaires dans la tradition Theravda ultrieure du Sri Lanka et du Sud-
Est asiatique. Lexpression proto-phnomnologie est prfre ici la
simple reprise de la dnomination familire phnomnologie , parce que le
propos de la description offerte par lAbhidharma est analytique plutt que
synthtique ; il vise indiquer comment le champ de lapparatre se
dcompose sous la pointilleuse surveillance mditative, plutt qu restituer
narrativement le mouvement continu, pour ne pas dire gestaltique , de
lexprience ordinairement inexamine. Ltat de conscience stabilis,
accueillant, mais en alerte du mditant vipayan a en effet pour fruit la
pulvrisation du manifeste. Son procd de mise entre parenthses de toutes
les tensions vers des objectifs globaux, qui sappuie sur un simple
exhaussement de lattention, en arrive fragmenter lapparatre en une
myriade de dharma , cest--dire dactes mentaux ponctuels, de
phnomnes phmres, ou dvnements-fulgurations
168
isols les uns des
autres. De mme que le regard appuy, concentr, solidement cal du peintre
fait clater les surfaces visibles en multiples flammches colores qui peuvent
alors tre portes une une sur la toile devenue impressionniste, les longues
stations vigilantes de la vision pntrante atomisent la structure perceptive
et catgoriale du vcu en flux, jusqu en user la trame et faire voir son
caractre fabriqu. Le regroupement des dharma momentans selon diverses
logiques classificatoires plus ou moins redondantes, dont la justification
mobilise une part importante de leffort des auteurs de la littrature
abhidharmique, confirme cette impression de dispersion, de dfaut radical de
cohsion, que donne dj leur simple numration. Car ne parvenir
regrouper les dharma quen les classant, et estimer plus de quatre-vingts le
nombre de leurs types
169
, incline irrsistiblement faire penser quil ny a
aucun principe intrinsque de liaison entre eux, aucun nexus rel mettant leur
solidarit au-dessus de leur discrimination. Leur seul facteur de connexion est
celui de la coproduction en dpendance , qui, dans le systme de
lAbhidharma, nest autre quun constat doccurrence corrle, un nonc
dimpossibilit empirique de voir surgir lun sans que tel autre surgisse
simultanment ou successivement. Comme nous lavons vu prcdemment, la
plus courante des classifications des phnomnes instantans et disjoints que
sont les dharma les rassemble en cinq skandha , cest--dire en cinq
tas ou agrgats dactes lmentaires dapprhension perceptive ou
mentale
170
, ce qui accentue encore, si besoin tait, limpression davoir
affaire une poussire dtincelles vcues tout juste ordonnable selon des
critres extrinsques. La conscience elle-mme, vue comme srie dactes
phmres de discrimination cognitive (vijna), dattention, ou de rflexion,
prend place parmi les phnomnes lmentaires fugitifs
171
, en tant
rpertorie au bout de la liste des cinq skandha malgr son omniprsence.
Elle survient en dpendance de chacun des actes de contact sensitif et de
raction cognitive lexprience sensible, sans se voir attribuer dans ce
systme le privilge dun continuum dtre.
lissue dun tel travail de dsagrgation, pour ne pas dire dmiettement
de lapparatre, il devient vident quaucune entit ayant une vocation un tant
soit peu gnrale, ou une prtention si faible que ce soit la permanence, ne
peut se voir attribuer davantage que le statut dun agencement conventionnel
d e phnomnes fugaces. Ni les universaux conceptuels, ni la substance
imprissable, ni surtout l ego durable ne sont vus comme autre chose que
des imputations artificielles des fins pratiques, servant de ciment factice
une ralit apparaissante essentiellement fragmente. Mme si la profondeur
de cette dconstruction de ltoffe du monde peut sembler perturbante pour qui
la comprend, et sans doute plus encore pour qui en fait lexprience directe,
cest elle qui est considre comme la meilleure garante de la finalit
sotriologique du bouddhisme, puisquelle dissipe lillusion de la constance
de soi et des choses, et apaise ds lors la vaine pulsion de leur saisie
long terme.
Dans les dcombres laisss par ce paroxysme dacuit analytique qui a
abouti des rpertoires quasi-statiques de phnomnes lmentaires, il reste
cependant faire droit la dynamique de la vie vcue, sa composition par
tapes en une apparence de courant de conscience. Cette ascension vers
lorganis a t entreprise ds les textes fondamentaux du bouddhisme indien
comme lAbhidharmakoa. Ainsi, ct de la classification originelle en
skandha qui sy trouve expose, une autre classification des phnomnes
(celle des dhtu) vise explicitement les envisager en tant qulments dun
flux dvnements auquel la coproduction en dpendance procure un semblant
dunit. Cette classification comprend non seulement six facults
sensorielles
172
avec leurs six corrlats objectivs, mais encore six
consciences rflexives-discriminatrices surgissant leur occasion et leur
offrant un liant ; au total dix-huit lments
173
. Certains commentaires
Theravda sont cependant alls plus loin que cette simple orientation de la
taxinomie vers une dynamique prouve, en tchant de dcrire cette dernire
au plus prs de son flot
174
. Et ce quils ont trouv est que cette dynamique est
en fait pulsatile, quelle consiste en lmergence squentielle de moments
unifis de conscience (citta, et non plus vijna), suivie de leur dissipation et
de leur remplacement par dautres moments de conscience conditionns par
les prcdents. De tels moments synthtiques de conscience, plus durables que
les actes fugaces du cinquime skandha, restent cependant composites, et
leurs constituants, ici appels cetesika, sont des lments assez analogues aux
dharma des classifications statiques prcdentes. Parmi ces derniers lments
constitutifs de lacte intgr de conscience, on compte le pur contact sensible,
le sentiment dvaluation (positif ou ngatif), la pulsion volitive de saisie ou
dvitement, leffort de choix attentif entre les composantes sensibles
donnes
175
, etc. Les moments synthtiques de conscience, ou citta, sont leur
tour articuls, travers le processus du conditionnement mutuel, en
enchanements quasi automatiques : les vthi (voies, avenues), qui subissent
eux-mmes un battement alternant lapparition squence et la rsorption dans
ce que lon a propos dappeler
176
une conscience de base sans contenu
(bhavaga en pli). Pas plus que la volatilisation du vcu en vnements
transitoires, lalternance de systoles et de diastoles, pour ne pas dire
dapparitions-disparitions, des actes de conscience, nest vrai dire familire
ou rassurante pour le penseur et le mditant qui y sont confronts pour la
premire fois
177
. Dans quel obscur ocan le complexe synthtique
dapprhension consciente se noie-t-il une fois passe la crte de sa vague
fugitive ? De quel abme un nouveau complexe synthtique temporaire de
conscience merge-t-il, portant en lui le lien prsum avec un moment
antrieur dsormais inaccessible, et poussant hors de lui vers un objet de
dsir pour lheure hors de porte ? Se confronter avec ce double vide
dirruption et de cessation, que les conventions du quotidien ont pour mission
de masquer en une continuit cinmatographique, est un dfi qui vaut la peine
dtre relev, tant il est vrai que nous ne pouvons de toute faon viter den
faire lexprience aux tournants de la vie o les habitudes distraites se brisent
et o les masques tombent.
L nest pourtant pas la dernire tape du parcours. De mme que ltat
dabsorption samplifiait bon gr mal gr en une aptitude la vision
pntrante analytique du champ entier de lexprience, la vision pntrante
aboutit de faon tantt volontaire tantt involontaire un tat encore plus
englobant quelle, que nous avons dj voqu comme horizon de
dpouillement catgorial et que nous allons mieux approcher par esquisses
successives. La vision pntrante suppose, redisons-le, de laisser tre, de
laisser faire, de ne plus poursuivre ce qui se manifeste dans lexprience, et
au lieu de cela de lexaminer tel quel aprs avoir raccommod lattention sur
elle. Mais la poursuite nest quun autre nom de la signification. Suivre une
pense, drouler ses consquences, cest se laisser entraner derrire elle vers
ce quelle dsigne, vers la proccupation quelle exprime, vers les sphres
loignes mais alarmantes dune occurrence passe qui ne sest pas droule
comme on laurait voulu, ou dun futur dautant plus nbuleux que son acteur
egologique est incertain de ses propres intentions. Ne pas suivre une pense
ou une configuration mentale, cest donc linverse la mettre hors du circuit
signifiant, cest--dire hors de la scansion de renvoi dun moment actuel
dexprience vers un autre moment virtuel, attendu, ou hallucinatoire
dexprience
178
. travers cette remarque sur la suspension de la fonction
signifiante, la prescription courante selon laquelle mditer cest savoir
(re)vivre dans le seul moment prsent
179
, selon laquelle faire oraison cest
nous contenter du moment actuel
180
, laisse apercevoir non seulement sa
porte mtaphysique mais aussi et surtout sa qualit phnomnologique.
Que se passe-t-il en effet lorsquon pousse lextrme linjonction
laisser tre les activits mentales, les accueillir comme telles au lieu de les
accomplir, les vivre de part en part au lieu de courir derrire leur
signification ? Quarrive-t-il lorsque la dernire demande dun remplissement
des attentes actuelles par ce qui va arriver, lorsque mme la demande sur les
demandes, typique de la vision pntrante, est suspendue, abandonne sa
palpitation dmergence et doubli, laisse llmentaire flottaison dune
prsence ne dbouchant sur rien dautre quun autre battement qui, en
mergeant, la condamne loubli ? Dans ce mode dexister fleur dinstant,
ce sont tous les fils de la vie et des croyances communes qui sont distendus,
effilochs, pour ne pas dire incinrs. Ces fils de conviction et dhabitus
quon suit pour se guider dun moment lautre, pour faire un effort inform
vers un moment dsir ou pour viter un moment redout, gisent pars sur un
terrain dexprience si radicalement simplifi quils nont plus rien relier.
On aurait envie de dire, en poussant la mtaphore, que le collier du temps
sest si entirement dnou quil a laiss chapper ses perles doccurrences
hors de lordre de la succession. Limage, cependant, nest qu moiti
pertinente, puisquon na plus affaire dans ce cas qu une seule perle omni-
annexante, celle dtre-l-maintenant. Sans fil chronologique, il ne peut tre
question daucun grnement squentiel, daucune liaison avec ce qui prcde
et ce qui suit, pas mme dune tension maintenue vers un prcdent et un
suivant qui ne peut que retomber force de lucidit en acte.
Sur le plan de la critique philosophique, cela incite une table rase
intgrale, en comparaison de laquelle le retrait des sceptiques et des
solipsistes nest quune timide bauche. Ainsi, par exemple, ce rquisitoire
contre le concept de mouvement emprunt au penseur indien Ngrjuna : une
marche dj accomplie nest pas une marche, pas davantage une marche qui
nest pas encore accomplie. Quant la marche en train de saccomplir, si elle
est coupe des deux autres, cela ne marche pas non plus
181
. Dans la mesure
o le mouvement pass nest plus quun souvenir, et le mouvement venir
seulement une anticipation, il semble quon ne puisse parler que dun
mouvement prsent. Mais ce dernier concept seffondre automatiquement avec
les deux premiers, car les fils qui nouent la position actuelle du mobile ses
positions passes et futures ont t dfaits. Apprhender un mouvement
prsent exigerait une continuit de lavant et de laprs, une diffrence ft-elle
infinitsimale entre le l et lici, rapporte une autre diffrence entre le
postrieur et lantrieur. Cette continuit tant tranche la racine,
lhypothtique mouvement prsent se contracte en un simple instant sans
arrire-plan et sans perspective. Mais ce prsent obnubilant ne saurait
davantage tre qualifi de stase, puisque, tant ngation du mouvement,
limmobilit ne svalue que par labsence de diffrence entre lavant et
laprs, tout aussi impossible tablir que son contraire sous lhypothse
retenue. Ni mouvement, ni stase, ni absurde conjonction de mouvement et de
stase, ni dngation stricte de lun comme de lautre
182
. la suite de cette
dvastation intellectuelle, deux options sont offertes : sabandonner la
volatilisation des catgories du devenir, et mettre ce suspens vertigineux
profit pour labourer le terrain contemplatif ; ou bien chercher une
chappatoire dans des concepts issus dune tradition non bouddhiste, comme
celui dun prsent fait de vibrations contenues
183
.
Sur un plan plus strictement phnomnologique (cest--dire moins
hybrid dlments logiques ou spculatifs), larrt des renvois dexprience
en exprience que suscitent habituellement les ruminations sur le pass et les
projets daction, la coalescence pacifie avec ce qui arrive maintenant, y
compris avec le geste prsent de ruminer ou de projeter, ont une saveur trs
particulire. La saveur qui rsulte de la suspension volontaire ou involontaire
de la fonction signifiante sapparente, on sen doute, celle du non-sens.
Cette saveur est familire ceux qui ont jou un certain jeu de droutement,
trs pris des enfants parce quil les remet brivement au contact de la glaise
sonore do a jailli le langage : le jeu qui consiste ne pas rpondre la
demande de lautre, mais se contenter de rpter ses paroles mot pour mot,
et intonation pour intonation. Un tel psittacisme commence par tre amusant et
intrigant pour celui qui le subit, mais il finit par susciter un malaise : celui de
ne plus entendre que des phonmes en miroir au lieu de slancer deux sur la
pente du signifi. Le jeu se termine dans un geste de lassitude, lorsque lenfant
qui cherche tablir un dialogue demande anxieusement mais pourquoi
rptes-tu tout ce que je dis ? Pourquoi ne me rponds-tu pas ? , et quil
entend ces mmes paroles en cho, suivies dun grand clat de rire de son
interlocuteur ttu. Il ny a rien qui veut tre dit, mais seulement le dire ; rien
qui ouvre autre chose que les mots, mais ces mots mmes ; nulle chappe
vers dautres temps ou vers limaginaire, mais lactualit incongrue,
obsdante, dun mur vocal ; aucune ouverture vers lavenir mais une prsence
battante. Cela est, de manire plus manifeste et plus insistante que jamais,
mais ne se voit plus attribuer de sens.
Pour autant, lexprience de la rduction au prsent a-t-elle
ncessairement la tonalit ngative qui sassocie de coutume la perception
dune perte de sens ? Est-elle sur de la dpression qui, en nous rejetant en
de de tout possible, de tout projet, de toute ipsit, [] nous remet en
contact avec la vie toute nue
184
? Sartre la suppos et la sans doute
prouv, comme en tmoigne le personnage principal de La Nause.
Supposons donc qu force de prsence, la vraie nature du prsent se
dvoil[e] : il est ce qui exist[e], et tout ce qui nest pas prsent nexist[e]
pas
185
. Alors, un monde scroule. Le monde civilis, construit couche aprs
couche de concepts dont les plus anciens ont sdiment en actes perceptifs
tacitement braqus vers leurs attentes et leurs ractions associes, nest plus
quun champ de ruines. Alors, les textes historiques ou futurologiques
scrasent en marques dencre sur du papier, les transcendances se dcouvrent
ntre quautant de songes pniblement anims par ceux qui les font, les
choses sont tout entires ce quelles paraissent, et derrire elles il ny a
rien
186
. Devant les idalits qui savrent ne pas tre, rejaillit la platitude
tangible de ce qui est, et la rvlation a quelque chose de terrible. Sartre
convoque pour la dire les images associes du dvoilement, voire de
lobscnit. Sans son vtement de catgorisations, de dnominations, et
dusages, le pur paratre dnu denvers, le paratre qui sidentifie de ce fait
avec ltre, acquiert une force bute, paisse, massive, impudique force
dvidence. Il est si inexorablement prsent, si capable de remplir les
moindres interstices de lexistence par sa persvrance pteuse, quil en
suscite la nause
187
. Au fur et mesure quil dcouvre sa (redoutable ?)
vrit, Roquentin multiplie les checs, les renoncements, et les rejets. Il
continue sactiver sur la lance de lhabitude
188
, mais il reconnat chaque
instant labsurdit de son lan.
Les imaginations grisantes et les exaltations chimriques une fois
dissipes, quelque chose demeure tout de mme : leurs antithses que sont le
sentiment dcurement, lamertume du dlaissement, ou limputation de non-
sens. Sur les dcombres de ldifice classique des catgories, la colonne
primitive de lattraction et de la rpulsion continue se dresser, dernire
rescape dun regard si lucide quil en est devenu dvastateur. Tout se passe
comme si Roquentin avait contempl son aride vrit de manire incomplte,
comme sil tait rest un peu en retrait pour continuer la juger dun point de
vue partiellement extrieur. Le paratre a beau avoir t dpouill
subrepticement de sa rsille de concepts, certains concepts senttent oprer
dans les jugements de dgot qui lui sont appliqus : la prsence du paratre a
une saveur fade
189
; elle est grotesque
190
, pour ne pas dire
monstrueuse
191
.
Que serait-il donc arriv si Roquentin stait laiss entirement aller
leau inconnue, ou peut-tre reconnue, de sa nue vrit ? Il naurait plus eu
quoi que ce soit en dire, faute des vocables et des concepts qui lui ont servi
formuler ses derniers jugements de valeur. Les choses seraient restes l,
sans mots, sans dfenses
192
. Lui aurait disparu en elles (et elles en lui),
ayant perdu le soutien de llmentaire dichotomie gnosologique qui nat de
lacte de juger. Il naurait plus rien eu dire, sauf, pour meubler le silence,
moduler le dmonstratif neutre tel et le constatif ainsi en talit ou
ainsit . Il naurait pas eu de got ou de dgot exprimer, mais seulement
la blanche litanie du cest ainsi . L rside sans doute la signification la
plus profonde (mais aussi la plus superficiellement immdiate, car il ny a pas
lieu ici de distinguer lun et lautre) de la pense bouddhique.
Cette signification se lit demble, quoique de manire cryptique, dans le
nom a-personnel du Bouddha, ce nom qui est suppos dnoter son
accomplissement sans le dcrire : Tathagata en sanskrit. Il sagit dun nom
compos, articulant le constatif Tatha (ainsi) et le participe pass Gata (all).
Linterprtation du compos ne va pas de soi, mais elle a une latitude limite
par la grammaire et elle peut tre guide entre ces limites par une bonne
comprhension phnomnologique de ce qui veut se dire travers le mot
employ. Tathagata est souvent traduit terme terme par Ainsi all , sans
quon sache trs bien en quoi consiste le voyage propos. Il y a pourtant
dautres options que de reproduire platement en franais la juxtaposition des
termes du sanskrit, pour peu quon examine les usages que fait cette dernire
langue des composs nominaux du type des dterminatifs dpendants (dont
lexemple paradigmatique est le compos Tatpurua : lhomme de celui-
l , son homme ). Le premier mot dun compos de ce type peut se voir
dtermin selon plusieurs cas grammaticaux, allant de laccusatif au locatif,
avec une prdominance du gnitif. Considrons quelques-uns de ces cas dans
lordre. Laccusatif tant souvent employ en sanskrit pour dnoter le but dun
acte, Tatha se lit sous cette premire hypothse comme le but du
mouvement, le but de l aller . Le compos se traduit alors all vers
lainsi , ce qui le rapproche du sens vcu que nous avons extrapol partir
de la nause sartrienne, mais avec ltrange notion surajoute quil y a
quelque chose faire pour gagner lainsi, un but atteindre, un effort
accomplir. Ainsi , le constatif neutre et universel, ne doit pourtant pas se
trouver autre part quici, en un autre temps que maintenant, chez qui que ce
soit dautre que soi-mme. Il peut bien y avoir eu une qute, suggre par le
nom demprunt du quteur (Tathagata), mais la qute se dcouvre sans
altrit aussitt quelle a abouti. Le sentiment dtranget demeure, et appelle
un supplment dinformation. Dautres cas grammaticaux font jouer
dintressants harmoniques du nom opaque. Si Tatha tait lablatif, cela
donnerait All partir de lainsi , signifiant peut-tre quune fois
dcouvert, lainsi demande tre transmis, rpandu de par le monde. Le
Tathagata serait dans cette perspective celui qui va sur les chemins et qui
dispense lenseignement aprs avoir ralis cest ainsi
193
. Par ailleurs, si
Tatha tait au locatif, Tathagata se lirait All dans lainsi , ce qui
sapparente l All vers lainsi de laccusatif, avec une connotation de
dplacement en moins : aller dans lainsi, cest se plonger au sein de lainsi,
cest sy abmer par acceptation, et non pas tendre vers lui par extraversion.
Une particularit grammaticale du verbe aller dans les composs sanskrits
restreint heureusement le champ des possibles hermneutiques : Le participe
pass gata, all , est souvent utilis la fin des composs Tatpurua
dans le sens de se rapportant , existant dans comme par exemple dans
hasta-gata, tenu dans la main
194
. Plutt qu All dans lainsi ,
Tathagata pourrait ds lors se comprendre comme Existant dans lainsi .
Nous brlons, mais il faut encore prendre garde ce quvoque,
incorrectement ici, le verbe exister : exister dans lainsi, cest au fond ne pas
ex-sister, cest tre tabli (sistere en latin) sans chercher un autre lieu (ex),
sans aller ailleurs que l o on est tabli
195
. Car o peut-on tre tabli de
manire aussi ferme que dans linluctable et omniprsent ainsi ? Lautre
suggestion du grammairien apparat dans ces conditions la meilleure,
moyennant une petite inflexion : non pas Tenu dans lainsi puisquil ny a
personne pour tenir, mais simplement Se tenant dans lainsi . Nulle part o
aller, mais une posture patiente dans lactualit continue du devenir ; nulle
dtermination fragmentaire oppose dautres, mais la totalit informe du
manifeste. Lveill (le Bouddha) est celui qui se tient constamment dans
lainsi, qui en suit minutieusement les contours mesure quils apparaissent,
qui sabstient de le fuir au profit de reprsentations du pass et de
spculations sur lavenir, et qui sait reconnatre avec son demi-sourire que
reprsentations, spculations, et dsir de fuir, sont de toute faon eux-mmes
ainsi .
Voil en tout tat de cause de quoi identifier la racine historique et
tymologique dun paradoxe bien connu de la voie mditative : en un sens, il y
a un objectif atteindre par son biais, mais en un autre sens tout est dj l
avant mme de sy tre engag : Nous y sommes parce que cela ne peut
tre rien dautre
196
. Mieux, tendre vers cet objectif nous le ferait perdre,
parce quil ne s atteint quen suspendant les pulsions dextrojection, parce
que la cible nest justement autre que la mise en repos de laller en
direction de : Quand vous le recherchez, vous vous en loignez
197
. Si la
voie vaut quand mme la peine dtre parcourue, cest quau dpart tout ce
qui peut apparatre est l, mais il ny a personne pour sen saisir
198
. La
scne de lainsi se trouve habituellement dserte par son personnage
principal, trop occup par les buts signifiants dune vie pratique, trop tendu
vers un monde l-dehors meubl des objets quont constitu ses catgories
instrumentales, trop press dagir afin de repousser ce qui le gne et de saisir
ce qui le conforte, trop absorb en somme pour lui prter lattention
persvrante et panoramique quelle exige. Sur la scne de lainsi, il ny a
personne , ou du moins personne ne se sait encore situ en elle. Le tmoin
sest absent force dtre attir par le mirage de lignorance mtaphysique,
cest--dire par un manque abyssal qui le pousse se mettre en mouvement
vers. Parcourir la voie signifie ds lors non pas aller de lavant vers un but de
plus saisir, mais peut-tre (en inversant la mtaphore) franchir un demi-pas
reculons pour rintgrer la scne vide de lainsi, ou encore (de manire un
peu moins mtaphorique) se reconfigurer de manire sen reconnatre
lhabitant. ceci prs quune fois sa reconfiguration accomplie, le soi est
tellement tiss de l ainsi habit quil faudrait plutt parler dun ainsi auto-
rverbrant que de quelquun ayant acquis la conscience de lainsi.
Comme celle de la vision pntrante, la dernire tape de la voie
mditative suppose de laisser tre, de laisser faire, de ne plus poursuivre.
la diffrence de la vision pntrante, cependant, il nest plus question aprs
cela de rediriger lattention, dexaminer les configurations vcues, de les
dcomposer en lments, de raccommoder le regard sur le proche aprs
lavoir rapatri du lointain. Cette ultime tape ressemble laccomplissement
rv du troisime et dernier temps de lpoch, qui exige de celui qui
laborde une attitude douverture absolue lintgralit de ce qui arrive, et
pour cela une correction des ultimes tentations de se donner un thme dtude
(y compris un thme rflexif accueilli sans jugement). La mditation est la
grande libert spontane de lesprit dans son cours naturel [] Dans cet tat
naturel primordial, nul besoin daccepter ou de rejeter quoi que ce soit
199
.
La posture est ici celle dun accueil trois cent soixante degrs, dun abandon
toutes les focalisations concevables, toutes les accommodations
souhaitables, sans quaucune ne soit retenue et fixe. Elle est maintenue
jusqu laisser affleurer ce que toutes ont en commun : quelque chose comme
lvidence ardente et jamais inattendue de ltre-tel. La tradition tibtaine
200
a caractris ltape en question comme celle de la prsence ouverte , et
elle en a fait un accs linvariant germinal de toute exprience : ce quelle
appelle la conscience veille, la luminosit et la clart
201
, ou encore ltat
naturel de lesprit
202
. lextrmit de la pratique de la vision pntrante, en
ce lieu ultime o la conscience rflexive a mouss sa pointe attentionnelle
jusqu luniversaliser, seuls se manifestent le simple clat dtre l, la
vivacit sauvage de lincatgoris, la drue transparence dun espace vcu
203
,
linsistance dmesure de ce qui se montre. Ce que lon peut en deviner, en
recoupant les aperus phnomnologiques avec les suggestions obliques quen
donnent les textes, ressemble une version parfaitement accomplie de lextase
du sentir artistique par laquelle stait introduite la voie contemplative. Non
pas la rencontre de nimporte quel artiste et de nimporte quelle uvre
plastique ou musicale, cette fois, mais sans doute un enveloppement entier
comme ceux que procurent la densit dtre oppressante et vaporeuse dune
brume londonienne de Monet, lpaisseur cinglante des volutes de plomb et
dor dun ciel toil de Van Gogh, ou les imprieuses montes chorales du
deuxime mouvement du requiem allemand de Brahms. Nous voil une autre
fois de retour lexprience pure, aprs avoir creus sous les strates de
lagir, de la classification, et de la rflexion ; mais une exprience assez
complice, dsormais, pour tre souleve dune rsonance gnralise delle-
mme.
QUESTION 4
Les questions sur la conscience sont-elles
auto-rfrentielles ?
Le philosophe a besoin pour ainsi dire dune instauration
originaire, qui est une autocration originaire.
E. Husserl
Ds lintroduction, il a t question de lauto-rfrentialit maximale,
vcue plutt que seulement logique, des questions sur la conscience. Une
question si minemment philosophique que le questionnant est entirement pris
en elle, peut mme tre qualifie de radicalement auto-rfrentielle. Mais
quest-ce qui justifie lutilisation de ce qualificatif radical , qui vient
amplifier celui dauto-rfrentialit ?
Afin de le comprendre, il suffit dtablir un parallle et un contraste avec
des versions plus banales dauto-rfrence. Une phrase qui se lit cette
phrase comporte cinq mots est auto-rfrentielle. Il est facile de
sapercevoir quelle nonce une vrit sur elle-mme condition de faire
osciller lattention entre le sens de la phrase et son lexique, entre ce quelle
dit et les graphmes dont elle est compose. Dans ce cas, le mouvement de
lattention bascule dun objet de conscience lointain (ce qui est signifi) un
autre objet de conscience proche (les mots couchs sur le papier ou sur
lcran). En revanche, on ne ralise le caractre auto-rfrentiel dune
question sur la conscience que si lattention se dplace du sens de la question
lexprience consciente actuelle en tant quarrire-plan de cet acte
dattention. Dans cette dernire configuration, le second centre dattention
nest pas un objet , il est une prcondition pour que quoi que ce soit se
trouve pris pour objet ; il nest pas quelque chose vers quoi se tourne
lattention, mais lattentionner revenu de lexil de lui-mme ; il ne se contente
pas dtre proche , il est concidant. Le cercle dauto-rfrence se
contracte ici jusqu fusionner avec lil du cyclone
1
exprientiel, ce lieu de
calme ferique o sbauche le mouvement-vers-lobjet. Il emporte tout avec
lui, ou en lui, comme seuls peut-tre ceux qui se sont sentis vaciller en lisant
les rcurrences vertigineuses des ouvrages de Raymond Smullyan
2
peuvent se
le figurer. Il reprsente la boucle la plus trange qui soit, plus trange
encore que celle de Douglas Hofstadter
3
, puisque ne se contentant pas
dtablir une rtroaction entre deux niveaux logiques distincts (par exemple
entre le sens et la trace), il recrute dans son tourbillon jusquau sol
transcendantal de la logique. Mais mon but, ici, nest pas de cerner par un
surcrot danalyse une telle version infra-logique de lauto-rfrentialit ; il
est den dployer les consquences pour la typologie des thses sur la
conscience, et de commencer pour cela en discuter quelques corrlats
concrets en termes de convictions philosophiques.
Linterrogation sur lauto-rfrence radicale va servir avant tout pointer
obliquement vers lune des difficults pratiques les plus immdiates et les
plus aigus du problme de la conscience, parce que les plus inhrentes son
caractre-limite. En termes plus directs, la question-titre de ce chapitre aurait
d snoncer ainsi : Ma thorie de la conscience dpend-elle de mon tat de
conscience ? ; ou encore : Deux personnes sont-elles condamnes ne pas
pouvoir saccorder sur une thorie de la conscience quand elles ne sont pas
dans le mme tat de conscience (ou du moins quand, parmi tous ceux qui leur
sont accessibles, elles ne prennent pas le mme tat de conscience comme
point dArchimde de leurs jugements) ? Si ces questions-l devaient avoir
une rponse positive, ce serait troublant, et dommageable au projet dune
science de la conscience ; part, bien sr, dans lhypothse o lon
parviendrait identifier des tats de conscience suffisamment ouverts et
universels pour y articuler entre elles les thories soutenables dans les
diffrents tats rpertoris.
Un certain nombre de tmoignages convergents et autoriss suggrent ainsi
que les thories scientifiques courantes, matrialistes et/ou physicalistes de la
conscience napparaissent pas seulement discutables, mais parfois
irrecevables, voire incomprhensibles, aux yeux de personnes ayant travers
certains tats modifis de conscience occasionns par des situations extrmes
(danger imminent, coma, drogues, accidents vasculaires crbraux, tats
dabsorption avancs, etc.). Et cela, mme si ces personnes acceptaient ou
soutenaient avec conviction des thories de ce type avant davoir travers de
tels tats modifis de conscience. Dj, dans la Californie hippie du tournant
des annes 1960 et 1970, des professeurs duniversit avaient remarqu avec
dsarroi quun nombre significatif de leurs tudiants se dtournaient des
cursus de sciences biologiques parce quils affirmaient ne plus pouvoir
prendre au srieux certaines reprsentations vhicules par ces sciences. La
raison de cette dsaffection, identifie grce des enqutes, tait quenviron
50 % dentre eux avaient expriment une drogue ou une autre ( lpoque,
surtout la marijuana ou le LSD), et quils ressortaient de cette exprience avec
une perspective profondment altre sur la nature de la vie-vcue, cest--
dire de la conscience
4
. Soulignons ce stade, pour dsamorcer demble
lune des stratgies dvitement les plus courantes, que les personnes qui ont
ainsi chang au point de rejeter comme sans fondement les thories
scientifiques standard de la conscience ne se trouvent gnralement plus, au
moment o elles affirment ce rejet, dans ltat de conscience modifi qui a
dclench leur basculement intellectuel. Ce nest pas laltration du vcu par
elle-mme qui provoque le glissement de terrain mtaphysique, mais une
sourde conviction acquise la suite de cette altration : celle que des modes
dtre alternatifs peuvent aussi bien servir de rfrence pour tablir le clivage
du rel et de lillusoire que le mode dtre ordinaire.
Mais de telles remarques sont pour lessentiel restes confines dans le
domaine des savoirs communs, infra-acadmiques. Elles sont demeures
confidentielles au nom de leur transgression apparente de linjonction de ne
pas scarter de ltat mental de rfrence, des comportements socialement
admis, et des seules stratgies de recherche autorises par les prsupposs
fondateurs des sciences. Cela jusqu une poque rcente o plusieurs livres
et articles universitaires impliquant des enqutes sociologiques tendues et
des rcits en premire personne convergents et contrls ont t consacrs
leffet transformateur quont des altrations, mme transitoires, des tats de
conscience sur la crdibilit perue des thories de la conscience. Ainsi, il est
dsormais connu et reconnu que les situations assez frquentes de Near
Death Experiences , ou Expriences de Mort Imminente , ont un effet
durable daltration de la vision du monde des patients, tout particulirement
de leur vision de la conscience dans le monde
5
. Un aspect marquant du
traumatisme que ces patients prouvent leur rveil est quils se trouvent
souvent incapables daccorder le systme de croyances psycho-physiques que
leur a transmis notre environnement culturel ce quils viennent de vivre. Ils
ont limpression de ne pas pouvoir parler de leur exprience bouleversante
aux personnes normales encore attaches ce systme de croyances, sans
passer pour un peu drangs . Tout un travail dadaptation des conceptions
psycho-physiques quils ont apprises celles qui leur apparaissent dsormais
les plus vraisemblables est alors ncessaire pour aboutir une bonne
rinsertion sociale. Dans le pass, ce travail sest longtemps rsum pour ces
patients une uvre de compromis, voire de renoncement aux leons
apparentes de ltat altr, afin de sassurer un retour la normalit
mtaphysique et axiologique . Mais, dsormais, un certain nombre de
psychothrapeutes ont pris la mesure de la spcificit de cette configuration
dtre
6
. Ils cherchent aider les patients approfondir le geste dauto-
transformation qua laiss entrevoir leur exprience initiale daltration de
ltat de conscience, jusqu lui trouver un mode redfini de compatibilit
sociale et existentielle, plutt qu pousser loublier. Des groupes de
personnes ayant affront la mme remise en question prouve de leur systme
de croyances jouent un grand rle dans ce processus de reconfiguration
individuelle et sociale sur un mode cratif.
Un cas singulier illustratif de leffet en retour des accidents de la
conscience sur les conceptions de la conscience est celui de la neurologue
amricaine Jill Taylor. Celle-ci raconte, dans un film et un livre
7
,
lexprience quelle a vcue la suite immdiate dun grave accident
vasculaire crbral ayant endommag lhmisphre gauche de son cerveau. Ce
rcit fait tat dune soudaine ralisation par elle de lubiquit de la
conscience ; du caractre fabriqu de lexprience du temps ; de la non-
dualit de lexprience et des choses ; de labsence de limites entre ltre
incarn et son environnement. Tout cela avant mme que la patiente ait ralis
que ses capacits de verbalisation taient perdues. Le point le plus frappant
est que, toute spcialiste de neurosciences quelle ft, Jill Taylor na pas
renonc prendre son exprience au srieux, pour ainsi dire la lettre,
partir du moment o elle a recouvr ses aptitudes sexprimer par le langage
et expliquer scientifiquement son propre cas. Elle ne sest pas contente
(comme lont sans doute fait certains de ses collgues discutant propos de
son cas) de supposer que cette exprience quivalait une sorte
dhallucination due au dficit dirrigation dune partie importante de son
cortex crbral, dassigner cette fraction du cerveau la fonction dassurer la
bonne reconnaissance dune dualit soi-monde suppose vidente ou
pr-donne , et de tourner la page pour revenir sur le sol ferme de la
ralit concrte et matrielle. Au contraire, malgr son usage systmatique et
trs professionnel du mode de description neurologique, elle a adhr de
faon persistante au sens vcu de cette exprience et la considre comme
rvlatrice dun aspect crucial de ce qui est ; un aspect que la dominance de
son hmisphre gauche analytique lui dissimulait jusque-l, et que
lautonomie provisoirement retrouve de son hmisphre droit lui a enfin
permis de dcouvrir. Il nest pas question pour nous de juger cette attitude : ni
de la minimiser en souponnant que la pathologie initiale a peut-tre laiss
des traces dans le cerveau de la patiente, ni linverse de la louer comme un
mouvement bienvenu de lucidit chez une chercheuse scientifique, mais de
constater une fois de plus la rmanence frquente des conceptions non
standard de la conscience acquises travers un tat de conscience altr, bien
aprs le retour prdominant dun tat de conscience ordinaire. Cette
rmanence sexplique, comme cela a t suggr plus haut, et comme le
confirme le rcit de Jill Taylor, par une inversion dlibre de laccrditation
des tats de conscience dans leur pouvoir de distinguer le rel de lillusoire :
au lieu que ce soit ltat normal qui permette daccder une ralit de la
sparation, cest ltat altr qui se trouve investi de la capacit de (re)mettre
au jour une ralit de lindistinct ; au lieu que laltration physiologique ait eu
pour seul effet une perte de la facult discriminatrice, elle se voit interprte
comme moyen de lever le voile de la discrimination et de gagner par l une
forme plus intgratrice, mais jusque-l occulte, de vrit.
Un autre cas allant dans le mme sens est celui de Benny Shanon,
chercheur rput en psychologie cognitive, dont la vision du monde a
progressivement bascul lorsquil a dcouvert, durant ses vacances au Brsil,
certains cultes sud-amricains lis la prise dune drogue, layahuasca, et
quil sest mis consommer cette drogue de faon rpte en se promettant
den faire un objet dtudes. Aprs de nombreuses expriences personnelles,
et aprs avoir dpouill des interviews encore plus nombreuses de personnes
ayant travers le mme genre dexprience, il a publi un livre intitul The
Antipodes of the Mind
8
. Ce livre dcrit et catgorise de manire rigoureuse
les contenus, les structures, et la dynamique, des tats de conscience modifis
par la prise de la drogue sud-amricaine. Lorsquon sen tient cet aspect de
louvrage, on peut avoir limpression de lire une tude distancie et
htrophnomnologique au sens de Dennett, cest--dire une
reconstitution purement extrieure de la manire dont des sujets drogus se
racontent leur propre histoire propos de leur vie et de leurs visions. ct
de cela, pourtant, on trouve dans lintroduction et la conclusion du livre
lesquisse dune authentique approche en premire personne. On y lit un rcit
trs discret, par fragments, de la transformation du systme de reprsentations
de lauteur, au dcours de son exprience ritre de la prise dayahuasca.
Une courte phrase en conclusion rcapitule tout sans fioriture : Ma
Weltanschauung avait compltement chang. Quelques brves notations
parses dans le texte permettent de comprendre un peu mieux quels furent les
tapes et les dterminants de cette transformation personnelle. Au dbut,
signale Shanon, lexprience isole dune prise de drogue ne [l]a pas
chang en tant que personne ; [sa] vision du monde na pas t altre et
aucune modification de [ses] plans ou de [ses] intrts ultrieurs ne serait
survenue si lpreuve stait arrte l. Mais au fur et mesure que les
prises dextraits de plante se multiplient, la perspective se modifie en
profondeur : les choses se passent comme si un cran avait t lev, et quun
autre monde apparaissait . Cest que l autre monde voqu na pas la
texture lacunaire et flottante des scnes imagines. Il est ressenti comme trs
rel ; et (vu) avec les yeux ouverts . Ses visions trs puissantes, parfois
effrayantes, charges dun vcu de ralit non moins convaincant que celui de
lexistence quotidienne, crit Shanon, ont eu un effet trs significatif sur [sa]
comprhension de soi, sur [sa] perspective de la vie, et sur [sa] reprsentation
du monde
9
. De telles visions lont dautant plus perturb dans son systme
de croyances antrieures quelles ne semblaient pas individuelles, ni mme
troitement culturelles, mais dans une certaine mesure communes tous ceux
qui prennent cette drogue, indpendamment de leur arrire-plan ethnique et
psychique
10
. Elles pouvaient se prvaloir dune forme forte, pan-
anthropologique, dintersubjectivit. Ds lors, au fur et mesure que ses
expriences se rptent, la qute devient personnelle , et non plus purement
professionnelle. Lauteur a limpression dentrer dans une cole , den
recevoir des leons qui se succdent, qui ne se ressemblent pas, et qui
semblent poursuivre un projet ducatif cohrent spcialement adress lui (y
compris lorsquil nest plus sous lemprise de layahuasca et quil y rflchit
tte repose). Son sentiment est quil se voit invit suivre un cursus
denseignement progressif, dont les contenus ne lui sont transmis quau sein
dune biographie alternative, distincte de la biographie ordinaire du non
drogu quil est habituellement ; une biographie alternative qui acquiert une
rgularit et une logique propres sans cesse renforces, travers la srie
discontinue des consommations de drogue. Le pointill temporel des prises
successives dayahuasca semble surmont et transfigur, dans cette biographie
alternative, en une ligne continue de souvenirs et de projets dont la cohsion
est reconstructrice didentit. Tout se passe, pour Benny Shanon, comme si
deux vies taient vcues en temps partag ; deux vies qui ont chacune leurs
rgles, leur fil conducteur, mais qui sont perues comme demandant tre
rendues cohrentes lune avec lautre. Pour les personnes (comme moi, et
peut-tre vous) nayant pas vcu cette exprience, il peut paratre plausible
que la cohrence requise entre les deux chanes biographiques soit rtablie
travers un compte rendu dtaill des projections psychiques illusoires
quoccasionne lanomalie de la biochimie neuronale induite par la substance
vgtale. Mais pour celui (comme Benny Shanon) qui a suivi ce quil sent tre
lenseignement dune cole de vie ayant mtamorphos en profondeur sa
reprsentation du monde, un tel mode de retour la cohrence par la modalit
standard de partage du rel et de lhallucinatoire nest plus crdible. Car ce
type de partage se contente dappliquer les mthodes de lune des deux
coles frquentes (luniversit) sans tenir compte de la leon de lautre
(la plante bue et lunivers culturel amrindien qui entoure sa consommation) ;
sans tenir compte en particulier de la rpartition non conventionnelle des
vcus de ralit, voire de cohsion logique, qui stendent aux deux squences
biographiques. Ici encore, il ne sagit pas de juger (lattitude
phnomnologique base de suspension du jugement nous aide ici), mais
daffermir notre constat. Le constat est qu un certain moment, aussi solide
que soit lducation scientifique de quelquun, le rapport dvaluation
mutuelle entre deux conceptions du monde et de la conscience relatives des
tats de conscience, squilibre ou sinverse. Vue de lextrieur, ou vue par
une personne qui a pris une seule fois de cette drogue, lexprience vcue
lissue de son absorption est explique dans le cadre dun systme de
reprsentations pralables drives de la vison scientifique du monde. Mais
lorsque la mme personne sest en quelque sorte installe dans lexprience
de conscience altre, lorsque la rptition de cette exprience a cr une
continuit historique alternative, lorsque cette nouvelle continuit sest
intgre et entrelace la continuit historique ordinaire, deux postures
neuves peuvent merger chez elle.
La premire, la plus simple, est une inversion intgrale du rapport de
lexplication et de lexpliqu. Au lieu dexpliquer ltat de conscience altr
par une reprsentation issue de ltat de conscience ordinaire (en invoquant
les modifications biochimiques dans son cerveau), le sujet peut trouver plus
facile dexpliquer ltat de conscience ordinaire par une reprsentation issue
de ltat de conscience altr (par exemple en identifiant lune des puissances
visionnaires perues dans cet tat comme tant celle qui est lorigine de
lattitude scientifique). Cette inversion explicative en traduit une autre qui est
un retournement dtre-au-monde, une dcision de se tenir dans le
prolongement plus ou moins exclusif du fil historique alternatif, et den faire
un nouveau principe de cohrence auquel lensemble des expriences doivent
tre subordonnes, y compris celles qui formaient la base de lancien principe
de cohrence. Or, la vision du monde la plus courante chez ceux qui
sadonnent rgulirement la drogue sud-amricaine, signale Shanon, est
animiste (y compris chez ceux qui navaient pas ces tendances auparavant)
11
,
et cest donc elle qui sert ici de nouvelle base pour une appropriation
intellectuelle de tout ce qui arrive, dans lexprience sans drogue comme sous
drogue.
Lautre posture, plus complexe, dont Benny Shanon semble tre un bon
reprsentant, consiste intgrer les deux points de vue et les deux attitudes en
une reprsentation du monde composite. Elle vise mettre plusieurs ordres de
ralits sur un mme plan et les prendre en charge sur ce plan unique. Au
lieu davoir recours trop vite la dualit ralit-illusion, qui consisterait
tantt considrer comme seuls rels les phnomnes apprhends dans un
tat de conscience ordinaire et rejeter ceux qui surgissent des tats de
conscience altrs dans le domaine dvaloris de lillusion, tantt renverser
ce rapport en prenant pour ralit ce qui se prsente dans un tat de
conscience modifi et comme illusion les croyances de ltat de conscience
ordinaire, la posture composite exige darticuler les divers moments
dexprience, de leur faire nourrir une conception qui serait difficilement
pensable dans chacun des tats de conscience pris isolment. Comme le
montre lvolution personnelle de Benny Shanon, cette posture composite tend
scarter de la conception unilatralement matrialiste-physicaliste de la
conscience, mme si ce nest pas sur le mode simplement animiste de la
conception dialectiquement oppose. Cherchant tablir un nouveau systme
bilatral de pense enveloppant les deux tats de conscience quil a
expriments, se sentant incapable davoir recours aux clichs issus de lun
comme de lautre, Shanon sest rappropri la tradition philosophique en la
transformant conformment son projet. Il a labor une version modernise
de platonisme, consistant attribuer une ralit (et mme une ralit minente)
au domaine des idalits ; ceci prs que, contrairement Platon qui ne
dclarait relles que les formes idales, Shanon pense aussi devoir attribuer
un genre de ralit aux contenus idaux qui se rvlent dans les visions
induites par la drogue et qui affleurent dans le domaine social travers leur
expression dans les mythes
12
. Il conclut partir de l quil est ncessaire de
briser le mur apparent qui spare les ralits dites extrieures et les ralits
dites intrieures pour former un seul domaine dense de ralits prouves
13
.
Ni matrialiste ni animiste, sa vision moniste des tats de conscience est celle
dun univers ontologiquement solidaire fait de manifestations vcues
encadres par des idaux-types, que ceux-ci soient de type physique ou de
type mythique ; elle a quelques affinits avec la philosophie des formes
symboliques de Cassirer, si lon excepte le retour au platonisme que Cassirer
considrait comme un simple moment annonciateur de la philosophie
transcendantale.
Notons que ce processus transformateur des conceptions de la conscience
dans le sillage dun tat de conscience altr na rien de spcifique
layahuasca, et quil se reproduit, bien que de manire module, avec
plusieurs autres drogues. Cest le cas de la psilocybine, substance active
extraite de champignons hallucinognes consomms chez certains peuples
mexicains prcolombiens puis hispaniss. Leffet psychologique de
labsorption dune seule dose de psilocybine a t valu sur une quarantaine
de sujets volontaires, et il sest avr quelle a sur les visions du monde un
effet de trane stendant sur plusieurs mois
14
. Bien des sujets considrent,
linstar de Jill Taylor, que cette exprience est rvlatrice dun aspect crucial
mais habituellement dissimul de la ralit-vcue, sans que lon ait
distinguer ici entre ce qui est rel et ce qui est vcu, puisque lun des rsultats
le plus communment rapports est prcisment la perte des limites entre le
connaissant et le connu. Cet aspect retrouv de la ralit tait, il est vrai,
frquemment revtu dun habit mythologique, conformment la thse des
formes symboliques ; mais le plus important aux yeux des sujets recruts,
comme pour leur entourage, est que sa reconnaissance a permis une rsolution
de conflits et de peurs enracines, brusquement dsactivs par cet aperu
prsum sur une face cache de ce qui se donne. Dautres drogues
chimiquement voisines sont dailleurs employes dans cet usage spcifique,
celui dun auxiliaire la cure psychothrapique, voire la cure de
dsintoxication dautres drogues
15
. Quil en soit ainsi suggre quavoir une
exprience ayant pour rsultat une refonte de la mtaphysique vhiculaire na
pas obligatoirement un effet addictif ; parfois, cest exactement le contraire
qui se passe, ds lors que la reconfiguration de ltre-au-monde qui en
dcoule contribue rendre au sujet une assise suffisamment ferme pour ne
plus avoir rechercher des diversions dans livresse.
Il est utile de se pencher prsent sur un autre cas galement troublant, o
la dpendance de la conception de la conscience lgard de ltat de
conscience du concepteur est seulement temporaire. Car ce cas-l comporte
une leon ambigu, et il peut donc servir de terrain de mise lpreuve pour
la thse dauto-rfrentialit des questions sur la conscience. Dans quelques-
uns de ses livres et de ses articles
16
, Susan Blackmore raconte quelle a vcu
une exprience de sortie hors de son corps
17
sous leffet dun tat de mort
imminente lorsquelle tait jeune, et que cela a occasionn un basculement
brutal de son systme de croyances. Cette exprience assez bouleversante
lavait lpoque pousse croire que lesprit existe indpendamment du
corps, et entreprendre des recherches parapsychologiques dans le sillage de
cette conception. Une telle squence dvnements, de convictions et de
projets corrobore, en premire analyse, la connexion des croyances sur la
conscience avec lhistoire des tats de conscience de ceux qui les
entretiennent. Mais la suite de la biographie de Susan Blackmore semble pour
sa part affaiblir, voire infirmer, ce lien. Elle signale en effet quaprs de
nombreuses tentatives infructueuses de mettre en vidence des effets para-
normaux comme la psychokinse, la prcognition, ou la tlpathie, elle a
abandonn sa qute tout en revenant des positions philosophiques et
scientifiques plus courantes (apparemment proches du physicalisme
dominant). Quelque chose, pourtant, dans luvre de Susan Blackmore, nous
met la puce loreille et nous empche dtre entirement tenus par cette
conclusion ngative. La palette largie de conceptions et de sources
dinformation que cet auteur mobilise dans ses recherches sur la conscience
est trs diffrente de celle dun psychologue ou dun neurologue standard, qui
sen tiendrait aux techniques de sa discipline ou aux arguments informs par
elle. Le livre de Blackmore sur la conscience traite de neurologie et de
psychologie, certes, mais aussi de philosophie analytique, de philosophie
phnomnologique, de thorie de lvolution, de robotique, de rflexions sur
limaginaire et sur le paranormal, dtudes sur le sommeil et lhypnose, de
rcits sur les Expriences de Mort Imminente , danalyses sur
lintrospection et sur la mditation. Cette richesse, pour ne pas dire ce
foisonnement, tmoigne de ce que Susan Blackmore continue tre marque
par son exprience initiale, non pas certes dans ses croyances, mais dans sa
mthode et dans son ouverture desprit. Pour elle, lenqute sur la conscience
nest pas simplement intressante ou professionnellement motive : elle est
primordiale, imprieuse, en raison de son rapport troit avec un vnement
vcu qui fait abyssalement question ; et elle justifie donc de mettre en jeu
toutes les ressources de la connaissance subjective aussi bien quobjective, de
la phnomnologie
18
comme de la physiologie. Cest peut-tre cela qui est
vraiment signifiant pour les conceptions de la conscience : les attitudes, les
sentiments durgence, leur continuit existentielle avec les tats ordinaires ou
modifis de conscience, plutt que les doctrines susceptibles den tre
(aventureusement) infres. Lintrt passager de Susan Blackmore pour la
parapsychologie apparat donc rtrospectivement moins important que nous ne
lavions cru au dpart. Cette foi parapsychologique transitoire se comprend
ngativement comme rien dautre quune tentative maladroite dinvestir de
respectabilit pseudo-rationnelle, cest--dire dune forme de crance imitant
celles qui relvent de ltat de conscience normal , quelque chose qui
relve dun tout autre tat de conscience et ne devrait donc pas se voir
imposer des lois qui lui sont trangres. On pourrait dire, en inflchissant une
expression de Gilbert Ryle
19
, que Susan Blackmore a commis, pendant sa
phase parapsychologique, une erreur de mta-catgorisation (une erreur
consistant transcrire en doctrine ce qui relve du prsuppos vcu des
laborations doctrinales). Et elle aurait ultrieurement commis une seconde
erreur de mta-catgorisation, en sens inverse, si elle avait essay de donner
lexclusivit une explication neurologique de ltat de conscience modifi.
Mais, lors de sa phase de retour une vision culturellement normale du
monde et de lesprit, elle nest justement pas tombe dans ce travers
simplificateur oppos. Elle a prfr conduire une investigation polymorphe
qui laisse deviner, derrire chacune des approches mises en jeu, la possibilit
de la conduire partir dun tat de conscience diffrent ; et elle a ainsi laiss
affleurer la flexibilit mentale que lui a confr sa familiarit avec plus dun
tat de conscience.
Quelles leons pistmologiques peut-on tirer de ces exemples, et du
constat corrlatif de dpendance des conceptions ou des approches de la
conscience lgard de ltat de conscience de qui les entretient ? Pour tenter
de rpondre cette question, une premire piste a t propose dans larticle,
dj voqu, qui traite du refus des conceptions biologiques standard de la
conscience, voire de la biologie tout court, par de nombreux tudiants
californiens de la gnration baba-cool
20
. La piste, ouvertement
relativiste, consiste recommander le dveloppement dune pluralit de
sciences spcifiques un tat de conscience . Cette conclusion a
cependant desservi larticle, parce quelle a vite abouti une impasse. Les
sciences locales espres nont pas vraiment vu le jour, et ce qui en tient
lieu sapparente plutt un magma de spculations dnues de consistance et
de srieux. Les dtracteurs dune approche pluraliste du problme de la
conscience se sont empresss den tirer argument pour revenir une attitude
directive et rigide qui nest sans doute autre que celle de la fondation de la
connaissance scientifique elle-mme : tous les tats de conscience alternatifs
sont pathologiques ; ils sont explicables comme dviations du fonctionnement
du cerveau par rapport son point dquilibre homostatique ; par suite, seuls
doivent se voir permettre davancer une thorie de la conscience ou den
discuter ceux qui sont et restent dans un tat ordinaire de conscience garanti
par un substrat neurophysiologique non perturb. Lobjection peut satisfaire
provisoirement, parce quelle permet un certain confort de la pense, et
quelle donne une forme moderne et naturalise la prsupposition latente de
toute connaissance objective, savoir que seuls sont habilits y mettre des
thses ceux qui nont pas perdu la raison, ceux qui se plient aux canons
supposs uniques de lintelligence, ceux qui habitent en permanence la
demeure des Lumires. Mais on peut aussi se sentir troubl par le fait quen
raison de cette forme, justement, lobjection opre comme une prvision auto-
ralisante.
Comment, en effet, dfinir ltat de conscience ordinaire requis pour la
formulation de jugements valides, tout particulirement de jugements valides
propos de la conscience ? Si nous dclarons, comme cela est impliqu par
lobjection, que ltat de conscience ordinaire est celui dans lequel les
paramtres biochimiques, anatomiques et lectrophysiologiques du systme
nerveux restent lintrieur dune gamme spcifie autour de la moyenne
constate dans une large population dindividus, nous prjugeons de ce que
nous voulons prouver, savoir que les questions portant sur la conscience
sont forcment subordonnes des donnes physiques, et particulirement
neurologiques. Autant affirmer dentre de jeu que les tats pistmiquement
acceptables de la conscience sont ceux o une thorie
matrialiste/physicaliste de la conscience est apte emporter la conviction.
Pour viter ce genre de ptition de principe, nous devons trouver une
dfinition extra-neurologique de ltat souhaitable de la conscience, une
dfinition autonome vis--vis des sciences physico-physiologiques. Or, cette
dfinition alternative, nous le savons, ne peut tre que normative ; elle est
prescriptive plutt que descriptive ; elle sexprime en termes de devoir-tre
plutt que dtre. Pour que ltat de conscience de quelquun soit
pistmiquement accrdit, il faut que ce quelquun se plie certaines rgles ;
rgles de vie, rgles dhygine, rgles dexercice de ses facults mentales,
rgles de soumission de ses paroles et de ses comportements des
conventions de la communication sociale et de linfrence argumentative. De
fait, cest exactement ainsi, et non pas sur le mode naturaliste, que fonctionne
traditionnellement le processus de guidage des chercheurs vers ltat de
conscience souhait. Adopter ltat de conscience slectif, discriminant,
intentionnel, distanci et systmatiquement valuatif qui permet le travail
scientifique relve de la norme dans notre culture. Cela relve mme de la
rgle de biensance dans certains contextes de dialogue. Il suffit de penser
laccueil condescendant rserv par bien des mdecins aux explications
syncrtistes que donnent parfois leurs patients, et surtout leurs patientes
21
, de
leurs propres maladies, pour voir cette rgle luvre au quotidien. Mais le
caractre ncessairement normatif de la dfinition de ltat de conscience
crdible ne va pas sans de srieuses consquences pour le genre de thse sur
la conscience qui dpend de lui.
De mme quon navait pas limpression de renoncer quelque chose du
seul fait dutiliser un langage signifiant, on na pas limpression de renoncer
quoi que ce soit du seul fait dadopter systmatiquement ltat de conscience
normal, de type naturel -intentionnel. Et pourtant, cest bien le cas, quel
que soit notre avis sur la valeur pratique, pistmique, ou sociale de ce
renoncement. Hraclite est lauteur de la premire version formule de ce
genre de prescription, et il lui donne une forme dimpratif catgorique ;
limpratif de rpudier les facilits de lidiosyncrasie et du plein dploiement
allgorique des vcus personnels ; limpratif demprunter en lieu et place de
cela la voie troite de ce qui se partage, de ce qui peut se mettre en commun et
constituer un patrimoine collectif fait dun langage circonstanci exprimant
une pense contrle : Il faut suivre ce qui est [commun tous]. Mais bien
que le Logos soit commun, la plupart vivent comme avec une pense en
propre
22
. Autrement dit, le Logos est dj une contrainte, dj un
renoncement, dj une mise en forme commune de la pense. Mais cette
contrainte est insuffisante, car elle peut encore porter dans sa matrice assez
souple de grandes possibilits dcarts, comme lexpression des jugements de
got, des rves, des univers potiques, ou des aperus mythologiques.
Limpratif de se plier au commun impose alors un renoncement dordre
suprieur qui vient encore restreindre le champ des possibilits par rapport
lusage inattentif du Logos, et qui aboutit aux grandes ralisations du genre
humain comme les sciences ou larchitecture. En rsum, sinscrire dans la
norme de conscience intentionnelle revient sauto-limiter, dans un but de
canalisation des efforts collectifs.
Sapercevoir ainsi que ltat de conscience accrdit pour le jugement
pistmique est le fruit dune restriction consentie ouvre des possibilits
neuves pour la rflexion. Cela incite recueillir un enseignement positif de
quelques tats de conscience alternatifs, au lieu de les traiter simplement
comme des repoussoirs. Sous ce constat, ce qui sprouve dans les tats de
conscience modifis nest pas simplement assimilable lillusion en tant
quoppose la ralit, mais quelque chose dautre qui na pas encore t
rejet hors du cercle dauto-limitation au sein duquel se dfinit la ligne de
partage entre illusion et ralit. Il ne faut pas oublier en effet que
lemplacement du clivage illusion-ralit dcoule de la norme
restrictive mme partir de laquelle sest constitu ltat de conscience
standard qui le pose ; quil dnote un mode de rpartition interne cet tat de
conscience standard, et demeure donc inapte prendre en charge ce qui
scarte vraiment de lui ; quil est le mode principal par lequel sinstaure
lauto-limitation normative, et ne saurait de ce fait qualifier de manire neutre
ce qui a t laiss demble lextrieur de cette limite. Au lieu de les
marquer du sceau de lexclusion, ou linverse de les riger en autant de
vrits relatives (ce qui reviendrait prononcer autant de sentences internes
dexclusion que de vrits affirmes), lattitude adopter face aux tats de
conscience non standard consiste ds lors les voir comme autant
dexpressions de lexcs de richesse de ltre indtermin, encore indompt
par la mthode dun avoir pistmique commun. Tout, dans ce foisonnement
pr-normatif, reste pensable, et pas seulement ce que notre hritage culturel
nous enjoint de penser. Tout reste pensable, y compris lorigine de la pense,
et lorigine de la culture qui sest difie sur la mise lcart de cet excs du
pensable. Dans le bouillonnement pr-normatif dont les tats de conscience
modifis constituent autant daperus, mme le choix normatif initial sur
lequel repose notre science demeure perceptible en tant que tel, au lieu de
demeurer enfoui sous les couches de lindiscutable et du quasi-tabou. Mais
pour nous mettre en mesure dlargir ainsi le regard au-del des normes
apprises, il faut auparavant identifier ce qui, dans notre pass, y a fait
obstacle.
Lhistoire de la philosophie, nous y avons dj fait allusion, est pleine de
la lgende dorigine dune connaissance discipline qui se construit sur la
base de lexclusion de ses autres rebelles
23
: la folie, le songe drgl,
limagination, lbrit, et la perspective singulire de lapproche de la mort.
Cette connaissance, selon Nietzsche
24
, est apollinienne plutt que
dionysiaque ; elle nat de la dfaite de lmotivit charnelle et fusionnelle
reprsente par Dionysos face la clart rationnelle et distanciatrice
rpandue par Apollon. Pourtant, certains moments de lhistoire, deux failles
se manifestent dans la mcanique dviction : le dionysiaque sert de ferment
lapollinien, et lapollinien, mme accompli, ne parvient pas touffer
compltement le dionysiaque qui le sous-tend. Dune part, nous le savons, le
rve et limagination agissent comme le terreau productif des renouveaux de
la connaissance scientifique ; livresse peut tre une respiration et une invite
au renouveau pour la recherche ; la folie, sur jumelle du gnie
25
, est son
envers toujours imminent ( la manire dont le chaos est lenvers toujours
proche de la vie, qui progresse en funambule sa lisire
26
) ; et lhorizon
indtermin de la mort oblige le chercheur raliser sa finitude, exigeant de
lui des synthses unificatrices et des raccourcis de la pense (ce quon
appelle la compression algorithmique en thorie de linformation).
Dautre part, linverse, la richesse dexprience, qui a d tre bannie pour
permettre la connaissance objective de stablir, devient difficile ignorer
lorsquil sagit de mettre au jour le soubassement gnrateur de lobjectivit.
Mme si nous nprouvons aucun dsir de la regarder en face, mme si nous
redoutons de nous confronter son travail dengendrement, linquitude
sourde que nous ressentons, en tant que personne et en tant que civilisation,
face un possible retour du refoul quest un vcu polymorphe dans lequel
aucun tri na t fait, serait un motif suffisant de sauter le pas et de lexplorer
avec mthode avant quil ne simpose sans mnagement.
Descartes, avant Husserl qui en a perfectionn et affin lhritage
revendiqu, a eu ce courage de la radicalit, cette audace de ne pas ignorer le
sous-sol dionysiaque des savoirs. Cest ce qui lui a permis dexprimer de
manire dcisive la fois lacte de naissance de la science par exclusion, et
le dsir de remonter sa source qui exige de suspendre lexclusion et de se
laisser aller au moins une fois dans sa vie la plus entire ouverture desprit.
Relisons nouveau la premire mditation mtaphysique, dans une
fascination accepte jusquau ressassement. Aprs tout, sa dmarche
audacieuse exige loisir et tranquillit
27
pour tre amorce, et au moins
quelques semaines
28
de rumination pour produire son effet transformateur.
Descartes commence par faire comme sil reprenait son compte le procd
consistant rejeter, titre de prsuppos ncessaire de la connaissance, les
tats altrs de la conscience. Il dclare admettre quen dpit de la capacit
reconnue quont les sens de nous tromper parfois, aucun dentre nous ne peut
douter de certains faits vidents comme celui que ces mains et ce corps-ci
sont moi
29
. Quelques-uns en doutent, mais ce sont des insenss , des
fous , ce qui sous-entend quil faut se garder de faire comme eux. Cette
tape introductive consistant dfinir, par contraste avec ce qui nest pas lui,
ltat de conscience droit, seul propre assurer le dveloppement de la
connaissance, est cependant vite dpasse. Descartes ne veut pas sarrter
cette facilit habituelle. Au lieu de cela, il amplifie rapidement la perplexit
du non-savoir, par vagues de plus en plus dvastatrices
30
. La premire vague
de perplexit que Descartes fait dferler vient de la considration du sommeil
et du rve. Aprs tout, remarque-t-il, les reprsentations qui surgissent en nous
dans les rves ne sont gure moins fantastiques que celle des insenss dont
nous voulions initialement nous distinguer. Et pourtant, elles sont souvent
affectes dun sentiment de ralit qui nest gure loign de celles de ltat
de veille ; le mme vcu de ralit que Benny Shanon prouvait lgard des
visions engendres par la consommation dayahuasca. Le sentiment-de-ralit
ne garantissant ainsi aucune ralit, comment lui ferions-nous confiance ? Il
est vrai quil reste, signale Descartes, un domaine de connaissance qui ne
semble pas dpendre du changement dtat de conscience allant du rve la
vigilance : cest celui des vrits mathmatiques
31
. Mais la seconde vague de
perplexit vient vite recouvrir ce dernier roc de certitude. Dieu, ou plutt un
malin gnie, pourrait aprs tout nous tromper sur toutes nos croyances ; il
pourrait nous avoir ancrs dans un tat de conscience qui rend lerreur
systmatique. partir de l, une conclusion dltre simpose : De toutes
les opinions que javais autrefois reues en ma crance pour vritables, il ny
en a pas une dont je ne puisse maintenant douter [] de sorte quil est
ncessaire que jarrte et suspende dsormais mon jugement sur ces
penses
32
. L poch, la suspension du jugement, est ici le fruit dun acte de
lucidit vertigineux, par lequel nous nous rendons compte que rien ne garantit
que ltat de conscience normatif, celui de la vigilance, de lattention, et
mme de lexercice rgl de la raison, soit intrinsquement propre nous
fournir une connaissance assure. Nous voudrions sans cesse chapper cette
lucidit, en revenant aux automatismes hrits, mais nous devons rsister la
tentation de lapparente scurit du familier. Car si nous procdions malgr
tous les avertissements ce retour dans les convictions paresseuses de la vie
quotidienne, nous serions comparables un esclave qui jouissait dans le
sommeil dune libert imaginaire , et craint dtre rveill lorsquil
commence souponner que sa libert nest quun songe
33
. Le parfait
veil cartsien ne consiste donc pas revenir dans lornire rassurante de
notre tat naturel de conscience, mais au contraire savoir demeurer
fermement, du moins un temps suffisant pour en saisir les consquences, dans
un tat de conscience plus vaste, un tat de suspension universelle, qui les
contient tous en puissance et vite de dcider par avance lequel est apte
nous faire dcouvrir la vrit. Cest uniquement condition davoir eu cette
patience et ce courage cartsiens de la dsorientation quon finit par dcouvrir
dans un mutisme stupfait que ltat de suspension, damplification, de la
conscience la reconduit elle-mme en tant quultime domaine dvidence
absolue. Seule la nescience pleinement accepte est apte nous conduire un
savoir inbranlable, parce que la carence la plus abyssale sy dcouvre du
mme coup tre la certitude la plus profonde, parce que sy produit ce que
nous avons appel le choc productif de laffirmer et du nier : je, pensant ne
suis pas , suis. La conscience se dcouvre alors comme non oppose quoi
que ce soit dautre, si ce nest (de manire factice) ses propres contenus,
projections, souvenirs, et allgations dauto-limitation. Il aurait t impossible
de faire cette dcouverte si lon tait rest, par habitude ducative ou par
valorisation culturelle, dans ltat naturel et scientifique de conscience qui
nous sert de convention pour communiquer avec nos semblables. Car, dans ce
dernier tat, la certitude naurait pu tre cherche quailleurs, et la conscience
serait reste hypnotise, pas aprs pas de la recherche indfinie de cet
ailleurs, par quelque horizon futur de lintelligence collective. Elle naurait en
aucun cas pu se trouver elle-mme, tant elle se serait transperce de manire
inattentive la poursuite dobjets communs. Comme lcrit Husserl, [si] je
veux effectuer, en tant que philosophe mditant sur le commencement, une
critique universelle de lexprience du monde, je ne puis le faire dans
lattitude communicative dans laquelle je prsupposais lexistence relle ou
[] possible [] des hommes. Car ce faisant, jaurais dj prsuppos
quelque chose qui est lui-mme en question
34
. Sans changement dtat de
conscience, de ltat naturel et scientifique vers ltat de doute hyperbolique
cartsien, ou vers ltat plus radical et plus englobant encore de la rduction
transcendantale introduite par lpoch, la pense continuerait tourner dans
la cage des prsuppositions mmes qui lui permettent doprer.
La conscience, la conscience pure dirait Husserl, savre tre le lieu
de tous les renversements de perspective, parce quelle est comme la rtine
universelle laquelle est reconduite la vision de nimporte quelle
perspective. Changer de point de vue sur la conscience suppose de sinscrire
dans une autre configuration de conscience ; tout autant que subir
involontairement une brusque altration de ltat de conscience peut induire un
profond changement de point de vue sur la conscience. Mais aprs tout,
pourquoi la dcouverte que la conception que nous entretenons de la
conscience dpend de ltat de cette conscience est-elle plus vertigineuse que
dautres constats analogues portant sur nos corps ? Pourquoi par exemple
semble-t-elle plus vertigineuse que la dcouverte selon laquelle la croyance
en la capacit de notre corps voler malgr son absence dailes dpend de
notre tat de conscience (tant il est vrai quil nous arrive parfois de voler en
rve) ?
Examinons de plus prs ce dernier cas. Le corps peut tre peru comme
pesant dans ltat vigile, et inexplicablement lger dans certains tats
oniriques. Nous ne nous laissons pas troubler par ce fait, mais cherchons
plutt extraire de lensemble de nos expriences une image du corps la
fois cohrente, rgle, et constante ; une image qui transcende les positions
perues et les tats vcus. Nous appelons cela avoir une reprsentation
objective de notre corps. Comment faisons-nous pour y arriver ? Notre
procd consiste slectionner ceux des aspects qui se laissent coordonner
selon des lois valant pour tous les points de vue spatiaux, et, si ce nest pour
tous les tats de conscience, au moins pour celui dentre eux qui parvient les
nouer en une connaissance structure unique. Les autres aspects, les autres
expriences, celles quon ne parvient pas rassembler dans ce noyau minimal
de structure invariante, celles qui ne sont pas passes travers le crible lgal,
sont laisses de ct, et ranges dans le vaste dpt des variations
subjectives. Ds que nous sommes parvenus faire ce tri, tout bascule
subtilement, et nous regardons les phnomnes de manire diffrente. Chacun
dentre eux est en quelque sorte teint de la couleur qui lui a t assigne
lissue de la procdure de criblage. Puisque la rgle universelle extraite
laide des principes de lentendement pur nonce limpossibilit dans laquelle
se trouve mon corps de voler spontanment, lexprience de ce corps pesant
se trouve en permanence marque au poinon du rel, tandis que lexprience
que jai parfois de mon propre corps volant est a posteriori colore de la
nuance de lhallucinatoire (mme si elle tait ressentie comme allant de soi
dans lambiance fantasmagorique du rve). Ici encore, ce qui a t mis en
uvre est la dualisation de la ralit et des apparences. Que certains tats
de conscience me laissent apparatre comme capable de voler na gure
dimportance dans ce cadre, partir du moment o lon admet quil ne sagit
justement que dune pure apparition.
Tout change lorsquon sintresse la conscience elle-mme, et non pas
lun quelconque de ses objets de vise intentionnelle (y compris le corps-
objet). Car, crit John Searle, [l] o il est question de la conscience,
lexistence de lapparence est la ralit
35
. Ou encore, comme le propose
Husserl
36
avec les ressources de lallemand, la conscience relve du reell
mme si elle nest pas real (cest--dire quelle est minemment prsence,
mme si elle na pas le mode dtre-prsent de la res). La particularit unique
de la conscience primaire est de ne rien exclure de lapparatre, mais de lui
tre coextensive. Aucun criblage ne peut seffectuer dans lexprience pour
accder ce quelle est par-del ses faux-semblants, parce quelle enveloppe
dans les vastes rets de sa puissance dauto-manifestation : ses variations, ses
chappes, ses fantasmes, ses tats aussi altrs quon peut se le figurer. Un
tri selon des rgles de partage ne lobjectiverait pas ; il ne ferait que la
mutiler dune immense fraction de son tre protiforme. Ds lors, la leon
daucun tat de la conscience ne saurait tre ignore lorsquil sagit de la
connatre et de la comprendre ; nul tat de la conscience nest demble
disqualifiable dans son travail dauto-rflexion ; nul autre tat de la
conscience ne peut sarroger de priorit mthodologique, et encore moins
ontologique, quand il sagit de lapprhender. Que notre conception de la
conscience dpende de notre tat de conscience se confirme tre un vrai
problme ; non pas un problme discursif ordinaire valant pour et dans ltat
de conscience particulier qui se donne pour seul habilit objectiver,
problmatiser, et raisonner ; mais un problme de nature existentielle qui na
peut-tre de chance de se rsoudre que par et dans un tat de conscience assez
vaste pour contenir en germe tous les autres.
Ce qui se devine travers cette discussion est quil y a bien un trait
distinctif du problme de la conscience qui le rend intrinsquement sensible
un fait dauto-rfrentialit, ou plutt dauto-implication du problmatis dans
le problmatisant. Le trait critique, cest lexhaustivit de la conscience, son
caractre programmatiquement omni-englobant, son insparabilit
wittgensteinienne davec le monde-totalit (qui est gnralement appel son
monde ; mais on ne le nomme ainsi bon escient qu partir de ltat de
conscience neutre de qui a cherch se mettre distance dun monde
objectiv par le jeu de ses propres variations intellectuelles). La division
ralit-illusion avait pour but de situer chaque rflexion ou chaque thorie
dans le fragment du paysage de connaissance que donne voir une perspective
partielle et slective, de les placer du bon ct de ce clivage aprs avoir
exclu une partie de ce qui arrive, et de dfinir ainsi des critres de validit
thorique par un jeu de contrastes. Mais si aucune ligne de dmarcation de ce
type nest tablie, si aucune exclusion nest prononce, si chaque apparence
fait partie de la ralit quil sagit daffronter, comment dsigner un critre de
validit pour les conceptions de la conscience ?
Une analogie avec le problme de la rfutabilit au sens de Popper peut
nous aider comprendre ce qui est en jeu ici. Popper accuse, on le sait, la
psychanalyse freudienne dtre irrfutable, et donc non scientifique en vertu
de la clause de scientificit quil a lui-mme nonce. Mais pourquoi au juste
souponne-t-il la psychanalyse dtre irrfutable ? Parce quelle se veut une
thorie exhaustive de la psych et donc des conduites humaines. Lorsque
quelquun avance un argument contre la psychanalyse, sa prise de position
tombe comme toutes les autres dans la circonscription des conduites
psychanalytiquement explicables. Or, lexplication, inspire de la manire
dont Freud valuait les ractions de rejet des socits bourgeoises vis--vis
de ses thories les plus provocatrices, ne peut tre en gros que celle-ci : si ce
quelquun critique le freudisme, cest quil se sent menac par ce quune cure
risquerait de lui rvler au sujet de ses propres refoulements, ou des conflits
internes entre ses plus basses pulsions et ses normes morales ; cette crainte est
le vrai motif, latent, qui le fait argumenter contre la psychanalyse en gnral,
tandis que les raisons manifestes quil avance lappui de sa critique ne sont
quun rideau de fume derrire lequel il abrite son inquitude de dvoilement.
travers ce genre dexplication, chaque tentative de rfutation se voit
immdiatement retourne en preuve supplmentaire du bien-fond de la
psychanalyse.
Sil en va ainsi, si la psychanalyse est tel point auto-justificatrice, ce
nest donc pas en raison dun quelconque dfaut qui devrait lui tre reproch,
mais seulement de son projet anthropologiquement totalisant. Au fond,
nimporte quelle thorie se prtendant complte, nimporte quelle authentique
thorie du Tout serait atteinte de la mme dmesure. Car si une thorie
traitait vraiment de tout, elle devrait entre autres pouvoir rendre raison de la
procdure de sa propre rfutation, et la rfuter reviendrait du mme coup la
corroborer.
Il ne faudrait pas pour autant prendre trop au srieux la capacit dauto-
prservation de ces systmes prtention exhaustive. Dans le cas dune
prtendue thorie du Tout comme dans le cas de la psychanalyse, la
compltude nest que de faade, ce qui rend possible, non pas certes den
proposer une rfutation directe et dcisive, mais de pouvoir tre tmoin dun
progressif dsinvestissement historique du crdit qui lui est accord. La
psychanalyse enveloppe la fois un arrire-plan thorique, une rgulation de
la scne thrapeutique et une offre de reprsentation des rapports humains.
Elle na cependant quun pouvoir de mise en forme indirect et incomplet sur la
vie concrte de la plupart des individus, et ceux-ci peuvent donc chapper
ses catgories, en ne les percevant plus ni comme pertinentes sur le plan
explicatif ni comme menaantes par leur pouvoir dvoilant, mais simplement
comme partielles, voire comme caduques lorsquelles manquent de capacit
rendre raison de leurs nouveaux modes dexister. Les personnes et les
collectivits sortent alors de la sphre dinterprtation de la psychanalyse non
pas en raison dun argument dcisif, mais parce que leurs formes de vie se
sont progressivement rorganises en dehors du filet normatif pos par cette
discipline. De manire un peu analogue, la thorie du Tout rve par les
physiciens (et plus gnralement par des spcialistes des sciences de la
nature) ne traite de tout que dans le cadre de ce quelle (ou la tradition
scientifique dans laquelle elle sinscrit) a prsuppos comme types dobjets
pertinents et comme limites tacites de linvestigation. Il se peut dans ces
conditions que la thorie du Tout prsume soit progressivement
dsinvestie, que son paradigme devienne caduc, non pas en raison dune
exprience cruciale ngative, mais dune accumulation danomalies et de
contraintes qui conduisent faire clater son cadre de prsuppositions et
installer la recherche dans un nouveau paradigme au sens de Kuhn.
Le caractre totalisant de lexprience, de la conscience primaire, est
semblable celui des deux genres de constructions interprtatives qui
viennent dtre voqus, mais il savre beaucoup plus radical queux. La
conscience relve dune sorte de totalit qui englobe les deux prcdentes,
pour ne pas dire chaque totalit concevable. Ainsi, nous avons signal que la
part dobscurit ou de cohrence exhume de ce qui se vit et de ce qui sagit,
dont la psychanalyse rend raison en invoquant linconscient, se donne en fait
comme lun des horizons dauto-dcouverte de la conscience, ou comme lun
de ses espaces dauto-transformation. Ainsi encore, la thorie du Tout
allgue reste tributaire de la conscience et la manque du mme coup,
puisquelle ne pourrait au mieux que dcrire ou prdire tous les phnomnes
en avanant leurs structures lgales, sans pouvoir traiter le fait de la
phnomnalit autrement que comme sa prcondition indiscute. Par contraste,
rien nest manqu par la conscience, rien ne sort vraiment de la
circonscription de lexprience ; ce qui est peru comme extrieur elle en
fait partie dans la mesure mme o il y a perception ; ce qui est ressenti
comme lui ayant chapp retourne elle de ce seul fait. Mme les carts de la
conscience vis--vis de sa propre norme de conduite en sont autant de phases
constitutives. Les apprhensions visionnaires, opiodes, oniriques,
hallucinatoires, voire psychotiques de la conscience par elle-mme demeurent
autant de guises de ce quelle est. Plus aigu encore que la conscience, cest le
moment de conscience qui savre total, ft-il total sur le mode de la
mmoire, de la chimre, de la prospective, ou de la finitude auto-reconnue ; et
le tout quil reprsente inclut galement la multiplicit des modes possibles de
son auto-valuation. Il ny a, pour rcapituler, aucun terrain de manuvre
disponible, aucun espace dchappe vis--vis de la conscience, aucun
ailleurs partir duquel il serait possible de la remettre globalement en cause.
Les modes dapprhension thorique de la conscience ne sauraient tre que
fragmentaires par rapport elle dans son entiret absolue, et il sensuit que
le seul critre de choix entre ces modes (par exemple, entre le mode
physicaliste et le mode phnomnologique) est intrieur elle, et dordre
pratique. Le choix dun angle dauto-apprhension dpend des intrts de la
personne ou de la communaut qui lentretient, et ces intrts sont leur tour
conditionns par un tat de conscience pris comme norme. Aucun tat de
conscience nen rfute aucun autre, mais contribue avec lui dployer les
luxuriances dmesures de ltre-conscient. Quant au jeu de renvoi de la
rfutation la corroboration, qui caractrise tous les cadres exhaustifs, il
devient si parfaitement incontournable dans le cas de la totalit sans
chappatoire dont la conscience est linstanciation la plus pure quil en
acquiert la fermet dun absolu : celui qui a t identifi dans la pratique
vcue du doute-certitude cartsien.
Cela nous conduit analyser plus prcisment, et surtout plus
empiriquement quauparavant, la dimension sociale du caractre auto-
rfrentiel des questions sur la conscience. Ici, les effets de lauto-rfrence
se manifestent par la rverbration des prjugs culturels sur ltre-au-monde
des personnes participant de cette culture ; par la projection des dcrets
collectifs dacceptation/exclusion des tats de conscience sur lauto-
perception de la psych de chacun comme normale ou pathologique ; et par la
reconfiguration des nosographies et des tiologies
37
cliniques mesure quun
certain tat de conscience (dans notre civilisation, ltat de conscience
naturel et naturalisant) progresse dans sa revendication dexclusivit
lgard de tout ce qui sexpose la lumire publique.
Tout dabord, il nest pas anodin pour la vie sociale que les prrogatives
de ltat de conscience intentionnel-objectivant stendent sans cesse
davantage, au point de lui subordonner les codes mmes de la relation entre le
mdecin et son malade. Cette norme invasive contraint le discours durant la
consultation, et somme le patient de changer sa propre faon dtre pour se
mettre en permanence en mesure de rpondre au cadre lgifrant que lui
impose son thrapeute. Pierre-Henri Castel
38
en donne plusieurs exemples
frlant le burlesque, comme celui dun certain patient qui un ami demandait
un jour ce qui le dprimait dans sa vie actuelle. Celui-ci, bien duqu par ses
mdecins et conditionn par un certain contexte culturel, rpondait que
ctait un manque de srotonine dans son organisme
39
. Sa conception de
lui-mme, comme celle de bien des patients contemporains, se formulait en
troisime personne plutt quen premire personne parce que ctait un moyen
de soffrir demble, sans mdiation, au regard objectivant de son thrapeute,
et aussi probablement parce que les mots de la premire personne en taient
venus lui manquer, ayant t subrepticement frapps dobsolescence par la
prvalence sociale de ce regard. Dsormais, les thories objectives de la
maladie mentale ne cherchent pas seulement les expliquer ; elles cherchent
transformer les patients de manire quils acceptent sans effort ces
explications comme leurs
40
; et elles entreprennent de dsactiver des pans
entiers du lexique des langues afin de les reforger leur image. Ce travail de
sape des tres-au-monde et de leur logos expressif est li par une boucle de
rtro-action aux types doutils thrapeutiques privilgis par la pratique
mdicale, et son uvre de redfinition des pathologies. La dpression a
remplac la fois les tristesses, les mlancolies profondes, les acdies
monastiques, les ruminations sur la mort, les hontes, les deuils, les
culpabilits, les spleens rveurs, les jugements ngatifs sur soi, et les
traverses du dsert ouvrant un nouveau projet de vie, parce que tous ces
tats numrs rpondent plus ou moins bien au traitement par les
antidpresseurs tricycliques et par quelques autres molcules inhibitrices
de la recapture des neurotransmetteurs. Rciproquement, les patients sont
encourags adopter le langage strotyp des symptmes de la dpression
(idation ralentie, mauvais sommeil en fin de nuit, sentiment de
dvalorisation, difficult se projeter dans lavenir, etc.) afin dtre
facilement dchiffrs dans leur pathologie par leur mdecin et de bnficier
sans dlai dune reconnaissance institutionnelle. Les mots de lexistence
perdent leur force et leur pertinence sociale, pour le simple motif quils ne se
laissent pas absorber par lattracteur de lagir thrapeutique, dans son geste
majeur consistant prescrire une molcule. Puis, ces mots tant devenus
caducs, cest le vcu mme des patients qui se transforme, se focalisant sur
des tats ou des causes, et laissant en friche le terrain du sens et des raisons.
Il y a un paradoxe, et une autre boucle de rtro-action ngative, dans cette
invocation de la vrit scientifique contre les fictions de la sagesse commune,
du fait brut attest contre lintention peut-tre chimrique. On met en avant la
solidit de lidentification objective des causes face la variabilit de
lexpos subjectif des raisons ; soit. Mais ne perd-on pas ainsi de vue que le
choix mme de focaliser lintrt sur le fait plutt que sur lintention, sur les
dterminants plutt que sur les projets, sur les vrits plutt que sur les
valeurs, est lui-mme une valeur, quil sest initialement prvalu de raisons, et
quil a satisfait un faisceau dintentions progressivement partages ? Sil en
va ainsi, la nouvelle thorisation hgmonique des pathologies mentales
base de neurologie, de sciences cognitives, et plus gnralement de projet de
naturalisation universelle, na rien dun regard extrieur ce quelle
dcrit : elle se pose elle-mme comme une norme tendant se substituer des
normes concurrentes ; elle conquiert le terrain du vcu en lui imposant
lattitude unidirectionnelle du dtachement objectivant contre la
multidirectionnalit des attitudes participatives ; elle prescrit avec succs une
concentration des efforts sociaux pour atteindre les buts quelle sest fixs.
Elle est, en somme, une norme de dclassement du normatif, une raison
avance en faveur des causes, une hyper-valorisation des vrits factuelles au
dtriment des valeurs. Surtout, sa stratgie mme de dprciation des rcits en
premire personne, traduite en abrgement des temps de consultation mdicale
et en restriction du rpertoire lexical utilis par le thrapeute et par son
patient, dtermine un certain type dexprience comme seul audible et donc
seul autoris : lexprience dune alination de soi, dune froideur cultive
permettant de demeurer un autre pour soi-mme
41
. Non seulement, comme
lcrit Castel, le concept naturaliste du mental devient une idologie
sociale
42
, mais cette idologie transfigure en retour jusquaux contenus
mentaux quelle avait pour fonction de rinterprter en tant que reflets dun
tat physiologique.
Il est vrai que le naturalisme et le neurologisme contemporains nont pas
ni leffet rtroactif que peut avoir leur idologie de dmentalisation sur le
cours des tats mentaux. Ils ont mme fait valoir avec quelques bons
arguments que la mise distance par les patients de leur pathologie en tant que
simple faisceau de symptmes pouvait tre lui seul un facteur dattnuation
des souffrances. Le procd de cet effet apaisant est facile comprendre
43
: si
je suis moi-mme comme un autre, si ce qui marrive mest inflig par la
biochimie crbrale plutt que par mes conduites et mes penses, alors je nen
suis ni responsable ni coupable ; et je peux tranquillement laisser faire le
mdecin muni de ses savoirs sans lui opposer de rsistance contre-productive.
Ce processus de renforcement des effets thrapeutiques par un changement des
reprsentations de responsabilit a t attest pour la dpression, bien sr,
mais aussi pour dautres pathologies. Lun des cas les plus fascinants est celui
du pouvoir de lauto-narration sur lvolution de lanorexie. Les thrapies
traditionnelles faisaient peser sur les patients refusant de salimenter une part
plus ou moins grande de la responsabilit de leur tat. Mais au moment o
quelques chercheurs ont avanc lhypothse que la cause de lanorexie rside
dans le gnome, o ils ont dclar que son dterminant gntique est hrit de
lointains anctres capables de sadapter aux famines et daller chercher,
jeun, de nouvelles sources de nourriture sans lesquelles le groupe serait vou
lextinction
44
, un systme indit de reprsentation de cette maladie est
devenu disponible. Non seulement le procd standard de dculpabilisation
tait ritr (ce nest pas moi, ce sont mes gnes), mais il recevait le renfort
inattendu dune hypervalorisation (je suis le descendant des courageux asctes
qui ont permis lhumanit prhistorique de conqurir le monde en dpit de
ses ressources rares et incertaines). Des gurisons spectaculaires ont t
rapportes lissue de dialogues o les mdecins soutenaient devant leurs
patients anorexiques cette nouvelle conception hroque de leur maladie. Plus
gnralement, les partisans des conceptions naturalistes de lesprit et de ses
maladies nont pas manqu de prconiser une manipulation volontaire et
systmatique des systmes de croyances entretenus par les patients lgard
de leurs propres troubles. Cest ce quils ont appel une thrapie
attributionnelle
45
: une thrapie qui joue sur lauto-attribution des causes de
sa maladie par le patient, afin de renforcer les effets curatifs dune molcule,
voire dun placebo, et dattnuer les ractions danxit contre-productives
46
.
Le problme est que ce dernier choix, celui de la canalisation
intentionnelle des systmes de croyance des patients, entre en contradiction
performative frontale avec le naturalisme. Car prconiser la manipulation des
convictions, cest admettre que ce qui compte nest pas seulement la vrit
des thories mdicales (au sens de leur correspondance avec une nature
absolutise), ou la connaissance des causes supposes relles des maladies
psychiatriques, mais aussi le croire-que-cest-vrai, le prendre-cela-pour-une-
connaissance. Peu importe que la thorie gntique et volutionniste de
lanorexie ait t ultrieurement conteste jusqu tre abandonne : pour les
patients qui ont t encourags se reprsenter leur hritage comme glorieux,
et qui sen sont sortis grce cela, le succs est acquis. Peu importe que
leffet dun somnifre placebo soit considrablement renforc par des fables
dtaillant ses pouvoirs, ses effets secondaires, et ses mcanismes daction
allgus : linsomnie recule tout de mme mieux quen labsence de ces
fables. Cependant, sil en va ainsi, cest que ces rcits interprtatifs au sujet
des substances administres ne sont justement pas que des fables, mais aussi
et surtout des performatifs complexes : des vecteurs dimages de soi qui
agissent en vertu de leur teneur confabulatrice. Sil en va ainsi, a contrario,
cest que le succs du paradigme naturaliste des maladies mentales, et de
ltat de conscience intentionnel-objectivant qui laccompagne, nest pas
seulement fond sur des contenus vritatifs qui sont seuls pouvoir satisfaire
ceux qui habitent cet tat de conscience ; il sinscrit en fait dans la perspective
beaucoup plus vaste dun travail dauto-transformation et dauto-guidage des
tats de conscience. Le naturalisme nest au fond que lune des modalits
(survalorise au point de vouloir devenir hgmonique) des techniques
dtablissement de synergie entre la reprsentation et le modelage de soi. Sa
stratgie de soins implique une forme de coopration entre limage-dtre et
lavoir--tre, certes soutenue par quelque altration chimiquement induite de
la physiologie crbrale, mais ne sy rduisant en aucune manire. Cette
puissante composante non naturaliste du naturalisme psychiatrique se voit en
pratique reconnatre travers la prescription courante dassocier des
traitements mdicamenteux des traitements psychothrapiques. Mais sa
reconnaissance tacite devrait galement avoir des consquences thoriques,
ne serait-ce que pour offrir une amplitude maximale au jeu de plasticit des
tats de conscience.
Que la varit purement naturaliste de la thrapie attributionnelle oppose
des limites trop troites cette plasticit se devine son silence sur les
ventuels effets ngatifs de lattribution de nos maladies psychiques des
causes biologiques. Lattribution naturalisante me dculpabilise, il est vrai ;
mais elle me dresponsabilise aussi. Elle peut me permettre de profiter au
mieux des ressources pharmacologiques de la mdecine moderne ; mais elle
risque galement de me couper les ailes lorsquil sagit de mobiliser mes
propres ressources pour rediriger mon projet de vie vers des rgions
accueillantes. Lattribution biochimique de mes troubles psychiques mincite
accepter les traitements mdicamenteux, et leur prparer un cadre de
reprsentations de moi-mme qui amplifient et canalisent leur capacit dagir.
Mais elle peut aussi avoir des effets pervers consistant tout attendre de ce
qui nest aprs tout quune modulation globale, et peine slective, du niveau
dactivit biolectrique du cortex crbral. Sans une interaction thrapeutique
fine, ou sans un dlicat travail dauto-redfinition, le simple stimulant cortical
est susceptible daboutir nimporte quel rsultat, y compris catastrophique ;
comme par exemple le brutal passage lacte suicidaire, qui nest pas trs
rare chez les jeunes patients mlancoliques commenant prendre un anti-
dpresseur. Le paradigme rductionniste appliqu aux maladies mentales a en
somme un certain nombre deffets mentaux que lon peut qualifier de
nocebo (par opposition placebo ). Ces effets prjudiciables de rtro-
action ngative nont de chances dtre surmonts que par ce que Dan Siegel
47
appelle l empowerment des patients neuro-psychiatriques ; cest--dire
par une forme de thrapie qui non seulement les persuade que leur destin
psychique est entre leurs mains, mais leur donne le pouvoir de choisir un
avoir--tre et de modeler patiemment leur tre en consquence. Exactement
le contraire de la dvolution de ses propres pouvoirs une matire physico-
chimique passivement regarde de lextrieur, telle que la prconise la vision
troitement neurophysiologique des pathologies psychiatriques. Alors, et alors
seulement, les manipulations de la biochimie crbrale pourront sintgrer,
sur un plan non seulement technique mais aussi culturel et existentiel, dans une
vaste boucle auto-rfrentielle incluant limage de soi, la conception de
lesprit, lintgration relationnelle dans une socit desprits, lajustement de
lactivit neurolectrique, et ltat ressenti dharmonie ou de dissonance. La
thrapie est cette boucle, et non pas son seul moment neurochimique. Elle
reste cette boucle mme lorsquune reprsentation matrialiste de lesprit tend
la rduire une intervention neurochimique ; mais elle nest alors quune
boucle tronque, affaiblie, aline dune partie importante de ses pouvoirs.
Elle reste galement cette boucle lorsquaucune administration de molcule
nest propose ; ne serait-ce que parce que chacun de ses autres chanons est
capable dinduire des altrations neurochimiques voire neuroanatomiques
48
en retour. Ltat de conscience rtro-agit sur les conceptions de la
conscience ; et les conceptions de la conscience rtro-agissent leur tour sur
la capacit de moduler son propre tat de conscience, y compris dans ses
modalits physiopathologiques.
Retenons de cette rflexion sur lauto-rfrentialit quelques prescriptions
mthodologiques qui vaudront pour les tapes ultrieures de notre enqute au
sujet de la conscience. chaque fois quun positionnement sera propos, il ne
faudra jamais cesser de se poser une srie questions dauto-positionnement :
partir de quel tat de conscience une certaine question ou une certaine thorie
sur la conscience fait-elle sens ? Du point de vue de quel tat de conscience
juge-t-on la fiabilit des thories formules ? Dans quel tat de conscience
nous trouvons-nous pendant que nous jugeons convaincant tel discours sur le
caractre driv ou au contraire originaire de lexprience consciente ? Quel
est notre intrt pendant que nous en parlons ? La teneur mme du problme
exige que nous revenions sans cesse l do nous partons, l o nous nous
tenons ; parce quen ce lieu se trouve son non-objet conscience , et
parce que sil sloignait de l qui est la fois sa source et son thme,
lacte mme de problmatiser aurait toutes les chances de sgarer dans des
arguties logico-formelles dnues de pertinence. Lenqute sera reprise avec
une acuit accrue au chapitre VI, propos des conceptions mtaphysiques de
la conscience. Mais son motif sera prsent chaque tape de la rflexion,
commencer par la prochaine.
QUESTION 5
La conscience est-elle le prsuppos
de la nature ?
Comment la subjectivit sera-t-elle rendue apte cette
connaissance de soi par laquelle elle pourra comprendre
absolument toute vrit et toute science comme un produit
se constituant en elle-mme ?
E. Husserl
Deux stratgies pistmologiques diamtralement opposes pour traiter le
problme de la conscience vont tre mises en regard, relevant
respectivement de ltat de conscience naturel et de ltat de conscience
troitement rflexif. Mais lacte mme de les confronter, larticulation de
lune lautre, puis la tentative de les faire entrer en synergie plutt quen
concurrence, relveront du troisime tat de conscience, celui dune vraie et
pleine rduction phnomnologique qui revient en vrit tendre lintrt
tous les aspects de ce qui arrive.
Dans ltat de conscience naturel , chaque question est une ouverture
de lexprience consciente ce qui nest pas elle, ce qui se donne elle
comme lui tant tranger. Si je pose par exemple la question quest-ce
quune chose (matrielle) ; de quoi est-elle faite ? , je dirige dabord votre
attention de lecteurs vers cela dont nous reconnaissons collectivement la
prsence devant nous, pour nous tous, et de ce fait extrieurement chacun
dentre nous. Jouvre ensuite cette attention sur une nigme, une absence, une
perplexit concernant des dimensions dtre inconnues de cette chose, qui
nous loignent plus encore de nous-mmes que le simple attrait de son
apparence. Si nous voulons rpondre la question sur la nature et les
constituants de la chose, il faut en effet que nous utilisions des mdiations
performatives et instrumentales de plus en plus labores, de plus en plus
indirectes ; il faut que nous dployions les dimensions inconnues de cela
qui est pos devant nous en avanant dhypothses thoriques en
investigations exprimentales. Ces investigations exprimentales sont
appuyes sur un savoir antrieur du fonctionnement des appareillages et de
leurs pices constitutives, cest--dire sur les pas prcdents de la mme
avance. Elles reprsentent une tape additionnelle dun mme lan
extraversif dont les strates antrieures sont dposes dans les technologies.
Or, au fur et mesure que nous poussons ainsi vers lavant, nous tendons
rejeter dans larrire-plan ce que nous considrons comme acquis, comme
prsuppos, et donc comme transparent. Lexprience consciente tant le
premier de ces prsupposs, le prsuppos des prsupposs, le prsuppos
extrme, sa diaphanit ne peut tre que la plus entire de toutes.
La seule circonstance qui remet ici la conscience en scne, sur la scne,
au lieu de la laisser dans linaperu qui est celui de la scne elle-mme
lorsque tous les projecteurs sont braqus sur les acteurs, cest quelle a des
corrlats objectivs qui nous importent au plus haut point sur un plan pratique,
personnel, et social. Ces corrlats, nous lavons vu, sont les signes de lveil
ou du sommeil, de la vigilance ou du coma, de la concentration ou de la
distraction, relevs sur nos congnres et parfois sur nous-mmes. Du coup,
dans ltat de conscience naturel , la conscience ne se laisse apprhender
que sous langle de la pertinence fdratrice de son concept, en tant que centre
unificateur de ses corrlats objectivs. Au nom de ces corrlats et de son
aptitude en offrir une reprsentation unifie, elle est traite comme prdicat
des corps vivants. Mais sil en va ainsi, il semble quon soit retomb presque
par inadvertance, propos de la conscience comme propos de tout le reste,
dans lornire archaque de lontologie reprsente par le schma ternaire de
la substance (1), des proprits (2), et des phnomnes manifestant ces
proprits (3). Ce qui joue ici le rle de substance est le corps, le corps
humain ou dautres corps de complexit et de mode dorganisation
comparable ; ce qui joue le rle de la proprit tudie est la conscience ; et
ce qui joue le rle de phnomnes supposs manifester cette proprit
conscience sont ses corrlats objectivs comme le comportement vigile,
les rponses verbales, ou bien la ractivit neurophysiologique des
stimulations smantiquement labores. Or, comme nous lavons brivement
not en introduction, aucun des phnomnes manifestant la proprit
conscience nest davantage quun signe ambivalent. Aucun dentre eux
nest une vritable preuve dont la seule prsence suffirait certifier
loccurrence de la proprit indirectement signifie par eux
1
. Pour le
comprendre, il faut commencer par rflchir sur des cas archtypaux de
proprits. Le principe mme de leur preuve repose sur la mise progressive
lcart, dans leur dfinition, de toute composante subjective. Si jaffirme
quun corps pse 5 kilogrammes, la lecture dune balance bien calibre
prouve que ce corps possde cette proprit. Rien dautre nest requis, parce
que la classe (relie un talon par lopration de calibration) des
phnomnes de lectures de balances tient lieu de dfinition constructive de la
proprit quantitative poids , par-del les incertaines valuations
subjectives du lourd et du lger. Si jaffirme que telle intensit de courant
lectrique passe dans un fil mtallique, les choses sont peine plus
compliques. Vers ce trait confluent plusieurs classes de phnomnes,
thermiques, lectrochimiques, et lectromagntiques : leffet Joule de
rchauffement du conducteur, llectrolyse de leau, la dviation dune bobine
de fil de cuivre suspendue dans un champ magntique, etc. La proprit
intensit , dfinie comme le dclencheur privilgi de lun de ces effets
(par exemple la dviation de la bobine de lampremtre qui sert la
mesurer), intgre simultanment ou progressivement les autres effets et se voit
en fin de compte assimile leur nud dintgration. Rien dautre nest
requis. La manifestation de lun de ces effets, ou de la totalit dentre eux,
dans un secteur circonscrit de matriau conducteur, est suffisante pour
affirmer que la proprit courant dintensit I y est instancie, par-del les
glissantes sensations subjectives dchauffement ou de picotement lectrique
sur la langue. Des problmes commencent apparatre dans des cas moins
franchement capturs par la sphre de lobjectivit, lorsque les modalits
dapplication concrte de la preuve laissent subsister une part darbitraire
individuel ou collectif. Ainsi, pour dclarer quun corps est rouge, on se fonde
sur le tmoignage convergent de plusieurs personnes au sujet de sa couleur ; le
phnomne intersubjectivement partag de rougeur opre comme dfinition
implicite du rouge dans la vie courante, et dans les recherches
psychophysiques. La lgre dispersion statistique dans le constat humain de
couleur, labsence de procdure indfiniment convergente dtalonnage,
limpossibilit en somme de tendre vers une preuve absolue que tel corps est
rouge, peuvent rendre dsirable dans certains contextes professionnels une
autre dfinition plus avance sur le chemin de lobjectivation, parce que
fonde sur un phnomne mtrique
2
. Des physiciens diront par exemple quun
objet est rouge sil rmet du rayonnement lectromagntique de longueur
donde comprise entre 625 et 740 nanomtres, en adoptant cette fois un critre
spectromtrique, objectif (au sens kantien duniversellement constatable) et
non pas qualitativement intersubjectif. La preuve formelle quune surface est
rouge devient dans ces conditions facile apporter. Mais cette dcision de
dflchir la dfinition de la couleur sur un plan objectif a une porte limite.
Car dans les cas, assez nombreux, o il ny a pas de concidence exacte entre
la gamme choisie de longueurs donde et la perception en tant que rouge ,
jaune , verte , bleue , violette des surfaces colores
correspondantes, on doit, en vertu dune dcision normative sur ce quest une
couleur, donner raison au jugement de la majorit des sujets contre la
spectromtrie. La preuve de la couleur garde sa part dincertitude, en mme
temps que sa part de subjectivit. Ce dernier cas suggre que la procdure de
dsubjectivation des dfinitions de proprits, et de consolidation
objectivante de la preuve de leur instanciation, a beau stendre de proche en
proche, elle ne saurait tout englober dans sa circonscription de validit (nous
y reviendrons plus fond la fin de ce chapitre). La dsubjectivation ne peut
pas toucher jusquaux dterminations essentiellement subjectives, puisque
cela reviendrait faire limpasse sur elles ; elle peut encore moins concerner
la subjectivit en tant que telle, puisque ce serait linviter se nier elle-mme.
Le cur de la subjectivit est la limite absolue dune recherche de preuve par
objectivation. Un procd consistant rechercher laccord universel propos
dune fraction ostensivement circonscrite du champ de ce qui se montre ne
saurait concerner ce-l qui nest pas fragmentaire mais omni-englobant ; il est
incapable de saisir ce-l qui ne saurait sindiquer par aucun geste ostensif
parce que lintention de chaque geste en est issue. Les stratgies scientifiques
sont en somme inapplicables par principe la soi-disant proprit
conscience, pour le simple motif quelles inverseraient le mouvement
accomplir pour y arriver. Le manque initial dune dfinition oprationnelle
satisfaisante de la conscience pouvant se retourner en preuve de sa prsence
chez des tres dots de comportements organiss, nest compensable par
aucun surcrot dobjectivit dans lextraction de phnomnes pertinents.
Si lon voulait redire en dautres termes pourquoi la conscience ne saurait
tre saisie par aucune apparition constatable au pluriel dun nous
universel, et ne relve donc pas bon droit du concept de proprit dun
corps, on citerait deux raisons principales. La premire est que la pseudo-
proprit conscience ne se manifeste vrai dire par aucun phnomne. Les
critres corporels externes de vigilance, qui tiennent lieu de phnomnes-de-
conscience pour lattitude naturelle, ne la montrent pas elle-mme, mais se
contentent de servir dindices de sa prsence par interconvertibilit avec la
pure monstration qui sorigine spatialement dans ce corps-ci, dans ce corps
propre actuellement vigile. La conscience au sens primaire sidentifie au fait
brut de la phnomnalit ; elle ne se rvle pas en tant que phnomne, mais
comme ce sans quoi il ny aurait aucun phnomne au sens premier
dapparition
3
; elle nest montrable nulle part, mais conditionne le se-montrer.
La seconde raison, dissimule dans la premire, est quen ce qui concerne la
conscience, le constat ne se fait jamais quau singulier : la premire
personne du singulier dfinie dun je , ou bien lindfini qui prvaut dans
le simple ouvert rilken nayant pas encore cristallis sa singularit en
individualit. La seule preuve indiscutable de la conscience, la seule
certification dnue dambigut, il faut sans cesse le rappeler, est
lexprience vcue en premire personne. Il ny a pas dautre dmonstration
envisageable de sa ralit que cette flagrance idiosyncrasique, et celle-ci
nest reconductible aucun nonc qui permettrait de la capturer dans une
chelle de caractrisations par oppositions. Ainsi saperoit-on de la
contradiction qui mine une conception de la conscience conforme aux
exigences dun tat de conscience intentionnel. Dans cet tat, la conscience ne
peut tre conue comme rien dautre que comme proprit ; mais, dans le
mme temps, elle reste justement insaisissable en tant que proprit,
inapprochable comme dtermination objective, jamais impossible
prdiquer dun corps avec certitude. Telle est lune des nombreuses
formulations envisageables de laporie que suscite la conscience lorsquelle
sabsente elle-mme.
La consquence surprenante de cela est quen ce qui concerne la
conscience, le seul vrai apport dune recherche relevant de lattitude naturelle
nest nullement dordre gnosologique. Il est pragmatique, avec un impact
potentiellement considrable pour lthique. Tout ce que lon peut faire, dans
le cadre de lattitude naturelle, et cest dj norme, consiste amliorer
progressivement notre connaissance des signes (et non pas bien sr des
preuves, inexistantes), qui nous permettent de donner les meilleures garanties
autrui quon saura le tenir prsomptivement pour conscient dans les
circonstances o les apparences corporelles et comportementales les plus
courantes risqueraient de le faire tenir tort pour profondment inconscient.
Le but thique de ces avances se laisse ds lors avantageusement formuler
sous la forme dun impratif plutt que dun constatif :
Tu chercheras tendre les circonstances smiologiques o tu te sens encore oblig de
reconnatre lautre comme sujet, ou comme capable de le redevenir, y compris dans des
situations extrmes o presque tout semble indiquer quil nest plus quun corps-objet.
La science neurobiologique franchit lheure actuelle des pas de gant
dans la direction indique par ce bel nonc dontologique ; et cela doit tre
port son crdit quelles que soient les objections quon peut lever par
ailleurs contre sa tentation de se prvaloir de succs cliniques ou empiriques
pour lever ses concepts la dignit dune connaissance de ce qui sous-tend
en ralit lexprience consciente. Nous ferons un bilan de ces progrs
thico-technologiques en temps utile, propos des tats danesthsie et de
coma
4
, tout en prenant soin dindiquer pourquoi ils ne nous avancent en rien
sur la voie rve dune connaissance objective de lorigine de la pseudo-
proprit conscience .
Revenant la qute thorique, aprs cette brve incursion dans le domaine
de la raison pratique, nous nous apercevons quune question troublante sest
fait jour : pourrons-nous jamais tablir une quelconque vrit concernant la
conscience, ce non-objet, cette non-proprit, ce non-phnomne ? A priori, la
rponse est ngative, pour le mme motif de principe qui rend ltat de
conscience intentionnel incapable de formuler le problme de la conscience
sans faire de contre-sens : parce quil ne peut aborder ce problme quen
linscrivant dans le domaine du sens, et quil lui tourne de ce seul fait le dos.
Une remarque de Levinas sur le statut de la vrit nous claire ce propos :
Sans sparation, crit-il, il ny aurait pas eu de vrit, il ny aurait eu que de
ltre
5
. Pour rendre possible la vrit, il faut que quelque chose soit
susceptible de stablir en contraste avec elle, autrement dit il faut mnager le
risque de lerreur. Mais lorsquil ny a pas de distance, lorsque ce que nous
abordons nest pas un objet, lorsque le contact avec le l en question est
entier, lorsque le dispositif mme de la signification, qui suppose un cart
plutt quune adhrence entre le signifiant et le signifi, lui reste inapplicable,
lerreur son propos est inconcevable. Le risque de lerreur ne se fait jour
que sous la condition dune distance entre soi qui juge et les objets jugs, car
il porte sur le contenu dun jugement. Par ricochet, la vrit qui soppose
lerreur ne surgit que sous la mme condition de distanciation. Or, cette
condition fait dfaut dans le cas de la conscience. Ntant pas spars de
lexprience consciente dans sa totalit, nous navons aucun moyen pour
formuler quelque chose de vridique son sujet : nous ne pouvons qutre
elle en baignant dans une forme inarticule de certitude
6
. Ce constat, qui
semble nous bloquer, ouvre pourtant une opportunit formidable la pense.
Lopportunit est celle de renverser intgralement la direction du
questionnement, en commenant cette fois par le fait dtre pour aller vers le
connatre, au lieu de rver dune connaissance apte dvoiler ltre.
Selon lpilogue de la rflexion prcdente, nous ne pouvons tablir
aucune vrit propos de lexprience consciente en utilisant la dmarche
dinvestigation habituelle dans laquelle nous positionnons fermement un objet
devant nous, anticipons sur ses faces caches en nous appuyant sur des
connaissances antrieures, puis testons les anticipations au cours dun examen
minutieux. Devant un tel mur oppos la connaissance et sa prtention la
vrit, il a t propos de prendre au mot la proposition de Levinas, de se
renraciner dans le simple fait dtre qui ne cesse dclater comme
exprience consciente, et den faire un nouveau point de dpart. Il savre
ncessaire dans cette hypothse de suspendre la question comment
lexprience consciente merge-t-elle dun objet ? et de la remplacer
purement et simplement par la question rciproque comment la croyance en
des objets spars, et le projet mme de connatre le vrai, prennent-ils leur
essor partir de la conscience ? La figure logique de cette inversion est
lmentaire, mais son processus vcu ne lest pas, et il a toutes les chances de
susciter de profondes rsistances. Pour laccomplir, pour habiter de manire
durable ce grand renversement, il ne suffit pas de le mettre en uvre titre de
gymnastique intellectuelle ; il faut stablir dans un tat de conscience rflexif
qui seul le rend ais, familier, presque invitable. Aussi longtemps quon
adhre ltat de conscience naturel , linversion des priorits
explicatives de la thorie de la connaissance ne peut que se voir accuser
dtre gocentrique et rgressive. Elle est en particulier charge du dfaut de
rgressivit au nom de la thse psychogntique discutable (sans doute hrite
de la psychanalyse, travers le concept freudien de narcissisme
primaire
7
) dun gocentrisme des nourrissons supposs vouloir
reconduire le monde eux seuls et leurs besoins
8
. Les qualificatifs
dsobligeants pleuvent, au nom de ltat dcentr et neutre exig par la
discipline ducative laquelle nous avons t soumis. Prendre lexprience
consciente pour point de dpart absolu, accusent les chercheurs solidement
tablis dans ltat de conscience naturel , cest ignorer que celle-ci nest
quun piphnomne localis, marginal, infime, dans un univers bien plus
vaste quelle, fait de matire brute et de processus aveugles ; cest pratiquer
une forme extrme de contre-rvolution ptolmenne
9
, de recentration
ignorante delle-mme, au lieu de parachever luvre hroque de la
rvolution copernicienne, dassumer sa vision vertigineuse dun univers infini
au sein duquel nous ne sommes que quantit accidentelle et ngligeable, et
daccepter dfinitivement la blessure narcissique quelle nous a inflige. Pour
qui persiste dans ltat de conscience naturel ou le survalorise, le centre
de lexprience vcue est certes notre terre nourricire, mais laune de la
connaissance mme quelle nous a permis dacqurir, cette terre doit tre
reconnue comme simple poussire dans limmensit des mondes.
Constater quun philosophe comme Husserl assume jusquau bout les
termes historiques de laccusation qui lui est signifie, en dclarant dans lun
de ses textes que La Terre ne se meut pas
10
comme sil niait le savoir des
temps modernes et voulait en revenir au gocentrisme, ne peut que stupfier
lhomme de ltat naturel. Le traumatisme engendr par cet intitul
provocateur peut mme conduire ce dernier marginaliser la phnomnologie,
en la versant dans des catgories-repoussoirs comme celles de logorrhe
anti-scientifique (dans notre sphre culturelle), ou de rumination de la
philosophie continentale (dans la sphre culturelle anglo-amricaine)
11
.
Husserl, et toute la philosophie transcendantale avant lui, nous offre pourtant
deux pistes argumentatives rendant peu crdible ce jugement lemporte-
pice port contre sa philosophie.
La premire piste est une lecture alternative, anticipe par Kant, de la
rvolution copernicienne : non pas simple dcentration du berceau terrestre de
lhumanit (comme le veut linterprtation populaire), mais avant tout
ralisation du fait que des caractristiques du monde que nous tenons pour
intrinsques, par exemple les trajectoires apparentes des plantes sur la vote
cleste, sont relatives notre position dans ce monde. La dcentration est
certes cruciale, mais titre de simple instrument mental nous permettant de
penser aisment cette relativit comme consquence dune relation tendue
dans le vide intersidral. Cest justement sur ce dernier point quinsiste
Husserl, sur le fait que la dcentration ne reprsente quun outil figuratif,
quune faon commode doffrir une image spatiale de la relativit. Une image
qui peut trs bien son tour, linstar de la figure trace par la trajectoire
apparente des plantes sur la vote cleste, se dcouvrir relative un autre
type de position pistmique (ne serait-ce qu la posture objectivante elle-
mme). Nous sommes ds lors invits remettre lendroit la hirarchie des
priorits, placer la relativit avant la relation spatialise, donner priorit
la relativisation sur la dcentration
12
dans notre interprtation de la rvolution
copernicienne. Mais lorsque nous procdons ainsi, lvaluation de notre auto-
assignation de centralit change du tout au tout. Si, dans la rvolution
copernicienne, cest la dynamique de la relativisation qui lemporte sur toute
image statique absolument dcentre, alors notre centre (ou plus exactement
nous-prouvant pris pour centre) se rappelle nous comme ce relativement
quoi ont t tablies toutes nos connaissances, y compris le modle
hliocentrique du monde et la reprsentation excentre de nous-mmes sur
la plante Terre . Ce centre dernier, tant celui relativement-auquel sont
dfinis lensemble des contenus pistmiques, ne peut plus tre minimis ; car
chaque image qui ne le figurerait que comme un point insignifiant et dcentr
de son espace-imaginal est dsormais, par ce fait mme, reconnue tributaire
de sa facult centre de forger des reprsentations images.
La seconde piste husserlienne pour assurer la dfense du point de vue
transcendantal contre laccusation commune de relever dun gocentrisme
infantile mal surmont consiste procder par tapes successives et
patientes au lieu de sauter la conclusion. Lenqute de Husserl commence
avec un mode de centration la fois spacieux et loign de nous-mmes, et se
recueille progressivement jusquau centre des centres, silencieux et intime.
Son point de dpart est donc la Terre, ce ple de fermet tellurique pour
notre exprience du mouvement et des choses de lunivers. La Terre,
remarque Husserl, peut tre apprhende de deux manires, comme sol et
comme corps matriel. Comme sol, elle est notre repre privilgi, notre lieu
naturel aristotlicien, notre havre de repos, notre absolu minral pour ainsi
dire. Chaque objet se dplace par rapport elle, qui reste seule vcue en tant
quimmobile ; chaque corps cleste est vu partir delle ou rayonne vers elle,
qui reste seule perue en tant quhabitat inquestionn. Comme corps matriel,
en revanche, elle nest quun corps parmi les corps clestes, visible de toutes
parts, en mouvement relatif par rapport dautres astres, dont certains sont
peut-tre galement habits. La question centrale qui se pose partir de l est
la suivante : sommes-nous libres de choisir entre la Terre-sol et la Terre-
corps ? Imaginer ou voyager, et senrichir ainsi des degrs de libert de la
pense, nous est en tout tat de cause accessible. Il est facile de se figurer soi-
mme hors de lhabitat terrestre, quitte construire (dans le sillage de
Copernic) quelque reprsentation dun ailleurs do cet habitat serait visible.
Il est moins facile, mais ralisable (et ralis), de sextraire de la surface de
la Terre et daccomplir la fameuse prophtie de Constantin Tsiolkovski : La
Terre est le berceau de lhumanit, mais on ne passe pas sa vie entire dans un
berceau. En dpit de son statut contingent de sol pour le genre humain, la
Terre est donc disponible pour toutes les oprations, mentales et physiques,
de dcentration, lissue desquelles elle devient un simple corps
plantaire. Une trace de sa situation originaire reste toutefois perceptible dans
lmotion profonde, voire dans la mutation psychique, quont ressentie
certains des astronautes qui lont vue pour la premire fois comme un corps
distant
13
.
La seconde tape du chemin husserlien noffre dj plus autant de latitude.
Il sagit du corps humain, de notre corps vivant. Lui aussi sest vu attribuer
deux statuts distincts par les phnomnologues : Leib et Krper chez Husserl,
corps-propre et corps-objet chez Merleau-Ponty. Corps-propre, il est notre
chair sensible, notre centre de perspective, notre perce vers ce qui apparat.
Corps-objet, il est, lgal de la Terre-plante, un corps particulier en
commerce avec dautres corps. Il semble cependant moins ais de dcider
entre voir ce corps comme chair ou comme objet, que de se dplacer tantt en
pense tantt en acte par rapport la Terre. Pas plus que je ne choisis la
bouche qui dit je , je nai jamais choisi mon corps. Je lai trouv l un jour
indtermin, dabord dans une atmosphre cnesthsique, puis dans la
surprise dun reflet spculaire ; et jai d le reconnatre comme mien, ou me
reconnatre comme sien, parce que je navais pas la moindre licence de le
refuser (tout au plus ai-je lopportunit de le transformer par la chirurgie
esthtique ou les greffes). Ce corps a t mon berceau, il sera mon tombeau, et
jaurai donc pass ma vie entire avec lui, en lui, par lui, ft-ce mon corps
dfendant . La seule option qui me soit laisse son sujet, et elle na rien de
ngligeable, est celle de limaginaire ou des perceptions altres. Je peux
mimaginer avoir un autre corps ; je peux me reprsenter ce que cela fait
dtre incarn dans cet autre corps ; je peux me figurer ce que voient les autres
lorsquils voient mon corps, en mappuyant sur des photographies, sur des
images en miroir, et parfois sur lexprience directe de sortie du corps
14
.
Mieux, je dois pouvoir changer par la pense les statuts de chair et dobjet
de mon corps afin dtablir la rciprocit quexigent lquit de la vie sociale
et la justesse de lthique. Ce corps ntant quun parmi dautres, il na pas
demander pour lui plus que ce que lui consent limpratif catgorique ; et ses
pulsions mmes qui le portent transgresser limpratif ne sont que pulsions
parmi dautres, ni plus ni moins souveraines que les autres.
Il reste la troisime et ultime tape de la centration husserlienne, la vie de
la conscience pure. ce stade, lespace de libert disponible samenuise
encore, il sannule en fait ; non pas parce quon subirait une quelconque
incarcration dans la conscience, mais parce que la plus entire libration est
encore vcue par elle. Il ny a aucune opportunit dchapper la tension
mme vers lchappe, de saffranchir spontanment de la source de toute
spontanit. Je peux certes encore osciller entre croire vivre la vie de la
conscience, ou celle dune conscience parmi dautres consciences (ma
conscience). Mais, mme si je ne donne ce que je vis quune acception
restrictive, sur le mode gologique, ma facult dchappe dcentratrice reste
inexistante. titre dhypothse dun raisonnement par labsurde, supposons
que je parvienne me dplacer de conscience en conscience, comme je peux
me dplacer physiquement de plante en plante, ou comme je peux imaginer
mon incarnation de corps en corps. Me serais-je alors vritablement
dplac ? En aucune manire. Tout ce que jaurais fait, cest me transfigurer
en tel autre, me volatiliser et devenir cet autre. Nen tant aucunement spar,
je naurais gagn aucune vrit propos de lautre conscience. Je me
contenterais dtre cette conscience-autre qui resterait de ce fait conscience-
mme : je-conscience. La dcentration est ici strictement, principiellement
impossible, parce quelle nest jamais que re-centration, et que la
re-centration ne se vit que comme simple et immmoriale centralit. La
centration est dans ce cas inluctable, pour ne pas dire fatale. Limage dune
multitude polycentre de monades a certes lintrt daider reconnatre
symboliquement la centralit particulire dun ce relativement quoi telle
classe de phnomnes se manifestent. Mais cela ne doit pas faire oublier que
la conscience, cette conscience, est ce relativement quoi tout phnomne et
toute reconnaissance de classes de phnomnes, se manifestent. Tout lui est
rapport, y compris la ralisation de sa propre finitude situe, y compris la
grandiose vision cosmogonique de la monadologie leibnizienne, y compris
lessai de savoir quoi ressemble le monde vu partir dautres monades, y
compris la conception dun univers unique demeurant invariable par
changement de point de vue monadique. Elle nest pas particulire, mais
singulirement singulire. Dans le cas ultime de la conscience, aussi choquant
que cela puisse paratre, tre pleinement copernicien (au sens de la
relativisation) implique donc dassumer pleinement la dmarche ptolmenne
(au sens de la centration). Ici, sans lombre dun doute, [la] Terre (absolue
de la conscience) ne se meut pas ; je ne quitte jamais je-conscience ;
je-conscience est mon sol insurpassable, et tout le reste se donne selon sa
perspective. Sil en va ainsi, cependant, ce nest pas parce que son sol-limite
a le trait dimmutabilit attribu au sol terrestre, mais, exactement linverse,
parce qutant indfiniment protiforme, il se prte nimporte quelle
identification sans jamais se laisser saisir autrement que comme une identit
prenne.
La voie vers un retournement intgral du rapport de connaissance se
trouve ainsi aplanie et pacifie sur un plan conceptuel. Mais, comme nous le
savons, les concepts ne sont pas seuls en jeu. Rester en prise avec ce
retournement, ne pas en minimiser la porte, ne peut vraiment pas faire
lconomie dun changement dtat de conscience, dune installation
demeure dans ltat de conscience rflexif. Car, sans capacit de suspendre au
moins momentanment ltat de conscience naturel , certains des arguments
que je viens davancer resteraient sans force, les concepts dploys ne
trouveraient pas la rsonance existentielle souhaitable, et ils pliraient ds
lors devant des arguments et concepts concurrents employs par la pense
objectivante. Cest quaux yeux de qui est install dans ltat de conscience
naturel , lopration de renversement pistmologique ne saurait avoir
quune signification marginale : celle dun exercice de reconstruction de la
procdure cognitive par laquelle nous avons fini par reconnatre lexistence
pralable et intrinsque de ce monde fait en ralit de multiples corps. Mais
sous condition dhabiter un tat de conscience rflexif, le retournement
devient tout autre chose. Il nous fait regagner la demeure de lvidence, la
chaleur de la prsence dont les prsents ne sont quautant de cendres tidies,
le lieu de ce qui na mme pas besoin de prtendre la vrit tant ltre, dans
sa certitude auto-engendre, lui suffit. Le retournement nous permet aussi de
revenir lhumus fcond de toutes les mises en forme, dont la structure de
monde dcentr produite par la rvolution copernicienne nest quun
exemplaire parmi dautres.
Une version lmentaire de ce genre de retournement est due lauteur
mme (Charles Tart) qui sest fait une spcialit de comprendre leffet quont
les divers tats de conscience sur les conceptions de la conscience et du
monde : La connaissance, crit-il, peut tre dfinie comme un sentiment
exprientiel immdiatement donn de congruence entre deux types diffrents
dexpriences ; comme un accord. Un premier ensemble dexpriences peut
tre vu comme des perceptions [] ; le second ensemble peut tre vu comme
une thorie, un schme, un systme de comprhension. Le sentiment de
congruence est quelque chose qui est immdiatement donn dans lexprience,
mme si de nombreux raffinements ont t labors pour juger des degrs de
congruence. Toute la connaissance est donc, fondamentalement, une
connaissance exprientielle
15
. Le mme renversement se lit ds le titre dun
article de Piet Hut et Roger Shepard : Retourner le problme difficile (de
la conscience) de haut en bas, et de ct
16
. Pourquoi, demandent ces
auteurs, devrions-nous chercher lucider la manire dont lexprience
consciente apparat dans le monde des objets, puisque cet effort tourne
vide ? linverse, la question retourne de haut en bas de savoir comment
un monde dobjets cristallise dans lexprience est plus accessible : Il y a
clairement de lespace pour les objets physiques dans lexprience ; mais il
nest pas vident du tout quil y ait de lespace pour lexprience dans les
objets physiques. Afin de ne pas en rester un constat dincomprhension et
de stupfaction mutuelle entre ceux qui prennent le problme de la conscience
lendroit et ceux qui le prennent lenvers , les auteurs proposent une
stratgie de conciliation : cest le retournement de ct, ou retournement
intersubjectif. Ce qui est ici expliquer nest pas isolment la gense de
lobjet dans une conscience, mais sa dsignation conventionnelle au sein
dune communaut de locuteurs conscients partageant un arrire-plan de
prsupposs sensori-moteurs et technologiques.
Quelles quen soient les variantes, monadique ou pluri-monadique, la
thse vers laquelle convergent ces hommes de lattitude rflexive est que la
connaissance sacquiert, se travaille, se constitue dans lexprience, entre des
moments dexprience, en tant quexprience de larticulation conforme des
strates interprtative, rceptive, et communicative de lexprience.
Lexprience consciente est la scne unique o se joue le drame de la
connaissance, non seulement ses scnes perceptives et intellectuelles, mais
aussi la scne dernire de mise en harmonie de chacun de ses moments. Pas
dadaequatio rei et intellectus, mais une coordination de lintelligence, de
lapprhension sensible, et de lactivit manipulatrice guide par un projet de
matrise anticipative de ce qui surgit dans la sphre de la prsence. Vous
ntes pas persuads de cela, vous voulez dfendre la thse quil y a de
lautre radical, de lautre qui fait irruption dans la connaissance et la force
se plier quelque chose qui est dune nature compltement trangre
lexprience ? Dans ce cas, vous devez au moins reconnatre que tout
argument qui viendrait tayer cette croyance en un extrieur devrait pour sa
part susciter ladhsion (la persuasion, justement !) lintrieur de
lexprience. Mme si lexprience nest pas tout, par hypothse ou par
conviction (par une hypothse ne dans lexprience, ou par une conviction
consolide en tant quexprience), elle est tout notre terrain dpreuve ;
nous nen avons aucun autre de rechange.
La plus puissante srie de preuves dune extriorit ne droge pas cette
rgle de sa mise au banc dessai dans lexprience. Elle a t formule depuis
longtemps, dans un climat philosophique trs diffrent du ntre. Il sagit des
preuves de lexistence de lAutre le plus entirement autre qui soit (et
pourtant, selon certaines interprtations, le plus secrtement proche qui soit),
savoir Dieu. Bas Van Fraassen ayant montr que toutes les preuves avances
par les dfenseurs du ralisme scientifique sont drivables par extrapolation
des preuves dites a posteriori de lexistence de Dieu formules par saint
Thomas dAquin
17
, ces dernires soffrent comme archtype universel des
arguments de recherche daltrit. Or, les preuves a posteriori dune
extriorit mtaphysique du Dieu crateur par rapport au monde cr se basent
toutes, par construction et par ncessit, sur des traits internes au monde et aux
cratures que nous sommes ; sur leur perfection adaptative, sur leur clatante
contingence, et sur leur qualit ressentie dtre donnes parce que proprement
incomparables. De faon analogue, aucune preuve du ralisme
mtaphysique ou du ralisme scientifique na t formule autrement quen
termes anti-ralistes ; cela est reconnu (il le faut bien) par les ralistes eux-
mmes
18
.
Pourtant, ce nest peut-tre pas tout. Il reste la preuve ultime, la preuve
suprme parce quelle est la mesure de Celui dont elle vise tablir
lexistence : la preuve a priori, ou preuve ontologique, initialement formule
par saint Anselme. Cette preuve, on le sait, part de lide dun tre tel que
rien ne peut se penser de plus grand
19
. Elle sappuie ensuite sur le constat
quil est facile de penser quelque chose de plus grand quun tre seulement
intelligible mais pas rel, et conclut a contrario la ralit de ltre conu
comme le plus grand, identifi Dieu. La rigueur de cet argument, la frange
mal matrise du possible et de lactuel, de lidal et du rel, est douteuse ; et
lhistoire de la philosophie, commencer par la clbre rfutation par Kant
de sa version cartsienne
20
, na gure t indulgente avec lui
21
. Mais on
devine que la mcanique dductive est loin dpuiser le pouvoir de sduction
de la prtendue preuve ontologique . Sous couvert de logique, la dmarche
de saint Anselme doit avant tout avoir eu un moteur vcu. Ce moteur est ce
quon pourrait appeler lexprience dun vertige dhorizon : une fois forge
la pense du plus grand, le penseur se sent exalt, aspir, par quelque chose
quil peroit comme capable denglober lacte mme de penser qui a amorc
sa dmarche. Il ne se considre plus autoris faire de pauses aux tapes du
raisonnement, il ne ressent plus la lourdeur de la cadence argumentative, car il
sest ouvert une perspective dillimitation par laquelle son processus
intellectuel apparat sexcder lui-mme de proche en proche. chaque
tentative que fait sa raison pour circonscrire le concept de Dieu, la dfinition
de ce dernier la remet en marche vers une conception plus large et plus haute ;
et ce processus dauto-dpassement se poursuit jusqu faire perdre
lquilibre au marcheur rationnel, jusqu le griser de sa propre inaptitude
se retenir dans sa fuite. La glissade indfinie, incoercible, de lintelligence
vers lobjet quelle a projet sans pouvoir le saisir dans lenclos de son acte
de projection, confre ce dernier les traits kantiens du sublime, savoir
dune chappe propre faire clater les bornes des facults mentales qui
cherchent la capturer, et les force ainsi raliser leur finitude par contraste
avec limmensit quelles se sont cre.
De mme que les preuves a posteriori de lexistence de Dieu, la preuve
anselmienne a priori a t traduite terme terme par des philosophies
ultrieures sous la forme dune preuve dexistence de quelque ralit
indpendante ; indpendante de lexprience quon peut en avoir. Ainsi,
Levinas reprend la preuve ontologique quasiment lidentique, sans mme la
mentionner ou sinquiter de sa forte prsomption dinvalidit. la lecture de
sa version de la preuve il est mme vraisemblable quil a fait, comme saint
Anselme, lexprience du vertige qui lui donne force vivante de conviction.
Essayons donc didentifier par touches successives les signes qua laisss
cette exprience fconde dans son texte. La version particulire de la preuve
quutilise Levinas est avance lappui de lide dune extriorit apte
aimanter tantt la qute de la vrit, tantt (et sans doute surtout) lobligation
thique. Lextrieur, commence-t-il, ne se donne que comme un infini ; cest-
-dire vraisemblablement comme la perspective dun dveloppement sans fin
de la marche que nous entreprenons vers lui. Mais lide de linfini, poursuit
Levinas, est dmesure par rapport lme qui lentretient. Elle ne peut donc
pas venir de cette me, et pas mme de ses lacunes qui sont aussi finies
quelle-mme. Elle vient donc dailleurs, de cette extriorit quelle sefforce
de penser et qui par l se rvle elle. Dans ces conditions, conclut Levinas,
le mouvement part du pens et non pas du penseur
22
. La dmesure sentie a
tout coup fait craquer la mesure de finitude, et la invite percer vers la
conviction dtre la fois excde et porte par de lAutre. Pourtant, mme
amplifi et soutenu par le vertige dhorizon, le procd de la preuve demeure
en-de de lhorizon du vertige prouv. Que le mouvement parte du pens est
pens par le penseur destination dautres penseurs. Le choc rvlateur du
tout autre que le phnomne reste un phnomne de rvlation. Sentir son
exprience englobe par quelque chose qui lexcde est encore une
exprience denglobement.
Quil faille le scander ainsi, le rpter jusqu ltourdissement, signale
quel point le geste rflexif nest pas naturel , quel point il risque de
soublier lui-mme ds que la fascination de son objet sest faite plus
prgnante que la volont de le raccomplir. Est-il possible quun aussi fin
phnomnologue que Levinas ne sen soit pas aperu ? Est-il concevable quil
se soit gar dans la disproportion de sa vise, et quil ait rechut dans une
demi-inconscience de son sol dexprience visante ? Sans doute
limmatrisable objet quil sest donn, cet infini ailleurs, a-t-il suffi pour lui
faire perdre pied et lexpulser hors du terrain sr de lpoch. Sa pense,
confirme-t-il, pense [ici] plus quelle ne pense
23
. Levinas a beau
reconnatre que laperu dextriorit suppose une conversion de lme ,
que linfinit se mesure un dsir sans cesse inassouvi, il ne va pas
jusqu avouer que le pens dvoil tire sa force de lexprience de son
dvoilement, quil nest trouv nulle part ailleurs qu la pointe de la tension
vcue qui sarrache vers lui. Saint Anselme a peut-tre fait preuve de plus
lucidit lorsquil a not que tout argument, y compris ontologique, en faveur
de lexistence de Dieu, est pr-conditionn par la croyance en Dieu.
Largument en faveur de lobjet premier de la foi ne vaut que dans et pour une
exprience de la foi qui prend la forme dune extase daccueil, et il se dissipe
comme brume logique au soleil de la critique ds que la foi sest absente.
Ce nest pas pour croire que je cherche comprendre : cest pour
comprendre que je crois. Car je crois galement ceci : que je ne comprendrais
pas si je navais pas cru
24
.
La sortie a chou, une fois de plus. Non pas la sortie hors de soi, hors
dun soi limit un corps et une personne, toujours-dj accomplie par la
prsupposition vcue dautrui et dun environnement de corps ( les petits
autres ), qui conditionne notre existence aussi bien individuelle que sociale.
Mais la sortie radicale vers le grand Autre sopposant lexprience ; la
sortie vers ce qui, peine reprsent comme irreprsent, peine prouv
comme tranger toute preuve, savoue min par une contradiction
performative et existentielle. Si cette tentative extrme de sortie nest pas
parvenue ses fins, cest sans doute quelle sest trompe de cible. Elle sest
leurre non pas sur la ncessit du dpassement de ce que nous sommes, mais
sur la nature de ce quil y a dpasser. Ce qui se prsente comme contingent,
surprenant, imprvu, inintelligible parfois, dfie incontestablement les bornes
dun moi, dun corps, dune biographie, dune intelligence en dveloppement ;
mais pas celles, infigurables, dune exprience qui embrasse en elle tout la
fois le choc de la surprise, le traumatisme de lincomprhensible, la
singularit dun point de vue, le ressouvenir dune vie, leffort intellectuel de
comprendre, linfrence de ce qui la dpasse, et le projet dune qute
dailleurs. Ce qui passe les limites de ma personne, qui dborde ma capacit
de prvoir et de calculer, qui dfie mme le pouvoir de thorisation de
lhumanit entire, en lui apportant des dmentis exprimentaux priodiques et
en imposant la rvision des paradigmes, reste donn comme une exprience
dobstacle ou comme un vcu de surabondance. Ce qui motive
souterrainement la pousse de lexprience et lui oppose des rsistances a
priori imprvisibles na donc pas tre quelque entire extriorit vis--vis
delle, mais peut se comprendre comme lespace dexploration, et dinconnu
sans fin, quelle entrevoit dans ses propres marges ombreuses sans pouvoir le
matriser. Chez saint Anselme, la foi esquisse les rgions dmesures dun tel
dploiement avant mme que la pense ait cru russir, par la preuve
ontologique, la projection rifiante de limmense pressenti en une entit
divine. Chez Levinas et chez nous tous, lextraversion vcue de la recherche
de la vrit dessine les lignes de fuite de sa progression indfinie, avant mme
que la pense se soit crue autorise la cristalliser en preuve ontologique de
lexistence dune tout-autre chose .
La sortie a chou, mais on saperoit quelle na plus lieu dtre, quelle
na plus de motivation pour se raliser, parce quil ny a rien attendre de
plus ailleurs ; tout est dj L, y compris ce qui se prsente l comme au-
del. Lautre ne se donne de facto que comme un puits dchappe du mme,
comme larrire-horizon dune surface dont seules les courbures que lui
imposent ses propres richesses la font svader delle-mme. Il nest aucun
besoin dadopter une douteuse mtaphysique idaliste pour sen persuader ; il
suffit douvrir grand les yeux sur tout ce qui se montre ou qui sannonce, sans
mme sinterdire dextrapoler vers ce qui se prtend tranger toute
monstration possible, pourvu quon sache voir aussi lacte dextrapolation et
le sens de ltrangret comme phnomne. Quant au sens claustrophobique
dtre retenu l intrieur de lexprience, que pourraient susciter ces
remarques, il ne surgit que comme un vcu symtrique de lillusion
dextriorit par laquelle on voudrait lui chapper, et il a donc toutes les
chances de se dissiper avec elle : sans extrieur, pas dintrieur, et par suite
nulle rclusion.
Dans ltat rflexif auquel nous venons de revenir, le poids de
ltonnement bascule. On ne stonne plus que certains contestent la thse
banale que ce quil y a, ce sont des objets physiques, et que la conscience ne
peut donc que dcouler secondairement dun processus impliquant ces objets
physiques. On stonne au contraire que certains autres ignorent que les objets
pris pour premiers existants ne sont autres que des objets dexprience
passe, actuelle ou possible, des objets perceptibles de nimporte quel point
de vue mais pas indpendamment de tout point de vue, des objets constitus
pour servir de mles dancrage constants une exprience emporte par, et
dans, son devenir. Sil est vrai que les objets physiques sont
intentionnellement premiers dans lexprience, cest seulement dans la mesure
o lexprience est existentiellement, transcendantalement, et
mthodologiquement premire par rapport ses objets. Bien entendu, il faut
prendre garde ici de ne pas ajouter (ou concder) de manire inattentive que
lexprience est chronologiquement antrieure ses objets ; car la
philosophie transcendantale prterait alors le flanc la vieille objection de
ceux qui veulent la rduire labsurde en demandant dun air incrdule sil
est seulement possible de soutenir que lunivers nexistait pas avant que
lvolution biologique ait abouti des tres humains conscients. Se garder de
cette confusion na rien de difficile, condition quon tire les ultimes
consquences de lattitude rflexive, en assignant la chronologie elle-mme
le statut dune structure transcendantalement pr-comprise ; une structure
mthodologiquement premire par rapport tous les rcits dorigine, y
compris les rcits volutionnistes et cosmologiques.
La crise des sciences europennes au sens de Husserl est lie la
mconnaissance (ou la minimisation) de ces faits. Une mconnaissance et
une minimisation qui nont rien dtonnant ou de rprhensible, mais qui
dcoulent inexorablement dun tat de conscience collectivement faonn pour
diriger les tres humains vers des tches de matrise collective de ce qui peut
servir assurer cumulativement leur avoir et leur bien-tre matriel, plutt
que vers un travail dauto-lucidation sans cesse recommencer, sans cesse
redfinir en fonction de ses propres rsultats, sans cesse rexprimer
mesure que se transforment ceux qui lentreprennent, et sans cesse justifier
tant il semble immdiatement strile (puisque tout ce quil fait cest prparer
les autres dmarches en amplifiant le champ de vision de ceux qui les
accomplissent). Mais comment cette situation de crise est-elle
apprhende une fois quon sest install dans ltat de conscience rflexif ?
Dun ct, crit Husserl, le domaine subjectif-relatif est ce que les
sciences se proposent de surmonter ; mais dun autre ct il opre comme
fondement de leurs positions objectivantes. Le domaine fondateur qualifi
faute de mieux de subjectif-relatif couvre, selon le dernier Husserl, non
seulement sur un mode abstrait le champ de la conscience pure, mais plus
concrtement tout ce qui est prsuppos par ltre humain conscient dans son
activit quotidienne et technologique (le monde-de-la-vie , die
Lebenswelt). Le domaine fondateur inclut en particulier lenclos du
laboratoire avec ses instruments tangibles et ses savoir-faire manuels, avec
ses appareillages actionnables et ses prescriptions techniques, cest--dire
avec tous ses outils sous-la-main, comme lcrirait Heidegger. Cette sphre
du laboratoire opre comme le prolongement ou la prothse de qui cherche
connatre ; il extrapole le corps-propre, le corps en tant que chair et que sol,
et lexprience consciente stend alors kinesthsiquement de proche en
proche depuis le corps jusquaux appendices instrumentaux du corps
25
. Cest
partir de cette matrice pratique que sdifient aussi bien les projets de
matrise de lenvironnement que les moyens intellectuels de cette matrise. Ce
sont en particulier les rgles de lactivit accomplir dans ce primtre du
laboratoire et dans les interventions technologiques inspires de lui, que
recueillent les formalismes de la physique mathmatique, la faon dont la
grammaire recueille les rgles dusage de la langue
26
.
partir du moment o ltat de conscience rflexif a ainsi permis de
sapercevoir du statut fondateur de lexprience et de ses vcus corporels
pour luvre scientifique, le dsir ultime quentretiennent les sciences
naturelles de ressaisir lexprience consciente entire sous leur juridiction,
apparat comme une anomalie. Ds cet instant, en effet, un tel projet ne peut
plus se comprendre que comme le fruit dun oubli de lorigine de la
connaissance, et dun renversement abusif de lordre des priorits gntiques ;
cest--dire comme le rsultat dune dmarche aussi incorrecte que celle qui
consisterait pour un logicien vouloir prouver ses axiomes en partant de ses
thormes, aprs avoir prouv les thormes partir des axiomes. Husserl
attribue la premire impulsion de ce renversement localement fcond mais
globalement insens Galile, le gnie la fois d-couvrant et re-
couvrant
27
; ce gnie qui dcouvre le pouvoir danticipation des
phnomnes quont les idalits mathmatiques, mais qui recouvre en mme
temps le sol vcu de lidalisation qui les engendre. Car la science galilenne
a pour rve non dissimul de faire retour possessif sur son sol pr-compris
dexprience vcue prolonge par le monde-de-la-vie, aprs lui avoir
substitu des idalits mathmatiques dans le rle de seule vraie ralit.
La ralit, dsormais, est ce qui se conoit idalement ; elle nest plus le fait
de vivre son idalit comme de vivre tout le reste. Le vcu est tax de
seulement subjectif , et ne se voit plus reconnatre dexistence quen tant
que rsultat driv dune connexion causale particulire, formule en termes
didalits lgales : la connexion qui lie le corps-objet dot de ses organes
sensori-moteurs son environnement objectiv. Les qualits sensibles, en
particulier, ne sont plus envisages que comme autant de reflets de processus
se droulant dans le royaume des formes , ce qui permet la forme,
initialement modele comme un invariant trans-exprientiel, de revendiquer
pour elle-mme le statut originaire dont bnficiait lexprience incarne et
instrumente. Ce faisant, accuse Husserl en substance, Galile et ses
successeurs ont dplac entirement le balancier axiologique du ct de ltat
de conscience naturel ; si entirement quon ne parvient plus concevoir,
dans cet tat, que la d-couverte de la science moderne est aussi un re-
couvrement, et que son renversement de priorits est un dni de fondement
mthodologique. Ceux qui revendiquent la suite de Galile lexclusivit
pour le domaine des formes au dtriment de celui de la vie vcue sont certes
des tres vivants et sensibles ; mais des tres que leur tat de conscience
naturel sur-valoris et auto-justifiant loigne si bien de ce quils sont,
aline si parfaitement de leur propre exprience, quils sont prts sinvestir
dans la seule vise de formes logico-mathmatiques et dans le projet
corrlatif de parachever leur perte deux-mmes en tentant darraisonner leur
conscience par lun de ses propres produits intellectuels.
Il faut redoubler dattention, ce point de lenqute, et revenir son point
de dpart. Dans quel tat de conscience la comparaison de ces manires de
voir antinomiques, relevant respectivement des tats de conscience naturel
et rflexif, est-elle possible ? Quel tat de conscience avons-nous tent
dhabiter pendant cette mise en regard ? Ltat de conscience requis pour
leffectuer ne saurait tre que la deuxime varit dtat rflexif distingue
prcdemment, sa varit amplifie, autrement dit ltat de pleine rduction
phnomnologique o seul est suspendu le jugement, mais pas la vise des
objets intentionnels initiaux. Car cest seulement partir dun tel tat de
conscience que les deux ples dintrts sont accessibles, et que les
consquences thoriques du conflit de leurs intrts sont intgralement
saisissables. Hors de ce troisime tat de conscience, qui est la vraie
dcouverte de Husserl, les deux points de vue donneraient lieu un dialogue
de sourds, et se contenteraient de se tenir lun lautre pour une figure inverse
de la seule conception correcte.
Un tel dialogue de sourds entre des interlocuteurs dfendant des approches
respectivement rflexive et scientifique du problme de la conscience se
droulerait peu prs comme suit. Le premier (appelons-le Edmund)
soulignerait comme il se doit quil est trange de vouloir driver lexprience
consciente de la description scientifique dun processus objectif, puisque ce
processus prsuppose une conscience constitutive. Lexprience consciente,
martlerait-il, est transcendantalement premire en plus dtre
existentiellement premire. Aprs un long change darguments, le second
interlocuteur (une interlocutrice quon appellera Patricia) finirait par
rpliquer, de guerre lasse, soit, jadmets que la conscience est
existentiellement et mthodologiquement premire, mais ma concession
sarrte l. Car on ne peut rien infrer de ce genre de primaut, on ne peut que
la vivre . Edmund se tairait un long moment, impressionn par cette rplique
reue dans ltat de conscience naturel-intentionnel o il se serait
involontairement plac pour mieux suivre le dbat et la vise partage
dobjets de discours. Dans cet tat, linfrence, la progression de la pense
dun point de dpart un thme quelle se donne comme but, est une valeur
indpassable ; ne plus pouvoir infrer quoi que ce soit apparat donc comme
une catastrophe et une reductio ad absurdum de la position qui instaure une
telle stase. Nest-il pas clair quune fois accompli le retour lvidence, il
ny a plus rien faire ; alors quen laissant lvidence en arrire de soi-mme
pour pratiquer les sciences de la nature, on ne cesse de progresser ? Aprs
une pause consacre non pas tant penser qu rintgrer et stabiliser un
autre tat de conscience, de type rflexif, Edmund reviendrait cependant la
charge en remarquant ceci : Certes, on ne peut rien infrer partir du
constat de la primaut transcendantale et existentielle de la conscience ; mais
pas davantage ne peut-on linverse lucider par linfrence la source
transcendantale et existentielle de ce procd logique. Linfrence nest quun
aspect du jaillissement de la conscience, et elle ne saurait donc envelopper la
conscience pour en rendre raison. Lorthogonalit des postures serait alors
consomme. Patricia rvait dexpliquer la conscience en mettant en uvre une
chane hypothtico-dductive, toute tendue quelle tait vers lobjectif du
raisonnement. Edmund, en revanche, voyait linfrence comme un acte de
conscience, tout immerg quil tait dans lorigine des procdures
rationnelles. Et nous ne devenons capables de percevoir les rouages de ce
type de dbat sans issue quen tendant notre immersion tous les aspects du
premier commencement conscient, depuis lex-stase signifiante et infrentielle
de lintentionnalit jusqu louverture de lapprhension rationnelle du
monde ses propres prconditions.
Il ne sagit cependant l que dun premier pas vers une lucidit accrue. Le
bnfice du troisime tat de conscience distingu, de ltat de conscience
amplifi qui caractrise la rduction phnomnologique intgrale, va
potentiellement bien au-del de la simple capacit de voir que la perspective
sinverse lorsquon passe de lattitude naturelle -intentionnelle lattitude
rflexive. Ce pas supplmentaire est franchi lorsquon suspend la tendance de
lattitude rflexive troite ne prendre chaque acte intentionnel dirig vers un
objet que pour un dsquilibre de la conscience qui se perd elle-mme en
sextravertissant, et quon apprend le voir comme ce quil est galement,
savoir une discrimination fine en retour du champ de conscience. Selon cette
approche ouverte, lobjet intentionnel est rvlateur de lacte qui le constitue,
et il est donc aussi clairant pour la dmarche rflexive que pour la dmarche
scientifique. Lorsquelle cherche saisir ce qui arrive en lui donnant la forme
dun domaine dobjets, la conscience se rvle elle-mme en tant que
pouvoir dauto-projection, ce qui lui permet de se rendre manifeste son propre
mode de structuration travers la structure de ses vises objectives. Il est
vrai quen entreprenant de se retourner vers le processus pistmique dont
elle est le point de dpart, la conscience en son tat rflexif largi risque de
commettre une erreur de principe, parce quelle est deux doigts de
transformer ainsi la prsupposition transcendantale de la connaissance en un
thme denqute pour cette connaissance. Mais, par cette improprit fconde,
elle se donne les catgories et le vocabulaire qui vont lui servir dcrire son
champ transcendantal, ne pas le confiner dans le silence des avnements,
lui prter les voix de la nature mme quil a servi constituer
28
. Lhistoire de
la philosophie est pleine de ces mtissages empirico-transcendantaux. Le
vocabulaire de Kant est entirement fait de dnominations psycho-
anthropologiques dont lusage est mthodiquement dtourn vers la
qualification du champ transcendantal ; les parties du corps propre nont pu se
voir attribuer de noms que par simple rptition de ceux des parties
correspondantes du corps-objet ; et le lexique de la phnomnologie laisse
transparatre son enracinement dans celui de la folk-psychology qui a hrit
une conception nave, spatiale et corporelle de la psych. L-motion est
drive dun mouvement (de recul ou dlan), lin-tention voque la tension
musculaire de qui se prpare laction, la peur (pavor en latin) pourrait bien
driver en partie du verbe latin pavio, pavire (battre, frapper, trembler), la
pense voque la pese, et ainsi de suite. Conscientiser la nature ne peut se
dire autrement que par les mots de la naturalisation de la conscience. Sous
couvert de conflit entre deux conceptions diamtralement opposes des
rapports entre lexprience et le monde se fait jour une troite synergie faite
de soutien dialectique, demprunts lexicaux et de rgles dinterconvertibilit.
Les tats de conscience naturel et rflexif sont lun lautre comme un
envers et un endroit contigus, et cela sentend jusque dans leur mode
dexpression. largir le domaine de la rflexivit conformment lacception
maximale de lacte de rduction phnomnologique revient ds lors pouvoir
jouer pleinement de cette rversibilit, en mobiliser toutes les ressources
qui avaient t progressivement taries par le durcissement de la discipline
objectivante aussi bien que par la ttanisation ractionnelle des retours
romantiques limmdiatet intuitive.
Nous allons prsent pratiquer cet exercice de mobilisation conjointe des
tats de conscience naturel et (troitement) rflexif la faveur dun tat de
rflexivit largie, en discutant un exemple historique. Demandons-nous
nouveau, avec une perplexit renaissante, ce quil faut penser des tentatives de
rduire lexprience lexpriment, la conscience quelques-uns de ses
objets, qui ont t lances ds la naissance de la science moderne. Lhomme
de lattitude naturelle se laissera avant tout fasciner par leur demi-succs. Il
concdera du bout des lvres (sil ne sest pas laiss aveugler) que ces
tentatives nont pas atteint leur aboutissement final, que la pure exprience
consciente reste hors de porte explicative, quon ne voit pas ce jour
comment le simple fait de son existence pourrait tre driv dun processus
physico-chimique. Mais il soulignera avec dexcellents motifs les immenses
progrs que lentreprise rductive a permis daccomplir, en rendant compte
de nombreuses structures de lexprience consciente et de leur articulation
aux structures naturelles. Puis il conclura par un acte de foi, en prconisant la
patience et en annonant que lultime rponse attendue sera apporte par la
science dans le long terme. linverse, lhomme de lattitude (troitement)
rflexive sappesantira sur le demi-chec de la cascade de rductions, en
dclarant mme que de son point de vue il sagit dun chec complet,
puisquun lment crucial (quil appellera alternativement esprit, conscience,
qualit sensible, et/ou intentionnalit, en sentant chaque fois que cela glisse
entre ses doigts) reste hors de porte de la course vers le dvoilement
dobjets. Lhomme de lattitude rflexive largie, pour sa part, ne se laissera
ni fasciner par un futur radieux, contrairement au scientifique en son attitude
naturelle , ni tenter par le simple repli sur un constat dinachvement
constitutif de lentreprise rductive des sciences, contrairement un
phnomnologue qui se bornerait une rflexivit troite. Il tirera profit de
lvolution des sciences et de leur ethos rductionniste pour mettre au jour le
vrai mode dtre de ce qui leur manque et leur manquera sans doute jamais.
Quelque chose nest pas rductible, mais quoi exactement ? Sagit-il dune
chose ou justement de rien de tel ? Peut-on nommer ce qui chappe tout
arraisonnement, ou est-il vou rester innommable ? Pour cerner
lirrductible, le mieux nest-il pas de procder par soustraction, en observant
ce qui reste aprs le passage de luvre de rduction, au lieu de se contenter
de dnoncer cette dernire ?
Ce que nous avons appel le demi-succs de la pousse rductionniste
des sciences physiques et neurophysiologiques offre de prcieuses cls pour
aborder ces questions. Cette pousse ne suffit certes pas oprer un ultime
dvoilement de la nature de ce qui file entre les doigts des scientifiques, et
encore moins en formuler une dfinition ; mais elle montre en ngatif ce que
ne peut pas tre cette nature. Les sciences savrent ainsi navoir pas
seulement une valeur de saisie et de manipulation, mais aussi, travers la
dlimitation prcise de leurs plus bantes lacunes, un pouvoir indirect
dlucidation phnomnologique. Elles sont un alli prcieux de lhomme de
lattitude rflexive largie, plutt que ladversaire combattre quen faisait
lhomme de lattitude rflexive troite.
Penchons-nous donc sur lhistoire des rductions, et cherchons
apprhender ce quelles laissent toujours-encore dans leur inaperu aussi bien
que dans leur impens. Curieusement, cest lenthousiasme mme des
partisans du rductionnisme en philosophie de lesprit qui va nous mettre sur
la piste de cet inaperu. Ceux-ci ouvrent leur plaidoyer en numrant ce que
nous avons appel des demi-succs rductifs des sciences de la nature, et
le concluent par une dclaration de confiance dans le parachvement omni-
englobant de lentreprise de rduction. Voil, constatent-ils : nous avons dj
rduit la chaleur lnergie cintique des molcules composant un matriau ;
la couleur la longueur donde du rayonnement lectromagntique ; la vie
des rseaux cycliques de ractions, de catalyses et de codages biochimiques ;
l a pense une machine de Turing implmentable sur des ordinateurs ; le
temps une dimension de lespace quadridimensionnel de Minkowski ; et
ainsi de suite, sans que la liste soit limitative. Tous ces concepts rduits
taient initialement pars dune connotation dineffable. Pire, ils taient
presque toujours associs une puissance surnaturelle ou une essence
impntrable. La chaleur tait reconduite llment feu ou une qualit
subtile, la couleur une modalit de la lumire en quelque sorte
spirituelle
29
, la vie une entlchie ou un principe vital, la pense un
intellect agent de nature divine ou des ides transcendantes, le temps
un dieu grec de mme nom Chronos . Et toute cette magie sest vapore
partir du moment o une thorie scientifique a pu rendre raison dans ses
propres termes des phnomnes circonscrits par les noms communs de
chaleur, couleur, vie, pense, temps . Ds lors, poursuivent les avocats du
rductionnisme, le prtendu mystre de lineffable conscience disparatra
dans lavenir la manire dont tous les autres ont disparu : par sa retraduction
en langage scientifique, et par la prise en charge des phnomnes qui lui
correspondent au sein dune thorie valeur prdictive. Lisons par exemple
Dennett : Aprs tout, nous avons dsormais obtenu dexcellentes
explications mcanistes du mtabolisme, de la croissance, de lauto-
rparation et de la reproduction qui, il ny a pas si longtemps, paraissaient
galement trop merveilleux pour tre dits en mots. La conscience, selon cette
conception optimiste, est effectivement une chose merveilleuse, mais pas si
merveilleuse que cela pas trop merveilleuse pour tre explique en utilisant
les mmes concepts et perspectives qui ont opr ailleurs en biologie
30
. Les
phrases de ce genre fonctionnent parfaitement sur le mode rhtorique, pour
emporter la conviction dun auditoire dj moiti conquis. Elles arrivent
leurs fins par le jeu conjoint de lanalogie et dun appel connivence.
Lanalogie est tablie entre un domaine connu (le mtabolisme) et un domaine
encore partiellement inconnu (la conscience). Lappel vise faire vibrer le
grand prsuppos qui sous-tend notre civilisation malgr ses affaiblissements
rcents : celui dun progrs indfini de la connaissance objective, apte en
principe rsoudre tous les problmes dans son cadre mthodologique, y
compris ceux qua d retrancher sa mthode pour exister. Pourtant, il suffit
dexplorer un peu plus avant le discours rductionniste pour y reconnatre la
lacune vertigineuse quil cherche recouvrir.
Le cas de la rduction de la temprature lnergie cintique moyenne de
chaque molcule dun corps, et de la chaleur lnergie totale des molcules
composant ce corps, fonctionne comme un archtype ; cest lui qui sert
souvent de paradigme auquel la science de la conscience est cense devoir se
conformer un jour. Lquation rductive admettre semble vidente : la
chaleur est lnergie molculaire ce que la conscience est la dynamique
des neurones corticaux. Jusque-l, rien que de trs banal en apparence. Deux
concepts globaux et macroscopiques (la chaleur et la conscience) sont rduits
ou rductibles des concepts microscopiques (lagitation molculaire et
lactivit lectrochimique des neurones en rseaux). Mais sagit-il seulement
de cela ? La conscience est-elle uniquement un concept recouvrant un type de
phnomne ou de proprit manifest lchelle macroscopique de
nos moyens cognitifs non appareills, comme la chaleur est un concept
recouvrant des phnomnes manifests lchelle macroscopique des
instruments de la physique du XIX
e
sicle ? Mme si les penseurs
rductionnistes donnent une rponse explicitement positive cette dernire
question (comment feraient-ils fonctionner leur analogie entre la science
physique et la science de lesprit dans le cas contraire ?), la description
dtaille quils donnent de la rduction de la chaleur lnergie molculaire
dment implicitement leur conviction affiche. Car la thse clandestine qui
sous-tend leurs arguments nest pas seulement que la conscience est un
concept macroscopique du mme genre que la chaleur ou la temprature, mais
galement linverse (mme si cela reste beaucoup plus discret) que la
chaleur ou la temprature sont des concepts impliquant un contenu conscient.
Ainsi, voulant promouvoir la valeur didal-type de la rduction de la
chaleur, Paul Churchland
31
commence par remarquer que la temprature mest
accessible directement, par le toucher, alors que lnergie cintique moyenne
molculaire ne lest pas. Qui nierait en dpit de cela, poursuit-il, quavoir une
temprature et avoir une nergie cintique moyenne est la mme chose ? la
lecture de ces deux phrases, on se met souponner que largument de
Churchland ne repose pas sur une analogie, un parallle, ou un isomorphisme
entre deux schmas rductifs, mais sur laffirmation latente de leur quasi-
identit. Il semble en effet devoir sinterprter comme suit : (1) la temprature
et la chaleur recouvrent des expriences tactiles, et pourtant nul ne doute de la
rductibilit de ces deux concepts des caractristiques de mouvements
molculaires dsordonns ; (2) par extension, nul ne devrait tre choqu de la
possibilit de rduire lexprience consciente en gnral des processus
physiques intra- et inter-neuronaux. Une fois le raisonnement reconstitu, y
compris dans ses aspects les plus tacites, sa dficience fondamentale saute
aux yeux
32
. Contrairement ce que sous-entend Churchland, les concepts de
temprature et de chaleur qui se trouvent rduits dans le cadre de la
thorie cintique des gaz et des matriaux nont plus rien voir avec
lexprience tactile. Ce sont des concepts objectifs intervenant dans la science
objective appele la thermodynamique macroscopique. Lhistoire entire de
cette science montre en effet quelle sest difie par une lutte constante contre
lorigine sensible de ses propres concepts, et quelle nest vraiment ne
quaprs avoir russi leur reconfiguration oprationnelle, la temprature tant
dsormais spcifie par elle comme la classe dquivalence des lectures de
thermomtres solides ou liquides, et la chaleur transfre comme le produit de
la variation de temprature par une dtermination massique des corps appele
capacit thermique
33
. La rduction qui sopre au passage de la
thermodynamique la thorie cintique consiste donc traduire les termes
dune thorie dcrivant des processus macroscopiques objectivs, dans les
termes dune thorie dcrivant des processus microscopiques galement
objectivs ; elle ne concerne en aucune manire lexprience sensible quon
fait au contact des corps chauds ou froids. Sil en va ainsi, la valeur de
lexemple de la chaleur comme argument en faveur de la rduction future de
lexprience consciente, ne peut plus tre, nouveau, que celle dune analogie
et non pas dune instanciation partielle. Mais le pouvoir de conviction dune
telle analogie est trs faible : en quoi la russite (dailleurs incomplte
34
) de
la rduction dun concept objectif un autre concept objectif rend-elle
plausible la rduction de la pr-condition de lobjectivit un concept
objectif ? Tout, dans ce dernier domaine, reste prouver. Aucun prcdent
historique ne vient soutenir la perspective lointaine de la rduction de la
conscience, puisque nous ralisons maintenant quel genre dabme spare les
deux rductions compares au-del de leur similitude superficielle : lune met
en relation deux termes de mme catgorie pistmologique (des proprits
objectives), tandis que lautre cherche relier deux termes relevant de
catgories pistmologiques mutuellement exclusives (une proprit objective
et un arrire-plan transcendantal ; quelque chose qui est et ce que a fait
dtre). Lune permet de se figurer un passage explicatif entre les proprits
objectives relies (la dilatation du liquide thermomtrique est par exemple
explicable en invoquant laugmentation de son nergie interne occasionne par
le choc des molcules environnantes), tandis que lautre reste suspendue en
lair, sans aucun passage explicatif entre le terme rducteur et le terme
rduire. Lanalogie nest donc pas seulement incertaine ; elle relve dune
erreur de catgorie , au sens de Ryle.
Pour aller plus loin dans lexploration de la dmarche rductionniste et en
faire ressortir lincompltude constitutive, il nous faut prsent insister sur
son procd crucial mais tacite, tel quil vient dtre mis au jour. Ce procd,
mentionn ds le dbut de ce chapitre, nest autre que la mise lcart de
lprouv dans les qualits rduire. John Searle le fait ressortir en pleine
clart propos du cas de la thermodynamique : Le compte rendu rductif de
la chaleur extirpe les sensations subjectives, et dfinit la chaleur comme
lnergie cintique des mouvements molculaires
35
. Deux tapes sont ici
reconnues sur le chemin de la rduction. La premire, dj signale, consiste
d-subjectiver le concept macroscopique de chaleur en le rapportant des
mesures thermomtriques et massiques plutt qu lexprience tactile du
chaud et du froid ; la seconde consiste redfinir la chaleur en faisant appel
des concepts objectifs aussi loigns que possible de la vie concrte, en
loccurrence des concepts microscopiques dabord construits en cherchant
rendre compte de ces mesures grande chelle, puis eux-mmes soumis des
mesures spcifiques trs petite chelle. Dans un premier temps, on sarrange
pour que la chaleur rduire ne soit pas une chaleur au sens le plus courant,
anthropologique et sensitif, mais une chaleur objective en tant que variable
macroscopique. Dans un second temps, on va jusqu identifier la chaleur en
gnral au processus objectif microscopique auquel la variable
macroscopique a t rduite, parachevant par ce redoublement leffacement de
son origine sensible. Sous la proclamation que lon a rduit la chaleur se
cache en somme une refonte complte de son concept. La chaleur rduite na
plus gure de ressemblance avec la chaleur au sens originel. La rduction
thorique na pas pris en charge la chaleur dans son intgralit
phnomnologique ; elle a extrait son ombre ou ses ossements dsactivs afin
de larraisonner, puis a donn son nom au squelette ainsi dpouill.
Ce cas paradigmatique de la chaleur veille la suspicion plus gnrale
que toute rduction demande au pralable de redfinir ce qui est rduire, de
manire en liminer le seul vrai noyau irrductible qui est (pour faire bref)
exprientiel. Il suscite aussi le sentiment que toute rduction exige de
conserver le nom de ce qui est rduire aprs en avoir pourtant tronqu la
signification, de faon laisser croire que son uvre a t pleinement
accomplie selon le projet quelle stait initialement fix. Les rductions
semblent condamnes laisser persister une zone obscure dans leur produit
achev, et en viter la reconnaissance par un tour de passe-passe lexical.
Mais cest justement la topologie de leur zone obscure qui dtient une
information essentielle pour la philosophie de la conscience. Car, ainsi que
nous allons prsent le constater, loin de se rpartir au hasard, les taches
sombres des rductions successives se recouvrent en une rgion la fois
prcise et cryptique, ce qui suffit dlimiter en creux le site de
lincompltude principielle qui affecte toute dmarche de ce genre. Cette
dlimitation constitue lenseignement, certes ngatif mais prcieux, quoffrent
les sciences la phnomnologie, le point de vue naturalisant au point de vue
transcendantal. grenons donc la litanie des actes rductifs en repartant de
lexemple de la chaleur. Nous avons vu que ce qui a t rduit lnergie
cintique molculaire nest pas la sensation du chaud et du froid, mais une
variable thermodynamique objective. De mme, ce qui a t rduit aux
caractristiques quantitatives dun rayonnement lectromagntique nest pas la
sensation de couleur, mais diverses variables objectives comme la position
relative des composantes du spectre de la lumire blanche. Ce qui a t rduit
un processus biochimique nest pas la vie dans sa pleine acception, qui
enveloppe le vcu, lexprience de vivre rflchie en aptitude se savoir
vivant, mais un ensemble de proprits biologiques objectives comme
lhomostasie, la croissance, ou la division cellulaire. Ce qui a t rduit la
quatrime dimension de lespace de Minkowski est la coordination gnrale
des indications dhorloges, et non pas lexprience (bergsonienne) de la dure
ou de la dissymtrie pass-futur. Ce qui a t rduit un processus mcanique
ou lectronique sous-tendant le schme de la machine de Turing, cest la
squence objective des tapes de linfrence symbolique, et non pas la
pense dans sa pleine acception, qui englobe lexprience de reconnatre une
conclusion comme vraie. Bien des logiciens ne signalent-ils pas dailleurs,
lappui de cette remarque, que leur science tend remplacer la notion de
vrit par celle de drivabilit ? Dans tous ces cas, laffirmation quun trait
apparemment ineffable du monde a t rduit un processus physique savre
tout simplement fausse. Comme pour la chaleur, elle ne recouvre rien dautre
que la redfinition objectivante de ce qui est rduire, et la traduction de la
proprit ainsi redfinie dans les termes dune thorie rductrice.
Il est vrai que quelque chose entretient la croyance en une captation finale
de lineffable dans les rets de la dmarche objectivante : cest que
lorsquelles sont considres dans leur squence historique plutt que dans
leur tat prsent, les rductions semblent restreindre progressivement
lextension de ce que nous avons appel la zone obscure . Les rductions
successives permettent de rendre raison de structures de plus en plus fines de
lexprience consciente, en les traduisant dans les termes de thories physico-
physiologiques sans cesse amliores. Nest-il pas tentant dextrapoler
partir de l vers la disparition pure et simple de lobscurit rsiduelle, cest-
-dire vers larraisonnement exhaustif de lexprience ? Pourtant, sauf
passer par pertes et profits la diffrence entre la texture thorisable des
phnomnes et le fait silencieux quil y a la phnomnalit, une telle
extrapolation est manifestement infonde. Car si les rductions diminuent bien
la zone dombre de lprouv en larpentant de manire de plus en plus fine,
elles lui restent dlibrment trangres en vertu de leur mode dopration par
d-subjectivation de proprits, et aveugles de surcrot sa prsence ttue en
arrire-plan.
Considrons le cas de la perception des couleurs, qui manifeste bien la
conjonction de rtrcissement et de persistance de la zone dombre des
rductions. A-t-on dabord le droit de considrer, conformment ltape
rductive atteinte par la physique du XIX
e
sicle, que la couleur est une
longueur donde de rayonnement lectromagntique ? La rponse cette
question est ngative pour deux espces de raisons : limperfection de la prise
en compte de la structure de lexprience perceptive, et le gouffre catgoriel
entre ce qui est rduire et les concepts rducteurs.
Premire raison : la corrlation structurale entre lchelle des longueurs
donde et les rapports verbaux propos des couleurs perues est trs
imparfaite.
Un rayonnement lectromagntique de longueur donde dtermine,
qualifi de monochromatique au nom de son rapport anticip avec la
couleur, ne donne lieu une classe dexpriences de couleur bien dfinie
que sous des conditions physiologiques normales. Dans certains tats
qualifis dachromatopsie, une seule couleur est perue quelle que soit la
longueur donde du rayonnement reu par lil. Et dans les
dyschromatopsies (comme le daltonisme), le rapport entre longueur
donde et perception de couleur nest pas le mme que chez les sujets
normaux ;
Aucune juxtaposition simple des perceptions de couleur ne rsulte de la
combinaison de plusieurs flux de rayonnements ayant chacun une longueur
donde fixe. Ainsi, une combinaison de rayonnements monochromatiques
bleu et rouge donne une couleur magenta. Cette nouvelle couleur nest pas
ressentie comme un amalgame des deux couleurs initiales, mais plutt
comme intermdiaire entre le rouge et le violet qui est pourtant associ
un rayonnement lectromagntique de longueur donde plus courte que le
rouge et le bleu ;
Des perceptions identiques de couleur peuvent tre associes diffrentes
combinaisons de rayonnements lectromagntiques de longueurs dondes
fixes. La perception du jaune peut par exemple rsulter dun rayonnement
lectromagntique monochromatique de longueur donde 580 nm, ou bien
dune synthse additive de rayonnements de longueurs donde 540 nm
(vert) et 650 nm (rouge).
Seconde raison, la fois plus succincte et plus insondable, de ne pas
penser que la couleur a t rduite un processus lectromagntique : il ny a
aucune connexion, aucune faon de se figurer un passage explicatif entre la
valeur numrique dune longueur donde et lexprience du rouge ou du bleu.
La premire classe de raisons sest avre accessible des recherches
ultrieures sur la voie des rductions, mais pas la seconde qui demeure intacte
en dpit de toutes les avances. Au chapitre des succs, Maxwell a tabli un
modle du systme des relations entre les couleurs perues, sous la forme
dun triangle de trois nuances primaires dot de coordonnes. Ce modle
permet de rendre compte immdiatement de faits comme la proximit
perceptive du rouge, du magenta et du violet, qui restent surprenants aussi
longtemps quon en reste au schma linaire des valeurs numriques
croissantes des longueurs dondes. Par ailleurs, le triangle maxwellien des
couleurs a t rapport la prsence de trois types de cnes rtiniens
contenant des photopigments diffrents. On a pu identifier partir de l
quelques-uns des motifs physiologiques pour lesquels la connexion entre la
longueur donde et la couleur perue nest pas immdiate, particulirement en
cas de combinaison de flux de rayonnement de diverses longueurs dondes. Et
on a galement pu comprendre les dyschromatopsies comme rsultant du
dficit dun ou deux photopigments. Au total, on a tabli un lien troit entre
certains traits structurels de lexprience et des traits structurels de certains
objets de science ; et lon a pu croire que rendre ainsi raison de ce quil
fallait bien qualifier de faits dexprience nous rapprochait dun compte
rendu explicatif de lexprience elle-mme. Bien plus tard, dans la seconde
moiti du XX
e
sicle, on a identifi la manire dont linformation rtinienne
propos du rayonnement incident est traite et articule dautres lments
dinformation. Les dcharges des cnes rtiniens sont initialement accentues
et contrastes par le rseau neuronal intra-rtinien, puis, aprs un itinraire
complexe travers le cerveau (passant par les corps gniculs latraux), elles
se projettent sur laire V1 du lobe occipital du cortex. Cette rgion du cortex
crbral contient plusieurs types de colonnes de neurones dont lactivation est
corrle diverses composantes de linformation visuelle ; certaines dentre
elles, appeles blobs , sont spcifiquement corrles aux couleurs
perues
36
. Na-t-on pas atteint ce stade la rduction espre de la
couleur, aprs lchec reconnu de sa rduction initiale la longueur donde du
rayonnement lectromagntique ? La rponse cette question est nouveau
ngative pour les deux mmes raisons que celles qui ont dj t exposes
auparavant : (a) la correspondance entre les contenus dcrits dexprience de
couleur et lactivation des neurones des blobs de laire V1 nest pas aussi
stricte quon laurait voulu (mme si elle est dj bien meilleure que la
correspondance entre ces contenus et les longueurs donde du rayonnement
incident), et (b) on ne voit aucun pont conceptuel entre lactivit
lectrochimique de ces neurones-l (pourquoi dailleurs ceux de laire
occipitale plutt que ceux de laire frontale, ceux des blobs plutt que ceux
des inter-blobs ?), et le simple fait quil y a une exprience de couleur plutt
quaucune. La corrlation entre exprience chromatique et processus
neuronaux a vite t amliore par des travaux ultrieurs sur laire V4-V8 du
cortex occipital qui ont montr un excellent parallle entre son activit et la
perception dclare des couleurs
37
, y compris dans les situations dlicates o
des variations dombre et dintensit sont impliques. Mais ici encore, la
corrlation nest pas parfaite, car la perception des couleurs peut impliquer
divers facteurs apparemment priphriques comme lorientation et la
motricit, qui sont grs par dautres rgions non occipitales du cerveau
38
. De
plus, nous navons toujours aucune ide de comment les dcharges rythmiques
des neurones de laire V4-V8 donnent naissance du bleu ou du rouge
prouvs ; pas le dbut dune piste supplmentaire par rapport aux tapes
prcdentes de la qute. Et ainsi de suite. Aucun terme nest en vue, ni mme
concevable, pour cette recherche sur lorigine de lexprience des couleurs,
en dpit des fruits remarquables de connaissance quelle a produits chemin
faisant. La progression vers cette origine suppose est constante mais semble
asymptotique, rejete linfini. Le filet se resserre autour de la zone
obscure , mais ses mailles invitablement ouvertes se laissent encore et
toujours traverser par un ocan de nuit.
Peut-on au moins dsigner ce qui est laiss de ct, ce que llan
objectivant manque du seul fait de son mouvement vers lavant, ce que la
recherche narrte pas de repousser vers de lointaines perspectives force
davoir commenc par loublier derrire elle ? On a envie de remettre
lhonneur, dans ce but de dnomination, certains mots anciens qui staient au
moins vu reconnatre laptitude encapsuler l obscurit en eux,
lempchant ainsi de se rpandre partout ou dtre compltement mconnue.
On pense par exemple aux mots esprit et conscience , que je ne me suis
pas priv dutiliser car il fallait dire quelque chose. Ce que ne capture pas
lentreprise rductionniste des sciences cest lesprit, cest la conscience !
Lesprit ? , risque alors de demander, faussement candide, un spcialiste
de sciences cognitives, mais je nignore pas cette fonction biologique
adaptative complexe de rgulation des comportements, et je suis en passe de
jeter toutes les lumires souhaitables sur elle ; la conscience ? Vous
voulez parler de la mta-cognition ? Il aurait t vain desprer que le
dcret dappropriation lexicale par lequel leffort rductionniste se fraie son
chemin sarrterait la chaleur, la couleur, la vie, la pense et au temps.
Les derniers retranchements terminologiques utiliss pour nommer ce qui lui
chappe savouent subjugus : lesprit, la conscience, sont dj redfinis,
prts cder un nouvel effort de rduction condition davoir t
pralablement vids de leur cur tnbreux (ou, plus exactement, trop
lumineux pour pouvoir tre fix sans obnubilation). Considrons la
dfinition de lesprit que propose la vulgate cognitive contemporaine inspire
par le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme nest certes pas rductionniste au
sens troit, parce quil admet limplmentabilit de chaque tat mental sur
plusieurs substrats physiques et ne cherche donc pas rduire lesprit un
seul dentre eux. Mais il est rductionniste au sens large parce quil tient
lesprit pour une fonction de traitement de linformation (analogue un
logiciel), potentiellement effectuable sur un grand nombre de substrats
physiques. Il est rductionniste en un sens encore plus large parce quil
reconduit lesprit une structure systmique objective (celle de
lorganigramme dun logiciel). Un tat mental, dans le cadre de pense
fonctionnaliste, est un tat interne [dun organisme ou dun robot] capable
dtre caus par certaines entres sensorielles et apte causer certaines
sorties comportementales
39
. Lesprit est suppos tre le rseau entier de ces
tats internes possibles, le gnrateur polymorphe des cartographies qui
guident les conduites, le nom gnrique des fonctions qualifies de
mentales dans cette acception machinique. Bien entendu, les tats mentaux
se voient parfois associs la conscience de leur ralisation, mais cette
association est loin dtre systmatique. Il est couramment admis que la
plupart des processus mentaux ne sont pas conscients, quils relvent dun
inconscient cognitif
40
. La conscience devient lexception de la rgle
mentale, le rare et superficiel supplment de qualit de la quantit
informationnelle. La difficult a de nouveau t repousse, lesprit a t dans
une certaine mesure rduit (au sens large du fonctionnalisme) au prix de sa
redfinition trs majoritairement in-consciente. Il reste bien la conscience,
mais mme elle, quelques doutes prs
41
, sest vu substituer une abstraction,
un schma, une fonctionnalit. La conscience est ainsi couramment assimile
une fonction unifie daccs aux informations, un centre de contrle des
comportements et des paroles coiffant les modules spcialiss de lesprit, et
aussi une aptitude lauto-surveillance. tel point quil a fallu inventer une
nouvelle expression pour ce qui, de la conscience, chappe la tentative de la
dfinir comme une fonction de fdration et de rtro-contrle. Ned Block a
propos de donner cet inscrutable rest hors de porte de la dfinition
fonctionnelle le nom de conscience phnomnale , et de rserver la
fonction unificatrice et auto-surveillante le nom de conscience daccs
42
.
Conscience phnomnale, exprience, qualia. Retranchements nouvellement
ultimes dans les replis du dernier retranchement de la parole. Mais ce serait
omettre limpatience des chercheurs presss den finir une bonne fois pour
toutes avec ce qui est dautant plus insaisissable quil est-saisissant. Les
qualia se voient accuser, non sans quelques raisons, dtre les derniers
rejetons de latomisme psychique du dbut du XX
e
sicle. Et la conscience
phnomnale se voit ravale au rang dillusion, ou encore de spectacle gratuit
que donne une partie du cerveau une autre pour sassurer un merveillement
fantasmagorique
43
(mais, au fait, qui est le spectateur apte prendre
conscience de ce spectacle ?). Tant et si bien que lexprience est tantt
traite comme superflue, tantt comme surnumraire, et quon tient pour
presque vident quelle doit se faire jour ( lgal dun supplment dme
ancillaire) ds que toutes les fonctions de la conscience daccs sont
ralises, ou ds que lingrdient allgu de la fantasmagorie est ajout.
La voie vers la construction dun robot conscient semble partir de l
ouverte, et elle jouit dune grande popularit de nos jours
44
, mme si lon sait
quaucun test ralisable ou imaginable ne pourra jamais garantir que ce robot
possde bien autre chose quune simple conscience daccs
45
. Autre
chose qui nest ni connexion causale des entres sensitives et des sorties
comportementales, ni fonction dunification des informations, ni boucle
rtroactive dauto-surveillance, ni aptitude reproduire les comportements
humains de manire que le test de Turing
46
soit pass avec succs. Autre
chose qui nest aucune chose, qui nest mme pas quelque chose au sens le
plus vague de lexpression. Autre chose qui nous frappe par son ubiquit
peine avons-nous suspendu lattention focalise aux choses, qui est la fois
partout et nulle part, qui recouvre toutes les choses sans sassimiler aucune.
Le projet rductionniste a eu le formidable rsultat involontaire de nous
montrer ce que nest pas sa zone dombre, de la dgager de sa gangue de
prjugs jusqu la laisser deviner dans sa nudit arienne. Encore plus
involontairement, il nous a rendu par ce biais plus accessibles quelques
allusions rputes cryptiques de la philosophie prenne et moderne : la voie
ngative, le connaissant inconnu, la prcondition non existante de lexistence.
Mais aprs ce temps darrt, il faut repartir. Se demander comment la
pense croit pouvoir saisir cet espace innomm, comment elle spcule en
cherchant une re-prsentation de la prsence, comment elle forge des images
mta-physiques de ce quoi (ou qui) se donne une physis.
QUESTION 6
Comment classer les thses mtaphysiques
au sujet de la conscience ?
Peut-tre lidalisme nest-il pas dfendable sous la forme
quil a prise jusqu prsent ; tandis que, sagissant du
ralisme, on ne peut mme pas dire quil soit indfendable,
dans la mesure o il ne sengage pas dans la dimension de
la problmatique philosophique.
M. Heidegger
Classer les thses mtaphysiques sur la conscience, cest dj prendre
parti. La classification la plus courante, en philosophie de lesprit
dobdience analytique, distingue entre les positions monistes matrialistes
(ou physicalistes) et les positions dualistes. Les positions monistes
matrialistes avancent quil y a un seul type dtre dans la nature, le type
matriel, ou physique, et que tout le reste, y compris les phnomnes mentaux
et la conscience, en est un trait mergent voire un piphnomne. Les positions
dualistes, hrites dun pass cartsien mais toujours vivaces en raison de
linachvement (peut-tre constitutif) du programme physicaliste, consistent
pour leur part soutenir que la nature comporte deux types dtres
intrinsquement distincts, physique et mental. cela sajoute une sous-
classification fine qui tient compte des diverses manires possibles
darticuler le mental au physique, ou de sous-valuer lun au profit de lautre.
Les thses monistes physicalistes se subdivisent ainsi en behaviorisme
1
,
thorie de lidentit neuro-psychique
2
, rductionnismes, liminativisme
3
, et
fonctionnalisme
4
. Les thses dualistes, quant elles, se rpartissent en
dualisme des substances
5
et dualisme des proprits
6
.
Si cette mise en ordre est partisane, cest que le principe mme de la
classification exerce une sorte de censure ou de refoulement contre certaines
positions tenues pour archaques .
La plus fascinante de ces positions omises est sans doute le
panspsychisme, rcemment ressurgi dans des numros spciaux du Journal of
Consciousness Studies
7
et dautres revues, sous la forme modre dun
pan-exprientialisme
8
. Le panexprientialisme rpand la conscience
primaire, la pure exprience, partout dans le monde matriel ; non pas, comme
le no-ralisme voqu au chapitre I, en identifiant la conscience primaire
dune proprit dobjet avec cette proprit ; mais en soutenant que les objets
ont eux-mmes une exprience de leur condition ou de leur environnement ;
quune bactrie, voire un atome, a un ce que cest dtre cela. Cette forme
dexprience peut tre aussi fruste, irrflchie, asymbolique, non cumulative
quon le souhaite, la manire des petites perceptions instantanes des
monades matrielles de Leibniz, elle reste considre comme prouve, selon
des modalits restant dfinir.
La classification initiale, biaise, na pourtant pas t vraiment
transgresse par lirruption de ces thses controverses, puisque le no-
ralisme et le panpsychisme entrent sans ambigut dans la vaste catgorie des
monismes matrialistes
9
. Selon ces doctrines, les supports dexprience
consciente sont encore et toujours des entits corporelles, tendues dans
lespace et dans le temps. Au lieu dattribuer lexclusivit de lexprience
consciente aux entits matrielles cerveaux , ou aux fonctions remplies par
celles des entits matrielles qui sont capables de traiter une quantit
importante dinformation, on la rpand sur toutes ou presque toutes les choses
matrielles. La pense mtaphysique reste ici entirement absorbe par ses
objets intentionnels les plus courants, et par une nature faite de ces objets.
La catgorisation binaire du monisme matrialiste et du dualisme psycho-
physique ne se trouve vraiment branle que par deux autres positions, peut-
tre encore moins bien comprises que le panspsychisme.
La premire de ces positions alternatives est ce quon pourrait appeler,
la suite de Mach, le monisme neutre . Elle consiste poser une entit,
domaine, ou substance unique, une sorte d entre-deux
10
ni matriel ni
mental, dont les phnomnes matriels et lexprience consciente seraient
deux aspects , deux attributs , ou deux facettes . On saperoit que le
monisme neutre nest pas toujours bien compris de nos jours lorsquon lit,
sous la plume de neurobiologistes comme Antonio Damasio
11
, un loge de
Spinoza en tant que prcurseur du monisme matrialiste, et un recrutement de
sa position au service dun projet rductionniste peine attnu. Or, si
Spinoza peut tre qualifi de moniste , cest parce quil affirme lunicit de
Dieu en tant que substance infinie
12
, laquelle na aucune raison dtre
qualifie de matrielle par elle-mme. La matire nen est que lun des
aspects, puisquelle relve de lattribut tendue de cette substance unique
et divine ; quant lesprit conscient et pensant, il relve dun second attribut
la fois distinct du premier et coextensif lui dans la substance unique
13
.
Mme si lobjet de lide constituant lesprit humain est le corps
14
, il nen
reste pas moins que ni le corps ne peut dterminer lesprit penser, ni
lesprit ne peut dterminer le corps au mouvement
15
, puisque esprit et corps
ne dpendent lun et lautre que dun Dieu non personnel sous ses attributs
respectifs de pense et dtendue. La rcupration infonde dun vrai monisme
neutre au profit du banal monisme matrialiste
16
est ce quil est permis
dappeler lerreur de Damasio.
La seconde classe de positions exotiques se situe nominalement aux
antipodes du monisme matrialiste ou physicaliste. Il sagit des monismes
idalistes, souvent caricaturs et rejets a priori dans le dbat actuel sur les
sciences cognitives au nom dune vague imputation de solipsisme qui les
discrditerait avant toute argumentation. Le problme est que la qualification
de solipsiste , laccusation de privilgier un certain moi humain au
dtriment des alter-ego et du reste du monde, na de pertinence que dans le
cadre du prjug objectiviste mme qui donne naissance au dbat
mtaphysique tronqu de la philosophie de lesprit contemporaine : celui qui
tient lapparatre pour la rvlation superficielle dun ensemble dentits
spares, ego sensibles incarns et choses inertes apparaissantes. Ce prjug
ne fait pas que configurer lespace des thses mtaphysiques possibles ; il
force en renvoyer demble quelques-unes, et tout spcialement lidalisme,
dans les marges de linsoutenable. Si lon veut valuer les potentialits des
thses idalistes, il faut alors commencer par suspendre le prjug qui les
rcuse, et suivre patiemment leur travail dauto-dfinition. On dcouvre ce
faisant que lidalisme est une question ouverte pour lui-mme, et que, loin
dtre monolithique, il enveloppe une famille de thses presque toutes plus
nuances que ses adversaires ne le laissent entendre. Cette richesse en auto-
analyse et en diversit se comprend aisment. Lidalisme est contraint de
prendre son essor dans le seul milieu quil reconnat, savoir lexprience,
de ne pouvoir sopposer rien dautre au cur de ce milieu sans bornes, et de
manquer ds lors de moyens pour caractriser des doctrines alternatives
autrement que dans ses propres termes
17
. Tout ce que peut accomplir
lidalisme dans ces conditions est de se diffrencier lui-mme en multiples
varits, qui surgissent de sa polarisation interne entre trois repres
existentiels : lvidence dtre do il part (celle du cogito), la
reconnaissance de la finitude laquelle il se heurte, et les diverses
infinitisations et absolutisations du sujet dexprience, sur fond desquelles il
dcoupe cette finitude.
Pour donner un aperu du foisonnement des idalismes, une courte liste
non limitative suffira. On distinguera :
1. Lidalisme (ou immatrialisme ) tho-anthropologique de
Berkeley, selon lequel :
a) ltre des objets nest rien dautre que leur tre-peru : their esse is
percipi
18
,
b) la perception dcoule dune influence immdiate de lesprit infini
divin sur nos esprits humains finis ;
2. Lidalisme pan-thologique de Malebranche, dont le problme est de
concilier le fait de la finitude humaine avec sa captation affirme par/dans
un Dieu ubiquitaire. Selon Malebranche, tout ce que nous voyons, nous le
voyons en Dieu , en ce Dieu dont nos esprits participent. Mais parce
que nous sommes des tres finis, parce que nous sommes des cratures qui
ne peuvent, dans les conditions normales, saisir lintgralit du Crateur
dont elles manent et auquel elles sont unies, nous nen voyons quun tout
petit aspect, un aspect partiel subdivis en formes spares ou objets
matriels
19
. Cela suggre a contrario que la contemplation mystique
serait lunique voie nous permettant de voir lintgralit du Dieu que nous
habitons. Ce que nous verrions alors aurait perdu toute division, tout
contour, toute forme ; quoi sajouterait une volatilisation du sujet du voir
au sein du grand voyant o il sinscrit. Mais cette vision comporterait
aussi ladhsion une vrit immuable, immense , dont seule
lapprhension rationnelle des vrits ternelles des mathmatiques
nous offre un aperu dans notre tat ordinaire
20
;
3 . Lidalisme (ou acosmisme) sans Dieu et sans sujet, des coles
bouddhiques indiennes du IV
e
sicle appeles vijnavda (voie de la
conscience) ou cittamtra (conscience mesure de toute chose)
21
. Ici, tout
ce qui est reconnu est la concatnation systmatique, soumise la loi de la
coproduction conditionne, des perceptions sensibles ou intellectuelles
momentanes. Le sujet personnel est considr comme une projection
illusoire, une immobilisation rifiante, de ce processus de dploiement
dune activit consciente impersonnelle, exactement autant et pour les
mmes motifs que le monde extrieur
22
. Aucune transparence des
phnomnes la raison nest par ailleurs suppose, rebours du penchant
platonicien des idalismes occidentaux. La rationalit est plutt
considre comme garante (tout en restant indispensable en tant
quantidote delle-mme), parce quelle impose la fiction de formes
universelles stables l o ne rgnent que les traits particuliers
impermanents. Comme il faut tout de mme rendre compte de la part de
rgularit de lapparatre, celle-ci est attribue au dploiement aveugle
des germes des actes psychiques accomplis antrieurement. Le processus
de dploiement se produit dans la conscience-base (alayavijna), sorte
dimmense rceptacle anonyme non pas tant inconscient que prconscient
de traces des processus mentaux passs
23
;
4. Lidalisme subjectif attribu Fichte par Schelling
24
, qui lopposait
son propre idalisme objectif . Cette appellation, proche de
laccusation traditionnelle de solipsisme, est premire vue justifie par
les principes et le vocabulaire de la premire Doctrine de la science.
Selon eux, cest du moi que surgit cela quoi il soppose en mme
temps quil se pose
25
. Mais le caractre thico-dynamique de la dfinition
fichtenne du moi, qui ne dsigne pas un tre particulier mais un devoir-
faire, un devoir-tre, et une tension vers la libert, motive, parmi bien
dautres dnominations plus plausibles, celle d idalisme pratique
26
;
5.
Lidalisme absolu de Hegel, implicitement conu comme hypostase de
lidalisme critique de Kant. Lidalisme critique, on le sait, ntait que
programmatique. Il assignait lentendement la seule tche de proposer
des rgles qui certes prconditionnent lapprhension dobjets, mais
restent ouvertes la srie empirique par laquelle ces objets sont
progressivement dtermins. Lidalisme absolu, au contraire, est
totalisant car il suppose un entendement qui na en dehors de lui que ce
qui l produit lui-mme partir de soi
27
. Nignorant pas que nous
sommes encore loin de raliser cette vrit dauto-englobement, Hegel
postule un processus dialectique dvelopp dans lhistoire, dont les
tapes culmineront en un ultime acte rflchissant par lequel lesprit se
reconnatra dans ses propres projections objectives
28
.
Le problme que doivent affronter ces monismes idalistes diffre, non
seulement dans son contenu mais aussi dans son type, du problme du
dualisme qui consiste trouver quel peut bien tre le procd de la
communication entre ses deux ples radicalement htrognes. Mais il est du
mme type que celui des monismes matrialistes, parce quil sagit
apparemment dans les deux cas de driver lun des termes du couple corps-
esprit partir de lautre. L o les monismes matrialistes se voient somms
de rendre raison de lapparition dune intriorit vcue au sein de lextriorit
universelle de lobjet-monde, les monismes idalistes doivent rendre raison
de la prtention lextriorit, voire la transcendance, de certains
phnomnes intrieurement perus et vcus. Chez Berkeley et chez
Malebranche, lexplication est fournie par une dlgation dextriorit au
divin : cest Dieu qui se voit attribuer la fonction du tout autre, du
transcendant, de lexcs par rapport notre finitude. Chez les idalistes post-
kantiens, cest linverse notre finitude, notre inachvement, notre auto-
apprhension comme tres limits, qui creuse un manque et esquisse les lignes
de fuite dune transcendance rejete lorigine et lhorizon de la
connaissance. Chez les idalistes bouddhiques, limputation de finitude de
l esprit limit est contrebalance par son dpassement dans l esprit
universel , ou conscience-base (alayavijna), ce qui sapparente
superficiellement la structure des idalismes thologiques ; cette cruciale
diffrence prs que la production volontaire des ides par Dieu est remplace
par une auto-production cyclique, inexorable et involontaire, des
vnements psychiques par dautres vnements psychiques ordonns avec
eux en sries biographiques au sein de la conscience-base
29
.
Un fait troublant, et peine visible, est qu travers la classification
choisie, toutes les positions mtaphysiques numres jusque-l paraissent
sordonner nominalement autour dun prsuppos dualiste. Cela semble
trange, parce que le dualisme ne reprsente que lune des grandes classes de
positions en prsence : monismes matrialistes, monismes neutres, dualisme
psycho-physique des substances ou des proprits, ou bien monismes
idalistes. Mais la primaut du schma dualiste, qui oppose lesprit conscient
et ce dont il y a conscience perceptive, savoir les objets matriels, sous-tend
la classification dans son principe. Chacun des deux monismes extrmes,
matrialiste et idaliste, peut en effet tre vu comme une affirmation
dexclusivit de lun des deux ples du schma dualiste. Exclusivit du ple
matriel, et engendrement de lesprit conscient par la matire selon le
monisme matrialiste. Exclusivit du ple vcu, et projection des phnomnes
matriels par un acte de lesprit conscient selon le monisme idaliste. Le
monisme neutre reproduit pour sa part le schma dualiste au second degr en
lattnuant en une dualit daspects, ou dattributs, de lunique substance. Et
mme le systme des rapports internes entre les positions monistes
matrialistes fait encore entendre un cho du schma dualiste. Car si la
version dominante de monisme matrialiste place lexprience consciente
dans la tte, et plus prcisment dans le cerveau, les versions no-raliste et
panpsychiste la placent dans les choses dites extrieures. Le dualisme nest
plus ici un dualisme des substances ou des proprits, mais un dualisme
spatial, un dualisme de lintra-crnien et de lextra-crnien, parfois rendu plus
subtil par une coopration de lintra-crnien avec lextra-crnien pour tisser
la toile de lesprit
30
.
la rflexion, pourtant, cette configuration simple dune forme dualiste
qui simposerait toutes les positions, y compris celles qui prtendent sen
dmarquer, est trop troite pour rendre intelligible le dbat mtaphysique sur
lorigine de la conscience. Hors caricature, la plupart des thses prsentes
comme idalistes visent dissoudre la forme gnrale de la classification qui
les tient pour une affirmation exclusive du ple individuellement mental de la
dualit esprit-corps. Leur refus dune telle classification na rien dtonnant,
puisque celle-ci dcoule, nous lavons vu, du schme naturaliste/objectiviste
en de duquel la volte-face idaliste cherche activement remonter. Ainsi, la
dissolution de lopposition dualiste est accomplie demble dans lidalisme
bouddhique. Il est vrai que ce dernier semble encore sinscrire dans le cadre
de lopposition, lorsquil saffirme comme une doctrine du seulement
esprit (sems tsam en tibtain)
31
, et quil tient le monde extrieur pour un
mirage engendr par cet esprit. Mais nonobstant cette structure de surface,
pragmatiquement utilise pour gurir ceux qui il sadresse de leur ralisme
chosiste, lidalisme bouddhique critique symtriquement toute imputation
substantialiste, toute solidification des squences de fulgurations
apparaissantes, sur le versant sujet comme sur le versant objet. Lapparatre
battant est son unique axe de rfrence, et celui-ci nappartient aucune
formation mtaphysique, aucune res, pas plus la res cogitans qu la res
extensa. Dans le domaine occidental, la stratgie daffranchissement de
lidalisme vis--vis de son positionnement sur lchelle dualiste est plus
dtourne, passant par des signes dinconfort et par de subtils carts. Elle nen
est pourtant pas moins reconnaissable. La gne vis--vis de lopposition duale
des doctrines est dj vidente lre des idalismes thologiques, puisque
ceux-ci font envelopper lesprit humain fini par un absolu divin irrductible
lun comme lautre des deux termes dualisants ; un absolu gros de tous les
possibles, qui prcde et conditionne sa dualisation apparente en un sujet
percevant born et des corps matriels rsultant de son auto-perception
fragmentaire. La gne saute galement aux yeux dans les idalismes post-
kantiens, tant il est vrai que leur rfrence tantt explicite tantt implicite un
moi cache mal une tension qui les porte dabord vers luniversalisation du
domaine mental, puis vers la perte du motif mme du clivage dualiste au terme
de leur dveloppement. Les formulations apparemment les plus
subjectivistes de lidalisme fichten portent dj en elles le ferment dun
tel dpassement. Car lopposition dun moi fini et dun non-moi rsulte chez
Fichte dun geste dauto-positionnement absolu irrductible lun comme
lautre de ces termes
32
. Lisons par exemple cette phrase a priori surprenante
des premires pages de la Doctrine de la science de 1794 : Le moi, comme
le non-moi, est le produit dun acte originaire du moi
33
. De toute vidence,
la dernire occurrence du pronom personnel moi ne saurait avoir le mme
sens fonctionnel que la premire
34
. Le dernier moi signifie une activit,
pour ne pas dire une spontanit, tandis le premier signifie un terme pos et
oppos ce qui nest pas lui, la suite dun choc actif dauto-ralisation
analogue celui du cogito cartsien. Le dernier moi prconditionnant toute
position et opposition, il nest encore appel moi qu mesure de
laptitude de ce pronom signaler lvidence sans gale : que tout cela se
donne de quelque part, en premire personne, mme si ce nest encore nulle
personne. Ce (dernier) moi -source est dailleurs explicitement considr
par Fichte comme unit (primitive) de sujet et dobjet, et non pas comme
simple sujet
35
. Linflexion universalisante ne parat cependant au grand jour
qu travers une volution lexicale qui inactive les mots trop suggestifs dune
troite subjectivit : entre sa Doctrine de la science de 1794 et celle de 1804,
Fichte remplace en grande partie le pronom personnel du dernier moi par
le nom commun raison , sous-entendant par l raison pratique. Il recule en
amont de ce qui reste de personnel dans le pronom moi , et se donne
pour tche dexposer labsolu, ni tre ni conscience. Cela le conduit
critiquer aussi bien lidalisme troit pour sa croyance dmiurgique au
pouvoir crateur des ides
36
, que le ralisme lmentaire pour sa capacit
sauto-contredire en prtendant penser ce qui est indpendant de toute pense
(la chose en soi)
37
. Lidalisme se sublime ici dans le projet suprieur de la
philosophie, qui est de ramener le divers lunit la plus indiscutable
38
, celle
du prsent dun se-savoir, dun vouloir et dun agir. Il a si bien perdu ses
attaches avec lun des ples du clivage dualiste quil se retourne sans
difficult en un ralisme volu de lauto-construction de ltre
39
se
dcouvrant comme moi. Mais cest sans doute dans luvre de Hegel que ce
rejet de la restriction personnalisante de lidalisme, voire de sa limitation en
doctrine, parvient son apoge. Chez le professeur dIna, la conscience
universelle ne cesse de travailler pour produire, puis pour rsorber un
niveau plus haut, la dualit de la chose et du sujet percevant particulier. Elle
alterne les moments o elle immobilise en chose lunit prsume des divers
moments perus, et dautres moments o elle se rapproprie en tant que sujet
le pouvoir dunifier ; et elle se donne par la suite ce balancement mme
comme objet de sa rflexion, dans le geste dauto-dpassement typique de la
dialectique
40
.
Mme les vocables de dernier ressort, savoir , conscience , qui
affichent sans ambigut le caractre idaliste de ces doctrines, ne sont pas
prendre pour de vritables assignations restrictives qui dsigneraient comme
ultime tant quelque chose du ple sujet par opposition au ple objet. Ce
quils ont pour mission de signaler, cest seulement que labsolu ni-objet-ni-
sujet dont ils dclarent partir et vers lequel ils sarc-boutent nest pas un
repos, une chose, un donn, mais un processus, une dynamique dauto-
dpassement, une qute toujours-encore motive par son incompltude ; et que
ce processus nest pas simplement constat, pos comme un foyer dattention
parmi dautres, mais senti, habit, incarn de manire immdiate et
irrductible quelque contenu que ce soit. Leur absolu processuel concide
avec sa manifestation vcue en tant queffort et spontanit. Cela ne devrait
pas nous surprendre. Si quelque processus doit dpasser la dualit esprit-
monde en lenveloppant, il ne saurait tre quintgral. Et comment serait-il
plus englobant quen sidentifiant tout ce qui se vit ? Vcu de soi ou vcu
dobjet, vcu dauto-apprhension dans la conscience ou vcu de
transcendance par rapport la conscience, vcu de mmoire biographique de
laccompli ou vcu dinaccomplissement du vcu dans la vibration de son
avance-vers. Comme nous lavons soulign de loin en loin, rien ne manque
au vcu, pas mme le vcu du manque, le vcu que quelque chose le dpasse.
Rien ne lui manque, pas mme ce que le participe pass employ pour le
nommer dissimule, et qui serait mieux rendu par le participe prsent se
vivant : la pousse incessante en quoi il consiste, son vide jamais
incombl maintenu en quilibre instable par sa conversion en dsir de
dcouverte.
Il y a en somme de fortes raisons de penser que le projet des grands
idalismes post-kantiens nest pas de pousser le balancier mtaphysique du
seul ct mental dun dualisme esprit-corps, mais de reprendre leur
compte, avec dimportants inflchissements, la position dquilibre des
monismes neutres dinspiration spinoziste. Cela sentrevoit dj chez Fichte,
qui crit que ltre est le terme dune disjonction, et nest quune moiti dont
la pense est lautre
41
. Cela se lit avec plus de nettet encore chez Hegel,
qui juge que le point de vue du spinozisme est le commencement essentiel de
toute pense
42
. Sil doit en aller ainsi, selon lui, cest que la rsorption
spinoziste de la varit du monde dans quelque champ unique savre
constituer un puissant dissolvant apte mettre en droute des prjugs
philosophiques
43
faits de systmes restreints de vrits particulires. Hegel
sinscrit dailleurs lui-mme au cur de la thse dfendue par Spinoza,
lorsquil dcrit sa propre Logique comme une prsentation de Dieu tel quil
est avant la cration dune nature et dun esprit fini
44
. Il nuance toutefois son
approbation de la version spinoziste du reploiement moniste, en faisant
ressortir ses deux dficiences majeures. Au yeux de Hegel, la premire
dficience du systme de Spinoza est son option consistant solidifier le
domaine central en une substance , support permanent de tout ce qui peut
arriver. La substance absolue est le vrai, crit Hegel, mais elle nest pas
encore le vrai en son entier ; il faut aussi quelle soit pense comme active en
soi, comme vivante
45
. Or, poursuit-il, le seul moyen de la mobiliser est de
cesser de la viser comme une sorte de grande chose sphrique et
parmnidienne, et de la reconfigurer comme un processus spirituel en
dveloppement
46
. Une deuxime dficience rsulte presque invitablement de
ce modle statique. Si tout ce qui est se ramne lunique substance, si le
domaine de la pense et le domaine des corps tendus sont en vrit une seule
et mme chose, comment rendre raison de leur diffrenciation ? Spinoza les
considre comme deux attributs de la substance une. Et les attributs, leur
tour, sont dfinis comme autant de formes que lentendement est capable
disoler et de saisir dans lessence prenne de cette substance
47
. Mais, accuse
Hegel, Spinoza ne dcrit nullement le procd de cette saisie, et il le maintient
donc dans une obscurit aussi grande que celle de la communication dualiste
des choses pensantes et tendue. Pire, on a parfois limpression que la
dfinition propose par Spinoza est circulaire : quest-ce que cet entendement
qui assure la capture des formes dattributs ? Ne relve-t-il pas de lun des
deux attributs quest la pense, ceci prs que lui se voit attribuer un rle
actif pendant que les attributs quil distingue restent figs ? On ne stonne pas
dans ces conditions quaucune prcision ne puisse tre fournie sur lorigine de
lentendement formateur et dualisant, ni sur son mode dintervention
48
. L o
un monisme substantiel prvaut, le reliquat de dualit qui continue tre
postul reste un mystre.
Cest le mme genre de reproche quadresse William James aux monismes
neutres dinspiration spinoziste. Ces monismes posent un domaine substantiel
inconnu dot de deux prsentations distinctes, esprit conscient et matire
inerte ; mais en cela, justement, ils restent formels, pour ne pas dire
verbaux
49
. Non seulement le domaine substantiel unique demeure une
entit spculative, une facilit arithmtique que soffre lintelligence
philosophique, mais la dualit esprit-matire se contente dtre pr-juge,
hrite sans prcaution critique dune tradition faite dimplicite culturel et de
patrimoine spculatif commun. Un peu plus dattention fine ce qui arrive,
ainsi quaux usages les plus courants de la langue, confirme que le clivage
dualiste est un produit labor de la rflexion plutt quun donn
insurmontable. Il ny a pas besoin de se figurer une substance unique cause de
soi pour rtablir mtaphysiquement lunicit suppose perdue dans la physis,
dans le devenir pluriel de ce qui se montre, puisque la monstration mme se
vit au singulier. Il faut seulement se mettre en position de raliser in vivo cette
singularit organique de lprouv, ainsi que nous avons cherch le faire ds
le chapitre I de ce livre, et pour cela ne pas se laisser distraire, absorber,
fasciner jusqu lamnsie par le produit de sa propre activit analytique.
Lattention largie quon doit exercer pour apercevoir cette singularit
archtypale est dordre phnomnologique, et il ny a donc rien dtonnant
ce que Heidegger compte parmi les philosophes qui en ont le plus
exhaustivement tir les leons. Lun des thmes rcurrents dtre et Temps, un
thme presque obsessionnel tant il peine remonter le courant dune
dispersion que le langage ne cesse de faire renatre, est lunit originelle de
ltre-au-monde. Examinons-en un exemple. Lorsque nous rencontrons
quelquun, lorsque nous croisons son regard, lorsque nous tendons le
faisceau de lattention lentiret de son visage, ce qui se donne nest pas un
pur objet. Cela, tout cela qui se prsente alors nous, est indissolublement
compos de joie ou de mlancolie, de mobilit des lvres, de tendresse, de
sens latent de la rivalit ou de la coopration, dclats colors des iris,
dobligation morale ressentie (comme le souligne Levinas), daccs tantt
transparent tantt opaque une disposition desprit, de perte intermittente des
limites personnelles, desquisses davenir commun ou de nostalgie sur un
pass perdu, de diffusion de la lumire crpusculaire sur le duvet des joues,
de crainte de la perte ou de la sparation, de rides au coin des paupires. Une
sorte daccommodation analogue celle de la vue, gnralement involontaire,
permet de passer dun foyer lautre de cette manifestation globale dont le
dploiement textuel produit un effet dinventaire htroclite. Cest seulement
lorsque laccommodation se systmatise, au nom dun intrt professionnel
(celui du dermatologue) ou dun engagement affectif (celui de lamant), que le
tri commence saccomplir, que les traits de la peau susceptibles dtre rgis
par les rgles dfinissant le physique se trouvent partiellement regroups, et
que les composantes rsiduelles sont rassembles sous le chapitre du
psychique, dans une rpartition souvent incertaine entre notre psych et celle
du partenaire. Une telle alternance dindiffrenciation et de dichotomisation
active, remarque William James, a laiss une trace profonde dans la structure
du langage courant. Nous commenons par voquer un chemin pnible, un
ciel triste, un coucher de soleil superbe
50
, avant doprer une rtractation
dichotomique. Ce nest qu lissue dune analyse serre que nous nattribuons
plus au chemin quune pente ou une granulosit, au ciel dautomne quune
faible luminosit, au coucher de soleil quune topographie de plages colores,
et que nous rejetons tout le reste de lapparatre de premire intention (la
tristesse, leffort, ou la beaut) sur notre propre rapport motionnel avec ces
entits objectives. Encore cette rpartition de lobjectif et du relatif nest-
elle quune esquisse perfectible, la granulosit, la luminosit, et la couleur
pouvant aprs tout tre considres comme des qualits secondaires au sens
de Locke, cest--dire relatives la constitution ou lchelle de notre
appareil perceptif.
La substance une demeure bien insaisissable, au regard de lunit
dsubstantialise de la perception native. Mais la dualit quelle avait pour
tche de rsorber en son sein glisse tout autant quelle entre les doigts de la
saisie conceptuelle, et se rsout en un travail de dualisation. Le besoin de
faire de la dualit esprit-corps un dploiement daspects de lentit
mtaphysique substance spinoziste na plus lieu dtre, parce quil
nexiste pas de telle dualit dans ltat dapprhension pleinement ouvert o
(re)commence lenqute. William James propose alors dentriner ce fruit de
lattitude phnomnologique en le formulant comme thse : la thse dun
monisme des commencements de la rflexion plutt que de ses laborations
ultimes ; un monisme de lin-diffrence originaire plutt que de la perte finale
des diffrences. Un monisme rudimentaire , crit James, parce que ce
monisme tend vers la dconstruction doctrinale plutt que vers llaboration
dune doctrine. Toute opposition thorique de lun et du deux substantiels
saffaiblit ici en une alternance des pratiques mentales du rassemblement et de
la dichotomisation. Car, de la texture de lunit incarne ne surgissent pas
deux attributs spars comme ltendue et la pense, mais seulement
loccasion fluente dune absorption dans la vise intentionnelle de choses ou
bien au contraire dune amplification rflexive du champ de lattention.
Lunit est ici plus parfaite que dans les monismes substantialistes parce
quelle est vcue plutt que conue, et la dualit rsultante se rvle du mme
coup plus instable, plus fugace, plus fabrique que dans aucune de ces
doctrines.
On ressent cependant un certain inconfort lnonc de la conception no-
moniste de William James, de son empirisme radical proche dans son
esprit du vrai positivisme dont Husserl nhsitait pas se rclamer. James
na pu ni sans doute voulu sabstenir de nommer son domaine neutre et
monadique. Le nom qui dsigne sa ralit premire est bel et bien celui
d exprience pure
51
. Or, comme tout nom, celui-ci dtermine ; et, comme
toute dtermination, celle-ci nie ce qui nest pas recouvert par elle. Dans le
vocabulaire commun, lexprience soppose ncessairement quelque chose,
elle soppose en gnral ce dont elle est exprience, autrement dit son
objet. Il a suffi dun nom, et la mcanique inexorable des affrontements entre
thses sur fond de prsuppos dualiste sest remise en marche sans quaucun
expdient additionnel de la langue ne semble pouvoir larrter.
Bertrand Russell, qui tait conscient de cet cueil, a un moment pench
vers lexpression incolore neutral stuff (toffe ou substance neutre)
52
.
Cependant, sen tenir ce choix impliquerait soit den revenir aux catgories
spculatives si lon prenait nouveau au srieux la dnomination de
substance , soit davouer quon ne sait pas de quoi on parle si lon se fixait
sur le vocable concret toffe .
Aprs avoir valu avec une remarquable prcision le biais des
phnomnologues vers la conscience, lexistence, voire la chair, lorsque
celui-ci les conduit se couper plus ou moins profondment du monde dans un
cho lointain mais encore reconnaissable de la scission dualiste, Renaud
Barbaras
53
a lui aussi fini par choisir un nom de substitution : la vie,
reconduite en-de du clivage entre vcu et corps vivant, vers sa vritable
essence qui est dsir et mouvement auto-produit. Mais la vie ne fait pas
exception la rgle dairain de la dtermination ; comme toute chose
dsigne, elle est diffrencie-de ; elle se diffrencie pour sa part du non-
vivant, du cadavre, de linerte, de lobjet des sciences physico-chimiques. Si
lon ne voulait pas la voir tomber dun ct de cette grille de polarits, dans
une rsurgence obstine du cadre dualiste et des autres divisions de la pense
analytique, il ne fallait pas la plonger dans le verbe, il fallait encore moins en
brandir le nom comme solution un pige rcurrent de la pense, il fallait
simplement la vivre.
Nous voil arrivs au fond du paradoxe des doctrines mtaphysiques de la
conscience. Elles ont beau vouloir chapper au schma pr-compris qui les
conditionne, elles y retombent mesure de leur effort, qui nest autre que la
pousse dlimitatrice de la langue. La mtaphore du bocal mouches de
Wittgenstein, si tentante dans ce cas, semble pourtant trop pauvre pour en
capturer la saveur auto-rflexive. Les parois de verre du problme de la
conscience sont en effet durcies par llan conceptualisateur mme de ceux
qui sy heurtent. Et louverture de ce bocal-l ne se fait jour que lorsque ses
prisonniers suspendent tout mouvement dfinitionnel. Ne pas sagiter en vain
dans lenclos de la dnomination, mais concider avec le motif de lagitation ;
ne pas lever la vie comme un tendard, mais la vivre, avons-nous conclu.
Cest peut-tre ce qua voulu signifier William James durant un bref instant de
mise en suspens de sa pulsion discursive. Les choses et les penses, crit
James, ne sont point foncirement htrognes, mais elles sont faites dune
mme toffe, toffe quon ne peut pas dfinir comme telle, maisseulement
prouver
54
. Ltoffe neutre au sens de Russell nest pas dfinissable, mais
seulement prouvable. En toute rigueur, elle ne devrait pas se voir capture
par les rets finis de la langue, mais seulement se parcourir, se dcouvrir
indfiniment, se montrer telle quen elle-mme au fil dune amplification de
lucidit rflexive apte mettre en vidence luvre de criblage, de
lgalisation, de retrait et de recueil, par quoi sinvente en elle la dualit du
sujet et de lobjet. Le problme est que, voulant noncer les consquences de
ce caractre prouv plutt que dfini de son toffe neutre , William James
ne peut sempcher de revitrifier le bocal mouche dont une brve pause de
son activit langagire lui avait laiss pressentir lissue bante autour de lui.
Sa phrase prcdente, que javais intentionnellement tronque pour laisser
saccomplir plus longtemps la respiration indispensable lchappe, se
poursuit ainsi : et que lon peut nommer, si lon veut, ltoffe de
lexprience en gnral . Le nom de lprouver est exprience . Mais
nommer transporte nouveau loin de lui, vers lun de ses thmes dpreuve.
On y entend une fois encore, et encore, la distorsion dune doctrine idaliste
qui rinviterait cette fois la rification dune exprience absolue . Tout
est reprendre ab initio. On doit recommencer se persuader que pour
aborder le problme de la conscience avec quelque chance de succs, il vaut
justement mieux ne rien commencer ; que cest force de sabstenir de
commencer quoi que ce soit, force de baigner dans cette retenue davant tout
commencement de discours, force de dcouvrir patiemment les ressources
auparavant recouvertes par sa rumeur, que lnigme se dissipe delle-mme.
Tout ce que ce discours-ci, dpos dans ce livre, ractiv linstant par
votre regard de lecteurs, a pour but dtablir, ce sont donc seulement les
conditions dune prise de distance critique vis--vis du pouvoir garant de
tout discours au sujet de l exprience consciente . Nous le savons dj, et
pourtant il faut le rpter, parce que le verbe captive et quil lui faut dposer
priodiquement son antidote en lui-mme, comme autant de petits cailloux
blancs traant la piste dun possible retour en amont de lgarement.
Cest peut-tre dans cette suite dessais et derreurs, de formulations
avances puis aussitt retires, que se peroit le vrai sens des idalismes. Ces
doctrines prennent leur lan en dnonant le matrialisme pour sa propension
chosifier lorigine. Elles acquirent leur force en accusant les matrialistes
de tenir pour secondaire aux choses ce qui se tient pourtant sans cesse
larrire-plan comme activit de position des choses et comme condition de
leur prsence aussi bien que de leur absence. Mais la critique idaliste a
besoin pour sexprimer de faire des choix lexicaux, qui la conduisent
valoriser les vocables moi , conscient , pour-soi , et les opposer
point par point non-moi , inanim , en-soi . Sapercevant alors que
leur choix terminologique les a ports corriger un biais intellectuel par un
autre biais oppos, un biais objectiviste par un biais subjectiviste, les
idalismes oprent une premire vague de rectifications. Ils commencent par
lever leur moi ou leur conscience un statut absolu (cest--dire
inconditionn, indpendant du contraste avec quoi que ce soit dautre), puis ils
vont jusqu se requalifier en monismes neutres en se rapportant lattracteur
doctrinal spinoziste. Mais ces rectifications savrent galement excessives. Il
devient vite vident que la projection de la conscience absolue sur le plan de
la substance cause de soi de lthique la fige, alors quelle se voulait
pousse vitale, marche historique, ou procs dialectique. Il faut alors en
appeler aux connotations agissantes du vivant, ou louverture mobile de
l exprience pure . Le balancier retombe une nouvelle fois, de lombre
impressionnante dun grand objet hypostasi vers une ombre de sujet
dpouille de la plupart de ses troitesses subjectives , sans que le
mouvement pendulaire lui-mme ait pu tre matris. Arrive alors cette
confidence chuchote, infiltre clandestinement dans la pause dun procd
dexposition, selon laquelle ce quoi aspirent en vrit idalistes absolus et
monistes neutres nest rien de ce qui se dfinit, mais plutt tout ce qui
sprouve . Laveu est clair qui sait le lire, et presque dchirant pour
ceux qui le font : la thse idaliste, cette thse dont ltymologie grecque
renvoie lacte de poser en un lieu, sest dracine force de nier chacun de
ses sols possibles, et ce qui a surgi sa place est dnu de lieu et de repos,
incapable de se poser o que ce soit, impropre lexpression.
Ce qui se cherche plus ou moins confusment dans le jeu dosmose
rciproque entre les idalismes absolus et les monismes neutres est en
dfinitive une pratique, plutt quune doctrine ; une pratique de rintgration
de la pulpe de ce qui se vit et sexprimente, plutt quune doctrine du vivant
ou de lexprience pure ; un faire-devenir escort par des verbes, plutt quun
tant sanctuaris par un nom. Mais partir du moment o cette conversion
sest accomplie, ce nest pas seulement une ou deux doctrine(s) qui ont chang
de signification, cest toute la grille typologique des doctrines mtaphysiques
de la conscience qui se trouve claire dune lumire inverse, comme si elle
se voyait soudain dveloppe en ngatif. Au lieu desprer que la nature de
lexprience consciente soit rvle par une doctrine, il est dsormais
invitable quon demande lexprience en flux de mettre au jour la nature
des doctrines. Tant il est vrai, comme nous allons le voir, quavancer lune ou
lautre des thses mtaphysiques sur lexprience consciente suppose que le
mtaphysicien ait opt implicitement pour une orientation prcise de son
prouver, quil se soit install dans une modalit bien arrte de sa propre
exprience, et qu partir de l il en privilgie le corrlat comme seul
lgitime. Ce que nous allons redcouvrir et approfondir, la suite de
linversion esquisse et conformment aux rflexions du chapitre IV, cest que
chaque thse sur lexprience consciente dpend dun tat de lexprience
consciente ; cest que dfendre une doctrine propos de lexprience
consciente prise in abstracto revient se raidir dans lune des postures
possibles de lexprience qui se vit, en disqualifiant les autres au moyen
darguments, tantt rationnels tantt dautorit, qui ne valent prcisment que
sous le prsuppos de cette posture. Plusieurs thses mtaphysiques vont tre
revisites au chapitre suivant dans cet esprit : non pas du point de vue de leur
cohrence doctrinale mais du point de vue de ce quil faut tre pour vouloir
les soutenir.
QUESTION 7
Que faut-il tre pour adhrer une thse
mtaphysique ?
On peut facilement croire que la conscience ou
lexprience intrieure nest jamais sortie de linconscient,
mais quelle et lunivers physique sont des aspects
coternels de la mme ralit, la manire dont le concave
et le convexe sont des aspects de la mme courbe.
W. James
Il est presque obligatoire de commencer par la posture qui sous-tend les
thses monistes matrialistes, parce que cest sous son rgime que se
dveloppent lensemble des dbats contemporains, y compris ceux qui portent
sur des thses alternatives ; parce que cette posture simposant comme norme
dans notre civilisation, il est invitable que toute tentative den sortir, toute
thse alternative, y cherche pralablement un point dappui ou une justification
formule dans ses termes.
Quelles sont donc les caractristiques principales de ltat de conscience
dont le matrialisme est lexpression doctrinale ? En reprenant lenqute
amorce au chapitre IV, on peut les exprimer par quelques mots-slogans avant
den dvelopper le sens : effacement de soi, attention focalise, extraversion,
transitivit, ouverture indfinie de lenqute ; et, couronnant tout cela, lacte
dobjectivation rig en valeur si exclusive que les autres composantes de
ltat de conscience de rfrence se trouvent mises son service, et que son
produit final est absolutis.
Lobjectivation est une forme d exprience canalise, une posture
travaille de la conscience, qui prend sa source juste en amont de lacte
consistant faire rfrence et attribuer des proprits, qui trouve un relais
dans le langage, et qui se parachve dans le travail scientifique. Son germe,
cest lexprience ant-prdicative dcrite par Husserl dans Exprience et
Jugement
1
, cette exprience proto-verbale qui consiste fendre la varit des
phnomnes vers une apprhension continue du mme. Au lieu dune
chronique anecdotique des paratres, lexprience se transforme par l en
lhistoire de lex-plication progressive dun cela vis par elle et constamment
identique lui-mme. La structure du jugement se trouve ainsi pr-dtermine
dans celle dune classe de vcus, puis sa naissance permet lexploitation
linfini des ressources de larticulation sujet-prdicat qui restait latente dans
ces vcus : lidentique vis se voit cristallis en substantif, et les moments de
son ex-plication en prdicats. Le jugement permet enfin de btir au-del de
linstant, daccumuler un patrimoine de connaissances ractivable par chacun,
valant pour tous et pour longtemps
2
.
Pourtant, si le vcu de signification est le moment originel de lexprience
dobjectiver, il est loin den recouvrir toute ltendue. Lenvironnement
partiellement condens en lots stables de dsignation verbale peut laisser
subsister entre ses rivages des ocans de chaos, de magie ou donirisme. Le
discours a beau merger comme consquence dune rgle consentie, dune
mise en forme universelle de la pense, cette rgulation reste partielle.
Comme nous lavons vu au chapitre IV en commentant linjonction
dHraclite, le langage a en lui suffisamment de marges pour admettre
lexpression des jugements de got, des hallucinations, ou des univers
potiques, ce qui impose de rtrcir encore le champ des possibilits par
rapport lusage inattentif, cratif, ou incantatoire de la langue. La seconde
strate de lexprience objectivante se prsente donc comme un resserrement
supplmentaire des gammes de vcus, comme une contraction de leurs
possibilits explicitement demande par des tables de la loi universalistes.
Cette strate apparat en cela diffrer considrablement de la premire, qui
avait pour sa part t assume avant quil y ait eu besoin den formuler les
injonctions, au fil de lactivit native consistant circonscrire un terrain de
jeu partag durant lchange entre personnes. Mais si le second degr de
lexprience dobjectiver est bien une exprience dassujettissement social,
explicitement vcue comme telle, subie anne aprs anne, quelle organisation
a reu la mission de limposer ? Cest probablement Bachelard qui a dcrit le
plus nettement le fonctionnement de linstitution mise en place pour nous
dloger des abris imaginatifs ou oniriques et pour nous imposer dvoluer
dans le pr carr des jugements ncessaires et unanimement valides. Cette
institution de mise disposition des esprits pour lutilit sociale nest autre
que lcole, prolonge par luniversit. Lducation, crit Bachelard, nest
morale que dans la mesure o elle nourrit didal objectif la solitude dune
me
3
. Rciproquement, lobjectivit finit par tre identifie par Bachelard
une valeur morale part entire. Elle est, martle-t-il, le premier des
devoirs , car une socit doit inculquer lindividu la ncessit de lui vouer
chacun de ses mouvements, chacune de ses penses. Il lui faut parvenir par
lducation extravertir lintrt quune me porte nativement elle-
mme
4
. Lextraversion est un effort, pour ne pas dire un dressage, la
ngation puis loubli de soi.
Mais cette conception qui oppose lindividu aux ncessits sociales, le
singulier incarn luniversel abstrait, est quelque peu caricaturale. Le conflit
du pouvoir et de ltre, de lobligation de servir et de laspiration se
raliser, de la rgle commune et de la spontanit personnelle, ne se joue pas
seulement sur la place publique. Son issue se dcide aussi et surtout dans
lconomie prive des dsirs, des identifications et des projections. Aprs
tout, lindividu duqu ne se sent pas toujours contraint de lextrieur par la
discipline objectivante. Il peut prendre les devants, se laisser griser par cette
discipline, pouser son projet, la reprendre son compte comme un mode
dtre qui le dfinit et le satisfait. En particulier, il lui arrive souvent de cder
la sduction quexerce la vision scientifique du monde jusqu lui vouer sa
vie entire avec bonheur. Sil en va ainsi, cest que lexprience dobjectiver
est gratifiante, bien quelle ne le soit que dans une certaine mesure, jusquau
moment o les enivrements quelle procure se dcouvrent assujettis quelque
chose de plus vaste et sans doute de plus tragique quelle. Mme si elle
focalise les individus sur des buts limits, dont se manifestera un jour
limmaturit au regard des questions quelle leur a permis desquiver,
lexprience dobjectiver exauce bel et bien certains de leurs souhaits
informuls. Elle ne pourrait pas prendre possession du mode dtre de tant de
personnes duques sans cela. Quels sont donc ces gratifications et ces
souhaits exaucs ?
Le premier bnfice, le bnfice archaque mais crucial, que procure
lacte dobjectiver consiste simplement devenir quelquun : devenir un
sujet, voire un individu, diffrenci de tout cela qui se donne. Cest en effet la
discipline dobjectiver qui laisse derrire elle, dans le champ dexprience,
un reste indompt, insaisi mais saisissant, qui sexpose et se dsigne comme
sujet. Sans objectivation, ou avant quelle ait atteint un certain degr
daccomplissement, il ne saurait y avoir dindividu, de sujet, ou de personne
pleinement constitus. Sans objectivation, il ny aurait pas de recul de
lhomme par rapport son environnement, mais sa coextensivit une
nature/physis assimile un principe dynamique sans frontires
ontologiques
5
. Sans tension de mise lcart, il ne serait pas question de se
dfinir comme personne unique dans une socit gomtrie variable ;
seuls seraient disponibles des nuds anonymes de relations de parents
relles ou mythiques dans lesquels chacun pourrait se couler le temps dun jeu
de rles
6
. Sans retrait de la nature, lauto-positionnement des sujets serait
court-circuit par la fusion assume de chaque chair vivante avec quelque
essence gnrique comme celle dune espce totmique
7
. Sans distinction de
soi et de la puissance des choses, il ny aurait pas desprits personnels, ni de
volonts intgralement propres, mais (comme dans le rcit dHomre)
8
une
soumission lordre olympien qui fait de chacun linstrument des projets dun
dieu ou dune puissance chtonienne qui le hante. Pour parfaire la rciprocit
de lobjectiver et du subjectiver, on note que dans des cultures o lidentit
individuelle est glissante, o elle peut assumer des peaux que nous
jugerions incompatibles, animales, humaines ou vgtales, la catgorisation
mme de lapparatre, et par l sa nuclation en invariants objectivs, manque
de force et de stabilit
9
. Si objectiver permet des sujets de sextraire de leur
environnement, subjectiver confre symtriquement lautorit ncessaire pour
cristalliser ses articulations et le segmenter par catgories dobjets.
travers cette matrise que permet lexprience dobjectiver, on aperoit
un genre secondaire de gratification quelle tient en rserve pour ceux qui la
cultivent. La mare des motions, le lien presque lancinant des affections petit
petit transformes en symbioses, le rayon possessif dun amour parental, le
retour obsdant dune vague culpabilit, menacent tout moment de noyer le
produit de leffort de subjectivation, den effacer le contour par leur
dferlement liquide. Nous nous sommes retirs du devenir indiffrenci, nous
nous sommes individualiss par le dialogue, mais voil que tout coup le
partage empathique dun saisissement, llan incontrlable dune tendresse,
linquitude de ne pas avoir t la hauteur, viennent dissoudre les limites
fragiles de notre moi difficilement dlimit. Le remde le plus vident contre
ce genre de pril de la perte de soi consiste cloisonner son propre espace,
se sparer mentalement dautrui en le renvoyant son statut social,
psychologique, voire biologique ; il consiste raffermir les limites
catgoriales dobjets et y inclure partiellement nos interlocuteurs dsigns
en troisime personne, au dtriment dune plonge vertigineuse dans ltre-
ensemble. Au lieu de laisser les choses et les tres qui se prsentent nous
renvoyer des tonalits affectives claires ou sombres mais toujours
immatrisables, lantidote immdiat revient les asscher de nos projections
motionnelles, y tudier de manire distante, la fois curieuse et tranquille,
lenchanement des causes et des effets qui gouvernent les comportements
aussi bien que les processus naturels
10
.
Un autre lot de gratifications quapporte lexprience dobjectiver est sans
doute le plus partag, et donc le plus important pour la civilisation. Il consiste
satisfaire ce quon pourrait appeler, avec une connotation nietzschenne, la
volont de puissance : puissance de saisir ce qui fuit entre les mains, dans
une forme dobjet modelable loisir ; et puissance dutiliser ce qui a t
objectiv, des fins de transformation et de domination. Notre but tacite, en
recherchant ce genre de gratification, est ici encore de conjurer un risque
auquel nous avons trop souvent t confronts durant notre enfance. Avant la
discipline de lobjectivation, nous avons appuy nos vies sur une activit
gratuite et une attente confiante qui nous ouvraient plus que de raison un futur
indfini. Mais il est souvent arriv que notre attente ait t due par ce qui
advient, et que laccueil confiant auquel nous nous tions abandonns soit
devenu notre plus grand chenal de vulnrabilit. Ltre-en-projet auquel nous
pensions pouvoir nous livrer sans rflchir sest drob sous nos pas ; et sa
place sest ouverte, bante, incertaine, et impersonnelle, la question du sens.
Une rponse immdiate, quasi-rflexe ce genre de risque, consiste ne plus
acquiescer entirement la surprise, ne plus consentir sans rvolte la
possible dception. La version pathologique la plus commune de cet antidote
est connue sous le nom de psychose paranoaque : les patients atteints se
protgent de la double angoisse dsidentifiante de laffect et de linconnu, par
un dlire de la raison consistant se croire menacs par des complots qui ont
au moins lavantage dtre supposs intelligibles. La version bnigne de ce
mme antidote nest autre que lexprience dobjectiver, lexprience de se
dissocier volontairement de ce qui arrive et de lui imposer une lgislation
systmatique afin de le prvoir et de sen servir. Ici, le langage et la
recherche scientifique mettent le temps, le vrai temps vcu impondrable et
cratif, au service de sa propre capture dans les filets dun rve de
spatialisation et dternit.
Ce quil faut retenir de ces remarques est que laxe central de la volont
de puissance consiste imposer un arrt, dlimiter des contours, dans le flot
de limmatrisable. Cette suspension espre a cependant ses limites, qui se
manifestent au plus immdiat de nos vies. Un bon rvlateur de limpossibilit
de gnraliser lternalisme spatialisant que Popper qualifiait de
parmnidien, est la ncessit de reconnatre aussi autrui comme non-objet
dans le rapport en deuxime personne du dialogue (aprs avoir tent son
objectivation). Lobjet de la connaissance, souligne Levinas, est toujours
fait, dj fait et dpass
11
. Lobjet enclos dans sa dfinition formelle, dot
de ses proprits identifies, est proprement parler un fait. Il est pass et
fix, y compris lorsquon envisage son futur qui ne peut plus tre que celui de
sa prvisibilit. Lobjet est (ou devrait tre) ce qui a cess de nous
interpeller, de nous inquiter, ou de nous ravir de surprise, pour ne plus nous
offrir que ce que nous lavons autoris rvler dans le cadre des lois
prescrites par notre entendement pur. Par contraste, autrui est vritablement
prsent, et non pas pass, parce quil est appel la parole
12
: il a tre
l pour se produire lui-mme dans les propos quil met au prsent et dans
les actes quil esquisse ou renouvelle prsent ; car, en tant que personne, il
ne se restreint pas ce qui est simplement constatable, il ne se rduit pas
son corps et ce quil a t, mais sinscrit bel et bien dans ce quil peut
maintenant dcider dtre. Sa spontanit actuelle brise lcrin solide dans
lequel on avait voulu ranger ce qui arrive, elle fait fondre les cloisons de la
classification de cela qui se prsente en une multiplicit rpertorie dobjets.
Elle nous force refaire attention lencore indistinct, et au dj cratif, que
nous avions voulu encadrer et prvoir au moyen de lobjectivation.
Se tourner de la deuxime la troisime personne, cest donc se dtourner
du risque dune temporalit ouverte, et dun dialogue quilibr mais sans
garanties, pour sentraner une sorte de savoir-faire calligraphique des
traces laisses par un temps chu. Il est facile de sapercevoir quune telle
discipline de ltat de conscience, peine sa motivation morale et son
pouvoir de gratification personnelle oublis au profit de son expertise de la
manipulation de choses fixes, na pas de meilleure issue mtaphysique que le
monisme matrialiste. Lissue satteint en deux tapes. La ngation de soi, la
dvalorisation des jugements seulement subjectifs, le dclassement
ontologique de lmotion et du sentiment esthtique, la mise distance du
toi en faveur du lui , ont dabord pour consquence de faire ressortir
quelque chose quon dclare extrieur au nom de sa subsistance travers le
flux des vcus, et de dfinir par simple soustraction un champ dit dintriorit.
Puis, dans un deuxime temps, le fruit dualiste de la dmarche devient lui-
mme objet de ngation, conduisant tenir lintrieur pour une production de
lextrieur, la res cogitans pour une manation de la res extensa. Le dualisme
sauto-annihile dans llan mme de son dploiement, il sauto-simplifie en un
monisme de la res extensa par simple extrapolation de la posture qui la
permis en premier ressort. Pour un esprit qui sest laiss dompter par la
discipline objectivante, il ne peut y avoir en dfinitive rien dautre que ce que
son regard a t duqu fixer. Il nexiste rien dautre parce que tout le reste
sest vu dpossd de sa lgitimit se dire et se connatre ; parce que
lexprience vcue dans son ensemble a t ravale au rang dinstrument pour
saffranchir delle-mme, ou de friche labourer pour sy enraciner dabord
et sen extraire ensuite. La focalisation de lattention sur les ples didentit
stable de lexprience (sa soumission lordre dignorer les variations, les
moirs affectifs, les saccades visuelles, et la versatilit incessante de ce qui
se vit), conduit ninvestir de la qualit absolue dtre que les rgions de
constance exprientielle recherche, et nattribuer leur rsidu fluent
nglig que la superficialit du paratre.
Un accomplissement extrme de ce projet de monopolisation de ltre par
les seuls objets partags, et dvacuation de tout le reste dans la zone
dvalorise de lapparence, a t men bien par Daniel Dennett. La stratgie
de son ouvrage Consciousness Explained revient proposer une squence
dexercices spirituels lenvers, tendant modifier et stabiliser ltat de
conscience de ses lecteurs dans la seule attitude intentionnelle. Les exercices
sont poursuivis jusqu ce que les lecteurs se sentent obligs de consentir la
thse centrale du livre : tout ce qui, dans lexprience consciente, ne se laisse
pas arraisonner par un compte rendu scientifique, est dclar illusoire ; la
structure de lexprience consciente (accessible ltude scientifique) relve
de ce qui est, tandis que le remplissement qualitatif de cette structure
(chappant au compte rendu objectif) se trouve repouss dans lenclos
dprci du paratre. Ces exercices sappliquent en bref changer
radicalement le voir-comme
13
des lecteurs ; pas seulement leur voir-comme
des contenus dexprience, mais leur voir-comme de la totalit de ce quils
vivent. Jusquau point o les lecteurs exercs avouent, espre Dennett, ne plus
voir ltoffe qualitative, colore, odorante, chaude, savoureuse, de
lexprience autrement que comme un comblement fictif des interstices que
laisse la trame structurale de leur activit cognitive. Lexercice de rfrence
est reprsent sur la quatrime de couverture du livre. Il sagit dun
quadrillage presque entirement fait de lignes noires sur fond blanc, sauf une
rgion en forme danneau o des lignes rouges remplacent les lignes noires.
Dans la rgion compose de lignes rouges, on a limpression (trompeuse, bien
sr) de voir une coloration rose et lgrement fluorescente staler entre les
lignes qui nenserrent pourtant rien dautre quune surface blanche. Il est alors
tentant, et Dennett favorise systmatiquement cette tentation, dextrapoler ce
constat lensemble de lexprience consciente, et de naccorder de
consistance ontologique qu son quadrillage , sa trame, cest--dire sa
structure scientifiquement identifiable
14
. Ce qui se montre, cest--dire le
continuum du remplissement qualitatif peru, est raval un faux-semblant.
Le lecteur a beau se rvolter en remarquant que cela nest dclar apparent
que secondairement, en vertu dun raisonnement, alors que lexprience
premire est bel et bien celle dun continuum qualitativement plein, il a beau
protester avec Searle quen matire dexprience lapparence est la ralit, il
se voit invit par Dennett faire et refaire de multiples tests d illusions de
remplissement jusqu ce quil apprenne prouver (et non plus seulement
comprendre rationnellement) leur caractre illusoire. Le problme est que,
par son insistance obtenir lexprience, et pas seulement lintelligence, du
caractre illusoire de la compacit qualitative de lexprience, Dennett
commet une contradiction performative flagrante. Il reconnat ironiquement,
peut-tre son corps dfendant, que la comprhension de sa thse
dflationniste au sujet des tats de conscience a pour condition pralable
u n tat de conscience adquatement modifi par ses soins. Ltat de
conscience dennettien ayant aussi sa qualit, son remplissement (le sentiment
envahissant dtre tromp), une rgression indfinie alternant des
remplissements et des perceptions de leur caractre illusoire, sensuit.
Jprouve au second degr le caractre illusoire de la part qualitative de mon
exprience premire (comme le demande Dennett) ; mais, en tendant mon
doute cette preuve, je fais au troisime degr lexprience de la part de
tromperie de mon exprience qualitative dillusion ; et ainsi de suite, sans fin
thoriquement assignable. Il y a pourtant bien un terme provisoire, vivant,
impens, de cette rgression ; et ce terme nest autre quune exprience
prsente pleine de pulpe qualitative (que ce soit la qualit du sensible, ou la
qualit du doute propos de la qualit sensible). Lexercice de Dennett ne
peut ds lors avoir pour but que de nous empcher daccorder la moindre
importance cela, de nous refuser toute possibilit de nous tablir dans cette
ralisation dfocalise, et de nous pousser sans cesse refocaliser lattention
sur une structure objectivable. Il vise nous faire perdre de vue quune
conscience vraie est pr-suppose jusques et y compris par laffirmation de
labsence de vrit des contenus qualitatifs de conscience
15
, et se faire
oublier lui-mme au passage en tant quexercice exprientiel, au profit de sa
seule consquence doctrinale quest la varit fonctionnaliste du monisme
matrialiste.
On saperoit travers ce tour de passe-passe dennettien, celui dune
exprience choisie pour son aptitude signorer elle-mme, que
lobjectivation a pour condition sous-jacente une stratgie lmentaire de la
conscience quon appellera la transitivit. La transitivit peut tre dfinie
comme une faon qua lexprience de se tourner le dos, et de chercher
ailleurs le principe de tout ce qui arrive, y compris de soi-ici. Une pense
transitive
16
soppose une pense intransitive comme le font les deux familles
de verbes qui portent ces qualificatifs. Elle ne saccomplit que tendue vers
son objet, de mme que le verbe transitif exige dtre suivi de son complment
dobjet. Elle soppose une pense intransitive qui se satisfait de son propre
dploiement, la manire dont le verbe intransitif se borne exprimer un
processus sans terme manifeste. La pense transitive ne se tient elle-mme que
pour une circonstance transitoire, que pour une terre de transit. Elle est en-
route-vers. Elle se perfore, elle se traverse et se dlaisse au profit de ce
quelle vise. Son complment dobjet lui devient seul perceptible, et demeure
ds lors le seul candidat toutes les fonctions, y compris celle du sujet
abandonn larrire-garde du geste de transition. Ce qui existe, aux yeux de
la pense transitive, cest lentit dont on parle, cest la scne quon observe,
cest le corps matriel sur lequel on agit, ce sont les outils quon manipule, ce
sont les artefacts quon fait servir quelque chose (ou qui ne servent rien
dautre qu entretenir la frnsie du faire). On , pour sa part, ne se devine
encore que comme le rsidu transi de ce quil a fallu surmonter pour slancer
vers quelque chose travers la faade oriente des que ou des sur
quoi . Il est somm de se faire lui-mme objet, proprit dobjet,
piphnomne dobjet, ou de ne pas tre. Car ne pas avoir statut dtant, se
tenir dans len-de typique dune condition de possibilit de la position de
tout tant, quivaut au simple nant pour la pense transitive. Le on nest
pas quelque chose et il est donc rien selon les canons de la transitivit. La
leon wittgensteinienne selon laquelle la sensation ou la conscience nest
pas quelque chose, mais [] nest pas rien
17
, nonce ds lintroduction de
ce livre, est littralement inaudible lesprit transitif ; inaudible parce que
dpourvue de manifestation autorise dans ltat de conscience qui est le sien.
Slancer, surmonter, passer la hte ne peut se satisfaire que dune
perspective sans obstacle, dune clause douverture indfinie de lenqute.
Cest certainement cette dernire clause qui singularise le mieux lapoge
scientifique de lactivit dobjectivation. En la mettant en uvre, la pense
transitive passe par-dessus son inachvement et lui donne un sens positif, une
vertu attractive. Louverture, on le sait, est la marque immanente de la
transcendance, le signe visible quil y a toujours plus connatre dans le
monde que ce qui en est immdiatement accessible, et donc la preuve que
quelque chose de lui nous chappe, nous excde
18
, et nous limite par un choc
en retour. Admettre louverture de lenqute signifie donc se mnager un
aperu vers la transcendance. Le problme est que la pense transitive a du
mal se rsoudre son incompltude et se contenter dun aperu ; elle
signifie souvent avec un optimisme militant que le programme dachvement
est en marche, que la lacune ne saurait tre que temporaire, et qu laperu va
se substituer une vision fidle.
partir de l, deux erreurs propos de louverture de la recherche, du
balancement indfini des conjectures et rfutations , menacent la pense
transitive dans son application au problme de la conscience. La premire,
dj dnonce par Kant dans la Dialectique transcendantale de sa Critique
de la raison pure, revient justement extrapoler la ligne de fuite de
linvestigation jusqu un point ferme mais imaginaire suppos totaliser toute
la connaissance qui pourra tre obtenue au cours dune histoire prsume sans
fin. Le point ferme sidentifie la chose relle telle quon se figure
quelle devrait tre pour expliquer la manire dont nous la dcouvrons
progressivement, en oubliant que le processus de dcouverte est la source
effective de cette figuration. Une telle hypostase, quon peut appeler lerreur
du point de fuite , est souvent commise par les dfenseurs des monismes
matrialistes et physicalistes en philosophie de lesprit. Lune des
manifestations les plus claires de cette erreur se lit dans la quasi-vacuit de
leur croyance selon laquelle la conscience est un phnomne physique .
Une telle croyance naurait une signification prcise que si lon pouvait
dsigner une thorie physique prsente ou annonce qui procure quelque clart
indiscute sur son origine
19
. Mais en labsence dune telle thorie, le mot
physique nest plus quun fragment de slogan dnu de contenu, tout au
plus investi dune valeur dontologique. On entend plus souvent parler dans
ce contexte doctrinal du physique que de la physique, dune mystrieuse
nature physique des choses que de leur lgalisation par la science physique
relle. tre physique , au sens de la doctrine physicaliste, nquivaut pas
relever dune thorie physique connue ou connaissable, mais tre lucidable
par une science physique idalement accomplie, selon lide quon se fait
actuellement de son achvement, et surtout selon les exigences les plus
dbrides quon a de nos jours vis--vis de ce que devrait nous offrir cette
science. Proclamer que la conscience est physique revient alors poser
comme impratif que la physique future devra, pour accomplir le rve de
science englobante dont on linvestit, rendre intgralement raison de tout, y
compris de la conscience (sans prciser, bien sr, ce que voudrait dire en
rendre raison dans ses propres termes). Malheureusement, cette faon
spculative et idalisante de proclamer le caractre physique de la
conscience ne va pas sans consquences dltres, qui prennent la forme
dune curieuse tautologie. tre physique in abstracto, sans rfrence des
thories physiques connues, ne peut signifier rien dautre que ne pas tre
mental , ce qui donne lieu ltrange proposition latente selon laquelle le
mental est un phnomne non mental . Pour viter cette consquence, il serait
certes possible de restreindre la fonction de la locution tre physique
exprimer la prescription de se servir de procds exprimentaux relevant des
sciences physiques dans la recherche sur les corrlats neurobiologiques de la
conscience ; mais dans ce cas, on nviterait la tautologie que pour tomber
dans une trivialit : il vaut mieux en effet utiliser des mthodes qui ont fait
leurs preuves dans le pass des sciences pour esprer atteindre une certaine
efficacit (cette efficacit ft-elle purement techno-manipulatrice, et ne
prtendant en rien nous rapprocher dun dvoilement du lieu de provenance de
la conscience). Nous reviendrons plus bas sur cette composante pratique qui
est sans doute le seul point dappui indiscutable, quoique mtaphysiquement
faible, du physicalisme.
Le second fourvoiement frquent de lattitude transitive sera appel
lerreur du point aveugle . Elle est pour ainsi dire la rciproque de la
premire, parce qu lhypostase du point de fuite, elle fait rpondre la
mconnaissance des rpercussions qua sur les savoirs le point-source de
leurs dcisions fondatrices. Lerreur du point aveugle consiste en bref
ignorer quune fraction de louverture de lenqute dcoule non pas de son
simple inachvement contingent, mais dune incompltude authentique,
incompensable, dfinitive parce que impose par les choix mthodologiques
initiaux qui sous-tendent la recherche, voire par ltat de conscience
quadoptent ds le dpart ceux qui la poursuivent. Lobjectivation est un
dcret primordial qui met par dfinition de ct tout ce qui relve de ltre
situ, de limmdiatet, de linstabilit de lexprience consciente, et qui fait
de ce refoulement de la singulire plnitude du vcu dans son angle mort la
condition de son oprativit. La transitivit est quant elle un mode dtre, un
tat de conscience optionnel, qui loigne lattention de lacte mental et la
projette sur le motif de cet acte, prparant ainsi les accomplissements de la
connaissance objective. Ne pas reconnatre cela, conformment une forme
damnsie rpandue dans notre culture, ne pas raliser que ces orientations
commenantes coupent par construction lenqute scientifique de sa source
exprientielle, a pour consquence damorcer une course en avant vers
lorigine chosifie de la conscience dont tout annonce quelle ne peut
dboucher que sur la plus entire dsillusion (mme si une myriade de
trouvailles excitantes et utiles faites en chemin protge la collectivit du
sentiment dchec et la tient en haleine). Utiliser la mthode scientifique pour
combler sa propre lacune constitutive ou son point aveugle fondateur est
peu prs aussi pertinent que slancer vers le futur pour rhabiter le pass, ou
que regarder au loin pour percevoir ce qui se tient ici. Aucun degr deffort
scientifique ne permettra de regagner ce qui a t perdu en fondant la science
sur la dcision mme de cette perte.
Une trace de lerreur du point aveugle au sein du dbat philosophique
contemporain se lit dans la combinaison de prgnance et dchec de la thse
physicaliste selon laquelle la conscience, sans tre proprement parler
rductible une base matrielle ou un niveau dorganisation rgis par
les sciences physiques, nen merge pas moins de cette base. La doctrine
de lmergence a en premire analyse de quoi sduire, parce quelle sloigne
de la caricature du physicalisme sans renoncer son principe. Rduire la
conscience une base matrielle (par exemple neurobiologique) voudrait dire
montrer quelle est une consquence immdiate, directe, prvisible,
thoriquement matrisable, de processus physiques se droulant dans un
certain corps. Mais considrer que la conscience merge de cette base
matrielle, cela veut dire quelle en est une efflorescence indirecte haut
niveau dorganisation, un effet ayant lallure de lentire nouveaut, un
corollaire a priori imprvisible et thoriquement insaisissable. Cela permet,
soit dit en passant, de ne pas exiger immdiatement des thories physiques
connues quelles permettent de driver la conscience partir de leurs
prmisses, et dallger du mme coup la charge de la preuve physicaliste. Par
ailleurs, au contraire dune proprit rduite, qui se verrait imposer une
relation bi-univoque avec une base de rduction bien dfinie (on dirait dans
ce cas quelle est ralise par cette seule base matrielle), une proprit
mergente est cense tre multiralisable, cest--dire capable de se
manifester lidentique dans plusieurs configurations matrielles distinctes.
Le problme est que cette thse de lmergence et de la multiralisabilit de
la conscience ne rsiste pas longtemps un examen ontologique srieux du
concept mme dmergence. Comme le remarque Jaegwon Kim titre
prliminaire, la plupart des proprits de haut niveau relevant de sciences
comme la chimie, la biologie, ou la sociologie, peuvent se concevoir comme
des mergents faibles . En dautres termes : (a) ces proprits de haut
niveau sont comprhensibles comme des rseaux configurationnels complexes
de proprits physiques sous-jacentes, mais (b) elles nont aucun pouvoir
causal propre et donc aucune autonomie ontologique par rapport aux
proprits dites lmentaires . Leur caractre de nouveaut et
dimprvisibilit, typique de lmergence, nest quapparent ; il drive dune
dficience thorique, conceptuelle, ou perceptive des sujets connaissants que
nous sommes
20
. Lincapacit dans laquelle nous nous trouvons danticiper
leur apparition partir de la connaissance des proprits lmentaires
relve donc dune forme simplement contingente dimprvisibilit. Par
contraste avec cela, poursuit Kim
21
, la conscience savre un cas
compltement part. Pour elle, et pour elle seulement, semble se justifier
lemploi dun concept dmergence forte , radicale, qui en fait une
proprit vraiment nouvelle, une proprit dont limprvisibilit a
priori dcoule dune limitation essentielle plutt que contingente de notre
connaissance objective, une proprit dont limmatrisabilit stend
tout le champ des thories physiques actuelles et possibles. Mais parler
d mergence forte dans ce sens extrme, et en rserver le concept au cas
dclar unique de la conscience, nest-ce pas avouer demi-mots quon ne
voit pas du tout quel genre de connexion il peut bien y avoir entre le niveau
physique et le niveau de lexprience consciente ? Ne doit-on pas reconnatre,
avec Galen Strawson
22
, que pour tre simplement en droit de supposer quune
proprit de haut niveau merge dune base , il faut avoir identifi dans
cette base quelque chose en vertu de quoi cette proprit peut se
manifester ? Or, nest-il pas clair quon na jamais pu entrevoir au niveau
physique ou physiologique un trait quelconque en vertu de quoi
lexprience consciente devrait en merger, alors quil est, par exemple,
facile didentifier un trait physique microscopique en vertu duquel le
caractre liquide de leau se manifeste au niveau macroscopique (lintensit
des forces de Van der Waals entre les molcules H
2
O) ? Si on continue malgr
tout de brandir le mot mergence propos de la conscience, nest-ce pas
alors parce quon ne veut pas dclarer forfait, et que plutt que dabandonner
une option physicaliste organiquement lie la mthode scientifique, on
prfre labriter dans une ultime niche verbale ? La singularit reconnue du
cas de la conscience dans sa dimension dexprience, sa mise en rapport avec
des limites constitutives de la connaissance, linvention dun concept
dmergence sui generis ne sappliquant qu elle, quivalent reconnatre
que sa conception physicaliste est bel et bien une variante de lerreur du
point aveugle. Car tout cela comporte laveu demi-mots que
limmatrisabilit de la conscience ne rsulte pas dun dfaut momentan des
thories physiques et physiologiques dont nous disposons, mais quelle
stend en principe toute thorie de ce type, et quelle dcoule donc
vraisemblablement de leurs plus profondes hypothses fondatrices.
Si loption mtaphysique dun monisme matrialiste ou physicaliste reste
cependant dominante dans notre culture, cest en vertu de deux arguments qui
ont t rapidement esquisss dans les paragraphes prcdents, mais qui vont
prsent tre dvelopps un peu plus longuement, avant dtre encore plus
amplement discuts dans les chapitres suivants. Ces deux arguments ont beau
tre vocateurs, ils ne sont pas logiquement contraignants. Ds lors, leur
pouvoir de conviction nest ressenti comme dcisif que dans ltat de
conscience transitif-intentionnel qui prconditionne lacceptation des
doctrines quils ont pour mission dappuyer, ce qui relve dune forme de
ptition de principe non pas certes purement logique, mais du moins logico-
existentielle.
Largument principal, mais aussi le plus faible en raison de sa symtrie,
est videmment la mise en vidence de corrlations plus ou moins troites
(selon les protocoles exprimentaux) entre vnements crbraux
publiquement accessibles et vnements mentaux rapports en premire
personne. Il est renforc par la possibilit dinduire des altrations du
fonctionnement mental par certaines interventions cibles sur le cerveau,
signant apparemment la dpendance causale du mental lgard du crbral.
Cette possibilit attesterait peut-tre une telle dpendance causale
unidirectionnelle sil ny avait aussi la possibilit rciproque doccasionner
des altrations du fonctionnement crbral par des interventions dordre
psychothrapique sur le cours des vnements mentaux. Dans ces conditions,
le fait de la rciprocit doit tre non pas certes ni, mais au moins minimis
sur le plan ontologique par les dfenseurs de loption physicaliste ; il doit tre
considr par eux comme un cas de causalit seulement apparente sur le
mode descendant (dun niveau suprieur un niveau infrieur
dorganisation), ne pas confondre avec la vraie causalit (confine selon
eux au niveau dorganisation physique de base )
23
.
Au moins un procd neutre pour synthtiser philosophiquement la
structure de ces dpendances mutuelles sans prjuger immdiatement de leur
signification causale est-il offert par le concept de survenance
(supervenience en anglais) du mental sur le physique : on considre que le
niveau mental survient sur le niveau physique lorsque toute modification
des vnements mentaux suppose une modification des processus crbraux,
tandis quil existe certaines altrations (gnralement minimes ou
adquatement distribues) des processus crbraux qui laissent les
vnements mentaux inchangs. Mais ici, nouveau, une distorsion se fait jour
lorsquon oublie que la survenance du mental sur le physique est
seulement une expression traduisant une forme labore, partiellement
dsquilibre, de corrlation entre les deux sries de phnomnes, et quon
se laisse trop fasciner par ses connotations de superficialit du mental par
rapport au physique. Car, au fond, les corrlations, dpendances mutuelles, et
articulations de type survenantes entre le physique et le mental ne sont pas
une condition suffisante pour affirmer que toute la ralit du mental est
puise par le physique. Dautres explications des corrlations et
dpendances que lassimilation-rduction du mental au physique, et mme
dautres faons de leur donner sens quen termes causaux, sont disponibles,
comme nous le verrons en dtail au chapitre XII. La plus connue des
explications alternatives, parmi celles qui restent enfermes dans le schme
causal, est un hritage du spinozisme. Elle consiste postuler la dpendance
commune du mental et du physique lgard dun troisime terme qui se
manifesterait tantt comme mental, tantt comme physique, et sur lequel on
pourrait intervenir par un travail psychologique aussi bien que par des
instruments physiques.
Pourtant, en dpit de ltat dindtermination dans lequel nous laissent les
arguments de la corrlation et de lintervention, ceux-ci restent largement
considrs comme les points dappui majeurs du monisme matrialiste ou
physicaliste. Quel est le motif dun tel engouement pour des arguments peu
concluants ? Essayer de le comprendre, mettre au jour le biais systmatique
qui conduit bien des chercheurs brandir ces arguments comme quasi-preuves
du monisme physicaliste va nous guider naturellement vers le second argument
latent en faveur de cette doctrine mtaphysique : celui de la productivit des
actions accomplies sous son prsuppos.
Si les corrlations et dpendances entre le mental et le physique sont
couramment envisages comme preuve de lexclusivit ontologique du
physique, cest que les moyens physiques daccs et de manipulation sont
nettement plus efficaces, plus finement modulables, et surtout plus aisment
matrisables, que les moyens mentaux. La raison principale pour laquelle il en
va ainsi, cest prcisment que ces moyens physiques relvent de lattitude
transitive : ils consistent en autant dobjets publiquement viss et partags la
disposition des gestes de prhension, autant dobjets dlimits et placs l-
devant pour toute utilisation et toute amlioration collective. Par contraste, les
moyens dintervention de type psychologique sont essentiellement
intransitifs ; ils supposent dans une large mesure la participation des
individus, lengagement des sujets, et une recration personnelle des
procdures, qui ne peuvent de ce fait tre quindirectement orientes par des
prescriptions verbalises, et qui restent donc mal contrles par des cribles
intersubjectifs. La stratgie physique dinvestigation, et lattitude
transitive qui la sous-tend, se rvlent ds lors capables dun progrs
technologique indfini, alors que la stratgie psychologique ne suit pas au
mme rythme parce quelle demande plus de srieux et dascse que de
dextrit. De l convertir une prfrence de productivit mthodologique en
primaut ontologique de lobjet privilgi de la mthode, cest--dire de l
considrer une cible commode du faire comme la seule chose qui est, il ny a
quun pas vite franchi. Les sciences physico-chimiques et physiologiques qui
se donnent pour tche dtudier et de manipuler le fonctionnement crbral
trouvent tout naturel de faire ce pas, puisquil revient accorder la dignit
dtre aux objectifs de leur activit rgle de matrise de lenvironnement.
Ces sciences sont si captives par leur propre lan et par les tmoignages
defficacit qui ne cessent de saccumuler leur propos quelles repoussent
comme secondaire tout ce qui na pas reu leur caution pragmatico-
ontologique. Elles tendent donc soit balayer du revers de la main les
objections fondamentales comme le problme difficile de lorigine de
la conscience, soit en annoncer la solution lhorizon glorieux de leur
avance suppose sans bornes (si ce nest sans limites). Mme le fait vident
que leur analyse de plus en plus fine du fonctionnement neuronal naurait
jamais pu acqurir la signification dune lucidation des processus mentaux si
elle stait entirement coupe de toute voie daccs lexprience en
premire personne naltre en aucune manire leur confiance, car il leur
semble dnu de porte thorique. Les chercheurs traitent lexprience en
premire personne comme une porte parmi dautres vers la connaissance
objective recherche, comme un passage traverser puis abandonner
derrire soi, comme un simple contexte de dcouverte qui ne conditionne
en rien le contenu des savoirs justifis, et ils ne se laissent donc pas
impressionner par la prsence ttue de lexprience dlaisse jusque dans le
sentiment quils ont de son insignifiance. Il faut dire que pour ces chercheurs,
la thse mtaphysique du monisme matrialiste ou physicaliste a un avantage
stratgique considrable : elle les met professionnellement labri du doute
instill par de nombreux philosophes de lesprit propos de leur capacit
rpondre aux questions les plus radicales, et leur permet en attendant de se
consacrer dinnombrables questions limites sur les mcanismes de la
perception, du sommeil et de la veille, de la conceptualisation, de lmotion,
etc., non seulement avec srnit mais aussi avec un espoir mobilisateur. Le
prjug mtaphysique de type matrialiste ou physicaliste sert en somme de
mol oreiller permettant aux recherches scientifiques de dployer leurs
immenses potentialits sans se laisser inhiber par des scrupules
philosophiques. Ainsi perdure-t-il en dpit de la faiblesse logique des deux
grands arguments (corrlation neuro-psychique et efficacit des procds
dintervention neurologique) rpertoris en sa faveur.
Le problme que pose aux philosophes une telle auto-affirmation pratique
du monisme matrialiste nest pas uniquement que cette doctrine ne rpond
pas leurs exigences argumentatives, et les remplace par une sorte de
proslytisme de la volont de puissance ; il est que sa faon de procder
devient hgmonique dans le domaine de la pense, au nom de lefficacit
techno-scientifique rige en seule valeur. Les normes qui sous-tendent le
prjug matrialiste ou physicaliste simposent bien au-del de sa
circonscription, et deviennent ltalon sur lequel viennent se rgler non
seulement les programmes scientifiques mais aussi ceux des dbats
philosophiques qui tendent transgresser leur cadre. Il en rsulte que les
dfenseurs de toutes les thses mtaphysiques sur la conscience, y compris de
celles qui visent surmonter les dficiences du physicalisme, se sentent
obligs de sauto-justifier sous le rgime de la pense transitive. Chaque
thse, aussi oppose quelle soit au matrialisme, se trouve implicitement
contrainte argumenter comme si elle traitait dobjets et proprits conus sur
le modle des corps matriels, alors mme que ses pseudo-objets et pseudo-
proprits nont t imagins que pour pallier tant bien que mal les
insuffisances explicatives dun monisme ontologique des corps matriels. Les
exemples de tels pseudo-objets et pseudo-proprits abondent, quil sagisse
de ractualisations de la substance neutre spinoziste, de la res cogitans
cartsienne, ou des proprits phnomnales de David Chalmers
24
. La
structure mme des explications non physicalistes en vient suivre le modle
physicaliste, lorsquelle met en scne des connexions pseudo-lgales entre ses
pseudo-objets ou pseudo-proprits, dune part, et les vrais objets et
proprits de la physique, dautre part, la manire des lois psycho-
physiques postules par Chalmers.
Penchons-nous donc avec un regard critique sur quelques-uns des
procds intellectuels par lesquels des thses mtaphysiques alternatives
cherchent slever contre la thse moniste physicaliste, mais ne parviennent
le faire quen adoptant ses formes ou ses normes (sous la contrainte de son
tat de conscience de rfrence), et en revendiquant une part de son terrain
ontologique.
titre de banc dessai de cette mise en vidence de lombre porte du
physicalisme au-del de sa circonscription, nous commencerons par la thorie
de lidentit psycho-physique, en vogue entre la fin des annes 1950 et le
milieu des annes 1960. Contrairement ce qui en est souvent dit, la thorie
de lidentit nest pas ncessairement, par elle-mme, un monisme
physicaliste. Lun de ses premiers dfenseurs, Herbert Feigl, a t amen
souligner une divergence majeure entre la thorie de lidentit et la thse
moniste physicaliste, pour couper court de nombreuses msinterprtations
qui tendent encore aujourdhui faire rsorber la premire par la seconde.
Sil admet que les seules lois fondamentales auxquelles peuvent accder les
sciences sont les lois physiques, Feigl nie cependant que la ralit dont les
rgularits sont formules dans les lois physiques soit elle-mme une
ralit exclusivement physique. La ralit ultime, pleine de rminiscences de
la substance spinoziste, doit selon lui tre comprise comme une entit dun
autre ordre qui, dun ct, se manifeste comme un ensemble de structures
descriptibles par les lois physiques, et dun autre ct est connue de nous
par accointance (cest--dire par connivence, par contact, par coextensivit)
travers notre exprience directe . Autrement dit, la ralit ultime, entit au
sujet de laquelle Feigl demande le droit de faire silence, est reprsente
dans deux systmes conceptuels diffrents : le systme de la physique et le
systme de la phnomnologie psychologique
25
. La ralit ultime est
doublement approchable, doublement manifestable, mais autre que ses
manifestations. Il dcoule de ce schma que la thorie de lidentit appartient
bien au type des thses mtaphysiques pseudo-objets (ici, lentit ralit
ultime ) traits sous le rgime dune pense transitive, mme si, selon son
principal fondateur, elle excde de loin larchtype physique de la transitivit
avec ses objets autoriss de type corporel.
la fin des annes 1960, deux dfauts ont t reprochs la thorie de
lidentit, invitant beaucoup de chercheurs abandonner son extrapolation
spculative de la norme ontologique physicaliste, en faveur dune ontologie
physicaliste stricto sensu. Le premier dfaut tait que la thorie de lidentit
excluait par principe que les processus mentaux aient dautres
implmentations que crbrales, ce qui interdisait de prendre en compte
lavnement annonc de lintelligence artificielle. Le second dfaut allgu
tait que les contours des concepts mentalistes, mal dfinis, ne recouvraient
les concepts neurophysiologiques que de faon incertaine et approximative, ce
qui rendait hasardeuse laffirmation de leur pure et simple identit. Pour
prendre un exemple, la nostalgie peut a priori recouvrir quantit dtats
neurologiques distincts suivant la varit des objets possibles de cette
motion et les climats affectifs qui lentourent. Auquel de ces tats
neurologiques la nostalgie est-elle ds lors identique ? Doit-on se
contenter de dire, selon la sagesse commune du moment, que chaque
chantillon de nostalgie est identique un tat neurologique donn, mme
si le type du sentiment de nostalgie ne peut pas se voir attribuer une
configuration physiologique unique ? Cette distinction entre chantillons et
types ne suffit pas surmonter la difficult, car si nos concepts typiques ne
russissent mme pas capturer les termes de lallgation didentit, si
lunicit de chaque cas didentit carte toute possibilit dattestation
reproductible, le maintien de cette allgation apparat mal fond.
Quelle quen soit la crdibilit, les deux critiques ont suscit des
dveloppements doctrinaux majeurs. La seconde critique a dbouch sur la
thorie liminativiste, dans laquelle les concepts mentalistes, dclars trop
flous, sont purement et simplement carts au profit de concepts
neurophysiologiques. Et la premire critique a engendr le fonctionnalisme,
qui, nous lavons vu, compare lesprit un logiciel, une structure abstraite
de rponses reprsentationnelles et comportementales pouvant tre mise en
uvre sur plusieurs substrats matriels, et pas seulement des cerveaux. Ces
deux dernires thses dobdience physicaliste, populaires durant les
dernires dcennies du XX
e
sicle, ont pu sarroger le mrite des comptes
rendus scientifiques de plusieurs aspects structuraux des oprations mentales,
au prix dun programme de recherche simplifi mais productif qui, linstar
de toutes les variantes de monisme physicaliste, laisse dlibrment lcart
la question la plus fondamentale. Lliminativisme remplace lesprit par un
organe et un processus objectif, laissant de ct (selon lexpression de
Thomas Nagel) ce que cest dtre un tel processus. Quant au
fonctionnalisme, il fait de lesprit une structure causale, laissant subsister un
gouffre explicatif
26
avec le trait non structural par excellence quest la
qualit vcue dune exprience particulire. Dans le cadre admis de la pense
transitive, la critique dune doctrine mtaphysique comme la thorie de
lidentit, qui repose sur la manipulation tantt ouverte, tantt tacite de
pseudo-objets comme la ralit ultime de Feigl, ne peut aboutir qu une
transitivit plus stricte encore, porte sur les seuls objets de la physique ; cela
suffit faire perdre lexprience consciente (ou conscience
phnomnale ) le statut majeur daperception de la ralit par accointance
quelle conservait encore dans cette doctrine, et en faire quelque
piphnomne incomprhensible et subalterne.
La pense transitive ne pouvant, on vient de le voir, quosciller entre
dincertaines imaginations thoriques et une lacune bante laisse en son point
aveugle, on ne doit pas stonner dun retour de balancier prconisant de
combler la lacune par une nouvelle chance accorde la thorie antrieure.
Et, de fait, un renouveau de la thorie de lidentit a pu sembler rcemment
offrir une rponse crdible au grand oubli que partagent lliminativisme et le
fonctionnalisme : nous avons la possibilit de gagner sur les deux tableaux,
crit Brian Loar. Nous pouvons prendre lintuition phnomnologique la
lettre, en acceptant les concepts introspectifs et leur irrductibilit
conceptuelle, et en mme temps tenir les qualits phnomnales pour
identiques aux proprits physiques-fonctionnelles du genre quenvisage la
science neurologique contemporaine
27
. La thorie de lidentit autoriserait
ainsi se rendre lvidence massive de la primaut existentielle de
lexprience vcue, sans pour autant perdre la facult de faire allgeance au
prsuppos fondateur de la mthode scientifique, des fins de conformit
idologique ou defficacit manipulative. En faveur de la thorie de lidentit
ainsi remotive, on a fait valoir quelques arguments qui sont cependant loin
davoir emport la conviction dune large communaut de penseurs.
Largument le plus parlant, et le plus souvent exhib, est celui de son pouvoir
apparent dexplication. La thorie de lidentit coupe court ds le dpart la
question de savoir comment lesprit conscient merge dune base matrielle,
puisquelle affirme leur identit ontologique. Elle rend raison de la
corrlation neuro-psychique de manire la fois efficace et triviale, en
soulignant quil ne sagit pas de deux mais dun seul processus reprsent
dans deux cadres diffrent. Lidentit tant lexplication la plus simple
possible, si ce nest la meilleure, de la corrlation psycho-neuronale, on est
pour ainsi dire forc de ladopter, proclament ses dfenseurs contemporains.
Mais au fait, la thorie de lidentit peut-elle vraiment tre dite expliquer
quoi que ce soit ? Bien des auteurs en doutent, avec de bonnes raisons
28
:
Les noncs didentit sont des redites, pas des explications ; une vraie
explication comporterait une squence dductive, allant de prmisses
acceptes des consquences observes, par lintermdiaire de lois ;
Les noncs didentit sont symtriques, alors quune explication lucide
un effet A par une cause B et non pas linverse. Limpression, fausse,
dune dissymtrie explicative surgit du pralable facultatif selon lequel la
thorie de lidentit est une branche du physicalisme. Ceci la contraint
tacitement expliquer le psychique par le physique. Mais, prise au
premier degr, la clause didentit pourrait aussi bien, ou aussi mal,
expliquer linverse le physique par le psychique ;
Les noncs didentit ne comportent aucun pouvoir prdictif : il est
impossible de dire a priori, en retournant simplement la prtendue
connexion explicative, quel tat psychique jusque-l inconnu un tat
neurologique peine dcouvert est associ ;
La corrlation neuropsychique ne se rduit pas une correspondance
formelle entre objets et quasi-objets, ou entre deux aspects dun quasi-
processus envisag en troisime personne (comme la reprsente la thorie
de lidentit). Elle est un fait concret quil faut tablir au cas par cas, en
employant une approche en deuxime personne pour recueillir des
rapports dexprience, ou en premire personne pour prendre conscience
de ce quon vit linstant o une image de son propre cerveau se montre
lcran. Cette dernire objection est sans doute la plus fondamentale de
toutes ; mais au-del de la thorie de lidentit, elle vise nimporte quelle
thse formule sous le rgime de lattitude transitive qui tendrait
systmatiquement rescamoter la richesse de lexprience situe ou le
travail de lempathie dialogique au profit dune chose ou dune proprit
phnomnale dsignable volont.
Si lon persiste refuser de sortir entirement de lattitude transitive, et
vouloir laborer une thorie mtaphysique sous son rgime, quelle option
reste encore disponible ? Peut-tre celle de renforcer la composante non
physicaliste de la thorie de lidentit, dtoffer sa reprsentation dune entit
centrale proto-physique et proto-psychique, dtablir plus fermement par l
lapparence dun itinraire explicatif allant de lentit centrale ses deux
aspects . Peut-tre galement celle doffrir un strapontin plus large
lattitude phnomnologique travers lattribution dun rle taill sur mesure
pour lexprience en premire personne, dans un schma spculatif relevant
pourtant essentiellement dune pense en troisime personne. Un bon exemple
de cette dernire stratgie est la thse finement labore par Max Velmans
sous le nom de monisme rflexif
29
. Pour Velmans, comme pour dautres
penseurs monistes non physicalistes inspirs par la tonalit spinoziste de la
thorie de lidentit, il faut postuler un univers psychophysique homogne
dont nous sommes partie intgrante, et qui peut tre connu de deux faons
compltement diffrentes
30
. La nette affirmation de cette entit la fois
centrale et totale permet daffronter lun des dfauts les plus patents du
paradigme matrialiste-physicaliste, et den proposer un palliatif
(conceptuellement) plausible avant de buter sur un usage mutil de la
phnomnologie.
Reformulons donc ce dfaut sous un angle alternatif, afin de montrer
comment le monisme rflexif de Velmans prtend en venir bout. La faiblesse
principale de la doctrine physicaliste peut se voir comme lenvers et la
consquence de sa force principale, comme le talon de cet Achille de la
pense philosophique. Sa force revendique, rappelons-le, est lauto-
suffisance prdictive et explicative des sciences physiques, leur capacit de
principe rendre raison de tout phnomne partir de leurs seules ressources
conceptuelles et algorithmiques, autrement dit la clture causale de leur
domaine de validit. Tout phnomne, et donc en particulier tout
comportement dtre vivant et pensant, doit pouvoir sexpliquer en faisant
intervenir des processus purement physiques, des chanes de causalits
exclusivement physiques, des lois relevant directement ou indirectement (
travers les strates de la survenance et de lmergence faible) des sciences
physiques. Cest un tel privilge dexhaustivit principielle que revendique
loption physicaliste, et ceux qui la dfendent ont en assumer les
consquences. Or, lune de ces consquences est manifestement dsastreuse
pour la prtention de la thse moniste matrialiste/physicaliste rendre
compte de lexprience consciente. Sil ny a, comme lexige lidal du
physicalisme, aucune lacune dans la concatnation des causes physiques qui
unit un stimulus sensoriel une rponse comportementale par le biais dun
fonctionnement crbral, alors lexprience consciente na absolument aucun
rle y jouer. Une telle conclusion fait cho la figure du zombie qui sera
tudie au chapitre suivant, et elle ne cesse de ressurgir propos des thories
neurologiques de la conscience, comme nous le verrons au chapitre IX. Cest
l ce que Velmans appelle le paradoxe causal de la conscience
31
.
Le monisme rflexif, avec son substrat universel cens se manifester sur le
mode psychique aussi bien que physique, est alors prsent comme une
solution de ce paradoxe
32
. Supposons en effet, propose Velmans, que la mme
grande chose universelle se prsente sous deux aspects diffrents, laspect
vcu en premire personne et laspect reconstruit en troisime personne. Dans
ce cas, la clture causale de la description ( physique ) en troisime
personne nexclut nullement quune description en termes de raisons ou de
motivations ressenties, typique de la premire personne, soit exactement aussi
pertinente que la prcdente pour rendre compte des comportements. La
concatnation des vcus na plus tre considre comme seulement
piphnomnale au regard de la chane des causes physiques, ni comme moins
fondamentale que cette dernire sur un plan ontologique, pour la simple raison
quelle partage avec elle un statut ontologiquement driv partir de lunique
univers psychophysique . Dans le cadre du monisme rflexif, la chane des
causes physiques a exactement le mme statut perspectif que la chane des
motivations vcues ; lune et lautre, la physique et la psychique, se font jour
en tant que vues diffrentes sur la mme chose ou le mme processus
universel, sous deux angles distincts. Ds lors, il ny a rien de choquant
alterner les langages physique et psychique, ainsi quon le fait souvent dans la
vie courante ou dans les sciences physiologiques, pour tenter de mieux
comprendre la succession des vnements qui ont abouti un comportement.
Lalternance ne doit pas ici tre tenue pour une trahison de la seule chane
causale relle (la chane physique), mais simplement pour un choix optimis
daperus perspectifs visant dcrire aussi conomiquement que possible un
processus sous-jacent plus rel que chacun dentre eux.
Le vrai dfaut de ces conceptions mtaphysiques proposes comme
alternatives au monisme matrialiste ou physicaliste se laisse voir lorsquon
creuse sous leur mtaphore des deux reprsentations et des deux perspectives.
Ce quon dcouvre alors est quelles noffrent quun simulacre de thorie
conforme la pense transitive, et que la ncessit interne dans laquelle elles
se trouvent dchapper au moins en partie ce mode de pense leur est
impossible cacher. Aprs tout, le motif principal de la rsurgence
contemporaine de la thorie de lidentit neuro-psychique nest pas seulement
doffrir une conception doctrinale convaincante de la place de la conscience
dans la nature aprs lchec partiel du fonctionnalisme, mais de faire (enfin)
une place la phnomnologie et lattestation vcue dune exprience, dans
ce quon pourrait appeler une science largie de la conscience . La
nouvelle version de la thorie de lidentit, aussi bien que le monisme non
physicaliste de Velmans, participent ainsi dun mouvement plus large de
traduction thorique de la mthode quemploient de facto les neurosciences
cognitives : la confrontation permanente dune description neurologique en
troisime personne avec des rapports dexprience en premire personne, qui
seule permet bon droit de confrer au processus neuronal le statut dun
corrlat physiologique dvnement mental
33
. Le problme est que son
contrle incertain du passage entre une pense transitive (mtaphysique aussi
bien que scientifique) et une pense intransitive (phnomnologique) expose
cette traduction thorique des confusions conceptuelles. Si le monisme no-
spinoziste propos par Max Velmans, ou avant lui le monisme no-leibnizien
esquiss par Raymond Ruyer, laissent entrevoir quils ne peuvent pas se
passer dune approche phnomnologique relevant de la pense intransitive,
cest seulement condition de la subordonner une description des relations
entre le grand objet universel (galement appel chose en soi ) et lun de
ses attributs, laquelle relve dune varit mtaphysique de pense transitive.
Cette dernire description doit alors tre place sous surveillance, afin dy
guetter lapparition dune faille entre des penses transitive et intransitive mal
distingues, entre une conceptualit massive et une rceptivit en filigrane.
La dnomination doctrinale monisme rflexif utilise par Velmans vise
demble signaler un retour lexprience par-del le dploiement
mtaphysique. Elle parvient voquer en deux mots une boucle de rtroaction,
un mouvement rflexif, qui reconduit lexprience consciente dans lacte
mme de viser son support mtaphysique unique ou son corrlat physico-
physiologique. La boucle samorce quand on note que le sujet percevant et
pensant est localis dans lespace, la manire dun objet singulier jet parmi
les objets du monde manifeste. La mme boucle se referme lorsquon
saperoit que les objets manifestes sont de simples apparitions rsultant dun
acte distanciateur et spatialisant quaccomplit la conscience du sujet que lon
est. Lespace en tant que domaine dobjets contient le sujet objectiv, mais
linverse le sujet conscient est porteur despace, et il se fait donc constitutif
dobjets tendus. Dans la mesure o nous sommes des parties de lunivers
qui, leur tour, font lexprience du grand univers, nous participons dun
processus rflexif par lequel lunivers sprouve lui-mme
34
. Lunivers vu
par Velmans ressemble en somme une bouteille de Klein, dont le goulot
repli slargit larrire pour produire le corps, tandis que le corps se
contracte et sallonge vers lavant en un goulot. Le goulot reprsente
mtaphoriquement le sujet dont les catgories constituent lespace objectif, et
la bouteille reprsente le domaine dobjets qui fait merger le sujet de son
sein
35
. Comme la bouteille de Klein galement, lunivers de Velmans na ni
intrieur ni extrieur, puisque son extrieur est projet par lintrieur et son
intrieur plong dans lextrieur. ce dtail capital prs que le point de vue
de Velmans est, et se sait tre, celui de lprouvant, du constituant, du
projetant, au regard duquel la pseudo-extriorit de la bouteille conue nest
quune commodit de reprsentation.
la manire de Velmans, Ruyer commence par noncer une forme de
doctrine moniste selon laquelle lorganisme et la conscience mergent comme
deux prsentations distinctes dune seule ralit premire. Il donne son
monisme une allure si simple quelle fait irrsistiblement penser la thorie
de lidentit neuro-psychique. Cest le cas lorsquil dclare que la
conscience est la ralit, ou un lment de la ralit, du systme nerveux
36
.
Mais cette belle construction spculative nest au fond quun faux-semblant,
dont le voile est vite jet terre par une sorte deffondrement sur le plan
phnomnologique. On saperoit de cette mutation de la pense en
dcouvrant ce quest exactement la ralit premire au sens de Ruyer.
Appele par lui domaine absolu de survol ou surface absolue , elle ne
sapparente rien dautre qu une pure exprience vcue encore dnue
dauto-apprhension rflexive. Dans le sillage de cette caractrisation
exclusivement exprientielle de la ralit premire sur laquelle est bti son
schma moniste, Ruyer concde que toute lefficacit appartient au subjectif.
Lobjectif nest quun piphnomne
37
. En particulier, le systme nerveux ne
doit lui aussi tre compris que comme un piphnomne, au sens o il nest
que lune des apparences manifestes dans la ralit premire exprientielle,
parmi celles que retient une conscience auto-dlimite rflexivement en son
sein. Si Ruyer adresse en dpit de cela une critique ouverte lidalisme qui
fait de la conscience un point de dpart inquestionn, cest parce quil ne peut
admettre la prdilection apparente de cette famille de doctrines pour lun des
deux termes du clivage dualiste traditionnel, pour le terme res cogitans plutt
que pour celui de res extensa. Contre une telle distorsion, Ruyer exige de sa
ralit premire exprientielle quelle soit consubstantiellement cogitans et
extensa, quelle soit la fois grosse de conscience et despace. La
conscience, crit-il, est de lessence mme de ltendue vraie
38
.
On retire de ces lectures limpression que, chez Velmans, comme chez
Ruyer avant lui, des termes spculatifs de dsignation transitive tels que
grand univers , chose en soi ou ralit premire ne sont que des
prte-noms pour cela vers quoi on ne peut justement pas gesticuler en
sextravertissant, savoir le constat dimmanence, le choc intransitif
consistant raliser lexprience pure au premier degr et tout le reste au
second degr comme ses objets. Sous couvert dexpliquer la corrlation
neuro-psychique par une dualit de perspectives ouvertes sur un mme objet
total, cest de lattitude mme de saisie tendue dun objet quelles se sont
subrepticement mais insuffisamment affranchies. Ltat de conscience dans le
cadre duquel voluent ces deux penseurs nest dj plus celui de la seule
attitude naturelle ou de la perptuelle distension intentionnelle. Il a
commenc basculer, ft-ce par intermittence, vers ltat de mise en suspens,
dpoch phnomnologique, au sein duquel llucidation dun problme
comme celui de lorigine de la conscience na plus prendre la forme dune
connexion dobjets, mais suppose une redfinition de la limite entre ce qui
compte comme problmes rsoudre et ce qui se manifeste comme la
prcondition trop souvent inaperue de leur formulation. Le rsultat de ce
caractre seulement sporadique, sans doute mal contrl, du basculement
dtat de conscience de ces penseurs, est que leur position hsite entre une
fausse symtrie pense et une vraie asymtrie vcue des perspectives en
premire et en troisime personnes. Chez Ruyer, une mtaphysique de la
monade , apparemment symtrique parce quelle se prsente de manire
quilibre selon les perspectives objective et subjective, dissimule mal
lasymtrie effective de ce qui finit par savouer une monadologie
subjective
39
. Quant Velmans, il dclare dun ct (sur un mode discursif et
transitif) que sa position combine un monisme ontologique et un
dualisme pistmologique , en ce sens qu il doit y avoir une chose,
vnement, ou processus que lon peut connatre de deux manires
complmentaires
40
, physique ou psychique. Mais dun autre ct, il
reconnat (sur un mode phnomnologique et intransitif) que les deux modes
complmentaires de prsentation de la chose centrale, les deux
perspectives allgues, ne sont en rien quivalentes. Car aprs tout, sans
expriences en premire personne, on ne peut pas avoir dobservations en
troisime personne
41
. La premire personne est larrire-plan, la condition
sine qua non de la troisime personne. Il nest pas possible de mettre les deux
sur un pied dgalit comme prtendent le faire le monisme neutre et le
dualisme ontologique, ni dinverser leur dpendance comme prtend le faire
le monisme matrialiste. En cette extrmit originaire du champ de la
rflexion philosophique, la pense transitive et ses schmas dobjets
prforms deviennent tout simplement hors de propos. La vise dobjet arrive
son point dextnuation, et masque trs mal le champ transcendantal qui la
prcde en fait comme en droit.
Ce genre doscillation pas tout fait matrise entre deux postures dtre
et de connaissance se retrouve dans la conception que lon prsente de nos
jours comme ladversaire archtypal et le repoussoir intellectuel du monisme
matrialiste : le dualisme des substances ou des proprits. Dans lesquisse
que nous avons propose de la psychogense du monisme physicaliste, le
dualisme nat dun arrt, dune pause, dune rticence dans le mouvement qui
conduit lentire ngation de soi. Quelle est la source existentielle de cette
pause ? Dans quel quilibre (ferme ou prcaire) dtats de conscience
senracine la demi-mesure dualiste ? Pour le savoir, la dmarche la plus
directe consiste relire quelques pages fondatrices de deux auteurs dualistes
spars par plus de trois sicles : Ren Descartes et David Chalmers. Ce que
nous y dcouvrons est que leur tat de conscience associe une pratique
rflexivement atteste de lpoch phnomnologique une volont
discipline de mnager un espace pour la connaissance objective. Il part
dune redcouverte de la concidence de soi avec lapparatre immanent. Il
sinflchit en une activit de mise en retrait vis--vis de cet apparatre. Et il
se prolonge par un effort de diffrenciation entre lapparatre rtract et ce qui
apparat pos dabord en lui, puis pour lui, comme face lui, dans le but de
pouvoir traiter ses contenus apparaissants comme autant de transcendances
accessibles la manipulation collective.
Penchons-nous dabord sur Chalmers, dont la dmarche est prompte et le
basculement postural facilement perceptible. Chalmers
42
part de la
proclamation lancinante de la prsence incontournable de lexprience,
connue de manire plus intime que quoi que ce soit dautre. Il carte une
une les tentatives den rendre raison en lui substituant la drobe des faits
cognitifs particuliers accessibles la mthode scientifique. Il rfute
soigneusement le parallle entre lexprience consciente et le principe vital,
souvent brandi par lapologtique matrialiste pour justifier la croyance que
rien de ce qui semble irrductible aujourdhui ne rsistera une rduction
explicative future, pas plus la conscience que les nigmes passes sur la
nature du vivant
43
. mi-chemin de sa critique implacable, pourtant, Chalmers
change de priorit. Il carte la tentation mystrianiste consistant relguer
dfinitivement lexprience consciente dans langle mort de la dmarche
scientifique, et il revendique la possibilit pour une science au domaine de
dfinition largi de prendre aussi en charge la question de lexprience. Mais
pour parvenir cette fin tout en continuant concevoir (avec la tradition
pistmologique dominante) les sciences comme des disciplines dobjets
voues tablir des lois connectant leurs proprits, il lui faut faire de
lexprience consciente un objet additionnel, ou du moins une proprit
dobjet supplmentaire. Le tournant est pris en deux phrases conscutives :
une thorie de la conscience devrait considrer lexprience comme
fondamentale. Nous savons quune thorie de la conscience demande
ladjonction de quelque chose de fondamental dans notre ontologie
44
.
Considrer lexprience comme fondamentale, cela est compatible avec une
attitude transcendantale qui la tiendrait pour une condition darrire-plan ou
une origine non thmatise (encore, dans ce cas, ny aurait-il mme pas
considrer lexprience, mais simplement sy savoir tabli). En revanche,
prendre lexprience pour quelque chose qui sajouterait notre ontologie
45
,
cest la lettre rifier lexprience consciente, en faire un tant, voire un objet
de pense (dexprience !) parmi dautres, mme si cest en plus des autres ;
ou bien la tenir pour une proprit fondamentale des choses au milieu dautres
proprits fondamentales comme la charge, la masse, et le spin, ainsi que le
propose plus prcisment Chalmers. En un instant, ltat de conscience de
lauteur a bascul. Il sest transform brusquement, passant de louverture la
focalisation, afin de se remettre en phase avec le dploiement de la dmarche
scientifique, dclar indfini en dpit de lchec reconnu de son emprise
rductive. Lapparatre obsdant, envahissant, omni-englobant, autre
dsignation de lexprience consciente, sest soudain transform en un trans-
paratre, et ce qui la remplac, cest une multiplicit accrue des figurations
de choses en elle. Le monolithe de lapparatre sest pulvris en une myriade
dapparaissants, lun dentre eux ayant reu mission de porter le reflet
fragmentaire de son bloc natif et den devenir en quelque sorte le reprsentant
saisissable. Le problme de la provenance de lexprience consciente a pris
place (mais place restreinte, et donc pas sa mesure) dans une sous-rgion
dlimite et objective de son propre domaine. Cest ainsi que ce domaine
sest dualis, selon Chalmers, en deux classes de proprits dobjets : les
proprits physiques et les proprits exprientielles. Cest ainsi galement
que le but de la nouvelle science tendue quil appelle de ses vux est devenu
dtablir des lois connectant les deux espces de proprits, physiques et
psychiques, postules au sein de lunique champ ontologique reconnu. Dune
dualit de postures, transitive et intransitive, on a ainsi rechut dans un
schma mtaphysique qui relve de la seule posture transitive, quitte laisser
affleurer sous le nom de proprits exprientielles le fossile peine
visible de son autre prcondition posturale.
Entre recueillement
46
et extraversion, ltat de conscience de Descartes a
suivi une trajectoire oscillante voisine, dposant par l le germe conjoint
dune philosophie de lesprit canonique, et de lapproche moderne de la
nature. la diffrence de Chalmers, cependant, Descartes ne cherchait pas
assurer que la mthode scientifique stend (ft-ce non-rductivement) jusqu
lexprience, voire que lexprience est lobjet dune science. Sa tche tait
la fois moins spcifique et plus ambitieuse, puisquelle consistait dgager,
par son balancement, un vaste terrain pour le dploiement de toutes les
sciences ltat naissant. lpoque, rester bloqu en tat dextraversion,
cela revenait accepter la thorie nave de la connaissance comme copie
sensorielle passive des choses extrieures, encore en vigueur dans
laristotlisme du XVI
e
sicle
47
, et exprimer de la rticence face au
dveloppement du pouvoir actif de lentendement mathmatique. Rester
bloqu en tat de recueillement, linverse, signifiait ne pas tablir assez
clairement la diffrence entre soi et les choses, rpandre lme dans les
territoires naturels, se percevoir en coextensivit avec lme du monde ( la
manire des no-platoniciens de la Renaissance
48
), ne pas fixer de bornes
ce qui sprouve, se souffre, et se vit, et par consquent ne mnager ni un
espace pour ce qui est connatre, ni la possibilit de lacte qui permet de le
poser face soi comme objet. Il fallait donc commencer par le recueillement
pour prendre acte fondateur de ce qui est manifestement l, puis procder
une extraversion mthodique afin de refouler ce l massif vers larrire et de
consacrer les efforts du chercheur de vrit aux contenus poss devant, ou
objets. Pour autant, il ntait pas question aux yeux de Descartes doublier
compltement ce quil prconisait de rejeter en arrire-plan. Le recueillement,
chez lui, tait encore vivant, continuellement vivant, et il fallait donc lui
donner un lieu, un droit, un nom (me ou esprit, res cogitans). Il fallait tracer
des limites entre limmense domaine assign aux jeunes sciences de la nature
voues dcrire les figures et les mouvements des choses montrables, et la
lgitimit ttue de ce qui, simplement, se montre de soi-mme (pour le dire
comme Wittgenstein). Cest seulement sur cette question dlicate des limites
que la dmarche de Descartes sest avre, invitablement, incertaine, et
quelle sest exprime de faon quelque peu baroque par lhypothse des
animaux-machines et par la dsignation de la glande pinale comme lieu
darticulation de lme humaine au corps
49
.
Ni le recueillement ni lextraversion, ni lacte de rduction
phnomnologique ni la systmatisation de l attitude naturelle , ne vont
pourtant sans dire. Chacun de ces tats de conscience, qui sarticulent en une
seule stratgie dtre-au-monde adapte lre de la premire rvolution
scientifique, a d tre conquis de haute lutte par Descartes.
La premire de ses six Mditations mtaphysiques, vers laquelle nous ne
cessons de revenir, trace litinraire de la dsorientation auto-impose de
quelquun qui veut tre absolument sincre avec lui-mme, et ne cder aucun
des leurres par lesquels la convention sociale anesthsie lintranquillit
existentielle. Un dialogue intrieur entre la voix claire du dsarroi et la voix
fausse de lapaisement tourne de plus en plus lavantage de la premire.
Jusquau vertige : Je vois si manifestement quon ne peut jamais distinguer
par des marques certaines la veille du sommeil que jen suis stupfait
50
. Le
doute se propage, mais la bien-pensance est si enracine quil faut
entreprendre un long travail sur soi pour que sa puissance corrosive ne soit
pas trop tt touffe. Ces remarques ne suffisent pas encore, il faut que je
prenne soin de men souvenir ; inlassablement en effet reviennent les opinions
accoutumes
51
. Il ne suffit pas dargumenter ni de prsenter les raisons du
doute propos des lieux communs ontologiques ; il est ncessaire de se
laisser pntrer par lui, de sorte quil finisse par ouvrir le regard ce que
Michel Henry appelle lapparatre comme commencement radical
52
. Il faut
que le doute se soit infiltr si profondment dans les croyances les plus
lmentaires que seuls les actes de douter et de croire restent intouchs, ou,
plus profondment, que seule la lumire dexprience qui les porte demeure.
La rduction phnomnologique, pour ne pas dire lveil soi , est bien un
combat contre les conditionnements anciens, et Descartes a su faire de ses
phases piques lun des rcits les plus vibrants de lhistoire de la philosophie.
Lobjectivation aussi est un combat, directement indispensable
lavnement des sciences de surcrot, et Descartes y consacre une grande
partie de sa troisime Mditation mtaphysique. Grce la table rase
initiale, le sol est dgag pour la reconnaissance du statut de pures ralits
objectives (au sens mdival dobjets de pense, autrement dit didalits)
de ces choses extrieures auxquelles nous croyons communment. Cela libre
la possibilit de leur appliquer le pouvoir de notre intellect rassembl dans la
discipline de lordre et de la mesure quest la mathmatique
53
, donnant ainsi
le coup denvoi la science moderne de la nature. Une fois cette libert
acquise, ajoute toutefois Descartes, il faut en affermir le fruit en nous assurant
qu la ralit objective des thmes de nos recherches rpond un degr
plus haut de ralit formelle , cest--dire de ralit effective, ou de ralit
tout court. Pour cela, nous nous fions notre lumire naturelle
54
cense
nous garantir que nos ides des choses et des proprits ont bien une cause
relle (au sens le plus fort de ce dernier qualificatif). Certes, la cause relle
na pas de raison de correspondre terme terme la multiplicit des objets
que nous identifions, conformment lenseignement du doute initial ; mais
elle sannonce de manire plus impressionnante encore travers une ide si
grande que je sois certain quelle nest en moi ni formellement ni
minemment
55
. Autrement dit, la cause relle est identifie Dieu, par le
biais dune varit de la preuve anselmienne.
Sans sappesantir sur la question de savoir si Descartes a affaibli son
acuit critique dans la troisime Mditation, par rapport la lucidit peu
commune de la premire, il faut maintenant sassurer que cette puissante
rsurgence de lontologie na pas contamin rtroactivement la conception
cartsienne du premier commencement exprientiel. Cest dans les
passages centraux de la deuxime Mditation mtaphysique que se joue le
risque dune telle contamination en retour. Comment comprendre autrement la
formulation de style ontologique que donne ici Descartes de laboutissement
de son exercice de recueillement ? Comment interprter lnonc selon lequel
je suis une chose qui pense
56
? Certes, la pense au sens cartsien ne se
restreint pas un simple exercice des facults mentales de raisonnement ; elle
est galement sensation, imagination, volition, cest--dire quelle embrasse
la totalit de lapparatre. Lapparatre na donc pas t perdu de vue en
faveur de quelques-uns de ses contenus. Mais le simple emploi du mot
chose ( res ) ne nous fait-il pas immdiatement retomber de lexpansion
attentionnelle ncessaire pour raliser le cogito en-de des cogitata, la
focalisation sur un secteur limit de la pense, et donc sur lun de ses objets ?
Le dualisme des substances ne nat-il pas de cet chec maintenir jusquau
bout leffort, non pas surhumain mais simplement proto-humain, de la
rduction phnomnologique
57
? Bien des dveloppements de la philosophie
de Descartes montrent incontestablement des signes dune rechute en dessous
du niveau de son acte fondateur, comme le dclassement de la chose pensante
que je suis au rang de substance cre parmi dautres probables
58
. Et
pourtant, quantit dindices nous persuadent aussi, comme cela a t suggr
plus haut, que Descartes na jamais compltement perdu de vue le sens de son
geste inaugural ; quil sest sans cesse mis en mesure de le raccomplir ds
quil lui a fallu scarter des thmes scientifiques pour affronter les questions
sur les confins de la connaissance.
Un premier signe de sa tnacit rflexive est perceptible dans la rponse
aux cinquimes objections formules par Gassendi. Lobjecteur y affirme que
la certitude du je suis navait pas besoin de sappuyer sur le dernier
retranchement de la pense , cest--dire de lapparatre pur ; quelle tait
suffisamment atteste par la moindre de nos actions localises dans lespace
et dans le temps. Cette demi-rduction pragmatique, sans doute suffisante pour
prendre conscience rflexive des sources de la performativit empirique, est
cependant rejete par Descartes au profit dune pleine rduction
phnomnologique. Car, remarque-t-il, la gesticulation du corps pourrait
ntre quun rve et la certitude de lacte nest donc radicale quen tant
quexprience de lacte
59
. Le corps ne participe de lindubitable que dans la
mesure o il est corps dpreuve, ou corps propre. Il est vrai que dans Les
Passions de lme, Descartes expose une physiologie des motions, et quil
semble donc mettre en scne non problmatiquement un corps humain
60
trait
comme objet dune science de la nature encore en gestation. Mme l,
pourtant, le motif du saisissement initial de Descartes, celui qui la pouss
exercer le doute hyperbolique et retourner au tissu mme de lexprience,
ressurgit : le rve, toujours et encore, tmoigne de ce quil est parfaitement
possible de se tromper sur la cause corporelle ou mondaine dune passion, et
que seul par consquent le vcu de cette passion est incontestable
61
. Cest l
un second indice que le geste de rduction phnomnologique initial reste
prsent en sous-main ; une prsence dautant plus significative quelle se
manifeste au centre de la premire grande tentative moderne de naturaliser un
aspect majeur de la vie mentale, en attribuant les affects des processus
crbraux et cardiaques capables de troubler lme.
Mais ce nest pas tout. Lattitude de rduction phnomnologique ne
persiste pas seulement dans les coulisses dune rvolution scientifique qui
sen serait affranchie ; elle continue dtre la principale ressource de
Descartes, ds que des interlocuteurs le forcent rvler les fondements
ultimes de sa philosophie. Lexemple le plus pur de retour la tabula rasa
exprientielle est offert par la rponse que propose Descartes une critique
pressante de la princesse Elisabeth
62
. Javoue, crit Elisabeth, quil me
serait plus facile de concder la matire et lextension lme, que la
capacit de mouvoir un corps et den tre mu un tre immatriel
63
.
Laporie matrialiste de la production dun esprit conscient partir dun objet
inerte, ou de son assimilation pure et simple une chose tendue, semblait
moins droutante la princesse de Bohme que laporie dualiste de la
communication des substances pensante et tendue, immatrielle et matrielle.
Elisabeth sattendait sans doute une rplique intellectuellement fonde, un
dploiement renouvel de concepts de la part dun Descartes mis en demeure
de sexpliquer sur lun des points les plus obscurs de sa philosophie. Mais la
rponse qui lui arrive en retour, par une lettre date de huit jours aprs la
sienne, est troublante parce quelle dplace la question sur un tout autre
terrain que discursif, et quelle exige rien de moins pour tre comprise que de
changer dtat de conscience. Elle demande, pour tre plus prcis, de se
garder dabstraire ou dimaginer, et den revenir aux vidences senties dune
vie plus quordinaire parce que consciente delle-mme. Descartes prconise
cette conversion posturale avant de lillustrer par son propre exemple : Je
nai jamais employ que fort peu dheures, par jour, aux penses qui occupent
limagination, et fort peu dheures, par an, celles qui occupent lentendement
seul, et jai donn tout le reste de mon temps au relche des sens et au repos
de lesprit
64
. Cest seulement comme cela, en interrompant les activits
mentales de lintelligence et de limagination, que lon peut, non pas bien sr
conceptualiser, mais raliser une union si intime de lme et du corps quils
semblent une seule chose . Cest seulement en sabstenant de
philosopher que chacun se met en mesure d prouver la notion de
lunion
65
. Cest seulement en suspendant les jugements, en relaxant leffort
de la pense transitive, quon en revient au fait intransitif premier de
lincarnation et que laporie dualiste se volatilise dans sa propre origine.
Un tel renvoi lexprience en de du raisonnement nest pas isol ; il
nest pas rserv la confidence intime chuchote dans une lettre. Descartes
en affirme la ncessit jusque dans ses rponses publiques aux quatrimes
objections, lorsquil fait rfrence cette troite liaison de lesprit et du
corps que nous exprimentons tous les jours
66
. Mais une si pleine
conversion exprientielle de la dmarche philosophique reste confondante
pour qui ne la pratique pas rgulirement ( tout le reste de son temps ). Les
chercheurs contemporains en sciences cognitives, absorbs par leurs propres
vises dobjets et duqus valoriser loubli de lorigine de ces vises,
risquent de nen tirer quune seule conclusion : que Descartes, court dides
pour rendre raison de la communication entre la matire tendue et lme
dmatrialise, sest vu forc davouer linconsistance de son systme
dualiste ; et que son aveu a pris la forme pathtique dun appel lvidence
quotidienne de la motricit volontaire en-de de lintelligence rationnelle.
Descartes lui-mme sest rendu compte que sa rponse Elisabeth, qui
invoque une platitude quand on le somme de produire un raisonnement, peut
sembler burlesque tant elle sapparente une esquive : Jai quasi peur,
sexcuse-t-il, que Votre Altesse ne pense que je ne parle pas ici
srieusement
67
. Et pourtant, Descartes na peut-tre jamais t aussi
srieux ; car il invite son interlocutrice faire elle-mme lexprience de
lune des plus hautes vrits auxquelles il soit parvenu, une vrit si ultime
quil ny a rien dire en sa faveur. Cette vrit, cest justement que, pour
clairer jusquau fond le rapport entre les deux versants clivs par lopration
dobjectivation, le domaine des corps et celui du vcu de leur perception ou
de leur manipulation, il ne faut plus affirmer ni penser quoi que ce soit ; quil
faut au contraire relcher les sens et reposer lesprit de manire
remonter spontanment en amont de lacte sparateur dobjectiver. L, et l
seulement, lnigme de la communication des deux ples distingus se dissipe
comme une vapeur lgre, parce quil ny a plus deux choses faire
communiquer, mais cette simple exprience dont le travail de questionnement
a secondairement donn lieu des concepts de choses et des divisions entre
elles. Descartes nignorait dcidment pas que le bocal mouche post-
wittgensteinien, celui que nous appelons le problme de la conscience, ne peut
fondre puis disparatre que si la mouche ratiocinante cesse de voler dune
notion lautre et consent sex-stasier dans lcoute. Ne serait-ce que parce
que la raison est partie intgrante du problme quelle prtend rsoudre.
Il suit de cette rflexion que le dualisme de Descartes, loin dtre une
erreur , comme le proclame A. Damasio
68
avec la quasi-totalit des
spcialistes de neuro-sciences cognitives et des philosophes analytiques
contemporains, tait le moins mauvais des compromis initiaux possibles face
la double ncessit historique dassurer la sphre de lobjectivit
scientifique, et de garder en vue la lumire de lapparatre en tant que sol
fcond de tout ce qui arrive et de tout ce qui se fait, y compris le travail
dobjectivation. La plupart des tentatives ultrieures de revenir sur ce
compromis ont abouti une dmarche hmiplgique, une distorsion dun
ct ou de lautre. Le monisme matrialiste dun La Mettrie ou dun Diderot
glorifiait les sciences mais rendait les scientifiques aveugles leur source
vive. La raction romantique senivrait de la richesse de lexprience, de ses
battements esthtiques, de sa rsonance avec une nature contemple, mais
remettait en question des choix mthodologiques cruciaux pour la naissance de
la science moderne. Si lon souhaite, bon droit, surmonter les maladresses
rifiantes et les clivages trop nets du dualisme cartsien, ce nest donc
certainement pas en niant sa motivation initiale quon peut y arriver. Cest
seulement en repartant de son oscillation dtats de conscience, en assumant
entirement son exigence de concilier la vrit premire de ltre-l et la
vrit seconde des tants, la vrit donne de lapparatre et la vrit
construite des objets apparaissants, la phnomnologie qui interroge les
racines de la naturalisation et la science qui explore la nature, que lon a une
chance de faire mieux que lui avec la mme ambition douverture et
dexhaustivit que lui.
Pour rcapituler, laccommodement dualiste cartsien tait utile afin de
construire une science conqurante bien quencore imprgne de son humus
exprientiel, une science assure delle-mme par ses succs mais se gardant
de devenir trangre ce qui la rend possible. En mme temps, le dualisme
prparait, par sa rigidit substantialisante et par une srie de questions
formulables dans ses termes mais restes sans rponse, les drives ultrieures
consistant ne plus admettre que lun de ses deux ples, et rester crisp
dans lune des attitudes associes. Cest donc cela quil faut dpasser : non
pas la dualit des tats de conscience, mais sa transcription substantialiste ;
non pas le libre balancement entre deux postures exprientielles, mais sa
lenteur et ses paralysies rcurrentes.
Dans le panorama des positions contemporaines, il en est une qui offre des
rponses prcises, la fois dualises et non dualistes, ce besoin de
renouveau de la motivation juste de la stratgie cartsienne. Il sagit de la
neurophnomnologie fonde par Francisco Varela. Varela a trs tt identifi
le cur de la dmarche quil faut suivre pour cela, comme en atteste cette
phrase dun de ses premiers articles : Une mutation de lexprience (cest--
dire de ltre) est aussi ncessaire quun changement dans la comprhension
intellectuelle, si lon veut parvenir suturer les dualismes de lesprit et du
corps
69
. Cette entre en matire est identique celle de Descartes et de
toute la ligne phnomnologique : en amont de tout effort rationnel, elle
prconise une rintgration de lexprience, et un travail sur lexprience,
comme principe dune dissolution du problme de la conscience. Ainsi que le
montre la suite des travaux de Varela, la mutation indispensable de
lexprience ne se restreint cependant pas la capacit daccomplir la
rduction phnomnologique nouveaux frais ; elle consiste favoriser la
plasticit et linterchangeabilit des modes de lattention ou des tats de
conscience, conformment un projet authentiquement post-dualiste
70
.
Lexprience vcue, crit-il, est l do nous partons et ce quoi nous
devons nous relier en retour, comme un fil conducteur
71
. Lexprience
vcue est au cur ; mais elle lest en tant quaxe prenne dun mouvement de
dpart et de retour, de vise et de concidence, de qute de lobjet
neurologique et de rapatriement sur le sol phnomnologique.
Dans la neurophnomnologie de Varela, ni les composantes rapportes
de lexprience en premire personne ni les structures objectives ne sont
considres comme intrinsquement fondamentales. Pas plus fondamentale
lune que lautre, chacune est en attente dun schme interprtatif ou dune
donation de sens de la part de lautre. Pas de fondationnalisme physicaliste,
pour lequel la conscience nest quune proprit mergente dun objet des
sciences de la nature ; et pas davantage de fondationnalisme idaliste, pour
lequel les contenus verbalisables dexprience en premire personne sont la
base ultime partir de laquelle tout le reste, y compris la nature objective, est
construit. Au lieu de cela, une circulation permanente de lun lautre, une
raction de lun sur lautre, au sein dune forme de vie humaine la fois
incarne, situe, et sociale laquelle participent les chercheurs par et dans
leur exprience. La mthode qui en dcoule consiste tablir une dynamique
dinterprtation rciproque entre comptes rendus en premire personne
dexpriences vcues, et descriptions en troisime personne de processus
neurologiques. Sinscrire dans une telle dynamique ne revient pas relever
des concomitances, qui restent de toute manire assez approximatives aussi
longtemps que la stabilit de lexprience subjective et la fiabilit de son
compte rendu ne sont pas la hauteur des donnes neurophysiologiques, et
qu linverse ces donnes neurophysiologiques nont pas t suffisamment
regroupes en classes phnomnologiquement signifiantes. Cela quivaut
plutt remplacer le problmatique constat de corrlation entre vnements
vcus et vnements neuronaux par des contraintes mutuelles gnratives
entre les deux termes.
Mais que veut dire exactement lexpression contraintes mutuelles
gnratives ? Elle signifie que la dmarche neurophnomnologique demande
dtablir une synergie entre lapproche phnomnologique et lapproche
neurologique-objectivante, en favorisant le raffinement de lune par le
raffinement de lautre, et en mettant en place les conditions dune possible
action de lune sur lautre. Cette faon de procder simpose dautant plus
quaucune catgorie neurophysiologique, quelle soit topographique,
fonctionnelle ou dynamique, ne correspond immdiatement une exprience.
Si lon veut tablir une telle correspondance, il faut singulariser des structures
neurologiques qui sy prtent ; et on ne peut savoir quelles sy prtent qua
posteriori, aprs les avoir confrontes des rcits en premire personne.
Rciproquement, aucune catgorisation phnomnologique ne correspond a
priori tels vnements corporels particuliers, tant le caractre personnel,
contextualis dans un milieu et une histoire, des contenus rapports
dexprience, est structurellement loign des figures spatialement rparties
de lactivation crbrale et neuro-vgtative
72
. La stratgie recommande
pour tablir une correspondance neuro-phnomnologique consiste donc
affiner la recherche phnomnologique en tirant parti de sa confrontation
critique des vnements neuronaux contemporains, et, conjointement,
orienter la recherche neurophysiologique en sappuyant sur des pralables
phnomnologiques. Il ny a l aucun cercle vicieux de double indtermination
catgoriale, mais au contraire une spirale productive dlaboration des
catgories par un va-et-vient rgl entre des tudes en premire et en
troisime personnes. Ici encore, il nest pas question de dsigner des ples
figs dans un schma dualiste, mais de sengager dans une avance conjointe,
dans une assistance mutuelle, dans une heuristique de la comparaison et de
lchange, en remettant constamment en chantier les processus jumeaux de la
subjectivation et de lobjectivation.
Ce changement de procd, dune attention dirige exclusivement vers
lobjet manipulable cerveau une plasticit posturale faisant alterner
focalisation et dfocalisation attentionnelle, dun exercice centr sur des
savoir-faire technologiques et thoriques une discipline largie incluant le
savoir-tre exprientiel, ne va pas sans consquences majeures sur le plan des
reprsentations ontologiques associes. Nous avons vu que lune des
motivations principales de la doctrine mtaphysique matrialiste est la
transfiguration dun choix mthodologique defficacit dans laction, en une
option ontologique consistant naccorder dtre quaux cibles de cette
action. Toute dcision alternative se heurte une clause automatique de
dfiance, au nom de la grande question pralable que doit affronter chaque
candidate au titre dimage du monde dans notre civilisation : quel procd
capable de progrs est-il guid par lontologie quelle implique ? Or, voil
quune nouvelle pratique dborde massivement le champ des objets corporels
de manipulation, inclut une culture de la stabilisation de lexprience vcue et
inspire, non pas en dpit de cela, mais grce cela, des dmarches de
recherche originales et fcondes. La principale source du crdit des
ontologies matrialiste et physicaliste sen trouve tarie, ou du moins
massivement dvie ; et la place se fait jour une pense allge de ses
pesanteurs ontologiques hrites, une pense irrsistiblement conduite vers la
racine de ses propres prjugs mtaphysiques.
Le clbre problme difficile de lorigine de la conscience , formul
de manire plus frappante que jamais par Chalmers, apparat, du coup, non
pas rsolu mais mis en repos, dissip
73
. Dun point de vue
neurophnomnologique, en effet, la question de lorigine physico-
physiologique de la conscience na mme pas lieu dtre souleve, parce
quelle suppose quon ait auparavant attribu un statut dtant fondamental au
domaine physico-physiologique alors que celui-ci reprsente seulement un
moment dans la dialectique du subjectif et de lobjectif, de lexprience vcue
et de ses contenus stabiliss. Cela semble simple, vident, presque trop
vident. Et pourtant, la dissolution mthodologique du problme de la
conscience propose par Varela reste mal comprise. Bien des spcialistes de
neurosciences cognitives la tiennent pour une simple chappatoire, de la
mme manire sans doute quils prendraient la rfrence de Descartes
lexprience immdiate de lunion de lme et du corps pour une drobade.
Cest que le mouvement amorc par Varela est doublement rvolutionnaire, et
doublement en avance sur son temps. Dune part, Varela esquisse une
conception profondment nouvelle de la science. Il tend la science non
seulement dans sa circonscription dobjets, comme Chalmers, mais dans sa
dfinition mme, puisquil la conduit englober les rgles dauto-ralisation
et de communication des points de vue des sujets. Dautre part, le va-et-vient
permanent entre rapports en premire personne et descriptions en troisime
personne, dont Varela fait le principe mme de sa mthode, est difficilement
accessible partir de nimporte quel tat de conscience. Ltat de conscience
dominant et valoris par notre civilisation, savoir lattitude transitive, ne
peut favoriser quune vision dsquilibre de la circulation neuro-
phnomnologique : une vision biaise selon laquelle lapproche en premire
personne nest quune expression dgrade de ce qui se passe en ralit
dans le cortex crbral, et na dintrt que comme matriau parmi dautres
pour la reconstruction htrophnomnologique
74
de ltat mental dun
tre humain tudi partir dune position extrieure. Cest seulement dans un
tat de conscience amplifi, assoupli, agrandi, comme celui de Francisco
Varela lui-mme, que les deux orientations posturales, transitive et
intransitive, vivent en symbiose et offrent de ce fait une perception quitable
de la premire et de la troisime personnes. Cest donc sans doute seulement
dans un tat de conscience semblable celui de ce penseur capable dassumer
en mme temps ses trois rles complmentaires de chercheur scientifique, de
philosophe, et de matre de mditation, que la disparition du problme de la
conscience dans le jeu des pratiques neurophnomnologiques va de soi.
charge pour chacun dentre nous de faire craquer la camisole troite dune
argumentation conduite sous le prsuppos de l attitude naturelle , et de se
mettre en mesure de rejoindre la sphre dexistence en expansion dont
tmoigne la quitude varlienne face au problme (prtendument) difficile
de la conscience.
Aprs avoir mis au jour les tats de conscience qui sous-tendent les deux
doctrines officiellement en lice de la philosophie contemporaine de la
conscience, le monisme physicaliste et le dualisme, nous allons prsent nous
intresser lassise vcue de la thse fortement dissidente quest le
panpsychisme. La ncessit de cette recherche renouvele dun soubassement
existentiel en-de des arguments discursifs est peut-tre encore plus grande
dans ce cas que dans les prcdents, parce que lopposition majoritaire
laquelle se heurtent les thses dallure panpsychiste est rarement mieux
motive que par des dclarations dincrdulit ou par des raffirmations du
consensus civilisationnel. Le panpsychisme, crit ainsi Peter Simons en
rponse Galen Strawson qui le dfend, est lune des positions
mtaphysiques les plus contrintuitives et les plus repoussantes
75
.
Repoussant est le qualificatif qui convient le mieux pour dcrire le
sentiment qui saisit de nombreux chercheurs lvocation du panpsychisme,
parce quil ne sagit prcisment que dun sentiment phobique partag et non
pas dune certitude rationnellement justifie. Un grand penseur panpsychiste
d u XIX
e
sicle, Gustav Fechner
76
, a eu beau souligner que linfrence qui
conclut la sensibilit prouve des vers de terre et des plantes (voire dtres
encore plus lmentaires) nest gure plus infonde que celle qui conclut la
conscience de nos alter-ego humains, rien ny a fait. Le panpsychisme reste
souvent peru comme une monstruosit archaque de la pense, un rsidu de
notre pass animiste ou des penchants magiques de cultures dont nous nous
sommes, croyons-nous, dfinitivement loigns
77
.
Conformment aux remarques qui viennent dtre avances, lhypothse
sous laquelle nous allons travailler est que la rpulsion ressentie vis--vis de
la constellation doctrinale panpsychiste nest pas dordre intellectuel, mais
implique une dcision collective (videmment tacite) dtre-au-monde, situe
dans lhistoire. Le risque de cette hypothse est quelle nous engage
remonter la pente chronologique des mutations existentielles, alors quil est
possible que la piste dun tel retour soit coupe, et que dans ce cas nous
devions nous contenter dexaminer nos traditions teintes partir dune pure
extriorit palontologique. Pouvons-nous donc retrouver, non pas seulement
la trace fane, mais aussi la saveur et la voie daccs ltre-au-monde
panpsychiste ? Pouvons-nous bon droit engager cette qute archophanique
alors quelle est peine formulable dans notre propre contexte mental et
culturel ? La rponse cette question semble la rflexion positive. Nous
pouvons tracer une piste vers cet tre-au-monde alternatif en recoupant trois
types de donnes : les donnes anthropologiques qui sont certes dsengages,
mais qui contiennent, par le biais des contes ou des mythes, une marque lisible
des attitudes alternatives quil sagit de faire revivre ; les donnes historiques
concernant des poques juste antrieures lge classique, qui laissent voir
une synergie entre une pistmologie participative et le paradigme
panpsychiste ; enfin, et surtout, les tmoignages dauteurs rcents qui ont
ressaisi avec un certain sens de lmerveillement ce que cest dtre un
homme pr-moderne.
Que faut-il donc tre pour raliser, et pas seulement pour affirmer
analogiquement, que : Chaque montagne est une personne. Les cours deau
sont leurs veines et leurs artres. Leau en eux est leur vie, comme notre sang
lgard de nos corps
78
? Ou bien encore que Tout dans linfini dit
quelque chose quelquun
79
? Le tmoignage des peuples premiers
tradition chamanique
80
, et des hommes contemporains qui ont tent de se
rinscrire dans leurs pas, est pratiquement unanime : ce quil faut commencer
par tablir, cest le silence, un silence creus patiemment dans les frondaisons
de nos penses jusqu mnager un espace libre o fassent cho les sonorits
mconnues des failles minrales clatant sous le gel, les froissements du vent
en fort, et les grondements aux pieds rocheux des cascades. Le chaman
aime le silence, lenveloppant autour de lui comme une cape un fort
silence dont la voix est semblable au tonnerre [] Il parle aux plantes et elles
lui rpondent
81
. Ainsi, cest en parcourant silencieusement les dserts et les
flots, en arpentant pas feutrs leurs sentiers ou leurs courants durant des
semaines, en sy laissant guider par de taciturnes claireurs du Mexique et
dailleurs, quune anthropologue contemporaine, Joan Halifax, dclare avoir
vcu la synchronie des tincelles du feu avec son propre systme nerveux,
stre sentie devenir une tendue bleue brillante en continuit avec la Terre-
ocan, avoir appris dialoguer avec les pierres, et chanter avec les
baleines
82
.
De quel silence prcis a-t-on besoin, pour sinscrire dans la mutation
dtre panpsychiste ? En quoi se distingue-t-il du repos de lesprit par
lequel Descartes accde la dimension phnomnologique de lexprience
pure ? Comment faire la diffrence entre le silence qui accueille le fait du
vcu, et le silence qui laisse murmurer le foisonnement complice des vies du
monde manifest ? Les deux silences se distinguent par les usages varis
quils font de la sensibilit. La sensibilit du philosophe franais qui
senferme dans un pole est replie dessein pour la mettre lcoute de
la prsence la plus diaphane qui soit : celle de ltre-prsent lui-mme. Mais
la sensibilit de lapprenti-chaman
83
rayonne fleur de peau, doue,
dodorat ; elle y frmit en poussant des antennes vers chaque asprit de ce
qui se montre. Ne se comprenant pas encore comme une proprit de
linterface entre soi et le monde, elle offre loccasion presque inaperue dune
dchirure de cette cloison, dune compntration rciproque des choses et de
soi dans une exprience a-personnelle. La sensibilit soublie elle-mme
force dtre exacerbe ; elle se fait vhicule dun panchement de ltre dans
la grandeur de ce quil rencontre, et dun dferlement en retour de laltrit
sentie dans son identit sensible. La sensibilit nest plus dmembrement du
monde le long de ses contours saisissables, mais flot de coappartenance qui
inonde les tissus, les personnes, et les paysages jusqu les dissoudre en un
seul lment au sein duquel schangent interrogations muettes et visions
ouvertes
84
. Le ciel, la terre, les animaux et les plantes ne se donnent plus
comme autant de choses distinctes, mais comme les fibres palpitantes dune
seule chair
85
qui tend sans limite nette celle du corps sentant. Dans notre
tre-au-monde contemporain ordinaire, seule lempathie entre deux personnes
retient en elle une rumeur assourdie de cette immensit rsonante capable de
nouer lhumain lenvironnement non humain qui le cerne. Peut-tre alors en
avons-nous la nostalgie, ainsi que le suggrent quelques scnes du film
Avatar
86
, qui vulgarisent la possibilit rve de revenir un tre--la-nature
symbiotique, quitte lexiler sur une autre plante. Mais cette aspiration
savre compltement coupe de sa source, incapable de sexprimer autrement
quavec linsigne maladresse dun bricolage intellectuel. Elle sous-entend en
effet que lunion des extra-terrestres sauvages avec la biosphre de leur
propre Ga a a besoin de la mdiation dun rseau neuronal tendu,
transindividuel, afin de saccomplir. Pourtant, aucun cblage nest ncessaire
pour nous faire participer au nexus naturel ; lattention exquise au sentir, et le
long abandon silencieux ses effleurements, suffisent. Cest ce que nous
avons demi-oubli, mais que savaient encore les promeneurs solitaires du
XVIII
e
sicle, au nom desquels tmoigne Chateaubriand : Aprs le souper,
crit-il, je me suis assis lcart sur la rive ; on nentendait que le bruit du
flux et du reflux du lac, prolong le long des grves ; des mouches luisantes
brillaient dans lombre et sclipsaient lorsquelles passaient sous les rayons
de la lune. Je suis tomb dans cette espce de rverie connue de tous les
voyageurs : nul souvenir distinct de moi ne me restait ; je me sentais vivre
comme partie du grand tout et vgter avec les arbres et les fleurs. Cest peut-
tre la disposition la plus douce pour lhomme, car, alors mme quil est
heureux, il y a dans ses plaisirs un certain fonds damertume, un je ne sais
quoi quon pourrait appeler la tristesse du bonheur. La rverie du voyageur est
une sorte de plnitude de cur et de vide de tte qui vous laisse jouir en repos
de votre existence
87
. La dissolution du moi , la suspension de la pense,
lextase dans ce qui se donne la prsence, et finalement le bonheur dnu de
contenu, loin dtre des tats exotiques rservs des extra-terrestres aux
neurones interconnects, sont autant de fruits simples dune coute sensible
soutenue.
Une telle combinaison de silence et dhyperesthsie est ltat de
conscience le plus propre sous-tendre les doctrines panpsychistes travers
les ges. On identifie dj cette affinit entre attitude pistmologique et thse
mtaphysique chez de nombreux penseurs renaissants, qui dfendaient lide
dune animation universelle en lappuyant sur une approche exclusivement
sensualiste de la physis
88
, et qui valorisaient une forme fusionnelle plutt que
distanciatrice de la connaissance de la nature. On en observe aussi la
rsurgence, de manire peut-tre plus audible pour nous parce que marque
par la familiarit avec la science moderne, chez le fondateur de la
psychophysique quest Gustav Fechner. Car la thse fechnerienne de
lintriorit consciente des plantes, exprime dans un livre ayant pour titre le
nom de la desse scandinave de la vgtation
89
, nest pas quune aventureuse
construction abstraite. Elle est ne dune exprience trs singulire, qui sest
manifeste au sortir dune longue maladie faute dtre invite par une
valorisation culturelle dsormais absente. Entre 1840 et 1843, Fechner a
souffert danorexie et de photophobie, ce qui la contraint rester inactif dans
une pice obscure (le silence). Puis, stant progressivement rduqu
supporter la lumire, il est sorti un jour dans son jardin et a t fascin par
lclat color des feuilles et des fleurs avec lesquelles il lui semblait
entretenir un profond courant de sympathie
90
. Sa sensibilit tait comme
vierge, son esprit comme purifi, et il savourait limpression dtre travers
par dautres vies, en tat de connivence avec elles : on imagine peine le
degr de nouveaut et de vivacit dune nature qui rencontre lhomme venu
lui-mme la rencontrer avec des yeux nouveaux
91
. Cest dans cet tat, et de
cet tat de conscience, quest n le projet philosophique de chercher les
critres organisationnels de lintriorit vcue, et den supposer la ralisation
accomplie partout dans lunivers
92
. Cest de lui galement quest venue la
puissante motivation de la psychophysique quantitative
93
, qui, par-del son
usage scientifique, avait pour but avou de dmontrer que la psych nest au
fond que lautre face de la physis (au moins chez les tres organiss et
homostatiques, ou tres vivants).
Chez tous les auteurs cits, le signe le plus profond de cette mutation
sensible de la conscience est sans doute la rversibilit du regard, ce quon
pourrait appeler en dautres termes un chiasme visuel. Si dsormais la
sensibilit ne se rduit plus informer le sujet sur ce qui se passe dans un
milieu spar de lui, et si elle parvient au lieu de cela transfixer la frontire
entre eux, alors se fait jour une entire rciprocit des rles entre le regard et
le regardant. La question relle et vitale, crit Fechner, nest pas de savoir
si le monde a un esprit que nous sommes seuls connatre, mais sil sagit
dun esprit qui nous connat
94
. Cette phrase traduit certes, au premier
examen, une pense dbride sur lme du monde, mais elle peut aussi tre lue
comme lexpression spculative dune exprience la fois plus modeste et
plus bouleversante : celle de se sentir scrut, pi, possd par tout ce qui se
prsente lentour. La vraie diffrence entre la connaissance exprimentale
scientifique et la co-naissance sensible de type chamanique rside sans doute
dans leurs directionnalits : sens unique pour des sciences pleines de
lautorit du juge kantien sommant la nature de rpondre aux seules questions
qui lui sont poses ; double sens pour des disciplines dcoute profonde
dont ceux qui les pratiquent acceptent de se faire les lves dune nature la
fois insoumise et indistincte. Un chercheur ne se reconnat pas regard par son
objet
95
(sil le faut, il vitera son regard
96
), tandis quun apprenti chaman peut
se laisser boire par la prunelle de son vis--vis. Le cur battant de
lintersubjectivit tel que la identifi Sartre
97
, cette capacit de se savoir vu
par lautre autant quon le voit, de percevoir lautre percevant autant que
peru, est ici tendu bien au-del de lespce humaine. Une troupe danimaux,
un sous-bois odorant, un vent sifflant, un ruissellement argent peuvent tre
perus percevants, jusquau point de vertige o les rles basculent et o la
question qui ? (qui est moi, qui est lautre) se dissout dans une danse sans
limites. Illustrant la rciprocit par le rcit de sa rencontre avec un bison,
David Abram crit : Nos yeux se sont verrouills lun lautre. Lorsquil a
grogn, jai grogn en retour ; lorsquil a dplac ses paules, jai dplac ma
posture ; lorsque jai remu ma tte, il a remu sa tte en rponse. Je me suis
trouv pris dans une conversation non verbale avec cet autre
98
. Il serait vain
de vouloir entirement arraisonner laccord des gestes et des postures en
lexpliquant par le contrle quexercent des neurones-miroirs sur les
mouvements de deux corps-objets, comme si lon ne savait pas que le sens de
ces actes se joue dans la chair de corps-propres qui se vivent alors comme
nen formant plus quun, et comme si lon avait oubli que la connivence
sensible peut parfois stendre jusqu des tres dnus de systme nerveux.
Non seulement connatre cette explication purement objectivante ne suffit pas
sinscrire dans une relation rciproque, mais cela relve dun tat de
conscience qui a pour premier effet dinhiber lextension de lempathie au-
del de notre espce
99
. Si jexplique, je ne suis plus ce que jai expliquer,
je me coupe de lopportunit prsente de le vivre, et je labolis de ce fait
puisquil nest autre quun vcu. Si je retrouve mes habitudes urbaines et les
prjugs civilisationnels qui vont avec, si je sais nouveau que je suis sujet et
que lautre est objet danalyse conceptuelle, mon aptitude la communication
inter-espces disparat. Mes yeux se dtournent ; mes mouvements ne sont plus
harmonieux ; les feuilles de saule couvertes de scintillements de rose ne
rsonnent plus au frlement de mon regard (re)devenu simple ligne droite
unissant un rcepteur photosensible un metteur de photons ; je ne suis plus
pris dans la conversation non verbale avec le bison, mais seulement
observateur dun comportement animal.
Il ne sagit pas de critiquer par l lapproche objectivante et rationnelle,
et encore moins den contester lefficience, mais simplement de montrer en
quoi elle nest pas universelle. Cela semble paradoxal, parce quobjectiver
revient accder une position abstraite permettant duniversaliser les
jugements. Mais le paradoxe est lev ds quon saperoit que la
prsupposition vcue de ce mode duniversalisation nest pas, pour sa part,
universelle ; que la manire dtre du juge nest pas la seule possible ; que la
position daccueil, ou la perte de positionnement qui en dcoule, est
galement disponible ; et quen cette approche de lacceptation ouverte, le
pouvoir mme de juger apparat tranger. En bref, lactivit de constitution
dobjectivit nest universalisante que sous son propre prsuppos de
dsincarnation ; elle nest pas existentiellement universelle pour des tres
incarns. Ce trac des limites dans le continuum des attitudes mnage un
espace pour une conception franchement dissidente comme le panpsychisme,
qui ne sentend pleinement que sous un rgime autre que celui du jugement,
dans un tat de conscience participatif essentiellement incompatible avec
ltat de conscience distanciateur que demanderait sa justification
argumentative. Que le panpsychisme dpende de ce mode dtre alternatif, de
cet tat de conscience distinct, ne devrait pas lui tre imput charge. Car
laccuser dune telle dficience reviendrait perdre de vue le caractre
de norme culturelle de ltat de conscience objectivant, et riger cet tat en
absolu partir de lui-mme.
La seule vraie faiblesse du panpsychisme lui est interne. Elle consiste,
comme cela a dj t reproch aux monismes neutres et aux thories du
double aspect, ne pas savoir aller jusquau bout de sa diffrence et
emprunter quelques-uns de ses moyens dexpression luniversalit
concurrente de lobjectivisme. Comme ces deux positions, le panpsychisme
manque de lucidit sur son propre statut, qui est postural plutt que doctrinal.
Il se cherche alors une formulation faussement discursive, difie sur le
modle inappropri des thses, infrences et jugements, par-del les procs
verbaux exprientiels dintimit aux tres et aux choses qui seraient seuls
lgitimes de son point de vue. Comme les monismes neutres et les thories du
double aspect, galement, le panpsychisme se rsout en un itinraire original
vers la rduction phnomnologique, cest--dire en autre chose que lui-
mme, ds quil cherche aller jusquau bout de ses propres consquences.
Cela ressort nettement de la dmarche de Fechner, comme auparavant de
celles de Ruyer et Velmans. Fechner brosse un portrait plus ou moins
monadologique de lunivers, en lui attribuant une me du monde
omnienglobante et omniprsente, et en le peuplant dune multiplicit dmes
(ou dintriorits conscientes) individuelles qui en sont des points de vue
partiels. Tandis que lme du monde est entirement auto-accessible, crit-il,
les mes individuelles restent inaccessibles les unes aux autres (dans leur
intriorit) en raison de lexclusivit mutuelle de leurs perspectives
100
. Dans
son cadre de pense, comme dans celui des thodices de Leibniz et de
Malebranche, il est bien sr impratif de confrer aux corps matriels un
statut compatible avec la thse de lanimation cosmique. Ces corps, selon
Fechner, ne sauraient reprsenter que laspect extrieur que prsentent des
monades (ou mes, ou esprits) pour dautres monades quelles-mmes ; ils
sont considrs comme la face visible des monades, manifeste dans la face
invisible mais voyante de chaque autre monade. Mais sil en va ainsi, la
monade ultime quest lme du monde doit se voir attribuer des
caractristiques qui la distinguent radicalement des monades partielles. La
monade des monades tant proprement parler tout, et incluant tout le reste, il
ny a aucune autre monade qui puisse lenvisager de lextrieur, et donc
aucune autre qui soit en mesure de la voir comme une chose totale. Tout au
plus les monades partielles en aperoivent-elles une facette limite, sous la
forme de lapparence matrielle des autres monades partielles qui la
composent. La consquence de cette image de lunivers commence par tre
inexorablement idaliste, avant de se rsorber dans lvidence
phnomnologique. Les monades partielles ntant quun fragment de lme du
monde, et lme du monde nayant pas dextrieur, il ny a dautre ralit que
le creux voyant de lme du monde, ses dclinaisons limites dans les mes
individuelles, et un apparatre corporel morcel pour chacune de ces mes
(cest--dire en fin de compte pour les dclinaisons de lme totale qui les
enveloppe). Les corps matriels ne sont compris ici que comme autant de
miettes de lauto-apparatre de lme du monde, ou plus exactement du monde
en tant qume. De la construction grandiose et spculative du panpsychisme,
il ne reste alors plus que son point de dpart, envisag dans un tat de
conscience qui lui est propre : le constat dtre-au-monde, au centre apparent
dun environnement rsonant, complice, charg de regards croiss qui
expriment luniversalit de lexprience sensible ; un constat prouv
tellement premier et tellement clatant dvidence quil sest vu investi, dans
un lan dexaltation nave, de tout le poids ontologique du monde sous ce nom
dme omnienglobante. Comme dans bien dautres cas, laboutissement
idaliste de la doctrine semble tre lhypostase et lhyperbole de son
initiation phnomnologique.
On comprend aisment que la ralisation de notre propre condition
dexistant puisse subir cette expansion cosmique, si lon suit pas pas le
dveloppement spontan du vcu panpsychiste. linstar du phnomnologue
et du philosophe dualiste en leurs premiers aperus, le penseur panpsychiste
se dcouvre situ dans un monde en tant que faisant lexprience de ce monde.
Comme eux galement, il tend identifier comme sa propre chair les
ramifications de lprouv dans un espace qui est une forme de sa sensibilit.
Sil veut prsent assumer toute la spcificit de sa position, il doit dcider
de ne pas sarrter un point prcis de ce processus, de ne pas borner sa
perception du charnel lenveloppe cutane, de ne pas identifier son seul
corps propre comme sensible, vivant, et pensant. Ce point darrt nayant pas
t reconnu, ce rtrcissement de laire spatiale du vcu nayant pas t opr,
la chair dpreuve ayant t tendue tout ce qui bruisse, remue, change, ou
simplement se prsente, le lieu du sensible ne saurait envelopper rien de
moins que lentiret de lunivers senti. Ce nest plus seulement moi (ego) qui
me dcouvre comme cogito au sens o lentend Descartes, mais cest
lunivers qui, travers lopercule du moi, sauto-rvle comme exprience
pure.
Un mme germe phnomnologique apparat en dfinitive commun toutes
les doctrines de la conscience (comment en irait-il autrement, puisque notre
tre-jet-vivant-et-prouvant-dans-un-monde est un patrimoine originairement
partag ?). Mais ce germe amorce diffremment son cristal mtaphysique
selon le degr de contrle quexercent les disciplines ducatives et culturelles
sur les tats de conscience. Contraint au plus haut point, confin quelque
origine abstraite des coordonnes exprientielles, le sujet physicaliste laisse
toute la place au droulement de sa lgalit objectivante, et il saline lui-
mme jusqu ne plus pouvoir se comprendre que comme lpiphnomne
dun objet parmi dautres. Suffisamment contrle pour ne pas empcher le
dveloppement des sciences, mais restant constamment prsente soi, la
conscience moderne reprsente par Descartes se thmatise sur le mode
dualiste. Levant un grand nombre de contrles hrits des premiers pas de la
science moderne, se rpandant nouveau dans un style chamanique sur les
ravines de la Terre ou les efflorescences de latmosphre, mais revendiquant
pour elle la possibilit dune formulation discursive vaguement analogue
celles de la science, la conscience romantique ou ractionnelle post-moderne
sexpose sous forme de doctrine panpsychiste. Pour ne tomber dans aucun de
ces biais doctrinaux successifs, il suffit alors de ne plus ignorer le pr-
conditionnement quexerce chaque mode dtre sur eux, puis de circuler entre
plusieurs modes dtre sans sarrter une doctrine. Les thses physicaliste,
moniste neutre, dualiste, panpsychiste, etc., qui reviennent figer en formules
statiques des stratgies anciennes de recherche de coexistence (ou de
dominance) entre les enseignements de plusieurs tats de conscience, se
dissolvent delles-mmes ds quune mobilit satisfaisante entre ces tats a
t instaure.
QUESTION 8
Quest-ce que a (ne) fait (pas) dtre
un Zombie ?
La libert ne signifie pas moins quune rsurrection
dentre les morts ces morts que nous sommes toujours, du
point de vue de Fichte, tant que, possds par lclat de
ltre objectif et indpendant qui se trouve devant nous,
nous menons notre existence dans lidoltrie de la ralit
extrieure.
P. Sloterdijk
tant donn le (non-) objet dsormais avr du dbat sur la conscience,
chaque argumentation son propos est claire dune lumire insolite. On ne
peut pas viter de se heurter phrase aprs phrase, dduction aprs dduction,
son point aveugle reconnu, qui est celui du concret, du situ, de lunique, du
non conceptuel, et de sentir que cette carence devenue visible ne saurait jouer
que le premier rle dialectique. Lenqute philosophique doit se voir confrer
dans ces conditions la mission de pivoter sur elle-mme afin de circonscrire
le hiatus constitutif de son propre dveloppement rationnel. Son but nest pas
de regarder dans le sens indiqu par le travail de vise et dinfrence, qui ne
peut de toute manire que lloigner de son (non-) objet en la condamnant la
plus volontaire des ccits, mais den surveiller les marges, les silences, les
arrire-gardes oublies.
Rexaminons dans cet esprit le dbat de la philosophie analytique
contemporaine sur le statut de lexprience consciente, avec son jeu de heurts
rgls entre positions standardises. Nous savons que rduire, faire merger,
identifier, ou liminer les concepts mentaux, en affirmant la primaut des
concepts physiques, est le projet multiforme du physicalisme. Les dualistes,
de leur ct, veulent montrer linanit de ce projet en dveloppant une batterie
de raisonnements par labsurde que nous allons discuter dans cette section.
Afin de percevoir les silences et les marges de ce type de raisonnement, il faut
commencer par rappeler deux malentendus courants qui rendent le dialogue
difficile entre les protagonistes du dbat canonique, et qui les font souvent
tomber dans les mmes ornires alors quils se veulent opposs.
Il y a dabord le malentendu que produit lambivalence contemporaine du
vocabulaire mentaliste. Lorsquon parle dintention, de perception, de
raisonnement, voire de processus mental en gnral, on peut donner deux
ordres de significations bien diffrents ces mots. On peut leur prter la
signification quils ont dans le langage ordinaire, savoir celle de procdures
vcues et parfois dcides par le sujet. Ou bien on peut leur donner la
signification thorique quils ont acquise dans les sciences cognitives,
savoir celle de processus souvent inconscients
1
et dont la dfinition est en
tout cas indpendante de lexprience consciente quon peut en avoir. Rduire
ou identifier le mental au physique na pas du tout les mmes consquences
selon quon a retenu le sens ordinaire ou le sens thorique-cognitif de
ladjectif mental . Dans un cas, la rduction ou lidentification doivent
indissolublement concerner lexprience consciente (ou conscience
phnomnale ), alors que dans lautre cas cela na rien de ncessaire. On
souponne alors que loption dune signification purement thorique et
cognitive du vocabulaire mentaliste est choisie dans le but de simplifier le
problme de la rduction ou de lidentification au physique, de lallger
dentre de jeu de ce quil a de plus sauvagement insaisissable pour la langue,
la pense et lexprimentation.
Il y a ensuite un malentendu gnral concernant ltre-situ des sujets
conscients. Les dualistes cherchent rifier cet tre-situ (en proprits ou en
substance), tandis que les physicalistes le minimisent dessein, en affirmant
quil ne fait que traduire de manire contingente une prise de position
particulire lintrieur dun monde de substances et de proprits objectives
conforme leur reprsentation. Mais les dualistes ne peuvent pas dire ce qui
les autorise dtacher les proprits ou les substances psychiques de la
situation qui les actualise, et les physicalistes se montrent incapables
dindiquer en quoi le simple fait dadopter une position (corporelle) dans un
environnement de proprits et de substances physiques aboutit se vivre
comme tre-situ-incarn. Telle est la lacune que partagent les thses dualiste
et physicaliste : leur incapacit saisir la singularit de ltre-situ, et leur
tendance projeter la situation en objet (que celui-ci soit psychique ou
physique). Dualistes et physicalistes se trouvent conjointement condamns
maintenir cette lacune et ne pas la voir, pour la simple raison quils ont fini
par saccorder (aprs la phase inaugurale de lucidit phnomnologique
reprsente par Descartes) sur la prsupposition suivant laquelle toute
recherche doit tre conduite dans le seul tat de conscience intentionnel-
naturaliste.
Or, le fait que ltre-situ soit rifi ou minimis par les protagonistes du
dbat sur la conscience a une consquence curieuse, que lon pourrait
qualifier de grand retour du refoul . Cette consquence, cest lusage
frquent dexpriences de pense mettant en scne des situations
dincarnation ; celles-l mmes quon prtend secondaires ou drives. Il est
vrai que cet usage des expriences de pense situantes est immdiatement
suivi dun travail de reconceptualisation qui a pour but de purifier
lintelligence universaliste de son bref contact avec la dimension pr-
thorique et singulire de son problme ; mais il est alors trop tard pour
revenir en arrire. Un chemin vers une autre posture, vers un tat de
conscience scartant de lattitude naturelle , a t involontairement trac
par lexercice mental dinsertion dans la peau dun sujet (ft-il imaginaire), et
cela suffit dissoudre les arguments abstraits les mieux affts, les rendre
inoprants parce que dplacs.
Rappelons que toute exprience de pense
2
, quelle soit utilise dans les
fondements des sciences ou dans lenqute philosophique, a pour fonction
dinstaurer une scne particulire sur laquelle des prconceptions ou des
thories gnrales se trouvent mises au dfi. Cette configuration particulire
peut parfois rester semi-abstraite et semi-distancie, comme dans lexprience
de pense du microscope de Heisenberg. Ici, en effet, on dcrit lobservation
dun lectron au moyen dun photon qui rebondit sur lui avant dtre recueilli
par un microscope, en adoptant tacitement le point de vue dune contemplation
extrieure du processus, plutt que celui dun regard coll lobjectif du
microscope. Mais lexprience de pense peut aussi tre minemment
concrte et engage, au sens o elle demande explicitement ceux qui en
prennent connaissance de sintroduire eux-mmes, par limagination, en un
lieu prcis du cadre instaur par la thorie ou la prconception teste. Cest le
cas, par exemple, de lexprience de lascenseur en chute libre dEinstein,
dans lequel nous sommes invits nous installer et y ressentir lapesanteur ;
ou encore de lexprience du chat de Schrdinger
3
, dont le dispositif
rhtorique aboutit nous, qui ouvrons la bote o il est enferm, et qui
constatons ( bien entendu ) que le chat est soit vivant soit mort mais pas les
deux la fois. La stratgie qui consiste abstraire de nouveau, aprs une telle
incursion provisoire dans le concret, est galement bien connue. Lexprience
de pense, une fois dcrite, est destine aboutir une conclusion thorique
valant pour toute exprience situe du mme type, et sautorisant ds lors
faire abstraction de la catgorie mme de situation. Lexprience du
microscope produit une dmonstration semi-classique des relations
d incertitude de Heisenberg, lexprience de lascenseur taye le principe
dquivalence entre masse inerte et masse pesante quEinstein emprunte
Mach, et lexprience du chat de Schrdinger se traduit par un nonc
gnrique du problme de la mesure de la mcanique quantique. Mais le
dtour par un lieu particulier dincarnation a suffi rappeler lvidence : la
thorie nest autre que linvariant pens dun faisceau rgl de variations
agies puis prouves.
Dans le dbat moderne en philosophie de lesprit, le passage rebours du
concret labstrait se manifeste ds son exprience de pense archtypale :
celle du doute hyperbolique cartsien. Cet acte de douter, on na cess de le
voir, est le motif mme de la dcouverte de soi du je doutant. Le doute
extrme aboutit une certitude dautant plus concentre quelle concide avec
lui-se-ralisant ; une certitude qui se confond avec lacte de la vivre
linstant o elle est manifeste : Il faut finalement poser que cet nonc, je
suis, jexiste, moi, toutes les fois que je le prononce ou que je le conois
mentalement, est ncessairement vrai
4
. Cependant, juste aprs son
ravissement dauto-concidence, ltre-situ cherche sortir de lui-mme pour
sassigner un statut dans sa propre reprsentation ; il sinquite dune certitude
qui ne le pose pas encore comme tant spcifi, mais comme (je) suis la
fois centr et sans bornes : Je ne connais pas encore dune intellection
suffisante ce quest ce moi, ce que je suis, moi qui prsent de toute ncessit
suis
5
. Ltre-situ a besoin de se ressaisir en tant qu entit au moyen de son
propre intellect, qui le localisera dans un systme de coordonnes
conceptuelles plutt que de le laisser flotter dans la plnitude indtermine de
lvidence ; et cest ce ressaisissement qui sexprime comme transfiguration
de la premire personne l (je suis) en une troisime personne acentre (le
moi est cela). Procdant par limination, mettant progressivement lcart
des secteurs entiers de la grille de lecture pose par son intelligence, niant
quil soit animal, corps, ou organe, ltre-situ va rflchir sur lacte qui la
conduit sa certitude et projeter sa rflexion devant lui la manire dune
chose pensante qui sajoute aux choses
6
. Origine des vises de choses
comme des doutes sur lexistence intrinsque des choses, le cogito a
finalement t lui-mme rifi titre de remde un reste d anxit
cartsienne
7
. Mais ici encore, le basculement germinal en-de des points
dappui solides de la vue et du toucher, vers ltre-voyant-touchant, a laiss
des traces indlbiles dont lhistoire ultrieure de la philosophie na plus
cess de faire revivre le motif.
Toutes les expriences de pense contemporaines de philosophie de
lesprit, que nous allons prsent discuter, se sont vu imposer la mme rgle
de passage clandestin entre situation et ontologie ; et elles offrent de ce fait la
mme occasion de discerner rtroactivement le situ sous le masque de
lentit. Chez les no-dualistes, la situation est contracte en proprits
psychiques/exprientielles ; chez les physicalistes, elle est particularise en
position dun corps humain dans un environnement matriel ; et chez des
perspectivistes consquents comme Thomas Nagel
8
, elle se trouve abstraite et
spatialise en tant que simple point de vue . Il sagira donc, en suivant les
plis des exposs et des discussions autour de trois expriences de pense
majeures, didentifier le moment du passage, le moment du basculement
projectif vers une ontologie fantasmagorique ou banale, avant quil ne nous ait
malencontreusement entran ignorer leur invitable point de dpart situ.
Les trois expriences de pense scruter sont : largument du zombie ;
largument du ce que cela fait dtre ( what it is like to be ) ; et
largument de la connaissance (du contenu sensible), ou argument de Mary,
ou argument de Franck Jackson.
La figure paradoxale du zombie sous-tend lun des arguments majeurs du
no-dualisme des proprits dfendu par David Chalmers
9
. Cet argument
repose sur la possibilit de concevoir quun tre justifiant la mme
description scientifique que le ntre, obissant aux mmes lois physiques que
le ntre, et se comportant exactement de la mme faon que nous en toutes
circonstances, soit nanmoins priv dexprience consciente. Le simple fait
que cela demeure concevable montre que lassociation des proprits
exprientielles aux proprits physiques na rien de ncessaire, et par
consquent, ajoute Chalmers, que les proprits exprientielles doivent
tre conues comme distinctes des proprits physiques. Aprs tout, il ny a
rien dans les sciences, et dans la physique en particulier, qui rende impossible
un tel tre-sosie pour qui tout est obscur lintrieur
10
; un tre apte
nous singer jusquaux moindres dtails, mais chez qui le fonctionnement
mental nest jamais clair par le faisceau lumineux de la conscience
(pour poursuivre la mtaphore en linversant). Cest ce genre de contrepartie
inconsciente de nous-mmes que Chalmers appelle un zombie . Le terme,
issu des cultes du vaudou des Carabes, a t trs galvaud par des mythes
populaires occidentaux, et il a fini par dsigner, dans lunivers des films
fantastiques ou des films dhorreur
11
, une sorte de mort-vivant certes dot
de mouvements (gnralement ralentis), mais priv dme.
La raison du succs de cette tonnante crature que reprsente le zombie
philosophique est quil ne fait au fond quentriner deux tournants dsormais
familiers : lun est la priorit donne aux thories objectivantes de lesprit,
qui excluent par dfinition ce qui se vit subjectivement (si ce nest comme fait
additionnel, driv, secondaire), et lautre est un vocabulaire des sciences
cognitives qui entrine cette priorit en dfaisant systmatiquement le lien
entre la terminologie mentaliste et sa connotation courante, indissociable de
lexprience vcue des oprations mentales. Loin dtre un jeu gratuit de
limagination philosophique, lexprience de pense des zombies a limmense
mrite de dmasquer ce genre de jeu avec le vocabulaire cognitif, et de lui
viter de sinstitutionnaliser en une novlangue orwellienne interdisant par
construction de formuler en elle la seule question vraiment vertigineuse. En
tant que possibilit de la pense ou de limaginaire, nous verrons que le
zombie est critiquable, mais en tant quexpression dun trait distinctif des
thories cognitives, il simpose titre de corrlat invitable de leurs choix
initiaux.
Il est trs instructif de voir le jeu trouble des sciences cognitives sur leur
propre vocabulaire ressortir de manire frappante de la figure du zombie.
Dans sa discussion assez clbre de lallgorie, Todd Moody propose de
dupliquer les termes mentalistes afin de distinguer le cas o ils sont utiliss
dans le sens qui convient aux tres conscients que nous sommes, et le cas o
ils sont utiliss par des zombies
12
. La discrimination seffectue en ajoutant
tout simplement le suffixe (z) aux vocables mentalistes des zombies, mais pas
ceux quemploient des tres conscients. On distingue par exemple
comprendre et comprendre(z) , croyance et croyance(z) ,
penser et penser(z) , souvenir et souvenir(z) , etc. Chez le
zombie, une croyance(z) quivaudra une disposition agir (ou plutt
gesticuler) dune manire dtermine dans des circonstances spcifies ;
comprendre(z) reviendra acqurir un ensemble cohrent et adapt de telles
dispositions agir ; un souvenir(z) sera simplement une information stocke
(linformation tant prise ici au sens de Shannon
13
, qui exclut toute
considration sur qui en prend connaissance, elle peut elle-mme bon droit
tre dnote information[z]) ; et enfin penser(z) dsignera un processus de
traitement computationnel de linformation(z). prsent, si lon y rflchit un
peu dans le sillage des remarques faites plus haut, il apparat vident que le
vocabulaire suffixe (z) nest autre que le vocabulaire cognitif ltat nu ; il
est pur aveu symbolique de la vraie nature du langage cognitiviste. Le zombie
nest pas tant une crature exotique issue dun esprit philosophique amateur de
films dhorreur ou de folklore des Carabes quune expression peine outre
du prsuppos fondateur des sciences cognitives. Mais sil en va ainsi, la
proposition de D. Chalmers, qui consiste admettre lexistence de
proprits psychiques-exprientielles en plus des proprits physiques-
cognitives, napparat plus que comme une tentative de surcompenser
artificiellement et de manire extrinsque une lacune intrinsque laisse dans
son sillage par la dcision normative qui a prsid la naissance des sciences
cognitives (pour ne pas dire la naissance des sciences objectives dans leur
ensemble). Tout se passe comme si, afin de neutraliser la distorsion introduite
par lajout subreptice du suffixe (z) dans le vocabulaire mentaliste des
sciences cognitives, Chalmers navait pu envisager dautre solution que dy
ajouter encore un suffixe supplmentaire, disons (pc) pour psych-conscience.
Le dualisme ne rtablit artificiellement dans sa plnitude vcue la croyance(z)
des cognitivistes quen lui ajoutant une proprit psychique-exprientielle qui
la transforme en un composite encore plus saugrenu : la croyance(z)(pc). Le
ct factice, et en fin de compte peu lucide, du procd de compensation
dualiste saute aux yeux travers cette notation. Ce quil aurait fallu faire pour
surmonter la faille tacitement creuse ds la fondation des sciences cognitives
nest pas ajouter une trs fantomatique proprit conscience lesprit(z)
pour le transformer en esprit(z)(pc), mais lui retirer son suffixe privatif (z)
pour le restituer comme espri t : esprit dans la langue ordinaire
patrimoniale, et non plus dans la novlangue cognitiviste qui cherche faire
oublier ses distorsions en se donnant comme seul usage correct. Sil nest
gure question dans le dbat actuel daccomplir ce geste de rintgration de la
banalit lexicale, cest quil implique un autre retour autrement profond : un
renversement complet de la dmarche et de lchelle de priorits des
sciences. Entirement tendues vers le pro-grs objectivant, ce qui leur est
demand ici est de souvrir lventualit dun r-grs vers leur pr-
condition universelle quest lexprience vcue, par le biais de retrouvailles
avec un tissu langagier hrit ; un r-grs qui nest dailleurs que
mtaphorique, comme le progrs souhait, puisque les deux saccomplissent
identiquement dans une alternance damplification et de rtrcissement
intentionnel du champ dexprience pure.
Le renversement propos concerne bien, quoi quil en soit, toutes les
sciences, et pas seulement les sciences cognitives. Car, ainsi que nous lavons
vu au chapitre V, ce nest pas seulement comprendre , penser ,
croire qui se sont vu indment alourdir dun suffixe (z) par les sciences
cognitives, les privant de leur indniable connotation exprientielle ; mais
cest aussi mouvoir , chauffer , vivre qui ont t auparavant allgs
de leur teneur de phnomne dexprience par la mcanique, la
thermodynamique, et la biologie. Il est vrai que ces stratgies de
reconfiguration objectivante des concepts, et de redfinition subreptice des
termes, ont remarquablement russi dans les sciences de la nature ; mais il est
galement invitable quelles se heurtent un mur lextrmit exprientielle
de leur projet, puisque ce mur nest autre que leur propre condition, et que
lextrmit nest autre que leur source. Dans cette situation dsquilibre, qui
combine un formidable succs plantaire de la dmarche scientifique avec la
ralisation discrte de ses limites dans quelques cercles philosophiques, il
faut viter de prendre la russite visible pour une bonne raison de minimiser
lobstacle terminal ou de le tenir pour provisoire. rebours de la stratgie de
minimisation, il se pourrait bien en effet quun tel obstacle prfigure la
ncessit dune reconfiguration future de lintgralit de lentreprise
scientifique, afin de retrouver la pleine intelligibilit de notre situation dans le
monde
14
.
Nous sommes maintenant prts examiner quelques objections opposes
la possibilit des zombies philosophiques. La premire objection est que le
raisonnement qui lutilise enveloppe une sorte de ptition de principe. On ne
peut poser la possibilit des zombies, dnonce lobjection, que sous
lhypothse de l inessentialisme de la conscience
15
, cest--dire sous
lhypothse que lexprience consciente nest pas essentielle au
fonctionnement mental, neurologique, voire matriel, mais seulement
accidentelle. Lexprience de pense des zombies sest donn pour but
central dargumenter en faveur dune forme de dualisme, qui suppose
demble que lexprience consciente est un lment additionnel, une
proprit quon pourrait fort bien concevoir absente du monde. En voquant
les zombies, remarquent les objecteurs, on na donc fait que donner une
expression image au dualisme, et il ny a dans ces conditions rien dtonnant
que le raisonnement qui sappuie sur eux aboutisse une conclusion dualiste.
Que penser de cette objection ? Elle vaudrait sans doute si elle tait formule
hors contexte, et plus particulirement hors du contexte dun dbat qui inclut
les sciences cognitives comme protagoniste majeur. Mais pas lintrieur de
ce dbat. Car lhypothse dinessentialisme est en fait dj latente dans les
concepts des sciences cognitives, dont les dualistes cherchent maladroitement
surcorriger les biais ; et lobjection apparat du coup assez perverse de la
part dutilisateurs consentants du vocabulaire mentaliste pur quont impos
ces mmes sciences cognitives. Linessentialisme de lexprience consciente
(ou conscience phnomnale) imprgne les prsuppositions, le lexique,
leffort dfinitionnel tout entier du projet cognitiviste, malgr leffort que
certains chercheurs font pour le nier. Et le dualisme tente seulement de le
compenser aprs lavoir (malencontreusement) accept. Ds lors,
lexprience de pense des zombies pourrait bien valoir comme un puissant
argument ad hominem ; cest--dire comme une rduction labsurde de
loption fondatrice surobjectivante de limmense majorit des spcialistes de
sciences cognitives, y compris de ceux qui lui opposent le curieux reproche
dinessentialisme. Une fois cela admis, le dualisme des proprits de
Chalmers devrait se comprendre non pas comme une alternative valide la
thse de ces chercheurs en sciences cognitives, mais comme une tentative
astucieuse et assez russie de les confronter linanit de leur propre
position.
La seconde objection, sans doute appuye sur la premire, est que les
zombies, ces tres semblables nous hormis leur absence dexprience
consciente, ne sauraient se comporter exactement comme nous. Il existerait
selon elle une marque comportementale de zombitude . La clause
dindiscernabilit devenant ainsi caduque, la figure trange et paradoxale dun
tre parfaitement semblable nous dans sa physiologie et son thologie bien
que ne sapercevant pas de sa condition deviendrait impensable. Mais quelle
marque comportementale pourrait distinguer les zombies de nous-mmes ? Un
tel trait distinctif a t cherch (de manire rflexive) dans leur incapacit
se poser(z) certains problmes philosophiques
16
. On ne peut en effet pas
concevoir comment les zombies pourraient sinterroger(z) spontanment au
sujet de leurs rves, de leurs hallucinations, de la prsence ou non dune
exprience consciente chez autrui. On sattend donc ce que, dans une socit
de zombies, aucune littrature philosophique sur ces questions ne fasse jamais
son apparition. Il y a peut-tre un sens parler de croyance(z), mais pas de
rve(z) et encore moins dexprience(z). Est-ce cependant si vident que
cela ? Daniel Dennett
17
a offert quelques raisons de le mettre en doute. Il a
propos dans ce but un affinement du concept de zombie sous le nom de
zimbo . Le zimbo dennettien est un tre qui, en plus dtats mentaux de
premier degr, a des tats mentaux de second degr, des tats souvent
qualifis de mta-cognitifs ; autrement dit des tats mentaux propos de
ses propres tats mentaux, rsultant de sa capacit dauto-examen (self-
monitoring). Le zimbo pourrait utiliser sans problmes des termes comme
rve(z) ou hallucination(z) : il les prononcerait pour dnoter
loccurrence auto-examine(z) dune activit mentale(z) spontane, hors de
toute sollicitation sensorielle. Il raliserait ainsi de manire prcise et
dtaille lidal complet du zombie qui, selon sa dfinition, a exactement les
mmes comportements que nous, y compris les comportements verbaux et
sociaux les plus labors. Lenseignement quen tire Dennett est pourtant aux
antipodes du dualisme de Chalmers, et il sest attir dinnombrables
rpliques. Selon Dennett, une fois dot de la capacit dauto-examen, le zimbo
penserait tre conscient. Un tre qui, comme nous, pense tre conscient, peut
donc fort bien tre un zombie au sens fort et complet du zimbo. Nous
sommes tous des zombies
18
, assne alors Dennett dans un dnouement en
forme de coup de thtre.
Cette fin nen est vrai dire pas une, non pas parce quelle est impossible
croire par nous, tres conscients (Dennett a anticip cette objection en la
rangeant parmi les expressions de notre inclination penser tre conscients),
mais parce que ses prmisses et ses procds infrentiels sont bien plus
faibles quil y parat. Dune part, la dernire tape du raisonnement de
Dennett revient infrer la ralit (de notre tre-zombie) partir de sa
possibilit allgue, ce qui est manifestement incorrect. Dautre part, lorsquil
est question dun zombie-zimbo qui pense tre conscient, pense est utilis
par hypothse au sens faible dun tat cognitif non accompagn dexprience
consciente. Lomission de cette consquence inluctable de la dfinition des
termes du raisonnement, permet Dennett de se livrer un tour de passe-
passe argumentatif qui laisse songeur. Ce tour consiste essayer de persuader
des tres conscients quils pourraient aprs tout tre des zombies en comptant
tacitement sur leur comprhension ordinaire, cest--dire sur leur
comprhension vcue et consciente, de ce que signifie le mot penser : je
pense tre conscient, or un zombie-zimbo pense aussi tre conscient, donc je
pourrais tre un zombie (et je le suis mme en ralit, car passer du possible
au rel a ici lavantage de court-circuiter le problme difficile de lorigine
physique de lexprience consciente en supprimant ce dont il sagit de
comprendre lorigine). Il suffit pourtant de se rappeler que pour un zombie-
zimbo, penser ne peut (par dfinition) vouloir rien dire dautre que se
trouver dans un tat physique de second degr consistant reprsenter son
propre tat physique sans exprience associe (en dautres termes, que cela
veut seulement dire penser(z) , tout comme dailleurs le reprsenter qui le
sous-tend nest quun reprsenter(z) ), pour rendre le tour argumentatif
inoprant. Je pense tre conscient, or un zombie pense(z) tre conscient. Rien
nen dcoule sur mon assimilation possible ou relle un zombie, puisque
penser se distingue immdiatement de penser(z) . Il est vrai que
Dennett pourrait encore nous arrter mi-chemin de cette rfutation de son
argument en niant que penser diffre de penser(z) ; mais il ne serait en droit de
faire cela quen sautorisant de la conclusion quil veut atteindre, et en
commettant donc une ptition de principe.
Ainsi choue une tentative damplifier lallgorie du zombie jusqu
lappliquer, par-del le problme des autres consciences (ou des autres
esprits : other minds ), au (non-) problme de ma propre conscience.
Regardons-y cependant de plus prs afin de mettre au jour les ressorts de sa
force rhtorique, qui dborde la question de sa validit logique. La possibilit
dun tre extrieurement indiscernable de nous et nanmoins dnu
dexprience consciente a traditionnellement, parmi dautres effets, celui
dexacerber le problme consistant savoir quel critre (invitablement
extrieur) je peux bien appliquer pour massurer que mes semblables sont
conscients. Par contraste, en ce qui me concerne, je nai pas besoin de
critres ; il mapparat que je suis conscient, et je suis donc rellement
conscient. Confront cette platitude, largument de Dennett doit sassigner
pour pralable de dissocier chez moi (chez lui !) lapparatre-conscient du
rel-conscient. Sil semble y parvenir, ce nest cependant quen mobilisant la
mme distorsion implicite de son vocabulaire mentaliste que celle qui
inactive ses infrences : alors quun vrai apparatre-conscient est du rel-
conscient, le penser(z) ou lapparatre(z)-conscient (autrement dit la mta-
cartographie obtenue par self-monitoring ) en reste dissociable. La ficelle
de la substitution du verbe apparatre par le verbe apparatre(z) est si
grosse, et si visible mme en labsence du suffixe z , quon stonne
quelle garde le moindre pouvoir de convaincre. Elle impressionne nanmoins
beaucoup de lecteurs rudits de Dennett parce quelle rencontre chez eux un
terrain favorable, prpar par un long travail de sape culturel. Quelle
condition faut-il donc remplir pour quun argument de ce genre, fond sur un
geste de prestidigitation lexicale, soit ainsi tenu pour crdible ? La condition
darrire-plan, sur laquelle Dennett sappuie tout en sefforant de la
renforcer, est que le destinataire de largument soit si entirement absorb
dans lattitude ou ltat de conscience naturel-intentionnel, quil inactive
automatiquement dans le processus dinfrence toute intimation en provenance
de lactualit vcue. Pour que le raisonnement atteigne sa pleine force
persuasive, il faut que chaque acte mental, y compris lapparatre, y compris
le croire ou le penser, se voie systmatiquement interprt conformment sa
version fonctionnaliste suffixe par (z), aprs avoir fui volontairement
latmosphre dexprience rflchie qui rendrait cette interprtation
manifestement inacceptable. Il faut, en dautres termes, que tout acte mental
soit spar par choix axiologique de sa propre donation prouve au moment
o elle sprouve, et quil soit remplac par une contrepartie discursive
inerte, dicible au-del de ce moment. Il ny a rien rpondre cela, si ce
nest sen apercevoir, sexercer dtendre la crampe intentionnelle, et
apprendre faire voluer chaque opration, y compris argumentative, dans le
champ de conscience amplifi de lattitude phnomnologique.
La troisime objection contre largument des zombies est sans doute la
plus profonde, car elle fait accder la rflexion lerreur inaugurale que
commettent ensemble les dualistes et les physicalistes. Le reproche est tout
simplement que le concept de zombie est vide, quil na aucun remplissement
intuitif possible ; quun zombie est pistmiquement inaccessible
19
. Pour
connatre, rappelons-le, il faut avancer un cadre danticipations, et le voir
confirmer ( remplir ) par une exprience habituellement sensible. Mais
comment y parvenir sil nexiste aucune circonstance envisageable qui
permette de confirmer ou dinfirmer lanticipation propose ? Dans ce cas, on
doit admettre que lanticipation vise un faux-semblant de phnomne, un
oxymorique phnomne non apparaissant, et quelle ne peut donc aboutir
quelque connaissance corrobore que ce soit. Or, tel est exactement le dfaut
dune thse faisant usage du concept de zombie. Ltre-zombie nest
manifestable dans aucune situation incarne relle ou concevable. Un tre
conscient ne peut pas sapercevoir que tel corps humanode extrieur est en
fait un zombie, en vertu de la dfinition de ce dernier. Et le zombie na pour sa
part aucun moyen de sidentifier(z) lui-mme comme tel, puisque, pour y
parvenir, il faudrait quil puisse tablir la diffrence entre son activit
mentale(z) et une activit mentale sans suffixe restrictif, ce qui exigerait de lui
au moins un clair de lexprience consciente dont on la priv au dpart.
Quelle leon peut-on alors tirer de cette troisime objection, pleine de bon
sens, de la vacuit pistmique ? Quen formulant largument du zombie, les
dualistes se sont accords subrepticement avec les physicalistes quils
critiquent pour perdre de vue quil ny a aucune acception valide en troisime
personne du concept dexprience consciente ou de conscience phnomnale ;
et aucun sens par consquent se figurer la conscience phnomnale comme
quelque chose (substance ou proprit) quil nous serait loisible de consentir
ou de refuser un tre physique. La conscience phnomnale concide avec ce
qui se vit en premire personne, dans une situation incarne. Elle ne peut se
prvaloir daucun degr de libert par rapport cette situation, daucun
moyen daccs en dehors de cette situation, et il est donc dans tous les cas
incorrect de len dsolidariser, que ce soit pour la faire merger de relations
entre objets physiques ou pour en faire une proprit non physique attribue
aux vrais alter-ego et dnie aux zombies. Mapercevoir que je suis conscient
nest pas un acte pistmique, mais un fait dimmersion existentielle ; et prter
une conscience autrui ne relve pas davantage de la connaissance mais de
lthique incarne
20
voire de lontologie-fondamentale au sens de Heidegger
et de Sartre (cest--dire de la comprhension que lexprience dautrui ne
mest pas extrinsque, mais me constitue comme tre-sous-son-regard
21
).
Le sort de largument dualiste du zombie semble partir de l scell,
aprs celui des arguments physicalistes quil parvient fragiliser. L encore,
pourtant, il ne faut pas crier victoire trop tt. Car ce serait minimiser la
difficult quil y a communiquer le genre dvidence dont dpend la
rfutation des multiples stratgies de rification de la conscience. Des
distinctions comme pistmique/immersif , ou connaissance/thique
incarne , risquent de glisser la surface des intelligences exclusivement
absorbes dans l attitude naturelle , et de ne paratre limpides qu ceux
qui ont dj acquis la souplesse ncessaire pour adopter tour tour
l attitude naturelle et lattitude phnomnologique. Le langage employ ici
ne se veut donc pas purement argumentatif. Il tend se faire performatif, en
dstabilisant les esprits en recherche par de multiples changements de plans
dtre, au-del du seul plan discursif. Il vise tirer avantage de chaque
problme conventionnel et de chaque dbat abord, non pas tant pour
consolider une position dmonstrative que pour favoriser un basculement
dtre-au-monde seul capable damener leurs lacunes au grand jour.
La seconde exprience de pense qui nous transporte la frange dlicate
du vivre et du dcrire est celle de Mary la scientifique, dcrite par Frank
Jackson
22
en 1982. Elle consiste canaliser habilement litinraire
argumentatif physicaliste, de manire ce quil ne puisse pas viter de faire
une tape situe puis de sauto-dissoudre en elle. Sans quil y ait lieu de sen
tonner, une telle stratgie a t inaugure par Husserl, qui la mobilise non
pas contre larraisonnement de lexprience consciente par une science
physique, mais contre la tentative parente de fonder la thorie de la
connaissance sur les sciences de la nature. Un sourd de naissance, crit
Husserl, sait quil y a des tons, que des tons fondent des harmonies, et quun
art merveilleux est fond sur elles ; mais comprendre comment les tons le
font, comment les uvres musicales sont possibles, cela lui est impossible.
[] Dduire partir dexistences seulement sues et non vues, cela ne va pas.
Le voir ne se laisse pas dmontrer ni dduire
23
. Si Husserl a mobilis
lanalogie prcdente du sourd de naissance, cest afin de justifier la priorit
quil donne au voir sur le savoir, lhabiter sur lanalyser, au raliser sur
linfrer, en thorie de la connaissance. Il cherche nous convaincre par son
truchement que si lon veut comprendre comment est possible une science
dobjets, aucun raisonnement faisant lui-mme usage de relations dobjets
dsigns par des mots ne peut convenir, car il prsuppose ce quil sagit
dlucider. Sortir de ce cercle vicieux suppose donc de voir comment naissent
des vises dobjets, de tmoigner directement de leur constitution dans le
domaine visant qui est celui de la conscience pure, avant mme quelles ne se
soient solidifies en choses nommables et en jugements sus leur propos. Le
thoricien de la connaissance naturaliste ressemblant au sourd de naissance
qui penserait tout saisir de la musique au nom de son savoir livresque sur le
solfge, le rythme, et les accords, le phnomnologue se donne pour double
mission de lui faire saisir quil sagit l dune illusion, et de lui apprendre le
savoir-tre dun aperu direct sur le champ constitutif (lquivalent
philosophique des savoir-faire de lauditeur et mlomane).
Il ressort en bref du dveloppement de Husserl que savoir ne suffit pas
voir ; que ni voir ni prouver ne sont puiss par une chane de symboles.
Cependant, lorsquil met son tour en scne ce genre de contraste dans son
exprience de pense, Jackson cherche tayer une thse bien plus forte :
quil y a quelque chose savoir qui est irrmdiablement absent du savoir
scientifique ; quun corpus scientifique mme exhaustif laisse derrire lui une
lacune dans la connaissance. Cest cette prtention placer sur un plan
pistmique le conflit entre la prtention des sciences lexhaustivit et leur
incompltude dans le champ pr-discursif qui a aliment le dbat et la rendu
quasiment inextricable.
Reprenons donc le rcit allgorique de Jackson en son commencement.
Mary est une chercheuse scientifique qui vit et travaille dans une pice peinte
en noir et blanc, do elle ne voit le monde que par lintermdiaire dune
tlvision en noir et blanc. Elle acquiert toutes les connaissances que la
physique et la neurophysiologie peuvent lui fournir sur la vision des couleurs.
Pourtant, quand on lui permet enfin de sortir de son laboratoire confin, il va
de soi quelle apprend quelque chose quaucune description scientifique ne
pouvait lui fournir : elle apprend comment est lexprience vcue du rouge et
du bleu. Sil en va ainsi, on doit en conclure que les qualits phnomnales
sortent du cadre de ce dont les sciences physiques au sens large permettent de
rendre raison, et quil y a donc des connaissances qui chappent par principe
la physique.
Deux sortes de rponses ont t opposes cet argument original de
Jackson, y compris dailleurs par Jackson lui-mme, qui rejette dsormais sa
validit
24
.
La premire rponse, avance par Dennett
25
, consiste affirmer que la
connaissance physique pourrait devenir plus complte que ce que nous
pouvons imaginer actuellement. En particulier, elle pourrait offrir Mary la
comprhension de la manire dont certains vnements neurophysiologiques
causent lexprience des couleurs, ce qui lui permettrait de savoir quoi
elle doit sattendre avant mme douvrir la porte de son laboratoire.
Largument est intressant, sauf quil omet une tape cruciale. Il ne suffit pas
Mary de comprendre, mme parfaitement, le lien (dont la nature causale
unidirectionnelle est dailleurs trs discutable) entre neurophysiologie et
exprience des couleurs, ni de pouvoir anticiper in abstracto quel sera son
tat neurologique lors de sa confrontation avec les pivoines et le ciel diurne,
pour acqurir ce savoir qui lui manque. Il convient au minimum, faute de
sortir de son laboratoire, quelle simpose une stimulation coordonne de son
systme nerveux du type voulu et dcrit par son savoir idalement complet
pour avoir lexprience de chaque couleur. Ici encore, comprendre ou prvoir
nest pas vivre ; comprendre ou prvoir est seulement un guide pour agir de
manire orienter le vivre.
La seconde rponse revient nier que ce que Mary acquiert de neuf en
sortant de son laboratoire soit une connaissance. Son exprience des couleurs
lui offre seulement un savoir-faire (un savoir-sorienter de faon la fois plus
spontane et plus fine dans son environnement)
26
, ou une accointance (une
connexion immdiate) avec ce dont elle navait quune connaissance
mdiate
27
.
ce stade, le cur de la question est atteint. Si lincompltude de la
connaissance physique (objective) ne fait aucun doute, cela ne signifie en
rien quil y ait quelque objet , ou quelque proprit qui ait t laiss de
ct par les sciences. Aucune chose na t laisse de ct, ou si elle la t
elle ne le sera plus dans un avenir envisageable ; et pourtant lessentiel a t
mthodiquement abandonn larrire-plan de lacte de vise intentionnel-
naturaliste. L essentiel, cest le vivre situ, qui nquivaut pas une
connaissance au sens de sparation-et-saisie, mais qui conditionne la
possibilit de toute connaissance de cette sorte. Si des esprits non forms la
phnomnologie, peu familiers avec la Crise des sciences europennes de
Husserl, et bien installs dans ltat de conscience intentionnel-naturaliste,
avaient encore du mal raliser que cette prcondition est incontournable
pour la connaissance physique elle-mme, un argument issu de la philosophie
des sciences pourrait les y aider
28
. Supposons quil nexiste aucun trait dont
la rvlation saccomplisse seulement dans lexprience ; quil ny ait rien de
plus que le canevas formel expos par une hypothtique thorie physique
idalement accomplie. Dans ce cas, lhorizon de la science physique ne se
distinguerait aucunement du logico-mathmatique. Elle tendrait vers un jeu
symbolico-dductif totalisant et auto-suffisant, sans pouvoir prtendre au titre
de connaissance de quelque chose de vraiment autre quelle-mme. Aussi
bien encadr par une structure dattente (ou par une charge thorique ) que
soit le fait exprimental prsuppos par la science de la nature, il doit donc
rester en lui quelque chose dincatgorisable et dinsaisissable, une richesse
inpuisable par quelque forme que ce soit (disons sa dispersion et son contenu
sensible). Cette opinitre surabondance du fait par rapport au formalisme
ou lexpression propositionnelle est ce qui confre la physique son statut
de science empirique constamment suspendue une rfutation possible parce
que, par construction, ses descriptions sont, et seront toujours, plus pauvres
que ce qui se montre.
Le diffrend entre physicalistes et anti-physicalistes en philosophie de
lesprit apparat partir de l sous un jour indit. Les physicalistes se
prsentent sur larne du dbat avec la croyance inbranlable en la possibilit
dune fin de la physique en apothose, dune connaissance physique
intgralement acheve et exhaustivement complte porte dun futur de la
science non infiniment loign. Au contraire, les anti-physicalistes se
prvalent de linachvement permanent voire principiel de la physique, et de
linaccessibilit de son horizon de dveloppement. Ils attribuent cet
inachvement au fait que la physique est ouverte une exprience riche en
donations de contenu qui outrepassent et traversent t out e structure qui
chercherait les capturer dans ses filets algorithmiques, et ils tiennent par
consquent pour un leurre le projet de rendre compte de lorigine de
lexprience mme qui tient chaque compte rendu la merci dune rfutation.
Les physicalistes caressent en vrit le rve de clture finale du savoir
symbolique que la mtaphysique classique a hrit de la thologie, tandis que
les anti-physicalistes reprennent leur compte la pense de la finitude de
ltre-situ qua inaugure la philosophie des lumires. Il est irritant pour la
Raison de sentendre signifier ses limites, et plus encore de sapercevoir
quelles lui ont t fixes depuis Kant sans quelle soit parvenue depuis les
nier de faon convaincante ; cest sans doute pour cela quelle a cherch dans
chaque tape du dveloppement des sciences de la nature, et dans la puissance
croissante dagir que celles-ci confrent lhomme, un motif suppos nouveau
(bien quen vrit ancien comme le dogmatisme pr-critique) de saffranchir
de ce quelle a ressenti comme un insupportable carcan. Mais ce dsir
daffranchissement sest rvl illusoire au vu des points aveugles
irrductibles quil laisse dans le systme de la connaissance, tandis
quaccepter le fait de la finitude de notre pouvoir de connatre a dbouch sur
la mise au jour de ressources dtre trop longtemps ngliges, dont la
phnomnologie a tout juste commenc dexplorer la richesse.
La dernire exprience de pense situante discuter est celle qua
propose Thomas Nagel en 1974 dans son article clbre What is it like to
be a bat
29
? En un sens, cette exprience de pense inaugurale contient toutes
les autres en puissance. Elle contient largument de la connaissance parce
quelle vise montrer quil y a des faits subjectifs connatre qui chappent
aux sciences objectives et en particulier la physique. Elle contient galement
largument et la figure du zombie, parce quelle repose sur le constat que les
comptes rendus fonctionnalistes des oprations mentales pourraient tout aussi
bien convenir des robots ou des automates qui se comportent comme des
tres humains quoiquils naient aucune exprience
30
. Mais elle a aussi une
originalit importante, qui est de dvelopper une reconstruction intgralement
perspectiviste du problme de lexprience consciente. Selon cette approche,
le problme est que la physique ne peut offrir aucun compte rendu des faits
lis chaque point de vue singulier ou mme chaque type de point de vue,
puisque sa mthode consiste abandonner entirement les points de vue en
faveur dune conception gnrique (elle adopte, en dautres termes, un point
de vue de nulle part
31
). Pour connatre de tels faits perspectifs, il ne suffit
pas de les dcrire de manire dtache, mais il faut adopter le point de vue
(ou le type de point de vue) qui leur correspond. Lintervention des chauves-
souris ( bats ) nest sollicite que pour dramatiser cette limite principielle
de la connaissance objective ; et, en mme temps, elle en approfondit
implicitement la signification au-del de la mtaphore spatiale des points de
vue.
Comment connatre les faits dexprience qui constituent le monde de la
chauve-souris ; comment connatre en particulier les qualits sensibles hors du
commun qui sont vraisemblablement associes lmission dultrasons et la
rception dchos ultrasonores ? La rponse laquelle on sattend dans le
sillage de lanalyse perspectiviste initiale est quil ne suffit pas pour cela de
dcrire une structure connectant les dlais de retour et les dcalages de
frquence des ultrasons, et une autre structure assurant le dcodage neuronal
de ces informations, mais quil faut aussi et surtout occuper le point de vue
dune chauve-souris immerge dans ces processus structuraux. Le langage
quemploie Nagel excde cependant trs vite limage gomtrique des points
de vue et sengage, ds son titre, dans lontologie fondamentale. Ce quil faut
pour connatre les faits dexprience du monde de la chauve-souris, selon
Nagel, cest ni plus ni moins tre une chauve-souris, cest sincarner en elle.
Cest seulement ainsi, de toute vidence, quon peut accder ce que
cela fait dtre une chauve-souris . Il y a l un saut dans la radicalit
existentielle, dont toutes les consquences sont loin davoir t tires par
Nagel. La diffrence entre un point de vue et un tre-au-monde est pourtant
manifeste. Je peux adopter un point de vue diffrent de celui que joccupe
actuellement dans lespace tout en restant moi-mme, parce quil y a une
continuit, sur le mode extrinsque de lidentit comme sur le mode
intrinsque de lipsit, entre le moi qui occupe le premier point de vue et
le moi qui occupe le second. En revanche, je ne peux pas tre une chauve-
souris sans cesser purement et simplement dtre moi, sans rompre toute
continuit entre lavant et laprs de ma mtamorphose en mammifre
volant. Ds lors, il nest mme plus correct de dire que jaccde des faits,
ou que je les connais par ce procd dincarnation, puisquune fois
devenu chauve-souris, je ne suis plus celui que jtais et qui
cherchait acqurir une telle connaissance. Il ny a personne ici pour accder
un contenu pistmique, puisque laccs supposerait la transition dun mme
sujet entre un tat de connaissance lacunaire et un autre plus complet, et non
pas la disparition du premier au profit du second.
Nagel a beau avoir aperu le motif de lchec conjoint du dualisme et du
physicalisme, lexpression trop faible quil donne de ce motif le rend en fait
complice des deux positions quil dnonce. Il est vrai, et nous lavons dj
signal, que ce que manquent la fois le physicalisme et le dualisme, cest le
caractre dtre-situ de lexprience consciente ; lun parce quil le tient
pour un trait piphnomnal et contingent de la description universaliste
offerte par la physique, et lautre parce quil cherche lui donner une
traduction pseudo-objective sous forme de substance ou de proprit
exprientielle. Mais que propose Nagel la place de cela ? Il propose
dabord dadmettre quune exprience nest accessible qu partir dun lieu
abstrait appel point de vue , comme si cela avait un sens de dire de
quelquun quil entre en contact avec sa propre exprience partir dailleurs
quelle-mme. Et il propose de surcrot de considrer le systme des points
de vue comme un constituant du monde ajout ceux que montrent une vue
neutre de nulle part ; comme sil y avait un point de vue surplombant aussi
bien la vue neutre que les vues particulires, une sorte dhyperbole
vertigineuse de lobjectivit apte englober non seulement les objets eux-
mmes mais aussi tous les aperus possibles sur les objets. la distance
instaure par le couple dualisme-physicalisme entre la description du monde
et lexprience situe, Nagel ajoute une distance supplmentaire entre le
couple (monde, expriences situes) et un suprme promontoire partir
duquel la diffrence des deux se laisse valuer. Il semble bien alors quau lieu
davoir rduit lcart vis--vis de la vie vcue qui emprisonne depuis ses
commencements le dbat entre dualisme et physicalisme, Nagel lait amplifi
par inadvertance en plaant son sujet dans une position typique de la
thodice leibnizienne : celle dune monade des monades, cest--dire dun
ultime point de vue partir duquel se contemplent tous les points de vue.
Considrons une proposition typique de son approche mtaphysiquement
perspectiviste : La manire dont le monde est, inclut les apparatres, et il
ny a aucun point de vue partir duquel ils puissent tous tre pleinement
apprhends
32
. En dautres termes, le monde englobe les vues aussi bien
que ce qui est voir. Mais, mme sil nexiste aucun point de vue do toutes
les vues puissent tre saisies dans leur contenu individuel, il y a
manifestement un point de vue (celui de Nagel) do la composition totale du
monde, faite de vues et de choses vues, se manifeste. Dualistes et
physicalistes planaient certes au-dessus des eaux du monde, mais le dfenseur
du perspectivisme ontologique, loin de rintgrer le liquide amniotique de la
vie vcue, semble sarroger le droit de planer encore plus haut afin de
surveiller le planeur objectiviste.
Ny a-t-il donc de compensation la distanciation du connatre abstrait
que dans linstauration dune distance encore accrue, de remde lalination
du vcu que dans une alination plus profonde ? Il semble bien quil en aille
ainsi dans le cadre de lattitude naturelle et dune philosophie troitement
discursive qui pouse ses priorits. Aucune variante, mme audacieuse, du
chemin de la pense conceptuelle et objectivante naide sortir de la spirale
de lloignement de soi. Cest une voie diamtralement oppose quil faudrait
emprunter pour cela ; mais ses asprits et ses -pics restent inquitants parce
quelle nest ni clairement trace, ni perceptible, ni bien comprise par la
mtaphore de lavance.
QUESTION 9
Les thories neurologiques
et volutionnistes
de la conscience : quexpliquent-elles ?
Les cellules motrices de la corne antrieure de la moelle
[] possdent le mme cylindre axe, les mmes expansions
protoplasmiques, la mme faon de se mettre en rapport et
de transmettre les courants, en somme tous les caractres
de la cellule psychique laquelle, nanmoins, nous
attribuons les activits les plus leves de la vie
(association dides, mmoire, intelligence, etc.). [] La
science donc, pour ne pas se dcourager dans cette lutte
perptuelle et si opinitre pour lexplication mcanique de
la pense, doit imaginer que ce quelque chose qui spare
la cellule crbrale de la cellule mdullaire et
ganglionnaire nest pas la forme extrieure.
S. Ramon y Cajal
1
Au vu des rflexions prcdentes, il nest pas absurde de dclarer que
lexpression explication neurobiologique de la conscience est un oxymore.
Et pourtant, cela risque de ne pas tre reconnu immdiatement comme vrai. De
quel droit le segment de phrase entre guillemets, qui se veut aussi un
programme de recherche, se voit-il rapprocher des obscures clarts , des
tintements silencieux , et autres effrois voluptueux de nos potes ? De
quelle nature peut bien tre sa dissonance si celle-ci ne se montre pas
demble au regard ? Et pourquoi la contradiction allgue de ses
significations semble-t-elle avoir chapp aux meilleurs spcialistes de
neurosciences ?
Il faut dabord noter, propos de la dernire question, que le conflit de
prtentions inhrent une qute dexplication neurobiologique de la
conscience, et plus encore de lorigine neurobiologique de la conscience, est
en fait loin dtre ignor. La perception de ce conflit a nourri discrtement la
pense de plusieurs gnrations de chercheurs, tout en ayant t refoule par
eux comme une tentation laquelle il faut savoir rsister pour ne pas perdre la
motivation la plus puissante de linvestigation neurophysiologique. Elle est en
particulier prsente dans les prmisses de lexprience de pense du zombie,
ainsi que dans largument rpandu de la clture causale du monde
physique
2
. Si toutefois loxymore dnonc ne saute pas immdiatement aux
yeux, cest quil nest pas tant de nature smantique que pragmatique. Aucune
composante de sens de la locution explication neurobiologique ne
soppose a priori celles du mot conscience , sauf peut-tre faire
ressortir la connotation objectiviste de la premire et la connotation
subjectiviste de la seconde. Ce nest qu mesure de lavance irrsistible du
projet consistant offrir un compte rendu neurobiologique des composantes
manifestes des comportements et des activits mentales des organismes
vivants, que la contradiction saute aux yeux. Les succs croissants de la raison
neurobiologique, ses progrs continus qui en font lune des aventures
scientifiques les plus fascinantes de ce sicle, ont en effet une condition
presque confondante tant elle va rebours des attentes. La condition est que la
conscience lmentaire ou phnomnale , le pur apparatre, lexprience,
nait aucun rle jouer dans une explication scientifique satisfaisante des
processus comportementaux et mentaux. La russite du compte rendu
physiologique dun geste ou dune configuration motionnelle se mesure son
aptitude ne pas y faire intervenir (tel un deus ex machina devenu superflu)
le fait que la volont de gesticuler ou le flot de lmotion sont ressentis. La
prsence ou labsence dune exprience consciente associe un
enchanement neurobiologique est (et d o i t tre, dans la perspective
pistmologique adopte) contingente, optionnelle, dnue de toute
pertinence. Que ltre vivant dans lequel se droulent les processus
neurobiologiques soit ou ne soit pas conscient (au sens plein du terme, cest-
-dire dot ou non dot dexprience vcue et pas seulement de rflexivit
mtacognitive ), rien ne doit changer dans ses comportements, selon la
proclamation dauto-suffisance de lapproche objective des processus
mentaux avance par les physicalistes les plus consquents, dont la figure du
zombie ne fait que prsenter une expression outre. La conscience ne jouant
aucun rle dans un bon compte rendu neurophysiologique, ce dernier,
linverse, manque de prise pour se saisir de la question de la conscience.
ce stade, un penseur physicaliste pourrait encore se prvaloir dune
analogie avec les processus (faiblement) mergents dans les sciences de la
nature, pour objecter que cette exterritorialit de la conscience vis--vis des
processus neurobiologiques rputs la sous-tendre nest pas une configuration
si exceptionnelle que cela dans ldifice des savoirs. Il pourrait par exemple
signaler que les comptes rendus microscopiques relevant de la thorie
cintique molculaire sont galement auto-suffisants, quils assurent
galement la clture causale de leur domaine ; mais que cela nempche pas
dy voir une explication satisfaisante de variables thermodynamiques
macroscopiques a priori trangres ce domaine, et causalement superflues
par rapport lui, comme la chaleur, la pression, voire la liquidit de leau
temprature modre. Lune des circonstances qui crdibilisent laptitude
explicative de la thorie cintique aux yeux des chercheurs est lisomorphisme
qui prvaut entre les lois dchelle macroscopique qui peuvent en tre
drives et les lois de la thermodynamique classique. Le fait quon puisse de
surcrot prvoir loccurrence de phnomnes thermodynamiques partir dun
agencement appropri de mouvements molculaires collectifs achve de les
persuader de la valeur dexplication qua leur modle microscopique, et du
caractre (faiblement) mergent de ces phnomnes macroscopiques. Nen
irait-il pas de mme pour la conscience ? Ne met-on pas en vidence une part
considrable disomorphisme entre certaines squences dvnements
neurobiologiques, et les squences dvnements mentaux vcus et rapports
par des sujets ? Ne peut-on pas sappuyer sur cet isomorphisme constat pour
prvoir que tel vnement mental se produira et sera relat, lorsque telle
structure dactivit neuronale sera observe ? Et cela ne suffit-il pas
affirmer quon tient enfin une explication neurobiologique de la conscience en
tant que trait mergent ? La rponse cette dernire question est ngative, et la
critique de lanalogie invitable, pour les deux mmes raisons qui ont conduit
Jaegwon Kim conclure que la conscience phnomnale ne saurait tre
assimile quelque trait faiblement mergent. Premirement, lisomorphisme
des lois cintiques et thermodynamiques nest pas un simple fait contingent ; il
est tabli rigoureusement travers un pont thorique qui nest autre que la
physique statistique. Au-del du simple isomorphisme lgal, cest ce pont
thorique qui fait compter la thorie cintique pour une vritable explication
de variables macroscopiques comme la temprature et la pression. Or,
lorsquon en vient au rapport entre un fonctionnement neuronal et loccurrence
de la conscience phnomnale, il nexiste aucun pont thorique permettant de
passer de lun lautre, aucun trait dsignable ou envisageable de lun qui
permette dengendrer les caractristiques de lautre. Deuximement, et surtout,
ce quon peut seulement prvoir sur la base dune configuration
neurophysiologique, comme sur la base dune configuration cintique, cest un
phnomne, et non pas le fait plnier de la phnomnalit. On prvoit (tant
bien que mal) la structure dun tat mental, ou la teneur dun rapport verbal
dexprience, mais pas que a fait quelque chose dtre dans cet tat mental,
ni quil y a une exprience rapporter.
Au total, la dconnexion de la conscience phnomnale lgard des
processus neurobiologiques est radicale, et ne ressemble que trs
superficiellement larticulation mergente des phnomnes
thermodynamiques aux phnomnes cintiques travers la mdiation
statistique. Ainsi, linverse de ce qui sest pass en thermodynamique
statistique, dont le nom mme voque ce que nous avons appel un pont
thorique entre les niveaux microscopique et macroscopique, plus les
neurosciences sapprochent de leur idal doffrir des comptes rendus
objectivement complets des phnomnes comportementaux et mentaux, plus
elles comprennent quen raison mme de cette compltude elles nont aucune
place non seulement en elles, mais aussi leur priphrie thorique, pour
lingrdient conscience phnomnale . Paradoxalement, les thories
neurologiques de la conscience parviennent dautant moins garder en prise
lexprience vcue quelles sont plus exhaustives, cest--dire plus capables
dtablir en dtail la chane causale des vnements neuronaux qui sous-tend
un comportement sans faire appel au moindre lment additionnel sous forme
de vcu. Le plus grand chec des recherches neurobiologiques est en somme
la consquence invitable de leur plus grand succs. La conscience
phnomnale leur devient alors un poids, une prsence, une nigme fascinante
pour leur discipline, mais pas un terme oprant de leur discipline ni dune
discipline qui en serait drivable (comme la thermodynamique statistique est
drive de la thorie cintique). tel point quune pousse continue se fait
sentir en faveur dune autonomisation des concepts neurobiologiques, cest--
dire dune limination intransigeante des antcdents introspectifs du
vocabulaire des tats mentaux. Il se confirme que lliminativisme, loin dtre
une position parmi dautres, est un formidable rvlateur de ce qui se trame
dans les coulisses de la science des neurones. Si, en dpit de cela, le mot
conscience ne cesse de simposer comme un foyer denqute pour la
neurobiologie, cest seulement condition de ne plus envelopper le vcu que
comme une sorte dombre, invitablement projete par lexprience des
chercheurs, mais repousse lhorizon de la recherche. La conscience
redfinie pour les besoins opratoires des neurosciences et des sciences
cognitives, nous lavons soulign aux chapitres prcdents, est restreinte un
ensemble de fonctions (dunification, de mta-cognition) dans lconomie du
traitement dinformation auquel sont assimils les processus mentaux. Les
explications neurologiques ou volutionnistes qui en sont donnes se bornent
ds lors rendre compte de ces fonctions hypothtiques, et esprer
vaguement, mais gratuitement, quun surcrot de raffinement dans llucidation
fonctionnelle suffira clairer un jour lorigine du vcu qui en a t expuls.
Mais, dans ce contexte stratgiquement liminativiste, quest-ce qui nous
permet tout de mme dutiliser des phnomnes neurophysiologiques comme
guides, ou comme signes, rendant vraisemblable lattribution dune
exprience consciente des tres diffrents de nous (patients en tat
apparemment vgtatif, ou animaux) ? Peut-on au minimum parvenir un
consensus sur les corrlats neurobiologiques de la conscience
phnomnale ? Do vient que la dcouverte du corrlat neuronal dune
structure dexprience visuelle ou idative nous donne souvent le sentiment
davoir lucid ce moment de conscience et dapprocher ainsi lexplication
neurobiologique entire de la conscience, y compris sa composante
phnomnale ? Telles sont quelques-unes des questions qui nous
accompagneront au cours de ce chapitre.
Il est utile de sappuyer sur une classification des principales thories
neurobiologiques de la conscience, avant de les commenter dans lambiance
de ces questions. Les thories se sont multiplies durant les trente dernires
annes, mais il est commode de les ordonner selon deux critres, et de
distinguer deux familles par critre.
Le premier critre est celui du caractre localis ou gnralis de la
base neurologique allgue de la conscience. Certaines conceptions
cherchent dsigner un locus particulier du cortex crbral, ou de quelques
autres structures de lencphale, comme substrat spcifique de la conscience ;
mais elles ne parviennent en fait identifier que des centres de rgulation de
la vigilance ou des organes de modulation de la mmoire. Comme nous le
verrons plus en dtail propos des effets de lanesthsie gnrale, il existe
ainsi un ensemble de centres de la partie suprieure du tronc crbral,
dsigns en bloc comme systme dactivation rticulaire , dont les
neurones se projettent dans un large domaine du cortex crbral en librant
des neuromdiateurs. Les neuromdiateurs scrts contrlent le niveau
gnral dexcitabilit neurolectrique du cerveau en modulant le circuit de
rtroaction qui lie le thalamus et le cortex
3
, avec pour consquence que
linhibition ou linactivation de diverses parties du systme dactivation
rticulaire fait perdre conscience aux patients qui les subissent. Nest-il
pas tentant partir de l de qualifier ce systme de centre de la
conscience ? Les choses sont loin dtre aussi simples. Le contre-exemple
des patients en tat vgtatif, dont le comportement ne manifeste pas les signes
habituels dune conscience organise, alors que la vigilance et lactivit du
systme dactivation rticulaire sont prserves, donne rflchir ; dans ce
cas, des lsions thalamo-corticales sont constates, et ce sont elles qui se
voient attribuer le dficit des manifestations de la conscience.
Rciproquement, il arrive que le thalamus remonte un niveau suffisant
dactivit en dpit de linactivation induite du systme rticulaire, et que cela
permette aux patients affects de retrouver leur vigilance
4
. On comprend dans
ces conditions que le rle du systme rticulaire ait t relgu larrire-
plan, que lintrt des chercheurs se soit port vers le thalamus avec sa
fonction dexcitation cyclique du cortex crbral, et que cette structure
diencphalique
5
ait pu tre considre son tour comme un candidat
prometteur au titre de centre de la conscience
6
. Mais ici, comme dans le
cas prcdent, le fait que linhibition slective dun centre fasse disparatre
les signes comportementaux et verbaux de conscience nimplique nullement
que ce seul centre soit une condition suffisante de la conscience dans son
intgralit, et encore moins que la conscience y soit spatialement localise.
Lintgrit du cortex crbral, en particulier, est une condition additionnelle
cruciale pour le maintien des signes comportementaux et verbaux de
conscience
7
.
Dautres conceptions sappuyant sur une distinction entre vigilance,
attention et conscience
8
tendent donc considrer que le substrat neuronal de
la conscience est largement distribu (plutt que localis) dans le domaine
spatio-temporel dactivit de lencphale, et quil inclut en particulier la
dynamique neurolectrique du cortex crbral. Plusieurs varits de ce
dernier type de conceptions ont t formules, et elles peuvent tre
discrimines selon un second critre : celui des fonctions allgues de la
conscience dont elles dclarent rendre raison de manire privilgie. Une
premire famille est celle des thories de la rtro-action ou de la rcurrence,
qui se concentrent sur la fonction de rflexivit assume par la conscience.
Une seconde famille est celle des thories de lunification cognitive, qui
privilgient la fonction de liaison et de synthse en un seul acte conscient, des
informations traites par divers modules ou processus cognitifs
spcialiss. coup sr, la rflexivit nest pas ignore dans les thories de
lunification, ni la liaison dans les thories de la rcurrence ; mais chacune
des familles de thories se distingue par la priorit quelle accorde lune
des deux fonctions ds sa conception, et par le traitement relativement
subalterne quelle rserve lautre fonction.
Les thories de la rcurrence se subdivisent leur tour en deux espces :
(a) les thories de premier ordre, selon lesquelles le caractre conscient dun
tat mental est dtermin par une activit cyclique, boucle sur elle-mme, des
neurones de chaque aire spcialise ; (b) les thories dordre suprieur selon
lesquelles lmergence de la conscience requiert des mta-tats mentaux
capables de reprsenter, par le biais de lactivation de vastes aires
dintgration, le fait dtre engag dans une srie de processus mentaux de
premier ordre. Quant aux thories de lunification cognitive, on peut en
discerner plusieurs varits selon la principale modalit de liaison quelles
mettent en avant. La liaison peut tre surtout spatiale, si lon suppose que
chaque information spcialise est concentre sur une certaine aire corticale,
et que les diverses aires ddies communiquent entre elles travers une
plaque tournante elle-mme localise. La liaison peut tre structurale, si lon
admet que cest en augmentant linterconnexion globale des rseaux neuronaux
que peut tre assure la convergence des informations portes par des rseaux
spcialiss encore peu intgrs. Enfin, la liaison peut tre spatio-temporelle,
si lon considre que la spcialisation des fonctions a pour corrlat
biologique la dsynchronisation des rseaux neuronaux, tandis que leur mise
en commun repose sur laccord de phase des dcharges neuronales grande
chelle corticale
9
. Notons en passant que la fonction de synthse est celle qui
est le plus souvent prise en charge par les thories physicalistes sub-
neuronales de la conscience faisant appel au paradigme quantique
10
. La
liaison , ou synthse, se voit dans ce cas attribuer une origine holistique,
celle de lintrication quantique
11
ou dune reprsentation globale de lactivit
neurolectrique dans un formalisme de thorie quantique des champs
12
, plutt
quune origine rticulaire.
Commencer par les thories rcurrentes de premier ordre, celles qui
attribuent la conscience de chaque modalit sensorielle aux activits cycliques
des rseaux de neurones locaux des aires corticales associes, a lintrt de
nous placer demble au cur du dfi physicaliste. Nous pouvons dfinir la
conscience comme un processus rcurrent dclare Victor Lamme
13
. Tous
les tats conscients sont des tats rsonants confirme Stephen Grossberg
14
.
La conscience est un tat fonctionnel interne crbral de nature onirique, qui
est modul plutt quengendr par les sens
15
, dveloppe Rodolfo Llinas. Les
thories de la rcurrence du premier ordre les plus ambitieuses se prsentent
donc ouvertement non pas comme des explications de lmergence de la
conscience, mais comme des discours substitutifs, voire liminatifs, visant
viter autant que possible la rfrence la conscience, et la remplacer par
un discours sur certaines activits cycliques des rseaux de neurones. Si leur
prtention rsoudre le problme difficile de lorigine physique de la
conscience se voit ainsi suspendre, ce nest pas par humilit pistmologique.
Cest dans le but pratique de ne pas rester pigs dans un problme de
principe, et daccrotre par cet affranchissement leur efficacit prvisionnelle,
lorsquil sagit par exemple de trancher cliniquement entre la prsence et
labsence de conscience chez des patients incapables de communiquer. Les
dfenseurs des thories rcurrentes se dclarent en particulier aptes rendre
raison de manire trs gnrale de la rpartition des processus mentaux entre
ceux qui sont considrs comme inconscients et ceux qui sont qualifis de
conscients la suite dun rapport verbal. Dans les processus apparemment
inconscients, observent-ils, laccord entre les entres sensorielles et les
attentes motrices seffectue immdiatement, en saidant dun procd
inhibiteur qui empche lmergence dune assemble neuronale rsonante
(cycliquement auto-excite) et court-circuite ainsi tout processus de jugement
et de dcision motive. Au contraire, dans les processus verbalement
rapports, laccord sensori-moteur est mdi par un processus amplificateur
qui aboutit une rsonance dactivit intra-corticale
16
. Le dfaut de rsonance
dans un cas et son apparition dans lautre cas sont censs suffire rendre
raison de la diffrence de niveau de conscience entre lun et lautre. Partant de
ce genre de rsultat, mais ne voulant plus faire dpendre limputation de
conscience du seul rapport verbal, Lamme va jusqu riger la rsonance (ou
rcurrence) intra-corticale en critre autonome de conscience. Dsormais,
indpendamment du fait quun sujet se montre capable ou non de rapporter
verbalement son exprience, il est rput en avoir une si des rcurrences
neuronales sont dtectables dans une rgion suffisamment tendue de son
cortex. Lamme sinterroge dans cet esprit sur les cas de ccit
attentionnelle
17
, dans lesquels les sujets dclarent ne pas avoir vu un stimulus
qui sest pourtant prsent dans leur champ visuel, cause de la focalisation
de leur attention sur un autre aspect de la mme scne. Doit-on dire que les
sujets taient inconscients du stimulus ? La rponse de Lamme cette
question est fermement ngative, et mme si dautres auteurs saccordent avec
lui pour admettre des cas de conscience sans attention
18
, la justification quil
en donne signe la singularit de sa position. Dans ces situations de ccit
attentionnelle, remarque-t-il, toute rcurrence de lactivit neuronale nest pas
absente ; simplement, la diffrence des cas de perceptions verbalement
rapportes, la rcurrence est limite aux aires visuelles et ne stend pas aux
aires associatives fronto-paritales. Cela doit porter selon lui considrer
que la perception a bien t consciente, mme si elle na pas accd au
carrefour unificateur de la mmoire pisodique et de la verbalisation. Sa
dfinition initiale de la conscience comme processus rcurrent lui suffit
formellement laffirmer. Surtout, des exprimentations fines capables de
capturer au vol une perception transitoire, non mmorise long terme, au
moyen dun rapport lmentaire en temps rel de type presse-bouton, ont
montr que cette affirmation a quelque fondement
19
: les stimuli qui semblent
avoir chapp la conscience auraient simplement chapp au processus
dintgration et de mmorisation durable dun moment de conscience labile
(associ une mmoire iconique trs court terme). Le pourquoi de
lassociation de la conscience des rsonances neurolectriques globales ou
locales na certes pas t clair (le projet de recherche des thoriciens de la
rcurrence du premier ordre ne la dailleurs mme pas abord), mais poser
cette association comme prmisse a conduit faire quelques prvisions
exprimentalement testables et raisonnablement corrobores sur les
phnomnes et les signes cliniques prsums de la conscience.
Il en va en partie de mme des thories de la rcurrence dordre
suprieur. Celles-ci, on la signal prcdemment, supposent que la
conscience nmerge qu partir du moment o des reprsentations de
reprsentations se dveloppent, ce qui implique non seulement des
rcurrences neurolectriques simples dans les aires sensitives ou motrices
primaires du cortex crbral, mais aussi des rcurrences de rcurrences
couplant les aires sensitives ou motrices aux aires associatives fronto-
paritales. La stratification des rcurrences rend par ailleurs compte, dans ce
modle, de la multiplicit des niveaux de rflexivit, dont nous avons vu
prcdemment limportance pour une caractrisation psychologique
diffrencie de la conscience
20
. Si un second degr de reprsentation (la
reprsentation de la reprsentation perceptive primaire) permet lavnement
dune conscience simplement rflexive, cest--dire du sapercevoir que
quelque chose est peru, un troisime degr de reprsentation (la
reprsentation comme mienne de cette mta-reprsentation, son rattachement
un complexe didentification) est requis pour que se fasse jour la conscience
de soi ou conscience auto-rflexive
21
. Mais cette thorie, pour saffirmer
contre ses concurrentes, doit elle aussi dboucher sur des occasions de mise
lpreuve exprimentale. Lune de ses principales anticipations testables est
la dissociation entre la capacit accomplir des tches, et la conscience de
les avoir voulues et den suivre le droulement
22
: une telle dissociation est
systmatiquement prvue par la thorie rcurrente dordre suprieur, alors
quelle ne lest pas par les thories rcurrentes de premier ordre qui tiennent
dans certains cas la capacit sentir et agir pour coextensive la
conscience correspondante. Quen est-il de la validit de cette prvision ? Le
fait que les aires prfrontales et paritales du cortex crbral soient
habituellement actives dans les circonstances o la conscience est
verbalement dclare, et quelles ne soient pas actives dans dautres
circonstances o une action automatique est accomplie, ne suffit pas pour
corroborer la dissociation anticipe. Car, nous lavons vu, il peut arriver que
des dclarations de perception consciente soient recueillies transitoirement,
alors mme que les aires associatives fronto-paritales ne sont pas en activit.
Cest pourquoi un argument supplmentaire est avanc par les partisans des
thories rcurrentes dordre suprieur ; un argument ne reposant pas seulement
sur la dtection passive de dcharges neuro-lectriques, mais sur une
intervention active capable de dclencher de telles dcharges. Cet argument
est quune stimulation magntique transcrnienne applique sur une rgion
limite du cortex prfrontal suffit changer les rapports verbaux de
lexprience consciente sans aucunement altrer la capacit du sujet
accomplir les tches qui laccompagnent
23
. Les dterminants neuronaux des
actes de conscience verbalisables, concluent les partisans des thories
rcurrentes dordre suprieur, ne sont donc pas les mmes que ceux des
perceptions ou des actions primaires, contrairement ce quaffirment les
partisans des thories rcurrentes de premier ordre. Ces derniers seraient en
droit de rpliquer quil ne faut pas confondre les dterminants neuronaux
dune conscience rapportable a posteriori sur un mode verbal, stable et
mmoris long terme, avec les dterminants neuronaux de la conscience tout
court (qui peut prcisment ne pas passer le seuil de rmanence ncessaire
une verbalisation diffre). Mais cette distinction, dont il sera de plus en plus
question dans ce qui suit, tant encore rare, il nest pas tonnant que
largument de la divergence entre variation provoque du rapport verbal et
stabilit des comportements moteurs paraisse suffisant, aux yeux des partisans
des thories rcurrentes dordre suprieur, pour soutenir leur thse.
Concdons-leur alors provisoirement ce succs exprimental. Les thories
rcurrentes dordre suprieur ont-elles pour autant progress propos de
lorigine neurophysiologique de la conscience dans son intgralit vcue ? En
aucune manire, puisquon ne voit pas davantage pourquoi des rcurrences
globales stendant aux aires associatives corticales devraient saccompagner
dexprience consciente, quon ne le voyait avant pour des rcurrences
restreintes aux aires primaires sensitives. Il y a mme un supplment
darbitraire cet gard dans les thories rcurrentes dordre suprieur par
rapport aux thories rcurrentes de premier ordre. Car les thories de premier
ordre se contentaient de dfinir la conscience comme rcurrence de lactivit
neuro-lectrique de quelque rseau cortical que ce soit, laissant dlibrment
la raison de cette association postule dans une zone dombre. Les thories
dordre suprieur, en revanche, laissent entendre quelles peuvent fournir
quelques justifications sur ce point, parce quil est naturel de penser quune
mta-reprsentation, une reprsentation de la reprsentation, soit gnratrice
de conscience, plutt quune simple reprsentation. Elles considrent que cet
appel une sagesse commune propos du processus de rflexion est une
bauche dexplication de la conscience pense comme un se-savoir, mais
elles ignorent la question autrement abyssale de la gense du simple
savoir de lexprience pure. Or, si la gnration de conscience dans toute
sa plnitude (qui inclut lexprience pure) par la simple rcurrence locale des
dcharges neurolectriques est obscure, la mise en uvre de boucles
supplmentaires de rcurrences tendues najoute rien dautre cette
obscurit initiale quun supplment quantitatif ; et lon ne voit donc pas
comment cela pourrait suffire produire le saut qualitatif allgu du
strictement inconscient des aires sensitives et motrices primaires au conscient
(non seulement rflchissant, mais aussi prouvant la rflexion) des processus
incluant les aires associatives. linverse, comme le remarquent les auteurs
dun argument anti-rductionniste assez rpandu, dit du petit rseau
24
, les
mcanismes de rcursivit avancs pour expliquer la conscience sont
en principe implmentables sur des rseaux comptant un trs petit nombre de
neurones, alors que peu de chercheurs diraient sans doute de ces rseaux
quantitativement restreints quils sont associs une conscience. Dans ces
conditions, mieux vaut encore la fin de non-recevoir oppose par les
thoriciens de la rcurrence de premier ordre toute demande dexplication
de lengendrement neuronal de la conscience que ce faux sentiment de le
comprendre un peu, distill par les thoriciens de la rcurrence dordre
suprieur.
Indubitablement, une thorie de la rcurrence dordre suprieur qui fait
driver la conscience dune reprsentation de second ordre de plusieurs
reprsentations spcialises, localise de manire prdominante dans les
aires prfrontales, ajoute au compte rendu de la rflexivit un compte rendu de
la capacit de liaison gnralement considre comme lautre fonction
centrale de la conscience dans lconomie cognitive. Mais on obtient
davantage de prcisions concernant cette seconde fonction travers des
thories neurologiques de la conscience qui en font leur thme dominant. Cest
le cas de la thorie du global neuronal workspace (espace de travail
neuronal global) dfendue par Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux, qui
est lune des plus rpandues et probablement lune des mieux tayes
lheure actuelle. Selon elle, seuls accdent la conscience ceux des processus
mentaux qui, par-del lactivit neurolectrique des modules spcialiss du
cerveau, recrutent un vaste rseau de neurones stendant jusquaux rgions
associatives du cortex crbral. Cette thorie est lhritire de la thorie de
lespace de travail global de Baars
25
, et de son image de la conscience
comme une scne de thtre centrale o des acteurs mentaux dabord
invisibles (inconscients) dans leur coulisses spcialises, se rendent visibles
(conscients) sous lclairage de projecteurs rflexifs. Dehaene et Changeux en
ont impos une conception fortement dynamique impliquant la formation de
mta-rseaux dont lactivit est synchronise grande chelle, autrement dit
de vastes rseaux cohrents dans lesquels sont coordonnes les activits
neurolectriques des petits rseaux de modules spcialiss
26
. Ils ont
galement soulign limplication prfrentielle, dans cet espace de travail, de
certaines aires corticales paritales et prfrontales riches en neurones ayant
des connexions longue distance. Cette conception dun rseau actif tendu,
alternativement en formation puis en fragmentation, a permis de rendre compte
facilement de la notion de prsents effectifs au sens de William James
27
,
ces brefs intervalles temporels durant lesquels les perceptions sont ressenties
comme prsentes. Car, en application de cette notion, il ne peut pas tre
question dun flux continu de conscience, mais seulement de moments
cycliquement mergents puis vanouissants de conscience unifie
28
.
Les thoriciens de lespace de travail global et de la rcurrence dordre
suprieur se rejoignent sur un point important : cest leur reconnaissance du
critre quasiment universel de prsence de la conscience quest le rapport
verbal
29
. Le traitement conscient de linformation, crivent Dehaene et
Changeux, est dfini comme exprience subjective rapportable
30
. La
corrlation entre conscience et verbalisation, ajoutent Lau et Rosenthal
31
,
dcoule de lassimilation de la conscience une pense (verbalisable)
dordre suprieur. Ce critre dtermine et contraint conjointement ce que les
thories se donnent expliquer sous le nom de conscience (laptitude au
rapport verbal), ainsi que le genre de test prfrentiel quelles utilisent toutes
deux pour mettre leurs prdictions lpreuve. Cela limite du mme coup le
sens que lon doit donner la prtention quont les deux thories rendre
raison de la conscience (en les restreignant de facto rendre raison de la
capacit verbaliser), tout en ayant lavantage de leur offrir un terrain
commun dvaluation empirique et de comparaison mutuelle. Or, justement, la
thorie de lespace de travail neuronal global se distingue assez, sur ce plan,
de la thorie rcurrente dordre suprieur pour pouvoir tre soumise des
tests exprimentaux diffrentiels brve chance. La thorie de lespace de
travail global associe une conscience certaines activits perceptives,
linstar de la thorie rcurrente du premier ordre, dans la mesure o le
contrle de ces activits peut parfois tre rgi par le processus de connexion
neuronale longue distance et de dcharge synchrone haute frquence qui est
ici cens sous-tendre la conscience. La thorie rcurrente dordre suprieur,
en revanche, soutient que la prise de conscience des tches perceptives ou
motrices ne peut jamais survenir qu titre de phnomne additionnel,
lorsquun processus trs spcifique de rtroaction (la pense dordre
suprieur ) les a prises pour objet. De faon encore plus frappante, la thorie
de lespace de travail global tend associer la conscience aux fonctions
cognitives leves (comme la pense, le contrle centralis des mouvements,
etc.) pour la simple raison quelles mettent en uvre les vastes aires
dactivation neuronale de lespace de travail ; mais la thorie rcurrente
dordre suprieur requiert pour cela une boucle rflexive supplmentaire qui
selon elle nest pas toujours ralise, y compris lors dactivations corticales
massives
32
.
ct de ces prvisions testables mais non encore suffisamment mises
lpreuve, plusieurs consquences exprimentales spcifiques de la thorie de
lespace de travail neuronal global sont dores et dj bien corrobores.
Parmi les plus frappantes, on relve la prvision dun goulot
dtranglement ( bottleneck ) interdisant laccs simultan la
conscience des nombreuses activits mentales ou tches perceptivo-motrices
qui sont accomplies chaque instant par un sujet. Lorsque deux tches se
droulent simultanment, seule lune dentre elles doit pouvoir accder la
scne de la conscience , pour la simple raison que, si elle est parvenue
recruter son profit le grand rseau synchronis de lespace neuronal global,
ce dernier est entirement occup et donc indisponible pour toute autre
tche. La prvision a t teste avec succs dans de nombreux cas. Elle la
par exemple t dans lexprience de rivalit binoculaire
33
, au cours de
laquelle chaque il se voit prsenter une scne diffrente, et o pourtant seule
lune des deux scnes est dclare consciemment perue. Elle la galement
t dans une exprience o lon demande aux sujets dvaluer leur propre
temps de raction lors dune certaine tche, tandis quune seconde tche est
propose presque simultanment la premire
34
; ou encore dans les
expriences de ccit attentionnelle, o la thorie prvoit quun stimulus peut
chapper la conscience en raison de la concurrence que lui fait un autre
stimulus pour la possession de lespace de travail global
35
. Une autre
prvi si on testable de la thorie de lespace de travail global est
linaccessibilit la conscience des tches perceptivo-motrices, aussi
longtemps que leur activit neuronale associe, mise en vidence par des
moyens dexploration fonctionnelle comme la magnto-encphalographie,
savre limite des aires corticales primaires. Cest typiquement le cas dans
le premier quart de seconde de lapprhension sensible, durant lequel le vaste
rseau de lespace global na pas eu le temps de se mettre en place
36
, avec
pour consquence labsence daccs la conscience (cest--dire ici encore,
rappelons-le, aux fonctions qui permettent le rapport verbal) des informations
sensorielles, sans que lon puisse bien entendu exclure une conscience
transitoire et pr-verbalise comme celle que supposent les thories de la
rcurrence du premier ordre. Enfin, on peut signaler le compte rendu
convaincant, par la thorie de lespace de travail global neuronal, dun fait
psychodynamique connu de longue date
37
: que la conscience accompagne les
tches nouvelles, cratives, tandis que les tches routinires (pour lesquelles
une expertise a t atteinte depuis longtemps) se droulent inconsciemment.
Dans le cadre de la thorie, les tches nouvelles requirent la mobilisation de
toutes les aptitudes disponibles et leur centralisation dans lespace de travail
global, ce qui rend raison de leur accs la conscience et de lincapacit dans
laquelle sont les sujets den accomplir dautres simultanment. Au contraire,
chaque tche rptitive est prise en charge par une aire corticale ddie
pouvant fonctionner en parallle avec plusieurs autres, ce qui rend raison de
son excution plus rapide, y compris lorsque dautres tches sont accomplies
en mme temps.
Il y a en somme une concomitance frappante entre lactivation de lespace
de travail global neuronal et la venue manifeste (verbalisable) la conscience
des processus mentaux. Une concomitance qui est corrobore par des tudes
cliniques sur le coma et les tats vgtatifs, et qui a donc valeur prdictive
pour le mdecin ranimateur
38
. Cette concomitance est si dtaille, elle met si
bien en correspondance les diffrences entre tats conscients et les diffrences
de mobilisation de lespace global, quelle peut passer aux yeux de certains
pour une explication de la conscience. Mais cela ne suffit pas aux partisans de
la thorie de lespace de travail neuronal global, qui souhaitent slever,
comme ceux de la thorie rcurrente dordre suprieur, dun constat de
corrlation rgulire une imputation de causalit. Lespace de travail
neuronal, avec ses dcharges rythmiques de larges assembles de neurones,
est-il la cause, ou simplement le corrlat, de la conscience ? La rponse
cette interrogation parat simple obtenir ; il semble quil suffise de lui
appliquer le schma standard de la mise en vidence active dun lien de
causalit par lintervention exprimentale. De manire semblable aux
thoriciens de la rcurrence dordre suprieur, lapproche choisie consiste
tester les consquences dune stimulation magntique transcrnienne de
lespace de travail neuronal global. Or cette stimulation a un effet majeur :
elle est capable dans certains cas de faire brusquement disparatre la
perception consciente, verbalement rapportable, dune scne visuelle
39
. De l
conclure que le secteur (ou le rseau) neuronal stimul est la cause de la
conscience, dans toutes ses dimensions, y compris exprientielle ou
phnomnale , il ny a quun pas apparemment infime, et les thoriciens de
lespace de travail neuronal global le franchissent sans arrire-pense. Une
fois ce pas franchi, ils peuvent procder la manire de Lamme, en
convertissant leur corrlat neuronal de conscience en dfinition neuronale
de conscience, puis en sen servant pour dtecter la conscience chez des
tres encore incapables de rapports verbaux, comme les nourrissons
40
. Mais
une srie de questions dstabilisantes, esquisse prcdemment et sans cesse
amplifie dans les prochains chapitres, doit tre souleve ce propos :
quest-ce qui a t supprim par la stimulation transcrnienne ; lexprience
consciente tout court, ou son accs la plate-forme qui permet son intgration
dans une mmoire biographique long terme et en fin de compte sa
verbalisation ? Par ailleurs, en quoi peut-on infrer un rapport asymtrique de
causalit allant du cerveau la conscience, lorsque la capacit dagir sur le
mode de la causalit descendante , en induisant des transformations
crbrales par des intimations mentales, est tout aussi avre que la capacit
inverse relevant de la causalit ascendante ? Enfin, toutes les conditions
de lextraction des causes partir dune squence de phnomnes sont-elles
remplies dans le cas si singulier o leffet dsign est le non-objet, non-
proprit, et non-phnomne exprience vcue en premire personne
41
?
Admettons pour lheure que le rapport de causalit modeste, parce que
relevant de la troisime personne, entre le phnomne dactivation de
lespace de travail neuronal global et le phnomne daccessibilit mnsique
ou de rapportabilit verbale dun vnement mental ait t tabli. Cela suffit-
il affirmer quon a enfin lucid lorigine physique ou physiologique de la
conscience ? Pas davantage dans ce cas que dans les thories de la
rcurrence. Car on ne sait toujours pas en vertu de quoi une activit
neurolectrique distribue sur lespace de travail neuronal global engendre
lexprience consciente, et non pas seulement une connexion mcanique
obscure des informations sensorielles primaires avec les aires du stockage
mnsique et du langage. En labsence du moindre indice propos de cet en
vertu de quoi , toutes les interprtations du lien causal entre le phnomne de
dclenchement synchrone des neurones de lespace de travail et le rapport
dexprience sont permises. Y compris celles (comme les thories de la
rcursivit primaire) qui dissocient laccs ou le rapport verbal du fait
davoir une exprience consciente, et qui dnient ainsi toute pertinence pour
la question de la conscience aux consquences verbalises de la stimulation
magntique transcrnienne aussi bien quaux corrlations neuro-verbales.
Il satteste ici que, pour la thorie de lespace de travail global, comme
pour la plupart des autres thories neurologiques, le vrai dfaut paradoxal
quelle a lorsquelle prtend affronter le problme difficile de lorigine
physique ou physiologique de la conscience est son excs defficacit. Si un
lien dtaill entre lactivit coordonne de lespace de travail neuronal dune
part, et laccs cognitif ou les rapports verbaux dautre part, est tabli sur le
plan de la pure description objective, quelle raison existe-t-il de faire en plus
rfrence au vcu subjectif, ou au ce que cela fait dtre , de quelque
manire quon veuille le nommer ? La conscience au sens premier de ce qui se
vit en premire personne (et non pas seulement de ses manifestations
rapportables, audibles et visibles en troisime personne) ne devient-elle pas
simplement hors de propos parce quexplicativement inutile ? Et cela ne
devrait-il pas avoir pour consquence de relguer toute question son propos
dans des marges extrathoriques ? Comme lcrit Jeffrey Gray lors de son
examen de la thorie de lespace de travail global, Si le travail est dj fait
en utilisant un langage neuronal, pourquoi aurions-nous besoin de la
conscience pour le faire galement
42
? Largument qui a ouvert ce
chapitre est lancinant, et il reviendra encore : si lon est entirement satisfait
du compte rendu des fonctions cognitives attribues la conscience ainsi que
des signes objectifs allgus de conscience, la conscience au sens propre et
vcu ( phnomnal ) du terme ny a strictement aucun rle jouer ; et les
comptes rendus neurologiques nont donc gure de prise sur elle. Elle y
demeure mthodologiquement piphnomnale.
Seule la confrontation directe des prvisions de la thorie avec
lexprience vcue de ceux qui la comprennent, linstant o ils en
saisissent les consquences, a le pouvoir de lui confrer un certain crdit aux
yeux de ces sujets en tant que compte rendu complet de la conscience, y
compris de la conscience phnomnale . Cette situation favorable de
concidence entre une anticipation thorique et un vcu prsent peut par
exemple tre le fait de quelquun qui est en train de subir sur lui-mme la
stimulation transcrnienne voque, ou bien les tests de ccit attentionnelle ;
mais pas seulement. Il suffit de simaginer quon est le sujet dpreuve, et
quon vit les consquences prvues par une thorie comme celle de lespace
de travail neuronal global, pour en retirer limpression quelle rend raison
entire de la conscience. Nous nous demanderons plus bas quel sens il faut
attribuer ce fascinant pouvoir oblique quont les thories neurologiques de
la conscience de convaincre des tres conscients de leur pertinence, en dpit
de leur lacune fondamentale.
En irait-il autrement de lune des thories neurologiques les plus rcentes,
et les plus fascinantes, de la conscience : la thorie de linformation intgre
dfendue par Giulio Tononi ? Pour commencer, il faut remarquer que la
thorie de linformation intgre a une caractristique qui la rapproche des
thories de la rcurrence du premier degr : elle nexclut pas par principe
dassocier une conscience toutes sortes de processus neurophysiologiques,
sans gard au fait que ceux-ci soient ou ne soient pas de type rcursif
dordre suprieur , et quils occupent ou quils noccupent pas entirement
lespace de travail. Ce qui la singularise par rapport toute autre thorie est
quelle dfinit en plus une quantit de conscience associe chaque
fonctionnement neurophysiologique. Suivant la valeur dun certain paramtre
informationnel phi calcul sur les rseaux neuronaux, le degr de
conscience quelle attribue au sujet correspondant est susceptible de varier.
Des changements phylogntiques, ontogntiques ou pathologiques du degr
de conscience sont ainsi dclars pouvoir tre valus a priori,
indpendamment de la capacit des sujets concerns (qui peuvent tre des
enfants, des animaux, ou des patients comateux) fournir des rapports sur ce
quils vivent. Cela ne veut pas dire que cette valuation est compltement
dconnecte des chelles classiques de ractions aux stimuli et de
rapportabilit des expriences, mais simplement que la thorie de
linformation intgre prtend extrapoler lattribution dune quantit de
conscience au-del du domaine o ces chelles sont en pratique utilisables,
avec quelques bons indices algorithmiques lappui. Une autre
caractristique de la thorie est son aptitude dfinir un corrlat neuronal
spcifique de chaque qualit sensible ou volitive, semblant ainsi prendre de
front lun des arguments les plus utiliss par les critiques du rductionnisme
neurophysiologique : celui de lineffabilit des qualia. Le corrlat allgu de
chaque qualit est une distribution de probabilits des connexions dans le
rseau neuronal, instaurant un critre de diffrenciation avec les autres
qualits.
Mais que veulent dire exactement les deux mots-cls de la thorie de
Tononi : information et intgration ? Information renvoie ici non pas la
simple teneur informationnelle des entres sensorielles et des sorties
motrices, mais la capacit globale qua un tat fonctionnel crbral de
discriminer au sein des entres entre une multitude dinterprtations et de
rponses possibles. Intgration veut dire que ces informations (au sens de
stimuli adquatement discrimins) ne restent pas spares les unes des autres
mais sont unifies de manire permettre la rponse verbale ou motrice de
tenir compte du plus grand nombre possible dentre elles. Tononi affirme
alors quen valuant la teneur dinformation discriminante et le degr variable
de son intgration selon les rgions, il devient possible dattribuer une
quantit de conscience des rseaux neuronaux partiels rpartis dans le
cerveau, aussi bien qu divers tats physiologiques ou pathologiques de ces
rseaux. La thorie permet en particulier de comprendre que le rseau
oscillant cortico-thalamique dans son tat normal est accompagn de
conscience (comme latteste le rapport verbal), tandis que le rseau
crbelleux
43
, aussi riche en information mais beaucoup moins bien
interconnect (et donc moins intgr ), natteint pas le seuil quantitatif
justifiant de lui associer un plein corrlat de conscience. Il en va de mme des
rseaux sous-corticaux, dont lintgration nest gure meilleure que celle du
cervelet, et dont la quantit de conscience mesure par le paramtre
phi est par consquent suppose basse. Dans le domaine de la pathologie,
la thorie a galement proposer dimportants candidats au titre
dexplications, qui se retournent en autant de critres prdictifs lorsquon les
traduit en termes danalyse des signaux lectro-encphalographiques ou
magnto-encphalographiques. La thorie de linformation intgre prtend
par exemple expliquer la perte de conscience qui accompagne la crise
pileptique : durant cette crise, les rseaux neuronaux ont beau tre hautement
corrls, cest--dire intgrs, par des dcharges synchrones, ces dcharges
strotypes, tendues, et de forte amplitude sont extrmement pauvres en
capacit discriminative et donc en information. La thorie dclare expliquer
galement, de faon analogue (cest--dire par perte de capacit
discriminative), leffondrement de la conscience lorsque survient le sommeil
profond. Elle donne enfin une base thorique srieuse aux valuations de ltat
de conscience du patient par la mesure de paramtres
lectroencphalographiques, trs utiles pour surveiller un patient en cours
danesthsie gnrale, comme on le verra au chapitre suivant.
Ce genre de thorie, soulignent Edelman et Tononi
44
, permet bel et bien de
rendre raison de quelques proprits de la conscience, des structures de
certains de ses pisodes, des rapports entre ses tats et ses degrs. Il ne faut
cependant pas oublier, ajoutent-ils dans un passage particulirement lucide,
que ni dcrire ces structures de la conscience ni noncer les conditions
matrielles de la prsence de conscience ne revient au mme que les vivre
45
;
et quentre ce dcrire et ce vivre, un abme, un gouffre explicatif demeure.
Les conditions matrielles et fonctionnelles de facto dune exprience
consciente (certifie, ici comme ailleurs, par le rapport verbal) sont un rseau
neuronal diffrenci et intgr ; mais avons-nous pour autant compris lorigine
de ce conditionnement constat ? Pourquoi linformation intgre
saccompagne-t-elle dexprience vcue, au lieu de circuler dans le noir ?
Par quel tour de passe-passe linformation(z), ce concept mathmatique
dinformation que Shannon a dfini en mettant sciemment entre parenthses
toute notion de rception subjective ou de signifiance vcue
46
, permettrait-il
de recouvrer ce quil a d nier pour exister ? Par ailleurs, mme si on consent
suivre Tononi dans ses prmisses physicalistes, des zones dombres
demeurent. Le traitement intgr de linformation est-il suffisant pour
engendrer la conscience, ce qui ouvrirait la voie lirrsistible
perspective dune conscience artificielle ; ou bien dautres conditions
biologiques, cellulaires, voire microphysiques ralises dans les organismes
vivants mais pas dans les ordinateurs, sont-elles requises titre additionnel ?
Dans ce dernier cas, comment savoir lesquelles de ces conditions annexes,
sajoutant la structure dinformation intgre, sont galement
indispensables ?
Mais il y a encore une autre question drangeante soulever propos de
la thorie de Tononi, comme de toutes les autres thories neurologiques de la
conscience. Les caractristiques computationnelles de linformation intgre
ne suffisent-elles pas expliquer la complexit des comportements et des
rapports verbaux immdiats ou diffrs sans jamais avoir y ajouter
lingrdient surnumraire de la conscience phnomnale ? La quantit de
conscience de Tononi est-elle autre chose quune mesure de la probabilit
dexpression phontique ou gestuelle des justifications dune rponse
comportementale diffrencie ? Une thorie dont lefficacit prdictive ne
dpend en rien du fait de lexprience vcue (si ce nest comme un mot ajout
en bout de course pour reconnecter conventionnellement ses symboles ce
que nous savons tacitement avoir reu en partage) a-t-elle la moindre aptitude
rendre raison de lorigine de cette exprience vcue ? Ainsi surgit nouveau
la rengaine dsormais familire du caractre mthodologiquement
piphnomnal de la conscience primaire : non pas quon affirme que la
conscience primaire est intrinsquement un piphnomne du fonctionnement
neuronal, mais quen vertu de ce en quoi consiste la connaissance
neurologique, elle ne peut pas tre traite autrement. Daniel Dennett connat
bien lobjection piphnomnaliste, quil toise ironiquement. Il la compare au
son monocorde dun moulin prires
47
, tant on ne cesse de la rentendre
dans les discussions philosophiques propos de lexplication matrielle
suppose de la conscience. Et il sempresse de nier sa pertinence en
lassimilant un argument spcieux. Mais, bien entendu, la manire de
formuler largument prconditionne son valuation, et avec elle sa
dprciation. En quoi consiste exactement le moulin prires selon
Dennett ? Simplement noter que rien nempche dimaginer que ces
dcharges neurolectriques, ces processus cognitifs, ces schmas fonctionnels
et ces traitements intgrs de linformation se droulent sans tre associs la
moindre exprience consciente. cette remarque obsdante quil attribue
ses adversaires, Dennett rplique : Comment savez-vous que vous avez
imagin tout cela avec suffisamment de dtails, et avec suffisamment
dattention toutes les implications
48
? Comment tre srs que notre
imaginaire nest pas dficient, et quil ne laisse pas chapper un facteur
essentiel qui le contraindrait, sil le connaissait, associer une exprience
consciente aux mcanismes cognitifs ? Le contradicteur de Dennett est ainsi
rduit au silence, sous la lourde accusation davoir trop peu dimagination au
regard de la crativit illimite de la recherche scientifique future. Pourtant, le
problme est-il seulement de se rendre capable dimaginer un fonctionnement
neuronal avec ou sans conscience ? Tout ce qui a t dit jusque-l le dment.
Le vritable chec des thories neurologiques et fonctionnalistes de la
conscience face au problme difficile de son origine na rien voir avec
nos capacits imaginatives. Comme nous lavons dj compris en discutant de
lexprience de pense du zombie, cet chec dcoule, plus profondment, dun
choix inaugural fait par les sciences sur lesquelles sappuient ces thories ; un
choix si ancien, allant si compltement de soi, conditionnant de manire si
vidente le succs de ces sciences, quil semble impensable de le remettre en
cause. Ce choix, dordre existentiel aussi bien que mthodologique, est de
sen tenir de bout en bout lattitude objectivante, et de naccepter une
explication que si elle est compatible avec cette attitude. Le vcu ntant pas
un objet mais lultime prcondition des vises dobjet, il ne peut pas tre
question par hypothse de lui attribuer le moindre rle dans un schma
explicatif ; ni celui dun explanans ni celui dun explanandum. Ds lors, il
nest pas exact de dire que cest pour des raisons historiquement contingentes
que les neurobiologistes ne parviennent toujours pas expliquer que quelque
chose soit ressenti subjectivement plutt que rien. Il nest pas davantage exact
de dire que cest cause de leur manque dimagination que certains
philosophes sont incapables de se figurer comment on pourra parvenir un jour
une explication physicaliste de lorigine de lexprience consciente. En
vrit, comme lcrivait Erwin Schrdinger, le neurophysiologiste sest fix
davance comme rgle de bonne mthode de ne jamais faire intervenir un
lment de subjectivit dans son compte rendu. Un neurophysiologiste qui
nexclurait pas demble lexprience situe des procds explicatifs de sa
thorie de lesprit, serait considr non pas comme un chercheur ayant une
dmarche originale, mais comme quelquun qui aurait trahi le projet de sa
science
49
. Sil ne peut pas retrouver lexprience vcue la fin de son
parcours, cest donc quil la exclue par principe de sa thmatique ds quil
sest fix son propre devoir-tre professionnel. Et si le philosophe sceptique
peut dnoncer bon droit linanit du rve doffrir un compte rendu neuro-
cognitif du simple fait de lexprience consciente, cest quil sappuie sur une
analyse prcise du soubassement mthodologique de ces sciences. Un
argument dirrductibilit de la conscience un processus neuronal pourrait
aisment tre contr, comme cherche le faire Dennett, mais pas le
dvoilement dune prsupposition (comme celle dobjectivation) qui rgit
tacitement jusquau contre-argument.
Il est vrai que lexprience a encore un rle jouer dans notre rapport
aux thories neuroscientifiques de la conscience, mais ce nest pas celui dun
lment constitutif de leur discours ou dun objet dexplication pour elles.
Cest celui dune atmosphre
50
omniprsente qui rgit leur formulation
aussi bien que leur comprhension ; prcisment le genre de milieu
insaisissable, darrire-plan immontrable, dont Dennett cherche parfaire
lescamotage. Nous en reparlerons plus bas.
Cette critique de principe dsormais rcurrente natteint pas seulement le
projet dexplication neurobiologique du fait brut de lexprience consciente ;
elle menace aussi de restreindre considrablement la porte philosophique
des thses volutionnistes sur lmergence phylogntique de la conscience.
Quest-ce en effet quune thorie volutionniste de la conscience ? Cest une
variation sur le thme de la conscience considre comme un avantage
volutif, slectionn par la pression de lenvironnement. La conscience, selon
ce type de thorie, serait apparue un certain stade de lvolution des
espces, en rponse un dfi adaptatif. Que la conscience soit passe de
linexistence lexistence semble aprs tout raisonnable : une molcule nest
pas consciente, et un tre humain est conscient (en vertu du bon sens ou de
lvidence commune) ; la conscience a donc bien d surgir quelque part sur ce
chemin organisationnel qui spare la molcule de lhomme contemporain. Que
la conscience ait une valeur adaptative semble par ailleurs indispensable : si
ce ntait pas le cas, souligne-t-on, elle naurait eu aucune raison dapparatre
et de se maintenir ; elle doit donc reprsenter un facteur de la survie des
espces animales dotes dun systme nerveux complexe
51
. Pourtant, une fois
ces simples conjectures darwiniennes nonces, les questions et les doutes
saccumulent. Quentend-on exactement par conscience lorsquon affirme
quelle reprsente un avantage volutif ? Sagit-il de la conscience de soi, de
la conscience simplement rflexive, ou de lexprience pure ? Laquelle
dentre elles est un facteur favorisant la survie des espces ? Plus dlicat et
plus dcisif encore, lavantage slectif que lon suppose confr par la
conscience peut-il tre formul en termes objectifs ou fait-il ncessairement
intervenir ce que cela fait dtre ltre vivant slectionn ? Et, sil
apparat formulable en termes purement objectifs, quest-ce qui garantit que
cest bien la conscience au sens plein et entier du mot, la conscience en tant
que systme primaire et rflexif de vcus, qui est slectionne, et non pas
lune des fonctions cognitives quon lui attribue dans le contrle des entres
sensorielles et des ractions motrices ?
Pour dployer le problme dans toute son ampleur, examinons une varit
de thorie volutionniste de la conscience. Lune dentre elles suggre que la
conscience est apparue avec le clade des amniotes
52
, ces animaux dont
lembryogense est protge par un sac amniotique et seffectue grce cela
en milieu aqueux ferm. Les amniotes incluent les reptiles, les mammifres et
les oiseaux, mais pas les amphibiens ni les poissons. Cette thorie, et la ligne
de dmarcation quelle trace, sappuient sur une dfinition fonctionnelle de la
conscience et sur une caractrisation des comportements qui attestent la
prsence de la pseudo-entit conscience ainsi dfinie. La dfinition est
emprunte dautres auteurs : selon eux, la conscience est un systme
cognitif dordre suprieur permettant laccs aux tats intentionnels
53
; en
bref, une mtacognition. La conclusion qui en est tire est que la conscience
apparat avec le sentiment de plaisir ou de peine, puisque le plaisir, et au-del
de lui les motions, traduit une mtacognition lmentaire des stimuli
sensoriels. Des symptmes comportementaux du plaisir, de la peine, et de
lmotion, napparaissant quavec les reptiles et les oiseaux, et restant absents
chez les amphibiens et les poissons, cest, dit-on, ce carrefour volutif que
doit tre apparue la conscience.
On voit assez bien ici par quel stratagme, sans doute involontaire, les
thoriciens volutionnistes de la conscience cherchent emporter la
conviction, alors mme que leur raisonnement est biais davance. Ds quil
est question de plaisir, de peine, ou dmotion, le lecteur de ces mots
reconnat par connivence leur sens vcu, et il accepte sans rsister quon
lintgre une argumentation sur la conscience. Pourtant, la prmisse de
largumentation a exclu dautorit ce sens vcu : un systme cognitif dordre
suprieur donnant accs aux tats intentionnels relve ouvertement de ce que
Ned Block a appel la conscience daccs , par opposition la
conscience phnomnale . Autrement dit, ce dont il faut rendre compte,
savoir la conscience phnomnale , sest vu carter dentre de jeu en
dpit des faux-semblants connots par des mots comme plaisir ou
motion . Comment pourrait-on ensuite rintgrer cette conscience
phnomnale dans le champ du discours explicatif ? En toute rigueur, les
sentiments de plaisir et de peine devraient tre dfinis, dans le prolongement
de la thorie de la conscience adopte et de son prsuppos objectiviste,
comme de simples dispositions ritrer ou viter un comportement
moteur de contact avec un objet donn, y compris distance de la premire
rencontre. Et de fait, la disposition ritrer un contact avec une substance
nutritive ou un abri, et la disposition viter un contact avec le feu ou une
substance ltale, sont autant de facteurs favorisant la survie. Ce genre de
facteur comportemental a t ncessairement slectionn au cours de
lvolution. Mais en quoi la slection de dispositions comportementales
favorises par une fonction daccs dordre suprieur quivaut-elle la
slection dune conscience prouve en premire personne ? Il y a encore et
toujours, entre la fonction et son vcu, un gouffre qui ne peut pas tre
lgitimement combl. Dautres thories plus complexes, attribuant la
conscience la fonction de traitement unifi de linformation, ou encore la
capacit centraliser le contrle moteur en fonction dune reprsentation
diffrenciant les informations environnementales et les informations
proprioceptives
54
, tombent exactement sous le mme reproche. Lapparition
dun processus neuronal de traitement unifi des entres et sorties, ou dun
processus neuro-cortical de tri des informations intro- et extro-ceptives,
permettrait lui seul dexpliquer lavantage volutif des animaux qui en sont
dots. Pourquoi faudrait-il supposer en plus que le vcu dexprience
consciente associ cette unit ou ce tri possde par lui-mme une valeur
slective ? Quelle raison a-t-on dailleurs de donner crdit une thorie
particulire de la phylogense de la conscience, sachant que la varit des
dfinitions (partiellement arbitraires, et invitablement fonctionnelles) de la
conscience objective se traduit point par point en varit tout aussi grande du
lieu phyltique allgu de son mergence ? Selon la dfinition retenue de la
fonction conscience , la frontire entre son en-de et son au-del peut tre
trace aussi bas que la vie bactrienne
55
ou aussi haut que lhumanit dj
culturellement raffine du nolithique tardif
56
, en passant par les oiseaux ou
les cphalopodes
57
. Dans le premier cas extrme, la fonction conscience
est dfinie comme un tre-concern , ou une directionnalit , visible ds
la remonte des gradients de saccharose par les bactries ; et dans le second
cas extrme, elle est dfinie comme une fonction de rflexivit sur un soi
unifi, et comme une capacit de dlibration auto-cohrente.
La conscience phnomnale, la conscience en tant que simple exprience
vcue, est en somme si peu concerne par ces raisonnements volutionnistes
standard, quil est tentant de forger des thories alternatives relchant
considrablement le lien entre la conscience proprement dite et les processus
de complexification des organismes. Une premire ide non conventionnelle
consiste entriner le statut mthodologiquement piphnomnal de la
conscience, et forger un quivalent volutionniste de lpiphnomne. Cet
quivalent a t propos par Gould et Lewontin
58
pour des traits somatiques,
et il est aisment transposable au cas de la conscience. Inspir de
larchitecture, il a t appel un spandrel , ou coinon en franais.
Lcoinon est un simple remplissage de maonnerie, entre un arc et un cadre
rectangulaire, qui ne joue aucun rle ni esthtique ni de soutien, mais qui est
plac l titre de corrlat architectural contingent des deux structures quil
unit. En biologie volutionniste, un coinon est un trait qui surgit titre
de consquence marginale de traits slectionns pour leur valeur adaptative,
mais qui na par lui-mme aucune valeur adaptative. Se pourrait-il que la
conscience phnomnale ne soit elle aussi quun coinon , une
consquence secondaire de fonctions telles que la rcursivit mtacognitive et
la capacit de centraliser la rponse neuronale des sollicitations sensori-
motrices varies
59
? Nest-il pas pensable que la conscience phnomnale
nait par elle-mme aucune valeur adaptative, et que toute valeur de ce genre
soit rserve aux fonctions dont elle est le sous-produit marginal ? Sil en
allait ainsi, le dispositif central de lvolutionnisme, savoir le couple
mutation-slection, naurait strictement aucun claircissement offrir en ce
qui concerne lorigine biologique de la conscience phnomnale ; car il
faudrait encore expliquer la nature de laccident qui la fait prtendument
surgir des fonctions mtacognitives ou unificatrices. Mais il y a encore une
seconde option plus radicale, conforme la thse mtaphysique pan-
exprientialiste
60
: cest que la conscience phnomnale au sens le plus
lmentaire, le moins rflexif et le plus fugace dexprience pure instantane,
soit une donne absolument primitive de ce quil y a, quelle ait toujours-dj
t l. La pression de slection naurait alors nul effet, ni ngatif ni positif, sur
elle, mais seulement sur les fonctions de filtrage, de retour rcursif, ou de
synthse informative du cerveau qui se contente ici de moduler et de focaliser
(sans lengendrer ex nihilo, pas mme titre accidentel et secondaire) cette
forme inaugurale, pour ne pas dire rudimentaire, de conscience
61
. Sil en
allait ainsi, loin que le problme de la conscience ait tre abord dun point
de vue volutionniste, cest linverse lvolution qui devrait tre envisage
du point de vue vcu de ses myriades dacteurs passs, de leur sensibilit
consciente aussi rudimentaire et rapidement oublieuse delle-mme quon veut
se le figurer, de leurs gots amers mais brefs dchec, de leur pulsion de se
reproduire et de leur sereine jouissance de subsister. De toute vidence, aucun
raisonnement de type darwinien na le pouvoir de rendre intenable cette
proposition spculative. Elle nest ni plus ni moins inacceptable de ce point
de vue que la thse inverse, et au fond aussi spculative, selon laquelle la
conscience entire (et non pas seulement ses traits de rflexivit et de
cumulativit) merge une tape donne de la phylogense sous une pression
slective spcifique.
La question de lorigine (ou de la non-origination) biologique de la
conscience phnomnale savre en somme sous-dtermine par la thorie de
lvolution ; exactement autant quelle lest par les neurosciences. Cela non
pas en vertu dun quelconque chec des disciplines volutionnistes et
neurobiologiques, mais linverse en raison de leur succs le plus grand, qui
est de rendre de mieux en mieux raison des fonctions cognitives en des termes
intgralement objectifs.
Au moins, se rassurera-t-on, les neurosciences parviennent un rsultat
incontestable et assez remarquable lui seul, qui est de mettre en vidence les
corrlats neuronaux de la conscience, voire les sites crbraux dactivation et
dinactivation de cette mme conscience. Les paragraphes prcdents
semblent dailleurs avoir entrin par avance cette conviction : ny a-t-il pas
t question plusieurs reprises de corrlations neuro-exprientielles, comme
si celles-ci taient un fait inquestionn ? lexamen attentif, on sapercevra
pourtant que lexpression corrlat de la conscience na t employe que
sur le mode de loratio obliqua, en la plaant dans la bouche ou dans
lintention dun auteur cit ; et que seuls les corrlats neurologiques dun
moment de conscience, ou dune structure dacte mental conscient, ont t
pleinement pris au srieux. Pour comprendre cette rticence, il faut tirer toutes
les consquences du seul procd qui permettrait dtablir que l a conscience
est corrle de manire privilgie une configuration ou un processus
neurophysiologique spcifique. Ce procd ferait invitablement appel
lexprience en premire personne, et au rapport (essentiellement verbal) de
cette exprience. En labsence de toute exprience rapporte, on dirait que le
processus neurologique observ, ventuellement associ une activit
mentale complexe rvle par un comportement labor, relve du traitement
inconscient de linformation. Au contraire, en prsence dune exprience
atteste par un rapport, on considrerait que les lments par lesquels le
processus neurologique associ diffre du premier, sont les corrlats propres
de la conscience. Mais, derrire ces noncs mthodologiques apparemment
trs simples, se fondant sur lanalyse diffrentielle des phnomnes
neurologiques selon quils sont associs une exprience rapporte ou quils
en sont dissocis, se cachent de redoutables difficults de principe. Les
difficults sont de deux types symtriques, relevant des versants en troisime
et en premire personne du procd, et elles ont t formules respectivement
par des neurologues et par un philosophe de la psychologie.
En premier lieu, quest-ce qui permet au neurologue daffirmer quune
activit mentale non rapporte nest pas consciente ? De nombreux cas o
cette infrence semble presque manifestement incorrecte peuvent tre cits. Le
plus criant est celui du split-brain , ou cerveau sectionn, dans lequel on
interroge des patients ayant subi une section du corps calleux, principale voie
de communication entre les deux hmisphres crbraux
62
. Aussi longtemps
que cette voie de communication est prserve, il est facile dobtenir des
rapports verbaux propos de processus mentaux impliquant lactivit de
lhmisphre droit de leur cerveau (comme par exemple la perception de la
moiti gauche du champ visuel
63
). Mais, ds que lhmisphre droit est isol
des centres de traitement du langage que sont les aires de Broca et de
Wernicke, toutes deux habituellement situes dans lhmisphre gauche, aucun
rapport verbalement articul ne peut plus tre labor au sujet de ces mmes
processus mentaux. Dira-t-on que le patient est devenu brusquement
inconscient de son champ visuel gauche la suite de la perte des moyens de
transmission inter-hmisphriques ? Cette formulation du rsultat de la section
du corps calleux est soit maladroite, soit approximative ; car elle met en
regard une entit synthtique (le patient en tant quindividu), et une pseudo-
dtermination (la conscience) qui na a priori aucune raison de se voir
imposer le mme degr de cohsion que lentit choisie. Il est vrai que
lexpression unitaire de lexprience du patient, telle que la traduit le rapport
verbal, ne peut plus faire tat des perceptions du champ visuel gauche. Et il
est galement vrai que lactivit motrice du ct gauche du patient, gouverne
par la dynamique neurolectrique dune aire corticale de lhmisphre droit
(le gyrus pr-central droit), manifeste des rponses aux stimuli du champ
visuel gauche. Dira-t-on que ces dernires rponses sont devenues purement
rflexes, inconscientes, chez ce patient ayant subi la section de son corps
calleux, alors quelles ne ltaient pas chez le mme patient avant
lopration ? Une telle affirmation ne peut manquer de susciter le scepticisme,
car elle aurait son tour des consquences invraisemblables en termes de
corrlats neurophysiologiques de la conscience. Elle supposerait soit que la
conscience est sous-tendue par le flux dinformation traversant le corps
calleux, soit quelle requiert imprativement la coopration des deux
hmisphres. Lune des hypothses est incompatible avec les donnes qui ont
conduit aux thories de lespace global de travail ou de linformation intgre.
Et lautre hypothse implique une consquence aberrante : il est peut-tre
plausible quune perception du champ visuel gauche, traite par lhmisphre
droit du cerveau, et verbalement rapporte grce lactivit des aires du
langage de lhmisphre gauche, doive tout coup tre requalifie de non
consciente ds quune section du corps calleux a fait perdre la coopration
avec lhmisphre gauche ; mais alors, il faudrait peut-tre symtriquement
qualifier de non consciente, aprs section du corps calleux et perte de la
coopration inter-hmisphrique, une perception du champ visuel droit traite
par lhmisphre gauche du cerveau, alors que celle-ci continue tre
verbalement rapporte (puisque les aires du langage appartiennent la plupart
du temps cet hmisphre). Il est donc nettement plus raisonnable de proposer
une interprtation alternative de cette perte des rapports verbaux portant sur
une fraction de lactivit mentale au dcours de la section du corps calleux :
que lexprience consciente de lactivit impliquant lhmisphre droit est en
vrit maintenue, et quelle nest simplement plus accessible lunification et
la verbalisation. Une fois mnage cette premire exception au lien
organique entre conscience et rapport verbal, il semble cependant que la bote
de Pandore ait t ouverte. Quest-ce qui empche dsormais de considrer
comme conscientes quantit dautres activits mentales non accessibles au
rapport verbal, comme celles qui sont associes des processus neuronaux
cantonns aux aires primaires du cortex crbral ? Pourquoi ne pas remarquer
que ces activits mentales sont souvent isoles des processus dunification et
de verbalisation qui les rendraient accessibles, et quil est alors possible que
ce soit seulement cet isolement qui laisse croire ceux qui interrogent le
patient, quelles sont restes inconscientes ? Cest ici le choix initial dun
critre (celui du rapport verbal, ou dun type de comportement) qui dcide des
activits mentales quon va tenir pour conscientes ou pour inconscientes.
Par voie de consquence, des parties du cerveau ont t incluses ou exclues
des corrlats neuronaux de la conscience, au seul nom du mode dvaluation
de lexprience consciente ou de la notion de conscience dont on est parti
64
.
Un mode daccs la conscience dtermine entirement la dsignation dun
corrlat neuronal de cette conscience, malgr son caractre contingent ; et la
dlimitation des corrlats est donc tout aussi contingente que le critre quelle
prsuppose.
En deuxime lieu, quest-ce qui mautorise affirmer que lune de mes
activits mentales sest droule sur un mode strictement inconscient (quelle
na t lobjet daucune exprience, ft-ce une exprience en marge du
faisceau attentionnel, nayant pas accd la mmoire pisodique) ? Plus
largement, quest-ce qui me permet de trancher en premire personne entre
des thories de la conscience rare (restreinte au centre de lattention, ou
aux vnements verbalisables) et les thories de la conscience abondante
(ubiquitaire et dbordant de loin le noyau immdiatement disponible de
lactivit mentale place au centre de lattention) ? E. Schwitzgebel
65
dresse
un tableau dtaill et convaincant des franges progressivement vanouissantes
de lattention ; des expriences inchoatives (qui steignent peine nes) ; en
somme de vastes rgions dincertitude sur le caractre conscient ou
inconscient de nos propres processus cognitifs. Chacun de nous, en tant
quindividu entier se reconnaissant dans sa capacit actuelle se raconter, est
trs mal connect aux conditions qui lui permettraient de sassurer de tout ce
quil a vcu. Il dcoule de cela (a) que le dbat entre les deux classes de
thories de la conscience rpertories, rare et abondante , semble
indcidable en premire personne ; et (b) quil ny a pourtant par principe
aucune autre manire de le trancher quen sappuyant sur lexprience en
premire personne. Mais sil en va ainsi, cest la totalit du projet de
recherche des corrlats neurophysiologiques de la conscience qui est sap la
base. Si lon ne peut pas dire avec certitude, pas mme en cette premire
personne qui est sa mesure initiale et finale, dans quelles circonstances une
conscience a accompagn telle activit mentale, de quel droit dsignera-t-on
tel processus neuronal comme le corrlat propre de la conscience ? Ne
risque-t-on pas, si on passe outre cette limitation de principe, de mettre en
vidence les corrlats neuronaux de la focalisation attentionnelle, de laccs
la mmoire pisodique ou la verbalisation, de telle ou telle structure
dactivit mentale, de tout en somme sauf du fait brut de la conscience
phnomnale ? Certaines thories neurologiques de la conscience, comme
celle de lespace de travail global, ou des penses dordre suprieur,
savrent particulirement vulnrables cette intimation sceptique. Car elles
associent rigidement la conscience des processus tendus, ou mtacognitifs,
qui pourraient aussi bien conditionner les activits mentales complexes
aboutissant garder un vcu en prise, se focaliser sur lui, en faire un
pisode racont et mmoris, que laffleurement mme de ce vcu. Dautres
thories neurologiques de la conscience, comme celle de linformation
intgre, sont premire vue plus flexibles, parce que plus aptes agrer
lide de degrs de la conscience ; ces thories font donc place la
possibilit que des activits neurocognitives non verbalisables soient
conscientes de quelque manire attnue. Mais elles non plus ne sont pas
labri des critiques, car ce quil sagit dintgrer la thorisation, ce nest pas
tant une chelle quantitative de lexprience consciente, que la possibilit de
sa dispersion et de son ubiquit, seulement compenses par une centralisation
et une localisation des processus qui conditionnent sa rmanence, sa
rverbration rflexive, et son expression verbale.
Les remarquables succs de ces thories dans la prvision et lvaluation
des tats de vigilance, et dans lexplication des manifestations expressives
des vnements conscients (comme le rapport verbal et les comportements
intgrs), ne doivent donc pas nous faire oublier quen ce qui concerne non
seulement le compte rendu de lorigine de la conscience, mais aussi
lidentification du corrlat neuronal de la conscience en gnral, elles
reposent sur une base empirique troite et minemment incertaine. Cette
incertitude, de mieux en mieux perue par les chercheurs en neurosciences,
menace de rduire nant tout le savoir quon avait cru accumuler en trois
dcennies de travaux fonds sur une analyse par contraste entre les actes
cognitifs accompagns de rapports dexprience et ceux qui ne le sont pas.
Peut-on obtenir une preuve dfinitive que le prtendu corrlat neuronal de la
conscience nest pas en fait un corrlat des activits cognitives qui
prparent larrive dune information au carrefour de sa mise en commun avec
dautres affrences, ou des processus ultrieurs daccumulation mnmonique
voire dlaboration coordonne dune rponse motrice ? Le contraste prtendu
entre vnements mentaux conscients et inconscients peut-il tre diffrenci du
contraste entre les vnements mentaux qui ont accd aux processus
permettant leur articulation verbale et ceux qui sont demeurs en-de ? Une
discrimination exprimentale entre les corrlats neuronaux de la conscience et
les corrlats neuronaux des tapes qui la prcdent ou qui la suivent est-elle
simplement concevable ? Y a-t-il mme un sens parler de corrlat neuronal
spcifique dun vcu conscient, lorsque tout ce dont on peut sassurer (en
troisime personne du comportement comme en premire personne de la
rflexivit), ce sont des conditions tardives de lexpressibilit de ce vcu ?
Ces questions sont dsormais ouvertement poses par les quipes les plus en
pointe sur le projet dune thorie neurologique de la conscience
66
. Pire
encore, certains auteurs leur donnent une rponse fermement ngative, et se
dclarent peu troubls par cette apparente difficult. Assumant sans tat dme
le choix dun liminativisme mthodologique dont nous avons vu quil est au
fond inhrent leur science, ils rappellent que la neurologie peut parfaitement
se passer de toute rfrence la conscience, puisque rien ne lempche de
rendre raison dans ses propres termes biolectriques de la gense des
rapports verbaux qui servent de critre indirect lattribution dun pisode
conscient
67
. Ces chercheurs acceptent en somme ouvertement plutt que
tacitement les consquences du postulat de clture causale du monde
physique , et considrent ds lors lassociation dune conscience
phnomnale certains vnements physiologiques comme un fait contingent
chappant par principe toute prise par des moyens scientifiques
68
. Mais sil
en va ainsi, les thories fondes sur une identification hautement incertaine
des corrlats neurologiques de la conscience sont sapes leur base. Loin
de pouvoir atteindre une forme de connaissance de la conscience, elles ne
devraient tre considres que comme des guides pragmatiques limits pour
lactivit exprimentale en neurobiologie, et pour certaines demandes
dvaluation clinique de ltat de vigilance des patients ou de pronostic quant
leur capacit recouvrer une capacit relationnelle (cest--dire
comportementale et verbale).
Il reste une nigme rsoudre, et un malaise dissiper, que nous navons
fait jusque-l quvoquer de loin en loin. Dun ct, des thories
neurologiques de la conscience comme celles de lespace de travail global et
de linformation intgre sont incontestablement de bons instruments
dorientation pour affiner le diagnostic des patients en tat comateux ou
vgtatif
69
. Et dun autre ct, aucune de leurs prtentions pistmologiques
concernant la nature et lorigine de la conscience
70
na pu tre retenue
lexamen attentif de leur base empirique. Cette dissociation entre lefficacit
des thories et leur contenu pistmique allgu na rien dexceptionnel ; elle
stend aprs tout bien dautres domaines scientifiques
71
. Mais ce qui la
rend troublante ici est quelle sinscrit en faux contre limmense aptitude des
thories neurologiques de la conscience convaincre leurs lecteurs et leurs
auditeurs quelles ont un pouvoir dlucidation, voire de rvlation, et non pas
seulement une valeur instrumentale. Lorsque nous lisons ou entendons quun
processus neurophysiologique est isormorphe une structure mentale
familire dont nous avons souvent lexprience consciente, ou quen modulant
activement ce processus, la structure de lactivit mentale en question se
trouve modifie, il est presque irrsistible de percevoir cela non seulement
comme la mise au jour dun corrlat neuronal de cette structure, mais aussi
comme une confirmation de la nature biologique de la conscience dans toutes
ses dimensions, y compris exprientielle. Ainsi, la latence de quelques
centaines de millisecondes entre lactivation des aires visuelles primaires et
la gnralisation de lactivit neurolectrique lespace de travail global
correspond terme terme au dlai qui spare une exprience initiale
acatgoriale
72
de pure surprise, lors de limposition brusque dun stimulus
visuel, et une exprience ultrieure didentification et de catgorisation de
lobjet vu. Nest-il pas tentant den infrer quon touche ainsi du doigt la
source ultime des expriences ressenties de surprise puis de reconnaissance
dobjet ? Ainsi encore, la stimulation lectromagntique dune rgion du
cortex parital stabilise lexprience rapporte de lun des deux percepts
possibles, chez des sujets soumis lexprience classique de la rivalit
binoculaire
73
. Na-t-on pas limpression que la technologie
neurophysiologique a cibl le centre mme do surgit lexprience visuelle
consciente ? Passer de ces faits frappants de concomitance (aussi bien active
que passive) entre structures neuronales et structures dexpriences la
conviction profonde que le progrs de la neurophysiologie rend raison de
lexprience consciente en gnral semble un pas presque bnin faire. Il est
donc intressant de comprendre comment nous sommes pousss franchir ce
pas, et nous installer demeure dans la vision neuronale de nous-mmes,
malgr ses incontestables lacunes argumentatives.
Le sentiment de persuasion peine n se trouve en fait renforc par de
subtils procds dloquence, omniprsents dans les crits ou les exposs
oraux physicalistes, bien que rarement dclars et perus comme tels. Ces
procds reposent sur une alternance impromptue entre lexpos dun
processus neuronal dcrit objectivement et lappel complice une exprience
partage, telle quelle est vcue par les lecteurs et les auteurs de lexpos en
plus des sujets dexprimentation. L o la mthode des sciences
exprimentales exigerait en droit de sen tenir la confrontation de deux
domaines objectifs (le domaine du formalisme de rseaux neuronaux et le
domaine des comportements ou des rapports verbaux)
74
, une sorte de
phnomnologie primitive ne cesse dintervenir dans les marges rhtoriques
de la communication neuroscientifique. Une phnomnologie qui nest
cependant pas pleinement assume, puisque la valeur des descriptions de
lexprience en premire personne se voit souvent dnie, dans le texte mme
o elles jouent un si grand rle souterrain pour enraciner chez le lecteur le
sentiment de stre vu offrir une authentique explication neurologique de la
conscience
75
.
Concentrons-nous sur un cas tir de louvrage dj cit dEdelman et
Tononi, Comment la matire devient conscience. La plupart de ses chapitres,
et mme parfois de ses pages, sont construits sur le mme plan ternaire : (1)
nonc en troisime personne dune association entre lactivit neuronale de
rgions cortico-sous-corticales et le dtail des informations entrantes et
sortantes dans les canaux sensoriels ; (2) vocation des rapports verbaux de
sujets dexprimentation ; et (3) passage presque de but en blanc la narration
dune exprience commune utilisant la premire personne. la page 171 du
livre, par exemple, il est dabord signal que certaines variations rapides de
la rponse des aires corticales primaires (comme laire occipitale V1) o se
projettent les affrences sensorielles nont gnralement pas de correspondant
en termes de modulation dactivit des aires corticales dites suprieures .
Puis, le fait prcdent est rapproch dun trait de conscience rapport
abstraitement : celui de la stabilit des scnes visuelles, de lintgration en
elles des seuls invariants dclairage et de forme, plutt que de linfini
chatoiement des reflets et des profils. En fin de parcours, ce rapprochement
travaill entre structures neurologiques et phnomnologiques est soutenu
rhtoriquement par un rcit dexprience banale : lorsque nous voyons un
colibri battre des ailes, nous pouvons le reconnatre et le percevoir, quil se
dtache sur un fond de ciel ensoleill ou de feuillage, quil soit loin ou
proche . Que les invariants neurophysiologiques (tape 1) soient la base,
voire la cause, des invariants de notre exprience (tapes 2 et 3) semble
partir de l relever de la simple vidence, de ces vidences si instantanment
ressenties quelles se discutent peine. La premire personne faussement
plurielle du nous a fait irruption ltape 3, nous rendant par l acteurs de
la dmonstration et garants de son rsultat. Nous reconnaissons dans notre
exprience prsente ou dans nos souvenirs ce quoi il est fait allusion dans le
compte rendu scientifique (la stabilit des percepts par-del les variations
fugaces de luminosit et dorientation), et nous acceptons dans la foule que
larchitecture neuronale en rende entirement raison. La capacit que nous
avons de nous reconnatre dans les consquences exprientielles allgues
dun processus neurophysiologique, travers un procd facilitant qui
sappuie sur des rcits crits en premire personne du pluriel, est un
ingrdient capital du procd discursif quutilisent les partisans du neuro-
rductionnisme pour emporter ladhsion dun large public leur thse. Ils ne
font pas lconomie, dans la mcanique mme des raisons thoriques quils
mettent en uvre, de lassomption pr-thorique selon laquelle leurs
interlocuteurs et leurs lecteurs sont conscients, et capables didentifier au
sein de leur propre champ de conscience ce qui leur est prsent comme la
projection morphologique dune structure neuronale. Ainsi que cela a t
signal rapidement plus haut, largument en faveur de la possibilit pour une
thorie neurologique de rendre intgralement raison de la conscience est
incapable de fonctionner sans lapport de lingrdient extra-argumentatif
quest lexprience vcue de ceux qui le comprennent, linstant mme o
ils en saisissent les consquences. La thorie neurologique nest perue
comme explication de la conscience, y compris phnomnale, que dans et pour
l atmosphre consciente qui lenveloppe.
Attardons-nous un peu sur ce constat, car il est potentiellement renversant.
La thse de lorigine neurophysiologique de la conscience a besoin pour
simposer de sappuyer sur la conscience de ceux qui la formulent et de ceux
qui la comprennent en tant que fait originaire. Ltre-conscient est le
pralable dune argumentation en faveur de son caractre driv. Ds lors, la
proclamation physicaliste nest pas seulement menace par une subtile
contradiction existentielle quimpose la prsence tacite, ds son point de
dpart, de ce quelle prtend obtenir en son point darrive ; elle se heurte
une contradiction performative plus classique dans laquelle lacte de langage
mme qui sert la dfendre demande admettre ce quelle nie. Ces remarques
sont vertigineuses, parce quelles montrent comment nous sommes reconduits
au fait de lexprience prsente par le simple geste de ceux qui visent
lignorer au profit dobjets de connaissance et de matrise technologique ;
parce quelles rvlent que lextrmit argumentative de l attitude
naturelle opre comme un miroir invitant irrsistiblement au retour de
lattitude phnomnologique.
Et pourtant, les remarques prcdentes sont gnralement sous-values
par les penseurs physicalistes, qui les tiennent pour une circonstance
accessoire : bien sr, pourraient-ils rpliquer, nous nignorons pas que nous
crivons pour des tres vivants et conscients. Et aprs ? Y a-t-il lieu den
dduire quoi que ce soit au sujet de la rductibilit ou de lirrductibilit de
la conscience ? Le fait originaire que chacun reconnat, y compris ceux qui
ne le jugent pas comme tel, est-il donc vraiment marginal et vou rester
infrentiellement strile, comme le dclarent ces penseurs physicalistes ? Ce
fait ne serait tout dabord marginal que si sa reconnaissance ntait pas
absolument invitable. Or, cette invitabilit ne fait pas lombre dun doute.
La capacit qua largument rductionniste demporter la conviction serait trs
exactement nulle, et non pas simplement imparfaite, sil ne mettait pas en tte
de ses procds lappel connivence adress une autre conscience. Aucun
raisonnement faisant uniquement intervenir des descriptions de processus
objectifs naurait cette aptitude, car on sapercevrait immdiatement quil na
rien voir avec ce qui se vit et sprouve. Il se confirme partir de l que la
thse qui tient la conscience pour le produit final dun objet de connaissance
est auto-rfutante : elle se rfute elle-mme parce quelle doit imprativement
traiter la conscience comme sa condition initiale pour tre tablie aux yeux de
tous. Par ailleurs, si lon peut avoir limpression quil ny a rien dduire du
fait que la conscience est la condition premire de tout argument visant en
montrer le caractre ontologiquement secondaire, cest que ce quon peut en
infrer nmerge qua posteriori, partir de la rduction labsurde dun
raisonnement dirig contre sa primaut. Pour conclure quelque chose du fait
inaugural de la conscience, il faut en effet que ladversaire de son caractre
premier ait commenc par savancer sur le terrain de largumentation, quil ait
longtemps err dans la toile intrique des raisonnements ou des faits
exprimentaux relevant des seules sciences objectives, puis que, dans le but
demporter la conviction, il se soit finalement rsolu emprunter la seule
issue souvrant encore lui : lappel complicit des alter-ego conscients
dans une procdure dappropriation, par eux, des structures mises en
vidence par la recherche neurophysiologique. Alors, peut-on objecter
linterlocuteur physicaliste, tu nas pu en aucun cas viter de prsupposer le
fait de conscience que tu voulais dduire ; jen infre que ta conclusion nest
pas autorise, puisquelle sapparente une forme subtile de ptition de
principe. La thse de loriginarit de lexprience consciente satteste
ainsi (si tant est quil y ait besoin de lattester) lissue dun argument de type
lenctique, o son adversaire se dcouvre en conflit avec lui-mme par
lusage quil ne peut pas manquer den faire.
Une autre question troublante surgit de la confrontation dj voque entre
la remarquable efficacit prdictive des thories neurobiologiques et leur
absence de pertinence propos de la nature et de lorigine de la conscience.
Cette question, souleve ds le dbut de ce chapitre, est la suivante : quest-
ce qui autorise les mdecins sappuyer sur les thories neurologiques pour
attribuer la conscience des patients, en dpit du gouffre qui continue de
sparer ces thories dune explication de la conscience dans leurs propres
termes ? Nous avons jusque-l admis sans discuter quil en allait ainsi, et
quune thorie inapte rendre raison de lorigine de lexprience consciente
pouvait nanmoins tre un bon guide et un prdicteur efficace dans ce
domaine ; mais la rflexion cela ne va pas de soi, et des justifications sont
donc requises. Lusage ncessaire du prsuppos de lexprience consciente,
dans la dfense de lide que la conscience drive de processus
neurophysiologiques, suggre heureusement une piste pour rpondre la
question pose et pour affronter la perplexit qui va avec. Supposer la base
une conscience actuelle sest rvl tre la condition indispensable pour que
des processus neuronaux, et plus largement corporels, se voient reconnatre
par autrui comme base matrielle de la conscience. Autrement dit, la
conviction en faveur de la thse physicaliste ne nat pas de quelque pure
dialectique thortico-exprimentale en troisime personne, mais dune
argumentation impure adosse sur une exprience en premire personne
partage. Ne peut-on pas procder de mme lorsquil sagit didentifier quels
tres semblables nous sont encore ou ne sont plus conscients ? Nest-il pas
judicieux demployer un genre voisin de dmarche impure , faisant aussi
bien appel aux vidences communes de lexprience subjective quaux
donnes objectives de la neurologie, pour extrapoler la reconnaissance de
conscience autrui au-del de la circonstance ordinaire quest le dialogue au
cours dune vie veille ? Aprs tout, comme le souligne Merleau-Ponty, pour
se sentir en droit dinvestir de conscience un autre corps visible (un corps-
objet), il faut dabord que la conscience-mienne se dcouvre elle-mme dans
tous les aspects de sa condition, quelle se sache incarne en ralisant sa
dpendance lgard du corps propre
76
. Ce nest pas par une simple analogie
morphologique, ou par le fruit dun pur raisonnement physiologique, que je
suis port attribuer une conscience autrui ; cest mesure de la pleine
rversibilit que jai tablie entre vivre mon corps et voir son corps, entre
donner sens social mes gestes par lobservation de ses comportements et
comprendre ses comportements comme investis de la mme motivation vcue
que mes actes. Dans ce contexte, les explorations fonctionnelles
neurophysiologiques, interprtes travers des thories neurologiques de la
conscience, nont pas pour seul intrt de menseigner des vrits
dsincarnes sur lenvironnement objectiv ; elles me donnent en plus accs
un nouveau registre dincarnation
77
, une rgion jusque-l ignore de mon
corps propre. De mme que je perois mieux ce corps comme mien lissue
dun jeu de rciprocit gestuelle avec son corps, je peux mieux reconnatre ce
cerveau comme mien par appropriation de processus initialement tudis dans
le cerveau de lautre. Ayant ainsi saisi ma dpendance concrte, en temps
rel, lgard dun cerveau-propre , je me juge en mesure dinvestir de
conscience un corps dot dun cerveau-objet, pour peu que celui-ci manifeste
des comportements neuronaux semblables ceux de personnes vigiles
avec qui jai en commun le prsuppos dune exprience consciente. Les
stratgies mdicales dvaluation diagnostique et dabord thrapeutique des
tats de conscience altrs sappuient donc sur ltre-conscient actuel, au
moins autant que sur des connaissances neurologiques abstraites. Elles
relvent dans cette mesure de ce que jai appel antrieurement une simple
technologie de lincarnation
78
, et non pas dune science au sens le plus
exigeant du terme. Mais cela ne constitue en rien un obstacle leur
application. Que ces disciplines ne puissent pas tre considres comme des
sciences objectives du pseudo-objet conscience , quelles voluent
ncessairement en funambule sur ltroite interface de chair entre lprouv et
le vis, loin dtre un frein leur mise en uvre, est la condition de leur
efficacit.
QUESTION 10
Anesthsie, sommeil,
coma : que suspendent-ils ?
Fermer de temps en temps les portes et les fentres de la
conscience ; demeurer insensible au bruit et la lutte que
le monde souterrain des organes notre service livre pour
sentraider ou pour sentre-dtruire [] voil, je le rpte,
le rle de la facult active doubli.
F. Nietzsche
Lanesthsie gnrale est un terrain idal de mise lpreuve des
conceptions philosophiques et neurologiques de la conscience, parce quelle
est contrainte en faire un usage pratique. Pour un mdecin anesthsiste, une
bonne thorie de la conscience est celle qui lui offre des critres daction,
indpendamment de sa capacit ou de son incapacit rendre raison de la
singularit dune pseudo- proprit qui ne sapprhende quen la vivant.
Lanesthsiste a besoin dorienter son action dans deux circonstances prcises
de son travail : linduction de la perte de conscience, et le contrle de sa
profondeur en temps rel. Ses deux questions directrices portent (1) sur le
choix des meilleures combinaisons dagents chimiques et des doses permettant
dobtenir linsensibilisation du patient, et (2) sur la possibilit pour lui, une
fois le protocole pharmacologique choisi, de sassurer chaque instant que le
patient nprouve aucune souffrance tout en demeurant dans une zone de
scurit physiologique. Si ces questions ont lair simples et troitement
techniques dans leur formulation, elles suscitent immdiatement une foule de
questions subsidiaires et dnigmes dfinitionnelles qui signalent
limpossibilit de mettre compltement entre parenthses les interrogations de
principe. Ds lors, la manire dont la discipline anesthsiologique ngocie les
rapports entre son besoin de prescriptions concrtes et sa rflexion sur le but
et le sens de son action, devient un aliment prcieux pour la philosophie de
lesprit.
Plusieurs difficults marginales de la pratique de lanesthsie gnrale
sont philosophiquement pertinentes. Tout dabord, que recherche-t-on
exactement dans lanesthsie gnrale, provoque par divers agents
chimiques, tantt des inducteurs administrs par voie veineuse comme le
propofol et divers sdatifs, tantt des agents de maintien administrs par voie
respiratoire comme lisoflurane, le svoflurane ou le xnon ? Labsence de
sensations douloureuses, bien sr ; ou plus largement, pour y parvenir,
labsence de sensations tout court, labsence globale de sensibilit et
danxit, labsence de saisie de quoi que ce soit, y compris des sensations
nociceptives et des affects. Cest dans cette mesure que lon dit rechercher
labolition de la conscience du patient. Mais ds que cet objectif a t
formul, on saperoit quil nest pas si vident ou si tranch quil en a lair.
Aprs tout, lanesthsie ne doit pas exclure a priori des formes de conscience
comme le rve
1
ou les hallucinations, pour peu quelles soient suffisamment
dissocies des peurs ou des souffrances quil sagit dviter. Ny a-t-il pas
des formes ou des degrs varis de conscience, et le vrai but de lanesthsie
nest-il pas de rechercher un degr la fois minimal et a-pathique de la
conscience plutt que son abolition complte ? Quoi quil en soit, que
lanesthsiologiste recherche la perte rversible ou la minimisation contrle
de la conscience, il lui faut affronter une deuxime grande difficult. Quelles
sont les cibles (uniques ou multiples) des produits anesthsiants dans le
systme nerveux central ? Peut-on prvoir quel sera le type et lintensit de
leffet anesthsiant dune certaine molcule daprs les rgions anatomiques et
cellulaires modifies par elle ? De toute vidence, pour quune telle prvision
soit possible et quon dpasse le pur empirisme des dbuts de la science
anesthsiologique, il faut savoir quels sont les effets neurophysiologiques
prcis quon doit rechercher, et, pour cela, quon ait une certaine
connaissance des relations entre ltat de conscience des patients et le
fonctionnement de leurs centres crbraux, voire de leur organisme entier.
Le problme est qu linverse, lanesthsie, plus encore que le sommeil
et les tats vgtatifs ou comateux, est lune des meilleures sources possibles
dinformation sur ces relations entre le niveau global de la conscience et les
processus neurophysiologiques. Car lanesthsie a lavantage sur le sommeil
et le coma dtre quantitativement contrlable par lintervention mdicale, et
facilement traable par ses points dimpact molculaires. Ainsi, les progrs
de lanesthsiologie savrent conditionns par la mise en uvre dune sorte
de cercle hermneutique, dans lequel lamlioration des protocoles
pharmacologiques dpend de la connaissance des corrlats neuronaux du
niveau global de conscience, tandis que cette connaissance dpend
rciproquement en bonne partie de llucidation du mode de fonctionnement
des protocoles pharmacologiques actuels. Le cercle hermneutique est
universel dans la dialectique ddification des sciences de la nature (sous la
forme spcifique dun cercle pistmologique
2
). Mais ce cercle-l ne
ressemble aucun autre, parce quil est cartel entre son vrai sens, qui est
dtablir une dpendance rciproque entre la connaissance neurologique et
lexprience vcue, et son idal, qui est de se ramener une dpendance plus
banale entre la thorie neurologique et lexprimentation sur le systme
nerveux.
Telle est la vraie pierre dachoppement des tudes sur lanesthsie, et elle
touche de trs prs la philosophie. Dun ct, leur idal dobjectivit est
mthodologiquement souhaitable. Car, si lon veut tudier les dtails de la
corrlation entre les processus neurophysiologiques et ltat de conscience
avec toute la rigueur dun protocole exprimental, il faut imprativement
disposer de critres objectifs pour affirmer quun patient sous traitement
anesthsiant est conscient ou pas, et plus finement pour valuer son degr de
conscience. Dun autre ct, pourtant, cette ambition demeure inaccessible,
puisquil nexiste aucun critre indiscutable de ce type. Tout ce dont on
dispose, nous lavons souvent soulign, ce sont des signes de conscience plus
ou moins indirects, ambigus, et sans cesse soumis la possibilit dune
rvision dramatique ; dramatique est le mot qui convient ici, parce que ce qui
est en jeu nest autre que la survie ou au moins le bien-tre des patients
oprs. Quil ny ait pas de critre objectif absolument irrcusable du degr
de conscience subjectivement prouv par quelquun na rien dtonnant,
bien sr ; mais cela reste incompltement apprci par les mdecins
anesthsistes et ranimateurs qui pensent parfois disposer de signes non
ambigus et exprimentalement attestables. Lorsquils admettent demi-mots la
carence dnonce, cest travers une remarque latrale sur le caractre
ncessairement secondaire des signes objectifs quils recherchent ;
secondaire, justement, un point dancrage subjectif. Tout signe objectif de la
conscience dun patient, remarquent-ils juste titre, est suspendu un index
ultime qui nest autre, encore et toujours, que le rapport dexprience. Le
rapport peut tre extrmement succinct, il peut se rduire un geste, il peut
mme arriver plus tard que le moment dexprience dont on veut sassurer,
mais il savre absolument indispensable en fin de parcours, dans lvaluation
clinique du degr de conscience au moins autant que dans les mises
lpreuve de thories neurologiques de la conscience. Cest vrai dans le cas
de lvaluation clinique du coma et des tats vgtatifs, puisque ici la seule
mthode fiable que nous ayons pour dterminer si un autre tre est conscient
est de le lui demander
3
. Cest galement vrai dans le cas de lanesthsie
gnrale o, lorsquon sinterroge pour savoir comment dtecte-t-on la
conscience ? , le constat auquel on aboutit bon gr mal gr est que ltalon-
or (de cette dtection) consiste demander verbalement au patient de
rpondre sous la forme dun mouvement simple
4
. De laveu mme des
anesthsistes-ranimateurs les plus fascins par les progrs des technologies
dexploration fonctionnelle neurologique, par consquent, le rapport en
premire personne reste la mesure ultime laquelle tous les autres signes de
prsence de la conscience chez un tre vivant sont compars. Cela se
comprend, bien entendu, parce que ce quil sagit de dtecter nest par
dfinition accessible quen premire personne.
Mais cela impose aussi de strictes limites, et corrlativement des
contraintes pistmologiques, la reconnaissance de ltat de conscience des
patients anesthsis. On doit en effet rappeler nouveau ici que, pour quun
rapport dexprience soit possible, un certain nombre de conditions
dintgrit physiologique doivent tre remplies ; et que ces conditions ne se
confondent pas ncessairement avec celles quexige la simple persistance
dune exprience consciente. En premier lieu, si le rapport doit intervenir
dans limmdiat, il faut que le patient soit capable de prononcer quelques
mots ou de mouvoir une partie de son corps en rponse coordonne une
sollicitation complexe. Il est vrai quon peut anticiper que des avances
technologiques permettront bientt de saisir directement le rapport verbal la
source, cest--dire dans les aires motrices corticales de larticulation sonore
(ou dans dautres aires motrices) ; mais mme dans ce cas, des contraintes
existent, puisquil faut au minimum que les connexions entre (a) les aires et
processus crbraux que lon suppose corrls une exprience sensible
consciente, et (b) les aires crbrales motrices et les processus corticaux pr-
moteurs qui peuvent tre mis en uvre pour amorcer une rponse neuro-
performative aux questions du mdecin ne soient pas interrompues. En
second lieu, si lon doit se contenter dun rapport rtrospectif, par exemple
dun rapport post-opratoire, il faut que le patient ait gard une forme, si
possible explicite, de souvenir de ce dont il a t conscient dans le pass
proche ou lointain de lopration chirurgicale. Nous reparlerons plus bas, en
dtail, de cet aspect crucial de toute approche de la conscience en phase
danesthsie, quest la mmoire.
Que peut-on dire prsent de la conscience du patient dans les cas o ces
conditions physiologiques daccs ne sont pas remplies ? Peut-on se contenter
de remarquer que lorsque les divers lments de la chane qui va de
lexprience son expression articule se trouvent dconnects les uns des
autres, la notion mme dune conscience attribuable un individu (au sens
tymologique dindivisible) ne sont plus remplies ? Dans cette situation
extrme, compltement trangre aux normes de la communication
quotidienne, na-t-on pas au contraire le devoir thique (formul au
chapi tre V) de se demander sil y a encore, corrle certains
fonctionnements neurophysiologiques rests intacts, de lexprience
consciente, de lexprience vcue mme si elle nest pas vcue par ce
quelquun dans son intgrit ? Sans doute y a-t-il encore un sens se le
demander par rfrence la possibilit quun rapport soit obtenu
ultrieurement, lhorizon dun futur indtermin : la mmoire peut tre
temporairement inaccessible sans avoir t bloque lors de la phase de
constitution des souvenirs, le patient peut tre momentanment inerte ou avoir
ses centres neuro-linguistiques passagrement coups du reste du systme
nerveux, ltat de la technologie dexploration fonctionnelle neurologique peut
nous rendre provisoirement incapables dobtenir des rapports pr-verbaux de
patients superficiellement non ractifs.
mesure quon augmente par la pense lcart entre lincapacit actuelle
et la capacit future (quelle soit biologique ou technologique) dobtenir un
rapport dexprience consciente de certains patients, on aboutit cependant un
nouveau problme philosophique appel le problme du zombie-inverse
5
.
Tandis que le problme du zombie nous confronte la possibilit thorique
dtres ayant un comportement identique au ntre mais aucune exprience
consciente associe, le problme du zombie-inverse nous force envisager le
cas dtres nayant aucun des comportements qui caractrisent normalement
l e s personnes conscientes, mais vivant des expriences conscientes
strictement et perptuellement inexprimes. Contrairement au problme du
zombie, qui est un comble dabstraction parce quil voque une configuration
du monde dont toutes les voies daccs pistmique ont t par principe
coupes (la zombitude ntant constatable ni de lextrieur ni de
lintrieur), le problme du zombie-inverse est minemment concret parce que
(a) il esquisse un programme de recherche de comportements et dvnements
physiologiques identifiables comme signes de plus en plus subtils de la
prsence dune exprience consciente, et (b) il fait rfrence des tres qui
vivent une exprience et qui y ont donc pistmiquement accs, mme si
(temporairement ou dfinitivement) ils ne peuvent le faire savoir personne.
Nous pouvons dire a posteriori que la plupart des patients victimes dun
rveil danesthsie silencieux durant leur opration chirurgicale, ainsi que
ceux qui sont atteints dun locked-in syndrome (cest--dire dune lsion
du tronc crbral bloquant toutes les voies motrices sans affecter la
conscience du patient inerte), correspondent, tant que leur exprience demeure
ignore faute de signes probants, larchtype du zombie-inverse . En
rsum, le problme du zombie-inverse fait nouveau signe vers une aporie
philosophique coutumire (comment dtecter objectivement lexprience
subjective ?), et il trace en mme temps une ligne dinvestigation crdible,
prometteuse, et cruciale sur le plan mdico-thique : celle qui consiste
identifier des signes objectifs ayant une telle capacit de prdiction des
rapports dexprience susceptibles dtre recueillis dans un futur indfini,
quils peuvent idalement servir de substituts ces rapports. Sous cette forme
pratique, le problme du zombie-inverse sous-tend les deux premires
difficults subsidiaires de lanesthsie gnrale. Dune part, si lon veut
valuer leffet rel et dsirable de lanesthsie gnrale en matire de
modulation de ltat de conscience des patients oprs, il faut disposer de
procds dvaluation de cet tat de conscience, y compris pendant les
priodes o les moyens normaux dobtenir un rapport dexprience en
premire personne sont indisponibles. Dautre part, si lon dsire savoir par
avance quelles cibles neurologiques il est souhaitable datteindre par le biais
des agents pharmacologiques anesthsiants, il faut avoir accumul une
connaissance suffisante des corrlats exprientiels de la stimulation ou de
linhibition des divers centres et processus crbraux ; et pour cela tre
capable dvaluer des niveaux de conscience altrs par ces interventions.
Cest donc essentiellement autour du problme du zombie-inverse, ou de
la dtection des divers degrs de conscience des patients anesthsis ou
comateux, que ce chapitre va se dvelopper. La discussion de la premire
difficult subsidiaire de lanesthsie gnrale (celle de leffet constat et
souhaitable de lanesthsie sur la conscience) sera purement et simplement
incluse dans la rflexion sur le problme du zombie-inverse. La seconde
difficult, en revanche, (celle des cibles anatomiques et fonctionnelles des
produits anesthsiants), va faire prsent lobjet dune rflexion prparatoire.
Repartons de la premire subdivision des thories neurologiques de la
conscience propose au chapitre prcdent. Suivant la vieille thorie des
localisations crbrales, dont la forme moderne remonte aux tudes clbres
de Paul Broca sur les corrlats anatomiques de laphasie
6
, et dont la critique
la plus aigu est due Kurt Goldstein
7
, la chose laquelle on pense
immdiatement lorsquon cherche un corrlat neuronal de la conscience et de
ses degrs est un ensemble de rgions spatialement circonscrites du systme
nerveux central. Lors dune seconde valuation, on peut galement proposer
dassocier lexprience consciente une configuration neurologique
spatialement rpartie, ou bien encore une organisation spatio-temporelle
des vnements neurophysiologiques. Dans le premier cas, la cible directe ou
indirecte des produits anesthsiants devrait tre une zone anatomique prcise,
tandis que dans le deuxime et le troisime cas elle concernerait un certain
mode de fonctionnement du systme nerveux central, altrable travers une
action diffuse des drogues.
Un pralable pour comprendre le mode daction des produits
anesthsiants est donc de revenir rapidement sur la structure anatomique
locale du cerveau et sur ses systmes neuro-fonctionnels distribus.
Parmi les rgions anatomiques pertinentes, on peut numrer dans lordre
ascendant des structures encphaliques : les formations rticulaires du tronc
crbral comme le locus coeruleus, impliqu dans lendormissement ; les
divers noyaux de lhypothalamus responsables des rythmes circadiens et du
dclenchement du sommeil (comme le noyau tubromamillaire de
lhypothalamus postrieur) ; lhippocampe (connu pour son rle crucial dans
la mmorisation) ; lamygdale (avec ses corrlats dans la rgulation
motionnelle) ; le thalamus (dot de nombreuses connexions sensorielles) ; et
enfin plusieurs rgions du no-cortex crbral, comme le prcuneus (portion
postro-mdiane du cortex parital cache entre les deux hmisphres
crbraux et implique dans diverses fonctions, comme la mmoire
pisodique), ou bien de vastes aires du cortex temporo-parital considres
comme secondaires et associatives (par opposition aux aires sensorielles
primaires et projectives, dont lexemple-type est laire V1 du cortex
occipital).
Les systmes fonctionnels globaux du cerveau, pour leur part, sont
essentiellement au nombre de trois, selon la description quen donnent
Edelman et Tononi
8
:
1) Un systme thalamo-cortical dinterconnexion des diverses aires
spcialises, qui opre sur le mode de laction rciproque et cyclique (ce
que les auteurs appellent la rentre ) ;
2) Un systme de cblage unidirectionnel entre le cortex crbral et
des dpendances anatomiquement spares comme le cervelet (impliqu
dans la rgulation fine de la posture corporelle et des mouvements), ou
lhippocampe (impliqu dans la mmoire) ;
3) Un systme de modulation densemble du niveau dactivit neuro-
lectrique et neuro-chimique du cerveau (ou systme de valeur ),
compos de quelques noyaux du tronc crbral ainsi que de
lhypothalamus, dont les neurones projettent leurs axones en ventail dans
la plupart des aires crbrales. Ces axones sont termins par des synapses
qui scrtent divers neuro-mdiateurs chimiques tantt activateurs tantt
inhibiteurs des neurones environnants, comme la noradrnaline,
lactylcholine, ou le GABA (Gamma Amino-Butyric Acid en anglais).
Lorganisation fonctionnelle des systmes crbraux permet de
comprendre immdiatement que, mme au cas (improbable) o il existerait un
centre de la conscience unique, les produits anesthsiants pourraient
parvenir supprimer ou affaiblir sa fonction suppose par plusieurs biais :
non seulement en affectant directement sa physiologie, mais aussi en agissant
sur les centres modulateurs du systme de valeur qui sy projettent, via
leur fixation sur certains rcepteurs protiques spcifiques des neurones
correspondants
9
. Cette dernire possibilit est dautant plus crdible quelle
suppose dintervenir sur des centres inducteurs et rgulateurs du sommeil, ce
qui va dans le sens de lapprciation superficielle selon laquelle tre
anesthsi, cest tre endormi . Elle est en partie (mais en partie
seulement) taye par de nombreuses tudes neuro-chimiques du cerveau
durant les diverses phases du sommeil, et sous leffet de divers produits
anesthsiants.
Le cycle veille-sommeil met en jeu les formations rticulaires du tronc
crbral et certains centres hypothalamiques, qui interviennent successivement
en secrtant leurs mdiateurs spcifiques dans le cortex pour maintenir
lveil, induire le sommeil profond ou promouvoir le sommeil
mouvements oculaires rapides (associ aux rves les plus complexes et
les plus organiss). Plusieurs drogues anesthsiantes ont prcisment pour
cible prfrentielle ces formations. Cependant, leurs effets sur ces cibles sont
assez diffrents de ceux qui seraient ncessaires pour provoquer le sommeil
selon chacune de ses deux phases principales. Lanesthsie gnrale
lisoflurane a par exemple pour consquence une baisse considrable de la
concentration locale du neuro-mdiateur GABA dans trois structures
crbrales : la formation rticulaire du pont crbral, laire hypothalamique
postrieure, et le prosencphale basal
10
. Par contraste, le sommeil
saccompagne de variations de concentration de ce neuro-mdiateur ajustes
selon ses phases successives. Le sommeil profond, sans mouvements
oculaires rapides, est associ des concentrations maximales de GABA dans
laire hypothalamique postrieure et des concentrations intermdiaires dans
la formation rticulaire du pont crbral. Le sommeil onirique, avec
mouvements oculaires rapides, est en revanche associ des concentrations
basses de GABA dans laire hypothalamique postrieure ainsi que dans la
formation rticulaire du pont crbral. Lveil, rfrence commune,
saccompagne pour sa part dun niveau lev de GABA dans la formation
rticulaire du pont crbral et le prosencphale basal, mais dune
concentration basse du mme neuro-mdiateur dans laire hypothalamique
postrieure. Tout se passe comme si lisoflurane, produit anesthsiant
rpandu, provoquait une dpression gnrale, non diffrencie, des activits et
des concentrations correspondantes en GABA, alors que chacun des tats de
conscience normaux, veille ou phases du sommeil, correspond une
modulation fine en concentration et en rpartition spatiale du neuro-mdiateur.
La diffrence des consquences psycho-cognitives est galement
considrable, puisque lanesthsie gnrale empche radicalement lveil
quelles que soient les stimulations de lorganisme (ce qui est souhaitable pour
viter que le patient ne se rveille sous leffet de la lsion provoque par
lintervention chirurgicale), tandis que la possibilit dun rveil est conserve
durant le sommeil, avec des seuils dintensit variable des stimuli selon ses
phases. Une seconde diffrence cruciale, nous le verrons, est que le sommeil
favorise la consolidation de la mmoire long terme alors que lanesthsie a
presque toujours un effet amnsiant.
Dautres centres du systme nerveux central ont t jugs capables de
servir de cible privilgie daction aux agents anesthsiants. Cest le cas du
thalamus, dont le mtabolisme est fortement diminu sous leffet de plusieurs
agents anesthsiants et dont le rle de relais sensoriel et moteur semble donc
se trouver suspendu dans ce cas. La mise au repos des boucles de rtroaction
thalamo-corticales a t voque comme une explication privilgie de la
perte de conscience lors de lanesthsie gnrale
11
, semblant aller dans le
sens de la thorie rflexive dEdelman
12
selon laquelle le processus sous-
tendant la conscience est la rentre des influx nerveux dans un circuit
unissant le thalamus au cortex. Cela dautant plus quil est possible de
rveiller brusquement un patient anesthsi par le svoflurane en injectant
directement des agents nicotiniques excitants dans un noyau thalamique
13
.
Faute dtre le centre de la conscience , nous lavons vu au
chapitre prcdent, le thalamus a t souponn dtre un interrupteur de
la conscience. Cependant, mme ce rle limit est contestable. Dune part,
lablation du thalamus nempche pas forcment lactivation du cortex
crbral, et dautre part, rciproquement, il existe des produits anesthsiants
qui ne diminuent pas lactivit thalamique
14
. De surcrot, leffet dpresseur
des agents anesthsiants sur lactivit thalamique est souvent retard dune
bonne dizaine de minutes par rapport laltration des fonctions du cortex
crbral et l endormissement comportemental
15
, ce qui porte suspecter
que les effets des anesthsiants sur le thalamus pourraient bien reprsenter
une transcription de lactivit globale du cortex plutt quun interrupteur de
conscience
16
. Lapplication la conscience de la thorie des localisations
semble dcidment peu crdible, mme sous la forme attnue que reprsente
la recherche de centres spcifiques darrt ou de dclenchement.
Il reste examiner leffet des agents anesthsiants sur le cortex crbral,
qui semble tre lune de leurs cibles majeures (ft-elle indirecte). Comme les
tats vgtatifs, les tats danesthsie gnrale profonde sont associs une
dsactivation (ou plutt, comme nous allons le voir, un grand changement du
rgime dactivation) des principales rgions associatives du cortex crbral
dj cites, comme le prcuneus, le cortex pr-frontal, ou le cortex temporo-
parital. Ils saccompagnent galement de dcorrlation longue distance
entre ces rgions
17
, tant et si bien que des signes neurologiques de rception
dune sollicitation linguistique ne sont plus suivis de lactivit corticale
ordinairement associe la comprhension smantique
18
. Nest-ce pas l le
(vaste) centre recherch de la conscience ? Na-t-on pas identifi lun des
principaux carrefours anatomiques de lespace de travail global de neurones
distribus dans lequel sallume la lumire de la conscience, et confirm ainsi
les thories de Bernard Baars
19
, ou de Stanislas Dehaene
20
? Il est dautant
plus tentant de le penser que ces aires corticales semblent tre les vritables
hubs de la connectique neuronale, les nuds du systme de communication
du cortex
21
. Si ce quil sagit dexpliquer est lune des fonctions spcifiques
de la conscience les plus souvent cites, savoir lunification des
reprsentations partielles par le biais dune liaison des informations traites
dans divers modules spcialiss du cerveau, alors la position de plaque
tournante quoccupent ces aires corticales en fait des candidats idaux au titre
de centre de la conscience . loccasion de ces tudes sur le site daction
des agents anesthsiants, il est nouveau tentant didentifier purement et
simplement le centre de convergence des informations au centre de la
conscience prsum, en vertu dune dcision initiale consistant assimiler
chaque aspect de lactivit mentale sa fonction.
Mais, peine la rflexion pistmologique est-elle remise en route en
de des thories mta-scientifiques comme le fonctionnalisme, ce qui
semblait tre la plus forte raison dassimiler les rgions associatives du
cortex au centre de la conscience devient la meilleure raison den douter.
Ici, comme dans plusieurs autres circonstances antrieures, il faut se rappeler
encore et encore que le critre ultime ( court ou long terme) de la
conscience de quelquun est le rapport verbal ; et que le critre de ma propre
conscience peine chue est la mmoire. Leffet dpresseur de conscience
qua linhibition de la plaque tournante informative du cortex dans les
processus danesthsie gnrale pourrait alors simplement tre la
manifestation dune perte daccs mutuel entre (a) les fractions du cerveau
corrles chaque exprience consciente particulire et (b) celles qui sont
impliques soit dans le rapport verbal (comme les centres moteurs de
larticulation vocale)
22
, soit dans le rapport gestuel (comme les aires motrices
des membres suprieur) soit dans la mmorisation (comme lhippocampe).
Une fois encore, loin de devoir tre considres comme des centres-de-la-
conscience-en-gnral, comme des centres dune conscience abstraite
trangement dissocie par la pense de ses contenus particuliers, les aires
associatives du cortex sont peut-tre limites tenir le rle dun lieu de
convergence, ditration et de mise disposition (pour le rapport verbal ou la
rminiscence mnmonique) de lensemble des corrlats neuronaux distribus
des multiples contenus dexprience consciente. Les donnes danesthsie
gnrale laissent partir de l subsister la possibilit drangeante dun
paroxysme de laporie du zombie-inverse : une exprience consciente
laquelle nul na accs aprs quelle sest prsente, pas mme moi en tant
quunit dune conscience rflexive et dune continuit auto-biographique
assure par la mmoire. Quen est-il en effet de ces rgions dactivit
crbrale que les agents anesthsiants laissent dans un tat disolement mutuel,
sans pour autant les suspendre compltement
23
, ou de ces rgions du cortex
qui demeurent dans une certaine mesure actives sous anesthsie, mais sans
plus rpondre par un signal de rtroaction dautres rgions corticales
24
?
Sont-elles associes des formes dexprience elles-mmes isoles, ou rien
de tel que cela ?
Avant de retravailler ce point central, il faut affiner la description de
leffet quont les agents anesthsiants sur le cortex crbral, en tudiant les
altrations de sa dynamique ; et examiner quelles consquences ont t tires
de cet affinement sur le plan thorique. Lune des meilleures manires de
saisir au vol la dynamique grande chelle du fonctionnement crbral est
denregistrer lactivit lectrique du cerveau, expression macroscopique des
multiples potentiels daction qui se propagent le long des axones
neuronaux au voisinage de la surface du cortex crbral. Cette activit
lectrique est value par divers procds, comme llectro-encphalographie
(EEG) et lun de ses drivs (la technique du potentiel voqu )
25
, ou bien
encore la magnto-encphalographie (MEG)
26
. La consquence lectro-
encphalographique de lanesthsie gnrale un niveau appropri de
sdation nest pas trs diffrente premire vue de celle du sommeil profond.
Tandis que les activits dveil sont associes des ondes EEG irrgulires,
faible amplitude et frquence leve (dans lordre de frquence
dcroissante : les ondes gamma, dont la frquence tourne autour de 40 hertz,
les ondes bta, de frquences comprises entre 12 et 30 hertz, et les ondes
alpha, de frquences comprises entre 8 et 12 hertz), certains tats danesthsie
saccompagnent comme le sommeil profond dondes rgulires forte
amplitude et frquence faible (les ondes thta et delta, de frquences
infrieures 7 hertz). Cette analogie des configurations EEG du sommeil
profond et de lanesthsie gnrale (en particulier celle quinduit le
Propofol
27
) ne va pas sans soulever des questions dlicates
28
. Elle montre par
exemple que lEEG ne permet pas lui seul de prvoir la disposition lveil
sous leffet de stimulations, puisque celle-ci est encore assez forte lors du
sommeil profond, et quasiment nulle sous anesthsie. Mais au moins suggre-
t-elle des indicateurs defficacit de sdation permettant dtablir une relation
dordre entre les tats danesthsie gnrale. De nombreux index de qualit
danesthsie utiliss par les praticiens durant les interventions chirurgicales,
comme lindex bispectral (BIS)
29
, ou lindex dentropie de Shannon, sont
ainsi fonds sur une valuation du rapport entre les composantes (a)
irrgulires haute frquence et (b) rgulires basses frquence de lEEG,
qui pourrait aussi bien servir de signe de profondeur du sommeil. Lorsque la
composante basse frquence augmente, lindex BIS dcrot partir de sa
valeur de rfrence pose gale 100, et on considre que la valeur cible
atteindre pour une anesthsie gnrale satisfaisante tourne autour de 50. Il faut
cependant ajouter que lanesthsie gnrale a galement (lorsquelle utilise
des doses massives) une traduction lectro-encphalographique parfois bien
diffrente de celle du sommeil profond, plutt proche de ce qui sobserve lors
des syndromes de souffrance crbrale durant lischmie
30
. Cest le cas du
phnomne de burst suppression
31
qui associe des priodes notables
dlectro-encphalogramme plat des priodes dactivit lectrique
rythmique et haute amplitude.
Ces donnes lectro-encphalographiques danesthsie gnrale sajoutent
aux arguments dont se prvaut la thorie neurologique de la conscience de
Tononi
32
, suivant laquelle, nous lavons vu, la conscience est de
linformation intgre. Que ce soit dans lanesthsie, dans le sommeil, dans le
coma, ou dans lpilepsie, les manifestations de la conscience disparaissent,
souligne Tononi, dans deux circonstances lectro-encphalographiques
prcises : (1) lorsque la complexit, lirrgularit, cest--dire la richesse
informative du trac EEG diminue ; et (2) lorsque lintgration de cette
information (qui se manifeste par des corrlations longues distances, ou des
synchronies entre les activits lectriques enregistres en divers points du
cortex) diminue
33
. Avec une faible concentration de la plupart des agents
anesthsiants, on observe dabord une perte dintgration de linformation
lectro-encphalographique, en ce sens que les ondes gamma encore prsentes
montrent moins de corrlations longue distance corticale. Puis, mesure de
laugmentation de concentration de lagent anesthsiant, on note une perte de
la richesse informative qui se traduit par lapparition de rponses lectriques
globales et strotypes de lensemble du cortex (comme les pics dactivit
dans la configuration de burst suppression ). Ce dernier cas est voisin de la
crise pileptique o la cohrence, et donc lintgration trans-corticale des
ondes lectro-encphalographiques est importante, mais o leur contenu
informatif est minimal. Il conforte lun des aspects les plus originaux de la
thorie de Tononi : sa capacit combiner lanalyse de deux traits principaux
des tracs EEG en une proprit composite, bien corrle au niveau
(comportementalement et verbalement) apparent de conscience dun patient.
Un intrt pratique majeur de cette thorie est donc dappuyer le pouvoir
prdictif bien connu des index spectraux de profondeur danesthsie sur un
modle explicatif, et de promettre leur amlioration quantitative sur la base de
ce modle. Son application, mme approximative, permet danticiper dans une
assez large mesure, sur la seule foi de leur trac EEG, la possibilit ou
limpossibilit dobtenir un rapport dexprience consciente chez des sujets
dans divers tats danesthsie ou de coma, et mme destimer la qualit
probable de ce rapport, module par le degr de vigilance. Cela explique le
succs destime rapide de la thorie de linformation intgre parmi les
spcialistes danesthsie et de ranimation
34
. Cette thorie les guide dans
lvaluation de leurs patients humains oprs, avec une sret et une efficacit
jusque-l ingale, en mettant en uvre des moyens conceptuellement et
instrumentalement assez simples. Mais de l dire que la thorie de
linformation intgre constitue une lucidation convaincante de la nature
(objective) de la conscience, il y a un pas immense que plusieurs motifs
incitent ne pas franchir. Certains motifs de rserve lgard des prtentions
explicatives de cette thorie ont dj t abords au chapitre prcdent, et je
me contenterai ici de dvelopper brivement lun dentre eux.
Il a t signal que, pour passer de la proposition oprationnelle la
richesse et lintgration du contenu informatif de llectroencphalogramme
dun sujet humain est un bon prdicteur de sa capacit (actuelle ou retarde)
dmettre un rapport dexprience en premire personne la proposition
ontologique la conscience est de linformation intgre , il faudrait au
minimum pouvoir attester que nimporte quelle entit capable de traiter et
dintgrer de linformation est un centre dexprience consciente. Car la
stricte identit entre la conscience et linformation intgre prise in abstracto
ne vaudrait que si leur corrlation pouvait tre universalise et dtache de
ses circonstances particulires dimplmentation chez des sujets humains.
Cest bien ce quentendent les partisans de la thorie de Tononi, qui se rvent
en prophtes dune forme moderne et objectiviste de panpsychisme tendue
la conscience artificielle des robots, des tlphones portables, ou du
rseau internet
35
. Le problme est que cette condition duniversalisation ne
peut que demeurer strictement inattestable. En effet, pour sassurer quelle est
remplie, il faudrait soit pouvoir garantir que lventuelle production verbale
dune entit non humaine et non animale apte atteindre une forme
dinteractivit de niveau de complexit quivalente lhumain est
ncessairement associe une exprience consciente (et non pas simplement
mcanique ), ce qui reviendrait nier la simple possibilit logique du
zombie direct ; soit accorder foi lexprience consciente de cet alien en
vertu de la seule valeur leve de son paramtre phi dintgration
informationnelle, ce qui serait entirement circulaire. ce stade, la difficult
pistmologique dans laquelle nous nous dbattons devient vidente : pour
assurer une base empirique dcisive la thorie abstraite quest celle de
linformation intgre, nous aurions besoin davoir vrai ment accs
lexprience consciente dentits exotiques ou robotiques, et non pas
seulement denregistrer chez elles des manifestations verbales et
comportementales qui ne sont pas formellement suffisantes pour affirmer
lexistence chez elles dune conscience phnomnale. Or, nous savons quil
ny a par dfinition aucun autre accs lexprience que de la vivre, de
ltre pour ainsi dire, et aucun autre signe plausible (bien quinfond) dun
tat dexprience consciente que la capacit actuelle ou retarde pour des
entits suffisamment proches de qui la vit de rapporter ce quelles ont vcu.
La garantie entire nexiste quen premire personne (elle est en vrit la
matrice de toutes les garanties et de toutes les certitudes), et elle nest tendue
prsomptivement la seconde personne de lalter-ego semblable que sur la
foi dune clause ceteris paribus : toutes les conditions que je remplis pour
tre moi-mme manifestement prouvant et conscient sont supposes gales
chez mon alter-ego semblable, y compris des conditions dun genre prsent
inconnu allant peut-tre trs au-del du seul paramtre dinformation intgre.
Il se confirme alors que, loin dtre une vraie thorie de ce quest la
conscience, comme elle le suggre, la thorie de linformation intgre ne peut
rien faire de plus quextrapoler un mode banal dattestation probable de
ltre-conscient dun autrui vigile et en bonne sant vers des cas un peu plus
lointains (ceux du coma ou de lanesthsie gnrale) o des tres humains se
sont trop coups des conditions qui permettraient un rapport verbal pour quon
puisse compter sur lui brve chance. La prtention de la thorie de
linformation intgre faire plus que cela, noncer la nature de la
conscience et transgresser partir de l les limites bio-anthropologiques de
lextrapolation, est parfaitement infonde. En rsum, ne pouvant pas compter
pour une vritable lucidation thorique de la conscience, le concept
dinformation intgre se contente dlargir un peu, par des biais
instrumentaux, le champ de notre comptence pratique apprcier ltat de
conscience de nos alter-ego en nous adossant lexprience incarne de
rfrence quest la ntre.
Et encore, la thorie de linformation intgre ne peut-elle pas toujours
avoir cette capacit dextrapolation de la probabilit doccurrence dune
exprience consciente dans un domaine proche des personnes qui la font.
Mme un succs restreint cette circonscription nest pas assur, puisque
leffet de certains agents anesthsiants semble parfois scarter
considrablement de ce que cette thorie anticipe. Ainsi, la plupart des index
spectraux EEG sont peu sensibles certains agents anesthsiants comme la
ktamine et les opiacs
36
. Lindex de rfrence, le BIS, est pratiquement
normal voire augment chez certains patients sous ktamine qui apparaissent
pourtant bien, selon les signes cliniques disponibles, anesthsis
37
. Comment
comprendre cette circonstance dans le cadre de la thorie de linformation
intgre ? La premire faon dy parvenir serait de faire de la ktamine une
exception sans signification thorique. Aprs tout, cette drogue est
couramment appele un anesthsiant dissociatif
38
parce que son utilisation
provoque des expriences de dissociation vis--vis du corps propre, avec
pour corrlat physiologique un dcouplage entre lactivit lectrique cortico-
thalamique et celle du systme limbique (hypothalamus, hippocampe,
amygdale), plutt que le genre de dfaut gnralis dintgration de lactivit
encphalique auquel conduisent la plupart des autres molcules. Une seconde
faon denvisager le cas spcifique de la ktamine consisterait
rciproquement se prvaloir de la thorie de linformation intgre pour
affirmer que les patients sous ktamine ne sont pas inconscients en dpit des
apparences cliniques ; que la ktamine provoque analgsie, amnsie, et
dconnexion du systme excutif du cerveau, mais pas dauthentique
anesthsie , au sens de perte de conscience. Une fois de plus, comme dans
le cas o lon accorderait foi au rapport d aliens sur la seule base du
paramtrage offert par la thorie de linformation intgre, cette affirmation
nest pas impensable, mais plutt circulaire. Par elle, la thorie prtend non
plus seulement extrapoler lexprience consciente standard vers des situations
proches, mais la court-circuiter pour ne plus sappuyer que sur ses propres
procds dinfrence formelle. De plus, elle revient suggrer, propos de
ce cas particulier, que la dconnexion de lactivit des divers centres
crbraux saccompagne de la prsence dune ou de plusieurs consciences
isoles des voies habituelles par lesquelles elles se manifestent lvaluation
extrieure, voire de lapprhension en premire personne dun individu
intgr. Quest-ce qui empche partir de l de gnraliser cette
interprtation dautres cas plus massifs de perte dintgration de lactivit
crbrale, en les lisant comme le tmoin non pas dune abolition ou dune
diminution de la conscience, mais dun clatement de ses contenus en autant
de courants dsormais spars ? Et comment soutenir encore dans ces
conditions que le paramtre signifiant suivre pendant lanesthsie est la
valeur unique de la quantit de conscience quest suppose fournir la
quantit phi dinformation intgre, plutt que la capacit variable des
secteurs de conscience se rassembler en un seul courant ? Que lon admette
une exception la rgle, ou que lon concde lide dune fragmentation plutt
que dune baisse quantitative du degr de conscience , le cur de la
thorie de linformation intgre se trouve mis en difficult par le simple
contre-exemple de lanesthsie par ktamine.
La lecture des corrlats neuronaux de lanesthsie gnrale en termes de
dcorrlation des rgions crbrales est conforte par dautres techniques
dexploration fonctionnelle, comme celle des potentiels voqus . La
mthode des potentiels voqus fait galement appel un enregistrement
lectro-encphalographique, mais elle a pour principe dextraire la part du
signal qui rsulte directement dun stimulus contrl, aprs avoir estomp le
reste (bruit) du signal par un effet de moyenne. Le stimulus peut tre simple,
se limitant un son ou un flash lumineux, ou bien complexe, faisant
intervenir des expressions linguistiques, des phrases musicales ou des objets
de perception visuelle aussi composs quun visage. Les consquences de la
slectivit dont il faut faire preuve pour mettre en vidence un potentiel
voqu partir de lactivit lectrique du cerveau sont remarquables. En
raison de leffet de moyenne, qui gomme des parts non pertinentes du signal,
on peut avoir accs des composantes faibles de lactivit neuro-lectrique
provenant de rgions du cerveau varies, gnralement plus profondes que
celles qui se manifestent directement par les tracs lectro-
encphalographiques primaires. Or, cette capacit daccder des signaux
profonds savre dcisive pour lun des tests les plus frquemment utiliss
afin dvaluer lintensit de lanesthsie : le test du potentiel voqu auditif,
qui utilise comme stimulus un son lmentaire
39
. Le potentiel voqu auditif
peut tre analys en trois composantes principales : latences temporelles
brve, moyenne et longue aprs le stimulus auditif. Chacune de ces
composantes est rattache, chez le sujet vigile, lactivit de trois rgions
crbrales distinctes. La composante latence brve correspond la
conduction nerveuse du signal initial dans le tronc crbral ( la base du
cerveau) ; la composante latence moyenne correspond lactivit du cortex
auditif primaire, situ dans le lobe temporal ; et la composante latence
longue correspond lactivit ultrieure du cortex dit associatif du lobe
frontal. Le devenir du potentiel voqu auditif dans diverses circonstances
thrapeutiques ou pathologiques nous renseigne donc sur le maintien,
laltration ou la disparition de lactivit dans chacune de ces trois rgions
crbrales. Or, ce quon observe avec une dose moyenne des agents
anesthsiants courants est le maintien de la contribution du tronc crbral, le
ralentissement et la diminution damplitude de lactivit dans le cortex auditif
primaire, et la disparition de la composante qui correspond lactivit du
cortex associatif
40
. On saperoit nouveau, grce cette mthode alternative
du potentiel voqu auditif, que lanesthsie impose une dconnexion des
diverses rgions et dynamiques dactivit neuronale. Si elle nest pas trop
profonde, elle laisse subsister une activit dans les cortex sensoriels
primaires (surtout les centres auditifs qui servent de moyen dalerte pour
lorganisme, et qui sont souvent mis en jeu lorsque lanesthsie est lgre),
tandis quelle supprime tout signal dans le cortex associatif qui fait fonction
de plaque tournante crbrale. Cet effet de dissociation, qui corrobore celui
que rvlent dautres mthodes dexploration comme la tomographie
mission de positrons ou la rsonance magntique
41
, est voisin de celui quon
observe chez des patients en tat vgtatif. Chez les patients en tat vgtatif
comme chez les patients anesthsis, on observe une activation des cortex
sensoriels primaires, mais une complte mise au repos du cortex associatif,
lors de stimulations simples ou complexes. Les cortex sensoriels primaires se
comportent en somme comme sils constituaient autant d lots dactivit
dconnects du reste du cortex crbral
42
.
Lenseignement tirer de ces donnes du potentiel voqu auditif, au sujet
de leffet de lanesthsie sur la conscience, ressemble celui que nous avons
dj tir des donnes directes dlectroencphalographie, et il est tout aussi
ambigu. L o manque le rapport verbal, ce tmoin paradigmatique du vcu, la
connectivit fonctionnelle des divers modules spcialiss du cerveau est
gnralement trs altre. Il se peut que cette perte dintgration soit la cause
dune perte de conscience, mais il se peut aussi linverse que nous ne
parlions dabsence de conscience quen raison dun dficit dinterconnexion
rendant ses contenus inaccessibles. Tout ce que lon peut faire pour se donner
des raisons de choisir entre les interprtations divergentes de ltat
danesthsie gnrale (conscience diminue, ou bien conscience la fois
fragmente et dissocie de ses possibilits expressives) est de multiplier les
indices et les sources dinformation. Deux sources complmentaires dindices
concernant ltat de conscience dun patient anesthsi sont ses capacits
motrices et le tmoignage de sa mmoire post-opratoire. Quen est-il de ces
indices additionnels ? Peut-on aller leur propos au-del de la remarque
banale quun patient anesthsi est gnralement inerte et amnsique ? La
rponse cette dernire question est positive, et elle va savrer clairante.
Les mouvements dun patient durant son intervention sous anesthsie
gnrale sont spontanment considrs par les praticiens comme un signe de
rveil. Il nest donc pas rare que des chirurgiens sadressent aux anesthsistes
pour quils mettent un terme cette motricit, soit en augmentant la dose de
lagent anesthsiant direct, soit en accroissant celle dun agent paralysant
(analogue au curare). Mais certains spcialistes ont remarqu que
lassociation habituelle de lagent paralysant au cocktail anesthsique risquait
de masquer une reprise partielle de conscience du patient sous son inertie
apparente
43
. Et de fait, une proportion pas tout fait ngligeable (0,1 0,2 %)
de cas de rveils durant lanesthsie se produisent sans que le patient puisse
bouger et alerter les mdecins (puisquil est paralys)
44
. Ce rveil sans
mouvement est gnralement attest par le rapport verbal rtrospectif des
patients, qui sont capables de rpter les paroles prononces par les membres
du personnel soignant durant lintervention, alors quils avaient les yeux clos
et demeuraient strictement immobiles. Un tel vnement savre assez souvent
traumatisant pour ces sujets, qui, mme lorsquils ne dclarent pas avoir
ressenti de la douleur, se souviennent de leur impression de dsarroi et
dimpuissance en se figurant ce que lon faisait leur corps un moment o
ils ne pouvaient esquisser aucun geste pour communiquer
45
. Lutilisation des
index spectraux lectroencphalographiques a permis de rduire un peu
lincidence de ces rveils peropratoires, en ajustant plus finement les doses
danesthsiants et en se fiant moins aux signes cliniques superficiels (comme
la gesticulation) quaux signes neuro-lectriques allgus de la conscience des
patients
46
. Mais mme si lon admet que prendre en compte les index
spectraux permet de diminuer le nombre de patients capables de raconter leur
pisode de rveil a posteriori, il reste une inconnue redoutable et lourde de
consquences philosophiques. Nest-il pas possible que lenfermement de
certains patients vigiles dans la prison de la paralysie corporelle soit renforc
par un autre enfermement, dans une prison temporelle cette fois, redoublant
leur statut de zombies inverses ? Ne peut-il pas arriver quun patient soit
rveill et quil soit incapable de mmoriser ce qui lui arrive, en plus dtre
incapable de bouger et de faire signe ? Nest-il pas envisageable quil
ressente tout ce qui se passe, sans avoir la possibilit non seulement de
communiquer prsent ce quil vit cause de linertie musculaire, mais aussi
de le rapporter plus tard, lorsque les mdecins linterrogeront aprs son
rveil ?
Cette suite de questions nous conduit tudier plus prcisment la
mmoire des patients anesthsis, qui conditionne le signe de conscience
peropratoire classique quest le rapport verbal a posteriori. Tout dabord,
au carrefour des valuations de ltat de vigilance et de motricit, il est
possible de demander au patient deffectuer des mouvements coordonns en
rponse des sollicitations linguistiques qui lui sont faites durant
lanesthsie. Cette approche vise surmonter le mur de la mmoire, en offrant
un substitut gestuel de rapport verbal linstant de la demande, avant que le
souvenir de ltat vigile durant lanesthsie ait t perdu par le patient. Un tel
mode daccs se heurte bien sr un obstacle majeur qui est le pouvoir
ankylosant de bien des agents anesthsiants, complt par lintroduction de
substances spcifiquement paralysantes. Mais cet obstacle a t lev
exprimentalement en appliquant temporairement un garrot sur le bras des
patients et en le serrant une pression suprieure celle de la systole
cardiaque, ce qui coupe compltement leur avant-bras de la circulation
sanguine, et empche par consquent que les agents paralysants parviennent
aux muscles de cette partie du corps. Cest ainsi qua t dveloppe la
technique communicationnelle peropratoire de lavant-bras isol
47
, dans
laquelle on demande au patient sous anesthsie de rpondre des questions
prcises au moyen dun code consistant serrer la main du mdecin un
nombre dtermin de fois. Le rsultat de cette approche est troublant, et il
remet immdiatement lenqute philosophique en marche. En voici un expos
succinct d des anesthsiologues : La technique de lavant-bras isol a
montr que des patients individuels peuvent tre conscients et ractifs durant
une opration chirurgicale, mme si leur index bispectral suggre quils ne le
sont pas. Soit llectroencphalographie nest pas assez sensible pour les
processus neurologiques sous-tendant la conscience, soit nous ne savons pas
ce que nous cherchons
48
. La conclusion, sous forme daveu dignorance, est
frappante. Navions-nous pas des raisons destimer que les index spectraux
lectroencphalographiques offrent un tmoin bien plus fiable de la perte de
conscience des patients sous anesthsie que des indications cliniques telles
que les mouvements spontans peropratoires ? Si nous lestimions, cest que
les index spectraux sont un meilleur prdicteur de la possibilit dun rapport
verbal rtrospectif de la vigilance peropratoire dun patient, que les signes
cliniques superficiels de cette vigilance. Mais voil qu prsent une sorte de
rapport en temps rel (certes pauvre, mais significatif) peut tre obtenu sous
anesthsie de faon beaucoup plus frquente que le rapport rtrospectif
49
.
Cela laisse souponner que les signes standard dexprience consciente dont
nous disposons (y compris les index spectraux lectroencphalographiques)
sont si composites et si peu immdiats quils nous portent croire quun
patient est inconscient alors quil a simplement perdu, en raison de son
ankylose motrice et de son dfaut partiel de connectivit encphalique, les
moyens de manifester un comportement spontanment organis et surtout de
garder la mmoire durable de son exprience peropratoire
50
.
Bien sr, il nest pas compltement impensable de repousser ces
enseignements troublants en niant catgoriquement que les rponses des
patients anesthsis, codes au moyen de leur avant-bras isol, rvlent quils
sont conscients. Les pressions de la main exerces par les patients ne sont-
elles pas des ractions motrices purement automatiques ? Leurs ractions,
certes structures comme un langage, saccompagnent-elles vraiment de la
conscience de ce qui est demand par le mdecin et de ce qui est exprim en
rponse ? Aprs tout, les index spectraux mesurs sur les patients sont
comparables ceux du sommeil profond, et les valuations de potentiels
voqus montrent que lactivit neuro-lectrique suscite par une stimulation
reste pour lessentiel confine dans des aires corticales spcialises (comme
le cortex sensoriel primaire) sans atteindre massivement le cortex secondaire
associatif. La premire caractristique est pratiquement incompatible avec la
conscience selon la thorie de linformation intgre ; et la seconde
caractristique est difficilement compatible avec la conscience selon les
thories du global workspace . Ces thories nont-elles pas dsormais
lautorit ncessaire pour passer outre les apparences, vers la ralit de
ltre-conscient ? Affirmer cela serait pour le moins tmraire. Dclarer que
des patients sont inconscients en dpit de ce qui a toutes les caractristiques
dun rapport dexprience, au nom de thories en fin de compte incertaines et
fondes sur dautres types plus courants de rapports dexprience, relverait
du prjug le plus troit. Plutt que de rester enferm dans ce genre de prjug
thorique, il vaut mieux envisager la figure surprenante dune conscience sans
mmoire long terme, dune conscience presque instantane, voire dune
conscience troite particularise un moment sensori-moteur, quimpose la
prise au srieux des rapports dexprience en temps rel obtenus par la
technique de lavant-bras isol.
Mais peut-tre mme la croyance en une disparition complte de la
mmoire longue chance au cours de lanesthsie est-elle trop
schmatique ? Avant dexplorer les consquences de lide fascinante de la
conscience momentane, il est donc indispensable de raffiner lvaluation des
capacits de mmorisation sous anesthsie. Nous avons dj signal que
quelques patients gardent la mmoire de leur opration chirurgicale, et de ce
qui a t dit par le personnel soignant au cours de son droulement. Il sagit l
dune mmoire explicite de type pisodique (qui permet de retenir et de
rapporter un pisode vcu). Ces cas sont cependant assez rares. En revanche,
un autre type de mmoire, dite implicite, savre beaucoup plus frquemment
prserv chez les patients anesthsis. La mmoire implicite
51
est une forme
de mmoire laquelle le patient ne peut pas avoir accs volontairement, et
quil ne peut pas non plus exprimer par un rcit, mais qui se manifeste par des
altrations systmatiques de ses comportements et de ses choix dans des
circonstances qui rappellent un pisode frappant de sa vie
52
. La prsence
dune mmoire implicite peut tre teste, par exemple, en rptant un mot au
patient durant lanesthsie, puis en lui demandant aprs son rveil de choisir
soit entre plusieurs mots dont lun dentre eux est celui qui a t rpt, soit
entre plusieurs images dont lune est vocatrice de ce mot
53
. Il rsulte de ces
tests en phase post-anesthsique que seules des concentrations dagents
sdatifs nettement suprieures celles qui sont recommandes couramment, et
des index spectraux nettement infrieurs ceux qui sont raliss dans les
conditions standard danesthsie, font disparatre compltement la mmoire
implicite long terme. Le phnomne de mmoire implicite, et la profondeur
des marques quil imprime sur la vie intrieure des sujets aprs lanesthsie,
sont partir de l si largement reconnus que certains spcialistes
recommandent aux chirurgiens de ne surtout pas exprimer voix haute davis
alarmants sur ltat du patient en train dtre opr, faute de quoi on risque de
susciter chez lui des dsordres psychologiques post-opratoires allant de
lanxit linsomnie en passant par la dpression
54
. Mais ce qui est peut-tre
encore plus troublant est la dpendance de la mmoire implicite lgard de
lacte chirurgical lui-mme. Les patients qui ont subi une simple anesthsie
sans intervention sur leur corps manifestent rarement des souvenirs implicites.
En revanche, ceux qui sont oprs ont souvent une mmoire implicite
importante de ce qui sest pass durant leur anesthsie. Que sest-il pass
pour quil en aille ainsi ? Une rponse rassurante cette question est
formulable en troisime personne. La diffrence majeure de mmoire
implicite entre les oprs et les non-oprs peut tre attribue au facteur
objectif quest lactivation de lamygdale, dans des conditions biochimiques
analogues celles du stress, qui sont ralises durant lopration
55
. Ces
conditions de stress physiologique peropratoire sont dailleurs corrobores
par lapparition assez frquente de signes neuro-vgtatifs de forte
sollicitation corporelle au cours de lintervention (sueur, pression sanguine
leve, rythme cardiaque augment, rponses pupillaires altres)
56
. Mais
quoi correspondent ces signes lorsquils sont traduits en premire personne de
lexprience instantane ? Ne doit-on pas les requalifier selon ce point de vue
de signes de souffrance ? Et nest-ce pas tout simplement cette souffrance,
celle-l mme quon croyait pouvoir viter par lanesthsie, qui se manifeste
par un traumatisme implicite post-opratoire ? Voil une srie de questions
drangeantes qui ne peut quen entraner dautres. Que signifie au juste tre
anesthsi ? Est-ce que cela veut dire ne pas tre conscient dune
douleur qui peut pourtant se manifester sur un plan inconscient ? Ou est-ce
que cela revient simplement perdre la mmoire explicite de cette douleur et
de ses circonstances opratoires, aprs stre vu priv des voies de
communication qui permettraient de la faire converger vers une exprience
unifie, ainsi que des capacits motrices den tmoigner au moment o elle se
produit
57
?
Certains anesthsiologues ignorent ces questions alarmantes en soulignant
que, pour la vie ultrieure du patient, avoir t conscient sans avoir mmoris
ce qui sest pass (probablement en raison dun dfaut de capacit de
consolider les souvenirs) ou avoir t vraiment inconscient durant son
opration revient au mme. Cela est sans doute vrai en pratique, si du moins
des souvenirs implicites ne viennent pas perturber lexistence post-opratoire
de ce patient. Mais pour le philosophe, lventuelle diffrence importe au plus
haut point, et elle pse de toutes faons sur le vocabulaire et les expressions
des mdecins. Considrons par exemple ces phrases crites par une quipe
danesthsiologues de langue anglaise : Lawareness est un concept relatif
qui nimplique pas forcment la consciousness. Durant lanesthsie
gnrale, plusieurs patients apprcient de temps autre les stimuli sensoriels,
et ils peuvent mme rpondre des requtes verbales spcifiques ou des
suggestions. De faon intressante, ces pisodes dawareness apparente ne
sont habituellement pas mmoriss par les patients aprs lopration
58
. Le
cur de la premire phrase de la citation pourrait sans doute se traduire en
meilleur franais par la conscience nimplique pas forcment la conscience
rflexive ; ou, plus prcisment, la pure exprience nimplique pas
forcment la conscience (au sens rflexif) . Mais il ne sagit encore l que
dessais de transposition terminologique dune langue lautre partir dune
seule occurrence des mots. Les deux phrases suivantes de la citation apportent
un clairage prcieux, bien quapproximatif, sur le genre de distinction vis
par lemploi altern des termes awareness et consciousness, quasiment
synonymes selon lOxford English Dictionary, mais pouvant diverger dans
certains contextes comme celui de lanesthsiologie. tre aware , selon la
seconde phrase, cela signifie pour un patient apprcier les stimuli
sensoriels et rpondre aux sollicitations . On reste tout de mme dans une
certaine confusion. Que veut dire dabord apprcier ? Si cela signifie
tre sensible , on aurait tendance y voir un quasi-synonyme dtre
conscient au sens minimal davoir une exprience sensible, sauf si la
sensibilit est seulement envisage dans ses aspects comportementaux et
ractifs (comme on le fait en gnral lorsquon dit dune plante comme le
basilic, qui devient odorante au toucher, quelle est sensitive ). De mme,
quimplique la rponse une sollicitation : une dcision consciente ou une
raction automatique ; un acte rflchi ou un simple rflexe ?
Lindtermination smantique ne semble pas encore leve ce stade ; elle ne
lest peut-tre, et encore de manire cryptique, que par la phrase suivante.
Selon elle, l awareness peropratoire nest pas mmorise par les
patients. Si lon admet que ce qui peut tre mmoris est une exprience
vcue, et non pas une simple raction motrice, on tend en dduire que ce qui
se trouve dsign par awareness est une forme de conscience primitive,
prive dcho temporel, incapable de retour sur soi parce que disparaissant
avant davoir eu lopportunit de se ddoubler pour se rflchir.
Rciproquement, ce qui se voit dsign par consciousness pourrait tre
une forme dexprience labore, cumulative, temporellement tendue, dote
dun fil conducteur historico-biographique ; une varit dexprience crant
pour elle-mme une chambre de rsonance, de rptition et damplification
qui relie entre eux les divers moments partiels d apprciation sensible et
les intgre lhistoire dun sujet.
Cette faon de voir semble latente dans les rflexions de bon nombre
danesthsiologues, qui se demandent : Considrez ce que cela ferait dtre
sans mmoire. Seriez-vous-mme conscient
59
? La question nest pas
purement rhtorique puisquil existe des pathologies, appeles amnsies
antrogrades acquises , qui permettent de se figurer ce que cela fait dtre
priv de la capacit dacqurir tout nouveau souvenir
60
. Le rsultat en est
assez simple, et trs frappant : les patients qui en sont atteints ont chaque
instant limpression de stre peine rveills
61
. Mais au moins peut-on dire
que ces patients, contrairement ceux qui sont sous anesthsie gnrale, ont
une vritable conscience rflexive de sortir du sommeil et de se reconnecter
lors de ce rveil aux souvenirs anciens (antrieurs au traumatisme qui a
dtermin lamnsie). Sil semble raisonnable de le dire, cest que ni la
mmoire des vnements loigns ni la mmoire de travail (ou mmoire trs
court terme) de ces patients nest affecte, et que seule leur capacit de
rtention long terme de nouveaux souvenirs se trouve abolie. Ici,
l awareness a une certaine paisseur temporelle, elle est amplifie,
cumulative, relie une biographie (mme si celle-ci est dfinitivement fige
dans son tat pr-traumatique), et elle se stabilise donc pour un temps bref en
une consciousness . Mais il narrive plus rien de tel si la mmoire de
travail elle-mme se trouve altre ou inhibe, et si lcho temporel de
l awareness sen trouve aboli
62
. Dans ce dernier cas dun vcu
( awareness ) restreint au plus strict prsent, sans contact avec un pass
plus lointain que quelques centaines de millisecondes, la plupart des auteurs
considrent quun sujet ne peut plus du tout tre dit conscient
( conscious )
63
. Selon eux, la conscience ( consciousness ) nest tout
simplement pas dissociable de la mmoire ce degr minimal.
De telles conclusions, issues dune rflexion sur des faits
neuropathologiques et anesthsiologiques, restent compatibles avec quelques-
unes des principales thories neurologiques de la conscience : la thorie des
boucles rentrantes du circuit thalamo-cortical soutenue par Edelman, la
thorie des penses dordre suprieur de Rosenthal
64
, ou encore la thorie
du recrutement de rseaux neuronaux du global workspace de Baars et
Dehaene. Toutes les thories cites soulignent en effet la ncessit dun
quivalent neurophysiologique de la rflexivit et de la stabilisation de
lactivit mentale, pour que la conscience se fasse jour. Mais en mme temps,
les observations des anesthsiologues, et le vocabulaire raffin quils
emploient pour en faire tat, nous rappellent avec de nouvelles donnes
lappui ce qui manque aux thories neurologiques de la conscience : celles-ci
peuvent certes fournir des candidats plausibles au titre dexplication
neurophysiologique de lmergence dactes de conscience rflexive
( consciousness ) partir de la pure exprience ( awareness ), mais elles
nont rigoureusement rien dire sur le fait premier de lexprience elle-mme.
Elles offrent un compte rendu neuronal de laccumulation, du pouvoir
dintgration, de la rverbration, de la stabilit temporelle, ncessaires la
conscience rflexive, mais pas de cela quil y a accumuler, intgrer,
rverbrer, stabiliser : lexprience mme. Elles restent sans ressources
explicatives propos de lexprience oublie aussitt que surgie, mais dont le
surgissement prconditionne la pousse contre loubli du vcu en quoi
consiste la conscience rflexive.
Pour rcapituler les conclusions des deux derniers chapitres, les thories
neurologiques de la conscience sont en vrit des thories dun
phnomne interprtable comme signe de conscience : le rapport rtrospectif
dexprience vcue et rflchie. Elles permettent dans le meilleur des cas de
prvoir loccurrence ou labsence du phnomne, elles offrent une vision de
plus en plus fine de ses prconditions intgratives et mnmoniques, elles
accdent aux rseaux et aux dynamiques neuronales qui sont les corrlats de
sa fonction. Mais elles sont par construction prives de moyens pour rendre
raison du sens ultime de ce phnomne : le fait mme, le fait simple, le fait
muet que cela apparat ( quelquun).
QUESTION 11
Quel genre dunit a le moment prsent ?
Le temps devient temps humain dans la mesure o il est
articul sur un mode narratif.
P. Ricur
Au chapitre prcdent, lattribution de conscience un patient a t
suspendue sa mmoire et sa capacit dlaborer un rcit, tandis qutait
mise de ct, titre de prcondition obstine, quelque chose comme son
exprience fleur dinstant. La leon qui en a t tire est que lexprience
actuelle se profile comme le toujours-dj donn et le lumineux insu de la
recherche. nouveau devin en fin de parcours, aux extrmits et aux
interstices du discours scientifique, cet arrire-plan tait vrai dire manifeste
ds lamorce de lenqute sur la conscience sapercevant delle-mme en tat
dpoch. Car, peine revenu de loubli de lvidence, on ne peut pas
manquer de constater que nulle clipse de la conscience ne se donne en dehors
dune conscience en son clat dexprience, que nulle priode dabsence ne
ressort autrement que comme une lacune ou une interrogation au sein de la
prsence. La conscience est l, tellement l quaucune autre place nest faite
sa possible disparition quen son apparition mme. Il ny a pas de fuite
permise hors de l , parce quil ny a pas dailleurs qui ne soit repr en
lui et par rapport lui. Cest ce quon pourrait appeler le caractre satur de
la conscience, analogue la saturation dune couleur lave du gris qui la nie,
ou la surexposition dune photographie prive des ombres qui lui
donneraient forme.
Au fond, ce livre entier nat dune ralisation lancinante de la saturation
de lexprience consciente, et il tche den exprimer les consquences en
utilisant jusquau point dextnuation un langage qui suppose le contraste, la
distinction, le partage, en somme la dsaturation. Mais ce que lon peut
admettre dans une qute de philosophie des limites ne convient sans doute pas
pour le travail scientifique ; ou du moins, ce que les sciences finissent par
entrevoir au point de fuite de leur enqute nest pas forcment acceptable
comme prescription mthodologique ds leur commencement. Les sciences
fondent leur essor sur lanalyse diffrentielle, et elles ont pour but dtablir
des catgories distinctes permettant de guider certaines activits slectives
dordre technologique. La dsaturation du champ dtude apparat donc
comme une insurmontable condition de possibilit des premiers pas de la
recherche scientifique. Lloignement de linvestigation vis--vis de la source
indivise dvidence qui scelle lexceptionnalit de son pseudo-objet semble
devoir tre le prrequis dune science de la conscience. Il ny a pas
stonner dans ces conditions que la dsaturation ait t pose comme
principe par le porteur du projet dune science de la conscience quest
Bernard Baars
1
. En dpit de la difficult de sassurer quil existe des
processus mentaux compltement inconscients (y compris lors dune
anesthsie gnrale), en dpit de la plausibilit de la thse alternative selon
laquelle tous les actes mentaux sont de quelque manire vcus mais pas
forcment mmoriss ou rflchis, en dpit du caractre incertain de
lexistence de quelque point zro de la conscience permettant den faire
une vraie variable quantitative repre par rapport une origine, il faut
supposer ce point zro, crit Baars, pour faire atteindre le rang de science
ltude de la conscience. Car cest seulement ce prix quon peut esprer
entreprendre un examen de la conscience par contraste, une analyse
discriminative des circonstances qui la permettent et de celles qui en inhibent
lapparition, une caractrisation des causes historiques de son mergence et
des risques accidentels de son abolition.
Des procdures trs simples de neuropsychologie exprimentale
promettent, pour peu quon retienne lhypothse de dsaturation, daccder
ce quon pense tre les conditions physiologiques prcises de ltre-
conscient. Elles reposent, nous lavons dit propos des thories
neurologiques de la conscience et de lanesthsie gnrale, sur la demande de
rapports verbaux dexprience vcue des sujets, et sur ltablissement dun
jeu doppositions entre les situations qui permettent ces rapports et celles qui
les rendent ngatifs ou inaccessibles. Deux exemples typiques de telles
procdures psychologiques sont les expriences dattention divise
2
, et les
expriences de masquage rtrospectif dun stimulus visuel
3
. Les expriences
de masquage rtrospectif consistent ainsi prsenter brivement deux stimuli
visuels en succession rapide et constater que le premier dentre eux fait
lobjet dun rapport verbal lorsquil est prsent isolment, tandis que tout se
passe comme sil navait pas t peru quand il est immdiatement suivi (ou
prcd) dun autre stimulus de forme approprie
4
. Des informations
prcieuses sont obtenues si lon relve, simultanment ce genre de tests
psychophysiologiques, les corrlats neuronaux des configurations o les
rapports verbaux sont prsents et de celles o ils sont absents ou ngatifs. Les
utilisateurs du postulat de dsaturation considrent en effet que la base
neurobiologique de la conscience ressort immdiatement dune opration
consistant soustraire lactivit neuronale associe aux situations o un
rapport verbal dexprience ne peut pas tre obtenu, de lactivit neuronale
associe aux situations o un rapport verbal est fourni. Comme nous lavons
appris en valuant les arguments exprimentaux lappui de la thorie de
lespace de travail global, les processus neuronaux considrs comme
inconscients, qui permettent tantt des ractions motrices automatiques tantt
un traitement de linformation pralable la prise de conscience rapporte
verbalement, sont le fait de nombreuses aires spcialises fonctionnant en
parallle indpendamment lune de lautre, qui fournissent des rponses
strotypes mais fiables et rapides. Au contraire, les processus neuronaux
supposs sous-tendre un pisode conscient attest par le rapport verbal
mobilisent de vastes assembles cellulaires du cortex crbral, manifestent
des synchronies longue distance qui les rendent hautement dpendants les
uns des autres, oprent squentiellement plutt quen parallle, sont lents et de
faible capacit mais restent capables de favoriser des innovations
comportementales
5
. On voit ainsi se dgager une grille de lecture
diffrentielle partir de laquelle ressortent quelques conditions neurologiques
supposes ncessaires la conscience, sur fond dun vaste ensemble de
processus physiologiques considrs comme aveugles.
Cette grille de lecture est un puissant levier de diagnostic et daction
thrapeutique puisquelle permet, nous lavons vu, de dlimiter des tats
neuropathologiques vraisemblablement associs la privation de conscience
des patients (sur la foi de labsence de rapport verbal), et didentifier
linverse des modes daction propres favoriser le retour dun tat de
conscience normal (attest par des comportements complexes incluant le
langage) au dcours dpisodes de coma. Mais nous avons aussi insist sur le
fait quelle reste hautement discutable et sous-dtermine, parce que les
corrlats neuronaux des oprations de haut niveau qui permettent la
verbalisation et les comportements labors ne sont pas ncessairement, du
mme coup, des corrlats spcifiques de la conscience phnomnale . Et
nous avons ajout que, de toute faon, dans le cadre de cette grille de lecture,
rien ne permet de rpondre la question de savoir ce qui, dans les
configurations neurologiques empiriquement associes une capacit de
rapport verbal, est cens donner naissance un ce que cela fait de vivre
cette exprience rapporte . En quoi le simple fait de lintgration
neurophysiologique pan-corticale permettrait-il de franchir le seuil radical qui
spare labsence de la prsence dexprience vcue ? Et pourquoi,
linverse, les modules spcialiss du cortex crbral, qui fonctionnent aprs
tout avec un certain degr dintgration locale, ne seraient-ils associs
aucune exprience ? Le postulat de la dsaturation de la conscience, et
lanalyse en contraste du conscient et de linconscient qui va avec, a en
somme une certaine valeur opratoire mais aucun potentiel explicatif. On a
mme des raisons de souponner que ce postulat engendre la question
aportique de lapparition dexprience consciente partir de processus
isolment inconscients, tant et si bien quaucune recherche poursuivie sous
son rgime na de chances dclaircir ce mystre auto-produit.
Il est alors tentant de transgresser le conseil de prudence mthodologique
formul pour les sciences en leur fondation, dessayer de prendre en charge
ds leurs postulats lenseignement quelles laissent deviner leurs moments
les plus avancs et les plus aportiques, autrement dit de suspendre demble
la clause de dsaturation laquelle sest adosse jusqu prsent la jeune
science de la conscience. Une telle option est encourage par le retournement
de lordre des priorits pistmologiques qui accompagne presque
automatiquement ltat de conscience dpoch. Du point de vue de lattitude
transitive, la saturation vcue est une circonstance accessoire, subjective,
idiosyncrasique ; elle ne fait que reflter la courte vue des habitants de lun
des rares centres corporels de perspective consciente qui se rencontrent dans
un vaste univers obtus et priv de conscience. Mais, du point de vue de
lattitude phnomnologique, lchelle dapprciation sinverse de part en
part ; ce qui se vit devient un paradigme laune duquel se mesure toute notre
conception des choses, et on se demande ds lors si lobstine prsence de
lapparatre ne pourrait pas tre tenue pour le fait le plus fondamental de tous.
Dans le sillage de ce renversement hirarchique, il semble naturel dtendre
la saturation constate de la conscience aux corrlats physiologiques de
lintgralit des vnements mentaux. Il semble raisonnable de ne pas refuser
a priori dassocier une exprience vcue chaque processus objectif corrl
un acte mental ; y compris les processus locaux, spcialiss, modulariss ; y
compris par consquent ceux qui sont accompagns de rapports verbaux
inexistants ou ngatifs. Bien entendu, une telle option rebours, o le
phnomnologue va se sentir tactiquement en phase avec quelques
neurologues audacieux qui dclarent passer outre le problme difficile de
lorigine physiologique de la conscience (avec le fondamentalisme
matrialiste en moins), ne va pas sans soulever des problmes dlicats ; mais
ce ne sont pas les mmes que ceux de la dmarche standard des sciences
cognitives, et le simple fait den changer annonce louverture de pistes
insouponnes.
L o lutilisateur du postulat de dsaturation se heurtait la question de
lmergence dune exprience consciente partir de son point zro
dobscurit absolue, le dfenseur de loption oppose de saturation
physiologique se trouve devant la ncessit dexpliquer comment seules
quelques-unes des expriences qui se font jour sont mmorises, rflchies,
verbalises, intgres un pass personnel, tandis que les autres, toutes celles
qui nont pas connu cette promotion, sont ignores et dclares avoir t
inconscientes . Lun doit rendre compte de la conscience partir de
linconscient, lautre dun semblant dinconscience partir de
lubiquitairement conscient (ou du moins partir dune exprience
ubiquitaire). Il y a quelque motif de croire que la seconde tche est moins
insurmontable que la premire. Il y a galement des raisons de penser que la
recherche scientifique et mdicale na pas grand chose perdre et beaucoup
gagner dans cette inversion des prmisses qui instaure un nouveau genre de
contraste ; non plus entre le conscient et linconscient, mais entre les lments
dexprience incorpors dans une histoire personnelle racontable, et ceux qui
en ont t exclus ds leur avnement. Aprs tout, inaugurer un projet
dinvestigation repens jusqu ses plus intimes prmisses ne peut avoir que
dheureuses consquences en termes de reformulation des questions et de
redfinition des procdures. De surcrot, la nouvelle tche dexplication a
lintrt philosophique, annonc prcdemment, dtre conforme lordre des
raisons constitutives qui descend de la conscience vers ses objets, et qui
senracine donc dans le fait de lexprience comme dans son plus indiscutable
prsuppos. Elle vite dentre de jeu lordre des raisons naturalisantes ,
qui ne cherche remonter des objets dclars naturels vers lexprience de
les voir ou de les penser qu condition davoir commenc par oublier son
flagrant point de dpart dans cette mme exprience. Elle substitue en somme
un itinraire direct de lprouv vers linfr, un trajet rtroactif qui prend
son essor dans le conu en esprant y retrouver son vcu primordialement
gar.
Il est vrai que cette nouvelle dmarche noffre pas plus de garanties que la
dmarche traditionnelle des sciences cognitives. En effet, loin dj de la
prudence descriptive de la phnomnologie qui lui sert de base arrire, elle y
introduit un lment spculatif, en esquissant la figure dune doublure
exprientielle de toutes sortes de processus physiologiques. Elle ne va pas
jusqu prter ces processus un ce que cela fait dtre eux , car il ny a
justement pas d eux en tant que nud didentit auto-reconnaissable et
racontable. Mais elle les associe un flux prouv, disponible pour tre
ultrieurement collect dans un acte de reconnaissance et de narration
identifiant. La dmarche adopte ressemble premire vue en cela la
version informationnelle de panpsychisme, qui a t critique
antrieurement. Mais, comme nous allons progressivement nous en
apercevoir, la diffrence entre les deux approches et les deux programmes de
recherche est considrable de ce point de vue. viter de dnier une
exprience aux processus mentaux de premier ordre, corrls aux processus
neuronaux des aires spcialises corticales, ouvre des consquences
potentiellement testables. Il suffit pour cela que lon trouve chez les sujets
humains des voies daccs psychiques rtrospectives permettant de faire
revenir au jour de la rapportabilit verbale certains moments initialement
vcus de manire inattentive, htive, ractionnelle. En revanche, associer la
conscience nimporte quel traitement dinformation intgr, y compris ceux
qui se droulent dans des machines, a beau avoir lintrt de crer un
mouvement dmulation technologique, cela demeure une impasse empirique.
Car, ainsi que nous lavons dj soulign, rien ne peut garantir que toutes les
conditions ncessaires dune conscience phnomnale sont remplies par
une machine, quelle que soit la qualit de ses performances comportementales
et mtacognitives. rebours de la mtaphysique pan-exprientialiste, par
ailleurs, lapproche propose ne consiste pas tenir lexprience pour une
proprit inhrente aux objets visibles et tangibles, mais simplement ne pas
envisager ce qui se voit et se touche hors de la continuit prouve avec le
corps propre actuellement voyant et touchant. Et cette perte de limite du corps
propre, son tour, nest pas rifie en quelque imputation dune me au
monde, mais plutt mobilise en une prescription de plasticit pistmique
consistant savoir identifier des moments dtre-en-situation, de
participation, ou dempathie dans le cours de chaque projet de connaissance, y
compris lorsque celui-ci porte sur un domaine infra-personnel. Lexprience,
ici, nest pas ajoute aux choses ; mais elle nest en principe soustraite de
rien de charnel tant elle simpose aux tres incarns que nous sommes comme
allant de soi.
Lhypothse de la saturation exprientielle des processus
neurophysiologiques vaut en tout tat de cause la peine dtre value pour
ses promesses de fcondit heuristique renouvele, et pour la reconfiguration
du champ problmatique quelle prsage. Afin de la mettre lpreuve, nous
procderons en deux temps. Lun, qui sappuie sur la neurophysiologie de la
vision, rend plausible lassociation dune exprience chaque corrlat dacte
mental spcialis. Lautre, qui est emprunt la philosophie de lesprit de
style analytique, permet dlaborer un scnario dtaill de la rpartition des
expriences entre la multiplicit de celles qui sont simplement vcues et
aussitt oublies ou simplement mises de ct, et celles beaucoup plus
troitement slectionnes qui se trouvent lies, mmorises, et rapportes.
Des arguments majeurs ont t avancs par Semir Zeki, chercheur en
neurophysiologie de la vision, en faveur du caractre distribu, et initialement
fragmentaire, de lexprience consciente associe au fonctionnement du cortex
crbral
6
. Il a tudi pour cela la modularit de la perception visuelle, qui se
divise en apprhensions spares du mouvement, de la couleur, de la forme,
voire de la direction spatiale. Chaque apprhension lmentaire est assure
par le fonctionnement dune aire spcialise du cerveau, presque toujours
localise dans le cortex occipital ; par exemple, laire V4 traite les
informations lies la couleur, et laire V5 traite les informations lies au
mouvement
7
aprs avoir reu aussi bien des affrences directes en
provenance des voies rtiniennes que des affrences mdies par certaines
colonnes spcialises de laire primaire visuelle occipitale V1. Un premier
point important noter est que laire affecte lapprhension des couleurs
traite linformation provenant de la rtine plus rapidement que laire affecte
lapprhension du mouvement (elle anticipe denviron 80 millisecondes
lapprhension du mouvement). Le fait que, dans des conditions
physiologiques normales, nous percevions des phnomnes intgrs, la fois
colors et en mouvement (sans dissociation apparente entre les deux),
implique selon les neurologues que des processus de liaison des
apprhensions spcialises sont mis en uvre par le cerveau, de manire
laborer des flux dapprhensions unifies
8
. La question qui se pose alors est
la suivante : la conscience apparat-elle seulement partir du moment o cet
acte de liaison des divers traitements spcialiss est accompli, comme le
pensent la plupart des thoriciens de la base neurologique de la
conscience
9
, ou bien est-elle dune manire ou dune autre dj prsente
chaque tape partielle ? Un certain nombre dindications vont dans le sens de
la conclusion hrtique , celle que nous avons dj vu dfendre par
Lamme
10
, et que Zeki appelle lhypothse des micro-consciences
corrles chaque fonctionnement local dune aire spcialise du cortex
crbral. Lune de ces indications provient de ltude de patients devenus en
partie aveugles la suite dune lsion partielle de laire corticale primaire
V1, mais capables de percevoir consciemment (de manire pouvoir le
rapporter verbalement) le mouvement des objets, y compris dans la fraction
atteinte de leur champ visuel
11
. Cette perception fragmentaire, trs diffrente
dans sa qualit de la perception intgre des sujets normaux, est corrle
une activation importante de laire corticale V5 des patients via les affrences
directes diriges vers cette aire. Il semble peu plausible partir de l de
considrer que seule la liaison des lments dapprhension visuelle est
consciente alors que chaque lment ne lest pas ; car on a l un exemple
dapprhension consciente de lun des lments pris isolment, celui qui
porte sur le mouvement des objets. Il nest en somme pas correct, souligne
Zeki, de dire que lactivit de cette aire spcialise V5 du cortex crbral est
ncessairement inconsciente
12
, alors que seules les dynamiques
intgratives le seraient. Un autre argument est tir dune exprience de rivalit
binoculaire, dans laquelle des images de mme forme, mais tantt de couleurs
identiques, tantt de couleurs diffrentes (vert et rouge), sont brivement
prsentes chacun des deux yeux. Dans ce dernier cas, lorsque les couleurs
montres sont diffrentes, la forme nest plus perue, et la seule exprience
rapporte est celle dune plage uniforme de couleur jaune. Or, un examen du
cerveau des sujets par imagerie fonctionnelle en rsonance magntique
nuclaire (dacronyme IRMf, en anglais fMRI), montre que la seule diffrence
entre ceux qui peroivent la forme la suite de stimuli de couleurs identiques
et ceux qui ne peroivent pas la forme mais seulement une plage jaune la
suite de stimuli de couleurs diffrentes est le niveau dactivit des aires
spcialises dans lapprhension de diverses formes (le gyrus fusiforme et le
gyrus parahippocampique, la face interne du lobe temporal du cortex
crbral). Ce niveau dactivit est fort dans le cas des couleurs identiques, et
faible dans le cas des couleurs diffrentes. Le corrlat principal de
lexprience consciente de la forme parat donc bien tre lintensit dactivit
des aires spcialises correspondantes, et non pas uniquement celle dune aire
ou dun processus de liaison intermodale
13
.
Mais sil en va ainsi, si une multitude de micro-consciences est corrle
au fonctionnement de multiples aires sensorielles (ou sensori-motrices)
spcialises, il faut encore expliquer deux choses : comment ces micro-
consciences dlments sensoriels disparates se composent en une conscience
globale de la chose sensible (et non pas en un agglomrat informe), et
comment les diverses consciences globales de choses se composent en une
seule conscience de personne-voyant-les-choses-dans-un-monde. Zeki appelle
macro-conscience la conscience compose de premier niveau, et
conscience unifie la conscience compose de second niveau
14
; il
demeure cependant discret sur le comment, sur les modalits de composition
des consciences lmentaires. Seules deux suggestions sont avances par lui
ce propos, lune quil emprunte la psychologie kantienne, et lautre quil
drive de la neurophysiologie.
Selon Kant, la liaison du divers des reprsentations sensibles en
units, lopration de leur synthse par le biais de limagination et sous les
concepts de lentendement, est une condition fondamentale de possibilit de
lexprience et de la connaissance dobjets. Or, cette condition de premier
ordre requiert elle-mme une autre condition de second ordre. Il sagit de
lunit de laperception , un principe fdrateur prsent davance sous
couvert dun Je qui lui sert de point focal. Ce Je na cependant rien de
substantiel ; il est seulement fonctionnel. Non pas que Je existe et quil
exerce un pouvoir attracteur sur les reprsentations sensibles, mais
simplement quun Je d o i t pouvoir accompagner toutes mes
reprsentations, faute de quoi celles-ci seraient perdues, isoles, et ne
seraient rien pour moi
15
puisquelles ne seraient intgres aucune histoire
personnelle unifie. Le Je nest donc autre que lindispensable axe
dynamique, le centre de forces effectif et sans cesse reconfigur, du milieu en
devenir de la conscience. Les deux tages dunification supposs par Zeki
trouvent ainsi leur rpondant exact dans la doctrine kantienne des facults : le
pouvoir de synthse et le Je fdrateur. ceci prs quils ont un statut
empirique chez le neurologue, et une justification transcendantale chez le
philosophe de Knigsberg. Ils sexpliquent par un mcanisme chez le
neurologue, et sinfrent partir dune finalit pistmique vcue chez le
philosophe.
Nous avons vu que la neurophysiologie contemporaine propose
essentiellement deux de ces mcanismes pour la liaison des vnements se
droulant dans les aires corticales spcialises (sans gnralement les
prendre pour un procd de liaison des micro-consciences, puisque, selon la
conception la plus rpandue, la conscience nmerge prcisment qu partir
de cette liaison) : la liaison spatiale, par convergence vers une aire commune
ou vers un complexe commun dactivit provisoire ; et la liaison temporelle,
par activation rythmique synchrone de plusieurs aires corticales
16
. La question
de savoir sil est ncessaire ou non de postuler quelque chose comme un
tmoin interne (pjorativement qualifi d homonculaire ) de ce processus
dunification, pour compenser son extension dans lespace ou dans le temps,
reste cependant un thme de controverse ; tout autant dailleurs que la question
associe de savoir comment la liaison ultime des micro-consciences et des
macro-consciences en une conscience suppose unifie de soi, se produit
17
.
Une thorie actuellement en vogue propos de la dernire question est que la
conscience unifie de soi a une origine indirectement sociale. Elle est
suppose apparatre lorsque je me forge une image de ma propre personne par
analogie avec celle que chacun se forme des autres personnes, sur le mode de
ce que je crois tre limage quun autre a de moi , ou, plus prcisment, de
ce que jaurais comme image de moi si jtais un autre . Cette thorie de la
conscience de soi a de nombreux antcdents, particulirement en psychiatrie
existentielle
18
o le jeu spculaire de conduites dcides en fonction de ce je
suppose tre lide que lautre a de moi est considr comme la racine du
fonctionnement ou du dysfonctionnement de la personne. Elle a galement t
propose partir dune base thologique, en supposant que la conscience (de
soi) rsulte dune capacit presque exclusivement humaine laborer une
thorie des autres esprits , et de son propre esprit thoris par dautres
19
.
Son aspect neurophysiologique consiste fonder la double capacit
apprhender lesprit des autres, et son propre esprit reprsent par les autres,
sur la mise en uvre des neurones miroirs
20
.
Mais, ce stade encore, bien des points restent obscurs. Admettons quon
commence entrevoir, par le biais dune mtaphore psycho-sociale plutt que
dune thorie neurologique pleinement labore, comment se forge une
image de soi rflchie partir du chaos des vnements mentaux ; quest-
ce qui permet le rassemblement de toutes les reprsentations sous ce ple
didentification ? Quest-ce qui permet de passer du simple acte de rflexion
dun moi lunification mienne des reprsentations ?
Pour rpondre ces questions, et quelques autres, nous allons trouver un
alli inattendu en la personne de Daniel Dennett, et un alli tout fait attendu
chez Paul Ricur. Lapproche de Dennett a lintrt pour nous dtre
demble souponneuse et ngative lgard des thories les plus rpandues
dans les sciences neuro-cognitives, qui font de la prise de conscience un
vnement mental singulier distinguer dautres vnements mentaux
inconscients. Cette attitude critique vis--vis de lopposition entre activits
mentales inconscientes et activits mentales conscientes, ce rejet de tout
mcanisme global apte transmuter le plomb des processus mentaux
inconscients en lor de la conscience, rapproche formellement la conception
de Dennett de la thorie neurologique de Zeki. Mais le rapprochement entre
les deux thses nen reste pas moins problmatique, puisquil semble ignorer
une opposition majeure qui va tre brivement nonce ici avant dtre
explore plus bas dans toutes ses consquences. Si la thse de Zeki
universalise lexprience consciente, avec son concept de micro-
consciences corrles aux activits neurophysiologiques locales, nous avons
vu au chapitre VII que celle de Dennett passe au contraire deux doigts
duniversaliser lactivit mentale inconsciente, et de mettre compltement
entre parenthses le fait vcu de la conscience au profit de la manire dont il
se raconte (et dont il compose son propre rcit). Pour Zeki, la conscience est
pratiquement partout, associe au moindre processus fragmentaire de
physiologie neuronale et peut-tre cellulaire, tandis que pour Dennett, il nest
ncessaire den invoquer lavnement nulle part, en aucune rgion
particulire et aucun moment privilgi, puisque seul est donn son compte
rendu rtrospectif. Lun plaque la saturation de lexprience vcue sur
lensemble des processus neurophysiologiques, alors que lautre formule une
interprtation hautement dflationniste et radicalement dsature du vcu, au
nom de la prminence mthodologique des contenus mmoriss et des
rapports verbaux dans les procds dattribution de conscience quelquun.
cette immense inversion philosophique prs, qui sera discute plus bas, la
structure de largumentation et des problmes rsoudre est curieusement la
mme dans la thorie intgralement sature de Zeki et dans la thorie
intgralement dsature de Dennett. Car, dans les deux cas, il ny a aucune
distinction accomplir entre des processus neurologiques corrls une
exprience consciente et dautres qui ne le seraient pas
21
, nulle rgion ou
dynamique identifier comme le site du passage des vnements mentaux sous
la lumire de la conscience , aucune scne de ce quil est convenu
dappeler le thtre cartsien mettre en vidence. Dans les deux cas, tout
ce quil sagit de comprendre est comment il se fait que certains vnements
mentaux semblent tre rests inconscients, pendant que dautres se prsentent
dans la conscience unifie (selon Zeki) ou bien sont rapports verbalement en
tant que conscients (selon Dennett).
Or, Dennett propose un compte rendu tonnamment simple de ce processus
de discrimination effective entre les deux types dvnements mentaux ; un
compte rendu qui passe par la diffrence entre ceux qui sont insrs dans une
trame narrative durable et cohrente assume long terme par la bouche dun
locuteur, et ceux, bien plus nombreux, qui se sont perdus dans un vaste ocan
dvnements isols ou articuls en squences courtes, non rflchis ou
transitoirement rflchis, parfois mal ou peu mmoriss. Selon Dennett, des
squences narratives sont sans cesse labores, sans cesse rvises, et
souvent abandonnes ; des bribes de biographie aptes unifier le divers de
lactivit mentale sous le fil nivel dun rcit sont constamment esquisses et
presque toujours mises de ct. De telles squences ltat naissant sont les
bauches multiples , ou les brouillons multiples ( multiple drafts )
dcentraliss, par lesquels Dennett remplace le lieu ou le moment central
darrive dun vnement mental sous les projecteurs (thtraux) de la
conscience
22
. Aucune bauche nest plus vraie que lautre, aucune nest plus
consciente quune autre. Cest seulement au moment o arrive linstant de la
question quas-tu peru, quas-tu pens ? , que se cristallise une rponse,
un rcit, un segment de biographie officialise , seule autorise dsormais
exprimer ce qui a t vcu consciemment par cette personne un certain
moment. Puis partir de l, en puisant dans le vaste rservoir des segments de
biographie officielle, slabore (et se rvise sans cesse galement) la grande
biographie qui constitue le soi la fois prsentable et assum comme tel.
Le soi , crit Dennett, nest ni plus ni moins quun centre de gravit
narratif
23
; une fiction utile pour la vie thique et sociale, mais aussi, par
ricochet, pour la vie psychique qui slabore sous le rgime des croyances
propos de limage que lautre a de moi. Le soi , confirme Ricur, rsulte
dune mise en intrigue des vnements vcus, qui engendre une ipsit ,
une identit personnelle idale dans laquelle se reconnatre en public aussi
bien quen priv. Car seule cette mise en intrigue narrative permet dinscrire
une ligne brise dvnements dans la matrice dordre dun projet, dapposer
rtrospectivement le sceau de la ncessit (de layant toujours t faire par
soi) sur des vnements et des choix qui sont apparus au premier abord
compltement contingents
24
.
Plusieurs arguments de psychologie exprimentale, parfois critiqus par
de bons spcialistes
25
, ont t avancs par Dennett en faveur de sa thorie des
bauches multiples. Leur but est de montrer que notre perception de la
squence temporelle des vnements est le fruit dune construction
rtrospective ; une construction qui seffectue justement sous le rgime du
rcit. Celle des constructions narratives que recueille le rapport verbal est
considre comme ayant t vcue, par opposition toutes celles qui taient
disponibles mais nont pas t recueillies et nont pas fait lobjet dun rcit
assum par la voix du sujet. La plus simple et peut-tre la plus parlante des
expriences de psychologie invoques est le phnomne PHI , tudi pour
la premire fois par Max Wertheimer en 1912, lpoque des premiers pas du
cinmatographe. Dans cette exprience trs connue et mille fois commente,
deux spots lumineux spatialement distants lun de lautre sont brivement et
successivement prsents un sujet ; le premier est de couleur rouge et le
second de couleur verte. Lorsque les moments et les dures de prsentation
sont bien choisis, le sujet a lillusion (cinmatographique) du mouvement .
Le point dlicat est que cette illusion lui est procure non pas par un pointill
lumineux squenc allant de lun lautre spot, ce qui permettrait de
lexpliquer banalement par la rmanence rtinienne, mais par deux spots
seulement, ce qui force faire intervenir un processus mental/crbral.
Comment la continuit dune trajectoire lumineuse est-elle constitue partir
de la discontinuit de lclairage ? Comment se peut-il que les sujets
dclarent avoir peru une ligne colore se dplaant dun spot lautre, et
mme lavoir vue changer de couleur, passant du rouge au vert mi-chemin ?
Si lon tente dexpliquer cela sous le rgime du thtre cartsien , celui o
on admet quil y a un sens dire quel vnement mental sest trouv jet sur la
scne de la conscience un moment donn, on a le choix entre deux scnarios
distincts. Le scnario que Dennett qualifie d orwellien , et celui quil
appelle stalinien . Selon le scnario orwellien, les deux vnements
mentaux discontinus, directement suscits par les stimuli lumineux successifs,
ont t conscients. Mais le cerveau a procd aprs coup une rcriture
de lhistoire analogue celle du Big Brother svissant dans le 1984 dOrwell.
Il a rtabli une continuit spatiale artificielle en remplissant de pigment
mental fictif , ou figment , lintervalle entre les deux spots initialement
perus. Aprs recouvrement et effacement des deux consciences initiales, il en
rsulte la conscience rtrospective davoir vu un mobile se dplacer et
changer de couleur dun spot lautre. Selon le scnario stalinien, en
revanche, aucun des vnements mentaux initiaux na tre considr comme
conscient. Cest seulement la suite dune dlibration ex post facto
(analogue un procs stalinien) quun vnement mental composite et
reconstruit sera autoris entrer sur la scne du thtre de la conscience, et
se prvaloir, aux yeux du moi spectateur comme des interlocuteurs de ce
moi , du titre de squence historique ayant effectivement t vcue. Or,
accuse Dennett, jusqu nouvel ordre, ces deux scnarios sont en pratique
indiscernables. Le seul critre nous permettant de savoir ce qui a t conscient
tant prcisment le rapport verbal, il est impossible de remonter des vcus
antrieurs au rapport.
moins de consentir au cercle auto-conflictuel consistant laborer une
thorie de la conscience sur la base des rapports verbaux, puis utiliser cette
mme thorie pour trouver des signes de conscience crbraux
indpendants des rapports verbaux, on doit donc se rsoudre selon Dennett
une forme d oprationalisme de la conscience : seul est dclar conscient
ce qui est attest verbalement comme tel, savoir ce qui fait effectivement
lobjet dun rcit circonstanci. Ni les vnements silencieux de conscience
initiale de lorwellisme ni la claironnante entre finale sous les feux de la
conscience du stalinisme ne sont accrdits. la fiction du caractre
intrinsquement conscient ou inconscient des vnements mentaux, on
substitue les seuls faits disponibles que sont les squences narratives. Et lon
tend le modle de la squence narrative en amont de sa production effective
par les organes vocaux du sujet, en admettant que cette squence-l est
seulement la partie merge dun iceberg d bauches multiples de rcits.
Il semble il est vrai trange dappliquer loprationalisme, doctrine
pistmologique de linaccessibilit principielle de la chose en soi , une
non-chose comme la conscience pour laquelle nous avons bien mieux quun
accs : une accointance, comme le dirait Russell, voire une co-naissance,
comme le dirait Claudel. Cest pourquoi Susan Blackmore
26
a complt
largument de Dennett par une stratgie subjective qui lui donne corps, et
ltend son vrai domaine de pertinence quest lexprience en premire
personne. Selon cet auteur, qui a procd une recherche phnomnologique
systmatique consistant sinterrompre sporadiquement dans ses activits et
sinterroger sur sa propre exprience cet instant, il ny a pas lieu de parler
de lexprience vcue indpendamment des coups de sondes auto-rflexifs
quon doit donner pour pouvoir en offrir un rcit public. Ce sont ces coups de
sonde qui fixent un contenu dexprience et qui, une fois articuls
squentiellement les uns aux autres, lui donnent la structure dune narration
potentielle. Un tel oprationalisme subjectif ne sinscrit pas ncessairement
en faux contre limputation traditionnelle de transparence soi et de
connivence quon accorde habituellement sa propre exprience consciente.
Il revient tenir compte du caractre fluent, polymorphe et indtermin de ce
qui est vcu ; un flux, une multiplicit, et une indtermination qui ne sont
suffisamment mis en forme que par le cadre ferme dune srie de questions, y
compris de questions adresses soi-mme.
Une dcision importante, rendue presque illisible par Dennett, doit encore
tre prise ce stade. Loprationalisme se prsente au premier abord comme
une attitude de prudence scientifique : ne pas en dire plus quon ne peut en
savoir par des oprations daccs. Mais il tend tre extrapol en une
doctrine mtaphysique : il nexiste rien dautre que ce quon peut savoir.
Dennett et Blackmore semblent sans cesse sur le point de prendre une dcision
en faveur de cette version mtaphysique de loprationalisme en matire de
conscience, et ils ne se rcusent sporadiquement que du bout des lvres.
Plusieurs passages de leurs livres et articles se lisent volontiers comme sils
en taient arrivs la conclusion quil ny a que des rcits, leurs bauches
successives, et leur version officielle traduite par un rapport verbal. Rien
dautre que cela, cest--dire en particulier ni flux unique de la conscience, ni
remplissement des lacunes que laisse le rcit dexprience par des qualits
sensibles vcues.
Un flux unique de la conscience supposerait une prslection
dvnements mentaux, et leur mise sous les projecteurs de lhypothtique
thtre cartsien . La squence claire sur la scne de ce thtre
reprsenterait alors le vrai flux de la conscience. Au lieu de cela, au lieu dun
flux de conscience se droulant dans le temps, ce quil y a seulement selon la
thorie des bauches multiples, est au mieux la conscience momentane dun
flux dont fait tat le dernier rcit en date, officiel , verbalis ; et au pire (un
pire souvent ctoy par Dennett et Blackmore) la narration rtrospective de
lillusion dun flux. Lmergence et la dispersion dassembles neuronales
gantes oprant par cycles de corrlation longue distance durant quelques
centaines de millisecondes, et impliquant des centres de mmorisation dans
leur activit, pourraient tre le corrlat physiologique de ces actes de saisie
narrative qui, tout en se droulant court terme, dploient en eux la trace de
squences antrieurement vcues. Le prsent tendu, avec sa structure
enchsse de rtentions et de protentions temporelles qui prolonge le
prsent effectif dj voqu, pourrait en tre quant lui la traduction
phnomnologique
27
.
La critique du remplissement des lacunes perceptives, au-del du simple
rcit de plnitude vcue, est au moins aussi aigu que celle du flux de
conscience, chez les dfenseurs de la thorie des bauches multiples. Elle
complte et amplifie sur un mode temporel leur entreprise de
dphnomnologisation de la science de lesprit que nous avons vue
luvre sur un mode spatial aux chapitres VII et VIII. De mme quil ny a pas
de flux de conscience, mais au mieux la conscience dun flux, souligne
Dennett, il nest pas cens y avoir dexprience consciente remplie aprs coup
de qualits sensibles, mais seulement un remplissement nominal par la
description de cette exprience. Lexprience archtypale du phnomne-PHI
est nouveau prise comme exemple. Le cerveau, explique Dennett, na pas
besoin de remplir lintervalle entre les deux spots lumineux successivement
rouge et vert par une bande intermdiaire de figment dabord rouge puis
vert. Le jugement de continuit, la narration dune trajectoire changeant de
couleur, est tout ce quil y a
28
.
Ce qui pourrait se dgager de l est la conception dune exprience
composite, faite pour partie dexprience sensible en pointill, et pour partie
de jugements partiels de remplissement intermdiaire, suffisants pour
permettre un jugement global de continuit perceptive. Mais Dennett ne sen
tient pas l, comme nous le signalions au chapitre VII, et comme nous allons
mieux le comprendre dsormais en prenant en charge le motif oprationaliste
de sa thse dlimination ontologique, sur laquelle nous butions dans une
ambiance de stupeur mle dincrdulit. Aprs avoir conclu que ces
adjonctions sont [] faites de jugement , il ajoute sans hsiter, en utilisant
de manire sans cesse plus extensive le il y a de lontologie : Il ny a
rien de plus dans la phnomnologie que cela ; la phnomnologie consiste
uniquement en jugements (de percevoir). Seulement cela, et rien dautre.
lintention de ceux qui, nen croyant pas leurs oreilles, hsiteraient encore
en tirer lultime consquence, Dennett susurre qu il semble y avoir une
phnomnologie
29
. Il semble seulement y en avoir une. La phnomnologie,
la teneur mme de lexprience, est assimile un jugement (douteux) et un
(faux-) semblant. L htrophnomnologie , cette discipline dfinie par
Dennett comme une mthode de reconstruction textuelle de lexprience de
lautre partir de ses rapports verbaux, a fini par contaminer, puis par
remplacer entirement, la phnomnologie, cette mise au jour de lexprience
vcue en de de toute activit constructive. Une telle tendance gnraliser
limputation fictionnaliste toute lexprience consciente pourrait bien
reprsenter la reductio ad absurdum involontaire de la position de Dennett.
Mais avant de ractiver ce retournement dcisif, nous pouvons mieux faire
ressortir le mcanisme de la gnralisation fictionnelle travers celle, trs
dennettienne, quaccomplit Susan Blackmore.
Pour Blackmore, tout ce qui est couramment tenu pour caractristique de
lexprience consciente relve du jugement fallacieux. Quil y ait un soi
substantiel est fallacieux, puisque tout ce quon peut trouver est un centre de
gravit narratif. Quil y ait un flux de la conscience est fallacieux, puisque
lide du flux rsulte dune construction fictionnelle, partir de jugements
rtentionnels et protentionnels sarticulant en un rcit. Quil y ait un
continuum dexprience sur toute la surface du champ visuel est galement
fallacieux, puisque lapparence dun continuum est le fruit dune trame de
jugements de reproduction de motifs identiques. On en infre que tout cela,
soi , flux et texture continue dexprience, est une grande illusion
30
.
Jusque-l, la thse apparat soutenable. Laccusation dtre illusoires
sadresse des traits de permanence et dextension peut-tre abusivement
surimposs lexprience consciente. Or un glissement se fait rapidement
sentir, un glissement imperceptible mais frappant. Du caractre illusoire de
certains traits attribus la conscience, on passe, moyennant quelques
prcautions dcriture, la conscience entire comme illusion. Dire que la
conscience est une illusion ne revient pas dire quelle nexiste pas, mais
quelle nest pas ce quelle semble tre
31
. Elle nest pas ce quelle semble
tre. Elle semble porte par un soi mais elle ne lest pas ; elle semble en
flux mais elle ne lest pas ; elle semble tre pleine et sans lacune mais elle ne
lest pas. Admettons-le hypothtiquement ; mais au moins ce quelle semble
tre est une exprience, une exprience consciente de semblant-tre, et cela ne
saurait tre une illusion. Sauf amorcer une rgression linfini dillusion en
illusion, et ne plus savoir par comparaison quelle ralit qualifier une
exprience dillusion, un point darrt effectif (quon peut appeler, si lon
veut, le prsent vivant) simpose. De mme que, comme le signale
Wittgenstein, le doute prsuppose la certitude, lillusion dun vcu prsuppose
la ralit vcue de lillusion. Ce point darrt effectif est implicite mais
vident dans les prmisses silencieuses du texte de Blackmore : il sagit de sa
propre conscience de persuasion ; cette conscience sur fond de laquelle elle
sest sentie autorise voquer, quitte la nuancer, la possibilit que la
conscience soit une illusion.
Au fond, pourquoi avancer une chose aussi norme pour se rtracter tout
de suite aprs ? Pourquoi suggrer que la conscience est une illusion , si
cest pour restreindre aussitt la porte de lassertion en dclarant que, bien
sr, cela nquivaut pas proclamer que la conscience nexiste pas ? La
figure de style est trange. Si, perdu dans le dsert, je dis que ce lac devant
moi est une illusion, que ce lac est un mirage, cela veut bien dire quil nexiste
pas. Seule existe la perception consciente dun lac. Mais cest justement cela
le problme ! Lcart qui vient dtre signifi entre la chose (inexistante) et la
conscience de chose svanouit lorsque la chose sidentifie la
conscience elle-mme. Et on se trouve alors pratiquement forc, si lon tient
maintenir le terme illusion , la contorsion mentale dune illusion qui ne
signifie pas linexistence. Ce nest que tout la fin de larticle de Blackmore
que la vritable motivation de cet usage non conventionnel de lillusion se
laisse voir, et elle laisse songeur. Pour rsoudre le problme difficile au
sens de Chalmers, dclare Blackmore, il nest plus ncessaire de savoir
comment un fonctionnement neuronal est transmut en conscience, mais
seulement didentifier les mcanismes dengendrement de la grande illusion.
Autrement dit, rendre compte de lorigine de la conscience ne requiert rien
dautre que la mise au jour des procds de gense des faux-semblants
auxquels elle se rduit. Lnonc la conscience est une illusion savre a
posteriori un point dappui indispensable une telle requalification du
problme de la conscience. La conscience est illusion, et par suite lucider
lillusion quivaut lucider la conscience. Voil donc la motivation latente
de lnonc mise au jour : si la phrase fatidique a t formule initialement,
cest pour servir ainsi de relais dans la tentative finale de rendre moins
difficile le problme de Chalmers, quitte affaiblir finalement son sens en
affirmant qu illusoire ne veut pas dire inexistante . Malheureusement,
ce dernier changement de sens fait aussitt perdre lavantage gagn par la
premire formulation de la phrase. On ne voit pas en quoi la requalification
propose constituerait une solution du problme difficile de lorigine
physique ou physiologique de la conscience, puisque lidentification des
procds de lillusion montrerait uniquement comment sengendrent des
consciences incorrectes dun soi , dun flux, dune continuit, et non pas
comment nat la conscience tout court, ft-ce en tant que conscience de ces
faux-semblants. Cest seulement condition que la proposition initiale la
conscience est une illusion soit prise au pied de la lettre quelle peut servir
de liant aux deux tapes du raisonnement : si la conscience est une illusion
dans sa totalit, alors rendre raison de lillusion quivaut bien rendre
raison de la conscience. Mais, prcisment, cette proposition ayant t
dsamorce par les prcautions qui lont suivie, elle ne peut plus assurer sa
fonction de connecteur logique. Le problme difficile reste intouch.
moins, bien sr, daller jusquau bout de la dmarche de dralisation
de la conscience, esquisse, sans tre pleinement assume, par Dennett et
Blackmore. Au lieu dtre explique, la conscience serait ainsi congdie,
conformment une inclination constante dans les crits de ces auteurs.
Postuler une semblance relle en plus du jugement [] exprim dans le
rapport verbal du sujet serait multiplier les entits sans ncessit, crit
Dennett
32
. On en revient sans cesse l : il ny a rien de plus supposer que
le jugement, rien tenir pour un apparatre par-del le jugement dapparatre.
Pour cultiver le doute du lecteur, pour lui faire perdre pied dans son sentiment
dvidence propos dun apparatre se tenant en de (plutt quau-del) du
jugement, pour mieux linciter pratiquer assidment le genre d exercices
spirituels de dspiritualisation que nous avons identifis et dnoncs au
chapitre VII, le procd du dialogue galilen, et de largument de contradiction
performative, est utilis plusieurs reprises par Dennett. Il met en scne un
contradicteur nomm Otto
33
dans le rle du Simplicio de Galile
34
; un
contradicteur assez bent pour croire la conscience, lapparatre, la
phnomnologie, et autres vieilles lunes hrites dun pass animiste et
vitaliste
35
. Lessence des dbats engags avec ce contradicteur consiste lui
faire voir que tout ce quil est en mesure de produire en faveur dun contenu
dexprience, voire du simple fait dune conscience par-del le jugement,
nest prcisment rien de plus quun jugement. Cela peut tre le jugement
dexistence dun flux de conscience, ou le jugement quil semble y avoir une
continuit dans la conscience du champ visuel. Dans chaque cas, remarque
ironiquement Dennett, la seule chose quOtto est capable de faire pour
persuader un interlocuteur de lexistence dun ailleurs du langage revient
savancer encore plus sur le terrain du langage. Otto et tous les
contradicteurs avec lui se voit invit reconnatre quil reste pig dans le
cercle magique de la langue, et que ses tentatives den sortir en faisant
pathtiquement signe vers autre chose par son moyen savrent un chec.
Cette doctrine de la clture absolue du champ des pratiques de la langue
est attribue par Dennett Wittgenstein
36
. Mais en vrit, elle ne sy trouve
pas sous cette forme minimale et rigide, pour qui sait voir transparatre une
phnomnologie wittgensteinienne
37
sous la surface de sa philosophie
linguistique
38
. Car, si Wittgenstein a toujours affirm avec force que la
sensation, le contenu qualitatif dexprience, la conscience, ne sont
(videmment) pas autant dobjets auxquels il est possible de faire rfrence,
il a galement soulign que le langage a des ressources pour les exprimer
39
.
Exprimer est ce que lon sait faire lorsquil ny a pas de distance entre soi et
ce qui veut se dire. Exprimer nquivaut pas juger en se tendant tout entier
vers un objet prsum extra-linguistique, mais inscrire les sonorits de la
langue dans la continuit de ce qui se vit. La philosophie wittgensteinienne
des jeux de langage suivie dans son plein dploiement est donc loin de se
limiter elle-mme un jeu logique. Elle est fermement tablie dans ce l qui
ne se dit pas mais qui se montre, qui ne se dsigne pas mais qui sexprime ; et
elle tire de cet ancrage sa productivit apparemment intarissable en dpit de
son absence de continuit argumentative et textuelle. partir de ce
recentrement de ltre-au-monde, de ce changement dtat de conscience, qui
nous fait passer de ltat dennettien au vritable tat wittgensteinien,
limputation de contradiction performative change de camp
40
. Dsormais, Otto
peut reprendre loffensive, retourner largument ad hominem son envoyeur,
et faire remarquer Dennett que lorsquil dclare croire quil ny a rien de
plus que des jugements, sa croyance prsente est une exprience de
persuasion. Si Dennett rplique encore que la croyance est accessoire, que
seule importe la teneur du jugement cru, Otto a la ressource de le reconduire
l o il en est (et l o il ne savait plus tre), en lui demandant perfidement :
et maintenant, crois-tu que la croyance est accessoire
41
?
Lun et lautre des arguments de contradiction performative relevs
jusqu ce point, largument dennettien et largument anti-dennettien, semblent
peser en sens inverse et squilibrer. Mais en va-t-il bien ainsi ? Un argument
de contradiction performative vise ramener linterlocuteur en amont de ce
quil dit, au milieu de lacte de dire, et faire ressortir un conflit entre le dire
et le dit. Mais les deux retours ne sont pas quivalents. Lun est retour au fait
quun jugement a t mis, lautre retour la croyance en ce qui est jug. Lun
est retour un objet (linguistique), lautre retour la prcondition des vises
dobjet. Le second argument de contradiction performative prcde donc et
annule par avance le premier. Il tire linterlocuteur un cran en arrire par
rapport au premier, en tchant de le cueillir linstant o sa conscience a tout
juste amorc son dploiement en vise ou en signification, o elle ne sest pas
encore entirement chappe elle-mme dans la fuite perdue vers un autre
quelle-mme. La contradiction dnonce par Dennett doit tre constate
aprs-coup par Otto, tandis que la contradiction dnonce par Otto ne peut
tre que vcue concomitamment par Dennett, titre de pralable tout constat.
Un lecteur factieux serait en droit de remarquer ce stade que cest
encore par le verbe que je viens ddifier ce que je pense tre un argument
convaincant en faveur de lchappe hors des rets de la langue vers sa
prcondition silencieuse. Oui, lecteur, mais vous, ntes-vous pas en train de
raliser en ce moment mme quil en va ainsi, avec pour tout signe lisible un
sourire narquois sur vos lvres ? Il est vrai que je nai pas russi prendre un
temps davance sur vous dans notre change dialectique (et que je nai aucune
chance dy parvenir) ; mais vous tes maintenant dans ce temps davance
espr, parce que vous vous en apercevez ; je vous ai lgu le soin dachever
mon argument dans la simple concidence de vous vous qui se produit au
moment mme, celui-ci, o vous le comprenez.
lissue de cette discussion, on a toutes les raisons et plus encore tous
les motifs vcus de ne pas retenir la rduction extrme du semblant-
conscient au logico-symbolique, dont Dennett est tout prs de se faire
lavocat. Mais il reste la possibilit dutiliser sa thorie des bauches
multiples pour clarifier la manire dont on passe des micro-consciences
de cognitions spcialises que postule Zeki aux macro-consciences
unifies et assumes comme miennes que traduisent les rapports verbaux
dexprience. La combinaison dune thorie sur-sature de la conscience
comme celle de Zeki et dune thorie intgralement d-sature comme celle de
Dennett vaut dtre tente, afin de rendre compte dun vcu satur de la
dsaturation (cest--dire de la conscience que jai de ne pas pouvoir
rapporter chaque instant toute ma vie mentale comme ce qui mest
effectivement, consciemment, arriv ; de la conscience que jai davoir laiss
quelque chose de ct, dans le rcit que je donne de ma vie consciente).
Une nouvelle pause, et un bref dtour, doivent cependant tre pratiqus
ce stade prcis de la rflexion. Dennett a rcemment formul de vigoureuses
objections contre lide que ltendue de la conscience excde le domaine de
laccs mnsique et verbal, autrement dit contre les thories quil qualifie de
dissociatives au nom du fait quelle dissocient la conscience vis--vis des
fonctions daccs. La thorie de Zeki figure au premier rang de celles que
rcuse Dennett, et la synthse propose entre les micro-consciences et les
bauches multiples en est rendue littralement inadmissible de son point de
vue. Nous ne pouvons donc pas viter daffronter ses contre-arguments plus
compltement encore que cela na t fait jusque-l. Ceux-ci, qui ressemblent
beaucoup aux arguments dj avancs en faveur de la thse de la grande
illusion , se divisent en deux genres.
Le premier genre dargument sinscrit en faux contre limpression que la
phnomnologie est plus riche que ce qui peut en tre rapport, ou que les
tableaux perceptifs comportent davantage dlments vcus (et dclars
comme tels) quon ne peut en dcrire de manire prcise et dtaille. Il
sappuie sur la considration dexpriences portant sur la structure de
lattention, qui est focalise, tout en tant dote dune priphrie la fois
distribue et dgrade. De deux choses lune, crivent Cohen et Dennett
42
:
soit il y a une forme affaiblie daccs la zone priphrique de lattention,
dont les sujets peuvent parler, et dans ce cas la conscience reste articule aux
fonctions cognitives qui en permettent le rapport verbal ; soit lattention, et
avec elle la conscience, est entirement manquante, comme cest apparemment
le cas dans les situations de ccit attentionnelle , et dans ce cas il ne
saurait videmment y avoir daccs ou de rapport. En somme, soit la
conscience est prsente, mme faiblement, et elle reste accessible et
verbalisable, soit cest sa complte absence qui explique son inaccessibilit.
Conscience et accessibilit sont strictement indissociables, selon cette
analyse. La littrature de psychologie exprimentale contient pourtant de
nombreux arguments allant contre la stricte solidarit entre conscience et
accessibilit cognitive dfendue par Dennett. Le principal dentre eux est la
varit et la plausibilit des explications quon peut donner dune absence de
rapport ou dun rapport ngatif, par-del la pure et simple inexistence de
lexprience rapporter. Lamnsie, lagnosie, et lindisponibilit seulement
rationnelle
43
des phnomnes comptent parmi ces explications alternatives
mnageant la possibilit que ce qui nest pas rapport soit nanmoins prouv.
Lamnsie peut si bien effacer des apparitions fugaces que les sujets sont en
droit de dclarer rtrospectivement navoir jamais t conscients delles
(comme cest souvent le cas, nous lavons vu, dans lanesthsie gnrale).
Lagnosie est un dfaut de catgorisation dune apparition, qui rend cette
dernire inapte une description verbale, sans pour autant lannuler. Il en va
ainsi, par exemple, lorsque des sujets dclarent ne pas avoir peru lentre
dun gorille sur un terrain de football opposant une quipe au maillot blanc
une quipe au maillot noir, non pas forcment parce quil ne lont pas vu, mais
parce quils tendent le catgoriser incorrectement comme lun des joueurs
habills en noir
44
. Lindisponibilit rationnelle de linformation associe
une exprience consciente, enfin, signifie sa mise lcart de la voie
principale qui lui permettrait de conditionner le raisonnement ou la production
verbale. Pour autant, toute influence retarde, indirecte ou subliminale de cette
exprience fugace et loigne du cercle attentionnel de la vie logique
socialement prsentable nest pas exclue. Il en va ainsi dans les effets dits
d amorage ( priming en anglais)
45
, o une exprience ni retenue ni
rapporte peut influencer, voire biaiser, les rponses ultrieures dautres
expriences faisant lobjet dun rapport verbal. Ainsi, contrairement ce
quavance Dennett, il pourrait bien y avoir quelque chose entre la conscience
directement accessible et labsence complte de conscience. Ce quelque
chose dintermdiaire, ce sont des moments de conscience qui en prparent
dautres, qui disposent de nouvelles ractions ou de nouvelles penses
sans tre eux-mmes en prise immdiate avec lagir ou le concevoir, et qui
sont indirectement accessibles travers des rapports verbaux rtrospectifs
portant sur leurs consquences vcues ou agies. En suivant la liste prcdente
de comptes rendus alternatifs des absences de verbalisations, lamnsie peut
savrer circonstancielle et tre surmonte par un travail de rvocation en
acte des situations passes
46
; lagnosie peut parfois tre corrige
rtroactivement et faire ressortir des pisodes occults par leur dficience de
catgorisation
47
; et lindisponibilit dun moment de conscience peut tre
seulement de second degr, en attente dune exprience influence par elle
mais cognitivement disponible au premier degr. Les interprtations de
Dennett ne suffisent dcidment pas exclure que le champ de lexprience
stende au-del de ce qui est cognitivement accessible , au sens prochain
de verbalisable, catgorisable, et squenable dans une histoire de soi
spontanment et immdiatement nonce
48
.
Le second genre de contre-argument avanc par Dennett prolonge et durcit
le prcdent en se prvalant de la force dune rgle pistmologique. La rgle,
dj mentionne, est celle doprationalisme htrophnomnologique, selon
laquelle il ny a aucun sens testable affirmer lexistence dune exprience
consciente chez un sujet (y compris soi-mme) indpendamment de la
possibilit quon a dy accder. Ds lors, les thories qui associent, comme
celle de Zeki, une conscience lmentaire chaque vnement
neurophysiologique local, indpendamment de sa connexion des fonctions
globales de prise de dcision et de formulation linguistique, sont qualifies
collectivement de non scientifiques. Il en rsulte une reconfiguration
fortement restrictive du problme de la conscience. Selon Dennett, la
distinction mme entre le problme difficile de lorigine de la conscience
phnomnale , et les problmes faciles portant sur les fonctions cognitives
daccs, doit tre considre comme nulle et non avenue, au nom de
limpossibilit de rfuter ou de vrifier des propositions portant sur la
conscience autrement quen accdant linformation associe. Il ne saurait y
avoir quun seul type de problme de la conscience, selon Dennett : celui qui
se prte un accs cognitif permettant lattestation et la thorisation. Seuls les
problmes faciles sont par consquent lgitimes, pour la simple raison quils
portent sur les fonctions mentales qui permettent cet accs en dernier ressort.
Loin dtre un obstacle formidable la science, concluent Cohen et Dennett,
le problme difficile doit son apparente difficult au fait quil se situe
systmatiquement en dehors du domaine de la science, pas seulement de la
science daujourdhui mais de toute science future
49
. Ce genre de dcret
dinsaisissabilit dun problme par la science sans limite de temps, que
Dennett repoussait ironiquement dans lun de ses livres
50
, est prsent
assum par lui, quoique dans un tout autre esprit. Le problme difficile ayant
t reconnu comme nappartenant au domaine oprationnel daucune science
prsente ou future, il est rput ne pas exister. Rciproquement, ce qui
appartient au domaine de la science, savoir les problmes faciles sur les
fonctions cognitives, doit puiser toute interrogation portant sur la conscience.
Et ltude de ces fonctions doit donc suffire donner le fin mot de lnigme :
la conscience ne peut pas ne pas se rduire au jeu des fonctions cognitives
daccs.
Que penser de cette stratgie de ngation dun problme au nom de son
cart par rapport une mthodologie scientifique prise pour norme troite et
exclusive ? Et que penser de la consquence de cette stratgie, qui consiste
favoriser un problme connexe, puis prvoir les termes de sa solution au
nom de sa conformit la mme mthodologie ? Il faut admettre pour
commencer que la stratgie de ngation nest pas dnue de pertinence tant
que le problme allgu se trouve lui-mme formul dans les termes de la
mthodologie scientifique. Le problme difficile de Chalmers tant celui
de lorigine physique de la conscience phnomnale, cette origine suppose
devrait tre accessible une mthode analogue celle de la physique.
Lenqute serait donc ici tenue de se conformer aux rgles de cette mthode,
parmi lesquelles les rgles de lattestabilit empirique sont les plus
cruciales ; et, sil lui est par principe impossible de sy conformer de bout en
bout, alors le problme qui la motive doit tre rejet. Toutefois, la rciproque
de ce rejet ne vaut pas : il nest pas vrai que toute interrogation sur la
conscience soit puisable par les tudes scientifiques portant sur les fonctions
cognitives, puisque la conscience dite phnomnale leur sert de
prcondition, et demeure donc cause de cela dans leur angle mort. Autrement
dit, il est juste de rejeter le problme difficile tel que la formul Chalmers
parce que, ayant encore un pied dans le cercle de validit mthodologique des
sciences objectives, sa non conformit partielle aux normes de ce cercle
lexclut de facto des recherches quil est lgitime dy mener. Mais il nest pas
juste de subordonner la question de la conscience dans son ensemble une
science qui est par construction lacunaire son gard.
Ces remarques sur les consquences troitement scientistes que Dennett
tire de son oprationalisme sont pourtant loin den avoir affront tout le dfi
pistmologique. Le point de vue phnomnologique lui impose encore plus
dacuit que le point de vue des sciences en troisime personne. Que peut bien
tre une exprience dont nul na connaissance, une conscience de laquelle
aucun accs ne permet dtre conscient ? Ces propositions sonnent comme
de vritables oxymores en premire personne. Mais elles ne semblent telles
que parce que ltanchit entre les deux domaines, lexpriment et le non-
expriment, a t exagre. partir du moment o lon a fait droit, comme
prcdemment, la possibilit dun accs cognitif diffr, dun dplacement
rtrospectif de lattention, dune recatgorisation tardive de rgions non
classes de lexprience, ou dune remmoration de vcus initialement
occults, tout change. Des pans entiers de conscience des franges et des
interfaces deviennent disponibles, comme on la signal au chapitre IX
propos de lvaluation critique du concept de corrlat neuronal de la
conscience formule par Eric Schwitzgebel
51
. Des expriences qui scartent
progressivement du centre attentionnel immdiatement verbalisable pour aller
vers des vnements de plus en plus marginaux ou fugaces se contentant
daltrer les dispositions mentales savrent parfois indirectement ou
tardivement accessibles. Une vaste phnomnologie de lalors-vcu, de l
peine remarqu, de lintentionnellement ignor, du trop vite pass, de
lentraperu avant toute conceptualisation, des tats de disponibilit vides et
pour cela ngligs, de linsupportable rprim, de linterrogation fugitive
reste sans rponse, des profondeurs cnesthsiques trop banales pour tre
constates, de tout cela qui est maintenant reconnu comme tel mais ne la pas
t immdiatement ni spontanment, souvre alors linvestigation. La limite
nette de linaccessible et du silencieux est ici remplace par la bordure floue
de l peine accessible et du peut-tre un jour racontable. Par ailleurs, et cest
prcisment l le motif de la synthse projete entre thorie des bauches
multiples et thorie des micro-consciences, une exprience dont nul na (
prsent) lexprience pourrait sinterprter comme une exprience qui nest
(en ce moment) assume par nul moi, qui nest (encore) intgre dans nul rcit
autobiographique, et non pas forcment comme une exprience inexistante. La
perspective de son intgration et de sa verbalisation, la latence de ses effets
induits, suffisent lui confrer un statut pistmologiquement respectable, y
compris sous la contrainte dun oprationalisme cognitif. Cest ici le lieu de
signaler que lexclusion des entits (ou des expriences) caches nest pas
une consquence invitable de loprationalisme. Un oprationaliste doit
incontestablement bannir de telles entits (ou de telles expriences) si celles-
ci noffrent aucune perspective de nouvelles observations ou de nouvelles
actions motives par elles, court ou long terme. Mais il na aucune raison
de les refuser si elles peuvent tre dfinies par une opration daccs, ft-elle
distante, diffre, dtourne, ou mdiate.
Il reste quuniversaliser la notion de telles expriences latentes ou isoles
au nom dun postulat duniformit neurologique, comme le fait Zeki, ou au
nom de lillimitation de lhorizon des vcus distants, oublis, ou
infraliminaux, comme est tent de le faire un phnomnologue, relve dans un
premier temps du pari, pour ne pas dire de la spculation, ainsi que nous
lavons admis plus haut. Ladversaire cognitiviste de cette universalisation
aura tendance accuser ses dfenseurs, non sans quelques bons motifs, de
commettre ds leur premier pas le sophisme de la lampe-torche
52
. Une lampe-
torche allume, voyant de la lumire devant elle indpendamment de la
direction vers laquelle elle pointe, ne peut que conclure (faussement) quil y a
de la lumire partout ; de mme, une conscience, sapercevant constamment
delle-mme durant le travail mental, est porte conclure (faussement, selon
le courant dominant des sciences cognitives) que toute opration mentale est
associe une conscience. Il est cependant ais de retourner lallgorie contre
ceux qui lont formule, condition de modifier lgrement ses termes de
comparaison. Au lieu de faire correspondre au couple lumire-obscurit le
couple conscient-inconscient, on peut le rapprocher du couple foyer
attentionnel/exprience aux marges de lattention, ou bien du couple
exprience explicite/exprience inchoative. On infre alors, partir de la
mme allgorie, quun foyer attentionnel dexprience verbalisable tend
conclure (faussement) que toute exprience est explicite et immdiatement
susceptible dun rapport verbal ; et que par consquent, rebours de
lhypothse de dpart, une exprience non explicite et non verbalise sur-le-
champ ne saurait exister. Une simple allgorie ne suffit dcidment pas
emporter la dcision, mme si elle peut temporairement susciter des
convictions superficielles. Car le choix mme de ses termes de comparaison
est conditionn par la thse quon vise lui faire illustrer. Dans lallgorie de
la lampe-torche, leffet du parti pris sur sa formulation est vident : pourquoi
choisir le couple conscient-inconscient, si ce nest parce quon tient pour
acquis que le statut quasi-constant de lactivit mentale est inconscient ; et
linverse, pourquoi choisir le couple foyer attentionnel
dexprience/exprience aux marges de lattention, si ce nest parce quon
sadosse sur le fait de lexprience en luniversalisant ?
Largument allgorique ntant pas concluant, il faut en revenir une strate
plus primitive, pr-argumentative, de la prise de position philosophique :
ladoption pralable dune posture ou dune orientation fondamentale. La
posture choisie ici est drive de lattitude empiriste de Van Fraassen
53
,
mais dans le genre de version sans compromis que doit adopter un
phnomnologue : se tenir fermement dans ltre-au-monde vcu, et se
demander comment le reste, science, objectivit, et concepts neurologiques,
en est issu. Le choix qui sous-tend cette posture expose au chapitre V semble
frapp au coin du bon sens : partir de l o on est pour en driver ldifice de
la connaissance (dans les sciences cognitives comme dans toutes les autres
sciences) au lieu de chercher inversement prendre appui sur la construction
obtenue pour rendre raison de l do le btir sest lanc. Mais au fait, o
est-on ? Quelle est lidentit de ce l autour duquel nous ne cessons de
tourner ? La caractrisation que nous avons commenc par en donner na rien
de partag. Lempirisme classique situe le l dans les donnes des sens.
Lempirisme constructif, le pragmatisme et le ralisme lmentaire de
l attitude naturelle le dsignent comme le monde familier de lactivit
quotidienne, ainsi que des oprations et des faits de laboratoire. Le ralisme
scientifique, enfin, tend le l la nature entire telle que les thories
prtendent la reprsenter. On saperoit ainsi que le slogan du retour l o
on se trouve ne suffit pas davantage que lallgorie dissiper lembarras de
la slection dun point de dpart. Les ralistes scientifiques sont par exemple
en droit de prfrer leur stratgie, que nous avons repousse comme une vaine
tentative de fonder loriginaire sur le driv, au nom de leur conviction que
l o on est ntant autre que la nature figure par les sciences, et non pas
une conscience humaine isole dans cette nature, ce que nous appelons
originaire est driv, tandis que ce que nous appelons driv est originaire. La
stratgie directe des uns est la stratgie rciproque des autres, lici des uns est
le lointain des autres.
Pour sortir de limpasse, il faut faire rintervenir quelque chose de plus
profond encore que la posture : ltat de conscience. Ce qui est premier pour
ltat de conscience ordinaire est lobjet sous la main, le milieu objectiv des
pratiques courantes ; ce qui est premier pour ltat de conscience dune vise
intentionnelle pousse jusquaux formes thoriques est la totalit des objets
des sciences de la nature ; ce qui est premier pour ltat de conscience rflexif
est le monde de la vie vcue entire, sensible, motionnelle, conceptualisante
et objectivante. Mais le seul tat de conscience qui autorise raliser cette
dpendance des originarits lgard des tats de conscience est celui
dpoch phnomnologique radicale. Capable de boucler sur les autres
comme sur lui-mme, il saffirme nouveau comme notre meilleur candidat au
titre doriginaire des originaires. L o on est se montre dans lapaisement
des pulsions vers les ailleurs ; il ne se rvle pas lextrmit dune qute
entreprise pour le chercher. L o on est se rend clair par son inassimilabilit
quelque lieu que ce soit, par sa disposition circuler dans les tendues
dune attention parfois extatique, et par son aptitude faire voir les origines
concurrentes comme autant de rgions dans une topographie fabrique ; il
nest pas lui-mme une collection de choses et de lieux ramasse devant le
regard. Une fois fixe lidentit de l o on est , cest ce l qui doit servir
de prsuppos normatif, pour la simple raison que nous nen savons nul autre
aussi bien que lui. Et si, comme cela vient dtre suggr, le l-source est
lexprience actuelle, alors cest cette dernire qui a qualit pour tre
prsomptivement universalise. L o je me trouve, l o jai t jet, est
exprience incarne des lieux et des choses, exprience situe dans une chair
rversible voyante et vue, objectivante et objective
54
. Pour tendre ma
connaissance assure de proche en proche, le choix le plus raisonnable et le
plus conome en hypothses est donc de reconnatre a priori toute chair que je
vois comme voyante, le corrlat objectiv de ma sensibilit comme apte tre
objectivant, les objets de conscience du vivant que je suis comme signifiant
une capacit au vcu conscient.
Lexprience pure, ni chose, ni proprit, ni phnomne, est simplement
accepte dans cet tat de rfrence comme la donne la plus primitive que
nous ayons, comme un matriau manifeste et indistinctement ubiquitaire dont
seuls restent lucider les procds de composition qui lui permettent
datteindre la forme de conscience rcursive, stable et articule de notre vie
humaine adulte. Tout ce qui a dj t dit prcdemment sur llaboration de
segments de rcit, sur leur mmorisation ou leur non-mmorisation, sur leur
intgration ou leur non-intgration au rcit officiel biographique, sur leur
rflexion ou leur non-rflexion comme mappartenant , peut tre emprunt
Dennett sans aboutir invitablement comme lui lextinction de la conscience
dans la suite de vocables dune narration. Que la conscience soit structure
narrativement nimplique pas que la structure narrative puise tout ce quil y a
dans la (ou les) conscience(s). Que lon rcuse limage dun thtre
cartsien o les vnements mentaux inconscients sont placs sous la
lumire crue de la conscience nentrane pas automatiquement que lactivit
mentale dans sa totalit soit reconduite lobscurit dune pure concatnation
de signes. Cela peut plutt sinterprter, aux antipodes dun tel
liminativisme, comme une affirmation de linutilit de promouvoir les
vnements mentaux la dignit dtre-conscient dans la mesure o tous la
possdent demble au sens minimal dtre prouv. Seule leur mise
disposition permanente pour des ractualisations, et leur acceptation long
terme comme faisant lgitimement partie de lhistoire dun moi , doivent
passer par la voie troite dun processus de slection qui en rejettera un grand
nombre dans loubli, ou bien simplement dans une dcharge de rcits tantt
avorts, tantt priphriques, tantt sans lien mutuel, do ils ont peu de
chances dtre extraits un jour (sauf faire un effort spcifique de remise au
jour de lindistinct et du quasi-oubli). Les processus neurologiques
intgratifs allant des oscillations synchroniques cortico-thalamiques aux
vastes assembles cellulaires corrles longue distance devraient partir de
l tre compltement rinterprts. On ne les tiendrait plus pour des corrlats
neuronaux de la conscience, mais pour des corrlats neuronaux de la
stabilisation de rcits verbalisables dune squence principale de vcu
conscient reconnu comme mien , partir dun rservoir de nombreux
candidats narratifs galement conscients nayant pas tous russi lpreuve de
la gnralisation et de la mmorisation pisodique. On ne leur ferait plus
jouer le rle de faisceau dclairage des actes cognitifs spcialiss et
inconscients, mais le rle de liant cohsif de consciences lmentaires
candidates lentre dans lavenue principale de lautobiographie.
Cette synthse inspire de deux auteurs (Zeki et Dennett, un Zeki
incomplet et un Dennett rticent) sera appele partir de l la thorie des
bauches conscientes multiples, aprs avoir simplement insr ladjectif
consciente dans le nom de la thse de Dennett. Elle a, entre autres
avantages, celui de donner une signification renouvele au fait que le critre
ultime de conscience nest autre que le rapport verbal, prconditionn par
un acte de mmorisation. Au lieu de considrer que la verbalisation est une
traduction indirecte de la part dactivit mentale qui sest droule sous les
projecteurs du thtre de la conscience, on doit dsormais en infrer quelle
est le fruit direct de la slection de lune des squences narratives conscientes
par le locuteur comme celle qui va tre enchane ses squences narratives
antrieures (ou plutt qu linverse elle modle lidentit du locuteur par
lacte de la retenir). Au lieu de raconter la conscience, on opte pour une
conscience travers la dclamation dun certain conte. Le changement
dinterprtation nest pas ngligeable. De lune lautre, la distance entre la
parole et ce quelle rvle sest beaucoup raccourcie. Dans le premier cas,
qui correspond la vision courante, le rapport verbal offre un aperu sur
quelque chose de tout autre que lui ; il est considr comme un accs, certes
imparfait mais quasiment unique, vers un champ de pur apparatre qui lui est
au fond tranger. Si lon en fait un critre de conscience, cest contraint et
forc, en raison du quasi-monopole qui lui est reconnu ; mais en droit il
manque tellement daffinits avec ce dont il est le critre quon le souponne
de faillir souvent sa tche de mise au jour
55
. Dans le second cas, le rapport
verbal nest rien dautre que la transcription de celle des prverbalisations de
squences vcues qui a t leve au rang de rcit officiel. Faire de la
prsence dun rapport verbal le critre, non pas dune conscience de toute
faon ubiquitaire, mais de litinraire particulier de conscience raconte qui
se trouve intgr (provisoirement ou durablement) dans le courant
autobiographique du sujet, va pour ainsi dire de soi ; car il y a coextensivit
de lun lautre.
Quant labsence de capacit de rapport verbal constate dans les tats
vgtatifs ou dans lanesthsie gnrale, elle na plus ici ncessairement tre
interprte comme perte complte de conscience, mais peut-tre comme
simple tmoin dun clatement des consciences dsormais prives de leur
terrain dintgration et de tissage en une seule histoire personnelle. Une
donne rend cette faon de voir plus plausible : cest la russite frquente des
procds danesthsie sous hypnose
56
. Ici, le patient peut difficilement tre
considr comme inconscient. Mais ce que parvient sans doute faire
lhypnothrapeute est disoler la conscience de douleur du patient de sa
grande squence autobiographique, et de la lui rendre ainsi inaccessible. La
douleur reste consciemment perue, mais tant localement perue, tant
maintenue en dehors du tissu de la narration auto-assume par le patient
comme vcue, elle nest plus rien pour lui. linconscience se trouve
substitue la fragmentation de la conscience, son d-tissage en un faisceau de
fils narratifs divergents, dont un seul est raccroch la chane des souvenirs
siens. Une autre donne se trouve clarifie par cette thorie, et lui donne de la
consistance en retour. Elle concerne lontogense de la mmoire des
nourrissons et des jeunes enfants. Chacun dentre nous vit dans une absence
apparente de souvenirs organiss, pisodiques, datant de la toute petite
enfance. Les premiers de nos pisodes mmoriss et racontables remontent
habituellement une poque situe entre lge de deux et de quatre ans.
Pourtant, des exprimentations psychologiques, et aussi le tmoignage de
nombreux parents, montrent que les trs jeunes enfants sont parfaitement
capables de mmoriser ce qui leur arrive. Des nourrissons savent reproduire
un geste fait par lexprimentateur plusieurs semaines aprs en avoir t
tmoins ; des enfants de dix-huit mois manifestent quils se souviennent avoir
vu un spectacle insolite ; et dautres enfants de deux ans savent relater un
pisode tonnant peru dans un zoo ou un parc dattractions
57
. La seule chose
que ne peuvent pas encore faire ces petits dhommes, cest sapproprier un
souvenir, et en faire un rcit centr sur eux-mmes en tant que protagonistes
58
.
Comme nous lavons vu au chapitre II propos de lontogense des niveaux
dtiquetage rflexif des expriences, ils ne connectent encore ni ce qui est
racont du pass ni ce qui est figur du futur un moi capable de sen faire
lacteur et le centre unificateur. La curieuse combinaison de mmoire et
doubli qui caractrise les jeunes enfants se comprend immdiatement partir
de l. Les enfants en bas ge sont bel et bien conscients de ce qui survient et
ils sont capables de sen souvenir ; mais ils ne sapproprient pas ce
souvenir ; ils ne le nouent pas une corde biographique intgre qui en ferait
un souvenir leur, rappelable tout instant en la tirant par son extrmit
identitaire prsente. Les souvenirs du tout jeune enfant que nous avons t ne
sont sans doute pas perdus, mais disperss, rpandus dans un champ de
possibilits didentification jusque-l non actualises. Seuls des procds
comme lhypnose (utilise rebours de sa finalit anesthsique), ou les libres
associations de la cure psychanalytique, parviennent parfois ractiver ces
possibilits perdues, carder partir deux dautres fils biographiques
esquissant des personnalits virtuelles, les faire converger enfin vers la
personnalit actuelle qui les autorise se raconter.
Ces remarques sur lanesthsie, lhypnose et la mmoire des jeunes
enfants nous conduisent au plus prs dune question de principe quil faut
prsent affronter nouveau. Quel est le statut de la thorie des bauches
conscientes multiples qui vient dtre expose ? Quest-ce au fond quune
thorie de la conscience ? Que parvient-elle faire si son objet est un non-
objet, et si elle ne peut mme pas sauver les phnomnes, la conscience
ntant pas un phnomne mais le fait dernier de la phnomnalit ? Pour
rpondre ces interrogations, il faut revenir au plus prs de la racine de
lactivit thorique. Avant mme dtre un discours sur des objets, et une loi
reliant les phnomnes, une thorie a pour fonction dimmerger lactualit
(perue, ou plus gnralement vcue) dans un rseau de possibilits ; elle a
pour fonction de faire concevoir ce qui est en acte comme une ralisation
particulire au sein dun univers de virtualits beaucoup plus vaste quelle.
Or, cest peu de choses prs ce que parvient faire la thorie des bauches
conscientes multiples, en situant lexprience consciente actuelle au sein dun
grand rservoir dexpriences conscientes latentes dont lintgration la
biographie actuelle aurait t envisageable mais na jamais t accomplie.
Cette sorte dexplication de lexprience consciente telle que la traduit le
rapport verbal ne ressemble mme pas superficiellement son contrepoint
mtaphysique. Il ny est pas question de rvler lorigine, la cause premire,
larch, du terme expliqu. Ce quil sagit dexpliquer est au contraire
reconnu modestement comme donn, puis plong dans un systme de
coordonnes traant ses rfractions, ses mtamorphoses, et ses laborations
possibles. Le systme de coordonnes nengendre rien, il repre. Il nexplique
pas au sens second de dvoiler le principe de lexplicandum ; il ex-plique au
sens premier de dployer sa toile arachnenne autour de cet explicandum et
de lui offrir par l un terrain de variations. Lexprience consciente actuelle
nest pas suppose engendre par quoi que ce soit ; elle est tellement l que
nul engendrement ne pourrait la prendre revers partir dun ailleurs. Elle
est simplement repre dans le systme de ses propres possibles, de ses
rflexions possibles, de ses mises en forme possibles, de ses fables possibles,
de ses synthses possibles, de ses oublis ou de ses ngligences possibles.
Une telle thorie de lexprience consciente ne pourrait toutefois avoir
une pertinence pour lexprience consciente elle-mme qu la condition
expresse quelle ait des consquences en premire personne. La disponibilit
dune traduction vcue et raconte de certaines manifestations de lubiquit de
lexprience consciente dans la vie mentale est capitale pour assurer
loprationalisation de cette thorie ; et elle lest galement pour lui assurer
un ancrage dans le tribunal de dernire instance des conceptions de la
conscience quest la conscience elle-mme. Nous avons admis prcdemment
quil en va bien ainsi, que rien nempche daccder rtrospectivement des
expriences inchoatives. Et pourtant des doutes de principe peuvent
lgitimement surgir ce sujet. On peut se demander sil est simplement
vraisemblable que se fassent jour des vnements vcus allant dans le sens
dune thorie des bauches multiples revue et corrige par le pan-
exprientialisme mental de Zeki. Lintgration des micro-consciences, leur
articulation en un rcit, se vit rtrospectivement partir du point de vue du
rcit intgr et articul. Sil en va ainsi, le rcit officiel incorpor dans la
biographie du sujet na-t-il pas toutes les chances de sapprhender lui-mme
comme unique, isol, et excluant toute autre squence consciente ? En
saisissant la corde biographique par son seul bout didentification actuelle, ne
semble-t-il pas quon puisse seulement tirer les souvenirs qui lui sont
accrochs, et que les squences alternatives de conscience, ces bauches
multiples fragmentaires non adhrentes lattracteur du moi , soient
condamnes rester ignores ? vrai dire, des rponses ces questions
deviennent disponibles, comme nous le verrons plus bas, et elles sont
encourageantes. Mme si, en fin de parcours, toute exprience exprime se
trouve lie de facto la squence biographique principale, il reste quon peut
se souvenir de lavoir auparavant gare ou exclue, et de lavoir rintgre
sous leffet dun dialogue de mise au jour ou dun travail sous hypnose. Son
statut dans le fil autobiographique est celui dun brin latent devenu patent, et
ressenti comme tel
59
, ce qui lui permet de venir lappui de la thorie des
bauches conscientes multiples sans briser lunicit finale du rcit
officiel .
Au moins cette remise en situation a-t-elle lavantage de clarifier quelques
dbats confus sur la place de la conscience dans lconomie mentale. Pour
comprendre le procd de la clarification, il faut dabord noter que, dans bon
nombre de ces dbats, on tend substituer la question quel rle la
conscience joue-t-elle dans la dtermination des comportements ? la
question apparemment plus modeste, et plus accessible lexprimentation,
quel moment apparaissent de possibles corrlats de la conscience, dans la
chronologie des dterminants neuronaux de laction ? . Lhypothse qui sous-
tend la substitution est que ce serait seulement dans le cas o les corrlats de
conscience, attests par un rapport verbal, apparatraient avant les corrlats
neuronaux de la commande motrice quon pourrait tenir une volition
consciente pour la cause de lagir. Cest cette reformulation de la question
qua retenue Benjamin Libet
60
pour son enqute tantt clbre, tantt dcrie,
sur la ralit du libre-arbitre
61
. Et cest elle galement que Dennett a prise
pour cible dans sa relecture des expriences de Libet la lumire de sa
thorie des bauches multiples
62
.
Rappelons lexprience centrale de Libet
63
, qui servira de tmoin. Elle
consiste demander un sujet daccomplir un geste strotyp un moment
arbitraire de son choix, puis enregistrer chez lui trois types dvnements en
squence. Le premier est le potentiel de prparation motrice (Readiness
Potential, ou RP, en anglais), qui est une onde lectroencphalographique
engendre par lactivit du cortex moteur et de laire motrice supplmentaire
du cerveau. Le deuxime vnement est la dclaration rtrospective du sujet
davoir dcid de faire son geste un certain instant, repr par la position de
laiguille dune horloge
64
quil observe pendant lexprience ; cet instant est
dnot W (pour Wanting, vouloir en anglais). Le troisime vnement, enfin,
est la contraction des muscles correspondant leffectuation du geste, atteste
par un lectromyogramme ; il est appel M (pour Motion, mouvement en
anglais). Le rsultat exprimental qui dcoule de ces enregistrements est
simple et reproductible : linstant verbalement rapport de la dcision de
bouger est nettement postrieur au potentiel de prparation motrice (il est
retard par rapport lui de 300 400 millisecondes), mais il reste antrieur
la contraction des muscles (lanticipant de 100 200 millisecondes). La
squence scrit : RP<W<M. Des versions ultrieures de lexprience ont
confirm pour lessentiel le rsultat chronomtrique de Libet, tout en
circonscrivant mieux les aires crbrales associes la prparation dun
mouvement et la conscience dclare de lavoir voulu
65
. Elles utilisent
pourtant des moyens diffrents, en explorant le cerveau par IRMf (imagerie
par rsonance magntique fonctionnelle) ou par TEP (tomographie par
mission de positrons) au lieu de llectroencphalographie, et en remplaant
linstruction de faire un geste strotyp par linstruction de choisir entre
deux gestes strotyps. La controverse ne se fait vraiment jour qu ltape
suivante, celle de linterprtation du rsultat.
Linterprtation que propose Libet est littrale. Selon elle : (a) la
conscience de vouloir agir (et la volont consciente dagir, qui lui est plus ou
moins assimile), retarde par rapport lamorce inconsciente du mouvement ;
(b) le mouvement est donc dcid inconsciemment, avant que la conscience
de vouloir (ou la volont consciente) nintervienne ; (c) il reste cependant un
dlai entre lmergence de la conscience de vouloir et leffectuation de lacte,
et ce dlai peut tre mis profit pour exercer une sorte de droit de veto
conscient sur le projet inconscient dagir, faisant ainsi parfois avorter ce
dernier.
Chacun des termes dune telle interprtation est contestable, et de
nombreux auteurs nont pas manqu de le souligner ds la parution de
larticle, ouvrant la polmique dans les colonnes mmes du journal qui la
publi. La fascination pour largument de Libet na pourtant cess de crotre,
et cela reprsente un phnomne au moins autant socio-culturel quintellectuel.
Le dsir secret quexprime cette fascination est sans doute celui de voir la
sci ence trancher, avec son autorit suppose sans appel, des dbats
existentiellement cruciaux mais philosophiquement ambigus ; un dsir
dailleurs contradictoire, qui en conduit beaucoup voir dans le rsultat de
Libet la preuve scientifique de linanit du libre arbitre et de linexorable
dtermination matrielle de nos actes (au nom du point b de son
interprtation)
66
, et dautres au contraire se sentir conforts dans leur
croyance au libre arbitre (en adaptant le point c de son interprtation)
67
.
Lobstacle qui soppose ce dsir est que la dcision scientifique espre
dpend de choix pralables en matire de dfinitions et de prsuppositions,
qui ne peuvent pour leur part manquer dtre philosophiques. Libet mle ainsi
des faits empiriques des prconceptions philosophiquement naves, et il lui
est impossible de se passer de ces dernires pour aboutir ses conclusions.
Cela se lit dans sa juxtaposition dun langage des causes (physiologiques) un
langage des intentions (conscientes), ainsi que dans sa prcipitation situer
chronologiquement une intention comme on le ferait dune cause. Un tel style
dexpos mixte convient dans le langage courant, parce quil entrine notre
capacit basculer dun tat de conscience intentionnel un tat de
conscience rflexif. Mais il demeure suspect dans les sciences cognitives,
parce quil nadhre pas de bout en bout leur approche objectivante, et
quau-del de cela il ne peut se prvaloir daucune garantie en matire
darticulation chronologique entre des vnements qui relvent de cette
approche et des vnements vcus qui nen relvent pas. En droit, lexpos en
premire intention des rsultats et de linterprtation de lexprience de Libet
devrait seffectuer dans le seul langage mthodologiquement liminativiste
des sciences cognitives. Or, en ce droit liminatif prliminaire, la seule chose
quenseigne lexprience de Libet
68
est quentre un vnement
lectrophysiologique et le geste quil anticipe sintercale linstant dsign par
une production verbale ; et que cette production verbale traduit laccs
conjoint, aux aires associatives et lespace de travail global du cortex
crbral, dune donne chronomtrique et dune donne motrice. Toute thse
ultrieure sur ce que fait ou ne fait pas la conscience, voire sur le moment de
la squence physiologique o elle intervient, est extrapole partir de cette
base prosaque et doit sans cesse y revenir pour y trouver ses lments de
justification ou de rfutation.
rebours dun tel droit minimal, le langage utilis par Libet porte la
marque de ses convictions dualistes latentes, vite reconnues par ses
commentateurs
69
. Un moment dstabilises par le rsultat inattendu de
lexprimentation, dans laquelle (en bon accord avec un pur
piphnomnalisme) la conscience de vouloir effectuer un geste semble
survenir aprs la prise de dcision par des processeurs neuronaux
supposs inconscients, ces convictions ont trouv une compensation dans la
thse du veto . Le libre arbitre, compris (sur un mode manifestement
dualiste) comme une capacit quaurait la conscience de dterminer selon ses
propres fins le cours des processus neuronaux aboutissant une action, est
ainsi sauv de la droute travers un pouvoir prt cette conscience de ne
pas agrer certains mouvements inconsciemment planifis. Malheureusement,
ce veto ressemble un deus ex machina qui droge compltement aux rgles
chronologiques nonces par Libet lui-mme en ce qui concerne la volition
consciente
70
. Comment se fait-il quon nobserve pas de potentiel de
prparation de veto , qui nous conduirait la mme conclusion
piphnomnaliste que celle de la premire phase de lexprience ? Faut-il
admettre quune volition a besoin dune anticipation neurophysiologique
inconsciente dans tous les cas sauf celui dune volition ngative comme le
veto ? Doit-on vraiment aller jusquaux ultimes consquences de la
dfinition offerte du libre-arbitre, en considrant que lors du veto, la
conscience se comporte comme une entit entirement part qui intervient
dans les processus neuro-musculaires et peut les interrompre loisir ?
Ladmettre reviendrait dpasser le crypto-dualisme inscrit dans la forme du
langage interprtatif, pour adopter un dualisme mtaphysique faiblement tay
par cette seule interprtation. Cela supposerait, contre toute prudence
logique
71
, quon excde les modestes constats de succession dvnements
neuro-comportementaux, pour les riger en marques de dpendances causales
entre entits de types ontologiques distincts.
Encore na-t-on avanc jusque-l que des arguments dimplausibilit
contre lhypothse libetienne du veto . Le seul moyen den venir bout
serait de montrer quelle nest en aucune manire indispensable pour rendre
raison des principaux faits qui lont rendue crdible aux yeux de Libet : non
seulement lantcdence du moment allgu de la dcision consciente par
rapport au geste, mais aussi et surtout le constat quun potentiel de prparation
motrice nest pas toujours suivi du geste bauch
72
. Le non-accomplissement
du geste, dans quelques cas o la monte dun potentiel de prparation
motrice a pourtant t enregistre, semble appeler une explication
transcendant les processus physiologiques qui sous-tendent ce potentiel ; et
cest ce genre dexplication allogne que suggre Libet, avec son ide dun
veto prononc par la conscience. Mais il se trouve que des travaux rcents ont
avanc des comptes rendus alternatifs de la dcorrlation partielle entre
leffectuation du geste et le potentiel de prparation motrice, rendant du coup
superflue leur explication par un veto de la conscience . Le dbut de ces
comptes rendus ressemble une amplification du dcalage temporel qui avait
frapp Libet, puisque des prodromes neurophysiologiques ont t dtects
jusqu dix secondes avant la conscience dclare davoir fait un choix entre
deux options prsentes
73
. La suite scarte en revanche des donnes de Libet,
et suggre de ce fait une interprtation trs diffrente du genre dexprience
dont il a t le pionnier. On a en effet pu montrer que cette anticipation
neurophysiologique ne vaut que de faon incertaine
74
, la probabilit que
loption prslectionne soit finalement choisie scartant dabord trs peu de
la valeur de lindiffrence, et ne tendant progressivement vers 1 que
lorsquon sapproche de linstant de laction
75
. Cest de cet instant tardif, o
la probabilit dune dcision tend vers son maximum, que date la conscience
verbalement rapporte davoir voulu agir. Le tableau qui se dgage de ces
travaux est alors bien diffrent du schme mixte, physiologiquement
dterministe et thiquement volontariste, de Libet. Il prend un tour
stochastique sur un plan physiologique
76
, et neutre sur un plan thique. Une
action ou une option ne sont pas brusquement dcides (ou
empches ) ; elles sont progressivement canalises, bauches, essayes
blanc, avant que le processus donnant lieu ces esquisses samplifie, et
finisse par aboutir un geste une fois dpass un seuil donn
77
. Cest le
passage de ce seuil dactivit neuronale que signale le rapport verbal davoir
dcid quelque chose un instant donn, et cest linverse le non-
franchissement de ce seuil en dpit de la pousse partielle dune activit
prparatrice qui se traduit par labsence de geste ou de choix
78
, sans quil y
ait besoin pour comprendre cette absence dinvoquer un veto extrinsque.
Il se confirme alors quun compte rendu cohrent, de bout en bout objectif,
des donnes exprimentales concernant lacte de dcision, scarte de tous les
points de linterprtation de Libet, aussi bien ceux qui confortent lide du
libre arbitre que ceux qui la fragilisent. Dans ce cadre de pense, le retard de
linstant verbalement affirm du choix par rapport la monte progressive de
la dynamique neuronale ne nous dit rien sur la prsence ou labsence
dexprience consciente associe, ni sur la capacit ou lincapacit de celle-
ci inflchir le cours des vnements physiologiques comme un pilote en
son navire
79
. Ce retard nest pas comprendre ici comme celui de la
conscience volitive par rapport aux mcanismes aveugles du cerveau, mais
comme lexpression dau moins deux temps de latence physiologiques. En
premier lieu, le temps de construire un faisceau dactivit neuro-lectrique
dpassant le seuil de dclenchement certain du geste ; et en second lieu, le
temps ncessaire pour faire arriver un carrefour commun mmorisable et
verbalement articulable les multiples informations que synthtise un rapport
de volition dat : linformation visuelle concernant la position de laiguille de
lhorloge, linformation intellectuelle provenant des centres traitant les
motivations rationnelles ou motives de lagir et linformation proprioceptive
concernant le franchissement du seuil deffectuation du geste envisag. Assez
logiquement, ce qui est trait dans le langage mi-intentionnel mi-causal de
Libet comme un retard de la conscience par rapport un processus
lectrophysiologique est compris, dans le langage intgralement causal des
liminativistes mthodologiques que sont les spcialistes de sciences neuro-
cognitives, comme un retard de la conjonction des informations permettant le
rapport verbal de volition, vis--vis du seul traitement des informations
motrices.
Est-on alors condamn, au nom de la rigueur du raisonnement, sen tenir
ce seul langage causal et aux consquences non plus mthodologiquement
mais mtaphysiquement liminativistes qui pourraient en tre tires ? Quel
rle assigner au langage intentionnel dans lconomie de la preuve, si on ne
peut pas lintercaler quelque part sur le chemin qui mne de lamorce
neurophysiologique au geste accompli ? Et o par consquent retrouver la
conscience, ses contenus, ses projets, dans le dsert formel du procs-verbal
neurobiologique de lagir ? La thorie des bauches conscientes multiples
propose une rponse non conventionnelle ces questions, en adhrant, dune
part, la structure du compte rendu purement objectif des vnements neuro-
cognitifs, et en prenant, dautre part, lexact contre-pied de son parti pris en
faveur dun fonctionnement de lesprit la manire dune collection de
zombies . Selon cette thorie, le langage intentionnel de la dcision ou du
veto conscient na pas interrompre quelque part le langage causal du
processus neurobiologique. Sil en va ainsi, ce nest pas parce que ce langage
est banni, mais au contraire parce quil est gnralis en tant que doublure
constante du langage causal : la doublure en premire personne dun langage
qui sest disciplin pour valoir en troisime personne. Le langage intentionnel
peut tre employ partout, dans une perspective qui rpand lapproche en
premire personne, aussi bien que nulle part, dans une perspective qui
universalise lapproche en troisime personne. Lemploi continu du langage
intentionnel par la thorie des bauches conscientes multiples ne sinscrit
donc pas en faux contre lemploi systmatique du langage causal par
lliminativisme, contrairement lusage discontinu et perturbateur des
enchanements causaux quen fait le dualisme. Il se contente de proposer une
stratgie dexpression parallle conforme lattitude rflexive-
phnomnologique, capable de sajouter celle de lattitude naturaliste et de
la complter. L o lliminativisme cognitiviste tend sans limites le champ
dune description de processus neurobiologiques inconscients, et vite ainsi
davoir rendre raison dun lment aussi htrogne son paradigme que la
conscience phnomnale, la thorie des bauches conscientes multiples se
garde rciproquement de refuser dassocier une forme (ft-elle nouveau
fruste, non rflexive, quasi-instantane) de conscience phnomnale quelque
phase que ce soit de la squence physiologique allant de la prparation au
geste, et sexempte ainsi de traiter dun lment aussi htrogne son
adossement phnomnologique quun mcanisme mental entirement
inconscient.
Les prodromes neuronaux et autres potentiels de prparation motrice ne
sont plus compris partir de l comme autant de processus aveugles
conduisant mcaniquement un mouvement optionnel, mais comme la
traduction objective dautant de projets inchoatifs, de brouillons de
planifications vcues puis aussitt oublies, de renforcements progressifs ou
daffaiblissements dune dcision encore incertaine delle-mme. Quant la
dclaration verbale demande aux sujets de Libet, elle nest plus considre
comme un rapport sur le moment effectif du dcret conscient (qui stale si
bien dans le temps, selon cette interprtation, quil est de toute faon mal
dfini), mais comme une indication de linstant que ces sujets tiennent pour
celui du renforcement final de leur volont. Ce qui est rapport, et intgr
lautobiographie officielle dun sujet, ce nest pas lvanescent instant de la
dcision consciente, mais la conscience rtrospective dun instant de dcision
ferme. Parmi toutes les consciences phmres dintentions flottantes, la seule
qui se trouve consolide, mmorise et affirme verbalement comme telle est
la conscience tardive de lintgration de tous les critres, temporels, rsolutifs
et pr-moteurs, permettant de rpondre la question de Libet : quel instant
as-tu dcid daccomplir ce geste ? La question joue ici un rle crucial, en
cristallisant un rcit. Sans elle, le rapport de dcision naurait pas t
construit et auto-assum, mais se serait dilu dans la multitude dbauches
intentionnelles dont est fait le flux inattentif des comportements quotidiens.
Il peut sembler que cette interprtation protge la notion du libre-arbitre
contre le versant critique de largument de Libet, sans avoir besoin pour cela
den appeler son versant dogmatique quest le veto . Aprs tout, si lon
considre que les vnements neurophysiologiques de type potentiel de
prparation motrice reprsentent la face objective de ce qui se prsente
subjectivement comme une longue dlibration pr-dcisionnelle, et non pas
un processus entirement automatique anticipant le brusque vcu subjectif de
quelque dcret final, rien ninterdit daffirmer que cest la conscience
omniprsente du sujet qui dcide progressivement du mouvement quil va
accomplir. La conscience ne cesse dtre luvre selon la thorie des
bauches conscientes multiples, mme dans ses moments germinatifs,
inattentifs, et peu ou mal mmoriss, que traduisent les processus
neurophysiologiques esquissant une commande motrice. Elle est dj prsente
durant le potentiel de prparation comme elle lest lpoque de la
dclaration et de la gesticulation. Plusieurs auteurs considrent dans ces
conditions que la conscience peut tre tenue pour la cause, et non pas la
consquence tardive, du dclenchement dune action
80
. La libre
dlibration prend simplement du temps, et cest ce dlai que traduit, selon
Dennett
81
, la lente escalade du potentiel de prparation motrice, culminant
avec une dclaration de rsolution terminale qui revendique a posteriori pour
elle-mme lexclusivit dans le rcit autobiographique.
Il faut toutefois redoubler de prcision ce stade : sous lhypothse
interprtative retenue, laffirmation selon laquelle la conscience est la
cause du mouvement a profondment chang de sens par rapport ce que
Libet entendait. La conscience nest plus ici une entit capable dinfluencer
comme de lextrieur un processus neurophysiologique, que ce soit en le
dirigeant ou en le contrecarrant. Elle est lavers vcu dun revers observ, le
courant prouv dune dynamique objective. Mais, l o le courant de
conscience adhre strictement sa rplique naturelle, la libert sauve
semble se rduire son acception spinoziste dagir en tant dtermine par
la seule ncessit de sa nature
82
. Bien des auteurs estiment que, sil en va
ainsi, le sens dans lequel le libre arbitre a t prserv est trop faible pour les
contenter
83
.
Une telle insatisfaction vis--vis des enseignements thiques dune thorie
comme celle des bauches conscientes multiples ne doit pas tre prise la
lgre. Car elle pourrait bien signaler une consquence indsirable de
lirrsistible drive mtaphysique de cette thorie, lorsquon la fait intervenir
dans le dbat sur la signification pratique des recherches neurobiologiques.
Ne loublions pas : la thorie des bauches conscientes multiples a
initialement t investie de la mission dviter de trahir la saturation vcue de
la conscience, et den tendre les consquences tous les domaines de la
science de lesprit ; elle est en somme partie dune volont de maintenir de
bout en bout le srieux de loption phnomnologique. Lnonc quon doit en
donner pour la transformer en un partenaire actif du dbat sur le problme
esprit-corps, en revanche, ne peut viter de prendre un tour mtaphysique,
parce que le dbat en question est lui-mme dordre mtaphysique. Au lieu
dadopter une position incarne pour dire la saturation de la conscience
(comme le voudrait la motivation originelle de la thorie des bauches
conscientes multiple), on simpose dans ce contexte une position excentre qui
ressemble sy mprendre celle dun Spinoza dployant sous le regard de
sa raison abstraite la coextensivit des attributs pense et tendue dans
la substance causa sui. Mais, une fois la tche polmique de la thorie des
bauches conscientes multiples ainsi mene bien par le biais de sa
formulation dallure spinoziste, une fois son message sur le sens thique de
lexprience de Libet dlivr en termes mtaphysiques, il faut savoir
suspendre ce langage, et revenir sa source phnomnologique. Il faut
sinterroger nouveau sur le sens de la libert dune volont consciente en
premire personne vcue, et non pas en cette personne radicalement ectopique
qui domine la scne des reprsentations du monde.
Or, en premire personne, savoir si lon peut se considrer comme libre
nest pas une question de fait ou dtre, mais de droit et de devoir-tre. Ni les
faits neurophysiologiques, ni les extrapolations ontologiques que les
philosophes physicalistes en tirent, ni les contre-arguments dualistes opposs
ces extrapolations ne sont ici dcisifs ; seule compte vraiment la perception
que nous avons de nos motivations dagir, au regard des droits que nous avons
et des impratifs que nous intriorisons. Dans la socit aussi bien que vis--
vis du pouvoir judiciaire, nous sommes tenus pour libres et traits comme
libres. Nous tchons alors de nous conduire conformment cette attente, et
nous nous supposons adquats ce qui est attendu de nous, indpendamment
de toute considration scientifique sur le fonctionnement de nos corps. Le
libre arbitre est un fait dexistence de la personne sociale, qui se passe
parfaitement de justifications en termes dessence de son organisme. Mais ne
sagit-il pas l dune libert feinte, prsume, conventionnelle, dune libert
de conviction trs diffrente de la libert relle ? Kant refuse de faire
cette distinction, car, selon lune de ses formulations les plus lucides, tout
tre qui ne peut agir autrement que sous lide de libert est par cela mme, au
point de vue pratique, rellement libre
84
. Labsence de preuve thorique
de la libert, valant pour un spectateur scientifique de la nature, nempche
pas aux yeux de Kant que lon soit pratiquement libre en tant quacteur
uvrant sous la prsupposition de cette libert. Un sujet se pensant lui-mme
et se comportant comme sil tait libre est rellement libre de son point de
vue dtre agissant. Il est rellement libre, indpendamment du fait que sa
conscience de vouloir adhre ou non un phnomne naturel. Comment
comprendre en termes contemporains
85
cette thse kantienne dune ralit
pratique de la libert, qui semble attribuer un sens droutant au prdicat
mme de ralit ? Sans doute en la relisant la lumire du caractre
radicalement auto-rfrentiel de la conscience. Car la consquence centrale
de cette forme dauto-rfrence est que, entre ce quon pense tre et ce quon
est, lintrication est entire. Ce quon pense tre, la libert dont on croit
pouvoir disposer, ce quon se donne comme ayant tre dans le sillage de la
libert crue, tout cela rtroagit immdiatement sur ce que lon fait, et donc sur
ce que lon est aux yeux des autres et de soi-mme. Inversement, ce que lon
fait dans une production suppose spontane de son propre tre rtroagit sur
ce quon croit tre, enclenchant ainsi une circulation sans limites entre ltre,
le penser-tre et le vouloir-tre, dote dune dynamique propre qui recrute le
substrat physiologique son profit tout autant quelle est porte par lui. Cette
sorte de boucle de rtroaction, dj mise en vidence propos du rapport
entre croyance de gurison et efficacit thrapeutique, est au moins aussi
efficace pour resserrer le nud entre se croire libre et tre libre. Elle a mme
dans ce domaine une traduction exprimentale spectaculaire. On a en effet
montr quil est possible de changer du tout au tout la conduite dcisionnelle
de groupes de sujets, selon quon les invite lire pralablement un texte
affirmant la vrit du dterminisme des comportements ou bien un texte
dclarant au contraire la ralit du libre arbitre
86
. Assez curieusement, les
sujets tendent adopter une conduite rigoureuse lorsquils ont t soumis un
discours en faveur du libre arbitre, tandis quils sont plus disposs des
dviations, voire des tricheries, lorsquils ont reu un enseignement
dterministe. Croire que nous sommes libres nous invite choisir en toute
conscience, tandis que croire que nous sommes dtermins nous indtermine.
Le dnouement de cette rflexion sur lexprience de Libet et le libre-
arbitre nous invite en tout tat de cause aller plus loin dans une lecture en
premire personne de la thorie des bauches conscientes multiples. Il nous
exhorte ne pas en rester, comme cela a souvent t fait prcdemment,
lvocation image mais quelque peu dsengage de ce que cela fait en
premire personne dtre immerg dans le maelstrm de vcus fragmentaires
en quoi consiste la vie mentale selon cette thorie. Que signifient les
expressions le point de vue du rcit , la corde biographique ou
lattracteur du moi employes plus haut, si ce nest une collection de
vignettes suggrant sans laccomplir lindispensable mouvement
didentification chaque histoire comme celle qui a t vcue ? Le chemin
dune tude de la conscience ne pouvant se contenter dtre un itinraire de
pense abstraite ou dimagination dbride, il faut le poursuivre plus loin que
ce que suggrent ces mtaphores, en se figurant de faon directe les
consquences prouves de la thorie des bauches conscientes multiples.
partir de maintenant, il va sagir dinverser la dmarche habituellement suivie
dans les sciences cognitives : au lieu de descendre de donnes gnriques
dordre physiologique, comportemental ou verbal vers la reconstruction
htro-phnomnologique dun moment singulier de conscience, le projet
est de monter dune collection phnomnologique concrte de vcus vers leur
traduction unifie, perceptible pour dautres aussi bien que pour soi-
mme . Essayons donc dhabiter quelques squences conscientes bauches
dchelle de complexit croissante, den endosser la saveur vcue, puis de
tirer les consquences de ces expriences simules en ce qui concerne leur
connexion ou leur dconnexion vis--vis des rapports verbaux. Lessai sera
conduit trois niveaux, correspondant respectivement ce que Zeki appelle la
micro-conscience, la macro-conscience et la conscience unifie, ou bien la
tripartition antrieure entre exprience pure, conscience rflexive et
conscience de soi.
Quest-ce que cela fait dabord dprouver un clat dapprhension
purement sensible, une couleur, un mouvement, une note aigu, ou une forme ?
Le choc du sensible, quil soit dcrit par Hegel au premier chapitre de la
Phnomnologie de lesprit, ou bien par Husserl lissue dun dtissage
rductif de lexprience perceptive visant parvenir sa matire (ou
,hyl) brute, est un moment dobnubilation, dindiffrenciation dun
apparatre la fois imprvu et non repris dans une histoire ; un moment
dimmdiatet galement, au sens relationnel aussi bien que temporel du
terme. Lobnubilation signifie qu linstant o le ceci sensible se produit, il
ny a rien dautre que lui. Lindiffrenciation est la traduction analytique de
cette obnubilation, puisquelle implique que la singularit du moment sensible
est absolue, quaucun contraste ne stablit (encore) entre lui et quoi que ce
soit dautre, que rien ne permet (dj) desquisser une dtermination fonde
sur la ngation de ce qui nest pas lui. Limmdiatet au sens relationnel
exprime pour sa part labsence de mdiation, le caractre isol et sui generis
de lvnement sensible, son absence dinsertion dans un rseau de rapports et
de comparaisons qui le feraient trop tt accder ltage du jugement.
Limmdiatet au sens temporel, enfin, dnote lactualit radicalement
phmre de limpression sensible, sa manifestation seulement maintenant.
Or, maintenant se trouve dj dans le pass ds quil est dit et
apprhend
87
, et il nest rciproquement localisable en aucun instant tant
quil nest ni dit ni apprhend. Vivre une fulguration sensible exclut donc de
raliser quelle survient ; car la raliser supposerait de la dtacher sur fond
de ce quelle nest pas, cest--dire sur fond dun moment ultrieur la faisant
apparatre comme ayant eu lieu juste avant. Vivre sans sapercevoir quon le
vit ; concider si bien avec cela que manque la distance permettant laperu :
voil ce que doit tre lexprience en premire personne de limpression
sensible isole. On peut bien sr se demander si ce genre dexprience mrite
le nom de micro-conscience , tant le mot conscience connote
habituellement le savoir que lon sait, et par consquent un certain recul par
rapport ce quon sait. Un tel doute concernant la dnomination de
limpression sensible va, notons-le, dans le sens de lopinion commune des
neurologues mentionne au chapitre prcdent, selon laquelle la conscience a
pour condition la mmoire (dune dure de rmanence dailleurs non
prcise). Pourtant, il semble raisonnable de ne pas refuser la dnomination
de conscience ce genre dexprience adhrente son contenu (mais sans
doute pas prive de mmoire trs court terme), de se contenter de la
distinguer dautres formes plus labores de conscience, en la qualifiant par
exemple de conscience primaire ou de conscience minimale par opposition
avec la conscience rflexive et labore, comme cela a t propos
antrieurement. Car sur quoi pourrait bien porter la rflexion si ce nest sur
une occurrence homogne elle-mme ? Et quest-ce quune vraie conscience,
une conscience rflexive, si ce nest une exprience de lexprience, cest--
dire une exprience ou une conscience primaire au second degr ?
Cela nous conduit au seuil de la macro-conscience , une conscience
diffrencie, cumulative, pisodique et non plus monadique. Quest-ce que
cela fait de vivre une telle exprience dordre perceptif plutt que sensitif,
une exprience pouvant mme stendre la liaison de plusieurs rgions de
perception, simultanes ou successives ? La tche de dcrire est dans ce cas
beaucoup plus aise, parce quelle concerne un domaine arriv au seuil du
prdicatif et non plus cantonn dans lant-prdicatif (au sens de Husserl
88
) ;
un domaine o des units de sens sont vises sur un mode synthtique plutt
quimpressionniste, au-del de linstant du remplissement sensible. Pour
amorcer la description dun tel moment de conscience tendue et capable de
rflexivit, il suffit ds lors dutiliser lune des ressources les plus banales du
langage : celle des attitudes propositionnelles. ce niveau dexprience, on
peroit que le ciel est bleu, on croit quelle est amoureuse, on pressent quil
voudrait demander quelque chose ; ou encore on prouve un sentiment
dangoisse (parfois dexaltation) en ralisant que lavenir est incertain, etc.
Le que peut tre suivi dune chane dautant plus longue de propositions,
articules par des conjonctions de coordination ou de conscution, que le
cumul dexpriences est plus important en extension spatiale et temporelle.
Mais, aussi longtemps que cette espce de conscience composite demeure elle
aussi isole, le fait quelle ait des ressources suffisantes pour se dire ne
garantit pas quelle puisse parvenir au stade du rapport verbal. Dtach dune
histoire, nayant pas t pourvu de sens par un projet (lavoir--tre de la
personne), un pisode de conscience a des chances de ntre vcu que comme
une simple impression fugace non corrobore, comme une circonstance
priphrique ne mritant pas dtre retenue, ou mme peut-tre comme une
phase onirique. Aprs tout, ce qui fait quun rve est reconnu comme tel, et
non pas qualifi de rel , cest quil manque la plupart du temps de liens
avec le corpus autobiographique, et avec les principes de cohrence qui en
gouvernent lagencement. Dtache du reste de la vie vcue, une squence de
conscience est apprhende sur un mode tantt anecdotique, tantt dralis,
ou bien elle se voit repousse dans les marges ou franges incertaines du
faisceau attentionnel
89
.
Il reste envisager la conscience unitaire telle quelle se vit en premire
personne. Ici, comme dans le cas prcdent, on fait lexprience dpisodes
longs et intgrs, descriptibles sur le mode des attitudes propositionnelles.
Mais cela sajoute leur interconnexion en rseaux manifestant la
reconnaissance quils ont pu tre vcus par moi, parce quils se raccordent
sans contradiction vidente mes actes antrieurs et postrieurs, et quils ne
drogent pas compltement mes intentions, mes convictions sur le monde,
et mes valeurs. Ces pisodes assums, internaliss dans mon auto-
biographie, sont alors transmis ; ils demeurent en arrire-fond de ce que je vis
actuellement comme ce que je sais tre mon pass. Chacun de mes vcus
unitaires actuels est momentan, peine moins phmre que le vcu dun
aperu sensible, mais en lui, agripp sa masse comme le sillage un navire,
se trouvent quantit dpisodes apprhends comme ayant t vcus par moi,
et dpisodes esprs ou redouts par moi. Repris itrativement de moment en
moment de mon exprience, ces pisodes restent prsents-en-tant-que-passs
ou prsents-en-tant-que-futurs avec pour fonction de rendre intelligible ce qui
marrive maintenant par ce quils annoncent, ou de suggrer des actions
prsumes efficaces par leur similitude avec des situations antrieures. Rien
dautre que ces pisodes slectionns pour leur capacit sincorporer mon
projet et ma logique de vie ne mest accessible au sein de chacun de mes
vcus unitaires. Tout le reste, tout ce qui na pas trouv place au sein de ce
bloc dynamique de lexprience-actuelle-dans-le-contexte-dune-chronique-
lui-donnant-sens, est soit inaccessible partir de lui, soit agglutin autour de
lui comme autant de lambeaux de vcus en phase doubli ou de rejet dans le
quasi-onirique.
Cest sans doute cause de ce travail massif doubli ou de rejet que la
thorie du thtre cartsien , qui postule une seule squence consciente
entoure dun grand nombre de processus mentaux inconscients, reste
hgmonique. Pour mieux le comprendre, il faut dabord se rappeler que, dun
point de vue en troisime personne, il est impossible de discriminer entre la
thse de processus mentaux majoritairement inconscients dont seuls certains
se trouvent unifis et clairs par la lumire de la conscience et la thse de
processus mentaux tous conscients mais dont la plupart restent ngligs parce
quisols de la squence reconnue comme ayant t vcue par moi. De ce
point de vue en troisime personne, le caractre phnomnalement
conscient ou inconscient des processus mentaux na de toute manire aucune
pertinence ; selon lui, les choses se passeraient exactement de la mme
manire quelle que soit ltendue du domaine des processus mentaux
conscients, y compris si leur totalit tait phnomnalement inconsciente
(comme ce serait le cas dun zombie). Tant quon en reste l, par consquent,
la thorie du thtre cartsien et la thorie des bauches conscientes multiples
restent aussi bien (ou aussi mal) corrobores lune que lautre. Et la thorie du
thtre cartsien, avec sa mise part des processus mentaux conscients et
inconscients, est gnralement prfre parce quelle donne prise la
mthode diffrentielle. Les choses ne changent vraiment que lorsquon prend
en compte la premire personne. Mais de quelle faon ? Suffit-il de mettre en
uvre une approche en premire personne pour se mettre en mesure de
trancher entre les deux thories et de pencher en faveur de la thorie des
bauches conscientes multiples ?
vrai dire, les choses ne sont pas si simples. Le choix entre la thorie du
thtre cartsien et celle des bauches conscientes multiples nest pas
automatiquement effectu du seul fait davoir adopt un point de vue en
premire personne ; il dpend de la profondeur de lanalyse que lon fait alors
de sa propre exprience vcue. Ainsi, une rflexion simple sur les vcus
ordinaires tend donner lavantage la thorie du thtre cartsien . Pour
un sujet napprofondissant pas sa recherche phnomnologique, tout ce qui
apparat est cens appartenir la squence biographique principale, et, dans
ces conditions, des squences de conscience ignores sont pour lui comme
rien. Face aux preuves extrieures accumules dactivits mentales survenant
mme en dehors de ce quil assume consciemment comme sien, il lui est plus
naturel de les assimiler autant dvnements inconscients, comme le veut la
thorie du thtre cartsien, qu des bribes parses de consciences, comme le
suppose la thorie des bauches conscientes multiples. Cest donc bien
seulement si lon mettait en vidence des indices vcus de moments de
conscience partiels non intgrs la squence biographique principale, qu
rebours de la premire impression, lquilibre des positions thoriques
basculerait de nouveau en faveur de la thorie des bauches conscientes
multiples. Nous avons besoin pour cela que ces moments pars de conscience
se manifestent ouvertement, quoiquaprs coup, dans la squence
biographique principale en tant que fragments ressentis comme initialement
gars. Or, il nest pas rare que cela arrive. Les aboutissements des cures
psychanalytiques et certains pisodes critiques des syndromes de
personnalits multiples
90
se laissent ainsi volontiers percevoir (et pas
seulement interprter) sur ce mode du raccrochage de squences vcues
accessoires une squence principale sans cesse rcrite. Et par ailleurs,
dautres illustrations significatives daffleurements tardifs dpisodes vcus et
de retissages narratifs sont offerts par les procds dintrospection assiste,
comme ceux qui seront discuts au chapitre XIII. Mais ici, je vais me
concentrer sur deux exemples lmentaires de ce retour des moments perdus
de conscience, lun tir dun texte phnomnologique, et lautre dune
exprience personnelle danesthsie gnrale.
Le premier exemple est issu des cours sur la synthse passive dispenss
par Husserl
91
. Rappelons quun acte de synthse, selon Husserl, a pour
fonction de tenir en prise une certaine unit de sens par-del le divers de ses
prsentations, profils ou aspects manifestes. Cest sur ce procd que repose
l a constitution dobjectivit, autrement dit lextraction, partir de la
variabilit des vcus, de motifs invariants pouvant tre traits comme objets.
Certaines de ces synthses sont passives, au sens o elles sont accomplies
involontairement, sans prise de position
92
explicite du moi leur gard.
Elles prparent les synthses actives qui font intervenir la dcision, assume
par un moi, de formuler un jugement propos de lobjet constitu. Une telle
stratification des synthses, celles qui soprent tantt en troite association
avec lauto-appropriation, tantt en-de de celle-ci, prsente des similitudes
notables avec la diffrence prcdente entre les consciences articules la
squence autobiographique et les consciences isoles. Mais cest sans doute
lorsque Husserl fait valoir une distinction entre ce qui se donne larrire-
plan et au premier plan
93
de lexprience que la similitude devient la
plus frappante et quelle offre une vraie contrepartie phnomnologique la
notion dbauches de rcits conscients non insrs dans la narration
principale. Les actes darrire-plan sont effectivement vcus selon Husserl,
tout comme les actes de premier plan. Mais ils ne le sont pas sur le mme
mode. Les actes darrire-plan sont bien des vises de quelque chose, ils sont
bien intentionnels, linstar des actes de premier plan. Cependant, ils restent
la marge du champ de conscience ; ils sont latents plutt que patents
94
. Leur
manifestation dans la conscience ne saccomplit pas dans lambiance de la
veille ; elle ne se raccroche pas, acte par acte, un moi qui sen affirme le
sujet. Au lieu de cela, les actes darrire-plan pntrent, crit Husserl, dans
latmosphre de la torpeur ; comme si ces actes avaient une fonction
dimprgnation gnrale de la tonalit affective ou axiologique du vcu plutt
que dindividualisation de contenus. Les actes darrire-plan sont vcus en
tant que matrice dune disposition gnrale de bien-tre ou de malaise , et
non pas de manire que le moi y soit immdiatement prsent et concern,
vise aprs vise
95
. Ils sont vcus, mais ils ne le sont pas un par un comme
actes goques ; seulement comme influence globale affectant en sous-main
le centre goque de la conscience. Cette modalit trs spciale des vcus
darrire-plan pourrait laisser penser quils relvent dune catgorie part,
fondamentalement diffrente de celle des vcus de premier plan reconnus
ouvertement par un moi. Or, ce nest pas le cas : Husserl admet que les deux
sortes de vcus sont interconvertibles. Un vcu darrire-plan peut
parfaitement devenir actuel, ds lors que le moi se lest appropri par un
inflchissement de lattention. Inversement, un vcu de premier plan peut
glisser dans le bain dispositionnel de larrire-plan, et ne plus relever du
centre goque . Un jeu sans fin de connexion et de dconnexion des
pisodes vcus vis--vis du moi caractrise la vie de la conscience. En
transposant cette analyse husserlienne la thorie prcdente, on est tent de
dire quil y a bien un vcu des micro-consciences ou des bauches de rcits,
entre le moment o ils nont pas (encore ?) pass le seuil dappartenance la
squence narrative principale qui dfinit le moi, et le moment o ils lont
franchi. Et que leur mode dtre-vcu est justement celui que Husserl
caractrise comme atmosphre darrire-plan.
Le test exprientiel le plus direct de la thorie des bauches conscientes
multiples consisterait par consquent exhiber des exemples prcis
dappropriation (ou de rappropriation), par la narration autobiographique
principale, de vcus et de fragments de rcits jusque-l isols. Ces exemples
correspondraient ce que Husserl dcrit comme des vnements de passage
de vcus darrire-plan vers le premier plan de ce qui est assum par le moi.
Ils seraient dautant mieux mme de conforter la thorie, que les vcus
parvenus au premier plan ne seraient pas perus comme totalement inattendus,
mais porteraient au contraire en eux la saveur de layant-t-vcu. Un pisode
peru comme ayant t vcu dans le pass, mais aussi comme ayant t nglig
initialement en raison de son manque daptitude tre intgr la narration
principale ou simplement de son caractre priphrique par rapport au champ
attentionnel, constituerait le tmoin le plus direct dun grand rservoir de
squences conscientes excdant ce qui est rapport comme conscient chaque
moment donn. Or, cest bien quelque chose comme cela qui semble se
dgager du compte rendu de ma premire exprience danesthsie gnrale,
que jai rdig quelques heures aprs les faits qui y sont relats (et plusieurs
annes avant dtre convaincu par la thorie des bauches conscientes
multiples). Il sagit dun tmoignage en premire personne, et de premire
main.
Le contexte est celui dun examen banal vise diagnostique. Entr
lhpital le matin, je passe par une cabine pour y revtir une tunique de papier
tiss vert, et jarrive au pied dun lit roulettes 10h05.
Temps et Rcit I
96
: ce qui sest pass selon MB avant 11 heures
Un infirmier me demande de mallonger sur le lit couvert dun long papier
blanc. Je suis calme : le temps de laction semble moins inquitant que
lattente et la perspective pralable. Dautres patients sont allongs autour de
moi, sur des lits similaires, dans une vaste salle faux plafond perc de
bouches circulaires daration et soutenu par des colonnes. Lune des bouches
daration est juste au-dessus de moi. La salle semble un lieu intermdiaire
entre les cabines-vestiaires et les pices dexamen (dintervention, pourrait-
on dire). Je ne fais que deviner les pices dexamen devant moi. Un jeune
anesthsiste arrive vers moi, souriant, habill en tenue chirurgicale bleue. Il
mexplique quil va me faire une injection intra-veineuse et me demande
quelle est ma veine la plus facile daccs. Je lui tends mon bras gauche. Il
parvient habilement dtourner mon attention de ses gestes en minterrogeant
sur ma profession, puis en plaisantant sur le peu de souvenirs quil a gards
de la philosophie en classe de terminale. Il injecte un produit, tout en parlant
et en me faisant abondamment parler, puis pose une lectrode
dlectrocardiographie sur mon index gauche. Selon moi, ce quil vient de
madministrer est un sdatif pralable lanesthsie proprement dite, qui aura
lieu dans la pice dexamen. Je reste trs tranquille. Je vois la bouche
daration au-dessus de moi, me tourne un peu et ne vois plus lanesthsiste,
qui semble avoir disparu. Jai maintenant du mal bouger, je me sens comme
cras sur le lit, un peu indiffrent ce qui se passe. Je mexplique cela en
pensant que le sdatif administr est trs puissant et quavec cela, je ne risque
pas de me soucier de quoi que ce soit lorsque le moment de lanesthsie
proprement dite, et de lexamen, viendra. Mais le temps semble trs long. On
attend vraiment beaucoup pour me prendre en charge. Je me livre quelques
exercices de respiration profonde, pour parfaire la readiness
shakespearienne, louverture ce qui arrive, la continuit entre les tats
dtre. Curieusement, le sdatif semble agir de moins en moins, je peux me
soulever, tourner la tte dans tous les sens. Le docteur A. arrive prs de moi et
mannonce : votre examen est termin, tout sest bien pass. Je nai trouv
aucune pathologie inquitante et je nai donc pas eu besoin de faire de
biopsie. Je le regarde, incrdule, et je rplique Mais rien ne sest pass,
je ne me suis aperu de rien. Avez-vous vraiment pratiqu lexamen ?
Sourire mi-aimable mi-narquois de mon interlocuteur : cest exactement
limpression que vous devez avoir, nous faisons tout pour cela.
Temps et Rcit II : ce qui sest pass selon MB aprs 11 heures
Mon premier rflexe, aprs la surprise provoque par la dclaration
surraliste du docteur A., est de consulter ma montre : il est exactement
11h00. Lheure est compatible avec la dure dexamen qui mavait t
prdite, environ 20 minutes. Mais elle est galement compatible avec ma
perception antrieure dune longue dure dattente. Ma perplexit reste
immense. Je me tourne dans tous les sens et me vois entour de patients ma
droite, galement allongs sur un lit. Ces patients ne sont plus les mmes
quau moment de mon arrive dans la salle Jinterroge une infirmire qui
passe par l, pour essayer de comprendre. Elle me rpond que les produits
anesthsiants sont aussi quelque peu amnsiants, et quil nest donc pas
tonnant que jaie une sorte de trou de mmoire. Jobserve le scope derrire
moi, avec mon lectrocardiogramme qui pulse sur lcran. La salle est bien la
mme que celle o jtais initialement, mais elle fait maintenant fonction de
salle de rveil. Quelques signes physiologiques, ainsi que des traces de gel
aqueux sur mon corps, maident raliser que quelque chose sest
effectivement pass. Les dires du docteur A. en sont rendus dautant plus
crdibles. Puis, en fouillant dans mes souvenirs, je maperois que jai laiss
de ct un lment important lors de mon premier rcit dexprience. Juste
aprs quil ma inject son produit et mis en place llectrode, lanesthsiste a
approch de moi un masque dont je me souviens prsent de manire
brumeuse : je ne le revois quen pointill, comme dans un tableau de Seurat.
Je lui ai demand : vous me mettez un masque ? , et il ma rpondu oui,
cest de loxygne. Ce sont les dernires expriences que je parviens
maintenant retrouver, avant ce que je sais dsormais interprter comme mon
rveil . Il me reste une pointe de doute, mais il est compltement lev
lorsque, aprs un petit djeuner sommaire servi dans ma cabine, je rcupre
les images de mes organes avec le compte rendu ngatif dexamen.
Le procd de rcriture et la continuit de la conscience
Le scnario de Temps et Rcit I commence par saccorder parfaitement
avec mon interprtation initiale de linjection pratique par lanesthsiste (un
sdatif ). Il tablit une continuit temporelle du flux de conscience, ou plus
exactement de la conscience dun flux, dans le cadre impos par cette
interprtation. Durant cette priode, tous les lments qui ne saccordent pas
avec le scnario retenu sont carts ou rvoqus en doute. Si le sdatif (en
fait le produit anesthsiant dont je viens de me rveiller) agit de moins en
moins, cest quon me laisse trop attendre. Si le docteur A. me dclare avoir
fait lexamen, cest peut-tre quil veut plaisanter. Si lanesthsiste a disparu,
cest que je nai pas fait attention ses pas trs discrets. Si je me rappelle
vaguement un masque, prsent par lui comme un masque oxygne, cest
quil sagit dun rve veill, et je lcarte sans difficult. Je continue
dailleurs quelques minutes ressentir lvnement du masque et le fragment
de conversation qui lui tait contemporain comme rv, en dpit de la
reconstitution rationnelle que je viens deffectuer dans Temps et Rcit II . En
fait, selon la vrit reconstitue aprs coup, le masque est mon dernier
souvenir avant lendormissement ; il a t pos prcisment linstant o
lanesthsiste savait que je perdais connaissance. Dailleurs, dix minutes
aprs mtre convaincu de la rinterprtation avance par Temps et Rcit II ,
je commence ressentir lpisode du masque et de la conversation finale avec
lanesthsiste comme ayant bien t vcu par moi. Depuis, je nai plus vari
sur ce point.
Le moment crucial de cette narration en deux temps est bien entendu le
changement de statut de lvnement de la pose du masque oxygne,
accompagn dune bribe de conversation. Durant la phase initiale du rveil,
cette brve squence est mise entre parenthses, elle est occulte, car elle
nest pas intgrable au fil biographique dont le principe de cohrence a t
choisi par moi. Tout se passe comme si lpisode du masque oxygne et du
bref change qui a suivi avait t arrt trop tt par laction du produit
anesthsiant. Son interruption brutale la empch dtre correctement
catgoris et de se voir raccroch une narration globale cohrente et ego-
centre. Fig un stade prcoce de son dveloppement, il est rest un
fragment de rcit bouts libres et flottants, priv de connexion quoi que ce
soit dautre ; une exprience vcue, mais isolment vcue, nayant pas t
capitalise dans le patrimoine de mon histoire. Cest seulement dans la phase
ultrieure de reconstruction sous lgide dun nouveau principe de cohrence
que lpisode interrompu merge sur le mode onirique, puis quaprs un
moment dhsitation, il est appropri comme ayant t vcu. Voil donc un
cas assez clair de promotion rtrospective, vcue en premire personne, dun
pisode de conscience marginal au rang de participant la squence
biographique principale. Quun pisode ait t conscient mais gar, puis
quil se soit retrouv postrieurement assum comme conscient pour moi, pour
ce moi dfini par une nouvelle condition de cohrence, est raisonnablement
attest par laffleurement tardif dun souvenir, et par son apprciation
rtrospective comme vnement-dj-vcu.
Trois consquences rcapitulatives peuvent tre tires de ce chapitre :
1) La diffrenciation interne du vcu, que postule la thorie des bauches
conscientes multiples, rend compatible le constat de saturation de la
conscience avec lanalyse dsature de lactivit mentale que proposent
les sciences cognitives. En effet, la structuration du vcu en pisodes
flottants et histoire egocentre, que suppose cette thorie, rend compte du
caractre apparemment extra-conscient de certains vnements mentaux,
sans pour autant limiter la porte du fait lmentaire que rien ne se donne
jamais que comme conscient ;
2) Le projet dexpliquer lapparition de la conscience partir de
processus strictement inconscients na donc plus de raison dtre.
Conformment au point (1), la seule chose dont il sagisse de rendre
raison ici est que ja i maintenant conscience dune seule squence
cohrente mais limite dvnements, alors que le champ de lexprience
consciente est a priori tenu pour illimit. Or, lexclusion, par cette
squence, de pripties mentales dont tmoigne pourtant lanalyse de mes
comportements et de ma physiologie, est bien prise en compte par la
thorie des bauches conscientes multiples, sans avoir besoin pour cela de
les considrer comme dissocies de toute forme de conscience. Et cette
faon particulire den rendre raison est corrobore par le frquent
affleurement rtrospectif, dans mon exprience, dpisodes mentaux
gars. Le meilleur point dappui de la thorie demeure, comme il se doit,
un fait dexprience pure qui manifeste en lui-mme la stratification des
multiples fragments narratifs dpisodes conscients ;
3) La thorie des bauches conscientes multiples confre aux donnes
neurophysiologiques une signification nouvelle. Dans le cadre de cette
thorie, les vastes assembles temporaires de neurones synchroniss qui
constituent l espace de travail global ont pour corrlat exprientiel le
caractre unifi, pris en masse et connect squentiellement, des vcus de
type autobiographique. Ces assembles ne sont pas ici le corrlat de la
conscience, contrairement ce qui est communment avanc, mais le
corrlat de lintgration des consciences fragmentaires autour du centre
de gravit narratif (et narrable) quest le moi.
QUESTION 12
Comment la nature est-elle noue par et avec
la conscience ?
La conscience apparat dun ct comme partie du monde
et dun autre ct comme coextensive au monde.
M. Merleau-Ponty
Autour dautrui se croisent le devenir-monde dune chair
et le devenir-chair dun monde.
R. Barbaras
Les hommes proclameront que lesprit dpend du cerveau,
ou bien, de faon galement plausible, que le cerveau
dpend de lesprit.
B. Russell
Il reste un nud ultime sonder, un nud que la thorie des bauches
conscientes multiples a pos, tenu pour acquis, mais jamais dpli : celui qui
unit solidairement la prsence quelque chose qui se prsente, lexprience
entire ses contenus privilgis que sont le corps propre ou le tissu nerveux
propre. La fermet obstine de ce nud se laisse voir travers les dfauts
symtriques de ses lectures matrialiste et idaliste. La dtente de ses fibres et
la dissolution du lien par lequel ses deux visions biaises nous tiennent captifs
ne seront donc obtenues quen remontant une fois encore en de des clichs
doctrinaux.
La version matrialiste du nud de la prsence et du prsent est
apparemment la plus simple comprendre, parce quelle fait appel au bon
sens pratique et quelle est unilatrale (allant de la matire lexprience
consciente, mais pas le contraire). Les lsions de certaines parties du cerveau,
ou la mise au repos de quelques-unes de ses fonctions, altrent les contenus de
conscience rapports par les patients. De surcrot, la stimulation des mmes
zones ou fonctions crbrales suscite des contenus de conscience pouvant
faire lobjet de descriptions. Par consquent, les processus neuronaux sont la
cause de la conscience dans toutes ses dimensions. Largument, qui a tout lair
dune mise en vidence exprimentale de lorigine matrielle de la
conscience, se veut imparable ; il a pour lui la simplicit du raisonnement, et
lefficacit croissante des pratiques pharmacologiques ou chirurgicales qui en
prsupposent la validit. lexamen, il est pourtant min de points faibles.
La premire faiblesse est que son domaine restreint de pertinence
dductive est loin de soutenir toute son ambition dexpliquer. Laction
instrumentale exerce sur le tissu et les processus crbraux affecte
lourdement les structures, les contenus ainsi que les modalits rflexives et
auto-identificatrices de la conscience, dont les patients peuvent rendre compte
par le rapport verbal ; mais rien nindique quelle atteigne le matriau mme
de la transformation, savoir lexprience pure, la conscience primaire. Nous
avons vu que mme lintervention la plus profonde que lon puisse effectuer
sans perdre dfinitivement la possibilit dun rapport ultrieur, savoir
lanesthsie gnrale, noffre aucune garantie de suppression de lexprience
pure, instantane, non rflexive et non cumulative. Les processus neuronaux
sont-ils donc causes, origines absolues, ou simplement modulateurs,
accumulateurs et rflecteurs dexprience consciente ? Nulle procdure
exprimentale ne permet de rpondre cette question sans ambigut.
La deuxime faiblesse de la lecture matrialiste du nud neuro-
exprientiel est encore plus massive, bien quinvisible ; massive mesure de
linvisibilit quelle induit. Cest que ce genre de lecture suppose que lon
pratique une sorte de scotome de/dans son propre champ dattention. Le terme
scotome a t choisi intentionnellement, de prfrence ablation ou oubli,
parce quil dnote avec prcision le geste fondateur de la dmarche
objectivante et de son corrlat mtaphysique matrialiste. En ophtalmologie
un scotome est lamputation, pas toujours perue par le patient, dune fraction
de son champ visuel. Les choses sont analogues dans la conception
matrialiste de la conscience, ceci prs que lopration pratique soustrait
bien plus quune fraction du champ dattention. Elle met en tat de
transparence lintgralit de ce champ dattention, et ne confre lopacit du
manifeste qu quelques fragments qui en sont les contenus. Elle tranche
ltre-attentif et ne retient que lobjet dattention. Elle fait de la simple
actualit de lexprience la grande disparue de sa problmatique. Comme le
scotome des ophtalmologistes, celui-ci reste inapparent ; il ne laisse aucun
sentiment de manque et ne suscite aucun dsir de le compenser. Nul ne
remarque le grand disparu quest lexprience actuelle, tant celle-ci va de soi.
Mais, comme pour le scotome des ophtalmologistes, galement, lescamotage
est gnrateur de troubles. De mme quun patient anosognosique (cest--
dire ignorant de sa propre pathologie visuelle) est susceptible de porter
atteinte involontairement sa vie, une thse arhizognosique (cest--dire
ignorante de sa propre racine existentielle) risque de porter involontairement
atteinte sa crdibilit.
Que le constat de corrlation entre les contenus dexprience rapports
par un sujet et certaines interventions sur son tissu nerveux se prsente lui-
m me en tant quexprience (celle du chercheur) na en effet rien
dindiffrent ni de neutre. Oublier cette exprience conditionnante, comme le
font les partisans de la lecture matrialiste, entrane une interprtation
tronque de la corrlation neuro-psychique. En tirer toutes les consquences a
rciproquement des chances de mettre en grande difficult cette interprtation
dficiente. Pour le comprendre, nous devons au pralable nous installer dans
ltat de conscience adquat, celui o lon se met en mesure de prendre
connaissance la fois de la corrlation neuro-psychique et de lexprience
prsente dans laquelle satteste cette corrlation. Ds que cette double
apprhension est ralise, ds quelle est stabilise dans ltat de conscience
requis, on saperoit sans difficult que la corrlation neuro-psychique se
dploie symtriquement dans ce que nous avons appel un nud, cest--dire
un lien rciproque et entrecrois. Une fois saisie dans toute son amplitude, la
corrlation neuro-psychique se dcouvre faite de deux brins tresss lun dans
lautre, et menant lun lautre, sans que lun ne prenne lascendant sur
lautre : le brin objectiv et le brin prouv ; le brin qui conduit de
laltration neurologique la modification dun rapport verbal dexprience,
et le brin qui conduit de lintention vcue par un sujet daltrer un
fonctionnement neuronal leffet constat (et donc lui aussi vcu) de lacte
daltration. On comprend la nature du biais matrialiste par contraste avec
cette pleine rciprocit. En ignorant ou en ngligeant lexprience darrire-
plan, lapproche matrialiste impose une brisure de symtrie, et cre la
motivation dune doctrine mtaphysique en miroir qui serait un idalisme. Le
premier brin du nud, allant de lintervention neurologique au rapport verbal,
est sur-valoris par lapproche matrialiste, tandis que le second brin, allant
de lexprience vcue ses objets neuronaux, instrumentaux, ou langagiers,
est implicitement vitrifi, cest--dire rendu la fois rigide et translucide par
son rejet dans linsu. La thse matrialiste a pour condition pralable de tenir
fermement en son foyer dattention les relations qui stablissent entre une
opration sur lobjet rseau neuronal et lvnement rapport
dexprience ; et de mconnatre quopration, objet et vnement relvent
dun vouloir, dune vise, et dune aperception de lexprience actuelle. Elle
coupe une branche de la boucle infinie qui lie, dun ct, certains processus
neurophysiologiques la possibilit de manipuler les contenus dexprience,
et, dun autre ct, lexprience vcue entire ses vises intentionnelles y
compris neurophysiologiques ; puis elle retient seulement la dpendance
unidirectionnelle de la premire branche de cette boucle infinie, qui la pousse
conclure que les processus neuronaux sont les substrats de lexprience
consciente.
Il est frappant que deux des plus importants philosophes du XX
e
sicle
aient converg vers ce genre danalyse critique de linfrence matrialiste,
alors mme que leurs doctrines sont souvent opposes lune lautre ( tort ou
raison) comme la philosophie analytique lest la phnomnologie.
Wittgenstein, dans le Cahier bleu
1
dict vers 1934, et Merleau-Ponty, dans la
Structure du comportement
2
publie en 1942, ont mis en garde la philosophie
contre sa tentation de prendre au pied de la lettre le fruit du raisonnement
neurologique au sujet de la conscience. Ils ont pris appui pour cela sur leur
propre tat de conscience englobant, qui les empchait docculter lun des
deux brins du nud neuro-exprientiel, lune des deux branches de la boucle
infinie de rciprocit entre le corrlat neuronal de lexprience et
lexprience de la corrlation. Leur enqute part dun questionnement rflexif
apte les mettre immdiatement en prsence de la seconde branche de la
boucle : qui est tmoin du lien entre fonctionnement neurologique et contenus
dexprience ; et comment linterprtation de ce lien est-elle transfigure par
le simple fait quil y a tmoignage ? Wittgenstein et Merleau-Ponty mettent
pour cela en scne un observateur, initialement extrieur, capable de voir ce
qui se passe dans le cerveau dun sujet et de recueillir ce que le sujet exprime
propos de lexprience quil vit pendant le processus dobservation. Les
deux auteurs convergent encore pour signaler que lobservateur a ici affaire
deux ordres de phnomnes : le phnomne pense et le phnomne
mouvements cellulaires du cerveau pour Wittgenstein ; le phnomne
perceptif et la perception de lactivit crbrale qui lui est associe pour
Merleau-Ponty. Quil sagisse dans les deux cas de phnomnes, cest--dire
dapparitions se donnant dans et pour une exprience consciente, et non pas
dune relativit dapparence dans un cas et dun absolu matriel dans lautre
cas, transforme radicalement la comprhension quon doit avoir de la
connexion entre les contenus dexprience et le fonctionnement du cerveau.
Certes, crit dabord Wittgenstein, une phrase comme le cerveau est le
lieu o se situe la pense
3
nest pas a priori absurde ; mais son sens, une
fois rapport lusage qui en est fait, ne rpond en rien limage du contenant
et du contenu quelle vhicule au premier degr. Pour la prendre au pied de la
lettre, il faudrait que le phnomne pense soit observable dans le
primtre spatial du phnomne cerveau . Or, ce nest videmment pas le
cas. Ce que la phrase cherche traduire est seulement que le phnomne
dexcitation dune partie de mon cerveau se trouve corrl avec les
phnomnes pense ou vision
4
. Mais sil en va ainsi, les mots quelle
emploie sont tellement bien sortis du contexte dans lequel on les a appris
quon peut se demander si elle est encore comprhensible
5
. La phrase parle
dembotement dentits l o lon na affaire qu une concomitance de
manifestations. Elle voque lespace des formes l o la chronologie et la
simultanit des vnements sont seules impliques. Dans la rgion mentale
vers laquelle la phrase nous guide obliquement, les abstractions ontologiques
ont cess doprer, et ce qui les remplace est un fourmillement doccasions
tangibles. Au cours de la critique wittgensteinienne, toutes les questions sont
alors patiemment rabattues sur le plan de limmanence et du concret des
pratiques. Les grandes interrogations sur les choses et les causes sont
mises en suspens, et, dans la plage de repos qui sensuit, des demandes
presque triviales se font jour : que voit-on de la pense et du cerveau, que
fait-on pour montrer la connexion de ces deux phnomnes, par qui tout cela
est-il vu et fait ? Du coup, sans tre proprement parler rfutes, les doctrines
ambitieuses qui assignent lexprience consciente un fondement
neurologique, ou une origine matrielle, se trouvent pour ainsi dire
dmembres ; car elles sont dsormais mesures laune de leur propre
source incertaine au sein de cette vidence silencieuse et infonde quest le
monde-de-la-vie-vcue. Il nest plus question de situer le support ontologique
de la conscience dans un tant corporel ou dans un processus spatio-temporel,
mais simplement dagir, de percevoir et dexprimenter de manire articuler
la phnomnalit profuse de lexprience consciente aux phnomnes partiels
de linvestigation physiologique. Quelquun pourrait objecter que ce genre de
dmembrement nest pas plus dcisif pour les thories neurologiques de la
conscience que pour nimporte quelle thorie scientifique portant sur dautres
rgions de connaissance. Si rien nempche descamoter larrire-plan
pratique et concret de domaines dtude comme la physique et la biologie, et
de focaliser lattention sur les seules entits objectives auxquelles il sert de
moule formateur, pourquoi ne pourrait-on pas se comporter de la mme faon
oublieuse et myope dans la science de la conscience ? Pourquoi ne pourrait-
on pas forger une ontologie, dans ce cas comme dans les autres secteurs
scientifiques, et linvestir de la mme sorte dautonomie productive par
dlgation de pouvoir transformateur que partout ailleurs ? La rponse ces
questions est vidente, au moins pour qui se tient dans lambiance de
lpoch : parce que la prtendue entit que pose la science de la
conscience, et dont elle cherche comprendre lorigine, nest rien dautre que
la matrice vcue de toute vise dentit ; parce que, en voulant dissimuler le
monde-de-la-vie-vcue prsuppos pour mieux confrer une dignit
ontologique son prtendu objet, elle se coupe du non-objet effectif de son
tude, qui nest justement autre que lpreuve de ce monde-de-la-vie. Le
procd classique de lengagement ontologique par dsengagement des
phnomnes se retourne ici contre lui-mme, parce quil mconnat quil est
tourn vers lui-mme.
Comment qualifier alors ce lien entre les contenus dexprience et le
phnomne neurologique, sil ne sagit pas de provenance ou de dpendance ?
Comment caractriser cette articulation entre les moments de lapparatre et
une certaine apparition exprimentalement matrise, si on se souvient que
lappeler survenance , comme on le fait couramment en philosophie
analytique, ne fait quajouter un vocable pour dsigner une varit
particulire, asymtrique, de corrlation
6
? Merleau-Ponty propose de voir ce
lien comme un rapport de signification. Aprs tout, souligne-t-il, les entits
physico-physiologiques quon voudrait dsigner comme causes de
lexprience consciente sont elles-mmes des termes de vises
intentionnelles, des units de sens, pour et dans une exprience
7
. Parce quon
ignore cela, on cherche rendre compte dune exprience visuelle en la
drivant de la chane neuro-sensorielle allant de la rtine la rgion de
projection occipitale des affrences optiques, puis aux aires frontales
interprtatives du cortex crbral
8
. Mais on pourrait aussi bien dire
linverse
9
dans la mesure o la chane neuro-sensorielle, la rtine, et les
aires corticales, savrent tre des significations logiques dune
exprience auto-expose par la rflexion. Elles empruntent [ cette
exprience] lindice dexistence relle
10
; et elles ne peuvent donc pas
fonder en retour la ralit de lexprience. La boucle infinie de la
neurologisation de lexprience et de lexprience du neuronal est ici expose
avec toute la clart souhaitable. partir de l, au lieu que la chose cerveau
avec ses processus neuronaux soit prise pour le fondement de la proprit
conscience , un phnomne neurophysiologique et un phnomne
dprouver sont investis de la fonction de se signifier lun lautre en vertu de
leur concomitance
11
. Entre lun(e) et lautre il ny a pas de rapport de
causalit. Ce sont des phnomnes concordants
12
. La mise en vidence des
corrlats neuronaux des structures de conscience et des tats mentaux
sapparente dans cette perspective une recherche smantique, un travail
actif de dcodage dune langue inconnue, et non pas une qute sotrique des
origines. La capacit impressionnante que les neurosciences ont rcemment
acquise de sappuyer sur ces corrlations pour lire les penses
13
de
quelquun par le biais de son activit crbrale peut facilement tre prise
comme une illustration de cette comprhension cryptographique du rapport
neuro-psychologique, plutt que comme un argument supplmentaire en faveur
du physicalisme.
Mais de quelle modalit smantique sagit-il ici ? On pourrait penser, en
premire analyse, que la signification dont parle Merleau-Ponty est
assimilable celle que la psychologie qualifie de langage du corps . En
voyant une certaine mimique se peindre sur le visage de quelquun, on la
considre comme un signe de surprise, au nom dun travail antrieur qui a
permis dtablir une corrlation entre les expressions faciales et les tats
motifs
14
. De mme, on a de bonnes raisons de considrer une certaine
configuration neuronale comme signe de peur ou de plaisir, au nom dun
travail antrieur de mise en correspondance des phnomnes neurologiques
avec les affects dclars. On est pourtant loin davoir puis par ce parallle
la teneur du concept de signification que mobilise Merleau-Ponty. Le rapport
tabli entre certains phnomnes neurophysiologiques et les vcus associs
est plus fort, plus intriqu que celui qui est pris pour terme de comparaison. Il
fait intervenir des procdures de contrle rciproque entre les deux types de
phnomnes, met en uvre une dlibration sur les moyens instrumentaux ou
mentaux de ce contrle, implique en somme une stratification dexprience
bien plus dense que celle dune simple lecture du langage du corps sa
surface cutane. vrai dire, le lien qui unit le signe neuronal lexprience
quil signifie est la fois plus singulier et plus intime que chacune des
modalits courantes par lesquelles un signe se rapporte ce quil dnote,
telles que les a rpertories C.S. Peirce
15
. Les processus neuronaux ne sont ni
des symboles, ni des indices, ni ( premire vue) des icnes de la teneur
dexprience laquelle ils sont corrls. Ils nen sont pas des symboles parce
que leur capacit de signifier nest pas le rsultat dune dcision arbitraire et
dun consensus tacite sur cet arbitraire. Ils nen sont pas non plus des indices,
mme si cela est moins facile voir. Lindice dune chose peut tre soit la
trace quelle laisse sur autre chose en y dposant un fragment delle-mme,
soit sa consquence inluctable en vertu dune loi explicative. Lexemple
classique du premier type dindice est offert par une touffe de poils marquant
le passage de lanimal qui la laisse lorsquil sest frott contre un arbre. Le
second type dindice est quant lui instanci par la fume, qui signale un feu
non seulement en raison de sa corrlation avec lui, mais aussi en vertu de la
capacit quon a dexpliquer lorigine physico-chimique des particules de la
fume au cours du processus de combustion. Or, le processus
neurophysiologique ne dpose manifestement aucun fragment de lui-mme
dans son corrlat exprientiel (Wittgenstein souligne que je pourrais
parfaitement tre conscient sans mme souponner que jai un cerveau) ; et de
plus, il ny a aucun lien de ncessitation thorique connu ou concevable entre
lexprience et son corrlat neuronal, que lon peut de ce fait qualifier de
corrlat brut. Enfin, les processus neuronaux ne sont pas immdiatement des
icnes de lexprience car ils ne ressemblent pas au premier abord ce
quils sont censs signifier : comme on le signale couramment, les flux
neurochimiques et neurolectriques dans la matire grise nentretiennent pas
de similitude vidente avec lexprience du rouge.
Pour se convaincre que la relation entre lexprience et ses corrlats
neuronaux peut quand mme tre tenue pour un rapport de signification, il faut
alors remonter en amont de ces signes dficients vers le signifier en acte. Le
cur du signifier, nous le savons, consiste anticiper, rejeter au futur et
entretenir un projet dunit. La vise intentionnelle est un archtype du
signifier, parce quelle implique danticiper, partir dune facette de la
chose, vers ses autres facettes ( travers ce que Husserl appelle une esquisse,
enveloppe dhorizons prfigurants) ; parce quelle remet sans cesse au futur
lachvement hypothtique de lexploration de la chose ; et surtout parce
quelle constitue son objet chose en lavanant comme projet dunit de
ses apparitions. Pour autant, ce prcurseur de la signification ne fait pas usage
de signes pr-dfinis, mais rige des moments dexprience en signes au fur et
mesure de sa pousse vers ce qui ne se montre pas encore. Ainsi ralise-t-
on, partir du cas de lintentionnalit, que le procd le plus germinal du
signifier ne consiste pas sappuyer sur un choix pass dindices, dicnes,
ou de symboles, pour renvoyer vers ce qui est indiqu, figur, symbolis, mais
quil entreprend de forger intentionnellement (ou sub-intentionnellement)
des rapports de ce type dans le mouvement mme de leur usage des fins
danticipation. Avant la smantique vient la smantisation ; avant la
correspondance et le renvoi vient le modelage de termes aptes se
correspondre et renvoyer de lun lautre. Dans le cas qui nous occupe, ce
procd smantisant peut consister instaurer un genre labor de
ressemblance iconique entre chaque moment du processus neuronal et chaque
contenu particulier dexprience, sans confrer de prminence lune des
deux rgions mises en rapport, et sans les dissymtriser sur le modle du
rapport de cause effet. Leur ressemblance iconique na rien dimmdiat,
ainsi que nous lavons signal plus haut. Elle peut pourtant tre recherche,
voire tablie activement au niveau des structures, avec un succs parfois
remarquable. Il suffit pour sen convaincre de penser la prcision tonnante
de lisomorphisme qui a t tabli entre certaines caractristiques structurales
de lexprience visuelle rapporte verbalement et des traits gomtriques ou
fonctionnels bien choisis des processus neuronaux
16
. Ce succs ne doit
toutefois pas tre rendu opaque par le geste habituel consistant ngliger ce
qui la permis. Il ne doit pas faire perdre de vue que la qute dune
correspondance signifiante des structures neuro-exprientielles est un travail,
un renvoi au futur de leur unit projete, une dynamique elle-mme dote de
signification dans et par lexprience de qui laccomplit, comme le
soulignait Francisco Varela dans son projet de neurophnomnologie. Loin de
se limiter un constat passif disomorphisme, elle comporte un effort pens et
vcu disomorphisation dans les deux sens, lexprience bien catgorise
servant de fil conducteur la recherche de structures neuronales qui lui soient
corrlables, et lidentification de structures (spatio-temporelles)
neurophysiologiques guidant laffinement de lanalyse phnomnologique. Ds
lors, la procdure de donation de sens aux structures neuronales par ses
corrlats exprientiels ne doit pas tre considre comme une vague addition
(un supplment dme ) pour la science neurophysiologique. tant le fruit
dune activit de conformation structurale rciproque, elle est partie intgrante
des mthodes constitutives de cette science. Certains chercheurs de cette
discipline commencent le reconnatre, aprs avoir constat que la donation
de sens aux vnements neurologiques par leurs corrlats comportementaux
simples (gestes, ou attestation dachvement dune tche par pression dun
bouton) a atteint ses limites. Cette smantisation comportementale laisse
quantit de faits neuroanatomiques et de processus neurolectriques dans la
zone grise de lininterprt, et elle oblige nassigner aux variations de
lactivit neuronale associe un comportement dtermin que le statut
incertain de bruit neurologique . Cest donc seulement en affinant luvre
de distribution du sens par le recours aux rapports dexprience en premire
personne, et en amliorant leur ajustement une connaissance physiologique
en essor, que la tche de constitution de nouveaux objets pertinents pour les
neurosciences peut se poursuivre
17
. Des configurations fonctionnelles
inattendues, des tranches spatio-temporelles dactivit neuro-lectrique, des
rsonances physiologiques, des rseaux transcorticaux sont extraits du
continuum de ce qui arrive dans le systme nerveux, au nom de leur
signifiance exprientielle.
Peut-tre toutefois ne sagit-il l encore que dune modalit faible du
procd dattribution de sens multiforme qui connecte la neurophysiologie
lexprience. Il a t soulign quune composante cruciale de lactivit
signifiante consiste projeter dunifier toutes les facettes de ce qui apparat.
Ne peut-on pas la prolonger jusqu son point de rupture ou de retournement,
en projetant dunifier les aspects de ce qui apparat lapparatre entier ?
Quest-ce qui pourrait jouer ce rle incomparable de ciment ou de foyer de
convergence de ce qui se donne et de la donation, du vu et du voir, de lobjet
et de lobjectiver, de lprouv et de lpreuve, du contenu dexprience et de
lexprience entire ? Lerreur du matrialisme est de concevoir lunit de
sens hyperbolique vise par ce projet sur un mode conservateur, en lui
appliquant le modle des objets constitus les plus courants que sont les corps
perceptibles. Lerreur inverse de lidalisme est de rsorber lunit de sens
dans son propre champ constitutif, et de dchoir les objets viss au profit du
processus perceptif et intellectuel de vise. Cest pour surmonter ces deux
erreurs opposes que Merleau-Ponty a propos de donner un nom
apparemment limitatif, mais en vrit plus extensif que nimporte quoi dautre,
son unit de sens ultime : ce vers quoi convergent prsomptivement le corps
peru et lexprience-du-corps, le senti et le sensible, il lappelle la chair
18
,
la suite de Husserl. La chair est ce qui est visible et voyant, tout en ntant
rductible ni une chose visible ni un pur voyant. Il est vrai que le concept
merleau-pontien de chair a t model limage dune exprience
immmoriale : celle du nud qui lie ce corps apprhend (ce corps-ci et non
pas ce corps l-bas) lexprience qui lapprhende. Mais il peut aisment
tre extrapol vers une exprience plus spcifique, plus rcente, et plus
lourdement tributaire de techniques dimagerie ou dexploration
fonctionnelle : celle du nud neuro-exprientiel. Conformment cet ordre
historique, je partirai des analyses phnomnologiques classiques du nud le
plus primitif : la rflexion sur le corps touchant-touch initie par Husserl
dans le second volume des Ides directrices pour une phnomnologie, et
lexpansion cosmique qui en a t propose par Merleau-Ponty travers son
concept de Chiasme. Puis je tcherai den tendre lenseignement ce que a
fait de voir son cerveau corrl (voire corrlable) sa propre pense.
Le Husserl des Ideen II ayant t une source majeure de toutes les
philosophies ultrieures du corps vcu, cest cet auteur qui va servir de
premier fil directeur. Chez Husserl, il nest pas question de chiasme, mais
simplement de rflexion
19
. Ce corps-ci se rflchit sur lui-mme, en
apercevant sous forme de chose tendue la source de la sensibilit et du
vouloir en quoi il consiste. Le mouvement de rflexion consiste en dautres
termes identifier un certain corps spatial comme tant mon corps
20
,
lirruption du pronom personnel signalant le plus haut degr de
concernement
21
. Dans ce corps-ci, il en va de moi, de manire plus intime et
plus inaugurale que dans tout autre, parce que ses parties ne sont pas
seulement des choses perues et saisissables, mais aussi les moyens que jai
de percevoir et de saisir. Toutefois, selon Husserl, je ne dploie toutes les
intrications de cette version spatio-sensible de la rflexivit qu travers la
rversibilit dun sens privilgi : le toucher. En effet, lorsque je palpe de la
main une chose quelconque rpute inerte, comme un meuble, je ne fais pas
que sentir cette chose. Je sens galement, aprs une ventuelle rorientation de
lattention, ma main envahie par limpression du chaud ou du froid, par une
tension de dformation, par le glissement caressant quexerce la surface
parcourue, voire par une douleur. Je sens que ma main sent, juste aprs (ou en
mme temps ?) que jai senti le meuble. Cette main nest pas seulement un
mdium obscur pour la sensation de quelque chose dautre ; elle est sentie
comme sentante, clairable dans son propre sentir ; cest ce qui en fait ma
main, la main du sentant. La dcouverte de la rflexivit samplifie encore
lorsque je palpe de la main gauche une autre chose virtuellement identique
elle, qui est la main droite. Dans ce dernier cas, crit Husserl, nous avons
[] deux sensations et chacune peut faire lobjet dune double apprhension,
et par consquent dune double exprience
22
. Comme dans la situation de la
main touchant le meuble, je sens avec lune de mes mains (Gauche) une autre
main (Droite), et en mme temps, ou juste aprs, je me sens sentir, toujours
avec la premire main (G), lautre main (D). Mais, la diffrence de ce qui se
passe lors de la palpation du meuble, je ne fais pas que sentir avec lune de
mes mains (G) une autre main (D) ; car en mme temps ou juste aprs je sens
aussi lautre main (D) sentant la premire main (G) et se sentant.
Schmatiquement, les deux degrs de la rflexivit husserlienne se
reprsentent ainsi :
Dans la palpation mutuelle, non seulement chacune des mains sent et se
sent, mais elles sont toutes deux sentantes aussi bien que senties, ou plus
spcifiquement touchantes aussi bien que touches, ce qui leur confre en un
seul geste deux marques de miennet. Chaque main est le lieu dune double
rversibilit, celle du sentir-cela et du se-sentir, aussi bien que celle de
ltre-senti et de ltre-sentant. Chaque main de ce corps est en quelque sorte
investie de deux faces, la seconde des faces (celle du se-sentir et du sentant)
se prsentant moi de manire exclusive. Mais que sont alors ces mains pour
avoir la capacit tre bi-faciales ? Sont-elles des choses parmi dautres
choses, simplement dotes de proprits supplmentaires, celle, gnrale,
dtre sentantes, et celle, particulire, du se-sentir ? En aucune manire,
martle Husserl. Ltre-sentant et le se-sentir ne sont pas des proprits (ils
prconditionnent lattribution des proprits) ; par suite la main nest pas une
simple chose. La main, mais aussi le corps et le cerveau propres, relvent
dcidment dune autre catgorie que celle de la res porteuse de proprits.
Ils sont autres que la res extensa et autres que la res cogitans. Ils sont autres
aussi que lexprience pure, ou apparatre, dans laquelle se ralisent tout la
fois la perception des corps, lintimit avec le corps propre, et lacte mme
de catgoriser. Une telle catgorie hors catgorie est prcisment celle de la
chair (Leib), selon la terminologie de Husserl
23
; cette chair qui, nous lavons
vu, est le seul (et inou) centre de convergence concevable des apparitions et
de lapparatre.
Un point troublant de la rflexion de Husserl est quil particularise le
toucher parmi tous les sens, et quil lui oppose tout spcialement la vision. Au
nom de quoi ? Au nom de lincapacit dans laquelle le voyant se trouve de se
voir, oppose la capacit qua le sentant de se sentir. Lil ne se voit pas
lui-mme, ou il ne se voit le cas chant que comme objet dans le miroir ;
alors que la main se sent immdiatement elle-mme, selon cette rversibilit
singulire qui la fait demble chair, et qui lidentifie comme ma chair. Les
yeux ne seraient-ils donc pas partie intgrante de ma chair ? La conclusion ne
sensuit pas, bien sr. Husserl esquisse un argument pour montrer quelle est
inexacte, mais son argument reste inabouti. Il est vrai que lil voyant nest
pas immdiatement vu, souligne-t-il, mais au moins peut-il tre touch
24
. Il
devient partie du corps propre dans la mesure o il relve du touchable et du
toucher : je peux toucher mon il, exercer une lgre pression sur lui ; et mon
il se sent alors lui-mme, il endure la pression sur le mode de la sensation
tactile, il intgre la masse corporelle auto-sensible. Une pression plus forte
sur le globe oculaire suscite mme des arcs de couleurs visibles, jetant un
pont entre laction tactile et la perception visuelle. Par consquent, a-t-on
envie dajouter, si la vision ne sinscrit pas dans le mme genre de boucle de
rflexivit troite que le toucher (puisque le voyant nest pas vu, alors que le
touchant est touch), elle sinscrit tout de mme dans une boucle de rflexivit
plus large impliquant au moins deux sens. Le voyant est touch, le touchant est
vu, toucher le voyant engendre du visible ; tout cela ritre, par croisements
multiples des voies daccs, la perception de la miennet de la chair. La
pleine rflexivit se manifeste non pas au niveau dun seul sens, mais celui
du corps propre entier. Elle inclut aussi et surtout certains sens composites de
ltre-simplement-prsent, des efforts, des rsistances, et des dplacements
que lon nomme cnesthsie dans leur tat inspar ou proprioception
dans leur version objective, mais que Michel Henry
25
identifie avant cela
une archi-rvlation de la vie , condition de possibilit charnelle de toute
vise dobjet.
La prmisse mme de lopposition husserlienne entre la rflexivit propre
du toucher et lirrflexivit propre du voir, doit cependant tre nuance
26
. La
vision ne fait pas autant exception quil y parat. Les structures en boucle du
toucher et du voir savrent tre du mme type, car, plus ample examen, le
touchant ne se touche pas plus lui-mme que le voyant ne se voit. Ne venons-
nous pourtant pas de dclarer, en contradiction apparente avec cela, que le
touchant peut tre touch, et nen avons-nous pas dploy un bon exemple
travers le cas de la main gauche touchant la main droite et touche par elle ?
Si nous lavons fait, cest en passant trop vite sur lindispensable analyse
temporelle de lacte du toucher (comme de tout acte mental ou physique)
27
. Le
terme touchant est un participe prsent ; et le prsent est la qualification la
plus fugace qui soit. Lorsque la main gauche est perue comme touche, la
caractrisation qui en fait une main touchante vient un bref instant trop
tard ; elle ne lui convient dj plus tout fait au moment o elle lui est
applique, mme si elle peut tre ractualise trs peu de temps aprs. tre
touchant est un fait fonctionnel et non pas substantiel. Une main nest pas
intrinsquement touchante, elle lest aussi longtemps quelle est mise en
position dexercer la fonction de sujet charnel du toucher dans le cadre global
de lconomie de la connaissance. Nous commenons mieux saisir, chemin
faisant, lun des plus forts motifs de la thse selon laquelle tre touchant,
voyant, entendant, ne constitue aucune proprit : une proprit se prvaut
dun certain degr de permanence et dautonomie vis--vis des circonstances,
alors qutre-sentant est suspendu un choix inconstant de posture
attentionnelle. Ma main gauche est touchante lorsque mon attention se porte
sur lobjet de son toucher ; elle est touche lorsque mon attention se porte sur
elle travers la mdiation transparente de la main droite, qui devient
touchante son tour. Ma main gauche sent lorsque mon attention est focalise
sur son objet palp, et elle se-sent lorsque mon attention abandonne son objet
dans les lointains et se concentre sur ses affections cnesthsico-
proprioceptives. Mais au fait, quest-ce qui est sentant lorsque ma main se
sent ? Faut-il dire que cest encore ma main, faisant simultanment delle un
sentant et un senti dans ce cas particulier de lauto-sensation ? Pas exactement.
Le sentant de la main qui se sent, cest ce qui, de cette main et ce moment-l,
a t sorti du foyer de lattention et rejet tacitement en son arrire-plan. Le
sentant est labsent du sentir ; il est dynamiquement ni au cours de la
sensation. On peut aller jusqu le dfinir par cette ngation : le sentant est ce
qui ne se sent pas lui-mme ; il est ce qui est ni dans lacte de sentir. En
particulier, le sentant de la main qui se sent est ce qui, dans cette main ou plus
largement dans ce corps, ne se sent pas soi-mme linstant o il sent. Il ny
a donc pas plus de vrai touchant-touch dans lenclos dun moment sensible
que de voyant-vu dans les limites de la seule modalit visuelle. Une main
tendue dans lespace et dans le temps peut jouer partiellement ou
alternativement les deux rles de touchante et de touche, sans que le
touchant actuel ne puisse (par dfinition, dsormais) tre confondu avec le
touch actuel.
Deux prcisions doivent tre apportes ce stade.
Tout dabord, dire que le sentant est labsent du sentir nquivaut pas
dire quil nest rien. Le sentant est reconnu comme un manque ; il est dessin
par le contour de ce manque ; il nest pas seulement ce qui ne se sent pas lui-
mme actuellement, mais ce qui pose son horizon la possibilit de se sentir.
La chair nest donc pas immdiatement cet lment biface que dcrit Husserl,
sentante-et-sentie dans un seul souffle ; si elle se singularise et se reconnat
elle-mme comme chair, cest par sa capacit inverser sa polarit au fil du
temps, de manire parfois si vive quil semble que cela se produit dun coup ;
cest en somme par sa reconnaissance que le sentant quelle abrite, labsent
auquel elle sadosse linstant, a t, sera, ou pourrait tre senti et prsent.
Ensuite, le fait dexclure la coexistence du touchant et du touch dans un
acte sensible ne revient pas refuser un certain type de sensation composite
que lon peut avoir de ses deux mains, lorsquelles se touchent en croisant par
exemple leurs doigts. Les deux mains, dans ce cas, sont bien le sige de
sensations intriques rsultant du contact de lune avec lautre. Toutefois, sil
en va ainsi, ce nest pas quelles sont simultanment touchantes-touches,
mais que le sentant des deux mains entrecroises est ailleurs, quil sest retir,
quil se tient dans la zone dombre de ce qui, de la paire de mains, se
prsente. Le sentant des mains noues est labsent de ce qui, delles deux, est
senti.
travers cet itinraire phnomnologique lmentaire sur les fluctuations
de lattention et sur langle mort quelle laisse forcment derrire elle, on
devient rceptif certaines propositions sibyllines de Merleau-Ponty propos
de la nature de la conscience. La conscience, dclare Merleau-Ponty, se
dcouvre comme le rien, le vide qui est capable de la plnitude du
monde
28
. Plus gnralement, le ngatif constitue le bord de ltre
29
, la
ligne priphrique par contraste avec laquelle il se manifeste. Ces remarques
ne sont que superficiellement mtaphysiques. Elles expriment en vrit le
cur mme de lexprience du voir et du sentir. Lexprience de ce qui se
voit et se sent est en effet dploye sur fond dune obscurit et dun silence
pour ainsi dire translucides. Lobscurit et le silence ne sont ultrieurement
requalifis de voyant et de sentant quau nom dune nouvelle exprience
obtenue par rorientation de lattention vers le corps. Et cette exprience
rflexive du corps est conditionne son tour par labsence, le vide, la
ngation que rejette en arrire de lui-mme le faisceau attentionnel qui la
permet. Ce qui est absent, vide et ni est contingent ; mais quil y ait,
lourlet de lexprience, de labsence, du vide et de la ngation est constant.
Le cas de la vision avec son voyant invisible et son invisible conditionnant le
voir nest dcidment pas une exception (ou une dviation par rapport au cas
du toucher), mais la rgle du sentir, pour ne pas dire de lexister.
Cest ainsi quon peut comprendre sur un plan phnomnologique le
statut des processus neuronaux : comme une rgion de vide, une ligne de
ngation bordant lprouver, qui peut se voir reconnatre aprs coup le rle de
chair des vnements mentaux la faveur dune rorientation de lattention.
La pure bance anonyme du connaissant se voit singularise comme cet
absent charnel titre rtroactif, ds quun acte rflexif a permis de dsigner
un certain corps comme sa face objective. De mme que labsence
inqualifie du voyant se laisse caractriser comme il absent du champ visuel
la suite dune analyse exprimentale lmentaire combinant la clture des
paupires et limage de lil dans un miroir, labsence du connaissant entier
se laisse caractriser comme systme nerveux initialement absent du champ
connu la suite dune analyse exprimentale labore, de type anatomo-
physiologique. Laissons-nous ici encore guider par Merleau-Ponty. Je sais,
crit-il, faire le geste qui convient pour memparer dun objet mme si je ne
sais pas comment cela se fait dans la machine nerveuse
30
. Jai dailleurs su
le faire bien avant quon mait appris que je possde une machine
nerveuse . travers cette remarque, le statut originel du systme nerveux
apparat bien tre celui de grand absent sentant-agissant ; un absent dont les
traits ne se laissent dabord pressentir que par la forme de laction, et dont le
caractre mme dabsence, bien diffrent de la simple inexistence, ne lui est
assign quaprs quil a manifest une forme de prsence. Cest
quultrieurement (dans lhistoire des connaissances physiologiques puis dans
lducation de chaque enfant), le systme nerveux peut devenir objet dexamen
et de manipulation, confrant une figure prcise labsent jusque-l ignor qui
prconditionne tout sentir et toute action. En travaillant la corrlation troite
des processus se droulant dans le cerveau objectiv avec les contenus sentis
et les mouvements accomplis par la personne qui le porte en son corps, on le
transforme en un candidat plausible au statut bifacial de chair . Il ne passe
toutefois du rang de candidat celui de chair vcue comme telle qu partir du
moment o une condition rarement rencontre dans nos vies est satisfaite.
Cette condition est que celui qui sent et qui agit concide en tant quindividu
humain avec celui qui exprimente sur son propre systme nerveux. Si
Merleau-Ponty reste discret sur cette possibilit ( lpoque spculative) que
le spectateur de mon activit neuronale ne soit autre que moi-mme,
Wittgenstein la formule ouvertement lorsquil voque lallgorie dun homme
qui regarderait son cerveau dans un miroir
31
.
De nos jours, la fiction est devenue une ralit mdicale, par le biais des
thrapies qui utilisent le neurofeedback , et des situations pr-chirurgicales
o les patients sont confronts au trac de lactivit lectrique de leurs
propres neurones. Dans le neurofeedback, les patients sont mis face une
image quasiment en temps rel de leurs hmisphres crbraux, obtenue en
balayant squentiellement lintrieur de leur bote crnienne par un appareil
utilisant, par exemple, la rsonance magntique nuclaire (RMN). Une fois le
dispositif mis en place, on leur apprend concentrer lattention sur une
certaine rgion de limage en RMN (IRM) de leur cerveau, corrle aux
troubles quil sagit de traiter chez eux. Un exemple particulirement
reprsentatif de cette pratique du neurofeedback est celui o lon entreprend
de soigner une douleur chronique
32
. Dans ce cas, on demande aux patients de
porter leur attention sur leur cortex cingulaire antrieur , une aire situe
vers lavant de la partie interhmisphrique du cortex crbral, frquemment
corrle la composante motive et interprtative de la douleur. En observant
scrupuleusement les codes de couleur sur limage IRM de cette rgion de leur
cerveau, ils peuvent noter des variations de sa vascularisation, et donc de son
activit mtabolique. On entrane ensuite les patients moduler leurs
orientations et leurs contenus mentaux, de manire dcrotre lactivit
visible de leur cortex cingulaire antrieur. Il sensuit une diminution nette de
la perception douloureuse, qui peut tre tendue dans le temps aprs que
lexercice a t rpt un nombre suffisant de fois. Une autre technique de ce
genre, baptise brain TV
33
, est applique des patients atteints dune
forme grave dpilepsie, rsistante aux traitements pharmacologiques. Ces
patients se voient proposer une intervention chirurgicale, et, dans les jours qui
prcdent lintervention, on implante chez eux des lectrodes intracrbrales
qui permettent de localiser prcisment leurs zones pileptognes. Les
enregistrements dactivit lectrique neuronale ainsi obtenus sont projets, l
encore en temps quasiment rel, sur un cran dordinateur. Mais, si les
enregistrements sur plusieurs jours sont utiles aux chirurgiens afin de dlimiter
leur cible daction, le trac minute aprs minute na dintrt que pour le
patient en personne. Les mdecins et chercheurs impliqus dans ce genre de
traitement de lpilepsie ont donc incit les patients regarder leurs propres
tracs lectriques crbraux, et tablir des corrlations entre ces tracs et
leurs activits mentales, sans ncessairement tendre (comme dans le
neurofeedback) vers lauto-contrle des phnomnes neurolectriques.
Il reste examiner comment saccomplit la transition entre une chair
infre et une chair vcue dans ce genre dexprience de voir son propre
cerveau et de pouvoir agir sur lui. Pour cela, il suffit de transposer ce que
nous avons dj appris sur la chair vcue lmentaire : la chair des membres,
parfois celle du thorax, toujours celle de la peau. La main de chair sent et se
sent elle-mme, elle est sentante et sentie, ft-ce en succession. Lorsquelle
sent, elle est labsente du sentir, tandis que, lorsquelle se sent elle-mme ou
lorsquelle est sentie travers lautre main, elle retourne la prsence.
Encore cela nest-il quune mtaphore commode pour dire que je sens
travers ma main, et que je la sens parfois elle-mme travers elle, qui mest
prsente comme lenvers de lobjet que je suis en train de sentir. Je sais par
ailleurs que cest travers ma main que je sens, parce que renverser
lattention pour la sentir sentante est une option sans cesse accessible dans le
cours de mon exprience sensible. En va-t-il ainsi pour le cerveau ? Pas
exactement. Le cerveau est bien le grand absent de nimporte quel sentir (pas
seulement de sa modalit tactile) ; et je peux le percevoir, toujours travers
lui en tant quabsent. Mais cette possible perception du cerveau nest pas une
option immdiatement disponible par un simple exercice de rotation
attentionnelle ; jai besoin pour y parvenir dune mdiation tactile, visuelle, et
plus encore instrumentale. De ce point de vue, son caractre charnel
sapparente plus celui de lil qu celui de la main. Mon cerveau
prouvant ne se laisse pas spontanment prouver, mais il peut tre touch, vu,
excit ou explor par moi condition que je dispose dun appareillage. Il
devient un lment du corps propre, dans la mesure o stimuler lune ou
lautre de ses rgions suscite une exprience particulire (assez spcifique de
cette rgion), et o il est possible de savoir quelle rgion affecte est associe
quel effet exprientiel. Si le cerveau ne sinscrit pas, comme la main, dans
la boucle de rflexivit monomodale du toucher, ni mme, comme lil, dans
une boucle de rflexivit bimodale de type visuo-tactile, il sinscrit dans une
boucle largie de rflexivit multimodale. Il se prsente comme la plaque
tournante dune rflexivit gnrale, puisque, tendant autant quil est possible
la configuration en boucle de la main qui se sent touche lorsquon la touche,
il participe dune boucle plus vaste dans laquelle tous les genres
envisageables dexpriences se font jour lorsquon en active diffrentes aires.
De mme que lil est ralis comme chair lorsquon le sent comprim et
gnrateur dexpriences colores (ou phosphnes ) sous la pression dun
doigt, le cerveau est ralis comme chair lorsque, dans les situations dauto-
contrle neurophysiologique, un simple geste prolongement instrumental
suffit susciter toutes sortes daffects, dactivits mentales, ou de figures
sensori-motrices. Notre capacit prter une signification charnelle nos
propres expriences vcues sen trouve considrablement amplifie. Certains
types reconnaissables dexpriences sensibles acquirent trs tt la
signification spcialise dtre auditives , visuelles , tactiles , ou
gustatives , en vertu de la capacit rtroactive que nous avons de modifier
spcifiquement ces expriences en agissant sur loreille, lil, la peau, ou les
papilles de la langue. Quelques expriences sont rapportes au cur ou
aux tripes en raison de leur connexion avec des sensations proprioceptives
des appareils cardio-vasculaire ou digestif. Par extension, toutes les
expriences peuvent se voir attribuer la signification fdratrice dtre
crbrales , en vertu de notre aptitude rtroagir sur elles en intervenant
sur des aires spcifiques de notre cerveau pendant le neurofeedback.
Lexprience se fait chair, chair troite sensorielle ou chair largie neuronale,
la faveur dun mouvement qui entrecroise une volont vcue dagir sur le
corps, et un corps dont la modification se traduit en altration du vcu.
Soit, rediront les sceptiques dobdience analytique ou de formation
exclusivement scientifique, mais nest-ce pas l une faon sophistique de
dire quon voit, clair comme le jour, que les processus crbraux sont la
cause de la conscience, et mme, pourquoi pas, de lexprience pure ?
Nessaie-t-on pas dviter cette conclusion vidente en la travestissant des
figures littraires quaffectionnent les phnomnologues et autres
philosophes continentaux ?
La premire rponse ces questions est que le style phnomnologique ne
semble une chappatoire que parce quil ne sinscrit pas dans des formes de
pense aisment accessibles un tat de conscience naturel . Il vise tirer
les consquences du grand constat dubiquit de lexprience vcue
quimpose un tat de conscience rflexif rsultant de la suspension du
jugement. Loin de svader des conclusions tires dune dmarche
intellectuelle relevant de ltat de conscience naturel , il leur assigne une
signification enrichie en les remettant en perspective dans son tat de
conscience plus vaste. Il renverse particulirement le sens de la corrlation
neuro-exprientielle, en tirant les consquences du fait vertigineux quelle est
elle-mme une exprience. Car, au moins autant que lexprience se fait chair,
la chair se rvle seulement elle-mme dans lexprience et comme
exprience. Ce que lon nomme la chair , y compris la chair neuronale,
nest autre que lentrelacement dune exprience des choses corporelles, et
dune exprience de la sensibilit de lexprience aux affections de parties
dun corps. Ainsi que lcrit Jan Patoka, sil est vrai que le corps est inclus
dans le monde, le corps propre (et plus largement la chair) nen reste pas
moins une tranche dexprience vcue
34
qui conditionne rciproquement
le monde en tant quapparition.
La seconde rponse (sans doute plus directe, et donc plus convaincante
quel que soit ltat de conscience adopt) consiste rappeler qu lexamen
attentif, le schma standard unidirectionnel de la dtermination causale
savre constitutivement inadapt la relation entre fonctionnement neuronal
et exprience consciente. Cette critique du schma causal oprant par un
retour la racine du concept de causalit dans lexprience du temps et de
lagir, elle peut de surcrot rendre ceux qui acceptent de la faire plus rceptifs
lattitude rflexive. Cest donc elle qui va tre dveloppe en priorit.
Rflchissons la manire dont nous effectuons un tri pour qualifier
quelque chose de cause dans la vie courante et dans le travail scientifique.
Nous sommes gnralement dbords par le nombre des antcdents
chronologiques qui pourraient avoir caus un vnement. Parmi tous les
antcdents, celui que nous avons lhabitude de considrer comme la cause de
lvnement est soit celui dentre eux qui apparat avoir chang rcemment,
soit, de manire plus convaincante, celui dont nous avons pris le contrle
35
.
Le contrle a priori, lintervention, laction, sont des pierres de touche
pragmatiques lorsquon cherche dsigner des causes, comme on le sait
depuis la naissance de la mthode exprimentale. Mais sagit-il seulement de
cela ? Le guide pour la mise en vidence des causes ne peut-il pas tre lev
au rang de dfinition de la fonction causale, par un retournement typique des
pistmologies transcendantales ? Certains auteurs, comme G.H. Von
Wright
36
, ont franchi ce pas du cognitif au constitutif. Ils ont difi une thorie
anthropologique ou interventionniste de la causalit vocation
universelle, qui a connu plusieurs dveloppements rcents
37
. Selon cette
thorie, une configuration A est une cause de la configuration distincte B, si :
1) chaque fois que A a t activement mise en place, et de quelque
manire que cela ait t fait, B se produit coup sr (ou au moins avec
une probabilit P suprieure la probabilit p de son occurrence en
labsence de A) ;
2) chaque fois que A a t activement vite, B ne se produit pas du tout
(ou alors seulement avec la probabilit p d occurrence spontane ).
Galile rsumait ainsi les deux conditions (dans leur version stricte, non
probabiliste) : La cause est celle qui, une fois pose, sensuit leffet ; et une
fois retire, leffet se retire
38
.
Cette dfinition, surenchriront ce stade les sceptiques, ne confirme-t-
elle pas quon peut qualifier certains processus crbraux de causes de la
conscience ? On agit sur une portion du tissu crbral, ou on inflchit un
processus neuronal, et voil que sensuit un genre dtermin de contenu de
conscience. On inhibe cette portion du tissu crbral, ou on vite dinflchir
ce processus neuronal, et le contenu de conscience prcdent ne se manifeste
pas. Le fait que tout cela se donne par et dans une exprience, poursuivront
ces sceptiques, nest pas a priori suffisant pour dnier que le site daction
neurophysiologique peut tre la cause dune exprience, et que par suite le
fonctionnement neuronal dans son ensemble est la cause de lexprience tout
court. Aprs tout, on ne se prive pas, dans le travail scientifique, de confrer
une autonomie aux causes par rapport leur mode de donation. Ayant mis en
uvre la procdure pragmatique et exprientielle de caractrisation dune
concomitance comme rapport de cause effet, on sestime en droit den
occulter le caractre constitutif pour le jugement causal et de ne plus la
considrer que comme une voie daccs, une fentre pistmique, une
technique de mise en vidence des causes autonomes (pour ne pas dire de
ces causes intrinsquement existantes). Plus largement, on ne cesse
daccomplir dans les sciences une opration de dtachement des units de
sens vis--vis de lactivit signifiante. Ne peut-on pas faire la mme chose
dans le cas du lien entre cerveau et conscience, en prtant lautonomie ce
quon cherche caractriser comme causes neurologiques, et en repoussant
dans un arrire-plan mthodologique lexprience dagir et de ressentir qui
sous-tend cette caractrisation ? Lomission volontaire de larrire-plan
performatif et exprientiel de la qute des causes, qui est presque une marque
de fabrique du travail scientifique, ne peut-elle pas tre tendue ce cas
particulier quest le travail sur le matriau neuronal ? Et dans ces conditions,
ne doit-on pas adopter sans arrire-pense la thse suivant laquelle la
conscience dans toutes ses dimensions, y compris phnomnale , est
cause par ce matriau, qui peut alors sappeler bon droit la base
neuronale de la conscience ?
La rponse ces questions est fermement ngative, pour deux raisons
simples comprendre (mais parfois difficiles raliser).
Lune des raisons sinscrit en faux contre ce quimplique la dernire
question. Elle consiste remarquer nouveau que linfrence gnralisatrice,
qui sappuie sur la possibilit de susciter certaines configurations
dexprience en altrant certaines configurations neuronales, pour en infrer
un lien causal fort entre le fonctionnement neurobiologique en gnral et
lexprience vcue en gnral, ne vaut pas. Le lien structural mentionn peut
aussi bien sinterprter comme une dtermination, par la dynamique
neuronale, des formes et des contenus dune exprience toujours-dj l, que
comme un engendrement ex nihilo de lexprience entire par un processus
physiologique.
Lautre raison met en difficult ce que suggrent les deux premires
questions : que lon peut toujours escamoter la voie daccs au lien causal,
lorsquon nonce les causes. Dans le cas de la connexion neuro-
exprientielle, ne loublions pas, ce que lon suppose caus sidentifie ce
quil faudrait repousser dans les coulisses de la connaissance pour
autonomiser sa cause. Ce que lon suppose caus nest en effet autre que
lexprience vcue entire, qui inclut lexprience dagir et de subir dont
dpend lassignation causale. Ici, le procd usuel qui consiste confrer
lautonomie causale des units de sens aprs les avoir coupes de leur
procd constitutif est donc tout simplement sorti de son contexte de validit.
Lentrelacement du signifiant, du signifi et du travail de signification est trop
troit dans ce cas pour quon puisse en abstraire des entits spares jouant
leur rle de causes et deffets comme par dlgation. Qualifier les processus
physico-physiologiques de causes de lexprience, cela supposerait quon ait
accompli une opration de dtachement des units de sens quils sont
lgard de lactivit signifiante ; mais comment procder un tel dtachement
des significations quand ce dont elles sont censes tre la cause concide avec
la source productive du signifier ? Rapparaissant ainsi la faveur de
linvitable inachvement du geste particulier dobjectivation par lequel on
cherche lui assigner une origine physique, lexprience ne peut faire
autrement que dadopter une posture rflexive. Lexprience quon cherche
escamoter dans lchafaudage de la connaissance se montre nouveau elle-
mme en tant que partie de son difice. Mais une fois que le voilement
existentiel dont dpend la connaissance objective a ainsi t dchir en un
point (celui de leffet dune intervention physiologique sur les contenus de la
conscience), il seffiloche entirement et laisse sexposer au grand jour de la
rflexion ce quil tendait dissimuler ou minimiser : oui, t out cela,
processus neurologique, action de stimulation, corps propre, contenus
conscients, et volont de repousser la conscience dans larrire-plan de la
connaissance, se donne seulement en tant quexprience vcue. Et ce qui, la
condition non remplie dtre isol et autonomis, aurait pu tre dsign
comme cause ou caus, apparat, une fois replac dans le chiasme dynamique
qui unit lexprience ses contenus objectivs neurophysiologiques, comme
simple moment dun lien rciproque et vcu de co-dpendance.
Quil en aille bien ainsi est corrobor par le caractre bidirectionnel de la
connexion neuro-exprientielle, dj voqu prcdemment, mais dvelopp
ici. Repensons aux situations de neurofeedback. Ce quelles montrent le plus
souvent nest pas tant la dpendance des contenus de conscience lgard de
leur base neuronale que le contraire, savoir la dpendance du
fonctionnement neuronal lgard de modifications intentionnelles des tats
mentaux ou des contenus de conscience. Dautres situations, qui concernent les
corrlats neuronaux de la pratique de la mditation
39
ou des techniques
thrapeutiques de pleine conscience (mindfulness
40
), vont dans la mme
direction. Ici, un exercice dauto-contrle des contenus et de la structure de
lexprience a pour consquence un ensemble de modifications calibres et
reproductibles des processus neurologiques, voire une altration permanente
de lanatomie crbrale
41
(qualifie de neuroplasticit). Si la dfinition
performative de la causalit sapplique lorsquil sagit de dsigner la cause
physiologique dune modulation de lexprience (cause ascendante), elle
sapplique donc exactement autant pour identifier la cause exprientielle
dune altration de la fonction neuronale (cause descendante). Il ny a aucune
raison de privilgier lune par rapport lautre, aucun motif (mme partiel)
par consquent de prsumer quune base neuronale est cause de
lexprience consciente en gnral plutt que le contraire, ou aucun des deux,
si ce nest un automatisme qui fait traditionnellement prfrer le sens des
causes ascendantes au sens des causes descendantes, par commodit
pistmologique. Une premire raison de cette prfrence habituelle est que le
sens des causes ascendantes promet de prenniser le procd descamotage
des prconditions de la connaissance et dautonomisation des objets de cette
connaissance, alors que le sens des causes descendantes a un point de dpart
trop proche de ce que nous voudrions escamoter pour ne pas le remarquer ;
mais largument ne rsiste pas lexamen, nous lavons vu, lorsque lun des
pseudo-objets autonomiser se confond justement avec la plus ultime des
prconditions de la connaissance. La seconde raison habituellement invoque
pour privilgier la causalit ascendante au dtriment de la causalit
descendante saffiche comme ontologique : si ce quil y a est un ensemble de
particules lmentaires relies par des forces, puis assembles en molcules,
en cellules et en cerveaux, alors toute action, quelle soit globale ou locale,
physique ou psychique, porte en vrit sur ces particules et sur leurs
assemblages organiques. Sous cette hypothse, la causalit ascendante allant
des processus physico-physiologiques aux contenus dexprience est relle,
alors que la causalit descendante qui inverse cette relation est fictive. Mais il
ne faut pas oublier que, selon lpistmologie transcendantale prise ici comme
guide, parler de ce quil y a est seulement une manire abrge de poser le
rsultat dun ensemble coordonn dactivits thortico-exprimentales. Si
lactivit thortico-exprimentale considre est du genre analytique, les
entits poses seront bien de type atomique ou anatomique. Mais, si le type
dactivit thortico-exprimentale mis en uvre est du genre synthtique, et
utilise des procds dinteraction verbale avec les personnes humaines, les
entits correspondantes pourront tout aussi bien tre mentales. On ne devrait
donc accorder aucun privilge une action dirige vers les entits
manipulables au moyen dinstruments, par rapport une action dirige vers
les processus orientables au moyen de la parole ; aucun privilge leffet
mental dune altration crbrale, par rapport leffet crbral dune
altration des contenus de conscience. Ni les uns ni les autres ne peuvent se
prvaloir dune primaut ontologique, parce que les uns comme les autres sont
constitus (en un sens no-kantien) par la procdure correspondante. On
aboutit ainsi une complte quivalence et symtrie entre le global et le local,
entre le crbral et le mental, entre les causes descendantes et les causes
ascendantes
42
.
Au minimum, il faudrait alors admettre que le nexus neuroexprientiel ne
se laisse pas subsumer sous un schme causal linaire, mais seulement sous un
schme circulaire de causalit bidirectionnelle, que Kant considre typique
des processus biologiques, et quil rapporte un mode de pense
tlologique : La liaison causale, dans la mesure o elle nest pense que
par lentendement, est un enchanement qui constitue une srie (de causes et
deffets) toujours descendante ; et les choses mmes qui, comme effets, en
supposent dautres comme causes, ne peuvent pas en mme temps tre leur
tour causes de celles-ci. On appelle cette liaison [causale] la liaison des
causes efficientes (nexus effectivus). En revanche, daprs un concept de la
raison (des fins), une liaison causale peut galement tre pense, qui, si on la
considre comme une srie, porterait en soi une dpendance tant ascendante
que descendante, liaison dans laquelle la chose dsigne comme effet mrite
nanmoins en amont le nom de cause de la chose dont elle est effet
43
. Avant
mme de commenter ce passage de la Critique de la facult de juger, prenons
garde son vocabulaire, pour ainsi dire invers par rapport celui quon
utilise de nos jours. Ici, srie causale descendante signifie une chane de
dtermination des effets par des causes efficientes ; et dpendance causale
ascendante signifie avant tout une remonte de cette chane, allant
gnralement de leffet global/formel aux dterminants locaux/matriels (
peu de choses prs ce que nous dsignerions aujourdhui par causalit
descendante ). Lillustration la plus simple de cette circulation bi-
directionnelle concerne laction humaine oriente vers un but. Loutil est
cause efficiente ( descendante au sens de Kant) dune transformation de
lenvironnement, et la reprsentation de cette transformation dsire, ainsi que
de la forme de quelque chose qui permettrait de lobtenir, est cause finale
( ascendante au sens de Kant) de la fabrication de loutil. Mais ce qui
intresse vraiment Kant est une situation extrapole dans laquelle un systme
naturel, bien que ne rsultant de lintention daucun agent concret, ne se laisse
nanmoins penser que sous lide dune finalit ayant pu prsider sa
production et son maintien. Cest le cas de ltre vivant (ou tre
organis ) : Ltre organis possde en soi une force formatrice quil
communique aux matriaux qui nen disposent pas (il les organise)
44
. Ltre
organis dans sa totalit est pens comme exerant sur les matriaux qui le
composent un genre de causalit ascendante au sens de Kant. Il exerce en
dautres termes une causalit qui remonte la chane ordinaire des
dpendances, fait rtro-agir lorganisation sur ce qui est organis, et simpose
ce dernier comme sil tait sa finalit. Ltre organis dtermine donc ce
que nous appellerions de nos jours une causalit descendante allant de son
niveau dorganisation lev vers le niveau infrieur de ses lments . A.
Weber et F. Varela ont rsum la leon kantienne dans un langage qui leur est
propre, en qualifiant lautopose (le circuit complet des causalits
rciproques, aussi bien celle des parties sur le tout et du tout sur les parties
que celle des parties les unes sur les autres), de finalit incarne
45
.
Il en va formellement de mme dans le cas du chiasme neuro-exprientiel.
Laction descendante, allant des contenus volontairement moduls de
lexprience leur corrlat neuronal, sentrelace avec laction montante,
allant dun processus neurophysiologique altr des contenus dexprience
consciente. Cet entrelacs se traduit par une forme de finalit incarne qui nest
autre que celle de lesprit et de ses intentions. Et cest seulement, comme nous
lavons dj signal titre de critique de linfrence matrialiste, lorsquon
ampute la circulation entrelace en retenant seulement lune de ses branches
(la branche montante, bien sr), quon se trouve conduit confrer aux
processus crbraux le statut de cause efficiente de lexprience consciente.
Mais une telle analogie entre le cycle autopotique de la vie et le cycle
autoproductif de lesprit, qui font agir rciproquement lun sur lautre la
configuration globale et les processus locaux, est seulement formelle. Faire
ressortir leur part de diffrence va conduire radicaliser encore les
conclusions quil faut tirer de leur structure commune. Dans le cas de
lhomostasie mtabolique des tres vivants, les deux niveaux entrelacs sont
autant dobjets de manipulation et de pense : un objet organisme de la
science biologique, et des objets molcules de la science chimique. Dans
le cas de larticulation neuro-exprientielle, en revanche, si lun des niveaux
est un objet pour la science neurophysiologique, lautre niveau reprsente rien
de moins que la prcondition pour que quoi que ce soit acquire le sens
dobjet. Mieux, lautre niveau entrelac recouvre le phnomne prsent de
lentrelacs, faisant entrer celui-ci dans une sorte de rsonance ou de jeu de
miroirs ouvert, dans lequel le connaissant est happ par ce quil cherche
connatre. Lautre niveau nest pas seulement un site dintervention possible,
quelle soit manuelle ou instrumentale ; il sidentifie lorigine mme des
dcisions dintervenir, y compris sur soi-mme. Sil doit bien, l encore, tre
question dune forme de finalit (parce que le niveau global est vu comme
projetant les objectifs du processus auquel participe le niveau local), il sagit
dune finalit vcue, assume, agie, et non plus simplement dune finalit
conue. On ne peut plus considrer, comme prcdemment, que le niveau
global est pens de lextrieur comme sil dterminait les fins du processus
par lequel il sentrelace au niveau local, mais quil se vit lui-mme comme
dsignant ses propres finalits. On ne peut plus dire quil est un objet
configur de telle manire quil semble viser des fins, mais quil existe sous
le rgime de la vise de fins. Ce nest pas seulement que des intentions sont
attribues quelquun, mais que ce quelquun sprouve comme source
dintentions. Lentrelacs neuro-exprientiel est unique en ceci que la finalit
conue y concide avec une finalit en acte, manifestement prsente en tant que
dessein prouv.
mi-parcours de notre analyse de la causalit, lchelle entire des
priorits sest dj inverse. On a voulu faire sous-tendre lexprience et ses
intentions par des causes, et cest lintentionnalit qui a deux fois t remise
au premier plan, comme prsuppos de la recherche de connexion causale, et
comme traduction pense et vcue du cycle entier des causalits rciproques.
Une lecture hmiplgique du rapport entre cerveau et exprience pouvait faire
du cerveau la cause de lexprience consciente ; mais une lecture intgrale qui
sinclut elle-mme en tant que mta-exprience commence par fluidifier le
concept de cause dans une circulation mutuelle, avant de lui faire
compltement perdre sa pertinence au profit de lintentionnalit vcue.
Comme annonc prcdemment, ltude critique du schme de la causalit
appliqu la relation entre fonctionnement neuronal et exprience consciente
a abouti le mobiliser, linactiver, puis renvoyer sa source mme dans
lexprience consciente dont il devait pourtant permettre de rendre raison. Le
schme de la causalit tait, chez Kant, lun des lments-cls de la
constitution dobjectivit. En revanche, la simple tentative dtendre ce
schme (hors de son domaine de validit) au lien entre un objet-cerveau et la
conscience qui vise lobjet reconduit automatiquement celui qui la fait
lactivit constitutive elle-mme dans son immdiatet vcue ; elle restitue,
son corps dfendant, la primaut lorigine plutt quau fruit de
lobjectivation.
Mais si lon ne peut ni dnier la corrlation neuro-exprientielle en tant
que phnomne, ni en infrer quoi que ce soit en matire dimputation
causale, que reste-t-il accomplir ? A-t-on comme seule issue de dresser sur
un mode quitiste le procs-verbal du nud mystrieux dans lequel nous
sommes tisss, entre le corps sensible et le sentir dun corps ? De la
corrlation neuro-exprientielle, il semble dcidment quon ne puisse rien
faire, si ce nest en nourrir notre perplexit et en tirer une stnographie de
significations mutuelles.
Cela rappelle une remarque-dfi qunonait Heidegger propos de la
philosophie : on ne peut rien faire avec la philosophie
46
. Dans chacun de
ces deux cas, limpossibilit de faire quoi que ce soit avec une situation, un
constat, une discipline, laisse lesprit transitif (lesprit entreprenant de notre
civilisation du devenir htif
47
) dans un tat de profonde dshrence. Que faire
lorsquil ny a rien faire ? Lisons la suite de la rflexion de Heidegger :
tant entendu que nous, nous ne pouvons rien faire [de la philosophie, on
peut se demander] si ce nest pas finalement la philosophie qui fait quelque
chose de nous, pour peu que nous nous engagions en elle . Le retournement
est vertigineux : nous navons pas demander la philosophie de faire
quelque chose pour nous ; il nous suffit de lautoriser instaurer les
conditions pour quelle fasse quelque chose de nous. Nous devons laisser la
philosophie faire quelque chose avec nous, cest--dire lui permettre daltrer
nos buts et nos valeurs, quitte ce quelle frappe dobsolescence la demande
dutilit que nous lui avons peut-tre adresse au dpart. La condition de ce
renversement est galement nonce : ce nest pas seulement que nous fassions
mtier de la philosophie, mais que nous nous engagions en elle, que nous
acceptions de nous mettre en jeu au fil de notre explication avec elle.
Il pourrait bien en aller de mme de la corrlation neuro-exprientielle.
Nous ne pouvons pas faire grand-chose de cette corrlation manifeste, mais
elle peut faire quelque chose de nous. Elle peut servir dambiance et de tuteur
nos mutations, donner chair agrandie nos aspirations de soin, de savoir, et
de cration. Elle peut le faire condition que nous ne nous contentions pas de
la tenir distance, la posant comme un objet dtude de plus, mais que nous
nous laissions prendre en elle, que nous permettions notre agir de se tresser
avec elle. Comment parvenir ce rsultat, concrtement ? Dans le champ
thrapeutique, cette stratgie opre par le neurofeedback
48
, ou par les
entranements mentaux visant la plasticit neuronale. Dans le domaine du
savoir, elle a un nom dj comment : neurophnomnologie. La
neurophnomnologie au sens de Varela na pas pour but de faire uvre
scientifique troite avec la corrlation neuro-exprientielle, mais de permettre
la corrlation neuro-exprientielle dexercer pleinement sa pression vers
llargissement de la dfinition mme des sciences. Si la dcision
objectivante prise la naissance de la science moderne de la nature laisse
lexprience vcue dans son angle mort, alors une science nouvelle incluant
dans son concept de nature le vcu aussi bien que le vivant doit tre fonde.
Cest seulement pour une telle science redfinie que la corrlation neuro-
exprientielle na plus tre une simple aporie, mais un thme de travail, une
forme nouvelle dans un espace pistmique redimensionn. La mthode
donnant accs ce nouveau thme dtude est au fond trs simple ; elle
consiste utiliser la corrlation pour lever les indterminations du sens vcu
de chaque configuration neuronale. Ces indterminations, quon noie
habituellement dans la catgorie vague de bruit neurologique , sont
facilement rduites par des patients confronts leur brain TV . Chaque
vnement visible sur leur propre trac neurolectrique ou neurovasculaire
acquiert presque immdiatement pour eux une signification exprientielle, qui
correspond ce quils se rappellent avoir ressenti peu de temps avant
49
.
Mais ce nest pas tout. Dans bien dautres champs que le savoir,
limmersion dans la corrlation neuro-exprientielle a un effet potentiellement
transformateur. Cest le cas, en particulier, dans certains domaines artistiques
o le chiasme neurophnomnologique peut participer dun cercle de
rtroaction potique (et potique). Pour le comprendre, partons du cas plus
large des arts performatifs
50
, qui ont beaucoup contribu rendre le processus
de rtroaction visible en incluant lactivit de lartiste dans la texture de son
uvre. Souvent, les artistes sy livrent lauto-analyse de leurs procdures de
cration, ce qui permet de saisir ltat naissant la boucle qui les unit leur
production et le mouvement par lequel leur production les transforme. Une
telle danse daction rciproque se devine par exemple dans ces phrases dune
artiste dcrivant la gense de son geste crateur : Chaque image, chaque son,
chaque pense, ou la sensation que je perois : cela sincorpore en moi,
souvent en tat de distraction, se fait partie de ma vie et se rfracte en se
manifestant comme une uvre nouvelle, comme une configuration despace-
temps rinvente [] lart est abord comme une production organique, ce
qui me permet de penser luvre comme une espce [] faisant partie du
systme organique vital
51
. Il nest pas question ici de re-prsenter ce qui se
donne, image ou son naturels, mais de le mtaboliser, de le faire entrer dans
une chane circulaire de rsonance dont luvre dart est lun des maillons. Il
nest pas question, autrement dit, de sopposer la nature, de lui faire face
pour procder une tche de mimsis, mais dassumer sa propre condition
dtre-nature et de laisser crotre luvre comme lune des formes
foisonnantes de cette nature, lartiste ayant avec elle le mme genre de rapport
que larbre avec ses feuilles ou quun phylum ancestral avec ses espces
drives. Dcider, en plus, de travailler dans lambiance de sa propre
rtroaction neurophysiologique, ce que cette artiste a galement entrepris de
faire, revient seulement dans ces conditions largir le maillage du cycle de
rsonance, redoubler lcho de la nature en nous par celui de la contrepartie
objective de notre nature. Cest l une faon particulirement limpide de
permettre la corrlation neuro-exprientielle de faire quelque chose de nous,
et travers nous, plutt que dexiger que nous fassions quelque chose avec
elle. Car ici, la corrlation perue transfigure lartiste, et sexprime en une
figure gestuelle, graphique ou textile qui devient son uvre. Lartiste nutilise
pas sa propre corrlation neuro-exprientielle, et essaie encore moins den
rendre compte, mais accepte simplement de se laisser porter et dvelopper
par elle. Apprendre vivre dans lentrelacs du neuronal et du vcu, rendre
vivant notre rapport avec lui plutt que passer en vain une vie tenter de le
dfaire en lments simples susceptibles darraisonnement au schma causal :
telle est la leon de lartiste, aprs celle du neurothrapeute et du
neurophnomnologue.
Sil y a, dans la corrlation entre phnomnes crbraux et phnomnalit
dexprience, quelque chose expliquer, ce nest pas au sens second et troit
dencapsuler, de re-ployer la corrlation en devenir dans une dmonstration
prenant la forme dune chane causale. Cest seulement au sens premier et
tymologique de d-ployer les potentialits nouvelles de percevoir et dagir
que cette occasion de rgularit nous ouvre ; un dploiement dactivits qui
fait dailleurs merger en retour une corrlation sans cesse plus troite, par le
jeu des contraintes mutuelles gnratives de la neurophnomnologie. Mais
au nom de quoi devrait-on accepter ce coup darrt port au projet banal
dexpliquer quelque chose en le faisant remonter sa cause suppose plus
fondamentale ? Pourquoi ressentirions-nous comme imprative cette mutation
de notre tre qui, lapproche du problme de lincarnation, nous invite
dposer les armes de lintelligence afin de vivre en bonne intelligence avec
lui ? Quel motif dterminant a-t-on dans ce cas de consentir tre-et-agir-
dans-le-mystre plutt que de faire face au mystre jusqu le forcer rendre
des comptes ? Nous avons montr lobstacle majeur qui empche dtendre le
schme causal au lien entre les processus neurologiques et lexprience : il est
li au caractre circulaire, tlologique et radicalement auto-rfrentiel du
genre de causalit mis en jeu ; il a aussi quelque chose voir avec le truisme
selon lequel faire face au mystre est vain quand le mystre est la face. Mais
cela ne nous suffit pas. Nous voulons comprendre, si ce nest la justification
du chiasme, au moins une justification plus avance de limpossibilit de le
justifier. Quelle est donc la principale racine intelligible de lobstacle qui
soppose son intelligibilit ?
Voici une suggestion, dj familire : si le chiasme de lapparatre et dun
certain apparaissant, de lexprience et du systme nerveux, chappe
ncessairement larraisonnement, cest quil est un fait total ; un fait priv
de lextriorit qui serait ncessaire pour le mettre en relation avec quoi que
ce soit dautre que lui. Si nous voulions dsigner lorigine de la totalit
dexprience qui enveloppe le fait de sa corrlation avec lun de ses propres
contenus (neurophysiologique ou plus gnralement organismique), il faudrait
soit sortir de lexprience, soit se contenter nouveau de mettre quelques-uns
de ses contenus en rapport mutuel. La premire option entrane un paroxysme
de contradiction performative, et la seconde option est manifestement
inadquate tant elle reste enferme dans sa partialit, bien en-de de lenjeu
holistique nonc. La raison (ou plus troitement lentendement), que nous
voudrions utiliser des fins dlucidation de la connexion neuro-
exprientielle, est de toute faon elle-mme un fait dexprience, pas une
instance trangre apte mettre des jugements dtachs son propos. La
causalit porte sur des phnomnes mutuellement distingus, pas sur la donne
pleine et entire de la phnomnalit. La raison aussi bien que son schme
causal sont tous deux si bien inclus dans cette totalit quil nest pas question
de leur demander den offrir une justification extrinsque.
Cest sans doute cela, ce caractre omni-englobant et sans dehors du
problme dune exprience noue ses corrlats corporels, que Merleau-
Ponty a voulu signifier en formulant une version cosmique du chiasme. Dans
Le Visible et lInvisible, Merleau-Ponty laisse progressivement tomber les
oripeaux de respectabilit acadmique et de bon sens analytique qui
rserveraient (comme chez Husserl) la rversibilit du percevant et du peru
au seul corps humain, distingu dentre les corps lissue de notre prhistoire
cognitive. Il renvoie dos dos toutes les manires denvisager les rapports du
percevant et du peru que peuvent imaginer les tard-venus de la cognition que
nous sommes : ni percevant dans le monde peru (ralisme) ; ni monde peru
dans le percevant
52
(idalisme) ; ni monde peru spar du percevant
(dualisme). Il ne retient rien de tout cela, mais affirme plutt, dans une aube
pr-cognitive prpare par un approfondissement de lpoch, la double
ralit dun percevant en continuit intime avec le monde, et dun monde
reconnu comme chair tendue du percevant
53
. Selon lui, le percevant est fait
de la texture perceptible des choses du monde, tandis qu linverse le monde
porte en lui une aptitude native bourgeonner en points de vue percevants afin
de se percevoir lui-mme dans un premier temps, et de se reconnatre
bourgeonnant dans un second temps. La rversibilit, la bi-facialit du
percevant et du peru est comprise comme un fait universel, une vrit
dernire sur tout ce quil y a, et non pas comme une proprit localise dun
tant particulier (ce corps-ci). Il en ressort quelques images quasi-
visionnaires (voquant irrsistiblement William Blake), dun Adam-voyant
mergeant de la glaise du visible. ceci prs que, dans ce cas, le
jaillissement du sujet incarn nest pas dcrit partir dune position ectopique
de conteur, par un rcit mythique ou par un tableau qui en reprsente leffort,
mais partir de ltoffe mme de lincarnation, sexprimant travers la voix
de lun des bourgeons du monde. Si la figure de lentrelacs dun voyant en
continuit avec le visible et dun visible sextrudant en voyant, ressemble la
reprsentation panpsychiste de la bouteille de Klein dont le sujet constitue le
monde tandis que le monde est le matriau du sujet, ce nest que
superficiellement
54
. Car ici, la bouteille de Klein allgue est vue de/dans sa
surface phnomnologique, et elle na donc aucun titre tre reprsente
comme bouteille puisquil ny a aucun lieu extrieur permettant
dapprhender son volume. Ce qui peut en dpit de cela nous guider vers sa
forme cyclique, tour tour surgissante et rentrante, est seulement une
infrence immanente sa propre tendue. Il faut, avance Merleau-Ponty, quil
y ait une complicit troite entre le voyant et le visible pour que la vision soit
possible ; il faut pour cela que le voyant et le visible ne soient que les deux
faces co-prsentes dun grand retournement du monde sur soi, le voyant se
ramassant partir dun enroulement du visible sur le visible
55
, et le
visible demeurant partout gros de la puissance de sinvaginer en un voyant.
Cest seulement cette condition de consubstantialit entre ce qui se voit et
son voir que la vision nest plus une nigme mais une vidence.
Pourtant, sous cette apparence dappel la ncessit logique trange
ncessit dailleurs, qui emprunte plus la doctrine renaissante des affinits
et des correspondances entre macrocosme et microcosme qu la pense
moderne des lois et des consquences , limage dun jaillissement du voyant
au cur du visible sappuie sur une tout autre lgitimit. La lgitimit dune
exprience presque trop lmentaire pour savouer par un discours labor,
trop indiffrencie pour tre acceptable dans un milieu professionnel qui
sefforce aux diffrenciations conceptuelles et aux prises de position
mutuelles. Mais quelle exprience, exactement ? Lisons les quelques
indications parses que laisse Merleau-Ponty son sujet : Le visible autour
de nous semble reposer en lui-mme. Cest comme si notre vision se formait
en son cur [] Ce quil y a, donc, ce ne sont pas des choses identiques
elles-mmes qui, par aprs, soffriraient au voyant, et ce nest pas un voyant,
vide dabord, qui, par aprs, souvrirait elles, mais [] des choses que
nous ne saurions rver de voir toutes nues, parce que le regard mme les
enveloppe, les habille de sa chair
56
.
La vision se forme au cur du visible. Ce nest pas l le fruit dune tude
scientifique, puisque les sciences ne disposent (par construction) daucun
instrument pour dtecter le fait-de-vision dans lpaisseur de la matire
visible, et quelles lignoreraient donc si elles ne le prsupposaient pas
toujours-dj. Cest plutt lexpression de ce que nous vivons
quotidiennement, ds que nous ouvrons les yeux et que nous consentons nous
laisser abasourdir par ce qui se prsente alors : un vaste environnement fait de
surfaces opaques ou opalescentes, qui se rapproche du regard en lenserrant
inexorablement par nos propres membres et notre propre thorax, puis qui
souvre brusquement en un cercle sans bords dabsolue transparence aux
environs de nos orbites oculaires. Comment lopacit du visible sest-elle
convertie en la limpidit du voyant ? Comment limpntrabilit de ces tissus
biologiques sest-elle laiss traverser jusqu sembler pour ainsi dire
volatilise en une certaine rgion de notre propre crne ? Il ne suffit pas, pour
en rendre compte, dinvoquer les proprits optiques de translucidit du
cristallin et de lhumeur vitre (qui, de toute manire, sarrtent la rtine).
Car la transparence dont il sagit, loin de se rduire lnonc de la prsence
dtectable des photons en de et au-del de la surface de la corne, se
manifeste par une vritable absence, dj commente : absence de tout objet
visible l o le voyant sorigine ; absence sur fond de laquelle se dtachent
les existences. Il ny a rien l o souvre la disposition voir quelque chose ;
et ce rien se promne en quelque sorte parmi les choses, absolument solidaire
de lune de ces choses quest le corps propre ; et ce rien, avant mme de se
promener et de distinguer la varit des choses, se tient immobile dans la
pulpe-de-chose, et se dcouvre comme une tonnante diaphanit dans la
masse indiffrencie, dense et tnbreuse de ce qui se prsente alentour. Cela
va de soi, et cest pourquoi il faut le faire ressortir partir de soi. Consentir
la stupfaction du banal ; cest ce que fait Merleau-Ponty comme tout vrai
philosophe, et ce qui en ressort est un constat aux antipodes de la banalit :
que le voyant est creus dans la substance entire du monde visible. Le constat
na rien dintellectuellement choquant, condition de ne pas confrer plus de
sens au mot monde que ce quautorise le motif phnomnologique de sa
dsignation : non pas un grand objet exhaustif, sphrique et dur, mais
simplement tout cela qui se montre. Lapparatre est excav au milieu de
lapparition ; ni plus, ni moins.
Poursuivons notre lecture du passage cit, dont la fin corrige les dualits
persistantes de ses premires phrases. Le voyant ne fait pas face au visible, il
ne positionne pas une alvole rceptive en attente de son remplissement par
les choses ; et les choses ne restent pas figes dans la nuit en attendant leur
piphanie par le regard. Retenir ce schma duel dun voyant pos en vis--vis
du visible, dune structure rceptrice prte accueillir len-soi des choses,
cela reviendrait accepter dentre de jeu une prsupposition trop rpandue
de la thorie de la connaissance, qui engendre tantt la navet, tantt le
scepticisme
57
. Loin de cet acadmisme, Merleau-Ponty nous invite donc
renoncer aux pr-catgorisations, laisser tre ce qui est, faire preuve dune
sensibilit exquise ce qui arrive en retardant aussi longtemps que possible
sa mise en tutelle par des distinctions usage pragmatique. Ce qui advient au
dcours dun tel renoncement est alors presque confondant de facilit. Il ny
est pas question de choses non vues, non imagines, non penses ; et il ny est
pas davantage question de vision, dimagination, de pense sans contenu de
choses ou au moins sans qualit. Au lieu de cela, les choses sont
immdiatement enveloppes de leur revtement dapparatre, elles ne se
donnent dailleurs pas autrement que comme revtement dapparatre ; et
lapparatre nest pas pour sa part un vernis pos sur quoi que ce soit dautre,
mais la chose mme, la seule chose disponible. La chose vue adhre la
vision de chose comme lenvers lendroit dun mme moment dexistence.
Et le dcollement ultrieur de cet unique moment dexistence en deux
pellicules, celle de la chose et celle de la vision de chose, est pris pour ce
quil est : le rsultat dun labeur, le produit dune exigence de distanciation,
de rgulation, duniversalisation du jugement au-del de la singularit dun
instant sensible. Une fois dposes les armes dun tel jugement pragmatique,
les lments visibles ne sont mme pas ressentis comme loigns ou
rapprochs, comme difficilement ou facilement accessibles, comme distincts
ou indistincts de moi. Ils sont l, poss arbitrairement l, fermes et
insondables, composant en leur double trame le voyant aussi bien que ce quil
voit, bouchant la perspective de la vision et louvrant simultanment linou
de leur prsence, jets avec aussi peu de pourquoi ? que la rose dAnglus
Silsius. Pour se faire une ide de cette exprience de simple densit visuelle
ininterprte et contingente sans simposer le pralable de lpoch radicale,
il suffit de simaginer soudainement confront au mobilier dune civilisation
inconnue, rpandu sans ordre dans un volume gris dnu de repres. Nayant
aucune ide de leur sens, de leur usage, de leurs dimensions, nous naurions
aucun moyen dvaluer la distance de ces meubles , ni de savoir quoi en
penser et quoi en faire. Durant la priode de stupeur passive qui suivrait
immdiatement notre premire confrontation avec eux, nous serions comme
absorbs par le choc de leur rencontre, anantis par la perte du rseau
dautomatismes et de familiarits qui nous prte une identit, dsorients et
extasis jusqu tre aspirs par ces tranges donnes, et jusqu peiner
tracer les limites qui sont censes nous en sparer. Sans doute est-ce l lun
des effets recherchs dans les arts abstraits : le dtissage des catgories, la
distorsion de lespace, le heurt brusque de la prsence, lvaporation de la
limite utilitaire entre moi et ce quil y a l.
Mais cet effet de dpaysement, de dstabilisation des discriminations
banales par l inquitante tranget (Unheimlichkeit), dpasse de loin les
bornes de la vision, jusque-l privilgie, et stend toutes les autres
modalits sensibles. Rappelons-nous par exemple ce qui se passe
lorsquclate un coup de tonnerre dans un ciel serein, un claquement trs fort,
brusque et inidentifi
58
. linstant exact de lexplosion, ce nest mme pas un
son qui est peru, cest une exprience totale qui amalgame la frayeur, le
sursaut, le serrement du cur, le refroidissement des extrmits, les toiles
en plein jour et autres brusques clats de formes visuelles
59
. Au voisinage
de cet instant de raction immdiate un vague mais violent quelque chose
arrive, rien nindique que lvnement menaant soit intrieur ou extrieur, ni
quil y ait mme un sens distinguer le dedans et le dehors, tant lintgrit de
cette limite conventionnelle est annihile par son irruption. Ce nest quau
moment daprs que les contours se recomposent, quun moi se reforme
face un monde qui na pas repris ses droits sur lui. Mon moi se recristallise
alors en constatant avec gratitude que ce qui est arriv ne la pas effac de la
surface de la Terre, ne la pas tragiquement impliqu, sest en somme pass
ailleurs. Puis cest dans un autre moment, encore plus loign, que
lvnement se trouve catgoris comme son, et que sa source est assimile au
phnomne lectrostatique de la foudre, en une double assignation qui pose un
nouvel objet face au moi peine redfini
60
. Cette exprience, si elle est suivie
dans lordre chronologique plutt que selon lordre des raisons qui en
inverserait la squence (mettant la source sonore et le moi tardivement
distingus au fondement du sursaut initial de tout ltre), conforte la critique
quadresse Merleau-Ponty au dualisme. En son instant premier, elle manifeste
une unique chair cosmo-phnomnologique, tressautante et sensible, sans
clivage intrieur-extrieur, sans opposition moi-monde, indiscerne et
indiffrencie.
Il en va encore de mme avec le toucher. Lorsque je ferme les yeux et que
je touche la surface rgulire de la table avec le plat entier de ma main, ce qui
sprouve nest pas une main sur une surface (sauf dans lanalyse ultrieure
que je peux en faire en croisant les indications visuelles et les indications
tactiles par un jugement appropri) ; cest dabord une pellicule indivise
combinant inextricablement la pression de la paume et la fracheur veloute du
bois ; cest un matriau qui minterpelle et me touche tout autant que je le
sonde et que je le palpe, un tel degr denveloppement rciproque que
seules les abstractions de la pense gomtrique sont aptes le dmler aprs
coup. On ne peut plus alors seulement dire que le percevant se love dans le
perceptible-monde, mais quils se compntrent, simbibent lun de lautre,
sont poreux lun lautre ; que leur ils , leur deux suppos jusque-l
sans discussion, montre, par contraste avec cette unit dpreuve, quil est le
fruit dun criblage ultrieur. La thse merleau-pontienne selon laquelle le
monde entier est ma chair semble partir de cet instant moins outre, moins
choquante, moins mtaphysiquement affine une doctrine panpsychiste. Car au
fond, loin dtre une thse, elle est la vrit muette qui simpose avant la
formulation de la moindre thse et aprs lextinction de toutes les thses.
Certes, un esprit normalement labor (ayant assimil les clichs dune
ducation lmentaire) dirait quil y a dun ct les choses inertes et dun
autre ct ma chair sensible et mobile, sige de plaisir et de douleur. Mais ce
qui se manifeste lors de lacte singulier de palpation que jai pris pour tmoin
est la fois beaucoup plus primitif et plus confondant que cela. Je ne sens plus
la main et la table, mais la table-contre-la-main, voire, si je mets entre
parenthses mon savoir antrieur sur la table et la main, et si je relaxe mon
travail dattention diffrentielle, un cela sensible tout uniment pressant, frais,
et lisse. Le cela sensible rsiduel sent et se sent lui-mme dans une
compntration quasi-fluide. Il est donc chair selon la dfinition de cet
hybride senti-sentant, mais il ne se limite plus comme chair de mon corps (ce
qui demanderait un retour dattention diffrentielle) : il est la chair quil y a,
il est la chair-monde pour peu quon ait dlivr le concept de monde de ses
pesanteurs ontiques et quon lait rendu la blanche simplicit panoramique
de lil y a. Cest comme chair-monde, sans distance et sans diffrence entre
les lments habituellement cribls pour composer un monde dobjets, que se
manifeste linterface sensible de la palpation. Le monde sest bel et bien fait
chair, au sens cosmo-phnomnologique o le monde est tout ce qui advient
la prsence sensible immdiate, et non au sens cosmo-ontologique de tout ce
qui est pos mdiatement comme subsistant et transcendant.
Cette conception du dernier Merleau-Ponty nen a pas moins t
vigoureusement critique pour sa dmesure universalisante. En un sens, les
prcautions peine prises sur la dfinition phnomnologiquement limite du
mot monde rpondent par avance la critique majeure contre laffirmation
de coextensivit de la chair et du monde. Mais il y a quand mme un
enseignement prcieux gagner dans ltude des arguments dorigine la fois
pratique et rationnelle qui ont t opposs la thse du Visible et
lInvisible ; un enseignement qui va nous reconduire larchi-chair du cortex
crbral et nous aider en clarifier le statut. Nous allons donc lancer un
supplment denqute, en interrogeant lun des auteurs la fois les plus
proches de la pense de Merleau-Ponty et les plus vhments contre son
amalgame tardif.
Michel Henry (comme Michel Haar avant lui
61
) nest pas tendre avec le
dernier Merleau-Ponty. Il se demande si ce grand auteur ne fut pas dupe de
son criture prestigieuse au point de remplacer lanalyse philosophique par
des systmes de mtaphores
62
, et il laccuse den revenir au ralisme naf
aprs avoir perdu de vue la leon de la phnomnologie. Pourquoi une telle
acrimonie ? Parce que, prises au premier degr, les propositions merleau-
pontiennes de coextensivit de ma chair et du monde, et de jaillissement du
voyant partir du visible, pourraient aussi bien sinterprter sur un mode
naturaliste : je suis fait de la mme matire que la nature, et ma conscience
merge du fonctionnement dun certain objet des sciences de la nature
(lorganisme humain que voici). Merleau-Ponty aurait-il trahi non seulement
les acquis, mais aussi loption existentielle de la phnomnologie ? Selon
cette lecture vigoureusement critique du Visible et lInvisible, cest bien le
cas. Tout se passe comme si Merleau-Ponty avait oubli que, aux yeux de la
ligne husserlienne dont il a repris le flambeau, les objets de la nature sont
constitus (au sein dune conscience transcendantale). Comment linstance
constituante pourrait-elle provenir secondairement de ses entits constitues ?
Croire cela ne revient-il pas, poursuit Michel Henry, tout rabattre sur la
surface de la nature constitue et retomber ainsi dans la grande ngligence
dont se rend coupable l attitude naturelle lgard de lorigine invisible
(mais reconnaissable) de toutes les objectivits au sein de lexprience ? Il
est un peu surprenant que le phnomnologue de haut vol quest Michel Henry
puisse ainsi accuser Merleau-Ponty de navoir pas assimil les premiers
rudiments de la phnomnologie. Sil se juge en droit de le faire, cest sans
doute quil y a encore, aprs un sicle, quelque chose clarifier dans le
primtre dfinitionnel de cette discipline. La mprise vient de ce que
Merleau-Ponty, dans un geste daudace difficile saisir, a tendu ce primtre
jusquaux confins du pensable. Loin dcraser sa description sur le seul plan
de la nature constitue, comme le lui reproche Michel Henry, il a au contraire
amplifi la circonscription de linstance constituante jusqu tout y englober.
Il a commenc, la suite du Husserl des Ideen II, par inclure le corps dans
larrire-plan constituant, le faisant passer du statut dobjet celui de tissu
propre. Puis il a affaibli, jusquau renoncement, la distinction entre corps
propre et corps prsents la perception, pour envelopper la totalit du
monde apparaissant dans le continuum bifacial de la chair. Le problme est
que, puisquaucun autre vocabulaire que celui du sens commun et des sciences
de la nature nest disponible pour dire la structure phnomnologique de la
chair-monde, il peut sembler un regard inattentif, ou dubitatif, que Merleau-
Ponty assigne la chair le statut de fragment ou de facette dun grand objet-
monde. La trahison de la phnomnologie serait alors avre. Mais en vrit,
loin de consentir cette rgression de la pense et de ltre-au-monde,
Merleau-Ponty fait enfin accder la phnomnologie son accomplissement
en lui faisant subir un passage la limite.
La phnomnologie nest pas un idalisme. Elle prend bras-le-corps
lexprience entire, en y incluant aussi ses pulsions dextraversion, son
ouverture une transcendance, ses pseudopodes de corps propre sans limite
spatiale absolue, sa compntration avec des regards et des intentions qui
chappent au contrle, sa connivence sensible avec ce qui se prsente pousse
jusqu labandon extatique, sa tendance se faire transparente elle-mme
au risque de lauto-alination. Par contraste, lidalisme nat dune intimation
au contrle de lexprience, sa rtractation dans la varit la plus plate et la
plus restrictive dimmanence, la mise entre parenthses du corps, lnonc
de lintersubjectivit comme problme, la sche dnonciation de lattitude
naturelle comme simple navet. Du coup, lidalisme savre vite dficient
lorsquil est confront toute lpaisseur des rapports entre le sujet du geste
et ses cibles prsentes comme corps-objets ; car il sest priv demble des
nombreux ponts dexprience qui traversent les frontires entre ces deux
genres de termes trop rigidement distingus. Or, la diffrence dun aride
idalisme, la phnomnologie ne se restreint pas un discours sur la psych,
ou sur une rgion conscience soigneusement distingue dun domaine
naturel qui lui ferait face au moins en imagination ; elle ne nie pas non plus
quarrive au jour de lexprience un donn sans cesse en excs par rapport
la capacit de mise en ordre rationnelle. Elle est dabord un exercice gradu
pour nous faire voir tout ce qui arrive comme un massif ni intrieur ni
extrieur, ni psychique ni physique, mais en instance de scission et de
discrimination objectivante. Elle nous fait voir tout cela comme exprience,
sans pour autant opposer lexprience quoi que ce soit dautre. Ds lors, les
mots pour dsigner ce qui arrive la prsence nont pas tre diffrents de
ceux de lattitude naturelle, mais doivent simplement tre allgs de la tension
extrusive que leur impose le naturalisme. Ils ne signifient pas (seulement)
quelque chose l-bas lextrieur, mais le tissu double entre de ce qui se
vit de manire plus ou moins partage, plus ou moins coordonnable
intersubjectivement. Merleau-Ponty est all jusquau bout de cette dmarche
dapaisement des oppositions, de retour au milieu fluent dune vie apte ne
plus signorer elle-mme. Cest ainsi quil a permis aux malentendus de natre
chez ceux (de loin les plus nombreux) qui ntaient pas prts le suivre
jusqu cette extrmit o la phnomnologie ne se distingue plus de son autre
que par un infime dcalage du regard, et o son vocabulaire, presque
entirement emprunt cet autre, se contente de changer discrtement de
fonction, passant du rle de dsignateur celui dauto-transformateur.
Du coup, ce sont les critiques de la thse du Visible et lInvisible qui
se montrent en retrait par rapport une phnomnologie quintessencie, et qui
font intervenir subrepticement des lments naturalisants aprs avoir flirt
avec la restriction idaliste. Reprenons le fil de largument anti-merleau-
pontien. Contre lextension au monde entier du rapport touchant-touch,
Michel Henry signale quun tel rapport est caractristique du corps propre
et ne se produit jamais ailleurs quen lui
63
. Mais comment peut-il le savoir ?
De quel droit parle-t-il de ce qui se manifeste (ou ne se manifeste pas)
ailleurs que dans le corps propre ? Tout ce quil peut dire en phnomnologue
est que la structure touchant-touch est ralise l, au prsent de lincarnation
qui est sienne, et quavant toute analyse cette incarnation se sent en continuit
avec ce qui lentoure manifestement (le monde au sens cosmo-
phnomnologique). Michel Henry poursuit alors, comme rvolt par
lamalgame : on na encore jamais vu une pierre touche par ma main se
mettre son tour toucher celle-ci, la palper, la caresser
64
.
Indubitablement, la pierre ne bouge pas. Mais est-ce bien l le problme ?
Avancer cet argument (et dailleurs avancer quelque argument que ce soit,
dans une question relevant de lexprience pure), cela revient se placer
demble dans une nature constitue, avec des corps humains et des pierres
pralablement distingus les uns des autres, qui ne se voient pas attribuer les
mmes proprits les uns que les autres (ici, les proprits dtre mobile et
sensible). En de de cette tape, cest--dire dans le domaine propre de la
phnomnologie, la dmarche serait tout autre. On devrait simplement
demander : navez-vous jamais senti une pierre chauffe par le soleil dt
en montagne, vous caresser en retour durant le passage de votre main ?
Navez-vous pas consenti la submersion par cette caresse, les yeux
ferms, jusqu oublier pierre et main et ne laisser tre que sa fascination ?
Si la rponse cette question est positive, cela suffit tablir
luniversalisation merleau-pontienne de la chair : celle-ci exprime ce qui
vient avant la discrimination entre pierres et mains, entre tres inertes et
sensibles, et qui se tient dans lexprience multiforme, rciproque, du pur
contact. Au moment du toucher, dans labandon du corps et des sens quon
peut consentir pour sy rendre pleinement sensible, la caresse se fait monde en
envahissant lexprience entire. Nous nadmettrons un monde pr-constitu,
une logique, crit Merleau-Ponty en phnomnologue consquent, que pour les
avoir vus surgir de notre exprience de ltre brut
65
. Cest cette
exprience de ltre brut, lexprience qui est ce que cela fait dtre ltre
brut, que lon doit patiemment revenir en relaxant les regards et les
catgories, en laissant tomber les illres et les faisceaux de jugements, si
lon veut viter de rejeter a priori limputation cosmique de la chair avance
par Merleau-Ponty.
Considrons un autre argument, driv cette fois de lexprience courante
des deux mains qui se touchent. Michel Henry note juste titre quen
dplaant mon attention de manire adquate, je peux sentir soit ma main
gauche touchante et ma main droite touche, soit linverse
66
. Cela suffit
mettre en vidence, estime-t-il, une stricte diffrence entre le corps propre en
tant quarrire-plan constituant, et les choses extrieures constitues (dont
lune de mes mains peut jouer le rle pour un certain temps), puis rfuter la
perte de limites et la dilution des deux fonctions dans le monde que proclame
Merleau-Ponty. Mais ce quaurait d voir Michel Henry est que la distinction
entre le moi touchant-constituant et le monde touch-constitu na t tablie
par lui qu lissue dun raisonnement portant sur une squence temporelle de
plusieurs phnomnes, et impliquant un geste volitif (celui de changer
squentiellement de foyer dattention, de la main gauche la main droite). Que
peut-on dire de ce qui se manifeste avant ce raisonnement, dans la dure
mme du sentir de palpation rciproque ? Y a-t-il dj lieu cet instant de
faire la distinction dont parle Michel Henry (sauf se rappeler le rsultat de
raisonnements antrieurs) ? Si la rponse cette question est ngative, cela
suffit donner raison Merleau-Ponty, et sa dsanalytisation de
lexprience de la chair. Or, cest bien une rponse ngative quon est
conduit au cours de lexprience des deux mains jointes, puisque, quand on
met en repos la qute attentionnelle aussi bien que le lien infrentiel de lune
de ses tapes la suivante, la seule chose qui vient la prsence est un
volume indivis de sensation unissant leffleurement la pression, oscillant
parfois de la gauche la droite, et irradiant sa texture surprenante jusquaux
avant-bras. Il ny a pas de main touchante nettement spare de la main
touche, dans ce cas, mais une sorte dhsitation prise dans la masse sensible,
un balancement tactile qui na pas encore affirm sa dcision propos de la
sparation dun sujet charnel et dun objet corporel, et la priphrie de tout
cela un grand absent qui ne se connat pas comme tel. Bien entendu, repousser
ainsi pour un temps les instruments de la rflexion, se laisser flotter dans
des expriences qui naient pas encore t travailles
67
, et ne chercher
quensuite en tirer lenseignement, reprsente aussi un effort, sans doute
aussi intense que celui des translations contrles de lattention dune main
touchante lautre. Mais ce genre deffort pour suspendre les efforts est la
prmisse indispensable de toute description phnomnologique. Demander de
lintensifier est donc tout le contraire dune forfaiture lgard de la
phnomnologie : cest lapprofondissement de son intention, et il semble bien
dans ces conditions que Merleau-Ponty, y compris et surtout dans lhyperbole
cosmique de sa dernire uvre, ait t lun des guides les plus srs vers
lhorizon de cette discipline.
Revenons-en prsent lopration analytique de Michel Henry : sparer,
en concentrant lattention, les fonctions de sujet et dobjet que remplissent tour
tour les parties du corps propre ; distinguer entre les corps inertes et les
corps vivants ; tracer des frontires et des bords au voisinage de la peau ;
attribuer le vcu dauto-affection de la chair au seul corps humain (avec des
extensions ventuelles dautres corps vivants) ; distinguer enfin ce type de
vcu immanent des vcus de transcendance typiques de lintentionnalit. Tout
ce travail combin de la raison discriminatrice et de lintuition sensible est
prcieux. Mais il doit aussi tre reconnu comme ce quil est : une forme
hybride denqute dont le matriau provient de lattitude phnomnologique et
de son projet constituant, tandis que les tracs diffrentiels sont emprunts
une certaine ontologie naturelle dobjets constitus. Cette forme dhybridation
est trs diffrente de celle que met uvre Merleau-Ponty, lorsquil a recours,
nous lavons vu, un procs de rversibilisation du langage courant afin de le
rendre apte porter la gamme entire des descriptions phnomnologiques.
Car elle superpose deux modalits bien diffrentes de la langue, faisant tantt
appel au discours pr-interprt mais historiquement surdtermin du sens
commun (en demandant par exemple au lecteur de consentir lvidence
banale quaucune pierre na jamais boug pour toucher un tre humain), tantt
aux plus profondes dcouvertes anhistoriques quon peut faire en dnudant
lapparatre de son revtement interprtatif (comme celle de la pure matire
sensible non informe, et auto-rvle, qui se fait jour dans la chair
68
). En se
dmarquant du phnomnologue des extrmes quest Merleau-Ponty, Michel
Henry inaugure donc (sans doute son corps dfendant) un usage pondr de
la phnomnologie, un usage mixte qui lui donne nouveau prise sur la nature
aprs avoir exig den neutraliser le concept pour mieux entrer en contact
avec son origine dans lexprience. Contre la dmarche expansive de
Merleau-Ponty, qui stait laiss hanter par un pur prouv progressivement
affranchi du systme de coordonnes dune nature vise intentionnellement,
lusage mixte de la phnomnologie demande den rintgrer les lignes,
demprunter les instruments de lexprimentation et du raisonnement pour
assigner des structures et des situations naturelles ce qui se vit. Une fois
lemprunt consenti, linstance constituante peut se voir localise dans la grille
de lecture de son propre systme dobjets constitus sans pour autant tre
indment confondue avec lun quelconque dentre eux. La chair trouve place
dans les corps vivants sans tre rduite un corps, la vie est dfinie comme
auto-mouvement sans tre limite au dplacement visible des organismes
animaux ou aux transformations mesurables des mtabolismes, lauto-affection
originaire est mise en correspondance avec le fait objectif des
proprioceptions sans leur tre purement et simplement identifie
69
. Un modus
vivendi devient ainsi envisageable entre la phnomnologie et les diverses
disciplines scientifiques ou hermneutiques, entre leurs vises, leurs valeurs,
leurs attitudes et leurs tats de conscience divergents. Ce modus vivendi,
notons-le, na rien dvident, puisquil semble au dpart quon ne puisse
obtenir une telle pacification que sur la base de lune des attitudes ou de lun
des tats de conscience tendant lhgmonie. Il parat ne pouvoir se faire
jour que dans le cadre dune phnomnologie hgmonique qui reconduit les
sciences de la nature leur seul statut driv de substructions
rationnelles
70
dune exprience qui ne sy rduit pas, ou bien symtriquement
dans le cadre de sciences de la nature hgmoniques revendiquant dtre
prises pour seules rvlatrices de la ralit, pour seules dtentrices de vrit,
y compris celle de lorigine de lexprience. Mais la phnomnologie hybride
vite ces deux captures opposes en alliant les attitudes, en oscillant de
manire rgle entre les tats de conscience, en articulant lune lautre la
leon de lvidence vcue et le fruit des dmarches denqute pratique puis
scientifique. Elle parvient une description du rapport entre lexprience et
ses contenus objectivs qui respecte la forme pratico-scientifique sans pour
autant stre laisse imposer sa prtention lexclusivit. Par ce rsultat, la
phnomnologie hybride ressemble comme le revers et lavers ce quon
pourrait appeler les sciences hybrides de lesprit. Les sciences hybrides de
lesprit mettent en uvre le mme genre de compromis que la phnomnologie
hybride, bien que de manire rigoureusement inverse. Elles se dveloppent
en demeurant constamment dans lhorizon de prsupposition dune exprience
consciente, en incitant simuler les consquences structurales de leurs
descriptions objectives de processus cognitifs au sein de cette exprience
consciente
71
, puis en affirmant, au nom de la conformit formelle de la
simulation vcue et des vcus ordinaires, quelles ont rendu raison de
lexprience. linstar de la phnomnologie hybride, elles allient deux
attitudes et deux tats de conscience, lextraversion avec vise dunit
objective, et lenstase de ralisation de lapparatre en de des
apparaissants ; mais elles sattardent si peu dans la seconde et lui accordent si
peu de valeur que tout se passe (pour ceux qui les pratiquent) comme si elles
taient parvenues lui offrir un vritable substitut objectif. La
neurophnomnologie repose exactement sur le mme compromis invers
quune science de lesprit hybride. La seule chose (mais elle est cruciale) qui
la distingue des versions standard de sciences hybrides de lesprit est quelle
cultive la pleine lucidit propos de lacte dhybridation de lobjectivit
avec son arrire-plan dexprience, et quau lieu de chercher minimiser ce
dernier, elle instaure une synergie, une rciprocit productive entre les deux
facettes de la transaction. La neurophnomnologie est la science de lesprit
hybride par excellence, parce quelle opre en pleine conscience de sa
dmarche de mixit mthodologique et posturale, et quelle en fait un
instrument de dveloppement plutt quune nigme rduire.
Il reste constater que le chiasme neuro-exprientiel, tel quil sprouve
durant les sessions de neurofeedback, nest aisment pensable que du point de
vue de lune des disciplines hybrides qui viennent dtre dfinies. Une
phnomnologie adhrant un vcu restrictif naurait pas grand-chose dire
de ce chiasme, si ce nest pour souligner le fait, maintes fois rappel, quil ne
se donne de bout en bout que comme exprience ; une exprience stratifie
alliant les volitions (celles qui visent intervenir sur le cerveau ou sur
lactivit mentale) et les affections passives (celles des transformations de
contenu ou de tonalit de conscience). Une neurophysiologie sarc-boutant sur
son rve oppos dobjectivit naurait pas non plus grand-chose dire du
chiasme, parce que ce rve est en droit liminativiste plutt que simplement
rductionniste, et quune altration des contenus dexprience devrait donc y
t r e retraduite en termes daltration des fonctions cognitives ou des
comportements. Au lieu dun nud liant les processus neurologiques
lexprience, ce qui serait tudi dans ce dernier cas serait le lien rciproque
entre : (1) les micro-processus neuronaux et (2) des processus
macroscopiques mergents allant des vastes assembles synchrones de
dcharges lectrochimiques dans le cortex crbral jusquaux mouvements
coordonns de lorganisme. Pour une phnomnologie purifie sur un
mode idaliste, comme pour une neurophysiologie pure (sil en existe), le
chiasme neuro-exprientiel est vou rester insaisissable, parce quil
dborde dun ct ou de lautre leur primtre restreint de pratiques
exploratoires. La phnomnologie idalisante saccroche lattitude
rflexive, et ne peut donc envisager lobjet neuronal que sous langle de son
nome, de son processus de constitution ou de la vise intentionnelle qui le
prend pour cible. La neurophysiologie pure , linverse, ne peut tenir
lexprience consciente que pour un arrire-plan invisible, ou pour quelque
rsidu verbal dun tat de la connaissance archaque dont les projets
dobjectivation et de saisie manipulatoire seraient rests inaccomplis. Mais,
vis--vis dune phnomnologie hybride ou dune science de lesprit hybride,
il en va autrement. La connexion agie entre configurations neurologiques et
configurations dexprience est une thmatique abordable par ces disciplines,
comme elle lest dune autre manire par une phnomnologie universalisante
de type merleau-pontien, parce quelle se prte sans reste la gamme largie
des pratiques de recherche qui leur sont accessibles. Le va-et-vient entre la
posture rflexive et la posture intentionnelle, entre la qute des essences
vcues et celle des lois objectives, fait partie des procds auxquels elles
peuvent avoir recours (bien quavec des priorits opposes selon quon a
affaire une phnomnologie hybride ou une science de lesprit hybride).
Lentrelacs neuro-exprientiel peut tre tudi fond par ces disciplines, sous
ses deux faces, et la seule diffrence portera sur le statut quelles lui
assignent.
Selon une phnomnologie hybride, le phnomne de chiasme qui se
manifeste au cours du neurofeedback na pas le sens dune mise en vidence
de lorigine objective de lexprience, y compris de celle qui se donne
explicitement comme auto-apprhension dune chair ; il a plutt le sens dun
reprage restrictif de la chair-quil-y-a existentiellement universelle, dans le
rseau des objets particuliers qui soffrent une activit manipulatrice et
discriminante. De mme quun jeune enfant apprend progressivement
reconduire la douleur ou le plaisir indiscrimins de ses premiers jours,
exprims par des pleurs ou des soupirs, des parties prcises de son corps
quil pourra alors dsigner son pdiatre ou sa mre (jai mal l, je prends
plaisir cela), le praticien de la phnomnologie hybride se donne pour but
dapprendre assigner une place aux diverses modalits expressives de la
chair constituante dans le systme de coordonnes de son environnement
dobjets constitus, afin dentrer en dialogue avec la sagesse commune et avec
les sciences. Dans les deux cas, on passe du pur exister au dsir de faire
reconnatre intersubjectivement la teneur de cet exister ; ou plus exactement,
on intgre dans lexister sa composante dtre-pour-autrui, qui sexprime en
effort de traduction des vcus dans un langage-dobjets aisment partageable.
Or, ce langage dobjets est un langage de corps tendus et de lieux indiqus,
ce qui a pour consquence que la mise en commun des pripties de lexister
se confond avec un programme de projections localisatrices.
Par un procd typiquement hybride de connexion entre les classes
dexpriences et le reprage spatial, la peau tait dj reconnue comme le
sige tendu de la modalit des sensations tactiles, les yeux comme le sige de
la modalit visuelle, la main comme le sige de la modalit haptique
compose de contact fin et de capacit de pression, etc. Une projection locale
de ltre-charnel tait dj assigne chacun de ces organes, travers la
rversibilit (touchant-touch, pressant-press, ou voyant-senti) quon y
mettait en vidence par une tude mixte des mouvements volontaires, des
squences sensibles, et de leurs localisations. Le neurofeedback et les
recherches antrieures portant sur leffet prouv des lsions crbrales nont
fait que prolonger ce mouvement de reprage en prcisant ltude
localisatrice. Leur surcrot de prcision consiste dabord projeter nouveau
les modalits sensori-motrices particulires, mais cette fois sur un carrefour
qui les joint toutes, une sorte de ralisation organique du sens des sens, ou
sensorium commune dAristote : lencphale avec ses diverses aires
fonctionnelles anatomo-physiologiques. Il consiste ensuite y projeter
galement les modalits les plus unifies de lexistence charnelle que sont la
capacit trouver ses mots, la perception densemble des formes, la qualit
affective globale des actes de conscience, les degrs de rflexion de
lexprience, ou les ventuelles distorsions du champ de lprouv. Ce
rsultat est obtenu au moyen dun procd raffin de corrlation entre le
reprage spatio-temporel des activits lectro-mtaboliques des neurones et
les expriences dcrites, usant dinterventions instrumentales slectives et de
stabilisations conjointes des tats exprientiels. Mais, et cest en cela que la
phnomnologie hybride reste une branche de la phnomnologie, ce stade
comme aux prcdents il nest toujours pas question de confondre une certaine
projection spatiale de la chair avec la mise en vidence du fondement de
lexprience dtre-incarn dans lespace des corps. Parce que dune part,
nous lavons vu, le lien est mutuel : lexprience sest certes reconnue
tributaire de certains lieux corporels, mais lacte de localisation, dauto-
projection en un lieu, est rciproquement tributaire dune exprience
localisatrice et projective. Parce que, dautre part, les projections autorises
(par le biais de la dtection ou de la stimulation dun corrlat objectiv de tel
acte de conscience) ne sont pas uniques mais distribuables sur la longueur
entire de larc sensori-moteur voire au-del, ce qui ne permet pas daffirmer
que lun quelconque de ces lieux est une condition suffisante de lexprience
considre. Une exprience particulire dapprhension de la couleur peut
ainsi tre projete spatialement sur la surface visible dun corps color, sur
les composantes spectrales de la lumire quil rmet, sur les cnes rtiniens,
sur les blobs de laire primaire visuelle V1 du cortex occipital, sur les
aires secondaires V4-V8, sur les aires associatives fronto-paritales, ou
mme sur les aires motrices qui contribuent la modulation de la
reconnaissance des surfaces colores
72
. Conformment ce quavance la
thorie nactive de la perception, le cycle entier allant des choses et de la
rception sensible la raction motrice module lexprience de couleur. Ce
genre de cognition tendue
73
, cette ubiquit des corrlats dune exprience
incarne dans le monde, est une remarquable transcription objective du fait
phnomnologique sans frontires de la chair-monde, et de limpossibilit de
la contenir dans le carcan troit des localisations et des causalits linaires.
La dmarche dune science de lesprit hybride est trs voisine de celle-ci,
si lon excepte sa finalit. La finalit dune phnomnologie peut tre
caractrise comme culture de la prsence, comme dploiement de
lexprience en acte selon toutes ses dimensions, y compris celle de sa
projection sur le maillage de coordonnes de son propre espace. Au contraire,
la finalit dune science est tendue vers un futur que lon souhaite plus
matris, y compris dans son rapport avec lexprience mme que prsuppose
(sans y prter attention) lactivit de recherche. Lorsquune science de lesprit
hybride prtend comprendre le corrlat, voire la base neurologique de
certaines modalits de lexprience consciente, elle se sert du mme genre de
procd dassociation entre les moments dexprience et leur localisation
active dans un rfrentiel multidimensionnel incluant lespace, le temps et les
paramtres physiologiques contrls que celui dune phnomnologie hybride.
Mais, contrairement une phnomnologie hybride, une science de lesprit
hybride tend limiter son strict minimum le champ dexpression de
lexprience (jusqu se contenter de rponses par oui ou par non des
questions troitement circonscrites), dans le but de le rendre
reproductible ; et elle dveloppe en revanche au maximum la finesse des
techniques dans lespace de ses interventions possibles, entretenant ainsi un
dsquilibre voulu entre ses deux voies daccs. Cest exactement ce
dsquilibre mthodologique qua dnonc Francisco Varela ; cest lui qui la
pouss crer la neurophnomnologie, dont le statut apparat ainsi
intermdiaire entre une science de lesprit et une phnomnologie hybrides.
Hors de lexception neurophnomnologique, le choix dlibr dun parti pris
en faveur des mthodes dintervention localises et objectives confirme
indirectement mais sans ambigut que le but des sciences de lesprit hybrides
est quasiment aux antipodes de celui dune phnomnologie hybride. Si la
phnomnologie dans sa varit hybride sassigne pour tche dassurer
lintersubjectivation des diverses modalits dune exprience vcue, les
sciences de lesprit favorisent la demande de reconnaissance intersubjective
au point de minimiser ou de rendre quasiment invisible lexprience
subjective quil sagirait galement de reconnatre. Par ailleurs, si la
phnomnologie hybride revient cycliquement lacte rflexif afin dtablir la
meilleure cartographie possible de ce qui se prsente l comme exprience, la
science de lesprit hybride cherche aller de lavant dans son exploration,
afin de gagner en efficacit dans les futurs contrles diagnostiques et
thrapeutiques (mais aussi, il ne faut pas loublier, commerciaux et politiques)
des processus et des tats mentaux, quitte ngliger le retour en arrire
quimpose la rflexivit.
Mais peut-tre sagit-il l encore dune fausse symtrie, dune rpartition
des tches trop artificiellement quilibre. La tension entre les deux
disciplines hybrides est en vrit plus accuse que ce qui ressort de lanalyse
prcdente, et leur dissymtrie massive. Car, si les sciences de lesprit
peuvent se prvaloir dune efficacit laquelle ne prtend pas la
phnomnologie, la phnomnologie est linverse en droit de demander aux
sciences de lesprit au nom de quelles valeurs elles dfinissent leurs propres
objectifs de contrle et de manipulation, ou au nom de quelles valeurs elles
permettent que certaines instances sociales les dfinissent leur place. La
question de la phnomnologie hybride, dj travaille au titre de lauto-
rfrentialit, serait peu prs celle-ci : Quelle est limpulsion vcue qui
vous pousse minimiser limportance de lexprience vcue ou chapper
sa prgnance par une fuite en avant ? Quelle est la motivation dont vous
participez avec votre culture, qui vous fait collectivement trouver juste et
souhaitable le contrle extrinsque de lexprience consciente ? Par le biais
de linterrogation sur les finalits et les valeurs, le dbat est ainsi reconduit
bon gr mal gr lorigine prouve de tous les choix, y compris ceux qui
tendent marginaliser lpreuve de lexprience et se prcipiter vers les
accomplissements tangibles de la volont de puissance. En amont des
dcisions de recherche et daction viennent au jour leur prcondition dans le
chercheur et lacteur. Se retournant sur le motif de llan hors de soi, on se
retrouve cherchant-agissant et se demandant pourquoi tant de prcipitation.
Une telle dissymtrie de posture, et surtout de proximit vis--vis de la source
dexistence, exige un jugement lui-mme dissymtrique propos du statut du
chiasme neuro-exprientiel. Pour le chercheur en sciences de lesprit, le lien
entre neurophysiologie et contenus dexprience est avant tout loccasion
dune intervention possible, dun geste daltration des uns par la
manipulation de lautre. Au nom de la priorit quil accorde lefficacit de
ses oprations instrumentales, il lui semble ds lors naturel de trancher le
cercle de dpendance rciproque qui unit les tats neurologiques et les tats
mentaux, de nen retenir que la direction qui va des premiers aux seconds, et
de penser ce rapport unidirectionnel artificiellement isol par le biais de la
catgorie de causalit. Pour sa part, le phnomnologue hybride (ou le
neurophnomnologue) nhsite pas nourrir lenqute quil mne sur la
projection spatiale des moments dexprience par les rsultats de ces sciences
de lesprit. Mais sa mthode lui vite de se laisser captiver par les seules
promesses pratiques de ce genre de rsultats ; elle lincite au contraire
largir son champ de vision et reprendre contact, en de des procdures et
des aboutissements performatifs, avec le continuum dtre-au-monde qui les
motive et les prconditionne ; elle nest donc pas simplement oppose la
dmarche de la recherche en sciences cognitives, mais plus vaste quelle,
tant galement apte accommoder le regard cette rgion intime de
lprouv sensible, intellectuel et axiologique qui est la fois son assise et
son horizon rv. Sans cesse capable de raliser lexprience comme lenvers
unique et omniprsent de chaque dcision dintervenir, de chaque projet de
recherche, de chaque plan de transformation des choses et des activits
mentales, cest cette exprience et elle seule que le phnomnologue
hybride est port demander le sens dtre de tout ce quil constate, y
compris la dpendance rciproque des phnomnes neurophysiologiques et du
fait de la phnomnalit. Pour lui, comme pour Merleau-Ponty avant lui, le
chiasme neuro-exprientiel ne peut ds lors avoir quune seule signification,
une signification immdiatement donne dans sa manifestation plutt que
mdiatement infre partir de son utilisation : celui dune divulgation
ponctuelle de la structure entire de ce qui se prsente, dune rvlation
locale de la bivalence constitutive du monde-l en sensible et en senti, en
agissant et en ptissant, en impulsion de saisir et en rsistance la saisie.
Constatant que lattitude labore, construite, absorbe par ses vises, du
chercheur scientifique lui fait perdre de vue son adossement vcu sans lui
permettre den rendre raison en retour, le phnomnologue volu de lge
des sciences cognitives propose daborder le chiasme neuro-exprientiel dans
un tat desprit redevenu innocent, dconstruit, dsabsorb. Cest seulement
ainsi quil lui devient possible de ne plus voir la bivalence du visible et du
voyant comme problme, mais comme milieu habiter, comme labyrinthe
explorer, comme topographie ostensible du monde, comme ultime merveille.
Face la probable objection ritre quil sagit l dun renoncement, que
lmerveillement ne traduit quun aveu dignorance primitive, que la
modernit scientifique sy est oppose de toutes ses forces en adoptant comme
slogan fondateur le ce nest pas merveille
74
cartsien, la rponse va de
soi. Elle consiste mditer sur la juste manire de rpartir les choses quil y
a en thmes dtude et en simples merveilles, aprs avoir compris quaucun
projet de rpartition ne peut prtendre tout envelopper dans la catgorie des
thmes dtude. Car, de nos jours, la candeur que suppose la reconnaissance
de la merveille dun voyant-percevant coextensif son site vu-peru est tout
sauf premire. Elle demande tre cultive, autant que son contraire ; elle
relve dune laboration de second ordre par rapport la dfinition de
simples thmes dtude ; elle nest consentie qu lissue dun examen
quitable des succs sans prcdent des sciences cognitives et de leur chec
permanent, cach en leur centre informul. La merveille gt lextrmit,
comme au commencement, de lenqute sur et dans la conscience. Et sa
marque la plus sre dinsurmontabilit est dtre identique lmerveill.
QUESTION 13
Lintrospection est-elle possible
1
?
Lintrospection, peut-on dire, est la base de la
psychologie ; elle caractrise la psychologie dune
manire si prcise que toute tude qui se fait par
lintrospection mrite de sappeler psychologique, et que
toute tude qui se fait par une autre mthode relve dune
autre science.
A. Binet
Dire lexprience consciente, cette totiprsence, contrevient au procd
mme de la langue qui fragmente et oppose. Mais la contradiction disparat
sil sagit de dire des contenus partiels ou des structures limites de la
conscience. Y a-t-il donc un procd dauto-rvlation de ces lments, et une
modalit du langage qui permette de les dcrire ? Lintrospection a-t-elle une
chance de devenir une mthode acceptable au sein des sciences cognitives ?
Ces questions, encore trop gnrales, peuvent tre reformules selon au moins
trois cadres conceptuels : celui de la philosophie de la psychologie
wittgensteinienne, celui de la phnomnologie husserlienne, et celui de la
thorie des bauches conscientes multiples.
En termes wittgensteiniens, on se demande sil existe un procd
dlaboration et de transmission dun vocabulaire ayant pour rle dexprimer
des contenus ou des formes de conscience de manire collectivement
identifiable. Ce vocabulaire ne contrevient pas a priori lnonc
dimpossibilit dun langage priv, puisquil nest pas cens dnoter des
vnements intrieurs singuliers lusage exclusif de celui qui les vit,
mais rendre reconnaissables des classes dtats de conscience des locuteurs
se comportant sous la supposition quils les ont en partage.
En termes husserliens, on senquiert dune espce de description
intermdiaire entre celle des vcus isols et celle des essences de vcus.
Une description la fois empirique et intersubjectivement changeable,
prenant appui sur le pralable mthodologique dune forme de rflexivit,
mais ne faisant usage ni de la rduction transcendantale ni du procd de la
variation eidtique. Une description sintressant aux objets gnriques
constitus partir de lauto-examen psychologique, et non pas leur pur mode
de donation qui est le thme propre de la phnomnologie
2
.
Dans le cadre de la thorie des bauches de conscience multiples, on
sinterroge sur deux points :
1. Peut-on remonter dune description neutre des faits de la squence auto-
biographique principale, vers un mode dexpression prcisment focalis
sur le Je qui lassume ? Peut-on suspendre ou retarder lacte de
dtachement caractristique des attitudes propositionnelles (marqu par la
conjonction de subordination que ), pour faire ressortir le Je
parlant comme le lieu et le thme de ce dont il parle ? Afin de saisir
concrtement ce dont il est question ici, considrons un exemple de retard
du dtachement. Dans la phrase Je suis convaincu que Fabienne est
rcemment tombe amoureuse de quelquun dautre, et quelle nose pas
me le dire , le segment de proposition objective qui suit la conjonction
que prdomine, tandis que seule la proposition je suis convaincu
exprime ltat mental du locuteur ; tel point que la mention de la
conviction est souvent omise au profit de la proposition purement
objective : Fabienne est rcemment tombe amoureuse de quelquun
dautre, et elle nose pas me le dire . Cet quilibre sinverse cependant
dans la phrase suivante : Je ressens en prsence de Fabienne une
impression de confiance rayonnante, dpanouissement, de doux abandon,
et en mme temps je perois une forme de distance, je discerne un certain
vague de son regard dirig vers les lointains, qui me fait comprendre que
son attitude daccueil nest pas dirige vers moi. Ici, la conjonction
que est repousse vers la fin du discours, et tout ce qui prcde,
organis autour des verbes ressentir , percevoir , discerner et
comprendre , se rapporte ce que vit le sujet. Cette temporisation dans
la cristallisation dobjet pourrait-elle mnager un espace dans lequel
dployer lactivit de description introspective ?
2. Peut-on raccorder la squence biographique principale certains vcus
latraux, disperss, et jusque-l non rflchis comme miens ? Une
attention entirement focalise sur lobjet dexprience repousse quantit
de contenus secondaires de cette mme exprience dans sa priphrie ;
de telle sorte que ces contenus demeurent irrflchis et ne sont pas
intgrs au rcit de ce que jai vcu. Au contraire, le redploiement de
lattention vers les attitudes qui prconditionnent la vise dobjet (vers
tout ce qui vient avant que ) pourrait permettre dextraire de leur
priphrie bien des contenus traits comme annexes, et de les remettre au
centre dans une rcriture enrichie de lautobiographie. Lintrospection
devient-elle donc possible condition daccomplir (a) sur le moment un
dploiement du champ de lattention, et (b) aprs coup une reprise en
charge par moi-mme de fragments de vcus passivement mmoriss mais
jusque-l absents de lauto-narration ?
Ces dclinaisons multiples de la mme question sont loin dtre
indiffrentes. En effet, le scepticisme rpandu au sujet de la possibilit, du
bien-fond ou de la fiabilit de lintrospection traduit probablement une
dficience dans la dtermination de ce quelle est, ainsi que de ce quon est
en droit den attendre. Travailler dfinir lintrospection, lenvisager partir
de points de vue mthodologiques et thoriques varis devrait dans ces
conditions permettre de lever son indtermination, et contribuer lui rendre
une certaine crdibilit.
Mais pour prparer le terrain cette qute de dfinition, il faut faire un
rapide bilan axiologique. Comment lintrospection est-elle value, aprs des
sicles de rflexivit philosophique et plusieurs dcennies de dbats en
psychologie et en sciences cognitives ? On est un peu surpris de constater qu
propos de la fiabilit de la connaissance en premire personne, deux positions
diamtralement opposes se sont fait jour et continuent de coexister
3
, parfois
chez le mme auteur.
La premire position consiste prter une sorte dinfaillibilit celui qui
parle de sa propre exprience, parce quil est suppos y avoir un accs direct.
Elle extrapole partir des conversions rflexives de plusieurs philosophes
majeurs, parmi lesquels Descartes, Locke
4
, Hume
5
, Husserl, et Ayer
6
, qui
cherchaient une fondation absolue de la connaissance en remontant sa source
vcue. Selon le Husserl de la deuxime Mditation cartsienne, par exemple,
la certitude apodictique atteinte par la rduction transcendantale concerne non
seulement la simple et nue identit du je suis , mais aussi de riches
structures universelles de lexprience que la phnomnologie a pour mission
de mettre au jour
7
. Certains philosophes de lesprit contemporains,
dobdience rductionniste ou fonctionnaliste, dfendent galement cette
position partiellement infaillibiliste
8
, bien quavec des sous-entendus
ngatifs : selon eux, certains jugements sur sa propre exprience sont
trivialement vrais, soit parce quils sont auto-ralisateurs
9
, soit parce quils
sont immdiatement expressifs ( lgal dun cri de douleur) plutt que
descriptifs
10
, soit encore parce quil ny a de toute faon aucun moyen de les
mettre en doute
11
.
La seconde position, apparemment antinomique, consiste dresser une
liste impressionnante de difficults de principe contre toute prtention
connatre base sur lintrospection. Les auteurs les plus mfiants vis--vis de
ce genre de connaissance la mettent globalement au dfi de se justifier, en
signalant que les jugements dintrospection sont des infrences contestables
plutt que des informations directement issues dune forme dobservation
12
,
quils ne nous procurent pas un meilleur accs nos propres processus
mentaux qu ceux dautrui, quils sont partiaux et incomplets en raison du
caractre prsum inconscient de limmense majorit des processus
mentaux
13
, quils demeurent incapables de rvler les vritables motivations
de nos actes, voire quils sont systmatiquement trompeurs parce
quindiscernables daffabulations rtrospectives
14
ou parce que soumis
linfluence de prjugs personnels ou culturels
15
. On signale de surcrot qu
supposer que lintrospection ne vise pas formuler des jugements, mais
seulement adhrer de manire plus intense lexprience vcue, elle ne
saurait sous cette hypothse constituer un corpus de connaissances
16
:
connatre exige en effet de prendre du recul par rapport au champ
dinvestigation, et non pas de simmerger batement en lui. Husserl lui-mme
na pas t en reste dans cette critique, puisquil signale, toujours dans les
Mditations cartsiennes, que le champ de la certitude apodictique ne couvre
pas les donnes singulires de lexprience, et quil faut donc garder une
attitude dfiante face aux prtentions la validit de certains moments de la
connaissance rflexive
17
. Un tel rquisitoire, parfois sans appel, a affermi la
croyance selon laquelle la disparition de la psychologie introspective durant
le premier quart du XX
e
sicle
18
est due des raisons de fond qui la
condamnent jamais. La monte des sciences cognitives et des approches
neuroscientifiques de la cognition a achev, selon les auteurs qui entretiennent
cette croyance, denterrer lintrospection comme une mthode dcidment
dpasse pour explorer les oprations mentales. Pourtant, une tude plus fine
du dveloppement de la psychologie montre que lintrospection na jamais t
vraiment abandonne
19
, tantt comme source primaire dinformation, tantt
comme guide vers des hypothses explicatives dordre comportemental ou
neurologique ; que plusieurs critiques de principe qui lui ont t adresses
sont surmontables sur un plan thorique ou pratique
20
; et quelle connat une
sorte de renaissance lheure actuelle, sous diffrentes formes et
dnominations
21
. Loin dtre rendue caduque par les progrs des
neurosciences, lintrospection est de plus en plus souvent perue comme un
partenaire part entire de ces progrs
22
; le partenaire sans lequel les faits
neurologiques ne pourraient de toute faon se voir assigner aucun sens de
corrlats dvnements mentaux
23
.
La vigueur du nouveau courant dtudes introspectives incite ne pas
accepter les critiques traditionnelles sans les discuter fond et sans en avoir
fait autant de thmes de rflexion. Est-il par exemple exact que tout rapport
dintrospection repose sur une infrence indirecte, qui incline linvention ?
Ne peut-on pas instaurer des conditions dtude introspective o toute
tentation daffabulation est soit carte, soit reconnaissable comme telle ? Est-
il vrai que la majorit des processus mentaux est faite dvnements
inconscients ? Ne doit-on pas plutt considrer, conformment la thorie
des bauches conscientes multiples, que de nombreux processus mentaux
chappant lattention ego-centre se trouvent momentanment exclus de la
trame mmorielle principale, mais quils sont disponibles pour une
redcouverte et pour une reconnexion cette trame lorsque certaines
conditions se trouvent remplies ? Loscillation dcrite entre linfaillibilit et
la faillite systmatique nest-elle pas vitable, pour peu quun statut alternatif
soit assign au matriau dintrospection ? Les deux statuts habituellement
reconnus lintrospection, tantt ladhsion muette ce qui est actuellement
vcu, tantt le jugement, la croyance et la rationalisation propos de
processus cognitifs passs, sont-ils bien les seuls disponibles ?
Notons tout de suite propos de la dernire question quun statut
intermdiaire de lintrospection va tre mis en avant dans ce chapitre. Il tire
lenseignement dune mthode consistant sonder de faon rpte des
moments actuellement revcus, rhabits, ou, plus exactement, reparcourus de
sa propre exprience passe, les verbaliser un niveau de conceptualisation
minimal, et dlguer la tche de catgorisation rtrospective quelquun
dautre
24
. Le jugement est ainsi diffr, vitant lartifice dune reconstruction
rationnelle, tandis que ladhsion est restreinte la fraction rejoue de
lexprience, laissant un espace suffisant pour dcrire cette dernire dans le
cadre plus vaste de lexprience prsente intgrale. Ce double cart par
rapport lalternative courante entre tre et connatre, entre le simple
accompagnement de ce qui est vcu et le jugement sur quelque chose
dentirement spar du sujet jugeant exige cependant une rvaluation des
standards pistmologiques. Il est ncessaire dabandonner ici les demandes
classiques de complet dtachement dun objet et dadquation
reprsentationnelle ce quil est, sans perdre entirement le bnfice
dobjectiver au sens plus faible, et donc plus gnral, de chercher des
structures intersubjectivement reproductibles. Il est en somme indispensable,
propos de lintrospection, de remplacer la traditionnelle thorie
correspondantiste de la vrit par des critres de validit plus englobants,
plus immanents et plus flexibles, comme le critre de cohrence
performative qui sera prcis plus bas.
Ltude historico-critique va en attendant tre approfondie, dans le but de
localiser au fil du parcours les modifications exactes quil faut apporter au
projet de connaissance introspective pour viter son chec. Celle-ci passe par
une apprciation dtaille de la liste impressionnante, et sans cesse
reformule, dobjections de principe contre laquelle lintrospectionnisme a
but dans le pass. Il est vrai que ces objections nauraient pas suffi elles
seules pour anantir le projet mme de la psychologie introspective, puisque
les succs pratiques des sciences suffisent habituellement court-circuiter les
critiques purement philosophiques. Mais elles ont contribu la mauvaise
rputation de lintrospection, partir du moment o ses problmes
mthodologiques, et le dfaut de consensus propos de ses rsultats, sont
devenus clatants. Quelles sont donc les principales objections, et quel genre
de rponse la nouvelle introspection peut-elle leur apporter
25
? Quels traits
pistmologiques lacunaires ou mal compris de la psychologie introspective
du tournant des XIX
e
et XX
e
sicles expliquent-ils sa vulnrabilit la critique,
et quest-ce qui permet la vague actuelle dtudes introspectives de passer
outre ces difficults ?
Lobjection la plus archtypale est quil est impossible dobserver sa
propre exprience, parce que cela suppose une scission entre le sujet et
lobjet, tandis que lobjet de lintrospection nest rien dautre que le sujet lui-
mme. Une esquisse encore incomplte de cette objection a t formule par
Platon dans le Charmide, afin de mettre en pril une conception courante de la
sagesse comme connaissance de soi : Essaie dimaginer une vue qui [] ne
voit aucune couleur, bien qutant une vue, et ne peroit quelle-mme et les
autres vues : est-ce possible ? Assurment non
26
! Selon ce dialogue, qui
compte parmi les plus proches de la position socratique, il ny a rien de tel
que lauto-vision, lauto-audition, et par extension lauto-connaissance. Mais
la raison pour laquelle il doit en aller ainsi reste encore dans lombre. On doit
Auguste Comte davoir tabli une justification classique, sans cesse rpte
depuis, de la proclamation dimpossibilit dune auto-connaissance : Il lui
est videmment impossible de sobserver dans ses propres actes intellectuels,
car lorgane observ et lorgane observant tant, dans ce cas, identiques, par
qui serait faite lobservation ? [] Il faudrait, pour que la prtendue
observation intrieure de lintelligence ft possible, que lindividu pt se
partager en deux, dont lun penserait et lautre, dans ce temps, regarderait
penser
27
. Ici, lauto-connaissance nest pas possible pour le simple motif
que le connaissant devrait y accomplir limpossible, savoir sarracher lui-
mme pour se faire son propre objet connu. Un cho de largument se lit
encore chez William James, qui lui a donn une forme appelant une rponse en
termes de scission chronologique du sujet et de lobjet introspectif, sous
forme dun retard de lun par rapport lautre : La tentative danalyse
introspective [] quivaut en fait saisir une toupie pour attraper son
mouvement, ou essayer dteindre le bec de gaz assez vite pour voir quoi
ressemble lobscurit
28
. Admettons donc, titre de concession provisoire
ces objections, quune scission du sujet et de lobjet soit indispensable pour
lintrospection, et que sa traduction temporelle soit un dlai entre la formation
de lobjet intrieur et sa saisie par le sujet de la rflexion. Un nouvel
obstacle, sans cesse rpt au cours de lhistoire de la philosophie, se dresse
alors face lintrospection, sous la forme dune menace de rgression
linfini. Cest sans doute le personnage leibnizien de Thophile qui en offre
lexpression la plus saisissante. Ayant commenc par admettre que les
ides naissant en notre me peuvent tre prises comme objets de la
pense, il se trouve amen prendre le contre-pied de la croyance cartsienne
en labsolue transparence de soi soi. Car, note-t-il, il nest pas possible
que nous rflchissions toujours expressment sur toutes nos penses ;
autrement, lesprit ferait toujours rflexion sur chaque rflexion linfini
29
.
Cette objection infinitiste a t reformule un sicle plus tard sous une forme
canonique par le philosophe danois Harald Hffding
30
la suite de
Kierkegaard. Lorsquun sujet prend pour objet une version lgrement
antrieure de lui-mme, il doit attendre dtre devenu un sujet ultrieur pour
sauto-lucider, et ainsi de suite sans limite assignable ; par ailleurs, la
scission auto-objectivante laissant toujours une fraction du sujet de ct, il est
ncessaire de tracer une pluralit de lignes de partage entre le versant
connaissant et le versant connu du sujet si lon veut en puiser la
connaissance. Largument de Hffding a resservi durant la priode de
profonde remise en question de lintrospection qui a suivi loffensive
behavioriste des premires dcennies du XX
e
sicle, pour assner ce qui tait
alors peru comme le coup de grce contre cette mthode : Supposons quun
introspectionniste particulirement tenace dsire introspecter le rapport
mme, ou bien la srie secondaire, ne devrait-il pas supposer une troisime
srie, et ainsi de suite linfini
31
? Mais cet argument a galement connu un
destin analogique remarquable chez Niels Bohr
32
, qui, cherchant surmonter
certains paradoxes apparents de la mcanique quantique (comme la dualit
onde-corpuscule), sest souvenu de la leon de son professeur de philosophie
danois. De mme que la sparation jamais inacheve du sujet et de lobjet
de lintrospection incite multiplier les lignes de partage pour en parfaire
lexploration, la sparation galement inacheve entre lobjet microscopique
et ses instruments de mesure impose davoir recours des approches
complmentaires , mutuellement exclusives et conjointement exhaustives,
afin den obtenir une connaissance optimale.
La suggestion implicite qui se donne entendre lissue de cette
discussion, particulirement dans les formulations de William James, est
quon peut tout au plus pratiquer la rtrospection, et non pas une introspection
synchrone. Au moins la rtrospection permet-elle premire vue de sparer le
sujet tudi (pass) du sujet tudiant (prsent) ; elle fige la situation que le
sujet tudiant se donne explorer ; et elle dlimite conventionnellement le
champ de ltude, en bloquant sa tendance inclure des moments de plus en
plus proches du prsent. Cette proposition a t retenue, nous le verrons, par
les nouvelles approches introspectives. On ne doit cependant pas se satisfaire
trop vite dune telle rponse facile la classe dobjections expose, car il faut
dabord se demander si cette dernire est simplement pertinente. Aprs tout,
la critique traditionnelle de lauto-scission, complte par celle de la
rgression linfini, natteint que lintrospection conue selon un prjug
rpandu, et non pas lintrospection telle quelle se pratique en fait. Le prjug
est que le sujet (ou une partie de lui-mme) sengage dans une observation de
second ordre des processus mentaux de premier ordre. Mais plusieurs
rsultats en provenance des sciences cognitives battent en brche cette faon
de comprendre lintrospection, en suggrant quelle pourrait bien nimpliquer
rien dautre quune version modifie des processus mentaux de premier ordre
sur lesquels elle est cense porter
33
. Lide dualiste dauto-observation doit
alors tre remplace par celle, immanentiste, d attention non
observationnelle
34
.
Cela nous introduit la question dlicate de la dfinition de
lintrospection, dont le seul nom porte la marque du reprsentationnalisme.
Quest-ce donc que lintrospection, et que doit-elle tre ? Sommes-nous vous
accepter une image dualiste des univers intrieur et extrieur, qui justifierait
pleinement quon utilise le terme intro-spection (intro-specere en latin,
regarder-dedans) propos dun certain acte mental de mta-connaissance, ou
de rflexion ? Une telle obligation nexiste pas en principe, et il nest
mme pas vident que limage dualiste ait t pleinement accepte en fait.
Aprs tout, peu de philosophes du tournant du sicle la prenaient au srieux, et
ce sont eux qui dterminaient une part notable du fond culturel de la premire
vague introspectionniste. Ce quil va alors falloir expliquer, cest pourquoi
les psychologues de cette poque demeuraient parfois en retrait de leur
environnement et de leur formation philosophique.
Passons rapidement sur le monisme neutre de Mach, sur lempirisme
radical de James, et mme sur la phnomnologie husserlienne, qui substitue
lopposition spatiale entre observation interne et externe une autre distinction
gnosologique entre la perception certaine (immdiate, complte, entire) et
la perception incertaine (mdiate, incomplte, par esquisses ou profils)
35
.
Appesantissons-nous plutt sur la conception du philosophe no-kantien Paul
Natorp
36
, qui a prsent un compte rendu dtaill de la manire dont une
organisation duale de la connaissance, objet et sujet, extrieur et intrieur,
peut surgir du continuum indiffrenci de lexprience. Selon cet auteur, cela
survient par le biais dun processus double face dont la premire phase est
lobjectivation, et la seconde phase, ractionnelle, est la subjectivation.
Objectiver veut dire extraire les composantes invariantes ou covariantes de
lexprience : celles qui demeurent invariables par-del les changements de
situation personnelle, spatiale, et temporelle ; ou celles qui varient
conformment une mme rgle lgale quels que soient les personnes, les
lieux, et les temps. Le domaine subjectif est alors caractris par
opposition systmatique avec cette part objective de lexprience. Il inclut
tout ce qui reste dans lexprience une fois que son domaine objectif a t
dlimit. Par suite, le domaine subjectif volue avec le processus
dobjectivation, et il se voit caractris dautant de manires quil existe de
dlimitations de lobjectivit. La subjectivit se dfinit tour tour comme :
Le contenu entier de la conscience par contraste avec les fragments
retenus par la constitution dobjectivit : la psychologie nest pas tant une
science empirique que la science de lempirie en gnral
37
;
Ce qui est immdiatement vcu, avant que des questions diriges vers les
objets dexprience ne restreignent le champ de lattention ;
La composante variable, personnelle, parfois onirique de lexprience,
par opposition sa part invariante et interpersonnelle ;
L e divers de lexprience par opposition lunit impose par la
catgorisation ;
Le chaos primitif des apparences, par contraste avec lordre prescrit par
la raison dans sa qute duniversalit ;
La structure biographique, par contraste avec les structures spatio-
temporelles impersonnelles formules dans des lois rsultant du
processus dobjectivation.
La nature comparative de ces dfinitions laisse clairement entendre
quaccder au champ de la subjectivit nest pas un simple don, mais une
discipline symtrique celle de lobjectivation. Ce champ est accessible en
dgageant les conditions (pouvant tre tenues rtrospectivement pour
subjectives) de la connaissance objective. Il lest galement en suspendant
lactivit de fragmentation du champ de lexprience, en relaxant lintrt
initialement focalis sur des secteurs choisis de lexprience pour le laisser
stendre loisir.
Malgr cette critique rpandue dans le milieu philosophique, la position
des psychologues sur le statut de lintrospection restait ambivalente, tombant
volontiers dans les travers du dualisme au nom dune pistmologie de
savant marque idologiquement par limage pieuse dune science
dcouvreuse de continents inconnus (le continent intrieur ), et ne sen
loignant quaux moments de plus grande sophistication pistmologique.
Dans son expression la plus simple, lusage dun grand public cultiv, le
discours des psychologues introspectionnistes restait pntr par le modle
des deux domaines et des deux orientations du regard. Wilhelm Wundt se
demandait ainsi comment notre propre vie mentale peut tre transforme en
un thme dinvestigation, de la mme manire que les objets de ce monde
extrieur autour de nous
38
. Et Edward Titchener approuvait lide que
lintrospection est une simple forme dobservation
39
, ne distinguant plus les
sciences que sur la base dune opposition entre deux directions du regard
observant : La mthode de la psychologie est lobservation. Pour la
distinguer de lobservation des sciences physiques, qui est inspection, un
regarder-cela, lobservation psychologique a t qualifie dintrospection, un
regarder-dedans
40
. Les pionniers de lintrospection nen restaient pas
moins mfiants vis--vis des consquences du schma de la thorie classique
de la connaissance dont ils continuaient faire usage, et ils ne cessaient
dintroduire des nuances, des mises en garde et des mtaphores alternatives
afin dattnuer dans leurs penses les plus avances ce que leurs clichs de
savants-psychologues avaient de caricatural. Wundt savait, quand il le fallait,
faire jouer toutes les harmoniques critiques de la tradition psycho-
philosophique du XIX
e
sicle. Sa premire manuvre dans cette direction
consistait rsister la dfinition lmentaire de lintrospection comme
observation interne , et lui prfrer lexpression voisine de perception
interne , reprenant ainsi son compte une distinction introduite par Franz
Brentano
41
puis rlabore par Husserl
42
. Selon Brentano, lobservation ne
peut pas tre la source vridique de la psychologie , pour la simple raison
quobserver un vnement mental en focalisant pleinement lattention sur lui
ne peut conduire qu sa disparition. La seule source adquate de lenqute
psychologique est donc la perception interne. Celle-ci, selon la dfinition
brentanienne, nexige pas que lattention soit fixe sur un objet mental, mais
seulement que, lorsque lattention est concentre sur quelque objet
(habituellement extrieur), elle garde une tendue latrale suffisante pour
noter les processus mentaux qui sous-tendent lacte de faire attention. On peut
percevoir la vibration dun tlescope en mme temps quon observe une
plante travers lui. Mais Wundt ne sarrtait pas cette simple expansion du
regard ; il ne se contentait pas de passer de la stricte observation des choses
intrieures une perception introvertie. Il se rapprochait considrablement de
la vision non dualiste no-kantienne lorsquil rapportait les intrts
divergents des sciences de la nature et de la science psychologique la
diffrence entre deux modes d organisation dun seul et mme continuum
dexprience plutt qu deux sphres mutuellement exclusives (interne et
externe) de subsistance. Aprs que tout le reste a t organis, crivait
Wundt, il demeure quelque chose qui na pas trouv de place nous-mmes,
nos sentiments, volitions, et penses
43
. linstar de Natorp, Wundt
considrait donc le domaine de la subjectivit comme ce qui est laiss de ct
dans lexprience lorsquun matriau objectiv a t extrait delle, et non pas
comme quelque enclos secret, bien spar dun monde objectif donn
davance. Il en va en partie de mme du psychologue amricain Edward
Titchener, qui, en dpit de son vocabulaire thorique dualiste, sexprimait
diffremment lorsquil avait orienter ses lecteurs vers lusage effectif de
lintrospection discipline
44
. Il caractrisait alors les diffrences entre la
psychologie introspective et les sciences de la nature en les rapportant deux
points de vue divergents, plutt quen leur associant comme prcdemment
deux directions opposes dun seul regard. Dans lintrospection, soulignait-il,
le point de vue de lobservateur est diffrent ; cest le point de vue de la vie
humaine et de lintrt humain, et non pas celui du dtachement et de la
rserve distante
45
. Sous couvert de la locution banale point de vue , ce
sont en fait ici deux attitudes qui sont mises en avant, celle du plein
engagement et celle de la distanciation, et non pas deux orientations pour un
seul il mental.
Ces faons de comprendre le savoir-faire spcifique de lintrospection
saccordent assez bien, remarquons-le, avec la caractrisation husserlienne de
la rduction phnomnologique : donner accs non pas une sphre
intrieure , mais au champ entier de lexprience pure avant que la
surfocalisation intentionnelle nait restreint la rgion de pleine conscience ; y
compris donc ses cts ou ses marges qui restent ngligs aussi
longtemps que prvaut un intrt exclusif pour les objets
46
; y compris, comme
le disait antrieurement William James, ses franges furtives de relations
virtuelles qui la lient dautres expriences contemporaines ou futures
47
. Bien
entendu, il ne sagit pas ici dignorer lantipsychologisme de Husserl. Selon
lui, lenqute phnomnologique nquivaut pas une varit dintrospection,
pour au moins trois raisons : (a) lintrospection est rendue possible par un tat
de conscience positionnelle, ce qui signifie que dans ce cas la conscience
pose un objet intentionnel, quil soit situ au centre ou la marge de
lattention, tandis quen phnomnologie la conscience devient non
positionnelle
48
; (b) tant positionnelle , dirige vers quelque chose
danalogue un objet transcendant, lintrospection reste faillible, lgal de
nimporte quelle autre recherche empirique ; (c) contrairement
lintrospection en son tape lmentaire, la phnomnologie nest pas
concerne, pas mme provisoirement, par des vnements particuliers de la
vie mentale ; elle cherche au lieu de cela lucider directement des invariants
eidtiques, ou essences , de lexprience vcue. Ces trois incontestables
diffrences nexcluent cependant pas des similitudes partielles de procdures
et dattitude
49
; car aprs tout il existe entre les deux mthodes des relations
intimes
50
. Comme la phnomnologie, la nouvelle introspection tend
supposer la ralisation dun tat de conscience particulier, obtenu en
parcourant au moins deux des tapes de lpoch gradue dcrite au
chapitre III : la phase de suspension du jugement sur les choses et la phase de
rorientation rflexive de lattention. Contrairement la phnomnologie,
cependant, elle ne va pas jusquau bout de la dernire tape de lpoch : le
lcher-prise dcatgorisant, lactivit de sexposer lentire passivit
51
,
louverture ce qui est simplement donn
52
et inqualifi. Car son but nest pas
doprer une remonte transcendantale vers la matrice non objective de
lobjectivation, vers cette eau inconnue qui prcde le dcoupage catgorial et
le conditionne. Il nest pas non plus dextraire des essences invariantes
partir dune variation mentale de ce qui se prsente dans lexprience, mais
de permettre une description fine de ces moments de prsentation,
conformment son projet psychologique.
Le parallle nuanc avec la phnomnologie nous guide pour repenser le
concept de rflexion dans le cadre de la nouvelle introspection ; il nous vite
de rejeter abruptement ce terme au nom du refus des connotations dualistes
quimpliquent les images dun miroir et dun regard. Nous avons dj signal
que la rflexion au sens phnomnologique signifie de moins en moins une
observation spculaire, et de plus en plus une modification de la conscience,
une transmutation de la totalit de lexprience vcue. La pleine ralisation de
ce sens alternatif de la rflexion se rpand lheure actuelle loccasion du
renouveau de la recherche introspective. Cest par exemple le cas chez Gregg
Ten Elshof, selon lequel lintrospection peut tre considre comme une
varit de perception condition quon reconnaisse que lacte perceptif ne
consiste pas exclusivement rediriger lattention, mais aussi faire varier son
extension
53
. Dans le mme esprit, pratiquant une synthse judicieuse des
penses de Brentano et de Wundt, Jrme Sackur
54
dfinit lintrospection
comme un processus de perception tendu ce qui est habituellement nglig
dans lexprience, ou ce qui est repouss la priphrie du champ
attentionnel. Au dernier stade de cette refonte du patrimoine mtaphorique, on
peut aller jusqu en expurger les dernires rsonances visuelles et accepter
que lintrospection, loin de ressembler un regard sur quelque objet (quil
soit focalis ou tendu), consiste rinstaurer un contact intime avec le
champ dexprience vcue qui est explorer
55
. Ici, limage du voyant
promenant son rayon attentionnel sur le monde est remplace par celle de
laveugle cherchant palper son environnement, en effleurer toutes les
surfaces par son toucher, ou du moins stablir en contigut avec lui par la
mdiation dun bton ; en attendant de lui substituer ses vrais opposs
figuratifs que seraient la reptation, limmersion, voire la compntration.
Les procds contemporains du rapport verbal introspectif tiennent
pleinement compte de cette conception articulant laccointance la
progressivit de la perception.
La mthode dentretien dexplicitation
56
, qui sera dveloppe plus bas,
se dcrit ainsi comme une stratgie consistant dployer progressivement les
aspects pr-rflexifs de lexprience vcue, en demandant aux sujets de
revivre, de rhabiter en acte plusieurs reprises un certain moment
dexprience, puis de lexplorer aspect aprs aspect au fur et mesure quils
rorientent leur champ dattention et en modifient lextension. Dans ce cadre,
la rtrospection est systmatiquement utilise de prfrence aux protocoles
classiques de pense voix haute , afin de permettre une expansion
croissante du champ de lattention chaque fois que la squence dexprience
choisie est revcue, de favoriser ensuite des refocalisations variables
facilitant lexploration rgion aprs rgion de ce moment dexprience, et de
permettre enfin la rintgration de fragments isols dexprience vcue dans
la squence autobiographique principale. Une autre mthode assez diffrente a
t dveloppe, avec le mme but de porter la conscience (ou plus
exactement la squence verbalisable du vcu) autant daspects pr-rflchis
de lexprience que possible. Son nom est mthode descriptive
dchantillonage de lexprience
57
. Elle consiste interrompre
alatoirement lactivit des sujets laide dun gnrateur de sons stridents, et
leur demander un rapport verbal sur ce qui leur traversait lesprit juste avant
lirruption du son. Cela permet de procder des tomographies
rtrospectives de moments dexprience, et de mettre en vidence des aspects
de cette exprience que les sujets laissent habituellement chapper.
Lhypothse est ici que lorsquaucun son ne survient, les sujets ngligent bien
des aspects de leur propre exprience prsente (les bauches bouts libres,
selon la thorie des bauches conscientes multiples), pour se tourner
prfrentiellement vers le seul objectif central de leur tche (llment
intgrable la squence biographique principale) ; et quen pratiquant des
coupes temporelles dans cette exprience, il y a une chance de saisir sur le vif
les aspects ngligs, de rattacher les bauches gares la squence
principale.
Pour rcapituler, il y a deux points cruciaux sur lesquels la dfinition
actuelle de lintrospection diffre de la dfinition classique, et qui peuvent lui
offrir de meilleures possibilits de dveloppement : (a) la discipline du
contact avec une exprience omni-prsente, de limmersion en elle, de
lamplification progressive de lattention ses contenus, est substitue celle
de lobservation dhypothtiques objets intrieurs ; (b) une technique
rtrospective permettant de concentrer lattention successivement sur des
fractions varies dun moment dexprience est adopte en lieu et place de la
tentative de tout dire dune exprience de faon contemporaine son
accomplissement. Ces deux lments de redfinition pourraient motiver le pur
et simple rejet du terme introspection , tymologiquement trop connot.
Dautres expressions, comme pleine conscience tendue , seraient sans
doute prfrables. Mais le maintien dune certaine continuit historique plaide
en faveur de la transmission du mot, si ce nest du concept, dintrospection.
La seconde srie dobjections de principe adresse lintrospection
consiste remarquer que lintrospection altre le processus mental quil
sagit de connatre. Il existe au moins trois varits, et plusieurs sous-varits
de cette objection. La distorsion observationnelle, en premier lieu. Lattitude
et le processus dintrospection sont accuss de perturber le flux mental quon
veut connatre, comme la clairement dclar Hume
58
: Il est vident que
cette rflexion [] perturberait lopration de mes principes naturels, de
telle sorte que cela devrait rendre impossible llaboration de quelque
conclusion que ce soit partir du phnomne. La distorsion temporelle, en
deuxime lieu, puisquil y a un cart entre le caractre fluent de lexprience
et la demande de stabilit des contenus de connaissance. Cest ainsi que
Kant
59
a estim quil ne peut y avoir de vraie connaissance de lme, parce
que cette dernire se dveloppe dans le temps, alors quon devrait
limmobiliser de quelque manire pour en extraire un invariant pouvant passer
pour un objet connu. Dans un esprit voisin, Wittgenstein a soulign que le
langage, dont lusage est tendu dans le temps, et qui aboutit en fin de
parcours une proposition arrte, ne saurait capturer un moment
dexprience dans son actualit instable
60
. La distorsion interprtative, enfin.
Le reproche est ici que les catgories utilises par les sujets pour dcrire leur
exprience sont charges de thorie
61
, quelles sont pr-conditionnes par
une thorie latente de leur esprit et des autres esprits. Il sagit l dun
problme trs srieux, puisque, comme lont montr plusieurs travaux
critiques lgard de lintrospection, les sujets chouent le plus souvent dans
la thorisation de leurs propres processus mentaux
62
. De surcrot, le langage
est souponn de ne mme pas tre capable de capturer quoi que ce soit de
significatif dune exprience dcrire essentiellement ineffable.
lexamen attentif, ce groupement dobjections nest pas aussi dcisif
quil en a lair. Il ne faut pas perdre de vue que les distorsions
observationnelles, temporelles, et interprtatives ne peuvent tre qualifies de
distorsions que relativement lexprience telle quelle est en elle-
mme , avant toute tentative de lobserver, de la saisir, et de linterprter. En
dautres termes, les objections prcdentes reposent sur une version du
mythe du donn
63
. Mais, si nous prenons des distances lgard de ce
mythe, une configuration bien diffrente merge.
Une tude soigneuse de laffirmation selon laquelle certains processus
sont perturbs
64
par lobservation ou par la verbalisation peut tre prise
comme premire tape vers cette nouvelle configuration. Parler dun
processus en soi perturb par les instruments grossiers que nous utilisons
pour y accder na de sens que sil existe un mode daccs ce processus
indpendamment des instruments en question. Mais, sil ny a rien, mme en
principe, comparer aux donnes des instruments supposs grossiers, une
telle faon de parler nexprime rien dautre quune libert spculative. Cette
remarque lmentaire a t la pierre angulaire de linterprtation standard de
la mcanique quantique
65
, et elle a inspir des analogies bien tayes entre le
mode de connaissance dont relve cette thorie physique, et lpistmologie
de lintrospection
66
. Il est vrai que la mtaphore dun objet microscopique
perturb par le dispositif exprimental a t presque unanimement accepte
par les physiciens juste aprs la naissance de la thorie quantique, et quelle
reste populaire dans les ouvrages de vulgarisation. Mais il est devenu vident
au cours des annes suivantes quune fois prise au srieux, cette mtaphore
conduit invitablement limputation d incompltude de la mcanique
quantique. Laccusation nest-elle pas naturelle face une thorie qui se voit
assigner la tche de dcrire des objets, mais qui na rien dire sur ce quils
sont avant leur perturbation par les instruments qui y donnent accs ? Cest
pour dfendre la nouvelle thorie de cette accusation que Bohr a rapidement
cart la mtaphore de la perturbation, et quil lui a substitu la thse suivant
laquelle chaque phnomne est co-dfini par les conditions exprimentales de
sa manifestation ; au sens de Bohr, chaque phnomne est constitu et non pas
perturb par le dispositif instrumental. La nouvelle physique telle que la
conoit Bohr porte sur des phnomnes technologiquement holistiques plutt
que sur dhypothtiques proprits prtendument mises en vidence par un
appareil qui, malencontreusement, les perturbe . partir de l, il ny a plus
lieu de se plaindre de la distorsion des phnomnes par les procds servant
les connatre, puisquil ny a rien de tel que des phnomnes indpendants de
ces procds.
Une stratgie du mme genre peut tre utilise pour affronter la question
de la validit des descriptions introspectives, et cest prcisment celle que
Husserl
67
a adopte pour affronter une srie dobjections que les adversaires
de lintrospection tendaient la phnomnologie peine ne. Contre
lhabituel reproche de distorsion, Husserl souligne que douter de la
possibilit de saisir de manire fiable les expriences vcues par un acte
rflexif revient supposer quon possde un savoir sur ce que sont ces
expriences vcues avant toute rflexion. Mais supposer cela est soit auto-
contradictoire, si la connaissance de lexprience peut seulement tre obtenue
par la rflexion, soit auto-contraignant, si cela quivaut demander de dfinir
des procds non rflexifs (sans doute oxymoriques) de connaissance de soi.
La seule issue ce dilemme, comme lcrit juste titre Benny Shanon,
consiste admettre que lintrospection porte directement sur les expriences
rflexives plutt quindirectement sur les expriences quest suppose
clairer la rflexion : Quelle reflte fidlement des entits caches ou non,
lintrospection naturelle exprime par des squences de penses spontanes,
des rves ou des fantaisies imaginatives nest pas un rapport secondaire
dautres activits mentales mais un phnomne psychologique dimportance
primaire
68
. coup sr, la dcision de ne pas se soucier de fidlit
spculaire est audacieuse, mais elle a le mrite douvrir la voie des
pistmologies alternatives, et des conceptions non conventionnelles de la
conscience. Lune de ces pistmologies alternatives suit de prs lapproche
de la mcanique quantique standard (celle qui a t drive des rflexions
pionnires de Bohr et de Heisenberg), et elle revient instaurer un savoir non
reprsentationnel de lexprience. Quant la conception non conventionnelle
de la conscience, elle a dj t esquisse sous le nom de thorie des
bauches conscientes multiples, et elle contient demble en elle, nous
lavons vu, de quoi court-circuiter les proccupations au sujet dventuelles
distorsions historiographiques. Car, selon elle, il ne saurait tre question
dune exprience vcue compltement indpendante des actes qui permettent
den tablir un rcit, que celui-ci soit encore latent, comme dans les bauches
gares, ou quil soit pleinement dvelopp comme dans l autobiographie
officielle .
La troisime srie dobjections anti-introspectionnistes consiste
affirmer, au-del de limputation somme toute modre de distorsion, quon se
trompe systmatiquement et compltement au sujet de sa propre exprience.
Une part de cette objection se fonde sur lobservation quil est facile pour des
sujets de sgarer propos des stimuli qui leur ont t imposs pour susciter
une certaine exprience. Mme Edward Titchener, le plus clbre des
introspectionnistes amricains du dbut du XX
e
sicle, se dclarait
extrmement mfiant propos de la capacit quavaient ses sujets
introspecteurs didentifier la totalit dun stimulus complexe : Le sujet peut
voir ce qui ntait pas l, il peut savrer incapable de voir la plus grande
partie de ce qui tait l, et il peut se tromper dans la reprsentation du peu
quil peroit rellement. Lintrospection ajoute, soustrait, et dforme
69
. Plus
rcemment, des critiques ont t formules contre la tendance quont les sujets
dire quils voient plus de choses que ce quils peuvent attester, ou contre
leur incapacit voir lessentiel de ce qui est devant eux lorsque leur
attention est distraite
70
. Il sagit l dun thme souvent repris par la
psychologie introspectionniste : celui de l erreur du stimulus
71
, qui
consiste demander lintrospection ce quelle peut rarement offrir, savoir
la fidlit du rapport verbal laffrence extrieure.
La prescription de ne pas esprer de correspondance entre les donnes
dintrospection et les stimuli imposs pourrait-elle avoir t dirige en partie
contre la premire cole allemande de psychologie introspective, celle de
Wundt ? Si cest le cas, la raction est excessive. Il est vrai que Wundt faisait
porter son enqute sur des fragments trs limits de rapports introspectifs
ayant la forme de jugements sur le nombre, lintensit, et les caractristiques
temporelles (simultanit ou dure) des stimuli
72
physiques. Mais, sous le
contrle exprimental troit permis par une instrumentation
exceptionnellement prcise pour lpoque, ses sujets introspectants
savraient capables dun haut degr de fidlit aux stimuli qui leur taient
appliqus. Wundt, aprs Fechner, avait donc toutes les raisons dnoncer en
confiance des lois psychophysiques telles que laccroissement du stimulus
ncessaire pour produire une diffrence galement notable de sensation
stablit dans un rapport constant avec lintensit totale du stimulus
73
. Plus
rcemment, une version modifie dintrospection wundtienne a t remise en
uvre avec succs, sous le nom d introspection quantitative
74
. Elle a
abouti, tout autant que son anctre, une fidlit satisfaisante des rapports
dexprience ultra-simplifis qui sont demands aux sujets. Dans ce dernier
cas, les rapports ne portent pas sur les stimuli eux-mmes, mais sur le temps
mis par les sujets pour accomplir certaines tches impliquant ces stimuli.
lissue de ces expriences, on constate une stricte corrlation entre les temps
de rponse mesurs et les temps de rponse subjectivement estims. Cette
bonne corrlation nest brise que lorsquune seconde tche interfre avec la
premire, ce qui est interprt par les auteurs, nous lavons vu prcdemment,
comme le signe dune comptition entre les deux tches pour leur accs
lespace de travail global du cortex crbral. Certains jugements
dinadquation entre les rapports dintrospection et les stimuli ayant suscit
lexprience rapporte, pourraient donc bien tre exagrs. Dans certains cas,
et sous des conditions troitement contrles, les rapports savrent plutt
exacts et fidles. Le soupon dinadquation aux stimuli tant excessif, il nest
donc pas suffisant lui seul pour motiver le rejet de lintrospection.
Un autre argument affaiblissant laccusation de non-fidlit des rapports
dintrospection leurs stimuli peut tre tir de certains travaux de
psychologie accomplis une poque, le milieu du XX
e
sicle, que lon suppose
pourtant domine par le behaviorisme. Une tude devenue classique dans
lhistoire de la psychologie
75
jette le doute sur lun des prjugs anti-
introspectifs les plus rpandus chez les chercheurs en sciences cognitives :
laffirmation selon laquelle les sujets se trompent systmatiquement lorsquils
prtendent avoir mmoris une scne entire tendue dans lespace
76
,
puisquils se montrent incapables de dcrire la plupart des dtails de cette
scne lorsquon leur demande de le faire. Selon cette tude conduite par
George Sperling, les choses ne sont pas si simples, et elles sont beaucoup
moins dfavorables lintrospection quil y parat
77
. Lexprience consiste
confronter brivement des sujets divers tableaux de lettres et de chiffres
choisis au hasard, et leur demander de rapporter aprs coup les caractres
dont ils peuvent se souvenir. Lun des tableaux typiques comprend douze
lettres disposes sur trois ranges de quatre. Les sujets affirment
habituellement avoir une mmoire image du tableau entier, mais ils sont
incapables de citer davantage que trois ou quatre lettres parmi les douze. Leur
affirmation de voir littralement le tableau devant eux aprs quon le leur a
retir du champ visuel est-elle donc compltement illusoire, comme
linsinueraient bien des spcialistes contemporains de sciences cognitives ?
Un supplment dtude a permis de mettre en grande difficult cette
interprtation purement ngative des rapports initiaux sur la visualisation
du tableau. Lors de la phase additionnelle de lexprience, les sujets taient
pris de se concentrer mentalement sur une seule range du tableau, et
dnumrer les lettres de cette seule range prise dans le faisceau attentionnel.
Le rsultat de ce processus est surprenant : les sujets taient capables de
rapporter trois quatre lettres de nimporte quelle range du tableau, choisie
au hasard par lexprimentateur. On est tent partir de l daccepter quils
avaient bien un souvenir imag court terme de tout le tableau, mais que ce
souvenir sestompait rapidement ds que quelques lettres taient prises dans
leur faisceau attentionnel rtrospectif, et numres par eux. Le rapport initial
dexprience des sujets parat dans ce cas moins inexact que ce que reconnat
lopinion commune dans les sciences cognitives. Il est vrai quune autre
interprtation de leur performance, compatible avec lopinion commune,
semble galement plausible : celle suivant laquelle le souvenir, initialement
inconscient, a t activ par la focalisation attentionnelle quinduit une
question cible
78
. Cependant, cette interprtation alternative reste suspendue
(de mme que sa rciproque) lindcidabilit de la caractrisation des tats
mentaux momentanment indisponibles comme strictement inconscients , ou
comme isolment conscients mais non intgrs la srie verbalement
rapporte . Le souvenir imag dense de lensemble du tableau peut aussi
bien exprimer une pleine extension (non intgralement verbalisable) du champ
d e conscience quune simple confiance en la ractivabilit de souvenirs
inconscients par la concentration attentionnelle. Cest seulement travers un
rexamen serr des dtails de lexprience de Sperling, et surtout de ses
dveloppements ultrieurs, que cette indcidabilit est en train dtre leve.
Dune part, lexcessive fugacit de la mmoire de travail la plus
vraisemblablement inconsciente
79
ne saccorde gure avec la ractivabilit
persistante du souvenir imag. Et dautre part, les tmoignages que labsence
de rapport immdiat nempche pas la rapportabilit diffre saccumulent
80
.
Au vu de ces arguments, la balance semble pencher en faveur de la conception
de la conscience abondante et du dbordement de la conscience
phnomnale au-del des contenus effectivement rapports
81
. Face elle, la
conception inverse de la conscience rare (borde de larges secteurs
inconscients), voire de la mise lcart du concept mme de conscience
phnomnale au profit du seul rcit, se trouve mise sur la dfensive
82
.
Lapproche utilise par Sperling et ses hritiers pour mettre en vidence
la part dexactitude des rapports dintrospection est particulirement
instructive. Elle suppose deux orientations exprimentales prcises : (a)
mettre les sujets dans une situation de succs plutt que dans une situation
dchec, en choisissant la tche pour laquelle ils manifestent un degr
maximal de capacit de verbalisation ; (b) aider les sujets en leur posant des
questions directionnelles (mais non suggestives) sur ce quils ont vcu, au lieu
de disperser leur attention par des questions qui sont soit trop abstraites, soit
trop vastes. Lexprience de Sperling comporte, par contraste, une leon
importante sur la manire dinterprter les clbres rsultats ngatifs de
Nisbett et Wilson
83
contre la fidlit des rapports dintrospection : ces
rsultats extrmement dommageables la rputation de la psychologie
introspective dcoulent de la mise lcart systmatique des deux rgles
prcdentes. Les sujets de Nisbett et Wilson ont t placs intentionnellement
en situation dchec, et leur attention a t carte du contact avec
lexprience vcue par la seule formulation de questions abstraites de type
pourquoi (avez-vous fait ce choix) ? Il en va par exemple ainsi dans lune
de leurs principales expriences, o des sujets doivent se prononcer sur
lattractivit dune certaine personne laccent tranger prsente par un petit
film
84
, lorsquon lui surimpose, de faon intentionnellement garante, soit des
traits damabilit, soit des traits de froideur. Les sujets sollicits, interrogs
sur les raisons de leur attrait ou de leur rpulsion pour cette personne, citent
laccent tranger comme motif de leur rpulsion, alors mme que celle-ci
nintervient majoritairement que dans les cas o un comportement froid est
impos la personne filme. Nisbett et Wilson sappuient sur ce genre de
rsultats pour dclarer que nous avons probablement peu ou pas daccs
introspectif direct nos processus cognitifs dordre suprieur
85
. A
contrario, nous verrons plus bas que les conclusions anti-introspectives
couramment tires des expriences de Nisbett et Wilson et de leurs
amliorations rcentes ont t rfutes directement et sans quivoque par une
exprience conue demble selon les deux rgles de la (re)mise en situation
de succs, et du guidage de lattention vers des tches descriptives plutt
quinterprtatives.
Une autre cible privilgie des critiques sur la fiabilit de lintrospection
est la fameuse querelle irrsolue de la pense sans images, et de limagerie
mentale
86
. John Watson, le fondateur du behaviorisme, y voyait la preuve
incontestable de labsence de consensus au sujet des donnes introspectives,
et par suite de leur invalidit. Cette fois, la menace qui pesait sur
lintrospectionnisme semblait encore plus srieuse quauparavant, puisque les
reproches ne portaient pas seulement sur la fidlit des rapports verbaux aux
stimuli qui suscitent lexprience, mais aussi sur leur fidlit lexprience
elle-mme. Elle atteignait le cur de la thse introspectionniste, suivant
laquelle la question [] de la validit de lintrospection ne consiste pas
savoir si les rapports concordent avec les stimuli, mais sils fournissent des
descriptions exactes de la conscience du sujet ; ils peuvent tre
fantastiquement faux sur le premier plan, mais absolument exacts sur le plan
des contenus de conscience
87
. Or, lapoge de la psychologie
introspective, les chercheurs de lquipe de Titchener luniversit de
Cornell dclaraient avoir mis en vidence que des lments sensibles, des
perceptions kinesthsiques, et des images mentales sont associes
lintgralit des processus mentaux
88
, tandis que des chercheurs de lcole de
Wrzburg, comme Oswald Klpe, August Mayer et Johannes Orth
89
,
affirmaient au contraire quil existe de pures penses abstraites, prives
dimages et de composante sensible. Ces proclamations systmatiquement
conflictuelles entre deux groupes dont les membres avaient pourtant tous t
directement ou indirectement les tudiants de Wundt saccompagnaient de
critiques mthodologiques rciproques. Titchener sinquitait de voir lquipe
adverse baser ses conclusions sur les rapports incomplets de sujets non
entrans, tandis que les membres de lcole allemande de Wrzburg
sinterrogeaient sur les effets induits que pouvaient avoir les prjugs de leurs
collgues amricains
90
. Cette diffrence tait dautant plus alarmante quelle
montrait que des diffrences thoriques pouvaient immdiatement prendre la
forme de diffrences entre les donnes elles-mmes
91
. tel point que
beaucoup dauteurs contemporains considrent encore que le plus entier
scepticisme est la seule attitude qui convienne face la question de limagerie
mentale
92
. Pourtant, un examen soigneux des textes dans lesquels sest
dvelopp le dbat sur la pense sans images montre quune fraction sous-
interprte des donnes verbales peut dans une certaine mesure tre isole des
interprtations thoriques, et que, dans ce cas, aucune vritable divergence ne
subsiste entre les deux coles
93
. Les sujets des deux coles saccordaient en
effet sur lexistence de processus vagues et vasifs, qui portent en concentr
la signification entire dune situation
94
, et qui mettent tous en uvre de
fines sensations kinesthsiques. Il se trouve simplement que les chercheurs ne
comprenaient pas ces rapports de faon identique : lune des coles assimilait
ces processus proto-smantiques des sortes dimages brouilles, tandis que
lautre rejetait cette lecture et considrait quil ny avait pas dimage du tout.
Les deux coles ont ainsi manqu une interprtation formule ultrieurement,
et qui aurait sans doute pu les mettre daccord : celle des significations
ressenties dEugen Gendlin
95
, ces tats corporels globaux dont la perception
subliminale prpare une action ou une pense abstraite.
Au lieu de signaler une faillite de lintrospection en gnral, lissue de la
querelle de la pense sans images confirme le genre de condition qui doit tre
remplie pour y atteindre un certain consensus en matire de prtention la
validit. La condition premire, redisons-le, est de rtrograder dans la
hirarchie des reconstructions rationnelles, des explications, et des
gnralisations, lorsque les rapports verbaux sont recueillis, et dadhrer de
manire aussi stricte que possible au comment de lexprience. Cette
procdure de rgression sur lchelle interprtative, analogue la rduction
phnomnologique, mais avec un degr de radicalit dans lpoch en moins,
est une exigence lmentaire de toute enqute introspective. La procdure peut
reposer soit sur lexpertise des sujets soit sur lexpertise des exprimentateurs
qui, layant matrise dans leur propre exprience, peuvent linduire chez
leurs sujets, au moyen dinstructions et de questions soigneusement choisies.
Aprs tout, dans la science exprientielle aussi bien que dans les sciences
exprimentales, identifier quelque chose quon puisse traiter en pratique
comme des faits exige un mouvement de descente vers le bas de la gamme
des charges thoriques ; non pas bien entendu pour atteindre le royaume
utopique des purs contenus ininterprts , mais pour prendre appui sur un
niveau lmentaire dinterprtation abrit de toute possibilit de discussion
dans un certain tat de la culture et de la recherche. Le consensus sur des
faits peut tre atteint soit en sappuyant sur un niveau de thorisation
unanimement accept parce que paradigmatique , soit (durant les priodes
de science rvolutionnaire) en revenant aussi prs que possible des
prsuppositions tacites dposes dans les savoir-faire incarns. Dans
lintrospection, cette dernire tape du mouvement de descente doit encore
tre pousse une tape plus bas, pour la simple raison que le niveau de
consensus atteindre ne concerne pas notre savoir comment faire, mais plus
profondment notre savoir comment tre afin dobtenir un contact tendu avec
notre propre exprience. De la mme faon que les savoir-faire ordinaires ou
artisanaux sont appris par limitation, par linteraction non verbale avec un
expert, et par lincorporation dune habilet gestuelle plutt que par la
transmission dides, ce savoir-comment-tre est mieux appris par le contact
direct avec des experts et par un entranement appropri
96
que par la
transmission de thories sur le statut de la rduction psychologique ou
phnomnologique.
Rpondre lobjection d affabulation avance contre lintrospection
suppose cependant de laffronter directement plutt que par le biais de ses
occurrences historiques : comment sassurer de quelque chose comme la
fidlit des rapports en premire personne indpendamment de toute
relation avec les stimuli qui suscitent lexprience ? Comment garantir
intersubjectivement la coextensivit des rapports dexprience lexprience
vcue, puisque les processus concerns semblent devoir rester confins dans
lenclos de chaque sujet particulier ? La tche est dlicate, mais pas
impossible. Il existe des moyens dvaluation dont on peut distinguer deux
niveaux : (a) des signes de fiabilit des actes qui prparent le rapport
dexprience, et (b) des critres non conventionnels de validit de ce rapport.
Des signes de fiabilit des actes prliminaires la verbalisation de
lexprience sont utiliss en temps rel dans les procdures dintrospection
assiste par interaction dialogique
97
. Ils sont dtects sous la forme
dattitudes corporelles, de positions variables du regard et de rythmes
dlocution, qui indiquent que le sujet a tabli un contact effectif avec son
exprience revcue pendant quil la verbalise. Ils peuvent aussi saider de
paramtres neurovgtatifs, comme la cohrence du rythme cardiaque, qui ont
une forte corrlation avec lvocation actuelle dune exprience passe
98
,
mme sils ne sont pas spcifiques de cet tat
99
. On doit simplement garder
lesprit que ces signes ne sont considrs comme de bons indices de fiabilit
quen vertu de la capacit quont les enquteurs daccder aux corrlats
exprientiels de signes semblables manifests par leurs propres corps. Si les
signes de fiabilit de la procdure qui conditionne la production des rapports
en premire personne peuvent se voir attribuer une valeur intersubjective,
alors mme quils nquivalent aucune garantie extrieure absolue, cest
par le biais de linterconvertibilit des manifestations corporelles et des
vcus corrlatifs. De mme que, selon Wittgenstein, des mots comme
plaisir ou peur se voient attribuer un sens collectivement acceptable,
non restreint celui qui en fait lexprience, par le biais dun prsuppos de
rciprocit entre les comportements manifestant ces sentiments et leur qualit
prouve, les rapports dintrospection sont tenus pour intersubjectivement
crdibles lorsquon peut attester un degr suffisant de rciprocit entre les
signes comportementaux et physiologiques de fiabilit de lvocation dune
exprience passe, et le contact en premire personne avec sa propre
exprience au moment o lon exhibe (aussi) ces signes.
Le mme genre de remarque peut tre formul quand on se met en qute de
critres de validit des rapports dexprience. Ici encore, il y a au moins
quelque chose dvident, cest quil nest pas question de comparer
directement une exprience en soi avec son rapport allgu. Il nen est
question ni pour les exprimentateurs et les enquteurs ni pour les sujets eux-
mmes. Cet nonc dimpossibilit est incontestable lorsquil sapplique aux
enquteurs qui nont aucun terme de comparaison mettre en vis--vis de ce
que leur raconte le sujet interrog propos de son exprience. Mais il vaut
aussi pour les sujets eux-mmes, puisque lacte ventuel de comparaison
entre leur rapport verbal et leur propre exprience est une nouvelle
exprience au sein de laquelle lexprience antrieure rapporter est
remmore, intgre et refondue. Comment pouvons-nous surmonter dans ces
conditions lobstacle du caractre incontrlable de la validit des rapports
dintrospection ? Sans doute en prenant plus entirement appui que jamais sur
une pistmologie approprie, plutt que sur la thorie classique
(reprsentationnaliste et dualiste) de la connaissance qui tait dominante
parmi les psychologues au tournant des XIX
e
et XX
e
sicles. Linspiration
pourrait en tre Kant, qui tait assez lucide pour comprendre que le rve de la
comparaison directe et de la correspondance biunivoque, loin de renforcer le
reprsentationnalisme et le dualisme dans les sciences de la nature, les sape
la base. Limmmoriale objection des sceptiques, selon lesquels nous navons
aucun accs absolu aux choses, aucun accs elles indpendamment des
relations que nous tablissons avec elles, et que nous ne pouvons donc rien
dire sur ce quelles sont en elles-mmes, abstraction faite de leffet quelles
ont sur nous, a t affronte de manire particulirement novatrice par Kant
100
.
Au lieu dessayer de prouver la correspondance entre les contenus de la
connaissance et des objets extrieurs prdonns, il a dfini lobjet comme ce
qui, dans lapparatre, est structur par les oprations intellectuelles
quimplique lacte de connatre. Mme si Kant a exclu quune telle procdure,
qui repose sur lextraction dinvariants par ces oprations intellectuelles, soit
transposable la psychologie (pur champ de lapparition variable), il a
involontairement formul travers elle un type trs gnral de rponse
lobjection sceptique qui stend la psychologie comme tous les domaines
du savoir. La rponse consiste admettre que le scepticisme propos dune
rgion quelconque de la connaissance ne peut pas tre surmont en sappuyant
sur une garantie externe/transcendante, mais seulement en faisant usage de
critres internes/immanents. Tout au plus peut-on envisager dtendre le
cercle de lauto-consistance, sur lequel repose la confiance quon accorde
un contenu de connaissance, en imposant des clauses de consistance mutuelle
entre plusieurs rgions dinvestigation.
La rponse kantienne au scepticisme est de surcrot susceptible dtre
actualise, et traduite en des termes conformes aux philosophies
contemporaines des sciences. Ainsi, dans le cadre des philosophies no-
pragmatistes des savoirs scientifiques
101
, rpondre aux doutes sceptiques
nexige pas limpossible preuve quil existe une correspondance biunivoque
entre les symboles thoriques et des proprits intrinsquement relles. Cela
demande seulement de montrer des schmas efficaces dinterventions
technologiques qui se sont stabiliss, ont t adopts collectivement, et ont t
lis les uns aux autres en rseaux cohrents isomorphes aux structures
thoriques. Pour faire bref, le nouveau genre de rponse au scepticisme
repose sur une conception cohrentiste de la vrit plutt que sur une
conception correspondantiste de la vrit. ceci prs que cette conception
fait fonds sur une cohrence largie entre les symboles, les activits de calcul,
et les pratiques exprimentales caractrisant les sciences de la nature plutt
que sur une simple cohrence intra-symbolique suffisant aux sciences logico-
mathmatiques. Il est vrai que dans plusieurs branches des sciences de la
nature, les procds de validation arrivent mimer de plus ou moins prs la
concordance dune reprsentation avec ce qui est reprsent. Mais il ne sagit
l que dun faux-semblant, car, ainsi que lcrit Bas Van Fraassen
102
, dans les
sciences la reprsentation-de se voit systmatiquement substituer la
reprsentation-comme ; la prtention la reprsentation spculaire effective
nest quun masque pour la fonction pistmique de reprsentation
(couramment appele modlisation par les chercheurs).
Retenant ces leons de la philosophie des sciences de la nature, il semble
appropri de ne pas essayer de rsister aux doutes sceptiques sur la validit
des rapports en premire personne en entreprenant une vaine qute de leur
correspondance avec dhypothtiques vnements privs , mais en
tablissant des critres exigeants dauto-validation des procdures
introspectives, ventuellement complts par des critres de co-validation
impliquant plusieurs secteurs des sciences cognitives. Cette stratgie
alternative de validation des donnes dintrospection a t propose depuis
assez longtemps
103
, mais elle nest sortie de la confidentialit que
rcemment
104
. Selon elle, tout ce que montrent les critiques standard de
lintrospection, cest que les donnes introspectives ne peuvent pas tre
values sur la base dun critre de correspondance avec quelque objet
extrieur ; et que cela na pas tre regrett, parce quaucune autre donne, y
compris dans les sciences de la nature, nest vraiment value de cette faon.
Lattitude quelle invite adopter vis--vis des donnes introspectives est
donc leur valuation sur la base de leur cohrence performative, une
cohrence qui concerne plusieurs niveaux de pratique : la cohrence interne
dans lauto-analyse et le rapport verbal qui laccompagne, la cohrence
interpersonnelle dans le processus dexplicitation dialogique de
lexprience
105
, ainsi que la cohrence multidimensionnelle dans un rseau de
connaissances articulant les rapports dexprience en premire personne et les
pratiques de lexprimentation neurophysiologique. Tout comme, suivant le
second Wittgenstein, le langage doit prendre soin de lui-mme, sans filet de
scurit fondationnel demand la logique, lintrospection doit prendre soin
delle-mme, sans filet de scurit fondationnel dans quelque vasive
correspondance avec lexprience en soi . Cela nempche pas quune
relation ressemblant fortement une correspondance (par exemple, la
concordance entre une image antrieurement montre en public et sa
remmoration verbalise par un sujet) puisse parfois tre constate et
dclare, comme nous le verrons plus bas. Mais il ne faut pas perdre de vue
que ce dernier concept de correspondance est driv dune exprience
multiforme de cohrence : celle qua le sujet de ladquation de son discours
prsent son vocation mnmonique prsente, ou bien celle qua
lexprimentateur dune concordance entre le rapport recueilli et la trace
documentaire de limage prsente. Il ne traduit aucune garantie de transfert
direct entre lexprience passe et le rapport actuel. Cest la cohrence
performative qui fonde la possibilit dun discours mimant la correspondance,
et non pas une utopique correspondance qui explique la cohrence des
pratiques et du discours.
Le quatrime ensemble dobjections contre lintrospection, enfin, dnonce
le statut troitement subjectif des descriptions introspectives, et le fait que les
situations sur lesquelles elles portent ne sont pas reproductibles. Ainsi, selon
la critique prcoce mais vigoureuse de Wundt, sauf tre svrement
encadres par un appareillage de contrle exprimental, les donnes
dintrospection sont voues la plus complte idiosyncrasie : Les rapports
ne peuvent pas tre rpliqus, non seulement par dautres, mais mme par un
introspecteur particulier
106
. Sil en va ainsi, supposer mme quil y ait un
sens dire quils sont valides, les rapports verbaux dintrospection ne
concernent nul autre que la personne qui les fait, un certain moment prcis
de sa vie. Ils ne nous apprennent rien sur dautres personnes, ni mme sur la
personne concerne dautres moments. Il sagit probablement l de la plus
srieuse objection qui puisse tre dirige contre lintrospection, parce quelle
en nie toute valeur pistmique au-del de la pure anecdote.
Lobjection va tre prise en charge dans le mme esprit que celui qui a
servi traiter la question de la validit des rapports introspectifs, cest--dire
en remettant profondment en question les prsupposs pistmologiques qui
la sous-tendent. Son dfi peut tre reformul ainsi : que nous enseignent sur le
monde objectif ces tranges fables racontes par les sujets propos de leur
propre exprience ? Leur porte ne se limite-t-elle pas aux seules personnes
qui les prononcent, au moment o elles sont prononces ? Ne peut-on pas
comprendre les rticences de la psychologie du milieu du XX
e
sicle lgard
des aspects idiosyncrasiques, participatifs ou empathiques des procds
dintrospection, qui ne font que prolonger lerrance de la science de lesprit
dans le marcage de la subjectivit ? Pour comprendre rapidement que cette
objection nest pas si dsastreuse quil y parat, on peut sappuyer nouveau
sur une certaine similitude pistmologique entre la psychologie introspective
et la microphysique
107
. Les questions qui viennent dtre souleves propos
de lintrospection nous rappellent en effet deux questions trs voisines quun
physicien quantique de lcole de Copenhague aurait pu se poser sur le sens
de lexprimentation. Selon Bohr, en particulier, chaque phnomne quantique
est un vnement unique et irrversible surgissant au dcours de linteraction
entre un objet microscopique et un appareil de mesure macroscopique. Et il
nexiste par ailleurs quassez peu de circonstances
108
o un phnomne
dtermin peut tre reproduit, lorsque la mesure est rpte sur le mme objet.
Sil en va ainsi, que peut bien nous apprendre tel phnomne singulier
propos de lobjet tel quil est en lui-mme indpendamment de lappareil de
mesure et de son interaction avec lui ? Sa signification nest-elle pas limite
un acte isol dexprimentation ? Ces motifs justifis de perplexit nont
pourtant nullement fait obstacle au dveloppement de la mcanique quantique
et son renforcement, jusqu en faire lune des plus puissantes thories
physiques de lHistoire. Pour surmonter le plus dlicat motif de se mfier de
lintrospection, il pourrait donc savrer utile didentifier ce qui, dans les
mthodes de la physique microscopique, a dsamorc cette sorte dobjection
presque dans linstant o elle tait formule.
titre introductif, il faut reformuler la consquence la plus importante de
la refonte kantienne de la thorie de la connaissance : lobjectivit (dans la
seule acception qui est pertinente pour nous, sujets aptes connatre) nest pas
quelque chose qui se trouve tout fait dans le monde extrieur ; elle consiste en
un projet opratoire dextraction de structures invariantes ou covariantes au
sein dun complexe dapparatre. Dans ces conditions, la question de savoir si
des vnements singuliers ont quelque intrt objectif, ou sils nen ont pas,
doit tre dcid sur un plan mthodologique et non pas sur un plan
mtaphysique. Ce que lon doit se demander nest pas ces vnements ou
ces rapports verbaux isols nous apprennent-ils quelque chose sur le monde
objectif ? , mais quelle mthode devons-nous adopter pour atteindre
partir deux lobjectivit en tant quinvariance ? . Une fois cette nouvelle
attitude adopte, la rponse ne se fait pas attendre. Extraire des structures
invariantes ou covariantes repose sur un processus dascension sur lchelle
de luniversalit et de labstraction thorique, symtrique du processus de
descente sur cette mme chelle dont nous avons vu lutilit pour atteindre un
noyau discursif pouvant tre considr comme factuel . Autrement dit,
lobjectivit est constitue en slectionnant un degr appropri de gnralit,
une granularit danalyse suffisamment grossire pour que les variations
erratiques de lexprience y soient rsorbes et inactives. Dans le domaine
de validit de la mcanique quantique, les modalits de mise en uvre de
cette procdure sont connues, et elles se dveloppent comme suit. On
commence par renoncer accomplir lobjectivation au niveau des
phnomnes ponctuels survenant dans lespace-temps (cest, entre autres, pour
cette raison que le concept de petits corps localiss est mis en grande
difficult dans le domaine quantique
109
). On procde ensuite une ascension
vers le niveau moins fin de la description statistique, en comptant sur le fait
que la stricte reproductibilit et lindiffrence lordre des mesures, qui ne
peuvent pas tre atteintes au niveau des valeurs individuelles, vont tre
facilement rcupres au niveau des rpartitions moyennes de grands nombres
de valeurs. En fin de parcours, on monte encore un niveau suprieur
dabstraction : celui des outils formels, ou vecteurs dtat dans un espace de
Hilbert, capables dengendrer autant de distributions statistiques que de types
de mesures, et de plus lgalisables dans le cadre de lquation de
Schrdinger. Les vecteurs dtat sont en somme les structures maximalement
invariantes utilises par les physiciens quantiques ; ils jouent le rle dentits
objectives sans pour autant entretenir la moindre ressemblance avec notre
image archtypale des objets de la physique, savoir les corps matriels
tendus dans lespace ordinaire.
Le principe de la procdure qui vient dtre dcrite sapplique aisment,
par analogie rgle, lintrospection : il allie une descente et une ascension.
(1) Descente vers des descriptions minimalement interprtes de la texture
fine des vnements vcus, en priant les sujets de ne pas essayer de
reconstituer leurs propres processus cognitifs, ni dexpliquer in abtracto leurs
raisons dagir. En dautres termes, un geste de rduction psychologique
trs rigoureux est demand aux sujets introspectants, ou bien induit chez eux
par un procd dialogique.
(2) Ascension a posteriori des chercheurs qui analysent les rapports
dintrospection traits comme autant de donnes, vers des structures
transversales ne dpendant pas des sujets et des circonstances. Comme lcrit
Benny Shanon, les structures sont moins particulires que les contenus :
elles ne sont pas associes aux expriences idiosyncrasiques de
lintrospecteur, et elles sont peu susceptibles dtre affectes par le processus
de recueil des donnes . Pour y parvenir, le tout est de se placer un niveau
de multiplicit et de gnralit suffisant pour que les variations dindividu
individu et de moment en moment sestompent : Tandis que les donnes
singulires offrent seulement un aperu limit et alatoire du domaine
phnomnologique auquel on sintresse, le corpus pris dans sa totalit peut
rvler des figures rgulires et systmatiques. Le corpus atteint un tat tel
quune augmentation du nombre dexemplaires de donnes cesse daugmenter
la varit des types
110
.
Ce quon doit ajouter ce stade est que lextraction des structures
gnriques est guide de facto par un critre nglig, mais essentiel, pour
reconnatre que la porte de la description introspective nest pas seulement
individuelle : la conviction que nous pourrions aisment partager cette
description produite par notre alter-ego humain ; la certitude sentie quelle
nous concerne galement. Ainsi que le souligne juste titre Ronald Laing,
une relation personnelle nest pas seulement transactionnelle, elle est
transexprientielle
111
. Un dialogue prsuppose que ses interlocuteurs
nchangent pas uniquement de linformation, mais quils aient lexprience
directe de ce que signifie cette information, quils se figurent dans leur
exprience ce que peut tre lexprience quen a lautre, et quils peroivent
que lautre personne est actuellement en train den faire lexprience. Le jeu
de miroirs multipli de lexprience de soi et dautrui, qui opre dans tout
change humain, doit tre intentionnellement renforc dans un dialogue vise
de dploiement dexprience. Et il se voit invitablement attribuer un rle
heuristique dans linterprtation finale des donnes verbales qui rsultent de
lchange. Cet engagement indispensable du chercheur dans la substance de sa
recherche reprsente-t-il une faiblesse des tudes en premire personne, ou au
contraire leur force et leur plus grand intrt ? Les lecteurs en dcideront pour
eux-mmes, aprs avoir test directement, si possible, ce genre denqute.
Afin de concrtiser cette rhabilitation de lintrospection dans un cadre
pistmologique rnov, il est utile de montrer en quoi lune au moins de ses
mthodes adopte le cadre dcrit et rpond aux critiques grenes dans ce
chapitre. Je vais donc prsent exposer la mthode dentretien dexplicitation
de lexprience
112
, laquelle jai t form
113
, au-del des mentions
nombreuses mais allusives qui en ont t faites jusque-l. Il apparatra en fin
de parcours que chacun des dtails procduraux de cette mthode contient une
parade implicite aux objections classiques contre lintrospection.
La mthode dentretien dexplicitation sappuie, comme son nom
lindique, sur un entretien dialogu entre un chercheur et un sujet, dont la
dure est typiquement comprise entre vingt minutes et une heure et demie.
Lentretien se fixe les objectifs suivants :
1. Orienter lintrt du sujet vers une certaine exprience vcue, localise
dans lespace et dans le temps. Ce qui doit tre rflchi, rapport, rendu
explicite, est ici une exprience singulire, et non pas lexprience que
j e crois vivre gnralement dans ce type de situation . Cette option,
mise en uvre en demandant au sujet de se concentrer sur un vnement
particulier de sa vie rcente et en laidant minute aprs minute ne pas le
perdre de vue, instaure une forte intimit avec lexprience dcrire ;
2. Guider le sujet vers lvocation vivante de la tranche temporelle
choisie de son exprience singulire, vers le geste de rhabiter ses
circonstances de survenue, vers le rinvestissement de toutes ses qualits
sensibles, motionnelles, et proprioceptives. Le guidage fait appel la
mmoire pisodique concrte du sujet, au dtriment de sa mmoire
abstraite. Il repose sur des stratgies verbales trs simples consistant
inciter le sujet se figurer nouveau le contexte historique et
gographique de son exprience passe, puis valuer ltat de
ractualisation dans lequel il se trouve, par son usage prfrentiel du
prsent de lindicatif, ou par le mouvement de ses yeux dans le
vague
114
;
3. Stabiliser lattention sur lexprience singulire :
a. En invitant le sujet suspendre toute autre proccupation que lentretien
actuel ;
b. En paraphrasant de temps en temps les derniers lments de rapport
verbal fournis par le sujet en rponse aux questions prcdentes, et en lui
proposant dapprcier lexactitude de la reformulation ;
c. En reconduisant patiemment le sujet vers le fil de sa description,
chaque fois quil suspend la verbalisation de lexprience choisie et
commence parler de thmes annexes ou de gnralits abstraites ;
d. En isolant quelques traits caractristiques de lexprience vis--vis de
leur arrire-plan, par le biais dun mot ou dun geste qui les singularise.
4. Relaxer toute attention focalise sur le pourquoi , et mme sur le
quoi de lexprience, en vitant soigneusement de demander
pourquoi tes-tu senti ainsi ? , pourquoi as-tu fait ce choix ? , et en
suspendant ce stade les questions du genre quas-tu fait ensuite ? qui
pouvaient encore tre utiles au stade 2. Au lieu de cela, tendre
progressivement lattention vers lapprciation du comment
( comment tes-tu senti ? , comment ty es-tu pris pour choisir ? ). Il
sagit par l dlargir lattention du sujet vers son acte complet de
conscience au lieu de la restreindre son contenu troit ou sa
conceptualisation ; autrement dit, il sagit dinduire une rduction
psychologique par le dialogue. Cette forme dattention largie, analogue
un contact cutan tendu plutt qu un regard focalis, est maintenue en
posant au sujet un grand nombre de questions non directives propos de
chaque aspect qualitatif de son exprience ;
5. Dplacer finement laire de lattention ainsi largie en lui permettant de
couvrir les nombreuses dimensions de lexprience singulire
slectionne, lune aprs lautre, au cours de plusieurs itrations de lacte
consistant lvoquer et la rinvestir. Cest cette tape de dploiement
soigneux de plusieurs aspects dune squence vcue qui justifie le mieux
le nom d explicitation donn cette mthode, et qui permet daccder
ces brins gars de squences biographiques vcues, ou bauches
conscientes , dont il a t question prcdemment. Elle peut tre franchie
en encourageant le sujet dcrire successivement les traits visuels,
auditifs, kinesthsiques et affectifs de lexprience verbaliser, y compris
des dtails souvent surprenants qui navaient pas t nots par le sujet au
moment o lexprience avait t vcue pour la premire fois. Lenquteur
peut tre aid dans lidentification de celle des dimensions sensorielles
que le sujet est en train dexplorer, par lobservation soigneuse de ses
postures corporelles
115
. Il peut galement aider le sujet interrog en lui
posant de nombreuses questions neutres voire quasiment vides de contenu,
dont la seule fonction est dinduire des modifications rptes du champ
attentionnel.
Aprs cette descente des sujets vers la chair mme de leur exprience
singulire, favorise par lvitement systmatique de labstraction, une
remonte vers les concepts gnraux et les structures invariantes (et par suite
vers lobjectivit), est entreprise rtrospectivement par les chercheurs. Ds
que les dialogues contenant des lments de rapports dexpriences
singulires ont t enregistrs et transcrits, le matriau est rorganis, class,
et partiellement formalis afin de faire ressortir des structures intra-
subjectives et inter-subjectives de lexprience. Ce matriau a beau tre
foisonnant et dense, le style et les expressions utilises par les sujets ont beau
rester trs personnels, on peut extraire partir de l un rsidu structural
signifiant
116
. Ainsi, la mthode dentretien dexplicitation de lexprience
ralise prcisment le procd en deux tapes qui permet de regagner une
forme dobjectivit partir de donnes isoles. Elle guide les sujets vers un
contact intime avec leur exprience, tout en les dissuadant dlaborer des
reconstructions rationnelles qui interfreraient avec leur tche de description ;
puis elle dlimite des donnes formates partir de leurs descriptions
disciplines, et entreprend den extraire des structures gnriques.
Il est fascinant de voir quon peut formuler et simplifier les tapes
prliminaires de ce procd dextraction structurale partir des rapports
dexprience, en sappuyant sur les clbres analyses des mythes par Claude
Lvi-Strauss
117
. Le discours du mythe, signale Lvi-Strauss, est caractris
par son extrme traductibilit. Ce qui compte en lui se restreint son sens en
tant quhistoire raconte. Ni son style ni les circonstances extrieures
anecdotiques qui entourent le noyau de cette histoire ne sont pertinents. Cela
tant admis, lhistoire proprement dite peut tre rduite en bout de course
des propositions trs simples, exprimant des relations entre des tres et des
actes. De la mme manire que les constituants lmentaires du langage sont
appels des phonmes (les plus petits sons diffrenciables), des morphmes
(les plus petites units signifiantes, savoir les mots), et des smantmes (les
plus petites units susceptibles davoir une valeur de vrit, cest--dire les
propositions), Lvi-Strauss appelle les constituants lmentaires du mythe des
mythmes (les plus petites formes propositionnelles capables dexposer
une relation pertinente entre les tres et leurs actes). Lorsque ces mythmes
ont t identifis, on les regroupe en catgories, et on ordonne ensuite ces
catgories en un rseau de relations dordre suprieur traduisant la
signification fonctionnelle du mythe.
La mthode lvi-straussienne danalyse du mythe est facilement
transposable lanalyse des rapports fournis par les sujets, durant les
entretiens dexplicitation de lexprience. Le procd se dcompose ici en
trois tapes :
1. Simplifier progressivement des fragments de discours. Les rapports
bruts sont souvent hsitants, longs, et rptitifs, ce qui est plutt rassurant,
car il y a des raisons de penser que ce caractre chaotique du discours est
un indice de plus que les sujets ont bien rhabit leur exprience au cours
de lentretien. Extraire des propositions simplifies partir de ce
matriau non dgrossi permet de fixer ce quon appellera des
descriptmes dexprience ;
2. Rassembler des descriptmes dexprience en catgories communes
plusieurs rapports et plusieurs sujets ;
3. Regrouper les catgories de descriptmes en tableaux montrant leurs
similitudes, leurs diffrences, ou leurs relations hirarchiques, ce qui
aboutit dgager des structures gnriques de lexprience vcue
118
.
Cette caractrisation rapide de la mthode dentretien dexplicitation
suffit attester quelle dtient de quoi surmonter lessentiel des objections de
principe lintrospection. Son choix de la rtrospection, pour commencer,
dsamorce demble le paradoxe comtien de la coextensivit du sujet et de
lobjet. Le sujet actuel ne concide dj plus avec lobjet exprientiel pass
de son tude. Pour autant, il nen est pas entirement dtach ; il reste capable
de lhabiter, den faire revivre une rplique voque , et de stablir en
contact intime avec cette dernire. Le sujet explicitant est la fois plus vaste
que son thme dtude (lexprience passe, dont son exprience prsente
contient la trace) et partiellement coextensif lui (par le biais de lexprience
voque, ou rejoue). Par ailleurs, le procd dtude rtrospective autorise
un dploiement verbal, une ex-plicitation soigneuse et consommatrice de
temps, l o lexprience originale na peut-tre dur que quelques secondes.
Le paradoxe temporel de Wittgenstein, cet cart entre le temps long de la
langue et le temps bref dun vcu synthtique, est ainsi court-circuit en
sappuyant sur la capacit quont les sujets ritrer leur exploration dun
moment dexprience, et utiliser de manire rpte les ressources ngliges
de leur mmoire pisodique. Lautre paradoxe temporel, celui de Kant, qui
opposait le caractre fluent de lexprience individuelle linvariabilit et
la reproductibilit requises par une authentique connaissance, est pour sa part
mis au repos par la technique de monte en gnralit : linvariance est ici
atteinte a posteriori, par la catgorisation des descriptmes dexprience
extraits tantt dune longue squence discursive provenant dune mme
personne, tantt dun grand nombre de rapports impliquant des personnes
diffrentes. Cest cette monte en gnralit opre par les chercheurs
travaillant catgoriser les rapports dexprience qui permet du mme coup
de contourner lobjection didiosyncrasie et de pure subjectivit des donnes
introspectives ; car identifier des invariants un niveau de conceptualisation
suffisamment gnral, revient (par dfinition kantienne) accomplir un acte de
constitution dobjectivit (ici, plus nettement, un acte de constitution
dintersubjectivit). Abordant ensuite les objections galement classiques de
la perturbation de lexprience par lacte rflexif, et de la validation
incertaine des connaissances tires de lintrospection, on saperoit quelles
sont affrontes par la mthode dentretien dexplicitation dans lesprit de
renouveau pistmologique qui a t esquiss prcdemment. En lieu et place
dune exprience perturbe, ce dont il est ici question est une exprience
voque, recre, suscite nouveau plusieurs fois, et ainsi rendue
contemporaine dun moment de sa description. Le rapport transpire de lacte
dvoquer une exprience, il lui est contemporain et coextensif (conformment
la thorie des bauches conscientes multiples), il catalyse le processus de
redploiement du vcu, au lieu de lui rester tranger et de risquer ds lors de
le distordre. Ce qui remplace ici la garantie absolue de fidlit un vcu
initial est la recherche dauthenticit
119
dans ladhsion du rapport
lvocation actuelle, dont peuvent sassurer aussi bien la personne interroge
que lenquteur travers son accordage empathique avec le sujet durant
lentretien. Mais ce point dappui de premire intention pour la validit des
rapports dexprience peut tre renforc par un bouclage de la procdure sur
elle-mme. La confiance quon a dans les rapports issus de lentretien
dexplicitation voit sa base affermie si lon procde un mta-interrogatoire
des sujets ayant subi dans un premier temps lexplicitation dun moment de
leur exprience. Par ce mta-interrogatoire men dans un second temps, on
roriente les sujets de lexprience initiale vers lexprience ultrieure quils
ont vcue lorsquils voquaient cette premire exprience et tchaient de
rendre leur rapport verbal authentiquement affine elle. Puis on value
lauto-consistance de lensemble constitu par les rapports et les mta-
rapports. Cette sorte dauto-consistance a t constate, et elle stablit un
niveau satisfaisant
120
. Lintrospection assiste, pratique selon les rgles de
lentretien dexplicitation, nest dcidment pas dnue de ressources pour
prendre soin delle-mme, autrement dit pour tayer par ses propres moyens
les prtentions la validit quelle avance. Cela sans compter la cohrence
externe entre les donnes de lentretien dexplicitation et certaines
configurations neurologiques dont la mise en vidence a t guide par lui
121
.
Mais les ressources dont dispose la technique dentretien dexplicitation
pour rhabiliter lintrospection vont bien au-del de ses arguments de mthode
contre les objections thoriques, de lextension de son domaine dauto-
consistance ou des soutiens externes que peuvent parfois lui apporter des
approches neuroscientifiques. Lentretien dexplicitation a en plus la capacit
mesurable doprer comme un facteur de fiabilisation des rapports par
lesquels chaque sujet caractrise ses propres oprations cognitives. On
dispose de preuves exprimentales que des jugements introspectifs
gnralement hasardeux, formuls par des sujets sur leurs modes de
fonctionnement cognitif, sont rendus beaucoup plus fiables lorsque lattention
de ces sujets est discipline et focalise par un entretien dexplicitation
122
.
tant un facteur attestable daccroissement de la fiabilit de certains rapports
dexprience en premire personne, lentretien dexplicitation se voit lui-
mme par ricochet lev au rang de procd de rfrence pour obtenir des
rapports crdibles. Cette aptitude particulire qua lentretien dexplicitation
daccrotre la fiabilit des rapports en premire personne est dautant mieux
assure quelle a t montre dans la configuration la plus difficile qui soit :
celle que Nisbett et Wilson
123
, et dautres auteurs aprs eux
124
, ont mise en
uvre pour retirer toute crdibilit lintrospection.
Commenons par dcrire lexprience de Petter Johansson et de ses
collaborateurs, amliorant les dispositifs de Nisbett et Wilson. Elle consiste
prsenter aux sujets deux photographies de visages humains durant un temps
limit, en leur proposant de choisir celui des deux visages qui leur semble le
plus attirant. Par la suite, on prsente nouveau lune de ces deux
photographies aux sujets, de faon durable cette fois, en leur demandant
dexpliquer les raisons de leur choix antrieur du portrait quils ont
maintenant devant leurs yeux. Lors de la seconde prsentation, certains de ces
sujets sont confronts au visage quils avaient slectionn initialement, mais
dautres se voient prsenter le visage quils avaient cart. Dans ce dernier
cas, des gestes subtils, proches de la prestidigitation, permettent de sassurer
quils ne saperoivent pas de la substitution des photographies. Or, parmi les
sujets que lon trompe dlibrment en leur demandant dexpliquer le choix
quils nont pas fait, moins dun tiers dentre eux saperoit de la supercherie.
Les autres, plus des deux tiers, entreprennent innocemment de dvelopper les
raisons du choix inverse de celui quils ont accompli. Cet chec massif, et
cette singulire propension justifier nimporte quoi, de faon aussi
convaincue que sil stait agi du vrai choix et des vritables actes cognitifs
utiliss pour ce choix, ont fait conclure la quasi-impossibilit de distinguer
entre de pures affabulations et les rapports introspectifs propos de ses
propres processus cognitifs
125
. Une telle conclusion dfaitiste a sembl tre
conforte par la dcouverte tout aussi surprenante que les rapports par
lesquels les sujets expliquent le faux choix sont aussi dtaills, et utilisent un
vocabulaire aussi riche, que les rapports de justification des vrais choix
126
.
Lhypothse qui a guid la recherche de Claire Petitmengin et de son
quipe
127
est que lchec massif des sujets sexplique non pas par leur
incapacit de principe accder introspectivement leurs processus
cognitifs, mais par lorientation des questions poses qui dflchit
immdiatement leur attention de lexprience vcue vers la rationalisation
rtrospective. Pour tester cette hypothse, lexprience de Johansson et
collaborateurs a t reproduite, mais sur deux groupes de sujets distincts. Les
sujets du premier groupe subissent exactement la mme preuve que celle des
sujets de Johansson, et ils sgarent aussi frquemment queux. Conformment
aux expriences prcdentes, ils ne dtectent la supercherie que dans 30 %
des cas environ. Les sujets du second groupe, pour leur part, se voient soumis
un entretien dexplicitation approfondi juste aprs quils ont accompli leur
choix et que les photos initialement prsentes leur ont t retires de devant
les yeux. Lentretien vise attirer leur attention vers leur procdure de choix
passe, vers les critres quils ont utiliss, vers les traits du visage choisi
(dsormais invisible) qui ont attir leur sympathie ou leur intrt. la suite de
lentretien, lpreuve est de nouveau la mme que chez les sujets du premier
groupe : on leur montre une photo qui peut ne pas correspondre leur choix
initial, et on leur demande de dire pourquoi ils ont choisi celle-l. Les sujets
du groupe explicit se distinguent dabord en ce que les explications quils
donnent de leur choix sont plus prolixes et prcises que celles du groupe non
explicit. Surtout, 80 % des sujets explicits saperoivent immdiatement de
la supercherie lorsquil y en a une. Leur contact prolong avec lexprience
passe de confrontation aux photographies, qua favoris lentretien
dexplicitation par le procd de la rvocation, les a rendus plus lucides sur
les raisons quils ont eues de choisir un visage, et, ds lors, beaucoup plus
aptes dtecter les ventuelles tromperies ; mieux, lorsquils ont exposer
leurs raisons, ils ne se contentent plus de gnralits mais dploient toutes les
modalits concrtes dun examen soigneux et dune dcision motive.
En surinterprtant ces faits exprimentaux spectaculaires, il est tentant de
considrer quils rendent caduque la stratgie jusque-l employe, qui
consiste protger la prtention la vrit de lintrospection en labritant
derrire une conception de la vrit-cohrence pragmatique. Ces
remarquables rsultats ne montrent-ils pas quon peut atteindre rien de moins
quune correspondance terme terme entre le rapport final en premire
personne et lexprience initiale des sujets ? Ne nous htons pas de conclure.
Par-del la remarque lmentaire dj faite quil nest pas question ici dune
correspondance entre lexprience raconte et lexprience initiale, mais entre
lexprience raconte et une trace tmoignant du choix initial, rflchissons
avant daller plus loin aux 20 % de sujets qui sont tombs dans le pige de la
substitution photographique malgr leur entretien dexplicitation
intermdiaire. Comme dans le cas standard, les sujets qui ne saperoivent
pas de la supercherie aprs lentretien dexplicitation fournissent des
justifications aussi fines, aussi dtailles, aussi apparemment sincres de leur
faux choix que les sujets qui expliquent leur vrai choix. Cela rintroduit un
fort doute quant linfaillibilit dun procd introspectif qui rechercherait la
stricte correspondance avec lexprience initiale de contact des visages
prsents. Pour autant, cela ne suffit pas disqualifier laccs introspectif aux
processus cognitifs du choix, puisquune trs forte proportion des sujets ne se
laisse pas berner. On retrouve donc un point dquilibre dans lassignation de
validit aux rapports dintrospection : ils noffrent pas de garantie absolue de
correspondance avec lexprience antrieure quils relatent, et pourtant ils
sont affects dun coefficient dauthenticit qui peut tre considrablement
accru par un travail de mise en vocation et de rcollection de lattention,
augmentant du mme coup la probabilit daccord du rapport avec le choix
initial. Mais ce nest pas tout ; on peut aller plus loin que cette remarque
gnrale dordre pistmologique, et analyser la manire dont les sujets
parviennent ltat de sincrit qui sous-tend leur compte rendu explicatif. Le
procd de la mise en authenticit des rapports est accessible lentretien
dexplicitation, tout autant que lexprience sur laquelle porte chaque rapport.
Durant lentretien qui prend place entre les deux prsentations de
photographies, les sujets se sont vu demander quel type dacte mental ils
avaient mis en uvre pour opter entre les deux visages prsents. Leurs
rponses les rpartissent en deux sous-ensembles principaux : ceux qui
dtaillent les traits visuels des visages et les comparent deux deux, jusqu
parvenir un choix motiv ; et ceux qui se concentrent sur les sentiments
quils prouvent la vue globale des visages, puis se dcident en fonction de
ces sentiments. Or, tous les sujets ayant chou dtecter la supercherie de la
substitution finale de la photographie non choisie par eux ont dclar avoir
opr par valuation de leurs sentiments globaux. Par ailleurs, les deux tiers
des sujets ayant opr ainsi ont chou dtecter la substitution
128
. Le sens de
ces rsultats est clair. Les sujets tromps sont aussi authentiques dans leur
rapport dexprience que les sujets non tromps. Cette authenticit ne se relie
toutefois en rien la perception initiale, elle ne garantit aucune
correspondance avec le peru antrieur ; elle consiste en une cohrence
interne entre le rapport introspectif et lexprience prsente des sujets,
voque durant ce rapport. Ceux des sujets dont la tactique de choix tait
visuelle voquent ultrieurement une exprience visuelle, et leur rapport final
est parfaitement cohrent avec une telle vocation. Ceux des sujets dont la
tactique de choix tait essentiellement affective voquent pour leur part une
exprience de ressenti, et leur rapport final est galement cohrent avec leur
vocation. Mais la cohrence avec une exprience voque dordre affectif
offre beaucoup moins dassurance dune adquation avec la perception
initiale quune exprience voque dordre visuel ; lauthenticit affective
peut parfaitement saccompagner dune occultation perceptive. Au total, le
point dappui central du rapport dintrospection demeure bien la cohrence
interne de lexprience associant sa formulation et un acte dvocation ; mais
cette cohrence saccompagne dune trs forte probabilit de correspondance
avec une exprience perceptive antrieure, lorsque lacte dvocation porte
lui-mme sur des traits perceptifs. Quil ait t possible de constater
objectivement cette forte probabilit de correspondance met lintrospection
dfinitivement labri des accusations daffabulation
129
.
Il reste examiner en dtail comment la mthode dentretien
dexplicitation, marque par son usage intensif du langage et du dialogue,
affronte lobjection classique dineffabilit de lexprience. Il a t suggr
prcdemment, sur un mode mtaphorique, que le rapport transpire en
quelque sorte de lexprience en phase dvocation. On pourrait ajouter, pour
faire mieux ressortir la coextensivit du langage introspectif et de
lexprience quil cherche dire, que Tout entier prsence, [ce langage-l]
ne reprsente [ne signifie] plus rien
130
; quau lieu de figurer un moment
vcu, il en est comme la doublure. Mais sen tenir l serait un peu court.
Linquitude rpandue sur la capacit qua le langage ordinaire de vhiculer
ou de rendre les subtilits de notre vie exprientielle
131
doit tre apaise de
faon plus prcise, en identifiant sa racine pistmologique.
Deux prsuppositions informules (et discutables) sous-tendent lopinion
commune selon laquelle les variations, les nuances, le dploiement temporel,
en somme la pleine richesse de lexprience vcue, sont hors de porte du
langage.
La premire prsupposition est prcisment que le langage na pour
fonction que de rendre les dtails vcus, ou de reprsenter bien ou mal
un aspect de ce qui arrive dans la conscience. Cela va de soi dans le cadre de
la conception dualiste standard de la connaissance introspective (et de la
thorie correspondantiste de la vrit qui laccompagne), mais perd toute
pertinence lorsquune conception participative de lauto-connaissance, et une
thorie de la vrit comme cohrence gnralise, sont retenues sa place.
Dans ce dernier cas, ce qui doit tre recherch nest pas tant une transcription
image ou une correspondance biunivoque entre une unit linguistique et un
lment du monde priv quune expression communicable de la richesse de
lexprience se dployant. Le mot expression , on le sait, a t adopt par
Wittgenstein
132
pour dnoter lusage que nous faisons de la langue lorsque
nous cherchons signaler dautres personnes une douleur prouve, une
sensation peine chue, ou plus gnralement une exprience vcue.
Contrairement ce que laissait penser lassociation troite des verbes
rendre et vhiculer dans la phrase prcdemment cite, il est ici
entendu que le langage peut signaler une exprience sans avoir besoin de la
rendre dans toutes les particularits fines de sa texture. Lacte expressif au
sens wittgensteinien renvoie en premire approche un mode primitif de
communication pouvant se rduire un grognement, ou une interjection
permettant de signaler ou de vhiculer une douleur ressentie, un plaisir
prouv, une peur envahissante, et dveiller un cho empathique de ces
expriences chez des alter-ego humains. Les sons mis le sont le plus souvent
sans intention de transmettre quoi que ce soit, comme sils taient dclenchs
par lintensit de ce qui se vit, secrts par le corps ptissant, et quils
participaient organiquement de son ptir. Cest cette contemporanit, ou cette
coextensivit, qui leur confre un statut part, peut-tre originel, dans le
langage ; un statut qui supprime la distance entre le dit et le dire, et qui assure
presque automatiquement une forme dauthenticit. Grognements et
interjections ne sont cependant que lamorce trs fruste dune ressource
dchange intersubjectif dont les possibilits sont quasi illimites. Rien
nempche de raffiner cette ressource dans le but datteindre un degr lev
dentente discriminante propos des tats exprientiels. La mtaphore, la
mtonymie, le dplacement dun vocabulaire de sensations vers un domaine
dmotions, la projection dun ordonnancement spatial concret sur le domaine
mental, sont couramment employs cet effet. Chaque image nouvelle, chaque
association indite, laisse pressentir une exprience jamais singularise
jusque-l mais susceptible dtre partage ; et chaque rptition dimages ou
dassociations rinstalle les participants du jeu expressif dans un contexte
dexprience quils ont dj prouv ou avec lequel ils ont dj rsonn.
Mais, au fait, que peut bien signifier entente intersubjective dans ce cas ?
Cela ne peut pas vouloir dire quon atteint une similitude de jugements sur
quelque chose de publiquement accessible. Cela signale plutt quon est
capable de susciter une exprience dans lauditoire par des mots, et dvaluer
la pertinence des mots reus en retour, jusqu sassurer dune cohrence
optimale entre les phrases exprimant lexprience directe de lun et les
phrases exprimant lexprience suscite puis reconnue par lautre. Ici, le type
dacte de langage impliqu nest manifestement pas locutoire (au sens de
John Austin), puisquil ne vise pas dsigner une chose que chacun peut voir.
Il est nouveau plutt perlocutoire, quoiquen un sens trs particulier, dans la
mesure o son rsultat nest pas tant de faire faire quelque chose quelquun
que de lui faire vivre une exprience. Lacte de langage expressif incite
linterlocuteur raliser pour lui-mme une certaine exprience aprs lavoir
(r)engendre ou voque analogiquement, et valuer, par son action en
retour dans le dialogue, la justesse du vocabulaire qui a t employ cet
effet.
La seconde prsupposition discutable est quun accord entre personnes
propos dune exprience vcue doit forcment tre illusoire. coup sr,
laccord ne peut quchouer si les connotations de prpositions comme
sur , ou propos de sont prises au pied de la lettre. Comment deux
personnes seraient-elles en mesure de sentendre sur une occurrence
prive , ou subjective ? Et, a contrario, quel intrt pourrait avoir une
telle entente, si lutilisation mme dun langage introspectif rendait toute
divergence propos dun pisode de lexprience vcue dun sujet
impossible en principe ? Ici encore, ces questions nadmettent pas de rponse
(et surtout pas de rponse positive) ; elles se dnouent par changement de
paradigme pistmologique. Ltre--propos-de est tout simplement dnu de
pertinence lorsquil sagit du langage de lexprience. Le genre dentente dont
nous discutons ne se fait pas sur quelque chose, mais dans un processus
daccordage mutuel. Il sagit dune entente sans vritable objet, surgissant au
fil dune dynamique dinvitations rciproques avoi r certains types
dexpriences. Cette faon non rfrentielle, mutuellement rverbrante, de
comprendre le langage de lexprience a t esquisse par Husserl
133
, et elle
a t dveloppe sporadiquement dans lhistoire ultrieure de la
phnomnologie. Lun des textes les plus aboutis concernant le langage de
lintrospection est sans doute celui du phnomnologue et philosophe post-
kantien John Findlay
134
. Selon cet auteur, nous tentons souvent de montrer
quelquun quoi ressemble un genre donn dexprience, en le plaant dans
une situation o il a effectivement ce genre dexprience
135
. La situation de
partage peut tre cre non seulement en proposant lautre personne de
changer de point de vue pour sinstaller dans le ntre, mais aussi et surtout en
utilisant des phrases dotes du pouvoir vocateur dune terminologie
analogique, et en suggrant implicitement linterlocuteur de leur chercher
une signification plausible dans sa propre exprience. La teneur smantique de
ces phrases nest donc fixe davance par lautorit daucun geste ostensif,
mais elle surgit dun jeu transexprientiel dans lequel les protagonistes
rpondent lorsquils pensent avoir identifi lexprience suggre, par
rsonance avec leur propre itinraire vcu. Les expressions introspectives
surgissent spontanment dans la parole de divers locuteurs, et crent leur
propre sens mesure que cette parole se dploie
136
. Les phrases
dintrospection de lun des protagonistes de lchange produisent leur sens, en
induisant ou en prcipitant chez lautre un flux dexprience quasi-
hallucinatoire quil sait provenir de sa rsonance intime avec la langue inoue
quil vient dentendre. Ces paroles dinduction mtaphorique se trouvent
ensuite stabilises et intersubjectivement acceptes par un processus de
circulation et de rciprocit dusage dans lequel leur emploi est peru (pour
ne pas dire vcu) comme adquatement expressif. Un tel processus tant
acquis, il ny a plus de raison de considrer que le langage constitue un
obstacle ou une limitation dans la transmission des expriences. Le langage
introspectif contribue au contraire cultiver et raffiner les vcus, travers
le processus dadoption de critres partags de discrimination intra-
exprientielle par lequel une communaut finit par saccorder sur une
terminologie. Il aide chacun dentre nous individualiser diverses nuances de
lexprience qui passeraient inaperues et indiscrimines sans lui. Il est
facilitateur dune richesse psychologique, bien loin de ne faire que traduire
une vie psychique. Sur la base de cette richesse induite, le langage introspectif
peut galement servir de guide la ractivation dexpriences passes, ou
dexhortation lmergence dexpriences indites. Une amorce verbale suffit
parfois nous plonger dans un monde vcu ou revcu, tout comme une seule
vibration traversant un pavillon rsonant fait jaillir une symphonie
dharmoniques. Au total, le langage introspectif ne porte pas sur
lexprience ; il suppose un milieu dexprience, il en merge, lorganise, le
(r)active, le cristallise, le raffine, lenrichit, et le rend identifiable par
dautres tres capables dexpriences.
Une telle intensit dentrelacement entre le langage de lexprience et
lexprience exprime par le langage saccorde bien avec la thorie des
bauches conscientes multiples. Selon cette thorie, il ny a pas dun ct un
contenu de conscience parvenu sous les feux de la rampe et de lautre un
rapport verbal qui rend compte de son spectacle. Chaque squence
dexprience est indissolublement associe une trame proto-narrative ; et la
squence dexpriences tenue pour consciente est celle dont la proto-
narration a conflu avec la narration, dont le rcit a t intgr au fil majeur
de lautobiographie. Lexprience et son expression ont ici partie lie ds le
dbut. Certes, lexprience et son expression ne sont pas strictement
identiques (contrairement ce que veut faire croire Dennett dans ses moments
les plus liminativistes), mais elles sont individuellement et collectivement
interconvertibles, la premire tant structure et articule par la seconde,
tandis que la seconde est inductrice et organisatrice de la premire.
La mfiance ancienne de la psychologie lgard de lintrospection a en
fin de compte de bonnes chances de disparatre de la mme manire que la
mfiance des astronomes pr-galilens vis--vis de la lunette astronomique.
La lunette, accusaient les philosophes de la nature dobdience
aristotlicienne, ne fournit quune image artificiellement dforme par les
lentilles. Persuads par cette accusation, ces philosophes allaient jusqu
refuser de regarder travers linstrument optique, de peur dtre captivs par
une illusion. Leur prvention na pas t vaincue par la seule optique
gomtrique, et par lassurance formelle quelle donnait dobtenir une image
fidle aux astres travers les verres courbes de la lunette. Car loptique
gomtrique ntait elle-mme quune jeune thorie, en attente de
corroboration. La suspicion des aristotliciens a t submerge par le
mouvement mme des pratiques, au fur et mesure que lusage du tlescope se
gnralisait, que la cohrence et la fcondit des informations qui en taient
tires saccroissaient, et que la thorie optique de son fonctionnement se
voyait soutenue par lefficacit des interventions technologiques conduites
sous sa prsupposition ainsi que par sa connexion oprante avec dautres
domaines de la connaissance. Lintrospection a galement subi une longue
priode de purgatoire, pendant laquelle la plupart des chercheurs refusaient
den (re)forger les mthodes et de la pratiquer fond, de peur de sgarer
systmatiquement. Son utilisation croissante (sous des formes modernises),
la cohrence et le pouvoir heuristique des informations quelle fournit et son
interconnexion avec plusieurs domaines des sciences cognitives devraient
avoir raison de la fin de non-recevoir qui lui a t oppose dans un pass
rcent. Puis, partir du moment o lart et la connaissance introspectives se
gnraliseront, les paradoxes dun discours distanci sur la conscience, sur
ses problmes difficiles et ses gouffres explicatifs , svanouiront
deux-mmes au profit dune pratique au cur de la conscience. Dans une
culture ayant intgr lattitude rflexive et la capacit en changer
verbalement le fruit, on ne recherchera plus lorigine de la conscience dans un
processus objectif, mais, conformment la figure du chiasme, on saura
reconnatre le nud redoubl de lobjectivation et de la conscience originaire
en son unique fil de prsence.
QUESTION 14
Que voudrait dire vivre sa propre mort ?
Bien sr que tout a se passe dans ta tte, Harry, mais
pourquoi diable cela voudrait-il dire que ce nest pas
rel ?
J.K. Rowling
La survalorisation de luniversel, la prescription de focaliser lattention
sur ce qui vaut partout et toujours quitte perdre le got de ce qui arrive au
moment o cela arrive, font partie de notre hritage civilisationnel. En mme
temps, comme le signale Franois Jullien
1
, lexcs mme de cette injonction
est gnrateur de rvoltes priodiques visant rhabiliter le singulier et le
vcu, en-de du gnral et du conu. Cest ce genre de rvolte quexprime
par exemple Tolsto, citant ses monologues intrieurs : Je sais, me dis-je
moi-mme, ce que la science cherche si constamment dcouvrir ; et le
long de ce chemin il ny a aucune rponse la question du sens de ma vie
2
.
La pulsion vers luniversel laisse derrire elle une dchirure durement
ressentie dans le tissu de lexistence. Mais aucun autre vnement que celui de
la mort ne concentre davantage en lui llancement de cette lacune.
Les sciences offrent une description de plus en plus dtaille des
processus qui se droulent dans les organismes vivants, et par voie de
consquence une description claire des vnements qui conduisent la mort
des tres vivants. On peut rsumer ces acquis en dclarant que la mort dun
organisme survient lorsque lhomostasie globale de ses cycles mtaboliques
ne peut plus tre maintenue, en raison de son puisement interne ou dune
perturbation extrieure damplitude plus grande que son seuil de rsilience.
ct de cela, les sciences nont rien de pertinent dire sur lexprience
directe, situe, exclusive, de la mort. Elles nont mme pratiquement rien
mapprendre sur ce que cela me fait dtre en train de mourir. Peu de
chercheurs scientifiques se contentent pourtant de ces aveux dignorance.
Enchans par une idologie sous-jacente, ils affirment habituellement tre
certains que lexprience de la mort est pur nant , et que rien dautre nest
ajouter sur ce point. Leur conviction est analogue au vers concis dHorace :
omnis una manet nox
3
(une mme nuit nous attend tous). Mais cette
dclaration, aussi courante et crdible soit-elle, se contente de projeter un fait
objectif sur le plan de la subjectivit, de plaquer une ide abstraite sur le
concret vcu. Lexprience partage de la dcomposition dun corps humain
au cours du temps se trouve simplement transpose en lintellection dune
non-exprience durable de qui possdait ce corps. Aucun examen soigneux
des conditions de validit dune telle transposition nest gnralement
effectu.
Avant de poursuivre cette amorce de rflexion sur larticulation entre
luniversel pens et le singulier vcu, un pralable utile est de rinterroger les
consquences thiques et esthtiques dune vision du monde dans laquelle la
seule ralit et le seul critre de vrit sont objectifs. En particulier, on peut
se demander quel en est le contrecoup sur lapproche moderne de la mort.
Cest peut-tre travers laccroissement continu de la reprsentation de la
mort dans les productions audiovisuelles, quil sagisse de films de fiction
4
ou dactualits tlvises, quon peut le mieux approcher ces consquences.
La question devient alors : pourquoi les images les plus largement diffuses
dans le grand public donnent-elles si souvent en spectacle la violence extrme
et la mort donne ou subie ? De nombreuses explications sociologiques ou
politiques ont t fournies de ce phnomne culturel
5
. Mais il pourrait bien y
avoir dautres faons plus philosophiques de le comprendre, en explorant la
configuration dtre-au-monde quimpose la recherche oblige de luniversel.
Limpratif duniversalit implique que le seul mode dexistence reconnu
est celui de lobjet : lobjet de pense, lobjet dexprimentation, lobjet du
regard. Ds quune question est considre comme essentielle, le seul moyen
de lui confrer un statut collectivement acceptable consiste lextruder du
continuum vcu, et la figurer sous les traits dun objet prsentable tous.
Axel Honneth nomme ce procd la rification , loppose lengagement
participatif, et lui prte comme consquence socio-conomique la
marchandisation des changes entre tres humains
6
. Or, il est trs
problmatique de traiter la mort de cette faon. Car ce qui importe vraiment
en elle, ce qui la rend mystrieuse, souvent terrifiante, parfois hypnotisante,
est lunicit de lexprience qui laccompagne, le fait que personne dautre
que celui qui participe de lpreuve ne peut en connatre quelque chose qui
vaille pour lui-mme. Aucun ouvrage scientifique na de quoi adoucir le sens
de linconnu radical que nous percevons son gard. Nous sommes par
essence seuls face ce singulier vnement notre horizon.
Notre culture est en somme cartele entre lunicit vridique de
lvnement de la mort et sa croyance quune vrit ne peut tre quobjective,
cest--dire commune tous. Il nest pas tonnant que la seule raction quelle
puisse exercer face la mort dans le cadre de sa conception du monde biaise
est de la reprsenter comme un objet visuel, de manire obsessionnelle, avec
un mlange de fascination et de rpulsion. La mort cinmatographiquement
visible est plonge dans une atmosphre dautant plus fantasmagorique,
paroxystique, gratuite
7
mais commercialement exploitable que sa
reprsentation en tant quobjet est compltement inadquate. Nous savons que
presque rien de ce qui compte dans lvnement de la mort ne peut tre
exprim en troisime personne, comme si elle ne pouvait tre que la mort de
lautre. Mais nous avons dlgitim tout autre procd de communication.
Nous utilisons donc ce moyen dexpression univoque sur un mode compulsif,
de plus en plus compulsif, parce que nous nous rendons compte que cest en
vain.
Quelque chose de la premire personne est cependant prserv (comment
pourrait-il en aller autrement ?) dans cette projection de la mort sur cran.
Cest celle dun sujet passif, en retrait, cal confortablement sur son sige, en
tat de quasi-dprivation sensorielle, lexception de la source lumineuse et
sonore du cinma. Le sujet spectateur mime sy mprendre le sujet
transcendantal abstrait qui demeure larrire-plan lorsque tout, non
seulement son environnement mais aussi son corps, a t objectiv. Or, que vit
ce sujet auto-transcendantalis ? Rien de moins que lapparence de sa propre
immortalit, puisquil est toujours l pour contempler nimporte quelle
squence tragique dvnements survenant dans lunivers virtuel. Mme
lorsquun film procure au spectateur le choc motif de voir la mort approcher
du point de vue de son hros, et quil clt soudainement la squence en faisant
tomber une nuit noire cense reprsenter (sur le mode dHorace) ltre-mort
de celui dont on a habit quelques minutes le regard, un tmoin demeure pour
sapercevoir de lobscurit et du silence. Un tmoin qui, une fois la
commotion passe, va rinvestir son corps, ses proprioceptions, et sa position
dans la salle pauvrement claire par des flches indiquant les sorties de
secours. Ce procd permet sans doute de dflchir artificiellement, bien qu
court terme, langoisse de mourir. Car une mort objective jusquau mime de
son vcu subjectif reste distance respectable, et laisse donc entendre son
spectateur quau moins pour cette fois, il nest pas personnellement concern.
Mais mme cette faon de prendre en charge lexprience en premire
personne de la mort nest rien de plus quune allgorie trompeuse. Elle revient
confondre Je avec mon corps, le Je-sujet avec le Je-objet, dirait
Wittgenstein
8
. Sil y a dans le monde, et non plus seulement dans la salle de
cinma, un tmoin rsiduel de ltre-mort, celui-ci na aucune chance
dprouver un corps, ni davoir des souvenirs, ni de ressentir des motions
lies lhistoire de ce corps. Tout au plus pourrait-il stre dilat en une pure
exprience sans contenu, sans rflexion, et sans souvenirs associs. Lultime
tmoin ne serait certes pas inexistant, par hypothse, mais il naurait aucune
parent avec quelque chose que ce soit. Priv de traces mnmoniques, il
aurait si bien perdu ses attaches avec le temps quil serait incorrect de
prtendre quil survit au corps spatio-temporel ; on aurait plutt envie de dire
quil est contemporain de tout ce qui arrive et de tout ce qui a cess darriver,
quil se laisse traverser par le temps de ce dont il tmoigne sans en retenir la
coloration.
Ni les sciences ni le cinma nayant offrir un aperu crdible sur
lexprience en premire personne du mourir et de la mort, il faut chercher
dautres sources. La source philosophique est assez riche cet gard, mme si
elle nous fait elle-mme douter de son aptitude nous conduire au cur de
lnigme par le seul maniement de labstraction. En manifestant par ce doute
quelle bute sur sa propre limite, elle rvle malgr elle sa nature, qui est
celle dune tentative hroque (et peut-tre dsespre) pour capturer dans le
langage commun ce qui est insurmontablement singulier.
Bien que la rptition nen garantisse pas la fiabilit, il est frappant de
constater qu propos du vcu de la mort, la philosophie non religieuse scande
un thme directeur quasi unique au cours de son histoire. Son expression
canonique a t faonne par picure : La mort nest rien pour nous, puisque
lorsque nous existons la mort nest pas l et lorsque la mort est l nous
nexistons pas
9
. La nuit dHorace est ici remplace par rien, ni nuit ni
jour, ni prsence ni absence (qui serait ncessairement ressentie). Un rien o
il ny a vraiment rien voir, parce que lexprience de rien nest nulle
exprience. Un rien qui ne mrite donc mme pas quon le dsigne par le
substantif nant , et encore moins quon sen soucie comme dune entit
nomme. Deux millnaires aprs, Wittgenstein na presque rien ajouter
cette vrit du rien, qui semble ainsi tre devenue prenne : La mort nest
pas un vnement de la vie. On ne vit pas la mort
10
. Lun et lautre, celui
dpicure et celui de Wittgenstein, sont des noncs semi-paradoxaux sur la
mort en premire personne. Ils visent exprimer ce que cela fait de ne pas
tre un sujet, ou, si lon veut jouer sur les mots, ce que cela fait dtre un sujet
non-tant. Sil ny a pas de sujet, alors il ny a aucun objet considrer, et par
consquent nulle chose comme la mort conue objectivement. Du seul point de
vue qui (m)importe, savoir le point de vue en premire personne, il ny a
rien de tel que ma propre mort , parce que Je-mort nest pas un sujet apte
en faire un objet pour lui. Cette remarque de bon sens a frquemment servi de
point de dpart pour une infrence du nunc stans , autrement dit de
lternel prsent. La fin du prsent est inconcevable, et surtout inprouvable,
parce quil faudrait encore une prsence pour la constater. Le prsent est sans
fin, faute de quoi que ce soit dextrieur lui pour le d-finir. Une expression
classique de cette infrence associant des thmes picuriens, no-platoniciens
et vdntins se trouve chez Schopenhauer, et elle a clairement servi
dinspiration Wittgenstein. Comparant tour tour le maintenant un soleil
lumineux, une position quelconque sur la surface de la Terre, la vie mme
dont il est le front incandescent, Schopenhauer dclare : Craindre la mort
parce quelle nous enlve le prsent, cest comme si, sous prtexte que la
boule terrestre est ronde, on se flicitait dtre par bonheur en haut, parce
quailleurs on risquerait de glisser en bas
11
. L o on se trouve sur le globe
terrestre est toujours le haut ; l o on se trouve dans le temps (ou, plus
prcisment, l o se situe le point de vue sur le temps) est toujours
maintenant. Pas plus quon ne peut perdre l ici ou le fuir, on ne peut ni
garer le prsent ni sen chapper. travers cette conception post-kantienne
de Schopenhauer, on retrouve un quivalent plus rigoureux des rflexions
prcdentes sur latemporalit de lultime tmoin hypothtique de ltre-mort.
Le temps tant la forme de la sensibilit prsente dun tre percevant,
concevant, vivant, il ny a pas de temps du non vivant, pas d aprs aprs
la mort, et, par suite, aucun prsent y perdre. Si le temps est linstrument
quengendre un sujet pour transformer les contradictions en successions
12
,
alors un tel sujet ne saurait avoir aucune fin dans le (dans son) temps ; tout au
plus peut-il se reconnatre un point de fuite concidant avec labsence de
temps.
Une uvre assez rcente mrite une mention particulire, parce quelle
soutient la proposition philosophique archtypale sur le mourir page aprs
page dun fort volume de rflexions serres, comme si elle avait entrepris de
transformer le rien que mentionne en passant picure en une immense
chambre dchos pour la pense. Il sagit de La Mort, de Vladimir
Janklvitch
13
. Dans ce texte, Janklvitch distingue nettement les points de
vue selon les trois personnes. Il consacre un chapitre entier ltude explicite
de la premire personne et en signale les consquences formidables,
intellectuellement scandaleuses mais existentiellement triviales, pour la
conception de la mort. Ma mort moi nest pas la mort de quelquun, mais
elle est une mort qui bouleverse le monde, une mort inimitable, unique en son
genre et nulle autre pareille
14
. Sil en va ainsi, la mort ne peut tre
aborde bon escient que par une philosophie de la partialit, une
philosophie qui a appris rester centre sur la vue situe quitte perdre sa
rputation dquit. Tout, dans lexprience de ma propre mort, sort de
lordinaire contempl pour tre remplac par un extraordinaire vcu. Ici
concident lobjet de la conscience et le sujet du mourir
15
. Lobjet sans
gal quest le fait de ma mort na aucune chance dtre saisi sil reste
distanci, et son tre suppose donc paradoxalement quil soit aboli dans un
mixte indistinct avec moi qui le vis. Lvnement de ma mort agit comme un
attracteur qui maspire en lui au moment mme o il est aspir en moi. La mort
en premire personne est cette trange occurrence dont ladvenue quivaut
rsorber le futur dans le prsent, mais qui en tout prsent constitu demeure
sans cesse venir. La mort, crit Janklvitch, est le seuil du temps et du
non-temps
16
.
Ces efforts pour marquer du sceau de lintelligible une configuration
seulement vivable sont impressionnants. Aussi instructifs quils soient, ils sont
malheureusement vous lchec. La raison de la dconvenue est facile
comprendre : linstar des chercheurs scientifiques, bien qu un degr plus
lev de raffinement, les philosophes de la ligne picurienne nont pu
sabstenir entirement dobjectiver la mort propre. Ils ont continu projeter
sur le plan de lexprience une comprhension en troisime personne de la
mort, quitte la travestir en premire personne. Ils ne se sont certes pas
contents de transposer en nuit ou en nant vcu lanantissement
visible de la forme du corps. Mais ils ont jou avec les concepts de sujet et
dobjet en les posant devant eux, puis en sidentifiant lun dentre eux. Le
sujet est devenu pour les philosophes post-picuriens un objet supplmentaire
de pense, ainsi que le montre son corps dfendant la belle image de la
concidence du sujet avec lobjet dans lavnement de la mort. Ils nont vit
de sarrter un angle exclusivement distanci quen faisant effort pour se
figurer ce que cela ferait dtre un tel sujet pig par sa solidarit ontologique
avec un objet-corps en dcomposition. Le problme est que mme leur
entreprise dempathie encadre, de glissement figur dans la peau du sujet
mourant, relve de la vue de nulle part quil sagissait pour eux dviter.
Toute lopration est perue par un tmoin externe (le philosophe) qui
sarroge le pouvoir de contempler volont le dehors et le dedans du mourir,
la fin dun corps vivant dans le temps et les consquences toujours-encore
prsentes de cette fin pour un sujet conu comme organiquement li au corps.
Le dedans dont il est question nest quun fait dimagination pour le penseur
dtach. La vue de quelque part si ardemment recherche reste une
construction factice de la vigie des mondes.
Comme le reconnat volontiers Janklvitch, si lon aspire trouver une
source dinformation de premire main sur la mort en premire personne, il
faut sloigner provisoirement de la philosophie et sappuyer sur la littrature,
sur des rcits personnels ou sur des textes sacrs
17
lus comme expressions de
vcus originels sanctuariss par une tradition. La littrature mondiale, tout
dabord, fait entendre de nombreuses voix de mourants, ou de revenants au
sens premier de revenus dun tat de mort atteste. On en trouve par exemple
chez Rainer Maria Rilke, dans son Livre dheures et sa huitime lgie de
Duino, dans la Mort dIvan Ilitch, de Lon Tolsto, et surtout dans La Mort
de Virgile, dHermann Broch
18
. Ce dernier roman met en scne un personnage
de Virgile vivant ses derniers instants et parlant presque en permanence de
son exprience vcue de mourir. Son monologue se concentre tantt sur le
processus mme de la mort imminente, tantt sur ses souvenirs et ses derniers
devoirs de vivant. la fin de la deuxime partie du livre, Le Feu , Virgile
senfonce dans un profond sommeil dagonie, passant trs prs de la mort
avant de bnficier dune rmission
19
. Il est alors emport par un murmure
trange, un murmure qui parle son cur, ses yeux, son odorat au moment
mme o il atteint ses oreilles. Il peroit une voix qui ressemble une toile,
une nuit qui a la brillance du jour, un grondement docan qui a la couleur de
lautomne. Et ainsi de suite. Toutes les modalits sensorielles sont mles ; la
morale et le bonheur mergent, indistincts. La clart nocturne, comme
paradigme des confluences sensibles et des clatements catgoriels, est
confirme par Ivan Ilitch et quelques autres hros de Tolsto qui notent,
merveills, qu la place de la noire mort redoute, il ny a que la lumire
20
.
Ces descriptions littraires entretiennent une parent frappante avec les
narrations dsormais nombreuses dexpriences de mort imminente ( near
death experiences )
21
, qui associent typiquement une perception de sortie du
corps propre, un voyage travers un tunnel oppressant mais ouvert son
extrmit distale, une fusion des modalits sensorielles, une rencontre
affective avec la forme thre des anctres, et surtout une fusion terminale,
associe un sentiment dternit, avec une lumire blanche radieuse
daimer
22
. Les comptes rendus recueillis, leur tour, voquent fortement les
descriptions mystiques et dantesques dun paradis vcu comme fusion avec
lclat divin. Et ils rsonnent avec la description prcise que fournit Le Livre
des morts tibtain
23
dune exprience du mourir culminant avec la perception
de la claire lumire au cours de ltat intermdiaire du bardo ; une ralit
extrme qui se compare au ciel vide sans nuages, un espace dnu de centre
et de priphrie, non sans ressemblances avec la clbre mtaphore tho-
gomtrique de Nicolas de Cues.
Que penser prsent de ces lments narratifs et de leurs remarquables
analogies ? premire vue, seules deux options interprtatives sont
disponibles. Mais jajouterai un peu plus loin une troisime option qui, si elle
tait adopte, reprsenterait la plus authentique victoire contre notre
crispation exclusive sur luniversel. Les deux options standard consistent
proclamer que les rcits en premire personne de la mort frle sont soit
littralement vrais, soit littralement faux, de faon apparemment
conflictuelle. Ceux qui soutiennent que les rcits sont vrais
24
veulent dire que
leurs auteurs revenants dcrivent des entits rellement existantes , au
mme titre que les choses matrielles le sont. ceci prs que leurs objets de
description, comme lesprit capable de se dtacher du corps, lEden, les mes
des disparus, ou le Dieu damour, existent dans une dimension surnaturelle du
monde habituellement cache aux regards, au lieu de stendre dans la nature
manifeste. Quant ceux qui affirment que les rcits sont faux ou illusoires, ils
sont convaincus quils ne rapportent rien dautre que des expriences plus ou
moins oniriques, rsultant dtats hautement altrs de la physiologie
crbrale. Des donnes exprimentales sont invoques lappui de leurs
dires. Ainsi, le pouvoir quont certaines substances anesthsiantes comme la
ktamine
25
de susciter artificiellement la sensation de sortie du corps suggre
analogiquement une cause biochimique de ce phnomne. Des arguments en
faveur dune chronologie inverse, o lexprience de mort imminente serait
(peut-tre) corrle au dbut du rveil crbral post-comateux plutt qu la
fin de son processus deffondrement mtabolique, sont par ailleurs invoqus
contre sa lecture surnaturaliste qui en fait une exploration de lau-del
26
.
Et, mme si ce nest pas le cas, ajoute-t-on, mme si cette exprience est bien
vcue durant le moment le plus critique de descente dans le coma, elle est
vraisemblablement lie un mode exceptionnel et transitoire dactivit
crbrale
27
.
On saperoit partir de l que les deux interprtations ont un point
commun capital. Elles attribuent un fondement objectif la narration, quil
sagisse dun fondement objectivement matriel ou dun fondement
objectivement transcendant. Lune comme lautre expriment le prjug
culturel, peine branl par la dissociation kantienne entre objet et chose en
soi, selon lequel il ny a de sens attribuer une ralit qu des entits
objectives.
Il reste pourtant une autre option qui nemprunte pas ce passage oblig.
Elle consiste simplement prendre au srieux les narrations pour ce quelles
sont
28
, savoir des rcits dexprience en premire personne, en mettant entre
parenthses la question de leur lien avec un quelconque domaine objectif,
familier ou transcendant. Pour comprendre que cette option ne se rduit pas
de la navet ou de lignorance volontaire, il suffit de raliser le caractre
exclusif et auto-transformateur de lexprience de mort imminente ; une
exprience qui dborde cause de cela lenclos de ses explications possibles.
Son caractre exclusif, la fois insulaire et cosmique, tout dabord.
Essayez durant quelques secondes de vous figurer ce que cela fait dtre une
personne en train de mourir. Puis, au milieu de cet effort empathique ou
prmonitoire, posez-vous ces questions : Est-ce important pour moi, ce
moment exceptionnel, que mon exprience intensment et indubitablement
vcue de fusion avec une lumire blanche charge damour soit procure par
un Dieu transcendant, ou par quelque vnement chimique dans mon cerveau
en perte dhomostasie ? Est-ce important pour moi, ce moment, que
lhorizon de temps infini que je perois sans lombre dune incertitude
prouve dnote une ternit cleste objective, ou traduise une distorsion
physiologique galement objective de la perception du temps ? Il semble
bien que la rponse ce genre de questions doive tre uniformment ngative.
Les alternatives quelles dploient manquent entirement de pertinence tant
que le point de vue en premire personne est strictement maintenu. On pourrait
aller jusqu dire que les questions poses sont dnues de sens dans le
contexte dun entier abandon lexprience vcue du mourir, lorsque leffort
pour suivre dans cette exprience le fil rouge de ce qui est commun tous na
mme plus lieu dtre accompli. Dans cette situation, et ce moment sans
pareil, la qute dobjectivit nest plus quun outil priv demploi, et aucune
autre transcendance que la transcendance-dans-limmanence de ce qui est
immdiatement prouv nest en jeu. Dans cette situation, et au voisinage de
cette singularit du temps, mme la dualit sujet-objet sest dissoute, comme
le souvenir estomp dun petit instrument utilis dans le pass pour
sauvegarder une vie biologique limite, dans le monde troit du consensus
entre les tres humains. Dans cette situation, rien dautre ne demeure quun
vcu ponctuel mais indfiniment distendu, se saturant lui-mme de sa prsence
bouleversante.
Cest dans cette configuration hors norme que linsistance de Husserl pour
ne pas rserver le terme-valeur de ralit aux choses palpables, visibles,
jetes dans lespace-temps ordinaire ou dans lillo tempore de la mythologie,
montre toute sa porte. Suspendons tout jugement sur la question de savoir si
lexprience de mort imminente est real , si elle est lpreuve de quelque
chose naturelle ou surnaturelle dont tous puissent reconnatre lexistence. Il
nen reste pas moins que cette exprience relve bel et bien du reell
29
au
sens de Husserl, puisque, chez le fondateur de la phnomnologie, cest le
contenu entier de lexprience qui est qualifi ainsi, par opposition sa part
restrictive de contenu intentionnel (et objectivant). Autrement dit, lexprience
de mort imminente est affecte de ce quon pourrait appeler, en usant dun
nologisme franco-allemand, le coefficient de reellit de nimporte quel
vcu. lgal des autres vcus, lexprience de mort imminente est dote de
laptitude servir de germe et de sol reell lventuelle imputation de
ralit des units de sens quelle vise. Mais la diffrence des vcus
ordinaires, celui-l sest jamais isol des conditions qui permettraient un
jugement validit collective sur ses contenus ; et son isolement, loin de le
confiner au moindre-tre, limprgne ds lors de la saveur dtre tout.
Il reste un point claircir. La reellit du vcu en question peut-elle se
prvaloir du seul critre qui fait de la ralit autre chose quun vain mot ?
En dautres termes, lexprience de mort imminente est-elle porteuse dune
aptitude changer quelque chose, de la mme manire quune pierre relle
( real !) lance dans le lac y fait natre des ondes et des remous ? La
rponse est oui , sans quivoque. Comme cela a t soulign, lexprience
de mort imminente est hautement transformatrice pour les personnes qui lont
vcue et qui en sont revenues
30
. Elle a de profondes rpercussions sur leur
perception du sens de la vie, sur leurs choix professionnels et existentiels,
ainsi que sur leurs relations avec les autres. Son impact est souvent dcrit
comme positif, entranant un pouvoir de connivence avec autrui et une paix
intrieure considrablement accrus, mais parfois aussi comme ngatif en
raison dun sentiment persistant dincommunicabilit de ce qui a t vcu. Les
causes vcues relevant du reell ont des effets reell sur le vcu, de la
mme faon que les causes objectives real ont un impact sur les choses.
Le got dtre tout, et tout le temps, qua laiss lexprience de mort
imminente, transfigure souvent la vie entire dans son sillage aprs avoir
ouvert une perspective illimite au mourir entier. Le rien dpicure nest
pas le dernier mot sur cette exprience dernire.
Conclusion
Ah ! Insens, qui crois que je ne suis pas toi.
V. Hugo
Ce livre doit finir comme il a commenc, sur une perplexit dmultiplie
en questions. Sa dmarche auto-ralisante est-elle prmonitoire, en phase
avec une mode passagre, ou fortement inactuelle ? Ne risque-t-elle pas dans
chacun de ces cas dtre forclose, oublie, nglige aussitt apais le
bruissement de ses mots ? Se rend-elle dailleurs simplement audible dans un
contexte culturel de long terme qui, sans lignorer, sest difi sur sa
relgation au rang de prmisse dsute de laventure des savoirs objectifs, et
qui ne parvient ventuellement sy intresser qu condition de lavoir
dsactive en la naturalisant ? laune dune telle dcision fondatrice de
notre culture, le chemin peine parcouru ne risque-t-il pas dtre dclar
historiquement rgressif, pistmiquement statique, et mthodologiquement
incommunicable ?
La rgressivit de lapproche adopte, tout dabord, a quelque chose de
perturbant. On peut se demander pourquoi tre revenu au foyer dindcision ;
pourquoi avoir voulu recommencer la marche de la philosophie depuis son
premier pas ; pourquoi avoir balbuti son commencement sans se lasser, avec
lmotion profonde de qui, stant affranchi volontairement des repres de
lintelligence, se rexpose sans protection son souffle natif dinconnu. Pour
quel motif avons-nous reflu une fois de plus sur nous-mmes aprs tant de
dbuts passs, aprs une si longue antriorit dides alternant les lans
spculatifs et les retours rflexifs ? Aprs tout, les dcouvertes ou
redcouvertes des aurores de la pense nont pas manqu durant les
millnaires couls, quil sagisse de laperu sur la vie de lesprit mnag
par les tragdies grecques
1
, de linitiation augustinienne lintriorit, de la
tabula rasa cartsienne, du point de dpart hglien dans la certitude
sensible, ou du retour husserlien aux choses mmes de lapparatre. La
comprhension du statut transcendantal de lexprience consciente, qui en
fait une condition pralable toute enqute signifiante y compris sur elle-
mme, semble pour sa part banale en dpit de linlassable parfum dtranget
quelle dgage. Son troite synthse dvidence et de secret imprgne le verbe
humain ds les mythologies dorigines, comme en tmoigne cette scansion
dune ancienne Upanishad : Cela [] nest jamais vu mais est le voyant,
nest jamais entendu mais est lentendant, nest jamais pens mais est le
pensant, nest jamais connu mais est le connaissant
2
. Pourquoi stre laiss
nouveau fasciner par ces vrits sans lendemain (mais pas sans prsence)
mille fois entrevues au cours de lHistoire, puis mille fois surdtermines par
des disciplines de connaissance qui les supposent, les omettent, et les
dpassent ? Pourquoi tre redescendu vers une strate aussi primitive de
linitiation au monde et soi, alors que nous vivons une poque o la
sdimentation entire des savoirs est disponible et utilisable dans une
nouvelle bibliothque de Babel plantaire, et o chaque recherche semble
devoir natre dune accumulation de donnes, de doctrines, et de noms propres
plutt que dune immersion ritre dans la simplicit du manifeste ?
Ce qui a motiv ce recul, et la rendu tout sauf naf, est dabord la
conviction que le choix de se lancer dans une investigation scientifique sur
lhypothtique substrat objectif de la conscience, loin dtre une opportunit
de solution, nourrit laporie sa racine. Et que par consquent aucun discours
prenant son essor partir de cette orientation indiscute ne saurait dfaire le
nud quelle a tress, mais seulement en accrotre lintrication. Sous cette
hypothse, il fallait dsapprendre ce qui a t appris, par petites touches et
brves aperceptions, afin de cueillir au passage le moment (plus historial
quhistorique) o la vue de lintelligence sest obscurcie propos de son
propre fond. Il fallait se dfaire, non pas des acquis de la connaissance
scientifique, mais des certitudes pistmologiques immotives qui lui rendent
difficilement acceptable lnonc de ses propres limites quand celles-ci
sannoncent principielles au lieu dtre temporaires.
La rticence reconnatre les limites auto-imposes de la dmarche
scientifique est connue, et elle se voit parfois dnonce avec force
3
. Mais elle
reste obstine, comme le montre une proclamation dfensive assez rpandue
parmi les chercheurs en neurobiologie. Selon plusieurs de ces chercheurs, les
philosophes stant gars dans le pass en prvoyant linaccessibilit la
science de certains problmes, ceux dentre eux qui dclarent dfinitivement
insoluble le problme difficile de lorigine matrielle de la conscience
seront dmentis par le futur de la science. Limputation dincomptence de la
philosophie, martele de livre en livre et darticle en article titre de rite
dadmission dans un cercle professionnel, est en gnral appuye sur une
rpartition parodique des rles : les chercheurs scientifiques ont accs aux
lois et aux faits naturels, tandis que les philosophes sen tiennent aux systmes
dabstractions, de croyances, pour ne pas dire dopinions
4
; comment ces
derniers pourraient-ils alors sexprimer bon droit sur ce que peuvent et ne
peuvent pas les sciences de la nature ? Soit, mais comment, linverse, un
chercheur entirement tendu vers ses objets naturels, et sabstenant de
regarder dans une autre direction queux en vertu de sa dcision initiale sur
d e s valeurs pistmiques, pourra-t-il sapercevoir des bornes que cette
dcision et ces valeurs imposent ab initio sa connaissance ? Comment y
parviendra-t-il si personne ne lencourage se tourner dans la direction
alternative, et ne laccoutume au fait troublant quil ne sagit justement
daucune direction mais dune suspension des directionnalits ? Or, nul autre
guide que la philosophie ne peut le conduire dans cette zone des options
fondatrices des savoirs, qui est aussi celle de lindcision premire entre
lblouissement dtre et la poursuite des tants. Personne, si ce nest le
philosophe, na la hardiesse ncessaire pour le confronter au truisme que
nulle apothose scientifique ne pourra jamais remettre au jour ce qui a t
enfoui par les dcisions inaugurales de la science. Il est donc indispensable
que le philosophe continue dassumer cette tche de remise en contact avec
linchoatif, dans laquelle il reste irremplaable, au lieu de courir aprs la
respectabilit acadmique en adoptant une organisation sociologique inspire
de la recherche scientifique, et en se bornant une mcanique argumentative
se voulant si assure de ses arrires quil semble inutile de les rinterroger.
Il y avait aussi un autre motif, latent mais crucial, doprer le repli
propos. Retrouver la philosophie au lieu authentique de ses commencements,
l o elle se refuse encore aux chappatoires de la glose ou de la rhtorique,
fait partie de nos tches urgentes. Nous vivons une poque o il ne reste
gure de temps pour se livrer au divertissement pascalien, et encore moins de
temps consacrer, sous le nom en partie usurp de philosophie , un cho
rationnel de la rue en avant du dveloppement techno-conomique. Celui-ci
se propage de toutes faons par lui-mme, comme un feu de fort qui consume
le milieu de nos vies dans le mme moment o il fait prolifrer les moyens
matriels de notre qualit de vie, et qui nous laisse entrevoir un futur
transhumain, voire posthumain
5
, par-del sa promesse lnifiante damliorer
la condition humaine. Sil peut avoir besoin dune forme domestique de
compagnonnage philosophique, cest seulement pour enrober son absence de
sens et de perspective long terme dun semblant de justification, ou pour
travestir sa rgle dimplacable ncessit en course vers un avenir voulu et
projet (selon le clbre slogan puisque nous sommes dpasss par ces
choses, feignons den tre les organisateurs
6
). Nous nous trouvons
aujourdhui dans une situation sans prcdent, o celui qui sest rv comme
matre et possesseur de la nature dcouvre la lacune dmesure de son rve
mesure du succs grandissant de son activit de matriser. Le possesseur de
la nature ne se possde pas lui-mme, il ne matrise pas le matre quil est,
parce quen abandonnant derrire lui la source vibrante de son projet, il a
perdu la possibilit de le soumettre la critique et de linflchir avant quil
nait eu des consquences irrversibles. Ne possdant pas le possesseur, ne
matrisant pas le matre, il voit approcher le moment o il ne matrisera plus
rien, mais se laissera possder par le processus quil a lanc. Dans ces
conditions, seul sans doute un retour au cur des choses, au bord fragile de
lagir et du non-agir, fleur dune exprience vide de surdterminations mais
pleine de possibles, au lieu o chaque dfi peut encore trouver sa rsolution
crative avant de se voir enserrer dans des certitudes hrites, laisse entrevoir
un paysage habitable par-del les hauts murs qui se profilent. Seule la lucidit
au miroir de nous-mmes, la conscience de la conscience dans linstant de la
dcision, nous rend les degrs de libert ncessaires pour rouvrir lespace
dune histoire viable.
Le deuxime trait dinactualit de ce livre dcoule du premier. Lattitude
rflexive sapparente bel et bien une stase, car elle exige un rebroussement
cyclique vers le commencement des savoirs, comme si ceux-ci ne
poursuivaient quun simulacre de clart et quil fallait sans cesse les inciter
retrouver leur intention ignore. Par contraste avec cette sorte de bgaiement,
lordre du jour rductionniste ou mergentiste en philosophie de lesprit peut
senivrer du mouvement propre la recherche scientifique. Les prsentations
de dcouvertes neurologiques, dans les sites de diffusion destins au grand
public aussi bien que dans les revues scientifiques spcialises, se suivent
un rythme soutenu, provoquant la fascination, nourrissant le besoin de
comprendre, suscitant des vocations nouvelles et des projets qui poussent
lattention toujours plus loin. chacune des objections quune philosophie
rflexive peut lui opposer, la recherche neurologique rpond par lesquive
consistant exhiber une surprise du savoir, une nouveaut imprvisible dans
la comprhension des dterminants physiologiques du comportement et du
verbe humains ; et elle laisse ainsi supposer quau bout de la squence des
nouveauts est tapie lultime surprise, la surprise des surprises qui rendrait
caduque toute objection, ft-elle de principe, la thse de lorigine physique
de la conscience. En attendant, leuphorie de dvoiler chaque jour quelque
chose dinconnu, den apprendre de plus en plus sur soi-mme sans se
dpartir de la rsolution de se jeter hors de soi, surmonte compulsivement
limpression de carence que laisse dans son sillage la discipline dracinante
des savoirs objectifs. La perception de labme que je suis se trouve en
permanence minimise, et priodiquement touffe par la frnsie de
linnovation. Ds lors, la mthode quon peut qualifier globalement de
physique (mme quand elle relve de sciences biologiques lies de faon
indirecte aux sciences proprement physiques), celle qui consiste extraire le
rsidu structural de lexprience et sextraire soi-mme de la reprsentation
du monde qui en rsulte, se voit rcupre et hrose par une doctrine
marque de son suffixe en isme . Les avances de la physique sont
portes au crdit du physicalisme
7
, avec pour consquence que ses idaux
rgulateurs tendent tre requalifis en ralits plus relles que lacte
didation qui leur donne consistance. La thse physicaliste sapproprie
lavantage de llan, de lhorizon en recul, du report au futur des questions
laisses pendantes par la connaissance prsente, qui est la marque de
lactivit de chercher. Mais elle ptrifie pour cela llan en rgle, lhorizon en
ressource accessible, et le rejet au futur en ombre dune vrit ultime.
Il ny a pas stonner ou sirriter de cette stratgie, qui ne fait au fond
que sinscrire dans un cadre axiologique plus vaste. Si notre culture substitue
chaque interrogation sur ce quon a tre un discours propos de choses
qui sont, cest afin dviter le vertige de se savoir un soi insaisissable et
infond. Si elle nous invite nous apprhender nous-mmes comme agis,
ports, produits par un corps sur lequel une connaissance thorique permettra
davoir entirement prise un jour, cest pour nous garder de la crainte dtre
balays et dmembrs par notre gnrativit inconnue. Cherchant nous
pargner le flottement dun regard grand ouvert sur lactualit de la
monstration, elle nous enseigne trouver un semblant dquilibre et de
stabilit dynamique dans lessor de la connaissance, dans la traverse htive
de la prsence diaphane de lexprience, dans la course perdue vers les
objets qui se montrent l-bas. Cest cela quelle sefforce daccomplir
lorsquelle externalise lintgralit de ses thmes dinterrogation en un
assortiment de figures abstraites et dexprimentations tangibles qui offrent
autant de points de mire sa mobilisation infinie
8
. Or, justement, o peut-
on encore aller lorsque, suivant la recommandation de la philosophie
rflexive, on a rintgr la provenance du o ? Comment marcher,
comment traverser, comment slancer lorsquon sest reconnu marchant,
traversant, slanant dans un participe prsent insensible au devenir ? Quelle
stabilit trouver sur le tranchant infinitsimal que le dj plus trace dans son
accueil du pas encore ? Peut-on faire indfiniment du surplace ? Face ces
questions ouvertes de lattitude qui le conteste, le physicalisme, chevauchant
la fuite en avant de la connaissance scientifique, et pousant un ethos
civilisationnel qui nous enjoint de ne pas tenir en place, semble avoir gagn la
partie ds louverture. Ses rcits dorigine de la conscience, qui prtendent
rendre raison nouvelle de cette ancienne nigme en submergeant les doutes
archaques par une confiance conqurante, acquirent de ce fait un indniable
pouvoir de sduction.
moins quen demandant aux chercheurs de revenir eux, de retenir leur
souffle pour apercevoir la prcondition de leur avance, de sveiller leur
propre situation au moment prcis o elle sextravertit en qute dun savoir,
on ne prenne pas un temps de retard mais plutt une hauteur de vues.
Laccusation de mener un combat darrire-garde ou de dfendre une position
rgressive perd toute force si le philosophe rflexif ne senferme pas dans la
citadelle dune sagesse immmoriale mais accompagne pas pas litinraire
des explorateurs auxquels il cherche ouvrir les yeux, et en observe
lavance avec la marge de lucidit additionnelle que lui confre son
engagement plus ample. Le philosophe rflexif ne souffre que dun bref dlai
sil dcide de suivre la progression de la recherche en neurosciences
cognitives comme son ombre, comme son reproche ou son double, comme sa
bonne ou sa mauvaise conscience. Il acquiert mme lavantage du surplomb en
montant sur les paules des gants de laventure scientifique, ce qui lautorise
parfois les prcder dans lannonce de leurs plus intimes possibilits de
succs ou dchecs. La phnomnologie, habituellement oppose la
recherche scientifique comme lest une expansion dans limmanence vcue
un parcours vers la transcendance infre, se rend sur-le-champ actuelle en
entreprenant, sur le modle de Maurice Merleau-Ponty ou dErwin Straus
9
,
une navigation de conserve avec les sciences de la nature. Les
phnomnologues peuvent promouvoir cette cohabitation sans abdiquer
aucune des prrogatives de leur discipline, sans renoncer au moindre de ses
aperus intemporels, pourvu quils aient assez dassurance pour soumettre
leur lecture phnomnologique luvre de la science en voie dlaboration,
au lieu dtre si intimids par son voisinage quils ne peuvent plus osciller
quentre un programme de scientifisation de la phnomnologie et son repli
sur les arts et les humanits.
Il reste un dernier sujet dalarme surmonter, qui porte sur la mthode
choisie. Souligner la dpendance mutuelle des conceptions de la conscience et
de ltat de conscience de ceux qui les soutiennent, suggrer que bon nombre
des dveloppements de ce livre ne se saisissent pleinement qu partir dun
certain tat de conscience (identifi une suspension radicale du jugement
accompagne dune amplification panoramique du champ de lattention),
nest-ce pas renoncer communiquer ? Dclarer que le problme difficile
de lorigine physique de lexprience consciente est par principe insoluble, et
que seule une mutation dtre
10
permet de voir qu vrai dire il ne se pose
mme pas
11
, cela ne revient-il pas noncer des conditions trop exigeantes et
trop spciales pour affronter un mystre qui nous concerne tous ? Cette
particularisation apparente du propos ne droge-t-elle pas une prescription
dontologique centrale du philosophe, qui le somme de se tenir fermement sur
la place commune de largumentation, et de ne chercher obtenir
lapprobation dun interlocuteur ou dun lecteur qu propos dune thse
vocation universelle ?
En dpit de leur forme qui invite lassentiment, et en dpit dune histoire
dj longue de demi-comprhensions ou dincomprhensions de textes
phnomnologiques crits dans latmosphre de lpoch (faute de savoir
comment adopter ltat de conscience prescrit), ces trois questions doivent se
voir opposer une rponse ngative. La philosophie ne saurait dserter aucun
terrain de parole, et plus largement de transmission, pas mme ceux qui
relvent dune modalit non exclusivement logico-dductive du partage. Son
impratif duniversalit devrait la conduire explorer aussi (et peut-tre
surtout) les terrains alternatifs o laccord stablit autrement que par le seul
discours. Certaines rgions dagrment pr-verbal ou para-verbal, comme par
exemple la communication avec un nourrisson ou avec un tre aim, sont aprs
tout rpandues, et elles constituent des thmes philosophiques au mme titre
que celles qui sont coulables dans le moule discursif. Quant aux cas o les
paroles changes sont presque incomprhensibles en dehors dune situation
ou dun tat sous-entendus, et o le seul moyen datteindre un consensus
revient faire converger les protagonistes vers la situation ou vers ltat dans
lesquels ces paroles font sens, ils sont bien plus frquents que les cas
utopiques de contexte unique, et ils rclament au moins autant dattention
philosophique. Imaginons, titre dillustration, un guide en chair et en os qui
voquerait sur un mode potico-allusif les beauts architecturales ou
naturelles entourant un groupe de touristes en excursion. Conviendrait-il
quelquun qui entendrait plus tard, dans son fauteuil, lenregistrement sonore
des paroles du guide, de reprocher ce dernier de ne pas lui offrir une
description planimtrique du milieu parcouru, et de ne lui apporter que de
vaines invitations voir ce qui ne se prsente pas ou marcher vers ce qui
nest plus vu ? Ou bien devrait-il accepter que le guidage nacquire sa pleine
pertinence quin situ, pour ceux qui ont pris la peine de se transporter au lieu
o les chefs-duvre se montrent ? Le mode de comprhension que le guide
met profit en sadressant ses touristes est situ, et il droge de ce fait la
recherche de luniversel. Mais le mode de mta-comprhension que peut
utiliser lauditeur dans son salon pour se figurer mentalement ce quil lui
faudrait percevoir pour donner sens aux phrases semi-cryptiques du guide est
pour sa part une application minente de lidal duniversalit ; une
application dpassant dun degr de polyvalence celle qui sen tiendrait une
varit non figurative, logico-formelle, dentente
12
. la manire de cet
auditeur, cest au nom de son impratif dontologique le plus fort (et non pas
contre lui) que le philosophe devrait outrepasser les limites imposes par un
mode dentente supposant les locuteurs fixs sur un seul type dtat de
conscience. Cest au nom de son horizon universaliste quil devrait
sintresser des modalits non conventionnelles dexpression permettant la
reconnaissance rciproque de ltat de conscience des interlocuteurs, dans
ltat de plasticit o ceux-ci peuvent encore voluer et sacqurir. Un tel
largissement du domaine dintervention de la philosophie, dun discours
resserr sur sa norme rationnelle une rflexion capable de traverser les
cercles normatifs, devient dautant plus indispensable que la question pose
est celle de la conscience. Car, le raisonnement tant un acte de conscience et
pas seulement un enchanement symbolique, il est partie intgrante de ce quon
se propose de comprendre
13
, et il manque donc du recul ncessaire pour
servir dinstrument unique de comprhension.
partir de l, il semblera moins choquant que tous les pas accomplis au
XX
e
sicle, par lesquels on est pass dune philosophie de la conscience une
philosophie du langage, dune mtaphysique de la prsence une
hermneutique de la trace
14
, du monde renvers
15
de Hegel la
philosophie de la vie ordinaire, semblent avoir t parcourus rebours dans
ce livre. Le premier passage tait rendu presque obligatoire par le constat
que, dans les textes philosophiques, la conscience fait partie de ce qui se
nomme, et quavant de produire des doctrines grandiloquentes sur elle, il faut
sassurer des rgles dusage du terme qui la dsigne. Mais le passage inverse
devient galement inluctable, lorsquon tire toutes les consquences du
tournant pragmatique de la linguistique. Car sil est vrai, trivialement, que
lorsquon en parle la conscience nest quun mot, il est non moins vrai quon
peut se donner le mot pour rhabiter le moment de conscience, que les mots
peuvent avoir un pouvoir de conversion soi-mme au moins aussi souvent
quils poussent sex-stasier devant soi. Cet usage diffrent des mots fait
signe vers un champ denqute alternatif, qui est celui dune philosophie de la
conscience renouvele. Il participe dun savoir-tre particulier, celui de se
mettre en prsence de la prsence, dont une mtaphysique de la prsence ne
serait que la cendre doctrinale. Parce quelle bnficie des leons de la
philosophie du langage qui a longtemps prtendu la remplacer, une telle
philosophie de la conscience et de la prsence na renoncer ni lanalyse
logico-linguistique ni au bien commun de la discipline philosophique quest
largumentation. Mais parce quelle vient aprs la philosophie du langage et
vise en faire craquer le canevas trop troit, la nouvelle philosophie de la
conscience et de la prsence se proccupe aussi de ce quon peut se faire les
uns aux autres avec les mots, et explore fond le champ de performativit de
largumentation. Cest quil y a dautres usages de largument que demporter
la conviction dun interlocuteur avec qui on partage un cadre de
prsupposition inscrit dans ltat de conscience de rfrence. Largument peut
encore servir drouter, dboucher sur une impasse devenue de ce fait
impossible ignorer, faire voluer son destinataire vers une posture
maximisant lintelligence de la situation quil occupe, miner la crdibilit
dun arrire-plan commun de conventions, faire vaciller par ltonnement
quil suscite ltat de conscience de qui lentend ; il est en somme capable
dinstaurer une une les multiples conditions de son dehors. Sous la pousse
darguments de cette espce indompte, on na pas seulement les facults
mentales engages dans lactivit infrentielle, on nest pas seulement port
une conclusion et maintenu dans ses termes contraignants ; on se sent saisi de
tous cts dans lintgralit de ce quon est, on se dcouvre retourn de fond
en comble et transform. Tandis que les arguments standards servent
affermir ou prciser les catgories qui cislent un monde face soi, les
arguments alternatifs font jouer le lacis catgorial jusqu dvoiler sa part
darbitraire et remettre ainsi en chantier, au cur de lexprience, la polarit
dun soi et dun monde. Ds lors, si de tels arguments peuvent se faire
entendre, ce nest pas travers leur propre voix, que conditionnent encore les
usages de la langue et de la tradition, mais par le biais des sonorits jusque-l
inoues quils engendrent chez certains de leurs destinataires en faisant entrer
en rsonance la faille du systme de leurs convictions. De mme quil y a en
littrature une esthtique de la rception
16
, il peut y avoir en philosophie une
dialectique de la rverbration intrieure. De mme quen littrature le lecteur
est capable de rfracter, de colorer, de transfigurer, de faire vivre ou de
laisser mourir ce qui lui est donn par lcriture, en philosophie le lecteur
noffre pas seulement un terrain dpreuve de la validit des thses avances ;
il peut devenir, dans lambiance cre par lauteur, le lieu davnement dun
genre indit du voir, le sol matinal o se reconfigurent les certitudes et les
questionnements. Lauteur et le lecteur dun tel laboratoire philosophique ne
sont pas des monades spares qui interagissent leur marge pour sinviter
faire un pas sur quelque rseau pr-dessin de conceptions possibles ; ils
sindterminent si entirement par leur confrontation commune aux points
aveugles gisant entre les mailles du rseau quils deviennent une cuve unique
o lordre des doctrines se liqufie en potentialits ouvertes.
Il en va plus forte raison ainsi quand la rflexion cherche envelopper
lexprience prsente du lecteur et de lauteur, quand lauteur dcide de
capturer le lecteur dans la langue argumentative comme dans une chambre
chos de ce quil vit pendant quil la comprend, quand le lecteur rv
devient si bien le double de lauteur que ce dernier sauto-rvle la faveur
de son criture enveloppante, et confre l un sens qui inclut le lecteur.
La philosophie de la conscience doit dautant plus sapparenter un inducteur
de mtamorphose mutuelle que ce quelle met en jeu nest autre que vous et
moi. Vous et moi non pas comme individus humains particuliers, mais comme
appropriateurs du pronom personnel singulier, l o sesquisse un projet et se
donne un monde. Vous et moi au sens pr-individuel douvertures vivantes
ce qui sexpose, avant le nom, avant le temps, et avant le lieu. Vous et moi
dans le frmissement dexister plutt que dans la litanie poussireuse dune
dnomination des personnes. Or, vous et moi avons, cet instant o
sapproche le point final du texte, une dernire occasion favorable dchapper
lenvotement du verbe et de replonger ensemble dans la forge des modes
dtre. cet instant, mon intention dcrire flchit, et votre curiosit de savoir
se dlite ou savoue frustre. cet instant, notre attention a presque cess
dtre captive par lespoir dune issue, et, si nous ne rvons pas dj dautre
chose, au moins glissons-nous dans labsence qui se profile : le silence
terminal, le blanc de la dernire page, le hors-livre. cet instant, les
traverses vers le sens spuisent, donnant voir ces lettres noires sur la
trame blanche veloute du papier ou sur les pixels fins de la tablette. cet
instant, les signifiants graphiques ne donnent plus accs rien ; ils saffaissent
sur eux-mmes et laissent affleurer dans leur chute la fracheur, lclat,
lirisation de ce non-ailleurs. Alors, cet instant nous y sommes enfin ; nous
nous tenons au foyer ardent de notre interrogation ; cest bien cela quelle
devait mettre au jour ; et en ce l se fait connatre que toute rponse serait
sans objet.
Bibliographie
ABRAM, D., The Spell of the Sensuous, Vintage, 1996.
Becoming Animal, Pantheon, 2010.
ABRAMSON, D., Turings responses to two objections , Minds and
Machines, 18, 2008, p. 147-167.
AGAMBEN, G., LOuvert, de lhomme et de lanimal, Rivages Poche,
2006.
AGRILLO, C., Near-death experience : Out-of-body and out-of-brain ? ,
Review of General Psychology, 15, 2011, p. 1-10.
AGUILAR-PRINSLOO, S. & LYLE, R., Client perception of the
neurofeedback experience : The untold perspective , Journal of
Neurotherapy, 14, 2010, p. 55-60.
AKINS, K., Lost the plot ? Reconstructing Dennetts multiple drafts
theory of consciousness , Mind & Language, 11, 1996, p. 1-43.
ALAIS, D. & BLAKE, R. (d.), Binocular Rivalry, MIT Press, 2005.
ALEKSANDER, I.L., Machine consciousness , in VELMANS, M. &
SCHNEIDER, S. (d.), The Blackwell Companion to Consciousness,
Blackwell, 2007.
ALEXANDER, E., Proof of Heaven : A Neurosurgeons Journey Into the
Afterlife, Simon & Schuster, 2012.
ALKIRE, M.T., MCREYNOLDS, J.R., HAHN, E.L. & TRIVEDI, A.N.,
Thalamic microinjection of nicotine reverses sevoflurane-induced loss
of righting reflex in the rat , Anesthesiology, 107, 2007, p. 264-272.
ALKIRE, M.T., HUDETZ, A.G. & TONONI, G., Consciousness and
Anesthesia , Science, 322, 2008, p. 876-880.
ALLIX, S. & BERNSTEIN, P., Manuel clinique des expriences
extraordinaires, Interditions, 2009.
ALQUI, F., La Nostalgie de ltre, PUF, 1950.
ANACKER, S., Seven Works of Vasubandhu, Motilal Banarsidass, 1998.
ANDRADE, J., Does memory priming during anesthesia matter ? ,
Anesthesiology, 103, 2005, p. 1-2.
ANDR, C., La mditation de pleine conscience , Cerveau et Psycho,
41, 2010, p. 18-24.
Mditer jour aprs jour, Iconoclaste, 2011.
ANONYME, The Cloud of Unknowing, Penguin, 1987.
ANSELME de CANTORBRY, saint, Proslogion, Flammarion, 1993.
APEL, K.-O., Transformation de la philosophie, vol. I, Cerf, 2007.
ARAMAKI, M., VION-DURY, J., SCHON, D., MARIE, C. & BESSON, M., Une
approche interdisciplinaire de la smiotique des sons , in DALMONTE, R.
& SPAMPINATO, F. (d.), Il Nuovo in musica e in musicologia, LIM,
2009.
ARGUILLRE, S., Lauto-production de lesprit I , Papiers du Collge
International de Philosophie, n
o
40, 1997, p. 17-70.
Lauto-production de lesprit II , Papiers du Collge International
de Philosophie, n
o
46, 1998, p. 15-65.
La coproduction conditionne selon le bouddhisme indien tardif et au
Tibet , Les Cahiers bouddhiques, 2, 2005, p. 75-113.
ARNAULD, A., Des vraies et fausses ides contre ce quenseigne lauteur
de la Recherche de la Vrit, Abraham Viret, Rouen, 1663.
ARRABALES, R., Establishing a roadmap and metrics for conscious
machines development , Proceedings of the 8th IEEE International
Conference on Cognitive Informatics, 2009.
ATMANSPACHER, H. & FACH, W., Acategoriality as mental instability ,
Journal of Mind and Behavior, 26, 2005, p. 181-206.
ARU, J., BACHMANN, T., SINGER, W. & MELLONI, L., Distilling the neural
correlates of consciousness , Neuroscience and Biobehavioral Review,
36, 2012, p. 737-746.
AUBENQUE, P. (d.), tudes sur Parmnide, Vrin, 1987.
AUBRUN, F., PAQUERON, X. & RIOU, B., Ktamine , Confrences
dactualisation SFAR, 2000, p. 279-291.
AUGUSTIN, saint, uvres, I, Gallimard, 1998.
AUSTIN, J., Quand dire cest faire, Seuil, coll. Points , 1991.
AVIDAN, M.S., ZHANG, L., BURNSIDE, B.A., FINKEL, K.J., SEARLEMAN,
A.C., SELVIDGE, J.A., SAAGER, L., TURNER, M.S., RAO, S., BOTTROS, M.,
HANTLER, C., JACOBSOHN, E. & EVERS, A.S., Anesthesia, Awareness
and the Bispectral Index , New England Journal of Medicine, 358, 2008,
p. 1097-1108.
AVRAMIDES, A., Other Minds, Routledge, 2001.
AYER, A.J., Language, Truth, and Logic, Gollancz, 1936-1946.
BAARS, B.J., A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge
University Press, 1988.
In the Theater of Consciousness : the Workspace of the Mind, Oxford
University Press, 1996.
BAARS, B.J. & FRANKLIN, S., Consciousness is computational : The
LIDA model of global workspace theory , International Journal of
Machine Consciousness, 1, 2009, p. 23-32.
BACHELARD, G., tude sur lvolution dun problme de physique. La
propagation thermique dans les solides, Vrin, 1928.
La Formation de lesprit scientifique, Vrin, 2000 .
BAERTSCHI, B., Les Rapports de lme et du corps. Descartes, Diderot,
et Maine de Biran, Vrin, 2000.
BAILEY, L.W. & YATES, J., The Near-Death Experience, a Reader,
Routledge, 1996.
BANSAT-BOUDON, L., An Introduction to Tantric Philosophy : The
Paramrthasra of Abhinavagupta with the commentary of Yogarja,
Routledge, 2011.
BAR-ON, D., Speaking My Mind, Oxford University Press, 2004.
BARASH, P.G., CULLEN, B.F. & STOELTING, R.K., Clinical Anesthesia,
Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
BARBARAS R., De ltre du phnomne : sur lontologie de Merleau-
Ponty, Jrme Millon, 1991.
La Perception, Vrin, 2009.
Introduction une phnomnologie de la vie, Vrin, 2008.
BARENDREGT, H., The Abhidhamma model of consciousness AM
0
and
some of its consequences , in KWEE, M.G.T., GERGEN, K.J. &
KOSHIKAWA, F., Horizons in Buddhist Psychology, Taos Institute
Publications, 2006.
BARGH, J.A., The automaticity of everyday life , in WYER, R.S. (d.),
Advances in Social Cognition, 10, 1997, p. 1-61.
BARRETT, L.F., MESQUITA, B., OCHSNER, K.N. & GROSS, J.J., The
experience of emotion , Annual Review of Psychology, 58, 2007, p. 373-
403.
BARROW, J. & TIPLER, F., The Anthropic Cosmological Principle, Oxford
University Press, 1986.
BARTELS, A. & ZEKI, S., The temporal order of binding visual
attributes , Vision Research, 46, 2006, p. 2280-2286.
BASILE, B.M. & HAMPTON, R.R., Dissociation of active working
memory and passive recognition in rhesus monkeys , Cognition, 126,
2013, p. 391-396.
BASILE, P., Figli del nulla, Albo Versorio, 2004.
BAUBY, J.-D., Le Scaphandre et le Papillon, Robert Laffont, 2007.
BEAUREGARD, M. & OLEARY, D., The Spiritual Brain, HarperOne, 2007.
BECK, L., The Metaphysics of Descartes. A Study of the Meditations,
Oxford University Press, 1965.
BECKER, M. & PASHLER, H., Volatile visual representations : Failing to
detect changes in recently processed information , Psychonomic Bulletin
& Review, 9, 2002, p. 744-750.
BEDAU, M., Downward causation and autonomy in weak emergence ,
Principia, 6, 2002, p. 5-50.
BEKOFF, M., ALLEN, C. & BUGHARDT, G.M.,The Cognitive
Animal :Empirical and Theoretical Perspectives on Animal Cognition,
MIT Press, 2002.
BELLISSIMA, F. & PAGLI, P., Consequentia mirabilis, una regola logica
tra matematica e filosofia, Leo Olschki, 1996.
BENOIST, J., Intuition catgoriale et voir comme , Revue Philosophique
de Louvain, 99, 2001, p. 593-612.
BERGSON, H., Lnergie spirituelle, PUF, 1990.
BERING, J.M. & BJORKLUND, D.F., The serpents gift : Evolutionary
psychology and consciousness , in ZELAZO, P.D., MOSCOVITCH, M. &
THOMPSON, E. (d.), Cambridge Handbook of Consciousness, Cambridge
University Press, 2005.
BERKELEY, G., uvres choisies, I, dition bilingue, Aubier-Montaigne,
1961.
BERNSTEIN, R., Beyond Objectivism and Relativism, University of
Pennsylvania Press, 1983.
BERTHOZ, A. & PETIT, J.L., Phnomnologie et Physiologie de laction,
Odile Jacob, 2006.
BERTOSSA, F. & FERRARI, R., Lo Sguardo senza occhio, Albo Versorio,
2004.
BERTOSSA, F., FERRARI, R. & BESA, M., Matrici senza uscita. Circolarit
della conoscenza oggettiva e prospettiva buddhista , in CAPPUCCIO, M.
(d.), Dentro la Matrice, scienza e filosofia di The Matrix,
Alboversorio, 2004.
BESNIER, J.-M., Demain les post-humains, Hachette, 2009.
BEYSSADE, J.-M., Descartes au fil de lordre, PUF, 2001.
BIKKHU BODHI (d.), A comprehensive manual of Abhidhamma, Pariyatti
Publishing, 2000.
BILLON, A., En personne : la ralit subjective de la conscience
phnomnale, thse de lcole Polytechnique, dcembre 2005.
BINET, A., Ltude exprimentale de lintelligence, Costes, 1903.
BINSWANGER, L., Mlancolie et Manie, PUF, 2002.
Analyse existentielle et psychanalyse freudienne, Gallimard, 1970.
BITBOL, M., Le chercheur, le philosophe et la psychasthnie , Alliage,
5, 1990, p. 19-24.
Mcanique quantique : une introduction philosophique, Flammarion,
1996.
LAveuglante Proximit du rel, Flammarion, 1998.
Lalter ego et les sciences de la nature , Philosophia Scientiae, 3,
1999, p. 203-213.
Le corps matriel et lobjet de la physique quantique , in
MONNOYEUR, F. (d.), Quest-ce que la matire ?, Le Livre de Poche,
2000.
Physique et Philosophie de lesprit, Flammarion, 2000.
The problem of other minds : A debate between Schrdinger and
Carnap , Phenomenology and the Cognitive Science, 3, 2004, p. 115-
123.
No-pragmatisme et incommensurabilit en physique , Philosophia
Scientiae, 8, 2004, p. 203-234.
Is consciousness primary ? , NeuroQuantology, 6, 2008, p. 53-71.
De lintrieur du monde. Pour une philosophie et une science des
relations, Flammarion, 2010.
Neurophenomenology, an ongoing practice of/in consciousness ,
Constructivist Foundations, 7, 2012, p. 165-173.
Downward causation without foundations , Synthese, 185, 2012,
p. 233-255.
BITBOL, M. & DARRIGOL, O. (d.), Erwin Schrdinger. Philosophy and
the Birth of Quantum Mechanics, Frontires, 1992.
BITBOL, M. & LUISI, P.-L., Science and the self-referentiality of
consciousness , Journal of Cosmology, 14, 2011, p. 4728-4743.
BITBOL, M. & PETITMENGIN, C., On pure reflection (a reply to Dan
Zahavi) , Journal of Consciousness Studies, vol. 18, 2011, p. 24-37.
A defense of introspection from within , Constructivist
Foundations, 8, 2013, p. 269-279.
On the possibility and reality of introspection , Kairos, 6, 2013,
p. 173-198.
BITBOL-HESPRIS, A., Le principe de vie dans Les Passions de
lme , Revue Philosophique, 4, 1988, p. 415-431.
Le Principe de vie chez Descartes, Vrin, 1990.
Le dualisme dans la correspondance entre Henry More (Morus) et
Descartes , in VIEILLARD-BARON, J.-L. (d.), Autour de Descartes. Le
dualisme de lme et du corps, Vrin, 1991.
Rponse Vere Chappell : lunion substantielle , in BEYSSADE, J.-
M. & MARION, J.-L. (d.), Descartes : objecter et rpondre, PUF, 1994.
La mdecine et lunion dans la Mditation sixime , in KOLESNIK-
ANTOINE, D. (d.), Union et distinction de lme et du corps : lectures
de la VI
e
Mditation, Kim, 1998.
Descartes face la mlancolie de la Princesse Elisabeth , in
MELKEVIK, B. & NARBONNE, J.-M. (d.), Une philosophie dans lhistoire,
hommages Raymond Klibansky, Presses de lUniversit de Laval, 2000.
BLACKMORE, S., Near-death experiences : In or out of the body ? ,
Skeptical Inquirer, 16, 1991, p. 34-45.
There is no stream of consciousness , Journal of Consciousness
Studies, vol. 9, 2002, p. 17-28.
The grand illusion : Why consciousness exists only when you look
for it , New Scientist, 22 juin 2002, p. 26-29.
Consciousness, an Introduction, Hodder, 2003.
BLOCK, N., On a confusion about the function of consciousness ,
Behavioral and Brain Sciences, 18, 1995, p. 227-247.
Perceptual consciousness overflows cognitive access , Trends in
Cognitive Sciences, 15, 2011, p. 567-575.
Response to Kouider et al. : Which view is better supported by the
evidence ? , Trends in Cognitive Science, 16, 2012, p. 141-142.
BODE S., HANXI HE, A., SOON, C.S., TRAMPE, R. & HAYNES, J.-D.
Tracking the unconscious generation of free decisions using ultra-high
field fMRI , PLOS ONE, 6, e21612, 2011.
BOCE, Traits thologiques, GF-Flammarion, 2000.
BOGEN, J.E., On the neurophysiology of consciousness. Part I : An
Overview , Consciousness and Cognition, 4, 1995, p. 52-62.
BOHR, N., La Thorie atomique et la description des phnomnes,
Gauthier-Villars, 1932.
BORING, E.G., A History of Experimental Psychology, Appleton-Century-
Croft, 1929.
A History of Introspection , Psychological Bulletin, 50, 1953,
p. 169-189.
BORJIGIN, J., LEE, U., LIU, T., PAL, D., HUFF, S., KLARR, D., SLOBODA, J.,
HERNANDEZ, J., WANG, M.M. & MASHOUR, G., Surge of
neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain , PNAS,
doi:10.1073/pnas.1308285110, 2013.
BORST, C.V., The Mind/Brain Identity Theory, MacMillan, 1970.
BOSSUET, J.B., Instruction sur les tats doraison, Claude Anisson, 1697.
BOUTON, C., Temps et Esprit dans la philosophie de Hegel, Vrin, 2000.
BREITMEYER, B.G., Visual Masking, an Integrative Approach, Oxford
University Press, 1984.
BRENTANO, F., Psychologie du point de vue empirique, Aubier, 1944.
BRETT KING, D. & WERTHEIMER, M., Max Wertheimer and Gestalt
Theory, Transaction Publishers, 2007.
BROCA, P., crits sur laphasie (1861-1869), LHarmattan, 2004.
BROCH, H., La Mort de Virgile, Gallimard, 1958.
BROOKS, R.A., Robot : The Future of Flesh and Machines, Penguin,
2002.
BUCKNER, W., REESE, E. & REESE, R., Eye movement as an indicator of
sensory components in thought , Journal of Counseling Psychology, 34,
1997, p. 283-287.
BNNINGA, S. & BLANKE, O., The out-of-body experience : Precipitating
factors and neural correlates , Progress in Brain Research, 150, 2005,
p. 331-350.
BURGAT, F., Une autre existence, Albin Michel, 2012
CABANAC, M., CABANAC, A. & PARENT, A., The emergence of
consciousness in phylogeny , Behavioural Brain Research, 198, 2009,
p. 267-272.
CALASSO, R., LArdore, Adelphi, 2010.
CALVIN, J., Institution de la religion chrtienne, IV, 41, Philbert
Hamelin, 1554.
CAMUS, A., Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, 1993.
CANT, R., COOPER, S., CHUNG, C. & OCONNOR, M., The divided self :
Near death experiences of resuscitated patients. A review of literature ,
International Emergency Nursing, 20, 2012, p. 88-93.
CAPUTO, J.D., The Mystical Element in Heideggers Thought, Fordham
University Press, 1986.
CARNAP, R., Le dpassement de la mtaphysique par lanalyse logique
du langage , in SOULEZ, A. (d.), Manifeste du Cercle de Vienne et
autres crits, PUF, 1985.
CARRUTHERS, P., Brute experience , Journal of Philosophy, 86, 1989,
p. 258-259.
Meta-cognition in animals : A skeptical look , Mind & Language,
23, 2008, p. 58-89.
CASSIN, B. (d.), Vocabulaire europen des philosophies, Seuil, 2004.
CASSIRER, E., Philosophie des formes symboliques, III, Minuit, 1972.
Les Systmes post-kantiens. Le Problme de la connaissance dans la
philosophie et la science des temps modernes, t. 3, Presses
Universitaires de Lille, 1983.
De Nicolas de Cues Boyle. Le Problme de la connaissance dans la
philosophie et la science des temps modernes, t. 1, Cerf, 2004.
Individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance, Minuit,
1983.
CASTEL, P.-H., LEsprit malade, Ithaque, 2009.
CATTIN, E., Srnit : Eckhart, Schelling, Heidegger, Vrin, 2012.
CERTEAU, M. de, La Fable mystique, Gallimard, 1982.
CHALMERS, D., Facing up to the problem of consciousness , Journal of
Consciousness Studies, vol. 2, 1995, p. 200-219.
The Conscious Mind, Oxford University Press, 1996.
The content and epistemology of phenomenal belief , in SMITH, Q. &
JOKIC, A. (d.), Consciousness : New Philosophical Perspectives,
Oxford University Press, 2003.
CHANG, H., Inventing Temperature, Oxford University Press, 2007.
CHANGEUX, J.-P., LHomme neuronal, Fayard/Pluriel, 1984.
Conscious processing : Implications for general anesthesia ,
Current Opinions in Anesthesiology, 25, 2012, p. 397-404.
CHAUVIER, S., Dire Je, Vrin, 2001.
CHATEAUBRIAND, F.-R. de, Atala. Ren. Voyage en Amrique, GF-
Flammarion, 2009.
CHENET, F., Psychogense et cosmogonie selon le Yoga Vsistha : le
monde est dans lme, Institut de Civilisation Indienne, 2000.
CHESTOV, L., Sur la balance de Job, Flammarion, 1971.
CHURCHLAND, P.M., Reduction, qualia, and the direct introspection of
brain states , The Journal of Philosophy, 82, 1985, p. 8-28.
On the Objective Reality of Colors , in COHEN, J. & MATTHEN, M.
(d.), Color Ontology and Color Science, MIT Press, 2007.
CHURCHLAND, P.S., Neurophilosophy, Toward a Unified Science of the
Mind-Brain, MIT Press, 1986.
CIAUNICA-GARROUTY, A., Physicalisme et Qualia, thse de luniversit
de Dijon, 2012.
CLERC, H., Les Choses comme elles sont, Gallimard, 2011.
COCTEAU, J., Antigone et les Maris de la tour Eiffel, Gallimard, 1977.
COHEN, J., Color and perceptual variation revisited : unknown facts,
alien modalities, and perfect psychosemantics , Dialectica, 60, 2006,
p. 307-319.
COHEN, M.A. & DENNETT, D., Consciousness cannot be separated from
function , Trends in Cognitive Sciences, 15, 2011, p. 358-363.
COMTE, A., Examen du trait de Broussais sur lirritation, in Corpus, 7,
1988, p. 87-99.
CONEE, E., Phenomenal Knowledge , Australasian Journal of
Philosophy, 72, 1994, p. 136-150.
COOLEY, C.H., Human Nature and the Social Order, Schocken Books,
1964.
CORALLO, G., SACKUR, J., DEHAENE, S. & SIGMAN, M., Limits on
introspection. Distorted subjective time during the dual-task bottleneck ,
Psychological Science, 19, 2008, p. 1110-1117.
CORAZZA, O., Near Death Experiences, Exploring the Mind-Body
Connections, Taylor & Francis, 2008.
CORNU, Ph., Le Bouddhisme : une philosophie du bonheur ?, Seuil, 2013.
COSTALL, A., Introspectionism and the mythical origins of scientific
psychology , Consciousness and Cognition, 15, 2006, p. 634-654.
COUTINHO DA SILVA, L., Pour un discours sensible sur la capacit
cognitive du corps dans lexprience de lart, thse de luniversit Paris-
I, 2012.
CRICK, F., The Astonishing Hypothesis, Scribner Paperback, 1995.
CRICK, F. & KOCH, C., Towards a neurobiological theory of
consciousness , Seminars in the Neurosciences, 2, 1990, p. 263-275.
CUDWORTH, R., The True Intellectual System of the Universe : the First
Part, Wherein All the Reason and Philosophy of Atheism Is Confuted
and its Impossibility Demonstrated, R. Royston, 1678.
CUMBERLAND, R., A Treatise of the Laws of Nature, R. Phillips, 1727.
CSIKSZENTMIHALYI, M., Flow : The Psychology of Optimal Experience,
Harper & Row, 1990.
DALLE PEZZE, B., Martin Heidegger and Meister Eckhart : A Path
Towards Gelassenheit, Edwin Mellen, 2009.
DAMASIO, A.R., LErreur de Descartes, Odile Jacob, 1997.
The feeling of what happens : Body and emotion in the making of
consciousness , Harcourt Brace, 1999.
Spinoza avait raison, Odile Jacob, 2003.
DANTE, Divine Comdie, GF-Flammarion, 1992.
DANTO, A.C., Consciousness and motor control , The Behavioral and
Brain Sciences, 8, 1985, p. 540-541.
DANZIGER, K., The history of introspection reconsidered , Journal of
the History of the Behavioral Sciences, 16, 1980, p. 241-262.
Constructing the Subject, Historical Origins of Psychological
Research, Cambridge University Press, 1994.
DAVIS, M.H., COLEMAN, M.R., ABSALOM, A.R., RODD, J.M., JOHNSRUDE,
I.S., MATTA, B.F., OWEN, A.M. & MENON, D.K., Dissociating speech
perception and comprehension at reduced levels of awareness , PNAS,
104, 2007, p. 16032-16037.
DECHARMS, R.C., MAEDA, F., GLOVER, G.H., LUDLOW, D., PAULY, J.M.,
SONEJI, D., GABRIELI, J.D.E. & MACKEY, S.C., Control over brain
activation and pain learned by using real-time functional MRI , PNAS,
102, 2005, p. 18626-18631.
DEEPROSE, C., ANDRADE, J., VARMA, S. & EDWARDS, N., Unconscious
learning during surgery with propofol anaesthesia , British Journal of
Anaesthesia, 92, 2004, p. 171-177.
DEHAENE, S., KERSZBERG, M. & CHANGEUX, J.-P., A neuronal model of a
global workspace in effortful cognitive tasks , PNAS, 95, 1998,
p. 14529-14534.
DEHAENE, S. & NACCACHE, L., Towards a cognitive neuroscience of
consciousness : Basic evidence and a workspace framework , in
DEHAENE, S. (d.), The Cognitive Theory of Consciousness, MIT Press,
2001.
DEHAENE, S. & CHANGEUX, J.-P., Ongoing spontaneous activity controls
access to consciousness : A neuronal model for inattentional blindness ,
PLOS Biology, 3, 2005, p. 910-927.
DEHAENE, S. & CHANGEUX, J.-P., Experimental and theoretical approach
to conscious processing , Neuron, 70, 2011, p. 200-227.
DENNETT, D., Consciousness Explained, Penguin, 1991.
The unimagined preposterousness of zombies , Journal of
Consciousness Studies, vol. 2, 1995, p. 322-326.
How could I be wrong ? How wrong could I be ? , Journal of
Consciousness Studies, vol. 9, 2002, p. 13-16.
Whos on first ? Heterophenomenology explained , Journal of
Consciousness Studies, vol. 10, 2003, p. 19-30.
Freedom Evolves, Viking, 2003.
Sweet Dreams, MIT Press, 2006.
What RoboMary Knows , in ALTER, T. & WALTER, S., Phenomenal
Concepts and Phenomenal Knowledge, Oxford University Press, 2007.
DENNETT, D. & KINSBOURNE, M., Time and the observer : The where
and when of consciousness in the brain , The Behavioral and Brain
Sciences, 15, 1992, p. 183-247.
DENYS lAROPAGITE, LExprience de Dieu, Fides, 2001.
DEPRAZ, N., La Conscience, Armand Colin, 2001.
Comprendre la phnomnologie : une pratique concrte, Armand
Colin, 2006.
Lire Husserl en phnomnologue, PUF, 2008.
Avatar je te vois : une exprience philosophique, Ellipses, 2012.
DEPRAZ N., VARELA, F. & VERMERSCH, P., lpreuve de lexprience,
Zeta Books, 2011.
DERRIDA, J., De la grammatologie, Minuit, 1967.
Lcriture et la Diffrence, Seuil, coll. Points , 1979.
Le Toucher, Jean-Luc Nancy, Galile, 2000.
DESCARTES, R., uvres, dition C. Adam & P. Tannery, Vrin, 1964-1974.
Correspondance, dition C. Adam & G. Milhaud, Flix Alcan, PUF,
1936-1963.
uvres philosophiques, II, Garnier, 1967.
Rgles pour la direction de lesprit, Le Livre de Poche, 2002.
LEntretien avec Burman, PUF, 1981.
Correspondance avec Elisabeth, et autres lettres, GF-Flammarion,
1989.
Mditations mtaphysiques, Le Livre de Poche, 1990.
Discours de la mthode, Gallimard, 2009.
DESCOLA, P., Par-del nature et culture, Gallimard, 2005.
DESMURGET, M., Searching for the neural correlates of conscious
intention , Journal of Cognitive Neuroscience, 25, 2013, p. 830-833.
DEVEREUX, G., De langoisse la mthode dans les sciences du
comportement, Flammarion, coll. Champs , 2012.
DILLON, P., COPELAND, J. & JANSEN, K., Patterns of use and harms
associated with non-medical ketamine use , Drug and Alcohol
Dependence, 69, 2003, p. 23-28.
DOBRUNZ, U.E.G., JAEGER, K. & VETTER, G., Memory priming during
light anaesthesia with desflurane and remifentanil anaesthesia , British
Journal of Anesthesia, 108, 2007, p. 630-637.
DGEN, Shbgenz, 6, Sully, 2012.
DRAKE, S., Cause, Experiment and Science, The University of Chicago
Press, 1984.
DROIT, R.-P., Le Culte du nant, Seuil, 1997.
DUCHEYNE, S., Galileos interventionist notion of cause , The
Journal of the History of Ideas, 67, 2006, p. 443-464.
DUDJOM LINGPA, Buddhahood Without Meditation, Padma Publishing,
1994.
DUFOUR-KOWALSKA, G., Michel Henry. Passion et magnificence de la
vie, Beauchesne, 2003.
DUMONT, J.P. (d.), Les Prsocratiques, Gallimard, 1988.
DUPRON, I., G.T. Fechner, le Paralllisme psychophysique, PUF, 2000.
ECKHART, Matre, Du miracle de lme, Calmann-Lvy, 1996.
EDELMAN, D.B. & SETH, A.K., Animal consciousness : A synthetic
approach , Trends in Neurosciences, 32, 2009, p. 476-484.
EDELMAN, G. & TONONI, G., Comment la matire devient conscience,
Odile Jacob, 2000.
EDWARDS, J.C.W., Is consciousness only a property of individual
cells ? , Journal of Consciousness Studies, vol. 12, 2005, p. 60-76.
EDWARDS, S., RICHMOND, S. & REES, G., I Know What You Are Thinking :
Brain Imaging and Mental Privacy, Oxford University Press, 2012.
EHRSSON, H., The experimental induction of out-of-body experience ,
Science, 317, 2007, p. 1048.
EKMAN, P., Emotions Revealed, Holt Paperbacks, 2007.
ELIADE, M., Le Chamanisme et les techniques archaques de lextase,
Payot, 1993.
ENGEL, A.K., FRIES, P., KONIG, P., BRECHT, M. & SINGER, W., Temporal
binding, binocular rivalry, and consciousness , Consciousness and
Cognition, 8, 1999, p. 155-158.
PICURE, Lettre Mnce, Garnier-Flammarion, 2009.
RASME, loge de la folie, Flammarion, 1999.
ERDELYI, M.H., Subliminal perception and its cognates : Theory,
indeterminacy, and time , Consciousness and Cognition, 13, 2001,
p. 73-91.
ERICSSON, K.A. & SIMON, H.A., Protocol Analysis, Verbal Reports as
Data, MIT Press, 1984.
ESPAGNAT, B. d, Trait de physique et de philosophie, Fayard, 2002.
EY, H., La Conscience, Descle de Brouwer, 1983.
FARTHING, G.W., The Psychology of Consciousness, Prentice Hall, 1992.
FAUGERAS, F., ROHAUT, B., WEISS, N., BEKINSTEIN, T.A., GALANAUD, D.,
PUYBASSET, L., BOLGERT, F., SERGENT, C., COHEN, L., DEHAENE, S. &
NACCACHE, L., Probing consciousness with event-related potentials in
the vegetative state , Neurology, 77, 2011, p. 264-268.
FECHNER, G., Nanna : Oder ber das Seelenleben der Pflanzen, Leopold
Voss, 1848.
Zend Avesta, Leopold Voss, 1851.
Elemente der Psychophysik, Breitkopf und Hrtel, 1860.
FEIGL, H., The Mental and the Physical, University of Minnesota Press,
1958.
FENNER, P., Le Fil de la certitude, Le Reli, 2001.
FERRI, F., BERTOSSA, F., BESA, M. & FERRARI, R., Point zero : A
phenomenological inquiry into the subjective physical location of
consciousness , Perceptual and Motor Skills, 107, 2008, p. 323-335.
FICHTE, J.G., La Thorie de la science, expos de 1804, Aubier, 1967.
La Doctrine de la science nova methodo, Lge dhomme, 1989.
uvres choisies de philosophie premire. Doctrine de la science
(1794-1797), Vrin, 1990.
FICIN, M., Quid Sit Lumen, Allia, 2004.
FILLIOZAT, P.-S., Le Sanskrit, PUF, 2010.
FINDLAY, J.N., Recommendations regarding the language of
introspection , Philosophy and Phenomenological Research, 9, 1948,
p. 212-236.
Language, Mind and Value : Philosophical Essays, Allen & Unwin,
1963.
FINK, E., What does the phenomenology of Husserl want to
accomplish ? , Research in Phenomenology, 2, 1972, p. 5-27.
Sixime Mditation cartsienne, Jrme Millon, 1994.
FLAJOLIET, A., Husserl et Messer , Expliciter. Journal de
lassociation GREX, 66, 2006, p. 1-32.
LAME DEER, J. & ERDOES, R., Lame Deer : Seeker of Visions, Simon &
Schuster, 1972.
FISETTE, D., Logique et philosophie chez Frege et Husserl , in BRISART,
R. (d.), Husserl et Frege : les ambiguts de lantipsychologisme, Vrin,
2002.
FITZGERALD, R.D., LAMM, C., OCZENSKI, W., STIMPFL, T., VYCUDILIK, W.
& BAUER, H., Direct current auditory evoked potentials during
wakefulness, anesthesia, and emergence from anesthesia , Anesthesia &
Analgesia, 92, 2001, p. 154-160.
FLANAGAN, O. & POLGER, T., Zombies and the function of
consciousness , Journal of Consciousness Studies, vol. 2, 1995, p. 313-
321.
FODOR, J.A., Psychological Explanation, Random House, 1968.
The Mind Doesnt Work That Way, MIT Press, 2000.
FORD, J., Attention and the new skeptics , Journal of Consciousness
Studies, vol. 15, 2008, p. 59-86.
FOUCAULT, M., Dits et crits 1984. Des espaces autres, in Architecture,
Mouvement, Continuit, n
o
5, 1984, p. 46-49.
Histoire de la folie lge classique, Gallimard, 1976.
FREEMAN, W.J. & VITIELLO, G., Nonlinear brain dynamics as
macroscopic manifestation of underlying many-body field dynamics ,
Physics of Life Reviews, 3, 2006, p. 93-118.
FREEMAN, A. (d.), Consciousness and its Place in Nature, Imprint
Academic, 2007.
FREUD, S., Mtapsychologie, Gallimard, 1978.
La Vie sexuelle, PUF, 1999.
LInquitante tranget et autres essais, Gallimard, 2003.
FRIED, I., MUKAMEL, R. & KREIMAN, G., Internally generated
preactivation of single neurons in human medial frontal cortex predicts
volition , Neuron, 69, 2011, p. 548-562.
FUCHS, T. & DE JAEGHER, H., Enactive intersubjectivity : Participatory
sense-making and mutual incorporation , Phenomenology and Cognitive
Sciences, 8, 2009, p. 465-486.
GALILE, G. Opere I, U.T.E.T., 1980.
Dialogue sur les deux grands systmes du monde, Seuil, 2000.
GALLAGHER, S., Understanding interpersonal problems in autism :
Interaction theory as an alternative to theory of mind , Philosophy,
Psychiatry, and Psychology, 11, 2004, p. 199-217.
How the Body Shapes the Mind, Oxford University Press, 2006.
GARCIA, P.S. & SEBEL, P., Current controversies in intraoperative
awareness I , in MASHOUR, G. (d.), Consciousness, Awareness, and
Anesthesia, Cambridge University Press, 2010.
GARFIELD, J.L, The myth of Jones and the mirror of nature : Reflections
on introspection , Philosophy and Phenomenological Research, 50,
1989, p. 1-26.
GAUKROGER, S. (d.), The Uses of Antiquity, Kluwer, 2001.
GENDLIN, E., Experiencing and the Creation of Meaning, Northwestern
University Press, 1962.
GENNARO, R.J., Leibniz on consciousness and self-consciousness , in
GENNARO, R.J. & HUENEMANN, C. (d.), New Essays on the Rationalists,
Oxford University Press, 1999.
GHEORGHIEV, C., Le Signe du miroir, ditions Universitaires
Europennes, 2011.
GHONEIM, M., Etiology and risk factors of intraoperative awareness ,
in MASHOUR, G.A., Consciousness, Awareness, and Anesthesia,
Cambridge University Press, 2010.
GHONEIM, M., BLOCK, R.I., HAFFARNAN, M. & MATHEWS, M.J.,
Awareness during anesthesia : risk factors, causes and sequelae : A
review of reported cases in the literature , Anesthesia & Analgesia, 108,
2009, p. 527-535.
GIL, D., Bachelard et la Culture scientifique, PUF, 1993.
GILLIES, D., An action-related theory of causality , British Journal for
the Philosophy of Science, 56, 2005, p. 823-842.
GILLOT, P., La question de lintriorit mentale lge classique : le
thtre cartsien , Revue de synthse, 131, 2010, p. 7-20.
GOLDBERG, I., HAREL, M. & MALACH, R., When the brain loses its self :
Prefrontal inactivation during sensorimotor processing , Neuron, 50,
2006, p. 329-339.
GOLDGAR, A., Tulipmania : Money, Honor, and Knowledge in the Dutch
Golden Age, University of Chicago Press, 2007.
GOLDMAN, A.I., Epistemology and the evidential status of introspective
reports , in JACK, A. & ROEPSTORFF, A. (d.), Trusting the subject ?,
Imprint Academic, 2001.
GOLDSTEIN, K., La Structure de lorganisme, Gallimard, 1983.
GOODING, D.C., GORMAN, M., TWENEY, R. & KINCANNON, A. (d.),
Scientific and Technological Thinking, Erlbaum, 2005.
GOPNIK, A. & MELTZOFF, A.N, Minds, bodies and persons : Young
childrens understanding of the self and others as reflected in imitation and
theory of mind research , in PARKER, S. & MITCHELL, R. (d.), Self-
Awareness in Animals and Humans, Cambridge University Press, 1994.
GOPNIK, A., Le Bb philosophe, Le Pommier, 2010.
GOULD, S.J. & LEWONTIN, R., The spandrels of San Marco and the
Panglossian paradigm : A critique of the adaptationist programme ,
Proceedings of the Royal Society of London, B, 205, 1979, p. 581-598.
GRAY, J., Consciousness : Creeping Up on the Hard Problem, Oxford
University Press, 2004.
GREENE, J., Memory, Thinking and Language : Topics in Cognitive
Psychology, Methuen, 1987.
GRESS, T., Descartes et la Prcarit du monde, CNRS, 2012.
GREYSON, B., The near-death experience as a focus of clinical
attention , Journal of Nervous and Mental Disease, 185, 1997, p. 327-
334.
GRICE, H.P. (d.), Studies in the Way of Words, Harvard University Press,
1989.
GRIFFITHS, L.J., Near-death experiences and psychotherapy ,
Psychiatry, 6, 2009, p. 35-42.
GRIFFITHS, R.R., RICHARDS, W.A., JOHNSON, M.W., MCCANN, U.D. &
JESSE, R., Mystical-type experiences occasioned by psilocybin mediate
the attribution of personal meaning and spiritual significance 14 months
later , Journal of Psychopharmacology, 22, 2008, p. 621-632.
GROSSBERG, S., The link between brain learning, attention, and
consciousness , Consciousness and Cognition, 8, 1999, p. 1-44.
GUISINGER, S., Adapted to flee famine : Adding an evolutionary
perspective on anorexia nervosa , Psychological Review, 110, 2003,
p. 745-761.
GUYON, J., Le Moyen court et autres rcits, Jrme Millon, 1995.
HAAR, M., Proximit et distance vis--vis de Heidegger chez le dernier
Merleau-Ponty , in BARBARAS, R. (d.), Recherches sur la
phnomnologie de Merleau-Ponty, prcd de MERLEAU-PONTY, M.,
Notes de cours sur lorigine de la gomtrie de Husserl, PUF, 1998.
HACKING, I., Rewriting the Soul : Multiple Personalities and the Science
of Memory, Princeton University Press, 1998.
HADOT, P., Quest-ce que la philosophie antique ?, Gallimard, 1995.
Exercices spirituels et philosophie antique, Albin Michel, 2002.
HGGQVIST, S., A model for thought experiments , Canadian Journal
of Philosophy, 39, 2009, p. 55-76.
HAGMANN, P., CAMMOUN, L., GIGANDET, X., MEULI, R., HONEY, C.J.,
WEDEEN, V.J. & SPORNS, O., Mapping the structural core of human
cerebral cortex , PLOS Biology, 6, e159, 2008.
HALIFAX, J., The Fruitful Darkness, Grove Press, 1993
Being With Dying, Shambala, 2008.
HALLETT, M., Volitional control of movement : The physiology of free
will , Clinical Neurophysiology, 118, 2007, p. 1179-1192.
HAMEROFF, S., Conscious events as orchestrated space-time
selections , Journal of Consciousness Studies, vol. 3, 1996, p. 36-53.
HANSEN, P.C., KRINGELBACH, M.L. & SALMELIN, R. (d.), MEG : An
Introduction to Methods, Oxford University Press, 2010.
HASENBALG, V., La bouteille de Klein, le langage et le rel , Revue
lacanienne, 2, 2007, p. 64-71.
HAYWARD, J.W. & VARELA, F. (d.), Passerelles. Entretiens avec le
Dala-Lama sur les sciences de lesprit, Albin Michel, 1995.
HEIDEGGER, M., Les Principes fondamentaux de la phnomnologie,
Gallimard, 1984.
tre et Temps, trad. E. Martineau, Authentica, 1985.
Quest-ce que la mtaphysique ?, Nathan, 1998.
Questions III et IV, Gallimard, 1990.
Introduction la recherche phnomnologique, Gallimard, 2013.
HEGEL, G.W.F., La Phnomnologie de lesprit, Aubier Montaigne, 1966.
La Relation du scepticisme avec la philosophie, suivi de LEssence
de la critique philosophique, Vrin, 1972.
Science de la logique, I, Aubier-Montaigne, 1976.
Leons sur lhistoire de la philosophie. Tome VI La philosophie
moderne, Vrin, 1985.
La Diffrence entre les systmes philosophiques de Fichte et de
Schelling, Vrin, 1986.
Encyclopdie des sciences philosophiques, III, Vrin, 1992.
HEKTNER, J., SCHMIDT, J.A. & CSIKSZENTMIHALYI, M., Experience
Sampling Method, Sage, 2007.
HENDRICKS, M., Experiencing level : An instance of developing a
variable from a first person process so it can be reliably measured and
taught , Journal of Consciousness Studies, vol. 16, 2009, p. 129-155.
HENRY, M., Gnalogie de la psychanalyse, PUF, 1985.
La Barbarie, Grasset, 1987.
Phnomnologie matrielle, PUF, 1990.
Incarnation, Seuil, 2000.
Philosophie et Phnomnologie du corps. Essai sur lontologie
biranienne, PUF, 2003.
HERZOG, M.H., ESFELD, M. & GERSTNER, W., Consciousness and the
small network argument , Neural Networks, 20, 2007, p. 1054-1056.
HIMANKA, J., Husserls argumentation for the pre-copernican view of
the earth , Review of Metaphysics, 58, 2005, p. 621-644.
HINTIKKA, J., Cogito ergo sum : infrence ou performance ? ,
Philosophie, 6, 1985, p. 21-51.
HOBBES, T., De la libert et de la ncessit, Vrin, 1977.
HFFDING, H., The Problems of Philosophy, The MacMillan Company,
1905.
HOFSTADTER, D., I Am a Strange Loop, Basic Books, 2007.
HONDERICH, T., On Consciousness, Edinburgh University Press, 2004.
Radical Externalism , Journal of Consciousness Studies, vol. 13,
2006, p. 3-13.
HONNETH, A., La Rification, Gallimard, 2007.
HORACE, uvres compltes, J.-J. Dubochet, 1845.
HORGAN, T. & KRIEGEL, U., Phenomenal epistemology : What is
consciousness that we may know it so well ? , Philosophical Issues, 17,
2007, p. 123-144.
HTZEL, B.K., CARMODY, J., VANGEL, M., CONGLETON, C., SERAMSETTI,
S.M., GARD, T. & LAZAR, S.W., Mindfulness practice leads to regional
increases in gray matter density , Psychiatry Research, 191, 2011, p. 36-
43.
HUDETZ, A.G., Are we unconscious during general anesthesia ? ,
International Anesthesiology Clinics, 46, 2008, p. 25-42.
HUGO, V., Les Contemplations, Le Livre de Poche, 1965.
HULIN, M., La Face cache du temps, Fayard, 1985.
Quest-ce que lignorance mtaphysique ?, Vrin, 1994.
Comment la philosophie indienne sest-elle dveloppe ?, Panama,
2008.
HULME, O., FRISTON, K.F. & ZEKI, S., Neural correlates of stimulus
reportability , Journal of Cognitive Neuroscience, 21, 2009, p. 1602-
1610.
HUME, D., A Treatise of Human Nature, Oxford University Press, 1978.
HUMPHREY, G., Thinking, Methuen, 1951.
HUMPHREY, N., The Inner Eye : Social Intelligence in Evolution, Oxford
University Press, 2003.
Soul Dust : the Magic of Consciousness, Princeton University Press,
2011.
HUNEMAN, P., Mtaphysique et Biologie. Kant et la constitution du
concept dorganisme, Kim, 2008.
HURLBURT, R.T. & HEAVEY, C.L., Telling what we know : Describing
inner experience , Trends in Cognitive Sciences, 5, 2001, p. 400-403.
Exploring Inner Experience, John Benjamins, 2006.
HURLBURT, R.T. & SCHWITZGEBEL, E., Describing inner experience ?
Proponent meets skeptic, MIT Press, 2007.
HUSSERL, E., Ides directrices pour une phnomnologie et une
philosophie phnomnologique pures I, Gallimard, 1950.
Ideen zu einer reinen Phnomenologie und phnomenologischen
Philosophie. Drittes Buch : die Phnomenologie und die Fundamente
der Wissenschaften, Husserliana V, Martinus Nijhoff, 1952.
LIde de la phnomnologie, PUF, 1970.
Exprience et Jugement, PUF, 1970.
Recherches logiques, PUF, 1972.
Philosophie premire, PUF, 1972.
La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, Gallimard, 1976.
Ides directrices pour une phnomnologie. Livre second :
Recherches phnomnologiques pour la constitution, PUF, 1982
La Terre ne se meut pas, Minuit, 1989.
Mditations cartsiennes, Vrin, 1992.
Leons pour une phnomnologie de la conscience intime du temps,
PUF, 1996.
De la synthse passive, Jrme Millon, 1998.
De la rduction phnomnologique, Jrme Millon, 2007.
Phnomnologie de lattention, Vrin, 2009.
HUT, P. & SHEPARD, R.N., Turning the hard problem upside down and
sideways , Journal of Consciousness Studies, vol. 3, 1996, p. 313-329.
HYPPOLITE, J., Gense et structure de la phnomnologie de lesprit de
Hegel, Aubier, 1946.
IRVINE, E., Consciousness as a Scientific Concept, Springer, 2013.
JACK, A., Introspection : the tipping point , Consciousness and
Cognition, 22, 2013, p. 670-671.
JACK, A. & ROEPSTORFF, A., The measurement problem for
experience : damaging flaw or intriguing puzzle ? , Trends in Cognitive
Sciences, 6, 2002, p. 372-374.
JACKSON, F., Epiphenomenal qualia , Philosophical Quarterly, 32,
1982, p. 127-136.
Mind and illusion , in LUDLOW, P., NAGASAWA, Y. & STOLJAR, D.,
Theres Something About Mary, MIT Press, 2004.
JACOBSON, Y., La Pense hassidique, Cerf, 1989.
JAMES, W., The Principles of Psychology, Holt, 1890.
Essays in Radical Empiricism, Harvard University Press, 1976.
Prcis de psychologie, Les Empcheurs de penser en rond, 2003.
Essais dempirisme radical, Flammarion, 2007.
JANICAUD, D., Le Tournant thologique de la phnomnologie franaise,
Lclat, 1991.
JANKLVITCH, V., La Mauvaise Conscience, Flix Alcan, 1939.
Philosophie premire. Introduction une philosophie du
presque , PUF, 1954.
Le je-ne-sais-quoi et le presque rien, PUF, 1957.
La Mort, Flammarion, 1966.
JAQUET, C., Le Spinoza protobiologiste de Damasio , in JAQUET, C.,
SVRAC, P. & SUHAMY, A., La Thorie spinoziste des rapports
corps/esprit, Hermann, 2009.
JAUSS, H.R., Pour une esthtique de la rception, Gallimard, 1978.
JAYNES, J., The Origins of Consciousness in the Breakdown of the
Bicameral Mind, Houghton Mifflin, 1976.
JIBU, M. & YASUE, K., Quantum Brain Dynamics and Consciousness,
John Benjamins, 1995.
JOHANSSON, P., HALL, L., SIKSTRM, S. & OLSSON, A., Failure to detect
mismatches between intention and outcome in a simple detection task ,
Science, 310, 2005, p. 116-119.
JOHANSSON, P., HALL, L., SIKSTRM, S., TRNING, B. & LIND, A., How
something can be said about telling more than we can know : On choice
blindness and introspection , Consciousness and Cognition, 15, 2006,
p. 673-692.
JULLIEN, F., Un sage est sans ide, Seuil, 1998.
De luniversel, Fayard, 2008.
JULLIER, L., Interdit aux moins de dix-huit ans : morale, sexe et violence
au cinma, Armand Colin, 2008.
JUNG, J., BAYLE, D., JERBI, K., VIDAL, J.R., HNAFF, M.-A., OSSANDON,
T., BERTRAND, O., MAUGUIRE, F. & LACHAUX, J.-Ph., Intracerebral
gamma modulations reveal interaction between emotional processing and
action outcome evaluation in the human orbitofrontal cortex ,
International Journal of Psychophysiology, 79, 2011, p. 64-72.
KABAT-ZINN, J., MASSION, A.O., KRISTELLER, J., PETERSON, L.G.,
FLETCHER, K.E., PBERT, L., LANDERKING, W.R. & SANTORELLI, S.F.,
Effectiveness of a meditation-based stress-reduction program in the
treatment of anxiety disorders , American Journal of Psychiatry, 149,
1992, p. 936-943.
KANE, R., The modal ontological argument , Mind, 93, 1984, p. 336-
350.
KANT, I., Premiers principes mtaphysiques de la science de la nature,
Vrin, 1982.
Critique de la raison pratique, PUF, 1989.
Critique de la facult de juger, Gallimard, 1989.
Fondements de la mtaphysique des murs, Vrin, 1992.
Critique de la raison pure, Flammarion, 2001.
KENTRIDGE, R.W., Visual attention : Bringing the unseen past into
view , Current Biology, 23, 2013, R69-R71.
KERSSENS, C. & ALKIRE, M., Memory formation during general
anesthesia , in MASHOUR, G.A., Consciousness, Awareness, and
Anesthesia, Cambridge University Press, 2010.
KIHARA, K., IKEDA, T., MATSUYOSHI, D., HIROSE, N., MIMA, T.,
FUKUYAMA, H. & OSAKA, N., Differential contributions of the
intraparietal sulcus and the inferior parietal lobe to attentional blink :
Evidence from transcranial magnetic stimulation , Journal of Cognitive
Neuroscience, 23, 2011, p. 247-256.
KIHLSTROM, J. F., The cognitive unconscious , Science, 237, 1987,
p. 1445-1452.
The automaticity juggernaut , in BAER, J., KAUFMAN, J.C. &
BAUMEISTER, R.F. (d.), Psychology and Free Will, Oxford University
Press, 2008.
KIM, J., Physicalism or Something Near Enough, Princeton University
Press, 2005.
Philosophy of Mind, Westview, 2006.
KLIBANSKY, R., PANOFSKY, E. & SAXL, F., Saturne et la Mlancolie,
Gallimard, 1989.
KNEALE, W., Aristotle and the consequentia mirabilis , Journal of
Hellenistic Studies, 77, 1957, p. 62-66.
KOCH, C., The Quest for Consciousness : A Neurobiological Approach,
Robert, 2004.
Consciousness : Confessions of a Romantic Reductionist, MIT Press,
2012.
KOUIDER, S., GARDELLE, V. de, SACKUR, J. & DUPOUX, E., How rich is
consciousness ? The partial awareness hypothesis , Trends in Cognitive
Sciences, 14, 2010, p. 301-307.
KOUIDER, S., SACKUR, J. & GARDELLE, V. de, Do we still need
phenomenal consciousness ? Comment on block , Trends in Cognitive
Sciences, 16, 2012, p. 140-141.
KOUIDER, S., STAHLHUT, C., GELSKOV, S.V., BARBOSA, L.S., DUTAT, M.,
GARDELLE, V. de, CHRISTOPHE, A., DEHAENE, S. & DEHAENE-LAMBERTZ,
G., A neural marker of perceptual consciousness in infants , Science,
340, 2013, p. 376-380.
KRETZ, L., Peter Carruthers and brute experience. Descartes revisited ,
Essays in Philosophy, 5, 2004, p. 1-13.
KULSTAD, M.A., Leibniz on Apperception, Consciousness and Reflection,
Philosophia, 1990.
LACHAUX, J.-P., JERBI, K., BERTRAND, O., MINOTTI, L., HOFFMANN, D.,
SCHOENDORFF, B. & Kahane, P., A blueprint for real-time functional
mapping via human intracranial recordings , PLOS ONE, 10, e1094,
2007.
LACHAUX, J.-P., If no control, then what ? Making sense of neural
noise in human brain mapping experiments using first-person reports ,
Journal of Consciousness Studies, vol. 18, 2011, p. 162-166.
LACROIX, A., Le visage, ce quil rvle , Philosophie Magazine, n
o
64,
2012, p. 44-45.
LA FORGE, L. de, Trait de lesprit de lhomme, Michel Bobin, Paris,
1666.
LAING, R., Soi et les autres, Gallimard, 1971.
The Politics of Experience and the Bird of Paradise, Penguin Books,
1967.
LALANDE, A., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF,
1968.
LAMME, V.A.F., Towards a true neural stance on consciousness ,
Trends in Cognitive Sciences, 10, p. 494-501, 2006.
How neuroscience will change our view on consciousness ,
Cognitive Neuroscience and Consciousness, 1, 2010, p. 204-220.
LAMOTTE, E., Histoire du bouddhisme indien, Publications Universitaires
de Louvain, 1958.
LANDMAN R., SPEKREISE, H. & LAMME, V.A.F, Large capacity storage of
integrated objects before change blindness , Vision Research, 43, 2003,
p. 149-164.
LANGER, E.J., The Power of Mindful Learning, Addison-Wesley, 1997.
LATOUR, B., Enqutes sur les modes dexistence. Une anthropologie des
modernes, La Dcouverte, 2012.
LAU, H. & ROSENTHAL, D., Empirical support for higher-order theories
of conscious awareness , Trends in Cognitive Sciences, 15, 2011,
p. 365-373.
LAUREYS, S., The neural correlate of (un)awareness : lessons from the
vegetative state , Trends in Cognitive Sciences, 9, 2005, p. 556-559.
LA VALLE POUSSIN, L. de, LAbhidharmakoa de Vasubandhu, Paul
Geuthner, 1931.
LEE, U., MASHOUR, G.A., KIM, S., NOH, G. & CHOI, B., Propofol
induction reduces the capacity for neural information integration :
Implications for the mechanism of consciousness and general anesthesia ,
Consciousness and Cognition, 18, 2009, p. 56-64.
LEENHARD, M., Do Kamo, Gallimard, 1947.
LEGGENHAGER, B., TADI, T., METZINGER, T. & BLANKE, O., Video ergo
sum : Manipulating bodily self-consciousness , Science, 317, 2007,
p. 1096-1099.
LEIBNIZ, G.W., Nouveaux essais sur lentendement humain, Flammarion,
1993.
Principes de la nature et de la grce, GF-Flammarion, 1999.
LENNMARKEN, C. & SYDSJO, G., Psychological consequences of
intraoperative awareness , in MASHOUR, G.A., Consciousness,
Awareness, and Anesthesia, Cambridge University Press, 2010.
LESVRE, N., tat actuel des tudes concernant les potentiels voqus
recueillis sur le scalp chez lhomme , LAnne psychologique, 68, 1968,
p. 143-184.
LESLIE, K., Dreaming during anesthesia , in MASHOUR, G. (d.),
Consciousness, Awareness, and Anesthesia, Cambridge University Press,
2010.
LE VAN QUYEN, M. & PETITMENGIN, C., Neuronal dynamics and
conscious experience : An example of reciprocal causation before
epileptic seizures , Phenomenology and the Cognitive Sciences, 1, 2002,
p. 169-180.
LVI-STRAUSS, C., Anthropologie structurale, Plon, 1958.
LEVINAS, E., En dcouvrant lexistence avec Husserl et Heidegger, Vrin,
2001.
Totalit et Infini, Le Livre de Poche, 2003.
LEVINE, J., Materialism and qualia : The explanatory gap , Pacific
Philosophical Quarterly, 64, 1983, pp 54-361.
LEWIS, G., Le Problme de linconscient et le cartsianisme, PUF, 1950.
LIBET, B., Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will
in voluntary action , The Behavioral and Brain Sciences, 8, 1985,
p. 529-538.
Do we have free will ? , Journal of Consciousness Studies, vol. 6,
1999, p. 47-57.
LIBET, B., WRIGHT, E.W., FEINSTEIN, B. & PEARL, D.K., Subjective
referral of the timing for a conscious sensory experience : A functional
role for the somatosensory specific projection system in man , Brain,
102, 1979, p. 191-222.
LLEU, J.-C., HAMM, P., JOUFFROY, L., LLEU, J., HARTMANN, G., LUPESCU,
R. & PAIN, L., Hypnose en anesthsie : des origines nos jours , Le
Praticien en anesthsie-ranimation, 13, 2009, p. 145-150.
LLINAS, R., RIBARY, U., CONTRERAS, D. & PEDROARENA, C., The
neuronal basis for consciousness , Philosophical Transactions of the
Royal Society of London, B, 353, 1998, p. 1841-1849.
LOAR, B., Phenomenal states , in BLOCK, N., FLANAGAN, O. &
GZELDERE, G., The Nature of Consciousness, MIT Press, 1999.
LOCKE, J., An Essay Concerning Human Understanding, Oxford
University Press, 1975.
LONGCHENPA, La Libert naturelle de lesprit, Seuil, 1994.
LONGO, G. & MONTEVIL, G., The inert versus the living state of matter :
Extended criticality, time geometry, anti-entropy : An overview ,
Frontiers in Physiology, 3, 2012, p. 39.
LU, H.D. & ROE, A.W., Functional organization of color domains in V1
and V2 of macaque monkey revealed by optical imaging , Cerebral
Cortex, 18, 2008, p. 516-533.
LUBKE, G.H., KERSSENS, C., PHAF, H. & SEBEL, P.S., Dependence of
explicit and implicit memory on hypnotic state in trauma patients ,
Anesthesiology, 90, 1999, p. 670-680.
LUTZ, A., Towards a neurophenomenology as an account of generative
passages : A first empirical case study , Phenomenology and the
Cognitive Science, 1, 2002, p. 133-167.
LUTZ, A., DUNNE, J. & DAVIDSON, R.J., Meditation and the neuroscience
of consciousness : An introduction , in ZELAZO, P.D., MOSCOVITCH, M. &
THOMPSON, E. (d.), The Cambridge Handbook of Consciousness,
Cambridge University Press, 2007.
LYONS, W., The Disappearance of Introspection, MIT Press, 1986.
MACDONELL, A.A., A Sanskrit Grammar for Students, Oxford University
Press, 1926.
MACGOVERN, K. & BAARS, B., Cognitive theories of consciousness , in
ZELAZO, P., MOSCOVITCH, M. & THOMPSON, E., The Cambridge
Handbook of Consciousness, Cambridge University Press, 2007.
MACH, E., LAnalyse des sensations, Jacqueline Chambon, 1996.
MACHOVEC, F., Near-death experiences : Psychotherapic aspects ,
Psychotherapy in Private Practice, 13, 1994, p. 99-105.
MACK, A. & ROCK, I., Inattentional Blindness, MIT Press, 1998.
MAISONNEUVE, I.M. & GLICK, S.D., Anti-addictive actions of an Iboga
alcaloid congener : A novel mechanism for a novel treatment ,
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 2003, p. 607-618.
MALDINEY, H., Penser lhomme et la folie, Jrme Millon, 2007.
Atres de la langue et demeures de la pense, Cerf, 2012.
MALEBRANCHE, N., uvres I, Gallimard, 1979.
MANGAN, B., Cognition, fringe consciousness, and the legacy of William
James , in VELMANS, M. & SCHNEIDER, S. (d.), The Blackwell
Companion to Consciousness, Blackwell, 2007.
MANZOTTI, R., Does process externalism support panpsychism ? The
relational nature of the physical world as a foundation for the conscious
mind , in SKRBINA, D. (d.), Mind That Abides, John Benjamins, 2009.
MARCEL, A., Introspective report , Journal of Consciousness Studies,
vol. 10, 2003, p. 167-186.
MARSH, M.N., Out-of-body and near-death experiences : Brain-state
phenomena or glimpses of immortality ?, Oxford University Press, 2010.
MARION, J.-L., La Thologie blanche de Descartes, PUF, 1981.
Rduction et Donation, PUF, 1989.
Sur lontologie grise de Descartes, Vrin, 1993.
tant donn, PUF, 1997.
La Rigueur des choses. Entretiens avec Dan Arbib, Flammarion,
2012.
MARTI, S., SACKUR, J., SIGMAN, M. & DEHAENE, S., Mapping
introspections blind spot : Reconstruction of dual-task phenomenology
using quantified introspection , Cognition, 115, 2010, p. 303-313.
MASHOUR, G.A., Integrating the science of consciousness and
anesthesia , Anesthesia & Analgesia, 103, 2006, p. 975-982.
MASHOUR, G.A. & LAROCK, E., Inverse zombies, anesthesia awareness,
and the hard problem of unconsciousness , Consciousness and
Cognition, 17, 2008, p. 1163-1168.
MASON, D., Demystifying without quining : Wittgenstein and Dennett on
qualitative states , South Africal Journal of Philosophy, 24, 2005, p. 33-
43.
MAUPASSANT, G. de, Bel-Ami, Le Livre de Poche, 1979.
MAYR, S. & BUCHNER, A., Negative priming as a memory phenomenon :
A review of 20 years of negative priming research , Journal of
Psychology, 215, 2007, p. 35-51.
MEAD, G.H., Selected Writings, Bobbs-Merrill, 1964.
MEILLASSOUX, Q., Aprs la finitude, Seuil, 2006.
MENARY, R. (d.), The Extended Mind, MIT Press, 2010.
MENZIES, P. & PRICE, H., Causation as a Secondary Quality , British
Journal for the Philosophy of Science, 44, 1993, p. 187-204.
MERICKLE, P.M., SMILEK, D. & EASTWOOD, J.D., Perception without
awareness : Perspectives from cognitive psychology , Cognition, 79,
2001, p. 115-134.
MERKER, B., The liabilities of mobility : A selection pressure for the
transition to consciousness in animal evolution , Consciousness and
Cognition, 14, 2005, p. 89-114.
MERLEAU-PONTY, M., Phnomnologie de la perception, Gallimard,
1945.
Lil et lEsprit, Gallimard, 1964.
Le Visible et lInvisible, Gallimard, 1964.
La Structure du comportement, PUF, 1990.
MEUWESE, J., POST, R., SCHOLTE, S. & LAMME, V., Does perceptual
learning require consciousness or attention ? , Journal of Cognitive
Neuroscience, DOI 10.1162/jocn_a_00424, 2013.
MICOULAUD-FRANCHI, J.-A., BAT-PITAULT, F., CERMOLACCE, M. & VION-
DURY, J., Neurofeedback dans le trouble dficit de lattention avec
hyperactivit : de lefficacit la spcificit de leffet
neurophysiologique , Annales mdico-psychologiques, 169, 2011,
p. 200-208.
MIDAL, F., Confrences de Tokyo, Cerf, 2012.
MILAREPA, uvres compltes, Fayard, 2006.
MILL, J.S., System of Logic, John W. Parker, 1851.
MILLER, G.A., The Science of Mental Life, Harper & Row, 1962.
Feedback from frontal cortex may be a signature of consciousness ,
Science, 332, 2011, p. 779.
MIN, B.-K., A thalamic reticular networking model of consciousness ,
Theoretical Biology and Medical Modelling, 7, 10, doi:10.1186/1742-
4682-7-10.
MISRAHI, R., Le Corps et lEsprit dans la philosophie de Spinoza, Les
Empcheurs de penser en rond, 2003.
MITCHELL, E., The Way of the Explorer : An Apollo Astronauts Journey
Through the Material and Mystical Worlds, G. Putnam & Sons, 1996.
MITCHELL, M., HRABER, P.T. & CRUTCHFIELD, J.P., Revisiting the edge
of chaos : Evolving cellular automata to perform computations , Complex
Systems, 7, 1993, p. 89-130.
MITCHELL, R.W., Kinesthetic-visual matching and the self-concept as
explanations of mirror-self-recognition , Journal for the Theory of
Social Behaviour, 27, 1997, p. 18-39.
MOESCHLER, J. & REBOUL, A., Dictionnaire encyclopdique de
pragmatique, Seuil, 1994.
MOLDAKARIMOV, S., BAZHENOV, M. & SEJNOWSKI, T., Perceptual
priming leads to reduction of gamma frequency oscillations , PNAS, 107,
2010, p. 5640-5645.
MONGIN, O., La Violence des images. Essai sur les Passions
dmocratiques II, Seuil, 1997.
MONTAIGNE, M. de, uvres compltes, Seuil, 1967.
MOODY, T.C., Conversations with zombies , Journal of Consciousness
Studies, 1994, p. 196-200.
MORE, H., The Immortality of the Soul, Martinus Nijhoff, 1987.
MORIN, A., Levels of consciousness , Science and Consciousness
Review, 2, 2004, p. 1-16.
Levels of consciousness and self-awareness : A comparison and
integration of various neurocognitive views , Consciousness and
Cognition, 15, 2006, p. 358-371.
MORRIS, S.G., The impact of neuroscience on the free will debate ,
Florida Philosophical Review, IX, 2009, p. 56-78.
MOUTOUSSIS, K. & ZEKI, S., The relationship between cortical activation
and perception investigated with invisible stimuli , PNAS, 99, 2002,
p. 9527-9532.
MURRAY, C.D., Psychological scientific perpectives on out of the body
and near death experiences, Nova Science Publishers, 2009.
NACCACHE, L., Le Nouvel Inconscient, Odile Jacob, 2006.
NGRJUNA, Stances du milieu par excellence, Gallimard, 2002.
NAGEL, T., What is it like to be a bat ? , The Philosophical Review,
LXXXIII, 1974, p. 435-450.
The View From Nowhere, Oxford University Press, 1986.
Mind and Cosmos, Oxford University Press, 2012.
NAHMIAS, E.A., Verbal reports on the contents of consciousness :
Reconsidering introspectionist methodology , Psyche, 8 (21), 2002.
NANAMOLI BHIKKHU, The Middle Length Discourses of the Buddha,
Wisdom publications, 1995.
NATORP, P., Psychologie gnrale selon la mthode critique, Vrin, 2008.
NAURIYAL, D.K., DRUMMOND, M. & LAL, Y.B. (d.), Buddhist Thought
and Applied Psychological Research, Routledge, 2006.
NEF, F., propos dune controverse entre Carnap et Schrdinger , in
BITBOL, M. & DARRIGOL, O. (d.), Erwin Schrdinger, Philosophy and
the Birth of Quantum Mechanics, Frontires, 1992.
Trait dontologie pour les non-philosophes (et les philosophes),
Gallimard, 2009.
NELSON, R.J., Libets dualism , Behavioral and Brain Sciences, 8,
1985, p. 550.
NELSON, T.O., Consciousness and meta-cognition , American
Psychologist, 97, 1990, p. 19-35.
NEMIROW, L., So this is what its like : A defense of the ability
hypothesis , in ALTER, T. & WALTER, S., Phenomenal Concepts and
Phenomenal Knowledge, Oxford University Press, 2007.
NEWBERG, A.B., Principles of Neurotheology, Ashgate, 2010.
NIETZSCHE, F., La Naissance de la tragdie, Le Livre de Poche, 1994.
La Volont de puissance, Gallimard, 1995.
NISBETT, R.E. & WILSON, T.D., Telling more than we can know : Verbal
reports on mental processes , Psychological Review, 84, 1977, p. 231-
259.
The halo effect : evidence for unconscious alteration of judgment ,
Journal of Personality and Social Psychology, 35, 1977, p. 250-256.
NISHIDA, K., Lveil soi, CNRS, 2003.
Une tude sur le bien , Revue Philosophique de Louvain, 97, 1999,
p. 19-29.
NIXON, G., From panexperientialism to conscious experience : The
continuum of experience , Journal of Consciousness Exploration &
Research, 1, 2010, p. 213-215.
NO, A., Out of the head. Why you are not your brain , MIT Press,
2009.
NO, A. & THOMPSON, E., Are there neural correlates of
consciousness ? , Journal of Consciousness Studies, vol. 11, 2004, p. 3-
28.
NOIRHOMME, Q., SODDU, A., LEHEMBRE, R., VANHAUDENHUYSE, A.,
BOVEROUX, P., BOLY, M. & LAUREYS, S., Brain connectivity in
pathological and pharmacological coma , Frontiers in Systems
Neuroscience, 4, 2010, p. 160.
OGDEN, R.M., Imageless thought : Resume and critique , Psychological
Bulletin, 8, 1911, p. 194.
OGMEN, H., BREITMEYER, B.G. & MELVIN, R., The what and where of
visual masking , Vision Research, 43, 2003, p. 1337-1350.
OHASHI, R. (d.), Die Philosophie der Kyoto-Schule, Alber, 1990.
OCONNOR, M.F., DAVES, S.M., TUNG, A., COOK, R.I., THISTED, R. &
APFELBAUM, J., BIS monitoring to prevent awareness during general
anesthesia , Anesthesiology, 94, 2001, p. 520-522.
OREGAN, J.K., RENSINK, R.A. & CLARK, J.J., Change-blindness as a
result of mudsplashes , Nature, 398, 1999, p. 34.
OREGAN, J.K., & NO, A., A sensorimotor account of vision and visual
consciousness , Behavioral and Brain Sciences, 24, 2001, p. 939-1031.
OTTO, R., Le Sacr, Payot, 1995.
OVERGAARD, M., KOIVISTO, M., SRENSEN, T.A., VANGKILDE, S. &
REVONSUO, A., The electrophysiology of introspection , Consciousness
and Cognition, 15, 2006, p. 662-672.
OVERGAARD, M., TIMMERMANS, B., SANDBERG, K. & CLEEREMANS, A.,
Optimizing subjective measures of consciousness , Consciousness and
Cognition, 19, 2010, p. 682-684.
OVERGAARD, M. & GRNBAUM, T., Cognitive and non-cognitive
conceptions of consciousness , Trends in Cognitive Sciences, 16, 2012,
p. 137-138.
OWEN, A.M., SCHIFF, N.D. & LAUREYS, S., The assessment of conscious
awareness in the vegetative state , in LAUREYS, S. & TONONI, G., The
Neurology of Consciousness : Cognitive Neuroscience and
Neuropathology, Academic Press, 2008.
PADMASAMBHAVA, Le Livre des morts tibtain, Buchet-Chastel, 2009.
PALANCA, B.J., SEARLEMAN, A. & AVIDAN, M.S., Current controversies
in intraoperative awareness II , in MASHOUR, G.A., Consciousness,
Awareness, and Anesthesia, Cambridge University Press, 2010.
PATOKA, J., Le Monde naturel et le mouvement de lexistence humaine,
Kluwer, 1988.
Papiers phnomnologiques, Jrme Millon, 1995.
PATTEE, H.H., Causation, control, and the evolution of complexity , in
ANDERSEN, P.B., EMMECHE, C., FINNEMAN, N.O. & CHRISTIANSEN, P.V.
(d.), Downward Causation, Minds, Bodies, and Matter, Aarhus
University Press, 2000.
PAVIE, X., Exercices spirituels : leons de philosophie antique, Les
Belles Lettres, 2012.
PEETERS, M. & RICHARD, S., Logique formelle, Mardaga, 2009.
PEIRCE, C.S., Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard
University Press, 1931-1935.
PERRET, N., A symmetrical approach to causality in biology ,
Philosophia Scientiae, 16, 2012, p. 177-195.
PESCHARD, I. & BITBOL, M., Heat, temperature and phenomenal
concepts , in WRIGHT, E., The Case for Qualia, MIT Press, 2008.
PESSA, E. & VITIELLO, G., Quantum noise, entanglement and chaos in the
quantum field theory of mind/brain states , Mind and Matter, 1, 2003,
p. 59-79.
PETITMENGIN, C., LExprience intuitive, LHarmattan, 2001.
Describing ones subjective experience in the second person : An
interview method for the science of consciousness , Phenomenology and
the Cognitive Science, 5, 2006, p. 229-269.
Towards the source of thoughts. The gestural and transmodal
dimension of lived experience , Journal of Consciousness Studies, vol.
14, 2007, p. 54-82.
PETITMENGIN, C. & BITBOL, M., The validity of first-person descriptions
as authenticity and coherence , Journal of Consciousness Studies, vol.
16, 2009, p. 363-404.
PETITMENGIN, C., BITBOL, M., NISSOU, J.-M., PACHOUD, B., CURALLUCCI,
H., CERMOLACCE, M. & VION-DURY, J., Listening from within , Journal
of Consciousness Studies, vol. 16, 2009, p. 252-284.
PETITMENGIN, C., REMILLIEUX, A., CAHOUR, B. & THOMAS, S., A gap in
Nisbett and Wilson findings ? A first-person access to our cognitive
processes , Consciousness and Cognition, 22, 2013, p. 654-669.
PETITOT, J., Neurogomtrie de la vision, ditions de lcole
Polytechnique, 2009.
PICCININI, G., Data from introspective reports , Journal of
Consciousness Studies, vol. 10, 2003, p. 141-156.
First-person data, publicity, and self-measurement , Philosophers
Imprint, 9, 2009.
PICKERING, A., The Mangle of Practice, The University of Chicago Press,
1995.
PLANTINGA, A., God, Freedom, and Evil, Harper & Row, 1974.
PLATON, uvres compltes, Gallimard, 1950.
PLOTIN, Ennades, I, Les Belles Lettres, 1976.
POGGI, C., Les uvres de vie selon matre Eckhart et Abhinavagupta,
Les Deux Ocans, 2000.
Le Sanskrit, souffle et lumire, Almora, 2012.
POSTLE, B.R., The hippocampus, memory, and consciousness , in
LAUREYS, S. & TONONI, G. (d.), The Neurology of Consciousness,
Academic Press, 2008.
PRICE, D.D. & BARRELL, J.J., Inner Experience and Neurosciences :
Merging Both Perspectives, MIT Press, 2012.
PRICE, H., Agency and causal asymmetry , Mind, 101, 1992, p. 501-
520.
PRINZ, J. The fractionation of introspection , Journal of Consciousness
Studies, vol. 11, 2004, p. 40-57.
PRIOR, H., SCHWARZ, A. & GNTRKN, O., Mirror-induced behavior in
the magpie (Pica pica) : evidence of self-recognition , PLOS Biology, 6,
2008, p. 8.
PROUST, J., Vers une gense cognitive de la centralit : rflexion partir
du travail clinique dHenri Grivois , in GRIVOIS, H. & DUPUY, J.-P.
(d.), Mcanismes mentaux, mcanismes sociaux : de la psychose la
panique, La Dcouverte, 1995.
PUTNAM, H., Mind, Language, and Reality, Cambridge University Press,
1975.
Le Ralisme visage humain, Seuil, 1993.
QUINE, W.V., The Roots of Reference, Open Court, 1974.
RADDER, H. & MEYNEN, G., Does the brain initiate freely willed
processes ? A philosophy of science critique of Libet-type experiments
and their interpretation , Theory & Psychology, 23, 2013, p. 3-21.
RAJALA, A.Z., REININGER, K.R., LANCASTER, K.M. & POPULIN, L.C.,
Rhesus monkeys (Macaca mulatta) do recognize themselves in the
mirror : Implications for the evolution of self-recognition , PLOS ONE,
5(9): e12865. doi:10.1371, 2010.
RAMACHANDRAN, V.S., Phantoms in the Brain, Fourth Estate, 1999.
RAMON y CAJAL, S., Les Nouvelles Ides sur la structure du systme
nerveux chez lhomme et chez les vertbrs, C. Reinwald & Cie, 1894.
REDER, L.M. & SCHUNN, C.D., Metacognition does not imply
awareness : Strategy choice is governed by implicit learning and
memory , in REDER, L.M. (d.), Implicit Memory and Metacognition,
Psychology Press, 1996.
REICHARD, G., Navaho Religion, Princeton University Press, 1974.
REISSAND, D. & MARINO, L., Mirror self-recognition in the bottlenose
dolphin : A case of cognitive convergence , PNAS, 98, 2001, p. 5937-
5942.
REY, O., Itinraire de lgarement, Seuil, 2003.
RHYS DAVIDS, C.A.F., Buddhist Manual of Psychological Ethics : First
Book of the Abhidhamma-Pitaka, Entitled Dhamma-Sangani
(Compendium of States or Phenomena), Kessinger Publishing, 2003.
RICARD, M., LArt de la mditation, Pocket, 2010.
Plaidoyer pour laltruisme, NiL Editions, 2013.
RICHIR, M., Altrit et incarnation. Phnomnologie de Husserl , Revue
de mdecine psychosomatique, n
o
30/31, 1992, p. 63-74.
RICUR, P., Temps et Rcit I, Seuil, 1983.
Soi-mme comme un autre, Seuil, 1990.
RIVELAYGUE, J., Leons de mtaphysique allemande, I, Grasset, 1990.
RIZZOLATI, G. & SINIGAGLIA, C., Les Neurones miroirs, Odile Jacob,
2008.
ROBBINS, P., Knowing me, knowing you. Theory of mind and the
machinery of introspection , Journal of Consciousness Studies, vol. 11,
2004, p. 129-143.
ROBINSON, H., Why Frank should not have jilted Mary , in WRIGHT, E.,
The Case for Qualia, MIT Press, 2008.
ROCHAT, P., Six levels of self-awareness as they unfold early in life ,
Consciousness and Cognition, 12, 2003, p. 717-731.
RODIS-LEWIS, G., Luvre de Descartes, Vrin, 1971.
ROGOZINSKI, J., Le chiasme et le restant (la phnomnologie franaise au
contact de lintouchable) , Rue Descartes, 35, 2002, p. 125-144.
Le Moi et la Chair, introduction lego-analyse, Cerf, 2006.
ROMANO, C., Le Chant de la vie : phnomnologie de Faulkner,
Gallimard, 2005.
Wittgenstein et la Tradition phnomnologique, Art du Comprendre,
2008.
Au cur de la raison, la phnomnologie, Gallimard, 2010.
ROUNIS, E., MANISCALCO, B., ROTHWELL, J.C., PASSINGHAM, R.E. & LAU,
H., Theta-burst transcranial magnetic stimulation to the prefrontal cortex
impairs metacognitive visual awareness , Cognitive Neuroscience, 1,
2010, p. 165-175.
ROUSTANG, F., La Fin de la plainte, Odile Jacob, 2000.
Quest-ce que lhypnose ?, Minuit, 2002.
Le Secret de Socrate pour changer la vie, Odile Jacob, 2009.
ROVERE, M., La tentation du paralllisme, un fantasme gomtrique dans
la tradition du spinozisme , in JAQUET, C., SVRAC, P. & SUHAMY, A.,
La Thorie spinoziste des rapports corps/esprit, Hermann, 2009.
ROSENTHAL, D.M., Two concepts of consciousness , in ROSENTHAL,
D.M. (d.), The Nature of Mind, Oxford University Press, 1991.
Consciousness and Mind, Oxford University Press, 2005.
RUSSELL, B., The Analysis of Mind, Allen & Unwin, 1971.
RUSSELL, I.F., Isolated forearm technique , Anaesthesia, 45, 1990,
p. 687.
Midazolam-Alfentanil : An anaesthetic ? An investigation using the
isolated forearm technique , British Journal of Anaesthesia, 70, 1993,
p. 42-46.
The Narcotrend depth of anaesthesia monitor cannot reliably detect
consciousness during general anaesthesia : An investigation using the
isolated forearm technique , British Journal of Anaesthesia, 96, 2006,
p. 346-352.
RUYER, R., La Conscience et le Corps, Flix Alcan, 1937.
Paradoxes de la conscience, Albin Michel, 1966.
RUDRAUF, D., LUTZ, A., CoSMELLI, D., LACHAUX, J.-P. & LE VAN QUYEN,
M., From autopoiesis to neurophenomenology : Francisco Varelas
exploration of the biophysics of being , Biological Research, 36, 2003,
p. 27-65.
RYCKMAN, T., The Reign of Relativity, Oxford University Press, 2007.
RYLE, G., The Concept of Mind, Barnes & Noble, 1949.
SACKUR, J., Lintrospection en psychologie exprimentale , Revue
dhistoire des sciences, 62, 2009, p. 5-28.
SAINT-AUBERT, E. de, Le mystre de la chair. Merleau-Ponty et Gabriel
Marcel , Studia Phaenomenologica (Romanian Journal for
Phenomenology, Bucarest), III, 2003, p. 73-106.
Vers une ontologie indirecte : sources et enjeux critiques de lappel
lontologie chez Merleau-Ponty, Vrin, 2006.
SAKAI, T., SINGH, H., MI, W.D., KUDO, T. & MATSUKI, A., The effect of
ketamine on clinical endpoints of hypnosis and EEG variables during
propofol infusion , Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 43, 1999,
p. 212-216.
SAMBURSKY, S. & PINES, S., The Concept of Time in Late Neoplatonism,
Israel Academy of Science and Humanities, 1971.
SARTI, A., CITTI, G. & PETITOT, J., The symplectic structure of
the primary visual cortex , Biological Cybernetics, 98, 2008, p. 33-48.
SARTRE, J.-P., Ltre et le Nant, Gallimard, 1943.
La Nause, Gallimard, 1972.
La Transcendance de lego, Vrin, 1978.
SASS, L., Les Paradoxes du dlire, Ithaque, 2010.
SCHACTER, D.L., Implicit memory : history and current status , Journal
of Experimental Psychology : Learning, Memory and Cognition, 13,
1987, p. 501-518.
SCHNEIDER, G., Monitoring anesthetic depth , in MASHOUR, G.A. (d.),
Consciousness, Awareness, and Anesthesia, Cambridge University Press,
2010.
SCHNEIDER, L., HOUDAYER, E., BAI, O. & HALLETT, M., What we think
before a voluntary movement , Journal of Cognitive Neuroscience, 25,
2013, p. 822-829.
SCHNELL, A., Husserl et les Fondements de la phnomnologie
constructive, Jrme Millon, 2007.
SCHOOLER, J.W., Re-representing consciousness : Dissociations
between experience and meta-consciousness , Trends in Cognitive
Sciences, 6, 2002, doi 10.1016/S1364-6613(02)01949-6.
SCHOPENHAUER, A., Le Monde comme volont et comme reprsentation,
PUF, 1966.
SCHRDINGER, E., Quelques remarques au sujet des bases de la
connaissance scientifique , Scientia, LVII, 1935, p. 181-191.
Ma conception du monde, Mercure de France, 1982.
LEsprit et la Matire, Seuil, 1990.
Physique quantique et Reprsentation du monde, Seuil, 1992.
SCHURGERA, A., SITTA, J.D. & DEHAENE, S., An accumulator model for
spontaneous neural activity prior to self-initiated movement , PNAS, 109,
2012, E2904-E2913.
SCHWITZGEBEL, E.B., Introspective training apprehensively defended :
Reflections on Titcheners lab manual , Journal of Consciousness
Studies, vol. 11, 2004, p. 58-76.
Perplexities of Consciousness, MIT Press, 2011.
SCOVILLE, W.B. & MILNER, B., Loss of recent memory after bilateral
hippocampal lesions , Journal of Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry, 20, 1957, p. 11-21.
SEARLE, J., The Mystery of Consciousness, Granta Books, 1997.
How to study consciousness scientifically , in HAMEROFF, S.R.
(d.), Towards a Science of Consciousness, II, MIT Press, 1998.
SEGAL, Z.V., WILLIAMS, J.M.G. & KABAT-ZINN, J., Mindfulness Based
Cognitive Therapy for Depression, deuxime dition augmente, Guilford
Press, 2012.
SENZAKI, N., Cent Koans Zen, Albin Michel, 2005.
SERGENT, C., BAILLET, S. & DEHAENE, S., Timing of the brain events
underlying access to consciousness during the attentional blink , Nature
Neuroscience, 8, 2005, p. 1391-1400.
SEVERINO, E., La Filosofia futura, Rizzoli, 2011.
SEVUSH, S., Single-neuron theory of consciousness , Journal of
Theoretical Biology, 238, 2006, p. 704-725.
SEYMOUR K., CLIFFORD, C.W.G., LOGOTHETIS, N.K. & BARTELS, A., The
coding of color, motion, and their conjunction in the human visual
cortex , Current Biology, 19, 2009, p. 177-183.
SEXTUS EMPIRICUS, Esquisses pyrrhoniennes, Seuil, 1997.
SHANNON, C.E. & WEAVER, W., The Mathematical Theory of
Communication, University of Illinois Press, 1949.
SHANNON, E., A mathematical theory of communication , Bell System
Technical Journal, XXVII, 1948, p. 379-423.
SHANON, B., The case for introspection , Cognition and Brain Theory,
7, 1984, p. 167-180.
The Antipodes of the Mind, Oxford University Press, 2002.
SHIKSNANDA, Sotra de lentre Lank, Fayard, 2006.
SHORT, T.L., Peirces Theory of Signs, Cambridge University Press,
2007.
SIEGEL, D.J., Mindsight : The New Science of Personal Transformation,
Random House, 2010.
The Developing Mind : How Relationships and the Brain Interact to
Shape Who We Are, Guilford Press, 2012.
SILBURN, L., Aux sources du bouddhisme, Fayard, 1997.
SILVERMAN, M. & MACK, A., Change blindness and priming : When it
does and does not occur , Consciousness and Cognition, 15, 2006,
p. 409-422.
SIMONS, D.J. & CHABRIS, C.F. Gorillas in our midst : Sustained
inattentional blindness for dynamic events , Perception, 28, 1999,
p. 1059-1074.
SIMONS, P., The seeds of experience , in FREEMAN, A. (d.),
Consciousness and its Place in Nature, Imprint Academic, 2007.
SINGER, T. & BOLZ, M. (d.), Compassion : Bridging Practice and
Science, www.compassion-training.org, 2013.
SKINNER, B.F., The Behavior of Organisms, Prentice Hall, 1938.
SKINNER, C., Readings in psychology, Farrart & Rinehart, 1935.
SLATER, M., SPANLANG, B., SANCHEZ-VIVES, M.V. & BLANKE, O., First
Person Experience of Body Transfer in Virtual Reality , PLOS ONE,
5(5): e10564. doi:10.1371, 2010.
SLOCUM, J.D., Violence in American Cinema, Routledge, 2000.
SLOTERDIJK, P., La Mobilisation infinie, Seuil, 2003.
Bulles, Fayard/Pluriel, 2010.
SMITHIES, D., Attention is rational-access consciousness , in MOLE, C.,
SMITHIES, D. & WU, W. (d.), Attention : Philosophical and
Psychological Essays, Oxford University Press, 2011.
SMULLYAN, R., This Book Needs No Title, Touchstone, 1986.
SNELL, B., The Discovery of the Mind in Greek Philosophy and
Literature, Dover, 1982.
SOON, C.S., BRASS, M., HEINZE, H.-J. & HAYNES, J.-D., Unconscious
determinants of free decisions in the human brain , Nature Neuroscience,
11, 2008, p. 543-545.
SORABJI, R., Time, Creation, and the Continuum, Duckworth, 1983.
SOTO, D., MNTIL, T. & SILVANTO, J., Working memory without
consciousness , Current Biology, 21, 2011, R912-R913.
SPENCE, S.A., Free will in the light of neuropsychiatry , Philosophy,
Psychiatry, & Psychology, 3, 1996, p. 75-90.
SPERLING, G., The information available in brief visual presentations ,
Psychological Monographs, 74 (9), 1960, p. 1-29.
SPINOZA, B., thique, PUF, 1993.
Correspondance, GF-Flammarion, 2010.
STCHERBATSKY, T., Buddhist Logic, I, Motilal Banarsidass, 1993.
The Central Conception of Buddhism, Sri Satguru Publications, 1991.
STEINDL-RAST, D., Deeper Than Words, Doubleday, 2010.
STEVENS, B., Invitation la philosophie japonaise, CNRS, 2005.
STORMS, M.D. & MCCAUL, K.D., Attribution processes and emotional
exacerbation of dysfunctional behaviour , in HARVEY, J.H., ICKES, W.J.
& KIDD, R.F. (d.), New Directions in Attribution Research, vol. I,
Erlbaum, 1976.
STRAUS, E., Du sens des sens, Jrme Millon, 2000.
STRAUSS, J., Concepts et ralits de la vie mentale , Psychiatrie,
sciences humaines et neurosciences, 5, 2007, p. 125-130.
STRAWSON, G., Why physicalism entails panpsychism , in FREEMAN, A.
(d.), Consciousness and its Place in Nature, Imprint Academic, 2007.
SUZUKI, D.T., Essais sur le bouddhisme Zen, I, Albin Michel, 1972.
TAGLIASCO, V., Artificial consciousness : A technological disciplin , in
CHELLA, A. & MANZOTTI, R. (d.), Artificial Consciousness, Imprint
Academic, 2007.
TANIGAWA, H., LU, H.D. & ROE, A.W., Functional organization for color
and orientation in macaque V4 , Nature Neuroscience, 13, 2010,
p. 1542-1548.
TART, C.T., States of consciousness and state-specific sciences ,
Science, 176, 1972, p. 1203-1210.
TAYLOR, J.T., Voyage au-del de mon cerveau, Jai Lu, 2009.
TENEGGI, C., Lo Spazio senso-motorio come rappresentazione dei
comportamenti intersoggettivi, thse de luniversit de Bologna/Paris-I,
2013.
TEN ELSHOF, G., Introspection Vindicated : An Essay in Defense of the
Perceptual Model of Self Knowledge, Ashgate, 2005.
TEN HOOR, M., A critical analysis of the concept of introspection , The
Journal of Philosophy, 29, 1932, p. 322-331.
TERRACE, H.S. & SON, L.K., Comparative metacognition , Current
Opinion in Neurobiology, 19, 2009, p. 67-74.
THRSE dAVILA, sainte, Le Chteau de lme, Seuil, 1997.
THOMAS-FOGIEL, I., Fichte, Vrin, 2004.
THOMPSON, E., Representationalism and the phenomenology of mental
imagery , Synthese, 160, 2008, p. 397-415.
Mind in Life : Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind,
Harvard University Press, 2010.
Waking, Dreaming, Being : New Light on the Self and Consciousness
from Neuroscience, Meditation, and Philosophy, Columbia University
Press, 2014.
THOMPSON, E. & STAPLETON, M., Making sense of sense-making : A
reflection on enactive and extended mind theories , Topoi, 28, 2009,
p. 23-30.
TILLER, W.A., MCCRATY, R. & ATKINSON, M., Cardiac coherence : A
new, noninvasive measure of autonomic nervous system order ,
Alternative Therapies, 2, 1996, p. 52-65.
TITCHENER, E.B, Experimental Psychology : A Manual of Laboratory
Practice, MacMillan, 1901-1905.
Lectures on the Experimental Psychology of Thought Processes,
MacMillan, 1909.
The Schema of Introspection , American Journal of Psychology, 23,
1912, p. 485-508.
A Textbook of Psychology, MacMillan, 1916.
TODD, S.J., Unmasking multiple drafts , Philosophical Psychology, 19,
2006, p. 477-494.
TOLA, F. & DRAGONETTI, C., The Yogastra of Patajali, Motilal
Banarsidass, 1987.
TOLLE, E., Le Pouvoir du moment prsent, Ariane, 2000.
TOLSTO, L., Confession, Pygmalion, 1998.
La Mort dIvan Ilitch, GF-Flammarion, 1999.
TONNEAU, F., Consciousness outside the head , Behavior and
Philosophy, 32, 2004, p. 97-123.
TONONI, G., An information integration theory of consciousness , BMC
Neuroscience, 5 : 42, 2004, p. 1-22.
Consciousness as integrated information : A provisional manifesto ,
Biological Bulletin, 215, 2008, p. 216-242.
TONONI, G. & KOCH, C., The neural correlates of consciousness : An
update , Annals of the New York Academy of Sciences, 1124, 2008,
p. 239-261.
TREVENA, J. & MILLER, J., Cortical movement preparation before and
after a conscious decision to move , Consciousness and Cognition, 11,
2002, p. 162-190.
TSONGKHAPA, The Great Treatise on the Stages of the Path to
Enlightenment, Snow Lion, 2002.
TSAKIRIS, M. & HAGGARD, P., The rubber hand illusion revisited :
Visuotactile integration and self-attribution , Journal of Experimental
Psychology : Human Perception and Performance, 31, 2005, p. 80-91.
TURING, A.M., Computing machinery and intelligence , Mind, 59, 1950,
p. 433-460.
TZELGOV, J., Automatic but conscious : That is how we act most of the
time , in WYER, R.S. (d.), The Automaticity of Everyday Life, Advances
in Social Cognition, 10, 1997, p. 217-230.
Automaticity and processing without awareness , Psyche, 5 (3),
avril 1999.
TULVING, E., Memory and consciousness , Canadian Psychologist, 25,
1985, p. 1-12.
TUNSTALL, M.E., The reduction of amnesic wakefulness during
caesarean section , Anaesthesia, 34, 1979, p. 316-319.
TYE, M., Consciousness, Color, and Content, Cambridge, MIT Press,
2000.
Consciousness Revisited, MIT Press, 2009.
UZAN, P., Conscience et Physique quantique, Vrin, 2013.
VALENZUELA-MOGUILLANSKY, C., Chronic pain and disturbances in body
awareness , Revista Chilena de Neuropsicologa, 7, 2012, p. 26-38.
VALENZUELA-MOGUILLANSKY, C., BOUHASSIRA, D. & OREGAN, J.K.,
The role of body awareness in pain : An investigation using the rubber
hand illusion , Journal of Consciousness Studies, vol. 18, 2011, p. 110-
142.
VAN FRAASSEN, B., The Scientific Image, Oxford University Press, 1980.
The Empirical Stance, Yale University Press, 2002.
Scientific Representation, Oxford University Press, 2008.
VANINI, G., BAGHDOYAN, H.A. & LYDIC, R., Relevance of sleep
neurobiology for cognitive neuroscience and anesthesiology , in
MASHOUR, G. (d.), Consciousness, Awareness, and Anesthesia,
Cambridge University Press, 2010.
VAN LOMMEL, P., VAN WEES, R., MEYERS, V. & ELFFERICH, I., Near-
death experience in survivors of cardiac arrest : A prospective study in
the Netherlands , The Lancet, 358, 2001, p. 2039-2045.
VARELA, F., Neurophenomenology, a methodological remedy for the
hard problem , Journal of Consciousness Studies, vol. 3, 1996, p. 330-
350.
The re-enchantment of the concrete , in STEELS, L. & BROOKS, R.
(d.), The Artificial Life Route to Artificial Intelligence : Building
Embodied Situated Agents, Lawrence Erlbaum, 1999.
Daseins brain : Phenomenology meets cognitive science , in AERTS,
D. (d.), Einstein Meets Magritte, Kluwer, 1999.
The specious present : A neurophenomenology of time
consciousness , in PETITOT, J., VARELA, F. PACHOUD, B. & ROY, J.-M.,
Naturalizing Phenomenology, Stanford University Press, 1999.
VARELA, F., Quel savoir pour lthique ?, La Dcouverte, 2004.
VARELA, F., LACHAUX, J.-P., RODRIGUEZ, E. & MARTINERIE, J., The
brainweb : Phase synchronization and large-scale integration , Nature
Neuroscience, 2, 2001, p. 229-239.
VARELA, F., THOMSON, E. & ROSCH, E., LInscription corporelle de
lEsprit, Seuil, 1991.
VARENNE, J., Upanishads du Yoga, Gallimard, 1971.
VARGAS, L.M., VOSS, J.L. & PALLER, K.A., Implicit recognition based on
lateralized perceptual fluency , Brain Science, 2, 2012, p. 22-32.
VELLY, L.J., REY, M.F., BRUDER, N.J., GOUVITSOS, F.A., WITJAS,
T., REGIS, J.M., PERAGUT, J.C. & GOUIN, F.M., Differential dynamic of
action on cortical and subcortical structures of anesthetic agents during
induction of anaesthesia , Anesthesiology, 107, 2007, p. 202-212.
VELMANS, M., Preconscious free will , Journal of Consciousness
Studies, vol. 10, 2003, p. 42-61.
Understanding Consciousness, Routledge, 2009.
VERMERSCH, P., LEntretien dexplicitation, ESF, 1994.
Introspection as practice , Journal of Consciousness Studies, vol.
6, 1999, p. 15-42.
Husserl the great unrecognized psychologist ! A reply to Zahavi ,
Journal of Consciousness Studies, vol. 18, 2011, p. 20-23.
Explicitation et Phnomnologie, PUF, 2012.
VICO, G., De la trs ancienne philosophie des peuples italiques, T.E.R.,
1987.
La Science nouvelle, Gallimard, 1993.
VIDAL, F., La neuroesthtique, une esthtique scientiste , Revue
dhistoire des sciences humaines, 25, 2011, p. 239-264.
VILLABLANCA, J.R., Counterpointing the functional role of the forebrain
and of the brainstem in the control of the sleep-waking system , Journal
of Sleep Research, 13, 2004, p. 179-208.
VILMER, J., Cogito ergo sum, induction et dduction , Archives de
philosophie, 67, 2004, p. 51-63.
VION-DURY, J. & BLANQUET, F., Pratique de lEEG, Masson, 2008.
VIVENZA, J.-M., Tout est concience : une voie dveil bouddhiste, Albin
Michel, 2010.
VOHS, K.D. & SCHOOLER, J.W., The value of believing in free will :
Encouraging a belief in determinism increases cheating , Psychological
Science, 19, 2008, p. 49-54.
VON WRIGHT, G.H., Causality and Determinism, Columbia University
Press, 1974.
VUILLEMIN, J., Le Dieu dAnselme et les Apparences de la raison,
Aubier, 1971.
WAISMANN, F., Principles of Linguistic Philosophy, MacMillan, 1997.
WALLACE, B.A., The Taboo of Subjectivity, Oxford University Press,
2000.
WALLON, H., Les rfrences de la pense courante chez lenfant ,
LAnne psychologique, 50, 1949, p. 387-402.
WANG, M., MESSINA, A.G. & RUSSELL, I.F., The topography of
awareness : A classification of intra-operative cognitive states ,
Anaesthesia, 67, 2012, p. 1197-1201.
WARD, L.M., The thalamic dynamic core theory of conscious
experience , Consciousness and Cognition, 20, 2011, p. 464-486.
WEBER, A. & Varela, F.J., Life After Kant , Phenomenology and the
Cognitive Sciences, 1, 2002, p. 97-125.
WEGNER, D., The Illusion of Conscious Will, MIT Press, 2003.
WEISKRANTZ, L., BARBUR, J.L. & SAHRAIE, A., Parameters affecting
conscious versus unconscious visual discrimination with damage to the
visual-cortex (V1) , PNAS, 92, 1995, p. 6122-6126.
WERNER, H., Lunit des sens , Journal de psychologie normale et
pathologique, 31, 1934, p. 190-205.
WEYL, H., Temps, espace, matire, Albert Blanchard, 1958.
WHEELER, M.A., STUSS, D.T. & TULVING, E., Toward a theory of
episodic memory : The frontal lobes and autonoetic consciousness ,
Psychological Bulletin, 121, 1997, p. 331-354.
WHITEHEAD, C., Social mirrors and shared experiential worlds ,
Journal of Consciousness Studies, vol. 8, 2001, p. 3-36.
WILDE, D.J., Finding meaning in out-of-body experiences : An
interpretative phenomenological analysis, thse de luniversit de
Manchester, 2012.
WILDE, D.J. & MURRAY, C.D., Interpreting the anomalous : Finding
meaning in out-of-body and near-death experiences , Qualitative
Research in Psychology, 7, 2010, p. 57-72.
WILSON, F., Mill and Comte on the method of introspection , Journal of
the History of the Behavioral Sciences, 27, 1991, p. 107-129.
WILSON, J.T., PETTIGREW, L.E. & TEASDALE, G.M., Structured
interviews for the Glasgow Outcome Scale and the extended Glasgow
Outcome Scale : Guidelines for their use , Journal of Neurotrauma, 8,
1998, p. 573-585.
WILSON, T.D. & DUNN, E.W., Self-knowledge : Its limits, value, and
potential for improvement , Annual Review of Psychology, 55, 2004,
p. 49-518.
WINCKLER, M., Le Chur des femmes, Gallimard, 2011.
WITTGENSTEIN, L., Le Cahier bleu et le Cahier brun, Gallimard, 1965.
Carnets 1914-1915, Gallimard, 1971.
Notes sur lexprience prive et les sense data, TER, 1982.
Philosophical Investigations, Basil Blackwell, 1983.
Remarques philosophiques, Gallimard, 1984.
Tractatus Logico-Philosophicus, Gallimard, 1993.
Remarques sur la philosophie de la psychologie, TER, 1998.
WOOD, C.W., Pardon, your dualism is showing , The Behavioral and
Brain Sciences, 8, 1985, p. 557-558.
WOODWARD, J., Making Things Happen, a Theory of Causal
Explanation, Oxford University Press, 2003.
WOODWORTH, R.S., Imageless Thought , The Journal of Philosophy,
Psychology and Scientific Methods, 3, 1906, p. 701-708.
WU, C.C., MOK, M.S., CHAO, S.L., & SIN, R.H., EEG-bispectral index
changes with ketamine versus thiamylal induction of anesthesia , Acta
Anesthesiologica Sinica, 39, 2001, p. 11-15.
WU, S.-W., LEE, U., NOH, G.-J., JUN, I.-G. & MASHOUR, G.A.,
Preferential inhibition of frontal-to-parietal feedback connectivity is a
neurophysiologic correlate of general anesthesia in surgical patients ,
PLOS ONE, 6, e25155, 2011.
WUNDT, W., Lectures on Human and Animal Psychology, Swan
Sonnenshein & Co., 1901.
YOON, J.R., KIM, Y.S. & KIM, T.K., Thiopental-induced burst
suppression measured by the bispectral index is extended during propofol
administration compared with sevoflurane , Journal of Neurosurgical
Anesthesiology, 24, 2012, p. 146-151.
ZAHAVI, D., Self-Awareness and Alterity : A Phenomenological
Investigation, Northwestern University Press, 1999.
Subjectivity and Selfhood, Investigating the First-Person
Perspective, MIT Press, 2005.
Varieties of reflection , Journal of Consciousness Studies, vol. 18,
2011, p. 9-19.
ZAJONC, A., La Mditation, une recherche contemplative, Triades, 2012.
ZARETSKAYA, N., THIELSCHER, A., LOGOTHETIS, N.K. & BARTELS, A,
Disrupting parietal function prolongs dominance durations in binocular
rivalry , Current Biology, 20, 2010, p. 2106-2111.
ZEKI, S., The disunity of consciousness , in BANERJEE, R. &
CHAKRABARTI, B.K. (d.), Progress in Brain Research, vol. 168,
Elsevier, 2008.
ZEKI, S., WATSON, J.D., LUECK, C.J., FRISTON, K.J., KENNARD, C. &
FRACKOWIAK, R.S., A direct demonstration of functional specialization
in human visual cortex , Journal of Neuroscience, 11, 1991, p. 641-649.
ZEKI, S., & FFYTCHE, D., The Riddoch syndrome : Insights into the
neurobiology of conscious vision , Brain, 121, 1998, p. 25-45.
ZELAZO, P.D., The development of conscious control in childhood ,
Trends in Cognitive Sciences, 8, 2004, p. 12-17.
ZELAZO, P.D., GAO, H.H., TODD, R., The development of
consciousness , in ZELAZO, P.D., MOSCOVITCH, M. & THOMPSON, E.
(d.), The Cambridge Handbook of Consciousness, Cambridge
University Press, 2007.
ZEMAN, A., Consciousness, a Users Guide, Yale University Press, 2002.
ZURIFF, G., Behaviorism : A Conceptual Reconstruction, Columbia
University Press, 1985.
ZWIRN, H., Les Limites de la connaissance, Odile Jacob, 2000.
Index
ABRAM, D., 1, 2, 3
ABRAMSON, D., 1
ABSALOM, A.R., 1, 2,460
AERTS, D., 1
AGAMBEN, G., 1
AGRILLO, C., 1
AGUILAR-PRINSLOO, S., 1
AKINS, K., 1
ALAIS, D., 1
ALEKSANDER, I.L., 1
ALEXANDER, E., 1
ALKIRE, M.T., 1, 2, 3, 4, 5
ALLEN, C., 1
ALLIX, S., 1
ALQUI, F., 1
ALTER, T., 1, 2
ANACKER, S., 1, 2
ANDERSEN, P.B., 1
ANDRADE, J., 1, 2
ANDR, C., 1, 2, 3
ANSELME de CANTORBRY, saint, 1-2
APEL, K.-O., 1
APFELBAUM, J., 1
ARAMAKI, M., 1
ARGUILLRE, S., 1, 2, 3
ARNAULD, A., 1, 2
ARRABALES, R., 1
ARU, J., 1
ATKINSON, M., 1
ATMANSPACHER, H., 1
AUBENQUE, P., 1
AUBRUN, F., 1
AUGUSTIN, saint, 1, 2
AUSTIN, J., 1, 2, 3
AVIDAN, M.S., 1, 2
AVRAMIDES, A., 1
AYER, A.J., 1
BAARS, B., 1, 2, 3, 4, 5-6, 7
BACHELARD, G., 1, 2
BACHMANN, T., 1
BAER, J., 1
BAERTSCHI, B., 1
BAGHDOYAN, H.A., 1
BAI, O., 1
BAILEY, L.W., 1
BAILLET, S., 1
BANERJEE, R., 1
BANSAT-BOUDON, L., 1, 2, 3
BARASH, P.G., 1
BARBARAS, R., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
BARBOSA, L.S., 1
BARBUR, J.L., 1
BARENDREGT, H., 1
BARGH, J.A., 1
BAR-ON, D., 1
BARRELL, J.J., 1
BARRETT, L.F., 1
BARROW, J., 1
BARTELS, A., 1, 2, 3
BASILE, B.M., 1
BASILE, P., 1
BAT-PITAULT, F., 1
BAUBY, J.-D., 1
BAUER, H., 1
BAUMEISTER, R.F., 1
BAYLE, D., 1
BAZHENOV, M., 1
BEAUREGARD, M., 1
BECK, L., 1
BECKER, M., 1
BEDAU, M., 1
BEKINSTEIN, T.A., 1
BEKOFF, M., 1
BELLISSIMA, F., 1
BENOIST, J., 1
BERGSON, H., 1
BERING, J.M., 1
BERKELEY, G., 1, 2, 3, 4
BERNSTEIN, P., 1
BERNSTEIN, R., 1
BERTHOZ, A., 1
BERTOSSA, F., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
BERTRAND, O., 1
BESA, M., 1, 2, 3
BESNIER, J.-M., 1
BESSON, M., 1
BEYSSADE, J.-M., 1, 2, 3
BIKKHU BODHI, 1
BILLON, A., 1
BINET, A., 1, 2
BINSWANGER, L., 1, 2
BITBOL, M., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39-40, 41, 42
BITBOL-HESPRIS, A., 1, 2, 3, 4, 5-6, 7
BJORKLUND, D.F., 1
BLACKMORE, S., 1-2, 3, 4, 5-6
BLAKE, R., 1
BLAKE, W., 1
BLANKE, O., 1, 2
BLANQUET, F., 1, 2
BLOCK, N., 1, 2, 3, 4, 5, 6
BLOCK, R.I., 1
BODE, S., 1
BOCE, 1
BOGEN, J.E., 1
BOHR, N., 1, 2, 3, 4
BOLGERT, F., 1
BOLY, M., 1
BOLZ, M., 1
BORING, E.G., 1, 2
BORJIGIN, J., 1
BORST, C.V., 1, 2
BOSSUET, J.B., 1
BOTTROS, M., 1
BOUHASSIRA, D., 1
BOUTON, C., 1
BOVEROUX, P., 1
BRASS, M., 1
BRECHT, M., 1
BREITMEYER, B.G., 1
BRENTANO, F., 1, 2
BRETT KING, D., 1
BRISART, R., 1
BROCA, P., 1, 2
BROCH, H., 1
BROOKS, R.A., 1, 2
BRUDER, N.J., 1
BUCHNER, A., 1
BUCKNER, W., 1
BUGHARDT, G.M., 1
BNNINGA, S., 1
BURGAT, F., 1, 2
BURNSIDE, B.A., 1
CABANAC, A., 1
CABANAC, M., 1
CAHOUR, B., 1, 2
CALASSO, R., 1, 2
CALVIN, J., 1
CAMMOUN, L., 1
CAMUS, A., 1
CANT, R., 1
CAPPUCCIO, M., 1
CAPUTO, J.D., 1
CARMODY, J., 1, 2
CARNAP, R., 1, 2, 3
CARRUTHERS, P., 1, 2, 3
CASSIN, B., 1
CASSIRER, E., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
CASTEL, P.-H., 1, 2, 3
CATTIN, E., 1, 2
CERMOLACCE, M., 1, 2, 3, 4, 5
CERTEAU, M. de, 1
CHABRIS, C.F., 1
CHAKRABARTI, B.K., 1
CHALMERS, D., 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12, 13, 14
CHANG, H., 1
CHANGEUX, J.-P., 1, 2-3, 4, 5, 6
CHAO, S.L., 1
CHATEAUBRIAND, F.-R. de, 1, 2
CHAUVIER, S., 1
CHELLA, A., 1
CHENET, F., 1
CHESTOV, L., 1
CHOI, B., 1
CHRISTIANSEN, P.V., 1
CHRISTOPHE, A., 1
CHUNG, C., 1
CHURCHLAND, P.M., 1, 2, 3
CHURCHLAND, P.S., 1, 2
CIAUNICA-GARROUTY, A., 1
CITTI, G., 1
CLARK, J.J., 1
CLEEREMANS, A., 1
CLERC, H., 1, 2, 3
CLIFFORD, C.W.G., 1
COCTEAU, J., 1
COHEN, J., 1
COHEN, L., 1
COHEN, M.A., 1, 2, 3, 4
COLEMAN, M.R., 1, 2, 3
COMTE, A., 1, 2, 3, 4
CONEE, E., 1
CONGLETON, C., 1, 2
CONTRERAS, D., 1
COOK, R.I., 1
COOLEY, C.H., 1
COOPER, S., 1
COPELAND, J., 1
CORALLO, G., 1
CORAZZA, O., 1
CORNU, Ph., 1, 2
COSMELLI, D., 1, 2
COSTALL, A., 1
COUTINHO DA SILVA, L., 1
CRICK, F., 1, 2
CRUTCHFIELD, J.P., 1
CSIKSZENTMIHALYI, M., 1, 2
CUDWORTH, R., 1-2
CULLEN, B.F., 1
CUMBERLAND, R., 1, 2
CURALLUCCI, H., 1, 2, 3, 4
DALLE PEZZE, B., 1
DALMONTE, R., 1
DAMASIO, A.R., 1, 2, 3, 4
DANTE, 1
DANTO, A.C., 1
DANZIGER, K., 1, 2
DARRIGOL, O., 1
DAVES, S.M., 1
DAVIDSON, R.J., 1, 2, 3, 4, 5
DAVIS, M.H., 1, 2, 3
DE JAEGHER, H., 1
DECHARMS, R.C., 1
DEEPROSE, C., 1
DEHAENE, S., 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
DEHAENE-LAMBERTZ, G., 1
DENNETT, D., 1, 2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12-13, 14-15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
DENYS lAROPAGITE, 1
DEPRAZ, N., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18
DERRIDA, J., 1, 2, 3, 4
DESCARTES, R., 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, 12, 13-14, 15,
16, 17-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
DESCOLA, P., 1, 2, 3
DESMURGET, M., 1, 2
DEVEREUX, G., 1
DILLON, P., 1
DOBRUNZ, U.E.G., 1
DGEN, 1
DRAGONETTI, C., 1, 2
DRAKE, S., 1
DROIT, R.-P., 1, 2
DRUMMOND, M., 1
DUCHEYNE, S., 1
DUDJOM LINGPA, 1
DUFOUR-KOWALSKA, G., 1
DUMONT, J.P., 1
DUNN, E.W., 1
DUNNE, J., 1, 2, 3, 4, 5
DUPRON, I., 1, 2, 3
DUPOUX, E., 1
DUPUY, J.-P., 1
DUTAT, M., 1
EASTWOOD, J.D., 1
ECKHART, Matre, 1, 2, 3
EDELMAN, D.B., 1
EDELMAN, G., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
EDWARDS, J.C.W., 1
EDWARDS, N., 1
EDWARDS, S., 1
EHRSSON, H., 1
EINSTEIN, A., 1, 2
EKMAN, P., 1
ELFFERICH, I., 1, 2
ELIADE, M., 1
EMMECHE, C., 1
ENGEL, A.K., 1
PICURE, 1, 2, 3
RASME, 1
ERDELYI, M.H., 1
ERDOES, R., 1
ERICSSON, K.A., 1
ESFELD, M., 1
ESPAGNAT, B. d, 1
EVERS, A.S., 1
EY, H., 1
FACH, W., 1
FARTHING, G.W., 1
FAUGERAS, F., 1
FECHNER, G.T., 1, 2, 3, 4, 5, 6
FEIGL, H., 1, 2, 3
FEINSTEIN, B., 1
FENNER, P., 1
FERRARI, R., 1, 2, 3, 4, 5
FERRI, F., 1
FFYTCHE, D., 1
FICHTE, J.G., 1, 2, 3-4, 5
FICIN, M., 1
FILLIOZAT, P.-S., 1
FINDLAY, J.N., 1
FINK, E., 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9-10
FINKEL, K.J., 1
FINNEMAN, N.O., 1
FISETTE, D., 1
FITZGERALD, R.D., 1
FLAJOLIET, A., 1
FLANAGAN, O., 1, 2
FLETCHER, K.E., 1
FODOR, J.A., 1
FORD, J., 1
FOUCAULT, M., 1, 2
FRACKOWIAK, R.S., 1
FRANKLIN, S., 1
FREEMAN, A., 1, 2, 3
FREEMAN, W.J., 1
FREUD, S., 1, 2, 3, 4-5, 6, 7
FRIED, I., 1
FRIES, P., 1
FRISTON, K.F., 1, 2
FRISTON, K.J., 1
FUCHS, T., 1
FUKUYAMA, H., 1
GABRIELI, J.D.E., 1
GALANAUD, D., 1
GALILE, G., 1, 2, 3, 4
GALLAGHER, S., 1, 2
GAO, H.H., 1, 2
GARCIA, P.S., 1, 2
GARD, T., 1, 2
GARDELLE, V. de, 1, 2, 3
GARFIELD, J.L, 1
GAUKROGER, S., 1
GELSKOV, S.V., 1
GENDLIN, E., 1
GENNARO, R.J., 1
GERGEN, K.J., 1
GERSTNER, W., 1
GHEORGHIEV, C., 1
GHONEIM, M., 1
GIGANDET, X., 1
GIL, D., 1
GILLIES, D., 1
GILLOT, P., 1
GLICK, S.D., 1
GLOVER, G.H., 1
GOLDBERG, I., 1
GOLDGAR, A., 1
GOLDMAN, A.I., 1
GOLDSTEIN, K., 1
GOODING, D.C., 1
GOPNIK, A., 1, 2, 3
GORMAN, M., 1
GOUIN, F.M., 1
GOULD, S.J., 1
GOUVITSOS, F.A., 1
GRAY, J., 1, 2
GREENE, J., 1
GRESS, T., 1
GREYSON, B., 1
GRICE, H.P., 1
GRIFFITHS, L.J., 1
GRIFFITHS, R.R., 1
GRIVOIS, H., 1
GROSS, J.J., 1
GROSSBERG, S., 1, 2
GRNBAUM, T., 1
GUISINGER, S., 1
GNTRKN, O., 1
GUYON, J., 1, 2, 3-4, 5
GZELDERE, G., 1
HAAR, M., 1
HACKING, I., 1
HADOT, P., 1
HAFFARNAN, M., 1
HAGGARD, P., 1
HGGQVIST, S., 1
HAGMANN, P., 1
HAHN, E.L., 1
HALIFAX, J., 1, 2, 3, 4
HALL, L., 1, 2
HALLETT, M., 1
HAMEROFF, S.R., 1, 2
HAMM, P., 1
HAMPTON, R.R., 1
HANSEN, P.C., 1
HANTLER, C., 1
HANXI HE, A., 1
HAREL, M., 1
HARTMANN, G., 1
HARVEY, J.H., 1
HASENBALG, V., 1
HAYNES, J.-D., 1
HAYWARD, J.W., 1
HEAVEY, C.L., 1, 2, 3
HEGEL, G.W.F., 1, 2, 3, 4-5, 6, 7
HEIDEGGER, M., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
HEINZE, H.-J., 1
HEISENBERG, W., 1, 2, 3
HEKTNER, J., 1
HNAFF, M.-A., 1
HENDRICKS, M., 1, 2
HENRY, M., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12
HRACLITE, 1, 2
HERNANDEZ, J., 1
HERZOG, M.H., 1
HIMANKA, J., 1
HINTIKKA, J., 1
HIROSE, N., 1
HOBBES, T., 1
HFFDING, H., 1
HOFFMANN, D., 1
HOFSTADTER, D., 1
HONDERICH, T., 1
HONEY, C.J., 1
HONNETH, A., 1
HORACE, 1, 2, 3
HORGAN, T., 1
HTZEL, B.K., 1
HOUDAYER, E., 1
HRABER, P.T., 1
HUDETZ, A.G., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
HUENEMANN, C., 1
HUFF, S., 1
HUGO, V., 1, 2
HULIN, M., 1, 2, 3
HULME, O., 1, 2
HUME, D., 1, 2
HUMPHREY, G., 1
HUMPHREY, N., 1, 2
HUNEMAN, P., 1
HURLBURT, R.T., 1, 2, 3, 4
HUSSERL, E., 1, 2-3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-25, 26-27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35-36, 37, 38-39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52
HUT, P., 1
HYPPOLITE, J., 1, 2
ICKES, W.J, 1
IKEDA, T., 1
IRVINE, E., 1
JACK, A., 1, 2, 3, 4
JACKSON, F., 1, 2, 3
JACOBI, 1
JACOBSOHN, E., 1
JACOBSON, Y., 1
JAEGER, K., 1
JAMES, W., 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
JANICAUD, D., 1
JANKLVITCH, V., 1, 2, 3, 4, 5-6
JANSEN, K., 1
JAQUET, C., 1
JAUSS, H.R., 1
JAYNES, J., 1, 2, 3
JERBI, K., 1
JESSE, R., 1
JIBU, M., 1
JOHANSSON, P., 1, 2
JOHNSON, M.W., 1
JOHNSRUDE, I.S., 1, 2, 3
JOKIC, A., 1
JOUFFROY, L., 1
JULLIEN, F., 1, 2
JULLIER, L., 1
JUN, I.-G., 1
JUNG, J., 1
KABAT-ZINN, J., 1, 2
KAHANE, P., 1
KANE, R., 1
KANT, I., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18
KAUFMAN, J.C., 1
KENNARD, C., 1
KENTRIDGE, R.W., 1
KERSSENS, C., 1, 2
KERSZBERG, M., 1, 2
KIDD, R.F., 1
KIHARA, K., 1
KIHLSTROM, J.F., 1, 2
KIM, J., 1, 2, 3, 4, 5, 6
KIM, S., 1
KIM, T.K., 1
KIM, Y.S., 1
KINCANNON, A., 1
KINSBOURNE, M., 1
KLARR, D., 1
KLIBANSKY, R., 1
KNEALE, W., 1
KOCH, C., 1, 2, 3, 4, 5, 6
KOIVISTO, M., 1
KONIG, P., 1
KOSHIKAWA, F., 1
KOUIDER, S., 1, 2, 3
KREIMAN, G., 1
KRETZ, L., 1
KRIEGEL, U., 1
KRINGELBACH, M.L., 1
KRISTELLER, J., 1
KUDO, T., 1
KULSTAD, M.A., 1
KWEE, M.G.T., 1
LA FORGE, L. de, 1, 2
LA VALLE POUSSIN, L. de, 1
LACHAUX, J.-P., 1, 2, 3, 4, 5, 6
LACROIX, A., 1
LAING, R.D., 1, 2, 3
LAL, Y.B., 1
LALANDE, A., 1
LAME DEER, J., 1
LAMM, C., 1
LAMME, V.A.F., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
LAMOTTE, E., 1
LANCASTER, K.M., 1
LANDERKING, W.R., 1
LANDMAN, R., 1
LANGER, E.J., 1
LAROCK, E., 1
LATOUR, B., 1
LAU, H., 1, 2, 3, 4
LAUREYS, S., 1, 2, 3, 4, 5
LAZAR, S.W., 1, 2
LE VAN QUYEN, M., 1, 2, 3
LEE, U., 1, 2
LEENHARDT, M., 1
LEGGENHAGER, B., 1
LEHEMBRE, R., 1
LEIBNIZ, G.W., 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
LENNMARKEN, C., 1
LESVRE, N., 1
LESLIE, K., 1
LEVINAS, E., 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8
LEVINE, J., 1
LVI-STRAUSS, C., 1
LEWIS, G., 1-2
LEWONTIN, R., 1
LIBET, B., 1-2, 3
LIND, A., 1, 2
LIU, T., 1
LLEU, J.-C., 1
LLINAS, R., 1
LOAR, B., 1, 2
LOCKE, J., 1, 2-3, 4, 5
LOGOTHETIS, N.K., 1, 2
LONGCHENPA, 1, 2, 3
LONGO, G., 1
LU, H.D., 1
LUBKE, G.H., 1
LUDLOW, D., 1
LUDLOW, P., 1
LUECK, C.J., 1
LUISI, P.-L., 1
LUPESCU, R., 1
LUTZ, A., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
LYDIC, R., 1
LYLE, R., 1
LYONS, W., 1
MACDONELL, A.A., 1
MCGOVERN, K., 1, 2
MACH, E., 1, 2, 3, 4
MACHOVEC, F., 1
MACK, A., 1, 2, 3
MACKEY, S.C., 1
MAEDA, F., 1
MAISONNEUVE, I.M., 1
MALACH, R., 1
MALDINEY, H., 1, 2, 3
MALEBRANCHE, N., 1, 2, 3, 4, 5
MANGAN, B., 1, 2
MANISCALCO, B., 1
MNTIL, T., 1
MANZOTTI, R., 1, 2
MARCEL, A., 1
MARIE, C., 1
MARINO, L., 1
MARION, J.-L., 1, 2, 3, 4, 5
MARSH, M.N., 1
MARTI, S., 1, 2
MARTINERIE, J., 1
MASHOUR, G.A., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
MASON, D., 1
MASSION, A.O., 1
MATHEWS, M.J., 1
MATSUKI, A., 1
MATSUYOSHI, D., 1
MATTA, B.F., 1, 2, 3
MATTHEN, M., 1
MAUGUIRE, F., 1
MAUPASSANT, G. de, 1, 2
MAYR, S., 1
MCCANN, U.D., 1
MCCAUL, K.D., 1
MCCRATY, R., 1
MCREYNOLDS, J.R., 1
MEAD, G.H., 1
MEILLASSOUX, Q., 1
MELLONI, L., 1
MELTZOFF, A.N., 1
MELVIN, R., 1
MENARY, R., 1
MENON, D.K., 1, 2, 3
MENZIES, P., 1
MERICKLE, P.M., 1
MERKER, B., 1
MERLEAU-PONTY, M., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12-13, 14, 15, 16-17, 18-19, 20-21, 22, 23
MESQUITA, B., 1
MESSINA, A.G., 1
METZINGER, T., 1
MEULI, R., 1
MEUWESE, J., 1
MEYERS, V., 1, 2
MEYNEN, G., 1
MI, W.D., 1
MICOULAUD-FRANCHI, J.-A., 1, 2
MIDAL, F., 1
MILAREPA, 1
MILL, J.S., 1
MILLER, G.A., 1, 2
MILLER, J., 1
MILNER, B., 1
MIMA, T., 1
MIN, B.-K., 1
MINOTTI, L., 1
MISRAHI, R., 1
MITCHELL, E., 1
MITCHELL, M., 1
MITCHELL, R., 1
MITCHELL, R.W., 1
MOESCHLER, J., 1
MOK, M.S., 1
MOLDAKARIMOV, S., 1
MOLE, C., 1
MONGIN, O., 1, 2
MONTAIGNE, M. de, 1
MONTEVIL, G., 1
MOODY, T.C., 1, 2
MORE, H., 1, 2
MORIN, A., 1, 2
MORRIS, S.G., 1
MOSCOVITCH, M., 1, 2, 3, 4
MOUTOUSSIS, K., 1
MUKAMEL, R., 1
MURRAY, C.D., 1, 2
NACCACHE, L., 1, 2, 3, 4
NGRJUNA, 1, 2
NAGASAWA, Y., 1
NAGEL, T., 1, 2, 3, 4, 5-6
NAHMIAS, E.A., 1
NANAMOLI BHIKKHU, 1
NATORP, P., 1, 2
NAURIYAL, D.K., 1
NEF, F., 1, 2, 3
NELSON, R.J., 1
NELSON, T.O., 1
NEMIROW, L., 1
NEWBERG, A.B., 1
NIETZSCHE, F., 1, 2, 3, 4
NISBETT, R.E., 1, 2, 3, 4, 5-6
NISHIDA, K., 1-2, 3, 4
NISSOU, J.-M., 1, 2, 3, 4
NIXON, G., 1
NO, A., 1, 2
NOH, G.-J., 1, 2
NOIRHOMME, Q., 1
OCONNOR, M., 1, 2
OLEARY, D., 1
OREGAN, J.K., 1, 2, 3
OCHSNER, K.N., 1
OCZENSKI, W., 1
OGDEN, R.M., 1
OGMEN, H., 1
OHASHI, R., 1
OLSSON, A., 1
OSAKA, N., 1
OSSANDON, T., 1
OTTO, R., 1, 2-3
OVERGAARD, M., 1, 2, 3
OWEN, A.M., 1, 2, 3, 4
PACHOUD, B., 1, 2, 3, 4, 5
PADMASAMBHAVA, 1
PAGLI, P., 1
PAIN, L., 1
PAL, D., 1
PALANCA, B.J., 1
PALLER, K.A., 1
PANOFSKY, E., 1
PAQUERON, X., 1
PARENT, A., 1
PARKER, S., 1
PASHLER, H., 1
PASSINGHAM, R.E., 1
PATOKA, J., 1, 2, 3
PATTEE, H.H., 1
PAULY, J.M., 1
PAVIE, X., 1
PBERT, L., 1
PEARL, D.K., 1
PEDROARENA, C., 1
PEETERS, M., 1
PEIRCE, C.S., 1
PERAGUT, J.C., 1
PERRET, N., 1
PESCHARD, I., 1
PESSA, E., 1
PETERSON, L.G., 1
PETIT, J.L., 1
PETITMENGIN, C., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-13,
14, 15
PETITOT, J., 1, 2
PETTIGREW, L.E., 1
PHAF, H., 1
PICCININI, G., 1
PICKERING, A., 1, 2
PINES, S., 1
PLANTINGA, A., 1
PLATON, 1, 2, 3
PLOTIN, 1
POGGI, C., 1, 2
POLGER, T., 1
POPULIN, L.C., 1
POST, R., 1
POSTLE, B.R., 1
PRICE, D.D., 1
PRICE, H., 1
PRINZ, J., 1
PRIOR, H., 1
PROUST, J., 1
PUTNAM, H., 1, 2
PUYBASSET, L., 1
QUINE, W.V., 1
RADDER, H., 1
RAJALA, A.Z., 1
RAMACHANDRAN, V.S., 1, 2
RAMON Y CAJAL, S., 1
RAO, S., 1
REBOUL, A., 1
REDER, L.M., 1
REES, G., 1
REESE, E., 1
REESE, R., 1
REGIS, J.M., 1
REICHARD, G., 1
REININGER, K.R., 1
REISSAND, D., 1
REMILLIEUX, A., 1, 2
RENSINK, R.A., 1
REVONSUO, A., 1
REY, M.F., 1
REY, O., 1
RHYS DAVIDS, C.A.F., 1
RIBARY, U., 1
RICARD, M., 1, 2
RICHARD, S., 1
RICHARDS, W.A., 1
RICHIR, M., 1
RICHMOND, S., 1
RICUR, P., 1, 2, 3, 4, 5, 6
RIOU, B., 1
RIVELAYGUE, J., 1
RIZZOLATI, G., 1
ROBBINS, P., 1
ROBINSON, H., 1, 2
ROCHAT, P., 1
ROCK, I., 1, 2
ROCKWELL, T., 1
RODD, J.M., 1, 2, 3
RODIS-LEWIS, G., 1
RODRIGUEZ, E., 1
ROE, A.W., 1
ROEPSTORFF, A., 1, 2, 3
ROGOZINSKI, J., 1
ROHAUT, B., 1
ROMANO, C., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ROSCH, E., 1, 2
ROSENTHAL, D.M., 1, 2, 3, 4, 5, 6
ROTHWELL, J.C., 1
ROUNIS, E., 1
ROUSTANG, F., 1, 2, 3, 4
ROVERE, M., 1
ROY, J.-M., 1
RUDRAUF, D., 1, 2
RUSSELL, B., 1, 2, 3, 4, 5, 6
RUSSELL, I.F., 1, 2
RUYER, R., 1-2, 3
RYCKMAN, T., 1
RYLE, G., 1, 2
SAAGER, L., 1
SACKUR, J., 1, 2, 3, 4-5
SAHRAIE, A., 1
SAINT-AUBERT, E. de, 1
SAKAI, T., 1
SALMELIN, R., 1
SAMBURSKY, S., 1
SANCHEZ-VIVES, M.V., 1
SANDBERG, K., 1
SANTORELLI, S.F., 1
SARTI, A., 1
SARTRE, J.-P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
SASS, L., 1
SAXL, F., 1
SCHACTER, D.L., 1
SCHIFF, N.D., 1, 2
SCHMIDT, J.A., 1
SCHNEIDER, G., 1
SCHNEIDER, L., 1
SCHNEIDER, S., 1, 2, 3
SCHNELL, A., 1
SCHOENDORFF, B., 1
SCHOLTE, S., 1
SCHON, D., 1
SCHOOLER, J.W., 1, 2
SCHOPENHAUER, A., 1, 2, 3
SCHRDINGER, E., 1, 2, 3, 4, 5, 6
SCHUNN, C.D., 1
SCHURGERA, A., 1
SCHWARZ, A., 1
SCHWITZGEBEL, E., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
SCOVILLE, W.B., 1
SEARLE, J., 1, 2, 3
SEARLEMAN, A.C., 1, 2
SEBEL, P.S., 1, 2, 3
SEGAL, Z.V., 1
SEJNOWSKI, T., 1
SELVIDGE, J.A., 1
SENZAKI, N., 1
SERAMSETTI, S.M., 1
SERGENT, C., 1, 2
SETH, A.K., 1
SVRAC, P., 1
SEVERINO, E., 1
SEVUSH, S., 1
SEXTUS EMPIRICUS, 1
SEYMOUR, K., 1
SHANNON, C.E., 1, 2, 3
SHANON, B., 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
SHEPARD, R.N., 1
SHIKSNANDA, 1
SHORT, T.L., 1
SIEGEL, D.J., 1
SIGMAN, M., 1, 2, 3
SIKSTRM, S., 1, 2
SILBURN, L., 1, 2
SILVANTO, J., 1
SILVERMAN, M., 1
SIMON, H.A., 1
SIMONS, D.J., 1
SIMONS, P., 1
SIN, R.H., 1
SINGER, T., 1
SINGER, W., 1, 2
SINGH, H., 1
SINIGAGLIA, C., 1
SITTA, J.D., 1
SKINNER, B.F., 1
SKINNER, C., 1
SKRBINA, D., 1
SLATER, M., 1
SLOBODA, J., 1
SLOCUM, J.D., 1
SLOTERDIJK, P., 1, 2, 3, 4
SMILEK, D., 1
SMITH, Q., 1
SMITHIES, D., 1
SMULLYAN, R., 1
SNELL, B., 1, 2
SODDU, A., 1
SON, L.K., 1
SONEJI, D., 1
SOON, C.S., 1
SORABJI, R., 1
SRENSEN, T.A., 1
SOTO, D., 1
SOULEZ, A., 1
SPAMPINATO, F., 1
SPANLANG, B., 1
SPEKREISE, H., 1
SPENCE, S.A., 1
SPERLING, G., 1-2
SPINOZA, B., 1, 2, 3, 4, 5
SPORNS, O., 1
STAHLHUT, C., 1
STAPLETON, M., 1
STCHERBATSKY, T., 1-2
STEELS, L., 1
STEINDL-RAST, D., 1
STEVENS, B., 1
STIMPFL, T., 1
STOELTING, R.K., 1
STOLJAR, D., 1
STORMS, M.D., 1
STRAUS, E., 1
STRAUSS, J., 1
STRAWSON, G., 1, 2
STUSS, D.T., 1
SUHAMY, A., 1
SUZUKI, D.T., 1
SYDSJO, G., 1
TADI, T., 1
TAGLIASCO, V., 1
TANIGAWA, H., 1
TRNING, B., 1, 2
TART, C.T., 1, 2, 3
TAYLOR, J.T., 1, 2, 3
TEASDALE, G.M., 1
TEN ELSHOF, G., 1
TEN HOOR, M., 1
TENEGGI, C., 1
TERRACE, H.S., 1
THRSE dAVILA, sainte, 1-2
THIELSCHER, A., 1
THISTED, R., 1
THOMAS, S., 1, 2
THOMAS-FOGIEL, I., 1
THOMPSON, E., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
TILLER, W.A., 1
TIMMERMANS, B., 1
TIPLER, F., 1
TITCHENER, E.B, 1, 2, 3, 4, 5, 6
TODD, R., 1, 2
TODD, S.J., 1
TOLA, F., 1, 2
TOLLE, E., 1
TOLSTO, L., 1, 2, 3
TONNEAU, F., 1, 2
TONONI, G., 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11-12, 13, 14, 15,
16
TRAMPE, R., 1
TREVENA, J., 1
TRIVEDI, A.N., 1
TSAKIRIS, M., 1
TSONGKHAPA, 1
TULVING, E., 1, 2
TUNG, A., 1
TUNSTALL, M.E., 1
TURING, A.M., 1, 2, 3
TURNER, M.S., 1
TWENEY, R., 1
TYE, M., 1, 2
TZELGOV, J., 1
UZAN, P., 1, 2
VALENZUELA-MOGUILLANSKY, C., 1
VAN FRAASSEN, B., 1, 2, 3
VAN LOMMEL, P., 1, 2
VAN WEES, R., 1, 2
VANGEL, M., 1, 2
VANGKILDE, S., 1
VANHAUDENHUYSE, A., 1
VANINI, G., 1
VARELA, F., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
VARENNE, J., 1
VARGAS, L.M., 1
VARMA, S., 1
VAUCANSON, 1
VELLY, L.J., 1
VELMANS, M., 1, 2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9
VERMERSCH, P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
VETTER, G., 1
VICO, G., 1
VIDAL, F., 1
VIDAL, J.R., 1
VILLABLANCA, J.R., 1
VILMER, J., 1
VION-DURY, J., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
VITIELLO, G., 1
VIVENZA, J.-M., 1
VOHS, K.D., 1
VON WRIGHT, G.H., 1
VOSS, J.L., 1
VUILLEMIN, J., 1
VYCUDILIK, W., 1
WAISMANN, F., 1
WALLACE, B.A., 1, 2
WALLON, H., 1
WALTER, S., 1, 2
WANG, M.M., 1, 2
WARD, L.M., 1
WATSON, J.B., 1
WATSON, J.D., 1
WEAVER, W., 1
WEBER, A., 1
WEDEEN, V.J., 1
WEGNER, D., 1
WEISKRANTZ, L., 1
WEISS, N., 1
WERNER, H., 1
WERTHEIMER, M., 1, 2
WEYL, H., 1
WHEELER, M.A., 1
WHITEHEAD, C., 1
WILDE, D.J., 1
WILLIAMS, J.M.G., 1
WILSON, F., 1
WILSON, J.T., 1
WILSON, T.D., 1, 2, 3, 4, 5-6
WINCKLER, M., 1
WITJAS, T., 1
WITTGENSTEIN, L., 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30
WOOD, C.W., 1
WOODWARD, J., 1
WOODWORTH, R.S., 1
WRIGHT, E.W., 1, 2, 3
WU, C.C., 1
WU, S.-W., 1
WU, W., 1
WUNDT, W., 1-2, 3, 4, 5, 6, 7
WYER, R.S., 1, 2
YASUE, K., 1
YATES, J., 1
YOON, J.R., 1
ZAHAVI, D., 1, 2, 3, 4, 5, 6
ZAJONC, A., 1
ZARETSKAYA, N., 1
ZEKI, S., 1, 2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ZELAZO, P.D., 1, 2-3, 4, 5, 6, 7
ZEMAN, A., 1, 2, 3
ZHANG, L., 1
ZURIFF, G., 1
ZWIRN, H., 1
Dans la collection Bibliothque des savoirs
Michel Agier, Grer les indsirables. Des camps de rfugis au
gouvernement humanitaire
Alberto Alesina, Edward L. Glaeser, Combattre les ingalits et la pauvret.
Les tats-Unis face lEurope
Ulrich Beck, Edgar Grande, Pour un empire europen
Michel Bitbol, De lintrieur du monde. Pour une philosophie et une science
des relations
Rmi Brague, Le Propre de lhomme. Sur une lgitimit menace
Stanley Cavell, Cits de paroles. Philosophie des salles obscures
Douwe Draaisma, Pourquoi la vie passe plus vite mesure quon vieillit
Une histoire de la mmoire
Didier Fassin, Richard Rechtman, LEmpire du traumatisme. Enqute sur la
condition de victime
Siegfried Kracauer, Thorie du film. La rdemption de la ralit matrielle
Christopher Lane, Comment la psychiatrie et lindustrie pharmaceutique ont
mdicalis nos motions
Benot de lEstoile, Le Got des autres. De lexposition coloniale aux arts
premiers
Andr Pichot, Aux origines des thories raciales. De la Bible Darwin
Karl Polanyi, La Subsistance de lhomme : la place de lconomie dans
lhistoire et la socit
Grard Pommier, Comment les neurosciences dmontrent la psychanalyse
Que veut dire faire lamour ?
Alain Renaut, Un humanisme de la diversit. Essai sur la dcolonisation des
identits
Bernard Stiegler, Prendre soin. 1. De la jeunesse et des gnrations
Pharmacologie du Front national, suivi de Vocabulaire dArs Industrialis
par Victor Petit
Pierre-Andr Taguieff, Le Sens du progrs. Une approche historique et
philosophique
Slavoj izek, Fragile absolu. Pourquoi lhritage chrtien vaut-il dtre
dfendu ?
Aprs la tragdie, la farce ! ou Comment lhistoire se rpte.
Vivre la fin des temps
Pour dfendre les causes perdues
Mtastases du jouir. Des femmes et de la causalit
T
Du mme auteur
Introduction
QUESTION 1 - Quel langage pour la conscience ?
QUESTION 2 - Peut-on dfinir la conscience ?
QUESTION 3 - Comment changer dtat de conscience ?
QUESTION 4 - Les questions sur la conscience sont-elles auto-
rfrentielles ?
QUESTION 5 - La conscience est-elle le prsuppos de la nature ?
QUESTION 6 - Comment classer les thses mtaphysiques au sujet
de la conscience ?
QUESTION 7 - Que faut-il tre pour adhrer une thse mtaphysique ?
QUESTION 8 - Quest-ce que a (ne) fait (pas) dtre un Zombie ?
QUESTION 9 - Les thories neurologiques et volutionnistes
de la conscience : quexpliquent-elles ?
QUESTION 10 - Anesthsie, sommeil, coma : que suspendent-ils ?
QUESTION 11 - Quel genre dunit a le moment prsent ?
QUESTION 12 - Comment la nature est-elle noue par et avec
la conscience ?
QUESTION 13 - Lintrospection est-elle possible ?
QUESTION 14 - Que voudrait dire vivre sa propre mort ?
Conclusion
Bibliographie
Index
Dans la collection Bibliothque des savoirs
Notes
1. L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, Basil Blackwell, 1983,
p. 103, 304.
2. Il sagit l dune expression du problme des autres esprits . A.
Avramides, Other Minds, Routledge, 2001 ; F. Nef, propos d'une
controverse entre Carnap et Schrdinger , in M. Bitbol & O. Darrigol (d.),
Erwin Schrdinger, Philosophy and the Birth of Quantum Mechanics,
Frontires, 1992 ; M. Bitbol, The problem of other minds : A debate
between Schrdinger and Carnap , Phenomenology and the Cognitive
Science, 3 (1), 2004, p. 115-123.
3. M. Heidegger, Quest-ce que la mtaphysique ?, Nathan, 1998, p. 42.
4. M. Merleau-Ponty, Le Visible et lInvisible, Gallimard, 1964, p. 47.
5. M. Heidegger, Quest-ce que la mtaphysique ?, op. cit., p. 42, note 2.
6. Le thme dun personnage qui ne se reconnat pas immdiatement dans le
miroir est frquent dans la littrature, avec diverses tonalits motives. Voir
par exemple Guy de Maupassant, Bel-Ami, Livre de Poche, 1979 : lpisode
clbre des trois miroirs dans lescalier comporte un premier temps de non-
reconnaissance tonalit laudative. Ce thme a par ailleurs t comment
philosophiquement par une ligne de penseurs viennois. Ainsi, Ernst Mach
dcrit deux pisodes (devant une boutique et dans un omnibus) durant lesquels
il a t surpris par une personne quil croyait tre autre et qui tait en fait sa
propre image dans un miroir (E. Mach, LAnalyse des sensations, Jacqueline
Chambon, 1996, I, 2, note). Son exprience de dfaut de reconnaissance le
confirme dans lide que les gens se connaissent trs mal eux-mmes .
Sigmund Freud cite Mach sur ce point, et mentionne quil a vcu la mme
exprience au moins une fois, dans un train (S. Freud, LInquitante
tranget et autres essais, Gallimard, 2003, p. 257, note 1). Lapparition de
son image, crit-il rebours du personnage de Maupassant, lui a fortement
dplu . Voir galement A. Lacroix, Le visage, ce quil rvle ,
Philosophie Magazine, n
o
64, 2012, p. 44-45.
7. S. Freud, LInquitante tranget et autres essais, op. cit., p. 257.
8. Ibid., p. 246.
9. M. Heidegger, tre et Temps , trad. E. Martineau, Authentica, 1985, p. 189,
40. trang(r)et est la traduction choisie ici pour Unheimlichkeit .
10. M. Foucault, Des espaces autres. Htrotopies , Dits et crits 1984.
Des espaces autres, confrence au Cercle d'tudes architecturales, 14 mars
1967, in Architecture, Mouvement, Continuit, n
o
5, octobre 1984, p. 46-49.
11. C.H. Cooley, Human Nature and the Social Order, Schocken Books,
1964 ; G.H. Mead, The social self , in G.H. Mead, Selected Writings,
Bobbs-Merrill, 1964.
12. R. Laing, Soi et les autres, Gallimard, 1971.
13. C. Whitehead, Social mirrors and shared experiential worlds , Journal
of Consciousness Studies, vol. 8, 2001, p. 3-36.
14. C. Gheorghiev, Le Signe du miroir, ditions Universitaires Europennes,
2011. Le signe du miroir , cest--dire la non-reconnaissance du sujet dans
un miroir (ou les longues sances de contemplations spculaires, pour
sassurer quil na pas chang), compte parmi les symptmes frquents de la
schizophrnie.
15. P.-H. Castel, LEsprit malade, Ithaque, 2009, p. 126.
16. H. Maldiney, Penser lhomme et la folie, Jrme Millon, 2007, p. 308
(p. 424 de ldition 1991) : La rceptivit accueillante lvnement,
incluse dans la transformation de lexistant, constitue sa transpassibilit. Elle
fait dfaut dans la psychose . Linterprtation existentielle de ce dfaut
daccueil le rapporte un vnement pass inintgrable, vcu comme
absolument tranger, et auquel la projection daltrit sur des personnages
dlirants fait cho.
17. L. Sass, Les Paradoxes du dlire, Ithaque, 2010.
Notes
1. Voir le chapitre XIII, qui porte sur lintrospection.
2. J. Austin, Quand dire cest faire, Seuil, 1991. La modalit locutoire du
langage est aussi appele constative ; elle sert faire des constats sur ce
quil y a ou ce qui se prsente. Elle soppose dautres modalits dites
performatives , dont la fonction est de modifier un tat de choses actuel en
agissant sur des interlocuteurs.
3. L. Wittgenstein, Notes sur lexprience prive et les sense data, TER,
1982, p. 24.
4. Une esquisse de ce thme se trouve dans M. Bitbol, De lintrieur du
monde. Pour une philosophie et une science des relations, Flammarion,
2010, p. 571. On peut y entendre une rminiscence du concept heideggerien de
Dasein, et de sa puissante reprise par Henri Maldiney.
5. M. Tye, Consciousness, Color, and Content, MIT Press, 2000.
6. F. Tonneau, Consciousness outside the head , Behavior and Philosophy,
32, 2004, p. 97-123 ; T. Honderich, On Consciousness, Edinburgh University
Press, 2004 ; T. Honderich, Radical Externalism , Journal of
Consciousness Studies, vol. 13, 2006, p. 3-13 ; J.K. ORegan, & A. No, A
sensorimotor account of vision and visual consciousness , Behavioral and
Brain Sciences, 24, 2001, p. 939-1031 ; A. No, Out of the head. Why you
are not your brain , MIT Press, 2009 ; R. Manzotti, Does process
externalism support panpsychism ? The relational nature of the physical world
as a foundation for the conscious mind , in D. Skrbina (d.), Mind That
Abides, John Benjamins, 2009.
7. L. Wittgenstein, Carnets 1914-1915, Gallimard, 1971, p. 158.
8. S. Freud, Mtapsychologie, Gallimard, 1978, p. 65.
9. Ibid., p. 76. Voir galement M. Bitbol, Physique et Philosophie de lesprit,
Flammarion, 2000, p. 129.
10. L. Wittgenstein, Carnets 1914-1916, op. cit., p. 145 ; L. Wittgenstein,
Tractatus Logico-Philosophicus, Gallimard, 1993, 5.621.
11. L. Wittgenstein, Carnets 1914-1916, op. cit., p. 148.
12. L. Wittgenstein, Notes sur lexprience prive et les sense data, op. cit.,
p. 42.
13. Ibid.
14. Une version du proverbe est attribue au Bouddha historique, Siddhrta
Gautama : L. Silburn, Aux sources du bouddhisme, Fayard, 1997, p. 225.
15. Lexpression langage identifiant traduit la locution italienne
linguaggio medesimale , forge par F. Bertossa pour indiquer le genre de
retournement de la langue sur son propre vcu de signification qui se produit
lors des enseignements directs et dialogiques du Zen. Voir F. Bertossa & R.
Ferrari, Lo Sguardo senza occhio, Albo Versorio, 2004.
16. N. Senzaki, Cent Koans Zen, Albin Michel, 2005.
17. Voir F. Midal, Confrences de Tokyo, Cerf, 2012.
18. K.-O. Apel, La question de la fondation ultime de la raison , Critique,
n
o
413, octobre 1981, p. 924 ; voir galement K.-O. Apel, Transformation de
la philosophie, vol. I, Cerf, 2007.
19. J.-L. Marion, La Thologie blanche de Descartes, PUF, 1981, p. 377.
20. J. Hintikka, Cogito ergo sum : infrence ou performance ? ,
Philosophie, 6, 1985, p. 21-51 ; discussion dans : J. Vilmer, Cogito ergo
sum, induction et dduction , Archives de philosophie, t. 67, 2004, p. 51-63.
21. R. Descartes, Discours de la mthode, IV, Gallimard, 2009, p. 102.
22. R. Descartes, lettre *** de novembre 1640, in C. Adam & P. Tannery
(d.), uvres de Descartes, III, Vrin, 1964-1974, p. 248.
23. Vivre le doute est certitude. Le doute nest pas prdateur de lui-mme. Il
nest invalidant que sil est transitif, sil est appliqu quelque chose
dautre . F. Bertossa, www.asia.it/adon.pl?act=doc&doc=1319, 2011. Cette
conception, issue de la pratique du Zen, saccompagne dune lecture
ontologique du cogito, assez proche de celle expose plus bas en sappuyant
sur les rflexions du philosophe japonais Nishida Kitar. Elle fait par ailleurs
usage dune analyse logique prcise de la forme gnrale dargument appele
consequentia mirabilis : Si de la ngation dune proposition A, on
dduit A, alors A est vraie . F. Bellissima & P. Pagli, Consequentia
mirabilis, una regola logica tra matematica e filosofia, Leo Olschki, 1996,
p. 7. La paternit du raisonnement est souvent attribue Aristote, dans son
Protreptique : W. Kneale, Aristotle and the consequentia mirabilis ,
Journal of Hellenistic Studies, 77, 1957, p. 62-66. Clavius la galement
formule au XVII
e
sicle, en sappuyant sur lutilisation quen fait Euclide : M.
Peeters & S. Richard, Logique formelle, Mardaga, 2009, p. 75.
24. Voir J. Derrida, Lcriture et la Diffrence, Seuil, 1979, p. 89.
25. Notons cependant que, si lon a pris la pleine mesure du sens non limitatif
du mot exprience , aucune opposition de cette sorte ne subsiste. Ltre, la
vie, le monde, se donnent comme exprience. Le choix de lun de ces
vocables pour dsigner cet illimit devient dans ce cas la fois libre et
arbitraire.
26. Nishida Kitar, 1870-1945, a inaugur la stratgie philosophique de
lcole de Kyto, qui consiste articuler une philosophie post-kantienne ou
phnomnologique avec la pense du Zen (essentiellement reprsente par
Daisetz Suzuki).
27. Nishida Kitar, propos de la philosophie de Descartes , in Nishida
Kitar, Lveil soi, CNRS, 2003, chapitre VI. Voir galement F. Alqui, La
Nostalgie de ltre, PUF, 1950 ; T. Gress, Descartes et la Prcarit du
monde, CNRS, 2012.
28. Cest une mme chose que penser, et la pense exprimant est. Car tu
ne trouveras pas le penser sans ltre dans lequel le penser est exprim .
Parmnide, Pome, VIII, 34-36, in P. Aubenque (d.), tudes sur Parmnide,
I, Vrin, 1987, p. 40. Voir galement H. Maldiney, Atres de la langue et
demeures de la pense, Cerf, 2012, p. 173. Maldiney traduit ce vers de
Parmnide dune manire encore plus cartsienne : Car tu ne trouveras
pas la pense quil ny a pas sans le il y a en lequel elle se trouve tre dite .
29. Nishida Kitar, Lveil soi, op. cit., p. 254.
30. Voir la formule clbre de Jacobi et Hegel, inspire de Spinoza : omnis
determinatio est negatio . C. Bouton, Temps et Esprit dans la philosophie
de Hegel, Vrin, 2000, p. 155. Spinoza lui-mme avait crit, dans sa lettre 50
Jelles, la dtermination est une ngation : B. Spinoza, Correspondance,
GF-Flammarion, 2010, p. 291.
31. Avec le prfixe latin ex- indiquant la sortie, et le verbe latin sistere
signifiant placer (ou se placer). Heidegger utilise souvent la graphie ek-sister,
en rattachant le mot au grec ekstasis (dplacement, extase).
32. R. Descartes, Mditations mtaphysiques, Livre de Poche, 1990, p. 33-
37.
33. Nishida Kitar, Lveil soi, op. cit., p. 193 ; B. Stevens, Invitation la
philosophie japonaise, CNRS, 2005.
34. L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, op. cit., 5.633.
35. M. Bitbol, De lintrieur du monde. Pour une philosophie et une science
des relations, op. cit., p. 85.
36. E. Thompson, Waking, Dreaming, Being : New Light on the Self and
Consciousness from Neuroscience, Meditation, and Philosophy, Columbia
University Press, 2014.
37. akara, Les Mille Enseignements, in M. Hulin, Quest-ce que
lignorance mtaphysique ?, Vrin, 1994, p. 60.
38. J.T. Wilson, L.E. Pettigrew & G.M. Teasdale, Structured interviews for
the Glasgow Outcome Scale and the extended Glasgow Outcome Scale :
Guidelines for their use , Journal of Neurotrauma, 8, 1998, p. 573-585.
39. Voir chapitre X. Le locked-in syndrome est une forme denfermement dans
le corps devenu inerte. J.-D. Bauby, Le Scaphandre et le Papillon, Robert
Laffont, 2007.
40. M. Velmans, Understanding Consciousness, Routledge, 2009, p. 8.
41. L. Wittgenstein, Notes sur lexprience prive et les sense data, op. cit.,
p. 40.
42. Ibid., p. 41.
43. Ibid., p. 64.
44. Ibid., p. 40.
Notes
1. Il ny a pas fixer le lieu de la conscience [] mais bien changer le
principe mme de lorientation. Au lieu de nous abandonner au mouvement
qui porte la connaissance vers son objet, nous devons apercevoir un but
auquel toute la connaissance tourne en quelque sorte le dos . E. Cassirer,
Philosophie des formes symboliques, III, Minuit, 1972, p. 67.
2. Nishida Kitar, Une tude sur le bien , Revue Philosophique de
Louvain, 97, 1999, p. 19-29.
3. E. Husserl, Recherches logiques, II, 2, PUF, 1972, p. 146, V
e
Recherche
logique, 2.
4. R. Descartes, Mditations mtaphysiques, op. cit., p. 62.
5. M. Merleau-Ponty, La Structure du comportement, PUF, 1990.
6. Ibid., p. 136.
7. W. James, Prcis de psychologie, Les Empcheurs de penser en rond,
2003, p. 108.
8. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie et une philosophie
phnomnologique pures, Gallimard, 1950, p. 276.
9. Saint Thomas dAquin (Somme thologique, 1a, question 10, article 2)
attribue ces paroles Boce : Nunc fluens facit tempus, nunc stans facit
aeternitatem : Le maintenant qui passe fait le temps, le maintenant qui
demeure fait lternit . Voir T. Hobbes, De la libert et de la ncessit,
Vrin, 1977, p. 104, note 2 (F. Lessay). Voir galement Boce, Comment la
Trinit est un Dieu, in Traits thologiques, GF-Flammarion, 2000, p. 157.
10. A. Zeman, Consciousness, a Users Guide, Yale University Press, 2002,
p. 27.
11. H. Ey, La Conscience, Descle de Brouwer, 1983, p. 19.
12. J. Barrow & F. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford
University Press, 1986, p. 2.
13. M. Heidegger, tre et Temps , op. cit., p. 12 (pagination de ldition
originale).
14. Heidegger a propos lui-mme cette traduction franaise de Dasein
dans sa lettre Jean Beaufret du 23 novembre 1945. M. Heidegger, Questions
III et IV, Gallimard, 1990, p. 130.
15. J. Calvin, Institution de la religion chrtienne, IV, 41, Philbert Hamelin,
1554 (cit par E. Balibar, Conscience , i n B. Cassin (d.), Vocabulaire
europen des philosophies, Seuil, 2004, p. 264). Lusage moral du mot italien
coscienza est attest avant cela par Dante, Divine Comdie, trad. de J.
Risset, Flammarion, 1992 : cf. Enfer , XIX, 119 ; XXVIII, 115 ;
Purgatoire , XXVII, 33 ; XXXIII, 93.
16. M. de Montaigne, Essais, III, 2, Du repentir , in uvres compltes,
Seuil, 1967, p. 327.
17. L. de La Forge, Trait de lesprit de lhomme, Michel Bobin, Paris, 1666,
p. 14.
18. R. Cudworth, The True Intellectual System of the Universe : The First
Part, Wherein All the Reason and Philosophy of Atheism Is Confuted and its
Impossibility Demonstrated, R. Royston, Londres, 1678. Voir galement U.
Thiel, Cudworth and seventeenth century theories of consciousness , in S.
Gaukroger (d.), The Uses of Antiquity, Kluwer, 2001.
19. H. More, The Immortality of the Soul, Martinus Nijhoff, 1987 (dition
originale Londres, 1659), p. 15, 16, 77, etc. On trouve galement une
occurrence de conscious dans H. More, An Antidote Against Atheism,
Londres, 1652, p. 347. Voir A. Bitbol-Hespris, Le dualisme dans la
correspondance entre Henry More (Morus) et Descartes , in J.-L. Vieillard-
Baron, Autour de Descartes, Le Dualisme de lme et du corps, Vrin, 1991,
p. 141-158.
20. R. Cudworth, The True Intellectual System of the Universe : The First
Part, Wherein All the Reason and Philosophy of Atheism Is Confuted and its
Impossibility Demonstrated, op. cit., p. 123.
21. Ibid., p. 196, 204, 207.
22. Ibid., p. 244, 253.
23. R. Cumberland, A Treatise of the Laws of Nature , R. Phillips, 1727, p. 5,
appendice de J. Maxwell.
24. J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, II, I, Oxford
University Press, p. 115, 19.
25. S. Freud, Mtapsychologie, op. cit., p. 73.
26. S. Freud, Mtapsychologie, op. cit., p. 70.
27. N. Malebranche, De la recherche de la vrit, III, II, VII, iv, in uvres I,
Gallimard, 1979, p. 350.
28. N. Malebranche, De la recherche de la vrit, III, II, VII, iii, in uvres I,
op. cit., p. 349.
29. G.W. Leibniz, Principes de la nature et de la grce, GF-Flammarion,
1999, section 4.
30. R. Descartes, uvres philosophiques, t. II, Classiques Garnier, 1967,
p. 879, rponses aux Siximes Objections.
31. J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, II, I, op. cit.,
p. 115, 19.
32. Ibid., II, XXVII, op. cit. p. 335, 9.
33. M.A. Kulstad, Leibniz on Apperception, Consciousness and Reflection,
Philosophia, 1990 ; R.J. Gennaro, Leibniz on Consciousness and Self-
Consciousness , in R.J. Gennaro & C. Huenemann (d.), New Essays on the
Rationalists, Oxford University Press, 1999, p. 353-371.
34. L. de La Forge, Trait de lesprit de lhomme, Michel Bobin, Paris, 1666,
p. 54.
35. Ibid. ; voir commentaire dans : B. Baertschi, Les Rapports de lme et du
corps. Descartes, Diderot, et Maine de Biran, Vrin, 2000, p. 379.
36. A. Arnauld, Des vraies et fausses ides contre ce quenseigne lauteur
de la Recherche de la Vrit, Abraham Viret, 1663, p. 49-50.
37. C. Adam & P. Tannery (d.), uvres de Descartes, IX-2, Vrin, 1964-
1974, p. 28 ; cit et comment par G. Lewis, Le Problme de linconscient et
le cartsianisme, PUF, 1950, p. 39.
38. C. Adam & P. Tannery (d.), uvres de Descartes, III, Vrin, 1964-1974,
p. 273, lettre Mersenne du 31 dcembre 1640.
39. Un cas contraire peut toutefois tre relev dans la traduction franaise de
Clerselier, revue par Descartes, de la rponse aux Troisimes Objections : C.
Adam & P. Tannery (d.), uvres de Descartes, IX-1, Vrin, 1964-1974,
p. 137 : il y a dautres actes que nous appelons intellectuels, comme
entendre, vouloir, imaginer, sentir, etc., tous lesquels conviennent entre eux en
ce quils ne peuvent tre sans pense, ou perception, ou conscience et
connaissance .
40. C. Adam & P. Tannery (d), uvres de Descartes, III, op. cit., p. 273,
lettre Mersenne du 31 dcembre 1640.
41. C. Adam & P. Tannery (d.), uvres de Descartes, VII, Vrin, 1964-1974,
p. 559 ; R. Descartes, uvres philosophiques, t. II, op. cit., p. 1070-1071.
Cit et comment par N. Depraz, La Conscience, Armand Colin, 2001, p. 23.
42. C. Adam & P. Tannery (d.), uvres de Descartes, IX, op. cit., p. 225.
Voir G. Lewis, Le Problme de linconscient et le cartsianisme, op. cit.,
p. 40.
43. R. Descartes, LEntretien avec Burman, PUF, 1981, p. 26 ; C. Adam & P.
Tannery (d.), uvres de Descartes, V, Vrin, 1964-1974, p. 149 ; G. Rodis-
Lewis, Luvre de Descartes, Vrin, 1971.
44. Ibid.
45. J.-P. Sartre, Ltre et le Nant, Gallimard, 1943, p. 19.
46. R. Descartes, Discours de la mthode, V, in C. Adam & P. Tannery (d.),
uvres de Descartes, VI, Vrin, 1964-1974, p. 56-60.
47. Descartes Plempius pour Fromondus, 3 octobre 1637, in C. Adam & P.
Tannery (d.), uvres de Descartes, I, Vrin, 1964-1974, p. 413 (traduction
C. Adam et G. Milhaud, Correspondance de Descartes, II, Flix Alcan, 1939,
p. 5-6). Lassimilation de la perception des animaux une perception humaine
inconsciente , en tat de distraction, a t avance plus rcemment par P.
Carruthers, Brute Experience , Journal of Philosophy, 86, 1989, p. 258-
259 ; voir galement L. Kretz, Peter Carruthers and Brute Experience;
Descartes Revisited , Essays in Philosophy, 5, 2004, p. 1-13.
48. linverse de P. Carruthers ( Brute Experience , loc. cit.), qui
considre la possibilit dune exprience inconsciente , o il entend une
exprience pure prive de conscience rflexive.
49. A. Zeman, Consciousness, a Users Guide, op. cit, p. 27.
50. Lettre Henry More du 5 fvrier 1649, in R. Descartes, uvres
philosophiques, t. III, Classiques Garnier, 1973, p. 885. Je remercie
chaleureusement mon pouse, Annie Bitbol-Hespris, pour avoir attir mon
attention sur ce texte, qui confirme que la position de Descartes au sujet de la
conscience des animaux tait plus nuance que ce qui est habituellement
admis.
51. Pour une tude approfondie sur cette question, voir F. Burgat, Une autre
existence, Albin Michel, 2012.
52. J. Greene, Memory, Thinking and Language : Topics in Cognitive
Psychology, Methuen, 1987 ; B.M. Basile & R.R. Hampton, Dissociation of
active working memory and passive recognition in rhesus monkeys ,
Cognition, 126, 2013, p. 391-396.
53. B. Russell, The Analysis of Mind, George Allen & Unwin, 1971, p. 292.
54. H. Bergson, Lnergie spirituelle, PUF, 1990, p. 5. Conscience signifie
dabord mmoire. [] Une conscience qui ne conserverait rien de son pass,
qui soublierait sans cesse elle-mme, prirait et renatrait chaque instant :
comment dfinir autrement linconscience ? En identifiant purement et
simplement la conscience et la mmoire, Bergson ignore cependant (contre
lavis de Leibniz) cela mme qui est mmoris : lexprience pure,
instantane. Cette mise lcart de toute considration sur lexprience ouvre
bon gr mal gr la voie, comme nous lavons signal, au monisme
matrialiste.
55. E. Tulving, Memory and consciousness , Canadian Psychologist, 25,
1985, p. 1-12.
56. Les trois modes de conscience de Tulving sont qualifis respectivement de
prnotique, notique et autonotique. Le mode prnotique quivaut une
exprience immdiate de la situation prsente. Le mode notique dcolle
lexprience de la pure actualit, et lui donne accs des situations figures,
passes ou projetes. Le mode autonotique met en scne le sujet en tant
quacteur de ses propres pisodes vcus.
57. La mmoire procdurale quivaut lenregistrement des programmes
daction efficaces et leur mise en uvre irrflchie dans linstant o elles
savrent utiles ; la mmoire smantique consiste en une reprsentation de
configurations passes de lenvironnement, pouvant tre dcrites laide du
langage ; et la mmoire pisodique permet la remmoration de squences
dvnements perues comme personnellement vcues.
58. J.F. Kihlstrom, The automaticity juggernaut , in J. Baer, J.C. Kaufman
& R.F. Baumeister (d.), Psychology and Free Will , Oxford University Press,
2008 ; J.A. Bargh, The automaticity of everyday life , in R.S. Wyer (d.),
Advances in Social Cognition, 10, 1997, p. 1-61.
59. G. Agamben, LOuvert. De lhomme et de lanimal, Payot & Rivages,
2006 ; voir galement M. Bitbol, Physique et Philosophie de lesprit,
Flammarion, 2000, p. 148.
60. F. Nietzsche, La Volont de puissance, t. I, Gallimard, 1995, p. 43, 98.
61. M. Henry, Gnalogie de la psychanalyse, PUF, 1985, p. 19.
62. M. Merleau-Ponty, Le Visible et lInvisible, op. cit., p. 100.
63. I. Goldberg, M. Harel & R. Malach, When the brain loses its self :
Prefrontal inactivation during sensorimotor processing , Neuron, 50, 2006,
p. 329-39.
64. La cnesthsie est un massif de sensations corporelles encore inanalyses,
prcdant toute objectivation de parties du corps auxquelles elles
appartiendraient.
65. L. Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun, Gallimard, 1965,
p. 128.
66. La reconnaissance de soi dans le miroir doit seulement tre considre
comme un signe dassimilation de cette rciprocit, qui est
vraisemblablement bien antrieure la rencontre de son propre reflet dans
leau claire ou dans la vitre mtallise. La dlgation de regard aux alter-
ego , comme lindique le texte prcdent, est sans doute le premier moteur de
la rciprocit ; il en est la fois le moteur et le fruit. Voir galement P.
Sloterdijk, Bulles, Fayard/Pluriel, 2010, p. 581.
67. H.S. Terrace & L.K. Son, Comparative metacognition , Current
Opinion in Neurobiology, 19, 2009, p. 67-74.
68. Une tache est faite sur le corps de lanimal son insu. Lanimal qui la voit
dans le miroir se touche lui-mme pour essayer denlever la tache (au lieu de
toucher le miroir !). Le dauphin ne peut pas se toucher lui-mme, il na pas de
main, mais il se retourne lui-mme dans tous les sens pour bien voir la tache
dans le miroir. Ses comportements ne sont pas les mmes face un
enregistrement diffr de ses propres mouvements, que face son image
immdiate dans un miroir.
69. M. Bekoff, C. Allen & G.M. Bughardt, The Cognitive Animal : Empirical
and Theoretical Perspectives on Animal Cognition, MIT Press, 2002.
70. D. Reissand & L. Marino, Mirror self-recognition in the bottlenose
dolphin : A case of cognitive convergence , PNAS, 98, 2001, p. 5937-5942.
71. A.Z. Rajala, K.R. Reininger, K.M. Lancaster & L.C. Populin, Rhesus
monkeys (Macaca mulatta) do recognize themselves in the mirror :
Implications for the evolution of self-recognition PLOS ONE, 5(9): e12865.
doi:10.1371, 2010.
72. H. Prior, A. Schwarz & O. Gntrkn, Mirror-induced behavior in the
magpie (Pica pica) : Evidence of self-recognition , PLOS Biology, 6, 2008,
p. 8.
73. P. Carruthers, Meta-cognition in animals : A skeptical look , Mind &
Language, 23, 2008, p. 58-89.
74. M. Tsakiris & P. Haggard, The rubber hand illusion revisited :
Visuotactile integration and self-attribution , Journal of Experimental
Psychology : Human Perception and Performance, 31, 2005, p. 80-91 ; C.
Valenzuela-Moguillansky, D. Bouhassira & J.K. ORegan, The role of body
awareness in pain : An investigation using the rubber hand illusion , Journal
of Consciousness Studies, vol. 18, 2011, p. 110-142 ; C. Valenzuela-
Moguillansky, Chronic pain and disturbances in body awareness , Revista
Chilena de Neuropsicologa, 7, 2012, p. 26-38.
75. V.S. Ramachandran, Phantoms in the Brain, Fourth Estate, 1999, p. 58-
60.
76. B. Leggenhager, T. Tadi, T. Metzinger & O. Blanke, Video ergo sum :
Manipulating bodily self-consciousness , Science, 317, 2007, p. 1096-1099 ;
M. Slater, B. Spanlang, M.V. Sanchez-Vives & O. Blanke, First person
experience of body transfer in virtual reality , PLOS ONE, 5(5): e10564.
doi:10.1371, 2010.
77. V.S. Ramachandran, Phantoms in the Brain, op. cit., p. 61.
78. M. Heidegger, tre et Temps, op. cit., p. 12.
79. J.-P. Sartre, Ltre et le Nant, op. cit., p. 95.
80. F. Roustang, Quest-ce que lhypnose ?, Minuit, 2002.
81. D. Zahavi, Self-Awareness and Alterity : A Phenomenological
Investigation, Northwestern University Press, 1999.
82. M. Henry, Philosophie et Phnomnologie du corps. Essai sur
lontologie biranienne, PUF, 2003.
83. Arrt, ou suspension, du jugement (en particulier du jugement de ralit
des objets dexprience). Cet arrt prpare le retour lexprience pure, en
de du jug ; une exprience qui inclut lexprience de juger, mais pas
ladhsion au jugement. Voir le chapitre III ci-dessous.
84. J.-P. Sartre, La Transcendance de lego, Vrin, 1978, p. 81.
85. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, PUF, 1972, p. 149.
86. H.P. Grice (d.), Studies in the Way of Words , Harvard University Press,
1989. Une implicature est un acte de langage consistant orienter
indirectement le lecteur vers une conclusion sans lavoir pour autant formule.
Une srie de questions sous-entendant limpossibilit dun certain fait sans
jamais le nier explicitement peut parfois suffire emporter la conviction.
87. F. Varela, Quel savoir pour lthique ?, La Dcouverte, 2004.
88. A. Morin, Levels of consciousness , Science and Consciousness
Review, 2, 2004, p. 1-16 ; A. Morin, Levels of consciousness and self-
awareness : A comparison and integration of various neurocognitive views ,
Consciousness and Cognition, 15, 2006, p. 358-371.
89. P.D. Zelazo, The development of conscious control in childhood ,
Trends in Cognitive Sciences, 8, 2004, p. 12-17.
90. J. Tzelgov, Automatic but conscious : That is how we act most of the
time , in R.S. Wyer (d.), The Automaticity of Everyday Life, Advances in
Social Cognition, 10, 1997, p. 217-230 ; J. Tzelgov, Automaticity and
processing without awareness , Psyche, 5 (3), avril 1999.
91. J.W. Schooler, Re-representing consciousness : Dissociations between
experience and meta-consciousness , Trends in Cognitive Sciences, 6, doi
10.1016/S1364-6613(02)01949-6, 2002.
92. Voir le tableau rcapitulatif dA. Morin, Levels of consciousness and
self-awareness : A comparison and integration of various neurocognitive
views , loc. cit.
93. G.W. Farthing, The Psychology of Consciousness, Prentice Hall, 1992.
94. A.R. Damasio, The feeling of what happens : Body and emotion in the
making of consciousness, Harcourt Brace, 1999.
95. Ibid., p. 127-128.
96. M.A. Wheeler, D.T. Stuss & E. Tulving, Toward a theory of episodic
memory : The frontal lobes and autonoetic consciousness , Psychological
Bulletin, 121, 1997, p. 331-354.
97. T.O. Nelson, Consciousness and meta-cognition , American
Psychologist, 97, 1990, p. 19-35.
98. D.M. Rosenthal, Consciousness and Mind, Oxford University Press,
2005.
99. E.J. Langer, The Power of Mindful Learning, Addison-Wesley, 1997.
100. L.M. Reder & C.D. Schunn, Metacognition does not imply awareness :
Strategy choice is governed by implicit learning and memory , in L.M. Reder
(d.), Implicit Memory and Metacognition, Psychology Press, 1996.
101. M. Csikszentmihalyi, Flow : The Psychology of Optimal Experience,
Harper & Row, 1990.
102. P.D. Zelazo, H. Hong Gao & R. Todd, The development of
consciousness , in P.D. Zelazo, M. Moscovitch & E. Thompson (d.), The
Cambridge Handbook of Consciousness, Cambridge University Press, 2007.
103. D.M. Rosenthal, Consciousness and Mind, op. cit.
104. Cette analyse correspond dassez prs ltagement husserlien des
expriences ant-prdicatives et prdicatives. E. Husserl, Exprience et
Jugement, PUF, 1970.
105. P.D. Zelazo, H. Hong Gao & R. Todd, The development of
consciousness , loc. cit., p. 416.
106. R.W. Mitchell, Kinesthetic-visual matching and the self-concept as
explanations of mirror-self-recognition , Journal for the Theory of Social
Behaviour, 27, 1997, p. 18-39.
107. P. Rochat, Six levels of self-awareness as they unfold early in life ,
Consciousness and Cognition, 12, 2003, p. 717-731.
108. G. Edelman & G. Tononi, Comment la matire devient conscience,
Odile Jacob, 2000, p. 243.
109. N. Lesvre, tat actuel des tudes concernant les potentiels voqus
recueillis sur le scalp chez lhomme , LAnne psychologique, 68, 1968,
p. 143-184 ; J. Vion-Dury & F. Blanquet, Pratique de lEEG, Masson, 2008.
Voir chapitre X.
110. C. Petitmengin, M. Bitbol, J.-M. Nissou, B. Pachoud, H. Curallucci, M.
Cermolacce & J. Vion-Dury, Listening from within , Journal of
Consciousness Studies, vol. 16, 2009, p. 252-284 ; M. Aramaki, J. Vion-
Dury, D. Schon, C. Marie & M. Besson, Une approche interdisciplinaire de
la smiotique des sons , in R. Dalmonte & F. Spampinato (d.), Il Nuovo in
musica e in musicologia, LIM, Lucques, 2009.
111. Pour plusieurs de ces langues (le danois, le russe, le hongrois, le chinois,
et lingessana), linformation est tire de A. Zeman, Consciousness, a Users
Guide, op. cit., p. 32. Pour le franais, langlais, lallemand, litalien et le
sanskrit, elle a t obtenue partir de diverses sources allant des
dictionnaires (Monier-Williams pour le sanskrit, Oxford English Dictionary
pour langlais) aux ouvrages philosophiques.
112. J. Moeschler & A. Reboul, Dictionnaire encyclopdique de
pragmatique, Seuil, 1994, p. 31.
113. J.B. Bossuet, Instruction sur les tats doraison, Claude Anisson, 1697.
114. M. De Certeau, La Fable mystique, I, Gallimard, 1982.
115. P.-S. Filliozat, Le Sanskrit, PUF, 2010 ; C. Poggi, Le Sanskrit, souffle et
lumire, Almora, 2012, p. 97.
116. R. Calasso, LArdore, Adelphi, 2010, p. 30-31.
117. Voir Platon, Rpublique, VII, 533 d, in uvres compltes de Platon, I,
Gallimard, 1950, p. 1128. Platon y voque l il de lme , avant Plotin et
son il intrieur (Plotin, Ennades, I, 6, 9, Les Belles Lettres, 1976,
p. 105), et galement avant la variante augustinienne des yeux de lme (saint
Augustin, Soliloques, I, 12, in saint Augustin, uvres, I, Gallimard, 1998,
p. 200). Voir galement la Yogakundalini Upanishad, in Thirty Minor
Upanishads, trad. anglaise de K. Narayanaswami Aiyar, Madras, 1914. On y
trouve mentionn un sixime chakra (ajna chakra), situ derrire la jonction
des deux sourcils, et ayant une fonction de contemplation spirituelle ; ce site
anatomique est couramment appel troisime il . Une tude rcente du
phnomne de regard intrieur peut tre trouve dans F. Ferri, F. Bertossa, M.
Besa & R. Ferrari, Point zero : A phenomenological inquiry into the
subjective physical location of consciousness , Perceptual and Motor Skills,
107, 2008, p. 323-335.
118. E. Severino, La Filosofia futura, Rizzoli, 2011, p. 159 : inevitabile
che diventa sembre pi lucida e pressante la consapevolezza che [] quella
sicurezza ha pur sempre un valore ipotetico . On hsite en franais entre
utiliser le substantif savoir ou le substantif conscience pour traduire
ici consapevolezza : il est invitable que devienne toujours plus clair et
pressant le savoir (la conscience) que cette scurit a pourtant toujours une
valeur hypothtique .
119. Longchenpa, La Libert naturelle de lesprit, Seuil, 1994.
120. Des quivalents de ces deux verbes sanskrits sont reconnaissables dans
le latin Esse, et dans langlais to Be.
121. Vasubandhu, A Discussion of the Five Aggregates, in S. Anacker, Seven
Works of Vasubandhu, Motilal Banarsidass, 1998, p. 65.
122. M. Bitbol, De lintrieur du monde. Pour une philosophie et une
science des relations, op. cit., p. 65.
123. W. James, Essais dempirisme radical, Flammarion, 2007. Notons que,
chez Leibniz, laperception sopposait la perception comme la conscience
rflexive la conscience primaire, ce qui est bien diffrent de lacception
propose par James.
124. Cette expression sanskrite signifie littralement achvement non
dualiste de la connaissance , comme cela a t prcis au chapitre I.
125. F. Jullien, Un sage est sans ide, Seuil, 1998.
126. L. Bansat-Boudon, An Introduction to Tantric Philosophy : The
Paramrthasra of Abhinavagupta With the Commentary of Yogarja,
Routledge, 2011, p. 174.
Notes
1. M. Heidegger, tre et Temps, op. cit., p. 31.
2. Ibid., p. 32 ; voir galement M. Heidegger, Introduction la recherche
phnomnologique, Gallimard, 2013, p. 45.
3. M. Heidegger, tre et Temps, op. cit., p. 35.
4. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., p. 87-
100, 27-31 ; voir le commentaire prcis de Natalie Depraz, Lire Husserl en
phnomnologue, PUF, 2008, p. 62.
5. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., p. 317,
92.
6. E. Husserl, Phnomnologie de lattention, Vrin, 2009, p. 91.
7. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, PUF, 1972, p. 141.
8. A. Goldgar, Tulipmania : Money, Honor, and Knowledge in the Dutch
Golden Age, University of Chicago Press, 2007.
9. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 143.
10. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., 78.
Voir aussi N. Depraz, Lire Husserl en phnomnologue, p. 141.
11. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 152-153.
12. Ibid., p. 4.
13. Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, I, 4, Seuil, 1997, p. 57.
14. P. Hadot, Quest-ce que la philosophie antique ?, Gallimard, 1995.
15. P. Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Albin Michel,
2002 ; X. Pavie, Exercices spirituels : leons de philosophie antique, Les
Belles Lettres, 2012.
16. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 15.
17. Ibid., p. 9.
18. Ibid., p. 15.
19. E. Fink, What does the phenomenology of Husserl want to
accomplish ? , Research in Phenomenology, 2, 1972, p. 5-27 (traduction
anglaise de Was will die Phnomenologie Edmund Husserls ? , in E. Fink,
Studien zur Phnomenologie 1930-1939, Martinus Nijhoff, 1966).
20. E. Husserl, La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, Gallimard, 1976, p. 171.
21. E. Fink, Sixime Mditation cartsienne, Jrme Millon, 1994, p. 93.
22. E. Husserl, La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, op. cit., p. 164.
23. H. Weyl, Temps, espace, matire, Albert Blanchard, 1958, p. 4 ; voir
galement T. Ryckman, The Reign of Relativity, Oxford University Press,
2007.
24. E. Husserl, La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, op. cit., p. 167.
25. E. Fink, Sixime Mditation cartsienne, op. cit., p. 94.
26. E. Husserl, La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, op. cit., p. 266.
27. E . Husserl, Mditations cartsiennes, Vrin, 1992, p. 66, 15.
28. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 136.
29. E. Husserl, La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, op. cit., p. 174.
30. N. Depraz, Lire Husserl en phnomnologue, op. cit., p. 138.
31. Du verbe latin duco, ducere : guider, conduire.
32. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., p. 168,
51.
33. Ibid.
34. Voir chapitre VI.
35. E. Husserl, De la rduction phnomnologique, Jrme Millon, 2007,
p. 48.
36. Il ne faut cependant pas oublier que, selon Husserl, la tche de la
phnomnologie est dtre une science rigoureuse des essences vcues.
37. E. Husserl, La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, op. cit., p. 172.
38. Ibid., p. 173.
39. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 173 ; voir B. Bgout,
LEnfance du monde, La Transparence, 2007.
40. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 107.
41. Ibid., p. 173.
42. Ibid., p. 196.
43. Ibid., p. 221 ; voir galement E. Husserl, Leons pour une
phnomnologie de la conscience intime du temps, PUF, 1996.
44. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 215.
45. E. Husserl, De la rduction phnomnologique, op. cit., p. 39.
46. N. Depraz, Lire Husserl en phnomnologue, op. cit., p. 65.
47. E. Fink, Sixime Mditation cartsienne, op. cit., p. 101.
48. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., p. 99,
31.
49. E. Levinas, En dcouvrant lexistence avec Husserl et Heidegger, Vrin,
2001, p. 54.
50. E. Fink, Sixime Mditation cartsienne, op. cit., p. 99.
51. J.-L. Marion, Rduction et Donation, PUF, 1989.
52. E. Fink, Sixime Mditation cartsienne, op. cit., p. 85.
53. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., p. 108,
33 ; N. Depraz, Lire Husserl en phnomnologue, op. cit., p. 68.
54. Selon Claude Romano, commentant un passage de Fink, lpoch nest pas
une dlimitation de la conscience, mais une d-limitation, voire une
illimitation, abolissant les limites entre la conscience et ses objets. C.
Romano, Au cur de la raison, la phnomnologie, Gallimard, 2010, p. 522.
55. E. Husserl, De la rduction phnomnologique, op. cit., p. 49.
56. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 156.
57. Ibid.
58. Voir chapitre I.
59. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., p. 166,
50 : Nous navons proprement rien perdu, mais gagn la totalit de ltre
absolu .
60. Voir C. Romano pour un travail convergent de clarification de la
diffrence entre poch et rduction, par-del une certaine indiffrenciation
dans les textes de la premire tradition phnomnologique. C. Romano, Au
cur de la raison, la phnomnologie, op. cit., p. 513. Voir aussi et surtout la
dfense dune poch radicale contre la rduction husserlienne limite chez J.
Patoka, Papiers phnomnologiques, Jrme Millon, 1995, p. 163 et suiv.
61. E. Husserl, Philosophie premire, t. I, P.U.F, 1970, p. 194.
62. E. Husserl, Recherches logiques. Tome I : Prolgomnes la logique
pure, PUF, 1990.
63. E. Husserl, Mditations cartsiennes, Vrin, 1992, p. 46, 8.
64. I. Kant, Critique de la raison pure, Flammarion, 2001, p. 110, A11, note.
65. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 106-109.
66. E. Husserl, Mditations cartsiennes, op. cit., p. 47, 8.
67. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., p. 242,
76.
68. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 107.
69. M. Heidegger, Les Principes fondamentaux de la phnomnologie,
Gallimard, 1984, p. 39.
70. Ibid., p. 40.
71. V. Janklvitch, Philosophie premire. Introduction une philosophie
du presque , PUF, 1954, p. 154.
72. Voir chapitre XIII pour plus de dtails.
73. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 171.
74. Ibid., p. 107.
75. Ibid., p. 172.
76. M. Bitbol, Le corps matriel et lobjet de la physique quantique , in F.
Monnoyeur (d.), Quest-ce que la matire ?, Livre de Poche, 2000 ; M.
Bitbol, Mcanique quantique : une introduction philosophique, Flammarion,
1996.
77. E. Husserl, Philosophie premire, t. II, op. cit., p. 170.
78. M. Bitbol, Lexprience dobjectiver , in N. Depraz (d.), Premire,
deuxime, troisime personne, paratre en 2014.
79. E. Fink, Sixime Mditation cartsienne, op. cit., p. 86.
80. Ibid.
81. W.V. Quine, The Roots of Reference, Open Court, 1974.
82. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, 1993, p. 30-31.
83. M. Heidegger, tre et Temps, op. cit., p. 187, 156.
84. M. Heidegger, Quest-ce que la mtaphysique ?, op. cit., p. 52.
85. R. Carnap, Le dpassement de la mtaphysique par lanalyse logique du
langage , in A. Soulez (d.), Manifeste du Cercle de Vienne et autres crits ,
PUF, 1985.
86. M. Merleau-Ponty, Le Visible et lInvisible, op. cit., p. 95.
87. N. Depraz, Lire Husserl en phnomnologue, op. cit., p. 91.
88. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., p. 201,
61.
89. N. Depraz, F. Varela & P. Vermersch, lpreuve de lexprience, Zeta
Books, 2011, p. 48.
90. Ibid., p. 73.
91. Ibid., p. 67.
92. Ibid., p. 71.
93. E. Fink, Sixime Mditation cartsienne, op. cit., p. 83.
94. Jai pu voir cela grce la traduction italienne de M. Ritte et F. Bertossa.
Les commentaires oraux de Quest-ce que la mtaphysique ? par F. Bertossa,
ses exercices de mise lpreuve exprientielle des commentaires, ont t une
source dinspiration pour ce passage sur Heidegger. Voir M. Ritte, La
Filosofia di Martin Heidegger , www.asia.it/adon.pl?act=doc& doc=1168.
95. Lettre de Heidegger Jean Beaufret du 23 novembre 1945.
96. M. Heidegger, Quest-ce que la mtaphysique ?, op. cit., p. 43-44.
97. Ibid., p. 50.
98. La traduction est en partie inspire de celle, italienne, de M. Ritte et
F. Bertossa, et en partie de celle, franaise, dHenry Corbin : M. Heidegger,
Quest-ce que la mtaphysique ?, op. cit., p. 60.
99. F. Roustang, Le Secret de Socrate pour changer la vie, Odile Jacob,
2009.
100. E. Husserl, lettre Hofmannsthal du 12 janvier 1907, cite par C.
Romano, Le Chant de la vie : phnomnologie de Faulkner, Gallimard,
2005, p. 39.
101. J.-P. Sartre, La Transcendance de lego, Vrin, 1965, p. 83-84.
Laccident transcendantal dont il est question est arriv au personnage sartrien
de Roquentin : J.-P. Sartre, La Nause, Gallimard, 1972.
102. J.-P. Sartre, La Transcendance de lego, op. cit., p. 19.
103. Ibid., p. 26.
104. Ibid., p. 74.
105. E. Levinas, En dcouvrant lexistence avec Husserl et Heidegger,
op. cit., p. 54-55.
106. E . Husserl, La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, op. cit., p. 156.
107. J.D. Caputo, The Mystical Element in Heideggers Thought , Fordham
University Press, 1986 ; B. Dalle Pezze, Martin Heidegger and Meister
Eckhart : A Path Towards Gelassenheit , Edwin Mellen, 2009 ; E. Cattin,
Srnit : Eckhart, Schelling, Heidegger, Vrin, 2012.
108. Le numineux peut tre dfini comme un rapport impressionnant et
charg daffectivit au sacr. R. Otto, Le Sacr, Payot, 1995.
109. D. Janicaud, Le Tournant thologique de la phnomnologie franaise,
Lclat, 1991.
110. A.B. Newberg, Principles of Neurotheology, Ashgate, 2010.
111. A. Zajonc, La Mditation, une recherche contemplative, Triades, 2012.
112. C. Romano, Le Chant de la vie : phnomnologie de Faulkner, op. cit.,
p. 41.
113. Une exception pourrait tre Jan Patoka, qui insiste pour aller jusquau
bout de lpoch sans sarrter un champ dimmanence, contrairement ce
que demande la procdure de la rduction transcendantale. J. Patoka,
Papiers phnomnologiques, op. cit., p. 195.
114. C. Andr, Mditer jour aprs jour, Iconoclaste, 2011 ; M. Ricard, LArt
de la mditation, Pocket, 2010.
115. Milarepa, uvres compltes, Fayard, 2006.
116. L. de La Valle Poussin, LAbhidharmakoa de Vasubandhu , Paul
Geuthner, 1931 ; S. Anacker, Seven Works of Vasubandhu , Motilas
Banarsidass, 1998 ; C.A.F. Rhys Davids, Buddhist Manual of Psychological
Ethics : First Book of the Abhidhamma-Pitaka, Entitled Dhamma-Sangani
(Compendium of States or Phenomena), Kessinger Publishing, 2003. Voir
galement : F. Varela, E. Thomson & E. Rosch, LInscription corporelle de
lEsprit, Seuil, 1991 ; D.K. Nauriyal, M. Drummond & Y.B. Lal (d.),
Buddhist Thought and Applied Psychological Research, Routledge, 2006.
117. Ngrjuna, Stances du milieu par excellence, Gallimard, 2002, p. 306.
118. J. Varenne, Upanishads du Yoga, Gallimard, 1971.
119. D.T. Suzuki, Essais sur le bouddhisme Zen, I, Albin Michel, 1972,
p. 315. Selon le Lankvatra Stra, texte de rfrence du Zen, les mots ne
peuvent recrer la vrit [] [Par consquent,] conformez-vous au sens
profond et ne vous laissez pas captiver par les mots et les doctrines . Ibid.,
p. 110.
120. Voir N. Depraz, F. Varela & P. Vermersch, lpreuve de lexprience,
op. cit., pour un travail beaucoup plus abouti dans cette direction.
121. Ph. Cornu, Le Bouddhisme, une philosophie du bonheur ?, Seuil, 2013.
122. A. Lutz, J. Dunne & R.J. Davidson, Meditation and the neuroscience of
consciousness : An introduction , in P.D. Zelazo, M. Moscovitch & E.
Thompson (d.), The Cambridge Handbook of Consciousness, op. cit.
123. M. Ricard, LArt de la mditation, op. cit. ; M. Ricard, Plaidoyer pour
laltruisme, NiL Editions, 2013.
124. T. Singer & M. Bolz (d.). Compassion: Bridging Practice and Science,
www.compassion-training.org, 2013.
125. F. Varela, Quel savoir pour lthique ?, op. cit. Cette mise en uvre
dune thique non prescriptive fait dire Nietzsche que le bouddhisme se
situe outre le bien et le mal . Voir un commentaire clairant dans R.-P.
Droit, Le Culte du nant, op. cit., p. 207-208.
126. Dgen, Zazengi, in Dgen, Shbgenz, 6, Sully, 2012, prsentation et
traduction de Yoko Orimo.
127. Anpnasati sutta, cit par H. Clerc, Les Choses comme elles sont,
Gallimard, 2011, p. 173.
128. F. Tola & C. Dragonetti, The Yogastra of Patajali , I, 34, Motilal
Banarsidass, 1987, p. 126.
129. N. Depraz, Comprendre la phnomnologie : une pratique concrte,
Armand Colin, 2006, p. 156 ; N. Depraz, F. Varela & P. Vermersch,
lpreuve de lexprience, op. cit., p. 87.
130. Madame Guyon, Le Moyen court et autres rcits, Jrme Millon, 1995,
p. 75.
131. Tsongkhapa, The Great Treatise on the Stages of the Path to
Enlightenment, Snow Lion, 2002.
132. A. Lutz, J. Dunne & R.J. Davidson, Meditation and the neuroscience of
consciousness : An introduction , loc. cit.
133. Thrse dAvila, Le Chteau de lme, Seuil, 1997, p. 94.
134. Madame Guyon, Le Moyen court et autres rcits, op. cit., p. 80.
135. Ibid., p. 74.
136. L. Silburn, Aux sources du bouddhisme, Fayard, 1997, p. 53.
137. Egalement appels ravissements , ou samaptti . Ibid., p. 54.
138. Ibid., p. 55.
139. Thrse dAvila, Le Chteau de lme, op. cit., p. 242.
140. Madame Guyon, Le Moyen court et autres rcits, op. cit., p. 71. Lors
donc que lme sest exerce, [] loraison lui devient aise, douce et
agrable .
141. N. Depraz, F. Varela & P. Vermersch, lpreuve de lexprience,
op. cit., p. 56.
142. F. Tola & C. Dragonetti, The Yogastra of Patajali, I, 2, op. cit., p. 3.
143. D. Steindl-Rast, Deeper Than Words, Doubleday, 2010.
144. Madame Guyon, Le Moyen court et autres rcits, op. cit., p. 89.
145. Y. Jacobson, La Pense hassidique, Cerf, 1989, p. 76.
146. Ibid., p. 81.
147. The Cloud of Unknowing, Penguin, 1987, p. 66.
148. Ibid., p. 143.
149. Pseudo-Denys lAropagite, Les Noms divins, i n Pseudo-Denys
lAropagite, LExprience de Dieu, Fides, 2001, p. 67, chapitre V.
150. Pseudo-Denys lAropagite, Les Noms divins, op. cit., p. 68, chapitre V.
151. Matre Eckhart, Du miracle de lme, Calmann-Lvy, 1996, p. 82, 92.
Voir galement E. Cattin, Srnit : Eckhart, Schelling, Heidegger, op. cit. ;
C. Poggi, Les uvres de vie selon Matre Eckhart et Abhinavagupta, Les
Deux Ocans, 2000.
152. M. Merleau-Ponty, Phnomnologie de la perception, Gallimard, 1945,
p. 249-250 ; voir galement C. Romano, Le Chant de la vie, op. cit., p. 43.
153. Matre Eckhart, Du miracle de lme, op. cit., p. 84.
154. Ibid., p. 90.
155. Nanamoli Bhikkhu, The Middle Length Discourses of the Buddha,
Wisdom Publications, 1995. Le nom Bouddha kyamuni est lun de ceux
qui ont t donns par la tradition Siddhrta Gautama, n Lumbni au sud
de lactuel Npal, vers le sixime sicle avant notre re. Il signifie
littralement : lveill, sage de (la tribu) des kya . Les kya taient
une tribu appartenant la caste des katrya (guerriers), dont le royaume avait
pour capitale Kapilavastu (galement dans lactuel Npal, peu de distance
de Lumbni).
156. Chndogya Upaniad, 7, 6 et 7, 1, cit, comment et traduit par R.
Calasso dans LArdore, op. cit., p. 164. Notons que, dans une traduction
ancienne de cette Upanishad propose par Max Mller, citta tait rendu par
considration , dhyna par rflexion , et vijna par entendement .
157. Anpnasati sutta, cit par H. Clerc, Les Choses comme elles sont,
op. cit., p. 174.
158. N. Depraz, F. Varela & P. Vermersch, lpreuve de lexprience,
op. cit., p. 307.
159. Cit par H. Clerc, Les Choses comme elles sont, op. cit., p. 85.
160. Comme le signalait dj Schopenhauer, le point au-del de toute
connaissance des bouddhistes est un tat o sujet et objet cessent dtre .
R.-P. Droit, Le Culte du nant, op. cit., p. 147.
161. B.A. Wallace, The Taboo of Subjectivity, Oxford University Press,
2000, p. 96.
162. A. Lutz, J. Dunne & R.J. Davidson, Meditation and the neuroscience of
consciousness : An introduction , loc. cit.
163. Z.V. Segal, J.M.G. Williams & J. Kabat-Zinn, Mindfulness Based
Cognitive Therapy for Depression, deuxime dition augmente, Guilford
Press, 2012 ; C. Andr, La mditation de pleine conscience , Cerveau et
Psycho, 41, 2010, p. 18-24.
164. L. Binswanger, Mlancolie et Manie, PUF, 2002.
165. F. Roustang, La Fin de la plainte, Odile Jacob, 2000, p. 15.
166. Abhidharma est compris comme voulant dire tantt propos du
dharma (cest--dire propos de lenseignement du Bouddha, ou propos
de la loi bouddhique), tantt dharma suprieur (cest--dire
enseignement suprieur). Le mot dharma lui-mme, issu de la racine Dhar
qui signifie porter, soutenir, possder , a plusieurs sens avrs. Lun est
loi, devoir, enseignement , et lautre lment, chose, proprit .
167. Les textes fondateurs de lAbhidharma sont dats approximativement du
troisime sicle avant notre re ; soit environ deux sicles aprs lpoque du
Bouddha kyamuni. E. Lamotte, Histoire du bouddhisme indien, t. I,
Publications Universitaires de Louvain, 1958.
168. T. Stcherbatsky, Buddhist Logic, I, Motilal Banarsidass, 1993, p. 79 et
suiv.
169. N. Ronkin, Abhidharma , in The Stanford Encyclopedia of
Philosophy, Edward N. Zalta (d.), 2013,
http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/abhidharma.
170. Ibid. ; T. Stcherbatsky, The Central Conception of Buddhism, Sri
Satguru Publications, 1991, p. 6.
171. Ibid., p. 63.
172. Les six facults incluent non seulement nos cinq sens, mais aussi le
sixime sens mental.
173. T. Stcherbatsky, The Central Conception of Buddhism, op. cit., p. 9.
174. Bikkhu Bodhi (d.), A Comprehensive Manual of Abhidhamma, dition
commente de lAbhidhammattha Sangaha dAcariya Anuruddha, Pariyatti
Publishing, 2000.
175. H. Barendregt, The Abhidhamma model of consciousness AM
o
and
some of its consequences , in M.G.T. Kwee, K.J. Gergen & F. Koshikawa,
Horizons in Buddhist Psychology, Taos Institute Publications, 2006.
176. Ibid.
177. Ibid.
178. Cest peut-tre ainsi quon peut le mieux comprendre la rfrence de
lAbhidharma un tat inconditionn identifi au Nirva, par-del les tats
mutuellement conditionns, surgissant en dpendance, qui correspondent aux
lments dexprience ordinaire.
179. C. Andr, Mditer, jour aprs jour, op. cit., p. 22 ; E. Tolle, Le Pouvoir
du moment prsent, Ariane, 2000.
180. Madame Guyon, Le Moyen court et autres rcits, op. cit., p. 75.
181. Ngrjuna, Stances du milieu par excellence, op. cit.
182. Il sagit dune application du clbre ttralemme ngrjunien.
183. La vibration (spanda, en sanskrit) est un concept typique du shivasme du
Cachemire. Voir L. Bansat-Boudon, An Introduction to Tantric Philosophy :
The Paramrthasra of Abhinavagupta With the commentary of Yogarja,
op. cit., p. 40.
184. C. Romano, Le Chant de la vie : phnomnologie de Faulkner, op. cit.,
p. 194.
185. J.-P. Sartre, La Nause, op. cit., p. 139.
186. Ibid., p. 140-142.
187. Ibid., p. 179-181.
188. Ibid., p. 222.
189. Ibid., p. 144.
190. Ibid., p. 179.
191. Ibid., p. 182.
192. Ibid., p. 179.
193. Ce que le Bouddha historique a effectivement fait en sloignant de
larbre sous lequel il avait atteint lveil pour dlivrer son premier sermon,
son premier tour de la roue du dharma , au parc des gazelles prs de
Bnars.
194. A.A. Macdonell, A Sanskrit Grammar for Students, Oxford University
Press, 1926, p. 171.
195. Une excellente analyse de lex-sister comme ignorance fondamentale (a-
vidy), et de sa dcouverte au fondement du bouddhisme, peut tre lue dans P.
Basile, Figli del nulla, Albo Versorio, 2004, p. 135 et suiv.
196. P. Fenner, Le Fil de la certitude, Le Reli, 2001, p. 14.
197. Linji (matre Chan du IX
e
sicle), cit par P. Fenner, Le Fil de la
certitude, op. cit., p. 124.
198. Longchenpa (penseur tibtain Nyingma du XIV
e
sicle), cit par P. Fenner,
Le Fil de la certitude, op. cit., p. 124-125.
199. Longchenpa, La Libert naturelle de lesprit, Seuil, 1994, p. 219.
200. En particulier celles du Dzogchen et du Mahamudra. Voir Longchenpa,
La Libert naturelle de lesprit, op. cit., et lexcellente introduction de
Philippe Cornu.
201. Respectivement Rigpa et Selwa. Voir A. Lutz, J. Dunne & R.J. Davidson,
Meditation and the neuroscience of consciousness : An introduction ,
loc. cit.
202. Ibid.
203. Dudjom Lingpa, Buddhahood Without Meditation, Padma Publishing,
1994, p. 91.
Notes
1. R. Ohashi (d.), Die Philosophie der Kyoto-Schule, Alber, 1990. propos
de lauto-rfrentialit des questions sur/dans la conscience, voir F. Bertossa,
R. Ferrari & M. Besa, Matrici senza uscita. Circolarit della conoscenza
oggettiva e prospettiva buddhista , in M. Cappuccio (d.), Dentro la
Matrice, scienza e filosofia di The Matrix, Alboversorio, 2004.
2. R. Smullyan, This Book Needs No Title, Touchstone, 1986.
3. D. Hofstadter, I Am A Strange Loop, Basic Books, 2007, p. 102. La boucle
trange est ici dfinie comme une squence ou hirarchie de niveaux logiques
croissants, qui se reconnecte pourtant en retour au niveau lmentaire pris
comme point de dpart.
4. C.T. Tart, States of Consciousness and State-Specific Sciences ,
Science, 176, 1972, p. 1203-1210.
5. S. Allix & P. Bernstein, Manuel clinique des expriences extraordinaires,
Interditions, 2009, p. 14 ; R. Cant, S. Cooper, C. Chung & M. OConnor,
The divided self : Near death experiences of resuscitated patients. A review
of literature , International Emergency Nursing, 20, 2012, p. 88-93 ; P. Van
Lommel, R. Van Wees, V. Meyers & I. Elfferich, Near-death experience in
survivors of cardiac arrest : A prospective study in the Netherlands , The
Lancet, 358, n
o
9298, 2001, p. 2039-2045. Voir galement chapitre XIV pour
une rflexion phnomnologique sur les expriences de mort imminente.
6. L.J. Griffiths, Near-death experiences and psychotherapy , Psychiatry,
6, 2009, p. 35-42 ; B. Greyson, The near-death experience as a focus of
clinical attention , Journal of Nervous and Mental Disease, 185, 1997,
p. 327-334 ; F. Machovec, Near-death experiences : Psychotherapic
aspects , Psychotherapy in Private Practice, 13, 1994, p. 99-105.
7. J.T. Taylor, My Stroke of Insight, Plume, 2009 (traduction franaise :
Voyage au-del de mon cerveau, Jai Lu, 2009).
8. B. Shanon, The Antipodes of the Mind, Oxford University Press, 2002.
9. Ibid., p. 40.
10. Ibid., p. 7.
11. Ibid., p. 167.
12. Ibid., p. 395.
13. Ibid., p. 400.
14. R.R. Griffiths,W.A. Richards, M.W. Johnson, U.D. McCann & R. Jesse,
Mystical-type experiences occasioned by psilocybin mediate the attribution
of personal meaning and spiritual significance 14 months later , Journal of
Psychopharmacology, 22, 2008, p. 621-632.
15. I.M. Maisonneuve & S.D. Glick, Anti-addictive actions of an Iboga
alcaloid congener : A novel mechanism for a novel treatment ,
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 2003, p. 607-618.
16. S. Blackmore, Consciousness, an Introduction, Hodder, 2003 ; S.
Blackmore, Near-death experiences : In or out of the body ? , Skeptical
Inquirer, 16, 1991, p. 34-45.
17. C.D. Murray, Psychological Scientific Perpectives on Out of the Body
and Near Death Experiences, Nova Science Publishers, 2009.
18. D.J. Wilde & C.D. Murray, Interpreting the anomalous : Finding meaning
in out-of-body and near-death experiences , Qualitative Research in
Psychology, 7, 2010, p. 57-72 ; D.J. Wilde, Finding meaning in out-of-body
experiences : An interpretative phenomenological analysis, thse de
luniversit de Manchester, 2012.
19. G. Ryle, The Concept of Mind, Barnes & Noble, 1949. Ryle qualifie
derreur catgoriale une confusion entre deux classes ontologiques distinctes,
par exemple les proprits actuelles et potentielles, les choses et les
processus, les btiments et les institutions quils abritent. Selon lui, le
dualisme des substances repose sur ce genre derreur : lesprit est pris pour
une chose (res cogitans) alors quil nest quune dnomination collective pour
dsigner un systme de dispositions se comporter de telle ou telle faon
dans diverses circonstances.
20. C.T. Tart, States of consciousness and state-specific sciences , loc. cit.
21. M. Winckler, Le Chur des femmes, Gallimard, 2011. Ce roman montre
avec lgance comment les processus dauto-gurison narrative des patientes
dune jeune gyncologue frachement moulue dun C.H.U. prestigieux sont
systmatiquement contrecarrs par les discours normatifs et naturalistes de
cette dernire.
22. Hraclite, Fragment B2, in J.P. Dumont (d.), Les Prsocratiques,
Gallimard, 1988, p. 146.
23. M. Foucault, Histoire de la folie lge classique, Gallimard, 1976.
24. F. Nietzsche, La Naissance de la tragdie, Livre de Poche, 1994.
25. R. Klibansky, E. Panofsky & F. Saxl, Saturne et la Mlancolie,
Gallimard, 1989 ; A. Bitbol-Hespris, Descartes face la mlancolie de la
Princesse Elisabeth , in B. Melkevik et J.-M. Narbonne (d.), Une
philosophie dans lhistoire, hommages Raymond Klibansky, Presses de
lUniversit de Laval, 2000 ; rasme, loge de la folie, Flammarion, 1999.
26. M. Mitchell, P.T. Hraber & J.P. Crutchfield, Revisiting the edge of
chaos : Evolving cellular automata to perform computations , Complex
Systems, 7, 1993, p. 89-130 ; G. Longo & G. Montevil, The inert versus the
living state of matter : Extended criticality, time geometry, anti-entropy : An
overview , Frontiers in Physiology, 3, 2012, p. 39.
27. R. Descartes, Mditations mtaphysiques, Livre de Poche, 1990, p. 29.
28. R. Descartes, secondes rponses, in C. Adam & P. Tannery (d.), uvres
de Descartes, IX, Vrin, 1964-1974, p. 103.
29. R. Descartes, Mditations mtaphysiques, op. cit., p. 33.
30. J. Derrida, Lcriture et la Diffrence , op. cit., p. 86-87 ; J.-M.
Beyssade, Descartes au fil de lordre, PUF, 2001, p. 36.
31. J.-M. Beyssade, Descartes au fil de lordre, op. cit., p. 27.
32. R. Descartes, Mditations mtaphysiques, op. cit., p. 42.
33. Ibid., p. 46.
34. E. Husserl, Philosophie premire, 2, op. cit., p. 79.
35. J. Searle, The Mystery of Consciousness, Granta Books, 1997, p. 112.
36. E. Husserl, Recherches logiques, V (2, 2), PUF, 1972, p. 204.
37. Une nosographie est une classification des maladies, et une tiologie est
un essai de leur attribuer une cause.
38. P.-H. Castel, LEsprit malade, op. cit.
39. J. Strauss, Concepts et ralits de la vie mentale , Psychiatrie,
sciences humaines et neurosciences, 5, 2007, p. 125-130.
40. P.-H. Castel, LEsprit malade, op. cit., p. 27.
41. Il sagit l bien sr dune allusion P. Ricur, Soi-mme comme un
autre, Seuil, 1990.
42. P.-H. Castel, LEsprit malade, op. cit., p. 152.
43. S. Preskorn, Outpatient Management of Depression, Professional
Communications, 1999, www.preskorn.com/books/omd_toc.html.
44. S. Guisinger, Adapted to flee famine : Adding an evolutionary
perspective on anorexia nervosa , Psychological Review, 110, 2003, p. 745-
761.
45. J. Proust, Vers une gense cognitive de la centralit : rflexion partir
du travail clinique dHenri Grivois , in H. Grivois & J.-P. Dupuy (d.),
Mcanismes mentaux, mcanismes sociaux : de la psychose la panique, La
Dcouverte, 1995.
46. M.D. Storms & K.D. McCaul, Attribution processes and emotional
exacerbation of dysfunctional behaviour , in J.H. Harvey, W.J. Ickes & R.F.
Kidd (d.), New Directions in Attribution Research, vol. I, Erlbaum, 1976.
47. D.J. Siegel, The Developing Mind : How Relationships and the Brain
Interact to Shape Who We Are , Guilford Press, 2012 ; D.J. Siegel,
Mindsight : The New Science of Personal Transformation, Random House,
2010.
48. B.K. Htzel, J. Carmody, M. Vangel, C. Congleton, S.M. Seramsetti, T.
Gard & S.W. Lazar, Mindfulness practice leads to regional increases in gray
matter density , Psychiatry Research, 191, 2011, p. 36-43.
Notes
1. Le rapport verbal dexprience est bien sr le candidat le plus srieux,
mais son absence ne suffit pas conclure labsence de conscience. Car il est
toujours possible que, dans un tat inerte et silencieux, quelquun vive une
exprience. Il faut alors riger le rapport verbal en critre plutt quen preuve
et le modaliser pour cela : est conscient celui qui pourra un jour,
ventuellement, faire un rapport de lexprience quil a vcue durant sa
priode dinertie et de silence ; ou plus largement (mais ce nest dj plus un
critre opratoire en raison de son ouverture sur le possible au lieu dune
actualit prsente ou future) est conscient celui qui pourrait, si les moyens
physiques ne lui manquaient pas, faire un rapport.
2. E. Cassirer, Philosophie des formes symboliques, III, op. cit., p. 32.
3. E. Cassirer, Philosophie des formes symboliques, III, op. cit., p. 66.
4. Chapitre X.
5. E. Levinas, Totalit et Infini, Livre de Poche, 2003, p. 54.
6. Giambattista Vico a avanc ds le dbut du XVIII
e
sicle un argument de ce
type contre la valorisation pistmique de largument cartsien du cogito :
selon lui, la conviction absolue que jai de mon existence dans lacte mme de
douter est de lordre de la conscience, mais pas de la science. Elle est
certitude, mais pas encore vrit. G. Vico, De la trs ancienne philosophie
des peuples italiques, T.E.R., 1987, p. 17 ; G. Vico, La Science nouvelle, I,
Gallimard, 1993, chapitre II, axiome 9.
7. S. Freud, Pour introduire le narcissisme , in S. Freud, La Vie sexuelle,
PUF, 1999, p. 81.
8. La thse est discutable parce qu gocentrisme suppose un ego constitu
alors que le nourrisson vit dans un tat de conscience ouvert pr-gotique ;
voir A. Gopnik, Le Bb philosophe, Le Pommier, 2010.
9. Voir par exemple Q. Meillassoux, Aprs la finitude, Seuil, 2006, p. 155 et
suiv. Le cinquime et dernier chapitre de ce livre est justement intitul La
Revanche de Ptolme .
10. E. Husserl, La Terre ne se meut pas, Minuit, 1989.
11. J. Himanka, Husserls argumentation for the pre-copernican view of the
earth , Review of Metaphysics, 58, 2005, p. 621-644.
12. Voir M. Bitbol, De lintrieur du monde. Pour une philosophie et une
science des relations, op. cit., p. 27 et suiv.
13. E. Mitchell, The Way of the Explorer : An Apollo Astronauts Journey
Through the Material and Mystical Worlds, G. Putnam & Sons, 1996.
14. H. Ehrsson, The experimental induction of out-of-body experience ,
Science, 317, 2007, p. 1048.
15. C. Tart, States of Consciousness and State-Specific Sciences , loc. cit.
16. P. Hut & R.N. Shepard, Turning the hard problem upside down and
sideways , Journal of Consciousness Studies, vol. 3, 1996, p. 313-329.
17. B. Van Fraassen, The Scientific Image, Oxford University Press, 1980,
conclusion.
18. Cest ce quadmet, par exemple, H. Putnam, Le Ralisme visage
humain, Seuil, 1993. Mme la considration du cas emblmatique de la
rceptivit sensible choue tablir une hypostase dextriorit, comme le
signale R. Barbaras, La Perception, Vrin, 2009, p. 97 : Le sentir nest pas
intriorisation mais sortie de soi, empitement vers la chose mme. Il ne faut
pas comprendre par l quil sapproprie une chose dj dispose distance :
il en dploie plutt la distance en la faisant apparatre [] Sentir, ce nest
pas rejoindre une chose lextrieur : une chose ne devient au contraire
extrieure quen tant quelle est sentie .
19. Anselme de Cantorbry, Proslogion, Flammarion, 1993, p. 42.
20. E. Kant, Critique de la raison pure, Flammarion, 2001, p. 530,
A592/B620.
21. J. Vuillemin, Le Dieu dAnselme et les Apparences de la raison, Aubier,
1971. Une dfense moderne, et analytique, de largument ontologique a
cependant t prsente par Alvin Plantinga. A. Plantinga, God, Freedom, and
Evil, Harper & Row, 1974. Voir galement R. Kane, The modal ontological
argument , Mind, 93, 1984, p. 336-350.
22. E. Levinas, Totalit et Infini, op. cit., p. 56.
23. Ibid.
24. Anselme de Cantorbry, Proslogion, Flammarion, 1993, p. 40.
25. A. Berthoz & J.L. Petit, Phnomnologie et Physiologie de laction,
Odile Jacob, 2006.
26. A. Pickering, The Mangle of Practice, The University of Chicago Press,
1995 ; M. Bitbol, No-pragmatisme et incommensurabilit en physique ,
Philosophia Scientiae, 8 (1), 2004, p. 203-234 ; M. Bitbol, Mcanique
quantique : une introduction philosophique, Flammarion, 1996.
27. E. Husserl, La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, op. cit., p. 61 ; voir une excellente analyse du raisonnement
husserlien dans : C. Romano, Au cur de la raison, la phnomnologie,
op. cit., p. 917.
28. M. Bitbol, De lintrieur du monde. Pour une philosophie et une science
des relations, op. cit., p. 568-569.
29. M. Ficin, Quid Sit Lumen, Allia, 2004, p. 19.
30. D. Dennett, Sweet Dreams, MIT Press, 2006, p. 6.
31. P.M. Churchland, Reduction, qualia, and the direct introspection of brain
states , The Journal of Philosophy, 82, 1985, p. 8-28 ; voir galement P.S.
Churchland, Neurophilosophy, Toward a Unified Science of the Mind-Brain ,
MIT Press, 1986.
32. I. Peschard & M. Bitbol, Heat, Temperature and Phenomenal
Concepts , in E. Wright, The Case for Qualia, MIT Press, 2008.
33. G. Bachelard, La Formation de lesprit scientifique, Vrin, 2000 ; G.
Bachel ard, tude sur lvolution dun problme de physique. La
propagation thermique dans les solides, Vrin, 1928 ; H. Chang, Inventing
Temperature, Oxford University Press, 2007.
34. Un concept macroscopique objectif comme celui de chaleur ne peut pas
tre dit strictement rduit un seul concept objectif microscopique. En
vrit, plusieurs concepts microscopiques sont traductibles en termes du
mme concept macroscopique. Ce dernier est ralisable sur plusieurs bases
macroscopiques ; il survient sur elles.
35. J.R. Searle, How to study consciousness scientifically , in S.R.
Hameroff (d.), Towards a Science of Consciousness, II, MIT Press, 1998.
36. H.D. Lu & A.W. Roe, Functional organization of color domains in V1
and V2 of macaque monkey revealed by optical imaging , Cerebral Cortex,
18, 2008, p. 516-533.
37. K. Seymour, C.W.G. Clifford, N.K. Logothetis & A. Bartels, The coding
of color, motion, and their conjunction in the human visual cortex , Current
Biology, 19, 2009, p. 177-183 ; H. Tanigawa, H.D. Lu & A.W. Roe,
Functional organization for color and orientation in macaque V4 , Nature
Neuroscience, 13, 2010, p. 1542-1548.
38. F. Varela, E. Thompson & E. Rosch, The Embodied Mind : Cognitive
Science and Human Experience, MIT Press, 1991 (dition franaise :
LInscription corporelle de lEsprit , Seuil, 1991) ; J. Cohen, Color and
perceptual variation revisited : Unknown facts, alien modalities, and perfect
psychosemantics , Dialectica, 60, 2006, p. 307-319 ; P.M. Churchland, On
the objective reality of colors , i n J. Cohen & M. Matthen (d.), Color
Ontology and Color Science, MIT Press, 2007.
39. D. Armstrong, reformul par J. Kim, Philosophy of Mind, Westview,
2006, p.120.
40. J.F. Kihlstrom, The Cognitive Unconscious , Science, 237, 1987,
p. 1445-1452.
41. M. Overgaard & T. Grnbaum, Cognitive and non-cognitive conceptions
of consciousness , Trends in Cognitive Sciences, 16, 2012, p. 137-138. Ces
auteurs remarquent que les discussions des sciences cognitives sur la
conscience sont conditionnes par une dcision pralable : celle de dfinir la
conscience comme une fonction cognitive ou comme quelque chose qui
excde et prcde la cognition.
42. N. Block, On a confusion about the function of consciousness ,
Behavioral and Brain Sciences, 18, 1995, p. 227-247.
43. N. Humphrey, Soul Dust, the Magic of Consciousness, Princeton
University Press, 2011.
44. R.A. Brooks, Robot : The Future of Flesh and Machines, Penguin, 2002 ;
R. Arrabales, Establishing a roadmap and metrics for conscious machines
development , Proceedings of the 8th IEEE International Conference on
Cognitive Informatics, 2009 ; I.L. Aleksander, Machine consciousness ,
in M. Velmans & S. Schneider (d.), The Blackwell Companion to
Consciousness, Blackwell, 2007 ; V. Tagliasco, Artificial consciousness :
A technological disciplin , in A. Chella & R. Manzotti (d.), Artificial
Consciousness, Imprint Academic, 2007.
45. Voir le chapitre X pour une discussion de laccessibilit dune conscience
robotique dans le cadre de la thorie de linformation intgre de Giulio
Tononi.
46. A.M. Turing, Computing machinery and intelligence , Mind, 59, 1950,
p. 433-460. Le test de Turing consiste en un jeu dimitation , dans lequel
des tres humains sont mis au dfi de reconnatre, parmi deux jeux de
rponses verbales (et/ou comportementales) leurs sollicitations, lequel est
produit par un robot et lequel par un autre tre humain. Le test de Turing est
russi par la machine si la distinction est impossible. Voir galement D.
Abramson, Turings responses to two objections , Minds and Machines,
18, 2008, p. 147-167.
Notes
1. B.F. Skinner, The Behavior of Organisms, Prentice Hall, 1938 ; G. Zuriff,
Behaviorism : A Conceptual Reconstruction, Columbia University Press,
1985.
2. H. Feigl, The Mental and the Physical, University of Minnesota Press,
1958 ; C.V. Borst, The Mind/Brain Identity Theory, MacMillan, 1970 ; voir
galement J.-P. Changeux, LHomme neuronal , Fayard/Pluriel, 1984, p. 174,
334.
3. P. Churchland, Neurophilosophy : Toward a Unified Science of the Mind-
Brain, MIT Press, 1989.
4. J.A. Fodor, Psychological Explanation, Random House, 1968 ; H. Putnam,
Mind, Language, and Reality, Cambridge University Press, 1975 ; J.A.
Fodor, The Mind Doesnt Work That Way, MIT Press, 2000.
5. Larchtype du dualisme des substances a t soutenu par Descartes. Voir
galement H. Robinson, Dualism , in E.N. Zalta (d.), The Stanford
Encyclopedia of Philosophy,
http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/dualism/ ; P. Gillot, La
question de lintriorit mentale lge classique : le thtre cartsien ,
Revue de synthse, 131, 2010, p. 7-20.
6. D. Chalmers, The Conscious Mind, Oxford University Press, 1996.
7. A. Freeman (d.), Consciousness and its Place in Nature, Imprint
Academic, 2007.
8. G. Nixon, From panexperientialism to conscious experience : The
continuum of experience , Journal of Consciousness Exploration &
Research, 1, 2010, p. 213-215.
9. M. Bitbol, Physique et Philosophie de lesprit, op. cit., p. 150 et suiv.
10. M. Heidegger, tre et Temps, op. cit., 1985, p. 132.
11. A. Damasio, Spinoza avait raison, Odile Jacob, 2003.
12. B. Spinoza, thique, I, PUF, 1993, p. 59, dfinition VI.
13. B. Spinoza, thique, II, op. cit., p. 103, proposition 1 ; M. Rovere, La
tentation du paralllisme, un fantasme gomtrique dans la tradition du
spinozisme , in C. Jaquet, P. Svrac & A. Suhamy, La Thorie spinoziste
des rapports corps/esprit, Hermann, 2009.
14. B. Spinoza, thique, II, op. cit., p. 113, proposition 13.
15. B. Spinoza, thique, III, op. cit., p. 158, proposition 2.
16. C. Jaquet, Le Spinoza protobiologiste de Damasio , in C. Jaquet, P.
Svrac & A. Suhamy, La Thorie spinoziste des rapports corps/esprit,
op. cit. ; voir galement R. Misrahi, Le Corps et lEsprit dans la philosophie
de Spinoza, Les Empcheurs de penser en rond, 2003.
17. Ainsi, lorsque Fichte doit dfinir lidalisme et le ralisme, il ny parvient
quen tablissant des distinctions dans lenclos des activits mentales :
lidaliste, crit-il, privilgie le fait de la rflexion, tandis que le raliste se
focalise sur le contenu des propositions. J.G. Fichte, La Thorie de la
science, expos de 1804, Aubier, 1967, p. 152.
18. G. Berkeley, uvres choisies, I, dition bilingue, Aubier-Montaigne,
1961, p. 208.
19. Il faut bien remarquer quon ne peut pas conclure que les esprits voient
lessence de Dieu []. Ce quils voient en Dieu est trs imparfait, et Dieu est
trs parfait. Ils voient de la matire divisible, figure, etc., et en Dieu il ny a
rien qui soit divisible ou figur : car Dieu est tout tre, car il est infini et quil
comprend tout . N. Malebranche, De la recherche de la vrit, livre III, in
uvres, I, Gallimard, 1979, p. 339, II
e
partie, chapitre VI.
20. Ibid., p. 343.
21. Dautres varits didalisme culturellement prgnantes sont attestes
dans lInde non bouddhique. Voir F. Chenet, Psychogense et cosmogonie
selon le Yoga Vsis t ha : le monde est dans lme, Institut de Civilisation
Indienne, 2000 ; M. Hulin, Comment la philosophie indienne sest-elle
dveloppe ?, Panama, 2008. galement L. Bansat-Boudon, An Introduction
to Tantric Philosophy : The Paramrthasra of Abhinavagupta with the
commentary of Yogarja, op. cit. : ce monde [] nest pas diffrent de la
conscience la plus pure .
22. Shiksnanda, Sotra de lentre Lank, Fayard, 2006, chapitre II.
23. S. Arguillre, La coproduction conditionne selon le bouddhisme indien
tardif et au Tibet , Les Cahiers bouddhiques, 2, 2005, p. 75-113 ; S.
Arguillre, Lauto-production de lesprit I , in Papiers du Collge
International de Philosophie, n
o
40, 1997, p. 17-70 ; J.-M. Vivenza, Tout est
concience : une voie dveil bouddhiste, Albin Michel, 2010.
24. A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie , PUF,
1968, p. 439 ; voir galement G.F.W. Hegel, La diffrence entre les systmes
philosophiques de Fichte et de Schelling, Vrin, 1986, p. 143.
25. J.G. Fichte, uvres choisies de philosophie premire. Doctrine de la
science (1794-1797), Vrin, 1990, p. 40.
26. E. Cassirer, Les Systmes postkantiens. Le Problme de la connaissance
dans la philosophie et la science des temps modernes, t. 3, Presses
Universitaires de Lille, 1983, p. 111.
27. E. Cassirer, Les Systmes postkantiens, t. 3, op. cit., p. 282.
28. G.F.W. Hegel, Encyclopdie des sciences philosophiques, III, Vrin, 1992,
575.
29. S. Arguillre, Lauto-production de lesprit II , Papiers du Collge
International de Philosophie, n
o
46, 1998, p. 15-65.
30. R. Menary (d.), The Extended Mind, MIT Press, 2010.
31. S. Arguillre, Lauto-production de lesprit I , loc. cit.
32. J. Rivelaygue, Leons de mtaphysique allemande, I, Grasset, 1990,
p. 161.
33. J.G. Fichte, uvres choisies de philosophie premire, op. cit., p. 28.
34. I. Thomas-Fogiel, Fichte, Vrin, 2004, p. 182.
35. J.G. Fichte, La Doctrine de la science nova methodo, Lge dhomme,
1989, p. 70.
36. J.G. Fichte, La Thorie de la science, expos de 1804, op. cit., p. 115.
37. Ibid., p. 125.
38. Ibid., p. 23.
39. Ibid., p. 158.
40. G.W.F. Hegel, La Phnomnologie de lesprit, Aubier, 1966, p. 100-
105 ; J. Hyppolite, Gense et Structure de la phnomnologie de lesprit de
Hegel, Aubier, 1946, p. 117.
41. J.G. Fichte, La Thorie de la science, expos de 1804, op. cit., p. 30.
42. G.F.W. Hegel, Leons sur lhistoire de la philosophie. Tome VI La
philosophie moderne, Vrin, 1985, p. 1455.
43. Ibid., p. 1456.
44. G.F.W. Hegel, Science de la logique, I, Aubier-Montaigne, 1976, p. 19.
45. G.F.W. Hegel, Leons sur lhistoire de la philosophie. Tome VI La
philosophie moderne, op. cit., p. 1456.
46. Ibid., p. 1497-1498.
47. Ibid., p. 1468.
48. Ibid., p. 1471.
49. W. James, Essays in Radical Empiricism, Harvard University Press,
1976, p. 106.
50. Ibid., p. 111.
51. Ibid., p. 114.
52. B. Russell, The Analysis of Mind, Allen & Unwin, 1971, p. 25.
53. R. Barbaras, Introduction une phnomnologie de la vie, Vrin, 2008.
54. W. James, Essays in Radical Empiricism, op. cit., p. 117.
Notes
1. E. Husserl, Exprience et Jugement, PUF, 1970, p. 72.
2. Ibid., p. 74.
3. G. Bachelard, La communication de Cracovie , 1934, in D. Gil,
Bachelard et la Culture scientifique, PUF, 1993, p .7.
4. Ibid., p. 9.
5. P. Descola, Par-del nature et culture, Gallimard, 2005, p. 55.
6. M. Leenhardt, Do Kamo, Gallimard, 1947.
7. P. Descola, Par-del nature et culture, op. cit., p. 211, 231.
8. B. Snell, The Discovery of the Mind in Greek Philosophy and Literature,
Dover, 1982 ; J. Jaynes, The Origins of Consciousness in the Breakdown of
the Bicameral Mind, Houghton Mifflin, 1976.
9. P. Descola, Par-del nature et culture, op. cit., p. 45.
10. V. Janklvitch, La Mauvaise Conscience, Flix Alcan, 1939, p. 14-15.
11. E. Levinas, Totalit et Infini, op. cit., p. 65.
12. Ibid.
13. Maintenant je vois [ce canard-lapin] comme une image de lapin : L.
Wittgenstein, Philosophical Investigations, II, XI, op. cit., p. 194 ; J. Benoist,
Intuition catgoriale et voir comme , Revue Philosophique de Louvain, 99,
2001, p. 593-612.
14. D. Dennett, Consciousness Explained, Penguin, 1991, p. 366.
15. Voir chapitre XI.
16. Dans une tude sur les commentaires que fournissent des enfants une
phrase descriptive simple, Henri Wallon fait la distinction suivante : [Parmi
les rponses, on en trouve] de deux grandes catgories : celles qui se bornent
identifier le fait nonc ou l'analyser et celles qui le compltent par
quelque circonstance extrieure. Pense statique dune part, pense transitive
de lautre . H. Wallon, Les rfrences de la pense courante chez
lenfant , LAnne psychologique, 50, 1949, p. 387-402. Voir galement F.
Bertossa & R. Ferrari, Lo Sguardo senza occhio, op. cit.
17. L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, op. cit., 304.
18. Cela excde le nous fini et personnel, et non pas la simple possibilit
de lexprience (voir chapitre VI).
19. Au sujet de laffirmation contraire de Roger Penrose, qui sappuie sur la
thorie quantique de la gravitation, voir M. Bitbol, Physique et Philosophie
de lesprit, op. cit., p. 45.
20. M. Bedau, Downward causation and autonomy in weak emergence ,
Principia, 6, 2002, p. 5-50 ; M. Bitbol, De lintrieur du monde. Pour une
philosophie et une science des relations, op. cit., p. 630.
21. J. Kim, Philosophy of Mind, Westview Press, 2006, chapitre VIII ; J. Kim,
Physicalism or Something Near Enough, Princeton University Press, 2005,
conclusion.
22. G. Strawson, Why physicalism entails panpsychism , in A. Freeman
(d.), Consciousness and its Place in Nature, Imprint Academic, 2007.
23. Voir chapitre XII pour un dveloppement sur ce thme.
24. D. Chalmers, The Conscious Mind, op. cit.
25. H. Feigl, Mind-body, not a pseudo-problem , in C.V. Borst, The Mind-
Brain Identity Theory, MacMillan, 1983, p. 40-41.
26. J. Levine, Materialism and qualia : The explanatory gap , Pacific
Philosophical Quarterly, 64, 1983, p. 354-361.
27. B. Loar, Phenomenal states , in N. Block, O. Flanagan & G. Gzeldere,
The Nature of Consciousness, MIT Press, 1999.
28. J. Kim, Physicalism or Something Near Enough, Princeton University
Press, 2005, chapitre V.
29. M. Velmans, Understanding Consciousness, Routledge, 2009.
30. Ibid., p. 327.
31. On peut galement parler de sur-dtermination des comportements :
sils sont dj entirement dtermins par un processus objectif, quel besoin y
a-t-il de faire intervenir lexprience vcue ? G.A. Miller, The Science of
Mental Life, Harper & Row, 1962.
32. Une rflexion rcente autour du thme moniste neutre a t prsente par
T. Nagel, Mind and Cosmos, Oxford University Press, 2012. Un modle
quantique de cette thse a t par ailleurs formul, avec dimportantes
prmisses philosophiques, par P. Uzan, Conscience et Physique quantique,
Vrin, 2013.
33. Cette traduction thorique, encore partielle dans les dernires versions de
la thorie de lidentit, est pleinement accomplie et finement utilise dans le
programme de la neurophnomnologie de Francisco Varela. Nous
rappellerons plus loin loriginalit de ce programme, en montrant quil hrite
galement de la part de pertinence du dualisme sans aucunement tomber dans
ses travers rifiants. F. Varela, Neurophenomenology, a methodological
remedy for the hard problem , Journal of Consciousness Studies, vol. 3,
p. 330-350 ; D. Rudrauf, A. Lutz, D. Cosmelli, J.-P. Lachaux & M. Le Van
Quyen, From autopoiesis to neurophenomenology : Francisco Varelas
exploration of the biophysics of being , Biological Research, 36, 2003,
p. 27-65 ; M. Bitbol, Neurophenomenology, an ongoing practice of/in
consciousness , Constructivist Foundations, 7, 2012, p. 165-173.
34. M. Velmans, Understanding Consciousness, op. cit., p. 298.
35. Lusage mtaphorique de cette figure topologique a un prcdent clbre
chez Lacan. Mais la situation illustre est trs diffrente dans les deux cas.
Voir V. Hasenbalg, La bouteille de Klein, le langage et le rel , Revue
lacanienne, 2, 2007, p. 64-71.
36. R. Ruyer, La Conscience et le Corps, Flix Alcan, 1937, p. 48.
Commentaire extensif et inspirant dans R. Barbaras, Introduction une
phnomnologie de la vie, op. cit., p. 157 et suiv.
37. R. Ruyer, La Conscience et le Corps, op. cit., p. 28.
38. R. Ruyer, Paradoxes de la conscience, Albin Michel, 1966, p. 22.
39. R. Barbaras, Introduction une phnomnologie de la vie, op. cit.,
p. 180.
40. M. Velmans, Understanding Consciousness, op. cit., p. 309.
41. Ibid., p. 316.
42. D. Chalmers, Facing up to the problem of consciousness , Journal of
Consciousness Studies, vol. 2, 1995, p. 200-219.
43. Voir chapitre V.
44. Ibid.
45. Sur la conception moderne et analytique de lontologie, on se reportera
F. Nef, Trait dontologie pour les non-philosophes (et les philosophes),
Gallimard, 2009.
46. Le mot recueillement nest peut-tre pas ici quune mtaphore.
Quelques auteurs ont en effet rapproch la mthode employe par Descartes
dans ses Mditations des exercices spirituels des jsuites. L. Beck, The
Metaphysics of Descartes. A Study of the Meditations, Oxford University
Press, 1965.
47. E. Cassirer, De Nicolas de Cues Boyle. Le Problme de la
connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes, t. 1,
Cerf, 2004, p. 61.
48. E. Cassirer, Individu et Cosmos dans la philosophie de la Renaissance,
Minuit, 1983, p. 189
49. Voir une tude nuance de cette articulation dans : A. Bitbol-Hespris,
La mdecine et lunion dans la Mditation sixime , in D. Kolesnik-
Antoine (d.), Union et Distinction de lme et du corps : lectures de la
sixime Mditation, Kim, 1998.
50. R. Descartes, Mditations mtaphysiques, Livre de Poche, 1992, p. 35.
51. Ibid., p. 43, 47.
52. M. Henry, Gnalogie de la psychanalyse, PUF, 1985, p. 18. Je remercie
Natalie Depraz pour avoir attir mon attention sur cette remarquable lecture
phnomnologique de Descartes.
53. R. Descartes, Rgles pour la direction de lesprit, Livre de Poche, 2002 ;
J.-L. Marion, Sur lontologie grise de Descartes, Vrin, 1993.
54. R. Descartes, Mditations mtaphysiques, op. cit., p. 103-105.
55. Ibid., p. 109.
56. Ibid., p. 63.
57. Husserl regrette qu cause de cela, Descartes ait manqu lorientation
transcendantale . E. Husserl, Mditations cartsiennes, op. cit., p. 50. Il
serait sans doute plus juste de dire que Descartes ne sen est pas tenu de bout
en bout une orientation transcendantale, quil retrouve cependant par
intermittences.
58. R. Descartes, Mditations mtaphysiques, op. cit., p. 117 : Par Dieu,
jentends une substance infinie [] par laquelle jai t cr moi-mme, et
aussi tout autre existant sil y a quelque autre existant . Voir M. Henry,
Gnalogie de la psychanalyse, op. cit., p. 21.
59. R. Descartes, uvres philosophiques, t. II, op. cit., p. 792.
60. A. Bitbol-Hespris, Le principe de vie dans Les Passions de lme ,
Revue Philosophique, 4, 1988, p. 415-431.
61. R. Descartes, uvres philosophiques, t. III, op. cit., p. 973 ; M. Henry,
Gnalogie de la psychanalyse, op. cit., p. 37.
62. A. Bitbol-Hespris, Rponse Vere Chappell : lunion substantielle ,
in J.-M. Beyssade & J.-L. Marion (d.), Descartes : objecter et rpondre,
PUF, 1994, p. 439.
63. R. Descartes, Correspondance avec Elisabeth, et autres lettres, GF-
Flammarion, 1989, p. 72, lettre du 20 juin 1643.
64. Ibid., p. 74, lettre du 28 juin 1643.
65. Ibid., p. 75.
66. R. Descartes, uvres philosophiques, t. II, op. cit., p. 669 ; commentaire
dans A. Bitbol-Hespris, Rponse Vere Chappell : lunion
substantielle , loc. cit.
67. R. Descartes, Correspondance avec Elisabeth, et autres lettres, op. cit.,
p. 75.
68. A. Damasio, LErreur de Descartes, Odile Jacob, 1997.
69. F. Varela, Not one, not two , The Coevolution Quarterly, 12, 1976,
p. 62-67.
70. M. Bitbol, Neurophenomenology, an ongoing practice of/in
consciousness , Constructivist Foundations, 7, 2012, p. 165-173.
71. F. Varela, Neurophenomenology : A methodological remedy for the hard
problem , Journal of Consciousness Studies, vol. 3, 1996, p. 330-349.
72. A. No & E. Thompson, Are there neural correlates of
consciousness ? , Journal of Consciousness Studies, vol. 11, 2004, p. 3-28.
73. M. Bitbol, Physique et Philosophie de lesprit, op. cit., p. 162.
74. D. Dennett, Whos on first ? Heterophenomenology explained , Journal
of Consciousness Studies, vol. 10, 2003, p. 19-30.
75. P. Simons, The seeds of experience , in A. Freeman (d.),
Consciousness and its Place in Nature, op. cit.
76. I. Dupron, G.T. Fechner, le paralllisme psychophysique, PUF, 2000.
77. P. Descola, Par-del nature et culture, op. cit.
78. G. Reichard, Navaho Religion, Princeton University Press, 1974, p. 19-
20 ; cit et comment par J. Halifax, The Fruitful Darkness, Grove Press,
1993, p. 76.
79. V. Hugo, Ce que dit la bouche dombre , in Les Contemplations, VI,
Livre de Poche, 1965, p. 463, XXVI.
80. M. Eliade, Le Chamanisme et les techniques archaques de lextase,
Payot, 1993.
81. J. Fire Lame Deer & R. Erdoes, Lame Deer : Seeker of Visions, Simon &
Schuster, 1972, p. 155.
82. J. Halifax, The Fruitful Darkness, op. cit., p. 25, 47, 94, 97.
83. D. Abram, The Spell of the Sensuous, Vintage, 1996.
84. Voir D. Abram, Becoming Animal, Pantheon, 2010, p. 38 et suiv.
85. Ibid., p. 68. Lusage du mot chair par D. Abram est explicitement
inspir de Merleau-Ponty.
86. N. Depraz, Avatar je te vois : une exprience philosophique, Ellipses,
2012.
87. F.-R. de Chateaubriand, Atala. Ren. Voyage en Amrique, GF-
Flammarion, 2009, p. 192.
88. F. Patritius, Panpsychia. Novae de universis Philosophiae, Ferrare,
1591. Cit et comment par E. Cassirer, Individu et cosmos dans la
philosophie de la Renaissance, op. cit., p. 188-190.
89. G. Fechner, Nanna : Oder ber das Seelenleben der Pflanzen, Leopold
Voss, 1848.
90. I. Dupron, G.T. Fechner, le paralllisme psychophysique, op. cit., p. 15.
91. G. Fechner, Nanna, op. cit., traduction anglaise : Religion of a Scientist,
Pantheon, 1946.
92. G. Fechner, Zend Avesta, Leopold Voss, 1851.
93. G. Fechner, Elemente der Psychophysik, Breitkopf und Hrtel, 1860.
94. G. Fechner, Religion of a Scientist, op. cit., p. 132.
95. J. Halifax, The Fruitful Darkness, op. cit., p. 98.
96. Il nen va pas de mme des ethnologues et des psychanalystes, qui
acceptent la rciprocit du processus pistmique. Voir G. Devereux, De
langoisse la mthode dans les sciences du comportement, Flammarion,
2012 ; B. Latour, Enqutes sur les modes d'existence. Une anthropologie des
modernes, La Dcouverte, 2012.
97. J.-P. Sartre, Ltre et le Nant, op. cit., p. 272.
98. D. Abram, The Spell of the Sensuous, op. cit., p. 21.
99. Ibid., p. 25.
100. I. Dupron, G.T. Fechner, le paralllisme psychophysique, op. cit.,
p. 115 ; G. Fechner, Zend Avesta, op. cit. ; G. Fechner, Religion of a
Scientist, op. cit., p. 164.
Notes
1. L. Naccache, Le Nouvel Inconscient, Odile Jacob, 2006.
2. S. Hggqvist, A model for thought experiments , Canadian Journal of
Philosophy, 39, 2009, p. 55-76.
3. E. Schrdinger, Physique quantique et Reprsentation du monde, Seuil,
1992.
4. R. Descartes, Mditations mtaphysiques, op. cit., p. 53.
5. Ibid.
6. Ibid., p. 59.
7. R. Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism, University of
Pennsylvania Press, 1983, p. 16.
8. T. Nagel, The View From Nowhere, Oxford University Press, 1986.
9. D. Chalmers, The Conscious Mind, Oxford University Press, 1996.
10. Ibid., p. 96.
11. Voir V. Halperin, White Zombie (1961) ; G. Romero, La Nuit des morts-
vivants (1968) ; M. Forster, World War Z (2013).
12. T.C. Moody, Conversations with zombies , Journal of Consciousness
Studies, 1994, p. 196-200.
13. C.E. Shannon & W. Weaver, The Mathematical Theory of
Communication, University of Illinois Press, 1949.
14. T. Nagel, Mind and Cosmos, op. cit.
15. O. Flanagan & T. Polger, Zombies and the function of consciousness ,
Journal of Consciousness Studies, vol. 2, 1995, p. 313-321 ; D. Dennett,
The unimagined preposterousness of zombies , Journal of Consciousness
Studies, vol. 2, 1995, p. 322-326.
16. T.C. Moody, Conversations with zombies , loc. cit.
17. D. Dennett, Consciousness Explained, op. cit.
18. Ibid., p. 406.
19. A. Billon, En personne : la ralit subjective de la conscience
phnomnale, thse de lcole Polytechnique, dcembre 2005.
20. F. Varela, Quel savoir pour lthique ?, op. cit.
21. J.-P. Sartre, Ltre et le Nant, op. cit., p. 266.
22. F. Jackson, Epiphenomenal qualia , Philosophical Quarterly, 32,
1982, p. 127-136.
23. E. Husserl, LIde de la phnomnologie, PUF, 1970, p. 63-64, [38].
24. F. Jackson, Mind and illusion , in P. Ludlow, Y. Nagasawa & D.
Stoljar, Theres Something About Mary, MIT Press, 2004.
25. D. Dennett, What RoboMary knows , in T. Alter & S. Walter,
Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge, Oxford University
Press, 2007.
26. L. Nemirow, So this is what its like : A defense of the ability
hypothesis , in T. Alter & S. Walter, Phenomenal Concepts and
Phenomenal Knowledge, op. cit.
27. E. Conee, Phenomenal Knowledge , Australasian Journal of
Philosophy, 72, 1994, p. 136-150.
28. H. Robinson, Why Frank should not have jilted Mary , in E. Wright,
The Case for Qualia, MIT Press, 2008.
29. T. Nagel, What is it like to be a bat ? , The Philosophical Review,
LXXXIII, 1974, p. 435-450.
30. Ibid.
31. T. Nagel, The View From Nowhere, op. cit.
32. Ibid., p. 26.
Notes
1. S. Ramon y Cajal, Les Nouvelles Ides sur la structure du systme
nerveux chez lhomme et chez les vertbrs, C. Reinwald & Cie, 1894.
2. Voir chapitre VII .
3. C. Koch, The Quest for Consciousness : A Neurobiological Approach,
Robert, 2004.
4. J.R.Villablanca, Counterpointing the functional role of the forebrain and
of the brainstem in the control of the sleep-waking system , Journal of Sleep
Research, 13, 2004, p. 179-208.
5. Le diencphale est une partie du cerveau forme de substance grise, et
situe entre les deux hmisphres crbraux, juste en dessous deux. Elle
inclut lhypothalamus.
6. J.E. Bogen, On the neurophysiology of consciousness. Part I : An
overview , Consciousness and Cognition, 4, 1995, p. 52-62 ; Byoung-Kyong
Min, A thalamic reticular networking model of consciousness , Theoretical
Biology and Medical Modelling, 7, 10, doi:10.1186/1742-4682-7-10 ; L.M.
Ward, The thalamic dynamic core theory of conscious experience ,
Consciousness and Cognition, 20, 2011, p. 464-486.
7. G. Miller, Feedback from frontal cortex may be a signature of
consciousness , Science, 332, 2011, p. 779.
8. G. Tononi & C. Koch, The neural correlates of consciousness : An
update , Annals of the New York Academy of Sciences, 1124, 2008, p. 239-
261.
9. F. Crick & C. Koch, Towards a neurobiological theory of
consciousness , Seminars in the Neurosciences, 2, 1990, p. 263-275 ; F.
Varela, J.-P. Lachaux, E. Rodriguez & J. Martinerie, The brainweb : Phase
synchronization and large-scale integration , Nature Neuroscience, 2, 2001,
p. 229-239.
10. P. Uzan, Conscience et Physique quantique, Vrin, 2013 ; M. Bitbol,
Physique et Philosophie de lesprit, op. cit.
11. S. Hameroff, Conscious events as orchestrated space-time selections ,
Journal of Consciousness Studies, vol. 3, 1996, p. 36-53.
12. M. Jibu & K. Yasue, Quantum Brain Dynamics and Consciousness, John
Benjamins, 1995 ; E. Pessa & G. Vitiello, Quantum noise, entanglement and
chaos in the quantum field theory of mind/brain states , Mind and Matter, 1,
2003, p. 59-79 ; W.J. Freeman & G. Vitiello, Nonlinear brain dynamics as
macroscopic manifestation of underlying many-body field dynamics , Physics
of Life Reviews, 3, 2006, p. 93-118.
13. V.A.F. Lamme, Towards a true neural stance on consciousness , Trends
in Cognitive Sciences, 10, 2006, p. 494-501.
14. S. Grossberg, The link between brain learning, attention, and
consciousness , Consciousness and Cognition, 8, 1999, p. 1-44.
15. R. Llinas, U. Ribary, D. Contreras & C. Pedroarena, The neuronal basis
for consciousness , Philosophical Transactions of the Royal Society of
London, B, 353, 1998, p. 1841-1849.
16. S. Grossberg, The link between brain learning, attention, and
consciousness , loc. cit.
17. J.K. ORegan, R.A. Rensink & J.J. Clark, Change-blindness as a result
of mudsplashes , Nature, 398, 1999, p. 34.
18. A. Mack & I. Rock, Inattentional Blindness, MIT Press, 1998 ; G. Tononi
& C. Koch, The neural correlates of consciousness : An update , op. cit.
19. R. Landman, H. Spekreise & V.A.F Lamme, Large capacity storage of
integrated objects before change blindness , Vision Research, 43, 2003,
p. 149-164.
20. Voir chapitre II.
21. D.M. Rosenthal, Consciousness and Mind, op. cit.
22. H. Lau & D.M. Rosenthal, Empirical support for higher-order theories
of conscious awareness , Trends in Cognitive Sciences, 15, 2011, p. 365-
373.
23. E. Rounis, B. Maniscalco, J.C. Rothwell, R.E. Passingham & H. Lau,
Theta-burst transcranial magnetic stimulation to the prefrontal cortex impairs
metacognitive visual awareness , Cognitive Neuroscience, 1, 2010, p. 165-
175.
24. M.H. Herzog, M. Esfeld & W. Gerstner, Consciousness and the small
network argument , Neural Networks, 20, 2007, p. 1054-1056.
25. B. Baars, A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge University
Press, 1988 ; B. Baars, In the Theater of Consciousness : The Workspace of
the Mind, Oxford University Press, 1996.
26. S. Dehaene, M. Kerszberg & J.-P. Changeux, A neuronal model of a
global workspace in effortful cognitive tasks , PNAS, 95, 1998, p. 14529-
14534 ; S. Dehaene & J.-P. Changeux, Ongoing spontaneous activity
controls access to consciousness : A neuronal model for inattentional
blindness , PLOS Biology, 3, 2005, p. 910-927.
27. W. James, The Principles of Psychology, Holt, 1890, p. 609.
28. Voir le chapitre III, au sujet de la contrepartie exprientielle la plus
frappante de la thorie des prsents effectifs : les pisodes de conscience
pulsatiles de lAbhidharma.
29. Des critres comportementaux non verbaux ont galement t proposs
pour assigner ou non lexprience consciente dun vnement chez des sujets
humains et animaux. Il a cependant t trouv que le critre verbal est le
meilleur prdicteur de ladaptation des conduites chez lHomme. M.
Overgaard, B. Timmermans, K. Sandberg & A. Cleeremans, Optimizing
subjective measures of consciousness , Consciousness and Cognition, 19,
2010, p. 682-684.
30. S. Dehaene & J.-P. Changeux, Experimental and theoretical approach to
conscious processing , Neuron, 70, 200-227, 2011.
31. H. Lau & D. Rosenthal, Empirical support for higher-order theories of
conscious awareness , loc. cit. ; D.M. Rosenthal, Consciousness and Mind,
Clarendon Press, 2005.
32. H. Lau & D. Rosenthal, Empirical support for higher-order theories of
conscious awareness , loc. cit.
33. S. Dehaene & L. Naccache, Towards a cognitive neuroscience of
consciousness : Basic evidence and a workspace framework , in S. Dehaene
(d.), The Cognitive Theory of Consciousness, MIT Press, 2001.
34. S. Marti, J. Sackur, M. Sigman & S. Dehaene, Mapping introspections
blind spot : Reconstruction of dual-task phenomenology using quantified
introspection , Cognition, 115, 2010, p. 303-313.
35. C. Sergent, S. Baillet & S. Dehaene, Timing of the brain events
underlying access to consciousness during the attentional blink , Nature
Neuroscience, 8, 2005, p. 1391-1400.
36. Ibid.
37. W. James, The Principles of Psychology, op. cit. ; E. Schrdinger,
LEsprit et la Matire, Seuil, 1990, p. 158.
38. S. Laureys, The neural correlate of (un)awareness : Lessons from the
vegetative state , Trends in Cognitive Sciences, 9, 2005, p. 556-559.
39. K. Kihara, T. Ikeda, D. Matsuyoshi, N. Hirose, T. Mima, H. Fukuyama &
N. Osaka, Differential contributions of the intraparietal sulcus and the
inferior parietal lobe to attentional blink : Evidence from transcranial
magnetic stimulation , Journal of Cognitive Neuroscience, 23, 2011, p. 247-
256.
40. S. Kouider, C. Stahlhut, S.V. Gelskov, L.S. Barbosa, M. Dutat, V. de
Gardelle, A. Christophe, S. Dehaene & G. Dehaene-Lambertz, A neural
marker of perceptual consciousness in infants , Science, 340, 2013, p. 376-
380.
41. Voir au chapitre XI I pour une analyse de lapplicabilit du concept de
causalit dans cette situation sans gale.
42. J. Gray, Consciousness : Creeping Up on the Hard Problem, Oxford
University Press, 2004, p. 172 (galement p. 40, 73, 124).
43. Autrement dit le rseau neuronal du cortex du cervelet.
44. G. Edelman & G. Tononi, Comment la matire devient conscience,
op. cit., p. 33.
45. Ibid., p. 30.
46. Les messages ont souvent un sens. [] Ces aspects smantiques de la
communication ne sont pas pertinents pour le problme technologique . E.
Shannon, A mathematical theory of communication , Bell System Technical
Journal, XXVII, 1948, p. 379-423.
47. D. Dennett, Consciousness Explained, op. cit., p. 281.
48. Ibid.
49. E. Schrdinger, Quelques remarques au sujet des bases de la
connaissance scientifique , Scientia, LVII, 1935, p. 181-191 ; M. Bitbol,
Lalter ego et les sciences de la nature , Philosophia Scientiae, 3, 1999,
p. 203-213 ; F. Nef, propos dune controverse entre Carnap et
Schrdinger , loc. cit. Une phrase-cl de cet article de Schrdinger est celle-
ci : Si on lui demande pourquoi lhomme crie, croiriez-vous qu un
physiologiste (en tant que physiologiste) il conviendrait de rpondre que
lhomme crie parce quil ressent une douleur ? Certainement non, car en
rpondant ainsi il fermerait les yeux sur le vritable problme scientifique .
50. L. Wittgenstein, Notes sur lexprience prive et les sense data, op. cit.,
p. 58.
51. J. Gray, Consciousness : Creeping Up on the Hard Problem, op. cit.,
p. 90.
52. M. Cabanac, A. Cabanac & A. Parent, The emergence of consciousness
in phylogeny , Behavioural Brain Research, 198, 2009, p. 267-272.
53. J.M. Bering & D.F. Bjorklund, The serpents gift : Evolutionary
psychology and consciousness , i n P.D. Zelazo, M. Moscovitch & E.
Thompson (d.), Cambridge Handbook of Consciousness, op. cit.
54. B. Merker, The liabilities of mobility : A selection pressure for the
transition to consciousness in animal evolution , Consciousness and
Cognition, 14, 2005, p. 89-114.
55. F. Varela, The re-enchantment of the concrete , in L. Steels & R.
Brooks (d.), The Artificial Life Route to Artificial Intelligence : Building
Embodied Situated Agents, Lawrence Erlbaum, 1999 ; F. Varela, Daseins
brain : Phenomenology meets cognitive science , in D. Aerts (d.), Einstein
Meets Magritte, Kluwer, 1999.
56. J. Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the
Bicameral Mind, Houghton Mifflin, 1976.
57. D.B. Edelman & A.K. Seth, Animal consciousness : A synthetic
approach , Trends in Neurosciences , 32, 2009, 476-484 ; F. Burgat, Une
Autre Existence, Albin Michel, 2012.
58. S.J. Gould & R. Lewontin, The spandrels of San Marco and the
panglossian paradigm : A critique of the adaptationist programme ,
Proceedings of the Royal Society of London, B, 205, 1979, p. 581-598.
59. M. Bitbol & P.-L. Luisi, Science and the self-referentiality of
consciousness , Journal of Cosmology, 14, 2011, p. 4728-4743.
60. Voir chapitre VII.
61. M. Beauregard & D. OLeary, The Spiritual Brain, HarperOne, 2007.
62. V.A.F. Lamme, Towards a true neural stance on consciousness ,
loc. cit. ; M. Bitbol, Is consciousness primary ? , NeuroQuantology, 6,
2008, p. 53-71. La section du corps calleux est galement appele
commissurotomie .
63. Linversion de la gauche et de la droite sexplique par le croisement des
voies de transmission, en particulier dans le chiasma optique. Les
informations sensori-motrices de la moiti gauche du corps sont traites par
lhmisphre droit du cerveau, et rciproquement.
64. V.A.F. Lamme, Towards a true neural stance on consciousness ,
loc. cit.
65. E. Schwitzgebel, Perplexities of Consciousness, MIT Press, 2011,
chapitre VI.
66. J. Aru, T. Bachmann, W. Singer & L. Melloni, Distilling the neural
correlates of consciousness , Neuroscience and Biobehavioral Review, 36,
2012, p. 737-746.
67. O. Hulme, K.F. Friston & S. Zeki, Neural correlates of stimulus
reportability , Journal of Cognitive Neuroscience, 21, 2009, p. 1602-1610.
68. E. Irvine, Consciousness as a Scientific Concept, Springer, 2013, p. 151.
69. F. Faugeras, B. Rohaut, N. Weiss, T.A. Bekinstein, D. Galanaud, L.
Puybasset, F. Bolgert, C. Sergent, L. Cohen, S. Dehaene & L. Naccache,
Probing consciousness with event-related potentials in the vegetative state ,
Neurology, 77, 2011, p. 264.
70. B.J. Baars & S. Franklin, Consciousness is computational : The LIDA
model of global workspace theory , International Journal of Machine
Consciousness, 1, 2009, p. 23-32.
71. M. Bitbol, LAveuglante Proximit du rel, Flammarion, 1998.
72. H. Atmanspacher & W. Fach, Acategoriality as mental instability ,
Journal of Mind and Behavior, 26, 2005, p. 181-206.
73. N. Zaretskaya, A. Thielscher, N.K. Logothetis & A. Bartels, Disrupting
parietal function prolongs dominance durations in binocular rivalry , Current
Biology, 20, 2010, p. 2106-2111.
74. O. Hulme, K.F. Friston & S. Zeki, Neural correlates of stimulus
reportability , loc. cit.
75. G. Edelman & G. Tononi, Comment la matire devient conscience,
op. cit., p. 257.
76. M. Merleau-Ponty, Phnomnologie de la perception, op. cit., p. 404.
77. Voir chapitre XII.
78. M. Bitbol, Physique et Philosophie de lesprit, op. cit., p. 232.
Notes
1. K. Leslie, Dreaming during anesthesia , in G. Mashour (d.),
Consciousness, Awareness, and Anesthesia, Cambridge University Press,
2010.
2. M. Bitbol, De lintrieur du monde. Pour une philosophie et une science
des relations, op. cit., p. 567.
3. A.M. Owen, N.D. Schiff & S. Laureys, The assessment of conscious
awareness in the vegetative state , in S. Laureys & G. Tononi, The
Neurology of Consciousness : Cognitive Neuroscience and Neuropathology ,
Academic Press, 2008, p. 167.
4. A.G. Hudetz, Are we unconscious during general anesthesia ? ,
International Anesthesiology Clinics, 46, 2008, p. 25-42.
5. G. Mashour & E. LaRock, Inverse zombies, anesthesia awareness, and the
hard problem of unconsciousness , Consciousness and Cognition, 17, 2008,
p. 1163-1168.
6. P. Broca, crits sur laphasie (1861-1869), LHarmattan, 2004.
7. K. Goldstein, La Structure de lorganisme, Gallimard, 1983.
8. G. Edelman & G. Tononi, Comment la matire devient conscience,
op. cit., p. 61-64.
9. J.-P. Changeux, Conscious processing : Implications for general
anesthesia , Current Opinions in Anesthesiology, 25, 2012, p. 397-404.
10. G. Vanini, H.A. Baghdoyan & R. Lydic, Relevance of sleep
neurobiology for cognitive neuroscience and anesthesiology , in G. Mashour
(d.), Consciousness, Awareness, and Anesthesia, Cambridge University
Press, 2010.
11. P.G. Barash, B.F. Cullen & R.K. Stoelting, Clinical Anesthesia,
Lippincott Williams & Wilkins, 2009, p. 98.
12. G. Edelman & G. Tononi, Comment la matire devient conscience,
op. cit.
13. M.T. Alkire, J.R. McReynolds, E.L. Hahn & A.N. Trivedi, Thalamic
microinjection of nicotine reverses sevoflurane-induced loss of righting reflex
in the rat , Anesthesiology, 107, 2007, p. 264-272.
14. M.T. Alkire, A.G. Hudetz & G. Tononi, Consciousness and anesthesia ,
Science, 322, 2008, p. 876-880.
15. L.J. Velly, M.F. Rey, N.J. Bruder, F.A. Gouvitsos, T. Witjas, J.M. Regis,
J.C. Peragut & F.M. Gouin, Differential dynamic of action on cortical and
subcortical structures of anesthetic agents during induction of anaesthesia ,
Anesthesiology, 107, 2007, p. 202-212.
16. Ibid.
17. J.-P. Changeux, Conscious processing : Implications for general
anesthesia , loc. cit.
18. M.H. Davis, M.R. Coleman, A.R. Absalom, J.M. Rodd, I.S. Johnsrude,
B.F. Matta, A.M. Owen & D.K. Menon, Dissociating speech perception and
comprehension at reduced levels of awareness , PNAS, 104, 2007, p. 16032-
16037.
19. B. Baars, In the Theater of Consciousness : The Workspace of the Mind,
Oxford University Press, 1997.
20. S. Dehaene, M. Kerszberg & J.-P. Changeux, A neuronal model of a
global workspace in effortful cognitive tasks , PNAS, 95, 1998, p. 14529-
14534 ; S. Dehaene & L. Naccache, Toward a cognitive neuroscience of
consciousness : Basic evidence and a workspace framework , Cognition, 79,
2001, p. 1-37.
21. P. Hagmann, L. Cammoun, X. Gigandet, R. Meuli, C.J. Honey, V.J.
Wedeen & O. Sporns, Mapping the structural core of human cerebral
cortex , PLOS Biology, 6, e159, 2008.
22. M.H. Davis, M.R. Coleman, A.R. Absalom, J.M. Rodd, I.S. Johnsrude,
B.F. Matta, A.M. Owen & D.K. Menon, Dissociating speech perception and
comprehension at reduced levels of awareness , loc. cit.
23. Q. Noirhomme, A. Soddu, R. Lehembre, A. Vanhaudenhuyse, P. Boveroux,
M. Boly & S. Laureys, Brain connectivity in pathological and
pharmacological coma , Frontiers in Systems Neuroscience, 4, 2010,
p. 160.
24. S.-W. Wu, U. Lee, G.-J. Noh, I.-G. Jun & G.A. Mashour, Preferential
inhibition of frontal-to-parietal feedback connectivity is a neurophysiologic
correlate of general anesthesia in surgical patients , PLOS ONE, 6, e25155,
2011.
25. J. Vion-Dury & F. Blanquet, Pratique de lEEG, op. cit.
26. P.C. Hansen, M.L. Kringelbach & R. Salmelin (d.), MEG : An
Introduction to Methods, Oxford University Press, 2010.
27. Il sagit dune molcule appele Di-isopropylphnol, se prsentant sous
forme dmulsion, et administre par voie intraveineuse.
28. P.S. Garcia & P. Sebel, Current controversies in intraoperative
awareness I , in G. Mashour (d.), Consciousness, Awareness, and
Anesthesia, Cambridge University Press, 2010.
29. M.S. Avidan, L. Zhang, B.A. Burnside, K.J. Finkel, A.C. Searleman, J.A.
Selvidge, L. Saager, M.S. Turner, S. Rao, M. Bottros, C. Hantler, E.
Jacobsohn & A.S. Evers, Anesthesia, awareness and the bispectral index ,
New England Journal of Medicine, 358, 2008, p. 1097-1108.
30. Lischmie est un dfaut dirrigation sanguine.
31. J.R. Yoon, Y.S. Kim & T.K. Kim, Thiopental-induced burst suppression
measured by the bispectral index is extended during propofol administration
compared with sevoflurane , Journal of Neurosurgical Anesthesiology, 24,
2012, p. 146-151.
32. G. Tononi, An information integration theory of consciousness , BMC
Neuroscience, 5: 42, 2004, p. 1-22 ; G. Tononi, Consciousness as integrated
information : A provisional manifesto , Biological Bulletin, 215, 2008,
p. 216-242.
33. M.T. Alkire, A.G. Hudetz & G. Tononi, Consciousness and anesthesia ,
loc. cit.
34. G.A. Mashour, Integrating the science of consciousness and anesthesia ,
Anesthesia & Analgesia, 103, 2006, p. 975-982 ; U. Lee, G.A. Mashour, S.
Kim, G. Noh & B. Choi, Propofol induction reduces the capacity for neural
information integration : Implications for the mechanism of consciousness and
general anesthesia , Consciousness and Cognition, 18, 2009, p. 56-64.
35. C. Koch, Consciousness : Confessions of a Romantic Reductionist, MIT
Press, 2012, p. 131.
36. A.G. Hudetz, Are we conscious during anesthesia ? , loc. cit. ; T.
Sakai, H. Singh, W.D. Mi, T. Kudo & A. Matsuki, The effect of ketamine on
clinical endpoints of hypnosis and EEG variables during propofol infusion ,
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 43, 1999, p. 212-216.
37. Chi Chen Wu, M.S. Mok, Chao Shun Lin & Sin Ru Han, EEG-bispectral
index changes with ketamine versus thiamylal induction of anesthesia , Acta
Anesthesiologica Sinica, 39, 2001, p. 11-15.
38. F. Aubrun, X. Paqueron & B. Riou, Ktamine , Confrences
dactualisation SFAR, 2000, p. 279-291.
39. R.D. Fitzgerald, C. Lamm, W. Oczenski, T. Stimpfl, W. Vycudilik & H.
Bauer, Direct current auditory evoked potentials during wakefulness,
anesthesia, and emergence from anesthesia , Anesthesia & Analgesia, 92,
2001, p. 154-160.
40. G. Schneider, Monitoring anesthetic depth , in G.A. Mashour (d.),
Consciousness, Awareness, and Anesthesia, Cambridge University Press,
2010, p. 122.
41. M.H. Davis, M.R. Coleman, A.R. Absalom, J.M. Rodd, I.S. Johnsrude,
B.F. Matta, A.M. Owen & D.K. Menon, Dissociating speech perception and
comprehension at reduced levels of awareness , loc. cit.
42. A.M. Owen, N.D. Schiff & S. Laureys, The assessment of conscious
awareness in the vegetative state , loc. cit.
43. M.T. Alkire, A.G. Hudetz & G. Tononi, Consciousness and anesthesia ,
loc. cit.
44. M. Ghoneim, Etiology and risk factors of intraoperative awareness , in
G.A. Mashour, Consciousness, Awareness, and Anesthesia, op. cit. ; M.
Ghoneim, R.I. Block, M. Haffarnan & M.J. Mathews, Awareness during
anesthesia : Risk factors, causes and sequelae. A review of reported cases in
the literature , Anesthesia & Analgesia, 108, 2009, p. 527-535.
45. C. Lennmarken & G. Sydsjo, Psychological consequences of
intraoperative awareness , in G.A. Mashour, Consciousness, Awareness,
and Anesthesia, op. cit.
46. M.F. OConnor, S.M. Daves, A. Tung, R.I. Cook, R. Thisted & J.
Apfelbaum, BIS monitoring to prevent awareness during general
anesthesia , Anesthesiology, 94, 2001, p. 520-522.
47. M.E. Tunstall, The reduction of amnesic wakefulness during caesarean
section , Anaesthesia, 34, 1979, p. 316-319 ; I.F. Russell, Isolated forearm
technique , Anaesthesia, 45, 1990, p. 687 ; I.F. Russell, Midazolam-
Alfentanil : An anaesthetic ? An investigation using the isolated forearm
technique , British Journal of Anaesthesia, 70, 1993, p. 42-46.
48. M.T. Alkire, A.G. Hudetz & G. Tononi, Consciousness and anesthesia ,
loc. cit.
49. M. Wang, A.G. Messina & I.F. Russell, The topography of awareness :
A classification of intra-operative cognitive states , Anaesthesia, 67, 2012,
p. 1197-1201.
50. I.F. Russell, The narcotrend depth of anaesthesia monitor cannot
reliably detect consciousness during general anaesthesia : An investigation
using the isolated forearm technique , British Journal of Anaesthesia, 96,
2006, p. 346-352.
51. D.L. Schacter, Implicit memory : History and current status , Journal of
Experimental Psychology : Learning, Memory and Cognition, 13, 1987,
p. 501-518.
52. J. Andrade, Does memory priming during anesthesia matter ? ,
Anesthesiology, 103, 2005, p. 1-2 ; U.E.G. Dobrunz, K. Jaeger & G. Vetter,
Memory priming during light anaesthesia with desflurane and remifentanil
anaesthesia , British Journal of Anaesthesia, 108, 2007, p. 630-637.
53. G.H. Lubke, C. Kerssens, H. Phaf & P.S. Sebel, Dependence of explicit
and implicit memory on hypnotic state in trauma patients , Anesthesiology,
90, 1999, p. 670-680.
54. J. Andrade, Does memory priming during anesthesia matter ? , loc. cit.
55. C. Deeprose, J. Andrade, S. Varma & N. Edwards, Unconscious
learning during surgery with propofol anaesthesia , British Journal of
Anaesthesia, 92, 2004, p. 171-177.
56. P.S. Garcia & P. Sebel, Current controversies in intraoperative
awareness I , in G.A. Mashour, Consciousness, Awareness, and Anesthesia,
op. cit.
57. A.G. Hudetz, Are we unconscious during general anesthesia ? , loc. cit.
58. B.J. Palanca, A. Searleman & M.S. Avidan, Current controversies in
intraoperative awareness II , in G.A. Mashour, Consciousness, Awareness,
and Anesthesia, op. cit.
59. C. Kerssens & M. Alkire, Memory formation during general
anesthesia , in G.A. Mashour, Consciousness, Awareness, and Anesthesia,
op. cit.
60. W.B. Scoville & B. Milner, Loss of recent memory after bilateral
hippocampal lesions , Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry,
20, 1957, p. 11-21.
61. B.R. Postle, The hippocampus, memory, and consciousness , in S.
Laureys & G. Tononi (d.), The Neurology of Consciousness, Academic
Press, 2008.
62. A.G. Hudetz, Are we unconscious during anesthesia ? , loc. cit.
63. M.H. Erdelyi, Subliminal perception and its cognates : Theory,
indeterminacy, and time , Consciousness and Cognition, 13, 2001, p. 73-91.
64. D.M. Rosenthal, Two concepts of consciousness , in D.M. Rosenthal
(d.), The Nature of Mind, Oxford University Press, 1991.
Notes
1. B. Baars, A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge University
Press, 1988, p. 11.
2. Les expriences dattention divise, dj commentes propos des thories
de lespace de travail global, comprennent : les tests de rivalit binoculaire,
et les tests de ccit attentionnelle au changement. D. Alais & R. Blake (d.),
Binocular Rivalry, MIT Press, 2005 ; D.J. Simons & C.F. Chabris, Gorillas
in our midst : Sustained inattentional blindness for dynamic events ,
Perception, 28, 1999, p. 1059-1074 ; A. Mack & I. Rock, Inattentional
Blindness, MIT Press, 2000.
3. K. McGovern & B. Baars, Cognitive theories of consciousness , in P.
Zelazo, M. Moscovitch & E. Thompson (d.), The Cambridge Handbook of
Consciousness, op. cit.
4. B.G. Breitmeyer, Visual Masking, an Integrative Approach, Oxford
University Press, 1984 ; H. Ogmen, B.G. Breitmeyer & R. Melvin, The what
and where of visual masking , Vision Research, 43, 2003, p. 1337-1350.
5. K. McGovern & B. Baars, Cognitive theories of consciousness , loc. cit.
6. Pour une vue plus extrme, associant une conscience aux neurones
individuels, voir : J.C.W. Edwards, Is consciousness only a property of
individual cells ? , Journal of Consciousness Studies, vol. 12, 2005, p. 60-
76 ; S. Sevush, Single-neuron theory of consciousness , Journal of
Theoretical Biology, 238, 2006, p. 704-725.
7. S. Zeki, J.D. Watson, C.J. Lueck, K.J. Friston, C. Kennard & R.S.
Frackowiak, A direct demonstration of functional specialization in human
visual cortex , Journal of Neuroscience, 11, 1991, p. 641-649.
8. A. Bartels & S. Zeki, The temporal order of binding visual attributes ,
Vision Research, 46, 2006, p. 2280-2286.
9. A.K. Engel, P. Fries, P. Konig, M. Brecht & W. Singer, Temporal
binding, binocular rivalry, and consciousness , Consciousness and
Cognition, 8, 1999, p. 155-158.
10. V.A.F. Lamme, How neuroscience will change our view on
consciousness , Cognitive Neuroscience and Consciousness, 1, 2010,
p. 204-220.
11. S. Zeki & D. Ffytche, The Riddoch syndrome : Insights into the
neurobiology of conscious vision , Brain, 121, 1998, p. 25-45 ; L.
Weiskrantz, J.L. Barbur & A. Sahraie, Parameters affecting conscious
versus unconscious visual discrimination with damage to the visual-cortex
(V1) , PNAS, 92, 1995, p. 6122-6126.
12. S. Zeki, The disunity of consciousness , in R. Banerjee & B.K.
Chakrabarti (d.), Progress in Brain Research, vol. 168, Elsevier, 2008.
13. K. Moutoussis & S. Zeki, The relationship between cortical activation
and perception investigated with invisible stimuli , PNAS, 99, 2002, p. 9527-
9532.
14. S. Zeki, The disunity of consciousness , loc. cit.
15. I. Kant, Critique de la raison pure, op. cit., p. 198, B132.
16. F. Crick, The Astonishing Hypothesis, Scribner Paperback, 1995 ; G.M.
Edelman & G. Tononi, A Universe of Consciousness : How Matter Becomes
Imagination, Basic Books, 2000.
17. D. Zahavi, Subjectivity and Selfhood, Investigating the First-Person
Perspective, MIT Press, 2005 ; E. Thompson, Mind in Life, Biology,
Phenomenology, and the Sciences of Mind, Harvard University Press, 2010.
18. R.D. Laing, The Politics of Experience and the Bird of Paradise, Penguin
Books, 1967, p. 29.
19. N. Humphrey, The Inner Eye : Social Intelligence in Evolution, Oxford
University Press, 2003. Lide dune thorie des autres esprits est
cependant trs conteste, et elle se voit substituer des thories de la
simulation (des motivations dagir de lautre), ou de la pure
interaction , qui vite tout quivalent dune reprsentation dautrui. T.
Fuchs & H. De Jaegher, Enactive intersubjectivity : Participatory sense-
making and mutual incorporation , Phenomenology and Cognitive Sciences,
8, 2009, p. 465-486 ; S. Gallagher, Understanding interpersonal problems in
autism : Interaction theory as an alternative to theory of mind , Philosophy,
Psychiatry, and Psychology, 11, 2004, p. 199-217 ; C. Teneggi, Lo Spazio
senso-motorio come rappresentazione dei comportamenti intersoggettivi,
thse de luniversit de Bologna/Paris-I, 2013.
20. G. Rizzolati & C. Sinigaglia, Les Neurones miroirs, Odile Jacob, 2008 ;
V.S. Ramachandran, The neurology of self-awareness , Edge, 01 aot
2007,
www.edge.org/3rd_culture/ramachandran07/ramachandran07_index.html.
21. D. Dennett, Consciousness Explained, Penguin Books, 1991, p. 126.
22. D. Dennett, Consciousness Explained, op. cit., p. 134 et suiv. ; discussion
dans : K. Akins, Lost the plot ? Reconstructing Dennetts multiple drafts
theory of consciousness , Mind & Language, 11, 1996, p. 1-43.
23. D. Dennett, Consciousness Explained, op. cit., p. 429.
24. P. Ricur, Soi-mme comme un autre, Seuil, 1990, p. 168.
25. S.J. Todd, Unmasking multiple drafts , Philosophical Psychology, 19,
2006, p. 477-494.
26. S. Blackmore, Consciousness, an Introduction, op. cit. ; S. Blackmore,
There is no stream of consciousness , Journal of Consciousness Studies,
vol. 9, 2002, p. 17-28.
27. F. Varela, The specious present : A neurophenomenology of time
consciousness , in J. Petitot., F. Varela, B. Pachoud & J.-M. Roy,
Naturalizing Phenomenology, Stanford University Press, 1999.
28. D. Dennett, Consciousness Explained, op. cit., p. 128.
29. Ibid., p. 366.
30. S. Blackmore, The grand illusion : Why consciousness exists only when
you look for it , New Scientist, 22 juin 2002, p. 26-29.
31. Ibid.
32. D. Dennett, Consciousness Explained, op. cit., p. 134.
33. Ibid., p. 230.
34. Galileo Galilei, Dialogue sur les deux grands systmes du monde, Seuil,
2000.
35. D. Dennett, Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of
Consciousness, MIT Press, 2005.
36. D. Dennett, Consciousness Explained, op. cit., p. 57.
37. C. Romano (d.), Wittgenstein et la Tradition phnomnologique, Art du
Comprendre, 2008.
38. F. Waismann, Principles of Linguistic Philosophy, MacMillan, 1997.
39. D. Mason, Demystifying without quining : Wittgenstein and Dennett on
qualitative states , South Africal Journal of Philosophy, 24, 2005, p. 33-43.
40. Voir chapitre VII.
41. Sur cette stratgie dargumentation, voir F. Bertossa, R. Ferrari & M.
Besa, Matrici senza uscita. Circolarit della conoscenza oggettiva e
prospettiva buddhista , loc. cit.
42. M.A. Cohen & D. Dennett, Consciousness cannot be separated from
function , Trends in Cognitive Sciences, 15, 2011, p. 358-363.
43. D. Smithies, Attention is rational-access consciousness , in C. Mole, D.
Smithies & W. Wu (d.), Attention : Philosophical and Psychological
Essays, Oxford University Press, 2011.
44. J. Ford, Attention and the new skeptics , Journal of Consciousness
Studies, vol. 15, 2008, p. 59-86.
45. L.M. Vargas, J.L. Voss & K.A. Paller, Implicit recognition based on
lateralized perceptual fluency , Brain Science, 2, 2012, p. 22-32 ; S.
Moldakarimov, M. Bazhenov & T. Sejnowski, Perceptual priming leads to
reduction of gamma frequency oscillations , PNAS, 107, 2010, p. 5640-
5645 ; S. Mayr & A. Buchner, Negative priming as a memory phenomenon :
A review of 20 years of negative priming research , Journal of Psychology,
215, 2007, p. 35-51.
46. Voir chapitre XIII.
47. Voir la fin du prsent chapitre.
48. N. Block, Perceptual consciousness overflows cognitive access ,
Trends in Cognitive Sciences, 15, 2011, p. 567-575.
49. M.A. Cohen & D. Dennett, Consciousness cannot be separated from
function , loc. cit.
50. D. Dennett, Sweet Dreams, op. cit., p. 23.
51. E. Schwitzgebel, Perplexities of Consciousness, op. cit.
52. J. Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the
Bicameral Mind, Houghton Mifflin, 1976, p. 23.
53. B. Van Fraassen, The Empirical Stance, Yale University Press, 2002.
54. Voir chapitre XII.
55. Cest la question de la validit du rcit introspectif, traite au chapitre XIII.
56. J.-C. Lleu, P. Hamm, L. Jouffroy, J. Lleu, G. Hartmann, R. Lupescu & L.
Pain, Hypnose en anesthsie : des origines nos jours , Le Praticien en
anesthsie-ranimation, 13, 2009, p. 145-150.
57. A. Gopnik, Le Bb philosophe, op. cit., p. 168.
58. Ibid., p. 176.
59. Des phnomnes de fausses mmoires peuvent bien sr se produire, dans
ce travail de mise au jour de segments gars de rcits comme dans bien
dautres cas ; mais ils sont lexception plutt que la rgle.
60. B. Libet, E.W. Wright, B. Feinstein & D.K. Pearl, Subjective referral of
the timing for a conscious sensory experience : A functional role for the
somatosensory specific projection system in man , Brain, 102, 1979, p. 191-
222.
61. B. Libet, Do we have free will ? , Journal of Consciousness Studies,
vol. 6, 1999, p. 47-57.
62. D. Dennett, Freedom Evolves, Viking, 2003, p. 228.
63. B. Libet, Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will
in voluntary action , The Behavioral and Brain Sciences, 8, 1985, p. 529-
538.
64. Il sagit en fait dun spot lumineux tournant rapidement.
65. M. Hallett, Volitional control of movement : The physiology of free
will , Clinical Neurophysiology, 118, 2007, p. 1179-1192 ; L. Schneider, E.
Houdayer, O. Bai & M. Hallett, What we think before a voluntary
movement , Journal of Cognitive Neuroscience, 25, 2013, p. 822-829.
66. S.A. Spence, Free will in the light of neuropsychiatry , Philosophy,
Psychiatry, & Psychology, 3, 1996, p. 75-90 ; D. Wegner, The Illusion of
Conscious Will, MIT Press, 2003.
67. M. Velmans, Preconscious free will , Journal of Consciousness
Studies, vol. 10, 2003, p. 42-61.
68. D. Dennett & M. Kinsbourne, Time and the observer : The where and
when of consciousness in the brain , The Behavioral and Brain Sciences, 15,
1992, p. 183-247.
69. R.J. Nelson, Libets dualism , The Behavioral and Brain Sciences, 8,
1985, p. 550 ; C.W. Wood, Pardon, your dualism is showing , The
Behavioral and Brain Sciences, 8, 1985, p. 557-558.
70. A.C. Danto, Consciousness and motor control , The Behavioral and
Brain Sciences, 8, 1985, p. 540-541.
71. H. Radder & G. Meynen, Does the brain initiate freely willed
processes ? A philosophy of science critique of Libet-type experiments and
their interpretation , Theory & Psychology, 23, 2013, p. 3-21.
72. B. Libet, Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will
in voluntary action , loc. cit.
73. C.S. Soon, M. Brass, H.-J. Heinze & J.-D. Haynes, Unconscious
determinants of free decisions in the human brain , Nature Neuroscience, 11,
2008, p. 543-545.
74. J. Trevena & J. Miller, Cortical movement preparation before and after
a conscious decision to move , Consciousness and Cognition, 11, 2002,
p. 162-190.
75. S. Bode, A. Hanxi He, C.S. Soon, R. Trampe & J.-D. Haynes, Tracking
the unconscious generation of free decisions using ultra-high field fMRI ,
PLOS ONE, 6, e21612, 2011.
76. A. Schurgera, J.D. Sitta & S. Dehaene, An accumulator model for
spontaneous neural activity prior to self-initiated movement , PNAS, 109,
E2904-E2913, 2012.
77. I. Fried, R. Mukamel & G. Kreiman, Internally generated preactivation
of single neurons in human medial frontal cortex predicts volition , Neuron,
69, 2011, p. 548-562.
78. M. Desmurget, Searching for the neural correlates of conscious
intention , Journal of Cognitive Neuroscience, 25, 2013, p. 830-833.
79. R. Descartes, Discours de la mthode, V, Gallimard, 2009, p. 120.
80. M. Desmurget, Searching for the neural correlates of conscious
intention , loc. cit.
81. D. Dennett, Freedom Evolves, op. cit., p. 239.
82. B. Spinoza, thique, I, op. cit., p. 60, explication VII.
83. S.G. Morris, The impact of neuroscience on the free will debate ,
Florida Philosophical Review, IX, 2009, p. 56-78.
84. I. Kant, Fondements de la mtaphysique des murs, Vrin, 1992, p. 129,
AK IV, 448.
85. En vitant en particulier de soutenir la dichotomie kantienne entre libert
noumnale et dtermination phnomnale. Voir I. Kant, Critique de la raison
pratique, PUF, 1989, p. 4, AK V, 6.
86. K.D. Vohs & J.W. Schooler, The value of believing in free will :
Encouraging a belief in determinism increases cheating , Psychological
Science, 19, 2008, p. 49-54.
87. Simplicius, Catgories, 352, 24, cit par S. Sambursky & S. Pines, The
Concept of Time in Late Neoplatonism, Israel Academy of Science and
Humanities, 1971. Voir galement R. Sorabji, Time, Creation, and the
Continuum, Duckworth, 1983.
88. E. Husserl, Exprience et Jugement, op. cit.
89. B. Mangan, Cognition, fringe consciousness, and the legacy of William
James , in M. Velmans & S. Schneider (d.), The Blackwell Companion to
Consciousness, Blackwell, 2007.
90. I. Hacking, Rewriting the Soul : Multiple Personalities and the Science
of Memory, Princeton University Press, 1998.
91. Voir lusage thorique quen fait Pierre Vermersch pour justifier le
processus de lentretien dexplicitation. P. Vermersch, Explicitation et
Phnomnologie, PUF, 2012.
92. E. Husserl, De la synthse passive, introduction de B. Bgout & N.
Depraz, Jrme Millon, 1998, p. 13.
93. Ibid., p. 38.
94. Ibid., p. 39.
95. Ibid., p. 37-38.
96. Cette expression voque intentionnellement louvrage de Paul Ricur,
Temps et Rcit I, Seuil, 1983.
Notes
1. L. Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun, op. cit., p. 34-35.
2. M. Merleau-Ponty, La Structure du comportement, PUF, 1990, p. 234-235.
3. L. Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun, op. cit., p. 34.
4. Ibid., p. 36.
5. Ibid., p. 38.
6. J. Kim, Philosophy of Mind, op. cit. Voir chapitre VIII.
7. M. Merleau-Ponty, La Structure du comportement, op. cit., p. 234-235.
8. B.J. Baars, The global brainweb : An update on global workspace
theory , Science and Consciousness Review, 2003, www.sci-
con.org/editorials/20031002.html.
9. M. Merleau-Ponty, La Structure du comportement, op. cit., p. 234.
10. Ibid., p. 235.
11. Nous verrons un peu plus bas si le fait que la concomitance neuro-
exprientielle peut tre provoque et non pas seulement constate change cette
conclusion.
12. M. Merleau-Ponty, La Structure du comportement, op. cit., p. 234.
13. S. Edwards, S. Richmond & G. Rees, I Know What You Are Thinking :
Brain Imaging and Mental Privacy, Oxford University Press, 2012.
14. P. Ekman, Emotions Revealed, Holt Paperbacks, 2007.
15. C.S. Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. 1-6,
Harvard University Press, 1931-1935 ; C.S. Peirce, Grand logic, the art of
reasoning. Chapter II : What is a sign ? , On signs. Ground, object, and
interpretant , in Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. 2 ; T.L.
Short, Peirces Theory of Signs, Cambridge University Press, 2007.
16. J. Petitot, Neurogomtrie de la vision, ditions de lcole
Polytechnique, 2009 ; A. Sarti, G. Citti & J.Petitot, The symplectic structure
of the primary visual cortex , Biological Cybernetics, 98, 2008, p. 33-48.
17. J.-P. Lachaux, If no control, then what ? Making sense of neural noise
in human brain mapping experiments using first-person reports , Journal of
Consciousness Studies, vol. 18, 2011, p. 162-166.
18. E. de Saint-Aubert, Le mystre de la chair. Merleau-Ponty et Gabriel
Marcel , Studia Phaenomenologica (Romanian Journal for
Phenomenology, Bucarest), III, 2003, p. 73-106 ; E. de Saint-Aubert, Vers
une ontologie indirecte : sources et enjeux critiques de lappel lontologie
chez Merleau-Ponty, Vrin, 2006.
19. E. Husserl, Mditations cartsiennes, op. cit., p. 159, 44. Voir
galement E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie. Livre
second : Recherches phnomnologiques pour la constitution, PUF, 1982,
p. 206.
20. Voir : M. Richir, Altrit et incarnation. Phnomnologie de Husserl ,
Revue de Mdecine Psychosomatique, n
o
30/31, 1992, p. 63-74 ; J.
Rogozinski, Le chiasme et le restant (la phnomnologie franaise au contact
de lintouchable) , Rue Descartes, 35, 2002, p. 125-144 ; J. Rogozinski, Le
Moi et la Chair, introduction lego-analyse, Cerf, 2006 ; S. Gallagher,
How the Body Shapes the Mind, Oxford University Press, 2006 ; D. Zahavi,
Subjectivity and Selfhood : Investigating the First-Person Perspective,
Bradford Books, 2006.
21. V. Janklvitch, Le je-ne-sais-quoi et le presque rien, PUF, 1957, p. 219.
22. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie. Livre second,
op. cit., p. 209.
23. Ibid., p. 207.
24. Ibid., p. 214-215, 221.
25. M. Henry, Incarnation, Seuil, 2000, p. 222.
26. J. Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy, Galile, 2000.
27. M. Merleau-Ponty, Le Visible et lInvisible, op. cit., p. 191.
28. Ibid., p. 78.
29. Ibid., p. 79, 106.
30. M. Merleau-Ponty, Lil et lEsprit, Gallimard, 1964, p. 19.
31. L. Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun, op. cit., p. 35.
32. R.C. DeCharms, F. Maeda, G.H. Glover, D. Ludlow, J.M. Pauly,
D. Soneji, J.D.E. Gabrieli & S.C. Mackey, Control over brain activation and
pain learned by using real-time functional MRI , PNAS, 102, 2005, p. 18626-
18631.
33. J.-Ph. Lachaux, K. Jerbi, O. Bertrand, L. Minotti, D. Hoffmann,
B. Schoendorff & P. Kahane, A blueprint for real-time functional mapping
via human intracranial recordings , PLOS ONE, 10, e1094, 2007 ; J. Jung, D.
Bayle, K. Jerbi, J.R. Vidal, M.-A. Hnaff, T. Ossandon, O. Bertrand,
F. Mauguire & J.-Ph. Lachaux, Intracerebral gamma modulations reveal
interaction between emotional processing and action outcome evaluation in the
human orbitofrontal cortex , International Journal of Psychophysiology, 79,
2011, p. 64-72.
34. J. Patoka, Le Monde naturel et le mouvement de lexistence humaine,
Kluwer, 1988, p. 106. Cit et comment par R. Barbaras, Introduction une
phnomnologie de la vie, op. cit., p. 108.
35. J.S. Mill, System of Logic, vol. 1, John W. Parker, 1851. Cit et comment
par T. Rockwell, A defense of downward causation ,
http://www.california.com/~mcmf/causeweb.html. Voir aussi H.H. Pattee,
Causation, control, and the evolution of complexity , in P.B. Andersen, C.
Emmeche, N.O. Finneman & P.V. Christiansen (d.), Downward Causation,
Minds, Bodies, and Matter, Aarhus University Press, 2000.
36. G.H. Von Wright, Causality and Determinism, Columbia University
Press, 1974.
37. H. Price, Agency and causal asymmetry , Mind, 101, 1992, p. 501-
520 ; P. Menzies & H. Price, Causation as a secondary quality , British
Journal for the Philosophy of Science, 44, 1993, p. 187-204 ; J. Woodward,
Making Things Happen, a Theory of Causal Explanation, Oxford University
Press, 2003 ; D. Gillies, An action-related theory of causality , British
Journal for the Philosophy of Science, 56, 2005, p. 823-842.
38. Causa quella, la qual posta, seguita leffetto ; e rimossa, si rimuove
leffetto . G. Galilei, Discorso intorno alle cose che stanno in su laqua o
che in quella si muovono, 1612, in G. Galilei, Opere I, U.T.E.T., 1980,
p. 425, notes prliminaires aux tudes dhydrostatique. Voir S. Ducheyne,
Galileos interventionist notion of cause , The Journal of the History of
Ideas, 67, 2006, p. 443-464 ; S. Drake, Cause, Experiment and Science, The
University of Chicago Press, 1984, p. 217.
39. A. Lutz, J.D. Dunne & R.J. Davidson, Meditation and the neuroscience
of consciousness, an introduction , loc. cit.
40. J. Kabat-Zinn, A.O. Massion, J. Kristeller, L.G. Peterson, K.E. Fletcher,
L. Pbert, W.R. Landerking & S.F. Santorelli, Effectiveness of a meditation-
based stress-reduction program in the treatment of anxiety disorders ,
American Journal of Psychiatry, 149, 1992, p. 936-943.
41. B.K. Hlzel, J. Carmody, M. Vangel, C. Congleton, S.M. Yeramsetti, T.
Gard & W. Lazar, Mindfulness practice leads to increases in regional brain
grey matter density , Psychiatry Research, 191, 2011, p. 36-43.
42. M. Bitbol, Downward causation without foundations , Synthese, 185,
2012, p. 233-255.
43. I. Kant, Critique de la facult de juger, op. cit., p. 335, 65 AK V, 372.
Une erreur de traduction a t corrige (mot entre crochets). Voir P. Huneman,
Mtaphysique et Biologie. Kant et la constitution du concept dorganisme,
Kim, 2008 ; N. Perret, A symmetrical approach to causality in biology ,
Philosophia Scientiae, 16, 2012, p. 177-195.
44. I. Kant, Critique de la facult de juger, op. cit., p. 338, 65, AK V, 374.
45. A. Weber & F.J. Varela, Life After Kant , Phenomenology and the
Cognitive Sciences, 1, 2002, p. 97-125.
46. M. Heidegger, Introduction la mtaphysique, Gallimard, 1967, p. 24-
25.
47. P. Sloterdijk, La Mobilisation infinie, Seuil, 2003.
48. J.-A. Micoulaud-Franchi, F. Bat-Pitault, M. Cermolacce & J. Vion-Dury,
Neurofeedback dans le trouble dficit de lattention avec hyperactivit : de
lefficacit la spcificit de leffet neurophysiologique , Annales mdico-
psychologiques, 169, 2011, p. 200-208.
49. J.-P. Lachaux, If no control, then what ? Making sense of neural noise
in human brain mapping experiments using first-person reports , loc. cit. ; S.
Aguilar-Prinsloo & R. Lyle, Client perception of the neurofeedback
experience : The untold perspective , Journal of Neurotherapy, 14, 2010,
p. 55-60.
50. L. Coutinho Da Silva, Pour un discours sensible sur la capacit
cognitive du corps dans lexprience de lart, thse de luniversit Paris-I,
2012.
51. C. Eslava Sarmiento, Pepe Cocolo , texte indit de 2005. Je remercie
ici Camila Eslava Sarmiento pour ses commentaires clairants propos de
son travail dartiste, lors dun expos la journe dtudes doctorales que jai
organise en mars 2011 au CREA de lcole Polytechnique. Cette modalit
intgre de la conception artistique, dans laquelle le processus crateur se fait
organique, dborde de loin le cadre triqu de la neuroesthtique o un
organe est cens dterminer la cration. Pour une critique de la
neuroesthtique, voir F. Vidal, La neuroesthtique, une esthtique
scientiste , Revue dhistoire des sciences humaines, 25, 2011, p. 239-264.
52. M. Merleau-Ponty, Le Visible et lInvisible, op. cit., p. 182.
53. R. Barbaras, De ltre du phnomne : sur lontologie de Merleau-
Ponty, Jrme Millon, 1991, p. 184, 187.
54. Voir chapitre VII, au sujet de la position de Max Velmans.
55. M. Merleau-Ponty, Le Visible et lInvisible, op. cit., p. 185.
56. Ibid., p. 173.
57. C. Petitmengin, Towards the source of thoughts. The gestural and
transmodal dimension of lived experience , Journal of Consciousness
Studies, vol. 14, 2007, p. 54-82.
58. M. Bitbol, Le chercheur, le philosophe et la psychasthnie , Alliage, 5,
1990, p. 19-24.
59. H. Werner, Lunit des sens , Journal de psychologie normale et
pathologique, 31, 1934, p. 190-205.
60. C. Petitmengin, M. Bitbol, J.-M. Nissou, B. Pachoud, H. Curallucci,
M. Cermolacce & J. Vion-Dury, Listening from within , Journal of
Consciousness Studies, vol. 16, 2009, p. 252-284.
61. M. Haar, Proximit et distance vis--vis de Heidegger chez le dernier
Merleau-Ponty , in R. Barbaras (d.), Recherches sur la phnomnologie de
Merleau-Ponty, prcd de M. Merleau-Ponty, Notes de cours sur lorigine
de la gomtrie de Husserl, PUF, 1998, p. 141.
62. M. Henry, Incarnation, op. cit., p. 166.
63. M. Henry, Incarnation, op. cit., p. 165.
64. Ibid., p. 167
65. M. Merleau-Ponty, Le Visible et lInvisible, op. cit., p. 209.
66. M. Henry, Incarnation, op. cit., p. 164-165.
67. M. Merleau-Ponty, Le Visible et lInvisible, op. cit., p. 172.
68. M. Henry, Phnomnologie matrielle, PUF, 1990 ; G. Dufour-Kowalska,
Michel Henry. Passion et magnificence de la vie, Beauchesne, 2003.
69. M. Henry, Incarnation, op. cit., p. 226.
70. E. Husserl, La Crise des sciences europennes et la phnomnologie
transcendantale, op. cit., p. 57.
71. Voir par exemple E. Thompson, Representationalism and the
phenomenology of mental imagery , Synthese, 160, 2008, p. 397-415.
72. Voir chapitre V.
73. E. Thompson & M. Stapleton, Making sense of sense-making : A
reflection on enactive and extended mind theories , Topoi, 28, 2009, p. 23-
30.
74. C. Adam & P. Tannery (d.), uvres de Descartes, IX, op. cit., p. 13,
22 ; voir A. Bitbol-Hespris, Le Principe de vie chez Descartes, Vrin, 1990,
p. 102.
Notes
1. Ce chapitre drive en partie dune srie darticles sur lintrospection
rdigs en collaboration avec Claire Petitmengin. C. Petitmengin & M. Bitbol,
The validity of first-person descriptions as authenticity and coherence ,
Journal of Consciousness Studies, vol. 16, 2009, p. 363-404 ; M. Bitbol & C.
Petitmengin, A defense of introspection from within , Constructivist
Foundations, 8, 2013, p. 269-279 ; M. Bitbol & C. Petitmengin, On the
possibility and reality of introspection , Kairos, 6, 2013, p. 173-198.
2. D. Fisette, Logique et philosophie chez Frege et Husserl , in R. Brisart
(d.), Husserl et Frege : les ambiguts de lantipsychologisme, Vrin, 2002,
p. 57.
3. R.T. Hurlburt & E. Schwitzgebel, Describing Inner Experience ?
Proponent Meets Skeptic, MIT Press, 2007.
4. J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Oxford University
Press, 1975.
5. D. Hume, A Treatise of Human Nature, Oxford University Press, 1978.
6. A.J. Ayer, Language, Truth, and Logic, Gollancz, 1936-1946.
7. E. Husserl, Mditations cartsiennes, op. cit., p. 58.
8. T. Horgan & U. Kriegel, Phenomenal epistemology : What is
consciousness that we may know it so well ? , Philosophical Issues, 17,
2007, p. 123-144.
9. Ces jugements sont censs tre auto-ralisateurs au sens o les
fameuses prophties auto-ralisatrices le sont : ils suscitent (dans
lexprience) ce quils affirment (sur lexprience). D. Chalmers, The
content and epistemology of phenomenal belief , in Q. Smith & A. Jokic
(d.), Consciousness : New Philosophical Perspectives, Oxford University
Press, 2003 ; M. Tye, Consciousness Revisited, MIT Press, 2009.
10. D. Bar-On, Speaking My Mind, Oxford University Press, 2004.
11. D. Dennett, How could I be wrong ? How wrong could I be ? , Journal
of Consciousness Studies, vol. 9, 2002, p. 13-16.
12. T.D. Wilson & E.W. Dunn, Self-knowledge : Its limits, value, and
potential for improvement , Annual Review of Psychology, 55, 2004, p. 493-
518.
13. P.M. Merickle, D. Smilek & J.D. Eastwood, Perception without
awareness : Perspectives from cognitive psychology , Cognition, 79, 2001,
p. 115-134 ; M. Becker & H. Pashler, Volatile visual representations :
Failing to detect changes in recently processed information , Psychonomic
bulletin & review, 9, 2002, p. 744-750.
14. R.E. Nisbett & T.D. Wilson, Telling more than we can know : Verbal
reports on mental processes , Psychological Review, 84, 1977, p. 231-259.
15. E. Schwitzgebel, Perplexities in Consciousness, MIT Press, 2011.
16. J. Prinz, The fractionation of introspection , Journal of Consciousness
Studies, vol. 11, 2004, p. 40-57.
17. E. Husserl, Mditations cartsiennes, op. cit., p. 50, 58.
18. W. Lyons, The Disappearance of Introspection, MIT Press, 1986 ;
K. Danziger, Constructing the Subject, Historical Origins of Psychological
Research, Cambridge University Press, 1994 ; A. Costall,
Introspectionism and the mythical origins of scientific psychology ,
Consciousness and Cognition, 15, 2006, p. 634-654.
19. E.G. Boring, A history of introspection , Psychological Bulletin, 50,
1953, p. 169-189.
20. K.A. Ericsson & H.A. Simon, Protocol Analysis, Verbal Reports as Data,
MIT Press, 1984.
21. P. Vermersch, LEntretien dexplicitation, ESF, 1994 ; N. Depraz,
F. Varela & P. Vermersch, On Becoming Aware, John Benjamins, 2003
(version franaise : lpreuve de lexprience, Zeta Books, 2011) ; R.T.
Hurlburt & C.L. Heavey, Exploring Inner Experience, John Benjamins,
2006 ; J. Hektner, J.A. Schmidt, & M. Csikszentmihalyi, Experience Sampling
Method, Sage, 2007 ; L.F. Barrett, B. Mesquita, K.N. Ochsner & J.J. Gross,
The experience of emotion , Annual Review of Psychology, 58, 2007,
p. 373-403 ; S. Marti, J. Sackur, M. Sigman & S. Dehaene, Mapping
introspections blind spot : Reconstruction of dual-task phenomenology using
quantified introspection , Cognition, 115, 2010, p. 303-313.
22. D.D. Price & J.J. Barrell, Inner Experience and Neurosciences :
Merging Both Perspectives, MIT Press, 2012 ; D. Rudrauf, A. Lutz, D.
Cosmelli, J.-P. Lachaux & M. Le Van Quyen, From autopoiesis to
neurophenomenology : Francisco Varelas exploration of the biophysics of
being , loc. cit.
23. J.-P. Lachaux, If no control, then what ? Making sense of neural noise
in human brain mapping experiments using first-person reports , loc. cit.
24. Il sagit de la mthode dentretien dexplicitation, dveloppe par P.
Vermersch et C. Petitmengin. Quelques dtails sur cette mthode seront
donns au cours de ce chapitre, essentiellement dans ses derniers paragraphes.
25. P. Vermersch, Introspection as practice , Journal of Consciousness
Studies, vol. 6, 1999, p. 15-42 ; C. Petitmengin & M. Bitbol, The validity of
first-person descriptions as authenticity and coherence , Journal of
Consciousness Studies, loc. cit. ; M. Bitbol & C. Petitmengin, On the
possibility and reality of introspection , loc. cit.
26. Platon, Charmide, in uvres compltes, t. II, Gallimard, 1956, p. 70, 167
d. Un remarquable commentaire se trouve dans : F. Roustang, Le Secret de
Socrate pour changer la vie, Odile Jacob, 2009.
27. A. Comte, Examen du trait de Broussais sur lirritation, in Corpus, 7,
1988, p. 87-99. Voir galement F. Wilson, Mill and Comte on the method of
introspection , Journal of the History of the Behavioral Sciences, 27, 1991,
p. 107-129.
28. W. James, The Principles of Psychology, Holt, 1890, p. 244.
29. G.W. Leibniz, Nouveaux essais sur lentendement humain, livre II,
Flammarion, 1993, chapitre I, 19.
30. H. Hffding, The Problems of Philosophy, The MacMillan Company,
1905.
31. M. Ten Hoor, A critical analysis of the concept of introspection , The
Journal of Philosophy, 29, 1932, p. 322-331.
32. N. Bohr, La Thorie atomique et la description des phnomnes,
Gauthier-Villars, 1932.
33. M. Overgaard, M. Koivisto, T.A. Srensen, S. Vangkilde, A. Revonsuo,
The electrophysiology of introspection , Consciousness and Cognition, 15,
2006, p. 662-672.
34. A. Marcel, Introspective report , Journal of Consciousness Studies,
vol. 10, 2003, p. 167-186.
35. Voir A. Schnell, Husserl et les Fondements de la phnomnologie
constructive, Jrme Millon, 2007, p. 49.
36. P. Natorp, Psychologie gnrale selon la mthode critique, Vrin, 2008.
37. Ibid., p. 130.
38. W. Wundt, Lectures on Human and Animal Psychology, Swan
Sonnenshein & Co., 1901.
39. E.B. Titchener, The schema of introspection , American Journal of
Psychology, 23, 1912, p. 485-508.
40. E.B. Titchener, A Textbook of Psychology, MacMillan, 1916, 6.
41. F. Brentano, Psychologie du point de vue empirique, Aubier, 1944.
42. E. Husserl, Recherches logiques VI, PUF, 1974, p. 269 ; E. Husserl,
Mditations cartsiennes, op. cit., p. 64 : les rflexions [] sont elles-
mmes des actes perceptifs dun ordre nouveau .
43. W. Wundt, Lectures on Human and Animal Psychology, op. cit.
44. E. Titchener, Experimental Psychology : A Manual of Laboratory
Practice, MacMillan, 1901/1905 ; E. Schwitzgebel, Introspective training
apprehensively defended : Reflections on Titcheners lab manual , Journal
of Consciousness Studies, vol. 11, 2004, p. 58-76.
45. E.B. Titchener, A Textbook of Psychology, op. cit.
46. E. Husserl, De la rduction phnomnologique, op. cit., p. 11.
47. B. Mangan, Cognition, fringe consciousness, and the legacy of William
James , in M. Velmans & S. Schneider (d.), The Blackwell Companion to
Consciousness, Blackwell, 2007.
48. A. Flajoliet, Husserl et Messer , Expliciter. Journal de lassociation
GREX, 66, 2006, p. 1-32 ; J.-P. Sartre, Ltre et le Nant, op. cit., p. 19.
49. P. Vermersch, Husserl the great unrecognized psychologist ! A reply to
Zahavi , Journal of Consciousness Studies, vol. 18, 2011, p. 20-23 ; P.
Vermersch, Explicitation et Phnomnologie, op. cit.
50. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie et une
philosophie phnomnologique pures, op. cit., p. 259.
51. J.-L. Marion, La Rigueur des choses. Entretiens avec Dan Arbib,
Flammarion, 2012, p. 141.
52. J.-L. Marion, tant donn, PUF, 1997.
53. G. Ten Elshof, Introspection Vindicated : An Essay in Defense of the
Perceptual Model of Self Knowledge, Ashgate, 2005.
54. J. Sackur, Lintrospection en psychologie exprimentale , Revue
dhistoire des sciences, 62, 2009, p. 5-28.
55. C. Petitmengin & M. Bitbol, The validity of first-person descriptions as
authenticity and coherence , Journal of Consciousness Studies, op. cit. ; M.
Bitbol & C. Petitmengin, On pure reflection (a reply to Dan Zahavi) ,
Journal of Consciousness Studies, vol. 18, 2011, p. 24-37.
56. P. Vermersch, LEntretien dexplicitation, op. cit. ; N. Depraz, F. Varela
& P. Vermersch, On Becoming Aware, op. cit. ; C. Petitmengin, Describing
ones subjective experience in the second person : An interview method for
the science of consciousness , Phenomenology and the Cognitive Science, 5,
2006, p. 229-269 ; C. Petitmengin, M. Bitbol, J.-M. Nissou, B. Pachoud, H.
Curallucci, M. Cermolacce & J. Vion-Dury, Listening from within ,
Journal of Consciousness Studies, vol. 16, 2009, p. 252-284 ; M. Bitbol &
C. Petitmengin, A defense of introspection from within , loc. cit.
57. R.T. Hurlburt & C.L. Heavey, Exploring Inner Experience, op. cit.
58. D. Hume, A Treatise of Human Nature , Oxford University Press, 1978,
introduction.
59. I. Kant, Premiers Principes mtaphysiques de la science de la nature,
Vrin, 1982, introduction.
60. L. Wittgenstein, Remarques philosophiques, Gallimard, 1984, p. 80 et
suiv.
61. A. Gopnik & A.N. Meltzoff, Minds, bodies and persons : Young
childrens understanding of the self and others as reflected in imitation and
theory of mind research , in S. Parker & R. Mitchell (d.), Self-Awareness
in Animals and Humans, Cambridge University Press, 1994 ; P. Robbins,
Knowing me, knowing you. Theory of mind and the machinery of
introspection , Journal of Consciousness Studies, vol. 11, 2004, p. 129-143.
62. R.E. Nisbett & T.D. Wilson, Telling more than we can know : Verbal
reports on mental processes , loc. cit.
63. J.L. Garfield, The myth of Jones and the mirror of nature : Reflections on
introspection , Philosophy and Phenomenological Research, 50, 1989, p. 1-
26.
64. A. Jack & A. Roepstorff, The measurement problem for experience :
Damaging flaw or intriguing puzzle ? , Trends in Cognitive Sciences, 6,
2002, p. 372-374.
65. M. Bitbol, Mcanique quantique : une introduction philosophique,
Flammarion, 1997.
66. A. Jack & A. Roepstorff, The measurement problem for experience :
Damaging flaw or intriguing puzzle ? , loc. cit. ; M. Bitbol, Physique et
Philosophie de lesprit, op. cit., p. 266.
67. E. Husserl, Ides directrices pour une phnomnologie, op. cit., 79.
68. B. Shanon, The case for introspection , Cognition and Brain Theory, 7,
1984, p. 167-180.
69. E.B. Titchener, The schema of introspection , American Journal of
Psychology, 23, 1912, p. 485-508 ; E. Schwitzgebel, Introspective training
apprehensively defended : Reflections on Titcheners lab manual , Journal
of Consciousness Studies, vol. 11, 2004, p. 58-76.
70. M. Silverman & A. Mack, Change blindness and priming : When it does
and does not occur , Consciousness and Cognition, 15, 2006, p. 409-422.
71. E.G. Boring, A History of Experimental Psychology, Appleton-Century-
Croft, 1929, in C. Skinner, Readings in Psychology, Farrart & Rinehart,
1935, p. 33.
72. Cette limitation extrme de lenqutre introspective au sens de Wundt a
cependant trs vite t conteste, en particulier par le psychologue franais
Alfred Binet. Celui-ci soulignait quel point les descriptions verbales
dexpriences taient utiles pour dsintriquer certains vnements faussement
considrs comme lmentaires au laboratoire de Wundt. A. Binet,
Ltude exprimentale de lintelligence, Costes, 1903.
73. W. Wundt, Lectures on Human and Animal Psychology, Swan
Sonnenshein & Co., 1901, p. 31.
74. G. Corallo, J. Sackur, S. Dehaene & M. Sigman, Limits on introspection.
Distorted subjective time during the dual-task bottleneck , Psychological
Science, 19, 2008, p. 1110-1117.
75. G. Sperling, The information available in brief visual presentations ,
Psychological Monographs, 74 (9), 1960, p. 1-29. Une discussion
approfondie de cet article est propose dans : J. Sackur, Lintrospection en
psychologie exprimentale , Revue dhistoire des sciences, 62, 2009, p. 5-
28.
76. D. Dennett, Consciousness Explained, op. cit.
77. N. Block, Perceptual consciousness overflows cognitive access ,
loc. cit.
78. S. Kouider, V. de Gardelle, J. Sackur & E. Dupoux, How rich is
consciousness ? The partial awareness hypothesis , Trends in Cognitive
Sciences, 14, 2010, p. 301-307.
79. D. Soto, T. Mntil & J. Silvanto, Working memory without
consciousness , Current Biology, 21, 2011, R912-R913. Cette mmoire
qualifie de la plus vraisemblablement inconsciente est celle qui ne parat
rapportable dans aucune circonstance, mais qui reste capable daltrer les
choix ultrieurs. Le caractre inconscient de la mmoire en question est
toutefois suspendu, lui aussi, de futures volutions des moyens de susciter
des rapports verbaux.
80. R.W. Kentridge, Visual attention : Bringing the unseen past into view ,
Current Biology, 23, 2013, R69-R71 ; J. Meuwese, R. Post, S. Scholte & V.
Lamme, Does perceptual learning require consciousness or attention ? ,
Journal of Cognitive Neuroscience, DOI 10.1162/jocn_a_00424, 2013.
81. N. Block, Perceptual consciousness overflows cognitive access ,
loc. cit. ; N. Block, Response to Kouider et al. : Which view is better
supported by the evidence ? , Trends in Cognitive Sciences, 16, 2012,
p. 141-142.
82. S. Kouider, J. Sackur & V. de Gardelle, Do we still need phenomenal
consciousness ? Comment on Block , Trends in Cognitive Sciences, 16,
2012, p. 140-141 ; M.A. Cohen & D. Dennett, Consciousness cannot be
separated from function , loc. cit.
83. R.E. Nisbett & T.D. Wilson, Telling more than we can know : Verbal
reports on mental processes , Psychological Review, 84, 1977, p. 231-259.
84. R.E. Nisbett & T.D. Wilson, The halo effect : Evidence for unconscious
alteration of judgment , Journal of Personality and Social Psychology, 35,
1977, p. 250-256.
85. R.E. Nisbett & T.D. Wilson, Telling more than we can know : Verbal
reports on mental processes , loc. cit.
86. R.S. Woodworth, Imageless thought , The Journal of Philosophy,
Psychology and Scientific Methods, 3, 1906, p. 701-708 ; R.M. Ogden,
Imageless thought : Resume and critique , Psychological Bulletin, 8, 1911,
p. 194.
87. E.B. Titchener, The schema of introspection , loc. cit.
88. E.B. Titchener, Lectures on the Experimental Psychology of Thought
Processes, MacMillan, 1909.
89. G. Humphrey, Thinking, Methuen, 1951 ; D. Brett King & M. Wertheimer,
Max Wertheimer and Gestalt Theory, Transaction Publishers, 2007.
90. E.A. Nahmias, Verbal reports on the contents of consciousness :
Reconsidering introspectionist methodology , Psyche, 8 (21), 2002.
91. K. Danziger, The history of introspection reconsidered , Journal of the
History of the Behavioral Sciences, 16, 1980, p. 241-262.
92. E. Schwitzgebel, Perplexities of Consciousness, op. cit., p. 35 et suiv.
93. R.T. Hurlburt & C.L. Heavey, Telling what we know : Describing inner
experience , Trends in Cognitive Sciences, 5, 2001, p. 400-403 ; A.I.
Goldman, Epistemology and the evidential status of introspective reports ,
in A. Jack & A. Roepstorff (d.), Trusting the subject ?, Imprint Academic,
2001.
94. E.B. Titchener, A Textbook of Psychology, op. cit., p. 505-506.
95. E. Gendlin, Experiencing and the Creation of Meaning, Northwestern
University Press, 1962.
96. B.A. Wallace, The Taboo of Subjectivity : Towards a New Science of
Consciousness, Oxford University Press, 2000.
97. P. Vermersch, LEntretien dexplicitation, op. cit. ; C. Petitmengin,
Describing ones subjective experience in the second person : An interview
method for the science of consciousness , loc. cit. ; M. Hendricks,
Experiencing level : An instance of developing a variable from a first
person process so it can be reliably measured and taught , Journal of
Consciousness Studies, vol. 16, 2009, p. 129-155.
98. J.-A. Micoulaud-Franchi, communication prive.
99. W.A. Tiller, R. McCraty & M. Atkinson, Cardiac coherence : A new,
noninvasive measure of autonomic nervous system order , Alternative
Therapies, 2, 1996, p. 52-65.
100. Un dveloppement sur ce thme peut tre trouv dans M. Bitbol, De
lintrieur du monde. Pour une philosophie et une science des relations,
op. cit., introduction, chapitre III et chapitre VII.
101. D.C. Gooding, M. Gorman, R. Tweney & A. Kincannon (d.), Scientific
and Technological Thinking, Erlbaum, 2005 ; A. Pickering, The Mangle of
Practice, The University of Chicago Press, 1995.
102. B. Van Fraassen, Scientific Representation, Oxford University Press,
2008, p. 11.
103. B. Shanon, The Case for Introspection , loc. cit.
104. G. Piccinini, Data from introspective reports , Journal of
Consciousness Studies, vol. 10, 2003, p. 141-156 ; G. Piccinini, First-
person data, publicity, and self-measurement , Philosophers Imprint, 9,
2009.
105. M. Bitbol & C. Petitmengin, A defense of introspection from within ,
Constructivist Foundations, 8, 2013, p. 269-279.
106. Cit par B. Shanon, The case for introspection , loc. cit.
107. M. Bitbol, Physique et Philosophie de lesprit, Flammarion, 2000.
108. Ces circonstances sont celles o, entre la premire et la dernire mesure
rpte de la variable concerne, on nvalue que des squences
dobservables qui commutent.
109. B. dEspagnat, Trait de physique et de philosophie, Fayard, 2002 ; M.
Bitbol, Le corps matriel et lobjet de la physique quantique , in F.
Monnoyeur (d.), Quest-ce que la matire ?, op. cit.
110. B. Shanon, The case for introspection , loc. cit.
111. R.D. Laing, The Politics of Experience, Penguin Books, 1990, p. 44.
112. P. Vermersch, LEntretien dexplicitation, op. cit. ; C. Petitmengin,
Describing ones subjective experience in the second person : An interview
method for the science of consciousness , loc. cit.
113. Je remercie cette occasion Claire Petitmengin pour sa patience
pdagogique dans la pratique de lentretien dexplicitation, et pour les
multiples collaborations fructueuses et amicales que nous avons eues.
114. W. Buckner, E. Reese & R. Reese, Eye movement as an indicator of
sensory components in thought , Journal of Counseling Psychology, 34,
1997, p. 283-287 ; M. Hendricks, Experiencing level , Journal of
Consciousness Studies, vol. 16, 2009, p. 129-155.
115. Ibid.
116. C. Petitmengin, LExprience intuitive, LHarmattan, 2001 ; C.
Petitmengin, Describing ones subjective experience in the second person :
An interview method for the science of consciousness , loc. cit.
117. C. Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, Plon, 1958.
118. Quelques exemples de tableaux de catgories permettant de dgager une
structure intersubjectivement invariante de lexprience auditive se trouvent
dans : C. Petitmengin, M. Bitbol, J.-M. Nissou, B. Pachoud, H. Curallucci, M.
Cermolacce & J. Vion-Dury, Listening from within , Journal of
Consciousness Studies, vol. 16, 2009, p. 252-284 ; M. Bitbol & C.
Petitmengin, A defense of introspection from within , loc. cit.
119. C. Petitmengin & M. Bitbol, The validity of first-person descriptions as
authenticity and coherence , loc. cit.
120. M. Bitbol & C. Petitmengin, A defense of introspection from within ,
loc. cit.
121. A. Lutz, Towards a neurophenomenology as an account of generative
passages : A first empirical case study , Phenomenology and the Cognitive
Science, 1, 2002, p. 133-167 ; M. Le Van Quyen & C. Petitmengin, Neuronal
dynamics and conscious experience : An example of reciprocal causation
before epileptic seizures , Phenomenology and the Cognitive Sciences, 1,
2002, p. 169-180.
122. C. Petitmengin, A. Remillieux, B. Cahour & S. Thomas, A gap in
Nisbett and Wilson findings ? A first-person access to our cognitive
processes , Consciousness and Cognition, 22, 654-669, 2013.
123. R.E. Nisbett & T.D. Wilson, Telling more than we can know : Verbal
reports on mental processes , loc. cit.
124. P. Johansson, L. Hall, S. Sikstrm, B. Trning & A. Lind, How
something can be said about telling more than we can know : On choice
blindness and introspection , Consciousness and Cognition, 15, 2006,
p. 673-692.
125. P. Johansson, L. Hall, S. Sikstrm & A. Olsson, Failure to detect
mismatches between intention and outcome in a simple detection task ,
Science, 310, 2005, p. 116-119.
126. P. Johansson, L. Hall, S. Sikstrm, B. Trning & A. Lind, How
something can be said about telling more than we can know : On choice
blindness and introspection , loc. cit.
127. C. Petitmengin, A. Remillieux, B. Cahour & S. Thomas, A gap in
Nisbett and Wilson findings ? A first-person access to our cognitive
processes , loc. cit.
128. Ibid.
129. A. Jack, Introspection : The tipping point , Consciousness and
Cognition, 22, 2013, p. 670-671. Cet article est un commentaire du travail de
Petitmengin et collaborateurs, visant tirer des leons pour le statut
pistmique de lintrospection.
130. L. Binswanger, Analyse existentielle et Psychanalyse freudienne,
prface de Pierre Fdida, Gallimard, 1970, p. 43.
131. D. Zahavi, Varieties of reflection , Journal of Consciousness Studies,
vol. 18, 2011, p. 9-19.
132. L. Wittgenstein, Remarques sur la philosophie de la psychologie, TER,
1998, 122.
133. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phnomenologie und
phnomenologischen Philosophie. Drittes Buch : die Phnomenologie und
die Fundamente der Wissenschaften, Husserliana V, Martinus Nijhoff, 1952,
p. 124.
134. John Niemeyer Findlay, Pretoria, 1903-1987.
135. J.N. Findlay, Recommendations regarding the language of
introspection , Philosophy and Phenomenological Research, 9, 1948,
p. 212-236. Voir galement J.N. Findlay, Language, Mind and Value :
Philosophical Essays, Allen & Unwin, 1963.
136. Ibid.
Notes
1. F. Jullien, De luniversel, Fayard, 2008, p. 24-25.
2. L. Tolsto, Confession, Pygmalion, 1998, chapitre VI.
3. Horace, Odes, in H. Patin, uvres compltes dHorace, J.-J. Dubochet,
1845, I, 28, 15.
4. L. Jullier, Interdit aux moins de dix-huit ans : morale, sexe et violence au
cinma, Armand Colin, 2008 ; J.D. Slocum, Violence in American Cinema,
Routledge, 2000.
5. O. Mongin, La Violence des images. Essai sur les Passions
dmocratiques, t. II, Seuil, 1997.
6. A. Honneth, La Rification, Gallimard, 2007.
7. Une volution importante de la reprsentation de la mort au cinma est le
passage croissant de sa justification sa gratuit. Lencadrement de la mort
par des rgles biologiques et des crmonies sociales, par des faits de guerres
ou par des crimes dots dun mobile , est de plus en plus souvent remplac
par la reprsentation obsdante dune frnsie meurtrire (celle du tueur
gages ou du srial killer devenus hros au premier degr). O. Mongin, La
Violence des images, op. cit.
8. L. Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun, op. cit., p. 126 ;
S. Chauvier, Dire Je, Vrin, 2001, p. 173.
9. picure, Lettre Mnce, GF-Flammarion, 2009.
10. L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Gallimard, 1993,
p. 111, 6.4311.
11. A. Schopenhauer, Le Monde comme volont et comme reprsentation,
PUF, 1966, p. 357.
12. I. Kant, Critique de la raison pure, op. cit., p. 127, B48. Voir galement
la dfinition de Leibniz en 1702 : le Temps est lordre des possibilits
inconsistantes . C.I. Gerhardt (d.), Die Philosophischen Schriften von
Leibniz, t. 4, Weidmannsche Buchhandlung, 1875/1890, p. 568.
13. V. Janklvitch, La Mort, Flammarion, 1966. Voir galement L. Chestov,
Sur la balance de Job, Flammarion, 1971.
14. V. Janklvitch, La Mort, op. cit., p. 23.
15. Ibid.
16. Ibid., p. 221.
17. M. Hulin, La Face cache du temps, Fayard, 1985.
18. H. Broch, La Mort de Virgile, Gallimard, 1958.
19. Ibid., p. 206.
20. V. Janklvitch, La Mort, op. cit., p. 422 ; L. Tolsto, La Mort dIvan
Ilitch, GF-Flammarion, 1999.
21. P. Van Lommel, R. Van Wees, V. Meyers & I. Elfferich, Near-death
experience in survivors of cardiac arrest : A prospective study in the
Netherlands , The Lancet, 358, 2001, p. 2039-2045 ; C. Agrillo, Near-
death experience : Out-of-body and out-of-brain ? , Review of General
Psychology, 15, 2011, p. 1-10. Seuls cependant 20% environ des patients
ayant subi de brusques entres dans le coma font tat de telles expriences,
sans que lon puisse dire si les 80% restants ne les ont pas eues ou sils ne les
ont pas mmorises.
22. L.W. Bailey & J. Yates, The Near-Death Experience, a Reader,
Routledge, 1996.
23. Padmasambhava, Le Livre des morts tibtain, Buchet-Chastel, 2009 ;
J.W. Hayward & F. Varela (d.), Passerelles. Entretiens avec le Dala-Lama
sur les sciences de lesprit, Albin-Michel, 1995.
24. E. Alexander, Proof of Heaven : A Neurosurgeons Journey into the
Afterlife, Simon & Schuster, 2012.
25. P. Dillon, J. Copeland & K. Jansen, Patterns of use and harms associated
with non-medical ketamine use , Drug and Alcohol Dependence, 69, 2003,
p. 23-28 ; S. Bnninga & O. Blanke, The out-of-body experience :
Precipitating factors and neural correlates , Progress in Brain Research,
150, 2005, p. 331-350.
26. M.N. Marsh, Out-of-Body and Near-Death Experiences : Brain-State
Phenomena or Glimpses of Immortality ?, Oxford University Press, 2010.
27. J. Borjigin, U. Lee, T. Liu, D. Pal, S. Huff, D. Klarr, J. Sloboda, J.
Hernandez, M.M. Wang & G. Mashour, Surge of neurophysiological
coherence and connectivity in the dying brain , PNAS,
doi:10.1073/pnas.1308285110, 2013.
28. J. Halifax, Being With Dying, Shambala, 2008.
29. E. Husserl, Recherches logiques, V (2, 2), op. cit., p. 202-204. Voir
chapitre IV.
30. O. Corazza, Near Death Experiences, Exploring the Mind-Body
Connections, Taylor & Francis, 2008, p. 46.
Notes
1. B. Snell, The Discovery of Mind, op. cit.
2. Bhadranyaka Upaniad, 3, VIII, 11. La rdaction de ce texte-cl de la
pense de lInde est habituellement date du huitime sicle avant notre re.
3. M. Henry, La Barbarie, Grasset, 1987 ; H. Zwirn, Les Limites de la
connaissance, Odile Jacob, 2000 ; O. Rey, Itinraire de lgarement , Seuil,
2003.
4. C. Koch, Consciousness : Confessions of a Romantic Reductionist,
op. cit., p. 137. Christof Koch donne un exemple derreur philosophique
concernant le dveloppement des sciences : celle dAuguste Comte annonant
que la science ne pourra jamais dterminer la composition chimique des
toiles. Peu dannes aprs cette proclamation, la signature spectrale du
rayonnement lectromagntique des toiles a t rapporte leur composition
chimique. Ne se pourrait-il pas, ajoute Koch, que les philosophes dclarant
que les sciences objectives ne parviendront jamais saisir le fait de
lexprience vcue, prjugent de la mme faon dun avenir scientifique quils
ne peuvent mme pas imaginer ? Cette analogie ne vaudrait que si la raison
quinvoquent aujourdhui les philosophes anti-rductionnistes pour dfendre
leur position tait du mme ordre que la raison donne par Auguste Comte
pour nier la possibilit de connatre la composition chimique des toiles. Or
ce nest manifestement pas le cas. Auguste Comte se bornait signaler
lextrme difficult pratique dtendre une certaine mthode danalyse
exprimentale (celle quemploient les chimistes dans leurs prouvettes) des
toiles vertigineusement distantes, sans pouvoir exclure quune autre mthode
danalyse exprimentale (quil nimaginait pas lpoque) nous permette de
surmonter cet obstacle de la distance. Les philosophes affirmant linsolubilit
du problme difficile de lorigine physique de lexprience consciente, en
revanche, font tat dune impossibilit de principe exactement aussi
contraignante que celle qui empche (selon le thorme de Gdel) que toute
proposition vraie portant sur les nombres soit dmontrable dans le cadre
axiomatique de larithmtique.
5. J.-M. Besnier, Demain les post-humains, Hachette, 2009.
6. J. Cocteau, Les Maris de la tour Eiffel, livret pour un ballet de Georges
Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine
Tailleferre, in J. Cocteau, Antigone et les Maris de la tour Eiffel,
Gallimard, 1977. La citation exacte est puisque ces mystres nous
dpassent, feignons den tre les organisateurs .
7. A. Ciaunica-Garrouty, Physicalisme et Qualia, thse de luniversit de
Dijon, 2012.
8. P. Sloterdijk, La Mobilisation infinie, op. cit.
9. M. Merleau-Ponty, La Structure du comportement, op. cit. ; E. Straus, Du
sens des sens, Jrme Millon, 2000.
10. F. Varela, Not one, not two , loc. cit.
11. M. Bitbol, Physique et Philosophie de lesprit, op. cit., p. 329.
12. Voir M. Bitbol, De lintrieur du monde. Pour une philosophie et une
science des relations, op. cit., p. 75 : La prise en considration dune
pluralit oprante de rfrentiels et de cadres organisateurs conditionne leur
unit synthtique .
13. E. Schrdinger, Ma conception du monde, Mercure de France, 1982,
p. 40.
14. J. Derrida, De la grammatologie, Minuit, 1967.
15. G.F.W. Hegel, La Phnomnologie de lesprit, op. cit., p. 24, note 45 de
J. Hyppolite ; G.F.W. Hegel, La Relation du scepticisme avec la philosophie,
suivi de LEssence de la critique philosophique, Vrin, 1972, p. 95.
16. H.R. Jauss, Pour une esthtique de la rception, Gallimard, 1978.
Vous aimerez peut-être aussi
- La Guerre Des Clans, Livre 1 - Hunter Erin PDFDocument731 pagesLa Guerre Des Clans, Livre 1 - Hunter Erin PDFChristian Tellier81% (27)
- La Guerre Des Clans, Livre 2 - Hunter Erin PDFDocument849 pagesLa Guerre Des Clans, Livre 2 - Hunter Erin PDFChristian Tellier100% (5)
- La Guerre Des Clans, Livre 2 - Hunter Erin PDFDocument849 pagesLa Guerre Des Clans, Livre 2 - Hunter Erin PDFChristian Tellier100% (5)
- Fiche Descriptive Du Test de RL-RI 16 Items FinalDocument4 pagesFiche Descriptive Du Test de RL-RI 16 Items FinalJuju6100% (1)
- L'Art de Voir-Aldous Huxley-LightDocument121 pagesL'Art de Voir-Aldous Huxley-LightChristian Tellier100% (2)
- George R.R. Martin (LeTronedeFer04) - L'Ombre MaléfiqueDocument331 pagesGeorge R.R. Martin (LeTronedeFer04) - L'Ombre Maléfiquezorrofidy0% (1)
- Ernst Mach La Connaissance Et L - ErreurDocument266 pagesErnst Mach La Connaissance Et L - Erreurdexterite99100% (3)
- Maintenant La Finitude Peut-On Penser L'absolu by Michel BitbolDocument520 pagesMaintenant La Finitude Peut-On Penser L'absolu by Michel BitbolXaverius Morales100% (1)
- La Nature de L'espace Et Du Temps PDFDocument210 pagesLa Nature de L'espace Et Du Temps PDFandreBishop80% (5)
- Douglas Harding - Renaître À L'évidenceDocument137 pagesDouglas Harding - Renaître À L'évidencearbedPas encore d'évaluation
- Le Secret de Nicolas Poussin PDFDocument90 pagesLe Secret de Nicolas Poussin PDFChristian Tellier100% (1)
- George R.R. Martin (LeTronedeFer06) Les BrigandsDocument337 pagesGeorge R.R. Martin (LeTronedeFer06) Les BrigandsCristea Ionut Cosmin100% (1)
- Problème de la connaissance scientifique: Dans "La formation de l'esprit scientifique" de Gaston BACHELARDD'EverandProblème de la connaissance scientifique: Dans "La formation de l'esprit scientifique" de Gaston BACHELARDPas encore d'évaluation
- Theosophie - Une introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée de l'homme (traduit)D'EverandTheosophie - Une introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée de l'homme (traduit)Pas encore d'évaluation
- Krishnamurti Le Temps AboliDocument240 pagesKrishnamurti Le Temps Aboliprinceonyx100% (2)
- Jacques Scheuer SJ, Henri Le Saux, Moine Chrétien Et Renonçant Hindou NRT 116-2 (1994) p.238-245Document8 pagesJacques Scheuer SJ, Henri Le Saux, Moine Chrétien Et Renonçant Hindou NRT 116-2 (1994) p.238-245aminickPas encore d'évaluation
- Gilles Cohen-Tannoudji, Emile Noel, Collectif-Le Reel Et Ses DimensionsDocument134 pagesGilles Cohen-Tannoudji, Emile Noel, Collectif-Le Reel Et Ses DimensionsDY SAXPas encore d'évaluation
- Bouddhisme Et Physique QuantiqueDocument15 pagesBouddhisme Et Physique QuantiquericojimiPas encore d'évaluation
- L'esprit Au-Delà Des Neurones - Une Exploration de La Conscience Et de La LibertéDocument286 pagesL'esprit Au-Delà Des Neurones - Une Exploration de La Conscience Et de La LibertéMichael64100% (5)
- L Aveuglante Proximite Du ReelDocument32 pagesL Aveuglante Proximite Du ReelsaironwePas encore d'évaluation
- Francisco J. VarelaDocument10 pagesFrancisco J. Varelaingi zoulefPas encore d'évaluation
- Le Livre Rouge de CG Jung Une Volonte deDocument131 pagesLe Livre Rouge de CG Jung Une Volonte deicar aphrodite100% (1)
- L'autorisation Noétique (Ou de La Notion de Sujet Dans La Philosophie de L'éducation de Jiddu Krishnamurti), Par René BarbierDocument19 pagesL'autorisation Noétique (Ou de La Notion de Sujet Dans La Philosophie de L'éducation de Jiddu Krishnamurti), Par René BarbierJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Krishnamurti Et Le Yoga de L'attention, Par Michel JourdanDocument2 pagesKrishnamurti Et Le Yoga de L'attention, Par Michel JourdanJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Essai Sur Le VideDocument126 pagesEssai Sur Le VideMonseigneur ChrisPas encore d'évaluation
- JUNG - DIALECTIQUE DU MOI ET DE L INCONSCIENT - 23 Pages - 467 KoDocument23 pagesJUNG - DIALECTIQUE DU MOI ET DE L INCONSCIENT - 23 Pages - 467 KoMondoloniPas encore d'évaluation
- Marc Richir, Les Structures Complexes de Limagination Selon Et Au Delà de HusserlDocument43 pagesMarc Richir, Les Structures Complexes de Limagination Selon Et Au Delà de HusserlGabriel Jiménez TaviraPas encore d'évaluation
- Gerald M. Edelman Biologie de La Conscience PDFDocument374 pagesGerald M. Edelman Biologie de La Conscience PDFJean Baptiste Des100% (3)
- Basarab Nicolescu, Niveaux de Réalité Et Non-Réductionnisme - Jung, Pauli, Lupasco Face Au Problème PsychophysiqueDocument19 pagesBasarab Nicolescu, Niveaux de Réalité Et Non-Réductionnisme - Jung, Pauli, Lupasco Face Au Problème PsychophysiqueBasarab Nicolescu100% (3)
- DialectiqueDocument34 pagesDialectiqueLinux Man100% (2)
- Centre Vedantique Science Et Spiritualite 2013Document8 pagesCentre Vedantique Science Et Spiritualite 2013luqmanPas encore d'évaluation
- Entretiens Nathalie DeprazDocument8 pagesEntretiens Nathalie DeprazbritocostaPas encore d'évaluation
- Theorie de La Double CausaliteDocument18 pagesTheorie de La Double Causalitemontex23Pas encore d'évaluation
- Quantique Dogen 3Document17 pagesQuantique Dogen 3luqmanPas encore d'évaluation
- La place de l'homme dans l'univers: L'unité et la pluralité des mondesD'EverandLa place de l'homme dans l'univers: L'unité et la pluralité des mondesPas encore d'évaluation
- Jean-Paul Sartre-Limaginaire. Psychologie Phénoménologique de Limagination-JerichoDocument302 pagesJean-Paul Sartre-Limaginaire. Psychologie Phénoménologique de Limagination-JerichoRIDA ELBACHIRPas encore d'évaluation
- Cette Chose - Jean-Jacques CharbonierDocument136 pagesCette Chose - Jean-Jacques CharbonierBlack Jedi100% (1)
- Rudolf Steiner - Connaissance, Logique, Pensée Pratique (PDF Images Avec Recherche) PDFDocument96 pagesRudolf Steiner - Connaissance, Logique, Pensée Pratique (PDF Images Avec Recherche) PDFrastacourage100% (1)
- Beauregard Mario - O'Leary Denyse - Du Cerveau À Dieu PDFDocument435 pagesBeauregard Mario - O'Leary Denyse - Du Cerveau À Dieu PDFploi100% (3)
- Schopenhauer-Mécanique QuantiqueDocument7 pagesSchopenhauer-Mécanique Quantiquejulen1000Pas encore d'évaluation
- Les Theories de La Synchronicite 18 Pages 233 KoDocument18 pagesLes Theories de La Synchronicite 18 Pages 233 Koimen trabelsiPas encore d'évaluation
- Le Chat de Schrodinger Philippe ForestDocument751 pagesLe Chat de Schrodinger Philippe ForestAla Eddine Benderradji100% (1)
- Krishnamurti Et WittgensteinDocument21 pagesKrishnamurti Et WittgensteinguillaumepetitprodPas encore d'évaluation
- Bernard D'espagnat - Physique Contemporaine Et Intelligibité Du Monde PDFDocument7 pagesBernard D'espagnat - Physique Contemporaine Et Intelligibité Du Monde PDFRicardo CabralPas encore d'évaluation
- J-P. SARTRE Et J. KRISHNAMURTI, Deux Athéismes Pour Une Morale, Par René BarbierDocument7 pagesJ-P. SARTRE Et J. KRISHNAMURTI, Deux Athéismes Pour Une Morale, Par René BarbierJoop-le-philosophe100% (1)
- La Conscience en Tant Que Metaphore Spatiale Theorie de Julian Jaynes StewartDocument24 pagesLa Conscience en Tant Que Metaphore Spatiale Theorie de Julian Jaynes StewartboulegamaiPas encore d'évaluation
- Precis Epistemologie PDFDocument230 pagesPrecis Epistemologie PDFabyayala1Pas encore d'évaluation
- D'étranges coïncidences dans votre vie. Petits événements curieux. Pressentiments. Télépathie. Ça vous arrive aussi?D'EverandD'étranges coïncidences dans votre vie. Petits événements curieux. Pressentiments. Télépathie. Ça vous arrive aussi?Pas encore d'évaluation
- Sri Aurobindo Entretiens Tres InteressantsDocument0 pageSri Aurobindo Entretiens Tres InteressantsAlberto ChicaybanPas encore d'évaluation
- 03-Lettres Sur Le Yogas-3ème PartieDocument276 pages03-Lettres Sur Le Yogas-3ème PartieBileonetPas encore d'évaluation
- Gerome Taillandier Le Graphe de Jacques LacanDocument35 pagesGerome Taillandier Le Graphe de Jacques LacanL'abbé RitifPas encore d'évaluation
- Pierre Teilhard Du Chardin - Le Coeur de La MatièreDocument230 pagesPierre Teilhard Du Chardin - Le Coeur de La Matièrestis73100% (1)
- Stephen Jourdain - Tout Et Le Reste Est Littérature - La Ferveur Du Quotidien (1993)Document6 pagesStephen Jourdain - Tout Et Le Reste Est Littérature - La Ferveur Du Quotidien (1993)Holomun100% (1)
- À La Frontière de L'être...Document2 pagesÀ La Frontière de L'être...FranckPas encore d'évaluation
- Adorno & Horkheimer - Souffrance Existentielle Des AnimauxDocument2 pagesAdorno & Horkheimer - Souffrance Existentielle Des AnimauxAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation
- Freud Merleau PontyDocument13 pagesFreud Merleau PontyVitor OliveiraPas encore d'évaluation
- Le Grand Livre Du BouddhismeDocument26 pagesLe Grand Livre Du BouddhismeparasolyPas encore d'évaluation
- L'idéal Du Moi Dans Le Schéma RDocument9 pagesL'idéal Du Moi Dans Le Schéma RJosé Miguel Granja NúñezPas encore d'évaluation
- La Conscience L Inconscient Et Le SujetDocument69 pagesLa Conscience L Inconscient Et Le SujetSimo Aouan100% (1)
- Melman Ch. Pour Introduire À La PA Aujourd'Hui-Sém. 2001-02Document382 pagesMelman Ch. Pour Introduire À La PA Aujourd'Hui-Sém. 2001-02Eleazar Correa GonzálezPas encore d'évaluation
- Phénoménologie de La Vie, Volume 1 de La Phénoménologie by Michel HenryDocument217 pagesPhénoménologie de La Vie, Volume 1 de La Phénoménologie by Michel Henrywaga7100% (1)
- (Bibliothèque Scientifique - Collection Science de L'homme - Dirigée Par Le Dr. G. Mendel) Lucien Sebag - Marxisme Et Structuralisme-Payot (1964)Document273 pages(Bibliothèque Scientifique - Collection Science de L'homme - Dirigée Par Le Dr. G. Mendel) Lucien Sebag - Marxisme Et Structuralisme-Payot (1964)tmmmmmmmm4Pas encore d'évaluation
- La Compassion Et L'individuDocument21 pagesLa Compassion Et L'individuBenoitVīriyaLenquettePas encore d'évaluation
- Intuition de InstantDocument90 pagesIntuition de InstantYoussef JabriPas encore d'évaluation
- Basarab Nicolescu, DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE AU RÉENCHANTEMENT DU MONDEDocument14 pagesBasarab Nicolescu, DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE AU RÉENCHANTEMENT DU MONDEBasarab Nicolescu100% (3)
- L'Enfant Exploité, ProlétariatDocument525 pagesL'Enfant Exploité, ProlétariatChristian Tellier100% (1)
- La Guerre Des Clans III, Livre - Hunter Erin PDFDocument896 pagesLa Guerre Des Clans III, Livre - Hunter Erin PDFChristian Tellier50% (2)
- Sang de Glace PDFDocument232 pagesSang de Glace PDFChristian Tellier100% (1)
- La Guerre Des Clans III, Livre - Hunter Erin PDFDocument898 pagesLa Guerre Des Clans III, Livre - Hunter Erin PDFChristian Tellier80% (5)
- La Guerre Des Clans III, Livre - Hunter Erin PDFDocument896 pagesLa Guerre Des Clans III, Livre - Hunter Erin PDFChristian Tellier50% (2)
- 08 - Les Noces Pourpres PDFDocument355 pages08 - Les Noces Pourpres PDFmaxstirner4403Pas encore d'évaluation
- George R.R. Martin (LeTronedeFer03) - La Bataille Des RoisDocument342 pagesGeorge R.R. Martin (LeTronedeFer03) - La Bataille Des RoiszorrofidyPas encore d'évaluation
- Reussir Memoires Et Theses - Anne-Sophie ConstantDocument182 pagesReussir Memoires Et Theses - Anne-Sophie Constantelric NoirtinPas encore d'évaluation
- INTRODUCTION AUX TCC - DIAPORAMA 2008 (66 Pages - 958 Ko)Document66 pagesINTRODUCTION AUX TCC - DIAPORAMA 2008 (66 Pages - 958 Ko)Aboudramane DialloPas encore d'évaluation
- Cognitions Et Émotions MoralesDocument55 pagesCognitions Et Émotions MoralesLucie RochatPas encore d'évaluation
- L'étude de L'ignoranceDocument2 pagesL'étude de L'ignoranceAbdelali BecettiPas encore d'évaluation
- Écrire Le Deuil: Décès Maternel Et Acte D'écriture Chez Albert Cohen, Annie Ernaux, Peter Handke Et Roger PeyrefitteDocument28 pagesÉcrire Le Deuil: Décès Maternel Et Acte D'écriture Chez Albert Cohen, Annie Ernaux, Peter Handke Et Roger PeyrefitteTiti SuruPas encore d'évaluation
- Les Secrets de Lestime de Soi Marie Laure CuzacqDocument60 pagesLes Secrets de Lestime de Soi Marie Laure Cuzacqendallkhan9Pas encore d'évaluation
- AFSC Fiches Theoriques Les Principaux Systemes de La MemoireDocument13 pagesAFSC Fiches Theoriques Les Principaux Systemes de La MemoireNounou NouhadePas encore d'évaluation
- Fiche Pédagogique ViergeDocument3 pagesFiche Pédagogique ViergeHicham AjeddouPas encore d'évaluation
- 1989 BROUSSEAU (Traducido)Document19 pages1989 BROUSSEAU (Traducido)Jhon Lima El ChamoPas encore d'évaluation
- Zida Daouda Tache2 Uumba717zmfr O43761 20230208Document6 pagesZida Daouda Tache2 Uumba717zmfr O43761 20230208compaore ulrichPas encore d'évaluation
- Objectivite Citat BiblioDocument2 pagesObjectivite Citat BiblioLindorPas encore d'évaluation