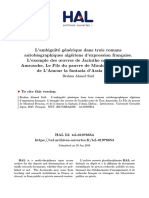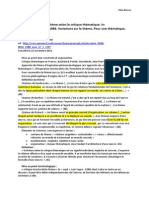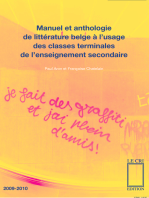Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Colona Autoficcao
Colona Autoficcao
Transféré par
tchulhaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Colona Autoficcao
Colona Autoficcao
Transféré par
tchulhaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vincent Colonna
Lautofiction
(essai sur la
fictionalisation de soi
en Littrature)
Doctorat de lE. H.E.S.S., 1989
Directeur : Monsieur Grard Genette
cole des Hautes tudes en Sciences Sociales
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
INTRODUCTION______________________________________________________ 8
P R E M I E R E P A R T I E : LA CHOSE AVEC LE NOM____________________ 14
1.1. LE TERME AUTOFICTION ______________________________________ 15
A) UN NEOLOGISME___________________________________________________ 16
B) UNE DEFINITION ___________________________________________________ 23
C) DES PROLEGOMENES _______________________________________________ 25
1. 2. QUESTIONS DE METHODE ____________________________________ 29
D E U X I E M E P A R T I E : MUTATO NOMINE __________________________ 41
2. 1. LE PROTOCOLE NOMINAL : PREMIER CRITERE DE FICTIONNALISATION 42
2. 2. FORME ________________________________________________________ 52
A) HOMONYMIE PAR TRANSFORMATION _____________________________________ 54
B) HOMONYMIE PAR SUBSTITUTION ________________________________________ 56
C). HOMONYMIE CHIFFREE_____________________________________________ 68
2. 3. CONTEXTE_____________________________________________________ 75
A) CONTEXTE PARATEXTUEL (I) : LEPITEXTE _________________________________ 77
B) CONTEXTE PARATEXTUEL (II) : LE PERITEXTE ______________________________ 80
C) CONTEXTE TEXTUEL ________________________________________________ 100
2
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
2. 4. EMPLOI _______________________________________________________ 115
A) EMPLOI VOCAL__________________________________________________ 117
B) EMPLOI ACTORIAL_______________________________________________ 130
C) EMPLOI FOCAL__________________________________________________ 149
T R 0 I S I E M E P A R T I E : LE MANTEAU DE LA FABLE ___________________154
1 - LE PROTOCOLE MODAL ___________________________________________155
A - OREAS OU LE "PARTI-PRIS DES CHOSES" ___________________________________160
B - THOTH OU LE "COMPTE-TENU DES MOTS"___________________________________162
C - EXAMEN CRITIQUE DES DEUX VULGATES____________________________________165
2 - DES MODALISATEURS FICTIONNELS PARATEXTUELS___________________169
I. MODALISATEURS EPITEXTUELS _____________________________________170
II. MODALISATEURS PERITEXTUELS _____________________________________173
IL. 1. PROTOCOLE MODAL INDEFINI. __________________________________________179
II.2. PROTOCOLE MODAL CONTRADICTOIRE.____________________________________184
3 - EPIMENIDE EN FICTION _____________________________________________192
4- LES INDICES DE LA FICTION _________________________________________200
I - INDICES SYNTAXIQUES _____________________________________________202
- Le discours sur soi la troisime personne : ________________________________207
- Le mode dramatique : __________________________________________________208
- II - INDICES SEMANTIQUES ____________________________________________212
- Invraisemblance mondaine physique : _____________________________________215
- Invraisemblance mondaine culturelle : _____________________________________215
- Invraisemblance auctoriale physique : _____________________________________216
- Invraisemblance auctoriale culturelle : _____________________________________216
3
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- III - INDICES PRAGMATIQUES __________________________________________217
5 - LE DISCOURS FICTIONNEL _________________________________________222
UNE RECHERCHE EN COURS. _______________________________________________224
UNE QUESTION PLURIELLE. ________________________________________________224
UN REGISTRE HETEROGENE. _______________________________________________225
Q U A T R I E M E P A R T I E : S T R A T E G I E S __________________________236
1 - FONCTIONNALITE D'UN DISPOSITIF SCHIZOPHRENE ____________________237
BILAN ET PERSPECTIVE. __________________________________________________238
UN DISPOSITIF SCHIZOPHRENIQUE. __________________________________________239
FONCTIONS DU DISPOSITIF. ________________________________________________246
al) fonctions rfrentielles ________________________________________________248
a2) fonctions rflexives __________________________________________________248
b) fonction figurative ____________________________________________________248
2 - FONCTION REFERENTIELLE ________________________________________249
- I - FONCTION DIDACTIQUE_____________________________________________250
II - FONCTION BIOGRAPHIQUE _________________________________________254
3 - FONCTION REFLEXIVE ______________________________________________261
UN MODELE : LE "QUICHOTTE". _________________________________________264
MISE EN ABYME ET FICTIONNALISATION DE L'AUTEUR. ____________________________269
A) MISE EN ABYME DE L'ECRIVAIN. ___________________________________________269
B) MISE EN ABYME DU LIVRE. _______________________________________________274
4- FONCTION FIGURATIVE______________________________________________281
L'AUTOFICTION SELON BARTHES____________________________________________283
"LAUTEUR QUI VA DANS NOTRE VIE"__________________________________________298
UNE EXPLOSION DE LA FICTION _____________________________________________302
4
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"LE FICTIF DE L'IDENTITE" _________________________________________________307
5 - SANS FAMILLE - ___________________________________________________313
LE "COURT-CIRCUIT" DE LA RECEPTION_______________________________________315
LA RECEPTION JOURNALISTIQUE ____________________________________________315
LA RECEPTION UNIVERSITAIRE______________________________________________318
UN "GENRE" SANS HISTOIRE ?______________________________________________323
Un "genre" secret ou un "genre" thorique ?__________________________________329
C 0 N C L U S I 0 N_____________________________________________________339
B I B L I 0 G R A P H I E_________________________________________________350
I- C 0 R P U S _________________________________________________________352
II - 0 U V R A G E S L I T T E R A I R E S___________________________________360
5
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Lautofiction
Essai sur la fictionalisation de soi en
Littrature
6
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Je dcidais de mentir, mais avec plus d'honntet que
les autres car il est un point sur lequel je dirai la vrit, c'est que
je raconte des mensonges (...). J'cris donc sur des choses que
je n'ai jamais vues, des aventures que je n'ai pas eues et que
personne ne m'a raconte, des choses qui n'existent pas du
tout et qui ne sauraient exister
Lucien.
On croit s'instruire par les
fables : eh bien ! Moi, je suis un grand fabuliste qui instruit les
autres ses dpens ; je suis un animal multiple, quelquefois
rus comme le renard, quelquefois bouch, lent et stupide
comme le baudet, souvent fier et courageux comme le lion,
parfois fugace et avide comme le loup...
Restif de la Bretonne.
Entreprendre de me crer ? Faire de Gombrowicz
un personnage - la manire de Hamlet ? Ou de Don
Quichotte ?
W. Gombrowicz.
7
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
INTRODUCTION
Laissons donc de ct l'imagination, qui n'est qu'un mot,
et considrons une facult bien dfinie de l'esprit, celle de crer
des personnages dont nous nous racontons nous-mme
l'histoire
H. Bergson.
8
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Une forme littraire peut-elle tre en trop, de trop ? Les pages qui
suivent essaient de dcrire une telle pratique surnumraire, excessive pour nos
habitudes de lecteur, disruptive pour les catgories narratives : une forme de
fiction sans titre et sans lieu, en surnombre. Son objet ? La fictionalisation de
soi", la dmarche qui consiste faire de soi un sujet imaginaire, raconter une
histoire en se mettant directement contribution, en collaborant la fable, en
devenant un lment de son invention.
Pour bien saisir la spcificit de cette pratique, il faut se la reprsenter
comme l'antithse prcise du roman personnel, de la fiction d'inspiration
autobiographique. Dans ce dernier cas, l'crivain utilise son existence, un
pisode de sa vie, pour relater une histoire, mais en modifiant une foule
d'lments, pour des raisons personnelles ou esthtiques. Une belle illustration
de ce processus cratif est fournie par le personnage d'Ariane dans Belle du
Seigneur :
J'ai rsolu de devenir une romancire de talent. Mais ce
sont mes dbuts d'crivain et il faut que je m'exerce. Un bon
truc serait d'crire dans ce cahier tout ce qui me passera par la
tte sur ma famille et sur moi. Ensuite, les choses vraies que
j'aurai racontes, une fois que j'aurai. Une centaine de pages,
je les reprendrai pour en tirer le dbut de mon roman, mais en
changeant les noms (1968, p. 13).
Par complaisance, manque d'imagination ou par une imprieuse
ncessit intrieure, l'crivain utilise ainsi sa biographie comme matire, pour
une forme narrative o il s'abrite derrire un personnage romanesque. Et pour
que cette attitude narrative soit conduite jusqu' son terme, il est ncessaire
que l'crivain laisse entendre que son texte est une confession, qu'il encourage
une lecture en partie rfrentielle, comme Goethe avec Werther Le roman
personnel n'est donc qu' demi-fictif, son contenu et l'effet qu'il recherche sont
aussi autobiographiques.
9
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
A loppos, la fictionnalisation de soi consiste s'inventer des
aventures que l'on s'attribuera, donner son nom d'crivain un personnage
introduit dans des situations imaginaires. En outre, pour que cette
fictionnalisation de soit totale, il faut que l'crivain ne donne pas cette
invention une valeur figurale ou mtaphorique, qu'il n'encourage pas une
lecture rfrentielle qui dchiffrerait dans le texte des confidences indirectes.
Une image approche de cette fabulation intime, o la fiction serait moyen et
but, est donne par Herman Hesse dans Le Jeu des Perles de Verre. Dans le
cadre d'un Ordre intellectuel situ dans un futur lointain (sorte de rponse la
Province pdagogique imagine par Goethe dans Les Annes de voyage de
Wilhem Meister, pour incarner sa conception de l'ducation), les lves doivent
rdiger, une fois l'an, un curriculum vit d'un genre trs particulier :
C'tait une autobiographie fictive, situe
une poque quelconque du pass. La tche de
l'tudiant consistait se replacer dans un milieu et dans
une culture, dans le climat spirituel d'une poque donne
du pass, et imaginer une vie qui y correspondt. Selon
les annes et la mode, la prfrence allait la Rome
impriale, la France du XVIIe sicle ou l'Italie du XVe,
l'Athnes de Pricls ou l'Autriche de Mozart et, chez
les linguistes, il tait devenu d'usage de rdiger ces
romans biographiques dans la langue et le style du pays
et de l'poque o ils se droulaient. Il y eut parfois des
biographies d'une haute virtuosit, dans le style de la
Curie pontificale romaine des environs de 1200, dans le
latin des moines, dans l'italien des Cent Nouvelles, dans
le franais de Montaigne, dans l'allemand baroque du
Cygne de Boberfeld. Il y avait dans cette forme de libre
jeune survivance de l'ancienne croyance asiatique en la
rsurrection et la mtempsychose ; il tait courant, pour
tous les professeurs et les lves de se reprsenter que
leur existence actuelle pouvait avoir t prcde par
d'autres, dans d'autres corps, des poques et dans ces
conditions diffrentes. Ce n'tait certes pas une foi, au
sens troit du mot, et encore moins une doctrine ; c'tait
un exercice, un jeu des forces imaginatives, que de se
figurer son propre moi dans des situations et des milieux
diffrents. On s'entranait ainsi, comme au cours de
maints travaux pratiques de critique du style et souvent
aussi dans le Jeu des Perles de Verre, pntrer
prcautionneusement dans des cultures, des poques et
des pays du pass, on apprenait considrer sa propre
personne comme un travesti, comme l'habit prcaire
d'une entlchie (Tr. fr. J. Martin, PP. 117-118).
10
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Il nest pas indiffrent que cette description se trouve dans un roman de
Hesse. Plusieurs de ses textes se prsentent comme une autobiographie
fictive . Pour rester dans notre parallle, cette description montre bien en quoi
cette forme de fiction s'oppose terme terme au roman personnel, avec lequel
on pourrait la confondre. Tant par sa matire que par son inscription intime et
par sa stratgie discursive, la fiction de soif se spare du roman
autobiographique. En elle, le contenu de l'histoire est fictionnel l'auteur
n'emprunte aucun masque et n'a aucune prtention la vrit personnelle.
Plutt qu'un dguisement, c'est un travestissement ; plus qu'une transposition,
c'est un "libre jeu des forces imaginatives". Bien sr, un tel rcit sera toujours
rvlateur de la vie intellectuelle et morale de son auteur, mais c'est le lot de
toute fiction et sans comparaison avec un texte dlibrment personnel. La
fictionnalisation de soi est donc l'origine d'une forme de fiction beaucoup plus
ambigu et retorse que tous les types de fiction d'inspiration autobiographique.
Qu'un crivain mette contribution son existence pour laborer une uvre de
fiction constitue un phnomne banal et bien connu. En revanche, qu'il figure
dans un rcit imaginaire, comme s'il tentait de se ddoubler en personnage
romanesque, voil un geste moins habituel et plus nigmatique.
On pourrait penser que cette dmarche littraire na produit que des
uvres limites, aux frontires de la littrature, du mysticisme et de la folie ;
qu'elle n'est le fait que d'imaginations drgles ou verses dans la
mtempsychose, comme celle d'un Philippe g. Dick ou d'un Swedenborg. En
tant attentif aux textes, on constate au contraire qu'il existe une multitude
d'auteurs - et non des moindres - chez lesquels on retrouve, avec des modalits
diverses, ce mariage inattendu du registre autobiographique et du registre fictif,
de l'imaginaire et du rfrentiel. Dante, Molire, Diderot, Chateaubriand, Proust,
Kafka, Cline, Genet, Gombrowicz : autant d'crivains qui prsentent cette
caractristique de stre donns des doubles imaginaires, mis en scne dans
leurs textes de fiction. Bien plus, le principe d'une pareille fictionnalisation de soi
dpasse largement, par des voies qui restent analyser, le cadre de la
littrature pour se manifester dans des arts figuratifs comme la peinture, le
cinma, la photographie et mme la bande dessine. C'est assez dire l'ampleur
et la complexit de cette forme imaginaire.
En ralit, moins bizarre qu'il n'y parat, cette activit de fictionnalisation
de soi exploite une tendance onirique et fantasmatique qui est inhrente la
11
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
condition humaine. Aprs tout, les rives nocturnes, la rverie diurne, le
fantasme ne font rien d'autre que de mettre en uvre, de faon plus
narcissique et plus complaisante, un tel processus. Entre le temps du sommeil
o il glisse dans des fantasmagories qu'il ne contrle pas et les rives veills
qu'il provoque et entretien, une grande partie de l'existence de l'tre humain se
dpense dans l'invention, l'laboration et la contemplation d'histoires
imaginaires o il joue un rle. Si la fabulation est, en croire, Bergson, une
facult aussi naturelle que le sens de la vue ou du toucher, que dire de
l'affabulation intime !
En outre, cette forme de fabulation n'est ni plus absurde ni plus
incohrente que la fiction ordinaire, simplement plus radicale. Comme on l'a
souvent remarqu, la fiction sous la forme la plus innocente appelle une forme
d'adhsion dconcertante, un type de croyance qui se dsavoue dans le
moment mme o elle se donne. Par dfinition contrefaite, la reprsentation
fictionnelle cherche pourtant tre perue comme relle, manifeste un trs
curieux fonctionnement o elle ne contente l'exigence de fictionalit qu'en
refoulant sa fictionalit, en se donnant comme vraie. Et pourtant, crivain et
lecteur sont trs conscient du fait qu'ils peuvent tout moment retirer leur
croyance, rvoquer leur illusion.
La fictionnalisation peut donc produire ses effets que si auteur et
lecteur sont complices pour s'installer dans une totale mauvaise foi la
fictionnalisation de soi se contente d'utiliser ce mcanisme un cran au-dessus,
en plaant l'auteur non plus derrire, mais dans le texte. L'crivain n'est plus
pargn par le droulement quivoque de la fiction. Comme on s'en doute,
cette contamination n'est pas sans consquence sur la fiction elle-mme :
quelques-uns des repres les plus solides de la littrature d'imagination se
trouvent renverss, comme la position privilgie de l'auteur, le cadre du rcit et
le rapport du lecteur luvre. Fiction duplex, la fiction de soi complique,
multiplie et acclre les contradictions et les antinomies de la fictionalit.
Il est curieux que cette forme artistique demeure mconnue et nglige.
Pour s'en tenir la littrature, l'ensemble plutt htroclite des textes qui
prsentent cette particularit gnrique se trouve dans une situation singulire.
Ils ne bnficient pas en tant que tels, comme on le verra, d'une vritable
rception. Jusqu' une date rcente, aucun terme ne permettait de les
rassembler sous un chef commun ; aucune tude n'avait signal la rcurrence
12
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
de ce registre mixte dans la littrature. Autrement dit, dans les discours critique
et thorique sur la littrature, il n'y avait pas d'horizon d'attente pour cette
classe de textes. Ce qui n'empchait pas, au demeurant, toutes ces uvres
d'tre trs bien reues individuellement et d'autres titres. De mme que la
fiction, qui entre pour une large part dans tous les secteurs de l'activit humaine
et qui appartient toutes les civilisations, s'est trouve pendant trs longtemps
en butte une hostilit quasi-gnrale, la fiction de soi parait maintenue dans
une sorte de quarantaine, comme si elle tait refoule de notre conscience
littraire.
Lever ce "refoulement", tel est le projet de cette tude gnrique, de
cette exploration de la fictionnalisation de soi en littrature.
13
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
P R E M I E R E P A R T I E : LA
CHOSE AVEC LE NOM
... Lorsqu'un objet est cach tous les yeux, il faut
l'inventer de toutes pices pour pouvoir le dcouvrir .
J.P. Sartre.
14
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
1.1. LE TERME AUTOFICTION
"L'impuissance nommer est le signe d'un trouble".
R. Barthes.
15
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Notre projet est donc d'identifier de dcrire et d'analyser une
pratique fictionnelle, A se retrouvent un certain nombre duvres qui sont
remarquables non pas par leur inspiration autobiographique, mais par la
"fictionnalisation" de leur auteur. Terra incognita pendant longtemps, ce "genre"
commence merger aussi bien dans les habitudes de lecture que dans le
discours mtalittraire.
Depuis peu, cette pratique dispose d'un terme distinctif, d'un nom, et
d'lments d'analyse qui rendent son existence moins inintelligible. Pour
entamer cette tude gnrique, on commencera donc par tudier l'origine de
son nom et par faire un tour d'horizon, forcment rapide, des travaux rcents
qui, en France, ont voqu l'existence de ce "genre". Cet examen de l'tat
actuel de la recherche sur la "fictionnalisation de soi" montrera concrtement
l'isolement forc dans lequel elle se trouve.
A) Un nologisme
On doit Serge Doubrovsky d'avoir cr un terme qui permette de
dsigner l'activit littraire de la fictionnalisation de soi en littrature le terme
"autofiction". Il ne s'agissait pour lui, l'origine, que de nommer une forme
indite d'autobiographie. Le mot fera pourtant fortune avec une extension
beaucoup plus large, pour dsigner des uvres totalement trangres au projet
autobiographique.
C'est sur la quatrime de couverture de Fils, paru en 1977, qu'il est fait
usage pour la premire fois de ce nologisme. A la diffrence de ses fictions
antrieures, Doubrovsky se met lui-mme en scne dans ce livre. Il est la fois
le narrateur et le personnage principal de ce rcit qui relate la journe d'un
professeur de Lettres franaises (une certain Serge Doubrovsky ) dans une
universit de New-York et ses dchirements entre deux langues, deux mtiers,
deux femmes, entre le pass et le prsent. L'ensemble, racont dans un style
dbrid, avec une ponctuation trs lche et des jeux typographiques
incessants. La couverture de ce livre portait comme indication gnrique
16
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"roman" et le prire d'insrer donnait, avec un rsum du contenu de l'ouvrage,
une sorte d'analyse de son statut gnrique :
''Autobiographie ? Non, c'est un privilge rserv aux
importants de ce monde, au soir de leur vie, et dans un beau
style. Fiction, d'vnements et de faits strictement rels ; si l'on
veut autofiction, d'avoir confi le langage d'une aventure
l'aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman
traditionnel ou nouveau. Rencontre, fils des mots, allitrations
assonances, dissonances criture d'avant ou d'aprs littrature,
concrte, comme on dit musique. Ou encore, autofiction,
patiemment onaniste, qui espre faire maintenant partager son
plaisir".
Doubrovsky a par ailleurs, comment sa pratique de l'autofiction dans
deux articles qui forment, avec cette prsentation, un ensemble prcieux :
"crire sa psychanalyse" en 1979 et ''Autobiographie/Vrit/psychanalyse" en
1980. Dans la mesure o c'est ce prire d'insrer qui a popularis le terme
autofiction, et o, plus souvent cit qu'analys, il contient en germe tout le
discours d'escorte ultrieur, il fournit un fil conducteur, videmment efficace,
pour rendre compte du pays d'origine de ce nologisme. On peut retenir quatre
propositions dans ce passage, quatre caractrisations qui esquissent un
tableau la fois fonctionnel, thmatique, formel et gnrique de l'autofiction.
1) Une caractrisation fonctionnelle
A la diffrence de l'autobiographie qui serait l'apanage des vies
mmorables, l'autofiction serait le refuge des vies ordinaires. Elle permettrait
chacun de raconter sa vie, ds lors qu'il la dote des atours de la fiction. Les
humbles qui n'ont pas droit l'histoire, ont droit au roman (Doubrovsky 1980,
p. 90). C'est la premire raison invoque pour justifier l'indication gnrique
"roman" de ce texte si fortement rfrentiel. Mais celle-ci n'est gure
dveloppe par Doubrovsky et elle parait si discutable que l'on en vient se
demander s'il faut vraiment la prendre la lettre. Depuis Montaigne, on sait bien
que "chaque homme porte en soi la forme entire de l'humaine condition" et
que le portrait de la vie la plus ordinaire peut-tre palpitant (Essais, 11/18). A
l'inverse, combien d'autobiographies ou de Mmoires sont tombs dans l'oubli,
malgr la somme d'aventures extraordinaires, de faits pittoresques ou
d'vnements spectaculaires qu'ils relataient : songeons Da Ponte, Dumas
ou Al Jennings. Nul ne vieillit plus mal ni plus vite que les "importants de ce
monde" ; et la simple retranscription de leurs souvenirs suffit rarement leur
17
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
garantir l'immortalit. Ce premier trait attribu l'autofiction reste toutefois
intressant parce qu'il rvle de la dmarche de Doubrovsky, c'est--dire par le
lien qu'il tablit entre cette forme de fiction et l'autobiographie. Il montre que,
pour lui, l'autofiction est d'abord un avatar de l'autobiographie, un moyen pour
rsoudre certaines difficults propres a l'criture de soi. Cette filiation se
retrouve dans le titre de ses deux articles "autocritiques" qui constituent un
programme de travail trs clair ; et elle ne manque pas, en outre, de se signaler
dans les traditions (l'autobiographie, l'autoportrait) et les auteurs mobiliss (La
Rochefoucauld, Rousseau, Leiris ou Marie Cardinal) par Doubrovsky pour
clairer sa dmarche.
2) Une caractrisation thmatique
L'autofiction selon Doubrovsky partagerait donc avec d'autres formes
de l'criture de soi l'autoportrait, l'autobiographie) l'authenticit du vcu qui y est
rapporte. Le contenu strictement rfrentiel de Fils est ainsi affirm dans ce
prire d'insrer et dans un des autocommentaires :"En bonne et scrupuleuse
autobiographie, tous les faits et gestes du rcit sont littralement tirs de ma
propre vie ; lieux et dates ont t maniaquement vrifis (...) noms, prnoms,
qualits (et dfauts), tous vnements et incidents, toute pense, Est ce la plus
intime, tout y (est) mien" (Doubrovsky, 1980, pp. 89p 94). Le second trait propre
lautofiction serait donc d'tre un rcit vrai.
Une part d'invention est toutefois reconnue par l'auteur de Fils : celle
consistant avoir amnag une de ses journes de faon pouvoir y
contracter les perceptions, les impressions, les sentiments, les souvenirs et les
faits d'une vie tout entire. En outre, il admet avoir compos cet ensemble de
faon obtenir une progression tripartite, pivotant autour d'une sance
d'analyse. Il est curieux que Doubrovsky ne voie l quune simple licence
narrative, somme toute ngligeable et sans incidence sur la manire dont son
texte pourrait tre peru et lu. On semble au contraire fond voir dans cette
libert prise avec sa biographie un lment dcisif. Non seulement ce procd
ne peut tre considr comme ngligeable pour l'authenticit des faits relats,
mais de plus, il a grande chance dtre identifi par le lecteur comme le signe
d'une intention fictionnelle. La contraction dune vie en une brve dure est un
procd narratif si commun dans la littrature romanesque et au cinma qu'il
est difficile de le percevoir autrement que comme une convention romanesque.
Rfracter une existence dans l'espace d'une journe ou d'une nuit ncessite
18
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
tant de rtrospections ou d'analyses, que cela finit par constituer autant dcarts
par rapport au registre rfrentiel et historique. Il est peu plausible qu'un
individu se remmore autant de choses en si peu de temps. Si le lecteur
accepte une telle transgression du vraisemblable, c'est parce qu'il sait qu'il ne
s'agit que d'une fiction. Ds lors qu'une nuit ou une journe est l'occasion de
faire le bilan d'une vie, un prtexte pour permettre la mmoire de dployer
toutes ses images, venues parfois d'un pass trs lointain, le lecteur ne peut
crditer le rcit de la mme rfrentialit que lautobiographie. Une telle
technique de composition est dommageable la crdibilit rfrentielle, l'effet
de ralit autobiographique du texte. Doubrovsky se trouve ainsi comme
dpass par les moyens qu'il met en uvre pour son projet. Malgr ses
dclarations d'intention autobiographique, Fils a beaucoup dun roman et se
donne lire comme une fiction. On reviendra sur le problme du registre
rfrentiel chez Doubrovsky, mais il faut dj noter que sa pratique permet de
donner au terme I autofiction un sens plus large que ne le laissait supposer
sa thorie.
3) Une caractrisation formelle
Ce troisime trait est essentiel c'est le pivot du discours mtatextuel de
Doubrovsky. Quoi quil reoive des formulations diffrentes, c'est l'argument
avanc le plus important pour justifier le statut fictif de son texte et introduire le
terme autofiction . La description la plus parlante est dans le prire d'insrer
de Fils : "... autofiction d'avoir confi le langage d'une aventure l'aventure du
langage... ". Ce roman donne bien, en effet, la mise en "langage d'une
aventure" ; entendons par l : l'criture d'une existence, la relation d'une vie.
Reste que cette "aventure" n'est pas retrace selon une succession
chronologique d'vnements biographiques. Comme on s'en aperoit
immdiatement la lecture, la narration est commande en partie par la
matrialit du langage, par ses proprits "consonantiques" (homophonie,
assonance, allitration, paronomase, calembour etc.)
Cette exploration de la littralit du langage, parce que Doubrovsky
appelle une "criture consonantique", n'est assurment pas sans rappeler la
logique scripturale de certains "romans" contemporains des annes 70. Et l'on
n'aura pas manqu de noter que la phrase cite fait cho une formule clbre
de Jean Ricardou : "Un roman est moins l'criture d'une aventure que l'aventure
dune criture" (Ricardou, 1967, p. 111). Doubrovsky paraphrase cette formule
19
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
bien connue, mais ce n'est lui pas sans/confrer un lger inflchissement, qui
marque toute la spcificit de sa dmarche. Dans Fils, l criture d'une
aventure n'est pas renie, elle est prise en charge, confie "l'aventure d'une
criture". Doubrovsky revendique bel et bien une vise rfrentielle et narrative
qui est absente chez un Ricardou par exemple : "contre une certaine modernit,
nous maintiendrons fermement qu'il n'y a aucune autoproduction possible d'un
texte, aucune parthnogense littraire, aucune fcondit du seul langage
coup d'un sujet et de l'insertion de ce sujet dans un monde" (Doubrovsky,
1979, pp. 184-185). L criture consonnatique demande de n'tre pas
laisse en roue libre, mais d'tre contrle, oriente pour tre en accord avec la
biographie et l'organisation du rcit. Fils prsente ainsi l'originalit d'tre
formellement mi-chemin d'un texte reprsentatif et dun texte purement
scriptural, de s'crire distance gale de la rfrence et de la littralit.
Ce mode exactement intermdiaire d'criture justifie pour Doubrovsky
l'indication "roman" et le recours qu'il propose son nologisme gnrique.
D'une part, c'est cette prgnance de la scripturalit qui le conduit se
dmarquer du genre autobiographique traditionnel et signaler cette
divergence au lecteur en dsignant son texte comme un "roman". Il faut ici
prendre ce terme "roman", dans le sens que lui donnent certains crivains
contemporains, dans son acception scripturale, comme dsignant une uvre
qui exhibe ses procdures d'engendrement et sa propre logique qui slabore
en vertu de contraintes d'abord propres l'criture (Doubrovsky, 1979, pp.
174-175). Par-l, l'auteur de Fils s'inscrit dans un courant qui s'est rclam de
la modernit et qui a voulu rendre la littrature son tymologie d'criture.
D'autre part, c'est l'effet de vrit de cette "criture consonantique" qui pousse
Doubrovsky employer le terme autofiction. Sur le modle de l'exprience de la
cure analytique, o le sujet labore sa vrit au fur et mesure de son analyse
(et non pas en dcouvrant un jour la clef de son comportement), la vracit
autobiographique de Fils est dclare distincte de la simple fidlit aux faits
vcus. Non pas qu'elle y contrevienne, mais son authenticit serait inscrite
avant tout au cur du langage du sujet crivant, dans la production de son
criture. La vie est reconstruite par le trac de la lettre du "scripteur", autant que
la reconstitution de son pass : auto-bio-graphie. Ds lors, Doubrovsky peut
affirmer : Lautofiction, c'est la fiction que j'ai dcid, en tant qu'crivain, de
me donner moi-mme et par moi-mme ; en y incorporant, au sens plein du
20
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
terme, l'exprience de l'analyse, non point seulement dans la thmatique, mais
dans la production du texte" (Doubrovsky, 1980), p. 96).
4) Une caractrisation gnrique
Ce dernier trait de l'autofiction tient tout entier dans l'insistance mise par
Doubrovsky souligner l'originalit de son entreprise au sein de la littrature et
des horizons d attente en usage. Le prire dinsrer de Fils revendique
ostensiblement cette excentricit : ... hors sagesse et hors syntaxe du roman
traditionnel ou nouveau (...) criture d'avant ou d'aprs littrature... . Et les
articles dj cits la soulignent en convoquant le travail de Philippe Lejeune
dans "le pacte autobiographique", ce qui leur permet de montrer de faon
prcise que Fils ne relve ni du roman, ni du "roman autobiographique" ni de
l'autobiographie. Dans cet article, Lejeune voquait l'hypothse d'un type de
texte faisant de l'auteur un personnage, tout en se prsentant comme fictionnel.
Il concluait la possibilit en droit dune telle classe de textes, mais pour lui
enlever toute existence de fait. En identifiant Fils comme un "roman", il semble
bien que Doubrovsky ait voulu remplir cette "case aveugle" dans la typologie de
Lejeune.
C'est en tous cas ce qu'il affirme dans une lettre Lejeune, publie par
les soins de ce dernier, dans un article postrieur (1983). Cette lettre permet de
comprendre que Doubrovsky a voulu, ou plutt a cru, remplir ce vide gnrique
avec le dispositif d'nonciation de Fils et le nologisme autofiction . En
crivant ce livre, il a pens inaugurer un genre qui n'existait que virtuellement,
qui ne demandait qu' tre ralise pour vivre pleinement. Pareille illusion peut
sembler bien nave aujourd'hui, alors que l'on prend toujours plus conscience
du volume et du pass des autofictions publies avant Fils. Il n'empche qu'elle
est constitutive de cette pratique et qu'on retrouvera cette erreur dapprciation
chez des critiques avertis, voire chez dautres crivains, quand on tudiera sa
rception. Mais cette illusion est surtout surprenante quand on revient sur le
projet initial de Doubrovsky dans Fils. Aprs tout, ce projet d'criture est en son
fond autobiographique, bien loign de toute fabulation biographique dlibre.
Que penser, par suite, de la signification donne par Doubrovsky cette notion
d'autofiction ? Un tat rcapitulatif de cette question va peut-tre permettre d'y
voir plus clair.
21
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Avatar de l'autobiographie, rfrentielle en thorie mais assez fictive en
pratique, romanesque au sens d'une certaine modernit, indite en son genre,
tels sont les caractres de l'autofiction selon Doubrovsky, du moins jusqu' Fils.
Ce rappel rapide permet de tirer un certain nombre de conclusions sur
l'apparition du vocable autofiction et sur la lgitimit de ses emplois ultrieurs.
Il est clair, en premier lieu, que ce nologisme n'a pas t cr pour
nommer ce qu'il dsigne aujourd'hui, une pratique ancienne mais jusque l
dpourvue d'appellation, la fictionnalisation de soi en littrature. C'est pour son
"projet prcis" d'criture (Doubrovsky, 1979, p. 194), en fonction de
sa tactique individuelle d'autobiographie (Doubrovsky, 1980 p. 94), qu'il
pensait comme novatrice et inaugurale, que Doubrovsky a propose ce mot.
Son projet tait manifestement dcrire une autobiographie postanalytique ,
de rpondre au dfi comment crire son autobiographie aprs et avec Freud ?
Aprs Freud, parce que ce matre du soupon a appris que le sujet ne
pouvait jamais concider avec lui-mme ; enseignement qui semble enlever
toute consistance au projet autobiographique. Avec Freud, parce qu'il est
difficile de relater sa propre cure sans faire de lanalyste le "sujet qui sait" et qui
fait dcouvrir au patient sa vrit ; situation qui parat supprimer la recherche de
soi lie lentreprise autobiographique. En ce sens, le projet de Doubrovsky ne
sort pas fondamentalement du cadre de l'autobiographie, sinon qu'il le module
de faon indite, qu'il le reprend nouveau frais, partir de la rvolution opre
par Freud dans la tradition occidentale de la connaissance de soi. Cet
inflchissement ne va pas, bien sr, sans bouleverser les habitudes de lecture,
les attentes en matire de style et de vraisemblance autobiographique. Mais les
procds traditionnels de l'criture de soi, pour paratre plus naturels, n'en sont
pas moins conventionnels et dats historiquement. Aprs tout, les liberts que
prend Fils avec le registre rfrentiel et la vrit n'excdent pas celles prises
par Chateaubriand dans ses Mmoires d'Outre-tombe. Elles sont simplement
diffrentes, induites par d'autres choix esthtiques, en particulier par une vision
de l'criture propre ce qu'on a appel la modernit.
Ds lors, le vocable autofiction peut sembler impropre pour dsigner ce
qui va faire l'objet de notre travail, pour nommer des textes souvent trs
loigns de l'autobiographie et une forme littraire o la fiction l'emporte sans
quivoque. A cette objection, on ne peut que rpondre qu'une situation de fait
s'est tablie et que le nologisme de Doubrovsky est le seul terme qui se soit
22
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
impos aussi bien dans la presse que dans l'institution scolaire ou scientifique.
Comment expliquer une telle mprise ? Comment expliquer que le terme qui
avait un contenu dtermin chez Doubrovsky ait pu voir son sens glisser ainsi ?
A relever la plupart des occurrences ultrieures du mot, ce glissement semble
tenir deux facteurs. D'une part, s'il manquait depuis longtemps un terme pour
cette pratique, ce besoin s'est fait sentir plus vivement cette dernire dcennie.
Ici et l des termes avaient t proposs ; mais c'tait toujours des noms
composs assez flous et prtant confusion : "roman-autobiographique",
autobiographie-roman", "autobiographie fantasme". "autobiographie rve",
"roman-miroir" (H. Juin) fiction-bilan (B. Poirot-Delpech) ou "roman d'aven-
tures intrieures" (F. Bott). Le terme autofiction prsentait lavantage d'tre
parlant, de bien signifier la dmarche consistant faire de soi une fiction ou
dcrire sa propre fiction, la fiction de soi. A quoi se conjugue le fait que le terme
autofiction n'a de sens prcis que dans les autocommentaires de Doubrovsky
qui ont t ignors la plupart du temps. A s'en tenir Fils et son prire
dinsrer, les choses sont moins claires. Le prire d'insrer, tout en asyndte,
permet toutes les interprtations du mot ; tandis que Fils, on l'a vu, par le
procd narratif qui consiste prendre le cadre d'une journe pour y condenser
une vie, parait beaucoup plus fictif que ne le pensait son auteur. D'autant plus
qu' notre connaissance, Doubrovsky n'a jamais dsavou l'usage ultrieur de
son nologisme.
En dfinitive, la faveur dont jouit le terme n'est donc pas si illgitime. Et
l'histoire est l, pour montrer d'autres malentendus qui ont t l'origine
d'innovations thoriques des plus fcondes. Ainsi, l'expression si fameuse de
"mise en abyme" qui repose sur une fausse analogie puisque, dans lart
hraldique, aucun blason ne se rflchit vraiment lui-mme comme le croyait
Gide.
B) Une dfinition
Si l'on doit Doubrovsky le mot autofiction, c'est Grard Genette que
l'on est redevable de la premire dfinition de la chose, telle qu'elle est ralise
chez Proust. Analysant un sommaire prospectif de la Recherche, adresse en
1915 Mme Scheikevitch, Genette montre bien dans quelle position
inconfortable se trouve Proust pour cerner l'identit de son narrateur et le statut
23
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
gnrique de son uvre. Cette analyse le conduit donner comme la formule
dveloppe du dispositif retors mis en place par Proust et le dsigner par le
terme autofiction :
"... La manire dont Proust dsigne et rsume son uvre
n'est pas celle d'un auteur de roman la premire personne
comme Gil Blas. Mais nous savons - et Proust sait mieux que
personne - que cette uvre n'est pas non plus une vritable
autobiographie. Il faudrait dcidment dgager pour la
Recherche un concept intermdiaire, rpondant le plus
fidlement possible la situation que rvle ou confirme,
subtilement et indirectement, mais sans quivoque, le 'contrat
de lecture' du sommaire Scheikvitch, et qui est peu prs
celle-ci : 'Dans ce livre, je, Marcel Proust, raconte (fictivement)
comment je rencontre une certaine Albertine, comment je m'en
prends, comment je la squestre, etc. C'est moi que dans ce
livre je prte ces aventures, qui dans la ralit ne me sont
nullement arrives, du moins sous cette forme. Autrement dit, je
m'invente une vie et une personnalit qui ne sont pas
exactement ("pas toujours") les miennes. Comment appeler
ce genre, cette forme de fiction, puisque fiction, au sens fort du
terme, il y a bien ici ? Le meilleur terme serait sans doute celui
dont Serge Doubrovsky dsigne son propre rcit : autofiction"
(Genette, 1982, p. 293).
Sous la forme d'une dclaration apocryphe de Proust, Genette rsume
donc le "contrat de lecture", la situation de la de communication propose par la
Recherche, telle que peut la percevoir intuitivement le lecteur. Ce qui ne peut
manquer de surprendre la lecture de cette uvre c'est que le narrateur porte
le mme prnom que l'auteur ("Marcel") et quil volue pourtant dans un univers
en grande partie imaginaire ; comme en font foi nombre danthroponymes
(Bergotte, Elstir, Vinteuil) ou de toponymes (Obmbray, Balbec) qui sont
manifestement invent. Intuitivement, le lecteur peroit un crivain qui s'identifie
lun de ses personnages dont le caractre fictif est affich un auteur qui se
met en scne dans des aventures visiblement imaginaires. Cest ce qui permet
de discerner chez un auteur la pratique de l'autofiction. Cette description de
Genette fournit donc une premire dfinition de l'autofiction son brevet de
dignit potique en quelque sorte.
On objectera que chez Proust la ralisation de l'autofiction, la
fictionnalisation de soi, est plus complexe. L'identification de "Marcel" est, en
effet, retarde dans la plus grande partie de luvre puisqu'elle n'a eu lieu que
dans La Prisonnire (1923), alors que le premier volume de A la recherche du
Temps perdu tait paru dix ans auparavant. Pour la plupart des lecteurs, le
24
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
narrateur de la Recherche est anonyme jusqu'en 1923. En outre, cette identit
peut-tre discute puisqu'elle est formule, au moins pour sa premire
occurrence dans La Prisonnire, de faon dngative. Au reste, comme on sait,
Proust a laiss ouverte la question du statut gnrique de son uvre, n'a
jamais situ clairement la position de la Recherche, par rapport au registre
autobiographique. Toutefois, cette complexit ne remet pas en question le
statut autofictif de luvre de Proust. Elle montre seulement que ce dernier a
compliqu une forme ralise plus simplement chez d'autres auteurs. Que cette
complication soit dlibre ou l'effet des indcisions de Proust, peu importe : le
rsultat est que la Recherche redouble l'ambigut constitutive la dmarche
autofictive et qu'elle n'en est que plus exemplaire. Car si le cas de Proust n'est
pas le meilleur exemple d'autofiction d'un point de vue didactique, c'est une
ralisation emblmatique pour l'autofiction en tant que forme littraire. Si l'on
peut parler de tradition propos de cette forme de fiction, la Recherche doit
tre considre comme l'un de ses paradigmes. C'est partir de Proust que
nombre d'crivains modernes, de Cline Bryce-Echenique, en passant par M
Charyn, vont chercher situer et dfinir leurs pratiques autofictives.
C) des prolgomnes
Pour terminer ce rapide panorama des travaux qui ont donn droit de
cit cette pratique littraire, il faut voquer les recherches de Philippe Lejeune
qui est le premier avoir esquiss l'analyse de cette forme et des problmes
qu'elle pose.
Dans un premier temps (1973). Lejeune avait reconnu la possibilit
thorique de cette forme de fiction, mais pour la refuser en pratique. Dans un
tableau qui dressait les combinaisons possibles entre le registre romanesque et
le registre autobiographique, il la reprsentait sous la forme d'une case aveugle
et ajoutait le commentaire suivant :
"Le hros d'un roman dclar tel peut-il avoir le mme
nom que l'auteur ? Rien n'empcherait chose d'exister, et
c'est peut-tre une contradiction interne dont on pourrait
tirer des effets intressants. Mais dans la pratique, aucun
exemple ne se prsente l'esprit d'une telle recherche. Et
si le cas se prsente, le lecteur a l'impression qu'il y a
erreur si la contradiction interne tait volontairement
choisie par un auteur, elle n'aboutirait jamais un texte
25
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
qu'or lirait comme une autobiographie; ni vraiment non
plus comme un roman ; mais un jeu pirandellien
d'ambigut. A ma connaissance, c'est un jeu auquel on
ne joue pratiquement jamais pour de bon"
(Lejeune, 1975, pp. 31-32).
Ce commentaire permet de constater qu'au dpart non seulement
Lejeune ne voit pas d'exemples de ralisations empiriques de ce registre mixte,
mais que la possibilit mme de son existence lui semble une hypothse
d'cole. Qu'un auteur puisse pour de bon en faire une stratgie exclusive
d'criture, comme Cline ou Gombrowicz, lui semble quelque chose
d'inconcevable. Cet aveuglement d'un spcialiste du genre autobiographique
envers une forme passablement rpandue peut surprendre. En l'absence d'un
terme et d'une tradition qui permettent de reprer cette forme de fiction, cette
mconnaissance n'a rien d'extraordinaire, comme on l'a vu avec Doubrovsky.
Dans un article publi pour la premire fois en 1978, Lejeune utilisera le
terme "autofiction", mais dans une note en bas de page et selon le sens
restreint que lui donnait initialement Doubrovsky. C'est propos d'Hosto-blues
(ditions des femmes, 1976). un rcit plutt atypique de Victoria Thrame sur la
condition dinfirmire :
Hosto-blues est-il un livre rfrentiel ou une fiction ?
Lemploi de techniques empruntes Butor, Cline ou Claude
Simon fait plutt classer le livre dans le registre des fictions. On
le prend pour un tmoignage romanc ou, pour me servir d'une
expression lance par Serge Doubrovsky a propos de son texte
"autobiographique" Fils (ditions Galile, 1977), une
autofiction. Il faudra sans doute du temps pour que ce type
d'criture et de composition s'intgre notre "vraisemblable" :
c'est une affaire d'volution historique des conventions, car en
elles-mmes ces techniques ne sont ni plus loin, ni plus prs de
la ralit (que celles qui sont plus conventionnelles) .
(Lejeune, 1980, p. 217).
On voit pourquoi le mot "autofiction" est pris ici dans son acception
originale. C'est que le rcit de 'Victoria Thrame est trs proche de la manire
de Fils. Si la narratrice ne porte pas le nom de l'auteur, s'appelle "Mlle Zo", l'une
des pigraphes suggre avec force qu'ils ne font qu'un :
26
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Observations
Hpitaux Cliniques
Paris - Marseille
1960 1970
Par ailleurs, les dix annes d'exprience hospitalire qui constituent la
matire du livre sont filtres, comme dans Fils, travers une dure trs brve
qui sert de cadre au rcit : une nuit de travail dans une clinique de Passy.
Comme chez Doubrovsky, il n'est pas question pour l'auteur de s'inventer une
existence originale ; il s'agit simplement de modifier, d'adapter le registre
autobiographique pour le rendre apte vhiculer un propos qui se veut
totalement indit, en l'occurrence une vision incendiaire de la socit et du
travail.
C'est aprs tre revenu sur quelques-uns de ses prsupposs
thoriques, dans Le Pacte autobiographique (bis) (1983), que Lejeune a
commenc prendre en compt l'existence empirique de l'autofiction. Cela l'a
conduit entreprendre le premier examen consquent de cette forme dans
"Autobiographie, roman, nom propre" (1984). Analysant les cas de Lanzman et
de Doubrovsky Lejeune aborde quelques-uns des problmes essentiels qui
touchent ce type de fiction : le systme de prsentation paratextuel, les
contraintes de l'dition sur ce systme, ses effets sur le lecteur, les questions
juridiques et thiques en jeu, les autocommentaires de Doubrovsky et les
facteurs qui dterminent la perception d'un nom de personnage comme rel. Si
l'autofiction n'est pas le seul objet de cette tude, Lejeune en propose une
description qui vient complter celle de Genette :
"Pour que le lecteur envisage une narration apparemment
autobiographique comme une fiction, comme une 'autofiction' il
faut qu'il peroive l'histoire comme impossible, ou comme
incompatible avec une information qu'il possde dj. Quand
Dominique Rolin raconte, dans Le Gteau des morts, roman
(Denol, 1982), l'agonie et la mort de Dominique Rolin, au mois
d'aot 2000, en nous livrant son monologue intrieur, nous
lisons effectivement l'histoire comme jeu et comme hypothse.
Il en est de mme quand nous lisons le cinquime volume de la
srie "autobiographique" de Cavanna, Maria (Belfond, 1985).
27
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
qui peint des pisodes de la vie de Cavanna en 1989 ou 1990
(Lejeune, 1986, p. 65).
Cet article est, notre connaissance, le premier tudier l'autofiction
comme une pratique gnrique, sans la limiter la stratgie singulire d'un
crivain. Passionnant plus d'un titre, il n'a qu'un dfaut : c'est de se limiter
des textes de la dernire dcennie et de suggrer que cette forme de fiction est
un phnomne rcent, propre un "temps du soupon" envers la forme
autobiographique (Lejeune, 1986, P. 40). Lejeune ne semble pas mesurer
l'ampleur des ralisations de ce dispositif d'identification fictionnelle, ni son ge
plus que respectable. Une uvre comme La Divine Comdie (voyage
imaginaire dont le narrateur-hros est, comme on sait, Dante lui-mme), par
exemple, remplit tout fait les conditions qu'il pose l'existence de l'autofiction.
Pourtant, ce texte fameux appartient une pistm o le sujet, le rfrent et la
vrit ne subissaient pas le travail de dconstruction dont ils sort aujourd'hui
l'objet.
Cet essai voudrait prcisment montrer et explorer l'importance la fois
quantitative et qualitative de l'autofiction. Nous voudrions rendre sensibles la
porte et l'amplitude de ce dispositif par lequel un auteur se transforme en un
personnage romanesque, et qui est prsent depuis longtemps un peu partout,
mme si ses effets demeurent souvent mystrieux.
28
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
1. 2. QUESTIONS DE METHODE
Si un clectisme des fins brouille indment tous les
systmes, il sembl qu'un clectisme des moyens soit
admissible...
G. Bachelard
29
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Ds prsent, cette enqute sur l'autofiction dispose de repres
prcieux. Ce sont un terminus technicus et une premire dfinition : une
autofiction est une uvre littraire par laquelle un crivain s'invente une
personnalit et une existence, tout en conservant son identit relle (son
vritable nom). Bien qu'intuitive, celle-ci permet de dessiner les contours d'une
vaste classe, d'un riche ensemble de textes ; une contre littraire semble
merger des limbes de la lecture. C'est aussi un nouveau visage et une
nouvelle cohrence que paraissent acqurir certaines uvres ; toute une
thorie d'crivains rputs "mythomanes", de Restif Gombrowicz, dont les
fabulations intimes prennent soudain une signification littraire. C'est le moyen,
enfin, de mettre en perspective des uvres jamais ou rarement rapproches.
Que peuvent bien avoir en commun La Divine Comdie et la trilogie allemande
de Cline, Moravagine et la Recherche, Siegfried et le Limousin et Cosmos, le
Quichotte et Aziyad ? Ils prsentent pourtant la proprit commune d'tre
fictifs et d'enrler leurs auteurs dans le monde imaginaire qui leur est propre.
On pourrait continuer de produire de telles rencontres, apparemment
improbables et de dployer la diversit foisonnante des uvres littraires
susceptibles de rpondre cette dfinition de l'autofiction.. Ces
rapprochements suffisent manifester les difficults et les objections que soulve
l'tude dun tel ensemble. Une telle varit doit rendre souponneux : la
profusion n'est bien souvent que le masque du syncrtisme. Indniablement, on
a affaire une classe de textes composite et problmatique.
C'est d'abord l'existence, dj voque, de formes extra-littraires de la
fiction de soi qui tmoigne de son caractre composite. Au mme titre que
l'autoportrait, l'autofiction ne semble pas pouvoir tre limite la littrature. Il
est possible de trouver des pratiques similaires dans d'autres domaines de l'art:
voyez le Christ outrag de Drer, Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godart ou
luvre photographique de Gilbert et George.
Mais mme en restant dans le champ de la littrature, le caractre
composite de cette classe de textes reste manifeste dans l'tonnante varit,
qualitative bien sr, mais aussi historique et gographique, thmatique,
formelle.
30
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
La diversit gographique et historique est vidente. Une bibliothque
imaginaire consacre l'autofiction devrait ranger cte cte un crivain de
Taiwan comme Huang chan Ming et le Limousin Giraudoux, un Pruvien
comme Vargas Llosa et un Florentin comme Dante ; Properce viendrait
s'aligner avec Proust et Restif de la Bretonne avec Philippe Sollers. Cette forme
de fiction semble traverser toutes les poques, tous les pays et toutes les
cultures.
Du point de vue thmatique et formel, aucune catgorie oblige ne
parat exister. Aucun topos, figure ou motif, aucun schme ou procd, aucune
technique n'apparat tre une mdiation du "genre". Tout comme pour le roman,
on a l'impression que l'autofiction peut accueillir tous les thmes, s'emparer de
toutes les ressources formelles.
Enfin, la diversit de ses situations d'nonciations, de ses modes n'est
pas moindre. Si le mode narratif mixte semble nettement dominant. on trouve
des autofictions au thtre comme le montrent l'glise de Cline ou La Grotte
dAnouilh ; des autofictions dans la posie comme l'illustre l'lgie rotique
romaine.
Ainsi, tant sur le plan culturel que sur le plan architextuel qui
dsigne, rappelons-le, les catgories thmatiques, formelles ou modales que
met en uvre le discours littraire (Genette, 1979, pp. 85-90). Lautofiction
prsente les ralisations les plus htroclites. Aucune proprit
architextuelle ne permet de donner, apparemment, une unit la classe de
textes qu'elle runit. Toute cette diversit, pour ne pas dire cette disparit, pose
un problme de cohrence. Aux antipodes d'une unit, le corpus que l'on peut
dresser n'est pas ressenti intuitivement comme un ensemble, comme une
totalit, ce qui explique peut-tre en partie la mconnaissance de la chose. On
se trouve devant une premire difficult qui est celle d'tudier des ralisations
diffrentes comme les manifestations d'un invariant identique. Cette situation
conduit se demander si cette classe n'existe pas la faveur d'un syncrtisme
de mauvais aloi ; si des analogies superficielles n'ont pas t confondues avec
la ralisation de traits dfinitoires ; si une confusion n'est pas au principe de
cette runion si cumnique.
Cette suspicion est d'autant plus lgitime que l'on a affaire une classe
de textes problmatique.
31
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Cette classe est problmatique pour plusieurs raisons, qui sont
factuelle, historique et pragmatique. Il y a d'abord une donne de fait, qui est
que les protocoles ditoriaux, pour dsigner un texte comme fictif se sont
modifies avec le temps et qu'il n'est pas toujours facile de savoir aujourd'hui
comment un crivain des sicles passs prsentait ses ouvrages ni comment
ils taient lus. Pour prendre un exemple trs simple, lindication gnrique
"roman", qui est aujourd'hui le signe le plus conomique et le plus commun
pour marquer le caractre imaginaire d'une uvre, ne se rpand sur les
couvertures ou les pages de titre que vers les annes vingt : comme l'a
judicieusement not Genette, "aucun roman de Balzac, de Stendhal ou de
Flaubert ne comporte cette mention" (Genette, 1987, P. 91) sur ldition
originale de leur ouvrage.
Plus avant, l'existence de l'autofiction prsuppose une donne plus
thorique, mais pas moins contraignante, et qui n'est pas naturelle comme on le
pense trop souvent, qui est dtermine historiquement. Nous voulons parler du
grand partage entre le fictif et le vcu, entre l'imaginaire et le rfrentiel, qui
commande aujourd'hui encore la lecture et qui se met en place au XVIIe sicle.
On sait bien sr qu'une telle dmarcation existait dj dans l'Antiquit et au
Moyen Age. Dans la Potique d'Aristote, on trouve ainsi une distinction entre le
pote et l'historien, au dbut du chapitre 9 :
"Le rle du pote est de dire non pas ce qui a lieu
rellement, mais ce qui pourrait avoir lieu dans l'ordre du
vraisemblable ou du ncessaire la posie traite plutt du
gnral, la chronique du particulier" (Trad. R. Dupont-Roc et J.
Lallot, 1980).
Seulement, il est clair que ce partage trs ancien n'a pas toujours eu le
mme visage. La citation d'Aristote montre elle seule que, dans l'univers de
pense grec, il ne s'est pas fait pour les mmes raisons, ni selon les mmes
modalits ni avec les mmes effets. Faute de tenir compte de cette variabilit,
on risque d'appliquer indment notre dfinition ; on prendrait alors pour des
autofictions des textes qui ne sont tels que rtrospectivement, en cdant cette
illusion rtrospective du vrai que dnonait Bergson. Voil une donne qu'il est
difficile d'ignorer et qu'il faut ncessairement prendre en compte face une
uvre comme La Divine Comdie, vis--vis d'un genre comme l'lgie rotique
romaine.
32
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Enfin, il faut tenir compte d'une difficult pragmatique presque
rdhibitoire. C'est l'absence d "horizon d'attente", de rception et,
paralllement, de code idologique ou rhtorique, de discours d'escorte pour
cette pratique fictionnelle. L'absence d'un terme spcifique pour la dsigner, la
reconnatre et la classer, marque bien ce manque. De la mme faon qu'il ne
semble pas y avoir d'attente particulire pour cette forme de fiction, celle-ci ne
dispose pas d'une thorie indigne labore par des crivains pour clairer
leur travail. Ainsi, Gombrowicz a pu construire toute son uvre romanesque sur
cette forme sui generis de fiction, sans prendre la peine de s'expliquer, sans
que la majeure partie des critiques s'interrogent et sans apparemment que ses
lecteurs en fassent une lecture approprie. Et l'on pourrait dire la mme chose
de Cline, si les travaux de Henri Godard n'avaient signal et analys le
mariage incessant de l'imaginaire et du vcu prsent dans sa trilogie allemande
(Dun Chteau l'autre, Nord, Rigodon).
Comme on l'a vu, le vocable autofiction est un terme rcent qui
vient coiffer rtrospectivement des textes qui n'taient peut-tre pas crits pour
produire un tel effet, qui n'taient en tous cas pas lu dans cette perspective. Par
consquent, si l'on peut construire une classe compose de textes prsentant
cette particularit gnrique, il faut se demander si cet ensemble a quelque
lgitimit littraire. Ds lors qu'il s'agit d'une classification a posteriori et
extrieure aux textes, on peut s'interroger sur sa validit et sur sa pertinence.
(Aprs tout, on peut aussi bien construire une famille littraire avec tous les
romans qui ont plus de quatre cents pages ou avec tous les recueils potiques
dont le titre commence par la seconde voyelle de l'alphabet). Pour que cette
dtermination de l'autofiction ait un sens, il faudrait au moins que cette classe
de textes prsente une certaine unit interne. Or on l'a vu, cette classe est
extrmement composite et ne manifeste aucune unit.
Composite et problmatique pour des raisons qui tiennent la diversit
des textes, la variabilit des protocoles de lecture et labsence de rception,
la chose autofictive fait problme sur le plan mthodologique et thorique. On
en vient douter de l'existence d'une entreprise commune, d'un projet similaire
chez divers auteurs qui justifierait l'existence gnrique d'une forme de fiction
appele autofiction. On sait que toute tude gnrique pose un problme de
mthode puisque, pour tudier les ralisations d'un genre, il faut au pralable le
dfinir, dfinition qui suppose connues les ralisations. Dans le cas de
33
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
l'autofiction, le risque d'une ptition de principe trouve sa forme hyperbolique
puisqu'on peut douter de l'existence mme de l'autofiction comme objet et se
demander si on ne l'invente pas en tentant de l'tudier. En commenant cet
essai, on a not qu'un certain nombre de textes se retrouvait dans la
fictionnalisation de leur auteur et que ce phnomne mritait un examen
attentif. Ne s'agissait-il pas d'une illusion ? Cette pratique de la fiction de soi
n'est-elle pas une fausse fentre ? Une catgorie produite par notre manire
d'apprhender les rapports entre la fiction et l'autobiographie ? C'est peut-tre
confondre un peu vite le plan pratique et le plan thorique, les mandres de la
praxis et les arcanes de la connaissance. Il est certain que notre apprhension
intuitive de l'autofiction ne peut suffire pour fonder son examen. Mais cela ne
signifie pas qu'il soit impossible de trouver une mthode adquate pour tudier
et traiter la masse des textes qui rpond notre dfinition intuitive de dpart.
Quelle pourrait tre cette mthode ? Trois types d'approche semblent possibles:
une approche historique, une approche critique et une approche thorique.
La premire serait sans doute la plus approprie pour avoir une vue
d'ensemble de l'autofiction. On tudierait cette forme de fiction comme on a pu
tudier le Journal intime, en retraant ses commencements, son
dveloppement et ses mutations, la conscience critique qui l'a accompagne et
sa progressive institutionnalisation. Cette dmarche est toutefois impensable
tant que l'on ne dispose pas d'une dfinition plus taye de l'autofiction ; tant
que l'on ignore s'il s'agit d'autre chose que d'une ralit hypostasie partir de
phnomnes littraires trs diffrents. Une telle perspective diachronique
suppose que l'on dispose d'instruments d'analyse plus sophistiqus et que l'on
sache au juste quel est le statut de cette forme littraire mconnue.
L'approche critique, quoique moins ambitieuse, serait-elle plus adapte
au statut incertain de cet objet ? Elle consisterait examiner l'autofiction, auteur
par auteur, en considrant chacun d'eux comme un cas d'espce et en
tablissant, de faon longitudinale, une suite de monographies. Une telle
mthode permettrait sans doute de voir plus en dtail quels besoins et pour
quels effets rpond l'usage de ce dispositif fictionnel. On aurait ainsi des
informations prcises sur les intentions, les modalits de ralisation et les effets
de ce type de fiction pour une ou plusieurs stratgies particulires. Quoique
sduisante cette mthode ne fournira pourtant jamais que des informations
lacunaires et disparates sur l'autofiction en gnral. Si ce travail est
34
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
indispensable; Ce ne peut tre un point de dpart. miette, l'analyse sera au
bout du compte strile car elle ne permettra pas de problmatiser le "genre",
d'identifier toutes ses manifestations, de les spcifier et de les expliquer. Bien
plus, en renonant atteindre l'autofiction comme une pratique rcurrente, on
s'interdit tout examen de la cohrence et de l'unit de celle-ci.
On l'aura compris, la seule dmarche qui permette de surmonter les
difficults de mthode que pose l'autofiction est une dmarche thorique, qui
considre celle-ci d'abord dans ses potentialits, ses proprits virtuelles, qui
cherche construire un modle susceptible d'analyser toutes les ralisations
empiriques. Kant disait que les sciences de la nature taient devenues adultes,
le jour o celles-ci avaient pris les devants, avaient suscit les problmes,
avaient oblig la nature rpondre leurs questions sans se laisser conduire
par elle. La raison scientifique se prsenta alors la nature, "non pas comme
un colier qui se laisse dire tout ce qu'il plait au matre mais au contraire,
comme un juge en fonction qui force les tmoins rpondre aux questions qu'il
leur pose". Mutadis Mutandis, il faut ici faire sienne cette "rvlation lumineuse"
qu'voque Kant, rpondre au caractre problmatique de l'autofiction en
construisant une problmatique de l'autofiction, en ramenant cette ralit
littraire composite un ensemble de questions dont les lments soient
homognes. Autrement dit, il s'agit d'envisager cette forme de fiction dans une
perspective potique, qui s'attache moins la littrature et aux uvres
existantes qu'aux "virtualits du discours littraire", qui ne se limite pas
"rendre compte des formes ou des thmes existants" mais qui explore "le
champ des possibles, voire des 'impossibles', sans trop s'arrter cette
frontire qu'il ne lui revient pas de tracer" (Genette, 1983, p. 109). Une telle
option permet de saisir les autofictions dans toute leur diversit et dans leur
ventuelle unit puisqu'elle consiste laborer les catgories pouvant
engendrer les formes possibles, effectives ou non, de cette forme de fiction.
Dans cette perspective, l'existence gnrique de l'autofiction est une hypothse
de travail, permettant la recherche d'instruments de description et d'analyse, qui
rendent possible leur tour la spcification et la justification de cette hypothse.
Eh laborant ces instruments de recherche, l'enqute ne manquera pas de
mettre l'preuve celle-ci car, si nous travail sur le possible autofictif, ce ne
sera pas sans convoquer les textes singuliers puisque c'est le seul lieu partir
duquel ce possible peut tre pens. On notera aussi que cette dmarche de
poticien permettra d'carter les difficults lies la variabilit des protocoles
35
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
de lecture et d'aborder la question pineuse des effets pragmatiques d'une
famille littraire qui n'a pas de vritable rception ou dont la rception est en
voie de constitution.
Pratiquement, notre enqute consistera donc chercher de la faon la
plus gnrale comment un auteur peut se fictionnaliser, consistera identifier
les paramtres de cette figure d'nonciation, consistera dcomposer les
prsupposs de cette "situation communicative globale" par laquelle un crivain
fait concider son rle d'auteur avec le rle fictif de l'un de ses personnages
(situation de communication qui n'est pas sans faire penser au rcit d'un
mythomane qui, contre toute attente, annoncerait le caractre imaginaire de sa
narration). Pour des raisons videntes, on limitera cette enqute au mode
narratif et notre corpus la littrature occidentale postrieure au XVIIe sicle.
Mais cela ne nous empchera pas, l'occasion, de faire des incursions dans
d'autres modes littraires ou de faire appel des ralisations empiriques
d'autres poques, d'autres cultures. Cette perspective analytique devrait
permettre d'viter toute rification et de temprer le "dsir ontologique" que l'on
peut ressentir devant l'autofiction. Une fois ce travail de dissociation accompli
(et une fois seulement), on tentera de juger la lgitimit de l'hypothse faisant
de l'autofiction une pratique littraire homogne. Jusqu' cette tape, la notion
d'autofiction n'aura aucun contenu, ce sera juste un terme commode pour dsi-
gner un dispositif formel rsultant de procds trs divers.
On partira, par consquent, de notre notion intuitive de l'autofiction et
l'on tentera de faire travailler conceptuellement cette notion, selon un
programme magistralement dcrit par Canguilhem :
"Travailler un concept, c'est faire varier l'extension et la
comprhension, le gnraliser par l'incorporation des traits
d'exception, l'exporter port de sa rgion d'origine, le prendre
comme modle ou inversement lui chercher un modle, bref lui
confrer progressivement, par des transformations rgles, la
fonction d'une forme" (Canguilhem, 1956, p.167).
La premire de ces "transformations rgles" sera de convertir notre
dfinition de dpart en un modle de base spcifi par des traits dfinitoires
minima, modle qui va nous permettre d'explorer cette forme de fiction dans
toutes ses dimensions.
36
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Le problme est donc de formaliser notre dfinition intuitive de
l'autofiction afin d'obtenir une sorte de modle analytique mettant en valeur les
indices formels par lesquels une autofiction se signale comme telle pour le
lecteur. Pour mettre en place un tel modle, le plus simple parait de partir de la
situation d'nonciation de l'autobiographie puisque l'autofiction est perue
d'abord comme un cart ou une aberration, comme on voudra, par rapport
celle-ci.
On sait, aprs les travaux de Lejeune, que le genre autobiographique se
distingue par deux critres, qui ne sont pas exclusifs, dterminants pouce la
lecture (Lejeune, 1975) :
a) l'identit nominale de l'auteur et du personnage principal ;
b) l'affirmation de cette identit, dans le titre, une prface ou un
avertissement.
Le plus souvent, cette identit nominale est partage par le narrateur.
Mais comme l'a aussi montr Lejeune (1980) par la suite, il n'y a rien dans la
langue ou dans les formes narratives qui rende cela ncessaire. Il est toujours
possible, comme l'ont fait Henri Adams ou Stendhal, d'crire son
autobiographie (ou son autoportrait) la troisime "personne" - comme il est
toujours possible de parler de soi autrement qu' la premire "personne". Si ce
rgime d'nonciation va l'encontre de l'usage et des habitudes de lecture,
c'est pourtant en un sens un "retour une situation fondamentale". Par cet
emploi inhabituel du il, on dfait et on exhibe la confusion entre le sujet de
l'nonciation (celui qui parle) et le sujet de l'nonc (celui dont on parle) qui est
au principe de la narration sur un mode personnel. On dmasque alors les
coulisses de l'nonciation, mais on ne fait pas violence la structure de la
langue. Cette remarque est importante car elle tablit que l'on peut sans
aberration se reprsenter de l'extrieur, comme travers le point de vue d'un
observateur tranger, en se dsignant par un nom propre ou par la troisime
"personne" du singulier. On verra que cette possibilit permet des formes
originales de fiction de soi.
Dans la dfinition de Lejeune, lautobiographie est dfinie par deux
critres. Pour les besoins de notre recherche, nous prendrons la libert
d'amnager cette analyse de la faon suivante. Par le terme de Protocole
37
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
nominal, nous dsignerons l'identit onomastique de l'auteur et d'un
personnage, principal ou non. Par celui de Protocole modal, nous dsignerons
tous les lments du texte ou du "paratexte" (de l'indication gnrique la
prface) qui valent pour une affirmation soit de fictionalit, soit de rfrentialit,
c'est--dire de vracit. Dans le premier cas, on aura affaire un Protocole
modal fictionnel ; dans le second, un Protocole modal rfrentiel.
A partir de l, notre dfinition intuitive de l'autofiction peut donc se
formuler, de faon plus rigoureuse, comme l'addition paradoxale d'un protocole
nominal et d'un protocole modal fictionnel. Prenons comme exemple un rcit
dont la valeur littraire n'est sans doute pas le plus notable, mais qui a
l'avantage d'actualiser le dispositif protocolaire de manire particulirement
appuye, pour ne pas dire brutale. A tel point que ce texte atteint dans
l'auto-drision et la charge auxquelles peut se livrer un crivain envers son
personnage d'auteur et sa propre personne, des sommets rarement atteints.
Soit donc La guerre des pds (A. Michel, 1982) de Copi. De quoi s'agit-il ?
D'une pochade en quatre tableaux qui, du milieu gay parisien des annes 80
la lune, en passant par le Berry, relate la passion du narrateur pour un
hermaphrodite amazonien, Conceo do Mundo ; passion contrarie par les
obscures manuvres d'une secte de mutants amazoniens, millnaristes et
adorateurs du soleil ; le tout baignant dans une hcatombe d'homossessuels
(comme dirait Zazie) avec en vrac un vaisseau spatial, une catastrophe
plantaire, un sjour sur la lune et des nouveaux croiss, la "Brigade des
Pds". Pourquoi cette histoire, aussi crue que grotesque, aussi sanglante
qu'abracadabrante, est-elle une autofiction ? Parce que c'est un rcit la
premire personne et que le narrateur se dfinit d'emble comme un
"dessinateur humoristique" (p. 13), qui de plus "a le sens du thtre" (p. 163)
comme on l'apprend par la suite ? Parce qu'il est invraisemblable que de telles
tribulations soient arrives qui que ce soit, ft-il Copi ? Parce que cette fiction
fait intervenir des individus dont l'existence historique est atteste (Sylvia
Monfort, Coluche, le mme Marceau, Wolinski, Topor, Michel Foucault,
Alexandre, Cohn Bendit, Duras) et qui pourtant nous sont dcrits (pp. 76-77),
tous plus morts les uns que les autres, dans une scne aussi invraisemblable
que de mauvais got ? Pas seulement. On est bien en face d'une
fictionnalisation de soi surtout parce que, tout d'abord, l'auteur Copi a un
homonyme dans sa propre fiction, qui se nomme indiffremment "Pico" ou
"Copi" (pp. 84, 94) : cette homonymie remplit la condition d'un protocole
38
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
nominal. Ensuite, parce que l'univers de ce rcit est irrel et que ce texte porte,
de faon dlibre et incontournable pour le lecteur, l'indication gnrique
"roman" sur sa couverture. Cette dclaration modale ralise la condition d'un
protocole fictionnel.
En mariant ces deux protocoles, Copi obtient des effets contradictoires
que ni la fiction ni l'autoportrait ne pourraient produire. Il donne une version
romanesque de cet univers fantastique rvl par ses dessins et son thtre
Mais il s'inscrit aussi dans son propre univers, donnant une sorte d'autoportrait
travesti, une reprsentation drisoire et grotesque de l'crivain Copi par
lui-mme, dans la tradition du thme de l'artiste-clown ou bouffon dont Jean
Starobinski a montr l'existence, les conditions d'apparition et la signification
(Starobinski, 1970).
On voit tout de suite l'intrt de ces deux protocoles pour certaines
uvres. Ils ont une valeur indiciaire et par suite discriminatoire vidente.
Chacun d'eux marque une position d'nonciation, c'est--dire un rgime de
discours singulier, soit fictif, soit autobiographique ; et leur conjonction, un
rgime plus retors mais qui n'en existe pas moins, mme si sa perception est
problmatique. Ce sont par consquent aussi des protocoles qui appartiennent
des systmes de conventions et de classifications qui organisent aujourd'hui
la lecture. C'est par eux que le lecteur peroit, quand il le fait, qu'il n'est ni dans
la fiction ni dans le rfrentiel, mais dans un registre indcis. Ils constituent pour
notre enqute, enfin, un modle fondamental qui doit permettre d'homogniser
les problmes d'identification, de spcification ou d'explication que pose
l'autofiction. Autrement dit, il doit permettre de dlimiter la classe des textes
autofictifs de faon indiscutable, d'en dgager les proprits et de fournir les
instruments ncessaires l'tude de ses effets.
A propos de ces protocoles, une prcision est ncessaire. Tous deux
fournissent un espace et un axe de travail, mais il faut bien voir qu'ils
constituent un "type idal" de l'autofiction et que, dans bien des uvres
abordes, ils ne seront pas aussi univoques, simples et explicites que dans le
roman de Copi. Par la suite, il faudra oprer une autre "transformation rgle"
de notre dfinition de dpart en la gnralisant par l'incorporation des traits
d'exception des protocoles, pour reprendre la formule de Canguilhem. Ainsi,
pour le protocole modal, on s'attachera examiner aussi bien des ralisations
sans ambigut que des cas plus impurs, comme par exemple celui de
39
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Moravagine o les diffrentes rditions ont sdiment l'appareil pritextuel de
telle faon que le protocole modal de ce texte est la fois complexe et
contradictoire. Entre la Prface de 1926, le Pro domo et la Postface de 1951,
Cendrars a mis en place un tel systme de reprises, de dmentis et de
dplacements qu'en ralit ce pritexte a pris la consistance d'une uvre : au
lieu de donner le mode d'emploi du texte qu'il surplombe, il est lui-mme
interprter.
De mme, il faudra s'attarder sur des uvres aux protocoles
onomastiques indcis car une identit n'est pas affaire de tout ou rien, il y a
toute une srie de degrs possibles qui va de l'anonymat partiel l'identit
contradictoire. Si le hros et narrateur ponyme de Ren ne s'appelle pas
Franois-Ren de Chateaubriand, il se prnomme tout de mme Ren et ce fait
est rarement examin dans sa valeur pragmatique et travers une typologie.
Camus avait not propos de luvre de Kafka un problme similaire : "Dans
le Procs, le hros aurait pu s'appeler Schmidt ou F. Kafka. Mais il s'appelle
Joseph K. Ce n'est pas Kafka et pourtant c'est lui. C'est un Europen moyen. Il
est comme tout le monde. Mais c'est aussi l'entit K..., qui pose l'x de cette
quation en chair" (Camus, Pliade, p.204)
Pourquoi intgrer tous ces cas plus ou moins impurs, au lieu de s'en tenir
au modle univoque que fournissent ces deux protocoles ? N'y a-t-il pas l le
risque de transformer cette enqute sur l'autofiction en un fourre-tout de toutes
les curiosits littraires ? C'est que cette forme de fiction n'est pas un genre
institutionnalis, historiquement situable par exemple. C'est une pratique au
statut incertain et aux frontires floues, qui ne rsulte peut-tre que de la
rencontre fortuite de tentatives venant d'horizons trs divers. On ne peut donc
prjuger de sa ralit avant de l'tudier. Plus qu'un canon ou un idal normatif,
ce modle doit servir de boussole pour se reprer dans cette rgion. Et comme
le dit si bien Lejeune : "Il ne faut pas confondre l'axe magntique qui rgit la
boussole avec la multiplicit des directions qu'elle permet de reprer. Et il faut
admettre qu'il y a dans la ralit d'autres axes d'organisations que l'axe
magntique..." (Lejeune, 1983, p. 421).
40
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
D E U X I E M E P A R T I E :
MUTATO NOMINE
"Qu'y a-t-il dans un nom ? C'est ce que nous nous
demandons quand nous sommes enfants en crivant ce nom
qu'on nous dit tre le ntre"
J. Joyce.
41
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
2. 1. Le protocole nominal : premier
critre de fictionnalisation
"Tout ce que j'ai eu de l'un, tout ce que j'aurai de l'autre,
c'est leur nom. Sans leur nom, ils n'auraient t que des
fantmes".
J. Giraudoux.
42
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
L'expression Mutato nomine, qui vient d'Horace, fut un temps une locution
courante pour signifier les allusions que l'on fait en dsignant des personnes ou
des choses sous un nom tranger. Le texte d'Horace dit :
"Pourquoi ris-tu, le nom tant chang, ce rcit est ton
histoire" (Satires, I, 1, V. 69)
A proprement parler, cette expression serait plus adquate en tte d'une
tude de la satire, du roman clefs, voire du roman personnel. En un sens,
l'autofiction n'est possible que si le nom de l'auteur n'est prcisment pas chang,
si le lecteur peut identifier l'crivain en reconnaissant son nom dans celui port par
un personnage. Toutefois, les manires par lesquelles un auteur peut se
reprsenter sous la forme d'un personnage de fiction sont trs nombreuses. Contre
les apparences, on verra que donner son patronyme et son prnom son hros
n'en est qu'une parmi d'autres, de loin la plus simple. Dans de nombreux cas, les
crivains recourent des transformations onomastiques subtiles qui ne sont pas
sans rappeler les procds de la satire ou du roman clefs. C'est justement toutes
ces transformations qui sont l'objet de cette partie et qui justifient l'emprunt fait
Horace.
Autrement dit, il s'agit d'examiner toutes les modalits possibles de
protocole nominal. Mais avant d'entrer dans le dtail de ces modalits, il n'est pas
inutile d'apporter quelques prcisions sur la nature et l'efficience de ce protocole.
La nature du protocole nominal consiste, on l'a vu, dans l'identit nominale
de l'auteur et de l'un de ses personnages. C'est parce que tous deux portent le
mme nom que le lecteur est amen les identifier, Il faut insister sur le caractre
nominal de cette identit. Le protocole nominal ne consiste que dans une
quivalence tablie directement ou indirectement, par le biais d'un nom propre de
personne, d'un anthroponyme. Il s'agit donc d'une simple relation d'homonymie
entre le nom "auctorial" (le nom de l'auteur) et un nom "actorial" (le nom d'un des
personnages). Ce terme d'homonymie se justifie parce que les noms de l'auteur et
du personnage ont la mme forme, mais n'ont pas le mme sens, ne prtendent
pas dsigner rellement la mme personne. La relation mise en place par le
protocole nominal rpond donc la dfinition linguistique de l'homonymie (Lyons
43
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
1978, p. 25). Cette relation est une condition la fois ncessaire et suffisante pour
la ralisation du protocole.
Ncessaire, cette condition l'est parce que l'homonymie est le seul critre
rigoureux et indiscutable pour distinguer les cas o un crivain s'est fictionnalis
dans un ou plusieurs de ses ouvrages. Des similarits physiques, psychologiques
ou biographiques entre un auteur et l'un de ses personnages ne peuvent pas
remplacer totalement cette identit du nom, faute de quoi il serait en effet
impossible de distinguer l'autofiction du roman personnel. Si l'on se contentait de
simples analogies, il faudrait considrer la quasi-totalit de la littrature comme
une tentative de fictionnalisation de soi, ce qui enlverait bien videmment tout
intrt cette catgorie. Aussi ne faut-il pas confondre le lien tabli par ce
protocole avec une ressemblance entre l'auteur et son hros.
Prenons un exemple pour illustrer le caractre ncessaire d'un tel critre et
pour montrer a contrario l'inadquation de cette notion de ressemblance : Louis
Lambert de Balzac. Il y a longtemps que ce texte est considr comme le plus
autobiographique des romans de La Comdie humaine, celui pour lequel Balzac a
prt le plus de lui-mme. On a relev que le personnage ponyme de cette fiction
faisant des tudes dans le mme lieu et la mme poque que Balzac : Tours,
au collge de Vendme, vers 1811. On a pu identifier dans le portrait physique de
Louis Lambert un autoportrait de Balzac adolescent. On n'a pas manqu de
signaler qu'entre autres similitudes, Balzac et Louis Lambert partageaient les
mmes opinions mystiques et volontaristes, la mme croyance dans le caractre
dltre de la pense. La lgende veut mme que Balzac ait crit un Trait de la
Volont sur les bancs du collge et qu'il lui ait t confisqu par un censeur, tout
comme son hros. Toutes ces analogies attestes ou vraisemblables ont permis
un spcialiste de La Comdie humaine, comme Albert Bguin, d'affirmer que "la
biographie de Lambert est une biographie intellectuelle de Balzac", qu'il ntait
"jamais all si loin dans l'expression, dans l'aveu de ses angoisses personnelles et
de ses esprances les plus extraordinaires" (Bguin, 1953 a, pp. 13, 15).
Faut-il, pour toutes ces raisons, considrer le personnage de Louis Lambert
comme un double de Balzac ? Comme une fictionnalisation de l'auteur de La
Comdie humaine ? videmment non. Cette dimension autobiographique ne fait
44
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
pas de ce roman une autofiction, mais tout au plus un roman personnel ou
autobiographique. Entre Honor de Balzac et Louis Lambert, il n'y a qu'une relation
de ressemblance, qui est vague puisque son tendue est difficile prciser et
qu'elle n'est gure distinctive. Elle l'est d'ailleurs si peu que le narrateur anonyme
de Louis Lambert, son compagnon de classe surnomm "le Pote" ressemble lui
aussi Balzac (got pour la lecture et l'criture, l'rudition, les questions
mtaphysiques) et suggre au moins deux reprises qu'il est Balzac lui-mme.
Une premire fois, en se dsignant comme un homme public, l'un des "deux seuls
coliers de Vendme de qui Vendme entende parler aujourd'hui", avec Barchon
de Penhom (p. 40) ; une seconde fois, en se rclamant comme l'auteur de ces
tudes auxquelles appartient Louis Lambert (p. 66). Plus que Louis Lambert, c'est
donc le roman Louis Lambert qui doit beaucoup Balzac. Mais c'est un lien dont
on pouvait se douter et que la notion de ressemblance n'aide gure spcifier.
Il y a plus. Ce qui tmoigne exemplairement du caractre lastique de cette
notion de ressemblance, c'est qu'un crivain comme Flaubert, par ailleurs si
diffrent de Balzac, a pu s'identifier totalement au rcit de Louis Lambert, au point
d'affirmer que ce roman racontait son adolescence. Dans une lettre extraordinaire
Louise Colet, Flaubert dclare en effet, s'identifiant la fois au narrateur et au
hros de ce roman :
"As-tu lu un livre de Balzac qui s'appelle Louis Lambert. Je
viens de l'achever il y a cinq minutes : il me foudroie, c'est
l'histoire d'un homme qui devient fou force de penser aux
choses intangibles. Cela s'est cramponn moi par mille
hameons. Ce Lambert, peu de choses prs, est mon
pauvre Alfred. J'ai trouv l de nos phrases (dans le temps)
presque textuelles : les causeries des deux camarades au
collge sont celles que nous avions, ou analogues. Il y a une
histoire de manuscrit drob par les camarades avec des
rflexions du matre d'tude qui m'est arrive, etc. Te
rappelles-tu que je t'ai parl d'un roman mtaphysique (en
plan), o un homme, force de penser, arrive avoir des
hallucinations au bout desquelles le fantme de son ami lui
apparat, pour tirer la conclusion (idale, absolue) des
prmisses (mondaines, tangibles) ? Eh bien, cette ide est l
indique et ce roman de Louis Lambert en est la prface..."
(Lettre Louise Colet du 27.12.1852).
45
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Enfin, cette notion de ressemblance est si peu distinctive qu'elle ne permet
pas de comparer l'investissement intime de Louis Lambert et du Lys dans la valle,
texte qui est considr par certains commentateurs comme la vritable
autobiographie de Balzac. Ainsi, Pierre Barbris :
"De tous les romans de Balzac, Le Lys dans la valle est
sans doute le plus directement autobiographique : l'enfance
et l'adolescence de Flix sont celles d'Honor, et Mme de
Mortsauf est en partie Mme de Berny, en partie Zulma
Carraud ; M. de Mortsauf ancien migr doit beaucoup au
commandant Carraud, rpublicain ancien prisonnier des
pontons, impuissant, rejet par le sicle bourgeois comme
l'tait le soldat des Lys" (Barbris, 1971, pp. 95-96).
Alors, Balzac ressemble-t-il Louis Lambert ou Flix de Vandenesse ?
Sans doute, un peu des deux, et bien d'autres personnages encore, surtout
ceux des premiers textes de La Comdie humaine qui sont largement d'inspiration
autobiographique. D'une faon gnrale, Balzac est un peu partout dans La
Comdie humaine, comme Joyce est un peu partout dans Ulysse. Pourtant, dans
les deux cas, cette ressemblance, par dfinition vague, entre l'uvre et l'homme
ne permet pas de parler d'une fictionnalisation de soi.
Il faut d'autant plus se mfier de cette notion de ressemblance quelle repos
bien souvent sur une illusion dont le mcanisme bien que simple, est d'une
efficacit redoutable. De Flaubert Valry, cette illusion a souvent t dnonce.
Mais comme elle a tendance tre ractive propos de l'autofiction, il n'est
peut-tre pas inutile de rappeler son fonctionnement. Montesquieu, chez qui l'on
n'attendrait, peut-tre pas une telle lucidit donne une belle image de son
mcanisme dans les Lettres persannes C'est Rica qui parle :
"Je souriais quelque fois d'entendre des gens qui n'taient
presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux
: 'il faut avouer qu'il a l'air bien persan' " (Lettre 30).
Comme on le voit, le mcanisme est simple : on trouve un personnage ou
un portrait ressemblant, sans vritablement connatre le modle original. C'est
partir d'une ide sur ce modle que l'on juge de la ressemblance, mais cette ide
elle-mme on l'emprunte luvre o se trouve le personnage et aux discours
qu'elle a produits. Dans le cas de la littrature, il y a une sorte de tourniquet qui fait
46
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
que l'on tire d'une uvre et de ses commentaires une image de la personne de
l'auteur et que l'on juge de la ressemblance de l'uvre en fonction de cette image.
Autrement dit, derrire des personnages et un auteur, on projette l'image d'un
homme que l'on va rechercher dans l'uvre et l'on a l'illusion d'avoir atteint
lcrivain.
Mme quand la relation de ressemblance ne repose pas sur une telle
circularit, elle n'est pas confondre avec la relation d'homonymie qui fonde
l'autofiction. Il ne suffit pas qu'une fiction emprunte des traits biographiques son
auteur pour tre une autofiction, au mme titre que l'inspiration autobiographique
ne suffit pas faire d'un texte une autobiographie. Pour que l'on puisse parler
d'autofiction, il faut que l'auteur engage son nom propre, mette en jeu son identit
au sens strict, ce qui est un acte d'une toute autre porte que de suggrer des
similitudes et des affinits avec l'un de ses personnages. En nomment un
personnage de son nom, un crivain engage symboliquement et affectivement sa
personne. Comme le dit bien Grard Mac :
"Il semblerait que le nom propre nous engage peu, qu'il soit
moins compromettant du fait qu'il offre moins de sens - jusqu'
l'instant o l'on dcouvre que tout passe par lui". Car, explique - t-il,
"ce que recouvre ( ) la prsence nigmatique du nom propre,
c'est bien entendu un problme d'identit. Il faudrait tre aveugle
pour ne pas le voir. L'homme ressent l'arbitraire du nom qu'il porte
autant que l'arbitraire de la langue qu'il parle. Le nom propre
contient l'entier labyrinthe du roman familial (Mac, 1987).
On trouverait difficilement une meilleure formule pour signifier toute la
charge sociale, symbolique et affective que vhicule, dans la culture occidentale, le
nom propre de personne. Ce poids du nom propre est sans commune mesure
avec des traits biographiques, aussi importants soient-ils. Ce phnomne n'a
besoin pour s'clairer que de l'exprience commune. Il suffit, pour s'en assurer, de
voir nos ractions quand on rencontre un homonyme ou, au contraire, quand on
oublie ou dforme notre nom. Donner son nom un personnage fictif, c'est mettre
en jeu sa responsabilit et toute la passion de soi qui habite tout mortel. C'est
toucher ce que Freud dcrivait comme un "complexe de sensibilit", description
qu'il illustrait par le cas-limite de cette malade qui "avait pris le parti d'viter d'crire
47
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
son nom, de crainte qu'il ne tombe entre les mains de quelqu'un qui se trouverait
ainsi en possession d'une partie de sa personnalit" (Freud, 1912, p. 70).
Pour en finir avec cette relation de ressemblance, il faut ajouter que cette
relation d'homonymie est une condition suffisante pour la ralisation du protocole
nominal. Peu importe que le personnage qui porte le nom de l'auteur en diffre
totalement, par le sexe, l'ge, le physique, le caractre, la nationalit ou la
profession. L'crivain peut bien se reprsenter en petite-fille, en chien ou en singe.
Ce qui est essentiel, c'est l'identit au sens strict, le nom propre. Pour le reste, le
personnage peut ne pas ressembler l'auteur. L'intrt de l'autofiction tant la
fictionnalisation de soi, la possibilit de changer de personnalit ou d'existence,
toutes les mtamorphoses sont envisageables.
Il reste examiner la lgitimit de ce protocole. On peut trouver exorbitant
le privilge accord un nom propre d'influer sur le rgime de lecture d'un texte ;
comme on peut s'interroger sur les capacits du lecteur percevoir la rcurrence
d'un simple nom de personne au cours d'une fiction. Mais ce serait se mprendre
sur cette activit de perception et de comprhension qu'est la lecture. Comme le
dcrit justement Barthes, "Lire (percevoir le lisible du texte), c'est aller de nom en
nom", "Lire, c'est trouver des sens, et trouver des sens, c'est le nommer" (Barthes,
1970, pp. 89, 17). Dans ce "procs de nomination" qu'est la lecture, les noms
propres en gnral et les anthroponymes en particulier sont un facteur essentiel de
la lisibilit. Non seulement, ils induisent un effet de rel et remplissent une fonction
anaphorique, mais ils fournissent autant d'articulations o se nouent et
s'changent les diffrents codes (symbolique, actantiel, hermneutique, culturel)
du discours littraire. Le nom propre est dans le texte ce que Jean-Franois
Lyotard appelle un "signe tenseur" : il est agent et patient tous les lieux et tous
les niveaux du texte. Les noms de personnes, qu'il s'agisse du nom de l'auteur ou
de ceux des personnages, constituent une pice essentielle dans le mcanisme de
la lecture.
Le nom propre d'auteur, tout d'abord, n'est pas un lment extrieur
luvre, une pice rapporte dont elle pourrait se passer, du moins dans notre
univers culturel. Le modle et oriente la lecture, comme n'importe quel composant
textuel, pour ne pas dire plus. Lire un passage, une page, voire un rcit entier sans
48
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
nom d'auteur et sans titre (qui n'est qu'un substitut de ce dernier) serait difficile. Il
manquerait un repre essentiel la lecture : pas seulement une griffe, mais aussi
une donne qui permet de situer le texte et par suite de mieux le comprendre.
C'est que, comme l'a bien montr Michel Foucault, le nom d'auteur ne fonctionne
pas comme un anthroponyme ordinaire; ils ne sont pas isomorphes dans leur
relation de nomination. En sus d'une fonction dsignative qui va de soi, le nom
d'auteur a aussi une fonction classificatoire et une fonction descriptive (Foucault,
1969).
Une fonction classificatoire parce que lire un ouvrage sign von Uexkll
plutt que Chateaubriand, ne produit pas les mmes attentes ni les mmes
exigences en matire de style, de discours et d'information. Une fonction
descriptive parce qu'un roman sign Balzac plutt que Flaubert ne cre pas, non
plus, les mmes dsirs ni la mme coute. Un nom d'auteur, c'est une concrtion
de traits la fois littraires et extra-littraires. En vrac et claire-voie: des traits
stylistiques, narratifs et thmatiques, des lambeaux d'criture restes en mmoire,
des prdicats historiques et culturels, des biographmes des jugements de valeur
personnels et institutionnels, une lgende etc. Tout cela faonne et oriente la
lecture de manire importante, mme si cela a encore t peu tudi. Et tout
crivain est conscient de ce phnomne, qu'il le constate chez d'autres auteurs ou
pour lui-mme. Il faudra s'en souvenir quand on tudiera les fonctions de la
fictionnalisation de soi.
Les anthroponymes de personnages ne sont pas moins importants. Il faut
rappeler, aprs Barthes, que le "nom actorial' est la condition d l'existence, de la
motivation et de la prdication d'un personnage (1970, p. 74). Pour le lecteur, un
personnage, c'est d'abord un nom propre, autour duquel viennent se disposer un
certain nombre de prdicats et de fonctions qui vont lui donner une "biographie",
une "psychologie" et un rle dans le texte. Les diteurs-imprimeurs du XVIIIe ou du
XIXe sicle taient trs conscients de ce rle fondamental jou par les noms
propres. Les ditions de cette poque, d'un texte de Restif ou de Sue par exemple,
signalaient toujours par des italiques la premire occurrence du nom d'un des
personnages, matrialisant ainsi la fonction conomique du nom.
49
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Il faut ajouter que la physionomie de ces noms propres, la varit des codes
onomastiques dans un texte, signalent toujours au lecteur des choix esthtiques.
C'est ainsi qu'Aristote notait dj dans sa Potique que l'un des indices essentiels
de la diffrence entre la comdie et la tragdie tait le statut des noms propres de
personnages : "noms pris au hasard" pour la comdie ; et "noms d'hommes
rellement attests" quand bien mme ce serait par la tradition mythique, pour la
plupart des tragdies. De mme, il est trs caractristique que les personnages
des romans modernes (ns avec Defoe, Richardson ou Fielding), portent un
anthroponyme complet (un prnom et un patronyme), et ordinaire, dont peuvent
tre dots des individus particuliers et contemporains ; la diffrence de la
littrature antrieure qui privilgiait des "noms historiques" ou des "noms types"
renvoyant un trait de caractre ou un type littraire, noms plus proches du
sobriquet que du nom de personnes (Watt, 1957, p. 19-22). Enfin, on peut noter
que le Nouveau Roman (et ses lecteurs attentifs avec lui) ne s'y sont pas tromps
en attaquant, surtout dans sa seconde priode, la ralit du personnage par ses
appellatifs. Non content de refuser aux protagonistes de leurs rcits un tat civil,
un caractre, un physique, une histoire, un Claude Simon ou un Robbe-Grillet ont
multipli l'anonymat, l'indcision ou la diffration de leur identit nominale. Comme
le remarque Ludovic Janvier, les personnages du Nouveau Roman "sont sans
visages : ce ne seront pas eux qui exhiberont au lecteur gourmand quelque loupe
sur le nez, quelque protubrance frontale (...). On ne sait pas la couleur de leurs
yeux, peine la forme de leur silhouette. On t- ils des noms ? Nous les apprenons
souvent bien tard..." (Janvier, 1964, pp. 20 21 ; nous soulignons).
Ces exemples illustrent le fait que les modulations et les transformations
littraires passent non seulement par un travail stylistique, thmatique ou formel,
mais aussi par des bouleversement dans l'onomastique des personnages. Il ne
parat pas exagr de dire, avec Barthes, que "toute subversion, ou toute
soumission romanesque commence donc par le Nom Propre " de personnage
(Barthes 1970 p.102). On ne saurait par consquent, tre assez attentif la
prsence et l'utilisation des patronymes en littrature. Cette importance des
noms propres parat montrer la lgitimit de notre protocole nominal.
Pour en finir avec ces prliminaires, il reste indiquer la dmarche que
nous allons suivre dans cet examen des formes de protocole nominal.
50
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Apparemment, on l'a dit, rien de plus simple que la ralisation d'un protocole
nominal : il suffit un auteur de donner son nom au hros de sa fiction. Si, en
outre ce hros est aussi le narrateur de son rcit, le lecteur est invit tablir
l'quation auteur = narrateur = hros. On est alors devant le mme dispositif
d'nonciation que la plupart des autobiographies, sinon que le texte se donne
comme une fiction. Pour autant que notre corpus permette de tels sondages, on
peut dire que c'est le cas le plus rpandu d'autofiction. Mais il ya dautres
manires pour un crivain de se doter d'un collatral dans ses fictions. On a vu par
exemple qu'il tait loisible de parler de soi la troisime "personne" : il faudra donc
faire une place dans notre analyse aux cas o le personnage qui porte le nom de
l'auteur n'est pas le narrateur. On peut imaginer aussi qu'il n'est pas indispensable
que l'auteur se fictionnalise dans le personnage principal de son rcit ; il peut le
faire travers un personnage secondaire, voire un comparse. On peut aussi
penser qu'il n'est pas indispensable que le hros d'un roman ait exactement le
mme nom que celui de son crateur : un auteur peut donner son double un nom
qui n'ait qu'un "air de famille" avec le sien. On peut envisager ensuite le cas d'une
identification ambigu, formule de telle faon qu'il soit impossible de dcider de
faon indiscutable si l'auteur a bien voulu s'incarner dans l'un de ses personnages.
On peut, enfin, penser un auteur qui se donnerait une identit contradictoire, son
propre patronyme venant se surcharger d'un prnom diffrent par exemple. Ce ne
sont l que quelques cas de variations protocolaires. Tous prsentent des
exemples dans notre corpus. Les intgrer notre analyse constituera une nouvelle
"transformation rgle" (Canguilhem) de la notion d'autofiction.
Mais pour rgler prcisment cette variation en comprhension et pour
dresser la liste la plus exhaustive possible des modalits de ce protocole nominal,
il convient de distribuer ces variations en fonction des paramtres qui les
commandent. On distinguera donc les facteurs smiologiques, topologiques et
narratologiques qui gouvernent le protocole onomastique. En suivant une mthode
qui a montr ses fruits ailleurs (Genette, 1687), nous allons ainsi examiner ce
quon pourrait appeler la forme, le contexte et le rle de ce "don du nom" quest le
protocole onomastique.
51
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
2. 2. FORME
"Tityre c'est moi et ce n'est pas moi".
A. Gide.
52
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Les noms propres sont des signes verbaux dont la fonction est de
reprsenter autre chose qu'eux-mmes, des entits singulires fictives ou relles.
Le trait le plus immdiat du protocole nominal est donc de nature smiologique : ce
protocole est une relation entre deux signes, deux noms propres, le nom d'un
auteur et le nom d'un personnage. La manire dont ces deux signes vont tre lis,
c'est ce que nous appelons, faute de mieux, la forme du protocole nominal. C'est
par cette forme qu'il faut commencer l'examen de ce protocole. La plus simple est
videmment, on l'a voqu, l'homonymie complte. Si l'crivain Pierre Loti
reprsente dans une de ses fictions un personnage nomm Pierre Loti, le lecteur
ne peut manquer de faire le rapprochement, C'est ce que fait effectivement l'auteur
d'Aziyad dans quelques-uns de ses romans les plus clbres. Dans Le Mariage
de Loti, il explique mme l'origine de son nom et comment il a t attribu un
personnage qui se dnommait l'origine Harry Grant. Cette forme intgrale
d'homonymie et cette "mise en scne du nom propre" est trs frquente dans la
pratique de l'autofiction. Bien souvent, l'crivain ne se contente pas de donner
son homologue fictif son prnom et son patronyme ; il fait du nom propre un
vritable motif littraire. Comme l'autobiographie l'autofiction est pour l'auteur une
manire d'explorer les mystres de son nom propre.
D'autres moyens sont cependant possibles pour tablir une identit ou une
quivalence avec un personnage. Ces ressources sont bien connues de la
tradition satirique. Quand Molire veut que l'on reconnaisse l'abb Cotin dans le
type du "tartuffe intellectuel" qui figure dans Les Femmes Savantes, il lui suffit de
l'appeler Tricotin : le public de l'poque savait qui tait pingl travers ce
personnage. Voil un exemple des transformations onomastiques, ici par addition,
qui permettent de forger un nom diffrent et pourtant semblable, assez analogue
pour tre identifiable. Le nombre de ces transformations est considrable un nom
peut tre amplifi, abrg, tronqu, intervertit combin etc. A ct de cette
homonymie fragmentaire, une autre espce d'quivalence onomastique peut tre
tablie : une homonymie indirecte, passant par d'autres mdiations qu'un nom
propre, par des substituts. Molire en donne encore un exemple, toujours dans Les
53
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Femmes Savantes. Abandonnant une altration onomastique un peu grossire,
Molire rebaptise dans la version dfinitive de cette pice son personnage d'auteur
mondain : Tricotin devient Trissotin. L'abb Cotin est pourtant toujours
reconnaissable sous ce dguisement car Molire a attribu Trissotin deux
pomes tirs de ses Oeuvres galantes : nouveau le public cultiv ne pouvait
manquer de percevoir l'crivain vis. Cette fois pourtant, c'est une substitution, et
non une transformation, qui permet l'identification.
Dans la tradition satirique, le travail sur le nom propre vise une personne
connue du public, mais diffrente de l'crivain. Mais on imagine sans peine qu'un
auteur puisse appliquer ces procds son propre nom. C'est bien ce qui arrive
parfois dans le domaine de l'autofiction : l'crivain lui-mme, le sujet de
l'nonciation du texte, se reprsente alors sous u chiffre plus ou moins transparent,
par une homonymie plus ou moins immdiate. Cette section va prcisment
consister dans l'examen du dtail des transformations et des substitutions qu'un
auteur peut oprer sur son nom, de faon se rendre perceptible travers
l'identit d'un personnage. Comme l'homonymie par transformation et celle par
substitution constituent deux types distincts d'quivalence onomastique, on les
considrera comme deux espces distinctes d'homonymie. En outre, on
distinguera une homonymie chiffre pour rendre compte de tous les cas, plus
dlicats, o la mise en place d'une figue auctoriale ne passe ni par un nom propre
ni par un titre d'ouvrage. Trois types d'quivalence onomastique entre un auteur et
un personnage vont donc tre envisags tour tour. Il ne faut, toutefois, rien
conclure de cette linarit de l'analyse. Ces trois types (ou ces trois espces) ne
sont pas exclusifs, ils peuvent tout fait fonctionner ensemble. Mais il est pratique
de les diffrencier car, on va le voir, ils se distinguent par leur mode opratoire et
par le travail d'interprtation qu'il exige du lecteur.
A) Homonymie par transformation
Dans cette espce d'homonymie, le nom auctorial joue le rle d'un nom
interprtant et le nom actorial d'un nom interprt. Le lecteur remonte, pour ainsi
dire, du personnage l'auteur en dcryptant le nom du premier la lumire du
54
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
nom de l'autre ; tout comme, l'inverse, l'crivain avait engendr le nom de son
mandataire fictionnel partir de son propre nom, Pour ce dcryptage, le lecteur
peut disposer des clefs suivantes :
- Un prnom :
Dans la Recherche, mme si cet exemple est ambigu, le narrateur ne
s'appelle que "Marcel".
- Des initiales ou un monogramme :
On pense bien sr au fameux K. du Chteau ou du Procs, oui a fait cole.
Mais les initiales de l'auteur peuvent aussi tre combines avec un htronyme,
comme le montre le personnage de Harry Haller dans le Loup des Steppes
d'Hermann Hesse.
- Un paronyme :
Luisa Futoransky met en scne, dans Chinois... Chinoiseries et dans De Pe
a Pa, une certaine Laura Kaplansky.
- Un anagramme intgral ou partiel :
Dans le nom de Wilette Collie, personnage de La Retraite sentimentale, on
reconnat aisment celui de Colette Willy. Mais dans L'Emploi du temps de Michel
Butor, le personnage de George William Burton serait peut-tre plus difficilement
identifiable s'il n'tait pas romancier.
Cette liste n'est sans doute pas exhaustive, mais elle indique bien la varit
des modalits qui permettent d'engendrer un nom partir d'un autre. On notera
que cette forme d'homonymie est trs peu coteuse et qu'elle permet de suggrer
trs sobrement que l'on a affaire un double fictif : c'est sans doute pour cette
raison qu'elle est la plus rpandue dans notre corpus. On observera enfin qu'il
s'agit d'une forme d'homonymie directe : le lecteur constate une relation et drive
immdiatement le nom du personnage du nom de l'auteur. Il ne lui est pas
ncessaire de recourir d'autres indications du texte, du pritexte ou d'autres
55
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
uvres. C'est l forme la plus simple d'homonymie et celle qui est la plus
perceptible pour le lecteur.
B) Homonymie par substitution
Il faut faire sa place, maintenant, un type de connexion moins immdiat
entre l'auteur et le personnage. Au lieu d'engendrer le nom du personnage partir
du sien, l'crivain peut poser un troisime terme qui tablira une quivalence entre
les deux. Cette quivalence sera indirecte, obligera le lecteur un dcodage plus
important. Mais elle n'en sera pas moins effective. Naturellement, ce troisime
terme commun l'auteur et au personnage ne peut tre un trait biographique ou
chronologique. Un tel trait n'tablirait qu'un rapport d'analogie entre les deux, ce
qui nous ramnerait la notion de ressemblance. Dans cette seconde forme
d'homonymie, il ne peut s'agir que d'une "correspondance structurale", d'une
"allusion proportionnelle", bref d'une homologie entre l'auteur ponyme et son
personnage, pas d'une analogie (Barthes, 1975, p. 45).
L encore, ce n'est pas par une analyse de contenu que le lecteur va
dchiffrer cette ponymie ; le nom propre d'auteur sera toujours le pivot de
l'articulation entre l'auteur et le personnage ; mais cette fois l'homonymie ne va pas
reposer sur une seule relation entre deux signes, la simple altration d'un nom
propre. Elle va passer par deux oprations successives, la relation va tre un
rapport de rapports, un rapport de proportion du type : A est B ce que C est B,
sans qu'il y ait une relation directe entre A et C. Entre l'auteur et le personnage, le
lecteur doit alors dchiffrer une correspondance non pas empirique, mais formelle.
Comment va pouvoir s'tablir une telle correspondance ? Quelles sont les
mdiations qui peuvent prsider ce rapport de proportion ? Il semble que l'on
puisse les distribuer en essentiellement deux classes : des mdiations livresques
ou des mdiations onomastiques. Deux sortes de mdiations qui constituent autant
de substituts une homonymie directe.
II 1. Substituts livresques
56
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
On sait que parmi les moyens dont dispose le langage pour "rfrer des
objets", il existe ce qu'on appelle les "descriptions dfinies", comme par exemple
"l'auteur de Waverley pour dsigner Walter Scott. Par l'article dfini et par les
sous-entendus de situation, cette expression renvoie au mme rfrent singulier
que le nom propre "Walter Scott" et elle peut, sauf cas particuliers, se substituer
lui Ducrot et Todorov 1972, pp. 320-321). C'est par un tel procd rfrentiel que
va s'tablir la premire classe des homonymies indirectes. Un crivain peut ainsi,
dans une fiction, s'identifier l'un de ses personnages en lui attribuant la paternit
d'un (ou plusieurs) de ses ouvrages. Pour cela, il n'est pas ncessaire bien
entendu que cet ouvrage soit effectivement reproduit, en partie ou en totalit ; il
suffit que son titre soit cit nommment. L'attribution de cet ouvrage au
personnage fictif joue alors le rle d'une description dfinie, constitue un "substitut
livresque" au "nom auctorial".
Pour le lecteur, cette substitution fonctionne selon un rapport de proportion
trois termes. Examinons-en le mcanisme, l'aide du Paradoxe du comdien :
un crivain Z (Diderot) reprsente un personnage Y (le "Premier interlocuteur")
comme tant "l'auteur de X (Le Pre de famille)", X (Le Pre de famille) tant un
de ses ouvrages (Diderot fait reprsenter cette pice pour la premire fois le 18
fvrier 1761) ; que le personnage Y soit anonyme ou non (l'appellatif "le Premier"
laisse ouverte la question de l'identit), on peut tablir une relation proportionnelle
entre lui et l'crivain Z (Diderot) : le personnage Y (le "Premier") est fauteur de X
(Le Pre de famille), comme l'crivain Z (Diderot) est l'auteur de X (Le Pre de
famille). Par cette proportionnalit, l'expression "l'auteur de X" ("l'auteur du Pre de
famille") est constitu en substitut du nom propre de l'crivain Z (le patronyme
Diderot). Naturellement, le processus est moins laborieux durant la lecture, mais il
a bien cette structure logique.
Il y a bien entendu des diffrences smantiques entre un nom propre
d'auteur et la description dfinie qui le dsigne comme tant l'auteur d'un ouvrage
qu'il a publi. Mais nous examinerons plus tard ces diffrences, afin de voir
d'emble quelles fonctions peut remplir une telle forme d'homonymie indirecte.
Pour l'essentiel, cette ponymie mdiate parat mme de remplir trois
fonctions : renforcer, compenser ou surdterminer l'identit d'un personnage.
57
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
II. 1. 1. Fonction de surcharge
Bien que cette fonction paraisse aller de soi, il n'est pas inutile de la signaler
: une telle dsignation indirecte permet de doubler et de spcifier une
dnomination parle nom propre de l'auteur, c'est--dire de renforcer une homo-
nymie Les substituts livresques viennent alors s'ajouter un nom propre pour
cerner l'identit du personnage. C'est par exemple ce que fait constamment
Cline, dans sa trilogie allemande (D'un Chteau l'autre, Nord, Rigodon). S'il
donne son narrateur autodigtique tous les appellatifs ("Cline", "Destouches".
"Ferdinand") qui permettent de l'identifier avec l'crivain Cline pris dans la
dbcle allemande, il ne manque pas de confirmer cette identification en lui
attribuant la paternit de la plupart de ses livres antrieurs (Normance, Nord, D'un
Chteau l'autre, Mort crdit), avec une prdilection pour son premier roman,
Voyage au bout de la nuit, qui a impos la "griffe" Cline et qui est pour lui le dbut
de tous ses ennuis, le livre qui lui a attir toutes les envies et toutes les haines. En
conjuguant ces deux formes d'homonymie, Cline fait ainsi de ses propres livres,
de leur production et de leur rception, un thme important de son uvre et une
pice dcisive de sa stratgie. Ce procd se retrouve chez des crivains qui ont
fait de la fictionnalisation de soi une stratgie d'criture, en mettant en scne de
fiction en fiction un personnage qui porte leur nom et revendique leurs textes. Des
crivains comme Blaise Cendrars, Witold Gombrowicz, Jean Genet, Jrme D.
Salinger ou Philippe Sollers ont ainsi trouv le moyen de replier leur uvre sur
elle-mme et de se construire un "univers" o la distinction entre la fiction et la
ralit est jamais dissoute.
II. 1. 2. Fonction de compensation.
Pour des raisons diverses, thmatiques ou formelles, la fictionnalisation de
soi peut devoir s'accompagner de l'anonymat du personnage qui reprsente
l'auteur. Les "substituts livresques" constituent alors un moyen simple pour
conjuguer un anonymat relatif et une identification sans ambigut. La traverse du
Luxembourg (Hachette, 1985) de Marc Aug permet de vrifier cet effet. Il s'agit du
rcit de la journe d'un anthropologue bien install dans sa profession. Celle-ci ne
comporte pas d'vnements particuliers, mais c'est l'occasion pour cet universitaire
de brosser son portrait, celui de quelques individus typiques de sa gnration et de
58
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
se livrer une rflexion ethnologique sur les aspects les plus diversifis de notre
socit contemporaine. Cet universitaire est anonyme, mais au cours de cette
journe il se dcrit au travail, crivant un article sur le "retour du religieux" (chap.
5). Les extraits cits permettent de constater qu'il s'agit du dmarquage d'un article
donn par l'auteur l'Encyclopaedia Universalis, Symposium, 1985. Dans ce livre
qui se dclare comme un "Ethno-roman d'une journe franaise considre sous
l'angle des murs, de la thorie et du bonheur", l'auteur et le hros se partagent
donc au moins la paternit d'un crit. Quoique le narrateur autodigtique soit un
personnage fictif, s'il faut en croire l'indication gnrique, il a au moins en commun
avec la personne de Marc Aug, d'tre le signataire du mme texte. En ralit, tout
un ensemble de traits thmatiques fait que cette identification est transparente.
Seulement il ne s'agit que d'analogies, comme celles qui pouvaient rapprocher
Louis Lambert de Balzac adolescent. Tandis qu'avec cette attribution d'un texte
effectivement publi et sign, dont l'existence est vrifiable, Aug et son
"narrateur-hros" sont dans un rapport formel qui permet de les mettre en
quivalence.
Pourquoi alors ce dtour ? Pourquoi Aug n'a-t-il pas tout simplement dor
son nom ce personnage d'anthropologue? C'est que cet anonymat partiel permet
un effet de distanciation qui n'est pas tout fait ngligeable. Il lui permet de
maintenir un ddoublement entre l'auteur et le narrateur qui matrialise la distance
de soi soi qu'introduit ncessairement l'criture et de formuler en marge un
discours second o il commente les propos de son hros et met en acte la
rflexion sur l'identit qui est l'un des objets de ce livre.
II. 1. 3. Fonction de surdtermination.
Cette homonymie par homologie peut aussi remplir une autre fonction, qui
est de capter en quelque sorte l'identit d'un personnage fictif en lui attribuant ses
propres ouvrages. On aura alors un auteur et un personnage ayant deux noms
diffrents, mais auxquels sont attribues les mmes oeuvres. Un personnage
htronyme de l'auteur s'attribuera ainsi les oeuvres mmes de cet auteur,
assignation qui le dote d'une identit contradictoire puisqu'il est alors la fois un
personnage autonome (ayant son propre anthroponyme) et un double de l'auteur.
59
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Un tel procd semble avoir t courant dans la tradition du dialogue
philosophique o il permettait un philosophe de prsenter des personnages aux
"noms types", selon les conventions du genre, tout en dsignant sans quivoque
celui qu'il fallait considrer comme son porte-parole. C'est ce que fait, en partie,
Leibniz dans ses Nouveaux essais sur l'Entendement humain (dialogue o il se
situe, comme on sait, par rapport la philosophie de Locke), en attribuant
Thophile une de ses dcouvertes mathmatiques et certains de ses opuscules.
L'interlocuteur de Philalte, d'abord prsent comme un disciple de Leibniz,
devient ainsi au cours du dialogue, un double de Leibniz lui-mme Cet exemple
montre, au passage, qu'une dcouverte scientifique (et plus gnralement toute
production laquelle est attach un nom propre) peut, comme un livre, remplir la
fonction de substitut.
Dans la littrature, cette complication d'identit est assez rpandue, plus
d'ailleurs que la fonction prcdente, sans doute parce qu'elle permet des effets
plus subtils et plus riches. Ferdydurke de Witold Gombrowicz en fournit un bel
exemple. Ds les premires pages de ce roman protiforme, le narrateur et hros
"Joseph" se prsente comme l'auteur de lpoque d'immaturit, le premier essai
littraire de Gombrowicz, un recueil de nouvelles publi en 1933 et traduit en
franais sous le titre Bakaka (Denol, 1967). Par cette appropriation, Joseph est
et n'est pas Gombrowicz, il passe travers les modalits reues de l'nonciation et
les catgories habituelles de la perception. Son identit devient une sorte de
palimpseste o l'on peut lire par transparence celle de son auteur, sans que
pourtant la synthse des deux soit possible. Cette contradiction permet d'inscrire
sa source, c'est--dire au cur du personnage qui est responsable de la narration,
le registre contradictoire de ce texte le protocole nominal est alors en mme temps
un protocole modal, un lment de la fictionalit. Ferdydurke est d'autant plus
exemplaire que la rfrence aux Mmoires de l'poque dimmaturit n'est pas
seulement le moyen d'une identification, elle donne aussi la raison sminale de cet
anti-roman de formation. Sans la publication de ce texte de jeunesse, qui tmoi-
gne, selon le narrateur lui-mme, d'une immaturit foncire tant par sa matire que
par son titre, le roman Ferdydurke n'aurait pas exist. S'il est vrai que "L'immaturit
est une ide dangereuse (...) que la premire condition de la maturit, condition
sine qua non, c'est de penser soi-mme qu'on la possde...", alors tous les
60
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
pisodes de cette odysse de l'infantilisation qu'est Ferdydurke, la "cuculisation"
de Joseph en Jojo, avec tous les agents de cette dchance (le professeur Finko,
le voyou Mentius, la lycenne Zuta, l'adolescente Sophie ou le valet Tintin), tout
cela n'aurait ni raison ni lieu d'tre sans ces Mmoires immatures. Quoique
extradigtique et htrodigtique au rcit de Ferdydurke, ce texte ou plutt sa
publication est comme le lieu gnratif, le moteur de l'infantilisation qui s'empare
progressivement du narrateur jusqu' l'excipit du livre o loin de disparatre "le
cucul (...) semble fig au firmament dans une dure absolue, radiant et rayonnant,
infantile et infantilisant, clos, massif, renforc par sa propre puissance et culminant
son znith..." (Trad. Sdir, p. 309).
Pour achever cet examen de "l'homonymie par substitut livresque", il est
ncessaire de faire deux observations sur la porte et la forme de ces substituts.
II. 1. 4. Amplitude
Jusqu'ici nous avons fait comme si les "substituts" livresques taient
convertibles salva veritate avec un nom propre d'auteur. En ralit, comme on sait,
il n'en est pas toujours ainsi. Comme tout signe, ces substituts n'ont pas seulement
un rfrent, une "dnotation", ils ont aussi un "sens" pour reprendre les termes de
Frege, c'est--dire une manire de dsigner leur rfrent (Frege, 1892), ici un
mode de dsignation mtonymique. C'est ce "sens" qui fait que dans certains
contextes, dits obliques par Frege, ces substituts ne sont pas interchangeables
avec les noms propres qu'ils peuvent remplacer. Ainsi dans une proposition qui
porterait sur le "sens" du substitut et non sur sa dnotation. Reprenons l'exemple
fameux de "l'auteur de Wavarley" (Russel, 1905) : quoique cette description dfinie
puisse tre un substitut Walter Scott, elle n'est pas compltement
interchangeable avec ce nom propre. Dans une proposition comme "Paul sait que
W. Scott est l'auteur d'Ivanho", on ne peut pas toujours remplacer "W. Scott" par
"l'auteur de Waverley" pour la raison simple que Paul ignore peut-tre que ces
deux auteurs n'en font qu'un. Mutadis Mutandis, il nous semble que le contexte
littraire prsente des similarits, pour ce qui concerne les "substituts livresques",
avec de tels contextes obliques. Ces similarits obligent tenir compte de deux
choses essentielles, face aux "substituts livresques" : de l'information dont dispose
le lecteur pour les identifier ; de l'information donne par le substitut pour remplir
61
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
sa fonction. Un exemple emprunt luvre de Blaise Cendrars va nous permettre
d'illustrer ce point.
Un des premiers essais romanesques de Cendrars, Moganni Nameh, publi
en 1922-23 mais crit vers 1911-12, campe un personnage d'apprenti crivain
"Jos" de retour dans sa famille Saint-Ptersbourg, aprs des tudes en Europe.
Pour toffer la vocation de son hros, Cendrars a donn plusieurs exemples et
descriptions de sa production littraire. Dans cet ensemble, on trouve deux
pomes qui ont pour tire Squences. Or, il se trouve qu'ils correspondent mot pour
mot aux deux premires pices d'une plaquette publie par Cendrars vers 1913 et
dont le titre tait Squences. On a donc l un autre exemple d'homonymie par
substitut livresque, surdterminant l'identit dun personnage fictif et ayant pour
fonction de confondre en partie le personnage "Jos" et Cendrars. C'est ici qu'il
faut faire deux remarques qui portent sur la condition d'une telle homonymie et sur
sa porte.
Observons tout d'abord que pour qu'une telle homonymie soit tablie par le
lecteur, il est ncessaire que celui-ci ait eu connaissance de l'existence de ce
recueil, dont la publication fut confidentielle et qui est rest une uvre mineure
dans l'opus cendrarsien. D'une manire gnrale, pour qu'un "substitut livresque"
puisse remplir sa fonction identificatoire, il faut que le lecteur dispose des
connaissances appropries, faute de quoi luvre voque passera pour une
uvre imaginaire et l'homonyme pour un auteur suppos.
L'objet de la prochaine section sera prcisment d'tudier les moyens dont
dispose un crivain pour fournir de telles informations ses lecteurs.
Il faut remarquer, ensuite, qu' la date o Cendrars publie Moganni Nameh,
il est l'auteur de textes potiques plus fameux et plus connus que ce recueil
Squences, qui est encore sous l'influence du symbolisme et qu'il reniera la fin
de sa vie comme un "pch de jeunesse". Il a en particulier publi Les Pques
New-York, la Prose du Transsibrien et Le Panama, qui ont fait sa rputation et
l'ont situ en bonne place dans l'avant-garde potique de son temps. Pourtant, le
narrateur de Moganni Nameh ne s'approprie pas ces pomes clbres, il se
contente de Squences. Certes, l'essentiel de la rdaction de ce rcit est antrieur
62
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ces pomes ; mais Cendrars aurait pu les intgrer rtrospectivement son texte.
S'il ne l'a pas fait, c'est videmment pour limiter la porte de son identification avec
son personnage. Jos n'est que dans une faible mesure Cendrars lui-mme, non
seulement parce qu'il ne s'appelle pas Blaise, mais surtout parce qu'il ne
reprsente qu'une priode de l'crivain Cendrars, qu'un tat de sa production
littraire : sa priode symboliste. Ces limites troites dans lesquelles est enferme
l'identification son personnage sont clairement inscrites dans le substitut choisi le
titre Squences et pas un autre ; titre d'une uvre presque honteuse ("pch"
dira-t-il), qui atteste plus de la gense de son criture que de choix esthtiques et
potiques durables. A propos de Moganni Nameh, Cendrars risque quelque part
l'indication gnrique "roman de mise au point". On ne saurait mieux dire pour un
texte o transparat tout ce que Cendrars doit Gourmont, en particulier Sixtine,
et l'influence symboliste ; mais o, aussi, il s'est dbarrass, en les objectivant,
de toutes ses tentations symbolistes.
Cet exemple montre qu'il est important d'tre attentif au choix des substituts
livresques et qu'il ne faut pas les concevoir comme des supports indiffrents
d'identification. Par ces substituts, c'est une quivalence qui est tablie entre un
crivain et un personnage, pas une identit ; quivalence dont les limites sont
inscrites dans le substitut lui-mme.
II. 1. 5. Altration
Il faut enfin noter que les titres qui servent de substitut ne sont pas
forcment la rplique exacte des titres d'ouvrages publis par l'auteur. De la mme
faon qu'un auteur peut jouer avec son nom propre, il peut jouer avec les titres de
ses uvres et donc avec la possibilit de l'identifier par une "correspondance
structurale". Comme pour le nom propre d'auteur, on pourrait ainsi faire l'inventaire
des procds qui permettent de dguiser un titre, d'tablir des diffrences et des
analogies, afin de le rendre identifiable tout en le transformant. Pour viter un
inventaire fastidieux, nous nous contenterons d'un exemple o ce procd ne
remplit qu'une fonction mineure, mais qui le fait apparatre d'autant plus nettement.
Dans L'Enfer (Pol, 1986), de Ren Belleto, roman o cet crivain continue (en
s'essoufflant un peu) dans la veine policire qui l'a fait connatre, on voit le
narrateur et hros Michel Soler consultant, dans un supermarch, une Histoire de
63
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Lyon de Robert Ballestron. On aura remarqu l'identit des initiales de cet auteur
suppos avec celles de Ren Belleto. Cette similitude ne peut manquer d'attirer
l'attention du lecteur sur le jugement port par le narrateur sur ce polygraphe
d'invention :
"... Robert Ballestron (crivain rgional prolifique et aux
talents varis, auteur d'un trait d'astronomie, d'une petite
encyclopdie sur la vie des btes, d'un dictionnaire des
symboles, d'un ouvrage de cuisine, d'un manuel de morale
l'usage de tous, d'un ouvrage mdical, de contes
fantastiques pour enfants, du Fantme et de Que notre rgne
arrive (...) et donc de cette Histoire de Lyon)..." (p. 249).
Le lecteur n'a pas besoin d'avoir lu la totalit des uvres de Belleto pour
savoir qu' ct de textes difficiles, ce dernier a publi deux romans policiers qui
ont eu un certain succs : Le Revenant (1981) et Sur la terre comme au ciel
(1983), Grand Prix de Littrature Policire 1983. Il lui suffit pour cela de consulter
l'pitexte de L'Enfer qui contient une liste "du mme auteur" donnant la
bibliographie de Belleto. Or, par synonymie et par allusion, les deux titres de
Ballestron renvoient manifestement ceux de Belleto, esquissant ainsi un
autoportrait ironique de l'auteur. Si ce procd reste marginal dans le dernier
roman de Belleto, il peut tre exploit sur une plus grande chelle comme le
montre Regarde, regarde les Arlequins ! de Nabokov. Dans ce roman, un crivain
imaginaire, Vadim Vadimovitch, retrace son existence et glose ses propres crits. Il
rsume et analyse ainsi des ouvrages qui ont, entre autres, pour titre Le Dard ou
Un royaume au bord de la mer. Un lecteur attentif reconnatrait sans peine dans
ces ouvrages Le Don et Lolita ; et serait donc amen identifier au moins
partiellement cet auteur suppos avec l'crivain Nabokov (Puech, 1982, pp.
138-139).
II - 2. Substituts onomastiques
Le cas de Nabokov permet de faire la transition avec une seconde classe
d'homonymie indirecte. On a rappel que l'auteur suppos de Regarde, regarde
les Arlequins ! se nommait Vadim Vadimovitch. Pour un lecteur inform, un tel
anthroponyme ne peut manquer d'veiller son attention. On sait que Nabokov n'est
qu'un pseudonyme : le nom vritable de cet crivain russe naturalis amricain est
64
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Vladimir Vladimirovitch. Il suffit d'un dictionnaire pour s'en assurer et pour
constater que dans cette autobiographie imaginaire, Nabokov n'a pas voulu
seulement gloser de faon fantaisiste son uvre, mais que c'est sa personne
mme d'crivain russe qu'il a voulu mettre en jeu.
Cet exemple permet d'introduire une autre forme d'homonymie
proportionnelle, savoir celle o l'crivain nomme un de ses personnages par un
substitut onomastique de son nom propre d'auteur, par un nom li publiquement
ou juridiquement sa personne. Expliquons ce procd l'aide d'un chapitre des
Essais, "Des noms", o sont montrs toute l'incertitude, tout le trembl de l'identit
de chaque sujet.
Dans ce fameux chapitre 46 du Livre I, Montaigne observe qu'une personne
peut pour ainsi dire s'toiler en des noms diffrents :
"Qui croirait que le capitaine Bayard n'eut d'honneur que
celui qu'il a emprunt des faits de Pierre Terrail (patronyme
vritable de Bayard) ? Et qu'Antoine Escalin se laisse voler
sa vue tant de navigations et charges par mer et par terre au
capitaine Poulin et au baron de la Garde (le nom d'tat-civil,
de guerre et de terre dsignent la mme personne) ?"
Dans l'esprit de Montaigne, il s'agit de montrer l'inanit de cette recherche
de la "gloire" qui dvore ses contemporains. Celle-ci est vaine car son seul support
est le nom, propre, assise si peu assure qu'il peul tre multiple, se dissminer en
des appellatifs diffrents. Certaines personnes ont pour ainsi dire un nom propre
pluriel, une identit clate. C'est ce que l'on peut appeler des noms de carrire :
nom dartiste, nom de soldat, pseudonyme d'auteur, nom de terre, nom de maison
etc. Un crivain peut ainsi multiplier ses noms propres en publiant la fois sous
son nom d'tat-civil et sous un pseudonyme ; ou en publiant sous plusieurs
pseudonymes comme Kierkegaard.
Tous ces noms "seconds" peuvent alors tre utiliss comme des substituts
onomastiques (des synonymes au sens logique) du nom d'auteur habituel, pour se
fictionnaliser, Comme les substituts livresques, de tels noms ne sont pas
substituables salva veritate, mais ils permettent d'tablir une quivalence, dfaut
d'une identit, entre un crivain et un personnage. Cette substitution fonctionne l
encore par un rapport de proportion, comme une homonymie par transitivit :
65
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
X est Y ce que Y est Z
(X = nom d'auteur, Y = nom de carrire, Z = nom de personnage).
Andr Chamson, par exemple, dans Le Dernier Village, a utilis son nom de
guerre, Capitaine Barrault, pour relater la troisime personne la dbcle de 1939,
telle qu'il l'a vcue. Cest la un exemple simple et attendu dans le genre du rcit de
guerre, mais tous les cas de figure sont imaginables et ralisables.
Les varits les plus subtiles de cette forme d'homonymie sont celles o un
crivain joue avec son nom d'tat-civil et son (ou ses) pseudonyme(s). Un
tourniquet vertigineux peut tre ainsi mis en place. Un crivain peut dsigner son
hros par un nom vritable, quand il a un pseudonyme ; ou, l'inverse, il peut
mettre en scne un personnage avec un de ses pseudonymes etc. Philippe
Sollers, par exemple, dans Portrait du joueur, nomme son hros "Philippe
Diamant", appellatif qui est une approximation de Philippe Joyaux, son nom
vritable, li l'enfance bordelaise que tente de restituer cette fiction.
Mais la palme revient, en ce domaine, comme pouvait s'en douter,
Kierkegaard. On sait l'importance des pseudonymes pour l'conomie des crits et
de la pense du philosophe danois. Ils sont si nombreux que lui-mme prfre le
terme de "polynymie " celui de pseudonymie : Victor Eremita, Johannes de
Silentio, Constantin Constantius, Vigiliux Hafniensis, Nicolaus Notabene, Johannes
Climacus, William Afham, Frater Taciturnus, Anti-climacus etc. Pour Kierkegaard, il
ne s'agit pas de "prte-nom" ou de masques pour publier des uvres mineures;
rien voir, par exemple, avec le statut des noms Lord R'Hoone ou Horace de
Saint-Aubin qu'utilise Balzac pour signer ses premires productions. Ils ne sont
pas, en plus, la reprise des affabulations littraires (manuscrit trouv,
correspondance recueillie, fiction d'diteur ou d'auteur) mises la mode par le
XVIIIe sicle et dveloppes par les romantiques allemands. Ces auteurs invents
sont glus que des noms d'emprunt : ils ont un milieu, une personnalit, une pense
et un langage qui leur sont propres ; et ils constituent autant de croix existentiels et
philosophiques. Tous ces pseudonymes permettent Kierkegaard la mise en
place d'un systme d'criture et d'nonciation trs complexe dont les fonctions
66
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
sont en rapport avec la nature mme de son projet philosophique et religieux
(Cornu, 1972).
Une des pices de ce systme, In vino veritas, permet d'illustrer le cas d'un
auteur faisant d'un de ses pseudonymes un personnage fictif. C'est mme un cas
exemplaire car Kierkegaard met en scne deux de ses pseudonymes d'auteur. (En
lui-mme, le statut de ce texte est encore plus complexe car il porte comme
sous-titre "un souvenir rapport par William Afham" et il est enchss dans cet
ouvrage - touffu qu'est tape sur le chemin de la vie, publi par Kierkegaard sous
un pseudonyme. Il est possible toutefois de ngliger toutes ces complications pour
ne retenir que ce qui intresse notre propos).
Ce texte est le rcit d'un dner dans les environs de Copenhague entre cinq
convives, qui discourent sur l'amour et les femmes, comme dans Le Banquet de
Platon qui est manifestement un des modles de cet crit. Trois d'entre eux portent
un nom : Johannes, "surnomm le sducteur", Victor Eremita et Constantin
Constantius. Le premier est bien sr le "Johannes" du fameux Journal du
sducteur. Mais il ne s'agit l que d'un personnage. 'tandis que les deux autres sort
respectivement l'auteur d'Ou bien... Ou bien et de La Rptition. En les
transformant en personnage part entire, Kierkegaard donne ainsi une
dimension supplmentaire ces pseudonymes, qui il avait donn la parole. Ils ne
peuvent plus tre pris comme des porte-parole de l'auteur, des reprsentants
honteux d'un penseur qui ne signa de son nom que des Discours chrtiens ou des
Discours difiants. Non content de donner vie chacun de ces mondes
imaginaires qu'il portait en lui, d'incarner chacun de ses possibles, il les fait se
rencontrer et dialoguer, donnant ainsi chacun d'eux une paisseur existentielle
dfinitive.
Pour terminer cet examen, notons que les remarques faites plus haut sur
les problmes de substitution et sur les substituts dguiss sont applicables aux
substituts onomastiques. Il faudra aussi se demander comment le lecteur peut tre
inform des noms seconds d'un crivain ; et, l encore, le choix de ces noms n'est
jamais indiffrent : ce ne sont pas seulement des moyens d'identification, mais
aussi des moyens de prdication du personnage. Si un crivain donne un per-
sonnage, dans un rcit de guerre, son nom de soldat, c'est videmment pour
67
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
rpondre aux rgles du genre et pas uniquement parce que ce nom lui permet de
se donner un homonyme. Enfin, il faut rappeler que, dans cette classe aussi, les
substituts peuvent tre dguiss : on l'aura compris avec les exemples de
Nabokov et de Sollers.
C). Homonymie chiffre
Malgr leur diffrence, les deux types d'homonymie envisags plus haut
(par transformation et par substitution) ont en commun de reposer sur une base
nominale. Mme quand cette homonymie est indirecte, construite et non pas
constate par le lecteur, son assise reste onomastique. Mme quand l'homonymie
se fait par une "correspondance structurale", le moyen terme est un nom propre ou
un substitut dont la valeur onomastique est indiscutable. Apparemment, aucun
autre indice ne peut remplacer avantageusement cette mdiation du nom propre.
Dans tous les exemples cits, la fictionnalisation de l'auteur passait, de prs ou de
loin, par l'usage de son nom.
Il faut pourtant se demander si d'autres indices ne sont pas en mesure de
remplir la fonction d'un nom propre ou de ses substituts. L'identit d'une personne
comprend, en effet, des donnes qui ne sont pas d'ordre onomastique, mais
factuel, dfinies par la lgislation en vigueur. C'est ce qu'en termes juridiques, on
appelle l'tat des personnes ou l'tat-civil. Il s'agit de "l'ensemble des qualits
inhrentes la personne, auxquelles la loi civile attache des effets juridiques"
comme le dfinit le Robert. Ces qualits sont donnes par l'tat-civil : nationalit,
profession, situation familiale, date et lieu de naissance, adresse, caractristique
physiques etc. Tous ces lments de l'tat-civil entrent en compte dans la
dfinition lgale d'une personne. Il faut donc se demander si ces indications
d'tat-civil ne peuvent pas concourir instaurer une homonymie indirecte entre
l'auteur et l'un de ses personnages.
Prenons d'entre de jeu un exemple. Dans Facino cane, Balzac reprsente
un narrateur qui est tudiant et qui mne une existence monastique dans une
petite rue prs de l'Arsenal. Ds les premires lignes de cette nouvelle, le nom de
cette rue est donn au lecteur :
68
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"Je demeurais alors dans une petite rue que vous ne
connaissez sans doute pas, la rue de Lesdiguires...".
Or, on sait que Balzac a effectivement vcu au numro 9 de cette rue, vers
les annes 1819-1820, dans une mansarde situe au cinquime tage. Cette
chambre, avec sa localisation, ne pouvait manquer d'tre mmorable pour Balzac :
elle est lie la priode hroque de ses dbuts, quand il dcida de se consacrer
la carrire des Lettres. C'est dans ce lieu qu'il fit de vastes lectures d'ouvrages
philosophiques, qui devaient le marquer toute sa vie ; c'est l qu'il crivit ses
premiers travaux, dont Cromwell, une laborieuse tragdie en alexandrins. Tous ces
lments font dire Albert Bguin qu'avec cette nouvelle, Balzac ajoute un
"chapitre supplmentaire aux parties autobiographiques de Louis Lambert"
(Bguin, 1953b,p. 853). Il est vrai que Facino cane est l'un des rares textes de La
Comdie Humaine tre narr la premire personne et que les ides formules
par le narrateur sur sa capacit de "seconde vue", de "devenir un autre que soi"
dveloppent un thme dj formul dans la prface La Peau de Chagrin en
1831.
Malheureusement, ces similitudes entre les propos assums par Balzac
lui-mme et ceux pris en charge par ses personnages sont monnaie courante dans
La Comdie Humaine. C'est surtout le domicile qui joue ici le rle d'un
dnominateur commun permettant de rapprocher Balzac du narrateur-hros de
Facino cane. A l'aide de cette indication, on peut formuler un rapport de proportion
suivant : le narrateur-personnage de Facino cane est un locataire de la rue de
Lesdiguires, comme Balzac tait le locataire de cette mme rue vers 1818-1819.
Apparemment, les indications d'tat-civil sont donc mme de remplir le mme
rle que le titre dun ouvrage, peuvent servir tablir une homonymie par
homologie, elle-mme mise en place par une descriptions dfinie.
Ce procd a tout de mme ses limites, qu'illustre bien l'exemple de Balzac.
Tout dabord, il faut noter qu'une indication d'tat-civil ne peut permettre elle
seule de formuler une description dfinie qui permette de dsigner un auteur.
Balzac na pas toujours habit la mansarde de ses dbuts. Lorsqu'un crivain
franais met en scne un personnage de nationalit franaise, l'auteur et sa
crature se partagent bien un trait d'tat-civil identique. Est-ce suffisant pour voir
dans l'un le double fictif de l'autre ? Il est vident que non. Le problme des
69
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
qualits ou des faits relatifs l'tat des personnes, c'est qu'elles sont de nature
factuelle et non smiologiques. Leur valeur dsignative est beaucoup moins
prcise, beaucoup plus floue. A leur accorder la mme valeur qu'un titre d'ouvrage
ou qu'un second nom propre, on risque de retomber dans le critre laxiste de la
ressemblance. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les ngliger. Mais on ne peut faire
fonds sur un fait d'tat-civil pris isolment pour dcider que l'on a affaire une
autofiction. Dans le cas de Facino cane, si l'on peut voir dans le narrateur de cette
nouvelle de Balzac un double de l'auteur, c'est que d'autres lments entrent en
compte : son anonymat, des donnes thmatiques comme son statut d'tudiant,
son don de "seconde vue" qui le dsigne comme crivain en puissance etc. Toutes
ces donnes viennent s'ajouter l'indication du domicile pour constituer
effectivement ce personnage en double fictif de Balzac. Si le registre explicitement
invraisemblable de cette nouvelle interdit d'y voir, comme le fait Bguin, un
chapitre de l'autobiographie de Balzac, il est nanmoins lgitime de penser que
l'auteur de La Comdie humaine ait voulu se mettre en scne dans ce texte. Mais il
faut tre trs prudent ; on ne peut lever en rgle de ddoublement la prsence
d'une qualit d'tat-civil. A elle seule une indication d'tat-civil ne permet pas
d'infrer que l'crivain ait voulu se reprsenter en la donnant un personnage.
Rastignac, par exemple, est n la mme anne que Balzac, en 1799 - au moins
dans la notice biographique de ce personnage rdige par l'auteur du Pre Goriot.
Cette similitude ne nous permet pourtant pas de voir dans Rastignac une
incarnation dlibre et voulue comme telle de Balzac. Cette concidence
chronologique est trop fragmentaire, trop isole pour que le lecteur opre une telle
identification. Relve-t-elle alors d'un pur hasard ? Sans doute pas. Si Balzac a
donn au personnage de Rastignac sa date de naissance, cela ne peut tre
totalement fortuit. Comme avec son nom propre, chacun entretient avec les
donnes de son tat-civil un rapport affectif trs fort. Mais ce genre d'inscription
biographique ne semble pas remplir la mme fin, ne parat pas viser l'instauration
d'un dispositif autofictif. Il faut plutt y voir, nous semble-t-il, la volont d'archiver
des faits, d'tablir des correspondances historiques.
Un autre exemple, emprunt aux Misrables va nous permettre de
dvelopper ce procd. Dans un chapitre justement fameux de ce colossal roman,
"L'anne 1817", Hugo mle dans un inventaire tourdissant toute la poussire des
70
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
faits et des vnements qui donnrent cette anne-l sa "physionomie". On
apprend ainsi aussi bien ce que portaient les "petits garons" comme casquette,
que les airs la mode ou les mesquineries politiques qui faisaient le quotidien de
la Restauration. Ce chapitre annonce bien des gards la "nouvelle histoire", et
Hugo tait trs conscient du caractre novateur de ce passage. Dans l'conomie
du roman, il sert d'ouverture la troisime partie qui est consacre, entre autres,
la dchance de Fantine. Cest cette anne-l que quatre jeunes Parisiens font
une bonne farce et que Fantine se retrouve enceinte, seule face une Socit qui
condamne sans piti les filles-mres. Pourquoi cette anne 1817 et pourquoi
s'attarder aussi complaisamment sur cette poussire de faits ? On s'accorde
reconnatre une "valeur autobiographique" au choix de cette date et ce chapitre
puisque 1817 est l'anne o dbuta la carrire potique de Hugo. A cette date, il
n'crit pas ses premiers vers, ni mme sa premire uvre, mais il obtient une
mention au concours de l'Acadmie franaise. Pour la premire fois, Hugo voit son
nom mentionn dans les journaux et il est reu par le doyen des Acadmiciens, qui
employa mme les talents du jeune pote pour traduire un ouvrage savant qu'il
signa de son nom. Pour Hugo, qui trs tt voulut galer Chateaubriand, l'anne
1817 reprsente donc le coup d'envoi de sa vocation d'crivain, le dbut d'une
conscration qui allait faire de lui l'crivain le plus clbre de son sicle. On
comprend alors l'attachement rtrospectif de Hugo pour cette anne 1817. En faire
une anne charnire dans un roman, c'est en quelque sorte l'archiver, la ressaisir
dans l'espace de la fiction. Il y a ainsi, chez Hugo, beaucoup de dtails, d'allusions,
de noms qui ne sont perceptibles que pour le lecteur prvenu et qui fonctionnent
comme un mmorial personnel, usage presque priv. Pour le lecteur moyen (ou
ne disposant pas d'une dition critique), un tel renvoi est imperceptible. Il
fonctionne comme un private joke, que seuls quelques happy fews sont en mesure
de saisir. On est ici proche de ce que la rhtorique ancienne appelait l'allusion,
sinon que le private joke est plus difficilement comprhensible et que le fonds
culturel commun ne suffit pas pour le saisir. Si Hugo place la sinistre farce
imagine par Tholomys en 1817, ce n'est pas pour s'identifier celui-ci, pour
suggrer qu'il fit cette date une action d'aussi mauvais aloi. C'est pour retracer
son souvenir et celui du lecteur une anne pour lui mmorable, pour faire
concider son histoire avec celle qu'il invente.
71
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Quelques pages d'Aragon dans l'Aprs-dire" de Blanche ou l'Oubli
confirment et largissent cette analyse :
"Blanche n'est pas Elsa. Je ne suis pas Geoffroy Gaiffier.
Le couple Marie-Noire-Philippe n'est pas notre couple. Tout
cela, ce sont des hypothses : des hypothses pour essayer
de comprendre ce que je n'ai pas su, pas compris (...). Par
exemple : J'imagine Blanche Java, vers 1930. Un
subterfuge pour comprendre Elsa par qui n'est pas elle, par
un pays o elle n'a jamais t (). Et Java du mme coup
devient Tahiti, o Blanche non, mais oui Elsa s'en fut, comme
en fait foi le passeport dlivr sur sa demande par la
commune de Papeete le 27 juillet 1920".
Premire explication : le procd consistant "brancher" la fiction sur sa
vie propre apporte l'crivain un "subterfuge" pour (se) comprendre lui-mme, son
rapport au monde et aux autres. Il permet l'criture d'avoir une fonction
modlisante, de structurer le vcu. La suite ajoute une autre dore, qui ne manque
pas d'intrt :
"J'ai donn Geoffroy Gaiffier ma date de naissance, pour
pouvoir lui faire cadeau d'vnements qui appartiennent,
c'est vrai, ma vie mais c'est comme on met un acteur
jouer dipe ou Hernani, il n'est pas dipe, il n'est pas
l'amant de Dona Sol. Il fallait, pour pouvoir se servir de mon
exprience, que ce personnage invent me ft strictement
contemporain".
Dans ce passage, le procd a une fonction heuristique ; il vivifie
l'exprience de l'crivain, son vcu, afin d'toffer linvention, comme c'est souvent
le cas chez Balzac. Mais tant que le procd en reste l, sa valeur est surtout
instrumentale il est au service du processus cratif de l'crivain, plus qu'il n'est
destin provoquer un effet chez le lecteur.
Par contre, si l'usage de ce procd est articul une constellation de
ressemblances significatives entre luvre et la vie, constellation avoue par
l'crivain, alors le lecteur est invit en faire une lecture rfrentielle et l'on se
trouve face quelque chose qui se rapproche du roman personnel, mais pas de
l'autofiction. C'est le cas de Blanche ou l'Oubli puisque dans la suite de cet
"prs-dire", Aragon explique que ce roman lui a permis de faire des "aveux" :
72
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"Il n'y a entre Blanche et Elsa que cette ressemblante,
Java-Tahiti, encore y a-t-il dix ans de dcalage entre les deux
voyages exactement pour ne pas cder la tentation qu'
Tahiti en 1930 arrive en mme temps qu'Elsa Matisse, sans
doute, mais simplement aussi parce que le dcalage
implique la diffrence d'ge entre Gaiffier et sa femme. Cette
diffrence suffirait elle seule rendre impossible de les
comparer nous, Cependant, si je cherche me
comprendre, c'est que je voulais dire une chose vraie de
notre vie qu'on retrouve chez les Gaiffier, et dont alors (Elsa
vivante) je n'avais pas os parler haute voix : dans ces
annes de Java, je puis si Gaiffier n'est pas moi d'vidence,
encore qu'il porte mon calendrier comme paletot (si surtout
Blanche n'est pas, ne peut pas tre Elsa, parce qu'Elsa n'est
plus Tahiti depuis treize ans quand Blanche devra quitter
Java) - je puis avouer son crime, qui est de ne pas
comprendre que Blanche est habite du besoin d'crire pour
se comprendre, de ne pas comprendre ce que cela signifie,
ces cahiers multicolores o elle crit, sans rien dire. En ce
temps-l, nous sommes Paris o Elsa fait des colliers beaux
n'y pas croire. Cependant six ou sept ans plus tard, sur des
cahiers multicolores, c'est en cachette de moi qu'Elsa crira
des choses inconnues, qui seront bientt Bonsoir, Thrse.
Et je ne le comprendrai pas comme Gaiffier de Blanche,
l'poque des colliers... Le livre de 1965 ne pouvait faire cet
aveu qu'autant que Blanche n'tait pas Elsa, je n'tais pas
Gaiffier. Pour cet aveu, cependant, et plusieurs autres
similaires, ce roman de 1965 a t crit" (1971, pp. 521-523).
D'une faon gnrale, il importe donc d'tre trs prudent et de ne pas faire
systmatiquement des indications d'tat-civil un moyen d'identification, le support
d'une homonymie indirecte. On ne peut formuler une rgle gnrale ; ce propos
; il faut procder cas par cas et chercher chaque fois valuer le poids des traits
d'tat-civil donns par l'auteur. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est
exceptionnel qu'un seul trait suffise lui seul pour tablir une identification. Quand
un crivain veut que l'on apprhende un personnage comme son double, il ne
craint pas la plupart du temps de multiplier des indices. Sinon, il s'agit plutt de
clins dil destins soit des intimes, soit la postrit : des private joke ou des in
joke.
Malgr leur diffrence, les deux types d'homologie envisags plus haut ont
en commun d'tre perceptibles l'intrieur d'une uvre. Dans tous les exemples
cits, la fictionnalisation de l'auteur est faite de faon immanente, par des
73
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dclarations ou des indications fournies intra-muros en quelque sorte. Dans le cas
de l'homonymie par transformation, le caractre immanent de la fictionnalisation se
passe d'explication. Pour l'homonymie par substitution, on verra dans la section
suivante quels sont les moyens pour un crivain de procurer au lecteur 1a
possibilit d'tablir un rapport de proportion entre lui-mme et l'un de ses
personnages. L'essentiel est de bien voir que, dans les deux cas, le lecteur n'a pas
se livrer une enqute d'histoire littraire, n'a pas besoin d'informations
extrieures luvre pour identifier un reprsentant de l'auteur dans la fiction.
Mme quand ihomologie est construite par un rapport de proportionnalit, n'est
pas seulement constate, le lecteur n'est pas dans la ncessit de faire appel
des donnes trangres au texte qu'il dchiffre. Le lecteur doit comprendre ou
percevoir une relation entre l'auteur et son hros, il n'a pas l'interprter l'aide
d'autres tmoignages sur l'identit du personnage. Bref, la perceptibilit des deux
types d'homonymie prcdents est manifeste, explicite, patente. Au contraire,
quand un crivain dote l'un de ses personnages d'un lment de son tat-civil, le
lecteur doit faire appel un savoir extrieur luvre. La concidence est implicite,
cache, chiffre. Du vivant de l'auteur, de telles indications sont imperceptibles,
moins d'une notorit exceptionnelle. Si l'crivain devient un classique, s'il acquiert
un droit de cit dans les ditions critiques, alors certes un pritexte ditorial
permettra au lecteur de les dcoder ; une dition savante permettra de faire un,
sort de tels dtails, de souligner tout le marquage autobiographique que recle
un texte. Mais on voit qu'il s'agit d'un effet diffr, retardement et qui ne peut agir
qu'avec le temps. Donc, mme dans le cas o les qualits relevant de l'tat-civil
sont multiplies de faon cohrente, afin de mettre en place un dispositif de
fictionnalisation, l'effet n peut tre immdiat. Ce procd retardement, conjugu
la ncessit de recourir des informations pose un problme d'interprtation.
Do notre parti-pris de classer part cette possibilit d'identification avec un
personnage et de la dsigner par l'expression "homonymie chiffre".
74
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
2. 3. CONTEXTE
" Pourquoi votre nom et votre adresse dans la bouche de
la tte d'ORPHEE ?"
C'est le portrait du donateur au bas de la toile ; le nom de
l'cras que l'on interroge chez le pharmacien.".
J. Cocteau.
75
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
La section prcdente a permis d'examiner tous les moyens pour l'auteur de
convertir son nom d'crivain en nom de personnage. Cet examen sest limit
dresser l'inventaire de procdures d'identification, de formes de nomination ou de
substitution, indpendamment de leur ralisation effective, de la manire dont elles
pouvaient tre utilises dans une uvre. Cette limitation tait ncessaire pour
souligner l'importance de ce paramtre onomastique, vritable pierre de touche de
la perception par le lecteur de la fictionnalisation de l'auteur dans le textes Mais en
ralit, ces formes de nomination et de substitution ne sont pas dissociables de
leur inscription dans une uvre. Elles n'existent que prises dans une histoire et
une narration, dans un texte et ses entours. Bien plus, elles sont en fait
subordonnes cet environnement puisque c'est lui qui les fait exister, qui permet
les occurrences d'un quivalent du "nom auctorial". En un mot, le paramtre
onomastique du protocole nominal est lui-mme dpendant d'un paramtre
contextuel, qui est constitu de l'emplacement, des variations, de la frquence, de
la situation des occurrences du nom propre (de son altration ou de son substitut)
d'auteur. Tout ce contexte va dterminer la perception du lecteur de faon
dcisive.
Tentons, un parallle avec un texte romanesque pour clairer l'importance
de ce paramtre contextuel. Pour tudier la figure de Mme de Rnal dans Le
Rouge et le Noir. il faut bien sr s'attarder sur son nom puisqu'un personnage c'est
essentiellement, on l'a vu, un nom propre autour duquel s'articulent des prdicats
et des fonctions. Mais cet examen ne peut se rduire isoler ce nom pour en
chercher les sources possibles, les quivalents littraires ventuels, les smes
(d'appartenance une classe sociale par exemple) qu'il vhicule, les connotations
qu'il peut suggrer. Il faut aussi chercher comment il est employ dans ce romans
par quels appellatifs il se monnaye, quels sont ses substituts etc. Faute de cette
recherche contextuelle, on manquerait par exemple ce trait essentiel, bien observ
par Jos Cabanis, mme si c'est en termes psychologisants :
"Une nuance peine perceptible, un certain silence
mme, peuvent rvler l'essentiel d'un personnage. Madame
76
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
de Rnal : elle est toujours dsigne de la sorte. Le prnom
qu'elle portait, nul ne s'avance jusqu' le prononcer. On
devine cette rserve un peu triste qu'elle ne perdait jamais,
on comprend le respect qu'elle inspirait et pourquoi Julien lui
revient pour mourir. Une des clefs du livre" (Cabanis, 1964,
pp. 251-252).
Au reste, ce contexte est important parce que, comme on l'a not, certains
cas d'homonymie indirecte supposent pour fonctionner que le lecteur puisse tablir
de lui-mme certaines mdiations, qu'il dispose de connaissances ncessaires
pour comprendre une transformation ou une substitution onomastiques. Or, seule
l'tude de ce paramtre contextuel va permettre de comprendre comment un
crivain pela fournir ses lecteurs ces indications.
Enfin, on va voir que par certains procds contextuels, un auteur peut
compliquer ses rapports avec son homonyme fictif, troubler passablement son
identification avec l'un de ses personnages. En jouant sur le contexte du protocole
nominal, un crivain peut non seulement moduler le sens de son identit, mais se
forger une identit indcise; ambigu ou contradictoire.
Il s'agit par consquent de considrer l'identification fictionnelle dans son
effectuation, dans son mouvement et plus seulement dans son rsultat, dans son
produit formel. Pour ce faire, il faut envisager le r81e du contexte paratextuel, puis
du contexte textuel, dans la constitution du protocole nominal.
A) contexte paratextuel (I) : lpitexte
Une uvre littraire n'est pas faite seulement d'un texte. Elle est constitue
aussi d'un ensemble de composants qui va du titre une exgse prive ou
publique, en passant par la prface ou le prire d'insrer. Depuis les travaux
dcisifs de Genette sur ce domaine, on appelle cet ensemble le "paratexte"
(Genette, 1982, p. 9). Tous les lments qui le composent sont, des titres
variables, dterminants pour l'orientation de la lecture d'une uvre.
Dans cet ensemble, il faut distinguer ce qui appartient aux marges de
luvre et ce qui est plutt un prolongement de luvre : toutes les dclarations,
commentaires ou mises au point dont elle peut tre l'objet par l'crivain lui-mme.
Dans la terminologie de Genette, il s'agit d'une part du "pritexte", d'autre part de
77
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"l'pitexte" (Genette, 1987). Ces deux aspects du paratexte ne vont pas avoir la
mme importance pour notre paramtre contextuel. Par sa situation particulire,
l'pitexte ne peut jouer qu'un rle minime. Coup en quelque sorte du livre,
excentrique son systme d'nonciation, il ne peut agir rellement dans la
constitution d'une identification fictionnelle. Par contre, il peut remplir une fonction
d'emphase qui n'est pas ngligeable. Un crivain peut ainsi attirer l'attention du
lecteur, dans son Journal ou dans un entretien, sur le fait que le personnage qui
porte son nom est bien un double fictif de lui-mme. S'il a transform son nom ou
utilis un substitut, il peut expliquer le mcanisme de ce change , S'il a mis en
uvre plusieurs formes de fiction de soi, il peut les diffrencier et clairer ces
diffrences. A l'inverse, l'crivain peut insister sur le fait qu'il n'a donn que son
identit son homonyme, qu'il ne s'agit pas de sa personne relle, qu'il n'a pas
voulu faire uvre autobiographique. Ce type d'indications relvera alors du
discours d'escorte de l'crivain sur son travail autofictif, sur la nature et les effets
de cette mise en scne fictionnelle de soi. Le Journal de Gombrowicz prsente par
endroits quelques aperus de cet ordre que l'on ne manquera pas de citer quand
l'occasion se prsentera - mais ils sont allusifs et rares. Dans l'ensemble, cette
fonction d'emphase du pritexte est peu exploite. En l'absence d'une tradition
autofictive, on pouvait s'y attendre.
Reste que l'on peut se demander si, dfaut de l'tablir, lpitexte ne peut
dvoiler une fictionnalisation de soi, rvler les traits cachs d'un protocole
nominal. On aurait alors affaire une autofiction effet retard, qui se
rapprocherait de l'identification chiffre vue dans la section prcdente. On peut
ainsi imaginer le cas d'un crivain rvlant aprs coup la signification dindices qui
permettent de l'identifier dans une fiction. Un tel cas est possible, mais il faut tre
trs prudent avec ce genre de dclaration. Pour que l'on ait rellement un tel cas, il
faudrait une formulation sans quivoque et explicitant le fonctionnement du
dguisement ayant permis cette fictionnalisation cele. On ne confondra pas, en
particulier, ce type de rvlation avec les dclarations du type "Mme Bovary, c'est
moi" que l'on trouve chez Flaubert bien sr, mais aussi chez Hugo, Gogol,
Fitzerald etc.
Cette phrase si clbre de Flaubert est une confidence orale de seconde
main, rapporte par Descharmes :
78
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"Une personne qui a connu trs intimement Mlle Amlie
Bosquet, la correspondante de Flaubert, me racontait
dernirement que , Mlle bosquet ayant demand au
romancier d'o il avait tir le personnage de Madame Bovary,
il aurait rpondu trs nettement et plusieurs fois rpt 'Mme
Bovary, c'est moi ! - D'aprs moi." (Descharmes, 1909, p.
103).
Faut-il prendre cette dclaration la lettre ? Peut-on penser que Flaubert ait
voulu se travestir en femme dans ce roman des "Murs de province" ? Cite hors
de son contexte, ampute de ses derniers mots, la phrase de Flaubert est
ambigu. Elle peut en effet suggrer que Flaubert voulait que l'on dcouvre sa
personnalit sous le masque de cette hrone que l'on comprenne qu'Emma
Bovary tait son double. Mais rtablie dans son contexte et dans son intgralit,
elle est sans quivoque : "Mme Bovary, c'est moi ! - D'aprs moi". A la question du
modle de Mme Bovary, Flaubert rpond que la source est essentiellement
lui-mme, qu'il s'est inspir de ses tourments et de son incapacit vivre la ralit
pour laborer le caractre de cette hrone. C'est l tablir une filiation entre "le
bovarysme" et son propre dgot de l'existence ; c'est dire qu'il avait mis beaucoup
de lui-mme dans ce personnage ; mais ce n'est pas s'identifier Emma Bovary,
inviter le lecteur voir dans ce personnage un autoportrait dguis.
Tout romancier tire de la multitude des tres virtuels qu'il y a en lui (comme
du rel et des ressources de l'criture) de quoi nourrir ses personnages. Parfois, il
reconnat ses filiations, cette paternit, dans des dclarations o il se situe par
rapport ses personnages. Mais il ne s'agit pas l d'une identification, de
l'tablissement d'un protocole nominal d'autofiction. Davantage, il arrive aussi
qu'un crivain dsigne dans son uvre un ou plusieurs porte-parole, un
personnage dont il se sent trs proche, qui exprime le plus fidlement sa vision du
monde. Ainsi Forster, en rponse la question d'un journaliste :
"Int. : Certains de vos personnages ne vous
reprsentent-ils pas un peu ? Forster : Rickie plus que tout
autre. Philip aussi. Et Cecil (...) a quelque chose de Philip"
(Forster, 1967, p. 64).
En voquant ces personnages de The longest journey, de Were the Angels
Fear to Tread et de A room with view, Forster indique que ceux dont il se sent le
plus complice, gui expriment le mieux sa "philosophie" de l'existence. En un mot, il
79
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dsigne ses reprsentants implicites, ses portes-paroles dans ses fictions. De
telles indications pitextuelles sont toujours utiles pour la critique d'un auteur. Elles
permettent de comprendre le sens qu'il donnait ses uvres. Mais il n'est pas
possible d'en faire le support d'un protocole nominal. De tels personnages ne
constituent pas des fictionnalisations de leur auteur.
D'une faon gnrale, il convient donc d'tre trs circonspect avec les
formules pitextuelles du type "X, c'est moi". Le plus souvent, il ne s'agit que de
dsigner une source ou / et un porte-parole. Si lon prenait de telles dclarations
la lettre, une grande partie de la littrature moderne deviendrait autofictive, ce qui
serait confondre source subjective, signification et fictionnalisation.
B) Contexte paratextuel (II) : Le pritexte
Par contraste avec lpitexte, le pritexte va se rvler trs efficace pour la
constitution dun protocole nominal. Rappelons que ce terme dsigne, comme
lcrit Genette, tout ce qui se trouve "autour du texte, dans lespace mme du
volume comme les titres de chapitres ou certaines notes"(Genette, 1987, p. 10).
Tous ces lments pritextuels ont un effet beaucoup plus marquant pour le
lecteur car ils sont directement attachs au texte, sont organiquement lis
luvre. Loin dtre une gne, leur prsence priphrique leur permet de participer
au ddoublement de lauteur par des voies trs varies et pour des effets plus
conomiques que ceux permis par le contexte textuel. Leur contribution au
protocole nominal peut tre double : ces lments pritextuels peuvent, dune part,
fournir les mdiations ncessaires au lecteur pour distinguer les homonymies
indirectes, tablies par les substituts tudis prcdemment ; ils vont permettre,
par ailleurs, dtablir par eux-mme de nouvelles formes dhomonymie indirectes.
1. Le pritexte, source dinformations.
Dans la section prcdente, on a vu des formes d'homonymie indirecte (par
substituts livresques ou onomastiques) qui ne pouvaient fonctionner que sous la
condition que le lecteur dispose des informations ncessaires pour oprer ces
substitutions. C'est le moment d'examiner par quelles voies l'auteur peut fournir
ces informations.
80
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Un crivain peut certes donner ces indications dans le corps de son texte,
mais c'est l une faon peu lgante et peu sre de procder. Peu lgante car il
enlve ainsi au lecteur le plaisir de les dcouvrir par lui-mme ; peu sre car le
lecteur peut mettre en doute ces informations qui sont donnes dans un texte qui,
aprs tout, est une fiction. Il est plus avantageux, par consquent, de confier ces
informations au pritexte qui surplombe le texte et parat, tort ou raison, plus
rel, dot d'un statut de vrit plus consistant quune fiction. On trouvera donc le
plus souvent ces mdiations dans le pritexte et plus prcisment dans le pritexte
d'auteur, pris en charge par l'crivain lui-mme.
Une bonne illustration de cette efficacit du pritexte est la "Prface" de
L'crivain de Strindberg. Dans ce volet dun vaste ensemble finalit
autobiographique, August Strindberg met en scne un crivain, "Jean", qui relate
une existence tourmente et s'attribue la paternit de la plupart des uvres de son
crateur. crit selon Strindberg en 1886, le texte resta indit jusqu'en 1909, date
o il fut publi prcd d'une prface dont la rdaction est contemporaine de cette
publication. Cette prface assez longue consiste essentiellement en une
numration chronologique de toutes les uvres de Strindberg, assortie d'un bref
commentaire. Strindberg explique qu'il a publi cette notice pour relativiser la
signification de ce texte, pour le replacer dans l'ensemble de son uvre, o il ne
reprsente qu' une tape et afin qu'on ne le prenne pas pour des mmoires ou des
confessions. Cette prface devait donc surtout fournir un contre-point au
dveloppement de l'crivain "Jean" sur les sources, le contexte et la fortune des
livres (de son crateur) qu'il sattribuait, dveloppement qui constitue une bonne
partie de ce texte.
Reste qu'aujourd'hui et pour le public franais (qui ne connat gure cet
crivain sudois), cette prface remplit aussi une autre fonction : elle permet de
comprendre que "Jean" est un double de Strindberg lui-mme. Cette prface
remplit ainsi deux fonctions presque contradictoires. Elle donne au lecteur un
rcapitulatif bibliographique qui fait qu'indirectement ce personnage fictif d'crivain
est aussi un homonyme de Strindberg. Mais elle permet aussi de limiter cette
identification, et de restreindre la valeur des propos de ce personnage. Ce procd
permet ainsi une identification la fois indirecte et partielle. Strindberg peut publier
un bilan ancien qu'il ft sur lui-mme et se dmarquer de ce pass qu'il estime
81
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"expi et ray du Grand Livre" ; prendre ses distances avec une personnalit qui,
la date o il publie Lcrivain, lui est "aussi trangre" que "peu sympathique" et
qu'il estime avoir tue en 1898, lors d'une "grande crise vers la cinquantime
anne". On retrouve ainsi chez Strindberg un des rles possibles de la
fictionnalisation de soi, dj entrevu chez Cendrars avec Moganni Nameh : le
"roman de mise au point".
Les informations fournies par le pritexte n'ont, toutefois, pas besoin d'tre
aussi abondantes pour joues un rle important. Elles peuvent, aussi bien, tre
minimales comme le montre l'exemple d'Andr-la-Poisse d'Abram Terz. Pour saisir
tout le sel de ce petit rcit fantastique, il faut savoir que le nom du personnage
principal est en ralit le nom vritable de cet crivain russe et quAbram Terz n'est
quun pseudonyme, adopt pour pouvoir publier en Occident, quand il vivait encore
en Union Sovitique. Le livre se charge de fournir cet lment par un nom d'auteur
double, une "signature'' bicphale. Suri la couverture et sur la page de titre, on
peut lire ainsi : "Abram Tertz (Andr Siniavski)", le second anthroponyme tant
l"onyme" de cet crivain. Le pritexte ditorial explicite bien sr cette indication,
mais celle-ci constitue une mdiation suffisante pour que le lecteur puisse
construire une homonymie entre l'auteur Tertz et le personnage Siniavski.
Parmi ces lments pritextuels qui peuvent permettre une identification
fictionnelle, il faut tre attentif au fait qu'ils peuvent parfois appartenir un pritexte
apparemment allographe, se prsenter sous la forme d'un pritexte ditorial. Il ne
faut pas oublier que cette distinction entre le pritexte d'auteur et le pritexte
ditorial est mobile, que l'auteur peut toujours investir des lieux du livre dhabitude
rservs l'diteur et qui sont sous sa responsabilit, Comme l'a souvent rappel
Butor, un livre ce n'est pas seulement un manuscrit, c'est aussi une publication
(Butor, 1979, p. 29). La forme et la matrialit de celle-ci laissent rarement
indiffrent un auteur car elles mettent en jeu son image et sa circulation. Certes,
les crivains n'ont pas beaucoup dinfluence sur la publication de leurs livres, sauf
s'ils sont aussi diteur et imprimeur comme pouvait l'tre Restif par exemple. Mais
ils peuvent agir sur certains messages ditoriaux imprims sur leur livre, pour les
mettre au service de leur texte.
82
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Prenons le cas de la liste des uvres "du mme auteur" qui se trouve le
plus souvent au dbut de l'ouvrage, face la page de titre, mme si parfois elle
peut tre imprime sur le dos ou sur un rabat de couverture. Un crivain ne peut
tre insouciant de cet lment pritextuel, comme en tmoigne ce passage dune
lettre de R.L. Stevenson Sidney Colvin, propos de la publication de L'migrant
amateur, en dcembre 1879 :
"Quoi qu'on fasse ct publication sous forme de livre, ne
pas oublier deux choses : un, il faut absolument que j'aie
droit une avance, et deux, je tiens ce qu'on fasse de la
rclame pour tous mes livres (comme il est d'usage en
France : en face de la page de titre). Je sais, par exprience
personnelle, que pour ce qui est des acheteurs... il n'y a rien
de mieux pour l'auteur !" (Stevenson, 1879, p. 257).
Quand il crit cette lettre, Stevenson a dj son actif deux rcits de
voyage : Un Voyage dans les terres et Voyage avec un ne travers les
Cvennes. Il veut rappeler leur existence pour des raisons qui sont d'abord, bien
sr, commerciales, le succs d'un nouveau livre relanant souvent la vente
d'ouvrages plus anciens du mme auteur. Mais il ne faudrait pas s'arrter cet
aspect commercial, mme si c'est lui que Stevenson met en avant. Par le rappel
de ses titres, Stevenson voulait donner plus d'toffe son nom, faire le lien avec
ces deux prcdentes relations de voyages dont l'ironie critique lui avait apport un
succs d'estime et l'avait introduit dans les milieux littraires londoniens. Bref, il
voulait qu'on le prenne pour un vritable crivain, avec un style propre, pas
seulement pour le signataire d'un ouvrage relatant une incursion dans le Nouveau
Monde.
Pour le public et la moyenne des lecteurs, un auteur c'est avant tout une
liste de titres d'ouvrages, qui dessine un type d'crivain et un style duvre. La
plupart du temps, le lecteur n'a pas d'autres informations pour se faire une ide
d'un livre. On objectera qu'aujourd'hui, avec les mdias audiovisuels, cette
situation est en train de changer ; mais ce n'est vrai que pour un petit nombre
d'auteurs, les plus populaires, quelles que soient les raisons de cette popularit.
Pour les autres, leurs visages se rduisent des descriptions dfinies : "L'auteur
de...". D'o l'intrt, pour un crivain, d'utiliser toutes les ressources de cette liste
"du mme auteur". Par les limitations qu'il impose (en omettant de recenser des
83
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ouvrages de jeunesse ou faits sur commande), par les anticipations qu'il formule
(en recensant des livres en prparation, mme si leur publication n'est qu'un dsir)
ou par les classifications qu'il met en place (en divisant ses ouvrages selon les
catgories gnriques de, son choix) un crivain peut ainsi moduler son image de
faon trs variable. Il est trs instructif de suivre chez un auteur les fluctuations de
cette liste d'un livre l'autre : on obtient ainsi la courbe de ses repentirs, de ses
projets et du relief qu'il donne son uvre.
Pour revenir au problme de l'identification fictionnelle par la mdiation du
pritexte, il est manifeste que cette liste "du mme auteur" va en tre un lieu
privilgi, pour les crivains qui veulent se mettre en scne par le biais de
substituts livresques ou onomastiques. Ce n'est pas le seul utilisable : le prire
d'insrer, une note, peuvent remplir une fonction similaire ; mais c'est bien
videmment le plus pratique et le plus lgant.
2. Le pritexte, moyen d'identification.
Jusqu' prsent, les exemples tudis ne donnaient qu'un rle subalterne
au pritexte dans la constitution d'une homonymie indirecte. Dans les cas
envisags, le pritexte ne remplissait qu'une fonction annexe pour l'laboration
d'une identification fictionnelle. Il reste voir comment le pritexte peut tre par lui
-mme le moyen d'un telle identification ; comment il peut tre non plus un
adjugent, mais le support principal de la mise au point du protocole nominal. Et un
support d'autant plus prcieux que, par son existence priphrique, le pritexte
autorise, au mme titre que les substituts livresques ou onomastiques, des
identifications par la bande qui permettent des effets trs varis.
Il faut rappeler, en effet, que par dfinition le pritexte existe et agit la
priphrie du texte, sur ses marges ou ses entours. Dot d'une ralit sui generis,
"mixte de dehors et de dedans (...) mixte qui n'est pas un mlange ou une
demi-mesure (...) dehors qui est appel au-dedans du dedans pour le constituer en
dedans" (Derrida, 1978, p. 74), le pritexte a ce privilge presque exorbitant d'tre
luvre, sans tre de l'uvre ni hors d'uvre. Autrement dit, le pritexte influe
sur le texte in absentia, associativement, de faon paradigmatique, par des
indications qui prennent en charpe la continuit textuelle. C'est toute la diffrence
84
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
avec le contexte textuel qui n'a d'impact que linairement et in praesentia. Cette
position excentrique du pritexte permet des procds et des effets de
surimpression que le texte rend difficilement possible, sinon mettre en cause son
intelligibilit et sa cohrence. En fonctionnant selon un axe vertical, en venant
s'associer de l'extrieur au texte, les indications pritextuelles vont permettre,
comme les substituts vus plus haut, des effets inattendus de supplance et de
surdtermination dans la constitution du protocole nominal. Presque tous les
lments pritextuels peuvent produire de tels effets. La dmonstration serait,
certes, fastidieuse. Par contre, il est sans doute utile d'expliciter la nature des
effets crs par les composants pritextuels. On va retrouver les fonctions que
remplissaient les substituts livresques : fonctions de surcharge, de compensation
et de surdtermination.
III. 2. 1. Fonction de surcharge.
Cette fonction va de soi et ne risque gure de provoquer de surprises
puisque le pritexte n'a encore qu'un rle subalterne dans la ralisation d'une
identification fictionnelle. Comme les substituts livresques, le pritexte renforce
alors une identification opre dans le texte. Selon leur position dans le livre, ses
lments ont une valeur cataphorique ou anaphorique par rapport au protocole
nominal : le pritexte liminaire annonce ce protocole, tandis que le pritexte central
ou terminal le confirme.
Plus surprenant par contre, est le fait que les lments pritextuels les plus
inattendus sont en mesure d'apporter une telle contribution. C'est le cas, par
exemple, du titre dont la capacit participer une identification fictionnelle n'est
priori pas vidente. Plusieurs uvres permettent de vrifier cette comptence
titulaire. Monsieur Nicolas, Lon Bloy devant les cochons, Il tait une fois Jean
Cayrol, Christopher et son monde, Bonjour, Monsieur Courtot autant de titres
curieux o l'crivain a intgr l'nonc titulaire son patronyme et/ou son prnom.
Il ne faut pas confondre ce procd avec une pratique ditoriale antrieure au XXe
sicle et qui consistait mettre le nom de l'auteur non pas avant le titre et dtach
de son nonc, mais aprs lui et en l'intgrant l'ensemble titulaire (titre, second
titre, indication gnrique) ; ainsi, Tess d'Uberville : une femme pure', fidlement
prsente far Thomas Hardy ou Post-scriptum final non scientifique aux Miettes
85
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
philosophiques, composition mimico-pathtico-dialectique, apport existentiel par
Johannes Climacus. Les ouvrages de Restif, de Bloy, de Cayrol ou d'Isherwood ne
relvent pas de la fabulation, mais du registre intime (autobiographie, essais,
souvenirs, polmique). Ils sont, malgr tout, mme de montrer qu'un protocole
nominal peut tre mis en place ds l'intitul. Avant mme que le livre soit ouvert,
une telle formulation titulaire expose au lecteur l'identit commune du sujet de
l'nonc et du sujet de l'nonciation, tablissant ainsi un protocole nominal,
souvent ractualis par la suite, qui place le lecteur dans une attente dfinie. Aussi
bien, peut-on imaginer une uvre o le titre ferait davantage et constituerait lui
seul le protocole nominal, o le lecteur n'identifierait la figure auctoriale par sa seu-
le existence : Flaubert crivant un rcit dont le narrateur-personnage serait
anonyme, mais qui porterait comme titre Vie de Gustave.
II. 2. 2. Fonction de compensation
Cette dernire coquecigrue permet de faire la transition avec une fonction
par laquelle, tout comme les substituts livresques, le pritexte autorise le cumul de
l'anonymat et de l'identification. On a vu que ces substituts pouvaient apporter une
identit relative un personnage anonyme et ainsi raliser une homonymie
partielle entre l'crivain et son hros. Ce procd trouve sa ralisation la plus
frappante avec le pritexte. Par son mode de prsence priphrique, excentr, le
pritexte permet un rgime didentit absolument duel, un rgime o la figure
auctoriale est la fois sans nom et dot d'un tat-civil, indtermine et pourtant
identifiable. Pour des motifs trs varis, un crivain peut en effet vouloir conjuguer
l'anonymat de son hros et la possibilit de 1e confondre avec lui-mme. Dans
cette perspective, le statut marginal du pritexte va se montrer infiniment prcieux.
Deux uvres illustrent de faon exemplaire cette capacit fonctionnelle du
pritexte. Ils prsentent de surcrot l'intrt de faire appel deux formes
pritextuelles distinctes et de raliser ce procd pour des raisons diffrentes,
thmatiques dans le premier cas et formelles dans l'autre.
Dans Le Pays sous l'corce de Jacques Lacarrire, le dispositif a pour
raison dtre un impratif thmatique. Ce roman est une sorte de Livre des
mtamorphoses, titre auquel avait pens La carrire. Homme parmi les hommes,
86
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
le narrateur, se glisse par une belle soire d't sous l'corce d'un platane et se
retrouve transform en criquet. Cette premire mutation est suivie de beaucoup
d'autres : on le retrouve en "apprentigrue", en "presque-loir", en "demi-acridien"
etc., Ces mutations ne russissent jamais totalement, cette impossibilit quitter
rellement sa peau donnant son sens ce rcit merveilleux. Elles permettent
toutefois au hros de connatre de l'intrieur cet univers luxuriant qu'est le
microcosme d'une prairie, d'prouver par lui-mme les sensations et les mois de
la plupart des formes d'existence animale.
Au cours de ce parcours initiatique, le narrateur dcouvre que le monde
animal est un "Pays sans nom". Dans cet univers, les individus ne comptent pas,
n'existent pas pour eux-mmes et par consquent n'ont pas d'identit ni de nom
propre :
"Anonyme. Sans nom. Il existe des mots dans la plupart
des langues pour nommer justement ce qui n'a pas de nom.
Quidam. Un tel. On. Mais quand, chez les hominiens, je me
dis Un tel ou Quidam, je me nomme en quelque faon et cela
pourrait m'tre un nom. Je pourrais m'appeler Personne par
exemple. Le vritable anonymat n'existe pas chez les
humains. Mais ici, je peux vous le dire, il existe, il se meut, il
frtille et il fraie, le grand ON anonyme des eaux. Il est foule,
il est houle d'cailles, il est corps distinct des flots, il est
milliers de ttes, d'yeux, de branchies, de nageoires
identiques, il est reproduction et multiplication de l'UN comme
de l'ON (ces deux notions se confondants chez les sardines),
il est absence, vacuit, nant argent de la mer" (Lacarrire,
1980a, p. 115, nous soulignons).
Ayant quitt la condition hominienne, le narrateur est bien sir lui aussi
anonyme. A aucun moment le rcit ne dvoile l'identit de son hros, il est "sans
nom" comme la totalit des autres protagonistes qui ne sont dsigns que par des
noms d'espces. C'est l une consquence logique de la thmatique de ce texte ;
ce n'est mme pas inattendu puisque de nombreux romans la premire personne
prsentent un narrateur anonyme. Lacarrire a toutefois ajout un lment
inhabituel cette forme narrative si commune. Il a voulu que le sujet de ces
mtamorphoses soit identifi lui-mme, il a dsir ne faire qu'un symboliquement
avec le narrateur-hros de son rcit et assumer en son nom ce cheminement
iniatique. Cette volont est trs nette dans les interviews qu'il a accordes la
87
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
presse crite ou audiovisuelle lors de la parution de son livre (Lacarrire, 1880 b).
Tout en le prsentant comme un "voyage dans l'imaginaire", un "conte" dans la
ligne de Lewis Carroll, il a pris soin d'assumer l'identit de son personnage, de se
dclarer le hros de ce rcit merveilleux. Les journalistes et certains libraires se
sont prts de bonne grce ce jeu. (A l'poque, une librairie parisienne avait
organis une de ses vitrines autour du livre : on y voyait, entre autres, des
montages photographiques qui reprsentaient Lacarrire l'chelle du "pays sous
l'corce", en compagnie de certains de ses animaux etc.).
Ce double langage ne prsentait pas de difficult au niveau mtatextuel, au
niveau d'un auto-commentaire. Par contre, il tait presque impossible tenir au
niveau du livre lui-mme puisqu'il fallait la fois que le narrateur n'ait pas de nom
et que pourtant l'on sache qu'il s'agissait de Lacarrire lui-mme. Comment
satisfaire des exigences aussi contradictoires ? C'est dans de tels cas que la
dnivellation entre le pritexte et le texte se rvle prcieuse. L'cart entre ces
deux niveaux du livre, et leur relative autonomie.permet de mettre en place un
discours hybride, voire contradictoire. Lacarrire pouvait ainsi dvoiler que le
narrateur-hros de son rcit tait lui-mme dans une prface ; et maintenir
l'anonymat de son personnage dans son texte, comme l'exige la thmatique de
l'univers animal o il se meut. C'est peu prs ce que l'auteur du Pays sous
l'corce a fait, mais en choisissant un procd plus subtil, plus oblique. En ralit,
c'est par des "notes en bas de page" que le lecteur est invit voir sous le sujet de
ces mtamorphoses Lacarrire lui-mme.
Le Pays sous l'corce contient en effet plusieurs notes auctoriales, et
savoureuses, portant sur les particularits du "langage animal", sur les systmes
de communication des espces animales rencontres par le
personnage-narrateur. Ce sont autant de mises au point sur les messages des
arthropodes, des arachnides etc., reproduits dans le roman et auxquels le hros
tente de rpondre. Le registre de ces notes est parfois impersonnel, l'auteur
adoptant alors l'objectivit d'un entomologiste pour dcrire le message d'un criquet
ou d'un grillon (pp. 34, 140). Mais le plus souvent, il s'agit d'un registre personnel,
qui s'aligne sur le rgime d'nonciation du narrateur-hros (pp. 140, 163, 164).
Ainsi dans cette note, o l'auteur traduit le passage mtaphorique communiqu ("'-
Qu tndvouuroirtie?") par son narrateur une Epeire :
88
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"Je tente ici malgr tout de retranscrire les vides et les
silences dus l'impossibilit d'exprimer avec quatre
membres un langage et une partition conus pour huit pattes
et pour deux pdipalpesv En ce qui me concerne, je me suis
appliqu et contorsionn de mon mieux mais je ne suis
nullement certain d'avoir toujours dans exactement ce que
je voulais dire Aussi indiquerais-je en note la phrase exacte
que je dsirais exprimer. En l'occurrence ici :
Qu'attendez-vous sur votre toile ?" (p. 163).
Comme on peut le constater,cette note prsente la particularit de ne pas
se dmarquer du rgime d'nonciation du texte. Elle se donne comme une
nonciation du narrateur-hros, bien qu'elle se dploie dans un lieu qui est
ordinairement le domaine rserv de l'auteur. Ds lors, cette note permet
d'identifier sans quivoque l'auteur au narrateur de ce rcit. Certes, elle trouble la
cohrence de la fiction qui se doit habituellement d'ignorer son producteur, mais
pour s'ajuster exactement l'nonciation du narrateur. Il en est de mme des
autres notes "personnelles" du Pays sous l'corce y par leur nonciation, elles
viennent s'aligner sur le texte et font que l'nonciation de ce dernier est finalement
pris en charge par l'auteur. En l'absence d'une solution de continuit entre le texte
et les notes du pritexte, le lecteur suture spontanment ces deux plans, de
manire confondre Lacarrire et l'hominien "bestialis". Cette identification est
indirecte, passe par la mdiation du pritexte, mais son efficace est indiscutable.
On retrouve avec cet exemple une nouvelle forme d'homonymie indirecte, non plus
par un substitut, mais par une procdure pritextuelle. Lacarrire peut ainsi
conjuguer, dans Le Pays sous l'corce, l'anonymat de son narrateur-personnage,
appel par la spcificit de la digse et son implication actoriale dans le texte.
L'Eubage de Blaise Cendrars montre le mme mcanisme d'identification
pritextuelle, mais command par un impratif formel et ralis par une forme
pritextuelle peu susceptible, en apparence, de remplir une telle fonction :la
ddicace. Rappelons que ce petit texte peu connu du grand public est le rsultat
d'une commande du mcne-couturier Jacques Doucet, vers 1917. Cendrars a
relat plusieurs reprises (dans L'Homme foudroy, La Main coupe, Le
Lotissement du ciel), sans craindre d'en rajouter ni de se mettre en valeur, les
conditions dans lesquelles ce petit ouvrage a t compos. Cette origine en
89
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
quelque sorte "alimentaire" n'enlve rien la densit potique de ce rcit, sans
nanmoins lever le mystre qui l'habite.
Tel qu'il se prsente dans sa version finale, publi par Cendrars Au Sans
Pareil en 1926, c'est un ouvrage divis en douze chapitres, eux-mmes trs brefs.
En plus de leur titre, chacun de ces chapitres porte un second intitul, qui reproduit
un des douze mois de l'anne, de mars fvrier, suivant l'ordre des constellations
du Zodiaque. Cette division chronologique donne ce texte l'allure d'un journal
intime ou d'un journal de bord. De fait, ce texte est la relation la premire
personne d'un voyage interstellaire d'un an, qui ccmmence avec le dpart du
"navire" spatial et s'achve avec son retour en catastrophe dans l'atmosphre
terrestre. L'essentiel de cette relation est fait de la description de l'espace sidral
travers, du rcit des vnements qui ponctuent cette exploration (une chasse au
papillon gant, la visite d'un canon qui renferme les "plus beaux bls de lumire"
ou l'hibernage du vaisseau) et d'un certain nombre de rflexions tenues par le
diariste sur la nature de l'univers, la vie ou les limites de la connaissance humaine.
Ainsi rsum, le livre semble s'inscrire dans une tradition familire, qui remonte au
moins Cyrano de Bergerac : le rcit de voyage extraordinaire qui mile l'aventure,
"le pittoresque du ciel", l'rudition pseudoscientifique et la rflexion philosophique.
Pourtant, seule la matire de ce rcit fait cho cette tradition. Cendrars
emprunte, par exemple, L'Astronomie populaire de Flammarion des notations,
des motifs ou des ides qui vont dans le sens de cette filiation (Bozon-Scalzitti,
1977, pP. 19-28). Mais c'est pour les utiliser de faon indite et pour le moins
imprvisible. En ralit, il semble multiplier plaisir les obstacles une telle
classification, parat tout faire pour drouter le lecteur, lui enlever tous les repres
qui permettraient d'intgrer ce texte dans une gnalogie littraire familire. On est
devant un rcit atypique et cette tranget est rarement interroge comme telle.
Elle parat pourtant rsulter d'une stratgie dlibre qui consiste marier des
procds d'criture venus d'horizons diffrents et parfois contradictoires. Le
principe de cette dmarche est de mettre en route un "genre" narratif assez
conventionnel (le rcit de voyage extraordinaire) puis de tout faire pour le dcevoir,
le contrecarrer, le mettre en droute et le transgresser de l'intrieur AM du texte,
tant au niveau narratif qu'au niveau digitique, stylistique ou pritextuel.
90
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Relavons quelques-uns des appareillements contradictoires qui font de ce
rcit un texte inclassable :
a) la manire dont le narrateur relate ce voyage, tout d'abord, semble
laborI.-pour miner ce qui est traditionnellement l'allure narrative. Discontinue,
morcele, la narration empche le lecteur de suivre ce texte comme une histoire.
Si la forme du journal commande un tel parpillement, celle-ci est pousse
l'extreme, rien n'est fait pour retenir ses effets ngatifs comme c'est souvent le cas
avec le rcme.njournal (Oura, 1987). On a l sentiment d'tre face une srie de
tableaux, de squences, de fragments, comme dans le scnario La Fin du Monde
qui date de la mre poque. Plus que le rcit suivi d'une aventure spatiale, cest
des fragments, des lambeaux de rcit que l'on a l'impression de lire, Si le texte
prsente tout de mme une certaine continuit, une progression relative, c'est avec
des lacunes et des manques qui font que le lecteur ne possde ni les tenants ni les
aboutissants de cette aventure. A plusieurs reprises, le narrateur suggre d'ailleurs
que ce voyage n'est qu'imaginaire, qu'il s'agit d'une exploration intrieure.
b) L'histoire, ensuite, est conduite de faon ce que le lecteur n'y adhre
pas. L'aspect onirique de la narration trouve son pendant dans le caractre
invraisemblable des paysages et des actions dcrites. Loin de chercher donner
une quelconque crdibilit son rcit, Cendrars peuple la carte du ciel d'une faune
et d'une flore extravagantes. L'espace sidral se trouve ainsi dot de serpents qui
se nourrissent de soleils, d'astres qui s'battent comme de jeunes lionceaux, de
papillons gants dont les flancs renferment les signes du zodiaque ou d'une "taupe
ocelle comme un paon". Cet irralisme est soutenu par l'indtermination des
coordonnes spatio-temporelles (absence de datation relle, d'itinraire prcis) et
des conditions matrielles de ce voyage. Il n'est pas jusqu' l'quipage qui ne
paraisse irrel, tant aucun individu ne s'en dtache, tant il n'est qu'une masse
indiffrencie aux ractions identiques. Enfin si le narrateur et hros est bien
individus il demeure anonyme, sans nom, simple support d'une figure symbolique :
l'Eubage.
c) L'criture, enfin, loin de seconder le rcit, parat s'ingnier le ralentir ou
l'immobiliser dans de longs passages descriptifs. Quand ce ne sont pas des
ciapilres entiers (chap. 3, 4, 5) qui sont consacrs dcrire le firmament, c'est un
91
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
pisode qui se clt par une numration (ch. 5, 6) par laquelle le texte semble
vouloir puiser les merveilles clestes. Et toujours le rcit prsente de nombreuses
accumulations de choses, dtres, de formes ou de couleurs. C'est d'autant plus
frappant que ces inventaires et ces descriptifs n'apportent aucune cohrence
cette aventure. Loin de compenser l'aspect irrel de cette histoire, ils mettent en
oeuvre des procds qui se conjuguent pour produire un univers "parataxique", un
univers d'une grande richesse mais o les liens entre les choses sont
problmatiques. Ce style parataxique rend malaise la comprhension de ces
tribulations spatiales et une lecture discursive de ce texte. Une participation
inhabituelle est exige du lecteur, celle-l mme que demandent les textes
potiques o il est surtout fait oeuvre de langage. On est ainsi plus proche des
Illuminations, dont quelques rminiscences affleurent par endroits, que de De la
Terre la lune. De ce fait, certaines pages, un ou deux chapitres, sont des
vritables pomes en prose, traverss par une sorte de "lyrisme cosmique".
En fin de compte, le lecteur ne sait pas trs bien comment lire ce texte qui
ne rpond aucun "horizon d'attente" dfini. Tous ces procds font qu'il est
partag entre des options de lecture diffrentes et qui ne sont pas forcment
compatibles entre elles. L'Eubage invite la fois une lecture romanesque qui
suivrait les tours et les dtours de la narration, ferait attention aux pripties de
cette exploration et se prendrait au jeu de cette aventure spatiale ; une lecture
initiatique, plus attentive aux symboles, soucieuse de dchiffrer dans ce texte un
savoir sur l'univers et l'existence, cherchant complter "l'astrognomie" esquisse
par le narrateur au chapitre 5 ; enfin, une lecture potique qui ne serait sensible
qu' la profusion des images, la beaut des associations, la rencontre des
mots que permet le pouvoir germinatif de l'criture. Il faut noter que cette dernire
possibilit de lecture s'oppose aux deux prcdentes. Si l'on savoure L'Eubage
comme un long pome, il faut alors prendre acte de son caractre intransitif, du fait
que l'univers de ce texte ne renvoie rien d'autre que lui-mme. Le problme, c'est
que ce texte est aussi un rcit, qu'il se donne aussi comme "le langage d'une
aventure", ft-ce en pointill.
Ds lors, il est tentant de chercher des solutions cette difficult dans les
lieux qui normalement donnent le "mode d'emploi" d'un ouvrage, savoir
l'ensemble du pritexte. Celui de L'Eubage est trs dtaill, il actualise la plupart
92
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
des lieux promis cet usage par un livre (titre et intertitre doubles, ddicace,
achev de rdaction) et reprsente de faon trs prcise le destinateur, les
destinataires et les conditions d'criture de ce texte. Le titre et le second titre, en
particulier, annoncent un programme qui est effectivement ralis par le texte : une
figure symbolique, L'Eubage, laquelle s'identifiera le narrateur ; un voyage
initiatique, Aux antipodes de l'unit. Mais pour le reste, ce pritexte prpare et
renforce l'infinition de ce rcit. Aucune prface, aucun "Pro domo", ne permettent
de savoir quoi s'en tenir sur son mode de lecture. Bien plus, les deux ddicaces
compliquent la programmation de l'acte de lecture puisqu'elles introduisent
d'emble une option qui est peu compatible avec celle de l'appareil titulaire. La
premire est adresse au ccmmanditaire de ce petit texte :
"JACQUES DOUCET
Cher Monsieur,
Ce que je vous envoie est la relation pure et simple du
volage que j'ai fait dans les montagnes suprastellaires, rgion
inekplore lest comme l'hinterland du Ciel. o prennent
sources les Forces et les Formes de la Vie et de l'Esprit.
L'eubage en exil,
B. C.
Paris, jeudi, le 3 mai 1917.
La seconde ddicace a pour destinataire un ami intime de Cendrars, qui
semble l'avoir initi l'astrologie et qui sera voqu la fin de Moravagine :
"CONRAD MORICAND
Cher Homoncule,
Ci-joint tes fiches. Puisque tu aimes tant les toiles fixes,
je vais dchirer la Voie Lacte pour t'en montrer d'autres,
d'insouponnes. Toutes celles que tu me cites,
anciennement fixes, sont doubles et secrtent de leurs
doubles mamelles une lumire prodigieuse qui rvolutionne
le spetre. Tche de travailler avec ces btes du ciels
93
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
humides et qui se cabren toi qui sais comment les saisir et
les dresser.
Ma main amie,
B.C.
Cannes, jeudi, le 3 mai 1917.
Cette dernire adresse va bien dans le sens du titre, confirme la
signification symbolique du rcit en appelant une lecture la fois fictionnelle et
hermneutique. Mais la premire oriente de faon tout autre le texte, elle le
prsente comte un crit personnel, elle fait de ce voyage extravagant la "relation
pure et simple" d'une exprience vcue par Blaise Cendrars lui-mme. L'eubage,
ce prtre lettr qui tient chez les Celtes du druide et du barde, de l'initi et du
pote, figure laquelle s'identifie le narrateur au chapitre 5, ce serait Cendrars en
personne. Par cette ddicace, c'est une lecture quasi-autobiographique que le
lecteur est convi. Aux trois types de lecture prcdents vient donc s'ajouter une
exigence intime : il faudrait lire ce texte comme le rcit d'une exprience
"personnelle".
A nouveau, c'est l'exemple d'une identification transversale que fournit
L'Eubage, mais cette fois pour des raisons formelles. Si Cendrars s'tait confondu
dans le texte avec son narrateur-hros, il aurait rompu un anonymat essentiel pour
la tension entre les diffrents types de lecture qui constituent l'originalit de ce
texte. Les noms propres sont des connecteurs trop puissants pour que l'on puisse
en faire usage sans qu'ils remplissent irrmdiablement les personnages qu'ils
dsignent. Dot d'un nom identique l'auteur, le narrateur aurait fait perdre ce
texte son indtermination et son allure intransitive. Anonyme, personnage individu
mais impersonnel, identifi par la bande, le narrateur permet de maintenir un
quilibrage entre les diffrents types de lecture du texte. Le rsultat de cette
identification indirecte, c'est qu'il rend possible des encodages contradictoires,
sans qu'aucun ne puisse prdominer sur les autres ; il autorise la multiplication des
lectures possibles, jusqu la dissonance et la contradiction, sans qu'aucune ne
l'emporte. De concert rcit fictif, texte initiatique, pome en prose et criture de soif
L'Eubage vit de cette belligrance, aux antipodes de l'harmonie, de la cohrence et
94
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
de l'unit. Comme l'univers dcrit par le narrateur, il prsente une criture pour
ainsi dire isomre, qui selon les procds retenus par la lecture produit des
proprits, des effets et des registres diffrents.
II. 3. Fonction de surdtermination.
Comme les "substituts livresques", la plupart des formes pritextuelles
permettent de combiner pour un mme personnage plusieurs identits. Un crivain
peut ainsi attacher son nom l'identit d'un protagoniste fictif totalement
autonome, dot d'une identit et d'un appellatif propres. Ainsi, il peut engendrer
des effets qui sont impossibles ou plus dlicats obtenir avec les substituts
livresques une identit contradictoire complexe et la possibilit d'une identification
rtrospective.
Notons d'abord que la ralisation d'une identification contradictoire est
moins coteuse par le pritexte parce qu'il suffit que l'crivain superpose deux
noms pour la raliser. Dans le cas des "substituts livresques", l'auteuur attribuait
ses propres oeuvres un personnage fictif. Cela supposait par consquent que ce
protagoniste soit un crivain, tout au moins un auteur, que sa production soit
motive ou rendue crdible. Si l'auteur ne voulait pas faire son autoportrait sous le
couvert d'un individu fictif (comme Strindberg) ou si ces oeuvres ne remplissaient
aucun rle dans l'histoire, cette accrditation pouvait apparaitre comme une pice
rapporte. C'est sans doute pour cette raison que de tels exemples ne se trouvent
pas dans notre corpus, sinon quand cette projection auctoriale est mineure
(comme chez Belleto)a Avec le pritexte, cette authentification est inutile. Une
simple dclaration liminaire, une brve annotation marginale suffisent amplement
pour surimprimer une identit actoriale et ainsi tablir un protocole nominal.
Naturellement, plus cette indication sera lapidaire et impromptue, plus l'effet de
cette surimpression sera transgressifo La Douleur de Marguerite Duras est cet
gard exemplaire. En tte d'an des textes de ce volume, "Albert des Capitales", on
trouve l'avertissement suivant :
"Ces textes auraient d venir la suite du Journal de la
douleur, mais j'ai prfr les en loigner pour que cesse le
bruit de la guerre, son fracas.
95
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Thrse c'est moi. Celle qui torture le donneur, c'est moi.
De mme celle qui a envie de faire l'amour avec Ter le
milicien, moi. Je vous donne celle qui torture avec le reste
des textes. Apprenez lire : ce sont des textes sacrs".
Cette dclaration abrupte est inhabituelle au dbut d'une fiction, dans le
pritexte immdiat d'une histoire. Ce genre de confidence, qui n'est pas sans
rappeler celle de Flaubert propos de Mme Bovary, est d'habitude ccnfi I'oralit
ou un entretien, bref l'pitexte priv ou public ; pour formuler moins une
identification qu'une affiliation, comme on l'a vu. Mais c'est qu'ici Duras joue sur ce
type de dclaration qu'un auteur peut faire sur ses personnages. D'une part, elle
en dplace le lieu canonique, en l'inscrivant en tte mme du texte plutt que de la
maintenir distance respectueuse de l'oeuvre. D'autre part, elle en modifie la
formulation, en ne dclarant pas que Thrse est invente d'aprs des actes et
des sentiments vcus durant la libration de Paris, mais en assumant
intgralement son comportement, jusqu'aux moins valorisants. Du coup, Duras
donne une tout autre porte ce type de dclaration. Il ne s'agit plus de fournir des
informations permettant de dchiffrer le sens de l'oeuvre, mais de constituer
celle-ci par une identification avec un protagoniste qui est important, mais qui n'est
pas le narra' teur, qui est prsente de l'extrieur et qui est un htronyme de
l'auteur. Un protocole nominal d'autofiction est ainsi mis en place par un simple
avertissement, qui rend contradictoire une identit actoriale, Thrse demeurant
malgr tout diffrente de Marguerite. Cet exemple est d'autant plus remar1uable
que le procd utilis a deux valeurs opposes selon l'amplitude qu'on lui donne :
disruptif pour "Albert des Capitales" o il dstabilise l'identit du personnage
focalisateur, permet toutefois l'chelle du volume La Douleur, d'homogniser
des textes dont les rgimes d'criture (un journal, une fiction la troisime
personne)sont, diffrents, bien qu'ils soient ccntemporains et d'une inspiration
identique.
La Douleur illustre un cas simple d'identit contradictoire : l'hrone d'
Albert des Capitales" n'a que deux noms, Thrse et Marguerite Duras. A partir de
l, on peut imaginer des cas plus complexes d'identit non plus double, mais
multiple. L'intrt de cette redondance peut tre larticulation du double auctorial
avec des personnages fictifs d'autres oeuvres, autographes ou allographes, qui
pourront tre eux-mmes des doubles fictifs de leur auteur. Plutt que d'laborer
96
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
une combinatoire encombrante pour cerner tous les cas de figure possibles, on se
contentera de la ralisation enpirique d'une de ces combinaisons avec Ingnue
Saxancour. Dans ce roman, la figure auctoriale a dj une identit contradictoire
puisque c'est le pre d'Ingnue qui en est le support, par le biais de "substituts
livresques", Restif lui attribuant quelques-unes de ses oeuvres. Mais le plus
clbre polygraphe du XVIIIe sicle a voulu compliquer davantage les choses...
Dans la seconde occurrence du titre, qui surplombe la premire partie,
l'intitul Ingnue Saxancour ou la femme spare renvoie la note suivante :
"Le vrai nom est Jean-de-Vert" (p. 37).
Dans le systme des notes de ces Mmoires fictives, il s'agit d'une "note
auctoriale assomptive", les "notes actoriales" tant soit signes soit revendiques
par Ingnue ou son pre. Cette indication est donc prendre au srieux, son statut
est rfrentiel. "Saxancour" serait ds lors un nom suppos, le
personnage-narrateur d'Ingnue aurait pour patronyme vritable "Jean-de-Vert".
Par suite, son pre se nommerait en ralit Nicolas-Edm Jean-de-Vert. Question :
d'o vient ce patronyme ? Dsigne-t-il une famille relle, dont l'existence est
vrifiable ? Evidemment non, comme on pouvait s'y attendre avec Restif. Il ne
s'agit que d'un masque de plus, ce nom de famille tant celui de personnages
fictifs d'un roman antrieur de Restif, intitul La Femme infidelle. Ce nom dsigne
d'ailleurs un pre et une fille dont les caractres et les destins ressemblent
trangement celui d'Ingnue et de son pre. Et pour cause, c'est que La Femme
infidelle relate exactement la mme histoire de mariage abusif, mais du point de
vue du pre. Dans ingnue, c'est le personnage ponyme qui raconte son calvaire,
selon le mode de l'autobiographie fictive si en faveur au XVIIIe sicle. Dans La
Femme infidelle, c'est le pre qui relate cette tragdie domestique, en donnant les
lettres du mari qui attestent de sa sclratesse (Restif, 1978, "Dossier"). Le texte
d'Ingnue Saxancour ne manque pas d'ailleurs de renvoyer plusieurs reprises
pour ces lettres La Femme infidelle, ce qui renforce sa filiation avec ce roman.
Mais Restif aurait pu se contenter de cette note initiale, qui suffisait articuler les
deux romans, et ainsi restituer par des fictionnalisations successives l'union
malheureuse de sa fille Agns avec Aug. Dans Ingnue Saxancour, la figure
auctoriale a donc trois noms et par suite une triple identit, puisqu'on a vu que le
97
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"pote Saxancour" tait une fictionnalisation de Restif. C'est donc bien un cas
d'identit contradictoire complexe.
Il reste signaler un dernier aspect de cette capacit du pritexte
surdterminer l'identit de la figure auctoriale. C'est qu'il permet la mise en place
d'une identification fictionnelle tardive, rtrospective, moindre cot, sans
remaniement textuel. En un sens, c'tait dj la fonction remplie par la ddicace
Jacques Doucet de L'Eubage. Pour ne pas compliquer l'analyse, on a omis de
relever qu'il semble que Cendrars ait eu seulement a posteriori l'ide de se
fictionnaliser dans son personnage d'Eubage. Cest pourtant ce que semble tre la
leon du manuscrit, en particulier des mires versions de cette ddicace
(Flckiger, 1986, pp. 132-133). Cela n'infirme toutefois pas notre analyse
puisquaussi bien, la stratgie complexe de ce rcit empchait toute identification
directe.
Ce n'est pas le cas de Le Pays d'origine d'Eddy du Perron o seul le dsir
de revenir sur le projet romanesque initial, de le rorienter dans le sens d'une
fabulation personnelle, a motiv la ralisation pritextuelle du protocole nominal.
On connat la matire de ce roman, salu nagure par Malraux : il s'agit du journal
tenu durant une anne, de fvrier 1933 fvrier 1934, par un dnomm Albert
Ducroo. Il y relate son apprentissage difficile de la vie Paris, la pauvret
succdant un mode d'existence facile et cosmopolite. En contrepoint, ce journal
fait en effet le rcit discontinu d'une enfance privilgie, mais jamais perdue, d'un
fils de colons nerlandais dans file de Java. Ces deux registres, la fois temporel
et mlodique, sur lequel ce roman-journal se donne lire, sont bien sr
d'inspiration trs autobiographique. Le texte donne d'ailleurs une foule de clefs
pour reconnatre les personnages gravitant autour de Ducroo : on a un certain
Viala quipar toutes sortes d'allusions, rappelle Pascal Pia et les activits ditoriales
qui l'occupaient cette poque ; un certain Hervel qui a crit un roman qui
ressemble trangement La Condition humaine, beaucoup d'autres transpositions
de figures plus ou moins connues de cette poque ; sans compter toute une srie
d'indices plus perceptibles pour un lecteur nerlandais que pour un lecteur
franais.
98
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
En 1935, lors de la publication, Eddy du Perron prsente ce texte comme un
simple roman, d'inspiration autobiographique. Il se met rdiger, cependant, pour
un de ses amis nerlandais, plus de quatre cents notes expliquant les clefs, les
modles et la part autobiographique de son texte. Par la suite, dans les ditions
ultrieures, l'indication gnrique roman fut abandonne. Puis du Perron
commena prparer une dition o les notes figureraient intgres dans le livre,
comme une dimension supplmentaire mais part entire de cette oeuvre, travail
que sa mort interrompit en 1940. Nanmoins, c'est bien ainsi que le livre se
prsente aujourd'hui pour nous (Gallimard, 1980). Le texte n'oscille plus
simplement entre le "pass et le prsent d'Arthur Ducroo" (un titre auquel avait
pens du Perron), entre le pays originaire (Java) et celui de l'criture (Paris), mais
aussi entre la fiction et le vcu, entre Ducroo et du Perron. Comme le note
judicieusement son traducteur, Philippe Noble, le lecteur se trouve ainsi devant un
"genre de texte nouveau, son gr roman ou autobiographie, selon qu'il se borne
au rcit ou interroge le commentaire" (p. 24). L'quivalent d'un protocole nominal
est mis sur pied dans les notes qui doublent le texte, dans la mesure o
quelques-unes d'entre elles permettent de poser l'quation : Arthur Ducroo = Eddy
du Perron.
Une fois encore, on retrouve donc la forme pritextuelle de la note pour
tablir un protocole nominal. C'est que, comme on l'a vu, celle-ci est
particulirement approprie pour dvelopper une identification par la bande. La
multiplication des annotations marginales ont permis Du Perron de rtablir ce
que la fiction occulte par convention et qui pourtant la permet : le vcu. D'habitude,
un crivain nourrit son oeuvre, entre autres, de son exprience et s'empresse
d'effacer les traces de celle-ci pour livrer un texte vraiment romanesque,
c'est--dire un texte o l'auteur est invisible. A rebours de cette dmarche, Du
Perron a voulu que ces traces demeurent et demeurent comme traces, comme
fragments, comme des lambeaux d'existence qui, agglutins, avaient permis un
roman. Mais il n'a pas voulu non plus naturaliser rtrospectivement son oeuvre,
transformer en autobiographie un roman personnel ; il a aspir restituer son
oeuvre l'chafaudage invisible qui l'avait permis.
Il est temps de conclure cette section sur le context. pritextuel. A l'inverse
de l'pitexte, le pritexte s'est montr trs efficace, aussi bien pour participer la
99
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
construction d'un double auctorial que pour le constituer. C'est ce qui justifie la
longueur de cet examen, qui a permis de voir comment le pritexte pouvait fournir
les mdiations ncessaires pour laborer une homonymie indirecte ; comment le
piri-teste pouvait servir aussi de support identificatoire, en renforant, confirmant
ou surdterminant une identit. A travers ce parcours, la quasi-totalit des formes
pritextuelles se sont montres capables de participer la ccnstitution du
protocole nominal, du nom d'auteur la ddicace, en passant par le titre ou la
note. Il fallait insister sur la richesse fonctionnelle de ces formes pritextuelles, si
ngliges depuis longtemps.
C) Contexte textuel
Il reste examiner le contexte textuel et voir s'il est aussi important que le
contexte pritextuel pour l'existence d'un protocole nominal. Certes, dans tous les
cas d'identification fictionnelle directe, qui sont tout de mme nombreux, c'est le
texte qui en est le seul support. Mais on peut se demander s'il est ncessaire de
s'y attardr car le texte ne parat pas mme de permettre des procds aussi
complexes que ceux permis par le pritexte.
Philippe Hamon a, en effet, montr qu'il fallait concevoir le nom propre d'un
personnage, comme son signifiant et qu'il tait dtermin par sa rcurrence, sa
stabilit, sa richesse et ses motivations (Hamon, 1972, p. 143). Ces caractres
n'ont pas tout fait le mme statut car seuls les deux premiers mettent directement
en cause son intelligibilit :
"La rcurrence est, avec la stabilit du nom propre et de
ses substituts (Sorel ne peut devenir Rosel, ou Porel,
quelques lignes de distance), un lment essentiel de la
cohrence et de la lisibilit du texte, assurant la fois la
permanence et la conservation de l'information tout au long
de la diversit de la lecture"
La rcurrence et la stabilit du "nom actorial" vont ainsi avoir une grande
importance pour la reconnaissance d'un protocole nominal. Pour que le lecteur
distingue dans la fiction un double de l'auteur, il faut que, de faon continue et
rpte, il puisse reprer un "nom actorial" qui soit un substitut ou un homonyme
du "nom auctorial". Il faut donc que le "nom auctorial" soit la fois rcurrent et
stable, qu'il revienne intervalles rguliers et qu'il ne change pas. C'est, d'une
100
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
faon gnrale, la norme en vigueur, proportion bien star de l'investissement
fictionnel de soi qui est pratiqu. Il est vident qu'un auteur qui ne se reprsente
qu' travers un personnage mineur ne pourra multiplier l'excs la rcurrence de
son nom propre dans un texte.
Mais il faut bien voir que cette obligation est moins une ncessit qu'une
convention. Elle rpond une attente du lecteur qui est dtermine par des
habitudes de lecture et des normes de lisibilit, qui ne sont pas naturelles mais
culturelles. L'auteur peut utiliser cette attente, en la prolongeant ou en la dcevant,
afin prcisment d'attirer l'attention et la vigilance du lecteur sur le nom de son
hros ou de l'un de ses personnages. Aussi bien, c'est un procd trs commun et
cher aux romanciers du XIXe que de jouer sur la rcurrence du nom de leurs
hros, en retardant la premire occurrence de celui-ci. Cet usage suspensif du
"nom actorial" permet ainsi de prsenter un personnage de l'extrieur, comme s'il
tait vu par un simple observateur ; et de le lier plus intimement aux vnements et
aux situations du rcit. Cet effet de retardement est bien mis en oeuvre dans La
Peau de Chagrin o l'identit de Raphal n'est dvoile qu'aprs que ce derrier ait
fait l'acquisition du talisman fatal, quand le roman est entam d'un bon septime
de son cous. Si Balzac met ds l'incipit le lecteur en prsence de son personnage
principal, il en retarde l'identification en le dsignant par des priphrases un "jeune
homme", un "inconnu", un "ange sans rayons", un "jeune savant", "un jeune fou".
Ce ne sont pourtant ni les situations ni les rencontres qui manquaient pour le
prsenter au lecteur, mais cette suspension permet d'veiller la curiosit et
d'attacher de faon indissociable le destin de Raphal la peau de chagrin. En lui
donnant un nom seulement au sortir du magasin d'antiquits, lorsqu'il se heurte
trois de ses amis et qu'il dtient le talisman, Balzac donne une dimension mythique
son personnage. Il confond le destin de celui-ci avec un symbole de l'opposition
du dsir et de l'existence : son histoire n'est plus que ce destin exemplaire o le
dsir est en raison inverse de la vie. Partant, comme l'a bien not Michel
Carrouges, "sans la peau de chagrin, Raphal ne serait pas Raphal". Loin d'tre
un accessoire de fantaisie, une concession l'orientalisme du temps, la peau de
chagrin reprsente pour Raphal "le blason de ses dsirs multiformes et fous : elle
est dans sa chair et dans son coeur, le cancer qui le dvore" (Carrouges, 1954, pp.
101
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
950, 954). La Peau de Chagrin fournit ainsi un exemple de roman qui utilise
contre-emploi, pour ainsi dire, la rcurrence du nom propre de personnage.
De la mme faon, un usage transgressif de la stabilit du nom du
personnage est aussi possible. Le roman moderne en a montr plusieurs
exemples, comme l'a remarqu Hamon :
"Le texte moderne (Beckett, Robbe-Grillet) transportera
systmatiquement dans le texte achev cette instabilit du
personnage : mme personnage (?) ayant des noms
sensiblement diffrents, personnages diffrents ayant le
mme nom, instabilit des permanences, le mme (?)
personnage tant successivement homme ou femme, blond
ou brun, et permanence des transformation: (des
personnages diffrents accomplissent les mmes actions ou
reoivent les mmes descriptions)" (Hamon, 1972, pp.
143-144).
Ces observations peuvent tre transposes dans le domaine de l'autofiction
et du protocole nominal. Un crivain peut utiliser l'attente du lecteur en matire de
rcurrence et de stabilit, pour constituer de faon inhabituelle un protocole
nominal ou pour lui donner une signification particulire. Une rponse dcale
cette attente ne mettra pas en pril l'existence de ce protocole, tout en lui dorant
une physionomie surprenante. Ainsi, un crivain a aussi bien la possibilit de jouer
sur la rcurrence de son "nom actorial", pour renforcer la singularit de son geste ;
que la possibilit d'utiliser la stabilit de ce nom, afin d'attirer l'attention du lecteur
sur l'identit du personnage qui le reprsente. Naturellement, ces deux traits sont
troitement associs dans un texte ; on ne les isole que pour montrer le trait
dominant.
1. La rcurrence.
Ce trait du "nom actorial" ne permet pas lui tout seul de raliser une
forme dtourne de protocole nominal. Qu'un crivain multiplie ou limite les
occurrences des appellatifs de son double fictif ne changera rien quant la dsi-
gnation de celui-ci, sinon qu'il sera plus ou moins perceptible, qu'il demandera plus
ou moins de vigilance pour le lecteur. Mais ce dernier effet n'est pas sans intrt.
102
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Prenons le cas de Fils de Doubrovsky. Les occurrences du nom de son person-
nage sont trs nombreuses et peles sous toutes les formes possibles.
Rapidement le lecteur reconnat le personnage principal de ce roman comme tant
une sorte de rduplication de son auteur : il a le mme prnom "Serge" et le mme
patronyme. Il n'a pas dchiffrer l'identit de ce personnage de professeur ni
accorder d'attention particulire la manire dont cette identit lui est donne. Par
contre, dans une fiction o l'identit du hros serait longuement retarde et o
celle-ci ne serait formule qu'avec parcimonie, le lecteur ne peut avoir la mme
attitude. Ds l'instant o le "nom actorial" ne serait donn qu'une fois par exemple,
on va avoir comme une dramatisation du protocole nominal. Le passage o sera
donn le nom de l'auteur va se trouver charg de sens, dot d'une signification
particulire.
La Divine Comdie est une bonne illustration de ce processus. On sait que
ce monumental rcit allgorique pourrait s'appeler La Dantide et que c'est mme
l'une des rares sources d'informations que nous possdions sur Dante. Cette
traverse peu courante des enfers, du purgatoire et du paradis est, en effet,
accomplis et narre par Dante Aliegheri lui-mme. Bien sr, il s'agit d'un voyage
imaginaire, mme si Dante a multipli les notations ralistes, les "petits faits vrais",
les trompe-lil, les prcisions chronologiques et gographiques ; mme sil a
aussi littralement hriss ce pome dallusions aux choses et aux hommes, aux
connaissances et aux doctrines, aux passions et aux murs, aux querelles et aux
conflits de son temps, pour en faire un tableau complet de son poque. Mais
malgr l'invraisemblance de ce rcit, Dante n'a pas hsit se prsenter comme
lacteur principal de ce douloureux voyage initiatique dans l'autre-monde. il ne se
nomme, toutefois, quune seule fois, mme si des traits thmatiques annoncent et
confirment cette identification, le narrateur indiquant son statut de pote et sa
nationalit, donnant des dtails sur sa biographie, faisant rfrence ses amis,
ses gots esthtiques, ses choix politiques et ses croyances. Pourtant, ce nest
ni une ngligeance ni un lapsus de la part de Dante, ce dvoilement du nom
propre intervenant dans une scne capitale, o Borgs voyait le "noyau primitif" de
la Divine Comdie, presque sa raison d'tre. Cette scne appartient au chant XXX
qui, dans le parcours du pome, se situe la frontire du Purgatoire et du Paradis
et dont tous les commentateurs saccordent reconnatre limportance, pour le
103
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dsigner comme lpisode o tout converge et qui explique lensemble du pome.
Cette squence narrative dcisive est celle de la premire rencontre avec Batrice
et de la disparition de Virgile, au seuil du Paradis. Nous citons le passage dans la
lumineuse traduction dAlexandre Masseron, sa version de la Comdie a inspire la
plupart de nos remarques :
"J'ai vu dj, au lever du jour, le ciel paratre l'orient tout
rose, et par ailleurs teint d'un bel azur et la face du soleil
alors natre voile, de sorte que les yeux pouvaient supporter
longtemps son clat tempr par les vapeurs ;
de mme, dans un nuage de fleurs, qui, des mains des
anges, montait et retombait sur le char et tout autour,
couronn d'oliviers sur un voile blanc, une dame m'apparut
en manteau vert, vtue d'une robe couleur de flamme
ardente.
Et mon esprit qui, depuis si longtemps, n'avait t par sa
prsence accabl de stupeur et de crainte, sans avoir
besoin.d'autre secours des yeux, par une vertu secrte qui
manait d'elle, sentit la force irrsistible de son ancien
amour.
Aussitt que m'et frapp dans mes regards la haute vertu
qui dj m'avait bless avant que je ne fusse sorti de
l'enfance,
je me tournai gauche, avec la confiance qui fait le petit
enfant courir sa mre, quand il a peur ou qu'il est afflig,
pour dire Virgile : 'Pas une goutte de mon sang ne m'est
reste qui ne tremble : je reconnais les traits de mon
ancienne flamme !
Mais Virgile nous avait abandonns, Virgile, mon tr doux
pre, Virgile, qui, pour mon salut, elle m'avait confi ;
et tout ce qu'a perdu notre antique mre n'empcha pas
que mes joues, purifies par la rose, ne fussent de nouveau
ternie par les larmes.
'Dante, parce que Virgile s'en est all, ne pleure pas
encore, ne pleure pas encore, c'est pour une autre blessure
qu'il te faut pleurer.
104
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Tel un animal qui, tantt de la poupe et tantt de la proue,
vient voir ceux qu manoeuvrent sur les autres vaisseaux, et
les excite bien travailler,
telle, sur le ct gauche du char, quand je me tournai au
son de mon nom, que je suis oblig denregistrer ici, je vis la
dame qui d'abord m'tait apparue voile sous les fleurs des
anges, diriger ses regards vers moi de ce ct du ruisseau.
Bien que le voile qui tombait de sa tte, couronn du
feuillage de Minerve! ne la laisst pas bien voir,
royalement, d'attitude toujours altire, elle poursuivit, du
ton de quelqu'un qui parle en rservant pour la fin ses plus
pres traits :
'Regarde-moi bien ! Je suis, oui, je suis Batrice !
Comment as-tu eu l'audace de gravir la montagne ? Ne
savais-tu donc point qu'ici l'homme est heureux ?' " (
1
).
Il fallait citer longuement ce passage pour montrer la richesse du contexte
textuel o apparat le prnom de Dante Alieghri, choisi comme nom d'auteur par le
pote florentin. Dans un texte aussi satur de symbolisme, tout est naturellement
signifiant et chaque vers se prte un ample commentaire. L n'est pas notre
propos. On se contentera de souligner les segments qui sont directement lis
l'inscription de son nom par Dante :
1) - la rfrence l"ancien amour" que portait Dante Batrice, amour qui
est l'objet de la Vita nuova, chef-d'oeuvre de posie lyrique, discursive et
symbolique, dont la clausule annonce La Divine Comdie et qui fit de Dante l'un
des maures de l'cole du dolce stil nuovo.
2) - La concomitance de la nomination de Dante et de la disparition de
Virgile, pre, matre et guide dans cette traverse de l'Enfer et du Purgatoire ;
guide envoy par Batrice mais qui ne peut demeurer en sa prsence.
3) - L'nonciation du nom de Dante par la mdiation de Batrice (comme si
ni Virgile ni Dante lui-mme n'tait mme de formuler ce nom) : c'est mme son
1
(1). Ch. XXX, v. 22 75 ; nous soulignons.
105
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
premier mot ; nonciation directement lie la disparition de Virgile et des fautes
dont Dante devra faire l'aveu public.
4) - La complaisance du narrateur souligner cette seule occurrence de son
nom et l"enregistrer", mettre en relief la fois la fin d'un anonymat et un geste
narcissique qui ne sera plus renouvel.
5) - L'auto-nomination de Batrice qui pour sa part n'a pas besoin de
mdiation apparente, nomination qui a lieu dans un vers qui se trouve exactement
au centre de ce chant et qui elle aussi est lie aux fautes de Dante.
On ne se hasardera pas risquer une interprtation de ces corrlations, qui
viendrait rivaliser avec la masse colossale des gloses consacres par les
Dantologues ce passage. Dans notre perspective, la signification importe moins
que la production de la signification, que les moyens mis en oeuvre pour obtenir du
sens. Or, il est clair que cette mise en valeur par Dante de son nom fait partie de
ses moyens. En retardant et en limitant la formulation de son nom une
occurrence dans ce chant XXX, Dante ritualise son dvoilement et le dote d'un
poids symbolique trs fort : il s'intronise en Dante pour lui-mme et pour la
postrit, ajoutant une dimension intime ce pome la gloire de Batrice et de
Dieu. La diffration et la rarfication du nom a un double effet : tout le passage o
il apparat prend une importance sans pareille et, en retour, ce nom se voit attach
tous les traits du lieu de son inscription.
La Divine Comdie montre ainsi comment en jouant sur la rcurrence du
"nom auctorial" dans le texte, on peut dorer au protocole nominal une signification
d'une ampleur exceptionnelle. Par ce procd, l'auteur ne modifie en rien la nature
du protocole, il ne lui donne pas une forme particulire, il ne produit pas une
identit hypothtique ou contradictoire. Mais il le dramatise, il lui donne une
signification symbolique particulirement importante pour tout le reste de l'oeuvre,
au lieu d'en faire un simple moyen d'identification. Il fallait s'attarder sur cet
exemple car La Divine Comdie est un texte fondateur pour le dispositif de
l'autofiction. Dans l'histoire de la fictionnalisation de soi, ce grand texte archaque
sera pour les sicles suivants ce qu'est la Recherche du temps perdu pour les
106
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
crivains du XXe sicle : une sorte d'tymon. On aura l'occasion d'en reparler en
examinant la pratique de la fictionnalisation de soi dans son historicit.
2. La stabilit.
De faon plus significative encore, un crivain peut formuler un protocole
nominal en mettant en cause la stabilit de son nom propre. Contre les
apparences, un tel geste ne met pas ncessairement en danger l'existence de ce
protocole. En fait, une telle mise en cause va au contraire mettre l'accent sur le
protagoniste incarnant l'crivain. Sans doute, ce personnage n'aura pas une
identit simple, son identit sera trouble, nest-ce pas, pourtant, une manire
intressante de raliser un dispositif qui, par dfinition, construit une identit
impossible ? Cette dstabilisation peut se faire par au moins deux voies : en
multipliant les noms du double de lauteur, en formulant de faon trouble son
identit.
Dans le roman russe, par exemple, les personnages ont tous plus de deux
noms, disposent de plusieurs "appelatifs". Naturellement, cette multiplication
apparente de leurs noms est strictement motive. Elle tient au systme
anthroponymique russe plus complexe que son quivalent europen, qui offre une
forme onomastique plusieurs termes. Cette forme est faite d'un prnom, d'un
"nom patronymique " (fille ou fils de..., suivi du prnom du pre), d'un nom de
famille et d'un ou plusieurs diminutifs, dont les liens avec le prnom ne sont pas
toujours manifestes : ainsi, "Sacha" est-il le diminutif d'"Alexandre". Quand un
romancier russe, Dostoevski en particulier, introduit un personnage dans son rcit,
il donne ses trois "appellatifs" "officiels". Puis, rapidement, il utilise soit l'un des
deux premiers (rarement le nom de famille), soit l'un des diminutifs qui peuvent se
driver de son prnom, en fonction de la situation et de l'individu qui le nomme.
Pour un lecteur russe, il n'y a l rien d'anormal, rien de transcressif. Il dispose dans
sa comptence linguistique des informations ncessaires pour reprer quel
prnom renvoie tel ou tel diminutif. En revanche, le lecteur qui n'est pas familiaris
avec le Russe, ne peut manquer d'tre drout par cette pluralit de noms pour
drisigner un personnage identique. La lecture, lui demande une attention
inhabituelle, un effort de mmorisation sortant de l'ordinaire, s'il ne veut pas voir
l'identit des personnages se dliter, leurs actes, leurs paroles et leurs penses
107
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
exister sans qu'il ne puisse les rapporter ux agents du rcit. S'il fait l'conomie de
cet effort, il ne pourra pas s'adapter cette lisibilit exotique, perdra vite pied dans
le roman.
Imaginons la transposition de ce phnomne, multipli et centr sur le
personnage auctorial, dans l'autofiction. Il suffit, pour cela, que l'auteur dsigne
son double par plusieurs noms : un tel procd ne manquera pas d'introduire une
certaine confusion, un brouillage de l'identit actoriale de l'auteur, mme dans un
rcit respectant les normes traditionnelles du rcit, s'interdisant des ruptures dans
le tissu narratif (comme peut le faire Tony Duvert, qui recours de faon
hyperbolique cette technique, dans ses romans). A force de se dissminer
travers plusieurs noms, de paratre mobile, le reprsentant auctorial finira par tre
relativement indtermin et par se dissoudre en partie dans l'histoire. A l'oppos
du brouillage par dfaut de lidendit des personnages opr par la Nouveau
Roman, le lecteur sera face un brouillage par excs, devant une plthore da
noms pour identifier le double de l'auteur. Comme dans le roman russe, il aura
alors beaucoup de mal trouver ses marques, donner une identit stable la
figure auctoriale. Voil donc une premire direction par laquelle l'crivain peut se
fictionnaliser de faon quivoque dans son texte.
Mais plus troublantes encore que ces dmultiplications, sera la formulation
dngative ou hypothtique d'une identit. Dans ces cas, le vertige ne natra pas
de noms donns ou distribus de manire excessive. Le personnage cens
incarner lauteur n'aura bien qu'un seul nom, le sien, en partie ou en totalit. Mais
cette identification sera amene de faon telle que l'identit produite sera
hypothtique ou indcidable. La linarit textuelle rend ces procdures
d'ambiguisation dlicates car il est difficile de les raliser sans toucher au systme
narratif traditionnel. Par son fonctionnement in praesentia, l'identification textuelle
ne peut se singulariser sans tre coteuse pour la lisibilit. Mais il ne faut pas pour
autant ngliger ces possibilits par lesquelles le protocole nominal peut tre tabli
sur le mode du C'est peut-tre moi ou sur le mode du C'est moi et ce n'est pas
moi.
Un indit d'Alain de 1935, Denys ou l'ambitieux, va nous permettre
d'examiner le premier mode d'identification. Il s'agit d'un rcit qui rapporte un
108
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dialogue ou une "histoire de penses" sur le pouvoir, dans la tradition plato-
nicienne. Quatre interlocuteurs, trs typs, sont les acteurs de ce colloque : Denys
l'ambitieux, le pote Maxime, le financier Julius et un narrateur, qu'on peut
supposer reprsenter la figure du philosophe et que Alain lui-mme. Mais vrai
dire, absolument rien ne permet d'n dcider ; il y a une seule occurrence du nom
d"Alain" et le contexte ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une autocitation
(que l'crivain fait par la bouche d'un de ses personnages, manire d'effet de rel
ou d'ironie) ou s'il s'identifie au narrateur. Qu'on juge sur pice :
"L-dessus, Denys nous ramena :
'Les penses, dit-il, sont comme des regrets.
Les passions ne commencent pas par des penses. Cette
belle suite, comme Alain aime dire, que font les trois
termes, amour, ambition, avarice, est premirement naturelle
comme les saisons" (Alain, 1935, p. 62).
Sur ce, le narrateur, qui semble tre confi le rle de philosophe,
intervient par un "je lui rpondis", mais il ne s'agit jamais pour lui que de remplir
cette "fonction de rgie" (Genette, 1972, p. 262) par quoi le tissu narratif prend
forme. Au bout du compte, il n'est pas possible de dcider : s'agit-il du philosophe
"Alain" ou de l'auteur "Alain" de ce texte ? Comme Dieu, l'crivain Alain "de toute
faon se tait. Et par lui nous ne savons rien (...) ce qui veut dire qu'il nous laisse
dcrter en son nom".
Ce petit texte d'Alain apporte ainsi l'illustration d'un protocole nominal
hypothtique. Rien ne permet de dcider si Alain est bien un des personnages de
ce rcit ou s'il ne s'agit que d'une mise en abyme de l'nonciation, par une citation
autographe. La brivet de ce dialogue rend le procd trs subtil et sa ralisation
vraiment parfaite. Est-il possible de le raliser l'chelle d'un roman vritable ?
C'est une question que l'on peut se poser. Peut-tre faudrait-il alors ttransgresser
quelques conventions de la lisibilit classique.
Autre mode d'identification incertain voquer, le mode du c'est moi et ce
n'est pas moi, qu'illustre l'exemple incontournable de Proust. Comme on sait, c'est
dans la Prisonnire que l'anonymat du hros de la Recherche disparait, ou plutt
est lev, pour tre immdiatement refoul, au moins dans la premire occurrence,
109
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
la recorde formulant son nom sans quivoque. Voici la formulation contradictoire,
faite par Albertine son rveil :
"Elle retrouvait la parole, elle disait : 'Mon' ou 'Mon chri',
suivis l'un ou l'autre de mon nom de baptme, ce qui, en
donnant au narrateur le mme prnom qu' l'auteur de ce
livre, et fait : 'Mon Marcel', 'Mon chri Marcel'." (Plade, t.
III, p. 75).
Et voici la seconde formulation, dans un billet d'Albertine :
"... un cycliste me porta un mot d'elle pour que je prisse
patience, et o il y avait de ces gentilles expressions qui lui
taient familires : 'Mon et cher Marcel, j'arrive moins vite
que ce cycliste dont je voudrais bien prendre la bcane pour
tre plus tt prs de vous. Comment pouvez-vous croire que
je puisse tre fche et que quelque chose puisse m'amuser
autant que d'tre avec vous ? Ce sera gentil de sortir tous les
deux, ce serait encore plus gentil de ne jamais sortir que tous
les deux. Quellesides vous faites-vous donc ? Quel Marcel !
Quel Marcel ! Toute vous, ton Albertine'." (t. III, p. 157).
Entre ces deux passages, difficile d'imaginer un contraste plus grand.
Certes, dans les deux cas, c'est Albertine qui dvoile l'incognito ; comme chez
Dante, c'est l'amante qui nomme le hros ; certes aussi, l'homonymie entre l'auteur
et le hros est partielle dans les deux occurrences : il ne s'agit jamais que de
"Marcel", le patronyme de l'crivain reste tu. Pourtant la premire manifestation du
nom est aussi ambigu, la fois hypothtique et restrictive, que la seconde est
claire, tranche et indiscutable.
La chose se complique quand on sait que cette partie de La Recherche n'a
pas t revue par Proust et qu'on ne connat mme pas l'tat d'achvement des
manuscrits qui sont notre disposition. Impossible de savoir si Proust voulait
revenir sur ce dvoilement, simplifier la premire occurrence, compliquer au
contraire la seconde ou tendre une identification sans quivoque. Pour ce
problme, lpitexte n'est en outre d'aucun secours puisqu'au gr de ses
interventions paratextuelles, Proust oscille entre la confusion avec son personnage
et une mise distance (Muller, 1965, IIIe partie).
Comment ds lors comprendre l'effet ou les effets produits par Proust ? Sil
parat inutile de chercher ce qu'a voulu exactement Proust (par exemple d'affirmer
110
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
qu'il "ne tenait pas prciser le nom de son hros" comme M. Suzuki), on peut
tenter denvisager ce qu'il a produit. Plusieurs lments sont prendre en compte.
En premier lieu, le fait que l'anonymat a soigneusement t dcid et conserv
dans tout le rcit antrieur. Comme l'a not Marcel Muller, le narrateur esquive
systmatiquement la profration de son nom dans les volumes prcdents et
mme aprs :
"... il semble protg d'un interdit aussi svre que celui
qui frappe le nom de Jhovah. Avoir un nom, c'est tre pour
autrui cet objet qu'autrui est pour nous ; dans une certaine
mesure, c'est tre le Vendredi de quelque Robinson et perdre
la mesure de son propre flot. ha mention mme voile du
nom du Protagoniste est plus d'une fois associe l'ide d'un
danger : il est dform par les employs italiens (III, 641),
hurl par l'aboyeur qui va ameuter contre les roturiers le
larbin des Guermantes (II, 637), marqu dj du sceau de la
mort par les domestiques parlant du 'pre untel' (III, 920)".
(1965. pp. 16-17).
Il est donc certains que, dans tous les cas de figure, Proust n'a pas voulu
qu'on le confonde simplement avec son protagoniste, qu'il a recherch une
identification rare, fugitive, prcaire.
Ensuite, on peut relever avec Michihiko Suzuki, sans accepter pour autant
sa thse, que La Prisonnire tait le volume le plus appropri pour un tel
dvoilement :
"... Les relations charnelles et psychologiques des deux
amants sont racontes l dans leur plnitude (...) par La
Prisonnire le lecteur pntre dans l'atmosphre tendue et
pnible o deux tres ttonnent pour connatre chacun le
corps, l'esprit, la pense et le pass de l'autre... Proust rvle
dans ce chapitre la fois romanesque et autobiographique -
autobiographie du narrateur, bien entendu, et non de Proust
cette rencontre tragique de deux aveugles qu'est l'amour"
(1959, p. 71).
Faut-il rappeler, ce propos, que le nom propre est un motif privilgi du
thme amoureux dans la littrature ? Depuis les Canzonire de Ptrarque, le nom
propre est un objet que l'amant dcline et savoure indfiniment. Ainsi dans ce
sonnet, qui est un "badinage sur le nom de Laureta" :
111
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"Quand j'meus mes soupirs pour vous chanter, vous et le
nom que dans le coeur m'crivit Amour, sur le mode LAUdatif
se fait d'abord entendre le doux sot de ses premiers accents.
Votre tat de Reine que je rencontre ensuite vient, dans
cette noble entreprise, redoubler ma valeur ; mais TAis-toi,
crie la fin ; car l'honorer est un fardeau fait pour d'autres
paules que les tinnes.
La mme voix refrne ainsi lAudace par le Respect ; et
pourtant je voudrais qu'on vous chantt, vous de tout
honneur et rvrence bien digne Sinon que peut-tre Apollon
se courrouce, quand, pour parler de ses rameaux toujours
verts, une langue mortelle ose se prvaloir" (Trad. F.L. de
Gramont, p. 29).
Plus prs de nous, dans un roman que Proust n'ignorait pas, l'importance et
le rle du nom propre pour les amant sont t figurs de faon magistrale. Il s'agit
d'une scne entre Flix de Vandenesse et Henriette de Mortsauf, dans Le Lys
dans la valle :
"... - Voici, lui dis-je, la premire, la sainte communion de
l'amour. Oui, je viens de participer vos douleurs, de m'unir
votre me, comme nous nous unissons au Christ en buvant
sa divine substance. Aimer sans espoir est encore un
bonheur. Ah ! Quelle femme sur la terre pourrait me causer
une joie aussi grande que celle d'avoir aspir ces larmes !
J'accepte ce contrat qui doit se rsoudre en souffrance pour
moi. Je me donne vous sans arrire-pense, et serai ce
que vous voudrez que je sois.
Elle m'arrta par un geste, et me dit de sa voix profonde : -
Je consens ce pacte, si vous voulez ne jamais presser les
liens qui nous attacheront.
Oui, lui dis-je, mais moins vous m'accorderez, plus
certainement dois-je possder.
-Vous commercez par une mfiance, rpondit-elle en
exprimant la mlancolie du doute.
- Non, mais par une jouissance pure. Ecoutez ! Je
voudrais de vous un nom qui ne ft personne, comme doit
tre le sentiment que nous nous vouons.
- C'est beaucoup, dit-elle, mais je suis moins petite que
vous ne le croyez. Monsieur de Mort sauf m'appelle Blanche.
112
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Une seule personne au monde, celle que j'ai le plus aime,
mon adorable tante, me nommait Henriette. Je redeviendrai
donc Henriette pour vous" (1835, pp. 337 - 338).
Comme le figure ce passage du Lys, le nom propre touche au plus intime
pour les amants, (c'est une peau ; et son nonciation est pour eux comme autant
de caresses sur la peau de l'autre : "... Le nom propre d'un homme n'est pas
comparable, par exemple, un manteau qui pend autour de lui et qu'on peut la
rigueur secouer et tirailler, mais bien un habit qui va parfaitement, qui s'est
dvelopp sur lui comme la peau et que l'on ne peut ni rafler ni corcher sans le
blesser lui-mme" (Goethe).
Ces deux citations sont mme de rappeler que la thmatique amoureuse
de La Prisonnire n'aurait pas t complte si Proust n'avait pas donn un
pendant, pour son personnage d'amant, aux dveloppements, faits propos
d'Albertine, sur la puissance du nom dans la relation amoureuse. Naturellement, la
formulation du nom de son hros se heurtait un anonymat dont la ncessit tait
esthtique. Mais on a aussi le prcdent de Dante, qui retarde, prolonge la
suspension de son nom, avant de rvler l'identit de son hros dans un moment
unique de son texte. Le choix de Proust a un effet similaire, sinon que l'effet de
cette rvlation se diffuse dans tout un volume, au lieu d'tre limite un chant, et
qu'il la complique par une tournure contradictoire.
La formulation initiale nous semble, en effet, disposer d'un privilge par
rapport la seconde. Dans l'ordre du rcit, elle est premire, aux deux sens du
terme ; elle est avant la formulation assomptive et elle la commande, la trouble.
Dans le systme occidental de la lecture, le livre est vectorialis et cette
vectorialisation n'est pas sans consquence sur le rcit. Comment accepter sans
soupon la positivit de la seconde occurrence du prnom "Marcel", alors qu'il est
prsent d'abord sous la forme d'une antinomie, que sa possibilit n'est mme pas
confirme ? Le lecteur est en droit de mettre en doute la simple identification de
Marcel Proust son reprsentant imaginaire. Mais il ne peut pas pour autant
l'vacuer compltement. Il est face une identit contradictoire, qui pouse le
mcanisme de la dngation. A la diffrence de La Divine Comdie, laquelle elle
peut tre compare pour son retardement savant dans la rvlation de l'identit de
son hros (ce rapprochement a dj t fait par G. Cattani dans son Marcel
113
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Proust), la Recherche manifeste une fictionnalisation sujette caution et
quasi-indcidable. C'tait peut-tre l'effet recherch par Proust : "Vous pensez que
cette personne dans le texte est l'auteur ? Ce n'est pas lui". Muller, entre autres
remarques pntrantes, avait trouv l'expression de "moi apocryphe" pour
dsigner le rsultat de ce protocole modal antinomique : c'tait loin d'tre une
mauvaise expression.
Avec Proust et Alain, on a donc deux illustrations d'un protocole nominal
trouble, deux exemples de fictionnalisation incertaine, qui utilisent des voies
diffrentes pour arriver provoquer un doute similaire dans la conscience du
lecteur, en jouant sur la stabilit du nom du reprsentant auctorial. Ces deux
cas-limites et ces deux rgimes exceptionnels de protocole nominal manifestent
l'importance de la situation topologique du nom auctorial, qu'il soit inscrit dans le
texte ou dans le paratexte, de la ncessit de porter une grande attention au
contexte de ce protocole.
114
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
2. 4. EMPLOI
"L'crivain de ses maux, dragons qu'il a choys, ou d'une
allgresse, doit s'instituer, au, texte, le spirituel histrion".
Mallarm.
115
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Aprs la forme et l'entourage contextuel, l'emploi est le dernier paramtre
important dans l'existence d'un protocole nominal d'autofiction. Il faut prendre ce
vocable dans son acception dramatique : l'emploi dsigne le rle rempli dans le
rcit par la doublure de l'auteur ; qu'on a appel indiffremment "double fictif",
"figure auctoriale", "homonyme de l'auteur", "reprsentant", personnage vicaire"
etc.
A travers les exemples qui ont aliment ce travail, on a dj entrevu que
cette figure auctoriale pouvait prendre des visages diffrents, occuper des emplois
trs varis. Tantt, il s'agissait d'un narrateur-personnage, hros ou tmoin ; tantt
d'un protagoniste sans fonction narrative ; parfois d'un personnage secondaire ;
voire d'un comparse. Toutes ces doublures ont t traites sur un pied d'galit ;
on n'a pas tent de les distinguer ni de dterminer leurs caractristiques
respectives. Il est temps nanmoins de chercher mettre un peu d'ordre dans ce
personnel auctorial ; d'essayer de dcrire et de classer les diffrents emplois que
peut occuper la figure auctoriale.
Premire observation : ces emplois peuvent appartenir des niveaux
diffrents du rcit. On sait, en effet, que le terme de rcit peut se prendre en trois
sens, qui dsignent autant de niveaux distincts : 1) c'est une histoire, un
enchanement d'vnements ; 2) c'est un texte o l'illusion de la temporalit joue
un rle essentiel, un rcit au sens strict ; 3) c'est un acte discursif, une narration
(Genette,1972, pp. 71-77). Avoir un emploi dans le rcit peut donc se prendre en
ces trois sens ; la figure auctoriale peut tre construite sur un ou plusieurs de ces
trois plans narratifs. Pour chaque oeuvre qui relve de la fabulation de soi, il faut
donc envisager la situation de la doublure de l'auteur par rapport chacun de ces
niveaux :
1) L'histoire :
Le rcit est fait d'un ou plusieurs vnements qui font intervenir des
personnages qui sont agents ou patients. Il importe donc de situer la figure
116
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
auctoriale dans cet enchanement vnementiel, d'apprcier son importance pour
le droulement de l'action.
2) le rcit :
Il informe sur les vnements de l'histoire et la narration, selon une
perspective, un point de vue, une vision propres. Le rle de la figure auctoriale
dans cette mise en perspective de l'information narrative ne peut tre nglig. Il
faudra se demander si elle participe (ou non) la slection de cette information.
3) La narration :
Le rcit est relat par un agent narratif qui peut s'effacer derrire les
vnements ou les commenter. Il va donc tre ncessaire, enfin, de prciser si la
figure auctoriale joue un rele dans cette production de l'information narrative et
lequel.
La figure auctoriale se trouve ainsi dans la capacit de remplir trois emplois
dans un rcit littraire, d'occuper trois fonctions dans la constitution d'une histoire
une fonction actoriale, selon le personnage qui l'incarne ; une fonction "focale",
selon sa participation au filtrage de l'information ; une fonction "vocale", selon son
statut par rapport la relation du rcit. Ces emplois ne sont bien sr pas exclusifs,
mais par commodit ils seront considrs chacun isolment.
A) EMPLOI VOCAL
On a longtemps utilis les pronoms personnels pour caractriser les types
de rcits. On parlait ainsi de rcit en Ich-Form et de rcit en Er-form, de rcit " la
premire" ou "la troisime personne". Cette division tait la fois vague et trop
restrictive puisque d'autres types de pronoms sont utilisables : Butor et Perec en
ont administr la dmonstration de faon exemplaire. Mais surtout, le choix des
pronoms personnels dans un rcit n'est que l'effet d'un choix plus important, qui est
celui du rle du narrateur dans les vnements raconts :
"Le choix du romancier n'est pas entre deux formes
grammaticales, mais entre deux attitudes narratives (dont les
117
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
formes grammaticales ne sont qu'une consquence
mcanique) : faire raconter l'histoire par l'un de ses
'personnages' ou par un narrateur tranger cette histoire.
La prsence de verbes la premire personne dans un texte narratif peut
donc renvoyer deux situations trs diffrentes, que la grammaire confond mais
que l'analyse narrative doit distinguer : la dsignation du narrateur en tant que tel
par lui-mme, comme lorsque Virgile crit 'Arma virumque cano...", et l'identit de
personne entre le narrateur et l'un des personnages de l'histoire, comme lorsque
Crusoe crit : 'En 1632, je naquis York...'. Le terme 'rcit la premire personne'
ne se rfre, bien videmment, qu' la seconde de ces situations, et cette
dissymtrie confirme son improprit. En tant que le narrateur peut tout instant
intervenir comme tel dans le rcit, toute narration est, par dfinition, virtuellement
faite la premire personne (ft-ce au pluriel acadmique, comme lorsque
Stendhal crit : Nous avouerons que... nous avons commenc l'histoire de notre
hros...'). La vraie question est de savoir si le narrateur a ou non l'occasion
d'employer la premire personne pour dsigner l'un de ses personnages"
(Genette, 1972, p. 52).
Genette a donc propos une distinction plus rigoureuse et plus intgrante,
en fonction de la place occupe par le narrateur dans l'histoire qu'il raconte :
"On distinguera donc (...) deux types de rcits : l'un
narrateur absent de l'histoire qu'il raconte (exemple : Homre
dans l'Iliade, ou Flaubert dans l'Education sentimentale),
l'autre narrateur prsent comme personnage dans l'histoire
qu'il raconte (exemple : Gil Blas, ou Wuthering Heights). Je
nomme le premier type, pour des raisons videntes,
htrodigtique, et le second homodigtique" (1972, p.
257).
Les catgories d'homo- et d'htrodigtique fournissent par consquent
deux grands types de narrateur, selon que leur monde est identique ou diffrent de
celui des personnages, selon qu'ils ont ou non une place dans l'histoire qu'il
raconte. Il faut toutefois, avec Genette, spcifier ce partage, en distinguant un sens
fort et un sens faible d'homodigtique, selon le degr de prsence du narrateur
dans l'histoire dont il rapporte les vnements. Le narrateur-personnage peut ne
pas tre le hros de son rcit et se limiter tre une sorte de tmoin, comme
Watson vis--vis de Scherlock Homes dans les romans de Conan Doyle. C'est l
118
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
un sens faible d'homodigtique, pour lequel Genette conserve le terme initial. Au
sens fort, quand le narrateur-personnage est le hros, il faut parler de narrateur
autodigtique (Genette, 1972, p. 257). Dans le domaine de l'autofiction, la
doublure de l'auteur peut donc jouer un rle dans la narration de trois faons.
1. Doublure autodigtique.
La figure auctoriale est alors une dcuble projection fictionnelle de l'auteur,
comme personnage et comme narrateur, comme fiction de personne et comme
fiction dnonciateur. Cette condition narratoriale est la plus rpandue
empiriquement ccmme le montrent Dante, Proust, Loti, Cline, Gombrowicz,
Cendrars, Isherwood, Genet, Copi, Charyn, Bastide, Rollin, Sollers ou Vargos
Llosa. Cette dominante s'explique sans doute par deux raisons. Tout d'abord, cette
situation du narrateur-hros permet de pratiquer la fiction de soi avec une certaine
continuits d'en faire une vritable stratgie d'criture, ralise l'chelle d'une
oeuvre et non pas pour un seul texte. Ensuite, cette dominante se comprend si l'on
songe qu'en Occident le modle de l'criture de soi est l'autobiographie,
c'est--dire un type de narration autodigtique. Comme l'autofiction consiste aussi
dans l'criture de soi, fut-elle fictive, cette situation narrative s'imposait presque
d'elle mme.
2. Doublure homodigtique.
Cette condition narratoriale o le narrateur n'est pas le personnage
principal, mais n'est qu'une sorte d'observateur, rend naturellement possible, elle
aussi, l'incarnation d'une figure auctoriale. Elle prsente beaucoup moins
d'exemples que la prcdente, bien que l'on puisse citer quelques oeuvres qui en
relvent, dont Mon Frre Yves de Loti et Une certaine parent de Carlo Fuentes.
Ce dernier roman actualise merveille ce type le rcit. La position en retrait
du narrateur n'est pas seulement un procd narratif, c'est aussi une donne
importante de l'action et de la thmatique du rcit. Il s'agit, en effet, de l'histoire la
fois d'une famille troublante et de la transmission de leur histoire par des tmoins
extrieurs qui deviennent les dpositaires de leur mmoire, mais aussi leurs
victimes. Cette histoire d'homonymes et d'enfanticide, enracine dans le pass
mythologique du Nouveau Monde, se double ainsi d'une parabole sur les
119
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
instruments et le pouvoir de l'illusion mimtique, sur la fascination qu'elle exerce
sur celui qui la prend en charge et celui qui se prte son jeu, avec tout ce qu'elle
charrie d'obscur, de fatal et de mortel.
3. Doublure`htrodigtique ?
La dernire condition narratoriale qu'il faut examiner est celle o le narrateur
est extrieur l'histoire qu'il narre. N'tant pas un personnage, il semble peu apte
permettre la construction d'une figure auctoriale, tre le moyen d'une
autofiction. Il faut pourtant distinguer deux cas de figure, selon le degr de
prsence de ce narrateur, selon qu'il se mette en scne ou non dans son acte
narratif.
Premier cas, ce narrateur htrodigtique n'est pas reprsent, ne se
montre pas. Il raconte une histoire en feignant de laisser parler les faits
eux-mmes, en cachant son rle d'intermdiaire. Le rcit semble alors exister par
lui-mme ; rien ne rappelle au lecteur qu'on lui raconte une histoire, qu'il lit un livre.
Comme on sait, l'exemple typique de cette situation narrative est The killers
d'Hemingway, une des nombreuses nouvelles o apparat le personnage de Nick
Adams.
Cette occultation du narrateur est propre au rcit du XXe, que l'on peut
apprhender comme le rsultat d'une lente volution pour faire disparatre le
narrateur. Au sens strict, elle est toutefois assez rare. Il est peu commun que le
narrateur n'introduise pas, fut-ce en sous-main, un commentaire didactique, moral,
intellectuel ou esthtique sur les vnements qu'il relate. Le passage en
apparence le plus objectif rvle souvent l'examen la prsence du narrateur.
Pour reprendre les fonctions narratoriales mises en vidence par Genette, il est
rare que le narrateur n'exerce qu'une "fonction narrative", qu'il se borne raconter.
Le plus souvent, il a aussi une "fonction idologique", de commentaire implicite ou
explicite de l'action, et une "fonction de rgie". d'organisation de l'histoire. En outre,
il peut remplir une "fonction communicative", par laquelle il met l'accent sur son
destinataire, voque le narrataire de son histoire ; et une "fonction testimoniale" qui
lui permet de reprsenter son rapport l'action et les conditions de sa narration
(Genette, 1972, pp. 261-263).
120
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Ces deux dernires fonctions narratoriales nous permettent d'introduire un
second cas de figure dans le statut du narrateur htrodigtique. C'est celui o ce
narrateur, tout en tant absent de l'histoire qu'il conte, ne manque pas de signaler
sa prsence et de tmoigner de son activit. Surgissant sur le devant de la scne,
le narrateur revendique alors haute voix sa fonction d'intermdiaire, de mdiateur
du rcit et ne se gne pas pour le cautionner, le diriger ou interpeller son
destinateur. Dans Stendhal et les problmes du roman, Blin a consacr de
prcieuses pages tudier ces "intrusions", en faire l'historique, en montrer les
modalits et les effets chez l'auteur de Lucien Leuwen. Il montre bien en particulier
comment cet "interventionnisme", quand il devient systmatique, comme chez
Stendhal, conduit manciper le narrateur et introduire un autre rcit qui vient
doubler l'histoire proprement dite :
" on voit ( le narrateur) qui, soucieux d'animer
personnellement son vocation, brle, comme l'a not
Valry, de se mettre en scne lui-mme. Il s'interpose entre
acteurs et public 'un peu la manire du choeur antique' ; il
ne nous livre pas un dtail sans un (guide-ne'. Il rompt si
communment avec l'objectivit pique qu'on pourrait
presque suivre le roman sur deux plans : dans le registre o
se suivent les vnements et dans la marge o l'auteur les
juge ; il subordonne mme parfois si nettement le fait la
glose, que lire le livre, ce n'est plus fournir une escorte d'ima-
gination ses cratures, mais converser ou se 'promener'
avec l'crivain" (Blin, 1951, pp. 205 - 206).
Ce genre d "interventionnisme" n'existe pas seulement chez Stendhal, il est
le propre de toute une tradition narrative. A des titres divers, des crivains comme
Scarron, Furetire, Fielding, Diderot ou Walter Scott ont permis ce dploiement de
la voix narrative, ces vocalises narratives, qui donne au rcit un ton enjou et
permet d'en dnuder les mcanismes. Ce type de narration a bien sr ses limites
et peut aisment tourner au procd. Flaubert, qui abhorrait comme on sait ces
"intrusions", ne manque pas de le signaler dans Bouvard et Pcuchet :
" Dans ce genre de livres, on doit interrompre la narration pour
parler de son chien, de ses pantoufles ou de sa matresse. Un tel
sans-gne d'abord les charma, puis leur parut stupide, car l'auteur
efface son oeuvre en y talant sa personne" (chap. 5).
121
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Quoi quil en soit, ces intrusions permettent de constituer un narrateur
fonctionnellement indpendant de ses personnages. Ds lors, un tel
"narrateur-intrus" semble pouvoir tre le support d'une figure auctoriale. Reste
cependant un problme, qui tient l'ide que l'on se fait du narrateur. Il existe, en
effet, aujourd'hui, deux conceptions concurrentes du narrateur. Une conception
rcente selon laquelle il est diffrent de l'auteur ; une plus ancienne, qui en fait un
rle jou par l'auteur. Selon la conception adopte, un narrateur pourra ou non tre
une doublure de l'auteur. Le problme c'est que ces deux conceptions coexistent
aujourd'hui, tant dans les habitudes de lecture que dans les thories les plus
rcentes de la littrature, o l'on assiste un retour la conception "classique" des
relations entre l'auteur et le narrateur (Ryan, 1980 ; Genette, 1983).
La conception moderne du narrateur est bien connue puisqu'elle fait partie
de la doxa potique contemporaine. On peut situer son mergence dans les
annes soixante, avec le dveloppement de la narratologie (qui exigeait coure
principe mthodologique que le narrateur soit distingu de l'auteur) et avec la
vulgarisation des potiques de Mallarm et de Valry. Roland Barthes est l'un des
critiques qui, en France, a popularis cette conception en dveloppant l'ide que
"l'auteur (matriel) d'un rcit ne peut se confondre en rien avec le narrateur de ce
rcit", en insistant sur le fait que "qui parle (dans le rcit) n'est pas qui crit (dans la
vie) et qui crit n'est pas qui est" (Barthes, 1966, p. 40). Cette ide est aujourd'hui
passe dans les habitudes de lecture et dans la pratique des crivains.
Pourtant, il n'en est pas toujours all ainsi. De faon significative, Blin parle
en 1951 d"'intrusions d'auteur" et non pas d"'intrusions de narrateur". De mme,
Flaubert, dans le passage cit de Bouvard et Pcuchet, crit bien, en critiquant les
romans humoristiques, "l'auteur efface son oeuvre en y talant sa personne". On
pourrait citer mille exemples qui montrent que l'on a pens pendant longtemps que
l'crivain et le destinateur de son texte, l'auteur et le narrateur ne faisaient qu'un.
Faut-il imputer cette confusion une navet ? un psychologisme qui toucherait
jusqu'aux critiques et aux crivains les plus pntrants ? Ce serait un peu simple.
Dans cette ccnception traditionnelle, le narrateur n'est pas identifi purement et
simplement l'auteur. Cette confusion est faite sous certaines conditions.
122
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Il faut d'abord que le narrateur ne soit pas dot dune identit propre, ne soit
pas un personnage autonome comme l'est le narrateur de Robinson Cruso. Il est
ncessaire qu'il soit anonyme et htrodigtique. (Notons au passage que cela
explique toute une srie de procds qui sont aujourd'hui tombs en dsutude ;
mais qui ont t trs utiliss pendant longtemps, comme les narrateurs parasites
de Maupassant ou les auteurs supposs que sollicite Voltaire pour ses contes. Ces
procds concourent tablir, pour des raisons diffrentes, un cran entre l'auteur
et le narrateur, un relais qui interdit leur identification, sans pour autant demander
l'laboration d'un narrateur-personnage). Il y a une seconde condition : c'est que si
l'auteur est le narrateur, ce n'est pas en un sens psychologique, c'est au sens o il
adopte un rle, une attitude.
Dans un article dj ancien, Wolfgang Kayser a bien dcrit cette simulation :
"Toutes les oeuvres de l'art du rcit comportent un
narrateur ; l'pope comme le conte, la nouvelle aussi bien
que l'anecdote. Tous les pres et toutes les mres de famille
savent qu'ils doivent se transformer quand ils racontent une
histoire leurs enfants. Ils doivent abandonner l'attitude
rationaliste des adultes et se mtamorphoser en tres pour
lesquels l'univers potique et ses merveilles sont une ralit.
Le narrateur y croit, mme s'il raconte un conte plein de
mensonges : il ne saurait mentir s'il n'y croyait pas. L'auteur
ne peut pas mentir ; il peut, tout au plus, crire bien ou mal.
Le pre ou la mre de famille qui racontent leur tour une
histoire subissent la mme mtamorphose que celle que
l'auteur a d oprer en lui quand il a commenc son rcit. Ce
qui veut dire que, dans l'art du rcit, le narrateur n'est jamais
l'auteur, dj connu ou encore inconnu, mais un rle invent
et adopt par lauteur" (Kayser, 1958, pp. 70-71).
Pour comprendre le mcanisme de cette simulation, Genette a propos de
distinguer entre la personnalit et l'identit de l'crivain :
"En principe, l'identit d'un narrateur extra-
htrodigtique n'est tout simplement pas mentionne, et
rien n'oblige - et par consquent rien n'autorise - la
distinguer de celle de l'auteur ; aprs tout, quand le narrateur
de Joseph Andrews mentionne une fois son "ami Hogarth", et
celui de Tom Jones une ou deux fois sa dfunte Charlotte,
c'est l bel et tien signer Henri Fielding. Le narrateur est donc
123
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Fielding lui-mme, mais feignant en partie une personnalit
qui n'est pas la sienne" (Genette, 1983, p. 100).
La personnalit de l'auteur n'est donc pas celle de son narrateur : il n'est pas
question de confondre son individualit relle avec celle de cet tre de papier
qu'est le narrateur ; d'autant plus qu'un crivain donne souvent son narrateur des
ides, un style qui ne sont pas forcment les siens. Ils s'agit l d'un jeu. Par contre,
au niveau de l'identit, c'est bien la sienne qu'il met en jeu. Mais il la met en jeu
dans une fiction, il joue tre le destinateur d'une histoire, de l'histoire qu'il
raconte. Il faut ici rappeler avec Blin, et avec d'autres, qu'un rcit fictif, c'est aussi
bien la fiction d'un rcit que le rcit d'une fiction. La narration est elle aussi une
fiction, toujours, ne serait-ce que parce qu'elle ne correspond pas la situation
d'criture relle. Depuis que la notion moderne d'auteur existe, on a toujours eu
conscience de ce hiatus entre la rdaction et la narration, la situation d'criture
empirique et son expression narrative. C'est seulement son ampleur qui a vari ; il
avait une extension sans doute moindre que celle que lui donnent Kayser et
Genette. De la mme faon qu'on dit que la plaisanterie a des limites, il semble
que le "faire-semblant" de l'crivain dans sa narration ait eu des limites, limites qui
se sont modifies dans des proportions qui restent analyser. Dans cette
conception "classique" du narrateur, narrer est un jeu, mais un jeu qui a ses rgles,
o l'irresponsabilit et l'intransitivit de la narration sont relatives, pas absolues
comme dans la conscience littraire moderne.
On voit bien la difficult pose par l'existence concomitante de ces deux
conceptions du narrateur : selon celle qui est adopte, la condition narratoriale
htrodigtique rendra possible ou non une fictionnalisation de soi qui ne
s'tendrait qu'au narrateur, sans qu'aucun double de l'crivain ne soit prsent dans
l'histoire. Pour la conception traditionnelle, une telle chose est impossible puisque
pour celle-ci le rcit s'accompagne toujours d'une irralisation (relative) du sujet
empirique de l'criture, la narration a constamment polis consquence une
fictionnalisation (variable) de l'crivain. Dans son cadre perceptif, toute fiction
serait une autofiction, ce qui enlve naturellement tout intrt cette notion. Par
contre, pour la conception moderne, l'autofiction pourrat exister l'chelle du
narrateur puisque pour cette conception, l'crivain s'puise dans l'laboration de
son criture fictionnelle, sauf s'il construit une figure narratoriale identifie
124
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
lui-mme par des indices formels indiscutables. Comment trancher entre ces deux
possibilits thoriques ? Sur quelle conception s'appuyer pour rsoudre notre
question ? On va d'abord examiner une oeuvre o le narrateur est fortement
prsent dans le rcit et o des marques indniables autorisent sa confusion avec
l'auteur.
C'est typiquement le cas de The History of Tom Jones, a Foudling (1749) de
Fielding, comme le notait dj Genette. Le narrateur de ce roman si fameux est
partout dans son rcit : dans les intertitres, dans le premier chapitre de charun des
livres qui divisent le texte, au dbut et la fin de bien des chapitres, dans le corps
du texte o il marque les scansions du rcit. Le contenu de ces interventions est
trs divers : des remarques apologtiques sur la nature de ce rcit, des
digressions sur des sujets trs varis, l'affirmation de son omniscience ou de son
ignorance, des interpellations du lecteur, des commentaires sur les personnages
ou les vnements, des jeux mtaleptiques avec l'histoire etc. Wolfgang Iser a bien
analys l'une des raisons essentielles de ce parti pris d'intrusion chez Fielding.
C'est qu' une poque o le roman au sens moderne n'existait pas encore, il fallait
en quelque sorte tablir dans l'oeuvre elle-mme le contact avec le lecteur, simuler
un dialogue dans le texte pour familiariser le public avec ce genre nouveau (Iser,
1976, p. 275).
Le plus souvent l'identit de ce "narrateur -intrus" qui a pour fonction de
capter l'adhsion du lecteur demeure indtermine : il se dsigne communment
comme tant "l'auteur", sans plus d'indications. Dans Tom Jones, pourtant,
l'identit du narrateur est spcifie.Tout d'abord, celui-ci ne manque d'voquer
dans le texte une dfunte Charlotte qui tait sa femme. Comme on devrait le
savoir, c'tait aussi celle de Fielding. Voici donc une indication d'tat-civil qui
permet d'tablir une homologie entre ce narrateur et l'auteur ; et par suite d'oprer
indirectement leur identification. Mais surtout, le texte prsente plusieurs notes en
bas de page qui, par un mcanisme que l'on a dj vu, permet d'identifier dans le
narrateur Fielding lui-mme. La premire est trs explicite et ne permet pas la
contestation de cette identification in absentia. A propos du terme "populace",
utilis pour dsigner la plupart des habitants du comt de Somerset, on trouve
cette annotation :
125
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"Toutes les fois que ce mot se rencontre dans nos
ouvrages, il s'applique des gens de toutes conditions
dnus de vertu ou de raison, et souvent des personnes du
plus haut rang. (H. F.)" (trad. de ha Bdoyere, p. 59).
Si le narrateur n'est pas nomm, la forme pritextuelle de la note parat le
moyen le plus st pour en faire un reprsentant auctorial. C'est un procd que
l'on retrouve souvent chez Stendhal qui constitue son narrateur en figure
auctoriale. Mais d'autres procds sont possibles. La plupart des moyens
d'identification tudis dans la section consacre ce problme peuvent remplir
cette fonction. Le cas de Fielding donne ainsi un exemple de texte o le narrateur
est dot de l'identit auctoriale. La prsence de cette figure auctoriale permet,
dans le cadre d'une conception moderne du narrateur, de voir dans Tom Jones
une autofiction. Mais pas dans la conception "classique" o l'interventionnisme
revendiqu de Fielding ne fait qu'expliciter et accentuer la prsence ordinaire, plus
ou moins insistante de auteur dans son texte.
Comme on s'en aperoit, l'autofiction met en vidence un rel problme, qui
sauf erreur n'a gure t tudi le problme de la prsence, aujourd'hui, de deux
perceptions concurrentes du narrateur, dont la cohabitation a des effets sur la
lecture et l'criture de la fiction. Car il est difficile de se dbarrasser de la
conception "classique" en la renvoyant l'idologie capitaliste, sa dtermination
possessive et personnelle de l'individu, qui de prs ou de loin serait l'origine de la
promotion de l'auteur. Cette explication a perdu une grande partie de son intrt,
maintenant que l'on a montr la valeur thorique de cette conception. S'il y a une
opration culturelle derrire cette exhaustion de l'auteur, elle est chercher dans
cet immense travail de modelage et de classification des discours accompli par
toute culture, dont Foucault a ouvert l'analyse (1970). Mais dans ce cas, la
conception moderne du narrateur rsulte aussi d'un tel travail, effectu au niveau
du discours littraire, commenc au dbut du sicle et achev sous la pression
conjointe de la disparition (tendancielle), du narrateur dans la littrature, de la
diffusion de la potique mallarmenne et des succs de la narratologie, pour qui
l'occultation de l'auteur tait une ncessit mthodologique. On ne prtend pas
pourtant s'aventurer sur ce terrain d'analyse qui demanderait des moyens et une
ampleur qui manquent ce travail. On se limitera proposer l'hypothse suivante :
ces deux conceptions ne s'opposent, ne sont opposes, que par et dans leurs
126
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ignorances rciproques. En ralit elles ne sont pas incompatibles, si on procde
quelques amnagements.
Si l'on radicalise la conception "classique", comme le fait en acte Fielding et
en thorie quelques poticiens, il est manifeste que quantit de propositions
propres la conception moderne du narrateur restent valides. Ds lors que lauteu
est dans sa narration un sujet fictif, un simulacre, on peut maintenir que qui parle
n'est pas qui crit, que l'criture est bien dsituation, suppression de toute origine
comme l'analyse Barthes au dbut de "La mort de l'auteur", et l'on peut conserver
le parti-pris d'vacuation de la narratologie. On y gagne de surcroit une "fonction
auteur" dont Foucault a montr tout l'intrt, tant historique que pragmatique. En
outre, cette conception "classique" gnralise permettrait de rendre compte de la
rception du sens commun qui assimile auteur et narrateur, mais en leur accordant
des liberts, une marge de manoeuvre dans le discours, qu'il refuse au producteur
d'une nonciation srieuse Enfin, une reprise de cette conception "classique" est la
seule voie possible pour envisager l'oeuvre littraire corme une nonciation, ce
qu'on s'accorde communment dire, mais en faisant comme si les traces de
l'nonciateur s'vanouissaient comme par enchantement, alors qu'il ne peut s'agir.
que d'une transformation, d'un dplacement ou d'une "translation" (Saraiva, 1974).
Entre ces deux conceptions antithtiques, il est par consquent possible d'tablir
une continuit, des passages, supprimant la difficult voque propos de la
fictionnalisation du narrateur.
En dfinitive, la fictionnalisation de soi au seul niveau du narrateur,
n'autorise donc pas affirmer l'existence d'une autofiction. Cette irralisation de
l'crivain tant une donne constitutive de la fiction, tous les rcits la manifestent.
Accepter d'indexer cette fictionnalisation narratoriale l'autofiction retirerait tout
trait distinctif cette forme. Par contre, il est certain que cette fictionnalisation
restreint et inhrente la logique de la fiction, prsente une curieuse homologie
avec l'autofiction. A des niveaux diffrents, un processus d'irralisation identique
intervient. Il faudra se demander quels sont leurs rapports.
4. Doublure homo- et htrodigtique.
127
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Ce rapide inventaire permet de voir quels types de narrateur, et dans quelle
proportion, sont les supports privilgis d'une figure auctoriale. Cet examen s'est
fait, toutefois, sans envisager la possibilit de cas intermdiaires, de gradation
entre l'homo- et l'htrodigtique. Pourtant, il peut y avoir des degrs dans cet
videment du narrateur qu'entrane une narration impersonnelle. Comme l'a not
Genette, il n'y a pas de "frontire infranchissable" entre lhomo- et
l'htrodigtique (1983, p. 77). La pratique simultane, de faon partielle ou
soutenue de ces deux types de "voix" peut mme permettre des effets originaux.
Christopher et son monde de Christopher Isherwood est un bon exemple de
cette pratique complexe de la vocalisation. Isherwood y relate sa vie de 1929
1939, dont la plus grande partie se passait Berlin, "le creuset o bouillonnait
l'Histoire en train de se faire" (p. 58). Ces sjours berlinois lui avaient dj inspir
plusieurs romans, dont le fameux Adieu Berlin qui a t adapt au thtre,
Broadway et deux fois au cinma, l'un de ces films tant le clbre Cabaret de Bob
Fosse. Mais dans ce livre, Isherwood a voulu se maintenir au plus prs de la vrit
historique, donner les clefs de ses personnages de fiction et ne rien sacrifier aux
exigences de stylisation ou de dramatisation qui sont propres au roman. A l'aide de
ses souvenirs, de son journal, de sa correspondance de l'poque, d'autres
tmoignages autobiographiques, il tente de reconstituer sa vie durant cette
priode, de rectifier les portraits de certaines personnes donns de faon
transpose dans ses romans et de relater ce que fut leur destine par la suite. Ce
texte ne manque pas d'intrt car on a ainsi comme l'arrire-plan rfrentiel et les
mcanismes de transposition qui sont l'origine de romans comme Le Lion et son
ombre, L'Ami de passage, Mr Norris change de train, Adieu Berlin ou La Violette
du Prater. Encore plus intressant est le type de vocalisation choisie par
Isherwood. A la diffrence de la plupart des autobiographies, celle-ci est la fois
la troisime et la premire personne, celle-l dominant quantitativement. D'une
part, Isherwood a choisi de parler de son pass comme s'il s'agissait de celui d'une
personne trangre, le pass d'un certain "Christopher" ainsi qu'il le dsigne le
plus souvent. Mais, en outre, il a doubl ce rcit impersonnel de nombreux
commentaires la premire personne du singulier pour formuler des jugements
rtrospectifs pour signaler des doutes ventuels sur ses souvenirs ou pour
voquer des faits qu'il ne pouvait connatre cette poque. Ce "mixage" n'est pas
128
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
pisodique mais systmatique ; il est maintenu tout au long de ce texte
autobiographique. C'est d'autant plus frappant qu'il arrive que ces deux "voix" se
trouvent au sein d'une mme phrase. Deux exemples, presque au hasard :
"Je me souviens du choc avec lequel Christopher
s'aperut que l'une des htesses tait un hte" (p. 26) ; "A
l'Institut, l'on avait projet Christopher l'un de ces films ou
peut-tre les deux, je n'en suis pas sr" (p. 44).
La fonction de ce partage entre un il-narr et un je-narrant-tmoin est
vidente, mme dans ces phrases. Au il-narr revient le pass rvolu, restitu le
plus fidlement possible ; au je-narrant l'valuation de ce pass et la mise en
perspective. Si l'htrodigtique domine quantitativement, c'est l'homodigtique
qui l'authentifie et lui donne son sens. Cette division souligne la distance psychique
et temporelle entre l'Isherwood des annes trente et celui des annes soixante-dix
; et facilite le ddoublement ncessaire au jugement de soi, particulirement dans
ce cas o l'crivain Isherwood doit se situer la fois par rapport au jeune homme
qu'il fut et des images de lui-mme, d'autres "Christopher" qu'il a donn dans ces
autofictions que sont Adieu Berlin et LAmi de passage. Le rsultat, c'est une
autobiographie la fois htrodigtique et homodigtique, autorisant une sorte
de Isherwood juge de Christopher. Quoique ce rsultat puisse paratre bizarre
une premire lecture, on s'y habitue vite, car en ralit il est implicitement
prsuppos dans toute autobiographie. L'criture de soi implique ncessairement
ce ddoublement entre le je-narrant et le ,je-narr, le premier jouant le rle d'un
tmoin et le seccnd celui d'un protagoniste presque autonome. Simplement, la
premire personne confond ces niveaux et ne les signale que par des temps
diffrents. Ce cas intermdiaire entre lhomo- et l'htrodigtique ne pose donc
pas vritablement problme car il est vident que le narrateur appartient un
monde qui est celui de son protagoniste, mme si leurs univers ne se recouvre pas
exactement.
Naturellement, ce texte reste une autobiographie. Mais il n'est pas difficile
d'imaginer la transposition de son principe dans le domaine de la fictionnalisation
de soi. C'est d'ailleurs le parti adopt par Antoine Blondin dans Monsieur Jadis ou
l'cole du soir. Seulement, comme ce dernier roman n'est qu'une pochade, il a
129
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
sembl plus fcond de dcrire le livre d'Isherwood, mme s'il relevait du registre
autobiographique.
B) EMPLOI ACTORIAL
Dans la section prcdente, on a vu la possibilit pour la figure auctoriale de
se constituer la fois comme narrateur et ccmme personnage. Seule la dimension
narratoriale de cet emploi a pour le moment retenu notre attention. Il s'agit
prsent d'examiner le double de l'auteur dans sa dimension actoriale, comme
personnage, acteur de l'histoire.
Cet examen va aussi tre l'occasion de se pencher sur la situation
d'nonciation o la figure actoriale n'est qu'un personnage, ne remplit aucune
fonction narrative essentielle. L'crivain parat alors prendre ses distances avec sa
doublure, semble ne pas reconnatre qu'il s'agit d'une projection fictionnelle de
lui-mme. Cette situation curieuse est comparable celle de l'autobiographie la
troisime personne, o un crivain se raconte comme s'il parlait non pas de
lui-mme mais d'un autre. Genette a propos l'expression "autobiographie
htrodigtique" pour dsigner ce cas atypique d'criture de soi (1983, pp.
72-73). Sur le modle de cette appellation, on nommera la fiction de soi la
troisime personne autofiction htrodigtigue. Linguistiquement, un tel choix de
reprsentation n'a rien d'incorrect. Comme on l'a vu, ce type d'nonciation ne fait
que dissocier des instances qui sont d'habitude confondues. D'ailleurs, les
exemples d'autofiction htrodigtiques ne manquent pas Cervants, Kafka,
Cendrars, Queneau, Cohen ou Bryce-Echenique ont chacun leur manire, opt
pour ce type de fictionnalisation.
L'analyse de cet emploi actorial exige par dfinition l'intervention d'une
notion problmatique. Elle a t fort dcrie, juge mme "prime" : nous voulons
parler de la notion de personnage. Un mot d'abord sur le terme. Chacun sait qu'il
est malheureux, cause de ses connotations anthropomorphiques et sa proximit
avec la notion de personne. Il est vident que les acteurs d'un rcit peuvent tre
aussi bien des animaux, que des objets, anims ou non. On prendra donc cette
notion dans un sens neutre et extensif, pour dsigner tous les participants d'une
histoire. En outre, pour ne permettre aucune mprise quant au contenu donn
130
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
cette notion, on reprendra notre compte cette description de Ren Wallek et
d'Austin Warren dans La thorie littraire :
"Un personnage de roman n'est pas une personnalit tire
de l'histoire ou de la ralit quotidienne. Il n'est fait que des
phrases qui le dcrivent ou que l'auteur a places dans sa
bouche. Il n'a ni pass, ni avenir, et parfcis mme aucune
ccntirui t. Cette remarque lmentaire fait un sort tout ce
que les critiques ont pu crire sur Hamlet Wittenburg,
l'influence du pre de Hamlet sur son fils, les annes de
sveltesse du jeune Falstaff, l"adlescence des hroines de
Shakespeare", le problme du "nombre des enfants de Lady
Macbeth" (trad. fr., 1971, p. 35).
Un mot, enfin, sur le statut pistmologique de cette notion. Si l'on excepte
l'article programmatique de Philippe Hamon, dj cit, on n'a gure progress
dans la connaissance d u personnage depuis cette mise au point de Wellek et
Waren. Aprs une tenace survalorisation, cet objet du rcit a t presque
totalement nglig. Comme par raction cette attitude critique qui pendant
longtemps considra la princesse de Clves et le pre Goriot comme des tres de
chair et de sang, les tudes littraires ont dsert ce phnomne littraire. Une
sorte de raction de rejet s'est installe dont les prmisses datent sans doute de
l'article fameux de Robbe-Grillet. Sa dconstruction dans la littrature
contemporaine ou les prodromes de sa critique dans la littrature antrieure a
surtout occup l'attention. On s'est peu souci d'analyser par quels procds les
personnages taient construits, diffrencis ; d'apprcier les investissements dont
ils faisaient l'objet, les choix esthtiques dont ils dpendaient.
Au reste, cette dsaffection fut favorise par la nature composite de ce
phnomne littraire qu'est le personnage. Ainsi, malgr l'importance de sa
fonction dans la structuration d'un rcit, il ne relve pas d'une narratologie au sens
strict. Objet du discours narratif ou plutt "pseudo-objet", il n'est comme l'a rappel
Genette, qu'un "effet" discursif (1983, p. 93). S'il appartient une narratologie de le
prendre en charge, c'est une "narratologie thmatique", encore en souffrance, de
le faire. Comme contenu narratif, il n'a donc pas profit de l'essor des tudes
narratives. Aussi bien, les logiques ou les grammaires narratives (Greimas,
Todorov, Bremond) labores dans le sillage de Propp, ont peu apport quant
l'tude du personnage. Comme le traduit leur dnomination de "logique", de
131
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"grammaire" ou de "syntaxe", ces thories se sont dlibrment dtournes du
personnage comme effet discursif. Leur but ccmmun est d'arriver atteindre une
structure profonde universelle, formalisable dans un modle dductif. Plus que les
personnages effectifs, ce sont les actions, les actants, leurs prdicats et leur
concancation qui constituent l'objet de ces grammaires du rcit. Quand le
personnage n'est pas purement et simplement exclu de l'analyse, il est considr
comme un support d'action et d'actants, n'ayant aucune autonomie.
Pourtant si le personnage n'est qu'un effet, force est de reconnaitre qu'il
n'est pas un effet anodin, ni mme comparable aux autres effets textuels. Dans la
littrature occidentale, le personnage jouit d'un privilge important, parfois
exorbitant. Pour la lecture, tous les personnages sont pour ainsi dire des ombilics,
au travers duquel s'laborent le dchiffrement, la comprhension, la construction et
l'appropriation du texte. Quand un personnage a en plus la fonction d'incarner une
figure auctoriale, de reprsenter en quelque sorte son crateur, son importance
"naturelle" dans le rcit ne peut tre que multiplie.
C'est ce qu'il va falloir essayer de souligner dans cette section, au moyen
d'indications forcment sommaire, en l'absence d'instruments d'analyse dignes de
ce nom. Pour dcrire les modalits de cet emploi actorial, trois classes de traits
semblent retenir :
a) des traits thmatiques, traduisant la relation tablie par l'auteur entre son
personnage et lui-mme : cart ou harmonie, ressemblance ou dissemblance,
consonance ou dissonance ;
b) des traits actantiels, exprimant l'importance de ce personnage pour le
droulement de l'intrigue, son degr de participation au cours de l'action ;
c) des traits mtadigtiques, indiquant sa position dans le rcit : sa
prsence ventuelle dans un rcit enchss ou, au contraire, sa possible
responsabilit dans l'existence d'un rcit second.
1. Profil thmatique
132
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Rappelons pour commencer une vidence. Tout livre prsente une
reprsentation minimale de son auteur, quand bien mme les traces de son
existence se rduiraient un nom propre. Ce dernier apporte des informations qui,
aussi limites qu'elle soient, suffisent au lecteur pour se constituer une image de
l'auteur. Souvent, de plus, le pritexte enrichit ces maigres indications par une
bibliographie, une notice biographique, parfois une photo : Si l'crivain dispose
d'une certaine notorit, il faut compter aussi avec un paratexte factuel (Genette,
1987, pp. 12-13) et plus tard, avec les ressources des ditions critiques,
confidences prives ou publiques, tudes et notes en tous genres qui informent en
dtail le lecteur sur ses origines, sa formation, sa vie, ses gots et ses habitudes,
ses opinions etc.
De mme, un personnage de fiction se prsente toujours au lecteur dot
d'un certain nombre de prdicats qui lui donnent un profil spcifique. Ces prdicats
viennent la fois de l'univers o il volue, du rle qu'il joue dans l'histoire et de
tous les lments qui composent son caractre. Bien que marqu d'une
indtermination constitutive, tout personnage montre ainsi des traits thmatiques
qui permettent au lecteur de s'en faire une reprsentation. C'est vrai du
personnage le plus lacunaire L'Arpenteur du Chteau a beau ne pas avoir de
visage, notre jamais dcrit physiquement, il est loisible d'isoler du texte assez de
propositions le concernant pour pouvoir le dcrire de faon restituer sa
spcificit.
Un livre de fiction admet par consquent la construction aussi bien d'une
image de l'auteur que de celle d'un personnage, Les termes employs ici ne sont
sans doute pas trs adquats. Tout ce que l'on veut dire, c'est qu'il est possible
d'tablir une relation d'analogie entre un personnage et son crateur. Et cela,
malgr la dissymtrie vidente, la fois quantitative et qualitative qui existe entre
les deux images. Naturellement, il n'est pas question de faire de cette relation
d'analogie un critre de l'autofiction. Au contraire, c'est en tant qu'elle est
subordonne au critre du nom que cette relation est intressante. Elle permet
alors de spcifier le ddoublement fictionnel ralis, de dpasser sa simple
reconnaissance pour le prciser. Au reste, il est sans doute bien venu de signaler
que cette relation d'analogie est presque toujours illusoire. Elle n'exprime qu'une
ressemblance avec l'image que l'auteur veut (ou peut ?) donner de lui-mme,
133
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
rarement avec son tre rel. Mais l'important et que cette illusion soit cre par le
texte lui-mme, qu'il fasse partie des effets de lecture, calculs avec plus ou moins
de prcision par l'auteur. Autrement dit, il s'agit de rintgrer un aspect du
dispositif autofictif qui avait t dlibrment ignor : son aspect smantique. Il est
trop souvent nglig pour les ouvrages de fiction. Sous prtexte qu'il est indment
hgmonique et peu fond, on l'ignore. On fait comme s'il tait toujours absurde et
naf de chercher des similitudes entre la fiction et le rel. Une telle conception
interdit pourtant de conprerdre le fonctionnement du roman personnel, du roman
clefs ou du roman historique. Pour toutes ces formes mixtes, c'est videmmert le
texte lui-mme qui demande etre lu en regard de personnes et de faits existants,
d'un pass vrifiable. Ngliger ce rapport la ralit est toujours possible, mais
c'est au prix d'une dimension importante de l'oeuvre. Un peu comme si en lisant Le
Virgile travesti de Scarron, on voulait ignorer son rapport L'Enide.
Mutadis Mutandis, l'autofiction demande que l'on apprcie la part de
conservation ou de dformation de soi qu'elle met en oeuvre. Signer une
autofiction, c'est parapher un texte o l'on a pris le parti de se fictionnaliser, de
faire sa part au fantastique et l'irrel qui hante chacun de nous. Ce procs
d'irralisation peut toutefois prendre des proportions diffrentes. Se fictionnaliser
en fourmi (Butor au dbut de Troisime dessous) plutt qu'en conservant tous les
traits de son tat-civil et de sa biographie, mais en les projetant dans un autre
monde (Dante dans La Divine comdie) n'est pas indiffrent.
Ce degr de transformation de soi, qu'il importe d'apprcier mme
grossirement, on l'appellera le profil thmatique de la figure auctoriale. Trois
paramtres sont mme de participer la constitution de ce profil : l'identit (nom
et substituts), la personnalit (ge, profession, nationalit etc.) et l'univers (poque,
lieu, situations vcues) de l'crivain. En faisant varier ces trois paramtres, l'auteur
tablit une relation d'analogie plus ou moins troite, plus ou moins contraste,
entre lui-mme et son double fictionnel. Mettre en place une ttypologie rigoureuse
de ces relations d'analogie n'est pas pensable. Il est possible, nanmoins, de
distinguer trois grands choix dans le degr de ressemblance que peut avoir un
personnage avec son crateur.
134
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
a) Analogie totale entre l'auteur et son personnage. C'est typiquement la situation
de Cline par rapport au narrateur-personnage quil met en scne dans ses
romans d'aprs-guerre. Il a donn son identit son hros, en le dotant de tous
ses noms, qu'ils soient d'tat-civil ou littraire (Ferdinand, Louis, Destouches,
Cline). De mme, il lui a attribu tous les traits de sa personnalit (mari une
danseuse, la fois mdecin et crivain etc.). Enfin, beaucoup plus spectaculaire,
Cline a fait vivre son hros ses propres aventures, l'a fait pass par des lieux et
une poque qu'il a lui-mme connus. D'un chateau l'autre, Nord ou Rigodon,
racontent une fuite en avant et un exil que le lecteur franais ne pouvait
qu'identifier avec l'existence de Cline aprs 1944. Tous les vnements raconts
dans ces derniers romans avaient fait les beaux jours des mdias aprs la
Libration. Cline tait alors un personnage public, un tratre, doubl d'un fuyard,
bref une aubaine pour les journaux ou les radios. Son sjour Sigmaringen, son
arrestation Copenhague, son exil au Danemark, son procs etc., sont cette
poque des faits publics (Godard, 1985, p. 296). Ils constituaient le "paratexte
factuel" de l'crivain Cline, bien connu de tous ses lecteurs. Certes, dans le
dtail, Cline modifie bien des choses dans ces vnements, comme l'a montr
Henri Godard dans les admirables ditions critiques de ces romans. Mais dans les
grandes lignes, pour ce qui est accessible au grand public, la ressemblance tait
parfaite entre le personnage-narrateur de ces romans et l'auteur Cline.
Presque trop parfaite, d'ailleurs. La concidence tait si complte que
nombre de lecteurs ont pens que Cline orientait dsormais son entreprise dans
le sens de l'autobiographie. beaucoup sont passs ct de la fictionalit de
l'oeuvre. Toutes les indications gnriques et toutes les dclarations qui
revendiquaient cette fictionalit ont t interprtes comme une protection ad hoc,
une sorte de fausse pudeur. Ce parti-pris d'analogie intgrale prsente donc un
risque important : celui d'occulter le travail de fictionnalisation. De fait, si l'on
excepte Cline, il ny a pas d'exemple d'une relation d'analogie totale entre
l'crivain et son personnage. La plupart des crivains prfrent tablir une relation
de proximit qui permet de se reprsenter de faon trs fidle, tout en manifestant
sans quivoque le travail fictionnel ralis.
b) Analogie partielle entre l'crivain et son personnage. Plus adapte parat
donc une ressemblance relative entre l'crivain et son double. Plus sduisante
135
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
aussi car elle permet l'auteur de donner davantage libre cours sa fantaisie et
ses dsirs. Par suite, rares sont les autofictions o le romancier, comme Cline,
s'astreint reconduire dans la fiction son univers, sa personnalit sociale et son
identit. Le plus souvent, il fait varier l'un de ces paramtres.
Ainsi l'identit chez Philippe Sollers. Dans ses derniers romans, qui
marquent un retour aux formules narratives raditionnelles, il met en scne tour
tour S., Philippe Joyaux et Ph. S. Tous ces personnages ont le mme profil
thmatique ; prsentent une grande unit au niveau des prdicats qui les
dfinissent. Ils ont tous en commun les donnes suivantes : crivain d'avant-garde,
salu trs tt par ses ans, d'origine bordelaise, conseiller littraire dans une
maison d'dition parisienne, "grand connaisseur" du patrimoine littraire universel,
de peinture, de musique etc. Toutes les rfrences culturelles et toutes les ides
mobilises par ces personnages dans Femmes, Portrait du joueur ou Le Coeur
absolu se retrouvent sous la signature de Sollers dans Logiques ou Thorie des
exceptions, deux recueils d'essais. Lenfance bordelaise du Philippe Joyaux de
Portrait d'un joueur avait dj t raconte par Sollers lui-mme dans Visions
New-York, une srie d'entretiens avec le journaliste amricain David Hayyman
Dans ce dernier livre, Sollers voquait mme sa pratique de la fictionnalisation de
soi. Le lecteur n'a donc aucun mal voir dans ses diffrents personnages autant
d'incarnations fictiornelles de l'crivain Sollers. Pourtant, la variation du paramtre
de l'identit empche toute naturalisation de ces romans. La ressemblance s'arrte
au nom propre. Il n'est pas possible de faire de ses textes autant de moments
d'une entreprise autobiographique.
Avec Moravagine de Cendrars, c'est l'illustration de la variation d'un autre
paramtre : l'univers de l'crivain. On sait que Cendrars lui-mme est l'un des
protagonistes de l'quipe du hros ponyme, narre par un certain Raymond la
Science. Son rle n'est pas prpondrant car son apparition concide avec une
ellipse tres importance du recit. Mais il est quand mme prsent a trois reprises
dans le court de l'ouvrage, Chartres en 1913, a Cannes vers 1916 alors qu'il
vient d'tre amput et, enfin, a Chartres en 1917. Tout ce qui est dit du
personnage Cendrars correspond ce que les lectevrs pouvaient savoir de
1'ecrivain, lors de la publication de ce roman en 1926.
136
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Ainsi pour la premiere apparition de Cendrars dans le roman. Moravagine et
Raymond le narrateur sont Chartres, sur l'invitation de Champcommunal,
linventeur. Ils se rendent dans son atelier :
"Le hangar etait encombre d'outillages et de pieces
dtaches. Un deuxieme avion tait en construction. Un
moteur tait au banc. Il y avait un lit de fer dans un coin et un
hamac derriere le pole. Il y avait une petite forge au fond, un
grand tour et un tabli devant la fentre. Un homme tait
ltabli. Il tait jeune. Ni notre venue, ni les cris intempestifs
de Champcommunal ne l'avaient distrait de son travail. Il
n'avait pas tourn la tte, pas une seule fois. Il tait pench
sun son travail. A l'aide d'un compas, il chiffrait den repres
sun une hlice en bois.
- Viens dejeuner, lui dit Champcommunal. Laisse donc a
l, tes logarithmes et tout le fourbi. Aujourd'hui c'est fri. On
fait la bombe.
Et se tournant vers nous :
- Messieurs, dit-il, permettez-moi de vous presenter mon
lieutenant, Blaise Cendrars" (IIe partie, chap. 8, p. 390)".
Ce portrait de Cendrars au travail est en harmonie avec l'image que
l'crivain donnait de lui-mme dans les annes 20. En 1913, Cendrars est plutt
Paris, o il frquente les milieux littraires et artistiques. Il fait de la copie pour
Apollinaire, compose la Prose du Transsibrien. Mais il semble bien avoir trouv,
par l'entremise de Delaunay, la possibilit d'avoir un contact avec l'aviation, dans
un atelier de construction Chartres (Myriam Cendrars, 1984, p. 375). Cette
exprience ne pouvait qu'enrichir l'image de dilettante dou que Cendrars aimait
rpandre autour de lui, l'intention de ses amis et de ses lecteurs. On pourrait
continuer cette comparaison pour ses deux autres apparitions dans Moravagine. A
chaque fois, Cendrars prsente de lui-mme une reprsentation trs plausible. Par
contre, il se campe en compagnie de personnages (Moravagine, Raymond) et
participant des vnements qu'il n'a jamais connus ; bien plus, qui sont
manifestement invents. La ressemblance s'arrte ici aux vnements vcus,
l'univers relat.
Ces deux illustrations suffisent montrer comment un crivain peut tablir
une analogie partielle avec son double. C'est le profil thmatique de la figure
137
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
auctoriale qui est le plus rpandue pour des raisons qui ne sont pas difficiles
claircir. Un tel choix permet la fois d'tre soi-mme et de se livrer aux dlices de
l'invention, de se reconnatre dans sa cration et de donner libre cours son
imagination.
c) Relation de contraste entre l'crivain et son personnage. Plutt que de
rester fidle lui-mme, un crivain peut chercher abolir toute ressemblance
avec son double, produire une reprsentation de lui-mme aux antipodes de son
identit, de sa personnalit sociale et de son univers.
C'est le cas de Michel Leiris avec le personnage de Damocls Siriel dans
Aurora. Si Siriel n'tait pas l'anagramme de Leiris, le lecteur serait bien en peine
de reconnatre dans ce personnage un double romanesque de l'auteur. Peut-on
objecter que ce personnage correspond sans doute ses fantasmes, ses dsirs
inavous ou sa mythologie personnelle ? Pas vraiment. Le rive n'est pas la vie ;
un hirarque de l'an 800 du crpuscule n'est pas l'auteur de L'Age d'homme. On
peut tre habit par la passion des figures gomtriques, du minral et des
femmes entirement rases, sans passer l'acte, sans chercher donner corps
ces hantises. Que l'on sache, Leiris n'a jamais commis les mutilations et les
meurtres accomplis par ce prtre d'un temple lev la gloire du corps fminin. Il y
a un monde entre les penses que lon peut avoir et leur ralisation effective.
De mme, Kafka n'est pas le K. du Chteau et du Procs. Certes, son
Journal laisse penser que de telles fantasmagories faisaient partie de sa vie
intrieure. Mais on ne peut en conclure que par l il ressemble son personnage.
L'univers o il apparat, sa personnalit, son identit, tout est fait pour montrer que
nous sommes ailleurs, dans une autre logique. Si Kafka avait voulu se reproduire
dans son double, il aurait fait comme Dante, trs soucieux de multiplier permettant
de le confondre rellement avec son personnage, au travers de sa biographie et
de son uvre antrieure. tablir une relation de contraste avec son double ne
suffit pas pour se dbarrasser de soi-mme. Un tel geste est impensable. On ne se
spare pas aussi aisment de soi. Il faut comprendre cette relation de contraste
comme une diffrenciation pousse l'extrme de ce qu'on est socialement et
culturellement.
138
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Reste que ce type de figure auctoriale est excessivement rare. Peut-tre
parce qu' ce degr de dformation de soi, la pratique commune de la fiction est
un recours plus simple et moins compromettant.
2. Profil actantiel
La seconde classe de traits envisager appartient au profil actantiel du
personnage auctorial. Quelle importance peut-il avoir dans une autofiction ? Quel
rle peut-il occuper dans l'histoire ? Est-il au premier plan ? Plutt au second plan
? En retrait ? Cest ce qu'il convient d'apprcier et de mesurer.
Le problme est donc de disposer d'une typologie permettant de distribuer
les personnages selon l'importance de leurs rles dans une histoire ; de critres
rendant possible l'valuation du poids digtique d'un personnage, de l'importance
de son existence pour la marche de l'intrigue. L'intrt de tels critres et dune
pareille typologie est vident. Quand on cherche dcrire l'importance d'un
personnage, on est limit par des catgories vagues comme celle de "hros", de
"personnage principal" ou de "personnage secondaire". L'existence d'une telle
typologie permettrait d'affiner la description des textes, d'analyser le choix et
l'usage des personnages dans la pratique d'un crivain, d'une cole ou d'une
poque.
Malheureusement, il ne semble pas qu'une telle typologie ait rellement fait
l'objet de recherches approfondies. Dans le Dictionnaire encyclopdique des
sciences du langage, l'article "Personnage", Tzevetan Todorov signale
l'opposition bien connue entre personnages principaux et personnages
secondaires, en notant qu'il ne s'agit l que de "deux extrme" et qu "'il existe de
nombreux cas intermdiaires" (p. 289). Mais la littrature sur le sujet ne lui permet
pas de dtailler ces "ces intermdiaires". De fait, on ne semble presque jamais
s'tre proccup de cette question. Mme au thtre, o une telle typologie serait
des plus utiles pour classer les rles dans une pice, on n'a pas song construire
une telle chelle. Dans la dramaturgie classique, la liste des rles est faite en
fonction du rang social ; dans les pices modernes, cet inventaire est fait par ordre
d'entre en scne. On disposait bien nagure d'une liste d'emplois (jeune premier,
ingnue, confident etc.), mais il s'agit bien sr d'une liste de personnages-types,
139
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
qui n'indique pas forcment leur importance et qui est inadapte au roman. Il n'y
aurait gure que la tragdie grecque qui pourrait ici tre de quelque utilit. Celle-ci
disposait, en effet, d'une tripartition pour dsigner les acteurs. Comme il y avait
une sorte de "rgle des trois" qui voulait que tous les rles soient jous par trois
acteurs, on les diffrenciait en fonction de leur importance par les termes
"protagoniste", "deutragoniste" et "trigoniste" (Rachet, 1973, pp. 114-117).
Malheureusement, cette tripartition ne peut suffire classer et articuler la somme
des personnages prsents dans un roman.
On se trouve donc devant une sorte de vide thorique qui mriterait dtre
combl. Ce n'est pas notre ambition. Une telle tche demanderait elle seule une
tude minutieuse, qui ne peut tre tente ici. On se contentera donc d'une
typologie intuitive, inspire de celle utilise au cinma. On obtient ainsi les rles
suivants, selon un ordre d'importance dcroissant :
Premier rle :
Ce terme servira dsigner la place occupe par le personnage qui est au
centre de l'histoire, sans qui celle-ci perdrait sa raison dtre : c'est le "personnage
principal" ou le "hros". Ce personnage n'est pas forcment toujours prsent dans
le rcit. L'auteur peut mnager ses apparitions, faire parler de lui plutt que le
montrer souvent. Renan notait ainsi propos de Racine : "qu'il a bien fait de ne
pas prodiguer Andromaque ! Elle apparat rare, comme l'idal de la pice, le
cleste voil" (Scherer, s. d., p. 29). Ordinairement, cette position est occupe par
un seul personnage. Elle peut trs bien, toutefois, tre remplie par plusieurs
personnages, comme on le voit dans Le Pre Goriot o il est difficile de dcider si
Rastignac est plus important que le personnage ponyme. Dans les autofictions
htrodigtiques, c'est bien sr le rle occup par le personnage auctorial.
Comme celles-ci constituent la majorit des autofictions, on peut dire que la figure
auctoriale a le plus souvent ce premier rle. Par contre, dans les autofictions
htrodigtiques, il n'est pas si courant que le double auctorial incarne ce rle
privilgi. Quelques uvres vont dans ce tiens : les grands romans de Kafka, Le
Paysan perverti de Restif (avec Edm R.) ou Le Loup des Steppes de Herman
Hesse (avec Harry Heller). Mais le plus souvent, le reprsentant auctorial occupe
un rle moins en vue.
140
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Second rle
Par ce terme, on dsignera un rle important, dont lhistoire ne peut faire
l'conomie, mais qui est pourtant subordonn celui du personnage principal. Le
personnage qui l'occupe a souvent une fonction d'adjuvant ou d'opposant par
rapport au premier rle : Vautrin dans Le Pre Goriot. On se doute que c'est le rle
par excellence du personnage auctorial dans les autofictions homodigtiques, o
le narrateur-personnage est un tmoin plutt que le hros : Loti dans Mon Frre
Yves, Kerouac dans plusieurs de ses romans. Il est moins couru pour les
autofictions htrodigtiques. Des exceptions existent : Edmond dans Ingnue
Saxancour de Rtif ; Thomas dans Les Buddenbrook de Thomas Mann. Mais ces
exemples ne sont qu'approximatifs. M. de Saxancour est plutt un trigoniste qu'un
deutragoniste. Le roman de Thomas Mann tant la saga d'une famille, suivie sur
plusieurs gnrations, il est particulirement difficile de distinguer les personnages
selon leur importance pour l'action. Dans l'ensemble, il faut reconnatre que ce rle
est peu pris par les crivains en qute d'une fictionnalisation de soi.
Petit rle
On arrive ici tous les personnages qui, sans tre de simples "utilits", sont
tout de mme secondaires, dont l'histoire pourrait se passer sans perdre sa
cohrence. Ce rle permet tout au plus un pisode dans la narration. Au-del, il
faudrait revenir la catgorie de second rle. On notera qu'il est difficile de donner
un tel rle un narrateur-personnage : c'est sans doute pour cette raison que les
autofictions homodigtiques n'en prsentent pas d'exemple. Par contre, les
illustrations abondent dans le cas des autofictions htrodigtiques. C'est le rle
que se donne Blaise Cendrars dans Moravagine ; Bryce-Echenique dans La Vie
exagre de Martin Romna ; P.Auster dans La Cit de verre ; S. dans Femmes
de Sollers ; Queneau dans Les Enfants du Limon etc. On notera que dans tous ces
exemples, l'crivain n'hsite pas donner son nom complet son reprsentant,
qu'il ne cherche pas le dguiser, ni d'ailleurs travestir son personnage. Dans
tous ces exemples, le profil thmatique du personnage auctorial ressemble celui
de l'crivain. Il faut observer enfin que le personnage qui occupe ce rle peut avoir
une fonction importante pour la narration. Le texte peut reprsenter ce petit rle
comme le responsable du rcit (S. dans Femmes ou Queneau dans Les Enfants
141
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
du Limon). Mais l'essentiel est que son rle est mineur pour le droulement de
l'action.
Comparse :
A ce niveau de la typologie, le reprsentant auctorial fait plus de la figuration
quautre chose. Son intervention ne peut mme pas produire un pisode. Il est
totalement soumis l'intrigue, n'existe qu'en fonction de l'histoire, sans mme avoir
assez de consistance pour en tre une des ramifications. Le personnage auctorial
relve alors de ce que la dramaturgie classique appelait les "utilits" : domestiques
de la comdie, soldats de la tragdie. De tels personnages sont appels
i'existence pour accomplir un seul geste ou pour ne profrer qu'une parole.
L'autofiction homodigtique ne prsente pas - et pour cause - d'illustration d'un tel
rle. Mais l'autofiction htrodigtique ne semble pas moins rpugner donner
ce rle au reprsentant de l'auteur. Les exemples sont rares : Larbaud qui permet
Barnabooth la rencontre d'un petit rentier, Valery L., qui ne paie pas de mine ;
Albert Cohen qui introduit dans tous ses romans un double discret et fortement
dvaloris : "... Basset - dont le nom vritable tait Cohen, patronyme vritable des
descendants d'Aaron, frre de Mose, mais qui prfrait, le petit puant, se
planquer en Basset -" (Belle du Seigneur, p. 252).
Silhouette
Cette dernire catgorie se distingue de la prcdente par le fait que le
reprsentant auctorial est alors moins mis en scne dans l'histoire, que cit ou
voqu par le truchement d'un personnage, d'un objet ou d'un vnement. Ainsi
dans Emmne-moi au bout du monde !, l'hrone Thrse voque deux
reprises un ami crivain nomm Cendrars. Dans Les Mtores, Michel Tournier:
place au dbut du roman une description o l'on voit un "souffle d'ouest-sud-ouest"
produire toutes sortes de petites perturbations, en particulier tourner "huit pages
des Mtores d'Aristote que lisait Michel Tournier sur la plage de Saint- Jacut".
Dans le mme genre d'apparition fugitive, Victor Hugo aime parsemer ses
romans d'allusions des homonymes ayant eu une importance historique, comme
ce "Hugo, voque de Ptolmas, arrire-grand-oncle de celui qui crit ce livre", qu'il
voque dans Les Misrables (I/5). Plus discrtement encore, Georges Perec a
142
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
paragrammatis son nom dans La Vie mode d'emploi, ralisant ainsi un procd
d"apparition hypographique" du nom d'auteur dont Saussure avait vainement tent
de prouver la pratique systmatique dans la posie grecque et latine. Dans tous
ces exemples, la figure auctoriale n'est plus un vritable personnage, plutt la
dclinaison d'une signature ou l'arabesque d'un nom. On pense la silhouette de
Hitchkock qui se profile dans chacun de ses films ; au geste de Shakespeare,
dcrit par Joyce dans Ulysse : "Il a dissimul son propre nom, un beau nom,
William, dans ses pices, ici c'est en figurant, l un rustre ; ainsi un vieux matre
italien. situait son propre visage dans un coin sombre de sa toile. Il l'a affich dans
les sonnets o il y a du Will en surabondance" (p. 206).
3. Profil narratif
La dernire classe de traits permettant de cerner un personnage est celle
qui se rapporte son niveau narratif. Un personnage peut, en effet, tre lui-mme
un narrateur ou n'exister que dans un rcit second, enchss dans le rcit
principal. Aux XVIIe et XVIIIe sicles, o cette pratique est trs rpandue, ces
rcits au second degr portent le nom d'pisodes et sont senss distraire le lecteur
de l'action principale. Cette pratique de l'enchssement peut parfois atteindre des
proportions vertigineuses, prsenter une cascade d'embotements successifs. Les
Mille et une nuits ou Le Manuscrit trouv Saragosse sont des exemples
classiques de ces enchssements rptition.
Dans Figures III et Nouveau discours du rcit, Grard Genette a donn une
thorie systmatique de ces niveaux narratifs, en proposant les termes de "rcit
primaire" pour le rcit enchssement et de "mta rcit" pour le rcit enchss.
Dans cette terminologie, l'histoire contenue dans l'histoire d'un rcit primaire
s'appelle donc "mtadigse". On adoptera ce vocabulaire pour formuler les points
qu'il faut aborder dans cette section. Le problme est de situer le personnage
auctorial dans ces ventuels embotements narratifs, d'examiner quel niveau
narratif il peut appartenir. Tout d'abord, il faut distinguer si cette doublure est le
personnage ou le narrateur d'un mta rcit :
a) le double auctorial est narrateur d'un mta rcit. C'est alors un narrateur
"intra digtique", intrieur une narration qui lui prexiste. L'histoire qu'il raconte
143
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
peut alors : a. 1) tre celle dun autre, ce qui le promeut en narrateur intra- et
htrodigtique ; a. 2) tre la sienne, ce qui fait de lui un narrateur intra et
homodigtique ;
b) le double auctorial est personnage d'un mta rcit. Une seule possibilit
se prsente alors : il est un personnage mtadigtique et seulement un
personnage.
Trois cas de figure sont, par consquent, possibles pour un double auctorial pris
dans un embotement narratif. Ils seront examins successivement.
Narrateur intra - et htrodigtique
C'est la situation bien connue de Shhrazade, qui est certes le narrateur
essentiel de tous les contes des Mille et une nuits, mais qui est aussi un
personnage puisque le recueil commence par relater dans quelles conditions cette
hrone a d rapporter tant d'histoires extraordinaires. Sans aller jusqu' ce
cas-limite, le reprsentant auctorial d'une autofiction peut sans difficult tre le
responsable d'un rcit second o est narre non pas sa propre histoire, mais celle
d'autres individus.
Ainsi, Ingnue Saxancour : dans ce roman, M. de Saxancour, on l'a voqu,
est une hypostase de Restif. Ses prnoms invitent dj une telle identification :
Nicolas-Edm. Mais surtout, il est donn par l'hrone comme l'auteur de trois
textes Le Loup dans la Bergerie ("Comdie-ariette, en quatre actes"), La Matine
du Pre de famille ("Pice en un acte"), Epimenide ("Comdie en trois actes") ;
trois textes dramatiques qui sont reproduits intgralement dans le roman. Restif de
la Bretonne rimprimera ces pices sous son nom, en 1793, quatre ans aprs la
publication du roman, dans le second volume de son Thtre. Ces "Pices
pisodiques" ne sont donc pas des rcits seconds, proprement parler. Ce sont
vraiment des pices de thtre. mme si elles sont brves, elles prsentent toutes
les caractristiques du genre : liste des acteurs, dcoupage scnique, didascalies
etc. Sur le plan narratif, ces pices fonctionnent toutefois comme des rcits
enchsss.
144
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Ces intermdes dramatiques ont une fonction ornementale ils sont introduits
pour distraire le lecteur, pour varier le ton et les motifs du roman. En outre, ce sont
naturellement des "uvres dans luvre", des textes qui coupent le rcit mais
pour le rflchir, par analogie ou par contraste. Enfin, ces pisodes jouent le rle
de substituts livresques. Ils permettent d'lever Saxancour au rang d'auteur. Et de
faon incontestable, puisque ses crations ne sont pas seulement voques, mais
donnes lire au lecteur, reproduites dans le corps du texte. Ils sont pour Restif
loccasion de donner sa mesure comme pote dramatique de raliser une ambition
qu'il eut toute sa vie, sans que la Fortune ne fit un geste en ce sens. Par
dlgation, Restif est ainsi promu auteur de thtre, pratique bien plus noble que
le roman au XVIIIe. Avec Ingnue Saxancour, on dispose donc de l'illustration dun
profil narratif o la figure auctoriale est l'origine de textes enchsss et o elle
nintervient pas comme personnage. Il ne faudrait pas croire, toutefois, qu'un tel
exemple est monnaie courante. En ralit, ce roman est le seul texte dans notre
corpus prsenter un tel profil narratif. Il apparat comme un happax pour
l'autofiction qui semble mal s'accommoder de la ''prsence dembotement narratif
de ce type.
Narrateur intra et homodigtique.
Le reprsentant auctorial est alors le personnage d'une histoire, mais aussi
le narrateur de sa propre histoire inclus dans la premire. L'exemple classique de
cette inclusion, c'est bien sr Ulysse s'adressant aux Phaciens aux Chants IX-XII
de lOdysse. Lautofiction semble mieux saccommoder dun tel profil narratif
puisque plusieurs crivains n'ont pas hsit recourir : Michel Leiris dans Aurora,
D.M. Thomas dans Poupes russes et Herman Hesse dans Le Loup des Steppes.
Dans ce dernier roman, le mta rcit est en ralit le rcit le plus important pour la
signification du roman, comme dans Manon Lescaut o le rcit englob de des
Grieux l'emporte largement sur le rcit englobant de M. de Renoncourt. Certes, le
lecteur n'a pas accs directement au rcit d'Harry Haller. Le roman commence par
une "Prface de l'diteur", crite par le neveu de la propritaire d'une pension de
famille chez qui Harry Haller a sjourn quelques mois. Cet diteur improvis
prsente la fois un texte ("le manuscrit de Harry Heller") et la personnalit de ce
fameux "Loup des steppes". Sa "Prface" constitue donc le premier niveau narratif
du roman, en est le "rcit primaire". Mais elle est brve ; et l'essentiel du roman est
145
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dans le "manuscrit" qui suit immdiatement aprs. Ce dcrochage fait que le rcit
principal est un rcit second, une histoire qui passe par un go-between, la fois
interlocuteur et premier lecteur.
Dans l'conomie du roman, ce dcrochage de la narration remplit plus d'un
but. Il permet de prparer le lecteur un individu plutt inhabituel : le neveu diteur
tant une personne "normale", son entremise apporte un capital de sympathie
Harry Heller. De plus, cette "fiction de non-fiction" (Rousset; permet de faire
l'conomie d'une laborieuse exposition, fait d'emble une nigme de la
personnalit de Harry Haller. Enfin et surtout, cette mdiation lgitime en quelque
sorte confession, lui apporte une motivation sans laquelle les tourments de Harry
Haller seraient sans doute moins crdibles. La figure auctoriale se trouve ainsi
situe et justifie pour le lecteur, par le truchement de cette fiction d'un manuscrit
abandonn.
Dans les romans de Leiris et de Thomas, l'enchssement narratif de la
fictionnalisation de soi obit d'autres raisons. Dans les deux cas, le mta rcit
prsente la particularit dtre nonc par un personnage qui n'existe pas dans le
reste de l'uvre. La prsence de la figure auctoriale est donc limite au rcit
qu'elle nonce. C'est que dans les deux cas, les rcits enchsss sont des textes
crits , qui existent dlis de leur origine. Dans Aurora, le rcit de Damocls Siriel
n'est pas profr par la bouche de ce dernier ; il s'agit dune simple plaque de rle
rectangulaire, grave il est vrai d'une multitude de caractres, lisibles encore bien
que presque effacs" (p. 80) trouve au fond de la mer ; tandis que dans Poupes
russes, c'est un article de magazine dont l'auteur n'est pas cit, mais qui se
dsigne dans son rcit comme tant un certain Donald Thomas (p. 161). Ce statut
particulier du mtarcit permet dans ces deux romans d'en faire une sorte
d'enclave, comme une parabole inscrite au cur des deux textes sur le travail de
la fiction, sa nature et son fonctionnement pour chacun des deux crivains.
"Personnage mtadigtique"
Grard Genette emploie cette expression pour dsigner un personnage qui
appartient un mta rcit (1983, p. 5i), On rangera sous son chef l'examen de la
possibilit pour la figure auctoriale de n'tre qu'un personnage, sans aucune
146
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
fonction narrative. Dans Manon Lescaut, pour emprunter un exemple la
littrature romanesque, c'est la situation de tous les personnages qui occupent le
rcit de Des Grieux, sans tre voqus dans le rcit primaire de Ma de
Ronencourt.
Dans la littrature autofictive, c'est par exemple l'vocation de l'actrice
Willette Collie dans La Retraite sentimentale. Ce roman appartient au cycle des
"Claudine" de Colette, dont le patronyme avant son divorce tait Willy. Au cours du
rcit, l'hrone fait raconter l'une de ses amies, ses dbuts sur la scne. Annie,
c'est le nom de cette amie, dcrit la premire rptition et son travail avec une
actrice dont le nom rappelle trangement celui de Colette :
"Cette premire rptition, grand Dieu ! Je n'avais consenti
rien, que dj chacun me traitait en meuble anim. L'auteur me
criait : 'Enlevez votre chapeau, Mademoiselle ! Il faut qu'on voie les
jeux de la physionomie !' Relve ta jupe, criait Auguste. Il faut
qu'on voie le mouvement de la jambe !...'
Et puis Willette Collie qui jouait le Faune, s'est crie mon
arrive : 'C'est a la jeune fille rousse ? Mince de bton de zan ! '
Elle cabriolait sur scne en maillot de bain, comme un dmon, et
dansait en aveugles ses cheveux courts dgringols sur son nez.
Elle aussi s'empara de moi comme d'une bte morte, comme d'une
guirlande rompue Ah ! Je n'eus pas de peine jouer mon rle,
ds la premire rptition ! Willette Collie qui devait memporter
la fin de pantomine, me jetait terre d'une soigne si rude, me
tranait avec un triomphe si convaincu et me suffoquait d'un baiser
si bien imit que l'on fit un succs ma faiblesse prs des larmes,
ma supplication involontaire... (...)
"Vingt et une fois j'ai accompli somnambuliquement mon
nouveau mtier, cte cte avec Auguste, qui jouait un jeune
Athnien. (...)
a marchait trs bien jusqu' ma grande scne avec le Faune,
Willette Collie. Cette toque s'ingniait varier notre duo tous les
soirs, et j'en tremblais d'avance. Un jour, elle m'empoigna par les
reins, comme un paquet, et m'emporta sous son bras, ma tunique
et mes cheveux roux tramant en queue triomphale... Une autre
fois, vendant notre baiser - le fameux 'baiser' qui fit scandale et
quelle me donnait avec une fougue indiffrente, elle insinua sa
main sous mon bras et me chatouilla irrsistiblement. Ma bouche
billonne, par la sienne, laisse chapper un petit cri rl... je ne
vous dis que a ! Un peu plus, on devait baisser le rideau... J'ai
pleur ce soir-l" (p. 127-129, 130-131 ; Nous soulignons)
147
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Ce rcit s'inspire de faits rels, quand Colette dut se mettre au thtre pour
vivre, aprs sa sparation d'avec Willy. Le mimodrame voqu est sans doute Le
Dsir, l'Amour et la Chimre, d'aprs un pome de Francis de Croisset, qu'elle
joua au Thtre Michel, tout en crivant dans les coulisses La Retraite
sentimentale. En se mettant en scne, Colette inscrit dans son roman le cadre o il
a t crit, comme une sorte de private joke.
Cette fictionnalisation lui permet aussi de multiplier les hypostases d'elle-
mme puisque Claudine est dj une doublure fictive. Ce motif du ddoublement,
lie l'criture, est un thme constant chez elle : voyez "Le miroir" dans Les Vrilles
de la vigne.
D'une faon gnrale, il est donc peu frquent de rencontrer des
reprsentants auctoriaux qui soient en mme temps des personnages mta-
digtiques. En fait, ils se rduisent aux exemples donns. Si notre corpus est
reprsentatif, on est bien oblig de conclure une sorte de rpugnance de
l'autofiction mettre en uvre des changements de niveaux digtiques. Peut-tre
ces deux pratiques d'criture ont finalement une finalit commune, qui ne peut que
les rendre concurrentes : distancier la narration de toute origine, ft-elle fictive.
Simplement, alors que le rcit mtadigtique opre cette distanciation en
dissociant les instances de la narration, en en multipliant les chicanes ;
l'affabulation de soi "mine" cette origine en reculant le dehors de la fiction, voire en
lui supprimant toute extriorit.
Pour achever cette section, on fera une remarque sur la relation entre les
diffrents traits qui dfinissent cet emploi de la figure auctoriale. Afin de rendre leur
exposition plus claire, on s'est trouv dans l'obligation de sparer des traits qui en
ralit fonctionnent ensemble, en se renforant ou en se compensant, voire en
s'annulant. Il n'est pas inutile d'insister sur cette interdpendance. Ainsi, le profil
thmatique et le profil actantiel sont souvent troitement solidaires. Notre corpus
prsente plusieurs exemples o le reprsentant auctorial a, de concert, un petit
rle et un profil thmatique identique celui de l'auteur. La fabulation sur soi tient
alors moins dans I'invention d'une existence extraordinaire, que dans la mise en
prsence avec d'autres personnages fictifs. Il est ainsi curieux de constater que
quand le reprsentant auctorial a un premier rle et que son profil thmatique
148
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
correspond celui de son crateur (Loti, Cendrars dans sa ttralogie, Cline) c'est
qu'on a affaire des crivains qui recherchent dlibrment l'ambigut, qui
cherchent volontairement garer le lecteur, rendre le statut apophantique de
leur texte indcidable. Si l'on excepte ces cas d'espce, l'occupation d'un premier
rle va le plus souvent avec un profil thmatique contrast. Ainsi Harry Haller est
bien le premier rle du Loup des Steppes, mais il n'y a gure que ses dbats
intellectuels qui sont ceux de Herman Hesse. Pour le reste, situation, personnalit,
existence, nom, tout l'loigne de son crateur. Naturellement, il ne s'agit pas l
d'un lien mcanique, mais de tendance, d'effets dont il faut souligner la solidarit.
C) EMPLOI FOCAL
Pour tre complet, cet examen des emplois narratifs se doit de dire un mot
sur la situation du reprsentant auctorial par rapport la "focalisation" du rcit, sur
son rle dans le rcit pris comme nonc et non comme narration ou comme
histoire. Dans la terminologie de Genette, la "focalisation" dsigne ce qu'on appelle
ailleurs la "vision" ou le "point de vue", c'est--dire la perspective par laquelle le
lecteur prend connaissance de l'histoire :
"Par focalisation, j'entends (...) une restriction de 'champ',
c'est--dire en fait une slection de l'information narrative par
rapport ce que la tradition nommait l'omniscience (..).
L'instrument de cette (ventuelle) slection est un foyer situ,
c'est--dire une sorte de goulot d'information, qui n'en laisse
passer que ce qu'autorise sa situation (...). En focalisation interne,
le foyer concide avec un personnage, qui devient alors le 'sujet'
fictif de toutes les perceptions (...). En focalisation externe, le foyer
se trouve situ en un point de l'univers digtique choisi par le
narrateur, hors de tout personnage..." (1983, pp. 49-50).
Les faits de focalisation sont distincts des faits d'nonciation, bien qu'on les
ait confondus pendant longtemps. Cette confusion s'explique aisment : quoique
autonomes, ces deux plans sont souvent solidaires dans la constitution d'une
situation narrative. Il est clair par exemple que la fameuse valorisation jamesienne
du "personnage rflecteur" (c'est--dire du choix d'un personnage comme canal
par o passe toute l'information) suppose implicitement le choix d'une narration
htrodigtique. Applique un narrateur homodigtique, cette valorisation est
149
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
moins comprhensible. On ne s'tonnera donc pas que cet examen de l'emploi
focal prenne parfois en compte la condition du narrateur. Cette section va toutefois
se limiter quelques remarques, car le seul point important pour nous est de
dterminer si le double auctorial est objet ou filtre du rcit, "goulot d'information" ou
consquence de cette slection, personnage rflchi ou "personnage rflecteur".
a) Le double comme objet du rcit
C'est exemplairement la situation de Cendrars dans Moravagine et de la
quasi-totalit des rcits fictionnalisation de soi o la figure auctoriale n'a pas la
narration en main. Cette distance prise par l'crivain l'gard de son reprsentant
produit en gnral un effet de surprise et d'tranget trs efficace. L'auteur
apparat dans son propre texte comme un tranger, comme un personnage dcrit
par un observateur extrieur. Cette absence de complicit rend opaque, dralise
son double, a un effet fictionnalisant en elle-mme, comme on le verra.
b) Le double comme filtre du rcit
Ce filtrage par le reprsentant auctorial peut emprunter des voies diffrentes
selon sa nature et la condition du narrateur.
Focalisateur externe.
En principe, cette forme de focalisation est impossible en prsence d'un
personnage. Mais un rcit autodigtique comme Poisson-chat de Charyn arrive,
au prix de nombreuses transgressions de la vraisemblance, pouser cette forme
en donnant au narrateur et personnage auctorial, qui porte exactement le nom de
son crateur, l'omniscience d'un romancier traditionnel envers son action et ses
cratures. Ainsi, dans ce livre qui porte comme sous-titre "Une vie romance", la
puissance du hros "Charyn" est telle qu'il n'a aucun mal revivre, par simple
empathie, le destin tragique d'un joueur d'checs prcoce et gnial, vivant au
milieu du XIXe sicle la Nouvelle Orlans. Cette ubiquit n'est justifie que par la
conscience qu'a le narrateur de sa sensibilit et de ses pouvoirs d"artiste" - juste
compensation de l'acharnement du sort son gard et de sa faiblesse face au
rel. Elle a pour rsultat de le faire apparatre, vis--vis des autres personnages,
comme une incarnation de l'Auteur au sens fort du terme, sous cette rserve que
150
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ses pouvoirs se limitent comprendre tout ce qui lui arrive, sans pouvoir agir sur
son destin.
Focalisation externe
Avec cette forme de filtrage, le lecteur n'en sait pas plus qu'un personnage
qui prend en charge l'information narrative et qui dcouvre les vnements au fur
et mesure de leur droulement. Dans un rcit narrateur homodigtique, ce
type de focalisation n'est ordinairement gure spectaculaire car le narrateur est
soumis, comme l'a signal Genette, une "restriction module a priori". Par
convention, il est en effet oblig de justifier toutes les connaissances dont-il
dispose sur les actions des autres personnages. Cette contrainte constitue une
"prfocalisation", en ce sens qu'elle dlimite par avance les informations dont le
narrateur peut faire tat.
A partir de ces limites initiales de la narration homodigtique, en matire
de focalisation, il reste nanmoins au narrateur la latitude de s'en tenir strictement
ce qu'il peut percevoir directement ou intgrer dans son rcit toutes les
informations qu'il peut tenir de seconde main. C'est, comme on sait, le premier
parti qu'a choisi Knut Hamsun, de faon magistrale, dans La Faim, o le champ de
perception du hros est rduit un rapport immdiat au monde. Dans une moindre
proportion, c'est aussi le parti d'une trilogie o Knut Hamsun (dont le patronyme
est un pseudonyme, qui semble venir de sa ferme natale) se fictionnalise sous son
nom rel, Knut Pedersen : Sous l'toile d'automne (1906), Un vagabond joue en
sourdine (1909) et La Dernire joie (1912). Le narrateur Knut rduit l'angle du rcit
ce qu'il voit, entend et ressent, limitant mme les rtrospections son propre
pass. Par-l, ces narrations s'cartent considrablement du rcit
autobiographique et atteignent une sorte d'pure narrative. Ce choix modal est
pour beaucoup dans le ton si singulier de Hamsun, mlange de lyrisme et d'une
simplicit touchant parfois la platitude, qui se conserve mme dans les
traductions.
Mais si l'on excepte cette uvre sans pareille, c'est avec la narration
htrodigtique que la focalisation interne prend toute sa force, comme l'a
dfendu et illustr en acte Henri James. Dans le domaine de l'autofiction,
151
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
l'efficacit de cette formule se vrifie chez Kafka, dans Le Chteau et Le Procs,
o le reprsentant auctorial K. est dot chaque fois d'un emploi focal. Dans ces
deux rcits, le lecteur est exactement dans la situation de l'Arpenteur ou de Joseph
K. vis--vis du chteau ou du dlit. L'intensit (et le mystre) de ces deux romans
vient en grande partie de cet effacement de l'instance narrative au profit des
perceptions et des penses du protagoniste K. par qui le lecteur dcouvre au fur et
mesure de l'action une communaut et une institution dont le fonctionnement et
la nature lui chappent. Non seulement Kafka ne donne pas la clef de l'univers
singulier qu'il met en place, mais il ne laisse aucun jeu entre la dcouverte
progressive de cet univers par son personnage et le rcit qui en est fait. Aucune
distance ne permet au lecteur de hasarder une hypothse qui lui permettrait de
recontextualiser dans un horizon plus familier les rgles curieuses des
fonctionnaires du Chteau ou les rouages sinueux de la Justice du Procs. Le
lecteur est oblig de se couler pour ainsi dire dans ces univers et de suivre le
cheminement de l'histoire, le jeu des motifs et des dialogues qui se font cho, sans
disposer d'un pourquoi qui donnerait un sens au comment trs perceptible de ces
deux rcits. Il est ainsi contraint de vivre ces deux univers, de la mme manire
que Kafka vivait et exprimentait la ralit quotidienne, s'il faut en croire le portrait
de Milena :
"Pour lui, la vie est quelque chose de totalement diffrent
de ce qu'elle est pour les autres ; avant tout, l'argent, la
Bourse, le march des changes, une machine crire sont
pour lui des choses totalement mystiques (et il est vrai qu'en
ralit, elles le sont, c'est seulement pour nous autres
qu'elles ne le sont pas), ce sont l pour lui les nigmes les
plus tranges, qu'il n'approche absolument pas de la mme
faon que nous. On aurait tort de croire, par exemple, qu'il
considre son travail de fonctionnaire comme l'excution
normale, habituelle d'une charge. Pour lui, le bureau y
compris le sien - est quelque chose d'aussi nigmatique,
d'aussi digne d'admiration que l'est une locomotive pour un
petit enfant" (Cit dans Buber Neuman, 1986, pp. 92-93).
Mme s'il est impossible de donner une explication globale de l'usage de la
focalisation dans l'autofiction, on voit que cet aspect du texte est rarement
indiffrent. Personnage objet, le double auctorial s'loigne de son original et
devient une conscience opaque qui parat exister pour elle-mme. Projecteur, le
double est alors comme un guide inconscient qui soustrait le lecteur de tous ses
152
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
repres habituels et le conduit se perdre dans l'univers de la fiction. Avec cet
examen des emplois possibles de la figure auctoriale, on achve l'tude du
premier protocole de l'autofiction, son protocole nominal. On a ainsi pu voir que le
ddoublement de l'auteur dpendait d'une relation onomastique, d'un lieu
d'inscription pour cette relation et d'un support actorial. Forme, contexte, emploi,
avec les traits secondaires qu'ils commandent, sont les dterminations essentielles
de toute inscription narrative de soi. Pour crer un reprsentant de lui-mme dans
son texte tout crivain doit mettre en uvre ces paramtres.
Cette investigation ne rgle pourtant pas l'exploration du dispositif de la
fictionnalisation de soi. Demeure un second protocole non moins important. Il faut,
en effet, se pencher surtout les moyens par lesquels l'crivain a produit, exhib,
dclar son texte fictif. Bref, il reste tudier le protocole modal fictionnel de
l'autofiction. C'est l'objet de la partie suivante.
153
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
T R 0 I S I E M E P A R T I E : LE
MANTEAU DE LA FABLE
"La fiction exige que le lecteur constitue, titre d'essai,
des systmes de pertinence complexes, qui dpassent
l'horizon de sa pratique quotidienne et qui l'invitent
d'autant plus exprimenter la ralit qu'il les fonde sur
une cohrence textuelle plus grande".
K. Stierle.
154
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
1 - LE PROTOCOLE MODAL
"Que nous regarde la vie prive d'un crivain ? Je
ddaigne de tirer de l le commentaire de ses ouvrages"
Lessing.
"Ne pas dire, donc, que la fiction c'est le langage : le
tour serait trop simple, bien qu'il soit de nos jours familier"
M. Foucault.
155
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
L'intitul de cette nouvelle partie se trouve dans le Torquato Tasso de
Goethe :
"clatant et fleuri, le manteau de la fable..." (v. 691).
Sous le couvert d'une thmatique florale, trs ancienne dans la posie,
ce vers nomme la fois la chair et la saveur, le corps et le chant de la fiction.
Cette expression a paru heureuse pour dsigner tout ce qui dans la fiction la
prsente comme telle, affiche sa fictionalit, oriente dans le sens du
non-srieux l'attitude du lecteur.
Sous ce titre, on se propose donc d'examiner, tous les moyens par
lesquels un crivain peut dfinir le registre fictionnel de son texte, tous les
lments dont il dispose pour affirmer ou afficher le caractre fictif de son
uvre. En d'autres termes, il s'agit de dcrire et de comprendre toutes les
modalits de ralisation du second protocole de lecture dfinissant l'autofiction :
le protocole modal fictionnel. Tous les exemples vus jusqu'ici supposaient un tel
protocole ; sans lui, tous ces textes relveraient du genre autobiographique.
Pour des raisons videntes, il tait impossible de s'attarder sur la physionomie
de leurs protocoles modaux. Le moment est venu de consacrer toute notre
attention aux ralisations de ce protocole. Non sans, auparavant, faire une mise
au point sur la nature et la lgitimit de ce protocole modal fictionnel.
Une remarque d'abord sur le terme "modal". En linguistique, le substantif
"mode" est une catgorie grammaticale traduisant deux choses : "1) le type de
communication institu par le locuteur entre lui et son interlocuteur (statut de la
phrase) ; 2) l'attitude du sujet parlant l'gard de ses propres noncs..."
(Dubois, 1973, p. 321). Le premier sens du terme a t mis au service de la
narratologie et de la problmatique de l'nonciation littraire par Grard Genette
(1972, pp. 75, 183), pour dsigner la fois : a) tous les procds de modulation
de l'information narrative ; b) les rgimes d'nonciation propres au rcit et au
thtre (1982, p. 332 ; 1983, p. 28). Comme ces deux derniers emplois de
mode se sont largement rpandus, il importe d'viter toute possibilit de
confusion : dans ce travail, l'adjectif modal n'a aucun rapport avec ces usages
narratologique et potique. Il renvoie la seconde acceptation de la catgorie
grammaticale de mode. Il dsigne par consquent un registre de discours, la
manire dont le sujet d'nonciation envisage son discours, l'attitude qu'il adopte
envers ses propres noncs. Par suite, il est en relation moins avec les
156
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
modalits de la reprsentation littraire qu'avec sa modalisation, c'est--dire
l'ensemble des marques qui permettent de percevoir l'adhsion ou la
non-adhsion du locuteur son nonciation.
Cette catgorie de modalisation est prcieuse parce qu'elle permet, par
homologie, de systmatiser et de dvelopper des observations intuitives que
l'on ne peut manquer de faire au contact des textes - sur la manire dont ces
derniers exposent leur registre de lecture, leur statut discursif. Le Dictionnaire
de linguistique de Jean Dubois dfinit cette catgorie de la faon suivante :
"Dans la problmatique de l'nonciation (acte de
production du texte par le sujet parlant), la modalisation
dfinit la marque donne par le sujet son nonc ().
Le concept de modalisation sert l'analyse des moyens
utiliss pour traduire le procs d'nonciation. L'adhsion
du locuteur son discours est ressentie par l'interlocuteur
tantt comme souligne, tantt comme allant de soi,
tantt en baisse (...). Le concept de modalisation permet
de rendre compte de la perception par l'interlocuteur du
fait que l'orateur croit, tient ce qu'il dit. La modalisation
est du domaine du contenu : une ou plusieurs phrases, un
"tat" du discours, sont ressentis comme comportant un
certain degr d'adhsion du sujet son discours. Le
paradoxe de la thorie de l'nonciation reste que cette
ligne continue de la modalisation se ralise dans le
discours par des lments discrets" (Dubois, 1973, pp.
319-320).
Mme si les transferts de la linguistique la potique ont toujours
quelque chose de prilleux, mme si un texte littraire ne prsente pas les
mmes proprits qu'un nonc linguistique, la notion de protocole modal ne
peut que s'enrichir dtre pense partir de cette analyse, qui permet d'avancer
les propositions suivantes :
-1. la notion de protocole modal permet de cerner la perception qu'a le
lecteur du registre dnonciation d'une uvre littraire, de sa place dans l'ordre
du discours, de sa valeur de vrit ;
- 2. le propre de ce protocole est de modaliser le texte, c'est--dire de
traduire l'attitude de l'crivain par rapport son discours. Dans le cas d'une
fiction, l'auteur ne croit pas son propos, n'assume pas ce qu'il dit et exprime
cette non-adhsion par des proprits discursives spcifiques ;
157
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- 3. Ces proprits, marques de la modalisation, sont des lments
discrets, mais qui valent pour la totalit de luvre. Il faut les concevoir sur le
modle des flexions verbales, des adverbes, des incises ou des guillemets qui
permettent un locuteur d'exposer la faon dont il envisage l'ensemble de son
nonc.
Le but de cette partie est donc de fournir un pendant ltude du
protocole nominal, d'tudier les procds par lesquels un auteur peut se
dissocier de l'histoire qu'il raconte de manire ce que le lecteur la peroive
comme fictive. Une tude des modalisateurs linguistiques consisterait dcrire
et comprendre comment un locuteur peut traduire verbalement le degr de
srieux qu'il accorde son discours. Mutatis mutandis, cette tude va chercher
examiner les modalisateurs littraires de fiction, les procds modalisants
valeur fictionnelle qui ont cours en littrature. On voit d'emble quels peuvent
tre ces procds : l'indication gnrique "roman", un avertissement du type
"Toute ressemblance..." une prface affirmant le caractre imaginaire du texte,
l'intervention dans l'histoire de forces surnaturelles etc. Tous ces procds
constituent autant de moyens de signifier qu'un texte est fictif, que son contenu
est irrel, qu'il ne s'agit pas d'un Tmoignage, de Mmoires, d'un Journal
intime, d'un Autoportrait etc.
Les modalisateurs littraires manifestent, ainsi, une des grandes
dichotomies qui commandent l'espace littraire : l'opposition fiction vs
rfrentiel. C'est une opposition qui transcende la classification en genre,
comme celles qui dpartagent la littrature en prose et en posie, en narration
et thtre. Ces oppositions sont si fondamentales et si gnrales qu'aucun
lecteur, ft-il le plus botien, ne peut les ignorer. Sensibles par les proprits
discursives propres chaque forme, registre ou mode, elles commandent des
types de lecture, des comportements culturels et jusqu' des investissements
sociaux et conomiques diffrents.
Naturellement, les frontires de ces partages ne sont pas immuables, ne
sont pas fixes une fois pour toutes. Historiquement, elles ont boug, elles se
sont dplaces et transformes. Ce ne sont pas des dlimitations logiques, des
normes intemporelles. Entre la posie et la prose, par exemple, il n'y a pas une
diffrence de substance qui interdirait jamais de les confondre. On sait que
leur frontire s'est considrablement dplace depuis le XVIIe sicle. La posie
a ainsi connu une extension de son contenu virtuel et une rduction de sa
158
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dfinition en comprhension. Il en est de mme pour les autres oppositions qui
ont connu de profonds bouleversements depuis la fin du XIXe sicle. Ainsi,
dans le domaine de l'autobiographie, les uvres de ces dernires dcennies
avec lesquels il faut compter - en France, on peut citer Queneau, Perec, Butor,
Sarraute, Leiris, Barthes - sont des textes o l'criture de soi se dploie
travers ou proximit de la fiction, dans un usage de l'criture qui bouleverse le
rapport avec le Rfrent et la division traditionnelle entre le vcu et l'invention.
De cette variabilit historique, des importantes redistributions
contemporaines de ces grands partages littraires, on en a parfois conclu qu'ils
n'avaient plus cours notre poque ; que la littrature moderne s'tait
dbarrasse de ces divisions comme d'autant de conventions inutiles, voire
nfastes pour la crativit des crivains. Ce refus des grandes divisions
littraires s'est accompagn la mme poque d'une critique radicale de la
notion de genre, comprise comme une catgorie tout aussi inutile,
historiquement dpasse, ayant perdu toute pertinence dans le cadre de la
modernit. Le propre de notre temps serait d'ignorer toute sparation gnrique
et, en-de, toute limite entre les pratiques littraires pour viser une sorte de
littrature totale, absolue, qui comprendrait tous les genres et toutes les
pratiques, qui intgrerait toutes les diffrences et toutes les proprits
discursives (Todorov, 1978, p. 44).
Cette affirmation et cette prsentation de la littrature moderne constitue
une objection srieuse l'tude de notre protocole modal. Dans cette
perspective, la dichotomie fiction vs non-fiction, comme bien d'autres, n'a plus
de sens. Certes, ce type de discours sur la littrature a perdu de sa force dans
la dernire dcennie du fait du dveloppement de l'tude des genres, de la
rception littraire, de l'acte de lecture. Nanmoins, il a tendance tre ractiv
dans le cas de l'autofiction. Une des raisons qui concourent sa
mconnaissance est justement que ce "discours de la neutralisation". (D. Oster)
trouve l une nouvelle jeunesse, parfois l'insu de ses usagers eux-mmes. Il
est donc ncessaire d'examiner ce "discours de la neutralisation" afin de voir si
rellement il rend notre opposition anachronique. Bien entendu, il n'est pas
question d'envisager sa pertinence pour toutes les oppositions qui,
traditionnellement, organisent le champ littraire : chercher si les frontires
entre le thtre et le rcit, la posie et la prose, existent encore vritablement
aujourd'hui nous conduirait trop loin de notre sujet. Nous nous limiterons
159
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
considrer les aspects de cette argumentation qui concerne l'opposition entre la
littrature de fiction et la littrature rfrentielle.
Notons pour commencer que ce discours sur la littrature n'est pas
homogne. Il est mme tenu par des crivains, des critiques et des thoriciens
de la littrature de famille bien diffrente et pour des enjeux qui ne sont pas
identiques. Dans cette varit, il semble toutefois que l'on puisse distinguer
deux vulgates, deux vulgates qui ont eu chacune leurs heures de gloire et qui
demeurent encore florissantes, l'une de faon diffuse, l'autre de faon plus
circonscrite. Apparemment, tout les distingue : horizon idologique, conception
de la littrature et de sa fonction. Elles ont pourtant en commun la ngation du
partage de la littrature entre fiction et non-fiction ; et plus gnralement, la
remise en cause de toute distribution ou classification d'ordre gnrique. Pour
relever la prsentation de ces deux vulgates, on donnera chacune d'elle un
dieu, sa divinit protectrice en quelque sorte, et un mot dordre, sa devise si lon
veut.
A - Oras ou le "parti-pris des choses"
Dans le Second Faust, Oras est un dieu qui a les apparences d'un
rocher, symbolise la matire et se "prvaut de sa qualit pour mpriser les rives
de potes et les fantmes des ges vanouis" (Nerval). Il peut servir de dieu
tutlaire cette vulgate, car ce qui la caractrise c'est de procder envers
l'ensemble de la littrature une sorte d'inflation rfrentielle, de pratiquer une
rduction prosaque de la fiction. Pour elle, la littrature ne vaut que pour son
extriorit, par son dehors.
Les origines de cette vulgate ? La fin du XVIIIe et le XIXe sicle ; des
considrations et des thories dveloppes par Madame de Stal, Taine,
Renan, Sainte-Beuve -, systmatises et souvent durcies par des pigones.
Aujourd'hui, on aurait du mal trouver les propositions de cette vulgate
formules de manire mthodique et cohrente ; plus personne n'aurait
l'intrpidit de publier ces Physiologie des crivains et des Artistes ou ces Essai
de Critique naturelle, qui faisaient flors et que le sicle pass a emport avec
lui. Toutefois, cette vulgate se retrouve de faon diffuse dans les propos du
grand public, dans la critique mondaine, dans les discours acadmiques et
dans les rflexions de certains (bons) crivains.
160
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
L'ide essentielle et principielle de cette vulgate, c'est qu'un crivain
n'crit jamais que sur lui-mme, qu'il est toujours son personnage principal,
quels que soient les masques ou les dguisements qu'il peut emprunter. La
nature de ce "soi" exprim est susceptible, bien sr, de dfinitions varies. Il
peut s'agir, tour tour ou la fois, de la race, du sol, du climat, de l'poque, du
sang, de la parent, de la vie, de la destine, du caractre, de l'humeur, de la
complexion - sans oublier pour certains cette "monade inexprimable"
(Sainte-Beuve) qui fait le mystre du gnie. Pour reprendre les trois grands
critiques franais du XIXe sicle, chacun mettait l'accent sur l'aspect qui lui tait
le plus cher Sainte-Beuve sur l'homme, Taine sur le milieu, Renan sur l'histoire.
Mais l'essentiel est qu'en fin de compte, luvre renvoie toujours un dehors
qui la dpasse et qui lui donne toute sa signification. Ds lors, les diffrences
gnriques ou formelles des textes sont perues comme secondaires, quand
elles ne sont pas juges superflues.
Soit le cas de Sainte-Beuve. Ce n'est pas un hasard s'il mprise la
rhtorique et se mfie des surfaces textuelles, demande qu'on juge l'abeille
son travail et non son miel. Au fond, les moyens mis en uvre par un crivain
lui paraissent accessoires. L'important, c'est son "caractre", le fond de sa
personnalit qui marque toute son uvre. Sans doute, l'auteur des Causeries
du Lundi est-il conscient des lignes de dmarcation qui sparent les diffrents
genres, des frontires qui distinguent les grandes formes de la reprsentation
littraire, des registres distincts qu'un crivain peut choisir pour crire. Il y a
mme de belles pages de sa plume sur la manire dont un crivain se fait une
place dans la littrature de son temps en cherchant dvelopper et exploiter
des formes ou des genres que ses ans ont nglig. Mais cette ralit n'est
pas pour lui primordiale. Plus vital ses yeux est le fait que la littrature est
l'affaire d'individualits qui portent en elles une "qualit secrte et essentielle",
qui la forgent et l'expriment travers les genres et les formes qui s'y prtent.
Bref, il y a dj chez Sainte-Beuve l'ide que les classifications littraires
importent peu, comme en tmoigne ce passage extrait d'un article sur
Chateaubriand, o il fait le point sur sa "mthode" :
"De mme qu'on peut changer d'opinion bien des fois
dans sa vie, mais qu'on garde son caractre, de mme on
peut changer de genre sans modifier essentiellement sa
manire. La plupart des talents n'ont qu'un seul et mme
procd qu'ils ne font que transposer, en changeant de
sujet et mme de genre. Les esprits suprieurs ont plutt
161
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
un cachet qui se marque un coin ; chez les autres, c'est
un moule qui s'applique indiffremment et se rpte"
(1862, p. 218).
(Le "cachet" de Chateaubriand, par exemple, serait d'tre un "picurien
qui a l'imagination catholique"). Dans ces lignes, on voit bien comment, partir
de Sainte-Beuve' et de quelques autres, la littrature s'est vue rduite une
fonction d'expression. De proche en proche, en liaison avec la rorganisation
du champ littraire qui se fait la fin du XIXe sicle, il va s'oprer comme une
dsaffection plus ou moins prononce envers la spcificit des formes qu'utilise
un crivain.
Cette dsaffection va trouver sa forme hyperbolique dans lesthtique de
Croce, qui ne verra dans les genres et les formes d'expression qu'une part
ngligeable de la cration artistique. Dans son Estetica (1902), Croce dfendra
avec force l'ide que chaque uvre d'art est singulire, rsultat d'une "intuition"
cratrice unique, excentrique toute tradition, tout modle et toute
classification. Cette ide aura un grand retentissement durant le premier quart
du XXe sicle et ne contribuera pas peu dvaloriser la notion de genre.
Consquence de cette vulgate du "parti-pris des choses" : toute uvre
est rfrentielle, tout texte est autobiographique, quels que soient son registre
de lecture, son rgime d'nonciation ou son mode de reprsentation. Non
seulement les diffrences gnriques s'estompent, mais la frontire qui spare
un autoportrait d'une pice de thtre, le registre intime du registre fictif, est
dclare superficielle. On trouve ainsi rpandue un peu partout une sorte de
thorie spontane de la littrature selon laquelle un crivain, de toute faon, ne
parle jamais que de lui-mme, de son existence, de ses tats d'me etc. Dans
chaque texte littraire, un "je biographique" serait ainsi implicitement prsent.
La seule diffrence reconnue entre les registres de lecture, entre la fiction et la
non-fiction, est dans la part de transposition labore par l'auteur - et par
consquent, le travail hermneutique exig du lecteur pour atteindre le sens
d'un texte.
B - Thoth ou le "compte-tenu des mots"
Thoth est, chez les gyptiens, le dieu dont l'ombre bienveillante s'tend
sur les bibliothques : "Thoth, dieu des bibliothques, un dieu oiseau,
couronne lunaire" (Joyce). Il peut servir de divinit protectrice cette seconde
162
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
vulgate, comme le mot de Ponge pourrait tre sa devise, parce que celle-ci ne
croit qu'aux livres, fait du langage et de la littrature la seule ralit qui compte
pour un crivain. A rebours de la prcdente, elle occulte les catgories de
genre, de mode, de registre d'nonciation partir d'une dfinition tautologique
de la littrature, dcrite comme un espace qui ne renvoie qu' lui-mme. Au
contraire de l'autre vulgate, c'est donc par un mouvement centripte, par une
attitude dflationniste envers la rfrentialit que toute diffrenciation gnrique
ou modale est nie.
Curieusement, cette vulgate s'affirme peu prs la mme poque que
son homologue rfrentiel : la fin du XVIIIe sicle. Mais ses origines sont
mieux connues, parce qu'elles sont circonscrites au Romantisme allemand. De
mme, son volution est plus facile suivre : on peut la voir se dvelopper et
s'enrichir travers les rflexions critiques de Baudelaire, de Mallarm, de
Blanchot, de Barthes ou, pour ses derniers reprsentants, du groupe Tel Quel
et de Ricardou. Cette vulgate connat, elle aussi, des formulations diverses et
qui prsentent des nuances parfois considrables. Ainsi, le groupe Tel Quel ou
Ricardou en montrent-ils deux versions extrmistes dans lesquelles un Novalis
ne se serait sans doute pas reconnu. De plus, cette vulgate a conserv une
consistance plus grande, sans doute parce qu'elle s'est moins diffuse.
Son ide cardinale et sminale trouve sa meilleure formulation dans le
mot fameux de Novalis : Die posie ist das cht absolut Reelle, "La Posie est
le Rel vritable", o le terme de "posie" dsigne bien entendu la littrature.
Avec cette phrase, Novalis donne pour ainsi dire le noyau dur de la doxa
romantique : la littrature est l'tre lui-mme, l'unit retrouve des mots et des
choses. A partir de l, la littrature ne saurait avoir de dehors, d'extriorit qui
viendrait la limiter et lui donner son sens : c'est une activit "autotlique" (T.
Todorov). Elle ne peut non plus tre gnrique, faute de quoi elle ne serait pas
la ralisation de l'tre dans sa plnitude : le Roman o la littrature atteint son
achvement contient tous les genres (Schaeffer, 1983, p. 39).
Prs d'un sicle plus tard, en des termes diffrents, Roland Barthes
retrouve dans un article clbre la mme argumentation. D'abord, l'intransitivit
de la littrature qui est prsente comme un postulat de base :
l'crivain est un homme qui absorbe radicalement
le pourquoi du monde dans un comment crire (...) le rel
163
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ne lui est jamais qu'un prtexte (pour l'crivain, crire est
un verbe intransitif)" (Barthes, 1960, pp. 148-149).
Ensuite, l'unit organique qui en dcoule et qui fait que l'crivain n'a pas
droit au "tmoignage" :
" en s'identifiant une parole, l'crivain perd tout
droit de reprise sur la vrit, car le langage est
prcisment cette structure dont la fin mme (...) est de
neutraliser le vrai et le faux" (pp. 149-150).
C'est naturellement cette dernire consquence qui est la plus
dommageable pour notre projet. Elle a pour effet de faire de la littrature un
espace homogne, transmodal et finalement univoque, vaste plage sans
dpression ni relief. Elle permet de condamner les genres et les modalisations
comme autant de dcoupages acadmiques et idologiques. Maurice Blanchot,
dans des pages souvent cites, a formul cette critique comme une exigence
commande par la vritable destination de la littrature :
"Seul importe le livre, tel qu'il est, loin des genres, en
dehors des rubriques, prose, posie, roman, tmoignage,
sous lesquelles il refuse de se ranger et auxquelles il
dnie le pouvoir de lui fixer sa place et de dterminer sa
forme. Un livre n'appartient plus un genre, tout livre
relve de la seule littrature, comme si celle-ci dtenait
par avance, dans leur gnralit, les secrets et les
formules qui permettent seuls de donner ce qui s'crit
ralit de livre. Tout se passerait donc comme si, les
genres s'tant dissips, la littrature s'affirmait seule,
brillait seule dans la clart mystrieuse qu'elle propage et
que chaque cration littraire lui renvoie en la multipliant -
comme s'il y avait une essence de la littrature" (1959, pp.
243-244).
Si la littrature est seulement une activit autonyme et auto-rfrentielle,
qui se conserve par l'entretien de sa propre fiction d'exister, elle ne peut en effet
laisser place aucune catgorie diffrencie, aucune pratique qui se
distinguerait en son sein. La possibilit d'une telle diffrenciation serait le signe
que la littrature n'est pas seulement une activit tourne vers elle-mme, mais
qu'elle a aussi affaire autre chose qu'elle-mme. Or, prcisment, il s'agit,
pour cette vulgate, d'affirmer avant tout cette intransitivit littraire, de refuser
164
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
toute extriorit la littrature. Partant, il n'est pas concevable qu'il existe une
catgorie de textes qui traverse ce renfermement sur soi pour introduire une
note intime, personnelle, relle, dans la littrature. Au nom de la littrature, voici
donc une nouvelle attitude ngative envers l'opposition fiction vs non fiction,
attitude qui a encore pour rsultat d'enlever toute pertinence la catgorie
d'autofiction.
C - Examen critique des deux vulgates
Malgr tout ce qui les oppose, malgr le fait qu'elles reprsentent deux
attitudes antagonistes envers la littrature, ces deux vulgates se retrouvent
donc dans la ngation de l'opposition rcit imaginaire vs rcit vridique et, plus
gnralement, de tout partage catgoriel de la chose littraire. Dans le cadre de
ces deux grandes formes de conscience critique, la notion d'autofiction est par
suite impensable. Pour la premire de ces vulgates, qui ne conoit la littrature
que comme expression de soi, l'ide d'une fiction de soi n'a pas de sens ; il ne
peut s'agir que d'une transposition de soi, comme dans le roman
autobiographique. Pour l'autre, pour qui toute littrature est par nature
fictionnelle, qui ne conoit pas l'criture de soi en dehors de la fiction, la
reprsentation d'un crivain par lui-mme ne peut tre que fictive ; comme l'est,
selon elle, toute autobiographie, quand bien mme son auteur multiplierait les
dclarations d'intention et les gages de bonne foi. Par assimilation ou par
exclusion, par gnralisation abusive ou par marginalisation, le principe de la
fictionnalisation de soi est ainsi vid de tout contenu heuristique.
Il n'est pas question de se livrer une critique en rgle des prsupposs
et des propositions de chacune de ces vulgates. Cette critique a dj t faite
par d'autres ailleurs. C'est seulement la communaut de leur mconnaissance
et de leur refus, pour autant qu'elle interdit toute tude de l'autofiction, qui
intresse ce propos. On se limitera donc montrer que ces deux vulgates
conduisent une mme conception rductrice des textes littraires, la mme
occultation de catgories littraires essentielles, et l'on tentera d'avancer une
explication ces exclusions.
Partons de la conception du texte littraire sous entendue par ces deux
vulgates. Dans les deux cas, le texte est rduit une surface ; il n'a pas de
volume, n'est pas un livre qui occupe une certaine position discursive, dont la
reconnaissance est au fondement de la participation du lecteur.
165
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
A les suivre, une uvre ne chercherait pas obtenir certains effets
discursifs , ou plutt n'en aurait pas besoin puisqu'elle ne produit au fond qu'un
type d'effet : intime pour l'une, spculaire pour l'autre. Qui ne voit pourtant que
la littrature offre des possibilits bien plus nombreuses, auxquelles les textes
ne manquent pas de recourir et qu'ils n'oublient pas de prsenter pour stimuler
en ce sens le lecteur. L'opposition fiction vs non-fiction est une division qui est
l'origine d'une partie de ces effets. Supprimer l'un de ces grands registres, c'est
amputer foule d'ouvrages qui s'efforcent de s'y rattacher par des mcanismes
pragmatiques spcifiques. Un roman, par exemple, se donne tous les signaux
conventionnels qui permettent d'identifier le genre romanesque. Quand bien
mme ce roman chercherait redfinir son genre, ce qui le conduirait
remodeler les signes distinctifs du roman, il conserverait avec la tradition
romanesque et ses indices pragmatiques une parent assez grande pour que
cette filiation soit sensible? Faute de quoi son originalit serait insensible et sa
dmarche incomprhensible. Or, par exclusion ou par gnralisation, ces deux
vulgates en arrivent supprimer cet aspect d'une uvre, faire l'conomie de
ces proprits pragmatiques par lesquelles un texte cherche agir sur son
lecteur, "programmer" en partie sa lecture. Pour elles, un texte n'oriente pas
son dchiffrement, il a une nature qui lui commande de raliser sa vritable
destination. Ces deux vulgates supposent par consquent une vision rductrice
des textes littraires, une vision o les textes n'auraient qu'un contenu
prdtermin, quil ne chercherait pas modeler d'une faon ou d'une autre.
Non moins grave est la prtention concomitante de ces deux vulgates
nier l'existence de catgories fondamentales pour les lecteurs et les crivains,
pour la lecture et lcriture littraires. Il faut bien tre conscient, avec H.R.
Jauss, qu on ne saurait imaginer une uvre littraire qui se placerait dans une
sorte de vide d'information et ne dpendrait pas d'une situation spcifique de la
comprhension (...) toute uvre suppose l'horizon d'une attente, c'est--dire un
ensemble de rgles prexistant pour orienter la comprhension du lecteur (du
public) et lui permettre une rception..." (1970, p. 82). L'opposition fiction vs
non-fiction relve prcisment de cet "ensemble de rgles". Elle fait mme
partie de ces catgories transcendantales, dont la transformation historique est
trs lente, qui permettent l'apprentissage de la littrature. Pour le lecteur,
aucune uvre n'est saisie de faon totalement isole, en dehors de toute
rfrence culturelle et littraire. S'il peroit et comprend des textes littraires,
c'est qu'il dispose d'un fonds cognitif minimal sur la littrature, qui est structur
166
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
entre autres par notre opposition. Sans ce grand partage, on voit mal sur quel
socle s'tablirait sa comptence de lecteur, comment mme il distinguerait la
littrature des autres types de discours. De mme, aucun auteur ne peut
ignorer cette grande dichotomie quand il crit. Il peut bien tenter de la
transgresser ou de la brouiller, c'est sur l'horizon de son existence la fois
discursive, culturelle, sociale et conomique qu'il doit le faire. C'est mme
l'existence et le poids de ce type de catgorie transcendantale qui le conduit
parfois tenter de renouveler leurs frontires, comme Baudelaire tentant de
dplacer la dichotomie prose vs posie avec le pome en prose. Aussi bien, les
romans du groupe Tel quel n'ont pu pratiquer une littrature amodal ou neutre
qu'au prix d'un discours d'escorte plthorique et de justifications infinies, mme
quand elles prenaient le chemin de la Provocation. Cet exemple montre que
mme une uvre originale doit se situer par rapport la division fiction vs
non-fiction. Tout crivain qui prtend uvrer contre elle doit non seulement la
mettre en cause mais aussi s'adosser elle, pour prparer le lecteur accepter
toute la nouveaut de son travail.
Comment ds lors expliquer que ces deux vulgates aient pu s'aveugler si
longtemps sur la ralit du partage entre le registre imaginaire et le registre
intime ? Sans doute, parce qu'elles ont toutes deux manqu une dimension
essentielle de l'activit littraire : la lecture. Il est quand mme frappant de
constater qu'aucune des deux n'accorde une place significative au lecteur,
l'acte de la lecture et aux protocoles qui inscrivent cette lecture dans luvre. Si
l'on se fie leurs descriptions, l'essentiel de la littrature se passe soit au ple
de la cration littraire, soit au sein de luvre ; peu de choses dans l'accueil ou
dans l'apprhension du lecteur. La finalit mme de leur dmarche les
poussent majorer un aspect de la littrature qui, par contre-coup, leur voile un
autre aspect, non moins important. Sans doute aussi est-ce parce que l'enjeu
rel de ces deux vulgates est moins d'arriver une thorie quilibre de la
littrature que de fonder une utopie littraire permettant de s'assurer de la
matrise des conditions de rception et de production des textes un moment
donn. Mais peut-tre est-ce le destin de toute tradition critique, peut-tre
mme la condition de sa fcondit.
Quoi qu'il en soit, il nous faut prendre acte de la ncessit de faire son
deuil de ces deux vulgates. Pour tudier l'autofiction, et se tenir au plus prs de
la ralit littraire, Il faut concevoir la littrature comme un espace qui n'est pas
167
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
homogne, dont l'htrognit tient l'existence de catgories multiples, qui
sont autant de normes ou de conventions dfinissant et spcifiant le systme
de lisibilit d'une poque donne. Parmi ces catgories, la dichotomie fiction vs
non-fiction joue, aujourd'hui encore, un rle essentiel dans notre conscience
littraire. Si la pratique de l'autofiction a un sens, c'est sur le socle de cette
dichotomie qu'il convient de la penser. On va d'ailleurs le vrifier en tudiant les
moyens pour un texte de se prsenter comme fictif.
168
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
2 - DES MODALISATEURS FICTIONNELS
PARATEXTUELS
"La marge, c'est ce qui tient la page"
J.L. Godard.
169
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
On a vu qu'il tait possible de concevoir la fictionalit d'une uvre
littraire sur le modle de la modalisation linguistique, comme l'actualisation
d'lments manifestant le caractre non srieux d'une nonciation. Il s'agit
maintenant d'entrer dans le dtail du fonctionnement d'une fiction en mettant
jour ces lments.
Ces lments sont envisager, comme on l'a vu aussi, par homologie
avec les modalisateurs verbaux, avec "les moyens par lesquels un locuteur
manifeste la manire dont il envisage son propre nonc ; par exemple, les
adverbes peut-tre, sans doute, les incises ce que je crois, selon moi etc.,
indiquent que l'nonc n'est pas entirement assum ou que l'assertion est
limite une certaine relation entre le sujet et son discours" (J. Dubois, 19739
p. 318). Cette homologie autorise. penser que les marques de la fictionalit :
a) ne sont pas chercher ailleurs que dans les uvres littraires elles-mmes,
dans une comparaison avec la ralit par exemple, b) qu'elles sont isolables.
Comme pour le protocole nominal, on cherchera ces traits fictionnels
d'abord dans le paratexte, en commerant par l'pitexte. Leur prsence dans le
texte d'une uvre littraire sera examine dans le chapitre suivant.
I. MODALISATEURS EPITEXTUELS
L'pitexte peut-il lui seul dterminer le statut d'une uvre ? Les
dclarations publiques ou prives de l'crivain sur son uvre peuvent-elles
constituer un protocole modal ? De mme que ces dclarations ne se prtaient
pas la mise en place d'un protocole nominal, on voit mal comment elles
pourraient elles seules dfinir le registre d'une uvre.
Imaginons un texte publi sans que son genre ne soit dfini, bien que
l'crivain en soit l'un des personnages. Un tel ouvrage sera forcment lu de
faon rfrentielle, comme une uvre autobiographique. Les habitudes de
lecture contemporaines sont ainsi faites que le public opre toujours
spontanment une indexation biographique d'une uvre o l'auteur s'est
reprsent. Si par la suite l'crivain dclare que son texte est une fiction, cette
dclaration n'abolira pas la situation de fait tablie. Elle rendra le livre ambigu
ou contradictoire, mais ne russira pas redfinir compltement son statut.
170
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Cette impossibilit est encore plus vidente dans le cas de figure o
luvre possde dj un registre dfini, mme si c'est de faon complexe.
Bourlinguer permet de le vrifier. Publi en 1948 avec l'indication gnrique
"souvenirs", cet ouvrage de Cendrars se prsente effectivement comme un
recueil de souvenirs, organis en fonction de villes-phares pour la mmoire
cendrarsienne. Certes, quelques rflexions, allusions ou motifs peuvent donner
penser un lecteur attentif que le pass relat est fortement retouch. Mais
enfin, l'pigraphe de ce livre est emprunte Montaigne et l'ouvrage ne
manque pas de suivre tous les passages obligs de l'criture de soi. En
particulier, le regard rtrospectif que l'on porte sur l'ensemble de sa vie, afin d'y
distinguer une cohrence :
" je partage ma vie en deux sries, mes aventures
en Occident (les trois Amriques), mes aventures en
Orient (en Chine, o j'ai fait mes dbuts)..." (o.c. t. 6,
p.157).
Pourtant, quelques annes plus tard, dans des entretiens avec Michel
Manoll, publi sous le titre Blaise Cendrars vous parle, Cendrars opposera un
dmenti formel cette affirmation. Alors que Manoll tente de l'utiliser pour sa
biographie, Cendrars lui rplique :
"Ce sont des choses que l'on dit quand on raconte des
histoires... pour mettre un peu d'ordre dans sa propre
existence. Mais ma vie n'a jamais t coupe en deux. Ca
serait trop commode, tout le monde pourrait couper sa vie
en deux, en quatre, en huit, en douze, en seize" (o.c., t. 8,
p. 543).
Notons qu'il ne s'agit pas d'une simple rtractation. Ce dsaveu a des
consquences plus importantes. Il dpasse la simple mise au point, le retour
sur une affirmation un peu aventure. En un raccourci formidable, c'est toute sa
manire d'crire, son rapport la fiction et l'autobiographie, que donne ici
Cendrars, en mme temps qu'il apporte un nouvel clairage Bourlinguer.
Impossible partir de l de lire ce livre comme un recueil de souvenirs ordinaire
; impossible aussi de classer luvre de Cendrars dans la simple catgorie des
autobiographies. L'important, pour lui, est d'abord de raconter des "histoires",
de faire uvre de narrateur, quitte utiliser sa vie parce qu'elle fournit un
matriel prcieux et parce que le lecteur croira d'autant plus l'histoire qu'on lui
donnera - l'occasion de penser qu'elle est relle, vcue. Mais ce dmenti ne
supprime pas pour autant le passage cit de Bourlinguer, il ne transforme pas
171
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
soudainement cet ouvrage en une fiction ordinaire, il vient s'y ajouter pour le
relativiser, pour situer cette uvre distance tant de la fiction que de
l'autobiographie, dans un registre difficile dfinir, qui n'est pas exacte ment
celui de l'autofiction, que l'on retrouve chez Restif ou chez Loti, o par toute une
stratgie de reprises contradictoires et de retournements, l'auteur se
fictionnalise sans l'affirmer clairement, tout en apportant au lecteur assez
d'lments pour qu'il doute de la vracit des faits rapports.
D'une faon gnrale, l'pitexte peut ainsi compliquer passablement le
protocole modal d'une uvre, mais il n'est pas mme de le modifier ou de s'y
substituer totalement. Par contre, il est trs utile pour confirmer ou spcifier un
registre de lecture dj tabli par luvre. C'est particulirement important pour
l'autofiction qui, on l'a dj not, ne dispose pas vraiment d'un "horizon
d'attente" propre.
Le dveloppement actuel de la forme de l'entretien et de l'interview tend
naturellement faciliter la possibilit de cette fonction d'emphases Ces
rencontres, dbats, interviews, entretiens, sances de ddicace, auxquels un
crivain doit se plier lors de la sortie d'un ouvrage, peuvent tre l'occasion pour
lui d'insister sur la dimension fictive de son texte, de doubler et d'expliciter par
la parole le dispositif d'nonciation de son livre. D'autant que la premire
question des journalistes (en particulier de la radio ou de la tlvision) consiste
souvent demander l'crivain quelle est la part d'exprience
autobiographique que recle son ouvrage. En un sens, si la vulgate "Thoth" est
plutt l'apanage de l'Universit, la vulgate "Gras" est davantage celle de la
presse littraire du grand publics. Ce faisant, les journalistes traduisent en
partie une attente du public ; mais ils la fabriquent aussi. Il n'est donc pas
tonnant qu'un ouvrage qui se donne comme une fiction alors que son auteur
est aussi l'un des personnages, veille cette sempiternelle question.
Ainsi, le 25 fvrier 1981, dans le cadre de lutilisation tlvise "La
Rage de lire", l'une des premires questions poses Maris Vargas Llosa sur
son livre La Tante Julia et le scribouillard, qui venait d'tre traduit en franais,
avait pour objet la dimension autobiographique de ce roman. Elle lui a permis
de prciser que seul le rcit de l'amour de son hros (qui porte son nom) pour
sa tante tait vrai, bien qu'il ait t profondment travaill et que l'pisode des
Noces soit invent par exemple. Tout ce qui porte sur le Balzac du
feuilleton-radio, Petro Camacho, serait ainsi fictif, mme s'il est inspir d'un
172
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
auteur rel, qui sombra aussi dans la folie. Vargos Llosa a en outre apport une
information qui ne manque pas d'intrt pour comprendre la pratique de
l'autofiction : l'ide et le besoin de reprsenter fictivement un pisode de sa vie
ne lui serait venu qu'aprs avoir commenc l'histoire d'un auteur de
mlodrames radiophoniques qui devenait fou force de produire et qui se
mettait emmler toutes les intrigues et tous les personnages qu'il menait de
front. C'est parce que son rcit commenait devenir compltement irrel, que
les niveaux de sa narration s'emballaient sans qu'il arrive s'y retrouver, qu'il a
senti la ncessit de pallier cet affolement "metaleptique" en mettant en
scne sa vie la radio de Lima, cet amour de jeunesse et son entourage
familial.
Cette bauche d'analyse de Vargos Llosa est l'une des rares explications
explicites et prcises que l'on possde sur l'utilisation du dispositif autofictif.
Comme on l'a dj signaler, la fonction de connaissance que remplit ailleurs
l'pitexte, est curieusement laisse l'abandon dans la pratique de l'autofiction.
Peu d'crivains ont pu ou voulu apporter des renseignements explicites sur le
pourquoi de cette fictionnalisation de soi.
II. MODALISATEURS PERITEXTUELS
Comme pour le protocole nominal, les entours immdiats du texte sont
plus appropris que ses prolongements pitextuels pour mettre en place un
protocole modal.
Cet entourage pritextuel ne se limite pas celui dcid par l'auteur. Il
ne faut pas ngliger le pritexte allographe, ditorial, qui parfois peut orienter la
lecture de faon importante. voquons quelques effets possibles de cette
modalisation ditoriale :
- l'effet-collection : il existe chez certains diteurs des collections qui ne
publient que des ouvrages de fiction, avec une prsentation et un format
identiques. Publier un ouvrage dans ces collections, c'est le classer comme
fictif, quel que soit son contenu ;
- l'effet-oeuvre complte : certains regroupements oprs par l'diteur
peuvent produire une indication gnrique implicite. Ainsi, la collection
"Bibliothque de la Pliade" chez Gallimard o les textes sont rassembls en
"Oeuvre romanesque", "Thtre", "crits intimes" etc. ;
173
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- l'effet-dition savante : l'appareil critique de certains textes influent;
indiscutablement sur la lecture. Il n'est pas indiffrent de lire Cline dans la
"Pliade" plutt qu'en dition de poche. Dans cette collection, ses romans sont
accompagns d'tudes d'Henri Godard intitules "Les donnes de
l'exprience". Elles permettent de suivre en dtail les modifications que Cline
apporte son pass dans les "romans" o il figue sous son nom - et de
comprendre que son projet d'criture diffre sensiblement du projet
autobiographique.
Quoique non ngligeables, ces effets ne sont toutefois pas comparables
avec ceux produits par le pritexte autographe. C'est lui le principal responsable
du protocole modal de fiction du dispositif autofictif. Les formes pritextuelles
qui peuvent en tre le support sont les suivantes :
- Le titre :
Les intituls prolixes, sur le modle du titre-sommaire de l'ge classique,
sort particulirement aptes cette fonction. Ainsi le titre d'A. Wurmser, Discours
fatalement imaginaire de mon successeur l'Acadmie franaise ; ou le second
titre, qui tient de l'indication gnrique, dj cit, de M. Aug, "Ethno-roman
d'une journe franaise considre sous l'angle des murs, de la thorie et du
bonheur".
- L'indication gnrique :
C'est le lieu par excellence de la formulation d'un protocole modal.
Mettre l'indication "roman" sur la couverture d'un ouvrage, c'est se garantir en
principe contre toute lecture rfrentielle. On sait, par exemple, que c'est Cline
qui a insist auprs des ditions Gallimard pour que cette dnomination
gnrique accompagne D'un chteau l'autre, Nord et Rigodon. De mme,
Cendrars dsignait ses recueils d"Histoires vraies" d'avant-guerre par le terme
gnrique "Nouvelles", ce qui connote sans quivoque la fictionalit - la
diffrence de "rcit".
Reste qu'il ne faut pas oublier que cet usage est relativement rcent
(Genette, 1987, pp. 89-97) ; qu'il est toujours difficile en particulier pour les
traductions, de mesurer la part prise par l'auteur dans ce geste classificatoire.
Notons aussi que peu d'crivains ont cherch crer une indication gnrique
originale, rellement utilise sur la couverture ou sur la page de titre, pour
174
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dsigner leur pratique de la fictionnalisation de soi. Seuls J. Charyn et J.
Franois l'ont tent avec les termes gnriques "Une vie romance" et "roman
de mmoires".
- La ddicace :
On ne pense gure elle pour l'exposition d'un registre de lecture. C'est
pourtant un support qui dans son rgime moderne permet une dtermination
la fois sobre et frappante. Vargos Llosa pour La Tante Julia et le scribouillard :
"A Julia Urqui di Illanes, qui nous devons tant, ce roman et moi". Cet envoi
lapidaire rsume lui seul toute l'nigme de l'autofiction : de concert, il atteste
de la vracit de l'amour relat par le texte et il affiche sa dimension
romanesque. Plus ample, le rgime classique ou romantique de la ddicace
(l'ptre ddicatoire et ses avatars) autorise une explication qui peut tre longue
et circonstancie comme on le voit dans la superbe ddicace de Nerval
Alexandre Dumas pour Les Filles de Feu - trop dveloppe pour tre cite ici,
mais qui sera juste convoque en temps voulu.
- L'pigraphe :
C'est un lieu attendu parce qu'il permet de se situer par rapport
d'autres crivains et d'autres projets d'criture. Pour son livre Joue-nous
"Espaa", Jocelyne Franois n'utilise pas moins de trois citations, afin
d'expliciter l'oscillation entre le roman et l'autobiographie qui le caractrise.
C'est d'abord une pigraphe emprunte Yves Bonnefoy pour marquer que ce
texte ne se rduit pas au vcu d'une personne, sa dimension biographique :
"L'universel n'est pas une loi, qui pour tre partout ne vaut vraiment nulle part.
L'universel a son lieu. L'universel est en chaque lieu dans le regard qu'on en
prend, l'usage qu'on en peut faire". Puis, cette phrase de Novalis, qui rappelle
que le romanesque s'enracine toujours dans un vcu : "Un roman est une vie
en livre". Une affirmation, enfin, de B. Nol, signale la part d'invention de ce
texte : "J'cris pour voir". A la lisire du texte, un mouvement de balancier entre
le vcu et la fiction s'installe ainsi, invitant le lecteur oprer une lecture bifide.
- L'avertissement :
Plus frappant qu'une prface, il permet de classer luvre dans le
registre de la fiction sans se livrer une laborieuse explication. C'est cette
forme qu'a choisie, par exemple, F.R. Bastide pour dfinir L'Enchanteur et
175
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
nous, non sans renouveler lgamment sa formulation traditionnelle. Sur la
page de garde, on peut lire : "Tout uvre d'imagination tant libre, il va de soi
que les personnages publics cits dans ce roman n'ont pu dire ce qu'ils disent,
ni agir comme ils agissent. Toute ressemblance ne serait que le rsultat d'une
improbable concidence, que l'auteur tiendrait pour involontaire".
- Le prire d'insrer :
C'est bien sr le lieu par excellence d'une dfinition gnrique pour les
textes contemporains. Sans doute, il est rarement sign, souvent allographe.
Mais si l'on carte cette difficult d'attribution, il faut bien reconnatre que c'est
le moyen le plus sr pour distinguer rapidement les autofictions parmi les
ouvrages romanesques contemporains, par exemple sur les tables des
libraires. Parce que les phnomnes de rverbration fascinent toujours, quels
que soient les domaines ils oprent, ce "petit digest coutumier de la fin"
(Cline) manque rarement de signaler un ddoublement fictionnel. Mme
quand la fictionnalisation de soi est minime, cette curiosit littraire est
pratiquement toujours note. Il serait d'ailleurs intressant de dresser un
florilge des oxynores qui sont employs pour signaler cette rflexion de
l'auteur dans sa fiction, mme s'ils sont rarement originaux ("L'auteur confond
en virtuose le rel et la vie rve", "Les mensonges font triompher le vrai de la
plus clatante manire", "L'autobiographie est recouverte, conquise par le
roman", "La confession devient impudique : c'est le risque du roman" etc.).
- La prface :
Fait curieux, ce moyen n'est presque jamais utilis pour exprimer un
protocole modal. Une des rares exceptions une notule de Herman Hesse pour
deux textes autofictifs, Enfance d'un magicien et Esquisse d'une
autobiographie, qui introduit le volume des Traumfhrte (les Voies du rve,
traduit partiellement en franais dans le recueil qui porte comme titre L'Enfance
d'un magicien) :
"Peu aprs la Premire Guerre mondiale, je tentai par
deux fois de tracer, sous la forme d'un conte
demi-humoristique, un aperu sommaire de ma vie
destin mes amis pour lesquels le cours de mon
existence tait devenu, l'poque, plus ou moins
problmatique. Celui de ces deux essais que je prfre,
Enfance d'un magicien, est rest l'tat de fragment.
176
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
L'autre, inspir de Jean-Paul, est une tentative de
"biographie conjecturale" qui anticipe l'avenir et qui parut
en 1925 dans la Neue Rundschau de Berlin. Le prsent
ouvrage en reproduit le texte, except quelques
corrections sans importance. Au cours des annes, j'ai
essay plusieurs fois de runir les deux morceaux d'une
manire ou d'une autre, cependant je n'ai pas trouv le
moyen de concilier deux textes aussi diffrents de ton et
d'atmosphre. (H.H.) .
Malgr sa brivet, cette prsentation fournit, avec la rfrence
Jean-Paul, une information d'importance pour la gnalogie de l'autofiction. Il
faudra s'en souvenir quand on tentera de tracer un historique de cette pratique
littraire.
Ce rapide inventaire appelle deux remarques.
Rappelons d'abord que les supports pritextuels privilgis pour la mise
en place d'un protocole modal sont l'indication gnrique, l'pigraphe et la
ddicace. Grande absente, la prface est rarement mise contribution pour
signaler le caractre imaginaire du texte. Si on met en corrlation ces deux
faits, un trait semble dominer l'emploi du pritexte dans l'indication du registre
fictif : l'pargne. Tout se passe comme s'il fallait indiquer rapidement qu'il
s'agissait d'une fiction, mais ne pas s'attarder sur ce choix modal pourtant
trange quand or. se reprsente soi-mme. Il est tout de mme remarquable
que des crivains utilisant systmatiquement ce dispositif comme Cline,
Cendrars, Gombrowicz eu plus rcemment Rollin, Sollers, Bastide, n'aient
jamais prsent et justifi leurs textes par un discours prfaciel. Ce silence est
naturellement mettre en rapport avec l'absence d'une tradition de l'autofiction,
qui rend malaise toute justification. Mais on peut aussi se demander si cela ne
tient pas au fait que le dispositif de l'autofiction est d'autant plus efficace qu'il
est elliptique, montr plutt qu'expliqu. Mme Nerval, qui dveloppe l'envi
les motifs de son utilisation du dispositif, ne le fait que pour rpondre un
article de Dumas, qui donnait de lui un portrait amical mais peu flatteur ("Tantt
il est le roi d'Orient Salomon () tantt il est sultan de Crime, comte
d'Abyssinie, duc d'gypte, baron de Smyrne. Un autre jour il se croit fou..."
etc.).
On notera aussi que tous ces exemples de modalisation utilisent un
support qui appartient au pritexte initial, la frange paratextuelle qui ouvre sur
177
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
le texte. Est-ce dire qu'une note en bas de page ne pourrait, par exemple
remplir un tel office ? On a pourtant une belle illustration de cette situation dans
Moravagine. Au cours de ce roman, il est question d'un trsor ayant appartenu
Moravagine. Un appel de note conduit cette explication, signe par l'auteur :
"Pour le trsor de Moravagine. Cf. Axel de Villiers de L'Isle-Adam. B.C." (o.c., t.
II, p. 271). Ce renvoi intertextuel une fiction a bien sr pour effet de draliser
l'aventure de Moravagine, qui est pourtant prsente dans la Prface comme
une histoire relle. Cette note introduit donc un facteur de complication pour le
registre de luvre ; elle ne permet pas d'tablir un protocole modal univoque. Il
semble que l'on puisse gnraliser cette description tout le pritexte central
ou terminal. La signification d'une uvre tant vectorialise, se faisant au cours
de la celle-ci que pour mourir sur l'chafaud, sans pouvoir mme donner un titre
sors tmoignage, avait pourtant trouv le moyen d'indiquer par une formule
propitiatoire le sens qu'elle donnait ce texte, en crivait sur la premire page
les mots : Appel l'impartiale postrit, qui serviront de titre la premire
dition en 1795.
Ce cas trs particulier doit nous rappeler qu'un protocole nominal ne se
suffit pas lui-mme pour donner le registre discursif d'une uvre : celui-ci doit
tre explicit, ne serait-ce que par une brve indication pritextuelle comme
celle de Mme Roland. Si cette explicitation vient manquer, le texte se trouvera
marqu d'une quivoque essentielle.
Par omission pritextuelle, un livre peut donc se placer dans un registre
indistinct, qui ne manquera pas de drouter le lecteur. Cette omission peut tre
accidentelle, mais elle peut aussi rsulter d'une dcision dlibre de l'auteur.
Un court rcit comme Giacomo Joyce de James Joyce fournit l'illustration
d'un texte au registre indistinct, pour des raisons que l'on peut supposer
indpendantes de la volont de son auteur. Rdig vers 1814, entre Portrait de
l'Artiste et Ulysse, ce bref rcit n'a jamais t publi du vivant de Joyce. Ayant
pill ce petit texte au profit de ces deux dernires uvres, il semble avoir
abandonn le projet de sa publication. Ces quinze feuillets manuscrits ne
manquent pourtant pas de charme. Nouveau Saint-Preux, Joyce s'y reprsente
en amoureux transi d'une jeune lve pleine de distinction. La narration la
premire personne est conduite de faon discontinue, dans lecture de faon
cumulative, il est ncessaire qu'une donne aussi importante que le statut
modal soit formule au seuil de luvre. Sans cette prcaution, le texte aura, un
178
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
statut ambigu. ou contradictoire, que ne russira pas modifier une
dtermination pritextuelle ultrieure.
Au reste, le pritexte est un moyen trs efficace pour rendre le registre
d'une uvre quivoque, pour troubler son statut gnrique. Si luvre ne
prsente pas un pritexte rpondant aux attentes de son poque, ne se dote
pas des signes paratextuels qui permettent d'identifier son "genre", elle ne sera
pas compltement intelligible. Selon luvre en question, le lecteur aura alors le
sentiment d'une dfectuosit ou d'un manque dlibr, qu'il doit combler par un
effort particulier de contextualisation. Le pritexte se rvle ainsi tre le moyen,
comme pour le protocole nominal, de se placer dans une aire gnrique
ambigu, soit en laissant en suspens le registre de luvre, soit en le rendant
contradictoire.
Il. 1. Protocole modal indfini.
La publication d'un rcit autobiographique se prsente ordinairement
entoure d'un halo paratextuel qui le contextualise. Que celui-ci achve une
uvre antrieure en clairant ses coulisses (autobiographie d'crivain) ou qu'il
retrace la trajectoire singulire d'une personne (rcit de vie ou Mmoires), il est
pris en charge, situ dans l'ordre du discours. Cette mise en situation suppose
que le signataire et le contenu soit prsents au lecteur, par un moyen ou un
autre. Mme Roland crivant ses Mmoires particuliers en prison et ne quittant
une prose trs potique, qui analyse par fragments les motions et les
sentiments d'un amour qui n'ose pas se dclarer :
"Douce crature. A minuit, aprs la musique, tout le
long de la via San Michele, ces mots furent murmurs. Eh,
doucement, Jamesy ! N'as-tu pas march la nuit par les
rues de Dublin, et, sanglotant, profr un autre nom ?"
(trad. fr. Du Bouchet, p. 6).
Dans son dition, R. Ellmann assure que ce rcit s'enracine dans la
biographie de Joyce. Il donne mme, avec beaucoup d'autres indications, le
nom probable de la jeune fille qui a inspir cet moi amoureux. De fait, Joyce
vivait Trieste et gagnait bien son existence en donnant des leons
particulires, l'poque o se situe ce rcit potique. Rien, toutefois, dans cette
uvre, ne permet de dire si Joyce a rellement voulu inscrire des motions
relles. A part la forme italianise de son nom, dont il est difficile de dcider s'il
179
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
devait tre le titre final, Joyce n'a formul aucune indication allant dans ce sens.
Dans les marges de cette uvre, aucune mention ne permet de savoir si
l'auteur d'Ulysse voulait que l'on fasse une lecture autobiographique de cette
relation d'un amour informul. Mais l'inverse, aucun lment n'autorise
suivre l'diteur dans la prsentation fictionnelle qu'il fait de ce rcit. Sur la
couverture de la traduction franaise d'Andr Du Bouchet, le lecteur peut en
effet lire l'indication gnrique "roman-pome". Pourtant, la description du
manuscrit par R. Ellmann n'indique rien de tel. Il s'agit d'une initiative discutable
de l'diteur. Lallure potique de ce texte suggre au premier abord, certes, que
ce texte est une fiction. Mais on pourrait aussi avancer que Joyce a choisi cette
forme potique, pour prendre ses distances avec cet pisode douloureux.
Il est ainsi impossible de trancher en faveur d'une lecture
autobiographique ou d'une lecture romanesque. Autant d'arguments peuvent
tre avancs dans un sens comme dans l'autre. Par contraste avec le protocole
nominal qui est nettement affich (Joyce apparat sous les diminutifs "Jamesy"
et "Jim", voque sa femme "Nora", cite Portrait de l'Artiste et Visse), le
protocole modal de cette prose reste dans le non-dit, comme l'amour qu'il
retrace. Il est bien entendu possible d'interprter ce silence et de donner une
signification littraire cette absence qui n'est peut-tre que contingente. Ce
texte, qui s'achve sur l'invocation de la femme lgitime, n'a-t-il pas une ralit
indcise parce que cet amour in petto tait lui-mme confus, plus involu que
tourn vers l'autre ? Une telle interprtation pourrait se dfendre, mais force est
d'abord de noter que Joyce a emport avec lui le secret de ce texte et qu'on ne
saura sans doute jamais quel statut il comptait lui donner.
Luvre de Jean Genet est, par contre, un bel exemple d'indtermination
voulue. Au sein de son corpus, des ouvrages comme Notre-Dame des Fleurs,
Miracle de la Rose, Pompes Funbres Journal du Voleur sont des textes
nigmatiques. Bien sr, Genet est prsent dans chacun d'eux. Il est difficile,
pourtant, dy apprcier la part de fiction et la part d'exprience vcue. Les
ditions disponibles aujourd'hui ont gard quelque chose de versions d'origine,
publies sans date, sans lieu, parfois sans nom d'diteur et qui allaient tout droit
l'Enfer de la B.N. le lecteur a du mal les situer, les classer et donc, les
lire. Rien voir avec son testament littraire et politique, Un Captif amoureux,
qui est pleinement rfrentiel, garanti hors-texte par la personne publique
180
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
qu'tait devenu Genet et le drame malheureusement trop connu des camps
palestiniens.
Certes, le protocole nominal de ces narrations est sans ambigut. Genet
y est toujours prsent sous son nom, la fois comme narrateur et comme
personnage. Mme dans sa premire uvre d'envergure, Notre-Dame des
Fleurs, dont il n'est pas le hros, Genet se prsente sans masque, sous sa
vritable identit. Complaisamment, il dcline son prnom et son patronyme
comme dans tous les autres rcits o l'abjection, le mal et la beaut se
disputent la prcellence.
Bien plus, le pritexte de ces rcits n'est pas tout fait dnu de signaux
rfrentiels. Notre-Dame des Fleurs porte comme achev de rdaction "Prison
de Fresnes, 1942", est ddi Maurice Pilorge, "dont la mort n'a pas fini
d'empoisonner ma vie" crit Genet. Comme on sait, c'est dans une cellule de
Fresnes que le narrateur "Jean Genet" invente "l'histoire artificielle" de Divine et
de Notre-Dame des Fleurs. Ce dernier est mme dcrit comme une
transfiguration d'un certain "Pilorge" mort vingt-cinq ans pour avoir tu son
amant Escudero, afin de "lui voler une misre". De mme, Miracle de la Rose
s'achve par l'indication "La Sant. Prison de Tourelles 1943". Cette information
sur le lieu de rdaction du livre rend crdible le sjour la centrale de
Fontevrault qui fait cho, vingt ans de distance, celui de la maison de
correction de Mettray, relat par l'crivain. Semblablement, Pompes Funbres
porte comme ddicace "A Jean Decarnin", jeune rsistant mort sur les pavs
parisiens, qui est au centre de ce chant funbre et dont la "dcomposition
prismatique" va produire les amours d'un bourreau berlinois et d'un jeune
Hitlrien. Le Journal du voleur, enfin, n'est ddi qu' des personnalits
littraires (" Sartre / au Castor"), mais c'est le seul livre ou Genet parle sans
intermdiaire, o la figure centrale aimantant la charge de misre et de gloire
qui fait son gibier habituel est lui-mme. Au reste, tout un texte second court
pour ainsi dire en bas de page pour authentifier le rcit, en apporter les pices
Justificatives, sous forme de prcisions chronologiques, d'extraits de la presse,
de rectifications gographiques etc.
Mettant en relief tantt le contenu, tantt le sujet d'nonciation de ses
ouvrages, le pritexte de Genet a ainsi pour fonction essentielle de leur
apporter un minimum de crdibilit rfrentielle. Toutes ses indications
pritextuelles donnent penser qu'il a, bien connu au moins les lieux et les
181
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
personnes voqus dans ses rcits. Pourtant, ce pritexte ne va pas plus loin
dans cette authentification. Il s'arrte la confirmation du dcor et des ores
dcrits. Il ne dit pas si l'auteur a rellement vcu cette immersion dans le crime
et si c'est bien ainsi que le lecteur doit lire ces livres. Aucune indication
gnrique, pigraphique, prfacielle ne permet d'en savoir plus sur ses
aventures. Pourquoi se poser de telles questions si Genet se reprsente bien
lui-mme ? Play boy ne titrait-il pas, en 1964, une interview de Genet : "A
candid conversation with the brazen, brilliant author of The Balcony and The
Blacks, self proclaimed homosexuel, coward, thief and traiter" ? Sartre n'a-t-il
pas brillamment expliqu, dans son Saint-Genet, les racines de son voyage au
bout du mal, partir de confidences faites par Genet lui-mme ?
C'est que comme ses pices de thtre, les rcits de Genet multiplient
les jeux avec l'apparence et la ralit, la fiction et la vrit, l'tre et le paratre
dans un jeu de glaces o l'auteur se trouve lui-mme pris. Comme il l'affirme
ds son second roman, Genet a seulement voulu dans son uvre, donner "les
honneurs du Nom" des "tres, des objets, des sentiments rputs vils" :
"Car mes livres seront-ils jamais autre chose qu'un
prtexte montrer un soldat vtu d'azur, un ange et un
ngre fraternels jouant aux ds ou aux osselets dans une
prison sombre ou claire ?" (1948, p. 24).
Mais pour que cette transmutation atteigne son maximum d'intensit, il a
souvent permut les places et les situations, chang les rles et les lieux, en
se mettant contribution. Dans Journal du Voleur, il dvoile ainsi une des clefs
de son travail romanesque :
pour que l'exprience soit plus efficace je ferai un
instant revivre Lucien dans ma peau misrable. Dans un
livre intitul Miracle de la Rose, d'un jeune bagnard qui
ses camarades crachent sur les joues et les yeux, je
prends l'ignominie de la posture mon compte, et parlant
de lui je dis : 'Je'. Ici c'est l'inverse . (1949, p. 1 81).
Ce travail commence ds Notre-Dame des Fleurs o Genet dclare que
Divine c'est lui, o Mignon est une sorte de rincarnation de Roger et o
Notre-Dame des Fleurs est un avatar de Pilorge. Dans Pompes Funbres, qui
est son dernier texte autofictif, ce travail de permutation devient vertigineux
puisque le ddicataire porte le mme prnom que l'auteur et que ces com-
mutations se succdent sans mme tre toujours dclares entre Jean
182
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Decarnin, Paulot, Erik, le bourreau berlinois et Jean Genet lui-mme - comme
dans les romans de Tony Duvert, qui semble avoir trouv l une source
d'inspiration importante. Ce flottement des identits, ce vacillement de la ralit
o le modle et sa projection fantasmatique ("prismatique" dirait Genet)
coexistent, amne dj le lecteur , se demander s'il a rellement affaire un
tmoignage, mme magnifi, sur les prisons, les voyous, la pdrastie et le
crime sous toutes ses formes.
Bien plus, la manire dont le narrateur traite de son travail d'crivain ne
peut que l'encourager dans cette voie puisque Genet n'a de cesse de dnoncer
la prtention d'atteindre l'exactitude dans le rcit de soi, d'afficher sa volont de
faire de sa vie une lgende, d'atteindre les fastes. de la Fable et l'irisation du
Pome :
"... que ma vie doit tre lgende c'est--dire lisible et
sa lecture donner naissance quelque motion nouvelle
que je nomme posie. Je ne suis plus rien, qu'un
prtexte" (1949 , p. 1 33) .
Comme on le voit, si le pritexte chez Genet apporte un dbut de crdit
autobiographique aux rcits, il s'arrte au seuil de l'essentiel, qui serait de
donner au lecteur le moyen de mesurer le degr de littralit des -aventures
rapportes. Il ne fournit que les donnes strictement ncessaires la densit
des faits, des actes et des motions mis en scne. Quant au texte de ces
narrations, il multiplie les dmentis et les avertissements contre une lecture
rfrentielle, qui aplatirait pour ainsi dire luvre sur l'homme.
A partir de l, si toute recherche biographique sur Genet a bien sr son
importance, il est quelque peu naf de traiter ses fictions intimes d "'insincres"
ou de "truques", comme le fait Jean-Bernard Moraly dans son livre, par ailleurs
trs riche, Jean Genet, La vie crite : la tche d'un crivain n'est pas de fournir
des documents ses futurs biographes. Tout aussi ingnu serait de prendre
la lettre les confidences faites Sartre pour Saint Genet, Comdien et Martyr :
ce serait oublie que cet ouvrage devait tre l'antichambre de la lgende, le
premier tome des Oeuvres compltes de Genet. Comme Proust et quelques
autres, Genet a voulu enlever son uvre romanesque sur une ligne de crte
prilleuse, o la vie n'tait qu'une matire destine fondre une lgende,
c'est--dire au sens tymologique un somptueux lisible. On sait d'ailleurs
aujourd'hui qu'en dcouvrant A l'Ombre des jeunes filles en fleurs... Genet "all
183
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
de merveilles en merveilles" (Moraly, 1988, p. 69). Avec une perspicacit
admirable, Barthes avait devin et signal cette affinit dans Le Plaisir du texte
et dans S / Z, comme on aura l'occasion de le voir. Aussi bien, cette affinit est
davantage une filiation, une dette mme. Par la thmatique florale, la reprise
de la construction "bouillonne" de sa phrase, et bien sr la mise en place d'un
"moi apocryphe", l'ombre de Proust est partout dans les romans de Genet
(Moraly, 1988, pp. 78-80). Mais ce "modle souverain" n'est pas tu, il est parfois
inscrit noir sur blanc, comme dans le Journal du Voleur. On se souvient que
dans un passage essentiel du Temps retrouv, Proust rend hommage une
famille, les Larivire, en dclarant que leur nom est le seul nom rel de tout son
colossal ouvrage. Reprenant ce geste son compte, Genet voque dans le
Journal un voyou exceptionnel, Armand, qui avait pour lui une "valeur d'autorit
morale" :
Jignore dans quelle fosse commune il est enterr,
ou sil est toujours debout, promenant avec indolence un
corps souple et fort. Il est le seul de qui je veux transcrire
le nom exact. Le trahir mme si peu serait trop. Quand il
se levait de sa chaise, il rgnait sur le monde . (1949,
p.251, nous soulignons.)
II.2. Protocole modal contradictoire.
A l'inverse de la situation prcdente, le pritexte rend aussi possible la
disposition d'un registre contradictoire. Son mode d'tre priphrique, dj
signal, lui permet l'addition de signaux gnriques opposs. Luvre n'est plus
alors sans protocole achev, sans registre de lecture fermement tabli. Elle est
plutt sature de modalisateurs, ceci prs que ces derniers sont
incompatibles, ne peuvent coexister de faon cohrente. Comme
prcdemment, cette "situation d'nonciation complexe" n'est pas
ncessairement le rsultat d'un choix dlibr.
On peut imaginer en effet la situation inverse de celle de Giocomo Joyce.
Un manuscrit semblable, mais prsentant une foule de signaux gnriques
contraires. Certains le dfiniraient comme un roman, d'autres comme un rcit
autobiographique etc. L'crivain mort sans laisser d'lments pour trancher, les
hritiers seraient bien embarrasss. Ce n'est bien star qu'une hypothse
d'cole. A notre connaissance, il n'est pas d'exemple d'une telle situation. Par
184
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
contre, de nombreux ouvrages ont un statut incohrent la suite d'erreurs, de
confusions ou d'abus des diteurs, voire des crivains.
Un exemple ? Le premier livre d'Ada, Elle voulait voir la mer... (Maurice
Nadeau, 1985). S'il faut en croire l'indication gnrique de la couverture et de la
page de titre, c'est un "roman". Pourtant, le prire d'insrer complique cette
classification gnrique dans le rsum qu'il donne de l'ouvrage. Dans celui-ci,
la narratrice et hrone du livre est identifie l'auteur :
"Une famille ouvrire italienne dans la banlieue
parisienne. Le pre est maon. La mre rve d'un meilleur
sort pour ses enfants. Elle parvient faire entrer Ada au
lyce. Pas d'autre orientation pour Ada que le 'technique'.
Elle effectue un travail de bureau dans une grande 'boite'
alors que ne cesse de l'habiter le dsir de parvenir la
culture et de se raliser".
Apparemment, ce texte est donc une autofiction. Le protocole modal du
dispositif est ralis (c'est un "roman") ; ainsi que le protocole nominal (l'auteur
et l'hrone ne font qu'un). Et cette classification est la seule faon d'accorder
les dsignations contradictoires sous lesquelles se prsente l'ouvrage.
Pourtant, le rcit ne rpond pas cette description du pritexte. A la lecture,
seule l'histoire correspond au rsum du prire d'insrer. C'est bien le rcit, la
premire personne, de l'enfance, de l'adolescence et de l'entre dans la vie
active d'une Franaise d'origine italienne, prise entre deux mondes, enferme
dans son milieu ouvrier, aspirant la culture et au bonheur personnel. Mais la
narratrice ne s'appelle pas le moins du monde "Ada". Dans le roman, on
apprend que son patronyme est "Renault" (pp. 68, 70) et de nombreuses
occurrences la dotent du prnom "Renata" (au hasard, pp. 153, 157, 159, 166,
168 etc.) L'indication gnrique prsente le livre comme un roman, alors que la
quatrime de couverture en fait un rcit autobiographique tandis que le texte
prsente une hrone diffrente de l'auteur. Que peut en conclure le lecteur ?
Naturellement, il ne verra pas dans ces palinodies la volont de produire un
effet littraire spcifique. Selon son humeur ou son indulgence, il pensera que
le personnel de cette maison d'dition) a) est tourdi, manque de coordination,
c) tente de concilier des recettes commerciales incompatibles (le "vcu" se
vend bien, mais tout ce qui est "romanc" ne se vend pas trop mal non plus). Il
ne s'agit l que d'un exemple, mais ces incohrences pritextuelles sont
185
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
malheureusement monnaie courante dans le secteur grand public de l'dition
(Lejeune, 1986 b).
Plus intressante littrairement est la constitution voulue d'un registre de
lecture contradictoire. Il suffit pour cela que l'crivain accompagne son texte
d'indications discordantes quant sa vracit ou sa fictionalit. Les proprits
du pritexte permettent mme d'oprer une mise en place tardive, lors d'une
dition ultrieure, de ce statut gnrique complexe.
Dans Monsieur Jadis (La Table ronde, 1970) d'Antoine Blondin, le
registre contradictoire du texte repose sur une double ddicace provocante :
"A l'abb Pistre, la part de confession qui lui revient de
droit.
A Yvan Audouard, les mensonges, en hommage au
matre de la 'vrit du dimanche'.".
Cette dclaration contradictoire donne d'emble le ton de cette pochade
qui fait alterner un rgime autodigtique et un rgime htrodigtique de
narration, afin de raconter une nuit passe par l'auteur au commissariat, pour
une vrification d'identit. Ce contrle policier est naturellement l'occasion pour
Blondin de rflchir sur son identit et de faire le bilan de son existence. C'est le
thme bien connu de l'homme mr qui se penche sur son pass et qui se
confronte au jeune homme qu'il fut. A ceci prs que cette fois, la confrontation
est relle, la fiction permettant l'auteur de se ddoubler et de camper un
personnage reprsentant le jeune homme qu'il a t, jadis. Ainsi cette histoire
est autant imaginaire que personnelle et intime, ce qui explique l'aporie de la
double ddicace. A vrai dire, l'pigraphe du roman donnait dj la solution de
cette contradiction :
"Ma vie est un roman"
(Tout-Un-Chacun).
Cette pseudo-sentence de la Sagesse des Nations donne exactement le
programme du livre, qui pourrait tre rapport de la faon suivante : "comme
tout le monde, je m'invente des histoires partir de la mienne. Pour me
raconter, je vais fixer quelques-unes d'entre elles en les ramassant dans un
roman. Comme tout ce que l'on imagine fait partie de son mythe personnel, ce
dernier sera aussi vrai que les incidents rels qui composent ma biographie".
186
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Plus complexe et d'une autre qualit littraire, Moravagine de Blaise
Cendrars appartient au cas de figure o le protocole modal d'un texte devient
contradictoire la suite d'addition uItrieures. On a dj cit ce "roman"
plusieurs reprises, en particulier pour indiquer que Cendrars y jouait un petit
rle et pour suggrer la possibilit d'un protocole modal de fiction "impur". Le
moment est venu de dtailler ce qui fait la singularit gnrique de cette uvre.
Le roman tel qu'il se donne lire aujourd'hui prsente en effet un
appareil pritextuel d'une ampleur inhabituelle. Il est en particulier encadr par
une Prface, qui date de la premire dition de 1926, et par deux textes,
ajouts lors de la dernire dition en 1951 : Pro domo, crit selon Cendrars
partir de notes rdiges de 1917 1926, dont le sous-titre est "Comment j'ai
crit Moravagine (Papiers retrouvs)" ; une Postface, date de 1951. Mais cet
ensemble n'est pas seulement plthorique, il est aussi conflictuel et contrast.
Il faut dire que ds l'dition de 1926, accompagne de la seule Prface,
ce livre tait dj assez retors dans son agencement et plutt problmatique
dans son statut. Si les pigraphes, la ddicace, la prface, les notes, le style
"ampoul et prtentieux" (Cendrars dixit), la construction, constituaient autant
de signaux ironiques quant la ralit des faits rapports, la Prface ne
dclarait la fictionalit du texte que sur le mode de la dngation. Dans celle-ci,
Cendrars reprend en effet les topo de la malle aux manuscrits et du texte
confi par un ami pour tre dit. Ordinairement, c'est l un signe sr de la
fictionalit, l'indice implicite qu'il est donn au lecteur une histoire imaginaire, la
marque d'une "fiction de non-fiction" (Rousset). Pourtant, il y a dans ce cas une
petite nuance qui fait une grande diffrence. Non seulement Cendrars apporte
un luxe de dtails son affabulation, mais en outre il est un lment de cette
mise en scne, une donne de cette mystification. L'auteur de ce manuscrit, il le
connat assez pour que celui-ci lui demande d'intervenir en sa faveur ; l'histoire
qui y est raconte, on a vu qu'il en fut un des acteurs, mme si celle-ci glisse
discrtement sur son rle. Il y a loin de cette situation et du procd traditionnel
du manuscrit apocryphe. Voyez le cas de Stendhal, avec La Chartreuse ou
Armance rien de comparable. Dans ces deux romans, Stendhal prtend avoir
reu un manuscrit (les annales d'un "bon chanoine", la nouvelle d'une "femme
d'esprit"), l'avoir publi sous son nom, en n'apportant que des corrections
minimes. Mais dans les deux cas, il n'est pas un personnage, mme effac, de
187
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ces rcits : il n'a pas eu le bonheur de croiser la Sanseverina, ni de goter
l'amiti d'Octave.
Au contraire, Cendrars remplit un rle dans l'histoire de Moravagine, rle
qui n'est minime que dans la mesure o son apparition est concomitante d'une
formidable ellipse digtique du roman, comme si tout ' coup une censure
imprieuse se levait pour occulter ses relations avec le hros ponyme. En
ralit, si l'on comble ce silence l'aide des donnes fournies par le texte, tout
montre que ds leur premire rencontre Cendrars et Moravagine font quipe.
Inutile de faire appel au hors-texte, de rappeler que Cendrars signait parfois ses
cartes postales "Moravagine". Le roman le dit en toutes lettres. A partir de
l'pisode de Chartres, Cendrars prend la place de Raymond le narrateur auprs
de Moravagine. puis par l'ardeur de ce dernier, par son culte furieux de
l'action, Raymond lui abandonne sa fonction de double fascin, participant,
tous les dbordements de son modle. Fort de son savoir d'Eubage (ce rcit
potique, dj rencontr, est publi la mme anne), de sa connaissance du
dsordre inhrent toutes choses, Cendrars passe dsormais l'acte dans le
morde de ses fictions : c'est maintenant un Portrait de l'artiste en activiste qu'il
donne, sur un mode mineur, ses lecteurs. Comme s'il voulait rassembler sur
son nom tous les extrmes, multiplier les images contrastes de lui-mme, il se
dpeint lanc. avec Moravagine dans " l'action qui obit un million de mobiles
diffrents, l'action phmre, l'action qui subit toutes les contingences possibles
et imaginables, l'action antagoniste. La vie" (M., p. 393). Par rapport lEubage,
cette fiction de soi largit le champ des possibles cendrarsiens : aprs la
connaissance, c'est l'action qu'il prtend aimanter son nom. Dans l'dition de
1926, Cendrars est ainsi la fois au cur et la priphrie de Moravagine : sur
ses marges comme diteur du texte et au centre du rcit comme double du
hros ponyme.
Une telle position de l'auteur complique naturellement outrance la
fiction du manuscrit apocryphe. La prsence de Cendrars dans le roman a un
effet contradictoire : elle le dralise tout en apportant une sorte de
vraisemblance au statut allographe du texte. Pousse la limite, la dngation
ne permet plus au lecteur de jouer innocemment la "fiction de non-fiction". Il
est oblig de se demander si l'auteur ne croit pas ce qu'il raconte, quand bien
mme l'objet de son rcit serait irrel. Il faudrait pouvoir approfondir le registre
curieux o Cendrars essaie de loger son texte. Mettons pour simplifier qu'il a
188
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
recours une "fiction de non-fiction", mais en essayant rellement d'y faire
croire le lecteur. Tendanciellement, la Prface de 1926 prsente donc
Moravagine comme un texte rfrentiel.
Tout se complique, si l'on peut dire, avec l'dition de 1951 et les deux
additions signales. Les liens entre ces deux pices rapportes, entre elles et
luvre de 1926, sont pour le moins inattendus.
- Pro domo / Postface : ces deux textes sont la fois contradictoires et
complmentaires. La Postface garantit l'authenticit de l'origine du Pro domo,
accrdite son statut de "papiers retrouvs", de fragments contemporains de la
longue gestation de Moravagine. Mais dans le mme temps, elle reconduit,
un quart de sicle de distance, la, mystification qui fait de Cendrars un simple
diteur de ce roman. Pourtant, cette mystification est en contradiction avec le
Pro dodo puisque, dans celui-ci, Cendrars rvle qu'il est le vritable auteur de
ce livre. Comme son sous-titre l'indique bien, ce Pro domo est, en effet, une
sorte de Journal de Moravagine : il relate toutes les circonstances qui ont
conduit son existence, depuis les sources du personnage jusqu'aux tapes de
la rdaction de ce texte. C'est un document littraire exceptionnel par toutes les
informations qu'il donne sur les sentiers de la cration chez Cendrars. Tout le
Pro domo s'inscrit donc en faux contre le simulacre qui fait de Moravagine une
personne relle et du rcit la relation de son histoire crit par un tiers. Avec
l'dition de 1951, Cendrars fait par consquent un geste contradictoire. Du
mme mouvement, il dfait (avec le Pro domo) et reconduit (avec la Postface)
l'artifice mis en place en 1926. Tout se passe comme s'il n'arrivait pas choisir
entre ces deux options - moins que ces "papiers retrouvs" ne soient, eux
aussi, une "fiction de non-fiction", que Cendrars ait invent aprs coup
l'laboration de Moravagine, comme il avait invent l'histoire de cet "idiot".
- Version de 1926 / Pro domo / Postface : si on considre maintenant le
livre dans sa totalit, tel qu'il se prsente dans sa version finale en 1951, on
constate que Cendrars s'est livr une curieuse manipulation. Considrons la
disposition des derrires pices du livre : la Postface boucle le volume et
garantit l'authenticit du Pro domo, alors que son contenu est manifestement
fictif, qu'elle s'inscrit dans la tradition des manuscrits perdus ou retrouvs. Le
commentaire gntique et explicatif du Pro domo se trouve, par suite, encadr
par une prsentation fictive (la Prface) et par sa ractualisation (la Postface).
Ce texte rfrentiel est comme enclav dans l'imaginaire, encercl par des
189
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
fabulations. En toute logique, on se serait attendu l'inverse : un texte final, la
rigueur liminaire, qui donnerait toutes les informations du Pro domo, rtablirait
la vrit et la ralit. Par convention, le dernier mot, le mot de la fin revient
d'habitude au commentaire discursif qui se situe un niveau plus abstrait et
dont la, position hirarchique est dominante. Or, c'est prcisment le contraire
que prsente Moravagine. Il y a l comme un contre-emploi du discours
d'escorte, du commentaire historique et critique par Cendrars. Au lieu de
surplomber le livre, d'avoir la matrise de son imaginaire, le Pro domo se trouve
plac sur le mme plan que les inventions qui le constituent ; bien plus, il se
trouve subordonn l'une d'elles. S'agit-il d'une tourderie de Cendrars ? Or. a
du mal le croire ; d'autant que son texte sur Villon montre combien Cendrars
tait sensible la structuration interne d'un livre, aux effets de sens produits par
la rpartition des textes dans le volume (1952, p. 60). De toutes faons, le
rsultat est le mme : dans la position o il est, le Pro domo perd sa
comptence dcliner la vrit du reste de l'ouvrage et disposer de la vrit
qui est la sienne. Cette inversion le signale au lecteur comme un texte qui n'a
aucun privilge particulier, une recration fictive de la cration littraire, un
commentaire fictif de Moravagine. Cendrars a imagin rtrospectivement la
rdaction de ce roman, comme il avait invent l'histoire de Moravagine et sa
rencontre avec lui. La fabulation n'est bien sr pas du mme ordre dans les
deux cas ; une frontire les spare, qui est celle-l mme qui passe entre les
autofictions et les textes "mythobiographiques" comme Bourlinguer. Dans ce
dernier cas, il part de la ralit pour inventer ; dans l'autre, il s'invente pour
tenter de retrouver le rel et son exprience vcue. Mais ces deux plans
"communiquent de faon subtile" comme le montrent Moravagine et ses autres
textes.
En inversant les attentes et les conventions discursives, Cendrars
pousse ainsi encore plus loin la fictionnalisation de soi. Non seulement son nom
est devenu celui d'un personnage fictif, mais son travail d'crivain est devenu
lui-mme une sorte de fiction. On assiste alors une invagination de l'ensemble
de luvre ; tout son ancrage rfrentiel se trouve retourn dans l'ordre
imaginaire qu'il a produit. La fiction n'a plus de bord ni de dehors.
Il faut arrter l ce tour d'horizon des modalisateurs pritextuels de
fiction. On aura not, une fois de plus, que le pritexte a montr sa capacit
produire des modulations et des effets aussi varis qu'inattendus. On ne saurait
190
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
assez souligner, aprs Grard Genette, combien ces franges littraires sont
importantes pour la physionomie des uvres et pour l'exprience de la lecture.
Si quelque analyse d'un texte particulier aura paru longue, on espre que
lindiffrence qui tait jusqu'alors lors de mise envers le paratexte l'excusera.
On aura relev, en outre, comment des usages apparemment inconciliables du
pri texte finissent par converger pour produire un registre complexe indfini ou
contradictoire. Entre Genet, et Cendrars, aucun dnominateur commun ne
semble exister 'dans l'laboration de la "situation globale de communication" de
leurs textes. Le premier opte pour un quasi-silence, refusant d'exploiter ce lieu
privilgi de la communication littraire que sont les marges de l'uvre pour
claircir le statut de ses textes par une sorte d'indiffrence envers le lecteur que
Bataille a dcrit un peu vite comme une forme de mpris. Le second multiplie,
au contraire, les dveloppements et les explications, sature les entours de son
uvre d'une lgion d'indications, comme s'il craignait que le lecteur manque
d'lments pour le dcouvrir. Pourtant, ces deux stratgies de communication,
en apparence opposes, cherchent un effet identique : brouiller les pistes afin
de disparatre dans une lgende, o seul l'criture demeure. Par excs ou par
dfaut, leurs emplois du pritexte et les profils gnriques qui en dcoulent, se
rejoignent dans un rsultat similaire des livres mystrieux, inclassables,
appelant l'infini l'exgse critique, entretenant indfiniment la curiosit et
l'tonnement des lecteurs.
191
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
3 - EPIMENIDE EN FICTION
"L'un d'entre eux, leur propre prophte a dit : 'Crtois
toujours menteurs, mchantes btes, ventres paresseux!.
Ce tmoignage est vrai"
Saint-Paul.
192
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Toutes les marques de fictionalit tudies jusqu' prsent relevaient du
pritexte. Cette limitation, ncessaire la clart de notre tude, a pu faire croire
une sorte d'autosuffisance du pritexte dans la constitution du contrat de
lecture d'une uvre. Il est pourtant vident qu'il n'en est presque jamais ainsi.
Si c'tait le cas, "la vrit, lpre vrit" en exergue au roman Le Rouge et le
Noir, "l'humble vrit" dans la marge d'Une Vie feraient de ces ouvrages des
rcits autobiographiques ou historiques. Ne dclare-t-on pas ainsi que
l'intgralit de ces deux textes est vridique ? En ralit, le lecteur ne s'y
trompe pas. Il comprend que ces pigraphes rsument les choix esthtiques,
voire thiques de Stendhal et de Maupassant. Il ne lui viendrait pas l'ide d'y
voir un engagement personnel quant la vracit des faits rapports.
Ces deux exemples sont convoqus pour rappeler cette vidence : le
pritexte est rarement le seul facteur orientant la perception que peut avoir le
lecteur d'une uvre littraire. Il y a dans le texte, dans le discours narratif, dans
l'histoire dans les vnements narrs, dans les personnages, dans le dcor, et
mme dans la composition et le style d'une uvre, des lments qui y
concourent au moins autant. Ce sont ces lments qu'il faut maintenant tenter
de recenser : les modalisateurs de fiction propres au texte.
Pour les cerner, il faut examiner les moyens dont dispose un texte pour
procder une modalisation explicite, pour mettre en uvre un protocole
modal la fois intra-textuel et formule de faon vidente. Il convient d'insister
sur le fait que notre examen se limite pour l'instant tous les cas o un texte
exprime directement et de faon patente la valeur de vrit de son contenu.
Toutes les formulations indirectes, donnes par le biais de commentaires
actoriaux, de mise en abyme ou de procds de thmatisation sont exclues de
notre investigation. Que Cendrars, par exemple, dans Une Nuit dans la fort
(sous titr "Premier fragment d'une autobiographie") se dcrive dans une scne
en train de faire un demi-mensonge ("j'ai menti sans mentir") l'un de ses
meilleurs amis, voil un trait qui ne peut qu'veiller la mfiance du lecteur quant
l'exactitude et la prcision de ce rcit. Mais c'est l un procd implicite
dambigusation, d'ailleurs familier Cendrars, qui ne peut retenir notre
attention. De tels inducteurs d'ambigut ne sont pas l pour donner le statut
gnrique d'un texte ; ils ne peuvent que le troubler et le rendre quivoque.
193
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Cette dtermination rduit donc le phnomne de la modalisation
textuelle au cas explicite o un narrateur (qu'il soit htrodigtique ou
homodigtique) dcrit le registre de son rcit. Que ce narrateur soit ou non un
personnage de son rcit, peut importe. L'essentiel est : a) que ce narrateur soit
le destinateur ultime du rcit, b) que sa description de la valeur de vrit de son
'histoire soit nonce de faon littrale, sans dtours, c) que cette description
dsigne bien le statut des vnements rapports.
De telles dclarations modalisantes sont monnaie courante dans la
plupart des rcits. Elles font partie de l'ensemble des noncs mtanarratifs
exigs par cette situation de discours qu'est le rcit littraire. Le caractre
diffr de sa communication et l'imprvisibilit de son destinataire font qu'il
appelle un "surcodage compensatoire" et qu'il se prsente toujours, par suite,
comme un "nonc mtalangage incorpor" (Hamon, 1977, pp. 264-265).
Au reste, ce besoin de "surcodage" devient imprieux quand une uvre
inaugure une nouvelle manire ou se situe dans un registre indit. On se
rappelle ainsi les excursus du narrateur dans Tom Jones. En consacrant le
premier chapitre de chacun des livres de cet ouvrage commenter son
entreprise, Fielding peut prendre ses distances avec la littrature romanesque
antrieure et expliciter la formule du roman moderne qu'il est en train d'inventer.
On se souvient aussi de la fameuse dclaration liminaire du Pre Goriot :
" vous qui tenez ce livre d'un main blanche, vous qui
vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant :
peut-tre ceci va-t-il m'amuser. Aprs avoir lu les secrtes
infortunes du pre Goriot, vous dnerez avec apptit en
mettant votre insensibilit sur le compte de l'auteur, en le
taxant d'exagration, en l'accusant de posie. Ah !
Sachez-le : ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All
is true, il est si vritable, que chacun peut en reconnatre
les lments chez soi, dans son cur peut-tre".
Aucun commentateur n'a manqu de souligner l'importance de ce
passage o Balzac nonce son credo romanesque. Contre les formes
narratives artificielles et conciliantes de son poque, il revendique un nouveau
vraisemblable, une fabulation vraie, qui ferait place des sujets presque tabous
et qui ne donneraient pas dans des dnouements moralisateurs.
Du fait de leur singularit gnrique, les textes autofictifs sont eux aussi
dans la ncessit d'expliciter leur registre. L peut-tre plus qu'ailleurs, la
194
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
plupart des rcits n expose, peu ou prou le caractre fictif ou rfrentiel de leur
contenu, dans des dclarations qui vont de la simple auto-dsignation des
dveloppements plus amples. Citons quelques exemples, presque au hasard
de notre corpus. Cline dans Normance, relatant Paris sous les
bombardements :
- "Je vous ai dit : je mentirai rien... Les phnomnes
surnaturels vous outrepassent, et c'est tout ! Les
chroniqueurs sans conscience rapetissent, expliquent,
mesquinent les faits ! Oh, votre serviteur... du tout ! Le
respect des somptuosits !" (1954, p. 50) ;
Bastide dans La Vie rve, o (comme Genet dans Notre Dame des
Fleurs) il superpose le rcit de soi et l'invention romanesque, se trouvant ainsi
dans l'obligation de faire de rgulires mises au point :
"Je vais aussi commettre des erreurs, en parlant de
ma famille. Mais la vrit stricte, qui importe peu ici, ne
doit pas tre prfre aux impressions reues ds
l'enfance. Ce qui compte, c'est que j'ai cru, ou imagin,
trs tt" (1962, p. 30)
Dominique Rolin qui dans L'Infini chez soi rve sa naissance, comme
elle rve sa mort dans Le Gteau des morts :
"Je dcouvre ceci ce matin : la ralit n'est que pure
invention prmonitoire. Jubilation. Je serai la pythie de
moi-mme. J'accomplirai mon travail de prospecteur ayant
pay cash sa concession avec une curiosit que l'on peut
qualifier de chirurgicale.( o..). Il faut oser. Percer. Fendre.
Toucher mon avant-vie pour cesser enfin d'tre le Je que
d'ordinaire on suppose tre moi" (1980, p. 9) ;
et plus loin, dans le mme roman :
"Je fabule ? Mettons. J'ai le droit. J'en ai mme le
devoir. Il faudra que j'accouche de mes gniteurs, n'est-ce
pas ?" (p. 131).
Le problme est de savoir quel crdit on peut accorder ces
commentaires o le narrateur claire le registre de son rcit. Un passage de
195
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Proust, dj voqu propos de Genet, peut servir de fil conducteur cet
examen.` Dans A la recherche du temps perdu, une page entire est consacre
dnier toute vracit luvre ; une page qui ne manque pas d'ailleurs
d'ambigut et fait par cela pendant aux passages quivoques o le narrateur
dcline son identit :
"Dans ce livre o il n'y a pas un seul fait qui ne soit
fictif, o il n'y a pas un seul personnage " clefs", o tout a
t invent par moi selon les besoins de ma
dmonstration, je dois dire la louange de mon pays que
seuls les parents millionnaires de Franoise ayant quitt
leur retraite pour aider leur nice sans appui, que seuls
ceux-l sont des gens rels qui existent. Et persuad que
leur modestie ne s'en offensera pas, pour la raison qu'ils
ne liront jamais ce livre, c'est avec un enfantin plaisir et
une profonde motion que, ne pouvant citer les noms de
tant d'autres qui durent agir de mme et par qui la France
a survcu, je transcris ici leur nom vritable : ils s'appellent
d'un nom si - franais d'ailleurs., Larivire" (Pliade, t. III,
p. 846)
Cette dclaration intervient au terme de la Recherche, dans le volume du
Temps retrouv. Elle est faite presque en passant, l'occasion d'un hommage
rendu des cousins extrmement fortuns de Franoise, cafetiers retirs pour
jouir de leur avoir et qui, pourtant, ont repris gracieusement du service pour
aider la veuve d'un neveu, mort durant la guerre de 14-18 Berry-au-Bac. Elle
insiste, en outre, sur le caractre entirement imaginaire de la digse de la
Recherche : ce ne serait pas un roman "clefs", ni mme un rcit d'inspiration
autobiographique. Apparemment donc, un avertissement net et sans quivoque
possible sur le statut du roman. Si on le considre comme le protocole modal
de luvre, il faut toutefois reconnatre qu'il n'est pas aussi transparent qu'il en
a l'air. "Marcel" prtend que "tout est invent" dans sa suite romanesque. Mais
cette affirmation est formule pour citer des personnes qui existeraient dans la
ralit. Qui plus est, ces Larivire ont un lien de parent avec une certaine
"Franoise", un personnage qui, lui, serait totalement fictif. Les personnages
fictifs de la Recherche auraient donc des parents rels ? Et rciproquement, les
Larivire ont donc de la famille dans la fiction ? Ce caractre hybride des
Larivire laisse songeur et leur statut paradoxal amne prendre conscience
d'un autre paradoxe.
196
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
C'est que, quand le narrateur affirme "tout est invent", dclare que son
discours est de part en part fictif, il s'enlve toute possibilit de garantir son
propos, de fonder son jugement. Ds lors que son discours droule une fiction
dont il fait partie (comme tout narrateur d'ailleurs, son statut autodigtique
important ici peu), lui mme est un tre de fiction et perd tout droit de reprise
sur la vrit. Puisque l'ensemble de la Recherche n'est qu'un rcit imaginaire,
une dclaration faite en son sein ne peut tre ni vraie ni fausse, tout au plus
vraie et fausse, indcidable.
Si cette dclaration a bien la valeur paradigmatique que nous lui prtons,
on comprend la difficult pour le lecteur adhrer ce type d'affirmation.
Naturellement, il faut supposer, comme pour la Recherche, que rien dans le
pritexte ne permet de dcider de la valeur rfrentielle de luvre. On sait
dj, en effet, que si les entours du texte bauchent un contrat
autobiographique, ce genre de revendication fictionnelle aura un effet
dstabilisateur : on l'a vu avec Genet. On peut donc dj en conclure que les
dclarations modalisantes ont un effet privatif, qu'elles peuvent exprimer
l'absence d'une qualit que suggrait pourtant la prsentation de luvre. Mais
la vraie difficult est de comprendre si une dclaration de cette sorte peut
constituer elle seule un nonc d'autorit, un mtalangage qui dirait la vrit
de luvre.
Est-ce vraiment une difficult ? Formule correctement, la question
s'claircit comme d'elle-mme. Un nonc d'autorit n'a d'autre garantie que
son nonciation, c'est--dire sa situation d'nonciation et la position du sujet de
l'nonciation (Lacan, 1966, p. 813). Si le discours prfaciel, par exemple., peut
dire le vrai sur un livre, c'est que par convention et institution, tous les noncs
formuls en ce lieu et pris en charge par l'auteur seront reconnus comme
dignes de foi. Les propositions avances se soutiendront de cette situation
discursive, de sa valeur fondatrice et authentifiante. Au contraire, appartenant
lui-mme l'univers qu'il dcrit comme fictif, ce Narrateur se retrouve dans la
mme position d'nonciation que le fameux Crtois Epimnide. Son propos
prsente le mme tour aportique qui porte son nom et qui est aussi connue
sous la version simplifie du "paradoxe du menteur". En disant "tous les Crtois
sont menteurs", Epimnide le Crtois ne pouvait dire la vrit qu'en mentant et,
inversement, ne mentait qu'en disant la vrit. On ne peut naturellement
197
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dcider de la fausset ou de la vracit d'une telle proposition. De mme quand
"Marcel" dit "tout est invent", il fait de lui-mme une invention.
Comment croire, ds lors, son affirmation ? S'il dit vrai, il perd son
statut de personnage romanesque. Il faut donc qu'il cherche mystifier le
lecteur pour que son ouvrage soit effectivement une affabulation. On voit mieux
en quoi ce passage apparemment sans difficult du Temps retrouv fait
pendant aux passages quivoques o le Narrateur dcline son identit, dans La
Prisonnire. Sous couvert d'une sche mise au point, pour les lecteurs
empresss de faire du roman une lecture biographique, Proust formule l
l'aporie de tout texte qui voudrait dans le mouvement mme de son criture
faire retour sur lui mme et indiquer son caractre fictif.
Insistons : il s'agit bien d'un paradoxe, pas d'un sophisme, d'une
mystification de Proust, d'une argumentation dlibrment vicie, reposant sur
une transgression logique. Rien voir avec un vice volontaire du raisonnement,
un cercle logique qui reposerait sur une conjonction du type "donnez-moi votre
montre, je vous dirai l'heure". Il y a l un paradoxe au sens strict, parce qu'on
arrive une conclusion contradictoire partir de prmisses non contradictoires.
Aucune fiction ne peut lever ce paradoxe si elle prtend inscrire sa nature,
rfrer elle-mme, en utilisant le mme langage que celui par lequel elle se
constitue. Comme une fiction est par dfinition le rcit d'une fiction et la fiction
d'un rcit, le niveau de la narration ne reprsente pas un niveau de langage
suffisant pour traiter l'histoire comme un langage-objet et lui appliquer les
prdicats "vrai" et "faux". Quand on dsigne les commentaires du narrateur par
les termes "mtadiscours", "mtanarratif" ou "mtalangage", il s'agit d'un abus.
Cet usage mtaphorique a son utilit, mais il ne doit pas faire oublier que dans
une uvre littraire l'histoire n'est jamais un vritable langage-objet, poussant
tre rellement prdiqu par le "mtalangage" du narrateur. Seuls le pritexte
et l'pitexte, pour autant qu'ils ne sont pas fictionnelles eux aussi par l'auteur,
constituent un tagement suffisant, une dnivellation assez forte pour atteindre
la consistance d'un mtalangage. La proprit pour un texte d'tre vridique ou
mensonger appartient ainsi au paratexte, ce qui montre une fois de plus toute
son importance.
Une prcision, pour finir sur ces pseudo-modalisations textuelles
explicites : si elles sont incapables de dfinir la vrit de luvre, elles n'en ont
pas moins un effet sur le lecteur. Si le narrateur est "digne de confiance"
198
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
(Booth), ces dclarations vont faonner et orienter la perception et la
comprhension du lecteur - au mme titre que des indications de rgie par
exemple. Quand Fielding dclare que l'histoire de Tom Jones est vraie et que
cette vracit la distingue des fictions de son poque, ces affirmations
dterminent la lecture de faon non ngligeable. On ne peut les carter
purement et simplement. Elles ont une signification pour le lecteur. Mais il faut
bien distinguer cette signification et cet effet de celui d'un nonc d'autorit qui
valuerait et dterminerait la ralit du contenu d'un texte. Ce sont des
indications sur la structure de la reprsentation de luvre, sur la
vraisemblance qu'elle produit et sur la lecture qu'elle exige. Ces commentaires
ont leur importance pour le statut ontologique de l'univers digtique de
luvre, mais pas pour la totalit de luvre. Aussi bien, ils peuvent compliquer
le registre de luvre s'ils sont en contradiction avec les indications du
pritexte, comme c'est le cas chez Genet. Mais ils n'ont alors qu'un effet
ngatif, leur efficacit et privative.
En dfinitive, il faut donc bien constater qu'il n'existe pas proprement
parler de modalisateurs textuels. Aucune dclaration modale explicite ne peut
donner le statut gnrique d'un texte, sous peine de tomber dans un paradoxe.
Si ces dclarations sont si courantes, c'est soit qu'elles cherchent prcisment
inscrire ce paradoxe dans le texte, soit qu'elles visent indiquer le
vraisemblable recherch par luvre. Mais le vraisemblable n'est pas la vrit.
Le XVIIe le savait bien qui recommandait de prfrer le premier au second.
C'est donc ailleurs et sous une autre forme qu'il va falloir chercher les
indices par lesquels un texte expose sa nature fictionnelle.
199
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
4- LES INDICES DE LA FICTION
"Nous saisissons prsent la condition essentielle
pour qu'une conscience puisse imager : il faut qu'elle ait la
possibilit de poser une thse d'irralit".
J.P. Sartre.
200
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Quels sont les moyens qui peuvent traduire l'attitude de l'auteur envers
son discours sans pour autant relever d'une intervention du narrateur ? Quels
sont les indicateurs de fictionalit qui peuvent viter l'aporie releve travers
Proust ? Pour les mettre jour, il faut revenir cette notion de modalisateurs
qui a t au point de dpart de cet examen du protocole de fiction.
Cette catgorie, on s'en souvient, rassemble des phnomnes
linguistiques aussi diffrents que des adverbes, des incises ou des flexions
verbales. Parmi eux, certains traduisent explicitement l'attitude du locuteur
envers son nonc : l'adverbe peut-tre par exemple. D'autres sont plus
implicites l'usage du conditionnel. Si l'on poursuit notre usage mtaphorique de
cette notion de modalisateur, il est possible de relever la mme diffrence dans
les moyens par lesquels une uvre littraire se prsente comme fictive. Il
existe en effet toute une srie de procds de fictionnalisation indirecte ; des
trait stylistiques, thmatiques ou textuels qui ont pour rsultat de classer un
texte dans le registre fictionnel. Ce sont des modalisateurs implicite mettons
des indices ou des symptmes de la fiction. A la diffrence des dclarations
examines prcdemment, ces traits montrent le mode de relation de l'auteur
son nonciation, sans le dclarer ni l'expliciter.
Ces indices sont trs varis et d'importance ingale.
Dans le cas de la littrature d'anticipation, par exemple, c'est la digse
tout entire, l'univers dcrit, qui permet au lecteur de dcider. Ainsi, la lecture
du Jeu des Perles de Verre d'Herman Hesse, le lecteur n'hsite pas un instant
quant au registre du texte qu'il a entre les mains. D'emble, le roman le
transporte dans une poque qui n'est pas la sienne, dans un futur indtermin,
o aprs une "re des guerres", les Nations se sont entendues pour tablir une
sorte de modus vivendi et permettre la fondation de ce fameux ordre
universaliste et esthtique, la Castalie, dont la vocation est de conserver et de
fait fructifier le patrimoine culturel de l'humanit, afin que celui-ci serve de
rempart contre la barbarie et une ultime conflagration. Parfois, ces indices
peuvent tre plus discrets, comme dans cette nouvelle de Cindia Hope, "Ocre
rouge", o c'est plutt l'onomastique des personnages et une certaine
dsinvolture envers la vraisemblance qui suggre que ce texte n'est pas
autobiographique ; jusqu' ce qu'on dcouvre au dtour d'une page que l'un
201
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
des personnages offre une licorne sa nice, cet animal fabuleux attestant
alors pleinement de la fictionalit du texte. Il ne s'agit que de deux exemples,
mais on imagine sans peine la richesse des ressources dont dispose un
crivain pour indiquer l'intrieur de son texte sa vise fictionnelle.
C'est donc l'ensemble de ces composants littraires, ayant une valeur
modalisante indirecte, qu'il faut maintenant examiner. Pour mettre un peu
d'ordre dans leur diversit, on se propose de les classer en fonction de leur
statut smiologique. On sait depuis Charles W. Morris que l'on peut avoir trois
points de vue sur un signe : un point de vue smantique si on le considre par
rapport la ralit ; un point de vue syntaxique si on l'envisage par rapport aux
autres signes auxquels il est li ; un point de vue pragmatique enfin si on
l'examine en fonction de son rapport ses utilisateurs, locuteur ou allocuteur.
Cette tripartition est bien pratique, mme si ses frontires ne sont pas toujours
faciles tracer, en linguistique comme ailleurs. Applique la ralit littraire et
plus prcisment au texte, elle va permettre de donner une vue d'ensemble des
indices de la fiction. Naturellement, il n'est pas question de prtendre les
recenser tous ; on espre simplement arriver donner une image fidle de leur
existence et de leur distribution. Aussi bien, on ne prtend pas faire uvre
originale, mais plutt rassembler des rsultats obtenus par des travaux
antrieurs, souvent trs diffrents dans leur manire d'tudier l fiction.
I - INDICES SYNTAXIQUES
Premier aspect qui peut modeler la perception du lecteur : l'aspect
syntaxique, au sens large, c'est--dire toute la texture proprement verbale, tous
les lments linguistiques et les relations qu'ils entretiennent entre eux, sur
quelque plan que ce soit. Une uvre littraire se dfinit entre autres, on le sait,
par le fait qu'elle est surdtermine sur le plan formel, qu'elle multiplie les
relations entre ses composants. Il y a donc une sorte de consistance propre au
texte littraire, sa matrialit, qu'il faut prendre en compte. A la diffrence de
Tzevetan Todorov, on ne fera pas de diffrence entre l'aspect verbal (les
lments linguistiques) et l'aspect syntaxique (les relations entre units
textuelles, phrases ou groupes de phrases) (Todorov, 1972, p. 376). Pour notre
propos, ces deux plans peuvent tre confondus.
L'importance de l'aspect syntaxique a t mis en relief par des travaux
pionniers dans le domaine des tudes sur la fiction ; travaux qui sont
202
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
prcisment des tentatives pour dfinir celle-ci dans sa littralit, pour la cerner
en considrant uniquement les signes verbaux qui la constituent, en faisant
l'inventaire des configurations verbales qui l'organisent. On veut parler, bien
sr, de Die Logik der Dichtung (1957) de Kate Humburger et de Tempus (1964)
d'Harald Weinrich. On ne rappellera pas leurs projets d'ensemble ni la totalit
des rsultats auxquels ils aboutissent : ce n'est pas l'objet de ce travail que de
se livrer une apprciation de ces tudes qui sont certes "incontournables",
mais qui souffrent aussi d'une propension la systmatisation qui est souvent
discutable (Schaeffer, 1987 ; Ricoeur, 1984, pp. 92-150). Par contre, on
retiendra l'apport le moins contestable de ces travaux : la mise en relief de
"rgularits" grammaticales, de proprits verbales faisant de la fiction un type
de discours marqu linguistiquement et, simultanment, produisant une
rception approprie chez le lecteur.
Ainsi, il est difficile de contester Weinrich que des temps comme le
pass simple, l'imparfait ou le plus-que-parfait sont dterminants pour la
constitution d'une "attitude de locution" manifestant un dsengagement du
locuteur, une "dtente" que le lecteur comprend comme le signal rpt de la
prsence en fiction, comme le dploiement d'un "monde racont" sans rapport
avec notre univers quotidien et les textes assertifs (ditorial, rapport, trait,
journal, essai, manuel) qui en relvent. Pareils toutes les uvres de la
littrature d'imagination, les textes autofictifs prsentent des traits lexicaux et
grammaticaux qui veillent chez le lecteur une autre coute que celle qu'il
accorde au monde et ses ouvrages. En particulier, on gardera en mmoire la
prcieuse remarque de Weinrich sur la valeur paradigmatique des
caractristiques formelles du conte merveilleux et de la manire dont,
immdiatement, il nous "arrache la vie quotidienne" par des formules comme
Il tait une fois... Once upon a time, Vor Zeiten, Erase que se era (pp. 46-47).
Witold Gombrowicz a russi utiliser merveille ce type d'incipit narratif,
en l'adaptant ses propres besoins. Quinze ans aprs Ferdydurke (1937) o il
mettait en jeu sa personne d'crivain et les effets suscits par sa premire
publication, aprs un exil en Argentine et des dbuts difficiles dans ce continent
o il tait inconnu, Gombrowicz ouvre Trans-Atlantique par ces lignes :
"Je ressens le besoin de transmettre la Famille, aux
cousins et amis, ce dbut que voici de mes aventures,
203
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dj vieilles d'une dcennie, dans la capitale argentine".
(Tr. C. Jelenski et G. Serreau).
A cette tape de son uvre, il tait difficile de percevoir autre chose
qu'un simple dbut ironique, cherchant donner le ton de ce rcit
pseudo-autobiographique o Gombrowicz parodie __ les vieilles chroniques
familiales polonaises des XVIIe et XVIIIe sicles, ainsi que le style baroque de
cette poque. Peut-tre que l'auteur de Trans-Atlantique lui-mme n'avait pas
encore senti toutes les ressources de ce type d'ouverture, ni pris conscience
qu'il pouvait en faire comme la clef de toute son entreprise fictionnelle.
Nanmoins, ds La Pornographie (1960), l'incipit n'a plus besoin de l'artifice
d'une chronique pour mimer le dbut d'un conte personnel :
"Je vous conterai une autre de mes aventures et, sans
doute, la plus fatale" (trad. G. Zisowski).
Enfin, Cosmos (1965), son dernier roman, n'a plus qu' reprendre une
formule qui dsormais a fait ses preuves ; le texte dbute ainsi
"Je vous raconterai une autre aventure plus
tonnante..." (trad. G. Sdiz).
Ainsi, en adaptant l'incipit du conte merveilleux sa propre entreprise,
Gombrowicz russit de concert commencer de faon lgante ses romans
d'aprs-guerre, d'indiquer d'emble leur registre fictionnel et d'tablir une
communication discrte entre chacun d'eux. Hormis l'identit de leur
narrateur-hros, ces romans n'ont aucun lien entre eux ; leur incipit dvoile
pourtant une solidarit essentielle, comme les les apparemment disperses
d'un archipel, qui communiquent sous la mer.
(Il faut dire que le conte merveilleux est chez Gombrowicz comme un fil
rouge qui court au travers de son uvre. De Bakaka au Mariage, il joue de
toutes les manires avec cette forme narrative, que ce soit pour la piller, la
parodier, la retourner ou lui rendre hommage. Mais est-ce vraiment tonnant ?
Faut-il rappeler la fascination qu'exerce Les Mille et une nuits depuis leur
introduction en Occident ? Le rayonnement de Perrault, de Grimm, d'Andersen
? Que la plupart des grands crivains ont caress le projet d'crire un conte de
fe, comme Joyce inventant pour son fils Le Chat et le diable ? La littrature de
fiction ne se pense-t-elle pas comme l'enfant du conte de fe, l'avatar de cette
204
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
pratique innocente de la narration ? Le conte merveilleux n'est-ce pas l'ge d'or
du rcit, le secret perdu d'un bonheur de narrer se passant de justification,
d'explication et de lgitimation, de causalit, de psychologie ou d'idologie ?
Comme le cinma parlant vis--vis du muet, "Le Grand Secret" selon Truffaut, il
y a sans doute au cur de la littrature d'imagination une nostalgie
irrpressible envers le merveilleux.
Avec l'apport de Weinrich, impossible d'oublier les procds de
fictionnalisation dgags par Kate Hamburger. Sans doute, ils sont moins
constitutifs qu'elle ne le prtend ; moins la manifestation de la "trame logique
cache" de la fiction, que celle d'une certaine formule romanesque, dont
Thomas Mann et Henry James pourraient tre les parangons. Reste qu'un des
mrites de son approche est d'avoir soulign l'abme qui existe entre le
fonctionnement de la fiction pique et celui du discours de ralit ou qui feint de
l'tre.
Elle isole six indices l'origine de cette diffrence fonctionnelle ; six
indices qui ont tous en commun de "draliser" le discours, d'orienter et de
faonner l'exprience du lecteur de manire lui faire prouver diffremment
un roman et un manuel scientifique. En sus des verbes de situation appliqus
un tiers et des dialogues entre tiers dans un pass lointain, il faut ajouter :
"... des indices qui, en eux-mmes, suffisent tablir
que la fiction narrative a une structure qui la distingue
catgoriellement de l'nonc (qui, rappelons-le, doit son
sujet d'nonciation rel sa valeur d'nonc de ralit)
l'utilisation la troisime personne de verbes dcrivant
des processus intrieurs, le discours indirect libre (qui en
est une consquence), la perte de la signification "pass"
du prtrit pique et la possibilit qui en dcoule de le
combiner avec des dictiques temporels (en particulier,
les adverbes de futur)..." (trad. fr., pp. 124-125).
Tous ces "indices" feraient systme pour permettre un monde "hors
espace et temps rels" et tmoigneraient d'une particularit logique du langage
l'tat fictionnel. A savoir que dans un rcit de fiction/"la narration peut tre
caractrise comme fonction, non comme nonciation" (p. 127). Par quoi, il faut
entendre qu'avec la fiction pique (la fiction la troisime personne) il n'y a plus
de sujet d'nonciation ni d'objet d'nonciation ; les personnes et les choses se
racontent elles-mmes.
205
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Sans suivre Hamburger dans les conclusions, on notera qu'elle dgage
des procds plus rcurrents que d'autres, des proprits linguistiques qui
constituent un style fictionnel (un style parmi d'autres, mme si celui-ci est
important dans notre paysage littraire) et partant un guidage de la lecture.
Tous ces indices sont par exemple particulirement prsents dans Les
Buddenzbrook de Thomas Mann. Cest par leur existence que Thomas Mann
russit faire de cette chronique historique d'une grande famille de ngociants
hansatiques, un vritable roman. Malgr tout le souci de vrit sociale et
historique qui anime le rcit du "dclin de cette famille", le lecteur n'a jamais le
sentiment de se trouver dans une monographie historique. Tout en analysant
avec mticulosit, sur quatre gnrations, les tapes de cette dcadence
physique et morale, Thomas Mann fait sentir chaque page au lecteur qu'il est
dans un monde qui se suffit lui-mme, qu'il n'a pas rapporter une ralit
historique qui le commanderait. C'est ce qui lui permet de s'incarner avec
autant de libert dans le dernier reprsentant de cette famille, de se ddoubler
dans Thomas Buddenbrook, l'amateur de Wagner et de Schopenhauer, qui ne
croit plus cette tradition austre et aristocratique qui l'a produit et qu'il est
charg de perptuer.
Comme l'a soulign Grard Genette dans sa prface de la traduction
franaise de Logik der Dichtung, le travail de Kate Hamburger ouvre une
contre indite dans le champ de la potique : l'analyse des procds formels
de fictionnalisation, des moyens linguistiques par lesquels une fiction se
constitue comme telle. Tous ces instruments d'irralisation, dont les effets sont
prouvs plus ou moins consciemment par le lecteur, sont particulirement
importants dans le domaine de l'autofiction o il est primordial que l'on ne
confonde pas la voix narrative et la voix de l'auteur, la "fiction de la fiction" et la
"vrit de la fiction".
Dans le sillage de ces approches syntaxiques de la fiction, on relvera
deux autres procds de fictionnalisation qui n'ont pas la mme envergure,
mais qui tous deux guident l'attention et les attentes du lecteur.
206
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- Le discours sur soi la troisime personne :
On a eu l'occasion plusieurs reprises d'voquer des autofictions
htrodigtique, des exemples de fictionnalisation de soi o l'auteur se
reprsente non pas comme un narrateur, mais comme un simple personnage.
Jusqu'ici on a trait de tels cas sans leur accorder d'attention particulire. On a
montr que ce type d'nonciation n'avait rien de transgressif sur le plan
linguistique, on l'a inscrit dans une typologie approximative. Bref, on a plutt
banalis ce type d'criture de soi. Il faut dire que l'existence d'autobiographies
la troisime personne, dcrites et analyses par Philippe Lejeune, invitait une
telle manire de se raconter quand elle est pratique avec quelque ampleur et
sans prise en charge par un projet autobiographique.
Sans doute, le discours sur soi la troisime personne s'enracine dans
les pratiques ordinaires du langage. On parle de soi comme d'un tranger, d'un
autre, quand on s'adresse un enfant ou dans des situations d'intimit. En ce
sens, c'est sans doute une "forme simple" du discours. Sans doute aussi,
l'criture de soi la troisime personne est prsente tant de faon ponctuelle
dans des autobiographies ordinaires que de faon mthodique dans certaines
uvres. Mais il faut bien voir aussi tout ce que cette pratique peut avoir de
droutante quand elle est ralise de faon permanente et sans avertissement
pralable. Parler de soi la troisime personne, c'est malgr tout faire comme
si l'on parlait d'un tranger, ou comme si un autre parlait de nous-mmes ; voire
osciller entre les deux (Genette, 1983, p. 73).
Dans le Roland Barthes par Roland Barthes, le lecteur est prpar
cette dissociation de soi par les normes d'une collection et des pages d'album
photographiques comments surtout la premire personne. Insensiblement,
ces prliminaires le prparent accepter et croire aux fragments critiques
htrodigtiques du livre. A la lecture de cet autoportrait la troisime
personne, on n'a pas le sentiment de dchiffrer une fiction. Mme la phrase
inaugurale du livre, inscrite au verso de la couverture ("Tout ceci doit tre
considr comme dit par un personnage de roman") ne distrait pas de cette
orientation. Le lecteur qui sait ses lettres comprend que la fiction qui est ici
dclare est celle qui nat de l'criture ("Le langage est, par nature, fictionnel",
crit-il dans La Chambre claire, p. 134) ; que Roland Barthes n'a pas la
prtention de concider avec lui-mme dans cet autoportrait d'un nouveau
genre.
207
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Par contre, si un tel dispositif de mesures est absent l'apparition
htrodigtique de l'auteur au premier plan d'une histoire ou au dtour d'un
pisode a quelque chose dirrel, ainsi dans La vie exagre de Martin Romana
de Bryce-Echenique. Le personnage auctorial qui surgit, le lecteur ne peut y
croire ; cette reprsentation dissocie de soi, il la reoit comme une ombre ou
comme une figure paradoxale. Ce n'est plus le sujet de l'criture de soi qu'il
apprhende, c'est le marionnettiste qui tire les fils de ses figurines. Sans
engagement autobiographique et sans relais qui pourrait assurer de sa ralit,
la reprsentation de soi la troisime personne est constitutivement
dralisante. Cet effet dralisant tient certainement au fait que, comme l'a
analys E. Benveniste, le il n'est pas vraiment "personnel", la diffrence du je
ou du tu : "La forme dite de troisime personne comporte bien une indication
d'nonc sur quelqu'un ou quelque chose, mais non rapport une personne'
spcifique (...) La consquence doit tre formule nettement : la 'troisime
personne' n'est pas une 'personne' ; c'est mme la forme verbale qui a pour
fonction d'exprimer la non-personne" (1946, p. 228).
- Le mode dramatique :
Le mode de discours propre au thtre prsente une caractristique
souvent remarque : la fictionalit. De mme qu'un texte dramatique est
immdiatement identifiable par des traits typographiques et formels, il est
implicitement suppos qu'il est fictionnel. Que l'on soit devant une scne ou
face aux pages d'une pice, que l'histoire soit reprsente ou perceptible par
les dialogues, totalement ou en partie invente, il ne parat pas discutable que
l'on a affaire une ralit imaginaire. C'est l un trait plus facile observer qu'
analyser. Et pourtant, il n'est pas contestable comme le note Octave Manonni
"Ce qui se passe sur la scne est ni d'une faon qui est propre au thtre (.e.)
le thtre, en tant qu'institution, fonctionne comme un symbole original de
ngation (Verneinung) grce quoi ce qui est reprsent le plus possible
comme vrai est en mme temps prsent comme faux, sans qu'aucune espce
de doute soit admis" (1969, p. 304).
Mme le thtre qui fait appel des vnements et des personnages
historiques, qui se dtache sur un fond dont l'historicit est indniable et qui
conserve un souci de vraisemblance, est marqu par cette valeur modale.
Quand Corneille emprunte l'histoire romaine la matire de Cinna, le lecteur
accepte tout cet univers comme autant de conventions, mais il ne doute pas
208
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
livre le dramaturge. Bien plus, c'est sur ce travail d'invention qu'il va juger
l'auteur et non sur ses emprunts la ralit historique.
Il est assez frappant cet gard qu'on ne possde aucune
autobiographie dramatique. Il nous semble que c'est l un phnomne curieux,
sur lequel on n'a pas assez mdit. Autant la littrature intime a investi
pratiquement toutes les formes de narration, s'est dploye travers toutes les
espces de configuration narrative, autant elle est reste trangement absente
de l'univers thtral. Il existe ainsi des autobiographies potiques, une criture
de soi potique ; il n'existe pas d'criture de soi dramatique. D'une manire
gnrale, le rgime discursif dramatique, l'criture thtrale, parat peu propre
l'expression de la vrit subjective. Ce n'est pas par hasard si les thoriciens de
la fiction prennent rgulirement le thtre comme paradigme et comme
modle explicatif du discours fictionnel (Warning, 1979 ; Herrnstein Smith,
1978). C'est qu'il y voient l'exemple par excellence d'une situation o le rapport
du langage au monde est court-circuit, o l'acte de rfrer des vnements,
des personnes, des lieux ou des choses, est un acte simul.
Comment expliquer ce phnomne ? Comment se fait-il que la forme
dialogue implique organiquement la fiction ? C'est l une question pineuse,
toujours vite et pour laquelle les moyens et l'espace manquent ici. On peut
simplement avancer qu'il y a sans doute convergence de raisons la fois
diffrentes et htrognes et parmi celles-ci :
a) des raisons historiques : chacun sait que Platon condamne, dans la
Rpublique, le mode dramatique, la situation d'nonciation o l'auteur parle
"comme s'il tait un autre". Il reproche la diegsis dia mimses dtre un
mode de reprsentation mensonger et illusoire. Ce rejet a sans aucun doute
pes d'un grand poids puisqu'on retrouve sa trace dans des polmiques
littraires du XVIIe franais, par exemple, qui ont pour enjeu la possibilit pour
la scne de prsenter la ralit historique. Si pour bien des questions littraires,
la Potique d'Aristote fut pendant des sicles l'ouvrage de rfrence, il semble
que sur ce point la problmatique platonicienne l'ait emport ;
b) des raisons fonctionnelles : il est vident que du mode narratif au
mode dramatique, il y a une norme perte de moyens textuels.
Paradoxalement, le thtre est peu propre la reprsentation de l'exprience
humaine dans toute sa complexit, en particulier de tout ce qui permet la
209
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
reprsentation de soi. Sauf laborer d'normes agencements scniques
comme Le Second Faust ou Le Soulier de Satin, la littrature dramatique
n'atteint jamais la puissance d'illusion du roman.
Quoi qu'il en soit des raisons de cette particularit, il faut retenir que la
simple traduction scnique d'tats de choses ou de personnages revient
pratiquement affirmer leur nature fictive. Des vnements et des individus
placs sur une scne, noncs dans un texte sous une forme dialogue,
deviennent fictifs presque mcaniquement. Tout se passe comme si les
caractres propres au rgime dramatique fonctionnaient comme autant de
signaux fictionnels pour la rception du lecteur.
Si le thtre procure immdiatement une impression d'irralit, ce trait va
marquer mme un texte o l'auteur se reprsentera lui-mme. Cette
particularit explique que l'on trouve quelque chose qui se rapproche de
l'agencement autofictif mme dans la littrature dramatique. Naturellement, ces
exemples d'autofictions dramatiques se comptent sur les doigts de la main :
L'Impromptu de Versailles, Rousseau juge de Jean-Jacques, Histoire de
Gombrowicz, La Grotte d'Anouilh, l'Eglise de Cline, Sodome et Gomorrhe de
Giraudoux, Six personnages en qute d'auteur de Pirandello sont parmi les
rares exemples que l'on peut citer. Naturellement, tous ces textes ont en
commun de se dispenser de tout protocole modal explicite. S'ils n'ont pas la
prtention de dire le vrai sur leur crateur, ils ne se proccupent pas de
l'indiquer. Leur fictionalit tient la seule existence de leur situation
d'nonciation. Parmi ces uvres, certaines sont lies au procd du thtre
dans le thtre, l'auto-rflexivit littraire comme chez Molire, Anouilh ou
Pirandello. Chez ces auteurs, la fiction de soi parat surtout tre la consquence
d'une mise en abyme paradoxale, o le texte reflte sa propre constitution et sa
propre existence. Mais c'est aussi le cas d'un certain nombre de textes
narratifs, du Quichotte aux Enfants du Limon de Queneau. Il est encore trop tt
pour dcider si ces uvres appartiennent rellement au domaine de
l'autofiction. Pour le moment, on se bornera noter qu'elles ralisent le
dispositif de l'autofiction, avec la spcificit du registre dramatique. L'absence
de narrateur fait en particulier que la figure auctoriale est toujours un simple
personnage (Molire, Ferdinand Bardage, Witold, Jean, "l'Auteur" identifi
Anouilh). Parfois, cette figure ne constitue mme pas un rle comme dans Six
210
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
personnages en qute d'auteur o Pirandello est seulement voqu dans le
dialogue.
A proximit de ces cas purs de fictionnalisation de soi en rgime
dramatique, il faut faire une place des textes o la forme dialogue est
importante, pour ne pas dire dominante : la pratique du dialogue et celle de
l'entretien. Dans les textes relevant de cette pratique, le rcit n'est pas
totalement absent. Il peut apparatre pour situer le cadre de l'interlocution,
prsenter les agents de cet change, rorienter l'change etc. Nanmoins sa
prsence est minime et c'est le discours dire qui domine. Dans ces cas aussi, le
mode d'nonciation intervient comme un signal auprs du lecteur et oriente ses
attentes dans le sens de la fiction. C'est le cas de beaucoup de dialogues de
Diderot, tels que Le Paradoxe du comdien, Le Rve de dAlembert,
L'Entretien sur le fils naturel, L'Entretien avec d'Alembert et Le Neveu de
Rameau. Diderot semble avoir trouv le modle de cette pratique dans le
dialogue philosophique, mme s'il en fait un usage diffrent. Ce genre discursif
permet un reprsentant auctorial explicitement identifi l'auteur : on l'a vu
avec Leibniz, mais les Entretiens sur la pluralit des mondes de Fontenelle en
fournissent une autre illustration. Au reste, Pluton lui-mme ne ddaignait pas
d'inscrire son nom dans le corps de ses dialogues comme le montre le Phdon
(59 b). L encore, il s'agit peut-tre moins d'une invention de soi qu'un artifice
commode pour exposer ses ides. Mais il faudra dmler ce point plus tard,
quand on tudiera les fonctions du dispositif de l'autofiction.
Pour finir cette section, on notera le caractre htrogne et partiel de
son inventaire. Les indices relevs, tout d'abord, psent d'un poids diffrent sur
la perception du lecteur les rgularits grammaticales soulignes par
Hamburger et Heinrich n'ont sans doute pas la valeur absolue que chacun leur
prte. Parmi tous ces indices, seuls ceux constituant le registre d'nonciation
dramatique peuvent se substituer un protocole de lecture explicite. Tous les
autres demandent tre accompagns d'autres moyens pour traduire de faon
indiscutable la fictionalit. Observons ensuite que le cadre de cette tude n'a
pas permis de pousser cet inventaire plus loin. Pourtant, il y manque des
indices qui ont un effet fictionnel indniable et qui sont, par ailleurs mis, en
uvre dans des autofictions. Ainsi, tous ceux qui concourent crer ce qu'on
peut appeler un style grotesque, dont l'effet dralisant est certain comme le
montre Agram Sers dans Andr-la-Poisse. Ainsi aussi, des traits mtriques
211
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
conventionnels comme ceux propres l'lgie romaine, dont Paul Veyne a
montr la dimension autofictionnelle dans son beau livre L'lgie rotique
romaine.
- II - INDICES SEMANTIQUES
Second aspect indiciel de la fiction considrer l'aspect smantique. Il
faut entendre cette expression dans un sens presque logique, comme
dsignant la relation du texte avec son Rfrent. Dans ce produit complexe
qu'est le contenu d'un texte, cet aspect dlimite les units de signification qui lui
donne sa dimension mimtique, la possibilit d'une illusion rfrentielle.
Contre les tenants d'un formalisme outrancier, l'existence de cet aspect
fictionnel vaut d'tre rappele
"Une uvre de fiction classique est la fois, et
ncessairement, imitation, c'est--dire rapport avec le
monde et la mmoire, et jeu, donc rgle, et agencement
de ses propres lments. Un lment de luvre - une
scne, un dcor, un personnage - est toujours le rsultat
d'une dtermination double : celle qui vient des autres
lments coprsents du texte, et celle qu'imposent, la
'vraisemblance', le 'ralisme', notre connaissance du
monde" (Todorov, 19(8, p.166).
Dans la section prcdente, c'est comme "agencement de ses propres
lments" que la fiction a donn les indices de son existence. A prsent, c'est
comme "imitation" qu'il faut l'envisager.
Cette perspective va permettre d'insister sur un phnomne littraire
nglig. C'est que les lments d'une uvre ne sont pas toujours commands
par un souci de vraisemblance ou de motivation. Il arrive le fait inverse, savoir
que certains lments ne soient l que pour montrer le caractre arbitraire d'un
rcit, pour souligner l'irralit d'une histoire et pour inviter la lecture ne pas
s'arrter aux vnements relats. Ainsi, du contenu dnotatif de ce petit rcit
boucl d'une morale, qui est appel fable. Ce n'est pas un hasard si La
Fontaine affectionne le terme apologue pour dsigner ce genre bref comme si
le rcit comptait moins que la leon que le lecteur pouvait en tirer. Comme l'a
soulign Karen Stierle, il y a une "invraisemblance programmatique" dans la
fable. L'utilisation d'un bestiaire humanis est avant tout au service d'une
212
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
thique, voire d'une politique : "Les animaux sont les prcepteurs des hommes
dans mon ouvrage" explique la Fontaine au Duc de Bourgogne. Son
invraisemblance est le "signe de l'intention allgorique constitutive du genre"
(Stierle, 1972, P. 182). Voil donc une illustration gnrique de la situation o
un contenu digtique a une valeur modalisante.
Selon un mcanisme similaire, une uvre peut afficher un protocole
modal de fiction exclusivement par des lments digtiques. Il lui suffit pour
cela de reprsenter des "tants", personnes, lieux ou tats de choses, qui n'ont
pas (ou pas encore d'quivalent dans l'univers du lecteur. On se rappelle peut-
tre que c'est essentiellement ce critre smantique que retenait Philippe
Lejeune dans sa description de l'autofiction :
"Pour que le lecteur envisage une narration
apparemment autobiographique comme une fiction,
comme une 'autofiction', il faut qu'il peroive l'histoire
comme impossible ou comme incompatible avec une
information qu'il possde dj" (1986, p.65).
Le dnominateur commun tous ces indices smantiques de fictionalit
est leur invraisemblance. Cette notion (avec son corollaire positif, la
vraisemblance), ne jouit pas d'un grand crdit aujourd'hui. Du fait de son
caractre normatif, elle a perdu beaucoup de son lustre depuis les potiques du
XVIIe sicle. Elle est mme, pourtant, de rendre encore quelques services si
l'on en fait un concept descriptif pour l'tude de la fiction. Un certain nombre de
tentatives, runies dans un volume de la revue Communication (n 11, 1968)
qui a fait date, ont dj t faites dans ce sens. Pour notre part, on emploiera
cette notion dans un sens troit, descriptif, et uniquement de faon ngative.
Sera considr comme invraisemblable tout lment digtique en
contradiction avec ce qu'enseigne une smantique lmentaire de l'exprience
quotidienne. Tout crivain voulant faire apparatre clairement la fictionalit d'une
histoire o il joue un rle, cherchera la draliser, la rendre invraisemblable,
en introduisant des donnes inexistantes, contradictoires ou fausses par
rapport la ralit physique et culturelle.
A propos du cinma, qui pose des problmes comparables on dispose
d'un tmoignage intressant sur ce travail de fictionalisation par l'introduction
d'lments digtiques invraisemblables. voquant le risque d'tre confondu
avec un personnage-narrateur, Alain Robbe-Grillet explique :
213
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"J'ai affront volontairement ce danger dans un de
mes films : Trans-Europ Express. C'est celui de mes films
qui a eu le plus de succs, par suite d'un malentendu
flagrant justement sur ce point. Voulant mettre en scne
une voix narrative, j'avais pris la peine de la ddoubler
sous la forme de trois personnages, un producteur au
cinma, une script-girl qui tait interprte par ma femme
et un auteur de films que j'avais imprudemment,
volontairement imprudemment, jou moi-mme. Le public
a vu Trans-Europ Express comme si c'tait un film de
Sacha Guitry : un vritable auteur expliquant son film qui,
en mme temps, est en train de se drouler sous les yeux
du spectateur. Mais le film entier tait prcisment
construit de faon rendre cette interprtation-l
impossible, c'est--dire absurde l'auteur dont je jouis le
plus ne pouvait pas tre l'auteur du film en question,
puisque, d'une part, il en ngligeait totalement un aspect
thmatique essentiel, celui de l'rotisme, et que, d'autre
part, du point de vue structurel, il n'avait aucune
conscience de l'architecture du rcit, et pour cause
puisqu'il en faisait partie lui-mme. M'tant rendu compte
de cette ambigut, j'avais pens ds le dbut draliser
au maximum ce personnage que je jouais. J'avais Ami
envisag de raser ma moustache mais je ne m'y suis pas
rsolu, et ensuite de faire doubler ma voix par un acteur et
a je l'ai fait : il existe une version du film, reste en copie
de travail, o la voix narratrice n'est pas la mienne mais
celle d'un autre. Malheureusement, comme toujours au
cinma, c'est sur l'effet produit qu'il faut se guider et l'effet
produit tait simplement celui d'un film mal doubl. J'ai
donc gard en dfinitive ma propre moustache et ma
propre voix ; et tous les spectateurs, qu'ils l'aient aim ou
non, taient persuads que vraiment j'tais en train de leur
expliquer mon film. A tel point que mes ennemis, voyant
ce personnage pompeux et dogmatique, assis raide dans
son compartiment, disaient : 'Ah vraiment, c'est tout fait
lui'. " (Nouveau Roman : hier, aujourd'hui, Paris, Union
gnrale d'ditions, coll. "10/18", 1972, t. I, pp. 232 sq).
Ce commentaire de Robbe-Grillet (qui fournit, au passage, un exemple
d'autofiction au cinma) montre bien l'importance des indices qui interdisent
une lecture rfrentielle et autobiographique d'une histoire. Ces indices peuvent
Vre si diversifis qu'il est difficile d'en faire un recensement systmatique. De
faon assez grossire, on distinguera deux grands modes d'invraisemblances
(physique vs culturelle), portant sur deux objets diffrents, l'univers du rcit et le
personnage auctorial, figurent l'auteur (mondaine vs auctorial). Le croisement
214
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
de ces deux axes fournit quatre types d'invraisemblances, d'indices
smantiques de fiction.
- Invraisemblance mondaine physique :
L'invraisemblance touche alors soit la totalit du monde naturel de la
fiction, soit seulement l'un de ses composants. Dans La Divine Comdie, c'est
la totalit de l'univers digtique qui est l'indice de la fiction. Le caractre irrel
de lieux comme le purgatoire, l'enfer ou le paradis suffit carter le texte d'un
rcit de voyage ordinaire et empcher une lecture littrale. Il en est de mme
des rcits qui reprsentent un monde inconnu, le pass, le futur ou des
espaces sidraux. Mais l'invraisemblance peut aussi notre le fait que d'un lieu,
voire d'un objet de l'histoire. Ainsi, la Recherche qui mle habilement des lieux
rels (Paris, Venise) et des endroits imaginaires : Balbec et Combray ; mme si
depuis 1971, un chef-lieu d'Eure-et-Loir a cru bon d'adjoindre ce dernier
toponyme fictif son nom Illiers-Combray. Dans "LAleph", c'est un seul objet
qui par son rayonnement porte toute la fictionnalisation : en relatant comment il
a pu contempler cet "objet secret et conjectural", o vient se rfracter
l'univers-pass, prsent et futur, Borgs donne une allure fantastique une
nouvelle qui, par ailleurs, est une sorte d'lgie une "Beatriz jamais perdue".
- Invraisemblance mondaine culturelle :
Dans ce type, l'irralit vient d'lments historiques, sociaux,
conomiques, artistiques, politiques etc. qui n'ont pas de correspondants dans
nos socits. Leur intervention fournit autant de propositions contre-factuelles,
dont la fausset est patente, dans le rcit. Ici encore, ces composants peuvent
occuper la totalit du rcit ou n'en Vre qu'un lment. Dans Le Chteau et Le
Procs, c'est tout le cadre social qui est manifestement fictif. Les institutions
dcrites par ces deux romans de Kafka constituent un cadre tel qu'il est
impossible au lecteur de confondre le personnage K. avec son crateur. Plus
discrtement, la Recherche sattarde sur des artistes clbres qui sont pourtant
inconnus dans notre univers culturel. Elstir, Bergotte ou Vinteuil ne sont pas des
personnages fictifs parce qu'il fallait mnager la personne ou la mmoire de tel
peintre, de tel crivain ou de tel musicien ; leur nature fictive interdit tout
dchiffrement extra-textuel, oblige rapporter leur existence au seul propos du
roman et tmoigne en fin de de la fictionalit de luvre tout entire.
215
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- Invraisemblance auctoriale physique :
L'invraisemblance porte alors sur la personne physique de l'auteur,
reprsente dans le rcit. Ce n'est plus l'histoire qui s'avre impossible, c'est la
ralit de son crateur, l'existence de son narrateur. Un rcit o le personnage
auctorial meurt (Loti dans Azyad), se mtamorphose en animal (J. Laccarire
dans Le Pays sous l'corce), vit son propre futur (Cavanna dans Maria), se
dplace dans l'espace (Copi dans La Guerre des pds), disparat dans un
tableau (Herman Hesse dans Esquisse d'une autobiographie) ne peut tre pris
la lettre, sans rendre son nonciation inconcevable ou dlirante. Dans tous
ces exemples, le caractre imaginaire de l'autoportrait est patent ; le lecteur n'a
besoin que de son bon sens pour le comprendre. Mais parfois, la perception
des indices fictionnels peut exiger un minimum d'information sur la biographie
d l'auteur. Ainsi, La Pornographie de Gombrowicz, dont la premire - page
annonce : "En ce temps-l, c'tait en 1943, je sjournais dans l'ex-Pologne et
dans l'ex-Varsovie, tout au fond du fait accompli". Impossible de comprendre la
valeur modalisante (et l'ironie) de cet incipit, si on ne sait pas que Gombrowicz
a quitt la Pologne en 1939, pour ne jamais y revenir.
- Invraisemblance auctoriale culturelle :
Si un crivain se reprsente en train de commettre des actes
sanctionns par la loi ou qu'il n'est pas pensable d'avouer, le lecteur verra sans
doute dans cette histoire une pure invention. Doubrovsky a ainsi eu le projet
d'crire un roman o il commettrait un meurtre ; dans Les Os de ma
bien-aime, Jacques Thieuloy se campe en anthropophage : la dvoration de
l'tre aim n'est plus une mtaphore ; dans Cit de verre, Paul Auster dcrit un
personnage qui a pris son nom et atteint le dernier stade de la clochardisation ;
dans Le Paysan perverti, Edmond cumule pratiquement tous les actes illicites
imaginables : de l'inceste l'assassinat, en passant par le vol ou la corruption.
- Un peu diffrent, mais ressortant aussi d'une impossibilit culturelle : un
auteur dclarant vivre sous une identit qui n'est pas la sienne, comme
Gombrowicz dans Ferdydurke ou Cendrars dans Moganni Nameh. Dans ce
dernier cas, le dispositif de l'auto fiction trouve sa version la plus conomique :
le protocole nominal et le protocole modal coexistent dans le mme support, qui
autorise la fois une identification de l'auteur et la mise en vidence du
caractre irrel de cette reprsentation de soi.
216
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Voil donc la fin de cet examen des moyens smantiques, propres la
dimension rfrentielle de l'histoire, par lesquels un crivain peut draliser
compltement ou en partie sa reprsentation. On ne cherchera pas donner
ce critre d'invraisemblance une rigueur qu'il ne possde pas. Il s'agit d'une
catgorie floue et lastique, dont la perception est lie des habitudes
culturelles qui sont difficilement formalisables. Toutefois, cela n'te rien son
caractre coercitif. Aussi vague que soit une telle catgorie, elle est
contraignante pour le lecteur et concourt fortement sa perception du registre
d'un texte. A la diffrence des indices syntaxiques, ces composants
smantiques sont suffisants pour classer un texte comme fictif. En dralisant
le Rfrent du rcit, on met en cause la ralit, ce qui est dj entrer en fiction.
- III - INDICES PRAGMATIQUES
Dernier aspect indiciel de la fiction envisager l'aspect pragmatique.
Gure heureuse, cette dnomination risque d'introduire une confusion. Quand
on parle de l'aspect pragmatique du texte, on devrait dsigner en toute rigueur
la faon dont il se prsente pour ses premiers usagers, l'auteur et le lecteur. Au
sens strict, cette expression conduirait examiner le pritexte, voire l'pitexte,
o se trouvent inscrites les traces de l'un et de l'autre. Toutefois, rappelons-le,
on se limite dans ces sections un examen des procds de fictionnalisation
internes au texte, abstraction faite de tous les autres facteurs qui peuvent
participer la constitution de la fiction. Il n'est donc pas question de revenir sur
les modalisateurs pitextuels ou pritextuels.
En ralit, nous visons ici tous les procds par lesquels un rcit mme
une communication diffrente de la relation d'une histoire ; toutes les uvres
o le texte se creuse pour ainsi dire, afin de produire en son sein une figure
d'nonciation distincte de la narration, afin de reprsenter une posture
communicationnelle propre. De mme que tous les textes crent leur propre
monde, un contexte smantique singulier que le lecteur est invit reconstruire/
tout rcit a la proprit remarquable de signaler l'attention du lecteur son
nonciation, par des marques spcifiques. Tout rcit a donc la capacit de se
distinguer de sa propre profration et par l de se redoubler, de se multiplier.
Mais il est des textes qui vont plus loin dans ce dcalage, en faisant de leur
nonciation un lment dterminant de l'histoire, en mettant sur le mme plan
l'instrument du rcit et le rcit lui-mme (Rousset, 1962, p.74) Ils se donnent
alors une situation de communication autonome, se fabriquent leur propre
217
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
contexte pragmatique, contexte fictif qui vient doubler leur contexte
pragmatique rel.
Soit La nause de Jean-Paul Sartre. On sait que ce livre est un roman,
qu'il est dsign ainsi par exemple dans les listes des uvres de Sartre : c'est
l son contexte pragmatique rel. Mais ce roman prsente aussi la particularit
d'tre un roman-journal, c'est--dire qu'il feint d'tre le journal intime d'un certain
Roquentin. Cette particularit a peu proccup la critique, fors de rares
exceptions, tant le contenu thmatique du texte appelait le commentaire.
Pourtant, Sartre a vritablement jou le jeu de cette mise en scne, en ouvrant
le texte par un "Avertissement des diteurs", en disposant des notes ditoriales
en bas de page, en donnant un rcit la premire personne discontinu, li au
droulement des jours et parfois des heures. Tout le roman imite ainsi un acte
d'criture sui generis, qui a ses rgles et ses licences propres. Ce dispositif
constitue un contexte pragmatique fictif, qui est aussi important que les tats de
choses, les vnements ou les personnages qui peuplent ce texte. C'est par
exemple lui qui rend supportables, savoureuses mmes, les analyses
existentielles du roman. Grce cet agencement, La Nause vite les cueils :
du roman thse. L'auteur Sartre adhrait peut-tre aux dveloppements
philosophiques du roman (dans Les Mots, plus d'un demi-sicle aprs sa
publication, il explique subtilement : "Je russis trente ans ce beau coup :
d'crire dans La Nause - bien sincrement on peut me croire - l'existence
injustifie, saumtre de mes congnres et mettre la mienne hors de cause").
Mais ces dveloppements sont avant tout crits par le personnage de fiction
Roquentin et cela change tout. Par indices pragmatiques, on dsignera donc
tous les moyens de cet ordre, par lesquels un texte feint dtre un recueil de
textes, un journal intime, des mmoires, une autobiographie, un manuscrit
trouv etc. .
Naturellement ce contexte pragmatique distinct, cette imitation d'un acte
ou d'une pratique verbale se donne toujours comme rel, au mme titre qu'une
histoire cherche emporter l'adhsion du lecteur en faisant comme si ses
vnements et ses personnages taient rels. Le roman-journal, comme le
roman pistolaire, le roman pseudo-autobiographique, le rcit enchss se
prsente pratiquement toujours comme une -non-fiction . Toutefois, par suite
d'une tradition culturelle importante, ces apparentes non-fictions fonctionnent
comme des uvres fictionnelles pour le lecteur. Comme le formule bien Jean
218
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Rousset, c'est une "fiction du non-fictif", "c'est par fiction qu'on exclut le fictif
(...). Et le lecteur le sait bien, tout le monde le sait, mais il y a toujours dans la
lecture, sous une forme variable, un consentement l'illusion" (1962, p. 76).
Peut-tre faut-il nuancer ce propos qui tend faire de ces formules fictionnelles
autant de conventions transparentes pour tous les lecteurs. Sans doute, comme
l'a not Thomas Pavel, s'agit-il moins de conventions proprement parler que
de "prconventions" qui demandent un apprentissage :
"Les prconventions recouvrent donc les rgularits
littraires qui n'atteignent pas la haute conformit des
conventions et doivent par consquent tre interprtes
comme des rgles locales, ou des indices de solution
dans un groupe particulier de jeux littraires. Au niveau
des techniques narratives, l'enchssement narratif (Les
Hauts de Hurlevent) produit le mme effet : afin de bien
douer le feu, le lecteur doit savoir (ou vite dcouvrir) que
les romantiques avaient l'habitude d'enchsser une
histoire peu vraisemblable dans une autre histoire
raconte la premire personne par un narrateur digne
de confiance. Que cette rgularit puisse, et doive, tre
apprise n'est pas un obstacle mon argument, puisque
dans les jeux, nous commenons par connatre quelques
rgles simples, et dcouvrons petit petit, des stratgies
de plus en plus complexes". (Javel, 1988, tr. fr., pp.
155-160).
A cette nuance prs, ces dispositifs d'nonciation sont donc des indices
srs de la fictionalit d'une uvre. En imitant des pratiques sociales d'criture
jadis trs rpandues, ils se signalent au lecteur comme simulacre et jeu. Il faut
donc retenir ces dispositifs comme autant de moyens de mettre en place un
protocole de fiction.
Reste qu'il faut dire tout de suite qu'ils sont peu utiliss dans le cadre de
la littrature autofictionnelle. La raison en est trs simple. Presque tous ces
agencements imitent des pratiques d'criture intime. Ds lors, ils sont peu
propices la fiction de soi. Le risque d'une confusion, d'une lecture
autobiographique est trop grand. Imaginons une version de La Nause o le
nom de Roquentin aurait disparu au profit de celui de Sartre. Seuls les intimes
de l'crivain auraient pu, lors de la parution du roman, comprendre qu'il
s'agissait d'un texte de fiction. Pour les autres lecteurs, ce roman serait un
vritable journal intime. Ce danger explique que ces "prconventions" ne
219
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
puissent tre employes pour l'autofiction, que sous e/une des conditions
suivantes qui limitent leur intrt et partant leur usage :
a. un profil thmatique contrast : on a vu un exemple de ce profil avec
Aurora de Leiris. C'est aussi le choix d'Hermann Hesse dans Le Loup des
Steppes : Barry Haller ne peut tre confondu purement et simplement avec son
crateur ; tout au plus peru comme une projection fictionnelle. C'est ainsi que
Hesse a pu utiliser la formule du roman pseudo autobiographique, mise au
point par Defoe dans son Robinson ; c'est aussi ce qui permet Restif
d'employer la formule du roman pistolaire, dans Le Paysan perverti. Edmond
mourant la fin du roman et prsentant de nombreux traits thmatiques
propres, Restif peut s'identifier lui par des substituts livresques et ainsi se
glisser dans cette aventure difiante sur "les dangers de la ville". La fictionalit
de l'ouvrage est ainsi assure autant par des moyens smantiques que par des
moyens pragmatiques dont Restif a trouv le modle chez Richardson, comme
il le relate dans Mes ouvrages.
b. Un rle de second plan : si la figure auctoriale a un profil actantiel bas,
un petit rle par exemple, la confusion avec un texte autobiographique sera
difficile. C'est le choix de Restif, encore, dans Ingnue Saxancour qui est, on l'a
vu, un roman pseudo-autobiographique o le personnage auctorial M. de
Saxancour n'est pas au premier plan du rcit. Cendrars, qui a souvent rendu
hommage cet crivain, adopte le mme parti dans Moravagine.
Seul le rcit enchss ou mtadigtique semble viter l'inconvnient
attach aux autres "prconventions", simulant une pratique d'criture
personnelle. Seulement on a vu que la littrature autofictionnelle ne prisait
gure la technique des embotements narratifs. On ne s'attardera donc pas sur
ce procd, l'essentiel ayant t dit lors de l'examen du profil narratif de la
figure auctoriale.
Dans l'ensemble, les indices pragmatiques se rvlent donc peu utiles
pour l'autofiction. Il fallait pourtant les voquer pour Vre systmatique dans cet
examen des signes fictionnels. Leur mise en vidence pourra se rvler utile
dans le chapitre suivant.
Aprs ce tour d'horizon trs clectique, il faut en effet tenter d'unifier
notre interrogation sur la fiction. Des questions restent en suspens. On peut
220
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ainsi se demander comment des indices aussi htrognes arrivent une
dtermination identique. Aussi bien, les raisons de leur efficacit demeurent
mystrieuses. Pourquoi, ces indices sont-ils plus importants pour le guidage de
la lecture que des dclarations explicites de narrateur ?
221
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
5 - LE DISCOURS FICTIONNEL
"- J'ai trouv dans un de vos livres un homme qui
parle et qui se conduit tout fait comme mon oncle.
Est-ce lui que vous avez copi ? - Non, mais je suis
toujours heureux d'apprendre qu'un de mes personnages
a un modle vivant".
E. Caldwell.
222
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Le chapitre prcdent a permis d'inventorier un ensemble de procds
par lesquels une uvre posait son irralit. Cet examen a montr comment
empiriquement le discours fictionnel se constituait et, dans le mme temps, se
signalait l'attention du lecteur, orientait sa perception et sa comprhension.
Cet inventaire a toutefois le dfaut de s'arrter cette description, du
reste partielle et morcel . Les indices recenss fonctionnent sur des plans
diffrents et de manire ingale. Il reste expliquer par quelle voie ils arrivent
au mme rsultat ; quel est le ressort commun qui leur permet de converger
vers le mme effet. Bref, ce recensement ne dit pas comment fonctionne
globalement le discours fictionnel.
Cette question est d'autant plus importante que la notion de fiction
utilise depuis notre dfinition initiale de l'autofiction n'a jamais t critique.
Depuis le dbut de cette enqute, elle est reste intuitive, dtermine par le
contenu que lui donne le sens commun et le langage ordinaire. Il importe par
consquent d'claircir ce qu'on entend par ce terme, de se poser la question :
qu'est-ce que la fiction ? Quelles sont les proprits de ce registre du discours ?
Qu'est-ce qui autorise cette sorte d'nonciation dlier son auteur de tout
engagement et ne pas tre prise la lettre par celui qui la reoit ?
On voit en quoi l'autofiction est directement concerne, par cette
interrogation. Il s'agit tout simplement de comprendre comment ce registre
d'nonciation peut dgager la responsabilit de l'crivain qui l'utilise, mme
quand il est nominalement impliqu par son contenu. Il y a dans l'autofiction un
phnomne tout de mme tonnant. Comme par la magie du radical "fiction",
par l'introduction d'un coefficient de fictionalit dans un agencement textuel, un
crivain peut faire les dclarations les plus folles, raconter les choses les plus
compromettantes, ce sera pour rire. Il peut prendre sur lui les passions et les
penses les plus asociales, sans que sa responsabilit ne soit engage, ni que
sa crdibilit n'en souffre - du moins en principe. La question est de savoir
comment un tel privilge est possible.
Avant de tenter une explication, on rappellera l'tat de la recherche dans
ce domaine, on cernera au plus prs notre perspective et enfin on soulignera
l'htrognit des ralisations du discours fictionnel.
223
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Une recherche en cours.
Face cette question massive qu'est-ce que la fiction ? , il faut
d'emble rappeler qu'on est loin de disposer actuellement d'une rponse qui fait
l'unanimit. Si le statut ontologique de la fiction est une vieille question
philosophique, dbattue au moins depuis le Parmnide de Platori, renouvele
par la philosophie analytique anglo-saxonne, la fictionalit littraire a t
longtemps ignore par les critiques et les thoriciens de la littrature - fors bien
star Aristote et sa Potique. Aucun des paradigmes thoriques qui se sont
succds depuis prs d'un sicle dans le domaine des tudes littraires, n'ont
permis par exemple, d'en faire une vritable question thorique. Le dernier en
date, impliquant une rduction linguistique des proprits et des mcanismes
littraires, rendait mme impossible ce questionnement (Pavel, 1988).
Certes, cette situation s'est modifie radicalement, surtout dans les pays
anglo-saxons et de langue allemande. La fiction est devenue un must
thorique, un objet d'tude qui a produit de brillantes analyses ces dix dernires
annes. La synthse de Thomas Pavel, Fictionnal Worlds, en tmoigne. On
reste encore, malgr tout, en pleine priode de dcouverte dans ce domaine.
Cette bullition est prometteuse, mais elle rend difficile la distinction des
analyses indiscutables : les thories, les approches et les concepts sont encore
en chantier pour ainsi dire. En outre, cet intrt pour la fiction commence
peine en France, ce qui rend difficile la connaissance et la participation, aux
dbats qui accompagnent cette recherche. Le "retard la traduction''
(phnomne typiquement franais) aidant; on est loin de toujours pouvoir
accder aux ouvrages et aux articles essentiels. Cette situation mritait dtre
rappele, ne serait-ce que pour expliquer le ct rustique de notre analyse.
Une question plurielle.
Le problme de le, nature de la fiction n'est pas simple. Il se prsente
sous des aspects, soulve des enjeux qui demandent tre nettement
dlimits. Comme l'a bien not Thomas Pavel, trois aspects sont distinguer :
"... les questions mtaphysiques, concernant les tres
et la vrit de la fiction, les questions de dmarcation qui
valuent la possibilit de tracer des frontires bien
prcises entre fiction et non-fiction ( la fois en thorie et
dans la pratique des analyses textuelles) et enfin les
questions institutionnelles, lies la place et
224
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
l'importance de la fiction en tant qu'institution culturelle"
(1988, pp. 20-21).
Ces trois ensembles de question ont une autonomie relative car ils sont
de nature diffrente. Pour notre propos, il est clair que seul le second ensemble
nous concerne directement. Seule l'analyse des bornes de la fiction se confond
avec la recherche des proprits distinctives et du mode de fonctionnement
original de ce registre discursif. Si les autres aspects de ce vaste problme sont
d'un grand intrt, ils peuvent tre dtachs de la question de la dmarcation.
Les envisager serait compliquer une question dj passablement embrouille et
outrepasser la perspective potique de ce travail.
Au reste, mme ainsi restreint, le problme de la fiction exige d'autres
limitations pour notre propos : (1) il ne s'agit pas d'envisager en soi la diffrence
fiction/non fiction ; cette dlimitation ne nous intresse que pour la littrature et
les textes littraires ; (2) il n'est donc pas question d'envisager les formes non
verbales de fiction ; ni mme d'ailleurs les formes verbales non littraires de
fiction, comme les exemples logiques, certaines formes de publicit ou de
citation (Herrstein Smith, 1978, 113) ; (3) on vitera aussi de confondre cette
question avec le problme de la nature du discours littraire, de la littrarit ; (4)
enfin, on ne confrontera pas la fiction au monde non fictif, la ralit. Notre
perspective sera celle d'un lecteur en contact avec les uvres. Comme le dcrit
Pavel,
"[Cette] approche interne vite de comparer les tres
et les propositions de fiction leurs correspondants non
fictionnels (puisqu'une telle comparaison montre
l'vidence aussi bien la vacuit des noms fictionnels que
la fausset des propositions qui les comprennent), et se
donne pour tche de reprsenter la fiction telle que ses
usagers la conoivent, une fois qu'ils entrent dans le jeu et
perdent de vue le domaine non fictif" (1988, P. 25).
Un registre htrogne.
Considr en lui-mme, le discours fictionnel frappe d'abord par son
infinie diversit, tant du point de vue de ses ralisations littraires que du point
de vue des lments qui peuvent concourir sa constitution.
225
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Le discours fictionnel n'existe pas, en effet, en soi dans la littrature. Il y
a des types de discours fictionnel institutionnaliss historiquement : le conte, la
fable, la lgende, la nouvelle, le roman, l'pope, la posie lyrique, la tragdie
et la comdie, le rcit fantastique, le roman pistolaire etc. Toutes ces formes
de fiction sont bien diffrentes, ne sont pas reues et classes dans la
littrature fictionnelle, pour les Mmes raisons. Aussi bien, elles sont nes
des poques distinctes, dans des paysages littraires diffrents.
Cette profusion historique recoupe bien sr une autre diversit. C'est, on
l'a dit, que le discours fictionnel, pour se prsenter comme tel, afin de guider la
reconnaissance du lecteur, a la possibilit de recourir des composants, qui
viennent de plan d'abstraction et de cadre de rfrence diffrents. L'examen
des modalisateurs fictionnels, explicites et implicites, a permis de percevoir
cette varit. Sans compter un "contrat de lecture" mis en place dans le
pritexte, contrat modulable de bien des faons, la fiction peut se constituer par
des traits aussi bien syntaxiques, que smantiques ou pragmatiques
(pseudo-pragmatiques). Cest bien sir cette diversit structurelle qui fonde la
profusion des ralisations historiques C'est parce que la fiction peut se former
par des lments aussi htrognes qu'il existe autant de types de fiction
historiquement dtermins.
0n ne fait que rappeler des vidences. Reste que cette diversit
structurelle et historique fait douter de la possibilit de mettre au jour une
structure profonde du discours fictionnel, une sorte de matrice que l'on
retrouverait sous-jacente tous les types de fiction. Les diffrentes tentatives
faites pour trouver des universaux du discours fictionnel, quelle que soit la
perspective choisie ne peuvent que fortifier ce doute. Que l'on considre le
travail de Kate Hamburger, par exemple, cherchant donner une dfinition
logico-syntaxique de la fiction, ou mme la tentative de John Searle (1982; cf. la
critique de Pavel, 1988), tentant d'apporter une solution pragmatique, aucune
de ces"dmarches essentialistes ne s'est rvle satisfaisante. D'une faon
gnrale, tous les essais faits en ce sens donnent penser qu'il n'existe pas de
caractres constitutifs universels, de quelque ordre qu'ils soient, appartenant au
discours fictionnel.
Pourtant, l'infinie varit des fictions ne fait pas problme pour le lecteur,
ne semble pas troubler sa perception culturelle. Qu'il s'agisse d'un roman
d'aventure ou d'une nouvelle minimaliste amricaine, l'amateur de fiction sait
226
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
retrouver chaque fois la bonne posture de rception. Hormis le cas duvres
ambigus, il fait d'emble la distinction avec le non-fiction arrive sans difficult
identifier le registre imaginaire. Barbara Herrstein Smith a bien observ ce
paradoxe qui fait que notre capacit d'analyse thorique de la fiction semble en
raison inverse de notre perception spontane :
"It seems clear (...) that no matter how vague or naive
our litterary theories, or how problematic our explicit
definitions, we do make functional discriminations
between, say, biographies and novels, and between the
transcriptions of actual utterances and the scripts of plays,
through the very manner in which we experience and
interpret them, and the sort of value and implications they
have for us. In other words ; we take them as different
kinds of things and, accordingly, take them differently"
L'auteur de ce livre remarquable qu'est On the margins of Discourse
ajoute, en outre, que l'enfant acquiert trs tt les moyens de distinguer ce qui
est fictif de ce qui ne l'est pas :
"Most children learn at a relatively early age that some
of the things we tell them are really true and others are
'just stories or, more generally, that sometimes we are
saying things to them and at other times using language in
a rather different spirit and with a different force. They
learn to make this distinction quite in ignorance of, and
independent of, categories such as fact and fiction or
chronicle and tale. Nor do they make the distinction of the
basis of the inherent credibility or 'imaginativeness of a
narration : for many contemporary storybooks narrate
banal events about banal characters hardly
distinguishable from events and persons in their own lives,
while many things we tell children truly must seem
inherently incredible in terms of a childs own experiences.
(How believable, for example, can a child of four find our
statement that men have traveled to and walked on the
moon Yet the child will appreciate the difference between
our telling him. that and our telling him a story about a boy
with a red balloon.) The distinction between, on the one
hands, things that are said and, on the other hand, things
such as stories, nursery rhymes, songs, and verbal games
is learned, rather, on the basis of the childs own
differential experiences with respect to each : the different
contexts in which they occur the different vocal tones in
which they are delivered, the different stylistic features
227
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
they may exhibit, but most significantly, the different force
- implications and consequences - they have as verbal
structures" (1978, pp. 44-45).
Sil y a dans notre comptence de lecteur, ds l'enfance, le savoir
ncessaire l'identification du discours fictionnel, il faut bien supposer que ce
registre discursif prsente une certaine unit, quelque proprit distinctive, en-
de ou par del la multitude de ses types institutionnaliss. De fait, il 'y a au
moins une proprit que le lecteur peroit intuitivement dans toutes les fictions :
c'est qu'il s'agit de communications joues, d'imitations d'nonciations verbales,
qui ne doivent pas avoir d'effets rels sur son comportement. Autrement dit, le
lecteur le moins averti sait que ce discours qui se donne comme rel pour
l'mouvoir, qui prsente des personnes et des tats de choses comme s'ils
existaient vraiment, n'est pas "srieux", n'appelle pas une comprhension
littrale. En adhrant "l'illusion rfrentielle" de cette configuration verbale il
sait qu'il s'agit d'une sorte de jeu, qu'il ne faut pas y croire jusqu'au bout. Le
discours fictionnel exige ainsi une comprhension ambivalente faite de foi et de
scepticisme, une attitude contradictoire, mixte dadhsion aveugle et de
clairvoyance. Cette double injonction est "programme" dans toutes les formes
de fiction, selon un "dosage" trs variable qui produit chaque fois un quilibre
diffrent.
Si comme l'a affirm Karlheinz Stierle "L'usage projet d'un texte donne
les rgles de sa constitution" (1972, p.189), c'est dans ces instructions
contradictoires qu'il faut chercher l'unit du registre fictionnel. C'est la dmarche
de Rainer Warning dans un article pntrant, qui recoupe les analyses de
Barbara Herrnstein Smith : "Pour un pragmatique du discours fictionnel" (1979).
On le citera longuement car il met en place les notions essentielles pour saisir
le fonctionnement du discours de la fiction :
"Dans le discours fictionnel la situation d'nonciation
n'est pas immdiatement dtermine par une situation
demploi, ce qui n'quivaut naturellement pas une simple
clipse de celle-ci. Il se produit plutt une espce de
clivage de la situation : une situation interne d'nonciation
entre en opposition avec une situation externe de
rception. Le discours fictionnel se dfinit donc
pragmatiquement par la simultanit de deux situations
qui disposent chacune de son propre systme dictique.
Or, pour tre prsent dans deux situations simultanes, le
228
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
sujet se voit confront avec ces instructions
contradictoires d'agir que la thorie de la communication
appelle le paradoxe pragmatique du double-bind. On peut
rsoudre de tels paradoxes pragmatiques en plaant l'un
des termes de l'opposition sur un plan hirarchique plus
lev pour ainsi rendre illusoire l'opposition. Mais pour
ceux qui sont pris dans le paradoxe Mme, une telle
solution est impossible - moins qu'ils ne puissent se
sauver par l'issue de la situation ludique. C'est au thtre
qu'il nous est donn d'assister l'exemplification typique
et en mme temps la rsolution - ludique - de ce
double-bind, et c'est en effet le modle thtral qui peut
tre considr comme le paradigme de la constitution
situationnelle du discours fictionnel en gnral. Nous
avons l, d'un ct, une situation interne dnonciation
avec locuteur(s) et destinataire et nous avons, de l'autre
ct, une situation externe de rception qui a ceci de
particulier que, l'encontre de la situation interne d'non-
ciation, le destinataire se voit priv d'un rapport deux
avec un locuteur rel. Ce locuteur rel, l'auteur, a disparu
dans la fiction Mme, il s'est dispers dans les rles des
personnages fictifs y compris, dans les genres narratifs, le
rle du narrateur. ( ... ) L'auteur peut bien tre absent
comme locuteur rel. Il reste prsent sous forme des
conventions pragmatiques, smantiques et syntaxiques
qui, respectes ou violes, organisent le discours mme.
Le clivage dictique le double-bind dont nous avons parl,
apparat comme la convention pragmatique majeure. Loin
d'branler l'identit de la performance discursive, il la
fonde, de sorte que situation interne d'nonciation et
situation externe de rception reprsentent les deux
termes d'une opposition qui constitue une situation de
communication homogne. La fictionnalit est donc
fonde en une prsupposition situationnelle. En tant que
telle elle est essentiellement contractuelle et, partant,
historique" (1979, pp. 327-328).
Rorganise pour les besoins de notre dmarche, l'analyse de Warning
sur la fiction, permet d'avancer les propositions suivantes
(a) "Le modle thtral () peut tre considr comme le
paradigme de la constitution situationnelle du discours fictionnel en gnral".
Le thtre, on l'a vu, est un terrain privilgi pour saisir le mcanisme de
la fiction. Au thtre, on assiste la reprsentation d'vnements et de
personnages qui sont le plus souvent imaginaires et qui pourtant sont prsents
229
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
comme rels. La scne dlimite un espace conventionnel o se droule une
action imaginaire, mais en mme temps elle carte le spectateur, le tient
distance des enjeux, des mouvements et des consquences de cette action. La
scne trace ainsi la frontire entre deux univers, la ralit et la fiction. Dans son
cercle magique, l'illusion rgne ; au-del, c'est le rel. Le pourtour de la scne
est comme un pli entre deux mondes que le spectateur doit habiter en Mme
temps. S'il veut jouir du spectacle, il lui faut en effet suivre le droulement de la
pice avec attention, se laisser entraner par les vnements reprsents par
les acteurs, bref donner sa crance "l'illusion thtrale". Mais il ne doit pas
intervenir pour juger ou arrter le cours de l'action ; il doit se garder de suivre le
comportement de ce soldat, rapport par Stendhal dans Racine et Shakespeare
"L'anne dernire (aot 1822), le soldat qui tait en faction dans l'intrieur du
thtre de Baltimore, voyant Othello qui, au cinquime acte de la tragdie de ce
nom, allait tuer Desdemona, s'cria : 'Il ne sera jamais dit qu'en ma prsence un
maudit ngre aura tu une femme blanche'. Au mme moment le soldat tire
son coup de fusil, et casse un bras l'acteur qui faisait Othello". Le spectateur
voit des gestes, entend des dialogues qui sont promus l'existence, tout
instant, par l'auteur, le metteur en scne, les acteurs et le personnel technique,
mais qui ne sont que des simulacres, comme doit le lui rappeler tout moment
l'espace de la scne.
Le thtre prsente par consquent avec un relief extraordinaire la
situation commune de la fiction, on l'on donne voir des actes et des
vnements qui ne sont pas en train d'arriver, mais qui sont reprsents
comme tant en train d'arriver. Il matrialise une situation duelle o coexistent
une certaine ralit et une thse d'irralit ; une situation o il faut croire au
spectacle montr et pourtant ne pas agir en consquence. Il faut croire la
"situation interne d'nonciation" de la pice, mais rester lucide quant sa
"situation externe de rception" qui est aussi celle du spectateur. Le thtre
ralise ainsi un clivage qui est structurel toute fiction, le discours fictionnel
demandant la Mme rponse divise son agencement.
(b)"Dans le discours fictionnel la situation d'nonciation n'est pas
immdiatement dtermine par une situation d'emploi... Il se produit plutt un
clivage de situation : une situation interne d'nonciation entre en opposition
avec une situation externe de rception".
230
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Comme le dfinit 0. Ducrot, "on appelle situation de discours l'ensemble
des circonstances au milieu desquelles se droule un acte d'nonciation (qu'il
soit crit ou oral)" (1972, P. 417). Peu d'actes d'nonciation, comme il le
rappelle, sont comprhensibles sans la connaissance au moins des traits
pertinents de leur situation. Une situation discursive est commande par toute
une srie d'lments qui relvent aussi bien de l'nonc que de l'interaction
locuteur/allocuteur et, dans le cas de cette nonciation diffre qu'est un
ouvrage littraire, du moment de sa production et du moment de sa
reconnaissance (Wunderlich, 1972).
Le propre dune nonciation fictive est de faire clater ses circonstances,
de ddoubler sa performance discursive, sa situation de communication.
Doublant le procs rel et historique o lcrivain publie un livre, un procs
simul et intrieur au texte se droule, qui peut prendre des formes varies
mais qui se ramne aussi toujours la relation par un narrateur d'une srie
dvnements l'intention d'un auditeur (narrataire). Il y a donc le
"ddoublement suivant des instances nonciatives :
auteur-narrateur-narrataire-lecteur" (Kerbrat-Orecchionie 1980, p.172), du
moins dans le cas de figure le plus simple, et un ddoublement corollaire du
contexte pragmatique. C'est l un trait de la fiction sur lequel on a eu l'occasion
d'insister et qui est bien connu. Pour qu'il y ait un texte de fiction, ou plutt pour
qu'un texte soit lu comme tel, il faut une double duplicit : la fiction d'une
histoire et la fiction dun discours prenant en charge cette histoire. Le lecteur
doit pouvoir croire l'histoire relate et au rcit qui en est fait. Le second terme
de cette duplicit est au moins aussi important que le premier, pour ne pas dire
plus : la matire de la fiction, comme le dit justement Roger Blin, n'est pas
moins des "vnements raconts" que l'"vnement de les raconter" ; et son
ressort, autant le "rcit d'une fiction'' que la "fiction dun rcit" (1954, pp.
318-319). C'est ce dernier simulacre, cette nonciation feinte, qui vient diviser la
situation de communication globale de toute fiction. A l'inverse, un ouvrage
rfrentiel comme les Essais de Montaigne ne prsente pas cette dualit dans
sa performance discursive. Dans cet autoportrait, le contexte pragmatique rel
historique. (Montaigne publiant en 1580 un recueil de rflexions l'intention du
public lettr de son temps), ne se distingue pas de son contexte interne :
l'nonciateur qui prend en charge les contenus propositionnels se confond avec
l'auteur effectif de ces propositions.
231
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
En dcrivant cette proprit constitutive de la fiction, on ne fait que
rappeler un fait notoire. A ceci prs qu'il n'est pas certain que lon ait tir toutes
les consquences ncessaires de cette situation. En particulier, le fait que ce
soit par cette proprit de simuler une nonciation que le discours fictionnel est
immdiatement reconnu par le lecteur le plus ingnu. Quand celui-ci
manque la fictionnalit dune uvre, c'est prcisment parce que la
"feintise" dun acte de langage na pas t perue, soit par manque dlments
textuels, soit par une comptence insuffisante du lecteur.
Barbara Herrnstein Smith a soulign ce point de faon trs pertinente.
Dans le passage qui suit, elle emprunte ses exemples la posie et insiste sur
la dimension conventionnelle de la fiction :
What is central to the concept of the poem as a fictive
utterance is not that the character or persona is distinct
from the poet, or that the audience purportedly addressed,
the emotions expressed, and the events alluded to are
fictional, but that the speaking, addressing, expressing,
and alluding are themselves fictive verbal acts. To be
sure, a fictive utterance will often resemble a possible
natural utterance very closely, for the distinction is not
primarily one of linguistic form. Moreover, although certain
formal Natures - verse, most notably - often do mark and
indeed identify for the reader the fictiveness of an
utterance, the presence of such features are not
themselves the crux of the distinction. The distinction lies,
rather, in a set of conventions shared by poet and reader,
according to which certain identifiable linguistic structures
are taken to be not the verbal acts they resemble, but
representations of such acts. By this convention, Keat's
ode "To Autumn'' and Shakespeares sonnets are
precisely as fictive as "The Bishop Orders His Tomb" or
Tennyson's "Ulysses". The statements in a poem may, of
course, resemble quite closely statements that the poet
might have truly and truthfully uttered as a historical
creature in the historical world evertheless, insofar as they
are offered and recognized as statements in a poem, they
are fictive. To the objection, Put I know Wordsworth meant
what he says in that poem, we must reply, you mean he
would have meant them if he had said them, but he is not
saying them. we may choose to regard the
composition not as a poem but as a historical utterance,
but then the conventions by virtue of which its fictiveness
is understood and has its appropriate effects are no longer
in operation" (1978, p. 28).
232
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
On retrouvera cette importance des conventions pour la consti-
tution de la fiction dans la dernire proposition de Warning.
(c) "La fictionnalit est donc fonde en une prsupposition situationnelle.
En tant que telle, elle est essentiellement contractuelle et, partant, historique.
Pour comprendre cette dernire proposition, il faut revenir une fois de
plus Dieter Wunderlich, sur qui s'appuie constamment Warning. Par
prsupposition situationnelle, le premier entend la fois la connaissance et les
capacits du locuteur, ainsi que tout ce qu'il peut prsumer de l'auditeur savoir
et moyens, espace perceptif, relation sociale qui les rattache (1972). Cest
videmment sur ce modle qu'il faut comprendre le discours fictionnel : ce
dernier se constitue en fin de compte en fonction de la comptence prsume
(par l'auteur) du lecteur, identifier un clivage situationnel. Plus avant, ce
clivage ne repose que sur des conventions, des signes linguistiques, textuels
ou pritextuels qui n'ont de valeur fictionnalisante qu'en fonction dun "contrat",
lui-mme enracin dans un "march" historiquement dtermine fait d'un
systme de normes et d'attentes qui reprsentent comme l'horizon littraire
d'une poque.
Prenons le cas du conte merveilleux. On a vu que l'entre en fiction de
cette performance discursive se signalait par des indices lexicaux et
smantiques. Mais ces indices ne sont tels qu'en fonction de conventions
historiques et culturelles, reconnues comme telles une poque donne et
perptues par les appareils scolaire et culturel. Ce n'est pas parce que ce
"genre" se retrouve dans toute l'Europe qu'il est par essence et de toute ternit
fictionnel. La rcurrence de ce genre signifie tout au plus que ses lments se
prtent particulirement bien la dissociation situationnelle de la fiction et que
le merveilleux prsente une idalit qui transcende la diffrence entre les
langues et les cultures europennes. Autrement dit, il n'y a rien dans sa
configuration qui en fasse un agencement constitutivement fictionnel. Le
discours mythique de certaines cultures africaines ou amricaines, dot
pourtant d'un coefficient rfrentiel, prsente des particularits lexicales et
smantiques qui le rapprochent du Merveilleux europen. La meilleure preuve
de cette contingence des lments signalant la fictionnalit, c'est qu'ils ne sont
pas drivables d'un clivage situationnel : on ne peut dduire a priori les
diffrentes formes institutionnalises de fiction partir de la situation duelle
propre la fiction.
233
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Si la fictionalit est bien un registre d'nonciation commun de
nombreux discours institutionnaliss, ce registre est toujours fonction d'une
situation d'emploi, qui elle-mme dpend dune pratique culturelle
transcendante et par l d'une situation historique englobante. Cette "convention
pragmatique majeure" (la situation clive de la fiction) peut tre ralise par des
voies bien diffrentes, faisant intervenir au choix des prsuppositions de
lecture, l'intention communicative du locuteur, les qualits phonologiques et
syntaxiques ou la smantique du texte. Dans le mme article, Warning rsume
bien cette impossibilit de dgager une structure profonde de la fiction qui
pourrait gnrer au sein dun modle homogne, l'ensemble des discours
historiques qui culturellement ont t reconnus comme fictionnels :
L'impossibilit de dfinir de faon satisfaisante la
fictionnalit l'aide des caractristiques de la situation
d'nonciation fictive elle-mme. La fictionnalit
prsuppose plutt une situation externe qui la dfinit en
tant que telle. Elle est donc essentiellement contractuelle.
Et par-l, le discours fictionnel est intgr au mme titre
que le discours non fictionnel dans une pratique sociale
transcendante. Ce genre d'intgration peut varier en
fonction de l'poque et du genre littraire. A l'poque de
l'art dit pr-autonome la situation de rception est
hautement codifie en situation demploi typifie. Il suffit
de nommer, dans cet ordre d'ides, la mise en scne de la
littrature courtoise dans le cadre des ftes de cour, ou
toute forme de thtre institutionnalis. A l'poque
post-courtoise, donc depuis le XVIIIe sicle environ,
larticulation de la situation de rception va en dcroissant"
(1979, p. 331).
Cette impossibilit de donner d'autres rquisits que sa situation clive
la fiction explique l'htrognit des indices fictionnels, des modalisateurs
recenss. Pour que le discours fictionnel existe, l'essentiel est cette division
nonciative qui fait coexister un contexte pseudo-pragmatique ct de son
contexte pragmatique rel. Ds lors, tous les moyens sont bons, si l'on peut
dire. Tous les procds qui permettent de poser une thse d'irralit, pour
reprendre le terme de Sartre, qui permettront de draliser l'nonciation du
narrateur, directement ou indirectement, seront retenus. Comme la littrature a
en propre une surdtermination formelle et fonctionnelle, ces procds se
trouvent souvent multiplis et utiliss de faon concurrente.
234
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Cette primaut du clivage situationnel permet, aussi, de comprendre
pourquoi les dclarations textuelles explicites ne peuvent dfinir un texte
comme fictif sans devenir paradoxales, sans se prsenter comme une aporie
pour le lecteur. Si l'essentiel pour une fiction, pour sa constitution, est cette
division de l'nonciation globale, le narrateur ne peut dsigner lui-mme son
statut, car il n'est que l'effet de cette situation d'nonciation fictive qu'il prtend
fabriquer. Ce n'est pas par des dclarations d'intention que la fiction existe en
tant que telle, c'est par la mise en place d'un dispositif d'nonciation, dun type
de communication agenc de faon particulire. Le narrateur peut bien
multiplier les auto-dsignations et les avertissements, ce qui importe, c'est sa
posture ; posture qui est commande par des signes qui ont un rel pouvoir
dissociatif soit parce qu'ils relvent du pritexte, soit parce qu'ils contribuent
constituer l'nonciation (indices syntaxiques et pseudo-pragmatiques), soit enfin
parce qu'ils ont une valeur ngative assez forte pour dcrocher le texte de toute
rfrentialit (indices smantiques).
Cette situation clive de la fiction explique, enfin, qu'un dispositif comme
l'autofiction soit possible. Si l'auteur se reprsente de faon explicite, il prend le
risque dune interprtation littrale de son nonciation. Mais d'un autre ct, le
discours fictionnel offre assez de ressources pour que son personnage
apparaisse comme un tre imaginaire, pour qu'il soit dot d'un coefficient de
lecture qui l'carte de toute rception "srieuse". Ds l'instant o le lecteur
adhre compltement la fiction, il la peroit comme une imitation d'nonciation
et par suite perd tout intrt pour un dchiffrement en termes de vrai/ faux.
Soustrayant l'autorit de la valeur de vrit l'auteur lui-mme, le lecteur prend
acte du fait qu'il est face une "assertion non vrifiable", qui "ne se laisse pas
corriger par une connaissance plus exacte des faits auxquels elle se rapporte''
(Stierle, 1979. p. 299).
235
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Q U A T R I E M E
P A R T I E :
S T R A T E G I E S
"Il se mfiait. Il voulait pas trop rajeunir. Il se dfendait.
Il a voulu que je lui explique encore tout ... le pourquoi M.
Et le comment M. C'est pas si facile... C'est fragile comme
papillon. Pour un rien a sparpille, a vous salit.
Qu'est-ce qu'on y gagne J'ai pas insist".
L.F. Cline.
236
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
1 - FONCTIONNALITE D'UN DISPOSITIF
SCHIZOPHRENE
"On ne confondra pas fonction et intention : une
fonction peut tre dans une large mesure involontaire,
une intention peut tre manque ou dborde par la
ralit de luvre".
G. Genette
237
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Bilan et perspective.
Deux protocoles de lecture ont t tudis en dtail. Cet examen, peut-
tre fastidieux, tait ncessaire pour passer dune dfinition intuitive une
dfinition plus rigoureuse de l'autofiction, pour montrer la diversit de leur
manifestation. Raliss par des procdures varies, de manire plus ou moins
appuye, de faon plus ou moins univoque, ces deux protocoles font de
l'autofiction un dispositif gomtrie variable, d'une trs grande souplesse
d'excution. Ils en font aussi un agencement excessivement retors et, au total,
assez compliqu si l'on veut avoir une vue densemble de son existence
gnrique.
Aprs ce travail d'analyse, on pourrait penser qu'une synthse serait la
bienvenus. Ne faut-il pas maintenant recomposer ce qu'on a dissoci ? Runir
les traits pertinents distingus pour chacun des protocoles ? Construire une
typologie partir de toutes les variables dgages ? Apparemment, c'est la
seule faon de poursuivre cette tude des proprits distinctives des textes
autofictifs. La runion de tous les paramtres rglant les deux protocoles
permettrait une mise plat de toutes les possibilits du dispositif, dcouvertes
jusqu' prsent de faon isole. En rassemblant tous ces facteurs et en les
faisant fonctionner simultanment, on obtiendrait une typologie, mes possibles
d'autofiction. Non seulement cette typologie apporterait un supplment de
cohrence thorique notre dmarche mais, de surcrot elle ouvrirait des
angles d'approche indits pour la comprhension de la fictionnalisation de soi
littraire.
Un tel geste est toujours tentant par ce qu'il laisse augurer de matrise et
de rigueur. Toutefois, il nous semble qu'il ne faudrait pas cder cette tentation
formaliste. Si l'on ne veut pas tre en contradiction avec ce qui a t dit
propos du discours fictionnel, il faut respecter la proposition qui a sous-tendue
son tude : la fonction dtermine la forme, la convention commande le
dispositif, le contrat organise l'agencement. Lucien Dallenbach a montr que la
mise en abyme servait autant "dsambiguser" un texte, assurer la clart de
son message (usage naturaliste), qu' rflchir son caractre littraire ou
permettre sa polysmie (usage symboliste)'(1977, pp. 78, 152). De mme, tous
les exemples d'autofictions mobiliss dans cette enqute ont manifest une
"disponibilit fonctionnelle et idologique" du dispositif importante, presque une
238
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
nature de "mercenaire textuel". Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de
dominantes ni de grands choix formels que l'on ne puisse remarquer. Mais il
faut se garder d'attacher mcaniquement un effet un procd, se garder
d'oublier qu'un mme dispositif peut servir des projets opposs.
Plutt que de partir d'une typologie formelle, on dressera donc un
spetre fonctionnel : on se demandera quoi peut servir ce dispositif de
fictionnalisation de soi, quels sont les effets qu'il peut bien remplir. Ce nouveau
temps dans notre enqute va permettre de faire un tri dans notre corpus.
Jusqu' prsent, on s'est content d'enrichir d'exemples et "transformations
rgles" notre dfinition de dpart. Toutes les actualisations du dispositif taient
par consquent bonnes prendre. On s'est peu proccup de savoir si ces
uvres avaient rellement pour enjeu d'laborer une fiction de soi. De faon
parfois abusive, on a mme mobilis des uvres dont le caractre fictif tait
quivoque, dont l'identification auctoriale tait rticente. Il faut maintenant
mettre un peu d'ordre dans les ralisations de ce dispositif, sparer les cas
"purs" d'autofiction des cas "impurs", partir de l'usage qui en est fait, en
fonction du rle qui lui est dvolu.
Un dispositif schizophrnique.
Avant cet examen fonctionnel, on aimerait toutefois insister sur les
implications et les consquences de ce dispositif pour ses usagers (auteurs et
lecteurs), quand il est ralis dans toute sa puret.
Considrons d'abord, en amont de l'autofiction, la situation d'un auteur
qui s'invente des aventures imaginaires. Qu'est-ce qui peut motiver une telle
dmarche ? Le bnfice de ce geste est vident. La fictionnalisation de soi
matrialise un rve qui est constitutif de la littrature ; elle ralise littralement
un dsir qui souvent n'est satisfait que socialement ou marginalement : se
textualiser, transformer sa vie en littrature et partant tre fils (fille) de ses
uvres. A partir de la pratique du pseudonyme, qui le satisfait partiellement,
Marthe Robert a bien formul ce rve de se crer soi-mme :
"Je suis fascine par les pseudonymes. Que Grard de
Labrunie signe Grard de Nerval () que Stendhal et
Kierkegaard lvent la continuelle invention de faux noms
la hauteur dune cration, jy vois non pas de la
dissimulation, mais un aveu aussi sincre que naf.
L'auteur pseudonyme (...) dit dans sa signature mme ce
qui est en fait son mobile le plus profond, par-del les
239
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
intentions et les ides qui constituent ses raisons de
publier : le dsir de remanier son tat-civil et de nier ainsi
toutes les dterminations biologiques, psychologiques et
sociales auxquelles ltre ne peut rien changer. Il dit sa
volont de rompre la chane des gnrations dans
laquelle il est jamais insr( ... Y Cette tendance
invtre se refaire une identit, qui fait positivement le
romancier, certains crivains la dveloppent un tel
degr que, non contents de la librer dans leurs livres, ils
cherchent encore la satisfaire dans leur vie, dussent-ils
pour cela ctoyer la folie'' (1981, pp. 97-98).
Cette page permet de situer la fictionnalisation de soi aux cts de
l'invention dun pseudonyme et de l'laboration d'une lgende, en l'articulant
l'un des ressorts les plus importants de l'criture littraire. En s'inventant un
pseudonyme, l'crivain fonde son identit, rebours de l'humanit ordinaire qui
la reoit, comme l'avait bien compris Cendrars : "... je suis le premier de mon
nom puisque c'est moi qui l'ai invent de toutes pices". En s'inventant une
lgende, il se fait lui-mme, la diffrence du commun des mortels qui s'adapte
tant bien que mal aux circonstances : Byron, Baudelaire, Rimbaud l'ont montr
chacun de faon diffrente ; notre poque se caractrise aussi par la difficult
rendre crdible longtemps une lgende : "On ne soigne plus sa lgende" disait
Breton. Dans les deux cas, cette invention de soi ne se concrtise pourtant qu'
l'extrieur de luvre de l'crivain. Avec le pseudonyme et la lgende, le dsir
dtre fils (fille) de ses uvres se satisfait dans la reconnaissance sociale et
culturelle mais cette matrialisation demeure hors de ce qui est le plus vital
pour un crivain, son texte. Au contraire, avec lautofiction, l'crivain s'invente
lui-mme dans son criture, dans ses histoires, dans ses fictions, bref dans son
uvre. En entrant dans son propre texte, il obtient ainsi le privilge d'tre
jamais un personnage fictif, de jouir du mme statut qu'Hamlet ou Don
Quichotte. Cette satisfaction explique que, poux quantit d'crivains, la fiction
de soi n'a pas, mme figuralement, une finalit rfrentielle. En outre, avec
cette forme de fiction, ils sont gagnants sur tous les tableaux : ils se donnent
la fois la libert du fantasme, d'un espace o toutes les oppositions et tous les
interdits sont suspendus ; et le bnfice de l'effet mimtique que procurent les
noms propres, spcialement le leur, qui renvoient des personnes relles.
Seulement, il ne faut pas sous-estimer tous les risques lis ce jeu avec
son patronyme et sa biographie. En les dstabilisant et en les brouillant,
l'crivain rompt une distinction tacite entre la personne et luvre qui permet
toutes les licences d'criture. !Il y a l un passage la limite qui n'est pas sans
240
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
consquences ni sans risques. L'auteur d'une autofiction, en mettant en scne
sa personne, peut-tre ses intimes, peut-tre d'autres, s'expose provoquer de
vives ractions dans sa vie prive, professionnelle ou publique. Mme s'il
russit ne pas mettre en cause sa famille ou ses relations, il s'expose tre
jug sur un terrain qui n'est pas le sien, sur un terrain A tous ses crits seront
interprts de faon littrale, sans aucune considration esthtique. En
principe, ce danger ne devrait pas exister puisque toute autofiction est une
uvre dimagination, une forme de fiction. Il faut nanmoins se rappeler que
cette pratique n'est prise en charge par aucun discours, que le lecteur moyen
nest pas prpar la lecture de ce type duvre. A ce jeu, l'auteur est donc
presque toujours perdant car, mme quand ses reprsentations de lui-mme ou
des autres ne seront pas outrancires, elles seront toujours fausses en regard
de la ralit et des habitudes des lecteurs, toujours considres comme
mensongres - et comme telles condamnables.
G. de Nerval est une bonne illustration de ce danger de la
fictionnalisation de soi. Pour s'tre livr imprudemment cette pratique, il a eu
droit un port rait terrible d'Alexandre Dumas, publi dans Le Mousquetaire du
10 dcembre 1853 et repris dans la ddicace aux Filles de Feu :
C'est un esprit charmant et distingu, comme vous
avez pu en juger, - chez lequel, de temps en temps, un
certain phnomne se produit qui, par bonheur, nous
l'esprons, n'est srieusement inquitant ni pour lui, ni
pour ses amis ; - de temps en temps, lorsqu'un travail
quelconque l'a fort proccup, l'imagination, cette folle du
logis, en chasse momentanment la raison, qui n'en est
que la matresse ; alors la premire reste seule, toute-
puissante, dans ce cerveau nourri de rves et
d'hallucinations, ni plus ni moins qu'un fumeur d'opium du
Caire, ou qu'un mangeur de haschisch d'Alger, et alors, la
vagabonde qu'elle est le jette dans les thories im-
possibles, dans les livres infaisables. Tantt il est le roi
d'Orient Salomon, il a retrouv le sceau qui voque les
esprits, il attend la reine de Saba ; et alors, croyez-le bien,
il n'est conte de fe, ou des Mille et une Nuit, qui vaille ce
qu'il raconte ses amis, qui ne savent s'ils doivent le
plaindre ou l'envier, de l'agilit et de la puissance de ces
esprits, de la beaut et de la richesse de cette reine ;
Tantt il est le sultan de Crime, comte d'Abyssinie, duc
d'gypte, baron de Smyrne. Un autre jour il se croit fou, et
il raconte comment il l'est devenu, et avec un si joyeux
entrain, en passant par des pripties si amusantes, que
chacun dsire le devenir pour suivre ce guide entranant
dans le pays des chimres et des hallucinations, plein
241
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
d'oasis plus fraches et plus ombreuses que celles qui
s'lvent sur la route brle d'Alexandrie Ammon ;
tantt, enfin, c'est la mlancolie qui devient sa muse, et
alors retenez vos larmes si vous pouvez, car jamais
Werther, jamais Ren, jamais Antony n'ont eu plaintes
plus poignantes, sanglots plus douloureux, paroles plus
tendres, cris plus potiques !.. .
On notera que ce morceau de bravoure est plus crit que rflchi.
Manifestement, Dumas a voulu faire des effets au dtriment dun jeune
confrre, qu'il croyait peut-tre dj enferm. Tel quel pourtant, ce passage
reproduit tous les sentiments ambivalents que peut produire la fictionnalisation
de soi l'accusation de mythomanie et l'affirmation du caractre intenable de ce
projet littraire ; la reconnaissance malgr tout de sa sduction et de son
efficacit, ds lors que l'auteur se donne le rle de guide dans sa fabulation.
Presque un sicle auparavant, Diderot avait eu droit un portrait non
moins satirique, pour ses nombreux Dialogues il se fictionnalise, sous la plume
de Garat dans Le Mercure de 1779 :
"Promenant son imagination sur les ruines de l'antique
Italie, il se rappelle comment les arts, le got et la
politesse d'Athnes avaient adouci les vertus terribles des
conqurants du monde. Il se transporte aux jours heureux
des Lelius et des Scipion ou mme les nations vaincues
assistaient avec plaisir au triomphe des victoires qu'on
avait remport sur elles Beaucoup de monde entre alors
dans son appartement Il me distingue au milieu de la
compagnie et il vient moi comme quelqu'un que l'on
retrouve aprs l'avoir vu autrefois avec plaisir" (cit par E.
de Fontenay, 1981, pp. 224225).
Une fois encore, l'crivain qui se fictionnalise est pris littralement,
comme un individu hors de lui-mme, possd par son imagination et ses
inventions - comme s'il n'tait pas acceptable qu'un homme de lettres brouille
les limites de la littrature et de la vie, du dedans et du dehors de la fiction, de
l'extrieur et de l'intrieur de la reprsentation. Il faut dire que, d'une faon
gnrale, le sens commun accepte tris mal le travestissement dun individu.
Quand cette mtamorphose n'a pas lieu dans un cadre social qui la lgitime,
elle fait du fabulateur un coupable en puissance. Se crer de toutes pices,
s'inventer un nom, une origine, une histoire, n'est-ce pas bon pour "un assassin,
un cambrioleur, un collaborateur" comme l'affirme Elsa Triolet au dbut de
L'Inspecteur des ruines ? Plusieurs auteurs de romans policiers ont exploit
242
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
cette mfiance du sens commun envers qui se fictionnalise, ce sentiment
partag que nous prouvons face la fabulation, mme manifeste, d'autrui.
C'est ainsi que Donald Westlake et Ruth Rendell, respectivement dans Adios
Scheherazade (Minerve, 1985) et Douces morts violentes (Belfond, 1987), ont
chacun mis en scne un personnage tenant un journal intime o il s'inventait
des aventures imaginaires, presque incroyables, mais intgres dans le rcit de
leurs vies vritables. Comme par hasard, ces journaux autofictifs seront
l'origine de toutes sortes de catastrophes et feront de leurs rdacteurs plus que
des suspects, des criminels.
Il y a ainsi dans la production d'une autofiction un effet pervers qui parat
presque fatal. C'est qu' vouloir se mtamorphoser en personnage de roman,
l'crivain prend le risque qu'on identifie srieusement ce personnage avec lui-
mme. Dans son Journal, Gombrowicz, dont pourtant toute luvre roma-
nesque utilise le dispositif de l'autofiction, a formul trs clairement ce danger et
la paralysie qu'il peut provoquer pour un crivain
"Je manque encore, semble-t-il, de fanatisme dans ma
passion pour ma propre personne, et de mme n'ai-je pas
su - par peur des autres - me donner cette vocation qui
m'incombe et creuser suffisamment la question. C'est moi
- le premier et sans doute le seul de mes problmes : le
seul, l'unique de tous mes hros auquel vritablement je
tienne" (Journal I, 1953-56 pp. 204).
Cette remarque de Gombrowicz signale une dimension de la littrature
souvent nglige, savoir qu'elle ne va pas sans imagerie sociale, que la
perception d'un crivain est faite aussi des images de lui-mme qui sont
vhicules un peu partout. Ces images sont en partie produites par ses
interventions, ses dclarations, ses comportements et, bien sr, ses uvres ;
en partie faite par l'interprtation qu'en donnent les mdias, l'opinion, la
communaut. Pour cette dernire, l'Image est importante, c'est elle qui lui
donne barre sur ces fabricants dnoncs, qui la confortent ou la drangent. Cre
sont bien souvent ces images qui portent vers la lecture d'un crivain inconnu
qui donnent le dsir de lire les uvres d'un crivain jusque-l ignor. Tout
crivain est conscient de ce rle des images, de la ncessit de composer avec
elles, d'laborer ses stratgies de publication et de comportement en fonction
d'elles. Si la littrature est une institution, comme on tend de plus en plus
l'affirmer, alors se pose pour chaque crivain la question de sa lgitimit et de
sa crdibilit. Dans notre univers post-romantique, cet aspect est le plus
243
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
souvent occult : on prtend se contenter des textes. Il n'est pas certain
pourtant qu'une uvre ne se ressente pas du crdit social et culturel dont jouit
ou ne jouit pas son auteur.
Le dispositif de l'autofiction met par dfinition en danger cette crdibilit.
En utilisant, l'crivain prend le risque de passer pour un mythomane invtr,
comme l'ont pris Restif, Nerval, Loti, Cline ou Gombrowicz en mlant la fiction
leur vcu. Le problme, c'est que les effets de cette pression sociale, de ce
souci de garder son crdit, ne sont pas facile mesurer dans un texte ou chez
un auteur sans que l'analyse devienne immdiatement, comme par le "retour du
refoul rductrice. Comme le dit bien Pierre Bourdieu, cest alors qu'"il faut
choisir de payer la vrit d'un cot plus lev pour un profit de distinction plus
faible" (1982, p. 10). Pourtant, ce risque constitutif l'criture de l'autofiction
explique sans doute bien des agencements retors, permettant l'crivain de
risquer son nom propre tout en se gardant une marge de replie pour le cas o
le jeu didentification fictionnelle se retournerait contre lui.
Pour illustrer ce cas de figure, on ne citera quun exemple : Moravagine
de Cendrars Ce roman, on l'a vu, ne donne qu'un petit rle son auteur, mme
si cette place est en vrit essentielle, voile par une formidable ellipse du texte
qui cherche comme censurer les relations entre Cendrars et Moravagine.
Mais il nen a pas toujours t ainsi : le manuscrit, conserv au fonds Cendrars,
de la Bibliothque de Berne, prsente une version de l'histoire bien diffrente :
le narrateur est Cendrars lui-mme, en personne, sous son nom. Au dpart
Cendrars voulait donc se reprsenter comme lhomme lige de Moravagine. Puis
il a recul, biff son nom et mis la place celui d'un narrateur imaginaire,
Raymond la Science. Peur des jugements ironiques de la Presse ? Souci de ne
pas inquiter des proches ? Volont de ne pas s'exposer une censure
possible ? Refus de l'diteur ? La raison qui a conduit Cendrars modifier son
manuscrit restera jamais mystrieuse. Le fait est que celui-ci montre bien que
le poids de l'Image pse mme sur un crivain aussi peu conventionnel que lui.
Pour clore cette considration, on signalera un artifice ingnieux pour
les candidats l'autofiction ne voulant prter le flanc aux ricanements de tout
bord. Le procd est Paul Auster, auteur dune trilogie new-yorkaise, dont le
premier volume est Cit de Verre. Au lieu de donner directement son n un
personnage, Auster a trouv le moyen suivant. Il commence par camper un
personnage fictif qui a un nom et une identit thmatique propres : Quinn,
244
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
auteur de romans policiers sous un pseudonyme de William Wilson et vivant
New-York. Et c'est seulement aprs coup, comme par la suite d'une erreur, qu'il
donne son patronyme ce personnage. Alors que Quinn est chez lui, train de
lire le dbut des Voyages de Marco Polo ( Pour quun livre soit droit et
vritable, sans nul mensonge, nous vous donnerons les choses vues comme
vues et les entendues comme entendues ). Aussi, tous ceux qui liront ou
couteront ce rcit doivent le croire parce que ce sont toutes choses vritable le
tlphone sonne :
- All ? fit la voix.
- Qui est-ce ? demanda Quinn.
- All ? rpta la voix. Ecoute, dit Quinn. Qui est-ce ? -
Est-ce Paul Auster ? demanda la voix. Je voudrais parler
M. Paul Auster" (Tr. fr. P. Furlan p. 12).
Quinn commence par refuser cette identification force ; puis il s'y prte
entirement, A la suite de quoi, il connat toutes sortes de tribulations et sombre
dans l'abjection, la folie et la mort. Tout lui est permis puisquil y a eu erreur sur
la personne et qu'il n'est qu'un faux homonyme d'Auster.
Lautofiction n'est, toutefois, pas seulement une entreprise prilleuse
pour son auteur. En aval du texte, le lecteur se trouve dans une contradiction
insoluble. Comment lire un "roman" dont l'auteur est l'un des personnages ?
Comme une fiction ? Comme un texte vise rfrentielle ? Les deux la fois?
Ni l'un ni l'autre ? Si lire c'est faire fonctionner un texte (et donc actualiser son
registre de lecture), la question se pose. Devant une autofiction, 0'' doit obir
deux injonctions. contradictoires : lire le texte comme une fiction et comme une
autobiographie. Pourtant, ces deux registres sont incompatibles, que ce soit par
leurs protocoles, leur rapport au rel ou leur usage. Ce sont deux systmes de
communication dont la synthse est impossible, deux territoires aux frontires
bien dlimites, Mme si des procds formels peuvent s'changer et circuler
de l'un l'autre. Sauf que le texte autofictif tire son sens de ces deux registres
et de leur coexistence Mme au niveau de l'nonciation, le lecteur est face un
paradoxe au sens strict, un paradoxe pragmatique. Un paradoxe parce qu'il n'y
a l nul sophisme ni abus de langage. Un paradoxe pragmatique parce que la
duplicit n'est pas au niveau de ce que dit le texte, mais dans la manire dont il
fait sens, s'nonce ou signifie.
245
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Mutatis mutandis, le lecteur est pris dans ce que les thoriciens de
l'cole de Palo Alto, la suite des travaux de Bateson sur la schizophrnie ont
popularis sous le terme de double-bind (Bateson, 1956 ; Watzlawick, 1967) :
une "situation double contrainte". Dans le domaine de l'interaction humaine,
on sait qu'un individu est prisonnier d'une telle situation quand il est l'objet d'une
communication qui se contredit elle-mme, d'un nonc ou l'intrieur d'un
cadre de rfrence sans ambigut, quelque chose est formul sur ce cadre qui
le dnie. Un tel type de communication paradoxale a pour effet d'interdire
l'usage du niveau mtacommunicatif, la capacit de communiquer sur la
communication, la perception des nuances entre les diffrents registres de
communication - et de produire terme un schizophrne. Sans forcer
davantage la comparaison, il faut reconnatre que le lecteur face un texte
autofictif se trouve devant le mme registre indcidable et dans une situation
tout aussi intenable : il se trouve dans limpossibilit de distinguer le littral et le
mtaphorique et de choisir entre ces deux registres. Selon son temprament, il
dcidera alors que toute luvre a un sens cach (rponse paranoaque qu'elle
n'appartient aucun registre-type dfini (rponse hbphrnique) ou qu'elle ne
prsente aucun intrt (rponse catatonique).
Fonctions du dispositif.
Naturellement, le lecteur est rarement conduit ces extrmits car une
autofiction est pourvue d'tiquettes, d'indices, de signaux mtacommunicatif qui
lui permettent de comprendre qu'il s'agit d'une sorte de jeu, qu'il est devant une
uvre d'art. Bien plus, ce double-bind de l'autofiction ne fait que prolonger et
redoubler le double-bind constitutif de la fiction, signal par Warning et dcrit
depuis longtemps sous la catgorie de "mensonge''.
C'est, en effet, depuis l'Antiquit que la littrature est place sous le
signe de la duplicit. Chaque poque a reconnu plus ou moins explicitement
qu'elle supposait de part et d'autre, du rle de la production celui de la
rception, une totale mauvaise foi. L'auteur par Iillusion qu'il cherche , rendre
crdible ; le lecteur par la bonne volont qu'il met adhrer cette illusion.
Cette description, parfois transforme en accusation, de la littrature en termes
de simulation, rendait compte de la posture d'nonciation du discours fictionnel.
Elle visait aussi dfinir la lecture comme un champ permissif ou nombres
d'oppositions irrductibles sont dsamorces, A des stratgies contradictoires
trouvent un compromis.
246
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Ainsi, si en droit le dispositif de l'autofiction est embarrassant pour le
lecteur, s'il ne peut conduire qu' une uvre impossible, en fait la plupart des
textes offrent une solution cette contradiction. On a volontairement insist sur
le caractre intenable de la fictionnalisation pour mettre en valeur le geste
provocant que reprsentait son existence. En ralit, comme on s'en doute,
aucun lecteur n'est jamais devenu schizophrne la lecture d'une autofiction.
Le lecteur trouve la plupart du temps une solution l'antinomie de cette posture
d'nonciation. De mme que le double-bind de la fiction trouve une "rsolution
ludique". l'autofiction offre le plus souvent un compromis qui permet daccorder
ses contraires. Quelle solution ? Comme pouvait le faire prvoir l'htrognit
du corpus, celle-ci n'est pas unique. Lexamen attentif des textes montre que,
loin de ne remplir qu'une fonction, le dispositif permet des effets multiples et
Mme contradictoires. Selon les uvres et selon les auteurs, le lecteur
constate, en effet, que dans certains cas le texte autofictif est recontextualisable
alors que dans d'autres, il demeure irrductible. Autrement dit, deux cas de
figures se prsentent : a) le lecteur peut recontextualiser le dispositif, c'est-
-dire lui trouver malgr sa particularit une appartenance gnrique, une place
dans le systme des genres et des pratiques littraires. On supposera que ce
lecteur est comptent, que sa recontextualisation n'est pas une "trahison", une
"mconnaissance par assimilation" (Derrida). Dans ce premier cas, c'est le
texte qui offre des "appels d'interprtation" en ce sens, qui mnage au lecteur
une orientation de lecture telle qu'il peut rattacher le dispositif des stratgies
balises, essentiellement rfrentielles et rflexives comme on va le voir.
b) Le texte demeure irrductible toute recontextualisation. L'usage qu'il
fait du dispositif n'est pas soluble l'aide d'une catgorie gnrique
conventionnelle. Par rapport la comptence du lecteur, son savoir littraire et
culturel, le dispositif est alors une "forme sans fonction". Pour lire, le lecteur doit
pouser le mouvement du texte, s'assujettir son autorit et une signification
qu'il ne tire que de lui-mme. Il se trouve alors devant ce que Ross Chamber
appelle un "texte difficile", qui appelle un travail d'interprtation important et qui
peut provoquer des effets varis angoisse, sentiment de rsistance, vertige, jeu
etc. (1982)
C'est selon ces deux orientations que se distribuent les ralisations du
dispositif, qui peuvent se dtailler fonctionnellement de la faon suivante :
247
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
al) fonctions rfrentielles
Le dispositif de fictionnalisation de soi sert en ralit une vise
didactique, constative ou autobiographique. Loin dtre le moyen dune plonge
dans l'imaginaire, il sert au contraire une volont de vrit ;
a2) fonctions rflexives
Le dispositif permet des textes spculaires ou autorfrentiels. Il produit
alors une forme spcifie de "mtalepse", par laquelle luvre se "dnude" ou
s'auto-glorifie ;
b) fonction figurative
Cette dernire fonction est une hypothse de travail. Il faudra se
demander si les ralisations ne correspondant pas une stratgie balise, ne
convergent pas malgr tout dans un effet commun : la figuration.
Trois grands types de rsolutions possibles apparaissent ainsi pour le
dispositif autofictif ; trois grandes fonctions que l'on va dtailler dans les
chapitres qui suivent. Cette tude fonctionnelle sera l'occasion de voir si,
dfaut de thmes obligs ou de traits formels rcurrents, ce dispositif ne
prsente pas une certaine unit au niveau des stratgies qui commandent son
usage. Cet examen pourra aussi permettre de cerner dfinitivement le contenu
donner au terme autofiction, de prciser la dfinition en comprhension de
cette catachrse.
248
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
2 - FONCTION REFERENTIELLE
La vrit n'est jamais jas ce dont on a dcid de se
souvenir
P.Cnnro
249
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
On a jusqu'ici toujours dcrit la mise en uvre du dispositif de
l'autofiction comme une pratique par laquelle un crivain s'inventait une vie et
une personnalit, comme une sorte de fictionnalisation de soi. Certaines
uvres, pourtant, actualisent le dispositif sans avoir de vise fictionnelle, tout
en manifestant au total une nette ambition rfrentielle. La figure d'nonciation
utilise est bien celle de l'autofiction mais le projet d'ensemble, le rsultat
recherch n'est pas l'laboration d'une autofiction. Cette affirmation paratra
sans doute paradoxale, voire incohrente.
Il faut, pourtant, comprendre que le dispositif de l'autofiction ne demande
pour tre "mont" que deux lments une identification de l'auteur avec l'un de
ses personnages une mention affirmant la fictionalit de luvre. C'tait,
rappelons-le, la dmarche de Doubrovsky avec Fils, dclar autobiographique,
malgr l'indication gnrique "roman" de son ouvrage. Cet exemple n'est pas
unique. Ce chapitre a prcisment pour but d'explorer tous les cas dans notre
corpus o le dispositif de l'autofiction sert des fins rfrentielles, un projet
didactique ou une entreprise autobiographique.
- I - FONCTION DIDACTIQUE
Par cette appellation, on dsignera toutes les ralisations o le dispositif
sert un dessein la fois pdagogique et idologique ; o il permet d'authentifier
un discours systmatique, qu'il soit philosophique ou historique, esthtique,
mtaphysique etc. Cette fonction se retrouve aussi bien dans des fictions
proprement dites que dans un genre dmonstratif comme celui du dialogue.
Dans un texte narratif fictif, la fictionnalisation de soi donne la possibilit
de mettre en place un reprsentant auctorial, un interprte de l'auteur. Par lui, le
texte va pouvoir se faire lire selon une orientation bien dtermine ; l'activit
interprtative du lecteur va se trouver troitement canalise, en fonction des
intentions de l'auteur. Si la notion de "porte-parole" a un sens, c'est bien dans
cette situation l, A l'auteur dlgue un personnage son autorit et son
pouvoir. Sans doute, cette notion est parfois utilise de faon peu rigoureuse.
Balzac avait raison de s'lever contre la fcheuse tendance attribuer
l'auteur les propos de ses personnages. Il ne suffit pas qu'un personnage tienne
un discours systmatique et cohrent, que rien ne vient contredire dans
luvre, pour que l'on puisse en faire un reprsentant de l'auteur. Par contre, si
250
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ce personnage porte un nom proche de celui de l'auteur, on n'aura pas tort d'y
voir comme un double charg de guider le lecteur.
Un tel personnage homonyme est un signal quasi-explicite que le texte
dispose de son propre appareil interprtatif, qu'il renferme en lui la clef de sa
"bonne interprtation". Son homonymie est la marque de l'autorit qui lui est
confre ; elle indique que ce personnage est comme un "dcodeur" incorpor
au texte, qu'il a charge de dchiffrer par avance le sens de l'histoire laquelle il
appartient. Naturellement, un narrateur pourrait remplir cette fonction
interprtative avec encore plus de nettet. Mais la structure de la fiction devien-
drait trop dmonstrative ; on serait devant un roman thse. Au contraire,
donner son nom (ou une partie) un personnage permet de faire l'conomie
d'un narrateur envahissant, dun commentaire interprtatif rigide comme celui
de la fable.
Ainsi, dans tes Buddenbrook, Thomas Mann a-t-il dlgu un
personnage qui porte son prnom pour donner son sens au roman. Tout montre
que Thomas Buddenbrook a pour tche d'clairer le dclin de sa famille, de
donner sa signification la dcadence de sa ligne, de faire de son histoire un
destin. Sa rflexion sur la discordance entre la force et le ressassement de soi,
sur lincompatibilit du vouloir-vivre et de la pense, sur l'opposition de l'art et
de la vie, dpasse sa propre situation pour expliquer toute la destine fatale des
Buddenbrook. Le constat qu'il fait d'une "nature artiste" rongeant la vitalit
initiale des Buddenbrook, c'est celui de Thomas Mann sur son poque ; le
diagnostic qu'il fait sur les rapports entre l'chec de sa famille et sa chute dans
la maladie, West encore celui de Thomas Mann. Ce personnage n'est pas
seulement le dernier acteur lucide de la saga familiale ; il est aussi l'interprte
de son histoire. Mutadis Mutandis, on pourrait faire la mme analyse avec le
personnage de Burton dans L'Emploi du temps de Butor ou avec celui
d'Andras dans Le Mur de la peste d'Andr Brink.
Cette fonction interprtative peut aussi jouer un rle dans un genre o
l'on ne l'attendrait pas, A ses vertus pdagogiques semblent inutiles : le genre
du dialogue. Ce genre didactique, qui trouve son point de dpart chez Platon,
est comme on sait un genre important. Au sein de cet ensemble, un certain
nombre de dialogues prsentent la particularit de mettre en scne leur
auteurs. On en a vu quelques exemples au cours de ce travail. En fait, ils sont
beaucoup plus nombreux qu'on ne pourrait le penser et ce corpus mriterait
251
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
une tude lui tout seul. Dialogue historique de Varron, les Dialogues de
Grgoire Le Grand, Dialogue entre un Juif, un philosophe et un chrtien
d'Ablard, certains Dialogues du Tasse, Dialogue en forme de Vision nocturne
de Marguerite de Navarre, Nouveaux Essais de Leibniz, Entretiens de
Fontenelle, tous ces textes forment comme un sous-ensemble homogne et
important, au mme titre par exemple que le sous-genre dialogue des morts o
l'auteur fait converser des morts illustres, sans aucun souci de vraisemblance,
en permettant par exemple la rencontre de Machiavel et Montesquieu comme
dans le magnifique et mconnu Dialogue aux enfers de Maurice Joly.
Dans cette pratique littraire, le recours au dispositif autofictif semble
s'expliquer de la faon suivante. Premier temps, l'auteur choisit de mettre en
place la fiction d'un dialogue, procd trs commun qui a l'avantage de divertir
tout en instruisant ; de montrer la vrit en train de natre, plutt que de la
prsenter fige et dj forme comme dans un Trait. Cette forme d'exposition
prsente toutefois un risque. La situation imagine, les personnages invents,
les mandres de leur discussion, tout cela risque de dborder les intentions de
l'auteur et de noyer pour ainsi dire les affirmations qu'il voulait imposer.
Autrement dit, force de vouloir plaire, de prtendre concilier la doctrine et la
littrature, il y a le danger d'une "revanche de l'criture" (Suleiman, 1983, pp.
239-264). Pour parer ce risque de dbordement par son cadre fictif, l'auteur
peut alors choisir, dans un second temps, de se reprsenter lui-mme dans le
texte. Il asseoit ainsi de son autorit le discours d'un personnage, permet ses
thses d'tre identifies par le lecteur et spares des autres voix du texte.
Prenons l'exemple des Entretiens sur la pluralit des mondes de
Fontenelle, un dialogue rapport sous une forme narrative. Fontenelle a donn
comme cadre fictif ses thses scientifiques un sjour dans le chteau d'une
marquise et des soires passes discuter dastrophysique Dans ces
conversations rudites, Fontenelle mle, comme il le reconnat dans sa prface,
le certain et le plausible l'apodictique et l'hypothtique. A ct d'affirmations
acceptes par la "Cit savante" de son poque, il avance des propositions qui
n'ont pas encore t dmontres, mais qui pour lui sont trs probables. Il fallait
donc que l'on prenne au srieux ces hypothses qui pour Fontenelle taient des
hypothses scientifiques. C'est l que son cadre imaginaire, sa fiction
d'entretiens, risquait de le perdre. Il y avait le risque d'une sorte de
contamination de tout son propos, par sa fiction mondaine et le bon badin utilis
252
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
pour le rapporter. Tout son ouvrage pouvait tre lu comme une rverie potique
sans fondements ; comme une description fantasmagorique du ciel ; comme un
livre dans la veine de l'Histoire vraie de Lucien, multipliant les descriptions
fantastiques et les inventions gratuites. Pour parer ce danger, Fontenelle a
bien sr multipli les arguments et les dmonstrations, a mis tout son discours
sous le signe du raisonnable. Mais surtout, il s'est identifi son narrateur, afin
que toute son autorit d'auteur taye les hypothses formules, leur donne
l'allure d'un discours srieux. Du coup, son narrateur n'est plus seulement un
savant avide de diffuser son savoir, c'est un personnage vicaire, un double de
l'auteur, son reprsentant dans le texte. Cette identification est une vritable
dlgation de pouvoirs : en partageant son identit, Fontenelle donne aussi son
autorit et il garantit le srieux de son discours.
Concluons : avec cette premire fonction, un paradoxe se fait jour. Alors
que le dispositif de la fictionnalisation de soi est dans l'absolu le comble de
l'invention, la fiction pousse sa limite, l A elle emporte jusqu' son auteur,
des textes montrent un tout autre emploi possible. Loin de servir l'imaginaire, le
dispositif peut aussi servir de "verrou'' rfrentiel en quelque sorte. Tout comme
la mise en abyme chez les naturalistes, il peut servir la cause dun message,
tre le garant d'un discours didactique. Comment reconnatre un tel emploi du
dispositif ? Dans le cas du dialogue, la question ne se pose pas. Le dispositif
n'est l que pour viter toute ambigut dans interprtation, le caractre
synthtique et dmonstratif du texte indiquant la ncessit de cette
interprtation. Dans le cas d'une fiction, c'est videmment plus compliqu. On
peut, toutefois, avancer l'existence des traits suivants : a) l'emploi htro- ou
homodigtique du double auctorial : si ce double est au centre du rcit, en est
l'acteur principal, il est moins apte en donner le sens, s'en faire l'interprte ;
b) un "Profil thmatique" contrast du personnage auctorial : par l,
l'auteur dcourage le lecteur dans toute tentative d'interprtation littrale, qui
ferait de son double un autre lui-mme et du texte une uvre
autobiographique ; c) enfin, trait qui va de soi mais qu'il faut rappeler, la
prsence dans le texte d'un discours interprtatif nonc par un personnage.
253
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
II - FONCTION BIOGRAPHIQUE
Cette seconde appellation permettra de nommer toutes les uvres o le
dispositif sert un projet intime, A une des finalits ultimes est de mettre laccent
sur sa vie, en particulier sur l'histoire de sa personnalit" (Lejeune, 1975, p. 14)
comme dans une autobiographie.
Pourquoi alors de tels ouvrages sont-ils prsents comme fictifs ?
Pourquoi des auteurs prouvent-ils la ncessit de classer des textes intimes
dans la littrature romanesque ?
Il faut distinguer dans ce choix fonctionnel deux cas de figures : la
littrature onirique et une littrature qui manifeste une "modlisation mineure du
projet autobiographique" (Lejeune).
Tout d'abord, il faut penser des textes autobiographiques dont le
contenu est par ncessit fictionnel : les rcits de Ave. Perec avec La boutique
obscure, Butor avec son Matire de rves ont montr lintrt et la cohrence
de cette criture onirique. Voil des ouvrages qui prennent leurs racines au plus
profond de l'intimit de l'crivain, qui sont d'une authenticit parfois douloureuse
et qui pourtant sont presque toujours irrels, dont le contenu est par dfinition
invraisemblable. Pour ces textes, l'crivain n'a pas besoin de mettre en place
un protocole de fiction compliqu. La matire de ces rcits indique le plus
souvent d'elle-mme leur fictionnalit : il s'agit d'autofiction presque naturelles.
C'est d'ailleurs une forme d'criture qui mriterait autre chose qu'une vocation
rapide si les limites de cette enqute ne lempchait pas. Dans cette littrature
onirique, le dispositif de fictionnalisation ne cherche pas draliser lcrivain, il
est ncessaire pour que le vcu onirique soit fidlement restitu.
Second cas de figure, une littrature qui se rpand de plus en plus
aujourd'hui, A l'crivain se raconte sur un mode fictionnel tout en assurant que
cette fiction est vraie. Une illustration trs claire : Alphonse Boudard, LHpital
(La table ronde, 1972). L'ouvrage porte comme second titre Une
hostobiographie et comme indication gnrique "roman". Sur le quatrime de
couverture, on peut lire entre autres : "Jinvente rien, je rorganise ma
souvenance et puis je fais danser les mots...". Les contradictions de ce
protocole pritextuel se retrouve l'intrieur de l'ouvrage' c'est bien le rcit
254
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
d'annes passes par l'auteur lHpital, mais il y a tant de verve dans le style,
de truculence dans les portrait se de jubilation dans les descriptions que cela
donne penser que leffet produire sur le lecteur a autant command cette'
autobiographie que la fidlit au vcue le souci de restituer
scrupuleusement une exprience difficile. Alphonse Boudart a ainsi publi
plusieurs volumes de ce type : La Mtamorphose des Cloportes, La Cerise,
Bleubite, Cinoche, Les Combattants du petit bonheur, Le Corbillard de Jules et
dernirement L'ducation d'Alphonse. Dans Le Corbillard de Jules, (La Table
Ronde, 1979), il donne une prface o il dsigne ces livres comme appartenant
un "grand ensemble de biographie romanesque", dont le titre gnrique serait
Les Chroniques des mauvaises compagnies. L'appellation "biographie
romanesque" ramasse pertinemment la formule de cette criture de soi moule
sur l'criture romanesque, mais se dfendant bien de dformer les faits et
n'ayant d'autre perspective qu'autobiographique.
Notons que ce registre contradictoire est aujourd'hui un phnomne
incontournable du monde ditorial. De plus en plus d'crivains, de faon
ponctuelle ou systmatique, publient de tels textes. Luvre de Doubrovsky
entre' naturellement dans cette catgorie. Lejeune en a relev Vautres
exemples dans "Autobiographie, roman et nom propre". On peut ajouter
quelques crivains son inventaire. Pour ne retenir que les crivains qui le font
de faon systmatique, on retiendra les noms de Jean-Franois Bastide, de
Gabrielle Rolin et de Thomas Bernhard. Tous ces crivains pourraient
reprendre la formule de Boudard : "J'invente rien, je rorganise ma souvenance
et je fais danser les mots".
Dans son examen de ce type hybride, Lejeune a insist sur le fait qu'il ne
s'agissait que d'une "modlisation mineure du projet autobiographique" ; que
les contradictions de ce registre n'apportaient gure que des confusions et que
leur seul mrite tait d'illustrer un malaise gnral envers les dis cours
rfrentiels. Il est vrai qu' une ou deux exceptions pris, ces textes hybrides ne
sont pas dune trs grande qualit littraire. Toutefois, il y a l un phnomne
de la vie littraire qui n'est pas ngliger et qui est l'quivalent pour notre
poque de ce qu'tait pour le XIXe sicle la roman personnel dont le prototype
est L'Oberma de Senancour. Comme on sait, ce sicle a vu se multiplier des
romans la premire personne, o le narrateur tait anonyme, que la rumeur
ou le contexte ditorial disait d'inspiration autobiographique et qui taient lus
255
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
comme des autobiographies retouches. Cest pour viter type de lecture que
Barris a nomm rtrospectivement "Philippe" le narrateur-hros de sa trilogie Le
Culte du Moi, qui tait anonyme dans les premires ditions.
Toutes ces "biographies romanesques" reposent sur une doxa qui
trouve son origine chez Goethe, selon laquelle dans le domaine de l'criture de
soi, toute vrit est posie Certes, les arguments avancs peuvent tre
diffrents : la part de fiction qui entre dans toute personnalit ; le phnomne
qui fait que l'on se souvient plus de l'effet que des faits la ncessit pour
l'exigence de vrit du projet autobiographique de composer avec l'exigence
artistique (de style, de composition). Ainsi avec Doubrovsky, on a vu une
formulation particulire de cette doxa utilisant un langage psychanalytique,
mettant l'accent sur le pouvoir althique du langage. Mais il ne s'agit que d'une
formulation diffrente. L'essentiel se trouve dj chez Goethe.
Dans la tradition autobiographique, Aus meinem Leben. Dichtung und
Wahrheit (Souvenirs de ma vie. Posie et Vrit (1811-1833) pst, en effet, un
livre fondateur, aussi important que Les Confessions de Rousseau, quoique en
un autre sens. On doit Rousseau d'avoir donn le coup d'envoi une criture
de soi A l'accent est mis sur une exigence de vrit absolue, une manire de
pratiquer l'autobiographie et la connaissance de soi qui va jusqu' l'impudeur,
dont Leiris est l'hritier moderne. Mais c'est Goethe que l'on doit d'avoir
signal la part d'invention qu'il y a dans l'criture de soi, part dont il fallait tenir
compte et qu'il faudrait mme faire fructifier selon lui.
Ds les premires lignes de son ouvrage, Goethe signale l'impossibilit
d'un rcit exact de sa vie
"Car il semble que la tche principale de la biographie
soit de reprsenter l'homme dans ses rapports temporels,
de montrer jusqu' quel point le monde lui rsiste, jusqu'
quel point il le favorise, comment il s'en forme une
conception de l'univers et de l'homme, et, s'il est artiste,
pote, crivain, comment il les rflchit au dehors. Mais,
pour cela, il faudrait une condition qui est, pour ainsi dire,
hors de nota atteinte : savoir, que l'individu connaisse et
lui-mme. et son sicle ; lui-mme pour autant qu'il est
rest identique dans toutes les circonstances ; le sicle
en tant qu'il entrane avec lui ceux qui le veulent comme
ceux qui ne le veulent point, les dtermine et les faonne,
de telle sorte qu'on peut dire qu'un homme, s'il fut n
seulement dix ans plus tt ou plus tard, t tout autre tant
256
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
en ce qui concerne sa propre culture que l'action qu'il
exerce au dehors.
C'est en suivant cette route, c'est de considrations et
de tentatives de ce genre, de souvenirs et de rflexions
semblables, qu'est n le prsent tableau, et c'est de ce
point de vue le point de vue de sa naissance - qu'on
pourra le mieux en jouir, en profiter et en juger avec le
plus dquit. Il y aurait peut-tre dire encore,
particulirement sur la manire mi-potique, mi-historique
de cet ouvrage, mais l'occasion s'en rencontrera sans
doute plus d'une fois au cours du rcit" (Trad. fr. P. du
Colombier)
Par la suite, il ne manque pas de noter les moments o le "pouvoir
potique" de l'imagination a interfr avec le travail de la mmoire. Au dbut de
la quatrime partie, il donne mme sa mthode, qui lui fait utiliser les altrations
de sa mmoire pour rafrachir par le vernis de la posie l'clat de sa vie passe:
En contant une vie dont la marche est aussi varie
que celle dont nous avons eu l'audace d'entreprendre le
rcit, nous sommes conduits, pour rendre clairs et
intelligibles certains vnements, sparer
ncessairement des choses qui s'entrelacent dans le
temps, en resserrer d'autres, que leur suite permet
seule de saisir, et grouper ainsi l'ensemble en parties
qu'on peut embrasser raisonnablement pour les juger, et
dont on peut tirer soi-mme quelque profit.
Nous plaons cette considration en tte du prsent
volume pour qu'elle contribue justifier notre mthode, et
nous y ajoutons cette prire nos lecteurs, de vouloir
bien prendre garde que le rcit qui se continue ici ne se
raccorde pas exactement la fin du livre prcdent, mais
que son objet est de reprendre peu peu tous les fils
principaux et de prsenter, en un enchanement solide et
sincre, aussi bien les personnes que les sentiments et
les actes .
Tout le travail de Goethe dans cet expos biographique consiste donc
assumer les dformations rtrospectives pour composer un ouvrage qui se
prte le mieux possible au sens qu'il donne sa vie et aux exigences d'une
uvre littraire. Un exemple frappant de ce souci d'organisation et de composi-
tion dans Posie et Vrit, est la mise en scne par Goethe de son propre nom.
Si l'ouvrage dbute par une dclaration qui a le caractre formel d'une
dclaration de naissance ltat civil ("Le 28 aot 1749, alors que sonnait le
douzime coup de midi, je vins au monde Francfort-sur-le-Main"), le narrateur
257
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
est anonyme durant toute la premire moiti de l'ouvrage. Alors que de
nombreux passages voquent sa signature, comme prolongement
mtonymique de sa personne et lment important dans le jeu amoureux, le
narrateur retarde loisir la profration de son nom. C'est seulement au centre
exact de l'ouvrage (IIe partie, Livre 10 1 l'ouvrage comprend quatre parties et
vingt livres), en reproduisant un pigramme de Herder que Goethe dvoile
Herder qui joue avec l'tymologie de son patronyme et qui permet Goethe un
beau dveloppement sur la manire dont chaque personne se familiarise avec
son nom, au point d'en faire comme un piderme symbolique. Il y a l comme
un rituel d'imposition, Goethe suggrant qu son nom d'auteur, il le doit
Herder, que sans lui toute sa production serait reste dans les grces mivres
du XVIIIe sicle qui caractrisaient ses dbuts. Ce n'est qu'un exemple du
formidable travail de composition auquel Goethe s'est livr sur les donnes de
son existence. Mais il est particulirement significatif.
Luvre aura une influence considrable en France, souvent chez des
crivains dont on ne souponnerait pas cette filiation. Ainsi Renan qui ds les
premires pages de Souvenirs d'enfance et de jeunesse reconnat sa dette :
"Goethe choisit pour titre de ses Mmoires Vrit et
Posie, montrant par l qu'on ne saurait faire sa propre
biographie de la mme manire qu'on fait celle des
autres. Ce qu'on dit de soi est toujours posie () Ce qui
est une qualit dans l'histoire eut t ici un dfaut ; tout
est vrai dans ce petit volume, mais non de ce genre de
vrit qui est requis pour une Biographie universelle. Bien
des choses ont t mises afin qu'on sourie ; si l'usage
let permis, j'aurais d crire plus d'une fois la marge
Cum grano salis," ( 1383, pp. 39-40 )
Toutes choses gales, on voit comment un auteur comme Boudard
dcoule directement de cette tradition. La nuance qui le spare de Goethe ou
de Renan, c'est qu'un discours d'escorte est moins ncessaire. Il suffit
aujourd'hui de disposer l'indication gnrique "roman" pour prendre son
compte les arguments de Goethe et se donner toutes les liberts pour conduire
le rcit de sa vie. On voit aussi en quoi cette forme d'criture de soi se distingue
de l'autofiction. La revendication fictionnelle n'est dans ce cas qu'un moyen de
se dfendre de l'accusation de mensonge ; c'est une licence biographique, pas
une fin en soi.
258
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
En ralit, le registre de ces uvres est tendanciellement rfrentiel ;
c'est mme ce qui permet de les diffrencier des autofictions proprement dites.
Soit le cas de Boudard ; tous ses ouvrages portent sur la couverture l'indication
gnrique "roman". Mais lui-mme ne manque pas une occasion, dans le reste
du pritexte, de signaler qu'il ne fait que relater les bonheurs et les avanies de
son existence mme s'il ne respecte pas l'ordre chronologique. La prface du
Corbillard de Jules met mme un peu d'ordre dans ces volumes en situant cha-
cun d'eux par rapport aux vnements de sa vie. On vitera donc de confondre
ces "autobiographies romanesques" avec l'autofiction, mme si c'est ce
phnomne qu'avait en vue Doubrovsky quand il a forg cette catachrse. Bien
plus, on vitera d'utiliser ce terme mme quand le rcit prsent est
extravagant, impossible. Ds lors que la vise est rfrentielle, peu importe le
contenu, il y a toujours une volont de vrit qui porte l'ouvrage et c'est l
l'essentiel. Le rcit de rve est l pour en administrer la dmonstration : si je
raconte mes rves, il y a de fortes chances pour qu'ils montrent la plus grande
fantaisie par rapport aux lois qui rgissent la vie ordinaire. Nanmoins, ces
rves seront bien les miens et si j'engage ma parole quant leur authenticit, il
faut bien que mon auditoire les reoive comme autobiographiques.
Cette dernire observation est ncessaire pour classer des textes
comme Vivre avec son double (La Table ronde, 1979 ) Alfred Fabre-Luce. Dans
ce "roman" l'auteur met en scne sa propre personne et le jeune homme qu'il
fut, venu le revisiter. Bien sr, ce texte ne peut tre que fictionnel dans son
contenu. Mis sa vise est rfrentielle, son ambition est autobiographique. En
faisant coexister le vieil homme qu'il est et l'adolescent qu'il fut, Fabre-Luce ne
fait que matrialiser ses propres penses et rveries, donne corps cette part
de dichtung qui entoure toute existence. C'est ce qui lui permet de donner
"l'avertissement" suivant en tte de son livre :
"Bien des auteurs ont crit un roman inspir de leur propre vie. Ce fut
pour eux un moyen de creuser plus profond qu'ils ne pouvaient le faire dans
des Mmoires. Telle est aussi la signification du livre que je publie. Trs
soucieux d'exactitude rigoureuse dans mes travaux d'historien, je tiens
prciser ici la distinction des genres. Un roman, peut tre, lui aussi, plein de
"vrit", mais ce n'est pas une vrit littrale, mme l o beaucoup de traits
sont exacts.
259
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
A propos duvres du mme genre, on a parl de "mentir-vrai".
L'expression est trop brutale pour mon got. Le mensonge m'est toujours anti-
pathique. J'ai plutt us de discrtion et de stylisation - parfois aussi d'humour".
Comment conclure ce chapitre sur les uvres A la fictionnalisation de
soi remplit un objectif rfrentiel, didactique ou autobiographique ? Il faut
reconnatre que l'on est devant un phnomne embarrassant. Des uvres qui
apparaissaient comme autofictives, qui parfois ont t analyses comme telles,
se dvoilent fonctionnellement comme porteuses d'un projet autobiographique
ou pdagogique. Ne sommes-nous pas en contradiction avec nous-mme ?
En fait, il faut bien voir que le dispositif de la fiction de soi est dune
disponibilit totale. Tous ces "romans, qui prtendent tre un roman sans ltre
utilisent des procdures qui seraient valides dans une autofiction vritable. En
ce sens, notre dmarche reste lgitim. Toutefois, cette tape de l'analyse, il
est en effet urgent de distinguer entre la fictionalisation de soi et l'autofiction. La
fictionnalisation de soi n'est qu'un dispositif par lequel un crivain se campe
dans une situation totalement ou en partie imaginaire pour des raisons qui
peuvent tre variables et dont la mise en place d'un "porte-parole" ou d'une
autobiographie attrayante sont sans doute les plus importantes. Lautofiction,
elle, est une pratique qui utilise le dispositif de la fictionnalisation auctoriale pour
des raisons qui ne sont pas autobiographiques.
260
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
3 - FONCTION REFLEXIVE
"Introduire dans le roman un romancier" A. Huxley.
261
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Avec le chapitre prcdent, on a vu un emploi du dispositif autofictif
familier au lecteur. Malgr son excentricit, parce qu'elle sert une finalit
rfrentielle, la fictionnalisation de soi ne fait pas alors problme : le lecteur
l'accepte, comme il accepte une autobiographie ou un dialogue philosophique
ordinaires, dont la "contextualisation" ne pose pas de difficults particulires. Il
reste examiner un autre cas de figure o, malgr la bizarrerie du dispositif, le
lecteur se trouve nouveau dans une situation connue, face un usage qui
permet d'indexer la fiction de soi une stratgie balise, en l'occurrence une
stratgie spculaire. Autrement dit, il faut examiner les ralisations o la
fictionnalisation auctoriale recoupe des procdures de rflexion, peut se dcrire
en termes de "mise en abyme
Quoique parfois subtils, tous ces moyens de duplication sont aujourd'hui
bien connus des lecteurs. Outre que des uvres majeures en ont fait leur miel,
de Cervantes au nouveau roman, en passant par Shakespeare ou Zola, tout un
discours d'escorte s'est progressivement constitu pour populariser ces jeux de
miroirs. De Jean-Paul Hugo, de Gide C.E. Magny, il n'a pas manqu
d'crivains ou de critiques pour expliquer la nature, la fonction et l'intrt de ces
techniques. Un des apport de la remarquable synthse de Lucien Dallenbach
sur cette question, le rcit circulaire, est de montrer en pointill comment
l'usage de la rflexivit littraire s'est institutionnalis au cours des sicles. A
travers des formes diffrentes et des enjeux multiples, une tradition s'est mise
en place pour accompagner la mise en abyme, permettre sa perception, sa
classification et par suite sa comprhension. Il parat donc lgitime d'affirmer
que ces procds de rflexion constituent une stratgie reconnue, ayant sa
place dans le paysage littraire. Que la fictionnalisation de soi vienne se
confondre avec l'une de ces techniques spculaires et elle sera perue comme
un effet de celle-ci.
RAPPEL
On sait que la notion de "mise en abyme" rassemble des procds de
rflexion varis, procds qui peuvent se rduire trois types comme le dcrit
Dallenbach :
"Tel que les auteurs l'utilisent sans le problmatiser le
terme de mise en abyme vise regrouper un ensemble
de ralits distinctes. Ces dernires se ramnent trois
figures essentielles qui sont la rduplication simple (frag-
262
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ment qui entretient avec l'uvre qui l'inclut un rapport de
similitude), la rduplication l'infini (fragment qui
entretient avec l'uvre qui l'inclut un rapport de similitude
et qui enchsse lui-mme un fragment qui... . et ainsi de
suite) et la rduplication aporistigu2 (fragment cens
inclure l'uvre qui l'inclut)`` (1977, P. 51).
Pour reprendre une formule ramasse de J. Verrier, est mise en abyme,
"toute uvre dans l'uvre", toute uvre sur l'uvre ou toute uvre par
l'uvre. Reste se demander sous quelles conditions la mise en abyme et la
fiction de soi peuvent se recouper ? Dans le type I, il n'y a qu'un rapport d'a-
nalogie entre le segment textuel rflchissant et le texte rflchi : la scne de
thtre dans Hamlet. Ce type de rduplication (simple) ne se prte donc pas
la fictionnalisation de soi. Le type II, lui, ne peut gure exister de faon effective
comme le souligne Dallenbach
le ddoublement interminable est littrairement vou demeurer sinon
l'tat de programme du moins au stade de l'bauche. La raison de cet
inaccomplissement se discerne sans peine. Elle tient la structure mme d'une
reprsentation dont la profondeur implicite se heurte aux limites du rcit
entrevues par Lessing Preuve en soit l'usage intemprant que les affiches
publicitaires font du procd, alors qu'en littrature il ne se signale par la force
des choses qu' l'tat de projet (a), de rfrence emblmatique (b) ou de
ralisation partielle (c) Exemples
(a) Contrepoint de Huxley ; (b) Le Vent et L'Herbe
de Claude Simon ; (c) Les Faux-Monnayeurs" (1977,
pp. 145-146).
Demeure donc le type III. En se rflchissant elle-mme, l'uvre
invagine ncessairement son producteur, le propulse fatalement au beau milieu
de sa fiction et rejoint ainsi le ddoublement de l'autofiction. Naturellement,
cette invagination a quelque chose de spcieux :
''Emblme du type III, Ouroboros ne l'est pas par
busard. On sait les difficults que reprsente pour
l'axiomatique un ensemble qui se contient lui-mme. Or
l'auto-enchssement narratif n'est pas une moindre
source d'apories. Emanant ici de l'auto-rfrence,
celles-ci enfreignent trois niveaux la loi du tertium non
datur : au niveau de la causalit, puisqu'un rcit
263
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
auto-enchssant exploite la rcurrence et se donne pour
le produit de son produit ; au niveau de la temporalit,
puisqu'il se projette dans l'avenir (...) alors qu'il est un
rcit accompli ou en train de voir le jour ; au niveau de la
spatialit, puisqu'il se reprsente comme sa propre partie
et se laisse enfermer par ce qu'il contient" (Dallenbach,
1977, p. 147).
Ce vacillement des catgories logiques et sensibles n'est toutefois pas
vraiment nouveau. Il rappelle le trembl qu'introduit le dispositif autofictif dans la
reprsentation, le trouble qu'il porte dans les limites entre le dedans et le dehors
d'une fiction Ainsi, tant par sa nature que par son effet, la rduplication
aportique se trouve tris proche de la fictionnalisation de soi.
Mais pour que ces deux pratiques littraires puissent se confondre, il faut
une dernire condition, qui est incontournable. La mise en abyme n'est possible
que si le segment textuel rflchissant se confond ou tend se confondre avec
le texte rflchi, il va de soi que la mise en abyme n'a plus de sens.
Davantage, le rendement narratif de celle-ci est suspendu sa
miniaturisation. Trop dveloppe, elle perd beaucoup de son efficace Pour le
type III, Dallenbach fait de cette exigence une 'loi importante" : "la force de
l'auto-enchssement est inversement proportionnelle la mobilisation d'une
uvre enchsse", (p. 147). Ainsi, la fiction de soi ne recoupera la mise en
abyme qu' la condition d'tre limite, de n'tre ralise qu'avec parcimonie
dans le texte. C'est dire que le personnage auctorial ne doit pas occuper une
place trop importante dans l'uvre. Faute de quoi, l'auteur n'apparatra pas
comme rflchi par son texte.
UN MODELE : LE "QUICHOTTE".
Afin d'examiner concrtement les modalits possibles de cette rencontre
entre la fiction de soi et la mis en abyme aportique, on partira d'un exemple
qui prsente le double mrite d'tre un texte fondateur et une ralisation
exceptionnelle :
L'Ingnieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Comme on sait, ce
roman comprend deux parties, nettement distinctes, publies respectivement
en 1605 et en 1615. La Seconde partie semble rsulter d'une dcision tardive
de Cervantes. Les dix ans qui sparent ces deux volets, le fait que le premier
volet comprenne un dnouement (mme s'il est dception) et soit lui-mme
264
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
initialement organis en parties, laissent penser qu'au dpart Cervants ne
voyait pas la ncessit d'une suite. C'est pourtant ce qu'il publia dix ans plus
tard. Il est peu vraisemblable que l'arrive intempestive dune pseudo seconde
partie, d'un Don Quichotte apocryphe, publi par un certain Avellaneda en
1614, fut l'origine du revirement de Cervants. Toutefois, elle le renfora sans
aucun doute dans sa dcision de ne pas donner une suite au sens traditionnel,
mais de replier son Don Quichotte II sur son Don Quichotte I. Peut-tre mme
ce plagiat lui permit de poursuivre et d'achever une entreprise sans prcdent,
qui pouvait faire reculer plus d'un crivain accompli. De faon inespre, le
Rel fournissait Cervants le prtexte pour donner une dfense, une critique,
une exgse, une authentification et une clture sa Premire partie.
C'est ainsi que dans la Seconde partie, la plupart des personnages ont lu
la premire ; ils sont en mme temps acteurs et spectateurs, protagonistes et
lecteurs du Quichotte. Cette reconnaissance de soi intervient dis le chapitre II,
par la bouche de Cantho, rpondant une question de Quichotte sur sa re-
nomme dans le village, chez le vulgaire, chez les cavaliers et gentilshommes :
si vous dsirez savoir tout ce que l'on en publie
(...) je vous amnerai cans un homme qui vous les dira
toutes sans y manquer d'un sou. Hier au soir, arriva le fils
de Barthlemy Caraco, qui vient d'tudier Salamanque
et qui est reu bachelier. Comme j'allais chez lui pour lui
donner la bienvenue, il m'apprit que dj l'histoire de Votre
Seigneurie courait par le monde, sous le non de
L'Ingnieux Chevalier don Quichotte de la Manche. Il me
dit encore qu'on m'y avait mis avec mon propre nom de
Cantho Panca et madame Dulcine du Toboggan, avec
d'autres choses qui se sont passes entre nous deux
seuls. J'en fis, tout tonn, mille signes de croix, ne
pouvant m'imaginer comment a pu les savoir celui qui les
a crites" (Trad. fr. F. Rosset et J. Cassou, P. 540).
Cette mise en abyme du livre par lui-mme autorise toutes sortes de
variations savoureuses : une autocritique en rgle (chap. 3), o la Premire
partie est juge d'un point de vue littraire ; une critique systmatique du
Quichotte apocryphe, dont le hros ponyme constate de visu l'existence dans
une imprimerie de Barcelone des comparaisons avec le Quichotte I :
"Le bachelier demeura tout tonn d'our les termes et
la manire de parler de Sancho Pana : car, encore qu'il
265
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
et lu la premire partie de l'histoire de son matre,
toutefois il n'avait cru que Sancho fit aussi plaisant qu'on
l'y dpeint. Mais, quand il l'ouit maintenant parler de
testament et de codicille qui ne se pt dtraquer, au lieu
de testament et de codicille qui ne se pt rtracter, il crut
tout ce qu'il en avait lu et le tint pour un des plus solennels
insenss de notre sicle. Aussi disait-il en lui-mme qu'on
n'avait jamais vu au monde deux fous tels qu'taient le
matre et la valet" (P. 572).
Bien entendu, toutes ces variations ne sont possibles que parce que le
Quichotte II se donne comme un livre crire, dnie sa nature littraire :
"Et par hasard, rpliqua don Quichotte, l'auteur
promet-il une seconde partie ? - Il en promet une, dit
Samson : si est-ce pourtant qu'il nous assure qu'il ne l'a
point trouv, et qu'il ne sait pas qui la peut avoir. C'est
pourquoi nous sommes en doute si elle sera publie ou
non" (P. 550).
Et ce ne sont pas seulement les personnages qui ignorent leur nature
dtres imaginaires, qui n'ont pas conscience d'voluer dans une fiction. Le
"beau-pre" du Livre, Cervants, et le chroniqueur maure Hamet Ben Engeli ne
s'en doutent pas non plus, mme si leur illusion n'est pas la mme. Tout en
sachant, et en signalant qu'ils font uvre de narrateurs, ils parlent de leurs
hros comme des individus rels :
''Le puissant Allah soit bni ! dit Hamet Ben Engel au
commencement de ce huitime chapitre. Bni soit Allah !
rpte-t-il trois fois. Et il ajoute qu'il prfre ces
bndictions en voyant qu'il tient enfin en campagne don
Quichotte et Sancho ; et par ce moyen, ceux qui lisent
cette histoire peuvent faire tat que ds ce mme point
recommencent les hauts faits et les facties de don
Quichotte et de son cuyer" (pp. 573-574).
Aportique, cette mise en spectacle de la Premire partie relance
considrablement le thme des rapports entre le livre et la vie qui traverse le
roman - et permet de reprsenter ces rapports pour ce qu'ils sont : une aporie.
L'ouvrage qui avait fait des romans de chevalerie et du genre pastoral le
support d'un questionnement sur l'opposition entre la fiction et la ralit, est
dsormais lui-mme en lice. Fable parmi les fables, le Quichotte ne peut plus
266
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
tre lu comme une nave dnonciation de genre littraires faciles, dj
dmods ou critiqu l'poque de Cervants. Le lecteur est maintenant
directement confront au scandale constitutif de toute uvre dimagination, de
toute configuration narrative mme, si on se rappelle les dveloppements sur la
thologie. Scandale qui ne tient pas seulement la nature illusoire du rcit,
mais aussi ce besoin qu'ont les hommes d'histoires, ce dsir irrpressible
qui les poussent vouloir vivre leur vie sur le mode enchant de la fable.
La Seconde partie prsente ainsi une mise en abyme du Quichotte qui a
pour effet une "auto-glorification", une signification aportique et une inclusion
par le livre de son dehors. Outre le comique produit par cette situation, cet
auto-enchssement a pour rsultat de fictionnaliser indirectement la personne
de Cervants. Si le Quichotte est une partie de lui-mme, alors Cervants est
aussi un lment de cet univers fictif. Quoique invisible dans le second volet du
roman, il doit appartenir son univers. Ce jeu avec le principe de rcurrence
fournit donc une premire catgorie A la rflexivit littraire et la fiction de soi
se rencontrent : la mise en abyme du livre. On notera que cette rencontre n'est
possible que parce que la fictionnalisation auctoriale est indirecte, se fait par le
biais dune auto-dsignation de luvre. C'est parce que le protocole nominal
est constitu par la mdiation dun livre autonyme, dont lautonymie a valeur de
substitut livresque, que cette fiction de soi quivaut exactement une mise en
abyme de l'nonciation.
Il est pourtant une autre espce de conjonction entre la reduplication et
la fiction de soi, qu'il ne faudrait pas manquer de signaler : la mise en abyme de
l'crivain. On peut en effet imaginer un texte qui ne se rflchisse pas
lui-mme, mais son auteur. Comme par hasard, c'est encore le Quichotte qui
offre un des premiers exemples de cette forme de mise en abyme. Mais pas l
o on l'attendrait. En effet, ce n'est pas nouveau dans la Seconde partie que
se trouve cette reduplication de la source de l'nonciation, mais dans la
Premire, comme si celle-ci renfermait par avance le principe d'un procd qui
allait relancer et transformer toute luvre.
Au chapitre VI du Quichotte I, aprs la premire sortie du hros, l'on voit
deux de ses amis, un barbier et un cur, se livrer un examen et un autodaf
de sa bibliothque :
267
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
quel livre est-ce l (...) ? - C'est la Galate de
Miguel de Cervants, dit le barbier. - Il y a bien longtemps
que ce Cervants est mon ami, et je sais qu'il est plus
vers en infortunes qu'en vers. Son livre a je ne sais quoi
de bonne invention ; il propose quelque chose et ne
conclut rien il faut attendre la seconde partie qu'il promet,
peut-tre qu'avec l'amendement il obtiendra entirement
l'indulgence, qui prsent lui est refuse et, en attendant,
tenez-le renferm en votre logis monsieur mon compre".
(Trad. fr. C. Oudin et i. Cassou, p. 68).
Cette apparition piquante est la seule occurrence de tout l'ouvrage du
nom de Cervants, si l'on excepte une nomination indirecte avec l'vocation de
Numance au chapitre 48, une de ses pices clbre, par son patriotisme. Mais
cette apparition n'est pas seulement piquante, elle est aussi pleine
d'enseignement. Dans le mme geste, Cervants fait obstacle toute
interprtation univoque de son uvre et formule de la faon la plus nette cette
impossibilit d'une lecture dogmatique. Car ce n'est pas seulement dans
Galate, que Cervants "propose quelque chose et ne conclut rien", c'est aussi
dans le Quichotte commencer par l'pisode de l'autodaf o il montre avec
indulgence le barbier et le cur cder la passion des livres qui ravage le che-
valier la triste figure. En s'introduisant dans sa fiction, Cervants va
apparemment rejoindre la cohorte des auteurs qu'il condamne. Surtout, il
complique passablement le sens de cette condamnation, s'enlve toute
possibilit de dtenir la signification ultime de son uvre. Etroitement localise,
plus discrte et plus implicite, cette transgression narrative a pourtant le mme
effet sur la signification de luvre que la mise en abyme gnralise de la
Seconde partie.
Ds le Quichotte I, comme l'a vu Borgs, le paradoxe de la seconde
partie est donc virtuellement prsent. Par cette mise en abyme de l'crivain, la
fiction, dj, quoique diffremment, s'approprie son contexte dnonciation et se
donne comme causa sui. La diffrence introduite par la reduplication de
l'auteur, et non du texte, a seulement pour rsultat de dplacer l'accent de la
transgression narrative. Elle souligne davantage la mise en crise de la fonction
auctoriale, porte l'effet disruptif sur la source du texte plutt que sur sa
consistance. Cette transgression auctoriale n'est sensible que parce que la
fictionnalisation de soi est limite. N'tait le caractre partiel de cette ralisation
du dispositif autofictif, la transgression ne serait pas significative. Simple
268
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
silhouette dans son texte, Cervants produit une distorsion que sa prsence
insistant( rendrait diffuse et insignifiante.
Le Quichotte a ainsi permis de dgager deux espces de conjonction
entre le dispositif de l'autofiction et la "structure en abyme" (Genette) : la mise
en abyme du livre, la mise en abyme de l'crivain. Il s'agit maintenant de
vrifier, d'tendre et de prciser cet examen. Est-ce bien les seuls cas o
l'autofiction et la rflexivit littraire convergent ? ne peut-on affiner la
description de ces mises en abyme ? Quelle est la nature du rapport
qu'entretiennent ces deux pratiques ? Est-il lgitime de saisir certaines
ralisations autofictives en termes de construction en abyme ?
Mise en abyme et fictionnalisation de l'auteur.
L'examen des fictionnalisations auctoriales pouvant tre interprtes
comme des mises en abyme de l'nonciation permet de vrifier la description et
l'analyse faite partir du Quichotte. Elles se distribuent nettement en deux
groupes, selon que la rflexion se porte sur l'crivain ou sur luvre elle-mme.
De ce point de vue, le Quichotte ralisait l'avance toutes les variations de
mise en abyme aportique possibles. Toute l'histoire ultrieure ne serait-elle
qu'une exploitation des ressources dcouvertes par Cervants ? Cest ce quil
faut examiner.
a) Mise en abyme de l'crivain.
Lors de l'tude du profil actantiel (du rle jou dans l'histoire par le
double fictif de l'auteur),on a rencontr des ralisations autofictives o la figure
auctoriale n'avait qu'un emploi mineur dans la fiction, petit rle, situation de
comparse ou de silhouette. Dans ces exemples, l'auteur ne fait qu'une
apparition fugitive dans son texte. Fidle la dcision initiale qui voulait qu'on
accueille toutes les uvres ralisant de pris ou de loin le dispositif de
l'autofiction, on s'est gard de discuter le statut de ces ralisations. Il est certain
pourtant que ces actualisations partielles ne vont pas sans difficult. Leur
octroyer le statut d'autofiction au sens strict du terme est difficilement
acceptable.
269
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Une telle gnrosit signifierait que l'autofiction existe aussi ltat de
fragment. Or, imagine-t-on une autobiographie ponctuelle ? Un journal intime
partiel ? Entre un auteur qui construit la totalit de son texte autour d'une repr-
sentation imaginaire de lui-mme et un autre qui inscrit son nom dans un recoin
de son uvre, il y a une disproportion que l'on ne peut ignorer. Si l'autofiction
est autre chose qu'un procd narratif, si elle est rellement une figure
d'nonciation, une posture de communication, il faut diffrencier les ralisations
o le reprsentant auctorial occupe une place centrale de celles o sa prsence
est ngligeable pour la digse, mme si elle n'est pas accessoire pour la
signification de luvre. C'est ce que l'on va faire, en cernant de plus prs la
forme, les effets et le statut de ces ralisations fragmentaires de l'autofiction.
Commenons par prendre deux exemples, afin de vrifier le caractre
peu significatif, pour l'intrigue, de ces interventions. Ainsi, dans Six
personnages en qute d'auteur, la prsence de Pirandello dans sa pice n'est
pas indispensable la progression du drame. S'il fallait ncessairement un
directeur avec sa troupe en train de rpter sur une scne de thtre, il n'tait
pas vital que leur rptition ait prcisment pour objet Ce soir on improvise, une
comdie de Pirandello :
Le souffleur, lisant.
'Au lever du rideau, Lon Gala, en tablier blanc, coiff
d'un bonnet de cuisinier, est en train de battre un uf
dans du chocolat, avec une cuillre pot. Philippe, habill
lui aussi en cuisinier, en fait autant. Guido Venanzi coute
assis'.
Le grand premier rle
Je vous demande pardon, est-il absolument nces-
saire que je me coiffe de ce bonnet de cuisinier.
Le directeur
Mais naturellement, puisque c'est crit.
Il montre la brochure.
Le grand premier rle
Mais c'est parfaitement ridicule !
Le directeur, se levant furieux
Ridicule ! Ridicule ! Que voulez-vous que j'y fasse s'il
ne nous arrive plus de France une seule bonne comdie
et si nous en sommes rduits reprsenter des comdies
de Pirandello, dont on ne comprend pas un tratre mot et
270
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
que l'auteur semble avoir crites exprs pour se f... de
moi, de vous et du public ?...". (trad. fr. C. Mallarm, pp.
9-10).
De mme, Albert Cohen se donne souvent un reprsentant discret dans
ses romans, on l'a vu avec Belle du Seigneur. Dans Mangeclous (1938), un
demi-sicle avant Belle du Seigneur, il le fait d'une manire qui n'est pas sans
rappeler Cervants. C'est le hros ponyme qui parle :
"- Je suis un inconnu, moi ? Mais ne sais-tu pas qu'un
livre tout entier appel Solal a t crit sur moi avec mon
propre nom et que l'crivain de ce livre est un Cohen dont
le prnom trange est Albert. Et que cet Albert, n en l'le
de Corfou, voisine de la ntre, est le petit-fils de l'Ancien
de la communaut de Corfou qui faillit pouser ma mre,
ce qui fait que cet Albert est en quelque sorte mon parent !
Ne sais-tu pas que dans tous les pays du monde et mme
Ceylan, Mattathias, on me trouve sympathique grce
ce livre et ne l'as-tu pas lu ?" (Folio, p. 298).
Entre Solal, (le premier roman de Cohen, publi en 1930) et Mangeclous
se trouve donc tabli le mme rapport qu'entre les deux parties du Quichotte. A
cette diffrence qu'il s'agit dans le roman de la seule occurrence rflexive. Sur
le plan smantique, ce passage tend tablir un lien entre les romans de
Cohen, constituer son uvre en "cycle des valeureux", et replier ce cycle
sur lui-mme. Mais cette sortie de Mangeclous ne modifie pas le cours de
l'histoire ; elle n'a aucune importance pour la progression de l'intrigue.
Dans ces deux exemples, l'irruption de l'crivain dans sa fiction ne
manque pas de piquant, n'est pas sans consquence pour le sens de luvre.
Au regard de l'intrigue, cette piphanie est pourtant trs secondaire : elle n'a
pas de rendement digtique. Par dfinition, c'est aussi la situation de la plupart
des textes cits lors de la description des emplois mineurs remplis par la figure
auctoriale (Larbaud, Cendrars, Tournier etc.). Dans toutes ces ralisations, la
fictionnalisation de l'auteur se caractrise par les traits suivants :
- l'auteur est nomm directement, sans transformation, sans substitut,
livresque ou onomastique ;
- il n'occupe qu'un segment textuel rduit (d'une phrase un paragraphe,
avec rarement plus dune occurrence de son patronyme) ;
271
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- son rle est insignifiant pour l'intrigue, il est rarement un vritable
personnage.
Cette limitation de la fictionnalisation fait que le plus souvent l'auteur
"ressemble" son reprsentant, prsente un profil thmatique identique
("analogie totale" dans notre typologie). Pour l'crivain, il s'agit moins de se
draliser que d'tre solidaire de son univers, de donner voir une prsence
qui normalement cherche se faire oublier.
Les effets de cette rverbration de l'auteur dans son texte ont
commenc tre analyss propos du Quichotte. On a dcrit l'invagination de
la fiction qu'elle provoquait. Cette analyse demande tre complte.
Signalons, tout d'abord, l'effet Sly locks pour reprendre une formule de C.E.
Magny. Dans tous les cas, l'apparition de l'auteur ouvre sur le dehors de la
fiction, permet des "regards en coulisse". Ce clin dil ne manque jamais
d'amener un sourire sur le visage du lecteur, de renforcer sa complicit avec
l'auteur. La fictionnalisation fragmentaire actualise ainsi une fonction phatique,
remplie dhabitude par le narrateur. Notons, aussi, l'effet emphatique que peut
avoir le ddoublement ponctuel de l'auteur. Quoiquon en dise, la rflexivit
n'est pas toujours transgressive. Sa ngativit peut avoir une vertu
pdagogique, comme la mise en abyme de l'nonc dans le Naturalisme. Selon
un mcanisme dj observ, la fictionnalisation passagre donne la possibilit
l'auteur d'indiquer ses intentions, d'indexer le discours d'un personnage son
autorit. C'est par exemple ce que fait Cendrars dans Emmne-moi au bout du
monde ! ..., sa dernire fiction. Dans ce "roman-roman", la silhouette de
Cendrars se profile dans le texte deux reprises. Comme Lorrain ou Proust, il y
fait de la figuration intelligente : l'hrone Thrse l'voque comme l'un de ses
amis intimes. A chaque occurrence (o.c., t. 7, pp. 302, 329) le nom de Cendrars
apparat dans un de ces longs monologues dont l'hrone a le privilge et qui
manifeste sa vitalit. Ces occurrences permettent Cendrars d'indiquer o va
sa sympathie et de prendre en charge le discours de Thrse, malgr l'image
peu flatteuse qu'il en donne parfois. Pour finir, il faut relever leffet de
dnudation qu'amne la fictionnalisation auctoriale. On sait que cette notion de
"dnudation" vient des Formalistes russes. Par "dnudation du procd", ils
dsignaient tous les usages contre-emploi d'un procd d'criture, une
manire de l'utiliser soulignant son caractre factice et littraire (Tomachevski,
1925, pp. 300-301 ; Todorov, 1972, pp. 336-33). La fictionnalisation de soi est
272
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
un instrument privilgi pour dnaturaliser un composant littraire essentiel : la
fonction d'Auteur. Elle a un effet critique majeur sur la conception du sens
commun pour qui l'auteur est le Sujet suppos savoir, le matre duvre,
autorit souveraine qui cre, distribue, anime et conserve les rles et les
significations. Par elle, l'auteur ne se laisse plus sparer de la ralit de ses
personnages et de leur monde ; il n'est plus ce surplomb qui apporte un Sens
au livre et qui garantit la Vrit de la fiction. Elle permet donc d'intgrer dans sa
propre uvre cette tranget par rapport soi qu'est pour chaque crivain
lcriture ; tranget que traduit bien Michel Butor dans ce passage :
lorsque je lis mon nom dans un ouvrage, dans un
article de revue, je suis flatt (parfois), mais j'ai du mal
admettre que ce soit bien de moi qu'il s'agit. Cet homme
dont on dit qu'il pense ceci, qu'il veut ceci, qu'il fait ceci,
quelquefois il m'intrigue, j'aurais envie d'en savoir
davantage. Bien sr j'ai la tentation d'expliquer, de me
dfendre, de montrer que ce n'est pas cela que je dis, que
je fais, que Je suis. Cela fait de nouveaux livres, ou de
nouveaux entretiens. Ainsi celui qui va vous rpondre est
quelqu'un qui est en quelque sorte pourchass par son
fantme, par une trange figure issue de ce qu'il a fait, et
qui cherche perptuellement l'exorciser, je dirais
presque l'apaiser" (1979, pp. 24-25).
Voici donc les traits formels et fonctionnels des mises en abyme de
l'crivain, qui ont pour caractristique d'entraner son ddoublement fictionnel.
Qu'en est-il de leur statut ? De leur rapport l'autofiction comme pratique
littraire ? Dans ces ralisations, le reprsentant auctorial occupe une place
minimale, fonctionnellement sans signification. Ni narrateur ni personnage
dterminant, son absence ne dfigurerait pas le rcit. A l'chelle des
personnages et de l'action, sa prsence est une miniaturisation du dispositif de
l'autofiction. Certes, ces ralisations manifestent des proprits que l'on
retrouvera dans les autofictions proprement dites. Certes aussi, elle prsente
bien un effet autofictif. Mais ds l'instant ou l'auteur ne remplit pas un rle
significatif dans son texte, on ne peut majorer ces miniatures pour les
classer dans le domaine d l'autofiction au sens strict, dont on a au moins une
connaissance ngative.
273
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
b) Mise en abyme du livre.
Seconde espce de rencontre entre la construction en abyme et la
fictionnalisation de soi la mise en abyme de l'nonciation o l'ouvrage se cite
lui-mme, en se donnant comme un livre faire ou en train de se faire.
Naturellement, cette dernire espce de rflexion peut se conjuguer avec celle
tudie prcdemment comme dans le Quichotte, Il est toutefois plus fructueux
de bien les distinguer, afin d'analyser le fonctionnement, les effets et le statut de
celle-ci par rapport l'auto fiction.
Par rapport son pendant auctorial, la mise en abyme du livre prsente
plus de diversit dans ses ralisations. L'crivain a le loisir de jouer sur deux
facteurs :
- la nature de la rflexion : celle-ci peut tre relle ou virtuelle. Relle si
l'on a effectivement un "roman du roman", l'histoire d'un roman qui s'crit au fur
et mesure que le rcit progresse, ce roman tant identique au rcit que le
lecteur dchiffre. Virtuelle, si le roman relate une histoire qui est promise au
lecteur, alors prcisment qu'il est en train de la lire ;
- l'identit du reprsentant : le "roman du roman". qu'il soit rel ou virtuel,
est fatalement un "roman du romancier". Il faut bien un auteur ce roman
autonyme, qui s'voque lui-mme. Ce personnage de "romancier" peut avoir :
(a) l'identit de son crateur rel, (b) une autre identit.
La variation de ces deux facteurs va avoir, on s'en doute, quelques
consquences sur la physionomie de la mise en abyme du livre.
Pour illustrer ces possibilits de variation, l'uvre de Gide est
exemplaire. On sait qu'il fut pour beaucoup dans linstitutionnalisation de ces
procds de rduplication. Dans une page de son Journal, souvent cite, il a
donn comme charte de cette technique narrative. C'est partir de cette
page que Claude-Edmonde Magny a cr l'expression de "mise en abyme" et
que la notion est passe dfinitivement dans le domaine public. En outre, Gide
a construit nombre de ses rcits autour d'une forme de mise en abyme. Il tait
donc difficile de ne pas faire un sort, aprs Dallenbach, deux de ses ouvrages
qui ralisent merveille l'espce de spcularit qui nous intresse ici. D'autant
que Gide apporte une innovation considrable dans la mise en abyme du livre,
274
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
en regard de celle du Quichotte : la promotion d'un personnage qui a charge de
raliser la reduplication.
Commenons par Paludes qui combine une rflexion relle et un
personnage de romancier ayant la mme identit que l'auteur. Dans ce rcit, un
narrateur anonyme relate la premire personne sa rdaction d'un rcit,
galement la premire personne, qui raconte la morne existence de Tityre,
dans un paysage de terres marcageuses et de landes monotones. Ce rcit
enchss porte, au sous-titre pris, le mme titre que luvre mre : c'est
Paludes ou Journal de Tityre. crivain complaisant le narrateur anonyme donne
quantit d'extraits de son rcit en cours de rdaction, attestant ainsi de
l'existence relle de cet homonyme titulaire
JOURNAL DE TITYRE
ou Paludes
De ma fentre j'aperois, quand je relve un peu la
tte, un jardin que je n'ai pas encore tien regard ;
droite, un bois qui perd ses feuilles ; au-del du jardin..."
(Folio, p. 20).
De plus, ce narrateur ne manque jamais une occasion dclairer et de
justifier son "roman". Vritable litanie du roman, la dclaration "j'cris Paludes"
accompagne toutes ces explications:
"Paludes, c'est l'histoire d'un clibataire dans une tour
entoure de marais" (p. 19).
"Ce qu'il faut indiquer c'est que chacun, quoique
enferm, se croit dehors" (p. 67).
'Qui cest Tityre ? () Tityre, c'est moi et ce n'est pas
moi ; - Tityre, c'est l'imbcile c'est moi, c'est toi - c'est
nous tous..." (p. 72)
"Ce que je veux ? Messieurs, ce que je veux - moi
personnellement - c'est terminer Paludes" (p. 88).
"C'est justement ce que je voudrais leur faire
comprendre, qu'il faut recommencer - toujours - faire
comprendre..." (p. 89).
275
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"Sur l'agenda Finir Paludes. - Gravit".
(p. 129).
Du fait de son anonymat, il est difficile de ne pas voir dans ce narrateur
un double de Gide. Aprs tout, Paludes est bien un ouvrage publi par Gide en
1895. Et ce narrateur se donne lui aussi comme l'auteur dun Paludes. Une telle
appropriation fonctionne, on l'a vu, comme un substitut du nom auctorial. En
racontant dans Paludes qu'il crit l'histoire de Tityre, rcit intitul lui aussi
Paludes, le je narrateur accapare la position de son crateur. Au reste, si le
Paludes fictif a un narrateur qui possde un nom diffrent de celui de Gide, son
histoire manifeste de nombreuses analogies avec celle du Paludes rel. La
rflexion produite par la concordance des titres est minutieusement motive, sa
leon est pour ainsi dire transparente, peut-tre trop : les marais de Tityre
mtaphorise l'envie l'enfermement du narrateur dans une vie mesquine et
sans horizon. Cet apologue est tellement manifeste que la frontire entre le
Paludes du narrateur et celui de Tityre tend se dissoudre. Le texte de ce
dernier est toujours en italiques, soit Mais qui nous dit que le Journal de Tityre
est fait des seules paroles de son personnage ponyme ? Pourquoi ne serait-il
pas encadr par les rflexions du narrateur anonyme ? L'insistance du "j'cris
Paludes" n'est pas sans entretenir cette ambigut. Au demeurant, le narrateur
anonyme ne fait rien pour lever cette quivocit, bien au contraire :
"Vous devriez mettre cela ...
- Ah ! Par piti n'achevez pas, chre amie -et ne me
dites pas que je devrais mettre cela dans Paludes. -
D'abord a y est dj..." (p. 118)
C'est donc en citant abondamment son homonyme et grce l'anonymat
de son narrateur que Paludes prsente la fois un auto-enchssement effectif
et une figure de "romancier" pouvant tre confondue avec son auteur. Insistons
bien sur les conditions qui rendent possibles ces deux traits il y a concordance
titulaire entre luvre enchsse et luvre enchssante ; (2)
l'auto-enchssement est tendu tout le rcit, en pouse le mouvement et
s'achve avec lui ; (3) cet auto-enchssement est opr par un narrateur
auto-digtique, un narrateur qui est aussi un personnage de l'histoire, point
essentiel comme on le verra.
Sur le plan fonctionnel, ce "montage" conduit une confusion des
niveaux narratifs, l'effet Ouroboros dj vu avec le Quichotte : le livre se
276
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
laisse recouvrir par ce qu'il est cens retenir, se trouve enclav par son
contenu. Cet encerclement paradoxal a dans ce cas un effet disruptif trs fort,
qui ne parat pas pouvoir tre reconverti au service de la cohrence d'un rcit,
pour produire un effet emphatique par exemple. Au contraire, en crasant
l'histoire de Tityre et celle du narrateur, le livre rend trs difficile l'apprciation
des rflexions esthtiques et thiques qui parsment son cours : le lecteur a du
mal faire le dpart entre ce qu'il faut prendre au srieux et ce dont il faut rire.
Comme dans Bouvard et Pcuchet, mais autrement, aucun point de vue ne
russit chapper l'ironie dvastatrice qui traverse le livre. Cette ironie est
d'autant plus forte qu'elle est dcuple par l'effet d'immanence que produit
l'existence relle du Paludes enchss : le livre semble s'crire devant les yeux
du lecteur, se constituer par lui-mme ; ce qui lui enlve toute possibilit de
constituer un sens qui chapperait la drision. Si les effets de cette catgorie
de mise en abyme sont du mme ordre que ceux tudis plus haut, ils portent
nanmoins dans ce cas davantage sur la consistance de l'nonc narratif, sur
son caractre non-contradictoire.
Qu'en est-il, maintenant, du statut de Paludes par rapport l'autofiction ?
Dans ce texte, le dispositif de fictionnalisation manifeste l'originalit d'avoir un
protocole nominal indirect trs particulier, reposant sur une "homonymie par
substitution". dont le relais est un substitut livresque autonyme. L'homonymie se
fait ainsi par le livre mme qui contient la fictionnalisation auctoriale. Autrement
dit, le livre n'a d'autre mdiation que lui-mme pour identifier le double de l'-
crivain. C'est l une situation singulire mais qui n'enlve rien l'efficacit du
protocole nominal tabli. Notons aussi que le dispositif de fictionnalisation est
ralis de faon systmatique dans le rcit. La figure auctoriale est loin d'y avoir
une place marginale, elle a une relle fonction digtique Parce que la
reduplication autonyme est prise en charge par un narrateur-hros, le
reprsentant de l'auteur a la stature et le rle d'un vritable personnage. Par l,
Gide est vritablement dans sa fiction, comme port par ce narrateur qui se
donne comme le crateur de Paludes. D'ailleurs, c'est bien ainsi que Gide
concevait cet ouvrage. Loin dtre un exercice de pure virtuosit, sans rapport
avec lui-mme, Paludes fut pour Gide, comme il le rappelle dans Si le Grain ne
meurt, un exutoire salvateur dans une priode difficile de sa vie.
Ce dernier point est d'importance. C'est cette seule condition d'une
prise en charge de la mise en abyme par un personnage, qui se dclare l'auteur
277
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
de luvre rflchit que lion a bien une autofiction et pas seulement une
fictionnalisation auctoriale. Comparons Paludes et Si par une nuit d'hiver un
voyageur d'Italo Calvino. Dans ce roman, combien complexe et ingnieux,
l'histoire ne cesse de rflchir son titre et son auteur. De l'incipit l'excipit :
"Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino,
Si par une nuit d'hiver un voyageur".
"- Encore un moment. Je suis juste en train de finir Si
par une nuit d'hiver un voyageur, d'Italo Calvino". (Trad.
fr. D. Sallenave et F. Wake, pp. 7 et 279).
Toutefois, cette rfraction systmatique n'exhausse pas Calvino au rang
de personnage. Seul son livre est un composant important de l'histoire ;
lui-mme n'est qu'un patronyme d'auteur ; sans rle significatif, dans la situation
d'une "silhouette", voqu par un narrateur anonyme. Le roman renferme donc
bien une mise en abyme du livre - et du lecteur, ce qui est peu courant sous
une forme aussi systmatique -, mais il ne prsente pas une fictionnalisation de
son auteur assez importante pour tre classe parmi les autofictions. On
pourrait en dire autant du Quichotte II : ni Cervants, ni Hamet Ben Engeli n'ont
un rle assez important pour tre vritablement dans leur fiction.
Pour continuer dvelopper ce point et achever l'examen de cette
catgorie de mise en abyme, il est ncessaire d'aborder la situation des
Faux-Monnayeurs qui prsente une combinaison nouvelle par rapport
Paludes rflexion autonyme quasi-virtuelle et personnage de romancier ayant
son individualit propre. Sans analyser le roman, cherchons d'emble si cette
modification des facteurs de la mise en abyme du livre change radicalement
son statut.
Relevons d'abord la "concidence-discordance" (Allenbach) entre la
figure du romancier et l'auteur rel. Edouard n'est ni un personnage anonyme,
ni un homonyme de Gide, ni mme le narrateur. Cela interdit-il l'tablissement
d'un protocole nominal ? Certes non, puisqu'il est prsent comme l'auteur d'un
projet de "roman pur" qui a pour titre Les Faux-Monnayeurs, comme l'ouvrage
de Gide. Par ce "substitut livresque" autonyme, c'est donc bien un reprsentant
auctorial de Gide qui est mis en place. Que son identit soit ds lors
contradictoire n'invalide pas la possibilit du protocole. D'autres exemples de ce
type ont t rencontrs, entre autres Ferdydurke de Gombrowicz et Moganni
278
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Nameh de Cendrars. Ces textes ont montr l'intrt d'une figure auctoriale
surdtermine.
Le fait que luvre enchsse soit quasiment virtuelle (seul le chapitre
III/15 pouvant donner penser qu'elle existe rellement) constitue-t-il un
obstacle cette "homonymie par substitut livresque" ? Certainement pas
puisque le titre du projet romanesque d'Edouard, tel qu'il est cit dans son
"journal". reproduit exactement celui de Gide. Il y a loin de cette concordance
titulaire aux romans A un personnage vit une histoire qu'il se propose, la fin
du rcit, de relater dans une uvre romanesque, comme dans La Modification.
Dans ce dernier cas, le roman virtuel ne peut servir de "substitut livresque", il
n'a pas de valeur onomastique. Si le livre semble s'enrouler sur lui-mme, il
n'absorbe pas son extriorit, qui commence et finit au titre et au nom d'auteur.
Essentiel, par contre, est le rang d'Edouard dans la population du roman.
Bien qu'il ne soit pas le narrateur, c'est malgr tout l'un des personnages
principaux. Cette qualit fait que la fictionnalisation auctoriale est tendue tout
le roman. Par suite, elle n'est pas un simple procd li la spcularit dans ce
texte, elle peut rellement prtendre au statut de pratique gnrique. Comme le
narrateur de Paludes, Edouard peut donc tre considr comme un double fictif
de Gide, mis en scne dans une autofiction.
Il est temps de conclure sur cette catgorie de ''structure en abyme'' et
plus gnralement sur les relations entre mise en abyme et autofiction. On aura
compris que la mise en abyme du livre est la seule qui puisse prtendre se
confondre avec l'autofiction. C'est qu' la diffrence de la mise en abyme de
l'crivain, la fictionnalisation auctoriale se produit alors selon un mouvement
centripte, par lequel luvre s'enroule sur elle-mme et, dans cet enrobement,
identifie l'auteur rel la figure du romancier qu'elle reprsente. Une condition
est toutefois ncessaire : que la rflexion du livre soit assume par un
personnage dot d'un "premier" ou d'un "second'' rle. Cette condition remplie,
la figure auctoriale dispose d'une fonction digtique assez importante pour
qu'il soit possible de parler dune uvre littraire par laquelle un crivain
s'invente une personnalit et une existence, tout en conservant son identit
relle'' bref d'une autofiction.
Au contraire, la mise en abyme de l'crivain, qui procde selon un
mouvement centrifuge, par un dbordement de son extriorit, ne doit pas tre
279
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
confondue avec l'autofiction. Dans cette catgorie, la fictionnalisation auctoriale
est miniaturise de faon rflchir l'nonciation, obtenir une construction en
abyme. A la diffrence de la situation o le dispositif est ralis l'chelle de
luvre, l'auteur est alors moins dans sa fiction, qu'au milieu de sa fiction,
rflchi comme fortuitement par elle.
Comme dans le chapitre prcdent, il faut donc distinguer la
fictionnalisation de soi de l'autofiction. Celle-l n'est qu'un procd labile,
celle-ci est une pratique globale et plus contraignante. De mme que la
fictionnalisation auctoriale pouvait tre au service d'une stratgie rfrentielle,
elle peut tre le moyen dune stratgie rflexive. Cest ce qui explique que les
illustrations partielles du dispositif de l'autofiction ne soient ni mconnues, ni
laisses elles-mmes, sans rception adquate. Comprise juste titre
comme une sorte de mise en abyme, la fictionnalisation auctoriale bnficie
pour tous les exemples cits d'un "horizon d'attente" constitu par la tradition
spculaire. Reste qu'entre la mise en abyme et l'autofiction, il n'y a qu'un
recoupement partiel, qu'il faut se garder de concevoir comme un
chevauchement.
280
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
4- FONCTION FIGURATIVE
''0 tu che leggi udirai nuovo ludo''
Dante
281
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Pour terminer cet examen fonctionnel, il faut tenter de dcrire les
ralisations dont la vise n'est pas rfrentielle et pas seulement rflexive. Le
dispositif de fictionnalisation n'est alors ni un moyen ni un effet ; il est
lui-mme sa propre fin et la fictionalit reste sa raison dtre. Tous les textes
dans cette situation portent leurs fruits hors de toute stratgie littraire
reconnue: aucune tradition ne les supporte ; ils ne tirent leur lgitimit et leur
force que d'eux-mmes. Ainsi, les uvres d'crivains comme Diderot, Kafka,
Borgs, Cline et Gombrowicz, ou encore, pour des crivains plus
contemporains, comme Copi, Bryce-Echenique, Vargos Llosa, J.D. Salinger ou
Charyn, o l'invention de soi ne parat obir qu' un simple got pour la
fabulation.
Le trait commun tous ces auteurs est, par consquent, dabord un
caractre ngatif : dans une perspective gnrique, leurs uvres sont
irrductibles aux catgories connues, rebelles toute classification, insituables.
Le constat de cette situation singulire a guid jusqu' prsent notre dmarche
et confort notre croyance en un usage sui generis du dispositif. A l'aide de ce
critre privatif, on a ainsi fait la distinction entre le procd de la fictionnalisation
de soi et la pratique de l'autofiction. Cette dichotomie renfermait une hypothse
de travail, lhypothse que tous ces textes apparemment inclassables
prsentaient une unit, manifestaient autant de ralisations d'une stratgie
commune.
Tout le problme de ce chapitre est dtayer cette hypothse, de donner
une positivit cette classe de textes dfinie ngativement. Toutes ces uvres
o l'crivain explore un pli entre le rel et l'irrel, ont-elles assez de points
communs pour rpondre une fonction identique ? Ou ne s'agit-il que de
rencontres fortuites que l'on a hypostasies un peu vite ? Naturellement, on sait
dj que si elles prsentent des caractres communs, ce ne sont pas des traits
formels ou thmatiques. Leurs similarits ne peuvent tre que fonctionnelles,
pragmatiques. Mais mme sous cet aspect, il importe de justifier notre
hypothse autrement qu'en invoquant l'insuffisance des stratgies reconnues
pour comprendre ces textes.
Ne cachons pas tout ce qu'a d'pineux la vrification de notre hypothse.
Tout d'abord, il s'agit de rendre compte dun effet d'nonciation trange,
282
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
paradoxal, troublant nos catgories ordinaires ; qui vient se loger au cur
mme des ides que l'on peut se faire sur la ralit et sur la fiction. Or, cet effet
commence tout juste tre repr la stratgie pragmatique dont il dpend
n'appartient aucun code, n'a pas encore une place reconnue par tous dans le
paysage littraire. Il faut donc dcrire un pouvoir discursif dont l'efficace, quand
elle existe, est cache ; qui n'est pas encore ou qui est en train de se constituer
dans les habitudes de lecture. Au demeurant, la stratgie analyser n'est pas
toujours luvre de manire univoque, n'est pas toujours exempte de
contaminations, de contradictions ou d'insuffisances. En l'absence d'une
tradition, chaque crivain a d presque rinventer chaque fois et
l'agencement et sa fonction, pour en faire une stratgie d'criture. Souvent, ses
commentaires clairent moins ses intentions qu'ils n'acclrent, compliquent ou
dtournent les pouvoirs de son dispositif. Parfois, enfin, l'crivain n'a pas russi
ou pas voulu matriser sa ''machinerie'' comme on peut le voir chez des auteurs
comme Restif, Loti ou Cendrars qui oscillent entre des pratiques inventive,
rfrentielle et mystificatrice de la fiction de soi. Cette part d'incertitude, ainsi
que la solitude de cette stratgie, font qu'il n'est pas facile d'en donner une
description convenable et de dlimiter avec prcision son extension.
Toutefois, le hasard (?) veut que cette stratgie ait t observe et en
partie questionne par Roland Barthes. Plusieurs de ses ouvrages prsentent
des remarques ou des dveloppements trs heuristiques sur son
fonctionnement et ses consquences. Il semble que Barthes ait eu l'intuition de
la pratique littraire qu'elle pouvait constituer, une poque o aucun terme ne
permettait de l'identifier et o personne ne s'tait encore interrog sur son
existence. C'est d'ailleurs pour lui rendre hommage qu'on s'est propos de
dsigner l'usage sui generis du dispositif de fictionnalisation de soi par
l'expression "fonction figurative". Comme on le verra, Barthes a cr le terme
de "figuration" pour nommer un mode original, fictionnel, de reprsentation de
soi.
L'Autofiction selon Barthes
La dcouverte de Barthes est lie au questionnement, qui traverse toute
son uvre, mais selon des perspectives diffrentes, de la notion d'Auteur.
Chacun sait que la critique de Sur Racine fit beaucoup pour abolir la conception
traditionnelle de l'Auteur. De livres en articles, d'interventions en dclarations, il
insista sur le fait que cette notion tait la fois un obstacle pistmologique
283
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
pour le dveloppement des tudes littraires et une catgorie idologique,
produit de l'individualisme bourgeois. Il souligna maintes reprises combien
l'ide d'une paternit concrte et souveraine de l'criture masquait les
problmes de technique littraire, oblitrait la nature de la littrature, empchait
la comprhension des textes modernes et confortait un systme conomique
s'organisant autour de la catgorie d'individualisme possessif. Ce discours
critique culmine dans un article de vulgarisation, publi en 1968, qui s'intitulait
"La Mort de l'Auteur". Dans le mme temps, ce discours critique tait tenu et
dvelopp par beaucoup d'autres critiques, crivains, philosophes, thoriciens
de la littrature. Bref, l'ide faisait son chemin, finissait mme par tre accepte
un peu partout et par constituer une sorte de discours dominant. Peu de temps
aprs, Barthes a eu une raction qui lui est familire et qui a consist revenir
sur cette ide de l'inexistence de l'Auteur. Non pas en faisant son autocritique
et en reconduisant la conception psychologique et raliste du sujet littraire,
mais en explorant l'autre face de cette notion, sa face fonctionnelle et
proprement littraire. A la mme poque, Michel Foucault, dans une
communication intitule "qu'est-ce qu'un auteur ?", s'inquitait de cet
acharnement vacuer une position discursive que l'on connaissait mal et dont
on ne mesurait peut-tre pas la capacit de rsistance et de mtamorphose.
C'est ainsi que dans S/Z, le livre n de son sminaire sur Sarazzine en
1968 et 1969, Barthes adopte simultanment deux attitudes vis--vis de la
notion d'auteur. Une premire attitude consistant affirmer le caractre
inluctable de sa disparition dans la pratique de la littrature, hritage de sa
critique antrieure : "... Ltre de l'criture (le sens du travail qui la constitue) est
d'empcher de jamais rpondre cette question : Qui parle ?" (1970, p. 146).
Et un nouveau point de vue, qui n'est pas contradictoire, consistant se
demander s'il n'y avait pas d'autre solution que cette perte, comme dans le
paragraphe XC :
''L'Auteur lui-mme - dit quelque peu vtuste de
lancienne critique - peut, ou pourra un jour, constituer un
texte comme les autres : il suffira de renoncer faire de
sa personne le sujet, la bute, l'origine, l'autorit, le Pre,
do driverait son uvre, par une voie d'expression ; il
suffira de le considrer lui-mme comme un tre de
papier et sa vie comme une biographie (au sens
tymologique du terme), une criture sans rfrent,
matire d'une connexion, et non d'une filiation l'entreprise
critique (si l'on peut encore parler de critique) consistera
alors retourner la figure documentaire de l'auteur en
284
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
figure romanesque, irrparable, irresponsable, prise dans
le pluriel de son propre texte : travail dont l'aventure a
dj t raconte, non pas des critiques, mais par des
auteurs eux-mmes, tels Proust et Jean Genet" (1970, p.
217).
Articul sur une quadruple opposition (temporelle, fonctionnelle,
relationnelle et textuelle), ce passage voque pour l'auteur la possibilit dune
nouvelle position discursive ("irresponsable, impersonnel", "prise dans le pluriel
de son texte") et d'une nouvelle situation, celle de "figure romanesque". Ces
lignes ont beaucoup frapp les lecteurs attentifs de Barthes par ce qu'elles
impliquaient de reconsidration thorique quant la catgorie d'auteur (Diaz,
1984, p. 48). Mais elles ont aussi lintrt de dgager un faisceau deffets de
lecture indits, propre aux textes proches de ceux de Proust ou de Genet, A
l'crivain fait de son uvre ni un cnotaphe, ni la mise en scne illusoire d'un
Destin et d'une Personne, mais le thtre o se djoue un imaginaire, A se
dfait une personnalit et o sanime un individu transform en "figure".
Cette notion de "figure" est aussi une catgorie de S/Z. qui prend son
sens par opposition celle de personnage :
"ce n'est plus une combinaison de smes fix sur un
nom civil, et la biographie, la psychologie, le temps ne
peuvent plus s'en emparer c'est une configuration incivile,
impersonnelle, achronique de rapports symboliques"
(1970, p. 74).
Une "figure romanesque", c'est par consquent un personnage que le
caractre, la situation, les motivations, la vraisemblance ne figeraient pas ; doit
le sens serait toujours en mouvement, sans trouver de terme. Ne s'agit-il que
d'une utopie ? Certains personnages, Manon Lescaut par exemple, y
approchent de trs pris. Quant Proust et Genet, leurs narrateurs n'en sont
pas loin, si l'on s'avise de les considrer aussi comme des reprsentants
auctoriaux. C'est alors que tous les prdicats qui sont attachs un crivain,
qui lui donnent sa physionomie propre, que le lecteur cherche totaliser dans
une autobiographie, reprer dans ses romans, sont laisses eux-mmes.
Inutile de chercher la Personne, son histoire, sa destine, ses tourments etc., il
n'y a qu'une "idalit symbolique". A travers diffrents crans, l'crivain s'interdit
toute reprsentation ou expression de soi au sens conventionnel,
transformation qui passe naturellement par un important travail stylistique,
thmatique et narratif. Il s'agit d'enlever tout privilge au personnage
285
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
reprsentant l'crivain l'enjeu est que ce double soit lisible dans tous les sens,
susceptible d'interprtations varies, de lectures diverses, comme le sont
Shrazade, Don Quichotte, Manon Lescaut, Charlus ou, Ulrich. Si l'auteur
russit, le lecteur doit se trouver devant une "structure symbolique", plus que
devant un mmorial qu'une personne s'est lev elle-mme. Au contraire, la
"figure documentaire" est l'illusion produite par une autobiographie d'crivain,
une reprsentation "verrouille" de toutes parts, s'attachant recueillir des
significations, les ordonner en destin et bloquer la circulation des signes.
Voil donc l'Effet que dcouvre Barthes dans les textes de Proust et de Genet.
On pourrait Mme dire, en reprenant la formule de Sartre, voil l'Effet qu'il
invente, tant ce dplacement tait cach aux yeux de tous. On notera au
passage la perspicacit avec laquelle Barthes rapproche Genet de Proust,
quand aucun document ne permettait encore d'tablir cette filiation.
Reste savoir, maintenant, le parti que l'on peut tirer de cette
dcouverte. Le problme, on l'a rencontr, c'est que ni luvre de Proust, ni
celle de Genet, ne constituent des exemples "purs" d'autofiction. Chez Proust,
le protocole nominal est rticent, formul sur le mode du C'est moi et ce n'est
pas moi, au moins pour la premire occurrence du prnom "Marcel".
Symtriquement, c'est le protocole modal qui est ambigu chez Genet ; tous les
rcits o il apparat montrent un "protocole modal indfini". Peut-on ngliger ces
"impurets'' ou font-elles que Barthes parle en ralit d'autre chose que de
notre dispositif ? Ce point est dommageable parce que ces deux crivains sont
et resteront emblmatiques dans son analyse.
Pour le rsoudre, il faut sarrter sur la nature de lquivocit des uvres
de Proust et de Genet. Celle-ci n'existe pas en soi, elle n'a de sens que par
rapport un modle idal, le dispositif dfini en commenant ce travail, qui est
un instrument de recherche et d'analyse, pas une norme. On peut se rappeler
ici la remarque de Ph. Lejeune, que nous citions au dbut de cette enqute : "Il
ne faut pas confondre, l'axe magntique qui rgit la boussole avec la multiplicit
des directions qu'elle permet de reprer. Et il faut admettre qu'il y a dans la
ralit d'autres axes d'organisation que l'axe magntique..." (1983, p. 21). Si
l'on considre le dplacement opr par l'autofiction. force est de constater que
Proust et Genet travaillent dans cette voie. Leurs textes nactualisent pas de
faon partielle ou inadquate le dispositif de l'autofiction, ils le ralisent la
marge, en se plaant sur chacune de ses lignes de dmarcation. En formulant
286
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
de manire dngative son nom, Proust se situe exactement sur la frontire qui
marque la constitution dun protocole nominal ; en conjuguant dclarations de
fictionalit et indices rfrentiels, Genet se situe exactement sur la limite d'exis-
tence d'un protocole modal de fiction. Naturellement, ce travail sur la marge du
dispositif n'est pas sans consquence. Il produit, dlibrment ou non, des
effets complmentaires qu'il faudrait pouvoir analyser en dtail. Mais il
n'hypothque pas l'appartenance de ces auteurs au domaine de l'autofiction, ni
lapplication dune stratgie fictionnalisante. Il parait donc lgitime de les
intgrer dans notre corpus et de leur laisser la valeur paradigmatique que
Barthes leur a accorde.
Dautant que Barthes ne s'est pas arrt cette brillante remarque sur
Proust et Genet. A partir de S/Z, il na pas cess de dvelopper sa pense sur
ce sujet, selon deux axes : en ritant sa critique de la notion traditionnelle
dauteur ; en poursuivant son exploration des effets de lecture propre au texte
proustien. Dans Sade, Fourier, Loyola, l'anne suivante, on trouve ainsi
nouveau une allusion la "figure romanesque" de l'auteur et la singularit de
l'agencement proustien. Il est remarquable que cette vocation intervienne dans
un ouvrage qui n'appelait pas, par son contenu, un tel rappel. Cela montre
l'attachement et la continuit de la pense de Barthes par rapport cette
pratique littraire. Il s'agit d'une brve notation dans la "Prface". Moquant le
"Texte" comme "objet de plaisir", en anticipant bien sr sur un de ses ouvrages
ultrieurs, Barthes note :
"Le plaisir du Texte comporte aussi un retour amical de
l'auteur. L'auteur qui revient n'est certes pas celui qui a
t identifi par nos institutions (...) ce n'est Mme pas le
hros d'une biographie. L'auteur qui vient de son texte et
va dans notre vie n'a pas dunit est un simple pluriel de
"charmes", le lieu de quelques dtails tnus, source
cependant de vives lueurs romanesques, un chant
discontinu d'amabilits, en quoi nanmoins nous lisons la
mort plus srement que dans l'pope d'un destin.. "
(1971 a, p. 13).
Naturellement, cette rflexion s'applique ici aux minuscules faits
biographiques que Barthes retient de la vie de Sade ou de Fourier. De Mme
que son ouvrage relve quelques-uns des bonheurs d'expression de ces
auteurs, il s'applique rassembler quelques menus incidents de leur existence,
incidents soustraits toute lecture interprtative, n'ayant qu'une saveur de
signifiants comme il le dclare lui-mme. Toutefois, ces "biographmes"
287
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dessinent en pointill un modle textuel o le rapport de l'auteur son uvre
serait transform. Et le passage voque bien une prsence auctoriale non
biographique, dtache de tout privilge centralisateur : un auteur dissmin
dans son texte. Davantage, ce paragraphe fait de la perceptibilit de l'auteur
l'un des composants du "plaisir du texte" ; une ide qui ne prendra tout son
sens que plus tard. Plus loin dans le mme ouvrage, Barthes illustre cette
remarque par une rfrence Proust, comme l'crivain ayant russi raliser
ce nouveau genre d'criture de soi :
"Car s'il faut que par une dialectique retorse il y ait
dans le Texte, destructeur de tout sujet, un sujet aimer,
ce sujet est dispers, un peu comme les cendres que l'on
jette au vent aprs la mort (au thme de l'urne et de la
stle objets forts, ferms, instituteurs du destin,
s'opposeraient les clats du souvenir, l'rosion qui ne
laisse de la vie passe que quelques plis si j'tais
crivain, et mort, comme j'aimerais que ma vie se rduist,
par les soins d'un biographe amical et dsinvolte,
quelques dtails, quelques gots, quelques inflexions,
disons des 'biographmes' dont la distinction et la mobilit
pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher,
la faon des atomes picuriens, quelque corps futur,
promis la mme dispersion ; une vie troue, en somme,
comme Proust a su crire la sienne dans son uvre ... "
(1971 a, p. 14).
Une fois de plus, Barthes voque donc la possibilit pour un crivain de
se donner en spectacle sans pour autant servir de caution un rcit ou de
garantie un discours. L'crivain pourrait viter ces cueils de la reprsentation
de soi, s'il accepte dtre dans son uvre un sujet "dispers". comme dpli
dans son propre-rcit. Et cette fois encore, Proust est lcrivain capital" dans
cette entreprise consistant se donner une "vie troue", toile, sans destin.
Mais nest-ce pas lui qui a montr, dans Le Temps retrouv, que lon ne peut
refaire ce qu'on aime qu'en le renonant". qu'il faut savoir "sacrifier son amour
du moment" et que lon peut alors "rencontrer ce qu'on a abandonn" ? La
nouveaut de ce passage, c'est que, tout en maintenant son ide selon laquelle
le texte est un tombeau vide, Barthes affirme que luvre peut produire un
"sujet aimer". formule aussi suggestive qu'nigmatique.
C'est dans Le Plaisir du Texte que Barthes toffera cette ide. Mais
avant d'en arriver l, il faut s'attarder sur une prface crite pour une rdition
chez le clbre diteur italien Franco-Marici Ricci et publie aussi en 1971 :
"Pierre Loti : Aziyad". Avec ce roman, Barthes avait en effet l'occasion de
288
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dvelopper l'chelle d'un texte tout entier ses remarques antrieures. Comme
on l'a voqu, ce premier ouvrage de Loti rfracte en effet son propre auteur,
offre un sujet historique et pourtant irrel : Loti lui-mme, engag dans une
histoire d'amour turque, qui le conduira la mort. Pourtant, l'analyse de ce
roman par Barthes est un peu en retrait par rapport aux propositions
prcdentes ; en tous cas, elle n'est pas articule la problmatique antrieure.
D'entre de jeu, Barthes signale le caractre insolite du systme
nonciatif de ce roman, la bizarrerie de ce texte par rapport aux conventions
romanesques :
"Loti, c'est le hros du roman(). Loti est dans le
roman mais il est aussi en dehors, puisque le Loti qui a
crit le livre ne concide nullement avec le hros Loti : ils
n'ont pas la mme identit. Le premier est anglais, il
meurt jeune ; le second Loti, prnomm Pierre, est
membre de l'Acadmie franaise, il a crit bien d'autres
livres que le rcit de ses amours turques. Le jeu d'identit
ne s'arrte pas l : ce second Loti, bien install dans le
commerce et les honneurs du livre, n'est pas encore
l'auteur vritable, civil, d'Aziyad : celui-l s'appelait Julien
Vaud..." (1971 b, p. 171).
Il en donne, ensuite, une analyse fonctionnelle :
''Ainsi un auteur mineur, dmod et visiblement peu
soucieux de thorie (cependant contemporain de
Mallarm, de Proust) met jour la plus retorse des
logiques d'criture : ( ... ) vouloir tre 'celui qui fait partie
du tableau', c'est crire pour autant seulement qu'on est
crit : abolition du passif et de l'actif, de lexprimant et de
l'exprim, du sujet et de l'nonc, en quoi se cherche
prcisment l'criture moderne" ( 1971 b, p. 181 ).
Enfin, au terme d'une brillante tude thmatique, Barthes fait de cette trange
immixion de l'auteur dans sa fiction, "la traduction structurale" d'une criture qui
se refuse au sujet, tous les sens du mot :
"Non seulement l'criture, venue du dsir, frle sans
cesse l'interdit, dsitue le sujet qui crit, le droute ; mais
encore (ceci n'tant que la traduction structurale de cela)
en lui les plans opratoires sont multiples : ils tremblent
les uns dans les autres. Qui parle (Loti) nest pas qui crit
(Pierre Loti) ; l'mission du rcit migre, comme au jeu du
furet, de Viaud Pierre Loti, de Pierre Loti Loti, puis
Loti ..." (1971 b, p. 186).
289
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Que retenir de cet examen dtaill d'un cas empirique d'autofiction par
Barthes ? En premier lieu, il faut rappeler qu'il s'agit, cette fois, la diffrence
de Proust ou de Genet, d'un cas "Pur" de fictionnalisation de soi. Quoique
publi de faon anonyme en 1879, aprs le succs du Mariage de Loti
(initialement Rarahu.) en 1880 et la publication du Roman d'un Spahi en 1881,
Aziyad est dit sous le nom d'auteur "Pierre Loti" et relate une histoire la
fictionalit indiscutable, puisque le hros, un capitaine de vaisseau anglais
nomm "Loti", meurt la fin du roman. Barthes aurait mme pu enrichir son
analyse puisque nombre des romans de Loti, du Mariage de Loti Mon frre
Yves, sont construits sur le dispositif de l'autofiction. Ne poussant pas son
examen plus loin qu'Aziyad, il manque de signaler que la fiction de soi est
chez Loti une stratgie narrative et littraire, ncessaire la fois pour son
criture et pour sa lgitimation.
Notons aussi que Barthes ne fait qu'un rapprochement allusif avec
Proust - qui pouvait rciter, dailleurs, des pages entires de Loti -, confondu
avec Mallarm pour sa mise en cause du sujet de l'criture. Aucune allusion,
dans cet article, la figure "retourne" de l'Auteur et l'effet de lecture qui
pourrait en dcouler. C'est se demander si cette tude n'a pas t crite bien
avant sa date de publication, peut-tre avant l'laboration finale de S/Z. Quoi
qu'il en soit, il faut reconnatre que l'analyse des effets du dispositif ne dpasse
pas, dans ce texte, une certaine gnralit. Barthes Semble prisonnier d'une
vulgate d'poque, la vulgate Tel Quel, sur le sujet qu'il s'agit de subvertir etc.
Comme toute vulgate cette dernire n'est pas fausse, mais elle est vague.
L'analyse propose ici pourrait s'appliquer d'autres pratiques que la fiction de
soi ; si l'effet qu'il relve est bien produit par celle-ci, c'est l'intrieur d'un
faisceau qui lui donne un relief et une force spcifiques.
Reste que cette prface est intressante en ce qu'elle confirme l'intrt
de Barthes pour les textes utilisant la situation d'nonciation propre
lautofiction. Il est facile aujourd'hui, presque vingt ans aprs, de juger
svrement un article envisageant de faon floue l'originalit de cette forme
fictionnelle. A l'poque o il fut crit, il tait dj remarquable d'arriver "mettre
plat" le dispositif de l'autofiction. qui plus est chez un crivain aussi peu couru
que Pierre Loti.
De plus, c'est surtout partir du Plaisir du texte, en 1973, que Barthes va
vraiment tirer tout son profit, pour la perception de ce nouvel agencement
290
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
littraire, de son regard diffrent sur l'auteur. C'est dans ce petit livre, tout en
fragments, qu'il rassemble et articule des ides lances et prouves
sparment dans sa production antrieure. C'est par exemple dans cet ouvrage
qu'il dveloppe vraiment sa rflexion sur "la possibilit dune dialectique du
dsir" entre le lecteur et l'auteur, sur ce mouvement par lequel l'auteur "vient de
son texte et va dans notre vie" :
"Le texte est un objet ftiche et ce ftiche me dsire.
Le texte me choisit, par toute une disposition d'crans
invisibles, de chicanes slectives : le vocabulaire, les
rfrences, la lisibilit etc. ; et, perdu au milieu du texte
(non pas derrire lui la faon d'un dieu de machinerie), il
y a toujours l'autre, l'auteur. Comme institution, l'auteur
est mort sa personne civile, passionnelle, biographique, a
disparu ; dpossde, elle n'exerce plus sur son uvre la
formidable paternit dont l'histoire littraire,
l'enseignement, l'opinion avaient charge d'tablir et de
renouveler le rcit ; mais dans le texte, d'une certaine
faon, je dsire l'auteur : j'ai besoin de sa figure (qui n'est
ni sa reprsentation, ni sa projection), comme il a besoin
de la mienne (sauf 'babiller').'' (1973, pp. 45-46).
A travers un discours psychanalytique qui bloque toute interprtation
psychologisante ou raliste et pouse un phnomne d'nonciation complexe,
ce fragment poursuit la rflexion amorce dans S/Z. Il dveloppe une ide qui
mriterait d'tre repense : il y a dans tout texte, sous des degrs et des modes
diffrents, une logique du dsir, un appel rciproque de l'auteur et du lecteur,
des attentes mutuelles qui se matrialisent dans toute la machinerie complexe
de sa pragmatique, depuis ses "dispositions" nonciatives jusqu'aux attitudes
de lecture qui lui sont appliques. Il faudra se demander si l'autofiction. n'est
pas un choix d'nonciation ouvrant la possibilit de dmultiplier l'expression et
la force de cette logique du dsir.
Autre intrt du Plaisir du texte : la notion de "figure" est prsente sous
un autre jour, toujours par opposition au produit de la reprsentation, toujours
avec les exemples paradigmatiques de Proust et de Genet, mais dans une mise
en perspective plus large
"Il faudrait d'ailleurs distinguer entre la figuration et la
reprsentation. La figuration serait le mode d'apparition
du corps rotique ( quelque degr et sous quelque mode
que ce soit) dans le profil du texte. Par exemple : l'auteur
peut apparatre dans son texte (Genet, Proust), mais non
point sous les espces de la biographie directe (ce qui
291
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
excderait le corps, donnerait un sens la vie, forgerait
un destin). Ou encore : on peut concevoir du dsir pour
un personnage de roman (par pulsions fugitives). Ou
enfin : le texte lui-mme, structure diagrammatique, et
non pas imitative, peut se dvoiler sous forme de corps,
cliv en objets ftiches, en lieux rotiques. Tous ces
mouvements attestent une figure du texte, ncessaire la
jouissance de lecture. De mme, et plus encore que le
texte, le film sera coup sr toujours figuratif (ce pour
quoi il vaut tout de mme la peine d'en faire) - mme s'il
ne reprsente rien. La reprsentation, elle, serait une
figuration embarrasse, encombre d'autres sens que
celui du dsir..." (1973, pp. 88-89).
En revenant sur la notion de "figure". Barthes lui donne un contenu
diffrent, plus libidinal que symbolique. Cette redfinition peut poser problme,
si l'on ne s'avise pas que c'est surtout la perspective qui a chang. Au fond,
l'objet vis est bien le mme : la rfrence Proust et Genet le montre. Il
s'agit toujours de pointer vers une configuration de signifiants dsirables, dont
le procs smantique ne serait qu'un incessant mouvement brasillant, allumant
de grands feux la lecture : "la figure". Et le dessein est identique : il s'agit
toujours dopposer la "reprsentation". dont le sens finit dans tous les cas par
s'immobiliser dans une dmonstration, une instruction ou une dification, - de
lui opposer un procs signifiant en roue libre, qui n'aurait pour finalit que
dbaucher interminablement le mouvement de la signification, sans jamais
venir mourir dans les Codes culturels : "la figuration". Donc, c'est encore la
mme dmarche que dans S/Z, consistant isoler une configuration atypique,
le procs d'criture dont elle rsulte (procs fonctionnant au revers de la
reprsentation) et son pouvoir sur la lecture. Le fait nouveau, c'est que ce
procs s'est diversifi dans ses points d'application (ce peut tre l'auteur, un
personnage ou le trac textuel lui-mme) et qu'il est dsormais susceptible
dtre articul la logique du dsir qui irrigue tout texte, puisqu'il est le dsir se
matrialisant, son incarnation.
Il est vrai que cette description a quelque chose d'une utopie littraire.
Est-ce une raison pour la dclarer irrecevable ? Comme souvent chez Barthes,
l'utopie apporte la pense son impulsion, lui ouvre des horizons et fonctionne
comme un modle opratoire : c'est un passage la limite qui permet
d'prouver dans toute leur ampleur les forces de lempirique. De fait, ces lignes
dcrivent un idal sans lequel les dplacements oprs par Proust et Genet,
dans la littrature, seraient moins sensibles. En outre, cette description
292
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
prsente une extension qui pourrait autoriser une analyse diffrentielle de la
figuration auctoriale. En situant cette entreprise par rapport d'autres
manifestations fictionnelles, du roman classique au texte "scriptible", Barthes lui
donne le statut d'une vritable pratique et invite prolonger la recherche de ses
traits distinctifs.
Barthes achve, dans Le Plaisir du texte, cette analyse des textes o
apparat la "figure de l'auteur", par une dernire description fonctionnelle.
Inventoriant l'tat de la recherche d'une "thorie du sujet matrialiste". il voque
tour tour sa critique moraliste, sa dconstruction dans l'criture d'avant-garde
et sa pulvrisation, pratique consistant "gnraliser le sujet" (1973, p. 97). Or.
cette multiplication est prcisment l'opration de la "figuration auctoriale", o
l'crivain se dmultiplie, se disperse dans son uvre. Que produit sur le lecteur
cette opration textuelle ?
"Alors peut-tre revient le sujet, non comme illusion,
mais comme fiction. Un certain plaisir est tir d'une faon
de s'imaginer comme individu, d'inventer une dernire
fiction, des plus rares : le fictif de l'identit. Cette fiction
nest plus l'illusion d'une unit ; elle est au contraire le
thtre de socit o nous faisons comparatre notre
pluriel : notre plaisir est individuel - mais non
personnel"(1973, p. 98).
Ainsi, le texte "figuratif" conduirait le lecteur prouver en lui le "fictif de
l'identit", se percevoir comme un individu impersonnel, comme une
singularit historique, mais soustraite tout Imaginaire, dfaite de toute illusion
d'unit, de transparence et de matrise. Paralllement la "dialectique du dsir"
voque plus haut, le "retour de l'Auteur" provoquerait une dialectique figurale,
o le lecteur s'exprimenterait comme figure, proportion de la perceptibilit de
la figure de l'auteur dans luvre. On voit par consquent tout ce qui rend
prcieux le Plaisir du texte, pour cette enqute sur l'autofiction, dfinie par
Barthes comme un travail de "figuration". Aucune ide n'est vraiment nouvelle
dans cet essai. Mais par leur articulation et leur remise en chantier, elles
acquirent un relief sans prcdent, qui claire jusqu' leur formulation
antrieure. Au crdit de cet ouvrage, il faut donc mettre un tableau la fois
gntique, textuel, gnrique et fonctionnel de la "figuration" auctoriale. On sait
prsent pourquoi l'auteur est manifeste dans ce type de texte ; comment il y
apparat pour quels effets ; et avec quel statut pour son texte.
293
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Les ouvrages postrieurs de Barthes apporteront peu de choses
nouvelles ces descriptions. Pour l'essentiel, Barthes a tout dit, en 1973, sur
cette pratique qui n'avait pas encore de nom et que peu de ses contemporains
avaient perue.
Pour mmoire, on signalera toutefois deux autres dveloppements qui
intressent ce qu'il dsigne par le terme de "figuration".
Dans Fragments d'un discours amoureux, publi en 1977, un des
"fragments" est consacr au caractre inexprimable de l'amour. Au passage,
Barthes affirme "Je ne puis mcrire. Quel est ce moi qui s'crirait ? ( ... On ne
peut crire sans faire le deuil de sa 'sincrit'." (1977, pp. 114-115). A travers la
dnonciation de l'illusion d'expressivit qui habite l'criture amoureuse, cest
donc tout le problme de la reprsentation de soi qu'aborde Barthes. Son
jugement est svre : il n'y a pas d'criture qui travaillerait au plus pris de soi.
Et toute une argumentation psychanalytique vient tayer cette affirmation. Ce
fragment fournit donc un complment utile la critique de l'criture
autobiographique qui sous-tend sa valorisation de la "figure romanesque" de
l'auteur. Sans remettre en cause la tradition autobiographique, on peut en effet
reconnatre que Barthes formule l un dsaveu qui reflte un tat d'esprit
presque gnral. Quel est l'crivain qui se lancerait aujourd'hui dans une
entreprise comparable celle de Rousseau dans Les Confessions ? Nous
sommes dans un temps o le registre intime est, de toutes parts, contest,
ddaign, relgu ou contamin par la fictionalit. Et ce n'est sans doute pas
une concidence si c'est dans ce mme temps qu'une pratique originale de
l'criture de soi, l'autofiction, a merg et acquis un statut littraire.
Qu'est-ce qui permet la fiction de soi d'chapper l'illusion
d'expressivit et ses travers textuels ? Tout simplement parce qu'elle
manifeste l'auteur sous la forme d'un "pluriel de charmes" et non sous celle
dune personnalit. Cette formule de Barthes, et toutes les notations qui s'y rap-
portent, mritent peut-tre une explication. Partons de lcriture
autobiographique. Chacun sait que l'crivain est alors sous le contrle d'un
idal de fidlit et d'exactitude qui fait que le rcit gravite autour de sa
biographie et de sa personne, avec les effets que l'on sait (hrosation
invitable, mise en destin, centralisation du sens etc.). Mme si l'crivain
s'accorde la licence des "biographies romanesques". s'il renonce l'idal
d'objectivit, les dimensions existentielle et subjective demeurent et exercent
294
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
toujours leur attraction sur le rcit. A dfaut de "reprsentation de soi", le
rsultat est maintenant une "projection de soi", une confession plus ou moins
retouche, mais le texte est toujours subordonn une extriorit, l'unit
imaginaire que toute personne se fabrique, parfois difficilement, pour vivre.
Dans l'autofiction, par contre, il s'agit d'emble d'un simulacre, d'une
invention. L'crivain labore une histoire fictive o il joue un rle, sans chercher
avant tout une mythique prsence soi. Si l'histoire qu'il imagine a invi-
tablement partie lie avec lui-mme - comment pourrait-il en tre autrement ? -,
cette articulation n'est pas du tout comparable au rapport de dpendance et de
subordination qui enchane une autobiographie une existence. Comme le dit
trs justement Barthes, il s'agit d'une connexion, pas d'une filiation. Dans le
cours de son travail, l'auteur fera certes appel, plus ou moins consciemment,
son vcu, des personnes rencontres, des lieux visits, des vnements
suivis de pris, des motions ressenties, des comportements effectus, une
culture personnelle etc. Seulement, tout ce matriel biographique n'aura pas le
mme vecteur qu'il a dans l'autobiographie. Il ne pourra que se distribuer en
fonction de la logique propre du rcit, selon les situations et les relations entre
les personnages, comme dans une fiction ordinaire. La Vie n'est plus la fois
une source et un rgulateur du rcit. Toute une srie d'obstacles interdisent
cette mainmise. Si l'auteur est prsent dans son texte, ce n'est plus que sous la
forme d'"clats", qui pourront tre aussi bien un lment du dcor, une bribe de
dialogue, un geste ou un sentiment venus habiter un personnage. Car mme
son double, son reprsentant, le personnage qui porte son nom, bref sa figure,
ne dispose d'aucun privilge : c'est seulement un ple relationnel dans l'histoire.
Naturellement, cette description est d'ordre logique, elle ne prtend pas
restituer le tortueux chemin que suit un crivain pour produire une autofiction.
Mais elle semble rendre compte sa manire de ce qui fait la spcificit du
dispositif de fictionnalisation quand il remplit une fonction figurative, de la
situation d'une autofiction au sens troit du terme. Pour s'en assurer, luvre de
Cendrars est un exemple prcieux. C'est qu'elle renferme la fois de vritables
autofictions - Moganni Nameh, LEubage et Moravagine - et des ouvrages o
Cendrars fabule, c'est certain, mais o sa "figure" n'est pas romanesque, tout
au plus mythique : L'Homme foudroy. La Main coupe, Bourlinguer, Le
Lotissement du Ciel. Cendrars est certes, dans ces textes, aurol de toutes les
295
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
gloires et sa vie y apparat comme un geste enchant. Mais ce n'est pas un
"retour amical de l'auteur", le "pluriel de charmes" manque.
Pourquoi ? Assurment parce que Cendrars construit ces textes de la
maturit autour et partir de sa biographie, mme s'il l'arrange, la dcoupe, la
redistribue, la corrige ou la magnifie, afin d'en procurer une version hroque,
de se dresser une "mythobiographie" comme l'a dmontr Claude Leroy. Dans
la ttralogie, il part de son vcu pour donner libre cours son talent de conteur
et s'inventer des histoires qui feignent de se plier aux conventions
autobiographiques, afin sans doute de capter la crdulit du lecteur au bnfice
de la lecture, tout en affichant quantit d'indices qui dnoncent la part de
fictionalit. Au contraire, dans un texte comme Moravagine, Cendrars
commence par la fabulation, son got pour les histoires sert de point de dpart,
quitte ensuite chercher une traverse ramenant au rel et l'exprience vcue,
comme il le fait en se mettant en scne Chartres, dans un emploi de
mcanicien-aviateur, qu'il aurait pu connatre dfaut de l'avoir rellement
vcu. Apparemment, la distance est mince entre ces deux dmarches :
l'invention est toujours l'expression du possible, la substitution d'une hypothse
vraisemblable un tat de choses vrifiable. En ralit, la diffrence est
norme car l'invention pouse deux orientations opposes par rapport au sujet
de l'criture : dans les autofictions, elle est fondatrice ; dans les pisodes de la
vie lgendaire, sa fonction est dcorative, mme si son dploiement peut
prendre des proportions considrables.
En rsum, ce qui mtamorphose l'crivain d'autofiction en "pluriel de
charmes". en sujet "pris dans le pluriel de son texte", cest donc un programme
d'criture qui a sa logique propre, une logique plus performative que constative,
o la fabulation est logiquement premire et interdit toute totalisation - comme
dans "L'Aleph", o les inflexions intimes glisses par Borges, que le lecteur a le
loisir de rver rfrentielles ou de juger mystificatrices, chouent constituer
une esquisse autobiographique.
Aprs ce dtour ncessaire, il faut retenir une dernire vocation de
Barthes, formule dans sa Leon, 'prononce en 1977 et publie en 1978, qui
permet de replacer la "figuration" dans la totalit de la littrature, de la
comprendre comme un enjeu qui est au cur de son criture. En explorant les
"forces de libert" propres la littrature, Barthes en retient trois, dont la
dernire est son pouvoir smiotique, sa capacit se jouer des signes.
296
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Kierkegaard et Nietzsche lui apparaissent comme deux figures emblmatiques
de cette "mthode de jeu" :
" L'un et l'autre ont crit ; mais ce fut, pour l'un et
l'autre, au revers mme de l'identit, dans le jeu, dans le
risque perdu du nom propre : l'un par un recours
incessant la pseudonymie, l'autre en se portant, la fin
de sa vie d'criture, comme la montr Klossovski, aux
limites de l'histrionisme. On peut dire que la troisime
force de la littrature, sa force proprement smiotique,
c'est de jouer les signes plutt que de les dtruire, c'est
de les mettre dans une machinerie de langage, dont les
crans d'arrt et les verrous de sret ont saut, bref c'est
instituer, au sein mme de la langue servile, une vritable
htronymie des choses" (1978, pp. 27-28).
Certes, les cas de Nietzsche et de Kierkegaard n'ont qu'un rapport
lointain avec la "figuration" auctoriale. Le caractre analytique de leurs textes,
plus philosophiques que littraires, et la nature priphrique de leurs
apparitions textuelles, les cartent apparemment de notre sujet. Pourtant, on a
eu l'occasion de parler de Kierkegaard, avec In Vinos Veritas, et de voir que ce
rcit constituait un cas-limite de ddoublement fictionnel. Quant Nietzsche,
son acharnement transformer son nom, la fin de sa vie, l'amne
fictionnaliser sa signature et son rle d'auteur ; dmarche o se croisent la
dralisation de soi et la construction d'auteurs supposs. Jacques Derrida a
rsum cette aventure peu commune, en mettant en relief tout ce qu'elle a de
contigu au projet de "figuration" d'un crivain :
"Mettre en jeu son nom (avec tout ce qui s'y engage et
qui ne se rsume pas un moi), mettre en scne des
signatures, faire de tout ce qu'on a crit de la vie du de la
mort un immense paraphe biographique, voil ce qu'il
aurait fait et dont nous devons prendre acte" (1984, p. 43).
Kierkegaard et Nietzsche peuvent donc tre dfinis comme deux
penseurs qui ont utilis les ressources de la "figuration" dans leur exploration
rflexive, qui ont risqu leur crdibilit pour trouver, inventer du Nouveau. Leur
"mobilisation'' montre que, pour Barthes, l'aventure figurative s'inscrit sur
l'horizon d'un usage ludique des moyens discursifs, d'un carnaval de signes,
d'un festin smiotique qui est constitutif la littrature. Parti dune critique de
l'image traditionnelle de l'auteur, Barthes dcouvrit donc une modalit d'non-
297
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ciation inconnue et acheva sa traverse en replaant sa dcouverte au cur
des forces vives de la littrature.
On excusera cette petite anthologie barthsienne. Si on a cit aussi
longuement ses ouvrages, c'est que sa dcouverte de la "figuration" est peu
connue ; que sa pense tire sa fcondit moins des catgories qu'elle met en
place que de son mouvement et de son nonciation. Que retenir du voyage ?
Quelques propositions qui figeront sans doute sa pense, mais qui permettront
de forcer le mystre des effets de l'autofiction. Le tableau de Barthes permet,
en effet, de distinguer trois effets de l'autofiction, trois forces produites par le
dispositif dans son usage figuratif. Aucun de ces effets n'est vritablement
propre cette pratique, mais son originalit est de les articuler en faisceau, de
les produire ensemble et presque simultanment, dans une sorte de rotation
trs rapide : "une dialectique du dsir" entre l'auteur et le lecteur, lie une
espce de conflagration fictionnelle, entranant un change figural. Ces trois
effets se soutiennent mutuellement, mme s'ils ont chacun leur spcificit.
Comme la description de Barthes est souvent allusive, on ne craindra pas de
l'expliciter par des instruments emprunts ailleurs, de nature assez diffrente,
dans un "clectisme de mthode" pour parler comme Bachelard.
"Lauteur qui va dans notre vie"
"Le texte () me dsire" (1973, p. 45), dclare Barthes. Affirmation
nave ? Innocente plutt, et que ne dsapprouverait pas un crivain comme
Alfredo Bryce-Echenique, qui dpose sur le seuil de La Vie exagre de Martin
Romana cette ddicace :
"A Sylvie Lafaye de Micheaux, bien sr, parce que
c'est pour tre aim davantage que l'on crit".
On notera la tonalit impersonnelle de cette dclaration, qui dpasse sa
ddicataire, pour viser l'ensemble des lecteurs. Et cela pour un texte qui inscrit
son auteur dans la fiction d'un roman pseudo-autobiographique ; o
Bryce-Echanique est l'un des personnages secondaires, escortant la qute litt-
raire, existentielle et affective du hros Martin Romna - comme si c'tait ce
besoin d'amour qui avait propuls l'crivain au milieu de sa cration, le
poussant se renoncer pour se retrouver sous le visage d'une pure
individuation.
298
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Aprs tous les discours nafs et errons tenus dans le pass sur la
relation auteur-lecteur, on peut hsiter accepter la prise en compte d'un tel
rapport dans la lecture. Quantit d'lments interdisent mme de penser cette
relation et d'envisager son propos une "dialectique du dsir", comme le fait
Barthes. Un livre n'est pas une personne, ne peut mme se concevoir comme
l'expression dune parole ; le lecteur n'a pas d'auteur en face de lui. Quant
l'auteur, il lui est impossible de connatre tous ses lecteurs, d'anticiper sur leurs
ractions ; par dfinition un texte est toujours ce que dit Celan du pome : un
message dans une bouteille jete la mer. Il n'est donc pas srieux d'assimiler
la lecture une conversation entre honntes gens, pas davantage une
relation amoureuse. La littrature tant une situation de communication la fois
diffre, crite et volutive, le modle de la communication orale et immdiate
n'est d'aucun secours pour la comprendre.
Ces restrictions faites, comment ignorer qu'on crit pour tre lu, qu'on
dsire toujours un lecteur ? Comment ngliger le fait que le lecteur a affaire
une nonciation singulire et que toute lecture met en marche une
pragmatique, autant qu'une smantique ? Mme si l'auteur ignore son lecteur, il
est son horizon ; et la manire dont il dsire cette relation ne peut pas ne pas
s'inscrire dans son uvre ; il faut bien que ce dsir s'inscrive comme une sorte
de programme dont le lecteur fera usage selon son propre dsir et sa
comptence. Sans doute, la notion de lecteur utilise par Barthes est-elle un
peu rustique. C'est videmment une position discursive, elle ne dsigne pas
une personne relle. Mais elle manque de la complexit qui lui permettrait de
rendre compte des directions multiples, en fonction de stratgies varies, dans
lesquelles s'engage un crivain pour modeler la place du destinataire. Elle
mriterait peut-tre dtre enrichie par la distinction que fait Mikhail Bakhtine
entre les lecteurs "seconds" et un lecteur "tiers". sorte didal de lecture, qui
occupent la plage rceptrice (Todorov, 1981, pp. 170-171). Pour l'essentiel,
pourtant, elle permet de dcrire l'autofiction comme une rponse originale au
dsir de l'autre qui irrigue l'criture et la lecture. Pour l'auteur, elle est l'occasion
de donner une figure de soi sans quivalent dans la ralit, de venir au texte et
au lecteur en toute libert, sans les contraintes et les impasses de l'criture
rfrentielle de soi.
En retour, ce dsir rencontre celui du lecteur, la recherche d'un "sujet
aimer" comme dit Barthes. Sans doute, ce nouveau dsir est-il lui aussi
299
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
multiforme ; sans doute aussi, s'incarne-t-il diffremment selon les pratiques,
voire selon les types de discours. Mais peu importe, il suffit de vrifier son
existence et de mesurer sa force, selon ses points d'application.
Insistons d'abord sur la ralit de ce dsir d'auteur, ce qui permettra de
spcifier celui ralis par l'autofiction. Dans une tude sur "L'image de l'auteur
dans les mdias", Ph. Lejeune a apport quelques lments permettant
d'tayer son existence. Il note, ainsi, que les mdias ne font pas que produire
une image de l'auteur ; en mettant au premier plan la personne physique,
psychologique et sociale de l'crivain, en rabattant son uvre sur son
individualit, elles rpondent des attentes du grand public et des attitudes
d'auteur :
" L'auteur apparat comme la 'rponse' la question
que pose son texte ...) on est souvent encourag ragir
ainsi par l'auteur lui-mme, qui tend plus ou moins se
reprsenter dans son uvre, ou donne penser qu'il s'y
est reprsent" (1986, p. 87).
Et il ajoute que cette "illusion biographique" est sans doute invitable :
l'analyse que j'ai faite de cette image ne montre-t-elle
pas aussi que la focalisation sur l'auteur et l'illusion de
transparence sont, pour diffrentes raisons, ncessaires ?
Et qu'il serait naf de penser pouvoir les dissoudre sans
dissoudre en mme temps la littrature - et la socit ?"
(1986, p. 97).
A travers des reprsentations convenues, romantique ou acadmique,
les mdias satisfont donc, en la canalisant, une relle demande, une attitude de
lecture A l'existence de l'auteur est un besoin irrpressible. Lejeune exclut
toutefois de ce constat une "fraction de l'appareil scolaire et universitaire", sous
prtexte que ce public refuse cette image traditionnelle.
Sans doute. Mais ne confond-il pas alors la rponse des mdias et
l'attente qui l'a permise ? Il semble oublier que mme le public "cultiv", plus
scolaris en tout cas, qui se refuse aux complaisances du grand public, fait lui
aussi une grande consommation d'images auctoriales. Tout un secteur de
l'dition n'existe aujourd'hui que par et pour ce public : le domaine de la
littrature intime et mme celui de la littrature critique. Carnets personnels,
correspondances, journaux intimes, autobiographies, livres d'entretien,
biographies, monographies, recueil de documents iconographiques sont
300
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dvors par ce public difficile, qui par ailleurs ne manque pas une occasion de
marquer sa diffrence. Il est tout de mme curieux de constater que c'est dans
ce milieu litiste que circulent le plus d'anecdotes ou de bons mots consacrs
aux auteurs. Ainsi, mme dans ce public o "la mort de l'auteur" est un lieu
commun, o les navets du grand public n'ont pas cours, il y a un besoin de
l'auteur, comme un tropisme de l'crivain.
Avec jean-Claude Bonnet, il faut par consquent se rsoudre cette
vrit plus gnrale :
" il est vain de prtendre en finir un jour avec le
thme biographique et lauteur. Non qu'ils soient de retour
aprs plusieurs annes de mise l'index, mais parce
qu'ils n'ont jamais cess d'tre l sous d'autres formes et
travers des interrogations nouvelles. Il apparat
aujourd'hui que l'auteur est produit la fois par luvre et
les multiples discours qui accompagnent celle-ci" (1985,
p. 260).
Qu'opre le lecteur lors de sa lecture, aussi familier qu'il soit de Blanchot,
de la narratologie et de tous les discours qui dfont la conception qu'a de
l'auteur le sens commun ? Il construit peu ou prou une image de l'auteur, quitte
la modifier pour chacune de ses uvres, si cela se rvle ncessaire. La
notion d'auteur implicite popularise par W.C. Booth, dont la cohrence
thorique est trs discutable, comme l'a montr Genette, ne dcoule-t-elle pas,
elle aussi, de ce dsir dauteur ? C'est bien une notion fantme inconsistante,
qui a bien du mal se trouver une place entre l'auteur rel et le narrateur.
Pourtant, elle sduit immdiatement et sa force de conviction est considrable.
Qui ne s'est pas laiss prendre par elle, un moment ou un autre ? Tous ces
faits montrent par consquent la rsistance de ce besoin d'auteur et la varit
de ses formes d'actualisation. L'autobiographie et plus gnralement la
littrature intime y rpondent leur faon. Avec l'autofiction, le lecteur trouve
une autre rponse ce dsir aussi vaste que plastique.
L'efficace de l'autofiction, son charme et son secret c'est d'abord de
rpondre au dsir du lecteur en ne lui procurant rien de plus que l'animation
fictionnelle d'un nom propre, la seule marque indfectible, immortelle, d'un
individu historique. Le lecteur n'est pas alors fascin, ni mme intress, par
une personne relle, dont les dterminations et la trajectoire sont vrifiables ; il
n'est pas plong dans le parcours dune vie, ni dans le portrait d'une
subjectivit. Mais ce n'est pas plus cette ombre porte, cette esquive
301
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
permanente, cette dception infinie de l'auteur que fournissent les meilleures
fictions. L'auteur n'est plus un esprit, pas davantage un malin gnie, seulement
une "hcceit" complice. C'est un sujet d'nonciation pris dans un rapport avec
sa fiction qui n'est ni de proximit, ni dloignement, mais de "sympathie", de
"conspiration", au sens o Hypocrate disait que "tout conspire". Gombrowicz
marchant dans la poussire d'une campagne polonaise occupe, dans La
pornographie alors que l'auteur rel tait en Argentine voil pour le lecteur un
sujet historique comme dsoss, dsitu, dsenclav ; ce qui passe entre les
lignes, c'est une voix asynchrone, inassignable, improbable, dont la source
n'est pas localisable, bien qu'elle soit identifiable. C'est ce dcalage entre
l'existence relle de ce sujet et son origine impossible qui fait une grande partie
de la sduction de l'autofiction. Ce flottement dans la position d'un existant,
l'illusion de son indtermination, comme si un tant pouvait possder la
plasticit des choses rves, c'est le plaisir dune pure mobilit, quelque chose
qui passe entre les lignes et la vie.
Une explosion de la fiction
Ce qui permet cette prsence incomparable de l'auteur dans l'autofiction,
c'est bien sr sa nature fictionnelle. Do un autre effet, dont le point
dapplication est cette fois l'uvre, troitement li au prcdent.
crire une autofiction, c'est rentrer dans le tableau comme disait en
substance Barthes, en citant Loti. En devenant un personnage fictif, l'crivain
s'introduit dans un espace qui lui est ordinairement interdit, qui n'merge et ne
se conserve d'habitude que par son absence. Cette rupture des conventions qui
rgissent la fiction, Grard Genette a propos de la dsigner par le terme de
"mtalepse" Un rappel de cette figure va permettre d'clairer l'effet qu'avait en
vue Barthes.
Dans la rhtorique classique, la mtalepse est une "figure de pense"
qui comprend, entre autres, le procd par lequel un pote, un crivain, est
reprsent ou se reprsente comme produisant lui-mme ce qu'il ne fait au fond
que raconter ou dcrire". pour reprendre la dfinition de Fontanier (Ed. G.
Genette, pp. 128-129). Cette "figure d'expression" a ainsi la caractristique
essentielle de franchir allgrement la frontire qui spare la reprsentation et la
302
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
ralit, de combler l'cart qui fonde par convention la possibilit de crer des
ralits imaginaires. C'est en enrichissant cette figure de discours que Genette
en a fait une catgorie narratologique importante, une catgorie dsignant tous
les transits invraisemblables de la narration :
"Cortazar raconte quelque part l'histoire d'un homme
assassin par l'un des personnages du roman qu'il est en
train de lire : c'est l une forme inverse (et extrme) de la
figure narrative que les classiques appelaient la
mtalepse de l'auteur () Sterne poussait la chose
jusqu' solliciter l'intervention du lecteur, pri de fermer la
porte ou d'aider Mr. Shandy regagner son lit, mais le
principe est le mme : toute intrusion du narrateur ou du
narrataire extradigtique dans l'univers digtique (ou de
personnages digtiques dans un univers mtadigtique
etc.), ou inversement, comme chez Cortazar, produit un
effet de bizarrerie ().
Nous tendrons toutes ces transgressions le terme
de mtalepse narrative. Certaines, aussi banales et
innocentes que celles de la rhtorique classique, jouent
sur la double temporalit de l'histoire et de la narration ;
ainsi Balzac, dans un passage dj cit d'Illusions
perdues : 'Pendant que le vnrable ecclsiastique monte
les rampes d'Angoulme, il n'est pas inutile d'expliquer...,
comme si la narration tait contemporaine de l'histoire et
devait meubler ses temps morts.
On sait que les jeux temporels de Sterne sont un peu
plus hardis, c'est--dire un peu plus littraux , comme
lorsque les digressions de Tristram narrateur
(extradigtique) obligent son pre (dans la digse)
prolonger sa sieste de plus d'une heure, mais ici encore le
principe est le mme. D'une certaine faon, le
pirandellisme de Six personnages en qute d'auteur ou
de Ce soir on improvise, o les mmes acteurs sont tour
tour hros et comdiens, n'est qu'une vaste expansion
de la mtalepse, comme tout ce qui en drive dans le
thtre de Genet par exemple, et comme les
changements d'e niveau du rcit robbe-grilletien :
personnages chapps d'un tableau, d'un livre, d'une
coupure de presse, dune photographie, d'un rve, d'un
souvenir, d'un fantasme etc. Tous ces jeux manifestent
par l'intensit de leurs effets l'importance de la limite qu'ils
s'ingnient franchir au mpris de la vraisemblance, et
qui est prcisment la narration (ou la reprsentation)
elle-mme ; frontire mouvante mais sacre entre deux
mondes : celui que l'on raconte, celui que l'on raconte"
(1972, pp. 244-245).
303
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Comme on le voit, le champ d'extension de la mtalepse est trs vaste et
toutes les mtalepses ne correspondent pas un agencement autofictif. Les
exemples de Cortazar, de Sterne, de Balzac, du thtre de Genet, de
Robbe-Grillet, cits par Genette, le montrent. Dans tous ces cas, l'auteur n'est
pas impliqu nominalement dans le tournoiement des plans de son texte. Seule
la comdie de Pirandello manifeste cette implication, mais de faon accessoire
comme on la vu. Si tout dispositif autofictif produit peu ou prou une mtalepse,
l'inverse n'est donc pas vrai. Un roman savoureux comme Le Vol dIcare de
Queneau a beau tre labor entirement sur le principe de la mtalepse, il ne
prsente aucune fictionnalisation auctoriale. Ce roman met bien en scne un
crivain (Hubert), dort les personnages d'une uvre en cours de rdaction se
sont chapps dans la "ralit". Il y a donc bien confusion de niveaux narratifs.
Mais cette confusion reste interne l'histoire narre, elle ne fait pas intervenir
l'auteur rel : Hubert n'est pas Queneau ; cet crivain suppos n'est pas un
personnage auctorial au sens que nous avons donn cette expression. Dans
Le Vol d'Icare, la diffrence de Les Enfants du Limon, Queneau n'apparat
pas dans son texte et la mtalepse n'est que digtique. On ne confondra donc
pas mtalepse et fictionnalisation de soi : la mtalepse digtique est
totalement indpendante du dispositif de l'autofiction.
Pour que la mtalepse et l'autofiction se confondent, il est ainsi
ncessaire que la premire ait pour appui, soit l'auteur, soit le narrateur.
Statistiquement, la mtalepse d'auteur est la plus rpandue, sans doute
cause de sa simplicit l'crivain feint d'avoir vcu ce qu'il ne fait que raconter et
le paradoxe s'achve l. Dans la mtalepse de narrateur, il faut que le narrateur
s'approprie, par un substitut livresque par exemple, l'identit de son crateur : le
narrateur feint alors de raconter ce qu'il ne fait que vivre (fictivement). De plus,
la mtalepse de narrateur entrane presque mcaniquement une construction
rflexive, ce qui complique passablement le paradoxe. Soit, en effet, le livre
s'enchsse lui-mme, comme on l'a vu avec Gide, et l'on dispose alors d'une
mise en abyme du livre. Soit, le livre enchsse luvre antrieure de son au-
teur, en partie ou en totalit, comme s'y est attach J.D. Salinger, et l'on a alors
une mise en abyme de l'crivain gnralise
Comme on a pass sous silence cette dernire forme de rflexion, il
n'est pas inutile d'en dire un mot. Dans Seymour, une introduction de Salinger,
le narrateur, Buddy Glass, sadjuge l'essentiel de l'uvre de son crateur. Se
304
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
prsentant comme le frre de Seymour Glass, il s'affirme l'auteur de L'Attrape-
coeurs et des deux Short Stories o apparaissait le personnage de Seymour.
Par un mouvement dj observ chez Gide, mais ici plus radical parce que plus
tendu, Salinger invagine donc sa propre uvre antrieure pour l'orienter dans
le sens d'une chronique des Glass. Rsultat de ce retournement : Salinger
s'vanouit dans son uvre. Cette disparition n'est que fictive, mais elle a ceci
de remarquable qu'elle semble avoir eu des retombes dans la vie de lcrivain
Comme on sait, il y a un mystre Salinger. Depuis plus de vingt ans, il n'a
jamais publi une ligne, aprs avoir annonc la suite du cycle Glass, et depuis
plus longtemps encore, il se refuse toute dclaration, tout entretien, toute
apparition publique. Ce mutisme social et littraire, il l'a conduit si loin
qu'aujourd'hui il est moins rel que ses personnages, moins crdible que sa fic-
tion. Et pourtant, on raconte qu'il crit seize heures par jour dans sa retraite de
Cornish, dans le New Hampshire. Cette mise en scne relle d'une disparition a
quelque chose du Portrait de Doran Gray. A propos de sa fresque sur les
Glass, il dclarait :
"Chose trange, les joies et les satisfactions que
m'apporte mon travail sur la famille Glass augmentent et
s'approfondissent singulirement avec les annes.
Cependant, je ne saurais proposer cela d'explication
raisonne. Aucune, en tous cas, hors du cercle enchant
de ma propre fiction".
On peut se demander si Salinger, grand lecteur de Kierkegaard et de
Kafka, n'a pas voulu prcisment que le "cercle enchant" de sa fiction ne se
referme sur lui, au sens propre. Ce serait alors un bel et rare exemple de
situation o la vie se calque sur luvre, o la lgende sert avrer l'uvre,
plutt que l'inverse comme c'est si souvent le cas.
Pour que la figure de la mtalepse chevauche un dispositif de
fictionnalisation de soi, il est donc requis que l'crivain soit intgr, d'une faon
ou d'une autre, dans la confusion des plans de narration. Qu'est-ce qui
distingue ces mtalepses o l'crivain est en jeu, au niveau du rsultat produit ?
Essentiellement, la radicalit du vacillement introduit. Quand la mtalepse ne
met en cause que les personnages ou le narrataire, lorsqu'elle demeure
inclave dans les bornes d'une histoire, ses effets sont plaisants ou
fantastiques, mais ils restent de bonne compagnie. Si elle prte rire ou
sourire, si elle tonne, elle ne trouble pas notre exprience de la ralit. Aprs
tout, le lecteur a alors affaire une fiction, il a pass un "pacte imaginaire" avec
305
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
l'auteur, il a accept de dcouvrir un univers qui a sa logique propre, diffrente
de celle qui gouverne le quotidien. Par contre, quand la mtalepse recouvre des
existants, des phnomnes dont l'existence est atteste, elle drange notre
sentiment du monde et notre pratique de la reprsentation, qui permet de le
symboliser, c'est--dire de vivre, comme dit quelque part Barthes.
Bien que les mtalepses d'auteur et de narrateur fonctionnent selon deux
mouvements inverses, on l'a signal, elles produisent le mme effet
profondment drastique. Dans la premire, la reprsentation prtend repousser
la ralit dans la seconde, la reprsentation feint de s'amalgamer la ralit.
Mais le rsultat est le mme. C'est le monde qui est touch et la dnivellation
qui fonde l'ordre du discours en gnral, et la fiction en particulier. Pour notre
perception commune, l'crivain de fiction, selon la belle formule de Sony Labou
Tansi, ajoute du monde au monde. Il invente des histoires, labore des rcits,
qui sont des constructions imaginaires. Ces reprsentations, fixes dans
l'criture, viennent agrandir, compliquer, enrichir notre existence, le monde que
nous habitons. Or, avec ces mtalepses, luvre de l'crivain prtend plus
radicalement s'approprier le monde., en l'assimilant ou en l'encerclant.
Consquence : le monde disparat, s'vapore ou s'vanouit dans la fiction : il n'y
a plus de ralit, rien que de l'imaginaire, des rcits l'infini, une mer de signes.
Avec cette coalescence du dedans et du dehors, de l'intrieur et de l'extrieur
du livre, les lignes de partage du rel et du fictif sont changes de telle sorte
qu'elles finissent par se confondre dans une dimension implexe.
Cette brche dans la stabilit de nos repres et de nos habitudes les
plus ncessaires a quelque chose de vertigineux. Difficile aprs cette
perturbation de ne pas prendre conscience des catgories et des principes sur
lesquels reposent notre insertion dans le monde et notre comptence la
symbolisation. Cette capacit de bouleversement explique la faveur dont jouit la
fictionnalisation de soi chez des auteurs dont la production n'est pas seulement
ou pas du tout littraire. Les dplacements et les branlements qu'elle provoque
dans le discours de la fiction constituent un instrument formidable pour
s'attaquer aux ides reues sur l'esprit, le monde et la transcendance. Do le
recours de penseurs comme Dante, Diderot, Nietzsche ou Kierkegaard au
dispositif, ralis en totalit ou marginalement. pour dstabiliser le discours
philosophique, la tranquille certitude qui habite la division des discours et le
cloisonnement des registres d'criture. Ce dchirement du champ pragmatique
306
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
libre la pense de prsences obsessionnelles qui l'entravaient, est promesse
de nouvelles aventures mentales, de dcouvertes improbables.
Au sein de la littrature, luvres se trouve aussi libre de dispositifs
parfois coercitifs, de conventions pesantes quand elles ne sont pas matrises.
Ce sont la fois son sens, sa "fonction auteur" et sa vraisemblance qui se
retrouvent soudain dnaturaliss. Le sens de luvre devient un procs sans
fin, une signification inpuisable puisque luvre n'a plus d'extriorit. L'auteur
bascule dans l'irrel, ce qui enlve sa fonction toute autorit, tout privilge et
donne au lecteur la possibilit d'un nouveau rapport avec lui. Luvre se
retrouve soudain causa sui, sans justification, purement arbitraire, situation
scandaleuse qui ne peut que dcupler sa force d'interpellation. Bien sr, ces
dplacements ont t dj nots propos de types de mise en abyme sans
rapport avec l'autofiction. Mais ici l'effet mtaleptique s'intgre dans un faisceau
d'effets, dont le retour amical de l'auteur". Cette articulation modifie son pouvoir
en l'ouvrant sur l'auteur et le lecteur dune manire jusque-l inconnue.
"Le fictif de l'identit"
Le dernier effet sensible de la fonction figurative a son point d'application
chez le lecteur. En produisant un horizon fictionnel sans rivages, en
transformant la ralit en rcit, l'autofiction amne le lecteur s'prouver
comme fictif. Borges avait not cet effet de retour de la mtalepse dans "Magies
partielles du Quichotte"
"Pourquoi sommes-nous inquiets que la carte soit
incluse dans la carte et les mille et une nuits dans le livre
des Mille et une nuits ? Que Don Quichotte soit lecteur du
Quichotte et Hamlet spectateur d'HamIet ? Je crois en
avoir trouv la cause : de telles inversions suggrent que
si les personnages dune fiction peuvent tre lecteurs ou
spectateurs, nous, leurs lecteurs ou leurs spectateurs,
pouvons tre des personnages fictifs. En 1833, Carlyle a
not que l'histoire universelle est un livre sacr, infini, que
tous les hommes crivent et lisent et tchent de
comprendre, et o, aussi, on les crit" (Tr. fr. P. et S.
Benichou, pp. 85-86).
Mais dans le cas de l'autofiction, ce sentiment est plus qu'une inquitude
ou qu'une hypothse, le lecteur s'exprimente, se ralise comme fictif. Il y a
307
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
plus parce que l'auteur est lui-mme dj une fiction, individu mais
impersonnel. Sa situation irrelle permet au lecteur de connatre une situation
identique. Non pas sur le mode de l'identification, mais sur celui de la
sympathie. Par une rtroaction dialectique, le lecteur est soudain complice de
l'auteur, dans le mme entre-deux incertain, dans la mme position indcise.
Quoique irrelle, cette dtermination originale possde une causalit
relle, car elle dispose dun enracinement anthropologique beaucoup plus
profond qu'on ne pourrait le penser superficiellement. Elle ravive, en effet, chez
le lecteur, une invincible puissance de rver veill, qui appartient au plus
cach de chacun. En tous, existe et subsiste une sorte de murmure imaginaire,
de bruissement fictionnel, o l'on tient toujours le premier rle, et qui
accompagne en permanence l'existence humaine. Dans un article fameux, "La
cration littraire et le rve veill" (1908), Freud a, le premier semble-t-il,
signal l'importance pour la vie psychique de ces "ralisations illusoires de
souhaits ambitieux, orgueilleux ou rotiques". Il montre que le rve veill
drive directement du jeu enfantin, constitue la matire premire de luvre
littraire et l'origine du plaisir de la lecture. Poursuivant dans un autre domaine
sa rflexion, Ernest Bloch a consacr des pages uniques analyser les
caractres, la fonction et l'ampleur de ce qu'il appelle "les petits rves veills".
Relevant leur mconnaissance quasi-gnrale, il s'attache dans Le Principe
d'Esprance les dcrire depuis le premier ge de la vie et rappelle leur
importance symbolique et narcissique lors de leur panouissement
l'adolescence :
"Pour la premire fois, on pratique l'art de parler de ce
qu'on n'a pas encore vcu soi mme. Mme un tre
moyen se racontera des histoires, des contes faciles o
tout lui russit. Il brode ces fables sur le chemin de l'cole
ou en se promenant avec des amis, mais dans tous les
cas le narrateur trne au centre du rcit, y posant comme
sur une photographie" (Tr. F. Wuilmart, p. 37).
Par la suite, Bloch consacre au rve diurne une importante partie la
fois thorique, esthtique et historique afin de montrer qu'il est le fondement
anthropologique de la "conscience anticipante', de l'ouverture sur le nouveau,
d'un "potentiel optatif" qui nous pousse en avant, d'une fonction utopique" qui
serait constitutive de ltre humain. Le grand mrite de Bloch est de distinguer
nettement ce type de rve du rve nocturne, auquel Freud le rduisait un peu
vite. Cette dissociation lui permet de montrer la fcondit des rves veills,
308
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
malgr leur immaturit et leur gocentrisme. Plastiques, perfectibles, volutifs,
capables de se transformer structurellement et de se diversifier en des
reprsentations artistiques ou des mythes collectifs, ces rves diurnes seraient
ainsi un ferment de progrs pour l'individu et la collectivit.
Pourtant, c'est D.W. Winnicott que l'on doit les propositions les plus
clairantes sur ce phnomne psychique. Dans Jeu et ralit, l'espace
potentiel, un modle de recherche psychanalytique patiente et nuance, D.
Winnicott a restitu ces rves veills dans son lieu propre, dnomm "espace
potentiel" ou "espace transitionnel". Sa dcouverte est ne de l'observation
clinique des petits enfants passant de l'tat d'union l'tat de relation avec la
mre. Pour effectuer ce stade de maturation, le petit enfant se trouve un objet
ou un comportement qu'il adopte et transporte partout avec lui. Comme
l'analysa Winnicott dans un article de 1951 qui a fait date, le statut de ces
"phnomnes transitionnels" est particulirement curieux : pour lenfant, cet
objet choisi, la couverture des Peanuts de Schultz en est le meilleur exemple,
nappartient pas la ralit extrieure, sans tre pourtant une hallucination ; il
relve dun statut intermdiaire. Avec les annes, lobjet est dsinvesti, sans
tre oubli :
"Les phnomnes transitionnels deviennent diffus et se
rpandent dans la zone intermdiaire qui se situe entre la
ralit psychique interne et le monde externe tel quil est
peru par deux personnes en commun' ; autrement dit, ils
se rpandent dans le domaine tout entier () englobant
le jeu, la cration artistique et le got pour lart, le
sentiment religieux, le rve et aussi le ftichisme, le
mensonge et le vol, lorigine et la perte du sentiment
affectueux, la toxicomanie, le talisman des rituels
obsessionnels etc." (Tr. fr. CI. Monod et J.B. pp. 13-14).
En tudiant les phnomnes transitionnels, Winnicott a donc mis au jour
une "aire intermdiaire o voluerait tout l'enfant, cette "aire d'exprience" o
voluerait tout individu. Ne de la maturation et du jeu de lenfant, cette aire
dexprience est le lieu de lactivit culturelle au sens le plus large du terme et
reprsente un levier essentiel pour l'acquisition du principe de ralit :
"Nous supposons ici que lacceptation de la ralit est
une tche sans fin, et que nul tre humain ne parvient
se librer de la tension suscite par la mise en relation de
la ralit du dedans et de la ralit du dehors ; nous
supposons aussi que cette tension peut tre soulage par
l'existence dune aire intermdiaire d'exprience, qui n'est
309
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
pas conteste (arts, religion etc.). Cette aire intermdiaire
est en continuit directe avec l'aire de jeu du petit enfant
perdu dans son jeu" (p. 24).
Cette zone singulire d'exprience ne reproduit pas, par consquent, le
fond originaire de la personne. En prise directe avec le rel, sa nature n'est pas
d'ordre fantasmatique, elle ne rejoue pas indfiniment le mme texte dipien,
les mme formations perdues faites de dsirs, de frustrations, de phobies et
d'anxits enfantins. Il y a un monde entre les manifestations psychiques
appartenant cet espace potentiel et les "ralisations illusoires" presque
compulsives que Freud voyait dans le rve veill.
Pour rsumer le contenu de la notion d'espace potentiel, on empruntera
J.B. Pontalis une belle description, donne dans sa prface Jeu et ralit,
qui n'est pas sans faire penser la relation au lecteur tablie par l'autofiction :
"Pas de scne chez Winnicott o se rpterait
l'originaire, ni de combinatoire o les mmes lments
permuteraient dans le cercle, mais un terrain de jeu, aux
frontires mouvantes, qui fait notre ralit. Un bout de
ficelle, le rythme de sa propre respiration, un regard qui
vous donnent la certitude d'exister, une sance o l'on est
seul avec quelqu'un : peu de choses, moins que rien,
simplement ce qui m'arrive quand je puis l'accueillir. Alors
le trouv n'est plus le prcaire substitut du perdu,
l'informe n'est plus le signe du chaos l'esprit ne fonctionne
plus comme organe spar du corps" (pp. XIV-XV).
On aura compris la finalit de cette prsentation de Winnicott. Notre
hypothse est que l'autofiction vient se loger et agir, en chaque lecteur, au
cur de cette "aire intermdiaire". de ce potentiel entre-deux. Sans doute,
est-ce le destin de toute uvre littraire que de permettre tout lecteur de
constater ce chevauchement, de reconnatre ses propres phnomnes
subjectifs. Mais l'autofiction prsente ceci de particulier qu'elle reprend
explicitement, chaque fois diffremment, la structure mme de cet espace
potentiel, qui nest ni du dehors ni du dedans, et pourtant en relation avec la
ralit. Cette homologie structurale donne l'autofiction le moyen de faire de
l'espace potentiel l'enjeu de la lecture, et pas seulement sa condition. C'est ce
qui conduit le lecteur se reconnatre comme sujet fictif, dlocalis, dans ce
type de textes. Dans la fiction, le lecteur trouve une satisfaction identificatoire :
celle-ci lui permet de goter et de vivre des histoires, d'une manire trs
complexe, mais qui reste cantonne l'nonc du texte. Dans l'autofiction, le
310
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
lecteur se trouve pris dans une identification qui implique le sujet de
lnonciation, l'auteur lui-mme. Autrement dit, il s'agit d'un phnomne o le
lecteur ne se limite pas s'prouver autre comme dans la fiction ; il
s'exprimente en train de devenir autre, dans l'autofiction.
On peut illustrer ce phnomne par une anecdote de Goethe, qui en
donne un exemple remarquable, dans Posie et Vrit. Enfant, Goethe faisait
du thtre avec une petite troupe de camarades de son ge ; et il assurait son
pouvoir sur eux en les envotant par des rcits - mais pas n'importe quel type
de rcit :
"J'tais capables de les rendre heureux () en leur
contant des histoires. Ils aimaient surtout m'entendre
parler la premire personne. Ils prouvaient une grande
Joie de penser qu'il pt mtre arriv, moi, leur
compagnon de jeux, des choses si tranges, et ils ne se
demandaient point, avec dfiance, comment j'avais pu
trouver temps et lieu pour de pareilles aventures, alors
qu'ils savaient bien quelles taient mes occupations, et o
j'allais et venais. Or ces vnements avaient besoin pour
thtre, sinon d'un autre monde, du moins d'un autre
pays, et tout s'tait pass la veille ou le jour mme. Il
fallait donc qu'ils se trompassent eux-mmes plus que je
ne pouvais les abuser. Et si, peu peu, suivant mon
naturel, je n'avais appris donner ces fantaisies et ces
gasconnades, la forme d'un rcit artistique, ces dbuts de
hbleur ne seraient certainement pas rests pour moi
sans consquences fcheuses" (Tr. fr. P. du pp. 38-39).
Dans le contexte de l'enfance, ce passage traduit bien le plaisir procur
par des histoires la fois impossibles et pourtant indexes un individu rel.
Comme le note pertinemment Goethe, ses compagnons avaient une demande
paradoxale : ils voulaient la fois du fabuleux et un engagement personnel du
contenu. Pourtant, le contexte fictionnel tait patent, aucune ambigut ne
permettait de percevoir ces rcits comme srieux. Goethe ne s'attarde pas sur
le sentiment de son auditoire. En homme des Lumires, il est plus proccup
de la place d'auteur qu'il occupait, dj. Est-il, pourtant, si difficile de
comprendre l'euphorie de ses camarades ? N'est-ce pas parce que cette si-
tuation pragmatique leur permettait d'changer leur position de narrataires
contre celle du conteur ? N'est-ce pas parce qu'ils pouvaient s'identifier, tous
enfants qu'ils taient, ce narrateur qui se fictionnalisait dans des aventures
merveilleuses ? Avec la littrature de l'enfance, on ne leur offrait que des
identifications d'nonc ; ils pouvaient se voir en personnage, goter l'altrit.
311
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Mais avec les rcits de leur camarade Wilhem Goethe, ils avaient la possibilit
d'une altrit plus exaltante : celle de se sentir devenir diffrent, de se voir en
train de se transformer en personnage, de la place de l'auteur.
Ainsi, ce qu'autorise l'autofiction, la diffrence de la fiction, c'est de
permuter les fonctions, de ne pas tre simplement spectateur et acteur, mais
dtre aussi fabulateur, de connatre un devenir fictionnel. Parce qu'elle est
exactement calque sur la structure de l'espace potentiel, l'autofiction permet
de vivre totalement le grand murmure fictionnel qui habite les humains. Elle fait
de cet espace intermdiaire qui les constitue l'objet de sa lecture. Et comme cet
espace est diffrent pour chacun, chaque lecteur exprimente diffremment son
explicitation fictionnelle. Ainsi, si la fiction donne chacun la possibilit
d'organiser la ralit, lautofiction, elle, apporte la possibilit d'prouver en soi
cet espace toujours sous-jacent et de le vivre de faon plus riche, moins
gocentrique.
312
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
5 - SANS FAMILLE -
"Si l'uvre est parole autrui et mme, si l'on veut,
rponse autrui, elle est une rponse inattendue et
surprenante, inentendue et inaperue du public auquel
elle s'adresse. Bien moins une rponse une question
dj pose qu'une rponse une question non encore
pose - une rponse permettant la question dtre po-
se".
G. Picon.
313
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
On sait maintenant ce qu'est l'autofiction, en quoi elle consiste et de quoi
elle diffre. L'tude des stratgies d'criture a fourni les derniers rquisits sa
dfinition prcise et opratoire. Pourtant, un problme demeure : o situer
l'autofiction, dans le champ des pratiques littraires ? Quel est son statut
discursif ou architextuel ? Est-ce bien un genre ? Ou n'est-ce qu'une catgorie
modale un simple registre discursif ? A moins que ce ne soit qu'un simple
procd d'criture ? Et si c'est un genre, est-il simple ou complexe ? Est-ce un
genre thorique ou un genre historique ? Un sous-genre ou un archi-genre ?
Cette question est importante car le projet de dpart tait, tout de mme, de
dcrire, de spcifier et de comprendre une classe de textes, de conduire une
tude d'ordre gnrique. En outre, pour analyser les paramtres de cette
situation de communication inattendue, il a fallu poser une hypothse de travail,
dotant l'autofiction d'une existence gnrique.
Cette hypothse a eu des effets sur ce travail. On aura not que notre
perspective oscillait entre une description gnrique et un tableau de
rencontres heureuses, hsitait entre une approche gnrique et un abord plus
prudent, faisant de toutes ces convergences un ensemble fortuit. Tant qu'il
s'agissait d'analyser les pices du dispositif de l'autofiction, de varier ses
facteurs afin d'ouvrir l'angle de notre description, cette attitude tait
mthodologiquement valide. Depuis que le dispositif a t comme dpli, que
l'on a born le champ de ses ralisations autofictives, que lon a prcis les
limites fonctionnelles l'intrieur desquelles on pouvait parler d'autofiction, ce
flottement n'est plus possible. Il faut maintenant dcider du statut discursif, de la
nature gnrique de cette pratique littraire. On ne peut plus se contenter de
faire de l'existence de l'autofiction une hypothse de travail il est temps
d'valuer la validit de ce point de dpart.
Au crdit de cette hypothse, on peut mettre l'existence d'une classe de
textes aux contours relativement prcis, manifestant des caractres distincts,
travers une conjonction spcifique de deux protocoles de lecture, et cherchant
produire des effets propres partir d'une image fictive de leurs auteurs.
Apparemment composite, cette famille textuelle prsente une unit pragmatique
qui n'est pas discutable. D'un autre ct, on l'a signal plusieurs reprises,
cette pratique littraire ne possde pas de rception propre ; dans le paysage
littraire, elle n'a pas d'existence reconnue. S'il s'agit d'un genre, il s'agit d'un
genre inconnu, d'un genre souterrain. Cette situation a quelque chose de
314
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
paradoxal puisque normalement un genre littraire dfinit une "catgorie
duvre reconnue par la tradition". Il est donc ncessaire d'y aller voir d'un peu
plus prs et de se demander si un genre peut exister sur le mode du secret.
Pour cela, on dtaillera d'abord cette dfaillance de la rception, puis on
examinera une de ses consquences, pour en venir enfin la nature gnrique
de cette pratique droutante.
Le "court-circuit" de la rception
En commenant cette recherche, on a signal la situation problmatique
de l'autofiction comme pratique gnrique. Sans dsignation ni statut pendant
longtemps, son existence pouvait tre mconnue par des thoriciens avertis de
la chose littraire comme Doubrovsky et Lejeune. Bien que cette situation soit
en train de changer radicalement, il faut malgr tout l'voquer parce que ce
phnomne touche au mode dtre lui-mme de l'autofiction et a des
consquences sur son statut discursif.
Quand on a pris conscience de l'importance littraire de l'autofiction,
l'aveuglement pass parat aberrant. Et dcrire cette ccit est naturellement un
exercice aujourd'hui facile. La vision rtrospective du vrai est une opration peu
coteuse sur le plan thorique. Il faut pourtant comprendre que cette raction
envers l'autofiction dpassait la simple ignorance, l'oubli, la ngligence ou la
prcipitation. Plus que d'erreurs individuelles, cette mconnaissance manifestait
une attitude culturelle collective. Aussi bien ne s'agit-il pas dans ce qui va suivre
de citer complaisamment les errances de tel critique ou de tel poticien. En
tudiant la rception journalistique, puis universitaire de l'autofiction, on cherche
rendre sensible ce phnomne tonnant et rare : une pratique littraire qui
n'est pas reconnue comme telle, une forme sans fonction.
La rception journalistique
Plutt qu'une tude dtaille partir d'un chantillonnage d'articles, on
se limitera quelques observations faites partir de la lecture du supplment
littraire du Monde de 1980 1987. En lisant cette critique d'accueil, on
constate les faits suivants :
315
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
a) le souci du registre de lecture :
Dans l'ensemble, le "contrat" pass avec le lecteur proccupe tous ces
articles de presse, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, de rubrique ou
d'intitul. Les journalistes se demandent dans la plupart des cas s'ils ont affaire
une fiction ou une autobiographie le protocole onomastique est l'objet d'une
attention soutenue ;
b). L'absence de mise en perspective :
Le plus souvent, aucun rapprochement n'est fait avec des textes
antrieurs, sauf si le contenu thmatique s'y prte. On ne cherche pas clairer
un texte autofictif par des prcdents ni le mettre en rapport avec un
ensemble gnrique qui pourrait l'intgrer. Davantage, une autofiction apparat
comme un hapax, comme un cas d'espce. Ainsi Yves Florenne, critique
pourtant comptent, dclare propos de Joue-nous "Espaa" : "C'est, que je
sache, le seul roman dont le personnage porte ouvertement, dans le texte, le
nom de l'auteur. Et pourtant, c'est un roman" (Monde, 21.11.1980).
c) La section inclassable :
Quand le contenu d'un texte autofictif est invraisemblable, l'ouvrage est
dclar "inclassable" ou relevant du merveilleux ainsi Andr-la-Poisse de Terz
en 1981 et La guerre des pds de Copi en 1982.
d) La confession qui n'en est pas une tout en l'tant : Pour le gros des
autofictions publies durant cette priode, une attitude contradictoire est
adopte. Le dispositif est identifi, mais c'est pour lui donner une fonction
autobiographique comme le rclame, il est vrai, certains textes, mais pas tous !
Un discours cliv s'installe alors dans le propos, qui consiste dire : c'est un
roman, mais qui touche l'impudeur tant il est sincre. D'une faon gnrale,
on retrouve ce que dit, avec raison, Michel Contat de Doubrovsky : "dire tout de
soi, mais le dire avec art (...) crire sa vie comme si elle tait un roman,
c'est--dire, l'inventer sans fausser les donnes du vcu. S'taler sur les pages
dun livre, mais pas comme une flaque. En construisant un objet littraire"
(Monde, 12.1.1985). On notera tout ce que ce projet, qui est bien celui de
Doubrovsky, doit Goethe. Il rsume bien l'ambition de quelques auteurs,
lancs comme Boudard, dans un cycle de "biographie romanesque". Mais il est
loin d'expliquer le travail de Sollers, d'Isherwood, de Lacarrire, de Fuentes, de
316
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Charyn, de Llosa, de Copi ou de Terz. Et surtout, il repose sur le topos selon
lequel le roman est plus vrai que l'autobiographie, selon lequel la sincrit d'une
criture de soi est proportion de la fiction mise en jeu. Lejeune a montr tout
ce qu'avait d'illusoire une telle opposition, o l'autobiographie est la fois juge
et partie (1974, p. 42). Ce topos fonde souvent, certes, l'identification du
dispositif, mais il fait aussi obstacle toute rflexion srieuse et rduit les
fictions de soi authentiques une confession teinte de romanesque et dont la
finalit serait rfrentielle. La perception de l'autofiction dans la presse, jusqu'
aujourd'hui, prsente ainsi deux traits caractristiques : une mconnaissance
par assimilation ; l'incapacit mettre en corrlation l'uvre lue avec d'autres
textes, penser en termes gnriques une uvre ralisant un agencement
autofictif.
On a l un phnomne que la sociologie de la lecture, pour des
segments textuels et au niveau des systmes idologiques des lecteurs, a trs
bien dcrit sous le nom d'effet de court-circuit". Si l'on transpose cette
description l'chelle plus gnrale des conventions de lecture qui sont les
ntres, on peut se reprsenter dette mconnaissance de l'autofiction comme un
court-circuit entre la lecture et l'interprtation, une rupture de la circulation du
sens entre la perception et la comprhension des textes. Les ralisations
d'autofiction sont bien lues, c'est--dire que leur spcificit est bien releve,
mais soit cela ne fait pas sens, soit ce sens est inassimilable, soit enfin il est
reu dans un espace qui n'est pas le sien. Chacune des autofictions est ainsi
l'objet d'une lecture flottante, d'une lecture que le systme de conventions de la
rception est incapable de mdiatiser. L'effet de ce court-circuit est double :
ct texte, il fait des uvres sans rception approprie, qui sont chaque fois
juxtaposes mcaniquement au systme de lecture en place ; ct lecteur, il
induit en lui "un malaise, une vidence non formalisable un questionnement
sans question que l'appareil idologique ne parvient pas digrer" (Leenhardt
et Jozsa, 1982, p. 96). Qu'indique un tel effet ? "Un manque, un trou dans le
rseau interprtatif ou une dfaillance de son pouvoir (...) le signe d'une zone
dindtermination dans les capacits d'accueil de la rception. Mais aussi bien,
un "point sensible et significatif" de celle-ci, le travail d'une ngativit o
peut-tre se manifeste dj la promesse de l'mergence de nouvelles
dterminations et la rvision du systme de conventions antrieur (Idem, p. 96).
317
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
D'o vient ce manque, cette dfaillance de la rception ? En partie, de
l'absence d'une prise en charge de la fiction de soi par les Universits et les
Institutions. Au XXe sicle, celles-ci sont une source importante, parfois la
seule, des habitudes de lecture. Par le biais d'enseignements, de colloques, de
revues, d'ouvrages, de manuels, elles fabriquent et transmettent une
comptence littraire, que recueille plus ou moins vite, plus ou moins bien, la
critique journalistique.
La rception universitaire
L'origine de ce trou ou de ce manque dans le systme interprtatif se
comprend comme le rsultat de la situation faite l'autofiction tant par la
critique universitaire que par les thoriciens de la littrature. En tmoigne, pour
commencer, la raret des tudes critiques mentionnant, ne serait -ce que la
prsence de ce dispositif, pour le moins bizarre, dans les uvres de quelques
patronymes consacrs de la littrature comme Diderot, Proust, Kafka, Cline,
Gombrowicz ou Cendrars. La Potique de Cline d'Henri Godard est un
ouvrage unique en son genre : notre connaissance, c'est la seule
monographie qui n'esquive pas le problme et se donne pour tche de
l'lucider. Faut-il ajouter que par rapport la multitude des ouvrages consacrs
ces auteurs ou quelques-uns des textes de notre corpus, cela fait trs peu
et manifeste un rel aveuglement.
Quelques auteurs ont bien relev cette anomalie qu'es le fait d'un
crivain se reprsentant dans un texte fictif. Mais cette prise de conscience ne
dpassait jamais le cadre de l'uvre tudie. Elle n'envisageait pas la
possibilit que ce dispositif soit ralis ailleurs, autrement, qu'il puisse
constituer une pratique. Autant qu'on puisse en juger, la raction de ces auteurs
est systmatiquement une sorte d'tonnement, puis une dclaration faisant de
cette situation d'nonciation inhabituelle un cas unique. On a vu Yves Florenne
adopter cette attitude. Rappelons que Serge Doubrowski pensait tre le premier
employer un pareil agencement d'nonciation. Mais il est d'autres exemples
de cet effet hapax .
Barthes lui-mme, qui la pratique de la fiction de soi n'a pas chapp
et qui a fourni les instruments pour l'analyser, a eu cette attitude devant
Aziyad. Dans son analyse du roman, il notait propos de la fictionnalisation de
Loti :
318
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"Ce n'est pas le pseudonyme qui est intressant (en
littrature, c'est banal), c'est l'autre Loti, celui qui est et
n'est pas son personnage, celui qui est et n'est pas
l'auteur du livre : je ne pense pas qu'il en existe de
semblables dans la littrature, et son invention (par le
troisime homme, Viaud) est assez audacieuse : car enfin
s'il est courant de signer le rcit de ce qui vous arrive et
de donner ainsi votre nom l'un de vos personnages
(c'est ce qui se passe dans n'importe quel journal intime),
il ne l'est pas d'inverser le don du nom propre ; c'est pour-
tant ce qu'a fait Viaud : il s'est donn, lui, auteur, le nom
de son hros" (1971 b, pp. 171-172).
Ph. Lacoue-Labarthe, pour sa part, a fait de cette situation d'nonciation
le rsultat dune "certaine logique inhrente au paradoxe". qui exposerait
ncessairement l'nonciation dun paradoxe sortir d'elle-mme. A propos du
Paradoxe sur le comdien, il affirme :
"... depuis le dbut du dialogue, l'auteur, le sujet
nonant du texte (...) n'a cess de multiplier les indices
destins l'identifier au Premier. Ou l'inverse. Par deux
fois, en tous cas, le Premier s'est rappel son interlocu-
teur ( ... ) comme l'auteur du Pre de famille par deux fois
il a renvoy (...) ses salons et il ne s'est pas mme priv
de se dsigner nommment.() l'auteur - Diderot -
occupe donc simultanment deux places. Et deux places
incompatibles. A la foi exclu et inclus, dedans et dehors
(...) le sujet nonant n'occupe vrai dire aucun lieu, il
est, inassignable ( ... ) est-ce que cette impossible
position du sujet ou de l'auteur, ici, ne serait pas l'effet de
ce que lui-mme ( ... ) a charge d'noncer, savoir tri
paradoxe ?" (1980t pp. 268-270).
Cette analyse est peut-tre lgitime pour le Paradoxe, mais srement
pas pour tous les dialogues o Diderot apparat dans son texte, encore moins
pour toutes les autofictions. Une recherche patiente apporterait sans doute
d'autres illustrations de cet effet happax Tels quels, ces exemples soulignent
coin bien la critique se trouvait dsarme devant la fictionnalisation de soi en
littrature.
Il faut dire que la thorie de la littrature, et spcialement les tudes
gnriques, n'apportaient aucun instrument pour resituer cette pratique dans
une perspective plus gnrale, qui aurait permis au dispositif de ne pas tre
simplement perut mais dtre aussi reu. Le "retour amical de l'auteur signal
par Barthes a eu pour consquence la rvision de la conception en vigueur de
la fonction auctoriale. Mais sa rflexion sur le travail de Proust ou de Genet na
319
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
pas fait souche. Dans lensemble, la situation faite l'autofiction est rsume par
le refus initial de Lejeune, en 1973, dj cit d'admettre son existence
empirique, sinon comme une hypothse dcole. Dans un ouvrage sur la
"Rhtorique de l'autoportrait", Miroirs d'encre publi en 1980, M. Beaujour
confirmait encore cette impuissance de la thorie. Alors qu'il trouvait, pour d-
signer le double de Leiris dans Aurora, la belle expression de "hros
anagrammatique", la question de la possibilit d'un autoportrait fictif lui
paraissait insoluble :
"Mais un roman peut-il tre un autoportrait ? En
l'absence d'un 'pacte autobiographique, la question doit
rester irrsolue Le problme est analogue celui dont
Philippe Lejeune traite dans Le Pacte autobiographique.
Mais il n'est pas identique, et bien plus dlicat, car il
faudrait songer un pacte imaginaire, qu'aucune formule
parajuridique ne peut sceller" (p. 70).
Pas plus que la critique, et mme plutt moins, la thorie de la littrature
ne percevait donc, jusqu'au dbut des annes 80, une pratique dont les
ralisations crevaient pourtant les yeux, si l'on peut s'exprimer ainsi. Vritable
constante du discours mtalittraire, cette mprise quasi-gnrale manifestait l
un seuil de la conscience critique et littraire, comme si ce savoir voluait alors
dans un paradigme (celui de la "mort de l'auteur" ?) qui lui interdisait tout dis-
cernement en ce domaine.
Comment expliquer cette ignorance collective, cette incapacit reprer
un dispositif, relier les textes qui l'utilisaient, donner une signification la
pratique qu'ils ralisaient ? Il n'est pas facile de rpondre cette question tant
le recul manque : nous appartenons encore au systme quia produit cette tache
aveugle ; l'autofiction est encore en train de se constituer. L'htrognit des
usages du dispositif de fictionnalisation auctoriale fut, certes, un facteur non
ngligeable : il fallait distinguer l'autofiction au sein d'un ensemble de pratiques
fabulatrices dont le but n'tait pas fictionnel. Mais le facteur dterminant fut
sans doute l'absence dun terme gnrique qui fasse l'unanimit. Il est
probable, par exemple que si Barthes avait cr un terme pour dsigner la
pratique discerne chez Proust et Genet, sa reconnaissance en aurait t
acclre ; il aurait fait cole et aurait diffus plus rapidement sa dcouverte.
Plus fondamentalement en se tenant dans un quasi-silence thorique sur leur
travail de fabulation, en se refusant le nommer, les crivains ont une large
320
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
part de responsabilit dans la solitude de l'autofiction. C'est se demander si
cet isolement n'tait pas ncessaire l'effectivit de leurs fabulations intimes.
Il faut insister, en effet, sur le fait que ct criture, au ple de la
production, les crivains d'autofiction ont t avares de confidences et
d'indications. Leurs tmoignages se ramnent, en tout et pour tout, quelques
notations, beaucoup de silences et aucune rflexion globale. Quand ils
commentent leur dralisation dans leurs textes, c'est comme incidemment, et
toujours latralement, sans vritable discours d'escorte, sans en appeler une
tradition, une pratique discursive qui les dpasserait. Fors le cas unique de
Nerval que lon verra, tout se passe comme si ce point tait ngligeable. Sans
doute, trouve-t-on de-ci del des remarques sur le registre hybride utilis. Mais
elles sont rares et se limitent presque toujours empcher une lecture littrale,
se situer par rapport aux registres de la fiction et du rel (comme Restif qui,
dans Mes ouvrages, donne leur dosage respectif ou Proust qui dans sa
correspondance tient se dmarquer des deux la fois) ou a signaler la source
du dispositif (Hesse, Krouac). Et pour la plupart, tout reste, obscur : le choix
d'une criture hybride, la conception qu'ils s'en font, les modalits du dispositif
ralis, les effets escompts, le "genre" dont ils se rclameraient, leurs modles
ventuels. Cette esquive systmatique est trs sensible chez Cendrars et
Gombrowicz, deux crivains dont luvre abonde en auto-commentaires. Alors
que les aspects les plus divers de leurs crations ont droit de gnreuses
explications, leur fictionnalisation, procd si inattendu et si bizarre, est comme
refoule, ou comme drobe par un parti-pris que l'on s'explique mal. Cette
absence, ou plutt ce manque de discours lgitimant, supprime la possibilit
d'un examen des thories "indignes". Non sans suggrer qu'il y a dans ce
mutisme gnral et mthodique quelque chose de prmdit. Mais elle a eu
aussi pour consquence qu'aucune dnomination, qu'aucun nom gnrique n'a
jamais t propos par un crivain, pour dsigner la dralisation de soi en
littrature. Les quelques dsignations qui ont t cites, lors de l'tude des
indices paratextuels de fictionalit, taient des indications gnriques timides,
presque des seconds titres, toujours le fait d'crivains contemporains, qui n'ont
jamais t exploites ailleurs que dans un "pritexte" interne. Sans lgitimation
et sans nom, chez ceux-l mmes qui lui avaient donn vie : tel tait le statut de
l'autofiction du ct des crivains.
321
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Or, d'une manire gnrale, les noms propres sont, Claude Levi-Strauss,
la dmontr, "des quanta de signification, au-dessous duquel on ne fait plus
rien que montrer" (1962, p. 285). Situs exactement aux limites du travail de
classification d'une culture, ils sont les units minimales par lesquelles le
systme dcoupe et organise le rel, donne forme l'exprience humaine. Le
champ littraire n'chappe pas cette ncessite de la nomination. En-de de
son existence, il n'y a plus de classification possible, c'est--dire plus de
structuration, rien que des cas atypiques comme l'a illustr la rception de
l'autofiction. Dans son remarquable travail sur les genres littraires, J.M.
Schaeffer a montr que les noms gnriques ont plus qu'une fonction
taxinomique, qu'ils remplissent aussi une fonction pragmatique dterminante :
... ils ne dcrivent pas uniquement les phnomnes
littraires, ils entrent aussi dans leur constitution. Je veux
dire par l que la nomination gnrique possde toujours
un aspect autorfrentiel, parce qu'elle implique une
composante dcisionnelle ( ... ). Les noms gnriques
n'expliquent donc pas l'histoire littraire, ils en sont une
composante spcifique L'existence des genres est en
premier celle d'une sorte de nom mi-nom propre, mi-nom
collectif, accol un texte" (1987, p. 17).
En sus de son rle taxinomique, la nomination mtalittraire a ainsi un
rle constituant dans la reconnaissance et le bon fonctionnement d'une pratique
littraire. En l'absence de nom, il tait donc fatal que l'autofiction reste un
phnomne marginal, atypique, incomprhensible.
Sur le plan pistmologique, cet tat de fait dmontre une fois de plus, si
cela tait encore ncessaire, que les faits nont pas en eux-mmes l'vidence
que l'on accorde trop souvent. Dans la premire leon de son Cours de
philosophie positive, Auguste Comte le notait dj :
"Si, en contemplant les phnomnes, nous ne les
rattachions point immdiatement quelques principes,
non seulement il nous serait impossible de combiner ces
observations isoles, et, par consquent d'en tirer aucun
fruit, mais nous serions mme entirement incapables de
les retenir ; et, le plus souvent, les faits resteraient inaper-
us sous nos yeux" (1830, p. 5).
Cette faiblesse des faits nus n'est pas propre la connaissance. Comme
le montre l'autofiction, la lecture a besoin de "principes". que Jauss appelle
"ensemble de rgles", qui la guident et l'orientent dans son dchiffrement. Sans
322
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
les "principes" adquats, trs variables selon les uvres, que la comptence
littraire doit possder, la lecture manque tout simplement les phnomnes
qu'elle est cense susciter, ce qui ne veut pas toujours dire qu'ils sont alors
sans causalit.
Du ct des uvres, c'est l'occasion de vrifier que la littrature n'est
pas un objet clos, l'intelligibilit immanente et qui se suffirait lui-mme. Ce
phnomne de mconnaissance collective confirme que la Littrature est la
fois une activit, complexe, o l'intelligibilit se construit en permanence, et une
institution, dbordant en amont et en aval les uvres, dpendante d'autorits
culturelles, dont la fonction est autant didactique que constituante et
lgitimante. Pour que les proprits discursives, thmatiques ou formelles des
uvres soient perues, il faut qu'elles soient reues, c'est--dire consacres.
Des schmes de perception et de comprhension doivent pouvoir les accueillir.
Ces schmes, ce sont les crivains, les critiques, les thoriciens, les appareils
scolaires, les mdias qui les laborent, non sans oprer dans le mme
mouvement un travail de valorisation et de dvalorisation important. C'est cette
laboration incessante qui permet d'intgrer les uvres nouvelles, les procds
indits ou les thmes originaux au champ littraire : par l, ils sont situs,
rendus familiers par des antcdents, par des discours de lgitimation
esthtique et culturelle. Mais ces oprations d'identification, de dtermination,
de classement et de discrimination ne portent pas uniquement sur le nouveau,
elles reprennent et redistribuent tout l'ancien, comme on gre un hritage.
Aprs y avoir chapp pendant longtemps, l'autofiction semble tre finalement
rentre dans le cycle de cette gestion.
Un "genre" sans histoire ?
Dans la dure, l'absence de conscience gnrique propre l'autofiction.
Le dfaut de rception, a aussi pour consquence que celle-ci ne parat pas
avoir de tradition, disposer d'une Histoire. Essayer de discerner les grandes
lignes d'une volution, des transformations, bref une dynamique du "genre",
tout risque d'anachronisme assum, semble une entreprise voue lchec.
Ce n'est pas pourtant le pass ni l'ampleur des ralisations qui lui
manque. Si on avait lui chercher des racines vnrables, on pourrait remonter
lAntiquit romaine, au Ier sicle avant Jsus-christ, Lucien de Samosate et
son Histoire vritable, dont le prologue a t cit plus haut. De l, il serait
323
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
loisible d'voquer le quattrocento florentin, qui voit natre la Comdie (1472) de
Dante Alighieri, ouvrage dont l'audace dans l'invention conserve aujourd'hui
encore toute sa force d'incitation. En poursuivant cette remonte du temps dans
la Renaissance, il faudrait faire une place au Quichotte (1615) de Miguel de
Cervants, mme s'il ne prsente qu'une tonalit autofictive, tant cette fiction a
connu de rayonnement. Pour le sicle des Lumires, on hsiterait avec raison
entre les affabulations de Restif de la Bretonne, qui ont frapp beaucoup
d'imaginations, malgr leur qualit parfois discutable. et la Biographie
conjecturale (1799) de Jean-Paul, qui en inversant l'ordre temporel de
"autobiographie toute la littrature d'expression allemande. Enfin, c'est vi-
demment La Recherche (1917-1927) de Marcel Proust que nous devons la
plupart des autofictions contemporaines.
Cette chronologie mmorable et ce petit panthon apportent un constat
impressionnant. A travers eux, l'autofiction parat exister depuis la Rome
impriale et quelques-unes des plus grandes uvres de la littrature
occidentale semblent s'tre relayes pour conserver sa tradition. Pourtant,
aucun crivain d'autofiction ne s'est jamais replac dans cette perspective, ni
rclam de cette ligne. A aucun moment de son volution, un auteur n'a crit
l'quivalent d'un texte comme Ivolution du roman au XIXe sicle de
Maupassant, pour se constituer en hritier d'une tradition aussi riche que
composite.
Au sein de cet oubli de soi, il faut apparemment extraire et mettre part
le cas de Nerval. Sa ddicace, Dumas pre, pour Les Filles de feu semble
infirmer cette description. Le caractre exceptionnel de ce texte a dj t
mentionn. De fait, on le citerait volontiers dans son intgralit, tant est riche
cette ptre dmesure. On se souvient que Grard de Nerval rtorquait par
cette ddicace un article, qu'on a cit, o Alexandre Dumas mettait en doute
la raison de l'auteur d'Aurlia. Pour lui rpondre, Nerval entreprend un plaidoyer
pro domo qui commence de la faon suivante
"Je vais essayer de vous expliquer, mon cher Dumas,
le phnomne dont vous avez parl plus haut. Il est, vous
le savez, certains conteurs qui peuvent inventer sans
sidentifier aux personnages de leur imagination. Vous
savez avec quelle conviction notre vieil ami Nodier
racontait comment il avait eu le malheur dtre guillotin
l'poque de la Rvolution ; on en devenait tellement
324
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
persuad que l'on se demandait comment il tait parvenu
se faire recoller la tte...
H bien, comprenez-vous que lentranement dun rcit
puisse produire un effet semblable ; que lon arrive pour
ainsi dire s'incarner dans le hros de son imagination, si
bien que sa vie devient la vtre et qu'on brle des
flammes factices de ses ambitions et de ses amours !
C'est pourtant ce qui m'est arriv en entreprenant
l'histoire d'un personnage qui a figur, je crois bien, vers
lpoque de Louis XV, sous le pseudonyme de Brisacier.
Ou ai-je lu la biographie fatale de cet aventurier ? J'ai
retrouv celle de l'abb de Bucquoy ; mais je me sens
bien incapable de renouer la moindre preuve historique a
l'existence de cet illustre inconnu ! Ce qui n'eu t qu'un
jeu pour vous, matre - qui avez su si bien vous jouer
avec nos chroniques et nos mmoires que la postrit ne
saura plus dmler le vrai du faux, et chargera de vos in-
ventions tous les personnages historiques que vous avez
appels figurer dans vos romans, tait devenu pour moi
une obsession, un vertige. Inventer, au fond, c'est se
ressouvenir, a dit un moraliste ; ne pouvant trouver les
preuves de l'existence matrielle de mon hros, j'ai cru
tout coup la transmigration des mes non moins
fermement que Pythagore ou Pierre Leroux. Le dix-
huitime sicle mme, o je m'imaginais avoir vcu, tait
plein de ces illusions. Voisenon, Moncrif et Crbillon fils
en ont crit mille aventures. Rappelez-vous ce courtisan
qui se souvenait d'avoir t sopha ; sur quoi Schahaba-
ham s'crie avec enthousiasme : 'Quoi ! Vous avez t
sopha ! mais c'est fort galant... Et, dites-moi, tiez-vous
brod ?. (1854, pp. 28-29).
Dans cette justification, les ides et les rfrences abondent. Il faudra
revenir par exemple sur le fait que des conteurs tendent se projeter sur leurs
personnages : on se demandera, moins prudemment que Nerval, si ce n'est
pas une tentation permanente pour l'crivain, voire un risque inscrit dans la
langue elle-mme. Notons aussi comment Nerval sait rappeler habilement que
Dumas a pass une grande partie de sa vie crire des romans o la vrit
historique se confondait avec ses propres inventions. Il est vrai que Dumas ne
pratiquait ce registre hybride qu'au niveau de l'nonc, en limitait ses mlanges
au contenu de ses ouvrages, sans risquer le statut de son nonciation ni son
propre nom.
Encore que... Mes Mmoires de Dumas sont un bel exemple
d'autobiographie truque, o l'auteur des Trois mousquetaires fait de sa vie un
enchantement permanent reprenant son d dans ses romans et pratiquant un
325
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
aller-retour permanent entre fiction et ralit. Les contemporains ne s'y sont
d'ailleurs pas tromps ; tmoin le portrait d'Hippolyte Romand, dans la Revue
des deux mondes de janvier 1834 :
"Don Juan la nuit, Alcibiade le jour : vritable Prote,
chappant tous et lui-mme ; aussi aimable par ses
dfauts que par ses qualits, plus sduisant par ses vices
que par ses vertus voil M. Dumas tel qu'il me parat en
ce moment car, oblig de l'voquer pour le peindre, je n'o-
se affirmer qu'en face du fantme qui pose devant moi je
ne sois pas sous quelque charme magique ou quelque
magntique influence" (cit dans Biet, Brighelli et Raspail,
1986, p. 74).
Aprs ce retour de bton et l'allusion sa "croyance" en la
mtempsycose, Nerval se rattache toute une tradition antrieure
Moi, je m'tais brod sur toutes les coutures. Du
moment que j'avais cru saisir la srie de toutes mes
existences antrieures, il ne m'en cotait pas plus d'avoir
t prince, roi, mage, gnie et mme Dieu, la chane tait
brise et marquait les heures pour des minutes. Ce serait
le Songe de Scipion, la Vision du Tasse ou La Divine
Comdie du Dante, si j'tais parvenu concentrer mes
souvenirs en un chef-duvre. Renonant dsormais la
renomme d'inspir, dillumin, ou de prophte, je n'ai
vous offrir que ce que vous appelez si justement des
thories impossibles, un livre infaisable, dont voici le
premier chapitre, qui semble faire suite au Roman
comique de Scarron... Jugez-en...
Est-ce donc la charte qui manquait l'autofiction ? C'est en tous cas un
texte qui en donne le mcanisme de production? dfinit diffrentiellement son
agencement, l'articule de faon complexe des croyances hermtiques et
l'intgre dans une continuit. Reste savoir si Nerval parle bien de l'autofiction
si ces exemples sont pertinents pour illustrer cette stratgie.
Pour le Tasse et Dante, la chose est certaine : le premier a crit des
dialogues imaginaires o il se mettait en scne ; on a vu toute la
fictionnalisation de soi que recelait La Divine Comdie. L'allusion au "Songe de
Scipion" est moins comprhensible. Car ce "songe" est attribu Scipion par
Cicron, pour relater un mythe eschatologique dans le dernier livre de sa
Rpublique, sur le modle du rcit de l'Er l'Armnien qui clt l'ouvrage
homonyme de Platon. Scipion n'est donc pas l'auteur du songe qui porte son
nom, la diffrence de Dante ou du Tasse qui sont les auteurs de leurs visions.
326
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Il est vrai que Nerval ne connaissait peut-tre pas ce dtail. L'ouvrage de
Cicron n'a t retrouv que vers 1820, par un humaniste italien qui travaillait
la Bibliothque Vaticane. Avant cette date et sans doute des annes aprs, ce
songe n'tait accessible que par la version de Macrobe, grammairien latin qui a
conserv et comment ce texte, et qui tend authentifier le songe. A moins
d'une confusion de Nerval, il faut donc supposer qu'il ne connaissait ce songe
qu' travers le texte de Macrobe. Dans l'esprit de Nerval, Scipion tait bien
l'auteur de son rve, c'est--dire d'un rcit irrel o il figurait.
A considrer les trois rfrences de Nerval, il parait lgitime de
considrer qu'elles font signe vers la situation dnonciation originale qui occupe
ce travail. Le seul point dlicat, c'est qu'on peut hsiter sur l'objet de cette
vocation : Nerval fait-il allusion une tradition d'illumins ou une tradition
littraire ? Scipion, Le Tasse, Dante sont, en effet, cits comparatre pour
leurs fictions, mais aussi bien parce qu'ils ont eu des visions ou se sont donns
le plaisir de croire qu'ils en avaient. Chez Nerval, on le sait, la rfrence
hermtique s'accompagne toujours de cette clause d'incertitude : il n'affirme
jamais crment la ralit du thme hermtique qui traverse son uvre. C'est
d'ailleurs ce flottement constant qui permet de comprendre l'ambigut de la
tradition dont il se rclame : il s'agit moins d'une quivoque que d'un dualisme ;
c'est l'angle sous lequel Nerval conoit la possibilit de la fiction de soi : comme
la rmanence, joue ou complaisante, de vies antrieures, comme un
ressouvenir.
La ressemblance est, en effet, une catgorie de base de la pense et de
la pratique de Nerval, qui sans cesse cherche des analogies, des termes de
comparaison, la possibilit de rapprochements, de correspondances,
promesses d'une unit du monde et des cultures (Richard, 1955, P. 56). D'o le
bric--brac sotrique, mais aussi historique, folklorique, philologique, de son
uvre, vritable festin pour l'exgse et l'hermtisme. Mais cet aspect cabinet
de curiosits a chez lui une fonction crative, comme il le relve d'ailleurs dans
la ddicace Dumas : ... ne pouvant trouver des preuves matrielles de
l'existence de mon hros, j'ai cru tout coup la transmigration des mes ... .
Ainsi, la mtempsycose est pour Nerval un moyen d'assurer sa dmarche et
une clef pour comprendre celle des uvres passes. Il se pourrait bien, ds
lors, que Nerval ait vraiment eu conscience de cette permanence de l'autofiction
et qu'il ait pratiqu en connaissance de cause ce registre. Et il est certain qu'il a
327
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
peru les ressources de cette situation de communication, comme le montre
son texte sur Restif, Confidences de Nicolas.
Pour des raisons historiques, cette clairvoyance n'a toutefois eu ni suite
ni matrialisation littraire. D'abord, Nerval est rest longtemps un auteur
confidentiel, une sorte de fou littraire ; ensuite, la description sotrique ou
mystique qu'il donne de l'autofiction. quand on connaissait mal son art et
l'ensemble de son uvre, pouvait prter confusion. Aprs lui, l'autofiction
redevient une pratique aveugle, dont les manifestations rptes s'enchanent
dans la mconnaissance, sans reconnatre la longue chane historique
laquelle elles appartiennent.
Pourtant il serait excessif de dcrire cette pratique comme une
juxtaposition duvres sans rapport entre elles.
A l'aide de dclarations explicites, plus souvent en interprtant les textes,
leurs marges ou les discours qui les prolongent de multiples connexions
apparaissent. Ce n'est pas que les auteurs revendiquent volontiers leur modle
d'inspiration, mais certaines insistances finissent par avoir presque valeur d'at-
testation. Ainsi du rapport de Cline Proust : l'crivain du Voyage ne se
rclame pas explicitement, pour autant qu'on puisse en juger, du modle
autofictif proustien, mais la multiplication des comparaisons et des mises en
parallle entre son uvre et la Recherche suggre fortement ce
rapprochement. Mais il s'agit le plus souvent de connexions entre un texte et un
autre texte, le recommencement d'une exprience unique, sans pareille.
Aucune autofiction ne se dtermine comme le point d'arrive d'une longue
procession, comme la relance d'un geste prenne ; la ralisation est toujours
une reprise. Loin dtre continue et cumulative, cette pratique se dploie en
rseaux toils, relativement autonome, partir de "phares" (Dante, Cervants,
Novalis, Rtif, Goethe, Proust). Du centre Proust , essaiment ainsi la plupart
des autofictions modernes, sans que celles-ci ne prsentent la trace d'une
dtermination par les grandes ralisations antrieures : ainsi des uvres de
Kerouac, de Cline, de Fuentes, de Charyn. L'enchanement des autofictions
s'opre selon un rapport privilgi d'crivains crivains ; la transmission du
dispositif n'pouse pas la marche du temps. Il n'y a pas de descendance
linaire, pas de filiation de proche en proche entre tous ces auteurs. Seulement
des plantes dont le pouvoir d'attraction perdure, mme quand d'autres astres,
aussi puissants, apparaissent et attirent d'autres satellites.
328
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Au demeurant, un examen du corpus ne met en relief aucune poque
particulire dans la production des autofictions aucune gnration littraire ne
parait avoir t plus sensible qu'une autre ce procd littraire ; ce qui rend
inutile toute priodisation. Le seul phnomne que l'on serait tent de noter,
avec Ph. Lejeune, c'est une acclration apparente, en cette fin du XXe sicle,
des actualisations du dispositif. Bien des raisons culturelles sont mme
d'expliquer ce tournant. Mais on peut aussi se demander s'il ne s'agit pas d'une
illusion de perspective ; en l'absence de tradition, l'identification des autofictions
rcentes est plus aise que celle des textes qui sont aujourd'hui noys dans la
multitude des pratiques hybrides.
En dfinitive, la diffrence de la biographie, du roman ou de
l'autobiographie, aucune autofiction quelque sicle qu'on l'arrache, ne
manifeste le poids d'une gnalogie, les traces d'une lutte pour assumer et se
distinguer d'un pass encombrant. L'absence de rception fait de cette pratique
une pratique sans mmoire.
Un "genre" secret ou un "genre" thorique ?
Voil donc une forme de fiction reste longtemps sans rception et sans
discours descorte, sans mmoire et sans histoire, sans statut et sans nom. Et
pourtant, elle se manifeste dans une classe de textes dont l'existence est
indniable, elle remplit mme quelques-unes des conditions d'un genre,
prsente les rgularits d'une pratique discursive. Alors, est-ce un genre
inconnu ou une illusion gnrique ? Un genre cach ou une catgorie fantme?
On se trouve devant le problme de classification voque au dbut de ce
chapitre : comment situer lautofiction ? Est-ce un genre ? Une hybridation ?
Une simple catgorie de lecture ? Le terrain de cette interrogation n'est pas trs
sr. Comme on sait, la problmatique des genres pose un vaste ensemble de
questions, qui sont loin d'avoir toutes trouv une rponse satisfaisante. Il
faudrait d'abord s'entendre sur toutes ces divisions, souvent employes, dans
ce travail comme ailleurs, en des acceptions varies. Tout d'abord, sur la notion
de genre d'o rayonnent la plupart des autres subdivisions. Qu'est-ce qu'un
genre ? Sur ce point, il semble qu'une solution soit aujourd'hui accepte par
tous. On s'accorde reconnatre qu'une classe de "textes" partageant des
proprits communes ne suffit pas dfinir un genre. Une condition
supplmentaire est ncessaire : Warning dirait la concrtisation historique".
329
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
c'est--dire la reconnaissance institutionnelle une poque donne. Comme
l'affirme pertinemment Tzevetan Todorov :
on disposerait d'une notion commode et oprante
si l'on convenait d'appeler genres les seules classes de
textes qui ont t perues comme telles au cours de
l'histoire. Les tmoignages de cette perception se
trouvent avant tout dans le discours sur les genres
(discours mtadiscursif), et, de faon sporadique et
indirecte, dans les textes eux-mmes (1978, p. 49).
Plus radical, Grard Genette critique l'ide que les catgories gnriques
puissent tre abstraites de l'histoire :
... toutes les espces, tous les sous-genres, genres
ou super-genres sont des classes empiriques, tablies
par l'observation du donn historique (1979, p. 70).
Ces propositions, difficilement discutables, suffisent carter l'ide que
l'autofiction puisse tre un genre second, complexe, infrieur, mlang ou
"familial". L'autofiction est bien une classe textuelle : les proprits qui la
dfinissent se retrouvent effectivement travers un certain nombre de textes.
Mais cette classe n'est pas reconnue par les lecteurs, n'a pas se place dans le
paysage littraire ; elle n'a pas d'enracinement historique. Il faut donc faire son
deuil de toute catgorisation qui directement ou non ferait appel la notion de
genre, sinon dans une acception trs vague.
A moins que l'on suppose qu'il s'agisse d'un genre cach, d'une pratique
gnrique clandestine, dont la condition de possibilit reposerait sur le secret.
Lo Strauss a dvelopp comme on sait, toute une thorie sur un "art d'crire"
cach, aujourd'hui oubli, permettant des penseurs comme Xnophon,
Machiavel, Hobbes, Spinoza, de formuler des propositions essentielles "entre
les lignes". tout en donnant l'illusion de soutenir les discours dominants de leur
poque (Ruwet, 1979). Sur ce modle trs suggestif, on pourrait concevoir tous
les textes autofictifs comme appartenant une tradition masque, dans la
ncessit de celer ses vritables objectifs. A partir de l il serait possible de
soutenir que ce genre existe bien (notre corpus prsente certes des uvres
ayant des traits communs) mais qu'il ne pouvait pas se prsenter au grand jour
(effectivement, pratiquement aucun auteur ne commente son travail fictionnel.
Certes, comme l'criture cache de Strauss, chaque crivain ne manquerait
pas de signaler cette appartenance gnrique par des indices habilement
330
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
disposs, mais il se garderait bien de revendiquer ouvertement la nature si
particulire de son criture. En ralit, le fond de son ouvrage ne s'adresserait
qu' un public sotrique, capable de reprer le dispositif utilis et le registre
d'criture qui en dcoule.
Pourquoi ce double langage serait-il ncessaire ? En quoi cette littrature
double entente s'imposerait-elle ? Comme Strauss, on rpondrait que la
Perscution sociale et culturelle commanderait cette duplicit. N'oublions pas
que le dispositif de fictionnalisation de soi, quand il ne remplit pas une fonction
interprtative ou biographique, met en cause des catgories aussi essentielles
que le Sens, la Vrit, le Rfrent et le Sujet. Si la culture occidentale est bien
ce long travail d'exhaustion de l'individu, qu'a dcrit Louis Dumont (1983) travail
la fois mtaphysique, politique et littraire qui commence au XIIIe et qui vise
faire de l'individu un tre moral causa sui, indpendant et autonome par rapport
la collectivit le dispositif dnonciation de l'autofiction a un effet disruptif
extraordinaire : il littralise en quelque sorte cette ide que tout individu est fils
de ses uvres en la portant un seuil o cette notion implose et crve l'horizon
de tout l'ordre culturel s'organisant autour de la notion de personne. En
pousant le modle de l'autobiographie, qui a tant fait pour la constitution de
l'individu, elle dralise de l'intrieur l'individu, lui enlve son assise (le vcu, la
subjectivit, le sens moral) pour le laisser tournoyer en spirale, dans des
distorsions sans fin, comme un systme autogouvernable qui aurait perdu son
rgulateur.
Dans cette perspective, toute la chronologie de l'autofiction prendrait un
sens, se transformerait en histoire en tant qu'elle pourrait se lire comme l'envers
du discours de la subjectivit, comme le retour priodique du refoul : Lucien de
Samosate, c'est l'poque des Stociens, de l'individu au sens moral Dante, c'est
le XIIIe, le dbut de la subjectivit au sens moderne ; Cervants, le XVIe ; c'est
la chute de l'Autorit et l'panouissement du moi singulier, qui trouve un
fondement mtaphysique avec le cogito ; Novalis, R.YSbi, cest la veille de
1789, le triomphe de la personne civile etc.
Cette explication rendrait compte aussi du silence ttu, systmatique et
nigmatique des crivains sur leur travail. Pour un Nerval qui vend la mche et
finit dclar fou, combien d'auteurs qui ne font que des dclarations rentres,
des affirmations contradictoires et qui en fin de compte, choisissent le silence.
Elle permettrait du mme coup dexpliquer l'absence dhorizon d'attente :
331
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
hormis des lecteurs attentifs, rares, forcment rares, peut-tre ne se recrutant
que parmi des crivains, qui pouvait percevoir la terrible originalit de cette
figure d'nonciation ? Elle donnerait, enfin, l'explication de l'apparition actuelle
de l'autofiction : aujourd'hui la Perscution n'existe plus (ou sous des modalits
diffrentes) et la civilisation occidentale remet en question cette notion d'indi-
vidu sur laquelle elle s'est btie.
Arrtons l ce roman gnrique. On ne l'a bauch que parce que le
silence entourant l'autofiction parat peu naturel et suggre une telle hypothse.
Il y a eu une poque o ce type de scoop aurait sans doute fait fureur. Les
temps actuels sont plus raisonnables, moins ports aux gnralisations partir
de la dralise la notion d'individu, qu'elle mette en pratique une critique de la
notion de personne que l'on trouve chez Pessoa, Pirandello et quelques autres,
cela n'est gure contestable. Car elle exploite une "aire d'exprience" qui ne se
situe ni dans la ralit ni dans la subjectivit. Mais de l en faire une
cinquime colonne, une pratique consciente de mise en crise de la notion
d'individu, dlibrment masque pour viter les foudres de la Perscution, il y
a un abme que l'on ne franchira pas. En matire de secret, le bon sens est le
meilleur guide si ce genre tait cach, alors il l'tait si bien que chaque auteur
d'autofiction a pens (comme Doubrowsky dans son registre) ouvrir une
nouvelle pratique ; s'il n'tait qu' moiti cach, transparent pour les initis,
alors cela se saurait, comme dit la Sagesse des nations.
D'une faon gnrale, il faut bien tre conscient qu'un genre secret est
une contradiction dans les termes, une impossibilit thorique. Un genre, c'est
un type duvre consacr comme tel une poque donne, atteste par les
discours qui entourent la production et la rception des uvres. Si ces discours
font dfaut, si la rception est absente, s'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a
plus de genre possible.
Plus srieusement, ne peut-on faire de l'autofiction un "genre thorique",
un "type" en quelque sorte ? C'est ce que fait Susan Rubin Suleiman dans son
livre suggestif sur Le Roman thse. Elle affirme et dfend le droit pour le
poticien de construire rtrospectivement un genre partir d'une observation
empirique et d'une induction analytique (1983, pp. 20-27).
Ce droit de construction gnrique revient affirmer la validit de la
notion de genre thorique, comme le faisait Todorov, plus de dix ans
332
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
auparavant, et avant de changer dattitude, dans Introduction la littrature
fantastique : "de mme que dans le systme de Mendeleev, on peut dcrire les
proprits des lments qu'on n'a pas encore dcouverts, de mme ici on
dcrira les proprits des genres - et donc des uvres - venir" (1970, p. 19).
Ces affirmations appellent deux remarques. Tout d'abord le travail de
classification rtrospective au double sens de valorisation et de dlimitation
rtrospectives constitue, il est vrai, une dimension importante de la vie des
Lettres, de l'volution de la littrature. Comme le notait il y a dj quelque
temps Genette, "une poque se manifeste autant par ce qu'elle lit que par ce
qu'elle crit" (1966, p. 169). En outre, il est toujours fcond de dcrire
l'existence dun genre possible (qu'aucune ralisation historique n'est venue
codifier (Todorov, 1978e p. 51). Reste qu'on ne peut donner cette
reconstruction gnrique le titre rel de genre ; elle n'a pas de porte des-
criptive et explicative vritables.
Dire que l'autofiction prsente des proprits, cest en faire une catgorie
de lecture ; pas dgager une catgorie de productivit textuelle", un "modle
d'criture" (Schaeffer, 1983).
L'existence de ressemblances discursives ne donnent aucune lgitimit
la ralit d'un genre, ne permet pas de promouvoir l'existence un genre,
mme aprs coup. Si Suleiman se donne cette illusion pour le roman thse,
c'est qu'elle passe subrepticement d'une dfinition extensionnelle (constituer
une classe de textes qui prsente des caractres communs) une dfinition
intensionnelle (prtendre donner une dfinition en comprhension, par ses
caractres, de cette classe) du genre. Un tel passage n'est possible, comme la
bien montr Schaeffer (1987), qu'en occultant la dimension temporelle qui
commande la dynamique gnrique et en sous-dterminant le genre, en le
rduisant un "air de famille". Quand un tel passage n'est pas dommageable
pour la thorie gnrique, cest que les ralisations du genre ont t limites
quelques cas exemplaires, comme cest le cas chez Suleiman qui n'envisage
pas les uvres de Bordeaux, de Bernanos, de Guilloux, de Brasillach ou de
Martin du Gard (1983, P. 27). Dterminer rtrospectivement un genre, c'est par
consquent prsupposer que l'on avait affaire un genre inconnu, cach ;
revenir notre roman gnrique.
333
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Naturellement, ce besoin d'hypostasier des ressemblances textuelles
s'enracine trs loin dans le dsir du poticien ou du critique. Il est difficile
d'tudier une pratique sans cder un dsir ontologique dont Barthes a bien
analys le mcanisme, propos de la photographie, au dbut de La chambre
claire :
"J'tais saisi l'gard de la Photographie d'un dsir
ontologique : je voulais tout prix savoir ce qu'elle tait
'en soi', par quel trait essentiel elle se distinguait de la
communaut des images. Un tel dsir voulait dire qu'au
fond, en dehors des vidences venues de la technique et
de l'usage et en dpit de sa formidable expansion
contemporaine, je n'tais pas sr que la Photographie
existt, qu'elle disposait d'un 'gnie' propre" (1980, pp.
13-14).
Donner un phnomne littraire le rang de genre, c'est s'assurer de sa
consistance, refouler les doutes que l'on peut avoir quant l'unit de ses
manifestations, quant la cohrence de sa dfinition. Comme on s'en doute,
l'autofiction veille un tel dsir ontologique , sa sduction pousse
l'objectiver, lui offrir un "en-soi". La thorie semble alors plus allgre, le
rapprochement de textes sensiblement diffrents plus lgitime, leurs analyses
plus convaincantes. Cette ontologisation napporte pourtant que des
confusions. Dire que l'autofiction est un genre au sens fort, un modle
d'criture, c'est fausser sa ralit littraire et historique et donner au dispositif
une valeur explicative qu'il n'a pas en lui-mme, puisque selon les usages qu'il
en est fait, ses effets sont opposs*
Une question rsiste tout de mme. Comment expliquer que la figure
dnonciation de l'autofiction : 1) existe autrement qu'une catgorie possible ; 2)
soit ralise de faon si rcurrente travers les sicles. Bref, lempirie se fait in-
sistante. Devant cette situation, le thoricien se trouve un peu comme Saussure
devant ses anagrammes : un phnomne discursif ritr, dont personne ne
parle et dont le principe est invisible. De mme lexistence et la rcurrence de
l'autofiction, sa ralisation effective et sa permanence (deux points ne pas
confondre) ne se laissent pas rduire facilement.
Examinons d'abord le problme de l'existence du dispositif autofictif.
Comment expliquer qu'un agencement aussi bizarre, aussi inattendu, aussi
risqu pour la stabilit d'une nonciation ait pu voir le jour, sans se cantonner
l'tat de possible ? Il faut penser ce principe de pathologie gnrale rappele
334
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
par Freud : ... tout processus contient les germes dune disposition
pathologique, en tant qu'il peut tre inhib, retard ou entrav dans son cours
(1908p p. 54). Si l'on transpose ce principe dans le domaine de
l'autobiographie, on peut avancer que tout autobiographe a sans doute pens
un jour ou l'autre, qu'il tait possible de pervertir les paramtres de son
entreprise, dcrire non pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de sa vie rve,
de sa vie invente. Dans l'criture de soi, il est invitable de reconstruire son
existence, de recrer ce qu'on a vcu : l'auteur le plus honnte, le moins nar-
cissique, doit procder des simplifications, des raccourcis, des distorsions,
parce qu'il doit couler une trajectoire temporelle dans un systme de signes.
Dans l'entreprise autobiographique, il y a donc une part d'invention irrductible,
sous peine de ne pas arriver communiquer. Un crivain conscient de ce
mcanisme peut alors dsirer lui donner libre cours, chercher l'isoler et
l'exorbiter, le dvelopper pour lui-mme. Surtout s'il se trouve dans
l'incapacit de raconter sa vie, ou gn dans cette entreprise, ou peu heureux
du sort que la fortune lui a fait - ou s'il doute de l'intrt du projet auto-
biographique.
Restif a ainsi, la fin de son existence, le projet d'crire des Revues,
c'est--dire de mener bien des "Histoires refaites sous une autre hypothse
du Cur humain dvoil". qui est le second titre de sa monumentale
autobiographie, plus connu sous l'intitul de Monsieur Nicolas :
"Pour que l'homme pt tre heureux, il lui faudrait une
prudence qu'il ne peut avoir que par l'exprience. En
consquence, il lui faudrait deux vies connexes et sans
intervalle. Revivre serait sa vritable vie. Car la nature
aurait dispos les choses de faon que l'homme ou la
femme repasseraient ncessairement par les mmes
circonstances, les mmes relations avec les mmes
personnes ; qui par consquent revivraient galement"
(Posthumes, t. IVe 1802).
Rappelons, dans le mme ordre d'ide, que la linguistique a montr
depuis longtemps que tout systme produit un anti-systme, que toute
opposition dichotomique produit tt ou tard son terme neutre (Dubois, 1965).
On voit mal pourquoi ce phnomne n'aurait pas cours dans le champ littraire.
L'existence depuis l'antiquit de l'opposition fiction vs rfrence autorisait sa
neutralisation et la cration d'un texte annulant les paramtres de ces deux
registres, brouillant les repres de ces deux formes de discours. Ds lors,
335
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
l'autofiction est tout simplement une posture d'nonciation ( Imaginons que je
sois... ) dont la possibilit se trouve inscrite dans toute conomie discursive,
dans l'ordre du discours lui-mme, et qui devait tt ou tard se trouve ralise.
Plus difficile comprendre semble-t-il, sont les ralisations rptes de
cette posture dnonciation travers l'histoire littraire certes cette posture est
possible, le dispositif de l'autofiction existe virtuellement, mais comment se fait-il
qu'il ait fonctionn si longtemps sans avoir d'identit propre ?
Notons d'abord que ce phnomne n'est pas rare dans l'histoire de la
culture :
Il arrive qu'un agencement existe depuis longtemps,
avant qu'il reoive un nom propre qui lui donne une
consistance particulire comme s'il se dtachait alors dun
rgime plus gnral pour prendre une sorte d'autonomie :
ainsi 'sadisme' masochisme. (Deleuze, 1977, p. 143).
Les thmes et les pratiques du sadisme et du masochisme ont exist,
mme en littrature, avant que le Marquis de Sade et que Sacher-Masoch n'en
fassent la matire de leurs uvres et qu'ils ne les marquent de leurs noms.
Auparavant, ces deux configurations thmatiques fonctionnaient fondues dans
des ensembles plus vastes (Eros, la Violence, le Mal) qui ne permettaient pas
d'en prvoir l'mancipation, ni peut-tre d'en distinguer la spcificit. Ce fut, et
c'est en partie encore, exactement la situation de l'autofiction. Elle se confondait
avec quantit de pratiques fictionnelles marginales : l'autobiographie
mensongre, le roman personnel, le roman a clefs, la biofiction , la faction, le
dialogue implication auctoriale, le texte rflexif etc. Il fallait que cette forme de
fiction rponde a un besoin nouveau pour qu'elle reoive un nom, soit dissocie
et pour que ses effets deviennent notables.
Ce changement de rgime d'un phnomne littraire, J. Tynianov l'a
situe en le replaant dans l'histoire littraire et en signalant toute son
importance. Comme il le montre dans le contexte russe, ce phnomne n'est
pas plus mystrieux que le phnomne exactement inverse, le "tragique
orphelinat d'une fonction sans forme". la situation plus connue o une
gnration littraire cherche vainement des moyens formels pour renouveler un
genre, traduire un aspect indit de la ralit, rpondre une demande sociale.
Puisqu'il existe des questions dont les solutions restent en suspens, pourquoi
n'existerait-il pas des rponses dont les questions restent trouver ? En 1927,
336
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Tynianov dclarait que ces deux problmes (une forme sans fonction, une
fonction sans forme) taient encore inexplors et il affirmait que l'tude du
discours en tant que "srie" (ensemble de rgularits) et en tant que "systme"
(ensemble d'nonciations singulires), "dpend des tudes futures sur ce sujet"
(1927, p. 130). Plus d'un demi-sicle plus tard, force est d'avouer que l'on n'a
pas beaucoup progress dans ce domaine L'histoire littraire demeure un
parent pauvre des tudes littraires. Pourtant, si l'on se dcidait aborder ces
questions, peut-tre que le destin obscur de l'autofiction serait un lment pour
voir plus clair dans la dynamique interne de la littrature.
Une dernire explication, suggre par Genette, la permanence
historique de l'autofiction, malgr l'absence de conscience gnrique, peut-tre
trouve dans une sorte de fondement existentiel. Chez les enfants, la
thtralisation de soi, l'action de jouer un rle, est une forme spontane de la
conduite et du discours. L'enfant, "naturellement", simule des comportements
fictifs, joue tre autre chose que ce qu'il est. Chez l'adulte, ce jeu se
transforme, Freud et Winnicott l'ont montr en rverie veille, en exploration
de son "aire transitionnelle' bauches de fiction o le sujet aime figurer. Tous
les ges de la vie se rvlent sensibles la fictionnalisation de soi, qu'il
s'agisse de la produire ou de la recevoir. L'exprience humaine cre par
consquent en chacun le lieu d'un accueil pour l'autofiction. Ceci explique qu'un
agencement en apparence impossible, faisant appel des moyens discursifs
antagonistes, produise un effet rel. L'agencement d'nonciation de l'autofiction
n'est pas homogne, il fait fonctionner ensemble des lments contradictoires.
Mais son enracinement anthropologique permet leur ajustement et leur
co-fonctionnement. L'autofiction trouve ainsi son origine et sa permanence dans
le discours et l'exprience humaines, tout simplement.
En rsum, il faut donc noter que l'autofiction n'est pas un genre, sous
quelque forme que ce soit ; il s'agit tout au plus d'un agencement discursif
autour duquel se sont rencontrs un certain nombre d'crivains et d'une
catgorie de lecture en train d'merger. Certes, rien ne dit que le nom "auto-
fiction" et l'intrt que la chose suscite, ne se rpercuteront pas sur les
pratiques venir et ne permettront pas la cristallisation d'un genre. Mais en
attendant, il serait sage de ne pas hypostasier cette posture d'nonciation et de
suivre cet avertissement de Lichtenberg, qui l'empruntait lui-mme au Novum
337
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Organum de Bacon : "L o l'homme aperoit un tout petit peu d'ordre, il en
suppose immdiatement trop".
338
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
C 0 N C L U S I 0 N
FICTIONNALISATION RESTREINTE ET
FICTIONNALISATION GENERALISEE
La marque mme d'une profonde nouveaut, c'est
son pouvoir rtroactif .
M. Butor.
339
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Soucieux de suivre le conseil de Bacon, on ne cherchera pas imposer
un semblant d'ordre nos rsultats, on ne tentera pas une synthse finale. Non
pas que la "compulsion de synthse" nous paraisse une propension
dangereuse, mais parce que son exercice n'apporterait rien cet essai. Pas
davantage, on ne ratiocinera sur l'avenir de l'autofiction si cette pratique semble
"prendre", rien ne permet de s'riger en prophte et de lui annoncer l'avenir
radieux d'un genre littraire.
Par contre, on tentera de prendre du champ en s'attardant sur lintrt
que peut reprsenter la notion d'autofiction pour les tudes littraires, pour une
meilleure comprhension du discours littraire et de ses nonciations
singulires. On voudrait montrer le caractre heuristique de cet objet pour la
thorie littraire et l'efficacit de son identification pour la lecture critique des
uvres. Ce sera l'occasion la fois de replacer l'autofiction dans l'ensemble de
la littrature, comme y invitait la rflexion de Barthes, et de tracer les limites de
notre recherche.
En quoi l'autofiction peut servir la recherche en littrature ? Il nous
semble qu'elle constitue une puissante incitation la rflexion thorique, qu'elle
fonctionne comme un instrument extrmement sensible pour enregistrer les
points nvralgiques du discours littraire. On se sera peut-tre tonn de la
multitude des problmes de fond rencontrs au cours de ce travail. L'tude de
l'autofiction conduit comme invitablement entrecroiser des problmatiques
distinctes : problmatique de l'onomastique littraire, du personnage, de la
thorie et de la description de la fiction, des stratgies discursives et de leur
volution, des effets de lecture et de la rception, de l'auteur et de la nature de
l'activit littraire, problmatique si complexe, enfin, de l'histoire littraire.
Non sans raison, on pourrait penser que ces rencontres ont t trop
nombreuses pour tre fructueuses. Toutes ces problmatiques constituent
souvent elles seules des domaines de recherche autonomes, dont certains
sont peine explors. De fait, cette confrontation ne fut pas toujours facile. On
a parfois procd des simplifications dommageables, propos des solutions
qui paratront simplistes, nglig des aspects importants. Ainsi pour la tentative
d'adapter la notion confuse de personnage notre projet ; pour l'examen des
modalisateurs fictionnels et de la nature de la fiction, qui demanderait tre
enrichi par des travaux rcents ; pour notre mise au point sur l'opposition entre
340
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
la fiction et la rfrence dans l'histoire littraire. Ces limites ne soulignent
pourtant que davantage le caractre roboratif de cet objet pour la recherche
thorique et potique. Comme si l'autofiction tait aux confluents des sources
les plus ncessaires du discours littraire.
A quoi tient cette fcondit thorique ? Sans doute faut-il prendre en
compte le fait que l'autofiction est une pratique, sinon gnrique, du moins
d'ordre gnrique. L'tude d'une stratgie d'criture globale engage forcment.
directement ou non, la totalit du discours littraire. Mais cela ne serait pas
aussi tangible si l'autofiction n'tait pas une pratique mettant en jeu le mode de
fonctionnement le plus intime de la littrature d'imagination. Si elle est aussi
paradoxale, si elle met en cause autant d'aspects de la littrature, c'est qu'elle
ne fait au fond qu'exorbiter une logique intrinsque de son nonciation
imaginaire.
Expliquons-nous. Lors de l'analyse des "emplois" possibles de la figure
auctoriale, on a vu que le rcit ne faisait pas disparatre proprement parler
l'auteur, comme l'a cru un peu vite notre modernit, mais qu'elle le dotait d'un
statut et dun rle propres la narration. Dans la narration fictionnelle
htrodigtique, l'auteur adapte sa voix la fiction d'un rcit, en mme temps
qu'elle lui sert drouler un rcit de fiction. C'est ce phnomne qui a interdit la
prise en compte d'une doublure htrodigtique de l'auteur, d'une
autofiction qui fonctionnerait au seul niveau de la narration. Il est temps
cependant de noter que cette transformation de l'auteur en narrateur est une
sorte de fictionnalisation, une fictionnalisation de soi restreinte. Comme dans
l'autofiction. l'crivain se ddouble dans le texte, et son double conserve son
identit, mais en tant mtamorphos, dpersonnalis, dot d'un emploi fictif de
conteur, quoiqu'il n'intervienne pas dans l'histoire. Cette transformation
fictionnelle s'exerce-t-elle dans tous les types de rcit ? On peut douter en effet,
d'une irralisation comparable si le narrateur htrodigtique est imperceptible
comme chez Hemingway, davantage encore si le narrateur est homodigtique,
si c'est un narrateur-personnage avec une identit propre.
Pour le premier cas, il faut rappeler avec Genette que le rcit est toujours
un "discours", un "acte de communication". ce qui implique un sujet de
l'nonciation, qu'on appelle "auteur" :
341
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
"Dans le rcit le plus sobre, quelqu'un me parle, me
raconte une histoire, m'invite l'entendre comme il la
raconte, et cette invite - confiance ou pression - constitue
une indniable attitude de narration, et donc de narrateur :
mme la premire phrase de The Killers tarte a la crme
du rcit 'objectif', 'The door of Henrys lunch-room
opened... prsuppose un narrataire capable entre autres
d'accepter la familiarit fictive de 'Henry', l'existence de la
salle--manger, l'unicit de sa porte, et ainsi, comme on
dit fort bien, d'entrer dans la fiction" (1983, p. 68).
Ainsi, mme quand la prsence du narrateur est insensible, l'irralisation
de l'auteur est effective, c'est mme le comble de l'irralisation si on y rflchit.
On a alors comme le degr zro de la fictionnalisation de soi, une mutation o
le rcit parat s'noncer de lui-mme et l'auteur avec le narrateur s'tre
vanouis.
Est-ce vrai aussi des rcits narrateur homodgtique ? Assurment,
ceci prs que cette fois le terre de dralisation conviendrait mieux. Dans le
roman pseudo-autobiographique, l'crivain feint de laisser parler un autre sa
place, ce qui produit l'imitation d'un acte de langage, au lieu d'une mimsis de
ralit. Mais il est toujours partie prenante dans une situation de
communication, engag dans un procs pragmatique, bien qu'il s'avance
masqu et qu'il fasse comme s'il cdait la direction du rcit autrui. Et le lecteur
est bien conscient de ce simulacre. S'il accorde sa crance Robinson Cruso
ou Meursault, il ne considre pas pour autant leur nonciation comme
srieuse. Bien plus, si le lecteur venait oublier la simulation de l'crivain, s'il
oubliait totalement son existence, il n'y aurait plus imitation d'une posture de
communication (fiction), mais acte de communication authentique
(l'autobiographie relle de Robinson ou de Meursault). Paradoxalement, c'est
donc l'assomption d'un auteur qui supporte la fictionalit d'un roman
pseudo-autobiographique et d'un auteur qui simule, qui joue faire parler un
autre - sans quoi il n'y aurait pas roman, mais construction dlirante.
Dans toutes les formes de rcit, la logique fictionnelle produit donc, dj,
en-dea de toute mise en scne dans l'intrigue, une drive imaginaire, de
nature pragmatique, de l'crivain. Au cur de l'invention littraire, entre celui
qui raconte et ce qui est racont, une attraction irrpressible a lieu, qui
transmue l'crivain en tre(s) fictif(s), qui amne une surdtermination
d'imagos. Selon le systme de narration choisi, ces ddoublements vont varier
342
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
considrablement et se faire ressentir diffremment. Dans tous les cas, il va
s'agir de rles, de positions discursives ou narratives, qu'il ne faudrait pas
confondre avec l'crivain rel, qui apparat en priv ou en public. Le sujet qui
circule ainsi, qui se divise, sirralise ou se dralise, se transforme en tout cas,
conserve pourtant la mme identit, celle de l'crivain rel. Il appert ainsi toute
fiction fictionnalise le sujet qui la profre. En crivant et en signant une uvre
d'imagination, l'crivain est dj dans le "fictif de l'identit". Mais cette fictionna-
lisation a une porte restreinte ; elle doit tre dchiffre par le lecteur ; elle n'est
pas directement reprsente comme dans l'autofiction. Car elle n'est pas
incarne, personnalise, actorialise . Sans cho dans l'histoire, le
ddoublement de l'auteur n'a pas d'paisseur : son double n'a aucune fonction
digtique et n'est pas un vritable personnage de fiction.
Cette forme rduite de fictionnalisation n'est toutefois pas totalement
trangre, totalement spare de l'histoire. Autrement dit, le statut imaginaire
du narrateur ou de l'auteur n'est jamais compltement coup de la ralit
imaginaire des personnages et de leur monde. C'est trs net dans le roman
pseudo-autobiographique, comme dans le roman pistolaire, qui saccompagne
souvent d'une prsentation fictive par laquelle l'crivain se donne le rle d'un
diteur ou invente un contexte justifiant l'htrologie du rcit - comme le font
Defo pour Robinson ou Sartre pour La Nause. Quand ce n'est pas le cas
comme dans L'tranger de Camus, cette absence n'est pas insignifiante ; elle
souligne cela mme qu'elle prtend esquiver, manifestant ainsi en creux
l'existence d'une relation entre le signataire du livre et un certain Meursault.
Dans le rcit htrodigtique, la proximit du narrateur son univers ima-
ginaire est sensible par le fait que le temps de la narration peut toujours arriver
rattraper celui de l'histoire et crer ainsi de lgres confusions de niveaux
narratifs. Il suffit d'ouvrir au hasard Tom Jones de Fielding pour en trouver :
"Nous avons laiss M. Western, sa sur Sophie et le vicaire Supple retournant
ensemble au chteau? La soire se passe gaiement" (Livre VI, dbut du
chapitre 2). La possibilit d'un tel tlescopage atteste que le narrateur est en
permanence contigu a sa fiction dans cette forme de rcit. D'une faon
gnrale, il y a donc bien une relation de voisinage, extradigtique ou
intradigtique, entre l'auteur et son univers fictif. Ce sont les structures mmes
de la langue et de la narration qui favorisent une telle mitoyennet.
343
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
La manire dont les crivains vivent et pensent ce voisinage intime avec
la fiction, dont les lecteurs se reprsentent ce contact, a t peu tudie.
Pourtant, il y a. l un thme mtalittraire qui mriterait un examen attentif, par
ce qu'il peut apprendre sur la place et le rle de la fiction dans l'imaginaire d'une
poque ; ce qui ne peut manquer d'intresser la constitution d'une perspective
historique pour tudier l'autofiction.
Au XIXe sicle, par exemple, cette proximit semble avoir t ressentie
avec une acuit toute particulire, comme une sorte de contagion. Le cas de
Balzac est bien connu. Ds 1821, alors qu'il n'est qu'un crivain dbutant, il
crit sa sur Laure : "Depuis que je m'en suis aperu, je me tiens en garde
contre l'intemprance de l'imagination". Dans sa Thorie de la dmarche, il
formule la fameuse parabole du fouet du savant, qui peut se lire comme
l'alternative qui se pose a tout crivain face sa cration : le choix du fou qui
dcouvre un abme et y tombe ou celui du savant qui le mesure et remonte
chez lui en se frottant les mains. A propos de La comdie humaine, il crira un
jour qu'il avait port une socit tout entire en lui. Et sur son lit de mort, la
lgende l'affirme, c'est Bianchon qu'il demandera. Mais au-del de la lgende,
appele ou posthume, Balzac a tenu exhiber cette contagion de la fiction
dans sa propre criture. Parfois en la thmatisant explicitement, comme dans la
Prface Histoire des Treize, o il se prsente comme l'historiographe d'un de
ses personnages, inversant le processus gntique de l'art romanesque pour
se donner comme la consquence, un effet de sa fiction ; dans plusieurs motifs
de son uvre, ns de cette exprience vcue si intensment de l'irralisation
qu'entrane un travail cratif forcen : le fameux don de double vue ou le motif
de la vie vcue par procuration, formuls en des termes emprunts au registre
littraire et qui sont si insistants dans ses romans. D'autres fois, par une sorte
de marquage systmatique de ses histoires, comme dans ces multiples
chevilles ou parenthses mtadiscursives, par lesquelles ses romans se
renvoient les uns aux autres, rfrent la totalit qui les subsume, qui lui
permettent de s'impliquer directement dans l'acte narratif de ses histoires.
Plus fascinant encore, bien sr, est le cas de Nerval, qui lve cette
contagion au phnomne de possession. Vcu plus intensment et plus
consciemment, la dralisation littraire lui a permis des pages inspires. Dans
la ddicace Alexandre Dumas, cite plus haut, il signale l'effet d'identification
dont l'criture narrative se rvle parfois responsable. Obsession, vertige,
344
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
dsordre mental, cet "panchement du songe dans la vie relle" lui parait un
vritable risque pour l'crivain. Dans Les Illumins, publi deux ans plus tt, il
avait dj abord ce thme. Avec son tude sur Restif, certes, o il cite un
passage tonnant que nous avons mis en exergue a cet essai : "On croit
s'instruire par les fables : eh bien Moi, je suis un grand fabuliste qui instruit les
autres ses dpens...". Mais aussi dans sa prsentation de Cazotte o il dcrit
l'auteur du Diable boiteux comme tant, par excellence, le pote qui croit
sa fable, le narrateur qui croit sa lgende, l'inventeur qui prend au srieux le
rve clos de sa pense... (1852, pp. 272-273) et o il affirme que c'est l
le plus terrible danger de la vie littraire, celui de prendre au srieux ses
propres inventions... Il (p. 280). Cette pathologie de la fiction qui guette
l'crivain n'est pas une mystification, ni le simple rve d'un pote. Plus d'un
sicle plus tard, dans un contexte culturel pourtant diffrent, l'auteur du fameux
roman de science-fiction Ubik, Ph. K. Dick, a prononc Metz, en 1977, un
discours de plus de deux heures o il affirmait, devant une assemble
mduse, la ralit de ses univers parallles et de ses rencontres personnelles
avec Dieu. Cette contamination fictionnelle fait un curieux pendant aux
identifications pathologiques causes par la lecture romanesque,
emblmatises par la figure du Quichotte. Plus rare, moins perue peut-tre,
cette maladie littraire ne semble gure avoir t dnonce ni analyse. Dans
l'imaginaire occidental, elle n'occupe pas, en tous cas, la place du thme sym-
trique des dangers de la lecture.
Mais ce qui nous intresse chez Nerval, c'est qu'il unit d'un trait la
conscience de la contagion fictionnelle qui guette l'exercice de la cration
littraire et la pratique dlibre, consciente, d'une forme d'criture qui assume
et recherche ce risque : la fiction de soi. Avec Nerval, on a l'exemple rare d'un
crivain qui a tent cette aventure fictionnelle en l'articulant directement sa
prsence informelle dans la fiction littraire. Son uvre permet ainsi de
comprendre que l'autofiction n'est qu'un passage la limite d'un phnomne
inhrent l'invention littraire, qu'elle n'est que la gnralisation d'une
fictionnalisation produite sous une forme restreinte par toute fiction : lorsque
l'intrigue met nominalement en scne l'crivain, cest l'criture comme
processus de dralisation ou d'irralisation qui se reprsente, en l'incarnant et
en le redupliquant. D'o, sans aucun doute, cette propension de l'autofiction
soulever, l'analyse, autant de questions thoriques gnrales. Vritable
compendium de cette activit fascinante qu'est la cration littraire, elle ras-
345
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
semble et noue autour de son existence improbable tous les fils du discours
littraire.
Car comme on le verra plus loin, ce ddoublement entrane avec lui les
principaux ples de l'activit littraire. Tout peut faire problme dans un texte
qui actualise le dispositif de l'autofiction. Selon les choix de l'crivain, dans sa
ralisation des protocoles, dans son ddoublement fictionnel, dans l'histoire
conte, c'est le paratexte, l'auteur, le personnage, les indices de fictionalit, la
place du lecteur, l'effet de lecture ou la stratgie discursive qui sera soumis un
travail de dplacement important, un par un, plusieurs en mme temps ou tous
ensemble. L'autofiction apparat ainsi comme une machine problmatiser les
conventions, les attitudes et les attentes reues en matire littraire ; comme
une machine duplexer les failles caches, les antinomies rentres, sur les-
quelles s'est btie la fiction.
Cette vocation des nonciations singulires qui travaillent la possibilit
du dispositif autofictif, qui l'incarnent, le portent, le poussent en avant,
l'exprimentent, bref le ralisent, va permettre de se demander en quoi la notion
dautofiction peut aider la recherche empirique sur la littrature, la critique
d'auteurs. Disons-le sans ambages, l'autofiction, la conscience de son
existence, des multiples modalits de son effectuation, de sa rcurrence, nous
parat tre un puissant instrument danalyse pour quantit d'crivains qui ont
peru, recherch, exploit, parfois sous-estim parfois conjur les vertiges de la
fiction.
Cette affirmation vise naturellement tous les crivains insolites, rputs
inclassables, comme Restif, Nerval, Cendrars ou Gombrowicz et, pour citer des
contemporains immdiats, Copi, Sollers, Charyn, Salinger, que les outils
d'analyse ordinaires chouent cerner. Pour tous ces crivains en marge des
partages traditionnels, en rupture par rapport aux systmes de communication
conventionnels, le mode de la fictionnalisation donne, directement ou par
comparaison, des moyens pour aborder positivement leur excentricit. Alors
que la plupart des lectures de leur uvre mconnaissent leur dtermination
fictionnalisante, ce modle permet de leur donner comme un coefficient de
fictionnalisation, de formuler les coordonnes de leur drive nonciative. Loin
de s'engluer dans des notions inconsistantes comme celles de "roman
insincre" ou de l'autobiographie mensongre". d'annuler la fermet de leur
programme en les mettant au compte du fantasme, de la posie, du dlire, de
346
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
lsotrisme ou d'une lubie personnelle, ce modle ouvre sur une analyse qui
prend au srieux leur "torsion" fictionnelle, apporte une valeur l'inconnue qui
travaille leur lisibilit.
Au demeurant, mme chez des crivains moins atypiques, il n'est pas
rare que l'on dcouvre, dans un coin de leur corpus, un texte frapp d'un tel
coefficient de fictionnalisation, quand bien mme sa teneur ne serait pas
vritablement autofictive, comme L'Impromptu de Versailles chez Molire, Ren
chez Chateaubriand ou Giacomo Joyce chez l'auteur d'Ulysse. Par sa
disponibilit fonctionnelle, le dispositif de l'autofiction se montre alors utile pour
considrer ces textes dcrts mineurs dans leur monumentalit , des
uvres au sens fort du terme, mme si leur situation marginale est
incontestable, et qui peuvent en dire long malgr leur dcentrement.
Aussi bien, l'intrt du modle autofictif ne se limite pas des cas-limites
d'criture fictionnelle. Il peut aussi ouvrir de nouvelles perspectives sur des
crivains et des uvres jugs "classiques", tort ou a raison, comme Lucien,
Dante Diderot, Proust etc. On n'a pas assez soulign que quelques-uns des
textes les plus considrables de notre panthon littraire appartenaient ce
registre impossible. Toutes ces uvres qu'on ne finit pas de clbrer,
d'interroger, de commenter et/ou de traduire, hantent notre culture sans que
pourtant on accueille pleinement, en toute connaissance de cause, leur
remaniement commun des catgories d'auteur, de registre et de position d'-
nonciation. L'conomie de cette orchestration parat comme occulte, relgue
et finalement refoule sous la forme d'un reste que l'on signale, sans lui donner
une place ou il existerait pour lui-mme et avec des effets qui lui seraient
propres.
Sans doute, notre approche de tous ces crivains, de toutes ces
nonciations dcales, parfois isoles, parfois dresses en stratgie d'criture,
a d paratre souvent sommaire, souvent partielle. Notre travail a consiste en
grande partie a identifier et mettre en perspective leur rupture. Sur bien des
points, ces analyses sont insatisfaisantes : il faudrait une tude plus complte
et plus spcifie des effets du dispositif quand il est actualis de faon
complexe, par toutes les formes possibles dhomonymie indirecte ; les cas
ambigus mriteraient de plus une tude plus fine ; Ia fonction figurative est
dcrite, enfin, dune faon trop gnrale, qu'il serait ncessaire d'ajuster la
matire, aux enjeux et l'conomie de chaque crivain. Reste que le cadre trs
347
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
gnral de cette recherche rendait difficile un abord spcifique de chaque cri-
vain d'autofiction. En outre, ces limites ne remettent pas en cause, nous
semble-t-il, la validit empirique de notre modle. Si elles pchent, c'est par leur
caractre approximatif, mais elles nous paraissent dans l'ensemble s'avancer
dans une direction qui est bien celle emprunte par ces uvres.
La fertilit empirique de cette forme de fiction n'est pas non plus un
hasard, bien qu'elle ne tienne pas au fait que l'autofiction soit un prtendu
modle d'criture cach, travaillant en secret l'histoire. Elle vient aussi de cette
mise plat et de cette rduplication de la logique inhrente la littrature
d'imagination qu'on a signale prcdemment. Dans cette opration, les trois
sommets du triangle pragmatique qui structure le procs de communication
littraire (lauteur, la mode discursif et le lecteur) sont soumis un travail de
transformation important.
Ces trois sommets, tout crivain doit s'y confronter, y engager son
criture, ses enjeux personnels et son "programme" littraire, en les acceptant
tels qu'il les a hrits ou en les transformant. Ce sont les limites extrmes de la
littrature, les bords o s'labore son discours ; ce par quoi elle s'effectue
s'actualise et se pense des bordures presque insondables la limite du
pensable, prilleuses, la frontire entre le sens et le non-sens, la cohrence
et l'informe, la communication et le bruit ; aux confins de la narration et de la
reprsentation. Par suite, il n'est gure tonnant qu'autant de textes
considrables, avec lesquels notre Culture doit compter, s'oprent dans
l'espace de cette situation d'nonciation limite qu'est l'autofiction. Car qu'est-ce
qu'un crivain insolite, dont la rception fait problme ? Qu'est-ce qu'un "grand
crivain", dont la rception est inpuisable ? Sinon quelqu'un qui touche aux
ressorts fondamentaux du procs littraire, soit en les troublant, soit en les
transformant considrablement, soit les deux la fois ? Le rappel de ce truisme
explique que notre modle ait un pouvoir rtroactif aussi fort, qu'il puisse s'ap-
pliquer des crivains aussi diffrents, d'poques si diverses, de cultures si
varies. Bien qu'il n'ait aucune porte explicative, qu'il ne soit qu'une forme
vide, ce modle d'nonciation renferme les paramtres essentiels l'acte
littraire, qui traversent les gnrations, les poques et les pistms, comme
toutes les formes discursives fondamentales. C'est ce qui explique le caractre
polyvalent du dispositif, capable de remplir des fonctions diverses, et mme
contradictoires, comme on l'a vu en tudiant ses usages rfrentiel et rflexif.
348
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Mais au sein mme de la fonction figurative, d'une fictionnalisation de soi
obissant une vise purement fictionnelle, le dispositif autofictif doit obir
des enjeux littraires diffrents, recevoir des expressions idologiques varies
et s'oprer sur l'horizon de conceptions du monde htrognes. Qu'un auteur
latin comme Lucien ralise, avec son Histoire vritable, une autofiction
dclare, dans une pistm o la fable a un visage autre que celui que nous
lui connaissons, le montre. L'une des limites de cette recherche est de n'avoir
pas pu marquer cette htrognit. Mais en l'absence dune pragmatique
littraire historique, cette limite tait peut-tre invitable.
Simple exfoliation du champ pragmatique, l'autofiction se prsente ainsi
comme une situation d'nonciation indite, qui vient faire clater une dichotomie
rductrice : littrature vcue ou littrature d'imagination ? Cet clatement libre
de bien des faux problmes et promet un vaste champ de recherches
thoriques et d'analyses empiriques. Avec cette forme inopine de fiction, la
littrature montre que, depuis trs longtemps, sa mthode et sa russite sans
faire sauter les "crans d'arrt et les verrous de sret du discours et du
langage.
Aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau ? Oui, mais l'inconnu
est aussi autour de nous, ct de nous, en nous : "Pourquoi chercher du
neuf? Tout est neuf", disait un philosophe.
349
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
B I B L I 0 G R A P H I E
"To love oneself is the beginning
of a life-long romance."
0. Wilde
350
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Cette liste a t limite aux ouvrages cits ou analyss, dont les rfrences
n'ont pas t donnes dans le texte. Ils ont t rpartis sous trois rubriques :
corpus des textes o l'auteur se fictionnalise; ouvrages thoriques et critiques;
ouvrages littraires. Pour la premire section, on a indiqu trs grossirement
la fonction de la fictionnalisation: (+) quand elle est rfrentielle (didactique ou
biographique), (=) quand elle est rflexive et (*) si elle est figurative. Mais il ne
s'agit jamais que d'une dominante, certains textes sont ambigus.
351
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
I- C 0 R P U S
"Je trouve la lettre K repoussante, presque
rpugnante, et pourtant je l'cris, elle doit me
caractriser".
F. Kafka.
352
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- A -
- Ablard P., Dialogue entre un juif, un philosophe et un chrtien, in Oeuvres
choisies, Tr. M. de Candillac, Aubier, 1945, (+).
- Alain, "Denys ou l'Ambitieux", La Nouvelle Revue Franaise, n292,
avril 1977, (+).
- Anouilh J., La Grotte, Gallimard, Coll. Folio, 1977, (+).
- Auster P., Cit de verre, Tr. P. Furlan, Actes Sud, 1987, (*).
- B -
- Balzac H. de, Facino Cane, Luvre de Balzac, t.2, Le Club franais du livre,
1953, (*).
- Bastide F-R., La Vie rve, Seuil, 1962, (+).
- L'Enchanteur et nous, Grasset, 1981, (+).
- Blondin A., Monsieur Jadis ou l'Ecole du soir, La Table ronde, 1970, (+).
- Borges J.L., "L'Aleph" in L'Aleph, Tr. R. Caillois et R.L.-F. Durand, Gallimard,
1967, (*).
- Brink A., Le Mur de la peste, Tr. J. Guiloineau, Stock, 1984, (+).
- Bryce-Echenique A., La Vie exagre de Martin Romaa, Tr. J.M.Saint-Lu
Luneau Ascot ed., 1983, (*).
- Butor M., L'Emploi du Temps, Minuit, 1956, (+). Matire de rves, Gallimard,
1975-1985, 5 vol.,(+). Troisime dessous, 1977, est le III vol. de ce cycle.
- C -
- Calvino I., Si par une nuit d'hiver un voyageur, Tr. D. Sallenave et F. Wahl,
Seuil, 1981, (=).
- Cavanna, Maria, Belfond, 1985, (*).
353
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- Cendrars B., Moganni Nameh, (*). o.c.t.4, L'Eubage, o.c.t.2, (*). Moravagine,
o.c.t.2, (*). Une nuit dans la Fort, o.c.t.7, (+). Bourlinguer, o.c.t.6, (+).
Emmne-moi au bout du monde!.... o.c.t.7, (=). Il s'agit de l'dition Denol en
huit volumes (1960-1965).
- Cline L.-F., L'Eglise, Gallimard, 1952, (*). Voyage au bout de la nuit, in
Romans, Bibl. de la Pliade, t.I, 1981, (*). Mort Crdit, Pliade, t.I, (*).
Normance, Gallimard, Coll. Folio, 1978, (*). D'un Chteau l'autre, in Romans, t.
II, Bibl. de la Pliade, 1974, (*). Nord, Pliade t. II, (*). Rigodon, Pliade t. II, (*).
- Cervants M. de, L'Ingnieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, tr J.
Cassou, C. Oudin et F. Rosset, Bibl. de la Pliade, 1976, (=).
- Chamson A., "Le Dernier village" in Suite guerrire, Plon, 1975, (+).
- Charyn J., Poisson-chat, trad fr. D. Mauroc, Seuil, 1982, (*).
- Chateaubriand R.-F. de, Ren, in Atala-Ren, Flammarion, Coll. GF, 1964,
(+).
- Cohen A., Mangeclous, Gallimard, Coll. Folio, 1980, (=). Belle du Seigneur,
Gallimard, 1968, (=).
- Colette, La Retraite sentimentale, Gallimard, Coll. Folio, 1972, (=). Le
Miroir , in Sido suivi de Les Vrilles de la Vigne, Hachette, Coll. Le Livre de
Poche, s.d., (=).
- Copi, La Guerre des Pds, A. Michel, 1982, (*).
- D -
- Dante, La Divine Comdie, Tr. A. Masseron, Albin Michel, 1950, (?).
- Diderot D., Paradoxe sur le comdien, (*). Rve de d'Alembert, (*). Entretien
sur le "Fils naturel", (*). Entretien avec d'Alembert, (*). Le Neveu de Rameau,
(*). Bibl. de la Pliade, 1957.
- Doubrovsky S., Fils, Galile, 1977, (+). Un Amour de soi, Hachette, 1982, (+).
La Vie l'instant, Balland, 1985, (+).
354
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- Duras M., "Albert des Capitales" in La Douleur, P.O.L., 1985, (+).
- F -
- Fontenelle, Entretiens sur la pluralit des mondes, Marabout, 1973, (+).
- Franois J., Joue nous "Espa",. Mercure de France, 1980, (+).
- Fuantes C.,.Une Certaine parent, Trad. fr. C. Zins, Gallimard, 1981, (*).
- Futoransky L., Chinois chinoiseries, trad. fr. A. Morvan, Actes Sud, 1984, (+).
De Pe a Pa (0 de Pekin a Paris), Anagrama, 1986, Barcelone, (+).
- G -
- Gide A., Paludes, Gallimard, Coll. Folio, 1973, (*). Les Faux-Monnayeurs,
Gallimard, Coll. Folio, 1972, (*).
- Giraudoux J., Siegfrid et le Limousin, B. Grasset, Coll. Le Livre de Poche,
1956, (*). Sodome et Gomorrhe, B. Grasset, 1969, (*).
- Genet J., Miracle de la rose (1946), Gallimard, Coll. Folio, 1977,
Notre-Dame-des-Fleurs (1948), Gallimard, Coll. Folio, 1978, (*). Journal du
voleur, (1949), Gallimard, Coll. Folio, 1982, (*). Pompes Funbres (1953),
Gallimard, Coll. L'imaginaire, 1981, (*).
- Gombrowicz W., Ferdydurke, Tr. G. Sdir, 10/18, 1973, La Pornographie, Tr.
G. Lisowski, Ren Julliard, 1962, (*). Cosmos, Tr. G. Sdir, Denok, Coll. Les
Lettres nouvelles, 1966, (*). Trans-Atlantique, Tr. C. Jelenski et G. Serreau,
Denol, Coll. Les Lettres nouvelles, 1976, (*). L'Histoire (Operette), Tr. C.
Jelenski et G. Serreau, Ed. de la diffrence, 1977, (*).
- Grgoire le Grand, Li Dialoge Gregoire Lo Pape, Ed. de W. Foerster, Appert et
Champion, Halle et Paris, 1876, (+).
355
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- H -
- Hamsun K., Sous l'toile d'automne, Tr. R. Boyer, Calmann-Levy, 1978, (*). M.
Un Vagabond joue en sourdine, Tr. R. Boyer, Calmann-Levy, 1979, (*). La
Dernire joie, Tr. R. Boyer, Calmann-Levy, 1979, (*).
- Hesse H., Le Loup des steppes, Tr. J. Pary, Calmann-Levy, 1947, (*).
"Enfance d'un Magicien" et "Esquisse d'une autobiographie", in Enfance d'un
magicien, Tr. E. Beaujon, Calmann-Levy, 1975, (*).
- I -
- Isherwood C., Adieu Berlin, Tr. L. Savitsky, Hachette, 1979, (*). Christopher
et son monde, Tr. L. Dil, Hachette, 1981, (+).
- J -
- Jean-Paul, Biographie conjecturale, Tr. R. Pierre, Aubier, 1981, (*).
- Joyce J., Giocomo Joyce, Tr. A. du Bouchet, Gallimard, 1973, (?).
- K -
- Kafka F., Le Procs, Tr. A Vialatte, Gallimard, 1957, (*). Le Chteau, Tr. A.
Vialatte, Gallimard, 1965, (*).
- Kierkegaard S., In Vino Veritas, in Le Stade esthtique, Tr. M. Grimault, 10/18,
1966, (*).
- L -
- Lacarrire J., Le Pays sous l'corce, Seuil, 1980, (*).
356
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- Larbaud V., A.O. Barnabooth, Son Journal intime, La Nouvelle Revue
Franaise, 1922, (*).
- Leibniz G.W., Nouveaux essais sur l'entendement humain, Tr. J. Brunschwig,
Garnier-Flammarion, 1966, (+).
- Leiris M., Aurora, Gallimard, 1973, (*).
- Llosa M.V., La Tante Julia et le scribouillard, Tr. A. Bensoussan, Gallimard,
1979, (*).
- Loti P., Aziyad, Calmann-Levy, Coll. Le Livre de Poche, 1974, (*). Le Mariage
de Loti, Calmann-Levy, Coll. Le Livre de Poche. 1976, (*). Mon frre Yves,
Calmann-Levy, s.d., (*).
- Lucien, Histoire Vritable, Tr. P. d'Ablancourt, Presses Universitaires de
Nancy, 1984, (*).
- M -
- Mann Th., Les Buddenbrook, Tr. G. Bianquis, Arthme Fayard, 1965, (+).
- Marguerite de Navarre, Dialogue en forme de vision nocturne, Ed. critique de
R. Salminen, Suomelainen Tiedeakatemia, Helsinki, 1985, (+).
- Molire, L'Impromptu de Versailles, o.c.t.I, Classiques Carnier, 1962, (+).
- N -
- Nabokov V., Regarde, regarde les arlequins !, Tr. Fr., Fayard, 1978,(*).
- Nerval G., Les Filles de Feu (1854), (*), Aurlia (1855), (*) Oeuvres,
Classiques Garnier, 1966.
357
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- P -
- Perec G., La Boutique obscure, Denol-Gonthier, Coll. "Cause commune".
1973, (+). La Vie mode d'emploi, Hachette, 1978, (=).
- Perron E. du, Le Pays d'origine, Tr. Ph. Noble, Gallimard, 1980, (*).
- Proust M., A la recherche du temps perdu, Bibl. de la Pliade, t.I-III,
1955-1956, (*).
- Q -
- Queneau R., Les Enfants du limon, Gallimard, 1938, (=).
- R -
- Restif de la Bretonne, Le Paysan perverti, 10/18, 1978, Ingnue Saxancourt,
10/18, 1978, (+). Rolin D., L'Infini chez soi, Denol, 1980, (+). Le Gteau des
morts, Denol, 1982, (*).
- Rousseau J.-J., Rousseau juge de Jean-Jacques, (+) in Confessions - autres
textes autobiographiques, Bibl. de la Pliade, 1951.
- S -
- Salinger J.D., Seymour, une introduction, Tr. B. Willerva, Robert Laffont, 1964,
(*).
- Sollers Ph., Une Curieuse solitude, Seuil, 1958, (*). Femmes, Gallimard, 1983,
(*). Portrait du joueur, Gallimard, 1984, (*). Le Coeur absolu, Gallimard, 1987,
(*).
- Strindberg A., L'crivain, (+), in Dans la Chambre rouge, Tr. A. Jolivet, Stock,
1949.
358
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- T -
- Terz A., Andr-la-Poisse, Tr. L. Martinez, A. Michel, 1981, (*).
- Thieuloy J., Les Os de ma bien-aime, Balland, Coll. L'instant romanesque,
1980, (*).
- Thomas D.M., Poupes russes, Tr. B. Matthieussent, Presses de la
Renaissance, 1985, (+).
- Tournier M., Les Mtores, Gallimard, 1975, (=).
- V -
- Varron, Economie rurale - Livre II, Tr. C. Guiraud, Les Belles Lettres, 1985,
(+).
359
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
II - 0 U V R A G E S L I T T E R A I R E S
"Rien n'est aussi difficile que de ne pas porter un pli ou
un faux pli mental et les citations sont un pliss la mode
scholastique. C'est du galon que l'on se donne. Comme
une plume surnumraire qu'une femme plante dans son
chapeau dj trop bien garni, de paradis d'autruche, de
coq de roche ou un couteau de corbeau."
B. Cendrars.
360
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- B -
- Balzac H. de, Le Lys dans la valle, L'uvre de Balzac, t1, Le Club franais
du livre, 1953.
- C -
- Cendrars B., "Sous le signe de Franois Villon" (1952), La Table ronde n51,
1952.
- D -
- Da Ponte, Mmoires et livrets, Livre de Poche, 1980.
- Dumas A., Mes Mmoires, Denol, 1942.
- F -
- Fielding H., Tom Jones, Tr. H. de la Bdoyre, Julliard, Coll. Littrature, t 1-2,
1964.
- G -
- Goethe W., Torguato Tasso, Tr. M. Baucher, Bibliothque de la Socit des
tudes germaniques, IAC ed., 1949. Faust et le Second Faust, Tr. G. de Nerval,
Garnier, 1879. Posie et Vrit, Tr. P. du Colombier, Aubier, 1941.
- Gombrowicz W., Journal 1953-1956, Tr. A. Kosko, Julliard, Coll. Lettres
nouvelles, s.d.
361
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- H -
- Hemingway E., "Les tueurs" in Cinquante mille dollars, Tr. 0. de Weymer,
Gallimard, 1958.
- Hesse H., Le Jeu des Perles de Verre, Tr. J. Martin, Calmann-Levy, 1955.
- Hoppe C., "Ocre Rouge" in Ils vous donnent de leurs nouvelles (ouvrage
collectif), Ramsay/Denol, 1988.
- J -
- Jennings A., Hors la loi!, Tr. B. Cendrars, Grasset, 1936.
- Joly M., Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, Calmann-Levy,
Coll. Libert de l'esprit, 1968.
- Joyce J., Ulysse, Tr. A. Morel, S. Gilbert, V. Larbaud et J. Joyce, Gallimard,
1948. Le Chat et le Diable, Tr. J. Borel, Gallimard, 1966.
- K -
- Kafka F., Journal, Tr. M. Robert, Grasset, 1954.
- M -
- Maupassant, "L'volution du roman au XIX sicle" in Une Vie, Gallimard, Coll.
Folio, 1974.
- Molire, Les Femmes savantes in Oeuvres Compltes, t.2, Classiques
Garnier, 1962.
- N -
- Nerval G. de, Les Illumins (1852) in Oeuvres, Classiques Garnier, 1966.
362
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- P -
- Ptrarque, Canzoniere, Tr. F.L. de Gramont, Gallimard, Coll. Posie, 1983.
- R -
- Renan E., Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883), Garnier Flammarion,
1973.
- S -
- Stendhal, Racine et Shakespeare, Garnier-Flammarion, 1970.
363
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
III - 0 U V R A G E S T H E 0 R I Q U E S
E T C R I T I Q U E S
" ... Toute uvre d'art n'est que la somme ou le
produit des solutions d'une quantit de menues difficults
successives.
A. Gide.
364
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
- A -
- Aragon L., "Aprs-dire" (1971) in Blanche ou L'Oubli, Gallimard, 1971.
- Aristote, La Potique, Ed. R. Dupont-Roc et J. Lallot, Seuil, Coll. Potique,
1980.
- B -
- Barbris P., Balzac, Larousse, 1971.
- Barthes R., "crivains et crivants" (1960) in Essais critiques, Seuil, Coll. Tel
Quel, 1964. "Introduction l'analyse structurale des rcits" (1966) in G. Genette
et T. Todorov (ed), Potique du rcit, Seuil, Coll. Points, 1977. "La mort de
l'auteur"(1968) in Le Bruissement de la langue Seuil, 1984. S/Z, Seuil, Coll. Tel
Quel, 1970. Sade Fourier Loyola, Seuil, Coll. Points, 1971a. "Pierre Loti:
Aziyad" (1971b) in Le Degr zro de l'criture suivi de Nouveaux essais
critiques, Seuil, Coll. Points, 1972. Le Plaisir du texte, Seuil, Coll. Tel Quel,
1973. Roland Barthe , Seuil, Coll. crivains de toujours, 1975, Fragments d'un
discours amoureux, Seuil, Coll. Tel Quel, 1977. Leon, Seuil, 1978. La
Chambre claire, Cahier du Cinma, Gallimard-Seuil, 1980.
- Bateson G., "Vers une thorie de la schizophrnie" (1956) in Vers une
cologie de l'esprit t.2, Tr. F. Drosso, L. Lot et C. Cler Seuil, Coll. Recherches
anthropologiques, 1980.
- Beaujour M., Miroirs d'encre, Seuil, Coll. Potique, 1980.
- Beguin A., "Prface Louis Lambert" (1953a), L'Oeuvre de Balzac t.1, Le
Club franais du livre, 1953. "Prface Facino Cane" (1953b), L'Oeuvre de
Balzac t.2, Le Club franais du livre, 1953.
- Benveniste E., "Structure des relations de personne dans le verbe" (1946) in
Problmes de linguistique gnrale t.1, Gallimard, Coll. Tel, 1976.
365
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
366
- Biet C., Brighelli J-P. et Rispail J.-L., Alexandre Dumas, Gallimard Coll.
Dcouvertes, 1986.
- Blanchot M., Le Livre venir (1959), Gallimard, Coll. Ides, 1971.
- Blin G., Stendhal et les problmes du roman, J. Corti, 1954.
- Bloch E., Le Principe Esprance t.1, Tr. F. Wuilmart, Gallimard, 1976.
- Bonnet J.-C., "Le fantasme de l'crivain", Potique n63, Septembre 198?
- Booth W., The Rhetoric of fiction, Univ. of Chicago Press. 1961.
- Borges J.-L., Magies partielles du Quichotte in Enqutes 1937-1952, Tr. P.
et S. Benichou, Gallimard, 1957.
- Bourdieu P., Ce que parler veut dire, Fayard, 1982.
- Bozon-Scalzitti Y., Blaise Cendrars ou la passion de lcriture, L'Age
d'homme, 1977.
- Buber-Neumann M., Milena, Tr. A. Brossat, Seuil, 1986.
- Butor M., Michel Butor Voyageur la roue (Entretien avec J.M. le Sidaner),
Encre, 1979.
- C -
- Cabanis J., Plaisir de la lecture t.1, Gallimard, 1964.
- Camus A., "L'espoir et l'absurde dans Kafka", Essais, Bibl. de la Pliade.
- Canguilhem G., La Formation du concept de rflexe au XVII et XVIII sicles,
PUF,1955.
- Carrougues M., "Prface La Peau de Chagrin", L'Oeuvre de Balzac t.7, Le
Club franais du Livre, 1954.
- Cendrars B., Blaise Cendrars vous parle ( Propos recueillis par M. Manoll)
o.c.t.8, Denoel, 1965.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
367
- Cendrars M., Blaise Cendrars, Balland, Coll. Points, 1985.
- Chambers R., "Le texte "difficile" et son lecteur", L. Dllenbach et J. Ricardoy
(ed), Problmes actuels de la lecture, Clancier-Guenaud, 1982.
- Comte A., Cours de Philosophie Positive (1830) t.1, Schleicher Frres, s.d.
- Cornu M., Kierkegaard et la communication de l'existence, L'Age d'homme,
Coll. Dialectica, 1972.
- D -
- Dllenbach L., Le Rcit spculaire, Seuil, Coll. Potique, 1977.
- Deleuze G., Dialogues, Flammarion, 1977.
- Derrida J., La Vrit en peinture, Flammarion, Coll. Champs, 1978.
Otobiographies, Galile, 1984.
- Descharmes R., Flaubert. Sa vie, son caractre et ses ides avant 1857, F.
Ferroud, 1909.
- Diaz J.-L., "La question de lAuteur", Textuel n15, 1984.
- Doubrovsky S., "crire sa psychanalyse" (1979) in Parcours critique, Galile,
1980. "Autobiographie/Vrit/Psychanalyse", L'Esprit crateur, XX, n3,
automne 1980. Lettre Ph. Lejeune, (1983) in "Le Pacte autobiographique
(bis)", Moi aussi, Seuil, Coll. Potique, 1986.
- Dubois J., Grammaire structurale du Franais: nom et pronom, Larousse,
1965. Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1973.
- Ducrot 0. et Todorov T., Dictionnaire encyclopdique des sciences du
langage, Seuil, Coll. Points, 1972.
- Dumont L., Essais sur l'individualisme, Seuil, 1983.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
368
- F -
- Flckiger J.-C., A propos de L'Eubag in Cl. Leroy (ed.) Blaise Cendrars.
Les inclassables 1917-1926, Minard, 1986.
- Fontanier P., Les Figures du discours, ed. G. Genette, Flammarion, Coll.
Champs, 1968.
- Fontenay E. de, Diderot ou le matrialisme enchant, Grasset, 1981.
- Forster E.M., "Entretien avec P.N. Furbank et F.J.H. Haskell", in Romanciers
au travail, Tr. J.R. Major, Gallimard, Coll. Tmoins, 1967.
- Foucault M., "Qu'est-ce qu'un auteur ?", Bulletin de la Socit franaise de
philosophie n'3, juillet-septembre 1969. L'ordre du discours, Gallimard, 1971.
- Frege G., "Sens et dnotation" (1892) in Ecrits logiques et philosohiques, Tr.
Cl. Imbert, Seuil, Coll. L'ordre philosophique, 1971.
- Freud S., Cinq leons sur la psychanalyse (1908). Tr.Y. Le Lay, Petite
Bibliothque Payot, 1978. Totem et tabou (1912), Tr. Dr S. Janklvitch, P.B.
Payot, 1977.
- G -
- Genette G., "Structuralisme et critique littraire" in Figures I(1966) Seuil, Coll.
Points 1976. "Discours du rcit" in Figures III, Seuil, Coll. Potique, 1972.
Introduction l'architexte, Seuil, Coll. Potique, 1979. Palimpsestes, Seuil, Coll.
Potique, 1982. Nouveau discours du rcit, Seuil, Coll. Potique, 1983. Seuil,
Seuil, Coll. Potique 1987.
- Godard H., Potique de Cline, Gallimard, 1985.
- H -
- Hamburger K., Logique des genres littraires. Tr. P. Cadiot, Seuil, Coll.
Potique, 1986.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
369
- Hamon Ph., "Pour un statut smiologique du personnage" (1972) in G.
Genette et T. Todorov, Potique du rcit, Seuil, Coll. Points, 1977. "Texte
littraire et mtalangage", Potique n'31, 1977.
- Herrnstein Smith B., On the Matgins of Discourse, The Univ. of Chicago
Press, Chicago, 1978.
- J -
- Janvier L., Une parole exigeante, Minuit, 1964.
- Jauss H.-R., "Littrature mdivale et thorie des genres", Potique nl, 1970.
- K -
- Kayser W., "Qui raconte le roman ?" (1958) Tr. A.-M. Buguet in G. Genette et
T. Todorov (ed.) Potique du rcit, Seuil, Coll. Points, 1977.
- Kerbrat-(.)recchioni C., L'Enonciation de la subjectivit dans le langage,
Armand Colin, 1980.
- L -
- Lacan J., Ecrits, Seuil, 1966.
- Lacoue-Labarthe Ph., "Diderot, le paradoxe et la mimesis", Potique n43,
1980.
- Leenhardt J. et Jozsa P., Lire la lecture, Le Sycomore, 1982.
- Lejeune Ph., "Le pacte autobiographique" (1973) in Le Pacte
autobiographique, Seuil, Coll. Potique, 1975. Je est un autre, Seuil, Coll.
Potique, 1980. "Le pacte autobiographique (bis)" in Moi aussi, Seuil, Coll.
Potique, 1986.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
370
- Leroy Cl. "Manuel de la bibliographie des livres jamais publis ni mme crits
par Cendrars", Europe, juin 1976. Blaise Cendrars I, Les "inclassables"
(1917-1926), Minard, 1986.
- Levi-Strauss Cl., La Pense sauvage, Plon, 1962.
- Lyons J., Elments de smantique, Tr. J. Durand, Larousse, Coll. Langue et
langage, 1978.
- M -
- Mac G., "La posie tombe dans la prose" (Entretiens), L'infini n19, Et
1979.
- Manonni 0., Clefs pour l'Imaginaire ou l'Autre Scne, Seuil, Coll. Le Champ
freudien, 1969.
- Moraly J.-B., Jean Genet la vie crite, Editions de la diffrence, 198
- Muller M., Les Voix narratives dans A.L.R.T.P., Droz, Genve, 1965.
- O -
- Oster D., Passages de Znon, Seuil, Coll. Pierres vives, 1983.
- Oura Y., "Roman journal et mise en scne "ditoriale", Potique n'69, 1987.
- P -
- Pavel Th., Univers de la fiction, Seuil, Coll. Potique, 1988.
- Puech J.-B., L'Auteur suppos, typologie romanesque, Thse EHESS, Paris,
1982.
- R -
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
371
- Rachet G., La Tragdie grecque, Payot, 1973.
- Ricardou J., Problmes du Nouveau Roman, Seuil, Coll. Tel Quel, 1967.
- Richard J.-P., Posie et profondeurs, Seuil, 1955.
- Ricoeur P., La Configuration dans le rcit de fiction (Temps et rcit t.II), Seuil,
Coll. L'ordre philosophique, 1984.
- Robert M., La Vrit littraire, Grasset, 1981.
- Rousset J., Forme et signification, J. Corti, 1962.
- Russel B., "On denoting" (1905) in Logic and Knowledge, The Macmillan
Company, New York, 1977.
- Ruwet F., " Prsentation de Lo Strauss", Potique n'38, 1979.
- Ryan M.-L., "Fiction, Non-Factuals and the Principle of Minimal Departure",
Poetics, VIII, 1980.
- S -
- Sainte-Beuve, Profils et jugements littraires, (1862), t. III, Librairie Larousse,
s.d.
- Saraiva A.-J., "Message et littrature", Potique n 17, 1974.
- Schaeffer J.-M., "Du texte au genre", Potique n53, 1983. "Fiction, feinte et
narration", Critique n481-482, 1987a. "Genres littraires et gnricit textuelle"
in Cohen R. (ed.), Critical projections, Methuen, New York, London, 1987b.
- Scherer J., La dramaturgie classique en France, Nizet, s.d.
- Searle J., "Le statut logique du discours de la fiction" in Sens et expression,
Tr. J. Proust, Minuit, 1982.
- Starobinski J., Portrait de l'artiste en saltimbanque, Flammarion, Coll.
Champs, 1970.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
372
- Stevenson R.-L., "Lettre S. Colvin" (1879) in La Route de Silverado, Tr. M. le
Bris, Phbus, 1987.
- Stierle K., "L'Histoire comme Exemple et l'Exemple comme Histoire", Tr. J.-L.
Lebrave, Potique n10, 1972. "Rception et fiction", Tr. V. Kaufmann, Potique
n'39, 1979.
- Suleiman S.-R., Le Roman thse ou l'autorit fictive, PUF, 1983.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
147
Vincent Colonna
Lautofiction
(essai sur la
fictionalisation de soi
en Littrature)
Tome II
Doctorat de lE. H.E.S.S., 1989
Directeur : Monsieur Grard Genette
cole des Hautes tudes en Sciences Sociales
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
148
T R 0 I S I E M E P A R T I E : LE MANTEAU DE LA FABLE _________151
1 - LE PROTOCOLE MODAL ________________________________152
A - Oras ou le "parti-pris des choses" _________________________157
B - Thoth ou le "compte-tenu des mots" ________________________159
C - Examen critique des deux vulgates_________________________162
2 - DES MODALISATEURS FICTIONNELS PARATEXTUELS ________166
I. MODALISATEURS EPITEXTUELS ________________________167
II. MODALISATEURS PERITEXTUELS ________________________170
Il. 1. Protocole modal indfini. ________________________________176
II.2. Protocole modal contradictoire. ___________________________181
3 - EPIMENIDE EN FICTION __________________________________189
4- LES INDICES DE LA FICTION ______________________________197
I - INDICES SYNTAXIQUES _______________________________199
- Le discours sur soi la troisime personne :________________204
- Le mode dramatique : _________________________________205
- II - INDICES SEMANTIQUES _______________________________209
- Invraisemblance mondaine physique :_____________________212
- Invraisemblance mondaine culturelle :_____________________212
- Invraisemblance auctoriale physique :_____________________213
- Invraisemblance auctoriale culturelle :_____________________213
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
149
- III - INDICES PRAGMATIQUES _____________________________214
5 - LE DISCOURS FICTIONNEL ______________________________219
Une recherche en cours. ____________________________________221
Une question plurielle.______________________________________221
Un registre htrogne._____________________________________222
Q U A T R I E M E P A R T I E :________________________________233
S T R A T E G I E S _________________________________________233
1 - FONCTIONNALITE D'UN DISPOSITIF SCHIZOPHRENE _________234
Bilan et perspective. _______________________________________235
Un dispositif schizophrnique.________________________________236
Fonctions du dispositif. _____________________________________243
al) fonctions rfrentielles _______________________________245
a2) fonctions rflexives _________________________________245
b) fonction figurative____________________________________245
2 - FONCTION REFERENTIELLE _____________________________246
- I - FONCTION DIDACTIQUE _______________________________247
II - FONCTION BIOGRAPHIQUE ____________________________251
3 - FONCTION REFLEXIVE ___________________________________258
UN MODELE : LE "QUICHOTTE". ____________________________261
Mise en abyme et fictionnalisation de l'auteur. ___________________266
a) Mise en abyme de l'crivain. _____________________________266
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
150
b) Mise en abyme du livre._________________________________270
4- FONCTION FIGURATIVE __________________________________278
L'Autofiction selon Barthes __________________________________280
"Lauteur qui va dans notre vie"_____________________________295
Une explosion de la fiction __________________________________299
"Le fictif de l'identit" _______________________________________304
5 - SANS FAMILLE - ________________________________________310
Le "court-circuit" de la rception ______________________________312
La rception journalistique __________________________________312
La rception universitaire ___________________________________315
Un "genre" sans histoire ?___________________________________320
Un "genre" secret ou un "genre" thorique ? _________________326
C 0 N C L U S I 0 N__________________________________________335
B I B L I 0 G R A P H I E ______________________________________346
I- C 0 R P U S ______________________________________________348
II - 0 U V R A G E S L I T T E R A I R E S________________________356
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
151
T R 0 I S I E M E P A R T I E : LE MANTEAU
DE LA FABLE
"La fiction exige que le lecteur constitue, titre d'essai,
des systmes de pertinence complexes, qui dpassent
l'horizon de sa pratique quotidienne et qui l'invitent
d'autant plus exprimenter la ralit qu'il les fonde sur
une cohrence textuelle plus grande".
K. Stierle.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
152
1 - LE PROTOCOLE MODAL
"Que nous regarde la vie prive d'un crivain ? J e
ddaigne de tirer de l le commentaire de ses ouvrages"
Lessing.
"Ne pas dire, donc, que la fiction c'est le langage : le
tour serait trop simple, bien qu'il soit de nos jours familier"
M. Foucault.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
153
L'intitul de cette nouvelle partie se trouve dans le Torquato Tasso de
Goethe :
"clatant et fleuri, le manteau de la fable..." (v. 691).
Sous le couvert d'une thmatique florale, trs ancienne dans la posie,
ce vers nomme la fois la chair et la saveur, le corps et le chant de la fiction.
Cette expression a paru heureuse pour dsigner tout ce qui dans la fiction la
prsente comme telle, affiche sa fictionalit, oriente dans le sens du
non-srieux l'attitude du lecteur.
Sous ce titre, on se propose donc d'examiner, tous les moyens par
lesquels un crivain peut dfinir le registre fictionnel de son texte, tous les
lments dont il dispose pour affirmer ou afficher le caractre fictif de son
uvre. En d'autres termes, il s'agit de dcrire et de comprendre toutes les
modalits de ralisation du second protocole de lecture dfinissant l'autofiction :
le protocole modal fictionnel. Tous les exemples vus jusqu'ici supposaient un tel
protocole ; sans lui, tous ces textes relveraient du genre autobiographique.
Pour des raisons videntes, il tait impossible de s'attarder sur la physionomie
de leurs protocoles modaux. Le moment est venu de consacrer toute notre
attention aux ralisations de ce protocole. Non sans, auparavant, faire une mise
au point sur la nature et la lgitimit de ce protocole modal fictionnel.
Une remarque d'abord sur le terme "modal". En linguistique, le substantif
"mode" est une catgorie grammaticale traduisant deux choses : "1) le type de
communication institu par le locuteur entre lui et son interlocuteur (statut de la
phrase) ; 2) l'attitude du sujet parlant l'gard de ses propres noncs..."
(Dubois, 1973, p. 321). Le premier sens du terme a t mis au service de la
narratologie et de la problmatique de l'nonciation littraire par Grard Genette
(1972, pp. 75, 183), pour dsigner la fois : a) tous les procds de modulation
de l'information narrative ; b) les rgimes d'nonciation propres au rcit et au
thtre (1982, p. 332 ; 1983, p. 28). Comme ces deux derniers emplois de
mode se sont largement rpandus, il importe d'viter toute possibilit de
confusion : dans ce travail, l'adjectif modal n'a aucun rapport avec ces usages
narratologique et potique. Il renvoie la seconde acceptation de la catgorie
grammaticale de mode. Il dsigne par consquent un registre de discours, la
manire dont le sujet d'nonciation envisage son discours, l'attitude qu'il adopte
envers ses propres noncs. Par suite, il est en relation moins avec les
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
154
modalits de la reprsentation littraire qu'avec sa modalisation, c'est--dire
l'ensemble des marques qui permettent de percevoir l'adhsion ou la
non-adhsion du locuteur son nonciation.
Cette catgorie de modalisation est prcieuse parce qu'elle permet, par
homologie, de systmatiser et de dvelopper des observations intuitives que
l'on ne peut manquer de faire au contact des textes - sur la manire dont ces
derniers exposent leur registre de lecture, leur statut discursif. Le Dictionnaire
de linguistique de J ean Dubois dfinit cette catgorie de la faon suivante :
"Dans la problmatique de l'nonciation (acte de
production du texte par le sujet parlant), la modalisation
dfinit la marque donne par le sujet son nonc ().
Le concept de modalisation sert l'analyse des moyens
utiliss pour traduire le procs d'nonciation. L'adhsion
du locuteur son discours est ressentie par l'interlocuteur
tantt comme souligne, tantt comme allant de soi,
tantt en baisse (...). Le concept de modalisation permet
de rendre compte de la perception par l'interlocuteur du
fait que l'orateur croit, tient ce qu'il dit. La modalisation
est du domaine du contenu : une ou plusieurs phrases, un
"tat" du discours, sont ressentis comme comportant un
certain degr d'adhsion du sujet son discours. Le
paradoxe de la thorie de l'nonciation reste que cette
ligne continue de la modalisation se ralise dans le
discours par des lments discrets" (Dubois, 1973, pp.
319-320).
Mme si les transferts de la linguistique la potique ont toujours
quelque chose de prilleux, mme si un texte littraire ne prsente pas les
mmes proprits qu'un nonc linguistique, la notion de protocole modal ne
peut que s'enrichir dtre pense partir de cette analyse, qui permet d'avancer
les propositions suivantes :
-1. la notion de protocole modal permet de cerner la perception qu'a le
lecteur du registre dnonciation d'une uvre littraire, de sa place dans l'ordre
du discours, de sa valeur de vrit ;
- 2. le propre de ce protocole est de modaliser le texte, c'est--dire de
traduire l'attitude de l'crivain par rapport son discours. Dans le cas d'une
fiction, l'auteur ne croit pas son propos, n'assume pas ce qu'il dit et exprime
cette non-adhsion par des proprits discursives spcifiques ;
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
155
- 3. Ces proprits, marques de la modalisation, sont des lments
discrets, mais qui valent pour la totalit de luvre. Il faut les concevoir sur le
modle des flexions verbales, des adverbes, des incises ou des guillemets qui
permettent un locuteur d'exposer la faon dont il envisage l'ensemble de son
nonc.
Le but de cette partie est donc de fournir un pendant ltude du
protocole nominal, d'tudier les procds par lesquels un auteur peut se
dissocier de l'histoire qu'il raconte de manire ce que le lecteur la peroive
comme fictive. Une tude des modalisateurs linguistiques consisterait dcrire
et comprendre comment un locuteur peut traduire verbalement le degr de
srieux qu'il accorde son discours. Mutatis mutandis, cette tude va chercher
examiner les modalisateurs littraires de fiction, les procds modalisants
valeur fictionnelle qui ont cours en littrature. On voit d'emble quels peuvent
tre ces procds : l'indication gnrique "roman", un avertissement du type
"Toute ressemblance..." une prface affirmant le caractre imaginaire du texte,
l'intervention dans l'histoire de forces surnaturelles etc. Tous ces procds
constituent autant de moyens de signifier qu'un texte est fictif, que son contenu
est irrel, qu'il ne s'agit pas d'un Tmoignage, de Mmoires, d'un J ournal
intime, d'un Autoportrait etc.
Les modalisateurs littraires manifestent, ainsi, une des grandes
dichotomies qui commandent l'espace littraire : l'opposition fiction vs
rfrentiel. C'est une opposition qui transcende la classification en genre,
comme celles qui dpartagent la littrature en prose et en posie, en narration
et thtre. Ces oppositions sont si fondamentales et si gnrales qu'aucun
lecteur, ft-il le plus botien, ne peut les ignorer. Sensibles par les proprits
discursives propres chaque forme, registre ou mode, elles commandent des
types de lecture, des comportements culturels et jusqu' des investissements
sociaux et conomiques diffrents.
Naturellement, les frontires de ces partages ne sont pas immuables, ne
sont pas fixes une fois pour toutes. Historiquement, elles ont boug, elles se
sont dplaces et transformes. Ce ne sont pas des dlimitations logiques, des
normes intemporelles. Entre la posie et la prose, par exemple, il n'y a pas une
diffrence de substance qui interdirait jamais de les confondre. On sait que
leur frontire s'est considrablement dplace depuis le XVIIe sicle. La posie
a ainsi connu une extension de son contenu virtuel et une rduction de sa
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
156
dfinition en comprhension. Il en est de mme pour les autres oppositions qui
ont connu de profonds bouleversements depuis la fin du XIXe sicle. Ainsi,
dans le domaine de l'autobiographie, les uvres de ces dernires dcennies
avec lesquels il faut compter - en France, on peut citer Queneau, Perec, Butor,
Sarraute, Leiris, Barthes - sont des textes o l'criture de soi se dploie
travers ou proximit de la fiction, dans un usage de l'criture qui bouleverse le
rapport avec le Rfrent et la division traditionnelle entre le vcu et l'invention.
De cette variabilit historique, des importantes redistributions
contemporaines de ces grands partages littraires, on en a parfois conclu qu'ils
n'avaient plus cours notre poque ; que la littrature moderne s'tait
dbarrasse de ces divisions comme d'autant de conventions inutiles, voire
nfastes pour la crativit des crivains. Ce refus des grandes divisions
littraires s'est accompagn la mme poque d'une critique radicale de la
notion de genre, comprise comme une catgorie tout aussi inutile,
historiquement dpasse, ayant perdu toute pertinence dans le cadre de la
modernit. Le propre de notre temps serait d'ignorer toute sparation gnrique
et, en-de, toute limite entre les pratiques littraires pour viser une sorte de
littrature totale, absolue, qui comprendrait tous les genres et toutes les
pratiques, qui intgrerait toutes les diffrences et toutes les proprits
discursives (Todorov, 1978, p. 44).
Cette affirmation et cette prsentation de la littrature moderne constitue
une objection srieuse l'tude de notre protocole modal. Dans cette
perspective, la dichotomie fiction vs non-fiction, comme bien d'autres, n'a plus
de sens. Certes, ce type de discours sur la littrature a perdu de sa force dans
la dernire dcennie du fait du dveloppement de l'tude des genres, de la
rception littraire, de l'acte de lecture. Nanmoins, il a tendance tre ractiv
dans le cas de l'autofiction. Une des raisons qui concourent sa
mconnaissance est justement que ce "discours de la neutralisation". (D. Oster)
trouve l une nouvelle jeunesse, parfois l'insu de ses usagers eux-mmes. Il
est donc ncessaire d'examiner ce "discours de la neutralisation" afin de voir si
rellement il rend notre opposition anachronique. Bien entendu, il n'est pas
question d'envisager sa pertinence pour toutes les oppositions qui,
traditionnellement, organisent le champ littraire : chercher si les frontires
entre le thtre et le rcit, la posie et la prose, existent encore vritablement
aujourd'hui nous conduirait trop loin de notre sujet. Nous nous limiterons
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
157
considrer les aspects de cette argumentation qui concerne l'opposition entre la
littrature de fiction et la littrature rfrentielle.
Notons pour commencer que ce discours sur la littrature n'est pas
homogne. Il est mme tenu par des crivains, des critiques et des thoriciens
de la littrature de famille bien diffrente et pour des enjeux qui ne sont pas
identiques. Dans cette varit, il semble toutefois que l'on puisse distinguer
deux vulgates, deux vulgates qui ont eu chacune leurs heures de gloire et qui
demeurent encore florissantes, l'une de faon diffuse, l'autre de faon plus
circonscrite. Apparemment, tout les distingue : horizon idologique, conception
de la littrature et de sa fonction. Elles ont pourtant en commun la ngation du
partage de la littrature entre fiction et non-fiction ; et plus gnralement, la
remise en cause de toute distribution ou classification d'ordre gnrique. Pour
relever la prsentation de ces deux vulgates, on donnera chacune d'elle un
dieu, sa divinit protectrice en quelque sorte, et un mot dordre, sa devise si lon
veut.
A - Oras ou le " parti-pris des choses"
Dans le Second Faust, Oras est un dieu qui a les apparences d'un
rocher, symbolise la matire et se "prvaut de sa qualit pour mpriser les rives
de potes et les fantmes des ges vanouis" (Nerval). Il peut servir de dieu
tutlaire cette vulgate, car ce qui la caractrise c'est de procder envers
l'ensemble de la littrature une sorte d'inflation rfrentielle, de pratiquer une
rduction prosaque de la fiction. Pour elle, la littrature ne vaut que pour son
extriorit, par son dehors.
Les origines de cette vulgate ? La fin du XVIIIe et le XIXe sicle ; des
considrations et des thories dveloppes par Madame de Stal, Taine,
Renan, Sainte-Beuve -, systmatises et souvent durcies par des pigones.
Aujourd'hui, on aurait du mal trouver les propositions de cette vulgate
formules de manire mthodique et cohrente ; plus personne n'aurait
l'intrpidit de publier ces Physiologie des crivains et des Artistes ou ces Essai
de Critique naturelle, qui faisaient flors et que le sicle pass a emport avec
lui. Toutefois, cette vulgate se retrouve de faon diffuse dans les propos du
grand public, dans la critique mondaine, dans les discours acadmiques et
dans les rflexions de certains (bons) crivains.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
158
L'ide essentielle et principielle de cette vulgate, c'est qu'un crivain
n'crit jamais que sur lui-mme, qu'il est toujours son personnage principal,
quels que soient les masques ou les dguisements qu'il peut emprunter. La
nature de ce "soi" exprim est susceptible, bien sr, de dfinitions varies. Il
peut s'agir, tour tour ou la fois, de la race, du sol, du climat, de l'poque, du
sang, de la parent, de la vie, de la destine, du caractre, de l'humeur, de la
complexion - sans oublier pour certains cette "monade inexprimable"
(Sainte-Beuve) qui fait le mystre du gnie. Pour reprendre les trois grands
critiques franais du XIXe sicle, chacun mettait l'accent sur l'aspect qui lui tait
le plus cher Sainte-Beuve sur l'homme, Taine sur le milieu, Renan sur l'histoire.
Mais l'essentiel est qu'en fin de compte, luvre renvoie toujours un dehors
qui la dpasse et qui lui donne toute sa signification. Ds lors, les diffrences
gnriques ou formelles des textes sont perues comme secondaires, quand
elles ne sont pas juges superflues.
Soit le cas de Sainte-Beuve. Ce n'est pas un hasard s'il mprise la
rhtorique et se mfie des surfaces textuelles, demande qu'on juge l'abeille
son travail et non son miel. Au fond, les moyens mis en uvre par un crivain
lui paraissent accessoires. L'important, c'est son "caractre", le fond de sa
personnalit qui marque toute son uvre. Sans doute, l'auteur des Causeries
du Lundi est-il conscient des lignes de dmarcation qui sparent les diffrents
genres, des frontires qui distinguent les grandes formes de la reprsentation
littraire, des registres distincts qu'un crivain peut choisir pour crire. Il y a
mme de belles pages de sa plume sur la manire dont un crivain se fait une
place dans la littrature de son temps en cherchant dvelopper et exploiter
des formes ou des genres que ses ans ont nglig. Mais cette ralit n'est
pas pour lui primordiale. Plus vital ses yeux est le fait que la littrature est
l'affaire d'individualits qui portent en elles une "qualit secrte et essentielle",
qui la forgent et l'expriment travers les genres et les formes qui s'y prtent.
Bref, il y a dj chez Sainte-Beuve l'ide que les classifications littraires
importent peu, comme en tmoigne ce passage extrait d'un article sur
Chateaubriand, o il fait le point sur sa "mthode" :
"De mme qu'on peut changer d'opinion bien des fois
dans sa vie, mais qu'on garde son caractre, de mme on
peut changer de genre sans modifier essentiellement sa
manire. La plupart des talents n'ont qu'un seul et mme
procd qu'ils ne font que transposer, en changeant de
sujet et mme de genre. Les esprits suprieurs ont plutt
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
159
un cachet qui se marque un coin ; chez les autres, c'est
un moule qui s'applique indiffremment et se rpte"
(1862, p. 218).
(Le "cachet" de Chateaubriand, par exemple, serait d'tre un "picurien
qui a l'imagination catholique"). Dans ces lignes, on voit bien comment, partir
de Sainte-Beuve' et de quelques autres, la littrature s'est vue rduite une
fonction d'expression. De proche en proche, en liaison avec la rorganisation
du champ littraire qui se fait la fin du XIXe sicle, il va s'oprer comme une
dsaffection plus ou moins prononce envers la spcificit des formes qu'utilise
un crivain.
Cette dsaffection va trouver sa forme hyperbolique dans lesthtique de
Croce, qui ne verra dans les genres et les formes d'expression qu'une part
ngligeable de la cration artistique. Dans son Estetica (1902), Croce dfendra
avec force l'ide que chaque uvre d'art est singulire, rsultat d'une "intuition"
cratrice unique, excentrique toute tradition, tout modle et toute
classification. Cette ide aura un grand retentissement durant le premier quart
du XXe sicle et ne contribuera pas peu dvaloriser la notion de genre.
Consquence de cette vulgate du "parti-pris des choses" : toute uvre
est rfrentielle, tout texte est autobiographique, quels que soient son registre
de lecture, son rgime d'nonciation ou son mode de reprsentation. Non
seulement les diffrences gnriques s'estompent, mais la frontire qui spare
un autoportrait d'une pice de thtre, le registre intime du registre fictif, est
dclare superficielle. On trouve ainsi rpandue un peu partout une sorte de
thorie spontane de la littrature selon laquelle un crivain, de toute faon, ne
parle jamais que de lui-mme, de son existence, de ses tats d'me etc. Dans
chaque texte littraire, un "je biographique" serait ainsi implicitement prsent.
La seule diffrence reconnue entre les registres de lecture, entre la fiction et la
non-fiction, est dans la part de transposition labore par l'auteur - et par
consquent, le travail hermneutique exig du lecteur pour atteindre le sens
d'un texte.
B - Thoth ou le " compte-tenu des mots"
Thoth est, chez les gyptiens, le dieu dont l'ombre bienveillante s'tend
sur les bibliothques : "Thoth, dieu des bibliothques, un dieu oiseau,
couronne lunaire" (J oyce). Il peut servir de divinit protectrice cette seconde
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
160
vulgate, comme le mot de Ponge pourrait tre sa devise, parce que celle-ci ne
croit qu'aux livres, fait du langage et de la littrature la seule ralit qui compte
pour un crivain. A rebours de la prcdente, elle occulte les catgories de
genre, de mode, de registre d'nonciation partir d'une dfinition tautologique
de la littrature, dcrite comme un espace qui ne renvoie qu' lui-mme. Au
contraire de l'autre vulgate, c'est donc par un mouvement centripte, par une
attitude dflationniste envers la rfrentialit que toute diffrenciation gnrique
ou modale est nie.
Curieusement, cette vulgate s'affirme peu prs la mme poque que
son homologue rfrentiel : la fin du XVIIIe sicle. Mais ses origines sont
mieux connues, parce qu'elles sont circonscrites au Romantisme allemand. De
mme, son volution est plus facile suivre : on peut la voir se dvelopper et
s'enrichir travers les rflexions critiques de Baudelaire, de Mallarm, de
Blanchot, de Barthes ou, pour ses derniers reprsentants, du groupe Tel Quel
et de Ricardou. Cette vulgate connat, elle aussi, des formulations diverses et
qui prsentent des nuances parfois considrables. Ainsi, le groupe Tel Quel ou
Ricardou en montrent-ils deux versions extrmistes dans lesquelles un Novalis
ne se serait sans doute pas reconnu. De plus, cette vulgate a conserv une
consistance plus grande, sans doute parce qu'elle s'est moins diffuse.
Son ide cardinale et sminale trouve sa meilleure formulation dans le
mot fameux de Novalis : Die posie ist das cht absolut Reelle, "La Posie est
le Rel vritable", o le terme de "posie" dsigne bien entendu la littrature.
Avec cette phrase, Novalis donne pour ainsi dire le noyau dur de la doxa
romantique : la littrature est l'tre lui-mme, l'unit retrouve des mots et des
choses. A partir de l, la littrature ne saurait avoir de dehors, d'extriorit qui
viendrait la limiter et lui donner son sens : c'est une activit "autotlique" (T.
Todorov). Elle ne peut non plus tre gnrique, faute de quoi elle ne serait pas
la ralisation de l'tre dans sa plnitude : le Roman o la littrature atteint son
achvement contient tous les genres (Schaeffer, 1983, p. 39).
Prs d'un sicle plus tard, en des termes diffrents, Roland Barthes
retrouve dans un article clbre la mme argumentation. D'abord, l'intransitivit
de la littrature qui est prsente comme un postulat de base :
l'crivain est un homme qui absorbe radicalement
le pourquoi du monde dans un comment crire (...) le rel
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
161
ne lui est jamais qu'un prtexte (pour l'crivain, crire est
un verbe intransitif)" (Barthes, 1960, pp. 148-149).
Ensuite, l'unit organique qui en dcoule et qui fait que l'crivain n'a pas
droit au "tmoignage" :
" en s'identifiant une parole, l'crivain perd tout
droit de reprise sur la vrit, car le langage est
prcisment cette structure dont la fin mme (...) est de
neutraliser le vrai et le faux" (pp. 149-150).
C'est naturellement cette dernire consquence qui est la plus
dommageable pour notre projet. Elle a pour effet de faire de la littrature un
espace homogne, transmodal et finalement univoque, vaste plage sans
dpression ni relief. Elle permet de condamner les genres et les modalisations
comme autant de dcoupages acadmiques et idologiques. Maurice Blanchot,
dans des pages souvent cites, a formul cette critique comme une exigence
commande par la vritable destination de la littrature :
"Seul importe le livre, tel qu'il est, loin des genres, en
dehors des rubriques, prose, posie, roman, tmoignage,
sous lesquelles il refuse de se ranger et auxquelles il
dnie le pouvoir de lui fixer sa place et de dterminer sa
forme. Un livre n'appartient plus un genre, tout livre
relve de la seule littrature, comme si celle-ci dtenait
par avance, dans leur gnralit, les secrets et les
formules qui permettent seuls de donner ce qui s'crit
ralit de livre. Tout se passerait donc comme si, les
genres s'tant dissips, la littrature s'affirmait seule,
brillait seule dans la clart mystrieuse qu'elle propage et
que chaque cration littraire lui renvoie en la multipliant -
comme s'il y avait une essence de la littrature" (1959, pp.
243-244).
Si la littrature est seulement une activit autonyme et auto-rfrentielle,
qui se conserve par l'entretien de sa propre fiction d'exister, elle ne peut en effet
laisser place aucune catgorie diffrencie, aucune pratique qui se
distinguerait en son sein. La possibilit d'une telle diffrenciation serait le signe
que la littrature n'est pas seulement une activit tourne vers elle-mme, mais
qu'elle a aussi affaire autre chose qu'elle-mme. Or, prcisment, il s'agit,
pour cette vulgate, d'affirmer avant tout cette intransitivit littraire, de refuser
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
162
toute extriorit la littrature. Partant, il n'est pas concevable qu'il existe une
catgorie de textes qui traverse ce renfermement sur soi pour introduire une
note intime, personnelle, relle, dans la littrature. Au nom de la littrature, voici
donc une nouvelle attitude ngative envers l'opposition fiction vs non fiction,
attitude qui a encore pour rsultat d'enlever toute pertinence la catgorie
d'autofiction.
C - Examen critique des deux vulgates
Malgr tout ce qui les oppose, malgr le fait qu'elles reprsentent deux
attitudes antagonistes envers la littrature, ces deux vulgates se retrouvent
donc dans la ngation de l'opposition rcit imaginaire vs rcit vridique et, plus
gnralement, de tout partage catgoriel de la chose littraire. Dans le cadre de
ces deux grandes formes de conscience critique, la notion d'autofiction est par
suite impensable. Pour la premire de ces vulgates, qui ne conoit la littrature
que comme expression de soi, l'ide d'une fiction de soi n'a pas de sens ; il ne
peut s'agir que d'une transposition de soi, comme dans le roman
autobiographique. Pour l'autre, pour qui toute littrature est par nature
fictionnelle, qui ne conoit pas l'criture de soi en dehors de la fiction, la
reprsentation d'un crivain par lui-mme ne peut tre que fictive ; comme l'est,
selon elle, toute autobiographie, quand bien mme son auteur multiplierait les
dclarations d'intention et les gages de bonne foi. Par assimilation ou par
exclusion, par gnralisation abusive ou par marginalisation, le principe de la
fictionnalisation de soi est ainsi vid de tout contenu heuristique.
Il n'est pas question de se livrer une critique en rgle des prsupposs
et des propositions de chacune de ces vulgates. Cette critique a dj t faite
par d'autres ailleurs. C'est seulement la communaut de leur mconnaissance
et de leur refus, pour autant qu'elle interdit toute tude de l'autofiction, qui
intresse ce propos. On se limitera donc montrer que ces deux vulgates
conduisent une mme conception rductrice des textes littraires, la mme
occultation de catgories littraires essentielles, et l'on tentera d'avancer une
explication ces exclusions.
Partons de la conception du texte littraire sous entendue par ces deux
vulgates. Dans les deux cas, le texte est rduit une surface ; il n'a pas de
volume, n'est pas un livre qui occupe une certaine position discursive, dont la
reconnaissance est au fondement de la participation du lecteur.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
163
A les suivre, une uvre ne chercherait pas obtenir certains effets
discursifs , ou plutt n'en aurait pas besoin puisqu'elle ne produit au fond qu'un
type d'effet : intime pour l'une, spculaire pour l'autre. Qui ne voit pourtant que
la littrature offre des possibilits bien plus nombreuses, auxquelles les textes
ne manquent pas de recourir et qu'ils n'oublient pas de prsenter pour stimuler
en ce sens le lecteur. L'opposition fiction vs non-fiction est une division qui est
l'origine d'une partie de ces effets. Supprimer l'un de ces grands registres, c'est
amputer foule d'ouvrages qui s'efforcent de s'y rattacher par des mcanismes
pragmatiques spcifiques. Un roman, par exemple, se donne tous les signaux
conventionnels qui permettent d'identifier le genre romanesque. Quand bien
mme ce roman chercherait redfinir son genre, ce qui le conduirait
remodeler les signes distinctifs du roman, il conserverait avec la tradition
romanesque et ses indices pragmatiques une parent assez grande pour que
cette filiation soit sensible? Faute de quoi son originalit serait insensible et sa
dmarche incomprhensible. Or, par exclusion ou par gnralisation, ces deux
vulgates en arrivent supprimer cet aspect d'une uvre, faire l'conomie de
ces proprits pragmatiques par lesquelles un texte cherche agir sur son
lecteur, "programmer" en partie sa lecture. Pour elles, un texte n'oriente pas
son dchiffrement, il a une nature qui lui commande de raliser sa vritable
destination. Ces deux vulgates supposent par consquent une vision rductrice
des textes littraires, une vision o les textes n'auraient qu'un contenu
prdtermin, quil ne chercherait pas modeler d'une faon ou d'une autre.
Non moins grave est la prtention concomitante de ces deux vulgates
nier l'existence de catgories fondamentales pour les lecteurs et les crivains,
pour la lecture et lcriture littraires. Il faut bien tre conscient, avec H.R.
J auss, qu on ne saurait imaginer une uvre littraire qui se placerait dans une
sorte de vide d'information et ne dpendrait pas d'une situation spcifique de la
comprhension (...) toute uvre suppose l'horizon d'une attente, c'est--dire un
ensemble de rgles prexistant pour orienter la comprhension du lecteur (du
public) et lui permettre une rception..." (1970, p. 82). L'opposition fiction vs
non-fiction relve prcisment de cet "ensemble de rgles". Elle fait mme
partie de ces catgories transcendantales, dont la transformation historique est
trs lente, qui permettent l'apprentissage de la littrature. Pour le lecteur,
aucune uvre n'est saisie de faon totalement isole, en dehors de toute
rfrence culturelle et littraire. S'il peroit et comprend des textes littraires,
c'est qu'il dispose d'un fonds cognitif minimal sur la littrature, qui est structur
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
164
entre autres par notre opposition. Sans ce grand partage, on voit mal sur quel
socle s'tablirait sa comptence de lecteur, comment mme il distinguerait la
littrature des autres types de discours. De mme, aucun auteur ne peut
ignorer cette grande dichotomie quand il crit. Il peut bien tenter de la
transgresser ou de la brouiller, c'est sur l'horizon de son existence la fois
discursive, culturelle, sociale et conomique qu'il doit le faire. C'est mme
l'existence et le poids de ce type de catgorie transcendantale qui le conduit
parfois tenter de renouveler leurs frontires, comme Baudelaire tentant de
dplacer la dichotomie prose vs posie avec le pome en prose. Aussi bien, les
romans du groupe Tel quel n'ont pu pratiquer une littrature amodal ou neutre
qu'au prix d'un discours d'escorte plthorique et de justifications infinies, mme
quand elles prenaient le chemin de la Provocation. Cet exemple montre que
mme une uvre originale doit se situer par rapport la division fiction vs
non-fiction. Tout crivain qui prtend uvrer contre elle doit non seulement la
mettre en cause mais aussi s'adosser elle, pour prparer le lecteur accepter
toute la nouveaut de son travail.
Comment ds lors expliquer que ces deux vulgates aient pu s'aveugler si
longtemps sur la ralit du partage entre le registre imaginaire et le registre
intime ? Sans doute, parce qu'elles ont toutes deux manqu une dimension
essentielle de l'activit littraire : la lecture. Il est quand mme frappant de
constater qu'aucune des deux n'accorde une place significative au lecteur,
l'acte de la lecture et aux protocoles qui inscrivent cette lecture dans luvre. Si
l'on se fie leurs descriptions, l'essentiel de la littrature se passe soit au ple
de la cration littraire, soit au sein de luvre ; peu de choses dans l'accueil ou
dans l'apprhension du lecteur. La finalit mme de leur dmarche les
poussent majorer un aspect de la littrature qui, par contre-coup, leur voile un
autre aspect, non moins important. Sans doute aussi est-ce parce que l'enjeu
rel de ces deux vulgates est moins d'arriver une thorie quilibre de la
littrature que de fonder une utopie littraire permettant de s'assurer de la
matrise des conditions de rception et de production des textes un moment
donn. Mais peut-tre est-ce le destin de toute tradition critique, peut-tre
mme la condition de sa fcondit.
Quoi qu'il en soit, il nous faut prendre acte de la ncessit de faire son
deuil de ces deux vulgates. Pour tudier l'autofiction, et se tenir au plus prs de
la ralit littraire, Il faut concevoir la littrature comme un espace qui n'est pas
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
165
homogne, dont l'htrognit tient l'existence de catgories multiples, qui
sont autant de normes ou de conventions dfinissant et spcifiant le systme
de lisibilit d'une poque donne. Parmi ces catgories, la dichotomie fiction vs
non-fiction joue, aujourd'hui encore, un rle essentiel dans notre conscience
littraire. Si la pratique de l'autofiction a un sens, c'est sur le socle de cette
dichotomie qu'il convient de la penser. On va d'ailleurs le vrifier en tudiant les
moyens pour un texte de se prsenter comme fictif.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
166
2 - DES MODALISATEURS FICTIONNELS
PARATEXTUELS
"La marge, c'est ce qui tient la page"
J .L. Godard.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
167
On a vu qu'il tait possible de concevoir la fictionalit d'une uvre
littraire sur le modle de la modalisation linguistique, comme l'actualisation
d'lments manifestant le caractre non srieux d'une nonciation. Il s'agit
maintenant d'entrer dans le dtail du fonctionnement d'une fiction en mettant
jour ces lments.
Ces lments sont envisager, comme on l'a vu aussi, par homologie
avec les modalisateurs verbaux, avec "les moyens par lesquels un locuteur
manifeste la manire dont il envisage son propre nonc ; par exemple, les
adverbes peut-tre, sans doute, les incises ce que je crois, selon moi etc.,
indiquent que l'nonc n'est pas entirement assum ou que l'assertion est
limite une certaine relation entre le sujet et son discours" (J . Dubois, 19739
p. 318). Cette homologie autorise. penser que les marques de la fictionalit :
a) ne sont pas chercher ailleurs que dans les uvres littraires elles-mmes,
dans une comparaison avec la ralit par exemple, b) qu'elles sont isolables.
Comme pour le protocole nominal, on cherchera ces traits fictionnels
d'abord dans le paratexte, en commerant par l'pitexte. Leur prsence dans le
texte d'une uvre littraire sera examine dans le chapitre suivant.
I. MODALISATEURS EPITEXTUELS
L'pitexte peut-il lui seul dterminer le statut d'une uvre ? Les
dclarations publiques ou prives de l'crivain sur son uvre peuvent-elles
constituer un protocole modal ? De mme que ces dclarations ne se prtaient
pas la mise en place d'un protocole nominal, on voit mal comment elles
pourraient elles seules dfinir le registre d'une uvre.
Imaginons un texte publi sans que son genre ne soit dfini, bien que
l'crivain en soit l'un des personnages. Un tel ouvrage sera forcment lu de
faon rfrentielle, comme une uvre autobiographique. Les habitudes de
lecture contemporaines sont ainsi faites que le public opre toujours
spontanment une indexation biographique d'une uvre o l'auteur s'est
reprsent. Si par la suite l'crivain dclare que son texte est une fiction, cette
dclaration n'abolira pas la situation de fait tablie. Elle rendra le livre ambigu
ou contradictoire, mais ne russira pas redfinir compltement son statut.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
168
Cette impossibilit est encore plus vidente dans le cas de figure o
luvre possde dj un registre dfini, mme si c'est de faon complexe.
Bourlinguer permet de le vrifier. Publi en 1948 avec l'indication gnrique
"souvenirs", cet ouvrage de Cendrars se prsente effectivement comme un
recueil de souvenirs, organis en fonction de villes-phares pour la mmoire
cendrarsienne. Certes, quelques rflexions, allusions ou motifs peuvent donner
penser un lecteur attentif que le pass relat est fortement retouch. Mais
enfin, l'pigraphe de ce livre est emprunte Montaigne et l'ouvrage ne
manque pas de suivre tous les passages obligs de l'criture de soi. En
particulier, le regard rtrospectif que l'on porte sur l'ensemble de sa vie, afin d'y
distinguer une cohrence :
" je partage ma vie en deux sries, mes aventures en
Occident (les trois Amriques), mes aventures en Orient
(en Chine, o j'ai fait mes dbuts)..." (o.c. t. 6, p.157).
Pourtant, quelques annes plus tard, dans des entretiens avec Michel
Manoll, publi sous le titre Blaise Cendrars vous parle, Cendrars opposera un
dmenti formel cette affirmation. Alors que Manoll tente de l'utiliser pour sa
biographie, Cendrars lui rplique :
"Ce sont des choses que l'on dit quand on raconte des
histoires... pour mettre un peu d'ordre dans sa propre
existence. Mais ma vie n'a jamais t coupe en deux. Ca
serait trop commode, tout le monde pourrait couper sa vie
en deux, en quatre, en huit, en douze, en seize" (o.c., t. 8,
p. 543).
Notons qu'il ne s'agit pas d'une simple rtractation. Ce dsaveu a des
consquences plus importantes. Il dpasse la simple mise au point, le retour
sur une affirmation un peu aventure. En un raccourci formidable, c'est toute sa
manire d'crire, son rapport la fiction et l'autobiographie, que donne ici
Cendrars, en mme temps qu'il apporte un nouvel clairage Bourlinguer.
Impossible partir de l de lire ce livre comme un recueil de souvenirs ordinaire
; impossible aussi de classer luvre de Cendrars dans la simple catgorie des
autobiographies. L'important, pour lui, est d'abord de raconter des "histoires",
de faire uvre de narrateur, quitte utiliser sa vie parce qu'elle fournit un
matriel prcieux et parce que le lecteur croira d'autant plus l'histoire qu'on lui
donnera - l'occasion de penser qu'elle est relle, vcue. Mais ce dmenti ne
supprime pas pour autant le passage cit de Bourlinguer, il ne transforme pas
soudainement cet ouvrage en une fiction ordinaire, il vient s'y ajouter pour le
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
169
relativiser, pour situer cette uvre distance tant de la fiction que de
l'autobiographie, dans un registre difficile dfinir, qui n'est pas exacte ment
celui de l'autofiction, que l'on retrouve chez Restif ou chez Loti, o par toute une
stratgie de reprises contradictoires et de retournements, l'auteur se
fictionnalise sans l'affirmer clairement, tout en apportant au lecteur assez
d'lments pour qu'il doute de la vracit des faits rapports.
D'une faon gnrale, l'pitexte peut ainsi compliquer passablement le
protocole modal d'une uvre, mais il n'est pas mme de le modifier ou de s'y
substituer totalement. Par contre, il est trs utile pour confirmer ou spcifier un
registre de lecture dj tabli par luvre. C'est particulirement important pour
l'autofiction qui, on l'a dj not, ne dispose pas vraiment d'un "horizon
d'attente" propre.
Le dveloppement actuel de la forme de l'entretien et de l'interview tend
naturellement faciliter la possibilit de cette fonction d'emphases Ces
rencontres, dbats, interviews, entretiens, sances de ddicace, auxquels un
crivain doit se plier lors de la sortie d'un ouvrage, peuvent tre l'occasion pour
lui d'insister sur la dimension fictive de son texte, de doubler et d'expliciter par
la parole le dispositif d'nonciation de son livre. D'autant que la premire
question des journalistes (en particulier de la radio ou de la tlvision) consiste
souvent demander l'crivain quelle est la part d'exprience
autobiographique que recle son ouvrage. En un sens, si la vulgate "Thoth" est
plutt l'apanage de l'Universit, la vulgate "Gras" est davantage celle de la
presse littraire du grand publics. Ce faisant, les journalistes traduisent en
partie une attente du public ; mais ils la fabriquent aussi. Il n'est donc pas
tonnant qu'un ouvrage qui se donne comme une fiction alors que son auteur
est aussi l'un des personnages, veille cette sempiternelle question.
Ainsi, le 25 fvrier 1981, dans le cadre de lutilisation tlvise "La
Rage de lire", l'une des premires questions poses Maris Vargas Llosa sur
son livre La Tante Julia et le scribouillard, qui venait d'tre traduit en franais,
avait pour objet la dimension autobiographique de ce roman. Elle lui a permis
de prciser que seul le rcit de l'amour de son hros (qui porte son nom) pour
sa tante tait vrai, bien qu'il ait t profondment travaill et que l'pisode des
Noces soit invent par exemple. Tout ce qui porte sur le Balzac du
feuilleton-radio, Petro Camacho, serait ainsi fictif, mme s'il est inspir d'un
auteur rel, qui sombra aussi dans la folie. Vargos Llosa a en outre apport une
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
170
information qui ne manque pas d'intrt pour comprendre la pratique de
l'autofiction : l'ide et le besoin de reprsenter fictivement un pisode de sa vie
ne lui serait venu qu'aprs avoir commenc l'histoire d'un auteur de
mlodrames radiophoniques qui devenait fou force de produire et qui se
mettait emmler toutes les intrigues et tous les personnages qu'il menait de
front. C'est parce que son rcit commenait devenir compltement irrel, que
les niveaux de sa narration s'emballaient sans qu'il arrive s'y retrouver, qu'il a
senti la ncessit de pallier cet affolement "metaleptique" en mettant en
scne sa vie la radio de Lima, cet amour de jeunesse et son entourage
familial.
Cette bauche d'analyse de Vargos Llosa est l'une des rares explications
explicites et prcises que l'on possde sur l'utilisation du dispositif autofictif.
Comme on l'a dj signaler, la fonction de connaissance que remplit ailleurs
l'pitexte, est curieusement laisse l'abandon dans la pratique de l'autofiction.
Peu d'crivains ont pu ou voulu apporter des renseignements explicites sur le
pourquoi de cette fictionnalisation de soi.
II. MODALISATEURS PERITEXTUELS
Comme pour le protocole nominal, les entours immdiats du texte sont
plus appropris que ses prolongements pitextuels pour mettre en place un
protocole modal.
Cet entourage pritextuel ne se limite pas celui dcid par l'auteur. Il
ne faut pas ngliger le pritexte allographe, ditorial, qui parfois peut orienter la
lecture de faon importante. voquons quelques effets possibles de cette
modalisation ditoriale :
- l'effet-collection : il existe chez certains diteurs des collections qui ne
publient que des ouvrages de fiction, avec une prsentation et un format
identiques. Publier un ouvrage dans ces collections, c'est le classer comme
fictif, quel que soit son contenu ;
- l'effet-oeuvre complte : certains regroupements oprs par l'diteur
peuvent produire une indication gnrique implicite. Ainsi, la collection
"Bibliothque de la Pliade" chez Gallimard o les textes sont rassembls en
"Oeuvre romanesque", "Thtre", "crits intimes" etc. ;
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
171
- l'effet-dition savante : l'appareil critique de certains textes influent;
indiscutablement sur la lecture. Il n'est pas indiffrent de lire Cline dans la
"Pliade" plutt qu'en dition de poche. Dans cette collection, ses romans sont
accompagns d'tudes d'Henri Godard intitules "Les donnes de
l'exprience". Elles permettent de suivre en dtail les modifications que Cline
apporte son pass dans les "romans" o il figue sous son nom - et de
comprendre que son projet d'criture diffre sensiblement du projet
autobiographique.
Quoique non ngligeables, ces effets ne sont toutefois pas comparables
avec ceux produits par le pritexte autographe. C'est lui le principal responsable
du protocole modal de fiction du dispositif autofictif. Les formes pritextuelles
qui peuvent en tre le support sont les suivantes :
- Le titre :
Les intituls prolixes, sur le modle du titre-sommaire de l'ge classique,
sort particulirement aptes cette fonction. Ainsi le titre d'A. Wurmser, Discours
fatalement imaginaire de mon successeur l'Acadmie franaise ; ou le second
titre, qui tient de l'indication gnrique, dj cit, de M. Aug, "Ethno-roman
d'une journe franaise considre sous l'angle des murs, de la thorie et du
bonheur".
- L'indication gnrique :
C'est le lieu par excellence de la formulation d'un protocole modal.
Mettre l'indication "roman" sur la couverture d'un ouvrage, c'est se garantir en
principe contre toute lecture rfrentielle. On sait, par exemple, que c'est Cline
qui a insist auprs des ditions Gallimard pour que cette dnomination
gnrique accompagne D'un chteau l'autre, Nord et Rigodon. De mme,
Cendrars dsignait ses recueils d"Histoires vraies" d'avant-guerre par le terme
gnrique "Nouvelles", ce qui connote sans quivoque la fictionalit - la
diffrence de "rcit".
Reste qu'il ne faut pas oublier que cet usage est relativement rcent
(Genette, 1987, pp. 89-97) ; qu'il est toujours difficile en particulier pour les
traductions, de mesurer la part prise par l'auteur dans ce geste classificatoire.
Notons aussi que peu d'crivains ont cherch crer une indication gnrique
originale, rellement utilise sur la couverture ou sur la page de titre, pour
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
172
dsigner leur pratique de la fictionnalisation de soi. Seuls J . Charyn et J .
Franois l'ont tent avec les termes gnriques "Une vie romance" et "roman
de mmoires".
- La ddicace :
On ne pense gure elle pour l'exposition d'un registre de lecture. C'est
pourtant un support qui dans son rgime moderne permet une dtermination
la fois sobre et frappante. Vargos Llosa pour La Tante Julia et le scribouillard :
"A J ulia Urqui di Illanes, qui nous devons tant, ce roman et moi". Cet envoi
lapidaire rsume lui seul toute l'nigme de l'autofiction : de concert, il atteste
de la vracit de l'amour relat par le texte et il affiche sa dimension
romanesque. Plus ample, le rgime classique ou romantique de la ddicace
(l'ptre ddicatoire et ses avatars) autorise une explication qui peut tre longue
et circonstancie comme on le voit dans la superbe ddicace de Nerval
Alexandre Dumas pour Les Filles de Feu - trop dveloppe pour tre cite ici,
mais qui sera juste convoque en temps voulu.
- L'pigraphe :
C'est un lieu attendu parce qu'il permet de se situer par rapport
d'autres crivains et d'autres projets d'criture. Pour son livre Joue-nous
"Espaa", J ocelyne Franois n'utilise pas moins de trois citations, afin
d'expliciter l'oscillation entre le roman et l'autobiographie qui le caractrise.
C'est d'abord une pigraphe emprunte Yves Bonnefoy pour marquer que ce
texte ne se rduit pas au vcu d'une personne, sa dimension biographique :
"L'universel n'est pas une loi, qui pour tre partout ne vaut vraiment nulle part.
L'universel a son lieu. L'universel est en chaque lieu dans le regard qu'on en
prend, l'usage qu'on en peut faire". Puis, cette phrase de Novalis, qui rappelle
que le romanesque s'enracine toujours dans un vcu : "Un roman est une vie
en livre". Une affirmation, enfin, de B. Nol, signale la part d'invention de ce
texte : "J 'cris pour voir". A la lisire du texte, un mouvement de balancier entre
le vcu et la fiction s'installe ainsi, invitant le lecteur oprer une lecture bifide.
- L'avertissement :
Plus frappant qu'une prface, il permet de classer luvre dans le
registre de la fiction sans se livrer une laborieuse explication. C'est cette
forme qu'a choisie, par exemple, F.R. Bastide pour dfinir L'Enchanteur et
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
173
nous, non sans renouveler lgamment sa formulation traditionnelle. Sur la
page de garde, on peut lire : "Tout uvre d'imagination tant libre, il va de soi
que les personnages publics cits dans ce roman n'ont pu dire ce qu'ils disent,
ni agir comme ils agissent. Toute ressemblance ne serait que le rsultat d'une
improbable concidence, que l'auteur tiendrait pour involontaire".
- Le prire d'insrer :
C'est bien sr le lieu par excellence d'une dfinition gnrique pour les
textes contemporains. Sans doute, il est rarement sign, souvent allographe.
Mais si l'on carte cette difficult d'attribution, il faut bien reconnatre que c'est
le moyen le plus sr pour distinguer rapidement les autofictions parmi les
ouvrages romanesques contemporains, par exemple sur les tables des
libraires. Parce que les phnomnes de rverbration fascinent toujours, quels
que soient les domaines ils oprent, ce "petit digest coutumier de la fin"
(Cline) manque rarement de signaler un ddoublement fictionnel. Mme
quand la fictionnalisation de soi est minime, cette curiosit littraire est
pratiquement toujours note. Il serait d'ailleurs intressant de dresser un
florilge des oxynores qui sont employs pour signaler cette rflexion de
l'auteur dans sa fiction, mme s'ils sont rarement originaux ("L'auteur confond
en virtuose le rel et la vie rve", "Les mensonges font triompher le vrai de la
plus clatante manire", "L'autobiographie est recouverte, conquise par le
roman", "La confession devient impudique : c'est le risque du roman" etc.).
- La prface :
Fait curieux, ce moyen n'est presque jamais utilis pour exprimer un
protocole modal. Une des rares exceptions une notule de Herman Hesse pour
deux textes autofictifs, Enfance d'un magicien et Esquisse d'une
autobiographie, qui introduit le volume des Traumfhrte (les Voies du rve,
traduit partiellement en franais dans le recueil qui porte comme titre L'Enfance
d'un magicien) :
"Peu aprs la Premire Guerre mondiale, je tentai par
deux fois de tracer, sous la forme d'un conte
demi-humoristique, un aperu sommaire de ma vie
destin mes amis pour lesquels le cours de mon
existence tait devenu, l'poque, plus ou moins
problmatique. Celui de ces deux essais que je prfre,
Enfance d'un magicien, est rest l'tat de fragment.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
174
L'autre, inspir de J ean-Paul, est une tentative de
"biographie conjecturale" qui anticipe l'avenir et qui parut
en 1925 dans la Neue Rundschau de Berlin. Le prsent
ouvrage en reproduit le texte, except quelques
corrections sans importance. Au cours des annes, j'ai
essay plusieurs fois de runir les deux morceaux d'une
manire ou d'une autre, cependant je n'ai pas trouv le
moyen de concilier deux textes aussi diffrents de ton et
d'atmosphre. (H.H.) .
Malgr sa brivet, cette prsentation fournit, avec la rfrence
J ean-Paul, une information d'importance pour la gnalogie de l'autofiction. Il
faudra s'en souvenir quand on tentera de tracer un historique de cette pratique
littraire.
Ce rapide inventaire appelle deux remarques.
Rappelons d'abord que les supports pritextuels privilgis pour la mise
en place d'un protocole modal sont l'indication gnrique, l'pigraphe et la
ddicace. Grande absente, la prface est rarement mise contribution pour
signaler le caractre imaginaire du texte. Si on met en corrlation ces deux
faits, un trait semble dominer l'emploi du pritexte dans l'indication du registre
fictif : l'pargne. Tout se passe comme s'il fallait indiquer rapidement qu'il
s'agissait d'une fiction, mais ne pas s'attarder sur ce choix modal pourtant
trange quand or. se reprsente soi-mme. Il est tout de mme remarquable
que des crivains utilisant systmatiquement ce dispositif comme Cline,
Cendrars, Gombrowicz eu plus rcemment Rollin, Sollers, Bastide, n'aient
jamais prsent et justifi leurs textes par un discours prfaciel. Ce silence est
naturellement mettre en rapport avec l'absence d'une tradition de l'autofiction,
qui rend malaise toute justification. Mais on peut aussi se demander si cela ne
tient pas au fait que le dispositif de l'autofiction est d'autant plus efficace qu'il
est elliptique, montr plutt qu'expliqu. Mme Nerval, qui dveloppe l'envi
les motifs de son utilisation du dispositif, ne le fait que pour rpondre un
article de Dumas, qui donnait de lui un portrait amical mais peu flatteur ("Tantt
il est le roi d'Orient Salomon () tantt il est sultan de Crime, comte
d'Abyssinie, duc d'gypte, baron de Smyrne. Un autre jour il se croit fou..."
etc.).
On notera aussi que tous ces exemples de modalisation utilisent un
support qui appartient au pritexte initial, la frange paratextuelle qui ouvre sur
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
175
le texte. Est-ce dire qu'une note en bas de page ne pourrait, par exemple
remplir un tel office ? On a pourtant une belle illustration de cette situation dans
Moravagine. Au cours de ce roman, il est question d'un trsor ayant appartenu
Moravagine. Un appel de note conduit cette explication, signe par l'auteur :
"Pour le trsor de Moravagine. Cf. Axel de Villiers de L'Isle-Adam. B.C." (o.c., t.
II, p. 271). Ce renvoi intertextuel une fiction a bien sr pour effet de draliser
l'aventure de Moravagine, qui est pourtant prsente dans la Prface comme
une histoire relle. Cette note introduit donc un facteur de complication pour le
registre de luvre ; elle ne permet pas d'tablir un protocole modal univoque. Il
semble que l'on puisse gnraliser cette description tout le pritexte central
ou terminal. La signification d'une uvre tant vectorialise, se faisant au cours
de la celle-ci que pour mourir sur l'chafaud, sans pouvoir mme donner un titre
sors tmoignage, avait pourtant trouv le moyen d'indiquer par une formule
propitiatoire le sens qu'elle donnait ce texte, en crivait sur la premire page
les mots : Appel l'impartiale postrit, qui serviront de titre la premire
dition en 1795.
Ce cas trs particulier doit nous rappeler qu'un protocole nominal ne se
suffit pas lui-mme pour donner le registre discursif d'une uvre : celui-ci doit
tre explicit, ne serait-ce que par une brve indication pritextuelle comme
celle de Mme Roland. Si cette explicitation vient manquer, le texte se trouvera
marqu d'une quivoque essentielle.
Par omission pritextuelle, un livre peut donc se placer dans un registre
indistinct, qui ne manquera pas de drouter le lecteur. Cette omission peut tre
accidentelle, mais elle peut aussi rsulter d'une dcision dlibre de l'auteur.
Un court rcit comme Giacomo Joyce de J ames J oyce fournit l'illustration
d'un texte au registre indistinct, pour des raisons que l'on peut supposer
indpendantes de la volont de son auteur. Rdig vers 1814, entre Portrait de
l'Artiste et Ulysse, ce bref rcit n'a jamais t publi du vivant de J oyce. Ayant
pill ce petit texte au profit de ces deux dernires uvres, il semble avoir
abandonn le projet de sa publication. Ces quinze feuillets manuscrits ne
manquent pourtant pas de charme. Nouveau Saint-Preux, J oyce s'y reprsente
en amoureux transi d'une jeune lve pleine de distinction. La narration la
premire personne est conduite de faon discontinue, dans lecture de faon
cumulative, il est ncessaire qu'une donne aussi importante que le statut
modal soit formule au seuil de luvre. Sans cette prcaution, le texte aura, un
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
176
statut ambigu. ou contradictoire, que ne russira pas modifier une
dtermination pritextuelle ultrieure.
Au reste, le pritexte est un moyen trs efficace pour rendre le registre
d'une uvre quivoque, pour troubler son statut gnrique. Si luvre ne
prsente pas un pritexte rpondant aux attentes de son poque, ne se dote
pas des signes paratextuels qui permettent d'identifier son "genre", elle ne sera
pas compltement intelligible. Selon luvre en question, le lecteur aura alors le
sentiment d'une dfectuosit ou d'un manque dlibr, qu'il doit combler par un
effort particulier de contextualisation. Le pritexte se rvle ainsi tre le moyen,
comme pour le protocole nominal, de se placer dans une aire gnrique
ambigu, soit en laissant en suspens le registre de luvre, soit en le rendant
contradictoire.
Il. 1. Protocole modal indfini.
La publication d'un rcit autobiographique se prsente ordinairement
entoure d'un halo paratextuel qui le contextualise. Que celui-ci achve une
uvre antrieure en clairant ses coulisses (autobiographie d'crivain) ou qu'il
retrace la trajectoire singulire d'une personne (rcit de vie ou Mmoires), il est
pris en charge, situ dans l'ordre du discours. Cette mise en situation suppose
que le signataire et le contenu soit prsents au lecteur, par un moyen ou un
autre. Mme Roland crivant ses Mmoires particuliers en prison et ne quittant
une prose trs potique, qui analyse par fragments les motions et les
sentiments d'un amour qui n'ose pas se dclarer :
"Douce crature. A minuit, aprs la musique, tout le
long de la via San Michele, ces mots furent murmurs. Eh,
doucement, J amesy ! N'as-tu pas march la nuit par les
rues de Dublin, et, sanglotant, profr un autre nom ?"
(trad. fr. Du Bouchet, p. 6).
Dans son dition, R. Ellmann assure que ce rcit s'enracine dans la
biographie de J oyce. Il donne mme, avec beaucoup d'autres indications, le
nom probable de la jeune fille qui a inspir cet moi amoureux. De fait, J oyce
vivait Trieste et gagnait bien son existence en donnant des leons
particulires, l'poque o se situe ce rcit potique. Rien, toutefois, dans cette
uvre, ne permet de dire si J oyce a rellement voulu inscrire des motions
relles. A part la forme italianise de son nom, dont il est difficile de dcider s'il
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
177
devait tre le titre final, J oyce n'a formul aucune indication allant dans ce sens.
Dans les marges de cette uvre, aucune mention ne permet de savoir si
l'auteur d'Ulysse voulait que l'on fasse une lecture autobiographique de cette
relation d'un amour informul. Mais l'inverse, aucun lment n'autorise
suivre l'diteur dans la prsentation fictionnelle qu'il fait de ce rcit. Sur la
couverture de la traduction franaise d'Andr Du Bouchet, le lecteur peut en
effet lire l'indication gnrique "roman-pome". Pourtant, la description du
manuscrit par R. Ellmann n'indique rien de tel. Il s'agit d'une initiative discutable
de l'diteur. Lallure potique de ce texte suggre au premier abord, certes, que
ce texte est une fiction. Mais on pourrait aussi avancer que J oyce a choisi cette
forme potique, pour prendre ses distances avec cet pisode douloureux.
Il est ainsi impossible de trancher en faveur d'une lecture
autobiographique ou d'une lecture romanesque. Autant d'arguments peuvent
tre avancs dans un sens comme dans l'autre. Par contraste avec le protocole
nominal qui est nettement affich (J oyce apparat sous les diminutifs "J amesy"
et "J im", voque sa femme "Nora", cite Portrait de l'Artiste et Visse), le
protocole modal de cette prose reste dans le non-dit, comme l'amour qu'il
retrace. Il est bien entendu possible d'interprter ce silence et de donner une
signification littraire cette absence qui n'est peut-tre que contingente. Ce
texte, qui s'achve sur l'invocation de la femme lgitime, n'a-t-il pas une ralit
indcise parce que cet amour in petto tait lui-mme confus, plus involu que
tourn vers l'autre ? Une telle interprtation pourrait se dfendre, mais force est
d'abord de noter que J oyce a emport avec lui le secret de ce texte et qu'on ne
saura sans doute jamais quel statut il comptait lui donner.
Luvre de J ean Genet est, par contre, un bel exemple d'indtermination
voulue. Au sein de son corpus, des ouvrages comme Notre-Dame des Fleurs,
Miracle de la Rose, Pompes Funbres Journal du Voleur sont des textes
nigmatiques. Bien sr, Genet est prsent dans chacun d'eux. Il est difficile,
pourtant, dy apprcier la part de fiction et la part d'exprience vcue. Les
ditions disponibles aujourd'hui ont gard quelque chose de versions d'origine,
publies sans date, sans lieu, parfois sans nom d'diteur et qui allaient tout droit
l'Enfer de la B.N. le lecteur a du mal les situer, les classer et donc, les
lire. Rien voir avec son testament littraire et politique, Un Captif amoureux,
qui est pleinement rfrentiel, garanti hors-texte par la personne publique
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
178
qu'tait devenu Genet et le drame malheureusement trop connu des camps
palestiniens.
Certes, le protocole nominal de ces narrations est sans ambigut. Genet
y est toujours prsent sous son nom, la fois comme narrateur et comme
personnage. Mme dans sa premire uvre d'envergure, Notre-Dame des
Fleurs, dont il n'est pas le hros, Genet se prsente sans masque, sous sa
vritable identit. Complaisamment, il dcline son prnom et son patronyme
comme dans tous les autres rcits o l'abjection, le mal et la beaut se
disputent la prcellence.
Bien plus, le pritexte de ces rcits n'est pas tout fait dnu de signaux
rfrentiels. Notre-Dame des Fleurs porte comme achev de rdaction "Prison
de Fresnes, 1942", est ddi Maurice Pilorge, "dont la mort n'a pas fini
d'empoisonner ma vie" crit Genet. Comme on sait, c'est dans une cellule de
Fresnes que le narrateur "J ean Genet" invente "l'histoire artificielle" de Divine et
de Notre-Dame des Fleurs. Ce dernier est mme dcrit comme une
transfiguration d'un certain "Pilorge" mort vingt-cinq ans pour avoir tu son
amant Escudero, afin de "lui voler une misre". De mme, Miracle de la Rose
s'achve par l'indication "La Sant. Prison de Tourelles 1943". Cette information
sur le lieu de rdaction du livre rend crdible le sjour la centrale de
Fontevrault qui fait cho, vingt ans de distance, celui de la maison de
correction de Mettray, relat par l'crivain. Semblablement, Pompes Funbres
porte comme ddicace "A J ean Decarnin", jeune rsistant mort sur les pavs
parisiens, qui est au centre de ce chant funbre et dont la "dcomposition
prismatique" va produire les amours d'un bourreau berlinois et d'un jeune
Hitlrien. Le Journal du voleur, enfin, n'est ddi qu' des personnalits
littraires (" Sartre / au Castor"), mais c'est le seul livre ou Genet parle sans
intermdiaire, o la figure centrale aimantant la charge de misre et de gloire
qui fait son gibier habituel est lui-mme. Au reste, tout un texte second court
pour ainsi dire en bas de page pour authentifier le rcit, en apporter les pices
J ustificatives, sous forme de prcisions chronologiques, d'extraits de la presse,
de rectifications gographiques etc.
Mettant en relief tantt le contenu, tantt le sujet d'nonciation de ses
ouvrages, le pritexte de Genet a ainsi pour fonction essentielle de leur
apporter un minimum de crdibilit rfrentielle. Toutes ses indications
pritextuelles donnent penser qu'il a, bien connu au moins les lieux et les
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
179
personnes voqus dans ses rcits. Pourtant, ce pritexte ne va pas plus loin
dans cette authentification. Il s'arrte la confirmation du dcor et des ores
dcrits. Il ne dit pas si l'auteur a rellement vcu cette immersion dans le crime
et si c'est bien ainsi que le lecteur doit lire ces livres. Aucune indication
gnrique, pigraphique, prfacielle ne permet d'en savoir plus sur ses
aventures. Pourquoi se poser de telles questions si Genet se reprsente bien
lui-mme ? Play boy ne titrait-il pas, en 1964, une interview de Genet : "A
candid conversation with the brazen, brilliant author of The Balcony and The
Blacks, self proclaimed homosexuel, coward, thief and traiter" ? Sartre n'a-t-il
pas brillamment expliqu, dans son Saint-Genet, les racines de son voyage au
bout du mal, partir de confidences faites par Genet lui-mme ?
C'est que comme ses pices de thtre, les rcits de Genet multiplient
les jeux avec l'apparence et la ralit, la fiction et la vrit, l'tre et le paratre
dans un jeu de glaces o l'auteur se trouve lui-mme pris. Comme il l'affirme
ds son second roman, Genet a seulement voulu dans son uvre, donner "les
honneurs du Nom" des "tres, des objets, des sentiments rputs vils" :
"Car mes livres seront-ils jamais autre chose qu'un
prtexte montrer un soldat vtu d'azur, un ange et un
ngre fraternels jouant aux ds ou aux osselets dans une
prison sombre ou claire ?" (1948, p. 24).
Mais pour que cette transmutation atteigne son maximum d'intensit, il a
souvent permut les places et les situations, chang les rles et les lieux, en
se mettant contribution. Dans J ournal du Voleur, il dvoile ainsi une des clefs
de son travail romanesque :
pour que l'exprience soit plus efficace je ferai un
instant revivre Lucien dans ma peau misrable. Dans un
livre intitul Miracle de la Rose, d'un jeune bagnard qui
ses camarades crachent sur les joues et les yeux, je
prends l'ignominie de la posture mon compte, et parlant
de lui je dis : 'J e'. Ici c'est l'inverse . (1949, p. 1 81).
Ce travail commence ds Notre-Dame des Fleurs o Genet dclare que
Divine c'est lui, o Mignon est une sorte de rincarnation de Roger et o
Notre-Dame des Fleurs est un avatar de Pilorge. Dans Pompes Funbres, qui
est son dernier texte autofictif, ce travail de permutation devient vertigineux
puisque le ddicataire porte le mme prnom que l'auteur et que ces com-
mutations se succdent sans mme tre toujours dclares entre J ean
Decarnin, Paulot, Erik, le bourreau berlinois et J ean Genet lui-mme - comme
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
180
dans les romans de Tony Duvert, qui semble avoir trouv l une source
d'inspiration importante. Ce flottement des identits, ce vacillement de la ralit
o le modle et sa projection fantasmatique ("prismatique" dirait Genet)
coexistent, amne dj le lecteur , se demander s'il a rellement affaire un
tmoignage, mme magnifi, sur les prisons, les voyous, la pdrastie et le
crime sous toutes ses formes.
Bien plus, la manire dont le narrateur traite de son travail d'crivain ne
peut que l'encourager dans cette voie puisque Genet n'a de cesse de dnoncer
la prtention d'atteindre l'exactitude dans le rcit de soi, d'afficher sa volont de
faire de sa vie une lgende, d'atteindre les fastes. de la Fable et l'irisation du
Pome :
"... que ma vie doit tre lgende c'est--dire lisible et sa
lecture donner naissance quelque motion nouvelle que
je nomme posie. J e ne suis plus rien, qu'un prtexte"
(1949 , p. 1 33) .
Comme on le voit, si le pritexte chez Genet apporte un dbut de crdit
autobiographique aux rcits, il s'arrte au seuil de l'essentiel, qui serait de
donner au lecteur le moyen de mesurer le degr de littralit des -aventures
rapportes. Il ne fournit que les donnes strictement ncessaires la densit
des faits, des actes et des motions mis en scne. Quant au texte de ces
narrations, il multiplie les dmentis et les avertissements contre une lecture
rfrentielle, qui aplatirait pour ainsi dire luvre sur l'homme.
A partir de l, si toute recherche biographique sur Genet a bien sr son
importance, il est quelque peu naf de traiter ses fictions intimes d "'insincres"
ou de "truques", comme le fait J ean-Bernard Moraly dans son livre, par ailleurs
trs riche, Jean Genet, La vie crite : la tche d'un crivain n'est pas de fournir
des documents ses futurs biographes. Tout aussi ingnu serait de prendre
la lettre les confidences faites Sartre pour Saint Genet, Comdien et Martyr :
ce serait oublie que cet ouvrage devait tre l'antichambre de la lgende, le
premier tome des Oeuvres compltes de Genet. Comme Proust et quelques
autres, Genet a voulu enlever son uvre romanesque sur une ligne de crte
prilleuse, o la vie n'tait qu'une matire destine fondre une lgende,
c'est--dire au sens tymologique un somptueux lisible. On sait d'ailleurs
aujourd'hui qu'en dcouvrant A l'Ombre des jeunes filles en fleurs... Genet "all
de merveilles en merveilles" (Moraly, 1988, p. 69). Avec une perspicacit
admirable, Barthes avait devin et signal cette affinit dans Le Plaisir du texte
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
181
et dans S / Z, comme on aura l'occasion de le voir. Aussi bien, cette affinit est
davantage une filiation, une dette mme. Par la thmatique florale, la reprise
de la construction "bouillonne" de sa phrase, et bien sr la mise en place d'un
"moi apocryphe", l'ombre de Proust est partout dans les romans de Genet
(Moraly, 1988, pp. 78-80). Mais ce "modle souverain" n'est pas tu, il est parfois
inscrit noir sur blanc, comme dans le Journal du Voleur. On se souvient que
dans un passage essentiel du Temps retrouv, Proust rend hommage une
famille, les Larivire, en dclarant que leur nom est le seul nom rel de tout son
colossal ouvrage. Reprenant ce geste son compte, Genet voque dans le
Journal un voyou exceptionnel, Armand, qui avait pour lui une "valeur d'autorit
morale" :
J ignore dans quelle fosse commune il est enterr, ou
sil est toujours debout, promenant avec indolence un
corps souple et fort. Il est le seul de qui je veux transcrire
le nom exact. Le trahir mme si peu serait trop. Quand il
se levait de sa chaise, il rgnait sur le monde . (1949,
p.251, nous soulignons.)
II.2. Protocole modal contradictoire.
A l'inverse de la situation prcdente, le pritexte rend aussi possible la
disposition d'un registre contradictoire. Son mode d'tre priphrique, dj
signal, lui permet l'addition de signaux gnriques opposs. Luvre n'est plus
alors sans protocole achev, sans registre de lecture fermement tabli. Elle est
plutt sature de modalisateurs, ceci prs que ces derniers sont
incompatibles, ne peuvent coexister de faon cohrente. Comme
prcdemment, cette "situation d'nonciation complexe" n'est pas
ncessairement le rsultat d'un choix dlibr.
On peut imaginer en effet la situation inverse de celle de Giocomo Joyce.
Un manuscrit semblable, mais prsentant une foule de signaux gnriques
contraires. Certains le dfiniraient comme un roman, d'autres comme un rcit
autobiographique etc. L'crivain mort sans laisser d'lments pour trancher, les
hritiers seraient bien embarrasss. Ce n'est bien star qu'une hypothse
d'cole. A notre connaissance, il n'est pas d'exemple d'une telle situation. Par
contre, de nombreux ouvrages ont un statut incohrent la suite d'erreurs, de
confusions ou d'abus des diteurs, voire des crivains.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
182
Un exemple ? Le premier livre d'Ada, Elle voulait voir la mer... (Maurice
Nadeau, 1985). S'il faut en croire l'indication gnrique de la couverture et de la
page de titre, c'est un "roman". Pourtant, le prire d'insrer complique cette
classification gnrique dans le rsum qu'il donne de l'ouvrage. Dans celui-ci,
la narratrice et hrone du livre est identifie l'auteur :
"Une famille ouvrire italienne dans la banlieue
parisienne. Le pre est maon. La mre rve d'un meilleur
sort pour ses enfants. Elle parvient faire entrer Ada au
lyce. Pas d'autre orientation pour Ada que le 'technique'.
Elle effectue un travail de bureau dans une grande 'boite'
alors que ne cesse de l'habiter le dsir de parvenir la
culture et de se raliser".
Apparemment, ce texte est donc une autofiction. Le protocole modal du
dispositif est ralis (c'est un "roman") ; ainsi que le protocole nominal (l'auteur
et l'hrone ne font qu'un). Et cette classification est la seule faon d'accorder
les dsignations contradictoires sous lesquelles se prsente l'ouvrage.
Pourtant, le rcit ne rpond pas cette description du pritexte. A la lecture,
seule l'histoire correspond au rsum du prire d'insrer. C'est bien le rcit, la
premire personne, de l'enfance, de l'adolescence et de l'entre dans la vie
active d'une Franaise d'origine italienne, prise entre deux mondes, enferme
dans son milieu ouvrier, aspirant la culture et au bonheur personnel. Mais la
narratrice ne s'appelle pas le moins du monde "Ada". Dans le roman, on
apprend que son patronyme est "Renault" (pp. 68, 70) et de nombreuses
occurrences la dotent du prnom "Renata" (au hasard, pp. 153, 157, 159, 166,
168 etc.) L'indication gnrique prsente le livre comme un roman, alors que la
quatrime de couverture en fait un rcit autobiographique tandis que le texte
prsente une hrone diffrente de l'auteur. Que peut en conclure le lecteur ?
Naturellement, il ne verra pas dans ces palinodies la volont de produire un
effet littraire spcifique. Selon son humeur ou son indulgence, il pensera que
le personnel de cette maison d'dition) a) est tourdi, manque de coordination,
c) tente de concilier des recettes commerciales incompatibles (le "vcu" se
vend bien, mais tout ce qui est "romanc" ne se vend pas trop mal non plus). Il
ne s'agit l que d'un exemple, mais ces incohrences pritextuelles sont
malheureusement monnaie courante dans le secteur grand public de l'dition
(Lejeune, 1986 b).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
183
Plus intressante littrairement est la constitution voulue d'un registre de
lecture contradictoire. Il suffit pour cela que l'crivain accompagne son texte
d'indications discordantes quant sa vracit ou sa fictionalit. Les proprits
du pritexte permettent mme d'oprer une mise en place tardive, lors d'une
dition ultrieure, de ce statut gnrique complexe.
Dans Monsieur Jadis (La Table ronde, 1970) d'Antoine Blondin, le
registre contradictoire du texte repose sur une double ddicace provocante :
"A l'abb Pistre, la part de confession qui lui revient de
droit.
A Yvan Audouard, les mensonges, en hommage au
matre de la 'vrit du dimanche'.".
Cette dclaration contradictoire donne d'emble le ton de cette pochade
qui fait alterner un rgime autodigtique et un rgime htrodigtique de
narration, afin de raconter une nuit passe par l'auteur au commissariat, pour
une vrification d'identit. Ce contrle policier est naturellement l'occasion pour
Blondin de rflchir sur son identit et de faire le bilan de son existence. C'est le
thme bien connu de l'homme mr qui se penche sur son pass et qui se
confronte au jeune homme qu'il fut. A ceci prs que cette fois, la confrontation
est relle, la fiction permettant l'auteur de se ddoubler et de camper un
personnage reprsentant le jeune homme qu'il a t, jadis. Ainsi cette histoire
est autant imaginaire que personnelle et intime, ce qui explique l'aporie de la
double ddicace. A vrai dire, l'pigraphe du roman donnait dj la solution de
cette contradiction :
"Ma vie est un roman"
(Tout-Un-Chacun).
Cette pseudo-sentence de la Sagesse des Nations donne exactement le
programme du livre, qui pourrait tre rapport de la faon suivante : "comme
tout le monde, je m'invente des histoires partir de la mienne. Pour me
raconter, je vais fixer quelques-unes d'entre elles en les ramassant dans un
roman. Comme tout ce que l'on imagine fait partie de son mythe personnel, ce
dernier sera aussi vrai que les incidents rels qui composent ma biographie".
Plus complexe et d'une autre qualit littraire, Moravagine de Blaise
Cendrars appartient au cas de figure o le protocole modal d'un texte devient
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
184
contradictoire la suite d'addition uItrieures. On a dj cit ce "roman"
plusieurs reprises, en particulier pour indiquer que Cendrars y jouait un petit
rle et pour suggrer la possibilit d'un protocole modal de fiction "impur". Le
moment est venu de dtailler ce qui fait la singularit gnrique de cette uvre.
Le roman tel qu'il se donne lire aujourd'hui prsente en effet un
appareil pritextuel d'une ampleur inhabituelle. Il est en particulier encadr par
une Prface, qui date de la premire dition de 1926, et par deux textes,
ajouts lors de la dernire dition en 1951 : Pro domo, crit selon Cendrars
partir de notes rdiges de 1917 1926, dont le sous-titre est "Comment j'ai
crit Moravagine (Papiers retrouvs)" ; une Postface, date de 1951. Mais cet
ensemble n'est pas seulement plthorique, il est aussi conflictuel et contrast.
Il faut dire que ds l'dition de 1926, accompagne de la seule Prface,
ce livre tait dj assez retors dans son agencement et plutt problmatique
dans son statut. Si les pigraphes, la ddicace, la prface, les notes, le style
"ampoul et prtentieux" (Cendrars dixit), la construction, constituaient autant
de signaux ironiques quant la ralit des faits rapports, la Prface ne
dclarait la fictionalit du texte que sur le mode de la dngation. Dans celle-ci,
Cendrars reprend en effet les topo de la malle aux manuscrits et du texte
confi par un ami pour tre dit. Ordinairement, c'est l un signe sr de la
fictionalit, l'indice implicite qu'il est donn au lecteur une histoire imaginaire, la
marque d'une "fiction de non-fiction" (Rousset). Pourtant, il y a dans ce cas une
petite nuance qui fait une grande diffrence. Non seulement Cendrars apporte
un luxe de dtails son affabulation, mais en outre il est un lment de cette
mise en scne, une donne de cette mystification. L'auteur de ce manuscrit, il le
connat assez pour que celui-ci lui demande d'intervenir en sa faveur ; l'histoire
qui y est raconte, on a vu qu'il en fut un des acteurs, mme si celle-ci glisse
discrtement sur son rle. Il y a loin de cette situation et du procd traditionnel
du manuscrit apocryphe. Voyez le cas de Stendhal, avec La Chartreuse ou
Armance rien de comparable. Dans ces deux romans, Stendhal prtend avoir
reu un manuscrit (les annales d'un "bon chanoine", la nouvelle d'une "femme
d'esprit"), l'avoir publi sous son nom, en n'apportant que des corrections
minimes. Mais dans les deux cas, il n'est pas un personnage, mme effac, de
ces rcits : il n'a pas eu le bonheur de croiser la Sanseverina, ni de goter
l'amiti d'Octave.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
185
Au contraire, Cendrars remplit un rle dans l'histoire de Moravagine, rle
qui n'est minime que dans la mesure o son apparition est concomitante d'une
formidable ellipse digtique du roman, comme si tout ' coup une censure
imprieuse se levait pour occulter ses relations avec le hros ponyme. En
ralit, si l'on comble ce silence l'aide des donnes fournies par le texte, tout
montre que ds leur premire rencontre Cendrars et Moravagine font quipe.
Inutile de faire appel au hors-texte, de rappeler que Cendrars signait parfois ses
cartes postales "Moravagine". Le roman le dit en toutes lettres. A partir de
l'pisode de Chartres, Cendrars prend la place de Raymond le narrateur auprs
de Moravagine. puis par l'ardeur de ce dernier, par son culte furieux de
l'action, Raymond lui abandonne sa fonction de double fascin, participant,
tous les dbordements de son modle. Fort de son savoir d'Eubage (ce rcit
potique, dj rencontr, est publi la mme anne), de sa connaissance du
dsordre inhrent toutes choses, Cendrars passe dsormais l'acte dans le
morde de ses fictions : c'est maintenant un Portrait de l'artiste en activiste qu'il
donne, sur un mode mineur, ses lecteurs. Comme s'il voulait rassembler sur
son nom tous les extrmes, multiplier les images contrastes de lui-mme, il se
dpeint lanc. avec Moravagine dans " l'action qui obit un million de mobiles
diffrents, l'action phmre, l'action qui subit toutes les contingences possibles
et imaginables, l'action antagoniste. La vie" (M., p. 393). Par rapport lEubage,
cette fiction de soi largit le champ des possibles cendrarsiens : aprs la
connaissance, c'est l'action qu'il prtend aimanter son nom. Dans l'dition de
1926, Cendrars est ainsi la fois au cur et la priphrie de Moravagine : sur
ses marges comme diteur du texte et au centre du rcit comme double du
hros ponyme.
Une telle position de l'auteur complique naturellement outrance la
fiction du manuscrit apocryphe. La prsence de Cendrars dans le roman a un
effet contradictoire : elle le dralise tout en apportant une sorte de
vraisemblance au statut allographe du texte. Pousse la limite, la dngation
ne permet plus au lecteur de jouer innocemment la "fiction de non-fiction". Il
est oblig de se demander si l'auteur ne croit pas ce qu'il raconte, quand bien
mme l'objet de son rcit serait irrel. Il faudrait pouvoir approfondir le registre
curieux o Cendrars essaie de loger son texte. Mettons pour simplifier qu'il a
recours une "fiction de non-fiction", mais en essayant rellement d'y faire
croire le lecteur. Tendanciellement, la Prface de 1926 prsente donc
Moravagine comme un texte rfrentiel.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
186
Tout se complique, si l'on peut dire, avec l'dition de 1951 et les deux
additions signales. Les liens entre ces deux pices rapportes, entre elles et
luvre de 1926, sont pour le moins inattendus.
- Pro domo / Postface : ces deux textes sont la fois contradictoires et
complmentaires. La Postface garantit l'authenticit de l'origine du Pro domo,
accrdite son statut de "papiers retrouvs", de fragments contemporains de la
longue gestation de Moravagine. Mais dans le mme temps, elle reconduit,
un quart de sicle de distance, la, mystification qui fait de Cendrars un simple
diteur de ce roman. Pourtant, cette mystification est en contradiction avec le
Pro dodo puisque, dans celui-ci, Cendrars rvle qu'il est le vritable auteur de
ce livre. Comme son sous-titre l'indique bien, ce Pro domo est, en effet, une
sorte de Journal de Moravagine : il relate toutes les circonstances qui ont
conduit son existence, depuis les sources du personnage jusqu'aux tapes de
la rdaction de ce texte. C'est un document littraire exceptionnel par toutes les
informations qu'il donne sur les sentiers de la cration chez Cendrars. Tout le
Pro domo s'inscrit donc en faux contre le simulacre qui fait de Moravagine une
personne relle et du rcit la relation de son histoire crit par un tiers. Avec
l'dition de 1951, Cendrars fait par consquent un geste contradictoire. Du
mme mouvement, il dfait (avec le Pro domo) et reconduit (avec la Postface)
l'artifice mis en place en 1926. Tout se passe comme s'il n'arrivait pas choisir
entre ces deux options - moins que ces "papiers retrouvs" ne soient, eux
aussi, une "fiction de non-fiction", que Cendrars ait invent aprs coup
l'laboration de Moravagine, comme il avait invent l'histoire de cet "idiot".
- Version de 1926 / Pro domo / Postface : si on considre maintenant le
livre dans sa totalit, tel qu'il se prsente dans sa version finale en 1951, on
constate que Cendrars s'est livr une curieuse manipulation. Considrons la
disposition des derrires pices du livre : la Postface boucle le volume et
garantit l'authenticit du Pro domo, alors que son contenu est manifestement
fictif, qu'elle s'inscrit dans la tradition des manuscrits perdus ou retrouvs. Le
commentaire gntique et explicatif du Pro domo se trouve, par suite, encadr
par une prsentation fictive (la Prface) et par sa ractualisation (la Postface).
Ce texte rfrentiel est comme enclav dans l'imaginaire, encercl par des
fabulations. En toute logique, on se serait attendu l'inverse : un texte final, la
rigueur liminaire, qui donnerait toutes les informations du Pro domo, rtablirait
la vrit et la ralit. Par convention, le dernier mot, le mot de la fin revient
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
187
d'habitude au commentaire discursif qui se situe un niveau plus abstrait et
dont la, position hirarchique est dominante. Or, c'est prcisment le contraire
que prsente Moravagine. Il y a l comme un contre-emploi du discours
d'escorte, du commentaire historique et critique par Cendrars. Au lieu de
surplomber le livre, d'avoir la matrise de son imaginaire, le Pro domo se trouve
plac sur le mme plan que les inventions qui le constituent ; bien plus, il se
trouve subordonn l'une d'elles. S'agit-il d'une tourderie de Cendrars ? Or. a
du mal le croire ; d'autant que son texte sur Villon montre combien Cendrars
tait sensible la structuration interne d'un livre, aux effets de sens produits par
la rpartition des textes dans le volume (1952, p. 60). De toutes faons, le
rsultat est le mme : dans la position o il est, le Pro domo perd sa
comptence dcliner la vrit du reste de l'ouvrage et disposer de la vrit
qui est la sienne. Cette inversion le signale au lecteur comme un texte qui n'a
aucun privilge particulier, une recration fictive de la cration littraire, un
commentaire fictif de Moravagine. Cendrars a imagin rtrospectivement la
rdaction de ce roman, comme il avait invent l'histoire de Moravagine et sa
rencontre avec lui. La fabulation n'est bien sr pas du mme ordre dans les
deux cas ; une frontire les spare, qui est celle-l mme qui passe entre les
autofictions et les textes "mythobiographiques" comme Bourlinguer. Dans ce
dernier cas, il part de la ralit pour inventer ; dans l'autre, il s'invente pour
tenter de retrouver le rel et son exprience vcue. Mais ces deux plans
"communiquent de faon subtile" comme le montrent Moravagine et ses autres
textes.
En inversant les attentes et les conventions discursives, Cendrars
pousse ainsi encore plus loin la fictionnalisation de soi. Non seulement son nom
est devenu celui d'un personnage fictif, mais son travail d'crivain est devenu
lui-mme une sorte de fiction. On assiste alors une invagination de l'ensemble
de luvre ; tout son ancrage rfrentiel se trouve retourn dans l'ordre
imaginaire qu'il a produit. La fiction n'a plus de bord ni de dehors.
Il faut arrter l ce tour d'horizon des modalisateurs pritextuels de
fiction. On aura not, une fois de plus, que le pritexte a montr sa capacit
produire des modulations et des effets aussi varis qu'inattendus. On ne saurait
assez souligner, aprs Grard Genette, combien ces franges littraires sont
importantes pour la physionomie des uvres et pour l'exprience de la lecture.
Si quelque analyse d'un texte particulier aura paru longue, on espre que
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
188
lindiffrence qui tait jusqu'alors lors de mise envers le paratexte l'excusera.
On aura relev, en outre, comment des usages apparemment inconciliables du
pri texte finissent par converger pour produire un registre complexe indfini ou
contradictoire. Entre Genet, et Cendrars, aucun dnominateur commun ne
semble exister 'dans l'laboration de la "situation globale de communication" de
leurs textes. Le premier opte pour un quasi-silence, refusant d'exploiter ce lieu
privilgi de la communication littraire que sont les marges de l'uvre pour
claircir le statut de ses textes par une sorte d'indiffrence envers le lecteur que
Bataille a dcrit un peu vite comme une forme de mpris. Le second multiplie,
au contraire, les dveloppements et les explications, sature les entours de son
uvre d'une lgion d'indications, comme s'il craignait que le lecteur manque
d'lments pour le dcouvrir. Pourtant, ces deux stratgies de communication,
en apparence opposes, cherchent un effet identique : brouiller les pistes afin
de disparatre dans une lgende, o seul l'criture demeure. Par excs ou par
dfaut, leurs emplois du pritexte et les profils gnriques qui en dcoulent, se
rejoignent dans un rsultat similaire des livres mystrieux, inclassables,
appelant l'infini l'exgse critique, entretenant indfiniment la curiosit et
l'tonnement des lecteurs.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
189
3 - EPIMENIDE EN FICTION
"L'un d'entre eux, leur propre prophte a dit : 'Crtois
toujours menteurs, mchantes btes, ventres paresseux!.
Ce tmoignage est vrai"
Saint-Paul.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
190
Toutes les marques de fictionalit tudies jusqu' prsent relevaient du
pritexte. Cette limitation, ncessaire la clart de notre tude, a pu faire croire
une sorte d'autosuffisance du pritexte dans la constitution du contrat de
lecture d'une uvre. Il est pourtant vident qu'il n'en est presque jamais ainsi.
Si c'tait le cas, "la vrit, lpre vrit" en exergue au roman Le Rouge et le
Noir, "l'humble vrit" dans la marge d'Une Vie feraient de ces ouvrages des
rcits autobiographiques ou historiques. Ne dclare-t-on pas ainsi que
l'intgralit de ces deux textes est vridique ? En ralit, le lecteur ne s'y
trompe pas. Il comprend que ces pigraphes rsument les choix esthtiques,
voire thiques de Stendhal et de Maupassant. Il ne lui viendrait pas l'ide d'y
voir un engagement personnel quant la vracit des faits rapports.
Ces deux exemples sont convoqus pour rappeler cette vidence : le
pritexte est rarement le seul facteur orientant la perception que peut avoir le
lecteur d'une uvre littraire. Il y a dans le texte, dans le discours narratif, dans
l'histoire dans les vnements narrs, dans les personnages, dans le dcor, et
mme dans la composition et le style d'une uvre, des lments qui y
concourent au moins autant. Ce sont ces lments qu'il faut maintenant tenter
de recenser : les modalisateurs de fiction propres au texte.
Pour les cerner, il faut examiner les moyens dont dispose un texte pour
procder une modalisation explicite, pour mettre en uvre un protocole
modal la fois intra-textuel et formule de faon vidente. Il convient d'insister
sur le fait que notre examen se limite pour l'instant tous les cas o un texte
exprime directement et de faon patente la valeur de vrit de son contenu.
Toutes les formulations indirectes, donnes par le biais de commentaires
actoriaux, de mise en abyme ou de procds de thmatisation sont exclues de
notre investigation. Que Cendrars, par exemple, dans Une Nuit dans la fort
(sous titr "Premier fragment d'une autobiographie") se dcrive dans une scne
en train de faire un demi-mensonge ("j'ai menti sans mentir") l'un de ses
meilleurs amis, voil un trait qui ne peut qu'veiller la mfiance du lecteur quant
l'exactitude et la prcision de ce rcit. Mais c'est l un procd implicite
dambigusation, d'ailleurs familier Cendrars, qui ne peut retenir notre
attention. De tels inducteurs d'ambigut ne sont pas l pour donner le statut
gnrique d'un texte ; ils ne peuvent que le troubler et le rendre quivoque.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
191
Cette dtermination rduit donc le phnomne de la modalisation
textuelle au cas explicite o un narrateur (qu'il soit htrodigtique ou
homodigtique) dcrit le registre de son rcit. Que ce narrateur soit ou non un
personnage de son rcit, peut importe. L'essentiel est : a) que ce narrateur soit
le destinateur ultime du rcit, b) que sa description de la valeur de vrit de son
'histoire soit nonce de faon littrale, sans dtours, c) que cette description
dsigne bien le statut des vnements rapports.
De telles dclarations modalisantes sont monnaie courante dans la
plupart des rcits. Elles font partie de l'ensemble des noncs mtanarratifs
exigs par cette situation de discours qu'est le rcit littraire. Le caractre
diffr de sa communication et l'imprvisibilit de son destinataire font qu'il
appelle un "surcodage compensatoire" et qu'il se prsente toujours, par suite,
comme un "nonc mtalangage incorpor" (Hamon, 1977, pp. 264-265).
Au reste, ce besoin de "surcodage" devient imprieux quand une uvre
inaugure une nouvelle manire ou se situe dans un registre indit. On se
rappelle ainsi les excursus du narrateur dans Tom J ones. En consacrant le
premier chapitre de chacun des livres de cet ouvrage commenter son
entreprise, Fielding peut prendre ses distances avec la littrature romanesque
antrieure et expliciter la formule du roman moderne qu'il est en train d'inventer.
On se souvient aussi de la fameuse dclaration liminaire du Pre Goriot :
" vous qui tenez ce livre d'un main blanche, vous qui
vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant :
peut-tre ceci va-t-il m'amuser. Aprs avoir lu les secrtes
infortunes du pre Goriot, vous dnerez avec apptit en
mettant votre insensibilit sur le compte de l'auteur, en le
taxant d'exagration, en l'accusant de posie. Ah !
Sachez-le : ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All
is true, il est si vritable, que chacun peut en reconnatre
les lments chez soi, dans son cur peut-tre".
Aucun commentateur n'a manqu de souligner l'importance de ce
passage o Balzac nonce son credo romanesque. Contre les formes
narratives artificielles et conciliantes de son poque, il revendique un nouveau
vraisemblable, une fabulation vraie, qui ferait place des sujets presque tabous
et qui ne donneraient pas dans des dnouements moralisateurs.
Du fait de leur singularit gnrique, les textes autofictifs sont eux aussi
dans la ncessit d'expliciter leur registre. L peut-tre plus qu'ailleurs, la
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
192
plupart des rcits n expose, peu ou prou le caractre fictif ou rfrentiel de leur
contenu, dans des dclarations qui vont de la simple auto-dsignation des
dveloppements plus amples. Citons quelques exemples, presque au hasard
de notre corpus. Cline dans Normance, relatant Paris sous les
bombardements :
- "J e vous ai dit : je mentirai rien... Les phnomnes
surnaturels vous outrepassent, et c'est tout ! Les
chroniqueurs sans conscience rapetissent, expliquent,
mesquinent les faits ! Oh, votre serviteur... du tout ! Le
respect des somptuosits !" (1954, p. 50) ;
Bastide dans La Vie rve, o (comme Genet dans Notre Dame des
Fleurs) il superpose le rcit de soi et l'invention romanesque, se trouvant ainsi
dans l'obligation de faire de rgulires mises au point :
"J e vais aussi commettre des erreurs, en parlant de
ma famille. Mais la vrit stricte, qui importe peu ici, ne
doit pas tre prfre aux impressions reues ds
l'enfance. Ce qui compte, c'est que j'ai cru, ou imagin,
trs tt" (1962, p. 30)
Dominique Rolin qui dans L'Infini chez soi rve sa naissance, comme
elle rve sa mort dans Le Gteau des morts :
"J e dcouvre ceci ce matin : la ralit n'est que pure
invention prmonitoire. J ubilation. J e serai la pythie de
moi-mme. J 'accomplirai mon travail de prospecteur ayant
pay cash sa concession avec une curiosit que l'on peut
qualifier de chirurgicale.( o..). Il faut oser. Percer. Fendre.
Toucher mon avant-vie pour cesser enfin d'tre le Je que
d'ordinaire on suppose tre moi" (1980, p. 9) ;
et plus loin, dans le mme roman :
"J e fabule ? Mettons. J 'ai le droit. J 'en ai mme le
devoir. Il faudra que j'accouche de mes gniteurs, n'est-ce
pas ?" (p. 131).
Le problme est de savoir quel crdit on peut accorder ces
commentaires o le narrateur claire le registre de son rcit. Un passage de
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
193
Proust, dj voqu propos de Genet, peut servir de fil conducteur cet
examen.` Dans A la recherche du temps perdu, une page entire est consacre
dnier toute vracit luvre ; une page qui ne manque pas d'ailleurs
d'ambigut et fait par cela pendant aux passages quivoques o le narrateur
dcline son identit :
"Dans ce livre o il n'y a pas un seul fait qui ne soit
fictif, o il n'y a pas un seul personnage " clefs", o tout a
t invent par moi selon les besoins de ma
dmonstration, je dois dire la louange de mon pays que
seuls les parents millionnaires de Franoise ayant quitt
leur retraite pour aider leur nice sans appui, que seuls
ceux-l sont des gens rels qui existent. Et persuad que
leur modestie ne s'en offensera pas, pour la raison qu'ils
ne liront jamais ce livre, c'est avec un enfantin plaisir et
une profonde motion que, ne pouvant citer les noms de
tant d'autres qui durent agir de mme et par qui la France
a survcu, je transcris ici leur nom vritable : ils s'appellent
d'un nom si - franais d'ailleurs., Larivire" (Pliade, t. III,
p. 846)
Cette dclaration intervient au terme de la Recherche, dans le volume du
Temps retrouv. Elle est faite presque en passant, l'occasion d'un hommage
rendu des cousins extrmement fortuns de Franoise, cafetiers retirs pour
jouir de leur avoir et qui, pourtant, ont repris gracieusement du service pour
aider la veuve d'un neveu, mort durant la guerre de 14-18 Berry-au-Bac. Elle
insiste, en outre, sur le caractre entirement imaginaire de la digse de la
Recherche : ce ne serait pas un roman "clefs", ni mme un rcit d'inspiration
autobiographique. Apparemment donc, un avertissement net et sans quivoque
possible sur le statut du roman. Si on le considre comme le protocole modal
de luvre, il faut toutefois reconnatre qu'il n'est pas aussi transparent qu'il en
a l'air. "Marcel" prtend que "tout est invent" dans sa suite romanesque. Mais
cette affirmation est formule pour citer des personnes qui existeraient dans la
ralit. Qui plus est, ces Larivire ont un lien de parent avec une certaine
"Franoise", un personnage qui, lui, serait totalement fictif. Les personnages
fictifs de la Recherche auraient donc des parents rels ? Et rciproquement, les
Larivire ont donc de la famille dans la fiction ? Ce caractre hybride des
Larivire laisse songeur et leur statut paradoxal amne prendre conscience
d'un autre paradoxe.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
194
C'est que, quand le narrateur affirme "tout est invent", dclare que son
discours est de part en part fictif, il s'enlve toute possibilit de garantir son
propos, de fonder son jugement. Ds lors que son discours droule une fiction
dont il fait partie (comme tout narrateur d'ailleurs, son statut autodigtique
important ici peu), lui mme est un tre de fiction et perd tout droit de reprise
sur la vrit. Puisque l'ensemble de la Recherche n'est qu'un rcit imaginaire,
une dclaration faite en son sein ne peut tre ni vraie ni fausse, tout au plus
vraie et fausse, indcidable.
Si cette dclaration a bien la valeur paradigmatique que nous lui prtons,
on comprend la difficult pour le lecteur adhrer ce type d'affirmation.
Naturellement, il faut supposer, comme pour la Recherche, que rien dans le
pritexte ne permet de dcider de la valeur rfrentielle de luvre. On sait
dj, en effet, que si les entours du texte bauchent un contrat
autobiographique, ce genre de revendication fictionnelle aura un effet
dstabilisateur : on l'a vu avec Genet. On peut donc dj en conclure que les
dclarations modalisantes ont un effet privatif, qu'elles peuvent exprimer
l'absence d'une qualit que suggrait pourtant la prsentation de luvre. Mais
la vraie difficult est de comprendre si une dclaration de cette sorte peut
constituer elle seule un nonc d'autorit, un mtalangage qui dirait la vrit
de luvre.
Est-ce vraiment une difficult ? Formule correctement, la question
s'claircit comme d'elle-mme. Un nonc d'autorit n'a d'autre garantie que
son nonciation, c'est--dire sa situation d'nonciation et la position du sujet de
l'nonciation (Lacan, 1966, p. 813). Si le discours prfaciel, par exemple., peut
dire le vrai sur un livre, c'est que par convention et institution, tous les noncs
formuls en ce lieu et pris en charge par l'auteur seront reconnus comme
dignes de foi. Les propositions avances se soutiendront de cette situation
discursive, de sa valeur fondatrice et authentifiante. Au contraire, appartenant
lui-mme l'univers qu'il dcrit comme fictif, ce Narrateur se retrouve dans la
mme position d'nonciation que le fameux Crtois Epimnide. Son propos
prsente le mme tour aportique qui porte son nom et qui est aussi connue
sous la version simplifie du "paradoxe du menteur". En disant "tous les Crtois
sont menteurs", Epimnide le Crtois ne pouvait dire la vrit qu'en mentant et,
inversement, ne mentait qu'en disant la vrit. On ne peut naturellement
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
195
dcider de la fausset ou de la vracit d'une telle proposition. De mme quand
"Marcel" dit "tout est invent", il fait de lui-mme une invention.
Comment croire, ds lors, son affirmation ? S'il dit vrai, il perd son
statut de personnage romanesque. Il faut donc qu'il cherche mystifier le
lecteur pour que son ouvrage soit effectivement une affabulation. On voit mieux
en quoi ce passage apparemment sans difficult du Temps retrouv fait
pendant aux passages quivoques o le Narrateur dcline son identit, dans La
Prisonnire. Sous couvert d'une sche mise au point, pour les lecteurs
empresss de faire du roman une lecture biographique, Proust formule l
l'aporie de tout texte qui voudrait dans le mouvement mme de son criture
faire retour sur lui mme et indiquer son caractre fictif.
Insistons : il s'agit bien d'un paradoxe, pas d'un sophisme, d'une
mystification de Proust, d'une argumentation dlibrment vicie, reposant sur
une transgression logique. Rien voir avec un vice volontaire du raisonnement,
un cercle logique qui reposerait sur une conjonction du type "donnez-moi votre
montre, je vous dirai l'heure". Il y a l un paradoxe au sens strict, parce qu'on
arrive une conclusion contradictoire partir de prmisses non contradictoires.
Aucune fiction ne peut lever ce paradoxe si elle prtend inscrire sa nature,
rfrer elle-mme, en utilisant le mme langage que celui par lequel elle se
constitue. Comme une fiction est par dfinition le rcit d'une fiction et la fiction
d'un rcit, le niveau de la narration ne reprsente pas un niveau de langage
suffisant pour traiter l'histoire comme un langage-objet et lui appliquer les
prdicats "vrai" et "faux". Quand on dsigne les commentaires du narrateur par
les termes "mtadiscours", "mtanarratif" ou "mtalangage", il s'agit d'un abus.
Cet usage mtaphorique a son utilit, mais il ne doit pas faire oublier que dans
une uvre littraire l'histoire n'est jamais un vritable langage-objet, poussant
tre rellement prdiqu par le "mtalangage" du narrateur. Seuls le pritexte
et l'pitexte, pour autant qu'ils ne sont pas fictionnelles eux aussi par l'auteur,
constituent un tagement suffisant, une dnivellation assez forte pour atteindre
la consistance d'un mtalangage. La proprit pour un texte d'tre vridique ou
mensonger appartient ainsi au paratexte, ce qui montre une fois de plus toute
son importance.
Une prcision, pour finir sur ces pseudo-modalisations textuelles
explicites : si elles sont incapables de dfinir la vrit de luvre, elles n'en ont
pas moins un effet sur le lecteur. Si le narrateur est "digne de confiance"
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
196
(Booth), ces dclarations vont faonner et orienter la perception et la
comprhension du lecteur - au mme titre que des indications de rgie par
exemple. Quand Fielding dclare que l'histoire de Tom J ones est vraie et que
cette vracit la distingue des fictions de son poque, ces affirmations
dterminent la lecture de faon non ngligeable. On ne peut les carter
purement et simplement. Elles ont une signification pour le lecteur. Mais il faut
bien distinguer cette signification et cet effet de celui d'un nonc d'autorit qui
valuerait et dterminerait la ralit du contenu d'un texte. Ce sont des
indications sur la structure de la reprsentation de luvre, sur la
vraisemblance qu'elle produit et sur la lecture qu'elle exige. Ces commentaires
ont leur importance pour le statut ontologique de l'univers digtique de
luvre, mais pas pour la totalit de luvre. Aussi bien, ils peuvent compliquer
le registre de luvre s'ils sont en contradiction avec les indications du
pritexte, comme c'est le cas chez Genet. Mais ils n'ont alors qu'un effet
ngatif, leur efficacit et privative.
En dfinitive, il faut donc bien constater qu'il n'existe pas proprement
parler de modalisateurs textuels. Aucune dclaration modale explicite ne peut
donner le statut gnrique d'un texte, sous peine de tomber dans un paradoxe.
Si ces dclarations sont si courantes, c'est soit qu'elles cherchent prcisment
inscrire ce paradoxe dans le texte, soit qu'elles visent indiquer le
vraisemblable recherch par luvre. Mais le vraisemblable n'est pas la vrit.
Le XVIIe le savait bien qui recommandait de prfrer le premier au second.
C'est donc ailleurs et sous une autre forme qu'il va falloir chercher les
indices par lesquels un texte expose sa nature fictionnelle.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
197
4- LES INDICES DE LA FICTION
"Nous saisissons prsent la condition essentielle
pour qu'une conscience puisse imager : il faut qu'elle ait la
possibilit de poser une thse d'irralit".
J .P. Sartre.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
198
Quels sont les moyens qui peuvent traduire l'attitude de l'auteur envers
son discours sans pour autant relever d'une intervention du narrateur ? Quels
sont les indicateurs de fictionalit qui peuvent viter l'aporie releve travers
Proust ? Pour les mettre jour, il faut revenir cette notion de modalisateurs
qui a t au point de dpart de cet examen du protocole de fiction.
Cette catgorie, on s'en souvient, rassemble des phnomnes
linguistiques aussi diffrents que des adverbes, des incises ou des flexions
verbales. Parmi eux, certains traduisent explicitement l'attitude du locuteur
envers son nonc : l'adverbe peut-tre par exemple. D'autres sont plus
implicites l'usage du conditionnel. Si l'on poursuit notre usage mtaphorique de
cette notion de modalisateur, il est possible de relever la mme diffrence dans
les moyens par lesquels une uvre littraire se prsente comme fictive. Il
existe en effet toute une srie de procds de fictionnalisation indirecte ; des
trait stylistiques, thmatiques ou textuels qui ont pour rsultat de classer un
texte dans le registre fictionnel. Ce sont des modalisateurs implicite mettons
des indices ou des symptmes de la fiction. A la diffrence des dclarations
examines prcdemment, ces traits montrent le mode de relation de l'auteur
son nonciation, sans le dclarer ni l'expliciter.
Ces indices sont trs varis et d'importance ingale.
Dans le cas de la littrature d'anticipation, par exemple, c'est la digse
tout entire, l'univers dcrit, qui permet au lecteur de dcider. Ainsi, la lecture
du Jeu des Perles de Verre d'Herman Hesse, le lecteur n'hsite pas un instant
quant au registre du texte qu'il a entre les mains. D'emble, le roman le
transporte dans une poque qui n'est pas la sienne, dans un futur indtermin,
o aprs une "re des guerres", les Nations se sont entendues pour tablir une
sorte de modus vivendi et permettre la fondation de ce fameux ordre
universaliste et esthtique, la Castalie, dont la vocation est de conserver et de
fait fructifier le patrimoine culturel de l'humanit, afin que celui-ci serve de
rempart contre la barbarie et une ultime conflagration. Parfois, ces indices
peuvent tre plus discrets, comme dans cette nouvelle de Cindia Hope, "Ocre
rouge", o c'est plutt l'onomastique des personnages et une certaine
dsinvolture envers la vraisemblance qui suggre que ce texte n'est pas
autobiographique ; jusqu' ce qu'on dcouvre au dtour d'une page que l'un
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
199
des personnages offre une licorne sa nice, cet animal fabuleux attestant
alors pleinement de la fictionalit du texte. Il ne s'agit que de deux exemples,
mais on imagine sans peine la richesse des ressources dont dispose un
crivain pour indiquer l'intrieur de son texte sa vise fictionnelle.
C'est donc l'ensemble de ces composants littraires, ayant une valeur
modalisante indirecte, qu'il faut maintenant examiner. Pour mettre un peu
d'ordre dans leur diversit, on se propose de les classer en fonction de leur
statut smiologique. On sait depuis Charles W. Morris que l'on peut avoir trois
points de vue sur un signe : un point de vue smantique si on le considre par
rapport la ralit ; un point de vue syntaxique si on l'envisage par rapport aux
autres signes auxquels il est li ; un point de vue pragmatique enfin si on
l'examine en fonction de son rapport ses utilisateurs, locuteur ou allocuteur.
Cette tripartition est bien pratique, mme si ses frontires ne sont pas toujours
faciles tracer, en linguistique comme ailleurs. Applique la ralit littraire et
plus prcisment au texte, elle va permettre de donner une vue d'ensemble des
indices de la fiction. Naturellement, il n'est pas question de prtendre les
recenser tous ; on espre simplement arriver donner une image fidle de leur
existence et de leur distribution. Aussi bien, on ne prtend pas faire uvre
originale, mais plutt rassembler des rsultats obtenus par des travaux
antrieurs, souvent trs diffrents dans leur manire d'tudier l fiction.
I - INDICES SYNTAXIQUES
Premier aspect qui peut modeler la perception du lecteur : l'aspect
syntaxique, au sens large, c'est--dire toute la texture proprement verbale, tous
les lments linguistiques et les relations qu'ils entretiennent entre eux, sur
quelque plan que ce soit. Une uvre littraire se dfinit entre autres, on le sait,
par le fait qu'elle est surdtermine sur le plan formel, qu'elle multiplie les
relations entre ses composants. Il y a donc une sorte de consistance propre au
texte littraire, sa matrialit, qu'il faut prendre en compte. A la diffrence de
Tzevetan Todorov, on ne fera pas de diffrence entre l'aspect verbal (les
lments linguistiques) et l'aspect syntaxique (les relations entre units
textuelles, phrases ou groupes de phrases) (Todorov, 1972, p. 376). Pour notre
propos, ces deux plans peuvent tre confondus.
L'importance de l'aspect syntaxique a t mis en relief par des travaux
pionniers dans le domaine des tudes sur la fiction ; travaux qui sont
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
200
prcisment des tentatives pour dfinir celle-ci dans sa littralit, pour la cerner
en considrant uniquement les signes verbaux qui la constituent, en faisant
l'inventaire des configurations verbales qui l'organisent. On veut parler, bien
sr, de Die Logik der Dichtung (1957) de Kate Humburger et de Tempus (1964)
d'Harald Weinrich. On ne rappellera pas leurs projets d'ensemble ni la totalit
des rsultats auxquels ils aboutissent : ce n'est pas l'objet de ce travail que de
se livrer une apprciation de ces tudes qui sont certes "incontournables",
mais qui souffrent aussi d'une propension la systmatisation qui est souvent
discutable (Schaeffer, 1987 ; Ricoeur, 1984, pp. 92-150). Par contre, on
retiendra l'apport le moins contestable de ces travaux : la mise en relief de
"rgularits" grammaticales, de proprits verbales faisant de la fiction un type
de discours marqu linguistiquement et, simultanment, produisant une
rception approprie chez le lecteur.
Ainsi, il est difficile de contester Weinrich que des temps comme le
pass simple, l'imparfait ou le plus-que-parfait sont dterminants pour la
constitution d'une "attitude de locution" manifestant un dsengagement du
locuteur, une "dtente" que le lecteur comprend comme le signal rpt de la
prsence en fiction, comme le dploiement d'un "monde racont" sans rapport
avec notre univers quotidien et les textes assertifs (ditorial, rapport, trait,
journal, essai, manuel) qui en relvent. Pareils toutes les uvres de la
littrature d'imagination, les textes autofictifs prsentent des traits lexicaux et
grammaticaux qui veillent chez le lecteur une autre coute que celle qu'il
accorde au monde et ses ouvrages. En particulier, on gardera en mmoire la
prcieuse remarque de Weinrich sur la valeur paradigmatique des
caractristiques formelles du conte merveilleux et de la manire dont,
immdiatement, il nous "arrache la vie quotidienne" par des formules comme
Il tait une fois... Once upon a time, Vor Zeiten, Erase que se era (pp. 46-47).
Witold Gombrowicz a russi utiliser merveille ce type d'incipit narratif,
en l'adaptant ses propres besoins. Quinze ans aprs Ferdydurke (1937) o il
mettait en jeu sa personne d'crivain et les effets suscits par sa premire
publication, aprs un exil en Argentine et des dbuts difficiles dans ce continent
o il tait inconnu, Gombrowicz ouvre Trans-Atlantique par ces lignes :
"J e ressens le besoin de transmettre la Famille, aux
cousins et amis, ce dbut que voici de mes aventures,
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
201
dj vieilles d'une dcennie, dans la capitale argentine".
(Tr. C. J elenski et G. Serreau).
A cette tape de son uvre, il tait difficile de percevoir autre chose
qu'un simple dbut ironique, cherchant donner le ton de ce rcit
pseudo-autobiographique o Gombrowicz parodie __ les vieilles chroniques
familiales polonaises des XVIIe et XVIIIe sicles, ainsi que le style baroque de
cette poque. Peut-tre que l'auteur de Trans-Atlantique lui-mme n'avait pas
encore senti toutes les ressources de ce type d'ouverture, ni pris conscience
qu'il pouvait en faire comme la clef de toute son entreprise fictionnelle.
Nanmoins, ds La Pornographie (1960), l'incipit n'a plus besoin de l'artifice
d'une chronique pour mimer le dbut d'un conte personnel :
"J e vous conterai une autre de mes aventures et, sans
doute, la plus fatale" (trad. G. Zisowski).
Enfin, Cosmos (1965), son dernier roman, n'a plus qu' reprendre une
formule qui dsormais a fait ses preuves ; le texte dbute ainsi
"J e vous raconterai une autre aventure plus
tonnante..." (trad. G. Sdiz).
Ainsi, en adaptant l'incipit du conte merveilleux sa propre entreprise,
Gombrowicz russit de concert commencer de faon lgante ses romans
d'aprs-guerre, d'indiquer d'emble leur registre fictionnel et d'tablir une
communication discrte entre chacun d'eux. Hormis l'identit de leur
narrateur-hros, ces romans n'ont aucun lien entre eux ; leur incipit dvoile
pourtant une solidarit essentielle, comme les les apparemment disperses
d'un archipel, qui communiquent sous la mer.
(Il faut dire que le conte merveilleux est chez Gombrowicz comme un fil
rouge qui court au travers de son uvre. De Bakaka au Mariage, il joue de
toutes les manires avec cette forme narrative, que ce soit pour la piller, la
parodier, la retourner ou lui rendre hommage. Mais est-ce vraiment tonnant ?
Faut-il rappeler la fascination qu'exerce Les Mille et une nuits depuis leur
introduction en Occident ? Le rayonnement de Perrault, de Grimm, d'Andersen
? Que la plupart des grands crivains ont caress le projet d'crire un conte de
fe, comme J oyce inventant pour son fils Le Chat et le diable ? La littrature de
fiction ne se pense-t-elle pas comme l'enfant du conte de fe, l'avatar de cette
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
202
pratique innocente de la narration ? Le conte merveilleux n'est-ce pas l'ge d'or
du rcit, le secret perdu d'un bonheur de narrer se passant de justification,
d'explication et de lgitimation, de causalit, de psychologie ou d'idologie ?
Comme le cinma parlant vis--vis du muet, "Le Grand Secret" selon Truffaut, il
y a sans doute au cur de la littrature d'imagination une nostalgie
irrpressible envers le merveilleux.
Avec l'apport de Weinrich, impossible d'oublier les procds de
fictionnalisation dgags par Kate Hamburger. Sans doute, ils sont moins
constitutifs qu'elle ne le prtend ; moins la manifestation de la "trame logique
cache" de la fiction, que celle d'une certaine formule romanesque, dont
Thomas Mann et Henry J ames pourraient tre les parangons. Reste qu'un des
mrites de son approche est d'avoir soulign l'abme qui existe entre le
fonctionnement de la fiction pique et celui du discours de ralit ou qui feint de
l'tre.
Elle isole six indices l'origine de cette diffrence fonctionnelle ; six
indices qui ont tous en commun de "draliser" le discours, d'orienter et de
faonner l'exprience du lecteur de manire lui faire prouver diffremment
un roman et un manuel scientifique. En sus des verbes de situation appliqus
un tiers et des dialogues entre tiers dans un pass lointain, il faut ajouter :
"... des indices qui, en eux-mmes, suffisent tablir
que la fiction narrative a une structure qui la distingue
catgoriellement de l'nonc (qui, rappelons-le, doit son
sujet d'nonciation rel sa valeur d'nonc de ralit)
l'utilisation la troisime personne de verbes dcrivant
des processus intrieurs, le discours indirect libre (qui en
est une consquence), la perte de la signification "pass"
du prtrit pique et la possibilit qui en dcoule de le
combiner avec des dictiques temporels (en particulier,
les adverbes de futur)..." (trad. fr., pp. 124-125).
Tous ces "indices" feraient systme pour permettre un monde "hors
espace et temps rels" et tmoigneraient d'une particularit logique du langage
l'tat fictionnel. A savoir que dans un rcit de fiction/"la narration peut tre
caractrise comme fonction, non comme nonciation" (p. 127). Par quoi, il faut
entendre qu'avec la fiction pique (la fiction la troisime personne) il n'y a plus
de sujet d'nonciation ni d'objet d'nonciation ; les personnes et les choses se
racontent elles-mmes.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
203
Sans suivre Hamburger dans les conclusions, on notera qu'elle dgage
des procds plus rcurrents que d'autres, des proprits linguistiques qui
constituent un style fictionnel (un style parmi d'autres, mme si celui-ci est
important dans notre paysage littraire) et partant un guidage de la lecture.
Tous ces indices sont par exemple particulirement prsents dans Les
Buddenzbrook de Thomas Mann. Cest par leur existence que Thomas Mann
russit faire de cette chronique historique d'une grande famille de ngociants
hansatiques, un vritable roman. Malgr tout le souci de vrit sociale et
historique qui anime le rcit du "dclin de cette famille", le lecteur n'a jamais le
sentiment de se trouver dans une monographie historique. Tout en analysant
avec mticulosit, sur quatre gnrations, les tapes de cette dcadence
physique et morale, Thomas Mann fait sentir chaque page au lecteur qu'il est
dans un monde qui se suffit lui-mme, qu'il n'a pas rapporter une ralit
historique qui le commanderait. C'est ce qui lui permet de s'incarner avec
autant de libert dans le dernier reprsentant de cette famille, de se ddoubler
dans Thomas Buddenbrook, l'amateur de Wagner et de Schopenhauer, qui ne
croit plus cette tradition austre et aristocratique qui l'a produit et qu'il est
charg de perptuer.
Comme l'a soulign Grard Genette dans sa prface de la traduction
franaise de Logik der Dichtung, le travail de Kate Hamburger ouvre une
contre indite dans le champ de la potique : l'analyse des procds formels
de fictionnalisation, des moyens linguistiques par lesquels une fiction se
constitue comme telle. Tous ces instruments d'irralisation, dont les effets sont
prouvs plus ou moins consciemment par le lecteur, sont particulirement
importants dans le domaine de l'autofiction o il est primordial que l'on ne
confonde pas la voix narrative et la voix de l'auteur, la "fiction de la fiction" et la
"vrit de la fiction".
Dans le sillage de ces approches syntaxiques de la fiction, on relvera
deux autres procds de fictionnalisation qui n'ont pas la mme envergure,
mais qui tous deux guident l'attention et les attentes du lecteur.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
204
- Le discours sur soi la troisime personne :
On a eu l'occasion plusieurs reprises d'voquer des autofictions
htrodigtique, des exemples de fictionnalisation de soi o l'auteur se
reprsente non pas comme un narrateur, mais comme un simple personnage.
J usqu'ici on a trait de tels cas sans leur accorder d'attention particulire. On a
montr que ce type d'nonciation n'avait rien de transgressif sur le plan
linguistique, on l'a inscrit dans une typologie approximative. Bref, on a plutt
banalis ce type d'criture de soi. Il faut dire que l'existence d'autobiographies
la troisime personne, dcrites et analyses par Philippe Lejeune, invitait une
telle manire de se raconter quand elle est pratique avec quelque ampleur et
sans prise en charge par un projet autobiographique.
Sans doute, le discours sur soi la troisime personne s'enracine dans
les pratiques ordinaires du langage. On parle de soi comme d'un tranger, d'un
autre, quand on s'adresse un enfant ou dans des situations d'intimit. En ce
sens, c'est sans doute une "forme simple" du discours. Sans doute aussi,
l'criture de soi la troisime personne est prsente tant de faon ponctuelle
dans des autobiographies ordinaires que de faon mthodique dans certaines
uvres. Mais il faut bien voir aussi tout ce que cette pratique peut avoir de
droutante quand elle est ralise de faon permanente et sans avertissement
pralable. Parler de soi la troisime personne, c'est malgr tout faire comme
si l'on parlait d'un tranger, ou comme si un autre parlait de nous-mmes ; voire
osciller entre les deux (Genette, 1983, p. 73).
Dans le Roland Barthes par Roland Barthes, le lecteur est prpar
cette dissociation de soi par les normes d'une collection et des pages d'album
photographiques comments surtout la premire personne. Insensiblement,
ces prliminaires le prparent accepter et croire aux fragments critiques
htrodigtiques du livre. A la lecture de cet autoportrait la troisime
personne, on n'a pas le sentiment de dchiffrer une fiction. Mme la phrase
inaugurale du livre, inscrite au verso de la couverture ("Tout ceci doit tre
considr comme dit par un personnage de roman") ne distrait pas de cette
orientation. Le lecteur qui sait ses lettres comprend que la fiction qui est ici
dclare est celle qui nat de l'criture ("Le langage est, par nature, fictionnel",
crit-il dans La Chambre claire, p. 134) ; que Roland Barthes n'a pas la
prtention de concider avec lui-mme dans cet autoportrait d'un nouveau
genre.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
205
Par contre, si un tel dispositif de mesures est absent l'apparition
htrodigtique de l'auteur au premier plan d'une histoire ou au dtour d'un
pisode a quelque chose dirrel, ainsi dans La vie exagre de Martin Romana
de Bryce-Echenique. Le personnage auctorial qui surgit, le lecteur ne peut y
croire ; cette reprsentation dissocie de soi, il la reoit comme une ombre ou
comme une figure paradoxale. Ce n'est plus le sujet de l'criture de soi qu'il
apprhende, c'est le marionnettiste qui tire les fils de ses figurines. Sans
engagement autobiographique et sans relais qui pourrait assurer de sa ralit,
la reprsentation de soi la troisime personne est constitutivement
dralisante. Cet effet dralisant tient certainement au fait que, comme l'a
analys E. Benveniste, le il n'est pas vraiment "personnel", la diffrence du je
ou du tu : "La forme dite de troisime personne comporte bien une indication
d'nonc sur quelqu'un ou quelque chose, mais non rapport une personne'
spcifique (...) La consquence doit tre formule nettement : la 'troisime
personne' n'est pas une 'personne' ; c'est mme la forme verbale qui a pour
fonction d'exprimer la non-personne" (1946, p. 228).
- Le mode dramatique :
Le mode de discours propre au thtre prsente une caractristique
souvent remarque : la fictionalit. De mme qu'un texte dramatique est
immdiatement identifiable par des traits typographiques et formels, il est
implicitement suppos qu'il est fictionnel. Que l'on soit devant une scne ou
face aux pages d'une pice, que l'histoire soit reprsente ou perceptible par
les dialogues, totalement ou en partie invente, il ne parat pas discutable que
l'on a affaire une ralit imaginaire. C'est l un trait plus facile observer qu'
analyser. Et pourtant, il n'est pas contestable comme le note Octave Manonni
"Ce qui se passe sur la scne est ni d'une faon qui est propre au thtre (.e.)
le thtre, en tant qu'institution, fonctionne comme un symbole original de
ngation (Verneinung) grce quoi ce qui est reprsent le plus possible
comme vrai est en mme temps prsent comme faux, sans qu'aucune espce
de doute soit admis" (1969, p. 304).
Mme le thtre qui fait appel des vnements et des personnages
historiques, qui se dtache sur un fond dont l'historicit est indniable et qui
conserve un souci de vraisemblance, est marqu par cette valeur modale.
Quand Corneille emprunte l'histoire romaine la matire de Cinna, le lecteur
accepte tout cet univers comme autant de conventions, mais il ne doute pas
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
206
livre le dramaturge. Bien plus, c'est sur ce travail d'invention qu'il va juger
l'auteur et non sur ses emprunts la ralit historique.
Il est assez frappant cet gard qu'on ne possde aucune
autobiographie dramatique. Il nous semble que c'est l un phnomne curieux,
sur lequel on n'a pas assez mdit. Autant la littrature intime a investi
pratiquement toutes les formes de narration, s'est dploye travers toutes les
espces de configuration narrative, autant elle est reste trangement absente
de l'univers thtral. Il existe ainsi des autobiographies potiques, une criture
de soi potique ; il n'existe pas d'criture de soi dramatique. D'une manire
gnrale, le rgime discursif dramatique, l'criture thtrale, parat peu propre
l'expression de la vrit subjective. Ce n'est pas par hasard si les thoriciens de
la fiction prennent rgulirement le thtre comme paradigme et comme
modle explicatif du discours fictionnel (Warning, 1979 ; Herrnstein Smith,
1978). C'est qu'il y voient l'exemple par excellence d'une situation o le rapport
du langage au monde est court-circuit, o l'acte de rfrer des vnements,
des personnes, des lieux ou des choses, est un acte simul.
Comment expliquer ce phnomne ? Comment se fait-il que la forme
dialogue implique organiquement la fiction ? C'est l une question pineuse,
toujours vite et pour laquelle les moyens et l'espace manquent ici. On peut
simplement avancer qu'il y a sans doute convergence de raisons la fois
diffrentes et htrognes et parmi celles-ci :
a) des raisons historiques : chacun sait que Platon condamne, dans la
Rpublique, le mode dramatique, la situation d'nonciation o l'auteur parle
"comme s'il tait un autre". Il reproche la diegsis dia mimses dtre un
mode de reprsentation mensonger et illusoire. Ce rejet a sans aucun doute
pes d'un grand poids puisqu'on retrouve sa trace dans des polmiques
littraires du XVIIe franais, par exemple, qui ont pour enjeu la possibilit pour
la scne de prsenter la ralit historique. Si pour bien des questions littraires,
la Potique d'Aristote fut pendant des sicles l'ouvrage de rfrence, il semble
que sur ce point la problmatique platonicienne l'ait emport ;
b) des raisons fonctionnelles : il est vident que du mode narratif au
mode dramatique, il y a une norme perte de moyens textuels.
Paradoxalement, le thtre est peu propre la reprsentation de l'exprience
humaine dans toute sa complexit, en particulier de tout ce qui permet la
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
207
reprsentation de soi. Sauf laborer d'normes agencements scniques
comme Le Second Faust ou Le Soulier de Satin, la littrature dramatique
n'atteint jamais la puissance d'illusion du roman.
Quoi qu'il en soit des raisons de cette particularit, il faut retenir que la
simple traduction scnique d'tats de choses ou de personnages revient
pratiquement affirmer leur nature fictive. Des vnements et des individus
placs sur une scne, noncs dans un texte sous une forme dialogue,
deviennent fictifs presque mcaniquement. Tout se passe comme si les
caractres propres au rgime dramatique fonctionnaient comme autant de
signaux fictionnels pour la rception du lecteur.
Si le thtre procure immdiatement une impression d'irralit, ce trait va
marquer mme un texte o l'auteur se reprsentera lui-mme. Cette
particularit explique que l'on trouve quelque chose qui se rapproche de
l'agencement autofictif mme dans la littrature dramatique. Naturellement, ces
exemples d'autofictions dramatiques se comptent sur les doigts de la main :
L'Impromptu de Versailles, Rousseau juge de Jean-Jacques, Histoire de
Gombrowicz, La Grotte d'Anouilh, l'Eglise de Cline, Sodome et Gomorrhe de
Giraudoux, Six personnages en qute d'auteur de Pirandello sont parmi les
rares exemples que l'on peut citer. Naturellement, tous ces textes ont en
commun de se dispenser de tout protocole modal explicite. S'ils n'ont pas la
prtention de dire le vrai sur leur crateur, ils ne se proccupent pas de
l'indiquer. Leur fictionalit tient la seule existence de leur situation
d'nonciation. Parmi ces uvres, certaines sont lies au procd du thtre
dans le thtre, l'auto-rflexivit littraire comme chez Molire, Anouilh ou
Pirandello. Chez ces auteurs, la fiction de soi parat surtout tre la consquence
d'une mise en abyme paradoxale, o le texte reflte sa propre constitution et sa
propre existence. Mais c'est aussi le cas d'un certain nombre de textes
narratifs, du Quichotte aux Enfants du Limon de Queneau. Il est encore trop tt
pour dcider si ces uvres appartiennent rellement au domaine de
l'autofiction. Pour le moment, on se bornera noter qu'elles ralisent le
dispositif de l'autofiction, avec la spcificit du registre dramatique. L'absence
de narrateur fait en particulier que la figure auctoriale est toujours un simple
personnage (Molire, Ferdinand Bardage, Witold, J ean, "l'Auteur" identifi
Anouilh). Parfois, cette figure ne constitue mme pas un rle comme dans Six
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
208
personnages en qute d'auteur o Pirandello est seulement voqu dans le
dialogue.
A proximit de ces cas purs de fictionnalisation de soi en rgime
dramatique, il faut faire une place des textes o la forme dialogue est
importante, pour ne pas dire dominante : la pratique du dialogue et celle de
l'entretien. Dans les textes relevant de cette pratique, le rcit n'est pas
totalement absent. Il peut apparatre pour situer le cadre de l'interlocution,
prsenter les agents de cet change, rorienter l'change etc. Nanmoins sa
prsence est minime et c'est le discours dire qui domine. Dans ces cas aussi, le
mode d'nonciation intervient comme un signal auprs du lecteur et oriente ses
attentes dans le sens de la fiction. C'est le cas de beaucoup de dialogues de
Diderot, tels que Le Paradoxe du comdien, Le Rve de dAlembert,
L'Entretien sur le fils naturel, L'Entretien avec d'Alembert et Le Neveu de
Rameau. Diderot semble avoir trouv le modle de cette pratique dans le
dialogue philosophique, mme s'il en fait un usage diffrent. Ce genre discursif
permet un reprsentant auctorial explicitement identifi l'auteur : on l'a vu
avec Leibniz, mais les Entretiens sur la pluralit des mondes de Fontenelle en
fournissent une autre illustration. Au reste, Pluton lui-mme ne ddaignait pas
d'inscrire son nom dans le corps de ses dialogues comme le montre le Phdon
(59 b). L encore, il s'agit peut-tre moins d'une invention de soi qu'un artifice
commode pour exposer ses ides. Mais il faudra dmler ce point plus tard,
quand on tudiera les fonctions du dispositif de l'autofiction.
Pour finir cette section, on notera le caractre htrogne et partiel de
son inventaire. Les indices relevs, tout d'abord, psent d'un poids diffrent sur
la perception du lecteur les rgularits grammaticales soulignes par
Hamburger et Heinrich n'ont sans doute pas la valeur absolue que chacun leur
prte. Parmi tous ces indices, seuls ceux constituant le registre d'nonciation
dramatique peuvent se substituer un protocole de lecture explicite. Tous les
autres demandent tre accompagns d'autres moyens pour traduire de faon
indiscutable la fictionalit. Observons ensuite que le cadre de cette tude n'a
pas permis de pousser cet inventaire plus loin. Pourtant, il y manque des
indices qui ont un effet fictionnel indniable et qui sont, par ailleurs mis, en
uvre dans des autofictions. Ainsi, tous ceux qui concourent crer ce qu'on
peut appeler un style grotesque, dont l'effet dralisant est certain comme le
montre Agram Sers dans Andr-la-Poisse. Ainsi aussi, des traits mtriques
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
209
conventionnels comme ceux propres l'lgie romaine, dont Paul Veyne a
montr la dimension autofictionnelle dans son beau livre L'lgie rotique
romaine.
- II - INDICES SEMANTIQUES
Second aspect indiciel de la fiction considrer l'aspect smantique. Il
faut entendre cette expression dans un sens presque logique, comme
dsignant la relation du texte avec son Rfrent. Dans ce produit complexe
qu'est le contenu d'un texte, cet aspect dlimite les units de signification qui lui
donne sa dimension mimtique, la possibilit d'une illusion rfrentielle.
Contre les tenants d'un formalisme outrancier, l'existence de cet aspect
fictionnel vaut d'tre rappele
"Une uvre de fiction classique est la fois, et
ncessairement, imitation, c'est--dire rapport avec le
monde et la mmoire, et jeu, donc rgle, et agencement
de ses propres lments. Un lment de luvre - une
scne, un dcor, un personnage - est toujours le rsultat
d'une dtermination double : celle qui vient des autres
lments coprsents du texte, et celle qu'imposent, la
'vraisemblance', le 'ralisme', notre connaissance du
monde" (Todorov, 19(8, p.166).
Dans la section prcdente, c'est comme "agencement de ses propres
lments" que la fiction a donn les indices de son existence. A prsent, c'est
comme "imitation" qu'il faut l'envisager.
Cette perspective va permettre d'insister sur un phnomne littraire
nglig. C'est que les lments d'une uvre ne sont pas toujours commands
par un souci de vraisemblance ou de motivation. Il arrive le fait inverse, savoir
que certains lments ne soient l que pour montrer le caractre arbitraire d'un
rcit, pour souligner l'irralit d'une histoire et pour inviter la lecture ne pas
s'arrter aux vnements relats. Ainsi, du contenu dnotatif de ce petit rcit
boucl d'une morale, qui est appel fable. Ce n'est pas un hasard si La
Fontaine affectionne le terme apologue pour dsigner ce genre bref comme si
le rcit comptait moins que la leon que le lecteur pouvait en tirer. Comme l'a
soulign Karen Stierle, il y a une "invraisemblance programmatique" dans la
fable. L'utilisation d'un bestiaire humanis est avant tout au service d'une
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
210
thique, voire d'une politique : "Les animaux sont les prcepteurs des hommes
dans mon ouvrage" explique la Fontaine au Duc de Bourgogne. Son
invraisemblance est le "signe de l'intention allgorique constitutive du genre"
(Stierle, 1972, P. 182). Voil donc une illustration gnrique de la situation o
un contenu digtique a une valeur modalisante.
Selon un mcanisme similaire, une uvre peut afficher un protocole
modal de fiction exclusivement par des lments digtiques. Il lui suffit pour
cela de reprsenter des "tants", personnes, lieux ou tats de choses, qui n'ont
pas (ou pas encore d'quivalent dans l'univers du lecteur. On se rappelle peut-
tre que c'est essentiellement ce critre smantique que retenait Philippe
Lejeune dans sa description de l'autofiction :
"Pour que le lecteur envisage une narration
apparemment autobiographique comme une fiction,
comme une 'autofiction', il faut qu'il peroive l'histoire
comme impossible ou comme incompatible avec une
information qu'il possde dj" (1986, p.65).
Le dnominateur commun tous ces indices smantiques de fictionalit
est leur invraisemblance. Cette notion (avec son corollaire positif, la
vraisemblance), ne jouit pas d'un grand crdit aujourd'hui. Du fait de son
caractre normatif, elle a perdu beaucoup de son lustre depuis les potiques du
XVIIe sicle. Elle est mme, pourtant, de rendre encore quelques services si
l'on en fait un concept descriptif pour l'tude de la fiction. Un certain nombre de
tentatives, runies dans un volume de la revue Communication (n 11, 1968)
qui a fait date, ont dj t faites dans ce sens. Pour notre part, on emploiera
cette notion dans un sens troit, descriptif, et uniquement de faon ngative.
Sera considr comme invraisemblable tout lment digtique en
contradiction avec ce qu'enseigne une smantique lmentaire de l'exprience
quotidienne. Tout crivain voulant faire apparatre clairement la fictionalit d'une
histoire o il joue un rle, cherchera la draliser, la rendre invraisemblable,
en introduisant des donnes inexistantes, contradictoires ou fausses par
rapport la ralit physique et culturelle.
A propos du cinma, qui pose des problmes comparables on dispose
d'un tmoignage intressant sur ce travail de fictionalisation par l'introduction
d'lments digtiques invraisemblables. voquant le risque d'tre confondu
avec un personnage-narrateur, Alain Robbe-Grillet explique :
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
211
"J 'ai affront volontairement ce danger dans un de
mes films : Trans-Europ Express. C'est celui de mes films
qui a eu le plus de succs, par suite d'un malentendu
flagrant justement sur ce point. Voulant mettre en scne
une voix narrative, j'avais pris la peine de la ddoubler
sous la forme de trois personnages, un producteur au
cinma, une script-girl qui tait interprte par ma femme
et un auteur de films que j'avais imprudemment,
volontairement imprudemment, jou moi-mme. Le public
a vu Trans-Europ Express comme si c'tait un film de
Sacha Guitry : un vritable auteur expliquant son film qui,
en mme temps, est en train de se drouler sous les yeux
du spectateur. Mais le film entier tait prcisment
construit de faon rendre cette interprtation-l
impossible, c'est--dire absurde l'auteur dont je jouis le
plus ne pouvait pas tre l'auteur du film en question,
puisque, d'une part, il en ngligeait totalement un aspect
thmatique essentiel, celui de l'rotisme, et que, d'autre
part, du point de vue structurel, il n'avait aucune
conscience de l'architecture du rcit, et pour cause
puisqu'il en faisait partie lui-mme. M'tant rendu compte
de cette ambigut, j'avais pens ds le dbut draliser
au maximum ce personnage que je jouais. J 'avais Ami
envisag de raser ma moustache mais je ne m'y suis pas
rsolu, et ensuite de faire doubler ma voix par un acteur et
a je l'ai fait : il existe une version du film, reste en copie
de travail, o la voix narratrice n'est pas la mienne mais
celle d'un autre. Malheureusement, comme toujours au
cinma, c'est sur l'effet produit qu'il faut se guider et l'effet
produit tait simplement celui d'un film mal doubl. J 'ai
donc gard en dfinitive ma propre moustache et ma
propre voix ; et tous les spectateurs, qu'ils l'aient aim ou
non, taient persuads que vraiment j'tais en train de leur
expliquer mon film. A tel point que mes ennemis, voyant
ce personnage pompeux et dogmatique, assis raide dans
son compartiment, disaient : 'Ah vraiment, c'est tout fait
lui'. " (Nouveau Roman : hier, aujourd'hui, Paris, Union
gnrale d'ditions, coll. "10/18", 1972, t. I, pp. 232 sq).
Ce commentaire de Robbe-Grillet (qui fournit, au passage, un exemple
d'autofiction au cinma) montre bien l'importance des indices qui interdisent
une lecture rfrentielle et autobiographique d'une histoire. Ces indices peuvent
Vre si diversifis qu'il est difficile d'en faire un recensement systmatique. De
faon assez grossire, on distinguera deux grands modes d'invraisemblances
(physique vs culturelle), portant sur deux objets diffrents, l'univers du rcit et le
personnage auctorial, figurent l'auteur (mondaine vs auctorial). Le croisement
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
212
de ces deux axes fournit quatre types d'invraisemblances, d'indices
smantiques de fiction.
- Invraisemblance mondaine physique :
L'invraisemblance touche alors soit la totalit du monde naturel de la
fiction, soit seulement l'un de ses composants. Dans La Divine Comdie, c'est
la totalit de l'univers digtique qui est l'indice de la fiction. Le caractre irrel
de lieux comme le purgatoire, l'enfer ou le paradis suffit carter le texte d'un
rcit de voyage ordinaire et empcher une lecture littrale. Il en est de mme
des rcits qui reprsentent un monde inconnu, le pass, le futur ou des
espaces sidraux. Mais l'invraisemblance peut aussi notre le fait que d'un lieu,
voire d'un objet de l'histoire. Ainsi, la Recherche qui mle habilement des lieux
rels (Paris, Venise) et des endroits imaginaires : Balbec et Combray ; mme si
depuis 1971, un chef-lieu d'Eure-et-Loir a cru bon d'adjoindre ce dernier
toponyme fictif son nom Illiers-Combray. Dans "LAleph", c'est un seul objet
qui par son rayonnement porte toute la fictionnalisation : en relatant comment il
a pu contempler cet "objet secret et conjectural", o vient se rfracter
l'univers-pass, prsent et futur, Borgs donne une allure fantastique une
nouvelle qui, par ailleurs, est une sorte d'lgie une "Beatriz jamais perdue".
- Invraisemblance mondaine culturelle :
Dans ce type, l'irralit vient d'lments historiques, sociaux,
conomiques, artistiques, politiques etc. qui n'ont pas de correspondants dans
nos socits. Leur intervention fournit autant de propositions contre-factuelles,
dont la fausset est patente, dans le rcit. Ici encore, ces composants peuvent
occuper la totalit du rcit ou n'en Vre qu'un lment. Dans Le Chteau et Le
Procs, c'est tout le cadre social qui est manifestement fictif. Les institutions
dcrites par ces deux romans de Kafka constituent un cadre tel qu'il est
impossible au lecteur de confondre le personnage K. avec son crateur. Plus
discrtement, la Recherche sattarde sur des artistes clbres qui sont pourtant
inconnus dans notre univers culturel. Elstir, Bergotte ou Vinteuil ne sont pas des
personnages fictifs parce qu'il fallait mnager la personne ou la mmoire de tel
peintre, de tel crivain ou de tel musicien ; leur nature fictive interdit tout
dchiffrement extra-textuel, oblige rapporter leur existence au seul propos du
roman et tmoigne en fin de de la fictionalit de luvre tout entire.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
213
- Invraisemblance auctoriale physique :
L'invraisemblance porte alors sur la personne physique de l'auteur,
reprsente dans le rcit. Ce n'est plus l'histoire qui s'avre impossible, c'est la
ralit de son crateur, l'existence de son narrateur. Un rcit o le personnage
auctorial meurt (Loti dans Azyad), se mtamorphose en animal (J . Laccarire
dans Le Pays sous l'corce), vit son propre futur (Cavanna dans Maria), se
dplace dans l'espace (Copi dans La Guerre des pds), disparat dans un
tableau (Herman Hesse dans Esquisse d'une autobiographie) ne peut tre pris
la lettre, sans rendre son nonciation inconcevable ou dlirante. Dans tous
ces exemples, le caractre imaginaire de l'autoportrait est patent ; le lecteur n'a
besoin que de son bon sens pour le comprendre. Mais parfois, la perception
des indices fictionnels peut exiger un minimum d'information sur la biographie
d l'auteur. Ainsi, La Pornographie de Gombrowicz, dont la premire - page
annonce : "En ce temps-l, c'tait en 1943, je sjournais dans l'ex-Pologne et
dans l'ex-Varsovie, tout au fond du fait accompli". Impossible de comprendre la
valeur modalisante (et l'ironie) de cet incipit, si on ne sait pas que Gombrowicz
a quitt la Pologne en 1939, pour ne jamais y revenir.
- Invraisemblance auctoriale culturelle :
Si un crivain se reprsente en train de commettre des actes
sanctionns par la loi ou qu'il n'est pas pensable d'avouer, le lecteur verra sans
doute dans cette histoire une pure invention. Doubrovsky a ainsi eu le projet
d'crire un roman o il commettrait un meurtre ; dans Les Os de ma
bien-aime, J acques Thieuloy se campe en anthropophage : la dvoration de
l'tre aim n'est plus une mtaphore ; dans Cit de verre, Paul Auster dcrit un
personnage qui a pris son nom et atteint le dernier stade de la clochardisation ;
dans Le Paysan perverti, Edmond cumule pratiquement tous les actes illicites
imaginables : de l'inceste l'assassinat, en passant par le vol ou la corruption.
- Un peu diffrent, mais ressortant aussi d'une impossibilit culturelle : un
auteur dclarant vivre sous une identit qui n'est pas la sienne, comme
Gombrowicz dans Ferdydurke ou Cendrars dans Moganni Nameh. Dans ce
dernier cas, le dispositif de l'auto fiction trouve sa version la plus conomique :
le protocole nominal et le protocole modal coexistent dans le mme support, qui
autorise la fois une identification de l'auteur et la mise en vidence du
caractre irrel de cette reprsentation de soi.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
214
Voil donc la fin de cet examen des moyens smantiques, propres la
dimension rfrentielle de l'histoire, par lesquels un crivain peut draliser
compltement ou en partie sa reprsentation. On ne cherchera pas donner
ce critre d'invraisemblance une rigueur qu'il ne possde pas. Il s'agit d'une
catgorie floue et lastique, dont la perception est lie des habitudes
culturelles qui sont difficilement formalisables. Toutefois, cela n'te rien son
caractre coercitif. Aussi vague que soit une telle catgorie, elle est
contraignante pour le lecteur et concourt fortement sa perception du registre
d'un texte. A la diffrence des indices syntaxiques, ces composants
smantiques sont suffisants pour classer un texte comme fictif. En dralisant
le Rfrent du rcit, on met en cause la ralit, ce qui est dj entrer en fiction.
- III - INDICES PRAGMATIQUES
Dernier aspect indiciel de la fiction envisager l'aspect pragmatique.
Gure heureuse, cette dnomination risque d'introduire une confusion. Quand
on parle de l'aspect pragmatique du texte, on devrait dsigner en toute rigueur
la faon dont il se prsente pour ses premiers usagers, l'auteur et le lecteur. Au
sens strict, cette expression conduirait examiner le pritexte, voire l'pitexte,
o se trouvent inscrites les traces de l'un et de l'autre. Toutefois, rappelons-le,
on se limite dans ces sections un examen des procds de fictionnalisation
internes au texte, abstraction faite de tous les autres facteurs qui peuvent
participer la constitution de la fiction. Il n'est donc pas question de revenir sur
les modalisateurs pitextuels ou pritextuels.
En ralit, nous visons ici tous les procds par lesquels un rcit mme
une communication diffrente de la relation d'une histoire ; toutes les uvres
o le texte se creuse pour ainsi dire, afin de produire en son sein une figure
d'nonciation distincte de la narration, afin de reprsenter une posture
communicationnelle propre. De mme que tous les textes crent leur propre
monde, un contexte smantique singulier que le lecteur est invit reconstruire/
tout rcit a la proprit remarquable de signaler l'attention du lecteur son
nonciation, par des marques spcifiques. Tout rcit a donc la capacit de se
distinguer de sa propre profration et par l de se redoubler, de se multiplier.
Mais il est des textes qui vont plus loin dans ce dcalage, en faisant de leur
nonciation un lment dterminant de l'histoire, en mettant sur le mme plan
l'instrument du rcit et le rcit lui-mme (Rousset, 1962, p.74) Ils se donnent
alors une situation de communication autonome, se fabriquent leur propre
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
215
contexte pragmatique, contexte fictif qui vient doubler leur contexte
pragmatique rel.
Soit La nause de J ean-Paul Sartre. On sait que ce livre est un roman,
qu'il est dsign ainsi par exemple dans les listes des uvres de Sartre : c'est
l son contexte pragmatique rel. Mais ce roman prsente aussi la particularit
d'tre un roman-journal, c'est--dire qu'il feint d'tre le journal intime d'un certain
Roquentin. Cette particularit a peu proccup la critique, fors de rares
exceptions, tant le contenu thmatique du texte appelait le commentaire.
Pourtant, Sartre a vritablement jou le jeu de cette mise en scne, en ouvrant
le texte par un "Avertissement des diteurs", en disposant des notes ditoriales
en bas de page, en donnant un rcit la premire personne discontinu, li au
droulement des jours et parfois des heures. Tout le roman imite ainsi un acte
d'criture sui generis, qui a ses rgles et ses licences propres. Ce dispositif
constitue un contexte pragmatique fictif, qui est aussi important que les tats de
choses, les vnements ou les personnages qui peuplent ce texte. C'est par
exemple lui qui rend supportables, savoureuses mmes, les analyses
existentielles du roman. Grce cet agencement, La Nause vite les cueils :
du roman thse. L'auteur Sartre adhrait peut-tre aux dveloppements
philosophiques du roman (dans Les Mots, plus d'un demi-sicle aprs sa
publication, il explique subtilement : "J e russis trente ans ce beau coup :
d'crire dans La Nause - bien sincrement on peut me croire - l'existence
injustifie, saumtre de mes congnres et mettre la mienne hors de cause").
Mais ces dveloppements sont avant tout crits par le personnage de fiction
Roquentin et cela change tout. Par indices pragmatiques, on dsignera donc
tous les moyens de cet ordre, par lesquels un texte feint dtre un recueil de
textes, un journal intime, des mmoires, une autobiographie, un manuscrit
trouv etc. .
Naturellement ce contexte pragmatique distinct, cette imitation d'un acte
ou d'une pratique verbale se donne toujours comme rel, au mme titre qu'une
histoire cherche emporter l'adhsion du lecteur en faisant comme si ses
vnements et ses personnages taient rels. Le roman-journal, comme le
roman pistolaire, le roman pseudo-autobiographique, le rcit enchss se
prsente pratiquement toujours comme une -non-fiction . Toutefois, par suite
d'une tradition culturelle importante, ces apparentes non-fictions fonctionnent
comme des uvres fictionnelles pour le lecteur. Comme le formule bien J ean
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
216
Rousset, c'est une "fiction du non-fictif", "c'est par fiction qu'on exclut le fictif
(...). Et le lecteur le sait bien, tout le monde le sait, mais il y a toujours dans la
lecture, sous une forme variable, un consentement l'illusion" (1962, p. 76).
Peut-tre faut-il nuancer ce propos qui tend faire de ces formules fictionnelles
autant de conventions transparentes pour tous les lecteurs. Sans doute, comme
l'a not Thomas Pavel, s'agit-il moins de conventions proprement parler que
de "prconventions" qui demandent un apprentissage :
"Les prconventions recouvrent donc les rgularits
littraires qui n'atteignent pas la haute conformit des
conventions et doivent par consquent tre interprtes
comme des rgles locales, ou des indices de solution
dans un groupe particulier de jeux littraires. Au niveau
des techniques narratives, l'enchssement narratif (Les
Hauts de Hurlevent) produit le mme effet : afin de bien
douer le feu, le lecteur doit savoir (ou vite dcouvrir) que
les romantiques avaient l'habitude d'enchsser une
histoire peu vraisemblable dans une autre histoire
raconte la premire personne par un narrateur digne
de confiance. Que cette rgularit puisse, et doive, tre
apprise n'est pas un obstacle mon argument, puisque
dans les jeux, nous commenons par connatre quelques
rgles simples, et dcouvrons petit petit, des stratgies
de plus en plus complexes". (J avel, 1988, tr. fr., pp.
155-160).
A cette nuance prs, ces dispositifs d'nonciation sont donc des indices
srs de la fictionalit d'une uvre. En imitant des pratiques sociales d'criture
jadis trs rpandues, ils se signalent au lecteur comme simulacre et jeu. Il faut
donc retenir ces dispositifs comme autant de moyens de mettre en place un
protocole de fiction.
Reste qu'il faut dire tout de suite qu'ils sont peu utiliss dans le cadre de
la littrature autofictionnelle. La raison en est trs simple. Presque tous ces
agencements imitent des pratiques d'criture intime. Ds lors, ils sont peu
propices la fiction de soi. Le risque d'une confusion, d'une lecture
autobiographique est trop grand. Imaginons une version de La Nause o le
nom de Roquentin aurait disparu au profit de celui de Sartre. Seuls les intimes
de l'crivain auraient pu, lors de la parution du roman, comprendre qu'il
s'agissait d'un texte de fiction. Pour les autres lecteurs, ce roman serait un
vritable journal intime. Ce danger explique que ces "prconventions" ne
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
217
puissent tre employes pour l'autofiction, que sous e/une des conditions
suivantes qui limitent leur intrt et partant leur usage :
a. un profil thmatique contrast : on a vu un exemple de ce profil avec
Aurora de Leiris. C'est aussi le choix d'Hermann Hesse dans Le Loup des
Steppes : Barry Haller ne peut tre confondu purement et simplement avec son
crateur ; tout au plus peru comme une projection fictionnelle. C'est ainsi que
Hesse a pu utiliser la formule du roman pseudo autobiographique, mise au
point par Defoe dans son Robinson ; c'est aussi ce qui permet Restif
d'employer la formule du roman pistolaire, dans Le Paysan perverti. Edmond
mourant la fin du roman et prsentant de nombreux traits thmatiques
propres, Restif peut s'identifier lui par des substituts livresques et ainsi se
glisser dans cette aventure difiante sur "les dangers de la ville". La fictionalit
de l'ouvrage est ainsi assure autant par des moyens smantiques que par des
moyens pragmatiques dont Restif a trouv le modle chez Richardson, comme
il le relate dans Mes ouvrages.
b. Un rle de second plan : si la figure auctoriale a un profil actantiel bas,
un petit rle par exemple, la confusion avec un texte autobiographique sera
difficile. C'est le choix de Restif, encore, dans Ingnue Saxancour qui est, on l'a
vu, un roman pseudo-autobiographique o le personnage auctorial M. de
Saxancour n'est pas au premier plan du rcit. Cendrars, qui a souvent rendu
hommage cet crivain, adopte le mme parti dans Moravagine.
Seul le rcit enchss ou mtadigtique semble viter l'inconvnient
attach aux autres "prconventions", simulant une pratique d'criture
personnelle. Seulement on a vu que la littrature autofictionnelle ne prisait
gure la technique des embotements narratifs. On ne s'attardera donc pas sur
ce procd, l'essentiel ayant t dit lors de l'examen du profil narratif de la
figure auctoriale.
Dans l'ensemble, les indices pragmatiques se rvlent donc peu utiles
pour l'autofiction. Il fallait pourtant les voquer pour Vre systmatique dans cet
examen des signes fictionnels. Leur mise en vidence pourra se rvler utile
dans le chapitre suivant.
Aprs ce tour d'horizon trs clectique, il faut en effet tenter d'unifier
notre interrogation sur la fiction. Des questions restent en suspens. On peut
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
218
ainsi se demander comment des indices aussi htrognes arrivent une
dtermination identique. Aussi bien, les raisons de leur efficacit demeurent
mystrieuses. Pourquoi, ces indices sont-ils plus importants pour le guidage de
la lecture que des dclarations explicites de narrateur ?
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
219
5 - LE DISCOURS FICTIONNEL
"- J 'ai trouv dans un de vos livres un homme qui
parle et qui se conduit tout fait comme mon oncle.
Est-ce lui que vous avez copi ? - Non, mais je suis
toujours heureux d'apprendre qu'un de mes personnages
a un modle vivant".
E. Caldwell.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
220
Le chapitre prcdent a permis d'inventorier un ensemble de procds
par lesquels une uvre posait son irralit. Cet examen a montr comment
empiriquement le discours fictionnel se constituait et, dans le mme temps, se
signalait l'attention du lecteur, orientait sa perception et sa comprhension.
Cet inventaire a toutefois le dfaut de s'arrter cette description, du
reste partielle et morcel . Les indices recenss fonctionnent sur des plans
diffrents et de manire ingale. Il reste expliquer par quelle voie ils arrivent
au mme rsultat ; quel est le ressort commun qui leur permet de converger
vers le mme effet. Bref, ce recensement ne dit pas comment fonctionne
globalement le discours fictionnel.
Cette question est d'autant plus importante que la notion de fiction
utilise depuis notre dfinition initiale de l'autofiction n'a jamais t critique.
Depuis le dbut de cette enqute, elle est reste intuitive, dtermine par le
contenu que lui donne le sens commun et le langage ordinaire. Il importe par
consquent d'claircir ce qu'on entend par ce terme, de se poser la question :
qu'est-ce que la fiction ? Quelles sont les proprits de ce registre du discours ?
Qu'est-ce qui autorise cette sorte d'nonciation dlier son auteur de tout
engagement et ne pas tre prise la lettre par celui qui la reoit ?
On voit en quoi l'autofiction est directement concerne, par cette
interrogation. Il s'agit tout simplement de comprendre comment ce registre
d'nonciation peut dgager la responsabilit de l'crivain qui l'utilise, mme
quand il est nominalement impliqu par son contenu. Il y a dans l'autofiction un
phnomne tout de mme tonnant. Comme par la magie du radical "fiction",
par l'introduction d'un coefficient de fictionalit dans un agencement textuel, un
crivain peut faire les dclarations les plus folles, raconter les choses les plus
compromettantes, ce sera pour rire. Il peut prendre sur lui les passions et les
penses les plus asociales, sans que sa responsabilit ne soit engage, ni que
sa crdibilit n'en souffre - du moins en principe. La question est de savoir
comment un tel privilge est possible.
Avant de tenter une explication, on rappellera l'tat de la recherche dans
ce domaine, on cernera au plus prs notre perspective et enfin on soulignera
l'htrognit des ralisations du discours fictionnel.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
221
Une recherche en cours.
Face cette question massive qu'est-ce que la fiction ? , il faut
d'emble rappeler qu'on est loin de disposer actuellement d'une rponse qui fait
l'unanimit. Si le statut ontologique de la fiction est une vieille question
philosophique, dbattue au moins depuis le Parmnide de Platori, renouvele
par la philosophie analytique anglo-saxonne, la fictionalit littraire a t
longtemps ignore par les critiques et les thoriciens de la littrature - fors bien
star Aristote et sa Potique. Aucun des paradigmes thoriques qui se sont
succds depuis prs d'un sicle dans le domaine des tudes littraires, n'ont
permis par exemple, d'en faire une vritable question thorique. Le dernier en
date, impliquant une rduction linguistique des proprits et des mcanismes
littraires, rendait mme impossible ce questionnement (Pavel, 1988).
Certes, cette situation s'est modifie radicalement, surtout dans les pays
anglo-saxons et de langue allemande. La fiction est devenue un must
thorique, un objet d'tude qui a produit de brillantes analyses ces dix dernires
annes. La synthse de Thomas Pavel, Fictionnal Worlds, en tmoigne. On
reste encore, malgr tout, en pleine priode de dcouverte dans ce domaine.
Cette bullition est prometteuse, mais elle rend difficile la distinction des
analyses indiscutables : les thories, les approches et les concepts sont encore
en chantier pour ainsi dire. En outre, cet intrt pour la fiction commence
peine en France, ce qui rend difficile la connaissance et la participation, aux
dbats qui accompagnent cette recherche. Le "retard la traduction''
(phnomne typiquement franais) aidant; on est loin de toujours pouvoir
accder aux ouvrages et aux articles essentiels. Cette situation mritait dtre
rappele, ne serait-ce que pour expliquer le ct rustique de notre analyse.
Une question plurielle.
Le problme de le, nature de la fiction n'est pas simple. Il se prsente
sous des aspects, soulve des enjeux qui demandent tre nettement
dlimits. Comme l'a bien not Thomas Pavel, trois aspects sont distinguer :
"... les questions mtaphysiques, concernant les tres
et la vrit de la fiction, les questions de dmarcation qui
valuent la possibilit de tracer des frontires bien
prcises entre fiction et non-fiction ( la fois en thorie et
dans la pratique des analyses textuelles) et enfin les
questions institutionnelles, lies la place et
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
222
l'importance de la fiction en tant qu'institution culturelle"
(1988, pp. 20-21).
Ces trois ensembles de question ont une autonomie relative car ils sont
de nature diffrente. Pour notre propos, il est clair que seul le second ensemble
nous concerne directement. Seule l'analyse des bornes de la fiction se confond
avec la recherche des proprits distinctives et du mode de fonctionnement
original de ce registre discursif. Si les autres aspects de ce vaste problme sont
d'un grand intrt, ils peuvent tre dtachs de la question de la dmarcation.
Les envisager serait compliquer une question dj passablement embrouille et
outrepasser la perspective potique de ce travail.
Au reste, mme ainsi restreint, le problme de la fiction exige d'autres
limitations pour notre propos : (1) il ne s'agit pas d'envisager en soi la diffrence
fiction/non fiction ; cette dlimitation ne nous intresse que pour la littrature et
les textes littraires ; (2) il n'est donc pas question d'envisager les formes non
verbales de fiction ; ni mme d'ailleurs les formes verbales non littraires de
fiction, comme les exemples logiques, certaines formes de publicit ou de
citation (Herrstein Smith, 1978, 113) ; (3) on vitera aussi de confondre cette
question avec le problme de la nature du discours littraire, de la littrarit ; (4)
enfin, on ne confrontera pas la fiction au monde non fictif, la ralit. Notre
perspective sera celle d'un lecteur en contact avec les uvres. Comme le dcrit
Pavel,
"[Cette] approche interne vite de comparer les tres
et les propositions de fiction leurs correspondants non
fictionnels (puisqu'une telle comparaison montre
l'vidence aussi bien la vacuit des noms fictionnels que
la fausset des propositions qui les comprennent), et se
donne pour tche de reprsenter la fiction telle que ses
usagers la conoivent, une fois qu'ils entrent dans le jeu et
perdent de vue le domaine non fictif" (1988, P. 25).
Un registre htrogne.
Considr en lui-mme, le discours fictionnel frappe d'abord par son
infinie diversit, tant du point de vue de ses ralisations littraires que du point
de vue des lments qui peuvent concourir sa constitution.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
223
Le discours fictionnel n'existe pas, en effet, en soi dans la littrature. Il y
a des types de discours fictionnel institutionnaliss historiquement : le conte, la
fable, la lgende, la nouvelle, le roman, l'pope, la posie lyrique, la tragdie
et la comdie, le rcit fantastique, le roman pistolaire etc. Toutes ces formes
de fiction sont bien diffrentes, ne sont pas reues et classes dans la
littrature fictionnelle, pour les Mmes raisons. Aussi bien, elles sont nes
des poques distinctes, dans des paysages littraires diffrents.
Cette profusion historique recoupe bien sr une autre diversit. C'est, on
l'a dit, que le discours fictionnel, pour se prsenter comme tel, afin de guider la
reconnaissance du lecteur, a la possibilit de recourir des composants, qui
viennent de plan d'abstraction et de cadre de rfrence diffrents. L'examen
des modalisateurs fictionnels, explicites et implicites, a permis de percevoir
cette varit. Sans compter un "contrat de lecture" mis en place dans le
pritexte, contrat modulable de bien des faons, la fiction peut se constituer par
des traits aussi bien syntaxiques, que smantiques ou pragmatiques
(pseudo-pragmatiques). Cest bien sir cette diversit structurelle qui fonde la
profusion des ralisations historiques C'est parce que la fiction peut se former
par des lments aussi htrognes qu'il existe autant de types de fiction
historiquement dtermins.
0n ne fait que rappeler des vidences. Reste que cette diversit
structurelle et historique fait douter de la possibilit de mettre au jour une
structure profonde du discours fictionnel, une sorte de matrice que l'on
retrouverait sous-jacente tous les types de fiction. Les diffrentes tentatives
faites pour trouver des universaux du discours fictionnel, quelle que soit la
perspective choisie ne peuvent que fortifier ce doute. Que l'on considre le
travail de Kate Hamburger, par exemple, cherchant donner une dfinition
logico-syntaxique de la fiction, ou mme la tentative de J ohn Searle (1982; cf. la
critique de Pavel, 1988), tentant d'apporter une solution pragmatique, aucune
de ces"dmarches essentialistes ne s'est rvle satisfaisante. D'une faon
gnrale, tous les essais faits en ce sens donnent penser qu'il n'existe pas de
caractres constitutifs universels, de quelque ordre qu'ils soient, appartenant au
discours fictionnel.
Pourtant, l'infinie varit des fictions ne fait pas problme pour le lecteur,
ne semble pas troubler sa perception culturelle. Qu'il s'agisse d'un roman
d'aventure ou d'une nouvelle minimaliste amricaine, l'amateur de fiction sait
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
224
retrouver chaque fois la bonne posture de rception. Hormis le cas duvres
ambigus, il fait d'emble la distinction avec le non-fiction arrive sans difficult
identifier le registre imaginaire. Barbara Herrstein Smith a bien observ ce
paradoxe qui fait que notre capacit d'analyse thorique de la fiction semble en
raison inverse de notre perception spontane :
"It seems clear (...) that no matter how vague or naive
our litterary theories, or how problematic our explicit
definitions, we do make functional discriminations
between, say, biographies and novels, and between the
transcriptions of actual utterances and the scripts of plays,
through the very manner in which we experience and
interpret them, and the sort of value and implications they
have for us. In other words ; we take them as different
kinds of things and, accordingly, take them differently"
L'auteur de ce livre remarquable qu'est On the margins of Discourse
ajoute, en outre, que l'enfant acquiert trs tt les moyens de distinguer ce qui
est fictif de ce qui ne l'est pas :
"Most children learn at a relatively early age that some
of the things we tell them are really true and others are
'just stories or, more generally, that sometimes we are
saying things to them and at other times using language in
a rather different spirit and with a different force. They
learn to make this distinction quite in ignorance of, and
independent of, categories such as fact and fiction or
chronicle and tale. Nor do they make the distinction of the
basis of the inherent credibility or 'imaginativeness of a
narration : for many contemporary storybooks narrate
banal events about banal characters hardly
distinguishable from events and persons in their own lives,
while many things we tell children truly must seem
inherently incredible in terms of a childs own experiences.
(How believable, for example, can a child of four find our
statement that men have traveled to and walked on the
moon Yet the child will appreciate the difference between
our telling him. that and our telling him a story about a boy
with a red balloon.) The distinction between, on the one
hands, things that are said and, on the other hand, things
such as stories, nursery rhymes, songs, and verbal games
is learned, rather, on the basis of the childs own
differential experiences with respect to each : the different
contexts in which they occur the different vocal tones in
which they are delivered, the different stylistic features
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
225
they may exhibit, but most significantly, the different force
- implications and consequences - they have as verbal
structures" (1978, pp. 44-45).
Sil y a dans notre comptence de lecteur, ds l'enfance, le savoir
ncessaire l'identification du discours fictionnel, il faut bien supposer que ce
registre discursif prsente une certaine unit, quelque proprit distinctive, en-
de ou par del la multitude de ses types institutionnaliss. De fait, il 'y a au
moins une proprit que le lecteur peroit intuitivement dans toutes les fictions :
c'est qu'il s'agit de communications joues, d'imitations d'nonciations verbales,
qui ne doivent pas avoir d'effets rels sur son comportement. Autrement dit, le
lecteur le moins averti sait que ce discours qui se donne comme rel pour
l'mouvoir, qui prsente des personnes et des tats de choses comme s'ils
existaient vraiment, n'est pas "srieux", n'appelle pas une comprhension
littrale. En adhrant "l'illusion rfrentielle" de cette configuration verbale il
sait qu'il s'agit d'une sorte de jeu, qu'il ne faut pas y croire jusqu'au bout. Le
discours fictionnel exige ainsi une comprhension ambivalente faite de foi et de
scepticisme, une attitude contradictoire, mixte dadhsion aveugle et de
clairvoyance. Cette double injonction est "programme" dans toutes les formes
de fiction, selon un "dosage" trs variable qui produit chaque fois un quilibre
diffrent.
Si comme l'a affirm Karlheinz Stierle "L'usage projet d'un texte donne
les rgles de sa constitution" (1972, p.189), c'est dans ces instructions
contradictoires qu'il faut chercher l'unit du registre fictionnel. C'est la dmarche
de Rainer Warning dans un article pntrant, qui recoupe les analyses de
Barbara Herrnstein Smith : "Pour un pragmatique du discours fictionnel" (1979).
On le citera longuement car il met en place les notions essentielles pour saisir
le fonctionnement du discours de la fiction :
"Dans le discours fictionnel la situation d'nonciation
n'est pas immdiatement dtermine par une situation
demploi, ce qui n'quivaut naturellement pas une simple
clipse de celle-ci. Il se produit plutt une espce de
clivage de la situation : une situation interne d'nonciation
entre en opposition avec une situation externe de
rception. Le discours fictionnel se dfinit donc
pragmatiquement par la simultanit de deux situations
qui disposent chacune de son propre systme dictique.
Or, pour tre prsent dans deux situations simultanes, le
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
226
sujet se voit confront avec ces instructions
contradictoires d'agir que la thorie de la communication
appelle le paradoxe pragmatique du double-bind. On peut
rsoudre de tels paradoxes pragmatiques en plaant l'un
des termes de l'opposition sur un plan hirarchique plus
lev pour ainsi rendre illusoire l'opposition. Mais pour
ceux qui sont pris dans le paradoxe Mme, une telle
solution est impossible - moins qu'ils ne puissent se
sauver par l'issue de la situation ludique. C'est au thtre
qu'il nous est donn d'assister l'exemplification typique
et en mme temps la rsolution - ludique - de ce
double-bind, et c'est en effet le modle thtral qui peut
tre considr comme le paradigme de la constitution
situationnelle du discours fictionnel en gnral. Nous
avons l, d'un ct, une situation interne dnonciation
avec locuteur(s) et destinataire et nous avons, de l'autre
ct, une situation externe de rception qui a ceci de
particulier que, l'encontre de la situation interne d'non-
ciation, le destinataire se voit priv d'un rapport deux
avec un locuteur rel. Ce locuteur rel, l'auteur, a disparu
dans la fiction Mme, il s'est dispers dans les rles des
personnages fictifs y compris, dans les genres narratifs, le
rle du narrateur. ( ... ) L'auteur peut bien tre absent
comme locuteur rel. Il reste prsent sous forme des
conventions pragmatiques, smantiques et syntaxiques
qui, respectes ou violes, organisent le discours mme.
Le clivage dictique le double-bind dont nous avons parl,
apparat comme la convention pragmatique majeure. Loin
d'branler l'identit de la performance discursive, il la
fonde, de sorte que situation interne d'nonciation et
situation externe de rception reprsentent les deux
termes d'une opposition qui constitue une situation de
communication homogne. La fictionnalit est donc
fonde en une prsupposition situationnelle. En tant que
telle elle est essentiellement contractuelle et, partant,
historique" (1979, pp. 327-328).
Rorganise pour les besoins de notre dmarche, l'analyse de Warning
sur la fiction, permet d'avancer les propositions suivantes
(a) "Le modle thtral () peut tre considr comme le
paradigme de la constitution situationnelle du discours fictionnel en gnral".
Le thtre, on l'a vu, est un terrain privilgi pour saisir le mcanisme de
la fiction. Au thtre, on assiste la reprsentation d'vnements et de
personnages qui sont le plus souvent imaginaires et qui pourtant sont prsents
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
227
comme rels. La scne dlimite un espace conventionnel o se droule une
action imaginaire, mais en mme temps elle carte le spectateur, le tient
distance des enjeux, des mouvements et des consquences de cette action. La
scne trace ainsi la frontire entre deux univers, la ralit et la fiction. Dans son
cercle magique, l'illusion rgne ; au-del, c'est le rel. Le pourtour de la scne
est comme un pli entre deux mondes que le spectateur doit habiter en Mme
temps. S'il veut jouir du spectacle, il lui faut en effet suivre le droulement de la
pice avec attention, se laisser entraner par les vnements reprsents par
les acteurs, bref donner sa crance "l'illusion thtrale". Mais il ne doit pas
intervenir pour juger ou arrter le cours de l'action ; il doit se garder de suivre le
comportement de ce soldat, rapport par Stendhal dans Racine et Shakespeare
"L'anne dernire (aot 1822), le soldat qui tait en faction dans l'intrieur du
thtre de Baltimore, voyant Othello qui, au cinquime acte de la tragdie de ce
nom, allait tuer Desdemona, s'cria : 'Il ne sera jamais dit qu'en ma prsence un
maudit ngre aura tu une femme blanche'. Au mme moment le soldat tire
son coup de fusil, et casse un bras l'acteur qui faisait Othello". Le spectateur
voit des gestes, entend des dialogues qui sont promus l'existence, tout
instant, par l'auteur, le metteur en scne, les acteurs et le personnel technique,
mais qui ne sont que des simulacres, comme doit le lui rappeler tout moment
l'espace de la scne.
Le thtre prsente par consquent avec un relief extraordinaire la
situation commune de la fiction, on l'on donne voir des actes et des
vnements qui ne sont pas en train d'arriver, mais qui sont reprsents
comme tant en train d'arriver. Il matrialise une situation duelle o coexistent
une certaine ralit et une thse d'irralit ; une situation o il faut croire au
spectacle montr et pourtant ne pas agir en consquence. Il faut croire la
"situation interne d'nonciation" de la pice, mais rester lucide quant sa
"situation externe de rception" qui est aussi celle du spectateur. Le thtre
ralise ainsi un clivage qui est structurel toute fiction, le discours fictionnel
demandant la Mme rponse divise son agencement.
(b)"Dans le discours fictionnel la situation d'nonciation n'est pas
immdiatement dtermine par une situation d'emploi... Il se produit plutt un
clivage de situation : une situation interne d'nonciation entre en opposition
avec une situation externe de rception".
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
228
Comme le dfinit 0. Ducrot, "on appelle situation de discours l'ensemble
des circonstances au milieu desquelles se droule un acte d'nonciation (qu'il
soit crit ou oral)" (1972, P. 417). Peu d'actes d'nonciation, comme il le
rappelle, sont comprhensibles sans la connaissance au moins des traits
pertinents de leur situation. Une situation discursive est commande par toute
une srie d'lments qui relvent aussi bien de l'nonc que de l'interaction
locuteur/allocuteur et, dans le cas de cette nonciation diffre qu'est un
ouvrage littraire, du moment de sa production et du moment de sa
reconnaissance (Wunderlich, 1972).
Le propre dune nonciation fictive est de faire clater ses circonstances,
de ddoubler sa performance discursive, sa situation de communication.
Doublant le procs rel et historique o lcrivain publie un livre, un procs
simul et intrieur au texte se droule, qui peut prendre des formes varies
mais qui se ramne aussi toujours la relation par un narrateur d'une srie
dvnements l'intention d'un auditeur (narrataire). Il y a donc le
"ddoublement suivant des instances nonciatives :
auteur-narrateur-narrataire-lecteur" (Kerbrat-Orecchionie 1980, p.172), du
moins dans le cas de figure le plus simple, et un ddoublement corollaire du
contexte pragmatique. C'est l un trait de la fiction sur lequel on a eu l'occasion
d'insister et qui est bien connu. Pour qu'il y ait un texte de fiction, ou plutt pour
qu'un texte soit lu comme tel, il faut une double duplicit : la fiction d'une
histoire et la fiction dun discours prenant en charge cette histoire. Le lecteur
doit pouvoir croire l'histoire relate et au rcit qui en est fait. Le second terme
de cette duplicit est au moins aussi important que le premier, pour ne pas dire
plus : la matire de la fiction, comme le dit justement Roger Blin, n'est pas
moins des "vnements raconts" que l'"vnement de les raconter" ; et son
ressort, autant le "rcit d'une fiction'' que la "fiction dun rcit" (1954, pp.
318-319). C'est ce dernier simulacre, cette nonciation feinte, qui vient diviser la
situation de communication globale de toute fiction. A l'inverse, un ouvrage
rfrentiel comme les Essais de Montaigne ne prsente pas cette dualit dans
sa performance discursive. Dans cet autoportrait, le contexte pragmatique rel
historique. (Montaigne publiant en 1580 un recueil de rflexions l'intention du
public lettr de son temps), ne se distingue pas de son contexte interne :
l'nonciateur qui prend en charge les contenus propositionnels se confond avec
l'auteur effectif de ces propositions.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
229
En dcrivant cette proprit constitutive de la fiction, on ne fait que
rappeler un fait notoire. A ceci prs qu'il n'est pas certain que lon ait tir toutes
les consquences ncessaires de cette situation. En particulier, le fait que ce
soit par cette proprit de simuler une nonciation que le discours fictionnel est
immdiatement reconnu par le lecteur le plus ingnu. Quand celui-ci
manque la fictionnalit dune uvre, c'est prcisment parce que la
"feintise" dun acte de langage na pas t perue, soit par manque dlments
textuels, soit par une comptence insuffisante du lecteur.
Barbara Herrnstein Smith a soulign ce point de faon trs pertinente.
Dans le passage qui suit, elle emprunte ses exemples la posie et insiste sur
la dimension conventionnelle de la fiction :
What is central to the concept of the poem as a fictive
utterance is not that the character or persona is distinct
from the poet, or that the audience purportedly addressed,
the emotions expressed, and the events alluded to are
fictional, but that the speaking, addressing, expressing,
and alluding are themselves fictive verbal acts. To be
sure, a fictive utterance will often resemble a possible
natural utterance very closely, for the distinction is not
primarily one of linguistic form. Moreover, although certain
formal Natures - verse, most notably - often do mark and
indeed identify for the reader the fictiveness of an
utterance, the presence of such features are not
themselves the crux of the distinction. The distinction lies,
rather, in a set of conventions shared by poet and reader,
according to which certain identifiable linguistic structures
are taken to be not the verbal acts they resemble, but
representations of such acts. By this convention, Keat's
ode "To Autumn'' and Shakespeares sonnets are
precisely as fictive as "The Bishop Orders His Tomb" or
Tennyson's "Ulysses". The statements in a poem may, of
course, resemble quite closely statements that the poet
might have truly and truthfully uttered as a historical
creature in the historical world evertheless, insofar as they
are offered and recognized as statements in a poem, they
are fictive. To the objection, Put I know Wordsworth meant
what he says in that poem, we must reply, you mean he
would have meant them if he had said them, but he is not
saying them. we may choose to regard the
composition not as a poem but as a historical utterance,
but then the conventions by virtue of which its fictiveness
is understood and has its appropriate effects are no longer
in operation" (1978, p. 28).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
230
On retrouvera cette importance des conventions pour la consti-
tution de la fiction dans la dernire proposition de Warning.
(c) "La fictionnalit est donc fonde en une prsupposition situationnelle.
En tant que telle, elle est essentiellement contractuelle et, partant, historique.
Pour comprendre cette dernire proposition, il faut revenir une fois de
plus Dieter Wunderlich, sur qui s'appuie constamment Warning. Par
prsupposition situationnelle, le premier entend la fois la connaissance et les
capacits du locuteur, ainsi que tout ce qu'il peut prsumer de l'auditeur savoir
et moyens, espace perceptif, relation sociale qui les rattache (1972). Cest
videmment sur ce modle qu'il faut comprendre le discours fictionnel : ce
dernier se constitue en fin de compte en fonction de la comptence prsume
(par l'auteur) du lecteur, identifier un clivage situationnel. Plus avant, ce
clivage ne repose que sur des conventions, des signes linguistiques, textuels
ou pritextuels qui n'ont de valeur fictionnalisante qu'en fonction dun "contrat",
lui-mme enracin dans un "march" historiquement dtermine fait d'un
systme de normes et d'attentes qui reprsentent comme l'horizon littraire
d'une poque.
Prenons le cas du conte merveilleux. On a vu que l'entre en fiction de
cette performance discursive se signalait par des indices lexicaux et
smantiques. Mais ces indices ne sont tels qu'en fonction de conventions
historiques et culturelles, reconnues comme telles une poque donne et
perptues par les appareils scolaire et culturel. Ce n'est pas parce que ce
"genre" se retrouve dans toute l'Europe qu'il est par essence et de toute ternit
fictionnel. La rcurrence de ce genre signifie tout au plus que ses lments se
prtent particulirement bien la dissociation situationnelle de la fiction et que
le merveilleux prsente une idalit qui transcende la diffrence entre les
langues et les cultures europennes. Autrement dit, il n'y a rien dans sa
configuration qui en fasse un agencement constitutivement fictionnel. Le
discours mythique de certaines cultures africaines ou amricaines, dot
pourtant d'un coefficient rfrentiel, prsente des particularits lexicales et
smantiques qui le rapprochent du Merveilleux europen. La meilleure preuve
de cette contingence des lments signalant la fictionnalit, c'est qu'ils ne sont
pas drivables d'un clivage situationnel : on ne peut dduire a priori les
diffrentes formes institutionnalises de fiction partir de la situation duelle
propre la fiction.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
231
Si la fictionalit est bien un registre d'nonciation commun de
nombreux discours institutionnaliss, ce registre est toujours fonction d'une
situation d'emploi, qui elle-mme dpend dune pratique culturelle
transcendante et par l d'une situation historique englobante. Cette "convention
pragmatique majeure" (la situation clive de la fiction) peut tre ralise par des
voies bien diffrentes, faisant intervenir au choix des prsuppositions de
lecture, l'intention communicative du locuteur, les qualits phonologiques et
syntaxiques ou la smantique du texte. Dans le mme article, Warning rsume
bien cette impossibilit de dgager une structure profonde de la fiction qui
pourrait gnrer au sein dun modle homogne, l'ensemble des discours
historiques qui culturellement ont t reconnus comme fictionnels :
L'impossibilit de dfinir de faon satisfaisante la
fictionnalit l'aide des caractristiques de la situation
d'nonciation fictive elle-mme. La fictionnalit
prsuppose plutt une situation externe qui la dfinit en
tant que telle. Elle est donc essentiellement contractuelle.
Et par-l, le discours fictionnel est intgr au mme titre
que le discours non fictionnel dans une pratique sociale
transcendante. Ce genre d'intgration peut varier en
fonction de l'poque et du genre littraire. A l'poque de
l'art dit pr-autonome la situation de rception est
hautement codifie en situation demploi typifie. Il suffit
de nommer, dans cet ordre d'ides, la mise en scne de la
littrature courtoise dans le cadre des ftes de cour, ou
toute forme de thtre institutionnalis. A l'poque
post-courtoise, donc depuis le XVIIIe sicle environ,
larticulation de la situation de rception va en dcroissant"
(1979, p. 331).
Cette impossibilit de donner d'autres rquisits que sa situation clive
la fiction explique l'htrognit des indices fictionnels, des modalisateurs
recenss. Pour que le discours fictionnel existe, l'essentiel est cette division
nonciative qui fait coexister un contexte pseudo-pragmatique ct de son
contexte pragmatique rel. Ds lors, tous les moyens sont bons, si l'on peut
dire. Tous les procds qui permettent de poser une thse d'irralit, pour
reprendre le terme de Sartre, qui permettront de draliser l'nonciation du
narrateur, directement ou indirectement, seront retenus. Comme la littrature a
en propre une surdtermination formelle et fonctionnelle, ces procds se
trouvent souvent multiplis et utiliss de faon concurrente.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
232
Cette primaut du clivage situationnel permet, aussi, de comprendre
pourquoi les dclarations textuelles explicites ne peuvent dfinir un texte
comme fictif sans devenir paradoxales, sans se prsenter comme une aporie
pour le lecteur. Si l'essentiel pour une fiction, pour sa constitution, est cette
division de l'nonciation globale, le narrateur ne peut dsigner lui-mme son
statut, car il n'est que l'effet de cette situation d'nonciation fictive qu'il prtend
fabriquer. Ce n'est pas par des dclarations d'intention que la fiction existe en
tant que telle, c'est par la mise en place d'un dispositif d'nonciation, dun type
de communication agenc de faon particulire. Le narrateur peut bien
multiplier les auto-dsignations et les avertissements, ce qui importe, c'est sa
posture ; posture qui est commande par des signes qui ont un rel pouvoir
dissociatif soit parce qu'ils relvent du pritexte, soit parce qu'ils contribuent
constituer l'nonciation (indices syntaxiques et pseudo-pragmatiques), soit enfin
parce qu'ils ont une valeur ngative assez forte pour dcrocher le texte de toute
rfrentialit (indices smantiques).
Cette situation clive de la fiction explique, enfin, qu'un dispositif comme
l'autofiction soit possible. Si l'auteur se reprsente de faon explicite, il prend le
risque dune interprtation littrale de son nonciation. Mais d'un autre ct, le
discours fictionnel offre assez de ressources pour que son personnage
apparaisse comme un tre imaginaire, pour qu'il soit dot d'un coefficient de
lecture qui l'carte de toute rception "srieuse". Ds l'instant o le lecteur
adhre compltement la fiction, il la peroit comme une imitation d'nonciation
et par suite perd tout intrt pour un dchiffrement en termes de vrai/ faux.
Soustrayant l'autorit de la valeur de vrit l'auteur lui-mme, le lecteur prend
acte du fait qu'il est face une "assertion non vrifiable", qui "ne se laisse pas
corriger par une connaissance plus exacte des faits auxquels elle se rapporte''
(Stierle, 1979. p. 299).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
233
Q U A T R I E M E P A R T I E :
S T R A T E G I E S
"Il se mfiait. Il voulait pas trop rajeunir. Il se dfendait.
Il a voulu que je lui explique encore tout ... le pourquoi M.
Et le comment M. C'est pas si facile... C'est fragile comme
papillon. Pour un rien a sparpille, a vous salit.
Qu'est-ce qu'on y gagne J 'ai pas insist".
L.F. Cline.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
234
1 - FONCTIONNALITE D'UN DISPOSITIF
SCHIZOPHRENE
"On ne confondra pas fonction et intention : une
fonction peut tre dans une large mesure involontaire,
une intention peut tre manque ou dborde par la
ralit de luvre".
G. Genette
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
235
Bilan et perspective.
Deux protocoles de lecture ont t tudis en dtail. Cet examen, peut-
tre fastidieux, tait ncessaire pour passer dune dfinition intuitive une
dfinition plus rigoureuse de l'autofiction, pour montrer la diversit de leur
manifestation. Raliss par des procdures varies, de manire plus ou moins
appuye, de faon plus ou moins univoque, ces deux protocoles font de
l'autofiction un dispositif gomtrie variable, d'une trs grande souplesse
d'excution. Ils en font aussi un agencement excessivement retors et, au total,
assez compliqu si l'on veut avoir une vue densemble de son existence
gnrique.
Aprs ce travail d'analyse, on pourrait penser qu'une synthse serait la
bienvenus. Ne faut-il pas maintenant recomposer ce qu'on a dissoci ? Runir
les traits pertinents distingus pour chacun des protocoles ? Construire une
typologie partir de toutes les variables dgages ? Apparemment, c'est la
seule faon de poursuivre cette tude des proprits distinctives des textes
autofictifs. La runion de tous les paramtres rglant les deux protocoles
permettrait une mise plat de toutes les possibilits du dispositif, dcouvertes
jusqu' prsent de faon isole. En rassemblant tous ces facteurs et en les
faisant fonctionner simultanment, on obtiendrait une typologie, mes possibles
d'autofiction. Non seulement cette typologie apporterait un supplment de
cohrence thorique notre dmarche mais, de surcrot elle ouvrirait des
angles d'approche indits pour la comprhension de la fictionnalisation de soi
littraire.
Un tel geste est toujours tentant par ce qu'il laisse augurer de matrise et
de rigueur. Toutefois, il nous semble qu'il ne faudrait pas cder cette tentation
formaliste. Si l'on ne veut pas tre en contradiction avec ce qui a t dit
propos du discours fictionnel, il faut respecter la proposition qui a sous-tendue
son tude : la fonction dtermine la forme, la convention commande le
dispositif, le contrat organise l'agencement. Lucien Dallenbach a montr que la
mise en abyme servait autant "dsambiguser" un texte, assurer la clart de
son message (usage naturaliste), qu' rflchir son caractre littraire ou
permettre sa polysmie (usage symboliste)'(1977, pp. 78, 152). De mme, tous
les exemples d'autofictions mobiliss dans cette enqute ont manifest une
"disponibilit fonctionnelle et idologique" du dispositif importante, presque une
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
236
nature de "mercenaire textuel". Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de
dominantes ni de grands choix formels que l'on ne puisse remarquer. Mais il
faut se garder d'attacher mcaniquement un effet un procd, se garder
d'oublier qu'un mme dispositif peut servir des projets opposs.
Plutt que de partir d'une typologie formelle, on dressera donc un
spetre fonctionnel : on se demandera quoi peut servir ce dispositif de
fictionnalisation de soi, quels sont les effets qu'il peut bien remplir. Ce nouveau
temps dans notre enqute va permettre de faire un tri dans notre corpus.
J usqu' prsent, on s'est content d'enrichir d'exemples et "transformations
rgles" notre dfinition de dpart. Toutes les actualisations du dispositif taient
par consquent bonnes prendre. On s'est peu proccup de savoir si ces
uvres avaient rellement pour enjeu d'laborer une fiction de soi. De faon
parfois abusive, on a mme mobilis des uvres dont le caractre fictif tait
quivoque, dont l'identification auctoriale tait rticente. Il faut maintenant
mettre un peu d'ordre dans les ralisations de ce dispositif, sparer les cas
"purs" d'autofiction des cas "impurs", partir de l'usage qui en est fait, en
fonction du rle qui lui est dvolu.
Un dispositif schizophrnique.
Avant cet examen fonctionnel, on aimerait toutefois insister sur les
implications et les consquences de ce dispositif pour ses usagers (auteurs et
lecteurs), quand il est ralis dans toute sa puret.
Considrons d'abord, en amont de l'autofiction, la situation d'un auteur
qui s'invente des aventures imaginaires. Qu'est-ce qui peut motiver une telle
dmarche ? Le bnfice de ce geste est vident. La fictionnalisation de soi
matrialise un rve qui est constitutif de la littrature ; elle ralise littralement
un dsir qui souvent n'est satisfait que socialement ou marginalement : se
textualiser, transformer sa vie en littrature et partant tre fils (fille) de ses
uvres. A partir de la pratique du pseudonyme, qui le satisfait partiellement,
Marthe Robert a bien formul ce rve de se crer soi-mme :
"J e suis fascine par les pseudonymes. Que Grard de
Labrunie signe Grard de Nerval () que Stendhal et
Kierkegaard lvent la continuelle invention de faux noms
la hauteur dune cration, jy vois non pas de la
dissimulation, mais un aveu aussi sincre que naf.
L'auteur pseudonyme (...) dit dans sa signature mme ce
qui est en fait son mobile le plus profond, par-del les
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
237
intentions et les ides qui constituent ses raisons de
publier : le dsir de remanier son tat-civil et de nier ainsi
toutes les dterminations biologiques, psychologiques et
sociales auxquelles ltre ne peut rien changer. Il dit sa
volont de rompre la chane des gnrations dans
laquelle il est jamais insr( ... Y Cette tendance
invtre se refaire une identit, qui fait positivement le
romancier, certains crivains la dveloppent un tel
degr que, non contents de la librer dans leurs livres, ils
cherchent encore la satisfaire dans leur vie, dussent-ils
pour cela ctoyer la folie'' (1981, pp. 97-98).
Cette page permet de situer la fictionnalisation de soi aux cts de
l'invention dun pseudonyme et de l'laboration d'une lgende, en l'articulant
l'un des ressorts les plus importants de l'criture littraire. En s'inventant un
pseudonyme, l'crivain fonde son identit, rebours de l'humanit ordinaire qui
la reoit, comme l'avait bien compris Cendrars : "... je suis le premier de mon
nom puisque c'est moi qui l'ai invent de toutes pices". En s'inventant une
lgende, il se fait lui-mme, la diffrence du commun des mortels qui s'adapte
tant bien que mal aux circonstances : Byron, Baudelaire, Rimbaud l'ont montr
chacun de faon diffrente ; notre poque se caractrise aussi par la difficult
rendre crdible longtemps une lgende : "On ne soigne plus sa lgende" disait
Breton. Dans les deux cas, cette invention de soi ne se concrtise pourtant qu'
l'extrieur de luvre de l'crivain. Avec le pseudonyme et la lgende, le dsir
dtre fils (fille) de ses uvres se satisfait dans la reconnaissance sociale et
culturelle mais cette matrialisation demeure hors de ce qui est le plus vital
pour un crivain, son texte. Au contraire, avec lautofiction, l'crivain s'invente
lui-mme dans son criture, dans ses histoires, dans ses fictions, bref dans son
uvre. En entrant dans son propre texte, il obtient ainsi le privilge d'tre
jamais un personnage fictif, de jouir du mme statut qu'Hamlet ou Don
Quichotte. Cette satisfaction explique que, poux quantit d'crivains, la fiction
de soi n'a pas, mme figuralement, une finalit rfrentielle. En outre, avec
cette forme de fiction, ils sont gagnants sur tous les tableaux : ils se donnent
la fois la libert du fantasme, d'un espace o toutes les oppositions et tous les
interdits sont suspendus ; et le bnfice de l'effet mimtique que procurent les
noms propres, spcialement le leur, qui renvoient des personnes relles.
Seulement, il ne faut pas sous-estimer tous les risques lis ce jeu avec
son patronyme et sa biographie. En les dstabilisant et en les brouillant,
l'crivain rompt une distinction tacite entre la personne et luvre qui permet
toutes les licences d'criture. !Il y a l un passage la limite qui n'est pas sans
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
238
consquences ni sans risques. L'auteur d'une autofiction, en mettant en scne
sa personne, peut-tre ses intimes, peut-tre d'autres, s'expose provoquer de
vives ractions dans sa vie prive, professionnelle ou publique. Mme s'il
russit ne pas mettre en cause sa famille ou ses relations, il s'expose tre
jug sur un terrain qui n'est pas le sien, sur un terrain A tous ses crits seront
interprts de faon littrale, sans aucune considration esthtique. En
principe, ce danger ne devrait pas exister puisque toute autofiction est une
uvre dimagination, une forme de fiction. Il faut nanmoins se rappeler que
cette pratique n'est prise en charge par aucun discours, que le lecteur moyen
nest pas prpar la lecture de ce type duvre. A ce jeu, l'auteur est donc
presque toujours perdant car, mme quand ses reprsentations de lui-mme ou
des autres ne seront pas outrancires, elles seront toujours fausses en regard
de la ralit et des habitudes des lecteurs, toujours considres comme
mensongres - et comme telles condamnables.
G. de Nerval est une bonne illustration de ce danger de la
fictionnalisation de soi. Pour s'tre livr imprudemment cette pratique, il a eu
droit un port rait terrible d'Alexandre Dumas, publi dans Le Mousquetaire du
10 dcembre 1853 et repris dans la ddicace aux Filles de Feu :
C'est un esprit charmant et distingu, comme vous
avez pu en juger, - chez lequel, de temps en temps, un
certain phnomne se produit qui, par bonheur, nous
l'esprons, n'est srieusement inquitant ni pour lui, ni
pour ses amis ; - de temps en temps, lorsqu'un travail
quelconque l'a fort proccup, l'imagination, cette folle du
logis, en chasse momentanment la raison, qui n'en est
que la matresse ; alors la premire reste seule, toute-
puissante, dans ce cerveau nourri de rves et
d'hallucinations, ni plus ni moins qu'un fumeur d'opium du
Caire, ou qu'un mangeur de haschisch d'Alger, et alors, la
vagabonde qu'elle est le jette dans les thories im-
possibles, dans les livres infaisables. Tantt il est le roi
d'Orient Salomon, il a retrouv le sceau qui voque les
esprits, il attend la reine de Saba ; et alors, croyez-le bien,
il n'est conte de fe, ou des Mille et une Nuit, qui vaille ce
qu'il raconte ses amis, qui ne savent s'ils doivent le
plaindre ou l'envier, de l'agilit et de la puissance de ces
esprits, de la beaut et de la richesse de cette reine ;
Tantt il est le sultan de Crime, comte d'Abyssinie, duc
d'gypte, baron de Smyrne. Un autre jour il se croit fou, et
il raconte comment il l'est devenu, et avec un si joyeux
entrain, en passant par des pripties si amusantes, que
chacun dsire le devenir pour suivre ce guide entranant
dans le pays des chimres et des hallucinations, plein
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
239
d'oasis plus fraches et plus ombreuses que celles qui
s'lvent sur la route brle d'Alexandrie Ammon ;
tantt, enfin, c'est la mlancolie qui devient sa muse, et
alors retenez vos larmes si vous pouvez, car jamais
Werther, jamais Ren, jamais Antony n'ont eu plaintes
plus poignantes, sanglots plus douloureux, paroles plus
tendres, cris plus potiques !.. .
On notera que ce morceau de bravoure est plus crit que rflchi.
Manifestement, Dumas a voulu faire des effets au dtriment dun jeune
confrre, qu'il croyait peut-tre dj enferm. Tel quel pourtant, ce passage
reproduit tous les sentiments ambivalents que peut produire la fictionnalisation
de soi l'accusation de mythomanie et l'affirmation du caractre intenable de ce
projet littraire ; la reconnaissance malgr tout de sa sduction et de son
efficacit, ds lors que l'auteur se donne le rle de guide dans sa fabulation.
Presque un sicle auparavant, Diderot avait eu droit un portrait non
moins satirique, pour ses nombreux Dialogues il se fictionnalise, sous la plume
de Garat dans Le Mercure de 1779 :
"Promenant son imagination sur les ruines de l'antique
Italie, il se rappelle comment les arts, le got et la
politesse d'Athnes avaient adouci les vertus terribles des
conqurants du monde. Il se transporte aux jours heureux
des Lelius et des Scipion ou mme les nations vaincues
assistaient avec plaisir au triomphe des victoires qu'on
avait remport sur elles Beaucoup de monde entre alors
dans son appartement Il me distingue au milieu de la
compagnie et il vient moi comme quelqu'un que l'on
retrouve aprs l'avoir vu autrefois avec plaisir" (cit par E.
de Fontenay, 1981, pp. 224225).
Une fois encore, l'crivain qui se fictionnalise est pris littralement,
comme un individu hors de lui-mme, possd par son imagination et ses
inventions - comme s'il n'tait pas acceptable qu'un homme de lettres brouille
les limites de la littrature et de la vie, du dedans et du dehors de la fiction, de
l'extrieur et de l'intrieur de la reprsentation. Il faut dire que, d'une faon
gnrale, le sens commun accepte tris mal le travestissement dun individu.
Quand cette mtamorphose n'a pas lieu dans un cadre social qui la lgitime,
elle fait du fabulateur un coupable en puissance. Se crer de toutes pices,
s'inventer un nom, une origine, une histoire, n'est-ce pas bon pour "un assassin,
un cambrioleur, un collaborateur" comme l'affirme Elsa Triolet au dbut de
L'Inspecteur des ruines ? Plusieurs auteurs de romans policiers ont exploit
cette mfiance du sens commun envers qui se fictionnalise, ce sentiment
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
240
partag que nous prouvons face la fabulation, mme manifeste, d'autrui.
C'est ainsi que Donald Westlake et Ruth Rendell, respectivement dans Adios
Scheherazade (Minerve, 1985) et Douces morts violentes (Belfond, 1987), ont
chacun mis en scne un personnage tenant un journal intime o il s'inventait
des aventures imaginaires, presque incroyables, mais intgres dans le rcit de
leurs vies vritables. Comme par hasard, ces journaux autofictifs seront
l'origine de toutes sortes de catastrophes et feront de leurs rdacteurs plus que
des suspects, des criminels.
Il y a ainsi dans la production d'une autofiction un effet pervers qui parat
presque fatal. C'est qu' vouloir se mtamorphoser en personnage de roman,
l'crivain prend le risque qu'on identifie srieusement ce personnage avec lui-
mme. Dans son J ournal, Gombrowicz, dont pourtant toute luvre roma-
nesque utilise le dispositif de l'autofiction, a formul trs clairement ce danger et
la paralysie qu'il peut provoquer pour un crivain
"J e manque encore, semble-t-il, de fanatisme dans ma
passion pour ma propre personne, et de mme n'ai-je pas
su - par peur des autres - me donner cette vocation qui
m'incombe et creuser suffisamment la question. C'est moi
- le premier et sans doute le seul de mes problmes : le
seul, l'unique de tous mes hros auquel vritablement je
tienne" (J ournal I, 1953-56 pp. 204).
Cette remarque de Gombrowicz signale une dimension de la littrature
souvent nglige, savoir qu'elle ne va pas sans imagerie sociale, que la
perception d'un crivain est faite aussi des images de lui-mme qui sont
vhicules un peu partout. Ces images sont en partie produites par ses
interventions, ses dclarations, ses comportements et, bien sr, ses uvres ;
en partie faite par l'interprtation qu'en donnent les mdias, l'opinion, la
communaut. Pour cette dernire, l'Image est importante, c'est elle qui lui
donne barre sur ces fabricants dnoncs, qui la confortent ou la drangent. Cre
sont bien souvent ces images qui portent vers la lecture d'un crivain inconnu
qui donnent le dsir de lire les uvres d'un crivain jusque-l ignor. Tout
crivain est conscient de ce rle des images, de la ncessit de composer avec
elles, d'laborer ses stratgies de publication et de comportement en fonction
d'elles. Si la littrature est une institution, comme on tend de plus en plus
l'affirmer, alors se pose pour chaque crivain la question de sa lgitimit et de
sa crdibilit. Dans notre univers post-romantique, cet aspect est le plus
souvent occult : on prtend se contenter des textes. Il n'est pas certain
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
241
pourtant qu'une uvre ne se ressente pas du crdit social et culturel dont jouit
ou ne jouit pas son auteur.
Le dispositif de l'autofiction met par dfinition en danger cette crdibilit.
En utilisant, l'crivain prend le risque de passer pour un mythomane invtr,
comme l'ont pris Restif, Nerval, Loti, Cline ou Gombrowicz en mlant la fiction
leur vcu. Le problme, c'est que les effets de cette pression sociale, de ce
souci de garder son crdit, ne sont pas facile mesurer dans un texte ou chez
un auteur sans que l'analyse devienne immdiatement, comme par le "retour du
refoul rductrice. Comme le dit bien Pierre Bourdieu, cest alors qu'"il faut
choisir de payer la vrit d'un cot plus lev pour un profit de distinction plus
faible" (1982, p. 10). Pourtant, ce risque constitutif l'criture de l'autofiction
explique sans doute bien des agencements retors, permettant l'crivain de
risquer son nom propre tout en se gardant une marge de replie pour le cas o
le jeu didentification fictionnelle se retournerait contre lui.
Pour illustrer ce cas de figure, on ne citera quun exemple : Moravagine
de Cendrars Ce roman, on l'a vu, ne donne qu'un petit rle son auteur, mme
si cette place est en vrit essentielle, voile par une formidable ellipse du texte
qui cherche comme censurer les relations entre Cendrars et Moravagine.
Mais il nen a pas toujours t ainsi : le manuscrit, conserv au fonds Cendrars,
de la Bibliothque de Berne, prsente une version de l'histoire bien diffrente :
le narrateur est Cendrars lui-mme, en personne, sous son nom. Au dpart
Cendrars voulait donc se reprsenter comme lhomme lige de Moravagine. Puis
il a recul, biff son nom et mis la place celui d'un narrateur imaginaire,
Raymond la Science. Peur des jugements ironiques de la Presse ? Souci de ne
pas inquiter des proches ? Volont de ne pas s'exposer une censure
possible ? Refus de l'diteur ? La raison qui a conduit Cendrars modifier son
manuscrit restera jamais mystrieuse. Le fait est que celui-ci montre bien que
le poids de l'Image pse mme sur un crivain aussi peu conventionnel que lui.
Pour clore cette considration, on signalera un artifice ingnieux pour
les candidats l'autofiction ne voulant prter le flanc aux ricanements de tout
bord. Le procd est Paul Auster, auteur dune trilogie new-yorkaise, dont le
premier volume est Cit de Verre. Au lieu de donner directement son n un
personnage, Auster a trouv le moyen suivant. Il commence par camper un
personnage fictif qui a un nom et une identit thmatique propres : Quinn,
auteur de romans policiers sous un pseudonyme de William Wilson et vivant
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
242
New-York. Et c'est seulement aprs coup, comme par la suite d'une erreur, qu'il
donne son patronyme ce personnage. Alors que Quinn est chez lui, train de
lire le dbut des Voyages de Marco Polo ( Pour quun livre soit droit et
vritable, sans nul mensonge, nous vous donnerons les choses vues comme
vues et les entendues comme entendues ). Aussi, tous ceux qui liront ou
couteront ce rcit doivent le croire parce que ce sont toutes choses vritable le
tlphone sonne :
- All ? fit la voix.
- Qui est-ce ? demanda Quinn.
- All ? rpta la voix. Ecoute, dit Quinn. Qui est-ce ? -
Est-ce Paul Auster ? demanda la voix. J e voudrais parler
M. Paul Auster" (Tr. fr. P. Furlan p. 12).
Quinn commence par refuser cette identification force ; puis il s'y prte
entirement, A la suite de quoi, il connat toutes sortes de tribulations et sombre
dans l'abjection, la folie et la mort. Tout lui est permis puisquil y a eu erreur sur
la personne et qu'il n'est qu'un faux homonyme d'Auster.
Lautofiction n'est, toutefois, pas seulement une entreprise prilleuse
pour son auteur. En aval du texte, le lecteur se trouve dans une contradiction
insoluble. Comment lire un "roman" dont l'auteur est l'un des personnages ?
Comme une fiction ? Comme un texte vise rfrentielle ? Les deux la fois?
Ni l'un ni l'autre ? Si lire c'est faire fonctionner un texte (et donc actualiser son
registre de lecture), la question se pose. Devant une autofiction, 0'' doit obir
deux injonctions. contradictoires : lire le texte comme une fiction et comme une
autobiographie. Pourtant, ces deux registres sont incompatibles, que ce soit par
leurs protocoles, leur rapport au rel ou leur usage. Ce sont deux systmes de
communication dont la synthse est impossible, deux territoires aux frontires
bien dlimites, Mme si des procds formels peuvent s'changer et circuler
de l'un l'autre. Sauf que le texte autofictif tire son sens de ces deux registres
et de leur coexistence Mme au niveau de l'nonciation, le lecteur est face un
paradoxe au sens strict, un paradoxe pragmatique. Un paradoxe parce qu'il n'y
a l nul sophisme ni abus de langage. Un paradoxe pragmatique parce que la
duplicit n'est pas au niveau de ce que dit le texte, mais dans la manire dont il
fait sens, s'nonce ou signifie.
Mutatis mutandis, le lecteur est pris dans ce que les thoriciens de
l'cole de Palo Alto, la suite des travaux de Bateson sur la schizophrnie ont
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
243
popularis sous le terme de double-bind (Bateson, 1956 ; Watzlawick, 1967) :
une "situation double contrainte". Dans le domaine de l'interaction humaine,
on sait qu'un individu est prisonnier d'une telle situation quand il est l'objet d'une
communication qui se contredit elle-mme, d'un nonc ou l'intrieur d'un
cadre de rfrence sans ambigut, quelque chose est formul sur ce cadre qui
le dnie. Un tel type de communication paradoxale a pour effet d'interdire
l'usage du niveau mtacommunicatif, la capacit de communiquer sur la
communication, la perception des nuances entre les diffrents registres de
communication - et de produire terme un schizophrne. Sans forcer
davantage la comparaison, il faut reconnatre que le lecteur face un texte
autofictif se trouve devant le mme registre indcidable et dans une situation
tout aussi intenable : il se trouve dans limpossibilit de distinguer le littral et le
mtaphorique et de choisir entre ces deux registres. Selon son temprament, il
dcidera alors que toute luvre a un sens cach (rponse paranoaque qu'elle
n'appartient aucun registre-type dfini (rponse hbphrnique) ou qu'elle ne
prsente aucun intrt (rponse catatonique).
Fonctions du dispositif.
Naturellement, le lecteur est rarement conduit ces extrmits car une
autofiction est pourvue d'tiquettes, d'indices, de signaux mtacommunicatif qui
lui permettent de comprendre qu'il s'agit d'une sorte de jeu, qu'il est devant une
uvre d'art. Bien plus, ce double-bind de l'autofiction ne fait que prolonger et
redoubler le double-bind constitutif de la fiction, signal par Warning et dcrit
depuis longtemps sous la catgorie de "mensonge''.
C'est, en effet, depuis l'Antiquit que la littrature est place sous le
signe de la duplicit. Chaque poque a reconnu plus ou moins explicitement
qu'elle supposait de part et d'autre, du rle de la production celui de la
rception, une totale mauvaise foi. L'auteur par Iillusion qu'il cherche , rendre
crdible ; le lecteur par la bonne volont qu'il met adhrer cette illusion.
Cette description, parfois transforme en accusation, de la littrature en termes
de simulation, rendait compte de la posture d'nonciation du discours fictionnel.
Elle visait aussi dfinir la lecture comme un champ permissif ou nombres
d'oppositions irrductibles sont dsamorces, A des stratgies contradictoires
trouvent un compromis.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
244
Ainsi, si en droit le dispositif de l'autofiction est embarrassant pour le
lecteur, s'il ne peut conduire qu' une uvre impossible, en fait la plupart des
textes offrent une solution cette contradiction. On a volontairement insist sur
le caractre intenable de la fictionnalisation pour mettre en valeur le geste
provocant que reprsentait son existence. En ralit, comme on s'en doute,
aucun lecteur n'est jamais devenu schizophrne la lecture d'une autofiction.
Le lecteur trouve la plupart du temps une solution l'antinomie de cette posture
d'nonciation. De mme que le double-bind de la fiction trouve une "rsolution
ludique". l'autofiction offre le plus souvent un compromis qui permet daccorder
ses contraires. Quelle solution ? Comme pouvait le faire prvoir l'htrognit
du corpus, celle-ci n'est pas unique. Lexamen attentif des textes montre que,
loin de ne remplir qu'une fonction, le dispositif permet des effets multiples et
Mme contradictoires. Selon les uvres et selon les auteurs, le lecteur
constate, en effet, que dans certains cas le texte autofictif est recontextualisable
alors que dans d'autres, il demeure irrductible. Autrement dit, deux cas de
figures se prsentent : a) le lecteur peut recontextualiser le dispositif, c'est-
-dire lui trouver malgr sa particularit une appartenance gnrique, une place
dans le systme des genres et des pratiques littraires. On supposera que ce
lecteur est comptent, que sa recontextualisation n'est pas une "trahison", une
"mconnaissance par assimilation" (Derrida). Dans ce premier cas, c'est le
texte qui offre des "appels d'interprtation" en ce sens, qui mnage au lecteur
une orientation de lecture telle qu'il peut rattacher le dispositif des stratgies
balises, essentiellement rfrentielles et rflexives comme on va le voir.
b) Le texte demeure irrductible toute recontextualisation. L'usage qu'il
fait du dispositif n'est pas soluble l'aide d'une catgorie gnrique
conventionnelle. Par rapport la comptence du lecteur, son savoir littraire et
culturel, le dispositif est alors une "forme sans fonction". Pour lire, le lecteur doit
pouser le mouvement du texte, s'assujettir son autorit et une signification
qu'il ne tire que de lui-mme. Il se trouve alors devant ce que Ross Chamber
appelle un "texte difficile", qui appelle un travail d'interprtation important et qui
peut provoquer des effets varis angoisse, sentiment de rsistance, vertige, jeu
etc. (1982)
C'est selon ces deux orientations que se distribuent les ralisations du
dispositif, qui peuvent se dtailler fonctionnellement de la faon suivante :
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
245
al) fonctions rfrentielles
Le dispositif de fictionnalisation de soi sert en ralit une vise
didactique, constative ou autobiographique. Loin dtre le moyen dune plonge
dans l'imaginaire, il sert au contraire une volont de vrit ;
a2) fonctions rflexives
Le dispositif permet des textes spculaires ou autorfrentiels. Il produit
alors une forme spcifie de "mtalepse", par laquelle luvre se "dnude" ou
s'auto-glorifie ;
b) fonction figurative
Cette dernire fonction est une hypothse de travail. Il faudra se
demander si les ralisations ne correspondant pas une stratgie balise, ne
convergent pas malgr tout dans un effet commun : la figuration.
Trois grands types de rsolutions possibles apparaissent ainsi pour le
dispositif autofictif ; trois grandes fonctions que l'on va dtailler dans les
chapitres qui suivent. Cette tude fonctionnelle sera l'occasion de voir si,
dfaut de thmes obligs ou de traits formels rcurrents, ce dispositif ne
prsente pas une certaine unit au niveau des stratgies qui commandent son
usage. Cet examen pourra aussi permettre de cerner dfinitivement le contenu
donner au terme autofiction, de prciser la dfinition en comprhension de
cette catachrse.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
246
2 - FONCTION REFERENTIELLE
La vrit n'est jamais jas ce dont on a dcid de se
souvenir
P.Cnnro
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
247
On a jusqu'ici toujours dcrit la mise en uvre du dispositif de
l'autofiction comme une pratique par laquelle un crivain s'inventait une vie et
une personnalit, comme une sorte de fictionnalisation de soi. Certaines
uvres, pourtant, actualisent le dispositif sans avoir de vise fictionnelle, tout
en manifestant au total une nette ambition rfrentielle. La figure d'nonciation
utilise est bien celle de l'autofiction mais le projet d'ensemble, le rsultat
recherch n'est pas l'laboration d'une autofiction. Cette affirmation paratra
sans doute paradoxale, voire incohrente.
Il faut, pourtant, comprendre que le dispositif de l'autofiction ne demande
pour tre "mont" que deux lments une identification de l'auteur avec l'un de
ses personnages une mention affirmant la fictionalit de luvre. C'tait,
rappelons-le, la dmarche de Doubrovsky avec Fils, dclar autobiographique,
malgr l'indication gnrique "roman" de son ouvrage. Cet exemple n'est pas
unique. Ce chapitre a prcisment pour but d'explorer tous les cas dans notre
corpus o le dispositif de l'autofiction sert des fins rfrentielles, un projet
didactique ou une entreprise autobiographique.
- I - FONCTION DIDACTIQUE
Par cette appellation, on dsignera toutes les ralisations o le dispositif
sert un dessein la fois pdagogique et idologique ; o il permet d'authentifier
un discours systmatique, qu'il soit philosophique ou historique, esthtique,
mtaphysique etc. Cette fonction se retrouve aussi bien dans des fictions
proprement dites que dans un genre dmonstratif comme celui du dialogue.
Dans un texte narratif fictif, la fictionnalisation de soi donne la possibilit
de mettre en place un reprsentant auctorial, un interprte de l'auteur. Par lui, le
texte va pouvoir se faire lire selon une orientation bien dtermine ; l'activit
interprtative du lecteur va se trouver troitement canalise, en fonction des
intentions de l'auteur. Si la notion de "porte-parole" a un sens, c'est bien dans
cette situation l, A l'auteur dlgue un personnage son autorit et son
pouvoir. Sans doute, cette notion est parfois utilise de faon peu rigoureuse.
Balzac avait raison de s'lever contre la fcheuse tendance attribuer
l'auteur les propos de ses personnages. Il ne suffit pas qu'un personnage tienne
un discours systmatique et cohrent, que rien ne vient contredire dans
luvre, pour que l'on puisse en faire un reprsentant de l'auteur. Par contre, si
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
248
ce personnage porte un nom proche de celui de l'auteur, on n'aura pas tort d'y
voir comme un double charg de guider le lecteur.
Un tel personnage homonyme est un signal quasi-explicite que le texte
dispose de son propre appareil interprtatif, qu'il renferme en lui la clef de sa
"bonne interprtation". Son homonymie est la marque de l'autorit qui lui est
confre ; elle indique que ce personnage est comme un "dcodeur" incorpor
au texte, qu'il a charge de dchiffrer par avance le sens de l'histoire laquelle il
appartient. Naturellement, un narrateur pourrait remplir cette fonction
interprtative avec encore plus de nettet. Mais la structure de la fiction devien-
drait trop dmonstrative ; on serait devant un roman thse. Au contraire,
donner son nom (ou une partie) un personnage permet de faire l'conomie
d'un narrateur envahissant, dun commentaire interprtatif rigide comme celui
de la fable.
Ainsi, dans tes Buddenbrook, Thomas Mann a-t-il dlgu un
personnage qui porte son prnom pour donner son sens au roman. Tout montre
que Thomas Buddenbrook a pour tche d'clairer le dclin de sa famille, de
donner sa signification la dcadence de sa ligne, de faire de son histoire un
destin. Sa rflexion sur la discordance entre la force et le ressassement de soi,
sur lincompatibilit du vouloir-vivre et de la pense, sur l'opposition de l'art et
de la vie, dpasse sa propre situation pour expliquer toute la destine fatale des
Buddenbrook. Le constat qu'il fait d'une "nature artiste" rongeant la vitalit
initiale des Buddenbrook, c'est celui de Thomas Mann sur son poque ; le
diagnostic qu'il fait sur les rapports entre l'chec de sa famille et sa chute dans
la maladie, West encore celui de Thomas Mann. Ce personnage n'est pas
seulement le dernier acteur lucide de la saga familiale ; il est aussi l'interprte
de son histoire. Mutadis Mutandis, on pourrait faire la mme analyse avec le
personnage de Burton dans L'Emploi du temps de Butor ou avec celui
d'Andras dans Le Mur de la peste d'Andr Brink.
Cette fonction interprtative peut aussi jouer un rle dans un genre o
l'on ne l'attendrait pas, A ses vertus pdagogiques semblent inutiles : le genre
du dialogue. Ce genre didactique, qui trouve son point de dpart chez Platon,
est comme on sait un genre important. Au sein de cet ensemble, un certain
nombre de dialogues prsentent la particularit de mettre en scne leur
auteurs. On en a vu quelques exemples au cours de ce travail. En fait, ils sont
beaucoup plus nombreux qu'on ne pourrait le penser et ce corpus mriterait
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
249
une tude lui tout seul. Dialogue historique de Varron, les Dialogues de
Grgoire Le Grand, Dialogue entre un Juif, un philosophe et un chrtien
d'Ablard, certains Dialogues du Tasse, Dialogue en forme de Vision nocturne
de Marguerite de Navarre, Nouveaux Essais de Leibniz, Entretiens de
Fontenelle, tous ces textes forment comme un sous-ensemble homogne et
important, au mme titre par exemple que le sous-genre dialogue des morts o
l'auteur fait converser des morts illustres, sans aucun souci de vraisemblance,
en permettant par exemple la rencontre de Machiavel et Montesquieu comme
dans le magnifique et mconnu Dialogue aux enfers de Maurice J oly.
Dans cette pratique littraire, le recours au dispositif autofictif semble
s'expliquer de la faon suivante. Premier temps, l'auteur choisit de mettre en
place la fiction d'un dialogue, procd trs commun qui a l'avantage de divertir
tout en instruisant ; de montrer la vrit en train de natre, plutt que de la
prsenter fige et dj forme comme dans un Trait. Cette forme d'exposition
prsente toutefois un risque. La situation imagine, les personnages invents,
les mandres de leur discussion, tout cela risque de dborder les intentions de
l'auteur et de noyer pour ainsi dire les affirmations qu'il voulait imposer.
Autrement dit, force de vouloir plaire, de prtendre concilier la doctrine et la
littrature, il y a le danger d'une "revanche de l'criture" (Suleiman, 1983, pp.
239-264). Pour parer ce risque de dbordement par son cadre fictif, l'auteur
peut alors choisir, dans un second temps, de se reprsenter lui-mme dans le
texte. Il asseoit ainsi de son autorit le discours d'un personnage, permet ses
thses d'tre identifies par le lecteur et spares des autres voix du texte.
Prenons l'exemple des Entretiens sur la pluralit des mondes de
Fontenelle, un dialogue rapport sous une forme narrative. Fontenelle a donn
comme cadre fictif ses thses scientifiques un sjour dans le chteau d'une
marquise et des soires passes discuter dastrophysique Dans ces
conversations rudites, Fontenelle mle, comme il le reconnat dans sa prface,
le certain et le plausible l'apodictique et l'hypothtique. A ct d'affirmations
acceptes par la "Cit savante" de son poque, il avance des propositions qui
n'ont pas encore t dmontres, mais qui pour lui sont trs probables. Il fallait
donc que l'on prenne au srieux ces hypothses qui pour Fontenelle taient des
hypothses scientifiques. C'est l que son cadre imaginaire, sa fiction
d'entretiens, risquait de le perdre. Il y avait le risque d'une sorte de
contamination de tout son propos, par sa fiction mondaine et le bon badin utilis
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
250
pour le rapporter. Tout son ouvrage pouvait tre lu comme une rverie potique
sans fondements ; comme une description fantasmagorique du ciel ; comme un
livre dans la veine de l'Histoire vraie de Lucien, multipliant les descriptions
fantastiques et les inventions gratuites. Pour parer ce danger, Fontenelle a
bien sr multipli les arguments et les dmonstrations, a mis tout son discours
sous le signe du raisonnable. Mais surtout, il s'est identifi son narrateur, afin
que toute son autorit d'auteur taye les hypothses formules, leur donne
l'allure d'un discours srieux. Du coup, son narrateur n'est plus seulement un
savant avide de diffuser son savoir, c'est un personnage vicaire, un double de
l'auteur, son reprsentant dans le texte. Cette identification est une vritable
dlgation de pouvoirs : en partageant son identit, Fontenelle donne aussi son
autorit et il garantit le srieux de son discours.
Concluons : avec cette premire fonction, un paradoxe se fait jour. Alors
que le dispositif de la fictionnalisation de soi est dans l'absolu le comble de
l'invention, la fiction pousse sa limite, l A elle emporte jusqu' son auteur,
des textes montrent un tout autre emploi possible. Loin de servir l'imaginaire, le
dispositif peut aussi servir de "verrou'' rfrentiel en quelque sorte. Tout comme
la mise en abyme chez les naturalistes, il peut servir la cause dun message,
tre le garant d'un discours didactique. Comment reconnatre un tel emploi du
dispositif ? Dans le cas du dialogue, la question ne se pose pas. Le dispositif
n'est l que pour viter toute ambigut dans interprtation, le caractre
synthtique et dmonstratif du texte indiquant la ncessit de cette
interprtation. Dans le cas d'une fiction, c'est videmment plus compliqu. On
peut, toutefois, avancer l'existence des traits suivants : a) l'emploi htro- ou
homodigtique du double auctorial : si ce double est au centre du rcit, en est
l'acteur principal, il est moins apte en donner le sens, s'en faire l'interprte ;
b) un "Profil thmatique" contrast du personnage auctorial : par l,
l'auteur dcourage le lecteur dans toute tentative d'interprtation littrale, qui
ferait de son double un autre lui-mme et du texte une uvre
autobiographique ; c) enfin, trait qui va de soi mais qu'il faut rappeler, la
prsence dans le texte d'un discours interprtatif nonc par un personnage.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
251
II - FONCTION BIOGRAPHIQUE
Cette seconde appellation permettra de nommer toutes les uvres o le
dispositif sert un projet intime, A une des finalits ultimes est de mettre laccent
sur sa vie, en particulier sur l'histoire de sa personnalit" (Lejeune, 1975, p. 14)
comme dans une autobiographie.
Pourquoi alors de tels ouvrages sont-ils prsents comme fictifs ?
Pourquoi des auteurs prouvent-ils la ncessit de classer des textes intimes
dans la littrature romanesque ?
Il faut distinguer dans ce choix fonctionnel deux cas de figures : la
littrature onirique et une littrature qui manifeste une "modlisation mineure du
projet autobiographique" (Lejeune).
Tout d'abord, il faut penser des textes autobiographiques dont le
contenu est par ncessit fictionnel : les rcits de Ave. Perec avec La boutique
obscure, Butor avec son Matire de rves ont montr lintrt et la cohrence
de cette criture onirique. Voil des ouvrages qui prennent leurs racines au plus
profond de l'intimit de l'crivain, qui sont d'une authenticit parfois douloureuse
et qui pourtant sont presque toujours irrels, dont le contenu est par dfinition
invraisemblable. Pour ces textes, l'crivain n'a pas besoin de mettre en place
un protocole de fiction compliqu. La matire de ces rcits indique le plus
souvent d'elle-mme leur fictionnalit : il s'agit d'autofiction presque naturelles.
C'est d'ailleurs une forme d'criture qui mriterait autre chose qu'une vocation
rapide si les limites de cette enqute ne lempchait pas. Dans cette littrature
onirique, le dispositif de fictionnalisation ne cherche pas draliser lcrivain, il
est ncessaire pour que le vcu onirique soit fidlement restitu.
Second cas de figure, une littrature qui se rpand de plus en plus
aujourd'hui, A l'crivain se raconte sur un mode fictionnel tout en assurant que
cette fiction est vraie. Une illustration trs claire : Alphonse Boudard, LHpital
(La table ronde, 1972). L'ouvrage porte comme second titre Une
hostobiographie et comme indication gnrique "roman". Sur le quatrime de
couverture, on peut lire entre autres : "Jinvente rien, je rorganise ma
souvenance et puis je fais danser les mots...". Les contradictions de ce
protocole pritextuel se retrouve l'intrieur de l'ouvrage' c'est bien le rcit
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
252
d'annes passes par l'auteur lHpital, mais il y a tant de verve dans le style,
de truculence dans les portrait se de jubilation dans les descriptions que cela
donne penser que leffet produire sur le lecteur a autant command cette'
autobiographie que la fidlit au vcue le souci de restituer
scrupuleusement une exprience difficile. Alphonse Boudart a ainsi publi
plusieurs volumes de ce type : La Mtamorphose des Cloportes, La Cerise,
Bleubite, Cinoche, Les Combattants du petit bonheur, Le Corbillard de Jules et
dernirement L'ducation d'Alphonse. Dans Le Corbillard de Jules, (La Table
Ronde, 1979), il donne une prface o il dsigne ces livres comme appartenant
un "grand ensemble de biographie romanesque", dont le titre gnrique serait
Les Chroniques des mauvaises compagnies. L'appellation "biographie
romanesque" ramasse pertinemment la formule de cette criture de soi moule
sur l'criture romanesque, mais se dfendant bien de dformer les faits et
n'ayant d'autre perspective qu'autobiographique.
Notons que ce registre contradictoire est aujourd'hui un phnomne
incontournable du monde ditorial. De plus en plus d'crivains, de faon
ponctuelle ou systmatique, publient de tels textes. Luvre de Doubrovsky
entre' naturellement dans cette catgorie. Lejeune en a relev Vautres
exemples dans "Autobiographie, roman et nom propre". On peut ajouter
quelques crivains son inventaire. Pour ne retenir que les crivains qui le font
de faon systmatique, on retiendra les noms de J ean-Franois Bastide, de
Gabrielle Rolin et de Thomas Bernhard. Tous ces crivains pourraient
reprendre la formule de Boudard : "J 'invente rien, je rorganise ma souvenance
et je fais danser les mots".
Dans son examen de ce type hybride, Lejeune a insist sur le fait qu'il ne
s'agissait que d'une "modlisation mineure du projet autobiographique" ; que
les contradictions de ce registre n'apportaient gure que des confusions et que
leur seul mrite tait d'illustrer un malaise gnral envers les dis cours
rfrentiels. Il est vrai qu' une ou deux exceptions pris, ces textes hybrides ne
sont pas dune trs grande qualit littraire. Toutefois, il y a l un phnomne
de la vie littraire qui n'est pas ngliger et qui est l'quivalent pour notre
poque de ce qu'tait pour le XIXe sicle la roman personnel dont le prototype
est L'Oberma de Senancour. Comme on sait, ce sicle a vu se multiplier des
romans la premire personne, o le narrateur tait anonyme, que la rumeur
ou le contexte ditorial disait d'inspiration autobiographique et qui taient lus
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
253
comme des autobiographies retouches. Cest pour viter type de lecture que
Barris a nomm rtrospectivement "Philippe" le narrateur-hros de sa trilogie Le
Culte du Moi, qui tait anonyme dans les premires ditions.
Toutes ces "biographies romanesques" reposent sur une doxa qui
trouve son origine chez Goethe, selon laquelle dans le domaine de l'criture de
soi, toute vrit est posie Certes, les arguments avancs peuvent tre
diffrents : la part de fiction qui entre dans toute personnalit ; le phnomne
qui fait que l'on se souvient plus de l'effet que des faits la ncessit pour
l'exigence de vrit du projet autobiographique de composer avec l'exigence
artistique (de style, de composition). Ainsi avec Doubrovsky, on a vu une
formulation particulire de cette doxa utilisant un langage psychanalytique,
mettant l'accent sur le pouvoir althique du langage. Mais il ne s'agit que d'une
formulation diffrente. L'essentiel se trouve dj chez Goethe.
Dans la tradition autobiographique, Aus meinem Leben. Dichtung und
Wahrheit (Souvenirs de ma vie. Posie et Vrit (1811-1833) pst, en effet, un
livre fondateur, aussi important que Les Confessions de Rousseau, quoique en
un autre sens. On doit Rousseau d'avoir donn le coup d'envoi une criture
de soi A l'accent est mis sur une exigence de vrit absolue, une manire de
pratiquer l'autobiographie et la connaissance de soi qui va jusqu' l'impudeur,
dont Leiris est l'hritier moderne. Mais c'est Goethe que l'on doit d'avoir
signal la part d'invention qu'il y a dans l'criture de soi, part dont il fallait tenir
compte et qu'il faudrait mme faire fructifier selon lui.
Ds les premires lignes de son ouvrage, Goethe signale l'impossibilit
d'un rcit exact de sa vie
"Car il semble que la tche principale de la biographie
soit de reprsenter l'homme dans ses rapports temporels,
de montrer jusqu' quel point le monde lui rsiste, jusqu'
quel point il le favorise, comment il s'en forme une
conception de l'univers et de l'homme, et, s'il est artiste,
pote, crivain, comment il les rflchit au dehors. Mais,
pour cela, il faudrait une condition qui est, pour ainsi dire,
hors de nota atteinte : savoir, que l'individu connaisse et
lui-mme. et son sicle ; lui-mme pour autant qu'il est
rest identique dans toutes les circonstances ; le sicle
en tant qu'il entrane avec lui ceux qui le veulent comme
ceux qui ne le veulent point, les dtermine et les faonne,
de telle sorte qu'on peut dire qu'un homme, s'il fut n
seulement dix ans plus tt ou plus tard, t tout autre tant
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
254
en ce qui concerne sa propre culture que l'action qu'il
exerce au dehors.
C'est en suivant cette route, c'est de considrations et
de tentatives de ce genre, de souvenirs et de rflexions
semblables, qu'est n le prsent tableau, et c'est de ce
point de vue le point de vue de sa naissance - qu'on
pourra le mieux en jouir, en profiter et en juger avec le
plus dquit. Il y aurait peut-tre dire encore,
particulirement sur la manire mi-potique, mi-historique
de cet ouvrage, mais l'occasion s'en rencontrera sans
doute plus d'une fois au cours du rcit" (Trad. fr. P. du
Colombier)
Par la suite, il ne manque pas de noter les moments o le "pouvoir
potique" de l'imagination a interfr avec le travail de la mmoire. Au dbut de
la quatrime partie, il donne mme sa mthode, qui lui fait utiliser les altrations
de sa mmoire pour rafrachir par le vernis de la posie l'clat de sa vie passe:
En contant une vie dont la marche est aussi varie
que celle dont nous avons eu l'audace d'entreprendre le
rcit, nous sommes conduits, pour rendre clairs et
intelligibles certains vnements, sparer
ncessairement des choses qui s'entrelacent dans le
temps, en resserrer d'autres, que leur suite permet
seule de saisir, et grouper ainsi l'ensemble en parties
qu'on peut embrasser raisonnablement pour les juger, et
dont on peut tirer soi-mme quelque profit.
Nous plaons cette considration en tte du prsent
volume pour qu'elle contribue justifier notre mthode, et
nous y ajoutons cette prire nos lecteurs, de vouloir
bien prendre garde que le rcit qui se continue ici ne se
raccorde pas exactement la fin du livre prcdent, mais
que son objet est de reprendre peu peu tous les fils
principaux et de prsenter, en un enchanement solide et
sincre, aussi bien les personnes que les sentiments et
les actes .
Tout le travail de Goethe dans cet expos biographique consiste donc
assumer les dformations rtrospectives pour composer un ouvrage qui se
prte le mieux possible au sens qu'il donne sa vie et aux exigences d'une
uvre littraire. Un exemple frappant de ce souci d'organisation et de composi-
tion dans Posie et Vrit, est la mise en scne par Goethe de son propre nom.
Si l'ouvrage dbute par une dclaration qui a le caractre formel d'une
dclaration de naissance ltat civil ("Le 28 aot 1749, alors que sonnait le
douzime coup de midi, je vins au monde Francfort-sur-le-Main"), le narrateur
est anonyme durant toute la premire moiti de l'ouvrage. Alors que de
nombreux passages voquent sa signature, comme prolongement
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
255
mtonymique de sa personne et lment important dans le jeu amoureux, le
narrateur retarde loisir la profration de son nom. C'est seulement au centre
exact de l'ouvrage (IIe partie, Livre 10 1 l'ouvrage comprend quatre parties et
vingt livres), en reproduisant un pigramme de Herder que Goethe dvoile
Herder qui joue avec l'tymologie de son patronyme et qui permet Goethe un
beau dveloppement sur la manire dont chaque personne se familiarise avec
son nom, au point d'en faire comme un piderme symbolique. Il y a l comme
un rituel d'imposition, Goethe suggrant qu son nom d'auteur, il le doit
Herder, que sans lui toute sa production serait reste dans les grces mivres
du XVIIIe sicle qui caractrisaient ses dbuts. Ce n'est qu'un exemple du
formidable travail de composition auquel Goethe s'est livr sur les donnes de
son existence. Mais il est particulirement significatif.
Luvre aura une influence considrable en France, souvent chez des
crivains dont on ne souponnerait pas cette filiation. Ainsi Renan qui ds les
premires pages de Souvenirs d'enfance et de jeunesse reconnat sa dette :
"Goethe choisit pour titre de ses Mmoires Vrit et
Posie, montrant par l qu'on ne saurait faire sa propre
biographie de la mme manire qu'on fait celle des
autres. Ce qu'on dit de soi est toujours posie () Ce qui
est une qualit dans l'histoire eut t ici un dfaut ; tout
est vrai dans ce petit volume, mais non de ce genre de
vrit qui est requis pour une Biographie universelle. Bien
des choses ont t mises afin qu'on sourie ; si l'usage
let permis, j'aurais d crire plus d'une fois la marge
Cum grano salis," ( 1383, pp. 39-40 )
Toutes choses gales, on voit comment un auteur comme Boudard
dcoule directement de cette tradition. La nuance qui le spare de Goethe ou
de Renan, c'est qu'un discours d'escorte est moins ncessaire. Il suffit
aujourd'hui de disposer l'indication gnrique "roman" pour prendre son
compte les arguments de Goethe et se donner toutes les liberts pour conduire
le rcit de sa vie. On voit aussi en quoi cette forme d'criture de soi se distingue
de l'autofiction. La revendication fictionnelle n'est dans ce cas qu'un moyen de
se dfendre de l'accusation de mensonge ; c'est une licence biographique, pas
une fin en soi.
En ralit, le registre de ces uvres est tendanciellement rfrentiel ;
c'est mme ce qui permet de les diffrencier des autofictions proprement dites.
Soit le cas de Boudard ; tous ses ouvrages portent sur la couverture l'indication
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
256
gnrique "roman". Mais lui-mme ne manque pas une occasion, dans le reste
du pritexte, de signaler qu'il ne fait que relater les bonheurs et les avanies de
son existence mme s'il ne respecte pas l'ordre chronologique. La prface du
Corbillard de Jules met mme un peu d'ordre dans ces volumes en situant cha-
cun d'eux par rapport aux vnements de sa vie. On vitera donc de confondre
ces "autobiographies romanesques" avec l'autofiction, mme si c'est ce
phnomne qu'avait en vue Doubrovsky quand il a forg cette catachrse. Bien
plus, on vitera d'utiliser ce terme mme quand le rcit prsent est
extravagant, impossible. Ds lors que la vise est rfrentielle, peu importe le
contenu, il y a toujours une volont de vrit qui porte l'ouvrage et c'est l
l'essentiel. Le rcit de rve est l pour en administrer la dmonstration : si je
raconte mes rves, il y a de fortes chances pour qu'ils montrent la plus grande
fantaisie par rapport aux lois qui rgissent la vie ordinaire. Nanmoins, ces
rves seront bien les miens et si j'engage ma parole quant leur authenticit, il
faut bien que mon auditoire les reoive comme autobiographiques.
Cette dernire observation est ncessaire pour classer des textes
comme Vivre avec son double (La Table ronde, 1979 ) Alfred Fabre-Luce. Dans
ce "roman" l'auteur met en scne sa propre personne et le jeune homme qu'il
fut, venu le revisiter. Bien sr, ce texte ne peut tre que fictionnel dans son
contenu. Mis sa vise est rfrentielle, son ambition est autobiographique. En
faisant coexister le vieil homme qu'il est et l'adolescent qu'il fut, Fabre-Luce ne
fait que matrialiser ses propres penses et rveries, donne corps cette part
de dichtung qui entoure toute existence. C'est ce qui lui permet de donner
"l'avertissement" suivant en tte de son livre :
"Bien des auteurs ont crit un roman inspir de leur propre vie. Ce fut
pour eux un moyen de creuser plus profond qu'ils ne pouvaient le faire dans
des Mmoires. Telle est aussi la signification du livre que je publie. Trs
soucieux d'exactitude rigoureuse dans mes travaux d'historien, je tiens
prciser ici la distinction des genres. Un roman, peut tre, lui aussi, plein de
"vrit", mais ce n'est pas une vrit littrale, mme l o beaucoup de traits
sont exacts.
A propos duvres du mme genre, on a parl de "mentir-vrai".
L'expression est trop brutale pour mon got. Le mensonge m'est toujours anti-
pathique. J 'ai plutt us de discrtion et de stylisation - parfois aussi d'humour".
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
257
Comment conclure ce chapitre sur les uvres A la fictionnalisation de
soi remplit un objectif rfrentiel, didactique ou autobiographique ? Il faut
reconnatre que l'on est devant un phnomne embarrassant. Des uvres qui
apparaissaient comme autofictives, qui parfois ont t analyses comme telles,
se dvoilent fonctionnellement comme porteuses d'un projet autobiographique
ou pdagogique. Ne sommes-nous pas en contradiction avec nous-mme ?
En fait, il faut bien voir que le dispositif de la fiction de soi est dune
disponibilit totale. Tous ces "romans, qui prtendent tre un roman sans ltre
utilisent des procdures qui seraient valides dans une autofiction vritable. En
ce sens, notre dmarche reste lgitim. Toutefois, cette tape de l'analyse, il
est en effet urgent de distinguer entre la fictionalisation de soi et l'autofiction. La
fictionnalisation de soi n'est qu'un dispositif par lequel un crivain se campe
dans une situation totalement ou en partie imaginaire pour des raisons qui
peuvent tre variables et dont la mise en place d'un "porte-parole" ou d'une
autobiographie attrayante sont sans doute les plus importantes. Lautofiction,
elle, est une pratique qui utilise le dispositif de la fictionnalisation auctoriale pour
des raisons qui ne sont pas autobiographiques.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
258
3 - FONCTION REFLEXIVE
"Introduire dans le roman un romancier" A. Huxley.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
259
Avec le chapitre prcdent, on a vu un emploi du dispositif autofictif
familier au lecteur. Malgr son excentricit, parce qu'elle sert une finalit
rfrentielle, la fictionnalisation de soi ne fait pas alors problme : le lecteur
l'accepte, comme il accepte une autobiographie ou un dialogue philosophique
ordinaires, dont la "contextualisation" ne pose pas de difficults particulires. Il
reste examiner un autre cas de figure o, malgr la bizarrerie du dispositif, le
lecteur se trouve nouveau dans une situation connue, face un usage qui
permet d'indexer la fiction de soi une stratgie balise, en l'occurrence une
stratgie spculaire. Autrement dit, il faut examiner les ralisations o la
fictionnalisation auctoriale recoupe des procdures de rflexion, peut se dcrire
en termes de "mise en abyme
Quoique parfois subtils, tous ces moyens de duplication sont aujourd'hui
bien connus des lecteurs. Outre que des uvres majeures en ont fait leur miel,
de Cervantes au nouveau roman, en passant par Shakespeare ou Zola, tout un
discours d'escorte s'est progressivement constitu pour populariser ces jeux de
miroirs. De J ean-Paul Hugo, de Gide C.E. Magny, il n'a pas manqu
d'crivains ou de critiques pour expliquer la nature, la fonction et l'intrt de ces
techniques. Un des apport de la remarquable synthse de Lucien Dallenbach
sur cette question, le rcit circulaire, est de montrer en pointill comment
l'usage de la rflexivit littraire s'est institutionnalis au cours des sicles. A
travers des formes diffrentes et des enjeux multiples, une tradition s'est mise
en place pour accompagner la mise en abyme, permettre sa perception, sa
classification et par suite sa comprhension. Il parat donc lgitime d'affirmer
que ces procds de rflexion constituent une stratgie reconnue, ayant sa
place dans le paysage littraire. Que la fictionnalisation de soi vienne se
confondre avec l'une de ces techniques spculaires et elle sera perue comme
un effet de celle-ci.
RAPPEL
On sait que la notion de "mise en abyme" rassemble des procds de
rflexion varis, procds qui peuvent se rduire trois types comme le dcrit
Dallenbach :
"Tel que les auteurs l'utilisent sans le problmatiser le
terme de mise en abyme vise regrouper un ensemble
de ralits distinctes. Ces dernires se ramnent trois
figures essentielles qui sont la rduplication simple (frag-
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
260
ment qui entretient avec l'uvre qui l'inclut un rapport de
similitude), la rduplication l'infini (fragment qui
entretient avec l'uvre qui l'inclut un rapport de similitude
et qui enchsse lui-mme un fragment qui... . et ainsi de
suite) et la rduplication aporistigu2 (fragment cens
inclure l'uvre qui l'inclut)`` (1977, P. 51).
Pour reprendre une formule ramasse de J . Verrier, est mise en abyme,
"toute uvre dans l'uvre", toute uvre sur l'uvre ou toute uvre par
l'uvre. Reste se demander sous quelles conditions la mise en abyme et la
fiction de soi peuvent se recouper ? Dans le type I, il n'y a qu'un rapport d'a-
nalogie entre le segment textuel rflchissant et le texte rflchi : la scne de
thtre dans Hamlet. Ce type de rduplication (simple) ne se prte donc pas
la fictionnalisation de soi. Le type II, lui, ne peut gure exister de faon effective
comme le souligne Dallenbach
le ddoublement interminable est littrairement vou demeurer sinon
l'tat de programme du moins au stade de l'bauche. La raison de cet
inaccomplissement se discerne sans peine. Elle tient la structure mme d'une
reprsentation dont la profondeur implicite se heurte aux limites du rcit
entrevues par Lessing Preuve en soit l'usage intemprant que les affiches
publicitaires font du procd, alors qu'en littrature il ne se signale par la force
des choses qu' l'tat de projet (a), de rfrence emblmatique (b) ou de
ralisation partielle (c) Exemples
(a) Contrepoint de Huxley ; (b) Le Vent et L'Herbe
de Claude Simon ; (c) Les Faux-Monnayeurs" (1977,
pp. 145-146).
Demeure donc le type III. En se rflchissant elle-mme, l'uvre
invagine ncessairement son producteur, le propulse fatalement au beau milieu
de sa fiction et rejoint ainsi le ddoublement de l'autofiction. Naturellement,
cette invagination a quelque chose de spcieux :
''Emblme du type III, Ouroboros ne l'est pas par
busard. On sait les difficults que reprsente pour
l'axiomatique un ensemble qui se contient lui-mme. Or
l'auto-enchssement narratif n'est pas une moindre
source d'apories. Emanant ici de l'auto-rfrence,
celles-ci enfreignent trois niveaux la loi du tertium non
datur : au niveau de la causalit, puisqu'un rcit
auto-enchssant exploite la rcurrence et se donne pour
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
261
le produit de son produit ; au niveau de la temporalit,
puisqu'il se projette dans l'avenir (...) alors qu'il est un
rcit accompli ou en train de voir le jour ; au niveau de la
spatialit, puisqu'il se reprsente comme sa propre partie
et se laisse enfermer par ce qu'il contient" (Dallenbach,
1977, p. 147).
Ce vacillement des catgories logiques et sensibles n'est toutefois pas
vraiment nouveau. Il rappelle le trembl qu'introduit le dispositif autofictif dans la
reprsentation, le trouble qu'il porte dans les limites entre le dedans et le dehors
d'une fiction Ainsi, tant par sa nature que par son effet, la rduplication
aportique se trouve tris proche de la fictionnalisation de soi.
Mais pour que ces deux pratiques littraires puissent se confondre, il faut
une dernire condition, qui est incontournable. La mise en abyme n'est possible
que si le segment textuel rflchissant se confond ou tend se confondre avec
le texte rflchi, il va de soi que la mise en abyme n'a plus de sens.
Davantage, le rendement narratif de celle-ci est suspendu sa
miniaturisation. Trop dveloppe, elle perd beaucoup de son efficace Pour le
type III, Dallenbach fait de cette exigence une 'loi importante" : "la force de
l'auto-enchssement est inversement proportionnelle la mobilisation d'une
uvre enchsse", (p. 147). Ainsi, la fiction de soi ne recoupera la mise en
abyme qu' la condition d'tre limite, de n'tre ralise qu'avec parcimonie
dans le texte. C'est dire que le personnage auctorial ne doit pas occuper une
place trop importante dans l'uvre. Faute de quoi, l'auteur n'apparatra pas
comme rflchi par son texte.
UN MODELE : LE " QUICHOTTE" .
Afin d'examiner concrtement les modalits possibles de cette rencontre
entre la fiction de soi et la mis en abyme aportique, on partira d'un exemple
qui prsente le double mrite d'tre un texte fondateur et une ralisation
exceptionnelle :
L'Ingnieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Comme on sait, ce
roman comprend deux parties, nettement distinctes, publies respectivement
en 1605 et en 1615. La Seconde partie semble rsulter d'une dcision tardive
de Cervantes. Les dix ans qui sparent ces deux volets, le fait que le premier
volet comprenne un dnouement (mme s'il est dception) et soit lui-mme
initialement organis en parties, laissent penser qu'au dpart Cervants ne
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
262
voyait pas la ncessit d'une suite. C'est pourtant ce qu'il publia dix ans plus
tard. Il est peu vraisemblable que l'arrive intempestive dune pseudo seconde
partie, d'un Don Quichotte apocryphe, publi par un certain Avellaneda en
1614, fut l'origine du revirement de Cervants. Toutefois, elle le renfora sans
aucun doute dans sa dcision de ne pas donner une suite au sens traditionnel,
mais de replier son Don Quichotte II sur son Don Quichotte I. Peut-tre mme
ce plagiat lui permit de poursuivre et d'achever une entreprise sans prcdent,
qui pouvait faire reculer plus d'un crivain accompli. De faon inespre, le
Rel fournissait Cervants le prtexte pour donner une dfense, une critique,
une exgse, une authentification et une clture sa Premire partie.
C'est ainsi que dans la Seconde partie, la plupart des personnages ont lu
la premire ; ils sont en mme temps acteurs et spectateurs, protagonistes et
lecteurs du Quichotte. Cette reconnaissance de soi intervient dis le chapitre II,
par la bouche de Cantho, rpondant une question de Quichotte sur sa re-
nomme dans le village, chez le vulgaire, chez les cavaliers et gentilshommes :
si vous dsirez savoir tout ce que l'on en publie
(...) je vous amnerai cans un homme qui vous les dira
toutes sans y manquer d'un sou. Hier au soir, arriva le fils
de Barthlemy Caraco, qui vient d'tudier Salamanque
et qui est reu bachelier. Comme j'allais chez lui pour lui
donner la bienvenue, il m'apprit que dj l'histoire de Votre
Seigneurie courait par le monde, sous le non de
L'Ingnieux Chevalier don Quichotte de la Manche. Il me
dit encore qu'on m'y avait mis avec mon propre nom de
Cantho Panca et madame Dulcine du Toboggan, avec
d'autres choses qui se sont passes entre nous deux
seuls. J 'en fis, tout tonn, mille signes de croix, ne
pouvant m'imaginer comment a pu les savoir celui qui les
a crites" (Trad. fr. F. Rosset et J . Cassou, P. 540).
Cette mise en abyme du livre par lui-mme autorise toutes sortes de
variations savoureuses : une autocritique en rgle (chap. 3), o la Premire
partie est juge d'un point de vue littraire ; une critique systmatique du
Quichotte apocryphe, dont le hros ponyme constate de visu l'existence dans
une imprimerie de Barcelone des comparaisons avec le Quichotte I :
"Le bachelier demeura tout tonn d'our les termes et
la manire de parler de Sancho Pana : car, encore qu'il
et lu la premire partie de l'histoire de son matre,
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
263
toutefois il n'avait cru que Sancho fit aussi plaisant qu'on
l'y dpeint. Mais, quand il l'ouit maintenant parler de
testament et de codicille qui ne se pt dtraquer, au lieu
de testament et de codicille qui ne se pt rtracter, il crut
tout ce qu'il en avait lu et le tint pour un des plus solennels
insenss de notre sicle. Aussi disait-il en lui-mme qu'on
n'avait jamais vu au monde deux fous tels qu'taient le
matre et la valet" (P. 572).
Bien entendu, toutes ces variations ne sont possibles que parce que le
Quichotte II se donne comme un livre crire, dnie sa nature littraire :
"Et par hasard, rpliqua don Quichotte, l'auteur
promet-il une seconde partie ? - Il en promet une, dit
Samson : si est-ce pourtant qu'il nous assure qu'il ne l'a
point trouv, et qu'il ne sait pas qui la peut avoir. C'est
pourquoi nous sommes en doute si elle sera publie ou
non" (P. 550).
Et ce ne sont pas seulement les personnages qui ignorent leur nature
dtres imaginaires, qui n'ont pas conscience d'voluer dans une fiction. Le
"beau-pre" du Livre, Cervants, et le chroniqueur maure Hamet Ben Engeli ne
s'en doutent pas non plus, mme si leur illusion n'est pas la mme. Tout en
sachant, et en signalant qu'ils font uvre de narrateurs, ils parlent de leurs
hros comme des individus rels :
''Le puissant Allah soit bni ! dit Hamet Ben Engel au
commencement de ce huitime chapitre. Bni soit Allah !
rpte-t-il trois fois. Et il ajoute qu'il prfre ces
bndictions en voyant qu'il tient enfin en campagne don
Quichotte et Sancho ; et par ce moyen, ceux qui lisent
cette histoire peuvent faire tat que ds ce mme point
recommencent les hauts faits et les facties de don
Quichotte et de son cuyer" (pp. 573-574).
Aportique, cette mise en spectacle de la Premire partie relance
considrablement le thme des rapports entre le livre et la vie qui traverse le
roman - et permet de reprsenter ces rapports pour ce qu'ils sont : une aporie.
L'ouvrage qui avait fait des romans de chevalerie et du genre pastoral le
support d'un questionnement sur l'opposition entre la fiction et la ralit, est
dsormais lui-mme en lice. Fable parmi les fables, le Quichotte ne peut plus
tre lu comme une nave dnonciation de genre littraires faciles, dj
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
264
dmods ou critiqu l'poque de Cervants. Le lecteur est maintenant
directement confront au scandale constitutif de toute uvre dimagination, de
toute configuration narrative mme, si on se rappelle les dveloppements sur la
thologie. Scandale qui ne tient pas seulement la nature illusoire du rcit,
mais aussi ce besoin qu'ont les hommes d'histoires, ce dsir irrpressible
qui les poussent vouloir vivre leur vie sur le mode enchant de la fable.
La Seconde partie prsente ainsi une mise en abyme du Quichotte qui a
pour effet une "auto-glorification", une signification aportique et une inclusion
par le livre de son dehors. Outre le comique produit par cette situation, cet
auto-enchssement a pour rsultat de fictionnaliser indirectement la personne
de Cervants. Si le Quichotte est une partie de lui-mme, alors Cervants est
aussi un lment de cet univers fictif. Quoique invisible dans le second volet du
roman, il doit appartenir son univers. Ce jeu avec le principe de rcurrence
fournit donc une premire catgorie A la rflexivit littraire et la fiction de soi
se rencontrent : la mise en abyme du livre. On notera que cette rencontre n'est
possible que parce que la fictionnalisation auctoriale est indirecte, se fait par le
biais dune auto-dsignation de luvre. C'est parce que le protocole nominal
est constitu par la mdiation dun livre autonyme, dont lautonymie a valeur de
substitut livresque, que cette fiction de soi quivaut exactement une mise en
abyme de l'nonciation.
Il est pourtant une autre espce de conjonction entre la reduplication et
la fiction de soi, qu'il ne faudrait pas manquer de signaler : la mise en abyme de
l'crivain. On peut en effet imaginer un texte qui ne se rflchisse pas
lui-mme, mais son auteur. Comme par hasard, c'est encore le Quichotte qui
offre un des premiers exemples de cette forme de mise en abyme. Mais pas l
o on l'attendrait. En effet, ce n'est pas nouveau dans la Seconde partie que
se trouve cette reduplication de la source de l'nonciation, mais dans la
Premire, comme si celle-ci renfermait par avance le principe d'un procd qui
allait relancer et transformer toute luvre.
Au chapitre VI du Quichotte I, aprs la premire sortie du hros, l'on voit
deux de ses amis, un barbier et un cur, se livrer un examen et un autodaf
de sa bibliothque :
quel livre est-ce l (...) ? - C'est la Galate de
Miguel de Cervants, dit le barbier. - Il y a bien longtemps
que ce Cervants est mon ami, et je sais qu'il est plus
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
265
vers en infortunes qu'en vers. Son livre a je ne sais quoi
de bonne invention ; il propose quelque chose et ne
conclut rien il faut attendre la seconde partie qu'il promet,
peut-tre qu'avec l'amendement il obtiendra entirement
l'indulgence, qui prsent lui est refuse et, en attendant,
tenez-le renferm en votre logis monsieur mon compre".
(Trad. fr. C. Oudin et i. Cassou, p. 68).
Cette apparition piquante est la seule occurrence de tout l'ouvrage du
nom de Cervants, si l'on excepte une nomination indirecte avec l'vocation de
Numance au chapitre 48, une de ses pices clbre, par son patriotisme. Mais
cette apparition n'est pas seulement piquante, elle est aussi pleine
d'enseignement. Dans le mme geste, Cervants fait obstacle toute
interprtation univoque de son uvre et formule de la faon la plus nette cette
impossibilit d'une lecture dogmatique. Car ce n'est pas seulement dans
Galate, que Cervants "propose quelque chose et ne conclut rien", c'est aussi
dans le Quichotte commencer par l'pisode de l'autodaf o il montre avec
indulgence le barbier et le cur cder la passion des livres qui ravage le che-
valier la triste figure. En s'introduisant dans sa fiction, Cervants va
apparemment rejoindre la cohorte des auteurs qu'il condamne. Surtout, il
complique passablement le sens de cette condamnation, s'enlve toute
possibilit de dtenir la signification ultime de son uvre. Etroitement localise,
plus discrte et plus implicite, cette transgression narrative a pourtant le mme
effet sur la signification de luvre que la mise en abyme gnralise de la
Seconde partie.
Ds le Quichotte I, comme l'a vu Borgs, le paradoxe de la seconde
partie est donc virtuellement prsent. Par cette mise en abyme de l'crivain, la
fiction, dj, quoique diffremment, s'approprie son contexte dnonciation et se
donne comme causa sui. La diffrence introduite par la reduplication de
l'auteur, et non du texte, a seulement pour rsultat de dplacer l'accent de la
transgression narrative. Elle souligne davantage la mise en crise de la fonction
auctoriale, porte l'effet disruptif sur la source du texte plutt que sur sa
consistance. Cette transgression auctoriale n'est sensible que parce que la
fictionnalisation de soi est limite. N'tait le caractre partiel de cette ralisation
du dispositif autofictif, la transgression ne serait pas significative. Simple
silhouette dans son texte, Cervants produit une distorsion que sa prsence
insistant( rendrait diffuse et insignifiante.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
266
Le Quichotte a ainsi permis de dgager deux espces de conjonction
entre le dispositif de l'autofiction et la "structure en abyme" (Genette) : la mise
en abyme du livre, la mise en abyme de l'crivain. Il s'agit maintenant de
vrifier, d'tendre et de prciser cet examen. Est-ce bien les seuls cas o
l'autofiction et la rflexivit littraire convergent ? ne peut-on affiner la
description de ces mises en abyme ? Quelle est la nature du rapport
qu'entretiennent ces deux pratiques ? Est-il lgitime de saisir certaines
ralisations autofictives en termes de construction en abyme ?
Mise en abyme et fictionnalisation de l'auteur.
L'examen des fictionnalisations auctoriales pouvant tre interprtes
comme des mises en abyme de l'nonciation permet de vrifier la description et
l'analyse faite partir du Quichotte. Elles se distribuent nettement en deux
groupes, selon que la rflexion se porte sur l'crivain ou sur luvre elle-mme.
De ce point de vue, le Quichotte ralisait l'avance toutes les variations de
mise en abyme aportique possibles. Toute l'histoire ultrieure ne serait-elle
qu'une exploitation des ressources dcouvertes par Cervants ? Cest ce quil
faut examiner.
a) Mise en abyme de l'crivain.
Lors de l'tude du profil actantiel (du rle jou dans l'histoire par le
double fictif de l'auteur),on a rencontr des ralisations autofictives o la figure
auctoriale n'avait qu'un emploi mineur dans la fiction, petit rle, situation de
comparse ou de silhouette. Dans ces exemples, l'auteur ne fait qu'une
apparition fugitive dans son texte. Fidle la dcision initiale qui voulait qu'on
accueille toutes les uvres ralisant de pris ou de loin le dispositif de
l'autofiction, on s'est gard de discuter le statut de ces ralisations. Il est certain
pourtant que ces actualisations partielles ne vont pas sans difficult. Leur
octroyer le statut d'autofiction au sens strict du terme est difficilement
acceptable.
Une telle gnrosit signifierait que l'autofiction existe aussi ltat de
fragment. Or, imagine-t-on une autobiographie ponctuelle ? Un journal intime
partiel ? Entre un auteur qui construit la totalit de son texte autour d'une repr-
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
267
sentation imaginaire de lui-mme et un autre qui inscrit son nom dans un recoin
de son uvre, il y a une disproportion que l'on ne peut ignorer. Si l'autofiction
est autre chose qu'un procd narratif, si elle est rellement une figure
d'nonciation, une posture de communication, il faut diffrencier les ralisations
o le reprsentant auctorial occupe une place centrale de celles o sa prsence
est ngligeable pour la digse, mme si elle n'est pas accessoire pour la
signification de luvre. C'est ce que l'on va faire, en cernant de plus prs la
forme, les effets et le statut de ces ralisations fragmentaires de l'autofiction.
Commenons par prendre deux exemples, afin de vrifier le caractre
peu significatif, pour l'intrigue, de ces interventions. Ainsi, dans Six
personnages en qute d'auteur, la prsence de Pirandello dans sa pice n'est
pas indispensable la progression du drame. S'il fallait ncessairement un
directeur avec sa troupe en train de rpter sur une scne de thtre, il n'tait
pas vital que leur rptition ait prcisment pour objet Ce soir on improvise, une
comdie de Pirandello :
Le souffleur, lisant.
'Au lever du rideau, Lon Gala, en tablier blanc, coiff
d'un bonnet de cuisinier, est en train de battre un uf
dans du chocolat, avec une cuillre pot. Philippe, habill
lui aussi en cuisinier, en fait autant. Guido Venanzi coute
assis'.
Le grand premier rle
J e vous demande pardon, est-il absolument nces-
saire que je me coiffe de ce bonnet de cuisinier.
Le directeur
Mais naturellement, puisque c'est crit.
Il montre la brochure.
Le grand premier rle
Mais c'est parfaitement ridicule !
Le directeur, se levant furieux
Ridicule ! Ridicule ! Que voulez-vous que j'y fasse s'il
ne nous arrive plus de France une seule bonne comdie
et si nous en sommes rduits reprsenter des comdies
de Pirandello, dont on ne comprend pas un tratre mot et
que l'auteur semble avoir crites exprs pour se f... de
moi, de vous et du public ?...". (trad. fr. C. Mallarm, pp.
9-10).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
268
De mme, Albert Cohen se donne souvent un reprsentant discret dans
ses romans, on l'a vu avec Belle du Seigneur. Dans Mangeclous (1938), un
demi-sicle avant Belle du Seigneur, il le fait d'une manire qui n'est pas sans
rappeler Cervants. C'est le hros ponyme qui parle :
"- J e suis un inconnu, moi ? Mais ne sais-tu pas qu'un
livre tout entier appel Solal a t crit sur moi avec mon
propre nom et que l'crivain de ce livre est un Cohen dont
le prnom trange est Albert. Et que cet Albert, n en l'le
de Corfou, voisine de la ntre, est le petit-fils de l'Ancien
de la communaut de Corfou qui faillit pouser ma mre,
ce qui fait que cet Albert est en quelque sorte mon parent !
Ne sais-tu pas que dans tous les pays du monde et mme
Ceylan, Mattathias, on me trouve sympathique grce
ce livre et ne l'as-tu pas lu ?" (Folio, p. 298).
Entre Solal, (le premier roman de Cohen, publi en 1930) et Mangeclous
se trouve donc tabli le mme rapport qu'entre les deux parties du Quichotte. A
cette diffrence qu'il s'agit dans le roman de la seule occurrence rflexive. Sur
le plan smantique, ce passage tend tablir un lien entre les romans de
Cohen, constituer son uvre en "cycle des valeureux", et replier ce cycle
sur lui-mme. Mais cette sortie de Mangeclous ne modifie pas le cours de
l'histoire ; elle n'a aucune importance pour la progression de l'intrigue.
Dans ces deux exemples, l'irruption de l'crivain dans sa fiction ne
manque pas de piquant, n'est pas sans consquence pour le sens de luvre.
Au regard de l'intrigue, cette piphanie est pourtant trs secondaire : elle n'a
pas de rendement digtique. Par dfinition, c'est aussi la situation de la plupart
des textes cits lors de la description des emplois mineurs remplis par la figure
auctoriale (Larbaud, Cendrars, Tournier etc.). Dans toutes ces ralisations, la
fictionnalisation de l'auteur se caractrise par les traits suivants :
- l'auteur est nomm directement, sans transformation, sans substitut,
livresque ou onomastique ;
- il n'occupe qu'un segment textuel rduit (d'une phrase un paragraphe,
avec rarement plus dune occurrence de son patronyme) ;
- son rle est insignifiant pour l'intrigue, il est rarement un vritable
personnage.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
269
Cette limitation de la fictionnalisation fait que le plus souvent l'auteur
"ressemble" son reprsentant, prsente un profil thmatique identique
("analogie totale" dans notre typologie). Pour l'crivain, il s'agit moins de se
draliser que d'tre solidaire de son univers, de donner voir une prsence
qui normalement cherche se faire oublier.
Les effets de cette rverbration de l'auteur dans son texte ont
commenc tre analyss propos du Quichotte. On a dcrit l'invagination de
la fiction qu'elle provoquait. Cette analyse demande tre complte.
Signalons, tout d'abord, l'effet Sly locks pour reprendre une formule de C.E.
Magny. Dans tous les cas, l'apparition de l'auteur ouvre sur le dehors de la
fiction, permet des "regards en coulisse". Ce clin dil ne manque jamais
d'amener un sourire sur le visage du lecteur, de renforcer sa complicit avec
l'auteur. La fictionnalisation fragmentaire actualise ainsi une fonction phatique,
remplie dhabitude par le narrateur. Notons, aussi, l'effet emphatique que peut
avoir le ddoublement ponctuel de l'auteur. Quoiquon en dise, la rflexivit
n'est pas toujours transgressive. Sa ngativit peut avoir une vertu
pdagogique, comme la mise en abyme de l'nonc dans le Naturalisme. Selon
un mcanisme dj observ, la fictionnalisation passagre donne la possibilit
l'auteur d'indiquer ses intentions, d'indexer le discours d'un personnage son
autorit. C'est par exemple ce que fait Cendrars dans Emmne-moi au bout du
monde ! ..., sa dernire fiction. Dans ce "roman-roman", la silhouette de
Cendrars se profile dans le texte deux reprises. Comme Lorrain ou Proust, il y
fait de la figuration intelligente : l'hrone Thrse l'voque comme l'un de ses
amis intimes. A chaque occurrence (o.c., t. 7, pp. 302, 329) le nom de Cendrars
apparat dans un de ces longs monologues dont l'hrone a le privilge et qui
manifeste sa vitalit. Ces occurrences permettent Cendrars d'indiquer o va
sa sympathie et de prendre en charge le discours de Thrse, malgr l'image
peu flatteuse qu'il en donne parfois. Pour finir, il faut relever leffet de
dnudation qu'amne la fictionnalisation auctoriale. On sait que cette notion de
"dnudation" vient des Formalistes russes. Par "dnudation du procd", ils
dsignaient tous les usages contre-emploi d'un procd d'criture, une
manire de l'utiliser soulignant son caractre factice et littraire (Tomachevski,
1925, pp. 300-301 ; Todorov, 1972, pp. 336-33). La fictionnalisation de soi est
un instrument privilgi pour dnaturaliser un composant littraire essentiel : la
fonction d'Auteur. Elle a un effet critique majeur sur la conception du sens
commun pour qui l'auteur est le Sujet suppos savoir, le matre duvre,
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
270
autorit souveraine qui cre, distribue, anime et conserve les rles et les
significations. Par elle, l'auteur ne se laisse plus sparer de la ralit de ses
personnages et de leur monde ; il n'est plus ce surplomb qui apporte un Sens
au livre et qui garantit la Vrit de la fiction. Elle permet donc d'intgrer dans sa
propre uvre cette tranget par rapport soi qu'est pour chaque crivain
lcriture ; tranget que traduit bien Michel Butor dans ce passage :
lorsque je lis mon nom dans un ouvrage, dans un
article de revue, je suis flatt (parfois), mais j'ai du mal
admettre que ce soit bien de moi qu'il s'agit. Cet homme
dont on dit qu'il pense ceci, qu'il veut ceci, qu'il fait ceci,
quelquefois il m'intrigue, j'aurais envie d'en savoir
davantage. Bien sr j'ai la tentation d'expliquer, de me
dfendre, de montrer que ce n'est pas cela que je dis, que
je fais, que J e suis. Cela fait de nouveaux livres, ou de
nouveaux entretiens. Ainsi celui qui va vous rpondre est
quelqu'un qui est en quelque sorte pourchass par son
fantme, par une trange figure issue de ce qu'il a fait, et
qui cherche perptuellement l'exorciser, je dirais
presque l'apaiser" (1979, pp. 24-25).
Voici donc les traits formels et fonctionnels des mises en abyme de
l'crivain, qui ont pour caractristique d'entraner son ddoublement fictionnel.
Qu'en est-il de leur statut ? De leur rapport l'autofiction comme pratique
littraire ? Dans ces ralisations, le reprsentant auctorial occupe une place
minimale, fonctionnellement sans signification. Ni narrateur ni personnage
dterminant, son absence ne dfigurerait pas le rcit. A l'chelle des
personnages et de l'action, sa prsence est une miniaturisation du dispositif de
l'autofiction. Certes, ces ralisations manifestent des proprits que l'on
retrouvera dans les autofictions proprement dites. Certes aussi, elle prsente
bien un effet autofictif. Mais ds l'instant ou l'auteur ne remplit pas un rle
significatif dans son texte, on ne peut majorer ces miniatures pour les
classer dans le domaine d l'autofiction au sens strict, dont on a au moins une
connaissance ngative.
b) Mise en abyme du livre.
Seconde espce de rencontre entre la construction en abyme et la
fictionnalisation de soi la mise en abyme de l'nonciation o l'ouvrage se cite
lui-mme, en se donnant comme un livre faire ou en train de se faire.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
271
Naturellement, cette dernire espce de rflexion peut se conjuguer avec celle
tudie prcdemment comme dans le Quichotte, Il est toutefois plus fructueux
de bien les distinguer, afin d'analyser le fonctionnement, les effets et le statut de
celle-ci par rapport l'auto fiction.
Par rapport son pendant auctorial, la mise en abyme du livre prsente
plus de diversit dans ses ralisations. L'crivain a le loisir de jouer sur deux
facteurs :
- la nature de la rflexion : celle-ci peut tre relle ou virtuelle. Relle si
l'on a effectivement un "roman du roman", l'histoire d'un roman qui s'crit au fur
et mesure que le rcit progresse, ce roman tant identique au rcit que le
lecteur dchiffre. Virtuelle, si le roman relate une histoire qui est promise au
lecteur, alors prcisment qu'il est en train de la lire ;
- l'identit du reprsentant : le "roman du roman". qu'il soit rel ou virtuel,
est fatalement un "roman du romancier". Il faut bien un auteur ce roman
autonyme, qui s'voque lui-mme. Ce personnage de "romancier" peut avoir :
(a) l'identit de son crateur rel, (b) une autre identit.
La variation de ces deux facteurs va avoir, on s'en doute, quelques
consquences sur la physionomie de la mise en abyme du livre.
Pour illustrer ces possibilits de variation, l'uvre de Gide est
exemplaire. On sait qu'il fut pour beaucoup dans linstitutionnalisation de ces
procds de rduplication. Dans une page de son Journal, souvent cite, il a
donn comme charte de cette technique narrative. C'est partir de cette
page que Claude-Edmonde Magny a cr l'expression de "mise en abyme" et
que la notion est passe dfinitivement dans le domaine public. En outre, Gide
a construit nombre de ses rcits autour d'une forme de mise en abyme. Il tait
donc difficile de ne pas faire un sort, aprs Dallenbach, deux de ses ouvrages
qui ralisent merveille l'espce de spcularit qui nous intresse ici. D'autant
que Gide apporte une innovation considrable dans la mise en abyme du livre,
en regard de celle du Quichotte : la promotion d'un personnage qui a charge de
raliser la reduplication.
Commenons par Paludes qui combine une rflexion relle et un
personnage de romancier ayant la mme identit que l'auteur. Dans ce rcit, un
narrateur anonyme relate la premire personne sa rdaction d'un rcit,
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
272
galement la premire personne, qui raconte la morne existence de Tityre,
dans un paysage de terres marcageuses et de landes monotones. Ce rcit
enchss porte, au sous-titre pris, le mme titre que luvre mre : c'est
Paludes ou Journal de Tityre. crivain complaisant le narrateur anonyme donne
quantit d'extraits de son rcit en cours de rdaction, attestant ainsi de
l'existence relle de cet homonyme titulaire
J OURNAL DE TITYRE
ou Paludes
De ma fentre j'aperois, quand je relve un peu la
tte, un jardin que je n'ai pas encore tien regard ;
droite, un bois qui perd ses feuilles ; au-del du jardin..."
(Folio, p. 20).
De plus, ce narrateur ne manque jamais une occasion dclairer et de
justifier son "roman". Vritable litanie du roman, la dclaration "j'cris Paludes"
accompagne toutes ces explications:
"Paludes, c'est l'histoire d'un clibataire dans une tour
entoure de marais" (p. 19).
"Ce qu'il faut indiquer c'est que chacun, quoique
enferm, se croit dehors" (p. 67).
'Qui cest Tityre ? () Tityre, c'est moi et ce n'est pas
moi ; - Tityre, c'est l'imbcile c'est moi, c'est toi - c'est
nous tous..." (p. 72)
"Ce que je veux ? Messieurs, ce que je veux - moi
personnellement - c'est terminer Paludes" (p. 88).
"C'est justement ce que je voudrais leur faire
comprendre, qu'il faut recommencer - toujours - faire
comprendre..." (p. 89).
"Sur l'agenda Finir Paludes. - Gravit".
(p. 129).
Du fait de son anonymat, il est difficile de ne pas voir dans ce narrateur
un double de Gide. Aprs tout, Paludes est bien un ouvrage publi par Gide en
1895. Et ce narrateur se donne lui aussi comme l'auteur dun Paludes. Une telle
appropriation fonctionne, on l'a vu, comme un substitut du nom auctorial. En
racontant dans Paludes qu'il crit l'histoire de Tityre, rcit intitul lui aussi
Paludes, le je narrateur accapare la position de son crateur. Au reste, si le
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
273
Paludes fictif a un narrateur qui possde un nom diffrent de celui de Gide, son
histoire manifeste de nombreuses analogies avec celle du Paludes rel. La
rflexion produite par la concordance des titres est minutieusement motive, sa
leon est pour ainsi dire transparente, peut-tre trop : les marais de Tityre
mtaphorise l'envie l'enfermement du narrateur dans une vie mesquine et
sans horizon. Cet apologue est tellement manifeste que la frontire entre le
Paludes du narrateur et celui de Tityre tend se dissoudre. Le texte de ce
dernier est toujours en italiques, soit Mais qui nous dit que le Journal de Tityre
est fait des seules paroles de son personnage ponyme ? Pourquoi ne serait-il
pas encadr par les rflexions du narrateur anonyme ? L'insistance du "j'cris
Paludes" n'est pas sans entretenir cette ambigut. Au demeurant, le narrateur
anonyme ne fait rien pour lever cette quivocit, bien au contraire :
"Vous devriez mettre cela ...
- Ah ! Par piti n'achevez pas, chre amie -et ne me
dites pas que je devrais mettre cela dans Paludes. -
D'abord a y est dj..." (p. 118)
C'est donc en citant abondamment son homonyme et grce l'anonymat
de son narrateur que Paludes prsente la fois un auto-enchssement effectif
et une figure de "romancier" pouvant tre confondue avec son auteur. Insistons
bien sur les conditions qui rendent possibles ces deux traits il y a concordance
titulaire entre luvre enchsse et luvre enchssante ; (2)
l'auto-enchssement est tendu tout le rcit, en pouse le mouvement et
s'achve avec lui ; (3) cet auto-enchssement est opr par un narrateur
auto-digtique, un narrateur qui est aussi un personnage de l'histoire, point
essentiel comme on le verra.
Sur le plan fonctionnel, ce "montage" conduit une confusion des
niveaux narratifs, l'effet Ouroboros dj vu avec le Quichotte : le livre se
laisse recouvrir par ce qu'il est cens retenir, se trouve enclav par son
contenu. Cet encerclement paradoxal a dans ce cas un effet disruptif trs fort,
qui ne parat pas pouvoir tre reconverti au service de la cohrence d'un rcit,
pour produire un effet emphatique par exemple. Au contraire, en crasant
l'histoire de Tityre et celle du narrateur, le livre rend trs difficile l'apprciation
des rflexions esthtiques et thiques qui parsment son cours : le lecteur a du
mal faire le dpart entre ce qu'il faut prendre au srieux et ce dont il faut rire.
Comme dans Bouvard et Pcuchet, mais autrement, aucun point de vue ne
russit chapper l'ironie dvastatrice qui traverse le livre. Cette ironie est
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
274
d'autant plus forte qu'elle est dcuple par l'effet d'immanence que produit
l'existence relle du Paludes enchss : le livre semble s'crire devant les yeux
du lecteur, se constituer par lui-mme ; ce qui lui enlve toute possibilit de
constituer un sens qui chapperait la drision. Si les effets de cette catgorie
de mise en abyme sont du mme ordre que ceux tudis plus haut, ils portent
nanmoins dans ce cas davantage sur la consistance de l'nonc narratif, sur
son caractre non-contradictoire.
Qu'en est-il, maintenant, du statut de Paludes par rapport l'autofiction ?
Dans ce texte, le dispositif de fictionnalisation manifeste l'originalit d'avoir un
protocole nominal indirect trs particulier, reposant sur une "homonymie par
substitution". dont le relais est un substitut livresque autonyme. L'homonymie se
fait ainsi par le livre mme qui contient la fictionnalisation auctoriale. Autrement
dit, le livre n'a d'autre mdiation que lui-mme pour identifier le double de l'-
crivain. C'est l une situation singulire mais qui n'enlve rien l'efficacit du
protocole nominal tabli. Notons aussi que le dispositif de fictionnalisation est
ralis de faon systmatique dans le rcit. La figure auctoriale est loin d'y avoir
une place marginale, elle a une relle fonction digtique Parce que la
reduplication autonyme est prise en charge par un narrateur-hros, le
reprsentant de l'auteur a la stature et le rle d'un vritable personnage. Par l,
Gide est vritablement dans sa fiction, comme port par ce narrateur qui se
donne comme le crateur de Paludes. D'ailleurs, c'est bien ainsi que Gide
concevait cet ouvrage. Loin dtre un exercice de pure virtuosit, sans rapport
avec lui-mme, Paludes fut pour Gide, comme il le rappelle dans Si le Grain ne
meurt, un exutoire salvateur dans une priode difficile de sa vie.
Ce dernier point est d'importance. C'est cette seule condition d'une
prise en charge de la mise en abyme par un personnage, qui se dclare l'auteur
de luvre rflchit que lion a bien une autofiction et pas seulement une
fictionnalisation auctoriale. Comparons Paludes et Si par une nuit d'hiver un
voyageur d'Italo Calvino. Dans ce roman, combien complexe et ingnieux,
l'histoire ne cesse de rflchir son titre et son auteur. De l'incipit l'excipit :
"Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino,
Si par une nuit d'hiver un voyageur".
"- Encore un moment. J e suis juste en train de finir Si
par une nuit d'hiver un voyageur, d'Italo Calvino". (Trad.
fr. D. Sallenave et F. Wake, pp. 7 et 279).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
275
Toutefois, cette rfraction systmatique n'exhausse pas Calvino au rang
de personnage. Seul son livre est un composant important de l'histoire ;
lui-mme n'est qu'un patronyme d'auteur ; sans rle significatif, dans la situation
d'une "silhouette", voqu par un narrateur anonyme. Le roman renferme donc
bien une mise en abyme du livre - et du lecteur, ce qui est peu courant sous
une forme aussi systmatique -, mais il ne prsente pas une fictionnalisation de
son auteur assez importante pour tre classe parmi les autofictions. On
pourrait en dire autant du Quichotte II : ni Cervants, ni Hamet Ben Engeli n'ont
un rle assez important pour tre vritablement dans leur fiction.
Pour continuer dvelopper ce point et achever l'examen de cette
catgorie de mise en abyme, il est ncessaire d'aborder la situation des
Faux-Monnayeurs qui prsente une combinaison nouvelle par rapport
Paludes rflexion autonyme quasi-virtuelle et personnage de romancier ayant
son individualit propre. Sans analyser le roman, cherchons d'emble si cette
modification des facteurs de la mise en abyme du livre change radicalement
son statut.
Relevons d'abord la "concidence-discordance" (Allenbach) entre la
figure du romancier et l'auteur rel. Edouard n'est ni un personnage anonyme,
ni un homonyme de Gide, ni mme le narrateur. Cela interdit-il l'tablissement
d'un protocole nominal ? Certes non, puisqu'il est prsent comme l'auteur d'un
projet de "roman pur" qui a pour titre Les Faux-Monnayeurs, comme l'ouvrage
de Gide. Par ce "substitut livresque" autonyme, c'est donc bien un reprsentant
auctorial de Gide qui est mis en place. Que son identit soit ds lors
contradictoire n'invalide pas la possibilit du protocole. D'autres exemples de ce
type ont t rencontrs, entre autres Ferdydurke de Gombrowicz et Moganni
Nameh de Cendrars. Ces textes ont montr l'intrt d'une figure auctoriale
surdtermine.
Le fait que luvre enchsse soit quasiment virtuelle (seul le chapitre
III/15 pouvant donner penser qu'elle existe rellement) constitue-t-il un
obstacle cette "homonymie par substitut livresque" ? Certainement pas
puisque le titre du projet romanesque d'Edouard, tel qu'il est cit dans son
"journal". reproduit exactement celui de Gide. Il y a loin de cette concordance
titulaire aux romans A un personnage vit une histoire qu'il se propose, la fin
du rcit, de relater dans une uvre romanesque, comme dans La Modification.
Dans ce dernier cas, le roman virtuel ne peut servir de "substitut livresque", il
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
276
n'a pas de valeur onomastique. Si le livre semble s'enrouler sur lui-mme, il
n'absorbe pas son extriorit, qui commence et finit au titre et au nom d'auteur.
Essentiel, par contre, est le rang d'Edouard dans la population du roman.
Bien qu'il ne soit pas le narrateur, c'est malgr tout l'un des personnages
principaux. Cette qualit fait que la fictionnalisation auctoriale est tendue tout
le roman. Par suite, elle n'est pas un simple procd li la spcularit dans ce
texte, elle peut rellement prtendre au statut de pratique gnrique. Comme le
narrateur de Paludes, Edouard peut donc tre considr comme un double fictif
de Gide, mis en scne dans une autofiction.
Il est temps de conclure sur cette catgorie de ''structure en abyme'' et
plus gnralement sur les relations entre mise en abyme et autofiction. On aura
compris que la mise en abyme du livre est la seule qui puisse prtendre se
confondre avec l'autofiction. C'est qu' la diffrence de la mise en abyme de
l'crivain, la fictionnalisation auctoriale se produit alors selon un mouvement
centripte, par lequel luvre s'enroule sur elle-mme et, dans cet enrobement,
identifie l'auteur rel la figure du romancier qu'elle reprsente. Une condition
est toutefois ncessaire : que la rflexion du livre soit assume par un
personnage dot d'un "premier" ou d'un "second'' rle. Cette condition remplie,
la figure auctoriale dispose d'une fonction digtique assez importante pour
qu'il soit possible de parler dune uvre littraire par laquelle un crivain
s'invente une personnalit et une existence, tout en conservant son identit
relle'' bref d'une autofiction.
Au contraire, la mise en abyme de l'crivain, qui procde selon un
mouvement centrifuge, par un dbordement de son extriorit, ne doit pas tre
confondue avec l'autofiction. Dans cette catgorie, la fictionnalisation auctoriale
est miniaturise de faon rflchir l'nonciation, obtenir une construction en
abyme. A la diffrence de la situation o le dispositif est ralis l'chelle de
luvre, l'auteur est alors moins dans sa fiction, qu'au milieu de sa fiction,
rflchi comme fortuitement par elle.
Comme dans le chapitre prcdent, il faut donc distinguer la
fictionnalisation de soi de l'autofiction. Celle-l n'est qu'un procd labile,
celle-ci est une pratique globale et plus contraignante. De mme que la
fictionnalisation auctoriale pouvait tre au service d'une stratgie rfrentielle,
elle peut tre le moyen dune stratgie rflexive. Cest ce qui explique que les
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
277
illustrations partielles du dispositif de l'autofiction ne soient ni mconnues, ni
laisses elles-mmes, sans rception adquate. Comprise juste titre
comme une sorte de mise en abyme, la fictionnalisation auctoriale bnficie
pour tous les exemples cits d'un "horizon d'attente" constitu par la tradition
spculaire. Reste qu'entre la mise en abyme et l'autofiction, il n'y a qu'un
recoupement partiel, qu'il faut se garder de concevoir comme un
chevauchement.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
278
4- FONCTION FIGURATIVE
''0 tu che leggi udirai nuovo ludo''
Dante
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
279
Pour terminer cet examen fonctionnel, il faut tenter de dcrire les
ralisations dont la vise n'est pas rfrentielle et pas seulement rflexive. Le
dispositif de fictionnalisation n'est alors ni un moyen ni un effet ; il est
lui-mme sa propre fin et la fictionalit reste sa raison dtre. Tous les textes
dans cette situation portent leurs fruits hors de toute stratgie littraire
reconnue: aucune tradition ne les supporte ; ils ne tirent leur lgitimit et leur
force que d'eux-mmes. Ainsi, les uvres d'crivains comme Diderot, Kafka,
Borgs, Cline et Gombrowicz, ou encore, pour des crivains plus
contemporains, comme Copi, Bryce-Echenique, Vargos Llosa, J .D. Salinger ou
Charyn, o l'invention de soi ne parat obir qu' un simple got pour la
fabulation.
Le trait commun tous ces auteurs est, par consquent, dabord un
caractre ngatif : dans une perspective gnrique, leurs uvres sont
irrductibles aux catgories connues, rebelles toute classification, insituables.
Le constat de cette situation singulire a guid jusqu' prsent notre dmarche
et confort notre croyance en un usage sui generis du dispositif. A l'aide de ce
critre privatif, on a ainsi fait la distinction entre le procd de la fictionnalisation
de soi et la pratique de l'autofiction. Cette dichotomie renfermait une hypothse
de travail, lhypothse que tous ces textes apparemment inclassables
prsentaient une unit, manifestaient autant de ralisations d'une stratgie
commune.
Tout le problme de ce chapitre est dtayer cette hypothse, de donner
une positivit cette classe de textes dfinie ngativement. Toutes ces uvres
o l'crivain explore un pli entre le rel et l'irrel, ont-elles assez de points
communs pour rpondre une fonction identique ? Ou ne s'agit-il que de
rencontres fortuites que l'on a hypostasies un peu vite ? Naturellement, on sait
dj que si elles prsentent des caractres communs, ce ne sont pas des traits
formels ou thmatiques. Leurs similarits ne peuvent tre que fonctionnelles,
pragmatiques. Mais mme sous cet aspect, il importe de justifier notre
hypothse autrement qu'en invoquant l'insuffisance des stratgies reconnues
pour comprendre ces textes.
Ne cachons pas tout ce qu'a d'pineux la vrification de notre hypothse.
Tout d'abord, il s'agit de rendre compte dun effet d'nonciation trange,
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
280
paradoxal, troublant nos catgories ordinaires ; qui vient se loger au cur
mme des ides que l'on peut se faire sur la ralit et sur la fiction. Or, cet effet
commence tout juste tre repr la stratgie pragmatique dont il dpend
n'appartient aucun code, n'a pas encore une place reconnue par tous dans le
paysage littraire. Il faut donc dcrire un pouvoir discursif dont l'efficace, quand
elle existe, est cache ; qui n'est pas encore ou qui est en train de se constituer
dans les habitudes de lecture. Au demeurant, la stratgie analyser n'est pas
toujours luvre de manire univoque, n'est pas toujours exempte de
contaminations, de contradictions ou d'insuffisances. En l'absence d'une
tradition, chaque crivain a d presque rinventer chaque fois et
l'agencement et sa fonction, pour en faire une stratgie d'criture. Souvent, ses
commentaires clairent moins ses intentions qu'ils n'acclrent, compliquent ou
dtournent les pouvoirs de son dispositif. Parfois, enfin, l'crivain n'a pas russi
ou pas voulu matriser sa ''machinerie'' comme on peut le voir chez des auteurs
comme Restif, Loti ou Cendrars qui oscillent entre des pratiques inventive,
rfrentielle et mystificatrice de la fiction de soi. Cette part d'incertitude, ainsi
que la solitude de cette stratgie, font qu'il n'est pas facile d'en donner une
description convenable et de dlimiter avec prcision son extension.
Toutefois, le hasard (?) veut que cette stratgie ait t observe et en
partie questionne par Roland Barthes. Plusieurs de ses ouvrages prsentent
des remarques ou des dveloppements trs heuristiques sur son
fonctionnement et ses consquences. Il semble que Barthes ait eu l'intuition de
la pratique littraire qu'elle pouvait constituer, une poque o aucun terme ne
permettait de l'identifier et o personne ne s'tait encore interrog sur son
existence. C'est d'ailleurs pour lui rendre hommage qu'on s'est propos de
dsigner l'usage sui generis du dispositif de fictionnalisation de soi par
l'expression "fonction figurative". Comme on le verra, Barthes a cr le terme
de "figuration" pour nommer un mode original, fictionnel, de reprsentation de
soi.
L'Autofiction selon Barthes
La dcouverte de Barthes est lie au questionnement, qui traverse toute
son uvre, mais selon des perspectives diffrentes, de la notion d'Auteur.
Chacun sait que la critique de Sur Racine fit beaucoup pour abolir la conception
traditionnelle de l'Auteur. De livres en articles, d'interventions en dclarations, il
insista sur le fait que cette notion tait la fois un obstacle pistmologique
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
281
pour le dveloppement des tudes littraires et une catgorie idologique,
produit de l'individualisme bourgeois. Il souligna maintes reprises combien
l'ide d'une paternit concrte et souveraine de l'criture masquait les
problmes de technique littraire, oblitrait la nature de la littrature, empchait
la comprhension des textes modernes et confortait un systme conomique
s'organisant autour de la catgorie d'individualisme possessif. Ce discours
critique culmine dans un article de vulgarisation, publi en 1968, qui s'intitulait
"La Mort de l'Auteur". Dans le mme temps, ce discours critique tait tenu et
dvelopp par beaucoup d'autres critiques, crivains, philosophes, thoriciens
de la littrature. Bref, l'ide faisait son chemin, finissait mme par tre accepte
un peu partout et par constituer une sorte de discours dominant. Peu de temps
aprs, Barthes a eu une raction qui lui est familire et qui a consist revenir
sur cette ide de l'inexistence de l'Auteur. Non pas en faisant son autocritique
et en reconduisant la conception psychologique et raliste du sujet littraire,
mais en explorant l'autre face de cette notion, sa face fonctionnelle et
proprement littraire. A la mme poque, Michel Foucault, dans une
communication intitule "qu'est-ce qu'un auteur ?", s'inquitait de cet
acharnement vacuer une position discursive que l'on connaissait mal et dont
on ne mesurait peut-tre pas la capacit de rsistance et de mtamorphose.
C'est ainsi que dans S/Z, le livre n de son sminaire sur Sarazzine en
1968 et 1969, Barthes adopte simultanment deux attitudes vis--vis de la
notion d'auteur. Une premire attitude consistant affirmer le caractre
inluctable de sa disparition dans la pratique de la littrature, hritage de sa
critique antrieure : "... Ltre de l'criture (le sens du travail qui la constitue) est
d'empcher de jamais rpondre cette question : Qui parle ?" (1970, p. 146).
Et un nouveau point de vue, qui n'est pas contradictoire, consistant se
demander s'il n'y avait pas d'autre solution que cette perte, comme dans le
paragraphe XC :
''L'Auteur lui-mme - dit quelque peu vtuste de
lancienne critique - peut, ou pourra un jour, constituer un
texte comme les autres : il suffira de renoncer faire de
sa personne le sujet, la bute, l'origine, l'autorit, le Pre,
do driverait son uvre, par une voie d'expression ; il
suffira de le considrer lui-mme comme un tre de
papier et sa vie comme une biographie (au sens
tymologique du terme), une criture sans rfrent,
matire d'une connexion, et non d'une filiation l'entreprise
critique (si l'on peut encore parler de critique) consistera
alors retourner la figure documentaire de l'auteur en
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
282
figure romanesque, irrparable, irresponsable, prise dans
le pluriel de son propre texte : travail dont l'aventure a
dj t raconte, non pas des critiques, mais par des
auteurs eux-mmes, tels Proust et J ean Genet" (1970, p.
217).
Articul sur une quadruple opposition (temporelle, fonctionnelle,
relationnelle et textuelle), ce passage voque pour l'auteur la possibilit dune
nouvelle position discursive ("irresponsable, impersonnel", "prise dans le pluriel
de son texte") et d'une nouvelle situation, celle de "figure romanesque". Ces
lignes ont beaucoup frapp les lecteurs attentifs de Barthes par ce qu'elles
impliquaient de reconsidration thorique quant la catgorie d'auteur (Diaz,
1984, p. 48). Mais elles ont aussi lintrt de dgager un faisceau deffets de
lecture indits, propre aux textes proches de ceux de Proust ou de Genet, A
l'crivain fait de son uvre ni un cnotaphe, ni la mise en scne illusoire d'un
Destin et d'une Personne, mais le thtre o se djoue un imaginaire, A se
dfait une personnalit et o sanime un individu transform en "figure".
Cette notion de "figure" est aussi une catgorie de S/Z. qui prend son
sens par opposition celle de personnage :
"ce n'est plus une combinaison de smes fix sur un
nom civil, et la biographie, la psychologie, le temps ne
peuvent plus s'en emparer c'est une configuration incivile,
impersonnelle, achronique de rapports symboliques"
(1970, p. 74).
Une "figure romanesque", c'est par consquent un personnage que le
caractre, la situation, les motivations, la vraisemblance ne figeraient pas ; doit
le sens serait toujours en mouvement, sans trouver de terme. Ne s'agit-il que
d'une utopie ? Certains personnages, Manon Lescaut par exemple, y
approchent de trs pris. Quant Proust et Genet, leurs narrateurs n'en sont
pas loin, si l'on s'avise de les considrer aussi comme des reprsentants
auctoriaux. C'est alors que tous les prdicats qui sont attachs un crivain,
qui lui donnent sa physionomie propre, que le lecteur cherche totaliser dans
une autobiographie, reprer dans ses romans, sont laisses eux-mmes.
Inutile de chercher la Personne, son histoire, sa destine, ses tourments etc., il
n'y a qu'une "idalit symbolique". A travers diffrents crans, l'crivain s'interdit
toute reprsentation ou expression de soi au sens conventionnel,
transformation qui passe naturellement par un important travail stylistique,
thmatique et narratif. Il s'agit d'enlever tout privilge au personnage
reprsentant l'crivain l'enjeu est que ce double soit lisible dans tous les sens,
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
283
susceptible d'interprtations varies, de lectures diverses, comme le sont
Shrazade, Don Quichotte, Manon Lescaut, Charlus ou, Ulrich. Si l'auteur
russit, le lecteur doit se trouver devant une "structure symbolique", plus que
devant un mmorial qu'une personne s'est lev elle-mme. Au contraire, la
"figure documentaire" est l'illusion produite par une autobiographie d'crivain,
une reprsentation "verrouille" de toutes parts, s'attachant recueillir des
significations, les ordonner en destin et bloquer la circulation des signes.
Voil donc l'Effet que dcouvre Barthes dans les textes de Proust et de Genet.
On pourrait Mme dire, en reprenant la formule de Sartre, voil l'Effet qu'il
invente, tant ce dplacement tait cach aux yeux de tous. On notera au
passage la perspicacit avec laquelle Barthes rapproche Genet de Proust,
quand aucun document ne permettait encore d'tablir cette filiation.
Reste savoir, maintenant, le parti que l'on peut tirer de cette
dcouverte. Le problme, on l'a rencontr, c'est que ni luvre de Proust, ni
celle de Genet, ne constituent des exemples "purs" d'autofiction. Chez Proust,
le protocole nominal est rticent, formul sur le mode du C'est moi et ce n'est
pas moi, au moins pour la premire occurrence du prnom "Marcel".
Symtriquement, c'est le protocole modal qui est ambigu chez Genet ; tous les
rcits o il apparat montrent un "protocole modal indfini". Peut-on ngliger ces
"impurets'' ou font-elles que Barthes parle en ralit d'autre chose que de
notre dispositif ? Ce point est dommageable parce que ces deux crivains sont
et resteront emblmatiques dans son analyse.
Pour le rsoudre, il faut sarrter sur la nature de lquivocit des uvres
de Proust et de Genet. Celle-ci n'existe pas en soi, elle n'a de sens que par
rapport un modle idal, le dispositif dfini en commenant ce travail, qui est
un instrument de recherche et d'analyse, pas une norme. On peut se rappeler
ici la remarque de Ph. Lejeune, que nous citions au dbut de cette enqute : "Il
ne faut pas confondre, l'axe magntique qui rgit la boussole avec la multiplicit
des directions qu'elle permet de reprer. Et il faut admettre qu'il y a dans la
ralit d'autres axes d'organisation que l'axe magntique..." (1983, p. 21). Si
l'on considre le dplacement opr par l'autofiction. force est de constater que
Proust et Genet travaillent dans cette voie. Leurs textes nactualisent pas de
faon partielle ou inadquate le dispositif de l'autofiction, ils le ralisent la
marge, en se plaant sur chacune de ses lignes de dmarcation. En formulant
de manire dngative son nom, Proust se situe exactement sur la frontire qui
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
284
marque la constitution dun protocole nominal ; en conjuguant dclarations de
fictionalit et indices rfrentiels, Genet se situe exactement sur la limite d'exis-
tence d'un protocole modal de fiction. Naturellement, ce travail sur la marge du
dispositif n'est pas sans consquence. Il produit, dlibrment ou non, des
effets complmentaires qu'il faudrait pouvoir analyser en dtail. Mais il
n'hypothque pas l'appartenance de ces auteurs au domaine de l'autofiction, ni
lapplication dune stratgie fictionnalisante. Il parait donc lgitime de les
intgrer dans notre corpus et de leur laisser la valeur paradigmatique que
Barthes leur a accorde.
Dautant que Barthes ne s'est pas arrt cette brillante remarque sur
Proust et Genet. A partir de S/Z, il na pas cess de dvelopper sa pense sur
ce sujet, selon deux axes : en ritant sa critique de la notion traditionnelle
dauteur ; en poursuivant son exploration des effets de lecture propre au texte
proustien. Dans Sade, Fourier, Loyola, l'anne suivante, on trouve ainsi
nouveau une allusion la "figure romanesque" de l'auteur et la singularit de
l'agencement proustien. Il est remarquable que cette vocation intervienne dans
un ouvrage qui n'appelait pas, par son contenu, un tel rappel. Cela montre
l'attachement et la continuit de la pense de Barthes par rapport cette
pratique littraire. Il s'agit d'une brve notation dans la "Prface". Moquant le
"Texte" comme "objet de plaisir", en anticipant bien sr sur un de ses ouvrages
ultrieurs, Barthes note :
"Le plaisir du Texte comporte aussi un retour amical de
l'auteur. L'auteur qui revient n'est certes pas celui qui a
t identifi par nos institutions (...) ce n'est Mme pas le
hros d'une biographie. L'auteur qui vient de son texte et
va dans notre vie n'a pas dunit est un simple pluriel de
"charmes", le lieu de quelques dtails tnus, source
cependant de vives lueurs romanesques, un chant
discontinu d'amabilits, en quoi nanmoins nous lisons la
mort plus srement que dans l'pope d'un destin.. "
(1971 a, p. 13).
Naturellement, cette rflexion s'applique ici aux minuscules faits
biographiques que Barthes retient de la vie de Sade ou de Fourier. De Mme
que son ouvrage relve quelques-uns des bonheurs d'expression de ces
auteurs, il s'applique rassembler quelques menus incidents de leur existence,
incidents soustraits toute lecture interprtative, n'ayant qu'une saveur de
signifiants comme il le dclare lui-mme. Toutefois, ces "biographmes"
dessinent en pointill un modle textuel o le rapport de l'auteur son uvre
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
285
serait transform. Et le passage voque bien une prsence auctoriale non
biographique, dtache de tout privilge centralisateur : un auteur dissmin
dans son texte. Davantage, ce paragraphe fait de la perceptibilit de l'auteur
l'un des composants du "plaisir du texte" ; une ide qui ne prendra tout son
sens que plus tard. Plus loin dans le mme ouvrage, Barthes illustre cette
remarque par une rfrence Proust, comme l'crivain ayant russi raliser
ce nouveau genre d'criture de soi :
"Car s'il faut que par une dialectique retorse il y ait dans
le Texte, destructeur de tout sujet, un sujet aimer, ce
sujet est dispers, un peu comme les cendres que l'on
jette au vent aprs la mort (au thme de l'urne et de la
stle objets forts, ferms, instituteurs du destin,
s'opposeraient les clats du souvenir, l'rosion qui ne
laisse de la vie passe que quelques plis si j'tais
crivain, et mort, comme j'aimerais que ma vie se rduist,
par les soins d'un biographe amical et dsinvolte,
quelques dtails, quelques gots, quelques inflexions,
disons des 'biographmes' dont la distinction et la mobilit
pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher,
la faon des atomes picuriens, quelque corps futur,
promis la mme dispersion ; une vie troue, en somme,
comme Proust a su crire la sienne dans son uvre ... "
(1971 a, p. 14).
Une fois de plus, Barthes voque donc la possibilit pour un crivain de
se donner en spectacle sans pour autant servir de caution un rcit ou de
garantie un discours. L'crivain pourrait viter ces cueils de la reprsentation
de soi, s'il accepte dtre dans son uvre un sujet "dispers". comme dpli
dans son propre-rcit. Et cette fois encore, Proust est lcrivain capital" dans
cette entreprise consistant se donner une "vie troue", toile, sans destin.
Mais nest-ce pas lui qui a montr, dans Le Temps retrouv, que lon ne peut
refaire ce qu'on aime qu'en le renonant". qu'il faut savoir "sacrifier son amour
du moment" et que lon peut alors "rencontrer ce qu'on a abandonn" ? La
nouveaut de ce passage, c'est que, tout en maintenant son ide selon laquelle
le texte est un tombeau vide, Barthes affirme que luvre peut produire un
"sujet aimer". formule aussi suggestive qu'nigmatique.
C'est dans Le Plaisir du Texte que Barthes toffera cette ide. Mais
avant d'en arriver l, il faut s'attarder sur une prface crite pour une rdition
chez le clbre diteur italien Franco-Marici Ricci et publie aussi en 1971 :
"Pierre Loti : Aziyad". Avec ce roman, Barthes avait en effet l'occasion de
dvelopper l'chelle d'un texte tout entier ses remarques antrieures. Comme
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
286
on l'a voqu, ce premier ouvrage de Loti rfracte en effet son propre auteur,
offre un sujet historique et pourtant irrel : Loti lui-mme, engag dans une
histoire d'amour turque, qui le conduira la mort. Pourtant, l'analyse de ce
roman par Barthes est un peu en retrait par rapport aux propositions
prcdentes ; en tous cas, elle n'est pas articule la problmatique antrieure.
D'entre de jeu, Barthes signale le caractre insolite du systme
nonciatif de ce roman, la bizarrerie de ce texte par rapport aux conventions
romanesques :
"Loti, c'est le hros du roman(). Loti est dans le
roman mais il est aussi en dehors, puisque le Loti qui a
crit le livre ne concide nullement avec le hros Loti : ils
n'ont pas la mme identit. Le premier est anglais, il
meurt jeune ; le second Loti, prnomm Pierre, est
membre de l'Acadmie franaise, il a crit bien d'autres
livres que le rcit de ses amours turques. Le jeu d'identit
ne s'arrte pas l : ce second Loti, bien install dans le
commerce et les honneurs du livre, n'est pas encore
l'auteur vritable, civil, d'Aziyad : celui-l s'appelait J ulien
Vaud..." (1971 b, p. 171).
Il en donne, ensuite, une analyse fonctionnelle :
''Ainsi un auteur mineur, dmod et visiblement peu
soucieux de thorie (cependant contemporain de
Mallarm, de Proust) met jour la plus retorse des
logiques d'criture : ( ... ) vouloir tre 'celui qui fait partie
du tableau', c'est crire pour autant seulement qu'on est
crit : abolition du passif et de l'actif, de lexprimant et de
l'exprim, du sujet et de l'nonc, en quoi se cherche
prcisment l'criture moderne" ( 1971 b, p. 181 ).
Enfin, au terme d'une brillante tude thmatique, Barthes fait de cette trange
immixion de l'auteur dans sa fiction, "la traduction structurale" d'une criture qui
se refuse au sujet, tous les sens du mot :
"Non seulement l'criture, venue du dsir, frle sans
cesse l'interdit, dsitue le sujet qui crit, le droute ; mais
encore (ceci n'tant que la traduction structurale de cela)
en lui les plans opratoires sont multiples : ils tremblent
les uns dans les autres. Qui parle (Loti) nest pas qui crit
(Pierre Loti) ; l'mission du rcit migre, comme au jeu du
furet, de Viaud Pierre Loti, de Pierre Loti Loti, puis
Loti ..." (1971 b, p. 186).
Que retenir de cet examen dtaill d'un cas empirique d'autofiction par
Barthes ? En premier lieu, il faut rappeler qu'il s'agit, cette fois, la diffrence
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
287
de Proust ou de Genet, d'un cas "Pur" de fictionnalisation de soi. Quoique
publi de faon anonyme en 1879, aprs le succs du Mariage de Loti
(initialement Rarahu.) en 1880 et la publication du Roman d'un Spahi en 1881,
Aziyad est dit sous le nom d'auteur "Pierre Loti" et relate une histoire la
fictionalit indiscutable, puisque le hros, un capitaine de vaisseau anglais
nomm "Loti", meurt la fin du roman. Barthes aurait mme pu enrichir son
analyse puisque nombre des romans de Loti, du Mariage de Loti Mon frre
Yves, sont construits sur le dispositif de l'autofiction. Ne poussant pas son
examen plus loin qu'Aziyad, il manque de signaler que la fiction de soi est
chez Loti une stratgie narrative et littraire, ncessaire la fois pour son
criture et pour sa lgitimation.
Notons aussi que Barthes ne fait qu'un rapprochement allusif avec
Proust - qui pouvait rciter, dailleurs, des pages entires de Loti -, confondu
avec Mallarm pour sa mise en cause du sujet de l'criture. Aucune allusion,
dans cet article, la figure "retourne" de l'Auteur et l'effet de lecture qui
pourrait en dcouler. C'est se demander si cette tude n'a pas t crite bien
avant sa date de publication, peut-tre avant l'laboration finale de S/Z. Quoi
qu'il en soit, il faut reconnatre que l'analyse des effets du dispositif ne dpasse
pas, dans ce texte, une certaine gnralit. Barthes Semble prisonnier d'une
vulgate d'poque, la vulgate Tel Quel, sur le sujet qu'il s'agit de subvertir etc.
Comme toute vulgate cette dernire n'est pas fausse, mais elle est vague.
L'analyse propose ici pourrait s'appliquer d'autres pratiques que la fiction de
soi ; si l'effet qu'il relve est bien produit par celle-ci, c'est l'intrieur d'un
faisceau qui lui donne un relief et une force spcifiques.
Reste que cette prface est intressante en ce qu'elle confirme l'intrt
de Barthes pour les textes utilisant la situation d'nonciation propre
lautofiction. Il est facile aujourd'hui, presque vingt ans aprs, de juger
svrement un article envisageant de faon floue l'originalit de cette forme
fictionnelle. A l'poque o il fut crit, il tait dj remarquable d'arriver "mettre
plat" le dispositif de l'autofiction. qui plus est chez un crivain aussi peu couru
que Pierre Loti.
De plus, c'est surtout partir du Plaisir du texte, en 1973, que Barthes va
vraiment tirer tout son profit, pour la perception de ce nouvel agencement
littraire, de son regard diffrent sur l'auteur. C'est dans ce petit livre, tout en
fragments, qu'il rassemble et articule des ides lances et prouves
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
288
sparment dans sa production antrieure. C'est par exemple dans cet ouvrage
qu'il dveloppe vraiment sa rflexion sur "la possibilit dune dialectique du
dsir" entre le lecteur et l'auteur, sur ce mouvement par lequel l'auteur "vient de
son texte et va dans notre vie" :
"Le texte est un objet ftiche et ce ftiche me dsire. Le
texte me choisit, par toute une disposition d'crans
invisibles, de chicanes slectives : le vocabulaire, les
rfrences, la lisibilit etc. ; et, perdu au milieu du texte
(non pas derrire lui la faon d'un dieu de machinerie), il
y a toujours l'autre, l'auteur. Comme institution, l'auteur
est mort sa personne civile, passionnelle, biographique, a
disparu ; dpossde, elle n'exerce plus sur son uvre la
formidable paternit dont l'histoire littraire,
l'enseignement, l'opinion avaient charge d'tablir et de
renouveler le rcit ; mais dans le texte, d'une certaine
faon, je dsire l'auteur : j'ai besoin de sa figure (qui n'est
ni sa reprsentation, ni sa projection), comme il a besoin
de la mienne (sauf 'babiller').'' (1973, pp. 45-46).
A travers un discours psychanalytique qui bloque toute interprtation
psychologisante ou raliste et pouse un phnomne d'nonciation complexe,
ce fragment poursuit la rflexion amorce dans S/Z. Il dveloppe une ide qui
mriterait d'tre repense : il y a dans tout texte, sous des degrs et des modes
diffrents, une logique du dsir, un appel rciproque de l'auteur et du lecteur,
des attentes mutuelles qui se matrialisent dans toute la machinerie complexe
de sa pragmatique, depuis ses "dispositions" nonciatives jusqu'aux attitudes
de lecture qui lui sont appliques. Il faudra se demander si l'autofiction. n'est
pas un choix d'nonciation ouvrant la possibilit de dmultiplier l'expression et
la force de cette logique du dsir.
Autre intrt du Plaisir du texte : la notion de "figure" est prsente sous
un autre jour, toujours par opposition au produit de la reprsentation, toujours
avec les exemples paradigmatiques de Proust et de Genet, mais dans une mise
en perspective plus large
"Il faudrait d'ailleurs distinguer entre la figuration et la
reprsentation. La figuration serait le mode d'apparition
du corps rotique ( quelque degr et sous quelque mode
que ce soit) dans le profil du texte. Par exemple : l'auteur
peut apparatre dans son texte (Genet, Proust), mais non
point sous les espces de la biographie directe (ce qui
excderait le corps, donnerait un sens la vie, forgerait
un destin). Ou encore : on peut concevoir du dsir pour
un personnage de roman (par pulsions fugitives). Ou
enfin : le texte lui-mme, structure diagrammatique, et
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
289
non pas imitative, peut se dvoiler sous forme de corps,
cliv en objets ftiches, en lieux rotiques. Tous ces
mouvements attestent une figure du texte, ncessaire la
jouissance de lecture. De mme, et plus encore que le
texte, le film sera coup sr toujours figuratif (ce pour
quoi il vaut tout de mme la peine d'en faire) - mme s'il
ne reprsente rien. La reprsentation, elle, serait une
figuration embarrasse, encombre d'autres sens que
celui du dsir..." (1973, pp. 88-89).
En revenant sur la notion de "figure". Barthes lui donne un contenu
diffrent, plus libidinal que symbolique. Cette redfinition peut poser problme,
si l'on ne s'avise pas que c'est surtout la perspective qui a chang. Au fond,
l'objet vis est bien le mme : la rfrence Proust et Genet le montre. Il
s'agit toujours de pointer vers une configuration de signifiants dsirables, dont
le procs smantique ne serait qu'un incessant mouvement brasillant, allumant
de grands feux la lecture : "la figure". Et le dessein est identique : il s'agit
toujours dopposer la "reprsentation". dont le sens finit dans tous les cas par
s'immobiliser dans une dmonstration, une instruction ou une dification, - de
lui opposer un procs signifiant en roue libre, qui n'aurait pour finalit que
dbaucher interminablement le mouvement de la signification, sans jamais
venir mourir dans les Codes culturels : "la figuration". Donc, c'est encore la
mme dmarche que dans S/Z, consistant isoler une configuration atypique,
le procs d'criture dont elle rsulte (procs fonctionnant au revers de la
reprsentation) et son pouvoir sur la lecture. Le fait nouveau, c'est que ce
procs s'est diversifi dans ses points d'application (ce peut tre l'auteur, un
personnage ou le trac textuel lui-mme) et qu'il est dsormais susceptible
dtre articul la logique du dsir qui irrigue tout texte, puisqu'il est le dsir se
matrialisant, son incarnation.
Il est vrai que cette description a quelque chose d'une utopie littraire.
Est-ce une raison pour la dclarer irrecevable ? Comme souvent chez Barthes,
l'utopie apporte la pense son impulsion, lui ouvre des horizons et fonctionne
comme un modle opratoire : c'est un passage la limite qui permet
d'prouver dans toute leur ampleur les forces de lempirique. De fait, ces lignes
dcrivent un idal sans lequel les dplacements oprs par Proust et Genet,
dans la littrature, seraient moins sensibles. En outre, cette description
prsente une extension qui pourrait autoriser une analyse diffrentielle de la
figuration auctoriale. En situant cette entreprise par rapport d'autres
manifestations fictionnelles, du roman classique au texte "scriptible", Barthes lui
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
290
donne le statut d'une vritable pratique et invite prolonger la recherche de ses
traits distinctifs.
Barthes achve, dans Le Plaisir du texte, cette analyse des textes o
apparat la "figure de l'auteur", par une dernire description fonctionnelle.
Inventoriant l'tat de la recherche d'une "thorie du sujet matrialiste". il voque
tour tour sa critique moraliste, sa dconstruction dans l'criture d'avant-garde
et sa pulvrisation, pratique consistant "gnraliser le sujet" (1973, p. 97). Or.
cette multiplication est prcisment l'opration de la "figuration auctoriale", o
l'crivain se dmultiplie, se disperse dans son uvre. Que produit sur le lecteur
cette opration textuelle ?
"Alors peut-tre revient le sujet, non comme illusion,
mais comme fiction. Un certain plaisir est tir d'une faon
de s'imaginer comme individu, d'inventer une dernire
fiction, des plus rares : le fictif de l'identit. Cette fiction
nest plus l'illusion d'une unit ; elle est au contraire le
thtre de socit o nous faisons comparatre notre
pluriel : notre plaisir est individuel - mais non
personnel"(1973, p. 98).
Ainsi, le texte "figuratif" conduirait le lecteur prouver en lui le "fictif de
l'identit", se percevoir comme un individu impersonnel, comme une
singularit historique, mais soustraite tout Imaginaire, dfaite de toute illusion
d'unit, de transparence et de matrise. Paralllement la "dialectique du dsir"
voque plus haut, le "retour de l'Auteur" provoquerait une dialectique figurale,
o le lecteur s'exprimenterait comme figure, proportion de la perceptibilit de
la figure de l'auteur dans luvre. On voit par consquent tout ce qui rend
prcieux le Plaisir du texte, pour cette enqute sur l'autofiction, dfinie par
Barthes comme un travail de "figuration". Aucune ide n'est vraiment nouvelle
dans cet essai. Mais par leur articulation et leur remise en chantier, elles
acquirent un relief sans prcdent, qui claire jusqu' leur formulation
antrieure. Au crdit de cet ouvrage, il faut donc mettre un tableau la fois
gntique, textuel, gnrique et fonctionnel de la "figuration" auctoriale. On sait
prsent pourquoi l'auteur est manifeste dans ce type de texte ; comment il y
apparat pour quels effets ; et avec quel statut pour son texte.
Les ouvrages postrieurs de Barthes apporteront peu de choses
nouvelles ces descriptions. Pour l'essentiel, Barthes a tout dit, en 1973, sur
cette pratique qui n'avait pas encore de nom et que peu de ses contemporains
avaient perue.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
291
Pour mmoire, on signalera toutefois deux autres dveloppements qui
intressent ce qu'il dsigne par le terme de "figuration".
Dans Fragments d'un discours amoureux, publi en 1977, un des
"fragments" est consacr au caractre inexprimable de l'amour. Au passage,
Barthes affirme "J e ne puis mcrire. Quel est ce moi qui s'crirait ? ( ... On ne
peut crire sans faire le deuil de sa 'sincrit'." (1977, pp. 114-115). A travers la
dnonciation de l'illusion d'expressivit qui habite l'criture amoureuse, cest
donc tout le problme de la reprsentation de soi qu'aborde Barthes. Son
jugement est svre : il n'y a pas d'criture qui travaillerait au plus pris de soi.
Et toute une argumentation psychanalytique vient tayer cette affirmation. Ce
fragment fournit donc un complment utile la critique de l'criture
autobiographique qui sous-tend sa valorisation de la "figure romanesque" de
l'auteur. Sans remettre en cause la tradition autobiographique, on peut en effet
reconnatre que Barthes formule l un dsaveu qui reflte un tat d'esprit
presque gnral. Quel est l'crivain qui se lancerait aujourd'hui dans une
entreprise comparable celle de Rousseau dans Les Confessions ? Nous
sommes dans un temps o le registre intime est, de toutes parts, contest,
ddaign, relgu ou contamin par la fictionalit. Et ce n'est sans doute pas
une concidence si c'est dans ce mme temps qu'une pratique originale de
l'criture de soi, l'autofiction, a merg et acquis un statut littraire.
Qu'est-ce qui permet la fiction de soi d'chapper l'illusion
d'expressivit et ses travers textuels ? Tout simplement parce qu'elle
manifeste l'auteur sous la forme d'un "pluriel de charmes" et non sous celle
dune personnalit. Cette formule de Barthes, et toutes les notations qui s'y rap-
portent, mritent peut-tre une explication. Partons de lcriture
autobiographique. Chacun sait que l'crivain est alors sous le contrle d'un
idal de fidlit et d'exactitude qui fait que le rcit gravite autour de sa
biographie et de sa personne, avec les effets que l'on sait (hrosation
invitable, mise en destin, centralisation du sens etc.). Mme si l'crivain
s'accorde la licence des "biographies romanesques". s'il renonce l'idal
d'objectivit, les dimensions existentielle et subjective demeurent et exercent
toujours leur attraction sur le rcit. A dfaut de "reprsentation de soi", le
rsultat est maintenant une "projection de soi", une confession plus ou moins
retouche, mais le texte est toujours subordonn une extriorit, l'unit
imaginaire que toute personne se fabrique, parfois difficilement, pour vivre.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
292
Dans l'autofiction, par contre, il s'agit d'emble d'un simulacre, d'une
invention. L'crivain labore une histoire fictive o il joue un rle, sans chercher
avant tout une mythique prsence soi. Si l'histoire qu'il imagine a invi-
tablement partie lie avec lui-mme - comment pourrait-il en tre autrement ? -,
cette articulation n'est pas du tout comparable au rapport de dpendance et de
subordination qui enchane une autobiographie une existence. Comme le dit
trs justement Barthes, il s'agit d'une connexion, pas d'une filiation. Dans le
cours de son travail, l'auteur fera certes appel, plus ou moins consciemment,
son vcu, des personnes rencontres, des lieux visits, des vnements
suivis de pris, des motions ressenties, des comportements effectus, une
culture personnelle etc. Seulement, tout ce matriel biographique n'aura pas le
mme vecteur qu'il a dans l'autobiographie. Il ne pourra que se distribuer en
fonction de la logique propre du rcit, selon les situations et les relations entre
les personnages, comme dans une fiction ordinaire. La Vie n'est plus la fois
une source et un rgulateur du rcit. Toute une srie d'obstacles interdisent
cette mainmise. Si l'auteur est prsent dans son texte, ce n'est plus que sous la
forme d'"clats", qui pourront tre aussi bien un lment du dcor, une bribe de
dialogue, un geste ou un sentiment venus habiter un personnage. Car mme
son double, son reprsentant, le personnage qui porte son nom, bref sa figure,
ne dispose d'aucun privilge : c'est seulement un ple relationnel dans l'histoire.
Naturellement, cette description est d'ordre logique, elle ne prtend pas
restituer le tortueux chemin que suit un crivain pour produire une autofiction.
Mais elle semble rendre compte sa manire de ce qui fait la spcificit du
dispositif de fictionnalisation quand il remplit une fonction figurative, de la
situation d'une autofiction au sens troit du terme. Pour s'en assurer, luvre de
Cendrars est un exemple prcieux. C'est qu'elle renferme la fois de vritables
autofictions - Moganni Nameh, LEubage et Moravagine - et des ouvrages o
Cendrars fabule, c'est certain, mais o sa "figure" n'est pas romanesque, tout
au plus mythique : L'Homme foudroy. La Main coupe, Bourlinguer, Le
Lotissement du Ciel. Cendrars est certes, dans ces textes, aurol de toutes les
gloires et sa vie y apparat comme un geste enchant. Mais ce n'est pas un
"retour amical de l'auteur", le "pluriel de charmes" manque.
Pourquoi ? Assurment parce que Cendrars construit ces textes de la
maturit autour et partir de sa biographie, mme s'il l'arrange, la dcoupe, la
redistribue, la corrige ou la magnifie, afin d'en procurer une version hroque,
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
293
de se dresser une "mythobiographie" comme l'a dmontr Claude Leroy. Dans
la ttralogie, il part de son vcu pour donner libre cours son talent de conteur
et s'inventer des histoires qui feignent de se plier aux conventions
autobiographiques, afin sans doute de capter la crdulit du lecteur au bnfice
de la lecture, tout en affichant quantit d'indices qui dnoncent la part de
fictionalit. Au contraire, dans un texte comme Moravagine, Cendrars
commence par la fabulation, son got pour les histoires sert de point de dpart,
quitte ensuite chercher une traverse ramenant au rel et l'exprience vcue,
comme il le fait en se mettant en scne Chartres, dans un emploi de
mcanicien-aviateur, qu'il aurait pu connatre dfaut de l'avoir rellement
vcu. Apparemment, la distance est mince entre ces deux dmarches :
l'invention est toujours l'expression du possible, la substitution d'une hypothse
vraisemblable un tat de choses vrifiable. En ralit, la diffrence est
norme car l'invention pouse deux orientations opposes par rapport au sujet
de l'criture : dans les autofictions, elle est fondatrice ; dans les pisodes de la
vie lgendaire, sa fonction est dcorative, mme si son dploiement peut
prendre des proportions considrables.
En rsum, ce qui mtamorphose l'crivain d'autofiction en "pluriel de
charmes". en sujet "pris dans le pluriel de son texte", cest donc un programme
d'criture qui a sa logique propre, une logique plus performative que constative,
o la fabulation est logiquement premire et interdit toute totalisation - comme
dans "L'Aleph", o les inflexions intimes glisses par Borges, que le lecteur a le
loisir de rver rfrentielles ou de juger mystificatrices, chouent constituer
une esquisse autobiographique.
Aprs ce dtour ncessaire, il faut retenir une dernire vocation de
Barthes, formule dans sa Leon, 'prononce en 1977 et publie en 1978, qui
permet de replacer la "figuration" dans la totalit de la littrature, de la
comprendre comme un enjeu qui est au cur de son criture. En explorant les
"forces de libert" propres la littrature, Barthes en retient trois, dont la
dernire est son pouvoir smiotique, sa capacit se jouer des signes.
Kierkegaard et Nietzsche lui apparaissent comme deux figures emblmatiques
de cette "mthode de jeu" :
" L'un et l'autre ont crit ; mais ce fut, pour l'un et
l'autre, au revers mme de l'identit, dans le jeu, dans le
risque perdu du nom propre : l'un par un recours
incessant la pseudonymie, l'autre en se portant, la fin
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
294
de sa vie d'criture, comme la montr Klossovski, aux
limites de l'histrionisme. On peut dire que la troisime
force de la littrature, sa force proprement smiotique,
c'est de jouer les signes plutt que de les dtruire, c'est
de les mettre dans une machinerie de langage, dont les
crans d'arrt et les verrous de sret ont saut, bref c'est
instituer, au sein mme de la langue servile, une vritable
htronymie des choses" (1978, pp. 27-28).
Certes, les cas de Nietzsche et de Kierkegaard n'ont qu'un rapport
lointain avec la "figuration" auctoriale. Le caractre analytique de leurs textes,
plus philosophiques que littraires, et la nature priphrique de leurs
apparitions textuelles, les cartent apparemment de notre sujet. Pourtant, on a
eu l'occasion de parler de Kierkegaard, avec In Vinos Veritas, et de voir que ce
rcit constituait un cas-limite de ddoublement fictionnel. Quant Nietzsche,
son acharnement transformer son nom, la fin de sa vie, l'amne
fictionnaliser sa signature et son rle d'auteur ; dmarche o se croisent la
dralisation de soi et la construction d'auteurs supposs. J acques Derrida a
rsum cette aventure peu commune, en mettant en relief tout ce qu'elle a de
contigu au projet de "figuration" d'un crivain :
"Mettre en jeu son nom (avec tout ce qui s'y engage et
qui ne se rsume pas un moi), mettre en scne des
signatures, faire de tout ce qu'on a crit de la vie du de la
mort un immense paraphe biographique, voil ce qu'il
aurait fait et dont nous devons prendre acte" (1984, p. 43).
Kierkegaard et Nietzsche peuvent donc tre dfinis comme deux
penseurs qui ont utilis les ressources de la "figuration" dans leur exploration
rflexive, qui ont risqu leur crdibilit pour trouver, inventer du Nouveau. Leur
"mobilisation'' montre que, pour Barthes, l'aventure figurative s'inscrit sur
l'horizon d'un usage ludique des moyens discursifs, d'un carnaval de signes,
d'un festin smiotique qui est constitutif la littrature. Parti dune critique de
l'image traditionnelle de l'auteur, Barthes dcouvrit donc une modalit d'non-
ciation inconnue et acheva sa traverse en replaant sa dcouverte au cur
des forces vives de la littrature.
On excusera cette petite anthologie barthsienne. Si on a cit aussi
longuement ses ouvrages, c'est que sa dcouverte de la "figuration" est peu
connue ; que sa pense tire sa fcondit moins des catgories qu'elle met en
place que de son mouvement et de son nonciation. Que retenir du voyage ?
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
295
Quelques propositions qui figeront sans doute sa pense, mais qui permettront
de forcer le mystre des effets de l'autofiction. Le tableau de Barthes permet,
en effet, de distinguer trois effets de l'autofiction, trois forces produites par le
dispositif dans son usage figuratif. Aucun de ces effets n'est vritablement
propre cette pratique, mais son originalit est de les articuler en faisceau, de
les produire ensemble et presque simultanment, dans une sorte de rotation
trs rapide : "une dialectique du dsir" entre l'auteur et le lecteur, lie une
espce de conflagration fictionnelle, entranant un change figural. Ces trois
effets se soutiennent mutuellement, mme s'ils ont chacun leur spcificit.
Comme la description de Barthes est souvent allusive, on ne craindra pas de
l'expliciter par des instruments emprunts ailleurs, de nature assez diffrente,
dans un "clectisme de mthode" pour parler comme Bachelard.
" Lauteur qui va dans notre vie"
"Le texte () me dsire" (1973, p. 45), dclare Barthes. Affirmation
nave ? Innocente plutt, et que ne dsapprouverait pas un crivain comme
Alfredo Bryce-Echenique, qui dpose sur le seuil de La Vie exagre de Martin
Romana cette ddicace :
"A Sylvie Lafaye de Micheaux, bien sr, parce que c'est
pour tre aim davantage que l'on crit".
On notera la tonalit impersonnelle de cette dclaration, qui dpasse sa
ddicataire, pour viser l'ensemble des lecteurs. Et cela pour un texte qui inscrit
son auteur dans la fiction d'un roman pseudo-autobiographique ; o
Bryce-Echanique est l'un des personnages secondaires, escortant la qute litt-
raire, existentielle et affective du hros Martin Romna - comme si c'tait ce
besoin d'amour qui avait propuls l'crivain au milieu de sa cration, le
poussant se renoncer pour se retrouver sous le visage d'une pure
individuation.
Aprs tous les discours nafs et errons tenus dans le pass sur la
relation auteur-lecteur, on peut hsiter accepter la prise en compte d'un tel
rapport dans la lecture. Quantit d'lments interdisent mme de penser cette
relation et d'envisager son propos une "dialectique du dsir", comme le fait
Barthes. Un livre n'est pas une personne, ne peut mme se concevoir comme
l'expression dune parole ; le lecteur n'a pas d'auteur en face de lui. Quant
l'auteur, il lui est impossible de connatre tous ses lecteurs, d'anticiper sur leurs
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
296
ractions ; par dfinition un texte est toujours ce que dit Celan du pome : un
message dans une bouteille jete la mer. Il n'est donc pas srieux d'assimiler
la lecture une conversation entre honntes gens, pas davantage une
relation amoureuse. La littrature tant une situation de communication la fois
diffre, crite et volutive, le modle de la communication orale et immdiate
n'est d'aucun secours pour la comprendre.
Ces restrictions faites, comment ignorer qu'on crit pour tre lu, qu'on
dsire toujours un lecteur ? Comment ngliger le fait que le lecteur a affaire
une nonciation singulire et que toute lecture met en marche une
pragmatique, autant qu'une smantique ? Mme si l'auteur ignore son lecteur, il
est son horizon ; et la manire dont il dsire cette relation ne peut pas ne pas
s'inscrire dans son uvre ; il faut bien que ce dsir s'inscrive comme une sorte
de programme dont le lecteur fera usage selon son propre dsir et sa
comptence. Sans doute, la notion de lecteur utilise par Barthes est-elle un
peu rustique. C'est videmment une position discursive, elle ne dsigne pas
une personne relle. Mais elle manque de la complexit qui lui permettrait de
rendre compte des directions multiples, en fonction de stratgies varies, dans
lesquelles s'engage un crivain pour modeler la place du destinataire. Elle
mriterait peut-tre dtre enrichie par la distinction que fait Mikhail Bakhtine
entre les lecteurs "seconds" et un lecteur "tiers". sorte didal de lecture, qui
occupent la plage rceptrice (Todorov, 1981, pp. 170-171). Pour l'essentiel,
pourtant, elle permet de dcrire l'autofiction comme une rponse originale au
dsir de l'autre qui irrigue l'criture et la lecture. Pour l'auteur, elle est l'occasion
de donner une figure de soi sans quivalent dans la ralit, de venir au texte et
au lecteur en toute libert, sans les contraintes et les impasses de l'criture
rfrentielle de soi.
En retour, ce dsir rencontre celui du lecteur, la recherche d'un "sujet
aimer" comme dit Barthes. Sans doute, ce nouveau dsir est-il lui aussi
multiforme ; sans doute aussi, s'incarne-t-il diffremment selon les pratiques,
voire selon les types de discours. Mais peu importe, il suffit de vrifier son
existence et de mesurer sa force, selon ses points d'application.
Insistons d'abord sur la ralit de ce dsir d'auteur, ce qui permettra de
spcifier celui ralis par l'autofiction. Dans une tude sur "L'image de l'auteur
dans les mdias", Ph. Lejeune a apport quelques lments permettant
d'tayer son existence. Il note, ainsi, que les mdias ne font pas que produire
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
297
une image de l'auteur ; en mettant au premier plan la personne physique,
psychologique et sociale de l'crivain, en rabattant son uvre sur son
individualit, elles rpondent des attentes du grand public et des attitudes
d'auteur :
" L'auteur apparat comme la 'rponse' la question
que pose son texte ...) on est souvent encourag ragir
ainsi par l'auteur lui-mme, qui tend plus ou moins se
reprsenter dans son uvre, ou donne penser qu'il s'y
est reprsent" (1986, p. 87).
Et il ajoute que cette "illusion biographique" est sans doute invitable :
l'analyse que j'ai faite de cette image ne montre-t-elle
pas aussi que la focalisation sur l'auteur et l'illusion de
transparence sont, pour diffrentes raisons, ncessaires ?
Et qu'il serait naf de penser pouvoir les dissoudre sans
dissoudre en mme temps la littrature - et la socit ?"
(1986, p. 97).
A travers des reprsentations convenues, romantique ou acadmique,
les mdias satisfont donc, en la canalisant, une relle demande, une attitude de
lecture A l'existence de l'auteur est un besoin irrpressible. Lejeune exclut
toutefois de ce constat une "fraction de l'appareil scolaire et universitaire", sous
prtexte que ce public refuse cette image traditionnelle.
Sans doute. Mais ne confond-il pas alors la rponse des mdias et
l'attente qui l'a permise ? Il semble oublier que mme le public "cultiv", plus
scolaris en tout cas, qui se refuse aux complaisances du grand public, fait lui
aussi une grande consommation d'images auctoriales. Tout un secteur de
l'dition n'existe aujourd'hui que par et pour ce public : le domaine de la
littrature intime et mme celui de la littrature critique. Carnets personnels,
correspondances, journaux intimes, autobiographies, livres d'entretien,
biographies, monographies, recueil de documents iconographiques sont
dvors par ce public difficile, qui par ailleurs ne manque pas une occasion de
marquer sa diffrence. Il est tout de mme curieux de constater que c'est dans
ce milieu litiste que circulent le plus d'anecdotes ou de bons mots consacrs
aux auteurs. Ainsi, mme dans ce public o "la mort de l'auteur" est un lieu
commun, o les navets du grand public n'ont pas cours, il y a un besoin de
l'auteur, comme un tropisme de l'crivain.
Avec jean-Claude Bonnet, il faut par consquent se rsoudre cette
vrit plus gnrale :
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
298
" il est vain de prtendre en finir un jour avec le
thme biographique et lauteur. Non qu'ils soient de retour
aprs plusieurs annes de mise l'index, mais parce
qu'ils n'ont jamais cess d'tre l sous d'autres formes et
travers des interrogations nouvelles. Il apparat
aujourd'hui que l'auteur est produit la fois par luvre et
les multiples discours qui accompagnent celle-ci" (1985,
p. 260).
Qu'opre le lecteur lors de sa lecture, aussi familier qu'il soit de Blanchot,
de la narratologie et de tous les discours qui dfont la conception qu'a de
l'auteur le sens commun ? Il construit peu ou prou une image de l'auteur, quitte
la modifier pour chacune de ses uvres, si cela se rvle ncessaire. La
notion d'auteur implicite popularise par W.C. Booth, dont la cohrence
thorique est trs discutable, comme l'a montr Genette, ne dcoule-t-elle pas,
elle aussi, de ce dsir dauteur ? C'est bien une notion fantme inconsistante,
qui a bien du mal se trouver une place entre l'auteur rel et le narrateur.
Pourtant, elle sduit immdiatement et sa force de conviction est considrable.
Qui ne s'est pas laiss prendre par elle, un moment ou un autre ? Tous ces
faits montrent par consquent la rsistance de ce besoin d'auteur et la varit
de ses formes d'actualisation. L'autobiographie et plus gnralement la
littrature intime y rpondent leur faon. Avec l'autofiction, le lecteur trouve
une autre rponse ce dsir aussi vaste que plastique.
L'efficace de l'autofiction, son charme et son secret c'est d'abord de
rpondre au dsir du lecteur en ne lui procurant rien de plus que l'animation
fictionnelle d'un nom propre, la seule marque indfectible, immortelle, d'un
individu historique. Le lecteur n'est pas alors fascin, ni mme intress, par
une personne relle, dont les dterminations et la trajectoire sont vrifiables ; il
n'est pas plong dans le parcours dune vie, ni dans le portrait d'une
subjectivit. Mais ce n'est pas plus cette ombre porte, cette esquive
permanente, cette dception infinie de l'auteur que fournissent les meilleures
fictions. L'auteur n'est plus un esprit, pas davantage un malin gnie, seulement
une "hcceit" complice. C'est un sujet d'nonciation pris dans un rapport avec
sa fiction qui n'est ni de proximit, ni dloignement, mais de "sympathie", de
"conspiration", au sens o Hypocrate disait que "tout conspire". Gombrowicz
marchant dans la poussire d'une campagne polonaise occupe, dans La
pornographie alors que l'auteur rel tait en Argentine voil pour le lecteur un
sujet historique comme dsoss, dsitu, dsenclav ; ce qui passe entre les
lignes, c'est une voix asynchrone, inassignable, improbable, dont la source
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
299
n'est pas localisable, bien qu'elle soit identifiable. C'est ce dcalage entre
l'existence relle de ce sujet et son origine impossible qui fait une grande partie
de la sduction de l'autofiction. Ce flottement dans la position d'un existant,
l'illusion de son indtermination, comme si un tant pouvait possder la
plasticit des choses rves, c'est le plaisir dune pure mobilit, quelque chose
qui passe entre les lignes et la vie.
Une explosion de la fiction
Ce qui permet cette prsence incomparable de l'auteur dans l'autofiction,
c'est bien sr sa nature fictionnelle. Do un autre effet, dont le point
dapplication est cette fois l'uvre, troitement li au prcdent.
crire une autofiction, c'est rentrer dans le tableau comme disait en
substance Barthes, en citant Loti. En devenant un personnage fictif, l'crivain
s'introduit dans un espace qui lui est ordinairement interdit, qui n'merge et ne
se conserve d'habitude que par son absence. Cette rupture des conventions qui
rgissent la fiction, Grard Genette a propos de la dsigner par le terme de
"mtalepse" Un rappel de cette figure va permettre d'clairer l'effet qu'avait en
vue Barthes.
Dans la rhtorique classique, la mtalepse est une "figure de pense"
qui comprend, entre autres, le procd par lequel un pote, un crivain, est
reprsent ou se reprsente comme produisant lui-mme ce qu'il ne fait au fond
que raconter ou dcrire". pour reprendre la dfinition de Fontanier (Ed. G.
Genette, pp. 128-129). Cette "figure d'expression" a ainsi la caractristique
essentielle de franchir allgrement la frontire qui spare la reprsentation et la
ralit, de combler l'cart qui fonde par convention la possibilit de crer des
ralits imaginaires. C'est en enrichissant cette figure de discours que Genette
en a fait une catgorie narratologique importante, une catgorie dsignant tous
les transits invraisemblables de la narration :
"Cortazar raconte quelque part l'histoire d'un homme
assassin par l'un des personnages du roman qu'il est en
train de lire : c'est l une forme inverse (et extrme) de la
figure narrative que les classiques appelaient la
mtalepse de l'auteur () Sterne poussait la chose
jusqu' solliciter l'intervention du lecteur, pri de fermer la
porte ou d'aider Mr. Shandy regagner son lit, mais le
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
300
principe est le mme : toute intrusion du narrateur ou du
narrataire extradigtique dans l'univers digtique (ou de
personnages digtiques dans un univers mtadigtique
etc.), ou inversement, comme chez Cortazar, produit un
effet de bizarrerie ().
Nous tendrons toutes ces transgressions le terme
de mtalepse narrative. Certaines, aussi banales et
innocentes que celles de la rhtorique classique, jouent
sur la double temporalit de l'histoire et de la narration ;
ainsi Balzac, dans un passage dj cit d'Illusions
perdues : 'Pendant que le vnrable ecclsiastique monte
les rampes d'Angoulme, il n'est pas inutile d'expliquer...,
comme si la narration tait contemporaine de l'histoire et
devait meubler ses temps morts.
On sait que les jeux temporels de Sterne sont un peu
plus hardis, c'est--dire un peu plus littraux , comme
lorsque les digressions de Tristram narrateur
(extradigtique) obligent son pre (dans la digse)
prolonger sa sieste de plus d'une heure, mais ici encore le
principe est le mme. D'une certaine faon, le
pirandellisme de Six personnages en qute d'auteur ou
de Ce soir on improvise, o les mmes acteurs sont tour
tour hros et comdiens, n'est qu'une vaste expansion
de la mtalepse, comme tout ce qui en drive dans le
thtre de Genet par exemple, et comme les
changements d'e niveau du rcit robbe-grilletien :
personnages chapps d'un tableau, d'un livre, d'une
coupure de presse, dune photographie, d'un rve, d'un
souvenir, d'un fantasme etc. Tous ces jeux manifestent
par l'intensit de leurs effets l'importance de la limite qu'ils
s'ingnient franchir au mpris de la vraisemblance, et
qui est prcisment la narration (ou la reprsentation)
elle-mme ; frontire mouvante mais sacre entre deux
mondes : celui que l'on raconte, celui que l'on raconte"
(1972, pp. 244-245).
Comme on le voit, le champ d'extension de la mtalepse est trs vaste et
toutes les mtalepses ne correspondent pas un agencement autofictif. Les
exemples de Cortazar, de Sterne, de Balzac, du thtre de Genet, de
Robbe-Grillet, cits par Genette, le montrent. Dans tous ces cas, l'auteur n'est
pas impliqu nominalement dans le tournoiement des plans de son texte. Seule
la comdie de Pirandello manifeste cette implication, mais de faon accessoire
comme on la vu. Si tout dispositif autofictif produit peu ou prou une mtalepse,
l'inverse n'est donc pas vrai. Un roman savoureux comme Le Vol dIcare de
Queneau a beau tre labor entirement sur le principe de la mtalepse, il ne
prsente aucune fictionnalisation auctoriale. Ce roman met bien en scne un
crivain (Hubert), dort les personnages d'une uvre en cours de rdaction se
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
301
sont chapps dans la "ralit". Il y a donc bien confusion de niveaux narratifs.
Mais cette confusion reste interne l'histoire narre, elle ne fait pas intervenir
l'auteur rel : Hubert n'est pas Queneau ; cet crivain suppos n'est pas un
personnage auctorial au sens que nous avons donn cette expression. Dans
Le Vol d'Icare, la diffrence de Les Enfants du Limon, Queneau n'apparat
pas dans son texte et la mtalepse n'est que digtique. On ne confondra donc
pas mtalepse et fictionnalisation de soi : la mtalepse digtique est
totalement indpendante du dispositif de l'autofiction.
Pour que la mtalepse et l'autofiction se confondent, il est ainsi
ncessaire que la premire ait pour appui, soit l'auteur, soit le narrateur.
Statistiquement, la mtalepse d'auteur est la plus rpandue, sans doute
cause de sa simplicit l'crivain feint d'avoir vcu ce qu'il ne fait que raconter et
le paradoxe s'achve l. Dans la mtalepse de narrateur, il faut que le narrateur
s'approprie, par un substitut livresque par exemple, l'identit de son crateur : le
narrateur feint alors de raconter ce qu'il ne fait que vivre (fictivement). De plus,
la mtalepse de narrateur entrane presque mcaniquement une construction
rflexive, ce qui complique passablement le paradoxe. Soit, en effet, le livre
s'enchsse lui-mme, comme on l'a vu avec Gide, et l'on dispose alors d'une
mise en abyme du livre. Soit, le livre enchsse luvre antrieure de son au-
teur, en partie ou en totalit, comme s'y est attach J .D. Salinger, et l'on a alors
une mise en abyme de l'crivain gnralise
Comme on a pass sous silence cette dernire forme de rflexion, il
n'est pas inutile d'en dire un mot. Dans Seymour, une introduction de Salinger,
le narrateur, Buddy Glass, sadjuge l'essentiel de l'uvre de son crateur. Se
prsentant comme le frre de Seymour Glass, il s'affirme l'auteur de L'Attrape-
coeurs et des deux Short Stories o apparaissait le personnage de Seymour.
Par un mouvement dj observ chez Gide, mais ici plus radical parce que plus
tendu, Salinger invagine donc sa propre uvre antrieure pour l'orienter dans
le sens d'une chronique des Glass. Rsultat de ce retournement : Salinger
s'vanouit dans son uvre. Cette disparition n'est que fictive, mais elle a ceci
de remarquable qu'elle semble avoir eu des retombes dans la vie de lcrivain
Comme on sait, il y a un mystre Salinger. Depuis plus de vingt ans, il n'a
jamais publi une ligne, aprs avoir annonc la suite du cycle Glass, et depuis
plus longtemps encore, il se refuse toute dclaration, tout entretien, toute
apparition publique. Ce mutisme social et littraire, il l'a conduit si loin
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
302
qu'aujourd'hui il est moins rel que ses personnages, moins crdible que sa fic-
tion. Et pourtant, on raconte qu'il crit seize heures par jour dans sa retraite de
Cornish, dans le New Hampshire. Cette mise en scne relle d'une disparition a
quelque chose du Portrait de Doran Gray. A propos de sa fresque sur les
Glass, il dclarait :
"Chose trange, les joies et les satisfactions que
m'apporte mon travail sur la famille Glass augmentent et
s'approfondissent singulirement avec les annes.
Cependant, je ne saurais proposer cela d'explication
raisonne. Aucune, en tous cas, hors du cercle enchant
de ma propre fiction".
On peut se demander si Salinger, grand lecteur de Kierkegaard et de
Kafka, n'a pas voulu prcisment que le "cercle enchant" de sa fiction ne se
referme sur lui, au sens propre. Ce serait alors un bel et rare exemple de
situation o la vie se calque sur luvre, o la lgende sert avrer l'uvre,
plutt que l'inverse comme c'est si souvent le cas.
Pour que la figure de la mtalepse chevauche un dispositif de
fictionnalisation de soi, il est donc requis que l'crivain soit intgr, d'une faon
ou d'une autre, dans la confusion des plans de narration. Qu'est-ce qui
distingue ces mtalepses o l'crivain est en jeu, au niveau du rsultat produit ?
Essentiellement, la radicalit du vacillement introduit. Quand la mtalepse ne
met en cause que les personnages ou le narrataire, lorsqu'elle demeure
inclave dans les bornes d'une histoire, ses effets sont plaisants ou
fantastiques, mais ils restent de bonne compagnie. Si elle prte rire ou
sourire, si elle tonne, elle ne trouble pas notre exprience de la ralit. Aprs
tout, le lecteur a alors affaire une fiction, il a pass un "pacte imaginaire" avec
l'auteur, il a accept de dcouvrir un univers qui a sa logique propre, diffrente
de celle qui gouverne le quotidien. Par contre, quand la mtalepse recouvre des
existants, des phnomnes dont l'existence est atteste, elle drange notre
sentiment du monde et notre pratique de la reprsentation, qui permet de le
symboliser, c'est--dire de vivre, comme dit quelque part Barthes.
Bien que les mtalepses d'auteur et de narrateur fonctionnent selon deux
mouvements inverses, on l'a signal, elles produisent le mme effet
profondment drastique. Dans la premire, la reprsentation prtend repousser
la ralit dans la seconde, la reprsentation feint de s'amalgamer la ralit.
Mais le rsultat est le mme. C'est le monde qui est touch et la dnivellation
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
303
qui fonde l'ordre du discours en gnral, et la fiction en particulier. Pour notre
perception commune, l'crivain de fiction, selon la belle formule de Sony Labou
Tansi, ajoute du monde au monde. Il invente des histoires, labore des rcits,
qui sont des constructions imaginaires. Ces reprsentations, fixes dans
l'criture, viennent agrandir, compliquer, enrichir notre existence, le monde que
nous habitons. Or, avec ces mtalepses, luvre de l'crivain prtend plus
radicalement s'approprier le monde., en l'assimilant ou en l'encerclant.
Consquence : le monde disparat, s'vapore ou s'vanouit dans la fiction : il n'y
a plus de ralit, rien que de l'imaginaire, des rcits l'infini, une mer de signes.
Avec cette coalescence du dedans et du dehors, de l'intrieur et de l'extrieur
du livre, les lignes de partage du rel et du fictif sont changes de telle sorte
qu'elles finissent par se confondre dans une dimension implexe.
Cette brche dans la stabilit de nos repres et de nos habitudes les
plus ncessaires a quelque chose de vertigineux. Difficile aprs cette
perturbation de ne pas prendre conscience des catgories et des principes sur
lesquels reposent notre insertion dans le monde et notre comptence la
symbolisation. Cette capacit de bouleversement explique la faveur dont jouit la
fictionnalisation de soi chez des auteurs dont la production n'est pas seulement
ou pas du tout littraire. Les dplacements et les branlements qu'elle provoque
dans le discours de la fiction constituent un instrument formidable pour
s'attaquer aux ides reues sur l'esprit, le monde et la transcendance. Do le
recours de penseurs comme Dante, Diderot, Nietzsche ou Kierkegaard au
dispositif, ralis en totalit ou marginalement. pour dstabiliser le discours
philosophique, la tranquille certitude qui habite la division des discours et le
cloisonnement des registres d'criture. Ce dchirement du champ pragmatique
libre la pense de prsences obsessionnelles qui l'entravaient, est promesse
de nouvelles aventures mentales, de dcouvertes improbables.
Au sein de la littrature, luvres se trouve aussi libre de dispositifs
parfois coercitifs, de conventions pesantes quand elles ne sont pas matrises.
Ce sont la fois son sens, sa "fonction auteur" et sa vraisemblance qui se
retrouvent soudain dnaturaliss. Le sens de luvre devient un procs sans
fin, une signification inpuisable puisque luvre n'a plus d'extriorit. L'auteur
bascule dans l'irrel, ce qui enlve sa fonction toute autorit, tout privilge et
donne au lecteur la possibilit d'un nouveau rapport avec lui. Luvre se
retrouve soudain causa sui, sans justification, purement arbitraire, situation
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
304
scandaleuse qui ne peut que dcupler sa force d'interpellation. Bien sr, ces
dplacements ont t dj nots propos de types de mise en abyme sans
rapport avec l'autofiction. Mais ici l'effet mtaleptique s'intgre dans un faisceau
d'effets, dont le retour amical de l'auteur". Cette articulation modifie son pouvoir
en l'ouvrant sur l'auteur et le lecteur dune manire jusque-l inconnue.
" Le fictif de l'identit"
Le dernier effet sensible de la fonction figurative a son point d'application
chez le lecteur. En produisant un horizon fictionnel sans rivages, en
transformant la ralit en rcit, l'autofiction amne le lecteur s'prouver
comme fictif. Borges avait not cet effet de retour de la mtalepse dans "Magies
partielles du Quichotte"
"Pourquoi sommes-nous inquiets que la carte soit
incluse dans la carte et les mille et une nuits dans le livre
des Mille et une nuits ? Que Don Quichotte soit lecteur du
Quichotte et Hamlet spectateur d'HamIet ? J e crois en
avoir trouv la cause : de telles inversions suggrent que
si les personnages dune fiction peuvent tre lecteurs ou
spectateurs, nous, leurs lecteurs ou leurs spectateurs,
pouvons tre des personnages fictifs. En 1833, Carlyle a
not que l'histoire universelle est un livre sacr, infini, que
tous les hommes crivent et lisent et tchent de
comprendre, et o, aussi, on les crit" (Tr. fr. P. et S.
Benichou, pp. 85-86).
Mais dans le cas de l'autofiction, ce sentiment est plus qu'une inquitude
ou qu'une hypothse, le lecteur s'exprimente, se ralise comme fictif. Il y a
plus parce que l'auteur est lui-mme dj une fiction, individu mais
impersonnel. Sa situation irrelle permet au lecteur de connatre une situation
identique. Non pas sur le mode de l'identification, mais sur celui de la
sympathie. Par une rtroaction dialectique, le lecteur est soudain complice de
l'auteur, dans le mme entre-deux incertain, dans la mme position indcise.
Quoique irrelle, cette dtermination originale possde une causalit
relle, car elle dispose dun enracinement anthropologique beaucoup plus
profond qu'on ne pourrait le penser superficiellement. Elle ravive, en effet, chez
le lecteur, une invincible puissance de rver veill, qui appartient au plus
cach de chacun. En tous, existe et subsiste une sorte de murmure imaginaire,
de bruissement fictionnel, o l'on tient toujours le premier rle, et qui
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
305
accompagne en permanence l'existence humaine. Dans un article fameux, "La
cration littraire et le rve veill" (1908), Freud a, le premier semble-t-il,
signal l'importance pour la vie psychique de ces "ralisations illusoires de
souhaits ambitieux, orgueilleux ou rotiques". Il montre que le rve veill
drive directement du jeu enfantin, constitue la matire premire de luvre
littraire et l'origine du plaisir de la lecture. Poursuivant dans un autre domaine
sa rflexion, Ernest Bloch a consacr des pages uniques analyser les
caractres, la fonction et l'ampleur de ce qu'il appelle "les petits rves veills".
Relevant leur mconnaissance quasi-gnrale, il s'attache dans Le Principe
d'Esprance les dcrire depuis le premier ge de la vie et rappelle leur
importance symbolique et narcissique lors de leur panouissement
l'adolescence :
"Pour la premire fois, on pratique l'art de parler de ce
qu'on n'a pas encore vcu soi mme. Mme un tre
moyen se racontera des histoires, des contes faciles o
tout lui russit. Il brode ces fables sur le chemin de l'cole
ou en se promenant avec des amis, mais dans tous les
cas le narrateur trne au centre du rcit, y posant comme
sur une photographie" (Tr. F. Wuilmart, p. 37).
Par la suite, Bloch consacre au rve diurne une importante partie la
fois thorique, esthtique et historique afin de montrer qu'il est le fondement
anthropologique de la "conscience anticipante', de l'ouverture sur le nouveau,
d'un "potentiel optatif" qui nous pousse en avant, d'une fonction utopique" qui
serait constitutive de ltre humain. Le grand mrite de Bloch est de distinguer
nettement ce type de rve du rve nocturne, auquel Freud le rduisait un peu
vite. Cette dissociation lui permet de montrer la fcondit des rves veills,
malgr leur immaturit et leur gocentrisme. Plastiques, perfectibles, volutifs,
capables de se transformer structurellement et de se diversifier en des
reprsentations artistiques ou des mythes collectifs, ces rves diurnes seraient
ainsi un ferment de progrs pour l'individu et la collectivit.
Pourtant, c'est D.W. Winnicott que l'on doit les propositions les plus
clairantes sur ce phnomne psychique. Dans Jeu et ralit, l'espace
potentiel, un modle de recherche psychanalytique patiente et nuance, D.
Winnicott a restitu ces rves veills dans son lieu propre, dnomm "espace
potentiel" ou "espace transitionnel". Sa dcouverte est ne de l'observation
clinique des petits enfants passant de l'tat d'union l'tat de relation avec la
mre. Pour effectuer ce stade de maturation, le petit enfant se trouve un objet
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
306
ou un comportement qu'il adopte et transporte partout avec lui. Comme
l'analysa Winnicott dans un article de 1951 qui a fait date, le statut de ces
"phnomnes transitionnels" est particulirement curieux : pour lenfant, cet
objet choisi, la couverture des Peanuts de Schultz en est le meilleur exemple,
nappartient pas la ralit extrieure, sans tre pourtant une hallucination ; il
relve dun statut intermdiaire. Avec les annes, lobjet est dsinvesti, sans
tre oubli :
"Les phnomnes transitionnels deviennent diffus et se
rpandent dans la zone intermdiaire qui se situe entre la
ralit psychique interne et le monde externe tel quil est
peru par deux personnes en commun' ; autrement dit, ils
se rpandent dans le domaine tout entier () englobant
le jeu, la cration artistique et le got pour lart, le
sentiment religieux, le rve et aussi le ftichisme, le
mensonge et le vol, lorigine et la perte du sentiment
affectueux, la toxicomanie, le talisman des rituels
obsessionnels etc." (Tr. fr. CI. Monod et J .B. pp. 13-14).
En tudiant les phnomnes transitionnels, Winnicott a donc mis au jour
une "aire intermdiaire o voluerait tout l'enfant, cette "aire d'exprience" o
voluerait tout individu. Ne de la maturation et du jeu de lenfant, cette aire
dexprience est le lieu de lactivit culturelle au sens le plus large du terme et
reprsente un levier essentiel pour l'acquisition du principe de ralit :
"Nous supposons ici que lacceptation de la ralit est
une tche sans fin, et que nul tre humain ne parvient
se librer de la tension suscite par la mise en relation de
la ralit du dedans et de la ralit du dehors ; nous
supposons aussi que cette tension peut tre soulage par
l'existence dune aire intermdiaire d'exprience, qui n'est
pas conteste (arts, religion etc.). Cette aire intermdiaire
est en continuit directe avec l'aire de jeu du petit enfant
perdu dans son jeu" (p. 24).
Cette zone singulire d'exprience ne reproduit pas, par consquent, le
fond originaire de la personne. En prise directe avec le rel, sa nature n'est pas
d'ordre fantasmatique, elle ne rejoue pas indfiniment le mme texte dipien,
les mme formations perdues faites de dsirs, de frustrations, de phobies et
d'anxits enfantins. Il y a un monde entre les manifestations psychiques
appartenant cet espace potentiel et les "ralisations illusoires" presque
compulsives que Freud voyait dans le rve veill.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
307
Pour rsumer le contenu de la notion d'espace potentiel, on empruntera
J .B. Pontalis une belle description, donne dans sa prface Jeu et ralit,
qui n'est pas sans faire penser la relation au lecteur tablie par l'autofiction :
"Pas de scne chez Winnicott o se rpterait
l'originaire, ni de combinatoire o les mmes lments
permuteraient dans le cercle, mais un terrain de jeu, aux
frontires mouvantes, qui fait notre ralit. Un bout de
ficelle, le rythme de sa propre respiration, un regard qui
vous donnent la certitude d'exister, une sance o l'on est
seul avec quelqu'un : peu de choses, moins que rien,
simplement ce qui m'arrive quand je puis l'accueillir. Alors
le trouv n'est plus le prcaire substitut du perdu,
l'informe n'est plus le signe du chaos l'esprit ne fonctionne
plus comme organe spar du corps" (pp. XIV-XV).
On aura compris la finalit de cette prsentation de Winnicott. Notre
hypothse est que l'autofiction vient se loger et agir, en chaque lecteur, au
cur de cette "aire intermdiaire". de ce potentiel entre-deux. Sans doute,
est-ce le destin de toute uvre littraire que de permettre tout lecteur de
constater ce chevauchement, de reconnatre ses propres phnomnes
subjectifs. Mais l'autofiction prsente ceci de particulier qu'elle reprend
explicitement, chaque fois diffremment, la structure mme de cet espace
potentiel, qui nest ni du dehors ni du dedans, et pourtant en relation avec la
ralit. Cette homologie structurale donne l'autofiction le moyen de faire de
l'espace potentiel l'enjeu de la lecture, et pas seulement sa condition. C'est ce
qui conduit le lecteur se reconnatre comme sujet fictif, dlocalis, dans ce
type de textes. Dans la fiction, le lecteur trouve une satisfaction identificatoire :
celle-ci lui permet de goter et de vivre des histoires, d'une manire trs
complexe, mais qui reste cantonne l'nonc du texte. Dans l'autofiction, le
lecteur se trouve pris dans une identification qui implique le sujet de
lnonciation, l'auteur lui-mme. Autrement dit, il s'agit d'un phnomne o le
lecteur ne se limite pas s'prouver autre comme dans la fiction ; il
s'exprimente en train de devenir autre, dans l'autofiction.
On peut illustrer ce phnomne par une anecdote de Goethe, qui en
donne un exemple remarquable, dans Posie et Vrit. Enfant, Goethe faisait
du thtre avec une petite troupe de camarades de son ge ; et il assurait son
pouvoir sur eux en les envotant par des rcits - mais pas n'importe quel type
de rcit :
"J 'tais capables de les rendre heureux () en leur
contant des histoires. Ils aimaient surtout m'entendre
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
308
parler la premire personne. Ils prouvaient une grande
J oie de penser qu'il pt mtre arriv, moi, leur
compagnon de jeux, des choses si tranges, et ils ne se
demandaient point, avec dfiance, comment j'avais pu
trouver temps et lieu pour de pareilles aventures, alors
qu'ils savaient bien quelles taient mes occupations, et o
j'allais et venais. Or ces vnements avaient besoin pour
thtre, sinon d'un autre monde, du moins d'un autre
pays, et tout s'tait pass la veille ou le jour mme. Il
fallait donc qu'ils se trompassent eux-mmes plus que je
ne pouvais les abuser. Et si, peu peu, suivant mon
naturel, je n'avais appris donner ces fantaisies et ces
gasconnades, la forme d'un rcit artistique, ces dbuts de
hbleur ne seraient certainement pas rests pour moi
sans consquences fcheuses" (Tr. fr. P. du pp. 38-39).
Dans le contexte de l'enfance, ce passage traduit bien le plaisir procur
par des histoires la fois impossibles et pourtant indexes un individu rel.
Comme le note pertinemment Goethe, ses compagnons avaient une demande
paradoxale : ils voulaient la fois du fabuleux et un engagement personnel du
contenu. Pourtant, le contexte fictionnel tait patent, aucune ambigut ne
permettait de percevoir ces rcits comme srieux. Goethe ne s'attarde pas sur
le sentiment de son auditoire. En homme des Lumires, il est plus proccup
de la place d'auteur qu'il occupait, dj. Est-il, pourtant, si difficile de
comprendre l'euphorie de ses camarades ? N'est-ce pas parce que cette si-
tuation pragmatique leur permettait d'changer leur position de narrataires
contre celle du conteur ? N'est-ce pas parce qu'ils pouvaient s'identifier, tous
enfants qu'ils taient, ce narrateur qui se fictionnalisait dans des aventures
merveilleuses ? Avec la littrature de l'enfance, on ne leur offrait que des
identifications d'nonc ; ils pouvaient se voir en personnage, goter l'altrit.
Mais avec les rcits de leur camarade Wilhem Goethe, ils avaient la possibilit
d'une altrit plus exaltante : celle de se sentir devenir diffrent, de se voir en
train de se transformer en personnage, de la place de l'auteur.
Ainsi, ce qu'autorise l'autofiction, la diffrence de la fiction, c'est de
permuter les fonctions, de ne pas tre simplement spectateur et acteur, mais
dtre aussi fabulateur, de connatre un devenir fictionnel. Parce qu'elle est
exactement calque sur la structure de l'espace potentiel, l'autofiction permet
de vivre totalement le grand murmure fictionnel qui habite les humains. Elle fait
de cet espace intermdiaire qui les constitue l'objet de sa lecture. Et comme cet
espace est diffrent pour chacun, chaque lecteur exprimente diffremment son
explicitation fictionnelle. Ainsi, si la fiction donne chacun la possibilit
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
309
d'organiser la ralit, lautofiction, elle, apporte la possibilit d'prouver en soi
cet espace toujours sous-jacent et de le vivre de faon plus riche, moins
gocentrique.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
310
5 - SANS FAMILLE -
"Si l'uvre est parole autrui et mme, si l'on veut,
rponse autrui, elle est une rponse inattendue et
surprenante, inentendue et inaperue du public auquel
elle s'adresse. Bien moins une rponse une question
dj pose qu'une rponse une question non encore
pose - une rponse permettant la question dtre po-
se".
G. Picon.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
311
On sait maintenant ce qu'est l'autofiction, en quoi elle consiste et de quoi
elle diffre. L'tude des stratgies d'criture a fourni les derniers rquisits sa
dfinition prcise et opratoire. Pourtant, un problme demeure : o situer
l'autofiction, dans le champ des pratiques littraires ? Quel est son statut
discursif ou architextuel ? Est-ce bien un genre ? Ou n'est-ce qu'une catgorie
modale un simple registre discursif ? A moins que ce ne soit qu'un simple
procd d'criture ? Et si c'est un genre, est-il simple ou complexe ? Est-ce un
genre thorique ou un genre historique ? Un sous-genre ou un archi-genre ?
Cette question est importante car le projet de dpart tait, tout de mme, de
dcrire, de spcifier et de comprendre une classe de textes, de conduire une
tude d'ordre gnrique. En outre, pour analyser les paramtres de cette
situation de communication inattendue, il a fallu poser une hypothse de travail,
dotant l'autofiction d'une existence gnrique.
Cette hypothse a eu des effets sur ce travail. On aura not que notre
perspective oscillait entre une description gnrique et un tableau de
rencontres heureuses, hsitait entre une approche gnrique et un abord plus
prudent, faisant de toutes ces convergences un ensemble fortuit. Tant qu'il
s'agissait d'analyser les pices du dispositif de l'autofiction, de varier ses
facteurs afin d'ouvrir l'angle de notre description, cette attitude tait
mthodologiquement valide. Depuis que le dispositif a t comme dpli, que
l'on a born le champ de ses ralisations autofictives, que lon a prcis les
limites fonctionnelles l'intrieur desquelles on pouvait parler d'autofiction, ce
flottement n'est plus possible. Il faut maintenant dcider du statut discursif, de la
nature gnrique de cette pratique littraire. On ne peut plus se contenter de
faire de l'existence de l'autofiction une hypothse de travail il est temps
d'valuer la validit de ce point de dpart.
Au crdit de cette hypothse, on peut mettre l'existence d'une classe de
textes aux contours relativement prcis, manifestant des caractres distincts,
travers une conjonction spcifique de deux protocoles de lecture, et cherchant
produire des effets propres partir d'une image fictive de leurs auteurs.
Apparemment composite, cette famille textuelle prsente une unit pragmatique
qui n'est pas discutable. D'un autre ct, on l'a signal plusieurs reprises,
cette pratique littraire ne possde pas de rception propre ; dans le paysage
littraire, elle n'a pas d'existence reconnue. S'il s'agit d'un genre, il s'agit d'un
genre inconnu, d'un genre souterrain. Cette situation a quelque chose de
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
312
paradoxal puisque normalement un genre littraire dfinit une "catgorie
duvre reconnue par la tradition". Il est donc ncessaire d'y aller voir d'un peu
plus prs et de se demander si un genre peut exister sur le mode du secret.
Pour cela, on dtaillera d'abord cette dfaillance de la rception, puis on
examinera une de ses consquences, pour en venir enfin la nature gnrique
de cette pratique droutante.
Le " court-circuit" de la rception
En commenant cette recherche, on a signal la situation problmatique
de l'autofiction comme pratique gnrique. Sans dsignation ni statut pendant
longtemps, son existence pouvait tre mconnue par des thoriciens avertis de
la chose littraire comme Doubrovsky et Lejeune. Bien que cette situation soit
en train de changer radicalement, il faut malgr tout l'voquer parce que ce
phnomne touche au mode dtre lui-mme de l'autofiction et a des
consquences sur son statut discursif.
Quand on a pris conscience de l'importance littraire de l'autofiction,
l'aveuglement pass parat aberrant. Et dcrire cette ccit est naturellement un
exercice aujourd'hui facile. La vision rtrospective du vrai est une opration peu
coteuse sur le plan thorique. Il faut pourtant comprendre que cette raction
envers l'autofiction dpassait la simple ignorance, l'oubli, la ngligence ou la
prcipitation. Plus que d'erreurs individuelles, cette mconnaissance manifestait
une attitude culturelle collective. Aussi bien ne s'agit-il pas dans ce qui va suivre
de citer complaisamment les errances de tel critique ou de tel poticien. En
tudiant la rception journalistique, puis universitaire de l'autofiction, on cherche
rendre sensible ce phnomne tonnant et rare : une pratique littraire qui
n'est pas reconnue comme telle, une forme sans fonction.
La rception journalistique
Plutt qu'une tude dtaille partir d'un chantillonnage d'articles, on
se limitera quelques observations faites partir de la lecture du supplment
littraire du Monde de 1980 1987. En lisant cette critique d'accueil, on
constate les faits suivants :
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
313
a) le souci du registre de lecture :
Dans l'ensemble, le "contrat" pass avec le lecteur proccupe tous ces
articles de presse, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, de rubrique ou
d'intitul. Les journalistes se demandent dans la plupart des cas s'ils ont affaire
une fiction ou une autobiographie le protocole onomastique est l'objet d'une
attention soutenue ;
b). L'absence de mise en perspective :
Le plus souvent, aucun rapprochement n'est fait avec des textes
antrieurs, sauf si le contenu thmatique s'y prte. On ne cherche pas clairer
un texte autofictif par des prcdents ni le mettre en rapport avec un
ensemble gnrique qui pourrait l'intgrer. Davantage, une autofiction apparat
comme un hapax, comme un cas d'espce. Ainsi Yves Florenne, critique
pourtant comptent, dclare propos de Joue-nous "Espaa" : "C'est, que je
sache, le seul roman dont le personnage porte ouvertement, dans le texte, le
nom de l'auteur. Et pourtant, c'est un roman" (Monde, 21.11.1980).
c) La section inclassable :
Quand le contenu d'un texte autofictif est invraisemblable, l'ouvrage est
dclar "inclassable" ou relevant du merveilleux ainsi Andr-la-Poisse de Terz
en 1981 et La guerre des pds de Copi en 1982.
d) La confession qui n'en est pas une tout en l'tant : Pour le gros des
autofictions publies durant cette priode, une attitude contradictoire est
adopte. Le dispositif est identifi, mais c'est pour lui donner une fonction
autobiographique comme le rclame, il est vrai, certains textes, mais pas tous !
Un discours cliv s'installe alors dans le propos, qui consiste dire : c'est un
roman, mais qui touche l'impudeur tant il est sincre. D'une faon gnrale,
on retrouve ce que dit, avec raison, Michel Contat de Doubrovsky : "dire tout de
soi, mais le dire avec art (...) crire sa vie comme si elle tait un roman,
c'est--dire, l'inventer sans fausser les donnes du vcu. S'taler sur les pages
dun livre, mais pas comme une flaque. En construisant un objet littraire"
(Monde, 12.1.1985). On notera tout ce que ce projet, qui est bien celui de
Doubrovsky, doit Goethe. Il rsume bien l'ambition de quelques auteurs,
lancs comme Boudard, dans un cycle de "biographie romanesque". Mais il est
loin d'expliquer le travail de Sollers, d'Isherwood, de Lacarrire, de Fuentes, de
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
314
Charyn, de Llosa, de Copi ou de Terz. Et surtout, il repose sur le topos selon
lequel le roman est plus vrai que l'autobiographie, selon lequel la sincrit d'une
criture de soi est proportion de la fiction mise en jeu. Lejeune a montr tout
ce qu'avait d'illusoire une telle opposition, o l'autobiographie est la fois juge
et partie (1974, p. 42). Ce topos fonde souvent, certes, l'identification du
dispositif, mais il fait aussi obstacle toute rflexion srieuse et rduit les
fictions de soi authentiques une confession teinte de romanesque et dont la
finalit serait rfrentielle. La perception de l'autofiction dans la presse, jusqu'
aujourd'hui, prsente ainsi deux traits caractristiques : une mconnaissance
par assimilation ; l'incapacit mettre en corrlation l'uvre lue avec d'autres
textes, penser en termes gnriques une uvre ralisant un agencement
autofictif.
On a l un phnomne que la sociologie de la lecture, pour des
segments textuels et au niveau des systmes idologiques des lecteurs, a trs
bien dcrit sous le nom d'effet de court-circuit". Si l'on transpose cette
description l'chelle plus gnrale des conventions de lecture qui sont les
ntres, on peut se reprsenter dette mconnaissance de l'autofiction comme un
court-circuit entre la lecture et l'interprtation, une rupture de la circulation du
sens entre la perception et la comprhension des textes. Les ralisations
d'autofiction sont bien lues, c'est--dire que leur spcificit est bien releve,
mais soit cela ne fait pas sens, soit ce sens est inassimilable, soit enfin il est
reu dans un espace qui n'est pas le sien. Chacune des autofictions est ainsi
l'objet d'une lecture flottante, d'une lecture que le systme de conventions de la
rception est incapable de mdiatiser. L'effet de ce court-circuit est double :
ct texte, il fait des uvres sans rception approprie, qui sont chaque fois
juxtaposes mcaniquement au systme de lecture en place ; ct lecteur, il
induit en lui "un malaise, une vidence non formalisable un questionnement
sans question que l'appareil idologique ne parvient pas digrer" (Leenhardt
et J ozsa, 1982, p. 96). Qu'indique un tel effet ? "Un manque, un trou dans le
rseau interprtatif ou une dfaillance de son pouvoir (...) le signe d'une zone
dindtermination dans les capacits d'accueil de la rception. Mais aussi bien,
un "point sensible et significatif" de celle-ci, le travail d'une ngativit o
peut-tre se manifeste dj la promesse de l'mergence de nouvelles
dterminations et la rvision du systme de conventions antrieur (Idem, p. 96).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
315
D'o vient ce manque, cette dfaillance de la rception ? En partie, de
l'absence d'une prise en charge de la fiction de soi par les Universits et les
Institutions. Au XXe sicle, celles-ci sont une source importante, parfois la
seule, des habitudes de lecture. Par le biais d'enseignements, de colloques, de
revues, d'ouvrages, de manuels, elles fabriquent et transmettent une
comptence littraire, que recueille plus ou moins vite, plus ou moins bien, la
critique journalistique.
La rception universitaire
L'origine de ce trou ou de ce manque dans le systme interprtatif se
comprend comme le rsultat de la situation faite l'autofiction tant par la
critique universitaire que par les thoriciens de la littrature. En tmoigne, pour
commencer, la raret des tudes critiques mentionnant, ne serait -ce que la
prsence de ce dispositif, pour le moins bizarre, dans les uvres de quelques
patronymes consacrs de la littrature comme Diderot, Proust, Kafka, Cline,
Gombrowicz ou Cendrars. La Potique de Cline d'Henri Godard est un
ouvrage unique en son genre : notre connaissance, c'est la seule
monographie qui n'esquive pas le problme et se donne pour tche de
l'lucider. Faut-il ajouter que par rapport la multitude des ouvrages consacrs
ces auteurs ou quelques-uns des textes de notre corpus, cela fait trs peu
et manifeste un rel aveuglement.
Quelques auteurs ont bien relev cette anomalie qu'es le fait d'un
crivain se reprsentant dans un texte fictif. Mais cette prise de conscience ne
dpassait jamais le cadre de l'uvre tudie. Elle n'envisageait pas la
possibilit que ce dispositif soit ralis ailleurs, autrement, qu'il puisse
constituer une pratique. Autant qu'on puisse en juger, la raction de ces auteurs
est systmatiquement une sorte d'tonnement, puis une dclaration faisant de
cette situation d'nonciation inhabituelle un cas unique. On a vu Yves Florenne
adopter cette attitude. Rappelons que Serge Doubrowski pensait tre le premier
employer un pareil agencement d'nonciation. Mais il est d'autres exemples
de cet effet hapax .
Barthes lui-mme, qui la pratique de la fiction de soi n'a pas chapp
et qui a fourni les instruments pour l'analyser, a eu cette attitude devant
Aziyad. Dans son analyse du roman, il notait propos de la fictionnalisation de
Loti :
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
316
"Ce n'est pas le pseudonyme qui est intressant (en
littrature, c'est banal), c'est l'autre Loti, celui qui est et
n'est pas son personnage, celui qui est et n'est pas
l'auteur du livre : je ne pense pas qu'il en existe de
semblables dans la littrature, et son invention (par le
troisime homme, Viaud) est assez audacieuse : car enfin
s'il est courant de signer le rcit de ce qui vous arrive et
de donner ainsi votre nom l'un de vos personnages
(c'est ce qui se passe dans n'importe quel journal intime),
il ne l'est pas d'inverser le don du nom propre ; c'est pour-
tant ce qu'a fait Viaud : il s'est donn, lui, auteur, le nom
de son hros" (1971 b, pp. 171-172).
Ph. Lacoue-Labarthe, pour sa part, a fait de cette situation d'nonciation
le rsultat dune "certaine logique inhrente au paradoxe". qui exposerait
ncessairement l'nonciation dun paradoxe sortir d'elle-mme. A propos du
Paradoxe sur le comdien, il affirme :
"... depuis le dbut du dialogue, l'auteur, le sujet
nonant du texte (...) n'a cess de multiplier les indices
destins l'identifier au Premier. Ou l'inverse. Par deux
fois, en tous cas, le Premier s'est rappel son interlocu-
teur ( ... ) comme l'auteur du Pre de famille par deux fois
il a renvoy (...) ses salons et il ne s'est pas mme priv
de se dsigner nommment.() l'auteur - Diderot -
occupe donc simultanment deux places. Et deux places
incompatibles. A la foi exclu et inclus, dedans et dehors
(...) le sujet nonant n'occupe vrai dire aucun lieu, il
est, inassignable ( ... ) est-ce que cette impossible
position du sujet ou de l'auteur, ici, ne serait pas l'effet de
ce que lui-mme ( ... ) a charge d'noncer, savoir tri
paradoxe ?" (1980t pp. 268-270).
Cette analyse est peut-tre lgitime pour le Paradoxe, mais srement
pas pour tous les dialogues o Diderot apparat dans son texte, encore moins
pour toutes les autofictions. Une recherche patiente apporterait sans doute
d'autres illustrations de cet effet happax Tels quels, ces exemples soulignent
coin bien la critique se trouvait dsarme devant la fictionnalisation de soi en
littrature.
Il faut dire que la thorie de la littrature, et spcialement les tudes
gnriques, n'apportaient aucun instrument pour resituer cette pratique dans
une perspective plus gnrale, qui aurait permis au dispositif de ne pas tre
simplement perut mais dtre aussi reu. Le "retour amical de l'auteur signal
par Barthes a eu pour consquence la rvision de la conception en vigueur de
la fonction auctoriale. Mais sa rflexion sur le travail de Proust ou de Genet na
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
317
pas fait souche. Dans lensemble, la situation faite l'autofiction est rsume par
le refus initial de Lejeune, en 1973, dj cit d'admettre son existence
empirique, sinon comme une hypothse dcole. Dans un ouvrage sur la
"Rhtorique de l'autoportrait", Miroirs d'encre publi en 1980, M. Beaujour
confirmait encore cette impuissance de la thorie. Alors qu'il trouvait, pour d-
signer le double de Leiris dans Aurora, la belle expression de "hros
anagrammatique", la question de la possibilit d'un autoportrait fictif lui
paraissait insoluble :
"Mais un roman peut-il tre un autoportrait ? En
l'absence d'un 'pacte autobiographique, la question doit
rester irrsolue Le problme est analogue celui dont
Philippe Lejeune traite dans Le Pacte autobiographique.
Mais il n'est pas identique, et bien plus dlicat, car il
faudrait songer un pacte imaginaire, qu'aucune formule
parajuridique ne peut sceller" (p. 70).
Pas plus que la critique, et mme plutt moins, la thorie de la littrature
ne percevait donc, jusqu'au dbut des annes 80, une pratique dont les
ralisations crevaient pourtant les yeux, si l'on peut s'exprimer ainsi. Vritable
constante du discours mtalittraire, cette mprise quasi-gnrale manifestait l
un seuil de la conscience critique et littraire, comme si ce savoir voluait alors
dans un paradigme (celui de la "mort de l'auteur" ?) qui lui interdisait tout dis-
cernement en ce domaine.
Comment expliquer cette ignorance collective, cette incapacit reprer
un dispositif, relier les textes qui l'utilisaient, donner une signification la
pratique qu'ils ralisaient ? Il n'est pas facile de rpondre cette question tant
le recul manque : nous appartenons encore au systme quia produit cette tache
aveugle ; l'autofiction est encore en train de se constituer. L'htrognit des
usages du dispositif de fictionnalisation auctoriale fut, certes, un facteur non
ngligeable : il fallait distinguer l'autofiction au sein d'un ensemble de pratiques
fabulatrices dont le but n'tait pas fictionnel. Mais le facteur dterminant fut
sans doute l'absence dun terme gnrique qui fasse l'unanimit. Il est
probable, par exemple que si Barthes avait cr un terme pour dsigner la
pratique discerne chez Proust et Genet, sa reconnaissance en aurait t
acclre ; il aurait fait cole et aurait diffus plus rapidement sa dcouverte.
Plus fondamentalement en se tenant dans un quasi-silence thorique sur leur
travail de fabulation, en se refusant le nommer, les crivains ont une large
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
318
part de responsabilit dans la solitude de l'autofiction. C'est se demander si
cet isolement n'tait pas ncessaire l'effectivit de leurs fabulations intimes.
Il faut insister, en effet, sur le fait que ct criture, au ple de la
production, les crivains d'autofiction ont t avares de confidences et
d'indications. Leurs tmoignages se ramnent, en tout et pour tout, quelques
notations, beaucoup de silences et aucune rflexion globale. Quand ils
commentent leur dralisation dans leurs textes, c'est comme incidemment, et
toujours latralement, sans vritable discours d'escorte, sans en appeler une
tradition, une pratique discursive qui les dpasserait. Fors le cas unique de
Nerval que lon verra, tout se passe comme si ce point tait ngligeable. Sans
doute, trouve-t-on de-ci del des remarques sur le registre hybride utilis. Mais
elles sont rares et se limitent presque toujours empcher une lecture littrale,
se situer par rapport aux registres de la fiction et du rel (comme Restif qui,
dans Mes ouvrages, donne leur dosage respectif ou Proust qui dans sa
correspondance tient se dmarquer des deux la fois) ou a signaler la source
du dispositif (Hesse, Krouac). Et pour la plupart, tout reste, obscur : le choix
d'une criture hybride, la conception qu'ils s'en font, les modalits du dispositif
ralis, les effets escompts, le "genre" dont ils se rclameraient, leurs modles
ventuels. Cette esquive systmatique est trs sensible chez Cendrars et
Gombrowicz, deux crivains dont luvre abonde en auto-commentaires. Alors
que les aspects les plus divers de leurs crations ont droit de gnreuses
explications, leur fictionnalisation, procd si inattendu et si bizarre, est comme
refoule, ou comme drobe par un parti-pris que l'on s'explique mal. Cette
absence, ou plutt ce manque de discours lgitimant, supprime la possibilit
d'un examen des thories "indignes". Non sans suggrer qu'il y a dans ce
mutisme gnral et mthodique quelque chose de prmdit. Mais elle a eu
aussi pour consquence qu'aucune dnomination, qu'aucun nom gnrique n'a
jamais t propos par un crivain, pour dsigner la dralisation de soi en
littrature. Les quelques dsignations qui ont t cites, lors de l'tude des
indices paratextuels de fictionalit, taient des indications gnriques timides,
presque des seconds titres, toujours le fait d'crivains contemporains, qui n'ont
jamais t exploites ailleurs que dans un "pritexte" interne. Sans lgitimation
et sans nom, chez ceux-l mmes qui lui avaient donn vie : tel tait le statut de
l'autofiction du ct des crivains.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
319
Or, d'une manire gnrale, les noms propres sont, Claude Levi-Strauss,
la dmontr, "des quanta de signification, au-dessous duquel on ne fait plus
rien que montrer" (1962, p. 285). Situs exactement aux limites du travail de
classification d'une culture, ils sont les units minimales par lesquelles le
systme dcoupe et organise le rel, donne forme l'exprience humaine. Le
champ littraire n'chappe pas cette ncessite de la nomination. En-de de
son existence, il n'y a plus de classification possible, c'est--dire plus de
structuration, rien que des cas atypiques comme l'a illustr la rception de
l'autofiction. Dans son remarquable travail sur les genres littraires, J .M.
Schaeffer a montr que les noms gnriques ont plus qu'une fonction
taxinomique, qu'ils remplissent aussi une fonction pragmatique dterminante :
... ils ne dcrivent pas uniquement les phnomnes
littraires, ils entrent aussi dans leur constitution. J e veux
dire par l que la nomination gnrique possde toujours
un aspect autorfrentiel, parce qu'elle implique une
composante dcisionnelle ( ... ). Les noms gnriques
n'expliquent donc pas l'histoire littraire, ils en sont une
composante spcifique L'existence des genres est en
premier celle d'une sorte de nom mi-nom propre, mi-nom
collectif, accol un texte" (1987, p. 17).
En sus de son rle taxinomique, la nomination mtalittraire a ainsi un
rle constituant dans la reconnaissance et le bon fonctionnement d'une pratique
littraire. En l'absence de nom, il tait donc fatal que l'autofiction reste un
phnomne marginal, atypique, incomprhensible.
Sur le plan pistmologique, cet tat de fait dmontre une fois de plus, si
cela tait encore ncessaire, que les faits nont pas en eux-mmes l'vidence
que l'on accorde trop souvent. Dans la premire leon de son Cours de
philosophie positive, Auguste Comte le notait dj :
"Si, en contemplant les phnomnes, nous ne les
rattachions point immdiatement quelques principes,
non seulement il nous serait impossible de combiner ces
observations isoles, et, par consquent d'en tirer aucun
fruit, mais nous serions mme entirement incapables de
les retenir ; et, le plus souvent, les faits resteraient inaper-
us sous nos yeux" (1830, p. 5).
Cette faiblesse des faits nus n'est pas propre la connaissance. Comme
le montre l'autofiction, la lecture a besoin de "principes". que J auss appelle
"ensemble de rgles", qui la guident et l'orientent dans son dchiffrement. Sans
les "principes" adquats, trs variables selon les uvres, que la comptence
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
320
littraire doit possder, la lecture manque tout simplement les phnomnes
qu'elle est cense susciter, ce qui ne veut pas toujours dire qu'ils sont alors
sans causalit.
Du ct des uvres, c'est l'occasion de vrifier que la littrature n'est
pas un objet clos, l'intelligibilit immanente et qui se suffirait lui-mme. Ce
phnomne de mconnaissance collective confirme que la Littrature est la
fois une activit, complexe, o l'intelligibilit se construit en permanence, et une
institution, dbordant en amont et en aval les uvres, dpendante d'autorits
culturelles, dont la fonction est autant didactique que constituante et
lgitimante. Pour que les proprits discursives, thmatiques ou formelles des
uvres soient perues, il faut qu'elles soient reues, c'est--dire consacres.
Des schmes de perception et de comprhension doivent pouvoir les accueillir.
Ces schmes, ce sont les crivains, les critiques, les thoriciens, les appareils
scolaires, les mdias qui les laborent, non sans oprer dans le mme
mouvement un travail de valorisation et de dvalorisation important. C'est cette
laboration incessante qui permet d'intgrer les uvres nouvelles, les procds
indits ou les thmes originaux au champ littraire : par l, ils sont situs,
rendus familiers par des antcdents, par des discours de lgitimation
esthtique et culturelle. Mais ces oprations d'identification, de dtermination,
de classement et de discrimination ne portent pas uniquement sur le nouveau,
elles reprennent et redistribuent tout l'ancien, comme on gre un hritage.
Aprs y avoir chapp pendant longtemps, l'autofiction semble tre finalement
rentre dans le cycle de cette gestion.
Un " genre" sans histoire ?
Dans la dure, l'absence de conscience gnrique propre l'autofiction.
Le dfaut de rception, a aussi pour consquence que celle-ci ne parat pas
avoir de tradition, disposer d'une Histoire. Essayer de discerner les grandes
lignes d'une volution, des transformations, bref une dynamique du "genre",
tout risque d'anachronisme assum, semble une entreprise voue lchec.
Ce n'est pas pourtant le pass ni l'ampleur des ralisations qui lui
manque. Si on avait lui chercher des racines vnrables, on pourrait remonter
lAntiquit romaine, au Ier sicle avant J sus-christ, Lucien de Samosate et
son Histoire vritable, dont le prologue a t cit plus haut. De l, il serait
loisible d'voquer le quattrocento florentin, qui voit natre la Comdie (1472) de
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
321
Dante Alighieri, ouvrage dont l'audace dans l'invention conserve aujourd'hui
encore toute sa force d'incitation. En poursuivant cette remonte du temps dans
la Renaissance, il faudrait faire une place au Quichotte (1615) de Miguel de
Cervants, mme s'il ne prsente qu'une tonalit autofictive, tant cette fiction a
connu de rayonnement. Pour le sicle des Lumires, on hsiterait avec raison
entre les affabulations de Restif de la Bretonne, qui ont frapp beaucoup
d'imaginations, malgr leur qualit parfois discutable. et la Biographie
conjecturale (1799) de J ean-Paul, qui en inversant l'ordre temporel de
"autobiographie toute la littrature d'expression allemande. Enfin, c'est vi-
demment La Recherche (1917-1927) de Marcel Proust que nous devons la
plupart des autofictions contemporaines.
Cette chronologie mmorable et ce petit panthon apportent un constat
impressionnant. A travers eux, l'autofiction parat exister depuis la Rome
impriale et quelques-unes des plus grandes uvres de la littrature
occidentale semblent s'tre relayes pour conserver sa tradition. Pourtant,
aucun crivain d'autofiction ne s'est jamais replac dans cette perspective, ni
rclam de cette ligne. A aucun moment de son volution, un auteur n'a crit
l'quivalent d'un texte comme Ivolution du roman au XIXe sicle de
Maupassant, pour se constituer en hritier d'une tradition aussi riche que
composite.
Au sein de cet oubli de soi, il faut apparemment extraire et mettre part
le cas de Nerval. Sa ddicace, Dumas pre, pour Les Filles de feu semble
infirmer cette description. Le caractre exceptionnel de ce texte a dj t
mentionn. De fait, on le citerait volontiers dans son intgralit, tant est riche
cette ptre dmesure. On se souvient que Grard de Nerval rtorquait par
cette ddicace un article, qu'on a cit, o Alexandre Dumas mettait en doute
la raison de l'auteur d'Aurlia. Pour lui rpondre, Nerval entreprend un plaidoyer
pro domo qui commence de la faon suivante
"J e vais essayer de vous expliquer, mon cher Dumas,
le phnomne dont vous avez parl plus haut. Il est, vous
le savez, certains conteurs qui peuvent inventer sans
sidentifier aux personnages de leur imagination. Vous
savez avec quelle conviction notre vieil ami Nodier
racontait comment il avait eu le malheur dtre guillotin
l'poque de la Rvolution ; on en devenait tellement
persuad que l'on se demandait comment il tait parvenu
se faire recoller la tte...
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
322
H bien, comprenez-vous que lentranement dun rcit
puisse produire un effet semblable ; que lon arrive pour
ainsi dire s'incarner dans le hros de son imagination, si
bien que sa vie devient la vtre et qu'on brle des
flammes factices de ses ambitions et de ses amours !
C'est pourtant ce qui m'est arriv en entreprenant
l'histoire d'un personnage qui a figur, je crois bien, vers
lpoque de Louis XV, sous le pseudonyme de Brisacier.
Ou ai-je lu la biographie fatale de cet aventurier ? J 'ai
retrouv celle de l'abb de Bucquoy ; mais je me sens
bien incapable de renouer la moindre preuve historique a
l'existence de cet illustre inconnu ! Ce qui n'eu t qu'un
jeu pour vous, matre - qui avez su si bien vous jouer
avec nos chroniques et nos mmoires que la postrit ne
saura plus dmler le vrai du faux, et chargera de vos in-
ventions tous les personnages historiques que vous avez
appels figurer dans vos romans, tait devenu pour moi
une obsession, un vertige. Inventer, au fond, c'est se
ressouvenir, a dit un moraliste ; ne pouvant trouver les
preuves de l'existence matrielle de mon hros, j'ai cru
tout coup la transmigration des mes non moins
fermement que Pythagore ou Pierre Leroux. Le dix-
huitime sicle mme, o je m'imaginais avoir vcu, tait
plein de ces illusions. Voisenon, Moncrif et Crbillon fils
en ont crit mille aventures. Rappelez-vous ce courtisan
qui se souvenait d'avoir t sopha ; sur quoi Schahaba-
ham s'crie avec enthousiasme : 'Quoi ! Vous avez t
sopha ! mais c'est fort galant... Et, dites-moi, tiez-vous
brod ?. (1854, pp. 28-29).
Dans cette justification, les ides et les rfrences abondent. Il faudra
revenir par exemple sur le fait que des conteurs tendent se projeter sur leurs
personnages : on se demandera, moins prudemment que Nerval, si ce n'est
pas une tentation permanente pour l'crivain, voire un risque inscrit dans la
langue elle-mme. Notons aussi comment Nerval sait rappeler habilement que
Dumas a pass une grande partie de sa vie crire des romans o la vrit
historique se confondait avec ses propres inventions. Il est vrai que Dumas ne
pratiquait ce registre hybride qu'au niveau de l'nonc, en limitait ses mlanges
au contenu de ses ouvrages, sans risquer le statut de son nonciation ni son
propre nom.
Encore que... Mes Mmoires de Dumas sont un bel exemple
d'autobiographie truque, o l'auteur des Trois mousquetaires fait de sa vie un
enchantement permanent reprenant son d dans ses romans et pratiquant un
aller-retour permanent entre fiction et ralit. Les contemporains ne s'y sont
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
323
d'ailleurs pas tromps ; tmoin le portrait d'Hippolyte Romand, dans la Revue
des deux mondes de janvier 1834 :
"Don J uan la nuit, Alcibiade le jour : vritable Prote,
chappant tous et lui-mme ; aussi aimable par ses
dfauts que par ses qualits, plus sduisant par ses vices
que par ses vertus voil M. Dumas tel qu'il me parat en
ce moment car, oblig de l'voquer pour le peindre, je n'o-
se affirmer qu'en face du fantme qui pose devant moi je
ne sois pas sous quelque charme magique ou quelque
magntique influence" (cit dans Biet, Brighelli et Raspail,
1986, p. 74).
Aprs ce retour de bton et l'allusion sa "croyance" en la
mtempsycose, Nerval se rattache toute une tradition antrieure
Moi, je m'tais brod sur toutes les coutures. Du
moment que j'avais cru saisir la srie de toutes mes
existences antrieures, il ne m'en cotait pas plus d'avoir
t prince, roi, mage, gnie et mme Dieu, la chane tait
brise et marquait les heures pour des minutes. Ce serait
le Songe de Scipion, la Vision du Tasse ou La Divine
Comdie du Dante, si j'tais parvenu concentrer mes
souvenirs en un chef-duvre. Renonant dsormais la
renomme d'inspir, dillumin, ou de prophte, je n'ai
vous offrir que ce que vous appelez si justement des
thories impossibles, un livre infaisable, dont voici le
premier chapitre, qui semble faire suite au Roman
comique de Scarron... J ugez-en...
Est-ce donc la charte qui manquait l'autofiction ? C'est en tous cas un
texte qui en donne le mcanisme de production? dfinit diffrentiellement son
agencement, l'articule de faon complexe des croyances hermtiques et
l'intgre dans une continuit. Reste savoir si Nerval parle bien de l'autofiction
si ces exemples sont pertinents pour illustrer cette stratgie.
Pour le Tasse et Dante, la chose est certaine : le premier a crit des
dialogues imaginaires o il se mettait en scne ; on a vu toute la
fictionnalisation de soi que recelait La Divine Comdie. L'allusion au "Songe de
Scipion" est moins comprhensible. Car ce "songe" est attribu Scipion par
Cicron, pour relater un mythe eschatologique dans le dernier livre de sa
Rpublique, sur le modle du rcit de l'Er l'Armnien qui clt l'ouvrage
homonyme de Platon. Scipion n'est donc pas l'auteur du songe qui porte son
nom, la diffrence de Dante ou du Tasse qui sont les auteurs de leurs visions.
Il est vrai que Nerval ne connaissait peut-tre pas ce dtail. L'ouvrage de
Cicron n'a t retrouv que vers 1820, par un humaniste italien qui travaillait
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
324
la Bibliothque Vaticane. Avant cette date et sans doute des annes aprs, ce
songe n'tait accessible que par la version de Macrobe, grammairien latin qui a
conserv et comment ce texte, et qui tend authentifier le songe. A moins
d'une confusion de Nerval, il faut donc supposer qu'il ne connaissait ce songe
qu' travers le texte de Macrobe. Dans l'esprit de Nerval, Scipion tait bien
l'auteur de son rve, c'est--dire d'un rcit irrel o il figurait.
A considrer les trois rfrences de Nerval, il parait lgitime de
considrer qu'elles font signe vers la situation dnonciation originale qui occupe
ce travail. Le seul point dlicat, c'est qu'on peut hsiter sur l'objet de cette
vocation : Nerval fait-il allusion une tradition d'illumins ou une tradition
littraire ? Scipion, Le Tasse, Dante sont, en effet, cits comparatre pour
leurs fictions, mais aussi bien parce qu'ils ont eu des visions ou se sont donns
le plaisir de croire qu'ils en avaient. Chez Nerval, on le sait, la rfrence
hermtique s'accompagne toujours de cette clause d'incertitude : il n'affirme
jamais crment la ralit du thme hermtique qui traverse son uvre. C'est
d'ailleurs ce flottement constant qui permet de comprendre l'ambigut de la
tradition dont il se rclame : il s'agit moins d'une quivoque que d'un dualisme ;
c'est l'angle sous lequel Nerval conoit la possibilit de la fiction de soi : comme
la rmanence, joue ou complaisante, de vies antrieures, comme un
ressouvenir.
La ressemblance est, en effet, une catgorie de base de la pense et de
la pratique de Nerval, qui sans cesse cherche des analogies, des termes de
comparaison, la possibilit de rapprochements, de correspondances,
promesses d'une unit du monde et des cultures (Richard, 1955, P. 56). D'o le
bric--brac sotrique, mais aussi historique, folklorique, philologique, de son
uvre, vritable festin pour l'exgse et l'hermtisme. Mais cet aspect cabinet
de curiosits a chez lui une fonction crative, comme il le relve d'ailleurs dans
la ddicace Dumas : ... ne pouvant trouver des preuves matrielles de
l'existence de mon hros, j'ai cru tout coup la transmigration des mes ... .
Ainsi, la mtempsycose est pour Nerval un moyen d'assurer sa dmarche et
une clef pour comprendre celle des uvres passes. Il se pourrait bien, ds
lors, que Nerval ait vraiment eu conscience de cette permanence de l'autofiction
et qu'il ait pratiqu en connaissance de cause ce registre. Et il est certain qu'il a
peru les ressources de cette situation de communication, comme le montre
son texte sur Restif, Confidences de Nicolas.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
325
Pour des raisons historiques, cette clairvoyance n'a toutefois eu ni suite
ni matrialisation littraire. D'abord, Nerval est rest longtemps un auteur
confidentiel, une sorte de fou littraire ; ensuite, la description sotrique ou
mystique qu'il donne de l'autofiction. quand on connaissait mal son art et
l'ensemble de son uvre, pouvait prter confusion. Aprs lui, l'autofiction
redevient une pratique aveugle, dont les manifestations rptes s'enchanent
dans la mconnaissance, sans reconnatre la longue chane historique
laquelle elles appartiennent.
Pourtant il serait excessif de dcrire cette pratique comme une
juxtaposition duvres sans rapport entre elles.
A l'aide de dclarations explicites, plus souvent en interprtant les textes,
leurs marges ou les discours qui les prolongent de multiples connexions
apparaissent. Ce n'est pas que les auteurs revendiquent volontiers leur modle
d'inspiration, mais certaines insistances finissent par avoir presque valeur d'at-
testation. Ainsi du rapport de Cline Proust : l'crivain du Voyage ne se
rclame pas explicitement, pour autant qu'on puisse en juger, du modle
autofictif proustien, mais la multiplication des comparaisons et des mises en
parallle entre son uvre et la Recherche suggre fortement ce
rapprochement. Mais il s'agit le plus souvent de connexions entre un texte et un
autre texte, le recommencement d'une exprience unique, sans pareille.
Aucune autofiction ne se dtermine comme le point d'arrive d'une longue
procession, comme la relance d'un geste prenne ; la ralisation est toujours
une reprise. Loin dtre continue et cumulative, cette pratique se dploie en
rseaux toils, relativement autonome, partir de "phares" (Dante, Cervants,
Novalis, Rtif, Goethe, Proust). Du centre Proust , essaiment ainsi la plupart
des autofictions modernes, sans que celles-ci ne prsentent la trace d'une
dtermination par les grandes ralisations antrieures : ainsi des uvres de
Kerouac, de Cline, de Fuentes, de Charyn. L'enchanement des autofictions
s'opre selon un rapport privilgi d'crivains crivains ; la transmission du
dispositif n'pouse pas la marche du temps. Il n'y a pas de descendance
linaire, pas de filiation de proche en proche entre tous ces auteurs. Seulement
des plantes dont le pouvoir d'attraction perdure, mme quand d'autres astres,
aussi puissants, apparaissent et attirent d'autres satellites.
Au demeurant, un examen du corpus ne met en relief aucune poque
particulire dans la production des autofictions aucune gnration littraire ne
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
326
parait avoir t plus sensible qu'une autre ce procd littraire ; ce qui rend
inutile toute priodisation. Le seul phnomne que l'on serait tent de noter,
avec Ph. Lejeune, c'est une acclration apparente, en cette fin du XXe sicle,
des actualisations du dispositif. Bien des raisons culturelles sont mme
d'expliquer ce tournant. Mais on peut aussi se demander s'il ne s'agit pas d'une
illusion de perspective ; en l'absence de tradition, l'identification des autofictions
rcentes est plus aise que celle des textes qui sont aujourd'hui noys dans la
multitude des pratiques hybrides.
En dfinitive, la diffrence de la biographie, du roman ou de
l'autobiographie, aucune autofiction quelque sicle qu'on l'arrache, ne
manifeste le poids d'une gnalogie, les traces d'une lutte pour assumer et se
distinguer d'un pass encombrant. L'absence de rception fait de cette pratique
une pratique sans mmoire.
Un "genre" secret ou un "genre" thorique ?
Voil donc une forme de fiction reste longtemps sans rception et sans
discours descorte, sans mmoire et sans histoire, sans statut et sans nom. Et
pourtant, elle se manifeste dans une classe de textes dont l'existence est
indniable, elle remplit mme quelques-unes des conditions d'un genre,
prsente les rgularits d'une pratique discursive. Alors, est-ce un genre
inconnu ou une illusion gnrique ? Un genre cach ou une catgorie fantme?
On se trouve devant le problme de classification voque au dbut de ce
chapitre : comment situer lautofiction ? Est-ce un genre ? Une hybridation ?
Une simple catgorie de lecture ? Le terrain de cette interrogation n'est pas trs
sr. Comme on sait, la problmatique des genres pose un vaste ensemble de
questions, qui sont loin d'avoir toutes trouv une rponse satisfaisante. Il
faudrait d'abord s'entendre sur toutes ces divisions, souvent employes, dans
ce travail comme ailleurs, en des acceptions varies. Tout d'abord, sur la notion
de genre d'o rayonnent la plupart des autres subdivisions. Qu'est-ce qu'un
genre ? Sur ce point, il semble qu'une solution soit aujourd'hui accepte par
tous. On s'accorde reconnatre qu'une classe de "textes" partageant des
proprits communes ne suffit pas dfinir un genre. Une condition
supplmentaire est ncessaire : Warning dirait la concrtisation historique".
c'est--dire la reconnaissance institutionnelle une poque donne. Comme
l'affirme pertinemment Tzevetan Todorov :
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
327
on disposerait d'une notion commode et oprante
si l'on convenait d'appeler genres les seules classes de
textes qui ont t perues comme telles au cours de
l'histoire. Les tmoignages de cette perception se
trouvent avant tout dans le discours sur les genres
(discours mtadiscursif), et, de faon sporadique et
indirecte, dans les textes eux-mmes (1978, p. 49).
Plus radical, Grard Genette critique l'ide que les catgories gnriques
puissent tre abstraites de l'histoire :
... toutes les espces, tous les sous-genres, genres
ou super-genres sont des classes empiriques, tablies
par l'observation du donn historique (1979, p. 70).
Ces propositions, difficilement discutables, suffisent carter l'ide que
l'autofiction puisse tre un genre second, complexe, infrieur, mlang ou
"familial". L'autofiction est bien une classe textuelle : les proprits qui la
dfinissent se retrouvent effectivement travers un certain nombre de textes.
Mais cette classe n'est pas reconnue par les lecteurs, n'a pas se place dans le
paysage littraire ; elle n'a pas d'enracinement historique. Il faut donc faire son
deuil de toute catgorisation qui directement ou non ferait appel la notion de
genre, sinon dans une acception trs vague.
A moins que l'on suppose qu'il s'agisse d'un genre cach, d'une pratique
gnrique clandestine, dont la condition de possibilit reposerait sur le secret.
Lo Strauss a dvelopp comme on sait, toute une thorie sur un "art d'crire"
cach, aujourd'hui oubli, permettant des penseurs comme Xnophon,
Machiavel, Hobbes, Spinoza, de formuler des propositions essentielles "entre
les lignes". tout en donnant l'illusion de soutenir les discours dominants de leur
poque (Ruwet, 1979). Sur ce modle trs suggestif, on pourrait concevoir tous
les textes autofictifs comme appartenant une tradition masque, dans la
ncessit de celer ses vritables objectifs. A partir de l il serait possible de
soutenir que ce genre existe bien (notre corpus prsente certes des uvres
ayant des traits communs) mais qu'il ne pouvait pas se prsenter au grand jour
(effectivement, pratiquement aucun auteur ne commente son travail fictionnel.
Certes, comme l'criture cache de Strauss, chaque crivain ne manquerait
pas de signaler cette appartenance gnrique par des indices habilement
disposs, mais il se garderait bien de revendiquer ouvertement la nature si
particulire de son criture. En ralit, le fond de son ouvrage ne s'adresserait
qu' un public sotrique, capable de reprer le dispositif utilis et le registre
d'criture qui en dcoule.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
328
Pourquoi ce double langage serait-il ncessaire ? En quoi cette littrature
double entente s'imposerait-elle ? Comme Strauss, on rpondrait que la
Perscution sociale et culturelle commanderait cette duplicit. N'oublions pas
que le dispositif de fictionnalisation de soi, quand il ne remplit pas une fonction
interprtative ou biographique, met en cause des catgories aussi essentielles
que le Sens, la Vrit, le Rfrent et le Sujet. Si la culture occidentale est bien
ce long travail d'exhaustion de l'individu, qu'a dcrit Louis Dumont (1983) travail
la fois mtaphysique, politique et littraire qui commence au XIIIe et qui vise
faire de l'individu un tre moral causa sui, indpendant et autonome par rapport
la collectivit le dispositif dnonciation de l'autofiction a un effet disruptif
extraordinaire : il littralise en quelque sorte cette ide que tout individu est fils
de ses uvres en la portant un seuil o cette notion implose et crve l'horizon
de tout l'ordre culturel s'organisant autour de la notion de personne. En
pousant le modle de l'autobiographie, qui a tant fait pour la constitution de
l'individu, elle dralise de l'intrieur l'individu, lui enlve son assise (le vcu, la
subjectivit, le sens moral) pour le laisser tournoyer en spirale, dans des
distorsions sans fin, comme un systme autogouvernable qui aurait perdu son
rgulateur.
Dans cette perspective, toute la chronologie de l'autofiction prendrait un
sens, se transformerait en histoire en tant qu'elle pourrait se lire comme l'envers
du discours de la subjectivit, comme le retour priodique du refoul : Lucien de
Samosate, c'est l'poque des Stociens, de l'individu au sens moral Dante, c'est
le XIIIe, le dbut de la subjectivit au sens moderne ; Cervants, le XVIe ; c'est
la chute de l'Autorit et l'panouissement du moi singulier, qui trouve un
fondement mtaphysique avec le cogito ; Novalis, R.YSbi, cest la veille de
1789, le triomphe de la personne civile etc.
Cette explication rendrait compte aussi du silence ttu, systmatique et
nigmatique des crivains sur leur travail. Pour un Nerval qui vend la mche et
finit dclar fou, combien d'auteurs qui ne font que des dclarations rentres,
des affirmations contradictoires et qui en fin de compte, choisissent le silence.
Elle permettrait du mme coup dexpliquer l'absence dhorizon d'attente :
hormis des lecteurs attentifs, rares, forcment rares, peut-tre ne se recrutant
que parmi des crivains, qui pouvait percevoir la terrible originalit de cette
figure d'nonciation ? Elle donnerait, enfin, l'explication de l'apparition actuelle
de l'autofiction : aujourd'hui la Perscution n'existe plus (ou sous des modalits
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
329
diffrentes) et la civilisation occidentale remet en question cette notion d'indi-
vidu sur laquelle elle s'est btie.
Arrtons l ce roman gnrique. On ne l'a bauch que parce que le
silence entourant l'autofiction parat peu naturel et suggre une telle hypothse.
Il y a eu une poque o ce type de scoop aurait sans doute fait fureur. Les
temps actuels sont plus raisonnables, moins ports aux gnralisations partir
de la dralise la notion d'individu, qu'elle mette en pratique une critique de la
notion de personne que l'on trouve chez Pessoa, Pirandello et quelques autres,
cela n'est gure contestable. Car elle exploite une "aire d'exprience" qui ne se
situe ni dans la ralit ni dans la subjectivit. Mais de l en faire une
cinquime colonne, une pratique consciente de mise en crise de la notion
d'individu, dlibrment masque pour viter les foudres de la Perscution, il y
a un abme que l'on ne franchira pas. En matire de secret, le bon sens est le
meilleur guide si ce genre tait cach, alors il l'tait si bien que chaque auteur
d'autofiction a pens (comme Doubrowsky dans son registre) ouvrir une
nouvelle pratique ; s'il n'tait qu' moiti cach, transparent pour les initis,
alors cela se saurait, comme dit la Sagesse des nations.
D'une faon gnrale, il faut bien tre conscient qu'un genre secret est
une contradiction dans les termes, une impossibilit thorique. Un genre, c'est
un type duvre consacr comme tel une poque donne, atteste par les
discours qui entourent la production et la rception des uvres. Si ces discours
font dfaut, si la rception est absente, s'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a
plus de genre possible.
Plus srieusement, ne peut-on faire de l'autofiction un "genre thorique",
un "type" en quelque sorte ? C'est ce que fait Susan Rubin Suleiman dans son
livre suggestif sur Le Roman thse. Elle affirme et dfend le droit pour le
poticien de construire rtrospectivement un genre partir d'une observation
empirique et d'une induction analytique (1983, pp. 20-27).
Ce droit de construction gnrique revient affirmer la validit de la
notion de genre thorique, comme le faisait Todorov, plus de dix ans
auparavant, et avant de changer dattitude, dans Introduction la littrature
fantastique : "de mme que dans le systme de Mendeleev, on peut dcrire les
proprits des lments qu'on n'a pas encore dcouverts, de mme ici on
dcrira les proprits des genres - et donc des uvres - venir" (1970, p. 19).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
330
Ces affirmations appellent deux remarques. Tout d'abord le travail de
classification rtrospective au double sens de valorisation et de dlimitation
rtrospectives constitue, il est vrai, une dimension importante de la vie des
Lettres, de l'volution de la littrature. Comme le notait il y a dj quelque
temps Genette, "une poque se manifeste autant par ce qu'elle lit que par ce
qu'elle crit" (1966, p. 169). En outre, il est toujours fcond de dcrire
l'existence dun genre possible (qu'aucune ralisation historique n'est venue
codifier (Todorov, 1978e p. 51). Reste qu'on ne peut donner cette
reconstruction gnrique le titre rel de genre ; elle n'a pas de porte des-
criptive et explicative vritables.
Dire que l'autofiction prsente des proprits, cest en faire une catgorie
de lecture ; pas dgager une catgorie de productivit textuelle", un "modle
d'criture" (Schaeffer, 1983).
L'existence de ressemblances discursives ne donnent aucune lgitimit
la ralit d'un genre, ne permet pas de promouvoir l'existence un genre,
mme aprs coup. Si Suleiman se donne cette illusion pour le roman thse,
c'est qu'elle passe subrepticement d'une dfinition extensionnelle (constituer
une classe de textes qui prsente des caractres communs) une dfinition
intensionnelle (prtendre donner une dfinition en comprhension, par ses
caractres, de cette classe) du genre. Un tel passage n'est possible, comme la
bien montr Schaeffer (1987), qu'en occultant la dimension temporelle qui
commande la dynamique gnrique et en sous-dterminant le genre, en le
rduisant un "air de famille". Quand un tel passage n'est pas dommageable
pour la thorie gnrique, cest que les ralisations du genre ont t limites
quelques cas exemplaires, comme cest le cas chez Suleiman qui n'envisage
pas les uvres de Bordeaux, de Bernanos, de Guilloux, de Brasillach ou de
Martin du Gard (1983, P. 27). Dterminer rtrospectivement un genre, c'est par
consquent prsupposer que l'on avait affaire un genre inconnu, cach ;
revenir notre roman gnrique.
Naturellement, ce besoin d'hypostasier des ressemblances textuelles
s'enracine trs loin dans le dsir du poticien ou du critique. Il est difficile
d'tudier une pratique sans cder un dsir ontologique dont Barthes a bien
analys le mcanisme, propos de la photographie, au dbut de La chambre
claire :
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
331
"J 'tais saisi l'gard de la Photographie d'un dsir
ontologique : je voulais tout prix savoir ce qu'elle tait
'en soi', par quel trait essentiel elle se distinguait de la
communaut des images. Un tel dsir voulait dire qu'au
fond, en dehors des vidences venues de la technique et
de l'usage et en dpit de sa formidable expansion
contemporaine, je n'tais pas sr que la Photographie
existt, qu'elle disposait d'un 'gnie' propre" (1980, pp.
13-14).
Donner un phnomne littraire le rang de genre, c'est s'assurer de sa
consistance, refouler les doutes que l'on peut avoir quant l'unit de ses
manifestations, quant la cohrence de sa dfinition. Comme on s'en doute,
l'autofiction veille un tel dsir ontologique , sa sduction pousse
l'objectiver, lui offrir un "en-soi". La thorie semble alors plus allgre, le
rapprochement de textes sensiblement diffrents plus lgitime, leurs analyses
plus convaincantes. Cette ontologisation napporte pourtant que des
confusions. Dire que l'autofiction est un genre au sens fort, un modle
d'criture, c'est fausser sa ralit littraire et historique et donner au dispositif
une valeur explicative qu'il n'a pas en lui-mme, puisque selon les usages qu'il
en est fait, ses effets sont opposs*
Une question rsiste tout de mme. Comment expliquer que la figure
dnonciation de l'autofiction : 1) existe autrement qu'une catgorie possible ; 2)
soit ralise de faon si rcurrente travers les sicles. Bref, lempirie se fait in-
sistante. Devant cette situation, le thoricien se trouve un peu comme Saussure
devant ses anagrammes : un phnomne discursif ritr, dont personne ne
parle et dont le principe est invisible. De mme lexistence et la rcurrence de
l'autofiction, sa ralisation effective et sa permanence (deux points ne pas
confondre) ne se laissent pas rduire facilement.
Examinons d'abord le problme de l'existence du dispositif autofictif.
Comment expliquer qu'un agencement aussi bizarre, aussi inattendu, aussi
risqu pour la stabilit d'une nonciation ait pu voir le jour, sans se cantonner
l'tat de possible ? Il faut penser ce principe de pathologie gnrale rappele
par Freud : ... tout processus contient les germes dune disposition
pathologique, en tant qu'il peut tre inhib, retard ou entrav dans son cours
(1908p p. 54). Si l'on transpose ce principe dans le domaine de
l'autobiographie, on peut avancer que tout autobiographe a sans doute pens
un jour ou l'autre, qu'il tait possible de pervertir les paramtres de son
entreprise, dcrire non pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de sa vie rve,
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
332
de sa vie invente. Dans l'criture de soi, il est invitable de reconstruire son
existence, de recrer ce qu'on a vcu : l'auteur le plus honnte, le moins nar-
cissique, doit procder des simplifications, des raccourcis, des distorsions,
parce qu'il doit couler une trajectoire temporelle dans un systme de signes.
Dans l'entreprise autobiographique, il y a donc une part d'invention irrductible,
sous peine de ne pas arriver communiquer. Un crivain conscient de ce
mcanisme peut alors dsirer lui donner libre cours, chercher l'isoler et
l'exorbiter, le dvelopper pour lui-mme. Surtout s'il se trouve dans
l'incapacit de raconter sa vie, ou gn dans cette entreprise, ou peu heureux
du sort que la fortune lui a fait - ou s'il doute de l'intrt du projet auto-
biographique.
Restif a ainsi, la fin de son existence, le projet d'crire des Revues,
c'est--dire de mener bien des "Histoires refaites sous une autre hypothse
du Cur humain dvoil". qui est le second titre de sa monumentale
autobiographie, plus connu sous l'intitul de Monsieur Nicolas :
"Pour que l'homme pt tre heureux, il lui faudrait une
prudence qu'il ne peut avoir que par l'exprience. En
consquence, il lui faudrait deux vies connexes et sans
intervalle. Revivre serait sa vritable vie. Car la nature
aurait dispos les choses de faon que l'homme ou la
femme repasseraient ncessairement par les mmes
circonstances, les mmes relations avec les mmes
personnes ; qui par consquent revivraient galement"
(Posthumes, t. IVe 1802).
Rappelons, dans le mme ordre d'ide, que la linguistique a montr
depuis longtemps que tout systme produit un anti-systme, que toute
opposition dichotomique produit tt ou tard son terme neutre (Dubois, 1965).
On voit mal pourquoi ce phnomne n'aurait pas cours dans le champ littraire.
L'existence depuis l'antiquit de l'opposition fiction vs rfrence autorisait sa
neutralisation et la cration d'un texte annulant les paramtres de ces deux
registres, brouillant les repres de ces deux formes de discours. Ds lors,
l'autofiction est tout simplement une posture d'nonciation ( Imaginons que je
sois... ) dont la possibilit se trouve inscrite dans toute conomie discursive,
dans l'ordre du discours lui-mme, et qui devait tt ou tard se trouve ralise.
Plus difficile comprendre semble-t-il, sont les ralisations rptes de
cette posture dnonciation travers l'histoire littraire certes cette posture est
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
333
possible, le dispositif de l'autofiction existe virtuellement, mais comment se fait-il
qu'il ait fonctionn si longtemps sans avoir d'identit propre ?
Notons d'abord que ce phnomne n'est pas rare dans l'histoire de la
culture :
Il arrive qu'un agencement existe depuis longtemps,
avant qu'il reoive un nom propre qui lui donne une
consistance particulire comme s'il se dtachait alors dun
rgime plus gnral pour prendre une sorte d'autonomie :
ainsi 'sadisme' masochisme. (Deleuze, 1977, p. 143).
Les thmes et les pratiques du sadisme et du masochisme ont exist,
mme en littrature, avant que le Marquis de Sade et que Sacher-Masoch n'en
fassent la matire de leurs uvres et qu'ils ne les marquent de leurs noms.
Auparavant, ces deux configurations thmatiques fonctionnaient fondues dans
des ensembles plus vastes (Eros, la Violence, le Mal) qui ne permettaient pas
d'en prvoir l'mancipation, ni peut-tre d'en distinguer la spcificit. Ce fut, et
c'est en partie encore, exactement la situation de l'autofiction. Elle se confondait
avec quantit de pratiques fictionnelles marginales : l'autobiographie
mensongre, le roman personnel, le roman a clefs, la biofiction , la faction, le
dialogue implication auctoriale, le texte rflexif etc. Il fallait que cette forme de
fiction rponde a un besoin nouveau pour qu'elle reoive un nom, soit dissocie
et pour que ses effets deviennent notables.
Ce changement de rgime d'un phnomne littraire, J . Tynianov l'a
situe en le replaant dans l'histoire littraire et en signalant toute son
importance. Comme il le montre dans le contexte russe, ce phnomne n'est
pas plus mystrieux que le phnomne exactement inverse, le "tragique
orphelinat d'une fonction sans forme". la situation plus connue o une
gnration littraire cherche vainement des moyens formels pour renouveler un
genre, traduire un aspect indit de la ralit, rpondre une demande sociale.
Puisqu'il existe des questions dont les solutions restent en suspens, pourquoi
n'existerait-il pas des rponses dont les questions restent trouver ? En 1927,
Tynianov dclarait que ces deux problmes (une forme sans fonction, une
fonction sans forme) taient encore inexplors et il affirmait que l'tude du
discours en tant que "srie" (ensemble de rgularits) et en tant que "systme"
(ensemble d'nonciations singulires), "dpend des tudes futures sur ce sujet"
(1927, p. 130). Plus d'un demi-sicle plus tard, force est d'avouer que l'on n'a
pas beaucoup progress dans ce domaine L'histoire littraire demeure un
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
334
parent pauvre des tudes littraires. Pourtant, si l'on se dcidait aborder ces
questions, peut-tre que le destin obscur de l'autofiction serait un lment pour
voir plus clair dans la dynamique interne de la littrature.
Une dernire explication, suggre par Genette, la permanence
historique de l'autofiction, malgr l'absence de conscience gnrique, peut-tre
trouve dans une sorte de fondement existentiel. Chez les enfants, la
thtralisation de soi, l'action de jouer un rle, est une forme spontane de la
conduite et du discours. L'enfant, "naturellement", simule des comportements
fictifs, joue tre autre chose que ce qu'il est. Chez l'adulte, ce jeu se
transforme, Freud et Winnicott l'ont montr en rverie veille, en exploration
de son "aire transitionnelle' bauches de fiction o le sujet aime figurer. Tous
les ges de la vie se rvlent sensibles la fictionnalisation de soi, qu'il
s'agisse de la produire ou de la recevoir. L'exprience humaine cre par
consquent en chacun le lieu d'un accueil pour l'autofiction. Ceci explique qu'un
agencement en apparence impossible, faisant appel des moyens discursifs
antagonistes, produise un effet rel. L'agencement d'nonciation de l'autofiction
n'est pas homogne, il fait fonctionner ensemble des lments contradictoires.
Mais son enracinement anthropologique permet leur ajustement et leur
co-fonctionnement. L'autofiction trouve ainsi son origine et sa permanence dans
le discours et l'exprience humaines, tout simplement.
En rsum, il faut donc noter que l'autofiction n'est pas un genre, sous
quelque forme que ce soit ; il s'agit tout au plus d'un agencement discursif
autour duquel se sont rencontrs un certain nombre d'crivains et d'une
catgorie de lecture en train d'merger. Certes, rien ne dit que le nom "auto-
fiction" et l'intrt que la chose suscite, ne se rpercuteront pas sur les
pratiques venir et ne permettront pas la cristallisation d'un genre. Mais en
attendant, il serait sage de ne pas hypostasier cette posture d'nonciation et de
suivre cet avertissement de Lichtenberg, qui l'empruntait lui-mme au Novum
Organum de Bacon : "L o l'homme aperoit un tout petit peu d'ordre, il en
suppose immdiatement trop".
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
335
C 0 N C L U S I 0 N
FICTIONNALISATION RESTREINTE ET
FICTIONNALISATION GENERALISEE
La marque mme d'une profonde nouveaut, c'est
son pouvoir rtroactif .
M. Butor.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
336
Soucieux de suivre le conseil de Bacon, on ne cherchera pas imposer
un semblant d'ordre nos rsultats, on ne tentera pas une synthse finale. Non
pas que la "compulsion de synthse" nous paraisse une propension
dangereuse, mais parce que son exercice n'apporterait rien cet essai. Pas
davantage, on ne ratiocinera sur l'avenir de l'autofiction si cette pratique semble
"prendre", rien ne permet de s'riger en prophte et de lui annoncer l'avenir
radieux d'un genre littraire.
Par contre, on tentera de prendre du champ en s'attardant sur lintrt
que peut reprsenter la notion d'autofiction pour les tudes littraires, pour une
meilleure comprhension du discours littraire et de ses nonciations
singulires. On voudrait montrer le caractre heuristique de cet objet pour la
thorie littraire et l'efficacit de son identification pour la lecture critique des
uvres. Ce sera l'occasion la fois de replacer l'autofiction dans l'ensemble de
la littrature, comme y invitait la rflexion de Barthes, et de tracer les limites de
notre recherche.
En quoi l'autofiction peut servir la recherche en littrature ? Il nous
semble qu'elle constitue une puissante incitation la rflexion thorique, qu'elle
fonctionne comme un instrument extrmement sensible pour enregistrer les
points nvralgiques du discours littraire. On se sera peut-tre tonn de la
multitude des problmes de fond rencontrs au cours de ce travail. L'tude de
l'autofiction conduit comme invitablement entrecroiser des problmatiques
distinctes : problmatique de l'onomastique littraire, du personnage, de la
thorie et de la description de la fiction, des stratgies discursives et de leur
volution, des effets de lecture et de la rception, de l'auteur et de la nature de
l'activit littraire, problmatique si complexe, enfin, de l'histoire littraire.
Non sans raison, on pourrait penser que ces rencontres ont t trop
nombreuses pour tre fructueuses. Toutes ces problmatiques constituent
souvent elles seules des domaines de recherche autonomes, dont certains
sont peine explors. De fait, cette confrontation ne fut pas toujours facile. On
a parfois procd des simplifications dommageables, propos des solutions
qui paratront simplistes, nglig des aspects importants. Ainsi pour la tentative
d'adapter la notion confuse de personnage notre projet ; pour l'examen des
modalisateurs fictionnels et de la nature de la fiction, qui demanderait tre
enrichi par des travaux rcents ; pour notre mise au point sur l'opposition entre
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
337
la fiction et la rfrence dans l'histoire littraire. Ces limites ne soulignent
pourtant que davantage le caractre roboratif de cet objet pour la recherche
thorique et potique. Comme si l'autofiction tait aux confluents des sources
les plus ncessaires du discours littraire.
A quoi tient cette fcondit thorique ? Sans doute faut-il prendre en
compte le fait que l'autofiction est une pratique, sinon gnrique, du moins
d'ordre gnrique. L'tude d'une stratgie d'criture globale engage forcment.
directement ou non, la totalit du discours littraire. Mais cela ne serait pas
aussi tangible si l'autofiction n'tait pas une pratique mettant en jeu le mode de
fonctionnement le plus intime de la littrature d'imagination. Si elle est aussi
paradoxale, si elle met en cause autant d'aspects de la littrature, c'est qu'elle
ne fait au fond qu'exorbiter une logique intrinsque de son nonciation
imaginaire.
Expliquons-nous. Lors de l'analyse des "emplois" possibles de la figure
auctoriale, on a vu que le rcit ne faisait pas disparatre proprement parler
l'auteur, comme l'a cru un peu vite notre modernit, mais qu'elle le dotait d'un
statut et dun rle propres la narration. Dans la narration fictionnelle
htrodigtique, l'auteur adapte sa voix la fiction d'un rcit, en mme temps
qu'elle lui sert drouler un rcit de fiction. C'est ce phnomne qui a interdit la
prise en compte d'une doublure htrodigtique de l'auteur, d'une
autofiction qui fonctionnerait au seul niveau de la narration. Il est temps
cependant de noter que cette transformation de l'auteur en narrateur est une
sorte de fictionnalisation, une fictionnalisation de soi restreinte. Comme dans
l'autofiction. l'crivain se ddouble dans le texte, et son double conserve son
identit, mais en tant mtamorphos, dpersonnalis, dot d'un emploi fictif de
conteur, quoiqu'il n'intervienne pas dans l'histoire. Cette transformation
fictionnelle s'exerce-t-elle dans tous les types de rcit ? On peut douter en effet,
d'une irralisation comparable si le narrateur htrodigtique est imperceptible
comme chez Hemingway, davantage encore si le narrateur est homodigtique,
si c'est un narrateur-personnage avec une identit propre.
Pour le premier cas, il faut rappeler avec Genette que le rcit est toujours
un "discours", un "acte de communication". ce qui implique un sujet de
l'nonciation, qu'on appelle "auteur" :
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
338
"Dans le rcit le plus sobre, quelqu'un me parle, me
raconte une histoire, m'invite l'entendre comme il la
raconte, et cette invite - confiance ou pression - constitue
une indniable attitude de narration, et donc de narrateur :
mme la premire phrase de The Killers tarte a la crme
du rcit 'objectif', 'The door of Henrys lunch-room
opened... prsuppose un narrataire capable entre autres
d'accepter la familiarit fictive de 'Henry', l'existence de la
salle--manger, l'unicit de sa porte, et ainsi, comme on
dit fort bien, d'entrer dans la fiction" (1983, p. 68).
Ainsi, mme quand la prsence du narrateur est insensible, l'irralisation
de l'auteur est effective, c'est mme le comble de l'irralisation si on y rflchit.
On a alors comme le degr zro de la fictionnalisation de soi, une mutation o
le rcit parat s'noncer de lui-mme et l'auteur avec le narrateur s'tre
vanouis.
Est-ce vrai aussi des rcits narrateur homodgtique ? Assurment,
ceci prs que cette fois le terre de dralisation conviendrait mieux. Dans le
roman pseudo-autobiographique, l'crivain feint de laisser parler un autre sa
place, ce qui produit l'imitation d'un acte de langage, au lieu d'une mimsis de
ralit. Mais il est toujours partie prenante dans une situation de
communication, engag dans un procs pragmatique, bien qu'il s'avance
masqu et qu'il fasse comme s'il cdait la direction du rcit autrui. Et le lecteur
est bien conscient de ce simulacre. S'il accorde sa crance Robinson Cruso
ou Meursault, il ne considre pas pour autant leur nonciation comme
srieuse. Bien plus, si le lecteur venait oublier la simulation de l'crivain, s'il
oubliait totalement son existence, il n'y aurait plus imitation d'une posture de
communication (fiction), mais acte de communication authentique
(l'autobiographie relle de Robinson ou de Meursault). Paradoxalement, c'est
donc l'assomption d'un auteur qui supporte la fictionalit d'un roman
pseudo-autobiographique et d'un auteur qui simule, qui joue faire parler un
autre - sans quoi il n'y aurait pas roman, mais construction dlirante.
Dans toutes les formes de rcit, la logique fictionnelle produit donc, dj,
en-dea de toute mise en scne dans l'intrigue, une drive imaginaire, de
nature pragmatique, de l'crivain. Au cur de l'invention littraire, entre celui
qui raconte et ce qui est racont, une attraction irrpressible a lieu, qui
transmue l'crivain en tre(s) fictif(s), qui amne une surdtermination
d'imagos. Selon le systme de narration choisi, ces ddoublements vont varier
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
339
considrablement et se faire ressentir diffremment. Dans tous les cas, il va
s'agir de rles, de positions discursives ou narratives, qu'il ne faudrait pas
confondre avec l'crivain rel, qui apparat en priv ou en public. Le sujet qui
circule ainsi, qui se divise, sirralise ou se dralise, se transforme en tout cas,
conserve pourtant la mme identit, celle de l'crivain rel. Il appert ainsi toute
fiction fictionnalise le sujet qui la profre. En crivant et en signant une uvre
d'imagination, l'crivain est dj dans le "fictif de l'identit". Mais cette fictionna-
lisation a une porte restreinte ; elle doit tre dchiffre par le lecteur ; elle n'est
pas directement reprsente comme dans l'autofiction. Car elle n'est pas
incarne, personnalise, actorialise . Sans cho dans l'histoire, le
ddoublement de l'auteur n'a pas d'paisseur : son double n'a aucune fonction
digtique et n'est pas un vritable personnage de fiction.
Cette forme rduite de fictionnalisation n'est toutefois pas totalement
trangre, totalement spare de l'histoire. Autrement dit, le statut imaginaire
du narrateur ou de l'auteur n'est jamais compltement coup de la ralit
imaginaire des personnages et de leur monde. C'est trs net dans le roman
pseudo-autobiographique, comme dans le roman pistolaire, qui saccompagne
souvent d'une prsentation fictive par laquelle l'crivain se donne le rle d'un
diteur ou invente un contexte justifiant l'htrologie du rcit - comme le font
Defo pour Robinson ou Sartre pour La Nause. Quand ce n'est pas le cas
comme dans L'tranger de Camus, cette absence n'est pas insignifiante ; elle
souligne cela mme qu'elle prtend esquiver, manifestant ainsi en creux
l'existence d'une relation entre le signataire du livre et un certain Meursault.
Dans le rcit htrodigtique, la proximit du narrateur son univers ima-
ginaire est sensible par le fait que le temps de la narration peut toujours arriver
rattraper celui de l'histoire et crer ainsi de lgres confusions de niveaux
narratifs. Il suffit d'ouvrir au hasard Tom Jones de Fielding pour en trouver :
"Nous avons laiss M. Western, sa sur Sophie et le vicaire Supple retournant
ensemble au chteau? La soire se passe gaiement" (Livre VI, dbut du
chapitre 2). La possibilit d'un tel tlescopage atteste que le narrateur est en
permanence contigu a sa fiction dans cette forme de rcit. D'une faon
gnrale, il y a donc bien une relation de voisinage, extradigtique ou
intradigtique, entre l'auteur et son univers fictif. Ce sont les structures mmes
de la langue et de la narration qui favorisent une telle mitoyennet.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
340
La manire dont les crivains vivent et pensent ce voisinage intime avec
la fiction, dont les lecteurs se reprsentent ce contact, a t peu tudie.
Pourtant, il y a. l un thme mtalittraire qui mriterait un examen attentif, par
ce qu'il peut apprendre sur la place et le rle de la fiction dans l'imaginaire d'une
poque ; ce qui ne peut manquer d'intresser la constitution d'une perspective
historique pour tudier l'autofiction.
Au XIXe sicle, par exemple, cette proximit semble avoir t ressentie
avec une acuit toute particulire, comme une sorte de contagion. Le cas de
Balzac est bien connu. Ds 1821, alors qu'il n'est qu'un crivain dbutant, il
crit sa sur Laure : "Depuis que je m'en suis aperu, je me tiens en garde
contre l'intemprance de l'imagination". Dans sa Thorie de la dmarche, il
formule la fameuse parabole du fouet du savant, qui peut se lire comme
l'alternative qui se pose a tout crivain face sa cration : le choix du fou qui
dcouvre un abme et y tombe ou celui du savant qui le mesure et remonte
chez lui en se frottant les mains. A propos de La comdie humaine, il crira un
jour qu'il avait port une socit tout entire en lui. Et sur son lit de mort, la
lgende l'affirme, c'est Bianchon qu'il demandera. Mais au-del de la lgende,
appele ou posthume, Balzac a tenu exhiber cette contagion de la fiction
dans sa propre criture. Parfois en la thmatisant explicitement, comme dans la
Prface Histoire des Treize, o il se prsente comme l'historiographe d'un de
ses personnages, inversant le processus gntique de l'art romanesque pour
se donner comme la consquence, un effet de sa fiction ; dans plusieurs motifs
de son uvre, ns de cette exprience vcue si intensment de l'irralisation
qu'entrane un travail cratif forcen : le fameux don de double vue ou le motif
de la vie vcue par procuration, formuls en des termes emprunts au registre
littraire et qui sont si insistants dans ses romans. D'autres fois, par une sorte
de marquage systmatique de ses histoires, comme dans ces multiples
chevilles ou parenthses mtadiscursives, par lesquelles ses romans se
renvoient les uns aux autres, rfrent la totalit qui les subsume, qui lui
permettent de s'impliquer directement dans l'acte narratif de ses histoires.
Plus fascinant encore, bien sr, est le cas de Nerval, qui lve cette
contagion au phnomne de possession. Vcu plus intensment et plus
consciemment, la dralisation littraire lui a permis des pages inspires. Dans
la ddicace Alexandre Dumas, cite plus haut, il signale l'effet d'identification
dont l'criture narrative se rvle parfois responsable. Obsession, vertige,
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
341
dsordre mental, cet "panchement du songe dans la vie relle" lui parait un
vritable risque pour l'crivain. Dans Les Illumins, publi deux ans plus tt, il
avait dj abord ce thme. Avec son tude sur Restif, certes, o il cite un
passage tonnant que nous avons mis en exergue a cet essai : "On croit
s'instruire par les fables : eh bien Moi, je suis un grand fabuliste qui instruit les
autres ses dpens...". Mais aussi dans sa prsentation de Cazotte o il dcrit
l'auteur du Diable boiteux comme tant, par excellence, le pote qui croit
sa fable, le narrateur qui croit sa lgende, l'inventeur qui prend au srieux le
rve clos de sa pense... (1852, pp. 272-273) et o il affirme que c'est l
le plus terrible danger de la vie littraire, celui de prendre au srieux ses
propres inventions... Il (p. 280). Cette pathologie de la fiction qui guette
l'crivain n'est pas une mystification, ni le simple rve d'un pote. Plus d'un
sicle plus tard, dans un contexte culturel pourtant diffrent, l'auteur du fameux
roman de science-fiction Ubik, Ph. K. Dick, a prononc Metz, en 1977, un
discours de plus de deux heures o il affirmait, devant une assemble
mduse, la ralit de ses univers parallles et de ses rencontres personnelles
avec Dieu. Cette contamination fictionnelle fait un curieux pendant aux
identifications pathologiques causes par la lecture romanesque,
emblmatises par la figure du Quichotte. Plus rare, moins perue peut-tre,
cette maladie littraire ne semble gure avoir t dnonce ni analyse. Dans
l'imaginaire occidental, elle n'occupe pas, en tous cas, la place du thme sym-
trique des dangers de la lecture.
Mais ce qui nous intresse chez Nerval, c'est qu'il unit d'un trait la
conscience de la contagion fictionnelle qui guette l'exercice de la cration
littraire et la pratique dlibre, consciente, d'une forme d'criture qui assume
et recherche ce risque : la fiction de soi. Avec Nerval, on a l'exemple rare d'un
crivain qui a tent cette aventure fictionnelle en l'articulant directement sa
prsence informelle dans la fiction littraire. Son uvre permet ainsi de
comprendre que l'autofiction n'est qu'un passage la limite d'un phnomne
inhrent l'invention littraire, qu'elle n'est que la gnralisation d'une
fictionnalisation produite sous une forme restreinte par toute fiction : lorsque
l'intrigue met nominalement en scne l'crivain, cest l'criture comme
processus de dralisation ou d'irralisation qui se reprsente, en l'incarnant et
en le redupliquant. D'o, sans aucun doute, cette propension de l'autofiction
soulever, l'analyse, autant de questions thoriques gnrales. Vritable
compendium de cette activit fascinante qu'est la cration littraire, elle ras-
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
342
semble et noue autour de son existence improbable tous les fils du discours
littraire.
Car comme on le verra plus loin, ce ddoublement entrane avec lui les
principaux ples de l'activit littraire. Tout peut faire problme dans un texte
qui actualise le dispositif de l'autofiction. Selon les choix de l'crivain, dans sa
ralisation des protocoles, dans son ddoublement fictionnel, dans l'histoire
conte, c'est le paratexte, l'auteur, le personnage, les indices de fictionalit, la
place du lecteur, l'effet de lecture ou la stratgie discursive qui sera soumis un
travail de dplacement important, un par un, plusieurs en mme temps ou tous
ensemble. L'autofiction apparat ainsi comme une machine problmatiser les
conventions, les attitudes et les attentes reues en matire littraire ; comme
une machine duplexer les failles caches, les antinomies rentres, sur les-
quelles s'est btie la fiction.
Cette vocation des nonciations singulires qui travaillent la possibilit
du dispositif autofictif, qui l'incarnent, le portent, le poussent en avant,
l'exprimentent, bref le ralisent, va permettre de se demander en quoi la notion
dautofiction peut aider la recherche empirique sur la littrature, la critique
d'auteurs. Disons-le sans ambages, l'autofiction, la conscience de son
existence, des multiples modalits de son effectuation, de sa rcurrence, nous
parat tre un puissant instrument danalyse pour quantit d'crivains qui ont
peru, recherch, exploit, parfois sous-estim parfois conjur les vertiges de la
fiction.
Cette affirmation vise naturellement tous les crivains insolites, rputs
inclassables, comme Restif, Nerval, Cendrars ou Gombrowicz et, pour citer des
contemporains immdiats, Copi, Sollers, Charyn, Salinger, que les outils
d'analyse ordinaires chouent cerner. Pour tous ces crivains en marge des
partages traditionnels, en rupture par rapport aux systmes de communication
conventionnels, le mode de la fictionnalisation donne, directement ou par
comparaison, des moyens pour aborder positivement leur excentricit. Alors
que la plupart des lectures de leur uvre mconnaissent leur dtermination
fictionnalisante, ce modle permet de leur donner comme un coefficient de
fictionnalisation, de formuler les coordonnes de leur drive nonciative. Loin
de s'engluer dans des notions inconsistantes comme celles de "roman
insincre" ou de l'autobiographie mensongre". d'annuler la fermet de leur
programme en les mettant au compte du fantasme, de la posie, du dlire, de
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
343
lsotrisme ou d'une lubie personnelle, ce modle ouvre sur une analyse qui
prend au srieux leur "torsion" fictionnelle, apporte une valeur l'inconnue qui
travaille leur lisibilit.
Au demeurant, mme chez des crivains moins atypiques, il n'est pas
rare que l'on dcouvre, dans un coin de leur corpus, un texte frapp d'un tel
coefficient de fictionnalisation, quand bien mme sa teneur ne serait pas
vritablement autofictive, comme L'Impromptu de Versailles chez Molire, Ren
chez Chateaubriand ou Giacomo Joyce chez l'auteur d'Ulysse. Par sa
disponibilit fonctionnelle, le dispositif de l'autofiction se montre alors utile pour
considrer ces textes dcrts mineurs dans leur monumentalit , des
uvres au sens fort du terme, mme si leur situation marginale est
incontestable, et qui peuvent en dire long malgr leur dcentrement.
Aussi bien, l'intrt du modle autofictif ne se limite pas des cas-limites
d'criture fictionnelle. Il peut aussi ouvrir de nouvelles perspectives sur des
crivains et des uvres jugs "classiques", tort ou a raison, comme Lucien,
Dante Diderot, Proust etc. On n'a pas assez soulign que quelques-uns des
textes les plus considrables de notre panthon littraire appartenaient ce
registre impossible. Toutes ces uvres qu'on ne finit pas de clbrer,
d'interroger, de commenter et/ou de traduire, hantent notre culture sans que
pourtant on accueille pleinement, en toute connaissance de cause, leur
remaniement commun des catgories d'auteur, de registre et de position d'-
nonciation. L'conomie de cette orchestration parat comme occulte, relgue
et finalement refoule sous la forme d'un reste que l'on signale, sans lui donner
une place ou il existerait pour lui-mme et avec des effets qui lui seraient
propres.
Sans doute, notre approche de tous ces crivains, de toutes ces
nonciations dcales, parfois isoles, parfois dresses en stratgie d'criture,
a d paratre souvent sommaire, souvent partielle. Notre travail a consiste en
grande partie a identifier et mettre en perspective leur rupture. Sur bien des
points, ces analyses sont insatisfaisantes : il faudrait une tude plus complte
et plus spcifie des effets du dispositif quand il est actualis de faon
complexe, par toutes les formes possibles dhomonymie indirecte ; les cas
ambigus mriteraient de plus une tude plus fine ; Ia fonction figurative est
dcrite, enfin, dune faon trop gnrale, qu'il serait ncessaire d'ajuster la
matire, aux enjeux et l'conomie de chaque crivain. Reste que le cadre trs
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
344
gnral de cette recherche rendait difficile un abord spcifique de chaque cri-
vain d'autofiction. En outre, ces limites ne remettent pas en cause, nous
semble-t-il, la validit empirique de notre modle. Si elles pchent, c'est par leur
caractre approximatif, mais elles nous paraissent dans l'ensemble s'avancer
dans une direction qui est bien celle emprunte par ces uvres.
La fertilit empirique de cette forme de fiction n'est pas non plus un
hasard, bien qu'elle ne tienne pas au fait que l'autofiction soit un prtendu
modle d'criture cach, travaillant en secret l'histoire. Elle vient aussi de cette
mise plat et de cette rduplication de la logique inhrente la littrature
d'imagination qu'on a signale prcdemment. Dans cette opration, les trois
sommets du triangle pragmatique qui structure le procs de communication
littraire (lauteur, la mode discursif et le lecteur) sont soumis un travail de
transformation important.
Ces trois sommets, tout crivain doit s'y confronter, y engager son
criture, ses enjeux personnels et son "programme" littraire, en les acceptant
tels qu'il les a hrits ou en les transformant. Ce sont les limites extrmes de la
littrature, les bords o s'labore son discours ; ce par quoi elle s'effectue
s'actualise et se pense des bordures presque insondables la limite du
pensable, prilleuses, la frontire entre le sens et le non-sens, la cohrence
et l'informe, la communication et le bruit ; aux confins de la narration et de la
reprsentation. Par suite, il n'est gure tonnant qu'autant de textes
considrables, avec lesquels notre Culture doit compter, s'oprent dans
l'espace de cette situation d'nonciation limite qu'est l'autofiction. Car qu'est-ce
qu'un crivain insolite, dont la rception fait problme ? Qu'est-ce qu'un "grand
crivain", dont la rception est inpuisable ? Sinon quelqu'un qui touche aux
ressorts fondamentaux du procs littraire, soit en les troublant, soit en les
transformant considrablement, soit les deux la fois ? Le rappel de ce truisme
explique que notre modle ait un pouvoir rtroactif aussi fort, qu'il puisse s'ap-
pliquer des crivains aussi diffrents, d'poques si diverses, de cultures si
varies. Bien qu'il n'ait aucune porte explicative, qu'il ne soit qu'une forme
vide, ce modle d'nonciation renferme les paramtres essentiels l'acte
littraire, qui traversent les gnrations, les poques et les pistms, comme
toutes les formes discursives fondamentales. C'est ce qui explique le caractre
polyvalent du dispositif, capable de remplir des fonctions diverses, et mme
contradictoires, comme on l'a vu en tudiant ses usages rfrentiel et rflexif.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
345
Mais au sein mme de la fonction figurative, d'une fictionnalisation de soi
obissant une vise purement fictionnelle, le dispositif autofictif doit obir
des enjeux littraires diffrents, recevoir des expressions idologiques varies
et s'oprer sur l'horizon de conceptions du monde htrognes. Qu'un auteur
latin comme Lucien ralise, avec son Histoire vritable, une autofiction
dclare, dans une pistm o la fable a un visage autre que celui que nous
lui connaissons, le montre. L'une des limites de cette recherche est de n'avoir
pas pu marquer cette htrognit. Mais en l'absence dune pragmatique
littraire historique, cette limite tait peut-tre invitable.
Simple exfoliation du champ pragmatique, l'autofiction se prsente ainsi
comme une situation d'nonciation indite, qui vient faire clater une dichotomie
rductrice : littrature vcue ou littrature d'imagination ? Cet clatement libre
de bien des faux problmes et promet un vaste champ de recherches
thoriques et d'analyses empiriques. Avec cette forme inopine de fiction, la
littrature montre que, depuis trs longtemps, sa mthode et sa russite sans
faire sauter les "crans d'arrt et les verrous de sret du discours et du
langage.
Aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau ? Oui, mais l'inconnu
est aussi autour de nous, ct de nous, en nous : "Pourquoi chercher du
neuf? Tout est neuf", disait un philosophe.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
346
B I B L I 0 G R A P H I E
"To love oneself is the beginning
of a life-long romance."
0. Wilde
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
347
Cette liste a t limite aux ouvrages cits ou analyss, dont les rfrences
n'ont pas t donnes dans le texte. Ils ont t rpartis sous trois rubriques :
corpus des textes o l'auteur se fictionnalise; ouvrages thoriques et critiques;
ouvrages littraires. Pour la premire section, on a indiqu trs grossirement
la fonction de la fictionnalisation: (+) quand elle est rfrentielle (didactique ou
biographique), (=) quand elle est rflexive et (*) si elle est figurative. Mais il ne
s'agit jamais que d'une dominante, certains textes sont ambigus.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
348
I- C 0 R P U S
"J e trouve la lettre K repoussante, presque
rpugnante, et pourtant je l'cris, elle doit me
caractriser".
F. Kafka.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
349
- A -
- Ablard P., Dialogue entre un juif, un philosophe et un chrtien, in Oeuvres
choisies, Tr. M. de Candillac, Aubier, 1945, (+).
- Alain, "Denys ou l'Ambitieux", La Nouvelle Revue Franaise, n292,
avril 1977, (+).
- Anouilh J ., La Grotte, Gallimard, Coll. Folio, 1977, (+).
- Auster P., Cit de verre, Tr. P. Furlan, Actes Sud, 1987, (*).
- B -
- Balzac H. de, Facino Cane, Luvre de Balzac, t.2, Le Club franais du livre,
1953, (*).
- Bastide F-R., La Vie rve, Seuil, 1962, (+).
- L'Enchanteur et nous, Grasset, 1981, (+).
- Blondin A., Monsieur Jadis ou l'Ecole du soir, La Table ronde, 1970, (+).
- Borges J .L., "L'Aleph" in L'Aleph, Tr. R. Caillois et R.L.-F. Durand, Gallimard,
1967, (*).
- Brink A., Le Mur de la peste, Tr. J . Guiloineau, Stock, 1984, (+).
- Bryce-Echenique A., La Vie exagre de Martin Romaa, Tr. J .M.Saint-Lu
Luneau Ascot ed., 1983, (*).
- Butor M., L'Emploi du Temps, Minuit, 1956, (+). Matire de rves, Gallimard,
1975-1985, 5 vol.,(+). Troisime dessous, 1977, est le III vol. de ce cycle.
- C -
- Calvino I., Si par une nuit d'hiver un voyageur, Tr. D. Sallenave et F. Wahl,
Seuil, 1981, (=).
- Cavanna, Maria, Belfond, 1985, (*).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
350
- Cendrars B., Moganni Nameh, (*). o.c.t.4, L'Eubage, o.c.t.2, (*). Moravagine,
o.c.t.2, (*). Une nuit dans la Fort, o.c.t.7, (+). Bourlinguer, o.c.t.6, (+).
Emmne-moi au bout du monde!.... o.c.t.7, (=). Il s'agit de l'dition Denol en
huit volumes (1960-1965).
- Cline L.-F., L'Eglise, Gallimard, 1952, (*). Voyage au bout de la nuit, in
Romans, Bibl. de la Pliade, t.I, 1981, (*). Mort Crdit, Pliade, t.I, (*).
Normance, Gallimard, Coll. Folio, 1978, (*). D'un Chteau l'autre, in Romans, t.
II, Bibl. de la Pliade, 1974, (*). Nord, Pliade t. II, (*). Rigodon, Pliade t. II, (*).
- Cervants M. de, L'Ingnieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, tr J .
Cassou, C. Oudin et F. Rosset, Bibl. de la Pliade, 1976, (=).
- Chamson A., "Le Dernier village" in Suite guerrire, Plon, 1975, (+).
- Charyn J ., Poisson-chat, trad fr. D. Mauroc, Seuil, 1982, (*).
- Chateaubriand R.-F. de, Ren, in Atala-Ren, Flammarion, Coll. GF, 1964,
(+).
- Cohen A., Mangeclous, Gallimard, Coll. Folio, 1980, (=). Belle du Seigneur,
Gallimard, 1968, (=).
- Colette, La Retraite sentimentale, Gallimard, Coll. Folio, 1972, (=). Le
Miroir , in Sido suivi de Les Vrilles de la Vigne, Hachette, Coll. Le Livre de
Poche, s.d., (=).
- Copi, La Guerre des Pds, A. Michel, 1982, (*).
- D -
- Dante, La Divine Comdie, Tr. A. Masseron, Albin Michel, 1950, (?).
- Diderot D., Paradoxe sur le comdien, (*). Rve de d'Alembert, (*). Entretien
sur le "Fils naturel", (*). Entretien avec d'Alembert, (*). Le Neveu de Rameau,
(*). Bibl. de la Pliade, 1957.
- Doubrovsky S., Fils, Galile, 1977, (+). Un Amour de soi, Hachette, 1982, (+).
La Vie l'instant, Balland, 1985, (+).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
351
- Duras M., "Albert des Capitales" in La Douleur, P.O.L., 1985, (+).
- F -
- Fontenelle, Entretiens sur la pluralit des mondes, Marabout, 1973, (+).
- Franois J ., Joue nous "Espa",. Mercure de France, 1980, (+).
- Fuantes C.,.Une Certaine parent, Trad. fr. C. Zins, Gallimard, 1981, (*).
- Futoransky L., Chinois chinoiseries, trad. fr. A. Morvan, Actes Sud, 1984, (+).
De Pe a Pa (0 de Pekin a Paris), Anagrama, 1986, Barcelone, (+).
- G -
- Gide A., Paludes, Gallimard, Coll. Folio, 1973, (*). Les Faux-Monnayeurs,
Gallimard, Coll. Folio, 1972, (*).
- Giraudoux J ., Siegfrid et le Limousin, B. Grasset, Coll. Le Livre de Poche,
1956, (*). Sodome et Gomorrhe, B. Grasset, 1969, (*).
- Genet J ., Miracle de la rose (1946), Gallimard, Coll. Folio, 1977,
Notre-Dame-des-Fleurs (1948), Gallimard, Coll. Folio, 1978, (*). Journal du
voleur, (1949), Gallimard, Coll. Folio, 1982, (*). Pompes Funbres (1953),
Gallimard, Coll. L'imaginaire, 1981, (*).
- Gombrowicz W., Ferdydurke, Tr. G. Sdir, 10/18, 1973, La Pornographie, Tr.
G. Lisowski, Ren J ulliard, 1962, (*). Cosmos, Tr. G. Sdir, Denok, Coll. Les
Lettres nouvelles, 1966, (*). Trans-Atlantique, Tr. C. J elenski et G. Serreau,
Denol, Coll. Les Lettres nouvelles, 1976, (*). L'Histoire (Operette), Tr. C.
J elenski et G. Serreau, Ed. de la diffrence, 1977, (*).
- Grgoire le Grand, Li Dialoge Gregoire Lo Pape, Ed. de W. Foerster, Appert et
Champion, Halle et Paris, 1876, (+).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
352
- H -
- Hamsun K., Sous l'toile d'automne, Tr. R. Boyer, Calmann-Levy, 1978, (*). M.
Un Vagabond joue en sourdine, Tr. R. Boyer, Calmann-Levy, 1979, (*). La
Dernire joie, Tr. R. Boyer, Calmann-Levy, 1979, (*).
- Hesse H., Le Loup des steppes, Tr. J . Pary, Calmann-Levy, 1947, (*).
"Enfance d'un Magicien" et "Esquisse d'une autobiographie", in Enfance d'un
magicien, Tr. E. Beaujon, Calmann-Levy, 1975, (*).
- I -
- Isherwood C., Adieu Berlin, Tr. L. Savitsky, Hachette, 1979, (*). Christopher
et son monde, Tr. L. Dil, Hachette, 1981, (+).
- J -
- J ean-Paul, Biographie conjecturale, Tr. R. Pierre, Aubier, 1981, (*).
- J oyce J ., Giocomo J oyce, Tr. A. du Bouchet, Gallimard, 1973, (?).
- K -
- Kafka F., Le Procs, Tr. A Vialatte, Gallimard, 1957, (*). Le Chteau, Tr. A.
Vialatte, Gallimard, 1965, (*).
- Kierkegaard S., In Vino Veritas, in Le Stade esthtique, Tr. M. Grimault, 10/18,
1966, (*).
- L -
- Lacarrire J ., Le Pays sous l'corce, Seuil, 1980, (*).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
353
- Larbaud V., A.O. Barnabooth, Son Journal intime, La Nouvelle Revue
Franaise, 1922, (*).
- Leibniz G.W., Nouveaux essais sur l'entendement humain, Tr. J . Brunschwig,
Garnier-Flammarion, 1966, (+).
- Leiris M., Aurora, Gallimard, 1973, (*).
- Llosa M.V., La Tante Julia et le scribouillard, Tr. A. Bensoussan, Gallimard,
1979, (*).
- Loti P., Aziyad, Calmann-Levy, Coll. Le Livre de Poche, 1974, (*). Le Mariage
de Loti, Calmann-Levy, Coll. Le Livre de Poche. 1976, (*). Mon frre Yves,
Calmann-Levy, s.d., (*).
- Lucien, Histoire Vritable, Tr. P. d'Ablancourt, Presses Universitaires de
Nancy, 1984, (*).
- M -
- Mann Th., Les Buddenbrook, Tr. G. Bianquis, Arthme Fayard, 1965, (+).
- Marguerite de Navarre, Dialogue en forme de vision nocturne, Ed. critique de
R. Salminen, Suomelainen Tiedeakatemia, Helsinki, 1985, (+).
- Molire, L'Impromptu de Versailles, o.c.t.I, Classiques Carnier, 1962, (+).
- N -
- Nabokov V., Regarde, regarde les arlequins !, Tr. Fr., Fayard, 1978,(*).
- Nerval G., Les Filles de Feu (1854), (*), Aurlia (1855), (*) Oeuvres,
Classiques Garnier, 1966.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
354
- P -
- Perec G., La Boutique obscure, Denol-Gonthier, Coll. "Cause commune".
1973, (+). La Vie mode d'emploi, Hachette, 1978, (=).
- Perron E. du, Le Pays d'origine, Tr. Ph. Noble, Gallimard, 1980, (*).
- Proust M., A la recherche du temps perdu, Bibl. de la Pliade, t.I-III,
1955-1956, (*).
- Q -
- Queneau R., Les Enfants du limon, Gallimard, 1938, (=).
- R -
- Restif de la Bretonne, Le Paysan perverti, 10/18, 1978, Ingnue Saxancourt,
10/18, 1978, (+). Rolin D., L'Infini chez soi, Denol, 1980, (+). Le Gteau des
morts, Denol, 1982, (*).
- Rousseau J .-J ., Rousseau juge de Jean-Jacques, (+) in Confessions - autres
textes autobiographiques, Bibl. de la Pliade, 1951.
- S -
- Salinger J .D., Seymour, une introduction, Tr. B. Willerva, Robert Laffont, 1964,
(*).
- Sollers Ph., Une Curieuse solitude, Seuil, 1958, (*). Femmes, Gallimard, 1983,
(*). Portrait du joueur, Gallimard, 1984, (*). Le Coeur absolu, Gallimard, 1987,
(*).
- Strindberg A., L'crivain, (+), in Dans la Chambre rouge, Tr. A. J olivet, Stock,
1949.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
355
- T -
- Terz A., Andr-la-Poisse, Tr. L. Martinez, A. Michel, 1981, (*).
- Thieuloy J ., Les Os de ma bien-aime, Balland, Coll. L'instant romanesque,
1980, (*).
- Thomas D.M., Poupes russes, Tr. B. Matthieussent, Presses de la
Renaissance, 1985, (+).
- Tournier M., Les Mtores, Gallimard, 1975, (=).
- V -
- Varron, Economie rurale - Livre II, Tr. C. Guiraud, Les Belles Lettres, 1985,
(+).
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
356
II - 0 U V R A G E S L I T T E R A I R E S
"Rien n'est aussi difficile que de ne pas porter un pli ou
un faux pli mental et les citations sont un pliss la mode
scholastique. C'est du galon que l'on se donne. Comme
une plume surnumraire qu'une femme plante dans son
chapeau dj trop bien garni, de paradis d'autruche, de
coq de roche ou un couteau de corbeau."
B. Cendrars.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
357
- B -
- Balzac H. de, Le Lys dans la valle, L'uvre de Balzac, t1, Le Club franais
du livre, 1953.
- C -
- Cendrars B., "Sous le signe de Franois Villon" (1952), La Table ronde n51,
1952.
- D -
- Da Ponte, Mmoires et livrets, Livre de Poche, 1980.
- Dumas A., Mes Mmoires, Denol, 1942.
- F -
- Fielding H., Tom Jones, Tr. H. de la Bdoyre, J ulliard, Coll. Littrature, t 1-2,
1964.
- G -
- Goethe W., Torguato Tasso, Tr. M. Baucher, Bibliothque de la Socit des
tudes germaniques, IAC ed., 1949. Faust et le Second Faust, Tr. G. de Nerval,
Garnier, 1879. Posie et Vrit, Tr. P. du Colombier, Aubier, 1941.
- Gombrowicz W., Journal 1953-1956, Tr. A. Kosko, J ulliard, Coll. Lettres
nouvelles, s.d.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
358
- H -
- Hemingway E., "Les tueurs" in Cinquante mille dollars, Tr. 0. de Weymer,
Gallimard, 1958.
- Hesse H., Le Jeu des Perles de Verre, Tr. J . Martin, Calmann-Levy, 1955.
- Hoppe C., "Ocre Rouge" in Ils vous donnent de leurs nouvelles (ouvrage
collectif), Ramsay/Denol, 1988.
- J -
- J ennings A., Hors la loi!, Tr. B. Cendrars, Grasset, 1936.
- J oly M., Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, Calmann-Levy,
Coll. Libert de l'esprit, 1968.
- J oyce J ., Ulysse, Tr. A. Morel, S. Gilbert, V. Larbaud et J . J oyce, Gallimard,
1948. Le Chat et le Diable, Tr. J . Borel, Gallimard, 1966.
- K -
- Kafka F., Journal, Tr. M. Robert, Grasset, 1954.
- M -
- Maupassant, "L'volution du roman au XIX sicle" in Une Vie, Gallimard, Coll.
Folio, 1974.
- Molire, Les Femmes savantes in Oeuvres Compltes, t.2, Classiques
Garnier, 1962.
- N -
- Nerval G. de, Les Illumins (1852) in Oeuvres, Classiques Garnier, 1966.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
359
- P -
- Ptrarque, Canzoniere, Tr. F.L. de Gramont, Gallimard, Coll. Posie, 1983.
- R -
- Renan E., Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883), Garnier Flammarion,
1973.
- S -
- Stendhal, Racine et Shakespeare, Garnier-Flammarion, 1970.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
360
III - 0 U V R A G E S T H E 0 R I Q U E S
E T C R I T I Q U E S
" ... Toute uvre d'art n'est que la somme ou le
produit des solutions d'une quantit de menues difficults
successives.
A. Gide.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
361
- A -
- Aragon L., "Aprs-dire" (1971) in Blanche ou L'Oubli, Gallimard, 1971.
- Aristote, La Potique, Ed. R. Dupont-Roc et J . Lallot, Seuil, Coll. Potique,
1980.
- B -
- Barbris P., Balzac, Larousse, 1971.
- Barthes R., "crivains et crivants" (1960) in Essais critiques, Seuil, Coll. Tel
Quel, 1964. "Introduction l'analyse structurale des rcits" (1966) in G. Genette
et T. Todorov (ed), Potique du rcit, Seuil, Coll. Points, 1977. "La mort de
l'auteur"(1968) in Le Bruissement de la langue Seuil, 1984. S/Z, Seuil, Coll. Tel
Quel, 1970. Sade Fourier Loyola, Seuil, Coll. Points, 1971a. "Pierre Loti:
Aziyad" (1971b) in Le Degr zro de l'criture suivi de Nouveaux essais
critiques, Seuil, Coll. Points, 1972. Le Plaisir du texte, Seuil, Coll. Tel Quel,
1973. Roland Barthe , Seuil, Coll. crivains de toujours, 1975, Fragments d'un
discours amoureux, Seuil, Coll. Tel Quel, 1977. Leon, Seuil, 1978. La
Chambre claire, Cahier du Cinma, Gallimard-Seuil, 1980.
- Bateson G., "Vers une thorie de la schizophrnie" (1956) in Vers une
cologie de l'esprit t.2, Tr. F. Drosso, L. Lot et C. Cler Seuil, Coll. Recherches
anthropologiques, 1980.
- Beaujour M., Miroirs d'encre, Seuil, Coll. Potique, 1980.
- Beguin A., "Prface Louis Lambert" (1953a), L'Oeuvre de Balzac t.1, Le
Club franais du livre, 1953. "Prface Facino Cane" (1953b), L'Oeuvre de
Balzac t.2, Le Club franais du livre, 1953.
- Benveniste E., "Structure des relations de personne dans le verbe" (1946) in
Problmes de linguistique gnrale t.1, Gallimard, Coll. Tel, 1976.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
362
- Biet C., Brighelli J -P. et Rispail J .-L., Alexandre Dumas, Gallimard Coll.
Dcouvertes, 1986.
- Blanchot M., Le Livre venir (1959), Gallimard, Coll. Ides, 1971.
- Blin G., Stendhal et les problmes du roman, J . Corti, 1954.
- Bloch E., Le Principe Esprance t.1, Tr. F. Wuilmart, Gallimard, 1976.
- Bonnet J .-C., "Le fantasme de l'crivain", Potique n63, Septembre 198?
- Booth W., The Rhetoric of fiction, Univ. of Chicago Press. 1961.
- Borges J .-L., Magies partielles du Quichotte in Enqutes 1937-1952, Tr. P.
et S. Benichou, Gallimard, 1957.
- Bourdieu P., Ce que parler veut dire, Fayard, 1982.
- Bozon-Scalzitti Y., Blaise Cendrars ou la passion de lcriture, L'Age
d'homme, 1977.
- Buber-Neumann M., Milena, Tr. A. Brossat, Seuil, 1986.
- Butor M., Michel Butor Voyageur la roue (Entretien avec J.M. le Sidaner),
Encre, 1979.
- C -
- Cabanis J ., Plaisir de la lecture t.1, Gallimard, 1964.
- Camus A., "L'espoir et l'absurde dans Kafka", Essais, Bibl. de la Pliade.
- Canguilhem G., La Formation du concept de rflexe au XVII et XVIII sicles,
PUF,1955.
- Carrougues M., "Prface La Peau de Chagrin", L'Oeuvre de Balzac t.7, Le
Club franais du Livre, 1954.
- Cendrars B., Blaise Cendrars vous parle ( Propos recueillis par M. Manoll)
o.c.t.8, Denoel, 1965.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
363
- Cendrars M., Blaise Cendrars, Balland, Coll. Points, 1985.
- Chambers R., "Le texte "difficile" et son lecteur", L. Dllenbach et J . Ricardoy
(ed), Problmes actuels de la lecture, Clancier-Guenaud, 1982.
- Comte A., Cours de Philosophie Positive (1830) t.1, Schleicher Frres, s.d.
- Cornu M., Kierkegaard et la communication de l'existence, L'Age d'homme,
Coll. Dialectica, 1972.
- D -
- Dllenbach L., Le Rcit spculaire, Seuil, Coll. Potique, 1977.
- Deleuze G., Dialogues, Flammarion, 1977.
- Derrida J ., La Vrit en peinture, Flammarion, Coll. Champs, 1978.
Otobiographies, Galile, 1984.
- Descharmes R., Flaubert. Sa vie, son caractre et ses ides avant 1857, F.
Ferroud, 1909.
- Diaz J .-L., "La question de lAuteur", Textuel n15, 1984.
- Doubrovsky S., "crire sa psychanalyse" (1979) in Parcours critique, Galile,
1980. "Autobiographie/Vrit/Psychanalyse", L'Esprit crateur, XX, n3,
automne 1980. Lettre Ph. Lejeune, (1983) in "Le Pacte autobiographique
(bis)", Moi aussi, Seuil, Coll. Potique, 1986.
- Dubois J ., Grammaire structurale du Franais: nom et pronom, Larousse,
1965. Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1973.
- Ducrot 0. et Todorov T., Dictionnaire encyclopdique des sciences du
langage, Seuil, Coll. Points, 1972.
- Dumont L., Essais sur l'individualisme, Seuil, 1983.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
364
- F -
- Flckiger J .-C., A propos de L'Eubag in Cl. Leroy (ed.) Blaise Cendrars.
Les inclassables 1917-1926, Minard, 1986.
- Fontanier P., Les Figures du discours, ed. G. Genette, Flammarion, Coll.
Champs, 1968.
- Fontenay E. de, Diderot ou le matrialisme enchant, Grasset, 1981.
- Forster E.M., "Entretien avec P.N. Furbank et F.J .H. Haskell", in Romanciers
au travail, Tr. J .R. Major, Gallimard, Coll. Tmoins, 1967.
- Foucault M., "Qu'est-ce qu'un auteur ?", Bulletin de la Socit franaise de
philosophie n'3, juillet-septembre 1969. L'ordre du discours, Gallimard, 1971.
- Frege G., "Sens et dnotation" (1892) in Ecrits logiques et philosohiques, Tr.
Cl. Imbert, Seuil, Coll. L'ordre philosophique, 1971.
- Freud S., Cinq leons sur la psychanalyse (1908). Tr.Y. Le Lay, Petite
Bibliothque Payot, 1978. Totem et tabou (1912), Tr. Dr S. J anklvitch, P.B.
Payot, 1977.
- G -
- Genette G., "Structuralisme et critique littraire" in Figures I(1966) Seuil, Coll.
Points 1976. "Discours du rcit" in Figures III, Seuil, Coll. Potique, 1972.
Introduction l'architexte, Seuil, Coll. Potique, 1979. Palimpsestes, Seuil, Coll.
Potique, 1982. Nouveau discours du rcit, Seuil, Coll. Potique, 1983. Seuil,
Seuil, Coll. Potique 1987.
- Godard H., Potique de Cline, Gallimard, 1985.
- H -
- Hamburger K., Logique des genres littraires. Tr. P. Cadiot, Seuil, Coll.
Potique, 1986.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
365
- Hamon Ph., "Pour un statut smiologique du personnage" (1972) in G.
Genette et T. Todorov, Potique du rcit, Seuil, Coll. Points, 1977. "Texte
littraire et mtalangage", Potique n'31, 1977.
- Herrnstein Smith B., On the Matgins of Discourse, The Univ. of Chicago
Press, Chicago, 1978.
- J -
- J anvier L., Une parole exigeante, Minuit, 1964.
- J auss H.-R., "Littrature mdivale et thorie des genres", Potique nl, 1970.
- K -
- Kayser W., "Qui raconte le roman ?" (1958) Tr. A.-M. Buguet in G. Genette et
T. Todorov (ed.) Potique du rcit, Seuil, Coll. Points, 1977.
- Kerbrat-(.)recchioni C., L'Enonciation de la subjectivit dans le langage,
Armand Colin, 1980.
- L -
- Lacan J ., Ecrits, Seuil, 1966.
- Lacoue-Labarthe Ph., "Diderot, le paradoxe et la mimesis", Potique n43,
1980.
- Leenhardt J . et J ozsa P., Lire la lecture, Le Sycomore, 1982.
- Lejeune Ph., "Le pacte autobiographique" (1973) in Le Pacte
autobiographique, Seuil, Coll. Potique, 1975. Je est un autre, Seuil, Coll.
Potique, 1980. "Le pacte autobiographique (bis)" in Moi aussi, Seuil, Coll.
Potique, 1986.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
366
- Leroy Cl. "Manuel de la bibliographie des livres jamais publis ni mme crits
par Cendrars", Europe, juin 1976. Blaise Cendrars I, Les "inclassables"
(1917-1926), Minard, 1986.
- Levi-Strauss Cl., La Pense sauvage, Plon, 1962.
- Lyons J ., Elments de smantique, Tr. J . Durand, Larousse, Coll. Langue et
langage, 1978.
- M -
- Mac G., "La posie tombe dans la prose" (Entretiens), L'infini n19, Et
1979.
- Manonni 0., Clefs pour l'Imaginaire ou l'Autre Scne, Seuil, Coll. Le Champ
freudien, 1969.
- Moraly J .-B., Jean Genet la vie crite, Editions de la diffrence, 198
- Muller M., Les Voix narratives dans A.L.R.T.P., Droz, Genve, 1965.
- O -
- Oster D., Passages de Znon, Seuil, Coll. Pierres vives, 1983.
- Oura Y., "Roman journal et mise en scne "ditoriale", Potique n'69, 1987.
- P -
- Pavel Th., Univers de la fiction, Seuil, Coll. Potique, 1988.
- Puech J .-B., L'Auteur suppos, typologie romanesque, Thse EHESS, Paris,
1982.
- R -
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
367
- Rachet G., La Tragdie grecque, Payot, 1973.
- Ricardou J ., Problmes du Nouveau Roman, Seuil, Coll. Tel Quel, 1967.
- Richard J .-P., Posie et profondeurs, Seuil, 1955.
- Ricoeur P., La Configuration dans le rcit de fiction (Temps et rcit t.II), Seuil,
Coll. L'ordre philosophique, 1984.
- Robert M., La Vrit littraire, Grasset, 1981.
- Rousset J ., Forme et signification, J . Corti, 1962.
- Russel B., "On denoting" (1905) in Logic and Knowledge, The Macmillan
Company, New York, 1977.
- Ruwet F., " Prsentation de Lo Strauss", Potique n'38, 1979.
- Ryan M.-L., "Fiction, Non-Factuals and the Principle of Minimal Departure",
Poetics, VIII, 1980.
- S -
- Sainte-Beuve, Profils et jugements littraires, (1862), t. III, Librairie Larousse,
s.d.
- Saraiva A.-J ., "Message et littrature", Potique n 17, 1974.
- Schaeffer J .-M., "Du texte au genre", Potique n53, 1983. "Fiction, feinte et
narration", Critique n481-482, 1987a. "Genres littraires et gnricit textuelle"
in Cohen R. (ed.), Critical projections, Methuen, New York, London, 1987b.
- Scherer J ., La dramaturgie classique en France, Nizet, s.d.
- Searle J ., "Le statut logique du discours de la fiction" in Sens et expression,
Tr. J . Proust, Minuit, 1982.
- Starobinski J ., Portrait de l'artiste en saltimbanque, Flammarion, Coll.
Champs, 1970.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
368
- Stevenson R.-L., "Lettre S. Colvin" (1879) in La Route de Silverado, Tr. M. le
Bris, Phbus, 1987.
- Stierle K., "L'Histoire comme Exemple et l'Exemple comme Histoire", Tr. J .-L.
Lebrave, Potique n10, 1972. "Rception et fiction", Tr. V. Kaufmann, Potique
n'39, 1979.
- Suleiman S.-R., Le Roman thse ou l'autorit fictive, PUF, 1983.
t
e
l
-
0
0
0
0
6
6
0
9
,
v
e
r
s
i
o
n
1
-
2
9
J
u
l
2
0
0
4
Vous aimerez peut-être aussi
- Philippe Gasparini-Est-il Je - JerichoDocument483 pagesPhilippe Gasparini-Est-il Je - JerichoYoussef El HabachiPas encore d'évaluation
- Marc Angenot - Glossaire Pratique de La Critique Contemporaine-Canada - Hurtubise HMH (1979)Document222 pagesMarc Angenot - Glossaire Pratique de La Critique Contemporaine-Canada - Hurtubise HMH (1979)Hatem Ben Badr100% (1)
- Étude de La Réception D Une Œuvre LittéraireDocument680 pagesÉtude de La Réception D Une Œuvre LittéraireYinping WANGPas encore d'évaluation
- Du Paragraphe A LessaiDocument41 pagesDu Paragraphe A LessaiOrlando ZamoraPas encore d'évaluation
- Bremond - La Logique Des Possibles NarratifsDocument18 pagesBremond - La Logique Des Possibles Narratifsa1765Pas encore d'évaluation
- La Littérature Antillaise Francophone Avant 1932Document8 pagesLa Littérature Antillaise Francophone Avant 1932Trid Lorena100% (1)
- L'Ambiguïté Générique Dans Trois Romans Autobiographiques Algériens D'expression Française.Document282 pagesL'Ambiguïté Générique Dans Trois Romans Autobiographiques Algériens D'expression Française.Yinping WANGPas encore d'évaluation
- AnneStrasser 1 PDFDocument24 pagesAnneStrasser 1 PDFmadwani1Pas encore d'évaluation
- Littérature de Voyage Et Excentricité: Henri Michaux en ÉquateurDocument13 pagesLittérature de Voyage Et Excentricité: Henri Michaux en ÉquateurAnonymous saZrl4OBl4Pas encore d'évaluation
- Portrait Craché Pirotte Jean Claude ZDocument109 pagesPortrait Craché Pirotte Jean Claude ZRomain Mistretta100% (1)
- Façons D'être Écrivain - N HeinichDocument29 pagesFaçons D'être Écrivain - N HeinichJoão Ivo GuimarãesPas encore d'évaluation
- L'Auteur Comme PersonnageDocument82 pagesL'Auteur Comme PersonnageCécile A.100% (6)
- Angenot - Que-Peut-LittératureDocument18 pagesAngenot - Que-Peut-LittératurefroblesdocPas encore d'évaluation
- Du Conscient À L'inconscientDocument42 pagesDu Conscient À L'inconscientNicoleta Aldea0% (1)
- Guide Pratique Du Professeur EsabacDocument208 pagesGuide Pratique Du Professeur EsabacarysnetPas encore d'évaluation
- Extrait PDFDocument20 pagesExtrait PDFMaster Littérature et CinémaPas encore d'évaluation
- Les Procédés Littéraires. de Allégorie À Zeugme-2018Document240 pagesLes Procédés Littéraires. de Allégorie À Zeugme-2018Sarah SlimaniPas encore d'évaluation
- BazinDocument13 pagesBazinCezar GheorghePas encore d'évaluation
- Genette. Frontières Du RécitDocument13 pagesGenette. Frontières Du RécitIsabelle Marc100% (2)
- Nicephore Baudelaire 0514Document61 pagesNicephore Baudelaire 0514MarianadeCaboPas encore d'évaluation
- Université de LausanneDocument222 pagesUniversité de Lausanneoradu1395Pas encore d'évaluation
- Georges Didihuberman Minima Lumina Phenomenologie Et Politique de La LumiereDocument4 pagesGeorges Didihuberman Minima Lumina Phenomenologie Et Politique de La LumiereTimothée BanelPas encore d'évaluation
- Dalie Giroux, René Lemieux, Pierre-Luc ChénierDocument253 pagesDalie Giroux, René Lemieux, Pierre-Luc ChénierEgregorPas encore d'évaluation
- Sartre, J.-P. Situations, IxDocument11 pagesSartre, J.-P. Situations, IxNicole DiasPas encore d'évaluation
- Les Crapauds Brousse Thierno Monenembo DialloDocument166 pagesLes Crapauds Brousse Thierno Monenembo DiallorapeatroPas encore d'évaluation
- Étude Du Personnage Dans Deux Textes de MOHYADocument234 pagesÉtude Du Personnage Dans Deux Textes de MOHYALakhdar Hadjarab100% (2)
- Les 100 Mots Du Littéraire-2011Document129 pagesLes 100 Mots Du Littéraire-2011وصفات و شهيوات رائعة أمة اللهPas encore d'évaluation
- DR Yves-Abel Feze, Langues Et Interculturalité Dans La Littérature D'afrique FrancophoneDocument12 pagesDR Yves-Abel Feze, Langues Et Interculturalité Dans La Littérature D'afrique FrancophoneAnnalesPas encore d'évaluation
- Présentation Thèse RinaldiPROJETDocument8 pagesPrésentation Thèse RinaldiPROJETAdriano FerrazPas encore d'évaluation
- Collot Thème Selon Critique ThématiqueDocument3 pagesCollot Thème Selon Critique ThématiqueDanieliPimentelPas encore d'évaluation
- Reception CritiqueDocument25 pagesReception CritiqueThéophile NGOUNA DJATOPas encore d'évaluation
- Narratologie de GenetteDocument16 pagesNarratologie de GenetteLilia ZermanePas encore d'évaluation
- Barthes, Roland - L'effet de RéelDocument7 pagesBarthes, Roland - L'effet de RéeleduardorbelloPas encore d'évaluation
- La Polyphonie Discursive PDFDocument10 pagesLa Polyphonie Discursive PDFAmazighPas encore d'évaluation
- Philippe GaspariniDocument5 pagesPhilippe GaspariniMilica SesicPas encore d'évaluation
- La Théorie en Revue PoetiqueDocument151 pagesLa Théorie en Revue PoetiqueIdir MazighPas encore d'évaluation
- Le Pacte AutobiographiqueDocument5 pagesLe Pacte AutobiographiquefatimezzahraPas encore d'évaluation
- Art Performance, Manœuvre, Coefficients de VisibilitéDocument125 pagesArt Performance, Manœuvre, Coefficients de VisibilitéAndré Éric LétourneauPas encore d'évaluation
- SIMON, J.P. Enonciation Et NarrationDocument38 pagesSIMON, J.P. Enonciation Et Narrationsimpla-1Pas encore d'évaluation
- La Porosité Au Monde. L'écriture de L'intime Chez Louise Warren Et Paul ChamberlandDocument350 pagesLa Porosité Au Monde. L'écriture de L'intime Chez Louise Warren Et Paul ChamberlandjcbazinetPas encore d'évaluation
- Socialisme Fasciste Drieu La (... ) Drieu La Bpt6k1512379p OCRDocument259 pagesSocialisme Fasciste Drieu La (... ) Drieu La Bpt6k1512379p OCRולדימיר מרטין סנטPas encore d'évaluation
- Butor, Michel - Improvisations Sur FlaubertDocument184 pagesButor, Michel - Improvisations Sur FlaubertLarisa Elena TimoftePas encore d'évaluation
- Duscursivitè Générecité Et Textualité Jean-Michel AdamDocument19 pagesDuscursivitè Générecité Et Textualité Jean-Michel AdamCarmen LuceroPas encore d'évaluation
- La Crise Du RomanDocument26 pagesLa Crise Du RomanLuciana AraújoPas encore d'évaluation
- Au Sujet Des Fondements de La Theorie Linguistique de Louis HjelmslevDocument25 pagesAu Sujet Des Fondements de La Theorie Linguistique de Louis Hjelmslevlarsen.marPas encore d'évaluation
- Nina BouraouiDocument313 pagesNina BouraouiARGYOU100% (1)
- Le Labyrinthe Comme Thème Et StructureDocument3 pagesLe Labyrinthe Comme Thème Et StructurejismailPas encore d'évaluation
- L IronieDocument67 pagesL IronieAmine El BattariPas encore d'évaluation
- Émile ZOLA Sur Flaubert, La Tribune, 28 Novembre 1869Document3 pagesÉmile ZOLA Sur Flaubert, La Tribune, 28 Novembre 1869DariaBKPas encore d'évaluation
- Lecture Cursive 2Document6 pagesLecture Cursive 2CléoPas encore d'évaluation
- Le Roman Et Ses PersonnageDocument43 pagesLe Roman Et Ses PersonnageJerôme Buisson100% (1)
- Christine Delphy - L'Ennemi Principal - 1 - Economie Politique Du Patriarcat. 1-Syllepse (2013)Document250 pagesChristine Delphy - L'Ennemi Principal - 1 - Economie Politique Du Patriarcat. 1-Syllepse (2013)Desislava ShPas encore d'évaluation
- PÉNINOU, G. - Physique Et Métaphysique de L'image PublicitaireDocument15 pagesPÉNINOU, G. - Physique Et Métaphysique de L'image Publicitairesimpla-1Pas encore d'évaluation
- Les Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLes Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Manuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littéraireD'EverandManuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littérairePas encore d'évaluation
- Cours Chimie Organique PC S2 2023-2024Document61 pagesCours Chimie Organique PC S2 2023-2024dohadahbi280Pas encore d'évaluation