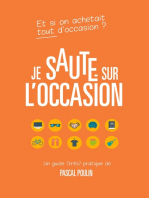Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Chap 11 Dormier
Chap 11 Dormier
Transféré par
Fawzi RahmouniCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chap 11 Dormier
Chap 11 Dormier
Transféré par
Fawzi RahmouniDroits d'auteur :
Formats disponibles
Philippe-Pierre Dornier
Michel Fender
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Enjeux principes exemples
Deuxime dition 2007
00 Dornier/Fender.fm Page III Vendredi, 23. fvrier 2007 5:31 17
Groupe Eyrolles, 2007
ISBN : 978-2-7081-3384-6
405
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
11
Les modes de coopration dans la Supply Chain :
dmarches, outils et organisations
Il faut que le sculpteur connaisse la technique de son art
et sache tout ce qui s'en peut apprendre : cette technique
concerne surtout ce que son uvre aura de commun avec
d'autres.
Henri Bergson
1
(La Pense et le mouvant)
Nous avons vu au travers des trois chapitres prcdents que la logistique se construit
essentiellement autour de trois formes dintgration, fonctionnelle, gographique et
sectorielle. Parmi ces trois formes, la plus innovante est vraisemblablement
lintgration sectorielle. Cest elle qui remet en cause de manire la plus nette les
pratiques de gestion au sein dune entreprise. Lobjectif de ce chapitre est donc de
rpondre aux questions suivantes relatives la mise en uvre de ces cooprations au
sein des Supply Chains :
quels sont les modes de coopration logistique et quelles sont les caractristiques
qui permettent de les distinguer ?
pourquoi entre-t-on dans un mode de coopration logistique ? Et pourquoi ne le fait-
on pas plus vite ?
quels sont les freins ltablissement de modes de coopration logistique ?
quels sont les modes de coopration logistiques quil semble performant de
dvelopper et en fonction de quels critres ?
quel est le rle jou par les prestataires de service logistique ?
1. Philosophe franais (1859-1941). Spiritualiste, hostile lintellectualisme formaliste, il dveloppe la
thorie de lintuition qui permet une synchronie avec la crativit de la vie et une approche articule autour
de lexprience immdiate.
11 Dornier/Fender.fm Page 405 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
406
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
quels sont les prrequis et les consquences organisationnelles de la coopration
logistique ?
Pour rpondre ces questions, nous proposons dans un premier temps une prsen-
tation des modes de coopration logistique au sein des chanes dapprovisionnement
en identiant galement ce qui les dtermine. Comme nous lavons dj montr dans
ce livre aux niveaux fonctionnel et gographique, le concept de coopration, par les
proprits dadaptation quil dveloppe, permet de jouer un rle de tampon face aux
incertitudes et la complexit, dimensions caractristiques des chanes dapprovi-
sionnement et dimensions rendues dautant plus sensibles par le double phnomne
de dstabilisation amont et aval auquel la logistique est soumise. Le cas des coopra-
tions dans le cadre des produits de grande consommation, et en particulier dans le cas
des produits cosmtiques est prsent par la mise en uvre dapproches coopratives
telles que le trade marketing et de projets tels que lECR. Nous concluons sur les
formes organisationnelles innovantes et les nouveaux mtiers quimplique le dvelop-
pement de cooprations logistiques entre producteurs et distributeurs.
1. L
ES
TROIS
MODES
GNRIQUES
DE
COOPRATION
DANS LES
S
UPPLY
C
HAINS
1.1. Les caractristiques de la coopration logistique
Lobservation des cooprations en gnral et des cooprations logistiques en parti-
culier, permet dnoncer les caractristiques majeures de la coopration logistique :
la dimension relationnelle, qui signie quil sagit dun processus continu sur une
priode de temps tendue et sur une base rptitive, qui se confond avec un
apprentissage mutuel interactif en opposition au simple mode transactionnel ;
la poursuite dobjectifs communs entre les membres du canal logistique dont les effets
seront bnques et partags, et qui aboutira la cration dactifs spciques ;
lgalit des partenaires sous une forme de donnant-donnant ;
le ncessaire changement de posture partir dune posture initiale, caractrise
entre autres faits marquants par la forte dimension concurrentielle des relations,
la pauvret des informations partages, labsence dexpriences passes permettant
de dvelopper la conance, considre comme une donne intrinsque de la
relation de coopration ;
loptimisation globale est privilgie plutt que les optimisations locales. Global peut
vouloir dire que dans certains cas, il faudra dpasser la dimension purement logistique.
1.2. Principes pour btir une coopration logistique
Linitialisation et le dveloppement dune coopration logistique se btissent sur
quelques principes qui ont t identis au nombre de six :
11 Dornier/Fender.fm Page 406 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
407
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
En premier lieu, il faut reconnatre que la coordination de la chane dapprovision-
nement saccrot dans le temps pour faire baisser les cots et que la coopration
constitue la voie privilgie de loptimisation globale des chanes dapprovisionnement
logistiques en termes de service et de cot, et quil faut cooprer pour tre comptitif ;
Ensuite, second principe, si la logistique apparat comme un domaine privilgi de
coopration, il faut savoir dpasser ce seul domaine en prenant en compte dautres
champs grce aux premiers dveloppements raliss en matire de gestion des ux.
Pour nous, le logisticien dot dune certaine neutralit par rapport aux enjeux sur les
prix et les conditions nancires est le facilitateur et lorganisateur de la coopration.
Celle-ci, aprs avoir port sur les oprations logistiques, peut stendre aux activits
commerciales et marketing. Les logisticiens, pour obtenir les objectifs de baisse des
cots et de service (respect du cahier des charges commercial) issus dune dmarche
cooprative, pilotent un ux transversal physique et informationnel, qui conduit
associer :
les oprationnels,
les commerants (orients enseignes de vente au dtail) et les acheteurs,
le marketing (orient consommateur nal) du producteur et du distributeur.
ces diffrents niveaux, la coopration sappuie sur le dnominateur commun du
pilotage logistique.
Troisime principe, trois modes gnriques de coopration producteurs-distributeurs
mergent dans les chanes dapprovisionnement. Ils se diffrencient par leurs
objectifs respectifs, les champs dapplication et les modes de coordination quils
mettent en uvre. Ils sont respectivement centrs sur des champs oprationnels,
commerciaux et marketing ;
Quatrime principe, la ralit des cooprations producteurs-distributeurs se situe
comme un mix entre les trois modes gnriques selon une pondration, fonction du
secteur o se situent le producteur et le distributeur donns ;
Cinquime principe, lvolution dans le temps des cooprations producteurs-distribu-
teurs ne procde pas dune dynamique circulaire ou linaire permettant de passer dun
mode gnrique un autre. Le dveloppement chronologique des cooprations rpond
une logique sectorielle et aux postures stratgiques des acteurs conomiques ;
Enn, sixime et dernier principe, chaque mode gnrique de coopration ncessite des
prrequis organisationnels intra-rme au sens des mtiers, des comptences et des
systmes dinformation. Cela signie quil y a une corrlation entre le mode de coordi-
nation intra-rme et le mode de coordination de la chane dapprovisionnement.
1.3. Les trois modes gnriques de coopration
1.3.1. Prsentation des modes gnriques de coopration
Le premier mode est quali de coopration logistico-oprationnelle. Lobjectif de
cette relation est dliminer les cots de dysfonctionnements en produisant le service
voulu (sil est connu), cest--dire en remplissant le cahier des charges commercial. La
coopration est donc limite la rsolution de problmes dont lorigine est essentiel-
11 Dornier/Fender.fm Page 407 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
408
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
lement logistique. Elle porte sur des activits oprationnelles de chacun des acteurs et
sur la mise en uvre de solutions techniques orientes vers la recherche de gains de
productivit. Les acteurs impliqus appartiennent la logistique oprationnelle du
producteur et du distributeur (entrepts, transport).
Dans le second mode, la coopration logistico-commerciale, lobjectif est non
seulement de minimiser la somme des cots oprationnels mais galement dintgrer
la composante commerciale. On cherche amliorer la performance commerciale,
chiffre daffaires et marges, en sappuyant sur des organisations et des systmes logis-
tiques adapts et en reconnaissant la ncessit dune approche diffrencie par
famille logistique. Cette relation associe les logisticiens et les vendeurs chez le
producteur et les acheteurs chez le distributeur.
Enn, troisime mode, la coopration logistico-marketing suppose lexistence de
vritables fonctions marketing chez le producteur (ce qui est frquent) et chez le
distributeur (moins frquent, mais en dveloppement rapide). Il sagit dadapter le
produit par une conception partage et une dmarche conjointe en termes de
marketing pour accrotre la fonction dutilit du consommateur. Dans ce mode,
lchange relationnel sinscrit dans la dure, les investissements (cration de valeur
distinctive) et les gains (nanciers, commerciaux et cots) sont partags.
Le tableau 11.1 prsente les caractristiques principales de ces trois modes gnriques
avant den prciser les variables de reprsentation :
Comme nous lavons mentionn prcdemment, dans la ralit, les modes de coop-
ration sont hybrides et empruntent aux trois modes gnriques selon des combi-
naisons qui varient en fonction des principaux facteurs suivants :
Mode 1 : coopration
logistico-oprationnelle
Mode 2 : coopration
logistico-commerciale
Mode 3 : coopration
logistico-marketing
relation asymtrique base sur
le pouvoir exerc
modle de standardisation et de
productivit
cots limits aux cots de
transaction
processus partags pour
rsoudre des problmes
champs de la coopration :
transport, entreposage, gestion
des commandes
implantation de systmes routi-
niers et standardiss (EDI) pour
accrotre la productivit
dune approche oriente cot
vers un objectif de parts de
march
modle de exibilit passive
minimisation du cot global de
la chane dapprovisionnement et
accroissement des ventes
champs de la coopration :
gestion des assortiments,
rduction des ruptures de stock
en linaire, gestion des embal-
lages
mise en uvre dindicateurs de
mesure de performance ddis
modle de exibilit dynamique
et de ractivit
cration dune valeur spcique
le client est au centre de la
coopration
champs de la coopration :
mutualisation des ressources,
gestion intgre des ux,
dnition partage des assorti-
ments, abandon des ventes
perte, conception et introduction
de nouveaux produits ddis la
relation
T
ABLEAU
11.1.
Prsentation comparative des trois modes gnriques
de coopration producteurs-distributeurs
11 Dornier/Fender.fm Page 408 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
409
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
les positions stratgiques respectives du producteur et du distributeur (stratgie
volume, diffrenciation) ainsi que la structure du canal de distribution (canal
administr, contrl) ;
les niveaux de service apports aux consommateurs, les caractristiques des
produits (valeur au kg, encombrement), les formes des points de vente (suprette
versus gros hypermarch) et les volumes traits ;
les objets de coopration, qui fondamentalement sont organiss autour de la gestion
partage des approvisionnements ou du pilotage intgr du ux entre producteur et
distributeur, la massication des ux, la gestion partage des conditionnements
adapte aux diffrents types de points de vente et lintroduction des nouveaux produits.
Le schma 11.1 illustre ce que peut tre un mode de coopration de type
hybride entre un producteur et un distributeur :
S
CHMA
11.1.
Coopration hybride entre producteur et ditributeur
Lexemple prsent dans ce schma montre quun producteur et un distributeur
peuvent tre engags dans un processus coopratif prsentant des caractristiques
60 % du mode 1, 10 % du mode 2 et 60 % du mode 3. Cela signie que les modes
gnriques ne sont pas exclusifs lun de lautre et quil ny a pas de dynamique
tendancielle dun type un autre.
1.3.2. Objets de la coopration
Les objectifs ddis chaque mode de coopration sont trs diffrents. Ils signient un
type dengagement rciproque (intensit de la motivation et rversibilit de laccord
coopratif) et un niveau dinvestissement dbouchant sur la cration dactifs spci-
ques. Le mode 1 est orient vers la baisse des cots par la mise en place de routines,
qui permettent des gains de productivit par limination des tches sans valeur
Coopration logistico-oprationnelle (mode 1)
(relation entrept-entrept)
Coopration logistico-commercial (mode 2)
(relation acheteur-vendeur)
Coopration logistico-marketing (mode 3)
(relation marketing-marketing)
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
(60 %, 10 %, 60 %)
Type hybride
11 Dornier/Fender.fm Page 409 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
410
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
ajoute, mais qui fondamentalement ne rglent pas le problme de matrise de lincer-
titude. De plus, elles ne prparent pas les organisations membres de la coopration
des modications brutales de lenvironnement. Ce type de coopration reste limit
des dveloppements techniques et est orient vers la rsolution de dysfonctionne-
ments coteux en rglement de litiges (erreurs de facturation, mauvaise abilit des
informations sur les produits, erreurs de livraison). Dans le mode 1, il existe un
rapport de forces en faveur de lun des membres de la relation et il ny a pas de
volont pour mieux connatre lorganisation de lautre membre. Les amliorations qui
mergent de la relation sont mises en uvre sous le mode de limposition.
Le second mode, la coopration logistico-commerciale, en largissant le champ de la
coopration des questions de nature commerciale, apprhende le cot logistique
global et identie la logistique comme vritable fonction de support de la stratgie
commerciale. La coopration logistique, non seulement par son niveau de performance
(solutions aux problmes de ruptures de stock, abaissement des niveaux de stock, accl-
ration de la rotation des produits), conditionne la russite des orientations commerciales
des entreprises, mais peut constituer un lment-cl de limplantation de la politique
commerciale (slection des canaux de distribution et des acteurs commerciaux :
grossistes, revendeurs, dtaillants, formes de points de vente). Ds lors, les solutions
imaginer dans le cadre de la coopration ont des implications sur les orientations
commerciales (remise plat des conditions gnrales de vente, prise en compte des
conditionnements, lissage des promotions et abandon des achats spculatifs, communi-
cation sur les nouveaux produits, organisation de promotions lectroniques). La fonction
de cot est largie aux cots de production, qui font rfrence aux ressources
consommes pour produire de lutilit sous forme de biens ou de services. Il devient, par
exemple, possible de remettre en cause les processus industriels de conditionnement
(cartons) des usines qui conduisent des units de conditionnements inadaptes un
point de vente donn. On passe dune logique de cot clat au niveau de chaque
membre du canal celle de partage, ce qui signie que non seulement les contraintes de
lautre acteur sont prises en compte, mais aussi celles de lenvironnement.
Le mode 3, la coopration logistico-marketing, met en avant la cration dune valeur
distinctive propritaire des membres de laccord coopratif. Des actifs communs
sont crs dans et par la relation cooprative, entre les partenaires. Cette valeur, qui
rsulte dun processus dapprentissage mutuel, permet lobtention dun vritable
avantage concurrentiel au sens des facteurs de succs limits la dimension
marketing pour russir dans son segment stratgique ou son domaine dactivit strat-
gique. Ici, cest le consommateur nal qui stimule la coopration, et cest par une
dnition conjointe du marketing mix quest maximise la fonction dutilit du
consommateur. Dans cette perspective, cooprer permet de crer la comptence
distinctive pour le client qui devient llment polaire principal. Le mode 2 met dj
en vidence la ncessit dinstaurer chez le producteur des organisations internes
diffrencies, ddies aux distributeurs. Limpact porte sur la rednition des
fonctions, des rles, des comptences. Avec le mode 3, linterdpendance organisa-
tionnelle est prise en compte par une volution des mtiers et des structures, et
limplantation dune vritable fonction de pilotage entre les organisations.
11 Dornier/Fender.fm Page 410 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
411
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1.3.3. Modes de pilotage et systmes dinformation
La coopration logistico-oprationnelle a pour objectif de mettre en place des
systmes routiniers gnraliss de transaction et de contrle sur le modle de la
relation lectronique. Cette approche est donc limite des tests de liaison de type
EDI. Il ny a pas de remise en cause organisationnelle, ni dapplications informatiques
complexes, ni cration de nouveaux processus, mais une automatisation de proc-
dures existantes. La complexit des systmes logistiques, couple une grande varia-
bilit, ne peut tre rsolue par de tels systmes qui apportent beaucoup de rigidit.
En revanche dans la coopration logistico-commerciale, le contenu des systmes
dinformation est redni en favorisant le partage dinformations au niveau des
catalogues articles ou de la fonction portefeuille de planication de loffre. Des infor-
mations sur les historiques de ventes sont changes et des travaux sont engags pour
tudier les modes dexploitation et de valorisation de ces donnes pour amliorer le
pilotage des ux. Les donnes sur les nouveaux produits et les promotions sont
galement changes pour amliorer la performance commerciale du produit. Ici,
lobjectif en matire dEDI nest pas de gnraliser, car le volume dinformations
gnr par le systme rend toute intervention valeur ajoute illusoire. Le systme
fonctionne alors comme un rvlateur des zones de progrs et par exception. Cest
lacteur qui dveloppe le systme dinformation, qui consolide son pouvoir diffren-
ciateur en matire de relation commerciale et dirige le ux dinformations vers des
rseaux partenaires pour arbitrer les choix commerciaux. Nanmoins, la logique
gnrale reste une logique push, dans le sens o lenjeu essentiel est le gain
commercial. Loccupation du linaire ou de la surface de vente par un producteur
donn au dtriment de ses concurrents horizontaux demeure un point-cl.
Il est ncessaire de mettre en place une vritable fonction de pilotage entre le
producteur et le distributeur pour atteindre les objectifs initiaux de la coopration
logistico-marketing. Cette fonction inclut les prvisions des ventes, les consomma-
tions relles, la connaissance des stocks sur lensemble de la chane dapprovision-
nement, les plannings de production et de distribution. Cest seulement ce stade qui
sappuie sur une transparence donne par le distributeur au producteur sur la nature
de la demande que lon pourra parler dun vritable pilotage intgr qui sappuie sur
une logique pull. Les procdures et les modes de communication sont trs labors et
spciques la relation. Les informations changes appartiennent au domaine du
dveloppement de la connaissance, cest--dire quil sagit dinformations dotes
dune valeur intrinsque non ncessaire lchange. Cest dans ce cadre que sont en
gnral dvelopps les systmes APS, Advanced Planning and Scheduling Systems,
conus par des diteurs tels que I2 Technologies, Manugistics et les diteurs majeurs
des ERP (SAP, Oracle,...) et qui sont particulirement dploys dans des industries
dassemblage complexe (automobile, micro-informatique) ou de process dans
lagroalimentaire.
11 Dornier/Fender.fm Page 411 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
412
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1.3.4. Performance des points de vente et des linaires
La performance commerciale des points de vente nest que le rsultat indirect de
lorganisation logistique linterface producteur-distributeur. Mais ce rsultat claire
les types de relations propres chaque mode de coopration car le point de vente,
lieu dachat des produits par le consommateur nal constitue le foyer des rencontres
concurrentielles. Alors que le merchandising est absent de la coopration logistico-
oprationnelle, il est subordonn aux ventes dans un objectif de volume dans la
coopration logistico-commerciale. Des gammes de produits spciques sont
dveloppes par enseigne, voire par magasin. Il devient ncessaire dlargir le champ
relationnel, de dvelopper une approche base sur la ngociation.
La coopration logistico-marketing implique un merchandising interactif, qui sappuie
sur la dnition dobjectifs communs, lintgration mutuelle des contraintes et une
conception conjointe du produit. La position centrale du consommateur nal conduit
une codnition des assortiments et la mise en place de gammes adaptes aux
enseignes de ces consommateurs des zones de chalandise concernes.
Linstauration des cooprations logistiques, de quelque nature quelles soient, conduit
une volution progressive des missions assignes aux points de vente.
Frquemment, le point de vente a cumul de nombreuses activits le dtournant plus
ou moins de sa fonction commerciale, de loin la plus exigeante. On a vu ainsi des
points de vente cumuler les fonctions achat, approvisionnement, logistique de prpa-
ration des commandes et de livraison aux clients. Les cooprations mises en place
permettent de dpolluer les points de vente des fonctions qui ne sont pas directement
lies avec laction commerciale. On peut ainsi assister la mise en uvre de rappro-
visionnement automatique de la part des fournisseurs.
2. L
E
CAS
DES
PRODUITS
DE
GRANDE
CONSOMMATION
:
TRADE
-
MARKETING
ET
EFFICIENT
CONSUMER
RESPONSE
Les rexions que nous venons de mener sur la nature des relations entre producteurs
et distributeurs et sur le rle quy occupe la logistique, laissent deviner lexistence de
trajectoires plus favorables que dautres qui faciliteraient le redploiement relationnel
des acteurs. Les enjeux se dessinent pour chacun des acteurs impliqus dans la
relation. Encore faut-il quils puissent trouver le meilleur cheminement pour prendre
la posture adapte linstauration dun mode dchange nouveau. Ce cheminement
commun, labor partir de questions logistiques, permet douvrir des perspectives
de travail beaucoup plus largies et touchant des domaines historiquement aussi
sensibles que celui des ventes et des achats.
Dans un premier temps, nous verrons comment un cadre gnral la structuration des
relations entre producteurs et distributeurs est propos. Cest la prsentation de la
dmarche de trade-marketing qui consacre linstauration dun lien nouveau entre
11 Dornier/Fender.fm Page 412 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
413
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
producteurs et distributeurs. Cependant, si le champ dni par le trade-marketing
propose un lieu commun de rencontre entre les deux acteurs, il est ncessaire que
lun et lautre y voient, dfaut dun intrt commun, un intrt respectif, pour
accepter de prendre la posture dchange ncessaire lentre dans les logiques
proposes par le trade-marketing. Dans un second temps, nous analyserons la nature
de lenjeu propos par lEfcient Consumer Response (ECR). LECR est la recherche
commune de toute action qui favoriserait en commun lamlioration de loffre
propose aux clients. Cette incitation est accepte en loccurrence par les deux partis.
Dans un troisime temps, nous analyserons la dmarche suivie par LaScad et par
Systme U. Enn, nous chercherons tirer quelques enseignements de cette
dynamique de reconstruction des relations producteurs-distributeurs.
2.1. La logistique dans le mix trade-marketing
2.1.1. Contexte
Dans le contexte difcile des produits de grande consommation, les distributeurs
comme les producteurs sont la recherche de nouvelles voies pour dynamiser leurs
activits. Les stratgies dachat se btissent partir de critres de performances
largies (dlit de la marque pour lenseigne, rponse au positionnement vis par
lenseigne) et de services fournis par la logistique. Les axes principaux de travail
sont susceptibles dtre noncs de la manire suivante :
cesser la recherche systmatique des prix les plus bas et tenter didentier et de
valoriser des services associs aux produits pour le client ;
appuyer la ngociation industriel/distributeur sur des critres plus diversis que le
seul prix comme, par exemple, les moyens de paiement, lautomatisation des proc-
dures, la continuit de la chane logistique.
Ces axes sont orients soit sur la relation client nal/distributeur soit sur la relation
producteur/distributeur. Les critres de rfrencement dun produit devraient voluer. la
puissance de la marque et lvaluation du rapport prix/qualit/quantit devrait sajouter
la capacit dun producteur mettre la disposition dun distributeur les moyens
doptimiser son offre produit. Dans les deux cas noncs, la voie complmentaire la
rduction des cots pour amliorer loffre produit du distributeur est une voie de diffren-
ciation ou de diversication qui propose des services complmentaires associs aux
produits. Ces services sont pour partie ceux qui sont proposs par la logistique.
2.1.2. Le trade-marketing : premier cadre conceptuel de lintgration sectorielle
de la logistique
Le trade-marketing, ou marketing du commerce, symbolise un changement dattitude
dans les rapports entre producteur et distributeur. Le trade-marketing permet
doptimiser loffre aux clients consommateurs nals grce une prise en compte plus
structure de son offre auprs du distributeur. Une dnition du trade-marketing
pourrait tre la suivante :
11 Dornier/Fender.fm Page 413 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
414
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le trade-marketing permet une meilleure prise en compte par lindustriel des besoins
et des exigences de ses clients distributeurs. Il complte ainsi sa dmarche classique
historiquement oriente vers le client consommateur nal.
Cette approche illustre la thorie qui dmontre que la performance commerciale
auprs du consommateur client nal est fonction de la coordination de lensemble des
acteurs de la chane de mise disposition des produits. Toutes les activits dune
chane de valeur doivent tre harmonises. Une perte de cohrence entre lensemble
des acteurs intervenant dans une chane a pour consquence, terme, une baisse de
comptitivit de la chane tout entire et donc pour chacun de ses acteurs. Le
producteur prend ainsi conscience que le rfrencement dun produit se fera de moins
en moins sur le seul pouvoir de la marque mais de plus en plus sur la matrise du
service et des cots associs. La ngociation entre producteur et distributeur sera alors
fonde sur un objectif commun de rsultat et non plus sur un prix dachat.
Le trade-marketing garantit une meilleure adquation du marketing producteur avec
le marketing distributeur et vient complter la structure de travail du triptyque
consommateur/distributeur/producteur dans le domaine des produits de grande
consommation (cf. schma 11.2). Au marketing producteur dvelopp par le fabricant
et tourn vers le consommateur, sest ajout le marketing distributeur dvelopp par la
rme de distribution et tourn galement vers le consommateur.
S
CHMA
11.2.
Les trois marketings du canal de la grande distribution
Le trade-marketing formalise quant lui, la prise en compte par le producteur de
chaque distributeur comme un type de client quil doit tudier et auquel il doit
proposer des rponses spciques ses attentes.
Dans le mix trade-marketing, la variable Supply Chain est identie clairement. Lune des
attentes reconnues dans ce schma, du distributeur lgard du producteur en termes
doffre, est celle du processus Supply Chain. Les enjeux se situent pour le distributeur soit
dans la diminution des cots, soit dans la diffrenciation des enseignes (cf. tableau 11.2).
Client consommateur
MIX
Producteur Fournisseur Trade marketing
M
a
r
k
e
t
i
n
g
d
e
n
s
e
i
g
n
e
produit
prix
publicit
distribution
MIX
Supply Chain
gestion des marques
merchandising
promotion
MIX
produit
prix
assortiment
communication
promotion
M
a
r
k
e
t
i
n
g
p
r
o
d
u
i
t
11 Dornier/Fender.fm Page 414 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
415
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
E
n
j
e
u
x
C
o
n
c
e
p
t
i
o
n
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
M
i
s
e
e
n
l
i
n
a
i
r
e
V
e
n
t
e
D
i
m
i
n
u
t
i
o
n
d
e
s
c
o
t
s
S
u
r
l
e
s
u
x
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
a
t
a
l
o
g
u
e
p
r
o
d
u
i
t
s
m
i
s
e
e
n
u
v
r
e
d
e
l
i
a
i
s
o
n
E
D
I
o
u
w
e
b
f
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
c
h
e
s
p
r
o
d
u
i
t
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
d
e
s
c
o
m
m
a
n
d
e
s
e
n
E
D
I
o
u
v
i
a
l
e
w
e
b
s
c
a
n
n
i
n
g
a
c
c
s
p
a
r
t
a
g
l
a
i
s
d
e
p
a
i
e
m
e
n
t
f
a
c
t
u
r
a
t
i
o
n
p
a
r
E
D
I
o
u
W
e
b
S
u
r
l
e
s
u
x
p
h
y
s
i
q
u
e
s
t
y
p
e
s
d
e
p
a
l
e
t
t
i
s
a
t
i
o
n
e
t
d
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
a
d
a
p
t
e
n
s
e
i
g
n
e
s
t
o
c
k
a
g
e
d
e
s
p
r
o
d
u
i
t
s
n
i
s
m
i
x
p
u
s
h
/
p
u
l
l
c
i
r
c
u
i
t
s
d
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
p
r
e
s
t
a
t
a
i
r
e
s
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
s
l
o
g
i
s
t
i
q
u
e
s
r
e
t
o
u
r
d
e
s
i
n
v
e
n
d
u
s
D
i
f
f
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
d
e
s
e
n
s
e
i
g
n
e
s
M
a
r
k
e
t
i
n
g
c
l
i
e
n
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
u
r
o
f
f
r
e
a
d
a
p
t
e
a
u
p
o
s
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
d
e
l
e
n
s
e
i
g
n
e
P
L
V
s
u
r
e
m
b
a
l
l
a
g
e
m
a
r
q
u
e
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
u
r
s
o
p
r
a
t
i
o
n
s
s
p
c
i
-
q
u
e
s
e
n
s
e
i
g
n
e
p
o
u
r
s
e
d
i
f
f
r
e
n
c
i
e
r
d
e
l
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
n
o
u
v
e
l
l
e
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
r
o
m
o
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
c
o
p
a
c
k
i
n
g
O
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
a
s
s
o
r
t
i
m
e
n
t
s
p
r
v
i
s
i
o
n
s
d
e
s
v
e
n
t
e
s
o
f
f
r
e
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
a
d
a
p
t
l
a
z
o
n
e
d
e
c
h
a
l
a
n
d
i
s
e
P
D
P
(
p
r
o
t
d
i
r
e
c
t
p
a
r
p
r
o
d
u
i
t
)
g
e
s
t
i
o
n
d
e
s
m
a
g
a
s
i
n
s
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
a
g
e
s
t
i
o
n
d
e
s
l
i
n
a
i
r
e
s
T
A
B
L
E
A
U
1
1
.
2
.
E
n
j
e
u
x
d
u
t
r
a
d
e
-
m
a
r
k
e
t
i
n
g
e
t
l
e
v
i
e
r
s
d
a
c
t
i
o
n
11 Dornier/Fender.fm Page 415 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
416
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.2. largissement la dmarche dEfcient Consumer Response
(ECR)
2.2.1. Principes de lECR
Le projet Efcient Consumer Response (ECR), sous son appellation franaise, Rponse
Efcace au Consommateur, est n aux tats-Unis en 1992 sous limpulsion du Food
Marketing Institute. Lobjectif principal vis est de chercher rationaliser la chane de
distribution pour accrotre la valeur apporte aux clients tout en limitant les cots sy
rapportant. Fournisseurs et distributeurs recherchent ainsi une coopration pour
accrotre dans une dmarche commune et coordonne la satisfaction du consom-
mateur qui est plac au centre des proccupations communes. Ainsi, ce sont deux
objectifs majeurs qui transparaissent au travers de la dmarche ECR :
un objectif de rduction des cots. Cest principalement un travail didentication
des dysfonctionnements linterface du distributeur et du producteur qui permettra
de trouver les sources de cots non justis et donc les possibilits dconomie
commune. Ce sont essentiellement les oprations physiques et administratives qui
offrent le champ de travail commun aux deux interlocuteurs sur cet objectif. pour
lequel une des rponses consistera dvelopper et mettre en uvre des standards
en termes de mthodologies, de langage commun et de systmes de communi-
cation. Il est donc essentiel que le plus grand nombre dauteurs soit mobilis pour
atteindre un volume critique ;
un objectif de dynamisation commerciale. Cest ce que lon dnomme le demand
side de lECR. Lide qui prvaut ici est de faire passer le travail commun entre
producteur et distributeur dune logique de cots une logique de gain. Cet objectif
donne la possibilit daller au-del de la seule coopration logistique destine
rduire les cots et de passer une recherche de relle coopration commerciale.
Cest dans ce cadre que sinstaurent des chantiers dans le domaine des promotions,
de lintroduction des produits nouveaux, des conditionnements
Le travail men initialement aux tats-Unis est pass par la runion commune et
parts gales dindustriels, de grossistes distributeurs et de dtaillants. Deux axes ont
t principalement travaills : laxe de lchange dinformation et laxe du ux de
marchandises. Les chantiers de travail sont gnralement identis :
les best practices (les meilleures pratiques) et les retours dexprience ;
les indicateurs communs de mesure de performance, les outils et la technologie,
pour faciliter lchange et le partage de linformation ;
la formation et le management ;
la dnition des standards de cots et de suivi ;
la rsolution des problmes spciques dans une dmarche pragmatique.
2.2.2. Les champs dapplication de lECR
Les axes de progrs de lECR peuvent tre regroups en deux domaines stratgiques :
la gestion de la demande consommateur ;
11 Dornier/Fender.fm Page 416 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
417
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
la gestion de la chane dapprovisionnement.
et deux domaines support :
les supports technologiques ;
les intgrateurs.
S
CHMA
11.3.
Les champs dapplication de lECR (Source : site ECR France)
Chacun de ces champs pour lequel une coopration est envisage, donne lieu
lidentication de leviers concrets dactions. Il se rvle lexprience quun nombre
signicatif de ces leviers se trouve tre de nature logistique et concerne aussi bien
laction sur le ux de marchandise que sur le ux dinformation. LECR propose des
grilles de maturit (scorecard) qui permettent toute entreprise de sauto-valuer en
termes de dmarche cooprative.
La coopration entre producteurs et distributeurs sest traduite dans la foule en Europe
par le lancement dune tude SRC (Supplier Retailer Collaboration). Le SRC est une tude
mene par le Coca-Cola Retailing Research Group, qui a port sur 11 cas de collaboration
dvelopps entre industriels et distributeurs. Selon cette tude, la somme des bnces
potentiels issus de cooprations entre producteurs et distributeurs dans lindustrie
europenne peut tre value entre 2,3 % et 3,4 % du volume des ventes au prix de
dtail, cest--dire 3 4 fois moindres que dans lapproche ECR amricaine. Ces bnces
seront rpartis entre dtaillants (environ 60 %) et fournisseurs (environ 40 %).
La dmarche dimplantation de lECR dans les entreprises a suivi deux grandes phases.
Tout dabord, la premire phase est une phase collective dobservation et dvaluation
des enjeux. Il est remarquable de constater que dans ses dbuts lECR a principa-
lement repos sur des approches runissant plusieurs distributeurs et plusieurs
Gestion de la chane dapprovisionnement
Stratgie doptimisation des approvisionnements et moyens
Approvisionnement
efficace
Approvisionnement
pilot par
la demande
Excellence
oprationnelle
Guide de la demande consommateur
Cration conjointe de la valeur consommateur
Stratgie de la demande et moyens
Optimisation
des
assortiments
Optimisation
des
promotions
Optimisation de
lintroduction des
nouveaux produits
Intgrateurs
Plans et prvisions concerts
Analyse de la valeur (cots/bnfices)
Supports technologiques
Synchronisation globale des donnes
Messages lectroniques standards
Standards communs didentification
11 Dornier/Fender.fm Page 417 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
418
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
producteurs cherchant dans leur ensemble valuer les enjeux et observer les orien-
tations susceptibles dtre prises par chacun. Par exemple, lassociation ECR Europe
regroupant des distributeurs et des producteurs europens, a men des tudes type
Efcient Unit Loads (EUL). Lune dentre elle a regroup 11 producteurs (Danone,
Gillette, Kelloggs, Mars, Nestl, Heineken, Oetker, LOral, Procter & Gamble, Sara
Lee, Unilever) et 10 distributeurs (Atlantic, Auchan, Edah, FDB, ICA, Karstadt,
Promods, La Rinascente, Spar, Tesco). Elle a eu pour vocation dtudier le design le
plus adapt des contenants tels que les palettes, les rolls, les bacs plastiques an
quils soient efcaces tout au long de la chane de production-distribution. Lun des
rsultats de ltude est conomique. Il dmontre quun travail commun entre produc-
teurs et distributeurs sur les vecteurs de manutention est denviron 1,2 % du prix de
vente.
De mme, en France, cest au travers de lUnion Nationale des Industries du Bricolage
du jardinage et des Activits manuelles de loisir (Unibal) et de la Fdration Franaise
des magasins de Bricolage (FFB) quune tude ECR a t amorce entre plusieurs distri-
buteurs et producteurs sur le thme de lapprovisionnement partag. La dynamique
mise en place rvle l encore, le mode de dveloppement des dmarches ECR.
Amorce par une sollicitation des pouvoirs publics, la dmarche est promue par deux
instances professionnelles. Cest une fois ces tapes passes quun certain nombre de
chantiers mettant des industriels et des distributeurs en binme a pu se mettre en place.
La seconde phase des dmarches ECR, est une phase de construction de chantiers
binomiaux. Le producteur et le distributeur, ainsi runis, cherchent au travers de
travaux sur des chantiers identis dans le cadre de la phase 1 trouver les moyens
oprationnels de cette coopration. En France, Carrefour dans sa composante
Promods est apparu historiquement comme leader en ce qui concerne le dvelop-
pement de la dmarche.
La dmarche est sans aucun doute motive par des dysfonctionnements dont ptissent
industriels et distributeurs. La rupture de stock sur linaire est un problme-clef dont
on connat les consquences au niveau des ventes perdues instantanes et induites.
Les tudes montrent quun taux moyen de 10 % nest pas exceptionnel. Ce taux
moyen recouvre bien videmment des ralits trs diffrentes dun article un autre,
dun jour de la semaine un autre et dun point de vente un autre. Ce phnomne a
t accentu par lexplosion du nombre de rfrences articles estime 220 % en
vingt ans alors que les surfaces de vente nont augment en France que de 10 %.
Lanalyse des causes montre que si un certain nombre de causes sont imputables
chacune des parties, industriel ou distributeur, beaucoup dentre elles appartiennent
un processus Supply Chain conjoint.
Au-del des rsultats globaux en termes par exemple de fonctions soutenues par la
technologie EDI, il est essentiel de sintresser toute dmarche entreprise par deux
socits qui se sont donn un programme de coopration devant permettre datteindre
des rsultats concrets. Souvent, les objectifs de chacune des parties ne sont pas
symtriques :
11 Dornier/Fender.fm Page 418 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
419
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
pour le producteur :
rduction des litiges trs coteux en gestion administrative ;
optimisation et matrise des ux logistiques ;
rduction des ruptures qui nont pas la mme valeur conomique en semaine
compare au samedi aprs-midi ;
anticipation des vnements souvent accentus par le jeu des promotions
dveloppes par les enseignes ;
volution dune relation essentiellement base sur laffrontement sur les prix une
relation cratrice de valeur pour le consommateur nal.
pour le distributeur :
rduction du stock et matrise des cots ;
amlioration du taux de service en limitant les ruptures de stock en linaire ;
diminution des documents changs ;
extension et optimisation des changes informatiss.
Cette approche cooprative requiert la volont de comprendre le mtier de lautre au
niveau de ses spcicits et de ses contraintes. Le partage ne doit pas se faire
uniquement sur les gains potentiels mais aussi sur la rsolution pragmatique des
problmes.
Le chapitre suivant propose une analyse approfondie dune telle approche innovante.
2.3. Application au cas des produits cosmtiques :
le cas LaScad-Groupe LOral
2.3.1. Environnement commercial de LaScad
Cest en 1907 que le dveloppement de LOral commence sous limpulsion de son
fondateur Eugne Schueller qui invente les premires teintures capillaires distribues
exclusivement aux coiffeurs. La croissance de lentreprise na jamais cess tant au
niveau national quau niveau international (prsence actuelle dans 150 pays au tra-
vers de 375 liales et plus dune centaine dagents). Leader mondial des produits
cosmtiques il est prsent aujourdhui avec des marques telles que Vichy, Helena
Rubinstein, Garnier sur tous les segments de marchs et sur tous les circuits de dis-
tribution. Son chiffre daffaires tait en 2005 de 14,5 milliards deuros. Ses trois prin-
cipaux ples dactivits sont les suivants :
les activits cosmtologiques qui comprennent les activits capillaires (sham-
pooing, laque), les produits dhygine et de toilette (produits de rasage, gel dou-
che, dodorant), les produits pour la peau (laits hydratants, crme solaire,
maquillage), les eaux de toilette et parfums. Ces activits reprsentent environ
86 % du chiffre daffaires du Groupe ;
les activits pharmaceutiques, dermatologiques et biomdicales qui psent pour
environ 13 % du chiffre daffaires ;
11 Dornier/Fender.fm Page 419 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
420
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
les activits culturelles, plus marginales (presse, cinma, tlvision, art) qui repr-
sentent environ 1 % du chiffre daffaires, mais qui contribuent mieux connatre
et mieux inuencer les courants socioculturels.
LOral a ainsi progressivement largi et diversi ses activits dans tous les domaines
de la beaut, du soin et de lhygine du visage et du corps. Lentreprise sest structure
partir de quatre grandes divisions qui sont ddies chacune un circuit de distri-
bution. Chacune des divisions sorganise autour daffaires indpendantes qui
dveloppent et commercialisent leurs propres marques, au risque volontairement
accept de se retrouver en concurrence directe entre elles :
Produits Professionnels (14 % du chiffre daffaires) conoit et dveloppe les produits
professionnels et les produits destins la revente pour le circuit des salons de
coiffure. Plusieurs affaires sont en charge des activits de la division coiffure,
Krastase, Redken et LOral Technique Professionnelle ;
Distribution Produits Grand Public (55 %). Cette division regroupe des socits dont
les gammes sont destines au march de la grande diffusion. Ce sont trois affaires
qui assurent le dveloppement des activits de LOral sur ce march, Garnier-
Gemey-Maybelline, LOral Paris et laScad ;
Produits de beaut (25 %) qui comprend les affaires suivantes : Lancme, Helena
Rubinstein, Biotherm et un dpartement parfums (Cacharel, Guy Laroche, Paloma
Picasso, Giorgio Armani). Lensemble de ces produits est vendu dans un circuit de
distribution slective constitu des parfumeries de luxe, des duty-free shops et des
stands des grands magasins ;
Cosmtique Active (6 %) est la division qui conoit et qui commercialise les
produits des grandes marques LOral qui sont vendus dans le circuit des
pharmacies et des espaces beaut spcialiss. Les affaires suivantes sont intgres
cette division : Vichy, Laboratoires pharmaceutiques Roche-Posay et Innov qui
dveloppent de nouveaux segments de marchs propres au circuit de la pharmacie
et spciques la dermo-cosmtique de sant.
Les divisions oprationnelles grent les affaires qui leur sont rattaches, cest--dire
des entreprises qui ont donc des activits similaires sur un mme circuit de distri-
bution. Chacune des affaires dispose dune structure autonome et est essentiellement
en charge des activits de production (environ 45 usines dans le monde et
100 centrales de distribution) et de commercialisation.
La division Distribution de Produits Grand Public de LOral comprend trois affaires
dont LaScad (Spcialits Capillaires et Dermatologiques). Cest une affaire strictement
commerciale qui ne possde ni laboratoire de recherche ni usine en propre. Elle cre
et commercialise ses produits en utilisant les ressources des usines et des laboratoires
des autres affaires. Cette affaire a pour objectif de se consacrer aux marchs de
consommation populaire. Elle cherche donc non seulement dliser les consomma-
teurs actuels, mais galement transformer en consommateurs les non-consomma-
teurs. Dans cette optique lentreprise a dcid de dvelopper une stratgie de mga-
marques. Ce sont des marques indpendantes et puissantes faites pour durer. Elle a
11 Dornier/Fender.fm Page 420 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
421
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
dvelopp des marques reconnues leaders sur les segments concerns : Dop, Mixa,
Narta, Vittel, Mennen, Fluoryl, Ushuaia et Jacques Dessange.
Trois lments-cls structurent la stratgie de cette affaire :
la recherche qui reprsente prs de 3,5 % du chiffre daffaires et regroupe
3 000 chercheurs. 529 brevets ont t dposs en 2005 ;
linnovation. Le catalogue de produits est entirement renouvel sur 2 3 ans ;
la communication, sachant que 30 % des achats sont raliss sous impulsion. La
marque occupe une place centrale en apportant scurit, image et caution.
LaScad travaille de manire privilgie avec la grande distribution. Ses dix premiers
clients reprsentent plus de 90 % du chiffre daffaires et sont tous associs une
grande enseigne de la grande distribution.
LaScad prsente donc lintrt dtre une entreprise leader sur son secteur. Lentreprise
est numro 1 en shampooing, en dodorant, en produits douche et en volume tous
produits confondus. LaScad parle mme de lexception cosmtique pour illustrer le
contexte de son march croissance forte dans un environnement o les autres
segments se situent dans un contexte de march stagnant voire en rgression. De plus,
les produits Hygine-Beaut commercialiss par LaScad sont particulirement impor-
tants pour la grande distribution puisquen 1990 ils reprsentaient environ 3 % du
chiffre daffaires du secteur, aujourdhui 4 %, et 12 % de la croissance en super et
hypermarch. Cette croissance se traduit par un rendement trs lev en grande distri-
bution, le rayon DPH (Droguerie, Parfumerie, Hygine) tant le troisime rayon visit.
Les clients passent beaucoup de temps dans ce rayon, prs de 1 minute 15 secondes,
alors que ce temps se rduit 39 secondes pour les produits alimentaires en gnral et
5 secondes pour la lessive. Dans les grandes surfaces, le rendement au mtre carr
des produits cosmtiques est suprieur la moyenne des autres segments. Pour un
indice de rendement moyen de 100 de tous les autres segments, cet indice est gal
138 pour le secteur DPH. Lorsquun hypermarch ralise un chiffre daffaires de
6 100
/m
2
tous produits confondus, le rayon DPH ralise quant lui 9 200
/m
2
.
Nous noterons enn, pour terminer dillustrer la sensibilit de ce secteur au sein de la
grande distribution, que le rayon DPH reprsente 3 % de la surface de vente en
grande distribution alors quil contribue 5 % du chiffre daffaires ralis et 15 %
des rfrences en rayon.
2.3.2. Place de la logistique dans lentreprise
Comme dans la plupart des entreprises de produits de grande consommation, la logis-
tique de LaScad est structure autour de deux ples, un ple de logistique industrielle
et un ple de logistique commerciale. Le ple de logistique industrielle ressemble
celui que lon retrouve chez les industriels non spcialiss en produits de grande
consommation. Elle se concentre sur la mise sous tension des ux, sur lorganisation
des approvisionnements, sur la gestion des transports assurant lapprovisionnement
des entrepts La logistique commerciale est beaucoup plus spcique aux entre-
prises travaillant avec la grande distribution. Cette logistique commerciale comprend,
11 Dornier/Fender.fm Page 421 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
422
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
le plus souvent : un service client qui assure la prise des commandes ; une partie
comptabilit qui assure la facturation et la relance paiement des clients ; une fonction
dveloppement qui suit essentiellement les projets de systme dinformation en cours
de mise en place avec la grande distribution ; une fonction stock court terme qui gre
les problmes avec la centrale de prparation de commande et dexpdition ; une
fonction de gestion de la codication et de maintenance du catalogue produits ; enn,
une fonction de production des prvisions qui assure la consolidation entre la
fonction marketing, la fonction commerciale et les usines.
La logistique constitue un enjeu stratgique double titre :
elle accrot le chiffre daffaires, en recrutant de nouveaux consommateurs et en
augmentant la valeur moyenne du panier, ce qui rpond la stratgie commerciale
dont lobjectif est de grer la rencontre entre le consommateur et le produit ;
elle diminue les cots logistiques et administratifs, ce qui amliore la protabilit et
rpond la stratgie globale de LOral.
Limportance des promotions est primordiale : un produit donn est promotionn en
moyenne 6 fois par an et plus de 50 % du chiffre daffaires sont raliss dans les
3 derniers jours du mois. Il est donc clair que le ux logistique est constitu de deux
familles logistiques : les produits promotionns et les produits en linaire. Par
dnition, les produits promotionns sont des produits quantit limite qui
Objectifs gnraux Dclinaisons logistiques
Toute entreprise de
produits de grande
consommation
Amliorer la productivit Amliorer le passage des commandes (EDI)
support de la relation commerciale
Assurer la qualit totale Livrer le bon produit au bon moment
Limiter les ruptures de stock
Adopter une stratgie enseigne Proposer une offre logistique par enseigne
Exception cosmtique Croissance importante Catalogue renouvel sur 2 3 ans
Rendements suprieurs la
moyenne
Sduction et achats dimpulsion
Activit promotionnelle centrale
180 rfrences standards
600 rfrences traites dans lanne
Limiter les ruptures de stock
60% du volume vendus en promotion dont
40 % en oprations spciales tte de gondole.
Mise en place dune logistique ddie
promotion
Particularits de
LaScad
Renouvellement trs rapide des
produits
50% des rfrences rednis chaque anne.
Piloter lintroduction de nouveaux produits et
rduire le time to market
Croissance suprieure celle du
march
60% des volumes en promotion. Clarier
loffre du linaire
T
ABLEAU
11.3.
Objectifs de LaScad et dclinaisons logistiques
11 Dornier/Fender.fm Page 422 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
423
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
conduisent gnralement des ruptures de stock et la ncessit darbitrer laffec-
tation des pnuries entre les distributeurs. Dans le schma 11.4, les produits destins
recomplter le linaire constituent le ux tir car dimensionn selon un rassort
automatique suivant la consommation, alors que les produits promotionns consti-
tuent le ux ngoci ou pouss (notion de push commercial) :
S
CHMA
11.4.
Prise en compte dun double ux logistique chez LaScad
La logistique intervient donc pour
la fois soutenir la demande par
la mise disposition des produits
promotionns caractriss par
un cycle de vie trs court et
pour limiter les ruptures de
stocks. La rsultante de limpli-
cation de la logistique comme
levier du marketing mix est
laccroissement du volume
comme le montre le
schma 11.5.
2.3.3. La logistique dans le partenariat cosmtique de LaScad
LaScad a intitul sa dmarche dinstauration de travail commun avec la grande distri-
bution, le partenariat cosmtique . Ce partenariat prsente trois grandes caractris-
tiques. La premire cale cette dmarche sur lECR et place donc le client au centre de
la rexion. LOral et ses partenaires distributeurs cherchent optimiser une offre
Produits fonds de commerce destins
alimenter en permanence le linaire.
rassort automatique suivant la consommation.
rgles de rapprovisionnements fixes a priori.
rfrentiel de consommation : teste lefficacit des promotions.
Des oprations spciales destination
des espaces promotionnels.
livraisons de quantits limites sur des priodes finies,
engagement rciproque avant la priode promotionnelle sur
les quantits et les dlais),
moyens associs.
Systme
dinformation
Unit de
distribution
Entrept
Magasin
Linaire
Promotion
Consommateur
Un flux tir Un flux ngoci
E.D.I
SCHMA 11.5. La logistique levier de production
des volumes vendus
Volume
Demande
consommateur
Ruptures
Promotions Prix Linaire Rassort
11 Dornier/Fender.fm Page 423 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
424
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
commune qui se dnit en termes de marque (LOral) et en termes de linaire (les
distributeurs). La seconde postule la construction dun partenariat global. La logistique
ne reprsente que lun des leviers daction qui agit sur des axes de travail multiples,
comme le montre le schma 11.6 :
SCHMA 11.6. Le partenariat cosmtique
Elle permet de trouver les gisements dconomie recherche et elle rend possible les
actions communes damlioration des ventes. Enn, la troisime prcise que ce parte-
nariat repose principalement sur une logique de gain et non pas seulement sur une
logique de cots.
La spcicit du partenariat cosmtique est donc de dpasser le cadre strict logistique
lintgration de la composante commerciale dans la dnition des objectifs du
partenariat, en cherchant en particulier augmenter les ventes, notamment par la
diminution des ruptures, comme le montre le tableau 11.4.
Actions
commerciales
Rduction des
ruptures
Diminution des
cots logistique
Partenariat classique + ++ +++
Partenariat cosmtique +++ +++ ++
TABLEAU 11.4. Comparaison des objectifs du partenariat classique
avec ceux du partenariat cosmtique
Politique
dassortiment
Assortiment large, segmentation
dveloppe, implantation par marques.
Propositions dassortiment.
Tableaux de bord contrle de gestion.
Dveloppement tests magasins.
Principes
Flux
logistiques
Qualit de service, acclration des
flux, mise en place EDI comme support
de la relation commerciale.
Optimisation des flux, circuit de
commandes, direct vs entrept,
gestion partage.
Politique
promotionnelle
Achat dimpulsion,
stimulation de la demande,
push commercial.
Redfinition du rle de la promotion,
tableau de bord danalyses,
critres de slection.
Marketing
denseigne
Oprations spciales spcifiques
enseigne, catalogues enseignes..
Personnaliser la relation commerciale
par enseigne, promotions spcifiques,
offre personnalise.
Merchandising
Sduction, lot beaut, implantation
par marques, thtralisation.
Dvelopper la rfrence LASCAD
en merchandising.
Projets
11 Dornier/Fender.fm Page 424 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
425
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Ce type de partenariat est donc principalement centr sur la coopration logistico-
commerciale comme le montre le schma 11.7 :
SCHMA 11.7. Mode de coopration logistique dans le domaine cosmtique
Lobjectif est avant tout danticiper et de provoquer la croissance du march pour
dgager de la marge et non pas de rduire laction commune la rationalisation des
circuits. Les questions poses sont donc :
comment optimiser les ux en prservant la dynamique commerciale ?
comment diminuer les ruptures en rayon ?
comment acclrer la mise en place des produits en rayon ?
En termes de conduite de la fonction logistique, cest un changement de posture qui
se dessine. Ce changement de posture se traduit par trois grands objectifs :
simplier les oprations en les clariant pour liminer toutes les sources
dambigut qui provoquent la plus grande partie des dysfonctionnements logis-
tiques et leur redonner un sens pour expliciter le lien existant entre la dynamique
logistique et les grands choix stratgiques de lentreprise ;
anticiper par la mise en place dun tat desprit et dun ensemble dindicateurs ;
intgrer de faon tablir une cohrence de fonctionnement de la matire premire
jusquau caddie du client.
La chane logistique de LaScad est ds lors apprhende de manire diffrente. Dune
approche squentielle des ux dinformation et des ux de matire, transitant par un
grand nombre dintermdiaires (cf. schma 11.8), on passe une vision beaucoup plus
intgre o le client est pratiquement directement en relation avec lindustriel (cf.
schma 11.9). Cest une redistribution des rles qui soppose lattitude prise par un
Coopration logistico-oprationnelle (mode 1)
(relation entrept-entrept)
Coopration logistico-commercial (mode 2)
(relation acheteur-vendeur)
Coopration logistico-marketing (mode 3)
(relation marketing-marketing)
Cas LaScad
(50 %, 100 %, 30 %)
1
0
0
%
1
0
0
%
3
0
%
1
0
0
%
5
0
%
11 Dornier/Fender.fm Page 425 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
426
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
grand nombre de distributeurs qui ont cherch pendant des annes isoler, au
contraire, le producteur de son client. Cette coopration, si elle ne prend pas encore le
caractre absolu dcrit dans le schma 11.7, nen est pas moins devenue une ralit.
SCHMA 11.8. Supply Chain classique de type Make to Stock
SCHMA 11.9. Supply Chain intgre cooprative
titre dexprimentation, le partenariat entre GALEC et LOral Parfumerie fut un
projet denvergure nationale. Il portait en 1996 sur un test dans deux centrales rgio-
nales sur les 16 que comprend le GALEC. Le partenariat portait plus prcisment sur :
un projet logistique sur deux points de vente o les rapprovisionnements sont
directement pilots par LOral Parfumerie partir des sorties de caisse fournies par
le GALEC ;
Entrept producteur Usine producteur Prestataire logistique
Flux de produits
Flux de la demande
Entrept distributeur Hypermarch
Entrept producteur Usine producteur Prestataire logistique Entrept distributeur Hypermarch
Flux de produits (lisss, continus et synchroniss la demande de consommation)
Flux de la demande (continu et prcis)
11 Dornier/Fender.fm Page 426 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
427
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
un projet commercial qui porte sur une amlioration des processus promotionnels
au niveau national (lissage dun plan promotionnel, une PLV adapte aux coule-
ments de marque la taille et au potentiel des magasins) ;
un projet de marketing denseigne (valorisation promotionnelle, merchandising,
formation des acteurs sur le terrain).
Le partenariat entre Garnier et Promods portait la fois sur les entrepts (un entrept
Promods concern sur les quatre), et sur les aspects commerciaux et marketing. Dans
ce cas la dimension logistique est aborde de manire diffrente de celle du GALEC.
Les rapprovisionnements sont pilots automatiquement par Garnier, non pas au vu
des sorties de caisse, mais en fonction des mouvements en entrept. On constate que,
dans ce cas, les premiers rsultats ont pu tre mesurs. Le taux de service est pass de
88 % 98 %, les litiges ont pratiquement disparu avec un passage du taux de
conformit des factures de 72 % 92 %. Enn, le nombre de jours de stock a baiss
de 33 % en volume et de 6 % en valeur. Le projet commercial est, quant lui, fond
sur la sparation entre ux de produits promotionnels et ux de produits normaux .
2.3.4. Outils et dmarches mis en uvre dans le partenariat cosmtique
Le partenariat cosmtique que LaScad cherche mettre en place comporte quatre
champs principaux.
Le premier champ est le traitement des causes de dysfonctionnement. Les outils mis
en uvre pour traiter ces dysfonctionnements concernent :
le traitement de linformation relative la commande :
. la cration dune fonction catalogue qui a pour but de ltrer les commandes
an de ne dverser dans le systme que les bons produits correspondant la
documentation de vente relative une enseigne donne et damliorer les
prvisions,
. la systmatisation de lEDI pour pouvoir mieux anticiper et abiliser,
la abilisation des prvisions des ventes par une meilleure communication chez le
producteur et entre le producteur et le distributeur. Cet axe de progrs est dtaill
dans la partie consacre aux implications organisationnelles de la coopration,
la planication de larrive des marchandises et du dchargement des marchan-
dises dans lentrept distributeur,
lamlioration de la gestion des stocks :
. en supprimant les rfrences non rentables : les responsables marketing et
commerciaux sont dune faon gnrale opposs au retrait dun produit, la
largeur de lassortiment gnrant de la croissance ;
. en supprimant les queues de stock, ce qui implique un engagement des distribu-
teurs sur des quantits concernant les prsentations spciales et lacceptation de
ruptures de stock sur des promotions. Ce dernier point est particulirement
dlicat (voir schma 11.10).
11 Dornier/Fender.fm Page 427 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
428
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
SCHMA 11.10. Dcomposition des stocks
Ce schma montre limportance des stocks spculatifs issus des comportements conjoints
du producteur et des distributeurs. La limitation des stocks spculatifs sur les produits
pousss permet de librer de lespace dans lunit de distribution logistique et de mettre
en place un stock outil qui rpondra immdiatement aux demandes des clients et qui
sera dimensionn partir des prvisions de vente issues du catalogue enseigne. Lespace
dgag permettra galement dimplanter un stock de scurit, qui aura pour but de com-
penser une certaine dfaillance des usines et ceci pour les produits plus forte rotation.
Paralllement, il a pour mission de rpondre une acclration de la demande ;
Le second champ est le traitement des promotions. Les promotions entranent une
grande dstabilisation au niveau de la gestion des ux physiques, les commandes
tant passes en n de mois et les livraisons physiques connaissant un pic en dbut
de mois suivant. Le lissage des promotions par des approches du type EDLP (Every
Day Low Price), pratiques par des enseignes telles que Wal Mart, est une solution
attrayante qui se heurte nanmoins un manque de conance sur le lissage effectif
des hausses de prix en particulier ;
Le troisime champ est lamlioration des performances du linaire. La coopration
sur ce champ entre LaScad et les distributeurs est engage sur 4 chantiers compl-
mentaires :
Lemplacement de lunivers parfumerie : LOral prconise de situer le rayon
parfumerie entre le textile (zone dagrment) et le rayon bb-pharmacie-produits
dittiques (zone saine). En effet, la vocation du rayon hygine beaut sant (HBS)
est de soutenir et de crdibiliser une surface dachat lie au bien-tre et au mieux-
tre. De plus, le rayon HBS marque autant le dbut de lachat plaisir et agrable
(textile, sduction) que la csure entre loccasionnel et lusuel, entre les achats de
soin ou de rafnement et les achats indispensables. Le consommateur considre le
Stock
moyen
Stock
outil
Stock
scurit
Stock
de gestion
Stock
spculatif
56 jours 48 jours
2 jours
3 jours
3 jours
11 Dornier/Fender.fm Page 428 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
429
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
rayon HBS comme essentiel et comme un bol dair au milieu des achats
incontournables que constituent les achats alimentaires,
Optimisation de lassortiment : LOral prconise un assortiment long qui offre en
permanence aux consommateurs un grand choix de produits techniques et de qualit,
des nouveauts, et aussi des premiers prix pour satisfaire une clientle moins aise,
Accroissement de la taille du rayon cosmtique : cette prconisation est justie
pour deux raisons :
. la rotation des produits cosmtiques est plus forte que la rotation moyenne de
lensemble des produits du magasin,
. clarication du rayon cosmtique et donc augmentation des ventes,
Dnition commune de lassortiment : il sagit de travailler ensemble pour dnir
lventail des produits en magasin an doptimiser lefcacit et le rendement de
lespace de vente. Cette collaboration a pour objectifs :
. laugmentation des ventes de 10 15 % et de la marge brute de 5 7 %,
. une meilleure performance logistique par lamlioration des prvisions des
ventes par rfrence ;
Enn, le quatrime champ concerne le dveloppement et le lancement de nou-
veaux produits. Lintroduction de nouveaux produits constitue une activit haute
valeur ajoute dans la chane dapprovisionnement. Elle renforce la position du
fournisseur par rapport ses concurrents, prote au processus dachat au magasin
du dtaillant et offre aux consommateurs des solutions plus adaptes leurs
besoins. La collaboration au niveau du dveloppement de nouveaux produits est
plus difcile appliquer, car les producteurs estiment que leurs programmes de
dveloppement sont exclusifs, condentiels et quil est donc dangereux de les parta-
ger avec des tiers. En revanche, la coopration relative au lancement de nouveaux
produits permet des gains signicatifs en sintressant aux domaines suivants :
la dnition de lemballage en termes de taille, de facilit de manutention, deffet
rendu sur le linaire et doptimisation du rassort (quantit minimale de commande),
la dnition de la gamme optimale de produits selon les articles que prfrent les
consommateurs et le nombre darticles qui doivent tre prsents sur les linaires,
la xation du meilleur prix par des tests parallles effectus dans les conditions
relles du march,
le choix de lemplacement des linaires et lattribution de lespace.
11 Dornier/Fender.fm Page 429 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
430
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
3. LES IMPLICATIONS ORGANISATIONNELLES DE LA COOPRATION
LOGISTIQUE ET SUPPLY CHAIN
3.1. Implications organisationnelles gnrales
de la coopration logistique
La coopration logistique largie implique un engagement de fonctions en nombre
plus important comme le montre le schma 11.11. un niveau strictement opra-
tionnel, la coopration logistique implique les acteurs de lentreposage, du transport
et des changes dinformations routiniers. La coopration logistico-commerciale
engage les vendeurs du producteur et les acheteurs du distributeur dans un dialogue
constructif, alors que la coopration logistico-marketing ncessite un dialogue
associant plusieurs acteurs des deux extrmits de la chane dapprovisionnement.
SCHMA 11.11. volution de linterface producteur/distributeur
Ce schma permet de reconnatre la modication de la nature et du contenu de
linterface organisationnelle entre le producteur et le distributeur. Une autre faon de
reprsenter cette volution est donne dans le schma 11.12 :
SCHMA 11.12. largissement de linterface producteur/distributeur
Producteur Distributeur
Usines de
production
et marketing
Appro
entrept du
producteur
Ventes Appro
entrept du
distributeur
Magasins
marketing
enseigne
Achats
Coopration
logistico-oprationnelle
Coopration
logistico-commerciale
Coopration
logistico-marketing
Industriel Industriel Industriel Distributeur Vente Achat
Logistique
Information
tudes
Marketing
Commercial
Merchandising
Administration
Relation transactionnelle Relation inter-organisationnelle
multifonctionnelle
11 Dornier/Fender.fm Page 430 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
431
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La premire situation est caractrise par une interface rduite au minimum entre la
fonction vente du producteur et la fonction achat du distributeur. Elle est occupe par
une relation mono-fonctionnelle mettant face face avec comme seul objet
dchange, le plus souvent conictuel, les conditions tarifaires. Nous sommes dans la
conguration dune relation transactionnelle caractristique de la coopration
logistico-oprationnelle (mode 1). La seconde phase permet une densication et un
largissement des changes en associant dautres fonctions aussi bien chez le
producteur que chez le distributeur. Nous la qualions de relation inter-organisation-
nelle multifonctionnelle caractristique de la coopration logistico-commerciale
(mode 2). Elle associe, en parallle la relation commerciale, des facteurs logistiques,
nanciers et industriels. Cette logique ne remet pas en cause fondamentalement les
organisations internes des deux acteurs. Elle est donc insufsante car on continue de
cloisonner les experts et il ny a pas dinterface de coordination.
Dans le cas de la coopration logistico-marketing (mode 3) et dans certains aspects
dlicats de la coopration logistico-commerciale (mode 2), dynamique promotion-
nelle), un prrequis organisationnel est ncessaire en redcoupant les fonctions au
sein des deux organisations et en crant de nouveaux mtiers et des systmes de
communication vhiculant les informations ncessaires la coopration intra et inter-
organisationnelle, comme le montre le schma 11.13 :
SCHMA 11.13. Changement de posture organisationnelle
Ds lors, ce ne sont plus des fonctions qui travaillent en parallle, mais cest une
organisation multifonctionnelle oprationnelle intgrant la palette des comp-
tences et des activits qui assurent la dynamique cooprative entre le producteur et le
distributeur au sein de nouveaux mtiers tels que le charg denseigne chez le
producteur et le category manager chez le distributeur. Les fonctions de spcialistes
(merchandising, logistique, sourcing, nancier, customer service) perdurent mais
sont dsormais positionnes en back-ofce en soutenant lorganisation cooprative.
Industriel Industriel Industriel
Distributeur
Vente Achat
largir la comptence du commercial Category-Management
Charg
denseigne
Category
manager
Coordination dexpertise, quipe de projet,
objectif commun, formation.
Relation transactionnelle Nouvelle forme organisationnelle ad hoc
11 Dornier/Fender.fm Page 431 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
432
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Lintgration fonctionnelle est souvent un prrequis lintgration sectorielle comme
le montre la partie suivante.
Si nous analysons les diffrentes composantes ncessaires linstauration dun mode
relationnel nouveau, nous pouvons, partir du cas de LaScad, dvelopper une trajec-
toire selon laquelle lvolution relationnelle sinstaure.
La question principale qui reste pose au producteur ou au distributeur lors de la mise
en uvre dune dmarche dintgration sectorielle de la logistique est celle de la
dmarche de travail avec linterlocuteur choisi. La remise en cause des habitudes et
des modes relationnels historiques entre producteur et distributeur se trouve fortement
pose. Il faut donc construire peu peu un nouvel espace dchange et faire du thme
logistique non plus un espace de manuvre commerciale limit une entreprise mais
un lieu commun de travail qui ne vise qu maximiser loffre au client nal.
La dmarche de coopration propose a port en termes de champ dapplication, sur
un espace gographique limit rvlant en cela la ncessit de dmontrer par un
exemple concret la faisabilit de la dmarche et ses impacts avant que den chercher
une gnralisation. Il est rvlateur danalyser le cheminement qua souhait suivre
LaScad pour crer les conditions de base dun change constructif, bas sur la
recherche commune de solutions, avec un distributeur, et partant dun climat
classique de conit. Cinq grandes tapes ont t suivies qui laissent deviner la
progression de la dmarche et qui conrme la nature progressive des relations que
peuvent instaurer un producteur et un distributeur qui souhaitent collaborer.
Une premire tape a consist tablir un change avec le distributeur pour le
convaincre dun travail commun. Cest la phase du dialogue qui a ncessit pour
LaScad plusieurs mois deffort. La seconde tape a consist trouver un chantier
concret sur un domaine factuel auquel le distributeur est sufsamment sensible et
pour lequel les enjeux concrets sont sufsamment perceptibles pour quil puisse
souvrir. Ce travail a t engag sur le terrain avec un entrept et deux magasins. Il
visait galement concrtiser un processus dchange dinformations. Le sujet sur
lequel il a t dcid de lancer le dialogue est celui des litiges. La dmarche consistait
fournir de linformation an de pouvoir en rcuprer en retour. Cest une tape
dinitialisation et de dcouverte sur des aspects ponctuels et concrets de lintrt dun
travail commun. Elle facilite plus particulirement la ddramatisation du processus
dchange de linformation particulirement sensible dans la grande distribution. Elle
a pour vocation principale dtablir un travail sur les thmes que vise la dmarche
dintgration logistique. Linformation logistique a acquis un caractre condentiel du
fait de la nature conictuelle des relations entre commerce et industrie. Cette phase
cherche donc dmontrer le caractre positif partag de lchange dinformation dans
le domaine logistique. Nous trouvons dans cette seconde tape lillustration de ce que
nous appelons la collaboration.
La troisime tape a port sur une dimension plus consquente dans ses implications
et dans sa logique : lanalyse historique puis continue des ruptures entre LaScad et
lentrept dune part et lanalyse des ruptures entre le dpt et les magasins dautre
11 Dornier/Fender.fm Page 432 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
433
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
part. Cette troisime tape rvle un processus de mise en ordre plus vaste. Les
ruptures peuvent tre considres comme un phnomne de dsordre. La compr-
hension de ce phnomne et les ractions mettre en uvre pour les pallier
sapparentent ce que nous appelons la coordination. La quatrime tape de la
relation a ouvert un nouveau registre. Si elle a encore une composante logistique elle
porte galement sur une dimension marketing et commerciale. Cette tape a consist
tablir un audit du merchandising et un diagnostic du linaire. Lintrt a t
dimpliquer dans ces changes un niveau diffrent dinterlocuteur. Ce sont donc le
reprsentant et le chef de rayon qui ont ainsi appris travailler ensemble avec une
proccupation dinscription de la relation dans le temps. Enn, la cinquime tape, la
plus dlicate, porte sur la recherche commune dactions commerciales. Plus spci-
quement elle vise une acclration des sorties de caisse par la cration de lot virtuel
ou doprations de couponnage. La dimension dactions commerciales communes
quelle comporte requiert un plus grand formalisme dans la dmarche et linstauration
dune relation que nous qualions dalliance.
Cet exemple montre comment le changement relationnel qui sinstaure dans le canal
de distribution des produits de grande consommation entre producteurs et distribu-
teurs ne peut pas tre pos uniquement en termes de logistique. Le risque serait alors
den rduire la porte. Comme nous lavons montr chez LOral, on se refuse parler
dun partenariat strictement logistique. Parler de partenariat entre distributeur et
LOral, suppose trois composantes :
une composante merchandising ;
une composante commerciale ;
une composante logistique.
La prsence de la logistique dans ce triptyque rvle le caractre intgrateur quelle
recle dans la relation entre producteurs et distributeurs. La logistique reprsente un
excellent point dentre susceptible de produire des rsultats quantis rapidement.
Cette production de rsultats valuables rend possible linstauration dune dynamique
rcurrente entre producteurs et distributeurs et permet llargissement de la rexion
de nouveaux champs qui sont ceux du merchandising et du commercial.
Le mode gnral est celui dun discours propre au secteur qui prche la mise en place
dun relationnel nouveau. Les concepts de trade-marketing et dECR offrent un cadre
de base favorable aux lancements de tentatives concrtes pour inchir le mode de
travail. Cette inexion sopre par un travail progressif sur un double axe douverture
du champ dchange dinformations et des changes fonctionnels. Historiquement, la
relation entre producteurs et distributeurs se grait exclusivement au travers de la
relation achat/vente. Ici, le point initial dinstauration de la relation est atypique
puisquil nest pas directement associ lacte dachat ou lacte de vente. Le
producteur propose au distributeur dentrer dans un change concret partir de la
dimension logistique. Cette relation parcourt une chelle progressive dans le degr de
la relation en passant dune position minimale, le dialogue, pour se diriger ensuite
vers la collaboration, la coordination, la coopration, puis, enn, lalliance. Le degr
douverture de linformation crot chaque tape. Il faut bien noter que dans la
11 Dornier/Fender.fm Page 433 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
434
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
relation qui existe et qui reste de nature commerciale, lchange dinformation est par
nature lune des dimensions les plus sensibles autour de laquelle se structure la
relation.
Au niveau du dialogue, lchange se structure autour de faits logistiques pour tenter
damorcer, sur un point prcis, un approfondissement. Le producteur apporte de
linformation pour tenter damorcer lchange. Le point dentre de ltape de collabo-
ration est un lment qui reste encore de nature conictuelle puisquil concerne
lexamen des litiges. Lapproche de cette question na bien videmment pas pour
vocation den faire un traitement nancier. Cest loriginalit de lapproche. Elle vise
faire une analyse des causes qui pourrait aider la rsolution ultrieure de la
dimension nancire. Le troisime degr douverture informationnelle porte sur une
dimension qui reste encore un constat a posteriori : les ruptures. Il a pour vocation de
trouver des modes de fonctionnement, ltude du pass, qui permettraient
danticiper sur le renouvellement de problmes identiques. La quatrime tape
consacre louverture des dimensions nouvelles puisquelles concernent le merchan-
dising et loptimisation du linaire.
SCHMA 11.14. Trajectoire dtablissement du dialogue producteurs-distributeurs
Nous voyons en parallle, quau fur et mesure que le degr douverture de lchange
dinformation saccrot, la nature et la varit des interlocuteurs slargissent pour
stendre aux responsabilits commerciales et achat. Dune relation bipolaire, achat/
vente, on voit ainsi se mettre en place une relation multipolaire qui sollicite dans la
relation entre le producteur et le distributeur des interlocuteurs multiples.
Directeurs
logistique
Faits
logistiques
Degr
douverture
fonctionnelle
Degr
douverture
informationnelle
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
C
o
o
p
r
a
t
i
o
n
A
l
l
i
a
n
c
e
Fonctionnels
Logistique
Litiges
Logistique
tendue
(magasin)
Ruptures
Reprsentants
et chefs
de rayon
Merchandising
et audit du
linaire
Mkg achat
Mkg vente
Actions
commerciales
D
i
a
l
o
g
u
e
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
11 Dornier/Fender.fm Page 434 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
435
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
3.2. volution des mtiers
3.2.1. Conguration organisationnelle initiale
Dans lorganisation initiale, la fonction logistique est totalement absorbe par la
fonction commerciale de lentreprise et se confond en quelque sorte avec une
fonction dadministration des ventes dans sa logique. Un approfondissement des
missions de cette fonction logistique permet didentier en ralit trois objectifs qui lui
sont ddis :
assurer une assistance au reprsentant commercial sur le terrain (chantillons,
publicit sur lieu de vente, informations documentaires sur les produits). Cette
mission sappuie sur deux outils, que nous avons dtaills dans le chapitre 8, lun
quali de produit , qui fournit des informations sur la che produit, et lautre,
portefeuille , qui permet de piloter le ux entre les commandes, les donnes
prvisionnelles et les plans de production, et par consquent de faire en sorte que
les produits soient disponibles quand la demande sexprime ;
faire en sorte que les produits soient en conformit qualitative lorsque les consom-
mateurs les trouvent en linaire ;
respecter les exigences de service que demandent les distributeurs. Ces attentes de
service sont gres soit magasin par magasin, soit au niveau national pour une
enseigne donne.
Cette organisation est inefcace pour faire face aux nouveaux enjeux imposs par
lvolution de la grande distribution et il devient ncessaire de concevoir une organi-
sation logistico-commerciale.
3.2.2. Rorganisation de la fonction logistique et implantation
dune structure logistico-commerciale
Lobjectif majeur pour la logistique commerciale est de dvelopper les partenariats
coopratifs entre le producteur et ses distributeurs. La dclinaison de cet objectif
principal conduit la conguration suivante :
le rapprochement entre les fonctions logistiques, dont la mission essentielle est de
fournir le niveau de service client souhait, et les fonctions commerciales, ce qui
conduit une approche enseigne par enseigne ;
la gestion par projets dans les domaines logistiques. Les dveloppements de
solutions informatiques comme celles exposes dans le chapitre 8 sont de bons
exemples de projets transversaux qui associent les diffrents acteurs impliqus dans
lobtention de ces objectifs communs.
Une vritable structure logistico-commerciale a t mise en place pour faire face ses
nouveaux objectifs. Dune part, lvolution de la distribution a conduit une restruc-
turation du rseau commercial. Organiss jusqualors en rgion, les reprsentants se
sont vu attribuer des enseignes spares en deux circuits : le circuit direct o le repr-
sentant doit prendre les commandes et ngocier directement sur chaque point de
vente et le circuit socits o cest lentrept ou la centrale qui sont dmarchs. Au
11 Dornier/Fender.fm Page 435 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
436
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
niveau du sige, des directeurs de clientle responsables de plusieurs enseignes ont
t mis en place. Les enseignes, dont ils soccupent, appartiennent lun des deux
circuits. Deux directeurs de circuit assurent la coordination de toutes les actions
commerciales menes par les directeurs de clientle.
SCHMA 11.15. Objectifs de la fonction commerciale
Dautre part, des postes de correspondants denseigne ont t crs sous la responsa-
bilit de la direction logistique. Leur fonction principale est de prolonger le
commercial pour un meilleur service au client. Le correspondant denseigne quitte
une fonction dintendance pour adopter une fonction de fournisseur de service
ractive sappuyant sur une logistique de soutien efcace. Il occupe donc une
position-cl dans linterface cooprative entre le producteur et le distributeur, comme
le montre le schma 11.16 :
SCHMA 11.16. Place du correspondant denseigne dans lorganisation commerciale
Le mtier de correspondant denseigne a vocation subir de profondes mutations an
de jouer un rle important au niveau de la diffrenciation des enseignes dont les
composantes sont principalement les suivantes :
analyser les rsultats obtenus avec lenseigne, tant du point de vue logistique que du
point de vue crdit recouvrement ;
travailler avec leur homologue commercial an de faire un bilan mensuel global des
rsultats obtenus avec lenseigne ;
proposer des solutions adaptes aux besoins de chaque enseigne. Ces solutions sont
la base dune vraie diffrenciation par la mise en place de solutions constructives
propres une enseigne donne ;
assumer les rsultats obtenus. Ces correspondants denseigne seront valus et
rmunrs selon les rsultats obtenus sur le crdit et sur le taux de service apport.
Simplifier Anticiper Intgrer
Clarifier les tches
et les procdures
Redonner un sens en
redfinissant les missions
de chaque acteur
Un tat desprit
Rquilibrer le pouvoir
dans la chane logistique
entre producteur et
distributeur
Vision globale
(des matires
premires au
consommateur final)
Service client Service interne
Fonctions dappui Client
Correspondant
denseigne
11 Dornier/Fender.fm Page 436 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
437
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
On peut parler de vritable pyramide inverse des activits de ce correspondant
denseigne comme le montre le schma 11.17 :
SCHMA 11.17. Inversion des proccupations de lorganisation logistique
Le correspondant denseigne sappuie sur des outils dinformation qui acclreront les
ux et participe au dveloppement de nouveaux indicateurs (crdit octroy par
enseigne, suivi des actions spciales, suivi de lactivit commerciale, suivi des actions
spciales, taux de service) qui permettront de mesurer les niveaux de performance
obtenus. Dans ce contexte, il est important de dvelopper des automatismes pour les
tches rptitives et sans relle valeur ajoute et au contraire accrotre la responsabili-
sation des hommes sur les dcisions engageantes au niveau du service apport au
distributeur, comme le montre le tableau 11.5 :
Fonctions Tendance volution
Grer la transaction commerciale
Pointage du portefeuille et saisie des
donnes complmentaires
Traiter des relances
Suivre les comptes clients
Rsoudre les problmes (litiges, erreurs de
livraison, ruptures, refus)
Informer les reprsentants
Baisse
Baisse
gal
Hausse
Hausse
Hausse
Automatisation de la saisie des
commandes (catalogues actifs, EDI, fax
normaliss)
Gestion par exception
faire en temps rel
Intgration de la coopration client
Intgration des litiges clients
Nouveaux outils/services
Indicateurs quantitatifs Indicateurs de service
Indicateurs par enseigne
TABLEAU 11.5. Contenu de la mission du service client
Service au reprsentant
Service au client
taux de service/enseigne
Exploitation des indicateurs,
Relance
Gestion des comptes
Traitement des commandes
contrle
Traitement des lignes
Aprs Avant
11 Dornier/Fender.fm Page 437 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
438
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
CONCLUSION
Lintgration verticale historique qui donnait un acteur privilgi de la chane de
valeur la matrise et le contrle de cette chane par les liens capitalistiques a laiss la
place, sauf cas contraires plutt isols ou propres des industries de process trs
dispendieuses en capital, des chanes de valeur clates. La fragmentation domine
et conduit lexplosion des interfaces, ce qui ncessite une coordination, et au renfor-
cement dj voqu dans des chapitres prcdents de limportance de la Supply
Chain comme processus dintgration en quelque sorte virtuelle via les changes
dinformation et la contractualisation en lieu et place des participations capitalis-
tiques. Lclatement des chanes de valeur sest fait au-del des recherches
dconomie dchelle et des stratgies de spcialisation sous la pression des volu-
tions du commerce de dtail. En terme stratgique, il est fondamental de conserver le
lien avec le client nal, ultime maillon des chanes de valeur, pour conserver la
visibilit sur un march devenu de plus en plus incertain. Le poids croissant du
commerce organis de masse a coup le Supply Side, c'est--dire les industriels des
chanes logistiques de ce consommateur nal.
Les cooprations logistiques au sein des Supply Chains ont pour but de retisser ce lien
entre lamont industriel et laval distributeur reconnaissant que ces deux acteurs ont
y gagner vis--vis du consommateur nal et donc face leur propre concurrence. Une
alliance verticale cible et soutenue par des processus et des outils ddis pour mieux
se battre au plan concurrentiel dans chaque march horizontal, cest ce que
proposent les cooprations logistiques. Cest une tendance lourde qui sest mise en
place depuis une dizaine dannes et qui ne cesse de se renforcer mme si on peut
noter que le tempo nest pas aussi rapide que lon pouvait limaginer. En effet, il ne
faut pas oublier que les distributeurs ont dvelopp de manire trs importante leurs
marques propres pour se dmarquer sur leur propre champ concurrentiel mais que
par l mme ils deviennent concurrents de leurs fournisseurs. Ces derniers sont donc
dans une position dlicate et il ne fait aucun doute que la coopration que nous avons
appele sectorielle est un enjeu stratgique pour leur faciliter laccs au march. Si les
outils et les technologies ont fortement progress, il nen reste pas moins vrai que
seule une volont partage de crer une valeur distinctive forte deux est la condition
requise dune coopration russie.
Ds lors, une fois les intentions stratgiques conrmes et partages entre les acteurs
impliqus, il est important de mettre en uvre une dmarche projet qui devra forma-
liser les bnces escompts et les rgles de rpartition de ceux-ci, mettre en place
une quipe projet pluridisciplinaire appuye le cas chant de la contribution neutre
dun consultant et dvelopper un pilote pour obtenir des rsultats tangibles qui encou-
rageront les parties poursuivre leurs efforts dans la voie de la coopration. La
volont de trouver des solutions pragmatiques aux leviers voire aux dysfonctionne-
ments identis sera sous-jacente lensemble de la dmarche qui sera engage
probablement sur plusieurs exercices. Cest cette double approche stratgique et
pragmatique qui dveloppera la conance, base-clef dune Supply Chain optimise.
11 Dornier/Fender.fm Page 438 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
439
Les modes de coopration dans la Supply Chain : dmarches, outils et organisations
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE 11
Arnould P., Renaud J., Les Niveaux de planication, AFNOR, Paris, 2002, 52 p.
Berglund M., Van Laarhoven P., Sharman G., Wandel S., Third-Party Logistics : is there a
Future ? , International Journal of Logistics Management, vol. 10, n1, 1999, pp. 59-70.
Brewer P. C., Le Tableau de bord prospectif, outil d'alignement des mesures de performance
de la chane logistique : l'exemple de Dell , Logistique & Management, vol. 9, n 2, 2001,
pp. 55-62.
Camman-Ldi C., Le Processus logistique, support du pilotage stratgique de dmarches
collectives , Gestion 2000, n 1, dossier : La logistique aujourd'hui : perspectives strat-
giques , janvier 2002, pp. 93-108.
Fabbe-Costes N., Modlisation des processus logistiques, e-Book, dit par e-thque, http://e-
theque.com/, Onnaing, 2003, 105 p.
Fender M., Les Conditions de succs de projets logistiques , Stratgie Logistique, n 43,
janvier-fvrier 2002, pp. 74-79.
Fulconis F., Pach G., Exploiting SCM as source of competitive advantage : the importance of
cooperative goals revisited , Competitiveness Review - International business journal of the
American Society for Competitiveness, vol. 15, n2, mai 2005, pp. 92-100.
Gencod EAN France, EDI et gestion partage de lapprovisionnement : manuel des meilleures
pratiques, ECR France, 1999, 32 p.
Heng S. H. M., Wang Y. C., Xianghua W. et H., Supply Chain Management and Business
Cycles , Supply Chain Management an International Journal, vol. 10, Issue 3, 2005,
pp. 157-161.
Martin A., Landvater D., Principes et perspectives du rapprovisionnement continu au cur de
la Supply Chain, Jouenne et Associs, 1998.
Martin A., Distribution Resource Planning, DRP, le moteur de lECR, Jouenne et Associs, Paris,
1997.
Martin A., Efcient Consumer Response, Jouenne et Associs, Paris, 1997.
Tordman A., De la conformit la coopration , Revue Franaise de Gestion, juin-juillet-aot
1999, pp. 112-114.
Waldman Ch., Efcacit et limites du category management , Revue Franaise de Gestion,
juin-juillet-aot 1999, pp. 115-121.
Wang Yu C. et H., Shun C., Case Study : the Dispatching of Information Systems for Global
Logistics Management in Acer Group , the Journal of Cases on Information Technology,
vol. 8, Issue 2, 2006, pp. 45-61.
Waters D., Global Logistics and Distribution Planning Strategies for Management, Kogan Page
Ltd, 2003, 416 p.
Wincel J. P., Lean Supply Chain Management : A Handbook for Strategic Procurement, Produc-
tivity Press, New York, 2003, 239 p.
11 Dornier/Fender.fm Page 439 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
440
LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
SITOGRAPHIE DU CHAPITRE 11
Nom et contact mail Mission Prcisions sur le site
Piloter
www.piloter.org
http://www.piloter.org/references/
contact.htm
Site mettant en ligne des
mthodes et outils pour mieux
matriser le pilotage de la perfor-
mance : tableau de bord,
Balanced Scorecard, projet
Business Intelligence, Six Sigma,
conduite des projets complexes,
rfrences
ECR France
www.ecr-france.org
www.ecr-france.org/web/contact.asp
ECR France runit l'ensemble des
distributeurs gnralistes de notre
pays, plusieurs distributeurs
spcialistes et prs de 70 entre-
prises industrielles reprsentant
tous les secteurs des produits de
grande consommation. Cette
masse critique d'oprateurs
permet une mise en uvre plus
rapide, plus large et plus efciente
des stratgies ECR. Groupes de
travail et publications en ligne.
La mission d'ECR France :
Promouvoir l'ECR auprs des
fabricants et distributeurs franais.
Dnir un langage commun et
identier les meilleures pratiques.
Construire la masse critique
d'oprateurs pour une mise en
uvre plus rapide, plus complte
et moindre cot de l'ECR.
Fournir un support aux initia-
tives bilatrales conduites par les
entreprises entre elles.
Inuer sur les dveloppements
europens et internationaux.
Identier de nouveaux axes de
progrs dans la relation indus-
triels/distributeurs.
Se saisir de toutes les questions
caractre technique (sans se
limiter aux seuls concepts ECR).
ECR Europe
www.ecr-europe.org
ecr@ecreurope.com
Cre en 1994, 2 ans avant ECR
France. Leurs missions sont relati-
vement similaires. Ouverte aux
entreprises du commerce et aux
fabricants du secteur des produits
de grande consommation,
lobjectif est de rendre ce secteur
plus responsable la demande
des consommateurs et de
supprimer les cots inutiles dans
la chane dapprovisionnement.
Site trs dense proposant
notamment :
Les liens vers les diffrents sites
nationaux ECR de chacun des
pays europens.
Les travaux de recherche et
dtudes.
Les publications venir.
La liste des entreprises parte-
naires.
Des sites dorganisations aux
missions associes.
ECR Europe possde un rle
centralisateur des actions menes
par les entits nationales.
11 Dornier/Fender.fm Page 440 Vendredi, 23. fvrier 2007 5:58 17
Vous aimerez peut-être aussi
- D31 - BE Supply Chain - Juin 2020 - SujetDocument18 pagesD31 - BE Supply Chain - Juin 2020 - SujetIkramPas encore d'évaluation
- Digitalisation de La Supply Chain: Fiche 19Document3 pagesDigitalisation de La Supply Chain: Fiche 19Mohamed AmmaouiPas encore d'évaluation
- Etude de Cas CADocument6 pagesEtude de Cas CAImane ZaariPas encore d'évaluation
- 83504tepa0207 01Document28 pages83504tepa0207 01Haifa JammeliPas encore d'évaluation
- MarketingLogistiqueHermes1 PDFDocument11 pagesMarketingLogistiqueHermes1 PDFLacenPas encore d'évaluation
- Coopération LogistiqueDocument33 pagesCoopération Logistiquemissor89Pas encore d'évaluation
- CPFRDocument3 pagesCPFRFadoua LahnaPas encore d'évaluation
- La LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmeD'EverandLa LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmePas encore d'évaluation
- Transformation Digitale de La Supply Chain Caract Ristiques Enjeux Et Voies de Recherche FuturesDocument7 pagesTransformation Digitale de La Supply Chain Caract Ristiques Enjeux Et Voies de Recherche FuturesIkram HibbouPas encore d'évaluation
- Akb FreDocument17 pagesAkb FredjaaaamPas encore d'évaluation
- Stratégies Logistiques - Fondements, Méthodes, Applications PDF - Télécharger, LireDocument8 pagesStratégies Logistiques - Fondements, Méthodes, Applications PDF - Télécharger, LireChris nonoPas encore d'évaluation
- Optimisation de La Chaine Logistique Et ProductiviDocument39 pagesOptimisation de La Chaine Logistique Et ProductiviElhadj Ibrahima DialloPas encore d'évaluation
- Soutien LogistiqueDocument76 pagesSoutien LogistiquedavinccicodePas encore d'évaluation
- 1-Logistique Amont - GEFCODocument2 pages1-Logistique Amont - GEFCOghislain philippe ndoh ekitePas encore d'évaluation
- Tableau de Bord de Gestion Des Stocks: MASTER: Management Logistique AppliquéeDocument12 pagesTableau de Bord de Gestion Des Stocks: MASTER: Management Logistique AppliquéeBlog wiki4everPas encore d'évaluation
- Corrigserie 010208 Lescotslogistiques 1Document6 pagesCorrigserie 010208 Lescotslogistiques 1Sidiki CamaraPas encore d'évaluation
- Optimisation Des Réseaux LogistiquesDocument10 pagesOptimisation Des Réseaux LogistiquesMostafa ZouakPas encore d'évaluation
- D31 - Bachelor SUC - Juin 2017 - CorrigéDocument8 pagesD31 - Bachelor SUC - Juin 2017 - CorrigéIkramPas encore d'évaluation
- Politique Logistique InternationaleDocument69 pagesPolitique Logistique InternationaleNizar GarzounPas encore d'évaluation
- De La Logistique Au Supply Chain LogistiDocument17 pagesDe La Logistique Au Supply Chain LogistiAbdessamad ElguezzamPas encore d'évaluation
- La E-Logistique, La Composante Incontournable Du E-CommerceDocument1 pageLa E-Logistique, La Composante Incontournable Du E-Commercetrek storPas encore d'évaluation
- F4 Flux Chaîne LogistiqueDocument16 pagesF4 Flux Chaîne LogistiqueJacques GAGNONPas encore d'évaluation
- Article Le Journal de La LogistiqueDocument8 pagesArticle Le Journal de La LogistiquekhalilPas encore d'évaluation
- Livre Blanc Comprendre Et Manager Sa E-Logistique ITinSellDocument46 pagesLivre Blanc Comprendre Et Manager Sa E-Logistique ITinSellChalmouse BenPas encore d'évaluation
- La Logistique Globale Realise Par MohameDocument26 pagesLa Logistique Globale Realise Par MohameAmadou KAPas encore d'évaluation
- G 1Document22 pagesG 1Saad GhoummidPas encore d'évaluation
- TD Calcul Des Besoins ÉquipementsDocument3 pagesTD Calcul Des Besoins ÉquipementsHamid Ait HaddouPas encore d'évaluation
- Gestion de La Chaîne LogistiqueDocument4 pagesGestion de La Chaîne LogistiqueMeryama EL HASSANIPas encore d'évaluation
- Politique de DistributionDocument9 pagesPolitique de DistributionFiedano BehivokaPas encore d'évaluation
- Optimisation de La Logistique Internationale À Horizon Stratégique - Application À Un Constructeur Automobile - Thèse 2011Document163 pagesOptimisation de La Logistique Internationale À Horizon Stratégique - Application À Un Constructeur Automobile - Thèse 2011Pascal BaudinPas encore d'évaluation
- La Logistique 20Document13 pagesLa Logistique 20rachid ouhaddouPas encore d'évaluation
- La Logistique InverseDocument6 pagesLa Logistique InverseThomas DronnePas encore d'évaluation
- MEMOIREDocument21 pagesMEMOIREAdam LamchahabPas encore d'évaluation
- Memoire 7Document72 pagesMemoire 7dess200889% (9)
- La DémarqueDocument10 pagesLa DémarqueJunior DossoPas encore d'évaluation
- LogistiqueDocument22 pagesLogistiqueHasnae BlPas encore d'évaluation
- Logistique Et Supply ChainDocument3 pagesLogistique Et Supply ChainHamid BoulahyaouiPas encore d'évaluation
- Bullwhip EffectDocument40 pagesBullwhip EffectFATIMA EZZAHRA SERBOUTPas encore d'évaluation
- SEANCE-3-Effet-coup-de-fouet NNNNDocument19 pagesSEANCE-3-Effet-coup-de-fouet NNNNYassine AallalouPas encore d'évaluation
- La Mutualisation LogistiqueDocument4 pagesLa Mutualisation LogistiqueTaha Bamohamed100% (2)
- Distribution Cours Lahlou 021022Document31 pagesDistribution Cours Lahlou 021022Salma Delami0% (1)
- Logistique TRDocument9 pagesLogistique TRMly Al AminiPas encore d'évaluation
- SupplyChainInfo - Optimiser Sa Stratã©gie LogistiqueDocument17 pagesSupplyChainInfo - Optimiser Sa Stratã©gie LogistiqueTiamo Kassebe100% (1)
- SI 4.0 - RapportDocument40 pagesSI 4.0 - RapportMohamed OUASSPas encore d'évaluation
- Logistique de Retour Présentation FinalDocument23 pagesLogistique de Retour Présentation FinalYassir Fedayên WŚPas encore d'évaluation
- Memoire FinalDocument110 pagesMemoire FinalIsmael SanouPas encore d'évaluation
- La Theorie Des ContraintesDocument37 pagesLa Theorie Des ContraintesBoumahdy MohamedPas encore d'évaluation
- Logistiqueinternationale 01082Document3 pagesLogistiqueinternationale 01082Ayoub AlaouiPas encore d'évaluation
- F 2193 ADocument21 pagesF 2193 AJebariPas encore d'évaluation
- Tendances Et Nouveaux Metiers Supply ChainDocument30 pagesTendances Et Nouveaux Metiers Supply ChainYousra Zhar100% (1)
- Comment Optimiser Les Opérations de Transport Grâce À Des Décisions Basées Sur Les DonnéesDocument5 pagesComment Optimiser Les Opérations de Transport Grâce À Des Décisions Basées Sur Les DonnéesidrissPas encore d'évaluation
- EL ARAFI Afaf CONCEPTION PDFDocument36 pagesEL ARAFI Afaf CONCEPTION PDFEl Arafi AfafPas encore d'évaluation
- Optimis Plate UP SabraDocument58 pagesOptimis Plate UP SabrasophiaPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Planification de La Chaîne Logistique PDFDocument19 pagesChapitre 2 Planification de La Chaîne Logistique PDFachraf weslatiPas encore d'évaluation
- Évaluations nationales des acquis scolaires, Volume 3: Mettre en oeuvre une évaluation nationale des acquis scolairesD'EverandÉvaluations nationales des acquis scolaires, Volume 3: Mettre en oeuvre une évaluation nationale des acquis scolairesÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Introduction à la douane commerciale au Canada: Comprendre les procédures douanières d'importation de marchandisesD'EverandIntroduction à la douane commerciale au Canada: Comprendre les procédures douanières d'importation de marchandisesPas encore d'évaluation
- Je saute sur l'occasion: Guide pratique pour acheter et vendre d'occasion en toute sécurité.D'EverandJe saute sur l'occasion: Guide pratique pour acheter et vendre d'occasion en toute sécurité.Pas encore d'évaluation
- Support de Cours de La Logistique CollaborativeDocument8 pagesSupport de Cours de La Logistique CollaborativemadoutourePas encore d'évaluation