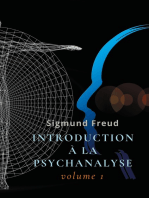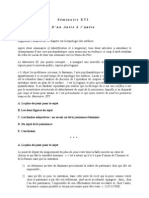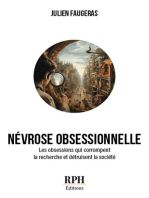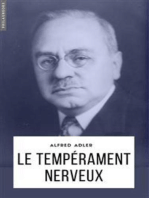Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Maleval - Psychose Ordinaire
Maleval - Psychose Ordinaire
Transféré par
Jonathan LerCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Maleval - Psychose Ordinaire
Maleval - Psychose Ordinaire
Transféré par
Jonathan LerDroits d'auteur :
Formats disponibles
ELEMENTS POUR UNE APPREHENSION CLINIQUE
DE LA PSYCHOSE ORDINAIRE.
PROFESSEUR JEAN-CLAUDE MALEVAL
(RENNES)
Sminaire de la Dcouverte Freudienne
Psychose et lien social
Toulouse
18-19 janvier 2003
Rsum : Le discernement de la structure constitue un des enjeux majeurs des entretiens
prliminaires, sachant quil conditionne de manire dcisive la conduite de la cure. Or les analystes
sont aujourdhui confronts des demandes accrues manant de sujets pour lesquels se pose la
question dun fonctionnement psychotique, et qui pourtant ne sont ni dlirants, ni hallucins, ni
mlancoliques. La clinique discrte de la forclusion du Nom-du-Pre savre dune grande diversit.
On en dgagera quelques aspects en rapport avec la spcificit de la dfaillance du nouage de la
structure subjective : indices de la non-extraction de lobjet ; dfaillances tnues du capitonnage,
prvalences des identifications imaginaires.
2
"La psychose, c'est ce devant quoi un analyste ne doit reculer en aucun cas"
1
, mme si cette
affirmation de Lacan exprime plus une exigence didactique qu'un conseil technique, il n'en reste pas
moins que selon lui la cure analytique n'a pas connatre de contre-indication diagnostique. Ce sont les
caractristiques de la demande du patient qui dcident de l'engagement d'une analyse ou de son refus.
Cependant le discernement de la structure du sujet conditionne de manire dcisive la conduite de la
cure. La confiance nave dans "l'hystrisation du psychotique" n'est plus recevable: on sait maintenant
que les interventions propres temprer la jouissance dbride doivent tre nettement distingues de
celles orientes vers l'analyse du refoul.
Si le sujet demandeur a dj fait des pisodes nettement psychotiques, ou s'il se prsente dans
l'actuel comme psychos, l'identification de sa structure, lors des entretiens prliminaires, ne pose pas
de problme majeur - la condition de ne pas confondre psychose et hystrie crpusculaire
2
. La
difficult nat pour l'analyste quand il est confront des demandes de la part de sujets qui ne
possdent aucun pass psychiatrique, qui ne sont ni dlirants, ni hallucins, ni mlancoliques, et pour
lesquels, malgr tout, se pose la question d'un fonctionnement psychotique. Or cette situation se
prsente aujourdhui avec une frquence accrue. Pourtant, jusqu la fin des annes 90, les travaux
restrent rares concernant la psychose non-dclenche, Anne-Lyse Stevens ne recense gure quune
quinzaine darticles sur ce sujet en 1996
3
. Parmi les difficults majeures poses par la pratique
analytique, il s'agit sans doute de l'une qui furent les moins tudies avant que lintroduction du
concept de psychose ordinaire en 1998 ne vienne soudain focaliser lattention sur cette clinique.
Il est vrai que son examen s'est longtemps heurt la thse largement rpandue, en particulier
par les kleiniens, selon laquelle la psychose constitue une virtualit inhrente tout tre humain. En
fait l'apprhension de sa spcificit est un problme qui ne pouvait gure venir se formuler avant le
milieu des annes 50: son tude requiert d'abord que la notion de structure psychotique trouve sa
consistance, et cela ne s'opre qu'avec la construction du concept de forclusion du Nom-du-Pre, aprs
quoi seulement surgissent des questions concernant des modes de compensation et de supplance.
Cependant, leur tude fut longtemps dlaisse. A titre d'exemple, les indications ritres de Lacan sur
l'intrt de la clinique d'Hlne Deutsch concernant les personnalits "comme si" n'ont quasiment pas
retenues l'attention. Les travaux modernes les insrent volontiers dans le fourre-tout des "borderlines"
sans y discerner une contribution d'importance aux modes de compensation de la structure psychotique.
Sans doute fallait-il que soit dpasse la subordination de l'imaginaire au symbolique dans
l'enseignement de Lacan pour que s'ouvre pleinement un nouveau champ d'tude sur les possibilits de
pallier la forclusion du Nom-du-Pre. D'ailleurs lui-mme n'en donne l'exemple que tardivement, aprs
1
Lacan J. Ouverture de la section clinique? in Ornicar? Revue du champ freudien, Avril 1977, 9, p. 12.
2
Maleval J-C. Les hystries crpusculaires. Confrontations psychiatriques, 18 me anne, 1985, 25, pp. 63-97.
3
Lysy-Stevens A. Ce quon appelle des psychoses non dclenches . Les feuillets du Courtil, juin 1996, 12, pp. 105-11.
3
avoir dgag l'importance quivalente de chacune des dimensions du nud borromen, quand il
s'attarde sur l'ego de Joyce dans l'un de ses derniers sminaires.
Phnomnes lmentaires et pr-psychose.
D'autre part, les recherches sur la structure psychotique se sont longtemps confondues avec
l'tude des phnomnes lmentaires. Un passage souvent cit du sminaire III semble inciter
corrler troitement les unes avec les autres. "Les phnomnes lmentaires, note-t-il le 23 novembre
1955, ne sont pas plus lmentaires que ce qui est sous-jacent l'ensemble de la construction du dlire.
Ils sont lmentaires comme l'est, par rapport une plante, la feuille o se verra un certain dtail de la
faon dont s'imbriquent et s'insrent les nervures - il y a quelque chose de commun toute la plante qui
se reproduit dans certaines des formes qui composent sa totalit. De mme, des structures analogues se
retrouvent au niveau de la composition, de la motivation, de la thmatisation du dlire, et au niveau du
phnomne lmentaire. Autrement dit, c'est toujours la mme force structurante, si l'on peut
s'exprimer ainsi, qui est l'uvre dans le dlire, qu'on le considre dans une de ses parties ou dans sa
totalit. L'important du phnomne lmentaire n'est donc pas d'tre un noyau initial, un point
parasitaire, comme s'exprimait Clrambault, l'intrieur de la personnalit, autour duquel se ferait une
construction, une raction fibreuse destine l'enkyster en l'enveloppant, et en mme temps l'intgrer,
c'est--dire l'expliquer, comme on dit souvent." Lacan s'oppose nettement la thse selon laquelle la
gense des phnomnes d'automatisme mental, situe en un processus crbral irritatif, serait en
rupture complte avec celle des laborations dlirantes, dues la facult raisonnante. Il rcuse la notion
de dissociation du socle et de la statue selon l'image employe par son matre. "Le dlire n'est pas
dduit, ajoute-il, il en reproduit la mme force constituante, il est, lui aussi, un phnomne lmentaire.
C'est dire que la notion d'lment n'est pas prendre autrement que pour celle de structure, structure
diffrencie, irrductible autre chose qu' elle-mme."
4
Il promeut ainsi une unification causale des
troubles psychotiques rapports une structure spcifique. On peut en dduire que la clinique de la
psychose ordinaire participe de la mme structure, et quelle ne doit diffrer de la psychose clinique
que par la discrtion de ses manifestations et par ses modes originaux de stabilisation.
Le concept de phnomne lmentaire possde une acception, certes extensive, mais prcise,
qui l'insre dans la structure psychotique. Lacan rappelle que cette conception de 1955 s'inscrit dans la
droite ligne de celle dveloppe en 1932 dans sa Thse. Afin de diffrencier sa doctrine de celle de
Clrambault, il utilisait dj la mme image: "l'identit structurale frappante, crivait-il, entre les
phnomnes lmentaires du dlire et son organisation gnrale impose la rfrence analogique au type
4
Lacan J. Les psychoses. Le sminaire III. Seuil. Paris. 1981, p. 28.
4
de morphogense matrialis par la plante"
5
. Entre-temps la structure de la personnalit est devenue
structure de l'inconscient, mais il s'agit toujours de s'opposer la conception mcaniciste ou la
doctrine des constitutions, en soulignant que les phnomnes lmentaires ne sont pas le fruit d'une
dduction raisonnante. Lacan prcise dans sa Thse les varits cliniques de ceux-ci: hallucinations,
interprtations, illusions de la mmoire, troubles de la perception, postulats passionnels, et tats
onirodes. Pour la plupart ils apparaissent d'emble chargs de "signification personnelle"
6
. Or cette
dernire tmoigne d'une rupture de continuit avec les penses antrieures du sujet: une certitude
s'impose lui selon laquelle il est vis par une signification dont le sens lui est profondment
nigmatique. Sauvagnat a montr l'ancrage de cette approche dans le courant anti-kraepelinien de la
psychiatrie allemande (Neisser, Margulis) qui considrait que l'on pouvait mettre en vidence au
dbut d'une paranoa une signification personnelle (Krankhafte Eigenbeziehung
7
) pralable toute
construction dlirante. La notion jaspersienne "d'exprience dlirante primaire", celle de "moments
fconds" (K. Schneider), voire celle "d'interprtations frustres" de Meyerson et Quercy rfrent des
intuitions du mme ordre
8
. Le phnomne lmentaire est ferm toute composition dialectique parce
qu'il se prsente sur un fond de vide absolu auquel la carence de la fonction paternelle ne permet pas de
parer. Dans la psychiatrie classique, il est intimement li la rvlation de cette carence, par
consquent au dclenchement de la psychose, nanmoins la plupart des cliniciens s'accordent
considrer qu'il peut subsister parfois longtemps sans donner naissance un dlire ni une psychose
dclare.
Il est notable que les concepts de pr-psychose et de phnomne lmentaire, prsents dans le
sminaire III, disparaissent ds la Question prliminaire, pour ne plus jamais rapparatre dans
l'enseignement de Lacan. Le terme de pr-psychose suggre qu'il y aurait au sein de la structure
psychotique un dynamisme qui tendrait vers la psychose dclare. Or il n'est pas douteux qu'il existe
des supplances permettant d'viter la survenue de celle-ci parfois pendant toute une existence: si
Schreber tait dcd avant 42 ans, en n'ayant souffert jusque-l que de quelques troubles
hypocondriaques, qui aurait song voquer la psychose le concernant? Le dgagement de la structure
psychotique en rfrence la forclusion du Nom-du-Pre implique d'emble l'existence de possibilits
d'y parer. Ds lors on conoit aisment que la pr-psychose soit un concept qui tombe en dsutude. En
revanche, on constate avec plus d'tonnement l'effacement du terme de phnomne lmentaire. En fait
de la Thse au sminaire III il faut noter qu'il a subi une extension qui lui fait inclure en 1955 le dlire
lui-mme. Ds lors que ce dernier doit tre considr comme un phnomne lmentaire, et mme au
5
Lacan J. De la psychose paranoaque dans ses rapports avec la personnalit. [1932]. Seuil. Paris. 1975, p. 297.
6
Lacan J. Expos gnral de nos travaux scientifiques. [1933], in De la psychose paranoaque, o. c., p. 400.
7
Ce sont Srieux et Capgras, dans leur ouvrage sur "Les folies raisonnantes" qui ont traduit "krankhafte eigenbeziehung" par
"signification personnelle". L'expression allemande dsigne en fait l'auto-rfrence dlirante; nanmoins, la plupart des
auteurs admettent que cette auto-rfrence est un effet de signification. (Sauvagnat F. Histoire des phnomnes lmentaires.
A propos de la signification personnelle. Ornicar? Revue du champ freudien. 1988, 44, pp. 19-27.).
8
Sauvagnat F. Vaisserman A. Phnomnes lmentaires psychotiques et manuvres thrapeutiques, Revue Franaise de
Psychiatrie, 1991.
5
fond comme le plus caractristique, puisque rvlant mieux que tout autre la structure, on conoit que
le concept tende perdre sa spcificit. Il se dissout dans l'ensemble des manifestations cliniques de la
psychose. Les tudes sur le phnomne lmentaire des classiques, celui de la Thse, presque toujours
caractris par une exprience de signification personnelle, se fondent dans celles sur le dclenchement
de la psychose et dans celles sur l'mergence du dlire. H. Wachsberger fait la mme constatation
quand il soutient la thse selon laquelle le phnomne lmentaire, dans l'enseignement de Lacan, "sera
finalement dlaiss au profit de l'exprience nigmatique"
9
.
Malgr cette dsaffection, il s'avre que le concept perdure dans le champ freudien. Il le fait
sous une forme originale, qui n'est pas celle de la psychiatrie classique, dans laquelle il est fortement
corrl la clinique du dclenchement de la psychose, et qui n'est pas non plus l'acception extensive
que lui donne Lacan en 1955. Jusqu la fin des annes 90, le phnomne lmentaire est rfr pour
l'essentiel aux manifestations cliniques qui traduisent l'isolement d'un signifiant par rapport la chane.
Ces S1 coups du S2 sont en attente de significations, de sorte qu'ils se prsentent sous un aspect
nigmatique qui suscite la perplexit du sujet. Dans la Question prliminaire Lacan voquait cette
clinique quand il faisait mention de "chane brise". La fortune tonnante connue par la notion de
phnomne lmentaire pendant cette priode rsulte probablement d'une attente inhrente l'approche
structurale: elle implique l'existence de manifestations discrtes de la forclusion du Nom-du-Pre,
indpendantes de la psychose clinique, qu'il faut pouvoir nommer.
Cependant, depuis la fin des annes 90, un nouveau concept, recoupant pour une part la clinique
des phnomnes lmentaires, fait son entre dans la thorie psychanalytique, celui de dbranchement.
Jacques-Alain Miller lintroduit en 1997 moins comme un concept que comme une expression bien
tourne
10
propos dune observation clinique, rapporte par Deffieux, semblant faire tat de la
prsence dune mtaphore dlirante en labsence de dclenchement.
11
. Il apparat alors comme
synonyme de pseudo-dclenchement ou de no-dclenchement . Laurent poursuit lide en
soulignant que la clinique du dbranchement de lAutre ne va pas sans la clinique de la production de
la pulsion
12
Deux ans plus tard, Castanet et De Georges, intitulent leur rapport Branchements,
dbranchements, rebranchements . Lintrt du concept de dbranchement par rapport lAutre leur
parat rsider dans lclairage rtrospectif quil permet doprer sur llment qui faisait
branchement pour le sujet, de sorte quil ouvre sur la possibilit de diriger la cure dans le sens dun
ventuel rebranchement
13
. A lencontre du phnomne lmentaire, issu de la clinique
9
Wachsberger H. Du phnomne lmentaire l'exprience nigmatique. La Cause freudienne. Revue de psychanalyse,
1993, 23, p. 14.
10
Miller J-A. Ouverture, in La conversation dArcachon. Cas rares : les inclassables de la clinique. Agalma. Le Seuil. 1997,
p. 163.
11
Deffieux J-P. Un cas pas si rare, in La conversation dArcachon, o.c., pp. 11-19.
12
Laurent E. Lappareil du symptme, in in La conversation dArcachon, o.c., p. 185
13
Castanet H. De Georges P. Branchements, dbranchements, rebranchements, in La psychose ordinaire. La Convention
dAntibes. Agalma-Le Seuil. 1999, p. 14.
6
psychiatrique, le dbranchement savre tre un concept gnr par le discours psychanalytique. La
tentation est grande de linsrer dans une clinique des nuds est den faire un synonyme de dnouage
de lun des lments de la structure du sujet. Le risque serait quil se substitue ainsi au phnomne
lmentaire et que nous disposions de deux termes pour nommer des cliniques trs similaires.
Cependant, Jacques-Alain Miller ne les confond pas. Lors mme quil introduit le dbranchement ,
il situe un laisser-tomber du corps comme phnomne lmentaire
14
. Or ce signe clinique, mis en
exergue par Lacan concernant Joyce, le conduit infrer une dconnexion de llment imaginaire de
la structure du sujet, dont son rapport au langage porte la trace. Un tel phnomne lmentaire nest
donc pas corrl un dbranchement lgard de lAutre du langage. Cependant, nommer phnomne
lmentaire un laisser-tomber du corps tmoigne dune extension du concept : il nest plus seulement
rapport la clinique de la chane brise , il tend plus largement dsigner les manifestations
cliniques dune clocherie dans le nouage RSI.
Le dveloppement des tudes consacres la psychose ordinaire semble aujourdhui induire
une approche plus fine gnratrice de concepts nouveaux. Lune des consquences semble en tre un
largissement de lacception du concept de phnomne lmentaire, tout en prcisant que la prsence
de celui-ci nimplique pas ncessairement dclenchement de la psychose ; tandis que le dbranchement
de lAutre nest pas une caractristique de tous les phnomnes lmentaires.
L'approche de la psychose ordinaire ne saurait se confondre avec celle de la pr-psychose, ni
avec celle de ce que Lacan nommait dans sa Thse "les bauches de troubles psychiques dcelables
dans les antcdents"
15
, car la psychose clinique n'est pas en germe dans la structure. Elle n'est qu'une
possibilit qui s'actualisera ventuellement l'occasion de mauvaises rencontres. L'identification de la
structure psychotique hors-dclenchement n'est pas rductible au discernement de faits morbides
initiaux.
Pour l'apprhender faudrait-il alors convoquer la "psychose blanche"? Il s'agit d'une notion
ambigu par laquelle Donnet et Green cherchent dcrire "une configuration clinique o se manifeste
en germe la psychose"
16
. partir de l'tude minutieuse d'un long entretien, recueilli la suite d'une
prsentation de malade effectue par l'un d'eux, ils s'efforcent de dgager la "structure matricielle"
d'une potentialit psychotique qui s'actualise ou non ultrieurement. se priver d'une rfrence la
forclusion du Nom-du-Pre, tout en essayant d'en intgrer certaines donnes, ils se trouvent cartels
entre deux thses incompatibles, l'gard desquelles ils vitent de choisir: celle, kleinienne, du noyau
psychotique, prsent chez chacun, et celle, lacanienne, selon laquelle ne devient pas fou qui veut, une
structure spcifique y tant ncessaire. Ils soutiennent la fois que la psychose se fonde sur un
"appareil de pense atteint dans son intgrit" et que les "mcanismes psychotiques" uvrent "en sous-
14
Miller J-A. Ouverture, in La conversation dArcachon, o.c., p. 164.
15
Lacan J. De la psychose paranoaque, o. c., p. 270.
16
Donnet J.L. Green A. L'enfant de a. Psychanalyse d'un entretien: la psychose blanche. Ed. Minuit. Paris. 1973.
7
main" chez les nvross. Dans le mme moment o ils opposent "structure nvrotique" et "structure
psychotique", ils sont contraints de gommer cette distinction en la rfrant des types idaux. Pour
satisfaire leur recherche de syncrtisme, ils doivent introduire les notions minemment spculatives
"d'ombilic de la psychose" et de "noyau psychotisant". Ces procds de patinage dialectique font sans
cesse osciller la "psychose blanche" entre un syndrome et une structure. Ils ne russissent pas
dtacher ce concept de configurations cliniques dans lesquelles la symptomatologie psychotique est
dj si prsente que l'hospitalisation s'avre ncessaire. Malgr les efforts des auteurs, en dernire
analyse, la "psychose blanche" ne dcolle gure du regard psychiatrique. Elle pche par les mmes
insuffisances que la pr-psychose: elle ne prend nullement en compte ce que la structure psychotique
hors-dclenchement possde de plus spcifique, savoir des modes de compensation et de
supplances.
La psychose froide est une notion qui cherche apprhender le mme domaine, celui des
psychoses non dlirantes, partir dune approche mtapsychologique originale, trs rticente lgard
dune rfrence structurale, fonde sur le modle de lanorexie mentale. Les auteurs soulignent
limportance dune organisation de type pervers en cette forme de psychose, dont tmoignerait une
recherche constante du plaisir de linsatisfaction
17
et une relation ftichiste lobjet
18
. En fait, il
semble que ce concept ne soit gure parvenu dcoller du syndrome qui lui a donn naissance. Il est
plus volontiers cit en rfrence limage quil suggre que pour contribuer la mtapsychologie
touffue qui cherche lui donner consistance. Pour dpasser cette suppose psychose, rien de bien
nouveau : une nvrose hystro-phobique, des comportements obsessionnels, voire des comportements
de type psychopathique. Une ouverture sur loriginalit des supplances dveloppes par les sujets
psychotiques dborde les possibilits heuristiques du concept.
Une structure prcocement identifiable.
Les tenants de la psychose blanche ou de la psychose froide sont des cliniciens ports
contester l'existence dune permanence de la structure psychotique ou bien la possibilit de son
discernement avant la psychose dclare. Les deux exemples suivants suffiraient au contraire montrer
la pertinence de lhypothse structurale. L'un des plus clbres fous littraires franais, Fulmen
Cotton
19
, qui eut le malheureux privilge d'tre examin par les alinistes les plus renomms de son
temps, la deuxime moiti du XIXme sicle, aurait eu une "ide fixe" depuis le moment auquel il fit
sa communion, l'ge de huit ans, - celle de devenir Pape. Les signes patents de psychose ne seraient
17
Kestemberg E.- Kestemberg J.- Decobert S. La faim et le corps. P.U.F. Paris. 1972, p. 189.
18
Kestemberg E. La psychose froide. P.U.F. Paris. 2001. p. 83.
19
L'abb Xavier Cotton signait ses oeuvres du prnom Fulmen, peut-tre adopt, selon F. Hulak, "par analogie avec le
fulmicoton (cordon dtonnant) et en rfrence au mot latin tonnerre".
8
cependant apparus que vingt cinq ans plus tard
20
. L'mergence prcoce d'un appel pressant la
fonction paternelle ne suggre-t-elle pas avec force que la forclusion de celle-ci tait dj prsente pour
le premier communiant? Que l'un des thmes de son dlire ait t de vouloir tre Pape la place de
Lon XIII semble le confirmer. Qui plus est ce fait n'est pas anecdotique. Srieux et Capgras rapportent
en 1909 un cas semblable. L'enfance d'Arsne, notent-ils, ne prsenta gure de particularits, si ce n'est
que dans son village lui avait t donn un surnom, suite une rponse mmorable faite l'vque lors
de sa premire communion l'ge de neuf ans: "Que veux-tu faire plus tard? lui demanda le prtre. -
Monseigneur, je veux tre Pape, rpondit-il sans hsiter"
21
. Quinze ans plus tard il entendit des voix
lui annoncer qu'il serait Pape. Il crivit Pie IX pour lui ordonner d'abdiquer en sa faveur. A la mort de
celui-ci, il fit acte de candidature auprs du Concile. Bref, il dveloppa un dlire paranoaque dont le
thme majeur tait dj prsent sa pense ds son enfance. A l'instar de Fulmen Cotton, Arsne
tmoigne donc trs prcocement d'une fascination pour une figure paternelle bien apte suggrer dans
l'imaginaire ce qui fait dfaut dans le symbolique, savoir la fonction paternelle forclose.
La prsence dhallucinations passes sous silence par de jeunes enfants nest pas rare. On
conoit ds lors que le non discernement de phnomnes lmentaires plus discrets ou plus mconnus
soit dune grande frquence quand lenfant ne prsente pas trop de difficults scolaires.
Les modes de compensation qui font la spcificit de la psychose ordinaire se discernent parfois
eux aussi ds l'enfance du sujet. Le fonctionnement "comme si" de Mme T. fut remarqu trs tt par
son pre, bien avant qu'elle ne dclenche une psychose l'ge adulte. "Depuis son enfance, tmoigne-t-
il, je me suis aperu qu'elle tait trs influenable, le moindre contact, elle adhre trs facilement [...] Je
l'ai toujours vue selon le milieu, les camarades qu'elle avait et je sentais a. J'ai d veiller. Quand elle
tait en bon contact, alors elle tait formidable, apprcie, mais quand elle tait en mauvais contact...
elle aurait pu partir sur le trottoir. Quand elle a un bon contact, elle a des possibilits, quand c'est des
gens honntes... mais si c'est des tortillards, elle sera comme eux. Elle n'a pas un comportement unique.
Elle a a parce qu'elle n'a pas de direction personnelle. Elle est plutt mythomane. Elle racontera des
choses en les agrandissant, en les brodant. Elle suit le cours des gens qu'elle frquente: quand elle tait
toute petite, six ans, elle a eu l'cole une camarade plus grande, plus bte. Elle faisait comme elle:
elle mettait la main dans la caisse, elle imitait. De parler avec elle, c'est pas suffisant: c'est la
frquentation" (il fait alors le geste de mettre ses deux mains [...] face face, en miroir), et dit "elle suit
comme a l'autre. Avec son premier amant, elle tait aussi menteuse, dsaxe que lui. C'est--dire que
parler avec elle, c'est pas assez, c'est l'image"
22
. Le syndrome dgag par H. Deutsch dans les annes
30, qu'elle discerna souvent dans les antcdents de schizophrnes, se trouve fort bien illustr par cette
20
Hulak F. Fulmen Cotton. D'un cas d'cole l'archologie du sinthome, in La mesure des irrguliers. Symptme et cration,
sous la direction de F. Hulak. Z'ditions. Nice. 1990, pp. 53-69.
21
Srieux P. Capgras J. Les folies raisonnantes. Alcan. Paris. 1909. p. 124.
22
Czermak M. Sur quelques phnomnes lmentaires de la psychose, in Passions de l'objet. Etudes psychanalytiques des
psychoses. Joseph Clims. Paris. 1986, p. 151.
9
remarquable observation. Elle nous confirme de surcrot que le fonctionnement "comme si" est
dcelable de nombreuses annes avant le dclenchement de la psychose - parfois mme ds l'enfance.
Il n'est pas rare de constater par ailleurs que de nombreux psychoss font tat dans leurs
antcdents d'un attrait exceptionnel pour les jeux de la lettre (mots croiss, anagrammes, contreptries,
etc.)."Du temps o j'tais en bonne sant", signale Schreber, les questions d'tymologie "avaient dj
infiniment captiv mon attention"
23
. Or la caractristique du phnomne lmentaire, nous venons de
le rappeler, rside dans la jouissance exceptionnelle qui s'attache certains lments linguistiques
dconnects de la chane, ce qui est prcisment le statut de la lettre.
De nombreux sujets psychotiques adultes, dclenchs ou non, rapportent avoir prouv ds leur
enfance des phnomnes lmentaires. Il en est ainsi pour Pierre, un tudiant brillant, qui consulte pour
des difficults relationnelles, des troubles discrtement rotomaniaques, et pour une qute dabsolu
dans le dsir et dans la pense. Il tmoigne quenfant, il lui arrivait de perdre la spontanit de la
parole, ce dont il reste trace aujourdhui dans une difficult sexprimer, surtout loral, moins
lcrit. Indice sans doute de subites manifestations de la carence de la signification phallique. Qui plus
est, en cours prparatoire et en cours lmentaire, il entendait des voix qui lui disaient de mourir, ce qui
lui paraissait pouvantable, car il ne voulait vivre. Il craignait aussi dtre empoisonn ou de mourir de
faim la nuit. Ces derniers phnomnes ont aujourdhui disparu. Pierre nen reste pas moins confront
Autre menaant lgard duquel il emploie diverses stratgies dvitement pour le maintenir
distance. Elles sont compatibles avec la vie sociale dun tudiant assez solitaire.
Bien que les tmoignages de phnomnes lmentaires prcoces soient nombreux, on peut les
mettre en doute en soulignant qu'ils ont t recueillis distance des phnomnes; mais des recherches
faites sur les antcdents de psychotiques adultes, en s'appuyant sur des dossiers tablis pendant leur
enfance, confirment que pour la plupart ils prsentrent des troubles manifestes bien avant le
dclenchement de la psychose clinique. On note en particulier la frquence de troubles du langage et
d'un comportement asocial et renferm
24
. La notion de structure est trs trangre au discours de la
psychiatrie contemporaine, nanmoins ses observations convergent avec cette hypothse quand, en
s'appuyant sur le traitement statistique d'un matriel clinique, elle avance le concept de "vulnrabilit"
du schizophrne
25
. - au sens large de ce terme. Zubin entend par l qu'il existe chez certains sujets des
prdispositions, volontiers supposes d'origine biologique, qui peuvent donner naissance une
schizophrnie quand elles sont actives par l'environnement, mais qui peuvent aussi bien rester
latentes.
23
Schreber D. P. Mmoires d'un nvropathe [1903] Seuil. Paris. 1975, p.191.
24
Spoerry J. Etude des manifestations prmorbides dans la schizophrnie. Psychiatrie de l'enfant, 1964, VII, 2, pp. 299-379.
25
Zubin J. Spring B. Vulnerability. A new view of schizophrenia. J. Abnormal Psychol., 1977, 86, pp. 103-126
10
Quand les sujets "vulnrables" n'ont pas dclench une psychose clinique, l'hypothse
structurale invite considrer qu'ils sont en mesure de recourir des processus leur permettant de
compenser la forclusion du Nom-du-Pre. Pourquoi alors viennent-ils parfois rencontrer l'analyste?
L'exprience montre une grande diversit des demandes, les principales paraissent cependant tre: pour
un tat dpressif, pour des inhibitions dans les tudes ou le travail, pour des troubles
"psychosomatiques", pour devenir analyste, voire parce qu'on leur a dit de le faire. Il arrive par surcrot
qu'ils se prsentent en mettant en avant une symptomatologie d'apparence nvrotique. Obsessions,
phobies, et mme conversions, ne sont pas incompatibles avec la structure psychotique. Lacan notait en
1956 que "rien ne ressemble autant une symptomatologie nvrotique qu'une symptomatologie
prpsychotique"
26
.
Il notait dj l'existence de pare-psychose: l'un en s'accrochant des "identifications purement
conformistes"
27
, l'autre en s'orientant sur une identification "par quoi le sujet a assum le dsir de la
mre"
28
. Il n'eut cependant pas l'occasion de dvelopper ces rapides indications. Sa contribution
majeure l'tude de la psychose ordinaire n'apparat dans son enseignement qu'une vingtaine d'annes
plus tard quand il consacre son sminaire Joyce - dont l'criture lui apparat mettre en vidence
l'essence du symptme.
Le raboutage de l'ego.
L'crivain irlandais dveloppe selon lui une uvre charge de valoriser son nom pour faire
"compensation de la carence paternelle"
29
. Ce ne sont pas des notions issues de la symptomatologie
psychiatrique qui l'incitent faire l'hypothse de la structure psychotique de l'artiste. Nulle rfrence
par exemple ce que l'on pourrait tre tent de nommer ses "traits paranoaques": ses sentiments de
perscution, son got des procs, son caractre difficile. C'est essentiellement l'criture de Joyce qui
retient son attention. Toute l'uvre de l'irlandais semble progresser avec mthode vers un des ouvrages
majeurs de la littrature du XXme sicle, "Finnegans Wake", publi en 1939, auquel il travailla
pendant dix-sept ans. En y crant une criture qui, tour tour ou simultanment, fait appel une lecture
alphabtique, pellative, idographique, en utilisant des homophonies translinguistiques fondes sur
dix-neuf langues diffrentes, son texte atteint une complexit propre donner du travail aux
universitaires pendant plusieurs sicles. Quand un audacieux se risque une impossible traduction, on
obtient par exemple: "(Il fait salement prtendant d'espincer la harbe jubalaire d'un second outeur
vcu, Farelly la Flamme). L'histoire est connue. Eclef ta lanterne et mire le vieil ores neuf. Dbln.
26
Lacan J. Les psychoses, o. c., p. 216.
27
Ibid., p. 231.
28
Lacan J. D'une question prliminaire tout traitement possible de la psychose, in Ecrits. Seuil. Paris. 1966, p. 565.
29
Lacan J. Le sinthome. Sminaire du 17 fvrier 1976, in Ornicar? Revue du champ freudien. Hiver 1976-1977, 8, p.15.
11
W.K.O.O. T'entends? Proche le mur du mausoliant. Fimfim fimfim. Gros fruit de fumeferrailles.
Fumfum. Fumfum. C'est octophone qui ontophane. Chute. La lyre muthyque de Pirebl..."
30
. Dans
l'volution de l'uvre de Joyce, de ses premiers essais critiques jusqu' Ulysse et Finnegans Wake, un
certain rapport la parole semble lui tre de plus en plus impos, au point, constate Lacan, qu'il finit
par dissoudre le langage en lui faisant subir une dcomposition qui va jusqu' porter atteinte l'identit
phonatoire
31
.
L'insistance de Joyce mconnatre la psychose de sa fille pour la considrer comme une
tlpathe capable de l'informer miraculeusement et de lire les secrets des gens tmoigne de la mme
intuition que son criture: il semble avoir form le soupon que le langage n'est pas un donn, mais un
acquis plaqu, impos, parasitaire.
L'argumentation de Lacan prend appui de manire privilgie sur un court pisode
autobiographique, rapport dans le Portrait de l'artiste en jeune homme, lors duquel Joyce relate avoir
t battu par des lves de sa classe, qui l'avaient attach, accul contre un grillage barbel. Ils le
frapprent coup de canne et l'aide d'un gros trognon de chou. Or, aprs s'tre dgag, trs vite, il
sentit sa colre tomber, "aussi aisment, crit-il, qu'un fruit se dpouille de sa peau tendre et mre"
32
.
Cette quasi-absence d'affect en raction la violence physique et cette mise distance du corps qui
semble lui-mme se dtacher comme une pelure retiennent l'attention. Or cet pisode n'est pas le seul
en son genre. Quand Joyce relate que le hros du Portrait se fit battre par le Prfet des tudes, il crit:
"De les imaginer endolories [ses mains] et enfles soudain, il les plaignait, comme si elles n'taient pas
lui, mais quelqu'un d'autre dont il aurait eu piti"
33
. L'existence de Joyce confirme ces confidences
littraires: par ngligence il laissa son il droit se calcifier au-del de toute possibilit de le sauver
34
;
tandis qu'il ne soigna gure l'ulcre qui fut l'origine de sa mort prmature
35
. "La forme du laisser-
tomber du rapport au corps propre, note Lacan, est tout fait suspecte pour un analyste"
36
. Nous avons
rapport plus haut que Deffieux dcrit une clinique semblable chez un autre sujet psychotique
37
. Elle
se rencontre de surcrot avec une certaine frquence chez les sujets sans domicile fixe. Dans un travail
remarquable sur les clochards de Paris, Declerck constate que la grande dsocialisation constitue une
30
Joyce J. Mutt et Jute, in Finnegans Wake. Traduction Andr du Bouchet. Gallimard. Paris. 1962.
31
Lacan J. Le sinthome. Sminaire du 17 fvrier 1976, in Ornicar? Revue du champ freudien, Hiver 1976-1977, 8, P. 17.
32
Joyce J. Portrait de l'artiste en jeune homme, in Oeuvres I. Traduction de L. Savitzky, rvise par J. Aubert. Gallimard.
Pliade. Paris. 1982, p. 611.
33
Ibid., p. 580.
34
Maddox B. Nora. Albin Michel. 1990, p. 362.
35
Ibid., p. 429.
36
Lacan J. Le sinthome. Sminaire du 11 mai 1976, in Ornicar? Bulletin du champ freudien, Septembre 1977, 11, p. 7.
37
Ctait au printemps, il avait 8 ans et allait un entranement de natation ; un homme lui a propos de lemmener sur son
vlo et B. a accept sans hsiter ; cet homme la amen dans les bois, la frapp avec un bton sur tout le corps ; un moment
lhomme a sorti un couteau et a voulu lui couper le sexe ; B. a alors russi schapper [] Il dira de cette bastonnade : Je
ne sais pas du tout si jai eu mal . En rentrant la maison, il le raconte son pre qui ne la pas cru . En fait, il est couvert
decchymoses et le mdecin qui le voit est effar. [] Quand il a commenc tre battu par cet homme, il a le souvenir
davoir abandonn son corps, de sen distancier, de disparatre : Un moment, jai vu un petit garon, ctait moi, cest l que
je me suis enfui . [Deffieux J-P. Un cas pas si rare, in La conversation dArcachon, o.c., pp. 16-18.
12
solution quivalente (mais non identique) la psychose . Il a observ chez ces sujets
dimpressionnants phnomnes de laisser-tomber du corps : fractures apparentes laisses en ltat
pendant plusieurs jours, chaussettes portes plusieurs mois et dont llastique en vient sectionner la
jambe jusqu los, inclusion dans la peau du pied dune chaussette qui navait pas t retire depuis
fort longtemps, etc. Il souligne avec un certain tonnement que ces sujets ne sont pourtant pas
psychotiques : il les situe plutt dans la catgorie des tats-limites ou des personnalits pathologiques.
Il constate les affinits de la clochardisation avec le fonctionnement psychotique, -prs dun quart de
ces sujets dsocialiss prsentent des symptmes psychotiques manifestes mais faute de disposer
dune clinique de la psychose ordinaire, il tente dintroduire le concept de forclusion anale , qui
nest pas sans tmoigner dune intuition pertinente de la non-extraction de lobjet pulsionnel.
Comment comprendre de telles aberrations, se demande-t-il, concernant les phnomnes de laisser-
tomber du corps, sinon en faisant lhypothse que lon se trouve l en prsence dun vritable retrait
psychique de lespace corporel qui, dsinvesti, se trouve alors comme abandonn son propre sort
dans lapparente indiffrence du sujet ?
38
De cette indiffrence, plus discrte et plus passagre chez Joyce, Lacan infre un dfaut dans le
nouage des trois dimensions qui dterminent la structure du sujet: en raison d'un ratage dans
l'articulation du symbolique et du rel, l'lment imaginaire ne demanderait qu' s'en aller. La figure
suivante montre o s'est opr le ratage pour lcrivain irlandais:
38
Declerck P. Les naufrags. Avec les clochards de Paris. Plon. 2001, p. 308.
13
Bien que la forclusion du Nom-du-Pre puisse tre conue dans les dernires laborations de
Lacan comme une carence de la nodalit borromenne de la structure du sujet, et bien que celle de
Joyce atteste d'une telle dfaillance, celui-ci n'a pas dclench une psychose. Pour en rendre compte,
Lacan introduit l'hypothse d'une rparation du nouage opr par l'entremise d'un raboutage de l'ego.
Lacan crit ainsi ce dernier:
14
En 1976 Lacan se trouve conduit diffrencier pour la premire fois le moi et l'ego. Il dfinit ce
dernier comme tant "l'ide de soi comme corps"
39
. Quand la fonction narcissique opre prise au
nouage borromen, l'ego ne se distingue pas du moi. Or chez Joyce l'ego s'avre prsenter la
particularit, si l'on en croit les pisodes de la rcle et des mains endolories, de ne pas se supporter de
l'image du corps. Lacan affirme, contrairement l'illusion philosophique, que l'homme ne pense pas
avec son me, mais avec son corps: sa psychologie participe de l'image confuse qu'il s'est form de son
corps dans l'image spculaire. "Il faut mettre la ralit du corps dans l'ide qui le fait"
40
, note-t-il, afin
de souligner que le sujet n'est pas condamn sa conscience, mais son corps, qui dresse un obstacle
majeur la saisie du sujet comme divis. La dbilit du mental chez chacun de nous trouve son
fondement dans l'adoration du corps. "La cogitation, insiste Lacan, reste englue d'un imaginaire qui
est enracin dans le corps"
41
. Or, pour Joyce, l'ego s'avre avoir une autre fonction que narcissique: il
corrige la dfaillance du nud, grce son "raboutage" par l'criture, en instaurant un second nouage
entre le rel et le symbolique, qui prend l'imaginaire dans sa tresse, empchant dsormais celui-ci de
glisser. L'ego de Joyce se constitue sans corps par l'entremise d'un encadrement formel trac par
39
Lacan J. Le sinthome. Sminaire du 11 mai 1976, in Ornicar? Bulletin du champ freudien, septembre 1977,11, p. 7.
40
Lacan J. Joyce le symptme II., in Joyce avec Lacan, sous la direction de J. Aubert. Navarin. Paris. 1987, p. 33.
41
Lacan J. RSI. Sminaire du 8 Avril 1975, in Ornicar? Bulletin du champ freudien, Hiver 1975-1976, 5, p. 37.
15
l'criture, de sorte que son art supple sa tenue phallique
42
. Il s'agit cependant d'un raboutage mal
fait, le nud garde la trace de la faute initiale. L'criture de Joyce n'veille pas la sympathie chez le
lecteur: elle abolit le symbole, elle coupe le souffle du rve, un lment imaginaire lui fait dfaut. En
tant "dsabonn l'inconscient"
43
l'crivain se trouve en mesure de mettre nu l'appareil du
sinthome: une lettre sans Autre qui fixe une jouissance opaque. "Il est celui, prcise Lacan, qui se
privilgie d'avoir t au point extrme pour incarner en lui le symptme, ce par quoi il chappe toute
mort possible, de s'tre rduit une structure qui est celle mme de lom, si vous me permettez de
l'crire tout simplement d'un l.o.m."
44
. Sans doute faut-il entendre que lom rsonne avec lom, le
verbe, de sorte que cette criture met l'accent sur l'autre corps du parltre, celui du langage, plus
exactement de la lalangue, avec lequel Joyce parvient rabouter l'ego sans impliquer l'imaginaire.
L'ide de soi s'avre soutenue chez lui par l'criture et non par le corps. Cependant lom est aussi une
rduction phontique qui ne saurait tre pousse au-del, en ce sens elle souligne que l'crivain met un
terme, un point final un certain nombre d'exercices. La littrature dite psychologique ne saurait aprs
lui tre apprhende de la mme faon. Il s'agit d'indiquer nouveau l'homologie entre l'criture de
Joyce et l'appareil du sinthome. Son art est parvenu produire une limite.
En instaurant un deuxime lien entre le symbolique et le rel, l'ego rabout coince l'imaginaire,
l'criture sinthomale restaure un nouage; cependant la structure de Joyce ne possde pas la proprit
borromenne: le rel et le symbolique y sont enlas. De ce dfaut, Lacan discerne un effet dans les
"Epiphanies". Il s'agit de textes trs courts, qui se prsentent pour la plupart sous forme de fragments
de dialogues, et qui semblent avoir valu comme tmoignage d'une exprience spirituelle sur laquelle
l'crivain fondait la certitude de sa vocation d'artiste. Il leur accordait une valeur que ne peut gure
concevoir le lecteur qui n'y dcouvre en gnral que la transcription d'un pisode banal.
Citons l'une d'elles:
"O'REILLY, de plus en plus srieux:... C'est maintenant mon tour, je suppose... (srieux au
possible)... quel est votre pote prfr?
Une pause.
HANNA SHEEHY:... Allemand?
O'REILLY:... Oui.
Un silence.
HANNA SHEEHY:... Je pense... Goethe"
45
Nous n'apprenons rien de plus, rien du contexte de l'pisode, de sorte que la trivialit des
piphanies semble, pour le lecteur, rester ouverte tous les sens, en ne dposant aucune signification.
42
Lacan J. Le sinthome. Sminaire du 18 novembre 1975, in Joyce avec Lacan, o. c., p. 40.
43
Lacan J. Joyce le symptme I, in Joyce avec Lacan, o.c., p.24
44
Ibid., p.28.
45
Joyce J. Epiphanies XII, in Oeuvres I, o.c., p. 92.
16
Cependant de telles "manifestations spirituelles" furent pour Joyce de la plus haute importance: il les
rapprochait de la Claritas, la troisime qualit du Beau selon Saint Thomas d'Aquin, lors de laquelle la
chose se rvle dans son essence. Ces expriences nigmatiques, portes l'criture, insres dans
l'uvre
46
, imposent pour l'crivain une rvlation touchant l'tre. En quoi elles se produisent en
articulant rel et symbolique. Elles mettent en vidence l'troitesse inhabituelle des liens qui unissent
chez Joyce ces deux dimensions.
La structure de ce dernier se caractrise par un nouage non borromen de l'imaginaire, du rel,
et du symbolique opr par un ego rabout du sinthome scriptural. Or, partir de 1975, le symptme se
trouve dfini comme tant la "faon dont chacun jouit de l'inconscient, en tant que l'inconscient le
dtermine"
47
, il est ce par quoi la jouissance se prend la lettre, de sorte qu'il porte la fonction de la
nomination. C'est ce qui autorise Lacan identifier ce quart lment de la chane borromenne l'un
des aspects de la fonction paternelle, celle qui donne un nom aux choses. Sans lui, affirme-t-il, "rien
n'est possible dans le nud du symbolique, de l'imaginaire et du rel."
La supplance paternelle construite par Joyce en laborant un symptme d'artifice apparat
constituer une performance exceptionnelle. "Finnegans Wake" parvient produire une limite de la
littrature. Aussi le raboutage de l'ego par une criture sinthomale constitue-t-il une forme de
supplance dont on ne connat gure d'quivalent.
Le concept de supplance.
N'existe-t-il pas cependant d'autres stratgies de supplmentation de l'ego pour parer la
dfaillance de la structure borromenne? La propension bien connue des psychotiques l'criture, et la
fonction le plus souvent pacifiante de celle-ci, tendrait le laisser supposer. L'examen de ce problme
implique un dtour pralable par un approfondissement du concept de supplance.
Lacan envisage pour la premire fois la possibilit de celle-ci dans le travail o il dtermine la
structure de la psychose en rfrence la forclusion du Nom-du-Pre. Il constate que "la figure du Pr
Flechsig" n'a pas russi suppler pour Schreber "au vide soudain aperu de la Verwerfung
inaugurale"
48
. Il semble d'ailleurs qu'il soit de rgle qu'une image, ft-elle paternelle, s'avre toujours
insuffisante l'laboration d'une supplance. A cet gard l'on pourrait avoir tendance distinguer entre
46
Pour une analyse plus approfondie de la fonction des "Epiphanies" dans l'oeuvre de Joyce, cf Marret S. James Joyce et
Virginia Woolf: moments piphaniques, in Dedalus, Revista Portugesa de Literatura Comparada n 2/3, Lisboa (Portugal).
Edioes Cosmos. 1993-94, pp. 207-219; et Marret S. Les piphanies joyciennes: l'indicible de la jouissance, in Tropismes.
Revue du centre de recherches anglo-amricaines. Universit Paris X - Nanterre. 1993, 6.
47
Lacan J. - RSI. Sminaire du 18 Fvrier 1975, in Ornicar ?, rentre 1975, 4, p. 106.
48
Lacan J. D'une question prliminaire tout traitement possible de la psychose, in o. c.,p. 582.
17
supplance et compensation. Dans le sminaire III ce dernier terme, plusieurs fois utilis, l'est toujours
en rfrence des images identificatoires: il y est indiqu que le sujet peut compenser la dpossession
primitive du signifiant "par une srie d'identifications purement conformistes"
49
, tandis que le
mcanisme du "comme si" y est qualifi de mode de "compensation imaginaire de l'Oedipe absent"
50
.
En revanche quand le terme de supplance prend vraiment une extension dans l'enseignement de
Lacan, c'est surtout au terme de celui-ci, il y dsigne un moyen utilis pour faire tenir ensemble les
lments de la chane borromenne. La distinction ne prend cependant pas un statut thorique puisqu'il
est fait mention en 1976 de "compensation par le sinthome" propos de Joyce
51
.
Il faut noter de surcrot que le concept de supplance dpasse le champ de la thorie de la
psychose. Quand il s'avre que la rfrence incarne par le Nom-du-Pre fait dfaut au champ du
signifiant sa fonction se rduit soutenir la dfaillance structurale de l'Autre. Dans ses dernires
recherches, Lacan tire les ultimes consquences de l'incompltude de l'Autre. Il en rsulte une
gnralisation de la forclusion de la rfrence. la faveur de cette approche, la fonction paternelle
apparat comme un quart terme, li la nomination, capable de supplmenter les trois autres et de les
articuler de manire borromenne. Ds lors, faute de rfrence dans le champ du langage, le Nom-du-
Pre est lui-mme une supplance, c'est pourquoi il participe toujours plus ou moins de l'imposture. La
forclusion du Nom-du-Pre note la carence de cette supplance paternelle, laquelle peut cependant tre
compense par d'autres formes de supplance, en quelque sorte des supplances au second degr qui
impliquent une certaine dgradation de leur fonction. Ainsi faut-il distinguer le symptme du nvros
comme quart terme assurant un nouage des lments de la chane borromenne propre pallier la
forclusion gnralise
52
et le sinthome de Joyce qui supple la forclusion du Nom-du-Pre en
restaurant un nouage non borromen.
Dans les dernires annes de son enseignement, Lacan esquisse quelques hypothses
concernant l'existence d'autres sortes de supplances et d'autres modalits de nouage des lments de la
structure. Retenons pour ce qui concerne la psychose qu'il fait quivaloir en 1975 la structure de la
personnalit et la psychose paranoaque en les rapportant toutes deux la mise en continuit des trois
lments de la chane par quoi s'effectuerait un nud de trfle
53
. Nul doute que le dlire, dans ses
formes les plus labores, paranoaques et paraphrniques, constitue lui-mme une supplance la
supplance dfaillante du Nom-du-Pre: il opre une significantiation de la jouissance qui localise
49
Lacan J. Les psychoses. Sminaire III, o.c., p. 232.
50
Ibid., p. 218.
51
Lacan J. Le sinthome. Sminaire du 17 fvrier 1976, in Ornicar? Bulletin du champ freudien. Hiver 1976-77, 8, p. 19.
52
Ce concept forg par Jacques-Alain Miller souligne que la rfrence fait dfaut dans le champ du symbolique. "Ce que
comporte le mode gnralis de forclusion, crit-il, ce qu'implique, disons, la fonction x, c'est qu'il y a pour le sujet, non
seulement dans la psychose mais dans tous les cas, un sans-nom, un indicible" [Miller J-A. Forclusion gnralise. Cahier de
l'Association de la Cause freudienne -Val de Loire & Bretagne, 1993, 1, p. 7.]
53
Lacan J. Le sinthome. Sminaire du 16 dcembre 1975, in Ornicar? Bulletin du champ freudien, juin-juillet 1976, 7, p. 7.
18
celle-ci et instaure une rfrence inbranlable. Un nouage s'opre, mais il n'est pas borromen, le nud
de trfle en rend mieux compte: jouissance mgalomaniaque de signifiants holophrass.
De mme qu'il existe une pluralit de Noms-du-Pre, il semble qu'il faille concevoir, en rapport
la structure psychotique, plusieurs modalits de supplances. Ces dernires ont en commun de
permettre l'instauration d'un nouage des lments de la structure, mais un nouage non borromen. La
supplance s'ancre dans une fonction de limitation qui opre sur la jouissance sans parvenir
quivaloir la castration. Il en rsulte qu'elle choue mettre en place le phallus symbolique. A.
Mnard souligne les caractristiques majeures d'une supplance: il s'agit d'une invention singulire qui
opre une pacification de la jouissance et qui conserve la trace de la dfaillance laquelle elle remdie.
Suppler n'est pas remplacer, affirme-t-il, "suppler veut dire que le dfaut, le manque qui l'appelle,
n'est pas rduit, combl, mais qu'il demeure inclus dans la solution qui permet d'aller au-del"
54
. Il
prcise de surcrot qu'il y a lieu de distinguer les supplances prventives, celles qui sont en rapport
avec la structure psychotique hors-dclenchement, et les supplances curatives, labores
postrieurement la psychose dclare.
Le concept de supplance dans son acception stricte appartient la thorie de la psychose. Seul
Briole a tent dtendre son champ au-del. Ltude de la pathologie traumatique la conduit
constater que le syndrome transtructural de rptition traumatique, qui met au premier le rel dune
jouissance angoissante, se trouve souvent contenu par diverses supplances. Dune manire gnrale,
prcise-t-il, cest dans une autre rencontre, diffrente de celle du trauma, que se met en place une
supplance. Elle fait alternative pour le sujet et non solution de compromis, qui serait celle du
symptme. Cest une solution en quelque sorte rductrice, en ce sens quelle suppose un effacement du
sujet derrire la cause quil va maintenant servir. Cest comme sil disparaissait pour le compte dun
autre ou des autres, comme sil ne comptait plus quexistant, ds lors, au rang dune hirarchie des
valeurs renverses : pas moi, les autres . Briole et ses collaborateurs dcrivent plusieurs modalits
de supplances qui peuvent se succder ou coexister chez un mme sujet : recours lidal du groupe,
sen remettre une figure de lautorit ou du savoir, sidentifier une victime, se soutenir dun dsir de
vengeance, se vouer une cause, dvelopper des activits de sublimation qui visent un bordage de la
souffrance souvent articules un impratif de tmoignage, etc
55
. De telles supplances possdent en
commun avec celles du psychotique de faire barrage une jouissance envahissante, mais elles ne
portent pas trace du dfaut auxquelles elles remdient, et surtout elles ne tmoignent gure dune
inventivit du sujet. Il semble donc quil ne faille pas confondre la supplance la rencontre
traumatique avec la supplance la forclusion du Nom-du-Pre. Le mme terme est ici utilis pour
54
Mnard A. Clinique de la stabilisation psychotique. Bulletin de la Cause freudienne Aix-Marseille, novembre 1994, I, p. 7.
55
Briole G., Lebigot F., Lafont B., Favre J-D, Vallet D. Le traumatisme psychique : rencontre et devenir. Congrs de
psychiatrie et de neurologie de langue franaise. Toulouse. 1994. Masson. Paris. 1994, p. 109.
19
dsigner des cliniques et des concepts diffrents. Briole envisage mme que le syndrome de rptition
traumatique puisse parfois constituer une supplance la psychose clinique
56
.
Lacan n'a pas explicitement thoris la spcificit de la structure psychotique hors-
dclenchement. Outre ses analyses du sinthome joycien, il a cependant donn une indication
intressante cet gard quand il dcle dans la rigueur de la pense de Wittgenstein"une frocit
psychotique, auprs de laquelle le rasoir d'Occam bien connu qui nonce que nous ne devons admettre
aucune notion logique que ncessaire n'est rien"
57
. Dans le mme sminaire, il prcise un peu plus
tard: "J'ai parl tout l'heure de psychose, il y a en effet un tel point de concurrence du discours le plus
sr avec je ne sais quoi de frappant qui s'indique comme psychose, que je le dis simplement en
ressentir l'effet. Qu'il est remarquable qu'une universit comme l'Universit anglaise lui ait fait sa
place. Place part, c'est bien le cas de le dire, place d'isolement, quoi l'auteur collaborait parfaitement
lui-mme, si bien qu'il se retirait de temps en temps dans une petite maison de campagne, pour revenir
et poursuivre cet implacable discours, dont on peut dire que mme celui des Principia Mathematica de
Russells'en trouve controuv. Celui-l ne voulait pas sauver la vrit. Rien ne peut s'en dire qu'il disait,
ce qui n'est pas sr, puisqu'aussi bien avec elle nous avons faire tous les jours. Mais comment Freud
dfinit-il donc la position psychotique dans une lettre que j'ai maintes fois cite? Prcisment de ceci
qu'il appelle, chose trange, unglauben, ne rien vouloir savoir du coin o il s'agit de la vrit". Lacan
voque l une notation du manuscrit K o Freud voque un retrait de croyance fondamental chez le
paranoaque
58
. On sait que dans le Tractatus logico-philosophicus (1922) Wittgenstein se donne pour
objectif de tracer une limite l'expression des penses, il considre que la thse de son ouvrage se
rsume en ces mots: "tout ce qui peut tre dit peut tre dit clairement, et ce dont on ne peut parler on
doit le taire". Les questions religieuses, mtaphysiques et esthtiques lui paraissent par consquent
dpourvues de sens et devoir rester sans rponse, en quoi il adopte une attitude plus extrme encore
que celle de Guillaume d'Occam dont les thses nominalistes portrent au XIVme sicle un coup
dcisif aux abstractions scolastiques. La rigueur de la dmarche logique de Wittgenstein le contraint
mettre en vidence la bance de l'Autre et l'absence de rfrence inhrente au langage, or il ne cherche
nullement y parer en la masquant d'un fantasme, il choisit au contraire d'en souligner le vide en en
interdisant l'approche au philosophe. Pas de mi-dire de la vrit subjective acceptable en logique selon
l'auteur du Tractatus, sa position est radicale: rien ne peut s'en dire. Il se discerne dans cette dmarche
56
Selon Briole et ses collaborateurs, les cas o le syndrome de rptition traumatique devient lui-mme une supplance la
psychose ne sont pas rares en pratique. Il sagit, prcisent-ils, de sujets qui ont trouv intgrer par emprunt dautres
patients rencontrs lhpital, dans des groupes danciens combattants ou de victimes des symptmes lis lvnement
dans une expression clinique qui reproduit en tous points un syndrome de rptition traumatique. A partir de cette
identification imaginaire, leur discours fait lien social tant avec les autres des groupes auxquels ils se rattachent quavec le
milieu mdical ceci dautant plus que leurs manifestations cliniques ont t nommes, reconnues ou pensionnes [Briole
G., Lebigot F., Lafont B., Favre J-D, Vallet D. Le traumatisme psychique : rencontre et devenir. Congrs de psychiatrie et
de neurologie de langue franaise, o.c., p.120] Ces lignes tmoignent dune extension souvent rencontre du concept de
supplance psychotique qui tend alors dsigner toutes les modalits de stabilisation de la structure psychotique.
57
Lacan J. L'envers de la psychanalyse. Sminaire du 21 Janvier 1970. Seuil. Paris.1991, p. 70.
58
Freud S. La naissance de la psychanalyse. PUF. Paris. 1956, p. 136.
20
un effort pour dconnecter le langage de tout montage de jouissance ; elle induit lhypothse dune
dfaillance du nouage borromen de la structure. Cependant, malgr ses angoisses, son mal-tre, ses
difficults caractrielles, Wittgenstein n'a pas prsent de troubles psychotiques manifestes. Son
enseignement, en bordant le vide de l'Autre, par un incessant travail sur les limites et les proprits du
langage, semble tre parvenu rparer la dfaillance du nouage des lments de la structure.
L'affirmation provocante de Lacan, prononce lors de ses Confrences dans les universits
amricaines, selon laquelle lui-mme serait psychotique parce qu'il a toujours essay d'tre rigoureux
59
s'claire quelque peu rapporte la dmarche de Wittgenstein. L'essentiel de l'enseignement de Lacan,
l'instar de celui du philosophe, part de l'ide d'un trou, il culmine dans une topologie borromenne qui
cherche forger une nouvelle criture, qui tmoigne d'un effort pour penser le symbolique hors d'une
rfrence l'Autre, et dans laquelle fonctionne un trou complexe et tourbillonnaire o un et trois se
conjoignent. Ds lors, l'insistance de Lacan sur l'intrication borromenne des lments de la structure
incite modrer sa propension la psychose, certes sa dmarche aboutit une pure logique, mais il
souligne la corrlation de la jouissance aux autres lments de la structure, il ne cesse de tenir le
nouage que Wittgenstein aurait voulu pouvoir rompre.
Il semble que l'on puisse retenir des quelques indications parses donnes par Lacan sur la
psychose ordinaire que celle-ci appelle un diagnostic bifide pour tre identifie: il s'agit d'une part de
dgager des signes de dfaillance du nouage borromen de la structure, d'autre part de discerner par
quel moyen ce dfaut vient tre imparfaitement compens. A cet gard l'argumentation dveloppe
pour apprhender la structure de Joyce pourrait passer comme un type idal si elle tait issue de la cure
analytique. Elle suggre la mise en uvre d'une nouvelle clinique diffrentielle, qui reste dvelopper,
fonde sur la mise en vidence des ratages du nud et des supplances correspondantes.
Tentons maintenant de la prciser en nous orientant sur les principaux phnomnes qui
indiquent un nouage dfaillant, respectivement du rel, du symbolique, ou de l'imaginaire. Approche
certes rductrice, lautonomisation dun lment impliquant celle des autres. De surcrot, on gardera
prsent que la formation d'une hypothse diagnostique demande tout le moins le rassemblement d'un
faisceau de signes convergents.
Indices de la non-extraction de l'objet a.
La non-extraction de l'objet a constitue une indication majeure pour apprhender la spcificit
de la structure psychotique, elle implique connexions inadquates du rel aux autres dimensions,
59
Lacan J. Confrence Yale University du 24 novembre 1975, in Scilicet 6/7. Seuil. Paris, 1976, p. 9.
21
lesquelles s'avrent alors n'tre pas en mesure de tenir pleinement leur fonction limitatrice par rapport
la jouissance.
Emergence d'une jouissance hors-limite.
La gloire prouve par R. Roussel, lorsqu'il rdigea son premier roman, l'ge de dix-neuf ans,
en constitue un exemple exceptionnel, en particulier par sa dure. Pendant plusieurs mois, crivant nuit
et jour, sans ressentir de fatigue, dans un tat hypomaniaque, il eut le sentiment que de la lumire
manait de sa plume et de son tre
60
. "Ce que j'crivais, rapporte-t-il, tait entour de rayonnements, je
fermais les rideaux, car j'avais peur de la moindre fissure qui et laiss passer au dehors les rayons
lumineux qui sortaient de ma plume [...] Mais j'avais beau prendre des prcautions, des rais de lumires
s'chappaient de moi et traversaient les murs, je portais le soleil en moi et je ne pouvais empcher cette
formidable fulguration de moi-mme.[...]. J'tais ce moment dans un tat de bonheur inou, un coup
de pioche m'avait fait dcouvrir un filon merveilleux, j'avais gagn le gros lot le plus tourdissant. J'ai
plus vcu ce moment-l que dans toute mon existence"
61
. De telles sensations sont l'indice qu'une
jouissance hors-limite, non phallicise, s'empare du corps. Il est plus frquent que des moments de
bonheur intense, s'apparentant des phnomnes extatiques, restent des manifestations erratiques,
ponctuelles, phmres. Ils ne se discernent parfois qu'en une ou deux indications fugitives. Ainsi
Karim me confia avoir plusieurs fois ressenti, lors de son adolescence, en des moments de solitude, une
sensation agrable, centrifuge, montant du bas-ventre, dont l'originalit l'incita la nommer "sensation
maternelle"; plus g, pleurant dans un terrain vague, assis au soleil, il vit un lzard, ce qui lui fit, dit-il,
comme de la drogue: il se coupa des choses et elles se magnifirent. Une autre patiente, aprs avoir
couch son enfant, prouve brusquement un "bien-tre", une "impression de russir quelque chose",
"comme un filet de capillaires, une forte chaleur dans la tte. C'est brillant, rayonnant comme un feu
d'artifice, broiement avec une toile, le visage libr, l'impression de grandeur". Le phnomne dura
quelques secondes et s'apaisa
62
.
De telles manifestations d'un bonheur inou qui envahit le corps constituent l'indice d'une
drgulation de la jouissance. Bien que ces expriences ne soient pas ncessairement psychotiques, il
est bien connu quelles peuvent appartenir la clinique de la psychose dclare. Schreber avait le
sentiment que Dieu exigeait de sa part "un tat constant de jouissance", de sorte que les limites de
celle-ci avaient cess de s'imposer lui. "Un excs de volupt, crivait-il, rendrait les hommes
incapables d'exercer les fonctions qui leur incombent; l'tre humain se trouverait empch de s'lever
un niveau suprieur de perfection spirituelle et morale; oui, l'exprience nous l'enseigne, les excs
volupteux ont men l'anantissement, non seulement de nombreux hommes mais encore des peuples
60
On trouvera un examen plus prcis de la gloire de Roussel dans le chapitre intitul "Supplance par un procd esthtique:
R. Roussel".
61
Janet P. De l'angoisse l'extase. Alcan. Paris 1926, I, pp. 116-117.
62
Czermak M. Sur quelques phnomnes lmentaires de la psychose, in Passions de l'objet, o.c., p. 134.
22
entiers. Or, soulignait-il, ces limites ont cess de s'imposer, et elles se sont en un certain sens
retournes en leur contraire"
63
.
On constate de surcrot que la rencontre inopine d'une jouissance extrme peut constituer un
facteur dclenchant de la psychose clinique. Lors de son premier rapport sexuel avec un de ses anciens
professeurs, Carole sentit ds les prliminaires l'nergie l'envahir. "Elle est monte de l'anus, du
prine, jusqu' la tte, elle a travers tout le corps par le milieu. a a fait boum. Quand a a atteint le
nez, j'ai eu l'impression de respirer dans le tout. Mon souffle se dgageait dans le vide. Il n'y avait plus
de diffrence entre le plein et le vide. Les paradoxes se conjoignaient, les contraires s'quivalaient,
j'avais accs l'tre des choses, le ciel et l'enfer n'taient plus qu'un, j'tais aussi lgre qu'une plume et
aussi compacte qu'un bloc. Ce n'tait pas seulement le dsir, c'tait une ouverture de l'tre. A un
moment, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une chaise, ce n'tait plus une chaise banale, je la comprenais de
l'intrieur, je touchais au divin, une connaissance absolue dans l'instant. Je percevais les liaisons de
toutes choses. J'avais accs l'unit. Je pouvais prvoir l'avenir. a augmentait toujours. Je me
demandais jusqu'o a allait aller. L'nergie est monte jusqu'en haut, jusqu' la tte, alors ce n'tait
plus moi, mon ego s'est dissout". Elle exprime clairement qu'en ce moment-l elle a franchi un interdit:
"c'tait trop de plaisir, j'ai eu l'impression qu'il y avait un ange gardien qui m'interdisait d'aller plus
loin". Depuis lors, une jouissance douloureuse s'est empare de son corps et, malgr plusieurs
hospitalisations et quelques tentatives de psychanalyse, elle prouve beaucoup de difficults pour
temprer ses troubles schizophrniques.
Les exemples prcdents pourraient suggrer que l'preuve de la jouissance Autre se caractrise
par la sensation d'un bonheur inou. On sait qu'il n'en est rien. Ce sont souvent des troubles
hypocondriaques qui tmoignent d'une jouissance non phallicise. cet gard des tudes sur les
corrlations entre le syndrome des polyoprs et la structure psychotique seraient sans doute
bienvenues.
Arielle n'prouve ni extase remarquable, ni douleur exceptionnelle, cependant elle confie
prouver un plaisir extrme quand elle se rend la selle. Cela est particulirement notable quand elle a
le loisir de s'y consacrer. "Pourtant, observe-t-elle avec un humour triste, on ne peut pas en faire le
summum d'une vie". A cet gard elle rapporte en outre que pendant un certain temps il lui arriva en ces
circonstances d'avoir l'impression de se vider entirement. Il est remarquable que cela s'accompagnait
de sensations dont elle n'aurait su dire s'il s'agissait d'angoisse ou de jouissance. Plusieurs fois
rencontr chez des sujets de structure psychotique, le sentiment de se vider entirement en dfquant
rsulte d'une absence de rgulation phallique de la jouissance anale. Cette carence suscite tantt une
angoisse de perte d'tre, tantt des volupts hors-normes. La manire dont les inquitudes d'Arielle se
sont interrompues, pour tourner au plaisir extrme, mrite d'tre note: il a suffi qu'un mdecin lui
63
Sbreber D.P. Mmoires d'un nvropathe [1903], o.c., p. 229.
23
crive sur une ordonnance, la premire ligne de celle-ci, "aller la selle rgulirement". Depuis lors,
l'encontre de ses habitudes passes, elle respecte scrupuleusement cette prescription. Le phnomne
ne manque pas de la surprendre elle-mme. Mais c'est toute son existence, nous y reviendrons, qui
s'avre dtermine par les prescriptions de son entourage.
Carence du fantasme fondamental.
La non-extraction de l'objet a implique que le montage du fantasme fondamental n'est pas en
mesure de s'instaurer. Les indices de la carence de celui-ci se discernent principalement dans le
sentiment d'une absence de direction personnelle, dans la labilit des symptmes et dans une incapacit
parer la malignit de l'Autre. Le premier de ces troubles se rvle clairement dans les formes les
plus manifestes du fonctionnement "comme si": les variations des conduites et des idaux du sujet
tmoignent qu'il ne dispose pas de quoi s'orienter dans l'existence. D'autre part, Federn note juste titre
que "la disparition rapide ou mme soudaine des symptmes nvrotiques svres" constitue un signe de
ce qu'il nomme une "schizophrnie cache"
64
. Outre cela, la concomittance de symptmes
ressortissant des logiques du fantasme diffrentes, associant par exemple phobie, perversion et
obsession, peut encore rvler l'absence du fantasme fondamental. Federn fait une constatation
convergente quand il dgage un autre signe de schizophrnie latente dans "une histoire comportant des
priodes avec des sortes de nvroses diffrentes, telles que la neurasthnie, la psychasthnie,
l'hypocondrie, l'hystrie de conversion prcoce, l'hystrie d'angoisse et les obsessions et les
dpersonnalisations svres".
Faute d'avoir t spar de lobjet de jouissance, le sujet de structure psychotique prouve la
crainte que lAutre veuille le lui prendre. Karim tait en qute d'un idal pour s'orienter dans l'existence
quand il m'affirma en une priode de son analyse: "Je veux tre auto-suffisant. Je ne veux rien devoir
aux autres, et je ne veux rien recevoir, surtout pas de vous". Or des dons d'argent lui avaient t fait
bnvolement qui l'avaient plong dans une forte angoisse. A la suite de quoi il supposa que l'Autre
allait se croire en droit d'exiger en retour ce qu'il avait de plus cher, peut-tre ses surs, ou plus
probablement une partie de son corps, en particulier son testicule gauche, dont la crainte de le perdre
constituait l'une ses plaintes majeures. La dfaillance de la fonction du fantasme laisse le sujet dans
l'incapacit de parer la malignit de l'Autre. Il est alors expos se rduire l'objet de jouissance de
celui-ci, se ressentant, au gr de l'imaginaire de chacun, soit comme "nul", soit comme une "momie
vivante", voire comme le "carcinome de Dieu".
Cette dernire expression est employe par Fritz Zorn pour qualifier son tre. Dans sa vie, rien
ne lui manque, rien ne l'incite s'engager, il n'prouve pas la ncessit de faire des choix. "Je n'tais
pas triste, crit-il, parce qu'il me manquait quelque chose de prcis, j'tais triste bien qu'il ne me
64
Federn P. La psychanalyse des psychoses [1943], in La psychologie du moi et les psychoses. PUF. Paris. 1979, p. 139.
24
manqut rien
- ou qu'apparemment rien ne me manqut". Il ajoute avec beaucoup de pertinence:
"Contrairement bien des gens tristes, je n'avais pas de raison de l'tre; et c'tait justement l qu'tait
la diffrence
65
, c'tait justement l ce qu'il y avait d'anormal dans ma tristesse"
66
. L'lan du dsir ne
s'est pas enclench, ce qui lui donne le sentiment de n'avoir "jamais fonctionn"
67
. Il est cet gard
trs explicite: "Je n'avais pas de souhaits satisfaire car je n'avais pas de souhaits. J'tais malheureux
sans rien souhaiter. L'argent n'avait pas de sens pour moi car rien de ce qu'il m'et permis de m'acheter
ne m'aurait fait plaisir. Je n'tais pas un acheteur enthousiaste car je savais que, pour moi, il n'y avait
rien acheter. J'avais donc un tas d'argent mais je ne savais pas quoi le dpenser"
68
. Il n'prouve
aucun apptit sexuel. A l'universit, constate-t-il, "je n'avais pas eu "des difficults avec les femmes" ni
mme des problmes sexuels; je n'avais absolument rien eu avec les femmes et ma vie entire n'tait
qu'un problme sexuel non rsolu. Ce n'tait pas que j'avais t "amoureux sans espoir", que cela
n'avait "pas march" et que la femme en et alors "pris un autre", je n'avais absolument jamais t
amoureux et n'avais pas la moindre ide de ce que c'tait que l'amour; c'tait un sentiment que je ne
connaissais pas, tout comme je ne connaissais peu prs aucun sentiment [...] c'tait la totale
impuissance de l'me"
69
. Quand la fonction du fantasme s'avre si radicalement carente, rien ne
protge le sujet d'une confrontation la jouissance de l'Autre. Ds lors, Zorn s'avre en guerre totale
contre le principe hostile qui le dtruit, incarn pour lui en divers avatars immondes: ses parents, la
Socit bourgeoise, zurichoise et occidentale, Dieu lui-mme. Le tourment que lui inflige l'Autre
jouisseur, qu'il tient pour responsable de son lymphome, il cherche le lui retourner par sa publication
conue comme "un dchet radioactif" lanc contre la socit occidentale
70
.
Arielle affirme qu'elle s'prouve dans un monde de pressions multiples: ds qu'elle a le
sentiment que les autres attendent quelque chose venant d'elle, il lui semble qu'ils l'exigent.
"L'agressivit des autres me fait tellement peur, dit-elle, que lorsque j'y suis confronte, je pourrais
tuer, a ferait un beau carnage. Pour une peccadille, ajoute-t-elle, je suis en danger de mort". Les
simples formules de politesse des commerants sont parfois ressenties comme des tentatives de
mainmise sur son tre. S'ils cherchent engager une conversation la situation peut devenir
insupportable. "Est-ce tout ce qu'il vous faut?" demande un charcutier. Elle sait que la phrase est banale
mais elle l'prouve comme "carrment intime". De semblables carences de la fonction du fantasme,
inapte parer la jouissance de l'Autre, se rencontrent parfois chez des hystriques. Cependant, cela se
combine chez Arielle avec de prcaires identifications imaginaires; elle se dsole au surplus que son
intellect soit "endommag" par diverses inhibitions, tout en s'tonnant que sa sexualit ait t pargne.
"Je ne supporte pas le dsir des autres, constate-t-elle, sauf dans le domaine sexuel, je me demande
65
Soulign par moi.
66
Zorn F. Mars. [1977]. Gallimard. Paris. 1979, p. 163.
67
Ibid., p. 267.
68
Ibid., p. 174.
69
Ibid., p. 194.
70
Maleval J-C. Fritz Zorn, le carcinome de Dieu. Phnomne psychosomatique et structure psychotique. L'Evolution
psychiatrique, 1994, 59, 2, pp. 305-334.
25
bien pourquoi. Il n'y a que dans la relation sexuelle o je ne suis pas entame, o je n'ai pas de
problme". Pourtant elle a cette phrase tonnante qui tmoigne mme en la circonstance d'une certaine
dfaillance du fantasme: "je vais peut-tre tre tue, mais je n'ai pas peur". Cette pente la connexion
du sexuel la mort semble un indice de 0. 0. Faute dtre en mesure dengager son manque dans
la relation, cest son tre mme qui sy trouve mis en jeu. Sa difficult interprter le dsir de lAutre
la laisse dans le danger dy discerner une volont de jouissance rclamant son sacrifice. Cependant tout
indique que le dsir d'un homme vient soutenir une image phallique d'elle-mme, aussi prcaire que
prcieuse, "les caresses, confie-t-elle, me donnent l'impression d'tre l'intrieur de moi-mme". En
leur absence elle court le risque de se rduire son tre de dchet: un poulet cuisses releves et cou
sectionn. Ceux que prparait l'Autre maternel. Un voile est port sur cette horreur grce la
reprsentation phallique d'elle-mme soutenue par le dsir du partenaire. Il est manifeste que
l'orientation dans l'existence confre par le fantasme fondamental lui fait dfaut. "Ma vie, affirme-t-
elle, est faite de scnes dcousues. Les sances de psychothrapie, c'est comme ma vie, je les fais une
une, sans lien entre elles
71
. J'ai une gestion besogneuse du quotidien qui n'est pas sous-tendue par un
but. Ma prise de notes compulsive reflte cela, j'en ai partout, je suis envahie, je multiplie les notes, j'ai
beaucoup de mal les classer, je n'arrive pas mettre de l'ordre dedans, ni dans mes ides. Pourtant
cela m'aide prserver le quotidien. Je rdige beaucoup d'emplois du temps qui me permettent de
mieux entrevoir le lendemain. Mais je n'ai pas de fil directeur. Je ne sais pas ce que c'est qu'un but. Je
suis incapable de faire des projets. Je ne sais tellement pas que je suis oblige de faire confiance.
J'attends que mon mari se dtermine, aprs je m'aligne. De manire gnrale, je me rgle sur des
schmas, mais le sens me manque".
L'impression frappante d'inconsistance donne par certains sujets psychotiques, ds les premiers
entretiens, souvent associe de discrtes diffluences de la pense, et un flottement sans but dans
l'existence constituent des indices assez manifestes de la carence du fantasme fondamental. Cette
inconsistance connat certes des formes dpressives, mais aussi bien mythomaniaques et exaltes; la
plus frquente semblant tre la plus discrte, en raison d'une adaptation par branchement sur un proche.
L'moussement affectif.
Le fantasme psychotique constitue un montage imaginaire qui permet de localiser un objet de
jouissance, produisant ds lors une prcaire, et souvent imparfaite, canalisation de l'nergtique
pulsionnelle. Quand la connexion de l'imaginaire aux autres dimensions n'est plus assure, les affects
s'en trouvent altrs. En effet, mme si pour l'essentiel, selon Freud, les affects sont des "hystries
71
Que l'on compare avec les propos d'une schizophrne: "Les choses se prsentent isolment, chacune pour soi, sans rien
voquer. Certaines choses qui devraient former un souvenir, voquer une immensit de penses, donner un tableau, restent
isoles. Elles sont plutt comprises qu'prouves". [Minkowski. E. La notion de perte de contact vital avec la ralit et ses
applications en psychopathologie [1926], in Au-del du rationalisme morbide. L'Harmattan. Paris. 1997, p. 48.] Non
seulement la carence de la signification phallique ne permet pas de connecter les fantasmes la pulsion, mais on constate que
par dfaillance du bouclage rtroactif de la chane signifiante les lments de la pense restent en suspens.
26
codes", l'affect ne saurait tre rduit au signifiant, il est comprhensible, souligne Jacques-Alain
Miller, de sorte que, "par quelque bout qu'on le prenne, on ne peut effacer son caractre d'effet de
signifi", il participe d'une "coalescence du signifiant et du signifi"
72
. Un lment imaginaire s'avre
ncessaire pour que les affects deviennent expressifs. S'il fait dfaut, il arrive qu'ils ne soient plus
ressentis. Lacan considre que ce phnomne signe parfois la structure psychotique: on sait qu'il
accorde une grande importance au fait que Joyce relate, aprs que son corps ait reu une svre rcle,
n'en avoir prouv comme sujet aucun affect.
Quand la carence du fantasme fondamental n'est plus compense, l'animation affective de la
structure subjective se rvle atteinte. Certains sujets de structure psychotique confient ainsi n'avoir
jamais ressenti le sentiment amoureux. "Je n'avais absolument jamais t amoureux, rapporte Zorn, et
n'avais pas la moindre ide de ce que c'tait que l'amour; c'tait un sentiment que je ne connaissais pas,
tout comme je ne connaissais peu prs aucun sentiment [...] c'tait la totale impuissance de l'me".
Arielle affirme de mme ne pas comprendre ce qu'est l'amour dont les autres parlent tant.
D'autres sujets s'tonnent de cesser brutalement de l'prouver. "J'ai une panne de sentiments",
me disait l'un d'eux. Dans des moments o il est en proie des difficults professionnelles, il constate
que surgissent des tats d'inaffectivit l'gard de son pouse. Nul grief ne les motive, aussi s'en
trouve-t-il surpris et pein. De multiples questions viennent alors le tourmenter: est-ce que je l'aime ou
non? Pourquoi cette femme-l? Est-ce que j'aime mes enfants? Il s'inquite de ne pas trouver de
rponse essentielle. Ces moments dpressifs durent quelques jours, parfois quelques semaines, puis
tout rentre dans l'ordre.
Une autre patiente, dont l'inconsistance domine le tableau clinique, bien qu'elle qu'elle assume
fort bien ses responsabilits professionnelles de comptable dans une grande entreprise, me confie avoir
rcemment rencontr un homme. Elle ne sait pas si elle l'aime, n'ayant jamais su ce que cela voulait
dire. Elle poursuit cependant la relation parce qu'elle suppose qu'avoir envie de voir l'autre constitue
une preuve suffisante de bien-tre. Elle tente de se satisfaire de ce sentiment parce qu'elle est trs
attache ce que sa vie apparaisse normale aux yeux des autres.
La psychiatrie classique a maintes fois soulign l'atteinte de la vie affective rencontre dans la
psychose clinique: anhdonisme, apathie, affect inappropri, etc. Dide et Guiraud proposrent mme de
considrer un dfaut du dynamisme vital et thymique, qu'ils nommrent l'athymhormie, comme tant le
trouble le plus profond et le plus global de la dmence prcoce
73
. Ces phnomnes qui peuvent se
rencontrer sous des formes plus ou moins discrtes dans la psychose ordinaire sont souvent trs
apparents dans la clinique de la schizophrnie. Plusieurs annes aprs son entre dans la psychose, une
72
Miller J-A. A propos des affects dans l'exprience analytique, in Actes de l'Ecole de la Cause Freudienne, 1986, X, p. 122.
73
Guiraud P. Psychiatrie Gnrale. Le Franois. Paris. 1950, p. 493.
27
patiente relate ainsi la dconnexion de sa pense et de sa vie affective: les choses, dit-elle, "sont plutt
comprises qu'prouves. C'est comme des pantomimes qu'on jouerait autour de moi, mais je n'y entre
pas, je reste en dehors. J'ai mon jugement, mais l'instinct de vie me manque. Je ne parviens plus
donner mon activit d'une manire suffisamment vivante. Je ne puis plus passer des cordes douces aux
cordes tendues, et pourtant on n'est pas fait pour vivre sur le mme thme. J'ai perdu le contact avec
toute espces de choses. La notion de valeur, de la difficult des choses a disparu. Il n'y a plus de
courant entre elles et moi, je ne peux plus m'y abandonner. C'est une fixit absolue autour de moi. J'ai
encore moins de mobilit pour l'avenir que pour le prsent et le pass. Il y a en moi comme une sorte
de routine qui ne me permet pas d'envisager l'avenir. Le pouvoir crateur est aboli en moi. Je vois
l'avenir comme rptition du pass"
74
. Tout cela la fait souffrir au point de mettre le feu ses
vtements pour se procurer, comme elle l'explique, des sensations vives qui lui font entirement dfaut.
La dconnexion du symbolique, de l'imaginaire et du rel se discerne ici nettement: toute jouissance
s'est absente de la pense et des objets, tandis que l'incorporation signifiante de l'organisme s'avre
elle-mme dfaillante. Quand la jouissance s'avre n'tre pas prise au montage dynamique du fantasme,
les pulsions risquent de se dsintriquer, et de librer la pulsion de mort. D'o la propension de certains
schizophrnes des passages l'acte inattendus pour l'entourage. On conoit qu'un certain
moussement affectif soit souvent not dans les antcdents des sujets qui les commettent.
Les bauches du pousse--la-femme.
Des bauches de fminisation, surtout discernables chez l'homme
75
, possdent une grande
valeur diagnostique quand ils tmoignent d'un "pousse--la-femme". On sait en effet que ce
phnomne rvle non seulement une identification du sujet l'objet de la jouissance de l'Autre, mais
aussi une tentative pour significantiser cette position. Les manifestations corporelles de la Jouissance
Autre, signales prcdemment, se prennent en ce cas au semblant. Pour l'inconscient freudien,
femme n'a pas de reprsentation signifiante, de sorte que l'on est conduit faire tat d'une forclusion
normale de femme. Or cet lment forclos du symbolique tend pour le psychotique faire retour
dans le rel. La femme est, selon Lacan, "un autre nom de Dieu"
76
, ce qui se conoit rapport aux
formules de la sexuation, dans lesquelles La femme ( ) et le Pre de la horde ( )
possdent en commun de se situer en des places logiques o la jouissance n'est pas rgle par l'interdit
phallique. Si La femme existait, elle serait toute, elle ne serait pas soumise au manque: l'instar du
Pre rel, elle capitaliserait la jouissance; c'est pourquoi elle tend se prsentifier chez le psychotique
vou par la carence paternelle tre un "sujet de la jouissance". La fminisation vite ce dernier de se
74
Minkowski. E. La notion de perte de contact vital avec la ralit et ses applications en psychopathologie [1926], in Au-del
du rationalisme morbide. L'Harmattan. Paris. 1997., p. 49.
75
Une femme peut se fminiser dans son dlire, c'est--dire devenir La femme-toute, non marque par la castration, elle
s'affirme alors comme "la mre unique et la vierge ternelle", "L'Etoile", "Trs haute", "la poule blanche", etc.
76
Lacan J. Le sinthome. Sminaire du 18 novembre 1975, in Ornicar? Bulletin priodique du champ freudien. Mars-Avril
1976, 6, p. 5.
28
trouver dans une position mlancolique qui se caractrise d'incarner l'objet de la jouissance de l'Autre
sans tre capable de la porter au semblant.
La forme la plus discrte du pousse--la-femme se traduit par l'apparition d'une crainte d'tre
homosexuel, ce que le sujet conoit comme une attitude passive et fminine. Il n'est pas rare que le
phnomne soit d'abord discernable dans les fantasmes masturbatoires. Le contexte clinique permet
parfois de le diffrencier de fantasmes nvrotiques. Ainsi Karim doit invariablement s'imaginer qu'il
est une femme quand il se masturbe. Il se dfend pourtant d'tre homosexuel. Il s'est bien laiss aller
quelques expriences, mais sans got et sans lendemain. Pendant un temps, souffrant de son incapacit
soutenir son dsir l'gard des femmes, il voulut "anantir sa sexualit", soit grce une intervention
au laser sur son cerveau, soit en demandant un chirurgien qu'on lui coupe le sexe. "Je ne veux pas
tre homosexuel, affirma-t-il, je veux tre asexuel". Chez d'autres le pousse--la-femme glisse vers la
transsexualisation.
Le phnomne n'est parfois discernable que dans les rves du sujet ou bien en de curieuses
visions. En celles de Zorn revenait toujours "la Grande Afflige" qu'il reconnut comme une image
mlancolique de son moi. Parfois c'est un dtail qui attire l'attention: "Pourquoi gardez-vous toujours
cette gabardine quel que soit le temps? - Parce que j'ai les hanches vases de faon effmine, je ne
veux pas que les autres s'en aperoivent".
Une femme qui n'avait jamais manifest de troubles psychotiques manifestes tua sa mre
soudain perue comme le diable dans un moment d'angoisse paroxystique. Elle attachait beaucoup
d'importance un manuscrit de plusieurs milliers de pages qu'elle rdigeait depuis de longues annes
dans lequel son identification Cloptre, reine d'Egypte tait clairement apparente.
Le signe du miroir.
L'Ecole franaise de psychiatrie a dgag dans les annes trente un important signe
prodromique de la dmence prcoce nomm par Ably "le signe du miroir". Il est aujourd'hui quelque
peu oubli et n'a gure fait l'objet d'tudes rcentes. Il ne consiste pas, comme on le croit parfois, en
une non-reconnaissance de l'image spculaire. Il est important de le distinguer d'un phnomne de
dpersonnalisation: la valeur diagnostique de ce dernier tant nulle
77
. Le signe du miroir consiste dans
le fait que le sujet s'avre si proccup par son image qu'il s'examine longuement et frquemment
devant les surfaces rflchissantes. Il peut se rencontrer en diverses pathologies, mais Delmas
78
et
Ably le discernent surtout l'occasion d'tats mlancoliques et lors d'entres dans la dmence prcoce.
Ajoutons quil nest pas rare dans la psychose ordinaire, en particulier dans ses formes mdiques.
77
Maleval J-C. La destructuration de l'image du corps dans les nvroses et les psychoses, in Folies hystriques et psychoses
dissociatives. Payot. Paris. 1981.
78
Delmas A. Le signe du miroir dans la dmence prcoce. Annales mdico-psychologiques, 1929, I, pp. 83-88.
29
Karim a attir mon attention sur ce trouble. Pendant plusieurs mois, lors de son adolescence, il
lui arriva de rester quatre cinq heures par jour devant la glace de sa chambre. Dix ans plus tard, la
cure analytique a amen une certaine sdation des troubles, mais il reste tonnamment proccup par
son image. "A la fin des cours, me confie-t-il, je me dpche d'aller au lavabo pour me regarder dans la
glace". Il ajoute avec un brin d'humour: "Je vois bien que je suis le seul comme a, sinon il y aurait
foule". Dans la rue, il faut qu'il s'observe dans les vitrines. Il a l'impression d'tre englu dans son
image. "Je suis enferm, dit-il, dans un monde o mon image est partout..." En une occasion, il lui est
arriv d'avoir dans le miroir une vision d'horreur: quelque chose d'affreux tait l, qui n'tait autre que
lui-mme. Il en perdit littralement tout appui, puisqu'il dut aussitt s'tendre sur son lit, en proie une
angoisse intense.
Deux caractres distinguent nettement ce phnomne d'un sentiment de dpersonnalisation:
d'une part, l'aspect itratif du recours au miroir, d'autre part la persvrance de la reconnaissance de
l'image. Cette dernire tend cependant s'effacer la faveur de l'volution du trouble. Il faut en effet
souligner, comme on l'a fait plus rcemment, et comme le montre Karim, que le signe du miroir
comporte souvent plusieurs stades. Nous n'en retiendrons que deux: l'observation incessante et le refus
de l'autoscopie. Colette Naud en distingue un troisime, elle le nomme stade de raction clastique, il se
caractrise par le bris du miroir. Il s'agit l'vidence d'une exacerbation du refus de l'autoscopie, de
sorte qu'il ne parat pas justifi mon sens d'en faire un stade supplmentaire. Par la suite, selon Ably,
le phnomne d'auto-observation disparat lorsque la psychose se dveloppe
79
.
Les avis divergent quant l'interprtation donner l'observation incessante. Certains sujets
indiquent qu'ils cherchent se retrouver, ou contrler quelque chose, mais il est manifeste que ces
explications ne les satisfont pas. Le trouble ne cesse de possder pour eux-mmes un caractre
nigmatique. Ils ressentent qu'un changement est intervenu, sans tre en mesure de rendre compte de ce
qu'il y a d'inaccoutum ou d'anormal. C'est en somme, selon Ably, une "rponse l'tonnement plus
ou moins inquiet que le malade prouve propos du changement survenant en lui". Lors des longues
heures quil passait devant le miroir, Jean-Pierre me confiait ne voir quune image vide. Elle lui
semblait dshabite. Cest moi, disait-il, mais jai peine ma reconnatre. Mon image manque de
sens . Cette dernire indication est prcieuse : elle tmoigne nettement que la texture symbolique du
sujet se dfait. Dans l'aprs-coup de l'avance lacanienne sur le stade du miroir, tout montre, selon F.
Sauvagnat, "que la mconnaissance constitutive de l'image du moi dans le miroir est devenue
impossible au sujet". Il se trouve brutalement confront la facticit de sa constitution
80
. En outre il
lui est devenu difficile de s'apprhender comme spar de cette image: Karim dit s'y sentir englu. Il
79
Ably P. Le signe du miroir dans les psychoses et plus spcialement dans la dmence prcoce. Annales mdico-
psychologiques, 1930, I, pp. 28-36.
80
Sauvagnat F. La double lecture du signe du miroir. Cahiers de Cliniques Psychologiques. Universit de Rennes II. 1992,
15, p. 45.
30
ajoute que dans le monde extrieur il la rencontre partout. Il est intrigu par cette image. Il lprouve
comme rassurante, mais sinquite delle, sans pouvoir expliquer pourquoi. Lautoscopie tmoigne
dune certaine inertie du sujet, car le mouvement des identifications imaginaires s'avre bloqu : le
fonctionnement "comme si" lui-mme n'est pas compatible avec cette position.
Pour que le sujet puisse ex-sister "en-dehors" de ce qu'il peroit, pour qu'il puisse se retrancher
de la ralit, il faut que l'opration de la castration soit intervenue. Quand ce n'est pas le cas, l'objet
n'tant pas ratur par le signifiant, il menace de venir faire tache dans limage. Cest ce qui se produit
quand saccentue la dfaillance de la phallicisation du moi qui semble au principe de lautoscopie, tant
par linquitude quelle implique que par leffort quelle suscite pour la compenser. Lacan nous a
appris considrer l'image spculaire, non seulement comme la matrice du moi, mais aussi comme
l'toffe de l'tre. "Ce qu'il y a sous l'habit, note-t-il dans Encore, et que nous appelons le corps, ce n'est
peut-tre que ce reste que nous appelons l'objet a"
81
, de sorte que " i(a) est l'habillement de ce reste".
Ds lors, quand le sujet se trouve englu dans une image vacillante du moi, il risque de voir son tre
transparatre dans l'image. La carence radicale de la fonction du trait unaire, qui soutient l'idal du moi,
l'expose ne plus tre en mesure de diffrencier l'endroit d'o il se voit de celui d'o il se regarde. C'est
ce que Jean-Pierre traduit par le sentiment d'tre "tomb dans le miroir". Dpressif et toxicomane, il ne
prsentait pas de signe de psychose clinique, mais il se sentait "pseudo", avait l'impression que sa tte
tait dsaxe, prouvait ses vtements comme une peau et son corps comme tranger. Il restait de
longues heures se regarder dans la glace de sa chambre. Il confia qu'il observait surtout "sa cage". En
lui demandant ce qu'il entendait par l, il prcisa "la cage" de ses yeux. Sans doute ce terme nologique
vient-il l dsigner l'objet regard qui en se prsentifiant se confond dans l'image avec l'il. Il associe en
effet sur le fait que peu avant d'tre tomb dans le miroir, il avait ralis un superbe tableau dont "il
avait crev la cage des yeux". Intuition dj que dans l'image spculaire une prsence innommable
manque manquer. Cette image n'inclut pas pour Jean-Pierre le point de ngativation partir duquel
elle se soutient quand elle donne au corps une consistance imaginaire stable. "Ce qui fait tenir l'image,
note Lacan, c'est un reste"
82
.
Quand l'objet a se prend celle-ci de manire plus accentue une horreur angoissante surgit.
C'est ce qui caractrise le deuxime stade du signe du miroir: celui du refus de l'autoscopie.
Voici cet gard les explications que donne un jeune homme de 21 ans observ par Ostancow.
"Il s'tait livr, au cours de plusieurs annes, un examen minutieux de sa figure en restant des heures
entires devant une glace.[...] Il croyait, disait-il, noter que les personnes de son entourage
remarquaient qu'il avait un aspect comique, une trs petite tte, un front troit, toute la structure d'un
poulet. Il prtendait avoir entendu dire, quand on parlait de lui, qu'il n'avait pas de nez, et, quand, rentr
81
Lacan J. Encore. Sminaire XX. Seuil. Paris. 1975, p. 12.
82
Ibid.
31
chez lui, il se regardait dans un miroir, il lui semblait en effet que son nez avait chang de forme et que
son front tait devenu trs troit. Ces sensations faisaient que le malade vitait la socit. Il lui semblait
que les passants se moquaient de lui, s'cartaient sur son passage pour ne pas le frler, se bouchaient le
nez et la bouche son approche. Il croyait aussi que quelqu'un rpandait le bruit qu'il se livrait
l'onanisme."
83
Dans cette observation, l'horreur de l'objet a envahit l'image spculaire: elle surgit par
l'entremise d'une tte de poulet et c'est bientt le sujet tout entier qui s'prouve comme un animal
ridicule, puant et masturbateur. Quelques temps plus tard ce sujet entra dans la psychose clinique et il
ne prsenta plus le signe du miroir.
Il arrive cependant qu'un phnomne semblable soit observable dans le cours d'une psychose
mlancolique. "Docteur, je vous en prie, se plaignait un patient d'Ably, dbarrassez-moi de ce martyr
(sic); malgr moi je me sens forc regarder mon visage et c'est trop pnible de voir ce que je suis
devenu; plus je m'examine, plus il me semble que j'ai une tte de canard". Ce canard-l, comme le
poulet prcdent, est une chose horrible qui surgit quand dfaille la fonction d'enveloppe de l'image
spculaire. Chez un sujet schizophrne, qui confiait viter les miroirs, limage est diffrente, mais elle
possde la mme caractristique repoussante : il se voyait livide, le teint bleu, perdant ses cheveux, une
image de cadavre.
Plutt que de voir cela certains sujets prfrent retourner les glaces ou les recouvrir d'un
morceau de tissu. Une schizophrne, rapporte Colette Naud, fut confronte par surprise au miroir
quand tomba l'charpe par laquelle elle l'avait voil. Elle se regarda avec une expression d'effroi,
poussa un cri, puis se prcipita sur un rveil-matin et le lana toute vole dans la glace qu'elle
brisa
84
. Quand la fonction d'toffe de l'tre dvolue l'image spculaire est radicalement carente,
quand l'objet a se prsentifie avec tant d'insistance, le sujet est le plus souvent entr dans la psychose
clinique.
Cependant, le phnomne peut se produire hors-dclenchement de manire temporaire. Ce dont
tmoigne Karim. Pour lui, quand l'objet s'est prsentifi, l'image spculaire s'est dissipe, de sorte qu'il
dut s'tendre sur son lit, n'tant plus en mesure de se soutenir, et s'prouvant comme laiss en plan. Il
fallut quelques heures pour qu'il puisse se relever.
Certains sujets confronts ces phnomnes angoissants parviennent dvelopper des dfenses
plus ou moins russies. Ils recourent alors l'une des mthodes les plus frquemment utilises pour
porter la jouissance disruptive au semblant: le pousse--la femme. Ce dernier est observ ds les
premires descriptions du signe du miroir. Ably rapporte l'observation d'un jeune homme de vingt et
un ans qui ne pouvait travailler qu'avec une glace ct de lui: "c'est, disait-il, pour me tenir
83
Ostancow P. Le signe du miroir dans la dmence prcoce. Annales mdico-psychologiques, 1934, II, pp. 787-790.
84
Naud C. A propos de certaines volutions rares du signe du miroir. Thse mdecine. Paris. 1962., p. 13.
32
compagnie". Dans les trains il s'enfermait dans les toilettes pour se contempler dans la glace. Il ne
pouvait pas entrer dans un salon sans se prcipiter vers la glace la plus proche. Il restait des heures dans
sa salle de bains se frotter nergiquement les joues devant son miroir: "c'est, disait-il, pour me donner
des couleurs comme les femmes". En la circonstance le pousse--la femme reste l'tat d'bauche. Il
n'en possde pas moins une grande valeur diagnostique quand il est connect l'autoscopie incessante.
Ce jeune homme deux ans plus tard tait devenu inerte, hostile et impulsif. Le signe du miroir avait
alors pratiquement disparu.
Sauvagnat note juste titre qu'il y a lieu de mettre en doute l'opinion classique selon laquelle les
troubles qui caractrisent ce signe clinique seraient plus avrs avant le dclenchement de la psychose.
Toutefois quand il se rencontre en une psychose dclare il se prsente sous des formes
caractristiques: soit sous la forme mlancolique du refus de l'autoscopie, soit sous une forme dlirante
dans laquelle le pousse--la femme apparat plus affirm. On sait que Schreber avait selon son mdecin
un "penchant se dnuder plus ou moins compltement et se regarder dans la glace attif de faveurs
et de rubans multicolores la faon des femmes"
85
Il donne lui-mme l'une des raisons qui peut
justifier en ces circonstances l'autoscopie itrative: une observation mene distraitement ne saurait
suffire convaincre de sa fminisation. "L'observateur, crit-il, devra se donner la peine de rester l au
moins dix minutes, un quart d'heure. Alors, tous pourraient remarquer le gonflement et le dgonflement
alternatif de mes seins. Evidemment, poursuit-il, le systme pileux demeure, d'ailleurs modestement
dvelopp chez moi, sur les bras et l'pigastre; les mamelons restent de petite taille, tels qu'ils le sont
couramment chez l'homme; mais part cela, je suis assez hardi pour l'affirmer, quiconque me verrait
debout devant un miroir, le haut du corps dvtu - surtout si l'illusion est soutenue par quelques
accessoires de la parure fminine -, serait convaincu d'avoir devant soi un buste fminin"
86
. La dure
de l'autoscopie prend donc l sa source dans les efforts du sujet pour parvenir conformer l'image
spculaire aux signifiants du dlire, ce dernier uvrant pour significantiser la jouissance incorpore
cette image.
Chez un schizophrne observ par Ably le pousse--la-femme associ l'autoscopie emprunte
des formes plus frustres. Il passait la plus grande partie de ses journes s'examiner. "Un matin,
rapporte le mdecin, notre visite, nous ne fmes pas peu surpris de le retrouver blotti dans un coin,
atrocement maquill, son visage tait recouvert de pltre qu'il avait arrach au mur du dortoir, ses yeux
taient bistrs avec la mine du crayon qui lui servait crire, ses lvres taient horriblement teintes de
rouge avec une substance que nous n'avons pas pu dfinir, peut-tre avec un bton qu'il avait mendi la
veille au parloir une visiteuse. Ce pierrot de carnaval n'tait nullement joyeux; il paraissait soucieux,
morose et nettement hostile. Par la suite, il crivit d'innombrables lettres des parfumeurs parisiens
85
Schreber D. P. Mmoires d'un nvropathe.[1903]. Seuil. Paris. 1975, p. 307.
86
Ibid., p. 228.
33
leur rclamant les produits de beaut les plus htroclites. Quand on lui et supprim la glace il
essayait de se regarder dans les carreaux de la fentre et dans un gobelet rempli de tisane"
87
Bien que le signe du miroir constitue apparemment un trouble de l'identit, on aura compris
quil est corrlatif dune dlocalisation de la jouissance, et dune carence de la fonction du trait unaire
porter sa marque sur l'objet a.
Le dgagement de sa logique permet de le discerner sous des formes discrtes chez des sujets
qui pourtant ne prsentent pas ce signe tel que la dcrit la psychiatrie. Un analysant de G. Dessal, qui
disait frquemment de lui je suis trs superficiel , avait depuis lenfance une propension se
regarder dans les miroirs. Il suscitait un problme de diagnostic diffrentiel, faisant hsiter entre
nvrose obsessionnelle et psychose ordinaire. Nous voyons, rapporte lanalyste, que ce monsieur a un
problme particulier avec les miroirs. Il sy regarde constamment depuis son enfance, il ressent un
profond rejet pour son image . Cela semble une contradiction, commente Jacques-Alain Miller, il ne
peut cesser de se regarder dans le miroir mais il se trouve laid et pour cela il rejette son image
88
. La
logique du signe du miroir semble clairer cette contradiction : la prsence latente de lobjet dans
limage tare celle-ci, cependant, malgr sa dfaillance, elle permet encore de masquer la dchance de
ltre, do limportance de la soutenir par la vision. Bien entendu, il est ncessaire que dautres
lments viennent confirmer lhypothse diagnostique, comme ce fut le cas, car le sentiment de laideur
pourrait tre en relation avec le complexe de castration, et ressortir de la clinique de la nvrose. Outre
la prsence de phnomnes accentus de transitivisme, ce mme sujet, sous leffet de la consommation
de substances hallucinognes, se regardant dans un miroir, avait cru se voir avec une poitrine de
femme, rvlant de nouveau la possible association, dj aperu par Ably, entre le pousse--la-femme
et le signe du miroir.
Ce dernier tmoigne d'une fragilit des assises du sujet, de sorte qu'il annonce souvent le
dclenchement de la psychose. L'mergence d'une jouissance hors-limite ou les bauches de pousse--
la-femme sont les indices de semblables preuves subjectives; elles semblent cependant moins
frquemment annonciatrices d'un marasme psychologique.
Dfaillances discrtes du capitonnage.
Certains sujets de structure psychotique ne s'avrent gure proccups par leur image, en
revanche ils se plaignent de troubles de la pense et du langage. La plupart de ceux-ci tmoignent de
87
Ably P., o.c., p. 30.
88
Miller J-A. Je suis trs superficiel. Cahier. Association de la Cause freudienne Val de Loire & Bretagne. 2000, 14, p. 12.
34
discrtes ruptures de la chane signifiante qui impliquent ratages dans le nouage du symbolique aux
autres dimensions.
Dans la parole chacun des termes est anticip dans la construction des autres, il faut qu'un
bouclage rtroactif intervienne pour qu'une signification se dpose, celle-ci, souligne Lacan, est
toujours phallique, en tant qu'elle rsulte d'un choix opr par le sujet partir du signifiant qui localise
sa jouissance. Quand il se rvle que la fonction phallique est dfaillante, la tension anticipatrice
devient lche, et le bouclage rtroactif s'avre difficile produire. C'est ce qu'prouve Artaud, sans
doute ds l'ge de dix-neuf ans, en tout cas longtemps avant le dclenchement de sa psychose en 1937.
Il dcrit fort bien le phnomne dans une lettre George Souli de Morant crite en 1932: "Dans cet
tat, confie-t-il, o tout effort d'esprit, tant dpouill de son automatisme spontan est pnible, aucune
phrase ne nat complte et toute arme; - toujours vers la fin, un mot, le mot essentiel, manque, alors
que commenant la prononcer, la dire, j'avais la sensation qu'elle tait parfaite et aboutie.[...] et
lorsque le mot prcis ne vient pas, qui pourtant avait t pens, au bout de la phrase commence, c'est
ainsi que ma dure interne se vide et flchit, par un mcanisme analogue pour le mot manquant, celui
qui a command le vide gnral et central de toute ma personnalit"
89
. Il rapporte cette "fragmentation
de sa pense" au "manque d'une certaine vue synthtique"
90
. Huit ans plus tt, dans sa
"Correspondance avec Jacques Rivire", il faisait dj tat du mme trouble: "Il y a donc, affirmait-il,
un quelque chose qui dtruit ma pense, un quelque chose qui ne m'empche pas d'tre ce que je
pourrais tre, mais qui me laisse, si je puis dire, en suspens. Un quelque chose de furtif qui m'enlve les
mots que j'ai trouvs, qui diminue ma tension mentale, qui dtruit au fur et mesure dans sa substance
la masse de ma pense, qui m'enlve jusqu' la mmoire des tours par lesquels on s'exprime et qui
traduisent avec exactitude les modulations les plus insparables, les plus localises, les plus existantes
de la pense"
91
. Artaud souligne que les lments qui dfaillent sont prcisment ceux qui seraient les
plus appropris pour le reprsenter dans sa singularit. Surgit alors une question: comment parvient-il
ds cette poque dvelopper malgr tout une uvre originale? Il semble indiquer que c'est, non
partir d'intuitions personnelles, mais en pensant contre les penses des autres: la "prsence de
quelqu'un", affirme-t-il George Souli de Morant, lui est ncessaire pour penser, "ma pense, prcise-
t-il, s'accroche ce qui vit et ragit en fonction des ides qu'il met, elle ne comble pas le vide [...] Seul
je m'ennuie mortellement, mais en gnral je me trouve dans un tat pire que l'ennui, extrieur toute
pense possible. Je ne suis nulle part, et tout ce qui me reprsente s'vanouit [...] C'est vous dire si par
moments je tombe bas. Le nant et le vide, voil ce qui me reprsente..." Pour qui ne dispose pas de la
fonction phallique, Artaud indique ici qu'il reste la ressource de s'appuyer sur des significations portes
par la prsence des autres. Cette notation est importante pour comprendre ce qui est au principe du
fonctionnement "comme si" et plus gnralement des stabilisations fondes sur des repres
imaginaires: si la prsence physique de l'autre est importante, c'est, semble-t-il, parce qu'elle donne au
89
Artaud A. Oeuvres compltes. Gallimard. Paris. 1976, I**, pp. 202-203.
90
Ibid., p. 194.
91
Artaud A. Oeuvres compltes. Gallimard. Paris. 1984, I*, p. 28.
35
sujet de structure psychotique un accs la connexion qui lui fait dfaut, celle de la jouissance et de la
parole. Que celle-ci soit porte par un corps qui l'anime lui confre un poids et une consistance
enviable pour qui ne dispose pas du signifiant phallique propre assurer la copulation de l'tre et du
langage: "Entendant parler des gens, note Artaud, j'en arrive tre tonn de la multiplicit des aspects
qui demeurent vivants en eux, des aperus qu'ils sont capables d'mettre sur les ides et sur la vie".
L'image de l'autre semble lui permettre un cadrage de l'objet a.
Frdric, un jeune homme dpressif, qui souffrait de troubles semblables, confiait qu'il ne
pouvait plus s'arrter quand il partait dans une conversation, parce qu'il prouvait une sensation
d'inachvement qui le portait chercher un point d'arrt toujours fuyant, et parce qu'il avait
l'impression que ses paroles ne parvenaient pas exprimer des penses vraiment personnelles. Il se
plaignait d'un manque d'ides matresses pour se diriger, ce qui ne lui permettait pas de s'lever au-del
des dtails dans lesquels il se sentait contraint perdre sa pense. Le dpart de sa femme avait
beaucoup accentu ce phnomne auparavant discret.
Le mme trouble se discerne sous une forme diffrente chez une jeune femme qui fit une
demande d'analyse pour la raison majeure qu'elle parlait trop. Ce n'est pas qu'elle craignait de trahir ses
penses ni qu'elle s'inquitait de la manire dont ses propos tait reus. En fait, disait-elle, sa parole
l'abrutissait, comme le bruit de la ville, comme le bavardage des autres femmes: tout cela tait vide.
Elle se plaignait par surcrot de parler trop vite, de sorte que parfois elle prononait les mots l'envers
ou elle intervertissait les lettres. Par exemple elle aurait dit "aminaux" au lieu d'animaux. Elle avait le
sentiment de trbucher sur les mots : persvrer, je narrive pas le prononcer, je dis souvent
pervers-serrer . C'est gnant , commentait-elle avec un sourire trange et dtach. Du fait de la
carence du signifiant phallique le symbolique lui parat tre dans une sorte d'tat de flottement
perptuel, la clture de la signification n'advient qu'avec difficult, des lments parasites s'insrent
trop aisment dans la chane. Elle peroit chacun son image de sorte qu'elle craint "un risque de
confusion des langues" pour son bb si elle l'emmne en vacances l'tranger. Elle-mme donne une
remarquable impression d'inconsistance corrle au peu de poids de ses propos: "a m'est difficile de
parler, dit-elle, parce que je ressens chaque mot comme une perte; en mme temps, je parle tout le
temps, mais tout ce que je dis est vide". Parfois elle prouve des difficults avec la mtaphore : quand
on me dit change de disque je ne sais pas comment je dois lentendre : il y a plusieurs sens, jai peur de
ne pas choisir le vrai . Elle fait des mots croiss pour stabiliser sa cervelle .
Quand la pense se fissure de manire plus accentue encore, l'absence de la rfrence dans le
champ du langage se rvle. Lors des entretiens prliminaires, Karim me confia que la cause de sa
difficult vivre devait rsider selon lui, dans un acte perptr par son arrire grand-pre, en Afrique
36
du Nord, dont il porterait encore le poids de culpabilit. Quel fut cet acte? Il ne le savait pas, et cela le
proccupait. Avait-il tu sa femme, sa mre, ou mme son propre pre? Avait-il vol? Avait-il
assassin un homme d'un autre clan? Ses hypothses reposant sur quelques indices plus ou moins
plausibles taient multiples, or malgr ses recherches auprs de sa famille il ne parvenait pas
conclure. Peu peu le problme perdit son acuit. Deux ans plus tard, la faveur de la cure, l'nigme
s'tait dplace, Karim, sujet fort intelligent, cernait avec finesse que son tourment portait sur la bance
du symbolique. "Je suis fascin par le pourquoi, me dit-il, c'est la raison pour laquelle je n'adhre
aucune rponse. Je suis construit 80% autour d'un pourquoi. a j'en suis sr. Quand on reste comme
moi dans une relation fusionnelle avec la mre, il n'y a pas de pourquoi; le premier pourquoi c'est peut-
tre le pre, pourquoi est-il l? Mais le principal pourquoi c'est: qu'est-ce que la vie? Je demandais
souvent autour de moi, on me rpondait par un comment: c'est fait pour... En fait il n'y a pas de rponse
au pourquoi, alors j'en ai marre". Il n'est pas en mesure de trouver appui sur une rponse porte par une
jouissance phallicise. Or il faut que celle-ci soit en mesure de lester le montage du fantasme pour
qu'elle fasse obstacle ce que des questions se multiplient et s'imposent avec une insistance
angoissante.
Quand le signifiant propre rguler la jouissance est carent, le fantasme n'est pas en mesure
d'assurer solidement sa fonction de protection contre la jouissance maligne de l'Autre. "Au moment, se
plaint Artaud Jacques Rivire, o l'me s'apprte organiser ses richesses, ses dcouvertes, cette
rvlation, cette inconsistante minute o la chose est sur le point d'maner, une volont suprieure et
mchante attaque l'me comme un vitriol, attaque la masse mot-et-image, attaque la masse du
sentiment, et me laisse, moi, pantelant comme la porte mme de la vie"
92
Que la chane signifiante puisse se briser, se relcher, perdre sa consistance chez des sujets de
structure psychotique, en l'absence de troubles majeurs, nous en trouvons l'indice en certaines
intrusions fugitives de mots parasites dans la pense, ainsi qu'en de discrtes mergences de vocables
nologiques dans la parole. Richard, un jeune homme d'origine anglaise, qui se plaignait de
"symptmes psychosomatiques", introduit la logique du phnomne. Il me fait part qu'il se trouve
parfois gn d'entendre des mots, le plus souvent obscnes, issus de sa langue maternelle, se faufiler
dans des syllabes franaises. Cela se produit parfois mme au sein de sa langue d'adoption. "Dans 'o
tu habites?', je perois 'o ta bite?', dans 'laitue', 'l'es-tu?', etc." On discerne en ces exemples, les
premiers qui lui viennent, dans l'un une allusion la jouissance, dans le second une rfrence l'tre,
par quoi s'indique un trop de prsence de l'objet a, ce que confirme Richard quand il note la propension
l'obscnit des signifiants parasites. Quand un signifiant se dconnecte de la chane il met en
vidence la dimension de la lettre
93
et sa fonction inconsciente d'accueil de la jouissance. La
92
Artaud A. Lettre Jacques Rivire du 6 juin 1924, in Oeuvres compltes. Gallimard . Paris. 1984, I*, p.42.
93
Le signifiant est un lment symbolique qui ne possde de valeur que diffrentielle: il ne se conoit que coupl un autre;
en revanche, la lettre est un objet rel, isolable, dont tmoigne la casse du typographe, de sorte que Lacan la dfinit comme
"la structure essentiellement localise du signifiant" (Lacan J. Ecrits, o. c., p. 501).
37
forclusion du Nom-du-Pre implique un relchement de la consistance de la chane qui fait du
psychotique un sujet particulirement attir par la jouissance de la lettre. L'on ne s'tonnera pas que
Richard affirme avoir une "jouissance" des mots compliqus, qu'il soit passionn par les mots croiss,
le scrabble, l'mission tlvise les chiffres et les lettres, enfin qu'il aime les anagrammes
94
, les
contreptries
95
et les palindromes
96
. Dans l'attrait pour ces exercices se manifeste une tentative de
matrise des lettres disruptives et de la jouissance inquitante portes par elles. L'exemple de Richard
n'est pas cet gard anecdotique: un got pour les jeux de la lettre a t maintes fois constat chez des
sujets de structure psychotique.
Arielle tait une bonne lve quand elle tait en classe de seconde, cependant elle perdait
beaucoup de points dans ses notes de dissertation parce qu'elle inventait des mots sans le savoir. Il
s'agissait de mots qui avaient du sens, prcise-t-elle, des mots fonds sur la racine, sur l'tymologie, "je
cherchais par leur intermdiaire tre exacte, prcise, et dpasser les limites". "J'aimais les mots,
ajoute-t-elle, d'ailleurs cette poque j'avais un cahier o je notais quand la langue fourche. Je me
souviens de l'un d'eux. Ma cousine voulait me dire: "dpche-toi de faire du gruyre rp", dans sa
prcipitation elle a dit :"fais du grouillard". Je notais soigneusement de telles expressions sur mon
cahier et ensuite je les dcomposais. Aujourd'hui, cela m'a pass. Je ne suis plus la recherche du mot
exact". Cependant, Arielle s'avre maintenant fascine par l'criture: elle s'tonne elle-mme de
l'exceptionnel attrait exerc sur elle par la lettre." Je pourrais recopier toute une journe, dit-elle, mais
cela m'inquite, car je pourrais recopier n'importe quoi, mme des btises, par moments le sens n'a plus
d'importance".
Une analysante de M-H Brousse, une femme traductrice, qui se plaint d'alcoolisme, tmoigne
d'un semblable attrait pour la lettre, associ chez elle des activits d'criture qui possdent une
fonction de supplance plus manifeste que les jeux de Richard. "Les mots dans leur matrialit
l'enchantent, rapporte-t-elle. Elle aime leur forme lorsqu'elle crit". Ds quinze ans l'criture, lie sa
facilit pour les langues trangres, devint une jouissance quotidienne. "Elle est intarissable, nous dit-
on, sur la qualit de la plume de son stylo, le rapport avec le papier, comme sur la musique des mots...
Du journal intime la posie, en passant par la nouvelle, ce n'est que lorsqu'elle crit que [la] division
de sa pense s'arrte[...] Il semble trs probable qu'crire et traduire sont pour elle deux faces d'une
mme supplance: celle d'un rapport la langue comme telle, sous les aspects de la multiplicit des
langues qui soutient une identification imaginaire au pre." La patiente rattachait en effet son got et sa
facilit pour les langues son pre, prtre dfroqu, parlant lui-mme de nombreuses langues. Il est
intressant de noter une nouvelle fois que certaines particularits taient prsentes trs tt permettant
94
Une anagramme est un mot obtenu par transposition des lettres d'un autre mot, par exemple de "Marie" en "Aimer".
95
Une contreptrie est une interversion de lettres ou de syllabes d'un ensemble de mots spcialement choisis, afin d'en
obtenir d'autres dont l'assemblage ait galement un sens, le plus souvent grivois. L'on doit Rabelais celle-ci: Femme folle
la messe - femme molle de la fesse.
96
Le palindrome est un groupe de mots qui peut tre lu indiffremment de gauche droite ou de droite gauche en
conservant le mme sens, tel que "lu par cette crapule".
38
de discerner la structure psychotique bien avant l'ge adulte. Ds l'enfance, elle avait invent une
langue, le "jibi", avec ses rgles, comprise par sa mre, et que d'autres ont pu saisir. Dans celle-ci, tous
les verbes se terminent par "". Elle donne trois exemples: "Ji mang l"= mange! ; - Ji tais= tais-toi! ;
Fout= va te faire foutre!". "Il s'agit d'une langue fondamentale, commente M-H Brousse, mais qu'elle
n'est pas la seule parler, et qui est traductible. Pourtant, la structure de cette langue prsente deux
caractristiques remarquables: elle ne comporte pas de troisime personne ("il n'y a pas de pronoms"),
et le je et le tu sont indiffrencis - ce qui nous renvoie la confusion de l'axe a-a' non rgl par le
Nom-du-Pre en A. Manque aussi le temps des verbes. Le signifiant produit une rduction la pure
relation imaginaire, comme c'est le cas dans les phrases interrompues de Schreber o le signifiant
tombe dans le champ exclu de l'Autre. La forme imprative prise par ces noncs indique une relation
imaginaire qui surgit lorsque, dans l'Autre, est invoqu par ce registre du tu, un signifiant primordial
exclu pour le sujet. Par ailleurs, de mme que la langue fondamentale de Schreber tait parle par
Schreber et par un Dieu que Lacan met du ct maternel, un Dieu occupant la place du laiss tomber,
de mme cette langue parle par la patiente et sa mre pointe l'exclusion de l'"Autre de la loi"
97
Qu'un
enfant invente une langue plus ou moins labore n'est certes pas en soi une caractristique de la
structure psychotique ; mais toutes ne se structurent pas comme le jibi sur une rduction de la
relation lautre laxe spculaire.
Il est frquent qu'une irruption de la lettre soit discernable chez des sujets psychotiques ds les
entretiens prliminaires. Une jeune femme me rapporta avoir vu dans la rue, aprs une dispute avec ses
parents, une voiture portant la marque commerciale "A.B. Dick", elle en tira la conclusion que ses
parents voulaient qu'elle abdique. Une autre supposait tre aime par son professeur depuis une dicte
intitule 'les semailles": elle pensait qu'il s'adressait elle quand il prononait "ils sment".
Des nologismes smantiques plus ou moins discrets sont encore notables. "Croyez-vous que
c'est pnitenciaire?" me demanda une patiente, faisant ainsi allusion des perscutions sur lesquelles
elle s'interrogeait. Il tait discernable dans le contexte qu'elle entendait par "pnitenciaire": "visant la
punir", mais, en dpit de ma demande, elle n'prouvait pas la ncessit de le prciser, le mot semblait
porter pour elle un caractre d'vidence extrme.
Stevens dcrit des phnomnes apparents en les nommant "msusage du signifiant". Une
patiente lui explique que ses surs ont coup tout lien avec ses parents, mais qu'elle a opr avec eux
un coup radical. Il lui demande de prciser, et elle rpond que dans les deux cas, "cela a produit une
sparation d'avec les parents mais que pour elle c'tait autre chose - c'est pourquoi elle dit un "coup".
Elle admet que cela ne convient pas, mais c'est tout de mme le mot qu'il faut utiliser. "Plus
brivement, continue Stevens, relevons d'autres exemples: "Je n'tais pas suffisamment normative" la
place de normale. "Je me rvolutionnais" la place de je me rvoltais. De mme, elle fait un usage
97
Brousse M-H. Question de supplance. Ornicar? Bulletin priodique du champ freudien, Oct-Dc. 1988, 47, pp. 70-71.
39
particulier, trs singulier mme, de certains proverbes, qu'elle dforme dans des situations qui mettent
en jeu une dimension subjective. Ainsi: "Avec ma sur, je suis couteau coup" au lieu de couteau
tir, ou encore: "Je lui dis mes quatre vrits" pour ses quatre vrits"
98
. Ces exemples sont relevs
dans un nombre important de sances, mais restent peu frquents. La difficult prouve par le sujet
pour rompre l'inertie de la lettre en rintroduisant ces msusages du signifiant dans les connections de
la chane semble assez caractristique des phnomnes. Ils restent cependant d'interprtation difficile,
et il serait imprudent de conclure la structure psychotique du seul fait de leur manifestation fugitive.
En revanche quand ils insistent ils constituent un signe clinique assez directement rfrable ce que
Stevens nomme une ptrification du sujet sous un signifiant..
Troubles de l'identit et prvalence des identifications imaginaires.
Les psychanalystes qui cherchent apprhender la psychose par une faiblesse accentue de
lego accordent une importance particulire aux troubles de limage du corps. Dans cette perspective le
moindre phnomne de dpersonnalisation devient un indice de psychose ; tandis que toute psychose
implique morcellement de la reprsentation du corps propre. Un travail antrieur mavait conduit
rappeler quil nen est rien
99
. Cependant, il est frquent que le sujet psychotique se plaigne dun
manque dassise de son identit ; tandis que le laisser-tomber du corps, mentionn plus haut, tmoigne
que llment imaginaire peut se dfaire de ses connexions. Il semble quun effet majeur de la perte des
assises du moi soit une propension de celui-ci se laisser capter par dautres images spculaires; do
lassociation souvent note entre les troubles de lidentit et la prvalence des identifications
imaginaires.
Bien plus que la dpersonnalisation, ce sont les phnomnes de transitivisme, situs sur laxe a-
a, qui, chez beaucoup de psychotiques, savrent au centre de la clinique des dfaillances et des efforts
de compensation du moi.
Lors dun stage effectu avec un tudiant de sa promotion, Norbert se plaint dtre comme
une ponge : il saperoit quil imite les gestes et les paroles de son camarade. Lui qui sprouve sans
personnalit, ni modle, constate quil pense en sentendant adopter les intonations de lautre. Il note
que ce nest pas la premire fois que cela lui arrive. Le phnomne lui est pnible. Un sujet mentionn
plus haut, qui se ressent trs superficiel , relate une exprience trs semblable. Dans une
discothque, par exemple, rapporte G. Dessal, il observe une femme et soudain se rend compte quil
imite involontairement ses mouvements corporels, y compris les mouvements de la bouche, semblant
98
Stevens A. Aux limites de la psychose. Ornicar? Bulletin priodique du champ freudien, Oct-Dc. 1988, 47, p. 77.
99
Maleval J-C. La dstructuration de limage du corps dans la nvrose et la psychose, in Folies hystriques et psychoses
dissociatives. Payot. Paris. 1981.
40
rpter ce que la femme est en train de dire ce moment. Cela ne lui arrive quune fraction de seconde,
parce quaussitt il se sent horrifi par ce qui arrive et sarrte immdiatement . En ce qui concerne le
sentiment dtre superficiel dont ce sujet fait tat, JacquesAlain Miller considre quil tmoigne dun
glissement sur la surface imaginaire, sur la pure captation de limage . Son identit sexuelle
inconsciente est marque dincertitude : devant une femme, il se sent capt par une image fminine,
devant un homme surgit la peur homosexuelle. Finalement, ajoute Jacques-Alain Miller, il na pas
une identit fixe parce quil y a quelque chose chez lui qui change en fonction du visage quil a devant
lui. Il dfinit son transitivisme subi en termes de tre superficiel [] Son transitivisme est quelque
chose de trs pur, de trs lmentaire, et il ny a pas de construction dlirante autour
100
. Des formes
plus complexes et plus spectaculaires peuvent sobserver. Ainsi, par exemple, une jeune femme en
analyse, Chlo, tmoigne prouver un phnomne quelle juge surnaturel : chaque fois quelle sort
dans la rue aprs avoir eu des relations sexuelles satisfaisantes avec son partenaire, les visages des
passants quelle regarde viennent se coller au sien et sy substituer, lui drobant son identit. [] Le
masque qui vient se coller sur son visage, commente G. Morel, est littralement dcoup sur limage de
lautre laquelle le sujet sidentifie en miroir [] Les fonctions du corps et de ses organes ne sont
cependant pas altres comme souvent dans la schizophrnie (Chlo nest pas, par exemple, touffe
par ce masque volant). Au moment o la jouissance se prsentifie, le sujet subit une double perte
didentit : elle ne sait plus qui elle est et doit se rpter elle-mme son propre nom
101
A un degr plus accentu, quand la psychose se dclenche, limage du corps peut nettement se
dconnecter de ses attaches symboliques, pour donner naissance des phnomnes qui ont t dcrits,
par la psychiatrie classique, sous les termes de syndrome de Fregoli, dillusions de sosies ou dillusions
dintermtamorphose. Dans le premier un nom simpose qui diffuse en de multiples images ; dans le
second des images sapparentent en se coupant de leur nom ; dans le dernier des images
sinterpntrent
102
.
Pour parer la dfaillance du fantasme fondamental, qui risque de laisser le sujet psychotique
sans orientation dans l'existence, Lacan indique que la solution initiale se trouve recherche par
quelque identification permettant d'assumer le dsir de la mre
103
. Il semble que cette identification
puisse tre relaye par d'autres qui prsentent une caractristique semblable: celle de fonctionner par
branchement, tantt sur les idaux d'un proche, tantt sur ceux d'un personnage lu. De telles
identifications imaginaires s'avrent souvent d'une grande labilit et de peu de consistance. Le sujet
l'exprime parfois lui-mme trs nettement: "je ne ressens pas qui je suis, me confiait l'un d'eux, j'ai d
l'apprendre par la psychologie et la psychanalyse, mais c'est un processus artificiel, purement mental.
100
Miller J-A. Je suis trs superficiel, in Cahier, o.c., p.18.
101
Morel G. Ambiguts sexuelles. Sexuation et psychose. Anthropos. 2000, p. 249.
102
On consultera avec profit sur ce sujet : Thibierge S. Pathologie de limage du corps. Etude des troubles de la
reconnaissance et de la nomination en psychopathologie. PUF. Paris. 1999.
103
Lacan J. D'une question prliminaire tout traitement possible de la psychose, in Ecrits, o.c., p. 565.
41
Je ne suis plus d'extrme-droite, mais je continue me cacher derrire des images de virilit". Les
identifications imaginaires non soutenues par le trait unaire constituent un signe clinique de premire
importance, car elles rpondent aux deux donnes exiges pour le discernement de la psychose
ordinaire : elles tmoignent et d'une faille subjective et de la compensation de celle-ci.
Alors mme que Schreber avoue dans ses "Mmoires" avoir consenti sa fminisation, il
affirme avoir conserv entirement l'ancien amour pour sa femme
104
. Indication prcieuse, note
Lacan, elle atteste que "la relation l'autre en tant qu' son semblable, et mme une relation aussi
leve que celle de l'amiti au sens o Aristote en fait l'essence du lien conjugal, sont parfaitement
compatibles avec le dsaxement de la relation au grand Autre"
105
. Il apparat donc que, mme dans la
psychose dclare, la dimension imaginaire possde pour le psychotique une autonomie. Cette
proprit semble au fondement de stabilisations parmi les plus frquentes.
A cet gard Lacan note en 1956 l'intrt de la mise en valeur du fonctionnement "comme si"
dans les antcdents du psychos. Il signale que ce sont les travaux d'Hlne Deutsch qui ont dgag ce
"mcanisme de compensation imaginaire" auquel ont recours des sujets qui "n'entrent jamais dans le
jeu des signifiants, sinon par une sorte d'imitation extrieure"
106
. Il est curieux de constater l'oubli
dans lequel ces indications ont longtemps t tenues. Les vocabulaires de la psychanalyse ignorent le
concept, les manuels de psychiatrie lui accordent au mieux quelques lignes. Les tudes d'orientation
lacanienne restent extrmement rares. En revanche, la notion de "personnalit comme si" trouve crdit
dans les travaux des psychanalystes qui se rfrent la psychologie du moi et qui tentent d'objectiver la
catgorie des "borderlines". Ce n'est que dans ce champ et dans cette perspective qu'on lui accorde une
place digne d'en faire un thme de congrs. Ainsi, en prsence d'Hlne Deutsch, l'Association
Amricaine de psychiatrie se runit en dcembre 1965 pour traiter des "Aspects thoriques et cliniques
des caractres "comme si". La focalisation sur les fonctions du moi y incite certains donner une si
large extension la notion que sa spcificit se perd en dcrivant des symptmes "comme si", des
mcanismes "comme si", des traits de caractres "comme si", des pseudo tats "comme si", etc. La
plupart des analystes estiment que le sens de la ralit est prserv chez les patients d'Hlne Deutsch,
suffisamment pour ne pas les confondre avec des psychotiques, toutefois, note le rapporteur, une tude
plus serre confirmerait probablement l'opinion de Phyllis Greenacre selon laquelle le sens de la ralit
s'avre dfaillant dans le caractre "comme si". Quand le fonctionnement psychotique se discerne
essentiellement l'aide d'un critre de ralit, la fois grossier et incertain, quand la psychose ordinaire
n'est pas conceptualisable, la catgorie fourre-tout des borderlines se trouve la bienvenue pour faire
place un peu de psychose sans psychose. Cependant, les six principales caractristiques des "tats
narcissiques" dgags par Hlne Deutsch, telles qu'on les rsume en 1965, s'avrent pour la plupart
constituer des traits partags par les psychotiques: a) stade primitif de la relation objectale sans
104
Schreber D.P. Mmoires d'un nvropathe, o.c., p. 152.
105
Lacan J. D'une question prliminaire tout traitement possible de la psychose, in Ecrits, o.c., p. 574.
106
Lacan J. Les psychoses, o.c., p. 218 et 285.
42
instauration de la constance de l'objet; b) dveloppement pauvre du surmoi avec persistance de la
prdominance de l'angoisse l'gard de l'objet; c) prvalence du processus de l'identification primaire;
d) manque du sens de l'identit; e) superficialit motionnelle et pauvret gnrale de l'affect, ce dont
ces patients n'ont pas conscience; et f) manque d'insight
107
. Leurs troubles s'apparentent certes la
dpersonnalisation, mais ils en diffrent car ils ne sont pas perus comme pathologiques par le patient
lui-mme.
Quand Hlne Deutsch introduit en 1934 le concept de personnalit "comme si", la notion de
borderline n'est pas encore forge, aussi souligne-t-elle alors, ds le titre de l'article, "leurs rapports
avec la schizophrnie"
108
.Les sujets prsents dans son travail se caractrisent de donner une
impression de complte normalit qui s'avre ne reposer que sur des capacits d'imitation hors du
commun. "S'attachant avec une trs grande aisance aux groupes sociaux, thiques et religieux, crit-
elle, ils recherchent, en adhrant un groupe, donner contenu et ralit leur vide intrieur et
tablir la validit de leur existence au moyen d'une identification"
109
. Elle constate que ses patients
schizophrnes lui ont donn l'impression que le processus schizophrnique passe par une phase
"comme si" avant de construire "la forme hallucinatoire". Elle note finement chez eux "une perte relle
de l'investissement d'objet", qui suggre une carence du fantasme fondamental, et une absence
d'introjection de l'autorit, qui traduit sans doute une certaine approche de la forclusion du Nom-du-
Pre. Ce ne serait que par identification des objets extrieurs qu'ils obtiendraient un prcaire accs
la Loi. Il suffit en effet que des identifications nouvelles les orientent vers des "actes asociaux ou
criminels" pour qu'ils deviennent dlinquants. Leurs relations sociales apparemment appropries
semblent fondes sur un processus purement imitatif. Ils prsentent, crit-elle, "une attitude totalement
passive l'gard du milieu environnant, avec une vivacit trs plastique relever les signaux dans le
monde extrieur et se modeler et modeler son comportement en consquence. L'identification avec
ce que les autres pensent et sentent est l'expression de cette plasticit passive et l'individu est capable
de la plus grande fidlit et de la plus vile perfidie. N'importe quel objet fera l'affaire comme pont vers
l'identification"
110
. H. Deutsch rapporte encore la carence de l'assomption de l'autorit la frquence
des conduites perverses chez les patients "comme si". Leur fonctionnement gnre parfois des
perversions transitoires qui sont abandonnes ds que "quelque personnage conventionnel" vient
proposer une nouvelle identification. De telles pratiques sexuelles, erratiques, plus subies que
recherches, lies au hasard des rencontres, n'voquent en rien le sujet pervers. Celui-ci se spcifie
d'tre dans un rapport de certitude l'gard de sa jouissance, sans commune mesure avec le flottement
propre au "comme si".
107
Weiss J. Clinical and theoritical aspects of "as if" characters. Journal of the american psychoanalytic association, 1966,
14, 3, p. 569.
108
Deutsch H. Divers troubles affectifs et leurs rapports avec la schizophrnie [1942], in La psychanalyse des nvroses.
Payot. Paris. 1963.
109
Ibid., p. 226.
110
Ibid., p. 225.
43
Parmi les exemples cliniques donns par H. Deutsch, elle cite une femme marie, ge de trente
ans, issue d'une famille o il y avait de nombreux psychotiques, qui se plaignait d'un manque
d'motions. "Malgr, crit-elle, une bonne intelligence et une preuve de la ralit parfaite, elle menait
une existence factice et elle tait toujours ce que le milieu environnant lui suggrait d'tre. Il apparut
clairement qu'elle ne pouvait rien ressentir d'autre qu'une facilit passive se diviser en un nombre
sans fin d'identifications. Cet tat s'tait instaur sous une forme aigu la suite d'une opration
pratique dans l'enfance, sans prparation psychologique. Au rveil de l'anesthsie, elle demanda si elle
tait bien elle-mme, puis dveloppa un tat de dpersonnalisation qui dura une anne et se transforma
en une suggestibilit qui cachait une angoisse paralysante".
Cette dernire patiente, selon H. Deutsch, ne prsente pas le syndrome comme si dans sa forme
la plus caractristique, sans doute en raison de l'pisode de dpersonnalisation. En fait, si l'on s'en tient
sa description princeps, il s'agit d'une pathologie quasiment introuvable dans sa forme pure. En 1965,
elle n'hsite pas affirmer: "Dans ma vie professionnelle depuis 1932, c'est--dire en trente-trois ans, je
n'ai rencontr qu'une seule personne que je puisse considrer du type "comme si"
111
. Sans doute s'agit-
il de sa patiente "aristocratique", qui constitue la premire observation de son article, "compltement
fixe dans l'tat comme si ds l'ge de huit ans", et qui oublia totalement plus tard son analyste, qui
avait pourtant t l'un de ses objets d'identification
112
. Ds lors chacun s'accorde noter que le
syndrome "comme si" constitue un trouble extrmement rare.
Il est en outre parfois mconnu. Un auteur lacanien qui en dcrit une remarquable observation,
peut-tre plus caractristique encore que celles prsentes par H. Deutsch, la range sous la notion de
"psychotique hors-crise", assurment beaucoup plus large.
Il s'agit d'un patient nord-amricain d'une trentaine d'annes qui fit un an d'analyse avec C.
Calligaris Paris dans les annes 80. Militaire combattant au Vietnam, il y fut dcor, et quitta
normalement le service la fin de sa priode, "il dcida de rentrer aux Etats-Unis de la faon la plus
intressante pour lui - bien que "intressant" ne soit pas un terme qui fisse partie de son vocabulaire, il
faut le noter. Quand il vint en analyse chez moi, crit Calligaris, il n'tait que sur le chemin du retour,
mais n'tait pas encore rentr aux Etats-Unis: il avait travers la Birmanie et l'Inde o il avait sjourn
longtemps, en se familiarisant avec les drogues, et finalement tait arriv en Europe o il rencontra une
femme qu'il pousa. Cette femme tait l'hritire d'une importante entreprise franaise. Il resta auprs
d'elle, en France, participant la direction administrative de cette entreprise.
Le symptme qui amenait sa femme l'envoyer en analyse tait le suivant: mari avec elle, sans
enfants, il tait l'amant de sa belle-mre, ce qui, apparemment, constituait un problme pour sa femme,
111
Weiss J, o. c., p. 581.
112
Ibid., p. 582.
44
peut-tre aussi pour la belle-mre, je ne sais pas, mais en tout cas pas pour lui. Toutefois, il vint et il
resta en analyse pendant un an. La difficult, c'est qu'il n'avait pas la moindre ide de ce pour quoi il
venait. [...]
L'histoire s'est termine ainsi: pendant un certain temps, je suis rest sans nouvelles de lui - il ne
venait plus et je ne savais pas pourquoi - puis, un jour, j'ai appris qu'il tait all dans un bar, un bar
quelconque o des gangsters, qui, apparemment, prparaient un coup, trouvrent, je ne sais comment,
qu'il avait la tte de l'emploi et lui proposrent de se joindre eux; il accepta. Le coup tourna mal, un
bandit fut tu et lui fut arrt [...]
Ce qui tait extraordinaire chez cette personne, commente Calligaris, c'est qu'il tait disponible
pour n'importe quoi. Non pas par docilit, au sens o il aurait t facilement manipulable, mais au sens
o n'importe quelle route, ou direction, pouvait lui paratre possible.
C'est ce qui se vrifie dans la fin de son histoire mais aussi au dbut de son aventure franaise,
par exemple. Avoir t au Vietnam, avec une histoire lourde de combattant de terrain, puis hippy en
Inde, avant de s'insrer dans la meilleure bourgeoisie franaise, il avait fait tout cela parfaitement [...]
De ce point de vue, la fin de l'histoire est significative. Il accepta - et pourquoi, diable, accepta-
t-il?- de prendre part l'attaque d'une banque, lui qui n'avait jamais commis d'acte criminel. La vrit
est qu'il accepta parce que: "pourquoi pas?"
Il est intressant de noter aussi que, dans le cadre de ses activits, par exemple diriger le
dpartement administratif d'une grande entreprise, il tait parfaitement la hauteur".
Calligaris souligne que "rien dans ce qu'il disait ne se prsentait comme une forme de
signification lective, mais tout avait une signification, au point qu'il pouvait dans n'importe quelles
circonstances, tre l'homme de la situation"
113
. L'analyste met l'accent sur le style d'errance de ce sujet
pour qui toutes les significations pouvaient apparatre comme quivalentes. Une telle absence d'un
point d'arrt dans la diversit des significations rvle la carence du bouclage phallique de la
signification ne permettant pas un signifiant-matre de fonctionner comme principe organisateur.
Malgr l'absence de manifestations phnomnales ordinairement rapportes la psychose, une
forclusion du Nom-du-Pre en est dductible. Toutefois, il faut noter que la spcificit de la clinique
psychanalytique cet gard reste souvent mal connue, puisque Calligaris lui-mme, d'une part ne fait
aucune allusion au fonctionnement "comme si", d'autre part, rapporte honntement que dans cette
circonstance il lui a fallu "de l'aide" pour poser un diagnostic de psychose.
113
Calligaris C. Pour une clinique diffrentielle des psychoses. Point Hors-Ligne. 1991, pp. 10-15.
45
Nicolas n'est pas sans voquer le patient prcdent, par son pass militaire, et par son aptitude
s'adapter aux circonstances les plus diverses. Lors de son adolescence, il entra dans la rsistance, non
par bravoure, ni par hrosme, ni par conviction politique, pas mme port par un choix dlibr, mais
essentiellement parce que, dsuvr, "il ne savait pas quoi faire". Il fit sauter des trains et mit sans
crainte sa vie en jeu. La guerre acheve, ne sachant vers quoi s'orienter, il s'engagea dans l'arme, fit
l'Indochine, puis l'Algrie. l'encontre de certains de ses camarades, ce n'tait ni un fou de guerre, ni
un militant de l'Algrie franaise: il ne prenait pas la guerre au srieux, mais il la faisait avec
application. Soldat modle, toujours volontaire pour les missions dangereuses, trs apprci par ses
suprieurs, il fut dcor et atteignit le grade de sergent-chef. Rentr en France sans qualification il se
trouve un peu dsempar. Un jour que tout va mal, sur un coup de tte, il s'improvise un mtier,
croupier, en se faisant passer pour tel avec un aplomb qui en impose au directeur d'un casino. Il exerce
la satisfaction gnrale pendant vingt ans. Pendant cette priode, il rencontre dans un bal une ouvrire
avec laquelle il se marie. 50 ans, il quitte son emploi, sans en prciser la raison, de sorte qu'il se
trouve confront une situation matrielle difficile. Il parvient alors de nouveau se faire embaucher
en usant d'une mthode assez semblable celle utilise prcdemment: il russit tromper un chef
d'entreprise grce un coup de bluff non prmdit. Il se fait passer pour un ouvrier qualifi alors qu'il
ignore tout du mtier. Il s'adapte ensuite remarquablement en apprenant sur le tas. Il donne satisfaction
ses employeurs pendant plusieurs annes avant de dmissionner pour monter un commerce avec ses
conomies sur l'instigation de sa femme. Mal lui en prit. Cet homme de devoir est peu apte prendre
des initiatives. Il dilapide assez vite son argent, si bien qu'il prend sa retraite ds qu'il le peut. C'est
alors, 60 ans passs, qu'il connat des hospitalisations rptes faisant suite des impulsions
thyliques graves, mettant parfois sa vie en danger, conduisant souvent le recueillir sur la voie
publique. Nicolas n'a jamais prsent de symptme psychotique manifeste, cependant, comme il le
souligne lui-mme, "il s'arrange de tout", son existence se caractrise par une adaptation originale, la
fois parfaite et inaffective, la diversit de situations beaucoup plus rencontres que recherches. Il fut
un rsistant exemplaire, il aurait aussi bien fait un milicien convenable, pour peu qu'il ait subi d'autres
influences. Il est en outre trs remarquable qu'il se soit toujours sorti des situations les plus difficiles
avec un aplomb stupfiant, tant la guerre que dans sa vie professionnelle. Il sympathisait aisment
avec les grands personnages rencontrs tant en Indochine que dans les casinos. Nullement
impressionn par les figures minentes. Cet homme-l ne craint rien. Il est inentamable. Ni lui ni
l'Autre ne sont dcomplts. Quoi que veuille l'Autre, il y consent pleinement, quitte sacrifier jusqu'
son tre si les circonstances l'exigeaient. La castration n'a aucune prise sur lui. La carence de la
ngativation phallique ne suscite pas de troubles de langage manifestes, pourtant il prsente une sorte
de tic verbal qui le conduit insrer, comme une ritournelle, l'expression "si vous voulez bien" dans la
plupart de ses dveloppements. Le vouloir de l'autre semble en effet constituer ce sur quoi se rgle en
permanence sa normalit sans faille. En une seule circonstance, il lui arrive de ne pas tre en mesure de
consentir au dsir de l'Autre: quand il se confronte celui de sa femme. C'est toujours la suite de
46
querelles avec celle-ci qu'il se trouve port soit une dchance thylique, soit de courtes errances. Il
vint docilement se confier un analyste pour suivre un conseil mdical, mais ce fut sans lendemain.
L'existence de Nicolas ne laisse rien discerner d'une orientation sur un idal command par le
signifiant-matre. La carence de celui-ci se manifeste par une certaine inconsistance des identifications
mais aussi par le peu de poids des significations portes par le sujet. Certains traduisent cela par un
sentiment d'tre vide. Il leur arrive parfois de percevoir clairement qu'ils ne disposent pas de repre sr
pour s'orienter dans l'existence. "Tout peut m'intresser, me disait Arielle, mais rien ne reste, il n'y a
pas de moteur". La jouissance du sujet n'est pas localise, le fantasme fondamental n'est pas en place.
Ces phnomnes sont dcrits avec une grande finesse par Fritz Zorn dans un ouvrage
autobiographique o il relate sa lutte contre le lymphome qui est en train de l'emporter. Avant
l'closion de celui-ci, Zorn ne se soutient que de ce qu'il nomme lui-mme un "moi simul" dont il
dcrit les branchements avec une remarquable prcision. En tout point, il pensait devoir suivre
l'opinion de ses parents, ceux-ci lui paraissaient avoir toujours fondamentalement raison. "Je pouvais
parfois tre d'un autre avis sur certains dtails, crit-il, mais mettre rellement en question leurs actions
ou leurs penses, cela je ne le faisais pas"
114
. Il fut duqu, non seulement se conformer au discours
familial, mais plus encore toujours adopter le jugement des autres, de sorte qu'il ne devait jamais
"risquer de dire quelque chose qui ne ft pas assur de l'approbation gnrale". Il considre en avoir
perdu "toute aptitude la spontanit"
115
. Derrire la faade d'un moi conformiste, calqu en miroir
sur les proches, le sujet s'avre incapable de procder des choix, parce que de choix il n'y a pas, faute
de fantasme fondamental pour les instaurer. "En ce temps-l, prcise-t-il, je n'avais pas de jugement,
pas de prfrences personnelles et pas de got individuel, au contraire, en toutes choses je suivais le
seul avis salutaire, celui des autres, de ce comit de gens dont je reconnaissais le jugement [...]
Naturellement, cette recherche constante de l'opinion juste et seule salvatrice conduisit rapidement
une grande lchet en matire de jugement, si bien que ma peur de prendre parti, devenue excessive,
empchait toute prise de conscience spontane. A la plupart des questions qu'on me posait j'avais
coutume de rpondre que je ne savais pas, que je ne pouvais pas en juger ou que cela m'tait gal; je ne
pouvais donner de rponse que lorsque je savais d'avance qu'elle pouvait correspondre au canon
salvateur. Je crois qu'en ce temps-l j'tais un vritable petit Kant effarouch, qui croyait toujours ne
pouvoir agir qu'en parfait accord avec la loi gnrale"
116
.
Certes, si le patient de Calligaris peut tre considr comme une observation trs pure du
syndrome "comme si", il n'en va pas tout fait de mme pour Zorn. Celui-ci se plaignant de son "moi
simul", il prsente une bauche de sentiments de dpersonnalisation qui ne sont pas compatibles avec
le phnomne dgag par H. Deutsch dans l'acception stricte qu'elle s'en est forme. Or elle-mme
114
Ibid., p. 113.
115
Ibid.,p. 40.
116
Ibid., p. 43.
47
nous indique qu'il y a lieu de contester celle-ci quand elle affirme en 1965 n'avoir jamais rencontr
qu'une seule personne du type "comme si" en trente-trois ans de pratique. A trop restreindre le
syndrome elle le rend quasiment introuvable. Il s'agit sans doute de l'une des raisons pour lesquelles sa
remarquable dcouverte clinique est reste peu connue.
L'imposture pathologique.
Elle mrite mon sens d'tre replace dans un plus large contexte. Elle constitue un lot
spectaculaire dans un vaste champ: celui des modes de branchements imaginaires auxquels le sujet
psychotique peut recourir pour compenser la carence de la fonction du signifiant-matre. Le
fonctionnement "comme si" tend remdier l'inconsistance de la signification, la carence du
fantasme fondamental et, dans le champ des identifications, au dfaut du trait unaire. Plutt que de le
restreindre au type d'H. Deutsch, il semble heuristique de montrer l'extension des mcanismes "comme
si" en tant que modes de stabilisation frquemment utiliss par le psychotique. Le champ de cette
clinique s'avre en fait si tendu qu'il ne saurait tre question de le parcourir dans ce travail. Tentons
cependant d'en indiquer certaines bornes, d'une part dans une sorte d'au-del du "comme si", o l'on
rencontre un trouble plus spectaculaire encore, l'imposture pathologique, d'autre part dans une sorte
d'en-dea, o le "comme si" se fait discret chez des sujets dont on note surtout l'inconsistance ou
l'tranget. L'un et l'autre de ces phnomnes ne possdent pas la mme importance clinique: la
frquence du second est sans commune mesure avec la raret du premier.
Hlne Deutsch et Phyllis Greenacre auxquelles on doit de belles tudes psychanalytiques sur
les imposteurs, produites dans les annes 50, ont toutes deux notes de nombreuses convergences entre
ces sujets et les personnalits "comme si". Le point commun rside dans l'tonnante plasticit des
identifications. Un exemple fascinant rapport par H. Deutsch est celui de Ferdinand Damara. Aprs
s'tre enfui de chez lui, il devint tour tour professeur de psychologie, moine, soldat, marin, citoyen
asserment faisant fonction de chef de police, psychiatre et chirurgien - toujours sous le nom d'un autre
homme. "Avec une habilet et un art presque incroyable il obtenait chaque fois un certificat d'expert et
faisait usage d'une science apprise ad hoc si brillamment qu'il tait capable de perptrer ses
supercheries avec un succs complet. C'tait toujours "accidentellement", jamais par des erreurs
commises, qu'il tait dcouvert comme imposteur"
117
. Greenacre relate une observation personnelle
moins spectaculaire mais beaucoup plus commune la rubrique des faits divers. Il s'agissait d'un
patient qui avait maintes reprises usurp l'identit d'un mdecin. "Il prenait des rendez-vous et
recevait des malades l'hpital, sans autre qualification que celle qu'il avait reue en tant qu'infirmier
pendant la seconde guerre mondiale. Comme il avait auparavant observ, avec beaucoup d'acuit,
nombre de procds et d'oprations chirurgicales qu'il tait capable de reproduire de faon tout fait
117
Deutsch H. L'imposteur: contribution la psychologie du moi d'un type de psychopathe [1955], in La psychanalyse des
nvroses. Payot. Paris.1963, p. 278.
48
honorable, il tait bien vu des collgues comptents avec lesquels il travaillait. Nanmoins il choua
faute de prcautions l'gard de ceux qui pourraient le dcouvrir, prcautions que n'importe quel
escroc perspicace ou bon conspirateur aurait certainement prises. Pendant la priode active de
l'imposture, il tait calme, placide, heureux". Elle note que les aptitudes contradictoires des imposteurs
les rendent parfois nigmatiques: ils donnent le sentiment de combiner habilet et force persuasive
avec folie pure et btise
118
.
L'article d'H. Deutsch est centr sur un patient nomm Jimmy qu'elle eut en psychothrapie de
soutien pendant huit ans. Celui-ci n'tait pas un imposteur extravagant, ses diverses identits
possdaient un fragile support: un projet d'acquisition de ferme suffit faire de lui "un gentilhomme
campagnard", la constitution d'un salon littraire le promut "grand crivain", il dpensa des sommes
importantes pour tenter de devenir "producteur de films", il ralisa de petites inventions pour se faire
confectionner des cartes de visite avec le qualificatif "inventeur", etc. En fait, "sa prtention tre un
gnie tait souvent si persuasive que beaucoup de gens s'y laissaient prendre pendant une courte
priode".
Les identits usurpes par les imposteurs possdent en commun d'tre au service d'une
valorisation narcissique rapide, ncessitant peu d'efforts, qui promeut un moi idal exalt, parant la
carence de l'idal du moi. La proximit de ces phnomnes avec la psychose ne manque pas d'tre
discerne par H. Deutsch, propos de Jimmy, quand elle note la carence de la libido objectale et la
prsence d'ides paranodes qui la conduisent envisager l'hypothse d'une "schizophrnie naissante".
De surcrot Greenacre note chez les imposteurs non seulement une propension aux calembours et aux
jeux de mots, mais aussi des traits paranoaques, tels que le fantasme de toute-puissance et la
revendication de recouvrer "sa position lgitime". Elle considre avec perspicacit que l'imposture
pathologique possde deux fonctions: celle de raliser un meurtre du Pre et celle de procurer un
sentiment temporaire d'achvement de l'identit.
Elle discerne un dsquilibre grave de la relation dipienne reposant sur le fantasme d'avoir
vaincu le Pre, de sorte que "toute possibilit d'identification avec lui" serait ferme. Le sujet, crit-
elle, s'imagine alors "pouvoir impunment suppler
*
son pre". Chacun notera qu'en usant de
formulations prises au mythe dipien on ne saurait gure mieux voquer la forclusion du Nom-du-
Pre. Qui plus est, elle souligne une des consquences majeures de cette forclusion, la rduction du
rapport l'autre la pure relation duelle, quand elle note l'intensit du lien la mre, allant jusqu' faire
mention d'une incorporation psychologique du sujet celle-ci.
118
Greenacre P. The impostor [1958], in Emotionnal growth. International University Press. Traduction franaise, in
L'identification. Tchou. 1978.
*
Je souligne le terme.
49
La proximit de l'imposture pathologique et du fonctionnement "comme si" apparat nettement
quand on constate avec Greenacre que la premire participe d'une lutte pour soutenir une identit
prcaire. "Il faut absolument, affirme-t-elle, que l'imposteur-type ait des spectateurs. C'est grce eux
qu'il peut se faire une ide positive, relle de lui-mme; sa valeur prend d'autant plus d'importance qu'il
est incapable de s'en assurer d'une autre manire. Le fait que les impostures aient souvent une
signification sociale s'explique par ce phnomne de qute d'un auditoire dans lequel le (faux) Moi se
reflte. Pour l'imposteur, la russite de la supercherie a tendance renforcer la fois la ralit et
l'identit"
119
. Le branchement sur une image de l'autre qui reflte celle du sujet s'avre aussi
ncessaire l'imposteur qu'au fonctionnement "comme si". Toutefois, dans le premier cas, l'autre est
passif, il n'est convoqu que pour confirmer un moi idal exalt, dans le second, la dynamique semble
venir de l'autre, sur les idaux duquel le sujet se repre. Dans ce dernier cas le processus est plus
labor: il y a une tentative pour se frayer un accs dans le champ des images vers l'instance
symbolique de l'idal du moi. Le sujet "comme si" se montre le plus souvent apte faire des efforts
pour se conformer l'image idale sur laquelle il se repre. Rien de semblable chez l'imposteur qui tel
Jimmy "tait incapable d'un effort orient vers un but parce qu'il tait incapable de retarder le moment
d'atteindre le but escompt".
partir de cette clinique, l'indication de Lacan donne en 1956, selon laquelle le sujet
psychotique peut se soutenir d'une identification par quoi il a assum le dsir de la mre, semble moins
tre concevoir dans l'histoire particulire que dans la structure. Pour la problmatique de l'poque,
c'est au phallus que le dsir de la mre est rfr. L'imposteur rvle clairement qu'il s'agit d'une image
phallique inentame, une image de compltude, qui n'est en rien marque par la castration. S'il arrive
que cette image ne soit plus conforte par un autre, que la tension entre le moi idal et ce qui tient lieu
d'idal du moi se trouve rompue, alors adviennent des circonstances favorables au dclenchement de la
psychose.
Les cliniques spectaculaires de l'imposteur pathologique et du fonctionnement "comme si"
possdent le mrite de dgager les dterminants essentiels des modes de compensations imaginaires
des psychotiques. Toutefois les plus frquentes sont aussi les plus discrtes.
Le branchement sur un proche.
Ce qui retient l'attention ds les premiers entretiens chez Arielle est son lgance. Cette jeune
femme apporte un soin extrme son image. Elle n'a jamais prsent de symptme psychotique
manifeste. Selon son entourage elle exerce son mtier et ses fonctions de mre de famille de manire
satisfaisante. Pour les autres elle parat adapte et heureuse, mais pour elle rien n'a de sens. "Chaque
moment est bien, dit-elle, pourtant l'ensemble de la journe ne l'est pas: le un plus un plus un ne se fait
119
Greenacre P., o. c., p. 274.
50
pas". Elle ne dispose pas de la fonction phallique pour assurer le bouclage de la signification. Aussi
est-elle contrainte de se tourner vers les autres pour s'orienter dans l'existence. "Quand les gens
s'intressent moi, confie-t-elle, a me porte un peu, mais si peu". Le soin pris son image ne
s'enracine gure en une volont de sduire: il s'agit plutt pour elle de masquer ce qu'elle nomme "le
tas de boyaux". Parfois, confie-t-elle, pour me rassembler, je me regarde dans une glace, j'y vois ce que
les autres voient". Cette formule indique que son regard sur elle-mme se rgle d'aprs l'opinion des
autres, ce qui lui suggre le plus souvent d'adopter une attitude conformiste. "Je tiens par l'image, note-
t-elle, si bien qu'il m'arrive de me demander ce que j'aurais fait si j'avais t aveugle, j'aurais peut-tre
t compltement confuse". Si Arielle s'avre bien adapte, et si elle ne prsente pas le fonctionnement
"comme si", elle le doit pour une grande part la prsence de son mari. Ce qu' elle l'exprime en une
formule lapidaire: "je ne tiens rien et pourtant je suis trs dpendante de mon mari. C'est paradoxal".
Elle prcise: "je ne supporte pas qu'on attaque mon mari: c'est comme scier la branche sur laquelle je
suis assise. Je m'alimente ses penses".
Pourtant Arielle affirme par ailleurs n'avoir dcouvert la souffrance qu'aprs son mariage. Lors
de son enfance et de son adolescence, elle cartait aisment les problmes, elle mettait les gens dans sa
poche, elle s'arrangeait pour que l'avenir soit le bonheur. "Je m'appuyais sur mon nom", observe-t-elle,
en effet son patronyme de naissance voque une ide de jeunesse et de gaiet. Nommons-l
"Jouvence". "J'tais gaie, insouciante, chouchoute par mes professeurs, on plaisantait souvent de
manire agrable sur mon nom, j'tais une sorte d'eau de jouvence. Ds toute petite je puisais l une
dtermination tre heureuse". La propension la substantivation du patronyme, souvent note chez
des sujets de structure psychotique, avait t mise par Arielle de manire originale au service de
repres imaginaires stabilisants. "Or, poursuit-elle, aprs mon mariage, quand j'ai perdu le nom de mon
pre, et surtout l'omniprsence de ma mre, je suis tombe malade"
120
. Il faut noter qu'elle trouvait
aussi du ct de sa mre un soutien d'importance. "Je n'ai pas de dsir, constate-t-elle en une phrase
remarquable, mais c'est le contraire de celui de ma mre". Elle prcise que dans son enfance, sous son
air insouciant et gai, elle s'est toujours efforce de faire le contraire de sa mre. "C'tait quelqu'un de
plaintif, toujours en train de faire son mnage, tandis que j'tais joyeuse et bordlique". Il semble que le
signifiant patronymique, pris la lettre, ait permis Arielle de ne pas tre prise en une relation trop
mortifre sa mre, en lui ouvrant la possibilit de s'orienter en s'opposant celle-ci. Aprs le mariage,
"mon mari s'est occup de moi, il m'a ramasse comme une loque, il a pris la place de ma mre.
Maintenant j'ai besoin de sa prsence pressante et mme parfois contraignante". Toutefois, aujourd'hui
encore, quand ce soutien dfaille, Arielle se dcouvre domine par "un attrait pour le rien", alors,
prcise-t-elle, "j'aspire me poser l comme un vgtal et me satisfaire de mon inertie; je n'aspire
plus rien d'autre qu' rien". Elle n'est pas alors envahie par une jouissance Autre: elle s'prouve
spare de son tre de jouissance: comme une marionnette, dit-elle, dont on aurait coup les ficelles.
120
Le patronyme d'Arielle acquis par son mariage ne se prte plus aux associations sur le bonheur auxquelles le prcdent
tait propice.
51
Tout indique que ces moments-l sont surmonts grce la stabilit de la relation conjugale qui fait
obstacle une drive des identifications imaginaires. L'amour et le dsir du mari permettent Arielle
de maintenir un voile phallique port sur son tre et contribuent soutenir sa capacit se faire
reprsenter au champ de l'Autre. De surcrot les idaux du mari orientent le champ de la signification et
instaurent des bornes la jouissance du sujet.
Rien qui appartienne l en propre la position fminine. Lucien le dmontre. Il a une
cinquantaine d'annes, il est bien adapt socialement, malgr la persistance de quelques voix apparues
quinze ans auparavant lors d'un grave pisode mlancolique. Toutefois il reste fondamentalement
incertain de tout. Parfois ses voix lui apportent de l'aide, en lui donnant des conseils, qu'il suit
volontiers; parfois cependant elles le dprcient et l'injurient, de sorte qu'il ne peut leur accorder une
totale confiance. Dans son entourage, seule sa femme connat l'existence de ces voix, et il aura fallu
plus d'un an pour qu'il m'en fasse part. Sa vie professionnelle le stabilise tant qu'il accepte de se rgler
sur des figures d'autorit. Mis part un certain vitement des relations sociales, rien dans son
comportement ne laisse supposer qu'il s'agit d'un sujet prsentant encore quelques troubles. Parfois
cependant des questions l'assaillent. "Heureusement qu'il y a ma femme, note-t-il, elle a toujours la
bonne rponse, elle me rassure. Parfois quand elle me parle, j'oublie tous mes soucis. Sans elle, je ne
sais pas o je serais". Il n'a jamais fait tat de quelque sentiment amoureux prsent ou pass l'gard
de son pouse; mais il est trs conscient que son quilibre est conditionn par la prsence de celle-ci
ses cts.
Cependant, mme au sein d'une relation conjugale apparemment stable, les conditions d'un
branchement stabilisant ne sont pas toujours ralises. L'poux de Jacqueline se prte moins la
soutenir que celui d'Arielle. "Il faudrait que mon mari m'aide, me dit-elle, il a beaucoup de puissance
sur moi. J'ai besoin de quelqu'un pour me retrouver, ses paroles ont beaucoup de poids. Mais il me
stresse. Il ne m'aime pas". Elle constate que depuis plus de dix ans il constitue son principal soutien
dans l'existence tout en se rvoltant contre cette situation. "Je suis trop dpendante de lui: il ne me
respecte pas". Bien loin de confrer son image une valeur agalmatique, il semble plutt viser son tre.
"Il me trouve nulle, dit-elle, il me traite comme sa chose". Ds lors sa vie lui parat "incertaine et
ennuyeuse". Elle se prsente souvent comme une obsessionnelle, cependant l'incapacit choisir dont
elle se plaint n'est pas celle du nvros incapable de se dcider entre plusieurs objets galement
attrayants, pour elle aucun des possibles ne la retient vraiment. Ses rares projets sont l'vidence
irralistes. Ses rcriminations contre son mari ne sont gure suivies d'effets. Elle donne plus une
impression d'inconsistance que celle d'un miroitement comme si. Sa "nullit" lui est trop prsente.
Quelques annes aprs l'avoir perdue de vue, j'ai appris qu'elle s'tait jete du haut d'une tour.
52
Ce que peut parfois obtenir la relation amoureuse, quand les circonstances sont favorables, les
groupes sociaux fortement structurs autour d'un idal peuvent aussi le raliser. L'attrait exerc par les
sectes sur certains sujets cultivs trouve l une de ses raisons. De mme on conoit les sductions de la
vie militaire ou monacale pour les psychotiques. En fait tout indique que de nombre d'entre eux, grce
des identifications imaginaires stables, parviennent cadrer leur existence et russissent parer la
psychose dclare. Dans cette perspective le fonctionnement "comme si" s'avre rvler, non pas le
plus exemplaire de ces mcanismes de compensations, mais bien un mode de dfaillance de ceux-ci.
Il n'y a pas lieu d'instaurer des limites infranchissables entre le "comme si" et la
dpersonnalisation, en suivant l'opinion d'H. Deutsch, ni mme de dissocier le signe du miroir de ces
derniers phnomnes. Quand ils surviennent chez le psychotique, il convient plutt de les rassembler
au sein du vaste ensemble des troubles de l'identit suscits par la carence de l'identification
primordiale au trait unaire. Une observation de Minkowski montre d'ailleurs qu'ils peuvent coexister. Il
s'agit d'un jeune homme de 26 ans sorti d'une cole suprieure. Pendant un an il prsente "un tat de
dpression trs accus" associ de svres sentiments de dpersonnalisation. "Je ne me sens plus,
constate-t-il. Je n'existe plus. Quand on me parle, j'ai la sensation qu'on parle un moi [...] J'ai, mon
propre sujet, la sensation de personnalit absente. En somme, je promne mon ombre [...] Le mdecin
lui demande s'il tait sorti la veille. Il rpond: 'Justement je ne suis pas sorti, c'est comme si un type
quelconque tait sorti et non pas moi [...] Je me fais l'impression d'un type qui est assis et qui cause
mais qui en somme n'est pas identique avec moi. Je ne me sens pas le droit d'employer les expressions
'Je' et 'moi'; elles ne correspondent rien de prcis pour moi."
121
Le sentiment d'inconsistance donn
par certains sujets psychotiques prend ici une forme extrme. Il est vrai que dans ce cas les troubles
sont situer dans l'au-del du dclenchement. Ce jeune homme ne dispose pas de la fonction du
signifiant matre pour lester l'idal du moi. Il n'est pas en mesure de se compter comme Un. Il ne
dispose plus gure que de quelques repres imaginaires auxquels il tente d'accrocher son tre. Or il les
cherche par l'entremise de deux phnomnes dj rencontrs. Il prsente d'abord des bauches du signe
du miroir. "Il faut que je me regarde, confie-t-il certains moments, pour m'assurer que c'est moi."
Toutefois, en certaines circonstances, il ne se reconnat plus dans la glace :"je ne retrouve plus mon
image, je ne me rappelle plus de m'tre vu dans une glace". Il ne conserve que la sensation de promener
son ombre. Il tmoigne en outre d'une forme pauvre du fonctionnement "comme si". "Aprs dner,
rapporte-t-il, quand les autres se lvent de table, je les suis automatiquement, entran par leurs
mouvements. Je suis le reflet des autres. En somme, je vibre avec les gens, je reflte leurs vibrations;
ce sont leurs vibrations qui me font vibrer moi-mme, je ne vibre plus tout seul.[...] Dans une
conversation c'est mon interlocuteur qui me fait parler. Je suis comme un fantme, mais un fantme
magntique, attir automatiquement par les divers vnements qui se droulent dehors". Il dcrit l une
sorte de diffraction l'infini de ce qui tient lieu d'idal du moi: il ne dispose plus de significations
121
Minkowski E. Le temps vcu. Etudes phnomnologiques et psychopathologiques [1933] Grard Monfort. Brionne. 1988,
pp. 304-306.
53
privilgies pour arrter la drive des images. Ce sujet psychos montre clairement que le signe du
miroir et le fonctionnement "comme si", alors associ la dpersonnalisation, constituent des tentatives
pour remdier la carence de la fonction du trait unaire, mais des tentatives situer du ct des modes
de compensation les moins achevs.
Certes, une extension fort large est alors confre au "comme si", de prime abord peu
compatible avec l'acception restreinte d'H. Deutsch, qui affirme en 1965 l'extrme raret de la
personnalit "comme si", pourtant elle-mme, dix ans plus tt, notait tout au contraire: "Le monde est
peupl de personnalits "comme si" et plus encore d'imposteurs et de simulateurs. Depuis que je
m'intresse l'imposteur, il me poursuit partout. Je le trouve parmi mes amis et mes relations aussi bien
qu'en moi-mme"
122
. Si elle oscille ainsi entre deux positions, d'ailleurs toutes deux justifies, c'est
qu'elle discerne, quand elle tend le concept, qu'elle dcrit par son entremise le procs des
identifications imaginaires, en effet discernable dans la constitution en pelure d'oignons du moi de tout
un chacun; en revanche, quand elle en restreint vigoureusement l'acception, elle objective un tableau
clinique, il est vrai fort peu frquent, mais exemplaire pour apprhender certains modes de stabilisation
du psychotique.
Il existe une gradation parmi ceux qui tentent de remdier la carence de la fonction du trait
unaire. La plus pauvre est l'autoscopie du signe du miroir. La plus haute donne une consistance un
moi idal de nouveau en mesure de s'orienter sur un tenant-lieu d'idal du moi. Les signifiants de ce
dernier ne sont certes pas chevills au sujet psychotique, d'o la possibilit de leur variabilit et de leur
fractionnement, mais il peut les rencontrer ports par l'image idale d'un semblable.
Quand la marque du trait unaire ne se porte pas sur l'tre de jouissance du sujet, en raison de la
diffraction du S1, la fixation de l'tre n'est pas assure, de sorte qu'il ne dispose que de masques labiles
pour asseoir son identit. A l'gard de ceux-ci le sujet prouve le sentiment d'un manque de connexion
stable et solide. Il en rsulte frquemment un sentiment d'inconsistance li la mollesse de ses
identifications.
La clinique du dysfonctionnement de l'identification au trait unaire trouve dans le signe du
miroir l'une de ses formes extrmes. L'insistance de l'autoscopie doit sans doute tre rapporte au
caractre nigmatique que prend alors une image en train de se vider de signification. Elle devient
trange, le sujet peine la reconnatre comme lui appartenant. En perdant tout attrait phallique, elle
laisse discerner l'horreur qu'elle masquait. A ce moment peut se produire une mort du sujet. Pour
combler la bance entrevue parfois surgissent des significations dlirantes. Le signe du miroir se situe
aux limites de la structure psychotique hors-dclenchement. Il tmoigne plus souvent d'une dfaillance
des identifications imaginaires que d'une tentative pour soutenir leur brillance phallique.
122
Deutsch H. L'imposteur, o.c., p. 285.
54
Dans l'imposture pathologique le sujet s'accroche un moi idal narcissique qui ne porte nulle
trace de ngativation phallique. Il ne s'oriente nullement sur les significations de l'Autre: la fonction de
l'idal du moi est totalement inoprante. Les autres ne sont convoqus que pour conforter l'image
idale. Le masque est trop mal arrim pour que l'imposture puisse durer: il est de rgle que le sujet
fasse en sorte qu'elle soit dcouverte et que se rvle sa dchance.
Le fonctionnement "comme si" tmoigne d'un fonctionnement plus labor. En prenant appui
sur les idaux d'un semblable, le sujet maintient une ouverture la dimension de l'Autre, ce qui lui
donne accs un tenant-lieu d'idal du moi. Ds lors, l'encontre de l'imposteur, il parvient parfois
s'imposer des efforts et accepter des contraintes. En fonction du modle identificatoire adopt, il sera
citoyen honorable aussi bien que dlinquant. Parfois l'un et l'autre selon les circonstances. Ce
fonctionnement, rare dans sa forme pure, peut se dgrader en "fantme magntique"; mais il peut aussi
se dpasser grce une identification qui parvient mieux que d'autres compenser la fonction
paternelle. Il semble qu'une des conditions majeures tienne au caractre exigeant de celui qui l'incarne
par quoi se trouvent mises en place des limites la jouissance du sujet. Le respect de celles-ci soutient
le moi idal dans sa fonction de masque port sur l'horreur de l'tre de jouissance. On conoit ds lors
que la rencontre d'un matre convienne fort bien arrter le fonctionnement "comme si"; tandis que la
mansutude de la femme du patient de Calligaris, tolrant la liaison de son mari avec sa mre, a sans
doute prcipit celui-ci dans la dchance.
Pour qu'une identification imaginaire parvienne stabiliser durablement un sujet psychotique, il
faut que certaines conditions soient remplies. Les prciser ncessite des tudes complmentaires. Il
apparat cependant que ces identifications sont porteuses d'idal, de sorte qu'elles limitent et localisent
la jouissance. En outre, il est frquent que des satisfactions pulsionnelles soit au principe du lien qui
unit ces sujets leur objet d'identification prvalent. On ne saurait ds lors douter que les mcanismes
imaginaires qui dominent la symptomatologie ne fonctionnent pas de manire autonome: ils sont
articuls l'conomie de la jouissance. Dans les formes les plus labores de ces processus de
stabilisation, les identifications imaginaires paraissent en connexion avec le rel. Restaurent-elles un
nouage de la structure du sujet? Lacan semble faire l'hypothse d'un phnomne assez comparable
quand il envisage la possibilit qu' "trois paranoaques pourrait tre nou au titre de symptme un
quatrime terme qui se situerait comme personnalit, distincte au regard des trois personnalits
prcdentes, et leur symptme"
123
. Cette dernire personnalit ne serait pas elle-mme ncessairement
paranoaque, tandis que la chane pourrait comporter "un nombre indfini de nuds trois". Cette
conjoncture, lors de laquelle une personnalit, notion qui met l'accent sur le moi du sujet, porterait pour
d'autres le poids de jouissance propre au symptme, serait sans doute chercher au sein de
123
Lacan J. Le sinthome. Sminaire du 16 dcembre 1975, in Ornicar? Bulletin priodique du champ freudien. Juin-Juillet
1976, 7, p. 7.
55
communauts qui se prtent plus que d'autres fournir de solides identifications des sujets de
structure psychotique: sectes, groupes religieux, militaires ou politiques. Il semble que les
identifications imaginaires du psychotique soient d'autant plus stables que leur connexion avec le rel
soit serre. Arielle l'indique quand elle constate sa difficult soutenir son tre lors d'absences
prolonges ou inhabituelles de son mari. "Dans ces cas-l, confie-t-elle, je continue effectuer mes
activits habituelles, rien ne transparat extrieurement, mais l'intrieur, c'est le chaos, je ne suis plus
qu'une enveloppe vide". Il est manifeste que la jouissance se trouve localise sur son partenaire, de
sorte qu'Arielle ne prsente aucun signe de psychose clinique: elle n'est pas envahie par l'objet a.
Pourtant cet objet n'est pas perdu, un processus de sparation n'est pas intervenu, c'est pourquoi la
prsence du mari s'avre essentielle. L'objet a n'est pas voil par l'image de l'autre: il est pris en celle-
ci. "Je sais que je ne peux pas demander cela mon mari, observe Arielle, mais l'idal serait qu'il soit
toujours prsent, qu'il ne me quitte jamais". Que son tre se situe non pas dans le manque de l'Autre,
mais dans son mari incarn, elle l'exprime encore clairement quand elle constate que l'absence
prolonge de ce dernier quivaut pour elle "la mort de l'me". Elle sait maintenant que cest se
rgler sur les idaux de son mari quelle parvient sorienter dans le champ des significations. Elle
trouve par l des bornes sa jouissance de linertie. Je nai de tranquillit qu me conformer ce
que mon mari attend de moi . Il semble que ce soit en parvenant oprer un cadrage de lobjet a que
les identifications imaginaires du psychotique russissent le stabiliser.
La cure des psychotiques ordinaires pose des problmes souvent peu aperus. Ils sont encore
accrus quand on les range dans les notions fourre-tout d'tat-limite, de schizophrnie latente ou de
dpression. Ces catgories syndromiques ne permettent pas la mise en place d'une direction de la cure
approprie. Elles sont gnralement associes des conduites thrapeutiques tout faire qui
mconnaissent que la place de l'analyste dans le transfert se trouve dtermine par la structure du sujet.
La clinique de la psychose ordinaire est reste dans les limbes chez Freud. Certes, il fallait
concevoir la forclusion du Nom-du-Pre pour qu'elle prenne son essor, mais aussi sans doute le nud
borromen, car il s'agit d'une clinique de connexions et de dconnexions, non d'une clinique du conflit.
Ce n'est qu'au terme de son enseignement que Lacan rompt nettement avec cette dernire, ne
privilgiant plus par exemple le symbolique par rapport l'imaginaire, mais insistant sur l'quivalence
des trois lments: rel, imaginaire et symbolique. "La clinique des nuds, souligne J-A Miller, est une
clinique sans conflit. [...] C'est une clinique du nouage et non de l'opposition, une clinique des
arrangements qui permettent la satisfaction et qui conduisent la jouissance. Il y a une difficult, mais
il n'y a pas de conflit. La structure mme des nuds ne permet pas de faire surgir la dimension du
conflit.[] Dans cette clinique, il ne s'agit donc pas de rsoudre le conflit, comme chez Freud, mais de
trouver un nouvel arrangement, d'arriver un fonctionnement plus ou moins coteux pour le sujet"
124
.
Cette nouvelle clinique oriente la cure, non plus vers linterprtation des symptmes du sujet
124
Miller J-A. Le sminaire de Barcelone sur Die Wege der Symptombildung, in Le symptme-charlatan. Seuil. Paris. 1998.
56
psychotique, mais, soit vers linvention de supplances, soit vers un soutien apport des modes de
stabilisation dj en place. La connaissance encore sommaire de l'tonnante diversit des formes
cliniques de la psychose ordinaire ne trouvera des prolongements qu'en acceptant de la prendre en
considration.
Vous aimerez peut-être aussi
- Jacques-Alain Miller - Marginalia de Constructions Dans Lanalyse PDFDocument22 pagesJacques-Alain Miller - Marginalia de Constructions Dans Lanalyse PDFlgrisaPas encore d'évaluation
- La Cause Freudienne 44 PDFDocument104 pagesLa Cause Freudienne 44 PDFMarcela Maria Azevedo50% (2)
- 002Document38 pages002Ptrc Lbr LpPas encore d'évaluation
- Ornicar IndicesDocument63 pagesOrnicar IndicesCasaolivo100% (4)
- Le Regard Marie-Hèlene BrousseDocument7 pagesLe Regard Marie-Hèlene Brousselacerda800100% (1)
- Miller, L'Autre Sans Autre, Athen 2013Document17 pagesMiller, L'Autre Sans Autre, Athen 2013a1107240Pas encore d'évaluation
- Lacan Présentations de MaladesDocument36 pagesLacan Présentations de MaladesTiffany Davis75% (4)
- Soler Quest Ce Qui Fait LienDocument69 pagesSoler Quest Ce Qui Fait LienColectivo de Pensamiento Psicoanalítico100% (2)
- Note Sur La HonteDocument13 pagesNote Sur La HonteManuel Hernández100% (1)
- L'Interpretation A L'envers, Par Jacques Alain MillerDocument15 pagesL'Interpretation A L'envers, Par Jacques Alain MillerBelinda CoturosPas encore d'évaluation
- Jacques Alain Miller-Des Semblants Entre Les SexesDocument7 pagesJacques Alain Miller-Des Semblants Entre Les SexesFengPas encore d'évaluation
- Moustapha Safouan - 2005. Lacaniana 2 - FRDocument295 pagesMoustapha Safouan - 2005. Lacaniana 2 - FRSpin Influence100% (3)
- Qui Sont Les Autistes Maleval PDFDocument29 pagesQui Sont Les Autistes Maleval PDFLuis Achilles FurtadoPas encore d'évaluation
- CASTANET Ne Devient Pas Fou Qui VeutDocument3 pagesCASTANET Ne Devient Pas Fou Qui VeutPW6100% (1)
- Marret-Maleval, S. - Le Sinthome PDFDocument5 pagesMarret-Maleval, S. - Le Sinthome PDFfrelami2Pas encore d'évaluation
- Conférence À L' ECF Sur l'Effet-De-Formation Des Analystes (Graciela Brodsky)Document5 pagesConférence À L' ECF Sur l'Effet-De-Formation Des Analystes (Graciela Brodsky)lunacuPas encore d'évaluation
- (Charles Melman) D'Un Autre À L'autre, SéminaireDocument131 pages(Charles Melman) D'Un Autre À L'autre, Séminairealiodormanolea100% (1)
- Jacques-Alain Miller, Le Désenchantement de La Psychanalyse - Cours 2001-2002Document269 pagesJacques-Alain Miller, Le Désenchantement de La Psychanalyse - Cours 2001-2002SchkrippePas encore d'évaluation
- 011Document47 pages011Ptrc Lbr LpPas encore d'évaluation
- Sauvagnat - Hallucination Et ÉnociationDocument41 pagesSauvagnat - Hallucination Et ÉnociationLuis6983100% (1)
- Lacan Fonction Champ Parole LangageDocument23 pagesLacan Fonction Champ Parole LangageÉric ZulianiPas encore d'évaluation
- ObsessionnelDocument55 pagesObsessionnelMarcelo Araújo100% (1)
- ORNICAR? Tome 02Document58 pagesORNICAR? Tome 02accatone100% (1)
- Miller HysterieDocument13 pagesMiller HysterieDan RaduPas encore d'évaluation
- Lacan - Séminaire 16 - Résumé 32 PgsDocument32 pagesLacan - Séminaire 16 - Résumé 32 Pgsfortyrr100% (1)
- Alain Miller, Jacques - Le Lieu Et Le Lien (2000)Document318 pagesAlain Miller, Jacques - Le Lieu Et Le Lien (2000)Patricio Andrés Bello100% (3)
- 023Document59 pages023Ptrc Lbr LpPas encore d'évaluation
- Serge Cottet Freud Désir PDFDocument111 pagesSerge Cottet Freud Désir PDFRicardo Martínez MartínezPas encore d'évaluation
- Deffieux - Interpretacion BorromeaDocument3 pagesDeffieux - Interpretacion BorromeaLuis6983100% (1)
- Jacques-Alain Miller, La Clinique Lacanienne, Cours de 1981-1982Document306 pagesJacques-Alain Miller, La Clinique Lacanienne, Cours de 1981-1982Schkrippe100% (2)
- Deffieux, J.-p.La Famille Est-Elle Necessairement OedipienneDocument7 pagesDeffieux, J.-p.La Famille Est-Elle Necessairement OedipienneHélida XavierPas encore d'évaluation
- Maurice BouvetDocument40 pagesMaurice BouvetLuxi FangPas encore d'évaluation
- 018Document57 pages018Ptrc Lbr LpPas encore d'évaluation
- Jacques-Alain Miller, L'Autre Qui N'existe Pas - Cours 1995-1996 - Leçons 1-19Document395 pagesJacques-Alain Miller, L'Autre Qui N'existe Pas - Cours 1995-1996 - Leçons 1-19SchkrippePas encore d'évaluation
- Jacques Lacan - Le Séminaire de Jacques Lacan, Livre 23, Le Sinthome (Seuil, 2005)Document253 pagesJacques Lacan - Le Séminaire de Jacques Lacan, Livre 23, Le Sinthome (Seuil, 2005)Pedro FelizesPas encore d'évaluation
- Seminaire 27 DISSOLUTIONDocument17 pagesSeminaire 27 DISSOLUTIONleroi77Pas encore d'évaluation
- RFP Transfert 1952 Rapport LagacheDocument605 pagesRFP Transfert 1952 Rapport LagachelgrisaPas encore d'évaluation
- La Naissance de L'école de La Cause FreudienneDocument44 pagesLa Naissance de L'école de La Cause FreudienneFengPas encore d'évaluation
- Les Non-Dupes Errent, 1973-74, XXIDocument253 pagesLes Non-Dupes Errent, 1973-74, XXIeuagg100% (1)
- Lecon 1 Parler Lalangue Du Corps Premiere Seance P G GueguenDocument5 pagesLecon 1 Parler Lalangue Du Corps Premiere Seance P G GueguenL'abbé RitifPas encore d'évaluation
- Lacan Pour Vincennes BilingüeDocument2 pagesLacan Pour Vincennes BilingüeDano Tommasi100% (1)
- Gorog, F. - Les Présentations Cliniques de Jacques LacanDocument11 pagesGorog, F. - Les Présentations Cliniques de Jacques LacanjonhgarciPas encore d'évaluation
- Lettre Mensuelle Numerique 324Document49 pagesLettre Mensuelle Numerique 324Palabreanteser1100% (2)
- Sur Les Perversions - Valas Et Miller PDFDocument36 pagesSur Les Perversions - Valas Et Miller PDFPalabreanteser1Pas encore d'évaluation
- Hysterie Et Etats Limites Andre GreenDocument24 pagesHysterie Et Etats Limites Andre GreenAnne de Beauvoir100% (1)
- Névrose obsessionnelle: Les obsessions qui corrompent la recherche et détruisent la sociétéD'EverandNévrose obsessionnelle: Les obsessions qui corrompent la recherche et détruisent la sociétéPas encore d'évaluation
- Le Point Du Vue Du Psychanalyste Au Dossier de TonusDocument3 pagesLe Point Du Vue Du Psychanalyste Au Dossier de TonusAndré LopesPas encore d'évaluation
- Lacan Structures Des Psychoses ParanoiaquesDocument13 pagesLacan Structures Des Psychoses Paranoiaquessagneh100% (3)
- La_theorie_lacanienne_de_la_pulsion_permettrait_de_faire_avancer_la_recherche_sur_l_autismeDocument14 pagesLa_theorie_lacanienne_de_la_pulsion_permettrait_de_faire_avancer_la_recherche_sur_l_autismeGelmouPas encore d'évaluation
- LOGIQUE DE L'INCONSCIENT CH FIERENS RedDocument227 pagesLOGIQUE DE L'INCONSCIENT CH FIERENS RedMónica Palacio100% (1)
- De Quelques Difficultés Dans Le Transfert Psychotique 2Document7 pagesDe Quelques Difficultés Dans Le Transfert Psychotique 2didier de brouwerPas encore d'évaluation
- Marret - Melancolía y Psicosis OrdinariasDocument5 pagesMarret - Melancolía y Psicosis OrdinariasLuis6983Pas encore d'évaluation
- Roussillon - Agonie Clivage Et SymbolisationDocument358 pagesRoussillon - Agonie Clivage Et SymbolisationJoão Pedro Peçanha100% (1)
- De La Impulsion Al Complejo 1938Document3 pagesDe La Impulsion Al Complejo 1938Julieta Bernal ChávezPas encore d'évaluation
- Plaidoyer Pour Une Certaines AnormalitéDocument22 pagesPlaidoyer Pour Une Certaines AnormalitéMANAL MOUSSAIDPas encore d'évaluation
- Marton - La Critique de Nietzsche de La Morale KantienneDocument23 pagesMarton - La Critique de Nietzsche de La Morale KantienneSherlock DestinyPas encore d'évaluation
- 15.05.3006.20 NevroseobsessionnelleDocument46 pages15.05.3006.20 NevroseobsessionnelleJu LePas encore d'évaluation