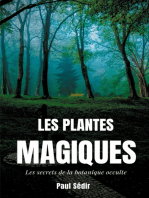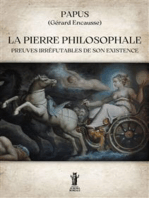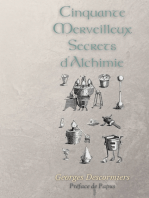Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Article 1 Feu Et Composantes PDF
Article 1 Feu Et Composantes PDF
Transféré par
Brahimlo0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
26 vues5 pagesTitre original
article_1_feu_et_composantes.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
26 vues5 pagesArticle 1 Feu Et Composantes PDF
Article 1 Feu Et Composantes PDF
Transféré par
BrahimloDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 5
_________________________________________________________________________________________
Article 1: Le feu et ses composantes, Josianne Roy, www.spiq.ca
1
par Josianne Roy, chimiste M.Sc.
Dun point de vue historique, ltude de la nature du
feu remonte lAntiquit ( 400 av. JC), o des
philosophes de lpoque comme Empdocle
croyaient que le feu tait un lment de base de
lUnivers, tout comme leau, lair et la terre. Le
mlange de ces quatre lments en proportions
diffrentes donnait la matire que lon observait
dans la nature. Le feu tait alors considr comme
un corps simple, indivisible et indestructible. Cette
thorie avait t corrobore par lobservation de la
combustion d'un morceau de bois ; pendant la
combustion (feu), il y avait production de fume
(air), de vapeur d'eau (eau) et de cendre (terre).
Par la suite, Platon (428-348 av JC) associa
llment feu au symbole du ttradre, car ctait
selon lui le plus lger des volumes rguliers et ses
artes taient les plus pointues, cest pourquoi le
feu tait piquant .
Il aura fallu attendre le 18
e
sicle pour que les premires
tudes vridiques sur le feu soient ralises. Lavoisier (1743-
1794), un chimiste franais considr comme le pre de la
chimie moderne, a t lun des premiers expliquer
vritablement la nature du feu et affirmer quil tait en
ralit le rsultat dune raction chimique active par loxygne
de lair (thorie antiphlogistique). Il est galement lauteur de
la clbre phrase Rien ne se perd, rien ne se cre, tout se
transforme , ce fameux principe de la conservation de la
masse et de lnergie qui est encore vrifi de nos jours. Dans
son Trait lmentaire de chimie de 1789, Lavoisier crivit :
Rien ne se cre, ni dans les oprations de l'art, ni dans celles
de la nature, et l'on peut poser en principe que dans toute
opration, il y a une gale quantit de matire avant et aprs
l'opration. Ainsi, puisque le mot de raisin donne du gaz
acide carbonique et de l'alkool, je puis dire que le mot de
raisin = acide carbonique + alkool.
Figure 2 : Antoine-Laurent
de Lavoisier (1743-1794)
Source : http://historyofscience.free.fr
Figure 1 : Les 4 lments de base de l'Antiquit
(leau, la terre, le feu et lair).
Source : www.astrosurf.com
_________________________________________________________________________________________
Article 1: Le feu et ses composantes, Josianne Roy, www.spiq.ca
2
Un peu plus tard, un ouvrage marquant fut ralis par le
physicien anglais Michael Faraday (1791-1867). Avec la
publication de Lhistoire dune chandelle en 1860, il
permit de comprendre les caractristiques des flammes ;
composition, temprature, coulement, couleur, fume, en
plus de prouver que la combustion produit de leau, qui
peut tre dcompose en oxygne et en hydrogne. Par la
suite, des tudes plus pousses ont permis de mieux
comprendre lorigine et la nature du feu, ce phnomne
la fois complexe et fascinant
Q QU U E ES ST T- -C CE E Q QU UE E L LE E F FE EU U ? ?
Pour la plupart des gens, le feu est reprsent par une flamme qui dgage de la
lumire, de la chaleur et de la fume.
Selon lOffice qubcois de la langue franaise (2003), le feu est dfini comme un
phnomne de combustion accompagn de flammes visibles et de fume.
De faon plus scientifique, on pourrait dfinir le feu comme tant une raction
chimique exothermique impliquant loxydation dun combustible et mettant du
rayonnement visible.
Autrement dit :
Pour comprendre le feu, il faut donc dfinir en premier lieu ce quest la combustion. Mme si
elle peut prendre plusieurs formes la combustion doit toujours runir trois lments de base
pour avoir lieu ;
1. source de chaleur (nergie dactivation, nergie thermique)
2. combustible (rducteur)
3. comburant (oxydant)
Une fois runis, ces lments peuvent amorcer une srie complexe de ractions chimiques
appeles souvent ;
4. ractions en chane
La combinaison de ces quatre lments est appele : ttradre du feu.
Figure 2 : Illustration tire de l'ouvrage
"Histoire d'une chandelle",
de Faraday, 1860.
Le feu est une combustion accompagne de flammes.
_________________________________________________________________________________________
Article 1: Le feu et ses composantes, Josianne Roy, www.spiq.ca
3
Le bilan global de cette raction est un dgagement de chaleur (exothermique) et les petits
morceaux de combustible et de comburant se recombinent sous dautres formes pour
donner des produits de combustion varis. Rien ne se perd, rien ne se cre, tout se
transforme !!!
1. CHALEUR (ou nergie thermique, nergie dactivation)
Grandeur dont l'accroissement se traduit par une augmentation de la temprature du
corps auquel elle s'applique. Forme d'nergie, perceptible par la temprature qu'elle
confre un corps.
lectrique : - statique : accumulation de charges sur une surface (frottement entre
deux mauvais conducteurs, foudre)
- dynamique : courant lectrique (appareil lectrique, ampoule, fusible)
chimique : ractions exothermiques (combustion, polymrisation, acide-base)
mcanique : potentielle et cintique (chute dun corps, frottement, choc entre 2 corps)
biochimique : ractions du monde vivant (fermentation, ractions bactriennes)
nuclaire : fusion (bombe thermonuclaire, soleil) et fission (racteur nuclaire)
naturelle : phnomnes de la nature (soleil, foudre, volcan, mtorites)
COMBUSTION
Oxydant
Chaleur
+
Produits de
combustion
+
Rayonnement
visible, UV, IR
Ex: thylne + dioxygne (air) dioxyde de carbone + eau + chaleur
C
2
H
4
(g) + 3 O
2
(g) 2 CO
2
(g) + 2 H
2
O (g) + 1323 kJ/mol
nergie thermique dpart nergie thermique finale
masse des ractifs masse des produits
2 atomes de carbone (C) 2 atomes de carbone (C)
4 atomes dhydrogne (H) 4 atomes dhydrogne (H)
6 atomes doxygne (O) 6 atomes doxygne (O)
AVANT APRS
Combustible
Chaleur
_________________________________________________________________________________________
Article 1: Le feu et ses composantes, Josianne Roy, www.spiq.ca
4
2. COMBUSTIBLE (ou rducteur)
Qui est susceptible de brler. Matire capable de brler au contact de l'oxygne en
produisant une quantit de chaleur utilisable.
La matire combustible pourrait tre divise en deux principales catgories : organique et
inorganique. Mis part quelques exceptions, la matire organique pourrait tre dfinie
comme tout ce qui contient du carbone. Par exemple, tout ce qui provient naturellement ou
qui est fabriqu partir de la matire vgtale ou animale est organique (ex : bois, papier,
polymres, cuir, charbon, gaz naturel, ). Le carbone tant combustible, on peut donc
avancer que la matire organique est combustible. De faon gnrale, aucune matire
organique ne rsiste une temprature suprieure 500 C.
linverse, la matire inorganique ne contient pas de carbone, et elle nest gnralement
pas facilement combustible, cest--dire quelle peut rsister normalement une temprature
allant jusqu 500 C. Certaines matires inorganiques peuvent brler plutt bien
(mtaux : magnsium, aluminium et non mtaux : phosphore, soufre), mais en gnral, il
leur faut plus de chaleur et leur combustion est beaucoup plus difficile.
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES
(Gaz, Liquides, Solides) (Gaz, Liquides, Solides)
ORGANIQUE ORGANIQUE INORGANIQUE INORGANIQUE
(avec carbone) (sans carbone)
+ presque toujours lhydrogne (H)
+ souvent loxygne (O)
+ parfois lazote (N)
+ autres atomes...
- mtaux : sodium (Na), Fer (Fe),
magnsium (Mg),
- non mtaux :soufre (S),
phosphore (P),
- composs : oxydes, halogns,
azots, phosphors,
Brlent bien Brlent mal
_________________________________________________________________________________________
Article 1: Le feu et ses composantes, Josianne Roy, www.spiq.ca
5
3. COMBURANT (ou oxydant)
Toute substance qui cause ou favorise la combustion. Corps qui, dans l'oxydation,
arrache les lectrons au compos chimique rducteur.
Il existe plusieurs types de matires oxydantes pouvant favoriser la combustion, la plus
courante tant loxygne (ou dioxygne) de lair (O
2
). Certains oxydants sont neutres (ex :
ozone O
3
), dautres basiques (ex : permanganate de potassium KMnO
4
) et dautres acides (ex :
acide nitrique HNO
3
). Plusieurs sont gazeux (ex : fluor F
2
), liquides (ex : acide chromique
H
2
CrO
4
), ou solides (ex : chromate dammonium H
8
CrN
2
O
4
). De plus, certains oxydants
favorisent plus ou moins fortement la combustion ; cest ce quon appelle le pouvoir oxydant.
Parmi les oxydants les plus forts, on retrouve le fluor (F
2
), lozone (O
3
), le peroxyde
dhydrogne (H
2
O
2
), le permanganate de potassium (KMnO
4
), le dioxyde de chlore (ClO
2
) et le
chlore (Cl
2
). Il est noter que les matires oxydantes elles-mmes ne sont pas combustibles.
Principaux comburants (oxydants) :
dioxygne (O
2
) : prsent dans lair environ 21 %
certains composs halogns : composs avec fluor (F), chlore (Cl) ex: hypochlorites,
chlorites, chlorates, perchlorates, brome (Br) ex: bromites, bromates, ou iode (I), ...
composs fortement oxygns : permanganates (-MnO
4
), dichromates (-Cr
2
O
7
), nitrates
(-NO
3
), phosphates (-PO
4
), ou lozone (O
3
),
peroxydes organiques et inorganiques : composs contenant dans leur structure deux
oxygnes lis (-OO-). Ex : peroxyde dhydrogne (H
2
O
2
), peroxyde de benzoyle (C
14
H
10
O
4
),
peroxyde dazote (N
2
O
4
)
En labsence dun seul de ces trois lments de base (chaleur, combustible, comburant), ou
mme de ltape qui se produit ensuite (raction en chane), un feu ne pourrait avoir lieu. Cest
dailleurs sur ce principe fondamental que les agents dextinction fonctionnent : la suppression
dun des lments du feu.
Rfrences :
DRYSDALE D., An Introduction to Fire Dynamics, Ed. Wiley, 2
nd
ed., USA, 1998, 452 p.
QUINTIERE JG., Principles of Fire Behavior, Delmar Publishers, USA, 1998, 258 p.
FRIEDMAN R., Principles of Fire Protection Chemistry and Physics, NFPA, 3e ed., USA, 1998, 296 p.
ROY G-Y., HUOT R., Chimie organique, notions fondamentales, ditions Carcajou, Qubec, 1994, 574 p.
http://historyofscience.free.fr
www.cdess.org/Chimie/Histoire_modele_atomique.pdf
www.astrosurf.com, www.bartleby.com, www.wikipedia.org
Vous aimerez peut-être aussi
- Formation Complete SSIAP3Document326 pagesFormation Complete SSIAP3AGENTSSIAP92% (74)
- Formation Complete SSIAP3 PDFDocument326 pagesFormation Complete SSIAP3 PDFABELWALID88% (8)
- Article 1 Feu Et ComposantesDocument5 pagesArticle 1 Feu Et Composantesrobin56Pas encore d'évaluation
- Chapitre IIDocument10 pagesChapitre IIKacem BazinePas encore d'évaluation
- Photosynthèse: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandPhotosynthèse: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Combustible - WikipédiaDocument20 pagesCombustible - WikipédiadilinobpfPas encore d'évaluation
- Comprehention Systeme FeuDocument34 pagesComprehention Systeme FeuLcs GjnPas encore d'évaluation
- HCGJBCHDocument10 pagesHCGJBCHAmira MiraPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 - Transformation ChimiqueDocument4 pagesChapitre 6 - Transformation Chimiqueroxane.bouskela1Pas encore d'évaluation
- Compte - Rendu Physique ChimieDocument1 pageCompte - Rendu Physique ChimieAynhPas encore d'évaluation
- Fours Et Chaudieres HasnaouiDocument18 pagesFours Et Chaudieres HasnaouiDjamila BenyoucefPas encore d'évaluation
- Lavoisier Et La Composition de L'Air: Des Phénomènes Et Des Hommes: MélangesDocument6 pagesLavoisier Et La Composition de L'Air: Des Phénomènes Et Des Hommes: MélangesmiavakanofidianaPas encore d'évaluation
- Yasser HseDocument2 pagesYasser HseyasserPas encore d'évaluation
- 4e Chap4Document5 pages4e Chap4zehwa aliPas encore d'évaluation
- Chapitre IDocument17 pagesChapitre IAmel TrabelsiPas encore d'évaluation
- Cours Sécurité Incendie Chap 1 Partie 1 2022 2023Document55 pagesCours Sécurité Incendie Chap 1 Partie 1 2022 2023grassi wajih100% (1)
- CombustionDocument12 pagesCombustionAbd El Basset BeNmansourPas encore d'évaluation
- Le Triangle Du FeuDocument6 pagesLe Triangle Du FeuLarache ThamiPas encore d'évaluation
- CarboneDocument4 pagesCarboneHELENE MOTTE -CAMPUS-Pas encore d'évaluation
- Cours Chapitre-2Document33 pagesCours Chapitre-2amiira bouzouadaPas encore d'évaluation
- ? Histoire de La Thermodynamique Classique - XVIIe Siècle - XVIIIe SiècleDocument5 pages? Histoire de La Thermodynamique Classique - XVIIe Siècle - XVIIIe SiècleAPPOLON Le NackyPas encore d'évaluation
- La CombustionDocument3 pagesLa Combustionelmouden rachidPas encore d'évaluation
- Géologie Des Combustibles SolidesDocument51 pagesGéologie Des Combustibles Solidespitir37596Pas encore d'évaluation
- Chap 2 La CombustionDocument17 pagesChap 2 La CombustionmilanoaaPas encore d'évaluation
- Cours Fours Et ChaudièresDocument23 pagesCours Fours Et ChaudièresKhalil LasferPas encore d'évaluation
- Chapitre 01 Éléments Chimiques Classe de Première Enseignement ScientifiqueDocument8 pagesChapitre 01 Éléments Chimiques Classe de Première Enseignement ScientifiqueAlix FaucretPas encore d'évaluation
- Expose PCDocument3 pagesExpose PCIaly RabenirinaPas encore d'évaluation
- CHIMIE DE LA CHAINE MACROMOLECULAIRE 2023 (Master 1)Document83 pagesCHIMIE DE LA CHAINE MACROMOLECULAIRE 2023 (Master 1)atefdinPas encore d'évaluation
- Lutte Contre L'incendie Juillet 2013Document30 pagesLutte Contre L'incendie Juillet 2013MohamedAroudam100% (1)
- Chimie 1 Chapitre 1Document22 pagesChimie 1 Chapitre 1nada benraadPas encore d'évaluation
- 1ES Acvivité 1 Eléments ChimqiuesDocument3 pages1ES Acvivité 1 Eléments ChimqiuesSidhoum SidPas encore d'évaluation
- Activité 2 SVTDocument10 pagesActivité 2 SVTsalsabile88Pas encore d'évaluation
- 19 IncendieDocument9 pages19 Incendiesaidiadamyounes711Pas encore d'évaluation
- Fernandez Hypotheses AvogadroDocument17 pagesFernandez Hypotheses Avogadroالغزيزال الحسن EL GHZIZAL HassanePas encore d'évaluation
- CombustionDocument5 pagesCombustionmechanical_engineer76Pas encore d'évaluation
- Combustion Et CombustiblesDocument35 pagesCombustion Et CombustiblesAbo KolouPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document3 pagesChapitre 1idouiPas encore d'évaluation
- Actdoc Composition AirDocument2 pagesActdoc Composition AirGALTIERPas encore d'évaluation
- Les Risques S'incendiesDocument6 pagesLes Risques S'incendiesChorouk El fouchilPas encore d'évaluation
- Combustion CoursDocument6 pagesCombustion CoursNessrine ZahiPas encore d'évaluation
- ChimieDocument13 pagesChimieDhouha GhorbelPas encore d'évaluation
- Principes de L'alchimie Et R.E.a.a.Document10 pagesPrincipes de L'alchimie Et R.E.a.a.pierre-yvesPas encore d'évaluation
- Classification Des Element Chimique PDFDocument16 pagesClassification Des Element Chimique PDFhadjeb_abdessalamPas encore d'évaluation
- Memoire ChimDocument50 pagesMemoire ChimmenofPas encore d'évaluation
- Chimie en PremièreDocument71 pagesChimie en PremièreCecile Spykiline100% (4)
- Revision Science 2Document2 pagesRevision Science 2Adel BetrouniPas encore d'évaluation
- Conséquence de La Combustion1Document9 pagesConséquence de La Combustion1Moussa El FatmiPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document28 pagesChapitre 1ahmed11102004Pas encore d'évaluation
- Formation Contre LA COMBUSTION Et L 'EXPLOSIMETRIEDocument56 pagesFormation Contre LA COMBUSTION Et L 'EXPLOSIMETRIEYahya JamaleddinePas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document4 pagesChapitre 1Nour el houdaPas encore d'évaluation
- Chef D Agres Inc 2 PDFDocument116 pagesChef D Agres Inc 2 PDFMegresAmir100% (2)
- SSIAP3.F1.L'incendie & ConséquensesDocument29 pagesSSIAP3.F1.L'incendie & ConséquensesJérôme G100% (1)
- Les Combustions - Partie 1Document4 pagesLes Combustions - Partie 1Marc EvansPas encore d'évaluation
- Les Combustions - Partie 1Document4 pagesLes Combustions - Partie 1Marc EvansPas encore d'évaluation
- Les Plantes Magiques: Les secrets de la botanique occulte : puissance secrète des végétaux, médecine hermétique, philtres de plantes magiques, et autres vertus méconnues des jardins d'alchimistes.D'EverandLes Plantes Magiques: Les secrets de la botanique occulte : puissance secrète des végétaux, médecine hermétique, philtres de plantes magiques, et autres vertus méconnues des jardins d'alchimistes.Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (3)
- La Pierre Philosophale: Preuves irréfutables de son existenceD'EverandLa Pierre Philosophale: Preuves irréfutables de son existenceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Article 1 Feu Et Composantes PDFDocument5 pagesArticle 1 Feu Et Composantes PDFBrahimloPas encore d'évaluation
- Thermo5 PDFDocument4 pagesThermo5 PDFBrahimloPas encore d'évaluation
- Micropropulsion Microcombustion PDFDocument5 pagesMicropropulsion Microcombustion PDFBrahimlo0% (1)
- D4.13.Ch4.machine Frigorifique bts94 PDFDocument3 pagesD4.13.Ch4.machine Frigorifique bts94 PDFBrahimloPas encore d'évaluation