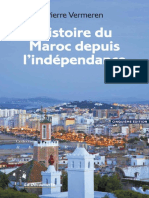Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Adam Smith - Sa Vie, Ses Travaux, Ses Doctrines
Adam Smith - Sa Vie, Ses Travaux, Ses Doctrines
Transféré par
Raul AmorimCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Adam Smith - Sa Vie, Ses Travaux, Ses Doctrines
Adam Smith - Sa Vie, Ses Travaux, Ses Doctrines
Transféré par
Raul AmorimDroits d'auteur :
Formats disponibles
DELATOUR Albert
Membre de la Socit d'conomie politique
(1886)
Adam Smith
Sa vie,
ses travaux, ses doctrines
La nature et l'homme suivent chacun les rgles qui leur
conviennent ; mais toutes ces rgles diverses tendent la
mme fin gnrale, l'ordre de l'univers, la perfection et
au bonheur de la nature humaine.
ADAM SMITH.
Un document produit en version numrique par Mme Marcelle Bergeron, bnvole
Professeure la retraite de lcole Dominique-Racine de Chicoutimi, Qubec
et collaboratrice bnvole
Courriel : mailto:mabergeron@videotron.ca
Dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales"
dirige et fonde par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web : http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
Un document produit en version numrique par Mme Marcelle Bergeron, bnvole,
professeure la retraite de lcole Dominique-Racine de Chicoutimi, Qubec
courriel : mailto:mabergeron@videotron.ca
Delatour Albert.
Une dition lectronique ralise partir du texte dAlbert Delatour, Adam Smith, sa vie,
ses travaux, ses doctrines, ouvrage couronn par lAcadmie des Sciences morales et
politiques. Paris, Librairie Guillaumin et Cie diteurs du journal des conomistes, de la
Collection des principaux conomistes, du Dictionnaire de l'conomie Politique, du
Dictionnaire universel du Commerce et de la Navigation, etc. 1886, 326 pp.
Polices de caractres utiliss :
Pour le texte : Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft
Word 2003 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 22 novembre, 2005 Chicoutimi, Qubec.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
Delatour Albert
Adam Smith
Sa vie, ses travaux, ses doctrines.
Ouvrage couronn par lAcadmie des Sciences morales et politiques. Paris, Librairie
Guillaumin et Cie diteurs du journal des conomistes, de la Collection des principaux
conomistes, du Dictionnaire de l'conomie Politique, du Dictionnaire universel du
Commerce et de la Navigation, etc. 1886, 326 pp.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
TABLE DES MATIRES
AVERTISSEMENT
PRFACE
PREMIRE PARTIE
LA VIE D'ADAM SMITH.
CHAPITRE PREMIER.
L'enfance d'Adam Smith. Sa famille. Il fait ses tudes l'cole de Kirkaldy.
Il les continue l'Universit de Glasgow sous la direction d'Hutcheson :
influence de cet illustre professeur sur l'esprit du jeune tudiant. Il est envoy
Oxford pour se prparer la carrire ecclsiastique ; il s'y distingue dans
toutes les branches des lettres et des sciences. Il renonce l'glise. Son
retour Kirkaldy. Il s'tablit Edimbourg et y fait des lectures sur la
Rhtorique et les Belles-Lettres ; succs de ces confrences. Il se lie avec
David Hume ; parallle de ces deux caractres. Il est nomm professeur de
logique, puis de philosophie morale Glasgow. Division du cours de
philosophie morale en quatre parties : thologie naturelle, thique ou morale,
jurisprudence, conomie politique. Importance relative de ces quatre parties.
CHAPITRE II.
Les premires publications d'Adam Smith : ses articles dans la Revue
d'Edimbourg. La Thorie des sentiments moraux. Lettre de flicitations
adresse Smith par David Hume. Propositions de sir Townsend. Adam
Smith donne une nouvelle direction son cours ; il accorde une plus large
place l'tude du droit et de lconomie politique. Influence de ses relations
avec les ngociants de Glasgow et leur prvt Cochrane. Succs croissant de
ses leons, Ses collgues lui confrent spontanment le grade de docteur en
droit. Il accepte la mission d'accompagner sur le continent le jeune duc de
Buccleugh.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
CHAPITRE III.
Dpart pour la France. Adam Smith donne sa dmission de professeur de
l'Universit de Glasgow. Son sjour Toulouse. Son passage Genve. Il
arrive Paris. La situation du royaume et l'tat des esprits cette poque.
Importance du mouvement conomique : attitude favorable de la Cour l'gard
des physiocrates. La querelle de Hume et de Rousseau : intervention d'Adam
Smith. Ses relations avec les conomistes. Son influence sur les doctrines
philosophiques de Turgot. Ses rapports avec le jeune duc de La
Rochefoucauld. Il profite de son sjour en France pour complter ses tudes
sur les arts imitatifs.
CHAPITRE IV.
Retour en Angleterre. Il se retire Kirkaldy. Sa solitude de dix annes. Il
songe d'abord prparer une vaste histoire de la Civilisation. Arguments
l'appui de cette hypothse ; une lettre lord Hailes. Comment il renonce
son dessein. Il rsiste aux sollicitations de David Hume qui veut l'arracher
sa retraite et l'attirer la ville. Il se livre tout entier la prparation de ses
Recherches sur la Richesse des Nations. Comment il composait.
CHAPITRE V.
Publication de la Richesse des Nations. Causes diverses de son succs.
Parallle entre l'esprit anglais et l'esprit franais au point de vue littraire.
Mort de Hume. Lettre d'Adam Smith Strahan sur les derniers moments de
son ami. Protestations du clerg contre cette apologie de l'historien cossais.
Smith passe deux annes Londres. Il est nomm commissaire gnral des
douanes en cosse. Les attaques dont la mmoire du clbre conomiste a t
l'objet de la part de M. Flourens ; rfutation de ces calomnies. Signification
vritable de l'acceptation du Dr Smith. Comment le philosophe tait peu
prpar cependant ces sortes de fonctions. Ses distractions. Il renonce
achever les ouvrages qu'il avait entrepris, notamment sur le Droit : motifs de sa
rsolution. La vie prive d'Adam Smith. Sa manire d'tre dans l'intimit.
Charmes de sa conversation ; originalit de ses jugements. Comparaison de
Smith et de La Fontaine. Son train de maison. Sa bibliothque. Les dernires
annes de sa vie ; il perd sa mre. Il est nomm recteur de l'Universit de
Glasgow. Destruction de ses manuscrits. Sa mort. Il est enterr modestement
au cimetire de Canongate. Triste tat dans lequel se trouve actuellement sa
tombe. Indiffrence des Anglais cet gard.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
DEUXIME PARTIE
SES TRAVAUX ET SES DOCTRINES.
CHAPITRE PREMIER.
Unit de l'uvre d'Adam Smith.
Comment on doit relier entre eux les divers travaux du clbre philosophe.
Opinions de Thomas Buckle et de sir W. Bagehot : discussion de ces
hypothses. On ne doit voir dans les diffrents ouvrages du matre que des
fragments d'une grande uvre destine mettre en lumire la tendance
universelle l'harmonie. Comment Smith a choisi pour cadre une histoire
gnrale de la Civilisation.
CHAPITRE II.
Travaux de Smith sur la littrature, la logique et la morale.
1 Les articles de la revue d'Edimbourg.
L'examen critique du Dictionnaire de Johnson. Divergence des jugements des
auteurs anglais sur cet article. Comment on peut concilier cependant la froideur
de Dugald-Stewart et l'enthousiasme de lord Brougham. Lettre d'Adam Smith
aux diteurs de la Revue sur le mouvement littraire en Europe. Coup d'il sur
les principales productions de notre pays. Originalit des jugements du jeune
professeur.
2. La thorie des sentiments moraux.
Sur quel point Adam Smith se spare d'Hutcheson. Expos de sa thorie. Point
de dpart vrai et consquences fausses. Inexactitude de la doctrine. Mrites
de l'ouvrage ; les observations qu'il dnote. Opinion de Victor Cousin et de
Jouffroy. Originalit des applications. L'ide de mrite et de dmrite. Le
phnomne du remords. La classification des vertus. L'ide de Dieu dans
l'uvre de Smith. Comparaison de la Thorie des sentiments moraux et des
Caractres de La Bruyre. L'histoire des systmes de philosophie morale.
Esprit dans lequel l'auteur a tudi ces systmes. Comment il distingue les
diffrentes coles.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
3. Considrations sur l'origine et la formation des langues.
Comment ce travail se rattache l'ensemble de l'uvre dAdam Smith Rsum
de l'ouvrage. Dveloppement logique du langage chez les nations primitives.
Invention successive des adjectifs, des dclinaisons et des conjugaisons.
Rvolution survenue dans le langage par suite du mlange des peuples ;
suppression des dclinaisons ; les langues deviennent plus simples dans leurs
principes et plus compliques dans leur composition.
4. Essais philosophiques.
Origine de ces Essais. Intrt qu'ils prsentent. Ce sont des fragments de l'Histoire
de la civilisation que Smith avait entreprise. L'Histoire de l'Astronomie, Cette
histoire est prcde d'une tude sur les commencements de la philosophie ;
originalit de cette tude. Les effets de la surprise sur la formation des ides et
sur la marche de l'esprit humain. Comment l'auteur considre les civilisations
europennes. Influence des aspects de la nature sur le dveloppement de
l'intellect. Rapprochement du travail de Smith et de l'ouvrage de Thomas
Buckle. L'Histoire de la physique ancienne. L'Histoire de la logique et de
la mtaphysique des anciens. L'Essai sur les arts imitatifs ; application
curieuse de la thorie de la sympathie. L'Essai sur les sens externes.
Caractres gnraux de ces diffrents Essais. Emploi de la mthode
dductive.
CHAPITRE III.
Recherches sur la nature et les causes
de la Richesse des Nations.
Comment il faut comprendre la Richesse des Nations : importance de cette
observation. Explication des nombreuses digressions historiques qu'on y
rencontre. Cet ouvrage ne doit pas tre considr comme un trait d'conomie
politique, cest une tude de l'un des principaux aspects de l'Histoire gnrale
de la civilisation. Plan suivi par Adam Smith. Ordre dans lequel il y aura
lieu d'exposer les diffrentes doctrines dissmines dans luvre du matre.
Groupement de ces doctrines dans quatre diffrentes sections, suivant qu'elles
ont trait la production, la circulation, la rpartition ou la consommation
des richesses
Section I. Production des Richesses.
Selon Smith, la production des richesses a pour principe le travail. Importance de
cette doctrine. Par quels cts elle diffre de celle des physiocrates. Ses
consquences. L'conomie politique se trouve ainsi classe parmi les sciences
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
morales. Rhabilitation du commerce et de l'industrie. Du travail productif et
du travail non productif : vritable sens de cette distinction. Opinions de J.-B.
Say et de M. Dunoyer. De la division du travail. Smith en montre les heureux
effets au point de vue conomique, mais il en dplore les rsultats au point de
vue intellectuel et moral. Fausset de sa doctrine ce dernier point de vue.
Effets de la division du travail sur la situation de l'ouvrier en temps de crise.
Invention des machines : leur influence sur la condition matrielle et morale
des classes laborieuses. De la libert du travail. Critique de l'organisation
industrielle au XVIIIe sicle en Angleterre et en France. Fondement de la
libert du travail. Doctrine leve de Turgot en cette matire.
Du capital. Distinction du stock, du capital fixe et du capital circulant :
justification de cette distinction ; son importance. Classification des
industries. Comment la classification d'Adam Smith a t modifie. M. Destutt
de Tracy et M. Dunoyer. Solidarit des industries. Expos de la doctrine
physiocratique. Ce qu'il y a de vrai et de faux dans ce systme. Il est rfut par
Condillac en mme temps que par Adam Smith : tendances diffrentes de ces
deux philosophes. Prfrences du matre pour l'agriculture. Il recherche les
causes qui lont dcourage : les grands domaines et les lois de substitution ; le
mode de tenure des terres (servage et mtayage) ; l'organisation industrielle et
commerciale.
Section II. Circulation des Richesses.
L'change et la valeur. Valeur en usage et valeur en change : importance de
cette distinction. Selon Smith, le travail est la commune mesure des valeurs.
Critique de cette doctrine. Il n'y a pas de commune mesure des valeurs. La
valeur se rgle sur les frais de production, mais elle est dtermine par la seule
loi de l'offre et de la demande
Les prix : prix de march et prix naturel. Thorie de la monnaie. Ses origines, son
rle, ses caractres essentiels. Ce n'est pas un pur signe ; c'est une marchandise
qui porte sa valeur en elle-mme. Intervention de l'tat dans la frappe des
monnaies et dans le choix de l'talon. Causes des variations de la valeur de
l'argent. Rapidit croissante de la circulation montaire. Substitution du
papier aux espces mtalliques : avantages de cette substitution partielle.
Thorie de la circulation fiduciaire. Banques de circulation. Libert des
banques. Les missions de billets sont contenues dans des limites
infranchissables. Inconvnients d'une rduction excessive du stock
mtallique : les crises montaires
Le systme mercantile. Son point de dpart. Craintes de voir diminuer le numraire
dans le pays. Thorie de la balance du commerce. Rfutation de ce systme.
Solidarit commerciale des nations. Avantages de la libert du commerce.
Les procds du systme mercantile. Entraves l'importation des
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
marchandises trangres : protection des industries ncessaires la dfense du
pays ; compensation ; reprsailles. Encouragements l'exportation des
produits manufacturs au moyen de drawbacks, primes, traits de commerce,
tablissements coloniaux. Mesures destines favoriser l'importation et
empcher l'exportation des matires premires et des instruments de travail.
Condamnation de ces divers rglements.
Section III. Distribution et rpartition des Richesses.
Parties constituantes du prix des marchandises. Le salaire. Constitution du
salariat. Le taux des salaires. La hausse des salaires est lie l'accroissement
des capitaux. Du salaire naturel et du salaire minimum. Opinion d'Adam
Smith sur les grves et les coalitions. De l'ingalit des salaires dans les
diverses industries.
Le profit, l'intrt et le loyer. Ce que lauteur entend par profit. Caractres
communs de l'intrt et du loyer. Lgitimit de l'intrt. Causes des
variations du taux de 1'intrt Quelle t l'influence de la dcouverte des
mines d'or de l'Amrique ? La baisse de lintrt est-elle un bien dans tous les
cas ? Opinions opposes de Turgot et d'Adam Smith. De la limitation lgale
du taux de l'intrt
De la rente de la terre. Inexactitude de la thorie de Smith. Lgitimit de cette
rmunration du propritaire. Comment la suppression de la rente ne
diminuerait en rien le prix des subsistances. Le taux de la rente a une
tendance gnrale la hausse. En quoi la doctrine d'Adam Smith diffre de
celle de Ricardo.
Section IV Consommation des Richesses.
L'pargne. Son rle puissant. Est-elle toujours un bien ? Consommations
improductives et consommations reproductives. Rle ngatif de l'tat dans la
formation de l'pargne.
Consommations publiques. Limites troites dans lesquelles Adam Smith a
restreint les dpenses de l'tat : dfense du pays ; police ; administration de la
justice ; travaux publics ; protection du commerce des nationaux l'tranger ;
instruction publique ; cultes. Exposition et discussion des ides de Smith sur
ces diffrentes fonctions de l'tat. Victor Cousin reproche l'auteur d'avoir
banni la bienfaisance du domaine de l'tat, Justification de la doctrine
gouvernementale des Recherches : dangers de la charit lgale. L'tat et le
commerce tranger : la politique coloniale.
Les sources du revenu de ltat. Le domaine priv. Comment Smith le
comprenait. Domaine industriel, domaine agricole, domaine forestier.
L'impt. Les principales rgles de l'impt : galit, certitude, commodit et
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
10
conomie. Influence de ces maximes sur notre lgislation fiscale.
Proportionnalit ou progression : opinion d'Adam Smith. Examen des divers
impts : leur incidence. Impt sur la rente des terres ; critique de la dme ; la
question de l'impt de quotit et de l'impt de rpartition. Impt sur le loyer
des maisons ; taxe sur les feux ; taxe sur les portes et fentres. Impts sur le
profit ou sur le revenu provenant des capitaux. Erreur de Smith en ce qui
concerne l'incidence des impts sur les profits. Droits de timbre et droits
d'enregistrement. Impts sur les salaires ; sont-ils efficaces ? Capitations.
Impts de consommation ; conclusions diffrentes d'Adam Smith suivant que
ces taxes atteignent les objets de premire ncessit ou seulement les objets de
luxe. Droits de douane.
Les emprunts. Origine des dettes publiques. Les trsors de guerre.
Comparaison de limpt et de l'emprunt. Prfrences d'Adam Smith pour le
recours l'impt dans le plus grand nombre des cas. Rfutation des erreurs de
Pinto et de Melon. De l'amortissement ; dans quelles circonstances il est
rellement efficace.
CONCLUSION
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
11
AVERTISSEMENT
Retour la table des matires
Dans sa sance du 11 juillet 1885, l'Acadmie des Sciences morales et
politiques, statuant sur le concours ouvert pour le prix Lon Faucher, a bien voulu
distinguer le travail que nous publions aujourd'hui, et elle lui a accord, avec le
premier rang, une rcompense de 2 000 francs.
Cette tude est, dans sa composition, telle que nous l'avons prsente
l'Acadmie. Nous y avons introduit seulement diverses modifications de dtail qui
nous ont t suggres par les bienveillantes critiques de nos juges.
On attaque de toute part l'cole d'Adam Smith, et, en Angleterre mme, un parti
bruyant prtend transformer de fond en comble le rgime industriel et commercial
qui a fait la richesse de ce pays. La doctrine du matre a-t-elle donc fait son temps
et devons-nous voir prochainement, comme le veut le professeur Lujo Brentano, la
fin de la priode de libert avant mme qu'elle ait atteint son complet
dveloppement ? Nous ne le croyons pas. Pour nous, la doctrine d'Adam Smith est,
dans ses grandes lignes, aussi vraie qu'elle l'tait il y a cent ans, parce qu'elle
repose sur une tude consciencieuse de la nature humaine et qu'elle met en jeu le
ressort puissant de la responsabilit individuelle ; la politique qu'elle indiquait est
donc toujours aussi ncessaire.
Nous voudrions l'avoir montr dans ce livre, et nous nous estimerions heureux
si, notre poque o les questions conomiques sont vivement discutes, nous
pouvions contribuer par l rallier quelques esprits libres de prjugs aux
principes suprieurs de la libert.
A. D.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
12
PRFACE
Retour la table des matires
En mettant au concours, pour le prix Lon Faucher, l'tude d'Adam Smith, sans
la limiter l'uvre conomique du matre, l'Acadmie des sciences morales et
politiques a tenu sans doute affirmer ainsi le lien intime qui unit les sciences
politiques aux sciences morales. On ne peut en effet qu'tre frapp dans cette
phase un peu fivreuse de la science, dans ce sicle de la spcialit o chacun veut
arriver vite en bornant ses investigations, du discrdit dans lequel sont tombes
certaines recherches fondamentales, notamment celles qui concernent la nature
humaine, l'esprit et le cur de l'homme. Des voix autorises l'ont cependant fait
remarquer assez souvent : une poque o les questions sociales sont l'ordre du
jour, o tant d'esprits distingus en font l'objet de leurs tudes, on nglige, de parti
pris, les sciences morales et on semble oublier que, pour affronter utilement
l'examen des redoutables problmes relatifs l'organisation de la socit, il est
indispensable, de connatre l'individu lui-mme, sa raison, ses passions, ses
instincts. En procdant autrement, on et vit bien des erreurs, bien des systmes
incompatibles avec la nature humaine.
Pour Smith comme pour Hutcheson, ces deux grands penseurs de l'cole
cossaise, l'tude des sciences politiques ne se comprenait pas sans l'tude
pralable du cur et de l'esprit humain, et c'est seulement aprs avoir observ
l'homme au dedans que le professeur de Glasgow a pu aborder scientifiquement et
mthodiquement l'examen des phnomnes multiples qui manifestent l'action du
moi sur les objets extrieurs dans la lutte pour la vie.
C'est cet enseignement prcieux, ce grand exemple que l'Acadmie a eu
certainement en vue, et c'est cette conviction qui nous guidera dans notre travail.
Nous nous attacherons montrer en mme temps l'unit de plan, l'unit de
conception qui se manifeste dans les uvres d'Adam Smith, si diffrentes au
premier abord, dans la Thorie des sentiments moraux qui repose sur la sympathie,
comme dans la Richesse des Nations fonde sur l'intrt. Nous verrons comment
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
13
ces monographies de la sympathie et de l'intrt ne constituent en ralit, avec les
Essais philosophiques, que des fragments spars d'une histoire plus gnrale de la
civilisation, o la grande proccupation de l'auteur est de faire ressortir, dans les
phnomnes moraux comme dans les phnomnes matriels, cette tendance
l'harmonie universelle que son esprit et son cur avaient devine.
Nous commencerons cette tude par une biographie, aussi complte que
possible, du Dr Smith ; nous nous efforcerons de nous pntrer de sa vie, de faire
connatre l'homme sous son vritable jour, en mettant surtout en lumire les
diffrentes circonstances qui expliquent ses travaux et qui ont exerc une influence
si considrable sur la tournure de son esprit et la direction de ses recherches. La
biographie, a dit en effet Rossi 1 , n'est pas sans utilit pour l'histoire de la science :
il est des faits personnels qui ont un rapport intime avec le dveloppement
scientifique de l'individu et avec les crations de son gnie. Or il en est ainsi pour
Adam Smith plus que pour tout autre.
Dans une seconde partie, nous examinerons ce qui nous reste de ses divers
travaux philosophiques ; mais, en nous inspirant de l'esprit qui semble avoir
prsid la dcision de l'Acadmie, nous n'en signalerons que les traits principaux,
nous rservant de donner une plus grande extension l'tude des doctrines
exposes dans la Richesse des Nations, cette uvre puissante qui a assis et
complt, en les rectifiant, les principes de la science conomique que Quesnay
venait de fonder, et qui, ne en France, devait se dvelopper si vigoureusement sur
le sol britannique.
Rossi. Journal des conomistes, 1842, t. II, p. 222.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
14
ADAM SMITH
SA VIE SES TRAVAUX SES DOCTRINES
_________________________________________________
PREMIRE PARTIE
LA VIE DADAM SMITH.
__________
CHAPITRE 1
________
Retour la table des matires
Sur la cte septentrionale du golfe du Forth, dans le comt de Fife (cosse),
s'tend, sur 5 kilomtres de longueur, la petite ville de Kirkaldy. C'est l que naquit
Adam Smith, le 5 juin 1723. Son pre venait de mourir. C'tait, dit-on, un homme
d'une relle valeur et trs-vers dans les affaires : il avait t d'abord secrtaire
priv du gardien du grand sceau, le comte de Londown, puis secrtaire des cours
martiales ; enfin, depuis neuf ans, il remplissait les fonctions de contrleur des
douanes au port de Kirkaldy lorsque la mort vint le surprendre.
Dans ces tristes circonstances, la naissance d'un fils fut, pour la jeune veuve,
comme une consolation ; elle donna au nouveau-n le prnom de celui qu'elle
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
15
regrettait, et, grce sa sollicitude, Adam Smith, dont la complexion tait trsdlicate, traversa aisment les preuves du premier ge.
Cependant, il n'avait pas encore trois ans lorsqu'il fut victime d'un accident qui
pouvait avoir les consquences les plus graves. C'tait Strathenry, chez M.
Douglas, son oncle, chez lequel il venait de temps en temps avec sa mre. Un jour
qu'il s'amusait devant la porte de la maison o, par hasard, on l'avait laiss seul
durant quelques instants, il fut aperu par une bande de ces vagabonds,
laccoutrement bizarre, que l'on dsigne gnralement en cosse sous le nom de
tinkers ; ces rdeurs enlevrent l'enfant et s'enfuirent au plus vite dans la fort
voisine pour se soustraire aux recherches. Heureusement, on ne tarda pas
constater la disparition du jeune Adam ; M. Douglas, accompagn de ses gens, se
mit aussitt la poursuite des malfaiteurs et il fut assez heureux pour leur arracher
leur captif qu'il remit sain et sauf dans les bras de sa mre affole.
Le reste de l'enfance de Smith se passa sans incidents. Il reut les premiers
rudiments de son ducation sous les yeux mmes de sa mre, l'cole de Kirkaldy,
qui, dirige par un homme consciencieux et actif, M. David Miller, jouissait alors
d'une rputation assez tendue. Ds cette poque, il se faisait remarquer pour sa
mmoire tonnante, servie par une vritable passion pour les livres, et il consacrait
dj l'tude ses heures de rcration, sans se mler jamais aux jeux de ses
condisciples ; d'ailleurs sa complexion dlicate lui et interdit les exercices
violents et elle l'et mis dans un tat d'infriorit continuelle l'gard de ses
camarades. Il passait son temps lire, observer ou rflchir. Dj il avait pris
l'habitude de parler seul, d'tre distrait en compagnie, et ces singularits,
s'aggravant avec l'ge, devaient donner plus tard un caractre parfois bizarre sa
physionomie. Cependant ses camarades le tournaient peu en ridicule ; il tait si
bon, si gnreux, toujours prt rendre service, que chacun l'aimait, et on lui
vitait ces sarcasmes, quelquefois pnibles et souvent impitoyables, que se
dcochent les coliers entre eux.
En 1737, l'ge de quatorze ans, il quitta Kirkaldy pour aller continuer ses
tudes la clbre Universit de Glasgow. Sa mre se rsigna avec peine cette
sparation, mais elle tait femme d'une grande valeur comme d'une rare nergie, et
son intelligente affection comprit qu'elle devait se sacrifier l'avenir de son fils.
Ce sjour de trois annes Glasgow devait avoir en effet une influence
dcisive sur la vie et les tudes d'Adam Smith. Hutcheson y professait alors avec
clat. Sa parole ardente, convaincue, qu'animait un profond amour de l'humanit,
gagnait la fois l'esprit et le cur de ses lves, et, en suivant ses leons, qui
embrassaient la fois la religion naturelle, la morale, la jurisprudence et le
gouvernement, Smith sentit se dvelopper rapidement en lui un got trs-vif pour
les sciences morales et politiques qu'il devait si brillamment illustrer un jour. La
mthode philosophique du matre fit aussi sur lui une profonde impression et il
comprit vite, l'excellence du procd scientifique qui vrifie les rsultats de
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
16
l'observation interne par les donnes qu'offrent au philosophe l'histoire gnrale,
l'histoire des sciences, des arts, de la littrature, c'est--dire l'histoire de la marche
de l'esprit humain.
Hutcheson d'ailleurs se multipliait. Outre les cinq leons qu'il faisait, chaque
semaine, pour le dveloppement de son cours, il runissait trois autres fois ses
lves pour expliquer avec eux, dans les textes originaux, les passages les plus
remarquables des grands crivains grecs ou latins qui ont trait de la morale, et, le
dimanche mme, dans la soire, il les entretenait de l'heureuse influence du
christianisme sur le dveloppement de la moralit. Smith put ainsi se pntrer des
doctrines de ce matre minent : au surplus, son cur l'y avait prpar. Comme
Hutcheson, il tait anim des sentiments les plus gnreux l'gard du peuple ;
comme lui aussi, il sentait que l'homme est fait pour tre heureux et qu'il suffit de
la libert pour le conduire au bonheur.
Mais la famille d'Adam Smith dsirait pour lui la carrire ecclsiastique, et,
dans ce but, elle voulait que le jeune tudiant allt, suivant la tradition, continuer
ses tudes en Angleterre. vrai dire, il n'avait pas de fortune ; mais il existait
Glasgow une fondation, The Snell Exhibition , qui permettait d'envoyer
Oxford quelques jeunes gens destins l'glise, et c'est ainsi que Smith partit pour
la clbre Universit, en qualit de boursier du collge de Balliol.
Son biographe Dugald-Stewart nous a appris peu de chose sur sa vie, pendant
les sept annes qu'il passa en Angleterre. De son ct, lord Brougham 1 a publi, il
est vrai, un certain nombre des lettres que le jeune tudiant adressait alors sa
mre, mais cette correspondance, qui tmoigne de sa profonde affection filiale, ne
nous fournit, par contre, aucun renseignement sur la nature de ses tudes, et elle n'a
trait le plus souvent qu' des dtails domestiques de linge ou de vtement.
Cependant ces lettres faisaient parfois aussi quelque allusion la sant du jeune
tudiant. Elles nous apprennent ainsi qu'il tait trs-dlicat, toujours souffrant, et
mme qu'au mois d'aot 1743, il fut pris d'une sorte de maladie de langueur qui le
cloua durant trois mois dans son fauteuil : c'est, assure-t-on, partir de ce moment
que les absences remarques chez lui devinrent plus frquentes.
Nanmoins, malgr ces indispositions continuelles, malgr toutes ces entraves
physiques que la nature lui opposait, Smith travaillait avec ardeur et il menait de
front les tudes les plus varies. On rapporte qu'il s'adonnait, dune manire toute
spciale, aux mathmatiques et aux sciences physiques, alors peu gotes de ses
camarades, et qu'il fit rapidement des progrs considrables. Il cultivait en mme
temps la littrature, et, grce sa mmoire prcieuse, il tonna ses amis, jusque
dans les dernires annes de sa vie, en leur citant textuellement des passages
entiers de pomes anglais qu'il avait tudis Oxford. Enfin, il consacrait un soin
1
Lives of men of letters and science who flourished in the time of George III, by Henry, lord
Brougham, 1846, 3 volumes grand in-8. London.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
17
particulier l'tude des langues tant anciennes que modernes et il y trouvait un
double avantage, s'clairant ainsi aux sources les plus pures sur les murs et les
institutions des peuples, tout en trouvant, dans l'exercice mme de la traduction, un
des meilleurs moyens de perfectionner son style.
Il s'attachait surtout se familiariser avec la langue d'Aristote, prvoyant
justement qu'il trouverait dans la lecture des philosophes de la Grce les donnes
les plus prcieuses sur l'origine des sciences et de la civilisation. Aussi, il acquit,
pour son temps, une rare connaissance de cette langue, et, s'il est vrai que, suivant
le mot du Rev. Sydney Smith, le grec n'ait jamais pass la Tweed en force, Adam
Smith en savait du moins beaucoup plus que les autres cossais de son poque ;
plus tard, dans les discussions philologiques qu'il aimait soutenir, il tonnait
encore le professeur de grec de l'Universit de Glasgow, son collgue, par une
connaissance approfondie de toutes les difficults de la grammaire grecque.
Cependant, d'un autre ct, on n'tait pas sans remarquer, l'Universit, que
Smith semblait apporter moins de zle et d'ardeur dans les recherches thologiques
qui devaient le prparer la carrire ecclsiastique, et que ses gots paraissaient au
contraire le diriger de prfrence vers des doctrines philosophiques rejetes par
l'glise. Ses suprieurs le firent surveiller et ils acquirent rapidement la certitude
que le jeune boursier se livrait des tudes qu'ils jugeaient pernicieuses : son
tutor , entrant un jour dans sa chambre l'improviste, le surprit en flagrant dlit,
plong dans la lecture du plus rcent ouvrage de Hume. Le livre fut saisi et Smith
svrement rprimand, mais sa dtermination tait prise : comme Turgot qui, lui
aussi, voulut rester laque, le jeune philosophe cossais tenait conserver
l'indpendance de ses opinions, et, renonant l'glise qui lui promettait un
brillant avenir, il retourna Kirkaldy.
Il voulait professer. En suivant, Glasgow, les cours de son matre Hutcheson,
il avait envi bien des fois cette vie calme du matre qui passait une moiti de son
temps s'instruire lui-mme et l'autre moiti communiquer aux autres le rsultat
de ses tudes. Mais les chaires taient rares, les postulants nombreux, et Smith,
sans fortune, aprs avoir pass deux ans dans l'attente, allait se voir oblig
d'crire pour les libraires . Comme il nous l'a appris lui-mme dans ses
Recherches, la misre tait alors le sort commun des gens de lettres : La plupart
d'entre eux, dans toutes les parties de l'Europe, disait-il plus tard 1 , ont t levs
pour l'glise, mais ils ont t dtourns, par diffrentes raisons, d'entrer dans les
ordres ; ils ont donc, en gnral, reu leur ducation aux frais du public et leur
nombre est partout trop grand pour que le prix de leur travail ne soit pas rduit
communment la plus mince rtribution .
Heureusement, il y avait alors Edimbourg une aristocratie intelligente qui
cultivait les lettres et les protgeait. sa tte se trouvait lord Kames, personnage
1
Richesse des Nations. Liv. I, ch. X (t. I, p. 174.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
18
d'un esprit tendu et actif, qui aimait se dlasser des fatigues du barreau, soit en
tudiant la philosophie, la littrature et les sciences, soit mme en se livrant
l'agriculture ; c'est lui qui introduisit en cosse les amliorations de la culture
anglaise et qui devait donner plus tard, dans son Gentilhomme fermier 1 , sur un
grand nombre de questions agricoles, des conseils encore couts de nos jours.
Lord Kames eut l'occasion de rencontrer Adam Smith, et, frapp des
connaissances tendues de ce jeune homme de 25 ans sur les divers sujets que luimme affectionnait, il lui persuada de s'tablir Edimbourg et d'y faire des cours
publics qu'il s'engagea patronner. Ces confrences, que les Anglais appellent des
lectures , roulrent sur les belles-lettres et sur la rhtorique : elles eurent un
plein succs. Les auditeurs, d'abord peu nombreux, que le nom et l'influence de
lord Kames avaient attirs, furent sduits par l'esprit nouveau qui animait ce cours,
comme par la clart de l'exposition des ides, et leur enthousiasme acquit
rapidement Smith une grande rputation locale. De nombreux tudiants,
principalement en droit et en thologie, dsertrent les cours de l'Universit pour
assister ses lectures. Il compta parmi ses lves des hommes qui devaient
occuper plus tard de hautes situations dans l'glise, la politique, la magistrature,
les lettres, et, parmi eux, Guillaume Johnstone, connu depuis sous le nom de
William Pulteney 2 ; Wedderburn, qui fut baron de Loughborough, comte de
Rosslyn et grand chancelier d'Angleterre ; enfin Hugh Blair, qui, devenu premier
ministre de la Haute glise, devait reprendre dans la suite et continuer pendant
vingt-quatre hivers, l'Universit de Saint-Andr, ces cours de rhtorique qu'avait
inaugurs Adam Smith. Son aimable simplicit lui gagna leurs curs et chacun
d'eux tint rester de ses amis.
Bien que Smith ne comptt jamais sur sa mmoire et que toutes ses confrences
aient t crites, au moins en substance, il ne nous en reste malheureusement rien.
Nous savons seulement que l'auteur avait runi ses leons en un Trait qu'il se
proposait de publier, et Hugh Blair en a dit quelques mots dans une note de ses
Lectures on the Rhetoric and Belles Lettres, qui parurent en 1783 : En traitant,
crit ce prlat 3 , des caractres gnraux du style, et en particulier du style simple,
et en rangeant les auteurs anglais sous certaines classes relatives cet objet, j'ai
emprunt plusieurs ides d'un trait manuscrit sur la rhtorique, de M. Adam
Smith. Une partie de ce manuscrit me fut communique, il y a plusieurs annes,
par son ingnieux auteur, et il y a lieu d'esprer qu'il le publiera en entier. Mais,
aprs l'ouvrage de Blair, qui tait le couronnement de toute une vie de professorat
sur la matire, le Trait de Smith et ncessairement paru un peu vieilli ; il n'tait
1
Le Gentilhomme fermier ou Essai pour perfectionner l'agriculture en la soumettant l'preuve
des principes rationnels (1776).
C'est Pulteney qui, en 1797, dans un de ses discours sur les finances, en appela, dans le
Parlement, l'autorit du Dr Smith qui persuaderait la gnration prsente et gouvernerait la
prochaine (the authority of Dr Smith would persuade the present generation and govern the
next). (Parliamentary History, t. XXIII, p. 778.)
Cours de Rhtorique et de Belles-Lettres, par Hugh Blair, traduit de l'anglais par Pierre Prvost.
Paris, 2e dition. Delalain, 1821, 2 vol. in-8.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
19
d'ailleurs plus ncessaire, et, dans ces conditions, il n'aurait pu que nuire la
rputation de l'auteur. Le philosophe cossais s'en rendit compte et nous ne
pouvons trop l'en blmer : il eut en effet la modestie et le bon sens de reconnatre
que ce qu'il aurait voulu dire tait dj dit et bien dit, et il renona son dessein.
On ne peut cependant que regretter, au point de vue historique et documentaire, la
destruction de ces papiers qui auraient permis de suivre, d'une manire fort
intressante, la marche de cet esprit suprieur depuis ses premiers travaux.
Smith resta ainsi trois ans Edimbourg, o sa mre l'avait suivi. Sa rputation
de lecturer , son affabilit et aussi l'amiti de lord Kames lui attirrent
rapidement de nombreuses relations : c'est cette poque, notamment, qu'il se lia
avec David Hume, auquel il conserva toute sa vie l'amiti la plus inaltrable.
On s'est souvent tonn, quelquefois mme scandalis, de l'intimit qui existait
entre ces deux hommes, de caractres en apparence si diffrents. C'est qu'on les
connaissait mal tous les deux : le mobile de leurs tudes tait le mme, l'amour du
bien public, et leur constante proccupation tait de combattre les privilges et les
monopoles qui crasaient le peuple. Tous deux taient donc d'accord sur le but
atteindre, qui tait de dissiper les erreurs et les prjugs de toute sorte, au nom
desquels on entravait la libert humaine, et c'tait cette communaut de vues qui
les unissait si troitement l'un l'autre. Ils diffraient absolument, il est vrai, et
sur le fondement de cette libert individuelle quils invoquaient tous deux, et sur
les moyens employer pour faire prvaloir leurs ides. David Hume, dont le gnie
avait mri en France et chez qui on retrouvait les dfauts comme les qualits de
nos philosophes du XVIIIe sicle, voulait aller droit au but, sans mnagement pour
les intrts, sans respect pour les situations acquises. Smith, au contraire, durant les
sept annes qu'il avait passes Oxford, avait subi l'influence de l'esprit anglais,
plus terre--terre que l'esprit franais, mais aussi plus politique ; d'un temprament
plus calme que son ami, il cherchait mnager les transitions, il redoutait les
rformes trop brusques, trop radicales, et il tait persuad, comme il l'a dit luimme, que c'est une folie que de vouloir disposer des diffrentes parties du corps
social aussi librement que des pices d'un jeu d'checs . Il tait mesur dans ses
affections comme dans ses antipathies ; de mme que tout cossais, il aimait la
France comme une seconde patrie et il ne dissimulait pas toujours son
mcontentement de l'attitude des Anglais l'gard de ses compatriotes, mais il ne
faisait jamais en cela preuve de parti pris et il ne partageait nullement l'hostilit
systmatique de Hume l'gard de l'Angleterre. Leurs opinions en matire
thologique taient galement loin d'tre les mmes, car Smith croyait fermement
une autre vie, comme le tmoignent certains passages de la Thorie des
sentiments moraux, et si, en parlant des pratiques religieuses, il s'est montr parfois
choqu de certaines crmonies au milieu desquelles il avait t lev, il vita
toujours avec le plus grand soin ces polmiques passionnes qui soulevaient tant
de temptes autour de son ami et qui lui amassaient tant de haines 1 . Toutefois,
1
Les sujets religieux taient d'ailleurs abords rarement dans les conversations de Hume avec ses
amis. Dans ses causeries comme dans ses lettres, dit M. Compayr, la philosophie et la
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
20
malgr ces divergences qui avaient leur source principale dans la diffrence de
l'ducation et du temprament, ces deux grands esprits taient faits pour se
rapprocher, et Smith tait fier d'tre l'ami de celui qu'il appelle quelque part
(l'historien le plus illustre de son sicle 1 . Chez tous deux, en effet, la mme
droiture, le mme amour de l'humanit, le mme but : c'en tait assez pour se
comprendre et pour s'apprcier.
Smith avait donc acquis, du premier coup, une place considrable dans la
socit intelligente d'Edimbourg. De l, sa rputation s'tendit rapidement dans le
reste de l'cosse, et, ds l'anne 1751, l'Universit de Glasgow lui offrait la chaire
de logique et le titre de professeur. Il atteignait ainsi, ds l'ge de 28 ans, l'une des
situations les plus envies des savants de son pays, et sa joie fut profonde lorsqu'il
se vit appel enseigner dans cette Universit qu'il affectionnait et qui avait ouvert
son intelligence aux ides philosophiques.
Toutefois, surpris par cette nomination qu'il n'avait pas os esprer, Smith
n'avait pu prparer son cours, et, pour se donner du temps, il se contenta d'abord de
reprendre, au moins dans ses grandes lignes, celui qu'il avait profess Edimbourg
sur la rhtorique et les belles-lettres. C'est l, croyons-nous, la vritable raison du
plan qu'il adopta et que des biographes trop zls ont cherch expliquer par le
seul intrt des lves.
Comme nous l'avons dj dit, il ne nous reste rien de l'enseignement du matre
sur cette matire, sauf son petit Trait de la formation des langues et quelques
tudes publies aprs sa mort sous le titre d'Essais philosophiques. Heureusement
Dugald Stewart nous a transmis un court prcis de ces leons, crit par un des
lves les plus assidus et les plus distingus du jeune professeur : cet lve tait M.
Millar, qui devait obtenir plus tard, sur la recommandation dAdam Smith, la
chaire de droit l'Universit d'Edimbourg, et qui se fit connatre surtout par son
intressante Historical view of the English government .
Dans le professorat de logique, dit M. Millar, dont Smith fut revtu son
entre dans l'Universit, il sentit bientt la ncessit de s'carter beaucoup du plan
suivi par ses prdcesseurs et de diriger l'attention de ses disciples vers des tudes
plus intressantes et plus utiles que la logique et la mtaphysique des coles. En
consquence, aprs avoir trac un tableau gnral des facults de l'esprit humain et
avoir expliqu de la logique ancienne autant qu'il en fallait pour contenter la
curiosit sur la mthode artificielle du raisonnement, qui avait occup pendant un
religion taient, d'un accord tacite, des sujets rservs. Les amis religieux de Hume se taisaient
avec lui sur ces questions, comme on se tait devant un infortun sur le malheur qui l'a frapp.
Et, de son ct, Hume, qui n'avait pas l'esprit de propagande et qui savait assez de psychologie
pour ne pas se faire illusion sur lefficacit de la discussion, vitait d'engager des controverses
qui aigrissent et divisent les curs, sans presque jamais rapprocher les esprits. (LI Philosophie
de Hume, par M. Gabriel Compayr. Paris, 1873.)
Richesse, t. II, p. 451.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
21
temps l'attention des savants d'une manire exclusive, il consacra tout le reste du
cours un systme de belles-lettres et de rhtorique. La meilleure mthode pour
expliquer et analyser avec clart les diverses facults de l'esprit humain (partie la
plus utile de la mtaphysique), se fonde sur un examen attentif des artifices du
langage, des moyens divers de communiquer nos penses par la parole, et, en
particulier, des principes par lesquels les compositions littraires peuvent plaire ou
persuader. Les arts qui s'occupent de cette recherche nous accoutument bien
exprimer ce dont nous avons la perception ou le sentiment, peindre, pour ainsi
dire, chaque opration de notre esprit d'une manire si nette qu'on peut clairement
en distinguer toutes les parties et en conserver le souvenir. En mme temps, il n'est
aucune branche de la littrature plus assortie l'ge des jeunes gens qui
commencent la philosophie, que ces tudes qui s'adressent au got et la
sensibilit. Il est fort regretter que le manuscrit des leons de Smith sur ce sujet
ait t dtruit avant sa mort. La composition de la premire partie tait finie avec
soin et tout l'ouvrage tait empreint de traits fortement prononcs, d'un got pur et
d'un gnie original. La permission accorde aux tudiants de prendre des notes a
fait connatre plusieurs observations contenues dans ce cours ; les unes ont t
dveloppes dans des dissertations spares, les autres insres dans des
collections gnrales et livres au public sous diffrentes formes. Mais il est arriv,
comme on avait lieu de s'y attendre, qu'elles ont perdu leur air d'originalit et le
caractre distinctif que leur auteur avait su leur imprimer, en sorte qu'on ne les
voit, la plupart du temps, qu' travers l'obscurit dont les recouvre une abondance
de lieux communs dans lesquels elles sont perdues, et, pour ainsi dire, submerges.
Ces renseignements, fournis par M. Millar quarante ans aprs ce cours de
logique, sont ncessairement bien vagues. Nous eussions aim, notamment,
connatre l'opinion de Smith sur la nature mme de la logique. Voyait-il dans la
logique une science ou un art ? La considrait-il comme une science qui doit se
borner tudier les lois du raisonnement, ou bien comme un art, qui, savamment
dirig, peut mener l'homme la vrit ? D'aprs l'ensemble des opuscules qui
nous restent, le Trait de la formation des langues, l'Histoire de lAstronomie et
celle de la Physique ancienne, il serait peut-tre permis de croire qu'Adam Smith
partageait la premire opinion, mais nous devons avouer que nous ne possdons
aucune donne certaine pour appuyer cette prsomption.
D'ailleurs, Smith ne conserva pas longtemps sa chaire de logique, et, moins
d'une anne aprs son lection, il tait appel celle de philosophie morale, en
remplacement de son collgue Thomas Craidgie. Il tait arriv au comble de ses
vux. Professer dans cette chaire mme qu'avait illustre Hutcheson, continuer la
tradition philosophique de son matre, cette mthode exprimentale qu'il avait
acclame avec enthousiasme, c'tait, pour un jeune homme de 29 ans, un honneur
insigne, mais aussi un lourd fardeau. L'Universit, qui avait dj pu apprcier son
ancien lve, avait eu foi dans son talent, dans son caractre, dans la puissance de
son travail. Il justifia pleinement cette confiance, et, bientt, le succs de ses cours
dpassa mme celui qu'avaient obtenu les leons du fondateur de l'cole cossaise.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
22
Il reprit, en le modifiant lgrement, le plan d'Hutcheson. Ce dernier, nous
l'avons dit, n'avait pas seulement profess la philosophie morale ; il s'tait occup
longuement de la religion, du droit naturel et politique dont l'tude lui avait sembl
indispensable pour prmunir les jeunes gens contre les dangereuses doctrines de
Hobbes ; il avait enfin rserv quelques leons l'examen des phnomnes de la
richesse et la rfutation des erreurs funestes sur la fausset desquelles des esprits
minents, tels que Pelty et Locke lui-mme, s'taient vainement efforcs jusque-l
d'attirer l'attention publique. De mme, Adam Smith divisa son cours en quatre
parties : la premire fut consacre la Thologie naturelle, la seconde l'thique
proprement dite, la troisime la Jurisprudence, la quatrime l'conomie
politique.
Les doctrines morales et conomiques qu'il dveloppa, durant ce professorat,
nous sont connues par la Thorie des sentiments moraux et les Recherches sur la
Richesse des Nations, que nous tudierons plus loin d'une manire assez complte ;
mais nous manquons de donnes aussi certaines en ce qui concerne les deux autres
parties de son cours. Il prpara cependant, ds 1759, un grand ouvrage sur le Droit
civil et politique et il y consacra, cette poque, une grande partie des loisirs que
lui laissaient ses fonctions ; il y travailla aussi plus tard, dans les dernires annes
de sa vie, mais, n'ayant pu le terminer, il a prfr l'anantir. Nous sommes donc
encore oblig de nous reporter aux souvenirs trop rtrospectifs de M. Millar sur
cette troisime partie du cours de son matre.
D'aprs ce jurisconsulte, Smith aurait suivi, en cette matire, un plan qui
semblait lui avoir t suggr par Montesquieu, s'appliquant tracer les progrs de
la jurisprudence, tant publique que prive, depuis les sicles les plus grossiers
jusqu'aux sicles les plus polics ; puis, indiquant avec soin comment les arts qui
contribuent la subsistance et laccumulation de la proprit agissent sur les lois
et sur le gouvernement pour y amener des progrs et des changements analogues
ceux qu'ils prouvent.
Il est vraiment regrettable que nous ne possdions rien de plus complet sur ces
leons, qui durent tre certainement trs remarquables. Il et t fort intressant de
voir le sagace observateur des causes de la Richesse des Nations s'efforant
d'expliquer, comme il le dit lui-mme 1 , les principes gnraux des lois et du
Gouvernement, ainsi que les changements dont ils ont t l'objet aux diffrents
ges de la socit, non-seulement sous le rapport de la justice, mais encore
relativement la politique, aux finances, aux armes et aux divers aspects que la
lgislation embrasse . Peu de temps avant la mort du matre, on esprait encore
que ce fameux manuscrit verrait le jour, et le Moniteur Universel du 11 mars 1790
annonait mme qu'il allait tre publi sous forme d'un Examen critique de l'Esprit
des Lois. Ce livre tait, disait-on, le rsultat de plusieurs annes de mditations et
promettait de faire poque dans l'histoire de la politique et de la philosophie.
1
Thorie des sentiments moraux, VIIe partie, IVe section.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
23
Malheureusement il ne parut pas : Smith mourut avant d'avoir ralis son dessein
et le manuscrit eut, suivant son dsir, le sort de ses autres papiers.
Nous n'avons pas de plus amples renseignements sur sa Thologie naturelle.
Nous savons, il est vrai, qu'il exposait, dans son cours, les preuves de l'existence de
Dieu, de ses attributs, ainsi que les principes ou facults de l'esprit humain sur
lesquels se fonde la religion, et sa Thorie des sentiments moraux tmoigne, dans
plusieurs passages, de ses convictions profondes en l'immortalit de l'me 1 .
Nanmoins nous eussions aim connatre plus compltement la Thodice du
philosophe cossais, la fois disciple d'Hutcheson et intime ami de Hume, car il
et t curieux de rechercher dans sa doctrine l'action de ces deux influences si
opposes.
Il parat, cependant, qu'il insistait peu sur cette partie de son cours. L, en effet,
il ne pouvait que suivre le sentier battu, car les questions religieuses ayant toujours
t en grand honneur en cosse, elles y donnaient lieu, depuis des sicles, des
discussions thologiques fort subtiles, mme dans les classes moyennes de la
socit.
Il prfrait, au contraire, des recherches plus personnelles, et le caractre le
plus saillant de ses confrences consistait surtout dans l'originalit et la nouveaut
des ides. Il ngligeait volontiers les points acquis, mais il insistait sur ses thories
particulires, les exposant avec clart, puis, par une mthode habile, en dmontrant
l'exactitude au moyen de faits consciencieusement observs et savamment
prsents. En dfendant ainsi ses propres doctrines, il montrait une conviction, une
chaleur qui lui gagnait tous les curs et c'tait l l'un des principaux lments de
son succs. Comme on le voyait s'intresser son sujet, crivait M. Millar, il ne
manquait jamais d'intresser ses auditeurs. Chaque discours consistait
communment en diverses propositions distinctes qu'il s'appliquait prouver et
claircir successivement : ces propositions, nonces en termes gnraux, avaient
assez souvent, par l'tendue de leur objet, un air de paradoxe. Dans les efforts qu'il
faisait pour les dvelopper, il n'tait pas rare de le voir, au premier abord, comme
un homme embarrass et peu matre de son sujet, parler mme avec une sorte
d'hsitation. Mais, mesure qu'il avanait, la matire semblait s'entasser devant
lui, sa manire devenait chaude et anime, son expression aise et coulante. Dans
les points dlicats et susceptibles de controverse, vous auriez dml sans peine
qu'il avait en secret la pense de quelque opposition ses opinions et qu'en
consquence il se sentait engag les soutenir avec plus d'nergie et de
vhmence. L'abondance et la varit de ses explications et de ses exemples
faisaient crotre son sujet tandis qu'il le maniait. Ainsi, bientt il acqurait, sans
aucune rptition d'ides, une tendue et une grandeur qui saisissaient l'attention
de son auditoire. L'instruction tait seconde par le plaisir qu'on prenait suivre le
mme objet travers une multitude de jours et d'aspects varis sous lesquels il
1
Voir Thorie des sentiments moraux, p. 94 et 102.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
24
savait le prsenter, et enfin, remonter avec lui, en suivant toujours le mme fil,
jusqu' la proposition primitive ou la vrit gnrale dont il tait parti et dont il
avait su tirer tant d'intressantes consquences.
Aussi la rputation de Smith allait sans cesse grandissant et attirait
l'Universit une foule d'tudiants anims du dsir de l'entendre. L'objet de ses
cours dfrayait toutes les conversations de la haute socit de Glasgow et mme
d'Edimbourg ; la mode s'en mlant, il devint bientt de bon ton de parler comme le
professeur en renom ; on chercha mme copier ses expressions les plus
familires et jusqu' ses dfauts de prononciation ou d'accent : son succs tait
complet.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
25
CHAPITRE II
________
Retour la table des matires
Cependant Adam Smith ne se livrait pas tout entier l'exercice de son
professorat. Assurment il respectait trop ses auditeurs pour ngliger de prparer
l'avance la matire et le plan de ses leons, ainsi que l'enchanement des ides qu'il
se proposait d'y exposer ; nanmoins, il ne s'inquitait pas outre mesure de la
forme, se fiant gnralement cet gard sa facilit d'improvisation, et il
conomisait ainsi un temps prcieux qu'il put consacrer d'autres travaux.
Ds 1755, il fondait, avec Hugh Blair, le fameux historien Robertson et d'autres
hommes de lettres minents, une publication priodique the Edimburgh
Review , et il y faisait paratre successivement deux articles, l'un sur le
Dictionnaire de Johnson, qui venait de faire son apparition, l'autre, sous la forme
d'une Lettre aux diteurs, sur le mouvement littraire en Europe. Ces deux tudes,
que nous aurons examiner dans la deuxime partie de ce travail, furent fort
remarques ; mais elles n'empchrent pas la disparition de la Revue, qui tomba,
aprs la deuxime livraison, sous les coups d'une coterie dirige contre quelquesuns des rdacteurs.
En mme temps, Smith prparait un grand ouvrage sur la morale. En effet, dans
ses leons sur l'thique, il n'avait pas accept entirement la doctrine d'Hutcheson.
Comme le fondateur de l'cole cossaise, il professait que le sentiment est le
principe de la morale ; mais il diffrait avec lui sur la nature de ce sentiment,
croyant le trouver dans la sympathie plutt que dans la bienveillance. C'est ce
dissentiment qu'il voulait justifier par un livre.
La Thorie des sentiments moraux parut en 1759. Nous n'entreprendrons pas ici
de faire l'analyse et la critique de cet important ouvrage que nous nous proposons
d'examiner plus loin avec tout le soin qu'il comporte, mais nous pouvons dire ds
maintenant qu'il eut un immense succs. Quelque opinion que l'on pt avoir, en
effet, sur le fond mme de la doctrine de l'auteur, il tait impossible de ne pas tre
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
26
sduit par les observations dlicates et consciencieuses, les aperus fins et
ingnieux de cette tude de la sympathie, et ces mrites furent parfaitement
apprcis par la socit cossaise, naturellement porte vers les recherches
psychologiques. Aussi le trait de Smith provoqua un tel enthousiasme que, malgr
les prventions nationales des Anglais de cette poque l'gard des ouvrages crits
au del de la Tweed, ce succs gagna leur pays, et, bientt mme, la Thorie des
sentiments moraux fit fureur Londres.
D'ailleurs, David Hume tait alors en Angleterre, et, bien que les doctrines
philosophiques d'Adam Smith ne fussent nullement les siennes, il mettait tout en
uvre pour faire connatre le livre de son ami. Wedderburn et moi, crivait-il
Smith le 12 avril 1759, nous avons fait don de nos exemplaires des personnes de
notre connaissance que nous estimons tre bons juges et propres rpandre la
rputation de l'ouvrage. J'en ai envoy un au duc d'Argyle, au lord Littleton,
Horace Walpole, Soame Jenins et Burke, gentilhomme irlandais, qui a crit en
dernier lieu un trs-joli Trait du Sublime. Millar m'a demand la permission d'en
envoyer un au Dr Warburton.
Le succs du livre s'affirma donc ds les premiers jours, et, par cette mme
lettre dont nous venons de citer quelques lignes, Hume pouvait dj l'annoncer
Adam Smith. Il le fit dans des termes si spirituels que nous ne pouvons rsister au
dsir de reproduire certains passages de ce document, d'autant plus qu'il nous fait
bien connatre le degr d'intimit qui existait entre les deux philosophes. Sachant
Smith trs-inquiet sur le sort de son livre, Hume se plat se jouer de son
impatience ; il lui parle de choses et d'autres, d'un ami recommander, d'ouvrages
en cours de publication, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'y a qu'une seule nature
de faits qui puisse intresser ce moment son interlocuteur, prenant ainsi plaisir
agacer le jeune professeur dont il connat le caractre bouillant :
Mais qu'est-ce que tout cela fait mon livre, dites-vous ? Mon cher
monsieur Smith, prenez patience, disposez votre me la tranquillit ; montrezvous philosophe pratique, comme vous l'tes par tat ; pensez la lgret, la
tmrit, la futilit des jugements ordinaires des hommes : combien peu la raison
les dirige dans tous les sujets, mais surtout dans les jugements philosophiques, qui
passent de beaucoup la porte du vulgaire :
Non si quid turbida Roma
Elevet, accedas ; examenve improbum in illa
Castiges trutina : nec te quasiveris extra.
Le royaume du sage, est dans son propre cur ; ou, si jamais il tend plus
loin ses regards, il se borne au jugement d'un petit nombre d'hommes choisis,
libres de prjugs et capables de l'apprcier. Rien, en effet, ne peut donner une plus
forte prsomption de fausset que l'approbation de la multitude, et Phocion, vous
vous en souvenez, souponnait toujours qu'il avait dit quelque sottise quand il se
voyait accueilli par les applaudissements de la populace. Supposant donc que par
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
27
ces rflexions vous tes prpar tout, j'en viens enfin vous annoncer que votre
livre a prouv le plus fcheux revers, car le public semble dispos l'applaudir
l'excs. Il tait attendu par les sots avec impatience et la tourbe des gens de lettres
commence chanter trs-haut ses louanges. Trois vques passrent la boutique
de Millar pour l'acheter et pour s'informer de l'auteur. L'vque de Peterborough
dit qu'il avait pass la soire dans une socit o on levait ce livre au-dessus de
tous les livres de l'univers. Le duc d'Argyle parle en sa faveur d'une manire plus
dcide qu'il n'a coutume de le faire ; j'imagine qu'il le considre comme une
production exotique ou qu'il croit que l'auteur pourra lui rendre service aux
lections de Glasgow, Lord Littleton dit que Robertson, Smith et Bower sont la
gloire de la littrature anglaise. Oswald proteste qu'il lui est impossible de juger s'il
a trouv dans ce livre plus d'instruction ou plus de plaisir ; mais vous voyez bien
quel cas on peut faire du jugement d'un homme qui a pass sa vie dans les affaires
et qui n'a jamais vu aucun dfaut dans ses amis. Millar triomphe et se vante que les
deux tiers de l'dition sont dj couls et qu' prsent le succs n'est plus douteux.
Vous voyez que c'est un fils de la terre qui n'value les livres que par les profits
qu'il en tire. Sous ce rapport, je ne doute pas que ce ne soit l un excellent livre.
Charles Townsend, qui passait pour l'un des meilleurs juges de l'Angleterre,
fut, lui aussi, sduit par l'originalit de cet ouvrage, et cette circonstance devait
avoir une influence dcisive sur la vie de l'auteur, car le succs mme de son livre,
qui affermissait et tendait sa rputation comme philosophe, allait avoir cet effet
bizarre de le dterminer indirectement abandonner la chaire de philosophie
morale qu'il venait d'illustrer.
En effet, Charles Townsend tait devenu, par son mariage avec la duchesse, le
beau-pre du jeune duc de Buccleugh, et, dsirant complter l'ducation de ce
gentilhomme par un voyage sur le continent, il songeait depuis quelque temps
confier un matre minent la mission de l'accompagner. La lecture de la Thorie
des sentiments moraux dsigna Smith son attention. Il ne connaissait pas
personnellement le philosophe cossais ; nanmoins son livre rvlait une si
grande finesse d'observation, un savoir si tendu, et en mme temps un cur si
gnreux, qu'il se persuada bien vite que nul mieux que l'auteur de cet admirable
ouvrage ne serait capable de diriger utilement le voyage de l'hritier du nom des
Buccleugh. De son ct, Oswald, l'un des meilleurs amis de Smith, l'encouragea
dans son dessein, et Hume, prvenu, chercha plusieurs fois le rencontrer, dans le
but de le dcider. Sir Townsend n'avait d'ailleurs pas besoin de sollicitations pour
persister dans son projet : dun caractre obstin et surtout autoritaire, il tenait
imposer ses volonts, et les rsistances qu'il sentit dans l'entourage du jeune duc ne
firent que fortifier sa dtermination, au lieu de l'branler.
Ces rsistances taient cependant fondes. Ceux qui connaissaient Smith se
demandaient avec inquitude comment on pouvait songer confier l'ducation
d'un jeune gentilhomme ce penseur gauche et distrait et charger du soin d'un
long voyage un homme qui n'avait jamais quitt son pays. Smith lui-mme ne se
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
28
sentait pas prpar pour cette lourde mission et il tait peu dispos l'accepter. Au
surplus, quoiqu'il et un grand dsir de voyager et de comparer les observations
qu'il avait recueillies en Angleterre avec celles qu'il pourrait faire en Europe, il ne
pouvait se rsoudre quitter sa vie calme et tranquille, sa chaire de Glasgow o sa
situation pcuniaire tait pour toujours assure.
Il continua donc, pendant quatre annes encore, ses cours de philosophie, mais
en leur faisant subir une transformation considrable. En effet, ses leons sur
lthique ayant t reproduites en grande partie dans la Thorie des sentiments
moraux, il devenait inutile de s'y arrter longuement, et Smith songeait donner
une plus large place l'tude du droit et des lois de la richesse.
Ces deux genres de recherches taient d'ailleurs l'ordre du jour. L'Esprit des
Lois, qui n'avait gure plus de dix annes de date, avait donn une puissante
impulsion l'tude de la jurisprudence, tant en France que dans le reste de
l'Europe : en un an et demi, il avait eu vingt-deux ditions 1 , il tait traduit dans
presque toutes les langues et il avait acquis en Angleterre, plus que partout ailleurs,
une autorit inconteste. Un mouvement analogue et parallle, mais plus gnral
encore, se manifestait, dans l'Europe occidentale, au sujet de l'tude des
phnomnes de la richesse. En Angleterre, les petits Essais de Hume, crits en
1752, avaient eu de la faveur, en attaquant les prjugs mercantiles qui rgnaient
depuis si longtemps dans la politique commerciale des nations. En France surtout,
on avait fait beaucoup de bruit autour des articles publis par Quesnay dans
l'Encyclopdie, en 1756 2 , et l'apparition rcente du Tableau conomique puis des
Maximes, avait opr une vritable rvolution dans cette science, peine close,
qu'on devait appeler plus tard l'conomie politique. Enfin, de tous cts, les
thories nouvelles avaient rencontr des adeptes, et, tandis que, en Italie, Verri et
Beccaria, pntrs des doctrines de l'cole franaise, poursuivaient les recherches
commences et songeaient fonder, pour la rforme des abus, leur fameuse
Socit, dite Socit du caf , en Espagne mme, un ministre puissant,
Campomanes, allait tenter d'appliquer, dans le pays le plus imbu des prjugs de la
balance du commerce, les nouveaux principes de la libert industrielle et
commerciale.
Smith, qui suivait toujours avec le plus grand soin, comme nous en trouvons la
preuve dans sa Lettre aux diteurs de la Revue dEdimbourg, les publications de
toute sorte qui se faisaient en Europe, ne pouvait rester tranger ce double
mouvement. Depuis 1752 d'ailleurs, poque laquelle il avait pris possession de sa
chaire de philosophie morale, il avait toujours rserv dans son cours, l'exemple
d'Hutcheson, quelques leons l'tude de la richesse et de la jurisprudence ; mais,
proccup par ses travaux sur les sentiments moraux, il n'avait pu jusque-l donner
cette importante matire toute l'attention qu'elle lui paraissait comporter. Il saisit
1
Lettre de Montesquieu au marquis de Stainville, le 27 mai 1850. uvres compltes, (Paris,
Lefebvre, 1835.)
Larticle Fermier et l'art. Grains.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
29
donc avec empressement l'occasion qui se prsentait pour imprimer son cours
une direction diffrente et il consacra le temps laiss libre par l'thique cet ordre
de recherches.
Du reste, le milieu o il se trouvait tait excellent pour ce genre d'tudes.
Quoiqu'elle n'et pas encore pris l'importance considrable qu'elle a acquise de nos
jours, la ville de Glasgow tait devenue dj, depuis l'union de l'cosse avec
l'Angleterre qui lui avait ouvert le march des Indes occidentales, une des villes les
plus commerantes de la Grande-Bretagne. Smith pouvait donc y examiner, dans
ses dtails, chacune des branches du commerce, et il s'attachait sans cesse, par des
observations rptes et consciencieuses, contrler, au moyen des faits, les
doctrines qu'il tenait de Hume ou de ses nombreuses lectures, notamment de
l'tude de l'Encyclopdie et des ouvrages des conomistes franais. Pour mieux
pntrer au cur de la place, il recherchait mme la socit des marchands et il
s'efforait, tout propos, d'amener la conversation sur l'objet de leur commerce.
Ce n'taient pas d'ailleurs des ignorants, ces marchands de Glasgow ; ils
dissertaient volontiers sur les principes de ce qu'ils appelaient leur art ; ils
aimaient, par temprament, les discussions doctrinales, raisonnaient les rgles de
leur commerce, et le jeune professeur, dans les argumentations dlicates qu'il eut
soutenir avec eux, apprit, dit M. W. Bagehott, non-seulement une foule de choses
qu'il et vainement cherches dans les livres, mais encore peut-tre cet art
puissant, et, pour ainsi dire pratique, de les expliquer, qui caractrise la Richesse
des Nations 1 . Certains de ces marchands prnaient dj la libert commerciale,
et Smith a lui-mme reconnu, au dire d'un de ses biographes, devoir beaucoup
leur prvt Cochrane qui venait de fonder un club pour la propagation de ces ides.
Le sjour de Smith Glasgow fut donc un excellent milieu pour ses premires
tudes sur la science de la richesse ; puis, la ncessit d'exposer dans un cours le
rsultat de ses recherches vint, point, le forcer digrer ses observations, en
dgager les principes, et, durant les quatre annes qu'il passa encore l'Universit,
ses leons gagnrent peu peu en nettet et en prcision. Il semble, en effet,
disait-il plus tard dans la Richesse des Nations 2 , que la mthode la plus efficace
pour rendre un homme parfaitement matre d'une science particulire, c'est de lui
imposer la ncessit d'enseigner cette science rgulirement chaque anne. tant
oblig de parcourir tous les ans la mme carrire, pour peu qu'il soit bon quelque
chose il devient ncessairement, en peu d'annes, compltement au fait de chaque
partie de sa matire ; et, s'il lui arrivait, dans une anne, de se former sur quelque
point en particulier une opinion trop htive, quand il vient, l'anne suivante,
repasser sur le mme objet dans le cours de ses leons, il y a parier qu'il
rformera ses ides. Si l'emploi d'enseigner une science est certainement l'emploi
naturel de celui qui est purement homme de lettres, c'est aussi peut-tre le genre
1
2
Fortnightly Review du 1er juillet 1876 : Adam Smith as a person.
Liv. V, ch. I
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
30
d'ducation le plus propre en faire un homme vraiment profond en savoir et en
connaissances.
Pour ces motifs, on doit, peut-tre se fliciter que Smith n'ait pas accept, ds
1759, la mission d'accompagner sur le continent le jeune duc de Buccleugh, car le
travail de classement et de condensation qui se fit dans son esprit durant les
dernires annes qu'il professa Glasgow, le mit mieux en tat de profiter de son
voyage en France et de ses relations avec les conomistes.
D'ailleurs, grce aux heureuses modifications qu'il avait apportes dans l'objet
de ses leons, il vit son cours de plus en plus suivi ; les tudiants accoururent en
foule pour l'entendre, de toutes les parties de l'cosse et jusque de l'Angleterre ;
enfin ses collgues eux-mmes tinrent lui donner un tmoignage flatteur de leur
admiration, en lui confrant, l'unanimit, le grade de Docteur en droit, comme
tmoignage, disent les minutes de l'assemble, de leur respect pour ses talents
universellement reconnus et du renom qu'a donn l'Universit la comptence
avec laquelle il a expos pendant plusieurs annes les principes de la
jurisprudence 1 .
Cependant, il regrettait parfois de n'avoir pas accept l'offre de sir Townsend.
Dans l'exercice de son professorat, il se rendait fort bien compte de l'insuffisance
de ses donnes et de ses observations ; il sentait que, pour mener bien cette
Histoire de la Civilisation qu'il avait en vue, il lui tait indispensable de sortir de
son pays et d'tudier au moins les murs et le gnie de la France qui tait
incontestablement le centre intellectuel de l'Europe et le foyer de la civilisation du
monde.
Heureusement sir Townsend n'avait pas abandonn son dessein, et, n'tant pas
press par l'ge de son pupille, il avait ajourn le voyage projet, esprant bien que
l'auteur de la Thorie des sentiments moraux se dciderait enfin le diriger. Aussi,
en 1763, il renouvela ses dmarches auprs de Smith, et celui-ci prta une oreille
plus attentive ses propositions. La seule chose qui pt arrter encore le jeune
philosophe, tait la question pcuniaire, car, n'ayant aucune fortune, il ne lui tait
pas permis d'abandonner sans compensation le traitement qui lui tait jamais
assur s'il restait l'Universit, et il hsitait sacrifier son indpendance
matrielle, se demandant ce qui arriverait lorsque aprs avoir termin, l'ducation
du jeune duc, il serait oblig de se crer des ressources pour lui et sa mre. Mais sir
Townsend comprit ces inquitudes bien lgitimes, et, sans que Smith et besoin de
formuler d'objections, il les prvint de lui-mme en lui offrant, comme condition
de son acceptation, une pension annuelle de 5,000 francs qui lui serait servie
jusqu'au moment o, par la protection de la famille de Buccleugh, dont l'influence
tait considrable, on pourrait lui procurer un emploi de la couronne, d'une valeur
Encyclopcedia Britannica.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
31
au moins gale. Les dernires rsistances du philosophe taient ainsi vaincues et il
accepta dfinitivement la mission qu'on lui proposait.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
32
CHAPITRE III.
________
Retour la table des matires
Au mois de mars 1764, Adam Smith, accompagn de son lve, partait pour la
France, et, ds le lendemain de son arrive Paris, il envoyait au recteur de
Glasgow sa dmission officielle de professeur.
Ce document a t conserv dans les Archives de l'Universit. On y sent toute
l'affection que Smith avait pour sa chaire et toute l'tendue du sacrifice qu'il
consentait en se rsignant, pour l'amour de la science, quitter cette vie heureuse
et tranquille qu'il avait mene pendant douze annes : Je n'ai jamais t, dit-il en
terminant, plus occup du bien du collge que je ne le suis en ce moment, et je
dsire sincrement que mon successeur, quel qu'il puisse tre, en mme temps qu'il
honorera sa place par ses talents, contribue au bonheur des hommes excellents
avec lesquels il sera appel vivre, par les vertus du cur et la bont du
caractre .
L'Universit ne pouvait qu'accepter cette dmission qu'elle avait tenu retarder
le plus possible, dans l'espoir, peu probable cependant, d'un revirement dans la
dtermination d'Adam Smith. Mais elle tint constater sur ses registres toute son
admiration pour le professeur et l'expression des regrets unanimes qu'il laissait
derrire lui. L'Assemble, y est-il dit, accepte la dmission du Dr Smith, aux
termes de la lettre prcdente, et, en consquence, la chaire de professeur de
philosophie morale dans cette Universit, est dclare vacante. L'Universit ne
peut, en mme temps, s'empcher de manifester son regret sincre de se voir
enlever le Dr Smith, dont les vertus distingues et les qualits aimables avaient
excit l'estime et l'affection de ses collgues et qui honorait cette Socit par son
gnie, ses talents et par l'tendue de ses lumires. Son lgante et ingnieuse
Thorie des sentiments moraux l'avait fait apprcier par les hommes de got et les
gens de lettres de l'Europe entire. L'heureux talent qu'il possdait de jeter du jour
sur les sujets abstraits, l'assiduit communiquer les connaissances utiles et
l'exactitude s'acquitter des devoirs de sa charge, qui le caractrisaient comme
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
33
professeur, taient, pour les jeunes gens confis ses soins, une source de plaisir
et de solide instruction.
On lui donna un successeur digne de lui dans la personne du clbre philosophe
Reid qui illustrait depuis onze ans la chaire de philosophie de l'un des collges
dAberdeen et qui devait continuer, d'une manire si brillante, la tradition de
l'cole cossaise, dans la chaire mme de ses fondateurs.
Adam Smith rencontra Paris son ami David Hume qui, secrtaire
d'ambassade auprs de lord Hertford, tait alors l'objet d'un vritable engouement.
Cet engouement tait gnral, bien que l'on et peine l'expliquer parfois chez
certaines gens dont les ides paraissaient tre, en tous points, bien peu d'accord
avec celles du clbre historien. M. Hume doit aimer la France, disait Grimm
dans sa Correspondance 1 , non sans quelque pointe d'ironie ; il y a reu l'accueil le
plus flatteur. Paris et la Cour se sont disput l'honneur de se surpasser. Cependant
M. Hume est bien aussi hardi dans ses crits philosophiques qu'aucun philosophe
de France. Ce qu'il y a encore de plaisant, c'est que toutes les jolies femmes se le
sont arrach et que le gros philosophe cossais se plat dans leur socit. C'est un
excellent homme que David Hume : il est naturellement serein ; il entend
finement ; il dit quelquefois avec sel, quoiqu'il parle peu ; mais il est lourd et n'a ni
chaleur, ni grce, ni agrment dans l'esprit, ni rien qui soit propre s'allier au
ramage de ces charmantes petites machines qu'on appelle jolies femmes. Oh ! que
nous sommes un drle de peuple !
Quoi qu'il en soit, Hume tait recherch, choy par tous, par les philosophes,
par les conomistes, par les gens du monde, et il crivait Robertson, encore tout
mu de sa rception la Cour : Je ne me nourris que d'ambroisie, ne bois que du
nectar, ne respire que l'encens, et ne marche que sur des fleurs 2 . Il est probable
qu'il aurait dsir garder avec lui son ami Smith et le prsenter dans le monde o il
tait reu ; mais les instructions de sir Townsend taient sans doute formelles, car
les deux voyageurs ne restrent que dix jours dans la capitale de la France, puis ils
partirent pour Toulouse.
Toulouse tait d'ailleurs, cette poque, un centre intellectuel considrable et
le sige d'un Parlement fameux par ses luttes contre le pouvoir royal ; elle
possdait une Universit trs-renomme et une bibliothque fort remarquable. Il
est donc possible aussi qu'Adam Smith ait prfr cette rsidence, afin de se
familiariser peu peu avec notre gnie national, avant de se jeter au milieu du
mouvement littraire et philosophique de cette socit tourmente de Paris, si
diffrente de la socit cossaise et qu'il n'avait fait qu'entrevoir en passant.
Toulouse, il pouvait loisir se perfectionner dans l'tude et la pratique de notre
langue, tout en recueillant par lui-mme, sur les murs, les coutumes, l'esprit
public, sur l'tat gnral du pays, au point de vue matriel et moral, des
1
2
Grimm. (Correspondance, t. V, p. 124.)
Life of David Hume, by Edward Ritchie. Villemain : Littrature au XVIIIe sicle, t. II, p. 368.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
34
observations qu'il n'eut pu faire Paris mme, car, sous bien des rapports, la
France de Paris tait toute diffrente de celle des provinces. Enfin, il trouvait l le
calme qui convenait ses recherches et qui lui tait indispensable pour tudier
utilement nos institutions. vrai dire, le franais qu'il entendit sur les bords de la
Garonne tait loin d'tre aussi pur que le franais de 1'le-de-France, et, quand il
arriva Paris, on trouva qu'il parlait fort mal notre langue 1 . Nanmoins, il en
avait appris assez pour soutenir, sur les sujets les plus varis et les plus techniques,
des conversations de plusieurs heures, pour profiter des relations qu'il comptait
entretenir avec les philosophes, et son but tait atteint.
Cependant Toulouse lui paraissait peu agrable, car il n'y connaissait presque
personne, et, habitu jusqu'alors se voir recherch, tant Edimbourg qu'
Glasgow, par l'lite de la socit, il sentait fort son isolement. La vie que je
menais Glasgow, crivait-il David Hume ds le 5 juillet 1764 2 , tait une vie de
plaisir et de dissipation (a pleasurable dissipated life), en comparaison de celle que
je mne ici ; j'ai entrepris de composer un livre afin de passer le temps. Ce livre
tait vraisemblablement la Richesse des Nations, qu'il commenait prparer, et il
en parla souvent, au dire de l'abb Morellet, lorsque plus tard, Paris, il entra en
rapport avec les conomistes.
Il passa ainsi, avec son lve, dix-huit mois Toulouse, cultivant notre langue,
amassant des matriaux pour son ouvrage et ne ngligeant aucune occasion de
recueillir des observations et des renseignements, soit au moyen des nombreux
documents qu'il pouvait consulter la Bibliothque de l'Universit, soit par des
conversations particulires avec d'minents magistrats auxquels Hume avait pu
enfin le recommander. Il ne quitta la capitale du Languedoc qu' la fin du mois de
septembre de l'anne 1765 et il se dirigea sur Genve, petites journes, traversant
le Midi de la France dont il visita les principales villes.
Genve tait une ville toute franaise, mais la parole y tait libre, et, pour ce
motif, son territoire servait habituellement de refuge aux philosophes menacs de
lettres de cachet. Adam Smith et le jeune duc y sjournrent deux mois, puis ils
partirent enfin pour Paris o ils arrivrent vers les ftes de Nol.
Hume tait alors sur le point de retourner en Angleterre. Depuis le rappel de
lord Hertford, nomm vice-roi d'Irlande, il tait rest Paris comme charg
d'affaires ; mais l'arrive du nouvel ambassadeur, le duc de Richmond, venait de le
relever de ses fonctions. Il songeait, ce moment, partir au plus vite pour
conduire au-del du dtroit son ami J.-J. Rousseau, qui, venu le rejoindre Paris,
malgr l'arrt du Parlement, attendait impatiemment son dpart, protg par
l'enceinte du Temple o habitait le prince de Conti, Grand-Prieur de France. Mais,
1
2
Labb Morellet : Mmoires.
Lord Brougham : Lives of men of letters and science who flourished in the time of George III. 3
vol. in-8. London, 1846.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
35
avant de quitter la France, il prit le temps de prsenter et de recommander Adam
Smith ses meilleurs amis.
Au surplus, le philosophe anglais n'tait pas un inconnu Paris : sa Thorie des
sentiments moraux avait t dj traduite, deux ans auparavant, sous le titre de
Mtaphysique de l'me, et, quoique cette publication ait paru sans nom d'auteur, on
n'ignorait pas qu'elle tait due la plume du professeur de Glasgow, dont la
clbrit n'avait pas tard traverser le dtroit. Il fut donc accueilli avec
empressement dans la socit des philosophes et des conomistes, chez
d'Alembert, Helvtius, Marmontel, Turgot, Quesnay, Necker, Mme Riccoboni, chez
le jeune duc de La Rochefoucauld et chez sa mre, la duchesse d'Anville, dont le
salon runissait les littrateurs les plus minents de cette poque.
Adam Smith avait beaucoup observer et apprendre dans une pareille
socit. Toulouse, cent soixante-dix lieues de Paris, il n'avait pu se rendre
compte de l'tat rel des esprits. Toute la vie intellectuelle tait concentre dans la
capitale, et c'tait un spectacle bien nouveau pour lui que celui qui se droulait
sous ses yeux, alors que les anciens abus et les nouvelles thories fleurissaient cte
cte, avec une vigueur qu'ils n'avaient jamais eue jusque l.
Le Gouvernement tait rest cantonn dans les prjugs et les pratiques du
systme mercantile organis par Colbert. Attribuant la richesse de l'Angleterre
son organisation industrielle, le ministre de Louis XIV avait voulu arriver aussi
faire de la France un pays manufacturier, et, sans s'inquiter de la nature diffrente
de notre climat qui nous pousse naturellement produire du bl et cultiver la
vigne, il avait cherch, par tous les moyens, dtourner les capitaux de
l'agriculture pour les porter vers les emplois plus productifs, selon lui, de
l'industrie et du commerce. De l une lgislation vexatoire et complique,
imagine par ce grand financier et aggrave encore par ses successeurs : on rglait
par des ordonnances jusqu'aux procds de la fabrication, la largeur des toffes, le
nombre des fils de la trame et de la chane ; en un mot, on s'efforait de favoriser
l'industrie en l'opprimant.
Toutefois, une certaine raction commenait se faire sentir dans les conseils
du Gouvernement : on n'en tait pas encore aux rformes, mais on commenait
discuter les mesures mercantiles jusque-l incontestes, et les ministres du roi,
pousss par l'opinion et sacrifiant la mode, parlaient conomie politique. C'est
qu'il y avait dj sept ans que le Tableau conomique et les Maximes de Quesnay
avaient t publis, et ces ouvrages, qui renversaient de fond en comble les
systmes tablis, avaient eu un immense retentissement dans cette socit du
XVIIIe sicle qui voulait tout rformer. Cette science nouvelle avait apparu au
moment le plus opportun : Vers 1750, dit Voltaire 1 , la nation, rassasie de vers,
de tragdies, de comdies, de romans, d'opras, dhistoires romanesques, de
1
Voltaire. Dictionnaire philosophique, art. Bl.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
36
rflexions morales plus romanesques encore, se mit raisonner sur les bls. il fut
alors de bon ton de s'occuper d'conomie politique et on s'engoua d'autant plus
facilement de ces tudes que, tendant amliorer la situation matrielle du plus
grand nombre, elles taient conformes l'esprit du sicle dont la grande gloire est
son amour fervent et dsintress de l'humanit. Paris offrit alors un admirable
spectacle : conomistes, philosophes, gens du monde et femmes d'esprit, tous
travaillaient, les uns l'mancipation politique, d'autres l'mancipation
religieuse, d'autres enfin l'mancipation industrielle et commerciale, et tous
taient anims du mme souffle, le souffle de la libert, tous taient dirigs par le
mme mobile, l'amour du bien public.
La Cour elle-mme favorisait le mouvement conomique. Alors qu'elle
poursuivait de toutes ses rigueurs les autres philosophes, elle protgeait
ouvertement ceux qu'on devait appeler plus tard les physiocrates. Le roi avait
anobli Quesnay, qu'il appelait le Penseur ; il avait tenu contribuer de ses propres
mains la composition typographique du Tableau conomique, et Mme de
Pompadour ne ddaignait pas de descendre parfois dans le petit entresol qu'habitait
le docteur pour s'asseoir la table qui runissait les partisans de la doctrine
nouvelle. Elle ne se rendait pas compte qu'en favorisant ainsi le mouvement
conomique, elle faisait courir de vritables prils la royaut, et que l'tude des
finances de l'tat, en mettant jour l'arbitraire, le dsordre et la corruption qui
rgnaient dans lassiette et la perception des taxes, aurait pour effet d'branler le
trne bien plus srement que toutes les attaques politiques du parti philosophique.
Les physiocrates paraissaient tre, au contraire, pour le pouvoir des auxiliaires
prcieux, parce que, comptant sur le roi pour imposer leurs rformes, ils voulaient
un gouvernement fort, imbu de la maxime tout pour le peuple et rien par le
peuple : c'tait l, tout au moins, la doctrine de la majeure partie d'entre eux. Ils
trouvaient, en effet, dit M. Taine 1 , que rien n'est plus commode qu'un tel
instrument pour faire les rformes en grand et d'un seul coup. C'est pourquoi, bien
loin de restreindre le pouvoir central, les conomistes ont voulu l'tendre. Au lieu
de lui opposer des digues nouvelles, ils ont song dtruire les vieux restes de
digues qui le gnaient encore. Dans un gouvernement, dclaraient Quesnay et ses
disciples, le systme des contre-forces est une ide funeste... Les spculations
d'aprs lesquelles on a imagin le systme des contre-poids sont chimriques...
Que l'tat comprenne ses devoirs et alors qu'on le laisse libre... Il faut que l'tat
gouverne selon les rgles de l'ordre essentiel, et, quand il en est ainsi, il faut qu'il
soit tout-puissant.
Pour tous ces motifs, l'conomie politique avait dj pris un essor assez
considrable au moment de l'arrive d'Adam Smith Paris : on nen parlait pas
seulement chez Quesnay, Turgot, Diderot, mais dans tous les salons. Aussi le
philosophe cossais put profiter largement de son sjour dans la capitale de la
France pour complter ses observations, tudier son aise les thories des
1
Taine. L'ancien rgime, p. 321.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
37
physiocrates et apprcier la valeur comme les points faibles de chacune d'elles,
grce ces discussions familires auxquelles il assistait chaque jour.
Malheureusement il ne nous a laiss aucun dtail sur son sjour Paris. Il est
fort regretter, dit son biographe Dugald Stewart 1 , qu'il n'ait conserv aucun
journal de ce priode si intressant de sa vie, et sa rpugnance crire des lettres
tait si forte que je ne crois pas qu'il en reste aucune trace dans sa correspondance.
L'tendue, la fidlit de sa mmoire, laquelle on en trouverait peu de
comparables, l'empchaient de mettre de l'importance consigner par crit ce qu'il
avait vu et entendu, et le soin inquiet qu'il a mis dtruire avant sa mort tous ses
papiers, semble indiquer qu'il avait cur de ne laisser ceux qui voudraient
crire sa vie, d'autres matriaux que ceux qui leur seraient fournis par les
monuments durables de son gnie et par les vertus exemplaires de sa vie prive.
Il nous est rest cependant un document de cette poque, une lettre, crite par
Adam Smith Hume et date Paris, du 6 juillet 1766 2 ; elle a trait la rupture
clatante qui venait de se produire entre l'historien cossais et J.-J. Rousseau. Bien
qu'elle soit exclusivement consacre cette querelle, nous tenons la traduire,
parce que, d'une part, les lettres de Smith tant rares, c'est une bonne fortune
d'avoir pu en dcouvrir quelques-unes, et, d'autre part, parce que ce document nous
rvle sous un jour particulier le caractre bouillant de notre philosophe, dont
l'indignation va peut-tre mme jusqu' l'injustice lorsqu'il voit attaquer son
meilleur ami.
On connat les faits. On sait qu'au commencement de 1766, David Hume avait
emmen en Angleterre J.-J. Rousseau qui venait d'tre chass de la Suisse, et qu'il
l'avait install Wooton, dans le comt de Derby : les rapports les plus cordiaux
rgnaient alors entre eux, et le philosophe genevois appelait son ami le plus
illustre de ses contemporains . Tout coup on apprit avec stupfaction que cette
intimit s'tait subitement rompue et que Rousseau avait crit Hume une lettre
violente pour le lui signifier. Dans sa solitude de Wooton, son imagination avait
travaill : il avait cru dmler que l'historien cossais s'tait ligu avec ses ennemis
pour le perdre, qu'il ne l'avait emmen en Angleterre que pour nuire sa rputation
en le comblant de bienfaits et pour le dshonorer en lui faisant accepter de la
Couronne une pension secrte. Sur ces entrefaites avait paru dans les feuilles
anglaises la prtendue lettre de Frdric, dans laquelle le roi de Prusse tait cens
tourner en ridicule la manie de perscution qui hantait l'esprit de l'auteur d'mile.
Cet crit tait d'Horace Walpole, mais Rousseau crut que Hume en tait l'auteur et
aussitt il brisa l bruyamment par la lettre que l'on sait.
Il n'est pas de notre sujet d'examiner ici les torts respectifs des deux
philosophes. Quoi qu'il en soit, Paris, certains amis de Hume estimaient que
1
2
Dugald Stewart. Vie de Smith (traduction P. Prevost). Paris, Agasse, 1797.
Cette lettre a t recueillie et publie par lord Brougham : Lives of men of letters and science
who flourished in the time of George III.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
38
celui-ci aurait le beau rle en ne s'offensant pas de cette lettre, qui dnotait un
esprit malade, et en prenant plutt en piti le caractre malheureux de ce pauvre
Rousseau. Quant Smith, il s'tait senti personnellement atteint par l'insulte qui
avait frapp son compatriote et il n'admettait aucune excuse en faveur de
l'agresseur, mais il n'en considrait pas moins aussi que Hume avait intrt viter
un clat et il tenait le lui faire savoir. Voici sa lettre :
Paris, 6 juillet 1766.
Mon cher ami,
Comme vous, je suis absolument convaincu que Rousseau est un grand
misrable (a great rascal), et chacun ici partage mon avis 1 . Cependant, laissez-moi
vous prier de ne songer publier quoi que ce soit au sujet de l'insolence dont il
s'est rendu coupable envers vous.
En refusant la pension que vous avez eu la bont de solliciter pour lui, avec son
assentiment, il peut avoir jet sur vous quelque ridicule aux yeux de la Cour et du
Ministre. Ne vous laissez pas atteindre par ce ridicule, montrez sa lettre brutale,
mais ne vous en dessaisissez pas, de faon qu'elle ne puisse jamais tre imprime.
Si vous le pouvez mme, soyez le premier en rire, et je parierais ma vie qu'avant
qu'il soit trois semaines, on considrera que cette petite affaire, qui, prsent, vous
cause tant d'ennui, vous fait autant d'honneur que quoi que ce soit qui vous arriva
jamais. En cherchant dmasquer devant le public ce pdant hypocrite, vous
courez le risque de troubler la tranquillit de toute votre existence. En le laissant
tranquille, il ne peut vous donner quinze jours de souci.
crire contre lui, c'est, vous pouvez y compter, ce qu'il dsire fort vous voir
faire. Il est sur le point de tomber dans l'obscurit en Angleterre et il espre se
rendre important en provoquant un illustre adversaire. Il aura beaucoup de gens
pour lui, lglise, les Whigs, les Jacobites, toute la partie claire de la nation
anglaise qui aimera mortifier un cossais et applaudir un homme qui a refus
une pension du Roi. Il n'est pas mme invraisemblable quils le paient trs-bien
pour l'avoir refuse et que Rousseau ait eu en vue cette compensation.
1
Smith, prvenu contre Rousseau, n'avait pas observ avec assez de sang-froid l'tat de l'opinion
Paris sur cette fugue du philosophe genevois. Les esprits impartiaux ne considraient pas
Rousseau comme un misrable, mais comme un caractre malheureux ; il ne leur inspirait pas
du mpris, mais plutt de la piti, et la marquise de Boufflers tait une interprte plus fidle du
sentiment gnral lorsquelle crivait Hume (22 juillet 1766) : Ne croyez pas que Rousseau
soit capable d'artifice ni de mensonge, qu'il soit un imposteur ni un sclrat. Sa colre n'est
pas fonde, mais elle est relle, je n'en doute pas... Au lieu de vous irriter contre un
malheureux qui ne peut vous nuire et qui se ruine lui-mme, que n'avez-vous laiss agir cette
piti gnreuse dont vous tes si susceptible ! Vous eussiez vit un clat qui scandalise, qui
divise les esprits, qui flatte la malignit, qui amuse, aux dpens de tous deux, les gens oisifs et
inconsidrs, qui fait faire des rflexions injurieuses et renouvelle les clameurs contre les
philosophes et la philosophie.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
39
Tous vos amis dsirent que vous n'criviez rien : le baron d'Alembert, Mme
Riccoboni, Mlle Riancourt, M. Turgot, etc., etc. M. Turgot, un ami en tous points
digne de vous, m'a pri de vous recommander cette conduite d'une manire toute
particulire, comme un avis trs-srieux sur lequel il insiste vivement. Nous avons
peur que vous ne soyez entour de mauvais conseillers et que l'opinion de vos gens
de lettres anglais (english litterati), qui sont eux-mmes habitus publier dans les
journaux tous leurs petits commrages, n'ait une trop grande influence sur vous.
Rappelez-moi au souvenir de M. Walpole, et croyez-moi, avec l'affection la
plus sincre,
Toujours vous.
ADAM SMITH
On sait que David Hume ne suivit pas le conseil de Smith : il tint rendre le
public juge du diffrend et il publia toute sa correspondance avec Rousseau, en y
joignant un commentaire destin faire ressortir l'ingratitude de son ancien ami.
La querelle fit beaucoup de bruit, mais tout cet clat n'eut d'autre rsultat que de
nuire grandement la rputation de l'historien cossais : on jugea qu'il tait
indlicat de se servir des armes d'une correspondance prive et qu'il tait maladroit
de reprocher des bienfaits.
lexception de la lettre que nous venons de citer, nous ne possdons, de la
main d'Adam Smith, aucun document qui puisse nous renseigner sur son sjour
Paris.
Nous n'avons, notamment, aucune donne sur ses rapports avec les
conomistes. Nous eussions aim cependant connatre la nature et le caractre de
ses relations avec Quesnay, et surtout ses premires impressions sur les thories
des physiocrates. Assurment nous trouvons, dans les Recherches mmes, une
tude sommaire de cette doctrine qui, avec toutes ses imperfections, dit Smith 1 ,
est peut-tre, de tout ce qu'on a publi sur l'conomie politique, ce qui se rapproche
le plus de la vrit ; mais cette tude, mrie par une solitude de dix annes, ne
reproduit certainement pas d'une manire exacte le jugement que le philosophe a
d porter sur ce systme son arrive Paris, lorsque ses ides taient sans doute
peu fixes sur les divers points de la science nouvelle.
Nous sommes un peu mieux renseigns sur ses relations avec Turgot, qui, en
philosophie, lui doit certainement beaucoup. Le futur ministre de Louis XVI tait
alors intendant du Limousin, mais il venait frquemment Paris et avait grand
plaisir converser avec Adam Smith dont il estimait beaucoup le talent 2 . Ces deux
grands esprits se ressemblaient d'ailleurs sous plus d'un rapport : mme puissance
1
2
Richesse des Nations, II, 328.
L'abb Morellet : Mmoires.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
40
d'observation, mme got pour les recherches philosophiques qu'ils poursuivaient
dans toutes les branches des sciences morales et politiques, mme amour pour
l'humanit, et on pouvait appliquer l'un comme l'autre ce vers de Voltaire que
M. Baudrillart a plac au frontispice de son admirable loge de Turgot 1 :
Il ne cherche le vrai que pour faire le bien.
Leur conversation roulait sur toutes les sciences qui leur taient familires, et si
Smith put tirer parti des recherches conomiques et de l'exprience administrative
de son interlocuteur, ce dernier profita, dans une plus large mesure encore, des
tudes philosophiques, des observations dlicates de l'auteur de la Thorie des
sentiments moraux, et son esprit, prpar par la noblesse de ses sentiments aux
principes suprieurs de l'cole cossaise, s'inspira puissamment de la doctrine
leve du philosophe de Glasgow.
D'ailleurs, depuis quelque temps dj, Turgot paraissait tout acquis cette
cole, et les entretiens de Smith, en la lui faisant mieux connatre, l'y rattachrent
seulement davantage. Il n'avait pas t sans lire, avant d'avoir rencontr Adam
Smith, le grand trait dHutcheson, et, presque son apparition, la Thorie des
sentiments moraux, car, ds 1760, un journal franais en avait publi un extrait, et,
en 1764, deux ans avant larrive du philosophe cossais Paris, l'ouvrage entier
avait t traduit chez nous, nous l'avons dit, sous le titre de Mtaphysique de lme.
Aussi les travaux philosophiques de Turgot n'avaient pas t sans se ressentir de
cette heureuse influence. Selon nous, dit Victor Cousin 2 , Turgot est, aprs
Montesquieu, le plus grand, esprit du XVIIIe sicle ; mais il serait, en vrit, un
homme un peu trop extraordinaire si, ne tenant en rien la tradition du XVIIe
sicle, il se ft lev une mtaphysique bien suprieure celle de Condillac et
une morale toute diffrente de celle d'Helvtius, sans aucun autre appui que ses
propres rflexions. Quand on lit sa lettre sur le livre de 1'Esprit, l'article Existence,
et quelques autres morceaux de philosophie sortis de sa plume, on est frapp du
rapport qui se trouve entre ses principes et ceux de l'cole cossaise. Dans l'article
Existence, il n'hsite pas fonder toute la mtaphysique sur la psychologie, c'est-dire sur la conscience et sur ce fait primitif et permanent de la conscience, le
sentiment du moi. En morale, il repousse l'gosme d'Helvtius au nom des
sentiments naturels du cur humain.
Durant son sjour Paris, le Dr Smith attacha encore l'cole cossaise un
autre disciple distingu, dans la personne du duc de La Rochefoucauld, ce jeune
libral qui devint plus tard l'un des membres les plus influents de la fameuse
socit dite des Amis des noirs, et qui devait prir si misrablement, aprs le 10
aot 1792, dans sa retraite de Gisors. Bien que le philosophe de Glasgow et fort
maltrait l'auteur des Maximes dans son ouvrage et dans son cours, il n'en fut pas
moins accueilli chez le petit-fils avec affabilit et respect, et plus tard, le jeune duc,
1
2
Cet loge a t couronn par l'Acadmie franaise, en 1846.
Philosophie cossaise, p. 150.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
41
tout--fait pntr des doctrines d'Adam Smith, entreprenait mme la traduction de
la Thorie des sentiments moraux, la suite de laquelle il comptait tenter en mme
temps une justification des crits de son aeul.
Voici la lettre par laquelle il annona Smith qu'il renonait son dessein. Ce
document, transmis par Dugald-Stewart, montre la nature des relations et les
rapports d'affectueuse dfrence qui existaient entre le jeune duc et le philosophe
cossais ; cet gard, il mrite de prendre place dans ce travail.
Paris, 3 mars 1778.
Le dsir de se rappeler votre souvenir, Monsieur, quand on a eu l'honneur de
vous connatre, doit vous paratre fort naturel ; permettez que nous saisissions pour
cela, ma mre et moi, l'occasion d'une nouvelle dition des Maximes de La
Rochefoucauld, dont nous prenons la libert de vous offrir un exemplaire. Vous
voyez que nous n'avons point de rancune, puisque le mal que vous avez dit de lui
dans la Thorie des sentiments moraux ne nous empche point de vous envoyer ce
mme ouvrage. Il s'en est mme fallu de peu que je ne fisse encore plus, car
j'aurais eu peut-tre la tmrit d'entreprendre une traduction de votre Thorie ;
mais, comme je venais de terminer la premire partie, j'ai vu paratre la traduction
de M. l'abb Blavet et j'ai t forc de renoncer au plaisir que j'aurais eu de faire
passer dans ma langue un des meilleurs ouvrages de la vtre.
Il aurait bien fallu pour lors entreprendre une justification de mon grand-pre.
Peut-tre n'aurait-il pas t difficile premirement de l'excuser, en disant qu'il avait
toujours vu les hommes la Cour et dans la guerre civile, deux thtres sur
lesquels ils sont certainement plus mauvais qu'ailleurs ; et ensuite de justifier, par
la conduite personnelle de l'auteur, des principes qui sont certainement trop
gnraliss dans son ouvrage. Il a pris la partie pour le tout, et, parce que les gens
qu'il avait eus sous les yeux taient anims par l'amour-propre, il en a fait le
mobile gnral de tous les hommes. Au reste, quoique son ouvrage mrite
certains gards d'tre combattu, il est cependant estimable mme pour le fond et
beaucoup pour la forme.
Permettez-moi de vous demander si nous aurons bientt une dition complte
des uvres de votre illustre ami M. Hume ? Nous l'avons sincrement regrett.
Recevez, je vous supplie, l'expression sincre de tous les sentiments d'estime et
d'attachement avec lesquels j'ai l'honneur d'tre, Monsieur, votre trs-humble et
trs-obissant serviteur.
DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
42
Ajoutons que Smith fut touch par les sentiments de pit filiale qui taient
exprims dans cette lettre. Il fit prvenir le jeune duc que, dans les futures ditions
de sa Thorie, le nom de La Rochefoucauld ne se trouverait plus associ celui du
Dr Mandeville, l'auteur de la Fable des abeilles, et il relut avec attention l'ouvrage
qu'on lui adressait, dans l'espoir de trouver la doctrine moins mauvaise qu'il ne
l'avait jug prcdemment. Mais il ne put trouver approuver quoi que ce soit, en
dehors de la forme, dans l'uvre du clbre frondeur, et il prfra faire disparatre
purement et simplement, dans la dernire dition de son trait, tout ce qui se
rapportait ce systme qu'il avait toujours qualifi jusque-l de licencieux et de
dgnr.
Adam Smith ne s'occupa pas seulement de philosophie et d'conomie politique
pendant son voyage en France : il ne ngligea aucune partie de son vaste plan, et,
de mme qu'il avait cherch Toulouse, dans la socit des magistrats, des
documents pour son Trait du Droit, il profita de son sjour Paris pour complter
ses recherches sur les arts imitatifs dans l'histoire desquels il comptait trouver des
renseignements prcieux sur la marche de l'esprit humain. Il n'avait jamais
nglig, dit Dugald-Stewart, de cultiver son got pour les arts libraux, moins sans
doute pour jouir des plaisirs qu'ils procurent, quelque sensible qu'il y pt tre, qu'
cause de leur liaison avec les principes gnraux de l'esprit humain, dont l'tude
semble s'ouvrir par cette voie sous sa forme la plus riante. Ceux qui s'occupent de
ce sujet dlicat trouvent dans la comparaison des gots divers des diffrents
peuples, un recueil de faits prcieux, et M. Smith, toujours dispos attribuer la
mode et la coutume toute leur influence sur les opinions relatives la beaut,
devait, comme on le sent assez, profiter de toutes les occasions que pourrait lui
offrir un pays nouveau pour lui de confirmer sa thorie par des exemples. Or,
Paris tait, plus que jamais, la reine de la littrature, et le philosophe cossais se
trouvait dans les meilleures conditions possible pour poursuivre galement ses
tudes dans cette partie de la science.
Toutefois il fallait songer au dpart et rentrer en Angleterre, car plus de deux
ans et demi s'taient couls depuis l'arrive en France des deux voyageurs. Aussi,
en octobre 1766, Smith ramenait son lve Londres pour le remettre sa famille.
Malgr toutes les apprhensions qu'avaient pu concevoir ses amis, le jeune duc de
Buccleugh tait enchant de son voyage. Il avait trouv dans Adam Smith, en
mme temps qu'un matre minent, un ami dvou, et, longtemps aprs, il crivait
ces lignes qui constituent le meilleur des tmoignages en faveur du caractre priv
du philosophe 1 : Au mois d'octobre 1766, nous rentrions Londres aprs avoir
pass presque trois annes ensemble, sans le moindre dsagrment, sans la
moindre froideur, et, de mon ct, avec tout l'avantage que l'on pouvait attendre de
la socit d'un pareil homme. Notre amiti s'est continue jusqu' l'heure de sa
mort et je resterai toujours sous le coup d'avoir perdu un ami que j'aimais et que je
Fortnightly Review. Adam Smith as a person, by W. Bagehot.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
43
respectais, non-seulement pour ses grandes facults, mais encore pour ses vertus
prives.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
44
CHAPITRE IV.
________
Retour la table des matires
De retour en Angleterre, Adam Smith s'empressa d'aller rejoindre sa mre
Kirkaldy. D'ailleurs, il avait hte de remettre de l'ordre dans ses ides. Durant les
annes qu'il venait de passer en France, il avait tant tudi, tant observ, tant vu de
choses diffrentes de celles qu'il avait eues jusque-l sous les yeux, qu'il prouvait
le besoin d'tre seul pour classer ses observations, les digrer, et contrler ainsi,
soit ses propres doctrines, soit celles qu'il avait entendu soutenir si brillamment
dans la socit des physiocrates. Aussi il se condamna une solitude presque
absolue, vivant de la pension que lui avait assure la famille de Buccleugh et ne
faisant que de rares apparitions Edimbourg et Londres. Le calme de la retraite
convenait d'ailleurs parfaitement ses gots et il le prfrait de beaucoup
l'existence fivreuse et agite qu'il venait de mener Paris. Mon occupation ici,
crivait-il Hume 1 , est l'tude, dans laquelle je suis trs profondment plong
depuis un mois environ. Mes distractions consistent dans de longues et solitaires
promenades au bord de la mer. Vous pouvez juger comment je passe mon temps.
Je suis cependant extrmement heureux, mon aise, et content ; je ne l'ai peut-tre
jamais t un plus haut point aucun moment de ma vie.
Durant les premires annes au moins qu'il passa Kirkaldy, Smith ne parat
pas s'tre attach exclusivement la prparation de son grand travail sur la
Richesse des Nations. Nous montrerons en effet, dans notre IIe Partie, que cet
ouvrage, dans lequel on a voulu voir souvent un trait d'conomie politique, n'est
en ralit qu'un fragment d'une histoire plus gnrale de la Civilisation, et tout
semble faire supposer qu' son retour en Angleterre, il n'avait encore abandonn
aucune partie de ce vaste plan qu'il avait combin ds son sjour Glasgow, car il
semble s'tre occup, cette poque, de coordonner les observations de toute sorte
qu'il avait recueillies sur la marche de l'esprit humain dans ses diffrentes
manifestations. Nous avons eu d'ailleurs la bonne fortune de trouver cet gard,
1
Lettre en date du 7 juin 1767, publie par lord Brougham. (Lives of men of letters, etc., etc.)
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
45
dans l'ouvrage de lord Brougham, une lettre convaincante qui ne parat pas avoir
t traduite jusqu' ce jour en notre langue et qui prouve qu'en 1769 Adam Smith
soccupait encore d'amasser des matriaux pour son Histoire du Droit.
Cette lettre tait adresse un jurisconsulte, lord Hailes, et nous demandons
la citer en entier, malgr son tendue, d'autant plus qu'elle constitue en outre,
croyons-nous, le seul document qui puisse donner une ide de la nature des
recherches d'Adam Smith sur la jurisprudence.
Kirkaldy, 5 mars 1769.
Mylord,
Je vous serai extrmement oblig de vouloir bien m'envoyer les papiers dont
vous m'avez parl et qui ont trait au prix des substances dans les temps anciens.
Afin que le transport puisse en tre tout--fait sr, j'enverrai, si vous voulez bien
me le permettre, mon domestique Edimbourg, un jour de cette semaine, pour les
prendre votre domicile.
Je n'ai pu me procurer les pices du procs de lord Galloway et de lord Morton.
Dans le cas o vous les possderiez, je vous serais galement trs-oblig de me les
envoyer, si cela se peut ; je vous retournerais le tout aussitt que possible. Si vous
m'y autorisiez, je copierais les manuscrits, mais cela dpend entirement de Votre
Seigneurie.
Depuis la dernire fois que j'ai eu lhonneur de vous crire, j'ai relu avec plus
d'attention qu'auparavant les Actes de Jacques 1er en les rapprochant des remarques
que vous avez faites et qui m'ont procur la fois beaucoup de plaisir et
d'instruction. Elles auront, je m'en rends parfaitement compte, beaucoup plus
d'utilit pour moi que les miennes n'en auront pour vous. J'ai tudi le droit
uniquement dans le but de tracer une esquisse gnrale des rgles suivant
lesquelles la justice tait rendue dans les diffrents sicles et les diffrents pays, et
je suis entr trs-peu clans le dtail des faits particuliers que vous possdez fond,
je le vois. Ces faits particuliers, que vous avez relevs, me seront d'un grand
secours pour contrler mes vues gnrales, mais je crains que ces dernires ne
soient toujours trop vagues et trop superficielles pour vous tre d'une grande
utilit.
Je n'ai rien ajouter ce que vous avez observ en ce qui concerne les Actes
de Jacques 1er. Ils sont crits, en gnral, dans une forme beaucoup plus
rudimentaire et plus inexacte que les statuts anglais ou les ordonnances franaises
de la mme poque, et l'cosse semble avoir t, mme pendant ce rgne que nos
historiens nous reprsentent comme nergique, dans un plus grand dsordre que ne
l'ont jamais t la France ou lAngleterre depuis les incursions des Danois et des
Norwgiens.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
46
Les 5e, 8e, 24e, 56e, 85e Statuts semblent avoir eu tous pour but de remdier
un seul et mme abus. Par suite de l'tat du pays, les voyages devaient tre
extrmement dangereux et, par suite, trs rares. Peu de gens pouvaient donc
esprer gagner leur vie en logeant des voyageurs et il ne devait y avoir que peu ou
point d'htelleries. Aussi les trangers taient forcs, de mme que dans tous les
autres pays barbares, de recourir l'hospitalit prive, et, comme ils taient, dans
cette situation, un rel objet de piti, les particuliers devaient se considrer comme
obligs de les recevoir, bien que cette hospitalit constitut une charge
extrmement lourde. Cependant, quoique les trangers, soient, selon Homre, des
personnes sacres, places sous la protection de Jupiter, aucun homme sens
n'aurait appel de plein gr un tranger, moins que ce ne ft un barde ou un
devin. De plus, les dangers auxquels on tait expos en voyageant seul ou avec peu
de serviteurs, obligeaient tous les personnages de quelque importance traner
avec eux une suite nombreuse qui rendait l'hospitalit encore plus onreuse. De l
l'ordre donn dans les 24e et 85e Statuts de construire des htelleries. Puis, comme
beaucoup de gens prfraient conserver l'ancienne coutume et vivre aux dpens
des autres plutt qu' leurs frais, il en rsulta, de la part des hteliers, des plaintes
nombreuses qui provoqurent l'Acte 56.
Je ne puis terminer cette lettre, dj trop longue cependant, sans vous exprimer
mon sentiment, et plus encore mon indignation, au sujet de ce qui s'est pass
rcemment tant Londres qu' dimbourg. J'ai souvent pens que la Cour suprme
du Royaume-Uni ressemble beaucoup un jury. Les lords-magistrats prennent
gnralement sur eux de rsumer les tmoignages et d'expliquer la loi aux autres
pairs, qui se rangent d'habitude aveuglment leur avis.
Or, des deux lords-magistrats qui, dans cette affaire, guidrent les autres, l'un a
toujours recherch les applaudissements de la multitude, et l'autre, de beaucoup le
plus intelligent, a toujours montr la plus grande frayeur de la haine populaire,
sans avoir pu russir toutefois l'viter. On l'a toujours accus aussi d'une
tendance la partialit et je le souponne d'avoir suivi, dans cette affaire, plutt ses
craintes et son penchant que les lumires de sa raison. Je pourrais en dire beaucoup
plus sur ce sujet, mais je crains d'en avoir dj trop dit. Je prfrerais avoir, pour
ma part, la solide rputation de votre respectable Prsident, bien qu'expos aux
insultes d'une populace brutale, plutt que les applaudissements vains et frivoles
qui leur ont jamais t accords l'un ou l'autre. J'ai l'honneur d'tre, Mylord,
avec les plus hauts sentiments d'estime et de considration,
De Votre Seigneurie le trs oblig et obissant serviteur,
ADAM SMITH.
On voit donc qu'au commencement de l'anne 1769, deux ans et demi aprs son
retour en Angleterre, Adam Smith navait pas encore song abandonner son plan
et qu'il prparait son histoire de la jurisprudence telle qu'il l'avait annonce en
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
47
1759 1 . Pour lui, comme plus tard pour Guizot 2 , la civilisation consiste dans le
dveloppement simultan de l'individu et de l'tat social. Aussi, aprs avoir tudi
la nature de lhomme dans la Thorie des sentiments moraux et la marche de son
esprit dans les Essais philosophiques qu'il avait commencs, il voulait composer,
comme seconde partie de son Histoire de la Civilisation, ce Trait du Droit dans
lequel, il devait passer en revue les lgislations successives des peuples, dans le
but de montrer leur influence relle sur la marche de la socit elle-mme et de
rechercher les principes gnraux qui auraient d servir de base aux institutions
positives pour favoriser utilement le dveloppement de l'tat social.
Malheureusement il ne put raliser son dessein. Aprs plusieurs annes
d'tudes, il fut forc de reconnatre qu'il faisait fausse route en persistant
embrasser un plan aussi vaste, et que toute la vie d'un homme ne pourrait suffire
mener bonne fin une pareille entreprise. Il se rsigna donc peu peu limiter
successivement sa tche, il scinda son travail et se mit composer d'abord la partie
de son sujet qui avait mri davantage dans son esprit depuis son voyage en France,
savoir l'tude des institutions dont le but ou l'effet tait de rglementer la
formation et la distribution de la richesse. Il s'acharna alors plus que jamais
l'tude, car son plan, bien que trs rduit, tait encore immense, et il avait rsolu de
ne pas quitter Kirkaldy avant que cette partie de son uvre fut compltement
acheve.
David Hume ne comprenait pas cette dtermination ; il estimait, au contraire,
qu'un crivain doit habiter une grande ville afin de se tenir constamment dans une
atmosphre littraire, mme un peu surchauffe, et il ne cessait de supplier son ami
de quitter son village ou tout au moins d'aller le voir. La rsistance que lui opposait
Smith ne le lassait pas et il multipliait ses sollicitations.
Ds 1769, se trouvant, Pames-Court, d'o il domine le golfe du Forth et la
cte oppose du comt de Fife, il le presse dj de venir lui rendre visite 3 .
Je suis charm, crit-il, de jouir enfin du plaisir de vous voir, mais, comme je
voudrais aussi tre porte de vous entendre, j'ai fort cur que nous concertions
ensemble quelques mesures pour y parvenir. Le mal de mer me met la mort et je
regarde avec horreur, avec une sorte d'hydrophobie, le large dtroit qui nous
spare. Je suis d'ailleurs las de courir, au moins autant que vous devriez l'tre de
rester au logis. Je vous propose donc de venir ici et de passer quelques jours avec
moi dans cette solitude. Je veux savoir ce que vous avez fait et j'ai dessein d'exiger
1
2
3
Je me propose d'tablir dans un autre ouvrage, crivait Smith, les principes gnraux des lois
et du gouvernement, et des diffrentes rvolutions quils ont essuyes dans les diffrents ges de
la socit, soit relativement la justice, soit l'gard des finances, de la police, des armes, de
tout ce qui peut tre l'objet des lois. Th. des sentim. moraux, VIIe partie, IVe section.
Guizot. Histoire de la civilisation, en Europe. Paris, Didier, 12e dit., p. 94.
Cette lettre est cite par Dugald-Stewart dans la Vie de Smith, traduite par P. Prevost en tte des
Essais philosophiques. Agasse, 1797.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
48
de vous un compte rigoureux de l'emploi de votre temps dans votre retraite. Je
vous dclare positivement que vous vous trompez dans plusieurs de vos
spculations, et particulirement dans celles o vous avez le malheur de diffrer de
mes opinions. Voil bien des raisons pour avoir un entretien et je souhaite que
vous me fassiez enfin quelque proposition raisonnable ce sujet. Il n'y a point
d'habitation dans l'le d'Inchkeith, sans quoi j'aurais choisi ce lieu pour vider notre
diffrend, et nous nen serions point sortis que nous ne fussions tombs d'accord
sur tous les points en controverse. J'attends ici demain le gnral Conway ; je
l'accompagnerai Roseneath et j'y passerai quelques jours. mon retour, j'espre
trouver une lettre de vous, qui m'annoncera que vous acceptez en homme de cur
le dfi que je vous, signifie.
Et il renouvelle sans cesse ses tentatives. En 1772, il le conjure encore de venir
passer quelques jours avec lui Edimbourg.
Je n'accepterai point, crit-il 1 , l'excuse de votre sant, que je n'envisage que
comme un subterfuge invent par l'indolence et l'amour de la solitude. En vrit,
mon cher Smith, si vous continuez d'couter tous ces petits maux, vous finirez par
rompre entirement avec la socit, au grand dtriment des deux parties
intresses.
Smith avait toujours un motif quelconque faire valoir pour ne pas quitter sa
retraite, et, sauf un petit voyage qu'il fit Londres en passant par Edimbourg, au
mois d'avril 1773, il reste constamment Kirkaldy, prparant son immense
ouvrage qui dnote, en effet, une somme de travail considrable et qu'il modifia
jusqu'au dernier moment au moyen des nouveaux documents qu'il pouvait
recueillir 2 .
Il rdigeait d'ailleurs fort lentement, malgr l'apparente limpidit de son style,
et il en faisait encore la remarque Dugald-Stewart peu de temps avant sa mort.
Cependant tout le travail de la composition s'effectuait dans son esprit mme et il
ne dictait son secrtaire le rsultat de ses mditations que lorsqu'un chapitre tait
compltement termin au point de vue de la forme comme au point de vue du fond.
Habitu au professorat, il prparait son uvre comme des leons, mentalement, et,
debout au milieu de sa chambre, tourn vers la chemine, il parlait comme s'il
faisait un cours un auditoire invisible, tandis que son secrtaire, la plume la
main, recueillait textuellement ses paroles. Il y a quelques annes peine, on
montrait encore aux touristes qui visitaient la maison du matre Kirkaldy, une
large tache de graisse marquant, sur la muraille du cabinet de travail, la place o
1
2
Dugald Stewart. Loc. cit.
C'est ainsi que nous trouvons dans la Richesse des Nations des documents officiels qui venaient
de paratre trs peu de temps avant la publication de l'ouvrage ; par exemple, la situation de la
dette fonde de la Grande-Bretagne au 5 janvier 1775 (Richesse des Nations, livre V, ch. III, p.
635).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
49
s'appuyait, pendant le feu de la composition, la tte du penseur mditant la
Richesse des Nations 1 .
De Studnitz. (Extrait du Die Gegenwart, de Berlin, du 26 fvrier 1876). Journal des
conomistes, 1876, II p. 258.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
50
CHAPITRE V.
________
Retour la table des matires
Enfin, au commencement de l'anne 1776, l'ouvrage parut Londres, en 2 forts
volumes, sous le titre de Recherches sur la nature et les causes de la Richesse des
Nations.
Il eut, en Angleterre, un immense succs. On l'accueillit d'abord avec faveur
cause de la rputation mme de l'auteur, qui tait considrable, puis cette faveur
devint de l'enthousiasme lorsqu'on et pu se rendre compte, par la lecture, de la
vaste porte de cette uvre.
Assurment cet ouvrage, quelle qu'en soit la valeur, manque parfois d'lgance
et toujours de sobrit ; mais cette pesanteur mme tait plutt, chez nos voisins,
un puissant lment de succs. Cet amas de faits qui alourdit le plan, ces
digressions continuelles qui fatiguent et distraient l'attention, taient
particulirement gotes par l'esprit anglais, et si Adam Smith, pntr de la
littrature franaise, avait allg son uvre en n'y maintenant que les ides
gnrales et les faits particuliers les plus indispensables leur dmonstration, son
livre n'et peut-tre pas t lu par beaucoup de ses compatriotes.
C'est l, en effet, une face curieuse du caractre de l'esprit anglais, et il importe
d'insister sur cette observation, parce qu'elle fait mieux comprendre la composition
de l'uvre que nous tudions et qu'elle permet de dmler l'un des plus puissants
lments du succs des Recherches en Angleterre. Le Franais, dit M. Taine 1 ,
demande tout crit et toute chose la forme agrable ; l'Anglais peut se contenter
du fonds utile. Le Franais aime les ides en elles-mmes et pour elles-mmes ;
l'Anglais les prend comme des instruments de mnmotechnie ou de prvision... En
gnral, le Franais comprend au moyen de classifications et par des mthodes
dductives ; l'Anglais, par induction, grce la reprsentation lucide et persistante
1
Notes sur lAngleterre, ch. VIII.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
51
d'une quantit de faits individuels, par l'accumulation indfinie des documents
isols et juxtaposs. Quiconque a tudi leur littrature et leur philosophie, depuis
Shakespeare et Bacon jusqu', aujourd'hui, sait que cette inclination chez eux est
hrditaire et qu'elle appartient la forme mme de leur esprit, qu'elle tient leur
faon de comprendre la vrit. Selon eux, l'arbre doit se juger aux fruits et la
spculation la pratique ; une vrit n'a de prix que si elle provoque des
applications utiles. Au-del des vrits banales, il n'y a que des chimres vaines.
Telle est la condition de l'homme : un cercle restreint capable de s'largir, mais
toujours ferm de barrires, dans lequel il faut savoir, non pour savoir mais pour
agir, la science n'tant valable que par le contrle qui la vrifie et l'usage auquel
elle sert.
Or, l'uvre de Smith rpondait parfaitement ce besoin de ses compatriotes :
son ouvrage tait hriss de faits. Point de thorie qu'il ne prouvt par des
exemples divers et surtout multiples ; point de doctrine dont il ne fit aussitt
ressortir toutes les applications. Il avait dbarrass l'conomie politique de
l'appareil solennel et formulaire dont les physiocrates l'avaient entoure et qui en
rendait l'tude inabordable au plus grand nombre, s'attachant, au contraire,
prsenter ses ides simplement, de faon les faire entrer plus facilement dans
l'esprit de ses lecteurs.
De plus, il ne comprenait pas l'conomie politique elle-mme comme Quesnay
et Turgot : il n'y voyait pas seulement une science, mais aussi un art, et son bon
cur ne pouvait se rsigner noncer un principe sans en rechercher
immdiatement toutes les applications dans l'intrt de l'humanit. L'conomie
politique, dit-il en tte du deuxime volume de ses Recherches, considre comme
une branche des connaissances du lgislateur et de l'homme d'tat, se propose
deux objets distincts : le premier, de procurer au peuple un revenu ou une
subsistance abondante, ou, pour mieux dire, de le mettre en tat de se procurer luimme ce revenu ou cette subsistance abondante ; le second objet est de fournir
l'tat ou la communaut un revenu suffisant pour le service public ; elle se
propose d'enrichir la fois le peuple et le souverain.
Le cadre mme de son uvre se prtait d'ailleurs de lui-mme cette double
conception, puisqu'il avait pour objet d'exposer l'un des aspects de l'histoire
gnrale de la civilisation : c'tait l'tude de la marche de la richesse que Smith
avait en vue, et, comme cette marche n'a pas t dirige uniquement par les lois
naturelles, qu'elle s'est heurte souvent aux rglements et aux institutions positives,
il se trouvait conduit non-seulement des spculations thoriques sur les lois et les
causes, mais aussi l'apprciation du rle mme du lgislateur, de ce qu'il avait t
et de ce qu'il aurait d tre.
Enfin, il faut bien l'avouer, un autre motif moins noble contribuait encore au
succs des Recherches chez nos voisins d'Outre-Manche. L'Angleterre jalousait, un
peu la suprmatie intellectuelle de la France. Grce sa puissance maritime, elle
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
52
avait russi nous enlever nos colonies, ruiner notre commerce, chasser notre
pavillon des mers ; mais elle se voyait avec peine force de reconnatre que la
France vaincue, replie sur elle-mme, restait toujours la reine inconteste de la
littrature et de la civilisation. Elle avait vu l'conomie politique clore chez nous,
l'cole de Quesnay accueillie avec enthousiasme, faisant, au point de vue
scientifique, la conqute de l'Europe, et l'orgueil britannique se sentait
intrieurement froiss de n'avoir pas un nom anglais opposer nos physiocrates.
Smith, il est vrai, tait cossais, c'est--dire un peu Franais, mais il avait t lev
Oxford, il ne partageait nullement l'aversion outre de David Hume pour
l'Angleterre et il paraissait mme gagn, en somme, au fait acquis de l'Union 1 .
Son triomphe devait donc tre un triomphe national, et il fut d'autant plus vif que
l'auteur dfendait chaleureusement la cause du commerce et de l'industrie qui
faisaient la gloire et la richesse de l'Angleterre, repoussant cette pithte de travail
strile que leur avaient maladroitement applique les physiocrates et qui tait
devenue blessante pour avoir t mal comprise.
Le succs des Recherches prit donc immdiatement un caractre gnral, et,
quels qu'en fussent les divers motifs, il tait absolument mrit.
Hume se montra heureux de la faveur qui accueillait le Trait de son ami, plus
heureux mme que s'il se ft agi d'un de ses propres livres, et, sur son lit de
douleur, il voulut tre le premier fliciter l'auteur :
Trs bien ! bravo ! mon cher monsieur Smith, lui crit-il ds le 1er avril
1776 ; votre ouvrage m'a fait le plus grand plaisir, et, en le lisant, je suis sorti dun
tat d'anxit pnible. C'tait un ouvrage dont l'attente tenait si fort en suspens et
vous-mme, et vos amis, et le public, que je tremblais de le voir paratre ; mais
enfin je suis soulag. Ce n'est pas qu'en songeant combien cette lecture exige
dattention et combien peu le public est dispos en accorder, je ne doive douter
encore quelque temps du premier souffle de la faveur populaire. Mais on y trouve
de la profondeur, de la solidit, des vues fines, une multitude de faits curieux : de
tels mrites doivent tt ou tard fixer l'attention publique. Il est probable que votre
dernier sjour Londres a contribu perfectionner cette production. Si vous tiez
l, au coin, de mon feu, je vous contesterais quelques-uns de vos principes... Mais
tout cela, et cent autres points, ne peuvent tre discuts qu'en conversation. J'espre
Dans plusieurs passages, en effet, on sent que Smith est ralli l'Union de l'cosse avec
l'Angleterre et qu'il n'en mconnat pas les avantages, tmoin le passage suivant : Par l'union
avec l'Angleterre, les classes moyennes et infrieures du peuple en cosse ont gagn de se voir
totalement dlivres du joug d'une aristocratie qui les avait toujours auparavant tenues dans
l'oppression (Richesse, t. II, p. 663). D'ailleurs, ds 1755, dans sa Lettre aux diteurs de la
Revue d'Edimbourg, il s'tait mme rjoui d'tre citoyen du Royaume-Uni : Depuis la runion
de l'cosse l'Angleterre, crivait-il, nous sommes disposs envisager les grands hommes que
je viens de nommer (Bacon, Boyle, Newton), comme nos concitoyens. Ainsi, en ma qualit de
citoyen de la Grande-Bretagne, je ne puis que me sentir flatt de voir ainsi reconnatre par une
nation rivale (il s'agissait de la France), la supriorit de l'Angleterre.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
53
que ce sera dans peu, car l'tat de ma sant est fort mauvais et ne peut vous
accorder un long dlai.
Malheureusement les deux amis ne devaient plus se revoir. Hume tait atteint
d'une dysenterie incurable, et, se sentant prs de sa fin, il crivit quelques mois
plus tard Adam Smith pour lui faire ses dernires recommandations au sujet de la
publication de ses Dialogues. Lord Brougham a publi la rponse de l'auteur de
Recherches et nous croyons devoir la traduire ici, car elle nous claire sur
l'affection toujours croissante que le philosophe de Glasgow professait pour le
grand historien. un autre point de vue d'ailleurs, elle est aussi fort curieuse, en ce
qu'elle montre Adam Smith soumettant en quelque sorte son ami mourant les
grands traits de l'apologie qu'il comptait faire de lui aprs son dcs :
Kirkaldy, 22 aot 1776.
Mon plus cher ami,
Je reois l'instant votre lettre du 15 courant. Afin de m'conomiser la somme
d'un penny-sterling, vous l'avez envoye par le messager au lieu de me la faire
parvenir par la poste, et, si vous ne vous tes pas tromp de date, elle est reste
chez lui pendant huit jours et elle aurait pu fort bien, je crois, y rester indfiniment.
Je serai trs heureux de recevoir une copie de vos Dialogues, et, s'il arrivait que
je mourusse avant qu'ils soient publis, j'aurai pris soin que cette copie soit
prserve aussi soigneusement que si je devais vivre cent ans.
Quant m'en laisser la proprit dans le cas o ils ne seraient pas dits dans
les cinq annes qui suivraient votre dcs, vous pouvez faire ce que vous jugerez
prfrable. Je pense, toutefois, que vous ne devez pas menacer Strahan d'une perte
quelconque dans le cas o il ne publierait pas votre uvre dans un dlai fix. Il
n'est pas du tout probable qu'il la nglige, et si quelque chose pouvait la lui faire
ngliger, ce serait une clause de cette nature qui lui donnerait un prtexte
honorable. On dirait alors que j'ai publi seulement en vue d'un profit et non par
respect pour la mmoire de mon ami, ce qu'un imprimeur mme n'avait pas dit
pour le mme bnfice. Strahan est suffisamment zl : vous le verrez par la lettre
ci-jointe que je vous prie de vouloir bien me retourner, mais par la poste et non par
le messager.
Si vous voulez me le permettre, j'ajouterai quelques lignes au rcit que vous
avez fait de votre propre vie, en rendant compte de la manire dont vous vous tes
comport dans cette maladie, si, contrairement mon espoir, elle devait tre la
dernire. Quelques conversations que nous avons eues dernirement ensemble,
notamment en ce qui concerne le manque d'excuses donner Caron, le prtexte
auquel nous avions pens la fin et la trs mauvaise rception qui nous et
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
54
probablement attendus de la part de Caron, feraient, je me l'imagine, assez bonne
figure dans cette histoire.
Vous avez, dans un tat de sant empirant sans cesse, en proie un mal
puisant, envisag, pendant plus de deux ans, l'approche de la mort (ou ce que
vous croyez du moins tre l'approche de la mort), avec une bonne humeur
persistante que peu de gens, mme de ceux qui jouissent de la meilleure sant
possible, eussent pu conserver pendant quelques heures seulement.
De mme, je corrigerai, si vous voulez bien me le permettre, les preuves de la
nouvelle dition de vos uvres, et je veillerai ce que celle-ci soit publie
conformment vos dernires corrections. Comme je serai Londres cet hiver,
cela me causera trs peu de drangement.
J'ai crit tout cela dans l'hypothse que l'issue de votre maladie serait diffrente
de celle que nous avons pu esprer jusqu'ici. Mais votre moral est si bon, votre
vitalit si grande et le progrs de votre mal si lent, que jespre toujours que cela
prendra un tour heureux. Le Dr Black lui-mme, si froid et si mesur, semble, dans
une lettre que j'ai reue de lui la semaine dernire, partager le mme espoir.
Je pense que je n'ai pas besoin de vous rpter que je suis prt me rendre prs
de vous ds que vous dsirerez me voir. quelque moment que ce soit, je compte
que vous ne vous ferez aucun scrupule de me mander.
Je vous prie de me rappeler au meilleur souvenir de votre frre, de votre sur,
de votre neveu et de tous mes autres amis,
Je suis toujours, mon trs cher ami,
Votre tout affectionn
ADAM SMITH.
Trois jours plus tard, le 25 aot l776, David Hume mourait 1 . Smith n'avait pas
cru, en ralit, un dnouement aussi rapide, et la fin de son ami lui causa un vif
chagrin. Mais il tint remplir aussitt la promesse qu'il avait faite au mourant et
rendre un tmoignage public d'estime et d'affection sa mmoire. Il retraa donc
Par son testament, Hume laissait son ami une somme de 200 livres sterling et un exemplaire
de ses uvres ; mais Adam Smith ne voulut pas accepter la premire partie du legs, malgr les
instances du fire du clbre historien, M. John Home de Ninewells. Voir, sur ce point, une
lettre du Dr Smith et la rponse de M. John Home, recueillies toutes deux par lord Brougham
(Lives of men of science, etc.)
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
55
les derniers moments du clbre historien dans une lettre Strahan 1 , et ce dernier
fut autoris la publier la suite de la Vie de Hume, dont il tait l'diteur.
C'est avec un plaisir rel, quoique bien ml de peine, crivait Smith, que je
prends la plume pour vous donner quelques dtails sur la manire dont notre
excellent ami, M. Hume, s'est conduit dans sa dernire maladie. Quoiqu'il et jug
lui-mme son mal incurable et mortel, cependant, par gard pour les instances de
ses amis, il consentit faire l'essai de ce que pourrait produire sur lui un long
voyage. Quelques jours avant de se mettre en route, il crivit le prcis de sa vie,
qu'il a confi vos soins ainsi que ses autres papiers. Mon rcit commence donc
o le sien finit.
Puis, aprs avoir fait l'historique des progrs de la maladie de Hume, de la fin
d'avril au 25 aot 1776, date du dcs, il ajoutait :
Telle a t la fin de notre excellent ami dont la mmoire nous sera toujours
chre. On pourra juger diversement de ses opinions philosophiques, chacun les
approuvant ou les condamnant suivant qu'il les trouvera conformes ou contraires
aux siennes ; mais il est difficile qu'il y ait de la diversit dans le jugement qu'on
portera de sa conduite et de son caractre. Jamais les facults naturelles d'aucun
homme ne furent plus heureusement combines et quilibres ; mme dans le plus
bas tat de sa fortune, son extrme conomie ne l'empcha jamais de faire
l'occasion des actes de charit et de gnrosit : c'tait une conomie ncessaire,
fonde, non sur l'avarice mais sur l'amour de l'indpendance. La grande douceur de
son caractre n'altra jamais la fermet de son me ni la confiance de ses
rsolutions. Sa plaisanterie habituelle n'tait que la simple effusion d'une bont
naturelle et d'une gaiet tempre par la dlicatesse et la modestie, et o il n'entrait
pas la plus lgre teinture de cette malignit qui est si souvent le principe
dangereux de ce qu'on appelle communment l'esprit. Jamais il ne lui chappa une
seule raillerie qui et pour but de mortifier : aussi ses railleries plaisaient-elles
ceux mmes sur qui elles tombaient, et, de toutes ses grandes et aimables qualits,
peut-tre n'y en et-il pas une qui rendit sa socit plus agrable ses amis que
cette tournure de plaisanterie, quoiqu'ils en fussent d'ordinaire les objets. Cette
gaiet naturelle, si agrable dans le monde, mais si souvent accompagne de
qualits frivoles et superficielles, s'alliait en M. Hume avec l'application la plus
srieuse, les connaissances les plus varies, la plus grande profondeur de pense, et
lesprit tous gards le plus tendu. Enfin, je l'ai toujours regard, pendant sa vie
et aprs sa mort, comme l'homme le plus approchant de l'ide qu'on se forme d'un
homme parfaitement sage et vertueux, que peut-tre ne le comporte la nature et la
faiblesse humaine .
Cette apologie tait certainement empreinte d'une forte exagration. En effet,
quelque favorable que puisse tre le jugement que l'on ait porter sur le caractre
1
Cette lettre Strahan est date de Kirkaldy, 9 novembre 1776 (Vie de Hume crite par luimme, traduction Suard. Paris, 1777).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
56
de David Hume, on ne peut nier que le clbre historien ait t souvent dispos
abuser de son esprit contre ses adversaires. Ses amis mmes ne furent pas l'abri
de ses saillies parfois incisives, et nous avons vu que le trait le plus piquant de la
fameuse lettre d'Horace Walpole contre J.-J. Rousseau n'tait que la rptition d'un
mot de Hume sur la manie de la perscution qui affligeait son malheureux ami.
D'ailleurs, la lecture mme de l'histoire de sa vie, que venait complter la lettre du
Dr Smith, forait reconnatre, qu'au moins dans ses derniers moments, il avait t
injuste et mme impertinent l'gard de ses adversaires, notamment, du Dr
Warburton, vque de Glocester 1 . Aussi la dernire phrase de cette lettre de Smith
souleva une tempte. On ne put se rsoudre voir, dans le philosophe sceptique
qui niait l'existence d'un Dieu, un modle de perfection et de vertu, et les plus
modrs estimaient tout au moins, comme l'a dit le Dr Carlyle, que Hume avait
moins vcu toute sa vie en homme moral qu'en investigateur ou en critique.
L'indignation fut profonde dans les rangs du clerg, et le Dr Horne, vque de
Norwich, dans une lettre anonyme, attaqua vivement Adam Smith sur le terrain
religieux.
On avait tort, cependant, d'attribuer au disciple d'Hutcheson les opinions
mtaphysiques de David Hume. Smith ne paraissait attach, il est vrai, aucune
des glises tablies, mais, nous l'avons dj fait remarquer, il professait une
doctrine leve en matire religieuse, et l'affirmation de l'existence de Dieu, de
l'immortalit de l'me, a servi de thme l'un des plus beaux morceaux de sa
Thorie des sentiments moraux 2 . Toutefois il ne rpondit rien au Dr Horne, il
vitait toujours avec le plus grand soin toute discussion religieuse, et d'ailleurs il
jugea peut-tre aussi, dans cette circonstance, qu'il avait t un peu loin dans
l'loge de son ami.
Vers la mme poque, il quitta Kirkaldy pour aller s'tablir Londres. Aprs
dix annes de solitude dans son petit bourg d'cosse, il jugeait ncessaire de se
retremper dans un milieu littraire, car il sentait que son esprit tait un peu fatigu
d'une trop longue concentration sur la mme matire, et, avant dentreprendre son
nouvel ouvrage, il trouvait utile de vivre quelque temps de la vie intellectuelle
d'une grande ville. Il fut accueilli avec empressement par la socit la plus
distingue de Londres, heureuse d'avoir dans son sein le grand conomiste, et il
passa de fort agrables moments dans le commerce des hommes les plus minents,
tels que l'historien Gibbon qui s'tait dj fait connatre par ses tudes sur la
On en jugera par les deux passages suivants : On imprimait dans une anne deux ou trois
rponses mes crits, faites par des rvrends et trs rvrends auteurs, et je jugeai, par les
invectives du Dr Warburton, que mes livres commenaient tre estims en bonne
compagnie. Et plus loin : (Dans cet intervalle, je publiai Londres mon Histoire naturelle de
la religion, avec quelques autres morceaux. Cette nouvelle production resta d'abord assez
obscure ; seulement le Dr Hurd y rpondit par un pamphlet crit avec toute l'arrogance,
l'amertume et la grossiret qui distinguent l'cole Warburtonienne. Ce pamphlet me consola un
peu de l'accueil assez froid d'ailleurs qu'on fit mon ouvrage. (Vie de Hume, traduction Suard).
Thorie des sentiments moraux, p. 149 et 276.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
57
littrature, l'loquent orateur Burke qu'on appelait le Cicron anglais, l'hellniste
Jones, le brillant causeur Beauclerc.
Nous savons peu de chose sur la nature et la direction de ses tudes durant son
sjour dans la capitale de l'Angleterre, et, s'il est probable qu'il travailla pendant
cette priode son Trait du Droit, il est certain, du moins, qu'il y consacra fort
peu de temps. D'ailleurs, il ne passa Londres que deux annes, car la famille de
Buccleugh s'occupait d'obtenir pour lui l'emploi qu'elle lui avait promis son
dpart de Glasgow, et, en 1778, il tait nomm commissaire des douanes avec
rsidence Edimbourg.
On a parfois reproch l'auteur des Recherches d'avoir accept ces fonctions
qui le foraient appliquer une lgislation douanire contre laquelle il s'tait lev
avec tant de violence dans ses ouvrages, et, dans l'enceinte mme de notre
Acadmie des Sciences, un savant distingu, M. Flourens, n'a pas craint de lancer
cet gard contre Adam Smith une accusation de mauvaise foi 1 .
Nous ne pouvons laisser passer cette attaque sans la relever, non seulement
pour la gloire d'Adam Smith dont la probit scientifique est indiscutable, mais
aussi dans l'intrt de l'conomie politique elle-mme que l'minent physiologiste a
voulu atteindre dans un des plus illustres de ses fondateurs. Cette attaque
inattendue prouve que le clbre acadmicien ne connaissait que superficiellement
celui qu'il condamnait, sans, quoi il et appris, par la lecture de ses uvres comme
par l'tude de sa biographie, respecter cette grande et sympathique figure du
savant modeste et dsintress qui n'avait en ralit pour seul but que le bonheur
de l'humanit. N'et-il que parcouru la Thorie des sentiments moraux qu'il net
pu se dfendre d'une vritable admiration pour le caractre de l'auteur. Il aurait vu
que ce n'tait pas seulement la fin de sa vie, comme commissaire des douanes,
que Smith avait accept la lgislation existante, et qu'au contraire, sa plus
constante proccupation avait toujours t d'viter, en cette matire plus qu'en
toute autre, les rformes trop radicales et trop brusques qui troublent la production
et violent les droits acquis 2 . Mieux clair, il n'et pas eu l'ide de rechercher ainsi
et de signaler, dans une forme regrettable et blessante, cette contradiction
imaginaire entre les doctrines de l'conomiste et les actes de l'homme priv. Mais
il est tomb dans l'erreur commune tous ceux qui n'ont pas lu les Recherches
dans leur entier : tous se reprsentent Adam Smith comme un ennemi dclar des
1
Nous voulons parler du passage suivant de l'loge de M. Benjamin Delessert, lu l'Acadmie
des sciences par M. Flourens, au mois de mars 1850 : Adam Smith lui apprit, par ses livres,
raisonner clairement sur l'conomie politique, et, par son exemple, ne pas trop se fier ses
raisonnements : le partisan le plus zl du libre-change est mort commissaire gnral des
douanes en cosse.
Tels sont, dit-il quelque part, les malheureux effets de tous les rglements du systme
mercantile ! Non-seulement ils font natre des maux trs dangereux dans l'tat du corps
politique, mais encore ces maux sont tels qu'il est souvent difficile de les gurir sans
occasionner, pour un temps au moins, des maux encore plus grands. (Rich. des Nations, II,
233).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
58
taxes douanires. Or il n'en tait rien, et ceux qui connaissent son chapitre DES
IMPTS savent que si le clbre conomiste repoussait les droits de douane en
tant que moyens protecteurs, il les recommandait du moins comme moyens
fiscaux, estimant que, s'ils sont bien compris et modrs, ils peuvent fournir juste
titre une partie considrable du revenu de l'tat 1 .
Pour notre part, loin de considrer l'acceptation des fonctions de commissaire
des douanes comme un dmenti officiel donn par le philosophe aux principes
qu'il avait professs sur la libert des changes, nous croyons plutt que Smith a d
choisir cet emploi de prfrence tout autre, esprant, tort peut-tre, que cette
situation lui permettrait de raliser de nombreuses amliorations de dtail dans
cette partie de l'administration fiscale de son pays, et de prparer ainsi la voie aux
grandes rformes par une application librale de la lgislation existante qu'il et
t imprudent de bouleverser brusquement.
Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'ancien professeur de Glasgow tait bien
peu prpar une situation de ce genre, car il n'avait jamais t ml, dans la
pratique, aucune besogne financire, et celui qu'on chargeait ainsi de grer les
affaires de l'tat n'aurait peut-tre pas t capable de grer les siennes propres. Il
fallait l des qualits d'ordre, de prcision, de vigilance, qu'on et trouves plus
facilement dans un mdiocre comptable que dans ce penseur mditatif dont les
hautes vues thoriques taient d'une application bien restreinte dans son nouvel
emploi. D'autre part, on le sait, ses distractions taient phnomnales, et sir
Bagehot rapporte que c'est dans l'exercice de ses nouvelles fonctions qu'il tonna si
fort un de ses subordonns qui lui apportait une pice viser, en imitant la
signature de son prdcesseur place au-dessus, au lieu de donner la sienne propre.
Nous reconnaissons donc volontiers que le Gouvernement ne pouvait faire un
plus mauvais choix. Mais certains biographes, se plaant un autre point de vue,
ont aussi regrett pour la postrit, cette interruption dans la vie littraire de
Smith : nous croyons que c'est tort. L'auteur des Recherches avait recueilli, il est
vrai, de nombreux documents, non-seulement pour son Trait du Droit, mais
encore pour cette autre partie de l'Histoire de la Civilisation qui a trait la marche
des sciences et des arts, et il avait mme commenc en crire des fragments dont
les principaux ont t conservs et publis aprs sa mort sous le titre d'Essais
philosophiques. Toutefois, en ce qui concerne les sciences et les arts, les matriaux
rassembls jusque-l taient rellement trop insuffisants et Smith se rendait compte
des difficults qu'il rencontrerait pour s'en procurer de nouveaux : son sicle
n'avait pas encore accumul assez d'observations pour permettre d'entreprendre un
pareil travail, et il sentait bien que, dans ces conditions, il ne lui serait pas possible
de donner une base exprimentale assez large ses thories.
Rich. des Nations, II, p. 578, 581 et 582.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
59
Quant l'histoire du Droit, elle tait mieux connue ; mais Montesquieu avait
tir un si merveilleux parti de tous les faits et il avait produit, dans cette partie de la
science, un monument si considrable que le Dr Smith dut craindre certainement
de mettre une uvre trop peu mrie en parallle avec l'Esprit des Lois. crire aprs
Montesquieu, sur le mme sujet, pouvait tre une tmrit dangereuse, et l'auteur
des Recherches qui, au fond, avait grand souci de sa rputation, dut reconnatre
qu' cinquante-trois ans, il tait peut-tre imprudent de tenter de composer la hte
un ouvrage de cette importance dont l'laboration aurait exig la vie entire d'un
homme.
Aussi nous ne serions pas loign de croire qu'au moment o il termina la
Richesse des Nations, Smith avait dj compltement abandonn l'espoir de
publier son Trait du Droit, car, dans aucun passage de son grand ouvrage, ni
propos de la lgislation douanire, ni en examinant l'administration de la justice, il
n'a fait mention de son intention d'crire l'histoire de la jurisprudence, et nulle part
il n'a renouvel les allusions contenues dans sa Thorie des sentiments moraux au
sujet de cette partie de son vaste plan. Certains biographes affirment, il est vrai,
qu'il ne parat jamais avoir perdu toute ide d'utiliser les documents qu'il avait
recueillis, et qu'il songea formellement les publier dans les dernires annes de sa
vie, sous forme d'un Examen critique de lEsprit des Lois ; mais cette dernire
information, qui ne repose que sur les racontages d'un journal 1 , nous parat peu
certaine, et nous croyons plus volontiers quAdam Smith, fier du succs de ses
uvres, recula jusqu' la fin devant toute autre publication qui, difie avec des
matriaux insuffisants, et pu porter atteinte sa gloire.
Edimbourg, il se livra tout entier aux obligations de sa profession. Quoique
ses occupations fassent trs simples et qu'elles n'exigeassent pas de grands efforts
intellectuels, elles ne lui laissaient aucun loisir, et non-seulement il ne publia rien,
mais encore il tudia fort peu. Il vcut ainsi tranquillement, pendant les quatorze
annes qui s'coulrent jusqu' sa mort, au milieu de ses compagnons de jeunesse
et recherch par l'lite de la socit cossaise ; on l'aimait pour la noblesse de son
caractre, pour sa gaiet, sa srnit inaltrable, pour la chaleur et l'empressement
qu'il mettait rendre service.
Sa conversation d'ailleurs, parfois originale, tait toujours pleine de charmes, et
nous ne pouvons mieux faire que de citer cet gard les impressions d'un tmoin
minent de ses entretiens, Dugald Stewart, qui, professeur de philosophie
Edimbourg en 1784, put ainsi apprcier, dans le commerce mme du Dr Smith, la
tournure de son esprit et la vivacit de son imagination :
Il est peut-tre impossible, crivait Dugald Stewart dans son loge de
Smith 2 , d'indiquer les nuances dlicates qui caractrisaient son esprit.
1
2
Voir le Moniteur universel du jeudi 11 mars 1790.
Prsent la Socit royale d'Edimbourg, et traduit, en tte des Essais philosophiques, par P.
Prevost, de Genve.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
60
L'observateur le plus superficiel ne pouvait manquer d'y voir des singularits qui
se manifestaient dans ses manires et dans ses habitudes intellectuelles. Mais
quoique ces singularits ne lui fissent rien perdre, aux yeux de ceux qui le
connaissaient, du respect qu'imposait son gnie, et qu'aux yeux de ses amis, elles
ajoutassent mme un charme inexprimable son commerce en dcouvrant, sous le
jour le plus heureux, l'aimable simplicit d'un cur exempt d'artifice, il faudrait un
pinceau bien habile et bien dlicat pour les exposer sans risque aux regards du
public. Il est certain que M. Smith n'tait pas propre au commerce du monde ni aux
affaires. Les vastes sujets de mditation dont il avait t occup ds sa jeunesse et
le grand nombre de matriaux que son esprit inventif fournissait sans cesse, le
rendaient habituellement inattentif aux objets familiers et aux petits vnements de
chaque jour ; en sorte qu'il donnait frquemment des exemples de distraction
comparables tout ce qu'a pu peindre en ce genre l'imagination de La Bruyre. En
compagnie, il n'tait pas rare de le voir absorb par les objets de ses tudes, et, au
mouvement de ses lvres, aussi bien qu' ses gestes et son regard, on pouvait
supposer qu'il tait dans le feu de la composition...
C'est probablement cette habitude de distraction qu'il faut attribuer en partie
la difficult qu'il avait se conformer au ton du dialogue ou de la conversation
ordinaire : on remarquait que la sienne prenait la forme d'une leon. Lorsque cela
lui arrivait, ce n'tait jamais par le dsir de s'emparer de la parole ou par un
sentiment de sotte vanit : il tait si dispos, par inclination, jouir en silence de la
gaiet de ceux qui l'entouraient, que ses amis en furent souvent rduits se
concerter entre eux pour le mettre sur les sujets qu'ils jugeaient devoir l'intresser,
et je ne crains pas d'tre accus d'exagration en avanant qu'on ne le vit presque
jamais mettre un nouveau sujet sur le tapis ni manquer de moyens pour traiter ceux
que d'autres lui fournissaient. la vrit, sa conversation n'tait jamais plus
piquante que quand il laissait errer son gnie sur le petit nombre d'objets qui, dans
le vaste champ de la science, lui taient peu familiers et dont il n'avait acquis que
des connaissances superficielles.
Les jugements qu'il formait sur les hommes d'aprs une lgre liaison, taient
souvent errons ; mais la pente naturelle de son caractre le portait beaucoup plus
une partialit aveugle qu' des prventions dfavorables et mal fondes.
Accoutum considrer les affaires humaines sous des points de vue vastes et
intressants, il n'avait ni le temps, ni l'inclination de considrer en dtail les
qualits particulires des caractres vulgaires. De l vient que, quoiqu'il ft
profondment vers dans la connaissance du cur et de l'esprit humain, quoiqu'il
et employ souvent cette connaissance dans ses crits en marquant d'une touche
dlicate les ombres les plus fines et les plus lgres du gnie et des passions,
cependant il lui arrivait souvent, en s'occupant des individus, de porter des
jugements qui s'cartaient de la vrit un tel point qu'on ne pouvait s'empcher
d'en tre surpris.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
61
Dans la confiance et l'abandon auxquels il se livrait quelquefois en socit
dans ses heures de dlassement, il hasardait des jugements sur les livres ou des
opinions sur des questions de thorie, qui ntaient pas toujours tels qu'on les
aurait attendus d'un esprit suprieur et d'un philosophe aussi distingu pour la
constance et l'accord de ses principes. Ses jugements et ses opinions se ressentaient
quelquefois de l'influence des circonstances accidentelles ou mme de l'humeur du
moment, et lorsqu'ils taient recueillis par ceux qui ne le voyaient
qu'occasionnellement, ils taient propres donner de ses vrais sentiments des ides
fausses et contradictoires. Toutefois, en ces occasions comme en d'autres, il y avait
toujours dans ses remarques beaucoup d'esprit et de vrit, et, si l'on et combin
les diffrentes opinions qu'il nonait en divers temps sur un mme sujet, de
manire les modifier et les limiter les unes par les autres, on en et tir
probablement de quoi former une dcision galement juste et complte. Mais, dans
la socit de ses amis, il n'avait pas de penchant rechercher ces rsultats si bien
dduits qu'on admire dans ses ouvrages ; il se contentait, d'ordinaire, d'une
esquisse de l'objet, hardie et de main de matre, en saisissant le premier point de
vue que lui prsentait son humeur ou son imagination.
On remarquait quelque chose de semblable lorsqu'il entreprenait, dans la
chaleur d'une conversation anime, de tracer le caractre de ses relations les plus
intimes et qui, par cette raison, devaient lui tre parfaitement connues. Le portrait
tait toujours plein de feu et d'expression ; il frappait d'ordinaire par des traits de
ressemblance marqus et trs piquants, pourvu qu'on envisaget l'original sous un
aspect particulier ; rarement peut-tre y aurait-on trouv une image juste et
complte sous tous les rapports et selon toutes les dimensions de l'objet. En un
mot, on pouvait reprocher ces jugements qu'il portait sans avoir le temps de les
mrir par la rflexion, d'tre trop systmatiques et de donner dans quelque
extrme.
Mais, de quelque manire qu'on doive expliquer ces petites singularits, il est
certain qu'elles taient intimement lies avec la noble simplicit de son cur. Cette
aimable qualit, qu'il possdait au plus haut degr, rappelait ses amis tout ce
qu'on a dit du bon La Fontaine. Elle avait mme chez lui une grce particulire, par
le contraste qu'elle faisait avec les autres qualits auxquelles elle se trouvait runie,
avec ces dons sublimes de la raison et de l'loquence qui ont rendu ses ouvrages de
morale et de politique l'objet de l'admiration de l'Europe.
Smith et pu donc tre ce qu'on appelle de nos jours un brillant causeur,
parlant avec esprit de tout, et d'autant plus tincelant qu'il avait moins tudi la
matire. Mais son caractre consciencieux mprisait cette vaine gloriole ; il tenait
aller au fond des choses, et ce n'tait qu'au milieu d'un petit cercle d'amis, durant
ses heures de dlassement, qu'il laissait errer, son imagination. Celle-ci, d'ailleurs,
tait trs vive et il s'en dfiait. Si c'est un clair de gnie qui lui a fait entrevoir
d'abord les vrits conomiques qui ont fait sa gloire, ce n'est que par un labeur
acharn qu'il est arriv les mettre en lumire ; il a t avant tout un grand
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
62
travailleur, absorbant beaucoup de faits par la lecture et l'observation, puis les
digrant par la mditation. Il saisissait vite un point de vue particulier, et si son
esprit n'et pas t si scrupuleux, il et t fort systmatique ; mais ces ides, qui
naissaient spontanment chez lui, il les mrissait et les rectifiait en les soumettant
l'preuve des faits et la contre-preuve des systmes opposs, s'attachant ainsi
travailler lentement, parce qu'il redoutait fort sa premire impression.
Au point de vue de la vivacit de son imagination, Dugald Stewart l'a compar
fort justement La Fontaine. Cependant, ni la conduite de ces deux crivains, ni
leurs ouvrages ne se ressemblaient beaucoup d'gards, et le caractre quelquefois
peu digne du pote courtisan qutant une pension, pas plus que sa morale lgre et
toute de plaisir, n'aurait eu certainement l'approbation du philosophe austre de
l'cole cossaise. Quoi qu'il en soit, cette comparaison est loin d'tre en tous points
inexacte, car, outre ce ptillement de l'esprit que nous venons de signaler chez
Smith et qui tait si fort remarquer chez La Fontaine, on pouvait noter chez
chacun d'eux des qualits communes que peu de gens possdrent un plus haut
point, savoir une puissance norme d'observation et une bont ineffable.
Tous deux taient ports exagrer les qualits de leurs amis et les lever
jusqu'aux nues : Savez-vous bien, disait La Fontaine, que, pour peu que j'aime, je
ne vois les dfauts des personnes pas plus qu'une taupe qui aurait cent pieds de
terre sur elle ? Ds que j'ai un grain d'amour, je ne manque pas d'y mler tout ce
qu'il y a d'encens dans mon magasin 1 . Le courage avec lequel il dfendit
Fouquet en fut la meilleure preuve.
L'un comme l'autre aussi fut peut-tre l'homme le plus distrait de son sicle. On
connait le mot de M. Taine sur le Bonhomme : Il a l'air d'un enfant distrait qui se
heurte aux hommes. Or, on aurait pu en dire parfois autant d'Adam Smith : il
avait une facult d'abstraction considrable, et, lorsqu'il mditait, le monde
extrieur n'existait plus pour lui. Nous avons dj rapport une de ses plus
fameuses distractions et dit l'tonnement d'un de ses employs qui lui vit imiter la
signature de son prdcesseur au lieu de donner la sienne propre. Mais les
anecdotes sont nombreuses, et, si elles ne nous avaient pas t transmises par des
crivains aussi scrupuleux que lord Brougham et sir W. Bagehot, nous les eussions
certainement crues exagres.
Elles lui attiraient mme souvent, de la part des gens du peuple, des rflexions
tout--fait dsobligeantes. Un jour, par exemple, qu'il traversait le march au
poisson dans son attitude habituelle, les mains derrire le dos et le nez en l'air, une
marchande le prit pour quelque fou en escapade et s'cria : Bon Dieu ! peut-on
voir un pareil homme se promener en libert ! Cependant, il n'est pas trop mal
vtu, tout de mme 2 Un autre jour, dans le mme endroit, il renversait l'talage
d'une vieille femme et se rveillait brusquement de ses mditations en s'entendant
1
2
Taine, La Fontaine et ses Fables, 4e dit., p. 39.
W. Bagehot, Fortnightly Review, loc. cit.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
63
traiter d' extravagant animal (doating brute) 1 . En socit mme, il commettait
de fortes bvues. Ainsi, dans un grand dner chez le duc de Buccleugh, Dalkeith,
il avait commenc un long discours sur une question politique du jour et il
appliquait de nombreuses et svres pithtes la conduite d'un homme d'tat,
lorsqu'on le vit tout--coup s'interrompre : il venait d'apercevoir en face de lui le
plus proche parent du personnage qu'il attaquait, et, tout interloqu de
l'inconvenance qu'il venait de commettre son insu, il murmura entre ses dents :
Que le diable l'emporte, mais c'est vrai tout de mme !
Ces distractions pouvaient sembler bizarres chez cet observateur puissant qui
avait crit la Thorie des sentiments moraux et la Richesse des Nations. Aussi, bien
des gens, lors de l'apparition de ces uvres, auraient pu scrier, avec ce jardinier
des environs de Kirkaldy, qui ne connaissait Smith que pour avoir eu rpondre
des questions quelque peu incohrentes que le philosophe lui avait poses au cours
de ses promenades 2 : Grand Dieu ! on prtend que cet Adam Smith a produit un
grand ouvrage. J'aurais certes t longtemps avant de me douter qu'il et pu faire
rien de pareil !
Cette tendance l'abstraction tait naturelle chez lui et ses petits condisciples
de l'cole de Kirkaldy n'avaient pu, par leurs moqueries, lui faire perdre cette
habitude. Elle ne fit, au contraire, que se dvelopper lorsqu'il se mit composer
mentalement. Travailleur infatigable, il ne voulait jamais perdre un instant ;
lorsqu'il n'avait rien observer, qu'il se trouvt seul, en socit ou en public, il
s'isolait par la pense, il mditait, et, en rentrant chez lui, il avait parfois plusieurs
pages dicter de mmoire son secrtaire.
Comme La Fontaine aussi, Smith tait encore d'une gnrosit sans bornes et il
aurait peut-tre fort mal gr ses affaires, s'il n'avait eu avec lui sa mre ; celle-ci
l'avait suivi Edimbourg avec sa parente, miss J. Douglas, qui ne l'avait pas quitt
depuis son sjour Glasgow et qui dirigeait la maison avec conomie.
Il ne s'tait jamais mari. Peut-tre n'en aurait-il pas trouv le temps, tellement
sa vie tait absorbe par l'tude. On affirme, cependant, qu'il eut une passion et
qu'il s'attacha pendant plusieurs annes une jeune fille trs-belle et d'un esprit
trs-orn 3 ; mais cette inclination, compltement ignore de la plupart des
biographes, ne parat pas avoir exerc une influence notable, soit sur sa vie, soit
sur la direction de son esprit.
Quoi qu'il en soit, Smith n'avait pas les soucis de son mnage et il se reposait
totalement sur miss Douglas du soin de ses affaires. Son train de maison tait
d'ailleurs fort modeste, et, bien que sa situation pcuniaire, d'abord peu brillante, se
ft beaucoup amliore depuis sa nomination au poste de commissaire des
1
2
3
Lord Brougham, Lives of men of science, etc.
Lord Brougham, loc. cit.
W. Bagehot. loc. cit.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
64
douanes, il n'avait rien voulu changer sa manire de vivre, employant le surplus
de ses revenus faire le bien, d'une faon si discrte que ses amis intimes ne
l'apprirent eux-mmes qu'aprs sa mort.
Le seul luxe qu'il se permt tait de recevoir souvent sa table, mais il le faisait
toujours simplement. Il avait aussi un faible particulier pour sa bibliothque qui
tait fort restreinte mais trs-prcieuse et bien compose. Il n'y laissait entrer que
des livres de valeur et il voulait mme que leur tat matriel ne laisst rien
dsirer. Aussi, ceux qui voyaient cette bibliothque taient surpris de constater que
tous les volumes taient lgamment relis et quelques-uns avec luxe. Comme il le
disait son compatriote Smellie, il n'tait petit-matre que dans ses livres 1 .
En 1787, il fut nomm recteur de Glasgow par les tudiants des quatre nations
de cette clbre Universit (Clydesdali, Tividali, Albani et Rothsay) 2 . Cette
situation, bien qu'elle ne confrt plus qu'une autorit nominale depuis la Nova
Erectio, tait encore environne d'un trs-grand prestige 3 . Elle constituait
d'ailleurs pour le clbre conomiste une marque de distinction d'autant plus
flatteuse que l'Universit avait rompu en sa faveur avec un usage constant auquel
elle n'avait fait jusque-l que de trs-rares drogations et qui exigeait que le recteur
habitt Glasgow. Il put rester Edimbourg en se faisant remplacer par un vicerecteur qu'il choisit lui-mme. Aussi fut-il vivement touch de ce souvenir de sa
vieille Universit. Aucune place, crivait-il 4 , ne pouvait me donner une
satisfaction plus relle. Nul homme ne peut avoir plus d'obligations une Socit
que je n'en ai l'Universit de Glasgow. C'est elle qui m'a lev et qui m'a envoy
Oxford ; peu aprs mon retour en cosse, elle m'lut au nombre de ses membres
et ensuite me confra un autre emploi auquel les talents et les vertus de l'immortel
Hutcheson avaient donn un haut degr d'illustration. Lorsque je repasse sur la
priode de treize annes pendant laquelle j'ai t membre de cette Socit, je
l'envisage comme la priode la plus utile et par l mme la plus heureuse et la plus
honorable de ma vie ; et maintenant, aprs vingt-trois ans d'absence, me voir
Encyclopdia Britannica (6e dition), art. Smith. You must have remarked that I am a beau
in nothing but my books.
Comme dans l'Universit de Paris, sur le modle de laquelle avait t organise celle de
Glasgow, les tudiants taient diviss en nations.
Aprs le chancelier, personnage d'un rang illustre, charg de protger la corporation et de la
reprsenter dans ses rapports avec l'tat, le recteur tait le premier dignitaire de l'Universit.
Jusqu'en 1577, il avait eu des attributions et des prrogatives importantes. Les jours de
solennit, il paraissait en grande tenue, prcd du bedeau et accompagn d'une suite
nombreuse ; tous les suppts (et on dsignait la fois sous cette dnomination les matres, les
gradus, les tudiants et mme les employs subalternes), devaient prter entre ses mains
serment d'obissance, et il avait leur gard des pouvoirs disciplinaires trs-tendus. Mais en
1577, Jacques VI, sur la proposition du rgent Morton, avait modifi profondment
l'organisation de l'Universit par la charte Nova Erectio, et l'institution d'une cour disciplinaire
spciale (juridictio ordinaria), compose du principal et des professeurs de robe, avait enlev au
recteur toute autorit effective.
Dugald Stewart, loc. cit.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
65
rappel au souvenir de mes amis d'une manire si agrable, c'est un sentiment qui
pntre mon cur d'une joie pure et que je ne saurais bien vous exprimer.
Malheureusement les dernires annes de cette vie si calme et si heureuse
furent assombries par des deuils de famille. Au moment mme o Adam Smith fut
lu recteur, sa mre tait dj morte depuis trois ans, et miss Douglas qui avait
pour son parent l'affectueuse sollicitude d'une sur, ne tarda pas la suivre dans la
tombe. En mme temps les infirmits commenaient se faire sentir et rendaient la
solitude encore plus pnible au philosophe. Il avait cependant encore avec lui un
de ses proches, le jeune David Douglas, qui fut plus tard lord Strathenry et dont il
avait entrepris l'ducation ; mais ce jeune homme ayant grandi, Smith craignit de
nuire son avenir en le gardant avec lui, et, l'anne mme de la mort de miss
Douglas, il n'hsita pas l'envoyer Glasgow pour lui faire tudier le droit sous la
direction d'un matre distingu, Millar, qui venait de publier avec clat son
Historical view of the English government.
partir de cette poque, les forces de Smith dclinrent rapidement. Toutefois,
sentant les approches de la mort, il voulut revoir sa Thorie des sentiments moraux
laquelle il dsirait depuis longtemps faire certains changements et de nombreuses
additions. Cet ouvrage avait toujours t l'objet de sa constante prdilection,
comme de celle de la plupart de ses contemporains, et lauteur le mettait bien audessus de ses Recherches sur la Richesse. Il eut le bonheur de vivre assez
longtemps pour en voir la nouvelle dition.
Avant de mourir, il tint aussi faire dtruire ceux de ses manuscrits qu'il ne
voulait pas laisser publier.
Ce dessein ntait pas nouveau, d'ailleurs, dans son, esprit, et, ds 1773, au
moment d'un voyage Londres, il crivait dj son ami David Hume la lettre que
l'on va lire 1 pour lui faire connatre ses intentions :
Edimbourg, 16 avril 1773.
Mon cher ami,
Comme je vous ai confi le soin de tous mes papiers littraires, je dois vous
dire qu'except ceux que j'emporte avec moi, il n'en est aucun qui soit digne d'tre
publi, except un fragment dun grand ouvrage qui contient l'histoire des
systmes astronomiques qui ont t successivement la mode jusqu'au temps de
1
Dugald Stewart, traduct. P. Prevost, loc. cit.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
66
Descartes. Je laisse votre jugement de dcider si on ne pourrait point publier ce
morceau, comme un fragment d'un ouvrage conu et projet dans la jeunesse,
quoique, la vrit, je commence souponner moi-mme quil y a dans quelques
parties de cet crit plus d'art que de solidit. Vous trouverez ce petit ouvrage dans
mon cabinet, crit sur un mince cahier de papier in-folio. Tous les autres papiers
dtachs que vous trouverez dans la mme layette ou dans l'armoire du bureau de
ma chambre coucher, ainsi qu'environ dix-huit cahiers minces in-folio, je vous
prie de les dtruire sans y jeter les yeux. moins que je ne meure d'une mort trssoudaine, je prendrai soin que les papiers que j'emporte avec moi vous soient
envoys soigneusement.
Je suis toujours, mon cher ami, tout vous,
ADAM SMITH.
Le temps n'avait fait que le confirmer dans sa rsolution, et, quelque temps
avant sa mort, au moment d'un autre voyage Londres, il prescrivit ses amis de
dtruire, en cas d'accident, tous les volumes de ses cours, ne leur laissant que la
libert de disposer, comme ils l'entendraient, du reste de ses manuscrits. De retour
Edimbourg, il leur avait renouvel encore la mme recommandation, puis,
craignant sans doute que ses dernires volonts fussent cet gard mal excutes,
il s'tait dcid faire brler lui-mme, devant ses yeux, ces prcieux documents.
La perte la plus considrable que la postrit parat avoir faite lors de cette
destruction, est celle des matriaux qu'Adam Smith avait amasss pour son Trait
du Droit, d'autant plus que si cet ouvrage avait t rellement commenc sous
forme d'une critique de l'Esprit des Lois, il et t trs intressant d'avoir ce
commentaire de Smith sur l'uvre de Montesquieu. Quant la destruction des
cahiers de ses cours, on ne saurait gure les regretter pour leur valeur mme ; mais,
en tant que documents, ils auraient t trs-utiles au biographe en lui permettant de
suivre plus facilement la marche de l'esprit du clbre philosophe. Nous eussions
aim constater, par exemple, l'tat des doctrines conomiques de Smith telles
qu'il les professait Glasgow avant son voyage en France, et les comparer la
Richesse des Nations, afin de comprendre toute l'influence que son sjour dans
notre pays et sa frquentation des physiocrates avaient exerce sur lui. En effet,
malgr les efforts tents par Dugald Stewart pour dmontrer que le grand cossais
devait peu la France et que toutes ses thories taient labores ds 1752, nous
avouons tre peu convaincu de l'exactitude de cette affirmation et nous ne pouvons
que remarquer au contraire que l'insistance tmoigne par le Dr Smith pour faire
dtruire les manuscrits de ses cours sans permettre qu'on les lt, semble attester
abondamment leur infriorit relative.
Nous n'entendons pas cependant reprocher au clbre conomiste sa
dtermination : l'auteur des Recherches ne devait pas laisser d'ouvrages indignes
de lui, il devait sa rputation de ne livrer la postrit que des uvres de haute
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
67
valeur, et on ne saurait lui faire un crime d'avoir ananti tout ce qui, ses yeux,
tait capable de l'amoindrir. Nous ne mconnaissons pas davantage l'immense
porte de la Richesse des Nations, ni les progrs considrables que l'auteur a fait
faire l'conomie politique ; nous dsirons simplement signaler l'exagration de
certains biographes anglais qui ont t jusqu' affirmer que, ds 1755 et mme ds
1752, bien avant l'apparition des ouvrages de Quesnay, toutes les doctrines de leur
compatriote taient arrtes dans son esprit, et qu'avant son voyage sur le
continent, il avait dj constitu de toutes pices la science dont il devait
dvelopper les principes dans la Richesse des Nations.
Aprs que Smith et ainsi dtruit la plupart des productions de sa jeunesse,
son esprit fut tellement soulag, dit Dugald Stewart, qu'il fut en tat de recevoir
ses amis, ds ce mme soir, avec le mme air de satisfaction qu'il avait coutume de
le faire.
Nanmoins, il fut oblig de se retirer avant le dner et il mourut, le 17 juillet
1790, emport par une cruelle maladie d'intestins qui le minait depuis longtemps :
il fut enterr Edimbourg, au cimetire de Canongate.
Adam Smith avait assez vcu pour jouir de sa gloire. Il avait eu la satisfaction
de voir la Richesse des Nations traduite dans toutes les langues et de constater que
ses ides commenaient tre partages par l'opinion publique. Il avait t
consult souvent par le Ministre, et William Pitt ne craignait pas de mettre en jeu
sa propre popularit pour faire passer dans la pratique les thories commerciales du
clbre conomiste 1 .
Ce succs ne devait que grandir encore aprs sa mort. Ds 1792, son nom,
invoqu la Chambre des Communes, tait accompagn des pithtes les plus
logieuses, et Pitt abritait ses rformes fiscales sous l'autorit du Dr Smith, auteur
qui malheureusement nest plus, disait-il, mais dont les connaissances tendues
jusquaux dtails et la profondeur des recherches philosophiques fournissent, je
crois, les meilleures solutions toutes les questions qui se rattachent l'histoire du
commerce ou aux systmes d'conomie politique 2 . Introduites au Parlement sous
un tel patronage et adoptes par quelques membres influents, ses doctrines avaient
t coutes d'abord avec tonnement ; mais, d'anne en anne, dit Buckle 3 , la
grande vrit fit son chemin, s'avanant toujours, ne reculant jamais ; quelques
hommes de talent dsertrent d'abord les rangs de la majorit, des membres
ordinaires les suivirent bientt ; puis la majorit passa l'tat de minorit et cette
minorit commena elle-mme se dissoudre. Pulteney avait donc eu raison,
1
2
3
Voir les discours de Pitt sur les Rapports commerciaux avec lIrlande (22 fvrier 1785) et sur le
Trait de commerce sign avec la France le 26 septembre 1786. Rapprocher notamment les
projets de Pitt sur l'Irlande du projet d'Union dvelopp par Adam Smith dans ses Recherches, t.
II, p. 663.
Vie de William Pitt, par lord Stanhope, traduct. Guizot, t. II, p. 139.
Thomas Buckle : Histoire de la Civilisation en Angleterre, traduct Baillot, t. I, p. 240.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
68
quand, en 1797, dans un de ses discours sur les finances, il affirmait que le clbre
conomiste persuaderait la gnration prsente et gouvernerait la prochaine 1 .
Dans toutes les discussions conomiques ou fiscales, on s'arrache maintenant le
nom de Smith, toutes les coles fouillent son uvre pour y trouver des passages
favorables leurs systmes et donner ainsi leurs thories l'appoint de son
autorit.
Cependant, alors que les Anglais se montrent gnralement si disposs
mouler dans le bronze les traits de leurs grands hommes, Adam Smith, par un oubli
peu explicable, n'a pas encore de statue. Ni Kirkaldy qui fut son berceau, ni
Oxford o il tudia, ni Glasgow o il fut successivement lve, professeur et
recteur, aucun monument ne fait connatre la jeunesse les traits sympathiques de
cet homme dont elle entend constamment citer le nom et dont l'orgueil national est
si fier. Edimbourg mme o il repose, personne n'entretient sa modeste tombe et
la pierre tumulaire disparat, dit M. de Studnitz, sous les mauvaises herbes et les
tessons de bouteilles ! 2
1
2
Parliamentary History, t. XXIII, p. 778, loc. cit.
Dans un article paru dans le Die Gegenwart, de Berlin, le 26 fvrier 1876, et traduit par le
Journal des conomistes (1876, t. II, p. 258), M. de Studilitz a insist sur ces faits. Durant un
rcent voyage en Angleterre et en cosse, il avait cherch vainement les monuments qu'on avait
d lever la gloire d'Adam Smith, et, au cimetire de Canongate o il tait all faire un pieux
plerinage, il avait eu mme beaucoup de peine trouver le tombeau du clbre conomiste. Il
faut passer, dit-il, sur beaucoup d'autres tombes pour en approcher. Il est adoss contre le mur
de derrire d'un btiment habit par un employ et dont une fentre donne de ce ct. Contre le
mur s'appuie une pierre peu orne, d'environ dix pieds de hauteur, o se trouve la simple
inscription que voici : Ici SONT DPOSS LES RESTES D'ADAM SMITH, AUTEUR DE
LA Thorie des sentiments moraux ET DE LA Richesse des Nations. IL TAIT N LE 5 JUIN
1723 ET IL MOURUT LE 17 JUILLET 1790... La tombe est compltement nglige : des
tessons, des cailles d'hutres la couvrent en partie, et les mauvaises herbes, qui croissent en
abondance, ne parviennent pas voiler ces dbris, car on parat en jeter de temps en temps de
nouveaux sur le tombeau, de la fentre qui se trouve au-dessus. Quant des statues, les
compatriotes d'Adam Smith n'ont pu nous en indiquer aucune. On sait cependant que
l'Universit d'Oxford avait confi un sculpteur autrichien, M. Garser, la mission d'en excuter
une ; il parat mme que cette statue a t faite d'aprs le mdaillon de Tassie et la silhouette
dessine par Kay en 1790, silhouette qui se trouve actuellement Oxford dans la Randolph
Gallery, mais on n'a pu trouver l'endroit o elle a t place. Ajoutons cependant qu'il existe un
petit buste d'Adam Smith, en marbre, par Maricotti, oubli dans un coin du Townhall de
Kirkaldy.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
69
DEUXIME PARTIE
SES TRAVAUX ET SES DOCTRINES
__________
CHAPITRE I
UNIT DE L'UVRE DADAM SMITH.
________
Retour la table des matires
La plupart des auteurs qui se sont occups d'Adam Smith, ont gnralement
considr les diffrentes parties de son uvre que comme des travaux distincts du
professeur publiant les divers objets de ses leons, et, de mme qu'ils ont regard
la Thorie des sentiments moraux comme un cours de morale, de mme ils ont vu
dans la Richesse des Nations un vritable trait d'conomie politique.
Un Anglais cependant, Thomas Buckle, s'est plac, il y a une vingtaine
d'annes peine, un point de vue beaucoup plus large et il a entrepris de
dmontrer, dans sa remarquable Histoire de la Civilisation en Angleterre, que,
pour comprendre la philosophie de Smith, il est ncessaire de runir les deux
grands ouvrages que le matre nous a laisss et de les considrer comme les deux
parties d'un mme sujet. Nous n'admettons pas compltement, htons-nous de le
dire, cette manire de voir qui nous semble encore trop troite ; mais nous
estimons nanmoins qu'il est intressant de la faire connatre, tant la question est
importante et le point de vue original.
Selon Buckle, Adam Smith avait un but unique, l'tude complte de l'me
humaine qui est un compos de sympathie et d'gosme. Mais il s'aperut bien vite
qu'il ne pouvait atteindre ce but directement par la mthode inductive et que le
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
70
travail de toute une vie d'homme ne suffirait mme pas runir des matriaux en
assez grand nombre pour en tirer des gnralisations de quelque valeur. Sous
lempire de cette ide, ajoute l'auteur anglais, et sans doute sous l'empire encore
plus grand des habitudes intellectuelles qui rgnaient autour de lui, il rsolut,
d'adopter la mthode dductive ; mais, tout en cherchant fixer les prmisses d'o
dcoulerait le raisonnement et sur lesquelles il voulait btir son difice, il eut
recours un artifice particulier, parfaitement valable d'ailleurs, et qu'il avait
assurment le droit d'employer, bien que, pour le mettre en uvre, il faille un tact
si dlicat, tant d'exquise subtilit, qu'il y a trs peu d'crivains qui s'en soient servis
avantageusement en traitant des questions sociales, soit avant, soit aprs Smith...
En effet, lorsqu'on ne peut appliquer la mthode inductive un sujet quelconque,
soit qu'il se refuse toute exprience, soit en raison de son extrme complexit
naturelle ou de la prsence de dtails multiples et embarrassants dans lesquels il est
englob, on peut alors faire une division imaginaire de faits indivisibles et
raisonner en s'appuyant sur des sries d'vnements qui n'ont aucune existence
relle et indpendante et qui ne se trouvent absolument que dans l'esprit du
philosophe. Un rsultat acquis de cette faon ne saurait tre strictement vrai, mais
si le raisonnement est exact, la conclusion sera aussi prs de la vrit que les
prmisses d'o nous serons partis. Pour parfaire sa vrit, il faut confronter le
rsultat avec d'autres acquis de la mme faon et sur le mme sujet. On pourra finir
par coordonner en un seul systme toutes les conclusions isoles, si bien que,
tandis que chacune d'elles ne contient qu'une vrit imparfaite, leur tout runi
renfermera la vrit parfaite.
C'est l, d'aprs Buckle, la mthode dductive qu'a employe le Dr Smith, et
voil pourquoi il a fait deux ouvrages distincts pour tudier un mme sujet, l'me
humaine. Dans la Thorie des sentiments moraux, il explore le ct sympathique
de notre nature ; dans la Richesse des Nations, il en fouille le ct goste. Dans
chacune de ces monographies, son raisonnement ne s'applique qu' une partie des
prmisses et trouve son complment dans l'autre : quoique personne ne soit
exclusivement sympathique et personne exclusivement goste, il divise, dans la
thorie, ces deux qualits indivisibles dans la pratique, et, pour bien comprendre
l'un de ses ouvrages, il faut aussi tudier l'autre.
Au surplus, ce qui dmontre bien, selon Buckle, que telle tait la mthode de
Smith, c'est que, dans son premier travail, en tudiant la sympathie, il a pass sous
silence l'gosme comme si cet instinct n'existait pas en nous, il l'a omis
volontairement et de parti pris ; de mme, dans sa Richesse des Nations, il s'est
gard de faire aucune allusion la sympathie laquelle il avait attribu
prcdemment un pouvoir si absolu et si exclusif, et il a pos en fait que le grand
pouvoir moteur de tous les hommes, de toutes les classes, en tous sicles et en tous
pays, c'est l'intrt. Il est donc vident, dit Buckle, qu'en tudiant d'abord une
passion, puis la passion contraire, il n'y eut l aucun arrangement capricieux ou
accidentel, mais la consquence de la vaste ide qui prsida tous les travaux
d'Adam Smith et qui, aux yeux de ceux qui les comprennent bien, leur donne une
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
71
admirable unit. Ce vaste gnie, embrassant la fois d'un coup d'il et l'horizon
loign et l'espace intermdiaire, chercha traverser le champ tout entier dans
deux directions distinctes et indpendantes ; il espra par l qu'en compltant dans
une srie d'arguments les prmisses qui manquaient dans l'autre, leurs conclusions
opposes seraient plutt compensatoires qu'hostiles et tabliraient une base large et
durable sur laquelle on pourrait lever en scurit une grande science de la nature
humaine.
Cette manire de comprendre l'uvre de Smith est trs curieuse : la mthode
employe par le philosophe cossais y est admirablement dcrite, et, plus on y
rflchit, plus on reconnat la vraisemblance de cette hypothse. Comme M. Lowe
le signalait au Political Economy Club de Londres, lors du centenaire de la
Richesse des Nations 1 , les ouvrages du clbre philosophe se font remarquer par
leur caractre dductif et dmonstratif, et la riposte de M. Thorold Rogers ne put
changer cet gard le sentiment de l'assemble. Au temps de Smith, en effet, la
statistique n'tait pas encore fonde et les donnes qu'on prtendait tirer des faits
trop peu nombreux qu'on avait pu runir, taient souvent trop contestables pour
servir de fondement une induction. Smith, ne s'y mprenait pas, et, il l'a dit luimme quelque part 2 , il n'avait pas beaucoup de foi dans l'arithmtique politique.
Dans ces conditions, il et t imprudent de partir des faits comme base de la
science et il dut adopter la mthode dductive. Si les faits abondent nanmoins
dans son uvre et l'alourdissent mme parfois, ils sont toujours subsquents
l'argument, lui donnant plus de clart sans pour cela le rendre plus certain : ils ne
servent qu' prciser le rsultat des spculations, en dmontrer ou en contrler
l'exactitude, et ils ont souvent, d'ailleurs, pour seul objet, de sacrifier au got du
public anglais pour l'amas des documents ; ils sont tout--fait distincts de
l'argumentation, et, seraient-ils tous faux, que le livre n'en resterait pas moins et
que ses conclusions, tout en perdant de leur intrt, ne perdraient rien de leur
valeur.
Toutefois, nous diffrons profondment avec Thomas Buckle, et sur le but
mme de l'uvre de Smith et sur la conception de son plan.
Pour nous, les divers travaux du matre ne sont que des parties distinctes d'une
vritable Histoire de la Civilisation ; il voulait tudier la fois le dveloppement
de l'homme et le progrs de la socit, afin de dmontrer finalement cette tendance
lharmonie universelle qu'il souligne toute occasion dans chacun de ses
ouvrages et qui parat tre l'objet de sa plus constante proccupation. Cette
proccupation, vrai dire, n'avait pas chapp Buckle, mais il n'y voyait qu'un
des traits particuliers de luvre alors que nous croyons y saisir le but mme de
l'auteur. L'me gnreuse du jeune philosophe de Glasgow avait t frappe de
1
Ce centenaire fut clbr, le 2 juin 1876, dans un banquet organis par le Political Economy
Club de Londres et prsid par M. Gladstone. Des discours intressants y furent prononcs par
MM. Gladstone, Lon Say, Lowe, de Laveleye, Thorold Rogers, etc.
Richesse, t. II, p. 140.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
72
l'antagonisme apparent qui se manifeste entre les intrts, il s'tait dit qu'il n'est pas
possible que la nature mme de l'homme le pousse la guerre, et il avait consacr
sa vie dmontrer qu'au contraire tout en nous tend l'harmonie, dans le domaine
moral par la sympathie, dans le domaine matriel par l'intrt, et que l'gosme luimme est un prcieux auxiliaire de la vertu. Il avait pens qu'en clairant ces
sentiments, qu'en clairant ces intrts, on viterait la postrit toutes sortes de
rivalits, et, sil a pris si violemment partie la plus funeste des erreurs
conomiques, le systme mercantile, c'est parce qu'il la considrait comme la
source la plus abondante des conflits entre les individus, des guerres entre les
nations.
Aussi, aprs avoir montr, dans la Thorie des sentiments moraux, que la
sympathie nous pousse l'harmonie en mettant nos sentiments l'unisson de ceux
des gens qui nous entourent, il veut tablir, par la Richesse des Nations, que, dans
la socit prise en son ensemble, il y a galement tendance l'harmonie et que
toutes les fois que l'homme travaille en vue de son intrt bien entendu, il agit
aussi son insu dans l'intrt de ses semblables. En un mot, la sympathie nous fait
tendre l'harmonie et l'intrt vient la seconder en nous y poussant
inconsciemment : voil la grande loi sociale que le matre a mise en lumire dans
ces deux ouvrages, et il avait entrepris de dmontrer, dans les derniers livres des
Recherches et dans son Trait du Droit, comment la justice humaine favorise cet
accord ou le contrarie.
Une histoire de la civilisation tait le cadre le plus propre faire ressortir
l'universalit de cette tendance et cest ce cadre qu'il choisit. Mais ce plan
particulier, qui convenait si bien aux besoins de son sujet et au groupement de ses
tudes, na gnralement pas t compris par ceux qui ont tudi l'ensemble de ses
uvres, ni par Buckle lui-mme qui, cependant, en crivant son Histoire de la
Civilisation, a puis en ralit bien des documents et des aperus dans les diverses
parties de ce travail immense. Un seul auteur, M. Walter Bagehot, le mme qui
dirigea jusqu' sa mort le journal financier The Economist, parat avoir saisi ce
point de vue, et il l'a signal, en 1876, dans un article de The Fortnightly Review ;
mais il s'est abstenu de le dvelopper. Un vaste dessein, dit-il 1 , semblable
beaucoup celui de Buckle, hantait l'esprit de Smith, et sa vie se passa dans l'tude
des origines et des progrs des sciences, des lois, de la politique, en un mot de tous
les moyens et de toutes tes forces qui ont lev l'homme de l'tat sauvage la
civilisation. Son plan tait plus vaste encore : il se proposait de retracer les progrs
non-seulement de la race, mais de l'individu ; il voulait montrer comment l'homme,
n, selon lui, avec un petit nombre de facults, tait parvenu en acqurir de
nombreuses et de puissantes, et rpondre la question souvent pose de savoir
comment l'homme, soit comme race, soit comme individu, tait parvenu son
point actuel.
W. Bagehot. Fortnightly Review. loc. cit.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
73
Cependant, nous ne pouvons pas non plus accepter sans restriction l'hypothse
de M. Bagehot, car il parat voir dans cette Histoire de la Civilisation le but mme
des travaux de Smith, alors qu'elle n'est pour nous qu'un mode de dmonstration,
ou plutt un vritable cadre destin mettre en lumire la grande loi de l'harmonie.
Selon le publiciste anglais, la dcouverte des principes de l'conomie politique
n'aurait t, pour ainsi dire, qu'un vnement fortuit dans les tudes du Dr Smith.
En faisant l'histoire des richesses, lminent philosophe aurait remarqu que les
lois en taient peu connues, il se serait heurt l'impossibilit de rencontrer l
aucune base certaine pour ses travaux, et, trouvant ainsi ce terrain inexplor, il
aurait t amen s'y attarder pour le mettre en valeur, quitte renoncer
l'excution d'une partie de son vaste plan. Une ambition comprhensive et
diffuse, dit en effet M. Bagehot, n' pas laiss de le conduire un rsultat
particulier et durable. Il a dcouvert les lois de la richesse en s'occupant des
progrs naturels de l'opulence en tant que lie au progrs et au dveloppement de
toutes les choses. Comme il est arriv beaucoup d'autres, quoique rarement sur
une aussi grande chelle, en visant un genre de renomme, il en avait atteint un
autre. Pour se servir du mot toujours vrai de lord Bacon, semblable Sal, il tait
parti la recherche des nes de son pre, et, chemin faisant, il avait rencontr un
royaume.
Ce point de vue n'est pas exact La Richesse des Nations n'est pas une
digression ni mme le rsultat d'une modification dans le plan de Smith, car il a
tudi les lois de la richesse comme il avait tudi les lois morales et comme il
avait entrepris d'tudier les lois qui rgissent notre esprit. Cette histoire de la
civilisation n'tait, dans son esprit, qu'un cadre destin grouper ces diffrentes
tudes faites dans un but unique et rendre manifeste cette tendance universelle
l'harmonie que son esprit et son cur avaient devine.
Comme l'a magistralement enseign Guizot 1 , la civilisation consiste dans la
combinaison des ides thoriques nes du dveloppement de l'esprit humain avec
les circonstances de l'tat social. Or, dans sa Thorie des sentiments moraux, le
philosophe cossais a suivi le dveloppement moral de l'homme ; dans ses Essais,
il a entrepris la gense de son dveloppement intellectuel ; dans ses Recherches, il
a tudi le dveloppement de l'tat social en ce qui concerne la richesse, c'est-dire l'histoire du dveloppement -matriel de la socit, tandis que dans son Trait
du Droit, il se proposait de suivre le dveloppement de ses institutions. Voil ce
qu'il tait ncessaire, d'tablir afin de bien faire comprendre l'unit de l'uvre de
Smith et la grande pense qui domine ses divers travaux.
Histoire de la Civilisation en Europe, p. 96.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
74
CHAPITRE II
TrAVAUX DE SMITH SUR LA LITTRATURE,
LA LOGIQUE ET LA MORALE.
________
1. Les articles de la Revue d'Edimbourg.
Retour la table des matires
Les deux premiers crits d'Adam Smith qui aient t conservs sont (deux
articles, parus en 1755 dans le journal cossais, The Edimburgh Review.
Cette publication, qu'il faut se garder de confondre avec la clbre Revue cre
en 1802 et qui a conquis dans les lettres une place si honorable, ne survcu pas
son second numro, et nous avons dit plus haut que, malgr la collaboration
distingue de Hugh Blair et de Robertson elle succomba rapidement sous les coups
dune coterie locale.
Smith avait applaudi la cration de la Revue et il y avait insr deux articles,
lun sur le Dictionnaire de Johnson, lautre, sous forme de Lettre aux diteurs, sur
le mouvement littraire en France et en Europe 1 .
Bien que ces deux crits ne puissent tre considrs que comme des travaux
isols, sans aucun lien avec le reste de luvre du matre, nous les examinerons
nanmoins, non seulement pour tre complet, mais aussi parce que nous estimons
quils contribuent grandement faire connatre lesprit de lauteur et la direction
de ses tudes cette poque de sa vie.
1
Ces deux articles sont anonymes, mais ils sont dus certainement la plume de Smith qui 1'a
reconnu plusieurs fois dans ses entretiens avec Dugald Stewart. S'il s'levait quelques doutes sur
lauthenticit des papiers mentionns ci-dessus, crivait ce dernier P. Prevost, traducteur des
Essais philosophiques, je juge convenable d'ajouter que M. Smith lui-mme m'a dit plus d'une
fois qu'il tait 1'auteur de lun et de lautre.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
75
L'examen critique du Dictionnaire de Johnson est dailleurs fort remarquable.
Ce grand ouvrage venait de paratre, aprs sept annes d'un travail opinitre et
grce au concours des libraires de Londres qui avaient avanc Johnson largent
ncessaire ses besoins pour lui permettre dachever son uvre. Or, Adam Smith
avait attendu avec impatience cette publication, qui devait tre pour lui d'un
secours considrable dans la rdaction de son Trait sur la morale, car il navait
gure parl que lcossais jusqu' sa quinzime anne, et, quoiqu'il sexprimt
depuis lors fort correctement en anglais, il ntait pas encore arriv se
familiariser avec les idiotismes de cette langue ni avec le maniement des
synonymes 1 . Il avait donc compt trouver dans ce dictionnaire un auxiliaire
prcieux pour son style ; mais son espoir fut un peu du et il ne put en tirer tout le
parti qu'il avait espr. Aussi, formulant contre ce travail un certain nombre de
critiques, il les exposa dans un article quil adressa la Revue dEdimbourg.
Les diffrentes significations d'un mot, crit-il, sy trouvent la vrit
recueillies, mais rarement elles sont digres en classes gnrales ou ranges sous
la signification que le mot est principalement destin exprimer, et les mots
synonymes en apparence n'y sont pas toujours distingus avec assez de soin.
Puis, afin de bien dmontrer 1'exactitude de ses critiques, il prend pour exemples
les mots but et humour, et, aprs avoir fait remarquer la mthode dfectueuse
suivie par Johnson dans lexposition des modes d'emploi de ces deux termes, il
refait lui-mme les deux articles daprs le plan qu'il prconise.
Nous n'avons pas qualit pour apprcier ces exemples et nous ne pouvons que
nous rfrer aux jugements qu'en ont ports les Anglais eux-mmes ; mais ces
jugements diffrent absolument entre eux. D'une part, Dugald Stewart se montre
peu enthousiaste et dclare que si les nombreuses significations du mot but ont t
distingues avec beaucoup de soin, du moins le mot humour n'a pas eu la mme
bonne fortune. D'autre part, au contraire, lord Brougham n'a pas assez d'loges
pour la mthode vraiment philosophique, selon lui, employe par Adam Smith
dans ces deux exemples ; il regrette mme que les conseils du jeune philosophe
n'aient pas t suivis et qu'on en soit encore attendre un dictionnaire bien
compris, qui serait appel cependant rendre la science et aux lettres un
immense service.
Eh prsence de cette diversit d'opinions, le lecteur franais, ne peut prendre
parti. Il nous semble, toutefois, que l'on pourrait peut-tre expliquer la divergence
1
On raconte, rapporte M. W. Bagehot, que lord Mansfield dit un jour Boswell quen lisant soit
Hume, soit Smith, il ne croyait pas lire de langlais, cc qui, aprs tout, ne doit pas beaucoup
surprendre puisque l'anglais n'tait la langue maternelle ni de lun ni de 1'autre. Smith en effet
avait parl l'cossais courant jusqu' sa quatorzime ou quinzime anne, et rien ne gne la
libert d'allure de la plume comme d'crire dans une langue avec le souvenir perptuel dune
autre dans la tte. Vous n'tes jamais sr que les idiotismes qui vous viennent naturellement
lesprit sont bien ceux de la langue que vous voulez parler et non les idiotismes de la langue
dont vous ne voulez pas vous servir. (Fortnight Review.)
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
76
de ces jugements en considrant les points de vue particuliers auxquels les deux
commentateurs se sont vraisemblablement placs. En effet, tandis que Dugald
Stewart parat avoir examin surtout la manire dont les diffrentes significations
taient distingues, lord Brougham s'est attach de prfrence la mthode
indique par Smith, la classification dont celui-ci voulait donner des exemples.
Or, en ce qui concerne la signification des mots, le professeur de Glasgow tait un
assez mauvais juge, puisque l'cossais tait sa langue maternelle et que la pratique
de la langue anglaise n'avait pu lui donner encore ce tact dlicat qui seul permet de
discerner srement les diffrentes nuances observer dans l'usage des termes. Au
contraire, au point de vue de la classification, on ne pouvait gure trouver un
meilleur matre. Ses Lectures dimbourg avaient roul sur la rhtorique, il avait
mme commenc sur ce sujet un trait fort estim des quelques amis qui avaient pu
en prendre connaissance, enfin il avait dbut Glasgow par la chaire de logique :
la nature de son esprit et la direction de ses tudes l'avaient donc mis mme de se
former des ides leves au sujet de la mthode, et c'est ce que lord Brougham a
vivement apprci.
La Lettre aux diteurs de la Revue dEdimbourg n'a pas le mme caractre :
elle n'a pris la forme ni d'une critique, ni d'une discussion, mais elle n'en est pas
moins fort intressante.
La Revue n'avait encore fait paratre qu'un numro, mais elle l'avait consacr
tout entier la littrature cossaise, bien que celle-ci ft en ralit trs pauvre. Or,
Smith aurait dsir qu'elle tendt son champ d'tudes, et il estima qu'il tait de son
devoir d'attirer l'attention sur l'importance du mouvement intellectuel qui se
manifestait de tous cts en Europe et surtout en France. Ce fut l l'objet de la
lettre qu'il adressa aux diteurs et qui fut publie dans la Revue.
Cette lettre contient un aperu sommaire, mais trs curieux, de l'tat de la
littrature sur le continent au milieu du XVIIIe sicle. Nous ne pouvons l'analyser
ici parce qu'elle est trop dense pour tre rsume, mais on prouve un vritable
plaisir la lire. Elle donne d'ailleurs au biographe des renseignements prcieux sur
la nature des tudes de Smith et elle montre toute la puissance de travail dont il
tait susceptible : appel depuis deux ans seulement la chaire de philosophie
morale, il avait prparer un cours extrmement charg, il travaillait en outre sa
Thorie des sentiments moraux, ses Considrations sur la formation des langues,
et nous voyons qu'il trouvait encore le temps de suivre au jour le jour le
mouvement littraire de toute l'Europe. Enfin on est frapp des jugements que le
jeune professeur portait sur les principales uvres du sicle, au moment mme de
leur apparition, et il y a lieu de remarquer que ces jugements ont t gnralement
ratifis par la postrit.
Il fait dfiler sous les yeux du lecteur les grandes productions littraires de
notre pays. C'est l'Encyclopdie, dirige par d'Alembert et Diderot, qui
s'annonait dj, crit-il, comme l'ouvrage le plus complet en ce genre qu'on ait
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
77
jamais publi ou mme, entrepris en aucune langue . Il en loue la remarquable
prface, le Discours prliminaire, o d'Alembert a fait un vaste tableau de la
science et trac la filiation et la gnalogie de chacune de ses branches. Il constate
le soin avec lequel ont t rdigs les divers articles : ce ne sont pas, dit-il, des
rsums arides, des vrits banales et courantes, ils constituent des ouvrages
complets sur la matire, et chacun, quelque lettr qu'il soit, y trouve apprendre,
mme dans les sciences qui lui sont familires. C'est la grande Histoire naturelle,
alors en cours de publication, o Buffon traitait la partie raisonne et
philosophique et Daubenton l'anatomie. Il vante chez le premier l'loquence et le
style, et surtout le charme par lequel il maintient l'attention et vulgarise la science ;
il admire chez le second la clart, la prcision, la rigueur scientifique, et dclare
que cette partie, quoique la moins pompeuse, est de beaucoup la plus
importante . C'est aussi, dans le mme ordre de sciences, l'ouvrage de Raumur,
o, sous le titre de Mmoires pour servir l'Histoire des Insectes, l'auteur a expos
le rsultat de ses tudes sur les murs, sur l'industrie de ces petits animaux, et
trouv le temps de composer sur ce sujet huit volumes in-4 de ses propres
observations, sans avoir recours, mme une seule fois, au vain remplissage de
l'rudition et l'talage des citations.
C'est enfin, en ce qui concerne la philosophie naturelle, le fameux discours de
J.-J. Rousseau Sur lorigine et les fondements de l'ingalit parmi les hommes.
Adam Smith le rapproche de l'ouvrage du Dr Mandeville ; mais les principes de
l'auteur anglais, dit-il, y sont adoucis, perfectionns, embellis, et entirement
dpouills de cette tendance la corruption et la licence qui les dfigure dans
l'ouvrage original et qui les y couvre de disgrce.
Toutefois, il rserve son jugement sur le philosophe genevois, car il parat
surpris par les ides et les paradoxes qui abondent dans ce travail, et on sent qu'il
prfre l'tudier encore avant de se prononcer. Le futur auteur de la Thorie des
sentiments moraux rprouve assurment ici les doctrines qu'il condamne dans la
Fable des Abeilles, mais l'lvation et l'austrit du style les ayant transformes
chez Rousseau, Adam Smith semble se recueillir, attendant, pour mettre un
jugement dfinitif sur l'crivain, qu'il connaisse mieux par d'autres productions, la
nature de son esprit et l'ensemble de son systme. Il se contente donc de faire
connatre le plan de l'ouvrage aux lecteurs de la Revue d'Edimbourg, et d'en citer
quelques passages ; mais il critique peu, ne discute gure, et voici quelle est sa
conclusion : La vie d'un sauvage, dit-il, lorsqu'on l'envisage une certaine
distance, s'offre nous comme une vie indolente ou seme d'aventures grandes et
merveilleuses. Ces deux aspects plaisent l'imagination et ils embellissent toutes
les descriptions dans lesquelles on les lui prsente. La passion des jeunes gens pour
la posie pastorale qui dcrit la vie indolente des bergers, et pour les romans et les
livres de chevalerie tout remplis d'aventures tranges et prilleuses, est l'effet d'un
got naturel l'homme pour ces objets disparates et en apparence incompatibles.
Nous nous attendons les trouver runis dans la description des murs des
sauvages. Aussi, jamais auteur n'a-t-il trait ce sujet sans exciter la curiosit. M.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
78
Rousseau, qui avait cur de peindre la vie sauvage comme la plus heureuse de
toutes, ne nous la reprsente que sous le point de vue de l'indolence. Il l'orne, la
vrit, des plus riches couleurs et lui prte les charmes d'un style lgant et soign,
mais toujours nerveux et quelquefois sublime. C'est l'aide d'un tel style, joint un
peu de chimie philosophique, que les principes et les maximes perverses de
Mandeville semblent acqurir ici la puret et la hauteur de la morale de Platon, et
qu'on n'y voit plus que l'empreinte du caractre rpublicain pouss peut-tre
lexcs.
C'est par J.-J. Rousseau que Smith termine cette revue du mouvement
philosophique. Mais, bien qu'il ne veuille pas parler des potes, de crainte d'tre
entrain trop loin, il tient nanmoins saluer dans Voltaire le gnie le plus
universel peut-tre, que la France ait jamais produit et qui parat, d'un commun
aveu, tre, presque en tout genre, sur la mme ligne que les plus grands crivains
du sicle dernier qui se bornrent un seul.
Dans tout cet article, Adam Smith ne s'est occup, en somme, que de la
littrature franaise, quoiqu'il ait annonc qu'il voulait signaler au public cossais
le mouvement intellectuel de l'Europe en gnral. C'est que la littrature de la
France formait elle seule la littrature de toute l'Europe, ou au moins de tout le
continent, et le jeune philosophe l'avait reconnu formellement ds les premires
lignes de son tude. Les sciences, il est vrai, disait-il, sont rpandues dans toute
l'Europe, mais ce n'est qu'en France et en Angleterre qu'on les cultive avec assez
de succs pour exciter l'attention des nations trangres. En effet, en Espagne et
en Italie, ces deux pays classiques, on ne produisait plus et mme on ne lisait plus.
En Allemagne, Gthe et Schiller n'avaient pas encore paru, le nom de Lessing
commenait peine se faire connatre, le mouvement littraire tait presque nul
et Smith en donne la raison : Jamais, dit-il, les Allemands n'ont cultiv leur
propre langue ; et, tant que leurs savants conserveront l'habitude de penser et
d'crire dans une autre, il leur sera peu prs impossible, en traitant des sujets
dlicats, de penser et de s'exprimer d'une manire heureuse et prcise. Dans les
sciences telles que la mdecine, la chimie, l'astronomie, les mathmatiques, qui
n'exigent que du jugement, du travail et de l'assiduit, o l'on a moins besoin de ce
qu'on nomme got et gnie, les Allemands ont eu des succs et ils en ont encore.
Les Acadmies d'Italie, d'Allemagne et mme de Russie, produisent des ouvrages
qui excitent partout un sentiment de curiosit ; mais il est rare que les crits d'un
seul homme y jettent assez d'clat pour que les trangers les recherchent.
Nous cesserons ici les citations ; mais, comme le lecteur a pu s'en rendre
compte par ces extraits que nous avons tenu lui mettre sous les yeux, cette lettre
aux diteurs de la Revue d'Edimbourg est pleine d'intrt, non seulement en ce
qu'manant d'Adam Smith, elle contribue jeter du jour sur ses travaux et son
esprit au commencement de sa carrire, mais aussi par elle-mme et pour les
jugements qu'elle contient. ce double titre, elle mritait de ne pas tre passe
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
79
sous silence, et l'clat des grandes uvres de Smith n'enlve rien la valeur de ces
deux articles de Revue qui, constituent les dbuts littraires du clbre philosophe.
2. La Thorie des sentiments moraux.
Retour la table des matires
Ces deux articles de la Revue dEdimbourg avaient t crits sous le voile de
l'anonyme, mais le professeur de Glasgow prparait alors un travail important sur
la morale et c'est avec cette uvre qu'il voulait se prsenter sur la scne littraire.
Cet ouvrage parut, en 1759, sous le titre de Thorie des sentiments moraux, et
nous avons dit avec quel succs 1 . C'tait la premire partie du vaste plan que
Smith avait conu ; il avait senti que le vritable point de dpart d'une Histoire de
la Civilisation doit tre l'tude de la nature humaine et il stait efforc de
dmontrer comment l'homme n, selon lui, avec un petit nombre de facults, tait
parvenu en acqurir de nombreuses et de puissantes.
Adam Smith tait un disciple convaincu de la philosophie morale d'Hutcheson.
Il avait suivi les cours du matre Glasgow, s'imprgnant fortement de sa doctrine
et surtout de sa mthode, la mthode exprimentale applique l'homme ; comme
lui, il tait persuad que l'on ne peut fonder la science de l'me sur des hypothses
et sur des raisonnements mtaphysiques, et qu'en cette matire il faut
ncessairement procder par l'observation du moi. Toutefois, en appliquant cette
mthode et en considrant la nature du cur humain, il n'tait pas arriv
absolument au mme rsultat que l'minent fondateur de l'cole cossaise, qui
avait tabli son systme sur la bienveillance, et il avait cru rencontrer un sentiment
prdominant dans la sympathie qui nous fait partager les peines et les joies de nos
semblables. Hutcheson avait cependant examin la sympathie comme les autres
sentiments, mais il avait trouv qu'elle ne rend pas suffisamment compte de tous
les faits moraux 2 . Smith ne partageait pas cet avis et il entreprit de dmontrer que
la sympathie est, plutt que la bienveillance, le vrai mobile de nos actes : ce fut l
le but de son livre.
Il ne se spare pas, l'gard des principes mmes, de la doctrine de son ancien
matre : comme lui, il voit dans le sentiment le fondement de la morale, mais il ne
s'arrte pas le dmontrer, il considre que la preuve est suffisamment faite par les
ouvrages d'Hutcheson, et toute son tude se borne au choix du sentiment. Aussi,
ds les premires lignes de sa Thorie, il expose la tendance sympathique qui est
en nous : Quelque degr d'amour de soi qu'on puisse supposer l'homme, il y a
videmment dans sa nature un principe d'intrt pour ce qui arrive aux autres, qui
lui rend leur bonheur ncessaire, lors mme qu'il n'en retire que le plaisir d'en tre
1
2
1re partie, ch. II, p. 17.
Hutcheson. Systme de philosophie morale, t. I, liv. I, ch. 3 5.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
80
tmoin 1 C'est l le fondement de son systme et il le dveloppe longuement, sous
toutes ses faces, avec mille observations dlicates, mille aperus ingnieux ; puis,
il en indique les applications morales.
Selon Smith, ce sentiment qui est en nous, sympathise avec tout ce qui est bien
chez nos semblables et il est antipathique toute vilaine action de leur part, en
d'autres termes, la conduite des autres nous produit une impression sympathique
ou antipathique qui est la source de nos jugements sur eux : c'est ainsi sur autrui
que nous formons nos premiers jugements et ce n'est qu'ultrieurement que nous
sommes amens les reporter sur nous-mmes pour apprcier notre propre
conduite.
Cette thorie de l'antriorit des jugements que nous portons sur autrui, est
fondamentale dans le systme d'Adam Smith, et il prend soin de l'affirmer jusque
dans le titre de son livre, qu'il intitule : Thorie des sentiments moraux ou essai
analytique sur les principes des jugements que portent naturellement les hommes,
d'abord sur les actions des autres, et ensuite sur leurs propres actions. Il est trs
catgorique sur ce point : S'il tait possible, dit-il, qu'une crature humaine
parvint la maturit de l'ge dans quelque lieu inhabit, et sans aucune
communication avec son espce, elle n'aurait pas plus d'ide de la convenance ou
de l'inconvenance de ses sentiments et de sa conduite, de la perfection ou de
l'imperfection de son esprit, que de la beaut ou de la difformit de son visage. Elle
ne pourrait voir ces diverses qualits, parce que naturellement elle n'aurait aucun
moyen pour les discerner et qu'elle manquerait, pour ainsi dire, du miroir qui peut
les rflchir sa vue. Placez cette personne dans la socit et elle aura le miroir qui
lui manquait : elle le trouvera dans la physionomie et dans les manires de ceux
avec lesquels elle vivra, et elle reconnatra infailliblement s'ils sympathisent avec
ses sentiments ou s'ils les dsapprouvent ; alors elle s'apercevra, pour la premire
fois, de la proprit ou de l'improprit de ses affections, de la perfection ou de
l'imperfection de son me 2 . Et plus loin : C'est aussi d'aprs ce rapport que
nous portons nos premires critiques morales sur le caractre et la conduite des
autres et que nous sommes disposs observer les impressions qu'ils nous
donnent. Mais nous nous apercevons bientt que les autres jugent nos actions aussi
librement que nous jugeons les leurs. Nous nous inquitons de savoir jusqu' quel
point nous mritons leurs censures ou leurs applaudissements, et jusqu' quel point
nous sommes pour eux ce qu'ils sont pour nous, des tres agrables ou
dsagrables. Dans cette vue, nous examinons nos sentiments et notre conduite, et,
pour savoir comment elle doit leur paratre, nous cherchons dcouvrir comment
elle nous paratrait nous-mmes si nous tions leur place. Nous nous divisons
donc, en quelque sorte, en deux personnes distinctes, dont l'une juge et l'autre est
juge.
Thorie des sentiments moraux, 1re partie, section 1re, ch. Ier, traduction de la marquise de
Condorcet.
Thorie des sentiments moraux, IIIe partie, ch. Ier, p. 127.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
81
Toutefois, le bon sens de Smith l'arrte sur cette pente qui devrait l'amener
fatalement ne reconnatre d'autre tribunal que l'opinion, si souvent variable et
parfois passionne. Il prouve le besoin de donner l'homme un juge plus
immuable et plus clair, et, malgr la contradiction de cette ide avec tout son
systme, il dclare que si l'homme est, en quelque sorte, le juge immdiat de
l'homme, il n'est son juge qu'en premire instance ; il appelle, dit-il, de la
sentence prononce contre lui par son semblable, un tribunal suprieur, celui de
sa conscience, celui d'un spectateur que l'on suppose impartial et clair, celui
que tout homme trouve au fond de son cur et qui est l'arbitre et le juge suprme
de toutes ses actions.
Ainsi, d'aprs l'auteur, pour examiner notre conduite, nous sommes forcs
d'abord de reporter sur nous-mmes les jugements que nous avons faits sur nos
semblables, puis nous tirons peu peu des cas particuliers qui ont donn lieu
notre sympathie ou notre antipathie une rgle gnrale pour tous les cas
semblables ou analogues : c'est ainsi que se forme le jugement de notre spectateur
impartial, et ce jugement devient si sr que c'est lui que nous devons couter
lorsqu'il est en conflit avec l'opinion de nos semblables chez qui la sympathie a pu
tre momentanment touffe par les passions.
Adam Smith a donc t oblig de reconnatre implicitement que le criterium
moral est la raison, car son spectateur impartial n'est pas autre chose ; mais, pour
maintenir son systme, il a cherch dmontrer que ce spectateur impartial ne
s'instruit, pour ainsi dire, que progressivement, par l'examen des jugements que
nous formons d'abord sur la conduite des autres, et il n'a pas voulu admettre que
nous ayons une ide inne du bien.
Ses critiques ont cependant une apparence de vrit lorsqu'il attaque la doctrine
de ceux qui trouvent dans la raison le criterium de nos actes, mais c'est qu'il
confond la raison avec le raisonnement. Quoique la raison, dit-il, soit
incontestablement la source de toutes les rgles de moralit et de tous les
jugements que nous portons au moyen de ces rgles, il est absurde et inintelligible
de supposer que, mme dans les cas particuliers d'aprs l'exprience desquels les
rgles gnrales sont formes, nos premires notions du juste et de l'injuste
viennent de la raison. Ces premires observations, comme toutes celles sur les
quelles les rgles gnrales sont fondes, ne peuvent tre l'objet de la raison, et
elles sont celui d'un sentiment immdiat. C'est en dcouvrant, dans une infinit de
cas, qu'une telle conduite plat constamment et qu'une autre dplat toujours, que
nous formons les rgles gnrales, de la moralit. La raison ne peut par elle-mme
rendre aucun objet agrable ou dsagrable l'esprit ; elle peut bien nous montrer
que telle chose est le moyen d'en obtenir une autre qui naturellement nous plat ou
nous dplat, et nous rendre agrable l'une en vue de l'autre ; mais elle ne nous rend
aucun objet agrable ou dsagrable en lui-mme quand le sentiment immdiat ne
parle pas pour ou contre. Ces observations sont spcieuses, on le voit, mais elles
n'ont aucune force contre la doctrine spiritualiste qu'elles prtendent infirmer,
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
82
parce qu'elles ne s'appliquent pas en ralit la raison, mais au raisonnement qui,
nous le reconnaissons volontiers avec l'auteur, n'est qu'un agent de gnralisation
et ne peut tre le fondement de notre jugement moral.
Voil, en quelques traits, les bases de la Thorie des sentiments moraux. Nous
en tudierons plus loin les applications, souvent fort justement dduites et toujours
ingnieuses, mais nous tenons, ds maintenant, montrer les erreurs du principe
lui-mme et en souligner les points faibles.
La critique de ce systme a t faite, d'une faon remarquable, par Victor
Cousin dans ses Leons sur la philosophie cossaise, et par Th. Jouffroy dans son
Cours de Droit naturel. Tout en reconnaissant la valeur de l'ouvrage lui-mme et
les observations dlicates qu'il renferme, ces deux professeurs minents ont t
d'accord pour condamner le fond mme de la doctrine.
Cependant, le fait sur lequel elle repose est en lui-mme incontestable ; il est
certain qu'il y a en nous un sentiment de sympathie pour ce qui est bien,
d'antipathie pour ce qui est mal, et Smith a admirablement dmontr la puissance
de ce sentiment. Mais autre chose est le sentiment qui nous pousse au bien en nous
le faisant aimer, et autre chose la loi morale qui nous ordonne de faire le bien : le
sentiment n'est en ralit que l'auxiliaire de la raison. La sympathie prsuppose la
loi morale, elle ne la constitue pas. Nous sommes sympathiques la belle conduite
des autres, parce que notre raison nous apprend qu'ils font bien, mais notre
sympathie, qui n'est qu'un effet ordinaire de la perception morale, n'est pas en ellemme un criterium du bien et du mal. Comme l'a dit fort lgamment Victor
Cousin, elle est l'cho harmonieux de la vertu dans l'me humaine .
La sympathie est, en effet, comme tout sentiment, essentiellement relative
suivant les temps et suivant les lieux : chez la mme personne elle varie mme
tout instant, selon son tat physique comme selon les dispositions de son esprit, et
la sympathie d'un homme, lorsqu'il est bien portant, est toute diffrente de celle du
mme homme lorsqu'il est souffrant.
Juge cette pierre de touche, une action ne serait donc en elle-mme ni
absolument bonne, ni absolument mauvaise. Telle aurait d tre la consquence du
systme de Smith, si l'auteur avait t logique jusqu'au bout et s'il avait tir des
dductions rigoureuses des principes qu'il avait poss. Mais ce qui empche
toujours le philosophe cossais, dans ses thories morales comme dans ses thories
conomiques, de pousser trop loin les consquences des principes inexacts, c'est la
sret de son bon sens qui refuse d'admettre certaines dductions qu'il sent
instinctivement tre entaches d'erreur. C'est ainsi que, prvoyant le reproche qui
devait lui tre fait et ne pouvant admettre cette conclusion funeste que le bien est
essentiellement relatif, il fait intervenir ce spectateur impartial, vritable Deus ex
machina, cette espce de demi-dieu qui juge dans nos mes, du bien et du
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
83
mal 1 . Cependant cette intervention est la ruine du systme, car si le spectateur
est impartial, c'est qu'il ne se laisse influencer par aucun sentiment, c'est qu'il
rsiste ses passions, sa sympathie mme ; ce serait donc, en dernire analyse, la
raison, car on est toujours amen la faire intervenir sous une forme ou sous une
autre lorsqu'on tudie les phnomnes moraux.
On ne pourrait concevoir, en effet, un spectateur sympathique qui ft impartial.
De quelle espce d'impartialit, dit Jouffroy 2 , peut-il tre ici question ? Ce n'est
pas d'une impartialit de jugement ; car remarquez que la raison n'intervient en
aucune manire dans l'apprciation morale, autrement l'apprciation morale
n'manerait plus de la seule sympathie et le systme serait renvers. En prsence
d'un homme qui prouve une certaine affection, ce qui se dveloppe en moi, selon
Smith, et ce par quoi l'action est apprcie, c'est l'instinct sympathique et pas autre
chose : l'intelligence ne fait que recueillir la dcision et la formuler. Par
l'impartialit du spectateur, on ne saurait donc entendre l'impartialit de sa raison
qui ne juge pas ; on est donc contraint d'entendre celle de sa sympathie qui seule
juge. Mais ici se prsente la difficult de comprendre ; car, je le demande, quel
sens mettre sous ces mots : l'impartialit d'un instinct ? On dit bien d'un homme
qu'il est impartial ; mais quelle condition ? condition qu'on parle de son
jugement ; car, supprimez en lui la facult de juger, l'expression n'a plus de sens.
C'est qu'en effet, l'impartialit ne peut s'entendre que de la facult de juger, et,
quand on dit que la facult de juger est impartiale, on veut dire qu'elle n'est
sollicite par aucune affection. Pourquoi ne suis-je pas impartial l'gard d'un
ami ? Parce que la sympathie incline mon jugement en sa faveur. Pourquoi ne le
suis-je pas l'gard d'un ennemi ? Par la raison contraire. Il est donc d'autant plus
difficile de comprendre l'impartialit de la sympathie que, dans l'acception
ordinaire du mot, c'est l'absence de la sympathie qui constitue l'impartialit.
un autre point de vue d'ailleurs, l'intervention de ce spectateur dtruit encore
le systme de la sympathie. En effet, d'aprs Smith, notre criterium moral est la
sympathie de nos semblables, et, lorsque nous voulons porter nous-mmes un
jugement sur notre propre conduite en l'absence de l'approbation ou de la
dsapprobation des autres, nous sommes forcs de nous mettre leur place. Or,
que fais-je, dit Jouffroy 3 , quand, aux sentiments des spectateurs rels de mes
actions, je substitue ceux d'un certain spectateur abstrait ? Non seulement
j'abandonne la rgle de la sympathie pose par ce systme, non seulement je lui en
substitue une autre, mais je nie cette rgle, mais je la dclare fausse et la
condamne, car ce spectateur abstrait n'existe pas, et, s'il n'existe pas, ces sentiments
n'ont point de ralit et sont une fiction. Ce n'est donc point par les sentiments
d'autrui que le me juge, mais par les miens. Que dis-je ? Les sentiments d'autrui, je
les rejette ; et au nom de quoi ? Au nom des miens, car c'est moi qui cre ce
spectateur abstrait ; le monde extrieur ne me le fournit pas ; il n'est ni un individu
1
2
3
Thorie des sentiments moraux, p. 148.
Cours de droit naturel, II, p. 12.
Cours de droit naturel, II, p. 17.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
84
rel de ce monde, ni une moyenne entre les individus rels de ce monde ; il sort, il
mane de moi, c'est--dire de mes sentiments. Je juge donc avec mes sentiments
qui, selon le systme, ne peuvent me juger, les sentiments d'autrui qui, selon le
systme, peuvent seuls me juger ; je renverse, donc le systme autant qu'il peut
tre renvers.
Ainsi, cette intervention du spectateur impartial, laquelle l'esprit sens et
vertueux d'Adam Smith n'a pu se soustraire, est la condamnation clatante du
systme par l'auteur lui-mme. Son spectateur abstrait existe rellement, mais c'est
la raison, qui est en nous ds notre naissance, qui nous accompagne dans l'le
dserte, et qui assure, bien mieux que la sympathie, l'harmonie universelle, en
donnant tous la mme notion du bien et du mal.
Toutefois, bien qu'errone dans son principe mme, la thorie de la sympathie
n'en donne pas moins lieu des applications curieuses et souvent remarquables,
lorsqu'Adam Smith entreprend de rendre compte, par son moyen, de tous les
phnomnes moraux : c'est ainsi qu'il analyse, d'une faon fort ingnieuse, l'ide de
mrite et de dmrite, la joie et le remords, la vertu elle-mme.
la vue d'une bonne action, nous sympathisons, selon lui, non seulement avec
le sentiment de son auteur, mais encore avec le sentiment de l'oblig. Or, ce
sentiment, qui est la reconnaissance, consiste vouloir du bien son bienfaiteur ;
nous sympathisons donc avec ce dsir et nous voulons du bien l'homme
vertueux, tout le monde doit lui vouloir du bien, il le mrite. De mme, en
prsence d'une mauvaise action, non seulement nous avons de l'antipathie pour le
mchant, mais encore nous sympathisons avec le sentiment de vengeance de
l'offens, et, comme lui, nous voulons la punition du malfaiteur : voil le principe
du dmrite. Toute action, dit Smith 1 , nous parat digne de rcompense ds
qu'elle excite en nous un sentiment qui nous porte faire du bien son auteur ; de
mme toute action nous parat digne de chtiment ds que le sentiment qu'elle nous
inspire nous porte nuire celui qui l'a faite. ...Comme le sentiment que nous
avons de la proprit de la conduite d'un homme nat de ce que j'appelle une
sympathie directe pour les affections et les motifs qui l'ont dtermin agir ; de
mme le sentiment que nous avons du mrite de son action, nat de ce que j'appelle
une sympathie indirecte pour la reconnaissance de la personne sur laquelle influe
cette action. Comme nous ne pouvons partager compltement la reconnaissance de
la personne qui reoit un bienfait, si nous n'approuvons auparavant les motifs qui
ont dtermin le bienfaiteur, il s'ensuit que le sentiment que nous avons du mrite
d'une action est un sentiment compos et qui renferme deux impressions distinctes
l'une de l'autre, savoir : une sympathie directe pour les sentiments de la personne
qui agit et une sympathie indirecte pour la gratitude de la personne que l'action de
l'autre oblige.
Thorie des sentiments moraux, IIe partie, section I, p. 73 et 82.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
85
Cette explication par la sympathie de l'ide de mrite et de dmrite est trs
ingnieuse, mais elle n'est pas exacte, et mme, contrairement aux autres thories
de Smith, elle n'est pas compltement vraisemblable. En effet, d'aprs ce systme,
nous n'avons une ide du mrite d'une action qu'en partageant la reconnaissance de
l'oblig, mais, lorsque cet oblig est ingrat, son bienfaiteur est-il moins mritant ?
De mme, lorsque, par bont, l'offens ne s'indigne pas contre le mchant, celui-ci
est-il moins dmritant ? Non, l'ide de mrite et de dmrite est indpendante de
tout sentiment de reconnaissance on de vengeance prouv par l'oblig ou la
victime. Lorsque nous avons connaissance d'une belle action qui a cot un certain
effort . son auteur, notre raison nous dit que cet homme a droit une
rcompense ; de mme, lorsque nous assistons un acte injuste, elle nous dit que
l'auteur doit tre puni. Nous sympathisons, il est vrai, avec le premier, et nous
prouvons de l'antipathie pour le second, mais ces sentiments n'interviennent
qu'aprs le jugement : ce n'est pas notre sympathie pour l'homme vertueux que
nous reconnaissons qu'il fait bien, nous sympathisons avec lui parce que nous
avons jug auparavant que son action est bonne. Toutefois, cette opration de
l'esprit qui juge de la bont d'une action est trs rapide, et elle a pu chapper
Smith, tandis que le philosophe cossais a t frapp par la persistance du
sentiment qui suit immdiatement l'apprciation morale.
L'erreur de l'auteur tient la mme cause lorsqu'il cherche expliquer le
remords et les joies de la conscience, phnomnes qu'il a peints, cependant, avec
beaucoup d'exactitude. Celui qui viole les lois les plus sacres de la justice, ditil 1 , ne saurait rflchir sur les sentiments qu'il inspire aux hommes, sans prouver
toutes les angoisses de la terreur, de la honte et du dsespoir. Quand la passion qui
l'a conduit au crime est satisfaite, et qu'il commence rflchir sur sa conduite
passe, il ne peut approuver aucun des motifs qui l'ont dtermin. Il se trouve aussi
hassable qu'il le parat aux autres ; il devient pour lui-mme un objet d'effroi, par
une espce de sympathie pour l'horreur qu'il inspire tout le monde. Le sort de la
personne qui a t victime de son crime lui fait connatre, malgr lui, la piti. La
seule pense de la situation o il l'a rduite, le dchire ; il dplore les funestes
effets de sa passion ; il sent qu'ils le rendent l'objet de l'indignation publique, et de
ce qui en est la consquence naturelle, la vengeance et le chtiment. Cette pense
s'attache au fond de son cur et le remplit d'pouvante et d'horreur. Il n'ose
regarder personne en face ; il croit tre rejet de la socit des hommes et pour
jamais banni de leur affection. Dans l'excs mme de son malheur, il ne peut
esprer les douces consolations de la sympathie. Ce sentiment est banni sans retour
du cur de ses semblables par le souvenir de son crime.
On voudrait pouvoir citer en entier ce passage remarquable. Malgr l'erreur
fondamentale qui domine toute la matire, l'auteur a dcrit avec une exactitude
tonnante ce phnomne du remords, et on ne peut que regretter qu'il ait d
rattacher cette tude son systme : elle est profondment vraie, sauf en ce qui
1
Thorie des sentiments moraux, IIe partie, sect. II, ch. II, p. 95.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
86
concerne le point de rattachement, et elle dnote des observations dlicates et
profondes qu'on ne saurait trop apprcier.
En ce qui concerne les considrations de cette nature, la Thorie des sentiments
moraux est fort intressante, et Victor Cousin conseillait ses lves de lire ce
livre tout entier, de le relire mme souvent. Son mrite, disait-il 1 , est dans cette
multitude d'ides justes et dlicates qui se ternissent et mme prissent dans la
scheresse d'un extrait et qu'il faut supprimer ou reproduire dans toute leur
tendue. Distinguez bien les observations sur lesquelles se fonde la thorie et la
thorie elle-mme, les applications du principe et le principe. Nous admettons
presque toutes les observations, mais non pas la thorie qui dpasse infiniment les
faits sur lesquels elle a l'air de s'appuyer ; nous admirons la richesse et la fcondit
des applications que Smith tire de son principe, mais ce principe chappe et
s'vanouit ds qu'on tente de le soumettre un examen srieux.
La plus originale et la plus ingnieuse de ces applications est peut-tre la
classification des vertus.
Adam Smith, en effet, envisage sous deux faces les diverses affections :
premirement, dans leur rapport avec l'objet qui les dtermine, et alors elles sont
convenantes ou inconvenantes ; deuximement, dans leur tendance, et alors elles
sont mritantes ou dmritantes. La convenance et le mrite sont donc les deux
qualits morales des actions. Or, l'ide de mrite correspondent deux vertus : la
bienfaisance, qui dveloppe en nous toutes les affections tendant au bonheur de
nos semblables, et la justice, qui nous fait rprimer toutes celles qui tendent au mal
d'autrui. l'ide de convenance correspondent deux autres vertus : la
bienveillance, source de toutes les vertus aimables, qui met nos sentiments
l'unisson de ceux des personnes qui nous entourent, et lempire sur soi, source des
vertus respectables, qui contient l'expression trop vive de nos propres sentiments :
De ces deux diffrents efforts, dit Smith en parlant des vertus fondes sur l'ide
de convenance 2 , l'un de la part du spectateur pour entrer dans les sentiments de la
personne intresse, l'autre de la part de celle-ci pour se mettre au niveau du
spectateur, naissent deux diffrents genres de vertus : les vertus douces,
bienveillantes, aimables, la nave condescendance, l'indulgente humanit, tirent
leur origine de l'un ; et les vertus svres et respectables, le dsintressement, la
modration, cet empire sur nous-mmes qui soumet tous nos mouvements ce que
notre dignit et notre honneur exigent, tirent leur origine de l'autre.... Les vertus
aimables naissent de ce degr de sensibilit qui surprend par tout ce qu'il renferme
de tendre, de dlicat, et, pour ainsi dire, d'exquis. Les vertus hroques et
respectables naissent de cet empire continuel sur soi-mme, qui tonne par la
supriorit qu'il annonce sur les passions les plus indomptables de la nature .
1
2
Philosophie cossaise, 4e leon, p. 176.
Thorie des sentiments moraux, Ire partie, section I, ch. V, p. 20.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
87
Dans cette classification des vertus, l'auteur se pose en adversaire dclar de la
morale goste, et, quelque errone que soit sa doctrine, on ne peut qu'en admirer,
cet gard, la noblesse des conclusions. Pour lui, la perfection consiste sentir
beaucoup pour les autres et peu pour soi-mme, rduire le plus possible l'amour
de soi et s'abandonner toutes les affections douces et bienveillantes : c'est l,
selon lui, la tendance sublime que Dieu a mise en nous et qui doit nous conduire
tous au but final de notre nature, l'harmonie universelle.
Nous venons de parler de Dieu. En effet, quoiqu'on ait souvent reproch
Smith de partager, au point de vue thologique, le scepticisme de son ami Hume,
et qu'il ait paru donner raison ces attaques en acceptant la mission de surveiller la
publication des Dialogues sur la Religion naturelle, l'auteur de la Thorie des
sentiments moraux n'en tait pas moins convaincu de l'existence de Dieu comme
de l'immortalit de l'me, et il avait mme fait de cette doctrine mtaphysique le
couronnement et la sanction de sa morale. C'est que le spectateur impartial qu'il a
constat en nous ne lui parat pas suffisant pour guider dans tous les cas notre
conduite ; il reconnat que ce spectateur reste parfois surpris et tourdi par la
violence des faux jugements d'autrui notre gard, et que, n'tant d'ailleurs que la
rsultante des prcdents jugements des hommes, il ne peut au nom de cette
rsultante de certains jugements, en rejeter d'autres d'une manire absolue. Il lui
faut donc faire intervenir dans le systme un spectateur possdant une autorit
suprieure, soustrait aux influences des passions humaines, et ce spectateur
universel que Smith ne veut pas chercher dans la raison, il le place en Dieu, juge
suprme en mme temps que grand justicier, qui donne, dans une autre vie, une
sanction la loi morale. Nous osons peine nous absoudre nous-mmes, dit-il 1 ,
quand les autres nous condamnent. Il nous semble que ce tmoin, suppos
impartial, de notre conduite, avec lequel notre conscience sympathise toujours,
hsite nous approuver quand nous avons unanimement et violemment contre
nous les vritables spectateurs, ceux dont nous cherchons prendre les yeux et la
place pour nous envisager nous-mmes. Cet esprit intrieur, cette espce de demidieu qui juge dans nos mes du bien et du mal, semble alors, comme les demidieux des potes, avoir une origine mortelle et une origine immortelle. Il parat
obir son origine cleste, quand ses jugements sont l'empreinte ineffaable du
sentiment de ce qui mrite la louange et de ce qui mrite le blme ; il semble rester
soumis son origine terrestre, quand il se laisse branler et confondre par les
jugements de l'ignorance et de la faiblesse humaines. Dans ce dernier cas, la seule
consolation efficace qui reste l'homme abattu et malheureux, est d'en appeler au
tribunal suprme du juge clairvoyant et incorruptible des mondes. Une ferme
confiance dans la rectitude immortelle de ses jugements qui, en dernier ressort,
proclament l'innocence et rcompensent la vertu, nous soutient seule contre
l'abattement et le dsespoir d'une conscience qui n'a d'autre tmoignage que le sien
propre, quoique la nature ait cependant destin la conscience tre la sauvegarde
de la tranquillit de l'homme comme de sa vertu. Ainsi, dans ce monde, notre
1
Thorie des sentiments moraux, IIIe partie, ch. II, p. 148.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
88
bonheur dpend souvent de l'humble espoir d'une autre vie, espoir profondment
enracin dans nos curs, espoir qui peut seul justifier la dignit de notre nature,
clairer les redoutables et continuelles approches de notre destruction, et nous
rendre capables de quelque srnit au milieu des malheurs qu'engendrent les
dsordres de la vie humaine. Le systme d'une vie venir, o l'homme trouvera
une justice exacte et sera enfin ct de ses gaux ; o les talents, les vertus
caches, longtemps opprimes par la fortune et presque inconnues de celui qui les
possdait, puisque la voix de sa conscience lui en rendait peine le tmoignage ;
o le mrite modeste et silencieux sera plac ct et quelquefois au-dessus du
mrite qui, favoris par sa situation, parvient la clbrit et la gloire : un tel
systme enfin, si respectable sous tous les rapports, si flatteur pour la grandeur de
notre nature, si rassurant pour notre faiblesse, lorsqu'il laisse encore quelques
doutes l'homme vertueux, lui laisse aussi le dsir et le besoin d'y croire. Et plus
loin 1 : Quand nous dsesprons de voir le triomphe de l'injustice renvers sur la
terre, nous en appelons au Ciel, et nous esprons que l'auteur de la nature
excutera dans l'autre vie ce que tous les principes qu'il nous avait donns pour
diriger notre conduite nous portaient tenter dans celle-ci. Nous nous flattons qu'il
achvera l'ouvrage qu'il nous a fait commencer et qu'il rendra chacun, dans un
autre monde, ce qu'il a mrit dans celui-ci. Ainsi nous sommes ports croire
une autre vie, non seulement par les faiblesses, par les esprances et par les
craintes propres notre nature, mais aussi par les plus nobles principes qui lui
appartiennent, par l'amour de la vertu et par l'horreur du vice et de linjustice.
Nous ignorons compltement sur quelles bases spculatives Adam Smith a fait
reposer, dans son cours de Glasgow, cette croyance l'existence de Dieu et une
vie venir : ni Millar, ni Dugald Stewart lui-mme ne nous ont laiss aucun
document sur ce sujet. Il ne nous en a pas moins paru intressant de constater
comment le clbre philosophe a fait intervenir ces grandes ides pour tayer sa
doctrine et donner la loi morale ce caractre absolu qui lui est indispensable et
que la sympathie tait, par dfinition, impuissante lui fournir. Avec le bon sens
qui lui tait habituel, il avait reconnu d'ailleurs qu'au point de vue pratique, cette
ide est un puissant auxiliaire pour la moralisation du peuple et il n'avait garde de
ngliger cette force, jugeant utile de rappeler constamment l'homme qu'il ne peut
se drober aux regards et aux chtiments d'un Dieu vengeur de l'injustice, quand
mme il chapperait aux regards et aux chtiments de ses semblables. La religion
fortifie, dit-il, le sentiment naturel du devoir. C'est ce qui donne gnralement plus
de confiance dans la probit des hommes profondment religieux : on suppose
toujours quils sont attachs l'observation de leurs devoirs par un lien de plus.
L'homme religieux, comme l'homme du monde, a en vue, dans toutes ses actions,
et leur moralit, et l'approbation de sa conscience, et le suffrage des hommes, et le
soin de sa rputation. Mais une considration encore plus importante le dirige : il
n'agit jamais qu'en prsence du juge suprme qui doit un jour le rcompenser selon
Thorie des sentiments moraux, IIIe partie, ch. V, p. 192.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
89
ce qu'il aura fait ; c'est un puissant motif d'avoir une double confiance dans la
rectitude de sa conduite
L'ide de Dieu, d'un juge suprme, clairvoyant et incorruptible, voil donc le
couronnement de la thorie morale de l'auteur. C'est Dieu qu'il faut en appeler en
dernier ressort, et c'est lui qui maintient l'harmonie universelle dans les curs et
dans les diverses parties du corps social. Cette harmonie universelle est belle, selon
Smith, comme un immense mcanisme dont toutes les parties marchent d'accord,
et, cause d'elle, chaque rouage, chaque mouvement du mcanisme, c'est--dire
tout acte de chaque individu agissant conformment sa nature, devient, par cela
mme, beau : c'est l, pour le philosophe cossais, le principe de la beaut morale.
Nous le reconnaissons aussi, cette harmonie est belle ; il est beau de voir tous nos
sentiments et tous nos intrts concourir la mme fin ; mais toutes les actions
combines dans ce but sont-elles bonnes par le fait mme de la beaut de la vaste
machine de l'univers ; c'est ce que Smith affirme sans le dmontrer. Nous
estimons, au contraire, que, bien que ce soit un effet de la loi morale de produire
l'harmonie, il ne s'ensuit nullement que cette tendance l'harmonie soit le caractre
auquel on doive reconnatre la loi morale, car elle est fonde sur un instinct qui n'a
en lui-mme aucun caractre moral et auquel aucune obligation ne peut tre
attache.
Ainsi, malgr son imagination ingnieuse et mme quelques infidlits au
principe gnral de son systme, Smith est impuissant donner un caractre
obligatoire sa rgle morale. C'est qu'il est tomb dans la mme erreur que
d'autres philosophes qu'il a combattus, et, comme eux, il a pris l'un des mobiles
que Dieu a placs en nous comme auxiliaires de la loi morale pour cette loi morale
elle-mme. Tandis que d'autres trouvaient le criterium du bien dans l'amour de soi,
l'gosme, tandis qu'Hutcheson le plaait dans la bienveillance, le professeur de
Glasgow a cru le rencontrer dans la sympathie ; mais ce mobile, qui lui paraissait
plus noble que l'gosme, n'est comme lui que l'effet d'un instinct, et, pas plus que
lui, il ne peut avoir de caractre obligatoire.
Telle est la doctrine expose par Adam Smith dans la Thorie des sentiments
moraux. Bien que le principe en soit erron, l'auteur en a tir des applications
curieuses, parfois mme fort justes lorsqu'il ne tentait pas de les rattacher trop
troitement son systme. Il a rendu d'ailleurs un rel service la philosophie en
poursuivant cette tude de l'un des plus puissants mobiles du cur humain, et si,
au lieu de considrer cette uvre comme un trait de morale, on ne veut voir en
elle qu'une monographie de la sympathie, si on nglige l'enchanement
systmatique, des ides pour n'en retenir que les observations dlicates et les
aperus originaux qui abondent chaque page, on trouvera dans ce livre des
documents prcieux pour l'tude de la psychologie. C'est pour ce motif que nous
nous sommes efforc de multiplier les citations et de laisser parler le plus souvent
possible l'auteur lui-mme dans l'exposition de son systme ; on voudrait pouvoir
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
90
tout citer, tant est grand le charme exquis qui se dgage de l'ensemble de
louvrage.
On a compar quelque part le livre de Smith aux Caractres de La Bruyre. Il
est certain qu'il y a dans la Thorie des sentiments moraux, et surtout dans la
premire partie, une foule d'observations qui ont la mme allure et une valeur
gale aux remarques de La Bruyre. La plus grande diffrence rside dans la forme
qui leur est donne. Chez le moraliste franais, les observations sont prsentes
dans un ordre particulier, trs sduisant, et groupes de manire peindre des
caractres ; chez le philosophe cossais, au contraire, elles ne sont l que pour
vrifier un systme, comme preuves l'appui, ou plutt, dirions-nous, pour
illustrate un trait didactique, si nous osions employer cette expression fort exacte
de la langue anglaise. Mais c'est justement cette diffrence de forme que tient le
succs diffrent des deux livres : les Caractres sont toujours lus, ils ont place
dans toutes les bibliothques, , l'tranger comme en France, parce que La Bruyre
ne paraissait chercher qu' peindre et qu'il vitait ainsi d'attacher son uvre au sort
d'une doctrine ; Smith, au contraire, n'observait que pour expliquer ensuite, et
lorsque l'erreur de sa thorie a t dmontre, le livre est tomb tout entier, bien
que les observations qu'il contient soient toujours aussi vraies, toujours aussi utiles
consulter, bien qu'elles reposent sur une tude consciencieuse du cur humain.
C'est ce titre que la Thorie des sentiments moraux mrite de vivre. Quand
on parcourt le livre de Smith, dit un juge comptent, Victor Cousin, sans songer
son principe, systmatique, il instruit et il charme, par cette multitude
d'observations fines, profondes, inattendues, sur les hommes et sur la socit, sur
les ressorts intimes de nos actions, sur leurs effets privs et publics, sur les mille et
mille formes que prennent la vertu et le vice, selon l'infinie diversit des situations
et des opinions ; sans parler des sentiments dlicats et levs rpandus de toute
part, depuis la premire page jusqu' la dernire, qui, passant de l'me de l'auteur
dans celle du lecteur, y forment et y entretiennent une sorte d'atmosphre morale
douce et sereine, semblable celle de la bonne conscience. Il semble alors qu'il n'y
a point de livre plus vrai et plus attrayant. Malheureusement, ce livre n'est pas
aussi connu de nos jours qu'il devrait l'tre ; il n'est plus consult qu'au point de
vue historique et pour le systme lui-mme qui est erron, alors qu'il devrait tre
entre les mains de tous les philosophes, littrateurs, romanciers, hommes d'tat, de
tous ceux, en un mot, qui, par got ou par profession, s'intressent l'tude du
cur humain et des phnomnes psychologiques.
Nous navons pas dit dailleurs tout le mrite de la Thorie des sentiments
moraux, car, outre le dveloppement de la doctrine de la sympathie, elle contient
encore une histoire fort remarquable, bien que trs brve, des principaux systmes
de philosophie morale.
Aucune histoire de cette nature ne paraissait avoir t entreprise jusqu'alors.
Bacon avait insist pourtant, d'une manire toute particulire, sur l'importance
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
91
capitale que prsente en philosophie l'tude des systmes, mais, avant Smith,
personne n'avait abord ces recherches ardues, et les auteurs, mme les plus
distingus, se contentaient trop souvent de condamner en bloc les doctrines les
plus remarquables, d'aprs le seul examen de leur conclusion, sans les avoir
mdites, sans avoir cherch discerner la part de vrit qu'elles renferment. Le
professeur cossais a tent de raliser le vu de Bacon, et, du premier coup, il s'est
rvl l comme un historien remarquable, possdant le vritable esprit de la
philosophie de l'histoire. Partant de ce principe, si souvent mconnu, que dans tout
systme il y a une certaine part de vrit, ncessaire pour le rendre vraisemblable,
a tudi avec soin chacune des diffrentes doctrines, afin de s'en pntrer et de
comprendre la marche qu'avait d suivre l'esprit du chef de l'cole pour arriver la
conception de sa thorie. On ne saurait trop apprcier ce point de vue lev, auquel
il s'est ainsi plac ds le dbut de cet aperu. La noblesse de ses sentiments, son
caractre consciencieux et l'amour qu'il professait pour la vrit, lui avaient fait
sentir instinctivement qu'il n'est pas possible que des hommes de valeur comme
ceux dont l'histoire de la philosophie nous a laiss les noms, aient cr des
systmes de toutes pices, sans partir d'un fait ou d'une ide exacte dont leur esprit
avait t frapp et dont ils avaient voulu donner une explication raisonne.
D'ailleurs, le succs mme des divers systmes moraux tait, ses yeux, une
prsomption srieuse que chacun d'eux reposait sur des faits, sinon absolument
exacts, du moins vraisemblables.
Un systme de physique, dit-il en effet 1 , peut tre pendant longtemps en
vogue, et cependant n'tre aucunement fond sur la nature et n'avoir mme aucune
des apparences de la vrit. Les tourbillons de Descartes ont t regards, pendant
prs d'un sicle, chez une nation ingnieuse, comme le systme qui expliquait de la
manire la plus satisfaisante les rvolutions des corps clestes. Cependant on a
prouv dmonstrativement que les causes prtendues de ces grands effets, non
seulement n'existaient pas, mais que mme, si elles existaient, elles ne produiraient
pas les effets qu'on leur attribue. Il en est autrement des systmes de philosophie
morale, et il n'est pas possible un auteur qui veut expliquer l'origine de nos
sentiments moraux, de se tromper et de s'loigner aussi grossirement de la vrit.
Lorsqu'un voyageur nous fait la description d'un pays loign, il peut abuser de
notre crdulit, au point de nous offrir, pour des ralits les fictions les plus
absurdes et les plus chimriques. Mais quand une personne veut nous instruire de
ce qui se passe dans notre voisinage ou des affaires de ceux avec lesquels nous
vivons, quoiqu'elle puisse aussi nous tromper quelques gards si nous ne
vrifions rien de nos propres yeux, cependant les faussets qu'elle veut nous faire
croire doivent avoir un certain degr de ressemblance avec la vrit et mme tre
mles de vrit. Un auteur qui nous propose un systme de physique et qui
prtend faire connatre les causes des principaux phnomnes de l'univers, est
comme le voyageur qui veut nous dpeindre un pays loign, qui peut nous en dire
tout ce qu'il lui plat et se flatter d'tre cru, tant qu'il ne sort pas du cercle des
1
Thorie des sentiments moraux, VIIe partie, sect. III, ch. IV, p. 268.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
92
probabilits. Mais le philosophe qui veut expliquer l'origine de nos dsirs et de nos
affections, de nos sentiments d'approbation et de dsapprobation, ne prtend pas
seulement nous rendre compte de ce qui intresse ceux avec lesquels nous vivons :
il veut nous instruire de nos affaires domestiques. Alors, semblables ces matres
indolents qui se confient un intendant fripon, nous sommes sujets tre tromps ;
mais nous sommes incapables d'admettre un compte o il ne se trouverait aucune
ombre de vrit ; il faut au moins que quelques articles soient justes, et mme que
les plus importants soient, quelques gards, vridiques, sans quoi la plus lgre
attention suffirait pour dcouvrir la fourberie. Un auteur qui nous donne pour
cause de nos sentiments naturels un principe qui leur est tranger et qui n'a mme
aucun rapport avec leur vritable principe, paratrait absurde et ridicule, mme au
lecteur le moins clair.
Ce raisonnement tait fort juste. Aussi, grce la puissance de travail que
possdait Adam Smith, il arriva acqurir la preuve de ce qu'il avait prvu, et il
s'est attach montrer, dans les divers systmes qui ont occup tour tour la scne
philosophique, ce que chacun d'eux avait d'exact et quelle tait l'observation,
toujours vraie ou paraissant telle, qui lui avait servi de point de dpart. On ne
saurait trop admirer, sous cet aspect, le caractre du matre : consciencieux dans
toutes ses uvres, il juge les autres par lui-mme, il ne combat jamais une doctrine
qu'aprs l'avoir bien comprise et s'tre compltement pntr de son esprit.
Aussi, le bref expos des divers systmes qu'il a passs en revue est fort
intressant. Il y classe les coles d'aprs leur rponse deux questions principales
qu'il pose chacune d'elles : il leur demande, en premier lieu, en quoi consiste la
vertu ou quel est le mode de conduite qui constitue un caractre excellent et digne
de louanges ; en second lieu, quelle est la puissance, ou la facult, de l'me qui
nous fait aimer ce caractre, quel qu'il soit. En d'autres termes, qu'est-ce que la
vertu et quelle est la facult de l'me qui nous la fait aimer : telle est la double
question d'aprs laquelle il prtend juger les diverses doctrines.
Il a reconnu ainsi que, dans leur manire de comprendre la vertu, les
philosophes de tous les sicles pouvaient tre groups en trois coles distinctes.
L'une de ces coles, avec Platon, Aristote, Znon, Wollaston et Shaftesbury,
plaait la vertu dans une certaine convenance ou proprit des actions ellesmmes. Les deux autres, au contraire, envisageant un aspect tout diffrent, avaient
cru la trouver, non dans les actions elles-mmes, mais dans les consquences des
actions, et, tandis que les uns, comme picure, La Rochefoucauld et Mandeville
l'avaient fait consister dans le bonheur que nos actions nous procurent, les autres,
comme Hutcheson et l'auteur lui-mme, la plaaient dans le bonheur qu'elles
procurent nos semblables : On peut rduire trois classes diffrentes, crit-il 1 ,
les diverses dfinitions que les moralistes ont donnes de la nature de la vertu, ou
de la manire d'tre de l'me qui constitue le caractre le plus excellent et le plus
1
Thorie des sentiments moraux, VIIe partie, sect. II, p. 313.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
93
digne de louanges. Selon quelques-uns, la disposition de l'me qui constitue la
vertu ne consiste pas dans un genre particulier d'affections, mais dans un empire et
une direction convenables de toutes nos affections, qui peuvent tre vertueuses ou
vicieuses, selon l'objet qu'elles ont en vue et selon le degr de vhmence avec
lequel elles le poursuivent : d'aprs ces auteurs, la vertu est donc ce qui est
convenable et propre. Selon d'autres, la vertu consiste dans une judicieuse
recherche de notre intrt et de notre bonheur particulier, ou dans l'empire et la
direction convenable des affections personnelles qui ont notre bonheur pour objet
unique, et, dans l'opinion de ces moralistes, la vertu consiste dans la prudence. Il
en est encore d'autres qui font consister la vertu, non dans les affections qui ont
pour objet notre bonheur, mais dans celles qui tendent au bonheur d'autrui ; d'o il
rsulterait qu'une bienveillance dsintresse est le seul motif qui puisse imprimer
nos actions le caractre de la vertu. La vertu consiste donc, suivant les
systmes, soit dans la convenance, soit dans la prudence, soit enfin dans la
bienveillance.
Quant au principe de l'approbation, c'est--dire la puissance ou la facult.de
l'me qui nous fait prfrer telle conduite telle autre, qui nous fait trouver l'une
mritante et l'autre dmritante, les diffrentes coles l'ont plac, ou dans la raison,
ou dans l'intrt personnel, ou dans le sentiment. On a expliqu de trois
manires, dit en effet Adam Smith 1 , le principe de l'approbation. Selon quelquesuns, nous approuvons ou nous dsapprouvons nos actions et celles des autres, par
amour de nous-mmes seulement et selon qu'elles ont plus ou moins de rapport
notre intrt ou notre bonheur ; selon d'autres, c'est la raison, c'est--dire la
facult par laquelle nous distinguons le vrai du faux, qui nous fait discerner ce qui
est convenable ou ce qui est inconvenable dans nos actions et dans nos affections.
Quelques autres encore prtendent que ce discernement est entirement l'effet de
notre sensibilit, qu'il n'est que le plaisir ou le dgot mme que certaines
affections ou certaines actions nous inspirent.
Nous ne voulons pas entrer dans les dtails de cette tude, car nous ne
pourrions suivre l'auteur dans l'examen des diverses doctrines, sans tre entran
rapidement hors du cadre de ce travail. Mais nous avons tenu faire remarquer, et
le point de vue lev o s'est plac Adam Smith, et la mthode originale qu'il a
employe dans cet aperu de l'histoire de la philosophie morale. Quant l'expos
des systmes, il faut le lire, car d'arides extraits ne peuvent en donner une ide.
Comme l'a dit Mackintosh 2 : l'auteur y dmontre d'une manire admirable quelle
influence durent avoir sur les systmes de morale, l'tat social, les rvolutions
politiques ainsi que les habitudes individuelles et nationales. Il se pntre de la
philosophie qu'il dcrit, et il nous fait connatre la morale de l'cole stoque avec
l'austrit et la fiert d'un sage stocien, tempres par la tolrance qui est propre
notre poque et que la rpugnance de l'auteur pour l'exagration et le paradoxe
contenait dans les limites de la nature.
1
2
Thorie des sentiments moraux, VIIe partie, sect. III, p. 370.
Mlanges, p. 3.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
94
Cette tude historique a t d'ailleurs juge d'une manire magistrale, soit dans
les Leons de Victor Cousin sur la philosophie cossaise, soit dans les Cours de
Jouffroy, et tout ce que nous pourrions en dire a t profess dj par des matres
minents dont nous ne saurions que citer les apprciations et les critiques.
Nanmoins, il nous a paru bon de donner ici un aperu rapide des diverses parties
de ce grand ouvrage par lequel le professeur de Glasgow voulait se prsenter au
monde savant. La valeur de ce livre a t mconnue trop souvent : on a voulu n'y
voir que l'erreur du principe, on a pass, sans y prendre garde, sur cent applications
ingnieuses, sur mille observations dlicates, et, rcemment encore, un publiciste
distingu, compatriote de Smith, M. W. Bagehot, dans un article quil crivait il y
a quelques annes sur la personne du clbre conomiste, condamnait fort
injustement les travaux du philosophe Glasgow, o il habillait, disait-il, en
mots pompeux des thories trs contestables . Cet ouvrage tait l'objet de la
prdilection de Smith ; il le considra, jusque dans les dernires annes de sa vie,
comme son plus grand titre de gloire, et il tait bien loin de se douter que son
uvre favorite tomberait presque dans l'oubli, tandis que, grce la Richesse des
Nations, qui lui semblait moins acheve et moins homogne, son nom traverserait
les ges.
3. Considrations sur l'origine et la formation des langues.
Retour la table des matires
En mme temps que la deuxime dition de la Thorie des sentiments moraux
et dans le mme volume, Smith publia un nouveau trait sous le titre de
Considrations sur l'origine et la formation des langues. Cette tude, sans lien
apparent avec la prcdente, se rattachait cependant encore au vaste plan de
l'Histoire gnrale de la Civilisation.
Pendant son sjour Edimbourg et son professorat de Glasgow, le philosophe
cossais avait prpar simultanment les lments dun ensemble de travaux par
lesquels il se proposait de faire connatre le dveloppement scientifique de l'esprit
humain, au moyen de l'histoire du langage, de l'histoire de la science et de
lhistoire des arts, se rservant de suivre plus tard, dans son Trait du Droit et ses
Recherches sur la Richesse des Nations, la marche des socits humaines, grce
aux autres manifestations de la civilisation, telles que les institutions politiques et
sociales. Il avait commenc l'excution de ce plan dans le fameux cours de
rhtorique et de belles-lettres qu'il avait inaugur Edimbourg et dont il avait
continu l'exposition dans sa chaire de logique. Mais, nous l'avons dit, le manuscrit
de ces leons fut dtruit, de mme que la plupart de ses autres essais, et, en dehors
de la Thorie des sentiments moraux et de la Richesse des Nations, il ne nous reste,
comme tmoins des diffrents aspects de cette vaste entreprise, que quelques
tudes incompltes, pargnes par l'auteur, on ne sait pour quel motif, et deux
dissertations peu prs entires : les Considrations sur la formation des langues
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
95
et l'Histoire de l'Astronomie jusqu'au temps de Descartes. Adam Smith ne publia
lui-mme que la premire de ces tudes : c'est d'ailleurs la plus remarquable.
Quelle est l'origine de la parole ? Sous quelle forme a-t-elle apparu ? Comment
s'est diversifie la multitude des langues et des idiomes ? Ces questions
fondamentales avaient frapp le jeune professeur ds ses dbuts dans la
philosophie, et, grce la vivacit de son imagination, une vaste rudition et
une vritable puissance d'observation, il arriva, malgr l'tendue de ses recherches,
un rsultat vraiment remarquable pour son poque. Nanmoins, nous
n'insisterons pas sur cet ouvrage, dont l'intrt a beaucoup diminu depuis les
dcouvertes modernes de la linguistique ; nous n'en dirons que quelques mots pour
faire connatre, sous toutes ses faces, le gnie de l'auteur et montrer comment il
embrassait la fois l'tude de toutes les manifestations de l'esprit humain.
Dans ces Considrations, Smith met en prsence deux sauvages ne sachant pas
parler et levs jusque-l dans un isolement complet, puis il discute la manire
dont ces deux hommes doivent s'y prendre pour se faire entendre. Ils assignent
d'abord un nom particulier aux objets qui leur sont les plus familiers, gnralisent
ensuite l'emploi de ces termes en les appliquant d'autres objets qui ont avec les
premiers une certaine ressemblance, forment ainsi les genres et les espces ; puis,
arrivant mme distinguer entre eux les objets d'une mme espce, ils crent deux
autres genres de mots, dont les uns expriment les qualits et les autres les rapports.
Mais cette invention des adjectifs et des prpositions demandant une grande
gnralisation et une abstraction considrable, les progrs du langage deviennent
alors plus difficiles et plus lents.
Smith constate partout, en effet, la difficult de former, l'origine des langues,
des termes abstraits et gnraux. Cette difficult est dj relle pour les adjectifs,
car les premiers hommes, par exemple, qui ont invent les mots vert, bleu, rouge,
et les autres noms des couleurs, ont eu besoin, dit-il, pour les trouver, d'observer et
de comparer ensemble un grand nombre d'objets, de saisir leurs ressemblances et
leurs dissemblances par rapport la qualit nomme couleur, de les ranger dans
leur esprit en diffrentes classes selon ces ressemblances et ces dissemblances. Un
adjectif est, par sa nature, un mot gnral, et, en quelque sorte, abstrait ; il suppose
ncessairement l'ide d'un certain genre ou d'une certaine collection de choses
chacune desquelles il est galement applicable.
Mais, si l'invention des adjectifs prsentait beaucoup d'obstacles celle des
prpositions en offrait encore davantage. En effet, un rapport est en lui-mme plus
mtaphysique qu'une qualit, et personne n'est embarrass de dire ce que c'est
qu'une qualit, tandis que peu de gens sont capables, au contraire, d'exprimer
clairement ce qu'ils entendent par un rapport, car les qualits, dit l'auteur, sont
presque toujours saisissables par nos sens extrieurs et les rapports ne le sont
jamais. Aussi, si, au dbut, les hommes paraissent avoir, pendant quelque temps,
vit la ncessit des adjectifs en variant la terminaison des noms des substances,
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
96
selon qu'elles taient elles-mmes varies par leurs plus importantes qualits, ils
ont cherch, plus forte raison, viter l'invention plus difficile des prpositions ;
c'est l l'origine des diffrents cas dans les langues anciennes o ils ont pour but
d'exprimer le rapport qui existe entre l'objet du nom substantif et l'objet d'un autre
mot compris dans la mme phrase. Cette invention des cas tait bien plus simple
que celle des prpositions. Il ne faut, en effet, aucun effort dabstraction pour
exprimer ainsi un rapport ; le rapport n'est pas exprim par un mot particulier qui
n'indique pas autre chose, mais par une variation dans le mot corrlatif, et encore
le rapport est alors exprim analogiquement ce qu'il nous parat tre dans la
nature, c'est--dire non comme quelque chose de spar et de dtach des objets
corrlatifs, mais comme quelque chose de joint eux et d'identique avec leur
existence.
Plus encore que les prpositions, les mots exprimant les nombres ont t trs
lents apparatre. Le nombre, envisag en lui-mme, sans aucun rapport avec une
espce particulire d'objets considrs en nombre, est, selon Smith, l'ide la plus
abstraite et la plus mtaphysique que l'esprit humain soit capable de se former, et,
par consquent, elle ne peut tre une de celles que les hommes se sont faites au
dbut des socits, poque d'ignorance et de barbarie. Ceux-ci devaient donc
naturellement distinguer la manire dont ils parlaient d'une multitude d'objets, de
la manire dont ils parlaient d'un seul, non par un adjectif pour ainsi dire
mtaphysique, mais par une variation dans la terminaison des mots qui exprimaient
les objets nombrs. De l l'origine du singulier, du pluriel, et quelquefois mme du
duel dans les langues anciennes.
Enfin les pronoms durent tre invents les derniers, et Smith fait remarquer,
l'appui de son hypothse, que ce sont en effet les derniers mots dont les enfants
apprennent faire usage. De mme que les hommes paraissent avoir vit d'abord
l'invention des prpositions et avoir exprim, par la variation des termes
corrlatifs, les rapports qu'elles dsignent maintenant, de mme ils ont d aussi
luder longtemps la ncessit de crer les pronoms, en variant la terminaison du
verbe selon que le fait exprim tait affirm de la premire, de la seconde ou de la
troisime personne. Del l'origine des conjugaisons.
Telle tait donc la tendance naturelle de l'esprit humain et tel dut tre le
dveloppement logique du langage chez les nations primitives. La rvolution qui
s'y opra fut l'effet du mlange des peuples. Les langues, dit Adam Smith,
seraient probablement restes telles dans tous les pays et ne seraient jamais
devenues plus simples dans leurs conjugaisons et leurs dclinaisons, si elles
n'taient devenues plus compltes dans leur composition, par l'effet du mlange
occasionn par celui des nations elles-mmes. Tant qu'une langue fut parle
seulement par ceux qui l'avaient apprise dans leur enfance, la complication de ses
conjugaisons et de ses dclinaisons ne pouvait les embarrasser beaucoup ; ils
l'avaient apprise dans un ge si tendre et d'une manire si lente, tellement
successive, que les difficults qu'elle pouvait avoir leur taient peine sensibles.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
97
Mais quand deux nations furent mles ensemble par la conqute ou par
l'migration, il n'en fut pas de mme ; chacune d'elles, pour se faire entendre par
l'autre, fut oblige d'en apprendre la langue. La plupart des individus apprenant la
langue nouvelle, non par art et par principe, mais par conversation et par routine,
ils furent extrmement embarrasss par la complication des conjugaisons et des
dclinaisons. Pour remdier cette ignorance, ils saisirent toutes les ressources que
la mme langue pouvait leur fournir. Ils supplrent ainsi aux dclinaisons, qu'ils
ne savaient pas, par l'usage des prpositions ; et un Lombard, qui essayait de parler
latin et qui avait besoin de dire que tel homme tait citoyen de Rome ou
bienfaiteur de Rome, s'il n'tait pas accoutum au gnitif et au datif du mot Roma,
s'expliquait naturellement en plaant les prpositions ad et de avant le nominatif,
et, au lieu de dire Rom, il disait ad Roma et de Roma... Ce changement est une
simplification de principes dans la langue : il mit, la place d'une grande varit
de dclinaisons, une dclinaison universelle qui est la mme pour chaque mot,
quels que soient le genre, le nombre ou la terminaison. l'aide d'un moyen
semblable, les hommes purent, la mme poque du langage, se dbarrasser de la
complication de leurs conjugaisons. Il y a, dans chaque langue, un verbe connu par
le nom de verbe substantif, en latin sum, en anglais I am, je suis. Ce verbe dsigne,
non un vnement particulier, mais existence en gnral. Il est, par cette raison, le
plus abstrait, le plus mtaphysique de tous les verbes, et, par consquent, n'a pas
d tre un mot d'invention premire. Lorsqu'il fut imagin cependant, il avait tous
les temps et tous les modes des autres verbes ; tant joint au participe passif, il
pouvait tenir la place de toutes les modifications de la voix passive et rendre cette
partie de leurs conjugaisons aussi simple et aussi uniforme que leurs dclinaisons
l'taient devenues par l'usage des prpositions. Un Lombard qui avait besoin de
dire I am loved (Je suis aim), mais qui ne pouvait se ressouvenir du mot amor,
supplait son ignorance en disant : ego sum amatus. Io sono amato est
maintenant l'expression italienne qui correspond la phrase anglaise ci-dessus.
Smith fait la mme remarque pour le verbe possessif habeo (I have, j'ai), qui, joint
au participe passif, peut tenir lieu gnralement du temps actif comme le verbe
substantif peut tenir lieu du passif.
C'est ainsi, conclut-il, que les langues devinrent plus simples dans leurs
principes et dans leurs rudiments, mesure qu'elles devinrent plus compliques
dans leur composition ; et il en fut, pour ainsi dire, comme des diverses machines.
Celles-ci sont toujours, au moment de leur invention, extrmement compliques, et
chacun des mouvements qu'elles doivent produire a souvent un principe particulier
d'action ; bientt ceux qui peuvent les amliorer observent qu'un seul de ces
principes peut tre appliqu plusieurs mouvements, et ainsi la machine devient
plus simple et produit ses effets, toujours avec moins de roues et moins de ressorts.
De mme, dans les langues, chaque cas de chaque nom, et chaque temps de chaque
verbe taient originellement exprims par un mot distinct qui servait cette fin et
aucune autre ; mais peu peu l'observation dcouvrit qu'une certaine suite de mots
tait capable de tenir la place de cette infinit de nombres, et que quatre ou cinq
prpositions et six verbes auxiliaires pouvaient tenir lieu de toutes les dclinaisons
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
98
et de toutes les conjugaisons des langues anciennes. Cependant il estime que la
comparaison ne peut pas tre continue jusqu'au bout et que les effets de ces
modifications sont diffrents dans les deux cas. Tandis que la simplification des
machines rend celles-ci de plus en plus parfaites, la simplification des langues les a
rendues, au contraire, de plus en plus imparfaites et de moins en moins propres
remplir leur fonction ; elle leur a enlev leur concision, leur harmonie et aussi leur
lgance, en obligeant placer les mots des endroits dtermins, et en
supprimant ainsi ces inversions gracieuses qui donnaient tant de beaut et tant
d'expression aux langues anciennes. Tel est le plan de cette petite tude.
Assurment elle a t bien dpasse de nos jours, elle a bien vieilli, mais on peut
dire que si elle a perdu de sa valeur depuis les progrs de la science, elle n'a rien
perdu de son charme et que le lecteur qui prend la peine de s'y arrter est frapp de
la vraisemblance des hypothses, de l'originalit des dductions et surtout de la
finesse des aperus.
4. Essais philosophiques
Retour la table des matires
L'Histoire de l'Astronomie, laquelle nous avons fait allusion plus haut, ne
parut qu'aprs la mort de Smith. Elle fut publie par les soins des excuteurs
testamentaires de l'auteur, le Dr Black et le Dr Hutton, en mme temps que les
autres fragments que le philosophe cossais avait consenti pargner.
Ces diffrents crits posthumes furent tous runis sous le titr unique d'Essais
philosophiques. L'auteur de ces Essais, disent les diteurs dans leur prface 1 , les
a laisss entre les mains de ses amis pour en disposer comme ils le jugeraient
convenable, et, peu avant sa mort, il dtruisit plusieurs autres manuscrits dont il ne
crut pas propos de permettre la publication. En examinant ceux qu'il a conservs,
on reconnut que c'taient des fragments d'un ouvrage, dont il avait conu le plan et
qui devait offrir une histoire lie des sciences et des arts libraux. Il avait
abandonn ds longtemps l'excution d'un projet si vaste, et ces fragments, mis
part, furent ngligs jusqu sa mort.
Ces Essais avaient tous, en somme, le mme objet, l'tude du dveloppement
de l'esprit humain. Dans sa dissertation sur les Sens externes, il exposait l'action de
la perception externe sur la formation des ides, dans son trait sur les Arts
imitatifs, il recherchait le dveloppement de l'ide de beaut aux divers ges, au
moyen des manifestations des arts libraux ; enfin, dans l'Histoire de lAstronomie,
l'Histoire de la Physique ancienne, l'Histoire de la Logique et de la Mtaphysique
des Anciens, il se proposait de montrer les principes qui ont dirig la marche de
l'esprit de l'homme dans les diffrentes parties de la science. Par cet ensemble de
travaux, qui rentraient d'ailleurs directement dans le plan de son Histoire de la
1
Essais phi1osophiquee, traduction P. Prevost.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
99
Civilisation, Smith voulait, en outre, combler une lacune signale par Bacon qui
avait tent vainement d'attirer l'attention des philosophes de son temps sur
l'importance des documents que pourrait fournir une tude consciencieuse de
lhistoire des sciences et des arts. L'histoire, avait dit en effet l'minent fondateur
de la philosophie moderne 1 , est naturelle, civile, ecclsiastique ou littraire.
J'avoue que les trois premires parties existent, mais je note la quatrime comme
nous manquant tout fait, car aucun homme ne s'est encore propos de faire
l'inventaire de la science, aucun n'a dcrit ni reprsent ce qu'elle fut de sicle en
sicle, tandis que beaucoup l'ont fait pour l'histoire naturelle, l'histoire civile et
l'histoire ecclsiastique. Cependant, sans cette quatrime partie, l'histoire du
monde me parait tre comme la statue de Polyphme, qui n'avait qu'un il ; et
pourtant c'est elle qui nous fait le mieux connatre l'esprit et le caractre de
l'homme. Toutefois, je n'ignore pas que, dans diverses branches de la science,
telles que la jurisprudence, les mathmatiques, la rhtorique et la philosophie, il
nous reste encore quelques notions incompltes sur les coles, les livres et les
auteurs, et quelques rcits striles sur les murs et l'invention des arts. Mais, quant
une histoire exacte de la science, contenant l'antiquit et l'origine des
connaissances, leurs sectes, leurs dcouvertes, leurs traditions, leurs diffrentes
administrations et leurs dveloppements, leurs dbats, leur dcadence, leur
oppression, leur abandon et leurs changements, ainsi que les causes prochaines et
loignes de ceux-ci, et tous les autres vnements relatifs la science depuis les
premiers sicles du monde, je puis hardiment affirmer que ce travail manque. Un
pareil travail n'aurait pas seulement pour objet et pour utilit de satisfaire la
curiosit des amis de la science ; mais il offrirait un but plus grave et plus srieux,
qui serait, pour le dire en peu de mots, de rendre les savants prudents dans l'usage
et l'administration de la science. Aucun auteur, avant Smith, n'avait encore
abord ce genre de recherches ; cette tude avait sembl trop ingrate, parce qu'on
n'en avait pas suffisamment compris la porte, et les philosophes taient plutt
tents d'tablir des hypothses et de fonder eux-mmes des systmes que d'tudier
ceux qui avaient t imagins avant eux. Les matriaux ncessaires pour cette
histoire taient donc rests trop dissmins, et, pour les recueillir, les coordonner,
pour composer une histoire complte des coles dans les diffrentes branches de la
philosophie, il et fallu la vie d'un homme. Aussi Adam Smith fut oblig de bonne
heure de sacrifier cette partie de son plan pour s'adonner plus exclusivement ses
recherches soit sur la morale, soit sur la formation de la richesse, et ses premiers
Essais sur l'histoire des systmes restrent, comme son Trait du Droit, l'tat de
fragments gnralement fort incomplets : une partie seulement de ces tudes
trouva sa place, la suite de la Thorie des Sentiments moraux, dans son rapide
aperu des doctrines de philosophie morale.
Toutefois, au moment de sa mort, Smith fut plus indulgent pour ces premires
tentatives de sa jeunesse que pour ses autres uvres. Il ne fit dtruire, d'ailleurs,
que ceux de ses manuscrits qu'il trouvait infrieurs aux travaux existants sur la
1
De augmentis scientiarum, lib. II.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
100
matire : c'est ainsi qu'il anantit son Trait sur la Rhtorique parce qu'il aurait eu
besoin de le remanier totalement pour l'lever la hauteur de l'uvre savante
d'Hugh Blair, et aussi son Trait du Droit, parce qu'il ne le jugeait pas digne d'tre
rapproch de l'Esprit des Lois. Mais, en ce qui concerne ses Essais philosophiques,
il tait le seul auteur qui et tent jusqu'alors d'crire l'histoire des systmes ; il
n'avait donc pas le mme motif pour les dtruire, et il jugeait au contraire que, par
la manire dont il avait compris son sujet, ces travaux pourraient tre de quelque
utilit aux philosophes futurs qui continueraient ses recherches.
L'Histoire de l'Astronomie est assurment la plus intressante de ces tudes, et,
bien que Smith n'ait pas tard reconnatre comme il le dit lui-mme 1 , qu'il y a
dans quelques parties de cet crit plus d'art que de solidit , elle mrite d'tre
analyse. Ici, toutes les ides sont personnelles l'auteur ; son esprit n'a pas, subi
l'influence de travaux antrieurs ; toutes les hypothses sont le fruit de son
imagination, et tous les documents sont le rsultat d'une rudition gnrale et
d'observations particulires. Il y a donc un grand intrt, pour le biographe surtout,
parcourir cet Essai spontan du philosophe au dbut de sa carrire.
L'histoire proprement dite de l'astronomie n'occupe qu'une faible partie de
l'ouvrage : au surplus, elle s'arrte Descartes. Mais la partie la plus importante
consiste en ralit dans les trois premires sections, o l'auteur recherche les
origines mmes de la philosophie dans les effets de la surprise sur la formation de
nos ides et sur la marche de l'esprit humain. Cette tude est fort curieuse, et,
malgr les limites restreintes de ce mmoire, il est ncessaire d'en faire connatre le
caractre.
Adam Smith avait remarqu que l'esprit prend plaisir rechercher et observer
les ressemblances entre les diffrents objets. C'est par de telles observations, selon
lui, qu'il s'efforce de combiner ses ides, d'y mettre de la mthode, de les rduire
en classes, d'en faire des groupements convenables, et c'est l l'origine de ces
assortiments d'objets et d'ides qu'on nomme genres et espces. Plus nous faisons
de progrs dans la science, plus nous augmentons le nombre des divisions et
subdivisions, parce que nous apercevons une plus grande varit de diffrences
entre les objets qui avaient t d'abord runis dans une seule classe d'aprs leur
premire ressemblance.
Nous voulons toujours, en effet, rapporter chaque objet l'une de ces
subdivisions. Mais, lorsqu'il se prsente nous quelque chose de tout fait
nouveau, et que nous nous sentons incapables de faire ce rapprochement, lorsque
cet objet se refuse en un mot toute classification, nous prouvons de
l'tonnement ; cet tonnement nous pousse rechercher les causes des phnomnes
qui nous embarrassent, il nous force leur donner au moins une explication
plausible de nature satisfaire notre esprit : c'est l l'origine de la philosophie.
1
Voir Ire Partie, p. 68.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
101
Lorsque les objets se succdent, dit Smith, selon le mme ordre que les ides de
l'imagination, lorsqu'ils suivent la marche que ces ides tendent prendre d'ellesmmes et sans le secours des impressions sensibles, ces objets nous paraissent
troitement lis entre eux, et la pense glisse aisment le long de cette chane unie
sans effort et sans interruption. Mais si cette liaison ordinaire est interrompue, si
un ou plusieurs objets s'offrent nous dans un ordre tout fait diffrent de celui
auquel notre imagination est accoutume et pour lequel elle est prpare, on
prouve un sentiment tout fait contraire. Au premier aspect, cette apparence
nouvelle et inattendue excite notre surprise, et, aprs ce premier mouvement, nous
nous tonnons qu'un tel phnomne ait pu avoir lieu. L'imagination n'a plus la
mme facilit passer d'un vnement celui qui le suit ; c'est un ordre ou une loi
de succession dont elle n'a point l'habitude et auquel, en consquence, elle ne se
conforme qu'avec peine ; elle se trouve arrte et interrompue dans le mouvement
naturel qu'elle se disposait suivre. Ces deux vnements spars par un
intervalle, elle cherche les rapprocher, mais ils s'y refusent ; elle sent ou croit
sentir une espce de brche ou d'abme, elle hsite et s'arrte sur les bords ; elle
voudrait le combler ou le franchir, jeter un pont, pratiquer un passage qui permit
d'aller d'une ide l'autre d'un mouvement doux et naturel. Le seul moyen qu'elle
trouve pour cela, le seul passage, le seul pont par lequel limagination puisse
assurer sa marche d'un objet l'autre et la rendre douce et facile, consiste
supposer que ces deux apparences incohrentes sont unies par une chane invisible
d'vnements intermdiaires et que la suite de ces vnements est analogue celle
selon laquelle nos ides ont coutume de se mouvoir. Ainsi quand nous observons
le mouvement du fer en consquence de celui de l'aimant, nous fixons nos regards,
nous hsitons, nous sentons un dfaut de liaison entre deux vnements qui se
suivent d'une manire si inusite ; mais aussitt qu'avec Descartes nous avons
imagin certaines manations invisibles qui circulent autour de l'un de ces corps et
forcent l'autre s'en approcher et le suivre, nous avons combl l'abme qui
sparait les deux phnomnes, nous avons jet un pont pour les unir, et nous avons
ainsi fait disparatre ce sentiment d'hsitation et de peine qu'prouvait l'imagination
chaque fois qu'elle voulait aller de l'un l'autre. Cette hypothse, une fois admise,
nous fait envisager le mouvement du fer qui suit l'aimant, comme tant en quelque
sorte conforme au cours ordinaire des choses.
Il en rsulte donc que la philosophie est un besoin de lesprit humain, conduit
naturellement rechercher les moyens d'expliquer les phnomnes qui frappent les
sens. Elle est, dit Smith, la science des principes de la liaison des choses. La
nature, aprs que nous avons acquis toute l'exprience qui est notre porte,
abonde encore en phnomnes qui semblent solitaires et ne se lient point ce qui
prcde et qui par l mme troublent le mouvement ais de l'imagination ; ils
forcent les ides se succder, pour ainsi dire, par sauts irrguliers ; ils tendent
donc y jeter la confusion et le dsordre. La philosophie, en exposant les chanes
invisibles qui lient tous ces objets isols, s'efforce de mettre l'ordre dans ce chaos
d'apparences discordantes, d'apaiser le tumulte de l'imagination, et de lui rendre, en
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
102
s'occupant des grandes rvolutions de l'univers, ce calme et cette tranquillit qui lui
plaisent et qui sont assortis sa nature.
Aussi, l'histoire gnrale de la philosophie semble tre l'auteur le meilleur
moyen qui soit en notre possession pour suivre la marche de l'esprit humain. En
effet, poursuit-il, on peut envisager la philosophie comme un de ces arts qui
s'adressent l'imagination et dont, par cette raison, l'histoire et la thorie se
trouvent comprises dans l'enceinte de notre sujet. Tchons d'en suivre le cours,
depuis sa premire origine jusqu' ce haut degr de perfection qu'elle a atteint de
nos jours et qu' la vrit chaque sicle son tour a cru, comme nous, avoir atteint.
C'est, de tous les beaux-arts, le plus sublime, et ses rvolutions ont t les plus
grandes, les plus frquentes, les plus remarquables de toutes celles qui ont eu lieu
dans le monde littraire. Par toutes ces raisons, son histoire doit tre la plus
intressante et la plus instructive. Examinons donc tous les diffrents systmes de
la nature qui, dans notre Occident (seule partie du globe dont l'histoire nous soit un
peu connue), ont successivement t adopts par les hommes savants et ingnieux.
Sans nous arrter juger de leur absurdit ou de leur probabilit, de leur accord ou
de leur disconvenance avec la vrit et la ralit, considrons-les seulement sous le
point de vue particulier qui appartient notre sujet, et contentons-nous de
rechercher comment chacun d'eux tait propre faciliter la marche de
l'imagination et faire, du thtre de la nature, un spectacle plus li et par l mme
plus magnifique. Selon qu'ils y ont plus ou moins russi, ils ont aussi plus ou
moins russi illustrer leurs auteurs : c'est le fil qui nous dirigera le mieux dans le
labyrinthe de cette histoire, car il servira la fois jeter du jour sur le pass et sur
l'avenir et il nous conduira cette consquence gnrale qu'aucun systme,
quelque bien tabli qu'il ait pu tre d'ailleurs, n'a jamais t accueilli, n'a jamais
obtenu l'assentiment gnral, lorsque les principes de liaison qu'il employait
n'taient pas familiers aux hommes auxquels il tait offert.
Ce dessein de suivre le dveloppement de l'esprit humain au moyen de
l'histoire gnrale de la philosophie, tait trs heureux et il aurait t trs fcond
dans ses consquences pour clairer l'Histoire de la civilisation qu'Adam Smith
avait en vue, car les phnomnes de la nature, qui frappent l'imagination et la
surprennent, ont t en ralit un puissant stimulant du dveloppement de l'esprit
en le forant chercher la raison des choses.
Malheureusement, nous l'avons dj dit, ce plan tait trop vaste, et, ne pouvant
en embrasser compltement chacune des parties, Adam Smith dut abandonner
bientt celle qui avait trait l'histoire des systmes, laissant cet gard ses tudes
inacheves. Mais le point de vue auquel il s'tait plac mritait d'tre repris et
dvelopp, et Thomas Buckle, l'un des rares philosophes qui aient tudi
consciencieusement les Essais de Smith, n'a pas manqu de tirer parti de cette ide
fconde pour son Histoire de la Civilisation. Nous ne pouvons, ce sujet, rsister
au dsir de rapprocher de l'Essai de Smith, le passage, suivant du livre de Buckle ;
bien que nous n'acceptions pas toutes les consquences de la thorie qui y est
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
103
dveloppe, nous devons reconnatre qu'il y a rellement une large part de vrit
dans l'hypothse qui y est mise, et nous croyons que c'est Smith qu'il faut
reporter l'honneur d'avoir mis le premier en lumire cette influence de l'imprvu et
de la surprise sur la marche de l'entendement. De mme que nous avons vu, dit
en effet Buckle 1 , l'influence du climat, de la nourriture et du sol sur l'accumulation
et sur la distribution de la richesse, de mme allons-nous voir la part que prennent
les aspects de la nature dans l'accumulation et dans la distribution de la pense...
Les aspects de la nature, considrs ce point de vue, peuvent se diviser en deux
classes : la premire classe se compose de ceux qui sont le plus propres exciter
l'imagination ; la seconde, de ceux qui s'adressent ce que l'on appelle
communment l'entendement, c'est--dire aux simples oprations logiques de
l'intellect... Or, en ce qui concerne les phnomnes naturels, il est vident que tout
ce qui inspire des sentiments de terreur ou de grand tonnement, que tout ce qui
excite dans l'esprit du vague et de l'irrsistible, a une tendance particulire
enflammer l'imagination et amener, sous son empire, les oprations plus lentes et
plus rflchies de l'entendement. Dans ces circonstances, l'homme se mettant luimme en contraste avec la force et la majest de la nature, prouve d'une faon
pnible la conscience de sa propre insignifiance. Un sentiment d'infriorit
s'empare de lui. Son esprit, pouvant devant l'indfini et devant l'indfinissable,
cherche peine scruter les dtails qui composent cette imposante grandeur. D'un
autre ct, l o les uvres de la nature sont mesquines et faibles, l'homme
reprend confiance, il semble qu'il soit plus capable de compter sur sa propre force ;
il peut, pour ainsi dire, passer outre et faire preuve d'autorit dans toutes les
directions. Plus les phnomnes sont accessibles, plus il lui devient facile de les
exprimenter ou de les observer minutieusement ; ses dispositions naturelles pour
l'investigation et l'analyse se trouvent encourages, il est tent de gnraliser les
aspects de la nature et de les relier aux lois qui les gouvernent. Si l'on examine de
cette manire l'esprit humain sous cette influence des aspects de la nature, c'est
srement un fait remarquable que, toutes les grandes civilisations primitives ont
t situes prs des tropiques o ces aspects ont le caractre le plus sublime et le
plus terrible, et o la nature entoure l'homme, sous tous les rapports, des plus
grands dangers.... Les uvres de la nature, ajoute-t-il plus loin 2 , qui, dans l'Inde,
sont d'un grandiose effrayant, sont, en Grce, bien plus petites, plus faibles et sous
tous les rapports moins menaantes pour l'homme Ces diffrences frappantes
dans les phnomnes matriels des deux contres ont donn lieu des diffrences
correspondantes dans leurs associations intellectuelles... Dans l'Inde, il y avait des
obstacles de tout genre si nombreux, si effrayants, et en apparence si inexplicables,
que les difficults de l'existence ne pouvaient se rsoudre que par un appel
constant l'agence directe de causes surnaturelles. Ces causes tant au del de la
porte de l'intelligence, les ressources de l'imagination taient continuellement
mises en jeu pour essayer de les tudier : l'imagination elle-mme se fatiguait au
del de ses forces, son activit devenait dangereuse, elle empitait sur l'intelligence
et l'quilibre gnral tait dtruit. En Grce, les circonstances tant diffrentes,
1
2
Hist. de la Civilisation, traduction Baillot, I, p. 137.
Hist. de la Civilisation, I, p. 159.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
104
amenrent des rsultats tout contraires. En Grce, la nature tait moins dangereuse,
moins importune, moins mystrieuse que dans l'Inde. Aussi, l'esprit humain y tait
moins pouvant, moins superstitieux ; on commena tudier les causes
naturelles ; pour la premire fois, la science physique devint possible, et l'homme,
ralisant peu peu le sentiment de sa propre puissance, chercha tudier les
vnements avec une hardiesse impossible dans ces autres contres o la pression
de la nature troublait son indpendance et suggrait des ides incompatibles avec
les lumires.
Ainsi, d'aprs Buckle, c'est l'imagination qui domine dans les civilisations
tropicales ; dans les civilisations europennes, c'est l'entendement. Smith n'avait
pas fait cette distinction : les documents manquaient d'ailleurs, son poque, sur
l'histoire des peuples orientaux, comme il l'a fait remarquer dans l'un des extraits
que nous avons cits, et il ne pouvait prtendre qu' crire une histoire de la
civilisation europenne, dans laquelle il voyait, comme Buckle aprs lui,
l'empitement continu de l'esprit humain sur le monde extrieur.
Mais, pour une histoire de la civilisation europenne, le point de vue du
philosophe de Glasgow tait parfaitement juste ; il n'a pas t condamn, et, si
Buckle remarque que, dans les civilisations tropicales, c'est l'histoire de la nature
qu'il faut suivre pour crire l'histoire du dveloppement de l'esprit humain, il
constate aussi que, pour l'histoire de nos civilisations, c'est la marche de l'esprit
qu'il faut tudier directement. En considrant en son entier l'histoire du monde,
dit Buckle 1 , la tendance a t, en Europe, de subordonner la nature l'homme ;
hors d'Europe, de subordonner l'homme la nature. Il y a plusieurs exceptions ce
principe dans les pays barbares, mais dans les pays civiliss, la rgle a t
universelle. Donc la grande division de la civilisation en europenne et en noneuropenne est la base de la philosophie de l'histoire, puisqu'elle nous suggre
cette importante considration que, si nous voulons comprendre, par exemple,
l'histoire de l'Inde, nous devons d'abord nous attacher l'tude du monde extrieur,
parce qu'il a eu plus d'action sur l'homme que l'homme n'en a eu sur lui. Si, d'un
autre ct, nous voulons comprendre l'histoire d'un pays tel que la France et
l'Angleterre, l'homme doit tre notre principal sujet d'tude, parce que la nature
tant comparativement plus faible, chaque pas vers le grand progrs a augment la
domination de l'esprit humain sur les influences du monde extrieur.
C'est pour ce motif que Smith cherchait suivre le dveloppement de l'esprit de
l'homme dans ses plus hautes manifestations, c'est--dire dans l'histoire des
systmes qu'il a successivement imagins pour expliquer la liaison des choses. Il
fait remarquer d'abord que la philosophie n'apparut pas ds l'origine des socits.
Avant de se livrer ces recherches leves, il fallait que les hommes eussent
acquis la scurit et la certitude du lendemain ; il tait ncessaire, en outre, qu'il y
et dj une certaine accumulation de richesses qui permit quelques-uns de
1
Hist. de la Civilisation, I, p. 171.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
105
trouver des loisirs. Ce n'est qu' cette poque que l'homme devint plus attentif aux
apparences de la nature, plus observateur de ses irrgularits, plus dsireux de
connatre la chane qui leur sert de lien. La crainte superstitieuse que lui inspiraient
les phnomnes naturels s'attnua peu peu, la curiosit commena s'veiller, et
c'est ainsi que les colonies grecques, qui arrivrent les premires la scurit,
donnrent naissance aux premiers philosophes.
Or, de tous les phnomnes de la nature, ceux qui devaient, frapper au plus
haut degr l'imagination de l'homme par leur grandeur et leur beaut, taient
assurment les rvolutions des corps clestes. Ce furent, en effet, les premiers
objets de la curiosit humaine, et la science qui se propose de les expliquer a d
tre ncessairement la premire branche de philosophie qu'on ait cultive : c'est
pourquoi Smith commena ses recherches par l'histoire de l'astronomie. Mais si
nous avons insist aussi longuement sur les prolgomnes de cette tude, nous ne
nous arrterons pas l'examen de l'tude elle-mme. Nous avons voulu montrer la
mthode employe ici par Smith et rendre sensibles les diverses parties de son
plan, mais nous ne dirons rien de l'histoire mme des systmes, qui est inacheve
et souvent peu digre. Les diteurs des Essais philosophiques ont tenu d'ailleurs
prvenir le lecteur qu'il doit considrer cet crit, non comme une histoire ou un
prcis de l'astronomie jusqu' Newton, mais plutt comme un nouvel exemple
propre jeter du jour sur les principes d'action qui existent dans l'esprit humain et
dans lesquels M. Smith trouvait les vrais motifs de toutes les recherches
philosophiques .
Nous dirons peu de chose aussi de l'Histoire de la physique ancienne. Aprs
s'tre occupe ranger et soumettre un ordre mthodique le systme du ciel, la
philosophie, selon Smith, descendit de cette hauteur pour contempler les parties
infrieures de la nature, la terre et les corps voisins qui l'entourent. Elle se trouva
alors en prsence d'une multitude de corps et de phnomnes divers. Dans le ciel,
elle n'avait eu considrer qu'un petit nombre d'espces, le soleil, la lune, les
plantes, les toiles. Sur la terre, elle avait tudier les phnomnes de l'air, les
nuages, l'clair, le tonnerre, les vents, la pluie, la neige, puis les minraux, les
plantes, enfin les animaux dont les espces sont si diverses. Si donc
l'imagination, dit lauteur 1 , en contemplant les apparences clestes, prouvait
souvent beaucoup de perplexit et se sentait brusquement carte de sa marche
naturelle, elle devait tre bien plus expose ce sentiment pnible lorsqu'elle
dirigeait son attention sur les objets terrestres et lorsqu'elle entreprenait de suivre
leurs progrs, de tracer leur marche et leurs rvolutions successives. Afin donc de
faire de cette scne infrieure du grand thtre de la nature un spectacle cohrent
aux yeux de l'imagination, il fallait supposer deux choses : premirement, que tous
les objets extraordinaires qu'on y remarque sont composs d'un petit nombre
d'autres objets avec lesquels l'esprit est bien familiaris ; secondement, que toutes
leurs qualits, leurs oprations, leurs lois de succession, ne sont que diverses
1
Hist. de la physique ancienne. (Essais, t. II, p. 4.)
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
106
modifications de celles auxquelles il est accoutum et qu'il a eu de frquentes
occasions d'observer dans des objets simples et lmentaires.
Or, de tous les corps qui nous environnent, ceux qui nous sont les plus
familiers sont assurment la terre, l'eau, l'air et le feu. Les premiers philosophes
furent donc tout naturellement ports chercher dans tous les autres quelque chose
qui leur ressemblt. La chaleur observe dans les plantes et les animaux semblait
dmontrer que le feu fait partie de leur composition. L'air n'est pas moins
ncessaire pour la subsistance de ces deux classes d'tres et parat aussi entrer dans
la structure des animaux par la respiration et dans celle des plantes par quelques
autres voies. Les sucs qui circulent dans leurs parties infrieures faisaient voir
combien l'eau tait employe dans toute leur texture ; et la putrfaction, qui les
rsout en terre, montrait assez que cet lment n'avait pas t omis dans leur
formation originelle. On vit donc, dans ces quatre corps, les lments de tous les
autres, et la curiosit humaine, dit le clbre philosophe, aspirant tout expliquer
avant de savoir bien expliquer un seul fait, se hta d'lever, sur un plan imaginaire,
l'difice entier de l'univers.
C'est par l'examen de ce systme que commence Adam Smith, mais nous
n'avons pas l'intention de parcourir les autres avec lui, d'autant plus que cette
tude, fort brve d'ailleurs, est loin d'tre complte. Nous avons voulu seulement
donner, par quelques extraits, une ide de cet crit, en montrant comment le
professeur de Glasgow apporte la clart dans cette histoire obscure des premiers
systmes, et avec quelle simplicit pleine de charmes il en expose les principes.
Nous passerons encore plus vite sur l'Histoire de la logique et de la
mtaphysique des anciens, qui contient l'expos des doctrines de Platon, d'Aristote
et des stociens, sur cette partie de la science. Cet essai est d'ailleurs trs court et
galement inachev. L'auteur y remarque notamment que, dans l'antiquit, avant
Aristote, on envisageait gnralement la logique et la mtaphysique comme une
seule et mme science et qu'on en avait fait cette ancienne dialectique dont on
parle tant, dit-il, et qu'on connat si peu 1
Tout en suivant l'histoire des diffrentes branches de la philosophie, Smith
avait galement entrepris de rechercher dans la marche des Arts imitatifs les
manifestations du dveloppement de l'esprit humain. Cet essai est assez long,
quoiqu'il n'ait pas t termin. Lauteur y examine l'origine et le caractre de la
peinture, de la musique, de la posie et de la danse ; il recherche quel est le mrite
des arts imitatifs, puis quelle est la cause de la faveur qui y a toujours t attache
et il la trouve dans le sentiment de la difficult vaincue.
C'est une tude fort curieuse ; mais, pour en donner une ide, il faudrait
examiner en dtail chacune des observations qui y sont contenues, et nous serions
1
Essais, II, 35.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
107
entran hors des limites de ce travail. Signalons ici toutefois une application
curieuse, mais peu exacte, de la doctrine de la sympathie. Smith voit partout l'effet
de cette affection : c'est dans la sympathie qu'il trouve le principe des sentiments
qui nous animent la vue d'un tableau, l'audition d'un morceau de musique et
jusque dans la danse. C'est ainsi qu'en peinture, dit-il, l'effet de l'expression nat
toujours de la pense de quelque chose dont le dessin et le coloris suggrent l'ide,
quoique tout fait diffrent du coloris et du dessin. Il dpend, tantt de la
sympathie, tantt de l'antipathie et de l'aversion que nous prouvons pour les
sentiments, les motions, les passions, dont la physionomie, l'action, l'air et
l'attitude des personnes reprsentes suggrent l'ide 1 .
En effet, pour le philosophe cossais, la peinture, la musique, la posie et la
danse sont des arts imitatifs. En reproduisant l'expression de certains sentiments,
ils suscitent notre sympathie comme si ces sentiments taient rels, et si la musique
instrumentale ne produit pas le mme effet, c'est qu'elle n'est pas imitative. La
musique instrumentale, dit Smith 2 , n'imite pas la tristesse ou la gaiet, comme le
fait la musique vocale, ou comme la peinture et la danse peuvent les imiter. Elle
n'exprime pas, comme elles, les circonstances d'un rcit d'une nature plaisante ou
triste. Ce n'est pas, comme dans ces trois arts, par sympathie avec la gaiet, la
tranquillit ou la tristesse de quelque autre personne, que la musique instrumentale
nous fait prouver ces diverses dispositions : elle devient elle-mme un objet gai,
tranquille ou triste, et l'esprit passe de lui-mme la disposition qui, dans ce
moment, correspond l'objet qui engage son attention. Ce que la musique
instrumentale nous fait prouver est un sentiment primitif et non sympathique ;
c'est notre gaiet, notre tranquillit, notre tristesse propres, et non la disposition
d'une autre personne qui se rflchit en nous.
Nous avons voulu signaler ce point de vue de l'auteur cause de son rapport
avec la Thorie des sentiments moraux, mais il n'est pas trs heureux et on doit
avouer que les hypothses de Smith sont gnralement plus ingnieuses. Toutefois,
bien que l'ensemble de cet essai nous ait paru infrieur en beaucoup de points
ceux que nous avons examins jusqu'alors, cet crit et les petits opuscules dont les
diteurs l'ont fait suivre, sont encore fort intressants en ce qu'ils tmoignent des
connaissances multiples et diverses du clbre philosophe. Nous le voyons ainsi
disserter avec aisance sur le principe et la mthode des compositions musicales,
sur les mrites compars des opras franais et des opras anglais, sur les vers
rims de l'cole franaise et les vers blancs en usage dans son pays, et nous
constatons avec une certaine satisfaction ses prfrences pour la versification
franaise et les productions thtrales qu'il avait admires durant son sjour en
France.
Enfin, les Essais philosophiques se terminent par un travail assez tendu sur les
Sens externes. C'est une tude des fonctions des sens externes plutt qu'une
1
2
Essais, II, 122.
Essais, II, 108.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
108
discussion mtaphysique de la formation des ides d'aprs la perception des sens ;
nous ny insisterons pas, d'autant plus qu'elle a peu de rapport avec l'ensemble de
l'uvre d'Adam Smith.
En rsum, dans tous ces Essais philosophiques, comme dans la Thorie des
sentiments moraux et les Considrations sur la formation des langues, on
remarque partout les traces de la mme mthode, que Smith parat avoir
exclusivement suivie, surtout dans la premire partie de sa vie, la mthode
dductive. Partout, il est vrai, on trouve une infinit de faits, une multitude
d'observations, mais ces faits ne sont pas l pour servir de base au raisonnement,
ils ne servent qu' vrifier et contrler les rsultats de la dduction. Dans ces
Essais, l'auteur ne commence pas par exposer les donnes de l'histoire pour en tirer
les lois gnrales qui rgissent le dveloppement de l'intellect humain ; ds le
dbut, au contraire, il pose les principes et il s'efforce ensuite de dmontrer que ces
principes devaient provoquer les progrs mmes que l'histoire a constats. En
d'autres termes, en partant des lois il cherche retrouver les effets, au lieu de partir
des faits pour remonter aux causes ; il cherche tracer la marche qu'ont d suivre
les dcouvertes de la science, au lieu d'indiquer d'abord ce qu'elles ont t. Ce
mode de raisonnement et d'exposition l'a conduit des hypothses quelquefois
tmraires, il est vrai, mais toujours originales, et la multitude d'observations
ingnieuses qu'il a groupes avec art pour les vrifier, ont donn un vritable
charme la lecture de ses crits. D'ailleurs, l'tendue et la varit de son savoir,
ainsi que le caractre consciencieux de ses uvres, ne sont pas aussi sans offrir un
grand attrait, Le style mme est gnralement trs soign : bien que diffus et
relch dans la Richesse des Nations o l'auteur tenait avant tout tre clair en
exposant les lments d'une science nouvelle, il est ici plus correct, souvent mme
lgant, et on pourrait peut-tre lui reprocher plutt une certaine redondance un
peu dclamatoire.
Aussi lit-on avec un vif intrt ces lments pars qui permettent de
reconstituer par la pense le plan de la premire partie de la grande uvre du
clbre philosophe. Dans cette premire partie, qui comprend la Thorie des
sentiments moraux et les Considrations sur les langues, aussi bien que les Essais
philosophiques, Smith s'tait propos d'tudier l'homme, de suivre lclosion et le
dveloppement de ses ides intellectuelles et morales. Dans la seconde partie, il
devait tudier la socit, les lois de son dveloppement et l'influence des
institutions positives sur la marche de la civilisation : tel devait tre le but du
Trait du Droit et de la Richesse des Nations.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
109
CHAPITRE III.
RECHERCHES SUR LA NATURE ET LES CAUSES
DE LA RICHESSE DES NATIONS.
________
Retour la table des matires
Lorsque Smith crivit, la Richesse des Nations, il avait dj renonc au projet
de publier une Histoire gnrale de la civilisation. La longueur des tudes
prparatoires qu'il avait d dj poursuivre, malgr les milieux minemment
favorables o il s'tait trouv, soit dans la ville commerante de Glasgow, soit
Paris dans la socit des conomistes, l'insuffisance des documents accumuls
jusque-l, l'absence de renseignements statistiques de quelque tendue, tous ces
obstacles lui avaient prouv surabondamment que, dans l'tat o se trouvait la
science, la vie entire du savant le plus consciencieux ne pouvait suffire une
pareille entreprise. Il prit donc le parti de borner le champ de ses travaux.
Abandonnant son dessein originaire, il classa les matriaux qu'il avait recueillis et
il se dcida composer successivement deux ouvrages distincts, l'un sur les lois de
la richesse, l'autre sur les principes de la jurisprudence ; puis, pour donner plus
d'unit chacun de ces lments de son plan primitif, il rsolut de substituer en
partie, dans ces deux traits, la forme didactique la forme historique, en se
rservant toutefois d'y introduire incidemment les principales des tudes
historiques qu'il avait prpares pour sa grande uvre. Mais, de ces deux ouvrages
auxquels Smith travailla dans sa solitude de Kirkaldy, un seul fut termin et put
tre publi : ce furent les Recherches sur la Richesse des Nations.
En se rappelant ainsi l'origine trange de ce livre clbre, on ne devra donc pas
s'tonner, comme l'ont fait un grand nombre de critiques des plus autoriss, de la
multitude des digressions que l'on rencontre toute occasion. Ces digressions ne
font pas partie, proprement parler, du corps mme de l'ouvrage : ce sont des
dbris de son uvre, des tudes compltes, souvent admirables, que l'auteur a
voulu sauver et qu'il a places, comme aprs coup, aux endroits qui lui ont sembl
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
110
s'y prter le plus facilement. Beaucoup de ces dissertations sont trs savantes et
fort remarquables, toutes sont trs consciencieuses, et elles mritent qu'on s'y
arrte. Toutefois, par leur nature mme, elles donnent au livre une certaine
lourdeur, et les commentateurs qui ne les ont pas considres sous le mme aspect
que nous, nont vu dans ces morceaux dtachs que des dfauts de rdaction ou
des vices de composition. C'est le cas des digressions clbres sur les variations de
la valeur des mtaux prcieux aux quatre derniers sicles, sur les banques de
circulation et le papier-monnaie, sur les banques de dpt, sur le commerce des
bls et la lgislation des crales.
Le plan d'Adam Smith est donc un plan particulier la nature mme de ses
tudes. Aussi, nous aurions dsir pouvoir le respecter ici dans tous ses dtails,
afin de nous pntrer du vritable caractre de cette uvre incomparable, et c'est
dans l'ordre mme o le clbre conomiste les a prsentes, avec ses digressions
historiques, ses incursions dans le domaine des autres sciences, que nous aurions
voulu exposer ces doctrines fondamentales qui ont fait l'admiration de la postrit
et la gloire de leur auteur. Malheureusement, il n'y faut point songer. Ce n'est pas
dans les limites, ncessairement restreintes, de ce travail, que nous pouvons tenter
de donner la physionomie exacte de ce livre considrable, si tendu et si vari,
dont le style et le plan charment toujours le lecteur, malgr leurs dfauts et par
leurs dfauts mmes, grce ce talent d'exposition persuasive que donnent Smith
l'amour de la vrit et la poursuite du bonheur du peuple, seconds par une
profonde connaissance de l'me humaine. Il faut lire l'ouvrage en entier pour s'en
rendre compte, et, en le lisant, il faut tre pntr de cette ide sur laquelle il
importe tant d'insister parce qu'elle claire singulirement la porte des recherches
de Smith, savoir que nous sommes en prsence d'un fragment remani d'une
Histoire gnrale de la civilisation.
Ce trait de la Richesse des Nations, qui a fond l'conomie politique, n'est pas,
proprement parler, un trait d'conomie politique ; il ne faut pas qu'on s'y
mprenne, et que, partant d'une fausse ide de son uvre, on vienne reprocher
l'illustre philosophe cossais d'avoir mal prsent ses ides, d'avoir choisi un plan
absurde et surtout d'avoir, au dbut mme de la science, amen une confusion
fcheuse dans les esprits, en juxtaposant dans son livre les doctrines de l'conomie
politique qui est une science, et les applications de la politique que l'on doit
considrer comme un art. En considrant sous cet aspect la suite des
dveloppements qui y sont prsents, on en saisira plus facilement toute la porte ;
on verra mieux l'enchanement des travaux de Smith, l'empreinte de son esprit
tendu, on sentira battre son cur ; on comprendra qu'il n'tudiait, pas seulement la
science pour la science, mais que son principal objet tait de contribuer, le plus
directement possible, au soulagement de l'humanit ; on s'expliquera alors tous ces
atermoiements, toutes ces concessions, qu'on a reprochs si souvent au matre
comme des contradictions, comme des dfauts de logique, qu'on ne doit pas
rencontrer en effet dans un trait d'conomie politique, mais qui trouvent
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
111
parfaitement leur place dans cet admirable fragment de l'Histoire de la Civilisation
que Smith avait rve.
Toutefois, nous devons nous borner ici exposer les plus importantes des
doctrines conomiques auxquelles Smith a donn son nom ou l'appoint de son
autorit ; nous serons mme forc d'abandonner l'ordre dans lequel elles sont
exposes, et de chercher leur donner, dans l'intrt des controverses qu'il y aura
lieu parfois de signaler et de discuter, un groupement plus scientifique.
De nos jours, on classe gnralement les lois et les phnomnes de la richesse
en quatre groupes, suivant qu'ils ont trait la production, la circulation, la
rpartition ou la consommation.
Cette classification n'a pas t faite par Smith et elle ne pouvait l'tre, car, d'une
part, elle suppose dj un certain degr d'abstraction qu'il n'est pas possible
d'atteindre l'origine mme de la science, et, d'autre part, cette division, trs utile
dans un trait didactique, n'aurait pu se prter une tude historique. L'ouvrage
d'Adam Smith exigeait un plan particulier, et voici, en quelques lignes, quelle en
est la charpente.
La richesse a pour origine le travail, et le travail crot en nergie par sa
division, en tendue par l'extension du march et le mode d'emploi des capitaux.
Or, sans entraves, le mode d'emploi le plus productif est l'agriculture, parce qu'elle
entretient, capital gal, une plus grande quantit de travail. Comment se fait-il
donc qu'elle ait t jusqu'alors si nglige et que la premire place, qui lui tait
due, appartienne maintenant au commerce ? C'est ce que l'histoire de la civilisation
doit nous apprendre, et c'est l le vritable objet de la Richesse des Nations. Les
deux premiers livres, qui contiennent l'expos et la dmonstration des principes et
qui ont fond l'conomie politique, ne sont gure que les prolgomnes ; tout le
reste de l'ouvrage est consacr l'histoire de la richesse et l'examen des causes
qui, aux diffrents sicles, ont eu pour effet de dtourner les capitaux des canaux
vers lesquels ils se dirigeaient naturellement au profit d'entreprises beaucoup
moins productives.
Tel est le cadre dans lequel viennent trouver place les diffrentes tudes
dAdam Smith. Nous devrons forcment en ngliger certaines parties, cependant
fort remarquables, qui sont plutt historiques qu'conomiques ; mais nous pensons
qu'en reprenant les divisions en usage dans l'tat actuel de la science, nous ferons
mieux ressortir la valeur permanente qu'ont conserve, mme notre poque, ces
doctrines fondamentales que Smith a mises en lumire et que le temps ni
l'exprience n'ont pu branler.
Nous les examinerons donc successivement dans les quatre sections suivantes :
Section
Ire.
Production des richesses.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
IIe.
Circulation des richesses.
IIIe.
Distribution et rpartition des richesses.
IVe .
Consommation des richesses.
112
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
113
Section premire
Production des richesses.
Retour la table des matires
Selon Smith, de mme que la loi morale est fonde sur la sympathie, la loi du
droit naturel sur la justice, ainsi la loi qui prside la formation des richesses a
pour principe le travail.
C'est l lide qui domine tout l'ouvrage et l'auteur la place au frontispice de
son livre : Le travail annuel d'une nation, crit-il, est le fonds primitif qui fournit
sa consommation annuelle toutes les choses ncessaires et commodes la vie, et
ces choses sont toujours, ou le produit immdiat de ce travail ou achetes des
autres nations avec ce produit. Toute la thorie d'Adam Smith est contenue dans
ces quatre lignes : c'est l que l'on doit chercher le vritable fondement de
l'conomie politique et c'est l'aspect qui donne cette science toute sa moralit.
vrai dire, cette ide fconde n'est pas due Smith, lui-mme : elle avait t
mise en substance par le clbre philosophe Locke dans son Essai sur le
Gouvernement ; elle avait t mme reprise, probablement l'insu de l'auteur
cossais, par l'abb de Condillac, qui, l'anne mme de la publication des
Recherches, en tirait dj des applications remarquables 1 , mais personne n'en avait
saisi toute l'importance comme le grand conomiste qui difia sur cette base une
science toute nouvelle.
Toutefois, bien qu'il et mis cette loi en pleine lumire, il aurait d faire plus
encore, et, non content de dmontrer que le travail est la source mme des
richesses, il aurait d remonter plus haut pour rechercher le principe mme du
travail. Il aurait constat ainsi que le travail n'est lui-mme qu'un effet, un
dveloppement de la puissance productive de l'homme, c'est--dire de l'esprit, et il
est assez tonnant qu'il ne se soit pas lev jusqu cette considration suprieure,
car il avait consacr toute la premire partie de sa vie l'tude de l'me humaine
dans ses diverses manifestations. Il aurait d remarquer que le vritable principe de
la valeur, le fonds primitif qui fournit toutes les choses ncessaires et commodes
la vie, est l'esprit, et que, suivant l'expression de V. Cousin, la richesse n'est autre
chose que le dveloppement rgulier de la force qui constitue l'homme. Ce point
1
Le Commerce et le Gouvernement, 1776. Toutes les richesses, disait Condillac, ne se
multiplient qu'en raison de notre travail. Nous devons toutes les productions au travail du
cultivateur, et nous devons au travail de l'artisan ou de l'artiste toutes les formes donnes aux
matires premires.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
114
de vue lev n'a peut-tre pas chapp, il est vrai, l'esprit philosophique d'Adam
Smith, mais il et t ncessaire qu'il le consignt et l'expost dans son livre : il et
ainsi vit ses successeurs et ses disciples bien des vues troites et des erreurs
regrettables, comme cette distinction malheureuse du travail productif et du travail
improductif.
Malgr cette rserve, la porte de la doctrine de Smith devait tre considrable,
car le principe sur lequel elle s'appuie plaait, de prime abord, la science nouvelle
au nombre des sciences morales. En effet, puisque le travail, source des richesses,
est dirig par l'intelligence et minemment perfectible, la science des richesses doit
donc tre classe parmi celles qui tendent amliorer leur objet. Or, il n'en tait
pas ainsi de l'conomie politique de Quesnay plaant la richesse dans la terre
mme et non dans le travail qui met celle-ci en valeur, elle se rangeait d'elle-mme
parmi les sciences naturelles qui n'ont pour objet que la connaissance et
l'exposition des lois qui rgissent les choses.
Par l aussi Adam Smith se sparait en mme temps, ds la premire page de
son livre, de l'cole physiocratique, sur la question fondamentale de la valeur. Les
conomistes franais ne voyaient de valeur que dans un excdent matriel, et,
comme la terre seule est susceptible de produire cet excdent, ils en concluaient
qu'elle est la seule source des richesses, confondant ainsi la condition de la valeur
avec son principe mme. Smith n'est pas tomb dans la mme erreur, et, grce
son exprience de la mthode analytique, le dlicat observateur de nos sentiments
moraux a distingu soigneusement les deux lments de la valeur : les conditions
de la richesse qui nous environnent de toute part et qui rsident principalement
dans la terre, et son principe mme, le travail, qui seul peut mettre en uvre ces
conditions et produire la valeur.
C'est au nom du mme principe qu'il a rhabilit le commerce et l'industrie que
les physiocrates avaient qualifis d'emplois striles et improductifs. L'erreur des
conomistes tait en effet une consquence logique du point de dpart de leur
doctrine. Pour eux, la terre tant la seule richesse, elle seule fournissant l'ouvrier
ses produits bruts et tous les hommes leur subsistance, elle est seule susceptible
de donner un excdent matriel, un produit net. Quant l'industrie et au
commerce, ils ne font que complter l'utilit de cet excdent de matires premires
par des transformations ou des changements de lieu, mais jamais ils ne produisent
eux-mmes un excdent, et leur action, au contraire, a le plus souvent pour effet de
rduire la matire premire par les dchets de la fabrication ou les avaries du
transport. Les manufacturiers et les commerants constituent donc, leur sens, une
classe strile, non pas qu'ils soient inutiles la classe agricole, mais parce que leur
travail reproduit seulement le capital qui les emploie ainsi que les profits ordinaires
de ce capital. S'il ajoute parfois une valeur considrable quelques parties du
produit brut, considres isolment, cette augmentation de valeur n'est prcisment
qu'un quivalent de la consommation simultane et journalire de certaines autres
portions de ce produit ; mais, dans aucun cas, il ne peut y avoir augmentation de la
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
115
somme totale du produit brut. Par suite, ces classes ne peuvent rien ajouter la
richesse et au revenu de la socit que par des conomies et par des privations sur
les fonds destins leur subsistance personnelle : telle est la conclusion que les
physiocrates avaient tire de leur doctrine, sans prendre souci des clameurs que
leurs pithtes blessantes provoquaient autour de leur systme.
Cette distinction fondamentale de l'industrie agricole et de l'industrie
manufacturire tait en elle-mme fort juste 1 . Assurment l'agriculture seule peut
donner un produit net, si l'on entend par ces mots un excdent matriel ;
assurment aussi le nombre des individus occups d'autres emplois est limit par
la somme des aliments qu'elle produit, dduction faite des subsistances ncessaires
l'entretien de la classe agricole. Mais, conclure de ce fait qu'elle seule puisse
contribuer laccroissement de la richesse gnrale, c'est l une question bien
diffrente que Smith a tranche fort exactement en dmontrant que la valeur ne
consiste pas dans la matire, mais dans l'utilit produite par le travail. Voil quelle
est l'importance de la doctrine du philosophe cossais et sa supriorit sur celle des
conomistes. Pour lui, il existe un produit net dans le commerce et l'industrie
comme il en existe un dans l'agriculture : ces deux sortes de produits nets diffrent
seulement dans leur nature.
Toutefois, on a reproch Adam Smith de ne pas avoir t toujours logique
avec lui-mme dans l'application du principe de l'immatrialit du travail et d'avoir
provoqu une distinction regrettable entre le travail de l'ouvrier et les travaux
intellectuels qui ne s'exercent pas sur la matire. Il est certain qu'en qualifiant
d'improductifs les travaux de cette espce, il a prt son tour le flanc aux
critiques, mais nous ne croyons pas que ces critiques soient rellement fondes. Le
clbre conomiste n'a pas prtendu nier l'utilit de ce que J.-B. Say a appel
depuis lors la production immatrielle, il a voulu seulement sparer cette
production sui generis de la production matrielle laquelle seule il donne le nom
de richesses, et qui seule, selon lui, doit tre l'objet de l'conomie politique. Il
n'entrait certainement pas dans la pense de celui qui avait rhabilit le travail
industriel et commercial de mettre en doute l'utilit du travail intellectuel, mais il
tenait dlimiter nettement le champ de la science qu'il voulait fonder et
distinguer le travail qui a pour objet de transformer la matire de celui qui a pour
objet de transformer le producteur, de transformer l'homme.
Ces deux sortes de productions ont, en vrit, certaines lois communes :
l'extension de la classe qui fournit les services est rgle par la loi de l'offre et de la
demande, tout comme celle de la classe qui fournit les marchandises, et les salaires
pcuniaires de l'avocat, du savant, du mdecin, de l'ingnieur, sont rgis de mme
par la formule commune de l'conomie politique. Nanmoins, il est impossible de
confondre ces deux productions dans la mme tude. En effet, alors que la valeur
des produits matriels est value par le prix qu'on en peut obtenir, il n'en est
1
Voir en ce sens les savantes tudes de MM. Dutens et Daire.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
116
nullement ainsi de la valeur des services rendus. Estimer la valeur des
dcouvertes de Newton, dit Malthus 1 , ou les jouissances causes par les
productions de Shakespeare, par le prix que leurs ouvrages ont rapport, ce serait
une mesure bien chtive du degr de gloire et de plaisir qui en est rsult pour leur
patrie ; ce serait une ide non moins grossire et ridicule de calculer les bienfaits
que l'Angleterre a retirs de la Rvolution de 1688 d'aprs la solde des soldats et
les autres dpenses qui auraient t faites pour l'accomplir. Voil pourtant o
conduirait le systme prconis par M. Dunoyer et qui tend absorber toutes les
sciences dans l'conomie politique. D'autres considrations que la poursuite de la
richesse rglent les productions de l'intelligence, et, bien qu'il soit du ressort de
l'conomie politique d'tudier les lois suivant lesquelles elles sont rmunres
pcuniairement, ces productions sont soumises en outre l'action d'autres
lments, souvent bien plus puissants, qui sortent compltement du domaine de la
science qui nous occupe. D'ailleurs, au point de vue de l'change, aucune
assimilation n'est possible entre elles et les productions matrielles ; ces dernires
seules sont susceptibles d'tre changes, les autres ne peuvent en elles-mmes
donner lieu aucun change, et, si notre savoir nous permet de rendre des services
et de les faire rtribuer, il ne peut tre alin puisque nous ne pouvons nous en
dessaisir.
Ce sont l, croyons-nous, les vritables motifs de la distinction que l'auteur des
Recherches voulait tablir ; mais nous devons reconnatre qu'il l'a faite bien
imparfaitement et que le chapitre qu'il y consacre est plein d'une regrettable
obscurit. Cependant il ne nie pas, comme on l'a dit, la fcondit du travail
intellectuel ; il cherche simplement dmontrer que, s'vanouissant au moment
mme qu'il est produit , il ne doit pas tre confondu avec le travail manuel, seul
susceptible d'tre accumul, et il tient rserver, dans la langue conomique, le
terme de production la transformation matrielle qui consiste en des
changements de forme ou de lieu et qui tombe tout entire dans le domaine de
l'conomie politique. Telle est, notre sens, l'explication la plus vraisemblable de
cette distinction, peu exacte dans ses termes, du travail productif et du travail non
productif.
Nous ne pouvons d'ailleurs mieux faire, pour clairer ce dbat, que de citer en
son entier le passage incrimin, car il nous a paru que, parmi ceux qui ont
approuv ou critiqu ce point de la doctrine du matre, il en est beaucoup qui
semblent avoir perdu de vue l'ensemble mme du texte discut. Il y a une sorte
de travail, dit Smith 2 , qui ajoute la valeur de l'objet sur lequel il s'exerce ; il y en
a un autre qui n'a pas le mme effet. Le premier, produisant une valeur, peut tre
appel travail productif ; le dernier, travail non productif. Ainsi, le travail d'un
ouvrier de manufacture ajoute, en gnral, la valeur de la matire sur laquelle
travaille cet ouvrier, la valeur de sa subsistance et du profit de son matre. Le
travail d'un domestique, au contraire, n'ajoute la valeur de rien. Quoique le
1
2
Principes dconomie politique, trad. Monjean, chap. I, sect. II.
Richesse, liv. II, ch. III (t. I, p. 410).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
117
premier reoive des salaires que son matre lui avance, il ne lui cote, dans le fait,
aucune dpense, la valeur de ces salaires se retrouvant en gnral avec un profit de
plus dans l'augmentation de valeur du sujet auquel ce travail a t appliqu. Mais
la subsistance consomme par le domestique ne se trouve nulle part. Un particulier
s'enrichit employer une multitude d'ouvriers fabricants ; il s'appauvrit entretenir
une multitude de domestiques. Le travail de ceux-ci a nanmoins sa valeur et
mrite sa rcompense aussi bien que celui des autres. Mais le travail de l'ouvrier se
fixe et se ralise sur un sujet quelconque ou sur une chose vnale qui dure au
moins quelque temps aprs que le travail a cess. C'est, pour ainsi dire, une
certaine quantit de travail amass et mis en rserve pour tre employe, s'il est
ncessaire, quelque autre occasion. Cet objet, ou, ce qui est la mme chose, le
prix de cet objet peut ensuite, s'il en est besoin, mettre
en activit une quantit de travail gale celle qui l'a produit originairement.
Le travail du domestique au contraire, ne se fixe ou ne se ralise sur aucune chose
qu'on puisse vendre ensuite. En gnral, ses services prissent l'instant mme o
il les rend, et ne laissent presque jamais aprs eux aucune trace ou aucune valeur
qui puisse servir par la suite procurer une pareille quantit de services. Le travail
de quelques-unes des classes les plus respectables de la socit, de mme que celui
des domestiques, ne produit aucune valeur ; il ne se fixe ni ne se ralise sur aucun
objet ou chose qui puisse se vendre, qui subsiste aprs la cessation du travail et qui
puisse servir procurer par la suite une pareille quantit de travail. Le souverain,
par exemple, ainsi que tous les autres magistrats civils et militaires qui servent
sous lui, toute l'arme, toute la flotte, sont autant de travailleurs non productifs. Ils
sont les serviteurs de l'tat et ils sont entretenus avec une partie du produit annuel
de l'industrie d'autrui. Leur service, tout honorable, tout utile, tout ncessaire qu'il
est, ne produit rien avec quoi on puisse se procurer une pareille quantit de
services. La protection, la tranquillit, la dfense de la chose publique, qui sont le
rsultat du travail dune anne, ne peuvent servir acheter la protection, la
tranquillit, la dfense qu'il faut pour l'anne suivante. Quelques-unes des
professions les plus graves et les plus importantes, quelques-unes des plus frivoles,
doivent tre ranges dans cette mme classe : les ecclsiastiques, les gens de loi,
les mdecins et les gens de lettres de toute espce, ainsi que les comdiens, les
chanteurs, les danseurs dopra, etc. Le travail de la plus vile de ces professions a
sa valeur qui se rgle sur les mmes principes que toute autre sorte de travail ; et la
plus noble et la plus utile ne produit par son travail rien avec quoi on puisse
acheter ou faire faire une pareille quantit de travail. Leur ouvrage tous, tel que
la dclamation de l'acteur, le dbit de lorateur ou les accords du musicien,
svanouit au moment mme qu'il se produit.
Lorsquon a tudi avec attention ce chapitre, on reste convaincu que
l'intention de lauteur tait de montrer que le travail intellectuel ne peut donner lieu
directement aucun des produits dont l'conomie politique a soccuper et que les
caractres des deux sortes de travail diffrent en ce que lun se ralise toujours
matriellement sur un objet quelconque et est susceptible d'tre accumul, tandis
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
118
que l'autre s'vanouit immdiatement. Il nous semblait d'ailleurs impossible
d'admettre un seul instant que le clbre philosophe mritt un reproche d'injustice
lgard de la production immatrielle et que ce grand savant pt ravaler laction
considrable qu'exerce l'intelligence sur la formation des richesses.
Le seul reproche qu'on puisse lui faire, selon nous, c'est davoir t un peu trop
loin dans cette distinction et de ne pas avoir constat expressment que les travaux
immatriels eux-mmes restent encore, certains gards, soumis aux rgles
communes de lconomie politique. Il y a l une question de mesure trs dlicate,
et M. Baudrillart a parfaitement dlimit ce point de vue le champ de la science :
L'conomie politique, dit-il 1 , doit se garder de l'ambition d'envahir tous les
domaines ; mais sans effacer de relles distinctions, nous croyons que tous les
services tombent, par un ct au moins, sous la juridiction de l'conomiste. Au
fond, tous les produits sont des produits humains, et les travaux, sous des formes
extrmement diffrentes, ne font que produire des services, que le mot de richesses
s'y applique d'ailleurs avec plus ou moins d'exactitude. La socit n'est qu'un
change de services, de travaux et de produits se rmunrant les uns par les autres.
L'ide de valeur sattache aux produits immatriels ; ils rendent des services gaux
et quelquefois suprieurs ceux que rendent les produits reprsents sous forme
matrielle... Ce qu'il faut viter, cest de ne voir dans les biens moraux et dans les
productions intellectuelles que le ct de l'utilit et de la valeur au sens
conomique. Ceux qui les font figurer comme autant de chapitres de l'conomie
politique n'ont pas toujours su se garder de cet cueil. Le bien et le beau semblent
perdre ainsi leur caractre dsintress ; l'art n'apparat plus que comme une
industrie dont les produits ont tout juste la valeur que leur assigne la loi de loffre
et de la demande ; l'estime quon fait de la science se mesure ses applications
lucratives pour celui qui s'en sert et immdiatement utiles pour la socit. De l'ide
trs juste qu'il y a un capital intellectuel et moral ayant une valeur par lui-mme et
servant de plus engendrer le capital matriel, on est arriv, ce semble, ne plus
voir dans ces biens suprieurs d'une nature si dlicate qu'un pur capital. N'oublions
pas que, dans les travaux et les produits qui ont pour but, non le bien-tre matriel,
mais le dveloppement intellectuel et moral, il y a deux choses qui chappent
l'conomie politique : c'est l'idal mme qui les constitue et le sacrifice qui y entre
toujours un certain degr. La perfection des uvres et non leur valeur sur le
march, voil le but de la science, de l'art, de la vertu. Leur rcompense n'est pas
toute contenue, et il s'en faut de beaucoup, dans le taux de leur rmunration
matrielle.
Nous repousserons donc, avec M. Baudrillart, la doctrine de J.-B. Say, et
surtout celle d'un conomiste moderne, M. Dunoyer, qui, sous prtexte de
rhabiliter la production immatrielle, a voulu supprimer la distinction ncessaire
pose par la Richesse des Nations, et confondre dans une mme tude, en les
soumettant aux mmes lois, les services et les travaux de tous les producteurs,
1
Manuel dconomie politique, p. 69.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
119
quelle qu'en soit la nature. Smith tait dans le vrai, quoi qu'on en ait dit, et la
distinction qu'il a faite, bien que malheureuse quant la forme, tait parfaitement
exacte quant au fond.
Si, dans la doctrine de Smith, les deux points que nous venons de considrer
ont donn lieu, par leur obscurit, des critiques quelquefois spcieuses, tout le
reste de l'tude de la production est trait plus magistralement et n'a provoqu,
dans l'cole fonde par le clbre philosophe, aucune divergence d'opinions.
Chacun connat les arguments par lesquels il dfend la division du travail,
comment il explique que le travail tant la source mme des richesses, il importe
d'en accrotre la productivit, et comment l'conomiste trouve un auxiliaire
prcieux dans la tendance de la civilisation sparer les tches. Il saisit
l'imagination, ds le dbut de ce chapitre, en mettant sous les yeux du lecteur le
spectacle d'une manufacture d'pingles, exemple qui, de nos jours, est devenu
presque banal par son succs mme, mais qui fit une profonde impression sur les
contemporains lorsqu'il fut mis en lumire par l'auteur des Recherches. Puis, aprs
avoir montr les divers ouvriers d'un mme atelier occups des travaux diffrents
dans la fabrication d'un mme objet, il fait remarquer que ce qui se passe ainsi
dans l'intrieur de chaque manufacture, se reproduit en grand dans l'ensemble de la
socit, et que, plus un pays est polic, plus la sparation des tches y est
pratique, parce que la division du travail s'impose ds que, par l'change, le
march peut s'tendre, ds que l'accroissement des dbouchs donne un certain
essor la production. Il invoque, cet gard, le tmoignage mme de l'histoire, et
il tablit que ce phnomne conomique s'est manifest d'abord chez les nations
commerantes, dans lgypte par exemple dont le march s'tendait facilement,
grce aux voies de communication naturelles dont elle tait pourvue, la fois
baigne par une mer tranquille o la navigation ctire est trs simple, et traverse
par le Nil dont les diverses branches peuvent tre facilement utilises pour le
transport des marchandises.
C'est que la sparation des tches contribue de trois manires, selon lui,
augmenter la puissance du travail : premirement, parce qu'elle accrot l'habilet de
chaque ouvrier individuellement en rduisant sa tche une opration simple qu'il
effectue indfiniment ; en second lieu, parce qu'elle vite la perte du temps que
l'artisan mettait passer d'un ouvrage un autre, changer de place et d'outils ;
enfin, parce qu'elle a donn lieu l'invention des machines. Quand l'attention d'un
homme, dit Smith 1 , est dirige tout entire sur un objet, il est bien plus propre
dcouvrir les procds de travail les plus rapides et les plus commodes que lorsque
cette attention embrasse une grande varit de choses. Celles mmes des machines
qui n'ont pas t inventes par des ouvriers, mais par des savants, sont dues encore
la division du travail qui, introduite dans les sciences spculatives, a seule pu
permettre aux thoriciens d'acqurir l'exprience, et l'aptitude ncessaires dans la
branche que chacun d'eux avait adopte.
1
Rich., liv. I, ch. I (t. I, p. 13).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
120
Cette numration des causes de la productivit du travail divis est
parfaitement exacte et elle a t accepte jusqu' ce jour, dans ses termes mmes,
par les conomistes les plus minents 1 . Malheureusement, il y a une ombre ce
tableau et nous sommes oblig de noter ici une dfaillance de lauteur. En effet, si
Smith a fait ressortir, au point de vue conomique, les heureux rsultats de la
division du travail en ce qui concerne la production, il a, dans une autre partie de
ses Recherches, mconnu compltement le caractre moral de ce progrs de la
civilisation, et lui qui difiait tout le systme de l'univers sur la tendance
l'harmonie universelle, il n'a pas craint de signaler l'antagonisme qui existerait,
selon lui, entre la marche naturelle de l'industrie et la tendance gnrale de l'esprit
humain. Dans les progrs que fait la division du travail, a-t-il dit dans son
chapitre de l'ducation 2 , l'occupation de la trs majeure partie de ceux qui vivent
de travail, c'est--dire de la masse du peuple, se borne un trs petit nombre
d'oprations simples, trs souvent une ou deux. Or, l'intelligence de la plupart des
hommes se forme ncessairement par leurs occupations ordinaires. Un homme
dont toute la vie se passe remplir un petit nombre d'oprations simples dont les
effets sont aussi peut-tre toujours les mmes ou trs approchant les mmes, n'a
pas lieu de dvelopper son intelligence, ni d'exercer son imagination chercher des
expdients pour carter des difficults qui ne se rencontrent jamais ; il perd donc
naturellement l'habitude de dployer ou d'exercer ses facults et devient en gnral
aussi stupide et aussi ignorant qu'il soit possible une crature humaine de le
devenir.
L'engourdissement de ses facults morales le rend non seulement incapable de
goter aucune conversation raisonnable ou dy prendre part, mais mme
d'prouver aucune affection noble, gnreuse ou tendre, et, par consquent, de
former aucun jugement un peu juste sur la plupart des devoirs, mme les plus
ordinaires, de la vie prive. Quant aux grands intrts, aux grandes affaires de son
pays, il est totalement hors d'tat d'en juger, et, moins qu'on n'ait pris quelque
peine trs particulire pour l'y prparer, il est galement inhabile dfendre son
pays la guerre : l'uniformit de sa vie sdentaire corrompt naturellement et abat
son courage, et lui fait envisager avec une aversion mle d'effroi la vie varie,
incertaine et hasardeuse d'un soldat ; elle affaiblit mme l'activit de son corps et le
rend incapable de dployer sa force avec quelque vigueur et quelque constance
dans tout autre emploi que celui auquel il a t lev. Ainsi, sa dextrit dans son
mtier particulier est une qualit qu'il semble avoir acquise aux dpens de ses
qualits intellectuelles, de ses vertus sociales et de ses dispositions guerrires. Or,
cet tat est celui dans lequel l'ouvrier pauvre, c'est--dire la masse du peuple, doit
1
Toutefois. M. Babbage (Science conomique des manufactures, traduction Isoard) a indiqu un
quatrime effet de la division du travail sur la production : c'est la possibilit d'employer les
ouvriers selon leurs aptitudes et leurs forces, tandis que, sans cette division des attributions, il
faudrait que les oprations qui exigent moins de force et d'habitude et les oprations difficiles
fussent faites par le mme ouvrier, ce qui lverait le prix du produit. On peut faire remarquer
aussi que, grce la sparation des tches, chaque ouvrier fait un apprentissage moindre, quil a
besoin dun plus petit nombre d'outils et que ces outils sont plus constamment occups.
Richesse, liv. V, ch. I (t. II, p. 442).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
121
tomber ncessairement dans toute socit civilise et avance en industrie, moins
que le gouvernement ne prenne des prcautions pour prvenir ce mal.
On ne saurait trop s'tonner de trouver une ide aussi troite sous la plume
mme de Smith dont nous avons fait connatre la doctrine leve en philosophie.
Ce n'est pas seulement la sparation des tches dans la fabrication de chaque
produit que le clbre conomiste attaque ici avec cette violence, c'est la division
mme des diffrentes industries, condition de tout progrs. En ralit, la vritable
conclusion d'un pareil systme serait l'exaltation de l'tat sauvage, qui seul pourrait
dvelopper ces qualits intellectuelles et morales qu'Adam Smith refuse ici
l'ouvrier alors que toute la suite de ses travaux tendait jusque-l en dmontrer le
progrs par l'histoire de la civilisation. C'est donc, en somme, le procs de la
civilisation que le philosophe cossais parat faire ici incidemment, et on croirait
lire en vrit, non pas un fragment des Recherches, mais plutt un passage d'un
livre de Rousseau.
Aussi, pour rpondre ces rcriminations d'Adam Smith, nous nous
contenterons d'en appeler au reste de son uvre ; mais nous ne pouvons que
regretter qu'il ait ainsi donn lui-mme le signal des attaques contre cette
organisation ncessaire du travail, dont il avait mis en lumire, d'une faon si
saisissante, les heureux effets conomiques. Depuis cette poque, en effet, des
philosophes, mme distingus, sont alls plus avant encore dans cette voie funeste,
et Blanqui crivait plus tard : Qu'est-ce qu'un homme qui ne sait faire, mme
parfaitement, que des ttes d'pingles ou des pointes d'aiguilles ? Cet homme,
pouvons-nous rpondre Blanqui, augmente, en fabriquant ses ttes dpingles la
force productive du travail, et par suite la richesse. Or, c'est laccroissement
gnral de la richesse qui amliore sa condition matrielle, qui lui donne le bientre et laisance auxquels succde d'ordinaire un dveloppement correspondant de
la moralit.
Il n'est pas exact d'ailleurs que la division du travail, prise en elle-mme,
abrutisse l'ouvrier un plus haut point que la concentration des tches, et nous
n'admettons pas, que celui qui ne fait que des ttes d'pingle soit moins intelligent
que celui qui fait l'pingle tout entire. Bien plus, nous dirons que cette sparation
des tches est plutt un auxiliaire de l'intelligence : cet homme qui fait
constamment le mme travail n'a plus penser ce qu'il fait ; ce n'est pas lui qui
est une machine ce sont ses bras seuls ; il peut laisser errer ailleurs son imagination
et se livrer ses rflexions. Si, aprs cette remarque, on veut comparer cet ouvrier,
dont l'esprit est toujours libre, avec un autre dont le travail demande plus
d'application, un horloger, par exemple, qui, courb toute la journe sur son tabli,
ne peut dtourner un instant son attention de sa pice, chez lequel des deux
trouvera-t-on le plus de jugement, le plus de bon sens et l'esprit le plus vif ? La
rponse n'est pas douteuse.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
122
Assurment, si on pouvait imaginer un pays o la division du travail
n'existerait aucun degr, o chacun serait forc de se livrer lui-mme aux
diffrentes occupations ncessaires la satisfaction de ses besoins, sa
subsistance, son vtement, son logement, o chacun devrait assurer directement sa
scurit, on pourrait peut-tre supposer que les hommes effectuant des travaux si
divers devraient acqurir une foule de qualits particulires que ne possdent pas
les ouvriers de nos villes ; mais, dans tous les cas, il leur manquerait des loisirs.
Chez nous, au contraire, non seulement la division du travail rserve l'ouvrier des
loisirs personnels pour la satisfaction de ses besoins intellectuels et moraux, mais,
en permettant une certaine classe de se livrer compltement des tudes
spciales, elle donne au travailleur la possibilit de profiter du rsultat de ces
tudes pendant les heures de repos. La moindre attention le dmontre
surabondamment, et on s'tonne de constater que des esprits vraiment observateurs
et sagaces nient encore les progrs de l'intelligence dans la masse ouvrire. Il n'y a
pas de doute pour, nous que la classe laborieuse ne soit, dans son ensemble, plus
instruite maintenant qu'au temps des corporations o chaque ouvrier faisait sa
pice et o Arthur Young constatait qu'aucun d'eux ne lisait de journaux. La
division du travail, en multipliant la production et la richesse, accroit le bien-tre
du peuple, et, en augmentant ses loisirs, elle dveloppe gnralement ses facults
intellectuelles : La civilisation, comme l'a dit fort exactement M. Paul LeroyBeaulieu 1 , se mesure l'accroissement simultan des produits et des loisirs.
C'est ce que nous rpondrons, au point de vue de la morale, Smith comme
Blanqui, et nous sommes surpris que cette observation ne les ait point frapps.
L'illustre fondateur de l'conomie politique n'aurait pas ainsi fray la voie et prt
l'appui apparent de son autorit aux coles socialistes qui ont attaqu violemment,
de nos jours, l'organisation de l'industrie moderne.
Partant de l, ces coles ont t jusqu' nier les avantages conomiques que
Smith avait signals dans des termes si remarquables, et elles ont reproch
violemment la division du travail de mettre l'ouvrier la merci des crises. Si
l'ouvrier, dit-on, ne sait faire que des ttes d'pingles, que deviendra-t-il lorsque la
production des pingles se ralentira ou lorsque des procds nouveaux rendront ses
services inutiles ? Ce reproche, assez spcieux, n'est pas plus fond que le
reproche tir de la morale, car le dfaut qu'il constate n'est malheureusement pas
spcial la sparation des tches. En effet, si, dans le cas d'une crise locale,
l'ouvrier d'une manufacture de tissus, par exemple, devient un producteur inutile,
n'en sera-t-il pas de mme, plus forte raison, du tisserand en chambre, et ce
dernier ne se trouvera-t-il pas dans une situation plus dsastreuse que l'ouvrier de
l'usine, puisque, ne pouvant couler sa production, il lui sera impossible de payer
mme le prix de la matire premire qu'il aura employe. De plus, l'ouvrier de
l'usine n'est congdi qu' la dernire extrmit ; il est soutenu, au dbut de la
crise, par les capitaux de son patron qui cherche lutter contre un arrt de la
1
Leroy-Beaulieu. Rpartition des richesses, ch. XVI, p. 463. Guillaumin, 1881.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
123
production qui causerait sa ruine, tandis que le tisserand en chambre, s'il ne peut
disposer de quelques ressources, succombera le premier. Enfin, lorsque tous deux
seront sans travail, le tisserand ne pourra pas changer d'emploi aussi vite que
l'ouvrier de manufacture et il se rsignera avec peine abandonner un capital fixe
devenu inutile ; l'ouvrier, au contraire, habitu la vie de l'usine trouvera plus
facilement se placer dans une manufacture d'un autre genre o la sparation des
tches permettra de lui confier un travail simple dans lequel il acquerra
rapidement, cause de cette simplicit mme, la dextrit quil possdait dans son
ancien mtier.
Aussi, pour tous ces motifs, on pourrait, il nous semble, conclure avec plus
d'exactitude et sans tre tax d'exagration, que la division du travail a plutt pour
effet d'attnuer les crises l'gard de l'ouvrier, et que l o les matres des
anciennes corporations auraient succomb, l'industrie moderne, avec ses capitaux
considrables, cherche continuer la lutte, prolonger la production jusqu' des
jours meilleurs.
On a encore attaqu la division du travail un autre point de vue. Le Dr Smith
avait signal les heureux effets de la sparation des tches sur l'invention et les
perfectionnements des machines, et il ne croyait certes pas devoir tre contredit
lorsqu'il vantait les avantages des procds mcaniques. Nanmoins, la substitution
graduelle des machines au travail manuel, substitution qui s'est de plus en plus
gnralise notre poque, ne laissa pas que de soulever des plaintes amres de la
part des ouvriers. Ceux-ci se crurent supplants par cette puissante concurrence, il
y eut des meutes o on brisa les mtiers, et, maintenant encore, les comptes
rendus des commissions d'enqute tmoignent chaque page de l'hostilit de la
masse des ouvriers l'gard des engins mcaniques.
Cependant cette concurrence que semblent faire les machines au travail humain
n'est qu'apparente, car si le nouvel outillage a modifi profondment lorganisation
du travail, il ne l'a pas rendu moins ncessaire, et la main-d'uvre n'a jamais t
plus rare que depuis la transformation industrielle qui s'est opre il y a cinquante
ans.
Pour tre exact, au contraire, il faudrait plutt dire que cette transformation a
donn, en ralit, une impulsion considrable la production en la rendant moins
chre, et qu'en favorisant l'accumulation des capitaux, elle t l'agent le plus
puissant de l'amlioration du salaire rel, du bien-tre de l'ouvrier. Cette grande
multiplication, dit Smith 1 , dans les produits de tous les diffrents arts et mtiers,
rsultant de la division du travail, est ce qui, dans une socit bien gouverne,
donne lieu cette opulence gnrale qui se rpand jusque dans les dernires
classes du peuple. Chaque ouvrier se trouve avoir une grande quantit de son
travail dont il peut disposer, outre ce qu'il en applique ses propres besoins ; et
1
Rich., liv. I, ch. I, (t. I, p. 14).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
124
comme les autres ouvriers sont aussi dans le mme cas, il est mme d'changer
une grande quantit des marchandises fabriques par lui contre une grande quantit
des leurs, ou, ce qui est la mme chose, contre le prix de ces marchandises. Il peut
fournir abondamment ces autres ouvriers de ce dont ils ont besoin, et il trouve
galement s'accommoder auprs d'eux, en sorte qu'il se rpand parmi les
diffrentes classes de la socit une abondance universelle.
C'est l l'expression de la vrit conomique, et l'histoire a donn raison au
philosophe cossais. Au dbut de cette transformation industrielle que notre sicle
a vue se drouler avec une tonnante rapidit, l'introduction des machines dans les
manufactures ne fut certes pas sans causer de brusques perturbations dans la
production : comme dans toute rvolution, il y eut un tat de transition pnible
pour la classe laborieuse ; des centaines d'ouvriers se virent congdis
brusquement pour tre remplacs par des agents mcaniques, et ceux qui restrent
l'usine furent obligs un moment de subir la loi des patrons. Pour beaucoup de
gens ce fut donc la misre, pour d'autres ce fut au moins une diminution de bientre, et cette immense rforme parut de bons esprits marquer un pas en arrire
dans la marche de la civilisation. C'est ce qui frappa de Sismondi, Blanqui et bien
d'autres ; mais ils auraient d attendre que l'quilibre conomique se ft rtabli
pour apprcier utilement l'effet permanent de cette transformation. Pour nous, qui
envisageons un demi-sicle de distance les rsultats dfinitifs de la crise et qui
pouvons mesurer les progrs accomplis, nous constatons, forts des donnes de
l'exprience, l'exactitude des prvisions de Smith. Loin de faire concurrence
l'ouvrier, les machines, en suscitant la production, ont augment la demande des
bras, et non seulement le salaire rel s'est accru dans des proportions fort sensibles,
mais le travail lui-mme est devenu moins dangereux, moins pnible, moins
malsain ; les loisirs de l'ouvrier se sont multiplis en mme temps que son bientre ; plus heureux au point de vue matriel, il est devenu plus clair au point de
vue intellectuel et meilleur au point de vue moral.
Tels sont les rsultats certains de la division du travail ; mais, pour qu'ils se
produisent, il faut que la sparation des tches soit l'effet naturel des progrs de
l'industrie sans tre provoque par l'intervention d'une institution positive, quelque
forme qu'elle puisse revtir.
En effet, le grand principe qui domine ici toute cette tude de la production est
celui de la libert du travail, et l'minent conomiste l'a clbr dans une page
admirable 1 : La plus sacre et la plus inviolable de toutes les proprits, dit-il,
est celle de son propre travail, parce qu'elle est la source originaire de toutes les
autres proprits : le patrimoine du pauvre est dans sa force et dans l'adresse de ses
mains, et, l'empcher d'employer cette force et cette adresse de la manire qu'il
juge la plus convenable, tant qu'il ne porte de dommage personne, est une
violation manifeste de cette proprit primitive. C'est une usurpation criante sur la
1
Rich., liv. I, ch. X, (t. I. p. 160).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
125
libert lgitime, tant de louvrier que de ceux qui seraient disposs lui donner du
travail : c'est empcher la fois, l'un de travailler ce qu'il juge propos, et l'autre,
d'employer qui bon lui semble. On peut bien en toute sret s'en fier la prudence
de celui qui occupe un ouvrier pour juger si cet ouvrier mrite de l'emploi,
puisqu'il y va assez de son propre intrt. Cette sollicitude qu'affecte le lgislateur
pour prvenir qu'on emploie des personnes incapables, est videmment aussi
absurde qu'oppressive.
Le style de Smith est ici plus vif et plus vhment qu'il ne l'est, dans le reste de
l'ouvrage, et on y voit le reflet de la gnreuse indignation qui dbordait du cur
du philosophe. On ne peut en effet se faire une ide, de nos jours des restrictions et
des rglements de toute sorte que le Gouvernement mettait en uvre cette
poque pour entraver la libert du travail. Ltat se considrait comme la sagesse
mme ; il jugeait que lui seul pouvait reconnatre o rside l'intrt gnral de la
socit, et, partant de l, il avait voulu organiser l'industrie d'aprs un plan
prconu. Pour forcer les manufactures atteindre dans leurs produits un degr de
perfection, qui leur donnt la supriorit sur les marchs trangers, on avait cr
les matrises et les jurandes dans le but d'carter les mauvais ouvriers qui auraient
pu discrditer le travail national ; on avait dcrt mme les conditions de la
fabrication, le nombre de fils que devaient avoir les tissus, la largeur des toffes,
sans remarquer que l'intrt personnel est l'agent le plus clair de tous les
perfectionnements industriels. Colbert lui-mme, qui fut cependant un homme
d'tat d'une grande valeur, avait encore aggrav cette rglementation. Comme l'a
fort bienfait remarquer l'auteur des Recherches, le clbre ministre de Louis XIV
tait acquis par temprament aux prjugs du systme mercantile, systme
essentiellement formaliste et rglementaire de sa nature, et qui ne pouvait gure
manquer par l, dit-il 1 , de convenir un homme laborieux et rompu aux affaires,
accoutum depuis longtemps rgler les diffrents dpartements de
l'administration publique et tablir les formalits et les contrles ncessaires pour
les contenir chacun dans leurs attributions respectives. Il chercha rgler
l'industrie et le commerce, d'un grand peuple sur le mme modle que les
dpartements d'un bureau ; et, au lieu de laisser chacun se diriger sa manire
dans la poursuite de ses intrts privs, sur un vaste et noble plan dgalit et de
justice, il s'attacha rpandre sur certaines branches d'industrie des privilges
extraordinaires, tandis qu'il chargeait les autres d'entraves non moins
extraordinaires. Aussi notre lgislation industrielle fut pleine de contre-sens et
d'anomalies, et l'institution des corporations, excellente dans son principe, devint
une arme funeste de tyrannie et d'oppression.
La rglementation tait encore plus considrable en Angleterre que chez nous ;
il tait dfendu de cumuler les professions, mme les plus connexes (le tissage de
la toile unie et le tissage des toffes de soie, par exemple) ; les statuts
d'apprentissage y taient trs restrictifs, et la lgislation sur les pauvres, en
1
Rich., liv. IV, eh. VIII (t. II, p. 309).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
126
attachant l'ouvrier sa paroisse, empchait en ralit les travailleurs de se porter,
suivant leur intrt, aux divers endroits o le manque de bras leur promettait un
salaire plus rmunrateur.
Toutes ces restrictions, avec leurs causes et leurs effets, ont t fort nettement
exposes dans les Recherches 1 , et Smith concluait que la rforme la plus urgente
devait tre celle de l'organisation industrielle. Toutefois, on peut regretter qu'en
proclamant avec autant d'loquence le principe suprieur de la libert du travail, le
clbre conomiste n'ait cru devoir parler qu'au nom de l'intrt seul : le disciple
d'Hutcheson aurait d, faire intervenir en mme temps la loi morale et invoquer
l'ide de justice, en montrant que si le travail est pour l'homme une ncessit, il
doit par cela mme tre libre.
Le travail, a dit en effet V. Cousin 2 , tant le dveloppement de la force qui
constitue l'homme, et cette force tant essentiellement libre, la loi essentielle du
travail est nos yeux la libert. La libert est le fondement de tout droit ; rien ne
vaut contre elle. Le droit permanent et inviolable de la libert est de se dvelopper
comme il lui plat, pourvu que, dans ses dveloppements, elle ne porte point
atteinte aux autres liberts. Loin que la socit ait le droit de mettre des entraves au
travail et la production, elle n'a le droit de s'en mler que pour veiller ce qu'il
n'y soit apport aucune entrave, comme le magistrat ne peut se mler de ce qui se
passe dans la rue que pour assurer l'ordre, la libert de tous. Il y a deux espces
d'ordre, l'un vrai et l'autre faux ; l'un naturel et l'autre artificiel. L'ordre naturel est
la loi d'une chose conforme sa nature. L'ordre artificiel est un systme de lois
imposes un tre contre sa nature. L'ordre naturel de la socit humaine consiste
y faire rgner la loi qui convient la nature des tres dont cette socit est
forme. Ces tres tant libres, leur loi la plus immdiate est le maintien de leur
libert. C'est l ce qu'on appelle la justice. Il y a dans le cur de l'homme, il peut
donc et il doit intervenir dans la socit d'autres lois encore, mais nulle qui soit
contraire celle-l. L'tat est avant tout la justice organise, et sa fonction
premire, son devoir le plus troit est d'assurer la libert. Et quelle libert y a-t-il
dans une socit o n'est pas la libert du travail, lorsque les conditions mises la
production, au lieu de l'assurer, l'empchent ? Rien de mieux que la surveillance en
certains cas, car elle est au profit de la libert gnrale ; mais, sous le manteau
d'une surveillance lgitime, favoriser celui-ci, entraver celui-l, organiser des
monopoles, instituer des corporations, voil qui excde les droits de la socit.
Ce sont l des ides que nous eussions voulu trouver sous la plume du Dr Smith
et qui eussent rehauss la porte de son uvre. Il existe, en effet, un lien troit
entre les suggestions de l'intrt et les prescriptions de la loi morale, et il est bon,
dans un ouvrage d'conomie politique, de constater cet accord. Telle tait,
d'ailleurs, la grande vrit qui, dans l'esprit du matre, devait se dgager de
l'ensemble de son uvre, et, dans cette histoire de la civilisation qu'il avait conue,
1
2
Rich., liv. I, ch. X (t. I, p. 176-186).
Philosophie cossaise, p. 222.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
127
il se proposait de dmontrer que toutes les forces qui agissent en nous nous
conduisent la mme fin et tendent produire une harmonie universelle. Mais il
n'et pas t inutile de le rappeler ici, propos du principe de la libert du travail.
Turgot l'avait bien compris, et, au commencement de cette mme anne 1776 qui
vit paratre les Recherches, il avait tenu baser ses rformes sur ce fondement
lev de la loi morale, plaant en tte de ses dits ces lignes remarquables qui sont
dans toutes les mmoires : Dieu, en donnant l'homme des besoins, en lui
rendant ncessaire la ressource du travail, a fait du devoir de travailler la proprit
de tout homme, et cette proprit est la premire, la plus sacre et la plus
imprescriptible de toutes.
Cette considration leve manque l'uvre de Smith, mais, au point de vue
de l'intrt proprement dit, les avantages de la libert du travail y sont
magistralement exposs ; il montre fort exactement comment l'intrt pousse
naturellement l'homme au progrs, au bien gnral, et comment on arrive
fatalement des rsultats dplorables lorsqu'on s'efforce de briser ou de dtendre
ce ressort que la Providence a plac en nous. L'auteur des Recherches nous en
donne un exemple dans le travail des esclaves 1 . Chez ceux-ci, aucun sentiment de
responsabilit, point d'intrt la production ; la crainte seule les fait travailler, et
combien est faible ce sentiment de la crainte si on le compare l'esprance qui
remplit le cur de l'homme libre et le pousse amliorer sa position par le travail !
L'exprience de tous les temps et de toutes les nations, conclut il, s'accorde donc
pour dmontrer que l'ouvrage fait par des esclaves, quoiqu'il paraisse ne coter que
les frais de leur subsistance, est, au bout du compte, le plus cher de tous. Celui qui
ne peut rien acqurir en propre, ne peut avoir d'autre intrt que de manger le plus
possible et de travailler le moins possible. Tout travail, au del de ce qui suffit
pour acheter sa subsistance, ne peut lui tre arrach que par la contrainte, et non
par aucune considration de son intrt personnel.
Le travail libre, tel est donc le facteur ncessaire de la production. Il s'exerce
d'abord exclusivement sur les agents naturels, et en particulier sur la terre ; puis
son produit arrive excder le fonds ncessaire la subsistance, il s'accumule et se
cre ainsi un nouvel auxiliaire pour la production. Cet auxiliaire n'est autre chose
que du travail accumul ; c'est ce qu'on a nomm le capital.
Smith n'a pas voulu voir dans le capital un second facteur de la production.
Pour lui, il n'y en a qu'un seul, le travail, qui est, selon son expression, le fonds
primitif qui fournit la consommation d'une nation toutes les choses ncessaires et
commodes la vie ; les agents naturels en sont la condition ncessaire, et le
capital, issu du travail lui-mme, en est l'instrument fcond. En d'autres termes, la
production consiste dans le rapprochement de deux substances, en vue d'obtenir un
certain rsultat : le vritable et seul facteur est donc le moteur, c'est--dire la force
active qui est en nous et qui se manifeste dans la production par le jeu de nos
1
Rich., liv. I, ch. VIII (t. I, p. 112) et liv. III, ch. II (t. I, p. 480).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
128
muscles. Le capital est de la richesse dj cre ; c'est la portion de cette richesse
qui sert la reproduction ; c'est, comme on l'a dit fort justement, la graine de la
veille qui devient semence le lendemain, et le travail trouve dans cette richesse
qu'il a produite lui-mme, un levier puissant pour continuer son uvre.
Le livre II des Recherches est consacr aux CAPITAUX : c'est l l'une des
tudes les plus lumineuses de tout l'ouvrage.
Smith expose fort nettement les causes ncessaires de l'accumulation du
capital. Il montre, comment l'homme, l'tat sauvage, pouvait vivre au jour le jour,
sans capital accumul, vivant des produits mmes de son travail, avec le seul
concours des agents naturels. Mais lorsque les besoins s'accrurent, lors que
lhomme, pour dvelopper la puissance de son effort, en arriva la sparation des
tches, et lorsqu'il dut pourvoir la plus grande partie de ses besoins au moyen des
produits du travail d'autrui achets avec les produits de son propre travail, alors, ne
pouvant attendre pour subsister qu'il et achev ses produits et qu'il les et
changs, il lui fallut l'appui d'un capital prexistant, ncessaire pour le faire vivre
et pour lui fournir les outils indispensables : par suite, la subdivision progressive
du travail dut toujours tre prcde d'un accroissement correspondant du capital.
Le clbre conomiste divise le fonds accumul que possde un pays, en trois
parties, dont chacune remplit une fonction distincte 1 .
La premire est le STOCK, la portion rserve pour servir immdiatement la
consommation et dont le caractre distinctif est de ne point rapporter de revenu ou
de profit. Elle consiste dans ce fonds d'habits, de meubles de mnage, etc., qui ont
t achets par les consommateurs, mais qui ne sont pas encore entirement
consomms.
La seconde est le CAPITAL FIXE dont le caractre distinctif est de rapporter
un revenu ou profit sans changer de matre. Ce capital se compose principalement
des quatre lments suivants :
1 Toutes les machines utiles et les instruments industriels qui facilitent et
abrgent le travail ;
2 Tous les btiments destins un objet utile et qui sont des moyens de
revenu, non seulement pour le propritaire qui en retire un loyer en les louant, mais
mme pour la personne qui les occupe et qui paie ce loyer ; ces btiments doivent,
en effet, tre distingus des maisons qui ne servent qu' l'habitation, car ce sont, en
ralit, de vritables instruments de l'industrie ;
Rich., liv. II, ch. I (t. I, p, 339.)
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
129
3 Les amliorations des terres, qui comprennent tout ce qu'on a dpens
d'une manire profitable les dfricher, desscher, enclore, marner, fumer et
mettre dans l'tat le plus propre la culture et au labourage ;
4
Les talents utiles acquis par les habitants ou les membres de la socit.
Enfin la troisime des branches en lesquelles se divise naturellement le fonds
gnral que possde une socit, c'est son
CAPITAL CIRCULANT, dont le caractre distinctif est de ne rapporter de
revenu qu'en circulant ou changeant de matre. Il est aussi compos, dit Smith, de
quatre articles :
1 L'argent, par le moyen duquel les trois autres circulent et se distribuent
ceux qui en font usage et consommation ;
2 Ce fonds de vivres qui est dans la possession des bouchers, nourrisseurs de
bestiaux, fermiers, marchands de bl, brasseurs, etc., et de la vente desquels ils
esprent tirer un profit ;
3 Ce fonds de matires, ou encore tout fait brutes, ou dj plus ou moins
manufactures, destines l'habillement, l'ameublement, la btisse, qui ne sont
prpares sous aucune de ces formes, mais qui sont encore dans les mains des
producteurs, des manufacturiers, des merciers, des drapiers, des marchands de bois
en gros, des charpentiers, des menuisiers, des maons, etc. ;
4 Enfin l'ouvrage fait et parfait, mais qui est toujours dans les mains du
marchand ou du manufacturier et qui n'est pas encore dbit ou distribu celui
qui doit en user ou le consommer ; tels que ces ouvrages tout faits que nous voyons
souvent exposs dans les boutiques du serrurier, du menuisier, du tapissier, de
l'orfvre, du joaillier, du faencier, etc.
Cette numration est bien nette. Elle est encore aussi vraie qu'elle pouvait
l'tre lors de l'apparition de la Richesse des Nations, et nous avons pu, un sicle
de distance, citer les termes mmes de Smith, sans avoir besoin de les modifier par
les donnes de l'exprience : c'est le plus bel loge qu'on puisse faire de la
puissance d'observation et de la perspicacit de l'auteur.
Le chapitre est d'ailleurs moins vague que plusieurs de ceux que nous avons
examins jusqu'ici en suivant Adam Smith dans son tude du travail, et il ne prte
pas le flanc aux mmes controverses. Il contribue mme indirectement clairer sa
fameuse doctrine du travail productif, et il nous montre que nous avons t bien
inspir en refusant de prendre au pied de la lettre cette distinction peu heureuse
dans ses termes. En effet, alors qu'on reproche l'auteur des Recherches d'avoir
mconnu la valeur des productions immatrielles, nous le voyons placer les talents
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
130
utiles dans son numration des capitaux fixes. Or, ds qu'on admet chez l'ouvrier
un capital immatriel, il est impossible de refuser une valeur au travail du matre
qui a form ce capital. Un capital est du travail accumul ; si donc le capital
produit a une valeur, c'est que le travail qui lui a donn naissance tait lui-mme
productif de valeur : c'est l un raisonnement auquel Adam Smith n'a pas pu
chapper, et c'est l une preuve certaine qu'il n'a vu autre chose qu'un moyen de
dlimiter le champ de l'conomie politique dans cette fameuse distinction si
vivement critique par J.-B. Say et M. Dunoyer.
Toutefois, cette distribution en trois classes des divers fonds accumuls n'a pas
satisfait MacCulloch 1 et quelques autres conomistes. Pour eux, la distinction du
stock et du capital serait peu satisfaisante et pourrait conduire des conclusions
errones, attendu qu'en fait certaines portions du fonds social, employes sans
aucune intention de produire un revenu, sont souvent les plus productives ; leur
sens, tout ce qui est immdiatement utilisable est un capital et le cheval attel la
voiture du gentleman l'est au mme titre que le cheval de labour. Ces critiques de
MacCulloch ne nous semblent pas fondes : la distinction du stock et du capital
constitue une division trs heureuse de l'ensemble des richesses, en ce quelle vite
de confondre le fonds de consommation qui est la condition mme de la
production avec le capital qui en est l'instrument.
Le mme conomiste a regrett galement que Smith ait distingu les capitaux
fixes et les capitaux circulants suivant qu'ils sont susceptibles ou non de produire
un revenu sans changer de matre, et, selon lui, le vritable caractre du capital fixe
serait la dure. Ce point de vue, bien que spcieux en apparence, n'en est pas plus
exact lorsqu'on le soumet quelque rflexion : l'argument souvent cit de
l'aiguille, cet outil fragile qui est assurment un capital fixe, a fait justice de ces
critiques.
La distinction pose dans les Recherches subsiste donc tout entire, et elle a
une trs grande importance. Il est, en effet, d'une utilit incontestable, que la
nation, comme l'individu, puisse comparer la part de ses capitaux fixes celle de
ses capitaux circulants. L'outillage national, comme celui d'un particulier, ne doit
pas tre en disproportion avec les ressources, et un pays doit viter d'immobiliser
une trop grande portion de l'ensemble de son capital : les nations, aux poques
mmes de prosprit, doivent se tenir en garde contre une pareille tendance,
dsastreuse pour leurs finances et pour le dveloppement de la production qu'on
prtend favoriser de la sorte.
Ainsi, si le travail est le facteur de la production, le capital en est l'instrument
puissant. Mais il ne prte pas toujours au travail un concours galement efficace,
suivant les diffrentes industries. Quoique tous les capitaux, dit Adam Smith 2 ,
soient destins l'entretien du travail productif seulement, cependant la quantit de
1
2
Voir une note de MacCulloch sur la Richesse des Nations (dit. Garnier, t. I, p. 336.).
Rich., liv. II, ch. V (t. I, p. 450).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
131
ce travail que des capitaux gaux sont capables de mettre en activit, varie
extrmement d'aprs la nature diffrente de l'emploi qu'on leur donne, et il y a la
mme variation dans la valeur que cet emploi ajoute au produit annuel des terres et
du travail du pays.
L'auteur des Recherches distingue cet gard quatre manires diffrentes
d'employer un capital :
1 En fournissant la socit le produit brut qu'il lui faut pour son usage et sa
consommation annuelle : c'est le cas de lindustrie agricole, dans laquelle il
comprend les travaux des mines, la chasse et la pche ;
2 En manufacturant et prparant ce produit brut pour qu'il puisse
immdiatement servir l'usage et la consommation : c'est l'objet de l'industrie
manufacturire ;
3 En transportant le produit brut et le produit manufactur des endroits o ils
abondent ceux o ils manquent (commerce en gros) ;
4 Enfin, en divisant des portions de l'un et de l'autre de ces produits en
parcelles assez petites pour pouvoir s'accommoder aux besoins journaliers des
consommateurs : c'est l la fonction du commerce de dtail.
On a critiqu trs souvent cette classification des industries. Les uns, avec
Destutt de Tracy, ont trouv les divisions trop nombreuses et n'ont voulu
reconnatre que deux modes vraiment distincts d'emploi des capitaux, suivant qu'ils
ont pour objet des transformations de forme ou seulement des transformations de
lieu, et ils ont mme confondu dans la mme classe l'industrie agricole et le travail
manufacturier, malgr la diffrence de leur objet. Mais la majorit des conomistes
modernes a pens, au contraire, avec M. Dunoyer, qu'il y aurait plutt lieu, dans
l'intrt de la science, d'augmenter encore les subdivisions indiques par Smith, et,
tout en rangeant dans une mme catgorie le commerce en gros et le commerce en
dtail, ils, ont cru devoir tablir deux classes spciales pour l'industrie extractive et
l'industrie des transports.
On a donc dsign sous le nom d'industrie extractive celle qui concerne
l'exploitation des richesses naturelles, des substances minrales enfouies dans le
sol, des bois extraire de forts quelquefois impntrables et qui ont cr sans le
concours du travail humain, enfin la chasse et la pche, en un mot, l'appropriation
de tous les tres ou objets qui ne deviennent utilits que par un changement de lieu.
Cette distinction tait ncessaire, et, pour ne pas l'avoir faite, Adam Smith a laiss
planer sur certaines parties de son ouvrage un peu d'obscurit, en s'appliquant
confondre dans une mme tude l'industrie agricole qui produit par transformation
et l'industrie extractive qui produit sans transformation au moyen de l'isolement
des matires ou des tres qu'elle veut mettre en valeur.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
132
On a jug aussi que l'industrie des transports ne peut tre range dans la mme
catgorie que le commerce, attendu que si le changement de lieu accompagne
gnralement l'change, il n'en est pas cependant la condition ncessaire. Mais
cette distinction tait d'ailleurs conforme la classification mme de Smith, car, en
parlant de commerce en gros dont il tenait sparer l'tude de celle du commerce
en dtail, c'tait en ralit l'industrie des transports qu'il avait en vue de dfinir,
quand il lui donnait pour mission de transporter soit le produit brut, soit le
produit manufactur, des endroits o il abonde ceux o il manque . Il n'y a l
autre chose qu'une confusion de termes, et si l'auteur des Recherches a fait du
commerce en gros un mode spcial d'emploi des capitaux, c'est quil visait
l'industrie des transports : tout le chapitre en est la preuve.
Quoi qu'il en soit, en dehors des rserves que nous venons de faire, cette tude
sur ls diffrents emplois des fonds est, beaucoup d'gards, fort exacte. Malgr
ses prfrences bien visibles pour l'agriculture, Adam Smith s'y montre assez juste
pour les autres industries et il dclare en termes exprs que chacune de ces
mthodes d'employer un capital est essentiellement ncessaire, tant l'existence et
l'extension des trois autres genres d'emploi qu' la commodit gnrale de la
socit 1 . Sans l'agriculture, en effet, qui fournit la matire premire, les
manufactures et le commerce ne pourraient pas exister. Sans les manufactures, qui
se chargent de transformer la portion du produit brut qui exige un certain degr de
prparation, cette portion du produit brut ne serait jamais produite, faute de
demande, ou si elle tait produite spontanment, elle n'aurait aucune valeur
changeable et n'ajouterait rien la richesse de la socit. Sans le commerce en
gros (industrie des transports), qui se charge de diriger la matire premire et le
produit manufactur des endroits o ils abondent ceux o ils manquent,
l'agriculture et l'industrie ne produiraient plus que ce qui serait ncessaire la
consommation locale, tandis que l'intervention du marchand qui change le
superflu d'un pays contre le superflu d'un autre, encourage l'industrie des deux
contres et multiplie les jouissances. Enfin le commerce de dtail, en divisant les
marchandises en parcelles assez petites pour s'accommoder la demande des
consommateurs, les met ainsi la porte de toutes les bourses, il en accrot la
consommation et il provoque par l mme le dveloppement de la production
agricole et manufacturire.
D'ailleurs, Smith n'avait garde d'omettre de constater ici comme il l'a fait en
toute occasion, cette tendance l'harmonie universelle qui est la base de sa
philosophie, et, l'heure mme o les physiocrates prtendaient dmontrer que
l'agriculture est le seul emploi vraiment productif du capital, il a magistralement
affirm la solidarit des industries.
Rich., liv. II, ch. V (t, I, p. 451).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
133
On a parfois mal compris la porte de la doctrine de Quesnay et on en a
souvent altr la physionomie. Comme l'ont fait observer les adeptes modernes de
cette cole distingue, MM. Dutens et Daire, il ne faut pas prter aux physiocrates
des ides ridicules et absurdes qu'on ne sexpliquerait nullement chez des hommes
aussi minents. Ils taient dans le vrai quand ils affirmaient que le travail agricole
se distingue de tous les autres en ce qu'aucun n'est concevable sans lui, en ce qu'il
sert de fondement, de principe et de cause tous les modes de l'activit, humaine
et en ce quil est, en dernire analyse, la source o toutes ces activits vont puiser
leur rcompense. Ils reconnaissaient galement l'importance des autres industries,
ainsi que leur action sur la formation des richesses, et l'pithte d'emplois striles
n'avait nullement, dans la bouche des chefs de l'cole, le sens qu'on lui a donn
depuis lors. Mais ils avaient tort de rapporter la classe agricole seule la facult de
fournir un produit net et de ne pas admettre que les autres industries puissent en
donner un, elles aussi, diffrent, il est vrai, du produit net territorial, mais
susceptible, comme lui, d'augmenter la richesse gnrale de la nation.
Smith a eu, on le sait, le mrite de protester contre cette doctrine et de
rhabiliter les divers emplois du capital. Toutefois nous avons dj fait remarquer
qu'il avait t devanc dans cette voie par un compatriote mme de Quesnay et que
cette anne 1776 venait justement de voir paratre un ouvrage de l'abb de
Condillac o le clbre philosophe combattait brillamment la thorie
physiocratique et dfendait victorieusement la cause du commerce. Mais ce trait,
publi sous un titre modeste 1 , n'avait pas attir l'attention du monde savant, bien
qu'il ft peut-tre suprieur certains gards cette partie de la Richesse des
nations, et jusqu' nos jours on avait report Adam Smith, l'honneur exclusif
d'avoir fait cette dmonstration. Nous croyons donc bon d'en citer quelques
extraits, qui compltent d'ailleurs heureusement les arguments de l'conomiste,
cossais.
Que devons-nous aux commerants ? disait l'abb de Condillac 2 . Si, comme
tout le monde le suppose, on change toujours une production d'une valeur gale
contre une autre production d'une valeur gale, on aura beau multiplier les
changes, il est vident que, aprs comme auparavant, il y aura toujours la mme
masse de valeurs ou de richesses. Mais il est faux que, dans les changes, on donne
valeur gale pour valeur gale. Au contraire, chacun des contractants en donne
toujours une moindre pour une plus grande. En effet, si on changeait toujours
valeur gale pour valeur gale, il n'y aurait de gain faire pour aucun des
contractants. Or, tous deux en font et en doivent faire. Pourquoi ? C'est que les
choses n'ayant qu'une valeur relative nos besoins, ce qui est plus pour l'un est
moins pour l'autre, et rciproquement. L'erreur o l'on tombe ce sujet vient de ce
qu'on parle des choses qui sont dans le commerce comme si elles avaient une
valeur absolue, et qu'on juge en consquence qu'il est de la justice que ceux qui
1
Le Commerce et le Gouvernement considrs relativement l'un l'autre (ouvrage lmentaire),
par l'abb de Condillac, membre de l'Acadmie franaise. Amsterdam, 1776, un vol. in-12.
Le Commerce et le Gouvernement, Ch. XXIX, p. 328.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
134
font des changes se donnent mutuellement valeur gale pour valeur gale. Bien
loin de remarquer que deux contractants se donnent l'un l'autre moins pour plus,
on pense, sans trop y rflchir, que cela ne peut pas tre ; et il semble que, pour
que l'un donnt toujours moins, il faudrait que l'autre ft assez dupe pour donner
toujours plus, ce qu'on ne peut pas supposer. Ce ne sont pas les choses
ncessaires notre consommation que nous sommes censs mettre en vente, c'est
notre surabondant, comme je l'ai remarqu plusieurs fois. Nous voulons livrer une
chose qui nous est inutile pour nous en procurer une qui nous est ncessaire : nous
voulons donner moins pour plus Or, les commerants sont les canaux de
communication par lesquels le surabondant s'coule. Des lieux o il n'a point de
valeur, il passe dans les lieux o il en prend une, et partout o il se dpose, il
devient richesse. Le commerant fait donc en quelque sorte de rien quelque chose ;
il ne laboure pas, mais il fait labourer ; il engage le colon retirer de la terre un
surabondant toujours plus grand et il en fait toujours une richesse nouvelle. Par le
concours du colon et du commerant, l'abondance se rpand d'autant plus que les
consommations augmentent proportion des productions, et rciproquement les
productions proportion des consommations. Une source qui se perd dans des
rochers et dans des sables n'est pas une richesse pour moi, mais elle en devient une
si je construis un aqueduc pour la conduire dans mes prairies. Cette source
reprsente les productions surabondantes, que nous devons aux colons, et
l'aqueduc reprsente les commerants.
Cette dmonstration de la productivit du commerce ne serait pas dsavoue de
nos jours, et c'est Condillac, dont on ignore trop les travaux conomiques, qu'on
doit cette rfutation clatante de l'erreur des physiocrates. Mais le philosophe
franais a exagr sa raction contre cette doctrine, et, faute d'avoir suffisamment
analys le travail, qui, en somme, ne consiste que dans un mouvement raisonn,
dans le rapprochement de deux substances, il s'est laiss aller jusqu' rabaisser un
peu le rle producteur de l'ouvrier agricole : parler exactement, dit-il 1 , le
colon ne produit rien : il dispose seulement la terre produire. L'artisan, au
contraire, produit une valeur, puisqu'il y en a une dans les formes qu'il donne aux
matires premires. Produire, en effet, c'est donner de nouvelles formes la
matire ; car la terre, lors qu'elle produit, ne fait pas autre chose.
De son ct, Smith est plutt tomb dans lexcs oppos, et, aprs avoir
combattu l'cole de Quesnay en affirmant la productivit des diffrentes industries,
il n'a pas cach ses prfrences pour l'agriculture. Aussi sa conclusion se rapproche
de celle du systme qu'il vient de rfuter. Aucun capital, dit-il 2 somme gale,
ne met en activit plus de travail productif que celui du fermier. Ce sont non
seulement ses valets de ferme, mais ses bestiaux de labour et de charroi qui sont
autant d'ouvriers productifs. D'ailleurs, dans la culture de la terre, la nature
travaille conjointement avec l'homme ; et, quoique son travail ne cote aucune
dpense, ce qu'elle produit nen a pas moins sa valeur, aussi bien que ce que
1
2
Le Commerce et le Gouvernement, ch. IX, p. 72.
Richesse, liv. II, ch. V (t. I, p. 455).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
135
produisent les ouvriers les plus chers. Les oprations les plus importantes de
l'agriculture semblent moins avoir pour objet d'accrotre la fertilit de la nature
(quoiqu'elles y parviennent aussi) que de diriger cette fertilit vers la production
des plantes les plus utiles. Un champ couvert de ronces et de bruyres produit
souvent une aussi grande quantit de vgtaux que la vigne ou la pice de bl la
mieux cultive. Le cultivateur qui plante et qui sme excite souvent moins l'active
fcondit de la nature, qu'il ne la dtermine vers un objet, et, aprs qu'il a termin
tous ses travaux, c'est elle que la plus grande partie de l'ouvrage reste faire.
Ainsi les hommes et les bestiaux employs aux travaux de la culture, non
seulement, comme les ouvriers des manufactures, donnent lieu la reproduction
d'une valeur gale leur consommation ou au capital qui les emploie, en y joignant
de plus les profits des capitalistes, mais ils produisent encore une bien grande
valeur. Outre le capital du fermier et tous ses profits, ils donnent lieu la
reproduction rgulire d'une rente pour le propritaire. On peut considrer cette
rente comme le produit de cette puissance de la nature dont le propritaire prte
l'usage au fermier. Ce produit est plus ou moins grand, selon qu'on suppose cette
puissance plus ou moins d'tendue, ou, en d'autres termes, selon qu'on suppose la
terre plus ou moins de fertilit naturelle ou artificielle. C'est l'uvre de la nature
qui reste, aprs qu'on a fait la dduction ou la balance de tout ce qu'on peut
regarder comme l'uvre de l'homme. Ce reste fait rarement moins du quart, et
souvent plus du tiers du produit total. Jamais une pareille quantit de travail
productif employe en manufacture ne peut occasionner une aussi riche
reproduction. Dans celle-ci, la nature ne fait rien, la main de l'homme fait tout, et,
la reproduction doit toujours tre ncessairement en raison de la puissance de
l'agent. Ainsi, non seulement le capital employ la culture de la terre met en
activit une plus grande quantit de travail productif que tout autre capital employ
en manufacture, mais encore, proportion de la quantit de travail productif qu'il
emploie, il ajoute une beaucoup plus grande valeur au produit annuel des terres et
du travail du pays, la richesse et au revenu rel de ses habitants. De toutes les
manires dont un capital puisse tre employ, c'est sans comparaison la plus
avantageuse la socit.
Cette partie de la doctrine de Smith est absolument errone. Ce n'est pas
seulement dans le travail agricole que la nature travaille conjointement avec
l'homme : l'air et l'eau sont les auxiliaires puissants d'un grand nombre de
manufactures ; les voies naturelles de communication ont seules rendu possibles
les progrs du commerce, et partout les agents physiques viennent seconder
l'homme dans l'uvre de la production. En quoi consiste d'ailleurs le travail ? Dans
le rapprochement raisonn de deux objets : l'action de l'homme se borne ce
rapprochement, et la nature agit seule ensuite. Smith a parfaitement saisi ce rle
tout puissant de la nature dans la production agricole, mais il n'a pas pouss assez
loin l'analyse en ce qui concerne les autres industries, car il aurait reconnu que,
sous une forme un peu plus complexe, le mode de production est toujours le mme
et que le rle de l'intelligence humaine servie par les muscles se borne au
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
136
mouvement. Dans la production matrielle, a dit fort justement M. Baudrillart 1 ,
qu'est-ce que l'homme apporte ? En dernire analyse, il n'apporte qu'une chose, le
mouvement. Il ne fait rien que de mouvoir un corps vers un autre. Il meut une
graine vers le sol, et les forces naturelles de la vgtation produisent
ncessairement une racine, un tronc, des fleurs, des fruits. Il meut une hache vers
un arbre, et l'arbre tombe par la force de la gravitation. Il meut une tincelle vers le
combustible, et celui-ci s'allume, fond ou amollit le fer, cuit les aliments, etc.
Quand je verse un alcali sur un acide, coup sr je ne suis pas le vritable auteur
du phnomne qui en rsulte : tout ce que je fais, c'est de rapprocher deux
substances. Entrez dans une manufacture, dans l'atelier le plus compliqu, vous
verrez qu'en dernier rsultat le travailleur le plus ignorant, comme le mcanicien le
plus habile, n'a fait autre chose que de crer du mouvement, d'oprer certains
rapprochements et de laisser ensuite agir les proprits de la matire.
C'est cette gnralisation que n'avaient faite ni Smith ni Condillac, et c'est
cause de cette vue incomplte que chacun d'eux a t conduit des consquences
errones, quoique diffrant suivant les tendances particulires et les prfrences
intimes de l'un et de l'autre philosophes. Adam Smith aimait naturellement
l'agriculture ; il avait t lev dans la campagne, au milieu d'une population
agricole assez claire, dans une contre o la fertilit du sol donnait aux habitants
une modeste aisance. De plus, il affectionnait, par temprament, le calme et la
tranquillit de la vie des champs, l'indpendance qu'elle procure ; il apprciait la
saine morale et le gros bon sens de ces populations rurales dans lesquelles il voyait
une force pour la nation et un gage de stabilit pour les institutions politiques.
Enfin, ses relations avec lord Kames, le clbre agronome, ses rapports mmes
avec les conomistes avaient accru encore sa sympathie pour l'industrie agricole, et
Il manifeste chaque occasion, dans le cours de ses Recherches, une partialit bien
visible son gard.
Aprs l'agriculture, c'est la production manufacturire qui a, selon lui, les plus
heureux effets sur la richesse d'une nation ; puis vient le commerce en gros, enfin
le commerce de dtail. Il subdivise mme le commerce en gros en trois branches,
comparant l'utilit de chacune d'elles au point de vue de l'essor et de
l'encouragement donns au travail national et l'augmentation des richesses.
Il distingue ainsi :
1 Le commerce intrieur, dont la fonction est d'acheter dans un endroit du
pays pour revendre dans un autre endroit du mme pays, les produits de l'industrie
nationale ;
Manuel, IIe partie, section I. ch. II, p 72.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
137
2 Le commerce tranger de consommation, que nous appelons de nos jours
le commerce d'importation et qui a pour objet l'achat de matires trangres pour la
consommation intrieure ;
3 Le commerce de transport, qui a pour objet l'change entre deux pays
trangers et qui transporte dans chacun d'eux le superflu de l'autre.
Mais, bien qu'en thorie, il trouve l une production de beaucoup infrieure
celle de l'agriculture, il constate cependant qu'en fait, les profits de la culture n'ont
en ralit aucune supriorit sur ceux des autres emplois des capitaux. Aussi il
entreprend de rechercher, travers les sicles, par quelle suite de circonstances cet
ordre naturel s'est interverti, et il consacre cette tude de longues et intressantes
pages qui auraient fait le meilleur effet dans son Histoire de la Civilisation : c'est
l'objet du troisime livre tout entier.
Il expose d'abord les phnomnes qui auraient d se produire sous un rgime
d'entire libert. La subsistance tant, dit-il 1 , dans la nature des choses, un besoin
antrieur ceux de commodit et de luxe, l'industrie qui fournit au premier de ces
besoins doit ncessairement prcder celle qui s'occupe de satisfaire les autres. Par
consquent, la culture et l'amlioration de la campagne qui fournit la subsistance,
doivent ncessairement tre antrieures aux progrs de la ville qui ne fournit que
les choses de luxe et de commodit. En outre, c'est seulement le surplus du produit
de la campagne, c'est--dire l'excdent de la subsistance des travailleurs, qui
constitue la subsistance de la ville, et celle-ci ne doit, en consquence, se peupler
qu'autant que ce surplus de produit vient grossir. Enfin, cet ordre de choses est
fortifi encore par le penchant naturel des hommes, qui, galit de profits,
prfrent employer leurs capitaux la culture des terres, et si ce penchant n'avait
jamais t contrari par les institutions positives, nulle part les villes ne se seraient
accrues au del de la population que pouvait soutenir l'tat de culture et
d'amlioration du territoire dans lequel elles taient situes, au moins jusqu' ce
que la totalit de ce territoire et t pleinement cultive et amliore. Or, il n'en
a pas t ainsi, et Smith trouve dans l'histoire les causes de cette anomalie. Il
examine en effet comment l'agriculture fut dcourage, puis sous quelles
influences les villes se dvelopprent, et il montre enfin comment ce fut la
prosprit mme de l'industrie manufacturire qui ragit sur l'industrie agricole,
alors que, par l'effet naturel des lois conomiques, c'est la prosprit de la culture
qui aurait d provoquer le dveloppement des manufactures et du commerce.
Cette partie des Recherches est fort intressante et tmoigne d'un vritable
esprit philosophique comme de grandes connaissances techniques. L'auteur
attribue la perturbation qu'il signale trois sortes de causes 1 la constitution des
grands domaines forms lors de l'invasion des barbares et maintenus par les lois de
primogniture et les substitutions ; 2 aux modes de tenure des terres ; 3 l'action
1
Rich., liv. III, ch. I (t. I, p. 470).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
138
des gouvernements qui ont cherch favoriser l'industrie, au moyen de tout un
ensemble de rglementations qu'il a condamnes sous le nom de systme
mercantile.
Il n'est pas partisan des trop grands domaines, et s'il admet que des
considrations puissantes aient pu militer, au point de vue politique, en faveur de
cette concentration des terres, un moment o la proprit tait expose de toute
part aux ravages et aux incursions des voisins, il dplore vivement, au point de vue
conomique, la prolongation de cet tat de choses aprs la disparition des
circonstances qui l'avaient fait natre. Il considre en effet que le grand propritaire
se montre gnralement peu dispos aux amliorations, tandis que le petit
cultivateur, au contraire, est, de tous ceux qui font valoir, celui qui apporte le plus
d'intelligence dans son exploitation et qui obtient les meilleurs rsultats, car il
connat tous les recoins de son petit territoire, il les surveille avec cette attention
soigneuse qu'inspire la petite proprit, il se plat cultiver sa terre, et mme
l'embellir.
Ce n'est pas dire, cependant, qu'il condamne absolument les grands domaines,
quels qu'ils soient. Assurment la grande proprit n'est pas un mal en elle-mme
lorsqu'elle est le rsultat de la libert des transactions, parce que l'effet de la libert
est toujours, la longue, de faire passer les terres des mains des inhabiles ou des
ngligents dans les mains des plus capables ; mais il n'en tait pas ainsi sous le
rgime des substitutions et des lois de primogniture qui empchaient l'alination
et le morcellement des hritages.
De plus, il estime que les systmes d'amodiation de ces grandes proprits
taient galement funestes au dveloppement de l'agriculture. Ce fut d'abord par
des serfs attachs la glbe, que 1es seigneurs firent cultiver leurs vastes
domaines, mais ces serfs n'avaient aucun avantage accrotre la production et
n'taient stimuls aucun degr par l'intrt, personnel ; ils travaillaient donc mal
et la culture priclitait. Par la suppression du servage, un progrs fut cependant
ralis : les anciens serfs, rests sur les domaines, furent intresss
l'augmentation du revenu et partagrent le produit brut avec leurs matres. Ce fut l
l'origine du mtayage, mais le mtayage tait encore, selon Smith, un mode bien
imparfait de tenure des terres. Par la forme mme dans laquelle s'effectue le
partage du revenu territorial entre le propritaire et le mtayer, il a un vice inhrent
sa nature, c'est d'empcher la culture intensive, car le mtayer, qui a droit une
portion fixe du produit brut, ne cherche pas tirer de son champ le plus possible,
mais accrotre seulement le rapport entre le produit brut et les frais de
production.
M. H. Passy, dans l'article Agriculture du Dictionnaire de l'conomie politique,
l'a prouv depuis lors mathmatiquement, et nous ne pouvons mieux faire que de
citer cette dmonstration qui vient, rendre manifeste l'exactitude des observations
du matre : Le mtayage, dit H. Passy, a un vice radical, ds longtemps aperu
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
139
par Adam Smith : c'est la forme dans laquelle s'effectue le partage du revenu
territorial. En attribuant au propritaire pour prix de loyer une proportion fixe du
produit brut de l'exploitation, il exclut des cultures les vgtaux qui rclament les
plus grands frais de production ou ne leur y laisse pas une place suffisante, et par
l il arrte, les progrs de l'art et de la richesse agricoles... La raison en est simple.
Le mtayer paie en nature : ce qu'il doit, c'est une certaine proportion du produit
brut obtenu, et ds lors il a un intrt constant consulter, dans le choix des
rcoltes, non pas ce qu'elles peuvent laisser par hectare, les dpenses de culture
recouvres, mais le rapport tabli entre le montant des frais de production et la
valeur totale des rcoltes. Pour lui, les meilleures cultures sont celles qui
demandent peu d'avances, les plus mauvaises sont celles qui en demandent
beaucoup, quel que puisse tre le chiffre de l'excdent ralis. Supposez, par
exemple, un lieu o l'hectare cultiv en seigle exige 45 francs de frais de
production pour rendre 120 francs, et o le mme hectare, cultiv en froment,
exige 120 francs de frais pour rapporter 250 francs : un fermier n'hsitera pas
prfrer la culture du bl. Cest en numraire qu'il solde son fermage, et une
culture qui lui rendra net 130 francs vaudra pour lui beaucoup mieux qu'une
culture qui, superficie gale, ne lui en rendrait que 75. Un mtayer sera contraint
de calculer tout autrement. L'hectare en seigle, pour 45 francs, en donne 120, et la
moiti de la rcolte lui demeurant, cest 15 francs qu'il aura de bnfice ; l'hectare
en bl au contraire, cotant 120 francs pour en produire 250, ne lui laissera, vu ses
avances, pour sa moiti qui montera 125 francs, que 5 francs de rtribution : c'est
pour la culture du seigle qu'il optera. plus forte raison le mtayer s'abstiendra-t-il
de porter son travail sur les plantes qui, comme le lin, le chanvre, le colza, cotent
en frais de culture au-del de la moiti de la valeur du produit obtenu. Vainement
ces plantes, superficie pareille, donnent-elles les plus beaux rsultats, il ne lui
resterait rien aux mains, le partage achev avec le propritaire, et, s'il les faisait
entrer dans ses cultures, des pertes irrmdiables viendraient chtier son
imprvoyance.
Il y a donc incompatibilit entre le mtayage et la culture intensive, car, pour
que le mtayage ft juste et rmunrateur l'gard de celui qui cultive, il
ncessiterait un partage ingal au profit de ceux des mtayers qui ont plus de peine
et qui font des avances plus considrables. Aussi ces sortes de contrats avaient une
tendance bien manifeste appauvrir la terre : c'est ce qui fora les propritaires y
renoncer et permettre la culture un nouveau progrs par l'introduction du
fermage. C'est, en effet, le fermage qui est, pour Adam Smith, le mode le plus
conomique de tenure des terres, et l'auteur affirme que si on l'avait largement
pratiqu, il aurait pu remdier en partie aux vices de l'extension des domaines.
Mais les propritaires ne voulaient pas conclure des baux assez longs et donner
ainsi leurs fermiers la scurit ncessaire pour faire eux-mmes les
amliorations ; quant aux gouvernements, au lieu de favoriser la culture dont le
dveloppement devait leur profiter, ils l'accablaient de taxes et de redevances de
toute espce qui en comprimaient l'essor.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
140
Enfin on dcouragea mme l'agriculture, de parti-pris, pour ainsi dire, dans le
dessein de favoriser l'industrie et le commerce, et on imagina tout un ensemble de
mesures destines dtourner les capitaux de ce genre d'emploi vers lequel ils se
dirigeaient naturellement. C'est l'tude de cette rglementation qui constitue le
systme mercantile, que le clbre philosophe a consacr la plus grande partie de
son livre, et nous nous rservons de nous y arrter longuement dans les pages qui
vont suivre, en tudiant la doctrine des Recherches sur la circulation des richesses.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
141
Deuxime section.
Circulation des richesses.
Retour la table des matires
Les doctrines d'Adam Smith sur la circulation des richesses sont dissmines
dans tout le cours de ses Recherches, et l'ordre dans lequel il les a exposes,
quoique moins scientifique peut-tre, est beaucoup plus conforme en ralit la
nature des choses que les divisions abstraites que nous avons cru devoir adopter
pour exposer sans longueurs et discuter sommairement les diverses thories
contenues dans cet important ouvrage. Tout ce qu'on a dit en effet de la production
suppose des changes, changes de matires ou changes de services, et le principe
de la division du travail, par exemple, qu'on examine ds la premire page de tout
trait d'conomie politique, trouve son origine et son utilit dans les changes
incessants qui ont lieu entre les individus. Nous avons tenu nanmoins tablir un
groupement particulier, afin d'tre aussi bref que possible : ce sera notre excuse.
Le point de dpart de toute tude de la circulation doit tre une bonne
dfinition de la valeur. En effet, l'change s'exerce sur celles des utilits qui
existent en quantit limite et qui sont susceptibles d'tre appropries ; ces
richesses sont les seules qui soient des valeurs.
Il ne faut donc pas confondre ce qu'on appelle la valeur en usage avec la valeur
en change ou valeur proprement dite. Le premier de ces termes s'applique la
simple utilit et indique le rapport existant entre les choses et nos besoins ; le
second dsigne le rapport qui existe entre les richesses elles-mmes s'changeant
les unes contre les autres. Cette distinction pralable des deux sens du mot valeur a
t trs heureuse, parce qu'elle a vit bien des confusions. Or c'est Adam Smith
qu'on la doit et si le clbre conomiste ne lui a pas donn immdiatement toute la
rigueur dsirable, il a eu au moins le mrite de dfinir nettement ces deux
significations du mme mot et de doter la science de deux termes diffrents que les
conomistes modernes se sont depuis lors accords maintenir. Il faut observer,
dit-il 1 , que le mot valeur a deux significations diffrentes ; quelquefois il signifie
l'utilit d'un objet particulier, et quelquefois il signifie la facult que donne la
possession de cet objet d'acheter d'autres marchandises. On peut appeler l'une
valeur en usage, et l'autre, valeur en change. Des choses qui ont la plus grande
valeur en usage n'ont souvent que peu ou point de valeur en change ; et au
contraire, celles qui ont la plus grande valeur en change, n'ont souvent que peu ou
1
Rich., liv. I, ch. IV (t. I, p. 35).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
142
point de valeur en usage. Il n'y a rien de plus, utile que l'eau, mais elle ne peut
presque rien acheter ; peine y a-t-il moyen de rien avoir en change. Un diamant,
au contraire, n'a presque aucune valeur quant l'usage, mais on trouvera
frquemment l'changer contre une trs grande quantit d'autres marchandises.
Adam Smith a, par l mme, clair dun jour tout nouveau les lois de la
circulation. Mais sa thorie de la valeur n'en est pas moins empreinte d'une
certaine obscurit, et il s'en est d'ailleurs parfaitement rendu compte. Je tcherai
de traiter, dit-il, ces trois points avec toute l'tendue et la clart possibles, dans les
trois chapitres suivants pour lesquels je demande bien instamment la patience et
l'attention du lecteur : sa patience, pour me suivre dans des dtails qui, en quelques
endroits, lui paratront peut-tre ennuyeux ; et son attention, pour comprendre ce
qui semblera peut-tre quelque peu obscur, malgr tous les efforts que je ferai pour
tre intelligible. Je courrai volontiers le risque d'tre trop long, pour chercher me
rendre clair ; et, aprs que j'aurai pris toute la peine dont je suis capable pour
rpandre de la clart sur un sujet qui, par sa nature, est aussi abstrait, je ne serai pas
encore sr qu'il n'y reste quelque obscurit. Smith a t long, en effet, mais il n'a
pu tre clair, et, malgr les qualits remarquables et les observations ingnieuses
que dnote cette tude, on n'y retrouve pas ce mode d'exposition lumineuse des
phnomnes et des causes qu'on a pu apprcier par exemple, dans son chapitre sur
la division du travail.
C'est que le clbre conomiste est parti, en ralit, d'une fausse conception de
la valeur, car, aprs avoir tabli avec raison que le travail en est l'origine et le
principe, il a voulu dmontrer en outre qu'il en est galement la mesure rigoureuse.
La valeur d'une denre quelconque, dit-il en effet 1 , pour celui qui la possde et
qui n'entend pas en user ou la consommer lui-mme, mais qui a l'intention de
l'changer pour autre chose, est gale la quantit de travail que cette denre le
met en tat d'acheter ou de commander. Le travail est donc la mesure relle de la
valeur changeable de toute marchandise. Et plus loin : Le travail est la seule
mesure universelle, aussi bien que la seule exacte, des valeurs, le seul talon qui
puisse nous servir comparer les valeurs de diffrentes marchandises toutes les
poques et dans tous les lieux 2 .
Cette thorie a t chaudement dfendue par Germain Garnier, mais elle n'en
est pas moins errone. Elle repose, il est vrai, sur une observation juste, savoir
que la valeur a son principe dans le travail, dans l'action de l'homme sur les
choses ; il est galement exact que la valeur de chaque marchandise est limite par
le travail que l'acqureur devrait effectuer lui-mme pour la produire ou pour
l'obtenir par un autre change ; mais il ne rsulte nullement de l que le travail soit,
comme le prtend l'auteur, la mesure relle de toute marchandise, l'talon des
valeurs, la commune mesure de la valeur des produits dans tous les temps et dans
tous les lieux.
1
2
Rich., liv. I, ch. V (t. I, p. 38).
Rich., liv. I, ch. V (t. I, p. 47).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
143
Il ne peut pas y avoir de mesure invariable des valeurs, pas plus le bl propos
par J.-B. Say, que le travail prconis par Adam Smith. La mesure des valeurs, en
effet, ne pourrait tre qu'une unit de mme nature, c'est--dire une valeur ; or,
toute valeur est mobile par dfinition, puisqu'elle consiste dans un rapport entre
deux objets ; elle ne peut donc tre une mesure fixe. D'ailleurs, aucun gard, le
travail de l'homme ne peut tre considr comme un fait invariable : la force
physique varie suivant les individus, et surtout suivant la race, les professions, les
modes d'alimentation ; l'adresse professionnelle, qui dirige la force physique, varie
encore davantage, et les instruments qui donnent au travail toute sa puissance, sont
aussi bien diffrents selon les lieux et les poques. Il n'en est pas de deux hommes
comme de deux machines qui peuvent fournir exactement le mme produit dans le
mme laps de temps, et on aura beau choisir avec soin deux individus, ils n'auront
pas tous deux identiquement la mme force musculaire, la mme dextrit ; leur
produit ne sera donc pas le mme, alors qu'ils feraient un effort gal.
Mais c'est au point de vue de l'invariabilit du sacrifice que se sont placs les
dfenseurs de la doctrine de Smith. Le salaire d'un ouvrier dans l'Inde, dit
Germain Garnier dans la Prface de sa traduction des Recherches, n'est peut-tre
qu'un cinquime de ce que reoit un ouvrier Paris pour la mme quantit de
travail ; cependant l'Indien comme le Parisien ont fourni, dans l'espace d'une
journe, la mme quantit de leur temps, de leur force, de leur repos et de leur
libert. Le travail est beaucoup plus productif dans une socit civilise et
industrieuse que dans une socit naissante et peu avance, c'est--dire que dans la
premire de ces socits, celui qui emploie l'ouvrier et qui paie son travail en retire
des produits plus abondants et d'une plus grande valeur ; mais, dans ces deux tats
de la socit, ce que donne l'ouvrier est toujours, quant lui, la mme valeur ; c'est
toujours un sacrifice pareil de son temps et de sa libert ; c'est toujours l'emploi de
sa force l'ouvrage quelconque qui lui a t command. C'est l un aspect moral
tout autre assurment que celui que l'auteur a d envisager ici. Quoi qu'il en soit, il
n'en rsulte nullement que ces deux hommes, qui ont donn le mme effort, aient
produit la mme valeur.
Pour nous, il n'existe pas de commune mesure des valeurs ; si la valeur se rgle
sur les frais de production, c'est nanmoins la loi de l'offre et de la demande qui
seule la dtermine. Dans l'offre, il ne faut pas mme se contenter de comprendre la
quantit de marchandises qui se trouve sur le march, il est ncessaire de faire
entrer aussi en ligne de compte l'intensit du dsir que le vendeur a de se
dbarrasser de son produit, ses embarras financiers, ses inquitudes pour l'avenir.
Et de mme, dans la demande, il faut comprendre non seulement la quantit de
marchandises demande, mais encore l'intensit du dsir, qu'en ont les acheteurs.
Cette influence des lments moraux ne doit pas tre nglige ; elle a une
importance considrable dans la spculation, et c'est elle seule qui peut expliquer
pourquoi, dans les mauvaises annes, le prix du bl augmente beaucoup plus que
ne parat le comporter la faiblesse de l'cart entre la quantit produite et la quantit
ncessaire : c'est que, comme il n'y a pas un approvisionnement suffisant, chacun
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
144
se prcipite au march et consent ainsi passer par les exigences des vendeurs,
dans la crainte de manquer de la denre dont il a besoin.
Smith, d'ailleurs, a compris lui-mme l'inexactitude de sa thorie en constatant
son impuissance dduire les phnomnes de la circulation, et il a d faire des
rserves qui en attnuent considrablement la porte. Quoique le travail, dit-il 1 ,
soit la mesure relle de la valeur changeable de toutes les marchandises, ce n'est
pourtant pas celle qui sert communment apprcier cette valeur. Il est souvent
difficile de fixer la proportion entre deux quantits de travail. Cette proportion, ne
se dtermine pas toujours seulement par le temps qu'on a mis deux diffrentes
sortes d'ouvrages, il faut aussi tenir compte des diffrents degrs de fatigue qu'on a
endurs et de l'habilet qu'il a fallu dployer. Il peut y avoir plus de travail dans
une heure d'ouvrage que dans deux heures de besogne aise, ou dans une heure
d'application un mtier qui a cot dix annes de travail apprendre, que dans un
mois d'occupation d'un genre ordinaire et laquelle tout le monde est propre. Or, il
n'est pas ais de trouver une mesure exacte applicable au travail ou au talent. Dans
le fait, on tient pourtant compte de l'un et de lautre quand on change entre elles
les productions de deux diffrents genres de travail. Toutefois, ce compte-l n'est
rgl sur aucune balance exacte ; c'est en marchandant et en dbattant les prix du
march qu'il s'tablit, d'aprs cette grosse quit qui, sans tre fort exacte, l'est bien
assez pour le train des affaires communes de la vie.
Smith a donc t forc de reconnatre, en fait, la loi de l'offre et de la demande
comme rgulatrice de la valeur : cette conclusion pratique tait fatale. Il n'y a pas,
en effet, de valeur absolue ; la valeur consiste, suivant la remarquable formule de
Bastiat, dans le rapport de deux services changs, et un rapport est
essentiellement relatif. Mais il ne s'ensuit nullement que les fluctuations de la
valeur n'aient aucune limite : la loi de loffre et de la demande est elle-mme
domine par une autre loi suprieure qui borne l'tendue de ces variations et les
maintient autour d'un point central reprsentant le travail dpens pour la
production des marchandises. Aussi nous ne pouvons qu'admirer, sans rserve, les
pages remarquables o l'auteur a mis cette loi en lumire dans son intressante
tude sur le prix des marchandises.
Le prix est l'expression de la valeur d'une marchandise lorsque la monnaie sert
de terme de comparaison Le prix actuel, auquel la marchandise se vend
communment est, selon Smith, ce qu'on appelle son prix de march ; il est
dtermin par l'offre et la demande effectives, et, par suite, minemment variable
suivant l'tat de la place ; il gravite ainsi autour d'un point central dont il ne peut
s'carter longtemps et qui constitue le prix naturel.
Lorsque le prix d'une marchandise, dit le clbre conomiste 2 , n'est ni plus,
ni moins que ce qu'il faut pour payer, suivant leurs taux naturels, et le fermage de
1
2
Rich., liv. I, ch. V (t. I, p. 39).
Rich., liv. I. ch. II t. I, p. 74).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
145
la terre, et les salaires du travail, et les profits du capital employ produire, cette
denre, la prparer et la conduire au march, alors cette marchandise est vendue ce
que l'on peut appeler son prix naturel... Diffrentes circonstances accidentelles
peuvent quelquefois tenir les prix de march un certain temps levs, au-dessus du
prix naturel, et quelquefois les forcer descendre un peu au-dessous de ce prix.
Mais quels que soient les obstacles, qui les empchent de se fixer dans ce centre de
repos et de permanence, ils ne tendent pas moins constamment vers lui.
Cette observation est fort exacte et trs bien prsente, et c'est elle qui a donn
Stuart Mill l'ide de sa comparaison ingnieuse des oscillations de la valeur
courante aux agitations des flots : L'Ocan tend partout prendre son niveau,
mais jamais il ne le garde exactement ; sa surface est toujours ride par les vagues
et souvent remue par les temptes. Seulement il n'est aucun point en pleine mer
qui soit plus lev que le point qui le touche ; chaque point s'lve et s'abaisse
alternativement, mais la mer garde son niveau.
Smith considre en effet, comme Stuart Mill, que ces fluctuations sont, en
gnral, de courte dure. Mais, aprs avoir pos ce principe, il s'empresse
nanmoins de faire des rserves et il signale toute une srie de causes qui, l'gard
de diverses marchandises, parviennent tenir longtemps le prix du march audessus du prix naturel. Il y a des causes accidentelles, comme les secrets de
fabrique, qui, permettant l'industriel de diminuer ses frais, le font bnficier, au
moins pendant un certain temps, de tout le montant de cette rduction, puisque le
prix de revient de ses concurrents continue tre le rgulateur du march. Il y a
aussi des causes naturelles : diverses productions agricoles, par exemple, exigent
un sol particulier ou une exposition spciale, comme il arrive pour certains
vignobles de la Bourgogne et du Bordelais, et il en rsulte parfois que les terres de
cette nature ne suffisent pas pour rpondre la demande effective. Enfin, il en est
de mme des monopoles artificiels tablis par l'arbitraire du lgislateur, attendu
que les individus ou les compagnies de commerce, qui en sont investis, tiennent le
march mal approvisionn et ne rpondent jamais pleinement la demande, pour
arriver ainsi vendre leurs marchandises fort au-dessus du prix naturel : tel tait
l'effet des privilges exclusifs des corporations, des statuts d'apprentissage et de
tous ces rglements multiples qui, au temps de Smith, restreignaient la concurrence
un petit nombre de producteurs.
Toutefois ces exceptions n'infirment nullement le principe, et, en rgle
gnrale, le prix du march ne peut s'loigner sensiblement du prix naturel sans
provoquer une raction. Si le prix courant d'une marchandise reste trop longtemps
au-dessous de ce prix naturel, les producteurs, vendant perte, retireront de ce
genre d'emploi soit une partie de leurs terres, soit une partie de leur capital ou de
leur travail ; si, au contraire, il reste au dessus, si ce genre d'emploi prsente des
avantages, les capitaux afflueront bien vite, et, dans les deux cas, l'quilibre sera
rtabli. Dans la ralit, il est vrai, cette raction ne se produira pas immdiatement,
car bien des causes s'opposent un rapide dplacement des capitaux et du travail,
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
146
et surtout un brusque changement dans la destination des terres ; mais, lorsque
l'cart persiste, cet effet n'en est pas moins fatal et Smith a eu le mrite de le
dmontrer clairement.
Nous venons de prjuger la question de la monnaie dans cette tude des prix : il
est temps maintenant de faire connatre la doctrine des Recherches sur cet
important sujet.
Smith a esquiss d'une faon fort intressante les origines de la monnaie. Ds
que la division du travail, qui apparat au dbut de toute civilisation, et chang les
conditions de la production, chaque individu ne produisit plus qu'une trs-petite
partie des objets ncessaires ses besoins et il n'obtint le reste que par change du
surplus de ses produits contre le surplus des produits des autres. Le troc en nature
ne pouvait donc subsister : il et donn lieu, dans la pratique, des difficults de
tous les instants, des impossibilits mme, en forant chaque producteur
rechercher un autre producteur qui pt lui fournir la denre ncessaire sa
consommation et qui et prcisment besoin au mme moment de la denre qu'il
avait offrir en paiement. Tout homme prvoyant dut donc naturellement chercher
tre pourvu, dans tous les temps, en outre du produit de sa propre industrie, d'une
certaine quantit de marchandise qui ft de nature convenir beaucoup de
monde et au moyen de laquelle il ft assur de se procurer les choses qui
deviendraient ncessaires. Cette marchandise fut, suivant les pays, le btail, le sel,
la morue sche, le tabac, le sucre ; mais ce furent l'or et largent qu'on choist
gnralement pour cet usage, parce qu'ils sont trs homognes, identiques euxmmes, peu prs inaltrables, facilement divisibles et peu susceptibles de dchet,
qu'ils sont trs portatifs, qu'ils ont une grande valeur intrinsque sous un faible
volume, et surtout parce que leur valeur est peu sujette des variations subites.
Bientt mme, pour viter de peser, lors de chaque change, les mtaux donns
comme prix, et surtout pour ne pas avoir les prouver, ce qui tait une opration
fort difficile, on en arriva l'institution du coin, dont l'empreinte, couvrant
entirement les deux cts de la pice et quelquefois aussi la tranche, certifia non
seulement le titre, mais encore le poids du mtal.
C'est ainsi que Smith expose l'origine de la monnaie, et, par cet historique
mme, il rduit nant le systme mercantile qui considre que toute la richesse
consiste dans le numraire, en mme temps que les thories de ceux qui, tombant
dans l'excs oppos, ne veulent voir dans les espces mtalliques qu'un pur signe.
Comme l'a fort bien dmontr le clbre conomiste, les mtaux prcieux sont une
marchandise comme les autres, qui a t choisie comme instrument gnral des
changes cause de ses qualits particulires, mais qui n'en est pas moins soumise
aux lois qui rgissent l'change : ce n'est pas seulement une mesure de la valeur de
la marchandise change, c'en est encore un quivalent rel. La seule monnaie qui
ne possde pas sa valeur en elle-mme est le billon, employ pour les paiements
minimes parce qu'on n'a pu trouver une denre qui, sous un faible volume, ait une
valeur intrinsque gale la valeur nominale qu'on voulait lui donner ; et
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
147
d'ailleurs, cette exception mme a peu d'importance, car il ne s'agit que d'une
monnaie d'appoint dont les dbiteurs ne peuvent gnraliser lusage. D'autre part,
si la monnaie est une marchandise, elle n'est pas la seule marchandise qui possde
une valeur ; elle sert comparer la valeur des diverses denres, elle ne la constitue
pas, et l'auteur a montr comment la valeur existe indpendamment de toute
monnaie servant l'exprimer.
En ce qui concerne l'intervention de l'tat dans la fabrication de la monnaie, le
Dr Smith constate que l'ingrence du souverain dans la frappe a servi gnralement
de prtexte des altrations des mtaux ; il s'indigne en signalant la cupidit et
l'injustice des gouvernements qui, abusant de la confiance des sujets, ont rduit la
quantit de mtal des monnaies pour masquer une banqueroute l'gard de leurs
propres cranciers, sans mme se proccuper des perturbations apportes dans la
richesse publique par une aussi inique mesure qui permettait aux dbiteurs
d'acquitter leurs dettes en monnaie amoindrie. Nanmoins ces abus funestes et trop
frquents dans l'histoire des nations, ne l'ont nullement empch de reconnatre la
lgitimit et la ncessit mme de l'intervention de l'tat dans la frappe des
monnaies, et il aurait vivement combattu ceux qui, de nos, jours, ont voulu livrer
cette fabrication sans contrle au libre jeu de la concurrence, sous le prtexte
d'obtenir des monnaies mieux faites ou meilleur march : pour que la monnaie
soit un instrument commode, il ne faut pas que sa valeur puisse tre mise en doute
et qu chaque transaction il faille avoir la balance et la pierre de touche la main.
Smith a reconnu encore un autre rle l'tat en ce qui concerne la monnaie :
c'est de choisir celui des deux mtaux prcieux qui doit servir d'talon dans les
changes, puis de dterminer le rapport lgal qui doit lier ce mtal l'autre. Je
pense, dit-il 1 , que, dans tous les pays, les offres lgales de payement ne purent tre
faites, l'origine, que dans la monnaie seulement du mtal adopt particulirement
pour signe ou mesure des valeurs. En Angleterre, l'or ne fut pas regard comme
monnaie lgale, mme longtemps aprs qu'on y eut frapp des monnaies d'or.
Aucune loi ou proclamation publique n'y fixait la proportion entre l'or et l'argent ;
on laissait au march la dterminer. Si un dbiteur faisait ses offres en or, le
crancier avait le droit de les refuser tout fait, ou bien de les accepter d'aprs une
valuation de l'or faite l'amiable entre lui et son dbiteur Dans cet tat de
choses, la distinction entre le mtal qui tait rput signe lgal des valeurs et celui
qui n'tait pas rput tel, tait quelque chose de plus qu'une distinction nominale.
Dans la suite des temps, et lorsque le peuple se ft familiaris par degrs avec
l'usage des monnaies de diffrents mtaux et que, par consquent, il connt mieux
le rapport existant entre leur valeur respective, la plupart des nations, je pense, ont
jug convenable de fixer authentiquement le rapport de cette valeur et de dclarer,
par un acte public de la loi, qu'une guine, par exemple, de tel poids et tel titre,
s'changerait contre 21 schellings ou bien serait une offre valable pour une dette de
cette somme. Dans cet tat de choses, et tant que dure le rapport tabli de cette
1
Rich., liv. I, ch. V (t. I, p. 51).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
148
manire, la distinction entre le mtal signe lgal et le mtal qui ne l'est pas n'est
plus gure qu'une distinction nominale.
Toutefois le Dr Smith n'est pas trs net sur cette question montaire qui partage
d'ailleurs de nos jours les meilleurs conomistes, et, aprs avoir tudi avec tant de
soin, dans cet ouvrage mme, les variations diverses de la valeur de l'or et de
l'argent aux diffrents sicles, il n'a pas fait sentir assez clairement les
inconvnients d'un rapport fixe invariable entre les deux instruments de l'change.
Il a reconnu cependant qu'il serait ncessaire de faire quelque changement au
rapport actuellement tabli entre ces deux mtaux , mais il n'a appuy, pour ainsi
dire, sur aucun argument doctrinal la ncessit de cette rforme. On est mme
forc de remarquer qu'il n'a pas saisi les vritables effets d'une pareille institution,
lorsqu'il affirme que, dans la ralit, tant que dure le rapport lgalement tabli
entre la valeur respective des diffrents mtaux monnays, la valeur du plus
prcieux de ces mtaux rgle la valeur de la totalit de la monnaie. Cette
observation n'est pas exacte. Sous ce rgime, en effet, la valeur de l'argent ne se
rgle pas sur celle de l'or, mais le rapport devient purement fictif : tous les
dbiteurs payant avec le mtal le moins cher, quel qu'il soit, l'autre mtal se trouve
ainsi chass de la circulation pour tre export avec bnfice, et l'tat est, alors
conduit prendre des mesures exceptionnelles pour entraver ce drainage. C'est ce
que Smith n'a pas signal : cependant l'effet ne lui a pas chapp, mais, malgr sa
perspicacit habituelle, il n'a pas su le rapporter sa vritable cause, qui est le
rapport invariable tabli entre les deux mtaux.
Smith avait suivi pourtant d'une faon fort remarquable l'histoire des variations
de la valeur de l'argent aux quatre derniers sicles, dans une digression clbre qui
est venue malheureusement se placer au milieu d'une discussion dlicate sur la
rente de la terre. Il en a donn une tude trs intressante, bien que, depuis lors,
elle ait t distance de beaucoup par les travaux de lord Liverpool, Humboldt et
Michel Chevallier : elle constituait pour l'poque un essai fort curieux, trs
apprci pour la largeur des aperus et l'abondance des dtails.
Le clbre conomiste ramenait trois cas les diverses combinaisons de
circonstances qui influent sur la valeur de l'argent : 1 si la richesse gnrale
augmente sans un accroissement simultan de la production du mtal, la valeur de
l'argent augmente parce que la demande s'accrot ; 2 si l'accroissement de la
richesse et, par suite, de la demande, n'est pas plus rapide que l'accroissement de la
production du mtal, la valeur de l'argent reste stationnaire ; 3 enfin, si
l'approvisionnement vient s'accrotre par suite de quelque vnement imprvu et
pendant plusieurs annes de suite dans une proportion beaucoup plus forte que la
richesse et la demande, le mtal se dprcie et le prix des subsistances hausse
d'autant. Tels sont les motifs gnraux des variations de la valeur de l'argent, car
cette valeur est soumise, comme toute autre marchandise, la grande loi de l'offre
et de la demande.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
149
Mais d'autres causes particulires viennent nanmoins modifier ces rapports
mmes de l'offre et de la demande. C'est notamment la rapidit de la circulation
montaire et surtout l'emploi des valeurs fiduciaires qui rduisent dans des
proportions considrables le rle des espces mtalliques. L'argent n'est rond que
pour rouler , dit un dicton populaire, et, de nos jours o le numraire ne reste
jamais en place, o chacun ne garde par devers soi que les sommes strictement
ncessaires des besoins imprvus et subits, la rapidit de la circulation est porte
un degr tel que la mme pice de monnaie intervient dans mille changes dans
le mme temps qu'elle mettait, il y a trois sicles, faciliter vingt transactions.
En outre, une tendance commune tous les peuples est de chercher
restreindre autant que possible l'emploi des mtaux prcieux comme instruments
d'change, car, ainsi que le fait remarquer Adam Smith, c'est la seule partie du
capital circulant dont l'entretien puisse occasionner en ralit quelque diminution
dans le revenu net de la socit. Non seulement ils s'usent en circulant et causent
par l mme la nation une perte assez sensible, mais leur acquisition, celle de l'or
notamment, demande de grandes quantits de travail et des capitaux importants qui
pourraient tre employs plus utilement d'autres productions. Aussi, au moyen de
la substitution du papier aux espces mtalliques on a voulu remplacer autant que
possible le numraire par un instrument d'change moins cher, bien que parfois
plus commode, et si Smith a pu dire que l'argent est la grande roue de la
circulation , il a ajout aussitt que le papier en est une nouvelle roue qui cote
bien moins fabriquer et entretenir que l'ancienne.
L'minent philosophe dveloppe alors sa thorie de la circulation fiduciaire qui
est une des plus belles de son uvre et qui est remplie des plus utiles
enseignements. Il y examine avec attention le rle respectif des deux roues et les
rapports qui doivent s'tablir entre elles.
Il y a plusieurs sortes de papier-monnaie, dit-il 1 , mais les billets circulants
des banques et des banquiers sont l'espce qui est la mieux connue et qui parat la
plus propre remplir ce but. Lorsque les gens d'un pays ont assez de confiance
dans la fortune, la probit et la sagesse d'un banquier pour le croire toujours en tat
d'acquitter comptant et vue ses billets et engagements, en quelque quantit qu'il
puisse s'en prsenter la fois, alors ces billets finissent par avoir le mme cours
que la monnaie d'or et d'argent, en raison de la certitude qu'on a d'en faire de
l'argent tout moment. Un banquier prte aux personnes de sa connaissance ses
propres billets, jusqu' concurrence, je suppose, de 100.000 livres. Ces billets
faisant partout les fonctions de largent, les emprunteurs lui en paient le mme
intrt que s'il leur et prt la mme somme en argent. C'est cet intrt qui est la
source de son gain. Quoique sans cesse il y ait quelques-uns de ces billets qui lui
reviennent pour le paiement, il y en a toujours une partie qui continue de circuler
pendant des mois et des annes de suite. Ainsi, quoiqu'il ait, en gnral, des billets
1
Rich., liv., II, ch. II (t. I, p, 353.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
150
en circulation jusqu' concurrence de 100.000 livres, cependant 20.000 livres en or
et argent se trouvent faire souvent un fonds suffisant pour rpondre aux demandes
qui peuvent survenir. Par consquent, au moyen de cette opration, 20.000 livres
en or et argent font absolument la fonction de 100.000. Les mmes changes
peuvent se faire, la mme quantit de choses consommables peut tre mise en
circulation et tre distribue aux consommateurs auxquels elle doit parvenir, par le
moyen des billets de ce banquier, montant 100.000 livres, tout comme cela se
serait fait avec la mme valeur en monnaie d'or et d'argent. On peut donc, de cette
manire, faire une conomie de 80.000 livres sur la circulation du pays, et si, en
mme temps, diffrentes oprations du mme genre venaient s'tablir par
plusieurs banques et banquiers diffrents, la totalit de la circulation pourrait ainsi
tre servie avec la cinquime partie seulement de l'or et de l'argent qu'elle aurait
exigs sans cela.
Adam Smith expose ainsi d'une faon fort exacte le rle du papier-monnaie et
l'heureuse influence de cette substitution partielle du papier au numraire. Pour
l'avenir, il dispense d'affecter la production de l'or et de l'argent des quantits de
travail et de capital de plus en plus considrables au fur et mesure de
l'accroissement des changes ; pour le prsent, les avantages s'en font sentir avec
plus de force encore, car le billet de banque, en chassant au dehors une grande
partie des mtaux prcieux, provoque par l mme une importation correspondante
de marchandises trangres qui viennent s'employer soit la reproduction, soit
accrotre nos jouissances.
Comme le montre fort bien l'minent philosophe, la valeur de la grande roue de
circulation et de distribution est ajoute elle-mme la masse des marchandises
qui circulaient et se distribuaient par son moyen, et il compare avec justesse cette
opration celle de l'entrepreneur dune grande fabrique, qui, par suite de quelque
heureuse dcouverte en mcanique, rforme les anciennes machines et profite de la
diffrence qui existe entre leur prix et celui des nouvelles pour l'ajouter son
capital circulant, la masse o il puise de quoi fournir ses ouvriers des matriaux
et des salaires. Cette portion du capital, dit-il 1 , qu'un marchand est oblig de
garder par devers lui, en espces sonnantes, pour faire face aux demandes qui
surviennent, est un fonds mort qui, tant qu'il reste dans cet tat, ne produit rien
pour lui ni pour le pays. Les oprations d'une banque sage le mettent porte de
convertir ce fonds mort en un fonds actif et productif, en matires propres
exercer le travail, en outils pour le faciliter et l'abrger, et en vivres et subsistances
pour le salarier ; en capital enfin, qui produira quelque chose pour ce marchand et
pour son pays. La monnaie, d'or et d'argent qui circule dans un pays, et par le
moyen de laquelle le produit des terres et du travail de ce pays est annuellement
mis en circulation et distribu aux consommateurs auxquels il appartient, est aussi,
tout comme l'argent comptant du ngociant, un fonds mort en totalit. C'est une
partie trs prcieuse du capital du pays, qui n'est point productive. Les oprations
1
Rich., liv. II, ch. II (t. I, p. 391 et suiv.).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
151
d'une banque sage, en substituant du papier la place d'une grande partie de cet or
et de cet argent, donnent le moyen de convertir une grande partie de ce fonds mort
en un fonds actif et productif, en un capital qui produira quelque chose au pays.
L'or et l'argent qui circulent dans un pays peuvent se comparer prcisment un
grand chemin qui, tout en servant faire circuler et conduire au march tous les
grains et les fourrages du pays, ne produit pourtant par lui-mme ni un seul grain
de bl ni un seul brin d'herbe. Les oprations d'une banque sage, en ouvrant en
quelque manire, si j'ose me permettre une mtaphore aussi hardie, une espce de
grand chemin dans les airs, donnent au pays la facilit de convertir une bonne
partie de ces grandes routes en bons pturages et en bonnes terres bl, et
d'augmenter par l, d'une manire trs considrable, le produit annuel de ses terres
et de son travail.
Outre cet expos lumineux du rle fcondant du papier-monnaie, le Dr Smith a
donn aussi, en termes fort exacts, la thorie et le mcanisme des banques de
circulation. Il a pris ses exemples dans les banques d'cosse qu'il avait pu tudier
loisir, et il a dvelopp, dans cette tude remarquable, des ides la fois librales
et sages qui font le plus grand honneur sa perspicacit et son jugement.
Le spectacle qu'il avait eu sous les yeux dans son pays l'avait rendu favorable
au principe de la libert des banques, mais, il insiste peu sur ce point qui a fait,
depuis lors, l'objet de tant de controverses. La seule rserve qu'il croie ncessaire
de faire ce principe, a trait la prohibition des trop petites coupures dont l'usage
tendrait chasser compltement le numraire de la circulation ; mais, part cette
restriction, il estime que lon peut, aprs cela, sans craindre de compromettre la
sret gnrale, laisser ce commerce, tous autres gards, la plus grande libert
possible. Il considre mme que la multiplicit des banques, loin de diminuer les
garanties du public, ne fait que les accrotre en forant les tablissements la
prudence pour arriver prvenir ce reflux du papier que leur suscite
malicieusement, dit-il, la rivalit de tant de concurrents toujours prts leur nuire.
Elle circonscrit, en outre, ajoute-t-il, la circulation de chaque compagnie
particulire dans un cercle plus troit et elle restreint ses billets circulants un plus
petit nombre. En tenant ainsi la circulation divise en plus de branches diffrentes,
elle fait que la faillite de l'une de ces compagnies, vnement qui doit arriver
quelquefois dans le cours ordinaire des choses, devient un accident d'une moins
dangereuse consquence pour le public. Cette libre concurrence oblige aussi les
banquiers traiter avec leurs correspondants d'une manire plus librale et plus
facile, de peur que leurs rivaux ne les leur enlvent. En gnral, ds qu'une branche
du commerce ou une division du travail quelconque est avantageuse au public, elle
le sera toujours d'autant plus que la concurrence y sera plus librement et plus
gnralement tablie. Le succs croissant des banques d'cosse, sous le rgime
de la libert, a donn raison au penseur de Kirkaldy, et, en 1826, ces
tablissements constataient avec orgueil que, dans l'espace de plus d'un sicle, les
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
152
faillites des banques cossaises avaient peine fait perdre au public la modique
somme de 36.000 livres 1 .
Dans toute cette tude, Adam Smith fait preuve constamment des principes les
plus libraux et il se garde avec soin des formules autoritaires. Ainsi, il ne veut pas
mme prendre sur lui de fixer le rapport qu'il est bon d'tablir entre le montant des
billets et le chiffre de l'encaisse mtallique, et bien que, dans ses calculs, il prenne
gnralement pour exemple une encaisse mtallique du cinquime, il ne dtermine
d'une manire absolue aucune proportion. Il a parfaitement senti qu'il ne peut y
avoir de rgle unique cet gard et que tout dpend des murs du pays, des
habitudes commerciales, de la clientle mme des banques. Dans un pays sujet aux
paniques, ces tablissements devront conserver constamment une forte encaisse
pour parer toutes les demandes de remboursement, et la mme circonspection
sera commande dans les villes qui se livrent au commerce international, parce que
la clientle peut avoir besoin subitement d'une grosse somme d'espces pour
l'exportation. Mais l'encaisse ncessaire ne sera pas aussi forte dans les autres
contres, et les banques apprennent d'elles-mmes exprimentalement quel doit en
tre le montant. Si une banque nouvelle, qui a besoin d'attirer la confiance et
d'tudier les habitudes de ses clients, est oblige une grande circonspection, elle
pourra bien vite se rendre compte elle-mme de la proportion qu'il convient
d'observer entre ses billets et son encaisse, de mme qu'elle s'assurera rapidement
de la limite maximum que pourront atteindre ses missions.
ce dernier point de vue aussi, le clbre conomiste a parfaitement dmontr
qu'en fait il existe galement une limite infranchissable qui arrte les missions de
billets trop considrables. La masse totale de papier-monnaie de toute espce,
dit-il 2 , qui peut circuler sans inconvnient dans un pays, ne peut jamais excder la
valeur de la monnaie d'or et d'argent dont ce papier tient la place, ou qui y
circulerait (de commerce tant suppos le mme) s'il n'y avait pas de papiermonnaie. Si les billets de 20 schellings, par exemple, sont le plus petit papiermonnaie qui ait cours en cosse, la somme totale de ce papier qui pourrait y
circuler sans inconvnient ne peut pas excder la somme d'or et d'argent qui serait
ncessaire pour consommer tous les changes de la valeur de 20 schellings et audessus qui avaient coutume de se faire annuellement dans le pays. S'il arrivait une
fois que le papier en circulation excdt cette somme, comme l'excdant ne
pourrait ni tre envoy au dehors ni rester employ dans la circulation intrieure, il
reviendrait immdiatement aux banques pour y tre chang en or ou en argent.
Beaucoup de gens s'apercevraient bien vite qu'ils ont plus de ce papier que nen
exigent les affaires qu'ils ont solder au dedans, et, ne pouvant le placer au dehors,
ils iraient aussitt en demander aux banques le remboursement. Ce papier
surabondant tant une fois converti en argent, ils trouveraient aisment s'en servir
en l'envoyant au dehors, mais ils ne pourraient rien en faire tant qu'il resterait sous
1
Cf. Courcelle-Seneuil. Trait thorique et pratique des oprations de banque, liv. IV, ch. I, p.
290.
Rich., liv. II, ch. II (t. I, p. 364).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
153
cette forme de papier. Il se ferait donc l'instant un reflux de papier sur les
banques, jusqu' concurrence de cette surabondance, et mme jusqu' une somme
encore plus forte pour peu que le remboursement prouvt de la lenteur ou de la
difficult ; l'alarme qui en rsulterait augmenterait ncessairement les demandes de
remboursement. On voudrait pouvoir citer en entier ces considrations
remarquables qui dnotent des observations profondes sur cette dlicate matire, et
par lesquelles Smith a montr avec force combien est funeste pour une banque la
surcharge produite dans la circulation par une trop forte mission de billets.
Il a tmoign aussi de vues leves en examinant les diverses oprations
auxquelles peuvent se livrer les banques de circulation. C'est dans ces oprations,
selon lui, qu'est le danger. En effet, ce n'est pas tant une mission excessive de
billets qui peut provoquer la ruine d'un tablissement, puisqu'elle se trouve
forcment ramene bref dlai dans les limites ncessaires ; ce sont les placements
qu'il importe de surveiller, c'est--dire la manire dont les banques utilisent leur
crdit.
Ces placements consistaient principalement, pour les banques d'cosse, dans
l'escompte des lettres de change et dans des crdits hypothcaires de faible
importance accords sous forme de comptes courants. Or, cette distribution du
crdit est fort dlicate et Smith trace aux oprations de cette nature des bornes fort
sages. Ce qu'une banque peut avancer sans inconvnient, dit-il 1 , un ngociant ou
un entrepreneur quelconque, ce n'est ni tout le capital avec lequel il commerce, ni
mme une partie considrable de ce capital, mais c'est seulement cette part de son
capital qu'il serait autrement oblig de garder par devers lui, sans emploi et en
argent comptant, pour faire face aux demandes accidentelles. Si le papier-monnaie
que la banque avance n'excde jamais cette valeur, alors il n'excdera pas la valeur
de l'or et de l'argent qui circuleraient ncessairement dans le pays, suppos qu'il n'y
et pas de papier-monnaie ; donc il n'excdera jamais la quantit que la circulation
du pays peut aisment absorber et tenir employe. De plus, ajoute-t-il plus loin,
une banque ne peut pas, sans aller contre ses propres intrts, avancer un
ngociant la totalit ni mme la plus grande partie du capital circulant avec lequel
il fait son commerce, parce que, encore que ce capital rentre et sorte
continuellement de ses mains sous forme d'argent, cependant il y a un trop grand
intervalle entre l'poque de la totalit des rentres et celle de la totalit des sorties,
et ds lors, le montant de ses remboursements ne pourrait pas balancer le montant
des avances qui lui seraient, faites, dans un espace de temps assez rapproch pour
s'accommoder ce qu'exige l'intrt de la banque. Bien moins encore une banque
pourrait-elle suffire lui avancer quelque partie de son capital fixe, car les rentres
d'un capital fixe sont presque toujours beaucoup plus lentes que celles d'un capital
circulant ; et des dpenses de ce genre, en les supposant mme diriges avec toute
l'intelligence et la sagesse possibles, ne rentrent gure l'entrepreneur avant un
intervalle de plusieurs annes, terme infiniment trop loign pour convenir aux
1
Rich., liv. II, ch., II (t. I, p. 369).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
154
arrangements d'une banque. Enfin, plus forte raison, une banque de circulation ne
doit pas prter jusqu' concurrence de la valeur des terres. C'tait l pourtant le
projet que le fameux Law avait soumis au gouvernement de son pays et qu'il fit
accepter par le ntre avec quelques modifications : l'ide de la possibilit de
multiplier le papier-monnaie presque sans bornes fut, dit l'auteur, la vritable base
de ce qu'on appela le systme du Mississipi, le projet de banque et d'agiotage le
plus extravagant peut-tre qui ait jamais paru au monde.
Mais ce n'est pas seulement sur ces crdits en comptes courants que Smith
appelle la vigilance des banques de circulation, c'est aussi et surtout sur la nature
du papier dont on leur demande l'escompte. Il les prmunit contre les expdients
des faiseurs de projets qui, pour se procurer plus de crdit qu'on ne veut leur en
accorder, mettent du papier de circulation, c'est--dire des lettres de change
fictives qui ne sont plus pour le tireur un moyen de liquider une dette, mais bien
d'en contracter une nouvelle. Il le reconnat toutefois, il n'est pas toujours facile
aux tablissements de crdit de refuser l'escompte de ce papier de circulation.
Lorsque les banques s'aperoivent de l'expdient, il est souvent trop tard, et, de
crainte de provoquer des banqueroutes, elles ne peuvent ni ne doivent retirer
immdiatement tout crdit ; mais, si elles sont prudentes, elles s'efforcent, dans
tous les cas, de le restreindre peu peu, sans se laisser mouvoir par les clameurs
qu'une pareille mesure ne manque jamais de soulever dans leur clientle. Si elles
ngligent ces sages prcautions, elles sont fatalement voues la ruine, et Smith en
donne pour exemple l'existence phmre d'un tablissement qui, fond en
Angleterre peu de temps avant l'apparition des Recherches, venait d'aboutir
rapidement une catastrophe retentissante. Il s'agissait d'une banque fonde Ayr,
en 1769, par MM. Douglas, Heron et C, dans le but de multiplier le crdit en
acceptant toutes lettres de change, relles ou non : cette institution disparut, aprs
trois annes d'existence, laissant un passif de 400,000 liv. st., et cette tentative
n'eut en somme d'autre rsultat que d'acclrer la ruine des mauvais clients et
d'allger, en fait, la situation des autres banques qu'elle avait eu pour but de
supplanter.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, en effet, et c'est l un point sur lequel
Adam Smith a eu le mrite d'insister, c'est que, si les oprations des banques
peuvent augmenter considrablement l'activit industrielle d'un pays lorsqu'elles
sont sagement conduites, ce n'est pas parce qu'elles crent un capital, mais parce
qu'elles rendent productive, une plus grande partie du capital existant. C'est la
condamnation de tous les utopistes qui ont voulu voir dans la multiplication du
signe une multiplication de la chose signifie.
Cependant, dans ces limites mmes, le crdit peut encore tre dangereux, et
Adam Smith a indiqu un autre cueil, que les nations n'ont pas toujours vit avec
assez de soin : nous voulons parler des crises, rendues plus frquentes par une
rduction excessive de la circulation mtallique. Il faut pourtant convenir, dit le
clbre conomiste, que si le commerce et l'industrie dun pays peuvent s'lever
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
155
plus haut l'aide du papier-monnaie, nanmoins, suspendus ainsi, si j'os dire, sur
les ailes d'Icare, ils ne sont pas tout fait aussi assurs dans leur marche que quand
ils portent sur le terrain solide de lor et de l'argent. Outre les accidents auxquels
les expose l'impritie des directeurs de ce papier-monnaie, ils sont encore sujets
en essuyer plusieurs autres dont la prudence et l'habilet de ces directeurs ne
sauraient les garantir. Smith craignait, par exemple, qu'en cas de guerre
malheureuse dans laquelle l'ennemi se rendrait matre de la capitale et du trsor qui
soutient le papier-monnaie, les plus grandes perturbations ne se produisissent alors,
et que, l'instrument habituel du commerce ayant perdu sa valeur, on en ft rduit
revenir au troc en nature, forme premire de toute transaction.
L'un des commentateurs de Smith, James Mill, a combattu cette rserve, en
faisant remarquer que, dans l'tat avanc o se trouve la civilisation, il y a, dans
tout pays ayant un bon gouvernement et une population considrable, si peu de
chances de guerre civile et d'invasion trangre, qu'en recherchant les moyens
propres assurer la flicit nationale, on ne doit gure tenir compte de ces
vnements, d'autant moins, ajoute-t-il, que l'ennemi n'aurait aucun intrt
dtruire le crdit. Nous ne pouvons partager cet optimisme, car nous avons appris
nos dpens, qu' notre poque mme les invasions trangres et la guerre civile ne
sont pas impossibles, mme dans un grand pays. En pleine paix, d'ailleurs, la
rduction excessive de la circulation mtallique peut avoir aussi des effets
funestes, et l'tude des crises industrielles et montaires qui ont svi chez les
nations o le crdit est le plus dvelopp, l'ont suffisamment prouv. La tendance
constante du commerce anglais, dans ce sicle, a t de restreindre le plus possible
la fonction du numraire, de faire beaucoup daffaires avec peu d'argent, et on doit
reconnatre qu'il est arriv, avec le concours des banques et linstitution de son
Clearing-house, des rsultats surprenants ; mais cette tendance mme, excellente
dans certaines limites, prsente un cueil, dangereux surtout pour une nation
essentiellement commerante dont les affaires s'tendent sur tous les points du
globe. Que se produit-il, en effet, dans cette circulation, lorsque, pour une cause ou
une autre (des placements au dehors, par exemple, comme en 1825), les
engagements vis--vis de l'tranger dpassent momentanment les crances et qu'il
faut de toute ncessit payer en or ? Tout le numraire mtallique qui est
indispensable aux petits changes prend alors le chemin de l'tranger, et, faute de
cet auxiliaire ncessaire, le papier se dprcie ; chacun court la Banque pour se
procurer de la monnaie, l'encaisse mtallique est impuissante satisfaire les
demandes, l'or mme qui reste dans la circulation se cache. Partout une
perturbation grave, partout des faillites ; la vie industrielle et commerciale s'arrte
jusqu' ce que l'or, sollicit par une hausse considrable du taux de l'escompte,
revienne dans le pays. C'est l un danger redoutable auquel expose l'abus de la
circulation fiduciaire, et on ne saurait trop y insister. Toute crise, quelque forme
qu'elle affecte, qu'on la dnomme crise industrielle, financire ou montaire, a
toujours, en somme, la mme cause dterminante : un vide produit dans la
circulation par la disparition d'une certaine quantit de numraire. Le vrai moyen
de la prvenir est donc de conserver dans le pays une notable proportion d'espces
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
156
mtalliques : c'est l une mesure de prudence dont Smith avait senti dj la
ncessit et que ses disciples mmes ont trop souvent perdue de vue.
Une doctrine clbre, le, SYSTME MERCANTILE, avait cependant mis en
lumire cette observation importante ; mais on eut le tort de la condamner en bloc,
au lieu de se pntrer de cette maxime de l Thorie des sentiments moraux, que
tout systme, est vrai sous quelque rapport. Les fondateurs de cette cole avaient
t frapps en ralit d'un fait exact, savoir que si une nation peut la rigueur se
passer de certaines denres, elle ne peut jamais se passer de la marchandise
spciale qui sert de monnaie. Aussi nous estimons que Turgot a t un peu loin
lorsqu'il a affirm, par une raction excessive contre l'exagration de ce systme,
que toute marchandise est monnaie. Cet aphorisme est vrai en principe, si on veut
dire par l que toute marchandise pourrait servir, d'une manire plus ou moins
convenable, d'intermdiaire dans les changes, et Smith a montr qu' l'origine des
civilisations, le btail, le bl, le tabac, le sel ont servi de monnaie. Mais lorsqu'une
marchandise a t, d'un consentement gnral, investie de la fonction de monnaie,
et que, depuis des sicles, elle a servi, en fait, d'instrument in dispensable des
changes, elle est quelque chose de plus qu'une marchandise ordinaire. Nous ne
dirons pas que c'est la marchandise par excellence, parce que ce terme a t
employ souvent d'une faon inexacte, mais c'est une marchandise qui ne convient
pas seulement quelques-uns, comme le tabac ou mme le bl, c'est une
marchandise qui est ncessaire tous, parce que tous ont besoin de vendre ou
d'acheter et que le numraire est devenu, par un usage constant, l'intermdiaire
commun de tous les changes. C'est l ce qu'avaient compris les grands esprits qui,
comme Colbert, avaient donn la doctrine mercantile l'autorit de leur nom et le
concours de leur influence.
Mais on sait que cette cole, partie d'un fait exact, a abouti des consquences
errones et funestes. Non seulement elle a considr le numraire comme une
richesse particulire dont un pays ne peut se passer, mais, prtendant mme que
c'est lui seul qui constitue la vraie richesse, elle s'est efforce, par une
rglementation complique et arbitraire de l'industrie et du commerce, d'attirer
autant que possible le mtal prcieux sur le march national et de l'empcher d'en
sortir. C'tait une erreur et une faute : une faute, parce que toute rglementation est
funeste au dveloppement de la richesse qu'elle prtend servir ; une erreur parce
que, ds que le canal de la circulation est rempli, toute accumulation nouvelle
d'espces devient inutile au mouvement gnral des affaires. Ce surplus augmente
ainsi le prix de toutes choses et, par l mme, il est impuissant se maintenir dans
le pays, se trouvant sollicit, par les prix plus bas des marchandises au dehors,
prendre le chemin de l'tranger.
Cette erreur de l'cole mercantile a t vivement combattue par Adam Smith, et
la rfutation de ce systme est la partie la plus connue de la Richesse des Nations.
Aussi, nous nous efforcerons de suivre ici presque littralement le clbre
conomiste dans son mode d'exposition du sujet comme dans son argumentation,
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
157
et, tout en cherchant prsenter cette matire sous une forme concise, nous
emploierons, autant que possible, les termes mmes de l'auteur afin de conserver
ses critiques leur vritable caractre. Nous esprons viter ainsi de tomber dans la
faute commune beaucoup de commentateurs qui, pour n'avoir pas suivi les
dtails de cette tude, se sont laisss aller parfois prsenter cette doctrine de la
libert commerciale sous une forme autoritaire et absolue que le matre s'tait bien
gard de lui donner.
L'auteur commence par exposer l'origine du systme. La double fonction, ditil , que remplit l'argent, et comme instrument de commerce et comme mesure des
valeurs, a donn naturellement lieu cette ide populaire que l'argent fait la
richesse ou que la richesse consiste dans l'abondance de l'or et de l'argent. L'argent
servant d'instrument de commerce, quand nous avons de l'argent, nous pouvons
bien plutt nous procurer toutes les choses dont nous avons besoin que nous ne
pourrions le faire par le moyen de toute autre marchandise. Nous trouvons tout
moment que la grande affaire, c'est d'avoir de l'argent ; quand une fois on en a, les
autres achats ne souffrent pas la moindre difficult. D'un autre ct, l'argent
servant de mesure des valeurs, nous valuons toutes les autres marchandises par la
quantit d'argent contre laquelle elles peuvent s'changer. Nous disons d'un
homme riche qu'il a beaucoup d'argent, et d'un homme pauvre qu'il n'a pas
d'argent. On dit d'un homme conome qui a grande envie de s'enrichir, qu'il aime
l'argent ; et, en parlant d'un homme sans soin, libral ou prodigue, on dit que
l'argent ne lui cote rien. S'enrichir, c'est acqurir de largent ; en un mot, dans le
langage ordinaire, richesse et argent sont regards comme absolument
synonymes. Or, on raisonnait ainsi l'gard d'un pays comme l'gard d'un
particulier, et Smith constate que cette ide nous est d'ailleurs tellement familire
que ceux-mmes qui sont convaincus de sa fausset sont tout moment tents
d'oublier leurs principes et entrans dans leurs raisonnements prendre ces
prjugs pour une vrit incontestable. Aussi une pareille erreur ne tarda pas
avoir des consquences vraiment trs funestes pour le dveloppement de la
richesse, et, imbues de ces ides, les diffrentes nations jugrent qu'elles devaient,
par tous les moyens, se disputer les mtaux prcieux.
1
Elles en prohibrent d'abord l'exportation, mais on s'aperut bientt que cette
prohibition tait en ralit fatale aux commerants ; ceux-ci exposrent qu'en
exportant de l'or et de l'argent dans le but d'acheter des marchandises trangres,
ils ne diminuent pas toujours le stock mtallique du royaume, et qu'en agissant
ainsi, ils font souvent comme le laboureur qui, dans les semailles, abandonne la
terre une partie de son capital pour obtenir une rcolte abondante. D'ailleurs les
rglements ne parvenaient pas empcher la fraude et, en fait, les mtaux
prcieux, faciles dissimuler cause de leur faible volume, passaient la frontire
sans obstacles. Les gouvernements renoncrent donc cette prohibition peu
efficace, mais ils ne se dsintressrent pas cependant de la protection de l'encaisse
1
Rich., liv. IV, ch. I (t. II, p. 2).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
158
nationale, ils cherchrent la favoriser indirectement, et chacun d'eux tablit tout
un arsenal de rglements destins faire tourner l'avantage du pays ce qu'on
appela la balance du commerce.
Pour une nation, la balance du commerce rsultait de la comparaison du chiffre
de ses importations et de celui de ses exportations. Ainsi, quand nous exportions
pour une valeur plus grande que nous n'importions, il nous tait d, disait-on, une
balance par les nations trangres, et cette balance, ncessairement paye en or et
en argent, augmentait la quantit d'espces existant dans le royaume : dans ce cas,
la balance passait pour nous tre favorable. Inversement, lorsque nous importions
pour une plus grande valeur que nous n'exportions, alors il tait d aux nations
trangres une balance contraire qu'il fallait leur payer de la mme manire et qui,
par l, diminuait notre stock de mtaux.
Or, Smith a montr fort justement qu'une balance exacte est impossible
tablir, cause des erreurs dont les agents de la douane sont susceptibles, cause
des marchandises de contrebande qui chappent aux constatations, cause des
divers modes dva1uation des denres la frontire. Il a constat qu'en somme
nous n'avons aucune donne exacte qui nous permette de juger de quel ct penche
cette balance du commerce ou de reconnatre lequel des deux pays exporte pour
une plus grande valeur, et il en a conclu que les seuls principes qui guident en
ralit notre jugement dans cette matire sont les prjugs et la haine nationale,
excits par l'intrt particulier des marchands : selon lui, ni les registres des
douanes, ni le cours du change ne donnent d'indices certains cet gard 1 .
Mais l'minent philosophe s'est attach surtout prouver la fausset du principe
et son indignation lui a suggr de fort belles pages lorsqu'il a montr que l'effet
d'un pareil systme est de semer la haine et la discorde entre les nations. Toute
cette doctrine de la balance du commerce, dit-il 2 , est la chose la plus absurde qui
soit au monde. Elle suppose que quand deux places commercent l'une avec l'autre,
si la balance est gale des deux parts, aucune des deux places ne perd ni ne gagne ;
mais que si la balance penche d'un ct un certain degr, l'une de ces places perd
et l'autre gagne en proportion de ce dont la balance s'carte du parfait quilibre.
Ces deux suppositions sont galement fausses.
C'est pourtant avec de pareilles maximes, poursuit Smith dans un passage
rest clbre 3 , qu'on a accoutum les peuples croire que leur intrt consistait
ruiner tous leurs voisins ; chaque nation en est venue jeter un il d'envie sur la
1
2
3
Liv. IV, ch. III (t. II, p. 66). Nous devons faire une rserve en ce qui concerne le cours du
change. Contrairement l'opinion de Smith, nous, estimons que le cours du change fournit en
ralit des donnes d'une grande valeur, mais nous rappellerons en mme temps qu'au XVIIIe
sicle il tait encore compliqu et fauss par des lments divers tenant la valeur relative des
monnaies des divers pays et surtout leur tat matriel.
Rich., liv. IV, ch. III (t. II, p. 82).
Rich., liv. IV, ch. III (t. II, p. 88).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
159
prosprit de toutes les nations avec lesquelles elle commerce, et regarder tout ce
qu'elles gagnent comme une perte pour elle. Le commerce, qui naturellement
devait tre, pour les nations comme pour les individus, un lien de concorde et
damitis, est devenu la source la plus fconde des haines et des querelles. Pendant
ce sicle et le prcdent, l'ambition capricieuse des rois et des ministres n'a pas t
plus fatale au repos de l'Europe que la sotte jalousie des marchands et des
manufacturiers.
C'tait l prcisment l'lment le plus puissant de la haine sculaire qui
divisait la France et la Grande-Bretagne, et l'adoption d'une politique douanire
plus librale et pu tre une cause d'apaisement entre les deux pays. William Pitt,
lecteur assidu et admirateur de Smith, tenta cette rforme, et sans les graves
vnements qui ne devaient pas tarder se drouler sur la scne de l'Europe, le
trait de commerce sign entre les deux pays le 26 septembre 1786 et peut-tre
marqu, malgr ses imperfections, une re nouvelle dans les rapports des deux
peuples : Je n'hsite pas m'lever contre cette opinion trop souvent exprime,
s'criait ce grand homme d'tat 1 en dfendant le trait la Chambre des
Communes, que la France est et doit rester l'ennemie irrconciliable de
l'Angleterre. Mon esprit se refuse cette assertion comme quelque chose de
monstrueux et d'impossible. C'est une faiblesse et un enfantillage de supposer
qu'une nation puisse tre jamais l'ennemie dune autre.
Smith a insist tout particulirement sur ce point de vue lev de la solidarit
commerciale des nations, et on ne saurait trop citer de ces passages qu'inspirent
l'auteur la plus saine doctrine conomique et un amour vritable de l'humanit. Si
l'opulence d'une nation voisine, dit-il 2 , est une chose dangereuse sous le rapport de
la guerre et de la politique, certainement sous le rapport du commerce, c'est une
chose avantageuse. Dans un temps d'hostilit, elle peut mettre nos ennemis en tat
d'entretenir des flottes et des armes suprieures aux ntres ; mais, quand
fleurissent la paix et le commerce, cette opulence doit aussi les mettre en tat
d'changer avec nous une plus grande masse de valeurs, de nous fournir un march
plus tendu, soit pour le produit immdiat de notre propre industrie, soit pour tout
ce que nous aurons achet avec ce produit. Si, pour les gens qui vivent de leur
industrie, un voisin riche doit tre une meilleure pratique qu'un voisin pauvre, il en
est de mme d'une nation opulente... Une nation qui voudrait acqurir de
l'opulence par le commerce tranger, a certainement bien plus beau jeu pour y
russir, si ses voisins sont tous des peuples riches, industrieux et commerants.
Une grande nation, entoure de toute part de sauvages vagabonds et de peuples
encore dans la barbarie et la pauvret, pourrait, sans contredit, acqurir de grandes
richesses par la culture de ses terres et par son commerce intrieur, mais
certainement pas par le commerce tranger. C'est que, comme il le dit ailleurs 3 ,
limportation de l'or et de l'argent n'est pas le principal bnfice et encore bien
1
2
3
William Pitt et son temps, par lord Stanhope, trad. Guizot (t. I, p. 332).
Rich., liv. IV, ch. III (t. II, p. 90).
Rich., liv. IV, ch. I (t. II, p. 25).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
160
moins le seul qu'une nation retire de son commerce tranger. Quels que soient les
pays entre lesquels s'tablit un tel commerce, il procure chacun de ces pays deux
avantages distincts. Il emporte ce superflu du produit de leur terre et de leur travail
pour lequel il n'y a pas de demande chez eux, et, la place, il rapporte en retour
quelque autre chose qui y est en demande. Il donne une valeur ce qui leur est
inutile en l'changeant contre quelque autre chose qui peut satisfaire une partie de
leurs besoins ou ajouter leurs jouissances. Par lui, les bornes troites du march
intrieur n'empchent plus que la division du travail soit porte au plus haut point
de perfection dans toutes les branches de l'art ou des manufactures. En ouvrant un
march plus tendu pour tout le produit du travail qui excde la consommation
intrieure, il encourage la socit perfectionner le travail, en augmenter la
puissance productive, en grossir le produit annuel et multiplier par l les
richesses et le revenu national. Tels sont les grands et importants services que le
commerce tranger est sans cesse occup rendre et qu'il rend tous les diffrents
pays entre lesquels il est tabli.
Ce nest pas en effet limportation de l'or et de largent qui a enrichi l'Europe
lors de la dcouverte de l'Amrique, c'est le commerce en gnral, c'est l'impulsion
qui a t donne aux changes par l'extension du march. En ouvrant toutes les
marchandises de l'Europe un nouveau march presque inpuisable, elle a donn
naissance de nouvelles divisions de travail, de nouveaux perfectionnements de
l'industrie, qui n'auraient jamais pu avoir lieu dans le cercle troit o le commerce
tait anciennement resserr, cercle qui ne leur offrait pas de march suffisant pour
la plus grande partie de leur produit. Le travail se perfectionna, sa puissance
productive augmenta, son produit s'accrt dans tous les divers pays de l'Europe, et
en mme temps s'accrurent avec lui la richesse et le revenu rel des habitants. Les
marchandises de l'Europe taient pour l'Amrique presque autant de nouveauts, et
plusieurs de celles de l'Amrique taient aussi des objets nouveaux pour l'Europe.
On commena donc tablir une nouvelle classe d'changes auxquels on n'avait
jamais song auparavant et qui naturellement auraient d tre pour le nouveau
continent une source de biens aussi fconde que pour l'ancien. Mais la barbarie et
l'injustice des Europens firent d'un vnement qui et d tre avantageux aux
deux mondes une poque de destruction et de calamit pour plusieurs de ces
malheureuses contres.
La libert des changes profite donc aux deux pays contractants, voil ce que
Smith voulait faire comprendre ses contemporains. Mais les prjugs mercantiles
taient encore tellement enracins que, malgr cette rfutation convaincante,
William Pitt, prs de dix ans aprs, ne put obtenir encore la runion commerciale
de l'Angleterre et de l'Irlande et associer celle-ci aux privilges commerciaux de la
Grande-Bretagne. Malgr son loquence et son talent, le clbre ministre anglais
ne put raliser son dessein qui peut-tre aurait sauv l'Irlande. Adoptez, s'criaitil dans la proraison du fameux discours qu'il pronona le 22 fvrier 1785 la
Chambre des Communes, adoptez envers l'Irlande ce systme commercial qui
tendra enrichir une partie de l'empire sans appauvrir l'autre et en donnant de la
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
161
vigueur toutes deux ; ce systme ressemble la misricorde, cet attribut favori du
Ciel ; comme elle, c'est une double bndiction, et pour celui qui donne et pour
celui qui reoit. Toutefois, Smith avait dj assez branl les prjugs des
hommes d'tat anglais pour que, malgr une ptition de 80,000 manufacturiers du
comt de Lancaster, le projet ft vot Londres avec quelques modifications ; il
n'en fut pas moins rejet par l'Irlande mme qu'il avait pour but d'manciper. Pitt
choua, mais il n'avait pas craint de mettre en jeu sa popularit pour faire prvaloir
les ides de Smith : c'est un titre de gloire pour l'un et pour l'autre.
Le matre ne se mprenait nullement d'ailleurs sur la difficult qu'il
rencontrerait pour faire pntrer ses ides dans la masse de la nation et surtout pour
les faire accepter par la classe les industriels et des commerants. Chacun connat
cette phrase amre, qui dpassait peut-tre ses apprhensions, mais qui fait sentir
combien le clbre philosophe croyait peu la ruine prochaine du systme
mercantile. la vrit, dit-il 1 , s'attendre que la libert du commerce puisse
jamais tre entirement rendue la Grande-Bretagne, ce serait une aussi grande
folie que de s'attendre y voir jamais se raliser la rpublique d'Utopie ou celle de
l'Ocana. Non seulement les prjugs du public, mais, ce qui est beaucoup plus
impossible vaincre, l'intrt priv, d'un grand nombre d'individus, y opposent une
rsistance insurmontable. Si les officiers de l'arme s'avisaient d'opposer toute
rduction dans l'tat militaire, des efforts aussi bien concerts et aussi soutenus que
ceux de nos matres manufacturiers contre toute loi tendant leur donner de
nouveaux rivaux dans le march national ; si les premiers animaient leurs soldats
comme ceux-ci excitent leurs ouvriers pour les porter des outrages et des
violences contre ceux qui proposent de semblables rglements, il serait aussi
dangereux de tenter une rforme dans l'arme qu'il l'est devenu maintenant
d'essayer la plus lgre attaque contre le monopole que nos manufacturiers
exercent sur nous. Ce monopole a tellement grossi quelques-unes de leurs tribus
particulires, que, semblables une immense milice toujours sur pied, elles sont
devenues redoutables au gouvernement, et, dans plusieurs circonstances mme,
elles ont effray la lgislature. Un membre du Parlement qui appuie toutes les
propositions tendant renforcer ce monopole est sr, non seulement d'acqurir la
rputation d'un homme entendu dans les affaires du commerce, mais d'obtenir
encore beaucoup de popularit et d'influence chez une classe de gens qui leur
nombre et leur richesse donnent une grande importance. Si, au contraire, il combat
ces propositions, et surtout s'il a assez de crdit dans la Chambre pour les faire
rejeter, ni la probit la mieux reconnue, ni le rang le plus minent, ni les services
publics les plus distingus ne le mettront l'abri des outrages, des insultes
personnelles, des dangers mme que susciteront contre lui la rage et la cupidit
trompe de ces insolents monopoleurs. Dans cet lan d'indignation, Adam Smith
n'a pas assez compt sur la force naturelle des choses, sur les effets du
dveloppement de la richesse et de la marche incessante de la civilisation. De nos
jours, de grands pas ont t faits dans la voie de la libert commerciale. Les
1
Rich., liv. IV, ch. II (t. II, p. 60).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
162
perfectionnements des agents mcaniques, les applications de la vapeur et de
l'lectricit, en dveloppant la production dans une mesure considrable et en
multipliant en mme temps les dbouchs, ont fait parfois dsirer par les
producteurs eux-mmes la suppression des entraves. un moment donn, on
aurait pu dire que, comme l'avait prvu Lon Faucher, la vapeur avait emport sur
ses ailes nos tarifs et nos prjugs 1 .
Cependant l'minent conomiste ne s'est pas laiss aller, en ralit, au
dcouragement qu'aurait pu susciter en lui cette amre pense de l'inutilit de ses
efforts ; il a frapp, au contraire, coups redoubls, et sur le principe, et sur les
diverses applications. Il ne s'est pas content de dmontrer l'erreur du systme, il a
pris successivement tous les privilges, toutes les entraves dont on avait enchevtr
la production et l'change, montrant avec une grande force comment ces
rglements sont funestes tous, bien qu'ils soient impuissants atteindre le rsultat
particulier qu'ils se proposent d'obtenir. Ces deux principes une fois poss, ditil 2 , que la richesse consistait dans l'or et dans l'argent, et que ces mtaux ne
pouvaient tre apports dans un pays qui n'a pas de mines que par la balance du
commerce seulement, ou bien par des exportations qui excdaient en valeur les
importations, ncessairement alors ce qui devint l'objet capital de l'conomie
politique, ce fut de diminuer autant que possible l'importation des marchandises
trangres pour la consommation intrieure et d'augmenter autant que possible
l'exportation des produits de l'industrie nationale. En consquence, les deux grands
ressorts qu'elle mit en uvre pour enrichir le pays furent les entraves
l'importation et les encouragements pour l'exportation.
C'tait l l'objet de ce que Smith appelait alors l'conomie politique. Ce terme,
en effet, avait ici un tout autre sens que celui que nous donnons maintenant la
science dont le philosophe de Glasgow a t lui-mme l'un des plus illustres
fondateurs. Pour l'auteur des Recherches, l'conomie politique se proposait deux
objets distincts 3 : le premier, de procurer au peuple un revenu ou une subsistance
abondante, ou, pour mieux dire, de le mettre en tat de se procurer lui-mme ce
revenu ou cette subsistance ; le second, de fournir l'tat un revenu suffisant pour
le service public ; en un mot, elle se proposait d'enrichir la fois le peuple et le
souverain. Ainsi comprise, l'conomie politique tait un art, c'tait une partie de la
politique, une branche des connaissances du lgislateur et de l'homme d'tat. Mais
la terminologie a, depuis lors, repris ce mot dans un autre sens. Pour nous,
1
2
3
Lon Faucher. Rponse au Manifeste du Comit central de la Prohibition (Journal des con.,
1846-1847, t. I, p. 208 et 289). L'Angleterre n'a pas pu supporter le monopole des
propritaires fonciers en matire de grains, aussitt qu'elle a possd des routes, des canaux, des
chemins de fer et de nombreux navires. Quant la France, si le rgime de la prohibition ne
succombe pas plus tt, il deviendra certainement intolrable et impraticable ds l'achvement de
nos grandes lignes de chemins de fer. La vapeur emportera nos tarifs et nos prjugs sur ses
ailes ; les restrictions du commerce tomberont devant la locomotive, comme sont tombes
devant l'imprimerie les chanes de la pense.
Rich., liv. IV, ch. I (t. II, p. 30).
Rich., liv. IV, Introduction (t. II, p. 1).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
163
l'conomie politique est une science qui nous fait connatre les lois suivant
lesquelles la richesse se produit, se consomme, se distribue, et qu'Adam Smith
nous a exposes avec tant de nettet dans les premiers livres de son uvre. Ce n'est
pas un moyen, c'est une science ; la politique de se servir de ses donnes !
Smith divise en deux classes les diverses entraves qui gnaient l'importation
des marchandises, suivant qu'elles avaient pour but d'atteindre celles des
marchandises trangres de toute provenance qui taient de nature tre produites
sur le territoire national, ou suivant qu'elles visaient seulement les marchandises
importes des pays avec lesquels on supposait la balance dfavorable.
Nous n'insisterons pas sur les entraves de la seconde catgorie, car elles
n'avaient d'autre but que de rtablir la balance du commerce ; or la discussion
mme de son principe avait donn cette thorie un coup mortel dont elle ne s'est
pas releve, et, de nos jours, on n'ose plus gure mettre en avant ce prjug pour
demander l'tablissement ou le maintien des droits de douane. Mais il n'en est pas
de mme des entraves qui ont pour objet de protger les productions nationales
contre les similaires ou succdans venant de l'tranger. C'est l l'objectif d'une
cole encore puissante qui, au milieu de la crise industrielle qui frappe notre
march, trouve dans la classe des producteurs et mme, fait inou, dans celle des
commerants, des adhrents de plus en plus nombreux.
Assurment ces entraves ont pour effet, Smith le reconnat volontiers, de
donner certaines classes, au moins momentanment, des avantages rels ; il est
non moins certain qu'il se tourne gnralement vers les emplois protgs une
portion du travail et des capitaux du pays plus grande que celle qui y aurait t
occupe sans cela. Mais ce qui n'est pas tout fait aussi vident, dit le clbre
conomiste, c'est de savoir si cette rglementation tend augmenter l'industrie
gnrale de la socit ou lui donner la direction la plus avantageuse. En effet, il
n'en est rien. L'industrie gnrale de la socit ne va jamais au-del de ce que peut
employer le capital de la nation ; les rglements n'arrivent tout au plus qu'
changer la direction de ce capital et entraver l'action de l'intrt personnel des
individus qui les conduirait tout naturellement vers l'emploi le plus avantageux
pour l'ensemble du pays.
Toute intervention gouvernementale ne se rsout donc qu'en une entrave
apporte la tendance universelle vers l'harmonie, car cette tendance est naturelle
et Smith ne nglige aucune occasion de proclamer ce principe rconfortant : la
vrit, dit-il 1 , l'intention de chaque individu n'est pas, en gnral, de servir l'intrt
public, et il ne sait mme pas jusqu' quel point il peut tre utile la socit. En
prfrant le succs de l'industrie nationale celui de lindustrie trangre, il ne
pense qu se donner personnellement une plus grande sret, et, en dirigeant cette
industrie de manire ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense
1
Rich., liv. IV, ch. II (t. II, p. 35).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
164
qu' son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par
une main invisible pour remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions ;
et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la socit que cette fin n'entre
pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intrt personnel, il
travaille souvent d'une manire bien plus efficace pour l'intrt de la socit que
sil avait rellement pour but d'y travailler.
On veut rserver le march national, poursuit-il, l'industrie indigne, mais de
deux choses l'une : ou bien le produit de notre industrie peut tre vendu aussi bon
compte que celui de l'industrie trangre, et alors les rglements sont inutiles ; ou
bien ils ne peuvent pas y tre mis aussi bon compte, et alors les rglements sont
nuisibles. En effet, la maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais
essayer de faire chez lui la chose qui lui cotera moins acheter qu' faire ; or, ce
qui est prudence dans la conduite de chaque famille en particulier, ne peut gure
tre folie dans celle d'un grand empire, et si un pays tranger peut nous fournir une
marchandise meilleur march que nous ne sommes en tat de l'tablir nousmmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelque partie du produit
de ceux des genres d'industrie dans lesquels nous avons quelque avantage. Agir
autrement, c'est consentir de gaiet de cur une diminution du produit annuel de
la socit, puisque, avec la mme quantit de marchandise, on achte une moins
grande quantit de produits que si on s'tait adress l'tranger. On ne saurait
signaler avec plus de force l'inefficacit des droits protecteurs, ni faire ressortir
avec plus de nettet les avantages de la libert commerciale, qui n'est, en ralit,
qu'une forme suprieure de la division du travail, et qui, comme elle, contribue
puissamment l'accroissement de la richesse gnrale.
Smith repousse de mme l'argument de ceux qui voient dans le systme
mercantile un moyen d'acclimater sur le territoire national certaines industries qui
n'auraient pu se dvelopper sous le rgime de la libert. Il ne nie pas le fait, mais il
conteste absolument la valeur de l'argument. la vrit, dit-il, il peut se faire
qu' l'aide de ces sortes de rglements un pays acquire un genre particulier de
manufactures plus tt qu'il ne l'aurait acquis sans cela, et qu'au bout d'un certain
temps ce genre de manufacture se fasse dans le pays aussi bon march ou
meilleur march que chez l'tranger. Mais quoiqu'il puisse ainsi arriver que l'on
porte avec succs l'industrie nationale dans un canal particulier plus tt qu'elle ne
s'y serait porte d'elle-mme, il ne s'ensuit nullement que la somme totale de
l'industrie ou des revenus de la socit puisse jamais recevoir aucune augmentation
de ces sortes de rglements. L'industrie de la socit ne peut augmenter qu'autant
que son capital augmente, et ce capital ne peut augmenter qu' proportion de ce qui
peut tre pargn peu peu sur les revenus de la socit. Or, l'effet qu'oprent
immdiatement les rglements de cette espce, c'est de diminuer le revenu de la
socit, et, coup sr, ce qui diminue son revenu n'augmentera pas son capital plus
vite qu'il ne se serait augment de lui-mme, si on et laiss le capital et l'industrie
chercher l'un et l'autre leurs emplois naturels.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
165
Toutefois, aprs avoir pos le principe de la libert commerciale, Smith se
laisse aller quelques concessions au systme restrictif ; de crainte d'tre jug trop
absolu, il rouvre la porte aux privilges, et il admet deux cas dans lesquels il peut
tre avantageux, selon lui, d'tablir quelque charge sur l'industrie trangre pour
encourager l'industrie nationale.
C'est, en premier lieu, le cas des industries ncessaires la dfense du pays. Par
exemple, la dfense de la Grande-Bretagne dpend beaucoup du nombre de ses
vaisseaux et de ses matelots ; c'est donc avec raison que l'Acte de navigation a
cherch donner aux vaisseaux et aux matelots anglais le monopole du commerce
maritime de leur pays, par des prohibitions absolues en certains cas, et par de
fortes charges dans d'autres, sur les navires trangers.
Nous ne suivrons pas le Dr Smith dans cette voie. Aprs l'avoir entendu
dplorer, dans un admirable lan d'indignation, les entraves funestes nes de la
haine et des rivalits des nations, on ne saurait trop s'tonner de le voir maintenant
approuver cet acte fameux de Cromwell, et dclarer que, bien qu'il ne soit pas
impossible que quelques-unes des dispositions de cet Acte clbre aient t le fruit
de l'animosit des Anglais l'gard des Hollandais, nanmoins elles sont aussi
sages que si elles eussent t toutes dictes par la plus mre dlibration et les
intentions les plus raisonnables. C'est qu'ici il parle en politique et que le
politique a eu raison de l'conomiste. Il n'avait pas t pourtant sans signaler
prcdemment les effets dplorables de ces mesures, et il avait parfaitement
reconnu que de telles entraves ne sont pas faites pour dvelopper le commerce. Il
avait fort justement montr comment l'intrt d'une nation est, dans ses relations
avec les nations trangres, le mme que celui d'un marchand vis--vis des
diverses personnes avec lesquelles il fait des affaires ; comment, pour acheter
bon march et vendre le plus cher possible, un pays doit dsirer la libert absolue,
afin d'encourager toutes les nations apporter leurs marchandises et venir
acheter en change les produits indignes. Cependant, si l'Acte de navigation
n'empchait pas, en droit, les btiments trangers de venir exporter les produits de
la Grande-Bretagne, il les en empchait en fait, en frappant les articles
d'importation qui formaient le chargement de ces navires, car ceux-ci ne pouvaient
consentir venir sans aucune cargaison, chercher des marchandises dans les ports
de l'Angleterre. Mais, dans l'esprit de Smith, les avantages politiques, bien
discutables cependant, devaient faire passer sur les inconvnients conomiques, et
l'auteur des Recherches conclut que comme la sret de l'tat est d'une plus
grande importance que sa richesse, l'Acte de Navigation est peut-tre le plus sage
de tous les rglements de commerce de l'Angleterre.
On ne saurait trop regretter que le clbre philosophe ne se soit pas born
constater les principes ; il a ainsi ouvert la porte une foule de restrictions de toute
sorte, et il a permis la cupidit des monopoleurs de se dissimuler sous un faux air
de patriotisme, en invoquant l'intrt suprme de la dfense du pays. De nos jours,
ce n'est plus seulement pour la fabrication des armes, la marine marchande,
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
166
l'levage des chevaux, que l'on met en avant cet argument solennel de la scurit
du pays, on en arrive l'invoquer pour la protection de toutes les denres
ncessaires la satisfaction de nos besoins, sous le prtexte qu'en cas de blocus, un
tat qui ne les produirait pas lui-mme serait fatalement la merci de ses ennemis.
Assurment, lorsqu'il s'agit de certaines industries indispensables au mtier des
armes, l'argument politique doit dominer toute la matire. Mais en ce qui concerne
les autres produits, nous estimons que la crainte de manquer, en temps de guerre,
des consommations indispensables est absolument chimrique ; en fait, on trouvera
toujours un pays neutre pour en fournir, et il y a folie, imposer la nation,
pendant la paix, des gnes et des sacrifices considrables, pour une ventualit qui
ne s'est jamais produite, mme au temps du blocus continental. Il en est ainsi
mme du bl, la consommation par excellence ; en entravant l'importation, on a
donn une grande instabilit aux prix que la libert commerciale aurait eu pour
effet de niveler. Quant l'institution de l'chelle mobile, que l'on imagina dans
notre pays comme un correctif et qui avait la prtention de rgler, comme par une
vanne, l'entre des bls trangers sur notre territoire, elle ne fit, en ralit, que
dtruire toute certitude chez le cultivateur comme chez le commerant.
La seconde des exceptions que Smith a faites au principe de la libert
commerciale est plus juste dans son principe, et elle peut avoir d'heureux effets
pour un peuple, condition dtre maintenue dans les limites troites que l'auteur
des Recherches lui a donnes. Elle a trait aux droits compensateurs. Le second
cas, dit l'auteur, dans lequel il sera avantageux, en gnral, de mettre quelque
charge sur l'industrie trangre pour encourager l'industrie nationale, c'est quand le
produit de celle-ci est charg lui-mme de quelque impt l'intrieur. Dans ce cas,
il parat raisonnable d'tablir un pareil impt sur le produit du mme genre venu de
fabrique trangre. Ceci n'aura pas l'effet de donner l'industrie nationale le
monopole du march intrieur, ni de porter vers un emploi particulier plus de
capital et de travail du pays qu'il ne s'en serait port naturellement. Tout l'effet qui
en rsultera sera d'empcher qu'une partie de ce qui s'y serait port naturellement
n'en soit dtourne par l'impt pour prendre une direction moins naturelle, et de
laisser la concurrence entre l'industrie trangre et l'industrie nationale aussi prs
que possible des conditions o elle se trouvait auparavant.
Ces droits sont en effet parfaitement quitables, lorsqu'ils ont pour objet de
compenser le montant des impts intrieurs qui frappent certaines marchandises
particulires ; mais Smith tient mettre le lgislateur en garde contre l'extension de
ces droits que les partisans de la protection rclament en faveur de toutes les
marchandises, sous prtexte de compenser les impts gnraux qui grvent la
proprit, l'exercice des industries, les moyens de communication et de transport.
Nous voudrions pouvoir citer en entier ce passage qui rpond d'une manire si
nette toutes les plaintes, toutes les rcriminations dont on assaille les pouvoirs
publics, dans notre pays notamment depuis l'tablissement des impts occasionns
par la guerre de 1870-1871.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
167
L'auteur ne nie pas que les impts gnraux ne psent quelquefois lourdement
sur la production, et qu'ils n'augmentent, dans une proportion souvent
considrable, le prix de revient de toutes les marchandises ; mais il ne peut
admettre aucune analogie entre le renchrissement produit sur une marchandise
particulire par une taxe spciale et le renchrissement gnral caus par
l'ensemble de la lgislation fiscale. Il montre comment les droits compensateurs ne
pourraient tre qu'arbitraires s'ils taient tendus tous les produits, parce qu'il
serait absolument impossible de dterminer, mme approximativement, de
combien le renchrissement gnral du travail influe en fait sur le prix de chaque
marchandise diffrente produite par le travail. Il fait voir en outre que ces droits
seraient aussi profondment injustes, en ce qu'ils feraient retomber certainement
sur les consommateurs le poids de tous les impts intrieurs, y compris ceuxmmes qui, dans l'esprit du lgislateur, doivent frapper la rente du sol, le revenu du
capitaliste ou le profit de l'industriel. Si l'impt foncier que doit supporter le
propritaire, l'impt des patentes qui doit atteindre l'industriel et le commerant
taient compenss par un droit quivalent la frontire sur tous les produits bruts
ou manufacturs, ds ce moment ils retomberaient forcment sur le consommateur
et ils quivaudraient en ralit une exonration partielle des classes riches au
dtriment de la masse du peuple.
Voil ce que Smith a pressenti et il a tenu prmunir ses compatriotes contre
un entranement qui pourrait avoir des consquences fatales l'gard des classes
laborieuses. Il aurait pu signaler, en outre, le fouillis inextricable des droits de
douane auquel conduirait ncessairement la gnralisation de cette thorie de la
compensation, les gnes pour le commerce, l'lvation du prix de toutes choses qui
entraverait l'exportation nationale. Mais cette discussion n'avait gure alors qu'un
intrt fort problmatique : la thorie de la balance du commerce rgnait alors en
matre, et le clbre conomiste n'osait pas esprer qu'un jour prochain verrait la
ruine de cette cole, que le systme mercantile en serait rduit se dissimuler sous
une forme nouvelle et rclamer le maintien des entraves douanires au nom des
ides de compensation.
En dehors de ces deux exceptions qui restreignent la libert commerciale et
qu'il a reconnues lgitimes, le Dr Smith admet encore que, dans certains cas
exceptionnels, d'autres restrictions puissent tre momentanment imposes la
libre circulation. Il estime en effet qu'il est parfois utile, dans l'intrt mme de la
libert, d'user de reprsailles l'gard d'une nation trangre qui gne, par de forts
droits ou par des prohibitions, l'importation chez elle de certains de nos produits ;
mais il dclare que ces reprsailles ne sont justifiables quen tant que mesures
politiques et lorsque la diplomatie peut prvoir qu'elles auront pour effet de
provoquer une raction dans la lgislation douanire de l'autre pays. Il reste ici, au
point de vue conomique, fidle ses principes et il spcifie que cette mesure ne
doit tre que temporaire, puisqu'elle est une charge pour les consommateurs sans
tre un ddommagement pour ceux des producteurs qui se sont trouvs atteints par
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
168
les taxes prohibitives de la nation voisine. Quand il n'y a pas probabilit, dit-il,
que nous puissions parvenir faire rvoquer ces empchements, c'est, ce qu'il
semble, une mauvaise mthode pour compenser le dommage fait quelques
classes particulires du peuple, que de faire nous-mmes un autre dommage tant
ces mmes classes qu' presque toutes les autres. Quand nos voisins prohibent
quelqu'un de nos objets de manufacture, en gnral nous prohibons non seulement
leurs ouvrages du mme genre, ce qui seul ne pourrait pas produire grand effet
chez eux, mais quelques autres articles du produit de leur industrie. Cette mesure,
sans doute, peut donner de l'encouragement quelques classes particulires
d'ouvriers chez nous, et, en vinant ainsi quelques-uns de leurs rivaux, elle peut
mettre ces ouvriers mme d'lever leurs prix dans le march intrieur.
Nanmoins la classe d'ouvriers qui souffre de la prohibition faite par nos voisins,
ne tirera pas d'avantages de celle que nous faisons. Au contraire, les ouvriers et
presque toutes les autres classes de citoyens se trouveront par l obligs de payer
certaines marchandises plus cher qu'auparavant. Aussi toute loi de cette espce
impose une vritable taxe sur la totalit du pays, non pas en faveur de cette classe
particulire d'ouvriers qui cette prohibition faite par nos voisins a port
dommage, mais en faveur de quelque autre classe.
Sauf ces trois drogations qu'il s'est attach renfermer dans d'troites limites,
Smith n'accepte aucune restriction la libert du commerce : c'est elle qui est
l'auxiliaire le plus puissant de la civilisation et qui, en respectant l'ordre naturel des
choses, en livrant lhomme ses aspirations, ses tendances, en mettant en jeu le
stimulant puissant de son intrt personnel et de sa responsabilit, le conduit le
plus srement au progrs, la multiplication de ses consommations, la
satisfaction progressive de tous ses besoins.
Toutefois, avec un grand sens pratique et bien qu'il n'ose esprer la ralisation
prochaine de son rve, le clbre philosophe tient prmunir la postrit contre un
entranement irrflchi vers les rformes. Il veut mnager les transitions, les coups ; comme un mdecin prudent empche un aveugle qui recouvre la vue de
sortir brusquement au grand jour, de mme il recommande de ne rtablir que peu
peu la libert commerciale, par des gradations lentes et prudentes, avec beaucoup
de circonspection et de rserve. Il montre comment la suppression trop brutale des
gros droits et des prohibitions depuis longtemps en vigueur, provoquerait soudain
une inondation de produits bas prix qui arrterait immdiatement tout travail
dans certaines manufactures peu prpares la concurrence. L'industrie
d'exportation ne serait pas atteinte, il est vrai, parce qu'elle est habitue la lutte et
qu'elle ne vit que par la lutte mme ; mais il n'en serait pas de mme de beaucoup
d'autres industries. Or, changer d'emploi n'est pas facile, c'est un pis-aller toujours
dsastreux auquel le producteur ne peut se rsoudre qu' la longue, car c'est
enlever toute sa valeur un capital fixe quelquefois considrable.
Pas de restrictions l'entre, Voil donc la premire partie du programme de
Smith ; aucun encouragement la sortie, voil la seconde.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
169
Le systme mercantile, fidle son principe, ne se bornait pas, en effet,
entraver l'importation des marchandises trangres ; il cherchait, en outre,
favoriser l'exportation des produits nationaux afin de modifier l'avantage du pays
la balance du commerce. L'exportation fut donc encourage, tantt par des
restitutions de droits ou par des primes, tantt par des traits de commerce avec les
nations trangres, tantt enfin par l'tablissement de colonies. Smith combat d'une
manire gnrale tous ces privilges accords au commerce d'exportation.
Il estime cependant que, parmi tous ces encouragements, les plus raisonnables
sont les restitutions de droit ou drawbacks, car, en remboursant la sortie les
droits que les produits ont pays l'intrieur, l'tat ne dtruit pas l'quilibre qui
s'est tabli naturellement entre les divers emplois du travail et des capitaux, il ne
fait que le rtablir. Nanmoins, il ne faudrait pas prendre la lettre cette
approbation mme, parce que Smith ne parat pas avoir saisi compltement le vrai
caractre de cette institution destine soustraire le commerce d'exportation aux
consquences funestes de la lgislation douanire. Il ne prvoit, en effet, la
restitution que dans le cas o les ouvrages de fabrication nationale sont assujettis
laccise ou lorsque des marchandises trangres avaient t importes en vue de la
rexportation ; or le rle principal des drawbacks a t surtout de dcharger les
produits exports des droits qu'avaient pays l'entre les matires premires ayant
servi leur fabrication. Aussi ce jugement des Recherches perd la plus grande
partie de son intrt, puisque Smith n'a eu apprcier ni l'arbitraire qui prside
ncessairement l'valuation de la matire premire employe pour la fabrication
de chaque produit, ni les fraudes que ce rgime est impuissant djouer, ni ces
vritables primes d'exportation qu'il a souvent pour but de dissimuler.
Un autre encouragement frquemment rclam consiste dans les primes au
moyen desquelles les gouvernements cherchent favoriser le dveloppement d'une
industrie particulire, gnralement d'une industrie naissante. Comme Adam Smith
le remarque avec raison, le systme des primes quivaut en ralit payer les
trangers sur les fonds de l'tat pour les dcider acheter les produits nationaux ;
il n'est donc pas soutenable au point de vue conomique. En effet, ou bien les
primes sont accordes des marchandises qui, aprs le paiement des frais de
production, laissent dj un certain bnfice l'industriel, et alors elles sont
inutiles ; ou bien elles sont accordes des marchandises qui ne se vendent qu'
perte sur le march tranger et alors elles sont funestes, puisqu'elles encouragent le
marchand continuer une entreprise telle que si toutes celles de la nation lui
ressemblaient, il ne resterait bientt plus de capital dans le pays.
Smith n'approuve pas davantage la pratique des traites de commerce et il
montre comment ces conventions ne tendent en gnral qu' constituer, dans
chaque pays, un monopole au profit de certaines classes de producteurs et au
dtriment de toute la masse du peuple. Cette apprciation est fort juste : le rgime
des traits est une pratique vicieuse en elle-mme qui met en uvre les procds
du systme mercantile ; c'est un change de concessions, souvent plus apparentes
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
170
que relles, qui apportent dans la lgislation douanire une instabilit funeste et qui
exercent en ralit sur l'ensemble de la production une action plus dsastreuse,
certains gards, que celle qu'exerceraient des tarifs protecteurs appliqus
uniformment toutes les marchandises de mme nature, quelle qu'en ft la
provenance.
Nanmoins, Adam Smith a peut-tre t trop absolu dans ses critiques, car si
les traits de commerce ont eu des effets pernicieux lorsqu'ils ont t inspirs par
les principes du systme mercantile, ils ont t depuis lors un instrument puissant
de progrs, un acheminement vers la libert du commerce. Assurment, comme l'a
fort bien dit M. Paul Boiteau 1 , un trait de commerce n'est pas autre chose qu'un
compromis avec l'erreur , mais ce compromis est indispensable pour faire
l'ducation conomique de la nation ; le public apprend bien plus par les faits que
par les livres, et, en voyant que dans les autres branches de la production o il
pntre, le libre-change apporte la prosprit, il se ralliera peut-tre aux ides
librales qui poursuivent la suppression complte de toutes les restrictions
douanires. Mais l'auteur des Recherches n'avait alors d'autre exemple de
conventions de cette nature que le trait Mthuen conclu en 1703 entre le Portugal
et l'Angleterre et qui avait pour objet de confrer chacun des deux contractants
un monopole, aux Portugais pour leurs vins, aux Anglais pour leurs lainages. Il a
d changer d'avis avant sa mort, et il a pu constater, par le trait conclu par Pitt
avec la France en 1786, que cette mthode, videmment empirique, peut cependant
constituer une tape relle vers la pratique du libre change.
Enfin, le clbre conomiste s'occupe de la question de l'tablissement des
colonies. Il y consacre un long chapitre plein de dtails et fort intressant. Il fait
l'historique de chaque espce de colonie, des colonies grecques fondes par des
citoyens trop l'troit dans leur pays, des colonies romaines tablies en pays
conquis, des colonies implantes dans les Indes occidentales par les Espagnols et
les Portugais attirs par la recherche de l'or, enfin des colonies plus modernes des
Hollandais, des Franais et surtout des Anglais lesquelles eurent pour objet la
culture des terres sans matre.
Il montre comment l'exploitation des colonies par la mre-patrie avait toujours
t jusqu'alors pratique sans scrupules ; il plaide avec chaleur la cause des colons,
et il voudrait, dans l'intrt mme de la mtropole, qu'on leur accordt une certaine
autonomie, qu'on les laisst libres surtout de rgler eux-mmes leur lgislation
douanire.
Quels sont donc, en effet, les avantages que l'on recherche d'ordinaire dans
l'tablissement des colonies ? Est-ce l'augmentation des forces -militaires de
l'empire ? Mais Smith tablit que les colonies anglaises ont t plutt pour son
pays une cause d'affaiblissement. Est-ce la possession d'un monopole exclusif de
1
Les Traits de commerce, par M. Paul Boiteau.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
171
commerce ? Mais ce monopole mme entrane la longue de graves inconvnients
pour la mre-patrie, car, en empchant les capitaux trangers de s'employer dans la
colonie, il force la mtropole fournir tous les fonds ncessaires ; il fait, en
consquence, hausser les profits et cause ainsi un grave malaise dans l'industrie du
pays. Et ce n'est pas l, d'ailleurs, selon l'minent philosophe, le seul inconvnient
de cette pratique funeste : en dtournant les capitaux nationaux de leurs emplois
naturels pour les porter vers les colonies, le systme mercantile a rduit la masse
des petits commerces intrieurs, il a donn une extension anormale au commerce
tranger et il a amen de la sorte une perturbation considrable dans la vie
industrielle du pays. Le commerce des colonies, dit Smith 1 en entranant dans ce
commerce une portion beaucoup plus forte du capital de la Grande-Bretagne que
celle qui s'y serait naturellement porte, parat avoir entirement rompu cet
quilibre qui se serait tabli sans cela entre toutes les diverses branches de
l'industrie britannique. Au lieu de s'assortir la convenance d'un grand nombre de
petits marchs, l'industrie de la Grande-Bretagne s'est principalement adapte aux
besoins d'un grand march seulement. Son commerce, au lieu de parcourir un
grand nombre de petits canaux, a pris son cours principal dans un grand canal
unique. Or, il en est rsult que le systme total de son industrie et de son
commerce en est moins solidement assur qu'il ne l'et t de l'autre manire, que
la sant de son corps politique en est moins ferme et moins robuste. La GrandeBretagne, dans son tat actuel, ressemble l'un de ces corps malsains dans lesquels
quelqu'une des parties vitales a pris une croissance monstrueuse, et qui sont, par
cette raison, sujets plusieurs maladies dangereuses auxquelles ne sont gure
exposs ceux dont toutes les parties se trouvent mieux proportionnes. Le plus
lger engorgement dans cet norme vaisseau sanguin, qui, force d'art, s'est grossi
chez nous fort au del de ses dimensions naturelles, et au travers duquel circule,
d'une manire force, une portion excessive de l'industrie et du commerce national,
menacerait tout le corps politique des plus funestes maladies. Aussi jamais
l'Armada des Espagnols, ni les bruits d'une invasion franaise n'ont-ils frapp le
peuple anglais de plus de terreur que ne l'a fait la crainte d'une rupture avec les
colonies. C'est cette terreur, bien ou mal fonde, qui a fait de la rvocation de l'acte
du timbre une mesure populaire, au moins parmi les gens de commerce.
L'imagination de la plupart d'entre eux s'est habitue regarder une exclusion
totale du march des colonies, ne dt-elle tre que de quelques annes, comme un
signe certain de ruine complte pour eux : nos marchands y ont vu leur commerce
totalement arrt, nos manufacturiers y ont vu leurs fabriques absolument perdues,
et nos ouvriers se sont crus la veille de manquer tout fait de travail et de
ressources. Une rupture avec quelques-uns de nos voisins du continent, quoique
dans le cas d'entraner aussi une cessation ou interruption dans les emplois de
quelques individus dans toutes ces diffrentes classes, est pourtant une chose qu'on
envisage sans cette motion gnrale. Le sang, dont la circulation se trouve arrte
dans quelqu'un des petits vaisseaux, se dgorge facilement dans les plus grands,
sans occasionner de crise dangereuse ; mais s'il se trouve arrt dans un des grands
1
Richesse, liv. IV, ch. VII (t. II, p. 23).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
172
vaisseaux, alors les convulsions, l'apoplexie, la mort, sont les consquences
promptes et invitables d'un pareil accident.
Pour ces divers motifs qu'il a exposs avec ampleur, Smith combat vivement ce
monopole exclusif de la mtropole, et il le considre comme funeste pour sa patrie.
Il fait ensuite remarquer combien les inconvnients de ce monopole sont plus
considrables encore lorsqu'on le confie une compagnie exclusive. Les
compagnies de commerce ont eu, il est vrai, l'origine, leur raison d'tre : ce sont
elles qui ont dirig les migrants vers les points du globe les plus riches, qui ont
concentr leurs efforts, qui leur ont fait l'avance des outils et des capitaux
ncessaires et qui leur ont enfin procur la scurit indispensable toute tentative
de colonisation. Mais bientt, animes d'un esprit mercantile troit et d'une
excessive cupidit, elles devinrent le flau des colonies qu'elles avaient pour rle
de dvelopper. Au lieu de se rendre compte que, en tant que souveraines du pays,
elles avaient intrt l'augmentation de son produit annuel, elles firent tout pour
en comprimer l'essor, et jamais elles ne s'arrtrent, en vue d'intrts gnraux et
permanents, devant aucune mesure, quelque inique qu'elle pt tre, ds qu'elle leur
paraissait de nature favoriser leurs intrts immdiats.
Une doctrine faite de prjugs et des procds sans scrupules, tel tait le double
caractre de cette institution au XVIIIe sicle. Dans les les pices, les
Hollandais, au dire de Smith, brlaient tout l'excdant de la production au del de
ce qu'ils espraient couler en Europe avec un profit suffisant ; dans les les o ils
n'avaient pas d'tablissements, ils donnaient mme une prime ceux qui
arrachaient les boutons et les feuilles nouvelles des girofliers et des muscadiers,
afin d'viter que le march europen, bien approvisionn, pt rsister leurs
exigences. Il en tait de mme des compagnies anglaises et il n'tait pas rare de
voir le chef d'une factorerie donner l'ordre de passer la charrue sur un champ de
pavots et y faire semer du riz, sous prtexte de prvenir une disette des
subsistances, mais en ralit, pour que cette rcolte de pavots ne gnt pas
l'coulement d'une grande quantit d'opium que ce fonctionnaire avait vendre. La
cupidit des agents dpassait alors tout ce qu'on peut imaginer chacun d'eux tirait
lui et ne songeait qu' s'enrichir au plus vite par tous les moyens possibles ; leur
moralit tait dtestable, et, quelques annes aprs l'apparition des Recherches, W.
Pitt dut, pour mettre des bornes ce scandale, dposer un bill obligeant tout
individu de retour des Indes dclarer sa fortune et instituant un tribunal spcial
pour juger les concussions commises par les agents. Les compagnies privilgies
aggravaient donc encore les funestes effets du systme mercantile ; elles devaient
tomber avant le monopole lui-mme et l'ouvrage d'Adam Smith n'a pas peu
contribu leur disparition.
Toutefois, si le clbre conomiste a condamn sans appel le systme colonial
lui-mme et les moyens que le monopole avait mis en uvre pour s'assurer les
marchs lointains ; il ne conteste nullement les heureux rsultats qu'aurait eus
l'tablissement des colonies dans le cas o leur commerce serait rest libre. Avec
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
173
la libert, en effet, les dbouchs nouveaux augmentent l'activit des manufactures
nationales ; ils attirent les capitaux sans emploi, mais ils n'en changent pas
violemment la destination, et cette exportation des capitaux et des bras se rgle
naturellement par l'effet modrateur de la concurrence ; il n'y a ainsi ni
augmentation artificielle des profits, ni plthore dans certaines branches de
l'industrie. L'minent philosophe va mme plus loin : il reconnat formellement
qu'en somme les bons effets qui rsultent naturellement du commerce des colonies
sont si grands qu'ils font plus que contrebalancer les inconvnients du monopole,
et il constate qu'en fait si le systme colonial a dtourn une partie des capitaux de
certains emplois vraiment productifs, la masse des fonds de la nation a nanmoins
augment dans des proportions considrables et entretenu en dfinitive dans la
mtropole une plus grande quantit de travail.
Quoi qu'il en soit, tout en tant favorable l'tablissement des colonies, il n'en
conseille pas moins son pays d'abandonner elles-mmes celles qui peuvent se
suffire et de leur laisser toute leur autonomie. En se sparant ainsi, de bonne
amiti, dit-il, l'affection naturelle des colonies pour leur mre patrie, ce sentiment
que nos dernires divisions ont peut-tre presque entirement teint, reprendrait
bien vite sa force, et elle constituerait en notre faveur un rel privilge pour le
maintien des relations commerciales. Mais, pas plus ici que dans son tude sur la
libert du commerce, le clbre psychologue ne se fait d'illusion sur l'influence de
ses conseils. Proposer, dit-il 1 , que la Grande-Bretagne abandonne
volontairement toute autorit sur ses colonies, qu'elle les laisse lire leurs
magistrats, se donner des lois et faire la paix et la guerre comme elles le jugeront
propos, ce serait proposer une mesure qui n'a jamais t et ne sera jamais adopte
par aucune nation du monde. Jamais nation n'a abandonn volontairement l'empire
d'une province, quelque embarras qu'elle pt trouver la gouverner et quelque
faible revenu que rapportt cette province proportionnellement aux dpenses
qu'elle entranait.
En effet, notre poque mme, aucune grande nation n'a renonc ses
colonies. Instruite par l'exprience dsastreuse de la guerre de l'Indpendance, la
Grande-Bretagne a consenti peu peu manciper celles de ses colonies qui
taient les plus puissantes et donner certaines d'entre elles une vritable
autonomie ; mais elle a toujours tenu, mme dans ce cas, maintenir avec elles un
lien nominal qui pt tre de nature assurer son commerce un avantage rel dans
ces pays. Or, quoiqu'en ait dit Smith, nous pensons que l'Angleterre a eu raison.
vrai dire, nous ne sommes pas partisan en gnral des expditions coloniales ; nous
estimons qu'au point de vue conomique, le seul auquel nous voulons nous placer
ici, un pays ne doit pas gaspiller partout le sang de ses soldats et consacrer des
capitaux souvent considrables des tablissements lointains. Les gouvernements
auraient d laisser faire l'initiative prive ; de la sorte, l'exportation des bras et des
capitaux aurait eu lieu le plus souvent en temps utile ; elle aurait t contenue dans
1
Richesse, liv. IV, ch. VII (t. II, p. 246).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
174
des limites naturelles plus raisonnables, et les colons, stimuls par le sentiment
puissant de leur responsabilit, auraient t plus attentifs se conformer aux
vritables principes de colonisation fconde et choisir les points les plus
favorables pour la prosprit de leurs tablissements. Nanmoins, lorsque l'tat
tort ou raison, a fond des colonies, et qu'aprs l're des sacrifices, est arriv le
moment o celles-ci peuvent se suffire elles-mmes, nous croyons qu'il n'est pas
injuste alors de les faire participer aux frais gnraux de la mtropole et, au point
de vue commercial, de conserver une certaine action sur la lgislation du pays afin
de l'empcher ventuellement de fermer ses ports aux produits europens au cas o
des ides protectionnistes viendraient y prvaloir.
Entraves l'importation des marchandises trangres, encouragements
l'exportation des produits nationaux au moyen de drawbacks, de primes, au moyen
de traits de commerce et d'tablissements coloniaux : tel est donc l'ensemble des
mesures par lesquelles le systme mercantile se proposait d'enrichir le pays.
Cependant, il procdait autrement l'gard des matires premires. Au lieu d'en
entraver l'importation, il cherchait la favoriser dans le but de permettre aux
manufactures nationales de produire meilleur march ; il attirait donc du dehors
les produits bruts, tantt par des exemptions de droits, tantt par des primes, et il
en empchait la sortie soit par des droits levs, soit par des prohibitions absolues.
Pour faire respecter ces prohibitions, on avait tabli une rglementation
minutieuse donnant lieu des vexations sans nombre et souvent appuye de
sanctions cruelles. Dans certains comts de l'Angleterre, tout propritaire de
moutons, jusqu' une distance de dix milles de la mer, devait, peine d'amende et
de confiscation, fournir la douane, trois jours aprs la tonte, un tat relatant le
nombre de ses toisons et le lieu o elles taient places ; puis, avant d'en dplacer
la moindre partie, il fallait qu'il dclart le nombre et le poids de celles qu'il voulait
enlever, le nom et la demeure de l'acheteur ainsi que le lieu o la livraison devait
tre faite. Pour les individus convaincus d'avoir export des brebis, des agneaux ou
des bliers, les peines taient terribles : aux termes du statut de la 8e anne
d'lisabeth, ch. III, quiconque exportait des btes laine devait, pour la premire
fois, avoir tous ses biens confisqus perptuit, subir un emprisonnement d'un an,
et, au bout de ce temps, avoir la main gauche coupe, un jour de march ; en cas
de rcidive, il devait tre reconnu coupable de flonie et puni de mort. la vrit,
ces peines taient trop cruelles pour tre appliques la lettre, mais elles n'en
taient pas moins suspendues sans cesse, comme une menace, sur la tte des
contrebandiers.
Les inspirateurs de ces rglements avaient donn pour prtexte que la laine
d'Angleterre tait d'une qualit particulire, suprieure celle de tous les autres
pays ; que les autres laines ne pouvaient tre travailles de la mme manire, sans
aucun mlange de celle-l ; que, sans cette laine, on ne saurait fabriquer de drap
fin ; que, par consquent, si on parvenait en empcher totalement l'exportation, la
Grande-Bretagne s'assurerait le monopole de la plus grande partie du commerce
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
175
des draps du monde entier, et ainsi, n'ayant point de rivaux et vendant ds lors au
prix qu'elle voudrait, elle arriverait en peu de temps un degr incroyable
d'opulence au moyen de la balance du commerce la plus avantageuse possible.
Mais, en ralit, le vritable but de ces mesures tait tout simplement d'avilir le
prix de la laine en Angleterre dans l'intrt des manufacturiers : il y avait l,
comme dans tout rglement de cette nature, l'intrt d'une certaine classe de
producteurs dissimul sous le prtexte toujours admis de l'intrt gnral.
Et non seulement le systme mercantile empchait l'homme de disposer des
choses, il lui interdisait mme de disposer de sa personne, et il lui refusait, sous les
peines les plus svres (lamende, la confiscation de tous ses biens, l'incapacit
civile), d'aller travailler en pays tranger. Si un ouvrier anglais avait pass la mer
et exerait son mtier dans un autre pays, il tait averti d'avoir rentrer dans les six
mois en Angleterre et, faute de le faire, il tait ds lors incapable de recevoir des
legs, d'tre excuteur testamentaire, de devenir propritaire de terres par
acquisition, succession ou autrement, et tous ses biens taient confisqus au profit
de la Couronne.
Voil par quelles mesures dplorables, qui ne respectaient ni la proprit, ni la
libert individuelle, le systme mercantile prtendait donner la nation cette
opulence tant dsire. Au lieu de favoriser le travail national, il avait pour effet rel
de le dcourager ; il nuisait l'industrie en ralentissant la consommation et en
empchant les amliorations ncessaires ; il nuisait aux salaris en maintenant
artificiellement un taux lev le prix de toutes choses ; il dtruisait fatalement
l'quilibre entre les diverses branches de la production, parce qu'il est impossible
l'tat de rgler arbitrairement, avec quelque quit, la distribution de la protection
entre les diffrents emplois ; enfin, non content de susciter l'antagonisme des
classes et des divers producteurs, il semait la haine entre les nations, et il amenait
des crises en provoquant de la part des autres peuples des reprsailles contre les
produits nationaux.
Smith a magistralement rfut cette doctrine dans son principe et dans ses
procds : c'est la partie des Recherches qui est, sinon la plus remarquable, du
moins la plus connue, et c'est elle que l'on doit en grande partie l'ide des
rformes librales que l'Angleterre a introduites dans sa lgislation douanire dans
le courant de ce sicle et qui ont inaugur dans l'histoire du commerce une re de
libert. Malgr des pronostics menaants, le systme mercantile ne peut renatre ;
s'il arrive qu'il ait momentanment la victoire, il ne peut plus tre rtabli d'une
manire durable : le dveloppement des moyens de communication, les progrs de
la civilisation s'y opposent. Adam Smith, en fondant l'conomie politique sur la
saine doctrine de la libert, lui a donn un coup mortel : il ne s'en relvera pas.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
176
Troisime section.
Distribution et rpartition des richesses.
Retour la table des matires
Adam Smith ne s'est pas content de rechercher seulement les lois de la
production et de la circulation des richesses, il a abord galement la question
dlicate de la distribution de ces richesses entre les individus ou plutt entre les
diffrentes classes de la socit, et c'est avec une simplicit vraiment scientifique
qu'il en a expos les lois et tudi les phnomnes. Il a analys ainsi avec soin les
lments du prix des marchandises et il a montr comment chacun d'eux est
destin rmunrer l'un des trois facteurs de la production, la terre, le capital et le
travail. Au fond, les trois sortes de rmunrations de ces divers agents ne sont en
ralit que des profils, mais Smith a tenu les distinguer nettement par des
dnominations spciales, afin de mettre en lumire les lois particulires chacune
d'elles : la rente de la terre, le profit et l'intrt des capitaux, enfin les salaires du
travail.
Le plus souvent, les prix des marchandises comprennent la fois les trois
lments de rmunration, mais il en est cependant qui ne se rsolvent qu'en deux
de ces parties, d'autres mme en une seule 1 . D'autre part, ces diverses sortes de
rmunrations n'choient pas toujours des individus distincts, et le propritaire
foncier, qui exploite lui-mme ses terres avec ses propres capitaux et sans le
secours d'aucun ouvrier, n'a partager avec personne les produits de son
exploitation. Mais, dans le prix de ses produits, il ne peroit pas tout au mme
titre : une partie correspond au salaire de son travail manuel, une autre partie au
profit qui lui est d pour son travail de direction, et l'excdant seul du prix sur les
frais de production constitue en ralit la rente de sa terre.
Le salariat n'existait pas l'origine des socits. Avant l'appropriation des
terres et l'accumulation des capitaux, le produit entier des marchandises
appartenait l'ouvrier. Mais, ds que la terre devint une proprit prive et fut
fconde par le travail, le propritaire qui en avait accru la productivit acquit un
droit une part de son revenu : cette part constitua la rente. Puis, lorsque
l'accroissement de la puissance productive du travail et permis de constituer des
1
Smith cite, titre d'exemple, le poisson de mer dont le prix n'a rmunrer que le travail des
pcheurs et le profit des capitaux, alors que le poisson d'eau douce donne lieu une rente ; il
trouve mme dans les petites pierres tachetes (cailloux d'cosse) qu'on rencontre sur les plages
de son pays, un cas o la marchandise n'a rmunrer que la peine des pauvres gens qui la
recueillent.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
177
capitaux et que la ncessit de la sparation des tches se ft fait sentir, le
capitaliste vint au secours de l'ouvrier pour lui avancer la matire premire, les
instruments ncessaires son travail, et pour prix de son concours il rclama un
profit. En mme temps, comme l'ouvrier ne pouvait attendre jusqu' la rcolte la
rtribution de ses efforts et qu'il fallait travailler et vivre jusque-l, il chercha
s'assurer un salaire immdiat qui lui permit de satisfaire ses besoins quotidiens ; il
laissa donc au capitaliste l'ala, l'excdant incertain du prix sur les salaires pays et
les dpenses de production, prfrant lui abandonner ainsi, comme compensation
de son concours, le risque du gain, insparable de celui de la perte.
La constitution du salariat a donc t, quoi qu'on ait dit, un progrs trs rel ; en
spcialisant les tches et en donnant un seul la direction de chaque entreprise,
elle a favoris la production, et, au point de vue distributif, elle a amlior
considrablement la situation de l'ouvrier en lui donnant la scurit du lendemain.
Mais ce salaire, toujours certain, ne pouvait pas tre invariable : de l des plaintes.
Ainsi on a accus le capitaliste d'exploiter le travailleur, on a affirm que
l'accumulation des capitaux est une cause d'asservissement, de misre pour
l'ouvrier, et on a t jusqu' prtendre que la condition du peuple devient pire par
l'accroissement de la richesse publique. Heureusement ces reproches ne sont
nullement fonds et l'uvre de Smith a contribu pour beaucoup clairer ce sujet
en rendant manifeste l'accord essentiel qui existe entre le dveloppement de la
richesse et l'augmentation du bien-tre de la masse des travailleurs : le salaire,
comme toute marchandise, est rgl par le rapport de l'offre et de la demande, par
l'tat du march, et la cause qui dtermine en ralit cette offre et cette demande
n'est autre que le rapport existant entre l'augmentation des capitaux et
l'accroissement de la population.
Smith a eu le mrite de mettre cette importante vrit en lumire, et les
observations qu'il a dveloppes sur ce point sont fort exactes. Pour lui, la
demande de travail ne peut augmenter qu' proportion de l'accroissement des fonds
destins payer les salaires, et il est impossible qu'elle augmente sans elle. Si le
propritaire, le commerant, le capitaliste, voient augmenter leurs revenus, les uns
augmenteront leur consommation en consquence, les autres consacreront leur
surplus la reproduction ; dans tous les cas, cet excdant servira en dfinitive
entretenir des travailleurs, il provoquera une demande supplmentaire de bras,
c'est--dire une augmentation des salaires.
La hausse des salaires est donc lie l'accroissement des capitaux. Mais, pour
que les salaires augmentent ainsi, il n'est ni ncessaire, ni suffisant, selon Smith,
que la richesse nationale soit considrable, il faut et il suffit qu'elle soit en progrs.
Cest ce progrs qui donne lieu la hausse des salaires en provoquant chaque
anne une demande de bras plus forte que l'anne prcdente ; un tat riche, dont
l'opulence resterait stationnaire, n'offrirait aux travailleurs qu'une maigre
subsistance, parce que la demande resterait la mme ; enfin, dans un pays o les
fonds viendraient dcrotre, le salaire baisserait jusqu' ce que la misre, les
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
178
privations et la diminution des naissances aient rduit le nombre des bras et, en
restreignant l'offre, aient rompu l'quilibre et provoqu une raction. C'est ainsi
qu'il faut entendre la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'on se contente de
proclamer que le salaire est soumis cette loi, on nnonce qu'une vrit banale
qui n'apprend rien. Mais quand, avec l'auteur des Recherches, on remonte aux lois
qui rgissent le march lui-mme, on dcouvre que la vritable cause qui
dtermine la demande est l'accroissement ou la diminution des capitaux, et que
cette mme cause ragit aussi sur l'offre en provoquant ou en ralentissant le
progrs de la population, car la population tend se rgler sur la demande des bras
afin d'empcher le salaire courant de s'carter d'une manire durable du salaire
naturel autour duquel il oscille comme tout prix courant vient osciller autour de
son prix naturel. C'est ainsi, dit Smith 1 , que la demande d'hommes rgle
ncessairement la production des hommes, comme fait la demande l'gard de
toute autre marchandise ; elle hte la production quand celle-ci marche trop
lentement et l'arrte quand elle va trop vite.
Toutefois, le clbre philosophe s'est montr moins exact en ce qui concerne la
dtermination du salaire naturel. Il a parfaitement compris qu'en cette matire, il
est ncessaire de considrer, non le salaire nominal qui consiste dans la quantit
d'argent que l'ouvrier obtient pour le prix de son travail, mais le salaire rel qui
consiste dans la quantit de consommations qu'il peut se procurer en ralit avec
cette rmunration. Cependant il a confondu le salaire naturel avec le salaire
minimum qui ne comprend que la subsistance de l'ouvrier et de la famille, et cette
confusion est dangereuse. Le salaire minimum est une limite extrme au-dessous
de laquelle le salaire moyen ne peut rester longtemps sans que la dpopulation se
charge de rtablir l'quilibre ; mais ce n'est pas l, heureusement, le salaire naturel,
le point central autour duquel gravite le salaire courant, comme un pendule, avec
des oscillations de faible amplitude. Si le salaire rel peut descendre
exceptionnellement et momentanment au-dessous du salaire ncessaire, il n'est
pas maintenu dans son orbite par ce salaire ncessaire, et l'histoire de la civilisation
nous prouve qu'au lieu d'osciller alternativement autour de ce minimum, il a
progress en fait d'une manire continue, toujours dans le rayon du salaire naturel
qui reprsente les frais de production, mais de plus en plus loign dans son
ensemble de ce salaire ncessaire au-dessous duquel l'ouvrier devient misrable et
la population diminue.
De cette conception errone du salaire naturel, il rsulterait, en effet, que le
salaire moyen de l'ouvrier n'est autre que le salaire minimum, strict quivalent des
frais de subsistance ; or il n'en est pas ainsi. Il serait assurment bien difficile de
suivre le cours du salaire rel moyen aux diffrents sicles, attendu que les points
de comparaison sont loin d'tre fixes et que les salaires sont souvent trs diffrents
suivant les pays et les professions, suivant les perfectionnements de l'industrie et
les conditions hyginiques mmes du travail ; mais l'ensemble des observations
1
Rich., liv. I, ch. VIII (t. I, p. 111).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
179
permet nanmoins de constater que partout le taux des salaires a hauss, en
gnral, beaucoup plus rapidement que celui des subsistances : la condition
matrielle et morale de l'ensemble des ouvriers en est la preuve. Smith, du reste,
avait lui-mme constat ce progrs vident, et il avait not dj dans la classe
ouvrire ces habitudes de luxe que dplorent les moralistes, mais qui tmoignent
abondamment de l'accroissement du salaire rel qui permet ces folies.
Telle est donc la thorie du salaire, et Smith a fort justement dmontr qu'il
n'est au pouvoir ni du lgislateur par une rglementation arbitraire, ni mme de
l'une des parties par des coalitions et des grves, d'en modifier le taux son gr.
Il n'approuve pas les coalitions, mais n'en conteste pas la lgitimit, et, s'il
estime que, de son temps, elles n'ont le plus souvent que des effets funestes pour
les ouvriers, il n'en revendique pas moins fort nergiquement le droit du travailleur
la grve. cette poque, en effet, l'tat viciait par la contrainte les rapports
d'ouvrier patron : les coalitions, faciles pour les matres qui pouvaient facilement
se concerter en secret, taient impraticables pour les salaris, et elles taient
d'ailleurs svrement rprimes par les gouvernements. Or, le clbre conomiste
voulait que l'on donnt tous les mmes armes, que l'on respectt la libert
individuelle des ouvriers comme celle des patrons ; son vu a t ralis, et
maintenant le travailleur, en possession de cet arme double tranchant, aid par
des rserves quelquefois considrables et des associations puissantes, n'est plus
l'opprim dont Smith dfendait nagure les droits. Un propritaire, un fermier, un
matre fabricant ou marchand, disait l'auteur des Recherches, pourraient, en
gnral, sans occuper un seul ouvrier, vivre un an ou deux sur les fonds qu'ils ont
dj amasss. Beaucoup d'ouvriers ne pourraient pas subsister sans travail une
semaine, trs peu un mois, et peine un seul, une anne entire. la longue, il se
peut que le matre ait autant besoin de l'ouvrier que celui-ci a besoin du matre,
mais le besoin qu'il en a n'est pas aussi pressant. Il n'en est plus ainsi de nos
jours : les rles sont intervertis. Pendant que l'usine chme, les capitaux restent
inactifs, les impts ne cessent pas de courir, le patron perd chaque jour l'intrt de
son capital et le meilleur de sa clientle ; il est donc plus impatient de terminer la
grve que ne l'est maintenant l'ouvrier dont la subsistance est assure pendant
quelque temps par une caisse de rsistance : un chmage prolong est la ruine
fatale de tout industriel qui n'est pas propritaire de la plus grande partie des
capitaux qu'il emploie.
Enfin, aprs avoir tudi la loi qui rgit le taux des salaires pris dans leur
ensemble, Adam Smith recherche pourquoi, en fait, les salaires sont ingaux
suivant les emplois, et il expose les motifs de ces ingalits : c'est l l'objet d'un
chapitre qui, quoique secondaire, est l'un des plus intressants de tout l'ouvrage,
car la puissance d'observation que le clbre philosophe apportait dans ses
investigations, s'y manifeste dans toute sa force.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
180
En principe, les divers emplois doivent ncessairement offrir la mme somme
d'avantages et d'inconvnients, sans quoi tous les bras se porteraient sur les plus
favoriss jusqu' ce que lquilibre ft rtabli. Mais ce n'est pas dire que dans
chacun d'eux la rtribution pcuniaire soit la mme, et la moindre observation
montre qu'elle est fort ingale suivant les diverses professions. Cette diffrence
tenait d'abord, du temps de Smith, aux restrictions rglementaires qui gnaient la
libert du travail et la circulation des ouvriers ; mais elle avait aussi d'autres causes
plus permanentes, qui subsistent mme sous le rgime de la libert, car elles
proviennent en grande partie de certaines circonstances inhrentes aux emplois
mmes. Ces circonstances supplent, soit en ralit, soit aux yeux de l'imagination,
la modicit du gain pcuniaire dans certains cas, ou bien elles en contrebalancent la supriorit dans d'autres.
La premire de ces circonstances, selon Smith, est l'agrment ou le
dsagrment des emplois considrs en eux-mmes. Les salaires varient, dit-il,
suivant que l'emploi est ais ou pnible, propre ou malpropre, honorable ou
mpris. Tous ces lments de faveur ou de dfaveur psent d'une grande force
dans la balance. Ainsi, en gnral, un garon tailleur gagne moins qu'un tisserand,
parce que son ouvrage est plus facile ; le tisserand gagne moins que le forgeron,
parce que l'ouvrage de ce dernier est malpropre ; le forgeron lui-mme, qui est
cependant un artisan, gagnera moins qu'un mineur, qui n'est qu'un simple
journalier, parce que son ouvrage est non seulement moins malpropre, mais surtout
parce qu'il est moins dangereux. La considration qui est attache ces emplois
entre pour beaucoup plus encore dans le salaire des professions honorables, et il en
existe mme un certain nombre des plus recherches l'gard desquelles la
rmunration pcuniaire est tout fait nulle. Inversement, la dfaveur attache un
tat produit l'effet contraire : le mtier de boucher, qui a quelque chose de cruel,
est d'ordinaire trs lucratif, le plus affreux de tous les emplois, celui d'excuteur
public, est, en proportion de la quantit de travail, mieux rtribu que quelque
autre profession que ce soit.
En second lieu, les salaires varient suivant la facilit et le bon march de
l'apprentissage, ou la difficult et la dpense qu'il exige. Quand on a tabli, dit
l'auteur 1 , une machine coteuse, on espre que la quantit extraordinaire de travail
qu'elle accomplira avant d'tre tout fait hors de service remplacera le capital
employ l'tablir, avec les profits ordinaires tout au moins. Un homme qui a
dpens beaucoup de temps et de travail, pour se rendre propre une profession
qui demande une habilet et une exprience extraordinaires, peut tre compar
une de ces machines dispendieuses. On doit esprer que la fonction laquelle il se
prpare, lui rendra, outre les salaires du simple travail, de quoi l'indemniser de tous
les frais de son ducation, avec au moins les profits ordinaires d'un capital de la
mme valeur. Il faut aussi que cette indemnit se trouve ralise dans un temps
raisonnable, en ayant gard la dure trs incertaine de la vie des hommes, tout
1
Rich., liv. I, ch. X (t. l, p. 135).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
181
comme on a gard la dure plus certaine de la machine. En d'autres termes,
c'est une prime d'amortissement, ou plutt une annuit viagre qui doit venir
s'ajouter au salaire, et cette prime est parfois considrable dans les professions
librales ou les arts qui exigent une grande habilet.
En troisime lieu, les salaires varient suivant l'inconstance ou l'incertitude de
l'occupation. En effet, si, dans la plus grande partie des ouvrages de manufacture,
un journalier est peu prs sr d'tre occup constamment, il n'en est pas de mme
dans toutes les professions ; un maon, par exemple, ne peut pas travailler dans les
fortes geles ou par un trs mauvais temps, et la plupart des artisans ne peuvent
d'ailleurs compter sur de l'occupation qu'autant que les pratiques auront besoin de
leurs services. Il faut donc, conclut l'auteur, que, pendant le temps que chacun
d'eux reste occup, il gagne de quoi s'entretenir mme pendant le temps o il
n'aura rien faire, et aussi de quoi se ddommager des moments de souci et de
dcouragement que lui cause parfois la pense d'une situation aussi prcaire.
Quatrimement, dit Smith, les salaires du travail peuvent varier suivant la
confiance plus ou moins grande qu'il faut accorder l'ouvrier. Les orfvres et les
joailliers, en raison des matires prcieuses qui leur sont confies, ont partout des
salaires suprieurs ceux de beaucoup d'autres ouvriers dont le travail exige non
seulement autant, mais mme beaucoup plus d'habilet. Nous confions au mdecin
notre sant, l'avocat et au procureur notre fortune, et quelquefois notre vie et
notre honneur ; des dpts aussi prcieux ne pourraient pas, avec sret, tre remis
dans la main de gens pauvres et peu considrs. Il faut donc que la rtribution soit
capable de leur donner dans la socit le rang qu'exige une confiance si
importante.
Enfin, une cinquime circonstance influe encore avec une grande force sur le
taux des salaires, c'est l'ensemble des probabilits de succs inhrentes aux
diverses professions. Adam Smith dveloppe longuement cette observation, et il le
fait avec beaucoup de sagacit. Il montre comment, dans la plupart des mtiers, le
succs est, en somme, peu prs sr, mais qu'il est, au contraire, trs incertain
dans les professions librales. Mettez, dit-il, votre fils en apprentissage chez un
cordonnier, il n'est presque pas douteux qu'il apprendra faire des souliers ; mais
envoyez-le une cole de droit, il y a au moins vingt contre un parier qu'il n'y
fera pas assez de progrs pour tre en tat de vivre de cette profession. Dans une
loterie parfaitement gale, ceux qui tirent les billets gagnants doivent gagner tout
ce que perdent ceux qui tirent les billets blancs. Dans une profession o vingt
personnes chouent pour une qui russit, celle-ci doit gagner tout ce qui aurait pu
tre gagn par les vingt qui chouent. L'avocat, qui ne commence peut-tre qu'
l'ge de 40 ans tirer parti de sa profession, doit recevoir la rtribution, non
seulement d'une ducation longue et coteuse, mais encore de celle de plus de
vingt autres tudiants qui probablement cette ducation ne rapportera jamais rien.
Quelque exorbitants que semblent quelquefois les honoraires des avocats, leur
rtribution relle n'est jamais gale ce rsultat. Calculez la somme vraisemblable
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
182
du gain annuel de tous les ouvriers d'un mtier ordinaire, dans un lieu dtermin,
comme cordonniers ou tisserands, et la somme vraisemblable de leur dpense
annuelle, vous trouverez qu'en gnral la premire de ces deux sommes
l'emportera sur l'autre, mais faites le mme calcul l'gard des avocats et tudiants
en droit dans tous les diffrents collges de jurisconsultes, et vous trouverez que la
somme de leur gain annuel est en bien petite proportion avec celle de leur dpense
annuelle, en valuant mme la premire au plus haut et la seconde au plus bas
possible. La loterie du droit est donc bien loin d'tre une loterie parfaitement gale,
et cette profession, comme la plupart des autres professions librales, est
videmment trs mal rcompense, sous le rapport du gain pcuniaire. Ces
professions, cependant, ne sont pas moins suivies que les autres, et, malgr ces
motifs de dcouragement, une foule d'esprits levs et gnreux s'empressent d'y
entrer. Deux causes diffrentes contribuent cette vogue : la premire, c'est le
dsir d'acqurir la clbrit qui est le partage de ceux qui s'y distinguent, et la
seconde, c'est cette confiance naturelle que tout homme a plus ou moins, non
seulement dans ses talents mais encore dans son toile.
Cette comparaison tire des loteries est fort ingnieuse, et Smith a ainsi
lgitim compltement, par ce rapprochement saisissant, les gros honoraires que
rclament, dans certaines professions, le petit nombre des lus qui sont en
possession du talent et de la faveur publique : c'est que ce sont eux qui ont gagn
les gros lots dans cette vaste loterie o il y a tant de billets blancs. C'est le secret
espoir de ces gros lots qui pousse tant d'tudiants entrer dans le barreau ; cest
l'espoir des gros lots (les hauts grades) qui lance dans l'arme et la marine tant de
jeunes gens ardents et remplis d'illusions. Comme l'a fort bien remarqu Smith,
chacun est port croire son toile, et celui qui a dit que tout conscrit a son bton
de marchal dans sa giberne, a, par ce mot seul, enflamm bien des imaginations et
provoqu bien des enrlements.
Telles sont les cinq circonstances qui, selon les Recherches, dterminent
l'ingalit des salaires dans les diffrentes professions : la somme des avantages et
des inconvnients est toujours la mme, mais la rtribution pcuniaire varie suivant
la nature des travaux, parce qu'elle a pour complment des considrations morales
qui ont souvent une influence dterminante sur la rpartition des individus entre les
diffrents mtiers. C'est cette varit des lments du salaire qui fait rgner
l'harmonie dans la production en partageant les citoyens, suivant leurs gots, leurs
aptitudes et leurs besoins, entre les diverses professions.
Au sujet des profits, Adam Smith est moins net, parce qu'il a voulu comprendre
la fois sous la mme dnomination l'intrt, le loyer et le profit proprement dit.
Pour lui, le profit est lintrt du capital employ dans une entreprise et toute la
portion du produit qui revient l'entrepreneur, quelque titre que ce soit 1 .
1
Le revenu qu'une personne retire d'un capital qu'elle dirige ou qu'elle emploie, dit Smith, est
appel profit. Celui qu'en retire une personne qui n'emploie pas elle-mme ce capital mais qui le
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
183
Or, cette dfinition n'est pas assez rigoureuse. La mme partie du produit ne
doit pas changer de nom selon la personne qui elle est chue, et il est ncessaire
de distinguer la part de l'intrt de celle du profit proprement dit, non seulement
lorsque le capitaliste et l'entrepreneur sont distincts, mais lors mme que les deux
qualits sont confondues dans le mme individu. Pour nous, il y a lieu de sparer
dans le gain de l'entrepreneur l'intrt de ses capitaux, le salaire de son travail et de
son habilet, enfin un profit qui est la fois une compensation du risque qu'il a
couru dans son entreprise, de la sagacit de son administration et la part de la
chance : le profit se distingue ainsi la fois du salaire et de l'intrt en ce qu'il ne
participe de la certitude d'aucun d'eux, en ce qu'il est essentiellement alatoire.
Malgr cette confusion regrettable, ce chapitre ne manque pas dune certaine
ampleur et il contient plusieurs observations fort exactes l'gard des profits pris
dans leur ensemble. C'est ainsi qu'Adam Smith constate que les profits du capital
dpendent, comme les salaires, de l'accroissement de la richesse nationale, mais en
sens inverse, et que, tandis que laccroissement des capitaux fait hausser les
salaires, il tend abaisser le taux de l'intrt et du profit. Les fluctuations des
profits tendent en effet suivre les fluctuations de l'intrt parce que les unes, et
les autres sont rgles galement par la marche du progrs. Avec la civilisation,
l'instruction professionnelle se multiplie, les prventions qui entouraient les
professions mercantiles disparaissent et la concurrence devient plus active dans
tous les genres de commerce et d'industrie ; en mme temps l'ala diminue grce
l'accroissement de la scurit des transactions, la multiplication des
communications et la rapidit des informations : les profits se nivellent ainsi,
mais par l mme ils se rduisent. Enfin les capitaux d'emprunt deviennent moins
chers, et, bien que la baisse de l'intrt paraisse profiter immdiatement aux
industriels et aux commerants, elle suscite aussi la longue une concurrence plus
active qui amne la baisse des profits.
Aussi Adam Smith s'est rgl sur les variations du taux de l'intrt pour suivre
les fluctuations des profits en gnral. Il avait reconnu qu'il n'est pas possible de
fixer pour eux un taux moyen, comme il l'avait fait pour les salaires, le profit tant
si variable que la personne mme qui dirige un commerce particulier ne peut pas
toujours indiquer le taux moyen de son profit annuel. Il est affect, non seulement
par chaque variation qui survient dans le prix des marchandises, mais encore par la
bonne ou la mauvaise fortune du commerant et de la clientle mme, enfin par
mille accidents divers auxquels les marchandises sont exposes, soit dans leur
transport par terre ou par mer, soit en restant en magasin ; en un mot, il n'est pas
possible de gnraliser les rsultats de l'ala, et toutes les donnes statistiques que
l'on pourrait obtenir directement ne permettraient pas de suivre la marche des
prte une autre, se nomme intrt : c'est une compensation que l'emprunteur paie au prteur
pour le profit que l'usage de l'argent lui donne occasion de faire Naturellement une partie de ce
profit appartient l'emprunteur, qui court les risques de l'emploi et qui en a la peine, et une
partie au prteur qui facilite au premier les moyens de faire ce profit.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
184
profits et leur taux le plus habituel aux diffrentes poques, sans le secours d'un
terme de comparaison de nature servir de point de repre. Ce terme de
comparaison, Smith crut l'avoir trouv dans le taux de l'intrt, et il fut en cela bien
inspir, non pas que, comme il parat le penser 1 , le taux de l'intrt soit gouvern
par le taux des profits, mais parce qu' l'inverse, le taux des profits est largement
influenc par la hausse et la baisse de l'intrt qui, en rendant l'argent plus ou
moins cher, diminue ou augmente la concurrence dans les entreprises. Ici, comme
dans tout le cours de cet admirable ouvrage, la puissance d'observation et la
perspicacit du clbre philosophe ne se dmentent jamais. Si, dans les diffrentes
parties de cette vaste science qu'il a fonde, il n'a pas toujours dml du premier
coup les vritables causes, il n'en a pas moins constat fort exactement les
phnomnes, et son coup d'il pntrant l'a rarement tromp sur la nature des faits
eux-mmes.
En comparant le taux du profit et celui de l'intrt, il avait aussi remarqu qu'en
moyenne ces deux taux sont peu prs gaux, et l'exprience a dmontr
l'exactitude de cette observation. Dans un pays, dit-il, o le taux ordinaire du
profit net est de 8 ou 10 pour 100, il peut tre raisonnable qu'une moiti de ce
profit aille l'intrt toutes les fois que laffaire se fait avec de l'argent d'emprunt.
Le capital est aux risques de l'emprunteur qui, pour ainsi dire, est l'assureur de
celui qui prte ; aussi, dans la plupart des genres de ce commerce, 4 ou 5 pour 100
peuvent tre la fois un produit suffisant pour le risque de cette assurance et une
rcompense suffisante pour la peine d'employer le capital. Toutefois cette rgle
ne peut tre absolue, et Smith l'a parfaitement compris, car, si l'intrt ne varie pas
suivant les emplois, il n'en est pas de mme du profit, et, bien que la rtribution
pcuniaire de l'entrepreneur ne soit gnralement pas affecte au mme degr que
le salaire par la nature de ces emplois, elle est nanmoins parfois fort ingale.
Des cinq causes, en effet, qui agissent sur les salaires, il y en a deux, selon
l'auteur des Recherches, qui font varier aussi les profits : c'est l'agrment ou le
dsagrment, la scurit ou l'ala qu'offrent les divers emplois. Le patron d'une
auberge ou d'une taverne, qui n'est jamais le matre chez lui et qui est expos aux
grossirets du premier ivrogne venu, exerce une industrie qui n'est ni trs agrable
ni trs considre ; il aura donc, en gnral, de trs gros profits destins
compenser ces inconvnients de sa profession. L'importance du risque couru influe
encore davantage sur les profits, puisque c'est cet ala mme qui est, en principe, la
vritable raison d'tre du profit. Quant l'intrt, il reste peu prs invariable,
quel que soit l'emploi, car l'argent, a dit un empereur romain, ne sent jamais
1
On peut tablir pour maxime, dit Smith, que partout o on pourra faire beaucoup de profits au
moyen de l'argent, on donnera communment beaucoup pour avoir la facult de s'en servir et
qu'on donnera en gnral moins quand il n'y aura que peu de profits faire par son emploi.
Ainsi, suivant que le taux ordinaire de l'intrt varie dans un pays, nous pouvons compter que
les profits ordinaires des capitaux varient en mme temps, qu'ils baissent quand il baisse, et
qu'ils montent quand il monte. Les progrs de l'intrt peuvent donc nous donner une ide du
profit du capital. (Rich., liv. I, ch. IX, t. I, p. 121.)
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
185
mauvais. Le seul lment que considre le prteur est le risque couru, les garanties
tant relles que personnelles qu'offre l'emprunteur, pourvu que l'emploi soit licite
et qu'il respecte les bonnes murs ; un entrepreneur trouvera aussi facilement des
capitaux pour des travaux d'got que pour l'industrie la plus considre.
Il importait donc de distinguer, expressment, tous les points de vue, l'intrt
du profit, dans le cas mme o l'entrepreneur fait valoir ses propres capitaux. Mais
si Smith n'a pas fait avec assez de nettet la sparation de ces deux lments de la
rtribution de l'entrepreneur, il n'en a pas moins trait d'une faon fort remarquable
la grande question de l'intrt.
Malheureusement, il n'a pas donn l'analyse mme de l'intrt toute l'tendue
ncessaire, parce qu'il ne le considre, tort suivant nous, que comme un revenu
secondaire qui, s'il ne prend pas sur le profit que procure l'usage de l'argent, doit
tre pay par, quelque autre source de revenu 1 . Aussi ce n'est que dans le
deuxime livre que nous trouvons, propos de l'accumulation des fonds, des
donnes sur sa doctrine.
De plus, dans aucune partie des Recherches, il n'a parl du loyer qu'il et t
fort intressant de distinguer de l'intrt. Cependant, l'un est le revenu du capital
fixe, tandis que l'autre est le revenu du capital circulant : dans le premier, le
capitaliste recouvre la chose mme qu'il a prte, dans le second des choses
semblables, et, par suite, tandis que le loyer comprend une prime d'amortissement
qui n'existe pas dans l'intrt, d'autre part, l'intrt comprend, de plus que le loyer,
une prime d'assurance plus ou moins forte pour le risque de perte. Il et donc t
utile de rapprocher formellement ces deux modes de la rmunration du capital,
car, bien que l'cart entre leurs taux moyens soit peu considrable, ils prsentent en
ralit des dissemblances trs sensibles qui ont servi souvent de prtexte aux
adversaires de l'intrt pour en critiquer l'assimilation. Il tait ncessaire de
montrer que ces deux revenus ont en dfinitive la mme source, le prt d'un
capital, et que si la rtribution du capital fixe est juste, la rtribution du capital
circulant ne peut tre condamne. Dans les deux cas, en effet, il y a loyer d'un
capital qu'on applique la production, et, entre l'emprunteur d'un instrument, par
exemple, et l'emprunteur d'une somme d'argent, il n'y a aucune diffrence
fondamentale, sinon que le premier emprunte en nature l'instrument ncessaire
son travail, tandis que le second emprunte de quoi l'acheter.
Mais si Smith a nglig de pousser aussi loin l'analyse, il n'en a pas moins
dfini l'intrt d'une manire fort nette et indiqu, dans cette dfinition mme, son
caractre, sa raison d'tre et sa lgitimit. on peut regarder, dit-il 2 , un capital
prt intrt, comme une dlgation, faite par le prteur l'emprunteur, d'une
portion quelconque du produit annuel, sous la condition qu'en retour l'emprunteur
lui dlguera annuellement, pendant tout le temps de la dure du prt, une portion
1
2
Rich., liv. I, ch. VI (t. I, p. 71).
Rich., liv. II, ch. IV (t. I, p. 442).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
186
plus petite, appele l'intrt, et, l'chance du prt, une portion pareille celle qui
a t originairement dlgue, ce qui s'appelle le remboursement. Quoique l'argent,
soit papier, soit espces, serve en gnral d'instrument de dlgation, tant pour la
petite portion que pour la grande, il n'en est pas moins tout fait distinct de la
chose qu'on dlgue par son moyen. Cette dfinition est l'expression de la plus
saine doctrine. On ne peut que regretter que Smith n'ait pas donn cette partie de
ses Recherches toute l'tendue qu'elle comportait, et montr, par exemple,
comment l'intrt est la rmunration du travail d'pargne, de mme que le salaire
et les profits constituent la rmunration du travail musculaire, rapprochement qui,
mis en lumire par un conomiste moderne, M. Courcelle-Seneuil, complte
encore, s'il est possible, la justification de lintrt.
Il a insist davantage sur la loi qui rgit le taux de l'intrt et sur les causes de
la baisse de ce taux avec les progrs de la civilisation. Sans s'en tenir cette vrit
banale que l'argent est soumis, comme toute marchandise, la loi de l'offre et de la
demande, il a tenu rechercher dans l'histoire des socits quelles sont les causes
mmes qui dterminent cette offre et cette demande, et il a reconnu que le taux de
l'intrt dpend, non de la quantit des capitaux existant actuellement dans le pays,
comme on l'avait affirm, mais de la quantit des capitaux nouvellement produits
qui viennent s'offrir pour la premire fois sur le march. Cette observation est fort
remarquable et parfaitement juste. Ce qui dtermine la quantit de fonds, dit-il 1 ,
ou, comme on dit communment, d'argent qui peut tre prte intrt dans un
pays, ce n'est pas la valeur de l'argent, papier ou espces, qui sert d'instrument aux
diffrents prts qui se font dans le pays, mais c'est la valeur de cette portion du
produit annuel qui, au sortir de la terre ou des mains des ouvriers productifs, est
non seulement destine remplacer un capital, mais encore un capital que le
possesseur ne se soucie pas d'employer lui-mme. Comme ces capitaux sont
ordinairement prts et rembourss en argent, ils constituent ce qu'on nomme
intrt de l'argent.
D'ailleurs, non seulement l'accroissement des capitaux agit ainsi directement
sur le taux des salaires, mais il prcipite encore, d'une manire indirecte cette fois,
la baisse de l'intrt en provoquant en mme temps la baisse des profits. En effet,
les profits baissent, car plus il a t fait, moins il reste faire, et, moins d'une
rvolution dans l'industrie, il devient de plus en plus difficile de trouver aux
nouveaux capitaux des emplois productifs ; aussi les industriels, gagnant moins,
sont moins disposs donner un intrt lev pour les capitaux dont ils ont besoin.
La concurrence des capitalistes, dit Smith, fait hausser les salaires du travail
et baisser les profits. Or, lorsque le bnfice qu'on peut retirer de l'usage d'un
capital se trouve, pour ainsi dire, rogn par les deux bouts, il faut bien
ncessairement que le prix qu'on peut payer pour l'usage de ce capital diminue en
mme temps que ce bnfice.
1
Rich., liv. II, ch. IV (t. I, p. 440).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
187
On peut donc conclure de l qu'en dfinitive le taux de l'intrt dpend la fois
de la quantit des nouveaux capitaux qui viennent s'offrir sur le march et de la
productivit moyenne des emplois qu'on peut donner ces capitaux. C'est par cette
loi que Smith explique non seulement la baisse constante du taux de l'intrt avec
les progrs de la civilisation, mais encore les mouvements temporaires de hausse
que ce taux a subis diffrentes poques. Si, en effet, par la scurit plus grande
des transactions et des personnes, par l'augmentation continuelle de l'pargne et la
diminution de productivit des nouveaux emplois, le taux de l'intrt a baiss peu
peu, il s'est produit nanmoins plusieurs reprises de brusques ractions. Les
guerres, les emprunts, les entraves apportes par les institutions positives la
libert du travail et du commerce, ont enray le mouvement de baisse ; d'autres
faits, mme des faits heureux, ont aussi agi dans le mme sens, et c'est ainsi que
l'migration des capitaux vers les pays neufs et surtout la transformation de
l'industrie, en ouvrant de nouveaux emplois productifs aux capitaux, ont provoqu
des demandes et relev souvent d'une manire durable le taux moyen de l'intrt.
En ce qui concerne la baisse persistante de l'intrt en Europe, Adam Smith
s'est, attach particulirement rfuter les prjugs en honneur sur cette matire,
d'autant plus que Locke, Law et Montesquieu lui-mme n'avaient voulu voir dans
ce phnomne qu'une consquence de l'accroissement de l'or et de l'argent produit
par la dcouverte de l'Amrique. Aprs son ami Hume, qui avait dj combattu
cette erreur dans un de ses petits traits, l'auteur des Recherches s'lve vivement
contre cette doctrine et il en montre fort bien le vice. Ds qu'on y rflchit, en
effet, on s'aperoit bien vite que, quelque action qu'ait la dprciation de la
monnaie sur le prix des marchandises, elle ne peut avoir aucune influence sur le
taux de l'intrt. Le capital et l'intrt tant reprsents tous deux par de l'argent,
chacun d'eux a t affect de la mme faon par la baisse du pouvoir de l'argent, et
la proportion entre le montant du capital et celui de l'intrt est reste la mme ; les
deux termes du rapport tant multiplis par un mme nombre, le rapport ne change
pas. Il est vrai de dire cependant qu'au moment mme de l'importation d'une
grande quantit d'or, il se produit temporairement une baisse de l'intrt, car toute
marchandise qui arrive soudainement en grande quantit sur un march o la
demande n'est pas prpare la recevoir, produit ncessairement une dprciation
des cours ; mais cette dprciation n'est que momentane. Ce qui rgle d'une
manire durable le taux de l'intrt, c'est, comme Smith l'a dmontr, l'offre des
capitaux de toute espce, et c'est l'accroissement incessant de l'ensemble de ces
capitaux qui a dtermin cette baisse graduelle que l'on cherche expliquer, et qui,
provoque par la civilisation, a donn la civilisation mme une nouvelle
impulsion.
Toutefois, bien qu'Adam Smith vante, en principe, les heureux effets de la
baisse de l'intrt, il ne veut pas que cette baisse soit trop rapide. Pour lui, elle n'est
un bien qu'autant qu'elle est lente et modre, et il considre qu'une baisse
excessive, au lieu de favoriser la production et l'accroissement du bien-tre,
amnerait, en ralit, le relchement de l'activit industrielle, la diminution de
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
188
l'pargne et l'augmentation du luxe. Ce n'tait pas l cependant l'opinion de Turgot.
Pour le philosophe franais, la baisse de l'intrt est un bien dans tous les cas, et
elle amne toujours avec elle un accroissement d'activit et de production. On
peut regarder le prix de l'intrt, dit en effet le clbre physiocrate, comme une
espce de niveau au-dessous duquel tout travail, toute culture, toute industrie, tout
commerce cessent. C'est comme une mer rpandue sur une vaste contre : les
sommets des montagnes s'lvent au-dessus des eaux et forment des les fertiles et
cultives. Si cette mer vient s'couler, mesure, qu'elle descend, les terrains en
pente, puis les plaines et les vallons paraissent et se couvrent de productions de
toute espce. Il suffit que l'eau monte ou baisse d'un pied pour inonder ou pour
rendre la culture des plages immenses. C'est l'abondance des capitaux qui anime
toutes les entreprises, et le bas intrt de l'argent est tout la fois l'effet et l'indice
de l'abondance des capitaux. Cette comparaison fameuse de Turgot est trs
saisissante, mais elle n'est pas absolument exacte, et la doctrine des Recherches
nous parat plus vraie. La baisse de l'intrt n'est pas toujours excellente en ellemme, et, pour la juger, il est ncessaire de remonter ses causes. Si elle est
favorable la production lorsqu'elle est amene par l'accroissement de la scurit
des transactions ou l'augmentation de l'pargne, elle est par contre regrettable
lorsqu'elle rsulte de la raret des emplois productifs. C'est ce que Turgot n'a pas
compris, et, malgr l'lvation de ses vues conomiques, il n'a considr ici que
l'effet, le signe, au lieu de remonter la cause. Smith, au contraire, avec cette
prescience extraordinaire dont il a donn maintes preuves, avait prvu ds la fin du
XVIIIe sicle, alors qu'il y avait encore tant faire, quil arriverait un moment o
les entreprises les plus rmunratrices seraient termines et o il deviendrait
successivement de plus en plus difficile de trouver, dans le pays, une manire
profitable d'employer son capital . Il avait senti que, dans ces conditions, une
baisse considrable du taux de l'intrt, qui serait l'indice d'une grande pnurie de
ces emplois, occasionnerait une perturbation funeste, non seulement dans la
production, mais surtout dans la rpartition de la richesse. Or, cette apprciation
diffrente de la baisse de l'intrt, suivant la cause qui lui a donn naissance, a une
grande importance au point de vue scientifique, et c'est Smith que l'on doit en
reporter l'honneur.
Cependant, le philosophe cossais a t moins heureux au sujet de la limitation
du taux de l'intrt, et on s'tonne de ne trouver dans son uvre aucune
protestation contre l'intervention des gouvernements cet gard. Il dmontre fort
bien comment les lois qui prohibent l'intrt ne font qu'accrotre l'usure au lieu de
la prvenir, parce que le prteur se fait payer, outre l'usage de l'argent, une
indemnit trs forte pour le risque qu'il court en contrevenant ainsi aux
rglements ; mais, en examinant les lois qui, sans prohiber l'intrt, en rglent le
taux maximum, il se borne rechercher quel doit tre ce maximum sans contester
aucunement l'tat le droit mme de le dterminer. Il aurait d signaler comment
cette pratique est injuste, parce que l'tat ne peut pas apprcier arbitrairement la
quotit de la prime d'assurance que reprsente le risque dans chaque cas
particulier ; comment elle est impraticable, parce qu'elle provoque, fatalement la
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
189
fraude ; comment enfin elle est inutile, en ce que, tout en gnant l'industrie, elle
n'empche pas le prodigue de se ruiner et les faiseurs de projets de trouver aussi
facilement de l'argent. Il est surprenant que ces considrations aient chapp la
perspicacit d'Adam Smith, et que ce dfenseur convaincu de la libert de
l'industrie et du commerce ait accept, sans les discuter, ces rglements
attentatoires la libert des conventions, qui avaient pour effet mme de prcipiter
la ruine de ceux qu'ils voulaient protger.
L'importante question de la RENTE DE LA TERRE n'a pas t non plus fort
bien traite. Adam Smith n'a pas expos ce sujet dlicat avec cette clart lumineuse
qu'il a apporte dans d'autres parties des Recherches, et on a pu lui reprocher non
seulement d'avoir contribu beaucoup, par le vague de sa doctrine, aux erreurs de
Ricardo, mais encore d'avoir fourni des armes ceux qui contestent la lgitimit
mme de cette rmunration du propritaire. Ds l'instant, dit-il 1 , que le sol d'un
pays est devenu proprit prive, les propritaires, comme tous les autres hommes,
aiment recueillir o ils n'ont pas sem, et ils demandent un fermage, mme pour
le produit naturel de la terre. Il s'tablit un prix additionnel sur le bois des forts,
sur l'herbe des champs et sur tous les fruits naturels qui, lorsque la terre tait
possde en commun, ne cotaient l'ouvrier que la peine de les cueillir et lui
cotent maintenant davantage. Il faut qu'il paie pour avoir la permission de les
recueillir, et il faut qu'il cde au propritaire du sol une portion de ce qu'il recueille
ou de ce qu'il produit par son travail. Cette portion, ou, ce qui revient au mme, le
prix de cette portion constitue la rente (rent of land), et, dans le prix de la plupart
des marchandises, elle forme une troisime partie constituante.
Cette doctrine est en tous points errone, et, prendre ce passage la lettre, on
s'expliquerait presque le fameux mot de Proudhon ( La proprit, c'est le vol ! .
Toutefois, Adam Smith attnue bien vite la gravit de ses paroles, et, quelques
pages plus loin, il reconnat lui-mme en termes exprs, que dans ce revenu du
propritaire, ct de la rente proprement dite qui reprsente la part de la nature
travaillant conjointement avec l'homme, il existe un autre lment affrent la part
des amliorations de toute sorte et des capitaux que le propritaire a incorpors la
terre. Mais, tout en admettant la prsence de ce second lment qui comprend la
part du travail accumul, il n'en a pas saisi l'importance, et il n'a voulu y voir qu'un
complment infime du don gratuit consenti par la nature au profit du propritaire.
On pourrait se figurer, dit-il 2 , que la rente de la terre n'est souvent qu'un profit
ou un intrt raisonnable du capital que le propritaire a employ l'amlioration
de la terre. Sans doute il y a des circonstances o le fermage pourrait tre regard
en partie comme tel, mais il ne peut presque jamais arriver que cela ait lieu pour
plus que pour une partie. Le propritaire exige une rente mme pour la terre non
amliore, et ce qu'on pourrait supposer tre intrt ou profit des dpenses
d'amlioration, n'est, en gnral, qu'une addition cette rente primitive ; d'ailleurs,
ces amliorations ne sont pas toujours faites avec les fonds du propritaire, mais
1
2
Rich., liv. I, ch. VI (t. I, p. 6).
Rich., liv. I, ch. XI (t. I, p. 188).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
190
quelquefois avec ceux du fermier ; cependant, quand il s'agit de renouveler le bail,
le propritaire exige ordinairement la mme augmentation de fermage que si toutes
ces amliorations eussent t faites de ses propres fonds. Adam Smith s'est
mme efforc de citer, l'appui de sa thorie, des cas o la rente de la terre
existerait indpendamment de toute espce d'incorporation, et, il a t chercher
jusque dans la cueillette d'une plante marine peu connue, la salicorne, un exemple
de ce genre. La salicorne, dit-il, est une espce de plante marine qui donne, quand
elle est brle, un sel alcalin dont on se sert pour faire du verre, du savon, et pour
plusieurs autres usages ; elle crot seulement sur des rochers situs au-dessous de
la haute mare, qui sont deux fois par jour couverts par les eaux de la mer et dont
le produit n'a jamais pu, en consquence, tre augment par l'industrie des
hommes ; cependant, le propritaire d'un domaine bord par un rivage o crot
cette espce de salicorne en exige une rente tout aussi bien que de ses terres bl.
Assurment il y a dans la rente un lment qui reprsente la part de la fertilit
naturelle de la terre, et, si on envisage deux domaines appartenant au mme
propritaire, ayant t l'objet des mmes amliorations, d'incorporations
quivalentes de capitaux, on trouvera toujours entre eux quelque diffrence dans le
produit, par suite de la diffrente fertilit naturelle des terres. Mais cette part est
gnralement minime ; aussi ne doit-on pas conclure, avec Smith, des exemples
tirs de la cueillette des produits naturels, que la rente, considre comme le prix
pay pour l'usage de la terre, soit un prix de monopole et qu'elle ne soit nullement
en proportion des amliorations que le propritaire peut avoir faites.
En effet, si la rente a sa premire origine dans la fertilit naturelle de la terre, si
elle peut se concevoir la rigueur sans le travail, il n'en est pas moins vrai que, ds
que la terre est fconde par le travail humain, ce caractre de don gratuit disparat
presque entirement et la majeure partie de la rente trouve alors sa cause et sa
raison d'tre dans la rmunration du travail de l'homme qui a dvelopp la fertilit
naturelle de la terre et qui en a multipli les produits. Comme le salaire et le profit,
la rente est, en somme, la rtribution du travail de l'homme. Le propritaire n'est
pas un parasite qui vient prendre, lors de la rpartition, une part qu'il n'a pas
mrite : cette part, il l'a gagne par son labeur : La terre sera maudite cause de
toi, a dit le Crateur l'homme, et tu n'en tireras de quoi te nourrir pendant toute ta
vie qu'avec beaucoup de travail ; elle te produira des pines et des ronces et tu te
nourriras de l'herbe des champs ; tu mangeras ton pain la sueur de ton front 1 .
Si d'ailleurs, au bout de quelques sicles d'exploitation d'un domaine, il tait
possible de dfalquer exactement de la rente l'intrt et le profit des capitaux
incorpors, alors il y a fort parier qu'il resterait bien peu pour la part de la
productivit naturelle de la terre. La rente que le premier occupant s'est attribue
ne consistait en ralit que dans les produits naturels que donnait sans culture le
champ qu'il dfricha, et cette rente, bien minime, tait indispensable pour
provoquer la culture et engager l'homme entreprendre ces travaux pnibles de la
1
Gense, ch. III, 17, 18 et 19.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
191
mise en valeur des terres. Depuis lors, ce n'est que grce au travail,
l'incorporation des capitaux et au perfectionnement des modes de culture que cette
rente, originairement insignifiante, a atteint l'importance qu'elle a acquise dans
tous les pays peupls, par suite de l'accroissement constant et graduel du produit
net. Le don gratuit de la nature n'est plus qu'une bien faible partie du montant de la
rente ; tout le surplus en revient au travail. Ce surplus s'accrot sans cesse, et, lors
mme que le montant d'un fermage reste stationnaire, on ne doit pas en conclure
que les nouveaux capitaux qu'on a incorpors la terre sont improductifs ; cet tat
tient des causes particulires ou mme ce fait plus gnral qui n'infirme en rien
notre argument, savoir que la baisse de l'intrt a rduit la rmunration de la
somme totale des capitaux qui ont successivement fcond la terre.
un double point de vue, il est curieux qu'Adam Smith nait pas saisi
l'importance du travail accumul dans la fcondation de la terre. D'une part, en
effet, cette thorie de la rente est une vritable inconsquence sous la plume de
l'conomiste qui avait donn la science des richesses la large base du travail et
qui avait crit au frontispice mme de son uvre que le travail annuel d'une
nation est le fonds primitif qui fournit la consommation annuelle toutes les
choses ncessaires et commodes la vie. Enfin, d'autre part, il est encore plus
surprenant que cette condamnation de la rente qui, au point de vue moral,
dnoterait un antagonisme rel entre l'conomie politique et le droit, mane du
philosophe mme qui a proclam partout l'accord des intrts et dont l'uvre
entire avait pour but de dmontrer la tendance gnrale l'harmonie universelle.
Et pourtant cet antagonisme n'existe pas. Du fait mme que la rente puisse tre
considre pour une petite partie comme un privilge au profit du propritaire, on
ne doit pas en conclure que ce privilge soit une injustice, car il ne viole en ralit
aucun droit et il constitue mme un gain non seulement pour le privilgi, mais
encore pour la socit en ce qu'il est un stimulant la mise en valeur des terres et
l'accroissement de la richesse gnrale. Les individus se sont vus la vrit privs
du droit de cueillette, comme le chercheur de salicornes que Smith a vu dpossd
de son droit et oblig de payer une rente au propritaire, de la cte ; mais il faut
reconnatre que cette perte s'est trouve plus que compense par l'essor de
l'industrie et du commerce, par la hausse des salaires et l'accroissement gnral du
bien-tre qui en ont t la consquence.
Du reste, en prenant une part lors du partage des produits, le propritaire du sol
naugmente en rien le prix des subsistances, et ltude des lois de la rpartition
dmontre surabondamment qu'il n'y a rente qu'autant qu'il reste un excdent aprs
le paiement de l'ouvrier du capitaliste et de l'entrepreneur. Le montant de la rente
n'exerce donc en ralit aucune influence sur les prix ; c'est un excdent qui reste
rpartir aprs la rmunration des diffrents agents qui ont concouru la
production ; et si la rente n'existait pas, le consommateur ne profiterait mme pas
de cet abandon puisqu'il n'entranerait aucune rduction des frais de production.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
192
'En rsum, a dit John Stuart Mill 1 , la rente galise simplement les profits des
capitaux des divers fermiers, en permettant au propritaire de s'approprier toute la
diffrence du profit qui peut rsulter de la supriorit des avantages naturels. Si
tous les propritaires, sans exception, renonaient la rente, les fermiers seuls en
profiteraient, le consommateur n'en retirerait aucun avantage, car il faudrait
toujours que les bls restassent au mme prix afin que l'on pt produire toute la
quantit demande pour les besoins de la socit, et il serait impossible que le bl
des terres les moins favorises se vendit ce prix sans que la totalit du bl produit
s'y vendt aussi. Donc la rente, tant qu'elle n'est pas surleve artificiellement par
des lois restrictives, ne pse point sur le consommateur, elle n'lve point le prix
du bl et ne cause au public aucun dommage.
Il est bon de remarquer que, longtemps avant Stuart Mill, Adam Smith avait
dj formul cette importante observation, et bien qu'il n'en ait pas tir le mme
parti que l'conomiste moderne, il avait cependant insist longuement sur cette
ide trs juste qui aurait d le faire revenir sur ses prventions l'gard de la
lgitimit de la rente. Il a constat en effet fort exactement qu'il ne peut y avoir de
rente que lorsque le prix des marchandises est plus que suffisant pour couvrir les
salaires, les profits et l'intrt des capitaux ncessaires l'exploitation. Or, si ce
n'est que d'aprs le prix des denres que l'on peut savoir s'il reste ou non une rente
pour le propritaire, la rente dpend en ralit de la demande et, par suite, ceux des
produits de la terre dont la demande est toujours abondante fourniront
constamment une rente, tandis que d'autres, soumis plus de fluctuations dans
leurs prix, n'en rapporteront pas toujours une. La rente, dit-il en termes formels 2 ,
entre dans la composition du prix des marchandises d'une tout autre manire que
les salaires et les profits. Le taux lev ou bas des salaires et des profits est la cause
du prix lev ou bas des marchandises ; le taux lev ou bas de la rente est l'effet
du prix. Le prix d'une marchandise particulire est lev ou bas parce qu'il faut,
pour la faire venir au march, payer des salaires et des profits levs ou bas ; mais
c'est parce que son prix est lev ou bas, c'est parce qu'il est ou beaucoup ou trs
peu plus, ou pas du tout plus lev que ce qui suffit pour payer ces salaires et ces
profits, que cette denre fournit de quoi payer une forte rente ou une faible rente,
ou ne permet pas d'en acquitter une.
L'auteur a consacr ensuite de longues pages la dmonstration exprimentale
de cette proposition, puis la distinction des parties du produit de la terre qui
fournissent toujours de quoi payer une rente et de celles qui ne peuvent pas
toujours en payer une. Pour lui, les parties du produit de la terre qui donnent
constamment une rente sont les denres ncessaires la subsistance de l'homme,
car la nourriture trouve toujours s'changer contre du travail, cause de la
tendance de la population se multiplier en raison des moyens de subsistance.
Mais il n'en est pas de mme des autres produits, de ceux notamment qui servent
au logement et au vtement, attendu que les pays ne se peuplent pas en raison du
1
2
Principes dcon. polit., liv, III, ch. V.
Rich., liv. I, ch. XI (t. I, p. 189).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
193
nombre d'hommes que leur produit peut vtir et loger, mais du nombre d'hommes
qu'il peut nourrir. En effet les terres qui les fournissent ne donnent pas
ncessairement une rente, car la demande de ces marchandises est sujette, suivant
les sicles et les pays, aux plus grandes fluctuations : sans valeur srieuse chez les
peuples barbares, elles n'acquirent gnralement de prix qu'avec la civilisation et
l'accroissement de la richesse, par une sorte de contre-coup produit par la hausse
de la rente des terres bl.
Cette tude est assez longue et elle est trs remarquable. Malgr la varit des
recherches qu'elle suppose, elle est en tous points fort intressante, soit que Smith
considre, dans une digression fameuse dont nous avons parl plus haut, les
variations de la valeur de l'argent aux quatre derniers sicles, soit qu'il apprcie les
diffrents modes de culture en usage. ce dernier point de vue surtout, il montre
toute occasion une connaissance parfaite de l'agriculture, de ses ressources comme
de ses procds, et on a tout lieu de supposer qu'il dut mettre profit ses relations
avec lord Kames, l'auteur du Gentilhomme fermier, pour complter ses
observations sur cette branche de la production qui avait toutes ses prfrences.
Enfin, aprs avoir examin ainsi dans quels cas le propritaire prend une part
lors de la rpartition, Adam Smith a t amen, par toute cette srie d'observations
et malgr le vice que nous avons signal dans son analyse des lments de la rente,
constater que le taux de la rente a une tendance continue la hausse. Mais la
constatation de ce phnomne si important ne lui a cependant pas fait dcouvrir
son erreur ; il ne s'est pas rendu compte que cette hausse persistante manifeste
l'accroissement graduel de ce second lment de la rente qui a son origine dans
l'incorporation successive des capitaux. C'est pourtant la prpondrance de cet
lment, qui est, notre avis, la cause la plus puissante de cette tendance gnrale
la hausse, car les amliorations utiles effectues sur les terres ne rendent pas
seulement l'intrt des capitaux qui y ont t incorpors, elles suscitent dans une
proportion beaucoup plus grande la fertilit du sol elle-mme. Quant la partie
invariable de la rente, celle, qui correspond la productivit naturelle du sol, elle
reste peu prs fixe ; elle n'est gure influence que par l'extension des cultures
aux terres moins fertiles, et c'est l une cause de hausse qui, quoi qu'en ait dit
Ricardo, a au fond bien peu de force si on la compare l'action puissante des
capitaux incorpors et des perfectionnements de l'art agricole sur l'augmentation
des produits et sur l'accroissement de la portion de ces produits qui, excdant les
frais de production, constitue la rmunration relle du propritaire.
Toutefois, aprs cette observation, nous ne pouvons que souscrire cette vrit,
mise en lumire par Adam Smith, que la rente a une tendance gnrale et puissante
la hausse. On a prtendu qu' cet gard le clbre conomiste a fray la voie la
thorie de Ricardo et qu'il a t ainsi le promoteur de cette doctrine affligeante qui
voit dans la civilisation une cause de diminution graduelle du prix des objets
manufacturs et d'augmentation correspondante de la valeur des subsistances. Ce
reproche n'est pas fond. Smith a bien constat que l'accroissement de la richesse
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
194
amne peu peu une rduction notable dans le prix des objets de manufacture ;
mais il n'a nullement abouti une conclusion oppose propos des subsistances,
et, s'il a signal la hausse de la rente, il n'en a pas conclu nanmoins la hausse
gnrale de l'ensemble des produits agricoles. Cette dduction et t d'ailleurs en
contradiction avec le reste de son ouvrage et notamment avec les documents qu'il
avait patiemment accumuls dans ses tudes sur les variations du prix du bl.
Il est vrai que les produits de l'agriculture n'ont pas baiss de prix dans la mme
proportion que ceux de l'industrie manufacturire ; en outre, si les prix des crales
et des vins ont une tendance manifeste la baisse, les prix de la viande et des
aliments de luxe ont plutt une tendance gnrale la hausse ; quoi qu'il en soit, on
peut dire, en somme, que la rente ne s'est pas accrue par l'effet de la hausse de
chacun des produits, mais par l'effet de leur multiplication. Grce une culture
intensive, la rmunration du propritaire a augment, bien que la valeur de
l'ensemble des produits ait dcru ou qu'elle soit reste stationnaire : telle est, en
dfinitive, la vritable doctrine d'Adam Smith, doctrine consolante s'il en est une,
et nous ne pouvons qu'y applaudir.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
195
Quatrime section.
De la consommation des richesses.
Retour la table des matires
Adam Smith est, aprs Hobbes, le premier philosophe qui ait compris le rle
puissant de l'pargne dans la formation des richesses. On a condamn parfois
l'pargne comme un tort fait la socit, mais si c'est l la condamnation
conomique du thsauriseur pour qui l'pargne est un but et non un moyen, cet
arrt n'atteint en rien celui qui rduit actuellement ses consommations
improductives pour employer une plus forte part de son revenu la reproduction.
Au point de vue moral, l'pargne, bien distincte de l'avarice, n'est pas plus
critiquable, car elle est une manifestation leve, du sentiment de la responsabilit
humaine et le rsultat d'un sacrifice mritoire de l'homme valide qui, au prix de
privations immdiates, cherche se garantir contre les hasards des mauvais jours
et se prmunir contre les infirmits de la vieillesse ou les risques du lendemain.
Aussi, cet homme, Smith l'a clbr comme un bienfaiteur de la socit. Les
capitaux, dit-il, augmentent par l'conomie 1 ; ils diminuent par la prodigalit et la
mauvaise conduite. Tout ce qu'une personne pargne sur son revenu, elle l'ajoute
son capital ; alors, ou elle l'emploie elle-mme entretenir un nombre, additionnel
de gens productifs, ou elle met quelque autre personne en tat de le faire en lui
prtant ce capital moyennant un intrt, cest--dire une part dans les profits. De
mme que le capital d'un individu ne peut s'augmenter que par le fonds que cet
individu pargne sur son revenu ou sur ses gains annuels, de mme le capital d'une
socit, lequel n'est autre chose que celui de tous les individus qui la composent,
ne peut s'augmenter que par la mme voie.
On a critiqu cependant cette assimilation de l'pargne de la socit l'pargne
des individus et on a prtendu que ce qui est recommandable pour l'individu serait
nuisible pour la nation si tous les citoyens suivaient de tels conseils et rduisaient
leurs consommations au minimum 2 . Mais on aurait d remarquer que Smith, en
prconisant l'pargne, n'avait nullement encourag les privations excessives, et
qu'allant plus loin mme que ses dtracteurs, il considrait celles-ci comme
funestes non seulement pour les nations, mais encore pour les individus. Il a
montr, en effet, que si l'pargne devenait excessive, si, au prix de privations
1
2
Rich., liv. II, ch. III (t. I, p. 421).
Ces critiques ont t notamment dveloppes par le comte de Lauderdale, dans ses Recherches
sur la nature et l'origine de la Richesse publique et sur les moyens et les causes qui concourent
son accroissement (ouvrage traduit de langlais par E. Lagentie de Lawasse. Paris, Dentu,
1808).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
196
considrables, les capitaux augmentaient jusqu' ne plus trouver d'emplois
rmunrateurs, alors la production se ralentirait, faute de consommations et de
dbouchs, au dtriment de la nation qui souffrirait de la crise produite par
l'engorgement des marchandises, et en mme temps au dtriment des individus ;
car tous les citoyens, du moins ceux qui pargnent, tant la fois des
consommateurs et des producteurs, ils subiraient durement, en tant que
producteurs, le contre-coup des privations qu'ils se seraient imposes en tant que
consommateurs.
D'ailleurs cet cueil n'est jamais craindre. De notre temps mme o l'esprit de
prvoyance a fait des progrs considrables jusque dans les classes laborieuses, le
nombre des individus qui se privent de consommations ncessaires pour en
pargner le montant est extrmement restreint, et il est plus que compens par le
nombre des prodigues. C'est pourquoi Smith a pu approuver sans rserve cette
pargne qu'il aurait voulu voir se multiplier dans toutes les classes du peuple.
L'excs des privations volontaires n'est pas possible, et, le serait-il, qu'il ne serait
nanmoins pas ncessaire de mettre les hommes en garde contre cet entranement,
car cet excs cesserait par son exagration mme : la baisse de l'intrt viendrait
bien vite imposer un frein cette accumulation ; faute de trouver un emploi
rmunrateur, les nouveaux capitaux se dissiperaient en consommations
improductives et l'quilibre se rtablirait de lui-mme par l'effet des lois
conomiques. Si donc il peut y avoir l un danger, comme dans l'usage des
meilleurs instruments, il est peu redoutable et il ne doit nullement entrer en
considration lorsqu'il s'agit d'engager l'homme pargner.
Smith a expos avec ampleur la puissante action de l'pargne sur la
reproduction et mme sur la rpartition des richesses. La cause immdiate de
l'augmentation du capital, dit-il, c'est l'conomie et non l'industrie. la vrit,
l'industrie fournit la matire des pargnes que fait l'conomie ; mais, quelques
gains que fasse l'industrie, sans l'conomie qui les pargne et les amasse, le capital
ne serait jamais plus grand. L'conomie, en augmentant le fonds destin
l'entretien des salaris productifs, tend augmenter le nombre de ces salaris dont
le travail ajoute la valeur du sujet auquel il est appliqu ; elle tend donc
augmenter la valeur changeable du produit annuel de la terre et du travail du
pays ; elle met en activit une quantit additionnelle d'industrie qui donne un
accroissement de valeur au produit annuel. Ce qui est annuellement pargn est
aussi rgulirement consomm que ce qui est annuellement dpens, et il l'est aussi
presque dans le mme temps, mais il est consomm par une autre classe de gens.
Cette portion de son revenu qu'un homme riche dpense annuellement est le plus
souvent consomme par des bouches inutiles et par des domestiques qui ne laissent
rien aprs eux en retour de leur consommation. La portion qu'il pargne
annuellement, quand il l'emploie immdiatement en capital pour en tirer du profit,
est consomme de mme et presque en mme temps que l'autre, mais elle l'est par
une classe de gens diffrente, par des ouvriers, des fabricants et artisans qui
reproduisent avec profit la valeur de leur consommation annuelle. ...Un homme
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
197
conome, poursuit-il, par ses pargnes annuelles, non seulement fournit de
l'entretien un nombre additionnel de gens productifs pour cette anne ou pour la
suivante, mais il est comme le fondateur d'un atelier public et il tablit en quelque
sorte un fonds pour l'entretien perptuit d'un mme nombre de gens productifs.
la vrit, la destination et l'emploi de ce fonds ne sont pas toujours assurs par
une loi expresse, une substitution ou un acte d'amortissement. Nanmoins, un
principe trs puissant en garantit l'emploi : c'est l'intrt direct et vident de chaque
individu auquel pourra appartenir dans la suite quelque partie de ce fonds. Aucune
partie n'en pourra plus, l'avenir, tre dtourne pour un autre emploi que
l'entretien des salaris productifs, sans qu'il en rsulte une perte vidente pour la
personne qui en changerait ainsi la vritable destination.
Il condamne le prodigue au nom des mmes considrations. En ne bornant
pas sa dpense son revenu, dit-il, le prodigue entame son capital, comme un
homme qui dissipe quelque usage profane les revenus d'une fondation pieuse ; il
paie des salaires la fainantise avec ces fonds que la frugalit de nos pres avait,
pour ainsi dire, consacrs l'entretien de l'industrie. En diminuant la masse des
fonds destins employer le travail productif, il diminue ncessairement, autant
qu'il est en lui, la somme de ce travail qui ajoute une valeur au sujet auquel il est
appliqu, et par consquent la valeur du produit annuel de la terre et du travail du
pays, la richesse et le revenu rel de ses habitants. Toutefois le philosophe
constate qu'heureusement la prodigalit n'est gure qu'une exception, et
l'exprience du psychologue vient rassurer l'conomiste. La profusion, dit-il, le
principe qui nous porte dpenser, c'est la passion pour les jouissances actuelles,
passion qui est, la vrit, quelquefois trs forte et trs difficile rprimer, mais
qui est en gnral passagre et accidentelle. Mais le principe qui nous porte
pargner, c'est le dsir d'amliorer notre sort, dsir, qui est, en gnral, la vrit,
calme et sans passion, mais qui nat avec nous et ne nous quitte qu'au tombeau.
Dans tout lintervalle qui spare ces deux termes de la vie, il n'y a peut-tre pas un
seul instant o un homme se trouve assez pleinement satisfait de son sort, pour n'y
dsirer aucun changement ni amlioration quelconque. Or, une augmentation de
fortune est le vrai moyen par lequel la majeure partie des hommes se propose
d'amliorer leur sort ; c'est le moyen le plus commun qui leur vient le premier la
pense ; et la voie la plus simple et la plus sre d'augmenter sa fortune, c'est
d'pargner et d'accumuler, ou rgulirement chaque anne, ou dans quelques
occasions extraordinaires, une partie de ce qu'on gagne. Ainsi, quoique le principe
qui pousse dpenser l'emporte chez presque tous les hommes en certaines
occasions, et presque en toutes les occasions chez certaines personnes, cependant,
chez la plupart des hommes, en prenant en somme tout le cours de leur vie, il
semble que le principe qui porte l'conomie, non seulement prvaut la longue,
mais prvaut mme avec force. ...Dans presque toutes les circonstances,
l'conomie et la sage conduite prive suffisent, non seulement pour compenser
l'effet de la prodigalit et de l'imprudence des particuliers, mais mme pour
balancer celui des profusions excessives des gouvernements.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
198
Toute cette doctrine de l'pargne est fort remarquable, et on pourrait multiplier
les citations sans qu'aucun point soulve de srieuses objections. Le clbre
conomiste a fait un parallle trs net des deux genres de consommations que J.-B.
Say a appeles plus tard consommations improductives et consommations
reproductives ; et il a fort clairement dmontr que toute consommation, qu'elle
soit par sa fin improductive ou reproductive, donne toujours lieu immdiatement
une mme somme de services personnels, la diffrence fondamentale consistant en
ce que, dans le premier cas, la consommation faite ne se renouvelle pas, tandis que,
dans le second, elle se renouvelle et se multiplie.
Le seul reproche que l'on puisse faire peut-tre cette tude est de n'avoir pas
distingu assez nettement, parmi les consommations improductives, les
consommations ncessaires et les consommations de luxe. Il est vrai que le luxe est
bien difficile dterminer, et Smith n'en a pas abord directement la dfinition.
Par objets de ncessit, dit-il quelque part 1 , j'entends non seulement les denres
qui sont indispensablement ncessaires au soutien de la vie, mais encore toutes les
choses dont les honntes gens, mme de la dernire classe du peuple, ne sauraient
dcemment manquer, selon les usages du pays... Toutes les autres choses, je les
appelle luxe, sans nanmoins vouloir, par cette dnomination, jeter le moindre
degr de blme sur l'usage modr qu'on en peut faire. Cette distinction est peu
scientifique et surtout peu pratique. Quelles sont, en effet, les consommations
superflues, et quelles sont les consommations ncessaires ? La rponse est
diffrente suivant les temps, les lieux, les individus, et beaucoup de
consommations juges superflues il y a quelques sicles, sont devenues Smith le
reconnat indiscutablement ncessaires notre poque pour tout homme civilis.
Chacun sent ce qu'est le luxe, mais on est gnralement impuissant le dfinir par
une formule. Nous estimons toutefois, qu'au lieu de chercher faire cette
distinction d'aprs la nature des consommations et leur rapport avec nos besoins, il
et t prfrable de dire que le luxe rside dans l'excdant des consommations
personnelles d'une classe sur la part de cette classe dans la rpartition, car les
consommations superflues ne sont pas blmables en elles-mmes, et Smith le
comprenait bien ainsi ; elles ne sont rprhensibles qu'autant qu'elles diminuent la
somme des richesses.
Mais un autre sujet qu'Adam Smith a trait de main de matre, est le rle de
ltat dans la formation de l'pargne. Htons-nous de dire que, pour le clbre
conomiste, ce rle est purement ngatif, et que si ltat a ncessairement une
action puissante sur l'accroissement des richesses, ce n'est pas en stimulant
l'pargne, mais simplement en vitant de l'entraver par sa prodigalit et en ne
prlevant pas sur le revenu annuel des citoyens des sommes trop considrables.
Les tats ont cependant leurs consommations, et ces consommations sont
mme la raison d'tre des gouvernements ; car la constitution des nationalits a eu
1
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 562.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
199
son origine dans l'impuissance des hommes satisfaire certains besoins en restant
isols, les individus se sont syndiqus dans le dessein d'y pourvoir en commun et
ils ont charg certains d'entre eux de lever une partie des revenus privs pour
atteindre ce but. Aussi, si l'tat n'a pas lui-mme pargner, parce que son pargne
ne serait qu'un retranchement dispendieux de la somme des pargnes prives que
les particuliers sont bien plus habiles faire valoir eux-mmes, nanmoins,
l'conomie s'impose lui avec plus de force encore qu'aux citoyens. Les taxes qu'il
lve ne sont lgitimes qu'autant qu'elles ont pour objet de satisfaire, non seulement
un intrt gnral, mais un vritable besoin que l'initiative prive est impuissante
contenter, et qu'autant qu'elles sont strictement proportionnes la dpense
ncessaire. Hors de ces limites, les impts ne sont pas seulement anticonomiques, ils sont aussi injustes ; et si le gaspillage et la prodigalit sont
funestes l'tat comme aux individus, ils sont encore plus coupables de la part
d'un gouvernement qui, ainsi qu'un tuteur malhonnte, dissipe le revenu de
l'incapable qu'il est charg de protger.
Smith a parfaitement compris toute l'importance de ce sujet, et il a jug qu'il
mritait une longue tude. En effet, si pour les consommations prives, on peut se
reposer sur l'intrt personnel et l'esprit de prvoyance naturel l'homme, pour
engager les particuliers l'conomie, il n'en est pas du tout ainsi des
consommations publiques. Pour les gouvernements, l'intrt personnel n'existe pas,
et la tendance au gaspillage est bien plus dangereuse en ce qu'elle manque de ce
contre-poids immdiat et ncessaire qui est la meilleure garantie contre les
entranements des individus 1 . La seule sauvegarde du revenu annuel consiste alors
dans les sentiments d'quit et de justice de ceux qui dirigent la fortune publique ;
mais les prjugs en cours ont bien souvent dissimul, aux yeux mmes des
hommes politiques, l'injustice de leurs rglements, ou servi de prtexte aux
mesures les plus iniques. Le philosophe cossais a donc pris tche de dissiper ces
erreurs, et, en montrant au peuple quel doit tre le rle de l'tat dans
l'administration de ses deniers, en prouvant en mme temps aux gouvernants que
l'intrt du Trsor est partout conforme, en dfinitive, aux intrts de la nation
comme aux principes de la justice, il a rendu un immense service l'humanit.
Il a ainsi restreint dans des bornes trs troites les DPENSES DE L'TAT.
Dans le systme de la libert naturelle, dit-il 2 , le souverain n'a que trois
devoirs remplir ; trois devoirs, la vrit, d'une haute importance, mais clairs,
simples, et la porte d'une intelligence ordinaire. Le premier, c'est le devoir de
dfendre la socit de tout acte de violence ou d'invasion de la part des autres
socits indpendantes. Le second, c'est le devoir de protger, autant qu'il est
1
Les princes et les ministres sont toujours et sans exception, les plus grands dissipateurs de la
socit. Qu'ils surveillent seulement leurs propres dpenses, et ils pourront sen reposer sur
chaque particulier pour rgler les siennes. Si leurs propres dissipations ne viennent pas bout de
ruiner l'tat, certes celles des sujets ne le ruineront jamais. (Rich., liv. II, ch. III, t. I, p. 434.)
Rich., liv. IV, ch. IX (t. II, p. 338).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
200
possible, chaque membre de la socit contre l'injustice ou l'oppression de tout
autre membre, ou bien le devoir d'tablir une administration exacte de la justice. Et
le troisime, c'est le devoir d'riger et d'entretenir certains ouvrages publics et
certaines institutions que l'intrt priv d'un particulier ou de quelques particuliers
ne pourrait jamais les porter riger on entretenir, parce que jamais le profit n'en
rembourserait la dpense un particulier ou quelques particuliers, quoique,
l'gard d'une grande socit, ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les
dpenses.
vrai dire, cette dernire classe est si lastique que toutes les dpenses que les
diffrents tats ont jug propos de se rserver, pourraient, la rigueur, rentrer
dans cette numration ; mais, dans les nombreux dveloppements qu'il a donns
ce sujet, l'auteur a tenu prciser sa pense et il a dsign limitativement les seuls
services dont, selon lui, le gouvernement peut et doit se charger. C'est l, l'objet
d'un long chapitre qui ne comprend pas moins de 150 pages et qui est fort
intressant. Adam Smith ne s'y est pas confin dans les limites de l'conomie
politique, il s'est plac un point de vue plus lev, celui du professeur qui avait
tudi, sous toutes ses faces l'histoire de la Civilisation, et il a mis en parallle, non
seulement les considrations relatives l'accroissement du bien-tre et de la
richesse publique, mais encore les considrations suprieures de la morale, tout en
modifiant parfois la rigueur de ses conclusions spculatives par les enseignements
de l'histoire ou les ncessits de la politique. Il avait compris, en effet, que, pour
apprcier les besoins gnraux d'une nation et les moyens de les satisfaire, il y a,
en ralit, une foule d'lments divers considrer et souvent concilier : la
morale, l'conomie politique, l'histoire, la politique et mme l'hygine, trouvent
leur place dans cette tude, et, mieux que tout autre, Smith tait prpar, par la
nature mme et l'tendue de ses travaux, peser avec quit la valeur respective
des diffrents arguments qui pouvaient tre mis en balance dans cette dlicate
matire.
Le premier des services et le plus essentiel que l'on est en droit d'attendre du
souverain est la scurit de la nation. Adam Smith approuve donc sans rserve les
dpenses de cette nature dans les limites o elles sont ncessaires, et il estime
mme que l'augmentation continuelle de ces dpenses, par suite de la
transformation de l'art de la guerre, a eu, en fait, une relle influence sur la
civilisation. Remontant aux sicles barbares, il nous montre l'origine des armes
chez les peuples chasseurs et chez les tribus nomades de pasteurs, puis dans les
anciennes rpubliques grecques et romaine, alors que tout le monde tait guerrier
et s'entretenait ses frais. Mais l'accroissement de lindustrie et les progrs de l'art
de la guerre vinrent imposer aux nations une autre organisation, base sur le
principe de la division du travail, et l'auteur en vante les heureux effets. Au point
de vue conomique, il fait ressortir les avantages inhrents la sparation des
tches ; au point de vue militaire, il montre la supriorit irrsistible qu'une
arme de troupes rgles, bien disciplines, a sur les milices, et, entrant cet
gard dans des considrations historiques fort remarquables, il cherche expliquer,
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
201
par la prpondrance de l'lment permanent dans les armes, la grandeur ou la
dcadence des principales nations de l'Europe. Enfin, au point de vue politique et
social, il voit dans cette transformation un agent trs puissant de civilisation : Si
ce n'est, dit-il 1 , que par le moyen d'une arme de troupes rgles, bien tenues,
qu'un pays civilis peut pourvoir sa dfense, ce ne peut tre non plus que par ce
moyen qu'un pays barbare peut passer tout d'un coup un tat passable de
civilisation. Une arme de troupes rgles fait rgner, avec une force irrsistible, la
loi du souverain jusque dans les provinces les plus recules de l'empire, et elle
maintient une sorte de gouvernement rgulier dans des pays qui, sans cela, ne
seraient pas susceptibles d'tre gouverns. Quiconque examinera avec attention les
grandes rformes faites par Pierre le Grand dans l'empire de Russie, verra qu'elles
se rapportent presque toutes l'tablissement d'une arme de troupes bien rgles.
C'est l l'instrument qui lui sert excuter et maintenir toutes ses autres
ordonnances. Ainsi l'minent politique ne marchande pas son adhsion ces
dpenses qui rpondent au besoin le plus pressant des citoyens et qui leur
permettent de se consacrer avec scurit aux travaux productifs de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce.
En dehors de cette protection gnrale de la masse des individus contre les
attaques des nations voisines, ltat a le devoir de protger chaque particulier
contre l'injustice et l'oppression des autres citoyens, au moyen d'une bonne
administration de la justice. Comme pour les armes, les dpenses ncessaires la
police et l'administration de la justice se sont accrues avec la civilisation. On n'en
a gure senti la ncessit que lors de la constitution de la proprit et lorsqu'il a pu
s'tablir une certaine subordination parmi les membres de la socit, d'abord au
profil du plus g, puis au profit du plus puissant ou du plus riche. Ce fut alors le
chef ou le souverain qui rendit la justice, et cette institution, au lieu d'imposer une
charge ltat, devint pour lui une source fort importante de revenus. Mais quand,
par suite de l'accroissement des dpenses, les revenus du domaine devinrent
insuffisants et qu'il fut ncessaire de recourir au principe d'une contribution
gnrale, on tendit l'impt la rtribution de la justice : afin d'viter la corruption,
on dcida que les juges ne recevraient plus, l'avenir, qu'un salaire fixe, et la
justice fut administre gratuitement. Enfin la civilisation, en multipliant le nombre
des affaires et des contestations, provoqua la sparation du pouvoir judiciaire et du
pouvoir excutif, et cette nouvelle application de la division du travail eut
d'excellents effets au point de vue de l'administration de la justice, trop souvent
sacrifie jusque l aux intrts politiques.
Adam Smith approuve sans rserve cette sparation des pouvoirs qui donne la
magistrature l'indpendance ncessaire ses fonctions 2 . Toutefois, en raison
1
2
Rich., liv. V, ch. I (t. II, p. 359).
Quand le pouvoir judiciaire est runi au pouvoir excutif, dit Smith, il n'est gure possible que
la justice ne se trouve pas souvent sacrifie ce quon appelle vulgairement des considrations
politiques. Sans qu'il y ait mme aucun motif de corruption en vue, les personnes dpositaires
des grands intrts de l'tat peuvent s'imaginer quelquefois que ces grands intrts exigent le
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
202
mme de la ncessit d'une justice indpendante, il n'approuve pas aussi
pleinement la rtribution des juges sur les fonds de l'impt, car il faut, dit-il, non
seulement que le juge ne soit pas sujet tre dplac ou priv de ses fonctions
d'aprs la dcision arbitraire du pouvoir excutif, mais encore que le paiement
rgulier de son salaire ne dpende pas de la bonne volont, ni mme de la bonne
conomie de ce pouvoir. En mme temps et un autre point de vue, il fait ses
rserves sur l'opportunit de donner aux juges des salaires fixes : il estime cet
gard qu'il y aurait peut-tre lieu plutt de les proportionner la peine rellement
prise et surtout de les faire payer par les plaideurs eux-mmes, attendu qu'il lui
semble plus quitable que cette charge retombe directement sur ceux qui profitent
du service ou qui provoquent l'action des tribunaux par leurs violences ou leurs
prtentions iniques. La dpense qu'exige l'administration de la justice, dit-il 1 ,
peut aussi sans doute tre regarde comme faite pour l'avantage commun de toute
la socit. Il n'y aurait donc rien de draisonnable quand cette dpense serait aussi
dfraye par une contribution gnrale. Cependant les personnes qui donnent lieu
cette dpense sont celles qui, par des actions et des prtentions injustes, rendent
ncessaire le recours la protection des tribunaux ; comme aussi les personnes qui
profitent le plus immdiatement de cette dpense, ce sont celles que le pouvoir
judiciaire a rtablies ou maintenues dans leurs droits, ou viols
ou attaqus. Ainsi, les dpenses d'administration de la justice pourraient trs
convenablement tre payes par une contribution particulire, soit de l'une ou de
l'autre, soit de ces deux diffrentes classes de personnes, mesure que l'occasion
l'exigerait, c'est--dire par des honoraires ou vacations pays aux cours de justice.
Il ne peut y avoir ncessit de recourir une contribution gnrale de toute la
socit que pour la conviction de ces criminels qui n'ont personnellement ni bien,
ni fonds quelconque sur lequel on puisse prendre ces vacations.
C'est, en somme, dans ces limites trs restreintes que Smith admet les dpenses
de l'tat en ce qui concerne l'administration de la justice, et il considre que si le
souverain a le devoir d'assurer la justice, il est cependant prfrable qu'il la fasse
rmunrer, suivant des tarifs rglementaires, par les parties elles-mmes.
Il professe peu prs la mme doctrine l'gard des dpenses qu'exigent les
travaux et tablissements publics. Le troisime et le dernier des devoirs du
souverain est, en effet, suivant Smith, celui d'lever et d'entretenir ces ouvrages et
ces tablissements publics qui, tout en tant d'intrt gnral, ne sont nanmoins
pas de nature pouvoir tre entrepris par des particuliers, parce qu'ils ne sont pas
assez rmunrateurs. Il estime donc que l'tat doit, dans certains cas, se faire
sacrifice des droits d'un particulier ; mais c'est sur une administration impartiale de la justice
que repose la libert individuelle de chaque citoyen, le sentiment qu'il a de sa propre sret.
Pour faire que chaque individu se sente parfaitement assur dans la possession de chacun des
droits qui lui appartiennent, non-seulement il est ncessaire que le pouvoir judiciaire soit spar
du pouvoir excutif, mais il faut mme qu'il en soit rendu aussi indpendant que possible.
(Rich., liv. V, ch. I, t. II, p. 375).
Rich., liv. I (t. II, p. 480).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
203
entrepreneur, mais seulement lorsque l'initiative prive fait dfaut et que l'intrt
gnral est indiscutablement tabli.
Ces entreprises sont de deux sortes :
1 Celles qui ont pour objet de faciliter le commerce ;
2 Celles qui sont destines tendre l'instruction parmi le peuple.
Les entreprises de la premire catgorie sont, selon l'auteur, lgitimes en
principe, soit qu'elles aient pour objet de favoriser la circulation en gnral, soit
qu'elles aient seulement pour but de favoriser certaines branches particulires du
commerce. Ltat, en effet, ne doit pas se dsintresser du dveloppement de son
rseau de routes, pas plus que de ses canaux, des ponts, etc. ; mais il n'est
nullement ncessaire cependant que la dpense de ces ouvrages soit dfraye par
ce qu'on appelle communment le revenu public, celui dont la perception et
l'application sont, dans la plupart des pays, attribues au pouvoir excutif. Smith
estime, cet gard, que la plupart de ces entreprises peuvent aisment tre rgies
de manire fournir un revenu particulier suffisant pour couvrir leur dpense, sans
grever d'aucune charge le revenu commun de la socit, et il donne d'heureux
exemples de la spcialit des taxes dans les droits de barrire ou de page pays
par les intresss pour l'usage des routes et des ponts, dans les droits de
seigneuriage exigs pour la fabrication de la monnaie et surtout dans les taxes
postales. Il trouve dans cette manire de procder de nombreux avantages, car non
seulement ces taxes sont plus justes, parce qu'elles ne sont supportes que par ceux
qui profitent de la dpense, mais les travaux eux-mmes sont plus
conomiquement effectus et mieux compris parce que l'intrt direct de ceux qui
les entreprennent est ici en jeu. Il insiste mme en toute occasion sur la prfrence
accorder l'industrie prive, lorsqu'elle consent se charger non seulement de
l'exploitation, mais encore de la construction. Alors, en effet, il faut que chaque
ouvrage fournisse au moins son revenu et la prime ncessaire l'amortissement du
capital : de la sorte, pas de grands travaux inutiles, pas de luxe strile, mais des
entreprises en rapport avec les besoins qu'elles ont pour but de satisfaire.
Lorsque les grandes routes, les ponts, les canaux, dit-il 1 , sont ainsi construits et
entretenus par le commerce mme qui se fait par leur moyen, alors ils ne peuvent
tre tablis que dans les endroits o le commerce a besoin d'eux, et, par
consquent, o il est propos de les construire. La dpense de leur construction,
leur grandeur, leur magnificence, rpondent ncessairement ce que ce commerce
peut suffire payer. Par consquent, ils sont ncessairement tablis comme il est
propos de les faire. Dans ce cas, il n'y aura pas moyen de faire ouvrir une
magnifique grande route dans un pays dsert qui ne comporte que peu ou point de
commerce, simplement parce qu'elle mnera la maison de campagne de
l'intendant ou au chteau de quelque grand seigneur auquel l'intendant cherchera
1
Rich., liv. V, ch. I (t. II, p. 378).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
204
faire sa cour. On ne s'avisera pas d'lever un large pont sur une rivire un endroit
o personne ne passe et seulement pour embellir la vue des fentres d'un palais
voisin, choses qui se voient quelquefois dans des provinces o les travaux de ce
genre sont pays sur un autre revenu que celui fourni par eux-mmes.
Ce passage est l'un des plus beaux de toute l'uvre de Smith, et l'illustre
philosophe ne pouvait mieux faire ressortir le vice fondamental des travaux
entrepris par l'tat. Il va d'ailleurs encore plus loin dans cette voie, et, lors mme
que l'initiative prive a fait dfaut et que l'tat a d, dans un intrt gnral bien
tabli, construire lui-mme, il veut qu'il se dessaisisse de l'entretien, qu'il charge
une rgie d'y pourvoir et de percevoir les taxes. Si l'tat, en effet, exploite luimme, non seulement il enlve ainsi tout recours aux intresss pour le cas o
l'entretien deviendrait dfectueux, mais il est en outre fatalement entran abuser
de son monopole et de sa toute puissance trouvant bientt dans les droits perus
une ressource fiscale, il arrive ncessairement les augmenter, il supprime ainsi
toute proportion entre le montant des dpenses et la quotit des taxes et il fait
participer aux charges ceux-l mmes qui ne peuvent profiter des services.
Smith prfre donc, dans tous les cas, le systme de la rgie et des droits de
barrire en usage en Angleterre, au systme franais de la gratuit des routes. En
effet, durant son voyage Toulouse et dans les provinces du Midi de la France, il
avait t frapp de l'tat pitoyable de la plupart de nos voies de communication.
Tant qu'il avait voyag sur les grandes routes de poste, il n'avait pas eu se
plaindre, et il juge que beaucoup sont mieux entretenues mme que les routes
barrires de son pays ; mais lorsqu'il dut sortir de ces larges voies et prendre des
chemins de traverse, il trouva ceux-ci fort ngligs ; ils taient parfois absolument
impraticables mme une forte voiture, et cependant ils formaient cette poque
la majeure partie de notre rseau. En certains endroits, dit Smith 1 , il est mme
dangereux de voyager cheval, et, pour y passer avec quelque sret, on ne peut
gure se fier qu' des mulets. Le ministre orgueilleux d'une cour fastueuse se plaira
souvent faire excuter un ouvrage d'clat et de magnificence, tel qu'une grande
route qui est, tout moment, sous les yeux de cette haute noblesse dont les loges
flattent sa vanit et contribuent de plus soutenir son crdit la Cour. Mais
ordonner beaucoup de ces petits travaux qui ne peuvent rien produire de trs
apparent ni attirer les regards du voyageur, de ces travaux, en un mot, qui n'ont
rien de recommandable que leur extrme utilit, c'est une chose qui semble, tous
gards, trop mesquine et trop misrable pour fixer la pense d'un magistrat de cette
importance. Aussi, sous une pareille administration, les travaux de ce genre sontils presque toujours totalement ngligs.
Smith avait raison lorsqu'il montrait les vices du rgime franais, et nous avons
mis profit ses critiques. Toutefois si, comme l'affirmait le clbre conomiste, les
rformes n'taient alors possibles, sous le gouvernement absolu de Louis XV,
1
Rich., liv. V, ch. I, t. II, p. 382).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
205
qu'au moyen de la spcialit des taxes et de la mise en rgie des routes,
l'exprience a montr que, sous un rgime de contrle parlementaire, la
dcentralisation peut donner aussi d'excellents rsultats en chargeant les
dpartements et les communes de la construction et de l'entretien des voies qui les
intressent particulirement. Nous en avons la preuve dans les heureux effets
produits, en ce qui concerne notre rseau, par le dcret du 16 dcembre 1811 sur
les routes nationales et dpartementales, et par la loi du 21 mai 1836 sur les
chemins vicinaux. En mme temps qu'au point de vue politique et conomique,
cette rforme a acclr le dveloppement de nos routes et assur leur entretien en
en confiant le soin aux intresss eux-mmes, elle a eu aussi, au point de vue de la
justice pure, des avantages analogues ceux de la spcialit, en mettant la dpense,
suivant l'intrt plus ou moins local des diffrentes voies, la charge de l'tat, des
communes ou des dpartements. C'est ainsi que, sans gner la circulation par des
droits de barrire, on a rsolu le problme de ne faire contribuer aux frais que ceux
des citoyens qui profitent ou peuvent profiter immdiatement des services rendus.
En dehors de ces entreprises qui ont pour objet de faciliter le commerce en
gnral, Smith admet encore que l'tat se charge de certaines autres, dans l'intrt
de diverses branches particulires de commerce. Ainsi le commerce de nos
concitoyens l'tranger a besoin d'une protection spciale pour assurer sa scurit,
surtout dans les pays lointains. Or, selon l'auteur des Recherches, cette protection
des nationaux incombe l'tat et il doit la leur procurer, soit en entretenant des
ambassadeurs ou des consuls chez les peuples civiliss, soit en tablissant une
force arme et des points fortifis chez les peuples sauvages. Cette fonction de
l'tat est, pour ainsi dire, le corollaire de son premier devoir qui est de dfendre les
citoyens contre les attaques des autres nations, et il ne doit recourir ici, pas plus
que pour la dfense commune, des intermdiaires pour assurer cette protection 1 .
Toutefois, il est arriv en fait que, chez la plupart des peuples de l'Europe, des
compagnies particulires ont obtenu de l'tat la dlgation de sa mission
protectrice, moyennant certains avantages qui constituaient gnralement en
monopole leur profit tout le commerce du pays ; c'est l l'origine des
Compagnies de commerce, Compagnies privilgies ou Compagnies par actions
suivant les cas et les pays, et Smith examine longuement leur caractre, le tort
qu'elles ont fait au commerce qu'elles taient charges de protger, et les causes de
leur dcadence. Il montre que si ces Compagnies, en faisant leurs propres dpens
une exprience que l'tat n'avait pas jug prudent de faire lui-mme, ont pu servir
en ralit introduire quelques nouvelles branches de commerce, elles sont
1
La protection du commerce en gnral a toujours t regarde comme essentiellement lie la
dfense de la chose publique, et, sous ce rapport, comme une partie ncessaire des devoirs du
pouvoir excutif ; par suite, la perception et l'emploi des droits gnraux de douane ont toujours
t laisss ce pouvoir. Or, la protection d'une branche particulire du commerce est une partie
de la protection gnrale du commerce, et, par consquent, une partie des fonctions de ce mme
pouvoir ; et si les nations agissaient toujours d'une manire consquente, les droits particuliers
perus pour pourvoir une protection particulire de ce genre auraient toujours t laisss
pareillement sa disposition. (Rich., liv. V, ch. I, t. II, p. 356.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
206
devenues partout, la longue, ou nuisibles ou inutiles au commerce en gnral ;
elles lui ont donn une fausse direction et ont fini par le restreindre, car leur but a
toujours t, comme nous l'avons rappel propos du systme mercantile, de tenir
le march aussi dgarni que possible afin d'lever leurs profits un taux
extravagant.
Nanmoins, l'auteur ne condamne pas absolument ces Compagnies, et
l'conomiste cde ici le pas l'homme d'tat. En raison de l'importance du devoir
de protection qui incombe au gouvernement l'gard de ses nationaux et des
obstacles d'ordre politique, et financier qui s'opposent souvent une action directe
de sa part, il admet que l'tat puisse exceptionnellement faire appel au concours de
l'association, et, pour prix de ce concours, accorder momentanment des
Compagnies des privilges commerciaux de nature les indemniser de leurs
dpenses et les rmunrer de leurs risques. C'est l un de ces compromis qui
abondent dans l'uvre de Smith, compromis qu'on peut avoir parfois blmer au
point de vue purement conomique, mais qui clairent sous son vrai jour le
caractre si politique du clbre philosophe et qui sont une des causes les plus
puissantes de son influence sur ses contemporains et sur la postrit 1 .
En ce qui concerne les tablissements d'instruction publique, Smith abandonne
compltement l'initiative prive l'instruction secondaire et suprieure. Non
seulement il n'admet pas que les professeurs aient un traitement fixe pay sur le
produit gnral de l'impt, mais il estime que les dotations particulires des
collges et des coles sont un obstacle aux progrs de l'enseignement. Il n'est pas
bon, selon lui, que le professeur se repose avec scurit sur son traitement, il faut
qu'il ait un intrt pcuniaire remplir exactement ses fonctions, sans quoi son
intrt immdiat se trouve mis trop directement en opposition avec son devoir
professionnel : s'il est ngligent, il s'abandonnera son indolence ; si au contraire il
est actif, il emploiera son activit d'autres tudes. En supposant mme tous les
professeurs consciencieux et travailleurs, Smith maintient encore ses conclusions,
et il pense que, dans ce cas aussi, il est ncessaire que le matre puisse savoir par
l'augmentation ou la diminution de sa rtribution pcuniaire, c'est--dire par le
nombre des lves qui suivent son cours, s'il leur donne d'utiles connaissances ou
s'il fait fausse route. S'il n'y avait pas d'institutions publiques pour l'ducation,
dit-il 2 , alors il ne s'enseignerait aucune science, aucun systme ou cours
d'instruction dont il n'y et pas quelque demande, c'est--dire aucun que les
1
Quand une socit de marchands entreprend, ses propres dpens et ses risques, d'tablir
quelque nouvelle branche de commerce avec des peuples lointains et non civiliss, il peut tre
assez raisonnable de l'incorporer comme compagnie par actions, et de lui accorder, en cas de
russite, le monopole de ce commerce pour un certain nombre d'annes. C'est la manire la plus
naturelle et la plus facile dont l'tat puisse la rcompenser d'avoir tent les premiers hasards
d'une entreprise chre et prilleuse dont le public doit ensuite recueillir le profit. Un monopole
temporaire de ce genre peut tre justifi par les mmes principes qui font qu'on accorde un
semblable monopole l'inventeur d'une machine nouvelle, et celui d'un livre nouveau son
auteur. (Rich., liv. V, ch. I, t. II, p. 414).
Rich., liv. V, ch. I (t. II, p. 441).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
207
circonstances du temps ne rendissent ou ncessaire, ou avantageux, ou convenable
d'apprendre. Un matre particulier ne trouverait jamais son compte adopter, pour
l'enseignement d'une science reconnue utile, quelque systme vieilli et totalement
dcri, ni enseigner de ces sciences gnralement regardes comme un pur amas
de sophismes et de verbiage insignifiant, aussi inutile que pdantesque. De tels
systmes, de telles sciences ne peuvent avoir d'existence ailleurs que dans ces
socits riges en corporations pour l'ducation, socits dont la prosprit et le
revenu sont, en grande partie, indpendants de leur rputation et totalement de leur
industrie. S'il n'y avait pas d'institutions publiques pour l'ducation, on ne verrait
pas un jeune homme de famille, aprs avoir pass par le cours d'tudes le plus
complet que l'tat actuel des choses soit cens comporter, et l'avoir suivi avec de
l'application et des dispositions, apporter dans le monde la plus parfaite ignorance
de tout ce qui est le sujet ordinaire de la conversation entre les personnes bien nes
et les gens de bonne compagnie.
Adam Smith nous semble avoir pouss bien loin l'amour de la concurrence, et
ce fait pourrait nous tonner de la part d'un ancien professeur de Glasgow si nous
ne nous rappelions la mauvaise impression qu'avait produite sur son esprit son
sjour Oxford ; c'est en ralit cette fameuse Universit, si indpendante par ses
richesses et dont le mauvais systme d'tudes tait alors notoire, que le philosophe
cossais a directement vise dans cette critique violente de l'ducation des jeunes
gens dans la Grande-Bretagne. Cependant, ce chapitre sur l'ducation a de
nombreux admirateurs, surtout de nos jours, et en 1876, un ancien ministre du
cabinet Gladstone, M. Lowe, dclarait, dans un grand discours qu'il pronona au
centenaire du livre d'Adam Smith, que de tous les chapitres de la Richesse des
Nations, celui-l est assurment, ses yeux, le plus remarquable, bien qu'il n'y en
ait pas qui ait t moins lu et qui ait exerc moins d'influence sur les esprits. Ce
chapitre n'a pas t apprci, disait M. Lowe, non seulement parce qu'il tait en
avance sur le sicle o il a t crit, mais parce qu'il devanait mme de plusieurs
sicles l'opinion publique des nations les plus claires.
nos yeux aussi, si ce chapitre na pas eu de succs, c'est que la rforme n'tait
pas mre, que les citoyens n'y taient pas suffisamment prpars, et nous avouons
que, pour nous, c'est l un des reproches les plus graves que l'on puisse adresser
un projet de cette nature. L'art de l'homme d'tat ne consiste pas, en ce qui
concerne l'ducation comme l'gard de toute institution positive, entreprendre
la lgre des rformes excellentes si l'on veut, mais qui supposent ncessairement
le concours d'une opinion publique claire ; il faut se rgler sur l'tat des esprits, il
faut non seulement considrer la mesure en elle-mme, mais encore en prvoir les
rsultats d'aprs l'tat du milieu o on se propose de l'introduire. Or, en matire
d'ducation, il nous semble qu'il serait tmraire de se reposer, mme l'heure
actuelle, sur l'opinion publique pour discerner les connaissances vraiment utiles de
celles qui le sont moins ; on risquerait fort d'affaiblir ainsi l'instruction gnrale qui
a le rle dlicat de former l'esprit, au profit de certaines tudes pratiques d'une
utilit plus immdiate et plus apparente, mais d'une porte plus restreinte. Nous
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
208
estimons donc, contrairement aux conclusions de l'auteur, que l'on doit laisser
encore l'tat ou l'Universit le choix des programmes et qu'il faut se garder de
l'attribuer en fait l'opinion en accordant au professeur une rtribution uniquement
proportionnelle au nombre de ses lves. L'lment ncessaire de la concurrence,
quil ne faut pas pousser l'excs en cette dlicate matire, est suffisamment
reprsent par la coexistence dun enseignement secondaire et suprieur libre assez
vivace pour empcher lUniversit de s'endormir dans la tradition et pour lui
permettre de profiter des expriences qui seraient tentes ct d'elle. Nous ne
croyons pas qu'il faille aller plus loin, que l'tat doive abandonner elle-mme
l'instruction publique et cesser d'tre professeur : les particuliers sont dj trop
enclins, surtout en Angleterre, sacrifier la haute culture intellectuelle des tudes
moins leves mais plus pratiques.
Le Dr Smith ne recommande toutefois la non-intervention du gouvernement
que dans l'instruction secondaire et suprieure. Quant l'enseignement primaire du
peuple, il le considre au contraire comme une fonction ncessaire de l'tat, il le
veut presque gratuit et mme en quelque sorte obligatoire. Pour la masse du
peuple, en effet, l'tat ne peut pas se reposer sur les familles du soin de l'ducation,
il doit donc les y engager par la gratuit, et mme les y contraindre, si c'est
possible 1 . Il est permis d'ailleurs de voir dans cette fonction de l'tat l'gard des
classes laborieuses, comme un complment de sa fonction relative la scurit des
personnes et des biens, et Smith parat en ralit s'tre plac ce point de vue.
Plus ces classes seront claires, dit-il, et moins elles seront sujettes se laisser
garer par la superstition et l'enthousiasme, qui sont, chez les nations ignorantes,
les sources ordinaires des plus affreux dsordres. D'ailleurs, un peuple instruit et
intelligent est toujours plus dcent dans sa conduite et mieux dispos l'ordre
qu'un peuple ignorant et stupide. Chez celui-l, chaque individu a plus le sentiment
de ce qu'il vaut et des gards qu'il a le droit d'attendre de ses suprieurs lgitimes ;
par consquent, il est plus dispos les respecter. Le peuple est plus en tat
d'apprcier les plaintes intresses des mcontents et des factieux ; il en est plus
capable de voir clair au travers de leurs dclamations ; par cette raison, il est moins
susceptible de se laisser entraner dans quelque opposition indiscrte ou inutile
contre les mesures du gouvernement. Dans des pays libres, o la tranquillit des
gouvernants dpend extrmement de l'opinion favorable que le peuple se forme de
leur conduite, il est certainement de la dernire importance que le peuple ne soit
pas dispos en juger d'une manire capricieuse ou inconsidre 2 .
C'est galement comme une consquence de la Mission essentielle du
gouvernement d'assurer la scurit, que Smith envisage la question dlicate de
1
L'tat peut imposer presque toute la masse du peuple l'obligation dacqurir les parties de
l'ducation les plus essentielles, en obligeant chaque homme subir un examen ou une preuve
sur ces articles avant de pouvoir obtenir la matrise dans une corporation ou la permission
d'exercer aucun mtier ou commerce dans un village ou dans une ville incorpore. (Rich., liv. V,
ch. I, t. II, p. 446).
Rich., liv. V, ch. I (t. II, p. 449).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
209
l'enseignement religieux, car la religion prvient souvent mieux que les institutions
positives les infractions la loi morale. Aussi, non seulement il estime que ltat
doit s'assurer le concours de ce puissant moyen de moralisation, il veut mme qu'il
pourvoie directement cette ducation en salariant les cultes. Il prfre de
beaucoup ce mode de rmunration, soit aux contributions volontaires payes par
les fidles, soit aux dotations ou aux revenus, et il considre que ces traitements
ont en outre l'avantage fort apprciable d'attacher le clerg au gouvernement et de
l'empcher de tourner son influence contre le rgime tabli.
C'est de cette faon que ce profond politique comprend la mission
gouvernementale. Pour lui, le rle de l'tat doit en somme se borner la protection
de la libert humaine, protection des personnes et des biens contre les attaques
injustes des nations ou des individus, protection de l'industrie et du commerce
contre les obstacles rsultant de la distance, protection du citoyen contre les
prjugs et l'erreur. Son seul but, en un mot, doit tre de favoriser le
dveloppement rgulier et libre de la force productive qui constitue l'homme. C'est
la seule satisfaction de ce besoin que doit veiller l'tat, et les enseignements de
l'conomie politique sont d'accord en cela avec les principes de la morale. Si Dieu
nous a donn des besoins, il nous a donn en mme temps les moyens de les
satisfaire, et l'action de notre responsabilit, lorsqu'elle s'exerce librement, nous
conduit plus efficacement au but que tous les moyens rglementaires par lesquels
l'tat, mme le plus clair, essaierait de diriger notre activit.
Mais si cette fonction est celle de l'tat, il ne s'ensuit nullement qu'il doive
toujours l'exercer directement et effectuer lui-mme les diverses consommations
exiges pour la satisfaction de ce besoin de libert. C'est ce qu'Adam Smith s'est
attach dmontrer dans l'tude que nous venons d'analyser. Pour lui, les dpenses
ncessaires la dfense commune et la protection des nationaux l'tranger sont
les seules que le gouvernement doive se rserver dans tous les cas, car la force
militaire qui en est la consquence est l'attribut essentiel du pouvoir excutif ; les
ncessits de la politique commandent aussi l'tat de prendre sa charge une
certaine part des dpenses de l'ducation du peuple et les frais de l'entretien des
cultes ; mais quant aux autres entreprises relatives l'outillage national ou
l'enseignement secondaire et suprieur, Smith estime que le rle du pouvoir leur
gard doit se borner surveiller l'initiative individuelle et n'y suppler que
lorsqu'elle fait dfaut. C'est l la thorie des Recherches en ce qui concernel'intervention de l'tat dans la consommation. Laissez faire, laissez passer, tel est le
mot d'ordre que le matre a emprunt Turgot, et il l'a dvelopp plus
compltement et plus scientifiquement que les physiocrates eux-mmes, amens
malgr eux, par leurs prfrences pour un gouvernement fort, exagrer les
attributions du souverain.
On a beaucoup critiqu cette doctrine et on a reproch l'auteur un rigorisme
trop absolu en matire de dpenses. On l'a blm surtout d'avoir trop limit le
champ de l'impt, qui est, prtend-on, l'une des plus belles manifestations de la
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
210
solidarit des citoyens, et plus spcialement d'avoir banni la bienfaisance du
domaine de l'tat. La justice, dit Victor Cousin 1 , est-elle la seule loi morale ?...
Nous aussi, par nos propres rflexions et le dveloppement de nos principes, nous
sommes arriv faire de la justice, de la protection de la libert, le principe
fondamental et la mission spciale de l'tat ; mais nous croyons avoir tabli en
mme temps qu'il est absolument impossible de ne pas mettre dans ce grand
individu qu'on appelle une socit, quelque chose au moins de ce devoir de la
charit qui parle si nergiquement toute me humaine. Selon nous, l'tat doit,
avant tout, faire rgner la justice, et il doit avoir aussi du cur et des entrailles ; il
n'a pas rempli toute sa tche quand il a fait respecter tous les droits ; il lui reste
quelque autre chose faire, quelque chose de redoutable et de grand ; il lui reste
exercer une mission d'amour et de charit, sublime la fois et prilleuse ; car, il
faut bien le savoir, tout a ses dangers ; la justice, en respectant la libert d'un
homme, peut en toute conscience le laisser mourir de faim ; la charit, pour le
sauver physiquement et surtout moralement, peut s'arroger le droit de lui faire
violence. La charit a couvert le monde dinstitutions admirables, mais c'est elle
aussi qui, gare et corrompue, a lev, autoris, consacr bien des tyrannies. Il
faut contenir la charit par la justice, mais non pas l'abolir et en interdire l'exercice
la socit. Smith n'a pas compris cela, et de peur d'un excs, il est tomb dans un
autre.
Malgr cet loquent et chaleureux plaidoyer de Victor Cousin, nous estimons
que c'est avec raison qu'Adam Smith a banni la bienfaisance du domaine de l'tat.
Pour lui, la justice seule peut justifier l'emploi de la force, et l'tat, qui dpense au
nom des individus, ne doit pas, en prlevant une partie de l'impt pour la
bienfaisance publique, forcer ainsi chaque citoyen exercer la charit. La
bienfaisance doit tre toujours volontaire, disait-il dj dans sa Thorie des
sentiments moraux 2 , la justice seule n'est pas laisse notre volont et peut tre,
au contraire, exige par la force. Ce n'est pas dire assurment que l'homme ait
le droit en, morale, de rester insensible aux souffrances de ses concitoyens, et
Smith, plus que tout autre, a fait preuve dans sa vie prive d'une dlicate et discrte
gnrosit ; mais il a compris que ce devoir est purement individuel, qu'il chappe
la pression de toute institution positive et que la distribution de ces secours doit
tre rserve l'initiative prive : la charit lgale a en elle-mme de grands
dangers, tant au point de vue purement conomique qu'au point de vue social.
Dans le cours de toute son uvre, le clbre philosophe a cherch prvenir la
misre en dvoilant ses causes et il a reconnu que, d'une, manire gnrale, chaque
fois que, sous un prtexte quelconque, l'tat intervient dans la rpartition des
richesses, il va toujours l'encontre du but qu'il se propose d'atteindre.
Spcialement, en ce qui concerne l'assistance, son exprience du cur humain lui a
parfaitement fait sentir qu'en voulant remdier cette plaie sociale du pauprisme,
l'tat ne fait que l'entretenir et mme l'aggraver, car, loin de mettre en uvre la
1
2
Philosophie cossaise, Ve leon, p. 227.
Thorie des sentiments moraux, IIe partie, sect. II p. 88.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
211
responsabilit individuelle qui est le vritable ressort de la production, la charit
lgale tend l'affaiblir et la supprimer.
D'ailleurs, si on reconnat au gouvernement le devoir de soulager les
malheureux, on reconnat par l mme aux malheureux un droit corrlatif tre
soulags, un droit l'assistance, Et si, par un dfaut de logique, on n'admet pas
expressment ce droit, il n'en rsultera pas moins que le misrable, en envisageant
ce devoir de l'tat, se considrera dornavant comme certain d'tre secouru : tout
sentiment de prvoyance s'teindra alors dans la masse des esprits faibles,
naturellement trop disposs dj se laisser aller aux jouissances actuelles, sans
souci du lendemain. Il faut donc abandonner la bienfaisance l'initiative des
particuliers et des associations charitables, toujours prte l'effort et
l'abngation, et toujours plus vive d'ailleurs lorsqu'elle est livre ses propres
forces, lorsqu'elle se sent libre de toute attache officielle. Elle seule peut soulager
le mal avec efficacit, car son action n'implique aucun droit correspondant du
malheureux, elle ne donne celui-ci aucune certitude qui puisse nerver sa
responsabilit, enfin elle exerce mme sur les esprits une influence fort heureuse
en tablissant entre les bienfaiteurs et les obligs ces rapports directs si
moralisateurs que l'intervention dun tre abstrait est impuissante faire natre.
Nous acceptons donc dans toute sa rigueur la doctrine gouvernementale de
Smith. Nous reconnaissons, il est vrai, que l'impt, lorsqu'il est trs lger, est en
quelque sorte un instrument de solidarit et de sociabilit qui a une puissante
action sur la marche de la civilisation ; mais nous savons par exprience que
l'impt, mme le plus lgitime, ne peut longtemps rester modr, et qu'en
restreignant mme les dpenses de ltat celles de la scurit, nous aurions
encore rpartir par l'impt une charge suffisante pour donner ces sentiments de
solidarit une entire satisfaction.
Nous oserons mme avouer qu' divers points de vue Adam Smith nous a paru
encore trop large pour certaines dpenses publiques. C'est ainsi qu'il a laiss, pour
ainsi dire, carte blanche l'tat en ce qui concerne les dpenses militaires, et il
parat s'tre un peu trop engou des armes permanentes sans se proccuper assez
de la tendance fcheuse des gouvernements accrotre dans des proportions
excessives ces instruments dociles de leur volont et de leur ambition. Certes, la
dfense de la patrie est le premier devoir des gouvernements et des individus, et on
ne saurait marchander ni notre or ni notre sang pour la dfense de notre libert ;
mais de la dfense l'attaque, il n'y a pas loin, d'autant plus que toute agression de
l'un a toujours pour prtexte de prvenir en temps utile une agression prmdite
par l'autre. Or si les armes permanentes ont jou un grand rle dans la civilisation,
et si maintenant plus que jamais elles sont indispensables aux nations, elles ont
aussi leurs prils qu'il importe de faire remarquer. Pour tre impartial, Adam Smith
aurait d signaler leurs dangers, non seulement au point de vue conomique de
l'accroissement incessant des dpenses, mais surtout au point de vue de la facilit
qu'elles donnent un gouvernement de se lancer dans des aventures guerrires.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
212
Mais si cette observation n'est qu'une critique de dtail qui n'infirme en rien la
valeur de la conclusion de Smith, nous croyons devoir condamner, expressment
cette fois, un autre point de la doctrine gouvernementale des Recherches, celle qui
a trait la protection militaire accorde aux nationaux l'tranger dans le but de
faciliter, dit l'auteur, quelques branches particulires de commerce .
Adam Smith n'a pas insist sur le principe de ce devoir, peut-tre parce qu'il l'a
jug indiscutable en le considrant, pour ainsi dire, comme un complment de la
dfense nationale. Mais, au moment o les gouvernements se lancent dans des
entreprises lointaines dans le but d'ouvrir des dbouchs aux produits nationaux,
nous ne pouvons nous empcher de rpondre Smith par le fragment suivant, tir
des uvres de Bastiat qui a pos la question sur son vritable terrain 1 : Ne faut-il
pas, dit-on, une puissante marine pour ouvrir des voies nouvelles notre
commerce et commander les marchs lointains ? Vraiment les faons du
gouvernement avec le commerce sont tranges ! Il commence par l'entraver, le
gner, le restreindre, et cela gros frais ; puis, s'il en chappe quelques parcelles,
le voil qui s'prend d'une tendre sollicitude pour les bribes qui ont russi passer
au travers des mailles de la douane. Je veux protger les ngociants, dit-il, et, pour
cela, j'arracherai encore 150 millions au public, afin de couvrir les mers de
vaisseaux et de canons. Mais d'abord, les 99/100es du commerce franais se font
avec des pays o notre pavillon n'a jamais paru ni ne paratra. Est-ce que nous
avons des stations en Angleterre, aux tats-Unis, en Belgique, en Espagne, dans le
Zollverein, en Russie ? C'est donc de Mayotte et de Nossi-B qu'il s'agit, c'est-dire qu'on nous prend, par l'impt, plus de francs qu'il ne nous rentrera de centimes
par ce commerce. Et puis, qui est ce qui commande le dbouch ? Une seule chose,
le bon march. Envoyez o vous voudrez des produits qui cotent 5 sous de plus
que les similaires anglais ou suisses, les vaisseaux ou les canons ne vous les feront
pas vendre. Envoyez-y des produits qui vous coteront 5 sous de moins, vous
n'aurez pas besoin, pour les vendre, de canons ou de vaisseaux. Ne sait-on pas que
la Suisse qui n'a pas une barque, si ce n'est sur ses lacs, a chass de Gibraltar mme
certains tissus anglais, malgr la garde qui veille la porte ? Si donc c'est le bon
march qui est le vrai protecteur du commerce, comment notre gouvernement s'y
prend-il pour le raliser ? D'abord il hausse, par ses tarifs, le prix des matires
premires, tous les instruments de travail, de tous les objets de consommation ;
ensuite, par voie de compensation, il nous accable d'impts sous prtexte d'envoyer
sa marine la qute des dbouchs. C'est de la barbarie, de la barbarie la plus
barbare, et le temps n'est pas loin o on dira : ces Franais du XIXe sicle avaient
de singuliers systmes commerciaux, mais ils auraient d au moins s'abstenir de se
croire au sicle des lumires.
On ne pouvait condamner d'une manire plus directe et plus saisissante ces
thories gouvernementales qui ont pour objet de favoriser la colonisation en la
prcdant. Et cependant, l'heure actuelle, on songe encore en France crer de
1
Paix et Libert. Paris, 1849, Guillaumin.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
213
toutes pices un systme colonial, on envoie, des troupes au Tonkin, des navires
Fou-Tcheou et Formose, on gaspille l'pargne nationale ainsi que le sang de nos
soldats, et on croit de bonne foi trouver un remde la crise conomique qui nous
treint, en arrachant l'agriculture si dlaisse, l'industrie, au commerce en
souffrance, une partie de leurs bras dj trop rares, en prlevant sur le produit
annuel, des capitaux dont toutes les branches de la production ont tant besoin pour
perfectionner leur outillage. Et pourquoi d'ailleurs tous ces sacrifices, sinon pour
prparer la colonisation un pays que nous verrons en ralit, avant dix ans,
compltement envahi par les produits anglais ou allemands parce qu'ils reviendront
meilleur march ? Que nous auront produit alors ces sacrifices que nous aurons
consentis pour conqurir le pays, les dpenses que nous aurons employes son
organisation, sinon un accroissement de dettes et d'impts qui, en augmentant nos
frais de production, nous empcheront de lutter sur ce march mme contre nos
concurrents trangers !
On ne saurait donc limiter trop strictement le champ de l'action
gouvernementale, car, ds que l'tat sort de son domaine, il entrave toujours par
l'impt la production qu'il prtend favoriser et il gne ainsi la libert qu'il a pour
seule mission de protger. Smith avait d'ailleurs parfaitement compris ces
principes, mais nous estimons qu'il y a lieu d'aller plus avant encore dans la voie
du self government, et l'tude des diverses ressources de l'tat, que nous allons
poursuivre avec l'auteur des Recherches, ne peut, en nous rvlant les dfauts de
chacun des impts, que nous confirmer dans cette doctrine de libert que le clbre
conomiste a eu le mrite de dvelopper si brillamment.
Les dpenses gnrales de l'tat sont dfrayes par les revenus du domaine, le
produit de l'impt, et quelquefois aussi au moyen de l'emprunt.
Le DOMAINE PRIV tait dj fort rduit dans les divers pays la fin du
XVIIIe sicle, par suite de la prodigalit des gouvernements, et on n'observait pas
encore la tendance plus moderne, qui conduit certains tats reconstituer un
nouveau domaine, sinon agricole, du moins industriel. Aussi Smith ne s'y arrte
pas et il ne fait gure que l'numration des diffrentes sources de ce revenu qui
comprend gnralement la poste, parfois aussi mais exceptionnellement, des
entreprises financires telles que la banque de prts de Hambourg, enfin la culture
des terres. Il dit peu de chose des entreprises financires, ne les jugeant pas
susceptibles de fournir un produit important et surtout certain, mais, en revanche, il
est d'avis que l'tat peut se charger du service de la poste. Les postes, dit-il 1 ,
sont, proprement parler, une entreprise de commerce ; le gouvernement fait
l'avance des frais d'tablissement des diffrents bureaux, de l'achat ou du louage
des chevaux et voitures ncessaires et il s'en rembourse, avec un gros profit, par les
droits perus sur ce qui est voitur. C'est peut-tre la seule affaire de commerce qui
ait t conduite avec succs, je crois, par toute espce de gouvernement. Le capital
1
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 485).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
214
qu'il s'agit d'avancer n'est pas trs considrable ; il n'y a pas de secret ni de savoirfaire dans une pareille besogne ; les rentres sont non seulement assures, mais
elles se font immdiatement .
Toutefois, s'il fait ainsi des distinctions parmi les entreprises industrielles et
commerciales de l'tat, admettant les unes et rejetant les autres, il condamne en
bloc toutes les exploitations agricoles, quelque forme qu'elles puissent prendre. Il
fait remarquer avec raison que, dans un pays civilis, les revenus fonciers de la
couronne sont peut-tre ceux qui cotent le plus cher la socit, galit de
produit, bien qu'en apparence ils ne paraissent rien coter aux citoyens, et il
conseille, en consquence, la mise en adjudication de cette partie du domaine. Un
tre abstrait, en effet, est naturellement mauvais agriculteur. L'tat, il est vrai,
trouve facilement les capitaux ncessaires l'amlioration des terres ; mais il ne
peut donner la culture l'attention constante et minutieuse qu'apporte le petit
propritaire qui aime sa terre et en connat tous les recoins ; il ne peut pas mme
surveiller efficacement ses fermiers ; enfin, ses employs sont ngligents et
recruts habituellement par la faveur, sans considration de leur aptitude ; en un
mot, il produit mal et il produit cher. Aussi le conseil de Smith et t bon suivre
par la plupart des gouvernements, car s'il est parfois ncessaire de conserver
temporairement certains domaines dans les contres o la culture est peu
dveloppe et la population clairseme, il est certain que le plus souvent le
morcellement par lots de ces immenses exploitations en et facilit la mise en
valeur ; leur productivit s'en ft accrue dans des proportions souvent
considrables ; on et ainsi favoris le dveloppement de la richesse du pays et
donn lieu indirectement des plus-values relles dans les diverses branches du
revenu public.
Le clbre conomiste aurait pu faire, toutefois, une exception pour les forts.
De son temps, il est vrai, leur influence climatrique, qui est aujourd'hui un
argument dcisif, navait pas encore attir l'attention des savants ; mais d'autres
considrations d'ordre conomique et financier ont toujours milit en faveur du
maintien du domaine forestier entre les mains de l'tat. Sans parler de l'intrt
prtendu de la marine qui ne pouvait rencontrer, dit-on, de beaux arbres que dans
les forts domaniales, l'tat a toujours trouv dans les coupes une source de
revenus certaine, rgulire et toujours croissante par suite de l'augmentation
incessante du prix du bois. D'ailleurs, contrairement ce qui a lieu dans les autres
entreprises agricoles, ltat est plus propre que les particuliers exploiter les
forts, parce que cette exploitation se fait en grand, suivant des mthodes
scientifiques dans l'emploi desquelles il a une comptence indiscutable ; enfin,
mieux que les particuliers aussi, il peut les mettre en pleine valeur grce aux
immenses capitaux dont il dispose et, qui lui permettent de rduire normment les
frais de production en ouvrant toutes les voies de communication ncessaires
l'enlvement des bois.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
215
On peut donc regretter que Smith n'ait pas cru devoir faire une exception cet
gard ; mais, cette rserve faite, on doit reconnatre que ses conclusions sont
gnralement fort justes et qu'il a montr ici, dans les applications comme dans la
doctrine, cet esprit libral qui tend exclure autant que possible l'tat du champ de
l'industrie : le vritable facteur de la production est lintrt personnel, et un tre
abstrait est impuissant le remplacer.
Au lieu donc de chercher dans un revenu propre des ressources aussi
insuffisantes qu'anti-conomiques, il est prfrable que l'tat recoure l'impt,
c'est--dire qu'il prlve, pour la satisfaction des besoins gnraux de la socit,
une portion du revenu annuel de chacun des citoyens. Mais ce prlvement, il faut
le reconnatre, est difficile effectuer : quel doit en tre le caractre ? La quotit ?
Sous quelle forme doit-il tre ralis ? quel moment doit-on saisir le revenu pour
l'empcher d'chapper l'impt et pour gner, le moins possible la production ?
Telles sont les principales questions, et il y en a bien d'autres encore, que doit se
poser le lgislateur et qu'Adam Smith s'est efforc de rsoudre.
Aussi, avant d'entrer dans l'examen des diverses taxes et de leurs avantages
respectifs, il s'est attach d'abord dterminer les rgles gnrales auxquelles doit
obir tout systme d'impts.
En premier lieu, l'impt doit frapper galement sur tous les revenus. Les
sujets d'un tat, dit Smith, doivent contribuer au soutien du gouvernement, chacun
le plus possible en proportion de ses facults, c'est--dire en proportion du revenu
dont il jouit sous la protection de l'tat. La dpense du gouvernement est, l'gard
des individus d'une grande nation, comme les frais de rgie sont l'gard des
copropritaires d'un grand domaine qui sont obligs de contribuer tous ces frais
proportion de l'intrt qu'ils ont respectivement dans ce domaine.
En second lieu, la taxe ou portion d'impt que chaque individu est tenu de
payer, doit tre certaine et non arbitraire. L'poque du paiement, le mode du
paiement, la quantit payer, tout cela doit tre clair et prcis, tant pour le
contribuable qu'aux yeux de toute autre personne.
En troisime lieu, tout impt doit tre peru l'poque et selon le mode que
l'on peut prsumer les plus commodes pour le contribuable.
Enfin, l'impt doit tre peru avec conomie ; il doit tre conu de manire
ce qu'il fasse sortir des mains du peuple le moins d'argent possible au del de ce
qui entre dans le Trsor de l'tat, et en mme temps ce qu'il tienne le moins
longtemps possible cet argent hors des mains du peuple avant d'entrer dans ce
Trsor.
Telles sont ces quatre maximes fameuses que chacun connat ; elles ont vieilli
peut-tre par leur succs mme, mais, jusqu' Smith, elles n'avaient jamais t
formules ni mme empiriquement appliques. L'ingalit devant l'impt drivait
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
216
de la constitution mme de la socit, et les rgles de certitude, de commodit et
d'conomie, taient compltement mconnues. Smith a donc rendu un grand
service la science en les prcisant.
L'galit devant l'impt est indispensable, non seulement au point de vue de la
justice qui doit tre la base ncessaire de toute institution positive, mais encore au
point de vue conomique parce qu'elle est la condition essentielle de tout progrs
social : en aggravant les charges d'une classe sans frapper les autres dans une
mme proportion, on drange le cours normal de la rpartition des revenus, on
dtruit l'quilibre social et on cause indirectement une perturbation considrable
dans la formation des richesses.
La certitude de la taxe, de sa quotit et de l'poque du paiement, n'est encore,
proprement parler, qu'un corollaire du principe d'galit, puisqu'elle a pour objet
d'exclure tout arbitraire. Au point de vue politique, elle vite les surprises, facilite
le recouvrement, permet au besoin de rsister aux prtentions illgales du fisc et
dnonce les concussions ; au point de vue conomique, elle donne au commerce la
scurit indispensable aux transactions, car celui qui achte pour revendre doit
pouvoir calculer exactement, avant de s'engager, combien lui cotera son achat, y
compris les frais. La violation de ce principe a toujours eu les effets les plus
dplorables sur la production, et, bien que cette maxime paraisse avoir en ellemme un fondement moins lev que celui de la justice distributive, elle est
tellement importante au point de vue commercial, que Smith a t jusqu'
considrer l'incertitude de la taxe comme plus funeste dans ses consquences que
l'inobservation du grand principe de l'galit 1 . Ces vices ont d'ailleurs frapp
vivement les gouvernements, et on doit reconnatre que, depuis la publication des
Recherches, ils se sont gnralement attachs mettre tout leur systme fiscal en
harmonie avec ce prcepte. En ce qui concerne notre pays, nous avons eu, il est
vrai, la triste exprience de l'chelle mobile, de l'assiette de l'impt sur le sucre
d'aprs sa teneur prsume et des droits de douane ad valorem, mais, sauf ces
exceptions regrettables, on peut dire que notre systme d'impts s'est ressenti
profondment dans son ensemble de l'influence d'Adam Smith : les rles des
contributions directes sont publis chaque anne, les tarifs des taxes indirectes sont
tablis par des lois et ports la connaissance de tous, les dlais de paiement sont
suffisamment connus, et tout contribuable pourrait la rigueur faire d'avance le
dcompte de ce qu'il aura directement payer au Trsor dans le courant d'une
anne.
De mme, l'tat a compris trs vite, grce la Richesse des Nations,
l'importance de la troisime maxime, la commodit. Il a reconnu qu'il est de son
intrt bien entendu de donner au contribuable pour acquitter l'impt toutes les
1
La certitude de ce que chaque individu a payer est, en matire d'imposition, une chose d'une
telle importance, qu'un degr d'ingalit trs considrable, ce qu'on peut voir, je crois, par
l'exprience de toutes les nations, n'est pas, beaucoup prs, un aussi grand mal qu'un trs petit
degr d'incertitude. Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 497).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
217
facilits compatibles avec les besoins du Trsor, et, plus le poids des taxes est
lourd, plus il cherche les faire supporter patiemment. Ainsi, chez nous, le fisc
autorise l'acquittement par douzimes des impts directs, tout en laissant aux
contribuables qui le prfrent, le droit de se librer en un moins grand nombre de
termes ; il dclare l'impt qurable et ne le laisse portable que dans les limites
d'une mme commune. Pour les taxes de consommation, il donne aux acheteurs ou
aux fabricants des dlais d'une certaine dure : les droits de douane au-dessus de
600 fr., de mme que les droits de fabrication de la bire, donnent lieu des
obligations cautionnes, les unes 4 mois, les autres 3, 6 ou mme 9 mois, et des
dlais analogues sont accords pour le paiement des droits sur les boissons. Enfin,
on gnralise les taxes indirectes, qui sont moins senties et plus commodes, non
pas, comme le dit Smith, parce que le consommateur est le matre d'acheter ou de
ne pas acheter, ainsi qu'il le juge propos, mais parce que l'impt est peru en
dtail et que, se confondant ainsi avec le prix des denres, il passe peu prs
inaperu. Les droits d'enregistrement et de mutation seuls n'ont pas paru pouvoir se
plier ces adoucissements, et c'est parce qu'ils violent ainsi la maxime de la
commodit qu'ils sont sentis si lourdement par la nation.
Mais les prceptes contenus dans la quatrime rgle, dite d'conomie, ont eu
plus de peine pntrer dans la pratique gouvernementale. Ils commandent, en
premier lieu, de rduire au minimum les frais de perception ; en second lieu, de
respecter le mcanisme de la production sans dranger l'quilibre des divers
emplois des capitaux et du travail ; en troisime lieu, de ne pas donner prise la
fraude ; enfin de ne pas entraver l'industrie et le commerce par une inquisition
vexatoire et des mesures oppressives. Un impt peut, dit Smith 1 , ou faire sortir
des mains du peuple plus d'argent que ne l'exigent les besoins du Trsor public, ou
tenir cet argent hors de ses mains plus longtemps que ces mmes besoins ne
l'exigent, de quatre manires diffrentes. 1 La perception de l'impt peut
ncessiter l'emploi d'un grand nombre d'officiers dont les salaires absorbent la plus
grande partie du produit de l'impt et dont les concussions personnelles tablissent
un autre impt additionnel sur le peuple. 2 L'impt peut entraver l'industrie du
peuple et le dtourner de s'adonner certaines branches de commerce ou de travail
qui fourniraient de l'occupation et des moyens de subsistance beaucoup de
monde ; ainsi, tandis que, d'un ct, il oblige le peuple payer, de l'autre il
diminue ou peut-tre il anantit quelques-unes des sources qui pourraient le mettre
plus aisment dans le cas de le faire. 3 Par les confiscations, amendes et autres
peines qu'encourent ces malheureux qui succombent dans les tentatives qu'ils ont
faites pour luder l'impt, il peut souvent les ruiner et par l anantir le bnfice
qu'et recueilli la socit de l'emploi de leurs capitaux. Un impt inconsidrment
tabli offre un puissant appt la fraude. Or, il faut accrotre les peines de la
fraude proportion qu'augmente la tentation de frauder. La loi, violant alors les
premiers principes de la justice, commence par faire natre la tentation et punit
ensuite ceux qui y succombent, et, ordinairement, elle renchrit aussi sur le
1
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 498).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
218
chtiment proportion qu'augmente la circonstance mme qui devrait le rendre
plus doux, c'est--dire la tentation de commettre le crime. 4 L'impt, en
assujettissant le peuple aux visites ritres et aux recherches odieuses des
collecteurs, peut l'exposer beaucoup de peines inutiles, de vexations et
d'oppressions, et quoique, rigoureusement parlant, les vexations ne soient pas une
dpense, elles quivalent certainement la dpense au prix de laquelle un homme
consentirait volontiers s'en racheter.
Il est inutile d'insister sur les deuxime et quatrime prceptes, l'gard
desquels nous croyons avoir fait suffisamment connatre la doctrine de Smith lors
de l'examen du systme mercantile. L'tat ne doit pas, dans un but fiscal pas plus
que dans un but conomique, modifier les rapports qui existent entre les diverses
branches de la production ou entre la production et la consommation ; il doit
veiller avec soin, au contraire, ce que l'impt ne vienne pas rompre cet quilibre,
soit en chargeant trop pesamment une des classes de la nation, soit en changeant
arbitrairement les relations de l'offre et de la demande. La rduction des frais de
perception a galement une importance considrable, qui apparat d'elle-mme,
mais que les gouvernements sont d'ordinaire peu enclins appliquer. Quant au
prcepte qui concerne la fraude, il a un intrt tout particulier, non seulement aux
yeux de l'conomiste, mais encore aux yeux du moraliste, et le Dr Smith, en le
recommandant, ne se place pas uniquement un point de vue fiscal, il se place
aussi au point de vue suprieur de la justice qui doit toujours inspirer le lgislateur.
La fraude viole d'ailleurs la rgle de l'galit devant l'impt, puisque certains
trouvent le moyen de se soustraire aux charges, au dtriment des autres ; elle viole
la rgle de la certitude parce que le ngociant ignore l'avance s'il pourra ou non
frauder ; elle viole enfin la rgle de l'conomie, puisque les fraudeurs punis seront
supprims, au moins momentanment, comme producteurs ; ils deviendront alors
des oisifs, et la violation de la loi fiscale les conduira souvent la violation des lois
sociales, au grand dtriment de la scurit publique.
Voil les rgles que Smith impose au lgislateur pour l'tablissement d'un bon
systme d'impts, et ces rgles, constamment cites, ne laissent en elles-mmes
aucune prise la critique. Toutefois, si ces maximes sont indiscutables et videntes
en tant qu'elles indiquent un but atteindre, si on peut considrer comme un
vritable axiome l'numration de ces qualits ncessaires de l'impt, il n'en est
pas toujours de mme des types qu'Adam Smith a prsents comme remplissant
ces qualits et des applications qu'il a faites de ces principes. L, l'conomiste ne
peut plus affirmer, il discute, il cherche mettre en uvre ses maximes, et, quelle
que soit l'ampleur de ses vues, il faut reconnatre qu'il n'y russit pas toujours,
lorsqu'il admet, par exemple, une progression dans certaines taxes ou qu'il
prconise les impts sur le luxe.
Il ne suffit pas, en effet, d'affirmer le principe de l'galit devant l'impt, il est
ncessaire aussi de faire connatre en quoi consiste cette galit et comment on
pourra l'atteindre. Et d'abord, est-ce l'galit dans le sacrifice ou l'galit dans la
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
219
protection ? Smith rpond nettement cette premire question : pour lui, un tat
n'est autre chose qu'une grande socit dans laquelle chaque socitaire doit
participer aux frais de rgie en proportion de l'intrt qu'il a au maintien de
l'association, c'est--dire en proportion de la protection qui lui est assure. Mais
comment valuer l'intrt que retire, en ralit, chaque citoyen de la protection de
l'tat ? C'est l une autre question pratique d'une extrme difficult. On a bien
cherch, par le procd de la spcialit des taxes, faire payer directement par
chaque individu le prix de tout service qui lui est rendu, et Smith a encourag dans
plusieurs cas ce mode de taxation ; mais on est forc d'admettre qu'il reste au
moins certaines dpenses qu'il n'est pas possible de spcialiser. Comment pourraiton rpartir, par exemple, les charges des armes, de la marine, de la police, qui
forment la partie la plus considrable du budget de l'tat ? Sur quelles bases
pourrait-on rpartir surtout les charges de la dette publique et dterminer la part de
chacun dans l'tablissement de cette dette, dans les fautes ou les malheurs de
l'tat ? Dans cet ordre d'ides, on se heurte donc chaque instant des
impossibilits, et tous les gouvernements ont d, en consquence, recourir plus ou
moins au principe de la solidarit nationale et rechercher une prsomption qui
dtermint approximativement la part de protection et de responsabilit de chaque
citoyen.
Quelle doit tre cette prsomption ? Les citoyens ne profitent-ils des avantages
sociaux qu'en proportion de leur avoir dans la socit, ou bien en profitent-ils dans
une plus large mesure ? Selon que l'on adoptera la premire manire de voir ou
bien la seconde, la justice commandera, soit de rpartir les charges publiques entre
les citoyens au prorata de leurs revenus, soit de prlever une proportion plus ou
moins forte de ces revenus suivant qu'ils sont plus ou moins considrables. Aussi
c'est l une des plus graves questions que puisse se poser le lgislateur, question
primordiale, non seulement au point de vue doctrinal, mais encore au point de vue
conomique et financier.
Nous aurions donc t heureux de connatre, en cette dlicate matire, l'opinion
d'Adam Smith, mais les Recherches ne nous donnent cet gard aucun
renseignement prcis. Si l'on prend la lettre les termes mmes de sa premire
maxime, le philosophe cossais semble partisan de l'impt proportionnel puisqu'il
dit que les sujets d'un tat doivent contribuer au soutien du gouvernement,
chacun le plus possible en proportion de ses facults, c'est--dire en proportion du
revenu dont il jouit sous la protection de l'tat . Mais une lecture attentive de
l'ensemble du cinquime livre le montre aussi, d'autre part, dispos admettre
parfois une certaine progression ; il trouve fort juste, par exemple, que, mme dans
une taxe spciale pour l'entretien des routes, les voitures de luxe soient taxes un
peu plus que leur poids, afin de faire contribuer le riche au soulagement du
pauvre 1 , et, dans un autre passage, il nonce la mme ide en termes plus formels
1
Quand cette mme taxe sur les voitures de luxe, les carrosses, chaises de poste, etc., se trouve
tre de quelque chose plus forte, proportion de leur poids, qu'elle ne l'est sur les voitures d'un
usage ncessaire, telles que les voitures de roulier, les charlots, etc., alors l'indolence et la vanit
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
220
encore, si c'est possible, en dclarant qu'il n'est pas trs draisonnable que les
riches contribuent aux dpenses de l'tat, non seulement proportion de leur
revenu, mais encore de quelque chose au del de cette proportion 1 . ,
Aussi chacun des deux systmes en prsence croit pouvoir revendiquer
l'appoint de l'autorit du grand philosophe. Quant nous, bien que nous nous
sentions ici en dsaccord avec l'opinion dominante des critiques, nous estimons
que la doctrine de Smith est contenue dans les termes mmes de sa maxime de
l'galit et que le fondateur de la science conomique trouve que le vritable
moyen d'arriver l'galit est de rechercher la proportionnalit de l'ensemble des
impts. S'il manifeste dans cette tude une certaine tendance la progression, c'est
que, trouvant de son temps la balance trop penche en gnral du ct des classes
pauvres, il a tent de diminuer cet cart en frappant plus lourdement certains
revenus du riche ; mais nous ne croyons pas qu'il ait eu ainsi d'autre but que de
rtablir prcisment dans l'ensemble du systme fiscal la proportionnalit
commande par la justice. Il tait loin de prvoir alors qu'il se produirait un jour un
dplacement si considrable dans les conseils des gouvernements qu'on tendrait
plutt dpasser cette proportionnalit et assujettir les revenus l'impt
progressif. Quoi qu'on en ait dit, il n'a pas entendu accepter l'erreur de
Montesquieu qui voulait que l'impt frappt l'utile moins lourdement que le
superflu et qu'il pargnt mme compltement la partie des revenus destine la
satisfaction des besoins indispensables du peuple 2 . L'impt n'est nullement la dette
particulire des riches, il est la dette commune de tous les citoyens pour les
services que rend l'tat. On ne peut rien demander ceux qui n'ont rien du tout ;
mais ceux qui ont un peu, pourquoi ne leur rien demander ? Est-ce que tout le
monde ne jouit pas de la protection de l'tat ? est-ce que tout le monde n'est pas
responsable, quelque titre, de l'tablissement de la dette publique ? Et il en est
ainsi surtout de nos jours o, par le suffrage universel, chacun participe
directement l'exercice de la puissance souveraine.
Il ne nous en faut pas moins reconnatre que l'tude des impts n'est pas aussi
satisfaisante que les autres parties de l'uvre de Smith. L'auteur semble avoir t
trop influenc par les considrations politiques, par l'tat social de son pays au
1
2
du riche se trouvent contribuer d'une manire fort simple au soulagement du pauvre, en rendant
meilleur march le transport des marchandises pesantes dans tous les diffrents endroits du
pays. (Rich., liv. V, ch. I, t. II, p. 377.)
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 524).
Esprit des Lois, liv. XIII, ch. VII. Dans l'impt de la personne, la proportion injuste serait
celle qui suivrait exactement la proportion des biens. On avait divis Athnes les citoyens en
quatre classes. Ceux qui retiraient de leurs biens cinq cent mesures de fruits liquides ou secs
payaient au public un talent ; ceux qui en retiraient trois cents mesures devaient un demi-talent ;
ceux qui avaient deux cents mesures payaient dix mines ou la sixime partie d'un talent ; ceux
de la quatrime classe ne donnaient rien. La taxe tait juste, quoiqu'elle ne ft point
proportionnelle : si elle ne suivait pas la proportion des biens, elle suivait la proportion des
besoins. On jugea que chacun avait un ncessaire physique gal ; que ce ncessaire physique ne
devait point tre tax ; que l'utile venait ensuite et quil devait tre tax, mais moins que le
superflu ; que la grandeur de la taxe sur le superflu empchait le superflu.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
221
temps o il crivait, et les applications de ses doctrines aux impts existants sont
parfois peu logiques. Aussi cette partie des Recherches prsente peut-tre un
intrt moins permanent que la partie doctrinale, toujours vraie malgr l'exprience
de plus d'un sicle.
C'est ainsi que, dans l'examen de l'impt foncier, il montre, toute occasion,
une tendance fcheuse faire intervenir limpt comme un moyen de dvelopper
ou de rprimer certains usages ou certaines pratiques de l'agriculture, et on ne peut
que s'tonner de voir cet aptre fervent de la libert substituer ainsi l'apprciation
de l'tat au libre jeu de l'intrt priv. Il y a certains baux, dit-il 1 , o l'on prescrit
au fermier un mode de culture, o on le charge aussi d'observer une succession
particulire de rcoltes pendant toute la dure du bail. Cette condition, qui est
presque toujours l'effet de l'opinion qu'a le propritaire de la supriorit de ses
propres connaissances (opinion trs mal fonde la plupart du temps), doit tre
regarde comme un surcrot de fermage, comme une rente en services, au lieu
d'une rente en argent. Pour dcourager cette pratique qui, en gnral, est une
sottise, on pourrait valuer cette sorte de rente de quelque chose plus haut que les
rentes ordinaires en argent et, par consquent, l'imposer un peu davantage.
Quelques propritaires, au lieu d'une rente en argent, exigent une rente en nature,
en grain, bestiaux, volaille, vin, huile, etc. D'autres aussi exigent une rente en
services. De pareilles rentes sont toujours plus nuisibles au fermier qu'elles ne sont
avantageuses pour le propritaire. Elles ont l'inconvnient d'ter au premier plus
d'argent qu'elles n'en donnent l'autre, ou au moins de tenir l'argent hors des mains
du fermier, sans profit pour le propritaire. Partout o elles ont lieu, les tenanciers
sont pauvres et misrables, et prcisment selon que cette pratique est plus ou
moins gnrale. En valuant de mme ces sortes de rentes plus haut que les rentes
ordinaires en argent et, par consquent, en les taxant de quelque chose plus haut,
on parviendrait peut-tre faire tomber un usage nuisible la socit. Quand le
propritaire aime mieux faire valoir par ses mains une partie de ses terres, on
pourrait valuer sa rente d'aprs une estimation arbitrale faite par des fermiers et
des propritaires du canton, et lui accorder une rduction raisonnable de l'impt,
comme c'est l'usage dans le territoire de Venise, pourvu que le revenu des terres
qu'il ferait valoir n'excdt pas une certaine somme. Il est important que le
propritaire soit encourag faire valoir par lui mme une partie de sa terre. Son
capital est gnralement plus grand que celui du tenancier, et, avec moins
d'habilet, il peut souvent donner naissance un plus gros produit. Le propritaire
peut, sans se gner, faire des essais, et il est en gnral dispos en faire. Une
exprience qu'il aura faite sans succs ne lui cause qu'une perte modique. Celles
qui lui russissent contribuent l'amlioration et la meilleure culture de tout le
pays. Il pourrait tre bon cependant que la rduction de limpt ne l'encouraget
cultiver qu'une certaine tendue seulement de ses domaines. Si les propritaires
allaient, pour la plus grande partie, essayer de faire valoir par eux-mmes la
totalit de leurs terres, alors, au lieu de tenanciers sages et laborieux qui sont
1
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 509).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
222
obligs, pour leur propre intrt, de cultiver aussi bien que leur capital et leur
habilet peuvent le comporter, le pays se remplirait de rgisseurs et d'intendants
paresseux et corrompus, dont la rgie pleine d'abus dgraderait bientt la culture
de la terre et affaiblirait son produit annuel, non seulement au dtriment du revenu
de leurs matres, mais encore aux dpens de la branche la plus importante du
revenu gnral de la socit.
Nous voyons ainsi Adam Smith, oubliant tous ses principes doctrinaux,
s'attacher chercher dans l'impt les moyens de faire prvaloir ses prfrences en
matire agricole, et nous ne saurions trop nous lever contre une pareille
inconsquence : La science moderne, a dit avec une grande force M. F. Passy,
dans une sance rcente de la Socit d'conomie politique 1 , a assign l'tat
pour unique devoir d'ouvrir toutes les activits industrielles un champ illimit
sans leur imposer d'autres rgles que celles qui garantissent la loyaut des
transactions et l'excution des contrats librement consentis. Ds que l'tat se dpart
de cette rserve et de cette impartialit pour intervenir dans le domaine
conomique sous prtexte de corriger les ingalits naturelles, il ne russit qu'
substituer ces ingalits d'autres ingalits plus choquantes, il oppose son
jugement, ses prfrences, l'incorruptible justice de la nature ; il indemnise les
paresseux et les incapables et frappe d'une amende les hommes laborieux,
intelligents et vraiment utiles qui russissent ; bref, loin de faire fleurir, suivant la
formule consacre, les arts, le commerce et l'agriculture, il arrte ou fait dvier le
progrs et nuit au dveloppement de la richesse publique .
Toute l'tude pratique des impts existants se ressent de cette inconsquence
vraiment inexplicable ; mais il est heureusement d'autres points de vue auxquels
elle prsente nanmoins un rel intrt, et il en est ainsi notamment des
observations relatives l'incidence de l'impt.
C'est d'ailleurs d'aprs leur incidence apparente qu'Adam Smith distingue les
taxes, et suivant que le lgislateur a voulu les faire porter sur la rente, les profits ou
les salaires. Ce sont l, dit-il, les trois sources du revenu des particuliers ; tout
impt doit donc, en dfinitive, se payer par l'une ou l'autre de ces trois diffrentes
sortes de revenus ou par toutes indistinctement. cartant ainsi implicitement, ds le
dbut, l'impt sur le capital, il examine, en premier lieu, l'impt sur la rente des
terres. Pour lui, cet impt est juste en ce qu'il retombe directement sur la rente
quil a en vue de frapper, mais il ne doit pas cependant pourvoir toutes les
charges de l'tat. cet gard, Smith rejette absolument l'impt foncier unique
prn par les physiocrates et il s'attache faire ressortir la fausset du principe qui
sert de base ce systme, savoir que tout impt retombe, en dernire analyse, sur
le revenu de la terre. En tudiant ensuite la forme que doit revtir limpt sur la
rente, il combat vivement la dme, qui frappe le produit brut. Sous l'apparence
d'une galit parfaite, ce mode de prlvement est essentiellement ingal en ce
1
Voir L'conomiste franais du 12 juillet 1884.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
223
qu'il prend autant aux mauvaises terres qu'aux bonnes ; de plus, en ne tenant aucun
compte de la diffrence des frais de production, il dcourage la fois les
amliorations du propritaire et les progrs de l'industrie agricole. Aussi la culture
intensive, qui a pris de nos jours un si grand dveloppement, n'a t possible
qu'aprs l'abolition de ce procd de taxation parce que, tout en augmentant le
rendement net des terres, cette culture abaisse en mme temps la proportion du
produit net au produit brut. Si la dme, dit en effet Adam Smith 1 est le plus
souvent un impt trs ingal sur les revenus, elle est aussi toujours un trs grand
sujet de dcouragement, tant pour les amliorations du propritaire que pour la
culture du fermier. L'un ne se hasardera pas faire les amliorations les plus
importantes, qui en gnral sont les plus dispendieuses ; ni l'autre faire natre les
rcoltes du plus grand rapport, qui en gnral sont aussi celles qui exigent les plus
grands frais, lorsque lglise, qui ne contribue en rien la dpense, est l pour
emporter une si grosse portion du produit. La dme a longtemps cause que la
culture de la garance a t confine aux Provinces-Unies, pays qui, tant
presbytrien et pour cette raison affranchi de cet impt destructeur, a joui en
quelque sorte contre le reste de l'Europe, du monopole de cette drogue si utile pour
la teinture. Les dernires tentatives quon a faites en Angleterre pour y introduire
la culture de cette plante nont eu lieu qu'en consquence du statut qui porte que
5sch. par acre tiendront lieu de toute espce de dme quelconque sur la garance.
Smith a abord galement la-question de l'impt de rpartition et de l'impt de
quotit. Le systme de la rpartition est conforme aux rgles de la certitude, de la
commodit et de l'conomie ; il prvient la fraude en intressant chaque
contribuable ce que les autres soient exactement imposs. Mais il devient bientt
ingal et les ingalits ne font que s'accrotre et s'aggraver dans la suite ; l'tat n'a
pas d'intrt aux amliorations, car il prlve uniformment la mme somme
malgr l'augmentation ou la diminution de la rente ; enfin, le poids de l'impt est
sujet varier suivant les fluctuations de la valeur de l'argent. Smith prfre donc
l'impt de quotit parce qu'il permet la taxe de suivre le dveloppement de la
richesse immobilire et surtout parce qu'il respecte mieux la grande rgle de
l'galit. Au milieu de toutes les variations, dit-il 2 , qu'prouverait la socit dans
les progrs ou dans le dprissement de son agriculture, au milieu de toutes les
variations qui surviendraient dans la valeur de l'argent, ainsi que de celles qui
auraient lieu dans l'tat des monnaies, un impt de ce genre s'ajusterait aussitt de
lui-mme et sans qu'il ft besoin d'aucune attention de la part du gouvernement,
la situation actuelle des choses ; il se trouverait toujours constamment d'accord
avec les principes de justice et d'galit. Il serait donc beaucoup plus propre tre
tabli comme rglement perptuel et inaltrable, ou comme ce qu'on appelle loi
fondamentale de ltat, que tout autre impt dont la perception serait toujours
rgle d'aprs une valuation fixe.
1
2
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 516).
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 512).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
224
L'tude de l'impt sur le loyer des maisons est moins nette. Toutefois, si Adam
Smith a laiss ici dans un certain vague la question de l'incidence, il a eu
nanmoins le mrite de reconnatre le premier que cette incidence dpend, en
ralit, de l'offre et de la demande des maisons. De mme, il a distingu avec soin
le loyer du sol de celui du btiment et mis le vu que ces deux lments fussent
imposs sparment cause de leurs caractres diffrents.
Enfin, il a montr comment le lgislateur, considrant que la valeur locative
des maisons est difficile valuer directement, a jug ncessaire de complter ce
mode d'imposition, soit par une taxe sur les feux, soit par une taxe sur les portes et
fentres. Mais il dsapprouve compltement ces bases de taxation : selon lui,
l'estimation directe est gnralement bien plus exacte que celle qui rsulte du
nombre des chemines ou des ouvertures de toute sorte, et d'ailleurs, un impt de
cette nature viole ncessairement la rgle de l'galit. La principale objection,
dit-il, contre tous les impts de cette espce, c'est leur ingalit, et la pire de toutes
les ingalits, puisqu'ils portent souvent avec plus de poids sur le pauvre que sur le
riche. Une maison de dix livres de loyer, dans une ville de province, peut
quelquefois avoir plus de fentres qu'une maison Londres de 500 livres de loyer ;
et, quoiqu'il soit parier que le locataire de la premire est beaucoup moins riche
que celui de l'autre, cependant, en tant que sa contribution aux charges de l'tat est
rgle par la taxe des fentres, celui-l contribuera plus que le dernier.
L'ingalit, en effet, est inhrente ce genre d'impt, et, quoi qu'on fasse pour la
supprimer, on ne peut la faire disparatre qu'en supprimant la taxe elle-mme.
Depuis Adam Smith, il est vrai, on a gnralement tabli des tarifs diffrents
suivant la population de la commune, l'tage des fentres, la nature des portes, le
nombre des ouvertures de l'ensemble de la maison, mais ces tarifications diverses
ne peuvent jamais tre assez multiplies, et, dans notre lgislation mme, beaucoup
d'ingalits subsistent encore.
Adam Smith passe ensuite l'tude des impts par lesquels le lgislateur a
voulu frapper les profits. Il distingue deux parts dans le revenu ou profit des
capitaux : 1 celle qui paie l'intrt et qui appartient au propritaire du capital ; 2
celle qui excde ce qui est ncessaire pour le paiement de l'intrt. Or, suivant lui,
cette seconde part du profit ne peut pas tre taxe efficacement. Cette dernire
portion du profit, dit-il 1 , ne peut videmment tre directement impose ; elle est la
compensation, et le plus souvent elle n'est rien de plus qu'une compensation trs
modre des risques et de la peine d'employer le capital. Il faut que celui qui
emploie le capital ait cette compensation ; autrement il ne peut, sans nuire ses
intrts, continuer l'emploi. S'il tait donc impos directement, proportion du
profit total qu'il retire, il serait oblig, ou d'lever le taux de son profit, ou de
rejeter l'impt sur l'intrt de l'argent, c'est--dire de payer moins d'intrt. S'il
levait le taux de son profit proportion de l'impt, alors, quoique l'impt pt tre
avanc par lui, cependant le paiement dfinitif tomberait en entier sur l'une ou sur
1
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 530).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
225
l'autre de deux classes de gens diffrentes, selon les diffrentes manires dont il
emploierait le capital dont il a la direction. S'il l'employait, comme capital de
fermier, la culture de la terre, il ne pourrait faire hausser le taux de son profit
qu'en retenant par ses mains une plus forte portion du produit de la terre, ou, ce qui
revient au mme, le prix d'une plus forte portion de ce produit ; et comme cela ne
pourrait se faire qu'en rduisant le fermage, le paiement dfinitif de l'impt
tomberait sur le propritaire. S'il employait le capital comme capital de commerce
ou de manufacture, il ne pourrait hausser le taux de son profit qu'en augmentant le
prix de ses marchandises, auquel cas le paiement final de l'impt tomberait
totalement sur les consommateurs de ces marchandises. En supposant quil n'levt
pas le taux de son profit, il serait oblig de rejeter tout l'impt sur cette portion du
profit qui tait destine payer l'intrt, de largent ; il rendrait moins d'intrt
pour tout ce qu'il aurait emprunt de capital, et, dans ce cas, tout le poids de l'impt
porterait sur l'intrt de l'argent. Tout l'impt dont il ne pourrait pas se dcharger
d'une de ces manires, il serait oblig de s'en dcharger de l'autre.
Cette observation n'est pas exacte et elle perd toute porte si l'on impose
l'ensemble des profits dans les diffrents emplois des capitaux. En effet, Adam
Smith ne dmontre nullement pourquoi les profits devraient rester indemnes, il
s'appuie uniquement sur ce fait qu'ils ne sont en ralit qu'une compensation trs
modre des risques et de la peine d'employer le capital. Mais, alors mme que,
comme le prtend l'auteur, ils ne constitueraient qu'une faible compensation de la
peine prise, nous nen estimons pas moins que la rmunration de cette peine est
gnralement suffisante pour donner lieu l'impt, sans que l'industriel rejette sur
le capitaliste tout ou partie de la taxe, et nous croyons que l'offre et la demande des
capitaux ne seront gure affectes par l'tablissement d'une taxe de cette nature si
elle n'est pas trop forte. L'industriel rejettera-t-il plus facilement la taxe sur le
consommateur en la portant sur sa facture, comme le disait Franklin ? Cette
hypothse, plus admissible premire vue, n'est au fond pas plus vraie.
Assurment, si l'impt existait au mme taux dans tous les pays ou que notre
territoire ft ferm aux produits trangers, le commerant arriverait peut-tre le
rejeter sur les acheteurs, condition toutefois que la richesse nationale permit de le
faire sans provoquer un resserrement de la consommation ; mais le march est plus
ou moins ouvert aux marchandises trangres et la concurrence vient forcer
l'industrie accepter au moins une partie de cette charge. Quant l'industrie
d'exportation, elle supporte en totalit les droits de patente et il n'y a, en somme,
que le petit commerce de dtail qui puisse arriver parfois hausser ses prix du
montant de l'impt.
En ce qui concerne au contraire la portion du profit qui paie l'intrt et qui
appartient au propritaire du capital, Smith dclare qu'en principe c'est une
excellente matire imposable parce que la taxe retombe immdiatement et
dfinitivement sur le capitaliste ; mais il ajoute qu'en fait il est difficile de
l'atteindre parce qu'il n'est pas possible d'valuer avec quelque prcision et sans
vexations la fortune mobilire des individus, et aussi parce que l'impt doit se
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
226
garder de mettre en fuite le capital qu'il prtend frapper 1 . L'intrt des capitaux ne
peut donc tre impos directement sans devenir en pratique essentiellement injuste,
sans violer au plus haut point les rgles qui ont trait l'galit et la prvention de
la fraude, soit en pargnant toute une catgorie de capitaux, soit en laissant
indemnes les capitaux qui se dissimulent et en donnant ainsi une prime la
mauvaise foi ; sans transgresser enfin la rgle de l'conomie telle que l'entend
Smith, en donnant lieu des vexations pnibles et en faisant obstacle
l'accumulation des capitaux.
Dans tous les cas, les impts sur les profits, pas plus que les impts sur les
terres, ne doivent avoir pour effet de prlever plus qu'une part du revenu annuel, et
jamais ils ne doivent s'emparer d'une portion quelconque du capital. Adam Smith
combat donc cet gard les droits de transmission entre vifs ou par dcs sous les
deux formes qu'ils revtent : droits de timbre et droits d'enregistrement.
L'incidence de ces impts est, il est vrai, ordinairement directe. Ceux qui
frappent les mutations par dcs et les donations tombent immdiatement et
dfinitivement sur les hritiers ou les donataires ; les droits relatifs aux obligations
retombent en entier sur les emprunteurs, gnralement presss de se procurer des
fonds, et ceux qui concernent les actes de procdure restent intgralement la
charge des plaideurs. Il n'en est autrement que des droits perus l'occasion de la
vente des terres : ceux-l atteignent le vendeur, souvent forc de vendre et ne
pouvant presque jamais faire la loi l'acheteur parce que ce dernier est rarement
oblig d'acqurir bref dlai ; ils restent donc compltement et dfinitivement la
charge de ceux qui sont dtenteurs des terres au moment de l'tablissement de la
taxe. Et encore, dans ce cas mme, l'incidence est directe lorsqu'il s'agit de maisons
nouvellement bties, car si l'entrepreneur qui fait construire pour revendre perdait
son profit, il cesserait de construire, et limpt, par la loi de l'offre et de la
demande, resterait quand mme la charge de l'acqureur.
Mais, malgr leur incidence gnralement directe, les impts de cette catgorie
ont un grand vice, aux yeux de Smith, en ce qu'ils attaquent le capital et qu'ils font
passer dans le revenu de l'tat une partie de ce capital des particuliers, diminuant
1
La terre est une chose qui ne peut s'emporter, tandis que le capital peut semporter trs
facilement. Le propritaire de terres est ncessairement citoyen du pays o est situ son bien. Le
propritaire de capitaux est proprement citoyen du monde, et il n'est attach ncessairement
aucun pays en particulier. Il serait bientt dispos abandonner celui o il se verrait expos
des recherches vexatoires qui auraient pour objet de le soumettre un impt onreux, et il ferait
passer son capital dans quelque autre lieu o il pourrait mener ses affaires et jouir de sa fortune
plus son aise. En emportant son capital, il ferait cesser toute l'industrie que ce capital
entretenait dans le pays qu'il aurait quitt. C'est le capital qui met la terre en culture ; c'est le
capital qui met le travail en activit. Un impt qui tendrait chasser les capitaux d'un pays
tendrait d'autant desscher toutes les sources du revenu, tant du souverain que de la socit.
Ce ne serait pas seulement les profits des capitaux, ce serait encore la rente de la terre et les
salaires du travail qui se trouveraient ncessairement plus ou moins diminus par cette
migration de capitaux. (Rich., liv. V, ch. II, t. II, p. 533).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
227
ainsi le fonds consacr l'entretien du travail productif. De plus, s'ils ont
l'avantage d'tre certains et peu prs commodes, ils sont essentiellement ingaux,
parce que la frquence des mutations n'est pas toujours la mme pour des
proprits d'gale valeur. Enfin, les impts sur les transmissions titre onreux
sont particulirement anti-conomiques ds qu'ils cessent d'tre trs modrs,
parce qu'ils entravent la circulation de la proprit, toujours dispose, nous l'avons
dit, passer des mains des inhabiles en celles des plus capables.
En ce qui concerne les salaires, Adam Smith repousse tout impt qui aurait
pour but de les frapper directement et efficacement, car il estime qu'il n'est jamais
possible de les atteindre. Selon lui, le taux des salaires est rgl uniquement par
l'tat de la richesse publique (tat de progrs, tat stationnaire, tat de dcadence) ;
en consquence, l'impt, pas plus qu'aucune autre cause, ne peut altrer ce rapport,
et le montant de la taxe ne fait que s'ajouter au taux du salaire, pour un chiffre
mme bien suprieur. Nous ne sommes pas de cet avis. Il est hors de doute que
l'effet immdiat de l'impt sera de faire hausser les salaires, mais cette hausse
mme aura bien vite pour rsultat de restreindre la consommation dans une
proportion peu prs correspondante, moins qu'il ne se produise une
augmentation simultane de la richesse publique, augmentation improbable
d'ailleurs un moment o se fait sentir la ncessit de nouveaux impts. La
diminution de la demande ramnera donc les salaires un taux voisin de celui qui
existait lors de l'tablissement de la taxe, et l'ouvrier sera forc de supporter ainsi
une part au moins de l'impt jusqu' ce que des perfectionnements nouveaux, en
rduisant le prix des produits, ramnent la demande son chiffre primitif, ou bien
jusqu' ce que la misre, en diminuant le nombre des travailleurs, rtablisse
l'quilibre entre l'offre et la demande et rejette enfin indirectement le reste de la
taxe sur le consommateur. Ces consquences sont fatales et il n'en serait autrement
que dans le cas o la nature des dpenses effectues par l'tat au moyen de l'impt
aurait pour effet de maintenir ou d'augmenter en fait la demande de travail.
Enfin Smith examine les impts qui, dans l'intention du lgislateur, doivent
porter indistinctement sur toutes les diffrentes espces de revenus, rente, profits,
salaires. Ce sont les impts de capitation et les taxes de consommation. Il
n'envisage que deux modes d'assiette des capitations : l'tat prsum de la fortune
de chaque contribuable ou le rang des individus. Dans les deux cas, il trouve
l'impt mauvais : dans le premier, en effet, la taxe devient ncessairement
arbitraire et incertaine, d'abord parce que l'tat de fortune d'un particulier peut
varier d'un jour l'autre, et ensuite parce qu' moins dinquisitions insupportables
et trs frquentes, on ne peut l'apprcier que par conjectures ; dans le second, la
taxe est forcment ingale parce que les revenus sont fort diffrents galit de
rang. Ainsi un pareil impt, dit-il 1 , quand on veut essayer de le rendre gal,
devient totalement incertain et arbitraire, et quand on veut essayer de le rendre
certain et hors de l'arbitraire, il devient tout fait ingal.
1
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 560).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
228
Le clbre conomiste n'a pas examin l'hypothse d'une capitation fixe pour
tous les individus, et cependant, malgr son ingalit flagrante, une taxe de cette
nature ne doit pas tre condamne sans appel lorsqu'elle est trs modre et qu'elle
n'a pour but que de servir de complment tout un ensemble de taxations. Chacun,
en effet, a besoin de la protection de l'tat, chacun doit donc en supporter une
partie des charges. Aussi, bien que par d'autres impts, ceux de consommation par
exemple, chacun contribue, en ralit, ces dpenses communes, il est peut-tre
bon, au point de vue moral comme au point de vue politique, que chacun se sente
directement impos. notre poque surtout o rgne le suffrage universel, nous
croyons qu'il est indispensable que tout citoyen possdant le droit de vote soit
personnellement frapp par certaines des taxes que l'on tablit ou que l'on
augmente en son nom et qu'il soit ainsi intress l'conomie. Mais ces
capitations, pour tre dfendables, doivent rester extrmement modres, et c'est
aux taxes de consommation qu'il est ncessaire de recourir pour frapper rellement
et efficacement l'ensemble des revenus, notamment les salaires qui chappent en
fait tous les autres impts.
Adam Smith enveloppe nanmoins dans la mme rprobation et les capitations
et celles des taxes indirectes qui frappent sur les objets de premire ncessit,
attendu qu'il n'admet pas, nous l'avons dj dit, la possibilit de taxer les salaires.
Aussi, avant d'examiner les taxes de consommation, il les divise en deux
catgories, suivant qu'elles frappent les objets de luxe ou les objets de premire
ncessit, entendant par objets de ncessit, dit-il, non seulement les denres qui
sont indispensables au soutien de la vie, mais encore toutes les choses dont les
honntes gens, mme de la dernire classe du peuple, ne sauraient dcemment
manquer selon les usages du pays.
Il approuve sans rserve les taxes de la premire classe, mais il rejette
absolument les secondes comme inefficaces. Comme, partout, dit-il 1 , le salaire
du travail se rgle en partie sur la demande de travail, et en partie sur le prix
moyen des choses ncessaires la subsistance, tout ce qui fait monter ce prix
moyen doit ncessairement faire monter les salaires, de manire que l'ouvrier soit
toujours mme d'acheter cette quantit de choses ncessaires que l'tat de la
demande de travail exige qu'il ait, quantit rgle par l'tat croissant, stationnaire
ou dcroissant de cette demande. Un impt sur les choses ncessaires ne peut
manquer de faire monter leur prix quelque peu plus haut que le chiffre de l'impt,
parce que le marchand qui fait l'avance de l'impt doit, en gnral, s'en faire
rembourser avec un profit. Ainsi il faut ncessairement qu'un pareil impt amne
dans le salaire du travail un surhaussement proportionn celui qui arrive dans le
prix de ces choses.
Rich., ch. II 4. t. II, p. 563).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
229
Ces critiques ne sont pas fondes, et nous croyons avoir dmontr
prcdemment que l'erreur de Smith procdait de la confusion du salaire naturel et
du salaire minimum. Le point central, autour duquel oscille le salaire courant, n'est
nullement le salaire minimum qui reprsente la somme des subsistances
indispensables la vie, mais c'est le salaire naturel, suprieur au salaire minimum
et dtermin par l'ensemble des frais de production ; il pourra donc s'lever sans
entraner immdiatement et fatalement avec lui le salaire courant, car l'ouvrier
pourra encore vivre. Aussi, bien que les impts de consommation correspondent
une augmentation du prix de revient, il n'en est pas moins vrai que si, au moment
mme de l'tablissement des droits, le travailleur ne peut pas, par suite du rapport
existant entre l'offre et de la demande, les rejeter aussitt sur le consommateur, il
devra les supporter lui-mme directement en totalit ou en partie ; il ne s'en
dchargera qu'autant que, par suite de causes diverses, la situation du march du
travail viendrait se modifier son avantage.
Smith a donc eu tort de ne pas admettre les taxes de consommation sur les
objets de premire ncessit. Ces impts ont certainement des inconvnients rels :
plus que tous autres, ils encouragent la fraude, exigent un personnel spcial, trs
coteux, et donnent lieu des inquisitions vexatoires ; mais, quoi qu'en ait pens le
clbre philosophe, leurs dfauts ne sont pas spciaux aux impts qui frappent les
consommations indispensables, et ils sont d'ailleurs beaucoup moins graves en
ralit qu'ils ne le paraissent premire vue. Ils ne violent qu'apparemment la rgle
de la proportionnalit, et, loin d'tre progressifs rebours comme on l'a dit
souvent, ils arrivent en fait, grce leur rpercussion indfinie, ne frapper chacun
en dfinitive qu'en proportion de son revenu. Ils sont commodes parce qu'on les
acquitte par fractions infinitsimales. De plus, tandis
que les autres impts ne
visent que la richesse dj produite, ceux-ci atteignent efficacement la portion de
la richesse qui est en train de se former et qui, au point de vue de la justice pure, ne
doit pas non plus tre indemne, puisqu'elle n'a t produite
que grce la
protection de l'tat. Enfin, bien qu' proprement parler, ils ne soient pas
volontaires parce que le consommateur n'est pas le matre dacheter ou non les
denres ncessaires la satisfaction de ses besoins et qu'il faut qu'il vive,
cependant, au lieu d'y voir, avec certains conomistes, de vritables capitations, on
doit reconnatre qu'ils ont tout au moins une qualit fort apprciable, en ce qu'ils
permettent au consommateur de proportionner dans une certaine mesure la taxe
mme ses propres revenus.
ce dernier point de vue toutefois, Adam Smith n'tait pas hostile aux taxes
indirectes et il exagrait mme la porte de cet avantage de l'impt d'tre presque
facultatif 1 . Aussi, il les recommandait vivement comme mode de taxation des
objets de luxe. Ces impts, disait-il, ont toutes les qualits ncessaires une bonne
taxe : ils sont proportionnels, en ce qu'tant pays par les consommateurs de la
1
L'ouvrier, dit-il, paie l'impt petit petit, selon qu'il est en tat de le payer et quand il y a
moyen de le payer. Chaque acte de paiement est parfaitement volontaire, et il est le matre de
s'en dispenser si cela lui convient mieux. Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 572).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
230
chose impose, ils atteignent ainsi, en ralit, les trois sources de revenus ; ils ne
drangent pas l'quilibre naturel de la rpartition en faisant monter le prix des
autres marchandises ; ils favorisent mme la production en dtournant l'ouvrier
laborieux des consommations excessives et en le poussant l'conomie. Mais, ce
que Smith n'a pas dit, c'est qu'en revanche les taxes sur les consommations de luxe
ont le dfaut le plus grave que puissent avoir des impts, attendu qu'elles sont peu
productives et qu'elles ne peuvent fournir au Trsor un revenu important. Or c'est
la condamnation absolue de ses conclusions. Il ne faut pas, en effet, chercher un
trop bon impt, il ne pourrait tre compltement inoffensif qu' la condition de ne
rien produire ; l'impt n'est jamais bon, et il le sera toujours d'autant moins qu'il
sera appel fournir au Trsor une somme plus considrable ; l'art du lgislateur
consiste choisir parmi les taxes susceptibles de donner un rendement suffisant,
celles qui sont les moins mauvaises, les moins gnantes, qui respectent la justice,
qui drangent le moins possible l'ordre naturel des choses, et, cet gard, des taxes
indirectes multiples, assez nombreuses pour atteindre toutes les consommations,
quel qu'en soit le caractre, lui fournissent, en ralit, une excellente matire
d'imposition.
Le clbre conomiste a profess les mmes principes en ce qui concerne les
droits de douane. Comme nous l'avons dit dj dans la premire partie de ce
travail, Smith ne dsapprouve nullement les douanes au point de vue fiscal et il les
considre avec raison comme un mode spcial d'assiette et de perception des droits
de consommation. Il estime que, comme les droits d'accise, ils sont en gnral trs
certains 1 , toujours commodes acquitter ; mais il les trouve ingaux, vexatoires et
coteux. Ils violent en outre la rgle de l'conomie tous les points de vue : leur
recouvrement exige un personnel nombreux dont les salaires constituent pour le
peuple un vritable impt additionnel qui ne rapporte rien l'tat ; ils donnent lieu
des visites, et des perquisitions trs gnantes ; ils occasionnent ncessairement
certaines perturbations dans quelque branche de l'industrie ; ils font hausser les
prix, ils dcouragent la consommation et par suite la production ; ils provoquent la
fraude qui prend rapidement des proportions considrables, dtermine un
relchement de la moralit publique et donne lieu des confiscations ou des
amendes qui ruinent le dlinquant et font tomber son capital dans le revenu
improductif du Trsor.
Enfin, selon Smith, ils violent la rgle de la justice, mme lorsqu'ils pargnent
les objets de premire ncessit, parce que bien souvent les dpenses ne sont pas
proportionnelles aux revenus, mais plutt aux inclinations. Comme cest, dit-il,
le caractre et le penchant naturel de chaque homme qui dterminent le degr de
consommation qu'il fait, chaque homme se trouve contribuer plutt selon la nature
de ses inclinations que selon son revenu. Le prodigue contribue au del de la juste
proportion ; l'homme parcimonieux contribue, en de de cette proportion ;
pendant sa minorit, un homme dou d'une grande fortune contribue ordinairement
1
Il n'en est pas ainsi toutefois des droits ad valorem.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
231
de fort peu de chose, par sa consommation, au soutien de l'tat dont la protection
est pour lui l source d'un gros revenu. Ceux qui rsident en pays tranger ne
contribuent en rien par leur consommation, au soutien du gouvernement du pays,
dont ils tirent leur revenu. Si, dans ce dernier pays il n'y avait pas d'impt
territorial ni aucun droit considrable sur les mutations des proprits mobilires
ou immobilires, comme cela est en Irlande, des personnes absentes pourraient
ainsi jouir d'un gros revenu la faveur de la protection d'un gouvernement aux
besoins duquel elles ne contribueraient pas pour un sou 1 .
Nous n'insisterons pas sur ces divers points, car ils ne sont gure, en ralit,
que la rptition o l'amplification des dveloppements que l'auteur avait prsents
pour laccise. Cependant tout ce chapitre est fort intressant au point de vue
historique en ce qu'il fait ressortir combien les applications du systme mercantile
taient dfavorables au souverain lui-mme, comment les gros droits qu'on avait
tablis avaient eu pour effet d'encourager la contrebande et de rduire le revenu
des douanes, comment les primes et drawbacks avaient donn lieu des fraudes
scandaleuses qui cotaient l'tat des sommes considrables, enfin comment les
droits de douane formaient un fouillis inextricable que les commerants et les
industriels avaient peine dmler.
Tel est l'ensemble d'impts par lequel l'tat se procure, en temps normal, les
ressources annuelles destines complter les revenus de son domaine. Mais ces
ressources sont parfois insuffisantes lorsque le souverain est oblig de pourvoir
des dpenses extraordinaires, dans le cas d'une guerre par exemple : il faut donc
recourir l'emprunt.
Au moyen-ge, avant le dveloppement du commerce et des manufactures, les
dpenses de la noblesse taient peu considrables et ne consistaient gure que dans
les frais d'une large hospitalit. Il en tait alors de mme du premier noble du
royaume, le roi : ayant peu de services rtribuer, pas d'arme permanente
entretenir et n'arrivant gnralement pas dpenser tous ses revenus, il faisait
comme ses vassaux, il thsaurisait, accumulant ainsi un fonds de prvoyance qui
pt lui permettre de faire face ventuellement aux dpenses d'une guerre. Mais ds
que les progrs de l'industrie eurent multipli les besoins et dvelopp les
consommations, le roi cessa d'conomiser et il trouva plus commode de s'adresser
ses sujets lorsqu'il eut effectuer des dpenses extraordinaires : ce fut l l'origine
des emprunts.
Les nations, comme les particuliers, commencrent en gnral par emprunter
sur leur crdit personnel, sans assigner ou hypothquer de fonds particuliers pour
le paiement de leurs dettes. Lorsque cette ressource leur et manqu, elles en
vinrent emprunter sur des assignations ou sur l'hypothque de fonds particuliers,
d'abord pour un temps limit, puis perptuit lorsque, faute de pouvoir
1
Rich., liv. V, ch. II (t. II, p. 594).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
232
rembourser le capital l'chance, on imagina la rente perptuelle. Ces sortes
d'emprunts furent appels, dans le premier cas, emprunts par anticipation, et, dans
le second, emprunts avec fonds perptuit (dette fonde). Pour contenter les
gots des rentiers, les gouvernements cherchrent encore des combinaisons
particulires, et Smith en note ainsi deux autres, trs rpandues, qui tenaient le
milieu entre les emprunts par anticipation et les emprunts perptuit : c'taient les
emprunts sur annuits terme et les emprunts sur annuits viagres. Les annuits
terme avaient beaucoup de faveur en Angleterre ; mais les annuits viagres,
cres soit sur vies spares, soit sous forme de tontines, taient de beaucoup
prfres en France. Les dettes se plirent ainsi par leur diversit aux gots des
citoyens, et elles prirent rapidement un dveloppement excessif, trs funeste aux
socits.
Toutefois, malgr les dangers qu'elles prsentent, on peut dire que les dettes
publiques sont en ralit l'un des signes les plus caractristiques des civilisations
modernes, en ce qu'elles supposent la confiance des citoyens dans la scurit des
contrats, dans la bonne foi comme dans la richesse des gouvernements. Les
emprunts tmoignent ainsi effectivement d'un vritable progrs et nous ne pouvons
que nous tonner, cet gard, qu'Adam Smith ait regrett les rserves mtalliques.
Les trsors de guerre avaient, la vrit, un avantage trs prcieux au moment
d'une guerre, en ce qu'ils mettaient la disposition du souverain une somme
considrable, immdiatement disponible ; mais, par contre, ils donnaient aux
gouvernements la tentation de se laisser aller au gaspillage ou aux aventures
guerrires, et, au point de vue conomique, ils n'taient nullement dfendables
parce qu'ils enlevaient la reproduction et la circulation des capitaux normes
pour les laisser dormir dans les caisses du Trsor 1 . Aussi, nous pensons que l'tat
doit recourir l'emprunt, non pas, comme le dit Adam Smith, parce qu'il nglige
d'conomiser, mais parce qu'en gnral, le lgislateur agit sagement en n'entravant
pas, ds le temps de paix, la marche des affaires.
Le clbre conomiste est cependant, en principe, absolument hostile aux
emprunts, et il ne les admet qu'exceptionnellement, dans les cas o il est
1
Nous ne croyons pas, toutefois, pouvoir condamner d'une manire aussi absolue, les trsors
modernes de l'tat prussien et notamment celui que M. de Bismarck a reconstitu aprs la
guerre de 1870. Ce trsor a t cr dans des circonstances exceptionnelles, au moyen de partie
de l'indemnit paye par la France et sans aucun prlvement direct sur le capital national ; en
outre, il n'est nullement improductif, il est reprsent dans la circulation par des billets au
porteur, non remboursables, reus dans toutes les caisses de l'tat. Assurment, les rserves
mtalliques sont encore trs attaquables, dans ces conditions mmes, au point de vue
conomique et mme politique ; mais elles offrent, au point de vue militaire, des avantages
incontestables, surtout dans un pays o le crdit public, peu dvelopp, ne pourrait fournir,
bref dlai, des ressources considrables. L'intrt suprieur de la mobilisation est ici en jeu, et
les approvisionnements d'espces mtalliques sont justifiables au mme titre que les
approvisionnements d'armes, de munitions, de vivres, d'quipements, qui sont conservs de tout
temps dans les arsenaux et dans les magasins de l'tat.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
233
impossible d'obtenir rapidement par l'impt les ressources ncessaires. Il reconnat
qu'au dbut d'une guerre, au moment o il faut pourvoir immdiatement des
dpenses considrables et imprvues, il n'est pas praticable de s'adresser l'impt
qui ne commencera gure fonctionner utilement que plusieurs mois aprs ; alors,
en effet, le salut de la patrie exige que l'arme soit augmente, la flotte quipe, les
villes de garnison mises en tat de dfense, il faut constituer d'immenses
approvisionnements de vivres, d'armes et de munitions. Il s'incline donc devant cet
intrt suprieur qui doit primer toute autre considration, et il comprend que, dans
ce cas pressant, le gouvernement puisse recourir l'emprunt ; mais il ne voudrait
pas qu'on allt au del, qu'on continut user de cet expdient pendant toute la
dure des oprations, et il estime qu'il est sage de chercher dans l'impt seul les
moyens mmes de continuer la guerre.
Cette doctrine est vraiment un peu troite. Il est certain, assurment, qu'au
point de vue moral et politique, l'impt est prfrable, parce qu'il fait sentir
immdiatement et lourdement la nation le poids des frais de la guerre et qu'il en
fait dsirer la fin. Comme l'a dit fort loquemment M. Gladstone la Chambre des
communes 1 : Les frais de la guerre sont le frein moral que le Tout-Puissant
impose l'ambition et la soif de conqutes inhrentes tant de nations ; il y a
dans la guerre une sorte d'clat et d'entranement qui lui donne un certain charme
aux yeux des masses et en dissimule les maux ; la ncessit de payer, anne par
anne, les frais qu'entrane la guerre, est un frein salutaire. Par l'emprunt au
contraire, Smith a parfaitement insist sur cette observation les gouvernements
vitent de mcontenter l'opinion publique un moment o elle pourrait peser sur
l'issue de la guerre, et, au lieu de froisser les citoyens dans leurs intrts
immdiats, ils acquirent gnralement la popularit en flattant l'amour-propre
national par des victoires et des conqutes qui ne paraissent coter qu'un faible
supplment d'impts. Au moyen de la ressource des emprunts, dit Smith 2 , une
augmentation d'impts fort modre les met mme de lever assez d'argent
d'anne en anne pour soutenir la guerre ; et, au moyen de la pratique de faire des
fonds perptuels, ils se trouvent en tat, avec la plus petite augmentation possible
dans les impts, de lever annuellement les plus grosses sommes d'argent. Dans de
vastes empires, les gens qui vivent dans la capitale et dans les provinces loignes
du thtre des oprations militaires ne ressentent gure, pour la plupart, aucun
inconvnient de la guerre, mais ils jouissent tout leur aise de l'amusement de lire
dans les gazettes les exploits de leurs flottes et de leurs armes. Pour eux, cet
amusement compense la petite diffrence des impts qu'ils paient cause de la
guerre, d'avec ceux qu'ils taient accoutums payer en temps de paix. Ils voient
ordinairement avec dplaisir le retour de la paix qui vient mettre fin leurs
amusements et mille esprances chimriques de conqute et de gloire nationale
qu'ils fondaient sur la continuation de la guerre.
1
2
Sance du 6 mars 1854.
Rich., liv. V, ch. III (t. II, p. 631).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
234
Mais si cet inconvnient politique de l'emprunt est rel, il ne doit pas faire
passer sur les dfauts conomiques et financiers du recours l'impt en temps de
crise. Nous l'avons dj dit, les rendements de l'impt sont trop lents, ils sont
surtout trop faibles, et loin de pouvoir tre augments aisment pendant la guerre,
ils se resserrent dans de notables proportions par suite de la diminution des
transactions. Quant aux impts nouveaux, ils sont d'ordinaire peu productifs, parce
que l'tablissement de toute taxe nouvelle apporte fatalement des perturbations
graves dans la production et la rpartition des richesses ; d'ailleurs, le contribuable
frapp, ne pouvant pas immdiatement rejeter sur d'autres le montant de l'impt,
cherche se drober, et la fraude prend une extension considrable une poque
o le gouvernement peut le moins la rprimer. En outre, les lourdes taxes entravent
l'industrie et le commerce dj atteints par la guerre, les faillites se multiplient, et
l'impt fait fuir les revenus qu'il prtend frapper ; enfin, consquence trs grave
encore, en prlevant ainsi une trop forte part des revenus, on rend par l mme
toute guerre intolrable, qu'elle qu'en soit la lgitimit. Aussi le parti le plus sage
que l'on puisse adopter consiste, selon nous, dans la combinaison des deux sortes
de ressources, en demandant aux impts tablis le maximum de ce qu'ils peuvent
donner sans ruiner le contribuable et en recourant l'emprunt pour obtenir tout le
surplus.
Nanmoins, on ne saurait reprocher Adam Smith d'avoir voulu ragir contre
la tendance funeste des gouvernements de son poque multiplier sans ncessit
les appels au crdit. Le systme des emprunts a tant de charmes : ltat n'a qu'
demander des fonds, et chacun accourt pour lui porter le fruit de ses pargnes ; on
fait queue ses guichets. Au temps dj du clbre philosophe, on regardait
comme une faveur d'tre admis aux souscriptions, et le gouvernement se faisait
ainsi des amis, tandis que par l'impt il ne se ft fait que des ennemis. Les prjugs
les plus spcieux le poussaient du reste se laisser aller sur cette pente glissante au
bas de laquelle est la banqueroute. L'tat ne peut tre affaibli par ses dettes, disait
Melon, attendu que les intrts sont en somme pays par la main droite la main
gauche ; selon Pinto, les emprunts crent dans l'tat un nouveau capital qui
s'ajoute l'ancien ; enfin Voltaire lui-mme voyait dans les dettes publiques un
encouragement l'industrie.
Smith a parfaitement rfut les erreurs de Pinto et de Melon. Il y a un auteur,
dit-il 1 , qui a reprsent les fonds publics des diffrentes nations endettes de
l'Europe, et spcialement ceux de l'Angleterre, comme l'accumulation d'un grand
capital ajout aux autres capitaux du pays, au moyen duquel son commerce a
acquis une nouvelle extension, ses manufactures se sont multiplies, et ses terres
ont t cultives et amliores beaucoup au del de ce quelles l'eussent t au
moyen de ses autres capitaux seulement. Cet auteur ne fait pas attention que le
capital avanc au Gouvernement par les premiers cranciers de l'tat, tait, au
moment o ils ont fait cette avance, une portion du produit annuel qui a t
1
Rich., liv. V, ch. III (t. II, p. 636).
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
235
dtourne de faire fonction de capital pour tre employe faire fonction de
revenu, qui a t enleve l'entretien des ouvriers productifs pour servir
l'entretien de salaris non productifs et pour tre dpense et dissipe dans le
cours, en gnral, d'une seule anne, sans laisser mme lespoir d'aucune
reproduction future. la vrit, en retour du capital par eux avanc, ils ont obtenu
une annuit dans les fonds publics, qui le plus souvent valait au moins autant. Sans
contredit, cette annuit leur a remplac leur capital et les a mis en tat de faire aller
leur commerce et leurs affaires avec tout autant et peut-tre plus d'tendue
qu'auparavant, c'est- dire qu'ils se sont trouvs mme d'emprunter des tiers un
nouveau capital sur le crdit de cette annuit, ou bien, en la vendant, de retirer de
quelque tierce personne un autre capital elle appartenant, gal ou suprieur
celui qu'ils avaient avanc au gouvernement. Mais ce nouveau capital qu'ils ont
achet ou emprunt de tierces personnes, il fallait bien qu'il existt dans le pays
auparavant, et qu'il y ft dj employ, comme le sont tous les capitaux,
entretenir du travail productif. Quand ce capital est venu passer dans les mains de
ceux qui avaient avanc leur argent au gouvernement, s'il tait pour eux, certains
gards, un nouveau capital, il n'en tait pas un nouveau pour le pays ; ce n'tait
autre chose qu'un capital retir de certains emplois particuliers pour tre tourn
vers d'autres. Bien qu'il remplat pour eux ce qu'ils avaient avanc au
gouvernement, il ne le remplaait pas pour le pays. S'ils n'eussent point fourni leur
capital au gouvernement, il y aurait eu alors dans le pays deux capitaux au lieu
d'un, deux portions du produit annuel au lieu d'une, employes entretenir du
travail productif.
Cette erreur venait de ce que Pinto prenait la lettre l'expression vulgaire
dsignant gnralement sous le nom de capitaux la masse des titres qui constatent
les droits des prteurs et qui ne sont au contraire, dans la ralit, que de vritables
hypothques grevant l'ensemble du patrimoine national dont elles diminuent
d'autant la valeur.
Quant l'erreur de Melon, Adam Smith la considre seulement comme une
consquence du systme mercantile qui n'admet pas qu'il y ait perte tant que la
mme quantit d'argent reste dans le pays. Aussi se plat-il la combattre en se
plaant au point de vue mme de ce systme et il fait remarquer que, de la sorte,
cette proposition ne serait encore admissible que si l'on supposait tous nos
emprunts souscrits par nos nationaux et jamais par l'tranger. Mais il n'a pas
pouss plus loin son tude et il ne s'est pas attach montrer, comme il aurait pu le
faire utilement ici, que le paiement de l'impt destin acquitter les arrrages de la
dette se rsout en somme en une perte pour le contribuable sans un avantage
corrlatif pour le rentier. M. Paul Leroy-Beaulieu, dans son remarquable, Trait
des Finances, a tabli d'une faon plus saisissante l'erreur de cette thorie : Pour
reprendre, dit-il, l'image de Melon, quand il y a emprunt, la main droite, c'est-dire le contribuable, passe son argent la main gauche, c'est--dire au rentier ;
quand il n'y a pas d'emprunt, chacune des deux mains reste pleine, aucune ne se
dessaisit et cela vaut mieux.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
236
Des autres avantages que l'on a gnralement trouvs aux emprunts, les uns
sont galement illusoires, les autres ont t au moins exagrs. C'est ainsi que les
partisans enthousiastes des dettes publiques ont prtendu que ce sont les emprunts
qui ont fait natre l'pargne. Or, pose en ces termes, cette proposition est
inexacte : c'est le travail seul qui produit les richesses et c'est le sentiment de notre
responsabilit qui nous dtermine diffrer la consommation d'une partie de ces
richesses. Les emprunts, il est vrai, ont pour rsultat de fortifier cette tendance et
de consolider l'pargne ; mais, ce point de vue mme, ils ne sont pas sans
dangers, car ils dtournent en mme temps cette pargne des emplois plus
productifs o elle se dirigeait naturellement, et on attribue, non sans raison, au
classement de nos grands emprunts une partie de la dprciation qu'ont subie
depuis dix ans en France les proprits rurales. De mme, au point de vue
politique, on a dit que les dettes publiques intressent les rentiers au maintien de
l'ordre de choses tabli, mais cela n'est vrai qu'en apparence ; ds qu'on consulte
l'histoire, on voit que ce n'est pas en s'endettant que l'tat s'attache les citoyens
d'une manire durable, et qu'au contraire c'est dans le bien-tre gnral, dans
l'accumulation des richesses qui accrot le taux des salaires, qu'un gouvernement
doit chercher sa meilleure sauvegarde.
Il n'en faut pas moins reconnatre que le clbre philosophe, trouvant l'arc
courb dans un sens, l'a trop recourb en sens inverse. Il parat mme, premire
vue, avoir partag cet gard l'hostilit systmatique de son ami Hume pour les
dettes publiques ; mais au fond, il n'en craignait rellement que l'abus, estimant
que l'emprunt n'est pas mauvais en lui-mme, si l'tat n'en use qu'avec prudence et
si la destination qu'il lui donne est conforme aux principes conomiques. Il n'en
contestait nullement d'ailleurs la lgitimit, considrant que le prsent, qui lgue
l'avenir un patrimoine considrable, a bien le droit de lui laisser aussi quelques
charges.
Quoi qu'il en soit, il recommande sagement aux gouvernements, au point de
vue politique, d'allger autant que possible le poids de leur dette, parce que les
tats obrs sont dans une sorte d'impuissance qui entrave leur libert d'action
dans les relations internationales, qui rend plus incertain le succs des emprunts
ultrieurs et qui peut conduire la banqueroute les nations imprvoyantes.
Il insiste particulirement sur ce danger de la banqueroute laquelle il voit les
tats fatalement conduits lorsqu'ils lvent inconsidrment leur dette sans aucune
proportion avec la richesse du pays. Quand la dette nationale, dit-il, s'est une fois
grossie jusqu' un certain point, il n'y a pas, je crois, un seul exemple qu'elle ait t
loyalement et compltement paye. Si jamais la libration du revenu public a t
opre tout fait, elle l'a toujours t par le moyen d'une banqueroute, quelquefois
par une banqueroute ouverte et dclare, mais toujours par une banqueroute relle,
bien que dguise souvent sous une apparence de paiement. Pour y arriver, ou
bien on augmentait la dnomination lgale de la monnaie, ou bien on rduisait le
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
237
titre du mtal. L'tat paraissait payer intgralement, mais il n'acquittait en ralit
qu'une fraction des arrrages : c'tait, pour nous servir de l'expression mme de
l'auteur, un vrai tour d'escamotage .
Smith concluait donc en conseillant aux gouvernements la pratique de
l'amortissement pour la rduction de leur dette, mais il prconisait un
amortissement tout autre que celui qui tait alors pratiqu en Angleterre. Il avait
compris que cet amortissement est une erreur conomique lorsqu'il faut emprunter
pour amortir ou lorsque la nation est surcharge d'impts vexatoires qu'il est plus
pressant de supprimer. Aussi ne s'tait-il pas laiss sduire par les thories
dcevantes du Dr Price qui voyait dans la puissance des intrts composs un
moyen certain de rembourser la dette de l'tat, quelle qu'en ft l'importance : bien
avant Hamilton et Ricardo, il avait montr que l'amortissement n'est rellement
possible qu'au moyen des excdents du budget et que le systme en usage n'avait
jamais eu d'autre effet dans la pratique que d'enlever tout scrupule et toute retenue
aux gouvernements engags sur la pente des emprunts.
Il constatait d'ailleurs qu'en fait, les fonds d'une caisse d'amortissement sont
toujours dtourns bien vite de leur destination primitive et que leur dissipation est
fatale. Mme pendant la paix la plus profonde, dit-il, il survient divers
vnements qui exigent une dpense extraordinaire, et le gouvernement trouve
toujours plus commode de satisfaire cette dpense en dtournant le fonds
d'amortissement de sa destination qu'en mettant un nouvel impt. Tout nouvel
impt est senti sur-le-champ plus ou moins par le peuple. Il occasionne toujours
quelque murmure et ne passe pas sans rencontrer de l'opposition. Plus les impts
ont t multiplis, plus on presse fortement chaque article d'imposition, et plus
alors le peuple crie contre tout impt nouveau, plus il devient difficile de trouver
un nouvel objet imposable ou de porter plus haut les impts dj tablis. Mais une
suspension momentane du rachat de la dette n'est pas sentie immdiatement par le
peuple et ne cause ni plaintes ni murmures. Emprunter sur le fonds
d'amortissement est une ressource facile et qui se prsente d'elle-mme pour se
tirer de la difficult du moment. Plus la dette publique se sera accumule, plus il
sera devenu indispensable de s'occuper srieusement de la rduire, plus il sera
dangereux, ruineux mme de dtourner la moindre partie du fonds
d'amortissement, moins alors il est prsumer que la dette publique puisse tre
rduite un degr un peu considrable ; plus il faut s'attendre, plus il est infaillible
que le fonds d'amortissement sera dtourn pour couvrir toute la dpense
extraordinaire qui peut survenir en temps de paix. Quand une nation est dj
surcharge d'impts, il n'y a que les besoins imprieux d'une nouvelle guerre, il n'y
a que l'animosit de la vengeance nationale ou l'inquitude pour la sret de la
patrie qui puisse amener le peuple se soumettre, avec un peu de patience, au joug
d'un nouvel impt : de l vient que les fonds d'amortissement sont si ordinairement
dtourns de leur destination.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
238
Cette condamnation du systme des caisses d'amortissement est fort
remarquable, et il est surprenant qu'elle n'ait pas fait comprendre William Pitt,
l'minent disciple de Smith, combien les conclusions du Dr Price, exactes en
thorie, deviennent errones ds qu'on tente de les appliquer dans le domaine de la
politique, sans tenir compte des ncessits pratiques, ni des sentiments des peuples,
ni surtout des passions des gouvernements.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
239
CONCLUSION.
Retour la table des matires
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les principales thories qui forment le
fonds de la doctrine du fondateur de l'conomie politique. Afin d'en respecter
l'originalit, nous avons laiss la parole, aussi souvent que possible, l'auteur luimme, et nous n'avons pas craint de multiplier les citations. En outre, pour en
mieux comprendre la porte et les exposer plus nettement, nous nous sommes
efforc de nous pntrer de l'esprit du matre, non seulement par une analyse
scrupuleuse des diverses parties de ses Recherches et de ses travaux antrieurs,
mais aussi et surtout en cherchant surprendre sa vie, ses habitudes, connatre
ses relations, le suivre dans les diffrents milieux qui ont pu influer sur le
dveloppement de ses ides et la direction de ses tudes. Nous avons acquis ainsi
la certitude que les divers travaux de ce puissant philosophe se rattachaient tous
un plan unique, immense, embrassant la fois chacune des faces de l'histoire de la
Civilisation.
Nous osons esprer que cette vue d'ensemble n'aura pas t inutile ; elle permet
d'apprcier mieux encore chacune des parties de cette uvre admirable, en en
faisant comprendre le vritable caractre, en clairant certaines obscurits et en
disculpant l'auteur des dfauts de composition qu'on lui a si souvent reprochs. Il
ne faut pas voir seulement dans Adam Smith le savant et le philosophe qui a
dml les lois des choses par la puissance de son observation et l'tude
consciencieuse des faits de l'histoire ; il faut voir aussi le philanthrope dsireux de
tirer de ces lois des consquences pratiques pour le soulagement de ses semblables.
Partout on sent battre son cur, et son amour de l'humanit lui arrache parfois
mme des concessions, des compromis et jusqu' des contradictions avec ses
principes. Cet aptre de la libert qui rclame des rformes, ne peut s'empcher de
redouter qu'on les ralise trop brusquement ; il demande la suppression des
entraves, mais il craint qu'on les brise ; il recommande sans cesse de mnager les
transitions, de ne pas brusquer les habitudes de la nation, de ne pas violer les droits
acquis.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
240
L'homme dont l'esprit public a pour base la bienfaisance et l'humanit, dit-il
avec un grand sens politique 1 , respectera les pouvoirs tablis et mme les
privilges des individus, particulirement ceux des ordres principaux qui
composent l'tat : quoiqu'il trouve, quelques gards, leur existence abusive, il se
contente souvent de modrer ce qui ne peut tre ananti que par des mouvements
violents. Lorsqu'on ne peut vaincre par la raison et la persuasion les prjugs
enracins des peuples, il n'essaie point de les touffer par la force, et il observe
religieusement ce que Cicron appelait si justement la divine maxime de Platon :
Qu'il ne faut pas plus employer la violence l'gard de son pays qu' l'gard de
ses parents. Il fait accorder, autant qu'il le peut, ses nouvelles institutions avec les
habitudes invtres et avec les prjugs du peuple, et il s'attache surtout
remdier aux maux rsultant de l'absence de certaines lois rgulatrices auxquelles
la foule se soumet en gnral avec peine. Quand il ne peut rtablir le droit, il ne
ddaigne pas d'affaiblir l'abus qui a pris sa place, semblable Solon, qui, ne
pouvant tablir la meilleure des lgislations possibles, se contentait de faire
admettre la moins mauvaise de toutes celles dont les Athniens taient
susceptibles. L'homme systmatique au contraire, peut tre sage dans ses
conceptions ; mais son enthousiasme pour la beaut idale du plan de
gouvernement qu'il a combin, est tel qu'il n'y peut souffrir la moindre altration. Il
veut l'tablir d'une manire complte, sans aucun gard pour les grands intrts et
les puissants prjugs qui s'y opposent. Il croit qu'on peut disposer des diffrentes
parties du corps social aussi librement que des pices d'un jeu d'checs : il oublie
que les pices d'un jeu d'checs n'ont d'autres principes de mouvement que la main
qui les dplace, et que, dans le grand jeu des socits humaines, chaque partie a un
principe de mouvement qui lui est propre et qui est absolument diffrent de celui
dont le lgislateur a fait choix pour le lui imprimer : quand ces deux principes
concident et ont la mme direction, le jeu de la machine sociale est facile,
harmonieux et prospre ; s'ils sont opposs lun l'autre, ce jeu est discordant et
funeste, et la machine sociale est bientt dans un dsordre absolu.
Ce passage admirable fait connatre sous son vritable jour l'esprit du matre, si
diffrent de celui des philosophes franais de son poque, et il donne le secret de
sa puissance sur ses compatriotes. De nos jours encore les gouvernements ne
sauraient trop s'inspirer de ces maximes, conformes la fois aux principes de la
morale et ceux de la politique.
On a contest Adam Smith l'honneur d'avoir fond l'conomie politique, et
Franais et Anglais ont apport dans cette discussion une passion regrettable : nous
n'y interviendrons pas. Mais que cet honneur revienne aux physiocrates ou
l'conomiste cossais, la gloire de ce dernier n'a nullement besoin d'tre rehausse.
Si les premiers avaient fond la science et creus habilement, suivant l'expression
de Germain Garnier, un terrain que personne n'avait pu dfricher avant eux, c'est
du moins Adam Smith qui sut lui faire porter des fruits. Ils n'avaient que des ides
1
Thorie des sentiments moraux, VIe partie, section II.
Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines (1886)
241
spculatives, mises dans un langage particulier et peu ralisables, il les traduisit,
les rectifia, les complta, et il en fit, en politique, des applications sages et
fcondes.
Son champ d'action fut immense et les services qu'il a rendus l'humanit ne
sont pas numrer. Loin qu'il nous en cote d'ailleurs de le reconnatre, nous
sommes plutt tent de nous en enorgueillir : les illustrations de l'cosse sont, en
effet, un peu les ntres, et, de mme que rcemment l'Universit d'Edimbourg, en
ftant solennellement son troisime centenaire, donnait la premire place aux
reprsentants de la France, de mme nous sommes heureux de devoir cette terresur cette sympathique figure du grand conomiste.
Vous aimerez peut-être aussi
- En Attendant Les Robots - Enque - Antonio A. Casilli PDFDocument423 pagesEn Attendant Les Robots - Enque - Antonio A. Casilli PDFabderrrassoulPas encore d'évaluation
- En Attendant Les Robots - Enque - Antonio A. Casilli PDFDocument423 pagesEn Attendant Les Robots - Enque - Antonio A. Casilli PDFabderrrassoulPas encore d'évaluation
- Napoleon Et Talleyrand - Dard, EmileDocument432 pagesNapoleon Et Talleyrand - Dard, Emileabderrrassoul100% (1)
- Topalov - Le Profit, La Rente Et La VilleDocument9 pagesTopalov - Le Profit, La Rente Et La VilleSteve PalmerPas encore d'évaluation
- Termes de Reference - Taux de Cession Interne - Scridb PDFDocument2 pagesTermes de Reference - Taux de Cession Interne - Scridb PDFEsmelagne Jean Arnold Sié100% (1)
- En Finir Avec Les Idees Fausses - AtdDocument205 pagesEn Finir Avec Les Idees Fausses - AtdabderrrassoulPas encore d'évaluation
- La Fin Des Empires - Patrice Gueniffey PDFDocument457 pagesLa Fin Des Empires - Patrice Gueniffey PDFabderrrassoul100% (3)
- Microéconomie L2 AES Semestre 2Document17 pagesMicroéconomie L2 AES Semestre 2ARatfatPas encore d'évaluation
- ManagementDocument104 pagesManagementJean-Noel BillerPas encore d'évaluation
- Economie Des Ressources Humaines S6Document39 pagesEconomie Des Ressources Humaines S6Justine Gengembre100% (5)
- Friedrich HAYEK Prix Et ProductionDocument206 pagesFriedrich HAYEK Prix Et ProductionGhazi Ben Jaballah100% (1)
- L3 LEA AEI MIRAIL - Theorie de La FirmeDocument17 pagesL3 LEA AEI MIRAIL - Theorie de La FirmeAnaBarahonaPas encore d'évaluation
- 2 - Marché Des Capitaux IslamiquesDocument28 pages2 - Marché Des Capitaux IslamiquesOussama Derwich100% (3)
- Detective de L'histoire - Tulard, JeanDocument275 pagesDetective de L'histoire - Tulard, Jeanabderrrassoul100% (2)
- Anne de Bretagne - Claire L'HoerDocument273 pagesAnne de Bretagne - Claire L'Hoerabderrrassoul100% (2)
- Histoire Du Maroc Depuis L'inde - Vermeren, PierreDocument243 pagesHistoire Du Maroc Depuis L'inde - Vermeren, Pierreabderrrassoul100% (1)
- Requiem Pour Le Monde Occidenta - Pascal BonifaceDocument117 pagesRequiem Pour Le Monde Occidenta - Pascal Bonifaceabderrrassoul100% (2)
- Attali Jacques - Karl Marx Ou L4esprit Du Monde - 2005Document337 pagesAttali Jacques - Karl Marx Ou L4esprit Du Monde - 2005abderrrassoul100% (6)
- Allais Maurice - Pour La Réforme de La FiscalitéDocument66 pagesAllais Maurice - Pour La Réforme de La FiscalitéabderrrassoulPas encore d'évaluation
- L'economie Mondiale, 2019, Cepii PDFDocument100 pagesL'economie Mondiale, 2019, Cepii PDFabderrrassoulPas encore d'évaluation
- Le Figaro Magazine - 21 D Cembre 2018bDocument124 pagesLe Figaro Magazine - 21 D Cembre 2018babderrrassoulPas encore d'évaluation
- La Croissance Economique de L'afriqueDocument34 pagesLa Croissance Economique de L'afriqueabderrrassoul100% (1)
- L Express - 19 D Cembre 2018bDocument132 pagesL Express - 19 D Cembre 2018babderrrassoulPas encore d'évaluation
- L Afrique-Defis Enjeux - Et.perspectives - En.40.fiches - Pour.comprendre.l ActualiteDocument178 pagesL Afrique-Defis Enjeux - Et.perspectives - En.40.fiches - Pour.comprendre.l ActualiteabderrrassoulPas encore d'évaluation
- Term S Maths Reperes Livre Du Professeur 2011Document28 pagesTerm S Maths Reperes Livre Du Professeur 2011abderrrassoulPas encore d'évaluation
- Le Loup Dans La Bergerie - Droi - Jean-Claude Michea PDFDocument125 pagesLe Loup Dans La Bergerie - Droi - Jean-Claude Michea PDFabderrrassoul100% (2)
- Rapport GADREY Indicateurs Richesse DeveloppementDocument179 pagesRapport GADREY Indicateurs Richesse Developpementabderrrassoul100% (1)
- National Geographic Hors-Série N°25Document112 pagesNational Geographic Hors-Série N°25abderrrassoulPas encore d'évaluation
- Regards Épist. GestionDocument15 pagesRegards Épist. GestionabderrrassoulPas encore d'évaluation
- Le Capitalisme Sans Capital PDFDocument386 pagesLe Capitalisme Sans Capital PDFMostafa Afifi100% (4)
- Corrigé de La Partie 3 de L'Epreuve Composée N°1 Novembre 2015 Comment Évolue Le Partage de La Valeur AjoutéeDocument7 pagesCorrigé de La Partie 3 de L'Epreuve Composée N°1 Novembre 2015 Comment Évolue Le Partage de La Valeur AjoutéeMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Exposé-Efficience Des Marchés FinancièrsDocument64 pagesExposé-Efficience Des Marchés FinancièrsAmine Lrhaich75% (8)
- Politique de DividendeDocument56 pagesPolitique de DividendeSaloua Chachoua100% (1)
- Histoire de La Pensée EconomiqueDocument23 pagesHistoire de La Pensée EconomiqueEL YOUBI Samia50% (2)
- 2 A Quoi Sert L Esprit D EntrepriseDocument32 pages2 A Quoi Sert L Esprit D EntrepriseSkimoghj100% (1)
- Les Prix de Cession Interne PDFDocument19 pagesLes Prix de Cession Interne PDFkaidi chaimaa100% (1)
- Fiche 2-1 - Comment L'entreprise Produit-ElleDocument8 pagesFiche 2-1 - Comment L'entreprise Produit-ElleMme et Mr Lafon100% (2)
- Chapitre 1Document35 pagesChapitre 1Erica Meli FokouPas encore d'évaluation
- TDDocument20 pagesTDel khaiat mohamed aminePas encore d'évaluation
- La Production Dans L'Entreprise: Chapitre 2Document15 pagesLa Production Dans L'Entreprise: Chapitre 2RafanomezantsoaPas encore d'évaluation
- Les Agents ÉconomiquesDocument13 pagesLes Agents Économiquesanissafmohamed100% (1)
- Economie IndustrielleDocument130 pagesEconomie IndustrielleJoh100% (1)
- Marche Du Travail Emploi ChomageDocument65 pagesMarche Du Travail Emploi ChomageMedStrikePas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D'études Réalisé Par AKLI C Et ALIK LDocument125 pagesMémoire de Fin D'études Réalisé Par AKLI C Et ALIK LSamir BenakliPas encore d'évaluation
- Exposé D'histoire Des Entreprises ModernesDocument48 pagesExposé D'histoire Des Entreprises ModernesJean Marie MondjehiPas encore d'évaluation
- YoussoufDocument76 pagesYoussoufTidiane SogobaPas encore d'évaluation
- Gandhi Unto This LastDocument62 pagesGandhi Unto This LastRoger MoukondjouPas encore d'évaluation
- Analyse de KaldorDocument11 pagesAnalyse de KaldorKushinadaPas encore d'évaluation
- Cours D'entrepriseDocument22 pagesCours D'entreprisekokoPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document18 pagesChapitre 1Jean Hidler MichelPas encore d'évaluation