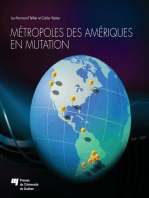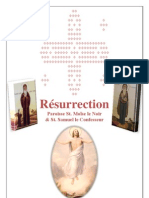Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Musique Ecclesiastique Byzantine
La Musique Ecclesiastique Byzantine
Transféré par
profurCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Musique Ecclesiastique Byzantine
La Musique Ecclesiastique Byzantine
Transféré par
profurDroits d'auteur :
Formats disponibles
Abr g de Thor i e et de Pr at i que Abr g de Thor i e et de Pr at i que Abr g de Thor i e et de Pr at i que Abr g de Thor i e et de Pr at i que
de l a de l a de l a de l a
MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE
BYZANTINE BYZANTINE BYZANTINE BYZANTINE
ECCLSIASTIQUE ECCLSIASTIQUE ECCLSIASTIQUE ECCLSIASTIQUE
p a r p a r p a r p a r Z ZZ Za c h a r a s a c h a r a s a c h a r a s a c h a r a s PASCHAL DS PASCHAL DS PASCHAL DS PASCHAL DS
Premier chantre de la cathdrale de
St. Grgoire Palamas Thessalonique
dition de 1985 prsente en franais par son disciple,
Andra ATLANTI Andra ATLANTI Andra ATLANTI Andra ATLANTI
Premire Partie
Premire dition, 2004.
D d i c a c e D d i c a c e D d i c a c e D d i c a c e
A tous les matres de la Musique Byzantine Ecclsiastique qui ont sauvegard
et qui nous ont transmis ce trsor prcieux de lglise Orthodoxe de lOrient.
Je chanterai mon Dieu tant que je serai .
Psaume 103, v. 33
T a b l e d e s M a t i r e s T a b l e d e s M a t i r e s T a b l e d e s M a t i r e s T a b l e d e s M a t i r e s
1. 1. 1. 1. Luvre du chantre Luvre du chantre Luvre du chantre Luvre du chantre 1 11 1
2. 2. 2. 2. Rgles lmentaires des obligations et du comportement du chantre Rgles lmentaires des obligations et du comportement du chantre Rgles lmentaires des obligations et du comportement du chantre Rgles lmentaires des obligations et du comportement du chantre ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 2 22 2
3. 3. 3. 3. Histoire abrge de la musique de la Grce antique et de la musique byzantine Histoire abrge de la musique de la Grce antique et de la musique byzantine Histoire abrge de la musique de la Grce antique et de la musique byzantine Histoire abrge de la musique de la Grce antique et de la musique byzantine ____________ ____________ ____________ ____________ 4 44 4
4. 4. 4. 4. La Musique Ecclsiastique Byzantine La Musique Ecclsiastique Byzantine La Musique Ecclsiastique Byzantine La Musique Ecclsiastique Byzantine ________________________________ ________________________________ ________________________________ ___________________________________________ ___________ ___________ ___________ 11 11 11 11
5. 5. 5. 5. Les notes Les notes Les notes Les notes ( ( ( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ ______________________________________________ ______________ ______________ ______________ 11 11 11 11
6. 6. 6. 6. Le temps Le temps Le temps Le temps ( ( ( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________________________ _______________ _______________ _______________ 12 12 12 12
7. 7. 7. 7. Le rythme Le rythme Le rythme Le rythme ( (( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________________________ _______________ _______________ _______________ 13 13 13 13
Le rythme de la musique de la Grce antique Le rythme de la musique de la Grce antique Le rythme de la musique de la Grce antique Le rythme de la musique de la Grce antique ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________13 13 13 13
Reprsentation symbolique des rythmes Reprsentation symbolique des rythmes Reprsentation symbolique des rythmes Reprsentation symbolique des rythmes ________________________________ ________________________________ ________________________________ ____________________________________________________ ____________________ ____________________ ____________________15 15 15 15
8. 8. 8. 8. La gamme La gamme La gamme La gamme ( ( ( ( ) ) ) ) ou diapason [avec tous les sons] ou diapason [avec tous les sons] ou diapason [avec tous les sons] ou diapason [avec tous les sons] _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ 16 16 16 16
9. 9. 9. 9. L'expression L'expression L'expression L'expression ( (( ( ) ) ) )________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________________________ _______________ _______________ _______________ 17 17 17 17
10. 10. 10. 10. Les tmoins Les tmoins Les tmoins Les tmoins ( ( ( ( ou martyries) ou martyries) ou martyries) ou martyries)________________________________ ________________________________ ________________________________ ____________________________________ ____ ____ ____ 17 17 17 17
La gamme diatonique naturelle ( la base de La gamme diatonique naturelle ( la base de La gamme diatonique naturelle ( la base de La gamme diatonique naturelle ( la base de ________________________________ ________________________________ ________________________________ _____________________________________________ _____________ _____________ _____________18 18 18 18
11. 11. 11. 11. Le double diapason (deux gammes conscutives) Le double diapason (deux gammes conscutives) Le double diapason (deux gammes conscutives) Le double diapason (deux gammes conscutives) ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________________________ __ __ __ 18 18 18 18
LA GAMME DE DOUBLE DIAPASON (deux gammes huit notes LA GAMME DE DOUBLE DIAPASON (deux gammes huit notes LA GAMME DE DOUBLE DIAPASON (deux gammes huit notes LA GAMME DE DOUBLE DIAPASON (deux gammes huit notes conscutives) conscutives) conscutives) conscutives) __________________ __________________ __________________ __________________20 20 20 20
12. 12. 12. 12. La smeiographie du Chant Byzantin La smeiographie du Chant Byzantin La smeiographie du Chant Byzantin La smeiographie du Chant Byzantin________________________________ ________________________________ ________________________________ ___________________________________________ ___________ ___________ ___________ 21 21 21 21
13. 13. 13. 13. Les signes qualitatifs Les signes qualitatifs Les signes qualitatifs Les signes qualitatifs 21 21 21 21
Signe pour rester la MME HAUTEUR ( Signe pour rester la MME HAUTEUR ( Signe pour rester la MME HAUTEUR ( Signe pour rester la MME HAUTEUR ( Tautophonie) Tautophonie) Tautophonie) Tautophonie) ________________________ ________________________ ________________________ ________________________21 21 21 21
Signes pour la MONTE ( Signes pour la MONTE ( Signes pour la MONTE ( Signes pour la MONTE ( ) ) ) )________________________________ ________________________________ ________________________________ ____________________________________________ ____________ ____________ ____________22 22 22 22
Signes pour la DESCEN Signes pour la DESCEN Signes pour la DESCEN Signes pour la DESCENTE TE TE TE ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________________________________ __________ __________ __________23 23 23 23
14. 14. 14. 14. Nomenclature des neumes Nomenclature des neumes Nomenclature des neumes Nomenclature des neumes 23 23 23 23
15. 15. 15. 15. La combinaison des signes quantitatifs et qualitatifs La combinaison des signes quantitatifs et qualitatifs La combinaison des signes quantitatifs et qualitatifs La combinaison des signes quantitatifs et qualitatifs ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 25 25 25 25
La monte discontinue (en saut) La monte discontinue (en saut) La monte discontinue (en saut) La monte discontinue (en saut) ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________25 25 25 25
La descente par saut La descente par saut La descente par saut La descente par saut ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________ ________________________________ ___________________________________ ___ ___ ___28 28 28 28
16. 16. 16. 16. Les signes temporels ( Les signes temporels ( Les signes temporels ( Les signes temporels ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _________________________________________ _________ _________ _________ 30 30 30 30
17. 17. 17. 17. Les signes qui rallongent le temps Les signes qui rallongent le temps Les signes qui rallongent le temps Les signes qui rallongent le temps ________________________________ ________________________________ ________________________________ ______________________________________________ ______________ ______________ ______________ 30 30 30 30
18. 18. 18. 18. Les signes qui divisent le temps Les signes qui divisent le temps Les signes qui divisent le temps Les signes qui divisent le temps 32 32 32 32
19. 19. 19. 19. Les signes qui la fois divisent et puis rallongent le temps Les signes qui la fois divisent et puis rallongent le temps Les signes qui la fois divisent et puis rallongent le temps Les signes qui la fois divisent et puis rallongent le temps____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 33 33 33 33
20. 20. 20. 20. La division ingale du temps La division ingale du temps La division ingale du temps La division ingale du temps 34 34 34 34
Ghorghn et dghorghon ponctu (avec point) Ghorghn et dghorghon ponctu (avec point) Ghorghn et dghorghon ponctu (avec point) Ghorghn et dghorghon ponctu (avec point) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________________________ _______________ _______________ _______________34 34 34 34
21. 21. 21. 21. Llaphrn continu Llaphrn continu Llaphrn continu Llaphrn continu ( ( ( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________________ _______ _______ _______ 35 35 35 35
22. 22. 22. 22. Les signes expressifs Les signes expressifs Les signes expressifs Les signes expressifs ( ( ( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ ______________________________________ ______ ______ ______ 35 35 35 35
23. 23. 23. 23.Les signes daltration Les signes daltration Les signes daltration Les signes daltration 37 37 37 37
24. 24. 24. 24. Les mutateurs Les mutateurs Les mutateurs Les mutateurs ( ( ( ( ) )) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ ___________________________________________ ___________ ___________ ___________ 38 38 38 38
25. 25. 25. 25. Les Colorateurs Les Colorateurs Les Colorateurs Les Colorateurs ( ( ( ( ) ) ) ) 40 40 40 40
Le Joug Le Joug Le Joug Le Joug ( ( ( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________41 41 41 41
Le Dclinateur Le Dclinateur Le Dclinateur Le Dclinateur ( ( ( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________41 41 41 41
Le Sabre Le Sabre Le Sabre Le Sabre () () () () ________________________________ ________________________________ ________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________42 42 42 42
26. 26. 26. 26. Classification des Mlodies ( Classification des Mlodies ( Classification des Mlodies ( Classification des Mlodies ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________________ _______ _______ _______ 42 42 42 42
27 27 27 27- -- -9 LES GENRES 9 LES GENRES 9 LES GENRES 9 LES GENRES ( ( ( ( ) ) ) ) 43 43 43 43
Le genre diatonique Le genre diatonique Le genre diatonique Le genre diatonique________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________ ________________________________ ____________________________________ ____ ____ ____44 44 44 44
Le genre ch Le genre ch Le genre ch Le genre chromatique romatique romatique romatique ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________________________ __ __ __44 44 44 44
Le genre enharmonique Le genre enharmonique Le genre enharmonique Le genre enharmonique ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________45 45 45 45
La particularit de la gamme diatonique du mode grave La particularit de la gamme diatonique du mode grave La particularit de la gamme diatonique du mode grave La particularit de la gamme diatonique du mode grave________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________________ ________ ________ ________46 46 46 46
30 30 30 30. Les Modes Les Modes Les Modes Les Modes ( (( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________________________ _______________ _______________ _______________ 46 46 46 46
31. 31. 31. 31. Mode Premier Mode Premier Mode Premier Mode Premier ( (( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________________________________ __________ __________ __________ 48 48 48 48
32. 32. 32. 32.Mode Deuxime Mode Deuxime Mode Deuxime Mode Deuxime ( (( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _____________________________________________ _____________ _____________ _____________ 49 49 49 49
33. 33. 33. 33. Mode Troisime Mode Troisime Mode Troisime Mode Troisime ( (( ( ) ) ) )________________________________ ________________________________ ________________________________ ____________________________________________ ____________ ____________ ____________ 50 50 50 50
34. 34. 34. 34. Mode Quatrime Mode Quatrime Mode Quatrime Mode Quatrime ( (( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _________________________________________ _________ _________ _________ 51 51 51 51
35. 35. 35. 35. Mode plagal du Premier Mode plagal du Premier Mode plagal du Premier Mode plagal du Premier ( (( ( ) ) ) )__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ 53 53 53 53
36. Mode plagal du Deuxime 36. Mode plagal du Deuxime 36. Mode plagal du Deuxime 36. Mode plagal du Deuxime ( (( ( ) ) ) ) _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ 55 55 55 55
37. 37. 37. 37. Mode Grave Mode Grave Mode Grave Mode Grave ( (( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ ____________________________________________ ____________ ____________ ____________ 56 56 56 56
38. 38. 38. 38. Mode plagal du Quatrime Mode plagal du Quatrime Mode plagal du Quatrime Mode plagal du Quatrime ( (( ( ) ) ) ) _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 58 58 58 58
39. 39. 39. 39. Les Allures de Tempo Les Allures de Tempo Les Allures de Tempo Les Allures de Tempo ( ( ( ( ) )) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ ____________________________________ ____ ____ ____ 59 59 59 59
40. 40. 40. 40. Mthodes de Lecture Mthodes de Lecture Mthodes de Lecture Mthodes de Lecture ( ( ( ( ) ) ) ) _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ 59 59 59 59
41. 41. 41. 41. Mlodies Empruntes Mlodies Empruntes Mlodies Empruntes Mlodies Empruntes ( (( ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________________________ __ __ __ 60 60 60 60
42. 42. 42. 42. Les Sytmes Les Sytmes Les Sytmes Les Sytmes () () () () ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________________________________ __________ __________ __________ 60 60 60 60
Le systme d'octave Le systme d'octave Le systme d'octave Le systme d'octave________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________ ________________________________ ____________________________________ ____ ____ ____61 61 61 61
Le systme de pentacorde Le systme de pentacorde Le systme de pentacorde Le systme de pentacorde ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________61 61 61 61
Le systme de ttracord Le systme de ttracord Le systme de ttracord Le systme de ttracorde ee e________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________62 62 62 62
43. 43. 43. 43. Les Modulations Les Modulations Les Modulations Les Modulations ( ( ( ( ) )) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _________________________________________ _________ _________ _________ 63 63 63 63
Les modulations par ton ( Les modulations par ton ( Les modulations par ton ( Les modulations par ton ( ) ) ) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ ___________________________________________ ___________ ___________ ___________63 63 63 63
Les modulations par genre ( Les modulations par genre ( Les modulations par genre ( Les modulations par genre ( ) ) ) )________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________________________________ __________ __________ __________63 63 63 63
Les modulation par dplacement ( Les modulation par dplacement ( Les modulation par dplacement ( Les modulation par dplacement ( ) )) ) ________________________________ ________________________________ ________________________________ _____________________________________________ _____________ _____________ _____________64 64 64 64
44. 44. 44. 44. Annexes Annexes Annexes Annexes 65 65 65 65
1
1 . 1 . 1 . 1 . L u v r e du c h a n t r e L u v r e du c h a n t r e L u v r e du c h a n t r e L u v r e du c h a n t r e
1. Le chantre est un clerc situ au premier degr de la hirarchie ecclsiastique.
Il accomplit un travail liturgique, une uvre sacre, et ceci n'est pas comparable
une profession exerce dans le monde.
2. Par son chant, le chantre reprsente les fidles et il tient de ce fait, parmi eux,
une place particulire dans l'glise. Mis part ses dons (sa voix mlodieuse, sa
connaissance musicale et son style personnel), le chantre doit tre aussi un
homme de prire et de foi. Le but de la psalmodie ne consiste pas faire
prouver aux fidles une jouissance esthtique mais avant tout de les lever
spirituellement.
3. Le chantre est le dpositaire de la musique ecclsiastique byzantine qu'il
transmet de gnration en gnration. Un tel hritage de nos pres constitue la
grandeur de l'glise orthodoxe grecque, il appartient aussi la tradition sacre de
l'glise.
La succession des chantres au pupitre sacr se fait de gnration en
gnration.
2
2 . 2 . 2 . 2 . R g l e s l me n t a i r e s d e s o b l i g a t i o n s e t d u R g l e s l me n t a i r e s d e s o b l i g a t i o n s e t d u R g l e s l me n t a i r e s d e s o b l i g a t i o n s e t d u R g l e s l me n t a i r e s d e s o b l i g a t i o n s e t d u
c o mp o r t e me n t du c h a n t r e c o mp o r t e me n t du c h a n t r e c o mp o r t e me n t du c h a n t r e c o mp o r t e me n t du c h a n t r e
1. Pour rpondre pleinement ses devoirs et ses obligations, le chantre doit
garder en son esprit une ligne de conduite prcise.
2. Sa tenue au pupitre doit tre srieuse, sans mouvements superflus, sans
grimaces ni gesticulations des mains. Il est en effet vu de tous les fidles et ne doit
pas dtourner leur attention de la prire. Il doit rester debout, la tte immobile,
le buste droit et ne pas ouvrir la bouche d'une faon exagre. Afin de ne pas
altrer le timbre des voyelles, la bouche doit s'ouvrir en forme d'ellipse et non pas
en rond. Il s'agit d'obtenir une prononciation claire et prcise et d'viter que les
sons soient touffs au fond du larynx.
3. La respiration doit se faire librement par la bouche et non par le nez et se
produire la fin des mots et non en leur milieu en vitant ainsi de les couper et
d'en altrer le sens. Cependant, dans les chants de style orn et lent (Hymnes des
Chrubins, chants de communion etc.), o les mots peuvent tre mis sur une
trs longue dure, la respiration devra se faire en leur milieu, les dcoupant
mme en plusieurs fois.
4. On dit que celui qui connat la technique de la respiration, il sait aussi chanter.
5. L'intensit de la voix ne doit pas tre uniforme sur toutes les syllabes ; les
syllabes accentues seront produites plus fortement que les syllabes atones afin
que, le mieux possible, soit mis en relief le sens du texte.
6. Pour l'interprtation de chaque mlodie, la hauteur de la voix doit
correspondre la tessiture du chantre. Si la hauteur est trop haute, la voix n'est
plus naturelle, le chantre tant oblig de forcer son larynx, et ceci produit des
effets disgracieux.
7. Il est du devoir du chantre de ne pratiquer que les chants classiques de la
musique byzantine sans y ajouter aucune modification car ceux-ci sont le fruit
d'un long travail li une profonde exprience des compositeurs de la grande
tradition.
3
8. Le chantre veillera tudier continuellement afin de toujours s'amliorer.
Avant tout office liturgique, il devra se prparer l'avance pour remplir sa
fonction au mieux.
9. Il s'efforcera par ailleurs d'tre un exemple pour tous, par ses murs et sa
conduite. Il sera dcent, modeste et consciencieux et il aura avant tout un
comportement chrtien. Pendant l'accomplissement de sa fonction l'glise, il ne
doit pas s'agiter mais tre dvou sa tche, participer la prire et ne pas
chercher donner une dmonstration de ses possibilits vocales.
10. Appliqu ce qu'il fait, le chantre chantera avec amour et ne donnera jamais
l'impression d'accomplir une corve.
11. Il respectera les prtres et estimera ses confrres mme si ceux-ci ont des
connaissances et des possibilits infrieures aux siennes. Il est d'ailleurs reconnu
que les attitudes envers les autres refltent principalement la personnalit de celui
qui les engendre plus qu'elles ne mettent en cause ceux envers lesquels elles sont
adresses.
12. Le chantre sera attentif ne pas faire un mauvais usage de sa voix. Pour la
conserver, il vitera les boissons alcoolises, ne fumera pas ni ne veillera tard la
nuit toutes choses qui sont nfastes pour la performances vocale.
13. C'est sans effort et d'une faon naturelle que la voix doit sortir de la bouche (et
non pas du nez). C'est une trs grande erreur de penser qu'il faut chanter du nez
pour chanter byzantin. Ceux qui chantent ainsi font non seulement du tort la
musique byzantine mais aussi eux-mmes.
4
3 . 3 . 3 . 3 . Hi s t o i r e a b r g e d e l a mu s i q ue de l a Gr c e Hi s t o i r e a b r g e d e l a mu s i q ue de l a Gr c e Hi s t o i r e a b r g e d e l a mu s i q ue de l a Gr c e Hi s t o i r e a b r g e d e l a mu s i q ue de l a Gr c e
a n t i qu e e t de l a mu s i q ue by z a n t i ne a n t i qu e e t de l a mu s i q ue by z a n t i ne a n t i qu e e t de l a mu s i q ue by z a n t i ne a n t i qu e e t de l a mu s i q ue by z a n t i ne
Ds l'antiquit grecque, de grands philosophes, mathmaticiens et potes ont
consacr une large part de leur activit l'tude de la musique. Voici les plus
importants d'entre eux :
Terpandros de Lesbos Terpandros de Lesbos Terpandros de Lesbos Terpandros de Lesbos (7
me
s. av. J.-C.), pote et musicien. C'est lui qui a form la
gamme sept intervalles conscutives en utilisant les lettres de l'alphabet (, , , , ,
, ). Cette gamme compose de deux ttracordes inscables (joints) est appele
gamme heptaphonique ttracordes joints. Pour les sons de chacun des deux
ttracordes, il a employ des mots monosyllabiques : (T), (Ta), (Ti),
(To)
Pythagore de Samos Pythagore de Samos Pythagore de Samos Pythagore de Samos (5
me
s. av. J.-C.). Philosophe et musicien, il a ajout, la gamme de
7 sons, un 8
me
son avec la lettre . Il a form, avec ces huit lettres ( - ),
une gamme huit sons, spare en deux ttracordes disjoints (cest dire, spars par
un intervalle supplmentaire dun ton, ajout entre les deux ttracordes). Ces
ttracordes sont spars au niveau de la lettre , celle-ci tant la base du deuxime
ttracorde.
5
Nous devons Pythagore d'avoir dcouvert la diffrence mathmatique des
intervalles musicaux. Un vnement fortuit est au dpart d'une telle dcouverte : en
passant un jour devant un atelier de forgerons, Pythagore a eu l'ide de dfinir les
intervalles musicaux partir des sons qui provenaient des frappes de ces derniers.
Aristoxne de Tarante Aristoxne de Tarante Aristoxne de Tarante Aristoxne de Tarante, (4
me
sicle av. J.-C.). Philosophe et musicien, a crit beaucoup de
livres sur l'histoire et la thorie de la musique grecque. De toutes ses uvres, ne sont
rests que quatre livres. Trois d'entre eux constituent Les lments de l'Harmonie ;
ils furent traduits en allemand en 1868. Le quatrime livre, Les lments du
Rythme , fut traduit Venise en 1685.
Euclide Euclide Euclide Euclide, (3
me
sicle av. J.-C.). Mathmaticien et musicien, il a crit sur la thorie
scientifique et sur l'histoire de la musique grecque. Lui aussi a utilis les lettres de
l'alphabet grec pour noter la quantit des sons. Ses uvres sont conserves dans le
Recueil de Musique Grecque de Marc Mevmios.
De grands philosophes comme Platon Platon Platon Platon (347 av. J.-C.), Aristote Aristote Aristote Aristote (321 av. J.-C.), etc. ont
aussi crit sur la musique de la Grce antique.
L'histoire de la Musique Ecclsiastique Byzantine commence ds la fondation
de l'glise du Christ.
Au cours des trois premiers sicles aprs J.-C. , de nombreux crivains ont
trait de la Musique Ecclsiastique. Citons :
Plutarque Plutarque Plutarque Plutarque (50 ap. J.-C.). Philosophe et historien, il s'est intress la musique grecque
d'un point de vue thique et philosophique. Il est l'auteur du clbre Dialogue qui
s'est droul dans la maison de son matre, Onsicrate.
Ignace le Thophore Ignace le Thophore Ignace le Thophore Ignace le Thophore (103 ap. J.-C.), vque d'Antioche. Il a crit beaucoup d'hymnes
ecclsiastiques, entre autres les Antiennes : Par les prires de la Mre de Dieu ,
Sauve-nous, Fils de Dieu , etc.
6
Justin le Philosophe et Martyr Justin le Philosophe et Martyr Justin le Philosophe et Martyr Justin le Philosophe et Martyr (105 ap. J.-C.), a crit Le Chantre , livre qui
malheureusement n'existe plus et qui donnait des instructions sur ce qu'il fallait chanter
et la manire de le faire, lors des rassemblements liturgiques.
Clm Clm Clm Clment d'Alexandrie ent d'Alexandrie ent d'Alexandrie ent d'Alexandrie (254 ap. J.-C.), auteur de trois livres rassembls sous le titre : Le
Pdagogue , ainsi que d'autres ouvrages.
Origne le Grand Origne le Grand Origne le Grand Origne le Grand (254 ap. J.-C.), disciple de Clment d'Alexandrie, a aussi crit beaucoup
d'ouvrages dont trs peu sont parvenus jusqu' nos jours.
Aprs le 3
me
sicle, c'est--dire aprs le triomphe du Christianisme, la plupart
des hymnographes furent aussi compositeurs de mlodies
1
. Voici les plus
importants d'entre eux :
Athanase le Grand Athanase le Grand Athanase le Grand Athanase le Grand (296 ap. J.-C.), crivain et compositeur, traite dans son ouvrage Sur
les Psaumes Marcel , du rle de la psalmodie dans l'accomplissement des devoirs du
chrtien. Il a aussi beaucoup lutt contre les hrtiques.
phrem le Syrien phrem le Syrien phrem le Syrien phrem le Syrien, (306 ap. J.-C.). Parlant plusieurs langues, dont le syriaque, le grec et le
latin, il a enrichi l'glise d'un grand nombre d'hymnes dont la prire des Grandes
Complies : Vierge sans tche
Basile le Grand Basile le Grand Basile le Grand Basile le Grand, (329 ap. J.-C.), vque de Csare, auteur de nombreuses prires de
l'glise. On lui doit aussi la Divine Liturgie qui porte son nom et que l'on chante dix
fois par an.
Jean Bouche d'Or (Chrysostome) Jean Bouche d'Or (Chrysostome) Jean Bouche d'Or (Chrysostome) Jean Bouche d'Or (Chrysostome) (345 ap. J.-C.), Patriarche de Constantinople, a rdig
beaucoup d'hymnes ecclsiastiques. Il est l'auteur de la Divine Liturgie qui porte son
nom et que l'on chante toujours dans nos glises.
Ambroise vque de Milan Ambroise vque de Milan Ambroise vque de Milan Ambroise vque de Milan, (340 ap. J.-C.). Connaissant bien l'criture de la musique de
la Grce antique, il a remplac les monosyllabes employes par les mots
monosyllabiques suivants : , - --- pour la monte et ,
- --- pour la descente, ce qui signifient : N, monte ainsi et
N, et descend ainsi
Il a aussi dnomm 1
er
, 2
me
, 3
me
et 4
me
mode, les quatre modes antiques, dorien, lydien,
phrygien et mixolydien.
Ambroise est juste titre considr comme le fondateur de la musique ecclsiastique
byzantine de lOccident.
Grgoire, Pape de Rome Grgoire, Pape de Rome Grgoire, Pape de Rome Grgoire, Pape de Rome (540 ap. J.-C.), a dnomm les quatre autres modes de la
musique grecque, hypodorien, hypolydien, hypophrygien et hypomixolidien, en
plagal 1
er
, plagal 2
me
, plagal 3
me
ou mode grave et plagal 4
me
.
1
NDLR NDLR NDLR NDLR Mlodes
7
Sous le rgne de l'empereur byzantin Justinien Justinien Justinien Justinien (527-565 ap. J.-C.), s'ouvre une nouvelle
tape dans l'histoire de la musique ecclsiastique byzantine qui a connu cette poque
une floraison incomparable et est arrive au fate de sa gloire. L'empereur lui-mme a
crit des mlodies liturgiques et s'est proccup de l'organisation des offices liturgiques.
L'glise de Sainte Sophie
2
avait 25 chantres et 100 lecteurs de grande formation
musicale.
Romain le Mlode Romain le Mlode Romain le Mlode Romain le Mlode (6
me
sicle ap. J.-C.), est considr comme le plus grand hymnographe
de l'glise. Il a crit plus de 100 Kondkion. Une nuit de Nol, il a reu la grce
d'crire des hymnes aprs avoir vu en rve la Toute-Sainte
3
lui donner manger un
rouleau de papier (kndos-kondakio). Ds son rveil, il s'est mis chanter ds l'ambn
La Vierge aujourd'hui . Parmi les plus beaux hymnes qu'il a donn la musique
byzantine se trouvent les kondakion suivants : La Vierge aujourd'hui (fte de la
Nativit), Aujourd'hui tu t'es manifest (fte de la Thophanie), La Mre de Dieu
intercdant sans relche , Recherchant les choses d'en haut , etc.
Jean de Damas (Damascne) Jean de Damas (Damascne) Jean de Damas (Damascne) Jean de Damas (Damascne) (676-756 ap. J.-C.). Philosophe, hymnographe et
compositeur de musique, il fait partie des plus grandes figures de la musique byzantine.
Son uvre majeure est l Octoque qui est la codification des mlodies liturgiques de
toute l'anne. Il a crit plus de 60 canons dont le canon de Pques Jour de la
Rsurrection , le canon de la Mre de Dieu J'ouvrirai la bouche , le canon de la
Nativit Il a sauv les peuples , etc. On lui doit galement des uvres thoriques sur
la formation des modes et leurs relations avec les modes de la musique de la Grce
Antique. On attribue encore Jean Damascne les Grands Kkragrion Ayant
apprit lordre divin secret , Voici l'poux , Quand les glorieux disciples ,
Gotez et voyez , Maintenant les puissances clestes , Hymnes des Chrubins
4
,
Hymnes de Communion, etc.
Lon le Sage, Empereur Lon le Sage, Empereur Lon le Sage, Empereur Lon le Sage, Empereur, (9
me
sicle ap. J.-C.), hymnographe et compositeur, a crit les
11 Tropaires Dominicaux de Glorificat (othinon), le Venez, peuple,
prosternons-nous devant la Divinit en trois Personnes , etc.
Jean Koukouzlis Jean Koukouzlis Jean Koukouzlis Jean Koukouzlis (12
me
sicle ap. J.-C.), hymnographe, compositeur et thoricien, il fut le
premier chantre du palais et matre de tous les chantres de l'empereur. Ses disciples
taient appels Mlurges ou Mastors. Mais il a trs vite quitt tous ces honneurs et
est all la Sainte Montagne, au monastre de la Grande Lavra o il est devenu moine.
Jean Koukouzlis a renouvel et rehauss la technique de Jean Damascne et l'a
transmise aux dpositaires de la tradition de l'glise, les moines de la Sainte Montagne.
Il a crit une Thorie de la musique , le Grand ISSON du style
2
NDLR NDLR NDLR NDLR : (Divine Sagesse), cest dire (Sagesse de Dieu).
3
NDLR NDLR NDLR NDLR c..d. la Thotokos
4
NDLR NDLR NDLR NDLR Hymnes des Chrubins = Hymne chante lors de la Grande Entre = dit
= Chrubikn
8
mlismatique , etc. Il a compos des Anoixandaria, des Chrubikn,
- Multi ani pour les vques, Les prophtes tont pr-annonc den haut etc.
Aprs le 12
me
sicle, se sont succds beaucoup de matres de la musique
byzantine. Les plus importants d'entre eux sont les suivants :
Jean Klads Jean Klads Jean Klads Jean Klads (15
me
sicle), lampadarios
5
de Sainte Sophie, il a mis en musique l'hymne
Acathiste, des Anoixandaria, des Chrubikn, des Hymnes de Communion, dont le
Gotez et voyez etc.
Balsios le Prtre Balsios le Prtre Balsios le Prtre Balsios le Prtre (16
me
sicle), nomophylax
6
de la Grande glise du Christ, il a mis en
musique des Catavasias, des Polylos, des Laudes, des Hymnes de Communion, etc.
Ptros le Doux, Brktis Ptros le Doux, Brktis Ptros le Doux, Brktis Ptros le Doux, Brktis (18
me
sicle). Il a compos le Thotok Parthn
Ave Maria) pour deux churs, des Grandes Doxologies, des Polylos, des Laudes,
des Hymnes de Communion, etc.
Ptros de Ploponnse Ptros de Ploponnse Ptros de Ploponnse Ptros de Ploponnse, ou le Ploponnsien (18
me
sicle), lampadarios de la Grande
glise du Christ, connaisseur de la musique grecque et de la musique arabo-persique, il
a invent une criture qui simplifia la smeiographies de Koukouzlis. Il a aussi
compos des Anoixandria, des Laudes, des Hymnes de Communion, deux
Anastasimatrion, le Tropaire de Cassia la moniale Seigneur, la femme tombe en de
nombreux pchs , des Grandes Doxologies, des Polylos, des Heirms
Kalliphoniques, etc.
ses dbuts, l'criture de l'glise tait base sur l'alphabet des anciens Grecs
comme l'a confirm la dcouverte rcente en gypte de l'Hymne grec de la
Sainte Trinit par Arthur Hunt, professeur Oxford. Sa publication se trouve au
14
me
volume de Papyrus d'Oxyrynx.
Jusqu'au 18
me
sicle, la smeiographie
7
de la musique byzantine est passe par
des tapes multiples (signes stnographiques, en forme de crochets et signes
symboliques) avant sa simplification finale.
Sa forme actuelle est le fruit du travail des trois grands matres de musique que
furent Chrsanthos Chrsanthos Chrsanthos Chrsanthos, Mtropolite de Prusse, Grgoire Grgoire Grgoire Grgoire le Protochantre et
Hourmozios Hourmozios Hourmozios Hourmozios le Hartophlax. C'est au Mtropolite Chrsanthos que nous
devons le nom des sept sons, , , , , K, , . Dans son ouvrage,
5
NDLR NDLR NDLR NDLR : 1
er
chantre du chur de gauche.
6
NDLR NDLR NDLR NDLR : gardien de droit. Ceci ne fut quun parmi les sept (offkion) ou grades de
distinction de ce prtre trs talentueux,
7
NDLR NDLR NDLR NDLR : criture des signes
9
La Grande Thorie , crit en 1832, il a dfini avec une exactitude scientifique
les gammes et les intervalles de la musique byzantine.
Le systme ainsi instaur par ces trois grands matres de musique a t ratifi
par le Patriarchat en 1881 et est toujours en usage de nos jours.
Depuis le 19
me
sicle, nombreux sont ceux qui ont consacr leur vie la
musique byzantine. Les plus importants d'entre eux sont les suivants :
PARSCHOU PARSCHOU PARSCHOU PARSCHOU Thodore de Phka, dit Phokae Thodore de Phka, dit Phokae Thodore de Phka, dit Phokae Thodore de Phka, dit Phokaevs vs vs vs, musicien renomm, disciple des trois
matres de musique de la Nouvelle Mthode, il a crit un trs grand nombre de livres.
VIOLKIS VIOLKIS VIOLKIS VIOLKIS Georges Georges Georges Georges, premier chantre de la Grande glise du Christ, il a t professeur de
musique l'cole de Thologie de Halki.
CHRYSPHIS CHRYSPHIS CHRYSPHIS CHRYSPHIS Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel, lampadarios de la Grande glise du Christ.
GHORGIADIS GHORGIADIS GHORGIADIS GHORGIADIS Thodose Thodose Thodose Thodose, premier chantre et matre de musique. Nous lui devons une
Thorie de la musique.
K KK KAMARDOS AMARDOS AMARDOS AMARDOS Nil, Nil, Nil, Nil, premier chantre et matre de musique.
BKIRIS BKIRIS BKIRIS BKIRIS Constantin Constantin Constantin Constantin, premier chantre et matre de musique.
RIGHPOULOS Stylians RIGHPOULOS Stylians RIGHPOULOS Stylians RIGHPOULOS Stylians, premier chantre, il a dit le Nouvel Anastasimatrion et
d'autres livres.
PSCHOS PSCHOS PSCHOS PSCHOS Constantin Constantin Constantin Constantin, excellent musicien et byzantinologue, il a crit la Thorie
Parasmantique de la musique byzantine et beaucoup dautres ouvrages sur la
musique ecclsiastique et populaire.
PRNGOS PRNGOS PRNGOS PRNGOS Constantin Constantin Constantin Constantin, premier chantre de la Grande glise du Christ, il est considr
comme l'un des plus grands protopsaltes ayant sauvegard le style patriarcal . Il a
dit la Nouvelle ruche musicale .
HATZIATHANASSOY HATZIATHANASSOY HATZIATHANASSOY HATZIATHANASSOY Michel Michel Michel Michel, premier chantre du saint monastre Stavropgiaque de
Baloukli de la Source Vivifiante . Il tait aussi matre de musique.
BALSIS BALSIS BALSIS BALSIS Jean Jean Jean Jean, premier chantre de l'glise Saint Nicolas de Galata (Constantinople), il
tait aussi un excellent compositeur de musique.
KHAGHIOGLOY KHAGHIOGLOY KHAGHIOGLOY KHAGHIOGLOY Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre, premier chantre de l'glise de la Sainte Trinit de Pras
(Constantinople) et matre de musique.
STANTSAS STANTSAS STANTSAS STANTSAS Thrasvoulos Thrasvoulos Thrasvoulos Thrasvoulos, premier chantre de la Grande glise du Christ, et excellent
compositeur de musique.
HATZITHODROY HATZITHODROY HATZITHODROY HATZITHODROY Thodore Thodore Thodore Thodore, professeur de musique byzantine au conservatoire grec
d'Athnes, il a dit la Mthode simple de la musique byzantine.
KARAMNIS KARAMNIS KARAMNIS KARAMNIS Athanase Athanase Athanase Athanase, premier chantre de l'glise mtropolitaine de Thessalonique.
Excellent matre de musique, il fut aussi mon professeur. Il a eu de trs nombreux
10
lves qui sont la gloire aujourd'hui de beaucoup d'glises dans toute la Grce. Son
uvre de sept tomes est riche et exquis.
PANAGHIOTDIS PANAGHIOTDIS PANAGHIOTDIS PANAGHIOTDIS Athanase Athanase Athanase Athanase, premier chantre et matre de musique.
EVTHYMIDIS EVTHYMIDIS EVTHYMIDIS EVTHYMIDIS Abraham Abraham Abraham Abraham, matre de musique et excellent thoricien de la musique
byzantine, il a dit Leons de musique byzantine et d'autres livres de musique.
TALIADROS TALIADROS TALIADROS TALIADROS Harlaos Harlaos Harlaos Harlaos, premier chantre de l'glise de Thessalonique, il a crit beaucoup
de livres de musique.
THODOSPOULOS THODOSPOULOS THODOSPOULOS THODOSPOULOS Chrsanthos Chrsanthos Chrsanthos Chrsanthos, premier chantre de l'glise du saint Patron de
Thessalonique, saint Dmtrios, il est l'auteur de nombreux livres de musique.
PRISTRIS PRISTRIS PRISTRIS PRISTRIS Spyrdon Spyrdon Spyrdon Spyrdon, premier chantre de l'glise mtropolitaine d'Athnes, il fut aussi
musicologue et ethnologue.
HATZIMRKOS HATZIMRKOS HATZIMRKOS HATZIMRKOS Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel, premier chantre de l'glise du saint protecteur d'Athnes,
saint Denis.
SRKAS SRKAS SRKAS SRKAS Antoine Antoine Antoine Antoine, premier chantre, matre de musique et auteur de livres de musique.
Il faut aussi citer TSATSARNIS TSATSARNIS TSATSARNIS TSATSARNIS Georges Georges Georges Georges, musicologue et matre de musique,
KOUTSOURDIS KOUTSOURDIS KOUTSOURDIS KOUTSOURDIS Christophe Christophe Christophe Christophe, MILARKIS MILARKIS MILARKIS MILARKIS Basile Basile Basile Basile, KARRS KARRS KARRS KARRS Simon Simon Simon Simon,
PANS PANS PANS PANS Constantin Constantin Constantin Constantin, BLOSIS BLOSIS BLOSIS BLOSIS Antoine Antoine Antoine Antoine et beaucoup d'autres qu'on ne peut nommer
par manque de place.
Ptros de Ploponnse. Un dessin de 1815 le reprsente dans le Codex de la
Grande Lavra . 178. Lampadrios de la Grande glise du Christ, il a simplifi la
smeiographie de Jean Koukouzlis.
11
4 . La Mu s i q u e Ec c l s i a s t i q u e By z a n t i n e 4 . La Mu s i q u e Ec c l s i a s t i q u e By z a n t i n e 4 . La Mu s i q u e Ec c l s i a s t i q u e By z a n t i n e 4 . La Mu s i q u e Ec c l s i a s t i q u e By z a n t i n e
La musique est un art sublime et la science du chant. C'est par elle que
l'homme peut exprimer les tats de son me : joie, tristesse, courage,
enthousiasme, etc.
On distingue la musique vocale (produite par les cordes vocales) de la musique
instrumentale (produite par des instruments de musique).
La musique ecclsiastique byzantine de l'glise orthodoxe d'Orient est
monophonique.
Les principaux lments utiliss dans le chant byzantin sont les suivants : notes,
gammes, expression, dure, rythme, tmoins, signes de note, signes de temps,
signes d'expression, signes d'altration, mutateurs (), genres ( :
diatonique, chromatique et enharmonique), colorateurs (), modes ( :
1
er
, 2
me
, 3
me
, 4
me
, plagal 1
er
, pl. 2
me
, pl. 3
me
ou mode grave et pl. 4
me
), types
de mlodie (heirmologique, stichrarique, papadique), mouvement temporel, et
systmes (d'octave, de pentacorde, de ttracorde).
5 . 5 . 5 . 5 . Le s n o t e s Le s n o t e s Le s n o t e s Le s n o t e s
( ( ( ( ) ) ) )
Les sons musicaux mis par l'homme ou par les divers instruments de musique
s'appellent des notes
8
. Chaque note est un pur son musical qui correspond une
hauteur dtermine (fixe).
8 NDLR NDLR NDLR NDLR : Nous traduirons , littralement consonne, par note , par son , ceci tant
lquivalent de lintervalle entre deux notes successives ; de x sons (ou notes) successives par
seconde, tierce, etc.; par ton , permettant ainsi de dcrire la grandeur dun intervalle entre deux
notes successives par comparaison un ton standard, cest dire une grandeur de rfrence dintervalle
entre deux notes successives; et par mode (et non pas ton), faisant allusion aussi linterprtation
modale (contextuelle) des intervalles.
12
Le son qui provient de mouvements vibratoires rguliers a une hauteur
dtermine tandis que le son qui provient de mouvements vibratoires irrguliers,
c'est--dire le bruit, n'a pas de hauteur dtermine : il consiste de variations
dhauteur multiples dans un temps donn.
En musique, la note est un son qui a une hauteur dtermine. Les notes qui
composent l'alphabet de la musique byzantine sont reprsentes par les sept
lettres de l'alphabet grec : , , , , , , (Alpha, Bta, Gamma, Delta,
Epsilon, Zta, ta). ces lettres se sont ajoutes une voyelle, une consonne ou
une diphtongue en position initiale ou finale. Par exemple l s'est ajout
un (Pi) pour crer la note , au s'est ajout le pour crer
la note (Vou) , au s'est ajout le pour crer la
note (Gha) , au s'est ajout le pour crer la note (Dhi) ,
au s'est ajout le pour crer la note (K) , au s'est ajout
le (Omga) pour crer la note (Zo) et l s'est ajout le
pour crer la note (Ni) . Avec les sept notes
9
, , , , , , ,
, se sont formes les gammes de la musique byzantine.
6 . 6 . 6 . 6 . Le t e mp s Le t e mp s Le t e mp s Le t e mp s
( ( ( ( ) ) ) )
En musique, le temps est la mesure de la dure des notes.
La dure de chaque note s'exprime en un mouvement de temps (temps
simple).
La rptition des mouvements de temps (temps simples) cre le rythme.
9
NDLR NDLR NDLR NDLR ; ;; ; Les correspondances en nom mais pas ncessairement en hauteur avec la musique occidentale sont
les suivantes : (R), (Mi), (Fa), (Sol), (La), (Si), (Do),
13
7 . Le r y t hme 7 . Le r y t hme 7 . Le r y t hme 7 . Le r y t hme
( (( ( ) ) ) )
En musique, le rythme est la division du temps en deux, trois ou plus de parties
gales et la rptition rgulire de cette division.
Le rythme peut tre simple ou compos.
Le rythme simple est le rythme binaire (Thsis
10
Arsis) qui est excut en
deux mouvements. Le rythme ternaire est excut en trois mouvements. Les
rythmes composs sont le rythme quatre temps (2 rythmes binaires) qui est
excut en quatre mouvements, le rythme cinq temps (binaire ternaire), le
rythme six temps (deux ternaires), etc. Les rythmes cinq temps, six temps ou
plus, ne sont pas utiliss dans la musique byzantine.
Quant au rythme simple, la Thsis est le temps fort et les autres temps sont des
temps faibles.
Les mesures du rythme sont spares par une ligne verticale qui s'appelle barre
de mesure. La premire mesure, quand elle n'est pas entire, s'appelle mesure
incomplte. La / (les) note(s) se trouvant dans une telle mesure s'excute(nt) sur
l'arsis car un silence est sous-entendu au dbut.
La musique byzantine fait usage dun rythme tonique. Dans le rythme
tonique, chaque syllabe accentue devient le dbut d'une nouvelle mesure,
c'est--dire que dans une mlodie de rythme binaire se trouvent des rythmes
ternaires et des rythmes de quatre temps selon l'accentuation tonique des mots.
Le r yt hme de l a mus i que de l a Gr ce ant i que Le r yt hme de l a mus i que de l a Gr ce ant i que Le r yt hme de l a mus i que de l a Gr ce ant i que Le r yt hme de l a mus i que de l a Gr ce ant i que
La musique de la Grce antique a utilis le rythme prosodique (le mot
prosodie signifie la distinction des syllabes en syllabes courte ou longue).
Ce rythme s'est form en suivant le mtre potique du texte. Un mouvement
de temps dans le mtre potique tait gal une syllabe courte ( = signe de
10
NDLR NDLR NDLR NDLR : :prise de position ; : leve
14
prosodie de la syllabe courte). Deux mouvements de temps taient gaux une
syllabe longue ( = signe de prosodie de la syllabe longue). C'est partir des
syllabes longues et courtes que se sont constitus les mtres potiques appels
pieds .
Ce nom vient de la danse : les danseurs excutaient en effet des mouvements
symtriques avec les pieds.
Les principaux mtres potiques sont :
Pyrrichios ou hghmon (rythme binaire) :
Pieds iambiques (rythmes ternaires)
Iambique
Troche
Tribrachique
Pieds dactyliques ( quatre temps)
Dactyle
Anapaiste
Sponde
Les pieds dans la musique byzantine et occidentale s'appellent mesure. Les
mesures dans la musique byzantine sont spares par une ligne verticale. Dans la
musique occidentale, elles sont signales par des nombres fractionnaires
- rythme binaire ( deux temps)
- rythme ternaire ( trois temps)
- rythme quaternaire ( quatre temps)
15
Repr s ent at i on s ymbol i que des r yt hmes Repr s ent at i on s ymbol i que des r yt hmes Repr s ent at i on s ymbol i que des r yt hmes Repr s ent at i on s ymbol i que des r yt hmes
rythme binaire
rythme ternaire
rythme quatre temps
16
8 . 8 . 8 . 8 . La g a mme o u d i a p a s o n La g a mme o u d i a p a s o n La g a mme o u d i a p a s o n La g a mme o u d i a p a s o n
( ( ( ( ) ) ) )
[ a v e c t o u s l e s s o n s ] [ a v e c t o u s l e s s o n s ] [ a v e c t o u s l e s s o n s ] [ a v e c t o u s l e s s o n s ]
11 11 11 11
On appelle chelle ou gamme, la monte ou la descente conscutive des huit
notes.
La gamme diatonique naturelle (ainsi dnomme car elle contient des
intervalles naturelles, classs ainsi : tons majeur, mineur, et minime) est constitue
de huit notes (la huitime note est la rptition de la premire produite une
octave plus haut), de deux ttracordes gaux, dun ton sparateur (dit
cest dire ton de sparation) entre les deux ttracordes et
de sept intervalles au total (do le nom heptaphonique = sept intervalles).
L'octave (systme huit notes et sept intervalles) est divise virtuellement en
72 parties gales (les [moria], pluriel du [morion]) que lon
dnommera units.
La premire note s'appelle la base et la huitime, le sommet.
La rptition de la mme note est appele unisson (tautophonie).
Les notes excutes dans l'ordre donnent la monte ou la descente conscutive.
Lorsque plusieurs notes intermdiaires sont sautes, nous obtenons la monte ou
la descente discontinue. Le ton est l'intervalle entre deux notes voisines.
Le ton compos de 12 units est le ton majeur,
celui compos de 10 units est le ton mineur,
et celui compos de 8 units est le ton minime.
12
Dans la musique byzantine, il existe, en plus de la gamme de diapason, la
gamme de double diapason (deux gammes conscutives).
11 Note Note Note Note : :: : Les (micro-intervalles) sont dfinis partir dun instrument spcialis appel monocorde.
Cet instrument est trs ancien et sa conception est attribue au sage Pythagore.
12
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : La musique occidentale ne fait usage que de deux types de tons (ton = 12 units et
demi-ton = 6 units). Comme on verra plus tard, il existe des tons supplmentaires en musique Byzantine,
ayant des valeurs de grandeur allant de 20 4 voire 2 units.
17
En dehors de la gamme diatonique appartenant au genre diatonique, il y a
d'autres gammes : la gamme chromatique appartenant au genre chromatique et
la gamme enharmonique appartenant au genre enharmonique. Ceci sera
envisag par la suite.
9 . 9 . 9 . 9 . L' e x p r e s s i o n L' e x p r e s s i o n L' e x p r e s s i o n L' e x p r e s s i o n
( (( ( ) ) ) )
En musique, l'expression est la faon dont chaque note est nonce.
1 0. 1 0. 1 0. 1 0. Le s t mo i n s Le s t mo i n s Le s t mo i n s Le s t mo i n s
( ( ( ( o u ma r t y r i e s ) o u ma r t y r i e s ) o u ma r t y r i e s ) o u ma r t y r i e s )
En musique byzantine, o la notation est linaire, les tmoins ()
13
sont des signes divers qui tmoignent de la hauteur de chaque note en fonction du
genre employ, ainsi que la hauteur de la note conclusive. Chaque tmoin est
donn par la premire lettre du nom de la note ainsi que d'un signe distinctif.
Les signes distinctifs de la gamme diatonique (tmoignant du genre diatonique)
sont au nombre de cinq :
Les tmoins de la gamme diatonique naturelle sont constitus de la lettre
initiale de la note au-dessus du signe distinctif du genre diatonique :
13
Note Note Note Note : :: : En ce qui concerne le quatre symboles qui se trouvent au dessous des
lettres initiales des notes, ils proviendraient des lettres initiales des anciens tropes grecs : (dorien)
(frygien) , (lydien) , (myxolydien) .
18
La gamme di at oni que nat ur el l e La gamme di at oni que nat ur el l e La gamme di at oni que nat ur el l e La gamme di at oni que nat ur el l e
( l a bas e de ( l a bas e de ( l a bas e de ( l a bas e de
1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . Le d o u bl e di a p a s o n Le d o u bl e di a p a s o n Le d o u bl e di a p a s o n Le d o u bl e di a p a s o n
( d e ux g a mme s c o n s c u t i v e s ) ( d e ux g a mme s c o n s c u t i v e s ) ( d e ux g a mme s c o n s c u t i v e s ) ( d e ux g a mme s c o n s c u t i v e s )
En chant byzantin, la gamme de huit notes ( - diapason ) peut
se prolonger par d'autres notes au-dessus du sommet ou en dessous de la base.
La gamme de double diapason est constitue partir de 15 notes, elle a
comme base le grave et comme sommet le aigu. Les deux notes graves ( ,
) appartiennent au registre grave ( - Hpat), les notes intermdiaires
(, , , , , , ) appartiennent au
19
registre moyen ( - Msis) et les notes aigus (, , , , , )
au registre aigu ( Nt)
14
.
Les tmoins de la gamme de double diapason se partagent en trois catgories :
Les tmoins du registre grave ( ), qui ont la lettre initiale de la note en
dessous du signe distinctif :
Les tmoins du registre moyen ( ), qui ont la lettre initiale de la
note au-dessus du signe distinctif :
Les tmoins du registre aigu ( ), qui eux aussi ont la lettre initiale de la
note au-dessus du signe distinctif, mais ils ont une apostrophe (ou bien un accent
aigu) leur droite pour les distinguer des tmoins du registre moyen :
14
Note Note Note Note : :: : Les grecs de lantiquit adoraient Delphes les trois muses nommes , et .
Ces trois noms ont t repris pour dsigner les registres des notes graves, moyennes et aigus.
20
LA GAMME DE DOUBLE DI APASON LA GAMME DE DOUBLE DI APASON LA GAMME DE DOUBLE DI APASON LA GAMME DE DOUBLE DI APASON
( deux gammes hui t not es ( deux gammes hui t not es ( deux gammes hui t not es ( deux gammes hui t not es cons cut i ves ) cons cut i ves ) cons cut i ves ) cons cut i ves )
21
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . La s me i o g r a p h La s me i o g r a p h La s me i o g r a p h La s me i o g r a p h i e i e i e i e
15 15 15 15
d u Cha n t By z a n t i n d u Cha n t By z a n t i n d u Cha n t By z a n t i n d u Cha n t By z a n t i n
Dans le chant byzantin, les notes
16
, les temps et l'expression sont transcrits par
des signes
17
(, neumes, caractres ) divers. Ceux en usage de nos jours
ont t ratifis par le Patriarcat de Constantinople selon les traits des trois
grands matres : Chrysanthe, mtropolite de Prousse, Grgoire le premier
chantre () du Patriarcat , et Hourmouzios le Conservateur de la
Bibliothque Patriarcale ( - Hartophylax).
La smeiographie comporte des signes (neumes) de variation de note (ou
caractres de quantit), des signes de variation du temps (ou caractres de
dure), et des signes d'expression (ou caractres de qualit). Quelques signes
quantitatifs bien prcis sont aussi associs une valeur qualitative et, dans
quelques cas prcis, peuvent ne sexprimer qu travers cet aspect qualitatif sans
que la valeur quantitative soit prise en compte (voir ci-dessous).
1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . Le s s i g n e s qu a l i t a t i f s Le s s i g n e s qu a l i t a t i f s Le s s i g n e s qu a l i t a t i f s Le s s i g n e s qu a l i t a t i f s
Les signes qualitatifs sont des signes phontiques qui permettent de transcrire
les notes des mlodies du chant byzantin. Ils sont au nombre de dix :
Si gne pour r es t er l a MME HAUTEU Si gne pour r es t er l a MME HAUTEU Si gne pour r es t er l a MME HAUTEU Si gne pour r es t er l a MME HAUTEUR RR R
( ( ( ( Taut ophoni e) Taut ophoni e) Taut ophoni e) Taut ophoni e)
L ' i s s o n L ' i s s o n L ' i s s o n L ' i s s o n ( (( ( ) ) ) )
= signe d'galit, il marque la continuation de la
note prcdente.
15
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Par smeiographie ( criture des signes ) nous sous-entendons le recueil des signes permettant de
transcrire la musique.
16
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : hauteur de son
17
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Le mot peut tre traduit par neume, caractre ou bien signe.
22
Si gnes pour l a MONTE Si gnes pour l a MONTE Si gnes pour l a MONTE Si gnes pour l a MONTE
( ( ( ( ) ) ) )
L Ol g h o n L Ol g h o n L Ol g h o n L Ol g h o n
18
( (( ( m. m. m. m. ) )) ) ( (( ( ) ) ) )
= monte simple d'une note.
L a P t a s t L a P t a s t L a P t a s t L a P t a s t ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( ( ( ( ) )) )
= monte dune note avec aspect qualitatif particulier
(monte dune seconde avec une qualit d envole ).
L e s Ke n d ma t a L e s Ke n d ma t a L e s Ke n d ma t a L e s Ke n d ma t a ( (( ( m. m. m. m. ) )) ) ( ( ( ( ) ) ) )
= monte dune note avec aspect qualitatif particulier
(monte dune seconde avec aspect qualitatif
particulier).
L e K n d i ma L e K n d i ma L e K n d i ma L e K n d i ma ( (( ( m. m. m. m. ) )) ) ( ( ( ( ) ) ) )
= monte de deux notes en saut
(monte discontinue dune tierce).
L Hy s p i l L Hy s p i l L Hy s p i l L Hy s p i l ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( (( ( ) )) )
= monte de quatre notes en saut
(monte discontinue dune quinte).
18
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Nous avons choisi une translittration base sur la prononciation courante du grec.
23
Si gnes pour l a DESCENTE Si gnes pour l a DESCENTE Si gnes pour l a DESCENTE Si gnes pour l a DESCENTE
L A p s t r o p h o s L A p s t r o p h o s L A p s t r o p h o s L A p s t r o p h o s ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( (( ( ) ) ) )
= descente d'une note.
L L L L l a p h r n l a p h r n l a p h r n l a p h r n ( (( ( m. m. m. m. ) )) ) ( (( ( ) ) ) )
= descente de deux notes en saut
(descente discontinue dune tierce).
L L L L Hy p o r r h o Hy p o r r h o Hy p o r r h o Hy p o r r h o ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( (( ( ) )) )
= descente de deux notes successives
(descente continue / successive dune tierce).
L a Ha mi l L a Ha mi l L a Ha mi l L a Ha mi l ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( ( ( ( ) )) )
= descente de quatre notes en saut
(descente discontinue dune quinte).
1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . No me nc l a t ur e de s n e ume s No me nc l a t ur e de s n e ume s No me nc l a t ur e de s n e ume s No me nc l a t ur e de s n e ume s
Les noms des notes sont imags et voquent la manire de les excuter:
L L L L I s s o n ( I s s o n ( I s s o n ( I s s o n ( m. m. m. m. ) )) ) ( (( ( = == = l g a l l g a l l g a l l g a l ) ) ) ) : :: :
signifie gal - la note a en effet la mme hauteur
que la note prcdente.
24
L L L L Ol g h o n ( Ol g h o n ( Ol g h o n ( Ol g h o n ( m. m. m. m. ) )) ) ( (( ( = == = l e p e t i t p e u l e p e t i t p e u l e p e t i t p e u l e p e t i t p e u ) ) ) ) : :: :
signifie peu - la note ne monte que d'une seule
note (monte simple dune seconde).
L a P t a s t L a P t a s t L a P t a s t L a P t a s t ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( ( ( ( = == = l e n v o l l e n v o l l e n v o l l e n v o l ) ) ) ) : :: :
signifie voler - ce signe demande une lgre
envole lors de la monte dune note (monte dune
seconde avec une qualit d envol ).
L Hy s p i l L Hy s p i l L Hy s p i l L Hy s p i l ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( (( ( = == = l a h a u t e l a h a u t e l a h a u t e l a h a u t e ) ) ) ) : :: :
= signifie haut - la note monte plus haut que les
autres notes (monte discontinue dune quinte).
L L L L A p s t A p s t A p s t A p s t r o p h o s ( r o p h o s ( r o p h o s ( r o p h o s ( f . f . f . f . ) )) ) ( (( ( = == = l a d t o u r n a n t e l a d t o u r n a n t e l a d t o u r n a n t e l a d t o u r n a n t e ) ) ) ) : :: :
signifie dtour ; la note s'incline en effet vers sa
voisine infrieure (descente simple dune seconde).
L L L L l a p h r n ( l a p h r n ( l a p h r n ( l a p h r n ( m. m. m. m. ) )) ) ( (( ( = == = l a l g r e l a l g r e l a l g r e l a l g r e ) ) ) ) : :: :
signifie lger - la note descend lgrement
(doucement) deux notes d'un seul bond (descente
discontinue dune tierce).
L L L L Hy p o r r h o Hy p o r r h o Hy p o r r h o Hy p o r r h o ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( (( ( = == = l e s o u s l e s o u s l e s o u s l e s o u s - -- - c o u l e me n t c o u l e me n t c o u l e me n t c o u l e me n t ) ) ) ) : :: :
du verbe , signifie coulement vers le
bas - la note descend de deux notes, une la fois
(descente continue dune tierce).
L a Ha mi l L a Ha mi l L a Ha mi l L a Ha mi l ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( ( ( ( = == = l a b a s s e l a b a s s e l a b a s s e l a b a s s e ) ) ) ) : :: :
signifie bas - la note est celle qui descend le plus
bas (descente discontinue simple dune quinte).
25
L e s Ke n d ma t a L e s Ke n d ma t a L e s Ke n d ma t a L e s Ke n d ma t a
19 19 19 19
( ( ( ( = == = l e s b r o d e r i e s l e s b r o d e r i e s l e s b r o d e r i e s l e s b r o d e r i e s ) ) ) )
e t e t e t e t
L e K n d i ma L e K n d i ma L e K n d i ma L e K n d i ma
20 20 20 20
( ( ( ( = == = l a l a l a l a b r o d e r i e b r o d e r i e b r o d e r i e b r o d e r i e ) ) ) ) ( (( ( m. m. m. m. ) )) )
sont des mots qui viennent du mot broder ou
lanciner - ces notes sont lies des mouvements de
main ( cheironomie) des matres de
chant qui voquaient le mouvement de broder.
1 5 . 1 5 . 1 5 . 1 5 . La c o mb i n a i s o n d e s s i g ne s q u a n t i La c o mb i n a i s o n d e s s i g ne s q u a n t i La c o mb i n a i s o n d e s s i g ne s q u a n t i La c o mb i n a i s o n d e s s i g ne s q u a n t i t a t i f s e t t a t i f s e t t a t i f s e t t a t i f s e t
q u a l i t a t i f s q u a l i t a t i f s q u a l i t a t i f s q u a l i t a t i f s
La mont e di s cont i nue ( en s aut ) La mont e di s cont i nue ( en s aut ) La mont e di s cont i nue ( en s aut ) La mont e di s cont i nue ( en s aut )
De u x n o t e s De u x n o t e s De u x n o t e s De u x n o t e s ( (( ( 2 ) 2 ) 2 ) 2 )
Avec l'olghon sur la ptast nous montons de deux
notes en saut (monte dune tierce discontinue avec
qualit denvol).
Nous montons de deux notes encore quand le
kndima se trouve droite ou en dessous de l'olghon.
19
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Le Kndima () est toujours combin avec un autre symbole de monte, et qui lui sert de
support . Le support lui attribue demble son caractre qualitatif et peut lui attribuer aussi un aspect
quantitatif selon lemplacement spatial du Kndima par rapport ce support. Ainsi, le Kndima peut monter
dune seconde ou dune tierce selon son emplacement par rapport son support qui peut avoir une qualit
simple, denvole, ou autre.
20
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Les Kendmata () ne se trouvent jamais sur une partie forte du rythme ( - thsis)
et, malgr la forme plurielle de ce neume, il ne monte que dune seule note mais avec des aspects qualitatifs
particuliers, quelquefois complexes, ce qui ne constitue plus une monte simple (monte qualitativement
labore dune seconde en dehors dun temps fort).
26
Ce dernier sert de support
21
(monte simple dune
tierce discontinue).
T r o i s n o t e s T r o i s n o t e s T r o i s n o t e s T r o i s n o t e s ( (( ( 3 ) 3 ) 3 ) 3 )
Nous montons de trois notes quand le kndima se
trouve au-dessus de l'olghon ou de la ptast (monte
simple ou avec qualit denvol dune tierce discontinue).
Qu a t r e n o t e s Qu a t r e n o t e s Qu a t r e n o t e s Qu a t r e n o t e s ( (( ( 4 ) 4 ) 4 ) 4 )
Nous montons de quatre notes quand lhypsil se
trouve droite au-dessus de l'olghon ou de la ptast ;
ces derniers ne sont que des support (monte simple ou
avec qualit denvol dune quinte discontinue).
Ci n q n o t e s Ci n q n o t e s Ci n q n o t e s Ci n q n o t e s ( (( ( 5 ) 5 ) 5 ) 5 )
Nous montons de cinq notes quand lhypsil se trouve
gauche au-dessus de l'olghon ou de la ptast. Dans
cette situation, les supports ne contribuent pas que
qualitativement mais quantitativement aussi (monte
simple ou avec qualit denvol dune sixte discontinue).
S i x n o t e s S i x n o t e s S i x n o t e s S i x n o t e s ( (( ( 6 ) 6 ) 6 ) 6 )
Nous montons de six notes quand le kndima se
trouve gauche et lhypsil droite au-dessus de
l'olghon ou de la ptast ; ces derniers ne sont que des
supports (monte simple ou avec qualit denvol dune
septime discontinue).
21
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Par support, nous allons sous-entendre une manire de donner un appui, cest--dire daccentuer
tous ce qui lui est plac au-dessus. Autrement dit, il sagit assez souvent dun aspect qualitatif daccentuation
surajout (simple, aigu, denvol, etc.)
27
S e p t n o t e s S e p t n o t e s S e p t n o t e s S e p t n o t e s ( (( ( 7 ) 7 ) 7 ) 7 )
Nous montons de sept notes quand le kndima et
lhypsil sont superposs au-dessus de l'olghon ou de la
ptast ; ces derniers ne sont que des supports (monte
simple ou avec qualit denvol dune septime
discontinue).
Hu i t n o t e s Hu i t n o t e s Hu i t n o t e s Hu i t n o t e s ( (( ( 8 ) 8 ) 8 ) 8 )
Nous montons de huit notes quand deux hypsil sont
droite et gauche au-dessus de l'olghon ou de la
ptast ; ces derniers ne sont que des supports (monte
simple ou avec qualit denvol dune octave
discontinue).
Ne u f n o t e s Ne u f n o t e s Ne u f n o t e s Ne u f n o t e s ( (( ( 9 ) 9 ) 9 ) 9 )
Nous montons de neuf notes quand l'un des deux
hypsil est droite au-dessus de l'olghon ou de la
ptast. Sur leur gauche se trouvent des kndmata
au-dessus desquels est pos l'autre hypsil. L'olghon ou
le ptast ne sont que des supports (monte simple ou
avec qualit denvol dune neuvime discontinue).
Di x n o t e s Di x n o t e s Di x n o t e s Di x n o t e s ( (( ( 1 0 ) 1 0 ) 1 0 ) 1 0 )
Nous montons de dix notes quand au-dessus de
l'olghon ou de la ptast, se trouve une hypsil droite
et gauche et un kndima en dessous. L'olghon ou la
ptast ne sont que des supports (monte simple ou avec
qualit denvol dune dixime discontinue).
28
La des cent e par s aut La des cent e par s aut La des cent e par s aut La des cent e par s aut
22 22 22 22
De u x n o t e s De u x n o t e s De u x n o t e s De u x n o t e s ( (( ( - -- - 2 ) 2 ) 2 ) 2 )
Nous descendons de deux notes avec l'laphrn
(descente simple dune tierce discontinue).
T r o i s n o t e s T r o i s n o t e s T r o i s n o t e s T r o i s n o t e s ( (( ( - -- - 3 ) 3 ) 3 ) 3 )
Nous descendons de trois notes quand une
apostrophe se trouve en dessous de l'laphrn (descente
simple dune tierce discontinue).
Qu a t r e n o t e s Qu a t r e n o t e s Qu a t r e n o t e s Qu a t r e n o t e s ( (( ( - -- - 4 ) 4 ) 4 ) 4 )
Nous descendons de quatre notes avec la hamil
(descente simple dune tierce discontinue).
Ci n q n o t e s Ci n q n o t e s Ci n q n o t e s Ci n q n o t e s ( (( ( - -- - 5 ) 5 ) 5 ) 5 )
Nous descendons de cinq notes quand un apostrophe
se trouve en dessous de la hamil (descente simple dune
quinte discontinue).
S i x n o t e s S i x n o t e s S i x n o t e s S i x n o t e s ( (( ( - -- - 6 ) 6 ) 6 ) 6 )
Nous descendons de six notes quand un laphrn se
trouve en dessous de la hamil (descente simple dune
sixte discontinue).
22
NDLR NDLR NDLR NDLR : Toutes ces combinaisons peuvent se trouver au dessus de supports tels que lolghon (
) ou la
ptast (
), dans quel cas elles bnficient dun aspect qualitatif supplmentaire : respectivement,
accentuation ou effet denvol.
29
S e p t n o t e s S e p t n o t e s S e p t n o t e s S e p t n o t e s ( (( ( - -- - 7 ) 7 ) 7 ) 7 )
Nous descendons de sept notes quand un laphrn et
une apstrophos se trouvent en dessous de la hamil
(descente simple dune septime discontinue).
Hu i t n o t e s Hu i t n o t e s Hu i t n o t e s Hu i t n o t e s ( (( ( - -- - 8 ) 8 ) 8 ) 8 )
Nous descendons de huit notes quand une hamil se
trouve en dessous d'un autre hamil (descente simple
dune octave discontinue).
Ne u f n o t e s Ne u f n o t e s Ne u f n o t e s Ne u f n o t e s ( (( ( - -- - 9 ) 9 ) 9 ) 9 )
Nous descendons de neuf notes quand une hamil
avec une apostrophe en dessous delle, se trouvent en
dessous d'un autre hamil (descente simple dune
neuvime discontinue).
Di x n o t e s Di x n o t e s Di x n o t e s Di x n o t e s ( (( ( - -- - 1 0 ) 1 0 ) 1 0 ) 1 0 )
Nous descendons de dix notes avec deux hamils
superposes et un laphrn en dessous d'elles (descente
simple dune dixime discontinue).
Ca s d e l ' o l g h o n e t d e l a p t a s t d e v a l e u r q u a l i t a t i v e Ca s d e l ' o l g h o n e t d e l a p t a s t d e v a l e u r q u a l i t a t i v e Ca s d e l ' o l g h o n e t d e l a p t a s t d e v a l e u r q u a l i t a t i v e Ca s d e l ' o l g h o n e t d e l a p t a s t d e v a l e u r q u a l i t a t i v e
i s o l e ( s a n s v a l e u r q u a n t i t a i s o l e ( s a n s v a l e u r q u a n t i t a i s o l e ( s a n s v a l e u r q u a n t i t a i s o l e ( s a n s v a l e u r q u a n t i t a t i v e ) t i v e ) t i v e ) t i v e )
Dans les combinaisons suivantes, l'olghon et la
ptast ne sont que des supports qualitatifs :
30
1 6 . 1 6 . 1 6 . 1 6 . Le s s i g n e s t e mp o r e l s Le s s i g n e s t e mp o r e l s Le s s i g n e s t e mp o r e l s Le s s i g n e s t e mp o r e l s
( ( ( ( ) ) ) )
Les signes temporels sont des symboles qui indiquent une dure temporelle
plus longue ou plus brve que la dure de temps choisie comme base. Ils se
rpartissent en trois catgories :
a) a) a) a) les signes qui les signes qui les signes qui les signes qui rallongent rallongent rallongent rallongent le temps le temps le temps le temps
b) b) b) b) les signes qui les signes qui les signes qui les signes qui divisent divisent divisent divisent le temps le temps le temps le temps
c) c) c) c) les signes qui la fois les signes qui la fois les signes qui la fois les signes qui la fois divisent divisent divisent divisent et et et et rallongent rallongent rallongent rallongent le temps le temps le temps le temps
1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . Le s s i g n e s Le s s i g n e s Le s s i g n e s Le s s i g n e s qu i r a l l o n g e nt l e t e mp s qu i r a l l o n g e nt l e t e mp s qu i r a l l o n g e nt l e t e mp s qu i r a l l o n g e nt l e t e mp s
Ces signes sont surajouts aux signes qualitatifs / quantitatifs :
L e Kl s ma L e Kl s ma L e Kl s ma L e Kl s ma ( (( ( m. m. m. m. ) )) ) ( ( ( ( ) ) ) ) : :: :
elle rallonge la note sur laquelle elle est place dun
temps de base supplmentaire.
L L L L Ha p l Ha p l Ha p l Ha p l ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( (( ( = == = l a s i mp l e ) l a s i mp l e ) l a s i mp l e ) l a s i mp l e ) : :: :
elle rallonge la note sous laquelle elle est place dun
temps de base supplmentaire.
L a Do u b l e L a Do u b l e L a Do u b l e L a Do u b l e ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( l a d i p l ( l a d i p l ( l a d i p l ( l a d i p l - -- - ) )) ) : :: :
elle rallonge la note sous laquelle elle est place de
deux temps de base supplmentaires.
31
L a T r i p l e L a T r i p l e L a T r i p l e L a T r i p l e ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( l a t r i p l ( l a t r i p l ( l a t r i p l ( l a t r i p l - -- - ) )) ) : :: :
elle rallonge la note sous laquelle elle est place de
deux temps de base supplmentaires.
L a P a u s e L a P a u s e L a P a u s e L a P a u s e ( f . ) ( f . ) ( f . ) ( f . ) ( l a ( l a ( l a ( l a p f s i s p f s i s p f s i s p f s i s - -- - ) ) ) ) : :: :
elle est gale un temps de silence.
L a Do u b l e P a u s e L a Do u b l e P a u s e L a Do u b l e P a u s e L a Do u b l e P a u s e ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( l a d i p l p f s i s ( l a d i p l p f s i s ( l a d i p l p f s i s ( l a d i p l p f s i s - -- -
) ) ) ) : :: :
elle est gale deux temps de silence.
L a T r i p l e P a u s e L a T r i p l e P a u s e L a T r i p l e P a u s e L a T r i p l e P a u s e ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( l a t r i p l p f s i s ( l a t r i p l p f s i s ( l a t r i p l p f s i s ( l a t r i p l p f s i s - -- -
) ) ) ) : :: :
elle est gale trois temps de silence.
L a d e mi L a d e mi L a d e mi L a d e mi - -- - P a u s e P a u s e P a u s e P a u s e ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( l i m p a f s i s ( l i m p a f s i s ( l i m p a f s i s ( l i m p a f s i s - -- - ) ) ) ) : :: :
elle dure la moiti d'un temps qui est retranch la
note qui la prcde.
L a Cr o i x L a Cr o i x L a Cr o i x L a Cr o i x ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( l e s t a v r s ( l e s t a v r s ( l e s t a v r s ( l e s t a v r s - -- - ) ) ) ) : :: :
est un signe de respiration retranch la note qui la
prcde.
On fait appel aussi des signes employs en musique occidentale :
L a Vi r g u l e L a Vi r g u l e L a Vi r g u l e L a Vi r g u l e ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( l e c o mma ( l e c o mma ( l e c o mma ( l e c o mma - -- - ) ) ) ) : :: :
est un signe de respiration.
,
32
) )) )
L a L i a i s o n L a L i a i s o n L a L i a i s o n L a L i a i s o n ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( l e h y p h n ( l e h y p h n ( l e h y p h n ( l e h y p h n - -- - ) ) ) ) : :: :
est un signe de liaison entre deux notes de mme
hauteur.
L a Co u r o n n e L a Co u r o n n e L a Co u r o n n e L a Co u r o n n e ( (( ( f . f . f . f . ) )) ) ( l a k o r o n s ( l a k o r o n s ( l a k o r o n s ( l a k o r o n s - -- - ) ) ) )
est un signe de prolongation ad libitum de la
note (c'est--dire volont).
1 8 . 1 8 . 1 8 . 1 8 . Le s s i g n e s qu i d i v i s e n t l e t e mp s Le s s i g n e s qu i d i v i s e n t l e t e mp s Le s s i g n e s qu i d i v i s e n t l e t e mp s Le s s i g n e s qu i d i v i s e n t l e t e mp s
23 23 23 23
Ces signes sont appels fractionnaires :
L e Gh o r g h n L e Gh o r g h n L e Gh o r g h n L e Gh o r g h n ( (( ( m. m. m. m. ) )) ) ( ( ( ( = == = l a r a p i d e ) l a r a p i d e ) l a r a p i d e ) l a r a p i d e )
divise le temps en deux parties gales et unit deux
notes en un seul temps. Il se place sur la deuxime
note et agit sur celle-ci et la note qui la prcde :
L e D g h o r g h o n L e D g h o r g h o n L e D g h o r g h o n L e D g h o r g h o n ( (( ( m. m. m. m. ) )) ) ( ( ( ( = == = l a d o u b l e me n t l a d o u b l e me n t l a d o u b l e me n t l a d o u b l e me n t
r a p i d e r a p i d e r a p i d e r a p i d e ) ) ) )
divise le temps en trois parties gales et unit trois
notes en un seul temps. Il se place sur la deuxime
note et agit sur celle-ci, sur la note qui la prcde et la
note qui la suit :
23
Note Note Note Note : :: : Du point de vue rythmique, le ghorghn divise soit la thsis, soit l'arsis en deux parties gales, le
dghorghon la divise en trois parties gales, le trghorghon la divise en quatre parties gales, etc.
33
L e T r g h o r g h o n L e T r g h o r g h o n L e T r g h o r g h o n L e T r g h o r g h o n ( (( ( m. m. m. m. ) )) ) ( ( ( ( = == = l a t r i p l e me n t l a t r i p l e me n t l a t r i p l e me n t l a t r i p l e me n t
r a p i d e r a p i d e r a p i d e r a p i d e ) ) ) )
divise le temps en quatre parties gales et unit quatre
notes en un seul temps. Il se place sur la deuxime
note et agit sur celle-ci, sur la note qui la prcde et les
deux notes qui la suivent :
1 9 . 1 9 . 1 9 . 1 9 . Le s s i g n e s qu i l a f o i s d i v i s e n t e t p u i s Le s s i g n e s qu i l a f o i s d i v i s e n t e t p u i s Le s s i g n e s qu i l a f o i s d i v i s e n t e t p u i s Le s s i g n e s qu i l a f o i s d i v i s e n t e t p u i s
r a l l o n g e n t l e t e mp s r a l l o n g e n t l e t e mp s r a l l o n g e n t l e t e mp s r a l l o n g e n t l e t e mp s
Ces signes sont appels mixtes (ils sont la fois fractionnaires et
prolongateurs) :
L ' A r g h n L ' A r g h n L ' A r g h n L ' A r g h n ( (( ( m. m. m. m. ) ) ) ) ( (( ( = == = l e l e n t ) l e l e n t ) l e l e n t ) l e l e n t )
se place au-dessus de l'olghon sous lequel se trouvent
des kndmata. Il agit comme un ghorghn sur les
kndmata pour ensuite agir comme un klsma sur
l'olghon :
L e D a r g h o n L e D a r g h o n L e D a r g h o n L e D a r g h o n ( (( ( m. m. m. m. ) ) ) ) ( ( ( ( = == = l e d e u x f o i s l e n t l e d e u x f o i s l e n t l e d e u x f o i s l e n t l e d e u x f o i s l e n t ) ) ) )
se place au-dessus de l'olghon sous lequel se trouvent
des kndmata. Il agit comme un ghorghn sur les
kndmata pour ensuite agir comme une dipl sur
l'olghon :
34
L e T r a r g h o n L e T r a r g h o n L e T r a r g h o n L e T r a r g h o n ( (( ( m. m. m. m. ) ) ) ) ( ( ( ( = == = l e t r o i s f o i s l e n t l e t r o i s f o i s l e n t l e t r o i s f o i s l e n t l e t r o i s f o i s l e n t ) ) ) )
se place au-dessus de l'olghon sous lequel se trouvent
des kndmata. Il agit comme un ghorghn sur les
kndmata pour ensuite agir comme une tripl sur
l'olghon :
2 0. 2 0. 2 0. 2 0. La d i v i s i o n i n g a l e d u t e mp s La d i v i s i o n i n g a l e d u t e mp s La d i v i s i o n i n g a l e d u t e mp s La d i v i s i o n i n g a l e d u t e mp s
Ghor ghn et d ghor ghon ponct u ( avec poi nt ) Ghor ghn et d ghor ghon ponct u ( avec poi nt ) Ghor ghn et d ghor ghon ponct u ( avec poi nt ) Ghor ghn et d ghor ghon ponct u ( avec poi nt )
Le temps peut tre divis en parties ingales si un point est not, droite ou
gauche, au-dessus du ghorghn ou du dghorghon (1 temps = )
Si le point se trouve gauche du ghorghn, la premire note vaut de temps et la
deuxime de temps
24
:
Si le point se trouve droite du ghorghn, la premire note vaut de temps et la
deuxime de temps :
Si le point se trouve gauche du dghorghon, la premire note vaut de temps et
les deux suivantes de temps chacune :
Si le point se trouve droite du dghorghon, la dernire note vaut temps et les
deux premires de temps chacune :
24
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Ceci est une simplification de nombreux ouvrages plus anciens qui proposent une division en trois
au lieu de quatre des deux notes concernes par lensemble point et ghorghn : | au lieu de | et
| au lieu de | .
35
2 1 . 2 1 . 2 1 . 2 1 . L l a phr n c o n t i nu L l a phr n c o n t i nu L l a phr n c o n t i nu L l a phr n c o n t i nu
( ( ( ( ) ) ) )
Si une apostrophe se trouve accole gauche d'un laphrn, ils constituent un
groupe appel laphrn continu ( = synchs laphrn) :
Dans ce groupe, l'apostrophe est excute comme si elle avait un ghorghn
au-dessus d'elle. Quant l'laphrn, il ne descend que d'une seule note et non de
deux :
Dans le cas de l'laphrn continu, l'apostrophe n'a pas de syllabe en dessous
d'elle, elle continue la syllabe prcdente. Par contre, l'laphrn a
obligatoirement une nouvelle syllabe.
Dans le cas o deux apostrophes continuent la mme syllabe, un autre signe
est employ, l'hyporrho avec ghorghn:
2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . Le s s i g n e s e x p r e s s i f s Le s s i g n e s e x p r e s s i f s Le s s i g n e s e x p r e s s i f s Le s s i g n e s e x p r e s s i f s
( (( ( ) ) ) )
Ces signes servent accentuer ou orner les notes :
L a Va r a L a Va r a L a Va r a L a Va r a ( ( ( ( = == = l a c c e n t g r a v e l a c c e n t g r a v e l a c c e n t g r a v e l a c c e n t g r a v e ) ) ) )
accentue la note qui lui succde en lui donnant ainsi
plus de pesanteur :
36
L e P s i p h i s t n L e P s i p h i s t n L e P s i p h i s t n L e P s i p h i s t n ( ( ( ( o u o u o u o u = == = l a c c e n t l a c c e n t l a c c e n t l a c c e n t
a i g u a i g u a i g u a i g u ) ) ) )
rajoute un accent la note qui se trouve en dessous
de lui :
L Oma l n L Oma l n L Oma l n L Oma l n ( (( ( = == = l e l i s s e l e l i s s e l e l i s s e l e l i s s e ) ) ) )
cre une lgre ondulation sur la note qui se trouve
au-dessus de lui :
L e S n d e s mo s L e S n d e s mo s L e S n d e s mo s L e S n d e s mo s ( ( ( ( = == = l e l i a n t l e l i a n t l e l i a n t l e l i a n t ) ) ) )
unit duex notes et cre une lgre ondulation
continue :
L A n t i k n o ma L A n t i k n o ma L A n t i k n o ma L A n t i k n o ma ( (( ( = == = l e c o n t r e l e c o n t r e l e c o n t r e l e c o n t r e - -- - p l a t p l a t p l a t p l a t ) ) ) )
cre un accent lger et instantan sur la note qui se
trouve au-dessus de lui :
L E n d p h o n o n L E n d p h o n o n L E n d p h o n o n L E n d p h o n o n ( (( ( = == = l a v o i x i n t r i o r i s e l a v o i x i n t r i o r i s e l a v o i x i n t r i o r i s e l a v o i x i n t r i o r i s e
[ e n d o b u c c a l e ] [ e n d o b u c c a l e ] [ e n d o b u c c a l e ] [ e n d o b u c c a l e ] ) ) ) )
s'utilise trs rarement, elle s'excute avec la bouche
ferme :
37
2 3 . 2 3 . 2 3 . 2 3 . Le s s i g n e s d a l t r a t i o n Le s s i g n e s d a l t r a t i o n Le s s i g n e s d a l t r a t i o n Le s s i g n e s d a l t r a t i o n
La hauteur d'une ou de plusieurs notes peut tre abaisse ou monte.
Les signes utiliss pour baisser ou monter la hauteur des notes sont
25
:
- -- - le bmol le bmol le bmol le bmol ( (( ( = == = hphsis), hphsis), hphsis), hphsis),
- -- - le dise le dise le dise le dise ( ( ( ( = == = d dd dsis), sis), sis), sis),
- -- - le bmol avec une barre le bmol avec une barre le bmol avec une barre le bmol avec une barre ( ( ( ( = == = monghrammos dsis), monghrammos dsis), monghrammos dsis), monghrammos dsis),
- -- - le dise avec une barre. le dise avec une barre. le dise avec une barre. le dise avec une barre. ( ( ( ( = == = monghrammos hphsis). monghrammos hphsis). monghrammos hphsis). monghrammos hphsis).
Le bmol ( ) baisse la hauteur dun son et le dise ( ) la fait monter d'une
grandeur quivalente un demi-ton
26
.
Le bmol avec une barre baisse la note et le dise avec une barre la fait monter
de plus d'un demi-ton.
25
Note Note Note Note : :: : Dans la musique de la Grce antique, le ton a t rparti en deux parties ingales. La partie la plus
grande tait plus grande d'un demi-ton et s'appelait - apotom = ce qui est obtenu suite une
section, et la partie la plus petite s'appelait limma = ce qui reste .
26
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Dans louvrage prsent, le mme symbole est employ pour baisser ou faire monter un son dune
grandeur variable, allant du demi-ton au sixime de ton (plus prcisment, 5/6 de ton). Dautres auteurs font
la distinction entre ces diverses variations par lajout de traits supplmentaires, chaque trait correspondant dun
abaissement (pour lhyphsis) ou dune monte (pour la disis) de 2 units supplmentaires par trait, au del
des 6 units requises par le symbol simple, sans trait. Ainsi : (6), (8), (10), (12) pour les dises
et (6), (8), (10), (12) pour les bmols. Bien dautres auteurs donnent dautres dfinitions.
Au total, il sagit alors de prcisions qui ont peu dutilit, les bons intervalles tant transmis oralement.
38
Premier exemple
Figure 23-1 Figure 23-2
Dans la figure gauche ci-dessus, la hauteur de la note est sa place
normale, tandis que, dans la figure droite, elle est baisse par un bmol .
Deuxime exemple
Figure 23-3 Figure 23-4
Dans la figure gauche ci-dessus, les hauteurs des notes et sont leur
place normale tandis que, dans la figure droite, la hauteur de la note est
baisse et celle de la note est monte.
2 4 . 2 4 . 2 4 . 2 4 . Le s mu t a t e ur s Le s mu t a t e ur s Le s mu t a t e ur s Le s mu t a t e ur s
( ( ( ( ) )) )
Ces signes servent modifier le genre, le mode, la hauteur des notes et le
systme.
39
Ils diffrent des signes d'altration (bmol, dise) dans la mesure o ces
derniers ne modifient que la hauteur de la note laquelle ils sont associs.
En musique byzantine, on fait appel treize mutateurs :
- -- - huit du genre diatonique, huit du genre diatonique, huit du genre diatonique, huit du genre diatonique,
- -- - quatre du genre chromatique quatre du genre chromatique quatre du genre chromatique quatre du genre chromatique
et et et et - -- - un du genre enharmonique. un du genre enharmonique. un du genre enharmonique. un du genre enharmonique.
Le genre enharmonique n'a qu'un seul mutateur enharmonique : . On peut le
placer sur les notes et et, trs rarement, sur le . Ce genre utilise aussi des signes
mutateurs : le bmol continu qui se trouve sur le et le dise continue utilise sur
le
27
.
27
NDLR NDLR NDLR NDLR : Selon un grand nombre dauteurs, le bmol continu plac sur le nagit sur le que si la
mlodie monte jusquau sans le dpasser. Lors dune monte dpassant le , celui-ci est naturel, ne
subissant une action du bmol que lors de la descente. On peut ainsi dire que le bmol continu est un bmol
continu partiel de descente : il est continu car il a une action au del de la note sur laquelle il est plac, et il est
partiel car il nagit sur le que lors de la descente vers le . Il est de mme pour le dise continu
du , mieux dfinie par le terme dise continu partiel de monte : il est continu car il a une action au
del de la note sur laquelle il est plac, et il est partiel car il nagit sur le que lors dune monte vers le .
40
2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . Le s Co l o r a t e u r s Le s Co l o r a t e u r s Le s Co l o r a t e u r s Le s Co l o r a t e u r s
( ( ( ( ) ) ) )
Les colorateurs
28
ont la particularit de ne changer que certaines notes
l'intrieur de la gamme sans changer le mode. Ils affectent ainsi les tmoins
29
.
L'effet des colorateurs peut tre annul par celui des mutateurs.
Les colorateurs sont au nombre de trois :
le conjugateur le conjugateur le conjugateur le conjugateur ( ( ( ( - -- - zyghs zyghs zyghs zyghs ) ) ) )
30 30 30 30
, ,, ,
le dclinateur le dclinateur le dclinateur le dclinateur ( ( ( ( klitn) klitn) klitn) klitn)
31 31 31 31
, ,, ,
le sabre le sabre le sabre le sabre ( ( ( ( spthi spthi spthi spthi ) ) ) )
32 32 32 32
. .. .
Par contre, le bmol gnralis agit sur les notes dont il est plac dune manire continue et gnrale (en
monte et en descente). En musique orientale, ce dernier est connu sous le nom d Adzm .
28
NDLR NDLR NDLR NDLR : Un autre nom valable est celui de teintes .
29
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Les colorateurs ne sont pas des mutateurs. Les mutateurs effectuent un changement darmature et
non seulement de cl : ils transforment une note une autre ainsi que toute la gamme qui suit. Les colorateurs
ont une action plus limite : tout comme les mutateurs, ils transforment la note sur laquelle ils sont placs, mais
ils nagissent quau sein des alentours du ttracorde dans lequel ils sont placs, et ceci plutt vers le grave, et
ninfluencent pas les autres intervalles en dehors de cette zone, quoi que leffet peut dborder vers laigu pour
deux sons conscutifs, selon le cas. Il sagit daccidents sans changement de gamme. Ce coup de pinceau
au sein dun ttracorde donne en effet une couleur transitoire.
30
NDLR NDLR NDLR NDLR : Le se traduit littralement par le joug ou bien celui qui va de pair . En effet, il agit sur
chaque deuxime note (note paire ) du ttracorde dans lequel il est employ. Nous avons prfr un terme
plus potique. Il sagit dun colorateur de rsonance chromatique. En musique orientale, il est connu sous le
nom de Moustar .
31
NDLR NDLR NDLR NDLR : Le se traduit littralement par celui incline do notre choix pour dclinateur . En
effet, sa sonorit invoque la supplication, exprime corporellement par linclinaison de la tte et du rachis. Il
sagit dun colorateur de rsonance enharmonique. En musique orientale, il est connu sous le nom de
Nisabour .
32
NDLR NDLR NDLR NDLR : La agit en effet comme un sabre, tel que lindique son nom : il coupe un peu la note du
haut ainsi que celle du bas, rduisant ainsi de manire trs significative ltendue totale de lintervalle qui
correspond normalement une tierce. Il sagit dun colorateur de rsonance enharmonique. En musique
orientale, il est connu sous le nom de Hisr .
41
Les colorateurs n'appartiennet aucun mode. part les deux notes qui sont
modifies par le colorateur, la mlodie utilise la gamme diatonique
33
,
indpendamment du mode de la mlodie.
Le J oug Le J oug Le J oug Le J oug
( ( ( ( ) ) ) )
Il est associ la note et il agit sur les notes et en les montant par
des dises.
Le joug ne modifie que deux notes de la gamme diatonique, et .
Les autres notes ne sont pas modifies. Lorsque sopre une modification de
hauteur sur ces deux notes, les tmoins sont aussi modifis.
Avec le joug, les deux notes et sont excutes continuellement avec des
dises jusqu' ce qu'un autre mutateur intervienne.
Le joug s'apparente au genre chromatique.
Le Dcl i nat eur Le Dcl i nat eur Le Dcl i nat eur Le Dcl i nat eur
( ( ( ( ) ) ) )
Il est associ la note et il monte les notes et par un dise :
Le dclinateur ne modifie que deux notes de la gamme diatoniques, et .
Les autres notes ne sont pas modifies. Lorsque s'opre une modification de
hauteur sur ces deux notes, les tmoins sont aussi modifis.
Avec le dclinateur, les deux notes et sont excutes continuellement
avec des dises jusqu' ce qu'un autre mutateur intervienne :
Le dclinateur s'apparente au genre enharmonique.
33
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : dans le ttracorde ayant t color et de ses alentours, et non pas pour ltendue de toute la
gamme.
42
Le Sabr e Le Sabr e Le Sabr e Le Sabr e
( ) ( ) ( ) ( )
Il est associ aux notes et . Il modifie la note voisine suprieure par un
bmol et la note voisine infrieure par un dise
Le sabre, lorsquil est associ la note , ne modifie que deux notes de la
gamme diatoniques, et . Les autres notes ne sont pas modifies. Lorsque
s'opre une modification de hauteur sur ces deux notes, les tmoins sont aussi
modifis. De la mme manire, les notes et sont modifies lorsque le
sabre est associ la note .
Avec le sabre, les deux notes et sont excutes continuellement avec
bmol et dise respectivement, jusqu' ce qu'un autre mutateur intervienne :
Le sabre s'apparente au genre chromato-enharmonique.
2 6 . 2 6 . 2 6 . 2 6 . Cl a s s i f i c a t i o n d e s M l o d i e s Cl a s s i f i c a t i o n d e s M l o d i e s Cl a s s i f i c a t i o n d e s M l o d i e s Cl a s s i f i c a t i o n d e s M l o d i e s
( ( ( ( ) ) ) )
Les chants d'glise sont regroups sous diffrents noms : kkragrion,
pasapnorion, doxastikn, mgalynrion, apolytkion etc., dfinissant ainsi
diffrentes formes de mlodie. Celles-ci se diffrencient quant la rpartition
musicale (temporelle) de texte : chaque syllabe chante peut correspondre une
dure simple dune seule note, ou une dure de deux voire de plusieurs temps
rpartis sur une plusieurs notes. On peut ainsi differencier trois formes de
mlodie :
- -- - l'heirmologique ( l'heirmologique ( l'heirmologique ( l'heirmologique ( , , , , que lon dnommera par la suite
syllabique syllabique syllabique syllabique), ), ), ),
- -- - le stichrarique ( le stichrarique ( le stichrarique ( le stichrarique ( , , , , que lon dnommera par la suite
mi mi mi mi- -- -orn orn orn orn), ), ), ),
et et et et - -- - le papadique ( le papadique ( le papadique ( le papadique ( , , , , que lon dnommera par la suite orn orn orn orn ou
mlismatique mlismatique mlismatique mlismatique). ). ). ).
43
Le terme heirmologique vient de heirmos et celui de stichrarique
de stchos (les versets de psaumes qui prcdent les tropaires dits stichres).
Ces deux formes de mlodie peuvent tre de composition rapide ou lente. Le
terme papadique vient de papas (le prtre). Les chants papadiques sont
orns, cest dire mlismatiques, et sont employs afin de combler des temps
liturgiques tendus occups par le prtre (lecture voix basse des prires,
moment de la communion, etc.)
Dans les mlodies heirmologiques, que celles-ci soient rapides ou lentes,
chaque syllabe est chante sur une ou deux notes et dure un ou deux temps. Les
mlodies rapides sont utilises pour des Canons, des grandes Doxologies, des
Apolytkion, des Anavathms, etc.; les mlodies lentes pour des Catavasa, des
grandes Doxologies, des Polylos, etc.
Dans les mlodies stichrariques, syllabiques ou mi-ornes, chaque syllabe est
chante sur deux ou trois notes ou plus et dure deux ou trois temps ou plus. Les
mlodies rapides sont utilises pour les stichres lents de l'Anastasimatrion, les
idiomles, les othinn, les Anixandria, etc.; les mlodies lentes pour les
Kkragrion lents, les Idiomles, les Pasapnorion lents, etc.
Dans les mlodies papadiques, chaque syllabe est chante sur beaucoup de
notes et peut avoir une trs longue dure. Ces mlodies sont utilises pour les
Chrubikn, les chants de communion (Koinonikn), etc.
2 7 2 7 2 7 2 7 - -- - 2 8 . LES GENRES 2 8 . LES GENRES 2 8 . LES GENRES 2 8 . LES GENRES
( (( ( ) ) ) )
En musique byzantine, le genre est constitu par un ensemble de modes qui
ont des caractristiques communes, telles les gammes, les intervalles, les
mutateurs, les tmoins. Il existe trois genres : le diatonique, le chromatique et
l'enharmonique.
44
Le genr e di at oni que Le genr e di at oni que Le genr e di at oni que Le genr e di at oni que
Dans celui-ci, les gammes utilisent des tons majeurs, mineurs et minimes
ce genre appartiennent les modes suivants :
- le premier et le plagal du premier
- le quatrime et le plagal du quatrime
Les mutateurs et les tmoins en usage sont des diatoniques.
Quant aux gammes, il est utilis, en plus de la gamme diatonique naturelle
base sur la note , une autre chelle diatonique base sur la note
34
.
Le genr e chr omat i que Le genr e chr omat i que Le genr e chr omat i que Le genr e chr omat i que
Dans celui-ci, les gammes utilisent des tons majeurs, minimes et hypergrands.
ce genre appartiennent les modes suivants :
- le deuxime et le plagal du deuxime
- le quatrime et le plagal du quatrime
Les mutateurs en usage sont les chromatiques.
Les tmoins sont constitus par la lettre initiale de la note et par quatre signes
de tmoin dont deux sont aussi des mutateurs
35
. Ces signes alternent d'une note
l'autre.
La gamme chromatique molle gamme chromatique molle gamme chromatique molle gamme chromatique molle, base sur la note , est utilise par mode 2.
Elle est forme partir de la gamme diatonique base sur la note , avec des
bmols sur les notes et . On l'appelle molle car elle n'a qu'un seul
signe d'altration, le bmol ( ).
34
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Il existe dautres gammes aussi, bases sur les notes de, , et .
35
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : On peut, dans ce cas, facilement distinguer la fonction de tmoin de la fonction de mutateur grce
lemplacement du symbol.
45
Avec le mutateur
du mode 2, les notes et se chantent
continuellement avec des bmols :
La gamme chromatique dure (ou sche) gamme chromatique dure (ou sche) gamme chromatique dure (ou sche) gamme chromatique dure (ou sche), base sur la note , est utilise par
le mode plagal du deuxime. Elle est forme partir de la gamme diatonique
base sur la note avec des bmols sur les notes et , et des dises sur
les notes et . On l'appelle dure car elle a deux signes d'altration
36
, le
bmol ( ) et le dise ( ).
Avec le mutateur
du mode plagal du deuxime, les notes et se
chantent continuellement avec des bmols et les notes et avec des dises.
Le genr e enhar moni que Le genr e enhar moni que Le genr e enhar moni que Le genr e enhar moni que
Dans celui-ci, les gammes utilisent des tons majeurs et des demi-tons.
ce genre appartiennent les modes suivants :
- le mode 3
- le mode grave
Un seul mutateur est en usage : . Il est associ aux notes et et
rarement la note .
Quand le mutateur est associ la note , celle-ci est continuellement
chante avec un bmol. Quand il est associ la note , la note est
continuellement chante avec un dise. Quand il est associ la note ,
celle-ci est continuellement chante avec un bmol.
Au mode 3, deux signes de mutation sont employs en plus du mutateur .
Il s'agit du bmol et du dise . Le bmol s'associe la note et agit
alors sur la note qui s'en trouve continuellement baisse. Le dise s'associe
la note et la note doit alors se chanter continuellement avec un dise.
36
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : La gamme chromatique molle prsente une seule altration par ttracorde, alors que la
chromatique dure en prsente deux.
46
La par t i c ul ar i t de l a gamme di at oni que du mode gr av La par t i c ul ar i t de l a gamme di at oni que du mode gr av La par t i c ul ar i t de l a gamme di at oni que du mode gr av La par t i c ul ar i t de l a gamme di at oni que du mode gr av e ee e
Elle est constitue d'un pentacorde diminu (38 units) et d'un ttracorde
augment (34 units) ; elle n'a donc pas de ton sparateur.
Pour crer celui-ci, il aurait fallu mettre la note avec dise. Cette pratique
n'est pas employe car les mlodies comme celles du psaume 50, de certaines
grandes doxologies, du mode grave pentaphone etc., tournent autour des
notes et et ne dpassent pas la note . Dans ces mlodies, la note
reste sa place normale et la note est excute avec bmol.
Dans certaines mlodies lentes et mlismatiques du mode grave comme celles
du Chrubikn, de Koinonikn etc., on utilise la gamme diatonique heptaphone
du mode grave.
3 0 3 0 3 0 3 0 Le s Mo de s Le s Mo de s Le s Mo de s Le s Mo de s
( (( ( ) ) ) )
En musique byzantine, chaque mode des signes distinctifs propres. Les plus
essentiels ont trait l'intonation, la gamme, aux notes dominantes, aux
cadences, aux tmoins, aux idiomes, aux attractions.
L' intonation ( ' intonation ( ' intonation ( ' intonation ( apchima) apchima) apchima) apchima) est donne par une brve formule
mlodique typique introduisant une mlodie.
La gamme ( gamme ( gamme ( gamme ( - -- - klmax) klmax) klmax) klmax) est l'ensemble des huit notes d'un mode,
montant ou descendant de faon continue.
Les notes dominantes ( dominantes ( dominantes ( dominantes ( - -- - despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos) au
sein d'un mode sont celles qui sont le plus souvent rptes et qui prdominent
dans la mlodie.
Les cadences ( cadences ( cadences ( cadences ( at at at atlixis) lixis) lixis) lixis) sont donnes par des tournures
typiques en clture d'une phrase musicale. Les cadences dites imparfaites ou
47
repos provisoires correspondent aux virgules et aux points virgules et les
parfaites aux points. Les cadences finales se trouvent la fin des mlodies
37
.
Les tmoins ( tmoins ( tmoins ( tmoins ( - -- - martyra) martyra) martyra) martyra) sont des signes qui dsignent la place
des notes. Ils se distinguent des tmoins initiaux, crits en dbut de mlodie, et
des tmoins intermdiaires.
Les idiomes ( idiomes ( idiomes ( idiomes ( - -- - idiomatisms) idiomatisms) idiomatisms) idiomatisms) sont des tournures
(formules) mlodiques caractristiques au sein d'une mlodie.
Les attractions ou attirances ( attractions ou attirances ( attractions ou attirances ( attractions ou attirances ( - -- - helxis) helxis) helxis) helxis) sont donnes par la facult
qu'ont certaines notes tre attires par des notes prcdentes ou suivantes.
C'est l'ensemble de ces lments distinctifs caractristiques qui cre l'ambiance
particulire des mlodies dans chaque mode.
Parmi les anciens modes (tropes) grecs, la musique byzantine n'utilise que huit
modes, les modes authentes (premier, deuxime, troisime et quatrime) et les
modes plagaux (plagal du premier, plagal du deuxime, plagal du troisime ou
mode grave et plagal du quatrime).
Le terme plagal = est li au fait que la mlodie dcline vers les
notes les plus graves.
Dans la musique grecque antique, les modes se nommaient
tropes = , et ils taient ainsi dsigns :
dorien hypodorien ( - ),
lydien hypolydien ( - ),
phrygien hypophrygien ( - ),
myxolydien hypomixolydien ( - ).
37
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Ajoutons aussi les finales conclusives, qui sont des cltures musicales du churs, donnant ainsi la
relve au reste du clerg (lectures, prires, ecphonses, etc.).
48
ou
3 1 . 3 1 . 3 1 . 3 1 . Mo de Pr e mi e r Mo de Pr e mi e r Mo de Pr e mi e r Mo de Pr e mi e r
( (( ( ) ) ) )
Ce mode appartient au genre diatonique. Il utilise la gamme diatonique base sur la
note .
L' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( apchi ma) apchi ma) apchi ma) apchi ma) : Monosyllabique, il suffit de monter du vers
le .
Les t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on ( (( ( - -- - arkti k arkti k arkti k arkti k martyra) martyra) martyra) martyra)
pour l e mode pri nci pal sont :
mode
ou ou
ou
ou
ou
Celui de la ml odi e emprunte ml odi e emprunte ml odi e emprunte ml odi e emprunte est : mode
Les notes domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( - -- - despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos)
- -- - mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : cadences imparfaites sur la note ; parfaites et finales sur la
note .
- -- - mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques : :: : cadences imparfaites sur les notes , ; parfaites et finales sur la
note .
- -- - mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques : :: : cadences imparfaites sur les notes , , ; parfaites et finales sur
la note .
Les mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( ) )) ) empl oys sont ceux du genre di atoni que.
Les attracti ons attracti ons attracti ons attracti ons ou attirances ( ou attirances ( ou attirances ( ou attirances ( - -- - hel xi s) hel xi s) hel xi s) hel xi s): La note est attire vers la
note quand la mlodie ne monte que jusqu'au . La note est attire vers la note
quand la mlodie tourne autour de la note sans dpasser la note .
Pour se mettre dans lambience du mode mode 1, on entonne, avant de commencer la
mlodie, la formule mlodique suivante :
49
3 2 . 3 2 . 3 2 . 3 2 . Mo de De u Mo de De u Mo de De u Mo de De u x i me x i me x i me x i me
( (( ( ) ) ) )
Ce mode appartient au genre chromatique. Il utilise la gamme chromatique molle.
L' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( apchi ma) apchi ma) apchi ma) apchi ma) :
Les t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on ( (( ( - -- - arkti k arkti k arkti k arkti k martyra) martyra) martyra) martyra)
pour l e mode princi pal mode princi pal mode princi pal mode princi pal sont :
mode ou ou
Celui de la mlodie emprunte mlodie emprunte mlodie emprunte mlodie emprunte est :
mode
( transform [mut] en ) ou ou
Les notes domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( - -- - despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos)
p pp pour toutes les mlodies our toutes les mlodies our toutes les mlodies our toutes les mlodies : :: : , , ; cadences imparfaites sur la note ; cadences
parfaites et finales sur la note .
Les mutateurs ( mutateurs ( mutateurs ( mutateurs ( ) )) ) employs sont au nombre de deux : l'un ( )
pour les notes ,
, , , et l'autre (
) pour les notes , , , (qui appartient l'aigu).
Les i di omes ( i di omes ( i di omes ( i di omes ( - -- - i diomati sms) i diomati sms) i diomati sms) i diomati sms) : Quand la mlodie descend
jusqu'au , ce dernier est diatonique. Quand la mlodie monte au-dessus du en aigu, la
note est, dans ce cas aussi, diatonique.
Pour se mettre dans lambience du mode 2, on entonne, avant de commencer la mlodie, la
formule mlodique suivante :
50
3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . Mo de Tr o i s i me Mo de Tr o i s i me Mo de Tr o i s i me Mo de Tr o i s i me
( (( ( ) ) ) )
Ce mode appartient au genre enharmonique.
L' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( apchi ma) apchi ma) apchi ma) apchi ma) :
Les t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on ( (( ( - -- - arkti k arkti k arkti k arkti k martyra) martyra) martyra) martyra)
sont :
mode
ou mode
Les notes domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( - -- - despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos)
- pour toutes les mlodies pour toutes les mlodies pour toutes les mlodies pour toutes les mlodies : :: : , , .
Les cadences ( cadences ( cadences ( cadences ( kat kat kat katl i xi s) l i xi s) l i xi s) l i xi s) : :: :
- -- - pour toutes les mlodies pour toutes les mlodies pour toutes les mlodies pour toutes les mlodies : :: : cadences imparfaites ; cadences parfaites en et finales sur la
note .
Les mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( ) )) ) : Le mode 3 utilise les mutateurs diatoniques et particulirement
celui du (
). Il utilise galement le mutateur enharmonique et les deux signes
mutateurs que sont le bmol gnral ( ) et le dise gnral ( ). Pour les mlodies
papadiques, est utilis le mutateur diatonique du (
) associ (plac) au . Il agit
comme au mode plagal du quatrime en triphonie.
Pour se mettre dans lambience du mode 3, on entonne, avant de commencer la mlodie, la
formule mlodique suivante :
51
3 4 . 3 4 . 3 4 . 3 4 . Mo de Qu a t r i me Mo de Qu a t r i me Mo de Qu a t r i me Mo de Qu a t r i me
( (( ( ) ) ) )
Ce mode appartient au genre diatonique.
L' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( apchi ma) apchi ma) apchi ma) apchi ma) :
- mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : ou
- mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques : :: :
- mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques : :: : mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques : :: :
-----------
Les mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( ) )) ) empl oys sont ceux du genre di atoni que.
Les t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on ( (( ( - -- - arkti k arkti k arkti k arkti k martyra) martyra) martyra) martyra)
sont :
- pour les mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : mode
ou mode
- pour les mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques : :: : mode
- pour les mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques : :: :
mode
- pour les mlodies empruntes mlodies empruntes mlodies empruntes mlodies empruntes : :: :
mode
Les notes domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( - -- - despzon fth despzon fth despzon fth despzon fthgos) gos) gos) gos)
- pour les mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : , . .. .
- pour les mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques : :: : , , .
- pour les mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques : :: : , ,
52
Les cadences ( cadences ( cadences ( cadences ( kat kat kat katl i xi s) l i xi s) l i xi s) l i xi s) : :: :
- pour les mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : cadences imparfaites sur la note ; parfaites et
finales sur la note .
- pour les mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques : :: : cadences imparfaites sur la note ; parfaites sur la
note , et finales sur la note .
- pour les mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques : :: : cadences imparfaites sur la note , , ; parfaites
et finales sur la note .
Les attracti ons attracti ons attracti ons attracti ons ou attirances ( ou attirances ( ou attirances ( ou attirances ( - -- - hel xi s) hel xi s) hel xi s) hel xi s): La note est attire vers le bas
quand la mlodie monte jusqu' celle-ci. La note est attire vers le haut quand la mlodie
descend jusqu' celle-ci. De mme la note est attire vers le haut quand la mlodie
descend jusqu' celle-ci.
Pour se mettre dans lambience du mode 4, on entonne, avant de commencer la mlodie, la
formule mlodique suivante :
- pour les mlodies heirm mlodies heirm mlodies heirm mlodies heirmologiques ologiques ologiques ologiques : :: :
- pour les mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques : :: :
- pour les mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques : :: :
53
3 5 . 3 5 . 3 5 . 3 5 . Mo de pl a g a l d u Pr e mi e r Mo de pl a g a l d u Pr e mi e r Mo de pl a g a l d u Pr e mi e r Mo de pl a g a l d u Pr e mi e r
( (( ( ) ) ) )
Ce mode appartient au genre diatonique. Il utilise la gamme diatonique base sur la
note .
L' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( apchi ma) apchi ma) apchi ma) apchi ma) :
- mlodies he mlodies he mlodies he mlodies heirmologiques irmologiques irmologiques irmologiques : :: :
- mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques et papadiques et papadiques et papadiques et papadiques : :: :
Les t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on ( (( ( - -- - arkti k arkti k arkti k arkti k martyra) martyra) martyra) martyra)
sont :
- pour les mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : mode
- pour les mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques et papadiques et papadiques et papadiques et papadiques : :: : mode
Les mutateurs ( mutateurs ( mutateurs ( mutateurs ( ) )) ) empl oys sont ceux du genre di at oni que et, en
parti cul i er, ceux du
(
)
et du (
).
Les notes domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( - -- - despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos)
- pour les mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : ,
- pour les mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques papadiques papadiques papadiques papadiques : :: : , , .
Les caden caden caden cadences ( ces ( ces ( ces ( kat kat kat katl i xi s) l i xi s) l i xi s) l i xi s) : :: :
- pour les mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : cadences imparfaites sur la note ; parfaites et finales
sur la note .
- pour les mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques : :: : cadences imparfaites sur les notes , ; parfaites sur
la note , et finales sur la note . .. .
- pour les mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques : :: : cadences imparfaites sur les note , K ; parfaites
parfaites et finales sur la note .
54
Les attracti ons attracti ons attracti ons attracti ons ou attirances ( ou attirances ( ou attirances ( ou attirances ( - -- - hel xi s) hel xi s) hel xi s) hel xi s):
- pour les mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : est attire vers le haut quand la mlodie descend
jusqu son niveau, tandis que reste naturel.
- pour les mlodies stichrariques et papadiques mlodies stichrariques et papadiques mlodies stichrariques et papadiques mlodies stichrariques et papadiques - identiques celles du premier mode : La
note est attire vers la note quand la mlodie ne monte que jusqu'au . La
note est attire vers la note quand la mlodie tourne autour de la note sans
dpasser la note .
- pour les mlodies mlodies mlodies mlodies : :: : cadences imparfaites sur la note , , ; parfaites et finales
sur la note .
La note est attire vers le bas quand la mlodie monte jusqu' celle-ci. La note est
attire vers le haut quand la mlodie descend jusqu' celle-ci. De mme la note est attire
vers le haut quand la mlodie descend jusqu' celle-ci.
Pour se mettre dans lambience du mode plagal du premier, on entonne, avant de
commencer la mlodie, la formule mlodique suivante :
- pour les mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: :
- pour les mlodies stichrariques et papadiques mlodies stichrariques et papadiques mlodies stichrariques et papadiques mlodies stichrariques et papadiques : :: :
55
3 6 . Mo de pl a g a l du De u x i me 3 6 . Mo de pl a g a l du De u x i me 3 6 . Mo de pl a g a l du De u x i me 3 6 . Mo de pl a g a l du De u x i me
( (( ( ) ) ) )
Ce mode appartient au genre chromatique. Il utilise la gamme chromatique dure (sche)
selon un systme par pentacordes.
L' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( apchi ma) apchi ma) apchi ma) apchi ma) :
Les t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on ( (( ( - -- - arkti k arkti k arkti k arkti k martyra) martyra) martyra) martyra)
sont :
- pour la mlodie principale mlodie principale mlodie principale mlodie principale : :: : mode
- pour la mlodie emprunt mlodie emprunt mlodie emprunt mlodie emprunte : :: : mode
Les mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( ) )) ) empl oys sont au nombre de deux, l ' un (
) pour
l es notes , , , , et l ' autre (
) pour l es notes , , ,
(qui appart i ent l ' ai gu).
Les notes domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( - -- - despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos)
pour toutes les mlodies pour toutes les mlodies pour toutes les mlodies pour toutes les mlodies : :: : , , ; cadences imparfaites sur la note ; cadences
parfaites et finales sur la note .
Les cadences ( cadences ( cadences ( cadences ( kat kat kat katl i xi s) l i xi s) l i xi s) l i xi s) : :: :
- pour les mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques mlodies heirmologiques : :: : cadences imparfaites sur la note ; parfaites et finales
sur la note .
- pour les mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques mlodies stichrariques : :: : cadences imparfaites sur les notes ; parfaites sur la
note et finales sur la note (souvent aussi, sur la note ).
- pour les mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques mlodies papadiques : :: : cadences imparfaites sur les note ; parfaites sur la
note parfaites et finales sur la note .
Les i di omes ( i di omes ( i di omes ( i di omes ( - -- - i diomati sms) i diomati sms) i diomati sms) i diomati sms) : Quand la mlodie tourne autour
des notes intermdiaires de et de , la mlodie utilise plutt les intervalles du genre
diatonique.
Pour se mettre dans lambiance du mode plagal du deuxime, on entonne, avant de
commencer la mlodie, la formule mlodique suivante :
56
3 7 . 3 7 . 3 7 . 3 7 . Mo de Gr a v e Mo de Gr a v e Mo de Gr a v e Mo de Gr a v e
( (( ( ) ) ) )
Ce mode est dnomm grave car il a pour base une note plus grave que celle qui est au
dpart des autres modes (la note ).
Il appartient soit au genre diatonique soit au genre enharmonique, selon qu'il utilise la
gamme diatonique avec comme base la note grave, ou la gamme enharmonique.
Le mutateur enharmonique (
) associ au notes et , cre la gamme
enharmonique qui consiste de deux ttracordes identiques disjoints.
L' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( apchi ma) apchi ma) apchi ma) apchi ma) :
- pour les mlodies du genre d mlodies du genre d mlodies du genre d mlodies du genre diatonique iatonique iatonique iatonique : :: :
- pour les mlodies du genre enharmonique mlodies du genre enharmonique mlodies du genre enharmonique mlodies du genre enharmonique : :: :
Les t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on ( (( ( - -- - arkti k arkti k arkti k arkti k martyra) martyra) martyra) martyra)
sont :
- pour les mlodies du genre diatonique mlodies du genre diatonique mlodies du genre diatonique mlodies du genre diatonique : :: :
mode
- pour les mlodies du genre enharmonique mlodies du genre enharmonique mlodies du genre enharmonique mlodies du genre enharmonique : :: : mode
ou
ou
Les mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( ) )) ) : :: : Ce mode utilise deux mutateurs :
- au genre diatonique genre diatonique genre diatonique genre diatonique, le mutateur (
) pour la note
- au genre enharmonique genre enharmonique genre enharmonique genre enharmonique, le mutateur (
) pour les notes et et rarement la note .
Les notes domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( - -- - despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos)
- pour le genre diatonique genre diatonique genre diatonique genre diatonique : :: : les notes , et .
- pour le genre enharmonique genre enharmonique genre enharmonique genre enharmonique : :: : les notes , , , .
57
Les cadences ( cadences ( cadences ( cadences ( kat kat kat katl i xi s) l i xi s) l i xi s) l i xi s) : :: :
Quand la mlodie a comme base (teneur) la note , les cadences imparfaites sont
sur les notes , et , et les cadences parfaites ainsi que les finales sont sur la
note .
Quand la mlodie a comme base (teneur) la note , les cadences imparfaites sont
sur les notes et , et les cadences parfaites ainsi que les finales sont sur la
note .
Pour se mettre dans lambience du mode grave, on entonne, avant de commencer la
mlodie, les formule mlodiques suivantes :
- pour le genre enharmonique genre enharmonique genre enharmonique genre enharmonique partir du :
- pour le genre diatonique genre diatonique genre diatonique genre diatonique partir du : : :: :
58
3 8 . 3 8 . 3 8 . 3 8 . Mo de pl a g a l d u Qu a t r i me Mo de pl a g a l d u Qu a t r i me Mo de pl a g a l d u Qu a t r i me Mo de pl a g a l d u Qu a t r i me
( (( ( ) ) ) )
Ce mode appartient au genre diatonique. Il utilise la gamme diatonique.
L' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( ' i ntonati on ( apchi ma) apchi ma) apchi ma) apchi ma) :
Les t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on t moins de mode et dintonati on ( (( ( - -- - arkti k arkti k arkti k arkti k martyra) martyra) martyra) martyra)
sont :
- pour le systme heptaphonique systme heptaphonique systme heptaphonique systme heptaphonique ( (( (ou octacorde): octacorde): octacorde): octacorde): mode
- pour les systme triphonique ( systme triphonique ( systme triphonique ( systme triphonique (ou ttracorde) ttracorde) ttracorde) ttracorde) : :: : mode
(le est mut en )
Les mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( mutat eurs ( ) )) ) : Ce mode utilise les mutateurs diatoniques, principalement
celui de la note .
Les notes domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( domi nantes ( - -- - despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos) despzon fthgos)
- pour les type de mlodie mlodie mlodie mlodie : :: : , . .. .
Les cadences ( cadences ( cadences ( cadences ( kat kat kat katl i xi s) l i xi s) l i xi s) l i xi s) : :: :
- pour le systme heptaphonique systme heptaphonique systme heptaphonique systme heptaphonique ( (( (ou octacorde): octacorde): octacorde): octacorde): cadences imparfaites sur la note , , et
; cadences parfaites ainsi que finales sur la note .
- pour les systme triphonique ( systme triphonique ( systme triphonique ( systme triphonique (ou ttracorde) ttracorde) ttracorde) ttracorde) : :: : cadences imparfaites sur la note ;
cadences parfaites ainsi que finales sur la note .
Les attracti ons attracti ons attracti ons attracti ons ou attirances ( ou attirances ( ou attirances ( ou attirances ( - -- - hel xi s) hel xi s) hel xi s) hel xi s): La note est attire vers le haut
quand la mlodie monte vers le , mais elle est attire vers le bas quand la mlodie descend
sur le .
Pour se mettre dans lambience du mode plagal du quatrime, on entonne, avant de
commencer la mlodie, la formule mlodique suivante :
ou
59
3 9 . Le s Al 3 9 . Le s Al 3 9 . Le s Al 3 9 . Le s Al l u r e s de Te mp o l u r e s de Te mp o l u r e s de Te mp o l u r e s de Te mp o
( ( ( ( ) )) )
l'intrieur d'une mlodie, le tempo peut changer. Un tel changement est
appel allure , et il est indiqu par les signes suivants
38
:
allure (tempo) rapide
allure (tempo) trs rapide
allure (tempo) moyennement rapide
allure (tempo) moyenne
allure (tempo) modre
allure (tempo) moyenne lente
allure (tempo) trs lente
4 0. M t h o de s d e Le c t u r e 4 0. M t h o de s d e Le c t u r e 4 0. M t h o de s d e Le c t u r e 4 0. M t h o de s d e Le c t u r e
( ( ( ( ) ) ) )
Les diverses mthodes de lecture de la musique byzantine sont : la lecture
simple, la lecture rythmique, le solfge et la mlodie.
En lecture simple ( ), nous nonons recto-tono le nom des
notes sans en donner leur hauteur.
38
Note Note Note Note : :: : Le contrle exact de l'allure du tempo se mesure avec un instrument appel mtronome.
60
En lecture rythmique ( ), nous nonons recto-tono le nom
des notes sans en donner leur hauteur, mais avec le rythme.
En solfiant (), nous chantons, avec le rythme, le nom des notes en
en donnant leur hauteur propre.
En donnant la mlodie (), nous chantons le texte en suivant le rythme et la
hauteur des notes.
4 1 . M l o d i e s Emp r un t e s 4 1 . M l o d i e s Emp r un t e s 4 1 . M l o d i e s Emp r un t e s 4 1 . M l o d i e s Emp r un t e s
( (( ( ) ) ) )
Les mlodies empruntes sont des tropaires qui ne se chantent pas dans les modes
respectifs auxquels ils appartiennent, mais qui se chantent dans d'autres modes.
Au premier mode, par exemple, la mlodie emprunte est le cathisme
, qui se chante selon la gamme du mode deux. Au
quatrime mode, la mlodie emprunte est lhyme de renvoie (
Apolytlion) cathisme , qui se
chante selon la gamme du mode deux, ainsi que le Cathisme potique
, qui se chante selon la gamme du mode plagal du
deuxime.
4 2 . Le s Sy t me s 4 2 . Le s Sy t me s 4 2 . Le s Sy t me s 4 2 . Le s Sy t me s
( ) ( ) ( ) ( )
En musique byzantine, on appelle systme le fait de dplacer (transposer) la
base de la gamme vers le bas ou vers le haut
39
.
39
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Ainsi, le systme est, selon le musicologue Dimitrios GIANNELOS, lensemble dune srie
dintervalles (de deux sept) qui se rptent avec le mme rapport entre eux laigu et/ou grave. Le systme
prend son nom du nombre de sons (intervalles) qui le constituent .
61
Quand le dplacement se fait sur la huitime note, c'est le systme d'octacorde
ou octave.
Quand le dplacement se fait sur la cinquime note, c'est le systme de
pentacorde (la roue
40
= ).
Quand le dplacement se fait sur la quatrime note, c'est le systme de
ttracorde.
Le s y s t me d' oc t ave Le s y s t me d' oc t ave Le s y s t me d' oc t ave Le s y s t me d' oc t ave
( hept aphone ) ( hept aphone ) ( hept aphone ) ( hept aphone )
Dans ce systme, les huit notes de la gamme se rptent, la huitime
note devenant la base du nouveau systme d'octacorde (octacordes joints).
Le s y s t me de pe nt ac Le s y s t me de pe nt ac Le s y s t me de pe nt ac Le s y s t me de pe nt ac or de or de or de or de
( t t r aphone ) ( t t r aphone ) ( t t r aphone ) ( t t r aphone )
Dans ce systme, les cinq premires notes de la gamme se rptent, la
cinquime note devenant la base du nouveau systme de pentacorde lorsqu'
celle-ci s'associe le mutateur du genre diatonique ou chromatique de la note de
base.
En allant vers le bas, la mme chose se ralise en mettant sur la premire
note du systme, le mutateur de la note du sommet du pentacorde (donnant lieu,
ainsi, des pentacordes joints).
40
Note : Note : Note : Note : Le terme roue provient du fait qu'autrefois le systme de pentacorde tait enseign en forme de roue
ou de cercle, ce qui ne se pratique plus aujourd'hui, mais le terme est toujours utilis dans le mode chromatique
(NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : ainsi que premier).
62
Le s y s t me de t t r ac or de Le s y s t me de t t r ac or de Le s y s t me de t t r ac or de Le s y s t me de t t r ac or de
( t r i phone ) ( t r i phone ) ( t r i phone ) ( t r i phone )
Dans ce systme, les quatre premires notes de la gamme se rptent, la
quatrime note devenant la base du nouveau systme de ttracorde lorsqu'
celle-ci s'associe le mutateur de la note de base.
En allant vers le bas, la mme chose se ralise en mettant sur la premire
note du systme, le mutateur diatonique du sommet du tetracorde (donnant lieu,
ainsi, des ttracordes joints).
Le systme par octacorde (heptaphonique) est utilis dans les modes
diatoniques.
Le systme par pentacorde est utilis en mode premier et en mode plagal du
deuxime.
Le systme par ttracorde est utilis en mode plagal du quatrime.
63
4 3 . Le s Mo d u l a t i o n s 4 3 . Le s Mo d u l a t i o n s 4 3 . Le s Mo d u l a t i o n s 4 3 . Le s Mo d u l a t i o n s
( ( ( ( ) )) )
Dans une mlodie, on rencontre des modulations modulations modulations modulations par ton par ton par ton par ton, par genre par genre par genre par genre et par par par par
dplacement dplacement dplacement dplacement. .. .
Les modul at i ons par t on Les modul at i ons par t on Les modul at i ons par t on Les modul at i ons par t on
( ( ( ( ) ) ) )
Celles-ci font changer la note sur laquelle un mutateur est plac. Dans ce cas,
si nous mettons sur la note , le mutateur diatonique de la note , l'ordre des
intervalles change mais le genre reste intacte.
La modulation par ton entrane un changement dans l'ordre des intervalles :
par exemple, un ton majeur peut devenir mineur, alors quun ton mineur devient
minime et quun ton minime devient majeur.
12
10
8
10
8
12
Dans les modulations par ton, les tmoins changent aussi : dans ce mme
exemple, la note aige reoit le tmoin de la note .
Les modul at i ons par genr e Les modul at i ons par genr e Les modul at i ons par genr e Les modul at i ons par genr e
( ( ( ( ) ) ) )
Elles sont ainsi dnommes car elles font passer d'un genre un autre. Par
exemple, si nous mettons le mutateur du mode plagal du deuxime () sur la
64
note (
) du genre diatonique, ce dernier est chang en genre
chromatique (
). Cette modulation s'annule sous l'effet du mutateur du mode
auquel appartient la mlodie.
Par exemple, le genre diatonique peut tre chang en chromatique par un
mutateur chromatique de la note () et il redevient diatonique avec le
mutateur diatonique de la note ().
4
20
20
4
12
10
8
12
Les modul at i on par dpl acement Les modul at i on par dpl acement Les modul at i on par dpl acement Les modul at i on par dpl acement
( ( ( ( ) )) )
Elles oprent des changements qui ne s'effectuent pas partir de la
note normale mais partir d'une autre note et dans ce cas, la base (la teneur) du
mode change galement.
Par exemple, le genre diatonique peut tre chang en chromatique par le
mutateur chromatique () pos sur une note (
)
41
. Cependant, ce
changement ne s'effectuant pas sur une note qui permet de sauvegarder intacte la
hauteur des notes limites des systmes di-, tri-, ttra-, penta- ou heptaphoniques,
ce dcalage constitue une (parachord), c..d. un dplacement des
notes limitrophes
42
.
8
18
18
8
12
12
10
8
41
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Cependant, ce changement ne s'effectuant pas sur une note ne permettant de sauvegarder intacte la
hauteur des notes limites des systmes di-, tri-, ttra-, penta- ou heptaphoniques, ce dcalage constitue une
, c..d. un dplacement des notes limitrophes.
42
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : titre dexemple, comparons les gammedu heptaphone diatonique (gamme la plus courante) et
celle qui volue selon un systme de triphonie partir du diatonique (voir Annexes) : selon les intervalles
de la Commison, les notes Ke et sont dcales,
65
4 4 . Ann e x e s 4 4 . Ann e x e s 4 4 . Ann e x e s 4 4 . Ann e x e s
Les trois colonnes par genre correspondent aux gammes de musique
Occidentale, de la Commission Patriarchale de 1881 et de Chrsanthos, selon
ldition de son livre de thorie 1832
43
.
43
NDLR NDLR NDLR NDLR : :: : Chrysanthos a fix les intervalles selon une octave correspondant 68 units. La Commission a ensuite
employ une gamme base sur un total de 72 units, tout en ajustant quelques intervalles afin de les rendre
identiques ceux de la gamme tempre de loccident. Ainsi, nous remarquons quun intervalle de 12/68 est plus
grand que celui de 12/72. Par consquent, des intervalles tel que - sont diffrents, selon Chrsanthos,
entre Musique Byzantine et Occidentale. Quoi que la commission de 1881 les a rendus quivalentes (abaissant
66
ainsi la frquence de de 480 Hz 440 Hz, frquence du La occidental), la tradition orale maintien les
intervalles tel que dcrits par Chrsanthos.
67
68
69
70
72
Tmoins de mode
(Tmoins dintonation)
Mode Papadique Stichirarique Heirmologique
73
Mode Papadique Stichirarique Heirmologique
grave grave grave grave
(ttraphonique) (pentaphonique) (heptaphonique)
(heptaphonique)
74
Tabl eaux r capi t ul at i f s des modes Tabl eaux r capi t ul at i f s des modes Tabl eaux r capi t ul at i f s des modes Tabl eaux r capi t ul at i f s des modes
m o d e s d i a t o n i q u e s
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type de
mlodie
Tmoin de mode Dbut
( ( ( ( ) )) )
Intonation
(apchma)
Notes
prin-
cipales
Incom-
pltes
Com-
pltes
Fi-
nales
Attirances et Mutateurs
H
e
i
r
m
o
l
o
g
i
q
u
e
44
S
t
i
c
h
i
r
a
r
i
q
u
e
- dans tous les type de mlodie du mode,
quand la mlodie monte jusquau
(de la ) sans le dpasser, ou lors
dune descente au dessous de celui-ci, il
subit une hyphse (bmol = u). Ceci
ne sapplique pas si le pentacorde au
dessus du volue selon le trochos (la
roue, par systme pentachordique), cas
dans lequel est fix et ne varie
pas.
- papad. : dans une partie principe par ,
est attir vers lui ( = u)
P
a
p
a
d
i
q
u
e
ou
ou
ou
ou
mutaeurs
diatoniques
44
Les symboles et sont tout fait quivalents. Dans cette dition, lhypsili (la haute,
M
) ne sera pas utilise en tant que neume dans les tmoins de mode. Il fait, par contre
partie dans toute indication prcisant un intervalle au dessus dune note (exemple
)
75
m o d e s d i a t o n i q u e s
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type de
mlodie
Tmoin de
mode
Dbut( (( (
) )) )
Intonation
(apchma)
Notes
prin-
cipale
s
Incom-
pltes
Com-
pltes
Fi-
nales
Attirances et Mutateurs
H
e
i
r
m
o
l
o
g
i
q
u
e
ou
ou
a
S
t
i
c
h
i
r
a
r
i
q
u
e
- en stichirarique et en papadique, quand la mlodie suit loctacorde diatonique (c..d.,
quand la gamme nest pas mute en systme pentacorde), subit des hyphses
(bmols) de manire semblable au mode : quand la mlodie monte jusquau
(de la ) sans le dpasser, ou lors dune descente au dessous de celui-ci, il subit
une hyphse (bmol = u). Ceci ne sapplique pas si le pentacorde au dessus du
volue selon le trochos (la roue, par systme pentachordique), cas dans lequel
est fix et ne varie pas.
- lors dune descente jusquau intermdiaire, celui-ci reste naturel tandis que peut
prendre une hyphse ( u ). Par contre, il existe des cas o reste
naturel en descente tandis que est attir par le ( z ). Quelques
chantres appliquent ces principes dans les chants heirmologiques aussi. Quelques
manuels interdisent lusage concomitant dun dise en et dune hyphse en
- papad. : dans une partie principe par , est attir vers lui ( = u)
- avec me mutateur sur le , la gamme devient mixte : enharmonique pour le
ttracorde de la et diatonique pour le ttracorde intermdiaire. Dans ce
cas, reste naturel.
mutaeurs
diatoniques
P
a
p
a
d
i
q
u
e
ou
mutaeurs
enharmonioques
76
m o d e s d i a t o n i q u e s
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type de
mlodie
Tmoin de mode Dbut
( ( ( ( ) )) )
Intonation
(apchma)
Notes
prin-
cipales
Incom-
pltes
Com-
pltes
Fi-
nales
Attirances et Mutateurs
H
e
i
r
m
o
l
o
g
i
q
u
e
ou
ou
---
S
t
i
c
h
i
r
a
r
i
q
u
e
- subit des hyphses (bmols) de manire
semblable au mode
- heirmol. : dans une partie principe
par , est attir vers lui. Selon
Chrysanthos , ce mme est demble
rapproch du .
- quelques fois, est attir
par ( = u)
- stich. et papad. : dans une partie
principe par , il attire ( = z)
- papad. : si est sa place naturelle,
il attire ( = z). Selon
Chrysanthos , ce mme est demble
rapproch du .
mutateurs
diatoniques
P
a
p
a
d
i
q
u
e
-----------
colorateurs
77
m o d e s d i a t o n i q u e s
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type de
mlodie
Tmoin de mode Dbut
( ( ( ( ) )) )
Intonation
(apchma)
Notes prin-
cipales
Incom-pltes Com-
pltes
Fi-
nales
Attirances et Mutateurs
(rare)
(rare
H
e
i
r
m
o
l
o
g
i
q
u
e
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
S
t
i
c
h
i
r
a
r
i
q
u
e
- subit des hyphses (bmols) de manire
semblable au mode
- dans une partie principe par , est
attir vers lui. Selon Chrysanthos , ce
mme est demble rapproch du
.
- pour , (qui est lquivalent de
dans ce systme par triphonie) est attir vers
le (qui est lquivalent de ; donc
= z ). Selon Chrysanthos , ce
mme quivalent de est demble
rapproch du .
mutateurs
diatoniques
P
a
p
a
d
i
q
u
e
--------
`
------------------------
(rare)
(rare)
colorateur
chromatique
78
m o d e s d i a t o n i q u e s
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type de
mlodie
Tmoin de mode Dbut
( ( ( ( ) )) )
Intonation
(apchma)
Notes
prin-
cipales
Incompl
tes
Compl
tes
Fi-
nales
Attirances et Mutateurs
H
e
i
r
m
o
l
o
g
i
q
u
e
S
t
i
c
h
i
r
a
r
i
q
u
e
- sauf pour le systme heptaphonique,
subit des hyphses (bmols) de manire
semblable au mode
- en systme penta- ou heptaphonique, dans
une partie principe par , est
attir vers lui ( = z). De mme,
est attir vers le naturel
( = z). Au total : ( = z,
z, ).
- en systme ttraphonique, dans une partie
principe par , est attir vers lui
( = u).
- la prsence dun mutateur de deuxime
mode (
) ds le dbut de quelques
hymnes a reu beaucoup dexplications.
Lune dentre elles soutient quil sagit
dune approximation de la gamme
ditonique du bas.
grave grave grave grave
diaton diaton diaton diatoni ii ique que que que
P
a
p
a
d
i
q
u
e
(ttraphonique)
(pentaphonique)
(heptaphonique)
`
(rare)
(rare)
mutateurs
diatoniques
80
m o d e c h r o m a t i q u e d o u x
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type de
mlodie
Tmoin de mode Dbut
( ( ( ( ) )) )
Intonation
(apchma)
Notes
prin-
cipales
Incom-
pltes
Com-
pltes
Fi-
nales
Attirances et Mutateurs
H
e
i
r
m
o
l
o
g
i
q
u
e
S
t
i
c
h
i
r
a
r
i
q
u
e
(rare)
(rare)
- stich. et papad. : dans une partie
principe par , il attire ( = z)
quand la mlodie passe du vers
le et revient immdiatement sur le
.
- le pentacorde du bas varie selon ltendue
de la mlodie :
- pour une descente jusquau ou
une montee du jusquau ,
le pentacorde est plutt diatonique.
- pour une descente au-dessous du ,
le pentacorde est plutt
chromatique doux. La monte du
jusquau est habituellement
chante encore une fois en
diatonique.
- dans une partie principe par , est
attir vers lui. Selon Chrysanthos , ce
mme est demble rapproch du
( = z).
P
a
p
a
d
i
q
u
e
(rare)
(rare)
mutateurs
chromatiques
81
m o d e s e m p r u n t s c h r o m a t i q u e s d o u x
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type de
mlodie
Tmoin de mode Dbut
( ( ( ( ) )) )
Intonation
(apchma)
Notes
prin-
cipales
Incom-
pltes
Com-
pltes
Fi-
nales
Attirances et Mutateurs
hors
mode
(rare)
- dans une partie principe par , il
attire ( = z) quand la mlodie passe
du vers le et revient immdiatement
sur le .
- le pentacorde du bas varie selon ltendue de la
mlodie :
- pour une descente jusquau ou une
montee du jusquau , le
pentacorde est plutt diatonique.
- pour une descente au-dessous du , le
pentacorde est plutt chromatique doux.
La montee du jusquau est
habituellement chante encore une fois
en diatonique.
- dans une partie principe par , est attir
vers lui. Selon Chrysanthos , ce mme est
demble rapproch du ( = z).
hors
mode
* Les quivalences sont les suivantes :
La discussion fait usage des
quivalences.
mutateurs
chromatiques
82
m o d e c h r o m a t i q u e d o u x
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type
de
mlodi
e
Tmoin de mode Dbut
( ( ( ( ) )) )
Intonation
(apchma)
Notes
prin-
cipales
Incom
-pltes
Com-
pltes
Fi-
nales
Attirances et Mutateurs
H
e
i
r
m
o
l
o
g
i
q
u
e
(rare)
(rare)
- stich. et papad. : dans une partie principe par , il
attire ( z ) quand la mlodie passe du vers le
et revient immdiatement sur le .
- le pentacorde du bas varie selon ltendue de la mlodie :
- pour une descente jusquau ou une montee du
jusquau , le pentacorde est plutt diatonique.
- pour une descente au-dessous du , le pentacorde est
plutt chromatique doux. La monte du jusquau
est habituellement chante encore une fois en
diatonique.
- dans une partie principe par , est attir vers lui
( = z). Selon Chrysanthos , ce mme est demble
rapproch du .
S
t
i
c
h
i
r
a
r
i
q
u
e
e
t
P
a
p
a
d
i
q
u
e
mutaeurs
chromatique
s
mutaeurs
diatoniques
hors
mode
colorateurs
84
m o d e s e n h a r m o n i q u e s
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type
de
mlo
die
Tmoin de mode Dbu
t
( ( ( ( ) )) )
Intonation
(apchma)
Notes
prin-
cipales
Incom-
pltes
Com-
pltes
Fi-
nale
s
Attirances et Mutateurs
H
e
i
r
m
o
l
o
g
i
q
u
e
S
t
i
c
h
i
r
a
r
i
q
u
e
ou
- selon les manuscrits, le mode 3 volue selon un systme de
triphonie. Chaque ttracorde alterne entre la forme
diatonique et enharmonique. Son caractre enharmonique
est assur par les intervalles 12/72 , 12/72 ,
6/72 . Selon les thoriciens contemporains, ceci
correspond une gamme tempre. Mais en pratique, les
intervalles sont encore plus serrs entre - et encore plus
distants entre - et -, ce qui est bien mis en vidence
par la reprsentation de Chrysanthos : 12/68 ,
13/68 , 3/68 , 12/68 12/68 ,
3/68 13/68 . La rsonance diatonique fait
son apparition lors des descentes jusquau ou . Mais la
composante enharmonique prend aussitt le dessus lors dune
monte vers et au del. Ces transitions ne sont pas
toujours prcises, et leurs prsence nest manifeste que par les
tmoins diatoniques lors des conclusions incompltes.
- pour , (qui est lquivalent de dans ce systme
par triphonie) est attir vers le (qui est lquivalent de
; donc = z ). Selon Chrysanthos , ce mme
quivalent de est demble rapproch du . Dans une
mlodie principe par , le est en plus dis, ce qui
confre un caractre enharmonique au ttracorde.
mutateurs
diatoniques
mutateurs
diatoniques
P
a
p
a
d
i
q
u
e
ou
(=)
(=)
(=)
(=)
(=
(=)
(=)
(=)
(=)
(=
(=)
(=)
colorateurs
enharmoniques
85
m o d e s e n h a r m o n i q u e s
Terminaisons
(Conclusions)
Mode Type
de
mlo
die
Tmoin de
mode
Dbut
( ( ( ( ) )) )
Intonation
(apchma)
Notes
pri-
cipales
Inco
m-
pltes
Com-
pltes
Fi-
nales
Attirances et Mutateurs
grave grave grave grave
enhar enhar enhar enhar- -- -
mon mon mon moni ii ique que que que
H
e
i
r
m
o
l
o
g
i
q
u
e
S
t
i
c
h
i
r
a
r
i
q
u
e
P
a
p
a
d
i
q
u
e
ou
ou
ou
ou
()
[]
[]
()
()
()
()
- selon les manuscrits, le mode grave volue selon un systme de triphonie. Chaque
ttracorde alterne entre la forme diatonique et enharmonique. Son caractre
enharmonique est assur par les intervalles 12/72 , 12/72 ,
6/72 . Selon les thoriciens contemporains, ceci correspond une gamme
tempre. Mais en pratique, les intervalles sont encore plus serrs entre - et
encore plus distants entre - et -, ce qui est bien mis en vidence par la
reprsentation de Chrysanthos : 12/68 , 13/68 ,
3/68 , 12/68 12/68 , 3/68 13/68 . La
rsonance diatonique fait son apparition lors des descentes jusquau ou . Mais
la composante enharmonique prend aussitt le dessus lors dune monte vers et au
del. Ces transitions ne sont pas toujours prcises, et leurs prsence nest manifeste
que par les tmoins diatoniques lors des conclusions incompltes.
- pour , (qui est lquivalent de dans ce systme par triphonie) est attir
vers le (qui est lquivalent de ; donc = z ). Selon Chrysanthos ,
ce mme quivalent de est demble rapproch du . Dans une mlodie
principe par , le est en plus dis, ce qui confre un caractre enharmonique
au ttracorde.
- le mode Plagal premier enharmonique volue toujours avec le teracorde du haut
enharmonique. Par contre, il donne naissance deux sous-modes, selon que son
ttracorde du bas est diatonique ( naturel) ou enharmonique ( ).
mutateurs
enharmoniques
enhar enhar enhar enhar- -- -
mon mon mon moni ii ique que que que
mutateurs
diatoniques
86
87
,
,
.
Fin.
Gloire au
Dieu en Trois Personnes.
Vous aimerez peut-être aussi
- Jubilate, Alleluia (Taizé) ( )Document1 pageJubilate, Alleluia (Taizé) ( )RiccardoEugenioToninPas encore d'évaluation
- Kniazeff Lecture de L'ancien Et Du Nouveau Testament Dans Le Rite Byzantin in Botte & Cassien Priere Des Heures 1963-3Document53 pagesKniazeff Lecture de L'ancien Et Du Nouveau Testament Dans Le Rite Byzantin in Botte & Cassien Priere Des Heures 1963-3ifrimPas encore d'évaluation
- L'acte Créateur Entre Culture de L'oralité Et Cognition Musicale - Mondher AyariDocument28 pagesL'acte Créateur Entre Culture de L'oralité Et Cognition Musicale - Mondher AyariAcohenPas encore d'évaluation
- Mess e Maroni TeDocument24 pagesMess e Maroni TemacucorumPas encore d'évaluation
- Solal Aigue MarineDocument3 pagesSolal Aigue MarineEnrico MirabassiPas encore d'évaluation
- Canon Andre Le CreteDocument75 pagesCanon Andre Le CretebolbulaPas encore d'évaluation
- G. PAPATHOMAS - Comment Et Pourquoi L'eglise Exclut L'agenouillement PDFDocument63 pagesG. PAPATHOMAS - Comment Et Pourquoi L'eglise Exclut L'agenouillement PDFGeorges GrigoPas encore d'évaluation
- Solfeggi Cantati VariDocument2 pagesSolfeggi Cantati VariFabrizio BoffiPas encore d'évaluation
- Langue, Musique, IdentitéDocument14 pagesLangue, Musique, Identitéa.kadmel5280Pas encore d'évaluation
- Guiraud de Bourneil - Reis GloriosDocument2 pagesGuiraud de Bourneil - Reis GloriosPaco100% (2)
- Ave de LourdesDocument2 pagesAve de LourdesAires CorreiaPas encore d'évaluation
- B000ZG77PADocument7 pagesB000ZG77PAAngelo ArangoPas encore d'évaluation
- La Musique Sacrée Au Moyen ÂgeDocument11 pagesLa Musique Sacrée Au Moyen ÂgeAmin ChaachooPas encore d'évaluation
- Traditionnel - La Marche Des RoisDocument1 pageTraditionnel - La Marche Des RoisAnonymous DNSgTc8pkRPas encore d'évaluation
- A Madre de JesúsDocument3 pagesA Madre de JesúsJosé Valle LorenzanaPas encore d'évaluation
- Intro Chant GregorienDocument7 pagesIntro Chant GregorienleonarddecorbiacPas encore d'évaluation
- Cmadq Progexternes ChantDocument71 pagesCmadq Progexternes ChantTito EdsonPas encore d'évaluation
- Jugement Esthétique Et Ontologie MusicaleDocument18 pagesJugement Esthétique Et Ontologie MusicaleKATPONSPas encore d'évaluation
- Canti - Ques Bretons: de Quimper Et de LéonDocument134 pagesCanti - Ques Bretons: de Quimper Et de LéonceriserPas encore d'évaluation
- Retiens La NuitDocument2 pagesRetiens La Nuit1Mecdu64Pas encore d'évaluation
- L'orchestres SymphoniquesDocument6 pagesL'orchestres SymphoniquesJoël MérahPas encore d'évaluation
- Bergson - Leçon D'esthétique - Le Beau - L'artDocument11 pagesBergson - Leçon D'esthétique - Le Beau - L'artAnonymous NE7Bwby7Pas encore d'évaluation
- Traite D'harmonieDocument268 pagesTraite D'harmoniesachiscore100% (5)
- La Musique Byzantine, Archimandrite Amphilochios Pikias, Professeur de Chant Sacré Byzantin Et Directeur de L'institut D'hymnologie de La Métropole de Rhodes.Document18 pagesLa Musique Byzantine, Archimandrite Amphilochios Pikias, Professeur de Chant Sacré Byzantin Et Directeur de L'institut D'hymnologie de La Métropole de Rhodes.Amphilochios Emmanuel PikiasPas encore d'évaluation
- RythmeDocument22 pagesRythmeKonstantinos AvdimiotisPas encore d'évaluation
- Leprest - Les TextesDocument105 pagesLeprest - Les TextesJean-Marc BismuthPas encore d'évaluation
- Machaut Messe de Notre Dame GloriaDocument9 pagesMachaut Messe de Notre Dame GloriasimmoraPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de Musique (IMSLP)Document611 pagesDictionnaire de Musique (IMSLP)watsonee100% (1)
- El Ultimo Cafe SATB Ar. E. Dublanc-EncDocument5 pagesEl Ultimo Cafe SATB Ar. E. Dublanc-EncVox LaciPas encore d'évaluation
- Ove Le Luci Giro / Roland de LassusDocument15 pagesOve Le Luci Giro / Roland de LassusDaniel Van Gilst100% (1)
- DURUFLÉ, M. - Requiem: POULENC, F. - Laudes de Saint Antoine de Padoue (Bouvard, Les Eléments Chamber Choir, Suhubiette)Document13 pagesDURUFLÉ, M. - Requiem: POULENC, F. - Laudes de Saint Antoine de Padoue (Bouvard, Les Eléments Chamber Choir, Suhubiette)Fernando Barbosa100% (1)
- Npgs 26-11 16h30 RequiemDocument36 pagesNpgs 26-11 16h30 RequiemAnaëlle ReitanPas encore d'évaluation
- Les Origines LiturgiquesDocument440 pagesLes Origines LiturgiquesMiguel RosaPas encore d'évaluation
- Retour Des Hirondelles PDFDocument3 pagesRetour Des Hirondelles PDFTommyDanPas encore d'évaluation
- L'improvisation Comme Outil Pédagogique, MémoireDocument57 pagesL'improvisation Comme Outil Pédagogique, MémoireCARNAVARO100% (2)
- Ave Maria (La Mision - Morricone)Document4 pagesAve Maria (La Mision - Morricone)gatalagataPas encore d'évaluation
- Valeur Humaine de L'education - Edgar Willems - SyntheseDocument3 pagesValeur Humaine de L'education - Edgar Willems - Syntheseholy_renanPas encore d'évaluation
- Histoire de L¡instrumentation Depuis Le Seizième Siècle Jusqu'a Nos Jours - LAVOIX, Henri PDFDocument490 pagesHistoire de L¡instrumentation Depuis Le Seizième Siècle Jusqu'a Nos Jours - LAVOIX, Henri PDFmompou88100% (3)
- Lem1 2014a CanonesDocument9 pagesLem1 2014a CanonesRubens NegrãoPas encore d'évaluation
- Kyrie de NoelDocument2 pagesKyrie de NoelFrancesco CarroPas encore d'évaluation
- Chiquilin de Bachin HistoireDocument4 pagesChiquilin de Bachin HistoireAnonymous HP284xVPas encore d'évaluation
- Traité de L'harmonie Tonale Réduite À Ses Principes NaturelsDocument628 pagesTraité de L'harmonie Tonale Réduite À Ses Principes NaturelsBenjamin Coudrin100% (2)
- Il Est RessusciteDocument1 pageIl Est RessusciteizaPas encore d'évaluation
- Chants MilitairesDocument101 pagesChants Militairesdelacroixmaximilien3Pas encore d'évaluation
- THE COVENANT OF THE WOLVES - The Beast of Lockhorn - (7º Mar)Document95 pagesTHE COVENANT OF THE WOLVES - The Beast of Lockhorn - (7º Mar)jaklsdhowePas encore d'évaluation
- Fiche de Contrôle - 2periodeDocument4 pagesFiche de Contrôle - 2periodeBiblioteca EBCubaPas encore d'évaluation
- Questionnaire - Musée Du Louvre - Peinture Espagnole PDFDocument2 pagesQuestionnaire - Musée Du Louvre - Peinture Espagnole PDFlilou77Pas encore d'évaluation
- Worksheet No.2 - French TL - GR 5Document3 pagesWorksheet No.2 - French TL - GR 5Essam AhmedPas encore d'évaluation
- 1º ESO - Francés - Los NúmerosDocument9 pages1º ESO - Francés - Los NúmerosDavid CamasPas encore d'évaluation
- Travaux Diriges Nouveau 4Document11 pagesTravaux Diriges Nouveau 4Didier TchaleuPas encore d'évaluation
- Fiche Schéma NarratifDocument1 pageFiche Schéma NarratifRim Taga Sayadi100% (1)
- Denocla, Ummo, Langage Extra TerrestreDocument182 pagesDenocla, Ummo, Langage Extra Terrestrecoucou0505100% (1)
- 1ST Periodical Exam Answer SheetDocument2 pages1ST Periodical Exam Answer Sheetolila.jeromezkiePas encore d'évaluation
- FRSHD Pub 00000181Document59 pagesFRSHD Pub 00000181Bart JeanPas encore d'évaluation
- 4 Hda Fiche Identite Eleve NecessaireDocument1 page4 Hda Fiche Identite Eleve NecessaireLouise JottreauPas encore d'évaluation
- Cône de Révolution - Exercices Corrigés - 4ème - GéométrieDocument2 pagesCône de Révolution - Exercices Corrigés - 4ème - GéométrieOlfa Chakroun100% (1)
- Answer SheetDocument2 pagesAnswer Sheetclarene aranasPas encore d'évaluation
- AMI FeuillesdejeuDocument5 pagesAMI FeuillesdejeuMathieu ReverséPas encore d'évaluation
- Rifa de Un Quintal de ArrozDocument3 pagesRifa de Un Quintal de ArrozGabriela PabonPas encore d'évaluation
- Pfe Geotechnique Tunnel PDFDocument105 pagesPfe Geotechnique Tunnel PDFMarouane Samadi100% (3)
- Fiche - de - Perso Pendragon PDFDocument2 pagesFiche - de - Perso Pendragon PDFRegibier YannPas encore d'évaluation
- Bedi Kartlisa 36 (1978) (Fragm)Document55 pagesBedi Kartlisa 36 (1978) (Fragm)His Life is minePas encore d'évaluation
- Table de La ProscomédieDocument36 pagesTable de La ProscomédieaurelmoPas encore d'évaluation
- Matines 12 25Document38 pagesMatines 12 25debolyPas encore d'évaluation
- Livre de PriereDocument1 pageLivre de Priereqrosbelito qrosbelitoPas encore d'évaluation
- Canon de Supplication À La Mère de Dieu - EnfantsDocument7 pagesCanon de Supplication À La Mère de Dieu - EnfantsPrietenosulPas encore d'évaluation
- Petite PannychideDocument28 pagesPetite PannychidedebolyPas encore d'évaluation
- Un Livre de Priere Publie en Langue Française Par La Metropole Orthodoxe Roumaine D'europe Occidentale Et MeridionaleDocument7 pagesUn Livre de Priere Publie en Langue Française Par La Metropole Orthodoxe Roumaine D'europe Occidentale Et MeridionaleAnonymous 52asQOUcyPas encore d'évaluation
- Liturgie Et Remission de PechesDocument296 pagesLiturgie Et Remission de PechesLupuPas encore d'évaluation
- Grand Canon ST AndréDocument28 pagesGrand Canon ST AndréMaria GilPas encore d'évaluation
- GD Canon Tout PDFDocument75 pagesGD Canon Tout PDFiteration615Pas encore d'évaluation
- Jean Damascene HymnographeDocument10 pagesJean Damascene HymnographeAdrian IugaPas encore d'évaluation
- ARKHIERATIKONDocument155 pagesARKHIERATIKONIon CretuPas encore d'évaluation
- Pontifical ByzantinDocument155 pagesPontifical ByzantinАлексей МорозовPas encore d'évaluation
- Office Pour Saint Luc de CriméeDocument8 pagesOffice Pour Saint Luc de CriméeJO_71Pas encore d'évaluation
- Acathiste Au Saint Apôtre AndréDocument9 pagesAcathiste Au Saint Apôtre Andréiteration615Pas encore d'évaluation
- And Octoèque (Paraclitique)Document803 pagesAnd Octoèque (Paraclitique)Maria GilPas encore d'évaluation
- TriodeDocument420 pagesTriodeIon Cretu100% (3)
- Pentecostaire Dimanches Thomas-Tous Les SaintsDocument813 pagesPentecostaire Dimanches Thomas-Tous Les SaintsJean-Pierre DEGUÎNESPas encore d'évaluation
- Canon de ST André - MercrediDocument15 pagesCanon de ST André - MercrediAnne-Lise HémeryPas encore d'évaluation
- Scriitorii de La Mar SabaDocument16 pagesScriitorii de La Mar SabaLatisha YoungPas encore d'évaluation
- Acathiste À La Très Sainte Mère de Dieu PDFDocument11 pagesAcathiste À La Très Sainte Mère de Dieu PDFJock EwingPas encore d'évaluation
- Resurection Diacres DeuilDocument61 pagesResurection Diacres DeuilBichoï BasthaPas encore d'évaluation
- L'icône de La Nativité Du Christ 95Document7 pagesL'icône de La Nativité Du Christ 95Agnès-mariam de la CroixPas encore d'évaluation
- La Figure de Precerseur Dans La Liturgie Oriental PDFDocument12 pagesLa Figure de Precerseur Dans La Liturgie Oriental PDFAlex ZammitPas encore d'évaluation
- Texte Paques FrançaisDocument13 pagesTexte Paques FrançaistchertkoffalexisPas encore d'évaluation
- Froyshov, Stig - La Reticence A L'hymnographie Chez Des Anachoretes de L'egypte Et Du Sinai Du 6 Au 8 Siecles (Conferences Saint-Serge, 1999) (Art.)Document19 pagesFroyshov, Stig - La Reticence A L'hymnographie Chez Des Anachoretes de L'egypte Et Du Sinai Du 6 Au 8 Siecles (Conferences Saint-Serge, 1999) (Art.)Robert-Andrei BălanPas encore d'évaluation
- Grand Canon de Saint André de CrèteDocument128 pagesGrand Canon de Saint André de CrèteJean-Pierre DEGUÎNESPas encore d'évaluation
- 10 OctobreDocument180 pages10 OctobreIon CretuPas encore d'évaluation